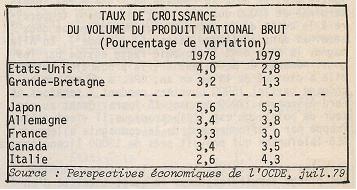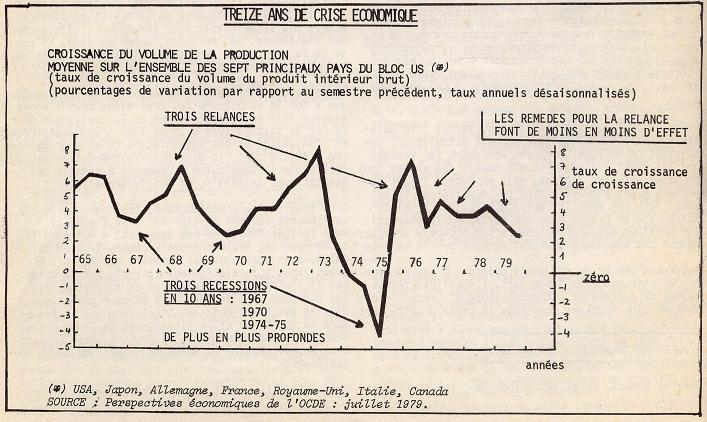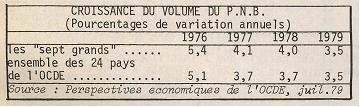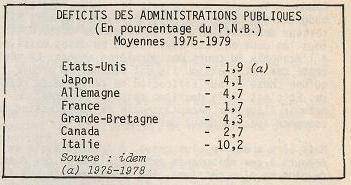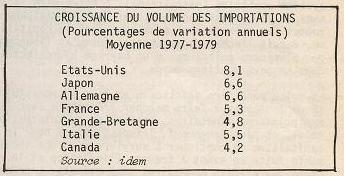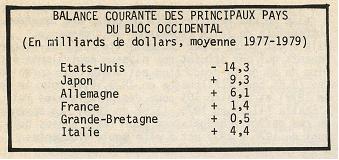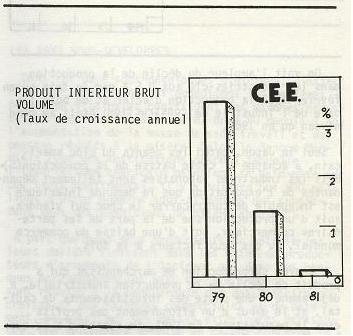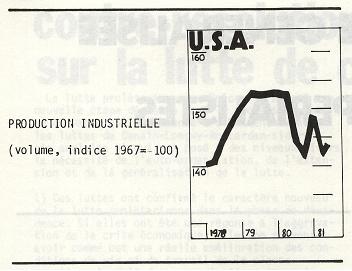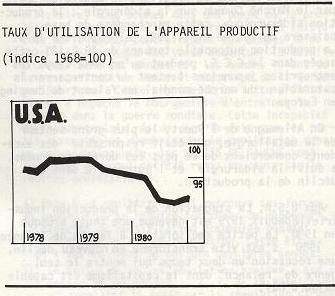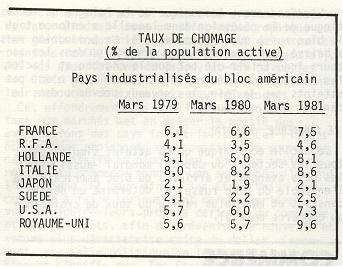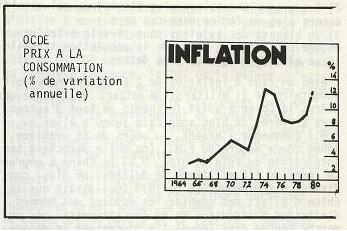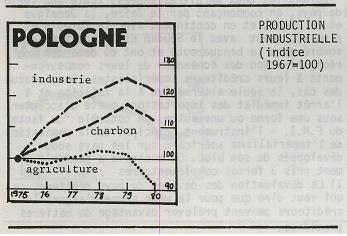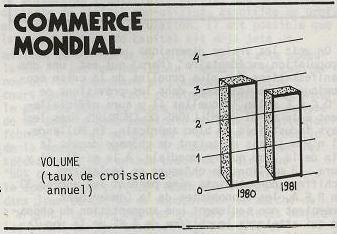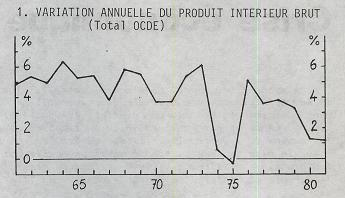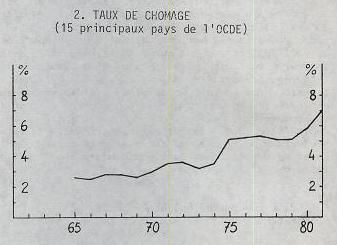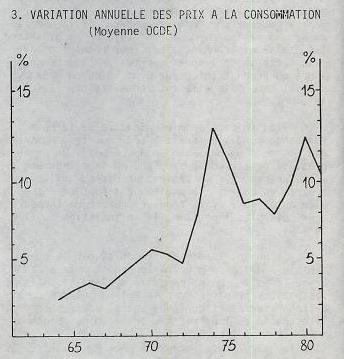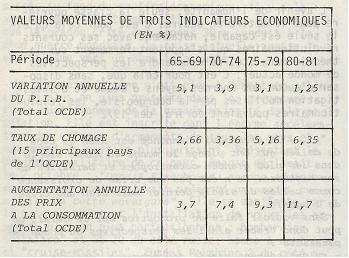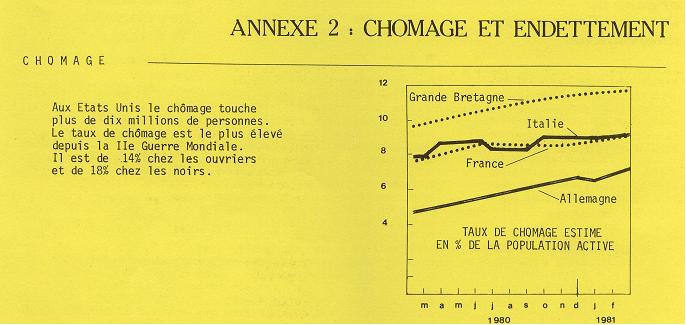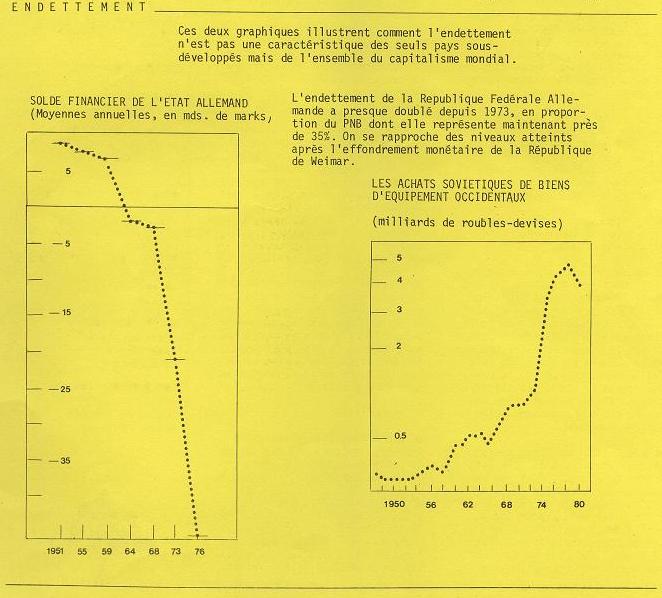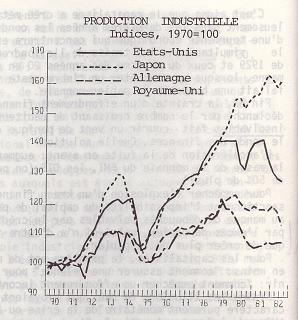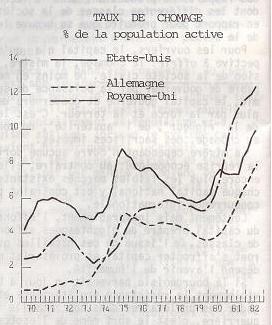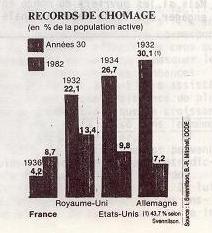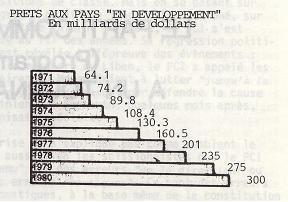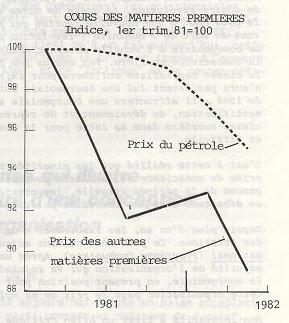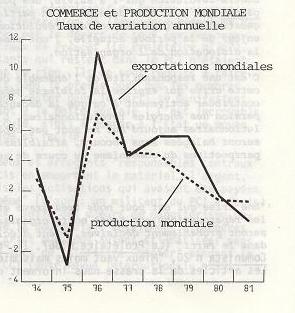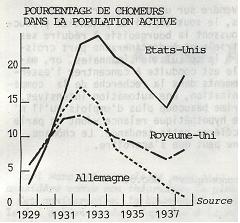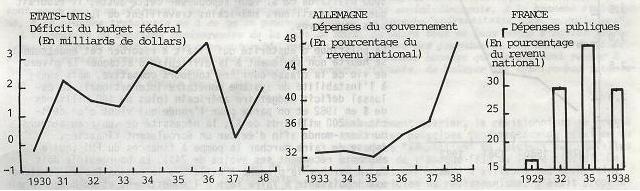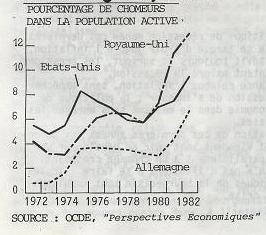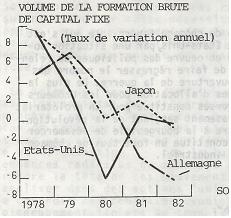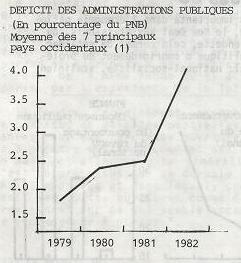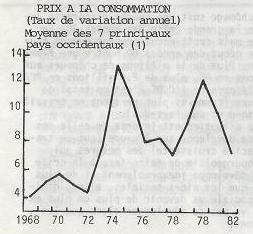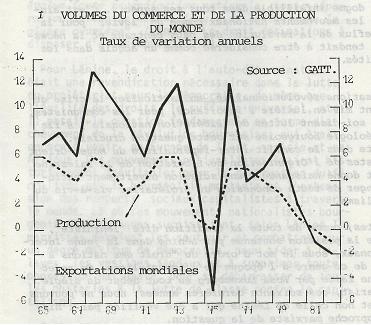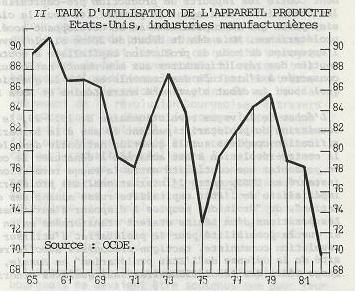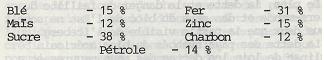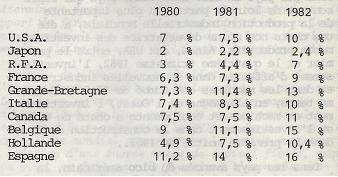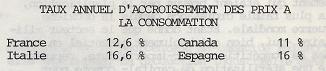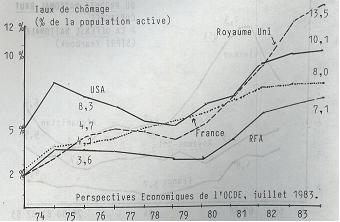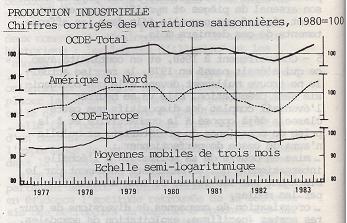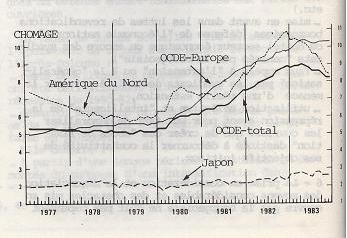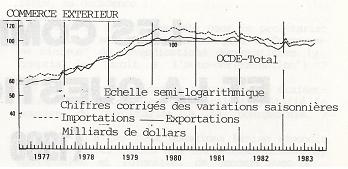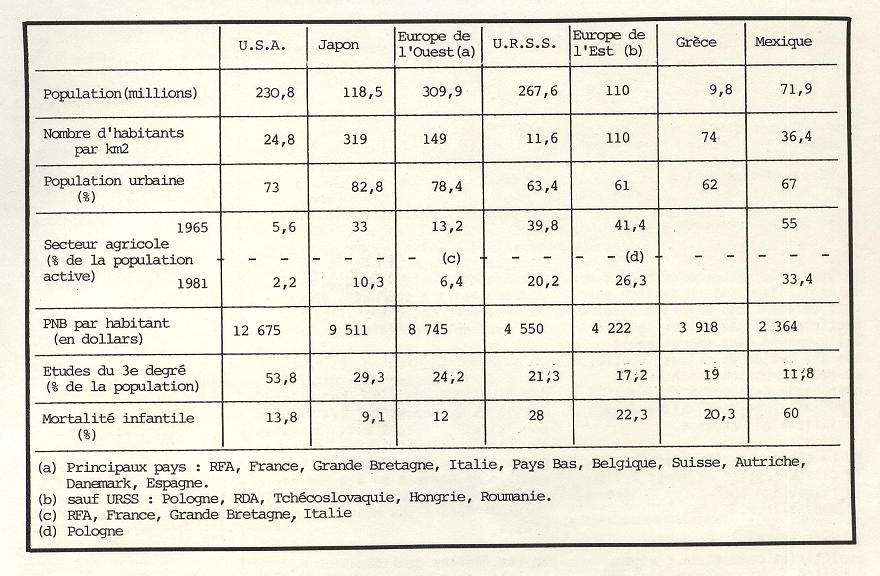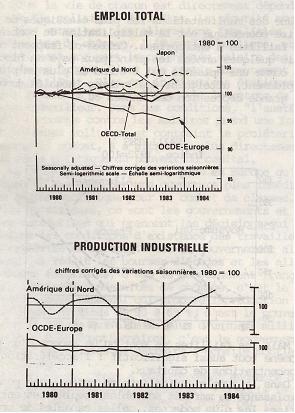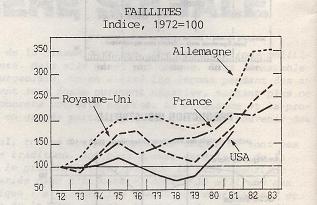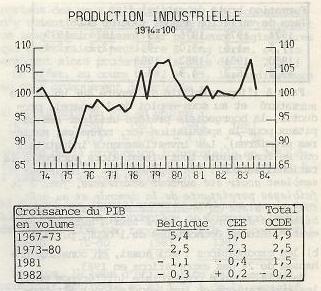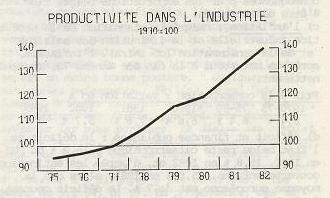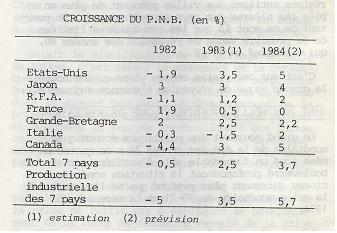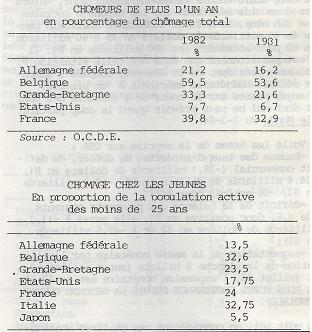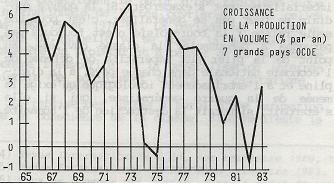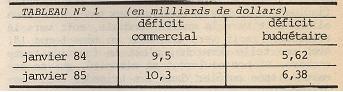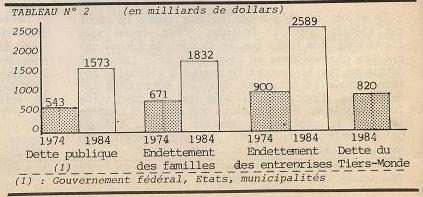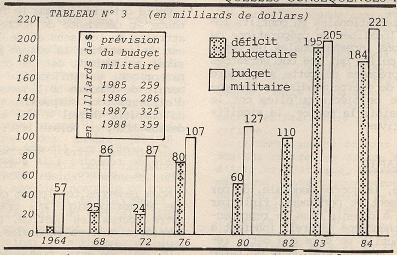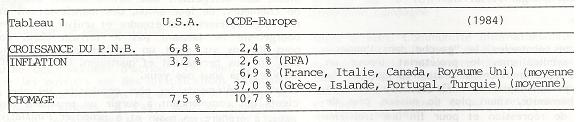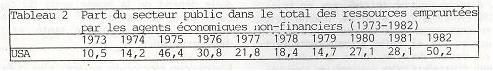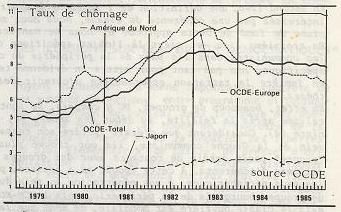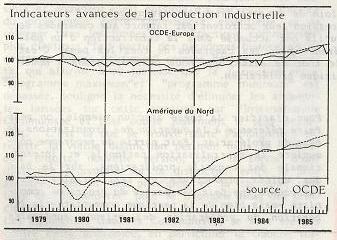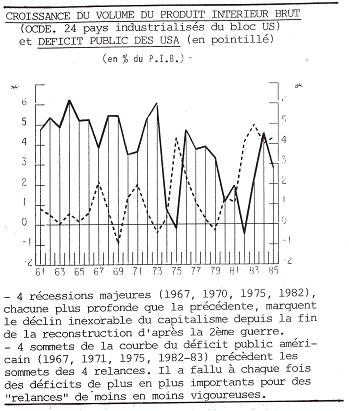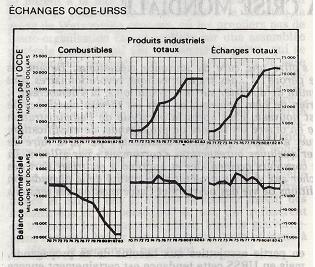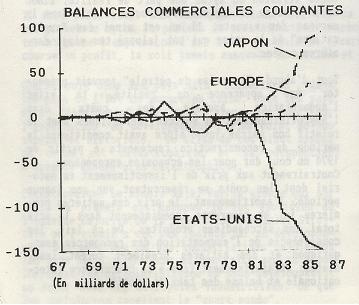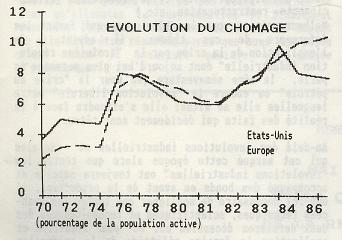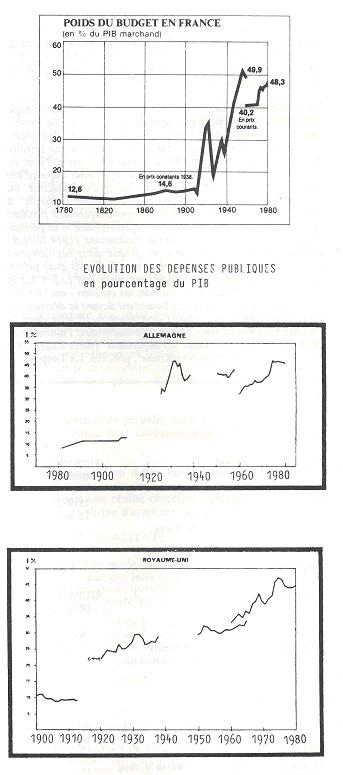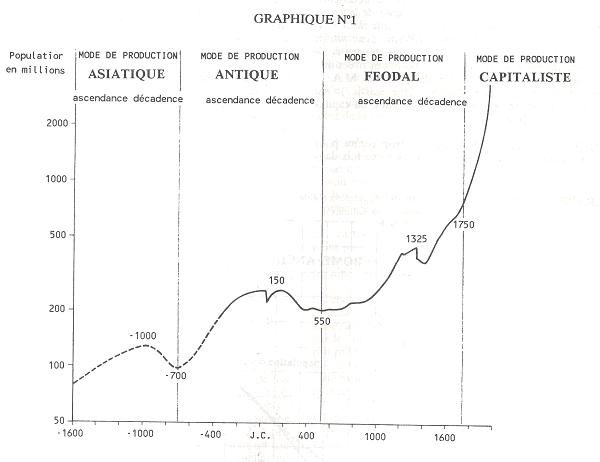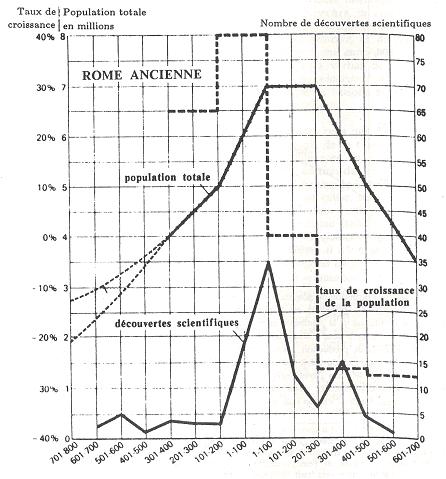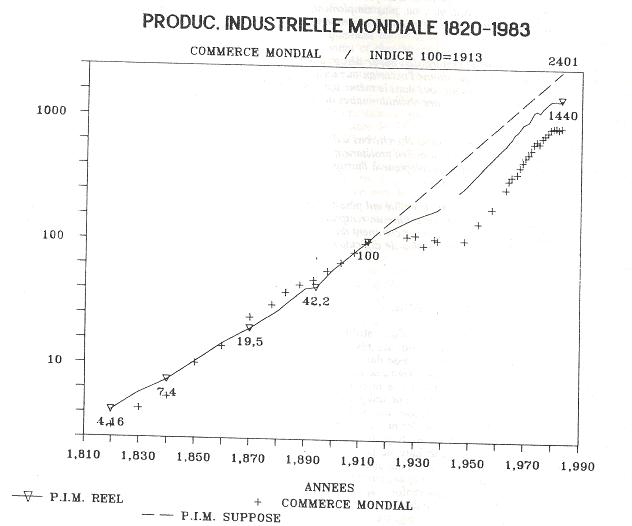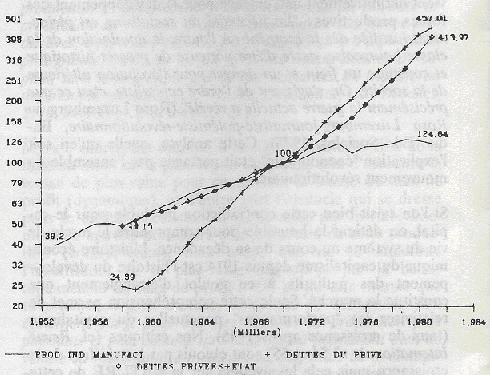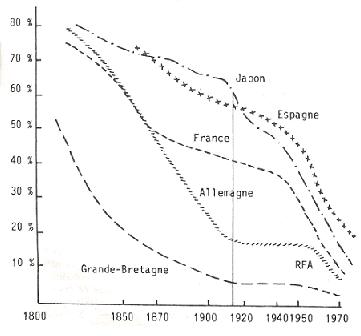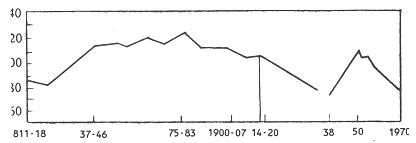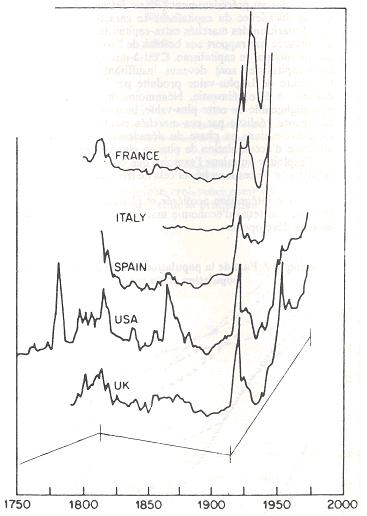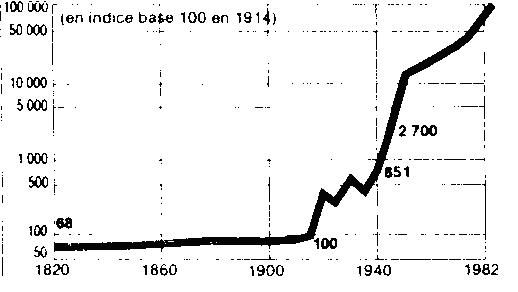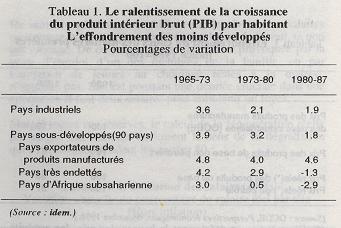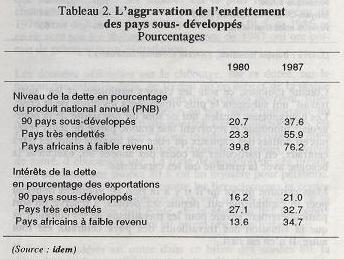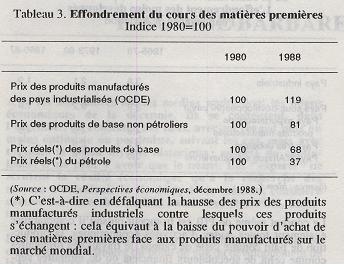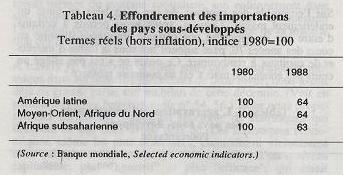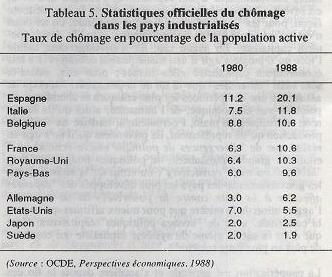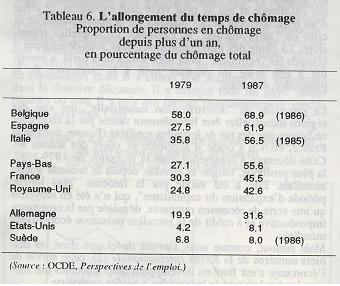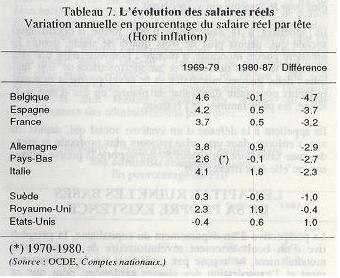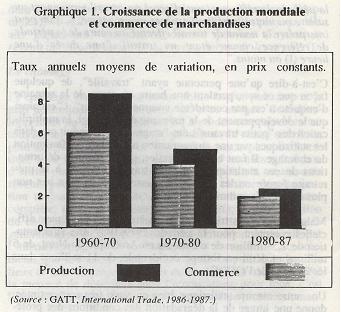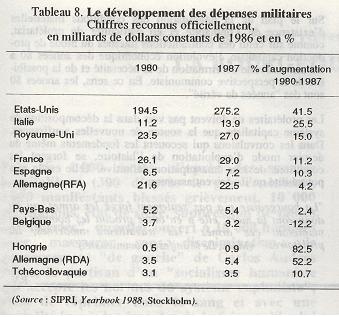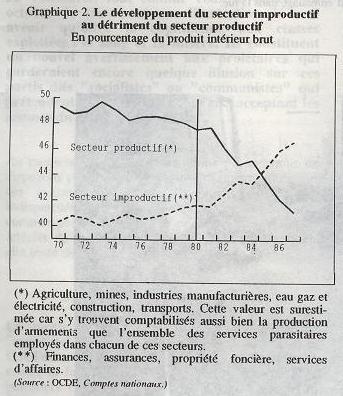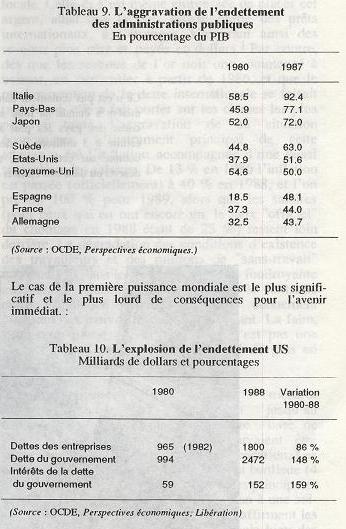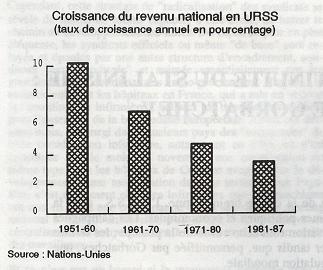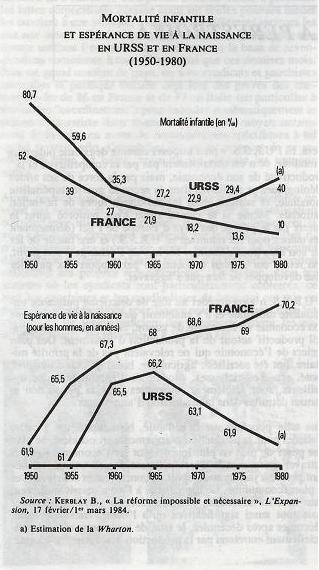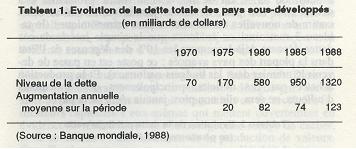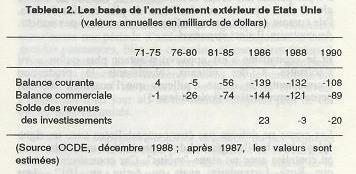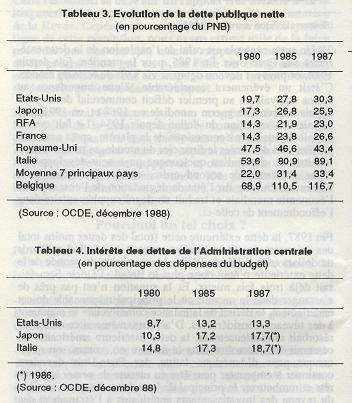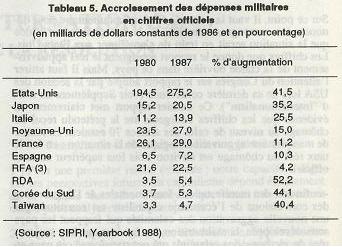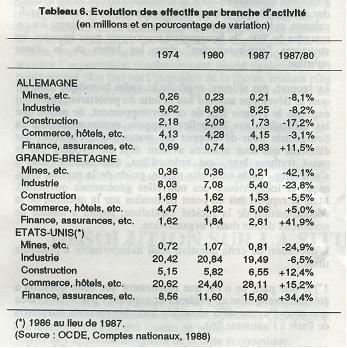Revue Internationale, les années 1980: n°20 - 59
- 4156 reads
Depuis la lutte massive des ouvriers en Pologne, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin et la fin des deux grands blocs impérialistes.
Structure du Site:
Sommaires de la Revue Internationale de 1980 à 1989
- 972 reads
N°20 – 1er trimestre 1980
Années 80 : Les années de vérité
L’accélération de la crise
Derrière la crise Iran-USA, les campagnes idéologiques
Correspondance :- Combat ouvrier et manoeuvres syndicales au Venezuela
Sur l’intervention des révolutionnaires : Réponse à nos censeurs
- Introduction
- Signification de la marche sur Paris
- Nos censeurs
- La CWO et notre intervention
Gauche mexicaine 1938 :
- Présentation
- Le Parti de la Révolution mexicaine “reconnaît la lutte de classe” pour combattre la révolution prolétarienne
- Une analyse des thèses du 2e Congrès de l’internationale Communiste (1920) : Sur les questions nationale et coloniale
N°21 – 2e trimestre 1980
Révolution ou guerre
Le gauchisme en France depuis dix ans
Texte d’orientation du congrès d’Internationalisme (Belgique) :
- L’organisation du prolétariat en dehors des périodes de luttes ouvertes (groupes ouvriers, noyaux, cercles, comités...)
L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective (Internationalisme n°52, été 1952)
- Série d’exposés faits au cours de réunions communes avec des camarades de l’Union Ouvrière Internationaliste (groupe de Munis)
Notes sur la Gauche hollandaise [3e partie]
- Les théories des crises dans la Gauche hollandaise
N°22 – 3e trimestre 1980
La signification du raid américain sur l’Iran
Troisième Conférence internationale des groupes de la Gauche communiste (Paris, mai 1980) :- Le sectarisme, un héritage de la contre-révolution à dépasser
Les théories des crises de Marx à l’internationale Communiste
- Marx
- De Marx aux débats sur l’impérialisme
- Les débats sur l’impérialisme
- La réponse de Rosa Luxemburg
- La position de l’internationale Communiste
Économie de guerre et crise en Allemagne de l’Est
- L’après-guerre
- Le développement de la crise
- Balances commerciales négatives à l’Est et à l’Ouest
- Qu’est-il arrivé au “miracle économique” ?
- Les mesures de la bourgeoisie
- La RDA et l’économie de guerre russe
- La situation de la classe ouvrière dans l’économie de guerre
- Les attaques contre ta classe ouvrière
- Perspectives pour la lutte de classe
Espagne 1936 :
- La publication des textes de “L’Internationale” sur la guerre d’Espagne (Union Communiste, Chazé, réédition chez Spartacus)
- La publication des textes de “Bilan” sur la guerre d’Espagne (Réédités par J. Barrot aux éditions 10/18)
Salut à Internationell Revolution :
- Constitution de la section du CCI en Suède
N°23 – 4e trimestre 1980
Grève de masse en Pologne 1980 : une nouvelle brèche s’est ouverte
La crise capitaliste dans les pays de l’Est
- Surproduction et pénurie de capital
- Le capitalisme décadent en URSS
Lutte de classe internationale
- Rapport présenté au 4e congrès de Révolution Internationale
La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme
- La nation
- Le développement de nouvelles unités capitalistes
- Les rapports entre l’État et la société civile
- La guerre
- Les crises
- La lutte de classe
- Le rôle de l’organisation révolutionnaire
Le Parti défiguré : la conception bordiguiste
- Le conseillisme et le parti : divergences réelles et divergences factices
- La nature du parti
- Rôle et fonction du parti dans la classe
N°24 - 1er trimestre 1981
La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne
A la lumière des événements en Pologne, le rôle des révolutionnaires
- La banqueroute du spontanéisme
- Les contradictions du substitutionnisme
- La conscience de classe et le rôle des révolutionnaires
Le mouvement révolutionnaire et la question syndicale après la défaite des années 20 [1e partie]
Notes sur la question paysanne
- Qu’est-ce que la paysannerie ?
- Les ouvriers agricoles
- Les différentes catégories de paysans
- La bourgeoisie rurale
- La petite-bourgeoisie
- Les paysans pauvres et sans terre
- Le poids de la décadence
- La danse macabre de la surproduction et de la sous-production agricole
- La mystification des réformes agraires
N°25 – 2e trimestre 1981
El Salvador, Espagne, Pologne :
- Face a la menace prolétarienne la bourgeoisie se prépare
L’aristocratie ouvrière : une théorie sociologique pour diviser la classe ouvrière
Le mouvement révolutionnaire et la question syndicale après la défaite des années 20 [2e partie]
- Comment les groupes révolutionnaires ont tiré les leçons du passé
Réponse à “Communisme de Conseils” (Danemark)
- Les 21 thèses du Communisme de Conseil aujourd’hui
- Le capitalisme, la crise, la révolution, le communisme
- Les organisations ouvrières capitalistes
- La situation présente
- En conclusion
Les confusions du “Fomento Obrero Revolucionario” sur Russie 1917 et Espagne 1936
Critique de “Lénine philosophe” de Pannekoek (Internationalisme, 1948)
- Introduction
- Politique et philosophie de Lénine à Harper [1re partie]
N°26 – 3e trimestre 1981
Quatrième congrès du Courant Communiste International :
- Présentation : “Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi"
Perspectives de la lutte de classe internationale : une brèche ouverte en Pologne
Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière
- Lutte économique et lutte politique
- L’immaturité des conditions de la révolution
- Les conditions de la généralisation de la lutte de classe
Résolution sur la lutte de classe
Contre-résolution sur la lutte de classe
Crise économique généralisée et conflits inter-impérialistes
Résolution sur la crise économique
N°27 – 4e trimestre 1981
Un an de luttes ouvrières en Pologne
Lutte de classe en Europe de l’Est (1920-1970) [1e partie]
- Révolution et contre-révolution
- La contre-révolution nationaliste
- L’unité du prolétariat de l’Est et de l’Ouest
- L’héritage de la contre-révolution
- La résistance des ouvriers dans la période d’après 1945
- Le soulèvement de Varsovie
- L’établissement du régime stalinien
- Les luttes de 1953
- Le soulèvement de 1956
- 1956 : quelques conclusions
- La fin de la contre-révolution
- La lutte de classe en Russie
- La Tchécoslovaquie 1968
- La Pologne 1970
Notes sur la grève de masse
Politique et philosophie de Lénine à Harper [2e partie]
Correspondance internationale : Contre la guerre Pérou-Equateur
- Tract rédigé et diffusé en Équateur, janvier 1981
- Réponse du CCI
N°28 – 1er trimestre 1982
Situation internationale : Crise économique et lutte de classe
Lutte de classe en Europe de l’Est (1920-1970) [2e partie]
- Les conditions de la classe ouvrière dans les “paradis socialistes”
- L’autarcie et l’économie de guerre
- Les “acquis d’Octobre”
- Le surgissement de la lutte de classe en URSS
- L’interlude polonais 1970-76
Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire
- L’échec des conférences internationales
- Les années de vérité
- Les exigences de la période actuelle
- Les débats dans le CCI
- Les difficultés organisationnelles
- Les récents événements
Politique et philosophie de Lénine à Harper [3e partie]
N°29 – 2e trimestre 1982
Après la répression en Pologne : Perspectives des luttes de classe mondiales
Lutte de classe en Europe de l’Est (1920-1970) [3e partie]
- La vague de luttes des années 70 à l’Est
- Les effets de la crise
- Une nouvelle période de luttes
Théories des crises : Le véritable dépassement du capitalisme c’est l’élimination du salariat [1e partie]
- A propos de la critique des thèses de Rosa Luxemburg par Nicolas Boukharine
Conférence extraordinaire du CCI, janvier 82 :
- Rapport sur la fonction de l’organisation révolutionnaire
Correspondance internationale
: Russie 1917 et Espagne 1936
- Texte de Focus (USA)
- Réponse du CCI
N°30 – 3e trimestre 1982
Guerre des Malouines : manoeuvres militaires, manoeuvres idéologiques, un piège pour le prolétariatPourquoi l’alternative guerre ou révolution ?
- La guerre est-elle une condition favorable pour la révolution communiste?
- La lutte de classe dans les conditions de la guerre
- Quatre conditions pour la révolution à notre époque
Théories des crises : Le véritable dépassement du capitalisme c’est l’élimination du salariat [2e partie]
- A propos de la critique des thèses de Rosa Luxemburg par Nicolas Boukharine
Politique et philosophie de Lénine à Harper [4e partie]
N°31 – 4e trimestre 1982
Moyen-Orient : La barbarie des impérialismes
Le prolétariat d’Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe
- Critique de la théorie du ‘maillon le plus faible’
Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie
- Notes sur la conscience de la bourgeoisie décadente
Crise de surproduction, capitalisme d’État et économie de guerre
- Extraits du rapport sur la situation internationale du 5e congrès de Révolution Internationale
N°32 – 1er trimestre 1983
La crise de surproduction capitaliste mondiale : Une tourmente qui pose la question de la révolutionOù en est la crise ?
Convulsions dans le milieu révolutionnaire
- Le Parti Communiste International (Programme Communiste) à un tournant de son histoire
- Une crise qui illustre la faillite d’une conception de l’organisation
- L’internationalisme contre toute forme de nationalisme
- La source des erreurs : le vide théorique
- Le réveil de la lutte de classe
- Perspectives
Le Parti Communiste International (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est
- Introduction
- Prometeo n°1, avril 1945: Appel du “Comité d’agitation” du PCI
- Commentaires de Prometeo aux réponses à l’appel
- Conclusion
La tâche de l’heure : Formation du Parti ou formation des cadres (Internationalisme n°12, août 1946)
- Moment de la constitution du Parti
- La possibilité du maintien du Parti dans une période de reflux
- La situation présente
Critique du Groupe Communiste Internationaliste
- Lutte revendicative, lutte révolutionnaire : la dynamique de la classe ouvrière
- Conscience de classe et rôle du Parti
- La dynamique de la Lutte de classe
- Internationalisation de la lutte et cours historique
N°33 – 2e trimestre 1983
Deux ans après la Pologne : Où va la lutte de classe ?
- Vers la fin du repli de l’après-Pologne
- 1968-1982, 15 ans de crise économique et de luttes ouvrières
- Perspectives : vers la fin du repli
Où en est la crise ?
- Le chômage dans les années 30
- Le poids de l’État dans l’économie des années 30
- Le chômage aujourd’hui
- La chute des investissements
- L’endettement mondial
- Une inflation toujours présente
Cent ans après la mort de Marx, l’avenir appartient au marxisme
- Marx dépassé ?
- L’utilisation de Marx contre la classe ouvrière
- Marx savant ou militant ?
- Être marxiste aujourd’hui
Problèmes actuels du mouvement ouvrier :
- Présentation
- La conception du chef génial (Internationalisme n°25, août 1947)
Conférence extraordinaire du CCI, janvier 1982 :
- Rapport sur la structure et le fonctionnement de l’organisation des révolutionnaires
N°34 – 3e trimestre 1983
Europe de l’Est : Crise économique et armes de la bourgeoisie contre le prolétariat
- Crise du capital et offensive contre les travailleurs
- Les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat
Où en est la crise ?
Les communistes et la question nationale (1900-1920) [1e partie]
- Débat sur la question nationale à l’aube de la décadence
- Lénine et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes
- La critique de l’autodétermination par Rosa Luxemburg
- Luxemburg sur l’indépendance de la Pologne
- L’émergence de l’impérialisme et les États de conquête
- Quelques conclusions sur l’attitude des révolutionnaires sur l’autodétermination dans le capitalisme ascendant
Problèmes actuels du mouvement ouvrier :
- “La discipline.., force principale...” (Internationalisme n°25, août 47)
Battaglia Comunista : A propos des origines du Parti Communiste Internationaliste
- Article de Battaglia Comunista n°3 (février 1983)
- Notre réponse
Polémique : Les doutes sur la classe ouvrière
- Critique du modernisme
- La Banquise
- La Guerre Sociale
Correspondance internationale :
- La perspective du CCI de “la gauche dans l’opposition”, la critique empirique et le rôle des révolutionnaires
- Lettre de Hong Kong
N°35 – 4e trimestre 1983
Tensions inter-impérialistes : La bourgeoisie met à profit le recul de la lutte de classeCinquième congrès du Courant Communiste International :
- Présentation du congrès
- La situation internationale
- L’état du CCI et la crise du milieu révolutionnaire
- Les statuts
- Le parti
- L’adresse aux groupes prolétariens
Rapport sur la situation internationale [1e partie]
- Crise économique : La descente dans l’abîme et l’impasse de la classe capitaliste
- La situation économique actuelle du capital mondial
- L’impasse de la classe capitaliste
- Le rapport de forces entre classe ouvrière et bourgeoisie
Rapport sur la situation internationale [2e partie]
- Où en est la lutte de classe ?
- La différence entre les années 30 et la période actuelle
- Face au prolétariat la bourgeoisie adapte ses armes aux conditions présentes
- Quelles perspectives ?
Résolution sur la situation internationale
Sur le parti et ses rapports avec la classe
- Le lien entre la vie de la classe et celle de ses organisations politiques.
- Quatre grandes étapes dans la vie du prolétariat: 1848, 1871, 1914, 1917
- L’épreuve de la contre-révolution
- Les principaux enseignements d’un siècle d’histoire sur la nature et la fonction du parti
- Vers le futur parti
Adresse aux groupes politiques prolétariens
N°36 – 1er trimestre 1984
Conflits inter-impérialistes, lutte de classe : L’histoire s’accélère
- L’aggravation des tensions impérialistes
- Le prolétariat : frein à la généralisation des conflits
- La reprise de la lutte de classe
Où en est la crise ?
- Le poids des dépenses militaires
- L’accélération des dépenses militaires
- Les dépenses militaires accélèrent la crise du capitalisme
Débat avec Battaglia Comunista sur les thèses de son congrès :
- Cours historique, les années 80 ne sont pas les années 30
A propos de l’adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e Congrès du CCI :
- Réponse aux réponses
Le deuxième Congrès du Parti Communiste Internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948)
- Avant-propos
- Le deuxième Congrès du PCI en Italie, 1948
- Le recrutement, objectif numéro un du Parti
- Un Parti sans cadres
- Existe-t-il un Parti en Italie ?
- La vérification des perspectives
- La vie intérieure du Parti, discipline ou conscience des militants
- La question de la participation aux élections
- Le problème syndical
- Conclusions
N°37 – 2e trimestre 1984
La reprise de la lutte de classe
- La lutte reprend dans tous les pays
- En germe, les traits de l’avenir
Thèses sur l’actuelle reprise de la lutte de classe
Où en est la crise ?
- Le mythe de la reprise économique
Les communistes et la question nationale (1900-1920) [2e partie]
- Le débat pendant la guerre impérialiste
La conception de l’organisation dans les Gauches allemande et hollandaise
La faillite du conseillisme :
- Présentation : Un socialiste perdu
- Extrait d’un texte de H. Canne-Meyer : "Le socialisme perdu, espérances du mouvement marxiste d’autrefois"
Débat : A propos de la théorie du “maillon le plus faible”
- Présentation
- Résolution du CCI
- Critique de quelques positions du CCI sur la théorie des “maillons faibles”
Réponse aux critiques
- Une démarche qui s’écarte du marxisme
- Un conseillisme horizontal
- L’unité du prolétariat
N°38 – 3e trimestre 1984
Lutte de classe internationale : Simultanéité des grèves ouvrières : quelles perspectives ?
- Le renouveau international des luttes
- Les armes de la bourgeoisie
- Les caractéristiques des luttes actuelles
- Le rôle des communistes
Où en est la crise ?
- La crise transforme l’Europe occidentale en une poudrière sociale
Belgique/Hollande : Crise et lutte de classe
Rapport du 5e Congrès d'Internationalisme section du CCI en Belgique
- Crise et austérité
- Le travail de sape de la gauche dans l’opposition
- Le prolétariat face a la gauche dans l’opposition
Organisation des révolutionnaires :
- Sur les conditions du surgissement du parti
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire :
- Le Kommunistenbond Spartacus et le courant “couseifliste” (1942-1948)
N°39 – 4e trimestre 1984
Quelle méthode pour comprendre la reprise des luttes ouvrières ?
Où en est la crise économique ?
- Crise historique de l’économie (Révolution Internationale n°31, juillet 1984)
Polémique avec la CWO :
- Comment se réapproprier les apports de la Gauche Communiste Internationale
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire :
- Le Kommunistenbond Spartacus et le courant conseilliste (1942-1948) [2e partie]
Correspondance internationale :
- Conscience et stratégie de la bourgeoisie
- Réponse a un camarade de Hong-Kong
N°40 – 1er trimestre 1985
Accélération de l’histoire : Aggravation de la crise, extension des luttes de classe
10 ans du CCI, quelques enseignements
La fonction des organisations révolutionnaires
- Le danger du conseillisme
Polémique : La
constitution du BIPR, un bluff opportuniste [1e partie]
Milieu révolutionnaire :
- Thèses du Collectif Communiste Alptraum
- Nos commentaires et critiques
N°41 – 2e trimestre 1985
Pour comprendre la lutte de classe
- La méthode marxiste et non l’empirisme
Où en est la crise économique ?
- Dollar : Le roi est nu
Socialisme ou barbarie
- La guerre dans le capitalisme
Thèses sur le rôle du Parti dans la révolution prolétarienne (KAPD)
- Présentation
- Thèses (Proletarier n°7, juillet 1921)
Polémique : La constitution du BIPR, un bluff opportuniste [2e partie]
Misère du conseillisme moderne
Débat interne :
- Le CCI et la politique du “moindre mal”
N°42 – 3e trimestre 1985
Situation internationale : Simultanéité des luttes ouvrières et obstacle syndicalOù en est la crise économique ?
- L’entrée dans la récession
Chômage massif et extension de la lutte de classe
Les communistes et la question nationale (1900-1920) [3e partie]
- Le débat pendant la vague révolutionnaire et les leçons pour aujourd’hui
Jan Appel, un révolutionnaire n’est plus
Correspondance internationale : En Inde, l’émergence d’un nouveau regroupement communiste
- Présentation
- Ce que nous sommes (Communist Internationalist)
Débat interne :
- Les glissements centristes vers le conseillisme
- L’orientation du débat
- Le développement du débat et la constitution d’une "tendance"
- L’article de la camarade J.A. : une illustration de la démarche des camarades minoritaires
- Le fond de la démarche de J.A. : les glissements conseillistes
N°43 - 4e trimestre 1985
Campagnes idéologiques : Les armes de la bourgeoisie face à la lutte de classeOù en est la crise économique ?
- Le bloc de l’Est de plain-pied dans la crise capitaliste
Révolution de 1905
- Enseignements fondamentaux pour le prolétariat
Réponse à la CWO
- Sur la maturation souterraine de la conscience de classe
Débat interne :
- Opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations
- Le concept du “centrisme” : Le chemin de l’abandon des positions de classe (La tendance)
Le rejet de la notion de “centrisme” : La porte ouverte à l’abandon des positions de classe
- La définition du centrisme
- Le CCI serait-il "centriste" vis-à-vis du trotskisme ?
- La "véritable" définition du centrisme selon Mac Intosh
- Les bases matérielles et sociales du centrisme
- Pas de centrisme dans la période de décadence ?
- La porte ouverte à l’abandon des positions de classe
N°44 – 1er trimestre 1986
Les luttes ouvrières seul frein à la guerre
Sixième congrès du Courant Communiste International
- Les enjeux du Congrès
- Résolution sur la situation internationale
- Résolution sur l’opportunisme et le centrisme dans la période de décadence
- Résolution (rejetée) Le centrisme et les organisations politiques du prolétariat
Zimmerwald (1915-1917)
- De la guerre à la révolution
- Les premières réactions
- La conférence socialiste internationale de Zimmerwald
- Le développement de la Gauche zimmerwaldienne
- Vers la Troisième Internationale
Salut à "Comunismo" n°1
- Premier numéro de la revue semestrielle du Collectif Communiste Alptraum du Mexique
N°45 – 2e trimestre 1986
La lutte ouvrière en 1985, bilan et perspectives
- Encart : Une même lutte dans des moments historiques différents
Où en est la crise économique ?
- Baisse du prix du pétrole, baisse du dollar, la récession à l’horizon
Situation internationale : Une crise de surproduction généralisée
Milieu politique : Le développement d’un milieu révolutionnaire en Inde
- Le surgissement de révolutionnaires à la périphérie du capitalisme
- En Inde : le difficile processus de rupture avec le gauchisme
- Conférences des révolutionnaires
La Gauche hollandaise (1900-1914) [1e partie]
- Naissance d’un courant révolutionnaire en Europe (1900-1909)
Polémique : La "Fraction externe du CCI"
- Les mensonges de "Perspective Internationaliste"
- Le "glorieux combat" de la tendance
- Une caricature de secte irresponsable
- Les perspectives de la "fraction"
N°46 – 3e trimestre 1986
Grèves massives eu Norvège, en Finlande, en Belgique :
- De la dispersion vers l’unification
Où en est la crise économique ?
- L’Europe en première ligne
Polémique avec le BIPR :
- Tâches des révolutionnaires dans les pays de la périphérie
Correspondance internationale :
- Présentation
- “Proposition internationale” aux partisans de la révolution prolétarienne mondiale (Emancipacion Obrera/Militancia Clasista Revolucionaria - Argentine, Uruguay)
- Réponse du CCI
La Gauche hollandaise (1900-1914) [2e partie]
- Naissance d’un courant révolutionnaire en Europe (1903-1907)
N°47 - 4e trimestre 1986
Les attaques frontales annoncent l’unification des luttes ouvrièresRésolution sur la situation internationale
Où en est la crise économique ?
- L’impasse
1936 : La gauche mène le prolétariat à la boucherie impérialiste
- Le “Front Populaire” en France, du dévoiement des grèves à l’union nationale
- Extraits de Bilan
Polémique avec le PCI (Battaglia Comunista)
- La période de transition
La Gauche hollandaise (1900-1914) [3e partie]
- Le mouvement “Tribune”
N°48 – 1er trimestre 1987
Situation internationale :
- Face à l’enfoncement dans la barbarie, la nécessité et la possibilité de la révolution
- La misère se généralise, le chômage s’intensifie, la barbarie s’approfondit
- La révolution communiste est une nécessité absolue
- Un scepticisme largement partagé
- Le prolétariat seul frein à la guerre impérialiste
- Le cours historique aux affrontements de classe généralisés
- Le scepticisme, une attitude qui détourne les organisations révolutionnaires de leurs tâches actuelles
Où en est la crise économique ?
- Récession, chômage, inflation : La grande plongée de la fin des années 80
- Un nouveau pas dans la récession
- Vers un accroissement dramatique du chômage
- Le retour de l’inflation galopante
- Le Japon et l’Allemagne dans la tourmente de la crise
- De plain-pied dans la catastrophe économique
Comprendre la décadence du capitalisme [1e partie]
- Les “anti-décadentistes”
- Y a-t-il une évolution historique ?
- Y a-t-il une phase ascendante du capitalisme ?
- Le communisme a-t-il toujours été à l’ordre du jour dans l’histoire ?
- La décadence du capitalisme : “une ère de révolution sociale”
- Une critique dénuée de sens
- “L’invariance”
- Gradualisme et fatalisme ?
Correspondance internationale - Le développement de la lutte de classe, la nécessité de l’organisation et de l’intervention des révolutionnaires : Critique du conseillisme
- Sur l’organisation (Lettre de Norvège, ex-KPL)
- Réponse du CCI
- Extraits d’une lettre du Danemark (Un membre du GIK, Octobre 1985)
- Quelques remarques en réponse au GIK
La Gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 [1e partie]
- Du tribunisme au communisme 1914-1916
- La nature de la guerre
- Le déclin du système capitaliste
- La faillite de la social-démocratie
- L’avenir
- Le SDP et Zimmerwald
- Quelques leçons
N°49 – 2e trimestre 1987
Leçons des grèves ouvrières en Europe de l’ouest : Entrer en lutte massivement, prendre en mains les luttes
- Une ambiance générale de combativité ouvrière
- Les enseignements de la grève des chemins de fer en France
- L’intervention des révolutionnaires
- Perspectives du développement des luttes
Crise et lutte de classe aux USA
- Extraits du rapport sur la situation aux USA, Internationalism
Où en est la crise économique ?
- Le capitalisme russe s’enfonce dans la crise mondiale
- La dégradation économique de L’URSS
- Une attaque redoublée contre le niveau de vie de la classe ouvrière
- Quelles perspectives ?
Comprendre la décadence du capitalisme [2e partie]
- Les origines de la théorie de la décadence
- L’invariance du programme ou le “marxisme des dinosaures”
- Le point de vue idéaliste de l’anarchisme et la méthode marxiste
Correspondance internationale : A propos du regroupement des révolutionnaires
- Lettre d’Emancipacion Obrera (Argentine) au CCI
- Répondre à quelques questions et clarifier des positions
- Sur la démocratie. Pourquoi nous nous référons peu au passé
- Revendiquer la continuité avec la Social-Démocratie ?
- Guérilla tiers-mondiste et terrorisme petit- bourgeois
- Les conseils ouvriers
- Caractérisation de la période actuelle
- Quelques conclusions
- Réponse à Emancipacion Obrera
- Quelles perspectives pour le regroupement des révolutionnaires dans la période historique actuelle
- Guerre ou révolution
- La crise actuelle
- Le cours à des affrontements de classes
- Les critères minimaux ouvrant la voie d’un rapprochement
- La continuité historique du mouvement révolutionnaire
- Sur le parlementarisme
- Face à la révolution russe
- Le développement du SDP entre la révolution et l’opportunisme (1916-1917)
- Le SDP en 1917 face à la révolution
- Premiers signes pré-révolutionnaires aux Pays-Bas
- La direction du SPD et la révolution russe
- La révolution russe et la révolution mondiale
N°50 – 3e trimestre 1987
Lutte de classe internationale : Le besoin de l’unification et la confrontation au syndicalisme de base
- Espagne : divisions syndicales contre unité ouvrière
- Italie : le syndicalisme de base contre la prise en mains des luttes
- Le développement de la perspective de l’unification
- Comités de lutte : une tendance générale au regroupement des ouvriers combatifs
Où en est la crise économique ?
- Crise et lutte de classe dans les pays de l’Est
- La faiblesse économique du bloc de l’Est
- Convulsions de la crise du capital et réactions ouvrières
Correspondance internationale : Le développement de la vie politique et des luttes ouvrières au Mexique
- Présentation
- A toutes les organisations révolutionnaires dans le monde, au prolétariat international (Comunismo, Mexico)
Comprendre la décadence du capitalisme [3e partie]
- La continuité des organisations politiques du prolétariat : la nature de la Social-Démocratie
- Un nihilisme apocalyptique
- L’importance de la continuité historique dans le mouvement communiste
- De quelle continuité nous réclamons-nous ?
- La nature de classe de la Social-Démocratie de la fin du 19e siècle, début du 20e
- Les conditions de la lutte du prolétariat à l’époque de la Social-Démocratie
- La Social-Démocratie ne s’identifie pas avec le réformisme
- Les acquis de la 2e Internationale
- Le pourquoi et le comment du combat des révolutionnaires dans les partis de la 2e Internationale
- Conclusion
Polémique : Réponse à Battaglia Comunista sur le cours historique
- La méthode marxiste : indiquer la direction ou agnosticisme ?
- Les conditions de la guerre généralisée aujourd’hui
- Le surgissement historique du prolétariat
- Est-ce que la lutte de classe affecte la bourgeoisie ?
- La Fraction Italienne et le cours de l’histoire
- Le danger qui guette Battaglia
La Gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 [3e partie]
- L’année 1918 : Entre la révolution et l’opportunisme, la naissance du Parti communiste hollandais
- L’offensive de la minorité dans le SDP : entre la fraction et l’opposition
- La révolution avortée de novembre
- 1918 : La fondation du Parti communiste en Hollande (CPN)
La Gauche hollandaise en 1919-1920 [1e partie]
- La Troisième Internationale
- Les courants de gauche dans l’Internationale en 1919
N°51 – 4e trimestre 1987
Situation internationale : Conflits impérialistes et lutte de classe
- Guerre dans le Golfe persique
- “Fanatisme et terrorisme” contre “paix et civilisation”
- Le développement des tensions militaires et les enjeux historiques
Luttes ouvrières en Corée du Sud et en Afrique du Sud
- La mobilisation du prolétariat mondial se développe
7e congrès du Courant Communiste International
- Présentation
- Sur la situation internationale
- Sur notre intervention
- Sur notre responsabilité à l’égard du milieu politique révolutionnaire
- Le renforcement de la capacité théorique et programmatique
- Conclusion
Résolution sur la situation internationale
- L’évolution de la crise du capitalisme
- L’évolution des conflits impérialistes
- L’évolution de la lutte de classe
Sur le milieu politique prolétarien
- Introduction
- Résolution sur le milieu politique
Rectification de la plate-forme du CCI
- Introduction
- Quelle démarche pour modifier la plate-forme ?
- Pourquoi des erreurs ont-elles été commises par le CCI ?
- Quelle ampleur pour les modifications de la plate-forme ?
- Quelles modifications de la plate-forme ?
- Les enjeux pour aujourd’hui
- Résolution de rectification de la plate-forme
Polémique avec Battaglia Comunista
- Syndicats bourgeois, organes ouvriers et intervention des révolutionnaires
- Les syndicats, organes de l’État bourgeois
- A quelle époque les syndicats se sont-ils intégrés à l’État bourgeois ?
- Comment s’est modifiée la conception de Battaglia Comunista de ses “groupes internationalistes d’usine” ?
- Les communistes peuvent-ils travailler dans des organes d’État comme les syndicats ?
- Deux hypothèses d’intervention dans la lutte de classe
- Les deux hypothèses à l’épreuve de la réalité
- La reprise de la lutte de classe remet à l’ordre du jour les discussions inachevées
Il y a 70 ans, la révolution russe :
- La plus importante expérience du prolétariat mondial
N°52 – 1er trimestre 1988
La crise économique, la guerre et la révolution
- La crise économique affaiblit le pouvoir de la bourgeoisie mondiale
- La crise crée des conditions pour l’unification prolétarienne
- La crise met à nu le véritable enjeu des luttes ouvrières
- Le triomphe du marxisme
Où en est la crise économique ?
- Krach : quand il faut payer le solde
- Une situation bien plus grave que dans les années 30
- La perspective d’une accélération majeure de la récession mondiale
- Une immense crise de surproduction
Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme [1e partie]
- La guerre et le militarisme dans la décadence du capitalisme
- Les destructions des deux guerres mondiales et leurs conséquences
- Le cancer du militarisme ronge l’économie capitaliste
- Les armes et les conséquences d’une 3e guerre mondiale : illustration de la barbarie du capitalisme décadent
Débat international
- Présentation du GPI (Mexique)
- Crise et décadence du capitalisme (critique au CCA, Mexique)
- Les caractères de la crise
- Les causes de la crise
- Les limites du marché
- La décadence du capitalisme (Grupo Proletario Internacionalista)
Polémique : Où va le FOR ? (Ferment Ouvrier Révolutionnaire)
- L’héritage du trotskisme
- La révolution espagnole dans l’évangile du FOR
- L’avenir d’une secte
La Gauche hollandaise en 1919-1920 [2e partie]
- La Troisième Internationale (suite)
- La question allemande.
- Le bureau d’Amsterdam (1919-1920)
N°53 – 2e trimestre 1988
Luttes ouvrières en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, émeutes et répression en Palestine : seul le prolétariat peut mettre fin la barbarie
- La bourgeoisie contre la prise de conscience des enjeux de la situation
- La décomposition du capitalisme
- Seul le prolétariat peut en finir avec la barbarie du capitalisme
- Les ouvriers britanniques ne sont pas seuls
- Les luttes actuelles ne suffisent pas : li faut aller plus loin
- En Italie : L’obstacle du syndicalisme de base
- Le géant prolétarien allemand se réveille et annonce l’unification des luttes
- Il faut se préparer aux combats à venir
20 ans depuis MAI 1968
- Lutte de classe : Le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne
- La rupture de mai 1968
- Ce que le prolétariat a appris en 20 ans
- Vers des affrontements difficiles et décisifs
Le capitalisme dans le tourbillon de la crise
- Ce qui a été dit a propos de la crise
- La crise du pétrole et la crise de surproduction
- La "révolution libérale"
- La “révolution technologique"
- Pour en finir avec les mythes et illusions sur la crise
L’évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968 [1e partie]
- Le milieu politique prolétarien avant 1968
- La fragilité du milieu qui renaît après 1968
- La dynamique du regroupement et le poids du sectarisme
Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme [2e partie]
- La démarche “suicidaire” du capitalisme décadent
- L’offensive du bloc américain
- La classe ouvrière doit combattre les illusions pacifistes
Correspondance internationale
- Adresse au milieu prolétarien et à la classe ouvrière (GPI, Mexique)
N°54 – 3e trimestre 1988
Reagan-Gorbatchev, Afghanistan : mensonges du “désarmement et de la paix”
- Réduction des armements et marche à la guerre
- Le pacifisme : un mensonge dirigé contre la classe ouvrière
Pologne : Les grèves sabotées par le syndicat “Solidarnosc”
Où en est la crise économique ?
- La perspective d’une récession n’est pas écartée, au contraire
- Le bilan réel de cinq ans de “non effondrement” et de dévastation
- Le bilan sur le plan financier
- L’effondrement boursier
Comprendre la décadence du capitalisme [4e partie]
- La décadence du capitalisme
- Sur le plan théorique
- Sur le plan quantitatif général
- Sur le plan qualitatif
- Le développement du capitalisme d’État
L’évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968 [2e partie]
- La dynamique des conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste
Polémique
- La confusion des groupes communistes sur la période actuelle : La sous-estimation de la lutte de classe
N°55 – 4e trimestre 1988
Les “paix” de l’été 88 : L’intensification des préparatifs guerriers
- La crise économique irréversible du capitalisme pousse à la guerre impérialiste
- Le capitalisme, c’est la guerre
- Les "paix” de l’été 88, une étape de l’offensive occidentale
- Les ‘paix” de l’été préparent la guerre impérialiste
- L’unique perspective du capitalisme : une 3e guerre mondiale
- Aujourd’hui le capitalisme c’est la chute dans la misère, la guerre et la barbarie
- Le prolétariat est le seul frein à la guerre impérialiste
- Le pacifisme désarme la classe ouvrière et prépare la guerre
Lutte de classe internationale : Luttes ouvrières en Pologne
- L’aggravation inexorable de la crise économique et l’intensification des attaques capitalistes
- Pour la classe ouvrière, une seule voie : le développement de ses luttes
- La défaite du mouvement : gouvernement et opposition se partagent le travail
- En Pologne, comme partout dans le monde, la perspective est plus que jamais aux affrontements de classe
Grupo Proletario Internacionalista (GPI) : Crise et luttes ouvrières au Mexique
- Dans l’abîme de la crise chronique
- La situation de la classe ouvrière dans le pays
- La lutte de classe au Mexique
- Perspectives de la lutte ouvrière
Comprendre la décadence du capitalisme [5e partie]
- L’analyse marxiste du développement de l’histoire
- Bordiga et ses épigones
- Critique de la conception bordiguiste de l’évolution historique
- Analyse de la décadence et trotskisme
Polémique
- Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR
- Le défaitisme contre le militantisme révolutionnaire
- Les avancées difficiles du milieu politique prolétarien
- Le BIPR et la lutte de classe : quelques contradictions de trop
1918-1919 : Il y a 70 ans : A propos de la révolution en Allemagne [1e partie]
- Introduction
- Les luttes en Allemagne et en Russie : la même force les dynamisait, la même perspective les unissait
- La bataille pour la prise du pouvoir par les conseils ouvriers
- Les origines de la défaite au cœur de la vague révolutionnaire
- Les leçons de la révolution en Allemagne
N°56 – 1er trimestre 1989
France : Les “coordinations” à l’avant-garde du sabotage des luttes
- Une nouvelle arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière : les “coordinations”
- Les agissements des “coordinations” dans la grève des hôpitaux en France
- Le partage du travail entre les “coordinations” et les syndicats
- Quelles leçons pour la classe ouvrière
Algérie : La bourgeoisie massacre
Où en est la crise économique ?
- De la crise du crédit à la crise monétaire et à ta récession, ou le crédit n’est pas une solution éternelle
- Les effets dévastateurs de l’excès de crédit
- Le crédit n’est pas une solution éternelle
- La poursuite de la fuite en avant
- Les perspectives
Comprendre la décadence du capitalisme [6e partie)
- Le mode de vie du capitalisme en décadence
- Le crédit
- Les marchés extra-capitalistes
- Le capitalisme d’État
- Armements, guerres, reconstruction
- L’épuisement des palliatifs
- Conclusions
L’évolution du milieu politique prolétarien depuis 1968 [3e partie]
- Un milieu politique aveugle face à la lune de classe
- La question de l’intervention au coeur des débats
- Les débats au sein du CCI et la formation de la FECCI
- Le poids de la décomposition sociale et la décantation au sein du milieu révolutionnaire
- Avec la reprise de la lutte de classe, le développement du milieu prolétarien
1918-1919 : Il y a 70 ans. A propos de la révolution allemande [2e partie]
- Arrêt de la guerre, gouvernement SPD-USPD et répression
- La stratégie du SPD : désarmer les conseils ouvriers
- La bourgeoisie provoque une insurrection prématurée
N°57 - 2e trimestre 1989
La décomposition du capitalisme
- En s’enfonçant dans la décadence, le capitalisme ne peut engendrer que toujours plus de destructions
- La décomposition idéologique de la société capitaliste
- Seul le prolétariat peut sortir la société de cette impasse
Bilan économique des années 80 : L’agonie barbare du capitalisme
- Le capital conduit l’humanité à l’agonie
- Le capital saigne à blanc le prolétariat dans les pays les plus industrialisés
- Le capital ruine les bases de sa propre existence
Émeutes de la faim et répression sanglante au Venezuela : La bourgeoisie massacre
- Des émeutes de la faim
- Le véritable visage de la démocratie bourgeoise
- C’est la bourgeoisie mondiale qui s’est livrée à un bain de sang au Venezuela
1919 : Fondation de l’Internationale Communiste
- La continuité de l’IC avec la 2e internationale
- La rupture de l’IC avec la 2e Internationale
- Aujourd’hui et demain : continuer le travail de l’IC
Engels sur la Révolution française de 1789
Polémique : Conscience de classe et Parti (GPI)
- Données du problème
- Comment le BIPR essaie d’approfondir Lénine
N°58 – 3e trimestre 1989
Les manoeuvres bourgeoises contre l’unification de la lutte de classe
- Le renforcement des campagnes idéologiques de la bourgeoisie
- Les manoeuvres de la bourgeoisie contre les luttes ouvrières
Un mensonge dans la continuité du stalinisme : La Perestroïka de Gorbatchev
- L’URSS d’avant la Perestroïka
- La Perestroïka et la Glasnost : Des mensonges contre la classe ouvrière
Comprendre la décadence du capitalisme [7e partie]
- Le bouleversement des formes idéologiques
- L’aveuglement de l’invariance
- Bouleversements économiques et formes idéologiques
- Sur quoi repose l’emprise de l’idéologie dominante ?
- Le développement des moyens de manipulation idéologique
- La spécificité de la décadence capitaliste
- Décomposition de l’idéologie dominante : développement des conditions de la révolution
A la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière
Contribution pour une histoire du mouvement révolutionnaire :
- Introduction à l’histoire de la Gauche germano-hollandaise
N°59 – 4e trimestre 1989
Convulsions capitalistes et luttes ouvrières
- Liban et Iran : La guerre hier, aujourd’hui et demain...
- Chine et Pologne
- Les convulsions des régimes staliniens
- URSS : La classe ouvrière affirme sa lutte
8e congrès du Courant Communiste International :
- Les enjeux du congrès
- La défense et le renforcement de l’organisation révolutionnaire
- La constitution de REVOLUCION MUNDIAL comme nouvelle section du CCI
- Un renforcement du milieu politique prolétarien
- L’histoire s'accélère sur tous les plans
La situation internationale :
- Sur la crise économique
- Sur les conflits impérialistes
- L’évolution de la lutte de classe
Résolution sur la situation internationale
Il y a 50 ans : Les véritables causes de la 2e guerre mondiale
- Rapport sur la situation internationale (Gauche Communiste de France, juillet 1945, extraits)
- Guerre et paix
- La guerre impérialiste
- La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile
- Manifeste de la Gauche Communiste de France (L’Etincelle n°1, janvier 1945, Organe de la Fraction Française de la Gauche Communiste)
Le rapport “Fraction/Parti” dans la tradition marxiste [1e partie]
- La Gauche italienne - 1922-1937
- Les critiques de Battaglia Comunista envers la Fraction Italienne à l’extérieur
- Les conditions pour la transformation de la Fraction en Parti
- Le débat de 1935 : Fatalisme ou volontarisme
- Le débat de 1935-37 : Vers la guerre impérialiste ou vers la reprise de classe
- La ligne de partage historique des années 1935-37
- La guerre d'Espagne : "Participationnisme" ou "Défaitisme révolutionnaire" ?
Revue Int. 1980 - 20 à 23
- 4045 reads
Revue Internationale no 20 - 1e trimestre 1980
- 2991 reads
Années 80 : les années de vérité
- 2853 reads
L'histoire ne se plie pas aux chiffres des calendriers. Cependant les décennies sont souvent associées dans la tête des hommes à des périodes spécifiques de l'histoire. Ainsi, si on parle des années 30 on pense immédiatement à la grande crise qui a frappé le capitalisme il y a 50 ans; si on évoque les années 40, c'est à la guerre que l'on pense, à cette guerre qui a anéanti l'équivalent d'un pays comme l'Italie ou la France. A l'aube des années 80, quelle image peut-on associer à la décennie qui se termine, quel sera le phénomène saillant de celle qui commence ?
La crise ? On peut dire qu'elle a marqué de son empreinte les années 70, mais elle marquera encore plus les années 80. Entre les années 60 et les années 70, il y eut effectivement une différence dans la situation économique du monde. Les premières furent les années de la fin de la reconstruction, celles où brillèrent les derniers feux d'une "prospérité" factice, basée sur des mécanismes on ne peut plus éphémères puisqu'associés à la reconstitution du potentiel industriel et commercial de l'Europe et du Japon détruit par la guerre. Ce potentiel reconstitué, le capitalisme s'est de nouveau trouvé confronté à son impasse mortelle : la saturation des marchés. C'est pour cela que, sur le plan économique, la décennie qui se termine n'a pas ressemblé à la précédente : "prospérité" pour l'une, marasme pour l'autre. Par contre, il n'y aura pas de différence de cette nature entre les années 70 et les années 80, sinon que, durant les secondes, la crise sera pire encore.
La misère humaine et les massacres ? Les années qui viennent s'annoncent particulièrement "riches" dans ce domaine : jamais il n'y a eu autant de famines et autant d'exterminations de populations de par le monde : à force de "libérer" des peuples, à force de leur apporter leur aide (qui en général, se réduit à l'envoi d'engins de mort), les grandes puissances les auront bientôt rayés de la carte du monde. Cette apocalypse n'est pas nouvelle. Dans la prochaine décennie, avec l'aggravation de la crise, on verra, malgré toutes les pétitions et toutes les campagnes humanitaires, se multiplier les Cambodge. Mais ce ne sera là, certes à un degré de plus en plus terrifiant, que la poursuite de calamités qui n'ont pratiquement pas cessé depuis la seconde guerre mondiale, qui ont fait de la société humaine un véritable enfer pour la majorité de ses membres. En ce sens, même s'ils sont appelés à se multiplier, on ne pourra qualifier la décennie qui vient comme celle des génocides, car en cela on ne saurait la distinguer de celles qui l'ont précédée.
Cependant,, les événements qui se sont produits ces derniers temps attestent que des changements très importants dans la vie de la société mûrissent en ses entrailles et qui concernent bien moins son infrastructure économique ou le degré de misère de ses membres que la façon d'être et d'agir des principales classes qui la composent : bourgeoisie et prolétariat.
D'une certaine façon, les années 70 furent les années d'illusion. Même dans les grandes métropoles du capitalisme, bourgeoisie et prolétariat ont été confrontés à la réalité de la crise, et même souvent de façon très crue. Mais en même temps, et notamment dans les pays les plus développés, ceux où se décide l'enjeu de la vie du monde, ces deux classes ont eu longtemps tendance à se voiler les yeux devant cette réalité : la première parce qu'il lui est insupportable de regarder en face le tableau de sa faillite historique, la seconde parce qu'elle a subi en partie les illusions véhiculées par la classe dominante mais aussi parce qu'il ne lui est jamais facile d'assumer d'emblée la formidable responsabilité historique qui pèse sur ses seules épaules et qu'une conscience claire de la signification de la crise lui aurait rappelée. Face à la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions. Certes, depuis 67, les récessions se sont succédé de façon régulière (67, 70-71, 74-75) en même temps que l'inflation devenait un mal chronique. Mais, à l'issue de chacune de ces récessions, il y avait une "reprise"; celle de 1972-73 faisant d'ailleurs connaître aux pays occidentaux (notamment les USA) des taux d'expansion parmi les plus élevés depuis la guerre. De même, il y avait de fortes poussées d'inflation galopante, mais certains plans de stabilisation n'échouaient pas complètement et on pouvait même voir certains pays "faire" moins de 5% par an: il suffisait de suivre leur trace. Evidemment, la bourgeoisie s'était rendu compte que les plans de "relance" relançaient...1'inflation et que les plans de "stabilisation" provoquaient...une nouvelle récession, mais elle s'était faite à l'idée que, même si les choses n'étaient plus comme "avant", on pourrait quand même continuer à marcher à ce rythme à condition "d'assainir" et de "couper les branches mortes", en d'autres termes d'imposer l'austérité et de licencier.
Aujourd'hui la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise, à la suite, comme nous le voyons dans l'article "L'accélération de la crise", de l'échec de tous les remèdes qu'elle a administrés à son économie et qui ont fini par l'empoisonner encore plus. Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste plus que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre.
Cette marche vers la guerre n'est pas nouvelle ; en fait, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le capitalisme n'a jamais désarmé comme il l'avait fait partiellement à l'issue de la première. Et depuis qu'il a connu une nouvelle aggravation de sa situation économique à la fin des années 60, les tensions impérialistes n'ont cessé de s'accentuer, les armements de croître de manière phénoménale : aujourd'hui, c'est un million de dollars qui sont engouffrés chaque minute en moyens destinés à semer la mort et la destruction. Mais jusqu'à présent, c'était de façon encore semi-inconsciente que la bourgeoisie s'acheminait vers une nouvelle guerre mondiale: elle y était poussée par les nécessités objectives de son économie mais en même temps elle ne se rendait pas vraiment compte que c'était la seule perspective que son système offrait à l'humanité. De même, la bourgeoisie n'avait pas vraiment conscience que son incapacité présente de mobiliser le prolétariat pour la guerre constituait l'obstacle le plus sérieux sur le chemin d'une telle issue.
Aujourd'hui, avec le constat de la faillite totale de son économie, la bourgeoisie est en train de prendre une conscience plus claire de la situation et elle agit en conséquence. D'une part, elle renforce encore ses armements. Partout les budgets militaires connaissent des hausses vertigineuses. Partout, on remplace des armes déjà terrifiantes par des armes encore plus "efficaces" ("Backfire", Pershing 2, bombe à neutrons, etc..). Mais elle n'agit pas seulement sur le terrain des armements. Comme nous le signalons dans notre prise de position sur la crise Iran/USA, elle a également entrepris de créer une psychose de guerre afin de préparer l'opinion à ses projets de plus en plus bellicistes. "Puisqu'à la guerre il faut aller et puisque les masses ne sont pas préparées à cette perspective, il faut utiliser tous les prétextes pour créer ce "sursaut national", cette "union sacrée", et les guider sur le bon chemin, celui qui s'écarte des sordides conflits d'intérêts (lire les conflits de classe) et mène à la "défense de la patrie et de la civilisation" contre ces forces de la barbarie qui les menacent, qu'elles aient nom fanatisme islamique, cupidité arabe, totalitarisme ou impérialisme". Tel est le discours que se tient de plus en plus la classe dominante partout dans le monde.
Face à la classe ouvrière, le langage de la bourgeoisie est donc en train de changer: tant que pouvait subsister l'apparence qu'il y avait des solutions à la crise, elle a bercé les exploités de promesses illusoires : acceptez l'austérité aujourd'hui et ça ira mieux demain. La gauche avait fait merveille dans ce style de mensonges : le crise n'était pas le résultat des contradictions insurmontables du mode de production capitaliste, mais celui d'une "mauvaise gestion" ou de la "cupidité des monopoles" et autres "multinationales" : qu'on vote pour elle et tout allait changer! Aujourd'hui ce langage ne prend plus, la gauche au gouvernement, là où elle y était parvenue, n'a pas fait mieux que la droite et, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, elle a même souvent fait pire. Puisque promettre des "lendemains qui chantent" ne trompe plus personne, la classe dominante a changé de registre. C'est le contraire que l'on commence à promettre maintenant en disant bien fort que le pire est devant nous mais qu'on n'y est pour rien, que "c'est la faute des autres", qu'il n'y a pas d'autre issue, et en espérant réaliser cette unité nationale que Churchill, en d'autres temps, avait obtenu de la population anglaise en lui promettant "du sang et des larmes".
Ainsi , de plus en plus, la bourgeoisie, en même temps qu'elle perd ses propres illusions, est obligée de parler clair à la classe ouvrière quant à l'avenir qu'elle lui réserve. Si celle-ci était résignée, démoralisée comme au cours des années 30, ce langage pourrait être efficace : "Puisque, de toutes façons, il n'y a pas d'autre issue, puis qu’il faut sauver quand même ce qui peut être sauvé : "la démocratie", la "terre de mes ancêtres", mon "espace vital", va pour la guerre et ses sacrifices !" Tel est l'écho que la classe dominante aimerait rencontrer à ses discours. Malheureusement pour elle, les nouvelles générations ouvrières n'ont pas la résignation de leurs aînées. Dès les premières atteinte de la crise, avant même que celle-ci ne soit reconnue comme telle par quiconque, à l'exception de quelques toutes petites minorités révolutionnaires qui n'avaient pas oublié les enseignements du marxisme, la classe ouvrière a engagé la lutte. Ses combats, au tournant des années 60 et 70, par leur extension et par leur détermination, signifiaient que c'en était fini de la terrible contre-révolution qui avait pesé sur la société à la suite de l'écrasement de la vague révolutionnaire du premier après-guerre. Il n'était plus "minuit dans le siècle", le capitalisme devait de nouveau compter avec ce géant qu'il croyait définitivement endormi : le prolétariat. Mais même si celui-ci débordait de nouveau de vitalité, il manquait d'expérience, et il s'est laissé en bonne partie piéger par les chausse-trappes que le capitalisme, une fois revenu de sa surprise, a disposé sur son chemin. S'appuyant sur le fait que la crise de son économie avançait à un rythme beaucoup plus lent que dans les années 30, la bourgeoisie a réussi à communiquer au prolétariat ses propres illusions sur la possibilité d'une "solution" à la crise. Pendant un certain nombre d'années, celui-ci a cru dans les bobards de "l'alternative de gauche", qu'elle ait nom "gouvernement travailliste", "pouvoir populaire", "programme commun", "pacte de la Moncloa", "compromis historique", etc.. Abandonnant pour un temps la lutte ouverte, il s'est laissé promener dans les impasses électorales et démocratiques, il a encaissé sans presque réagir une austérité et un chômage à doses de plus en plus massives. Mais ce que sa première vague de luttes débutée en 68 révélait déjà, est en train maintenant de se confirmer: les mystifications bourgeoises d'aujourd'hui n'ont pas la force de celles du passé. A force de servir, les discours sur la "défense de la patrie", de la "civilisation", de la "démocratie", de la "patrie socialiste", s'usent. Et ceux sur "l'intérêt national", la "menace terroriste" et autres "gadgets" n'arrivent pas à les remplacer. Comme le fait ressortir notre article : "Notre intervention et ses censeurs", le prolétariat a repris maintenant le chemin de la lutte au point de contraindre la gauche, là où elle était au gouvernement, à poursuivre dans l'opposition sa tâche capitaliste et, partout, à radicaliser son verbe.
Avec une crise qui fait peser chaque jour plus sur elle ses terribles effets, avec une expérience d'une première vague de luttes et de l'arsenal de pièges que peut lui tendre la bourgeoisie pour les asphyxier, avec enfin la réapparition encore timide mais qui ne cesse de se confirmer de ses minorités révolutionnaires, la classe ouvrière revient donc affirmer sa puissance et son énorme potentiel de combativité. Si la bourgeoisie n'a d'autre avenir à proposer à l'humanité que la guerre généralisée, les combats qui se développent aujourd'hui démontrent que le prolétariat n'est pas prêt à lui laisser les mains libres et que lui a un autre avenir à proposer, un avenir où il n'y aura plus de guerre ni d'exploitation : le communisme.
Dans la décennie qui commence, c'est donc cette alternative historique qui va se décider : ou bien le prolétariat poursuit son offensive, continue de paralyser le bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer et démoraliser par ses discours et sa répression et, alors, la voie est ouverte à un nouveau holocauste qui risque d'anéantir la société humaine.
Si les années 70 furent tant pour la bourgeoisie que pour le prolétariat les années d'illusion, parce que la réalité du monde actuel s'y révélera dans toute sa nudité, et parce que s'y décidera pour bonne part l'avenir de l'humanité, les années 80 seront les années de la vérité.
Questions théoriques:
- Décadence [2]
- Le cours historique [3]
L'accélération de la crise
- 2883 reads
Les soi-disant "explications économiques" dont les classes dominantes abreuvent la population à travers la presse, la radio, la télévision ont presque toujours un objectif clair et déclaré : justifier au nom d'une prétendue "science économique" les nouveaux "sacrifices" que le capital exige de ses exploités.
Les "experts" ne prennent la parole et ne citent leurs statistiques que pour "expliquer" pourquoi il faut accepter l'augmentation du chômage, la baisse des salaires réels, pourquoi il faut cependant travailler plus, pourquoi les impôts augmentent, pourquoi il faut expulser les travailleurs immigrés, bref pourquoi il faut rester soumis aux lois du capitalisme alors que celles-ci conduisent l'humanité à la ruine et au désespoir.
Refuser et combattre la domination de ces lois, c'est aussi rejeter les justifications "économiques" avec lesquelles les gouvernements imposent leur système d'exploitation. Mais il ne suffit pas de se dire : "De toutes façons tout ce qu'ils racontent est faux". Il faut encore comprendre en quoi et pourquoi c'est faux, si on veut être capable de construire quelque chose de réellement différent demain.
La révolution prolétarienne est une révolution CONSCIENTE. Le prolétariat ne pourra pas débarrasser l'humanité des entraves qui la paralysent sous le capitalisme sans savoir quelles sont ces entraves.
La compréhension de la situation économique du capitalisme est indispensable pour agir consciemment au niveau global de la société, car jusqu'à présent les hommes restent soumis à leurs besoins économiques.
Dans le capitalisme, comme dans toutes les sociétés passées, comprendre le monde c'est d'abord comprendre sa vie économique. Comprendre comment le détruire, c'est aussi comprendre comment il s'affaiblit : c'est comprendre ses crises.
L'article qui suit s'inscrit dans cet effort. Son objet est de faire le point sur le développement actuel de la crise et d'en dégager les perspectives. Il s'attache à démontrer que l'actuelle aggravation de la crise annonce pour le début des années 80 une récession de l'économie mondiale sans précédent depuis la guerre.
L'article comporte beaucoup de chiffres, mais il faut passer par ce terrain aride pour tenter de mesurer où en est la crise du capitalisme et où elle va. Nous nous sommes servis de chiffres "officiels" en sachant ce qu'ils valent. Les statistiques économiques subissent des distorsions d'ordre aussi bien idéologique que technique. Du fait même que la soi-disant "science économique" fait partie intégrante de l'idéologie et de la propagande de la classe dominante, ses statistiques subissent toujours toutes les déformations utiles pour justifier, la survie et la défense du système. Les "experts" de la bourgeoisie ne le font pas toujours avec des visions machiavéliques : ils sont eux-mêmes victimes du poison idéologique qu'ils sécrètent. Mais leurs statistiques ne subissent pas uniquement des déformations idéologiques. Elles sont aussi victimes d'incapacités techniques qui tiennent au délabrement même du système économique. En effet, l'instrument de mesure de la plupart des statistiques économiques c'est la monnaie, que ce soit le dollar ou autre.
Or l'inflation et les soubresauts de plus en plus fréquents et violents des taux de change des monnaies internationales, rendent les monnaies de moins en moins capables de mesurer l'activité économique réelle. Cela est particulièrement vrai pour la mesure des agrégats économiques en termes de "volume", (le volume du produit national brut, par exemple) c'est à dire en termes de "monnaie constante", une monnaie théorique qui n'aurait pas été dévaluée par l'inflation.
Mais, quels que soient les défauts, connus, des statistiques économiques existantes, elles sont les seules disponibles. Et si elles manquent de précision, elles n'en rendent pas moins compte d'une façon ou d'une autre, du SENS des principaux mouvements économiques.
De toute façon, tenter de démontrer la faillite du capitalisme et la possibilité de le détruire en se servant des statistiques des capitalistes eux-mêmes, n'affaiblit pas la force de la démonstration ; cela tendrait plutôt à la renforcer.
L'économie mondiale entre dans les affinées 80 en s'enfonçant dans une nouvelle récession. La quatrième depuis 1967.
Dans les pays de l'Est, la croissance de la production est tombée au niveau le plus bas depuis la 2ème guerre mondiale (4% de croissance en 1978). Le secrétariat de l'OCDE, l'organisation qui regroupe les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, annonce pour l'ensemble de sa zone 3% de croissance en 1979 et prévoit une chute de cette croissance à 1,5% en 1980. 1,5%, c'est la quasi-stagnation de l'activité économique. Ce sont les Etats-Unis et le Royaume Uni qui s'enfoncent les premiers dans la nouvelle récession. La première et la cinquième puissance du bloc -qui réalisent à elles seules plus de 40% de la production des pays de l'OCDE- connaîtront en 1980 des taux de croissance de leur production négatifs, c'est à dire que la masse de production réalisée chaque jour va non seulement cesser de croître, mais va diminuer de façon absolue.
Quelle sera l'ampleur de cette récession ? Combien de pays va t'elle toucher ? Combien de temps peut-elle durer ? Quelle sera sa profondeur ? Elle s'annonce la plus étendue géographiquement depuis la 2ème guerre : pour la première fois, toutes les zones de la planète vont être simultanément touchées.
Elle risque d'être la plus longue par la durée. Elle devrait être aussi la plus profonde en termes de recul de la croissance de la production et donc d'aggravation du chômage.
En d'autres termes, les travailleurs du monde entier vont connaître la plus violente dégradation de leurs conditions d'existence depuis la seconde guerre mondiale. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage de salaires et de l'aggravation de l'inflation. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage des salaires et de l'aggravation de l'inflation.
Les dernières miettes accordées par le capitalisme pendant les années de relative prospérité de la reconstruction sont reprises par le capital...et il ne parle pas de les rendre de si tôt. Les différents Etats du monde se préparent à connaître un nouveau regain de convulsions économiques et sociales.
Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que la récession dans laquelle s'enfonce actuellement le capitalisme sera la plus large, la plus longue et la plus profonde depuis la guerre ?
Trois types de facteurs :
- Premièrement, l'ampleur de la dégradation que connaît dans 1'immédiat 1’économie mondiale
- Deuxièmement l'inefficacité croissante des moyens dont se sert le capital pour relancer la croissance économique.
- Troisièmement 1'impossibilité grandissante pour les Etats de continuer à recourir aux moyens de relance.
Ce qu'on peut exprimer en d'autres termes : la maladie mortelle du capitalisme connaît actuellement une aggravation majeure ; or, non seulement les remèdes que les Etats lui administrent depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. Tels ces médecins qui s'acharnaient à maintenir en vie un Franco plus que moribond, la bourgeoisie pratique aujourd'hui envers son économie un acharnement thérapeutique pourtant dénoncé par la science.
Reprenons chacun de ces trois points : l'aggravation de la crise actuelle d'une part, l'inefficacité des moyens de relance et l'impossibilité d'y recourir davantage sans aggraver davantage la crise d'autre part.
L’AGGRAVATION ACTUELLE DE LA CRISE
Pour le moment, parmi les grands pays industrialisés du bloc occidental, les pays les plus frappés sont les Etats-Unis et la Grande Bretagne. C'est dans ces deux pays que la croissance de la production s'est le plus ralentie au cours de l'année 1979 comme le montre le tableau suivant :
Cependant, personne ne se fait d'illusions sur la possibilité pour les autres pays du bloc de maintenir longtemps les rythmes de croissance actuels avec l'entrée des Etats-Unis en récession dans la mesure où les économies du Japon et de l'Europe sont totalement liées à celle de leur chef de file économique et militaire.
Cette dépendance qui repose tout d'abord sur la suprématie absolue du leader du bloc au sein de sa zone (elle est la même dans le bloc russe), n'a fait que se renforcer depuis le début des années 70. En ralentissant la croissance de leur production, les Etats-Unis cherchent à réduire la masse de leurs importations. Mais, en réduisant leurs achats sur le marché mondial, ils rétrécissent directement ou indirectement les débouchés pour la production européenne et japonaise.
Contrairement à ce qu'ont affirmé certains économistes, l'actuelle croissance en Europe et au Japon ne pourra pas se maintenir pour compenser l'effondrement des Etats-Unis. Au contraire, comme en 1969, la chute de la croissance aux Etats-Unis annonce celle des autres pays industriels.
Le rapport annuel de la Commission du Marché Commun, qui a publié en octobre ses prévisions pour l'année 80, annonce déjà un ralentissement de la croissance pour la CEE de 3,1% en 1979 à 2% en 1980 ; une accélération de l'inflation et une augmentation du taux de chômage (de 5,6% à 6,2%), "la plus forte augmentation prévue depuis que la Commission a commencé à établir des statistiques en 1973" ("Le Soir", Bruxelles).
Dans tous les pays occidentaux, les annonces de licenciements se sont multipliées à la fin de 1979. Mais la spécificité de ces annonces, c'est qu'elles concernent non seulement des secteurs déjà en difficulté, mais également des secteurs qui avaient été jugés jusqu'ici relativement épargnés par la crise. Les licenciements continuent de se multiplier dans les secteurs déjà frappés : le premier producteur d'acier des Etats-Unis -US Steel- annonce la fermeture de 10 usines et le licenciement 13000 travailleurs en Grande-Bretagne ; la British Steel Corporation entend réduire sa force de travail de 50000 travailleurs.
Mais désormais, c'est aussi l'automobile et l'électronique, ces secteurs que Ton disait être des "locomotives de l'économie", qui sont fortement touchés. Aux Etats-Unis, la production automobile a diminué de 25% entre décembre 78 et décembre 79. "Cent mille salariés de l'automobile (soit 1 sur 7) sont d'ores et déjà au chômage pour une durée indéterminée et 40000 ouvriers sont en chômage temporaire à la suite de fermetures d'usines d'une ou deux semaines dans plusieurs Etats" ("Le Monde"). En Allemagne, le pays dont l'économie reste enviée par les gouvernements du monde entier, la production automobile a diminué de 4% en un an. OPEL a du mettre au chômage partiel 16000 ouvriers pendant 2 semaines et Ford-Allemagne 12000 pendant 25 jours. Quant au secteur de pointe qu'est 1'électronique, il vient d'être frappé par l'effondrement de la compagnie allemande AEG-Telefunken qui prévoit près de 13000 licenciements,
Dans les pays sous-développés, la crise économique qui plonge depuis longtemps la quasi-totalité d'entres eux dans un marasme total, est venue frapper violemment les quelques pays que l'on disait "miraculés". Que ce soit les pays qui avaient connu un relatif développement industriel au cours des dernières années (la Corée du sud ou le Brésil par exemple) ou que ce soit les pays producteurs de pétrole (l'Iran ou le Venezuela par exemple), ils connaissent tous une violente dégradation de leur situation économique et avec elle l'écroulement de tous les mythes sur leur éventuel "décollage industriel".
Quant aux pays de l'Est, ils connaissent actuellement une puissante aggravation de leurs difficultés économiques. Malgré leur politique destinée à réduire leur endettement à l'égard de l'occident, celui-ci s'est encore accru. Selon la Commission Economique pour l'Europe ces Nations Unies, cet endettement a augmenté de plus de 17% en 1978 par rapport à l'année précédente. Quant à la situation interne, l'examen de la situation économique auquel ont procédé les dirigeants de l'URSS à l'occasion délia session d'automne 79 du Soviet Suprême, fait état d'un bilan particulièrement défavorable dans des domaines aussi fondamentaux que les transports^, la production agricole et pétrolière. Dans les pays satellites, tels que la Pologne, les gouvernements commencent à parler officiellement de chômage et partout d'inflation ; cette maladie que le dogme stalinien prétend réservée aux pays occidentaux, connaît une accélération sans précédent.
Voilà pour la situation immédiate. A elle seule, par 'étendue et la rapidité de la dégradation économique, elle permettrait de prévoir qu'elle ne constitue que le début d'une nouvelle récession dont le plus fort est encore à venir.
LES MOYENS DE "RELANCE"
I. L'INEFFICACITE CROISSANTE DES MOYENS DE "RELANCE"
Une des caractéristiques majeures de l'évolution économique mondiale, et plus particulièrement en occident depuis la récession de 1974-75, c'est que, contrairement à ce qui s'était produit au lendemain des récessions de 1967 ou de 1970, les politiques de "relance", malgré les efforts considérables de la part des gouvernements, se sont soldés par des résultats de plus en plus médiocres, sinon nuls.
Avec l'arrêt définitif de tous les mécanismes de la reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en occident a commencé à vivre suivant des oscillations de plus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté de plus en plus violemment à deux écueils : d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et de plus en plus inflationnistes.
Le graphique ci-dessous qui trace l'évolution de la croissance de la production pour l'ensemble constitué par les "sept grands" du bloc occidental (Etats-Unis, Japon, Allemagne de l'ouest, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada), montre comment ces oscillations se sont faites de plus en plus brutales pour aboutir de 1976 à 1979 à un retentissant fiasco des politiques de "relance".
On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante :
- en 1967, ralentissement de la croissance ;
- en 1968, relance ;
- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967 ;
- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flottement des principales parités monétaires ; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe" ;
- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis 18 ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973) ;
- fin 1973 à fin 1975, nouvelle récession ; la troisième mais aussi la plus longue et la plus profonde ; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel ; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3% par an ;
- 1976-1979, troisième relance ; mais cette fois-ci malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés des pays industrialisés([1] [4]) malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en œuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement mais systématiquement.
Pourtant les doses de remèdes employées par les gouvernements ont été particulièrement importantes.
Déficits budgétaires : les principaux pays industrialisés ont eu recours depuis 1975 et sans interruption à une augmentation des dépenses de l'Etat supérieure à celle de ses recettes afin de créer une demande susceptible de faire redémarrer la croissance. Cela s'est traduit par des déficits budgétaires permanents qui ont atteint des niveaux équivalents à plus de 5% de la production nationale dans certains cas (5,8% pour l'Allemagne en 1975, 5,4% pour le Japon en 1979) et dépassé 10% pour des pays faibles tels l'Italie (11,7% en 1975, 11,5% en 1979). La moyenne de ces déficits budgétaires pour les 5 années qui vont de 1975 à 1979 est à elle seule éloquente.
Le financement de la croissance du bloc par le déficit extérieur des Etats-Unis : en achetant à l'étranger beaucoup plus qu'ils ne parvenaient à vendre, les Etats-Unis ont, de 1976 à 1979, constitué un facteur de croissance pour l'économie de leur bloc. En réalité, c'est depuis la fin de la reconstruction de l'Europe et du Japon à la fin des années 60, et avec la guerre du Vietnam que la croissance du bloc occidental est en partie financée artificiellement par le déficit extérieur des Etats-Unis. Le dollar américain étant la monnaie d'échange et de réserve, dans le marché mondial, les autres pays sont contraints d'accepter la monnaie de singe des Etats-Unis comme moyen de paiement.
C'est ainsi que déjà la relance au lendemain de la récession de 1970 fut "stimulée" par deux années de déficit particulièrement important des Etats-Unis. Mais depuis la récession de 1974-75, les Etats-Unis ont eu recours à la même politique avec une ampleur et une persistance sans précédent. Au cours des trois dernières années, les Etats-Unis ont augmenté leurs importations plus rapidement que les autres puissances de leur bloc, comme le montrent les chiffres ci-dessous.
Cette politique s'est traduite par un développement vertigineux du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis. Un déficit qui a momentanément permis aux autres puissances de connaître pendant ces mêmes années des balances commerciales positives.
Comme on le voit, que ce soit le remède "déficits budgétaires" ou que ce soit le remède "déficit extérieur des Etats-Unis" ("injection de dollars"), tous les deux ont été administrés en doses massives à l'économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats«qu'ils ont obtenus ne prouve qu'une chose : leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80.
Mais il y a encore plus grave. A force d'avoir eu recours à ces stimulants artificiels avec des doses de plus en plus massives, les gouvernements ont fini par empoisonner totalement le corps de leur économie.
II. L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A RECOURIR AUX MEMES REMEDES
L'année 1979 a été marquée, entre autres soubresauts sur le plan économique, par la plus spectaculaire alerte monétaire que le système ait connu depuis la guerre. Au moment même où le capitalisme fêtait les 50 ans du krach de 1929, le prix de l'or s'enflammait et atteignait des sommets sans précédent. En quelques semaines de hausse, le cours de l'or a dépassé 400 dollars l'once ! Cette alerte ne traduisait pas un simple accident spéculatif. Au début des années 70, le cours officiel de l'or était de 38 dollars l'once après la première dévaluation du dollar en 1971). 9 ans plus tard, il faut dix fois plus de billets verts pour acquérir la même quantité d'or ! Mais le cours de l'or n'a pas augmenté seulement en dollars. C'est dans toutes les monnaies qu'il a flambé. C'est à-dire que c'est le pouvoir d'achat réel de toutes les monnaies qui a brusquement baissé.
Ce qu'a exprimé la récente crise de l'or n'est rien d'autre que la menace d'un écroulement définitif du système monétaire international, c'est-à-dire la menace de la disparition de l'outil qui conditionne toutes les opérations économiques dans le capitalisme, depuis l'achat de savonnettes jusqu'au financement par plusieurs puissances d'un barrage hydroélectrique dans un pays du tiers-monde.
La crise monétaire sanctionne en fait l'impossibilité de continuer à faire marcher l'économie avec des manipulations monétaires, nationales ou internationales, et plus largement, l'impossibilité pour le capitalisme de continuer à survivre dans une incessante fuite en avant à travers l'inflation et le recours aux crédits monétaires tous azimuts. L'endettement de l'ensemble de l'économie mondiale a atteint des niveaux critiques dans tous les domaines : l'endettement des pays du tiers-monde qui, pendant des années, ont acheté des usines à crédit mais qui ne disposent pas de débouchés pour les faire fonctionner, l'endettement des pays de l'Est qui n'a cessé de se développer sans que l'on entrevoie avec quoi ces pays pourraient payer, l'endettement enfin des Etats-Unis qui ont inondé le monde de dollars (Eurodollars ou Pétrodollars) et qui ont connu dans les dernières années une accélération sauvage de leur endettement interne.
D'après l'hebdomadaire "Business Week", un des porte paroles les plus conséquents du grand patronat américain : "Depuis la fin de 1975, les Etats-Unis ont relancé l'économie d'endettement et provoqué une explosion du crédit si effrénée qu'elle laisse loin derrière elle la fièvre qui avait marqué le début des années 1970" (16 octobre 1978). D'après le même article, de 1975 à 1978, l'endettement de l'Etat (emprunts) a augmenté de 47% atteignant 825 milliard:' de dollars en 1978, soit plus du tiers du Produit National Brut du pays ; quant à l'endettement de l'ensemble des agents économiques (entreprises, particuliers, Etat, etc.), il a atteint cette même année 3900 milliards de dollars, soit à peu près le double de ce même P.N.B. !
Confronté à l'impossibilité croissante de vendre ce qu'il est capable de produire, le capitalisme a vécu de plus en plus en s'endettant pour l'avenir. Le crédit sous toutes ses formes a permis de repousser en partie les problèmes de fond. Mais ce faisant, il ne l'a pas résolu, au contraire, il n'a fait que l'aggraver. A force de reculer les échéances à coup de stimulants artificiels, l'économie capitaliste mondiale est parvenue à un degré de fragilité et d'instabilité extrêmes comme vient de le démontrer la chai de "alerte de l'or" de l'automne 1979.
Au début des années 80, le capitalisme se trouve placé devant l'alternative suivante : ou bien continuer des politiques de "relance" et c'est la culbute monétaire définitive ; ou bien cesser de recourir aux remèdes artificiels et c'est la récession.
Le gouvernement américain a déjà été contraint de choisir la seconde "issue"... et ce faisant, il a choisi pour le monde.
UNE FAUSSE ALTERNATIVE POUR LES TRAVAILLEURS
Devant cette situation, les gouvernements dans chaque pays prétendent convaincre les travailleurs qu'i doivent accepter les baisses de salaires et les licenciements pour que "ça aille mieux demain". Ce serait la condition de "la reprise" : "restructurons notre économie nationale et on s'en sortira".
Il est certain que l'insuffisance des marchés contraint les capitaux nationaux à être le plus compétitifs possible (et cela implique licenciements et baisses des salaires). Les quelques marchés existants iront à ceux des capitalistes qui parviennent à vendre au meilleur prix. Mais mourir les derniers ne veut pas dire échapper à la mort. C'est tous les pays qui doivent faire face à la pénurie des débouchés. Le rétrécissement du marché est mondial. Et quel que soit l'ordre dans lequel les entreprises et les pays s'effondrent, ils s'effondrent tous.
La restructuration de l'appareil productif aujourd'hui n'est pas une préparation à une nouvelle renaissance, mais une préparation à la mort ; ce n'est pas une crise de jeunesse que subit le capitalisme mais une convulsion d'agonie.
Pour les travailleurs, accepter les sacrifices aujourd’hui ne résoudra en rien leurs problèmes de demain. La seule chose qu'ils auraient à y gagner serait de subir sans réaction la plus violente attaque du capital. Et se soumettre au capitalisme lorsque celui-ci est aux abois, c'est se préparer à se faire conduire à la seule solution que le capitalisme a pu trouver à ses crises depuis 60 ans : la guerre.
Par contre, résister à cette attaque c'est forger la volonté et la force pour détruire le vieux monde en déclin et bâtir un nouveau.
R.V.
[1] [5] D’après le rapport annuel du GATT sur le commerce international en 1978-79, en 1978, les pays sous-développés ont absorbé, grâce surtout aux revenus des pays de l’OPEP, 20% des produits manufacturés exportés par l’Europe occidentale et 46% de ceux exportés par le Japon.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Derrière la crise Iran-USA, les campagnes idéologiques
- 2844 reads
Dix mois après une "révolution" qui avait accompli l'exploit de mettre en place un régime encore plus anachronique que le précédent, la situation en Iran est revenue avec force au centre de l'actualité mondiale, provoquant un raz-de-marée d'imprécations contre la "barbarie" des Iraniens et des musulmans, ainsi que des prévisions alarmistes sur les risques de guerre ou de catastrophe économique. Au milieu de ce bruit et de cette fureur complaisamment amplifiés par les mass-médias, il est nécessaire aux révolutionnaires d'y voir clair et notamment de répondre aux questions suivantes :
1°) Que traduit la prise des otages de l'ambassade américaine concernant la situation interne de l'Iran ?
2°) Quel impact cette opération et cette situation ont-elles sur la situation mondiale et notamment :
- quel est le jeu des grandes puissances ?
- y a-t'il réellement une menace d'un conflit armé ?
3°) Quels enseignements faut-il en tirer quant aux perspectives générales qui se présentent à la société dans la prochaine décennie ?
1) La prise en otage du personnel diplomatique par un gouvernement légal constitue une sorte de "première" dans le monde pourtant agité du capitalisme contemporain. Les prises d'otages en elles-mêmes sont chose courante dans les convulsions qui assaillent le capitalisme en décadence : dans tous les affrontements inter-impérialistes, ce sont des populations entières qui en sont les victimes sans que cela émeuve particulièrement la communauté internationale des brigands impérialistes. La particularité et le caractère "scandaleux" de celle de Téhéran réside dans le fait qu'elle bafoue les règles élémentaires de convivialité établies entre ces brigands : de même que le silence par rapport à la police est la règle d'or entre gangsters du milieu, le respect des diplomates est celle des gangsters de l'impérialisme. Le fait que les dirigeants de l'Iran se soient laissé aller à adopter ou à cautionner un comportement qui, en général, est réservé aux "terroristes" en dit long sur le degré de décomposition de la vie politique de ce pays.
En effet, depuis le départ du Shah, la classe dominante de l'Iran s'est révélée incapable d'assurer la plus élémentaire stabilité politique. La presqu'unanimité qui s'était faite contre la dictature sanglante et corrompue du Shah s'est rapidement désagrégée, de par :
- le caractère hétéroclite des forces sociales qui avaient combattu l'ancien régime, le caractère complètement anachronique du nouveau régime, s'appuyant sur des thèmes idéologiques de type médiéval,
-l'incapacité de ce régime d'apporter une quelconque satisfaction aux revendications économiques des couches les plus pauvres, et notamment la classe ouvrière,
-l'affaiblissement important subi par les forces armées en partie décapitées après la chute du Shah, où la démoralisation et la désertion gagnaient de plus en plus.
En quelques mois, les oppositions contre le gouvernement se sont développées au point de compromettre totalement la cohésion et les bases économiques de l'édifice social :
- opposition des secteurs "libéraux" et modernes de la bourgeoisie,
- menace de sécession des provinces kurdes,
- reprise des luttes prolétariennes qui menacent de plus en plus la source quasi unique de riches ses du pays : la production et le raffinage de pétrole.
Face à cette décomposition générale de la société, les dirigeants de la "République Islamique" se sont rabattus sur le thème qui avait réussi, 10 mois avant, à réaliser une unité éphémère : la haine du Shah et de la puissance qui l'avait soutenu jusqu’a son renversement et qui l'héberge en ce moment. Que l'occupation de l'ambassade américaine ait été "spontanée" ou voulue par les dirigeants iraniens "durs" (Khomeiny, Ghotbzadeh) ne change rien au fait que la mise en avant de 1'épouvantail du Shah, utilisé, comme en d'autres circonstances, d1épouvantail fasciste, a permis de façon momentanée de reconstituer une certaine "unité nationale":
-cesser le feu des nationalistes kurdes,
-interdiction des grèves par le "Conseil de la Révolution"
Mais, à terme, le remède choisi par Khomeiny et compagnie est pire que le mal et exprime bien toute l'impasse dans laquelle se trouve cette équipe dirigeante : en choisissant de s'affronter politiquement et économiquement à la première puissance mondiale, elle n'a fait que plonger dans une fuite en avant qui ne pourra qu'aggraver la situation intérieure et en premier lieu sur le plan économique.
2) Les convulsions qui agitent aujourd'hui l'Iran constituent une nouvelle illustration :
a) de la gravité de la crise actuelle du capitalisme mondial, qui s'exprime dans les pays avancés par des crises politiques de plus en plus fréquentes et profondes et qui, dans les pays arriérés, se répercute sous la forme extrême d'une décomposition presque totale du corps social.
b) de l'incapacité d'une réelle indépendance nationale de la part des pays sous-développés : soit ceux-ci se rangent docilement derrière un bloc ou Vautre, soit ils sont plongés dans une instabilité et une déroute économique telles qu'ils sont, en fin de compte, obligés d'en venir à un tel ralliement : là où la France de De Gaulle et la Chine de Mao ont échoué, on ne voit pas comment l'Iran de l'imam Khomeiny pourrait réussir.
3) Face aux convulsions que connaît en ce moment l'Iran, il n'existe pas, contrairement à toute une série de rumeurs alarmistes, de danger immédiat d'affrontement militaire majeur dans la région. La raison essentielle en est que, malgré toute la campagne anti-américaine menée par Khomeiny, il n'y a pas actuellement de possibilité de basculement de l'Iran dans le camp russe. Comme l'ont déjà montré plusieurs exemples du passé, notamment l'affaire de Chypre en 74, si les difficultés et l'instabilité qui peuvent surgir dans un pays du bloc américain, dans le sens où elles peuvent affaiblir ce bloc, sont en général un élément favorable pour l'autre, elles ne signifient pas nécessairement que ce dernier soit en mesure de les orienter directement à son profit. A l'heure actuelle, l'URSS, qui éprouve déjà les plus grandes difficultés avec les guérillas musulmanes en Afghanistan et qui doit compter avec une menace possible d'agitation nationaliste parmi ses populations musulmanes, n'est pas en mesure de mettre la main sur un pays en ce moment submergé par une vague islamique et d'en conserver le contrôle, et cela d'autant plus qu'il n'existe pas en Iran de force politique apte à prendre en charge un tel basculement (PC faible et officiers de l'armée bien contrôlés parle bloc US)
4) Pendant un certain nombre de mois, la situation en Iran a échappé au contrôle des USA. En partie à cause de l'absence d'une équipe de rechange crédible, cette puissance avait commis l'erreur de soutenir trop longtemps un régime complètement déconsidéré, y compris dans les rangs de la classe dominante. C'est ce retard dans la politique américaine qui a été le principal responsable de l'échec des tentatives de dernière heure visant, en la personne de Bakhtiar, à une transition sans heurts vers un régime plus "démocratique", apte à calmer le mécontentements populaire. Face au processus de désagrégation de l’armée qui s'était instauré début février 79, c'est donc "à chaud" que s'était opérée cette transition et en faveur de la force politique momentanément la plus "populaire" mais à terme la moins appropriée à une direction un tant soit peu lucide et efficace du capital iranien. A l'heure actuelle, nous assistons à une étape de la reprise en main de la situation iranienne par le bloc US, qui, après l'échec d'une solution progressive tentée avec Bazargan, vise à laisser pourrir la situation locale. Semblable à la déclaration de guerre du dictateur vénézuélien Gomez aux USA et aux puissances européennes dans les années 30, la décision iranienne de déclarer, outre la "guerre sainte", la guerre économique aux USA, équivaut à un véritable suicide : l’interruption des échanges commerciaux entre l'Iran et les Etats-Unis, si elle ne peut provoquer que des perturbations mineures pour ces derniers, condamne l'Iran à l'asphyxie économique. La politique américaine consiste donc à laisser le régime actuel s'enferrer dans l'impasse où il s'est mis, le laisser s'isoler face aux différents secteurs de la société, afin de cueillir le fruit quand il sera mûr, en remplaçant l'équipe Khomeiny par une autre formule gouvernementale ([1] [7]) qui devra avoir les caractéristiques suivantes:
- être plus conciliante à l'égard du bloc US,
- être plus apte à contrôler la situation,
- avoir l'appui de Tannée (si ce n'est pas l'armée elle-même), dans la mesure où cette institution, comme dans tout pays du Tiers-Monde, est primordiale dans la vie politique.
Il est probable que nous aurons en Iran, toutes proportions gardées, un processus similaire à celui du Portugal où l'instabilité politique et la prépondérance d'un parti hostile aux USA (le PCP), résultant du caractère tardif et brutal de la transition hors d’une dictature complètement déconsidérée, avaient été éliminées à la suite d'une pression massive du bloc US sur le plan diplomatique et économique.
5) L'épreuve de force entre l'Iran et les USA, loin de marquer un affaiblissement du bloc dominé par cette puissance, a toutes les raisons au contraire de le renforcer. Outre qu'elle va aboutir tôt ou tard à une reprise en main de la situation au Moyen-Orient, elle permet un raffermissement de l'allégeance; des puissances occidentales (Europe, Japon) à l'égard du pays leader. Cette allégeance avait été perturbée ces derniers temps par le" fait que ces puissances étaient (outre les pays arriérés non producteurs) les principales victimes des hausses pétrolières encouragées en sous-main par les USA (cf. Revue Internationale n°19). La crise actuelle met en évidence la dépendance bien plus grande de ces puissances à l'égard du pétrole iranien que celle des USA et leur commande de resserrer les liens autour de leur chef de file pour collaborer à la stabilisation de la situation dans cette région du monde. La relative modération de certaines de ces puissances (notamment la France) dans leur condamnation des agissements de Khomeiny ne doit pas faire illusion : si elles ne se lient pas d'emblée complètement les mains, c'est afin de mieux pouvoir apporter leur concours, notamment sur le plan diplomatique, au processus de reprise en main de la situation au profit du bloc US : comme on a déjà pu le constater au Zaïre, par exemple, une des forces de ce bloc réside dans sa capacité à faire intervenir ses éléments les moins "compromis" là où la puissance de tutelle ne peut pas agir par elle-même.
6) Si un des objectifs des USA dans la crise actuelle est le renforcement de son bloc sur le plan de la cohésion internationale, un autre objectif bien plus important encore réside dans la mise en place d'une psychose de guerre. Jamais les malheurs de 50 citoyens américains n'avaient provoqué une telle sollicitude de la part des mass-médias, de la totalité des hommes politiques ainsi que des églises. Depuis longtemps on n'avait vu se déverser un tel torrent d'hystérie guerrière au point que le gouvernement, qui pourtant orchestre la campagne, fait figure de modéré. Auprès d'une population traditionnellement peu favorable à l'idée d'une intervention extérieure, à qui il avait fallu l'attaque de Pearl Harbour en 1941 pour la mobiliser dans la 2ème guerre mondiale, qui depuis la guerre du Vietnam était échaudée de ce genre d'aventure, les agissements "barbares" de la "République Islamique" sont un thème excellent pour les campagnes bellicistes de la bourgeoisie américaine. Si Khomeiny a trouvé dans le Shah un épouvantai1 efficace pour ressouder l'unité nationale menacée, Carter„qu'il ait voulu délibérément la crise actuelle en laissant entrer le Shah comme il semblerait, ou qu'il l'ait seulement utilisée, a trouvé dans Khomeiny un épouvantail similaire pour renforcer sa propre unité nationale et préparer la population américaine à l'idée d'une intervention extérieure même si elle ne se réalise pas en Iran. La seule différence existant cependant entre les deux manœuvres réside dans le fait que la première est désespérée et va se retourner rapidement contre ses promoteurs alors que la deuxième s'inscrit dans un plan plus lucide du capital américain.
Les USA ne sont pas le seul pays à utiliser la crise présente pour mobiliser l'opinion en vue des préparatifs pour la guerre impérialiste, En Europe occidentale également, avec des thèmes adaptés à la situation locale, tout le battage présent sur le "péril arabe" ou "islamique" (semblable au "péril jaune" d'autrefois)censé être responsable de la crise, s'inscrit dans le même type de préparatifs, dans la création de la même psychose de guerre.
Quant à l'URSS, même si elle ne tente pas d'exploiter la situation à l'extérieur pour les raisons qu'on a vues, elle essaye de faire chez elle corps à la campagne occidentale sur les "droits de l'homme" en dénonçant les menées impérialistes des USA et en se solidarisant des "sentiments anti-américains des masses iraniennes".
7) Même si elle prend dans ce pays, comme dans l'ensemble des pays sous-développés une forme caricaturale, la décomposition interne de l'Iran n'exprime nullement un phénomène strictement local. Au contraire, la virulence des campagnes idéologiques actuelles des grandes puissances indique que partout la bourgeoisie a le dos au mur, que de plus en plus elle se réfugie dans la fuite en avant vers un nouvel affrontement inter-impérialiste et qu'elle ressent le manque de mobilisation des masses autour de ses objectifs bellicistes comme l'entrave majeure vers une telle issue.
Il revient donc une nouvelle fois aux révolutionnaires :
- de dénoncer toutes ces campagnes idéologiques d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs feuilles de vigne (droits de l'homme, anti-impérialisme, menace arabe, etc.) et quelles que soient leurs promoteurs^ de droite ou de gauche, de l'Est ou de l’Ouest ;
- d'insister sur la seule sortie qui puisse se présenter à l'humanité pour lui éviter un nouvel holocauste ou même la destruction : la poursuite de l'offensive prolétarienne et le renversement du capitalisme
CCI 28 novembre 1979
[1] [8] La façon précise dont va s'opérer ce remplacement est encore difficile à prévoir : capitulation de l'actuelle équipe, scission en son sein, coup d'Etat militaire, intervention armée d'un pays arabe ; l'hypothèse la moins probable étant celle d'une intervention militaire directe.
Géographique:
- Etats-Unis [9]
- Moyen Orient [10]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Combat ouvrier et manœuvres syndicales au Venezuela
- 2814 reads
CORRESPONDANCE
L'agitation et la combativité qui se sont manifestées durant la négociation de la dernière convention dans l'industrie textile n'ont pas disparu. A la suite d'une convocation du syndicat des textiles (SUTISS), une assemblée nomme un "comité de conflit" au niveau régional en vue d'organiser une riposte ouvrière. Que ce comité soit dominé par des syndicalistes du parti AD ([1] [12]), n'enlève rien au fait important que même confusément, s'exprime la nécessité d'une organisation de lutte distincte de l'appareil syndical.
C'est quelque chose d'analogue qui s'est produit avec les ingénieurs qui ont exigé l'incorporation à la table des négociations d'un délégué élu en Assemblée Générale. Ce "comité de conflit" lance l'idée d'une grève régionale pour le 17 octobre 1979. Au début, la Fédération syndicale se montre réticente mais finalement cède devant le comité (elle lui prête même ses locaux) et après bien des pourparlers tendant à obtenir l'agrément de la centrale syndicale CTV ([2] [13]), on rend public l'appel à la grève pour le mercredi 17 octobre. La CTV commence alors à parler de l'organisation d'une grève nationale pour le 25. Ce qui allait se produire en Aragua était vu comme un test qui déterminerait le cours ultérieur des événements.
"SUIVEZ L'EXEMPLE QU'ARAGUA A DONNE !" ([3] [14])
Le 17, Maracay ([4] [15]) se réveille paralysée; dans quelques zones périphériques le trafic est interrompu par une multitude d'objets divers déversés sur la chaussée. Les ouvriers arrivent à leurs usines et de là se dirigent vers la place Girardot dans le centre de la ville. Les syndicats avaient diffusé Tordre de grève mais étaient volontairement restés silencieux sur l'heure et le lieu de rassemblement. La direction syndicale était intéressée au succès numérique de la grève mais elle tenait tout autant à conserver le contrôle des masses. Cela explique la diffusion de l'appel à la grève et le maintien du monopole de l'information concernant les actions prévues. Néanmoins, les ouvriers ne voulaient pas perdre l'occasion de manifester leur mécontentement et ont accepté ces conditions dans leur désir de pouvoir s'unir dans la rue avec leurs frères de classe.
A 10 heures du matin, la place est pleine de monde. Dans leur immense majorité, il s'agit d'ouvriers : on note une multitude de pancartes faites précipitamment indiquant la présence de leur usine respective, exigeant des augmentations de salaires ou simplement affirmant une vision de classe (exemple : "Eux ils ont le pouvoir parce qu'ils en ont la volonté"). Commencent alors les éternels discours dont les axes sont : l'augmentation des prix, le besoin d'un ajustement salarial, la mauvaise administration gouvernementale, la lutte contre les Chambres de Commerce et d'Industrie et la préparation de la grève nationale.
Dans la foule, on sent que les ouvriers interprètent aussi bien le rassemblement que la grève comme le début d'un affrontement avec la bourgeoisie et son Etat. Visiblement, la masse ouvrière ne se contente pas d'écouter passivement mais désire s'exprimer comme un corps collectif et cela ne peut se réaliser qu'en défilant dans les rues. La pression dans ce sens est tellement forte que, malgré ce qui a été prévu (uniquement un rassemblement), les dirigeants syndicaux finissent par appeler à défiler dans l'avenue Bolivar jusqu'au Parlement provincial. Auparavant des groupes de jeunes ouvriers s'étaient chargés de parcourir les rues du centre faisant fermer les magasins (excepté les pharmacies) avec une attitude décidée de faire respecter la grève, mais sans aucune tentative de violence individuelle ou d'agression envers des personnes. De même, ils interceptent les autobus et les taxis, font descendre les passagers et laissent ensuite les véhicules s'éloigner sans le moindre inconvénient.
LA MANIFESTATION DEVIENT INCONTROLABLE
La classe ouvrière prend pratiquement possession des rues du centre de la ville, empêche le trafic, ferme les magasins, fait éclater sa colère, impose son pouvoir. A partir de là les événements vont prendre leur propre dynamique. Les 10 à 15000 manifestants (la presse parle de 30000, probablement en raison de la grande peur que la journée lui a causée - infarctus de E.Mendoza ([5] [16]), commencent à lancer des consi gnes improvisées, insistant particulièrement sur celles qui expriment leur sentiment de classe ("l'ouvrier mécontent exige son droit" et "en chaussures ou en espadrilles, la classe ouvrière ça se respecte" entre autres). Impossible de reprendre le ton quémandeur de l'appui explicite à la loi salariale introduite par la CTV. Le seul chiffre avancé est 50% d'augmentation, mais en général les manifestants ne formulent pas de "demandes" précises ; ils expriment leur rage et leur volonté de lutte. Souvent on entend des commentaires qui parlent de la totale inutilité de la fameuse loi, du début de la guerre des "pauvres contre les riches". Aux alentours du Palais du Parlement apparaît brusquement un petit détachement des "forces de Tordre". La tête de la manifestation se jette sur lui et les policiers doivent courir se réfugier dans le dit palace où ils se sentent plus à l'abri. Immédiatement, la foule se concentre en face de l'entrée évidemment fermée. La manifestation n'a pas été préparée et ne se décide pas à tenter d'y pénétrer mais elle sent toute la différence entre le "peuple" dans la rue et ses "représentants" retranchés dans le palais. Comme il était à prévoir, la bureaucratie syndicale consacre tout son effort pour pacifier les manifestants et pour détourner l'attention en appelant à retourner place Girardot pour clore la journée. Après quelques hésitations, le cortège se met à nouveau en marche mais au lieu de se diriger vers la place Girardot, il préfère auparavant faire le tour des quatre côtés du "Palais législatif" Ainsi, la classe ouvrière désigne les lieux que demain elle devra occuper. Montés sur des voitures, des orateurs spontanés se succèdent et les manifestants savourent le fait d'être les maîtres de la rue, en contraste avec les vexations et les impuissances auxquelles ils sont soumis quotidiennement.
Place Girardot les attendent autant de nouveaux discours syndicaux avec pour but de mettre un point final "à cela". Mais une partie de la manifestation, une fois arrivée à la place, poursuit son chemin jusqu'à l'immeuble de l'Inspection du Travail. Il est, bien sûr,fermé. Ils retournent donc à la place. Là, des milliers d'ouvriers déjà fatigués sont assis sur la chaussée et les trottoirs. Ils ne savent pas très bien que faire, mais personne ne semble avoir envie de retourner chez soi et retrouver la monotone et insupportable vie quotidienne. Déjà, les chefs sont partis et les militants syndicalistes plient leurs banderolles. Apparemment, c'est la fin.
MAIS, ÇA CONTINUE ...
A midi, apparaît soudain une petite manifestation d'ouvriers du textile. L'animation reprend de nouveau et cette fois sans direction syndicale on entreprend un parcours démentiel à travers toute la ville. En un premier temps, on décide ensemble de marcher vers la Municipalité où, après avoir monté et rempli les marches des quatre étages, on exige une confrontation avec les Conseillers Municipaux. Ceux-ci n'ont pas l'air d'apprécier l'insistance avec laquelle un ouvrier déjà d'un certain âge frappe à la porte armé de sa canne. Puis l'idée est lancée de se diriger vers les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie où, curieusement, il n'y a personne sauf quelques caisses de bouteilles d'eau qui sont prestement utilisées pour calmer la soif collective. De là les travailleurs prennent la décision d'aller jusqu'à la station terminus des transports. En chemin, ils interrompent un chantier de construction et cherchent le contremaître pour lui donner quelques "conseils". Ils se partagent, avec un sens social et démocratique élevé, les poulets et les accompagnements d'un magasin de volailles qui a eu la malencontreuse idée de rester ouvert.
Il était plus de 2 heures de l'après-midi et la ma nifestation avait parcouru quelque 10 kilomètres. La faim, la chaleur et la fatigue avaient considéra blement réduit le nombre de manifestants. Il était temps de mettre fin à l'ivresse collective et de les faire revenir à la triste réalité. Etant donné que la direction syndicale avait échoué, cette tâche revenait à d'autres organismes. A coups de matraques et autres moyens "persuasifs" ([6] [17]), les forces de l'ordre démontrent pour la nième fois que les rues n'ap partiennent pas encore au peuple mais à la police. A 3 heures de l'après-midi l'ordre régnait à Maracay.
La journée avait été extrêmement riche en expériences. Instinctivement, la classe ouvrière avait identifié quelques points névralgiques du pouvoir : le Parlement, le Conseil Municipal, le Ministère du Travail, les syndicats et le terminus des passagers, ce" dernier comme pivot pour étendre la lutte en dehors de Maracay. Ce fut comme une sorte de mission de reconnaissance du terrain qui servira pour des luttes ultérieures. Durant la nuit, il semble qu'il y ait eu des manifestations dans certains quartiers. Ce fut un jour de fête prolétarienne.
LA C.T.V. : TROUBLE-FETE
Si certains ouvriers avaient pu entretenir l'illusion qu'il s'agissait d'un premier pas dans un cours de luttes apparemment triomphantes grâce à l'appui des appareils syndicaux, la presse du lendemain s'est chargée de leur rappeler leur condition de classe exploitée et manipulée. En effet, d'un côté la CTV, comme par magie, transformait la grève nationale en une mobilisation générale... pour 4 heures de l'après-midi le 25 octobre. Visiblement, la CTV ne voulait pas que se reproduise à l'échelle nationale le débordement par l'initiative des masses. Que les ouvriers travaillent d'abord toute la journée et s'il leur reste encore quelques envies, qu'ils aillent manifester ! La nuit se chargera de calmer les exaltations. Pour les syndicats, il s'agissait maintenant de tenter la formidable manifestation mais sans grève, formule qui leur permettrait de maintenir simultanément l'apparence de luttes et le contrôle social. Par ailleurs, quelques industries d'Aragua profitant du caractère juridiquement illégal de la grève du 17, procédèrent au licenciement massif d'ouvriers (spécialement à La Victoria ([7] [18]) où on a compté quelques 500 cas de licenciements). Avec cela, elles mettent en pratique des projets prévus de "réduction de personnel", de "déplacement des industries", d'"aménagements administratifs". Il s'agit d'affronter au moindre coût la situation financière particulièrement critique des petites et moyennes entreprises. Cette manoeuvre crée une situation particulièrement tendue à La Victoria avec des marches et des protestations ouvrant la perspective de nouvelles luttes dans les semaines à venir, mais maintenant sans le simulacre de l'appui de la CTV. Les ouvriers de La Victoria devront apprendre à se battre par eux-mêmes ou seront obligés d'accepter les conditions de la dictature du capital.
LA COLERE ECLATE MALGRE TOUT
La journée de "mobilisation nationale" du 25 octobre a donné lieu à de nouvelles manifestations de combativité ouvrière malgré son caractère signalé plus haut. Dans l'Etat du Carabobo et en Guyana ([8] [19]) eurent lieu des grèves régionales avec des marches regroupant beaucoup de monde très enthousiaste. A Caracas, la capitale, où il était nécessaire pour le prestige syndical que la manifestation soit nombreuse, la CTV s'est même chargée d'amener par cars des contingents ouvriers qui, pour leur part,ont profité de l'occasion qu'on leur offrait pour la première fois depuis des années pour exprimer leur haine de classe. Le gouvernement conscient, après les événements du 17, du danger de débordement ouvrier, ne pouvait pas permettre que la manifestation envahisse toutes les rues du centre de la capitale comme c'était arrivé à Maracay. Aussi, les "forces de l'ordre" avaient-elles décidé d'affronter la gigantesque masse ouvrière pratiquement dès le début. Il ne s'agit donc pas d'un excès ou d'une erreur, il s'agit simplement d'une fonction de classe accomplie vaillamment par les forces de police. L'affrontement a eu lieu. Les gens ne couraient pas paniques comme d'habitude mais ont opposés une dure résistance durant plusieurs heures ; ils ont détruit des symboles de l'opulence bourgeoise des alentours et il s'en est suivi un climat de violence qui s'est prolongé pendant plusieurs jours dans les quartiers ouvriers et en particulier au "23 de enero" ([9] [20]), avec pour solde plusieurs morts.
Pendant ce temps à Maracay, la masse ouvrière qui avait déjà savouré les événements du 17 n'était pas gagnée à participer à ce qui paraissait être pour tout le monde une pâle répétition. Très peu d'ouvriers se sont dérangés pour aller à ce rassemblement. En contre-partie, la fausse rumeur qu'un étudiant avait été assassiné à Valencia ([10] [21]) (en réalité, il y eut effectivement un mort à Valencia : un ouvrier) avait lancé quelques 2000 étudiants dans la rue. C'est typique des étudiants de se scandaliser pour la mort d'un étudiant tué par la police et rester aveugles aux peu spectaculaires destructions journalières de la classe ouvrière dans les usines : 250 accidents mortels par an et plus d'un million de blessés et malades pour raison professionnelle révèlent à satiété la violence capitaliste. La manifestation était de type estudiantin ; le caractère ouvrier du 17 avait disparu, le tout était noyé dans une mer de consignes universitaires, juvéniles et autres. Malgré cela, on pouvait noter l'absence des organismes estudiantins traditionnels ainsi que la participation de beaucoup d'étudiants"indépendants" qui pourront dans le futur converger avec la révolte ouvrière naissante. Seul un groupe de professeurs -ils étaient en grève- a maintenu un certain caractère de classe.
Il était démontré que la classe ouvrière est disposée à manifester son profond mécontentement dès que l'occasion se présente mais qu'elle n'était pas et n'est pas actuellement en condition de chercher à créer par initiative propre, de façon autonome, cette possibilité.
DE LA RUE AU PARLEMENT
Sans perdre de temps, la CTV en conclut qu'il s'agit d'empêcher à tout prix qu'une telle occasion ne se présente. Dans les faits, nous sommes en train d'assister à une relative pacification momentanée, situation qui pourrait bien être bouleversée à l'occasion des primes de fin d'année, étant donné les difficultés financières de certaines entreprises. On parle de moins en moins de mobilisations et de plus en plus des négociations parlementaires qui devraient faire promulguer la fameuse loi proposée par la CTV; mais cette fois-ci il n'est plus question de créer une capacité de pression au niveau de la rue. Le 29 octobre, le conseil consultatif de la CTV concrétise les résultats des négociations entre sociaux-démocrates et démocrates-chrétiens et décide que la centrale devra désormais être préalablement consultée à l'occasion de tout mouvement de grève décidé par les fédérations locales ou professionnelles. Il s'agit de maintenir le contrôle de toute situation potentiellement dangereuse. Et une fois ce point acquis, les grèves ministérielles sont déclarées illégales. C'est ainsi que la centrale agit avec ses propres fédérations; on peut imaginer ce que sera son attitude face à un mouvement ouvrier agissant de façon autonome par rapport aux syndicats.
Tout cela jette une claire lumière sur la prétendue alternative qui caractériserait les syndicats : être des agences de réclamations ou bien être des instruments de lutte. Dans la réalité, les syndicats sont des agences de réclamations pendant les périodes de calme social et des organes de sabotage des luttes dès que le prolétariat surgit.
LA VIEILLE TAUPE MONTRE SON NEZ ET LES LEADERS CONTEMPLENT LE FIRMAMENT.
La situation actuelle est celle du resurgissement de la classe ouvrière sur la scène nationale. C'est un phénomène analogue à celui qui s'est produit au début des années 60 et pendant les années 69-72. Ce resurgissement a été le produit de la fin de la période de la manne pétrolière et des rêves de grandeur de la bourgeoisie nationale. Aujourd'hui il faut régler l'addition, ce qui en deux mots veut dire rationalisation de la production entraînant la faillite des petites et moyennes entreprises (dont le maintien des profits constitue un des motifs de préoccupation de nos "socialistes".. .Ah que le capitalisme était beau lorsqu'il n'y avait pas de monopoles!), et l'intensification de l'exploitation de la classe ouvrière.
La libération des prix n'est en fait qu'un des instruments de la politique de restructuration de l'appareil productif du pays, restructuration qui ne peut être faite qu'à travers le seul chemin qui reste aux capitalistes : la crise, la récession. Contrairement à ce qu'affirment d'éminents professeurs d'université, il ne s'agit pas d'une politique erronée, mais d'une politique inévitable dans le cadre du système capitaliste. Lutter contre cette politique sans s'attaquer aux fondements mêmes du système capitaliste (comme le prétendent ceux qui demandent la révocation du cabinet économique, soi-disant "mal informé" ou trop "ignorant"), c'est faire preuve d'une myopie sociopolitique qui confine au rejet de la lutte révolutionnaire.
Face aux problèmes qu'impose aux masses le développement capitaliste, ce qu'il faut mettre en avant c'est l'impérative nécessité de dépasser les rapports de production marchands et monétaires par la prise en main de la production et de la distribution par les producteurs librement associés. On cherche à détourner l'attention en l'orientant vers une loi des salaires qui, par la crainte même des syndicats à mobiliser les masses, se trouve réduite à sa plus simple expression. En fait cette loi vise à peine à compenser l'inflation telle qu'elle est mesurée et reconnue par la Banque Centrale du Venezuela depuis la libération des prix. Les plus "radicaux" prétendent l'être en demandant des pourcentages plus élevés, voire même le nec-plus-ultra d'une échelle mobile des salaires (ce qui équivaut, dans le meilleur des cas, à lier définitivement le revenu des ouvriers aux oscillations de l'économie bourgeoise). A ce propos, il est intéressant de signaler que les ouvriers brésiliens viennent de s'opposer à une loi analogue parce que, d'après eux, elle diminue leur capacité de lutte au niveau des usines en vue d'obtenir des augmentations nettement supérieures à celles de l'inflation, comme cela s'est effectivement produit au début de 1'année.
Il ne s'agit pas d'un problème de pourcentages, d’augmentation. Ce dont il s'agit c'est d'impulser toutes les luttes qui tendent à mettre en évidence 1'autonomie des intérêts ouvriers face à la société bourgeoise, toutes les luttes qui tendent à se généraliser, s'unifiant et s'étendant par-dessus les étroitesses professionnelles à tous les secteurs en lutte, toutes celles qui tendent à s'attaquer à l'existence même du travail salarié. Ce ne sont pas tant les motifs particuliers de chaque lutte qui importent, mais les expériences organisationnelles acquises pendant leur déroulement. On peut remarquer par ailleurs qu'il s'est produit une rupture dans le comportement du prolétariat lorsqu'on constate que depuis 1976 le nombre de grèves n'a cessé d'augmenter alors qu'il n'en a pas été de même pour les dépôts légaux de cahiers de revendications. Ce fait semble indiquer que la classe ouvrière se sent de moins en moins concernée par la légalité bourgeoise et tend de plus en plus à agir en fonction directe de ses intérêts.
Face à la libération des prix, les travailleurs devront imposer une libération de fait des salaires; tout comme ils devront mettre en pièces les délais stipulés dans les conventions collectives. Il leur faudra se préparer à une lutte quotidienne et permanente sur lieurs lieux de travail et dans la rue.
LES TRAVAILLEURS DU VENEZUELA NE SONT PAS SEULS
Ce qui se passe actuellement au Venezuela n'est pas unique dans le monde; au contraire, nous ne faisons que nous incorporer dans un phénomène qui a des dimensions universelles. Nulle part le capitalisme n'a réussi, et nulle part il ne réussira à satisfaire de façon stable les besoins de l'humanité. Le chômage en Europe et en Chine, l'inflation aux USA et en Pologne, l'insécurité d'ordre alimentaire ou d'ordre atomique qui sévissent dans le monde, tout comme les luttes sociales qu'elles engendrent, en sont le témoignage.
Le cri de guerre de la 1ère Internationale reste à 1'ordre du jour:
"L’émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière elle même*"
Venezuela, Novembre 1979
[1] [22] Parti Accion Democratica (Social-démocrate) passé à l'opposition aux dernières élections présidentielles portant au pouvoir les Démocrates-chrétiens.
[2] [23] CTV : Confédération des Travailleurs Vénézuéliens, inféodée au Parti AD.
[3] [24] Un des Etats du Venezuela (industrie textile). L'hymne national vénézuélien dit : "Suivez l'exemple que Caracas a donné !".
[4] [25] Capitale de l'Etat d'Aragua.
[5] [26] Grand représentant du patronat vénézuélien.
[6] [27] Au Venezuela, la police a l'habitude de frapper les manifestants avec le plat de longues machettes.
[7] [28] Ville industrielle d'Aragua
[8] [29] Deux zones où existent des concentrations industrielles (métallurgie et sidérurgie)
[9] [30] Quartier à grande concentration ouvrière très combattive.
[10] [31] Capitale de l'Etat de Carabobo.
Géographique:
- Vénézuela [32]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Sur l'intervention des révolutionnaires : réponse à nos censeurs
- 2997 reads
INTRODUCTION
Le renouveau de la combativité ouvrière depuis plus d'un an oblige les organisations révolutionnaires à développer leur intervention. Plus que jamais, il faut savoir comprendre rapidement l'enjeu d'une situation et intervenir en mettant en avant "les buts généraux du mouvement" de façon concrète et compréhensible.
L'intervention concrète dans les luttes est un test, la mesure de la solidité théorico-politique et organisationnelle d'un groupe révolutionnaire. Dans ce sens, des ambigüités, voire des tergiversations sur le plan programmatique se traduisent inévitablement par des interventions fausses, floues, éparpillées, ou même par une paralysie face à la réalité d'un mouvement de montée des luttes. Par exemple, dans les luttes actuelles et à venir, la compréhension du rôle des syndicats est une question-clé pour le développement de l'autonomie du prolétariat sur son terrain de classe. Si un groupe révolutionnaire n'a pas compris que les syndicats ne sont plus des organes de la classe ouvrière et sont devenus à tout jamais et sans aucun chemin de retour des armes de l'État capitaliste en milieu ouvrier, ce groupe ne peut pas contribuer à l'évolution de la conscience de classe.
L'action même de la classe exige des réponses nettes sur l'ensemble des fondements théoriques d'un programme de classe : que ce soit à propos de la crise économique, ou que ce soit à propos des luttes de libération nationale ou des diverses expressions de la décomposition du monde bourgeois en général. C'est pour cette raison que la discussion et la réflexion dans les groupes révolutionnaires aujourd'hui et entre les groupes sur le terrain international se donne comme but de clarifier, de critiquer, de compléter et d'actualiser l'héritage des positions politiques du marxisme et surtout de la dernière grande organisation ouvrière internationale, l'Internationale Communiste.
Mais l'intervention concrète au cours des affrontements de classe ne mesure pas seulement les capacités "théoriques", "programmatiques", d'une organisation, elle est aussi une mesure des capacités organisationnelles d'un groupe politique prolétarien. Pendant les dix années qui nous séparent de la vague de luttes de 1968, le milieu révolutionnaire a travaillé longuement et péniblement pour prendre conscience de la nécessité d'un travail organisé internationalement ; pour entretenir et développer une presse révolutionnaire, pour créer des organisations dignes de ce nom. Dans la période actuelle de resurgissement des luttes, un groupe qui n'est pas capable de se mobiliser, de marquer sa présence politique, d'intervenir énergiquement quand les événements se précipitent est voué à l'échec, à l'impuissance. Aussi justes puissent être ses positions politiques elles se trouvent réduites à un pur verbalisme, à des phrases creuses. Pour une organisation prolétarienne, l'efficacité de son intervention dépend des principes programmatiques ainsi que de la capacité de se donner un cadre organisationnel conforme à ces principes. Mais si ce sont là des conditions nécessaires, ce ne sont pas pour autant des conditions suffisantes. De même que la capacité de créer une organisation politique appropriée ne découle pas automatiquement d'une compréhension théorique des principes communistes, mais nécessite en plus une prise de conscience spécifique de la question d'organisation des révolutionnaires (appréhender et savoir adapter les enseignements du passé aux spécificités de la période actuelle), de la même façon, l'intervention efficace dans les luttes actuelles n'est pas le résultat automatique d'une compréhension théorique ou organisationnelle. La réflexion et l'action forment un tout cohérent, la praxis, mais chaque aspect de la totalité apporte sa contribution à l'ensemble et exige des capacités spécifiques.
Sur le plan théorique, il faut savoir analyser les rapports de forces entre les classes mais sur un laps de temps assez long, à l'échelle des phases historiques. Les positions de classe, le programme communiste, évoluent et s'enrichissent lentement au fur et à mesure de l'expérience historique, fournissant à ceux qui se penchent sur ces problèmes le temps de les assimiler. De plus, l'étude théorique permet, sinon de façon intégrale du moins de façon adéquate, de comprendre le matérialisme historique, le fonctionnement du système capitaliste et ses lois fondamentales.
De même, en ce qui concerne la question de la pratique organisationnelle, si une connaissance théorique ne remplace pas une continuité organique brisée par les convulsions du 20ème siècle, un effort de volonté et l'expérience limitée mais réelle de notre génération peuvent apporter des éclaircissements. Il en est tout autrement en ce qui concerne l'intervention ponctuelle dans le feu des événements. Ici, il s'agit d'analyser une conjoncture non pas sur une échelle de 20 ans, ni même 5, mais de pouvoir saisir l'enjeu à court terme, quelques mois, des semaines, même parfois des jours. Lors d'une épreuve de force entre les classes, on assiste à des fluctuations importantes et rapides face auxquelles il faut savoir s'orienter, guidé par les principes et les analyses sans se noyer. Il faut être dans le flot du mouvement, sachant comment concrétiser des "buts généraux" pour répondre aux préoccupations réelles d'une lutte, pour pouvoir appuyer et stimuler les tendances positives qui se font jour. Ici une connaissance théorique ne peut plus remplacer l'expérience. Même des expériences limitées auxquelles la classe ouvrière et les révolutionnaires ont pu participer depuis 1968 ne sont pas suffisantes pour acquérir un jugement sur.
Le CCI, pas plus que la classe ouvrière ne "découvre" l'intervention tout à coup aujourd'hui. Mais nous voulons contribuer à une prise de conscience de l'envergure que peuvent prendre les luttes dans les années à venir qui n'auront pas de commune mesure avec le passé immédiat. Les explosions actuelles et encore plus à venir mettront les révolutionnaires devant de grandes responsabilités et l'ensemble du milieu ouvrier devrait profiter des expériences des uns et des autres pour mieux corriger nos faiblesses, pour mieux se préparer. C'est pour cela que nous revenons ici sur les luttes en France de l'hiver dernier et l'intervention dg CCI depuis l'attaque du commissariat de police de Longwy en février 1979 par les ouvriers de la sidérurgie jusqu'à la Marche sur Paris du 23 mars 1979. Depuis lors, il y a eu d'autres expériences importantes d'intervention notamment dans la grève des dockers de Rotterdam en automne 1979 (voir Internationalisme, journal de la section du CCI en Belgique). Mais nous consacrons cet article aux événements autour du 23 mars parce que nous avons reçu un certain nombre de critiques de la part de groupes politiques; des critiques parfois "d'en haut" (généralement par ceux qui ne sont pas intervenus du tout) par des groupes qui apparemment veulent nous faire la leçon.
Le CCI n'a jamais prétendu avoir la science infuse ni le programme achevé. Nous commettons des erreurs inévitablement et nous nous efforçons de les reconnaître pour mieux les corriger. En même temps, nous voulons répondre à "nos censeurs", espérant ainsi clarifier une expérience pour tous et non pas encourager un tournoi stérile entre les groupes politiques
SIGNIFICATION DE LA "MARCHE SUR PARIS"
Si on prend la manifestation du 23 mars 1979 à part, comme un événement isolé, on ne comprend pas pourquoi cela devait susciter tant de discussions et de polémiques. Une manifestation à Paris, conduite par la CGT n'est pas chose nouvelle. L'énorme foule défilant durant des heures n'a rien en soi de quoi exciter l'imagination. Même la mobilisation exceptionnelle des forces de police et l'affrontement violent de milliers de manifestants aux forces de l'ordre n'est absolument pas chose nouvelle. On a vu cela autrefois. Mais la vision change radicalement et prend une tout autre signification dès qu'on se dégage d'une optique événementielle et qu'on situe le 23 mars dans un contexte plus général. Ce contexte indique un changement profond intervenu dans l'évolution de la lutte du prolétariat. Ce n'est pas le 23 mars qui ouvre le changement, mais c'est le changement intervenu qui explique le 23 mars qui n'est somme toute qu'une de ses manifestations.
En quoi consiste cette nouvelle situation ? La réponse est : l'annonce d'une nouvelle vague de luttes dures et violentes de la classe ouvrière contre l'aggravation de la crise et les mesures draconiennes d'austérité que le capital impose au prolétariat: licenciements, chômage, inflation, baisse du niveau de vie, etc.
Durant quatre ou cinq années, de 1973 à 1978, le capitalisme est parvenu en Europe à enrayer le mécontentement des ouvriers en faisant miroiter la perspective du "changement". "La gauche au pouvoir" était la principale arme pour mystifier la classe ouvrière et permit de canaliser le mécontentement dans l'impasse électoraliste. La gauche s'employait de toutes ses forces et durant des années, à minimiser la portée historique et mondiale de la crise, ramenant et réduisant celle-ci à une simple "mauvaise gestion" des partis de droite. La crise cessant d'être une crise générale du capitalisme devenait une crise propre à chaque pays et donc trouvait sa source dans les gouvernements de droite. Il en découlait que la solution devait également se trouver dans le cadre national, dans le remplacement de la droite par la gauche au gouvernement. Ce thème mystificateur a été grandement efficace dans la démobilisation de la classe ouvrière dans tous les pays d'Europe occidentale. Durant des années, l'espoir illusoire d'une amélioration possible de leurs conditions de vie par la venue de la gauche au pouvoir, a endormi la combativité de la première vague des luttes ouvrières. C'est ainsi que la gauche a pu mettre en pratique le "Contrat Social" en Grande-Bretagne, le "Compromis Historique" en Italie, le "Pacte de la Moncloa" en Espagne et le "Programme Commun" en France, etc.
Mais comme l'écrivait Marx, "il ne s'agit pas de savoir ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier se représente momentanément comme but. Il s'agit de ce que le prolétariat est et de ce qu'il sera historiquement contraint de faire conformément à son être". Le poids de l'idéologie et des mystifications bourgeoises peuvent momentanément avoir raison du mécontentement ouvrier mais elles ne peuvent pas arrêter indéfiniment le cours de la lutte de classe. Dans les conditions historiques actuelles, les illusions de la "gauche au pouvoir" ne pouvaient tenir trop longtemps devant l'aggravation de la crise, et cela aussi tien dans les pays où la gauche était déjà arrivée au gouvernement que dans ceux où elle était encore sur ses marches. Le barrage de la "gauche au pouvoir" s'usait et cédait lentement devant, l'accumulation d'un mécontentement chaque jour plus perceptible et moins convenable.
Ce sont les syndicats, les plus directement présents au sein de la classe, sur les lieux de travail, dans les usines qui enregistrent le mieux et les premiers ce changement qui est en train de se produire dans la classe et les dangers d'une explosion de la lutte. Ils sont conscients que, de la place qu'ils occupent, c'est-à-dire le soutien de la "gauche au pouvoir", ils ne sauraient contrôler de telles luttes. Ce sont eux qui font pression sur les partis politiques de gauche, dont ils sont le prolongement, et font valoir la nécessité du passage urgent dans l'opposition -la place la plus adéquate- pour faire plus sûrement dérailler le train de la nouvelle reprise des luttes ouvrières.
Ne pouvant plus comme auparavant, s'opposer et empêcher l'éclatement des luttes et des grèves, les partis de gauche et avant tout, les syndicats, doivent faire semblant de les soutenir et radicaliser leur langage afin de mieux les torpiller au cours de leur déroulement.
Les groupes révolutionnaires ont tardé et tardent encore à saisir pleinement cette nouvelle situation, caractérisée par la gauche dans l'opposition et tout ce qu'elle implique. En se contenant dans des généralités, sans tenir compte des changements intervenus dans la réalité concrète, leurs interventions restent forcément abstraites et leurs tirs marquent inévitablement les buts.
Le 23 mars n'est pas un événement isolé mais fait partie du cours général de reprise des luttes. Il est précédé par une série de grèves, un peu partout en France, et plus particulièrement à Paris : des grèves dures avec une haute combativité. Il est surtout le produit direct des luttes des ouvriers de la sidérurgie de Longwy et de Denain accompagnées d'affrontements violents contre les forces armées de l'État. Ce sont les ouvriers de Longwy et de Denain, en lutte contre la menace des licenciements massifs qui ont émis l'idée de la marche sur Paris. Les révolutionnaires devaient-ils soutenir cette initiative et participer à cette action ? Toute hésitation à ce sujet est absolument inadmissible. Le fait que la CGT, après avoir, en accord avec les autres centrales syndicales, tout fait pour faire échouer ce projet et le retarder, se soit décidé à y participer en prenant sur elle la tâche "d'organiser" cette marche ne pouvait nullement justifier l'abstention de la part des révolutionnaires. Il serait de la plus grande stupidité de leur part d'attendre des luttes "pures" et que la classe ouvrière soit déjà parvenue à se débarrasser complètement de la présence des syndicats pour daigner y participer. Si telle devait être la condition, les révolutionnaires ne participeraient jamais aux luttes menées par la classe ouvrière, jusqu'à et y compris la révolution. En même temps, on aura prouvé la parfaite inutilité de l'existence même des groupes révolutionnaires.
En prenant l'initiative FORMELLE de la marche du 23 mars, la CGT a démontré, non pas l'inanité de la manifestation mais sa capacité extrême de s'adapter à la situation, une capacité énorme de manœuvre et de récupération afin de mieux pouvoir saboter et dévoyer les actions du prolétariat. Cette capacité des syndicats de saboter les luttes ouvrières de l'intérieur même des luttes est le plus grand danger qu'aura à affronter dans les prochains mois et pour longtemps la classe ouvrière, et c'est aussi le combat le plus difficile que les révolutionnaires auront à livrer contre ces pires agents de la bourgeoisie. C'est de l'intérieur des luttes, et non en restant sur les bords que les révolutionnaires devront apprendre à combattre ces organes. Et c'est non pas par des généralités -abstraites, mais dans la pratique, par des exemples concrets au cours de la conduite de la lutte, compréhensibles et convaincants pour chaque ouvrier, que les révolutionnaires parviendront à démasquer les syndicats et dénoncer leur rôle anti-ouvrier.
NOS CENSEURS
Toute autre est la démarche de nos éminents censeurs. Ne parlons pas des modernistes, qui sont encore et toujours à se demander : qui est le prolétariat ? Ceux-là sont toujours à chercher et à découvrir les forces subversives capables de transformer la société. Perte de temps que d'essayer de les convaincre. Nous les retrouverons, peut-être, après la révolution, si toutefois ils survivent jusqu'alors ! Il en est d'autres, les intellectuels, trop occupés à écrire leurs grandes œuvres. Ils n'ont pas de temps à perdre dans des bagatelles comme le 23 mars. Il y aussi les "vieux combattants" par nature sceptiques et qui regardent les luttes actuelles avec des haussements d'épaules. Lassés et désabusés, par les luttes passées auxquelles ils avaient participé autrefois s’ils n'accordent plus grande foi aux luttes présentes» Ils préfèrent écrire leurs mémoires et il serait inhumain de les déranger de leur triste retraite. Il y a aussi les spectateurs de bonne volonté, qui, s'ils souffrent parfois du mal d'écriture, sont toutefois des "anti-militants" forcenés. Ils ne demandent pas mieux que de se laisser convaincre mais pour cela ils ... attendent les évènements. Ils attendent... et ne comprennent pas que d'autres s'y engagent.
Mais il y a aussi des groupes politiques pour qui l'intervention militante est la raison de leur existence et qui trouvent cependant à critiquer notre intervention du 23 mars.
Le FOR, par exemple. Activiste et volontariste au-delà du commun, ce groupe se refuse à participer à la manifestation, probablement pour la raison que celle-ci avait pour axe la lutte contre les licenciements. Le FOR qui ne reconnaît qu'une "crise de civilisation" nie qu'il y ait crise économique du système capitaliste. Licenciements, chômage, austérité, ne sont pour lui que des apparences ou des phénomènes secondaires qui ne peuvent servir de terrain de mobilisation pour des luttes ouvrières. Pourtant le FOR s'est bien souvent livré à l'élaboration des revendications économiques comme la hausse massive des salaires, le refus des heures supplémentaires, et notamment en 68, émettait la revendication de la semaine de 35 h. A croire que c'était uniquement par un goût prononcé de la surenchère et du radicalisme verbal. La présence de la CGT et sa direction de la manifestation complétaient la raison de la dénonciation de celle-ci.
Un autre exemple, le PIC. Ce groupe qui avait fait de l'intervention à toute vapeur son cheval de bataille s'est distingué par son absence précisément dans ces mois tourmentés de luttes du début de 1979. Ayant pris en 74 -dans le moment de stagnation et de recul des luttes- un départ à plein gaz (prétendant "intervenir" dans chaque petite grève localisée, se proposant de multiplier des feuilles de boites, etc....) le PIC à la façon d'un mauvais sportif, arrive épuisé et essoufflé au moment où il faut sauter. Évidemment, il ne vient pas à l'idée du PIC de se demander si la raison des échecs répétés de ses "campagnes" artificielles (rassemblement pour le soutien des ouvriers portugais, conférence des groupes pour l'autonomie ouvrière, bloc anti-électoral, rencontres internationales, etc.) ne résiderait pas dans son incompréhension de ce que peut et doit être une intervention, dans son ignorance voulue du rapport existant nécessairement entre l'intervention communiste et l'état de la lutte de classe. L'intervention pour le PIC est un pur acte de volonté, et de même qu'il ne comprend pas la nécessité de nager sur les côtés quand on veut remonter la rivière, il ne comprend pas davantage pourquoi on doit nager au milieu quand on veut aller dans le sens de la rivière. Tout ce raisonnement reste de l'hébreu pour le PIC qui préfère inventer d'autres explications pour justifier son absence et pour -comme il se doit- la théoriser. Ainsi, les interventions bidon, l'illusion de l'intervention se transforment aujourd'hui en non intervention effective.
C'est juste au moment où se manifeste une nouvelle irruption de la classe et sa volonté combative de faire face aux attaques du capitalisme et de sa politique d'austérité et de licenciements que le PIC "découvre" que ces luttes, comme les luttes pour les revendications économiques en général relèvent du réformisme. A ces luttes de résistance, il oppose "l'abolition du salariat" pour laquelle il se propose de lancer une nouvelle campagne.
Nous savons par expérience ce qu'il y a derrière ces "campagnes" épisodiques du PIC : des bulles de savon qui apparaissent et disparaissent aussitôt dans le vide. Ce qui est plus intéressant, c'est la redécouverte que le PIC fait du langage des modernistes et la récupération pour lui de cette "phraséologie révolutionnaire" typique de feu Union Ouvrière dont il entend peut-être occuper la place vide. Mais revenons à la définition du réformisme que le PIC identifie à tort avec la résistance ouvrière aux attaques immédiates de la bourgeoisie[1]. Le réformisme dans le mouvement ouvrier d'avant 1914 ne consistait nullement dans le fait de la défense des intérêts immédiats de la classe ouvrière mais dans la séparation opérée par lui entre cette défense des intérêts immédiats et le but final historique du prolétariat : le communisme, ne peut être atteint que par la révolution[2].
Les idéologues de la petite bourgeoisie radicale, les restes du mouvement étudiant, les continuateurs anarchisants de l'école proudhonienne opposent au réformisme l'haleine brûlante de leur phraséologie pseudo-révolutionnaire, mais partagent avec lui la séparation artificielle entre luttes immédiates et but final, entre revendications économiques et luttes politiques. Le "mouvement est tout, le but n'est rien" (Bernstein) du réformisme et le "but est tout le mouvement n'est rien" des phraséologues modernistes ne s'opposent qu'en apparence mais sont en réalité l'endroit et l'envers d'une même démarche.
Les marxistes révolutionnaires ont de tout temps combattu les uns et les autres. Ils se sont toujours élevés énergiquement contre toute tentative d'opérer ce genre de séparation. Ils ont de tout temps montré l'unité indivisible du prolétariat, à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire, et l'unité indivisible de sa lutte, à la fois pour la défense de ses intérêts immédiats et pour son but historique. De même que dans la période ascendante du capitalisme -avec la possibilité d'obtenir des améliorations durables l'abandon du but historique révolutionnaire équivalait à une trahison du prolétariat, de même dans la période de décadence l'impossibilité des améliorations ne saurait servir de justification pour la renonciation à la lutte de la résistance ouvrière et l'abandon de ses luttes pour la défense de ses intérêts immédiats. Une telle démarche quel que soit le radicalisme de la phraséologie qui la recouvre, signifie purement et simplement la désertion et l'abandon de la classe ouvrière.
C'est un abus éhonté que d'utiliser "l'abolition du salariat" à l'encontre de la lutte violente que livre la classe ouvrière contre les licenciements dont elle est victime aujourd'hui. Citer à tort et à travers en la séparant de son contexte cette formule célèbre extraite du fameux exposé fait par Marx dans le "Conseil général" de TAIT en 1865 contre l'oweniste J.Weston, et connue sous le nom de "Salaire, prix et profit", revient à commettre une grossière déformation de la lettre et de l'esprit de son auteur. Cette déformation qui a pour racine un "radicalisme faux et superficiel" (Marx. "Salaire, prix et profit". Ed. Sociales, p. 117) repose entièrement sur la séparation et l'opposition faites entre la défense des conditions de vie de la classe ouvrière et l'abolition du salariat. Dans cet exposé remarquable, Marx s'acharne à démontrer la possibilité et la nécessité pour la classe ouvrière de mener une lutte quotidienne pour la défense de ses intérêts économiques, non seulement parce que tel est son intérêt immédiat mais surtout parce que cette lutte est une des conditions majeures de sa lutte historique contre le capital. Il énonce cet avertissement : «S'il (le prolétariat) se contentait d'admettre la volonté, l'ukase du capitaliste comme une loi économique constante, il partagerait toute la misère de l'esclave sans jouir de sa situation assurée" (idem. p. 135). Et plus loin, après avoir démontré que la "tendance générale de la production capitaliste n'est pas d'élever les salaires moyens, mais de les abaisser", Marx tire cette première conclusion :
- " Mais telle étant la tendance des choses dans ce régime, est-ce à dire que la classe ouvrière doive renoncer à sa résistance contre les empiétements du capital et abandonner ses efforts pour arracher dans les occasions qui se présentent tout ce qui peut apporter quelques améliorations à sa situation ? Si elle le faisait, elle se ravalerait à n'être plus qu'une masse informe écrasée, d'êtres faméliques auxquels on ne pourrait plus du tout venir en aide"»
Et revenant sur le même point, il poursuit plus loin :
- " Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande ouverture"'. (idem. p.141)
Il n'est jamais venu à Marx l'idée saugrenue d'opposer le mot d'ordre de l'abolition du salariat à la lutte immédiate, considérée et rejetée comme réformiste, comme veulent le faire croire tous les fanfarons qui se gargarisent avec la phraséologie 'révolutionnaire". Non, c'est textuellement contre 'illusion et le mensonge d'une harmonie possible entre le prolétariat et le capital, basée sur une fausse notion abstraite de justice et d'équité qu'il oppose son mot d'ordre :
- " Au lieu du mot d'ordre conservateur "un salaire équitable pour une journée de travail équitable ils (les ouvriers) devraient inscrire sur leur drapeau le mot d''ordre révolutionnaire "abolition du salariat".
Devons-nous rappeler encore la lutte de Rosa Luxemburg contre la séparation entre programme minimum et programme maximum, revendiquant dans son discours au "congrès de la Fondation du Parti Communiste" fin 1918, l'unité du programme, de la lutte économique et immédiate et de la lutte politique du but final, comme deux aspects d'une seule lutte historique du prolétariat. C'est aussi dans le même sens que Lénine, tant abhorré par le PIC, pouvait affirmer que "derrière chaque grève se profile le spectre de la révolution".
Pour le PIC, au contraire, la lutte contre les licenciements équivaut à revendiquer... le salariat, tout comme pour Proudhon l'association des ouvriers et les grèves signifiaient la reconnaissance du capital. Voilà comment nos sévères censeurs ont compris et interprètent et déforment la pensée marxiste !
Le PCI bordiguiste, quant à lui, n'est pas en reste quand il s'agit de minimiser l'importance de la manifestation du 23 mars ou même d'en faire tout autre chose que ce qu'elle représentait réellement. Alors que dans "Le Prolétaire" nr288, on couvre la plus grande partie de la première page par un article sur le 1er mai bien que cette journée ne soit plus depuis longtemps qu'une célébration de la "fête du travail", qu'une sinistre mascarade orchestrée par ces pires ennemis de la classe ouvrière que sont les partis de gauche et les syndicats , on ne consacre, avant et après le 23 mars, que quelques commentaires furtifs, tendant à faire de cette manifestation exactement la même chose que n'importe quelle "journée d'action". Ainsi, avant le 23 mars, on peut lire dans "Le Prolétaire " nc285 (p.2) : "Dès lors que les forces ont été contenues, il n'y a plus qu’à donner le change par une "vaste action" de type journée nationale qui en donnant l'illusion de la solidarité, détruit son tranchant de classe et ne lui laisse d'autre issue qu'une intervention sur le terrain parlementaire ..."
Après le 23 mars, le PCI revient sur cette journée pour n'y voir autre chose que : "Un gaspillage prévisible d’énergies ouvrières, une entreprise de division et de démoralisation, une journée de bourrage de crâne à coups de beuglements chauvins, de pacifisme social et de crétinisme électoral." (Le Prolétaire n°287 : "Quelques enseignements de la marche sur Paris").
Ainsi, enfermé dans ses schémas du passé, le PCI est passé en bonne partie à côté de la réalité des affrontements de classe de l'hiver dernier. Ceci ne l'a pas empêché de dénoncer (Le Prolétaire n°285) "les nouvelles formes plus "romantiques" d'opportunisme qui ne manqueront pas de fleurir en réaction au sabotage réformiste et centriste, à savoir les formes de syndicalisme, de conseillisme, d'autonomisme, de terrorisme, etc." Sans faire de persécution, nous pouvons nous sentir visés par cette référence aux "conseillistes" quand on sait que le PCI qualifie toujours ainsi notre organisation et que ses militants ne se sont pas privés lors de diverses réunions publiques d'attaquer notre "opportunisme" et notre "suivisme" par rapport aux luttes du début 79 en France. À croire qu'il ne se regarde jamais dans un miroir! Ne sait-il donc pas qu'on ne doit jamais parier de corde dans la maison d'un pendu !
Nous le reprocher, c'est le comble de la part d'un "Parti" (sic) qui défend toujours la "nature prolétarienne des syndicats, parce qu'ils rassemblent des ouvriers", argument aussi spécieux que la défense trotskyste de la nature "toujours prolétarienne" de l'État russe. Il n'y a pas si longtemps que le PCI faisait encore valoir les titres de noblesse de la CGT, dues à ses origines prolétariennes et qui la distingueraient des autres confédérations syndicales, aux origines plus douteuses. Et que penser du cahier de revendications immédiates élaboré par le PCI où, entre autres, on réclame pour les chômeurs le droit... de rester membres des syndicats ? On se souviendra aussi de la réclamation équitable, du droit de vote... pour les ouvriers immigrés. On n'a pas oublié le zèle particulier avec lequel les membres du PCI, dans le service d’ordre de la manifestation des Foyers Sonacotra interdisaient, sous prétexte d'apolitisme, la vente des journaux révolutionnaires. Et comment doit-on apprécier ce soutien apporté par le PCI au Comité de Coordination des Foyers Sonacotra, en se chargeant de la diffusion (lors de la réunion publique de la "Gauche Internationaliste") d'un tract appelant à un meeting à Saint-Denis, contresigné par des sections syndicales et l'union locale CFDT, et en plus portant cette précision : "Meeting soutenu par "Parti Socialiste Saint-Denis"? Le PCI se reconnaîtrait-il donc en lisant dans ce tract : "Aujourd'hui, tous les démocrates de ce pays doivent prendre position."
Ces terribles pourfendeurs de l'opportunisme qui sont encore à préconiser la tactique, oh combien "révolutionnaire" (!) du Front Unique syndical, tactique quotidiennement appliquée par la CGT et la CFDT pour mieux encadrer et immobiliser les ouvriers en lutte, sont vraiment mal placés pour donner des leçons à qui que ce soit. En identifiant syndicats EN GENERAL et réformisme, ils entretiennent la plus grande confusion parmi les ouvriers. En effet, les révolutionnaires pouvaient et devaient participer au mouvement syndical dans la période ascendante du capitalisme, malgré le fait que l'orientation et la majorité était réformiste. Il n'en n'est pas de même aujourd'hui, dans la période de décadence quand les syndicats devaient nécessairement devenir et sont effectivement devenus des organes de l'État capitaliste dans tous les pays. Il n'y a aucune place pour la défense de classe et donc pour les révolutionnaires dans de telles organisations.
En ne tenant pas compte de cette différence fondamentale entre les syndicats d'aujourd'hui et le réformisme, en les identifiant, et en qualifiant ces syndicats de réformistes le PCI rend le plus grand service à la bourgeoisie, en l'aidant à faire croire aux ouvriers que c'est leur organisation. D'autre part, il lui fait gratuitement un cadeau -sa caution révolutionnaire- très appréciable, un cache sexe, avec lequel les syndicats cachent leur nudité, leur nature et leur fonction anti-ouvrière. Quand le PCI aura compris cette différence, il saura alors peut-être, mieux juger ce qu'est une intervention révolutionnaire et ce qu'est opportunisme et suivisme.
LA CWO ET NOTRE INTERVENTION
Pour terminer d'une façon plus détaillée, examinons le n°15 de "Revolutionary Perspectives" dans lequel la Communist Workers Organisation de Grande-Bretagne se livre à une dissection professorale de ce qu’il fallait faire, de ce qui aurait dû être fait, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on aurait pu faire le 23 mars dernier, le tout avec un minimum d'informations et un maximum de remarques outrancières à l'égard du CCI... pour les besoins de la cause polémique:
- " Étant donné la vision de ce groupe (le CCI), dominé par le spontanéisme et l'économisme, son intervention n'était qu'une série d'efforts incohérents et confusionnistes. Bien que le CCI soit intervenu très tôt dans les villes de la sidérurgie en dénonçant les syndicats et en appelant les ouvriers à s'organiser et à étendre la lutte3 il a rejeté pour lui tout rôle d'avant-garde fidèle à ses tendances conseillistes. Le CCI s'est refusé de canaliser l'aspiration des ouvriers en faveur d'une marche sur Paris vers un aboutissement pratique, préférant dire aux ouvriers de s'organiser "eux-mêmes". À certaines occasions, le CCI a pu surmonter cette hésitation comme par exemple à Dunkerque où les militants du CCI ont aidé les ouvriers à transformer une réunion syndicale en assemblée de masse. Mais ceci a été fait empiriquement sans dépasser réellement ses conceptions spontanéistes et conseillistes. Le CCI dans son "tournant pratique" va finir dans l'opportunisme et non pas dans une pratique cohérente d'intervention puisqu'il lui manque toute compréhension de la conscience et du rôle de l'avant-garde communiste... ".
Le CWO, par contre, qui comprend parfaitement les chemins de la conscience et du parti dirigeant a tout compris du 23 mars : "Par rapport au 23 mars il est clair que seule une action d'arrière-garde était alors possible"'. Voilà une clarté magnifique qui vient, 6 mois après les événements nous dire que ce n'était pas la peine de se casser la tête !
Quelle analyse approfondie de la CWO lui a-t-elle permis d'avoir cette clarté lumineuse ? Que dit la CWO sur la situation politique et sociale en France ? Dans le n°10 de Revolutionary Perspectives, au moment des élections en France, nous avions lu que la CWO constatait (avec le monde entier) que "l'initiative reste du côté de la classe dominante" et qu'il y a eu une relative paix sociale en France depuis 5 ans. Dans le n°15, en octobre 79, la CWO récite ce passage en ajoutant : "Depuis lors, nous sommes heureux de vous informer que la situation a changé". Merci pour la nouvelle! Constater une réalité quand elle crève les yeux n'est guère une base pour l'intervention. L'intervention ne se prépare pas en s'agitant après coup pour se donner de l'importance mais en affinant à temps ses analyses politiques. Ce n'est pas chose facile, surtout en comité restreint comme pour la CWO mais également pour toute organisation révolutionnaire. Cependant, malgré la difficulté de saisir toutes les nuances d'une réalité mouvante, dès avant les élections de mars 1978, le CCI (dans la RINT n°13) a attiré l'attention sur le fait que les conditions du reflux commençaient à s'épuiser et que des soubresauts de la combativité ouvrière longtemps contenue se préparaient (ce qui allait se révéler juste à travers les grèves du printemps 1978 en Allemagne, aux USA, en Italie et en France). De cette perspective tracée par le CCI qui nous a permis de rester vigilants et de reconnaître l'importance des premiers signes de lutte et d'y être présents, de cette analyse qui ensuite nous a permis de mettre en garde la classe ouvrière contre le danger de la gauche dans l'opposition, la CWO ne parle pas et pour cause : petite polémique oblige. Se contenter de constater une situation, c'est quand même mieux que l'attitude d'autres groupes révolutionnaires qui refusent de reconnaître la montée des luttes mais ce n'est pas suffisant pour s'orienter rapidement face à des surgissements brusques.
Si la CWO ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas su armer l'organisation pour affronter la lutte de classe, il nous reproche par contre de ne pas avoir su "être l'avant-garde" d'un mouvement "voué à être une action d'arrière-garde". On dirait, avec cette notion "d'avant-garde de l'arrière-garde" que la CWO donne l'impression d'avoir le cul par-dessus tête, ou, tout au moins d'être amateur de contorsions.
Mais sur quelle analyse géniale se base la CWO pour pouvoir dire du haut de sa chaire que le 23 mars était d'avance voué à l'échec ? Quelle était réellement la situation ?
La combativité ouvrière a explosé à Longwy avec la mobilisation générale des ouvriers sidérurgistes contre les licenciements, l'attaque du commissariat de police, la destruction des dossiers au siège patronal, une situation de lutte ouverte échappant au contrôle des syndicats et dénoncée par ces derniers. L'agitation s'étend à Denain et à toute la sidérurgie. De plus, à Paris, plusieurs grèves éclatent contre les licenciements, contre l'austérité et les conditions de travail : à la Télévision française (SFP), dans les banques, les assurances, aux PTT. Dans cette situation pleine de potentialités dans le contexte de la crise, que faire ? Se contenter de parler dans le vague de la nécessité de généraliser la grève, de sortir de la région et de la catégorie ? Les ouvriers, eux, ont pensé à concrétiser cette idée de l'extension de la lutte et Ils ont commencé à parler d'une marche sur Paris, Paris où à travers toute l'histoire du mouvement ouvrier en France, le détonateur social a toujours été le plus efficace. Comment ne pas soutenir ce besoin exprimé et revendiqué par les ouvriers des zones en lutte de se centrer à Paris ? Pourquoi pendant plus d'un mois, les syndicats ont-ils fait face à ce projet ouvrier en repoussant de jour en jour sa réalisation ? N'est-ce pas qu'ils espéraient l'annuler complètement ou du moins de le désamorcer ?
Mais avant même d'avoir fixé la date de fin mars (suffisamment tard pour permettre un matraquage des ouvriers) les syndicats faisaient déjà inlassablement leur travail de sape. Ils utilisaient la tactique de la division syndicale pour rompre toute tendance à l'unité parmi les ouvriers : la CGT (syndicat PC) prenait sur elle "l'organisation" de la marche pour mieux la saboter de l'intérieur alors que la CFDT criait bien haut qu'elle refusait les "journées nationales étouffoirs". Au début, personne ne pouvait se prononcer avec certitude sur l'ampleur que pourrait prendre la manifestation du 23 mars. Toute la question repose dans les potentialités des luttes qui se déroulaient à ce moment-là. Dix jours avant la manifestation, il était encore possible que cette marche devienne le catalyseur concret de la volonté d'élargir les luttes et faire l'unité entre les sidérurgistes et les ouvriers en grève à Paris, de faire de cette marche un débordement syndical. Mais si les révolutionnaires ont senti cette potentialité, (c'est à dire ceux qui ne croient pas que tout est voué à l'échec d'avance), la bourgeoisie et son armée syndicale l'ont senti aussi. Les syndicats se sont mis à la besogne et quelques jours avant le 23 mars, ils ont précipité la rentrée de tous les grévistes de la région de Paris. Une à une les luttes se sont éteintes sur une pression syndicale hors du commun. De toute façon, il est clair que la date tardive de la manifestation avait été choisie par les syndicats en vue de l'application de cette tactique.
Nous avions distribué des tracts aux grévistes en les appelants à la marche, à l'unité dans la lutte, au débordement syndical. Mais la pression de la bourgeoisie a eu raison de cette première tentative d'expression de la combativité ouvrière. Déjà, dans les villes du nord, les ouvriers se méfiaient et avec raison de la CGT qui avait tout encadré. Tout en disant qu'il ne fallait pas laisser venir des délégations syndicales, que les ouvriers devaient venir en masse, ce qui constituait la seule possibilité de sauver la marche, nous nous sommes rendus compte que la délégation de Denain, par exemple, serait beaucoup plus restreinte qu'on ne pouvait le penser.
Que faire ? Continuer sur la lancée comme si rien n'était ? Bien sûr que non ! Les jours précédant le 23 mars, le CCI a préparé un tract pour la manifestation qui disait que seul le débordement syndical pouvait donner à la marche le véritable contenu qu'avaient espéré les ouvriers. Au passage, la CWO accuse le CCI d'avoir diffusé un tract désignant la manifestation comme un "pas en avant". Il est facile d'extraire un mot d'une phrase pour lui faire dire son contraire, or il est dit dans ce tract : "Pour que la journée du 23 mars soit un pas en avant pour notre lutte à tous." et le contenu du tract ne laisse pas planer le doute sur la nécessité de rompre le cordon syndical. Les syndicats l'ont d'ailleurs si bien compris que leurs S.0.déchiraient le tract et agressaient nos militants qui vendaient le journal RI n°59, lequel titrait: "Pas d'extension des luttes sans débordement syndical" et "Salut aux ouvriers de Longwy".
Mais attention ! La CWO, elle, aurait fait autrement. Elle nous donne la leçon : d'abord on aurait dû "canaliser la marche vers un aboutissement pratique" au lieu de "dire aux ouvriers de s'organiser eux-mêmes". Que signifie exactement "canaliser la marche nous-mêmes" ? "... Avant la manifestation, le CCI aurait dû intervenir pour dénoncer la manifestation comme une manœuvre pour tuer la lutte..." Ceci, dès le début en février, ou seulement après que la CGT ait pris le train en marche et fait rentrer les ouvriers de Paris ? La CWO ne daigne pas éclaircir ces petits détails. Il ne semble pas comprendre qu'un mouvement de classe va vite et des rapports de force entre les classes sont à saisir sur le terrain au fur et à mesure. Mais "le CCI aurait dû appeler à une autre alternative pour la marche : aller aux usines de Paris et appeler aux grèves de solidarité". Nous avons appelé à la solidarité dans les entreprises à Paris, Mais pour la CWO, si nous avons bien compris, la manifestation était vouée à l'échec d'avance. Fallait-il la dénoncer et en proposer une autre? (Où ? à la télé ? en tirant un lapin du chapeau ?) et au cours de celle-ci marcher sur les usines (lesquelles ? aucune n'était alors en grève). La CWO devrait se mettre d'accord : soit une manifestation est vouée à l'échec d'avance et alors on la dénonce à la rigueur mais on ne se fait pas d'idées sur le "détournement", soit une manifestation a une potentialité importante et alors on ne la dénonce pas. Quant à une manifestation "alternative", cette idée est aussi absurde que celle d'une poignée d'ouvriers de Longwy qui nous a demandé de les loger à Paris s' ils descendent à 3000. Supposer que nous aurions pu offrir cette alternative aujourd'hui, c'est planer dans les nuages de la rhétorique, c'est se croire en période quasi-insurrectionnelle. La question n'était pas d'imaginer l'impossible sur le papier, mais de réaliser tout ce qui était possible dans la pratique.
La CWO pense qu'il était possible à une minorité révolutionnaire de détourner cette manifestation. Il néglige encore une fois de préciser comment et dans quelle circonstance. Curieuse conception de la CWO, qui, en gros, verrait la révolution à chaque coin de rue, du moment que le parti infaillible donne les bonnes directives, et cela quel que soit le degré de maturité de la classe.
Cependant, malgré le sabotage le plus raffiné, le plus systématique, malgré un service d'ordre de 3000 "gros bras" du PC pour encadrer les ouvriers, malgré l'éparpillement des ouvriers les plus combatifs dès leur arrivée dans la banlieue parisienne, malgré la dispersion manu-militari dans les rues avoisinantes de l'Opéra, le 23 mars n'était pas une manifestation promenade à l'image des sinistres 1er mai. Le 23 Mars, la combativité ouvrière ne pouvant pas trouver une brèche par où s'exprimer, a explosé dans une bagarre où des centaines d'ouvriers ont affronté le service d'ordre syndical. Mais là aussi, la CWO a une version à elle de la vérité : "aller suivre ces ouvriers sans réfléchir en un combat futile avec les CRS/CGT était un acte désespéré".
La CWO invente à présent que notre intervention "irréfléchie" s'est réduite à aller combattre les flics aux côtés des ouvriers dans un combat "futile" Venant d'une autre publication, cette "accusation" nous laisserait songeurs! Avons-nous vraiment besoin de préciser que nos camarades n'ont pas cherché la bagarre mais se défendaient contre les charges de CRS comme les autres ouvriers et avec eux. Ils ont reculé avec les manifestants jusqu'à la dispersion complète du rassemblement tout en continuant à diffuser et à discuter. Le CCI n'a jamais exalté la violence en soi, ni aujourd'hui, ni demain, au contraire, comme en témoignent les textes publiés sur la période de transition. La CWO nous reproche maintenant d'avoir été obligés de nous défendre contre la police tandis que dans le n°13 de RP, on peut lire : "Le CCI est sous l'influence grandissante des illusions libérales et pacifistes"(p.6). La CWO devrait se décider : les membres du CCI sont des "rêveurs", des "utopistes", parce qu'ils sont contre la violence au sein de la classe pendant la révolution (tandis que la CWO, telle l'instituteur de la révolution, se frotte déjà les mains en préparant la bonne leçon de plomb destinée aux ouvriers qui ne marcheront pas droit) ; par contre, quand le CCI s'affronte avec la police dans une manifestation, alors la CWO trouve cela "irréfléchi". S'affronter avec la police est "futile" mais s'entretuer, voilà une "tactique" vraiment révolutionnaire !
Nous avons dit que la marche sur Paris offrait une occasion de concrétiser la nécessité et la possibilité de la généralisation des luttes, une occasion pour montrer la force réelle de la classe ouvrière. Que cette potentialité n'ait pas pu se réaliser n'est pas de notre fait. Bien que nous ayons tenté de lancer l'idée d'un meeting par une prise de parole, la rapidité de la charge de la police en conjonction avec la dispersion organisée tambour battant par les syndicats n'a pas permis aux milliers de prolétaires qui "ne se dispersaient pas" de tenir un meeting.
Le fait que la manifestation du 23 mars n'ait rien donné d'autre que ce que voulaient en faire les syndicats ne signifie cependant nullement qu'elle n'ait eu aucune potentialité. Malgré tout le sabotage préalable, malgré le report de sa date après la fin des grèves de la région parisienne, elle aurait pu également tourner autrement comme l'a démontré quelques jours plus tard le débordement de la manifestation de Dunkerque où le meeting syndical qui devait la clore s'était transformé en assemblée ouvrière où un nombre important de travailleurs avait dénoncé les syndicats. Avec la logique de la CWO, les révolutionnaires n'auraient pas dû participer à cette manifestation puisque encore plus encadrée et d'une certaine façon bien plus "artificielle" que celle du 23 mars; ils se seraient alors privés d'une intervention importante et relativement efficace comme s'en est privé le PCI qui avait une analyse similaire à celle de la CWO.
Après la marche, le CCI a diffusé à toutes les usines où se font les interventions régulières un tract-bilan analysant la réussite du sabotage syndical. Il y était dit que l'enseignement essentiel de cette lutte où les syndicats se sont dévoilés comme défenseurs de la police contre la colère des ouvriers réside dans le fait qu'il n'y a pas d'autre issue pour la classe ouvrière que le débordement syndical.
Dans l'intervention de l'organisation lors de toute la période mouvementée des luttes des ouvriers de la sidérurgie en France, la CWO ne voit que la "culmination d'une longue série de capitulations politiques du CCI". Ce groupe ne sait pas mesurer ses mots. Outre le fait que ses remarques sur comment une "véritable (!) intervention révolutionnaire" aurait pu se faire ne tiennent pas debout, il n'y a rien dans ce qui a été fait par le CCI qui justifierait l'accusation de "capitulation politique". Le CCI a été fidèle à ses principes et une orientation cohérente. L'agitation est une arme difficile à manier et elle s'apprend sur le terrain. Nous ne prétendons pas que chacun des 7 tracts diffusés en 6 semaines soit un chef d'œuvre, mais il n'y a rigoureusement rien dans toutes les critiques de la CWO qui pourrait prouver un quelconque écart à nos principes. Que Messieurs les futurs aspirants à la "direction" de la classe ouvrière de demain reconnaissent que l'intervention du CCI n'est pas du style substitutioniste, nous nous en félicitons, mais dans la pratique, ils n'ont rien de précis à apporter comme contribution et leurs paroles ne sont en fin de compte autre chose que du vent.
La CWO conclut son assaut de mauvaise foi contre le CCI en disant que sur les questions vitales du mouvement ouvrier d'aujourd'hui, telles que "doit-on aider à la constitution de groupes d'ouvriers chômeurs? Doit-on aider des noyaux ouvriers ? Doit-on assister à des réunions internationales d'ouvriers même s'il y a encore une influence syndicale ?", le CCI ne fait que laisser ses membres dans le noir et les destine à tomber dans l'opportunisme. Là, il dépasse la mesure. La CWO a pourtant assisté au 3ème Congrès du CCI où ces questions ont été soulevées : mais il est devenu amnésique à moins qu'il n'ait fait la sourde oreille. Il faut dire que lorsqu'on n'est pas habitué comme c'est le cas de la CWO à l'élaboration des positions politiques dans une organisation internationale et quand on croit au monolithisme à l'intérieur de son armoire, on a du mal à s'orienter dans un Congrès où il y a forcément différentes propositions, une confrontation d'idées. Mais si la CWO se noie déjà aujourd'hui dans un verre d'eau, que fera-t-il dans la tourmente de la lutte de classe le jour où tous les ouvriers se mettront à réfléchir.
Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, pas plus que la CWO d'ailleurs qui, dans un sursaut de réalisme, avoue qu'il n'a "pas encore une totale clarté sur ces question". Mais sur les questions posées plus haut, le CCI a déjà répondu oui dans la pratique (cf. le comité de chômeurs d'Angers, la grève de Rotterdam, la réunion internationale des dockers à Barcelone). Tout en appuyant toute tendance vers l'auto organisation de la classe ouvrière, nous devons savoir comment l'orienter, quels dangers éviter, comment contribuer à cet effort ? Et pour cela, on ne peut compter que sur les principes et l'apport de l'expérience.
C'est dans ce sens que nous affirmons la nécessité de donner notre soutien à toutes les luttes du prolétariat sur un terrain de classe. Nous appuyons les revendications décidées par les ouvriers eux-mêmes à condition que celles-ci soient conformes aux intérêts de la classe ouvrière. Nous refusons le jeu de la surenchère gauchiste (les syndicats et la gauche demandent 20 centimes, alors les gauchistes proposent 25 centimes !) ainsi que l'idée absurde du PCI de faire des "cahiers de revendications" à la place des ouvriers.
Le plus grand obstacle devant les luttes ouvrières aujourd'hui est constitué par les syndicats. Nous nous efforçons dans une période de montée des luttes de dénoncer les syndicats non seulement de façon générale abstraite mais surtout concrètement, dans la lutte, de démontrer dans le quotidien leur sabotage de la combativité ouvrière.
L'essentiel de toute lutte ouvrière aujourd'hui c'est la poussée vers l'extension : au-delà des catégories, des régions et même des nations, l'unité de la lutte ouvrière contre la décomposition du système capitaliste en crise. Une lutte qui se laisse isoler va vers la défaite. Il n'y a qu'une seule chose qui fait reculer le capital, l'unité et la généralisation des luttes. En cela, la situation présente se distingue de celle du siècle dernier où la durée d'une lutte était un facteur essentiel de sa réussite : en face d'un patronat beaucoup plus dispersé qu'aujourd'hui, le fait d'arrêter la production pendant une longue période pouvait créer des pertes économiques catastrophiques pour l'entreprise et constituait donc un moyen efficace de pression. A l'heure actuelle, par contre, il existe une solidarité d'ensemble du capital national, prise en charge notamment par l’État, qui permet à une entreprise de tenir bien plus longtemps (surtout dans un moment de surproduction et d'excédent des stocks). De ce fait, une lutte qui s'éternise a toutes les chances d'être perdue de par les difficultés économiques qu'elle provoque pour les grévistes et la lassitude qui s'installe à la longue. C'est pour cela que les syndicats ne sont pas trop gênés pour jouer à peu de frais les "va-t-en-guerre" en déclarant "nous tiendrons le temps qu'il faudra": ils savent, qu'à la longue, la lutte sera brisée. Par contre, ce n'est pas par hasard qu'ils sabotent tout effort de généralisation : ce que craint par dessous tout la bourgeoisie, c'est d'avoir à affronter un mouvement touchant non telle ou telle catégorie de la classe ouvrière, mais tendant à se généraliser à son ensemble mettant en présence deux classes antagoniques et non pas un groupe d'ouvriers à un patron. Alors elle risque d'être paralysée tant économiquement que politiquement et c'est pour cela qu'une des armes de la lutte c'est la tendance à son élargissement même s'il ne se réalise pas d'emblée. La bourgeoisie a bien plus peur des grévistes qui vont d'usine en usine pour tenter de convaincre leurs camarades d'entrer en lutte, que de grévistes qui s'enferment dans leur usine même avec la volonté de tenir deux mois.
C'est pour cela et parce qu'elle préfigure les combats révolutionnaires de demain qui embraseront toute la classe que la généralisation des luttes est le leitmotiv de l'intervention des révolutionnaires aujourd'hui.
Pour pouvoir mener la lutte en dehors et contre les syndicats, la classe ouvrière s'organise de façon hésitante au début mais en laissant entrevoir déjà les premiers signes de la tendance vers l'auto-organisation du prolétariat (voir la grève de Rotterdam en septembre 1979). Nous appuyons de toutes nos forces les expériences qui enrichissent la conscience de classe sur ce point capital.
Quant aux ouvriers les plus combatifs, nous poussons à ce qu'ils se groupent non pas pour constituer de nouveaux syndicats, ni même pour qu'ils se perdent dans un apolitisme stérile issu d'un manque de confiance en soi, mais en groupes ouvriers, comités d'actions, collectifs, coordinations, etc., lieux de rencontres entre ouvriers, ouverts à tous les ouvriers pour discuter les questions fondamentales devant la classe. Sans s'enthousiasmer plus qu'il ne faut et sans bluffer, nous affirmons que le bouillonnement dans la classe ouvrière s'annonce déjà par des minorités combatives contribuant au développement de la conscience de classe non pas tant par les individus directement concernés à un moment donné mais par le fil historique que la classe reprend en ouvrant la discussion et la confrontation en son sein.
Sur ces questions comme sur la manifestation du 23 mars, on doit affirmer qu'il n'y a pas de recettes toutes faites valables de tout temps. Demain de multiples autres manifestations de la combativité ouvrière concentreront notre attention parce que révélatrices de la force du prolétariat. Comme l'ensemble de la classe, les révolutionnaires ont devant eux des tâches de la plus grande importance : définir des perspectives en tenant compte d'une situation précise, savoir quand il faut passer de la dénonciation générale à la dénonciation concrète fournie par les faits, quand il faut aller à un rythme supérieur, apprécier le niveau réel de la lutte, définir à chaque étape les buts immédiats par rapport à la perspective révolutionnaire.
Nous ne sommes dans le monde qu'une poignée de militants révolutionnaires ; il ne faut pas se faire d'illusions sur l'influence directe des révolutionnaires aujourd'hui, ni sur la difficulté qu'aura la classe ouvrière à se réapproprier le marxisme. Dans le tourbillon des explosions de lutte, dans cette œuvre "de la conscience, de la volonté, de la passion, de l'imagination qu'est la lutte prolétarienne'', les révolutionnaires ne pourront jouer un rôle que "s'ils n'ont pas désappris d'apprendre".
JA/MC/JL/CG
[1] En effet, dans "Jeune Taupe" n°27, le PIC ait suivre un tract d'un groupe d'ouvriers d'Ericsson qu'il reproduit, d'une critique dans laquelle il lui reproche de s'opposer aux licenciements en arguant que : "Il ne semble pas que l'on puisse à la fois "maintenir l'emploi" et "en finir avec le capitalisme et le salariat".
[2] Il faut se garder de confondre le réformisme avec les syndicats d'aujourd'hui. Le réformisme fondait sa politique de négation de la nécessité de la révolution, en lui opposant la défense des intérêts immédiats des ouvriers, sur des illusions émanant d'un capitalisme en pleine expansion. Tandis que les syndicats dans la période de décadence ne nourrissent aucunes illusions, et s'ils sont toujours contre la révolution, ils ont en plus abandonné également la défense des intérêts immédiats des ouvriers, se convertissant en organes directs de l' État capitaliste.
Heritage de la Gauche Communiste:
Gauche mexicaine 1938
- 2464 reads
INTRODUCTION
Dans le n°10 de la Revue Internationale (juin-août 1977) nous avons commencé la publication de textes de la gauche communiste mexicaine. Comme nous l'avons proposé, nous avons continué ce travail, il est vrai avec retard, mais indépendamment de notre seule volonté, en publiant dans le dernier numéro (19) le texte sur "Les nationalisations". Texte dans lequel la gauche mexicaine dénonçait vigoureusement cette mystification, largement utilisée par les partis soi-disant ouvriers pour tromper sans vergogne la classe ouvrière et mieux la rattacher à la défense du capital national. Aujourd'hui comme hier, les nationalisations continuent à être la plate-forme de ces partis, et l'accélération de cette évolution vers le capitalisme d'Etat est toujours présentée par eux comme l'alternative ouvrière à la crise du capitalisme. Et tout comme hier, les trotskystes et autres gauchistes continuent sur cette question comme sur tant d'autres à leur emboîter le pas et leur servir d'auxiliaires très dévoués.
Les deux textes que nous publions aujourd'hui sont à notre connaissance les derniers que ce groupe a publiés dans leur revue "Comunismo" n°2 (octobre-décembre 1938). La violente hostilité de toutes les forces de la bourgeoisie, de droite et de gauche, la campagne de dénonciation publique dans le style stalinien par la section mexicaine de la 4ème Internationale contre les militants et le groupe comme étant des "provocateurs, agents de Hitler et de Staline", la répression (voir leur "Appel" publié dans le n° 10 de la Revue Internationale) du gouvernement de gauche, et surtout la bourrasque de la guerre s'approchant à pas accélérés ont eu raison des faibles forces de la gauche mexicaine, qui vu son extrême jeunesse n'a pas su résister longtemps à une telle coalition des forces ennemies. Le "Groupe des travailleurs marxistes" de Mexico disparaît dans la tourmente de l'année 1939. Mais dans ce court laps de temps (2 ans) de son existence, le groupe communiste de gauche du Mexique a su apporter une contribution effective dans la défense des positions communistes fondamentales. Sa place et sa contribution dans les heures .les plus sombres du mouvement révolutionnaire international ne devraient pas rester méconnues des nouvelles générations.
Le premier texte que nous publions dans cette revue est un exemple vivant de comment les révolutionnaires défendent dans un pays sous-développé les positions de classe et dénoncent tous les mensonges d'une bourgeoisie "progressive". Bon exemple, non seulement contre les trotskystes et leur soutien à Cardenas, mais également contre les bordiguistes d'aujourd'hui qui ne trouvaient rien de mieux que de critiquer ( !) "les faiblesses" du gouvernement de gauche d'Allende au Chili face à Pinochet, de lui reprocher ses hésitations (!) et de lui donner post festum des conseils édifiants sur la "violence révolutionnaire".
On se souvient de l'apologie faite par les bordiguistes de la "terreur révolutionnaire" exemplaire les khmers rouges au Cambodge. C'est aussi à eux lue s'adresse la conclusion de l'article de la gauche mexicaine, quand dénonçant les mensonges de "révolution sociale" dont s'affublait le parti national révolutionnaire (parti gouvernemental) elle s'écrie :
"Quelle vision sociale si magnifique : établir dans le pays la paix de cimetière et décréter qu’elle est "la société sans classe".... comme l’entendent les généraux."
Le deuxième texte est une étude analytique des thèses du 2ème congrès de l'Internationale Communiste sur la question nationale et coloniale. Il est absolument inévitable pour tout groupe communiste, se dégageant du long cours de la dégénérescence et de la trahison finale de la 3ème Internationale de dénoncer non seulement la contre-révolution stalinienne mais encore de soumettre à une critique minutieuse les travaux de l'Internationale Communiste depuis ses premières années au temps glorieux de Lénine. Tout comme les fractions italiennes et belge de la gauche communiste internationale, la gauche mexicaine ne pouvait se contenter d'emboucher simplement les clairons de la plus plate apologie de tout ce qui venait de Lénine, comme le faisaient les trotskystes ou comme le font aujourd'hui les bordiguistes. La gauche mexicaine aurait le plus grand mal à reconnaître dans ces derniers les continuateurs de "Bilan" tant ils ont régressé sur bien des questions pour apparaître comme une variante du trotskysme. Comme les révolutionnaires, lors de l'éclatement de la première guerre mondiale, ne pouvaient se contenter d'un simple constat de la trahison de la 2ème Internationale mais devaient soumettre à un examen critique toute l'involution au cours de son histoire, la gauche communiste ne pouvait et ne devait pas se contenter de stigmatiser le triomphe de la contre-révolution stalinienne mais devait chercher à mettre à nu ses racines dont, non la moindre, se trouve dans l'immaturité de la pensée et l'organisation du mouvement communiste lui-même. Le stalinisme ne tombe pas du ciel et ne surgit pas du néant. Et s'il est absurde de jeter l'enfant avec l'eau sale de la baignoire, de condamner l'Internationale Communiste parce qu'en son sein a pu se développer et triompher le stalinisme (voir par exemple "les modernes" tard venus, et sévères "juges de paix provinciaux" comme le PIC et la Gauche Internationaliste"), il n'est pas moins absurde de prétendre que l'eau de la baignoire a toujours été absolument pure et parfaitement limpide, de présenter l'histoire de "L'Internationale Communiste" divisée en deux périodes bien tranchées, dont l'une, la première serait du cristal pur, révolutionnaire, sans la moindre tâche, sans défaillance aucune et brusquement interrompue par l'explosion de la contre-révolution. Ces imageries d'un paradis bienheureux et d'un horrible enfer sans aucun lien entre eux, n'a rien à voir avec un mouvement réel, telle l'histoire du mouvement communiste où la continuité se fait au travers de profondes ruptures, et où les futures ruptures ont leurs germes dans le processus de la continuité.
Seul l'examen critique inexorable, l'autocritique constante permet au mouvement révolutionnaire de la classe de surmonter ses faiblesses, son immaturité d'hier et de corriger ses erreurs du passé et lui donner la possibilité de se hisser à la hauteur de ses tâches historiques, de mieux ajuster ses positions au travers de l'expérience. Il n'est pas surprenant que la gauche mexicaine ait porté l'examen de la question nationale au centre de ses préoccupations. A côté des questions de la période historique de la décadence et ses implications -la question syndicale, électorale, fascisme et antifascisme, fronts uniques- la question nationale est une de celles qui a laissé le plus d'ambiguïtés permettant des interprétations opportunistes et entrouvrant la porte à ces courants.
Dans la première partie de ce texte, la gauche mexicaine, en rappelant le premier et le deuxième paragraphe de la deuxième thèse du second congres de l'IC, s'efforce de démontrer comment les trotskys-tes et autres "anti-impérialistes" dénaturent sans vergogne la position de principe énoncée dans les thèses du second congrès. Elle revendique ses principes internationalistes comme un acquis du mouvement communiste et dénonce toute altération comme une régression vers des positions nationalistes bourgeoises. C'est par la suite, que la gauche mexicaine se proposait de faire la critique des insuffisances, des ambiguïtés que contenaient encore ces thèses, notamment le troisième paragraphe. Autant les deux premiers paragraphes mettent clairement l'accent sur la séparation nécessaire entre les intérêts de classe des exploités et le concept trompeur bourgeois d'un soi-disant intérêt national commun à toutes les classes, le troisième paragraphe, lui, reste dans le vague, dans la simple description de l'exploitation à outrance de la majorité des pays sous-développés par une minorité de pays où le capital est hautement développé sans tirer d'autre conclusion que le constat que telle est "la situation propre à l'époque du capital financier impérialiste".
Que découlait-il de ce constat ? Pour la majorité centriste de l'Internationale autour de Lénine et le parti bolchevique, il s'en suivait que dans certaines circonstances et plus particulièrement dans une période révolutionnaire, le prolétariat concentré dans les pays de haut développement capitaliste pouvait trouver dans son assaut contre le monde capitaliste un appui dans les pays sous-développés en butte à 1'oppression des grandes puissances. L'erreur d'une telle conclusion réside dans le fait de faire découler mécaniquement d'un constat d'antagonismes existants entre pays dominants et pays dominés une affirmation qui fait de cet antagonisme une opposition historique irréconciliable contre l'ordre existant. La société bour-geoise n'est pas une société harmonieuse mais fondée sur beaucoup d'antagonismes entre pays à capital hautement développé et pays sous-développés, entre des pays développés eux-mêmes, entre un bloc de pays contre un autre bloc, pour la domination du monde. Ce qui aboutit dans la période impérialiste à des guerres généralisées. La question est de savoir si ces antagonismes mettent en question 1'ordre bourgeois, tendent à donner une solution aux contradictions qui déchirent la société, la mènent à des catastrophes, ou bien ces antagonismes ne sont que les manifestations de l'ordre existant, son mode d'existence ?
Pour les marxistes, seul l'antagonisme de classe du prolétariat contre la bourgeoisie présente une dynamique révolutionnaire, non pas seulement parce que c'est la lutte des opprimés contre l'oppression, mais uniquement parce que le prolétariat porte en lui la solution à tous les antagonismes et contradictions dans lesquels la société s'est embourbée et cette solution est l'instauration d'un nouvel ordre social : une société sans classes et sans divisions nationales : le communisme. L'ambiguïté de la position plaçait l'Internationale Communiste sur une pente dangereuse. Les démentis fracassants et les échecs successifs auxquels cette politique a conduit (voir le soutien à Kemal Pacha en Turquie, ou à Tchang Kaï chek en Chine) n'a fait que savonner plus la pente et accélérer la dégénérescence de l'Internationale. D'une "possibilité occasionnelle", la position devenait une règle constante et la possibilité pour le prolétariat de trouver un appui problématique dans les luttes nationales des pays coloniaux s'est transformée en un soutien inconditionnel du prolétariat aux luttes nationales et nationalistes. C'est ainsi que les trotskystes ont fini par participer à la guerre impérialiste et à la défense nationale au nom de 1'antifascisme allemand et que les bordiguistes, tournant le dos à la conception d'une révolution internationale ont construit une théorie d'aires géographiques où dans les unes, (une minorité) serait à Tordre du jour la révolution prolétarienne et dans les autres (groupant l'immense majorité des pays et de la population mondiale) serait à l'ordre du jour "la révolution démocratique bourgeoise anti-impérialiste".
La disparition de sa revue en 1939 a empêché la gauche mexicaine de poursuivre sa critique implacable des positions ambiguës de la 3ème Internationale. Mais déjà cette première partie de leur étude constitue une contribution très importante à ce travail.
Il appartient aux révolutionnaires aujourd'hui de le reprendre et de le continuer.
LE PARTI DE LA REVOLUTION MEXICAINE «RECONNAIT LA LUTTE DE CLASSE» POUR COMBATTRE LA REVOLUTION PROLETARIENNE
Un des traits les plus caractéristiques de la vie politique de nos jours est le fait que la bourgeoisie, pour dévoyer l'attaque des masses affamées et désespérées ,se présente, hypocritement et démagogiquement, comme l'opposé de ce qu'elle est en réalité, c'est à dire, elle se fait passer pour le défenseur des masses contre la bourgeoisie elle-même. Bien entendu, pour réussir un mensonge aussi éhonté et absurde, la bourgeoisie doit se diviser en deux secteurs : l'un "oppresseur" et l'autre "protecteur" et ces deux secteurs, les "mauvais" capitalistes et les "bons" doivent être "en lutte". Dans le cas des pays à dictature masquée qui se dénomment "démocratiques", ce sont les "bons" capitalistes qui détiennent le pouvoir ; dans le cas des pays à dictature ouverte, ce sont les "mauvais". Dans le second cas, les "bons" capitalistes, les "protecteurs des masses" se trouvent en situation "d'opposition irréconciliable" selon leurs propres ternies. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un secteur capitaliste qui "défend" les masses contre un autre secteur capitaliste. Les ouvriers et les paysans pauvres, pour se libérer du joug capitaliste n'ont plus qu'à offrir leur destinée aux capitalistes eux-mêmes -bien entendu aux "bons", ceux qui se déguisent ennemis". Cet abandon total à l'ennemi de classe qui, naturellement, exige d'énormes sacrifices économiques et politiques et jusqu'à la vie même (comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne et en Chine), pour "protéger" les prolétaires et les paysans contre les autres capitalistes, les "réactionnaires", "fascistes", ou "impérialistes", cet abandon de la lutte, donc, se nomme, ironiquement "lutte". Au Mexique, devenu aujourd'hui le jardin tropical de l'exubérance démagogique, cela s'appelle même "lutte de classe"!
Lorsqu'on lit les phrases ci-après de la déclaration du "nouveau" P.R.M., "Parti de la Révolution Mexicaine et authentique représentant des travailleurs", et l'éditorial intitulé "Sur le patriotisme" dans "El Nacional" du 21 avril 1938, on se croirait facilement dans un asile de fous.
"La lutte de classe est reconnue -par le Parti de la Révolution mexicaine et par le consensus de l'opinion ouvrière du pays, comme une réalité insurmontable étant donné que c'est un phénomène inhérent au système de production capitaliste. On ne pourra espérer la paix sociale que lorsque ce régime sera substitué. Nous; les révolutionnaires, concevons la société structurée en deux couches superposées par la force d'une loi économique que le capitalisme impose comme valable, ne fut-ce que de façon transitoire. Le paysan maya est plus frère du pêcheur finlandais, brumeux dans ses eaux polaires, que du propriétaire blanc, maître de la même langue, fils du même sol et protégé par des institutions identiques, qui n'emploie ce qu'il a en commun avec son serf que pour mieux le spolier."
Et qui est-ce qui parle ainsi ? L'authentique représentant de la bourgeoisie, l'authentique représentant du système capitaliste, l'authentique représentant des propriétaires blancs, l'ennemi irréconciliable des [paysans mayas et des pécheurs finlandais, le parti de la soi-disant "révolution mexicaine"!
LES OPPRESSEURS VEULENT DIRIGER LA LUTTE DES OPPRIMES.
Les capitalistes et propriétaires fonciers mexicains "reconnaissent" ainsi la lutte de classe, mais, naturellement, ils ne se réfèrent.pas à la lutte de classe entre eux et les masses opprimées, mais à la lutte entre les opprimés et les exploités et les autres propriétaires fonciers et capitalistes, les "mauvais", les "fascistes". Contre ces derniers, la "bonne" bourgeoisie mexicaine, dirigée par les généraux "démocratiques" lutte à côté des ouvriers et de paysans, et-non seulement elle participe à cette lutte, mais encore elle la dirige! Il est clair qu'une telle "lutte de classe", dirigée par un secteur de la bourgeoisie elle-même, ne signifie pas lutte des opprimés contre les oppresseurs, mais, au contraire, une lutte de ceux-ci contre les opprimés. C'est la lutte de classe de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers, "bons" et "mauvais" ensemble, contre les prolétaires et les paysans.
La bourgeoisie mexicaine "reconnaît" la lutte de classe dans le but de dénaturer la lutte des exploités contre les exploiteurs et d'utiliser la combativité aux fins de la lutte des exploiteurs contre les exploités. Voilà la clé de la confusion qui règne aujourd'hui parmi le prolétariat et la paysannerie du pays et l'explication de leurs innombrables défaites.
IL MANQUE UN PARTI DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE !
Le triomphe de la démagogie "classiste" de la bourgeoisie mexicaine s'explique par l'absence d'un parti classiste du prolétariat du Mexique. Il n'existe, en dehors de notre organisation, aucun autre groupe, aussi petit soit-i1, qui essaie de combattre à partir des positions du marxisme, le mensonge de la bourgeoisie "révolutionnaire" du pays. Ainsi, la démagogie du P.R.M. et de tous les grands "ouvriéristes" au gouvernement trouve la voie libre et atteint des limites inconnues dans d'autres pays.
"Celui qui accepte seulement la lutte de classe n'est pas encore marxiste et peut rester dans le cadre de la pensée et de la politique bourgeoises.. . Est marxiste seulement celui qui "étend la reconnaissance de la lutte de classes " jusqu'à la DICTATURE DU PROLETARIAT". (Lénine dans l’Etat et la révolution)
Combattre la bourgeoisie et la détruire complètement au moyen de la dictature du prolétariat, c'est cela pour les marxistes, pour les communistes, le seul chemin pour "substituer" au régime actuel un autre qui instaurera enfin la "paix sociale" (pour reprendre les termes de la déclaration du P.R.M.).
Les généraux du P.R.M. et leurs rusés conseillers "ouvriéristes" ont, bien entendu, une conception entièrement différente. D'après eux, SUBSTITUER un régime à un autre, cela signifie simplement CHANGER SON ETIQUETTE, et cela naturellement, ils peuvent et doivent le faire EUX-MEMES. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une soi-disant "lutte de classes", mais d'une "révolution sociale"... sous la direction des généraux !
Quelle magnifique vision "sociale" : établir dans le pays la paix des cimetières et décréter que c'est là la "société sans classes"... telle que l'entendent les généraux !
UNE ANALYSE DES THESES DU 2eme CONGRES DE L INTERNATIONALE COMMUNISTE 1920 (1ière partie).
Sur les questions nationale et coloniale
"Abolissez l’exploitation de l'homme par l'homme et vous aurez aboli l'exploitation d'une nation par une autre".
Le paragraphe 2 des Thèses du Second Congrès de l'Internationale Communiste, sur les questions nationale et coloniale, dit textuellement :
"Conformément à son but essentiel - la lutte contre la démocratie bourgeoise, dont il s'agit de démasquer l'hypocrisie - le Parti Communiste- interprète conscient du prolétariat en lutte contre le joug de la bourgeoisie, doit considérer comme formant la clef de voûte de la question nationale, non des principes abstraits et formels, mais : 1° une notion claire des circonstances historiques et économiques ; 2° la. dissociation précise des intérêts des classes opprimées, des travailleurs, des exploités, par rapport à la conception générale des soi-disant intérêts nationaux, qui signifient en réalité ceux des classes dominantes ; 3° la division tout aussi nette et précise des nations opprimées, dépendantes, protégées, et oppressives et exploiteuses, jouissant de tous les droits, contrairement à l'hypocrisie bourgeoise et démocratique qui dissimule, avec soin, l'asservissement (propre à l'époque du capital financier de l'impérialisme) par la puissance financière et colonisatrice, de l'immense majorité des populations du globe à une minorité de riches pays capitalistes."
Nous allons analyser ce paragraphe avec soin, point par point.
LA LUTTE CONTRE LA DEMOCRATIE.
Le plus significatif dans ce paragraphe est sans aucun doute son début : l’affirmation claire, sans équivoque que la tâche essentielle du Parti Communiste Mondial n'est pas la fameuse "défense de la démocratie" dont nous parlent tant aujourd'hui les prétendus "communistes", mais au contraire la lutte contre elle !
Cette affirmation répétée tant de fois dans d'autres thèses de l'Internationale de l'époque de Lénine, quoiqu'aujourd'hui niée catégoriquement par l'institution qui porte encore ce nom, servait à Lénine et à ses camarades de point de départ précisément pour l'étude des questions nationale et coloniale. Et il n'y a pas d'autre point de départ ! Ceux qui n'acceptent pas la lutte contre la démocratie bourgeoise comme la tâche principale des communistes, ne peuvent jamais donner une solution marxiste à ces questions.
LE MENSONGE DE L'EGALITE DANS LE SYSTEME DANS LE SYSTEME CAPITALISTE.
Le premier paragraphe des thèses explique plus en détail quels sont ces "principes abstraits et formalistes" que le Parti de la Révolution Prolétarienne doit rejeter comme base de sa tactique dans les questions nationale et coloniale.
"La position abstraite et formelle de la question de l'égalité, y compris de l'égalité des nations, est propre à la démocratie bourgeoise sous la forme de l'égalité des personnes en général. La démocratie bourgeoise proclame l'égalité formelle ou juridique du prolétaire, de l'exploiteur et de l'exploité, induisant ainsi les classes opprimées dans la plus profonde erreur. L'idée d'égalité% qui n'était que le reflet des rapports créés par la production pour le négoce, devient, entre les mains de la bourgeoisie, une arme contre l'abolition des classes combattue désormais au nom de l'égalité absolue des personnalités humaines."
La lutte pour l'abolition des classes serait évidemment superflue si, comme l'affirme la bourgeoisie, l'égalité était réellement possible au sein de la société actuelle malgré sa division en classes. La vérité est que non seulement il n'y a pas d'égalité au sein de la société actuelle, mais qu'il ne peut pas y en avoir. Les thèses ajoutent, à la fin du paragraphe cité :
"Quant à la signification véritable de la revendication égalitaire, elle ne réside que dans la volonté d'abolir les classes".
Et encore une fois, au paragraphe 4, on parle de :
"Car ce rapprochement est la seule garantie de notre victoire sur le capitalisme, sans laquelle ne peuvent être abolies ni les oppressions nationales, ni l'inégalité"'.
En d'autres termes : l'affirmation de l'existence de l'égalité ou, au moins dans la société actuelle, de la possibilité de son existence, a comme but de préserver l'exploitation et l'oppression de classes et de nations. La revendication de l'égalité, sur la base de l'abolition des classes poursuit le but opposé : la destruction de la société actuelle et la construction d'une nouvelle société sans classe . La première est l'arme préférée de tous les réformistes au service de la contre-révolution. La deuxième est une revendication du prolétariat conscient de ses intérêts de classe, l'exigence du Parti de la Révolution Prolétarienne Mondiale.
LES PROLETAIRES N'ONT PAS D’INTERETS NATIONAUX".
D'après le second point des thèses citées, le Parti Communiste Mondial doit rejeter le "concept général des soi-disant intérêts nationaux" parce que ces intérêts n'existent pas et ne peuvent pas exister puisque toutes les nations sont divisées en classes aux intérêts opposés et irréconciliables, de sorte que ceux qui parlent d'"intérêts nationaux", consciemment ou inconsciemment, défendent les intérêts des classes dominantes. L'affirmation selon laquelle il pourrait exister des "intérêts nationaux", c'est-à-dire des intérêts communs à tous les membres d'une nation, se fonde justement sur la soi-disant "égalité formelle et juridique de l'exploiteur et de l'exploité" proclamée hypocritement par les classes possédantes et exploiteuses elles-mêmes. Sur les traces de Marx et Engels, nous devons combattre le mensonge qui dit par exemple que "tous les mexicains" seraient égaux et que nous aurions des intérêts communs et donc une "patrie" commune à défendre. La patrie est à eux. Les travailleurs, comme l'a déjà affirmé avec une absolue clarté le Manifeste Communiste il y a presque cent ans, n'ont pas de patrie. Notre futur ne connaîtra pas des patries différentes au nom desquelles les classes possédantes pourront envoyer les dépossédés sur les champs de bataille, mais une seule patrie : l'humanité laborieuse.
LE BON VOISIN DE LA BOURGEOISIE MEXICAINE
Pour combattre efficacement la bourgeoisie et détruire sa société, nous devons rejeter non seulement le mensonge de l'égalité des hommes au sein des nations, mais aussi celui de l'égalité des nations. Nous devons démontrer, comme nous le montre le deuxième point des thèses citées, que "1'asservissement par la puissance financière et colonisatrice de l'immense majorité des populations du globe à une minorité de riches pays capitalistes" (Etats Unis, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Japon) est une situation propre à l’époque du capital financier et Impérialiste" et que cet asservissement, par conséquent, ne peut disparaître avec quelques déclarations mensongères contre l'impérialisme pour une soi-disant politique du "bon voisin", mais seulement avec la disparition du capitalisme lui-même, avec sa destruction violente par le prolétariat mondial.
Nous ne devons pas nous lasser de répéter cette vérité fondamentale, non pas sous une forme abstraite, générale mais sous une forme qui démasque concrètement chaque jour l'hypocrisie démocratique dont parlent les thèses. Dans le cas du Mexique, il est nécessaire de démasquer le mensonge selon lequel un pays capitaliste avancé et, par conséquent, impérialiste comme les Etats-Unis, pourrait être le "bon voisin" d'un pays capitaliste arriéré comme le Mexique. Il faut détruire le mensonge selon lequel l'amitié qui se noue en ce moment entre les exploiteurs d'Amérique du Nord et les serviles exploiteurs mexicains équivaudrait à une "amitié entre les peuples d'Amérique du Nord et du Mexique", comme les exploiteurs des deux pays veulent nous faire croire. Il faut au contraire insister sur le fait que nos seuls bons voisins sont les prolétaires et tous les opprimés des Etats Unis et du monde entier, avec lesquels de vrais intérêts communs nous unissent contre les exploiteurs et leurs "patries" respectives.
LE PATRIOTISME CONTRE-REVOLUTIONNAIRE DES STALINIENS ET DES TROTSKYSTES.
Tout cela est admis "théoriquement" par les soi-disant "communistes" de souche stalinienne et trotskyste, mais, dans la pratique, ils font le contraire. Les staliniens du Mexique et des Etats-Unis sont aujourd'hui au premier rang de ceux qui font l'éloge de la "nouvelle politique" de l'impérialisme nord-américain. Les trotskystes ne le font pas aussi ouvertement ; ils utilisent la méthode indirecte qui consiste à n'attaquer que les "mauvais voisins" de la bourgeoisie mexicaine : l'impérialisme anglais, allemand, japonais.
Mais leur lutte contre les positions fondamentales de l'Internationale Communiste du temps de Lénine va plus loin. Utilisant un tour de passe-passe propre aux renégats, les staliniens et les trotskystes "oublient" le point des thèses citées qui parle de "la dissociation précise des intérêts des classes opprimées, des travailleurs, des exploités, par rapport à la conception générale des soi-disant intérêts nationaux, qui signifient en réalité ceux des classes dominantes" et s'accrochent exclusivement à l'autre point qui parle de "la division tout aussi nette et précise des nations opprimées, dépendantes, protégées et des nations oppressives et exploiteuses".
C'est ce que fait par exemple Léon Trotski dans ses attaques contre notre position sur la guerre chinoise (voir le bulletin interne de la Ligue Communiste Internationaliste du Mexique n°1). Avec cette méthode, il arrive exactement à la même position que les staliniens : au lieu de démontrer aux prolétaires chinois que leurs intérêts de classe sont irréconciliables avec les soi-disant "intérêts nationaux" (en réalité les intérêts des exploiteurs chinois) et que, par conséquent, ils doivent lutter autant contre leurs ennemis "compatriotes" que contre l'ennemi envahisseur, au moyen de la fraternisation avec les soldats japonais et du défaitisme révolutionnaire. Au lieu de cela, Trotski s'efforce de convaincre les exploités de Chine que leurs intérêts de classes: coïncident dans une certain mesure, c'est-à-dire sur le point de la défense de la soi-disant "patrie", avec "les intérêts nationaux" de leurs exploiteurs !
Pour Trotski, les prolétaires "en général" n'ont pas de patrie. Il reste par là "théoriquement" fidèle au marxisme. Mais dans le cas concret des prolétaires de Chine, du Mexique, de tous les pays opprimés et dépendants, c'est-à-dire dans le cas de la majorité écrasante des pays du monde, cette règle fondamentale du marxisme n'a pour lui aucune application. "Le patriotisme chinois est légitime et progressif" affirme ce renégat ! Bien entendu, pour lui et ses semblables, il en va de même pour le patriotisme mexicain, guatémaltèque, argentin, cubain, etc.
LES TRAVAILLEURS N'ONT PAS DE PATRIE MEME DANS LES PAYS OPPRIMES !
Pour un marxiste, cela ne fait pas de doute que le plus important des points cités dans les thèses du Second Congrès de TIC est justement le deuxième point, celui qui insiste sur la non-existence d' "intérêts nationaux" et que la distinction qui est faite au troisième point, entre "nations opprimées" et "nations oppressives", doit se comprendre dans ce sens. En d'autres termes, même dans les nations opprimées, il n'existe pas d'autre "intérêt national" que celui des classes dominantes. La conclusion pratique de cette position théorique est que les règles fondamentales de la politique communiste doivent être appliquées à tous les pays, impérialistes, semi-coloniaux et coloniaux. La lutté contre le patriotisme et la fraternisation avec lés opprimés de tous les pays, y compris les prolétaires et paysans en uniforme des armées dés pays impérialistes, est une des règles dé la politique communiste qui n'admet pas d'exception"!
"Il résulte de ce qui précède que la pierre angulaire de la politique de l'Internationale Communiste, dans les questions coloniale et nationale, doit être le rapprochement des prolétaires et des travailleurs de toutes les nations et de tous les pays pour la lutte commune contre les possédants et la bourgeoisie. Car ce rapprochement est la seule garantie de notre victoire sur le capitalisme, sans laquelle ne peuvent être abolies ni les oppressions nationales, ni l'inégalité."
L'application de cette "pierre angulaire" aux situations concrètes exclut clairement tout cas de "patriotisme légitime" et de "'défense nationale". Dans le cas de la guerre en Chine par exemple, quelle autre application peut avoir la règle générale de la "lutte commune des prolétaires et travailleurs de toutes les nations et de tous les pays contre les possesseurs et la bourgeoisie" que celle de la fraternisation entre les soldats chinois et japonais pour la lutte commune contre les possesseurs et les capitalistes chinois et japonais, c'est-à-dire le défaitisme révolutionnaire des deux côtés ? Comment peut-on faire entrer dans cette règle générale, la politique de Trotski de participation dans la lutte militaire sous les ordres de Tchang-Kai-Chek ?
CHANGEMENT DE TACTIQUE, PAS DE PRINCIPE !
Pour nous répondre, Trotski cite le cas de Marx et Engels qui ont soutenu la guerre des Irlandais contre la Grande Bretagne et celle des Polonais contre le Tsar, même si, dans ces deux guerres nationales, les chefs étaient dans la majorité bourgeois et parfois même féodaux. Le problème est que Trotski, malgré ses grandes connaissances, n'a pas compris l'importance primordiale du premier point que les thèses du Second Congrès de TIC qualifient de "clé de voûte de la question nationale" : "une notion claire des circonstances historiques et économiques".
Notre grand historien ex-marxiste ne se souvient-il pas que la tactique communiste ne peut pas être la même dans la phase ascendante du capitalisme (dont il nous cite deux exemples de guerres progressives) et dans sa phase de décomposition, la phase impérialiste, celle que nous vivons actuellement ? Les circonstances historiques et économiques ont changé à un tel point depuis l'époque où Marx et Engels ont soutenu la guerre des Irlandais et des Polonais, que ce serait un suicide pour le prolétariat de suivre aujourd'hui la même tactique qu'à cette époque.
Il est clair que les changements tactiques ne doivent jamais sortir du cadre des principes communistes déjà établis et dont la validité a été vérifiée mille fois par les événements. Loin de sortir de ce cadre, chaque réajustement tactique doit être une application plus correcte, plus rigide de ces principes, parce que ce ne sont pas seulement de nouvelles situations qui nous obligent à effectuer de tels changements mais aussi l'expérience historique c'est-à-dire l'étude de nos erreurs du passé. Ce n'est que comme ça que l'on peut maintenir la continuité de la lutte communiste à travers la décomposition des anciens organismes ouvriers et la création de nouveaux.
LE RENEGAT TROTSKY REVISE LE MANIFESTE COMMUNISTE ET LES THESES DU SECOND CONGRES DE L’IC.
Un des principes fondamentaux qui doit guider toute notre tactique sur la question nationale est l’antipatriotisme. "Les travailleurs n'ont pas" de patrie". Quiconque propose une nouvelle tactique qui aille à rencontre de ce principe abandonne les rangs du marxisme et passe au service de 1'ennemi.
Or, ce qui est intéressant est que le même Trotski qui insiste sur le fait que le prolétariat doit aujourd'hui suivre la même tactique qu'à l'époque de Marx et Engels, abandonne ouvertement le principe déjà affirmé par ces deux hommes dans le Manifeste Communiste ! Dans sa préface à la nouvelle édition du Manifeste Communiste publiée récemment sn Afrique du Sud, ce renégat déclare sans honte : "...Il est bien évident que la "patrie nationale" qui, dans les pays avancés, est devenue le pire "frein historique, reste encore un facteur relativement progressif dans les pays arriérés, ceux qui sont obligés de lutter pour leur existence indépendante".
Ainsi le renégat veut régler sa montré 100 ans en retard ! (Texte inachevé)
Géographique:
- Mexique [36]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 21 - 2e trimestre 1980
- 2836 reads
Révolution ou guerre.
- 2502 reads
Dans le précédent numéro de la "Revue Internationale", nous soulignions l'importance de la décennie qui s'ouvrait et que nous appelions "Les années de vérité". Nous mettions notamment en avant le pas qualitatif que la bourgeoisie était en train d'accomplir dans ses préparatifs vers une nouvelle guerre mondiale :
"D'une certaine façon, les années 70 furent des années d'illusion. Face à la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions Aujourd'hui, la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante, elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise... Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste plus que la fuite en avant. Et, pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre...
Aujourd'hui, avec le constat de la faillite totale de son économie, la bourgeoisie est en train de prendre une conscience plus claire de la situation et agit en conséquence. D'une part, elle renforce encore ses armements... Mais, elle n'agit pas seulement sur le terrain des armements, elle a également entrepris de créer une psychose de guerre afin de préparer l'opinion à ses projets de plus en plus bellicistes".
("Années 80, les années de vérité")
A la suite du battage provoqué autour de la prise d'otages de Téhéran, nous mettions en particulier en évidence l'intensification de la campagne idéologique du bloc occidental et notamment des USA :
"Si un des objectifs des USA dans la crise actuelle est le renforcement de son bloc sur le plan de la cohésion internationale, un autre objectif bien plus important encore réside dans la mise en place d'une psychose de guerre... Depuis longtemps, on n'avait vu se développer un tel torrent d'hystérie guerrière... Auprès d'une population rationnellement peu favorable d l'idée d'une intervention extérieure,... qui, depuis la guerre du Vietnam était échaudée de ce genre d'aventure, les agissements "barbares" de la "République islamique" sont un thème excellent pour les campagnes bellicistes de la bourgeoisie américaine. Si Khomeiny a trouvé dans le Shah un épouvantail efficace pour ressouder l'unité nationale menacée, Carter, qu'il ait voulu délibérément la crise actuelle en laissant entrer le Shah comme il semblerait, ou qu'il l'ait seulement utilisé, a trouvé
C'est en ce sens qu'on ne peut considérer cette intervention comme une simple opération de politique intérieure de l'URSS, uniquement destinée, comme l'ont prétendu certains, à remettre de l'ordre au sein de son bloc ou même au sein de ses frontières face aux désordres provoqués par l'agitation islamique. L'enjeu réel est bien plus important et motivait le prix à payer d'une résistance meurtrière de la part des guérilleros afghans. En réalité, la "pacification des rebelles féodaux" était surtout un prétexte permettant à l'URSS d'améliorer une position militaire et stratégique qui n'avait cessé de se dégrader ces dernières années : profitant de la décomposition de la situation politique en Iran qui, en d'autres temps, avait reçu du bloc US la "mission" de faire le gendarme dans la région, l'URSS a pris le risque d'une crise internationale grave afin de transformer l'Afghanistan en base militaire. C'est pour cela que le battage fait par le bloc occidental, et en premier lieu les USA autour de l'Afghanistan, n'est pas comme c'est le cas pour celui organisé autour des otages de Téhéran, du simple "vent-. Même s'il fait partie, lui aussi, de la campagne idéologique qui avait déjà débuté auparavant, il recouvre une réelle préoccupation du bloc US face à l'avancée russe et traduit donc une réelle aggravation des tensions inter-impérialistes, un pas de plus vers une nouvelle guerre mondiale.
LA CAMPAGNE BELLICISTE DES USA ET DU BLOC OCCIDENTAL
Cependant, malgré la gravité pour le bloc US de l’installation massive des troupes russes en Afghanistan, celui-ci n'a pu rien faire pour l'empêcher. Aujourd'hui, il essaye de compenser et d'utiliser ce recul partiel de sa puissance par une intensification étourdissante de la campagne belliciste afin que, lorsque ce sera nécessaire, il puisse envoyer ses corps expéditionnaires sans craindre les remous intérieurs. Les décisions officielles de Carter de constituer une force d'intervention de 110 000 hommes et de recenser les jeunes en vue d'une éventuelle mobilisation -décisions prises au moment où la campagne était à son paroxysme- sont une expression claire de cette politique de la bourgeoisie. De fait, l'enchaînement des évènements d'Iran et d'Afghanistan permet de faire la constation suivante : tout s'est passé comme si les USA prévoyant l'intervention russe en Afghanistan (les satellites d'observation et les "experts" servent à quelque chose !) avaient sciemment provoqué la prise d'otages de Téhéran en laissant entrer le Shah alors qu'ils avaient été prévenus des réactions que cela pouvait provoquer. Cela leur permettait de laisser pourrir un peu plus la situation en Iran afin d'isoler les éléments extrémistes et d'obliger les "modérés" à reprendre les choses en main en faveur du bloc US (la tournure "antirusse" des évènements étant une garantie par l'intervention de l'URSS contre un pays "frère" en islam). C'est à cela que Bani Sadr s'emploie aujourd'hui.
Mais de plus, les évènements d'Iran permettaient de mettre sur les rails une campagne en deux temps :
- d'abord, on "chauffe" l'hystérie guerrière au nom de la défense de citoyens américains menacés ou de la riposte aux "affronts" infligés à l'honneur de la nation";
- ensuite, au moment où l'URSS entre en action, on relance de plus belle une campagne qui commençait à s'essouffler en désignant cette fois le véritable 'ennemi" : l'URSS (la bourgeoisie US n'avait que faire d'un Khomeiny sinon de l'utiliser comme épouvantail pour la mise en branle de sa campagne).
Même s'il faut se garder d'un trop grand machiavélisme me dans l'analyse des situations politiques, la bourgeoisie étant toujours à la merci d'éléments impondérables, même si l'ensemble de l'opération n'a pas été planifiée avec autant de précisions, il est important de mettre en évidence l'ampleur de la campagne idéologique actuelle qui n'a nullement été improvisée et qui était en préparation depuis plusieurs mois, notamment depuis la "découverte" soudaine et tapageuse à la mi-79 de troupes russes à Cuba qui s'y trouvaient depuis... des années.
Et tout montre que les bourgeoisies des USA et de son bloc ne sont pas prêtes à abandonner cette campagne, qu'elles sont décidées à utiliser au maximum la situation actuelle pour développer la plus grande emprise idéologique possible sur les populations afin de s'assurer de la précieuse "solidarité nationale" nécessaire à toutes les guerres.
C’est ainsi que l'embargo sur les céréales et le boycott des Jeux Olympiques ont une fonction non pas (ou très peu) de pression directe sur l'URSS (qui a acheté ailleurs ce qui lui manquait et qui peut se passer des Jeux Olympiques) mais bien d'entretien de la tension belliciste et de mobilisation des esprits au sein du bloc US. Même si le rôle des révolutionnaires n'est pas de , faire un choix entre les blocs impérialistes, même s'il ne leur appartient pas, comme l'ont fait à une époque Bordiga et ses fidèles, de juger "plus dangereux" l'un que l'autre et "d'estimer préférable la défaite du plus fort" (sic !), il leur revient par contre de dénoncer les mensonges et les dangers des campagnes idéologiques de la bourgeoisie et d'insister plus particulièrement sur les thèmes les plus mystificateurs comme ils l'ont fait notamment entre les deux guerres à propos de l'"anti-fascisme".
Aujourd'hui un des chevaux de bataille du bloc US est sa prétendue "faiblesse" militaire face à une URSS de plus en plus "armée, agressive". En réalité, la "supériorité" militaire du bloc russe est un pur mensonge destiné à la propagande : le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dont les travaux font autorité et qu'on ne peut soupçonner de sympathies pro-russes, parle à ce sujet dans son rapport pour 1979, "d'exercice de propagande particulièrement réussi" de la part des médias des pays occidentaux. C'est vrai que, ces dernières années, les dépenses d'armements de l'URSS et de son bloc n'ont cessé d'augmenter : en 1958, celles de la Russie représentaient 20,3% des dépenses mondiales, en 1978 : 25,5%. Mais, même à cette dernière date, elles étaient encore (très faiblement) inférieures à celles des USA : 25,6%. Par contre, les dépenses totales de l'OTAN représentaient n 1978 42,8% des dépenses mondiales contre 28,6% pour le Pacte de Varsovie soit la moitié plus (chiffres du SIPRI).
Bien que significatives, ces données doivent être complétées par les faits suivants :
1. Elles ne rendent pas compte de l'accumulation d'armements au cours de la période précédente bien plus considérable pour l'OTAN que pour le Pacte de Varsovie (en 1968, les dépenses de l'OTAN représentent 56,2% du total mondial contre 25,3% pour celles du Pacte de Varsovie).
2. Elles ne concernent que les deux alliances militaires officielles et excluent donc des pays comme la Chine (laquelle à elle seule dépense 10,5% du total mondial) qui appartiennent sans conteste au bloc américain, alors que le seul pays important du bloc russe à n'être pas affilié au Pacte de Varsovie est le Vietnam.
3. Elles ne disent rien de la qualité des armements eux-mêmes ni de leur nombre ; or, l'énorme retard technologique de l'URSS sur les USA fait que ses armes sont beaucoup moins perfectionnées, efficaces et fiables, qu'elles coûtent à qualité égale beaucoup plus cher pour être fabriquées et qu'elles demandent à 'puissance égale un nombre bien plus grand d'hommes dans leur mise en œuvre. C'est ainsi que :
- pour un nombre de missiles (terrestres et sous-marins) moins élevé (1700 contre 2400), les USA peuvent lancer entre 2 et 3 fois plus de têtes nucléaires (7700 contre 3100) que l'URSS (une fusée américaine peut emporter jusqu'à 14 charges atomiques) ;
- les 415 bombardiers "stratégiques" américains peuvent larguer 5400 bombes atomiques alors que les 180 bombardiers russes ne peuvent en larguer que 1900 ;
- sur les 12000 ogives nucléaires américaines, 10400 sont sur support mobile (sous-marins et avions) donc pratiquement invulnérables, alors que sur les 5000 ogives russes moins de 3000 sont dans le même cas ;
- pour servir ces arsenaux nucléaires il faut 75000 militaires américains contre presque 400000 militaires russes alors que, contrairement à la légende, l'OTAN a toujours eu plus d'hommes sous les armes que le Pacte de Varsovie, même si l'URSS a plus de soldats que les USA.
Cette énorme supériorité du bloc américain se retrouve également dans le domaine des armements classiques : est-ce un hasard si, avec des armes américaines, Israël a toujours gagné ses guerres contre les pays arabes armés par l'URSS, si, en 1973, ce pays a stoppé au bout de 10 km les 2000 chars syriens lancés sur Haiffa, ces mêmes chars qui équipent le Pacte de Varsovie et dont on agite tellement "la menace contre l'Europe occidentale" ? Ou bien faut-il croire que Jehova est plus fort qu'Allah ?
En réalité, l'écrasante supériorité militaire du camp occidental n'est nullement d'origine mystérieuse. Comme le signalait déjà Engels, la supériorité militaire traduit toujours la supériorité économique. Et celle du bloc de l'Ouest est également écrasante. Qu'on en juge :
- Total pour 1978 des PNB des pays du Pacte de Varsovie : 1 365 milliards de dollars ;
- Total pour les pays de l'Alliance Atlantique : 4 265 milliards de dollars.
Et si on inclut le PNB des autres pays importants (plus de 20 milliards de dollars) du bloc de l'Ouest, on arrive à 6 200 milliards de dollars, alors que le bloc de l'Est se résume au Pacte de Varsovie (faut-il compter les 8,9 milliards de dollars du PNB du Vietnam ou les 3,6 de celui de l'Ethiopie ?).
Encore une donnée : parmi les douze pays économiquement les plus puissants du monde, il n'y en a que deux du bloc de l'Est : l'URSS (3ème rang) et la Pologne (12ème rang) alors que tous les autres sont entièrement intégrés dans le bloc de l'Ouest
Et c'est bien à cause de cette énorme faiblesse économique que l'URSS apparaît comme la puissance "agressive" dans la plupart des conflits locaux. Comme ce fut le cas de l'Allemagne en 1914 et
en 1939, c'est le pays qui a été le plus mal servi dans le partage d'un gâteau impérialiste déjà. trop restreint qui a tendance à vouloir remettre en cause ce partage.
C'est là une constante de la période de décadence du capitalisme qui traduit à la fois le caractère inéluctable de la guerre impérialiste et son absurdité du simple point de vue économique bourgeois (sans parler de son absurdité pour l'humanité).
En effet au siècle dernier, au moment du capitalisme ascendant, les guerres pouvaient avoir une réelle rationalité et notamment les guerres coloniales. Certains pays pouvaient se lancer dans des opérations guerrières en ayant la garantie que cela rapporterait sur le plan économique (nouveaux marchés, matières premières, etc.). Par contre, les guerres du 20ème siècle traduisent l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Le monde étant entièrement partagé entre grandes puissances impérialistes, les guerres ne peuvent signifier la conquête de nouveaux marchés, donc d'un nouveau champ d'expansion pour le capitalisme. Elles aboutissent à un simple repartage des marchés existant qui ne s'accompagne nullement d'une possibilité plus grande de développement des forces productives mais au contraire d'une destruction massive de celles-ci dans la mesure où :
- elles mettent aux prises non des pays avancés et des pays arriérés, mais les grandes puissances entre elles, ce qui suppose un niveau d'armement et de destruction bien plus élevé ;
- elles ne peuvent par ce fait être et rester localisées mais débouchent sur des boucheries et des destructions à l'échelle planétaire.
Ainsi, les guerres impérialistes apparaissent comme une pure aberration pour l'ensemble du capitalisme et ce caractère absurde se manifeste entre autres dans le fait que c'est le bloc qui, parce que le plus faible économiquement, est condamné à "perdre" la guerre (si tant est qu'il y ait un "gagnant"), qui pousse le plus vers la guerre. Cette conduite "suicidaire" du futur vaincu ne traduit, quant à elle, nullement une "folie" de ses dirigeants mais bien le caractère inévitable de la guerre impérialiste dans le capitalisme décadent, l'engrenage inéluctable qui échappe à tout contrôle de la part des classes dominantes et des gouvernements. La course au suicide des puissances dites "agressives" ne fait que résumer la course au suicide de l'ensemble du capitalisme.
Le fait que ce soit l'impérialisme le plus "belliqueux" qui, en général, soit vaincu permet, après les guerres, de donner un semblant de crédibilité aux mascarades sur les "réparations" et les procès de "criminels de guerre" et de "responsables" de l'holocauste (comme si tous les gouvernements, tous les partis bourgeois, tous les militaires n’étaient pas criminels, n'avaient pas de responsabilité dans les orgies de meurtres, dans les massacres industriels des guerres impérialistes), alors que par ces mascarades, l'impérialisme vainqueur dissimule en réalité sa tentative de "rentabiliser" ses propres dépenses militaires de même que sa tentative de mettre en place a la tête des pays vaincus un personnel politique qui soit favorable à ses intérêts.
Tout est bon pour la propagande bourgeoise : les morts d'Auschwitz servent à justifier ceux de Dresde et d'Hiroshima, ceux du Vietnam font accepter ceux de l'Afghanistan, les massacres passés servent à préparer les futurs massacres. De même, les dépenses d'armement (réelles ou exagérées) et les menées impérialistes du bloc "ennemi" servent à faire avaler, avec l'austérité qui en résulte, les dépenses de "son" propre bloc, ses menées impérialistes et à préparer la "solidarité nationale" nécessaire à un nouvel holocauste.
Autant les révolutionnaires se doivent de dénoncer (comme nous l'avons toujours fait dans nos publications) les mystifications accompagnant la politique impérialiste du bloc de l'Est, notamment le mythe des "libérations nationales", autant il leur appartient donc de démasquer l'hypocrisie des campagnes idéologiques du bloc de l'Ouest.
LE PARTAGE DES TACHES ENTRE SECTEURS DE LA BOURGEOISIE
Nous avons amplement mis en évidence dans la Revue Internationale (n°20) des facettes essentielles de' l'offensive idéologique présente des bourgeoisies du bloc américain en vue de la guerre impérialiste la création d'une psychose de guerre destinée à démoraliser les populations, à leur faire accepter avec fatalisme et résignation la perspective d'une nouvelles guerre mondiale. De même, nous venons d'examiner une autre facette de cette offensive : le développement d'un sentiment "antirusse" pour lequel les mensonges sur les niveaux d'armement se combinent aux campagnes sur les "droits de l'homme" et autre boycott des Jeux Olympiques. Ce n'est encore là qu'un tableau incomplet des moyens que met en œuvre la bourgeoisie des pays occidentaux pour préparer les populations et notamment les classes exploitées au "sacrifice suprême". Il faut y ajouter une campagne moins tapageuse mais cependant plus insidieuse et dangereuse : celle qui vise plus spécifiquement la classe ouvrière.
Derrière le premier type de campagnes de la bourgeoise, on trouve essentiellement les partis de droite et du centre dont le langage consiste à en appeler l'ensemble des citoyens "pour qu'ils réalisent "l'unité nationale" en vue des dangers qui "menacent la patrie" ou "la civilisation". Derrière la création d'une phobie "antirusse" qui complète le premier type de campagnes, on trouve les mêmes partis auxquels viennent se joindre les partis sociaux-démocrates aux arguments plus nuancés et moins hystériques mais qui ne perdent pas une occasion de dénoncer le stalinisme et les violations des droits de l'homme en Europe de l'Est. Bien entendis les partis "communistes", quant à eux, ne participent pas, directement à ce volet de la campagne idéologique malgré les con damnations de certains agissements de l'URSS qu'ils sont obligés de faire pour se dédouaner auprès de la bourgeoisie et de "l'opinion" de leurs pays respectifs.
Par contre, il est un aspect de l'offensive idéologique de la bourgeoisie qui met côte à côte les partis dont la fonction spécifique est l'encadrement de la classe ouvrière : les PC et les PS. Le langage tenu par la gauche du capital se présente comme l'opposé de celui tenu par la droite et en constitue en fait le-complément. Ce langage consiste à dénoncer les campagnes alarmistes de la droite et à affirmer qu'il n'y a pas de véritable danger de guerre dans la période actuelle. On peut même voir dans certains pays (comme la France) la gauche unanime dire clairement que la campagne alarmiste de la droite a pour fonction de détourner l'attention des travailleurs et imposer un surcroît d'austérité.
Ce langage des partis de gauche est évidemment lié au fait que, à l'heure actuelle, ils sont conduits à assumer dans l'opposition leur fonction capita- liste afin de mieux pouvoir saboter de l'intérieur les luttes ouvrières qui tendent à se développer. N'ayant pas ou plus de responsabilités gouvernementales, ils n'ont plus la charge de créer "l'unité nationale" autour des dirigeants du pays ([1] [38]) mais bien de radicaliser leur langage afin de tenter de gagner la confiance des prolétaires pour être en mesure de les orienter vers des impasses et épuiser leur combativité.
Cependant ce n'est pas seulement pour cette seule raison que les partis de gauche tiennent aujourd'hui des discours apaisants. En réalité, ce langage a pour fonction de combler les lacunes contenues dans la campagne idéologique de la droite. Celle-ci, en effet, tente d'asséner avec beaucoup de force une vérité partielle : la guerre est inévitable (sans préciser évidemment que c'est dans le cadre du capitalisme qu'existe une telle fatalité) dans le but de démoraliser et pousser à la résignation l'ensemble de la population, de lui faire accepter les sacrifices présents au nom de la préparation des sacrifices encore plus durs qui s'imposeront dans le futur. Mais cette demi-vérité comporte l'inconvénient de reconnaître avec clarté l'impasse totale dans laquelle se trouve aujourd'hui la société capitaliste. Dans certaines parties de la population, et notamment le prolétariat, classe naturellement la plus portée à remettre en cause le système, cette propagande risque de contribuer à un but contraire à celui qu'elle se fixe : la compréhension de la nécessité d'affronter massivement le capitalisme pour arrêter sa main criminelle et le détruire. La campagne d'apaisement promue par la gauche a pour fonction de permettre au capitalisme de couvrir tout le champ de la mystification, de ne pas laisser de failles dans lesquelles pourrait s'engouffrer la prise de conscience de la classe ouvrière.
Déjà la gauche et la droite s'étaient ainsi partagé le travail à propos de la crise économique : la droite affirmant qu'elle était de nature internationale, qu'il n'y avait rien à faire et qu'il fallait se résoudre à l'austérité, la gauche rétorquant qu'elle était le résultat d'une mauvaise politique, des menées cupides des monopoles et des multinationales et qu'il y avait moyen de la résoudre en mettant en place une autre politique réellement conforme à "l'intérêt national et des travailleurs". Ainsi, la droite appelait déjà à la résignation, à l'acceptation sans résistance de l'austérité alors que la gauche se donnait comme tâche de dévoyer le mécontentement ouvrier vers les impasses électorales de "l'alternative de gauche" (gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, gouvernement d'Union de la gauche en France, compromis historique en Italie, etc.).
Cette division du travail entre droite et gauche en vue de soumettre l'ensemble de la société, et en premier lieu la classe ouvrière aux exigences du capitalisme n'est pas nouvelle. Elle a été appliquée dès avant la première guerre mondiale dans la campagne de préparation idéologique de celle-ci. Alors que la droite du capital agitait le plus fort le grelot du "patriotisme" et appelait ouvertement à la guerre contre "l'ennemi héréditaire", les secteurs opportunistes et réformistes des partis de la 2ème Internationale qui impulsaient leur passage dans le camp du capitalisme, n'avaient de cesse, tout en dénonçant les campagnes d'hystérie chauvine, de minimiser les dangers de guerre. Alors que la gauche de l'Internationale (notamment Lénine et Rosa Luxemburg) insistait sur le caractère inévitable de la guerre impérialiste dans la logique même du capitalisme, sur la nécessité d'une mobilisation massive des ouvriers pour ne pas lui laisser les mains libres et pour préparer sa destruction, les secteurs de droite, dont l'influence allait grandissante, développaient des théories sur la possibilité d'un capitalisme "pacifique", qui serait capable de résoudre les conflits entre nations par "l'arbitrage". Tant que la classe ouvrière s'est mobilisée, notamment sous la forme de manifestations de masse lors des divers conflits qui ont éclaté au début du siècle (heurts franco-allemands à propos du Maroc, conflits dans les Balkans, invasion de la Tripolitaine par l'Italie, etc...), tant que l'influence de la gauche de L'Internationale a été déterminante en son sein (motions spéciales contre la guerre aux Congrès de 1907 et 1910, Congrès Extraordinaire en 1912 sur cette même question), la bourgeoisie n'a pas pu laisser dégénérer ces conflits en guerre généralisée. Ce n'est qu'au moment où la classe ouvrière, endormie par les discours des opportunistes, cesse de se mobiliser face à la menace de guerre (entre 1912 et 1914) que le capitalisme peut déchaîner la guerre impérialiste à partir d'un incident (l'attentat de Sarajevo) en apparence bénin par rapport aux précédents.
Ainsi la préparation idéologique à la guerre mondiale n'est pas seulement le fait du développement de l'hystérie chauvine et belliciste. Elle comporte également des discours pacifistes et lénifiants plus spécifiquement tenus par les forces politiques qui ont le plus d'impact au sein de la classe ouvrière afin de démobiliser celle-ci, de lui faire perdre de vue le véritable enjeu de la situation, de la livrer pieds et poings liés, impuissante, aux gouvernements bourgeois et à cette hystérie belliciste, en bref, de l'empêcher de jouer son rôle de seule force en mesure d'empêcher la guerre mondiale. La mobilisation pour la guerre impérialiste passe par la démobilisation du prolétariat de son terrain de classe.
QUELLE PERSPECTIVE : GUERRE OU REVOLUTION ?
On peut donc constater que l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS et ses prolongements expriment et accentuent l'accélération de la marche vers la guerre impérialiste généralisée, seule réponse que le capital puisse donner à sa crise. Faut-il déduire de cette constatation la nécessité de remettre en cause l'analyse que le CCI depuis sa constitution a développée sur le cours historique, sur le fait que la perspective présente n'est pas celle d'un affrontement impérialiste généralisé mais celle d'affrontements massifs entre classe ouvrière et bourgeoisie ?
La réponse est non. En fait, la détermination avec la- quelle la bourgeoisie s'est attelée à la préparation idéologique en vue de la guerre mondiale indique à elle seule qu'aujourd'hui, les conditions subjectives d'un tel aboutissement de la crise capitaliste ne sont pas réunies. Pour certains, si la guerre mondiale n'a pas encore eu lieu, c'est que les conditions objectives -situation économique, préparatifs militaires, etc - n'existeraient pas encore. Telle est la thèse défendue, par exemple, par le Parti communiste International (Programme Communiste). En réalité, si on compare la situation présente, à celle existant en 1939 ou en 1914, on peut constater que, tant du point de vue de la gravité de la crise, que du niveau des armements, que du renforcement des alliances militaires au sein de chaque bloc, les conditions sont aujourd'hui beaucoup plus mûres pour une nouvelle guerre mondiale. La seule donnée manquante, mais décisive est l'adhésion de la classe ouvrière aux idéaux bourgeois, sa discipline à l'égard du capital national, sa soumission aux intérêts de celui-ci. Ce sont cette adhésion, cette discipline, cette soumission qui existent en 1939 à la suite de la plus terrible défaite subie par sa classe ouvrière au cours de l'histoire; défaite d'autant plus terrible que jamais comme à la fin de la première guerre mondiale, le prolétariat ne s'était élevé aussi haut; défaite à la fois physique et idéologique avec son cortège de massacres mais aussi de mystifications, notamment sur la nature soi-disant socialiste de la Russie, son cortège de défaites présentées comme des victoires. Ce sont des conditions similaires qui existent en 1914 bien que la défaite de la classe soit moins profonde qu'en 1939, ce qui permet le resurgissement de 1917-18. Cette défaite est essentiellement idéologique. Elle se manifeste par la gangrène opportuniste qui gagne peu à peu la 2ème Internationale jusqu'à aboutir, en 1914 à la trahison de la plupart des partis qui la composent. En passant à l'ennemi, ces partis, ainsi que les organisations syndicales, parce qu'ils ont encore l'oreille et le cœur du prolétariat, jettent celui-ci pieds et poings liés en pâture aux appétits impérialistes de la bourgeoisie, l'entraînant dans la "défense nationale" et la "défense de la civilisation". Et cet embrigadement du prolétariat derrière son capital national est d'autant plus facile que ne se développent pas avant 1914 (à l'exception de la Russie) des luttes de classe importantes, du fait que la crise économique aiguë n'a pas le temps de s'approfondir vraiment avant son issue guerrière.
Toute autre est la situation présente où les mystifications qui ont permis la 2ème guerre mondiale, notamment l'antifascisme et le mythe du socialisme en URSS ont fait long feu, où la croyance en un progrès incessant de la "civilisation" et de la "démocratie" telle qu'elle existait en 1914 à fait place, après plus d'un demi-siècle de décadence du système à un dégoût généralisé, où les partis de gauche, pour avoir trahi depuis trop longtemps, n'ont plus sur la classe ouvrière l'impact qui était le leur en 1914 ou dans les années 30, où l'enfoncement progressif du capitalisme dans la crise à partir du milieu des années 60 a provoqué une reprise historique des luttes de classe. Ainsi, au lieu d'annoncer au sont faits", que, quoi qu'il fasse le déclenchement d'un nouvel holocauste, il importe que les révolutionnaires lui indique clairement que la situation historique est encore entre ses mains que de lui dépend, et de ses luttes que l’humanité soit écrasée ou non sous un déluge de bombes thermonucléaires ou même qu'elle périsse.
Cependant, il n'existe pas de situation acquise de façon définitive. Si aujourd'hui, la voie n'est pas libre pour la réponse bourgeoise à la crise, il ne faudrait pas croire que rien ne peut remettre en cause une telle situation, que le cours historique ne peut pas être renversé. En réalité, le cours qu'on pourrait appeler "normal" de la société capitaliste est vers la guerre. La résistance de la classe ouvrière qui peut éventuellement remettre en cause ce cours apparaît comme une sorte "d'anomalie", comme allant à "contre-courant" d'un processus organique du monde capitaliste. C'est pour cela, que, si on examine les 8 décennies de notre siècle, on en trouvera à peine un peu plus de deux, au cours desquelles le rapport de forces aura été suffisamment en faveur du prolétariat, pour qu'il puisse barrer le chemin à la guerre impérialiste (1905-12, 1917-23, 1968-80).
Pour l'heure, le potentiel de combativité de la classe, qui s'est révélé à partir de 1968, n'a pas été détruit. Mais il est nécessaire d'être vigilant (et les évènements d'Afghanistan nous rappellent cette nécessité) car :
- plus la réponse du prolétariat sera lente face à la crise et moins il sera expérimenté et préparé au moment des affrontements décisifs avec le capitalisme
- alors que le chemin de la victoire est unique pour le prolétariat : l'affrontement armé et généralisé contre la bourgeoisie, celle-ci dispose de divers moyens pour défaire son ennemi : soit en épuisant la combativité dans des impasses (c'est la tactique présente de la gauche), soit en l'écrasant paquet par paquet (comme en Allemagne entre 1918 et 1923), soit en l'écrasant physiquement lors d'un choc frontal (qui est toutefois le type d'affrontement le plus favorable au prolétariat).
Cette vigilance que la classe ouvrière doit conserver et auxquels les révolutionnaires doivent contribuer de leur mieux, passe par la compréhension la plus claire possible du véritable enjeu de la situation présente, des luttes qu'elle mène aujourd'hui. Cette contribution ne saurait donc consister, ni dans l'affirmation qu'il n'y a rien à faire face à la menace de guerre impérialiste (les révolutionnaires se faisant alors les auxiliaires de la campagne - de démoralisation menée par la droite), ni qu'il n'y a aucun danger réel de guerre impérialiste, de renversement du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat (leur "contribution" apportant alors de l'eau au moulin de la gauche). Si les révolutionnaires se doivent donc de dénoncer aussi bien les campagnes de la droite que celles de la gauche, ce n'est donc nullement pour prendre leur simple contrepied mais bien pour retourner les divers arguments contre leurs promoteurs :
- c'est vrai qu'il n'y a pas d'issue à la crise et que la guerre menace comme dit la droite...
- c'est vrai, comme dit la gauche que la campagne alarmiste est utilisée pour imposer plus d'austérité... dans un cas comme dans l'autre, c'est une bonne raison, non pour s'y résigner, mais au contraire pour engager le combat de résistance contre l'austérité, prélude à la lutte pour la destruction de ce système. Dans les combats à venir de la classe ouvrière, une compréhension claire de leur enjeu véritable, du fait qu'ils ne constituent pas une simple résistance au coup par coup contre les agressions croissantes du capital mais qu'ils sont le seul rempart contre la menace de guerre impérialiste, qu'ils sont les préparatifs indispensables en vue de la seule issue pour l'humanité : la révolution communiste, une telle compréhension de l'enjeu sera la condition tant de leur efficacité immédiate que de leur aptitude à servir réellement de préparatifs pour les affrontements décisifs.
Par contre, toute lutte qui se cantonne sur le terrain strictement économique, défensif contre l'austérité sera plus facilement défaite, tant au niveau immédiat que comme partie d'une lutte beaucoup plus vaste. En effet, elle se sera privée du ressort de cette arme, aujourd'hui si importante pour les travailleurs qu'est la généralisation et qui s'appuie sur la conscience du caractère social et non pas professionnel du combat de la classe. De même, par manque de perspectives, les défaites immédiates seront surtout un facteur de démoralisation au lieu d'agir comme éléments d'une expérience et d'une prise de conscience.
Pour que la nouvelle vague de luttes qui s'annonce aujourd'hui ne soit pas épuisée par les manœuvres de la gauche et des syndicats -ce qui laisserait le champ libre à l'issue" guerrière de la crise- mais, au contraire, constitue une étape vers l'assaut révolutionnaire pour le renversement du capitalisme, elle devra comporter les trois caractéristiques suivantes absolument liées entre elles :
- un rejet du carcan syndical et une prise en main directe par la classe de ses intérêts et de son combat
- l'utilisation de façon croissante de l'arme de la généralisation, de l'extension au delà des catégories, des entreprises, des branches industrielles, des villes et des régions, et finalement, au delà des frontières nationales
- une prise de conscience des liens indissolubles qui existent entre les luttes contre les mesures d'austérité, la lutte contre la menace de guerre et la lutte pour la destruction de cette société moribonde et barbare en vue de l'instauration de la société communiste.
F.M
[1] [39] Là où la gauche est encore au gouvernement, son attitude n'est évidemment pas aussi claire. On peut même voir en Belgique le ministre socialiste des Affaires étrangères tenir un langage alarmiste alors que son collègue, également socialiste, des affaires Sociales tient le langage contraire.
Questions théoriques:
- Décadence [2]
- Le cours historique [3]
Le gauchisme en France depuis 10 ans
- 8171 reads
Depuis mai 68, en France, le mouvement gauchiste a subi de nombreuses transformations. Si 1969 a été l'année de pointe de son renforcement, les années qui vont suivre vont voir un relatif recul de l'influence de certains groupes gauchistes et le développement d'une certaine crise qui va se manifester de façon différente suivant les courants.
LE MOUVEMENT MAOISTE (DIT MARXISTE LENINISTE)
Contrairement au courant trotskyste qui est issu d'une tradition prolétarienne passée dans le camp bourgeois lors de la seconde guerre mondiale, le courant maoïste est directement un avorton de la contre-révolution. Issu du PCF au milieu des années 60, sur la base de la détérioration des rapports entre le capitalisme russe et le capitalisme chinois, le mouvement "pro-chinois" n'a jamais rompu avec une seule des positions contre-révolutionnaires du PCF; il prôna même un retour aux enseignements de Staline et un alignement derrière l'Etat bourgeois de Mao.
En 1969, deux groupes maoïstes principaux existaient : la Gauche Prolétarienne qui se dissoudra trois ans plus tard et le P.C.M.L.F. (Parti Communiste marxiste léniniste de France). Depuis une dizaine de ruptures ont ponctué la vie du mouvement maoïste en France et aujourd'hui (début 80), quatre groupes importants existent encore : le P.C.M.L. (Parti Communiste Marxiste Léniniste), le P.C.R. ml (Parti Communiste Révolutionnaire marxiste léniniste), l'UCFML. (Union Communiste de France marxiste léniniste) et l'O.C.F.ml (Organisation Communiste de France marxiste léniniste. Drapeau Rouge). Il faut ajouter à ces groupes une dizaine de petits cercles locaux dont certains "pro-albanais" comme le P.C.O.F. (Parti Communiste des Ouvriers de France) qui publie le journal "la Forge". Mais, en fait le courant maoïste a subi depuis dix ans un important déclin numérique et une crise quasi-permanente qui sont le produit d'un certain nombre de contradictions politiques propres à un courant bourgeois sans grande expérience et lié à l'évolution de la politique de l'Etat chinois. Cette crise a été le produit de la réduction croissante du champ d'intervention et de mystification des groupes maoïstes coincés entre un fort mouvement trotskyste, un puissant parti stalinien et une Social-Démocratie en pleine expansion depuis l'après-mai 68.
Plus précisément, les facteurs d'affaiblissement des groupes maoïstes relevant de l'évolution de la lutte de classe et de la situation internationale ont été :
1. Le développement de la mystification du "Programme Commun du PC et du PS" que les maoïstes n'ont pas soutenu. Ils conciliaient ouvertement avec la droite et même l'extrême droite sur les questions de la défense nationale (propagande antirusse, soutien à la force de frappe atomique, dénonciation du mouvement antimilitariste, soutien de l'impérialisme français). On pouvait ainsi lire dans "L'Humanité Rouge" (journal du P.C.M.L.F.) :
"Le gouvernement actuel, tout en maintenant le principe de la défense nationale est incapable de mobiliser les masses populaires en raison du caractère oppresseur et réactionnaire de sa politique intérieure.
Quant au "Programme Commun" qui représente la tendance montante de la bourgeoisie, il est extrêmement dangereux car tout en prétendant renforcer la défense nationale, il passe complètement sous silence le danger soviétique". (Humanité Rouge n°240, sept.74).
Et aussi :
"Quant d nous aujourd'hui plus que jamais, nous appelons les travailleurs, la jeunesse d agir pour le renforcement de la défense nationale..." (Humanité Rouge n°309, juil.75)
Le maoïsme sapa ainsi les bases de son influence en se dévoilant trop rapidement et trop ouvertement comme une officine nationaliste directement au service de la bourgeoisie et du bloc américain.
2.L'abandon d'un anti-syndicalisme verbal par la plupart des groupes maoïstes va contribuer à effacer complètement le mythe maoïste : en effet, le verbiage antisyndical a été un des principaux facteurs de l'influence des groupes maoïstes. En mai 68 et puis après, de nombreux ouvriers conscients du sabotage syndical se sont ainsi tournés vers des groupes comme la GP qui appelait à "pendre les bureaucrates syndicaux", ou comme le P.C.M.L.F. qui appelait à la constitution de "syndicats de base" et dénonçait la C.G.T. comme "social-fasciste". Cette démagogie utile pour dévoyer les ouvriers dans une période de lutte devenait inutile au moment du reflux des luttes à partir du début des années 70. Les maoïstes n'avaient alors pas de politique de rechange.
3.L'intégration de plus en plus ouverte de la Chine dans le bloc américain (rappelons que les groupes maoïstes en France ont surgi essentiellement sur la base du soutien au Vietnam contre les USA et d'une critique des capitulations de la Russie face aux USA).
4.Les remaniements politiques au sein de l'Etat chinois survenus notamment après la mort de Mao. (liquidation de la "Bande des quatre", ré émergence de Teng Hsiao Ping que tous les groupes maoïstes avaient traîné dans la boue).
Tous ces facteurs ont ainsi contribué à une dispersion des maoïstes dans des voies aussi diverses qu'impénétrables : de l'abandon du militantisme pour entrer dans la voie du marginalisme mais aussi _du journalisme (Libération), de la philosophie( la "nouvelle philosophie", aujourd'hui ouvertement de droite), du semi-terrorisme (NAPAP), de l'autonomie spontanéiste ("Camarades") et même de quelques tentatives de rejoindre le terrain prolétarien comme l'a exprimé la constitution de l'Organisation Communiste "Le Bolchevik" qui donnera naissance à L'Eveil Internationaliste et à la Gauche Internationaliste à travers une série de ruptures.
Depuis l'échec du "Programme Commun" et la reprise de la lutte prolétarienne, les principaux groupes maoïstes (P.C.M.L.F. et P.C.R.ml.) ont accéléré le changement de cap qu'ils avaient opéré dans le milieu des années 70 en abandonnant les aspects un peu trop "radicaux" de leurs interventions. Ils ont maintenant opté pour une attitude plus conciliante avec les syndicats et les partis de gauche. Ces derniers ont assoupli eux aussi leur attitude à l'égard des gauchistes en général.
Ce tournant du courant maoïste a été clairement exprimé au début de 1978 par le P.C.M.L.F. à l'occasion du 40ème Congrès de. la C.G.T. dont "l'ouverture démocratique" fut saluée. Par ailleurs la décision du P.C.M.L.F. et du P.C.R.ml de présenter une liste commune aux élections de mars 78 fut une façon de revaloriser un électoralisme qu'ils n'avaient cessé de dénoncer auparavant chez les partis de gauche et les trotskystes. Enfin, au lendemain de ces élections le P.C.M.L.F, développait la perspective d'un travail d'"explication en direction des électeurs, des militants de base, ouvriers, employés, petits paysans du P.S. et du P.C.F. en liaison avec, une poursuite des indispensables luttes de classe pour la défense des revendications les plus immédiates" (HR n°851,mars 78).
Fin 1978, le P.C.M.L.F. opèrera même une autocritique de ses positions trop chauvines de soutien à l'impérialisme français notamment leur soutien à l'intervention française au Zaïre.
Par rapport à la montée des luttes ouvrières il n'est pas inintéressant de relever dans la presse maoïste le renforcement d'une perspective d'unité à la base" dans les luttes sur le terrain de l'encadrement syndical. Cette perspective confirme le rapprochement de plus en plus prononcé des groupes maoïstes vers les vieilles tactiques trotskystes de sabotage des luttes. Sous le titre "Qu'est-ce donc que l'unité à la base ?", le P.C.M.L.F. expliquait fin 1979 : "la réalisation de l'unité à la base exige des compromis...aussi en .tant qu'individu ou représentant d'une force politique organisée ou d'une section syndicale, chaque contractant doit renoncer d agir unilatéralement. Dans l'action unie, il ne doit pas populariser ses seules idées, le seul programme de son seul parti ou de son seul syndicat... De la même façon, je n'accepte pas que des militants d'autres forces politiques 'récupèrent' notre action commune en essayant de la dévier sur leur propre programme de parti..." (HR n°1133). On ne peut être plus explicite. Au même titre que les staliniens du P.C.F. et que les trotskystes, les maoïstes se préparent ouvertement à briser toute tentative d'organisation autonome de la classe dans les luttes.
Plus précisément, les groupes maoïstes, à part le petit groupe de l'U.C.F.M.L., ont réintégré pleinement les appareils syndicaux et notamment la C.F.D.T. Pourtant, aujourd'hui que la gauche divisée assume un rôle d'opposition plus marqué, une hésitation semble traverser le mouvement maoïste dont la logique consiste à se retrouver avec la Social-Démocratie contre le P.C.F., et plus particulièrement derrière le tandem Maire-Rocard (le dirigeant de la C.F.D.T. et le "nouvel homme" de la Social-Démocratie). C'est cette perspective qu'énonce très clairement le petit groupe O.C.F.ml.: "En vérité, l'échec politique et économique de la droite, mais surtout la faillite profonde en quelque sorte idéologique aussi bien des partis de la vieille droite que des partis de la fausse gauche exigent une alternative neuve et nette : une force révolutionnaire antitotalitaire. Les prémisses de l'émergence de cette force apparaissent aussi bien dans les conditions même de la bonne tenue de la C.F.D.T. lors des élections prudhommales que dans le succès d'estime de Michel Rocard dans l'opinion" (Drapeau Rouge n°72, déc.79). Dans le même journal, l'O.C.F.ml. dans un article intitulé "Les gauchistes rejoindront-ils le P.C.F. ?" exprime ses craintes de voir les gauchistes se mettre à la remorque d'un P.C.F. qui se lance aujourd'hui dans une activité "radicale" liée à la nécessité de contrôler et d'encadrer la remontée des luttes ouvrières ; elle cite en exemple un extrait d'une lettre d'un militant syndical publiée dans l'Humanité Rouge et qui explique : "il y a même des camarades, qui pensent que le P.C.F. est mieux que notre parti (le P.C.M.L.F.) et qui nous quittent sur cette base. Faute d'analyse sérieuse, j'ai bien peur que le parti se cantonne à être simplement une force d'appoint au service de la ligne actuelle P.C.F./C.G.T.".
Et l'O.C.F.ml. de rappeler à cette occasion l'alignement du P.C.F. derrière le bloc russe et la nécessité de renforcer le camp du "socialisme démocratique", en clair le camp Social-Démocrate et l'alignement derrière le bloc américain.
Sur le plan international en effet, la plupart des groupes maoïstes tente de suivre de façon plus ou moins cohérente l'évolution de la Chine et de se mettre au diapason de la propagande antirusse du bloc occidental. A plusieurs reprises, les groupes maoïstes français ont soutenu ouvertement les manœuvres du bloc américain. Pour eux, l'impérialisme russe est l'ennemi principal et cela explique leur propagande belliciste. Ainsi, le n°65 de Drapeau Rouge de 'septembre 79 reproduisait une publicité du journal Le Monde sur le livre du Général Hackett "La Troisième Guerre Mondiale" et expliquait dans un article intitulé "Défense : armer le peuple" : "En Europe et en France, la conscience des périls et des réalités semble mieux perçue (qu'aux USA) dans les cercles bourgeois, et même si le doute et l'indécision y règnent, il s'y manifeste également la volonté de faire face et de s'opposer au danger de guerre russe". Quelques moïs auparavant, ce même groupe reprochait au bloc américain sa faiblesse lors du conflit sino-vietnamien : "Carter en arrive même à céder à cette pression militaire et politique. Il vient de déclarer à un moment où tout le monde parle des préparatifs de guerre de l'URSS contre la Chine : "il n'y a pas de doute dans mon esprit que les soviétiques veulent la paix'" (DR n°54, mars 79). Dans ce même article, l'O.C.F.ml. soutenait en ces termes l'attaque de la Chine contre le Vietnam :
"La Chine est dans son bon droit ! Elle vient simplement de rappeler qu'elle ne cède pas aux menaces du petit hégémonisme soutenu par l'URSS. Munich en 1938 a défia prouvé que toute politique de faiblesse était en fait un encouragement à l'agression".
D'une façon plus large, lorsque les groupes ne soutiennent pas explicitement l'impérialisme occidental, le soutien implicite aux options européennes bénies par Washington montre clairement l'optique pro-occidentale de tous les groupes maoïstes. L’U.C.F.M.L., petit groupe "marginal", n'a pas soutenu l'agression chinoise au Vietnam : "L'entrée, des troupes chinoises sur le territoire vietnamien n'est justifiée ni par les provocations vietnamiennes à la frontière, ni par l'invasion du Cambodge par les Vietnamiens, ni par l'inféodation du Vietnam au social-impérialisme russe". Ce groupe a consacré dans le n°36 de son journal (Le Marxiste-Léniniste) un long article défendant l'idée d'une Europe réunifiée Est-Ouest, contre les deux "superpuissances", une "Europe des peuples". Très vite, le groupe admet que l'alliance Chine-USA est "inévitable" et il expliquait fin 78 à propos des menaces de guerre impérialiste : "Sur la question de la guerre, le prolétariat ne peut se contenter d'une attitude passive. En la matière, le pacifisme est la garantie du désastre. Quand le P.C.F. au tout début de la guerre de 39-45 a refusé de prendre la tète de la résistance d l'envahisseur nazi, il a commis une faute dramatique, chèrement payée par la suite, malgré l'héroïsme des F.T.P. Laisser à De Gaulle le soin d'incarner la résistance, c'était laisser une chance à la bourgeoisie, massivement capitularde, de se reconstituer" (Le Marxiste-Léniniste n°31).
C'est de la même tradition patriotarde que se réclame le groupe "pro-albanais" P.C.O.F.. Il dénonce les préparatifs de guerre en renvoyant dos à dos le P.S. et le P.C.F., "complices de la fascisation du régime". Cette pseudo-dénonciation s’inscrit dans la logique "antifasciste" et le P.C.O.F. en fait tente à son échelle minuscule de ressortir les vieux mythes qui servirent au P.C.F. pour préparer et embrigader le prolétariat dans la 2e Guerre Mondiale. En assimilant guerre et fascisme, le P.C.O.F. complète à sa façon la panoplie mensongère du maoïsme. Ainsi, c'est de A à Z, avec une constance imperturbable, que le maoïsme défend les positions bourgeoises.
Mais faute d'une réelle influence dans la classe ouvrière, le courant maoïste a peu de perspectives propres d'un nouveau développement par rapport au courant trotskyste qui reste le "fer de lance" du gauchisme en France.
LE MOUVEMENT TROTSKYSTE
Il est la force centrale de l'extrême-gauche du capital en France. La LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE (LCR), LUTTE OUVRIERE (LO) et l'ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALISTE (OCI) se partagent depuis mai 68 la plus grande part du travail mystificateur réservé au gauchisme.
Les groupes trotskystes, contrairement aux maoïstes, ont été moins affectés par les crises et les scissions dans la période de recul de la lutte prolétarienne. Il y a pourtant eu un net phénomène de crise larvée qui s'est traduit par une "crise" de militantisme dans un groupe comme la LCR, par un net recul organisationnel de l'OCI et par un affaiblissement de la phraséologie politique de LO qui avait fait figure à une époque de groupe "pur" et "radical". En fait, la cause profonde de ces phénomènes a été l'alignement de ces trois groupes derrière l'Union de la Gauche (PC, PS, Radicaux de Gauche) et leur intégration rapide dans le jeu électoral.
Cette orientation du mouvement trotskyste va provoquer une série de petites scissions "de gauche" qui vont réagir contre une politique trop suiviste et trop ouvertement anti-prolétarienne. Ainsi, le petit groupe de la LIRQUI (aujourd'hui Ligue Ouvrière Révolutionnaire - LOR), après avoir scissionné de l'OCI expliquait lors des élections du printemps 74 : "Le récent ralliement 'sans ambigüité pour la victoire de Mitterrand de la part de l'OCI est l'un des faite politiques les plus importants actuellement. Ce ralliement signifie un reniement complet de toute la lutte passée de la 4ème Internationale en France. Parce que c'est ni plus ni moins dans les faits que le ralliement au Front Populaire. Il s'agit là d'une capitulation éhontée et sans conditions" (Bulletin n°4). Quant à la Ligue Trotskyste de France (LTF), issue d'un groupe exclu de la LCR, elle avançait la même accusation : "L'accusation majeure que la LTF porte contre les pseudo-trotskystes est leur incapacité à tracer la ligne de classe face au Front Populaire-Union de la Gauche, tant dans leur intervention générale que dans leur travail syndical. L'axe stratégique d'intervention des trotskystes est celui de l'indépendance de la classe ouvrière par rapport à la bourgeoisie, indépendance oblitérée quand les partis ouvriers et les syndicats entrent dans le front populaire. L'axe central de tout travail syndical pour des révolutionnaires conséquents devrait porter sur le problème du front populaire de trahison et la nécessité de la rupture des syndicats d'avec le front populaire. Les pseudo-trotskystes ont, soit appelé l'arrivée au pouvoir du front populaire (LCR et LO), soit appelé à voter Mitterrand contre...le front populaire (OCI) !" (Bulletin en français de la Spartacist League n°10, octobre 75).
Enfin, Combat Communiste, petit groupe dit "capitaliste d'Etat" pour la reconnaissance de la nature capitaliste de l'URSS, exclu de LO après la scission d'un autre groupe (Union Ouvrière), tapait lui aussi sur le même clou : "LO soutint donc la coalition camouflée entre la bourgeoisie et les leaders ouvriers contre-révolutionnaires sans même qu'ils se soient engagés sur quoi que ce soit de positif pour la classe ouvrière" (Critique du Programme de Transition, Brochure de CC).
Tous ces groupes, y compris Combat Communiste, conservaient la logique du trotskysme sur la question du soutien à la gauche capitaliste. Ils divergeaient seulement sur l'opportunité d'un tel soutien dans une période "non révolutionnaire". Ainsi Combat Communiste, dénonçant l'application caricaturale du mot d'ordre de gouvernement ouvrier par les grands groupes trotskystes ajoutait : "Nous venons de voir que le mot d'ordre de 'gouvernement ouvrier' n'a de sens que dans une période prérévolutionnaire. Dans une situation où par exemple - à l'image de ce qui s'est passé dans la révolution russe - des dirigeant bourgeois de la classe ouvrière seraient majoritaire dans les conseils ouvriers, on ne peut exclure la possibilité de les inviter à prendre le pouvoir" (idem). Cette position que CC n'a jamais critiquée publiquement depuis, permet de comprendre la difficulté voire l'impossibilité pour un tel groupe de rompre avec la contre-révolution malgré la reconnaissance de la nature capitaliste de l'URSS.
Quant à la LTF, section sympathisante de la Tendance Spartakiste Internationale qui préconise le retour aux sources du trotskysme, elle n'exprimait pas plus une rupture de classe avec le trotskysme officiel. Le radicalisme d'un tel groupe n'est qu'artifice et verbiage autour d'une défense des mêmes positions contre-révolutionnaires que les autres trotskystes : le frontisme, la défense du démocratisme bourgeois, du syndicalisme et du bloc impérialiste russe (encore que ce dernier point est la source d'un certain nombre de contradictions dans le mouvement trotskyste actuel comme, nous allons le voir plus loin). En fait ces scissions n'ont eu quasiment aucun impact sur les trois grands groupes trotskystes français.
Dans le redéveloppement de la lutte prolétarienne de l'hiver 79, ces groupes n'ont pas été capables de suppléer aux difficultés du mouvement trotskyste à redéfinir une politique nouvelle après l'échec électoral de l'Union de la Gauche. La volonté de maintenir un trotskysme "pur" ne peut que se heurter à la réalité même de la lutte de classe : en ce sens, des groupes comme la LTF, la LOR ou même CC (qui ne semble pas capable d'être conséquent dans sa volonté de rupture avec le trotskysme) n'ont guère de perspectives propres en France.
Un autre aspect du mouvement trotskyste français consiste en son poids relatif au niveau international. La LCR, rattachée au Secrétariat Unifié (SU) de la 4ème Internationale (plus ou moins dirigé par E.Mandel), et l'OCI qui a créé le Comité d'Organisation pour la Reconstruction de la Quatrième Internationale (CORQUI) rivalisent d'habileté dans leurs manœuvres pour constituer un organisme international capable de faire illusion, susceptible d'être confondu avec une véritable organisation prolétarienne internationale. Depuis que le trotskysme est passé dans le camp bourgeois lors de la 2ème Guerre Mondiale en soutenant l'impérialisme russe et l'alliance avec le bloc impérialiste des alliés contre le bloc impérialiste fasciste, il n'a cessé de maintenir le mythe de l'existence d'une 4ème Internationale véritablement révolutionnaire. Il serait trop long de faire l'historique des scissions et des regroupements éphémères, qui se sont succédés depuis les années 50, mais dans tous ces paniers de crabes concurrents, il n'y a rien qui se rapproche de près ou, de loin d'un véritable travail internationaliste prolétarien.
En ce qui concerne l'OCI, ce groupe a vu s'effondrer le Comité International pour la Reconstruction de la 4ème Internationale auquel il participait, en 1971 d'abord par la rupture du groupe anglais de Healy, la S.L.L. (aujourd'hui W.R.P.), puis en 1973 par le départ de la LIRQUI de Varga, dénoncé pour la circonstance d'agent double au service de la C.I.A. et de la Guepeou ! Depuis, l'OCI a tenté, non sans un certain succès de débaucher le S.W.P. américain qui appartient au SU et qui est l'organisation rivale de la LCR...
En fait, derrière toutes ces manœuvres sordides, il y a une crise du mouvement trotskiste liée en partie à la période qui voit le renforcement des blocs impérialistes et le resurgissement de la lutte prolétarienne. Cette crise s'exprime par une recomposition de toute une partie du mouvement trotskyste de plus en plus tenté par un alignement derrière la Social-Démocratie. Déjà lors des évènements au Portugal en 1974, on avait vu au sein du SU un écartèlement entre une tendance "classique" encore attachée à la défense des intérêts russes et par là même plus liée au parti stalinien, et une tendance "pro-Social-Démocrate" de plus en plus déterminée par les besoins du bloc américain. L'OCI a été dans ce sens le précurseur de cette tendance et à cette époque elle rejoignait la vision du SWP américain en soutenant quasiment ouvertement le P.S. Portugais:
"Constater que la radicalisation des masses utilise le canal du Parti Socialiste ne signifie pas adopter le programme ou la politique de la direction. du PS portugais. Mais aveugle serait celui qui refuserait de voir que sur les problèmes brûlants de la révolution, aujourd'hui, le PS portugais a engagé un combat qui rejoint les intérêts fondamentaux du prolétariat (démocratie ouvrière dans les syndicats, élections municipales, respect de la Constituante, liberté de la presse, etc.)" (Informations Ouvrières n°717, septembre 75).
Sur d'autres points et notamment sur celui du soutien aux "dissidents" des pays de l'Est, l'OCI s'est alignée derrière le bloc occidental et bien plus a contribué à donner un vernis "révolutionnaire" aux cliques nationalistes et démocratiques qui agissent dans les Etats capitalistes de l'Est et qui seront des mystificateurs dangereux pour le prolétariat en lutte : "Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui un puissant levier entre les mains du prolétariat qui lutte contre l'impérialisme et la bureaucratie du Kremlin il disloque l'ordre contre-révolutionnaire européen que l'impérialisme et la bureaucratie du Kremlin ont imposé, après accords d Yalta et d Postdam„ aux peuples et aux prolétariats d'Europe, et qu'ils veulent maintenir ; il donne toute leur puissance aux contradictions sociales ; il participe de la lutte pour la révolution politique en Europe de l'Est et de la lutte pour la révolution sociale à l'Ouest" (La Vérité n°565, janvier 75). Comme quoi les trotskystes seront encore au premier rang pour châtrer le mouvement prolétarien dans les pays de l'Est en le dévoyant sur l'utopique "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" qui ne sert que les intérêts impérialistes et dans le cas présent l'impérialisme occidental.
Face à l'approfondissement des contradictions inter-impérialistes dont l'Europe sera de plus en plus le centre, une partie du mouvement trotskyste tend à s'adapter de plus en plus aux besoins de la Social-Démocratie. Cette dernière a d'ailleurs habilement orchestré en France une campagne de réhabilitation de Trotski lui-même comme homme politique opposant à Staline. Plus concrètement, à l'occasion de la prise du pouvoir au Nicaragua par le Front Sandiniste, cette convergence entre une partie du mouvement trotskyste et le Parti Socialiste s'est encore confirmée notamment à l'occasion de campagnes de soutien au "nouveau" Nicaragua. Cet abandon plus ou moins rapide d'une défense intransigeante du bloc russe ne va pas sans frictions étant donné le caractère particulièrement pourrissant du milieu trotskyste rongé par les rivalités et les querelles de personnes. Par ailleurs il ne peut manquer d'y avoir une exacerbation des contradictions entre les groupes trotskystes qui ont concentré leurs énergies en direction des partis staliniens, comme LO notamment et même la LCR dans une moindre mesure, et ceux qui suivent la Social-Démocratie comme l'OCI, ou qui occupent déjà une place de petit parti Social-Démocrate comme le SWP américain. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la rupture de la Ligue Communiste Internationaliste qui a été quasiment exclue de la LCR lors de son dernier Congrès à cause de ses liens avec l'OCI, alors qu'au même moment se déroulaient des négociations officiel les entre OCI et LCR !
Dans toutes ces péripéties se joue en fait la question du rôle de mystification des groupes trotskystes au sein de la lutte prolétarienne. Si, dans un premier temps, l'ensemble des groupes trotskystes français a soutenu l'illusion électoraliste de l'Union de la Gauche, aujourd'hui que cette gauche se redivise dans l'opposition pour mieux jouer son rôle de sabotage des luttes, le mouvement trotskyste se. retrouve ébranlé et momentanément incapable de déterminer une politique cohérente, ce qui explique l'absence d'une forte intervention des trotskystes lors de la grève des sidérurgistes du début 79. Ainsi à propos de la marche du 23 mars 79, la LTF est amenée à sermonner ses "grands frères" pour leur carence militante : "La CGT et le PC ont tous deux saboté leur propre marche, mortellement effrayés qu'elle puisse échapper à leur contrôle. Face à cette situation potentiellement explosive, les pseudo-trotskystes de tous bords se sont montrés lamentablement incapables d'avancer une perspective de lutte pour les travailleurs" (Le Bolchevik n°13, octobre 79).
Si les révolutionnaires ne peuvent que se réjouir de ces moments d'impuissance du trotskysme, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si le suivisme vis-à-vis de la Social-Démocratie d'une partie du mouvement trotskyste est incontestablement en France un affaiblissement de ses capacités mystificatrices liées à son soutien au bloc russe, soutien qui lui permettait de développer un "anti-impérialisme", un internationalisme de façade et surtout une influence auprès des militants staliniens, un groupe comme LO sera plus difficilement entrainé dans cette voie. Ainsi, à l'époque de l'Union de la Gauche, ce groupe traçait nettement une divergence avec les autres trotskystes : "Pourtant, s'il y a dans les partis qui composent l'union de la gauche un parti dont les révolutionnaires doivent se préoccuper, ce n'est pas le Parti Socialiste, mais le Parti Communiste Français. Parce que le PCF a gardé, lui, une base ouvrière, et qu'il organise encore dans ses rangs nombre de militants dévoués à la classe ouvrière, et aspirant vraiment à changer le monde, au socialisme... C'est donc au sein de ce qui se passe au sein du PCF, de ce que pensent les militants de ce parti, de leurs aspirations, de leurs espoirs, et de leurs doutes, que nous devons nous préoccuper." (Lutte de Classe n°22, oct.74).
On voit qu'aujourd'hui un groupe comme LO est un auxiliaire précieux pour le PCF qui dans les faits est le seul parti de gauche à pouvoir véritablement casser la pression prolétarienne, briser, grâce à son contrôle sur la CGT, la combativité et la tendance à l'autonomie chez les prolétaires. En revalorisant les tâches des staliniens et leur travail militant, LO rend évidemment des services plus "radicaux" à la contre-révolution que l'OCI qui de son côté tente de revaloriser Bergeron, le dirigeant du syndicat Force Ouvrière, ou que la LCR qui tendrait plutôt à encenser la CFDT.
Mais finalement, qu'ils soient plutôt "pro-staliniens" ou plutôt "pro-Sociaux-démocrates", plutôt "prorusses" ou tendanciellement "pro-occidentaux", les groupes trotskystes accomplissent fondamentalement la même tâche de chiens de garde du capital, la même tâche de dévoiement de la conscience de classe et de sabotage des luttes ouvrières. Les exemples ne manquent pas au niveau international dé ce travail de sape des premiers combats de classe accompli par le trotskysme. Même si en France, les groupes trotskystes n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir un strapontin gouvernemental comme le groupe trotskyste ceylanais (LSSP) ou bien de soutenir un coup d'Etat militaire comme les trotskystes argentins du PST qui, après avoir soutenu le retour de Perón en 1973 ont applaudi la prise du pouvoir du Général Videla début 76, ils ont tous soutenu à un moment ou à un autre au niveau international la mise en œuvre des défaites ouvrières.
Ainsi, à propos du Chili gouverné par Allende, la LCF soutint ouvertement le gouvernement d'Unité Populaire, le présentant comme autre chose qu'un gouvernement bourgeois, et présentant le Chili comme autre chose qu'un Etat capitaliste. Face aux menaces de l'armée, la LCR appela la classe ouvrière à défendre une fraction de la bourgeoisie contre une autre :
"Les révolutionnaires, chiliens du MIR ont clairement analysé cette situation : ils appellent à la constitution de comités pour le socialisme soutenant Allende tant qu'il se situe sur une ligne de classe et prêts à passer à l'action dès qu'il s'en éloignera" (Rouge n°86, nov.7 ). Rappelons que le MIR avait constitué une garde personnelle pour Allende et n'a cessé d'être une force d'appoint à la gauche bourgeoise au pouvoir.
Nous avons déjà mentionné plus haut le soutien de l'OCI au PS portugais. LO prétendait pour sa part que le Mouvement des Forces Armées (MFA), c'est-à-dire la clique militaire chargée de la répression des grèves pouvait aller dans le sens des aspirations des masses travailleuses : "Dans une période où de larges masses faisaient confiance au MFA, précisément parce que celui-ci se proposait de réaliser des objectifs correspondant à leurs aspirations, cela aurait été se couper des masses que de s'opposer en bloc à la politique du MFA. il fallait au contraire soutenir ceux des objectifs du MFA qui étaient justes : la réforme agraire par exemple. Il fallait au contraire, affirmer hautement que, chaque fois que le MFA fait un pas en avant dans le sens de la satisfaction des revendications démocratiques, il a le soutien des travailleurs contre la réaction" (Lutte de Classe n°31, oct.75).
Quant aux conflits inter-impérialistes, ils ont été l'occasion des positions les plus cyniques notamment de la part des groupes trotskystes apparemment les plus "radicaux" : "Les révolutionnaires sont pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Même si dans certains cas, soutenir le droit de certains peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est soutenir les intérêts de l'impérialisme" (Lutte de Classe n°34, fév.76). Dans le même article, LO se garde bien de dire un mot sur le rôle de l'URSS dans les dites luttes de libération nationale. Quant à la Spartacist Tendency, elle est moins hypocrite et se détermine crument en fonction des intérêts militaires russes. Lors de la guerre en Angola, ce groupe avançait cette position : "Alors que les staliniens de tout poil chantent les louanges de leurs mouvements nationalistes préférés, la Tendance Spartakiste appelle, depuis début novembre, au soutien militaire pour le MPLA contre la coalition impérialiste...Nous avons toujours refusé de donner un soutien politique à ces forces qui se proposent de construire un Angola capitaliste" (Spartacist n°11). Ce groupe pense certainement se dédouaner en distinguant subtilement entre soutien militaire et soutien politique, ce qui est le comble de la duperie chauviniste qui consiste à être internationaliste sur le papier et à être farouchement nationaliste sur le terrain, les armes à la main. Dans le cas de la Tendance Spartaciste, c'est d'autant plus ignoble que ce groupe se garde bien de mettre en pratique ses idées tout en demandant simplement aux prolétaires africains ou asiatiques d'aller se faire trouer la peau pour le capital russe avec la bénédiction du trotskysme et du tiers-mondisme international. C'est ce qu'il a fait une nouvelle fois avec l'Afghanistan. La LTF, qui défend en France les positions de la Tendance Spartaciste, n'est pas en reste et a montré à propos de la situation en Iran ce que cachait son "intransigeance" face aux trotskystes qui ont soutenu Khomeiny : dans une polémique contre Combat Communiste, la LTF accuse CC de voir dans les luttes en Iran une situation plus importante pour le prolétariat que "les guérillas paysannes et nationalistes" car cela signifierait préférer Khomeiny à Ho Chi Minh et finalement nier les "acquis ouvriers" du Vietnam. Il n'est pas étonnant que la LTF préfère les stigmates de la barbarie capitaliste des zones dominées par l'impérialisme russe aux premiers pas du prolétariat iranien. Dénoncer Khomeiny pour la LTF n'est en rien une défense des positions de classe, mais simplement un appel aux forces pro-russes en Iran pour liquider la clique islamique. C'est dans cette perspective que la LTF continue à développer une défense des perspectives "démocratiques" et de "droit à l'autodétermination" qui sont justement les impasses sanglantes dont doit se débarrasser le prolétariat iranien.
En conclusion, le mouvement trotskyste en France a confirmé au cours de ces dernières années sa nature bourgeoise, notamment par une présence dans le jeu électoral de plus en plus marquée et massive (aux élections législatives de 1978, LO a présenté plus de 500 candidats I), par une présence dans les trois centrales syndicales les plus importantes (CGT, CFDT et F0) et même par le contrôle du syndicat étudiant UNEF-Unité Syndicale par l'OCI et les Etudiants Socialistes, concurrençant ainsi l'UNEF-Renouveau contrôlé par les staliniens. On peut noter aussi le rôle de plus en plus "responsable" des services d'ordre trotskystes lors des manifestations qui n'hésitent pas à attaquer les groupes "autonomes" qualifiés de "provocateurs" pour la circonstance. Enfin, dans les luttes ouvrières, soit en luttant pour l'unité syndicale, soit en défendant le frontisme et le démocratisme à l'égard des staliniens et des sociaux-démocrates, le mouvement trotskyste assume son rôle anti-prolétarien avec constance et abnégation.
C'est aussi à un autre niveau que le courant trotskyste joue pleinement son rôle anti-prolétarien : en caricaturant, en défigurant ce que doit être le fonctionnement et le rôle d'une véritable organisation prolétarienne internationaliste, en faisant passer leurs querelles de cliques bureaucratiques pour un débat politique prolétarien, les divers groupes trotskystes contribuent, largement à écœurer de nombreux travailleurs voulant renouer avec la tradition communiste révolutionnaire. Devant ce spectacle misérable qu'offre le courant trotskyste, nombreux sont ceux qui tendent à rejeter toute forme d'organisation révolutionnaire, tout militantisme, et sombrent dans l'anarchisme, le modernisme et l'individualisme qui sont souvent des écueils fatals.
Mais bien plus, le trotskysme exerce une pression sur le milieu révolutionnaire lui-même. Le Parti Communiste International (PCI) bordiguiste par exemple, pour des mobiles tactiques douteux et par incompréhension politique a largement liquidé le travail accompli par la Gauche Italienne regroupée autour de la revue "Bilan" avant-guerre dans la critique des erreurs de Trotski (sur l'analyse de la période, sur la question des tactiques frontistes et entristes, sur la question nationale, etc.). Aujourd’hui, le PCI est tombé dans des polémiques superficielles où la nature de classe du trotskysme est soigneusement cachée, où celui-ci est dénoncé comme "centriste" ou "opportuniste", jamais comme bourgeois. De plus, pour mener ses critiques, le PCI utilise l'œuvre de Trotski lui-même pour s'en revendiquer contre les "renégats" d'aujourd'hui, reniant la tradition de la Gauche Communiste qui dénonça unanimement les capitulations de Trotski face au stalinisme qui menèrent le trotskysme dans le camp bourgeois lors de la 2ème Guerre Mondiale.
Pour toutes ces raisons il est nécessaire de comprendre et d'insister sur le rôle et la nature contre-révolutionnaires des groupes trotskystes actuels.
Loin d'être une expression de la petite-bourgeoisie ou bien un courant prolétarien "activiste", "centriste ou "opportuniste", ou autre, le mouvement gauchiste actuel a bien sa place dans le front de la gauche du capital. Ni le trotskysme, ni le maoïsme n'ont quelque chose de prolétarien et de révolutionnaire. Par contre avec les orientations sociale-démocrates ou staliniennes, ils n'ont que des terrains d'entente même s'ils divergent sur des points secondaires ou tactiques. Ainsi, en ce qui concerne la question de la révolution "armée" et la dictature du prolétariat qui semblerait placer "quand même" le gauchisme dans le camp révolutionnaire, l'ensemble des courants gauchistes, non seulement présente cette alternative comme une tactique parmi d'autres mais en plus il présente les prises de pouvoir des Castro, Mao, Ho Chi Minh comme des modèles pour les prolétaires.
Ce que le gauchisme tente de préparer, c'est la défaite de la classe ouvrière, ce qu'il met en œuvre ce sont des méthodes politiques pour battre le prolétariat. Le courant gauchiste ne fait que préparer le terrain de la contre-révolution étatique déjà expérimentée par le stalinisme qui consiste à faire passer le capitalisme d'Etat ou l'autogestion pour du socialisme ou même du communisme.
Chénier
Liste des sigles :
Groupes maoistes :
PCMLF : Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France (aujourd'hui PCML), "L'Humanité Rouge".
PCRml : Parti Communiste Révolutionnaire marxiste-léniniste, "Quotidien du Peuple"
OCFml : Organisation Communiste de France marxiste-léniniste, "Drapeau Rouge".
UCFML: Union des Communistes de France Marxistes-Léninistes, "Le Marxiste-Léniniste".
PCOF : Parti Communiste des Ouvriers de France, "La Forge".
Groupes trotskystes et apparentés :
OCI : Organisation Communiste Internationaliste, "Informations ouvrières", "La Vérité".
LCR : Ligue Communiste Révolutionnaire, "Rouge", "Inprecor".
LO : Lutte Ouvrière, "Lutte Ouvrière", "Lutte de Classe".
LCI : Ligue Communiste Internationaliste, "Tribune Ouvrière".
LTF : Ligue Trotskyste de France, "Le Bolchevik". LOR : Ligue Ouvrière Révolutionnaire, "La Vérité des Travailleurs".
CC : Combat Communiste, "Combat Communiste", "Contre le Courant".
Courants politiques:
- Gauchisme [40]
Heritage de la Gauche Communiste:
L’organisation du prolétariat en dehors des périodes de luttes ouvertes (groupes, noyaux, cercles. etc.)
- 3986 reads
TEXTE D ORIENTATION
Ce texte a été proposé pour le Congrès d'Internationalisme (janvier 1980).
"Que faire en dehors des luttes ouvertes? Comment s'organiser lorsque la grève est terminée? Comment préparer la lutte à venir?"
Voilà quelques unes des questions auxquelles la maturation actuelle de la lutte de classe impose de répondre.
Face à cette question, face aux problèmes que posent les comités, cercles, groupes, noyaux, etc., regroupant de petites minorités d'ouvriers, nous n'avons aucune recette à fournir. Entre les leçons morales ("organisez vous comme ceci ou cela", "dissolvez-vous", rejoignez-nous") et les flatteries démagogiques, nous n'avons pas à choisir. Notre souci est bien plutôt celui-ci : comprendre ces expressions minoritaires du prolétariat comme une partie d'un tout. Les insérer dans le mouvement général de la lutte de classes, de cette manière nous pourrons comprendre à quelles nécessités générales ces organes répondent. De cette manière nous pourrons également, en ne restant ni dans le flou politique ni emprisonnés dans des schémas rigides, cerner les aspects positifs de ces démarches et souligner les dangers qui les guettent.
CARACTERISTIQUES DE LA LUTTE OUVRIERE DANS LE CAPITALISME DECADENT
Notre première préoccupation dans l'appréhension de ce problème doit être de rappeler le contexte historique général dans lequel nous nous trouvons. Nous devons nous remettre en mémoire la nature de cette période historique (l'ère des révolutions sociales) et les caractéristiques de la lutte de classe en période décadence. Cette analyse est fondamentale car elle nous permet de comprendre le type d'organisation de classe qui peut exister dans une telle période.
Sans entrer dans les détails, rappelons simplement que le prolétariat au 19ème siècle existe comme un une force organisée de manière permanente. Le prolétariat s'unifie comme classe au travers d'une lutte économique et politique pour des réformes.
Le caractère progressif du système capitaliste permet au prolétariat de faire pression sur la bourgeoisie pour obtenir des réformes et pour ce faire regrouper de larges masses d'ouvriers au sein des syndicats et des partis.
Dans la période de sénilité du capitalisme les caractères et les formes d'organisation de la lutte changent. Une mobilisation quasi permanente du prolétariat sur des intérêts immédiats et politiques n'est plus possible ni viable. Les organes unitaires permanents de la classe ne peuvent plus désormais exister qu'au cours de la lutte elle-même. La fonction de ces organes ne se limite plus désormais à simplement "négocier" une amélioration des conditions de vie du prolétariat (car cette amélioration n'est plus possible à long terme et parce que la seule issue réaliste est celle de la révolution) mais à se préparer, à mesure que les luttes de développent, à la prise du pouvoir.
Ces organes unitaires de la dictature du prolétariat ce sont les conseils ouvriers. Ces organes possèdent un certain nombre de caractéristiques que nous devons mettre en évidence si nous voulons bien cerner tout le processus qui mène à l'auto-organisation du prolétariat.
Ainsi nous devons mettre en évidence que les conseils sont une expression directe de la lutte ouvrière. Ils surgissent de manière spontanée (mais non mécanique) de cette lutte. C'est pourquoi ils sont intimement liés au développement et à la maturité de cette lutte, ils puisent en elle leur substance et leur vitalité. Ils ne constituent donc pas une simple "délégation" des pouvoirs, une parodie de Parlement, mais bien l'expression organisée de l'ensemble du prolétariat et de son pouvoir. Leur tâche n'est pas d'organiser une représentativité proportionnelle des groupes sociaux ou des partis politiques mais de permettre à la volonté du prolétariat de se réaliser pratiquement. C'est à travers eux que se prennent toutes les décisions. C'est pour cette raison que les ouvriers doivent constamment en garder le contrôle (révocabilité des délégués) par le biais des Assemblées Générales.
Seuls les conseils ouvriers sont capables de réaliser l'identification vivante entre la lutte immédiate et le but final des luttes. Par cette liaison entre la lutte pour des intérêts immédiats et la lutte pour le pouvoir politique, les conseils posent la base objective et subjective de la révolution. Ils constituent le creuset par excellence de la conscience de classe. La constitution du prolétariat en conseils n'est pas une simple question de forme d'organisation mais bien le produit d'un développement de la lutte elle-même et de la conscience de classe. Le surgissement des conseils n'est pas le fruit de recettes organisationnelles, de structures préfabriquées, d'organes intermédiaires.
L'extension et la centralisation de plus en plus consciente des luttes, au delà des usines et des frontières, ne peut 'être un fait artificiel et volontariste. Pour se convaincre de cette idée, il suffit de se rappeler l'expérience des ANU ([1] [42]) et cette tentative artificielle de relier et de centraliser les "organisations d'usines" dans une période où la lutte refluait.
Les conseils ne peuvent subsister que tant que subsiste une lutte permanente, ouverte, signifiant la participation d'un nombre toujours plus important d'ouvriers dans le combat. Leur surgissement est essentiellement fonction d'un développement de la lutte elle-même et de la conscience de classe.
TENTER DE COMBLER UN VIDE
Mais nous ne nous trouvons pas encore dans une période de lutte permanente, dans un contexte révolutionnaire qui permettrait au prolétariat de s'organiser en conseils ouvriers. La constitution du prolétariat en conseils est fonction de conditions objectives (degré de la crise, cours historique) et subjectives (maturité de la lutte et de la conscience). Elle est le résultat de tout un apprentissage, de toute une maturation tant organisationnelle que politique.
Nous devons être conscients que cette maturation, cette fermentation politique ne se déroule pas suivant une ligne bien dessinée et bien droite. Elle s'exprime bien plutôt à travers un processus bouillonnant et confus, à travers un mouvement heurté et saccadé. Elle exige en outre une participation active de minorités révolutionnaires. Incapable d'agir mécaniquement selon des principes abstraits, selon des plans préconçus, selon un volontarisme détaché de la réalité, le prolétariat mûrit son unité et sa conscience au cours d'un apprentissage douloureux. Incapable de regrouper toutes ses forces à un jour "J", il concentre ses rangs au cours de la bataille elle-même, son "armée", il la forme dans le conflit lui-même. Mais au cours de la lutte, il forme dans ses rangs des éléments plus combatifs, des avant-gardes plus décidées. Celles-ci ne se regroupent pas forcément au sein d'une organisation de révolutionnaires (car celle-ci dans certaines périodes est peu connue). L'apparition de ces minorités combatives au sein du prolétariat, que ce soit avant, après ou pendant les luttes ouvertes, n'est pas un phénomène incompréhensible ou nouveau. Elle exprime bien ce caractère irrégulier de la lutte, ce développement inégal et hétérogène de la conscience de classe. Ainsi depuis la fin des années 60 nous assistons à la fois à un développement de la lutte dans le sens d'une plus grande auto-organisation, à un renforcement des minorités révolutionnaires, à l'apparition de comités, noyaux, cercles, etc. où tente de se regrouper une avant-garde ouvrière. Le développement d'un pôle politique cohérent, la tendance du prolétariat à s'organiser en dehors des syndicats, procèdent d'une même maturation de la lutte.
L'apparition de ces comités cercles etc, répond donc bien à une nécessité de la lutte elle-même. Si des éléments combatifs sentent la nécessité de rester groupés après qu'ils aient lutté ensemble, c'est à la fois dans le but de continuer à "agir ensemble" (éventuellement préparer une nouvelle grève) et à la fois dans le but de tirer des leçons de la lutte (à travers une discussion politique). Le problème qui se pose à ces ouvriers est autant celui de leur regroupement en vue d'une action future que celui de leur regroupement en vue d'éclaircir les questions posées par la lutte passée et à venir. Cette attitude est compréhensible dans la mesure où l'absence de luttes permanentes, la "faillite" des syndicats et une très grande faiblesse des organisations révolutionnaires créent un vide tant organisationnel que politique. La classe ouvrière lorsqu’elle reprend le chemin de son combat historique a horreur du vide. Elle cherche donc à répondre à un besoin posé par ce vide organisationnel et politique. Ces comités, noyaux, ces minorités d'ouvriers qui ne comprennent pas encore clairement leur fonction répondent à ce besoin. Ils sont à la fois une expression de la faiblesse générale de la lutte de classe actuelle et l'expression d'une maturation de l'organisation et de la conscience de classe. Ils cristallisent tout un travail souterrain qui s'opère au sein du prolétariat.
LE REFLUX DE 1973-77
C'est pour cette raison que nous devons faire attention à ne pas enfermer ces organes dans des tiroirs hermétiques, dans des classifications rigides. Nous ne pouvons pas prévoir l'apparition et le développement de ceux-ci de manière tout à fait précise. De plus nous devons être attentifs à ne pas séparer artificiellement différents moments dans la vie de ces comités et ne pas poser a un faux dilemme dans le style :"l'action ou la discussion."
Ceci dit cela ne doit pas nous empêcher d'avoir une intervention par rapport à ces organes. Nous devons également être capables d'apprécier l'évolution de ces organes en fonction de la période, suivant que nous nous trouvons dans une période de reprise des luttes ou de reflux. En effet, dans la mesure où ils sont un produit immédiat et spontané des luttes, qu'ils surgissent plus sur la base de problèmes conjoncturels (à la différence de l'organisation des révolutionnaires qui surgit sur la base des nécessités historiques du prolétariat), ces organes restent très fortement dépendants du milieu ambiant de la lutte de classe. Ils restent plus fortement prisonniers des faiblesses générales du mouvement et ont tendance à suivre les hauts et les bas de la lutte.
C'est ainsi que nous devons opérer une distinction dans le développement de ces comités etc. au moment du reflux de la lutte entre 1973 et 77, et dans la période actuelle de reprise internationale des luttes.
Tout en soulignant les dangers qui restent identiques pour ces deux périodes, nous devons être capables de cerner les différences d'évolution.
C'est ainsi qu'avec la fin de la première vague de luttes à la fin des années 60 nous avons pu assister à l'apparition de toute une série de confusions au sein de la classe ouvrière. Ces confusions nous pouvons les mesurer surtout en fonction de l'attitude des quelques éléments combatifs de la classe qui tentent de rester groupés.
Nous voyons ainsi se développer :
- L'illusion du syndicalisme de combat et la méfiance de tout ce qui-est politique (OHK, AAH, Komiteewerking ([2] [43]). Dans la plupart des cas, les comités issus des luttes se transforment carrément en para-syndicats. C'est le cas des Commissions Ouvrières en Espagne et des "Conseils d'Usines" en Italie. Plus souvent encore, ils disparaissent carrément.
- Un très fort corporatisme (ce qui constitue la base même du syndicalisme "de combat").
- Lorsque des tentatives sont faites pour dépasser le cadre de l'usine, une confusion et un éclectisme politique très grand.
- Une très grande confusion politique ce qui rend ces organes très fragiles aux menées des gauchistes et les font tomber aussi dans des illusions du style de celles entretenues par le PIC (voir le "bluff" des groupes ouvriers. ([3] [44])
C'est également au cours de cette période que se développe l'idéologie de "l'autonomie ouvrière" avec tout ce qu'elle comporte comme apologie de l'immédiatise, de l'usinisme et de l'économisme.
Toutes ces faiblesses sont essentiellement fonction des faiblesses de la première vague de luttes de la fin des années 60. C'est ainsi que ces mouvements se caractérisent par une disproportion entre la force et l'extension des grèves et une faiblesse dans le contenu des revendications. Ce qui marque surtout cette disproportion c'est une absence de perspectives politiques claires dans le mouvement. Le repli ouvrier de 73-77 est le produit de cette faiblesse utilisée par la bourgeoisie pour opérer un travail de démobilisation et d'encadrement idéologique des luttes. Chacun des points faibles de la première vague de grèves est "récupéré" par la bourgeoisie à son profit :
"Ainsi l'idée d'une organisation permanente de la classe à la fois politique et économique s'est transformée ensuite en celle des "nouveaux syndicats" pour finalement en revenir aux syndicats classiques. La vision de l'A.G. comme une forme indépendante du contenu a aboutie - via les légendes sur la démocratie directe et le pouvoir populaire- au rétablissement de la confiance dans la démocratie bourgeoise classique. Les idées d'autogestion et de contrôle ouvrier de la production, confusions explicables dans un premier temps, furent théorisées par le mythe de "l'autogestion généralisée", les "Îlots du communisme" ou la "nationalisation sous contrôle ouvrier". Tout ceci a préparé les ouvriers à faire confiance au plan de restructuration "qui évite les licenciements" ou aux pactes de solidarité nationale pour "sortir de la crise".
(Rapport sur la lutte de classe présenté au 3ème Congrès international du CCI)
LA REPRISE DES LUTTES DEPUIS 1977
Avec la reprise des luttes depuis 1977, nous voyons se dessiner d'autres tendances. Le prolétariat a mûri par la "défaite", il a tiré même très confusément les leçons de ce reflux et même si les dangers restent toujours présents de "syndicalisme de combat", de corporatisme, etc, ils s'inscrivent dans une évolution générale différente.
C'est ainsi que depuis 77 nous voyons se développer timidement :
Une volonté plus ou moins marquée de développer une discussion politique de la part d'une avant-garde combative des ouvriers (rappelons l'AG des coordinamenti à Turin, le débat mené à Anvers avec des ouvriers de Rotterdam, d'Anvers, etc., la conférence des dockers à Barcelone,...([4] [45]).
La volonté d'élargir le champ de la lutte, de dépasser le ghetto de l'usinisme, de donner un cadre politique plus global à la lutte. Cette volonté s'exprime par l'apparition de "coordinamenti" et plus spécifiquement dans le manifeste politique d'un des coordinamenti du nord de l'Italie. Ce manifeste réclame une unification de l'avant-garde combative des usines, la nécessité d'une lutte politique indépendante des ouvriers et insiste sur la nécessité de dépasser le cadre de l'usine pour lutter;
Le souci d'établir une liaison entre l'aspect immédiat de la lutte et le but final. Ce souci s'exprime particulièrement dans des groupes de travailleur: en Italie (FIAT) et en Espagne FEYCU, FORD). Les premiers sont intervenus par voie de tract pour dénoncer les menaces de licenciements faits au nom de "l'anti-terrorisme", les seconds pour dénoncer l'illusion du parlementarisme;
-Le souci de mieux préparer et organiser les luttes à venir (cf.. action des "porte-parole" de Rotterdam appelant à la formation d'AG).
Bien entendu, répétons le, les dangers de corporatisme, de syndicalisme de combat, d'enfermement de la lutte sur un terrain strictement économique subsistent même au cours de cette période,
Mais ce dont nous devons tenir compte c'est l'influence importante de la période sur l'évolution de comités, noyaux, etc. surgissant avant ou après les luttes ouvertes. Lorsque la période est à la combativité et à la remontée des luttes, l'intervention de telles minorités ouvrières prend un autre sens et notre attitude également. C'est ainsi que dans une période de recul généralisé des luttes, nous insisterons plus sur les dangers pour de tels organes de se transformer en para-syndicats, de tomber dans les bras des gauchistes et des illusions du terrorisme, etc. Dans une période de remontée, nous insisterons plus sur les dangers du volontarisme et de l'activisme (cf. les illusions exprimées à cet égard dans le manifeste du coordinamento de Sesto Seovanni), sur les illusions que pourraient avoir ces ouvriers combatifs de former les embryons des comités de grève futurs, etc. Dans une période de reprise des luttes, nous serons également plus ouverts face à l'apparition de minorités combatives se regroupant en vue d'appeler à la lutte et à la formation de comités de grève, d' d'A.G., etc.
LES POSSIBILITES DE CES ORGANES
Ce souci de replacer ces comités, noyaux, etc. dans le bain de la lutte de classe, de les comprendre en fonction de la période dans laquelle ils se meuvent, n'implique pas pourtant que nous changions nos analyses du tout au tout, suivant ces différentes étapes de la lutte de classe.
Quel que soit le moment où naissent ces comités ou noyaux, nous savons qu'ils ne constituent qu'UNE ETAPE D'UN-PROCESSUS DYNAMIQUE GENERAL, un moment dans la maturation de l'organisation et de la conscience de classe. Ils ne peuvent avoir un rôle positif que s'ils se donnent un cadre large et souple pour ne pas figer ce processus. C'est pourquoi ils doivent être vigilante et ne pas tomber dans les pièges suivants :
- s'imaginer constituer la structure qui prépare le surgissement des comités de grève ou des conseils.
- s'imaginer être investis d'une sorte de "potentialité" en vue de développer la lutte future (ce ne sont pas des minorités qui créent artificiellement une grève ou font surgir une A.G. ou un comité même si elles ont une intervention active dans ce processus).
- se doter d'Une plate-forme ou de statuts ou de tout élément risquant de figer leur évolution et les condamnant à la confusion politique.
- se présenter comme des organes intermédiaires entre la classe et une organisation politique, comme une organisation à la fois unitaire et politique.
C'est pourquoi, quelle que soit la période dans laquelle nous nous trouvons, notre attitude envers ces organes minoritaires, si elle reste, ouverte, vise cependant à influencer l'évolution de la réflexion politique en leur sein. Nous devons essayer de faire en sorte que ces comités, noyaux, ne se figent ni dans un sens (une structure qui s'imagine préfigurer les conseils), ni dans l'autre (fixation politique). Ce qui doit nous guider avant tout, ce ne sont pas les intérêts et les préoccupations conjoncturelles de ces organes (car nous ne pouvons pas leur suggérer une recette organisationnelle et une réponse toute faite), mais les intérêts généraux de l'ensemble de la classe. Notre souci est de toujours homogénéiser et développer la conscience de classe de telle sorte que le développement de la lutte se fasse avec une participation toujours plus massive des ouvriers à celle-ci et une prise en main de la lutte par les ouvriers eux-mêmes et non par une minorité, quelle qu'elle soit. C'est pour cette raison que nous insistons tant sur la dynamique du mouvement et que nous mettons les éléments combatifs du prolétariat en garde contre les tentatives de substitutionnisme ou contre tout ce qui risque de bloquer le développement ultérieur de la lutte et de la conscience. En orientant l'évolution de ces organes dans une direction (réflexion et discussions politiques), plutôt que dans une autre, nous répondons à ce souci de favoriser la dynamique du mouvement. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous condamnions toute forme d'Intervention" ou d'action" ponctuelle de la part de ces organes. Il est évident que dès l'instant où un groupe d'ouvriers combatifs comprend que sa tâche n'est pas d'agir en vue de se constituer en para-syndicats mais plutôt en vue de tirer des leçons politiques des luttes passées, cela n'implique pas le fait que cette réflexion politique se fasse dans le vide éthéré, dans l'abstrait et sans aucune conséquence pratique. La clarification politique menée par ces ouvriers combatifs va également les pousser à agir ensemble à l'intérieur de leur usine (et dans des cas plus positifs même au delà de l'usine). Ils vont sentir la nécessité de donner une expression politique matérielle à leur réflexion politique (tracts, journaux, etc.), ils vont sentir la nécessité de prendre position par rapport à des faits concrets qui touchent la classe ouvrière. En vue de diffuser cette prise de position et de la défendre, ils vont donc avoir une intervention concrète. Dans certaines circonstances ils vont proposer des moyens d'action concrets (formation d'A.G., de comités de grève,...) en vue de riposter ou de lutter. Au cours de la lutte elle-même, ils ressentent la nécessité de se concerter pour développer une certaine orientation de la lutte, pour appuyer des revendications permettant d'élargir la lutte, pour insister sur l'élargissement de celle-ci, etc.
Mais, par rapport à cela, même si nous restons attentifs à ne pas plaquer des schémas rigides, il est clair que nous continuons à insister sur le fait que ce qui compte avant tout, c'est la participation active de tous les ouvriers à la lutte, et qu'en aucun cas ces éléments combatifs ne doivent se substituer à cette participation et mener l'organisation et la coordination de la grève à la place de leurs camarades. De plus, il est également clair que plus l'organisation des révolutionnaires augmentera son influence au sein des luttes, plus ces éléments combatifs se tourneront vers elle. Ceci, non pas parce que l'organisation aura mené une politique de recrutement forcé envers ces éléments, mais tout simplement parce que ces éléments prendront conscience qu'une intervention politique réellement active et efficace ne peut se faire que dans le cadre d'une telle organisation internationale.
L'INTERVENTION DES REVOLUTIONNAIRES
Tout ce qui brille n'est pas or. Mettre en évidence que la classe ouvrière fait surgir dans sa lutte des minorités plus combatives ne signifie pas affirmer que l'impact de ces minorités est décisif pour le déroulement ultérieur de la conscience de classe. Nous ne devons pas faire une identification absolue entre expression d'une maturation de la conscience et facteur actif dans le développement de celle-ci.
En réalité, l'influence que peuvent avoir ces comités, cercles, etc. dans le déroulement ultérieur de la lutte est très limitée. Elle est entièrement fonction de la combativité générale du prolétariat et de la capacité de ces comités ou cercles à poursuivre sans cesse un travail de clarification politique. Or, à long terme, ce travail ne peut se poursuivre que dans le cadre d'une organisation révolutionnaire.
Mais là encore aucun mécanisme ne peut avoir cours. Ce n'est pas d'une manière artificielle que l'organisation révolutionnaire gagnera ces éléments. Contrairement à des organisations comme Battaglia
Comunista ou le PIC, le CCI ne cherche pas à combler d'une manière artificielle et volontariste un "fossé" qui existerait entre le parti et la classe. Notre compréhension de la classe ouvrière comme force historique et de notre rôle nous empêche de vouloir figer ces comités dans des structures intermédiaires ou de chercher à créer des "groupes d'usine", courroies de transmission entre la classe et le parti.
Se pose alors la question de savoir quelle est notre attitude par rapport à de tels comités, cercles etc. Tout en leur reconnaissant une influente limitée, des faiblesses, nous restons ouverts et attentifs au surgissement de tels organes. Nous leur proposons avant tout une très grande ouverture dans la discussion et nous n'adoptons en aucun cas une attitude de mépris, de condamnation sous prétexte de l'impureté" politique de ces organes. Ceci est une chose. Une autre chose serait de flatter ces organes ou même de concentrer notre énergie uniquement sur eux. Nous n'avons pas à faire une psychose des "groupes ouvriers", comme nous n'avons pas à les ignorer. Tout en reconnaissant le processus " de maturation de la lutte et de la conscience de classe et ses tentatives à se "hisser" vers le terrain politique, tout en ayant conscience que le prolétariat dans ce processus fait surgir en son sein des minorités plus combatives qui ne s'organisent pas nécessairement en organisation politique, nous devons faire attention à ne pas identifier ce processus de maturation avec celui qui caractérisait le développement de la lutte au siècle dernier. Cette compréhension est très importante car elle nous permet d'apprécier en quoi ces comités, cercles, etc. sont véritablement des expressions de la maturation de la conscience de classe, mais des expressions avant tout temporaires et éphémères et non pas des jalons fixes et structurés, des échelons organisationnels dans le développement de la lutte de classe. Car la lutte de classe en période' de décadence se fait par explosions, par surgissements brusques qui surprennent même les éléments les plus combatifs d'une lutte précédente et peuvent les dépasser tout à fait en conscience et en maturité. Le prolétariat ne peut s'organiser réellement au niveau unitaire qu'au sein de la lutte elle-même et au fur et à mesure que la lutte devient permanente il grossit et renforce ses organisations unitaires.
C'est cette compréhension qui nous permet de mieux cerner en quoi, même si dans certaines circonstances il peut être très positif de mener une discussion suivie et systématique avec ces cercles et de participer à leurs réunions, nous n'avons pas de politique spécifique, de "tactique" spéciale à l'égard de ces comités ouvriers. Nous reconnaissons la possibilité et une plus grande facilité de discuter avec ces éléments combatifs (particulièrement quand la lutte n'est pas encore ouverte) ; nous avons conscience que certains de ces éléments peuvent nous rejoindre, mais nous ne focalisons pas toute notre attention à leur égard. Car ce qui reste avant tout essentiel pour nous, c'est la dynamique générale de la lutte à l'intérieur de la laquelle nous n'opérons aucune classification rigide, aucune hiérarchisation. Nous nous adressons avant tout à la classe ouvrière dans son ensemble. Contrairement aux autres groupes politiques qui essaient de combler l'absence d'influence de minorités révolutionnaires par des procédés artificiels en s'illusionnant sur ces "groupes ouvriers': le CCI reconnaît son peu d'impact dans la période présente. Nous ne cherchons pas à développer, pour augmenter cette influence, une confiance artificielle des ouvriers à notre égard. Nous ne sommes pas ouvriéristes, comme nous ne sommes pas des mégalomanes. L'influence que nous développerons progressivement au sein des luttes, viendra essentiellement de notre PRATIQUE POLITIQUE en leur sein, et non d'un quelconque rôle de "porteurs d'eau" ou d'une politique de flagorneries. De plus, cette intervention politique, nous l'adressons aux ouvriers dans leur ensemble, au prolétariat pris comme un tout et comme une classe. Nous existons non pas pour nous satisfaire de la "confiance" que nous accorderaient deux, trois ouvriers aux mains calleuses, mais pour homogénéiser accélérer l'épanouissement de la conscience de classe. Et soyons conscients que ce n'est qu'au cours du processus révolutionnaire lui-même que le prolétariat nous accordera sa "confiance" politique, dans la mesure où il reconnaîtra alors que le parti révolutionnaire fait réellement PARTIE de son combat historique.
[1] [46] AAU, Allgemeine Arbeiter Union : Union Générale des Travailleurs. Les 'unions" ont été des tentatives de créer des formes d'organisation permanentes regroupant l'ensemble des ouvriers en dehors des syndicats et contre eux, en Allemagne, dans les années qui suivirent l'écrasement de l'insurrection de Berlin en 1919. Elles exprimaient un une nostalgie des conseils ouvriers, mais ne parvinrent jamais à en remplir la fonction.
[2] [47] Groupes d'ouvriers en Belgique.
[3] [48] Le groupe français PIC (Pour une Intervention Communiste) vécut pendant quelques mois convaincu et cherchant à convaincre tout le monde, qu'il participait au développement d'un réseau de "groupes ouvriers", qui constitueraient une puissante avant garde du mouvement révolutionnaire. Il fondait et entretenait cette illusion sur la réalité squelettique de deux ou trois groupes constitués pour l'essentiel d'éléments "ex-gauchistes". Il ne reste plus grand chose de tout ce bluff.
[4] [49] Il s'agit de rencontres organisées regroupant des délégations de différents groupes, collectifs, comités ouvriers...
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective - 1952 INTERNATIONALISME
- 10873 reads
Le texte que nous reproduisons ci-dessous est paru, dans le n°46 d'Internationalisme en été 1952. Ce fut le dernier numéro de cette revue, et à ce titre, ce texte constitue en quelque sorte un résumé condensé des positions et de l'orientation politique de ce groupe. L'intérêt qu'il présente est donc certain.
Ce qui devrait être tout particulièrement mis en évidence, est la différence de la perspective telle qu'elle se dégage du texte et telle que nous la percevons aujourd'hui. Internationalisme avait raison d'analyser la période qui a suivi la 2ème guerre mondiale comme une continuation de la période de réaction et de reflux de la lutte de classe du prolétariat, et en conséquence, de condamner comme artificielle et aventuriste la proclamation bordiguiste de la constitution du Parti. elle avait encore raison d'affirmer qu'avec la fin de la guerre le capitalisme ne sort pas de sa période de décadence, que toutes les contradictions qui ont amené le capitalisme à la guerre subsistaient et poussaient inexorablement le monde vers de nouvelles guerres. Mais Internationalisme n'a pas perçu ou pas suffisamment mis en évidence la phase de reconstruction possible dans le cycle : crise-guerre-reconstruction-crise.
C'est pour cette raison et dans le contexte de la lourde atmosphère de la guerre froide USA-URSS de l'époque qu'Internationalisme ne voyait la possibilité d'un resurgissement du prolétariat que dans et à la suite d'une 3ème guerre. On doit noter qu'aujourd'hui encore il y a des militants révolutionnaires qui partagent cette vision. Cependant, la crise qui a suivi nécessairement la phase de reconstruction, durant laquelle se sont en partie épuisées bien des mystifications, a permis une reprise de la lutte de la classe ouvrière et obligé le capitalisme mondial, malgré l'aggravation de ses antagonismes internes, à faire face d'abord son ennemi de classe.
Si la perspective d'inévitabilité de la 3ème guerre peut se comprendre dans le contexte des années 50, car elle reposait sur une possibilité réelle, nous n'avons aucune raison de la maintenir aujourd'hui. Le capitalisme peut trouver dans des guerres localisées un exutoire momentané à ses contradictions et antagonismes, mais il ne peut aller à la guerre généralisée tant qu'il n'a pas réussi à immobiliser le prolétariat. Cette immobilisation, il ne peut l'obtenir que par l'affrontement ouvert et l'écrasement par la force du prolétariat. C'est cet affrontement qui est notre perspective aujourd'hui et auquel nous devons nous préparer. Rien ne nous autorise à présager une issue défavorable à cet affrontement. De toutes leurs forces, les révolutionnaires ne peuvent que miser et espérer la victoire de leur classe (extraits de l'introduction à la republication du texte parue dans le Bulletin d'études et de discussion t n°8, de Révolution Internationale, juillet 1974)
Nous publions ici une série d'exposés, faits au cours de réunions communes avec des camarades de l'Union Ouvrière Internationaliste. Afin d'en permettre, au plus rapidement, la discussion, nous les donnons sous la forme de compte-rendu analytique. Il s'ensuit que le lecteur n'y trouvera pas les nécessaires-indications statistiques ni certains développements importants. Ce sont des schémas d'un travail de fond, plutôt que ce travail de fond. Le camarade M. qui portait la responsabilité de ces exposés, se réserve de les élargir et de leur adjoindre la documentation utile.
Nous souhaitons vivement qu'une discussion la plus large possible, s'engage cependant à leur propos. Il est superflu d'insister sur la nécessité d'une telle discussion et de la publication de tous documents s'y rapportant. Il va sans dire que nous sommes prêts à assumer ces publications.
L'ÉVOLUTION DU CAPITALISME ET LA NOUVELLE PERSPECTIVE
Avant de dégager les caractères généraux du capitalisme à son présent stade du capitalisme d'Etat, il est nécessaire de rappeler et préciser les caractères fondamentaux du capitalisme en tant que système.
Tout système économique, au sein de la société divisée en classes, a pour but l'extraction de surtravail aux classes laborieuses et au profit des classes exploiteuses. Ce qui distingue, entre eux, ces différents systèmes et partant ces différentes sociétés, c'est le mode d'appropriation du surtravail par les exploiteurs, de son évolution à laquelle le développement des forces productives confère un caractère de nécessité.
L'on se bornera ici à rappeler les caractères essentiels de l'exploitation capitaliste de la force de travail.
SEPARATION DES MOYENS DE PRODUCTION D'AVEC LES PRODUCTEURS
Le travail passé et accumulé-le travail mort- domine et exploite le travail présent -le travail vivant-. C'est en tant que contrôlant le travail mort, c'est à dire les moyens de production, que les capitalistes -non pris individuellement mais comme classe sociale exploitent le travail des ouvriers.
La vie économique est toute entière suspendue à cet objectif de recherche du profit par le capitaliste. Ce profit lui-même est en partie consommé par le capitaliste, et en partie, la plus grande, destiné à la reproduction et à l'élargissement du capital.
LA PRODUCTION COMME PRODUCTION DE MARCHANDISES
Les rapports entre les membres de la société prennent la forme de rapports entre marchandises. La force de travail est elle-même une marchandise qui est payée à sa valeur : celle des produits nécessaires à sa reproduction totale se mesure par la valeur de la force de travail comparée à la valeur du produit. Ainsi, l'accroissement de la productivité du travail, en faisant baisser la valeur des marchandises consommées par la classe salariée, et partant la valeur de la force de travail, aboutit à la diminution du salaire par rapport à la plus-value. Plus la production augmente, et plus baisse la part des ouvriers dans cette production, plus baisse le salaire relatif à cette production 'accrue.
(L'échange des marchandises s'opère sur la base de la loi de la valeur. Cet échange est mesuré par la quantité de travail social nécessaire dépensé dans la production des marchandises.
Les caractères, que l'on vient de dire, se retrouvent à tous les stades de l'évolution du capitalisme. Cette évolution les modifie, sans doute; mais ces modifications, qui s'effectuent à l'intérieur du système, demeurent secondaires, elles n'altèrent pas fondamentalement la nature du système.
LE MODE DE L'APPROPRIATION
On ne peut analyser le capitalisme qu'en le saisissant dans son essence qui est le rapport capital-travail; il faut examiner le capital dans ses rapports avec le travail, et non ceux du capitaliste et de l'ouvrier.
Dans les sociétés antérieures au capitalisme, la propriété des moyens de production était fondée sur le travail personnel, l'usage de la force étant considérée comme une expression de ce travail personnel. La propriété était réellement propriété privée des moyens de production, étant considéré que l'esclave, par exemple, était lui-même moyen de production. Le propriétaire était souverain, cette souveraineté n'étant limitée que par des biens d'allégeance au plus fort (tribut, vassalité, etc...).
Avec le capitalisme, la propriété se fonde sur le travail social. Le capitaliste est assujetti aux lois du marché. Sa liberté est limitée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de son entreprise..: il ne peut produire "à perte", en enfreignant la loi du marché. En ce dernier cas, la sanction serait immédiate : ce serait la faillite: cependant, il faut noter que cette faillite est celle du capitaliste, mais non celle de la classe capitaliste. Tout se passe comme si la classe capitaliste était le propriétaire collectif, social, des moyens de production. La situation du capitaliste est instable, chaque instant le remet en question. Ainsi Marx pouvait-il affirmer que "le système d'appropriation découlant du mode de production capitaliste et, par suite, la propriété capitaliste constituent la première négation de la propriété privée individuelle fondée sur le travail personnel." Car cette propriété capitaliste est essentiellement celle de la classe comme telle. Et c'est très justement que Marx peut désigner, dans la préface à sa "Contribution à la critique de l'économie politique", les rapports de propriété comme "l'expression juridique des rapports de production".
La propriété du capitaliste, la propriété de son entreprise privée, correspond aux stades du capitalisme où elle est rendue nécessaire par le faible niveau des forces productives et par le fait que le champ d'expansion du système est encore vaste et n'oblige pas à recourir à un mode supérieur de concentration de la propriété. Dans ces conditions, l'intervention de l'Etat dans l'économie demeure accidentelle, l'Etat demeure un organisme politique, chargé d'administrer la société en fonction des intérêts des capitalistes.
Toutefois, si le faible niveau de développement des forces productives entrainait l'existence d'une propriété privée capitaliste sur une fraction du capital social global (... celle constituée par son entreprise), il ne suit pas de là que le haut niveau atteint par ces forces exigent le recours au capitalisme d'Etat, Le haut niveau provoque certes une concentration de la propriété ainsi qu'on le vit avec la société anonyme ou le monopole, mais il ne suffit pas de l'invoquer pour expliquer le recours à la concentration-de la propriété dans les mains de l'Etat. En effet, sur le plan strict de la propriété, la concentration aurait pu s'effectuer et s'effectue en partie selon la modalité différente d'une concentration monopoliste de la propriété à l'échelle internationale-(cartels par exemple) et non pas à l'échelle nationale qu'implique toute forme étatique de la propriété.
LE CAPITALISME COMME ETAPE HISTORIQUE NECESSAIRE A L'INSTAURATION DU SOCIALISME
L'un des fondements essentiels de l'exploitation de l'homme par l'homme tient en ce que l'ensemble de la production ne parvient pas à satisfaire l'ensemble des besoins sociaux humains. Il y a lutte pour répartir les biens, en d'autres termes pour exploiter le travail. Aussi la possibilité historique d'une émancipation des travailleurs ne peut-elle surgir qu'à partir d'un certain degré d'expansion des forces productives et suffisant à couvrir l'ensemble des besoins sociaux.
Le socialisme, comme société sans classe ne peut se concevoir qu'à partir de ce degré atteint, lequel permet de liquider les anciennes contradictions de classe. Le capitalisme, le développement de la production qu'il a su provoquer, apparait ainsi comme la condition nécessaire du socialisme.
Ce n'est que sur son acquis que peut s'instaurer le socialisme.
On ne peut donc soutenir, comme le font les anarchistes par exemple, qu'une perspective socialiste resterait ouverte quand bien même les forces productives seraient en régression, en écartant toute considération relative à leur niveau. Le capitalisme représente une étape indispensable et nécessaire à l'instauration du socialisme dans la mesure où il parvient à en développer suffisamment les conditions objectives. Mais, de même qu'au stade actuel, -et c'est l'objet de la présente étude-, Il devient un frein par rapport au développement des forces productives, de même la prolongation du capitalisme, au-delà de ce stade, doit entraîner la disparition des conditions du socialisme. C'est en ce sens que se pose aujourd'hui l'alternative historique : le socialisme ou la barbarie.
LES THÉORIES DE L'EVOLUTION DU CAPITALISME
Si Marx analyse les conditions de développement de la production capitaliste, il ne put cependant, pour d'évidentes raisons de chronologie, examiner dans lé concret les formes suprêmes de son évolution. Cette tâche devait incomber à ses continuateurs. Aussi, différentes théories ont-elles surgi dans le mouvement marxiste, lesquelles prétendaient mettre à jour la théorie de l'évolution du capital. Nous nous proposons, pour la clarté de l'exposition de rappeler très cursivement trois axes essentiels de ces théories.
LA THEORIE DE LA CONCENTRATION
Proposée par Hilferding, puis reprise par Lénine,
- cette théorie est plutôt une description qu'une interprétation de l'évolution du capitalisme. Elle part de la constatation générale que le haut degré de concentration de la production et de centralisation du capital donne aux monopoles le rôle directeur dans l'économie. La tendance de ces monopoles à s'aménager des superprofits géants les conduit au partage impérialiste du monde.
Cette théorie peut s'appliquer au passage du capitalisme concurrentiel à celui des monopoles, elle ne saurait s'appliquer au capitalisme d'Etat, lequel apparaît comme une négation du monopole international. Une concentration plus poussée n'implique pas nécessairement le recours à des formes étatiques de concentration. La concentration capitaliste résulte de la concurrence entre capitalistes au travers de laquelle le moins bien placé techniquement finit par être absorbé par le plus gros. Suit de là un élargissement du capitaliste victorieux. Ce développement continu de quelques 'entreprises tend à interdire l'apparition de nouvelles entreprises du fait de l'importance des capitaux nécessaires aux investissements en capitaux fixes et circulants. Si ce procès explique la formation de trusts monopolistiques à capitaux hautement centralisés, rien ne prouve que, du point de vue du montant des capitaux à investir, le monopole était incapable de faire face aux exigences d'une concentration supérieure à celle déjà atteinte. L'étatisation ne représente nullement une concentration supérieure à celle déjà atteinte par le monopole. Bien plus, certaines ententes monopolistiques internationales représentaient une tendance vers une concentration supérieure, en tout état de cause, à celle qui s'opérerait à l'intérieur d'un seul Etat.
D'autre part, en reprenant le point de vue réformiste d'Hilferding, Lénine en arrivait à cette conclusion, au moins logique et implicite, que le capitalisme n'avait pas de terme à son développement. Aussi la barbarie ne représentait pas pour lui une éventualité historique, mais une image : expression de la stagnation des forces productives et du caractère "parasitaire" du capitalisme dans ces conditions. Pour Lénine, comme pour les sociaux-démocrates -mais selon, des voies et moyens différents et opposés-, la question des conditions objectives de la révolution ne se posait plus en termes de progression ou de régression des forces productives-il n'importait- mais uniquement en fonction de la nécessité historique pour le prolétariat de faire culminer la révolution bourgeoise en révolution prolétarienne. Ce dernier aspect sera touché plus loin.
LA THEORIE DE LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT
Cette théorie fut présentée par Henryk Grossman. Partant d'une formulation nouvelle des schémas marxiens de la reproduction élargie, Grossman insista sur ce que la hausse continue de la composition organique du capital amenait une chute de la valorisation de ce capital (baisse du taux de profit entraînant celle de la masse de ce profit) : l'insuffisance relative de la plus-value s'oppose aux besoins de l'accumulation. Pour y remédier, les capitalistes s'essaient à diminuer le coût de production du capital et des transports, le niveau des salaires, etc... Le développement technique suit un rythme accéléré, tandis que la lutte de classe se poursuit avec une vigueur accrue par la surexploitation du travail.
Cette théorie assigne nettement une fin objective au développement de l'accumulation capitaliste : son effondrement. Les capitaux ne trouvent plus à s'employer dans des conditions de rentabilité suffisante. C'est une série de guerres -entraînant le maintien provisoire de la rentabilité- et au delà l'effondrement du capitalisme. Le point de vue de Grossman , cependant, ne paraît guère convaincant en ce qu'il établit un lien absolu entre la baisse du taux et la diminution relative de la masse du profit.
Dans son "Anticritique" Rosa Luxembourg eut l'occasion de noter :
"On dit que le capitalisme s'écroulera par suite de la baisse du taux de profit. Cet espoir sera malheureusement réduit en fumée par une seule thèse de Marx, là où il montre que, pour de grands capitaux, la chute du taux de profit est compensée par la masse de ce profit. Si on attend de la chute du taux de profit l'écroulement du capitalisme, on pourrait attendre aussi bien jusqu'à ce que le soleil s'éteigne."
Comment le capitalisme réagit-il à la baisse du taux de profit ? Marx a déjà montré que face à la tendance à la baisse du taux, le capitalisme a certains moyens de réagir et de rendre rentable l'exploitation du travail additionnel. L'accentuation de l'exploitation de la force de travail est un de ces moyens. Un autre est l'élargissement de la production, bien que dans chaque produit la-baisse du taux entraîne une diminution de la part du profit, la somme totale du profit augmente par la somme supérieure de produits ainsi obtenus. Enfin le capitalisme réagit par l'élimination d'éléments "parasitaires" émargeant antérieurement sur la totalité du profit. Ainsi le passage du capitalisme concurrentiel à celui du monopole entraîna l'élimination partielle de petits producteurs retardataires. Rien ne permet d'affirmer que le passage au capitalisme d'Etat s'accompagne de ce processus. Bien au contraire, peut-on soutenir, avec plus de motifs, que la concentration étatique fait surgir une couche sociale -improductive de valeurs et donc parasitaire- qui est la bureaucratie.
Pour que cette théorie puisse passer pour interprétative de la crise du système, il faudrait qu'elle démontrât que l'augmentation de la masse de profit ne parvient plus à compenser la baisse du taux ou, en d'autres termes, que la somme du profit social global diminue malgré une augmentation de la production.
Le théorème que la théorie de Grossman devrait démontrer serait alors le suivant : à la fin du nouveau cycle de production, le profit global (entant que produit d'une masse augmentée de la production multipliée par un taux inférieur) est inférieur au profit social global issu du cycle antécédent (en tant que, produit d'une masse inférieure de la production multipliée par un taux de profit supérieur antérieur à la baisse). Une telle démonstration peut être donnée dans l'infini de des schémas, elle ne se retrouve pas dans les conditions réelles de la production. Il faut donc conclure que la solution véritable est ailleurs. L'impossibilité d'élargir la production vient aujourd’hui, non de la non-rentabilité de cette production élargie, mais uniquement de l'impossibilité de son écoulement.
LA THEORIE DE L'ACCUMULATION DE ROSA LUXEMBOURG
Pas plus que pour les précédentes théories nous ne donnerons ici qu'un résumé, un tant soit peu complet ([1] [50]), de la thèse de Rosa Luxembourg. On sait que Rosa, après une étude approfondie des schémas marxiens de la reproduction élargie, concluait à l'incapacité pour les capitalistes de réaliser toute leur plus-value sur leur propre marché. Afin de poursuivre l'accumulation, les capitalistes sont contraints d'écouler une partie de leurs marchandises dans des milieux extra-capitalistes : producteurs possédant en propre leurs moyens de production (artisans, paysans, colonies ou semi-colonies). C'est l'existence de ces milieux extra-capitalistes qui conditionne le rythme de l'accumulation capitaliste. Cette frange extra-capitaliste vient-elle à se rétrécir et le capitalisme est plongé dans la crise. Les luttes se développent entre les différents secteurs du capitalisme mondial afin de se réserver l'exploitation de ces pays extra-capitalistes.
La disparition des marchés extra-capitalistes entraîne donc une crise permanente du capitalisme. Rosa Luxemburg démontre par ailleurs que le point d'ouverture de cette crise s'amorce bien avant que cette disparition soit devenue absolue. Afin de pallier à cette disparition, le capitalisme développe une production parasitaire, improductive de par sa nature : celle des moyens de destruction. Le caractère décadent du capitalisme s'affirme par cela qu'il devient incapable de maintenir la production dés valeurs sociales (objets de consommation). La guerre devient le mode de vie du capitalisme : guerres entre Etats ou coalition d'Etats où chacun tente de se survivre par le pillage ou l'assujettissement du vaincu. Alors qu'aux stades antérieurs, la guerre provoquait une expansion de la production chez l'un ou l'autre des antagonistes, elle amène aujourd'hui la ruine, à des degrés divers, de l'un et de l'autre. Cette ruine se traduit aussi bien par la baisse du niveau de vie de la population que par le caractère toujours plus improductif de valeurs que prend la production. L'aggravation des luttes entre Etats et leur caractère décadent depuis 1914, mène chaque Etat à vivre sur lui-même, en cycle fermé, et à recourir à la concentration étatique. Nous n'insisterons pas plus ici, ce sera l'objet des développements suivants que d'ajuster la théorie à la réalité historique.
QUELQUES CARACTERES FONDAMENTAUX DU CAPITALISME D’ETAT
Le capitalisme d'Etat n'est pas une tentative de résoudre les contradictions essentielles du capitalisme en tant que système d'exploitation de la force de travail, mais la manifestation de ces contradictions. Chaque groupe d'intérêts capitalistes essaie de rejeter les effets de la crise du système sur un groupe voisin, concurrent, en se l'appropriant comme marché et champ d'exploitation. Le capitalisme d'Etat est né de la nécessité pour ce groupe d'opérer sa concentration et de mettre sous sa coupe les marchés extérieurs à lui. L'économie se transforme donc en une économie de guerre.
LE PROBLÈME DE LA PRODUCTION ET DE L'ECHANGE
Dans les stades Capitalistes antérieurs au capitalisme d'Etat, l'échange précédait la production : la production suit le marché. Lorsque l'indice de la production approche l'indice du volume du commerce mondial, la crise s'ouvre. Cette crise manifeste la saturation du marché. A la sortie de la crise, la reprise de l'expansion économique s'effectue d'abord dans la sphère de l'échange et non dans celui de la production, lequel suit la demande.
A partir de 1914, le phénomène se renverse : la production précède l'échange. Il apparût, tout d'abord, que ce phénomène était imputable aux destructions causées par la guerre. Mais en 1929, l'indice de l'échange rejoint celui de la production et c'est la crise. Les stocks s'accumulent, le capitaliste est dans l'incapacité de réaliser la plus-value sur le marché.
Auparavant les crises se résorbaient par l'ouverture de nouveaux débouchés, laquelle entraînait une reprise du commerce mondial et, à sa suite, celle de la production. Entre 29 et 35, la crise ne peut trouver d'exutoire dans un élargissement des marchés dont les limites tendancielles sont atteintes. La crise fait déboucher le capitalisme sur une économie de guerre.
Le monde capitaliste est entré dans sa crise permanente : il ne peut plus élargir sa production. On verra là l'éclatante confirmation de la théorie de Rosa.: le rétrécissement des marchés extra-capitalistes entraîne une saturation du marché proprement capitaliste.
LE PROBLEME DES CRISES
Le caractère essentiel des crises depuis 1929 est qu'elles sont plus profondes que les précédentes. Il ne s'agit plus de crises cycliques, mais d'une crise permanente. La crise cyclique, celle que connut le capitalisme classique, affectait l'ensemble des pays capitalistes. La reprise s'effectuait, elle aussi, de façon globale. La crise permanente, celle que nous connaissons aujourd'hui, se caractérise par la chute continue des échanges et de la production dans l'ensemble des pays capitalistes (ainsi des années 1929 à 1934). Mais on n'assiste plus à une reprise généralisée. Cette reprise ne se manifeste que dans un compartiment de la production et dans ce secteur aux dépens des autres. De plus, la crise se déplace d'un pays à l'autre, maintenant en permanence l'économie mondiale en état de crise.
Devant l'impossibilité de s'ouvrir de nouveaux marchés, chaque pays se ferme et tend désormais à vivre sur lui-même. L'universalisation de l'économie capitaliste, atteinte au travers du marché mondial, se rompt : c'est l'autarcie. Chaque pays tente de se suffire à lui-même; on y crée un secteur non rentable de production, lequel a pour objet de pallier aux conséquences de la rupture du marché. Ce palliatif même aggrave encore la dislocation du marché mondial.
La rentabilité, par la médiation du marché, constituait avant 1914 l'étalon, mesure et stimulant, de la production capitaliste. La période actuelle enfreint cette loi de la rentabilité : celle-ci s'effectue désormais non plus au niveau de l'entreprise mais à celui, global, de l'Etat. La péréquation se fait sur un plan comptable, à l'échelle nationale; non plus par l'entremise du marché mondial Ou bien, l'Etat subventionne la partie déficitaire de l'économie, ou bien, l'Etat prend en mains l'ensemble de l'économie.
De ce qui précède, on ne peut conclure à une "négation" de la loi de la valeur. Ce à quoi nous assistons tient en ce que la production d'une unité de la production semble détachée de la loi de la valeur cette production s'effectuant sans considération apparente de sa rentabilité.
Le surprofit monopolistique se réalisait au travers de prix "artificiels", cependant sur le plan global de la production, celle-ci demeurait liée à la loi de la valeur. La somme des prix, pour l'ensemble des produits n'exprimait rien d'autre que la globale valeur des produits. Seule la répartition des profits entre divers groupes capitalistes se trouvait transformée : les monopoles s'arrogeaient un surprofit aux dépens des capitalistes moins bien armés. De même peut-on dire que la loi de la valeur joue au niveau de la production nationale. La loi de la valeur n'agit plus sur un produit pris individuellement, mais sur l'ensemble des produits. On assiste à une restriction du champ d'application de la loi de la valeur. La masse totale du profit tend à diminuer du fait de la charge que fait peser l'entretien des branches déficitaires sur les autres branches de l'économie.
LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DE LA VALEUR
1) Le capital
De ce qui précède, ressort que si le rigoureux mécanisme de la loi de la valeur ne joue plus toujours à l'échelon de l'entreprise, d'une branche entière de l'économie, la loi se manifeste au ni veau de l'échange. Ainsi qu'aux stades antérieurs le marché reste, en dernière instance, le souverain régulateur de la valeur capitaliste des marchandises ou, si l'on préfère, des produits.- La loi de la valeur semble niée dans ces pays où plusieurs secteurs industriels cohabitent à l'intérieur même du secteur étatique. Cependant en cas d'échange avec les autres secteurs, cet échange s'opère sur la loi de la valeur.
En Russie, la disparition de la propriété privée a entraîné une très grande restriction dans le mode capitaliste d'application de la loi de la valeur. Cette loi peut ne pas jouer dans les échanges entre deux secteurs étatisés -de même qu'elle ne joue pas à l'intérieur de l'usine, entre ses divers ateliers- mais elle joue dés lors qu'il s'agit d'échanger un produit fini contre un autre produit. C'est toujours le temps de travail socialement nécessaire à sa production qui fixe le prix du produit, et non l'omnipotent caprice d'un "bureaucrate". Les produits s'échangent, se déplacent d'après les besoins de la production et si "dirigés" soient-ils, selon ceux aussi du marché. Les prix demeurent l'expression marchande de la loi de la valeur.
2) La force de travail
Mais l'échange fondamental dans l'économie capitaliste est celui qui se fait entre les produits et la force de travail....En Russie comme ailleurs, l'achat de la force de travail se fait à sa valeur capitaliste. Le prix payé est celui nécessaire à sa reproduction.
La plus ou moins grande valorisation de la force de travail, la plus ou moins grande hauteur du niveau des salaires ne change rien à la question. La valeur de la force de travail est fixée en partie par la façon dont les ouvriers réagissent 'à leur exploitation. Leur lutte, ou leur absence de lutte, peut augmenter ou diminuer ainsi la part de la production qui leur échoit sous forme de salaire. Les ouvriers cependant ne peuvent agir, au sein même du capitalisme, que sur la grandeur du volume des produits qui leur sont attribués en échange de leur force de travail et non sur le sens capitaliste -ce qu'il implique- de cette répartition.
La présence, en Russie ou ailleurs, d'une force de travail "concentrationnaire" ne change rien à ces observations. Non seulement, elle ne représente qu'une fraction minime de la force de travail dépensée sur l'ensemble du territoire, mais encore ce phénomène demeure dans le cadre des caractéristiques fondamentales des rapports entre la force de travail et le capital.
La signification de ce phénomène doit être recherchée dans la nécessité pour un pays capitaliste arriéré de maintenir un bas niveau de salaires. C'est une pression exercée, dans le cadre de l'accumulation, afin d'agir sur la grandeur de la valeur sociale globale des produits affectés à la reproduction de la force de travail, telle l'armée industrielle de réserve, des chômeurs du capitalisme classique. Le caractère passager de ce phénomène s'affirme plus encore si l'on considère que, le plus généralement, la main d'œuvre "concentrationnaire" est dirigée vers des travaux de colonisation intérieure. Il s'agit de travaux qui ne sont rentables qu'à une échéance lointaine exécutés par une main d'œuvre bon-marché et non spécialisée et qu'il serait impossible dans les conditions générales d'un état arriéré de l'économie, de compter les salaires de cette main-d’œuvre à leur valeur capitaliste. Il faut ajouter qu'à cet investissement de force de travail s'ajoute, en Russie, la nécessité pour le capitalisme de se créer un efficace moyen de coercition politique.
D'aucuns s'efforcent à voir dans cette forme d'exploitation du travail l'amorce d'un retour à l'esclavagisme. Il faudrait, pour persuader, démontrer auparavant la disparition absolue de la loi capitaliste de la valeur. Signalons encore que l'esclave antique pénalisé était soumis à une punition corporelle (verges, marque au fer, jeux du cirque). Pour l'ouvrier russe "saboteur", la punition est une pénalité de valeur. Cet ouvrier sera contraint de fournir un certain nombre d'heures de travail supplémentaires et non-payées. En revanche, le "bon" ouvrier stakhanoviste jouira davantage de salaires et surtout de logement et de loisirs. Politiquement ce système a pour mission de diviser 1a classe des exploités (formation d'une aristocratie ouvrière dévouée au régime).
D'une façon générale, l'on doit reconnaitre que, pour pallier la baisse du taux moyen et de la masse du profit, on doit utiliser au maximum la force de travail disponible. Le nombre des ouvriers est accru : la prolétarisation des masses paysannes ou petites bourgeoises s'accentue; les mutilés de guerre, les fous sont soignés et récupérés dans le cycle de production; la procréation et l'éducation des enfants est encouragée et soutenue. L'intensité du travail est accrue : les temps sont sévèrement contrôlés, on revient au travail aux pièces sous la forme du "boni" et autres primes, etc... Les crapuleux théoriciens de l'accroissement de la productivité ou du plein emploi ne font que rationaliser cette tendance à l'exploitation maximum du travail humain.
LA DESTINATION DE LA PRODUCTION.
La production se développe alors que le commerce diminue. Où donc va cette production que l'absence de possibilité d'échanges condamne à demeurer sans emploi social ? Elle est orientée vers la production de moyens de destruction. Si le capitalisme d'état accroit la production industrielle, il ne crée pas pour autant de valeurs nouvelles, mais des bombes ou des uniformes.
Le financement de cette production s'opère essentiellement de trois façons :
1) - Dans un cycle de production donné, une partie de plus en plus grande de cette production va dans les produits qui ne se retrouvent plus au cycle suivant. Le produit quitte la sphère de la production et n'y revient plus. Un tracteur revient à la production sous forme de gerbes de blé, un tank non.
Le temps de travail social incorporé dans cette production lui confère une valeur. Mais ce temps de travail est dépensé sans contrepartie sociale: ni consommé, ni réinvesti, il ne servira pas à la reproduction. Il demeure rentable sur un plan privé, par rapport au capitaliste, mais non sur un plan global.
La production s'élargit en volume, non en valeur sociale réelle. Ainsi une première part de la production des moyens de destruction est prélevée sur la production courante.
2) - Une deuxième part est payée par le drainage des capitaux improductifs (rentiers, boutiquiers, et paysannerie du bas de laine) et par celui aussi des capitaux accumulés productifs, mais non indispensables au fonctionnement d'une production qui n'est plus orientée vers la consommation productive. L'épargne finit par disparaître. Certainement contestables, les indications suivantes donnent cependant une idée de la tendance dans un pays comme la France où l'évolution est typique à cet égard : "Evalué en pouvoir d'achat, le capital de 1950, soit 19 500 milliards en chiffre rond, ne représente plus que 144 milliards de 1911 (contre 286), ce qui lui retire la moitié de sa valeur. Mais cette vue serait incomplète si l'on ne prenait en considération la masse des apports de l'épargne. Au rythme de 1910-1914 (4 milliards) elle eût -toutes choses égales- ajouté 144 milliards-or aux 300 milliards de cette époque. Pour avoir été moindre sous l'effet des deux guerres, cette épargne annuelle n'en a pas moins existé. Or il n'en reste aucune trace". ([2] [51])
Les bénéfices commerciaux sont amputés par un prélèvement étatique énorme. Enfin l'inflation devient permanente et la dégradation du pouvoir d'achat de la monnaie atteint des proportions considérables.
3) - Une troisième part, enfin, est directement prélevée sur les ouvriers : diminution du niveau de vie et intensification de l'exploitation du travail. Alors qu'en France, par exemple, l'indice de la production se situe, au début de 1952, à 153 par rapport au niveau de 1938, la baisse du niveau de vie ouvrier par rapport à l'avant-guerre, atteint plus de 30% et plus même encore si l'on examine relativement à l'augmentation de la production. Ce paradoxe apparent d'une production en progression continue qu'accompagne une consommation des ouvriers en régression continue, ainsi que la fonte du capital social accumulé est une manifestation de la décadence du capitalisme.
STRUCTURE SOCIALE DE LA CLASSE CAPITALISTE
De telles transformations économiques entraînent de profondes modifications sociales. La concentration du pouvoir économique entre les mains de l'Etat -et parfois même l'élimination physique du bourgeois en tant que capitaliste individuel- précipite une évolution déjà sensible aux stades antérieurs du capitalisme. Nombre de théories ont fleuri –particulièrement sur le terrain trotskiste- qui prétendaient interpréter cette évolution en lui assignant pour dynamique la lutte d'une nouvelle classe contre la bourgeoisie classiques. Ces théoriciens arguaient de la destruction physique du bourgeois, de la propriété privée dans l'Est européen et de sa mise au pas dans les pays fascistes, travaillistes, ou "issus de la Résistance". Ces exemples cependant n'autorisent pas cette conclusion. Bâtir une théorie sur une série de faits dont les témoignages les plus typiques sont empruntés à une économie relativement arriérée, et sur des faits plus apparents que réels (le capitaliste n'est pas une personne physique, mais une fonction sociale), revient à bâtir sur le sable.
Seule reste fondamentale, au regard d'une saine analyse, l'observation du monde capitaliste hautement développé. La situation y est caractérisée par un amalgame, une imbrication d'éléments capitalistes traditionnels et d'éléments issus de 1 appareil étatique. Un tel amalgame ne s'opère pas, sans doute, sans frictions vives, ni éclopés. Le "fascisme" ou la "résistance" furent, en ce sens, des tentatives qui échouèrent.
La conclusion, que tirent nos théoriciens, d'une guerre civile entre la nouvelle classe "bureaucratique" et le capitalisme classique-mène à nier l'évidence de la crise permanente du capitalisme. A cette crise, dont les effets se répercutent au sein même des couches exploiteuses, on substitue une lutte prétendument progressive (le trotskysme officiel) ou non (SCHACHTMAN), entre deux classes "historiques". L'absence du prolétariat sur la scène historique est ainsi rationnalisée. A l'alternative que posent l'Histoire et les révolutionnaires : le Socialisme ou la Barbarie, un troisième terme est offert qui permet à nos théoriciens de s'intégrer à l'un ou l’autre bloc. Cette présupposition de l'existence, au sein du capitalisme, d'une nouvelle classe exploiteuse, apportant avec elle une solution historique aux contradictions du capitalisme, mène à l'abandon de l'idéologie révolutionnaire et le passage à celle du capitalisme.
SITUATION DES CAPITALISTES.
Le bénéfice du bourgeois de la propriété privée prenait la forme d'une rétribution proportionnée à la grandeur de l'entreprise gérée. Le caractère salarié du capitaliste, par rapport au capital, demeurait caché : il apparaissait être le propriétaire de son entreprise. Dans sa dernière forme, le capitaliste continue de vivre sur la plus-value extirpée aux ouvriers, mais perçoit son profit sous forme de salaire direct : c'est un fonctionnaire. Les profits ne sont plus distribués d'après les titres juridiques de propriété, mais d'après la fonction sociale du capitaliste. Aussi ce capitaliste se sent-il profondément solidaire, en tout temps, de l'ensemble de la production nationale, et non plus intéressé au seul profit de son entreprise. Il tend à traiter l'ouvrier d'égal à égal, à l'associer à la production, aux soucis qu'elle entraine.
Le prolétariat voit nettement que le capitalisme peut subsister sans la propriété privée des moyens de production. Cependant, l'évolution de la "salarisation" du capital abolit, en apparence, les frontières économiques entre les classes. Le prolétariat se sait exploité, mais il parvient avec difficulté à reconnaître l'exploiteur sous le veston du "boss" syndical ou la chemise du savant progressiste.
LE PROBLEME COLONIAL
On croyait autrefois, dans le mouvement ouvrier, que les colonies ne pourraient parvenir à leur émancipation nationale que dans le cadre de la révolution socialiste. Certes, leur caractère "du maillon le plus faible dans la chaîne de l'impérialisme" du fait de l'exacerbation de l'exploitation et de la répression capitaliste, les rendaient-elles particulièrement vulnérables à des mouvements sociaux. Toutefois leur accès à l'indépendance demeurait lié au sort de la révolution dans les métropoles capitalistes.
Ces dernières années ont vu, cependant, la plupart des colonies accéder à l'indépendance : les bourgeoisies coloniales se sont émancipées peu ou prou des métropolitaines. Ce phénomène, si limité soit
-il en réalité, ne peut se comprendre dans le cadre de l'ancienne théorie qui faisait du capitaliste colonial le pur et simple laquais de l'impérialisme, un courtier.
En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés, ce qui rend moins énergique la résistance des vieux impérialismes aux revendications des bourgeoisies coloniales. A ceci s'ajoute le fait que les difficultés propres à ces impérialismes ont favorisé l'expansion économique -au cours des deux guerres mondiales- des colonies. Le capital constant s'amenuisait en Europe, tandis que la capacité de production des colonies ou semi-colonies augmentait, amenant une explosion du nationalisme indigène (Afrique du Sud, Argentine, Inde, etc...). Il est significatif de constater que ces nouveaux pays capitalistes passent, dès leur création, en tant que nations indépendantes, au stade de capitalisme d'Etat présentant ces mêmes aspects d'une économie tournée vers la guerre que l'on décèle par ailleurs.
La théorie de Lénine et de Trotski s'effondre: Les colonies s'intègrent au monde capitaliste et, par là même, le renforcent d'autant. Il n'y a plus de "maillon le plus faibles : la domination du capital est également répartie sur la surface entière du globe.
INCORPORATION DE LA LUTTE DU PROLETARIAT ET DE LA SOCIETE CIVILE DANS L'ETAT
La vie réelle, au stade classique du capitalisme, se déroulait dans la Société Civile, en dehors de l'Etat. Cet Etat n'était que l'instrument des intérêts dominants dans la Société Civile et cela seul : agent d'exécution et non organe de direction effective de l'économie et de la politique. Les éléments de l'Etat, cependant, appelés à maintenir l'ordre -c'est à dire administrer les hommes- tendait à se libérer du contrôle de la société, tendait à se muer en classe autonome, axant tant ses intérêts propres. Cette dissociation et lutte entre l'Etat et la Société Civile ne pouvait aboutir à la domination absolue de l'Etat tant que cet Etat ne contrôlait pas les moyens de production. La période des monopoles vit s'opérer le début d'un amalgame de l'Etat et de l'Oligarchie, toutefois cet amalgame demeurait instable : l'Etat restait extérieur à la Société Civile essentiellement fondée sur la propriété privée. La phase actuelle voit s'unifier dans les mêmes mains, l'administration des choses et le Gouvernement des hommes. Le capital décadent nie les antagonismes entre les deux classes économiques exploiteuses : les Capitalistes et les propriétaires fonciers (par la disparition des seconds). Il nie également les contradictions entre les divers groupes capitalistes dont les contrastes formaient auparavant l'un des moteurs d'une production qui, du point de vue de la production réelle de valeur, est sur le déclin.
A son tour, la classe économique exploitée est intégrée à l'Etat. Cette intégration s'effectue d'autant plus aisément, sur le plan de la mystification que les ouvriers ne trouvent plus en face d'eux que le capital en tant que tel, comme représentant du patrimoine de la nation, comme cette nation même dont les ouvriers formeraient une part.
Nous avons vu que le capitalisme d'Etat se trouve dans l'obligation de réduire la grandeur des biens destinés à alimenter le capital variable, à exploiter sauvagement le travail des ouvriers. Hier, les revendications économiques des ouvriers pouvaient être satisfaites, au moins partiellement, par l'expansion de la production : le prolétariat pouvait prétendre à une amélioration effective de sa condition. Ce temps est passé. Le capital a perdu ce volant de sécurité que représentait pour lui une augmentation réelle des salaires. La baisse de la production entraîne l'impossibilité, pour le capitalisme, d'une revalorisation même du salaire. Les luttes économiques des ouvriers ne peuvent plus amener que des échecs -au mieux le maintien habile de conditions de vie d'ores et déjà dégradées. Elles lient le prolétariat aux exploiteurs en l'amenant à se considérer solidaire du système en échange d'une assiette de soupe supplémentaire (et qu'il n'obtiendra, en fin de compte qu'en améliorant sa "productivité").
L'Etat maintient les formes d'organisation des ouvriers (syndicats) pour mieux les encaserner et mystifier. Le syndicat devient un rouage de l'Etat et comme tel intéressé à développer la productivité -c'est à dire accroitre l'exploitation du travail. Le syndicat fut l'organe de défense des ouvriers tant que la lutte économique eut un sens historique. Vidé de ce contenu ancien, le syndicat devient sans changer de forme, un instrument de répression idéologique du capitalisme d'Etat et de contrôle sur la force de travail.
LA REFORME AGRAIRE ET L'ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION : LES COOPERATIVES.
Afin d'assurer un rendement maximum du travail, et aux conditions les meilleures, le capitalisme d'Etat se doit d'organiser et centraliser la production agricole ainsi que de limiter le parasitisme dans le secteur de la distribution. Il en va de même pour les branches artisanales. Ces différentes branches sont groupées en coopératives dont l'objet est d'éliminer le capital commercial, de réduire la distance de la production à la consommation et d'intégrer la production agricole à l'Etat.
LA SECURITE SOCIALE.
Le salaire même est intégré à l'Etat. La fixation, à sa valeur capitaliste, en est dévolue à des organismes étatiques. Une part du salaire est enlevée à l'ouvrier et est administrée directement par l'Etat. Ainsi l'Etat "prend en charge" la vie de l'ouvrier, il contrôle sa santé (lutte contre l'absentéisme), dirige ses loisirs (répression idéologique). A la limite l'ouvrier n'a plus de vie privée, chaque instant en appartient, directement ou non, à l'Etat. L'ouvrier est conçu comme la cellule active d'un corps vivant qui le dépasse, sa personnalité disparait (ce qui ne va pas sans provoquer de nombreuses névroses : l'aliénation mentale sous toutes ses formes est à notre époque ce que les grandes épidémies furent au Moyen-âge). II va sans dire que ce qui est le sort des ouvriers est aussi mutatis mutandis, celui des autres catégories économiques dans la société.
Il n'est pas besoin de souligner que si la société socialiste défend l'individu contre la maladie ou les risques de l'existence, ses objectifs ne sont pas ceux de la Sécurité Sociale capitaliste. Celle. ci n'a de sens que dans le cadre de l'exploitation du travail humain et en fonction de ce cadre. Elle n'est qu'un appendice du système.
LA PERSPECTIVE REVOLUTIONNAIRE,
Nous avons vu que la lutte économique, les revendications immédiates ne peuvent plus émanciper en rien les ouvriers. Il en va de même pour leur lutta politique menée à l'intérieur et pour la réforme du système capitaliste.
Quand la Société Civile vivait séparée de l'Etat, la lutte entre les différentes couches sociales qu' la composaient, amenait un bouleversement continu des conditions politiques dans la société. La théorie de la Révolution en permanence correspondait à cette modification perpétuelle des rapports de for. ce à l'intérieur de la société. Ces transformations permettaient au prolétariat de mener sa propre lutte politique en débordant les luttes ouvertes au sein de la bourgeoisie. La société créait ainsi les conditions sociales et le climat idéologique nécessaires à sa propre subversion. Flux et reflux révolutionnaires se succédaient à un rythme chaque foi plus approfondi. Chacune de ces crises permettait au prolétariat de manifester une conscience de classe historique toujours plus nette. Les dates de 1791, 1848, 1871 et 1917 sont les plus significatives d'une bien longue liste.
Le capitalisme d'Etat ne connaît plus de luttes politiques profondes naissant des perturbations entra différents groupes d'intérêts. A la multiplication de ces intérêts correspondait, dans le capitalisme classique, la multiplication des partis, condition d'exercice de la démocratie parlementaire. Avec le capitalisme d'Etat la société s'unifie, la tendance s'affirme au parti unique : la répartition de la plus-value sur le plan de la fonction entraine un intérêt global pour la classe spoliatrice, une unification dans les conditions d'extraction et de distribution de la plus-value. Le parti unique est l'expression de ces conditions nouvelles. Il signifie la fin de la démocratie bourgeoise classique : le délit politique devient un crime. Les luttes, qui trouvaient leur expression traditionnelle au Parlement, ou même dans la rue, se déroulent aujourd'hui au sein même de l'appareil d'Etat ou bien, avec quelques variantes, au sein même de la coalition généralisée des intérêts capitaliste d'une nation et, dans les conditions actuelles, d'un bloc de nations.
SITUATION PRESENTE DU PROLETARIAT
Le prolétariat n'a pu di su prendre conscience de cette transformation de l'économie. Plus même, il se trouve intégré à l'Etat. Le capitalisme eût pu, avant d'accéder à sa forme étatique, être renversé. L'ère des révolutions était ouverte. La lutte politique, révolutionnaire, des ouvriers se traduisait par un échec et un recul absolu de la classe, tel que l'Histoire contemporaine n'en a pas connu. Cet échec et ce recul ont permis au capitalisme d'opérer sa transformation.
Il semble exclu qu'au cours de ce procès, le prolétariat, en tant que classe historique, puisse se ressaisir. Ce qui donna la possibilité à la classe de s'affirmer, c'était qu'au travers de ses crises cycliques, la société rompait ses cadres et éjectait le prolétariat du cycle de production. Rejetés de la société, les ouvriers prenaient une conscience révolutionnaire et de leur condition et des moyens de la transformer.
Avant la guerre d'Espagne, et le début de la mystification "antifasciste", où se traduit pour la première fois l'unification relative de la classe exploiteuse, puis au cours de la deuxième guerre mondiale et par après, le capitalisme tend à faire disparaître les crises cycliques et leurs séquelles, il s'installe dans la crise permanente. Le prolétariat se trouve associé à sa propre exploitation. Il se trouve ainsi intégré mentalement et politiquement au capitalisme. Le capitalisme d'Etat enchaîne plus fortement que jamais le prolétariat avec sa propre tradition de lutte. Car les capitalistes, comme classe, ont tiré les leçons de l'expérience, et compris que l'arme essentielle du maintien de leur domination est moins la police que la répression idéologique directe. Le parti politique des ouvriers est devenu celui des capitalistes. Ce qui se passe avec le syndicat, vidé de son ancien contenu et absorbé dans l'Etat, se passe pour ce qui fut le parti ouvrier. Ce parti peut devenir, tout en gardant une phraséologie prolétarienne, l'expression d'une classe d'exploiteurs, adaptant ses intérêts et son vocabulaire aux réalités nouvelles. L'un des fondements de cette mystification sont les mots d'ordre de lutte contre la propriété privée. Cette lutte trouvait un sens révolutionnaire à l'époque où le capitalisme s'identifiait à la propriété privée, elle venait mettre en cause l'exploitation sous sa forme la plus apparente. La transformation des conditions du capital a rendu cette lutte des ouvriers contre la propriété privée historiquement caduque. Elle est devenue le cheval de bataille des fractions du capital les plus avancées dans la décadence. Elle leur allie les ouvriers.
L'attachement affectif des ouvriers à leur tradition de lutte, aux mythes et à toute une imagerie dépassée est utilisé aux mêmes fins de leur intégration à l'Etat. Ainsi du Premier Mai, qui signalait naguère des grèves parfois violentes, et qui gardait toujours un caractère de lutte, devenu un jour férié du capitalisme : le Noël des ouvriers. L'Internationale est chantée par des généraux, et des curés font dans l'anticléricalisme.
Tout cela sert le capitalisme pour cette raison que l'objectif de lutte, attaché à une période écoulée, a disparu, alors que les formes de cette lutte survivent sans leur ancien contenu.
LES ELEMENTS D'UNE PERSPECTIVE REVOLUTIONNAIRE
Le procès de prise de conscience révolutionnaire, par le prolétariat, est directement lié au retour des conditions objectives à l'intérieur desquelles peut s'effectuer cette prise de conscience. Ces conditions peuvent se ramener à une seule, la plus générale, que le prolétariat soit éjecté de la société, que le capitalisme ne parvienne plus à lui assurer ses conditions matérielles d'existence.
C'est au point culminant de la crise que cette condition peut être donnée. Et ce peint culminant de la crise, au stade du capitalisme d'Etat se situe dans la guerre.
Jusqu'à ce point, le prolétariat ne peut se manifester en tant que classe historique, ayant sa propre mission. Il ne peut s'exprimer, bien au contraire, qu'en tant que catégorie économique du capital.
Dans les conditions actuelles du capital, la guerre généralisée est inévitable. Mais ceci ne veut pas dire que la révolution soit inéluctable, et moins encore son triomphe. La révolution ne représente qu'une des branches de l'alternative que son développement historique impose aujourd'hui à l'humanité. Si le prolétariat ne parvient pas à une conscience socialiste, c'est l'ouverture d'un cours de barbarie dont, aujourd'hui, on peut mesurer quelques aspects.
MAI 1952 - M.
[1] [52] On sait que ce résumé a été fait par Lucien Laurat (l'Accumulation du Capitale d'après Rosa Luxemburg; Paris 1930). Voir aussi J. Suret, le marxisme et les crises, Paris 1933. Léon Sarbre, la Théorie marxiste des crises 1934 - et c'est toute la bibliographie française sur ce sujet.
[2] [53] René Papin dans Problèmes économiques n°159 16-1651
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les théories des crises dans la gauche hollandaise
- 3376 reads
Dans cette troisième partie, noue traitons un des aspects les plus importants des fondements théoriques de la gauche hollandaise. Dès le début de son existence à l'aube de ce siècle, la gauche hollandaise a donné une interprétation du matérialisme historique qui allait devenir une caractéristique marquante de l'Ecole marxiste hollandaise"(A.Pannekoek, H.Gorter, H.Roland-Holst). Cette interprétation de la méthode marxiste est souvent appelée le "spontanéisme". Nous montrerons dans cet, article que ce terme n'est pas approprié. La position de Gorter et Pannekoek sur le reflet de la spontanéité a permis à la gauche hollandaise de comprendre les changements imposés à la lutte ouvrière avec l'ouverture de la période de décadence du capitalisme. Nous verrons en même temps certaines faiblesses chez Pannekoek qui sont poussées à leurs conséquences les plus absurdes par les "conseillistes" d'aujourd’hui..
Le marxisme a été un apport décisif pour la théorie socialiste dans la mesure où, contrairement aux socialistes utopiques, il ne partait pas de présupposés arbitraires ou dogmatiques. La théorie marxiste en effet part "des individus réels, de leur action et des conditions matérielles d'existence dans lesquelles ils vivent, conditions matérielles qu'ils ont trouvées toutes prêtes et qu'ils ont crées par leur propre action" ([1] [55]). Qu'on se rappelle de la formulation sur le matérialisme historique dans la "Préface à la contribution à la critique de l'économie politique" de Marx :
"Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, politique et intellectuel en général. Ce n'est pas la conscience des honnies qui détermine leur être; c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression, juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une période de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel - qu'on. peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse- des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi; il faut au contraire, expliquer cette conscience par les contra dictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et lei rapports de production. Une formation sociale ne disparait jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société.
C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre; car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de le devenir. A grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d'époques progressives de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production social« contradictoire non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui nait des conditions d'existence sociale des individus : cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. "
(Contribution à la Critique de l'Economie Politique. Ed. Sociales 1966. Préface. p.4,5)
LA CONTRIBUTION DE LA GAUCHE HOLLANDAISE AU MATERIALISME HISTORIQUE
On peut mettre en relief deux aspects fondamen1 taux du matérialisme historique en fait indissolublement liés :
1. Qu'il existe un rapport entre l'être et la conscience ou en d'autres termes entre l'infrastructure et la superstructure;
2. Qu'il y a une relation nécessaire entre le développement des forces productives et les rapports de production.
De l'antagonisme entre les forces productives et les rapports de production, nous pouvons déduire la nécessité objective d'une société communiste. La théorie marxiste pour qui l'être détermine la conscience permet de comprendre aussi comment les ouvriers agissent subjectivement dans le processus de la révolution. L'"Ecole marxiste hollandaise" a toujours mis l'accent sur ce facteur subjectif, sur le rapport entre l'être et la conscience, sur le rapport entre l'infrastructure et la superstructure. Rosa Luxemburg s'est également attachée à clarifier la question du développement de la conscience de classe. En 1904, elle s'opposa à Lénine qui défendait la position de Kautsky selon laquelle la conscience est apportée de l'extérieur dans la lutte de classe et non un produit de la lutte elle-même. Pour Rosa Luxemburg, cette question était capitale face â la bureaucratisation de la Social-Démocratie allemande. En s'appuyant sur l'histoire du mouvement ouvrier en Russie, elle montra que seule l'initiative créatrice des larges masses prolétariennes peut mener à la victoire :
"Dans ses grandes lignes, la tactique de lutte de la Social-Démocratie n'est en général pas à "inventer"; elle est le résultat d'une série ininterrompue de grands actes créateurs de la lutte de classe souvent spontanés, qui cherche son chemin. L'inconscient précède le conscient et la logique du processus historique objectif précède la logique subjective de ses protagonistes".
Rosa Luxemburg. "Questions d'organisation dans la Social-Democratie russe". Article paru en 1904 dans l'"Iskra" et dans la "Neue Zeit" Marxisme contre Dictature, Ed. Spartacus 1946 p.24
Rosa Luxemburg et la gauche hollandaise défendaient cette position sur le rôle de la spontanéité des masses qui n'a rien à voir avec la position spontanéiste des conseillistes d'aujourd'hui. Le "spontanéisme" néglige complètement la tâche des éléments les plus conscients dans la classe : que la conscience une fois surgie de l'expérience de la lutte devienne le point de départ pour les luttes futures. Les spontanéistes et les conseillistes se réclament de l'expérience prolétarienne pour la rejeter ensuite.
Au contraire l'"Ecole marxiste hollandaise" a approfondi les positions défendues par Rosa Luxemburg sur le rôle de la spontanéité dans la développement de la conscience de classe. Gorter, Pannekoek et Roland-Holst ont trouvé dans le travail de Joseph Dietzgen (un Social-Démocrate de la première génération) un développement de la pensée marxiste selon laquelle l'être détermine la conscience. Ils ont écrit beaucoup d'articles sur les positions de Dietzgen et Gorter a traduit son œuvre la plus importante : "L'essence du travail intellectuel humain" ([2] [56]) en hollandais.
La gauche hollandaise pensait qu'il était nécessaire de souligner les aspects subjectifs du matérialisme historique parce que :
"Les grandes révolutions dans les modes de production (du féodalisme au capitalisme, du capitalisme au socialisme) se produisent parce que de nouvelles nécessités transforment l'esprit de l'homme et produisent une volonté; quand cette volonté se traduit en actes, l'homme change la société pour répondre aux nouveaux besoins".
PANNEKOEK ("Le marxisme comme action" dans "Lichtstrahlen" n°6. 1915)
Ces lignes furent écrites au moment où les forces productives sont entrées clairement en contradiction avec les rapports de production capitalistes; la première guerre mondiale a démontré de la façon la plus horrible la décadence du capitalisme.
La Social-Democratie, d'où sa trahison, s'est montrée incapable de s'adapter aux besoins du prolétariat dans la période de décadence, à l'époque des guerres et des révolutions sociales.
"L'heure a donc sonné aujourd'hui pour souligner l'autre aspect négligé jusqu'alors du marxisme parce que le mouvement ouvrier doit se réorienter, doit se libérer de l'étroitesse et de la passivité de la période révolue pour surmonter sa crise".
(ibidem)
Cependant, en soulignant l'aspect subjectif du marxisme, Pannekoek a négligé l'aspect objectif du matérialisme historique. Les contradictions qui se manifestent dans l'infrastructure de la société pendant la période de décadence du capitalisme sont négligées, niées, repoussées dans l'avenir (nous verrons plus loin la critique de Pannekoek des différentes théories des crises et les effets de sa critique sur les épigones conseillistes d'aujourd'hui). Pannekoek craignait que certaines théories des crises puissent amener la classe ouvrière à attendre passivement un effondrement "automatique" du système capitaliste. Dans l'article cité ci-dessus de 1915, Pannekoek souligne que le marxisme a deux aspects : "l'homme est le produit de circonstances, mais à son tour il transforme les circonstances". Selon Pannekoek, ces deux aspects sont "également justes et importants; c'est seulement par leur liaison étroite qu'ils forment une théorie cohérente. Mais bien entendu dans des situations différentes l'un ou l'autre de ces deux aspect prévaut". (Idem).
Ainsi, dans la période difficile des lois anti-socialistes de 1878 à1890, quand Bismarck mit hors la loi la Social-Démocratie, l'idée était de laisser mûrir les circonstances. Le cours fortement fataliste qu'avait pris le matérialisme historique pendant ces années a été, selon Pannekoek délibérément entretenu jusque pendant les années précédant la première guerre mondiale. Kautsky disait qu'un vrai marxiste était celui qui laissait mûrir les circonstances. Le besoin de nouvelles méthodes de lutte menaçait les habitudes routinières des dirigeants du parti. Pannekoek avait raison lorsqu'il soulignait la nécessité de mettre l'accent sur l'élément subjectif dans le matérialisme historique, mais, ce faisant, il sous-estimait l'évolution objective du capitalisme. Le prolétariat devait agir consciemment, poser de nouveaux problèmes, les soulever et les résoudre dans l'expérience de la lutte. Bien sûr, mais pourquoi ? Quels sont ces nouveaux problèmes ? Pourquoi sont-ils soulevés ? Pourquoi le besoin d'une nouvelle société, du communisme ? Le capitalisme peut-il encore se développer ? Qu'a-t-il à offrir à l'humanité ?
Chez Pannekoek, nous ne trouvons en général pas de réponse, ou quand elles existent elles sont insuffisantes, ou même fausses. Il n'avait pas vu clairement que le changement objectif dans le capitalisme, la décadence posait la nécessité de l'activité de masse du prolétariat. Alors que le développement progressif des luttes pour des réformes menées par les syndicats et les parlementaires socialistes, était adéquat dans la période précédente, il n'est plus approprié dans la période de décadence.
THEORIE DES CRISES
Les réponses aux questions posées ci-dessus se trouvent dans les théories marxistes des crises. En cherchant à déterminer les lois objectives du développement du capitalisme, ces théories essaient d'évaluer si les crises qui se produisent sont des crises de croissance d'un mode de production dans une période ascendante et prospère ou, au contraire, si ces crises sont des expressions d'un système en déclin qui doit être remplacé consciemment par une nouvelle classe révolutionnaire.
En partant des théories des crises, nous pouvons déduire certaines conséquences programmatiques importantes, même s'il est vrai que la conscience de la nécessité d'accélérer l'évolution historique du capitalisme par la lutte n'est jamais le produit d'arguments "purement économiques" Les théories des crises clarifient le processus de la lutte de classe. Mais en même temps, cette clarification est un besoin important de la lutte. Une théorie des crises donne aux révolutionnaires des arguments précieux contre l'idéologie bourgeoise, dans leur tâche de stimulation de la conscience de classe qui se développe par et dans la lutte. Avec la théorie des crises, la classe ouvrière a pu comprendre, par exemple, que les idées proudhoniennes sur l'autogestion n'abolissent pas en fait l'esclavage salarial. La théorie marxiste des crises a combattu les illusions réformistes en montrant que les réformes ne signifiaient rien d'autre qu'une relative amélioration de la situation de la classe ouvrière, et, en même temps, poussaient le développement capitaliste vers sa décadence finale. Aujourd'hui, la théorie des crises montre à la classe ouvrière que la lutte pour défendre son niveau de vie ne peut plus être une lutte pour des réformes puisque le capitalisme ne peut plus offrir d'améliorations durables.
Cette unité fondamentale des deux aspects objectif et subjectif du matérialisme historique apparaît très clairement dans l'œuvre de Rosa Luxemburg. Elle ne met pas simplement l'accent sur le rôle de la spontanéité des masses dans le développement des nouvelles méthodes de lutte, elle dit aussi pourquoi ces nouvelles tactiques sont nécessaires. Dans un cours donné à l'Ecole centrale du Parti en 1907, elle souligne que "les syndicats les plus forts sont complètement impuissants" contre les conséquences du progrès technique sur le salaire :
"La lutte contre la chute du salaire relatif n'est plus une lutte sur le terrain de l'économie marchande mais devient un assaut révolutionnaire contre l'existence même de cette économie; c'est le mouvement socialiste du prolétariat. D'où les sympathies de la classe capitaliste pour les syndicat -qu'elle avait d'abord combattus furieusement- dès que la lutte socialiste commence et dans la mesure où les syndicats se sont retournés contre le socialisme.
ROSA LUXEMBURG.("Introduction à l'économie polit. que Ed. Antropos. 197U, p.. Z48
Dans l'"Accumulation du capital", Rosa Luxemburg trace les 1imites historiques de la production capitaliste dans la maturation croissante du marché mondial. Déjà dans le "Manifeste Communiste", nous trouvons l'idée que les crises cycliques qui, aux yeux de Marx et Engels étaient une manifestation de la contradiction entre les forces productives et les rapports de production, ne peuvent être surmontées que par la conquête de nouveaux marchés, par la création du marché mondial. Dans 1"Idéologie allemande", ils appellent cette création du marché mondial "une interdépendance universelle, cette première forme naturelle de coopération mondiale historique des individus", une pré condition de la révolution mondiale qui mènera au "contrôle et à la gestion consciente de ces forces nées de l'interaction des hommes, les ont éblouis et dominés jusqu'à nos jours".
Dans "Le Capital", Marx dit explicitement :
"En exposant ainsi la réification des rapports de production et comment ils deviennent autonomes vis a vis des agents de la production, nous ne montrons pas dans le détail comment les interférences du marché mondial, ses conjonctures, les mouvements des prix de marché, les périodes du crédit, les cycles de l’industrie et du commerce, les alternances de prospérité et de crise, apparaissent à ces agents comme des lois naturelles toutes puissantes, expression d'une domination fatale, et qui se manifestent à eux sous l’aspect d'une nécessité aveugle. Nous ne le montrerons pas parce que le mouvement réel de la concurrence se situe en dehors de notre plan et que nous n'avons à étudier ici que l'organisation interne du mode de production capitaliste, en quelque sorte dans sa moyenne idéale".
Marx.("Le Capital". Tome III. Ed. Sociales. p.208)
Ce projet de décrire seulement l'organisation interne du capitalisme était complètement justifié dans la mesure où le capitalisme après les années révolutionnaires troublées de 1848-1849 était entré dans une longue période de prospérité. Marx et Engels ont conclu : "Une nouvelle révolution n'est possible que comme résultat d'une nouvelle crise. Mais elle est aussi sûre que la crise elle-même". Marx semblait se rendre compte que la période de révolution sociale n'était pas encore commencée et que le capitalisme était encore dans sa phase de développe ment progressif. "Le Capital" est une démystification de l'idéologie bourgeoise de son époque qui tentait de masquer les divisions en classes de la société et présentait le capitalisme comme un système éternellement progressif.
Il est évident que Rosa Luxemburg ne pouvait pas se contenter du plan de Marx. Elle voyait dans les mouvements de masse et dans l'impérialisme la manifestation de l'épuisement de l'ère progressive du capitalisme. Son étude de l'"Accumulation du capital" lui a permis d'écrire dans le programme du parti communiste d'Allemagne après la première guerre mondiale et dans le feu de la révolution allemande :
"la guerre mondiale a placé la société devant l’alternative : ou bien continuation du capitalisme avec comme perspectives prochaines une nouvelle guerre et la chute dans le chaos, ou bien le renversement des exploiteurs capitalistes. Par la guerre, la domination bourgeoise a fourni- la preuve négative de son droit d l'existence; elle n'est plus en état de tirer la société du terrible effondrement économique que l'orgie impérialiste a laissé derrière elle... Seule, la révolution mondiale du prolétariat peut introduire l'harmonie dans ce chaos..."
ROSA LUXEMBURG.("Que veut Spartakus ?". 1918. Collection Spartacus)
Au début de la période de décadence, tous les révolutionnaires ont senti le besoin de développer la "théorie des crises pour montrer les conséquences de la décadence sur les luttes ouvrières : Lénine, Boukharine, Luxemburg, etc., et Gorter (cf. sa brochure intitulée "L'impérialisme, la guerre mondiale et la Social-Démocratie". 1915, citée dans la première partie de cette série d'articles). Pannekoek qui a saisi les implications politiques du changement dans le capitalisme plus que d'autres est resté fermement opposé aux théories économiques qui cherchaient à déduire des causes objectives les Changements dans les méthodes de lutte prolétarienne. Comme nous allons le voir, sa critique des théories des crises a contribué malheureusement très peu au développement de la conscience de classe.
LA CRITIQUE DE PANNEKOEK A LA THEORIE DE LA CRISE MORTELLE DU CAPITALISME
Avec le reflux de la lutte révolutionnaire, le KAPD tourna son attention vers le développement d'une théorie de la "crise mortelle du capitalisme", et revint au déterminisme économique de la direction du parti Social-démocrate avant 1914.
Après des années de silence quasi-total, Pannekoek entra à nouveau dans la discussion dans la gauche communiste. En 1927, il publia un article sous le pseudonyme de Karl Horner dans "Proletarier" de la tendance de Berlin du KAPD sous le titre "Principe et tactique" (juillet-août 1927).
Réfutant la théorie de la "crise mortelle du capitalisme", voici comment Pannekoek définit la question de la crise d'une nouvelle manière :
"Quelles sont les conséquences pour le développement révolutionnaire ? Une fois de plus, la question de la crise mortelle' vient au premier plan, posée maintenant clairement : sommes nous en face d'une dépression économique qui durera assez longtemps pour que la réaction du prolétariat, conséquence de celle-ci devenue permanente mène à la révolution ?
Il est certain que la position selon laquelle le capitalisme ne peut plus revenir à une phase de prospérité et a atteint une crise finale qu'il ne peut plus surmonter est partagée par le KAPD. Parce que cette question est très importante pour la tactique du KAPD, elle requiert une observation plus approfondie".
Pannekoek fit remarquer justement que la théorie de "la crise mortelle du capitalisme" renvoie à "L'Accumulation du capital" de Rosa Luxemburg, mais dit aussi que cette théorie mène à des conclusions qui ne sont pas tirées dans "L'Accumulation du capital" parce que "le livre a été publié quelques années avant la guerre" (sic!). Ensuite Pannekoek revient à sa critique de "L'Accumulation du capital", critique publiée en 1913 et republiée dans un des numéros de "Proletarier". Dans ces critiques, Pannekoek entre dans les détails des schémas de la reproduction du capital à son niveau le plus haut tels qu'ils se trouvent dans "Le Capital", Tome: II. Nous n'entrerons pas dans le débat sur la façon dont Rosa Luxemburg et d'autres ont interprété le plan de Marx. La question essentielle est que le plan devait être corrigé, comme nous l'avons dit plus haut, question jamais abordée par Pannekoek. Celui-ci a voulu mettre en garde contre la position selon laquelle le capitalisme est parvenu à une crise finale, ce qui conduirait selon lui à l'adoption d'une tactique à court terme. Pannekoek pensait qu'une nouvelle période de prospérité n'était pas à exclure.
Pour argumenter cette position, il montra la possibilité de nouvelles découvertes d'or qui pourraient stimuler à nouveau la demande et insista sur l'apparition de l'Asie Orientale comme un facteur indépendant dans la production capitaliste. Dans la mesure où Pannekoek illustra la question de l'or et de l'Asie Orientale en se référant au capitalisme au 19ème siècle, il ne défendit pas seulement la possibilité d'une reprise économique (dans le sens où la théorie de la crise mortelle posait le problème); mais nia même que le capitalisme entrait dans une nouvelle phase différente de la phase d'ascendance et de prospérité dont le 19ème siècle faisait partie. La reprise de la production capitaliste qui eut lieu effectivement au milieu des années 30 ne fut pas le résultat de découvertes d'or ([3] [57]) mais d'une découverte qui aboutit au même résultat .
Ce ne fut pas la découverte de nouvelles ressources d'or qui remit en mouvement le flux économique, mais la découverte du rôle stimulateur de l'Etat dans l'économie, notamment à travers l'inflation. Celle-ci de 1933 à la guerre ne stimula guère la demande en moyens de production et de consommation comme le prétend l'idéologie keynésienne de l'intervention de l'Etat, mais principalement en moyens de destruction : le matériel de guerre, belle prospérité!
Dans le même sens, l'apparition de l'Asie Orientale comme un facteur "indépendant" dans la production capitaliste, prit la forme de l'impérialisme japonais et de l'axe Berlin-Rome-Tokyo. La "nouvelle période de prospérité économique du capitalisme" prédite par Pannekoek, ne peut pas être comparée aux mouvements conjoncturels de prospérité et aux crises commerciales du 19ème siècle. La prétendue "prospérité" par l'économie de guerre au milieu des années 30 n'était qu'un moment essentiel du cycle de crise-guerre-reconstruction-crise, etc., caractéristique de la période historique de décadence du capitalisme. Mais/néanmoins, Pannekoek touche du doigt la question lorsqu'il dit que toute éventuelle prospérité doit conduire à une crise plus violente, qui provoquera à nouveau la révolution.
DECADENCE ? "CRISE FINALE"? LES CONSEQUENCES POLITIQUES DE LA CRISE SELON LE KAPD ET LE GIC
Dans la deuxième partie de cet article, nous avons déjà vu que Pannekoek a montré depuis le début que les "Unions" n'étaient pas une organisation unitaire et qu'il était préférable d'abandonner les "unions" pour le parti. Aussi, la question de savoir si les "unions" doivent organiser ou soutenir les luttes salariales n'était pas la bonne question à ses yeux. Plus intéressante était pour lui la question de savoir si oui ou non les révolutionnaires devaient intervenir dans les luttes salariales et, dans ce cas, comment. Malgré toutes les confusions sur les taches des 'unions", nous trouvons dans un texte de la Tendance Essen du KAPD/AAUD sur la 'crise mortelle du capitalisme" des arguments très valables sur la nécessité impérieuse de transformer les luttes salariales en luttes pour la destruction du capitalisme :
"Là où l'offensive de la bourgeoisie pour réduire les salaires et les conditions de vie des ouvriers amène à une lutte économique pure de groupe d'ouvriers touchés, ceci se termine presque sans exception par une victoire pour les patrons et une défaite des ouvriers. Cette défaite des ouvriers dans de telles luttes, malgré des grèves tenaces et puissantes, trouve sa cause une fois de plus dans la réalité de la crise mortelle du capitalisme lui-même (...). Le résultat de ces luttes de défense sur les salaires dans la période de crise mortelle du capitalisme est une preuve amère mais irréversible que la lutte pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions dans le capitalisme à l'heure de sa crise mortelle sont une pure utopie et que, par conséquent, les syndicats, dont la seule tache historique est de s'occuper de la vente de la force de travail à la bourgeoisie, avec tous leurs buts, leurs moyens de lutte et leur forme d'organisation, sont devenus complètement anachroniques du 'fait du processus historique et sont par conséquent des formations contre-révolutionnaires. Les syndicats savent que leur rôle vital comme vendeurs de la force de travail prolétarienne sera dépassé dès que les bases de cet échange, le système économique capitaliste s'effondrera. Par conséquent, ils essaient de conserver les conditions de vie du capitalisme, qui sont en même temps leurs propres conditions de vie, en bradant la force de travail prolétarienne au plus bas prix".
("Proletarier,"1922)
Pannekoek prêta attention attentivement à cet argument économique. L'article de Pannekoek "Principe et tactique" eut un tel succès dans les organisations de la gauche communiste allemande et hollandaise de la fin des années 20 que certaines tendances commencèrent à voir une contradiction entre discuter la théorie des crises et discuter de la conscience de classe. Certaines tendances ignorèrent complètement tout besoin d'élaboration théorique sur les crises. Mais tous arrivèrent à la position sur "la crise du capitalisme", "la décadence du capitalisme", formulée dans le programme de 1920 du KAPD d'où tous venaient. Ce fut aussi le cas avec le groupe des Communistes Internationalistes (GIC) auquel Pannekoek contribua régulièrement à partir de 1926. Dans ces prises de positions, le GIC écrit :
"Le développement du capitalisme mène à des crises toujours plus violentes qui s'expriment elles-mêmes dans un chômage toujours croissant et une dislocation toujours plus forte de l'appareil de production, de sorte que des millions d'ouvriers se retrouvent hors de la production et en proie d la famine. L'appauvrissement croissant et l'incertitude toujours croissante de l'existence contraint la classe ouvrière d commencer la lutte pour le mode de production communiste..."
Lorsque P. Mattick fit adopter par les IWW (Indus-trial Workers of the World) la théorie de Grossman de la baisse tendancielle du taux de profit dans leur programme après 1929 (voir "La crise mortelle du capitalisme", Chicago. 1933), Pannekoek étendit sa critique de Rosa Luxemburg à la théorie de Mattick de la crise à travers un exposé qu'il fit au GIC et qui fut publié. Il mettait à nouveau en garde sur le fait que l'effondrement final, dont parlait Mattick pouvait arriver plus tard que prévu et que, fondamentalement, seule la classe ouvrière pouvait mettre fin au capitalisme. Le GIC fut d'accord avec les conséquences politiques de la critique de Pannekoek, conséquences avec lesquelles nous pensons aujourd'hui que les groupes et les éléments révolutionnaires peuvent être globalement d'accord. Dans une brochure de 1933 sur "les mouvements de l'économie capitaliste", le GIC s'engage dans une discussion style "l'oeuf ou la poule" qui continue encore aujourd'hui entre ceux qui défendent la théorie de la crise à travers la saturation des marchés (Rosa Luxemburg) et ceux qui défendent la théorie de la crise à travers la baisse tendancielle du taux de profit (Boukharine/Lénine, Grossman/Mattick). Dans cette brochure, le GIC se présente lui-même comme un avocat de l'explication par la baisse tendancielle du taux de profit mais en même temps insiste sur un fait souligné par l'autre théorie de la saturation des marchés :
"Le monde entier a été relié en un immense atelier. Ceci signifie que les crises au niveau actuel de spécialisation, ont un caractère international".
Nous pouvons dire que dans ses grandes lignes, le GIC suit la théorie économique de P. Mattick. Mais, en même temps, le GIC fait la même mise en garde que Pannekoek :
"Particulièrement à l'époque actuelle où nous entendons parler beaucoup de "crise mortelle" du capitalisme, de la "crise finale" dans laquelle nous nous trouvons, il est important d'être attentif à la caractéristique essentielle de la crise actuelle. Celui qui ne l'est pas subira toutes sortes de désillusions et de surprises tant vis à vis des mesures par lesquelles les classes dominantes essaient de subsister que du développement futur du système capitaliste. Un effondrement "absolu" est attendu, sans se rendre compte de ce que cela signifie. Il faut dire que le capitalisme est plus fort que prévu parce que l'effondrement "absolu" n'est pas venu, parce qu'une grande partie de la vie économique continue à fonctionner. La transition du capitalisme au communisme n'est pas par conséquent un processus automatique mais sera toujours reliée au degré développement de la conscience de la classe ouvrière.
C'est la raison précise pour laquelle la propagande des principes est nécessaire".
("De bewegingen van het kapitalistische bedrijfsleven" - Permaterial GIC, 6.Jg n°5)
Dans ce sens, le GIC, dans les années suivantes s'est attaché à analyser les mesures de la bourgeoisie qui menaient au développement de l'économie guerre. Il a montré que la "planification" économique abaissait le niveau de vie de la classe ouvrière sans réellement surmonter la crise. Voici la conclusion d'un article sur "la'planification' économique en Hollande" :
"Il est clair que les rapports de propriété sont entrés en conflit avec les forces productives. Et en même temps, ceci montre clairement que le problème ne peut être résolu sur la base de la production capitaliste. Le problème ne peut être résolu qu'à partir d'une 'économie' mondiale basée sur la division internationale du travail, sur des fondements communistes"
("Radencommunisme", mai 1936)
Un deuxième article sur cette question démystifia les "plans de travail" sociaux-démocrates qui s'inscrivaient dans la tendance à l'étatisation, suivant en cela l'exemple de l'organisation fasciste du capital. Le GIC a montré que les Sociaux démocrates dans le gouvernement avec plein pouvoir stimulèrent la défense nationale alors qu'en même temps, l'économie de guerre créait de nouvelles conditions de lutte pour les ouvriers : les luttes purement économiques devenaient inutiles contre la politique organisée des prix; les luttes pour la conservation du système légal bourgeois-démocratique agonisant devenaient inutiles. Les articles du GIC sur l'Allemagne montrèrent comment la Social-Démocratie et la politique étrangère de l'URSS durant la période de la République de Weimar amenèrent la "planification" économique et la défaite des luttes ouvrières et conservèrent la puissance militaire de l'Allemagne qui pouvait être perfectionnée par les Nazis en une machine de guerre fonctionnant pleinement.
PANNEKOEK AUX EPIGONES CONSEILLISTES
Revenons au "dédain" de Pannekoek pour les théories économiques de la crise. Dans "Les conseils ouvriers" écrit pendant la 2ème guerre mondiale, il traite de façon cohérente et globale la question des limites du développement capitaliste. Partant de l'idée développée dans "Le Manifeste Communiste", l'expansion du capitalisme à l'échelle mondiale, Pannekoek arrive à la conclusion que la fin du capitalisme approche :
"Lorsque les centaines de millions de gens qui vivent dans les plaines fertiles de l'Asie de l'Est et du Sud seront poussés dans le cercle du capitalisme, la tâche principale du capitalisme sera remplie".
(P. Aartsz: "Les Conseils ouvriers", ch..II par. 6)
Il est intéressant de voir que Marx posait la même question dans une lettre à Engels du 8 octobre 1858 :
"La véritable mission de la société bourgeoise est de créer le marché mondial, du moins dans ses grandes lignes et de développer la production sur cette base. Comme le monde est rond, cette mission semble être achevée avec la colonisation de la Californie et de l'Australie et l'ouverture du Japon et de la Chine. La question difficile pour nous est la suivante : sur le continent, la révolution est imminente et adoptera immédiatement un caractère socialiste. Ne sera-t-elle pas nécessairement étouffée dans ce petit coin, puisqu'a une échelle beaucoup plus grande, le mouvement de la société bourgeoise est encore dans sa phase d'ascension ?"
("Textes sur le collectivisme", Ed.Moscou, p.343)
Mais dans ses articles sur la Chine de ces mêmes années, publiés dans le "New York Daily Tribune: Marx répond à cette question par la négative.
Aujourd'hui, 120 ans plus tard, les épigones de Pannekoek continuent à défendre l'idée que le capitalisme a encore une grande tâche à remplir en Asie ([4] [58]).
Alors que Marx montrait dans les années 1850 que l'attente américano-britannique concernant le développement du commerce avec l'ouverture de la Chine était grandement exagérée, à l'heure actuelle, la bourgeoisie du bloc américain est déjà parvenue à cette conclusion concernant la réouverture récente de la Chine au bloc occidental : la bourgeoisie occidentale ne fournit qu'équipements militaires en préparation d'une troisième guerre mondiale et voit même ses échanges diminuer vu l'étroitesse du marché chinois. Aujourd'hui, la crise est là. Personne de sensé n'oserait prétendre qu'elle n'existe pas.
Les conseillistes actuels, comme "Daad en Gedacht" laissent partout entendre que le capitalisme est libéré des crises, sinon en paroles, du moins par leur silence sur la crise actuelle. Exagération de notre part ? C'est ce que prétend Cajo Brendel (cf. Wereld Revolutie) en réponse à nos critiques :
"Je pense que je connais les positions de"Daad en Gedacht" d'une certaine façon. Je voudrais savoir où "Daad en Gedacht" n'a jamais écrit quelque chose qui puisse justifier cette position. Autant que je sache, "Daad en Gedacht" prend exactement la position opposée en disant qu'il ne peut y avoir de capitalisme libéré des crises (...). C'est une chose de dire qu'il ne peut y avoir de capitalisme sans crises et tout à fait une autre de parler de "crise permanente" ou "crise mortelle" du capitalisme ou quelque chose comme ça. Déjà, dans les années 30, le GIC non seulement présumait mais aussi prouvait avec des arguments que la crise permanente n'existe pas. Je suis toujours d'accord avec ceci, mais quiconque 'traduit' cela en la croyance à un capitalisme sans crises montre à mon avis qu'il n'a rien compris d cette position..."
Nous pensons aussi connaître un peu les positions de "Daad en Gedacht" pour autant qu'on les trouve dans des publications ! Peut-être ne lisons-nous pas très bien, mais nulle part, nous ne trouvons qu'il ne peut y avoir de capitalisme sans crises. A part la brochure "Beschouwingen over geld en goud" (une répétition de la théorie marxiste de la valeur-travail et des fonctions de la monnaie et de l'or), nous n'avons trouvé un seul article sur les sujets économiques durant ces dix dernières années. Ce silence sur la crise semble être un des principes de ce groupe !
Qu'entendons-nous donc par "crise permanente" et "crise mortelle", termes qui furent développés par la gauche allemande ? Défendrions-nous l'idée que l'effondrement, la mort du capitalisme serait aussi certain qu'un phénomène physique dans un laboratoire? Telle n'est pas notre pensée.
Si le terme de "crise permanente" signifie quelque chose, c'est parce qu'il se réfère à toute une période du. capitalisme, la période de décadence, dans laquelle le cycle crise-guerre-reconstruction-crise... a remplacé le cycle périodique et conjoncturel de crises commerciales et de prospérité dans la période ascendante du capitalisme. Il n'y a pas, bien sûr, de "crise mortelle" au sens d'un effondrement automatique du capitalisme; le capitalisme ne saurait trouver d'issue que dans la guerre mondiale, si le prolétariat n'agit pas dans un sens révolutionnaire.
Le capitalisme pourrait sortir de la crise s'il était encore dans une période de développement, parce qu'il pourrait encore pénétrer de nouvelles aires géographiques, possibilité que suggère Cajo Brendel dans son livre sur l'Espagne et la Chine. Mais Cajo Brendel et Daad en Gedacht ne sont pas intéressés à cette question. Leur étude de multiples prétendues "révolutions bourgeoises" (Espagne 36, Chine) part d'un cadre national et non de l'internationalisme qui était déterminant pour Marx et Pannekoek (cf. "Les Conseils Ouvriers"), même si Pannekoek fit une réponse différente à cette question.
C'est de cet internationalisme dont nous nous revendiquons, celui de Pannekoek, de la gauche communiste internationale dont la gauche hollandaise fut une partie avant de dégénérer lentement.
A l'heure où la crise ouverte du capitalisme mondial est une réalité criante, il est important d'approfondir les apports de la gauche hollandaise. Si elle est restée tâtonnante, multiple et diverse dans son élaboration de la théorie de la crise capitaliste, elle a du moins exposé les problèmes et contribué à l'enrichissement de la théorie marxiste même si elle ne les a pas résolus. Elle a surtout maintenu l'essentiel : sa fidélité de classe à la révolution communiste, à l'internationalisme, aux principes prolétariens.
F.K
[1] [59] Marx-Engels: Idéologie Allemande - Ed. Soc. p45
[2] [60] Traduction "Champ Libre", 1973, avec une préface de Pannekoek.
[3] [61] 'Parce que l'or est le seul de s produits du travail à avoir le pouvoir spécifique d'acheter sans avoir d'abord été vendu, il peut ainsi être le point de départ du cycle et le mettre en mouvement". (Karl Horner: "Principe et Tactique"- Proletarier 1927)
[4] [62] Voir la critique du CCI sur les "Thèses sur la révolution chinoise" de Cajo Brendel dans "Les épigones - du conseillisme"(II), Revue Internationale n°2)
Conscience et organisation:
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 22 - 3e trimestre 1980
- 2649 reads
La signification du raid américain sur l'Iran
- 4002 reads
Dans les moments de crise de la société, l'histoire semble s'accélérer. En quelques semaines, des événements qui avaient, au moment où ils se sont produits, secoué les esprits, apparaissent comme de petites péripéties lointaines. Après deux mois, le raid américain du 24 avril sur l'Iran sombre déjà dans le quasi-oubli. Cependant, les problèmes qu'il a mis en évidence ou qu'il a rappelés demeurent avec toute leur importance :
- le rôle déterminant de l'Iran dans le dispositif stratégique du bloc américain,
- le chaos qui continue de régner dans ce pays dont l'incapacité des autorités légales à régler le problème des otages n'est qu'un des aspects, chaos qui ne fait qu'exprimer le chaos général dans lequel s'enfonce le monde actuel,
- l'accentuation des préparatifs de guerre de la part des blocs impérialistes et notamment des U.S.A. dont le raid sur l'Iran avait une résonance qui allait bien au delà des événements qui secouent ce pays : mise en garde au bloc adverse, resserrement des liens des pays du bloc autour de leur chef de file, poursuite et intensification du bourrage de crâne de la population.
C'est dans la mesure où elle tente d'éclairer ces différents problèmes que cette prise de position du C.C.I. à la suite du raid américain, malgré le côté "daté" de certains événements (notamment ceux d'Iran), demeure d'actualité.
Une nouvelle fois, avec le raid américain du 24 avril en Iran, ce pays, ainsi que la menace d'une guerre mondiale, viennent d'être placés au centre du jeu politique international. Au delà de toutes les campagnes de brouillage mises en œuvre par la bourgeoisie et ses mass-médias, autour du "fiasco" des U.S.A., il importe que les révolutionnaires et la classe ouvrière aient une idée claire
- des véritables objectifs de la bourgeoisie américaine,
- de la situation, tant en Iran que sur la scène internationale, que traduit cet événement.
A - L'opération américaine en Iran n'est pas un fiasco.
C'est au contraire une réussite. On pourrait parler de fiasco si les objectifs qui étaient visés n'avaient pas été atteints, or, ils l'ont été. Ces objectifs étaient les suivants :
1) signifier à la bourgeoisie iranienne que les USA n'étaient pas disposés à supporter plus longtemps l'anarchie qui règne dans son pays,
2) signifier aux autres pays du bloc qu'on attendait d'eux une solidarité active non pas seulement face à la question de l'Iran mais à l'ensemble des problèmes auxquels les USA et son bloc sont confrontés sur la scène internationale,
3) signifier à l'URSS la détermination des USA face à toute tentative de ce pays de mettre à profit quelque situation que ce soit pour élargir sa zone d'influence : les USA ne toléreront pas un nouveau Kaboul,
4) relancer sur le plan interne le mouvement de "solidarité nationale" déjà mis sur rails au moment de la "découverte" des troupes russes à Cuba et considérablement amplifié au moment de la prise des otages de Téhéran et de l'invasion de l'Afghanistan.
Il est clair que si l'objectif des USA avait été de délivrer les otages de Téhéran on pourrait alors parler de fiasco. Par contre, si ces objectifs sont bien ceux énumérés ci-dessus, c'est bien de réussite qu'il faut parler :
- la bourgeoisie iranienne n'a aucunement profité du raid pour renforcer sa campagne anti-américaine; au contraire, la modération de sa réponse, mis à part les bavures imputables aux éléments les plus fanatiques et stupides du clergé, a indiqué qu'elle avait bien reçu le message,
- les gouvernements de tous les principaux pays du bloc U.S. ont apporté un soutien sans faille à Carter après l'opération américaine : il est même intéressant de constater que c'est le seul point où il y a eu accord lors du récent sommet des pays de la C.E.E., à Luxembourg,
- l'URSS a fait preuve, elle. aussi, d'une grande modération dans sa condamnation des "menées" américaines, se contentant de dénoncer "l'irresponsabilité" de Carter : elle indiquait par là qu'elle avait bien compris la mise en garde qui lui était adressée,
- une majorité de la population américaine et l'ensemble de l'appareil politique des USA ont apporté leur appui à Carter malgré l'échec officiel de l'opération.-
B - Pour quelles raisons faut-il considérer que ce sont bien là les principaux objectifs de la bourgeoisie américaine ?
1) L'Iran constitue une pièce essentielle du dispositif stratégique du bloc américain. En premier lieu, son importance comme producteur de pétrole, c'est-à-dire un des nerfs de la guerre moderne, n'est pas à démontrer. Mais là n'est pas la raison essentielle de son importance, le bloc US dis posant avec le Mexique, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, les Emirats et l'Irak de stocks considérables (sans compter que les gisements iraniens pourraient être, si nécessaire, conservés à l'occident par l'Irak interposé). En fait, c'est bien la position géographique de ce pays :
- qui contrôle le détroit d'Ormuz, point de passage des pétroliers
- qui a une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec l'URSS,
- qui constitue un obstacle dans la progression de l'URSS vers les "mers chaudes" dont la mainmise sur l'Afghanistan a constitué un pas important, qui lui confère cette importance exceptionnelle pour le bloc US et qui a motivé le fait que celui-ci l'équipe, du temps du Shah, d'une des armées les plus puissantes du monde.
Les secteurs les plus importants de la bourgeoisie iranienne ont depuis longtemps été conscients de ce fait et de l'intérêt qu'ils avaient de monnayer l'importance de leur pays au sein du bloc US plutôt que de le laisser devenir un satellite de l'URSS. Même aux moments de plus fort anti-américanisme de ces derniers mois, il ne s'est dégagé de force politique importante en faveur du bloc russe. C'est pour cela que les événements d'Iran, le conflit entre ce pays et les USA n'ont constitué à aucun moment une expression du conflit entre les grands blocs, mais une affaire interne du bloc US. C'est notamment pour cette raison que les USA ne sont pas intervenus militairement jusqu'à présent ; préférant faire un maximum d'efforts pour reprendre les choses en main de façon progressive et donc plus efficace.
Cependant, l'Iran ne peut assumer son rôle de pion essentiel du jeu américain que s'il dispose d’un minimum de stabilité interne et d'un pouvoir fort : son incapacité à jouer son rôle de gendarme de la région n'est certainement pas étrangère à la décision de l'URSS d'envahir l'Afghanistan.
Or, depuis la chute du Shah, il y a plus d'un an, l'Iran n'est pas sorti de l'anarchie ; depuis date, il ne s'est dégagé dans ce pays de force politique en mesure de reprendre en main la situation, de constituer un réel pouvoir. C'est d'ailleurs bien parce qu'ils prévoyaient une telle situation et non par aveuglement que les Etats-Unis ont soutenu pratiquement jusqu'au dernier moment un régime qui pourtant faisait l'unanimité contre lui. Successivement Baktiar et Bazargan ont échoué dans tentative de remettre de l'ordre dans le pays pour le compte du capital national et du bloc US. En fait, l'affaiblissement considérable, à cause de ses liens trop étroits avec le régime du Shah, de la seule force qui soit en général en mesure dans les pays sous-développés d'exercer le pouvoir, l'armée, a pratiquement privé le capital iranien de carte politique de rechange : l'Eglise a très bien joué son rôle en tant que force de mystification mais n'a, comme nulle part ailleurs, de quelconque compétence pour assumer le pouvoir politique. La prise des otages de Téhéran :
- en refaisant dans un premier temps une unité nationale fortement menacée par les soulèvements nationalistes et les luttes ouvrières,
- en pouvant permettre dans un deuxième temps de mettre en évidence l'impasse dans laquelle les secteurs les plus arriérés et fanatiques de la classe dominante entraînaient le pays et d'isoler ces secteurs, aurait pu marquer le début d'une reprise en main de la situation au bénéfice des Etats-Unis. Bani Sadr, représentant, après Bakhtiar et Bazargan, les secteurs les plus modernes et lucides de la bourgeoisie nationale, mais jouissant d'une audience "populaire" plus grande que ses prédécesseurs, a pu porter les espoirs américains d'une telle reprise en main. Son élection à la présidence de la république constituait une première étape d'un tel processus mais il est rapidement apparu qu'il était incapable d'exercer une réelle autorité sur l'ensemble de la classe dirigeante et notamment sur le secteur ecclésiastique. Pour le moment, il n'existe pas de pouvoir réel en Iran : l'appareil étatique légal est paralysé tant par ses dissensions internes que par l'action de multiples forces sociales et politiques qui n'acceptent pas son autorité :
- classe ouvrière
- minorités nationales
- église
- forces paramilitaires "islamiques" (les "gardiens de la révolution") ou "de gauche" (les "moudjahidin").
La classe ouvrière a joué un rôle déterminant dans le renversement du régime du Shah : à l'automne 78 ce sont ses grèves qui, en paralysant l'appareil économique du pays, ont donné le signal du "lâchage" du Shah par les dernières forces qui le soutenaient encore, notamment les USA. Depuis, les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de la "république islamique" n'ont pas réussi à la mettre réellement au pas.
De même les minorités nationales, Baloutches, Arabes et surtout Kurdes, ont mis à profit les bouleversements de Téhéran pour entrer en sécession, sécession que les efforts successifs de l'armée et des "pasdars" (ou "gardiens de la révolution") n'ont pas réussi à liquider malgré des massacres répétés.
Face à ces deux forces de désagrégation du pays, le capital iranien a trouve un soutien actif de la part de l'église chiite et des "gardiens de la révolution" qui se sont illustrés dans la répression. Mais, en même temps, ces forces n'ont cessé de mettre à profit leur place dans cette répression pour agir pour leur propre compte par dessus le pouvoir légal dont l'armée semble constituer, malgré sa désorganisation et ses tensions internes, le seul pilier. Ces divisions entre les différents secteurs de l'appareil politique, idéologique militaire du pays n'ont pu, en fin de compte, qu'encourager les soulèvements des minorités nationales et la lutte ouvrière. Une remise en ordre du pays pour le compte du capital national et du bloc US passe donc par une remise en ordre préalable au sein de cet appareil, remise en ordre qui ne peut, en fin de compte, se faire qu'autour de l'armée et de la bourgeoisie industrielle.
Le message que les USA, à travers leur opération, ont envoyé à la bourgeoisie iranienne est donc clair : "remettez de l'ordre dans votre maison, sinon nous viendrons nous-mêmes le faire". Et il semble que ce message commence à être compris, notamment par Khomeiny qui vient d'autoriser Bani Sadr à nommer un premier ministre et à prendre le commandement suprême de toutes les "forces de l'ordre" ainsi que le contrôle de l'ensemble des moyens d'information (même si, en même temps, il continue à lui mettre des bâtons dans les roues en appelant à "voter islamique") ([1] [64]).Apparemment affaibli par le raid américain, Bani-Sadr s'en révèle en fait un des bénéficiaires : c'était bien un des objectifs des U.S.A.
2) Globalement, depuis le début de l'aggravation des contradictions économiques du capitalisme à la fin des années 60 et des tensions inter-impérialistes qui en ont résulté, le bloc US a fait preuve d'une bonne cohésion tendant à se renforcer au fur et à mesure que ces tensions devenaient plus vives et non à "s'effriter" comme l'ont pensé certains groupes comme le P.I.C. ("Pour une Intervention Communiste"). S'il s'est maintenu en son sein des orientations diplomatiques ou militaires apparemment différentes, cela résultait du fait :
- que l'existence de blocs n'élimine nullement les antagonismes d'intérêts, notamment commerciaux, entre les pays qui les constituent,
- qu'il est souvent plus facile pour le bloc de faire exécuter certaines tâches par des pays apparemment "indépendants" (par exemple les interventions militaires et diplomatiques de la France en Afrique et au Moyen Orient).
Cependant, même limitée et relative, cette "souplesse" du bloc US est de moins en moins de mise au fur et à mesure que s'exacerbent les tensions inter-impérialistes. Avec une telle exacerbation :
- les intérêts nationaux doivent céder de plus en plus le pas aux intérêts généraux du bloc qui, pour une bonne part, s'identifient avec les intérêts nationaux du pays leader. Par exemple, la "mauvaise humeur" manifestée par certains alliés des U.S.A., en constatant que ce pays favorisait en sous-main les hausses pétrolières, devait faire place à une plus grande « discipline » ;
- l'utilité pour le bloc d'une apparente "indépendance" de certains de ses composants -surtout efficace sur le plan diplomatique- s'amoindrit pour tendre à se convertir en handicap quand s'impose le langage des armes dans la mesure où une telle "indépendance" risque, sur le plan international, d'être comprise comme un manque de cohésion et une faiblesse du bloc et ne favorise pas, sur le plan interne, les campagnes de mobilisation idéologique.
Ce besoin d'une plus grande cohésion du bloc autour du chef de file, rendu nécessaire par les nouvelles données de la situation internationale, mais qui n'avait pas été suffisamment perçu, au gré des USA par tous les alliés, notamment par ceux qui se faisaient tirer l'oreille pour s'associer aux restrictions commerciales envers l'URSS et au boycott des jeux olympiques; ce besoin a été affirmé avec fracas par le raid américain du 24 avril. Cette opération venait souligner et concrétiser la détermination des USA de s'assurer une plus grande solidarité de la part de ses alliés, détermination qui s'était exprimée par les déclarations de Carter à quatre chaînes de télévision européennes le 13 avril et qui avaient été accueillies avec des réticences par certains pays européens. L'opération du 24 avril, en contradiction avec l'assurance de ne pas intervenir militairement avant la mi-mai donnée aux alliés, mettait ceux-ci au pied du mur : le 28 avril, au sommet de Luxembourg, les neuf "réaffirment leur solidarité avec le gouvernement et le peuple des Etats-Unis". Le deuxième objectif du raid américain est atteint.
3) Si l'URSS a envahi l'Afghanistan, c'est qu'elle avait la certitude qu'elle n'allait pas se heurter de front aux forces armées du bloc occidental, certitude qui s'appuyait notamment sur le fait que le gendarme local de ce bloc, l'Iran, était paralysé par des convulsions internes. Les USA ont été obligés d'inscrire l'Afghanistan à la colonne "pertes" de leur bilan mais il était très important pour eux et pour leur bloc que cette mésaventure rie se renouvelle pas. Il leur importait donc de signaler très clairement à l'URSS qu'eux aussi étaient capables de mener des actions militaires en dehors de leurs frontières, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis la guerre du Vietnam. En particulier, ils se devaient d'avertir très clairement l'URSS qu'ils n'accepteraient pas qu'elle sorte de la prudence qu'elle avait manifestée jusqu'à présent à l'égard de l'Iran, qu'elle utilise l'instabilité de ce pays pour y avancer ses propres pions. Et un tel avertissement avait besoin, pour être pris pleinement au sérieux, d'être ponctué par une manifestation concrète de la détermination américaine : l'intervention en Iran remplissait également cet office. Lorsque le 9 mai, Carter a rappelé ses paroles du 23 janvier : "Toute tentative extérieure pour prendre le contrôle de la région du Golfe serait considérée comme étant une attaque contre les intérêts vitaux des Etats-Unis et serait repoussée par tous les moyens, y compris par les armes", il était mieux en mesure de signifier que sa détermination n'était pas uniquement verbale, qu'il ne s'agissait nullement de velléités mais bien d'un choix politique et militaire délibéré et décidé
4) Depuis novembre 79, la population américaine subit un bourrage de crâne quotidien destiné à la préparer aux impératifs militaires de sa bourgeoisie et, en particulier, à l'idée d'une intervention extérieure, idée qui, depuis la guerre du Vietnam était fort peu populaire. Dans l'ensemble, cette opération a donné ses fruits mais on a pu noter quelques "couacs" dans l'exécution de la partition composée par le maestro Carter :
- réactions contre le recensement en vue de la mobilisation,
- persistance de grèves ouvrières.
En réalité, le battage intensif mis en œuvre par l'ensemble des médias ne peut conserver à la longue son efficacité, de même qu'il ne peut faire oublier de façon permanente les dures conséquences de la crise qui frappent la classe ouvrière, que s'il est relancé à intervalles réguliers par quelque événement spectaculaire. Après l'affaire des otages, la bourgeoisie américaine a exploité au maximum l'invasion de l'Afghanistan (même si l'importance de l'enjeu de ce dernier événement va de très loin au delà d'une simple campagne idéologique) et a cultivé avec application le sentiment antirusse notamment à travers le battage sur les jeux olympiques, mais il était utile de donner plus de corps aux campagnes bellicistes en ajoutant "des actes à la parole". Le raid américain en Iran présentait le triple avantage :
- de donner satisfaction aux secteurs de la population qui demandaient que "quelque chose soit tentée" pour libérer les otages,
- de tester le degré d'adhésion de la population à l'idée d'une intervention extérieure,
- de préparer par la pratique et non seulement par les mots cette population à des interventions futures bien plus importantes.
Bien que l'opération se présente comme un fiasco piteux, il ne faut pas se cacher que son principe a reçu, de façon majoritaire, l'approbation de la population américaine. Par ailleurs, cette opération a été l'occasion de mettre en évidence et de renforcer encore l'unité qui existe au sein de la bourgeoisie sur les problèmes de politique extérieure. Par exemple, aucun des concurrents de Carter pour l'élection présidentielle n'a tenté de tirer profit du "fiasco" pour l'attaquer sur ce terrain. Au contraire, c'est une belle unanimité qui s'est manifestée. A cet égard, il serait erroné de considérer la démission de Cyrus Vance comme une manifestation de crise politique. En réalité elle correspond à l'infléchissement de la politique extérieure des USA vers une orientation de plus en plus belliciste et militaire qui n'est remise en cause par aucun secteur important de la bourgeoisie mais que Vance, qui est l'homme d'un certain type de politique, plus basé sur la composante diplomatique, ne pouvait pas personnellement mettre en œuvre.
C - Par rapport à des objectifs qui se révèlent essentiels pour les USA et leur bloc, le raid américain du 24 avril apparaît donc comme une réussite remarquable. Cependant cette opération est présentée presqu'unanimement comme un "fiasco" dans la mesure où :
1°) elle n'a pas atteint son objectif officiel : la libération des otages,
2°) elle affiche une faiblesse de l'armée américaine tant sur le plan de son équipement que de son personnel, ce qui altère la crédibilité de la puissance militaire des USA dans le monde,
3°) elle renforce l'image de marque de Carter corme "l'homme des échecs" ce qui risque, d'après certains, de lui coûter sa réélection.
La bourgeoisie américaine, est-il besoin de le dire, se moque totalement du sort des cinquante otages. Jusqu'à présent, au contraire, cette prise d'otages a servi remarquablement ses desseins (cf. Revue Internationale n° 20 et 21). Pour elle la question de la restitution des otages, si elle s'y intéresse, a uniquement valeur d'indicateur de la capacité du gouvernement officiel iranien à reprendre le contrôle de la situation et de ses dispositions à l'égard des USA : le jour où les otages seront restitués, cela voudra dire que cette puissance pourra de nouveau compter sur l'Iran comme pièce de son jeu militaire. En ce sens, la libération par la force des otages, outre qu'elle aurait privé la campagne idéologique d'un de ses thèmes les plus utilisés, aurait également privé le gouvernement US de cet indicateur. De plus, si l'expédition était arrivée à Téhéran, elle n'aurait très probablement pu délivrer les otages (au cas où ils auraient été encore en vie) qu'au prix de combats assez meurtriers en particulier pour les iraniens (voir la récente opération à l'ambassade d'Iran â Londres), ce qui n'aurait pas facilité un règlement rapide du contentieux entre USA et Iran. D'ailleurs, Carter, dans sa déclaration spectaculaire annonçant "l'échec" de l'opération s'est bien empressé de dire que le sang iranien n'avait pas été versé et que cette opération se voulait "uniquement humanitaire" et non belliqueuse à l'égard de l'Iran : la porte restait ainsi ouverte à une issue à l'amiable du conflit. Ainsi, "l'échec" du raid américain se révèle plus payant à l'égard d'une reprise en main de l'Iran par le bloc US que son éventuelle réussite.
Sur le plan de la campagne idéologique actuelle du bloc américain, "l'échec" du raid est un élément très positif ; il vient renforcer l'argument totalement mensonger qui veut que ce bloc soit en état de faiblesse face au bloc russe. Pour alimenter un mythe il faut un semblant de réalité : de ce point de vue, également, le "fiasco" américain est une belle réussite. Quant à l'idée que peuvent se faire les gouvernements des principaux pays du monde (tant alliés qu'ennemis) sur la puissance réelle des USA, elle est basée sur des éléments bien plus sérieux que cet événement.
Ainsi, même là où elle apparaît comme un échec, l'opération montée par le gouvernement américain se révèle une réussite : même s'il faut se méfier d'une interprétation trop machiavélique des faits et gestes de la bourgeoisie, on peut quand-même affirmer que toute l'opération y compris "l'échec" ressemble fortement à une énorme mise en scène, ce qui est corroboré par :
- le caractère peu vraisemblable des explications techniques de "l'échec" quand on connaît le degré de perfectionnement de l'armement américain,
- le côté spectaculaire et dramatique de l'annonce de cet "échec".
Quant à l'argument de "l'image de marque de Carter" contre une telle interprétation des faits, il n'a pas la moindre consistance d'une part, cette image ne semble pas réellement avoir été affectée par ce "fiasco" de même que ses chances de réélection, d'autre par, un tel argument fait la part belle à l'illusion que la politique de la bourgeoisie serait encore influencée par le suffrage universel : lorsque la bourgeoisie US a décidé de se retirer du Vietnam, elle a sacrifié allégrement la réélection de Johnson en 1968.
En réalité, la bourgeoisie américaine est déjà familière de ce genre de "catastrophes" qui se transforment en réussites. De même qu'il a été établi que la destruction de la flotte américaine du Pacifique en 1941 avait été voulue par Roosevelt afin d'entraîner la population et les secteurs réticents de la bourgeoisie dans la guerre contre le Japon, peut-être apprendra-t-on un jour que le "Pearl Harbour" en petit de Jimmy Carter était cousu de fil blanc.
D - Quel que soit le degré d'authenticité de l'opération américaine en Iran, il est important de souligner qu'elle révèle, sur la présente situation internationale, les faits suivants :
- une nouvelle accentuation très nette de l'orientation belliciste de la politique américaine : si avec ses "prêches" et ses "droits de l'homme" Carter s'était révélé depuis le début comme l'homme des préparatifs de guerre, il confirme aujourd'hui amplement cette orientation ; désormais l'URSS n'aura plus le quasi monopole des expéditions militaires, après s'être essentiellement appuyé sur sa puissance économique, l'impérialisme US s'appuiera de plus en plus sur sa puissance militaire ;
- une nouvelle aggravation des tensions inter-impérialistes (même si l'Iran n'est pas aujourd'hui un enjeu direct).
Plus que jamais, il revient aux révolutionnaires de mettre en évidence et de dénoncer ces préparatifs de guerre et d'en faire un élément de propagande dans leur tâche de participation au développement de la conscience de la classe ouvrière.
C.C.I. le 10.05.80
[1] [65] La récente libération par les "S.A.S." anglais des diplomates iraniens pris en otage dans leur ambassade de Londres, qui a valu au gouvernement britannique les remerciements de Bani Sadr, constitue la face "positive" de ce message, l'expression de la "bonne volonté" du bloc occidental.
Géographique:
- Moyen Orient [10]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Le sectarisme, un héritage de la contre- révolution à dépassé.
- 3028 reads
La troisième Conférence des Groupes de la Gauche Communiste a abouti à une dislocation. Deux des principaux groupes qui l'animaient ([1] [66]) (Partito Comunista Internazionalista -Italie- et Communist Workers Organisation - Grande-Bretagne) ont posé comme condition à la poursuite de leur participation, la fermeture du débat sur la question du rôle du parti révolutionnaire. Le C.C.I. a rejeté une telle condition.
La situation présente de l'effort mené depuis près de quatre ans par un certain nombre de groupes révolutionnaires en vue de créer un cadre facilitant le regroupement des organisations politiques du prolétariat peut se résumer en deux phrases
- il n'y aura certainement plus de conférences comme les trois qui viennent d'avoir lieu ;
- les nouvelles conférences devront, pour être viables,
1°) se débarrasser des restes de sectarisme qui pèsent encore lourdement sur certains groupes, 2°) être politiquement responsables.
Les lecteurs intéressés par les détails du déroulement de la Conférence elle-même, pourront lire le compte-rendu des débats que nous publierons prochainement.
Ce que nous voulons ici, c'est tirer les leçons de l'expérience qu'ont constitué ces trois conférences.
Ces quatre années d'effort pour "le regroupement des révolutionnaires" ont constitué la tentative la plus sérieuse depuis 1968 pour briser l'isolement et la division des groupes révolutionnaires. Quelles qu'aient été ses gigantesques faiblesses, c'est seulement en tirant toutes les leçons que le travail général de regroupement des révolutionnaires pourra être poursuivi.
Il faut, pour aller de l'avant, comprendre les raisons qui ont conduit à la dislocation de la 3ème conférence et définir ce qu'il faut en déduire pour le déroulement des prochaines conférences.
POIDS DU SECTARISME
Au cours de la deuxième conférence, il y eut un débat entre le P.C.Int. ("Battaglia Comunista", selon le nom de son journal) et le C.C.I. à propos du sectarisme. Le C.C.I. avait proposé une résolution condamnant l'attitude sectaire des groupes révolutionnaires qui avaient refusé l'invitation à participer aux conférences internationales. Le P.C.Int rejette la résolution affirmant, entre autres, que le refus des groupes n'était pas une question de sectarisme mais de divergences politiques. Et d'affirmer que nous chassions des fantômes de sectarisme au lieu de nous occuper des divergences politiques. Le PCInt ne parvenait pas à localiser le cheval du sectarisme parce que c'était celui qu'il était en train d'enfourcher. Le sectarisme existe. Nous l'avons rencontré. Tout au long des travaux de ces conférences.
Qu'appelle-t-on sectarisme ?
Le sectarisme c'est l'esprit de secte, l'esprit de petite église. Dans le monde de la religion, la question de savoir qu'est-ce-qui est vrai et qu'est ce-qui ne l'est pas apparaît comme une question d'affrontement d'idées dans le monde éthéré de la pensée abstraite.
Puisqu'à aucun moment la réalité, la pratique matérielle des mortels ne peut être supérieure aux textes sacrés et à leurs interprétations divines, puisque la réalité ne peut trancher les débats, chaque secte en divergence avec d'autres n'a que deux possibilités : ou bien renoncer à ses divergences et disparaître, ou bien vivre éternellement isolée et en opposition avec les sectes "rivales".
Puisque la pratique sociale et matérielle ne peut pas permettre de déterminer où est la vérité, les sectes qui survivent le font inévitablement isolées les unes par rapport aux autres, cultivant amoureusement dans leur mini-monastère "leur vérité" à elles.
Engels disait, parlant des sectes dans le mouvement ouvrier, que l'essentiel de leur vie se résumait à mettre toujours en avant ce qui -les différencie du reste du mouvement.
Et c'est certainement là la manifestation majeure de cette maladie qui isole ses victimes de la réalité
Face à tout problème posé, les sectes n'ont qu'une préoccupation : affirmer ce qui les distingue, ignorer ou condamner ce qui tend à les confondre avec le reste du mouvement.
Cette crainte de reconnaître ouvertement ce qu'on peut avoir de commun avec l'ensemble du mouvement, de peur de disparaître, cette manifestation caricaturale du sectarisme, a toujours entravé les travaux des trois conférences des groupes de la gauche communiste et a finalement conduit à la dislocation de la troisième.
"PAS DE DECLARATIONS COMMUNES" ?
On sait que la 3ème conférence, mai 1980, s'est ouverte dans une situation dominée au niveau de l'actualité par la menace d'une troisième guerre mondiale. Les contributions des groupes pour la préparation de la conférence ont toutes souligné la gravité de la situation et affirmé des positions de classe face à cette menace : une telle guerre serait de même nature que les deux guerres mondiales précédentes : impérialiste. La classe ouvrière mondiale n'a d'intérêts à défendre dans aucun bloc. La seule lutte efficace contre la guerre est celle du prolétariat contre le capitalisme mondial.
Le C.C.I. demanda que la conférence prît position sur cette question et proposa une résolution, à discuter et amender si nécessaire, pour affirmer ensemble la position des révolutionnaires face à la guerre.
Le P.C.Int. refusa et, à sa suite, la C.W.O. et l'"Eveil Internationaliste". Et la conférence resta muette.
Du fait même des critères de participation à la conférence, tous les groupes présents partageaient inévitablement la même position de fond sur l'attitude qui doit être celle du prolétariat en cas de conflit mondial et face à sa menace. "Mais, attention!", nous disent les groupes partisans du silence, "C'est que nous, on ne signe pas avec n'importe qui! Nous ne sommes pas des opportunistes!" Et nous leur répondons : l'opportunisme c'est trahir des principes à la première opportunité. Ce que nous proposions ce n'était pas de trahir un principe, mais de l'affirmer avec le maximum de nos forces.
Le principe internationaliste est un des plus hauts et des plus importants pour la lutte prolétarienne. Quelles que soient les divergences qui séparent les groupes internationalistes par ailleurs, peu d'organisations politiques au monde le défendent de façon conséquente. Leur conférence devait parler sur la guerre et parler le plus fort possible.
Au lieu de cela, elle se tut..."parce qu'on a des divergences sur ce que sera le rôle du parti révolutionnaire de demain !".
Le contenu de ce brillant raisonnement "non opportuniste" est le suivant : puisque les organisations révolutionnaires ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur toutes les questions, elles ne doivent pas parler de celles sur lesquelles elles sont d'accord depuis longtemps.
Les spécificités de chaque groupe priment par principe sur ce qu'il y a de commun à tous. C'est cela le sectarisme.
Le silence des trois conférences (dans les trois le P.C.Int puis le CWO ont refusé toute déclaration commune malgré l'insistance du CCI ([2] [67]) est la plus nette démonstration de l'impuissance a laquelle conduit le sectarisme.
LES CONFERENCES NE SONT PAS UN RING
Sélection ! Sélection ! Telle est la seule fonction que le P.C.Int et le CWO voient aux conférences.
Comment expliquer à une secte qu'elle doit apprendre à envisager l'idée que...peut-être... elle se trompe ? Comment faire comprendre à des sectaires que dans les conditions actuelles, parler d'une conférence qui sélectionne quels sont les groupes qui construiront le parti de demain c'est une absurdité.
Il est certain que dans le processus révolutionnaire il y a des sélections qui se produisent entre les organisations qui se réclament du mouvement ouvrier. Mais ces sélections c'est la pratique de la classe ou les grandes guerres mondiales qui les font et non quelques conciliabules entre organisations. Même des ruptures aussi importantes que celle des bolcheviks et mencheviks ne se sont réellement concrétisées qu'au fur et à mesure de la guerre de 1914 et des luttes de 1917.
C'est pourquoi, en premier lieu, il ne faut pas surestimer la capacité "d'auto-sélection" au niveau du simple débat, des conférences. En deuxième lieu, dans les conditions actuelles, les débats entre révolutionnaires sont loin d'en être au point de pouvoir être tranchés en commun. Pour le moment on en est à peine à tenter de créer un cadre dans lequel un débat puisse commencer à avoir lieu de façon efficace et utile à la classe ouvrière. La sélection, on en parlera en temps voulu.
CONCLURE UN DEBAT QUI N'A PAS EU LIEU ?
Le P.C.Int et le CWO, par impatience... ou par peur, ont refusé de continuer le débat jusqu'à ses conclusions sur le problème du parti. Cette question est une des plus graves et des plus importantes à laquelle sont confrontés les groupes révolutionnaires actuels, en particulier eu égard à l'appréciation que l'on a de la pratique du parti bolchévik pendant la révolution russe (répression des conseils de Kronstadt -des milliers de morts commandée par le parti bolchevik à la tête de l'Etat et de l'armée, par exemple). Le débat sur cette question n'a jamais encore été sérieusement abordé.
Cela n'a pas empêché le P.C.Int et C.W.O. de décider un beau jour, on ne sait pourquoi, de déclarer la question close et de disloquer la conférence, découvrant soudain qu'ils ne sont pas d'accord avec "les spontanéistes du C.C.I.".
Indépendamment du fait que ni le P.C.Int. ni le C.W.O. ne savent ce que veut dire "spontanéiste" (sinon que c'est quelque chose de différent de ce que EUX ils pensent), il est pour le moins inconséquent de déclarer un débat qui n'a pas eu lieu...CLOS, alors que par ailleurs on le considère de la plus haute importance... au point de servir doivent pas parler de celles sur lesquelles elles sont d'accord depuis longtemps.de justification au fait de se taire sur la menace de guerre mondiale. La gravité de la question ne rend que plus importante la nécessité de la traiter.
LA NECESSITE DU DEBAT ORGANISE ENTRE REVOLUTIONNAIRES
Ce débat doit avoir lieu. Peut-être que nous ne parviendrons pas à le résoudre avant qu'une nouvelle vague révolutionnaire de l'ampleur de celle de 1917-1923 ne vienne trancher dans la pratique la question. Mais au moins nous arriverons aux combats décisifs avec les problèmes correctement posés, débarrassés des incompréhensions et des esprits de chapelle.
La période de luttes de 1917-23 a posé, du point de vue de la question du rôle des avant-gardes, plus de questions qu'elle n'en a résolues.
De l'impuissance du nouveau-né Parti Communiste allemand en janvier 1919 à la répression sanglante de Kronstadt par les bolcheviks en 1921, l'expérience de ces années de soulèvements échoués nous ont plus montre ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Mais encore faut-il savoir quoi et qu'est-ce-qu'on en déduit. Ce débat n'est pas nouveau, il existe, sous ses premières formulations, depuis les années des premiers congrès de l'Internationale Communiste.
Mais c'est inévitablement ce débat que les révolutionnaires devront reprendre aujourd'hui, ouvertement, sérieusement, de façon conséquente, responsable, face à la classe et à l'ensemble des nouvelles forces révolutionnaires qui se développent et vont se développer partout dans le monde. Considérer ce débat clos, terminé aujourd'hui, c'est non seulement ignorer ce que "débat" veut dire, mais c'est surtout fuir sa responsabilité historique (même si ce mot peut sembler un peu grand pour certaines chapelles).
Refuser de le mener dans le cadre d'une conférence de groupes révolutionnaires, c'est refuser de le mener dans le seul cadre sérieux où il puisse avancer ([3] [68]).
Ceux qui fuient ce débat, fuient les nécessités du mouvement révolutionnaire présent, tel qu'il existe actuellement, pour se réfugier dans leurs certitudes livresques.
Dans les luttes futures, ce débat aura lieu dans la classe, à la lumière des problèmes qu'elle rencontrera dans sa lutte, que les révolutionnaires actuels l'aient préparé ou non. Mais ceux qui refusent de l'éclaircir aujourd'hui dans un cadre organisé, que ce soit les super-partitistes de "Programme Communiste" ("Parti Communiste International") ou que ce soit les "anti-constructeurs de parti" du P.I.C. ("Pour une intervention communiste"), ou encore les "non opportunistes" du P.C.Int ou du C.W.O., auront tout fait pour qu'il soit abordé dans les pires conditions.
EXPRIMER LA TENDANCE A L'UNITE DE LA CLASSE
La tendance à l'unification est le propre du prolétariat. La tendance à l'unification des organisations révolutionnaires en est une manifestation. Comme la classe dont elles ont épousé la cause, ces organisations ne sont pas divisées entre elles par des intérêts matériels. Contrairement aux organisations politiques bourgeoises qui incarnent et reflètent les intérêts matériels de certaines fractions de la classe exploiteuse, les organisations révolutionnaires expriment toutes en premier lieu la nécessité de l'unification consciente de la classe. Les révolutionnaires débattent et divergent souvent sur les moyens de cette unité, mais tous leurs efforts sont tendus vers elle.
Etre à la hauteur de leur classe c'est d'abord, pour des révolutionnaires, être capable d'exprimer cette tendance prolétarienne à l'unité, tendance qui fait de cette classe la porteuse de la réalisation de ce que Marx appelait "la Communauté humaine".
UN DIALOGUE DE SOURDS ?
Dans l'esprit de secte, le dialogue avec d'autres ne sert évidemment à rien. "On n'est pas d'accord ! On n'est pas d'accord ! On ne va pas se convaincre !"
Et pourquoi des organisations révolutionnaires
ne convaincraient pas d'autres organisations à travers le débat ? Seules les sectes refusent de remettre en question leurs certitudes ([4] [69]).
Comment se sont donc faits tous les regroupements de révolutionnaires dans le passé si ce n'est en parvenant à travers le débat à "se convaincre" ? Pour la secte, "être convaincu par une autre organisation" ce n'est jamais parvenir à une nouvelle clarté. Pour "les programmistes" c'est être "fottuto" -foutu (d'après un article publié dans "Programma Comunista"). Pour le C.W.O. ou le G.C.I. (Groupe Communiste Internationaliste), c'est tomber sous l'impérialisme d'un autre groupe. Dans les deux cas, c'est le pire malheur qui leur puisse arriver ([5] [70]). Cela peut et doit arriver aux autres, mais pas à eux.
C'est ça l'esprit de secte.
Il est certain que le débat est difficile. Il est très possible, comme nous l'avons déjà dit, que les révolutionnaires ne parviennent pas à trancher ces débats en l'absence de grands mouvements des masses ouvrières, mais :
1°) la difficulté de la tâche n'est pas un argument en soi ;
2°) depuis 1968, une nouvelle pratique de classe a repris dans le monde entier : des U.S.A. à la Corée, de Gdansk et Togliattigrad à Sao Paolo, créant les bases d'une nouvelle réflexion et mettant les minorités révolutionnaires devant leurs responsabilités.
Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Souhaitons que les révolutionnaires n’attendent pas trop longtemps encore pour entendre la puissance des grondements des bouleversements historiques qui se préparent.
CE QUE DEVRONT ETRE LES PROCHAINES CONFERENCES
Un pôle de référence
Les années 80 connaîtront un développement sans précédents de la lutte des classes sous la pression de la crise économique. L'évidence de la faillite du capitalisme, de l'impasse meurtrière dans laquelle il conduit l'humanité si celle-ci ne réagit pas, fait et fera apparaître le projet révolutionnaire prolétarien de moins en moins comme un rêve utopique et chimérique et de plus en plus comme la seule façon de répondre à l'holocauste planétaire que développe la survie du système d'exploitation.
Le développement des luttes prolétariennes s'accompagne et s'accompagnera de plus en plus du surgissement de nouveaux éléments, cercles, organisations révolutionnaires.
Ces nouvelles forces, en cherchant à devenir des facteurs actifs et efficaces dans la lutte internationale du prolétariat, sont et seront rapidement confrontées à la nécessité de se réapproprier les leçons de l'expérience des luttes passées du prolétariat mondial. Tant bien que mal, ce sont les groupes révolutionnaires dont l'existence a précédé le surgissement de ces forces qui ont cherché à définir ces leçons et à reprendre les enseignements du mouvement ouvrier international du passé. Aussi, est-ce inévitablement vers ces organisations que tôt ou tard tendront à se tourner les nouveaux éléments surgis du mouvement, pour tenter de s'armer des acquis fondamentaux du passé. Une des fonctions les plus importantes des Conférences Internationales est celle de permettre à ces nouvelles forces DE TROUVER UN CADRE OU CETTE TACHE PUISSE COMMENCER A ETRE REALISEE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES. Ce cadre c'est celui de la confrontation OUVERTE, RESPONSABLE, et LIEE AUX LUTTES EN COURS entre organisations se situant sur un terrain révolutionnaire.
L'écho rencontré par les trois conférences des groupes de la gauche communiste, l'intérêt soulevé par cette expérience des Etats-Unis à l'Algérie, de l'Italie à la Colombie, démontre, par delà les énormes insuffisances des Conférences elles-mêmes, que ce type de travail REPOND A UNE NECESSITE REELLE dans le mouvement révolutionnaire.
C'est pourquoi la poursuite de ce type de travail constitue aujourd'hui une des responsabilités de premier ordre dans l'intervention des groupes révolutionnaires.
DES CRITERES DE PARTICIPATION SERIEUX
Pour pouvoir remplir cette fonction, les conférences doivent posséder des critères de participation précis, qui permettent le mieux possible de délimiter un terrain de classe. Ces critères ne peuvent pas être le résultat de "coups de tête" de quelques organisations. Contrairement à l'idée initiale du P.C.Int., qui, lors de la préparation de la 1ère Conférence refusait l'établissement de critères de participation, le C.C.I. a toujours défendu
1) la nécessité de ces critères,
2) le fait que ceux-ci doivent reprendre d'une part les principaux acquis de la dernière grande organisation internationale du prolétariat, expression de la dernière vague de lutte révolutionnaire prolétarienne internationale (1917-23) : les deux premiers Congrès de la IIIe Internationale. D'autre part, les principaux enseignements de l'expérience de la 2ème guerre mondiale : nature capitaliste de l'URSS et de tous les Etats soi-disant 'socialistes" ou "en voie de le devenir" ainsi que de toutes les organisations qui, des P.C. aux P.S. en passant par les trotskystes, les "défendent".
Les critères de participation définis par les trois Conférences, constituent en ce sens -avec quelque reformulation mineure telle le remplacement du terme "science du prolétariat" en parlant du marxisme, par celui de "théorie du prolétariat"- une base solide ([6] [71]).
Depuis la IIIe Internationale, les importants débats qui avaient commencé à se dérouler en son sein, en particulier entre les bolcheviks et les "gauches" d'Europe occidentale ont été éclairés par plus de soixante ans d'expérience critique.
Des questions telles que celle du Parti révolutionnaire et de son rôle, la nature des syndicats dans le capitalisme après la 1ère guerre mondiale, la nature des "luttes de libération nationale", les questions du "parlementarisme révolutionnaire" et des tactiques de "fronts uniques", etc. n'ont pas perdu de leur importance depuis lors, au contraire. Ce n'est pas par hasard si ce sont elles qui divisent encore aujourd'hui les groupes révolutionnaires.
Mais leur importance, leur gravité, loin de constituer une entrave à la confrontation organisée entre révolutionnaires, comme le prétendent le CWO et le P.C.Int -devenu soudain un féroce partisan de "nouveaux critères de sélection"- ne rend que plus urgente et inévitable cette confrontation. En ce sens, fermer les conférences en fonction de ces questions, constituerait, dans l'état actuel du mouvement, une condamnation à l'impuissance. Cela transformerait très vite ces conférences en "de nouvelles chapelles".
Les Conférences ne sont pas le regroupement lui-même. Elles sont un cadre, un instrument dans le processus plus global et général du regroupement des révolutionnaires. C'est en les considérant comme telles qu’elles pourront remplir leur fonction et non en cherchant précipitamment à les transformer en une nouvelle organisation politique définie ([7] [72]).
Cependant, l'expérience a démontré, surtout lors de la IIIe Conférence, que les critères politiques généraux de principe, ne suffisent pas à eux seuls.
Les prochaines conférences devront exiger de leurs participants une conviction réelle de l'utilité et du sérieux avec lequel doivent être menées ces conférences. Des groupes qui, tels le G.C.I. (Groupe Communiste Internationaliste) n'assistent (à la IIIe Conférence) que pour "dénoncer" les conférences et faire de la "pêche à la ligne" n'y ont pas leur place.
La première condition évidente pour l'efficacité d'un travail collectif c'est que ceux qui le réalisent soient convaincus de son utilité. Cela devrait aller de soi, mais lors des prochaines conférences, il faudra en tenir compte explicitement.
Se taire, c'est pour des révolutionnaires, nier leur existence. Les communistes n'ont rien à cacher à leur classe. Face à elle, dont ils se veulent l'avant-garde, ils assument de façon responsable leurs actes et leurs convictions.
Pour cela, les prochaines conférences devront rompre avec les habitudes "silencieuses" des trois conférences précédentes.
Elles devront savoir affirmer et assumer CLAIRE1ENT, explicitement, dans des textes et des résolutions courtes et précises, et non dans les centaines de pages des procès-verbaux, les résultats de leurs travaux, qu'il s'agisse de l'éclaircissement des DIVERGENCES et de ce sur quoi elles portent, ou qu'il s'agisse des positions COMMUNES partagées par l'ensemble des groupes.
L'incapacité des conférences passées à mettre noir sur blanc le contenu réel des divergences a été une manifestation de leur faiblesse.
Le silence jaloux de la Ille Conférence sur la question de la guerre est une honte.
Les prochaines conférences devront savoir assumer leurs responsabilités, si elles veulent être viables.
CONCLUSION
Le regroupement des révolutionnaires est une nécessité et une possibilité qui va de pair avec le mouvement vers l'unification de la classe ouvrière mondiale.
Ceux qui, à l'heure actuelle, prisonniers de l'esprit de secte imposé par des années de contre-révolution et d'atomisation du prolétariat, ignorent cette tâche des révolutionnaires, ceux dont le crédo révolutionnaire commence par "NOUS SOMMES LES SEULS !" seront impitoyablement jugés par l'histoire comme des sectes irresponsables et égocentriques.
Pour notre part, nous restons convaincus de la validité et de l'URGENCE du travail de regroupement des révolutionnaires, aussi long, pénible et difficile soit-il.
Et c'est en ce sens que nous continuerons d'agir.
R. Victo
r
[1] [73] Organisations qui ont participé à la conférence : le "Partito Comunista Internazionalista" (P.C.Int. qui publie "Battaglia Comunista"), le"Courant Communiste International"(C.C.I.),"I Nuclei Leninisti"(fusion de l'ex-Nucleo Comunista Internazionalista et ex-Il Leninista), la "Communist Workers Organisation", le "Groupe Communiste Internationaliste", l'"Eveil Internationaliste". L'"Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie" (OCRIA qui publie "Travailleurs Immigrés en Lutte") envoya des contributions écrites. Le groupe américain "Marxist Workers Group" s'y associa et devait envoyer un délégué qui fut empêché à la dernière minute.
[2] [74] Lors de la 1ère conférence, le P.C.Int refusa même une déclaration tentant de résumer les divergences.
[3] [75] Rien ne remplace le débat oral organisé et en prise avec les problèmes de la lutte de classe présente.
[4] [76] Ce n'est pas par simple esprit de boutade que Marx disait que sa devise personnelle était :"Doute de tout". C'est quelqu'un qui n'a cessé toute sa vie de combattre l'esprit de secte dans le mouvement ouvrier
[5] [77] Est-ce-que pour ces groupes, les fractions de gauche de la deuxième Internationale convaincues par les arguments de Rosa, de Lénine, de Pannekoek, de Trotsky, de mener la lutte la plus intransigeante contre la guerre et contre la social-démocratie pourrissante, étaient des "VICTIMES" ?
[6] [78] Critères de participation aux conférences internationales définis lors de la 2ème Conférence :
- Reconnaissance de la Révolution d'Octobre comme révolution prolétarienne
- Reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le 1er et le 2ème Congrès de l'Internationale Communiste
- Rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion
- Rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois
- Orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat
Reconnaissance du refus de l'encadrement du prolétariat derrière, et sous une forme quelconque, les bannières de la bourgeoisie
[7] [79] Le déroulement des conférences, leur élargissement à d'autres groupes n'a pas empêché qu'entre temps des regroupements aient lieu parmi les participants. Ainsi, depuis les premières conférences, le "Nucleo Comunista Internazionalista" et "Il Leninista" se sont unifiés en une seule organisation. De même, l'essentiel des éléments qui constituaient le groupe "For Komunismen" de Suède, présent à la IIe Conférence, a constitué depuis le section en Suède du C.C.I.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les théories des crises, de Marx à l'Internationale Communiste.
- 5830 reads
Dans la période qui précéda la 1ère Guerre Mondiale, puis au cours de la guerre elle-même, les révolutionnaires marxistes se sont efforcés non seulement de dénoncer la nature impérialiste de la guerre, mais aussi d’en démontrer le caractère inévitable tant que le capitalisme resterait le mode de production mondialement dominant.
Contre les pacifistes qui appelaient de leurs vœux un capitalisme sans guerres, les révolutionnaires mettaient en avant l'impossibilité d'empêcher les guerres impérialistes sans détruire en même temps le capitalisme lui-même. L'Accumulation du Capital ou la Brochure de Junius de Rosa Luxemburg, tout comme L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme de Lénine, furent écrits essentiellement avec cet objectif. Les moyens de l'analyse dans ces travaux, tout comme certaines conclusions, y sont différents, mais la préoccupation qui traverse ces ouvrages de bout en bout est la même : celle de l'action révolutionnaire du prolétariat international face à la barbarie capitaliste.
Aujourd'hui, lorsqu'une nouvelle crise ouverte du capitalisme vient de nouveau faire peser la menace d'une guerre impérialiste mondiale, et crée des conditions pour une nouvelle attaque révolutionnaire du prolétariat contre le capital à l'échelle de la planète, il revient aux révolutionnaires de poursuivre ce travail d'analyse de la société capitaliste dans ce même esprit d'INTERVENTION MILITANTE.
Contrairement à ce que peuvent penser les professeurs de marxisme en université, le marxisme ne fait pas partie de l'économie politique : il en est la critique révolutionnaire. Pour les révolutionnaires, l'analyse de la crise actuelle du capitalisme ne saurait être une spéculation académique flottant dans le monde éthéré de l'analyse économique. Elle n'est qu'un moment dans leur intervention globale en vue de préparer les armes de la révolution prolétarienne. Elle n'est pas une pure interprétation du monde capitaliste, mais une arme pour le détruire.
II
Face aux convulsions économiques croissantes que Connaît actuellement le capitalisme, il s'agit donc pour les révolutionnaires de mettre en évidence la vérification des perspectives révolutionnaires marxistes en démontrant :
- que la crise actuelle n'est pas une difficulté passagère du capitalisme, mais une nouvelle convulsion mortelle après plus d’un demi-siècle de décadence
- que, comme en 1914 et en 1939, la seule "solution" que peut offrir le capitalisme décadent à sa crise, c'est une nouvelle guerre mondiale qui risque, cette fois-ci, de mettre en question l'existence même de l'humanité ;
- que la seule issue pour l'humanité face à cette impasse apocalyptique, c'est l'abandon et la destruction de l'ensemble des rapports de production qui constituent le capitalisme, et l'instauration d'une société d'où auront disparues les causes qui ont conduit à cette situation : une société sans marchandise ni échange, sans profit ni salariat, sans nations ni Etat, la société communiste ;
- que la seule force sociale capable de prendre l'initiative d'un tel bouleversement, c'est la principal classe productive elle-même : la classe ouvrière mondiale.
III
Pour s'acquitter de cette tâche, les révolutionnaires doivent être capables de traduire en termes clair largement vérifiables par la réalité de la crise telle que la vit l'ensemble de la société et en particulier la classe ouvrière, les fondements principaux de l'analyse marxiste des contradictions internes du capitalisme. Défendre l'idée de la nécessité et de la possibilité de détruire le capitalisme sans être capables clairement et simplement les origines de la crise de ce système, c'est se condamner à passer soit pour des professeurs d'économie universitaire, soit pour des illuminés utopistes ([1] [80]). Et cette nécessité est d'autant plus algue aujourd'hui que tout indique, contrairement aux mouvements révolutionnaires de 1871, de 1905 ou de 1917-23, la prochaine vague révolutionnaire prolétarienne éclatera non pas à la suite d'une guerre, mais d'une crise économique. De plus en plus le débat sur les causes de la crise du capitalisme se déroulera non plus dans les revues théoriques de quelques groupes révolutionnaires exigus, mais dans les assemblées de chômeurs, les assemblées d'usine, au cœur même de la classe ouvrière en lutte contre les attaques croissantes du capitalisme aux abois. La tâche des communistes dans ce domaine est de savoir se préparer à y être des facteurs efficaces de clarté.
IV
Paradoxalement, la question des fondements de la du capitalisme, pierre de touche du socialisme scientifique, a été l'objet, surtout depuis les débats sur l'impérialisme, de nombreux désaccords entre marxistes.
Tous les courants communistes partagent en général la conception fondamentale suivant laquelle l'instauration d'une société communiste constitue une nécessité et une possibilité à l'ordre du jour de l'histoire à partir du moment où les rapports de production capitalistes cessent de constituer des facteurs indispensables au développement des forces productives pour se transformer en entraves, ou, pour reprendre.la formule du Manifeste Communiste, lorsque "les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créée".
Les désaccords surgissent lorsqu'il s'agit de préciser la façon dont se concrétise cette contradiction générale, lorsqu'il s'agit de définir les caractéristiques et le moment du phénomène économique qui transforme ces institutions, le salariat, le profit, la nation, etc., en entraves définitives du développement précipitant le capitalisme dans la crise, la faillite et le déclin.
Ces désaccords subsistent aujourd'hui, recouvrant souvent les mêmes divergences qui opposèrent les révolutionnaires au début du siècle ([2] [81]). Cependant, l'extraordinaire affaiblissement des forces révolutionnaires, sous les coups de 50 ans de contre-révolution triomphante, la rupture organique quasi-totale avec les organisations du passé, ainsi que l'isolement extrême dans lequel ont vécu les groupes communistes pendant des décennies, ont rendu presque inexistant le débat entre révolutionnaires sur cette question.
Avec la reprise des luttes prolétariennes et le surgissement de nouveaux groupes révolutionnaires depuis dix ans, la discussion a eu une certaine tendance à reprendre, aiguillonnée par la nécessité de comprendre les difficultés économiques croissantes que connaît le capitalisme mondial. Le débat reprend trop souvent cependant sur des bases qui en réduisent la portée et les chances de le faire aboutir à des résultats conséquents pour l'enrichissement de l'analyse.
C'est tout naturellement que le débat a repris autour des discussions laissées en suspens par les théoriciens marxistes du début du siècle et reprises depuis, entre autres, par des groupes comme Bilan, Internationalisme, ou la revue Living Marxism. Au centre du débat, la confrontation entre les analyses de Rosa Luxemburg et celles de ceux qui, rejetant celles-ci, se sont attachés à défendre l'analyse de la baisse tendancielle du taux de profit comme explication fondamentale des contradictions du capitalisme. Mais, malheureusement, ce débat a eu jusqu'à présent une trop forte tendance à se cantonner dans un débat d'exégèses des écrits de Marx, les uns s'efforçant de démontrer que les thèses de Rosa Luxemburg sont "totalement étrangères au marxisme", ou du moins une très mauvaise interprétation des travaux du fondateur du socialisme scientifique, les autres s'attachant à mettre en relief la continuité marxiste des thèses de L'Accumulation du Capital.
Aussi importante puisse être la question de replacer toute analyse "marxiste" par rapport aux travaux de Marx, le débat serait condamné à une impasse totale s'il se cantonnait à cette seule préoccupation. C'est dans la CONFRONTATION AVEC LA REALITE qu'elle prétend expliquer qu'une théorie trouve sa confirmation ou son infirmation C'est seulement au crible de la critique des évènements qu'une pensée peut se développer positivement et trouver les moyens de devenir une force matérielle.
Pour pouvoir se développer avec des perspectives constructives, l'actuel débat sur les fondements de la crise du capitalisme doit donc :
- savoir considérer les analyses des marxistes par le passé, y compris Marx, non pas comme des livres saints dont il suffirait de faire l'exégèse pour qu'ils nous fournissent l'explication de tous les phénomènes économiques du capitalisme présent, mais comme des efforts théoriques qui doivent, pour être compris et repris, être replacés dans le contexte des conditions historiques dans lesquelles ils ont été élaborés ;
- s'attacher à "l'analyse concrète de la réalité concrète" de l'évolution du capitalisme, en confrontant avec cette réalité les différentes théories qui se réclame du marxiste.
C'est alors, et seulement alors, que nous pourrons commencer à déterminer véritablement qui de Luxemburg ou de Grossmann-Mattick par exemple, a fourni des instruments valables de la compréhension du prolétariat des conditions objectives de son action historique. C’est ainsi que nous pourrons véritablement contribuer à l'effort de la classe ouvrière pour s'élever à la conscience des conditions générales de sa mission révolutionnaire.
Il nous apparaît donc fondamental de :
- Replacer de façon générale les principaux travaux des marxistes par le passé dans leur contexte historique afin de mieux en cerner la portée pour la période historique actuelle ;
- Confronter ces résultats à la seule chose qui puisse permettre de trancher et d'avancer dans le débat, à savoir, la réalité du capitalisme, aussi bien dans son évolution depuis la 1ère Guerre Mondiale que dans son actuelle crise.
MARX
C'est au cœur de la crise économique de 1847-48 et en vue d'intervenir dans le mouvement des luttes ouvrières engendré par elle, que Marx expose dans des conférences à l'Association des Ouvriers Allemands de Bruxelles (Travail Salarié et Capital) puis dans le Manifeste Communiste, les fondements de l'explication des crises du capitalisme. En quelques formules simples mais précises, Marx dégage la spécificité majeure de la crise économique capitaliste par rapport aux crises économiques des sociétés passées : contrairement à ce qui se produisait dans les sociétés précapitalistes où la production avait toujours pour objectif immédiat la consommation, dans le capitalisme, où l'objectif du capitaliste est la vente et l'accumulation du capital, la consommation n'étant qu'un pis-aller, la crise économique ne se traduit pas par une pénurie de biens, mais par la SURPRODUCTION : les biens nécessaires à la subsistance ou les conditions matérielles pour les produire existent, mais la masse des producteurs' qui ne reçoit des maîtres que le coût de sa force de travail, est privée des moyens et de l'argent nécessaire pour les acheter. Qui plus est, en même temps que la crise précipite les producteurs dans la misère et le chômage, les capitalistes détruisent les moyens de production qui permettraient de pallier à cette misère.
En même temps, Marx ébauche la raison profonde de ces crises : vivant dans la concurrence permanente entre eux, les capitalistes ne peuvent vivre qu'en développant leur capital et ils ne peuvent développer leur capital sans disposer de nouveaux débouchés. C'est ainsi que la bourgeoisie est contrainte d'envahir toute la surface du globe à la recherche de nouveaux marchés. Mais en même temps qu'elle se livre à cette expansion qui seule lui permet de dépasser et surmonter ses crises, elle rétrécit le marché mondial et crée par là même les conditions de nouvelles crises plus puissantes.
En résumé : par la nature même du salariat et du profit capitaliste, le capital ne peut fournir à ses salariés les moyens d'acheter tout ce qu'il produit. Les acheteurs de ce qu'elle ne peut vendre à ses exploités, la bourgeoisie les trouve dans les secteurs et les nations où ne domine pas le capitalisme. Mais en vendant sa production à ces secteurs, elle les oblige à adopter le mode de production bourgeois, ce qui les élimine comme débouchés et engendre à son tour le besoin de nouveaux débouchés.
"Depuis plusieurs décennies, -écrit Marx dans le Manifeste de 1848- l'histoire de l'industrie et du commerce n'est que l'histoire de la révolte des forces productives contre les rapports de production modernes, contre le système de propriété qui est la condition d'existence de la bourgeoisie et de son régime. Il suffit de rappeler les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate, qui, dans toute autre époque, eut semblé absurde : l'épidémie de la surproduction. Brusquement, la société se voit rejetée un état de barbarie momentanée : on dirait qu'une famine, une guerre de destruction universelle qui ont coupé les vivres ; l'industrie, le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de vivres, trop d'industrie, trop de commerce...".
"... Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'une part en imposant la destruction d'une masse de forces productives ; d'autre part en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens. Qu’est--ce à dire ? Elle prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir." (Souligné par nous).
Qu'entendent Marx et Engels par "s'emparer de marchés nouveaux" ? Le Manifeste répond :
"Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d’importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image... De même qu'elle a subordonné la campagne à la ville, elle a assujetti les pays barbares et demi-barbares aux pays civilisés, les nations paysannes aux nations bourgeoises, l'Orient à l'Occident.".
Comment cette conquête du monde constitue le moyen pour la bourgeoisie de surmonter ses crises et en même temps sa condamnation à des "crises plus générales et plus profondes" ? Dans Travail Salarié et Capital Marx répond :
"C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés." .
Ces formules constituent certainement un raccourci magistral de la théorie marxiste des crises. Ce n'est pas par hasard que Marx et Engels les formulent dans des documents qu'ils ont rédigés dans l'objectif de présenter à la classe ouvrière la quintessence des analyses des communistes. Ni Marx, ni Engels n'ont par la suite remis en question ces formulations, au contraire. Cependant, on ne trouve pas, dans la suite des travaux économiques de Marx un exposé systématique et achevé de ces thèses. Il y a à cela deux raisons majeures :
- La première tient à la façon mime dont Marx avait conçu l'organisation de son étude sur l'économie. La partie consacrée au marché mondial et aux crises mondiales, il l'a toujours envisagée comme devant être la dernière. Or, comme on le sait, il est mort avant de pouvoir mener à leur terme ses travaux sur l'économie.
- La deuxième raison, qui en fait explique en partie la première, tient aux conditions historiques qui ont caractérisé la période vécue par Marx.
En effet, la période historique du 19ème siècle est celle qui voit l'apogée du mouvement de constitution du marché mondial. "La bourgeoisie envahit toute la surface du globe... et crée un monde à son image" constate Marx. Mais le mouvement de constitution du marché mondial n'est pas encore réellement achevé. Le mouvement décrit par Marx suivant lequel le capital "soumet au monde commercial un marché mondial non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés", ce mouvement au travers duquel "le marché mondial se rétrécit", ce mouvement historique qui fait que la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes tout en réduisant les moyens de les prévenir", ce mouvement donc n'est pas encore parvenu au point critique où le marché mondial est tellement rétréci, que la bourgeoisie ne dispose plus de moyens pour prévenir et surmonter ses crises. Le rétrécissement du marché mondial, la restriction des débouchés, n'a pas encore atteint un niveau qui rend la crise du capitalisme un phénomène permanent.
Les crises du 19ème siècle que Marx décrit sont encore des crises de croissance, des crises dont le capitalisme sort à chaque fois renforcé. Les crises commerciales dont parle Marx "qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise", ne sont pas encore des râles d'agonie -comme Marx le reconnaîtra d'ailleurs lui-même quelques années plus tard dans la préface de : Les luttes de classes en France- mais des crises de développement. Au 19ème siècle, comme le dit encore Marx, "la bourgeoisie surmonte ses crises en s'emparant de nouveaux marchés et en exploitant mieux les anciens". Cela lui est possible parce que le marché mondial est encore en constitution. Après chaque crise, il y a encore des débouchés nouveaux à conquérir par les pays capitalistes.
Ainsi, par exemple, de 1860 à 1900, l'Angleterre colonise encore près de 7 millions de milles carrés de territoires, peuplés par 164 millions de personnes (ce qui triple la surface et double la population de son empire) et la France accroit son empire de 3,5 millions de milles carrés et de 53 millions d'habitants (ce qui multiplie par 18 l'étendue et par 16 la population de ses colonies).
Marx assiste au mouvement de développement des contradictions du capitalisme et il définit la contradiction fondamentale qui d'une part IMPULSE ce mouvement et d'autre part le CONDAMNE à une impasse, Marx décèle dans le capitalisme à l'apogée de sa puissance historique, la maladie qui le condamnera à mort. Mais cette maladie ne présentait pas encore à ce stade de développement un caractère mortel. Et de ce fait, Marx ne parvint pas à en étudier tous les aspects.
De même que pour mesurer la résistance d'un matériau, il faut le solliciter jusqu'au point de rupture, de même que pour comprendre toutes les fonctions d'une substance nutritive sur un être vivant il faut en priver celui-ci jusqu'au point où le manque se fait sentir dans toutes ses conséquences, de même il fallait que le marché mondial se soit rétréci au point de bloquer de façon définitive l'épanouissement du capitalisme pour que puisse être analysée dans toute sa complexité sa contradiction fondamentale.
Il faudra attendre le début du 20ème siècle et l'exacerbation des antagonismes entre pays capitalistes pour la conquête de nouveaux débouchés au point de conduire à la préparation de la guerre mondiale, pour que l'analyse du problème franchisse une nouvelle étape et atteigne un niveau plus élevé de compréhension. C'est ce qui sera fait dans les débats sur l'impérialisme.
Marx n'avait pas pour autant cessé toute analyse des contradictions internes du capitalisme après le Manifeste. Dans Le Capital, on retrouve à plusieurs reprises des études détaillées des conditions des crises capitalistes. Mais dans presque toutes ces études, il fait explicitement abstraction du marché mondial renvoyant le lecteur à une étude ultérieure qu'il devait entreprendre sur la question. Plutôt qu'une vision totale du monde capitaliste, qui ne pouvait être autre que celle du marché mondial, il analyse des mécanismes internes au "processus d'ensemble du capital", abstraction faite de tous ces secteurs de l'économie mondiale qu'il nommait dans le Manifeste "les débouchés nouveaux".
Il en est ainsi, en particulier, de la fameuse LOI DE LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT". Cette loi, qu'il a découverte, met en évidence les mécanismes à travers lesquels, en l'absence d'un certain nombre de facteurs contraires, l'élévation de la composition organique du capital (c'est-à-dire l'accroissement de la productivité du travail par l'introduction dans le processus de production d'une proportion croissante de travail mort -machine en particulier- par rapport au travail vivant), conduit le taux de profit du capitaliste à la baisse. Elle décrit les mécanismes économiques qui traduisent au niveau du taux de profit du capital, la contradiction entre, d'une part le fait que le profit capitaliste ne peut être tiré que du travail vivant contenue dans chaque marchandise capitaliste diminue en permanence au profit de celle du travail mort. Dans un monde sans ouvriers où seules les machines produiraient, le profit capitaliste serait un non-sens. La loi de la baisse tendancielle du taux de profit décrit comment, en mécanisant et automatisant de plus en plus la production, le capitaliste doit recourir à une série de mesures pour empêcher la tendance à la baisse de devenir effective.
Marx a ébauché l'étude de ces mesures destinées à enrayer cette baisse et qui font de la loi une loi tendancielle et non absolue. Or, les principaux facteurs qui contrecarrent cette loi sont eux-mêmes dépendants de la capacité du capital à étendre l'échelle de sa production, et donc de sa capacité à se procurer des débouchés nouveaux.
Qu'il s'agisse des facteurs qui compensent la baisse du taux de profit par l'augmentation de la masse du profit, ou qu'il s'agisse des facteurs qui empêchent cette baisse par l'accroissement du degré d'exploitation de l'ouvrier (élévation du taux de plus-value) grâce à l'élévation de la productivité sociale (baisse des salaires réels, extraction croissante de plus-value relative), ces deux types de facteurs fondamentaux ne peuvent jouer que si le capitaliste trouve en permanence de nouveaux débouchés lui permettant d'accroître l'échelle de sa production et donc :
- augmenter la masse des profits ;
- accroître l'extraction de plus-value relative.
C'est pourquoi Marx insiste tant sur le caractère tendanciel et non absolu de cette loi. C'est pourquoi aussi au cours de son exposé de la loi et des facteurs qui la contrecarrent. Il renvois à plusieurs reprises le lecteur à des travaux ultérieurs.
La loi de la baisse tendancielle du taux de profit décrit en réalité la course entre deux mouvements parallèles dans la vie du capitalisme : le mouvement vers la mécanisation et l'automatisation croissante du processus de production d'une part, et le mouvement du capitalisme vers une intensification toujours plus grande de l'exploitation du prolétariat d'autre part ([3] [82]). Si la mécanisation de la production capitaliste se développe plus rapidement que la capacité du capital à intensifier l'exploitation du prolétariat, le taux de profit baisse. Si, par contre, l'intensification de l'exploitation se développe plus vite que le rythme de mécanisation de la production, le taux de profit tend à augmenter.
En décrivant cette course contradictoire, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit met en lumière un phénomène réel. Mais elle ne décrit pas par elle-même tous les éléments de la réalité de ce phénomène, ses causes et ses freins. Aux questions fondamentales : qu'est-ce qui détermine la vitesse de chacun de ces mouvements ? Qu’est-ce qui engendre et entretient la course à la modernisation du processus de production ? Qu’est-ce qui provoque en permanence le mouvement d'intensification de l'exploitation ? A ces questions, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit ne répond pas et ne prétend d'ailleurs pas répondre. La réponse se trouve dans la spécificité historique fondamentale du capitalisme, à savoir, son caractère de système marchand et universel.
Le capitalisme n'est pas le premier mode de production dans l'histoire à connaître l'échange marchand et l'argent. Dans le mode de production esclavagiste, tout comme dans le féodalisme, l'échange marchand existait, mais il ne régissait alors que certains aspects, toujours limités, de la vie productive sociale. Ce qui est spécifique au système capitaliste, c'est sa tendance à universaliser cet échange, non seulement à toute la planète, mais aussi et surtout à tous les domaines de la production sociale, et tout particulièrement à la force de travail. Ni l'esclave, ni le serf ne vendaient leur force de travail. La part qui leur revenait dans la production sociale dépendait d'une part de la production réalisée, d'autre part des règles en usage pour cette répartition.
Dans le capitalisme, l'ouvrier vend sa force de travail. La part qui lui revient dans la production sociale est déterminée par la loi du salaire, c'est-à-dire par la valeur de sa force de travail transformée par le capital en marchandise. Sa "part" n'est que l'équivalent du coût de sa force de travail pour le capitaliste, et encore à condition qu'il ne soit pas au chômage (ce qui ne se posait ni pour le serf, ni pour l'esclave). C'est pourquoi le capitaliste peut connaître cette situation, inconnue auparavant dans l'histoire, d'être en SURPRODUCTION, c'est-à-dire dans une situation où les exploiteurs se retrouvent avec "TROP" de produits, "TROP" de richesses entre les mains, qu'ils ne parviennent pas à réintroduire dans le processus de production.
Ce problème ne se pose pas au capital tant qu'il dispose de marchés autres que ceux constitués par ses propres salariés. Mais de ce fait même, la vie de chaque capitaliste se confond avec une course permanente aux marchés. La CONCURRENCE entre capitalistes, cette caractéristique essentielle de la vie du capital, n'est pas une concurrence pour des honneurs ou des idéaux, mais pour des MARCHES. Un capitaliste sans marchés est un capitaliste mort. Même un capitaliste qui parviendrait le miracle biologique de faire travailler ses ouvriers gratuitement (réalisant alors un taux d'exploitation infiniment grand et donc un taux de profit aussi énorme, ferait faillite du moment qu'il ne parviendrait pas à écouler les marchandises créées par ses exploités. C'est pourquoi la vie du capital est constamment confrontée au choix : conquérir des marchés ou mourir.
Telle est la concurrence capitaliste à laquelle aucun capital ne peut échapper. C'est cette concurrence pour des marchés (ceux qui existent déjà comme ceux à conquérir) qui contraint impitoyablement chaque capitaliste à chercher à produire à des coûts toujours plus bas. Le bas prix des marchandises est non seulement "la grosse artillerie" avec laquelle le capital "démolit toutes les murailles de Chine", qui encerclent les secteurs extra-capitalistes, mais aussi l'arme économique essentielle de la concurrence entre capitalistes.
C’est cette lutte pour baisser les prix de leurs marchandises afin de maintenir ou conquérir des marchés, qui constitue le moteur des deux mouvements dont la vitesse détermine le taux de profit. Les deux moyens principaux dont dispose le capital pour baisser ses couts de production sont en effet :
- la plus grande mécanisation de son appareil productif ;
- la diminution de ses coûts de main d’œuvre, c'est-à-dire une intensification de l'exploitation.
Un capitaliste ne modernise pas ses usines par goût d'un idéal de modernisme quelconque, mais parce qu'il y est contraint, sous peine de mort, par la concurrence sur les marchés. Il en est de même pour la contrainte d'intensifier l'exploitation de la classe ouvrière.
Qu'on envisage donc la baisse tendancielle du taux de profit du point de vue des forces qui la provoquent, ou qu'on l'envisage du point de vue des facteurs qui la modèrent et la contrarient, on a toujours affaire à un phénomène dépendant de la lutte du capital pour de nouveaux marchés.
La contradiction économique exprimée par cette loi, comme toutes les autres contradictions économiques du système, se résolvent toujours dans la contradiction fondamentale entre d'une part la nécessité pour le capital d'élargir toujours plus la production, et d'autre part le fait qu'il ne peut jamais créer en son propre sein, en donnant à ses salariés le pouvoir d'achat nécessaire, les débouchés indispensables à cet élargissement.
C'est pourquoi, après avoir exposé la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, Marx écrit (deux sections plus loin, dans le même 3ème Livre du Capital) :
"Le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu'ils ne sont employés qu'aussi longtemps que leur emploi est profitable pour la classe capitaliste. La raison unique de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économe capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société." ([4] [83])
Comme on l'a déjà dit, et pour les raisons que nous avons exposé (la mort de Marx avant d'avoir mené à bout son étude sur l'économie, les limites de la période historique qu'il vivait), Marx n'a pas pu développer et systématiser l'analyse de "la raison ultime de toutes les crises réelles" du capitalisme. Mais du Manifeste au 3ème Livre du Capital, son énoncé reste le même.
Une théorie sous-consommationniste ?
Afin de mieux préciser le contenu de ce que Marx a effectivement formulé -et au risque de faire encore des concessions aux débats d'exégètes- il nous faut ici répondre à un des derniers arguments développés par un des défenseurs les plus connus de l'idée suivant laquelle la baisse tendancielle du taux de profit constituerait la seule théorie des crises de Marx. D'après Paul -Mattick, dans son livre Crise et théories des crises, les formulations de Marx se référant aux problèmes des marchés provoqués par la consommation inévitablement restreinte des travailleurs, seraient, soit des "fautes de plume", soit des concessions aux théories sous-consommationnistes en particulier de Sismondi.
Marx a critiqué la théorie sous-consommationniste de Sismondi., Mais ce qu'il a rejeté dans cette théorie, ce n'est pas l'idée suivant laquelle le capitalisme est confronté à des problèmes de marché du fait même qu'en élargissant son champ d'action, il restreint toujours en permanence la capacité d'achat et la consommation des travailleurs ; ce que Marx rejette des théories sous-consommationnistes c'est :
- le fait qu'elles envisagent la "sous-consommation" ouvrière comme quelque chose qui pourrait être évité dans le cadre du capitalisme, par des augmentations de-salaires ; montre comment, dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit : plus les capitalistes sont confrontés à la surproduction et au manque de marchés, et plus ils réduisent les salaires des ouvriers ; pour que le capitalisme puisse résoudre ses crises par des augmentations de salaires, il faudrait que la concurrence qui le contraint à réduire toujours plus ses coûts salariaux disparais se, bref il faudrait que le capitalisme ne soit pas le capitalisme ;
- Sismondi était en fait l'expression au 19ème siècle de la petite bourgeoisie condamnée par le capitalisme à la prolétarisation ; au bout de sa théorie, il y avait la revendication d'un capitalisme qui ne 'détruise pas la petite bourgeoisie; la théorie sous-consommationniste de Sismondi' cherchait à démontrer non pas la nécessité pour l'humanité de se libérer de l'échange marchand et donc du salariat pour permettre un épanouissement libre des forces productives dans une société communiste, mais a préconiser un retour en arrière dans l'histoire en freinant la croissance capitaliste qui balaie sur son passage tous les secteurs précapitalistes de la petite bourgeoisie ; si le capitalisme parvenait à contrôler cette soif de croissance aveugle, dit Sismondi, le problème de trouver en permanence des débouchés nouveaux ne se poserait pas... et la petite bourgeoisie agricole, artisanale et commerciale pourrait survivre ; c'est cette vision utopique et réactionnaire que Marx rejette en démontrant qu'elle aboutit ici encore, à nier la réalité et à rêver d'un capitalisme qui ne peut exister.
En résumant le fond de la critique de Marx aux sous-consommationnistes, on peut dire que celui-ci ne rejette pas le problème économique qu'ils posent mais :
- la façon dont ils le posent,
- les réponses qu'ils lui donnent.
La théorie des crises de Marx place au centre de son analyse le problème de l'incapacité pour le capitalisme de créer tous les débouchés nécessaires à son expansion et donc celui de la consommation restreinte des masses de travailleurs. Mais elle n'est pas pour autant une théorie "sous-consommationniste".
DE MARX AUX DÉBATS SUR L'IMPERIALISME
Le dernier quart du 19ème siècle constitua sans aucun doute l'apogée historique du capitalisme. Le colonialisme capitaliste domine presque entièrement la planète. Le capitalisme se développe à des rythmes sans précédent aussi bien en extension qu'en productivité interne. Les luttes syndicales et parlementaires du mouvement ouvrier parviennent à arracher de véritables réformes durables au capitalisme. Les conditions d'existence du prolétariat connaissent dans les pays les plus développés des améliorations certaines en même temps que l'expansion foudroyante du capital mondial semble avoir relégué aux souvenirs du passé les grandes crises économiques.
Dans le mouvement ouvrier se développe alors le "révisionnisme", c'est-à-dire des tendances remettant en question l'idée de Marx du capitalisme condamné à des crises mortelles et mettant en avant la possibilité de passer au socialisme graduellement, pacifiquement par des réformes sociales progressives. Le mot de Bernstein "Le mouvement est tout, le but n'est rien" en résume le contenu.
En 1901, un des principaux "marxistes" révisionnistes, le professeur russe Tougan-Baranovsky, publie un livre soutenant l'idée que les crises du capitalisme découlaient non pas d'un défaut de consommation solvable par rapport à la capacité d'extension de la production capitaliste, mais d'une simple dis-proportionnalité entre les différents secteurs, dis-proportionnalité qui pouvait être évitée au moyen des interventions adéquates des gouvernements. Il s'agissait en fait d'une reprise d'une des thèses fondamentales de l'économie bourgeoise, formulée par J.B.Say, selon laquelle le capitalisme ne peut jamais connaître de véritables problèmes de marchés.
Ces thèses donnèrent lieu à un débat qui porta la Social-Démocratie à se pencher à nouveau sur la cause des crises. Il revint à Kautsky, qui était encore alors le porte-parole le plus reconnu dans tout le mouvement ouvrier des théories de Marx, de répondre à Tougan-Baranovsky. Nous citons ici un extrait de l'article de réponse de Kautsky qui met en évidence comment à cette époque encore il ne faisait aucun doute dans le mouvement ouvrier que la cause des crises du capitalisme résidait bien dans son incapacité à créer les débouchés nécessaires à son expansion.
"Les capitalistes et les ouvriers qu'ils exploitent constituent un marché pour les moyens de consommation produits par l'industrie, marché qui s'agrandit avec l'accroissement de la richesse des premiers et le nombre des seconds, moins vite cependant que l'accumulation du capital et que la productivité du travail, et qui ne suffit pas d lui seul pour absorber les moyens de consommation produits par la grande industrie capitaliste. L'industrie doit chercher des débouchés supplémentaires d l'extérieur de sa sphère dans les professions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode capitaliste. Elle les trouve et les élargit sans cesse, mais trop lentement. Car ces débouchés supplémentaires ne possèdent pas, et de loin, l'élasticité et la capacité d'extension de la production capitaliste.
Depuis le moment où la production capitaliste s'est développée en grande industrie, comme c'était le cas en Angleterre au 19ème siècle, elle possède la faculté d'avancer par grands bonds, si bien qu'elle dépasse en peu de temps l'extension du marché. Ainsi chaque période de prospérité qui suit une extension brusque du marché est condamnée d une vie brève, la crise y met un terme inévitable. Telle est en quelques mots la théorie des crises adoptée généralement, pour autant que nous le sachions, par les "marxistes orthodoxes" et fondée par Marx." ([5] [84]).
Kautsky donne la dimension politique du débat en écrivant dans le même article de 1902 :
"Ce n'est pas par hasard que le révisionnisme a attaqué avec une violence particulière la théorie des crises de Marx."(Le révisionnisme veut faire du parti prolétarien) un parti démocratique où l'aile gauche du parti démocratique des réformes sociales."
Cependant, pour autant que cette théorie résumée "en quelques mots" par Kautsky fut "généralement adoptée" dans le mouvement ouvrier marxiste, personne n'avait entrepris de la développer de façon plus systématique comme se l'était proposé Marx.
C'est ce que tenta de faire Rosa Luxemburg dans les débats sur la nature de l'impérialisme à l'époque de l'explosion de la 1ère Guerre Mondiale.
LES DEBATS SUR L'IMPERIALISME
Le début du 20ème siècle voit l'achèvement des tendances contradictoires décelées par Marx. Le capital a effectivement étendu sa domination au monde entier. Il n'est pour ainsi dire plus un kilomètre carré de territoire sur la planète qui ne soit sous les griffes de l'une ou l'autre des métropoles impérialistes. Le processus de constitution du marché mondial, c'est-à-dire l'intégration de toutes les économies du monde dans un même circuit de production et d'échange, a atteint un degré tel que la lutte pour les derniers territoires non capitalistes devient une question de vie ou de mort pour tous les pays.
De nouvelles puissances, telles l'Allemagne, le Japon, les Etats-Unis, sont devenues capables de concurrencer la toute-puissante Angleterre sur le plan industriel, et cependant, dans le partage colonial du monde, elles sont quasiment inexistantes. Aux quatre coins de la planète, les antagonismes entre toutes les puissances s'exacerbent. De 1905 à 1913, à cinq reprises les antagonismes éclatent en incidents où la marche à la guerre généralisée apparaît de plus en plus comme la seule solution que peut trouver le capitalisme pour se partager le marché mondial. Enfin, l'explosion de la 1ère Guerre Mondiale vint marquer par le plus grand holocauste que l'humanité n'avait jamais connu dans son histoire, l'impossibilité pour le capitalisme de continuer à vivre comme il l'avait fait jusqu'alors. Les nations capitalistes ne peuvent plus se développer parallèlement les unes aux autres, laissant le libre échange et les courses d'explorateurs régler l'étendue de leur domination. Le monde est devenu trop restreint pour trop d'appétits capitalistes. Le libre échange doit laisser la place à la guerre et les explorateurs aux canons. Le développement d'une nation capitaliste ne pourra se faire qu'aux dépens d'une ou plusieurs autres. Il n'y a plus de véritable possibilité d'élargir le marché mondial. Celui-ci ne pourra plus être que repartagé de façons différentes. Le capitalisme ne pourra donc plus vivre que par des guerres et des préparations de guerres pour ces partages et repartages.
"Pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir il pourra uniquement être question de nouveaux partages c'est-à-dire du passage d'un "possesseur" à à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans martre".
(Lénine - L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme)
Sans destruction du capitalisme mondial, l'humanité est condamnée à vivre dans une situation de guerre quasi permanente. "Socialisme ou Barbarie" devient le mot d'ordre de tous les révolutionnaires.
La troisième Internationale se constitue en 1919 sur la base de la reconnaissance et de la compréhension de ce changement, cette rupture historique de caractère qualitatif. Ainsi, le premier point de la Plateforme de l'Internationale Communiste déclare :
"Les contradictions du système mondial, auparavant cachées en son sein, se sont révélées avec une force inouïe en une formidable explosion : la grande guerre impérialiste mondiale. ... UNE NOUVELLE EPOQUE EST NEE. EPOQUE DE DESAGREGATION DU CAPITALISME, DE SON EFFONDREMENT INTERIEUR. EPOQUE DE LA REVOLUTION COMMUNISTE DU PROLETARIAT".
Par ces formules, l'I.C. réaffirmait sa rupture avec les tendances réformistes et patriotardes qui s'étaient développées au sein de la IIe Internationale et qui venaient de conduire le prolétariat à la boucherie inter-impérialiste au nom de la possibilité d'un développement continu des forces productives qui permettrait un passage pacifique du capitalisme au socialisme.
L'I.C. affirmait clairement :
- que la guerre mondiale n'était pas un choix que le capitalisme aurait pu éviter mais la conséquence inévitable, la révélation violente de ses contradictions internes, "auparavant cachées en son sein";
- que cette guerre n'avait pas été une guerre comme les guerres capitalistes précédentes. Elle marquait la fin d'une ère et l'ouverture d'une nouvelle époque, "l'époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur";
- l'I.C. affirmait enfin que l'entrée du capitalisme dans cette époque de déclin, correspond historiquement à la mise à l'ordre du jour de la révolution prolétarienne, à l'ouverture de l'"époque de la révolution communiste du prolétariat":
Toute l'Internationale Communiste reconnaissait donc dans la Première Guerre Mondiale la manifestation du fait que le développement des contradictions internes du capitalisme avait atteint un point de non retour historique.
Cependant si tous les révolutionnaires marxistes partageaient ces conclusions, il n'en était pas de même des analyses qui devaient rendre compte de la nature précise de ces contradictions et de leur développement.
Au sein de ce qui avait constitué la Gauche de la IIIe Internationale, avaient été développées deux théories principales concernant l'analyse de l'impérialisme et des contradictions économiques du capitalisme qui l'engendrent. L'une, celle de Rosa Luxemburg , développée dans L'Accumulation du Capital (1912) puis dans La crise de la social-démocratie allemande, écrit en prison pendant la guerre ; l'autre, celle de Lénine dans L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916).
Pour les deux théories, l'analyse de l'impérialisme et celle des contradictions fondamentales du capitalisme n'étaient que deux aspects d'une même question. Leurs travaux visent les conceptions sociale-démocrates patriotardes qui défendent un pacifisme de parade derrière l'illusion de la possibilité d'empêcher la guerre impérialiste et l'impérialisme lui-même par des luttes légales parlementaires susceptibles d'influencer la politique du gouvernement. Pour Rosa Luxembourg comme pour Lénine, il est impossible d'empêcher la guerre autrement qu'en détruisant le capitalisme, car l'impérialisme n'est que la conséquence des contradictions internes du capitalisme. Répondre à la question : qu'est-ce-que l'impérialisme ? Impliquait donc répondre à cette autre question : quelle est la contradiction fondamentale que le capitalisme cherche à pallier par sa politique impérialiste ?
LA REPONSE DE ROSA LUXEMBURG
La réponse de Rosa Luxemburg se veut -et nous pensons qu'elle le constitue- une poursuite des travaux de Marx sur le développement du capitalisme en le considérant non plus sous la forme abstraite et simplifiée d'un système pur, fonctionnant dans un monde où il n'y aurait 'que des ouvriers et des capitalistes, mais sous sa forme historiquement concrète, c'est-à-dire comme cœur et partie du marché mondial. Sa réponse constitue un développement systématique de l'analyse des crises de Marx, à peine ébauchée du Manifeste au Capital. Dans L'Accumulation du Capital, elle entreprend une analyse de la question de la croissance capitaliste en rapport avec le reste du monde, non capitaliste, en passant au crible d'une méthode marxiste parfaitement maîtrisée, les grandes étapes historiques de cette croissance, puis les différentes approches théoriques du problème.
Sa réponse à la question de l'impérialisme est la simple actualisation des analyses du Manifeste Communiste, soixante ans plus tard. Le capitalisme ne peut pas créer lui-même, en son propre sein, les débouchés nécessaires à son expansion. Les ouvriers, les capitalistes et leurs serviteurs directs, ne peuvent acheter qu'une partie de la production réalisée. La partie de la production qu'ils ne consomment pas, c'est-à-dire, cette partie du profit qui doit être réinvestie dans la production, le capital doit la vendre à quelqu'un en dehors des agents qu'il soumet à sa domination directe et qu'il paie de ses propres deniers. Ces acheteurs il ne peut les trouver que dans les secteurs qui produisent encore suivant des modes de production précapitalistes.
Le capital s'est développé en vendant le surplus du produit de leurs manufactures d'abord aux seigneurs féodaux, puis aux secteurs artisanaux et agricoles arriérés, enfin aux nations "sauvages", précapitalistes, qu'il a colonisées.
Ce faisant, le capital a éliminé les seigneurs, transformé les artisans et les paysans en prolétaires ; dans les nations précapitalistes il a prolétarisé une partie de la population et réduit le reste à l'indigence en détruisant avec le bas prix de ses marchandises les anciennes économies de subsistance.
Pour Rosa Luxemburg, l'impérialisme est essentiellement la forme de vie que prend le capitalisme lorsque les marchés extra-capitalistes devenant trop restreints pour les besoins d'expansion d'un nombre croissant de puissances toujours plus développées, celles-ci sont contraintes à des affrontements permanents et de plus en plus violents pour trouver une place dans le partage du marché mondial.
"L'impérialisme actuel... est la dernière étape du processus historique (du capitalisme) : la période de concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe".
(R. Luxemburg - Critique des critiques, ed. Maspéro, p. 229).
La contradiction fondamentale du capitalisme, c'est-à-dire CELLE QUI EN DERNIERE INSTANCE DETERMINE LES LIGNES DE FORCE DE L'ACTION ET LA VIE DU CAPITALISME, est celle entre d'une part, le besoin permanent d'expansion du capital de chaque nation sous la contrainte de la concurrence et d'autre part le fait qu'en se développant, en généralisant l'instauration du salariat, il restreint les débouchés indispensables à cette expansion.
"Par ce processus, le capital prépare doublement son propre effondrement : d'une part en s'étendant aux dépens des formes de production non capitalistes, il fait avancer le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation, deviendront impossibles. D'autre part, à mesure qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie économique et politique internationale d tel point qu'il provoquera contre sa domination la rébellion du prolétariat international BIEN AVANT QUE L'EVOLUTION ECONOMIQUE AIT ABOUTI A SA DERNIERE CONSEQUENCE : la domination absolue et exclusive de la production capitaliste dans le monde". (Rosa Luxemburg - Critique des critiques, p.152).
Le terme final de cette contradiction théorique ne sera jamais atteint, précise Rosa Luxembourg, car "l'accumulation du capital n'est pas seulement un processus économique mais un processus politique".
"L'impérialisme est d la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin à la lettre d'être atteint. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase ultime du capitalisme une période de catastrophes". (Rosa Luxemburg - L'accumulation du capital, ed. Maspéro, p. 364).
L'exacerbation des antagonismes inter-impérialistes pour la conquête de colonies à la fin du XIXe siècle et début du XXe, avait contraint Rosa Luxemburg, plus que Marx, à se pencher sur l'analyse de l'importance des secteurs non capitalistes pour la croissance du capitalisme. Le recul de l'histoire et les spécificités de la période historique qui la séparait de Marx ont fondé sa conviction de poursuivre par ses travaux l'analyse du maître.
Cependant, en développant son analyse, Rosa Luxemburg a été conduite à faire la critique des travaux de Marx sur la reproduction élargie (en particulier les schémas mathématiques) dans le IIe livre du Capital. Cette critique consistait surtout à montrer d'une part le caractère inachevé de ces travaux que l'on avait trop tendance à présenter comme définitifs et achevés ; d'autre part, à mettre en évidence que le postulat théorique sur lequel ils pétaient fondés -étudier les conditions de l'élargissement de la reproduction capitaliste en faisant abstraction du milieu non capitaliste qui l'entoure, c'est-à-dire en considérant le monde comme un monde purement capitaliste- ne permettait pas de comprendre le problème dans sa totalité.
La publication des travaux de Rosa Luxemburg à la veille de la guerre mondiale provoqua au sein de l'appareil officiel de la Social-Démocratie allemande une réaction extrêmement violente et énergique souvent sous prétexte de "sauvegarder" l’œuvre de Marx : Rosa aurait inventé un problème là où il n'y en avait pas ; le problème des marchés serait un faux problème ; Marx l'aurait "démontré" par ses fameux schémas sur fa reproduction élargie, etc. et au bout de toutes ces critiques "officielles", la thèse des futurs patriotes : l'impérialisme n'est pas inévitable dans le capitalisme.
LA REPONSE DE LENINE
L'analyse de Lénine dans L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, écrit en 1916, ne se réfère pas aux travaux de Rosa Luxemburg et ne traite la question des marchés que de façon accessoire. Pour démontrer le caractère inévitable de l'impérialisme dans le capitalisme "en putréfaction", Lénine met l'accent sur le phénomène de concentration accélérée du capital au cours des décennies qui ont précédé la guerre. En cela son analyse reprend la thèse de Hilferding, Le Capital financier (1910), suivant laquelle ce phénomène de concentration constitue l'élément essentiel de l'évolution du capitalisme à cette époque.
"Si l'on devait définir l'impérialisme aussi brièvement que possible, écrit Lénine, il faudrait dire qu'il est le stade monopoliste du capitalisme."
Lénine définit cinq caractères fondamentaux de l'impérialisme : "Aussi, sans oublier ce qu'il y a de conventionnel et de relatif dans toutes les définitions en général, qui ne peuvent jamais embrasser les liens multiples d'un phénomène dans l'intégralité de son développement, devons-nous donner de l'impérialisme une définition englobant les cinq caractères fondamentaux suivants : 1) concentration de la production et du capital parvenu à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles, dont le râle est décisif dans la vie économique ; 2) fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création sur la base de ce "capital financier" d'une oligarchie financière ; 3) l'exportation de capitaux, d la différence de l'exportation de marchandises, prend une importance toute particulière ; 4) formations d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde, et ; 5) fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes." (chap.VII).
De ces cinq "caractères fondamentaux", trois ont trait à la concentration croissante du capitalisme au niveau national et international. Pour Lénine, la contradiction fondamentale du capitalisme, celle qui le conduit au stade de l'impérialisme et de la "putréfaction", est celle entre sa tendance au "monopolisme" qui fait devenir la production capitaliste toujours plus sociale, et les conditions générales du capitalisme propriété privée, production marchande, concurrence) qui les contredisent.
"Le capitalisme arrivé à son stade impérialiste conduit aux portes de la socialisation intégrale de la production ; il entraîne en quelque sorte les capitalistes, en dépit de leur volonté et sans qu'ils en aient conscience, vers un nouvel ordre social, intermédiaire entre l'entière liberté de la concurrence et la socialisation intégrale. La production devient sociale, mais l'appropriation reste privée. Les moyens de production sociaux restent la propriété privée d'un petit nombre d'individus. Le cadre général de la libre concurrence nominalement reconnue subsiste, et le joug exercé par une poignée de monopolistes sur le reste de la population devient cent fois plus lourd, plus tangible, plus intolérable." (chap. I)
Puis, dans le chapitre sur "Le parasitisme et la putréfaction du capitalisme" : "...la principale base de l'impérialisme est le monopole. Ce monopole est capitaliste, c'est-à-dire- né du capitalisme ; et, dans les conditions générales du capitalisme, de la production marchande, de la concurrence, il est EN CONTRADICTION PERMANENTE ET SANS ISSUE avec ces conditions générales."
Cette contradiction entre le caractère de plus en plus "social" que prend la production capitaliste au fur et à mesure qu'elle s'étend et se concentre, et d'autre part la subsistance de l'appropriation privée capitaliste, est une contradiction réelle du capitalisme, mise en évidence par Marx à plusieurs reprises. Mais par elle-même, elle est loin de rendre compte réellement ni de l'impérialisme ni des effondrements du capitalisme.
La tendance vers le "monopolisme" n'explique pas pourquoi à partir d'un certain degré de développement les pays capitalistes sont contraints à une guerre à mort pour les colonies. C'est au contraire la nécessité de mener une guerre de plus en plus âpre pour les colonies qui explique la tendance dans chaque nation capitaliste à l'unification et la concentration de tout le capital national. Les puissances capitalistes qui connaissent les concentrations les plus rapides et étendues ne sont justement pas celles qui possèdent les plus grands empires (Angleterre, France), mais celles qui doivent se faire une place dans le marché mondial (Allemagne, Japon).
En négligeant le problème des marchés pour le capitalisme, Lénine est conduit à prendre pour cause, de l'impérialisme ce qui en réalité n'est qu'une conséquence -tout comme l'impérialisme lui-même - de la lutte des capitalistes pour de nouveaux débouchés. De même il est amené à voir dans l'exportation de capitaux un phénomène fondamental de l'impérialisme ("à la différence de l'exportation de marchandises") alors que dans la réalité l'exportation de capitaux n'était qu'une des armes de la lutte entre puissances pour les marchés où placer leurs marchandises (Lénine le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son ouvrage :
"L'exportation de capitaux devient ainsi un moyen d'encourager l'exportation de marchandises" chap.IV).
En prenant comme point de départ de son analyse les travaux de Hilferding sur le monopolisme, Lénine pouvait difficilement parvenir à des conclusions cohérentes avec ses prémisses. Hilferding était un des théoriciens de l'aile réformiste de la 2ème Internationale ; derrière l'importance démesurée qu'il donnait au phénomène de concentration du capital dans le capital financier, il y avait la volonté de démontrer la possibilité du passage au socialisme par des voies pacifiques et progressives. (D'après Hilferding, la concentration croissante imposée par le monopolisme permettrait de réaliser au sein du capitalisme une série de mesures qui progressivement jetteraient les bases du socialisme : élimination de la concurrence, élimination de l'argent, élimination des nations...jusqu'au communisme). Tout l'effort théorique de Hilferding était tendu vers la démonstration de la fausseté de la voie révolutionnaire au communisme. Tout l'effort de Lénine visait l'inverse. En empruntant à Hilferding les bases de sa théorie sur l'impérialisme, Lénine ne pouvait aboutir à des conclusions révolutionnaires qu'en faisant subir à la théorie des contorsions contradictoires.
LA POSITION DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE
Dans sa plateforme, l'IC ne se prononce pas réellement sur le fond du débat. Cependant, l'explication esquissée de l'évolution du capitalisme vers son "effondrement intérieur" se réfère explicitement au monopolisme et à l'anarchie du capitalisme, alors que la question des marchés n'est que signalée pour expliquer partiellement l'impérialisme.
"Le capitalisme a tenté de surmonter sa propre anarchie par l'organisation de la production. Au lieu de nombreuses entreprises concurrentes, se sont organisées de vastes associations capitalistes (syndicats, cartels, trust, le capital bancaire s'est uni au capital industriel, toute la vie économique est tombée sous le pouvoir d'une oligarchie financière capitaliste qui, par une organisation basée sur ce pouvoir, acquit une maîtrise exclusive. Le monopole supplante la libre-concurrence. Le capitaliste isolé se transforme en membre d'une association capitaliste. L'organisation remplace l’anarchie insensée.
Mais dans la mesure môme où, dans les Etats pris séparément, les procédés anarchiques de la production capitaliste étaient remplacés par l'organisation capitaliste, les contradictions, la concurrence, l'anarchie, atteignaient dans l'économie mondiale une plus grande acuité. La lutte entre les plus grands Etats conquérants conduisait, avec une inflexible nécessité, d’une monstrueuse guerre impérialiste. La soif de bénéfices poussait le capitalisme mondial à la lutte pour la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles sources de matières brutes, de la main d’œuvre bon marché des esclaves coloniaux. Les Etats impérialistes qui se sont partagés le monde entier, qui ont transformé des millions de prolétaires et de paysans d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Australie en bêtes de somme, devaient révéler tôt ou tard dans un gigantesque conflit la nature anarchique du capital. Ainsi, se produisit le plus grand des crimes. La guerre du banditisme mondial."
Il serait difficile de dégager de ces formulations une idée vraiment claire sur les questions de l'impérialisme et des contradictions fondamentales du capitalisme. A la question des contradictions internes du système, l'IC répond, à la suite de Lénine et donc suivant l'influence de Hilferding, par l'évolution du système vers des monopoles. Et tout comme Lénine, elle affirme immédiatement l'impossibilité d'une évolution continue jusqu'à l'élimination des nations par des concentrations internationales successives. La concentration au niveau national conduit à ce que "les contradictions, la concurrence, l'anarchie, atteignent dans l'économie mondiale une plus grande acuité", laissant entendre encore comme Lénine, que cette tendance à la concentration est cause et non conséquence de l'exacerbation des "contradictions, concurrences et anarchie" internationales.
Quant aux politiques impérialistes de conquêtes, l'IC se contente de parler de "soif de bénéfices" qui "poussait le capitalisme mondial à la lutte pour la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles sources de matières brutes, de la main d’œuvre à bon marché des esclaves coloniaux". Ce qui est juste, au niveau de la dénonciation des idéologies qui parlaient de l'impérialisme comme un moyen de porter "la civilisation", mais reste au niveau économique une pure description qui ne permet pas de comprendre en quoi l'impérialisme est lié à la contradiction fondamentale du capitalisme.
Enfin, quant à l'explication de la 1ère Guerre Mondiale, et des raisons de son explosion, l'IC se réfère tout comme Lénine et Rosa au fait que "les Etats impérialistes se sont partagés le monde entier" mais sans dire pourquoi le fait que ce partage soit achevé conduit inévitablement à la guerre, pourquoi ce partage ne pouvait pas s'accompagner d'une évolution parallèle des différentes puissances.
Quant à la question des crises de surproduction, du marché mondial, de son rétrécissement, etc. dont parlait le Manifeste, l'IC n'en dit mot.
L'Internationale Communiste ne parvient pas dans son ensemble à se mettre d'accord sur cette question. Les partis communistes en 191.9 avaient d'ailleurs d'autres problèmes bien plus urgents et importants à discuter : le prolétariat détenait le pouvoir en Russie, l'explosion de la révolution allemande avait été une confirmation de la vision des communistes d'après laquelle la guerre engendrerait un mouvement révolutionnaire international. Mais la défaite immédiate de ce premier assaut révolutionnaire en Allemagne posait la question de la force réelle de ce mouvement international. Dans une telle situation, la question de savoir les raisons théoriques de l'explosion de la guerre mondiale passaient au second plan. L'histoire s'était chargée de balayer dans la barbarie de la guerre et le feu de la révolution toutes les théories qui parlaient de développement continu du bien-être dans le capitalisme et du pas sage pacifique au socialisme.
La guerre, la plus violente forme de la misère humaine était là. Elle avait engendré un mouvement révolutionnaire international, et c'était inévitablement les questions concernant directement la lutte révolutionnaire qui passaient au premier plan.
Mais cela n'est pas la seule raison qui explique le fait que l'IC ne soit pas parvenue à un accord sur les, fondements des crises économiques du capitalisme. La 1ère Guerre Mondiale prend la forme d'une guerre totale, c'est-à-dire la forme d'une guerre qui, pour la première fois, exige la participation active non seulement des soldats sur le front, mais aussi de toute la population civile encadrée par un appareil d'Etat devenu l'omniprésent organisateur de la marche au massacre et de la production industrielle d'instruments de mort.
La monstrueuse réalité de la guerre se construisait avec des usines qui "tournaient à plein rendement", des dépenses de vies humaines, en uniformes ou non, qui faisaient "disparaitre le chômage". La réalité du premier holocauste qui coûta 24 millions de morts à l'humanité cachait, sous le vrombissement des usines produisant la destruction, le fait que le capitalisme n'était plus capable de produire. La sous-production d'armements cachait la surproduction de marchandises... Les ventes aux Etats pour la guerre cachaient le fait que les capitalistes ne pouvaient plus rien vendre d'autre. Ils devaient vendre pour détruire parce qu'ils ne pouvaient plus produire pour vendre.
Telle est certainement la raison majeure du fait surprenant de voir la plateforme de l'IC ne plus reprendre une virgule des formulations du Manifeste sur la question soixante ans plus tôt à propos des crises de surproduction et du rétrécissement du marché mondial.
En conclusion, on peut dire que la nécessité d'expliquer l'impérialisme permit de poursuivre la compréhension développée par Marx. Mais les conditions mêmes de cette crise (mouvements prolétariens révolutionnaires qui font passer au second plan les préoccupations d'ordre théorico-économique, le caractère récent de la rupture communiste avec la 2ème Internationale et le poids de l'influence sur l'analyse des révolutionnaires des théoriciens social-démocrates réformistes, enfin le fait que la guerre dissimule des spécificités fondamentales de la crise du capitalisme, en particulier la surproduction) entravaient l'aboutissement à un accord sur le fond sur l'analyse des causes de la crise entre les révolutionnaires dans l'Internationale Communiste
R.V.
[1] [85] Ce n'est pas par prétention académique que le livre de Lénine L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme porte comme sous-titre : Essai de vulgarisation.
[2] [86] Sur cette question, lire les articles Marxisme et théories des crises, Théories économiques et lutte pour le socialisme, Sur l'impérialisme (Marx, Lénine, Boukharine, Luxemburg), Les théories des crises dans la Gauche Hollandaise, dans la REVUE INTERNATIONALE, respectivement N° 13, 16, 19, 21.
[3] [87] En utilisant les notations de Marx, le taux de profit, c'est-à-dire le rapport entre le profit obtenu et le capital total dépensé, s'écrit : pl/c+v où pl représente la plus-value, le profit, c le capital constant dépensé, c'est-à-dire le coût pour le capitaliste des machines et des matières premières, v le capital variable, c'est-à-dire les coûts salariaux. En divisant le numérateur et le dénominateur de cette expression par y, le taux de profit devient :
C’est-à-dire le rapport du taux de plus-value ou taux d'exploitation (pl/v, ou travail non payé divisé par le travail payé v) sur la composition organique du capital (c/v, ou dépense du capitaliste en travail mort sur dépense en travail vivant, expression en valeur de la composition technique du capital dans le processus de production).
[4] [88] Le Capital, Livre III, Cinquième Section, p.1206 Editions La Pléiade.
[5] [89] NEUE ZEIT, 1902, N°5 (31), p.140, cité par Rosa Luxemburg dans la "critique des critiques".
Questions théoriques:
- L'économie [90]
Heritage de la Gauche Communiste:
Économie de guerre et crise en Allemagne de l'Est
- 3656 reads
Nous avons choisi d'étudier ici le développement de la crise en Allemagne de l'Est pour les raisons suivantes :
- l'Allemagne de l'Est, étant le capital national le plus développé du bloc de l'Est, la crise est supposée y être "introuvable" ;
- l'économie d'Allemagne de l'Est, comme celle de la Tchécoslovaquie, est une pièce maîtresse de l'économie de guerre russe ; par conséquent, le développement de la crise dans ce pays revêt une importance particulière ;
- la possibilité de la lutte de classe à l'Est de freiner la marche vers la guerre en bouleversant l'économie de guerre, dépend du développement de la crise et de la résistance ouvrière en Allemagne de l'Est (et en Tchécoslovaquie), car c'est dans ces pays que la classe ouvrière est le plus concentrée dans le bloc de l'Est. En plus, la situation géographique de ces deux pays, qui ont frontière commune avec l'Europe occidentale, pose la possibilité de l'extension de la lutte par delà le "rideau de fer".
Pour les révolutionnaires d'aujourd’hui, il ne suffit plus de savoir qu'il y a la crise du capitalisme dans les pays de l'Est. Il faut encore comprendre :
- comment la crise économique s'approfondit
- le niveau que la crise a atteint dans le bloc russe et dans chacun de ses capitaux nationaux - la perspective pour l'avenir
- l'effet que produit la crise économique sur :
1) la crise politique de la bourgeoisie
2) le développement de la lutte du prolétariat
3) le comportement des autres couches sociales et en particulier des grandes masses paysannes.
L'APRES-GUERRE
La 2ème guerre mondiale a décimé le territoire qui allait devenir la République Démocratique Allemande (R.D.A.). A la fin de 1945, le ravitaillement des villes, l'industrie et les moyens de transport étaient pratiquement inexistants. Dans leur zone d'occupation, les "libérateurs" russes avaient enlevé des usines entières pour les transporter en Russie ; ils se sont emparés des positions-clé de l'économie d'Allemagne de l'Est à travers des holdings soviétiques. Ce n'est qu'au début des années 50 que l'URSS a un peu relâché sa poigne de fer sur l'économie d'Allemagne de l'Est. Pendant la guerre et l'occupation, la capacité industrielle de la zone d'occupation soviétique était tombée à moins de la moitié du niveau de 1939.
Cependant, la reconstruction d'après-guerre a suivi, à un rythme inégal. Vers 1959, la R.D.A. était le neuvième producteur industriel au niveau mondial. En 1969, avec ses 17 millions d'habitants, la R.D.A. avait atteint un niveau de production industriel plus élevé que celui du Reich allemand de 1936 qui avait une population de 60 millions d'habitants. De même que le "miracle économique" de l'Allemagne de l'Ouest et d'autres pays occidentaux après la guerre a servi de base aux mythes sur un "capitalisme qui ne connaîtrait plus de crises" et sur la "société de consommation", de même la reconstruction en-R.D.A. et dans d'autres pays de l'Est est devenue "la preuve" de la nature socialiste -ou non capitaliste- de ces économies. Mais, pour les marxistes, la capacité d'accumuler rapidement du capital n'a jamais été une preuve de socialisme ; au contraire. Aujourd'hui, la crise économique mondiale du capitalisme prouve, sinon aux staliniens et aux trotskystes, au moins à la classe ouvrière, la nature capitaliste des pays du bloc de l'Est.
LE DEVELOPPEMENT DE LA CRISE
La crise mondiale du capitalisme qui se manifeste aujourd'hui en R.D.A. met en danger non seulement la stabilité politique de la bourgeoisie locale mais aussi la machine de guerre russe. La R.D.A. n'est pas seulement le principal fournisseur d'industrie lourde de la Russie ; elle est aussi le gendarme de Moscou sur la frontière occidentale du bloc.
On admet maintenant à Berlin-Est que la R.D.A., de même que n'importe quel autre capital national aujourd'hui, souffre des effets d'un ralentissement da son taux de croissance économique. Les taux d'expansion élevés des années 50 et 60 appartiennent au passé. Cette stagnation signifie que la phase de reconstruction qui a suivi la 2ème guerre mondiale a laissé la place à une crise générale et ouverte. Le tournant s'est accompli avec les années de crise 1969 et 1970 pendant lesquelles la production a été sérieusement freinée par des coupes sombres dans l'économie. Grâce à une intervention de l'Etat encore plus énergique qu'auparavant dans le développement conjoncturel et grâce à une relance des exportations, il a été possible de surmonter les goulots d'étranglement et les déséquilibres de ces deux années et d'atteindre un taux de croissance du revenu national d'environ 5,5 % en moyenne pour les années suivantes. Malgré cette reprise, tous les signes dénotaient que le taux de croissance général était en train ' de ralentir, de sorte que le plan quinquennal de 1976-80 escomptait depuis le départ un ralentissement de l'expansion économique. Déjà en 1971, et pour la première fois, on avait planifié moins d'investissements.
Ce qui est certain est que le taux de croissance du revenu national n'a pas cessé de décroître au '.cours de ce plan quinquennal :
"Déjà avant que les effets de la seconde crise du pétrole ne soient ressentis (les taux de croissance) avaient atteint un niveau tel que le "Neues -Deutschland" ne voulait plus en publier les chiffres"
(Miner Stadt-Anzeiger, 21-22 juillet 1979).
L'Institut Allemand de Recherche Economique estime que la réduction annuelle réelle de la productivité . du capital industriel en R.D.A. est de 1 % "ce qui correspond presque exactement aux chiffres de la ; R.F.A." (Voir D.D.R. Wirtschaft, DIW). Les dirigeants staliniens blâment les directeurs d'usine de la R.D.A. pour la sous utilisation des capacités productives. Ce n'est pas le manque de demande qui en est la cause, mais le chaos économique général : les machines qui commencent à être usées ne peuvent pas être modernisées ou remplacées par manque de capitaux ; les services de dépannage ' laissent à désirer. Il y a en particulier pénurie de pièces de rechange. Cette pénurie de capital est exacerbée par la nécessite d'investir autant, de plus-value que possible dans l'industrie lourde ; or, ceci déséquilibre toute l'économie de , façon dramatique en désorganisant les autres secteurs de production : produits manufacturés défectueux ou inutilisables, diminution des exportations... Nous avons bien à faire ici à l'anarchie de la production capitaliste, à la crise capitaliste.
Cette stagnation de l'économie se reflète dans les résultats des plans quinquennaux. Les chiffres visant à l'expansion sont de plus en plus modestes ou bien ils n'arrivent pas à être tenus. On a reconnu il y a quelque temps déjà l'échec du plan quinquennal qui prend fin cette année. Le gigantesque appareil de contrôle de "l'économie planifiée" arrive de moins en moins à maîtriser le chaos. Pendant l'année 1978, de hauts fonctionnaires du Parti Socialiste Unifié d'Allemagne (de l'Est - "S.E.D") y compris Honecker et Stoph, ont fait allusion à ces problèmes lors de discours sur la situation économique. Il a été admis que le plan quinquennal actuel, par exemple, n'arrive pas à atteindre son but à cause d'un manque d'investissements de l'ordre de milliards de marks. Par ailleurs, on durcit la lutte contre le marché noir qui devient de plus en plus important, non seulement pour les biens de consommation et les devises (le mark d'Allemagne de l'Ouest est actuellement pratiquement la seconde monnaie de la R.D.A -certains disent même la première), mais aussi en matières premières et en énergie : les grandes compagnies étatisées se livrent à une concurrence acharnée entre elles pour la possession de ces marchandises si estimées et échangent fiévreusement (achètent ou vendent) des matières premières et des pièces de rechange pour pouvoir remplir leur plan. Cela s'accompagne d'investissements massifs en dehors du plan dont l'ampleur est en train de devenir un vrai casse-tête pour les "planificateurs".
BALANCES COMMERCIALES NEGATIVES A L'EST ET A L'OUEST
La R.D.A a toujours été connue pour être un grand exportateur au sein du Comecon et, entre 1960 et 1973 elle a eu une balance commerciale excédentaire de l'ordre de 3 % .Durant cette période, la R.D.A a connu un excédent commercial de 9 % par rapport aux pays du Comecon et de 23 % par rapport aux "pays en voie de développement", mais un déficit commercial de 20 % par rapport au bloc de l'Ouest. Ce beau bilan n'a pas survécu longtemps aux coups que lui a portés la crise mondiale. Afin de défendre sa propre économie et face à l'endettement croissant du Comecon vis-à-vis du bloc occidental (plus de 50 milliards de dollars), l'URSS s'est vue obligée à reporter le poids de la crise sur les épaules plus étroites de ses alliés ; en 1973 elle a augmenté le prix à l'exportation de toute une série de matières premières et de sources d'énergie. Ces mesures ont frappé particulièrement fort la R.D.A qui dispose de très peu de matières premières sur son sol. L'excédent commercial de 5,7 milliards de marks-devises que la R.D.A avait accumulé pendant la période de 1960-73 a cédé la place, dans les deux années suivantes -1974-75- à un déficit commercial de 7,3 milliards de marks. Les prix à l'exportation de la R.D.A. ont augmenté de 1972 à 1975 d'environ un quart. Jusqu'à la fin de 1979 la R.D.A devait, rien qu'à l'Allemagne de l'Ouest 2,6 milliards de marks-devises, ce qui n'est qu'une partie de sa dette de 16 milliards au bloc de l'Ouest. "Der Spiegel" note que la R.D.A. a encore plus de dettes vis-à-vis de l'Ouest que la Grande-Bretagne (Der Spiegel du 16.01.78).
A cause de cet endettement envers l'Ouest, la proportion du commerce extérieur de la R.D.A. avec les autres pays du Comecon est passée à 73,5 %. Le commerce entre la R.D.A. et l'URSS a augmenté particulièrement. Ce développement est un facteur essentiel pour le renforcement du bloc russe contre le bloc occidental. Alors que le commerce entre l'URSS et les pays industriels occidentaux a connu une lente expansion, le commerce entre l'Ouest et les autres pays du Comecon a eu tendance à stagner ou même à décroître. Les satellites d'Europe de l'Est, et en particulier l'Allemagne de l'Est, resserrent les rangs autour de l'URSS.
La balance commerciale de Berlin-Est par rapport à la Russie est aussi source de préoccupations. Le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" observe : "En 1977 la balance commerciale par rapport à l'URSS a été déficitaire de 3 milliards de marks-devises. C’est le déficit commercial le plus élevé en chiffres relatifs et absolus qu'un pays de l'Est ait connu par rapport à l’U.R.S.S. " (F.A.Z. du 5.07.78). La concurrence provenant des pays industrialisés occidentaux -en particulier la R.D.A.-sur le marché russe vient s'ajouter aux difficultés de la R.D.A. Pour relever ce défi, Berlin-Est, par exemple, a été obligé d'acheter de l'acier et des produits semi-manufacturés à l'Ouest afin de pouvoir remplir ses contrats avec l'URSS dans les temps et avec une qualité compétitive.
QU'EST-IL ARRIVE AU "MIRACLE ECONOMIQUE" ?
Le "boom" d'après-guerre -baptisé "socialiste"- a en fait été rendu possible par la destruction qu’ont causée la 2ème guerre mondiale et le démantèlement de l'industrie qui a suivi. Il a fallu faire fonctionner l'infrastructure développée de la R.D.A. et mettre au travail sa classe ouvrière, très spécialisée et disciplinée, pour renforcer le bloc russe. On a installé en R.D.A. des moyens de production nouveaux et plus modernes, provenant en particulier de la Tchécoslovaquie qui avait une capacité industrielle avancée en encore intacte ; on les a payés avec une exploitation inimaginable du prolétariat d'Allemagne de l'Est, en état de défaite et de prostration. C'est comme cela que la R.D.A. est devenue le bastion industriel le plus moderne du bloc, mû par une classe ouvrière qui, jusqu'en 1953 n'a pas eu la force de résister à la terreur capitaliste.
C'est la faiblesse économique du bloc russe dans son ensemble qui a donné lieu aux nationalisations par delà les frontières et à une administration étatique à tous les niveaux de l'économie. Ce contrôle brutal exercé par le capitalisme d'Etat a pu permettre pendant un temps de forcer le pas de la reconstruction, sans pour autant résoudre les contradictions inhérentes au système.
L'impérialisme mondial, avec ses chambres à gaz et ses bombardements massifs a rendu au capitalisme allemand, autant de l'Est que de l'Ouest, un service inoubliable en massacrant les chômeurs et en liquidant une large fraction de la petite-bourgeoise; débarrassé de ces fardeaux qui ponctionnent l'économie, il n'est pas étonnant que le capitalisme en Allemagne ait connu une rapide expansion.
Afin de favoriser le développement économique de l'après-guerre, l'Etat de la R.D.A. s'est attaqué aux petits fermiers et petits producteurs qui restaient encore. Déjà, la "Réforme agraire" de septembre 1945 avait exproprié tous les propriétaires qui possédaient plus de 100 hectares de terre. La terre a été divisée parmi les paysans pauvres, en des parcelles si minuscules et si peu rentables que les paysans ont été obligés, depuis le début, d'aller rejoindre les coopératives agricoles étatiques. En 1960, il ne restait plus aucun fermier indépendant ; la croisade contre la petite bourgeoisie a servi non seulement à baisser les prix de la production agricole en la rationalisant (grandes exploitations dans les coopératives étatiques au lieu de petits lopins non rentables), mais également à baisser le coût des produits industriels (puisqu'en baissant les prix des produits agricoles, les salaires des ouvriers ont pu être réduits d'autant). Elle a également permis de faire face au problème de pénurie de main-d’œuvre dans l'industrie lourde, puisqu'une partie de ces paysans n'a plus eu qu'à aller vendre leur force de travail dans ce secteur de l'industrie.
Même dans la période de reconstruction, l'Etat a eu à lutter contre les effets de la crise capitaliste qui, avec la décadence du système, prend un caractère permanent. Les plans quinquennaux, par exemple, n'ont été que des tentatives brutales de faire face à la crise. L'aspect essentiel des plans est que la production de biens de consommation et que l'expansion de la consommation privée doit rester au plus bas de l'échelle de croissance. Les augmentations de salaires du premier plan quinquennal de 1951 ont été annulées par la pénurie chronique de biens de consommation - situation qui a ouvert la voie aux soulèvements ouvriers de 1953. Le plan septennal qui a suivi, de 1959 à 1965, fut reconnu comme un échec dès 1962 et abandonné. Au lieu d'augmenter, le taux de croissance de l'économie a baissé (DIW, DDR Wirtschaft, p.26). Le plan de 1965-70 était supposé surmonter ces problèmes en forçant sur les exportations. Mais qu'est-il réellement arrivé ? Les importations ont augmenté plus vite que les exportations. Autant pour la "planification socialiste de la R.D.A''
LES MESURES DE LA BOURGEOISIE
Quelles mesures prend la bourgeoisie aujourd'hui pour ralentir le développement de la crise ouverte ?
- En particulier depuis la fin des années 60, on essaie de stimuler la croissance en augmentant la concentration (en particulier en formant des combinaisons industrielles). La part des entreprises nationalisées dans la production industrielle a augmenté de 82 % en 1971 à 99 % en 1972: Pendant les années 70, des secteurs entiers de l'économie, tels que la machinerie agricole, l'industrie automobile, la science et la technologie, ont été transformés en combinaisons géantes. Cependant, une grande part de cet effort de concentration de l'industrie n'existe que sur du papier et n'arrive pas à couvrir la très réelle faiblesse et incohérence de l'économie.
- On essaie de favoriser de nouveaux secteurs d'exportation mais nous avons vu plus haut le "succès" de ces efforts.
- Les mesures mentionnées ci-dessus s'avérant impuissantes, il devient d'autant plus nécessaire d'attaquer de front le niveau de vie de la classe ouvrière. Et cette attaque elle-même ne peut être qu'un prélude à la "solution" capitaliste à la crise : une troisième guerre mondiale.
LA R.D.A. ET L'ECONOMIE DE GUERRE RUSSE
Par elle-même, la R.D.A, malgré sa capacité économique, ne dispose pas d'une industrie de guerre significative. L'A.N.P. (Armée nationale du Peuple -sic) est équipée avec des armes russes. En outre, la R.D.A. n'investit que 22 millions de marks par an dans l'"aide au développement militaire" des pays du tiers-monde, contrairement à l'Allemagne de l'Ouest qui en investit 82 milliards ("Der Spiegel", 30.07.78). Mais l'industrie est-allemande participe pour une grande part au développement de la machine de guerre russe. En fait, l'industrie de la R.D.A. produit essentiellement pour l'économie de guerre russe. C'est-à-dire qu'elle produit directement ou indirectement pour les forces armées du Pacte de Varsovie. L'économie de guerre russe n'absorbe pas seulement la part du lion de la plus-value extraite en Russie-même ; elle s'accapare aussi une part importante de la richesse produite dans les pays de l'Est. Si elle ne le faisait pas, elle n'aurait pas la moindre chance de rivaliser avec le développement militaire des U.S.A.
Le commerce extérieur entre la R.D.A. et l'URSS s'est multiplié par cinq depuis le début des années 50. Représentant 16 % du commerce extérieur russe, la R.D.A. est le partenaire commercial le plus important de l'URSS ; elle est aussi son principal fournisseur de biens-capitaux (ou biens de production). Un bon quart des importations russes en machinerie et en pièces détachées proviennent de la R.D.A. Alors que les autres pays du Comecon fournissent essentiellement à l'URSS des matières premières et des produits semi-finis, seules la R.D.A et la Tchécoslovaquie sont en mesure de fournir des moyens de production, qui sont utilisés en Russie pour la construction de chemins de fer, le développement de sources d'énergie ou directement pour la production de chars de guerre, de camions, de bateaux de guerre, etc. Il existe aussi, bien entendu une coopération directe dans le domaine de la production militaire entre l'URSS et ses alliés, comme par exemple, la coopération entre l'URSS et la fameuse entreprise "Skoda" de Tchécoslovaquie pour la production d'armes, de camions et de réacteurs nucléaires. Mais jusqu'à présent la R.D.A n'a pas été associée à ce type de coopération à grande échelle.
Les économies des pays d'Europe de l'Est sont constamment sous la pression (futile) de vouloir arriver à se doter d'une industrie lourde comparable à celle du bloc américain. La capacité guerrière des blocs ne doit pas se mesurer seulement en fonction de la capacité actuelle à produire des chars ou autre chose, mais aussi dans leur capacité à doubler ou tripler cette production dans un laps de temps déterminé. Indépendamment de l'efficacité de sa production, le bloc russe n'arriverait jamais à produire autant d'armements que le bloc américain. La nécessité de survivre en tant que bloc impérialiste distinct a obligé le Pacte de Varsovie à mobiliser toutes ses ressources disponibles pour l'économie de guerre, de façon à rester compétitif par rapport à l'Ouest au moins à ce niveau. Ainsi, alors que nous avons d'un côté tous les signes d'une surproduction massive dans les pays industrialisés du bloc de l'Ouest (trop d'ouvriers, trop d'industrie, etc.), la crise à l'Est prend la forme d'une sous-production, parce qu'il n'y a pas assez de capital et de travail disponible pour satisfaire les nécessités de l'économie de guerre. Alors que la crise de surproduction dans le bloc de l'Ouest entraîne une réduction de la production dans tous les secteurs de l'économie sauf dans le militaire, on peut voir que ce développement exclusif du secteur militaire existe dans le bloc de l'Est depuis des années.
Ce phénomène de sous-production à l'Est est l'expression de la division du globe en deux blocs militaires rivaux ; il est le résultat de la pénurie mondiale de marchés. C'est la preuve que les entraves du marché mondial bloquent le développement des forces productives. Le marché mondial est trop restreint pour permettre la réalisation de tout le capital qui a été accumulé. Après la 2ème guerre mondiale, les pays avancés du bloc américain qui avaient à leur disposition la majeure partie du marché mondial ont pu (pour une série de raisons que nous ne pouvons pas examiner ici) connaître un certain développement des forces productives aux dépens de l'appauvrissement du reste du monde. Quant au bloc russe, qui n'a presque rien retiré de la re divisions impérialiste du monde à la suite de la 2ème guerre mondiale, il n'a pu réaliser qu'une économie de guerre. Cette nécessité de développer l'économie de guerre à partir d'une position de faiblesse économique et stratégique, entraîne une profonde modification dans le fonctionnement de la loi de la valeur à l'intérieur du bloc russe, de sorte que la crise capitaliste y prend des formes différentes qu'à l'Ouest. Ces différences sont utilisées *par les staliniens et les trotskystes pour "prouver" la nature non capitaliste du bloc de l'Est. Mais aucun de ces mensonges ne peut cacher les effets dévastateurs de la crise capitaliste sur les conditions de vie du prolétariat d'Europe de l'Est, de la Russie ou de la Chine.
Afin de développer l'industrie lourde (base de l'économie de guerre), la bourgeoisie d'Europe de l'Est doit négliger toutes les autres branches de l'économie. Ce simple fait produit crise après crise. Par exemple, en R.D.A, seulement 36 % des investissements reviennent au secteur tertiaire et à l'infrastructure, contre environ 58 % en R.F.A. Une telle orientation des investissements, en entraînant inévitablement un rétrécissement du secteur des biens de consommation et des services, entraîne un rétrécissement encore plus fort des marchés, une baisse du taux de profit et une stagnation dramatique de l'économie. Comme le secteur militaire ne produit ni des biens de production ni des biens de consommation mais ne fait qu'avaler de la plus-value sans contribuer au renouvellement du cycle d'accumulation, la stagnation risque de se transformer en paralysie.
Les choix qui s'offrent à l'Allemagne de l'Est ou à la bourgeoisie russe ne sont pas la "planification" stalinienne ou une "économie de marché". En fait, les seules alternatives, dans l'abstrait, sont : soit une économie de guerre désespérément renforcée et dirigée par l'Etat avec ses industries de base -ce qui ne peut conduire qu'à une stagnation plus poussée et au chaos-, soit un ralentissement des taux de croissance dans ces industries de façon à niveler le développement général de tous les secteurs de l'économie -ce qui conduirait à uns stagnation globale, en quelque sorte "plus douce". Mais en réalité, elles ne peuvent pas choisir la seconde alternative parce que cela voudrait dire perdre la bataille la plus importante avec le bloc américain : la course aux armements. Les dirigeants staliniens n'ont donc d'autre alternative que de suivre le cours précédent. Il ne leur reste qu'à préparer et tenter de gagner une nouvelle guerre mondiale, afin de tirer profit du programme d'investissements massifs dans l'économie d'armements.
LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIERE DANS L'ECONOMIE DE GUERRE
L'Allemagne de l'Est a actuellement le taux le plus élevé du monde de population active
(53,3 % de la population). Alors qu'entre 1950 et 1969 le nombre d'Allemands de l'Est en âge de travailler abaissé de 1,9 million, le nombre réel de travailleurs a augmenté de 700.000 -soit, environ 10 % Cette augmentation a été possible grâce à l'intégration de plus de femmes, mais aussi de retraités, à la vie économique. Par ailleurs, l'Allemagne de l'Est n'a pu attirer qu'un nombre relativement faible d'ouvriers immigrés de Pologne, des Balkans, etc.
Cette pénurie croissante de main-d’œuvre est un résultat direct de l'économie de guerre. L'Etat est obligé de baisser le prix de la marchandise force de travail en dessous du niveau nécessaire pour en assurer la rénovation et l'expansion. Ce niveau nécessaire, comme l'explique Marx, n'est pas un absolu qui se situerait en dehors de l'histoire, mais évolue avec le développement de la société. Dans une société industrielle moderne comme la R.D.A, où les ouvriers travaillent sous un régime d'exploitation brutal, automatisé et scientifiquement dirigé, ce niveau de vie nécessaire à la reproduction et l'élargissement de la force de travail n'est pas garanti : dans les familles ouvrières, la plupart du temps, les deux parents travaillent et doivent faire des heures ou des brigades de travail supplémentaires ; en plus, il faut faire des heures de queue dans les magasins ou aller marchander dans le marché noir illégal pour obtenir les biens de première nécessité ; les ouvriers doivent vivre dans des appartements minuscules, souvent à huit ou dix sous le même toit parce que la tante, la grand-mère et les deux fils mariés ne peuvent pas obtenir d'appartement pour eux-mêmes ; dans les grandes villes et les banlieues industrielles, les ouvriers habitent dans des logements provisoires, à des kilomètres de distance de leur lieu de travail et de n'importe quel centre ; ils doivent attendre des années sur des listes d'attente avant de pouvoir obtenir un moyen de transport décent. Il n'est pas étonnant que les gens aient essayé de s'échapper à l'Ouest, tant que le "boom" de l'après-guerre y existait encore, ou que si peu d'ouvriers étrangers veuillent aller travailler en R.D.A. ; il n'est pas étonnant non plus que les familles d'Allemagne de l'Est ne puissent se permettre d'avoir que peu de membres malgré toute la propagande de l'Etat sur les "booms" à la natalité. Les ouvriers de la RDA ne connaissent que le besoin parce qu'ils doivent porter sur leurs épaules tout le poids de l'économie de guerre.
Le prix de la marchandise force de travail, comme pour n'importe quelle autre marchandise, est déterminé par son coût moyen de production, ainsi que par la loi de l'offre et la demande. Ici aussi, l'Etat stalinien intervient pour maintenir ce prix aussi bas que possible. Cette intervention dans les lois de l'économie revêt un caractère militaire. La loi du marché a dicté que les ouvriers iront là où ils peuvent vendre leur force de travail au plus haut prix. Mais la bourgeoisie est-allemande a résolu le problème. Elle a construit un mur le long de la frontière occidentale et l'a habillé de fil barbelé, parsemé de mines et de miradors, parce que les salaires en R.F.A. sont plus élevés qu'en R.D.A.
Un autre exemple : là où il y a pénurie de main d’œuvre, les salaires tendent à augmenter ; il existe un marché de l'emploi. Pour éliminer cela, l'Etat a rendu extrêmement difficiles le changement de travail ou de lieu de résidence.
LES ATTAQUES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
L'approfondissement de la crise attaque le niveau de vie de la classe ouvrière de tous côtés :
- par une augmentation de l'exploitation
- par une réduction des salaires réels, ce qui s'opère de l'une des manières suivantes :
. la quantité de marchandises qui sont difficiles ou impossibles à trouver augmente rapidement ; cela va du café et du beurre, au logement et même à l'électricité qui est régulièrement coupée dans beaucoup d'endroits du pays ;
. la qualité des marchandises disponibles se détériore ;
. l'inflation passe sous la forme d'augmentations
. de prix déclarées ou déguisées et par la disparition des subventions de l'Etat ;
. les services sociaux, l'assistance médicale, etc., sont réduits, abaissant ainsi le salaire social ;
. des interruptions continuelles dans le procès de production causent des chutes catastrophiques dans les salaires des ouvriers payés à la pièce ;
. le "Nouveau Système Salarial", introduit en 1978, transforme une augmentation de salaire avant impôts en une baisse de salaire après impôts, par l'augmentation de ceux-ci. Le Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, cynique comme toujours, a fait appel aux ouvriers pour qu'ils compensent les "possibles" pertes de salaire en augmentant les heures supplémentaires ;
. l'augmentation du travail supplémentaire et l'introduction de brigades de travail supplémentaires, c'est-à-dire l'augmentation de la durée de la journée de travail est une autre caractéristique des attaques actuelles contre la classe ouvrière. Ici encore, nous n'avons pas de statistiques dans ce domaine.
On assiste à un développement lent mais sûr du chômage. Un des paradoxes du système capitaliste est que les pays qui souffrent de pénurie de main-d’œuvre souffrent aussi du chômage. Nous savons, par exemple, qu'en Chine (un pays où la production est à un niveau si primitif qu'il souffre de pénurie de main-d’œuvre malgré ses milliards d'habitants), il y a environ 20 % de chômeurs dans les villes. Nous n'avons pas de chiffres exacts pour la R.D.A. bien qu'il semble que l'on puisse affirmer que le nombre de chômeurs est considérablement moindre qu'en URSS ou en Pologne (600.000). Même si les chômeurs en R.D.A. n'ont plus à craindre de se retrouver en camps de concentration, ils sont néanmoins criminalisés par l'Etat. Ils reçoivent de 1,20 à 2 marks par jour, plus 35 centimes pour chaque personne à charge, tout cela payé par l'"Etat ouvrier". Le chômage à l'Est est dû à la pénurie de capital et la chute de la production qui s'ensuit. Mais le développement énorme d'un chômage masqué dans le bloc de l'Est est beaucoup plus significatif que le développement du chômage déclaré. Les goulots d'étranglement qui se forment régulièrement dans le procès de production rendent inutilisable une proportion importante des capacités productives. Ce chaos entraîne un excès permanent de main-d’œuvre au niveau des lieux de travail dans toute l'économie. Ce chômage masqué pèse sur l'économie du bloc de l'Est autant que le chômage déclaré pèse à l'Ouest. Et tant à l'Est qu'à l'Ouest, la cause réelle du chômage réside dans l'incapacité du capitalisme à développer réellement les forces productives.
PERSPECTIVES POUR LA LUTTE DE CLASSE
Nous n'avons pas l'intention ici d'essayer de tracer dans le détail des perspectives pour le cours ultérieur de la crise et de la lutte de classe. Ce que nous voulons c'est simplement mentionner quelques unes des implications d'importance dé notre analyse sur la crise et notre estimation du stade que la crise a atteint actuellement dans es pays du bloc de l'Est. Nous attirons l'attention sur les points suivants :
- La méthode qui consiste à essayer de mesurer la profondeur de la crise seulement à travers les critères classiques tels que la comparaison des taux d'inflation et du nombre de chômeurs -ce qui, en fait, tendrait à indiquer que la crise est "plus jeune", moins avancée dans les pays du bloc de l'Est- s'avère en fait une méthode inutile lorsqu'il s'agit de comparer le niveau de la crise à l'Est et à l'Ouest.
- La crise -et nous parlons ici de la crise historique du capitalisme décadent telle qu'elle s'est développée tout au long de ce siècle- est en réalité plus aiguë, à l'heure actuelle, dans les pays du bloc de l'Est que dans les pays industriellement avancés du bloc de l'Ouest.
- Cela prouve à son tour que même la militarisation totale de l'économie et la soumission totale de la vie économique et de la société civile au contrôle direct, dictatorial, du capitalisme d'Etat, ne résous aucune des contradictions du capitalisme décadent. Ces mesures entraîneront une modification des formes sous lesquelles la crise se fait jour et, à la rigueur, permettront un ralentissement du rythme de la crise. Mais l'Etat ne peut pas arrêter la dégénérescence du capitalisme.
La crise à l'Ouest apparaît comme une vaste surproduction de marchandises, qui entraîne des coupures drastiques dans la production. A l'Est, l'incapacité du bloc russe d'être concurrentiel sur le marché mondial, accentue la chute du taux de profit à un point tel que l'Etat doit absorber du capital de tous les autres secteurs de façon à assurer un minimum d'expansion à l'industrie lourde et à l'industrie de guerre en général. Ceci conduit à son tour à un étranglement de la production à tous les niveaux et, par conséquent, à une CHUTE MASSIVE DE LA PRODUCTION, d'abord dans le domaine de la consommation et de l'infrastructure (comme par exemple la baisse actuelle dans la production agricole en URSS, consécutive à la stagnation marquée de ce secteur que l'on constate depuis longtemps) et qui sera suivie par une chute de la production dans les secteurs-clé de l'industrie également (en 1979 Brejnev lui-même devait annoncer une productivité stagnante, voire même décroissante dans le secteur de l'énergie en URSS).
- Pour la classe ouvrière, cela signifiera -et dans des pays comme la Pologne, l'URSS et la Roumanie c'est déjà une réalité- une chute des plus brutales du niveau de vie, à mesure que la bourgeoisie se voit forcée à délaisser de plus en plus l'infrastructure, le secteur de biens de consommation, des services, le secteur agricole, etc. Cela impliquera aussi la nécessité pour la bourgeoisie de mettre en œuvre une militarisation totale de la classe ouvrière. Cela voudra dire créer une "armée" de millions d'ouvriers qui pourront être envoyés d'un secteur à un autre de la production, en fonction du secteur qui est en train de fonctionner à un moment donné et en fonction des secteurs où les goulots d'étranglement doivent ' être éliminés. La militarisation de la main-d’œuvre permettra une certaine diminution du poids effroyable du chômage "masqué"-pour autant que les ouvriers le permettent, bien entendu ! Le chômage "masqué" deviendra alors ouvertement une armée de chômeurs, vivant bien en-dessous du minimum vital.
Ces perspectives ne sont pas de simples spéculations sur le futur. En fait, elles sont la projection des tendances qui se font jour sous nos yeux. Ainsi, par exemple, les opposants polonais autour du "KOR" ont rapporté qu'un tiers de l'équipement industriel en Pologne n'est actuellement pas utilisé. Il en résulte, évidemment, une pénurie chronique de produits alimentaires, des coupures régulières d'électricité dans les foyers et même dans les usines, la disparition d'une grande partie des transports en commun et dans d'autres services, etc. En Roumanie, en Bulgarie, même en Hongrie, c'est la même histoire à peu de chose près ; en R.D.A. aussi, bien que ce ne soit pas si poussé. Dans tous ces pays, on est en train de mobiliser les ouvriers pour faire du travail et des brigades supplémentaires, mais aussi pour travailler dans des brigades mobiles qui pourront être utilisées pour construire des pipelines à l'Ouest de la Russie aujourd'hui et pour extraire du lignite en Allemagne de l'Est demain. C'est là le début de la militarisation que nous avons mentionnée. Les sursauts de lutte de classe en Europe de l'Est, en réponse à la crise depuis la fin des années 60 (Pologne 70 et 76, Tchécoslovaquie 68, Roumanie 77, ont été les exemples les plus notables) ont été très puissants mais ont eu tendance à rester sporadiques et isolés ; ils n'ont pas évolué vers un niveau plus élevé de politisation. Cela se comprend vu le manque d'expérience des ouvriers concernés, le poids de cinquante ans de contre-révolution, la sévérité de la répression étatique, pour ne mentionner que ces quelques facteurs. Ces luttes n'ont pas réellement dépassé le niveau de luttes défensives contre la chute des salaires réels et l'augmentation de l'exploitation. Mais la lutte de classe des années 80 devra aller au-delà de ce niveau, parce que ce que nous avons en face maintenant -et on peut le voir particulièrement clairement en Europe de l'Est-est la destruction de la société humaine sous le poids des rapports économiques et sociaux capitalistes. Le capitalisme ne peut même plus garantir l'assouvissement des besoins les plus vitaux pour la survie de la société humaine sous quelque forme que ce soit. La pénurie de produits alimentaires et de logements d'Europe de l'Est -nous en voyons de plus en plus en Europe occidentale aussi!- rend cela parfaitement clair. La classe ouvrière sera forcée de poser le problème du pouvoir afin de sauver société de la destruction totale, de la sauver du capitalisme. L'approfondissement de la crise est donc en train de créer les conditions nécessaires à l'unification et la politisation de la lutte de classe contre la crise capitaliste et la militarisation de la société. La profondeur de la crise et la réponse des ouvriers à cette crise, permettront au prolétariat d'entraîner les vastes masses paysannes et les couches non exploiteuses derrière lui, corme le fit le prolétariat russe en 1917.
Il n'est pas certain que cette lutte triomphera. Cela dépend de la capacité du prolétariat dans ces pays à se réapproprier les leçons du passé et, en coordonnant ses luttes avec celles des ouvriers à Ouest, à ouvrir ses rangs à 1 influence politique et à la solidarité du mouvement révolutionnaire qui est actuellement en formation en occident.
Krespel, Novembre 1979
Géographique:
- Allemagne [92]
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Sur la publication des textes de «l'Internationale» sur la guerre d'Espagne
- 3090 reads
Le milieu révolutionnaire en France des années 30 constituait un véritable microcosme des courants révolutionnaires existants. Alors que le trotskysme allait perdre son caractère prolétarien pour devenir une authentique force contre-révolutionnaire, quelques rares groupes se maintenaient dans cette période sur des positions de classe. La gauche communiste italienne fut l'expression la plus authentique d'une cohérence et fermeté révolutionnaires.
La confusion ambiante, à laquelle céda le groupe "UNION COMMUNISTE", n'allait malheureusement pas lui permettre de passer positivement le test des événements d'Espagne. Né dans la confusion, il disparut en 1939 dans la confusion, sans avoir donné un apport substantiel au prolétariat.
L'un de ses fondateurs (Chazé), plus de quarante ans après, a réédité avec une préface, un recueil de textes de son organe "L'Internationale". Malheureusement, en restant souvent fixés sur des positions qui ont fait faillite (conseillisme, anarchisme), en soufflant parfois pessimisme et amertume, de vieux militants prolétariens illustrent de façon tragique la coupure entre les anciennes générations révolutionnaires usées et démoralisées par la contre-révolution et les nouvelles générations qui souffrent d'une difficulté à se réapproprier les expériences passées. Que le bilan critique du passé fasse grandir la flamme nouvelle des prolétaires qui n'ont pas connu l'ambiance étouffante de la contre-révolution.
La guerre en Espagne (1936-1939) a suscité de nombreuses études depuis quelques années, souvent malheureusement sous forme universitaire ou de "mémoires" de caractère équivoque. C'est bien souvent la voix "Frente Popular", "POUMiste", trotskyste, anarchiste qui se faisait entendre. Toutes ces "voix", ces "visions" multiples se confondaient en un chœur pour chanter qui les mérites du "Frente Popular", qui la vertu des collectivisations, qui le courage des "combattants antifascistes".
La voix des révolutionnaires, par contre, ne pouvait que faiblement se faire entendre. La publication dans la REVUE INTERNATIONALE du CCI puis dans une édition de poche française de texte de Bilan ([1] [93]) consacrés à cette période est venue combler faire résonner -faiblement certes- la voix des révolutionnaires internationalistes. Cet intérêt pour les positions de classe, exprimées dans le plus total isolement, est un signe positif ; peu à peu, et trop lentement encore, se desserre et se fissure l'étau de fer idéologique que la bourgeoisie mondiale a fixé sur le prolétariat pour annihiler sa capacité théorique et organisationnelle à surgir sur son seul terrain, où s'exprime sa véritable nature : la révolution prolétarienne mondiale.
C'est donc avec un grand intérêt que le petit milieu révolutionnaire internationaliste a vu paraître en français Chroniques de la révolution espagnole, recueil de textes de l'Union Communiste parus de 1933 à 1939, et dont H.Chazé qui les republie aujourd’hui était un des principaux rédacteurs.
ORIGINES ET ITINERAIRE POLITIQUE DE L'"UNION COMMUNISTE"
L'Union Communiste était née en 1933. Sous le nom de Gauche Communiste, elle avait regroupé en avril de cette année les anciennes Oppositions du 15ème rayon de Courbevoie, de Bagnolet ([2] [94]), ainsi que le groupe de Treint (ancien dirigeant du Parti Communiste Français, avant son exclusion) qui avait scissionné de la Ligue communiste trotskiste de Frank et Molinier. En décembre, 35 exclus de la Ligue, presque tous issus du "Groupe juif" se fondaient dans la Gauche Communiste pour fonder l'Union Communiste.
Ce groupe se prononçait contre la fondation d'une 4ème Internationale, contre le "socialisme en un seul pays". Groupe révolutionnaire, l'Union Communiste (UC) gardait d'un héritage trotskyste beaucoup de confusions. Non seulement elle se prononçait pour la "défense de l'URSS", mais ses positions se démarquaient mal de l'antifascisme ambiant. En février 1934, elle demandera des milices ouvrières, reprochant au PCF et à la SFIO (socialistes) de ne pas vouloir constituer un "Front unique" pour battre le "fascisme". En avril 1934, elle verra avec satisfaction la "Gauche socialiste" de Marceau Pivert "prendre une attitude révolutionnaire", poussée "à poser le problème de la conquête révolutionnaire du pouvoir" (L'Internationale n°5, organe de l'UC). En 1935, elle prendra contact avec la "Révolution prolétarienne" ([3] [95]), des pacifistes, des trotskystes, tous "antifascistes", pour préconiser un rassemblement de ces organisations. En 1936, elle participera à titre consultatif à la Création du nouveau parti trotskyste (Parti Ouvrier Internationaliste).
C'est dire les difficultés énormes qu'eut l'UC à se définir comme une organisation prolétarienne.
Dans la confusion ambiante qui traduisait le poids de la contre-révolution, les militants révolutionnaires se réduisaient à peu, et leur marche vers une clarification des positions de classe se heurtait à e, mille obstacles. Dans l'introduction à Chroniques de la révolution espagnole, H.Chazé le reconnaît et jette un œil critique sur le passé :
"Sur la nature et le rôle contre-révolutionnaire de l'URSS, nous avions au moins dix ans de retard par rapport à nos camarades hollandais (communistes de conseils) et à ceux de la gauche allemande."
Il ajoute que ce retard allait amener des membres de l'UC à abandonner :
...les uns pour chercher des auditoires chez Doriot en 34-35, d'autres parce que dans l'UC ils ne pouvaient jouer au "number one", d'autres encore tout simplement parce que notre évolution rapide les effrayait. Départs sur la pointe des pieds ou après discussion, courte et amicale. Quelques années après, presque tous ces camarades étaient ou dans la Gauche socialiste de Marceau Pivert ou chez les "staliniens de gauche" du groupe qui éditait 'Que Faire ?". ([4] [96]).
L'UC s'était donc constituée dans la plus grande hétérogénéité politique. Néanmoins elle fut capable, et c'est là son mérite, de se rattacher progressivement aux positions de classe, en rejetant la "défense de l'URSS" et le Front Populaire défini à très juste titre comme "front national".
Cette clarification s'était-elle vraiment opérée totalement ? Les évènements d'Espagne, si déterminants par le massacre du prolétariat espagnol la guerre du prolétariat impérialiste espagnole allaient-ils amener l'UC à rompre définitivement avec les confusions du passé et en faire une aide sûre de la conscience révolutionnaire ?
C'est ce qu'affirme H.Chazé dans sa préface :
"Après quarante années de franquisme, les travailleurs espagnols ont commencé à affronter les pièges de la démocratie bourgeoise dans un contexte de crise économique et sociale mondiale.(...) la lutte de classe ne se laisse pas piéger durablement...à condition toutefois que les travailleurs tiennent compte des enseignements des luttes passées. C'est pour les aider à briser la camisole de force de l'encadrement que nous publions cette chronique de la révolution de 1936-37.".
De quelle "aide" s'agit-il ?
LES "ENSEIGNEMENTS" DE LA "REVOLUTION ESPAGNOLE" : "L'INTERNATIONALE" EN 1936-37
A la lecture des textes de L'Internationale, force est de constater que les positions exprimées n'aident pas à briser la camisole de force de 1`'encadrement. L'Internationale croit, tout comme les trotskystes, que la révolution a commencé en Espagne. Elle affirme en octobre 1936, après l'insurrection du 18 juillet des ouvriers de Barcelone, puis celle de Madrid : "l'armée, la police, la bureaucratie étatique se sont coupées et l'intervention directe du prolétariat a pulvérisé les morceaux républicains. Le prolétariat a créé de toutes pièces et en quelques jours ses milices, sa police, ses tribunaux, et il a jeté les bases d'un nouvel édifice économique et social" (N°23). L'UC voit surtout dans les collectivisations et la fondation des milices la base de la "Révolution espagnole".
Pour soutenir cette "révolution", l'UC fonde à la fin de l'année 1936 un "Comité pour la révolution espagnole" auquel participent trotskystes et syndicalistes. Comme le rappelle H.Chazé, ce soutien était aussi militaire bien que l'UC n'ait pas participé formellement aux milices espagnoles : "Quelques camarades techniciens spécialisés dans les fabrications d'armements, membres de la Fédération des ingénieurs et techniciens m'avaient demandé de m'informer auprès des responsables de la CNT pour savoir s'ils pouvaient être utiles. Ils étaient prêts à quitter leur emploi en France pour travailler en Catalogne."
Dans cette voie, l'UC fait chorus avec les trotskystes et le PCF qui demandent des armes pour l'Espagne. L'Internationale proclame : "la non-intervention (du Front Populaire, NDLR), c'est le blocus de la Révolution espagnole". Enfin, l'UC voit dans la CNT et le POUM des organisations ouvrières d'avant-garde. Le POUM surtout, malgré "ses grossières erreurs", lui paraissait "appelé à jouer un rôle important dans le regroupement international des révolutionnaires", à condition de rejeter la "défense de l'URSS". L'Internationale, jusqu'à sa disparition, se faisait le conseiller du POUM puis de son aile "gauche" ; elle voyait dans les jeunesses anarchistes un ferment révolutionnaire et se félicitait de voir sa revue lue en Espagne par les jeunes POUMistes et anarchistes.
Toutes ces positions, sur lesquelles nous reviendrons, étaient d'ailleurs très confuses. Dans le même article cité, on peut lire un paragraphe plus loin que l'Etat républicain qui était "pulvérisé" existait bel et bien : "il reste beaucoup à démolir, car la bourgeoisie démocratique se cramponne aux derniers morceaux du pouvoir bourgeois qui subsistent." A côté d'un appel pour l'"intervention" en Espagne, on peut lire plus loin : "la lutte pour le soutien effectif de nos camarades d'Espagne se ramène en réalité à la lutte révolutionnaire contre notre propre bourgeoisie."
L'enthousiasme pour la "Révolution espagnole" devait tomber au fil des jours. En décembre 1936, on pouvait lire dans le N°24 de L'Internationale :
"La révolution espagnole recule...La guerre impérialiste menace.(...) la faillite de l'anarchisme devant le problème de l'Etat (...) le POUM se trouve engagé dans une voie qui peut le mener rapidement à la trahison de la révolution, s'il ne modifie pas radicalement sa politique."
Le massacre des ouvriers de Barcelone en mai 1937 amènera L'Internationale à dénoncer la trahison des dirigeants anarchistes Elle soulignera que la contre-révolution a triomphé. Elle continuera cependant à voir des potentialités révolutionnaires dans l'aile "gauche" du POUM et chez "Les Amis de Durruti".
Deux ans après, à l'éclatement de la guerre, l'UC se dissolvait.
LA CONTRE-REVOLUTION EN ESPAGNE
De quelle révolution s'agissait-il donc ? H.Chazé ne cite que les collectivisations anarchistes et les "comités" de Front Populaire en 1936. S'attaquant à Révolution Internationale, organe du CCI en France, il affirme que nous parlons de contre-révolution en "niant qu'il y ait eu au moins un foyer révolutionnaire provoquant cette 'contre-révolution'", et il ajoute : "Ils affirment que le prolétariat espagnol ne s'était pas organisé en 'conseils'. Mais qu'étaient donc ces comités de toute sorte nés au lendemain du 19 juillet ? Le mot 'conseil' est le plus souvent, en France, utilisé par la bourgeoisie pour désigner les instances directoriales, juridiques et politiques.".
S'il est vrai que le 19 juillet 1936 a exprimé des potentialités révolutionnaires du prolétariat espagnol, celles-ci se sont rapidement épuisées. Ce furent justement ces comités, fondés à l'initiative bien souvent des anarchistes et POUMistes qui allaient ranger le prolétariat derrière la défense de l'Etat républicain. Très rapidement, ces comités allaient enrôler les ouvriers dans des milices qui les éloignèrent des villes pour les transporter sur le front militaire. Ainsi, la bourgeoisie républicaine conservait quasiment intact son appareil d'Etat, et en premier lieu son gouvernement, qui n'allaient pas tarder à interdire les grèves, les manifestations, au nom de "l'unité nationale" pour "la défense de la révolution". Ce rôle ouvertement contre-révolutionnaire du Front Populaire allait être pleinement soutenu par la CNT et le POUM, dans lesquels H.Chazé voit encore 40 ans après des vertus révolutionnaires.
"Des révolutionnaires existaient, nous le savions, et ils se manifestèrent notamment au cours des journées de mai 37." affirme-t-il dans sa préface. Mais que des individus soient restés révolutionnaires, qu'ils aient lutté les armes à la main contre le gouvernement républicain en mai 37, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. La leçon ineffaçable de ces évènements, c'est qu'anarchistes et POUMistes ont mené par leur politique le prolétariat au massacre. Ce sont eux qui mirent fin en juillet 36 à la grève générale ; ce sont eux qui poussèrent les ouvriers hors des villes ; ce sont eux qui soutinrent la "Généralité de Catalogne" ; ce sont eux qui firent de ces "comités" des instruments contraignant les ouvriers à produire d'abord, revendiquer ensuite.
Voila le triste bilan de cette politique "révolutionnaire" où les "comités" furent un instrument aux mains du capitalisme. Rien à voir avec les "conseils ouvriers", véritables organes de pouvoir qui surgissent d'une révolution. Ce n'est pas une question de mot !
Mais le plus grave dans la position de l'Union Communiste, toujours défendue par H.Chazé aujourd'hui, ces son appel aux armes pour l'Espagne, la sous-estimation sinon la négation du caractère impérialiste de la guerre en Espagne. H.Chazé est encore tout fier de rappeler que son organisation se mit à la disposition de la CNT pour l'aider à fabriquer des armes. Ignore-t-il que ces armes servirent à jeter dans le carnage les ouvriers ? Il se plaint que le gouvernement Blum n'ait pas donné des armes. L'URSS en a donné. A quoi ont-elles servi, sinon ² en mai 37 ? De cela, H.Chazé ne pipe mot. Il préfère cacher la nature contre-révolutionnaire de cette politique en la définissant comme une "solidarité de classe avec les travailleurs espagnols en lutte".
On ne peut qu'être peiné de voir un vieux militant comme H.Chazé conserver la même confusion que L'Internationale en 1936-39. En affirmant encore aujourd'hui que la position de défaitisme révolutionnaire dans la guerre en Espagne était "insensée", il nie le caractère impérialiste de cette "guerre civile". "Cette guerre est bien une guerre de classe" affirmait L'Internationale en octobre 36. H.Chazé le réaffirme aujourd'hui. Ces mêmes articles de L'Internationale montrent pourtant clairement le caractère impérialiste de la guerre : "D'un côté Rosenberg, ambassadeur soviétique à Madrid est l'éminence grise de Caballero ; de l'autre côté, Hitler et Mussolini prennent la direction des opérations...Dans le ciel de Madrid, les avions et aviateurs russes combattent les avions et aviateurs allemands et italiens" (N°24, 5 décembre 1936). Ce passage pourtant très clair ne suffit pas à éclairer l'UC (et H.Chazé aujourd'hui)qui se demande : "La guerre civile d'Espagne se transformera-t-elle en guerre impérialiste ?". H.Chazé ne voit la transformation en guerre impérialiste qu'après mai 37, comme si ce massacre n'était pas la conséquence du carnage impérialiste commencé en juillet 36 !
"MENSONGE", "FALSIFICATION", "AMALGAME" ?
La préface de H.Chazé aux Chroniques de la révolution espagnole est l'occasion pour lui de se livrer à un règlement de comptes contre Bilan et Communisme, organes respectifs à l'époque des fractions italienne et belge de la gauche communiste, dite "bordiguiste". Il affirme : "une poignée de jeunes bordiguistes belges, dès 1935 et donc avant de publier Communisme, pratiquaient allègrement le mensonge, la falsification de textes et l'amalgame... Ils continuèrent à propos de l'Espagne dans Communisme et furent épaulés par la direction de l'organisation italienne des bordiguistes qui publiait Bilan, et bien souvent en utilisant les mêmes procédés indignes de militants révolutionnaires". Et il conclut : "la position 'a priori' de la direction bordiguiste la conduisit à un monstrueux refus de la solidarité de classe avec les travailleurs espagnols en lutte".(Préface, p.8).
On chercherait en vain des arguments étayant des accusations aussi graves. Ce qui est sûr, c'est que Bilan et Communisme, lors de la guerre en Espagne, ont défendu sans concession aucune au courant ambiant, "interventionniste", les positions internationalistes. Ils ont refusé de soutenir un camp impérialiste ou un autre, et affirmé inlassablement que seule la lutte sur les "fronts de classe" contre toutes les fractions bourgeoises, anarchistes et POUMistes inclus, pourrait mettre fin au massacre sur les "fronts militaires" impérialistes. Au refrain classique de tous les traîtres au prolétariat "faire la guerre d'abord, la révolution ensuite", le courant "bordiguiste" opposait le seul mot d'ordre internationaliste "faire la révolution pour transformer la guerre impérialiste en guerre civile". Cette position sans concession, seule la Gauche italienne et belge avec le Groupe des Travailleurs Marxistes du Mexique ([5] [97]) l'a défendue avec fermeté contre le courant de démission et de trahison gagnant même les petits groupes communistes de gauche, à gauche du trotskysme Une telle position ne pouvait que laisser isolée la Gauche communiste italienne et belge. Ce choix, elle l'a fait délibérément, pour ne pas trahir le prolétariat international.
Ce qui se cache derrière les mots "falsification", "mensonge", "amalgame", c'est une intransigeance politique que le groupe Union Communiste n'a pas su adopter. L'UC se situait-ans un marais indéfini où elle essayait de concilier tant bien que mal des positions de classe et des positions bourgeoises. Ce fut la raison de la rupture définitive entre la Gauche italienne et l'UC, qui jusqu'alors conservaient quelques liens. Le courant "bordiguiste" pensait même que l'UC avait passé la barricade lors du massacre en Espagne ([6] [98]).
La guerre en Espagne, parce que, dès le début, elle préparait le second grand massacre impérialiste, a été un test décisif pour toutes les organisations prolétariennes. Si l'UC n'est pas passée dans le camp ennemi en 1939, comme les trotskystes, par ses confusions, son manque de cohérence politique, elle a été condamnée à disparaître sans avoir pu donner de véritables contributions au prolétariat.
H.Chazé croit sans doute beaucoup nous blesser en nous présentant comme les héritiers des "falsificateurs" "...nos censeurs de 36 ont des héritiers qui sévissent dans leur journal Révolution Internationale". Passons sur la réduction du CCI à RI, procédé habituel employé pour nier la réalité internationale de notre courant. Loin de nous sentir atteints nous ne pouvons qu'être flattés d'être présentés comme les "héritiers" des "censeurs" de l'UC. L'héritage de la Gauche communiste italienne et belge, que H.Chazé présente comme "monstrueux", est un très riche héritage de fidélité et de fermeté révolutionnaires, qui lui a permis pendant la 2ème Guerre Mondiale de se perpétuer comme courant prolétarien. Ce que Bilan, Communisme ont dénoncé, c'est précisément le mensonge d'une guerre impérialiste présentée aux ouvriers espagnols comme une "guerre de classe". Ce qu'ils ont dénoncé, c'est la plus gigantesque falsification historique qui a travesti le massacre d'ouvriers sur les fronts militaires, en mai 37, comme une "révolution ouvrière". Le pire amalgame, c'était, et c'est toujours aujourd'hui, de confondre terrain capitaliste et terrain prolétarien, là où ils s'excluent, le terrain prolétarien étant la destruction de l'Etat capitaliste, le terrain capitaliste, celui de l'embrigadement du prolétariat derrière la cause ennemie, au nom de la "révolution".
Les leçons de la Gauche communiste ne sont pas un héritage mort. Demain, comme hier, les prolétaires peuvent parfaitement être entraînés en dehors de leur terrain de classe et être appelés à mourir pour la cause ennemie. Dans une situation aussi difficile que celle de l'Espagne 36, il est décisif de comprendre -quelles que soient les difficultés rencontrées par le prolétariat sur un terrain militaire où s'avancent les armées capitalistes- que les fronts militaires ne peuvent être abattus que si le prolétariat y oppose fermement et résolument son front de classe. Un tel front ne peut s'affermir que s'il se dresse contre l'Etat capitaliste et ses partis "ouvriers". Le prolétariat n'a pas d'"alliances" momentanées et "tactiques" à nouer avec eux : il doit, seul, par ses propres forces, se battre contre ses prétendus "alliés" qui l'immobilisent pour le massacre et le condamnent à un nouveau mai 37. Le prolétariat d'un pays donné n'a d'alliés que dans sa classe qui est mondiale.
LA VOIE DU DEFAITISME OU LA VOIE DE LA REVOLUTION ?
H.Chazé explique qu'il a voulu republier les textes de L'Internationale pour aider à "briser la camisole de force de l'encadrement". Sa tentative va malheureusement dans le sens opposé. Non seulement il ne bouge pas d'un iota par rapport aux positions de l'UC et montre une incapacité à faire un bilan sérieux des évènements de l'époque, mais qui plus est, tout au long de la préface aux Chroniques de la révolution espagnole, il se dégage ici et là un ton nettement défaitiste. Alors qu'aujourd'hui, l'activité et l'organisation des révolutionnaires est une donnée fondamentale à comprendre pour la lutte du prolétariat, un instrument qui sera décisif dans la maturation de la conscience de classe, H.Chazé préconise la voie du "communisme (ou socialisme) libertaire" qui précisément a fait lamentablement faillite en Espagne. Il rejette toute possibilité et nécessité d'une organisation prolétarienne de révolutionnaires en affirmant : "la notion du parti (groupe ou groupuscule), seul porteur de la 'vérité' révolutionnaire, contient en germe le totalitarisme". Quant à la période actuelle, H.Chazé nourrit le plus noir pessimisme en affirmant n'avoir "pas trop d'illusions sur le contexte international, guère différent de ce qu'il était en 1936, malgré le nombre de grèves sauvages, dures, longues, contre la politique d’"austérité à sens unique du patronat des pays industrialisés." (...) "les forces contre-révolutionnaires se sont accrues partout dans le monde". Si nous sommes encore dans une période de contre-révolution, à quoi bon serviront les "leçons" que H.Chazé veut donner à ses lecteurs ? H.Chazé fait partie de ces vieux militants dont l'immense mérite a été de résister au courant contre-révolutionnaire. Mais comme beaucoup qui ont traversé la période la plus noire de l'histoire du mouvement ouvrier, tragiquement impuissants, il en a gardé une immense amertume, un désabusement sur la possibilité d'une révolution prolétarienne. Non, les leçons que H.Chazé veut donner, son pessimisme, ne sont pas nôtres([7] [99]).Aujourd'hui, depuis plus de dix ans, s'est close la longue nuit de la contre-révolution. Le prolétariat a ressurgi sur le terrain de la lutte de classe. Face à un capitalisme en crise qui voudrait le mener, comme dans les années 30, à une boucherie impérialiste, il garde une combativité intacte, il n'est pas battu. Malgré le poids des illusions qui pèsent sur lui, que souligne d'ailleurs à juste raison H.Chazé, il est une force immense qui attend son heure pour se dresser et proclamer à la face du monde capitaliste "J'étais, je suis, je serai.".
Roux/Ch.
[1] [100] Voir Revue Internationale n° 4, 6 et 7.
"La contre-révolution en Espagne", UGE 1979, avec une préface de Barrot dont nous critiquons le contenu dans ce numéro. Les éditions "Etcetera" à Barcelone ont publié en 1978 la traduction de certains textes de Bilan sur l'Espagne: "Textos sobre la revolucion espanola, 1936-39".
[2] [101] Rayon : organisation de base du PCF. Courbevoie, Bagnolet: banlieues ouvrières de Paris.
[3] [102] "La révolution prolétarienne" : revue syndicaliste révolutionnaire.
[4] [103] "Que Faire ?", dirigée par Ferrat, était une scission du PCF, partisane du "Front Unique" avec la SFIO socialiste. Après la guerre, Ferrat intégra le parti de Léon Blum.
[5] [104] Voir les textes publiés dans les Revues Internationales n° 10, 19 et 20.
[6] [105] La question espagnole entraîna la rupture entre Bilan et la Ligue des Communistes Internationalistes de Belgique en 1937. De cette dernière sortit la Fraction belge qui publia jusqu'à la guerre la revue Communisme. L'attitude face à la guerre d'Espagne fut à l’origine de la scission. Sur le fond, la LCI avait les mêmes positions que l'Union Communiste de H.Chazé et Lastérade.
[7] [106] Le recueil de textes de L’Internationale préfacé par H.Chazé a trouvé des admirateurs
Géographique:
- Espagne [107]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [108]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Sur la publication des textes de «Bilan» sur la guerre d'Espagne
- 2917 reads
La reparution des textes de "BILAN" consacrés aux événements d'Espagne de 1936 à 1938, dans une collection de poche, est un événement important. Longtemps refoulées par la puissance de la vague contre-révolutionnaire, les positions internationalistes ré émergent peu à peu dans la mémoire, prolétarienne. Depuis quelques années, un intérêt croissant se manifeste pour la gauche communiste en général, pour la véritable gauche italienne, incarnée par "BILAN" en particulier.
On ne sera pas surpris que de prétendus "héritiers" de la gauche italienne - le courant bordiguiste - n'aient pas jugé bon de publier les textes de BILAN. Leur politique du silence n'est pas fortuite. La gauche italienne des années 30 est un "ancêtre" gênant qu'ils auraient bien voulu ensevelir dans un oubli définitif.
En réalité, les "bordiguistes" d'aujourd'hui n'ont qu'un rapport très lointain avec BILAN et ne peuvent sous aucun titre se revendiquer d'une filiation de lui.
Nous nous proposons, d'ici quelques mois, de publier une histoire de la gauche communiste italienne de 1926 à 1945, sous forme de livre, afin que son apport reste bien vivant pour les nouvelles générations révolutionnaires.
Au mois de juin 1979, c'est avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction que nous avons vu la publication d'un choix de textes de Bilan sur la guerre' d'Espagne, sous l'égide de 3: Barrot. Ce travail de réimpression avait déjà été fait en partie par le CCI dans sa Revue Internationale (n° 4, 6 et 7), et concernant notre analyse de l'importance du travail effectué par la Fraction Italienne de la Gauche Communiste, nous renvoyons le lecteur aux introductions écrites à cette occasion.
Avec la volonté de situer Bilan dans l'histoire des fractions de gauche qui ont lutté contre la dégénérescence de la IIIème Internationale, Barrot a écrit une longue introduction où, bien qu'il affirme et rappelle des positions révolutionnaires, l'auteur finit certainement par égarer le lecteur profane en mêlant les genres : considérations personnelles mêlées à celles de Bilan, comparaisons historiques avec la période actuelle, définition de concepts, histoires d'autres groupes, polémiques contre le CCI et Bilan. Si beaucoup d'annotations sont justes, et nous ne nions pas qu'il ne faille pas porter des critiques sur Bilan, qui était le produit comme tout groupe d’une période donnée, il faut constater malheureusement que Barrot se situe en juge de l'histoire et que ses conceptions propres viennent jeter la confusion sur les positions fondamentales pour l'émancipation de la classe ouvrière, sur la vie de celle-ci et sur son rôle historique.
- MESURES CONCRETES ET PERSPECTIVE REVOLUTIONNAIRE
L'expérience espagnole, la réaction spontanée des prolétaires se dotant de milices contre l'attaque franquiste en dépit des tentatives de conciliation du Front Populaire, puis ces mêmes prolétaires se soumettant à l'encadrement de la gauche bourgeoise, montre la nature des barrières politiques dressées contre le prolétariat et l'échec auquel il est voué s'il ne les franchit pas.
Saluant les positions claires de Bilan à ce propos, et ne pouvant faire autrement car là il n'invente rien, J. Barrot se pose cependant en contempteur du haut de sa chaire à propos de ces évènements d'Espagne en 36-37 :
"Bilan a tendance à ne voir qu'un étouffement des prolétaires (ce qui est vrai), et non l'apparition d'un mouvement social susceptible dans d'autres conditions d'avoir un effet révolutionnaire." "Dénoncer la contre-révolution sans en énoncer aussi les mesures positives et leur enracinement dans chaque situation, c'est agir de façon purement négative. Le parti (ou la 'fraction') n'est pas un sécateur." (page 88)
Si J. Barrot entend par mouvement social, le bouleversement inévitable des institutions bourgeoises en temps de crise, tel que grèves et occupations des terres, c'est un fait que Bilan ne nie pas. Ce que dit Bilan, c'est qu'un tel bouleversement est insuffisant sans le renversement de l'Etat bourgeois !
Quand Bordiga disait qu'il faut détruire le monde capitaliste avant de prétendre construire la société communiste, ce n'était pas pour énoncer un adage de plus, c'était surtout pour montrer comme le faisait Rosa Luxembourg que les révolutionnaires ne disposent que de quelques poteaux indicateurs pour la voie du communisme. Mais J. Barrot a sans doute la prétention, comme les utopistes, de définir dans les détails la marche et la constitution d'une société que bâtiront des millions de prolétaires et sur laquelle nous savons peu, sinon, à grands traits, qu'elle verra le dépérissement de l'Etat, l'abolition du salariat et la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme ([1] [109]).
J. Barrot semble avoir oublié la part fondamentale de la dénonciation de la société bourgeoise quand il reprend à son compte, avec d'autres mots, l'accusation traditionnelle du bourgeois, selon laquelle les révolutionnaires (la Fraction Bilan en l'occurrence) seraient purement nihiliste.
Alors oui, et qui plus est, à propos du massacre des travailleurs en Espagne, le rôle de la Fraction était et ne pouvait être que sécateur entre les idées bourgeoises et prolétariennes, et, sans aucun nihilisme, de dresser la perspective de lutte autonome de la classe -qui en tant que telle n'a rien à voir avec la lutte syndicale basée sur les revendications de la gauche- d'affirmer la nécessité de s'opposer à tout envoi d'armes pour l'un ou pour l'autre camp impérialiste, de mettre en avant la nécessaire fraternisation des prolétaires, sans quoi (ce qu'il advint) ils seraient tués dans la guerre locale d'abord, puis dans l'holocauste mondial. Telles étaient les mesures concrètes politiques à mettre en avant, et Bilan les a défendues!
2. CRISE DU PROLETARIAT OU NECESSAIRE RECONSTITUTION DE SON INDEPENDANCE DE CLASSE ?
Oubliant un demi-siècle de contre-révolution et dénaturant l'affirmation de l'autonomie de classe par Bilan, J. Barrot semble rabaisser cette indépendance de l'action du prolétariat au niveau du danger que la lutte économique reste sur le terrain économique (et plus loin d'ailleurs il nie la primauté du politique quand l'action de la classe englobe nécessairement le politique et l'économique):
"...Dans ces conditions, insister sur "l'autonomie" des actions ouvrières ne suffit pas. L'autonomie n'est pas plus un principe révolutionnaire que le "dirigisme" par une minorité: la révolution ne se revendique pas plus de la démocratie que de la dictature."
Bien qu'il rappelle l'importance du contenu pour l'autonomie, on se demande quel contenu met Barrot dans la dictature du prolétariat, dans la démocratie prolétarienne, dans les organes de masse du prolétariat ?
On comprend que pour cet auteur, l'autonomie ne soit pas un principe car ainsi il rejette l'affirmation du prolétariat comme classe distincte des autres classes et qui forge son expérience à travers ses multiples luttes même sous la domination du capital. C'est lui qui fait la séparation entre la lutte économique et politique, alors que ni Bilan ni le CCI, qu'il met en cause, n'ont jamais fait précéder l'un ou l'autre de façon mécanique; Rosa et Lénine ont assez souvent démontré en quoi les phases de luttes économiques et politiques se succèdent en s'interpénétrant au point qu'elles se confondent, parce qu'elles sont des moments d'une même lutte de la classe ouvrière contre le capital.
Les révolutionnaires ont toujours mis en avant que les ouvriers sont amenés à dépasser le stade strictement revendicatif, faute de quoi les luttes sont vouées à l'échec. Pour autant, les échecs de nombreuses luttes ces dernières années sont le ferment de la lutte décisive à l'avenir, mais J. Barrot y voit une contradiction :
"...contradiction (qui) engendre une véritable crise du prolétariat, reflétée entre autres par la crise des quelques groupements révolutionnaires. Seule une révolution pourrait dépasser pratiquement cette contradiction."
Pour résoudre ce qu'il comprend de cette apparente contradiction, Barrot secoue le mot révolution comme le curé prodigue l'encens pour chasser le diable.
Il est de peu d'intérêt ici de retenir toutes les jongleries contradictoires de Barrot, mais si par exemple, d'un côté il reconnaît que "l'expérience prolétarienne s'enracine toujours dans les conflits immédiats", comment peut-il soutenir l'idée selon laquelle: "c'est l'activité réformiste des salariés eux-mêmes qui les enchaîne au capital" ?
Que vient faire là le réformisme, alors que les prolétaires se battent contre l'aggravation de leurs conditions de vie ? A moins que Barrot -comme tout gauchiste moyen- identifie la classe aux partis contre-révolutionnaires qui prétendent la représenter et qui passent pour être "réformistes" ?
Si les prolétaires s'enchaînent par eux- mêmes au capital, autant dire que les partis de gauche en Espagne (et ailleurs !) n'ont aucune responsabilité dans la guerre impérialiste et que les idées bourgeoises ne sont plus des forces matérielles ! Alors, le prolétariat n'existe plus comme classe révolutionnaire et la société communiste n'aura été qu'une utopie de plus !
Mais Barrot risque encore de dire que nous dénaturons les questions qu'il pose - certes, ce serait de la mauvaise foi - si seulement Barrot ne confirmait pas la nature de ses questions par ses réponses modernistes et ses jugements a-historiques !
Nous avons appris successivement que l'autonomie de classe n'était pas un principe, que les prolétaires s'enchaînaient au capital. Nous apprenons ensuite que le CCI sait "à peu près ce que la révolution doit détruire, mais non ce qu'elle doit faire pour pouvoir le détruire" (page 87); ceci nous renvoie aux "mesures concrètes„ telles qu'elles entrent dans le schéma barrotien, et on verra que c'est Barrot qui fait l'ignorant.
3. AUCUNE MODIFICATION TANGIBLE DE LA STRUCTURE SOCIALE N'EST VIABLE SANS DESTRUCTION DE L'ETAT BOURGEOIS 1
Nous avons déjà noté l'insuffisance de certains bouleversements sociaux ; que la classe ouvrière tende à remettre en route la production et que les paysans sans terre exproprient les propriétaires fonciers n'a pas un effet révolutionnaire en soi, mais est au contraire un des moments du processus de tâtonnement de la classe, qui, en lui-même n'est pas émancipateur si ce contrôle de la production devient "l'autogestion" et si les prolétaires, comme en Espagne sont soumis à une fraction de la bourgeoisie au nom de "l'antifascisme". Barrot reconnaît les limites de tels bouleversements, mais tout de même en les présentant comme "une immense poussée révolutionnaire".
Tout en reconnaissant partiellement que l'Etat bourgeois républicain "répugnait" (évidemment) à l'emploi de méthodes de lutte sociale pour envoyer en fin de compte les prolétaires au front impérialiste, Barrot pense que :
"La non-destruction de l'Etat empêche aux socialisations et collectivisations d'organiser une 'économie anti-mercantile' à l'échelle de toute la société."
Ce qui est vrai en un sens, mais pour cet auteur, socialisations et collectivisations sont forcément "la tendance potentielle" au communisme. Pour nous, si tendance potentielle au communisme il y a, elle s'exprime dans la capacité de la classe ouvrière à généraliser ses luttes, à centraliser et coordonner son organisation, à faire la démarcation avec les partis bourgeois, à s'armer pour mettre fin à la domination capitaliste, comme condition première de la transformation sociale, plutôt qu'un contrôle de la production visant à atténuer la faillite de la bourgeoisie, ou pire, prétendant, avant la destruction de l'Etat, instituer des rapports de production nouveaux !
En octobre 17 en Russie, ce type d'expérience d'autocontrôle des usines tourne vite court. Ce qui se dégage d'abord et avant tout, c'est la centralisation de la lutte, une centralisation qui, soit n'existe pas en Espagne, soit...est prise en charge par l'Etat bourgeois. Les prolétaires en Russie, après la destruction de l'Etat bourgeois, ont pu croire un court moment organiser une économie anti mercantile avec toutes les difficultés que l'on sait : ce qui s'est confirmé, c'est une impossibilité de la faire dans un cadre national, même après la destruction de l'Etat bourgeois.
Il est évident que les prolétaires, dès avant l'assaut contre l'Etat, dans la période de maturation, bouleversent la bonne marche de l'exploitation, mettent en avant une réduction du temps de travail (les 8 heures), imposent des décrets sur la terre et sur la paix, mais ces mesures ne sont pas en soi communistes. Leur application n'est que la satisfaction de revendications que le capitalisme n'est même plus capable de satisfaire. Et même si le capital cède avant sur certaines de ces mesures, le degré de conscience atteint par les prolétaires au cours du processus de la lutte ne peut leur faire négliger la nécessité de l'insurrection politique.
Après l'insurrection, les prolétaires d'une aire géographique donnée continuent à subir le joug de la loi de la valeur. Si on ne le reconnaît pas, il faut alors nier que le capitalisme impose sa loi à l'ensemble de la planète tant qu'il existe, c'est la porte ouverte à la thèse stalinienne du "socialisme dans un seul pays". Tout ce que nous savons, c'est que le prolétariat ne se trouvera pas avec un mode de production fixe, mais qu'il lui faudra constamment le bouleverser dans un sens anti-mercantile
Pour ce qui est d'établir aujourd'hui de façon précise le quand et le comment sera effectuée la distribution des richesses sociales selon les besoins à long terme (hormis la satisfaction des revendications les plus immédiates, la nourriture, le logement, la suppression de la hiérarchie des salaires, etc.), cela relève de la spéculation hasardeuse ou du bricolage politique. A ce niveau, nous nous trouvons dans la société en transition du capitalisme au communisme, étape inévitable comme l'a toujours affirmé le marxisme.
4. DE LA LUTTE DE CLASSE SOUS LA DOMINATION DU CAPITAL A L'AFFIRMATION DU PROLETARIAT
Il est facile à tous les novateurs en théorie sociologique de théoriser les faiblesses du mouvement ouvrier, de voir les ouvriers récupérés par la "société de consommation" ou intégrés au capital. La prétention de ces fabricants d'idées n'est au vrai qu'une tentative de plus pour liquider le marxisme en tant que méthode et instrument de combat d'une lutte de classe qui tend à détruire l'infrastructure de leur classe d'appartenance, la bourgeoisie. Tel est le chemin sur lequel Barrot risque fort de s'embourber.
Malheureux prolétariat d'Espagne 1936 qui n'obéit pas aux considérations d'un grand observateur au dessus de l'histoire. Au début, il y a un "comportement communiste bien rapporté par Orwell" et ensuite "il ne s'organise pas de façon communiste parce qu'il n'agit pas de façon communiste." Comprenne qui pourra ! En réalité, Barrot met la charrue avant les bœufs :
"Le mouvement communiste ne peut vaincre que si les prolétaires dépassent le simple soulèvement (mine armé) qui ne s'en prend pas au salariat lui-merle. Les salariés ne peuvent mener la lutte armée qu'en se détruisant comme salariés."
Barrot s'engage à la légère pour tirer une leçon des évènements en Espagne, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas alors (en juillet 36) d'un soulèvement armé contre l'Etat. Après avoir été incapable de nous expliquer comment les ouvriers atomisés en individualités peuvent devenir le prolétariat s'affirmant pour le renversement de l'ordre établi, autrement que par des formules du genre "éclatement de la théorie du prolétariat" (!), il veut nous faire croire à la simultanéité absolue de l'abolition du salariat et du renversement de l'Etat bourgeois. Autant rêver encore une fois de la constitution immédiate du communisme !
Effectivement, les prolétaires insurgés ne sont plus à proprement parler des salariés, mais cesseront-ils pour autant de produire dans les usines - même avec un fusil en bandoulière - ? Travailleront-ils gratuitement pour des millions de sans-travail ? Est-il possible au sein du secteur sous contrôle prolétarien de supprimer toute rétribution dans l'anarchie léguée par le capitalisme international, qui dans sa tentative matérielle pour écraser la révolution, imposera par exemple une plus grande production d'armes ou de matériaux de première nécessité? Et de toute façon, qui peut décider du mode de rétribution et de la meilleure façon d'aller au plus vite à l'abolition du salariat dans la division du travail encore existante : Marx et ses bons du travail évoqués dans la Critique du Programme de Gotha ? Barrot ? Le Parti ? Ou plutôt l'expérience même de la classe.
Ce qui distingue aujourd'hui les révolutionnaires de tous les élucubrateurs du communisme en imagination, c'est l'affirmation que toutes les mesures économiques ou de transformation sociale, seront assumées sous la dictature du prolétariat, sous le contrôle politique de cette classe et qu'il n'y aura pas de mesures économiques acquises définitivement, garantissant l'avance vers le communisme ou dont on soit sûr qu'elles ne se retournent pas contre le prolétariat, tant que la politique bourgeoise ne sera pas définitivement vaincue.
Barrot n'a même pas encore levé un coin du voile de la société en transition vers le communisme, qu'il définit déjà la révolution comme "la réappropriation des conditions de la vie et de la production des rapports nouveaux" en traitant par dessus la jambe la période insurrectionnelle décisive. On comprend qu'il reproche, comme tous les modernistes, à la Gauche italienne "un formalisme ouvrier voire un économisme" (!), même s'il est lui-même obligé de reconnaître un rôle-clé aux ouvriers. Par le manque de clarté de toutes ces formulations, n'est-on pas fondé de croire que la démonstration implique le rejet de l'affirmation du prolétariat comme classe sujet de la révolution ?
Tous ceux qui dissolvent déjà le prolétariat en voulant faire croire qu'il est en crise parce qu'il n'arriverait pas à dépasser ses triviales luttes immédiates qui l'enchaîneraient au capital, tous ceux qui envisagent la disparition de la classe ouvrière avant l'assaut révolutionnaire, avant le communisme, sont inutiles au prolétariat parce qu'ils gomment d'un trait toutes les difficultés du passage au communisme. Leurs théories fumeuses 'sur papier glacé finiront à la corbeille à papier de l'histoire.
Loin d'aider à une juste appréciation du rôle des fractions de gauche et de leurs apports à l'usage de notre génération, Barrot les déforme en accusant la Gauche Italienne d'hypertrophier le politique, d'en rester à une conception successive de la révolution (politique puis économique); et qui plus est, bien que Bilan ait tracé les caractères généraux de la révolution communiste future, en l'accusant d'avoir "opposé" le but au mouvement".
Ce genre de commentaires confine au charlatanisme. A l'encontre de ce que tente de démontrer Barrot il suffit de lire le choix des textes publiés, pour voir le soin que Bilan met dans l'analyse du rapport des forces, à rappeler les percées prolétariennes et les sacrifices de la classe, pour montrer en quoi la classe vit et lutte, même handicapée par le poids de l'anarchisme en Espagne, même déviée de la perspective communiste, en quoi les expériences de luttes en 36 constituent une part irremplaçable de l'expérience de la classe dans sa recherche du but final.
La guerre d'Espagne n'a aucunement bloqué le développement théorique de la Gauche Italienne, elle a au contraire vérifié les analyses de Bilan, confirmé qu'il ne fallait pas abandonner d'un pouce la politique prolétarienne. Quant au mouvement "potentiel" dont parle Barrot pour les besoins de sa théorie, les mesures concrètes telles que les "socialisations et collectivisations", elles ont été exagérées dans leur importance et utilisées par la bourgeoisie comme exutoire au problème politique fondamental : l'attaque contre l'Etat bourgeois. Pour Barrot, le communisme est pour tout de suite ou pour jamais. Il clame à qui veut l'entendre : "le communisme théorique ne peut plus exister que comme affirmation positive de la révolution" (souligné par nous). Dans ces conditions, le lecteur de la préface aux textes de Bilan aura pu se demander de quoi se revendique la révolution barrotienne, si elle n'est pas quelque chose qui mène nulle par pour aller n'importe où.
Le lecteur attentif a compris que la révolution viendrait toute seule un beau jour pour résoudre la "crise du prolétariat" par la négation pure et simple de cette classe, qu'elle se passerait de ces petits groupes révolutionnaires émiettés qui "ressemblent plus à des maisons d'édition" ou de groupes comme le CCI qui ne savent pas "ce que la révolution doit faire". La force du trait de plume de Barrot élimine les acquis programmatiques du mouvement révolutionnaire, le débat sur la période de transition, rejette la conscience de classe et l'importance de l'activité des révolutionnaires et fait un grand saut dans le vide intersidéral ! Barrot a un grand mérite : c'est d'avoir fait publier des textes de Bilan sur la guerre d'Espagne.
J.L.
[1] [110] Sur la période de transition, consulter les travaux de Bilan et différents textes dans la Revue Internationale du CCI.
Géographique:
- Espagne [107]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [108]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 23 - 4e trimestre 1980
- 2661 reads
Grève de masse en Pologne 1980: une nouvelle brèche s'est ouverte
- 4498 reads
- "La grève de masse n'est ni fabriquée artificiellement, ni décidée et propagée dans un éther immatériel. Elle est un phénomène historique résultant, à un certain moment, d'une situation sociale à partir d'une nécessité historique".
R. Luxemburg. (Grève de masse, Parti et syndicats)
Une brèche s'est ouverte dans l'histoire qui ne se refermera plus : sous les yeux du monde entier, la classe ouvrière en Pologne a ouvert le glacis de l'Est pour rejoindre la lutte de classe de tous les ouvriers. Comme en 1905 en Russie, ce mouvement est sorti des profondeurs du prolétariat; son caractère de classe est sans équivoque. La grève de masse en Pologne par son ampleur, par sa dimension historique, par sa voix résolument ouvrière marque l'évènement le plus important depuis le réveil de la lutte de classes en 1967-68.
La portée de cet évènement dépasse de loin les jalons encore hésitants de mai 68 en France. A l'époque de ce grand coup de tonnerre marquant la fin de la période de la contre-révolution et le début d'une nouvelle période de bouleversements-sociaux, le potentiel du mouvement ouvrier restait encore flou. D'autres parlaient à la place de la classe ouvrière, comme les étudiants par exemple, qui sentaient viscéralement l'écroulement de toutes les valeurs d'une société encaissant sourdement les premières secousses de la crise mais qui ne pouvaient apporter de solutions. A l'Est, la Tchécoslovaquie de 68 était à l'image de l'époque : un mouvement où la classe ouvrière n'a pas tenu directement la scène, un mouvement nationaliste dominé par une fraction du Parti au pouvoir, un "Printemps de Prague" de "revendications démocratiques" sans lendemain. Bien que le mouvement de Pologne en 70 ait fait preuve d'une plus grande maturité du prolétariat, il est resté peu connu et limité.
Aujourd'hui, par contre, la crise économique du système est une réalité quotidienne ressentie dans la chair des ouvriers, donnant ainsi aux évènements de Pologne 80 une toute autre dimension : c'est un pays entier embrasé par le feu d'une grève de masse, par l'auto organisation généralisée des ouvriers. C'est la classe ouvrière qui a tenu le devant de la scène, débordant le cadre de la défense économique pour se poser, malgré des faiblesses, sur le terrain social .En réagissant aux effets de la crise économique, les ouvriers en Pologne viennent de faire l'éclatante démonstration du fait que le monde est un -tous les gouvernements du monde quelle que soit leur couverture idéologique, pataugent dans la crise, demandent des sacrifices aux exploités. La lutte de Pologne 80 est la meilleure preuve que le monde n'est pas divisé en deux systèmes différents, mais que le capitalisme sous une forme ou une autre règne partout à travers l'exploitation des travailleurs. Les grèves en Pologne donnent un immense coup, qui se révélera irréversible, à la crédibilité devant la classe de la mystification stalinienne et pro-stalinienne sur les "Etats ouvriers" et le "socialisme" à l'Est. Chaque fois que les ouvriers en lutte se heurteront n'importe où dans le monde aux chaînes idéologiques et physiques du stalinisme, on se souviendra de la voix ouvrière de Gdansk. Et la brèche ne fera que s'élargir. Les évènements de Pologne ne peuvent être compris que dans le cadre de la crise du capitalisme (cf. dans ce numéro l'article sur "La crise dans les pays de l'Est") et comme partie intégrante d'une reprise internationale des luttes ouvrières.
A l'Ouest, depuis plusieurs années, la lutte de classes a surgi avec plus de vigueur, confirmant la combativité intacte de la classe ouvrière : la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne, la lutte des dockers à Rotterdam, Longwy-Denain en France, les combats au Brésil en sont les exemples les plus frappants.
A l'Est, les évènements récents font partie de toute une agitation ouvrière qui se développe depuis plusieurs mois, notamment la grève générale qui a paralysé la ville de Lublin en Pologne en juillet 1980 et les récentes grèves en URSS (celle des conducteurs d'autobus à Togliattigrad qui a reçu l'appui des ouvriers des usines automobiles). Ces éléments apportent un démenti catégorique à tous ceux qui propageaient le mythe que la classe ouvrière est à jamais écrasée à l'Est et que toute lutte de classes y est impossible.
Nous voyons aujourd'hui des signes incontestables d'une réaction généralisée de plus en plus vive aux manifestations de la crise mondiale. Dans ce sens, les grèves en Pologne marquent un pas immense pour la reprise internationale de la lutte prolétarienne, pour la démonstration de cette unité fondamentale de la condition et de la solution ouvrière.
C'EST LA NAISSANCE DE NOTRE FORCE.
LE PROLETARIAT ET LES ANTAGONISMES INTER-IMPERIALISTES
Que la reprise internationale des luttes de la classe ouvrière trouve son point culminant dans un pays de l'Est, a une signification toute particulière pour le prolétariat. Celui-ci vient de vivre toute une période de battage intense de la part de la bourgeoisie occidentale sur le danger de guerre qui viendrait du bloc de l'Est, seul "belliciste" face à un bloc de l'Ouest "pacifique". A ce niveau, la leçon est énorme et apporte un démenti cinglant aux mensonges d'un bloc guerrier, homogène et uni, contre lequel il serait nécessaire de se mobiliser, toutes classes confondues, pour éviter d'autres Afghanistan. En se soulevant, le prolétariat polonais est venu jeter le trouble dans ce choix monstrueux que la bourgeoisie s'ingénue à présenter comme le seul choix possible, celui d'un camp impérialiste contre un autre. Les ouvriers en Pologne ont remis au premier plan le seul véritable choix par-delà les frontières nationales: OUVRIERS CONTRE PATRONS, PROLETARIAT CONTRE CAPITAL.
La bourgeoisie de tous les pays a senti cette menace ouvrière; face à la lutte de classes qui tend à rompre le cadre de la société capitaliste, en mettant à nu l'antagonisme prolétariat-bourgeoisie, la classe capitaliste -au plus chaud des évènements- a fait preuve d'une espèce de solidarité internationale qui étonne les non-avertis. Contrairement à la Hongrie 56 ou même à la Tchécoslovaquie 68 où la bourgeoisie du bloc de l'Ouest a profité de la situation pour tenter de gagner un nouveau point d'appui, on a vu cette fois-ci l'édifiant spectacle de tous les gouvernements du monde -à l'Est comme à l'Ouest- apportant chacun leur "seau d'eau" pour éteindre le feu ouvrier. Les crédits que l'occident offre à la Pologne à travers la pression faite sur les banques allemandes et le Fond Monétaire International et l'argent envoyé par les syndicats occidentaux, les crédits accordés par la Russie. Les voilà tous autour de la "mère malade" essayant de faire en sorte que l'endettement colossal de la Pologne n'empêche pas celle-ci d'accorder des miettes à la classe ouvrière pour pouvoir calmer le mouvement. Tous n'ont qu'un seul but : maintenir le statuquo face au danger prolétarien et sa tendance à faire tache d'huile... On ne peut pas connaître tous les détails de la diplomatie secrète mais les lettres "personnelles" de Giscard et Schmidt à Gierek, de Président à Président, les coups de téléphone, les consultations Carter-Brejnev, montrent la préoccupation commune que les ouvriers en Pologne ont suscité chez l'ennemi de classe.
Dans ce sens, les évènements de Pologne ne font que confirmer une loi historique fondamentale de ce monde divisé en classes antagoniques. Quand les mutineries des marins en Allemagne 1918, suite à l'exemple de la révolution russe, ont fait peur à la bourgeoisie des deux côtés des tranchées, celle-ci a dû arrêter la guerre pour ne pas risquer l'effondrement de tout son système. De même, la lutte décidée et organisée des ouvriers en Pologne contre l'austérité, même si elle n'a pas été insurrectionnelle, a repoussé provisoirement la question des conflits inter-impérialistes à l'arrière-plan en mettant la question sociale au premier plan. Ces facteurs inter-impérialistes ne disparaissent pas et ne sont mis à l'écart que provisoirement puisque la pression de la classe ouvrière est encore sporadique et pas suffisamment mûrie pour permettre un affrontement décisif. Mais ces évènements constituent la preuve la plus nette que le potentiel de résistance de la classe ouvrière représente aujourd'hui le seul frein efficace à la guerre. Contrairement à ce que clament la gauche et autres sur la prétendue nécessité de battre d'abord le camp impérialiste qui se trouve en face ("l'ennemi n°1") pour ensuite engager la lutte sociale (souvenons-nous du battage autour de la guerre du Vietnam dans les années 60), les évènements de Pologne montrent que seule la solidarité prolétarienne dans la lutte peut faire reculer les menaces de guerre.
LA BOURGEOISIE CEDE
Un acquis de ce mouvement qui ne s'effacera pas est le fait que la lutte ouvrière peut faire reculer la bourgeoisie à l'échelle internationale et nationale et établir un rapport de forces en sa faveur. La classe ouvrière n'est pas démunie devant la force répressive de son exploiteur, elle peut paralyser la main de la répression par la généralisation rapide du mouvement.
Il est clair que les ouvriers en Pologne ont tiré beaucoup d'enseignements de leurs expériences précédentes de 1956, 70 et 76. Mais, contrairement à ces luttes et notamment à celles de Gdansk, Gdynia et Szczecin en 1970 où les émeutes dans la rue ont constitué l'aspect le plus marquant, la lutte de 1980 des ouvriers en Pologne a consciemment évité les affrontements prématurés. Ils n'ont pas laissé de morts. Ils ont senti que leurs forces résident avant tout dans la généralisation de la lutte, dans l'organisation de la solidarité.
Il ne s'agit pas d'opposer "la rue" à "l'usine" car elles font partie toutes deux de la lutte de la classe ouvrière mais il faut comprendre que "la rue" (sue ce soient des manifestations ou des bagarres) et "l'occupation de l'usine" comme lieu de repère et non de "prison" ne sont des moyens efficaces pour la lutte que si la classe prend le combat en ses propres mains en généralisant la lutte au-delà des divisions des catégories du travail et en s'organisant de façon décidée. C'est en cela que réside notre force et non pas en une exaltation morbide de la violence en soi. Contrairement aux légendes des situationnistes à propos de "brûler et piller les supermarchés" ou des bordiguistes sur "la terreur rouge" de Nosferatu, la lutte a franchi aujourd'hui une étape en dépassant le stade des explosions de colère. Et ceci, non pas parce que les ouvriers en Pologne seraient devenus sous la pression du KOR pacifistes. A Gdansk, Szczecin et ailleurs, les ouvriers ont organisé immédiatement des groupes de défense contre toute répression éventuelle. Ils ont su juger quelles étaient les armes adéquates à leur lutte dans le moment présent. Il n'y a évidemment pas de recette valable en toute circonstance, mais la preuve est faite que c'est l'extension rapide du mouvement qui a paralysé l'Etat. On a beaucoup parlé du danger "des chars russes".
En réalité, les armées russes ne sont jamais intervenues directement en Pologne, que ce soit à Poznań en 1956 ou pendant les mouvements de 70 et 76. Ceci ne veut pas dire que l'Etat russe n'enverra pas en dernière instance l'équivalent "des marines" américains si le régime risque de sombrer.
Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la période de la "guerre froide" (comme en Allemagne de l'Est en 1953) où la bourgeoisie avait les mains libres face à un soulèvement isolé. Ce n'est pas non plus une insurrection historiquement prématurée et noyée (comme ce fut le cas pour la Hongrie 1956) ni un mouvement nationaliste tendant à s'ouvrir vers le bloc rival (Tchécoslovaquie 1968). La lutte des ouvriers en Pologne 1980 se situe dans une époque de potentialité du mouvement ouvrier dans tous les pays, à l'Est comme à l'Ouest. Et malgré la situation militaire et stratégique de la Pologne, l'Etat russe doit faire très attention. Il n'était pas possible de faire face à la lutte dès le départ par un massacre des ouvriers. D'autant plus qu'en 1970, en Pologne, c'est la réponse aux premières répressions brutales qui avait déclenché la généralisation immédiate des luttes. Face à un mouvement ouvrier de la taille de 1980, la bourgeoisie a cédé; la classe ouvrière a senti sa force, prenant confiance en elle-même.
POLOGNE 1980 NOUS MONTRE LE CHEMIN
Partant des mêmes causes qui provoquent les mouvements de grèves ouvrières -la révolte contre les conditions de vie- les ouvriers en Pologne, mobilisés au début contre la pénurie et la hausse des prix des produits alimentaires, notamment la viande, ont étendu le mouvement par des grèves de solidarité, refusant les injonctions du gouvernement pour négocier usine par usine, secteur par secteur et déjouant ainsi le piège auquel se heurte de façon répétée la lutte ouvrière dans tous les pays depuis quelques années. Car au-delà des septicités des attaques du capitalisme contre la classe ouvrière (ici, licenciements massifs, inflation; là, rationnement des biens de consommation, également inflation), ce sont les mêmes problèmes fondamentaux qui sont posés à l'ensemble du prolétariat, quelles que soient les modalités de l'austérité, quelle que soit la bourgeoisie nationale qu'il trouve en face de lui. Et la lutte des ouvriers en Pologne ne peut servir véritablement à ses frères de classe que si tous ses enseignements, peu à peu sont assimilés.
En 1979, en France, les ouvriers de la sidérurgie se sont mobilisés spontanément et violemment contre l'Etat capitaliste qui venait de décréter une vague de licenciements. Il a fallu deux mois aux syndicats pour parvenir à enrayer les possibilités d'extension du mouvement -en faisant cesser notamment les grèves dans la région parisienne- et faire rentrer les ouvriers dans le cadre capitaliste et légaliste de la négociation des licenciements. L'organisation de la lutte laissée aux mains des organes de base des syndicats, l'extension limitée au seul secteur de la sidérurgie, la violence ouvrière dévoyée en opérations "coups de poing" nationalistes, tels ont été les obstacles rencontrés par la classe ouvrière et qui ont permis à la bourgeoisie de démobiliser la combativité ouvrière et de mettre en œuvre, finalement, ses plans.
En 1980, en Grande-Bretagne, sous la poussée générale des ouvriers, les syndicats de base -les shop-stewards- prennent l'initiative des comités de grève. Alors que des licenciements massifs (plus de 40.000) se profilent, les revendications sont limitées à des augmentations de salaire; alors que d'autres secteurs de la classe ouvrière sont prêts à bouger, la "généralisation" est noyée vers la seule sidérurgie privée, moins combative. Il faudra néanmoins trois mois pour parvenir à démobiliser les ouvriers... les trois mois de stocks à écouler prévus par la bourgeoisie.
Dans ces grèves, la classe ouvrière fait l'expérience à la fois de sa force, mais aussi des impasses du corporatisme et de la spécialisation de ses revendications par secteur ou par usine, de la stérilité de "l'organisation" syndicale. Le mouvement en Pologne, par son caractère massif, par sa rapidité, son extension au-delà des catégories et des régions, confirme non seulement la nécessité mais la possibilité d'une généralisation et d'une auto-organisation de la lutte allant au-delà des expériences précédentes de la classe ouvrière, apportant une réponse à celles-ci.
Les syndicalistes de tous bords nous disent : "Sans syndicats, il n'y a pas de lutte possible, sans syndicats, la classe ouvrière est atomisée". Voilà que les ouvriers en Pologne apportent un démenti retentissant à ce mensonge. Les ouvriers en Pologne n'ont jamais été aussi forts, parce qu'ils possédaient leurs propres organisations nées de la lutte, avec des délégués élus et révocables à tout instant .C'est seulement lorsqu'ils se sont tournés vers les chimères des syndicats libres qu'ils ont été amenés à se remettre dans le carcan de l'ordre capitaliste en reconnaissant le rôle suprême de l'Etat, du parti communiste dans l'Etat et le Pacte de Varsovie (Protocol de Gdansk). Les évènements de Pologne nous montrent le potentiel contenu dans toutes les luttes actuelles et qui jaillirait s'il n’y avait pas des amortisseurs sociaux, les syndicats et les partis de la "démocratie" bourgeoise pour le contenir et le désamorcer.
LES EVENEMENTS
- "La grève de masse est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants... Tantôt, elle se divise en un réseau infini de minces ruisseaux, tantôt, elle jaillit du sol comme une source vive, tantôt, elle se perd dans la terre".
R. Luxemburg. (Grève de masse, Parti et syndicats)
La faiblesse économique du capitalisme à l'Est oblige celui-ci à mener une politique d'austérité brutale contre la classe ouvrière. N'ayant pas la capacité d'échelonner les effets de la crise mondiale en s'attaquant à la classe ouvrière graduellement, jour après jour, paquet par paquet, industrie par industrie comme l'a fait jusqu'à présent la bourgeoisie à l'Ouest, la bourgeoisie de l'Est, ne pouvant tricher à l'infini avec la loi de la valeur, a soulevé contre elle, par sa politique dirigiste, le mécontentement accumulé des ouvriers. La rigidité du capitalisme d'Etat à l'Est pousse l'Etat à fixer les prix alimentaires; en les augmentant brutalement, faisant baisser d'un seul coup le niveau de vie de la classe ouvrière, l'Etat polonais a suscité contre lui (et ce malgré les différences de salaire pratiquées par le régime selon les secteurs professionnels) une réponse ouvrière homogène. Cette unité de la bourgeoisie derrière son Etat à l'Est est aussi une réalité économique et politique à l'Ouest qui est masquée par une myriade de patrons privés dans des secteurs apparemment séparés. En fait, tout ce que la rigidité du système stalinien rend plus évident et plus facile à comprendre le sera aussi à l'Ouest à la suite des dures expériences de la classe ouvrière. Les évènements de Pologne participent de cette expérience. Le vrai visage de la décadence du système capitaliste sera partout dénué de son masque "démocratique" et libéral".
Le 1er juillet 1980, à la suite de fortes augmentations sur le prix de la viande, des grèves éclatent à Ursus (banlieue de Varsovie) dans l'usine de tracteurs qui s'est trouvée au cœur de la confrontation avec le pouvoir en juin 1976, ainsi qu'à Tczew dans la région de Gdansk. A Ursus, les ouvriers s'organisent en assemblées générales, rédigent un cahier de revendications, élisent un comité de grève. Ils résistent aux menaces de licenciements et de répression et vont débrayer à de nombreuses reprises pour soutenir le mouvement.
Entre le 3 et le 10 juillet, l'agitation se poursuit à Varsovie (usines de matériel électrique, imprimerie), à l'usine d'aviation de Swidnick, à l'usine d'automobiles de Zeran, à Lodz, à Gdansk. Un peu partout, les ouvriers forment des comités de grève. Leurs revendications portent sur des augmentations de salaires et l'annulation de la hausse des prix. Le gouvernement promet des augmentations: 10 % d'augmentation en moyenne (souvent : 20 %) accordées généralement plus aux grévistes qu'aux non-grévistes afin de calmer ( !) le mouvement.
A la mi-juillet, la grève gagne Lublin. Les cheminots, les transports puis l'ensemble des industries de cette ville arrêtent le travail. Leurs revendications : élections libres aux syndicats, sécurité garantie aux grévistes, maintien de la police hors des usines, et des augmentations de salaires.
Le travail reprend dans certaines régions mais des grèves éclatent ailleurs. Krasnik, l'aciérie Skolawa Wola, la ville de Chelm (près de la frontière russe), Wroclaw sont touchées durant le mois de juillet par la grève; le département K1 du chantier naval de Gdansk à débrayé, également le complexe sidérurgique de Huta-Varsovie. Partout les autorités cèdent en accordant des augmentations de salaires. Selon le "Financial Times", le gouvernement a établi au cours du mois de juillet un fond de quatre milliards de zlotys pour payer ces augmentations. Des agences officielles sont priées de rendre disponible immédiatement de la "bonne" viande pour les usines qui débrayent. Vers la fin juillet, le mouvement semble refluer; le gouvernement pense avoir stoppé le mouvement en négociant au coup par coup, usine par usine. Il se trompe.
L'explosion ne fait que couver comme le montre début août la grève des éboueurs de Varsovie (qui a duré une semaine). Le 14 août, le renvoi d'une militante des Syndicats libres provoque l'explosion d'une grève au chantier Lénine à Gdansk. L'assemblée générale dresse une liste de 11 revendications; les propositions sont écoutées, discutées, votées. L'assemblée décide l'élection d'un comité de grève mandaté sur les revendications : y figurent la réintégration des militants, l'augmentation des allocations sociales, l'augmentation des salaires de 2000 zlotys (salaire moyen : 3000 à 4500 zlotys), la dissolution des syndicats officiels, la suppression des privilèges de la police et des bureaucrates, la construction d'un monument en l'honneur des ouvriers tués par la milice en 1970, la publication immédiate des informations exactes sur la grève ! La direction cède sur la réintégration de Anna Walentynowisz et de Lech Walesa, ainsi que sur la proposition de faire construire un monument. Le comité de grève rend compte de son mandat devant les ouvriers l'après-midi et les informe sur les réponses de la direction. L'assemblée décide la formation d'une milice ouvrière; l'alcool est saisi. Une seconde négociation avec la direction reprend. Les ouvriers installent un système de sonorisation pour que toutes les discussions puissent être entendues. Mais bientôt on installe un système qui permet aux ouvriers réunis en assemblée de se faire entendre dans la salle des négociations. Des ouvriers saisissent le micro pour préciser leurs volontés. Pendant la plus grande partie de la grève, et ce jusqu'au dernier jour avant la signature du compromis, des milliers d'ouvriers interviennent du dehors pour exhorter, approuver ou renier les discussions du comité de grève. Tous les ouvriers licenciés du chantier naval depuis 1970 peuvent revenir à leurs postes. La direction cède sur les augmentations de salaire et garantit la sécurité aux grévistes.
Le 15 août, la grève générale paralyse la région de Gdansk. Les chantiers navals "La commune de Paris" à Gdynia débrayent. Les ouvriers occupent les lieux et obtiennent 2100 zlotys d'augmentation immédiatement. Ils refusent cependant de reprendre le travail car "Gdansk doit gagner aussi". Le mouvement à Gdansk a eu un moment de flottement : des délégués d'atelier hésitent à aller plus loin et veulent accepter les propositions de la direction des ouvriers venus d'autres usines de Gdansk et de Gdynia les convainquent de maintenir la solidarité. On demande l'élection de nouveaux délégués plus à même d'exprimer le sentiment général. Les ouvriers venus de partout forment à Gdansk un comité inter-entreprises dans la nuit du 15 août et élaborent un cahier de revendications (21).
Le comité de grève compte 400 membres, 2 représentants par usine; ce nombre atteindra 800 à 1000 quelques jours plus tard. Des délégations font le va et vient entre leurs entreprises et le comité de grève central, utilisant parfois des cassettes pour rendre compte de la-discussion. Les comités de grève dans chaque usine se chargent de revendications spécifiques, l'ensemble se coordonne. Le comité d'usine des chantiers Lénine comporte 12 ouvriers, un par atelier, élus à main levée après débat. Deux sont envoyés au comité de grève central inter-entreprise et rendent compte de tout ce qui se passe 2 fois par jour.
Le 16 août, toutes les communications téléphoniques avec Gdansk sont coupées par le gouvernement. Le comité de grève nomme un Présidium où prédominent des partisans des syndicats libres et des oppositionnels. Les 21 revendications diffusées le 16 août commencent avec un appel pour la reconnaissance des syndicats libres et indépendants et du droit de grève. Et ce qui était le point 2 des 21 revendications est passé à la 7ème place : 2000 zlotys pour tous.
Le 18 août dans la région de Gdansk-Gdynia-Sopot, 75 entreprises sont palysées.I1 y a environ 100.000 grévistes; on signale des mouvements à Szczecin et à Tarnow à 80 km au sud de Cracovie. Le comité de grève organise le ravitaillement : des entreprises d'électricité et d'alimentation travaillent à la demande du comité de grève. Les négociations piétinent, le gouvernement se refuse à parler avec le comité inter-entreprise. Les jours suivants, viennent des nouvelles de grèves à Elblag, à Tczew, à Kołobrzeg et dans d'autres villes. On estime que 300.000 ouvriers sont en grève le 20 août. Le bulletin du comité de grève du chantier Lénine "Solidarité" est quotidien; des ouvriers de l'imprimerie aident à publier des tracts et les publications.
Le 26 août, les ouvriers réagissent avec prudence aux promesses du gouvernement, restent indifférents aux discours de Gierek. Ils refusent de négocier tant que les lignes téléphoniques sont coupées à Gdansk.
Le 27 août, des laissez-passer" pour Gdansk venant du gouvernement à Varsovie sont donnés aux dissidents pour se rendre auprès des grévistes en tant "qu'experts", pour calmer ce monde à l'envers. Le gouvernement accepte de négocier avec le Présidium du comité de grève central et reconnaît le droit de grève. Des négociations parallèles ont lieu à Szczecin à la frontière de la RDA. Le cardinal Wyszynski lance un appel à l'arrêt de la grève; des extraits passent à la télévision. Les grévistes envoient des délégations à l'intérieur du pays pour chercher la solidarité.
Le 28 août, les grèves s'étendent, elles touchent les usines de cuivre et de charbon en Silésie dont les ouvriers ont le niveau de vie le plus élevé du pays. Les mineurs, avant même de discuter de la grève et d'établir des revendications précises déclarent qu'ils quitteront le travail immédiatement "si on touche à Gdansk". Ils se mettent en grève "pour les revendications de Gdansk". Trente usines sont en grève à Wroclaw, à Poznań (les usines qui ont commencé le mouvement en 1956), aux aciéries de Nowa-Huta et à Rzeszois, la grève se développe. Des comités interentreprises se forment par région. Ursus envoie des délégués à Gdansk. Au moment de l'apogée de la généralisation, Walesa déclare : "Nous ne voulons pas que les grèves s'étendent parce qu'elles pousseraient le pays au bord de l'effondrement. Nous avons besoin du calme pour conduire les négociations". Les négociations entre le Présidium et le gouvernement deviennent privées; la sonorisation est de plus en plus "en panne" aux chantiers. Le 29 août, les discussions techniques entre le gouvernement et le Présidium aboutissent à un compromis : les ouvriers auront des syndicats libres à condition qu'ils acceptent :
- 1) le rôle suprême du parti dirigeant ;
2) la nécessité de soutenir l'appartenance de l'Etat polonais au bloc de l'Est ;
3) que les syndicats libres ne jouent pas un rôle politique.
L'accord est signé le 31 août à Szczecin et à Gdansk. Le gouvernement reconnaît de syndicats "autogérés" comme dit son porte- parole : "la nation et l'Etat ont besoin d'une classe ouvrière bien organisée et consciente". Deux jours après, les 15 membres du Présidium donnent leurs démissions aux entreprises où ils travaillent et deviennent des permanents des nouveaux syndicats. Ensuite, ils seront obligés de nuancer leurs positions, des salaires de 8000 zlotys ayant été annoncés pour eux; cette information a été démentie par la suite face au mécontentement des ouvriers.
Il avait fallu plusieurs jours pour que ces accords puissent être signés. Des déclarations d'ouvriers de Gdansk les montrent moroses, méfiants, déçus. Certains, en apprenant que l'accord ne leur apporte que la moitié des augmentations déjà obtenues le 16 août crient : "Walesa, tu nous a vendus". Beaucoup d'ouvriers ne sont pas d'accord avec le point reconnaissant le rôle du parti et de l'Etat.
La grève des mines de charbon de la Haute Silésie et des mines de cuivre durent jusqu'au 3 septembre pour que les accords de Gdansk s'étendent à tout le pays. Pendant le mois de septembre, les grèves continuent : à Kielce, à Bialystok parmi les ouvrières de la filature de coton, dans le textile, dans les mines de sel en Silésie, dans les transports à Katowice. Un mouvement de la taille de l'été 80 ne s'arrête pas d'un seul coup. Les ouvriers essaient de généraliser les acquis qu'ils croient discerner, de résister à la retombée de la lutte. On sait que Kania va visiter les chantiers de Gdynia avant même ceux de Gdansk parce que les ouvriers de ces chantiers semblent avoir été les plus radicaux. Mais de leurs discussions, comme de celles dans des centaines d'autres endroits, on n'a que le silence de la presse qui s'est focalisée uniquement sur Gdansk. Il faut attendre avant de pouvoir mesurer toute la richesse réelle qui va bien au-delà de ces quelques points de chronologie assez succincts.
Dans cette marche difficile et douloureuse vers l'émancipation de la classe ouvrière, s'inscrivent la grève de masse en Pologne, la créativité de millions de travailleurs, la réflexion et la conscience devenues concrètes, la solidarité. Pour nous tous, ces ouvriers ont pu, du moins pendant un grand moment, respirer l'air de l'émancipation, vivre la solidarité, sentir le souffle de l'histoire. Cette classe ouvrière si méprisée et humiliée a montré la voie à tous ceux qui espèrent confusément briser la prison du monde bourgeois en les ralliant à ce qui seul vit dans cette société moribonde : la force des ouvriers conscients. A ceux qui croient corriger l'erreur de Lénine e "Que faire ?" suivant laquelle la conscience lente du dehors de la classe, en disant, comme le PCI -bordiguiste- que la classe n'existe pas sans le parti, les ouvriers en Pologne donnent un nouveau démenti.
En Pologne, comme partout ailleurs, et plus encore qu'ailleurs, la classe ouvrière doit bouillonner de discussions; en son sein doivent se cristalliser des cercles politiques qui donneront naissance aux organisations des révolutionnaires. Au fur et à mesure qu'elle se développe, la lutte pose à la classe avec de plus en plus d'acuité les questions essentielles de son combat historique et pour la réponse desquelles elle• engendre ses organisations politiques. La grève des ouvriers en Pologne illustre une fois de plus que celles-ci ne sont pas une condition des luttes mais qu'elles ne se développent vraiment que comme expression de la classe qui existe et agit avant elles si besoin.
Comment s'organiser ? Comment lutter ? Quelles revendications mettre en avant ? Quelle négociation faut-il mener ? A toutes ces questions qui se posent dans toutes les luttes ouvrières, l'expérience et le courage des ouvriers en Pologne sont d'une énorme richesse pour tout le mouvement de la classe.
LES FAIBLESSES
- "La tradition des générations mortes pèse: d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d'ordre, leurs costumes..."
K. Marx. (Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Chap.1, P.14. Ed. Sociales)
Dans les premières grèves de masse en 1905, les ouvriers avaient du mal à trouver leur terrain propre. C'est derrière le Père Gapone et les icônes de l'église "conservatrice des opprimés" et non à l'appel des sociaux-démocrates que les ouvriers sont descendus dans la rue. Mais en 6 mois, les icônes se sont transformées en drapeaux rouges. On ne connait pas le rythme du mûrissement des conditions de la lutte aujourd'hui, mais on sait que le processus est entamé. Lorsque les ouvriers de Silésie se prosternent devant Sainte-Barbe, quand ceux de Gdansk revendiquent le droit à la messe, ils subissent d'une part le poids des traditions antérieures et d'autre part, ils expriment un relent de résistance à la désolation de la vie moderne, une nostalgie déplacée parce qu'ils "reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts" (K. Marx, "Le 18 Brumaire. Ch.1). Mais cette enveloppe erronée de leurs aspirations, l'église, n'est pas une enveloppe neutre. Elle est un support formidable du nationalisme comme on a pu voir au Brésil aussi bien qu'en Pologne. L'église s'est déjà dévoilée devant les ouvriers les plus combatifs en utilisant sa première prise de parole publique depuis 30 ans pour appeler "à l'ordre" et au "retour au travail". Néanmoins ce piège reste à détruire.
Certains, à la courte vue, ne verront dans la Pologne que des ouvriers à genoux, ou chantant l'hymne national. Mais l'histoire ne se juge pas avec une photographie. Les sceptiques ne voient pas la dynamique du mouvement qui va aller plus loin. Les ouvriers se débarrasseront des chiffons nationaux et des icônes. Il ne faut pas recommencer comme le PCI (Programme) ou Battaglia Communista ou d'autres qui ne voyaient en mai 68 qu'un jeu d'étudiants. Si les révolutionnaires sont incapables de dire la réalité sans que celle-ci soit écrite en toutes lettres et en pleine lumière, alors ils ne seront jamais à la hauteur de l’œuvre de Marx qui, dans le tout jeune prolétariat de 1844 voyait déjà le géant de l'histoire.
Il est indiscutable qu'en Pologne, l'action des dissidents a eu depuis 1976 une influence dans le mouvement ouvrier, surtout dans la Baltique. Il est difficile d'évaluer exactement son poids, mais il semblerait que le journal "Robotnik" soit diffusé à 20.000 exemplaires, créant tout un milieu ouvrier autour de lui; souvent des, ouvriers combatifs sont happés dans le mouvement des syndicats libres pour protester contre la répression sur les lieux de travail. L'opposition catholique comme les réformateurs et les intellectuels patriotes sont tolérés par le régime depuis que celui-ci se rend compte de la nécessité de désamorcer les poussées ouvrières de ces dernières années. Mais le KOR (Comité d'autodéfense sociale) est clair sur ses buts : "L'économie du pays est en décomposition. Seul un immense effort de tous accompagné d'une profonde réforme peut la sauver. L'assainissement social de mandera des sacrifices. S'élever contre la hausse des prix porterait un coup au fonctionnement de l'économie... Notre tâche comme opposition consiste d transformer les revendications économiques en revendications politiques" (Kuron).
Bien sûr, la dimension politique est absolument indispensable aux luttes ouvrières. Les grèves de masse traduisent dans les faits cette unité des aspects économiques et politiques de la lutte. Le KOR joue sur l'aspiration des ouvriers à politiser les combats, mais en parlant de la "politique", les Kuron et Cie et tous les "experts" venus aider les négociations à Gdansk ne font que vider la lutte de son contenu de classe pour se poser en opposition loyale dans la patrie polonaise. Peur sauver l'économie de la patrie, les ouvriers de Gdansk ont perdu plus de la moitié de leurs revendications économiques. C'est ainsi que l'opposition représente une aile de la bourgeoisie polonaise qui veut créer des structures plus adéquates pour "avoir l'assentiment des travailleurs aux sacrifices; pour faire apparaître des interlocuteurs valables". Mais la bourgeoisie polonaise ainsi que la Russie sont dans leur ensemble loin d'accepter entièrement cette thèse et l'évolution de la situation reste ouverte, surtout si les nouveaux syndicats ne s'intègrent pas rapidement à l'appareil.
Cinquante ans de contre-révolution ont tellement désorienté la classe ouvrière qu'eue n'arrive pas à rester entièrement sur un terrain de classe. En Pologne, la classe ouvrière a ouvert une brèche formidable dans la structure stalinienne mais elle endosse des "vêtements" du passé avec la revendication des syndicats libres, des vrais et durs comme ceux du 19ème siècle. Dans l'esprit des ouvriers, ces syndicats doivent représenter le droit de s'auto-organiser, de se défendre_ Mais ces "vêtements" sont pourris, ils sont un piège et se retourneront contre la classe ouvrière.
Pour obtenir le droit de s'organiser dans des syndicats libres, il a fallu que les 21 revendications de Gdansk reconnaissent l'Etat polonais, la domination du Parti et le Pacte de Varsovie. Et ce n'est pas pour rien !
A notre époque du déclin du capitalisme, les syndicats font partie intégrante des rouages de l'Etat, qu'ils surgissent, aujourd'hui comme des mort-nés en Pologne, ou qu'ils jouissent d'une "tradition" du passé. Déjà toutes les forces de la bourgeoisie se regroupent autour des syndicats libres : certains membres du comité de grève deviennent des permanents; avec les "règles" de fonctionnement, c'est un nouveau carcan qui se met en place; les accords de Gdansk parlent de l'engagement d'accroitre la productivité. En offrant l'aide de l'AFL-CIO[1], la bourgeoisie internationale apporte sa pierre à l'effort de ligoter ce géant prolétarien.
La situation en Pologne n'est pas encore revenue au calme et l'ébullition de la classe ouvrière ralentit considérablement la mise en place de ces rouages. Mais les illusions se paieront cher.
Les syndicats libres ne sont pas un tremplin pour aller plus loin mais un obstacle que la combativité ouvrière doit dépasser. C'est un guet-apens. Les ouvriers les plus combatifs l'ont déjà senti quand ils ont hué les accords à Gdansk. Mais, ce n'est pas encore eux que le mouvement met en avant, ce sont plutôt les moins clairs, les plus catholiques, les plus confus. Walesa est une expression et le symbole de ce stade, et il sera obligé de se plier ou il sera éliminer.
Au 20ème siècle, seule la vigilance, la mobilisation ouvrière peuvent faire avancer les intérêts de la classe ouvrière. C'est une vérité amère et difficile que de réaliser que tout organe permanent sera inévitablement happé dans l'engrenage de l'Etat, à l'Est comme à l'Ouest (comme les comités ouvriers en Italie en 1969, par exemple, intégrés dans la constitution syndicale maintenant; comme toutes les tentatives du "syndicalisme de base").
Au 20ème siècle, il n'y a que stabilité capitaliste ou pouvoir prolétarien. C'est seulement dans une période de lutte prérévolutionnaire que peuvent se constituer des organes permanents du pouvoir prolétarien, les conseils ouvriers, parce qu'ils défendent les intérêts immédiats de la classe ouvrière en intégrant ces derniers dans la question du pouvoir. En dehors de la formation de conseils, il ne peut exister d'organisation permanente des luttes.
Aujourd'hui, le pourrissement du système capitaliste est plus avancé, la classe ouvrière bénéficie de toutes ses expériences de lutte et du mûrissement des conditions de la révolte. Contrairement à 1905, elle n'a pas en face d'elle le régime pourri et sénile du tsarisme; elle affronte le capitalisme d'Etat partout dans le monde, un ennemi plus subtil et plus sanguinaire.
La bourgeoisie va essayer de tirer les leçons des avènements de Pologne à sa façon, elle ne peut pas laisser la réalité parler par elle-même. L'idéologie bourgeoise doit tenter de récupérer les mouvements de classe en donnant une "explication officielle", une version déformée destinée à détourner l'attention des autres ouvriers. Elle utilise et utilisera les évènements de Pologne jusqu'à la corde : à l'Est, pour montrer qu'il faut se plier "raisonnablement" aux exigences de l'austérité dans le COMECON; à l'Ouest pour prouver que le mouvement ouvrier ne veut que des "libertés démocratiques" qui, en occident, font tout le bonheur des ouvriers !
Les évènements de Pologne ne sont pas la révolution ni une révolution manquée; sa dynamique propre tout en établissant un rapport de forces favorable au prolétariat n'est pas allé jusqu'au stade insurrectionnel, ce qui d'ailleurs serait prématuré dans la situation actuelle du prolétariat mondial. Toute une période de maturation de l'internationalisation des luttes est nécessaire au prolétariat avant que la révolution soit immédiatement à l'ordre du jour.
Mais c'est aux révolutionnaires de dénoncer les cauchemars du passé, les guet-apens qui risquent d'immobiliser la lutte. Tandis qu'on voit tous les agents du capital, les PC, les trotskistes, la gauche et gauchistes, les "droits de l'homme" applaudir les obstacles à la conscience, c'est aux révolutionnaires de les dénoncer avec la dernière énergie et de montrer le chemin du dépassement.
Les luttes en Pologne 1980 sont une ébauche pour l'avenir, elles en contiennent toutes les promesses. Contre tous les sceptiques pour qui mai 68 n’était rien, pour qui toute lutte est sans lendemain; pour les dénigreurs professionnels même au sein du milieu révolutionnaire, le souffle de la Pologne va peut-être les réveiller. L'histoire va vers des affrontements de classes, la contre-révolution est finie et ce n'est qu'avec le courage et l'espoir des ouvriers en Pologne qu'on lutte efficacement.
C'est en comprenant et tirant tous les enseignements de cette lutte historique: le capitalisme d'Etat et la crise économique mondiale à l'Est comme à l'Ouest; l'ignominie "démocratique" et la mascarade électoraliste; l'intégration des syndicats à l'Etat; la créativité et l'auto-organisation de la classe dans l'extension de sa lutte, que les combattants de la classe ouvrière pourront dire quand ils iront plus loin demain : Nous sommes tous des ouvriers de Gdansk.
J.A., le 22 septembre 1980
[1] La principale centrale syndicale américaine.
Géographique:
- Pologne [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
La crise capitaliste dans les pays de l'est
- 2843 reads
LE TEXTE QUE NOUS PUBLIONS ICI EST LE RAPPORT PRESENTE AU IVEME CONGRES DE REVOLUTION INTERNATIONALE : CE RAPPORT SE FIXAIT POUR TACHE, NON PAS TANT DE FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA CRISE ECONOMIQUE DANS LE BLOC DE L'EST, MAIS DE CONTRIBUER A APPROFONDIR LA QUESTION SUIVANTE : COMMENT LA CRISE DANS LE BLOC DE L'EST EST LA MEME CRISE CAPITALISTE QUI TOUCHE TOUS LES PAYS DU MONDE ; EN QUOI ET POUR QUELLES RAISONS LES MANIFESTATIONS DE CETTE CRISE DIFFERENT DES FORMES QU'ELLE PREND DANS LES PAYS DEVELOPPES DU BLOC OCCIDENTAL ?
LA DEUXIEME PARTIE DU RAPPORT ABORDE L'ANGLE HISTORIQUE DE CETTE QUESTION, EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT L'U.R.S.S. ; ELLE S'ATTACHE A MONTRER,A PARTIR DES CONDITIONS MEMES DE L'APPARITION TARDIVE DU CAPITAL RUSSE SUR L'ARENE MONDIALE ET AU TRAVERS DES MOYENS PAR LESQUELS IL A ASSURE SA PUISSANCE IMPERIALISTE DANS LE CADRE DE LA DECADENCE CAPITALISTE, EN QUOI LES MANIFESTATIONS DE LA CRISE EN U.R.S.S. SONT LA TRADUCTION LA PLUS CARICATURALE DES CONTRADICTIONS DU CAPITALISME.
C'EST DANS CE SENS QUE, DANS UNE PREMIERE PARTIE DU RAPPORT, EST ABORDEE LA QUESTION DE LA PENURIE DE CAPITAL, EN TANT QU'ILLUSTRATION PARTICULIERE, QUE MANIFESTATION, DANS CERTAINS PAYS A LA FOIS LES PLUS-FAIBLES ET LES PLUS MILITARISES DU GLOBE -EN PARTICULIER LES PAYS DU BLOC RUSSE-, DE LA CRISE GENERALE DE SURPRODUCTION DU CAPITALISME MONDIAL.
EN PUBLIANT CE RAPPORT, NOUS PRESENTONS A NOS LECTEURS L'ETAT ACTUEL DU DEBAT AU SEIN DE NOTRE ORGANISATION AUTOUR DES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DECADENCE CAPITALISTE A L'EST ET DE SES MANIFESTATIONS DANS LA CRISE OUVERTE.
Surproduction et pénurie de capital
"Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :
1- que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs (pas acheteurs) d'une très grande portion de leur produit : les moyens et la matière de travail;
2- que la majeure partie des producteurs, les ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent pour leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent -qu'ils produisent de la plus-value ou du surproduit. Il leur faut constamment être des SURPRODUCTEURS, produire au delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs, à l'intérieur des limites de leurs besoins."
(Marx : Théories sur la plus-value-XVIIème chapitre - Editions Sociales p.619)
Confronté à cette contradiction, inhérente au fonctionnement de l'exploitation capitaliste, le capital ne peut trouver son salut que dans la vente aux secteurs extra-capitalistes, afin de réaliser
la plus-value contenue dans ses marchandises et de perpétuer son accumulation et poursuivre ainsi son développement sur une base élargie.
Dés les origines du capitalisme industriel, les cries sont des crises de surproduction localisées à l'échelle des marchés existants, qui ne trouvent leur solution que dans un élargissement du marché par la pénétration de nouveaux marchés précapitalistes (comptoirs, colonisation).
Mais le développement du marché, c'est à dire l'écoulement du surproduit capitaliste, a une limite absolue : la limitation du marché mondial. A la fin du 19ème siècle, quand les impérialismes dominants finissent de se partager la planète, les marchés précapitalistes qui subsistent encore sont contrôlés et protégés par un impérialisme ou un autre. Il n'est plus possible de découvrir de nouveaux marchés qui pourraient permettre d'écouler le surproduit et de pallier ainsi à la crise. Le capitalisme rentre en crise permanente de surproduction. Par le jeu de la concurrence, cette surproduction tend à se généraliser à toutes les marchandises, mais aussi partout où dominent les rapports capitalistes de production, c'est à dire partout dans le monde une fois que le marché mondial est créé.
Le capitalisme est entré dans sa phase de décadence.
LA PENURIE DE CAPITAL : CONSEQUENCE DE LA SURPRODUCTION GENERALISEEI
Les premières fractions de la bourgeoisie qui sont parvenues tôt à faire leur révolution nationale, à créer un cadre national propice à développer l'accumulation (Angleterre, France, Etats-Unis d'Amérique, etc...) se sont emparés de l'essentiel du marché mondial et ont pu, grâce à ces marchés en extension permanente dans la période ascendante, réaliser une accumulation de capital leur permettant de développer leur industrialisation, d'élever le taux de composition organique de leur capital, afin d'obtenir une productivité toujours plus forte.
Lorsque le marché mondial est créé, il se pose comme saturé, il y a surproduction mondiale de capital, la concurrence entre les différents capitaux va se faire de plus en plus acharnée. Ceux qui sont arrivés trop tard, qui n'ont pu sauvegarder leur indépendance nationale, qui ne disposent pas de marché extérieur, qui n'ont donc pu accumuler suffisamment de capital dans la période ascendante, dans la période de décadence du capitalisme sont condamnés, non seulement à ne jamais rattraper le retard pris, mais de plus à voir ce retard s'accroître. En effet, au moment où la concurrence se fait exacerbée, où la course à la productivité de-' vient effrénée, ils ne possèdent pas suffisamment de capital pour pouvoir concurrencer efficacement les grandes puissances capitalistes bien mieux loties qu'eux. Ils sont confrontés à une situation de pénurie de capital, condamnés au "sous-développement". Ils ne peuvent survivre qu'en se mettant sous la protection d'un capitalisme plus puissant, qui va les utiliser uniquement comme réservoir de matière première industrielle ou agricole ou comme réservoir de main-d’œuvre, sans permettre un réel développement des forces productives qui feraient d'eux des concurrents supplémentaires sur le marché mondial déjà encombré.
Cette situation de pénurie de capital dans laquelle se trouvent ces pays est relative par rapport aux capitaux les plus développés, elle est une des manifestations du fait que l'écart entre les pays "riches" et les pays "pauvres" ne cesse de s'accroître.
Du point de vue économique, dans la période de décadence, avec la concurrence qui se fait de plus en plus forte, c'est le pôle d'accumulation le plus puissant qui tend à réduire les autres au "sous-développement", à la pénurie de capital; le capital national le plus puissant tend à aspirer vers lui le capital, parce qu'il tend à être le plus productif, le plus capable d'innover. (Par exemple, aujourd’hui, les pays producteurs de pétrole préfèrent investir dans les grandes métropoles impérialistes plutôt que de développer leur propre production nationale).
La situation de saturation du marché mondial tend à condamner à péricliter ceux qui ne peuvent mettre en place des investissements suffisants pour se maintenir au niveau de compétitivité nécessitée par le marché. Si, au 19ème siècle, la Grande-Bretagne représentait l'avenir du développement capitaliste, aujourd'hui c'est exactement l'inverse, c'est la situation dans les pays sous-développés qui indique l'avenir du capital. Ainsi les pays européens et le Japon ont perdu leur autonomie nationale pour se retrouver de plus en plus dépendants des USA dans le cadre du bloc occidental; confrontés avec les destructions de la seconde guerre mondiale, ils ont du faire appel aux capitaux américains pour reconstruire.
Du point de vue économique, le développement du capital tend à une inégalité croissante entre le pôle d'accumulation le plus puissant et l'ensemble de la planète, qui se retrouve dans une misère croissante où la majorité de la population subit une paupérisation absolue, une misère totale. Dans la crise, à un pôle on ne sait où investir car les marchés sont bouchés et on n'arrive pas à rentabiliser les investissements, à l'autre, de toutes façons, on n'a pas de capital à investir.
ACCUMULATION ET DESTRUCTION DE CAPITAL
Nous l'avons vu, par définition "les ouvriers ne consomment jamais l'équivalent de leur production .., ils doivent toujours être surproducteurs. Mais pour le capitaliste, il faut réaliser ce surproduit sur le marché pour poursuivre le cycle de son accumulation. Avec la décadence du capitalisme, les marchés extra-capitalistes ont été réduits à leur plus simple expression, c'est à dire quasiment au néant, soit par la prolétarisation, soit par la paupérisation. La plus-value ne peut se réaliser que dans l'échange avec d'autres sphères capitalistes, c'est-à-dire aux dépens d'autres capitalistes. Les plus avantagés, sont donc les capitalistes les plus puissants qui peuvent vendre à un moindre coût, car ils sont les plus productifs. La concurrence devient intense.
Cette situation devient une entrave au processus de l'accumulation; la nécessité pour chaque capital de maintenir le processus de l'accumulation va pousser le capital global vers des contradictions de plus en plus grandes qui culminent dans la cri- se et se traduit dans les faits par une destruction de capital, une désaccumulation :
- Par la concurrence qui, dans la crise, culmine dans une dévalorisation massive des marchandises mises sur le marché. En effet, le capitaliste qui a produit un produit trop cher est obligé de vendre à perte pour réaliser, malgré tout, une partie de son investissement initial.
L'incapacité d'investir dans un marché déjà sursaturé pousse vers des spéculations massives dans lesquelles le capital se trouve stérilisé, tandis que, d'autre part, la tentation de créer des marchés artificiels pousse vers une inflation galopante qui traduit une dévalorisation constante du capital.
- Par la production militaire. En effet, la seule solution pour protéger ses marchés ou s'en ouvrir d'autres, c'est le recours à l'armée, à la force militaire. Dans la décadence, l'économie est soumise aux nécessités militaires. L'économie de guerre s'impose car la guerre devient le mode de survie du capital. La concurrence se trouve déplacée du terrain économique au terrain de la capacité guerrière. Mais au niveau du capital global, la production d'armes est une destruction du capital car, contrairement aux biens de production ou aux biens de consommation, elle ne permet pas de reproduire le capital.
- Par le recours au système étatique tentaculaire et improductif. En effet, le capital soumis à des contradictions de plus en plus violentes ne peut maintenir l'unité de son processus productif qu'au travers des palliatifs administratifs totalement improductifs qui consomment du capital sans le reproduire.
D'autre part, les contradictions sociales de plus en plus explosives imposent le fonctionnement d'un secteur répressif de plus en plus important et totalement parasitaire (police, justice, syndicats, etc..).
Ainsi, dans la période de décadence du capitalisme, si quelques capitaux nationaux parviennent à poursuivre avec de plus en plus de difficultés leur accumulation, c'est aux dépens du capital global qui subit de plus en plus une destruction de capital qui culmine dans la crise et dans la guerre impérialiste.
Cette situation se traduit par un fonctionnement de plus en plus totalitaire du capital, dont le corollaire est une misère toujours plus grande de l'humanité, un gaspillage toujours plus important des forces productives.
C'est en détruisant le rapport capital-travail à l'origine de toutes les misères, de toutes les inégalités, que le prolétariat pourra mettre fin au règne de la barbarie et libérer ainsi les forces productives qui portent en elles la promesse de l'abondance communiste, la fin de la pénurie capitaliste.
LE CAPITALISME DECADENT EN U.R.S.S.
A la fin du 19ème siècle, l'empire russe est le bastion des forces féodales, frein objectif au développement progressiste du capital. Si la bourgeoisie russe est parvenue à mettre en place un appareil productif moderne, elle n'a, malgré tout, pas été assez forte pour imposer totalement son pouvoir politique et balayer les entraves féodales qui paralysaient son développement.
Dans ces conditions, le capital russe se développe trop tardivement et trop faiblement pour concurrencer ses rivaux européens, qui sont en train de se partager le monde. Il est trop tard, les places sont déjà prises et le principal atout du capitalisme russe, c'est le gigantesque marché intérieur hérité de l'empire féodal tsariste. Cependant, dès le début du 20 ème siècle, avec le rétrécissement des crises précapitalistes, la concurrence se faisant plus âpre, les capitalistes européens et japonais lorgnent avec rapacité cet empire féodal à l'état de friche pour le capital et commencent à le grignoter (guerre russo-japonaise en 1905).
Avec la création du marché mondial, une nouvelle époque s'ouvre, marquée par l'éclatement de la guerre de 1914-1918 et la révolution prolétarienne en 1917. La bourgeoisie russe est secouée par la guerre et balayée par la révolution.
L'année 1928 voit l'achèvement de la contre-révolution stalinienne, marquée par l'adoption du "socialisme en un seul pays" et la mise en place du premier plan de production. Mais, pour la bourgeoisie russe, il est de toutes façons trop tard, marquée par ses difficultés de jeunesse, elle a loupé le coche de la période ascendante du capital et n'a pas accumulé suffisamment de capital pour concurrencer les impérialismes rivaux sur le plan économique : elle est confrontée à la pénurie de capital qui entrave à jamais son développement capitaliste, elle est condamnée au sous-développement vis à vis des capitalismes dominants (U.S.A., Grande-Bretagne, Japon, etc...).
Cependant si l'U.R.S.S. aujourd'hui a pu s'imposer comme le capital dominant d'un bloc impérialiste qui fait face au bloc occidental, dans un monde partagé en deux par la rivalité USA - URSS, c'est parce que l'URSS possédait certains atouts pour survivre dans la période de décadence.
LES ATOUTS DE L'URSS DANS LA PERIODE DE DECADENOE
La bourgeoisie stalinienne hérite en fait d'acquis pour lesquels elle n'a pas contribué
1- Un important marché intérieur hérité de l'empire tsariste. Même si au lendemain de la première guerre mondiale, l'URSS se trouve amputée de la Pologne, des pays baltes, de la Finlande, de la Corée, de la Bessarabie, ce qui reste n'est pas négligeable et constitue un gigantesque marché extra-capitaliste composé de millions de paysans et d'artisans. L’U.R.S.S. reste le plus grand pays du monde par sa superficie, garante de ses richesses minières.
2- Une indépendance nationale maintenue par l'empire du Tzar, puis des frontières défendues par le prolétariat comme son bastion. Si bien que la contre-révolution stalinienne hérite d'un cadre national indépendant qui a été protégé de la rapacité" dés grands impérialisme.
3- Avant 1914, la Russie est, malgré tout, la cinquième puissance mondiale. Cependant, son importance tient plus à son immensité et au chiffre élevé de sa population, ainsi, en 1913, son revenu national n'est que de un cinquième de celui des Etats-Unis, et elle produit moins de charbon, de fer ou d'acier que la France. C'est le plus fort des pays sous-développés.
Cependant, ces atouts n'ont pu être mis à profit que parce que l'U.R.S.S. de Staline a utilisé le plus tôt les "recettes" les plus aptes à permettre la survie de son capital en période de décadence. Cela pour deux raisons essentielles : d'une part les spécificités de son histoire, d'autre part la faiblesse de son économie.
Ces "recettes" sont celles qui ont déjà été largement éprouvées par les puissances belligérantes de la première guerre mondiale, mais que celles-ci ont eu tendance à oublier avec les illusions de la reconstruction qui s'en est suivie. Elles sont constituées de deux volets indissociables : le capitalisme d'Etat et l'économie de guerre.
LE CAPITALISME D'ETAT
Déjà faible avant 1917, la bourgeoisie privée russe n'a plus de rôle économique important au lendemain de la révolution. Alors que la contre-révolution s'est imposée au travers de l'Etat, c'est tout naturellement celui-ci qui est amené à assumer la responsabilité du capital russe.
Déjà profondément marqué par l'Etat tsariste (expression de la faiblesse de la bourgeoisie privée russe, le capital industriel russe avec la contre-révolution se retrouve totalement entre les mains de l'Etat stalinien. Le capitalisme d'Etat à la russe est le produit direct de la contre-révolution. L'Etat est la seule structure à même de gérer les intérêts économiques et militaires de l'U.R.S.S. face aux impérialismes rivaux.
L'ECONOMIE DE GUERRE
A peine la bourgeoisie stalinienne parvient-elle à s'imposer définitivement (1928), que la crise qui commence en 1929 vient secouer le capitalisme mondial et vient balayer les illusions sur des possibilités d'échanges économiques entre l'URSS et Te reste du monde. Le capitalisme russe est trop faible pour défendre économiquement ses intérêts sur la scène mondiale.
Face aux tensions impérialistes de plus en plus fortes qui opposent les grandes puissances impérialistes à la recherche de nouveaux débouchés, face au péril militaire que constituent l'Allemagne et le Japon, l'URSS ne peut préserver son indépendance que par un recours massif à l'économie de guerre, qi devient sa seule garantie de survie en tant que capital, qu'impérialisme indépendant. Devant la faiblesse de son économie, c'est là sa seule issue pour se tailler une place sur le marché mondial : la guerre impérialiste.
Devant la faiblesse de son économie, c'est dans la guerre impérialiste que se trouve sa seule issue pour se tailler une place sur le marché mondial et, dès la fin des années 30, elle s'y prépare activement, subordonnant toute son activité économique à cet impératif.
Ces mesures, si elles permettent à l'URSS de se maintenir sur la scène mondiale, ne sont pas pour autant des solutions à la crise inhérente au capitalisme confronté à la saturation du marché mondial, elles ne font que répercuter la contradiction à un niveau plus élevé, plus explosif. Elles sont les stigmates du capitalisme décadent partout dans le monde. Cependant, dans le cas spécifique de la Russie, par leur précocité, par leur importance, par leur brutalité, elles vont permettre à l'URSS de s'imposer comme le second impérialisme du globe, aux dépens de ceux qui n'ont pas pu s'adapter aussi bien, ni aussi vite, aux conditions nouvelles qui s'ouvrent avec la première guerre mondiale.
LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME RUSSE DANS LA PERIODE DE DECADENCE
Durant les années 30, le capital russe n'échappe pas à la tourmente de la crise mondiale, il n'assure sa survie que par un protectionnisme total et un développement en quasi-autarcie. Comment ce développement est-il possible ? En effet, même selon les estimations les plus pessimistes, l'URSS triple sa production de 1929 à 1940.
Tout d'abord, on peut noter qu'à partir de pas grand-chose, il est plus facile de doubler ou de tripler sa production, mais surtout l'URSS va profiter de l'importance de son marché intérieur extra-capitaliste et de la quantité de main-d’œuvre disponible.
Cependant, étant donné la faiblesse du capitalisme russe, l'accumulation ne va pas se réaliser au travers d'un échange économique classique, mais au travers du pillage le plus brutal des secteurs extra-capitalistes et de l'exploitation féroce de la force de travail, le tout garanti par la terreur imposée par l'Etat. Des millions de paysans vont être déportés dans les camps de travail, fournissant ainsi à la fois par la spoliation brutale le capital nécessaire aux investissements industriels, et une main-d’œuvre quasi gratuite. Le prolétariat va être exploité de manière absolue, le stakhanovisme imposé par la terreur. De camp retranché, la Russie va se transformer en gigantesque camp de concentration.
Toute la production est orientée vers la production de biens de production (86% des investissements dans le Premier Plan), puis, à partir de 1937, vers la production en vue de la guerre. Le fameux "modèle' de développement à la russe est en fait un modèle de sous-développement (et c'est d'ailleurs pour cela que ce sont essentiellement les pays sous-développés qui vont l'adopter), il correspond à l'incapacité à réaliser dans l'échange la plus-value qui permettrait une accumulation de capital. Le capital russe, trop faible, est obligé de court-circuiter ce processus, ce n'est pas sa force économique qui garantit son développement, mais sa force policière.
Malgré ce développement dans les années 30, qui va trouver sa concrétisation dans l'économie de guerre, la Russie reste un pays économiquement faible et c'est plus le jeu des alliances et sa richesse en chair à canon qui vont lui permettre de tirer ses marrons du feu dans la seconde guerre mondiale.
En 1945, l'URSS sort de la guerre avec une économie ravagée (20 millions de morts, 31 850 usines détruites, etc.), mais avec des acquis non négligeables que sont la main mise sur les pays d'Europe de l'Est et plus tard sur la Chine (1949).
Mais, alors que l'impérialisme russe, à la tête du nouveau bloc ainsi formé est le plus puissant, il ne représente pas pour autant le capital le plus développé, la RDA, la Tchécoslovaquie, ou même la Pologne, sont plus compétitifs que lui. Là encore ce n'est pas par l'échange classique que l'URSS peut attirer à elle les capitaux nécessaires à sa reconstruction, mais par le pillage encore une fois (démontage d'usines, déportation de main d’œuvre, annexions pures et simples). Même si cette politique va être adoucie après la mort de Staline, devant la nécessité de renforcer l'ensemble du bloc et face à la pression des évènements sociaux (RDA en 1953, Pologne et Hongrie en 1956), l'échange qui s'installe au sein du COMECON est un échange forcé : l'URSS impose ses produits de mauvaise qualité à ses partenaires, les paye en roubles (monnaie non convertible sur le marché mondial) et se fait payer en devises occidentales, se fait octroyer par ses vassaux des crédits qu'elle ne rembourse pas et qui servent à développer son économie (9,3 milliards de roubles de 1971 à 1980).
On le voit, ce n'est pas par sa puissance économique que l'URSS contrôle son bloc, mais par sa puissance militaire, elle profite ainsi pleinement de la réalité du capitalisme décadent qui, partout dans le monde, tend à déplacer la concurrence économique sur le plan militaire. La seule garantie de survie de l'URSS est sa puissance coercitive militaire et policière. Cela détermine toute l'orientation de son économie vers l'économie de guerre. Mais une telle tricherie avec la loi de la valeur, si elle est la condition de la survie du capital russe, pousse celui-ci dans des contradictions insurmontables qu'un appareil d'Etat, lourd et totalitaire, nécessaire au maintien d'un processus d'accumulation de plus en plus difficile, ne parvient plus à masquer. Le développement même de l'Etat russe est l'expression de ces contradictions déchirantes.
LA CRISE EN URSS AUJOURD'HUI
Parvenue trop tard sur la scène mondiale, l'URSS du point de vue économique est un pays faible qui souffre d'une pénurie chronique de capital. C'est un colosse militaire à l'économie d'argile. Sa puissance économique est plus quantitative que .qualitative, en 1977 l'URSS se situe au 26ème rang mondial (sans compter les pays de l'OPEP) pour le PNB par habitant, juste devant la Grèce (France: PNB = 35.000F/h; URSS: PNB = 14.000F/h), devancée au sein de son bloc par la RDA (21.700 F/h), la Tchécoslovaquie (15.500 F/h) et la Pologne (15.100) (15.100 F/h). En une heure, un ouvrier russe produit une valeur ajoutée de 3 dollars, un ouvrier français de 8 dollars, et un ouvrier américain de 10 dollars.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR
Dans ces conditions, on comprend que la balance commerciale de l'URSS avec les pays occidentaux soit constamment déficitaire et se traduise par un endettement vis à vis de l'Occident de 16,3 milliards de dollars à la fin de 1977. Mais, même avec les pays du COMECON, l'URSS voit sa position se dégrader constamment, la reconstruction des économies de ces pays, après la seconde guerre mondiale, se traduit pour l'URSS par un déficit qui commence à être perceptible dès la fin des années 50. De 1971 à 1974, le solde a été nettement négatif pour l'URSS vis à vis de ces pays, la situation a été redressée artificiellement par la hausse des matières premières (pétrole), mais aujourd'hui la situation se dégrade de nouveau.
Mais la faiblesse économique de l'URSS n'apparait pas seulement dans le solde de sa balance commerciale, mais aussi dans la structure de ses échanges. Ils sont typiques de ceux d'un pays sous-développé. L'URSS est essentiellement importatrice de produits manufacturés et exportateur de matières premières : avec le COMECON, les matières premières constituent 38,7% des exportations, tandis que les produits manufacturés représentent 74% des importations; avec l'occident, c'est encore plus clair, les matières premières représentent 76% des exportations, les produits manufacturés 70% des importations. Il n'y a guère qu'avec les pays sous-développés que l'URSS a des échanges de pays développé, mais en ce cas 50% de ses exportations sont constituées de matériel militaire.
L'ECONOMIE LE GUERRE
Tous ces éléments mettent en évidence la faiblesse du capital russe, ses caractères sous-développés. Face à une telle situation, qui traduit une crise chronique, le seul recours pour maintenir sa place sur le marché mondial est donc l'économie de guerre, le développement du potentiel militaire. Ce qui maintient l'unité du bloc de l'Est, c'est la puissance de l'armée rouge. Le potentiel économique est mobilisé prioritairement vers les besoins militaires, par l'économie de guerre.
Ce n'est pas au niveau économique, mais au niveau militaire que se concrétise la rivalité entré les deux blocs. Sur le plan économique, l'URSS est battue d'avance. Sur le plan militaire, elle ne peut concurrencer l'occident qu'en mobilisant l'essentiel de son économie pour l'armée. Si les USA consacrent 6% de leur budget à l'armée, pour essayer d'être militairement crédible dans la course aux armements, l'URSS consacre officiellement 12% de son budget (en fait, à ce niveau les chiffres sont un mensonge permanent et, pour l'URSS, 20% serait une estimation encore très prudente). Il est impossible de dissocier les secteurs industriels civils et militaires (par exemple, les usines de tracteurs produisent aussi des chars). Une absolue priorité est donnée à la production militaire : approvisionnement, mobilisation des usines et de la main d'œuvre, transports, entretien, etc .... L'économie russe est une économie entièrement militarisée.
Un tel effort militaire ne peut se faire qu'aux dépens de l'économie elle-même. En effet, la production militaire a ceci de particulier qu'elle ne permet aucun développement ultérieur des forces productives. C'est du capital qui est détruit (lorsqu'on sait que les importations de viande du Tiers-Monde, en 1977, représentent 82% du prix d'un seul sous-marin nucléaire et que l'URSS en possède des dizaines, on peut mesurer l'ampleur du gaspillage). Pourtant cet immense gaspillage est la seule garantie de survie de l'URSS, qui lui permet d'imposer par la terreur des sacrifices draconiens au prolétariat et, par la force, de faire rentrer le capital nécessaire à la poursuite du processus d'accumulation en taxant ses vassaux européens.
Cependant, avec l'intensification de la crise dans les années 60, la pression économique et militaire de l'occident s'est intensifiée. Cette pression s'est traduite par le changement de bloc de la Chine, de l'Egypte, de l'Irak, etc., et par des velléités d'indépendance vite réduites au silence par l'armée rouge de la Tchécoslovaquie. Vu la faible part des échanges de l'URSS avec l'occident (3% de son revenu national), on ne peut pas dire que l'URSS a importé la crise. Pour l'URSS, la concurrence est d'abord au niveau militaire. Face à la pression occidentale avivée par la crise, la nécessité de renforcer encore plus son potentiel militaire, de détruire donc encore plus de capital, pousse l'URSS dans ses contradictions capitalistes, à des distorsions encore plus fortes par rapport à la loi de la valeur. Cette situation tend à se traduire par une désaccumulation de capital qui ne peut plus être compensée par les revenus de l'impérialisme. C'est pour cela que la crise qui apparaît en occident, au milieu des années 60, se traduit immédiatement par une aggravation dramatique de la crise déjà permanente du capital russe.
Confrontée à la pénurie de capital, l'URSS tout au long de son histoire a du faire des choix draconiens, toujours en faveur de son potentiel militaire, mais qui se sont traduits par un affaiblissement de son économie, confirmant ainsi le cercle vicieux de la pénurie de capital dont l'URSS ne peut sortir. Ainsi, les choix stratégiques en faveur de l'industrie aérospatiale et nucléaire, nécessaires à la mise en place d'une force de frappe nucléaire, n'ont pu se faire qu'aux dépens d'autres secteurs vitaux de l'économie. Cela se traduit aujourd'hui par un retard grandissant de l'URSS dans des domaines de pointe, tels que l'informatique, la biologie, ou la métallurgie des métaux et alliages nouveaux. Dans la concurrence internationale, il y a un affaiblissement de l'économie russe comme le montre le fait que le Japon vient de la rattraper comme deuxième puissance économique mondiale. Cette situation a forcément un contrecoup sur la puissance militaire et impose à l'URSS des sacrifices toujours plus grands pour maintenir sa crédibilité guerrière.
La priorité accordée à l'économie de guerre, ne peut se faire qu'aux dépens des investissements pour la modernisation des secteurs non liés à la production d'armements. Dans tous ces secteurs, il y aura donc une très faible mécanisation, cette pénurie de capital constant se traduit par un recours à une main d'œuvre abondante. Ainsi, dans l'agriculture travaille 20% de la population active (France : 10%, USA : 2,6%), le manque de matériel moderne (tracteurs, silos, engrais, etc.) se traduit régulièrement par une pénurie agricole et oblige donc à des achats sur le marché mondial, ce qui aggrave encore les difficultés de l'économie russe.
LA PENURIE DE MAIN D'OEUVRE
En URSS, les bras ont remplacé les machines inexistantes, comme dans tous les pays sous-développés du monde. Cependant, et c'est là qu'est la différence, sa situation d'hégémonie sur son bloc va lui permettre -et les nécessités imposées par les rivalités impérialistes lui imposer- le développement d'industries lourdes et d'industries de pointe nécessaires à sa puissance militaire. Ce qui crée une situation de déséquilibre profond entre les divers secteurs économiques, entre ceux liés à l'armée et les autres. Mais une économie capitaliste est un tout, pour faire de l'acier, il faut non seulement extraire du minerai de fer, mais aussi du charbon, il faut ensuite transporter cet acier, le travailler, etc..., il faut nourrir les travailleurs, pour cela il faut fournir des produits agricoles... Malheureusement pour elle, la bourgeoisie russe ne pouvait investir partout à la fois. Pour pallier à la déficience de capitaux dans ces secteurs, un seul recours: user et abuser de la force de travail, sous peine de voir l'économie se paralyser totalement. Dans les mines, dans les champs, sur les chantiers, les hommes vont remplacer les machines. Ainsi, dans l'agriculture et le bâtiment, sont employés en Russie 36% de la population active contre 19% en France et 10% aux Etats-Unis. Cela se traduit par une faible productivité de l'industrie russe et, étant donnés les gros besoins liés à la forme même de son développement économique, par une pénurie de main d'œuvre.
Phénomène encore plus renforcé par le fait que les déséquilibres internes de l'économie russe se traduisent par une tendance brutale au capitalisme d'Etat (seul capable de maintenir un minimum de cohésion au sein de ces contradictions explosives), qui se caractérisent par une inertie bureaucratique terrible, par un approvisionnement chaotique des usines en matières premières et pièces de rechange.
Ces deux aspects conduisent le chef d'entreprise à employer des travailleurs en surnombre, de peur de ne pouvoir réaliser le plan et pour pallier au fait que les chaînes fonctionnent souvent au ralenti par manque d'approvisionnement, ou sont paralysées par le manque de pièces de rechange, pour avoir une réserve de main-d’œuvre pour rattraper les objectifs de production lorsque les approvisionnements arrivent, en faisant travailler à fond la chaîne et en ayant des services d'entretien pléthoriques, afin de refaire les pièces dans la mesure où elles manquent. Ainsi, l'ensemble des secteurs "auxiliaires" dans l'entreprise, en 1975, utilisaient 49% des effectifs de l'industrie.
Cette situation pousse la bourgeoisie russe à utiliser de manière extensive la force de travail par l'institutionnalisation de la double journée de travail (heures supplémentaires, travail au noir), par le recours à des jours de travail gratuits, par un recours au travail des femmes (93% travaillent) et des retraités ( en 1975 : 4,4 millions cumulaient leur retraite avec un salaire).
La pénurie de main d'œuvre se traduit donc par son corollaire, le plein emploi. Cependant, ce plein emploi ne peut masquer le sous-emploi réel de la force de travail, qui se traduit dans le faible taux de productivité de l'économie russe. Le plein emploi, en Russie, exprime la même chose que le chômage dans les pays occidentaux : le sous-emploi de la force de travail, c'est à dire l'incapacité du capitalisme décadent d'utiliser les ressources du travail vivant.
LA PENURIE SUR LE MARCHE INTÉRIEUR
La nécessité de faire baisser les coûts de production va conduire la bourgeoisie russe à mener une attaque constante contre la force productive la plus malléable et la plus importante : la force de travail. Un seul but, faire baisser coûte que coûte les salaires réels.
Confronté à la pénurie de main d’œuvre, qui implique une pression constante au niveau de la masse salariale, la bourgeoisie dans l'incapacité à dégager un volant de chômage ne peut avoir recours qu'à des méthodes draconiennes pour abaisser ses coûts :
- le rationnement typique de l'économie de guerre;
- la baisse ou la stabilité des prix imposés artificiellement et autoritairement par l'Etat, au prix d'une vente à des prix inférieurs aux coûts de production sur le marché intérieur.
Ce système permet d'obtenir une main d’œuvre bon marché, mais se traduit par :
- un niveau de vie très bas de la population,
- une pénurie d'approvisionnement dans les magasins. La demande solvable (distribuée sous forme de salaires et subventions) étant supérieure à la valeur officielle des produits de consommation mis sur le marché, conduit aux longues queues devant les magasins et à un profond mécontentement de la population, à une épargne forcée qui ne sert à rien et à une pression inflationniste très forte.
- la création d'un marché noir très important et une tendance au troc.
La pénurie dans les magasins est encore accentuée par le mauvais fonctionnement général de l'économie russe :
- 15% de la production invendable ou défectueuse
- une distribution anarchique et une mauvaise adaptation des produits aux besoins du marché, ce qui donne, dans un cadre de pénurie générale, des stocks d'invendus inutilisables,
- une agriculture chroniquement déficitaire.
De cette situation découle une épargne importante (qu'il ne faut pas cependant surestimer, elle équivaut en grande partie à l'absence de crédits à la consommation), qui n'a fait qu'augmenter depuis 1965, montrant ainsi l'austérité croissante au travers des rationnements.
Cette situation est le produit de la priorité accordée au développement des biens de production dans l'industrie, aux dépens des biens de consommation (87% des investissements industriels contre 13%). Cependant, à cause de l'arriération et du déséquilibre du capitalisme russe, la pénurie de marchandises se fait aussi bien sentir dans la production de biens de production, au niveau de l'approvisionnement déficient en matières premières et en pièces de rechange.
Cependant, la pression du marché mondial et du marché intérieur tendent à briser le carcan que constitue la tricherie par rapport à la loi de la valeur, à la base du fonctionnement du modèle rus-. se. Ainsi, la saturation du marché mondial induit en Russie l'apparition de stocks importants dans l'industrie et la pression de la demande sur le marché intérieur pousse au développement du marché noir, qui a énormément progressé ces, dernières années, sur lequel la loi de la valeur joue à plein, provoquant ainsi une baisse de la croissance de l'épargne depuis 1975 et une pression inflationniste croissante.
L'INFLATION EN URSS
Les indices officiels des prix en URSS sont remarquables par leur stabilité (indice 100 en 1965, 99,3 en 1976). L'inflation n'existerait-elle pas dans ce pays ? Là encore, le fonctionnement même du marché intérieur tend à masquer l'inflation telle qu'on la conçoit en occident (surtout dans sa manifestation classique : augmentation des prix). En effet, cette inflation prend des formes différentes sur le marché officiel :
- augmentation des subventions aux produits de consommation, afin de maintenir leurs prix artificiels,
- rationnement accentué, qui se traduit par l'allongement des files d'attente devant les magasins, monnaie en excédent, stérilisée par l'épargne (133 milliards de roubles).
Les facteurs inflationnistes en Russie sont :
- Excédent de la demande solvable sur l'offre, qui pousse a la constitution du marché noir qui reflète l'inflation réelle (le rouble y est côté à un quart de sa valeur officielle).
- Investissements mal rentabilisés (85% du montant global placé dans des chantiers inachevés).
- Poids énorme ces secteurs improductifs, notamment de l'armement (12% du PNB).
- Pression du marché mondial au travers du commerce extérieur.
Cette pression inflationniste est tellement forte qu'aujourd'hui la bourgeoisie russe ne peut même plus la masquer; les augmentations en cascades se succèdent à vitesse accélérée : taxis 100%, soieries 40%, vaisselle 80%, confection 15%, bijoux 110%, automobiles 50% pour les modèles les plus recherchés, telles sont quelques augmentations décidées par l'Etat le 1er Janvier 1977, sans compter les hausses déguisées, telle que le retrait d'un produit peu cher et la mise en circulation d'un équivalant plus onéreux, ni les hausses brutales sur le marché kolkhozien et le marché noir.
Contrairement à ce que peuvent prétendre les staliniens et les trotskystes, lorsqu'ils déclarent que l'inflation en URSS est due uniquement à la crise des pays occidentaux qui pénètre la Russie par son commerce extérieur, c'est essentiellement les contradictions internes qui poussent son processus inflationniste, vu que le commerce avec l'occident ne représente que 3% du revenu national.
Dans les conditions particulières de la Russie, l'inflation exprime l'excédent de la demande sur l'offre, alors que c'est l'inverse sur le marché mondial. Est-ce contradictoire ? Non, car la situation particulière de la Russie est précisément due au fait que, pour elle, étant donné son manque de compétitivité, le marché mondial est toujours apparu comme saturé. La situation en Russie est le produit même de la crise économique mondiale qui se manifeste sur le marché mondial.
Dans ces conditions, le marché intérieur russe, non saturé, représente t'il un débouché possible pour son économie ? Pas vraiment, dans la mesure où les prix pratiqués y sont des prix inférieurs aux coûts (déficit qui ne peut être équilibré que par l'extorsion de capitaux aux pays d'Europe de l'Est). Pour que le marché intérieur puisse constituer un débouché réel, il faudrait d'abord mettre ses prix au niveau des prix du marché mondial, c'est cette tentative qui exprime la vague de hausse des prix. Mais cela signifie un pas en avant dans une spirale inflationniste, par une pression accrue sur la masse salariale et un risque d'explosion sociale grandissant. En fait, la part plus importante accordée aux biens de production dans le Xème plan exprime plus la crise que subit le secteur I des biens de production par rapport à la saturation du marché mondial.
L'URSS n'échappe pas à la crise mondiale du capitalisme. Elle exprime, au contraire, pleinement la réalité du capitalisme décadent.
- incapacité d'un réel développement des forces productives,
- tendance brutale au capitalisme d'Etat,
- économie de guerre.
En fait, tous ces traits expriment la crise permanente du capitalisme. Les caractères spécifiques de la crise en URSS, loin de signifier l'absence de crise dans ce pays, expriment, au contraire, son importance et sa permanence, ils sont la preuve des contradictions explosives qui secouent l'économie russe.
Pour maintenir son existence indépendante, le capital russe ne peut que s'enfoncer dans une tricherie de plus en plus forte par rapport à la loi de la valeur et la loi de l'échange. Mais une telle tricherie ne peut durablement masquer la réalité du capital et ses contradictions, la loi de la valeur tend de plus en plus à faire éclater le cadre formel qui la distord.
Face à une telle menace, l'URSS est poussée de plus en plus à chercher de nouveaux marchés à piller pour poursuivre son propre renforcement. Comme solution à la crise, elle est de plus en plus poussée vers la guerre.
Mais ces contradictions, si elles apparaissent plus brutales, ne sont pas pour autant différentes de celles qui secouent le capitalisme sur l'ensemble de la planète, où partout la loi de la valeur est à l’œuvre, où partout le capital se trouve confronté à la limite de ses débouchés.
Par bien des aspects, l'URSS montre le chemin que suit le capital partout dans le monde : contrôle de plus en plus ouvertement totalitaire de l'Etat, gaspillage insensé dans l'économie de guerre, etc.
A l'Est comme à l'Ouest, la crise économique sape les bases de la production capitaliste et crée les conditions de la crise sociale qui, en faisant exploser la contradiction entre le capital et le travail, crée les conditions de la révolution communiste.
JUIN 1980.
"LE TRAVAIL QUI N'EST PAS EXPLOITE EST AUTANT DIRE DE LA PRODUCTION PERDUE. DES MATIERES PREMIERES QUI RESTENT INEMPTAYEES NE SONT PAS DU CAPITAL. DES DATIMENTS QU'ON N'OCCUPE PAS (TOUT COMME DES MACHINES NOUVELLEMENT CONSTRUITES) OU QUI RESTENT INACHEVES, DES MARCHANDISES QUI POURISSENT DANS LES ENTREPOTS,- TOUT CELA C'EST DE LA DESTRUCTION DE CAPITAL."
(Marx :"Théories sur la plus-value", XVIIème chapitre, Editions sociales page 591.)
Géographique:
- Pologne [111]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [112]
Questions théoriques:
- L'économie [90]
Lutte de classes internationale
- 2428 reads
PRESENTE AU 4EME CONGRES DE REVOLUTION INTERNATIONALE, SECTION DU C.C.I. EN FRANCE, LE RAPPORT QUE NOUS PUBLIONS ICI TENTE DE CERNER LES PREMIERS PAS DU PROLETARIAT DANS LA REPRISE INTERNATIONALE DES LUTTES OUVRIERES.
CE RAPPORT EST CONCU EN TROIS PARTIES :
LA PREMIERE TRAITE DU DEVELOPPEMENT DES CONDITIONS GENERALES, ECONOMIQUES, POLITIQUES ET SOCIA, LES DANS LESQUELLES SE DEROULE LA LUTTE DE CLASSE ET QUI LA CONDITIONNENT.
DANS LA DEUXIEME SONT EVOQUEES RAPIDEMENT LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA LUTTE DE CLASSES A NOTRE EPOQUE.
LA TROISIEME PARTIE S'ATTACHE A DEGAGER QUELQUES PROBLEMES AUXQUELS SONT CONFRONTEES LES DERNIERES LUTTES OUVRIERES.
SI CE RAPPORT A ETE CONCU DE CETTE MANIERE, C'EST QU'IL NOUS SEMBLAIT QU'ELLE PERMETTAIT UNE APPROCHE A LA FOIS GLOBALE ET DYNAMIQUE DE LA LUTTE DE CLASSES ET DES PROBLEMES QU'ELLE SOULEVE.
LE DEVELOPPEMENT DES LUTTES OUVRIERES EN POLOGNE SEMBLE CONFIRMER CETTE METHODE D'ANALYSE ET LE CONTENU DU RAPPORT. EN EFFET :
- LE DEVELOPPEMENT DES CONDITIONS GENERALES, A L'ECHELLE INTERNATIONALE, CONFERE AUX LUTTES EN POLOGNE UN IMPACT ET UNE IMPORTANCE BIEN PLUS GRANDS QUE NE POUVAIENT EN AVOIR LES LUTTES DE 70-71 ET DE 76 ;
- D'AUTRE PART, CES LUTTES DEMONTRENT UNE FOIS DE PLUS A QUEL POINT LA LUTTE DE CLASSES SE DEVELOPPE PAR DE BRUSQUES BONDS EN AVANT DANS LA PERIODE ACTUELLE, ET NON DE FACON PROGRESSIVE, OBEISSANT A UNE DYNAMIQUE DIFFERENTE DE CELLE OU SIECLE PASSE ;
- ENFIN, CES LUTTES MONTRENT L'UNITE DES PROBLEMES ET DES QUESTIONS QUE RENCONTRE LA CLASSE OUVRIERE DANS SA LUTTE, DANS QUELQUE PAYS QUE CE SOIT. MAIS CE QUI CARACTERISE LES LUTTES EN POLOGNE PAR RAPPORT A CELLES QUI les ONT PRECEDEES, CE QUI FAIT QU'ELLES REALISENT UN BOND EN AVANT DU MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL, C'EST QUE LES OUVRIERS EN POLOGNE ONT COMMENCE A REPONDRE DANS LA PRATIQUE A CES PROBLEMES ET A CES QUESTIONS; que CE SOIT L'EXTENSION, L'UNIFICATION DE LA LUTTE, L'AUTONOMIE, L'AUTO-ORGANISATION ET LA SOLIDARITE DE LA CLASSE.
AVANT DE LAISSER LE LECTEUR JUGER PAR LUI-MEME, IL FAUT ENCORE PRECISER QUE CE RAPPORT S'EST SURTOUT DONNE POUR TACHE DE METTRE EN AVANT L'ASPECT DYNAMIQUE ET POSITIF DE LA REPRISE A L'HEURE ACTUELLE, SANS S'ATTACHER A ANALYSER LA MANIERE DONT LA BOURGEOISIE TENTE DE S'Y OPPOSER (EN PARTICULIER AVEC L'ATTITUDE OPPOSITIONNELLE DE LA GAUCHE).
L'évolution de la lutte de classes, dans ses formes et dans son contenu, est toujours l'expression des changements et de l'évolution des conditions dans lesquelles elle se déroule. Chaque évènement qui met aux prises le monde du travail contre le capital peut révéler, selon la situation, tel ou tel aspect prometteur d'un mouvement souterrain qui mûrit, ou, au contraire, les derniers soubresauts d'un mouvement qui s'épuise. Aussi ne peut-on traiter de la lutte de classes et de son évolution sans considérer les conditions qui y président.
Pour ces raisons, il est nécessaire d'examiner, dans un premier temps, l'évolution des conditions sociales générales par rapport à la lutte de classes avant de se pencher, dans une seconde partie, sur les aspects marquants de son évolution, et de sa dynamique depuis deux ans et des perspectives qu'elle ouvre.
L’EVOLUTION DES CONDITIONS DE LA LUTTE DE CLASSE A L'HEURE ACTUELLE
Il nous faut considérer les déterminations sociales de la situation; aujourd'hui sous ses différents angles : économique, politique, et de l'ensemble de la société.
AU NIVEAU ECONOMIQUE
L'accentuation et la généralisation de la crise économique développe les conditions de la lutte de classes aujourd'hui. La tendance à l'égalisation dans la descente et la stagnation qui caractérise le sort des nations bourgeoises dans la période de décadence s'exacerbe dans cette période de crise aiguë. Par rapport à il y a dix ans, tous les pays sont frappés par la crise et les "modèles de développement" allemand, japonais, américain pour les pays développés, coréen, iranien, brésilien pour les pays sous développés/sont ramenés au rang des autres.
Au sein de chaque économie nationale également, il y a de moins en moins de secteurs industriels "locomotives". Les espoirs que la bourgeoisie pouvait mettre dans le développement des uns au détriment des autres trop anachroniques et peu rentables, s'effondrent. Tous les secteurs de la production tendent à être touchés.
Tous les ouvriers aussi. Le spectre des licenciements et du chômage, la baisse du niveau de vie, la perspective de l'aggravation de conditions d'existence de plus en plus intolérables ne soit plus l'apanage de certains secteurs. Les difficultés des uns deviennent les difficultés de tous. CETTE TENDANCE A L'UNIFICATION, PAR LA CRISE, DES CONDITIONS D'EXISTENCE DU PROLETARIAT DEVELOPPE LE LES CONDITIONS POUR LA GENERALISATION DE SES LUTTES.
L'approfondissement et la généralisation de la crise économique constituent un aspect fondamental des conditions nécessaires à la généralisation des luttes dans la période actuelle.
Mais un autre aspect de cette réalité, non moins fondamental pour le développement de ces conditions, réside dans le fait que la crise économique se présente aujourd'hui SANS PERSPECTIVES, sans autre issue que la guerre, à la conscience des différentes classes.
Au langage de "restructuration", de "participation", d'"auto-gestion" que nous a tenu depuis dix ans la bourgeoisie, a fait place un langage d'austérité. On ne parle plus du "bout du tunnel". Le bout du tunnel pour la bourgeoisie aujourd'hui, c'est la guerre et elle le dit.
Aussi nous tient-elle un "langage de vérité". Mais la vérité bourgeoise n'est pas toujours bonne à dire, surtout aux exploités.
QUE LA BOURGEOISIE INDIQUE OUVERTEMENT QUE SON SYSTEME EST EN FAILLITE, QU'ELLE N'A RIEN D'AUTRE A PROPOSER QUE LA BOUCHERIE IMPERIALISTE, CONTRIBUE A CREER LES CONDITIONS POUR QUE LE PROLETARIAT TROUVE LE CHEMIN DE SON ALTERNATIVE HISTORIQUE AU SYSTEME CAPITALISTE. AU NIVEAU POLITIQUE
Toutes les perspectives illusoires mises en avant depuis dix ans, et que la bourgeoisie croyait elle-même être des solutions, tendent à s'évanouir.
Ainsi, la situation économique catastrophique du capitalisme, la conscience qu'en ont les différentes classes et les réactions qu'elle détermine dans la classe ouvrière se retrouvent et se traduisent sur le plan politique, non seulement au niveau de la lutte entre les différentes fractions de la bourgeoisie (crise politique), mais surtout PAR L'ABSENCE D'ALTERNATIVE HISTORIQUE FACE A LA LUTTE DE CLASSE.
L'usure de la "gauche au pouvoir", qui avait dominé la perspective sociale pendant les années précédentes, est un élément déterminant de cette absence d'alternative. C'est pourquoi on a assisté à la réorientation de la gauche dans l'opposition, dans les principaux pays européens, face et contre le développement de la lutte de classe.
Cependant, sur le plan politique, la gauche ne peut pas présenter à l'heure actuelle de perspective propre. Sa fonction consiste surtout à minimiser les enjeux de la situation. Face au langage de "vérité" des gouvernements en place, elle brouille les cartes. Elle dit que cette vérité -la perspective de guerre- est un mensonge, mais elle a peu de mensonges à proposer en guise de vérité. Aussi, ce n'est pas tant sur le terrain de la perspective politique que la gauche va remplir actuellement sa fonction anti-ouvrière mais directement sur le terrain de la lutte de classe.
ESSENTIELLEMENT ET FONDAMENTALEMENT, CETTE ABSENCE D'ALTERNATIVE POLITIQUE SE TROUVE AUJOURD'HUI AU COEUR DE LA CRISE POLITIQUE DE LA BOURGEOISIE; DE CE POINT DE VUE, LA POSITION DE LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION TRADUIT UNE POSITION ET UNE SITUATION DE FAIBLESSE POUR ELLE-MEME ET POUR L'ENSEMBLE DE LA BOURGEOISIE.
AU NIVEAU SOCIAL
Sur le plan social, le développement des conditions dans lesquelles se déroule la lutte de classes S'EXPRIME ET SE TROUVE RESUME DANS LA POSITION DE L'ETAT DANS ET FACE A LA SOCIETE. Et cela d'autant plus que l'Etat tend, dans la période de décadence, à régir l'ensemble de la vie sociale et à établir son emprise sur toutes ses expressions.
Si l'on examine rapidement la situation de l'Etat aujourd'hui, on s'aperçoit (lut les effets de la crise et les différents plans économiques de ces dernières années pour y faire face ont eu des conséquences très graves sur l'état de ses finances dont les déficits atteignent des proportions de plus en plus importantes et sont d'ailleurs une des sources principales d'inflation. Il n'y a guère que le budget de l'armée et de la police qui soient augmentés ; pour le reste, ce que la bourgeoisie appelle les "budgets sociaux" et qui sont en réalité une partie des salaires dont l'Etat a la charge, ils ont tous été fortement diminués en même temps qu'augmentaient les charges sociales.
Au moment même où il est obligé de développer la répression et la militarisation de la vie sociale, l'ébranlement économique de l'Etat affaiblit son emprise idéologique et l'apparence "sociale" de l'Etat du capitalisme d'Etat tend à disparaître pour laisser de plus en plus au grand jour sa réalité de gardien de l'ordre capitaliste.
La position dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'Etat laisse la porte ouverte à l'expression des contradictions qui rongent la société, celles qui divisent les classes sociales et s'expriment dans la désobéissance à l'Etat, la révolte et la lutte du prolétariat.
Face à ce processus, l'Etat tend à renforcer de plus en plus son caractère répressif pour empêcher les contradictions d'éclater au grand jour. Sans parler des pays sous développés où la réponse de l'Etat à ces contradictions se traduit par des massacres de plus en plus grands des populations, ouvriers, paysans (massacre des ouvriers aux Indes, massacres en Iran, meurtres à répétition en Turquie, en Tunisie, en Equateur, etc...), dans les pays développés et jusqu'ici au visage "démocratique", l'Etat est de plus en plus acculé à ne proposer que sa police et sa "justice" de classe comme réponse à toute expression sociale.
Les lois que nous concoctent tous les gouvernements d'Europe à l'heure actuelle, "anti-terroristes" en Italie, "anti-autonomes", "anticasseurs" en France, les pratiques judiciaires des "flagrants délits", les morts dans les affrontements comme en Corse, à Jussieu, à Miami, les blessés à Bristol, à Plogoff, les blindés dans les rues d'Amsterdam contre les "squatters", voilà la réponse des Etats "démocratiques" aux contradictions dans la société.
Dans cette situation, les illusions qui avaient subsisté sur la possibilité de changement dans le cadre des institutions existantes et dans la "légalité" tendent à disparaître elles-aussi.
Mais le renforcement de la répression étatique n'est pas une expression de la force de l'Etat mais un renforcement formel. En l'absence de perspectives économiques et politiques, en l'absence d'un embrigadement idéologique des populations derrière les buts de l'Etat, l'exacerbation de sa répression exprime sa faiblesse.
D'autre part, la faillite du système non seulement empire les conditions de vie de la classe ouvrière, mais encore accélère le développement des milliers de sans-travail exclus de la vie économique, jette sur le pavé des milliers de paysans, appauvrit toutes les couches et classes sociales intermédiaires et détermine une révolte grandissante des couches non-exploiteuses contre l'ordre social existant. On a vu se développer, de façon accélérée depuis les derniers deux ans, des révoltes de populations entières (Iran, Nicaragua, Salvador), des mouvements des paysans, des émeutes dans les pays développés (Bristol, Miami, Plogoff), des révoltes des étudiants (Jussieu en France, Corée, Afrique du Sud).
Le développement du mécontentement social et de la révolte dans la société est l'une des conditions dans lesquelles se développe la lutte de la classe ouvrière, une condition de la révolution prolétarienne. En effet, les mouvements contre l'ordre social existant participent d'une part au processus d'isolement de l'Etat et constituent, d'autre part, le contexte social au sein et vis à vis duquel le prolétariat se dégage et trouve sa voie propre comme seule force capable de présenter une alternative.
Ce n'est pas seulement contre la bourgeoisie que le prolétariat fait la révolution, mais c'est face à l'ensemble de la société qu'il peut ouvrir un chemin nouveau et c'est face à elle qu'il développe sa prise de conscience.
Ainsi, avec le développement de ces facteurs :
1) approfondissement important de la crise économique qui ne présente d'autre perspective que la guerre;
2) absence de perspective politique immédiate et de grands thèmes idéologiques qui canalisent, sinon "l'espoir", du moins la révolte ;
3) affaiblissement de la position et de l'emprise des Etats qui tendent à être de plus en plus isolés face à la révolte des couches et classes sociales non exploiteuses dans l'ensemble du monde ; se développent les conditions pour que le prolétariat trouve le chemin d'un processus révolutionnaire international.
Mais au sein des conditions générales, le passage de la gauche dans l'opposition répond au besoin pour la bourgeoisie d'empêcher qu'un tel processus ne s'enclenche. Avant même que la reprise des luttes ne se soient clairement dessinée, la bourgeoisie armée de ses thermomètres syndicaux et de ses "experts du travail" a compris la situation. En ce sens, et contrairement à la période précédente de luttes où le prolétariat avait surpris le monde par son resurgissement sur la scène historique, la bourgeoisie connaît aujourd'hui le danger de la lutte de classes et s'y est préparée.
Du point de vue de la bourgeoisie, le passage de la gauche dans l'opposition ne correspond pas à un plan machiavélique et prévu d'avance. L'emprise et l'audience des partis de gauche et surtout des syndicats s'affaiblissant dangereusement tout au long de cette période de course au pouvoir ou de "responsabilité" vis à vis des pouvoirs établis (désyndicalisation, perte d'influence et hémorragie des militants sont les signes révélateurs de cet affaiblissement), ceux-ci ont été contraints d'adopter une autre position pour ne pas perdre ce qui est le fondement de leur réalité et de leur force, le contrôle de la classe ouvrière.
Même s'ils font tout et ils vont tout faire pour "redorer leur blason" dans l'opposition en prenant la "tête" des luttes, ils s'usent également dans l'opposition car la lutte de classes n'est pas leur terrain véritable. C'est pourquoi nous disions plus haut que la position d'opposition de la gauche était une position de faiblesse; c'est la poussée de la lutte de classes qui détermine sa position actuelle d'opposition et de "radicalisation verbal".
Dans notre travail au sein de la lutte du prolétariat et donc en butte au problème de la gauche dans l'opposition, nous devons garder à l'esprit ce double aspect que revêt la position de la gauche dans l'opposition. D'un côté entrave au développement de la lutte de classes, et de l'autre, position de faiblesse due elle-même à la faiblesse de l'encadrement idéologique de la bourgeoisie. Da toutes façons, la gauche devra, elle, vivre et travailler au sabotage de la lutte de classes avec cette contradiction qui se développera nécessairement avec le développement des luttes et qui l'usera d'une manière plus radicale que la course au pouvoir.
Après avoir examiné les conditions objectives de la lutte de classe à l'heure actuelle, il faut chercher à évaluer le contenu des luttes qu'on a vu se développer. Mais il est encore nécessaire de rappeler rapidement les caractéristiques générales des luttes dans la période de décadence, la dynamique qui les anime et que l'expérience du prolétariat nous a enseignée.
LE PROCESSUS DE LA LUTTE DE CLASSES
1- Contrairement au 19ème siècle, le prolétariat ne peut plus se constituer en force face à la société sans remettre directement en cause la société elle-même. Alors qu'à l'époque, le prolétariat pouvait développer ses luttes de façon limitée et faire céder le capital sans ébranler toute la société, le caractère obsolescent et décadent du capitalisme et l'exacerbation de ses contradictions dans les périodes de crise aiguë ne peuvent plus supporter la constitution d'une force antagonique en son sein. Les luttes du prolétariat ne peuvent qu'accentuer la crise de la société et poser la question de la société elle-même.
Les buts du mouvement, de remise en cause des conditions d'existence s'étendent à la remise en cause de cette existence elle-même ; les formes de lutte, de résistance partielle et localisée de fractions de la classe ouvrière, s'étendent à la classe ouvrière dans son ensemble. Le développement de la lutte nécessite la participation massive de la classe ouvrière.
2- Contrairement au mouvement ouvrier du siècle dernier qui, malgré le caractère toujours heurté de la lutte de classes, pouvait se développer de façon progressive au sein de la société, où chaque lutte partielle de la classe venait renforcer la prise de conscience et l'union grandissante des travailleurs dans leurs organisations de masse, les luttes d'aujourd'hui ont un caractère explosif, préparé et imprévu.
Malgré son caractère heurté et explosif, le développement de mouvements de masse est un processus et obéit à une logique qui constitue la dynamique de la lutte de classes, qui se développe au travers de plusieurs moments de lutte, même si ceux-ci ne se relient pas forcément entre eux, de façon apparente, par un lien évident.
"Il est absolument faux d'imaginer la grève de masse coffre une action unique. La grève de masse est bien plutôt un terme qui désigne collectivement toute une période de lutte de classes s'étendant sur plusieurs années, parfois sur des décennies." (R. Luxembourg. Grèves de masses, parti et syndicats, p.128. Ed Maspero 1969).
C'est dans un tel cadre, en gardant â l'esprit les lois générales et les caractéristiques du mouvement révolutionnaire à l'heure actuelle, que nous pouvons et devons nous pencher sur les éléments que nous a apportés la pratique de la classe dans ses derniers combats.
Aujourd'hui, nous sommes au tout début d'un processus qui va mener vers le développement des grèves de masses; un processus durant lequel la classe va trouver le chemin pour constituer une force qui régénérera la société en la débarrassant de ses entraves capitalistes.
C'est pourquoi, c'est avec beaucoup d'attention que nous devons chercher à voir, dès maintenant, dans les luttes, les éléments dynamiques, porteurs de possibilités immédiates, pour participer de toutes nos forces et capacités à la marche historique du prolétariat vers l'avenir.
CERTAINS ASPECTS DE LA LUTTE DE CLASSES AUJOURD' HUI
Au cours de ces dernières luttes, aussi embryonnaires soient-elles, l'activité de la classe ouvrière a déjà soulevé beaucoup de problèmes, beaucoup plus qu'elle n'en a résolus et ne peut en résoudre dans l'immédiat. Mais le .fait qu'ils aient été posés dans la pratique constitue déjà un pas en avant du mouvement. On peut en énumérer en vrac un certain nombre qui, s'ils sont tous liés dans et par le processus d'affirmation révolutionnaire de la classe, apparaissent encore connes des éléments isolés, sans dégager nécessairement une orientation claire, se présentant ponctuellement dans les luttes à l'heure actuelle :
- les affrontements avec l'Etat ont eu lieu dans toutes les luttes principales en Europe (Longwy, Denain, Paris, Grande-Bretagne, mineurs du Limbourg, Rotterdam ...);
- l'auto-organisation (comité de coordination de la Sonacotra, comité de grève de Rotterdam);
- la solidarité active (Grande-Bretagne, France); - l'occupation de l'usine (Denain, Longwy) ;
- l'information et ses moyens de diffusion par la presse, la radio, la TV (Espagne, France) ;
- la répression et la lutte contre la répression (emprisonnés de Denain, de Longwy, du 23 mars).
Dans toutes ces questions, les ouvriers ont rencontré les manigances syndicales, sous ses multiples formes, de la base au sommet, et avec l'esprit syndicaliste qui pèse encore lourdement sur leur conscience ; ils ont dû les déborder, les contourner, les affronter, et bien souvent s'y sont laissés prendre.
Si tous ces aspects, ces questions, surgis de la lutte, trouveront leur réponse dans la lutte elle-même, on ne peut se contenter de généralités en attendant leur résolution. Contrairement à "Pour une Intervention Communiste" qui , à Longwy et Denain, demandait à la classe ouvrière d'inscrire l'"abolition du salariat" sur son drapeau ; contrairement au "Groupe Communiste Internationaliste" pour qui la question de l'heure (et à toute heure!) à laquelle les luttes doivent se consacrer est "l'affrontement" ; contrairement au "Ferment Ouvrier Révolutionnaire" qui préconise "l'insurrection", et à la "Communist Workers Organisation" qui "attend" que les masses rompent avec les syndicats (et rejoignent le parti ?) pour s'y intéresser , nous devons examiner concrètement les nécessités et les possibilités de la lutte actuelle, comme les dangers actuels qui les guettent, si nous voulons participer activement à leur développement. A la veille de l'insurrection, les problèmes cruciaux immédiats ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, au tout début d'un processus fragile, nous devons nous pencher avec attention sur les différents aspects des luttes, si faibles et si petits soient-ils, pour comprendre à chaque moment où en est le processus, comment il se développe, où réside l'avenir immédiat du mouvement, quelles sont ses potentialités, et y apporter notre contribution.
Nous nous limiterons à étudier certains points parmi ceux mentionnés ci-dessus, qui nous semblent dominants à l'heure actuelle.
LES MOYENS ET L'EXTENSION DES LUTTES
Une des premières questions que pose la lutte, c'est celle de son efficacité immédiate par rapport à la bourgeoisie et à son Etat. Si l'on prend l'exemple de trois situations différentes dans lesquelles se trouvent Tes ouvriers dans la production on voit qu'ils sont tous confrontés à ce problème.
- En Grande-Bretagne, la grève de trois mois qu'ont menée les sidérurgistes et qu'ils ont étendue en partie à la sidérurgie privée, n'a eu quasiment aucun effet sur la vie économique du pays. En Hollande, malgré un mois de grève des dockers, 80% de l'activité du port de Rotterdam a été assurée.
- D'autre part, un grand nombre de luttes a été engagé contre les licenciements. Dans ce cas, encore plus que dans les autres, la pression économique que les ouvriers voudraient exercer sur la bourgeoisie est rendue impossible de fait.
- D'autre part encore, dans des secteurs vitaux pour le fonctionnement de l'économie et celui de l'Etat (secteurs de pointe, mais surtout énergie, armement, transports, etc.), les ouvriers ont été
et sont soumis, dès qu'ils veulent entrer en lutte, à une pression très forte de l'Etat et à des diktats de plus en plus totalitaires. En France, par exemple, on a pu assister tout au long de ces derniers mois, à une campagne de la bourgeoisie contre les grèves dans les secteurs publics, et tout dernièrement la bourgeoisie cherche à imposer des mesures antigrèves dans la production d'électricité.
Aussi, dans les mouvements que la classe ouvrière a menés ces derniers mois, elle a à nouveau fait l'expérience de la difficulté à imposer une pression économique qui rende sa lutte efficace. La quantité de stocks dont dispose la bourgeoisie, la haute technicité du capital et son corollaire, une main d’œuvre limitée, l'organisation mondiale du capital, le contrôle et la centralisation économique par l'Etat, bref la puissance du capital par rapport au travail sur le terrain économique, font que les grèves dans une usine, ou même dans une branche d'industrie ont un effet des plus limités.
Tout cela n'est pas nouveau et est l'expression du capitalisme d'Etat et de la militarisation de la vie économique qu'impose la décadence du système et que renforce la crise aiguë actuelle. Mais ce qui est "nouveau" par contre, dans les luttes de ces derniers mois, c'est que la prise de conscience de cette situation a été l'aiguillon, la force principale qui a poussé les ouvriers à chercher d'autres voies, à étendre leurs luttes.
En Grande-Bretagne, les ouvriers ont vite réalisé que le blocage du trafic de l'acier dans les ports, les lieux de stockage etc., était pratiquement impossible à réaliser et qu'il fallait trouver une autre voie pour s'imposer. C'est alors qu'ils ont cherché à orienter leur mouvement vers la recherche de la solidarité active des autres ouvriers.
En France, la lutte des ouvriers de la sidérurgie avait lieu contre les licenciements. Dans ce cas, encore plus que dans les autres, la pression économique ne pouvait avoir de poids sur la bourgeoisie, et les ouvriers s'en sont rendu compte dès le début. A aucun moment ils ne se sont mis en grève et c'est dans la rue qu'ils ont engagé la lutte. Lorsque la CGT, à Denain, a proposé l'occupation de l'usine, elle s'est fait huer par les ouvriers.
A Rotterdam, le problème de l'extension du mouvement s'est posé dès le début de la grève. Les ouvriers se sont orientés dans différentes tentatives d'extension (appeler les autres dockers à la grève) et lorsqu'au bout de trois semaines de grève, ils ont voulu aller chercher les autres ouvriers du port, c'est alors que l'Etat a envoyé sa police, exprimant ainsi clairement que c'est là que résidait pour lui le danger de cette lutte.
Dans ces luttes, la classe ouvrière a commencé à se rendre compte de la limitation objective du terrain catégoriel et strictement économique, terrain où le rapport de forces ne peut qu'être favorable à la bourgeoisie. Si le prolétariat ne fait que commencer à entrevoir la question, l'accentuation de la crise économique et avec elle, d'un côté, l'augmentation des licenciements, et de l'autre l'effort de rentabilisation et de militarisation des secteurs-clés de l'économie, vont pousser de plus en plus la classe ouvrière à trouver de nouvelles voies, et , en attaquant la force du capital de tous côtés, à la transformer en faiblesse.
LA QUESTION DU CHOMAGE ET LES LICENCIDENTS DU LES LUTTES ACTUELLES
Dans la résolution que le CCI avait adopté sur les questions du chômage et de la lutte de classe, nous mettions en avant que "si les chômeurs avaient perdu le terrain de l'usine, ils gagnaient du même coup celui de la rue". Les luttes de l'an dernier contre les licenciements dans la sidérurgie sont venues confirmer cette thèse.
Ces luttes nous ont montré que la lutte contre les licenciements sur le "terrain de la rue" constituait un TERRAIN TRES PROPICE AU DEVELOPPEMENT GENERAL DE LA LUTTE, A SON EXTENSION ET A SON UNIFICATION, et cela en particulier parce que le terrain de la rue déborde le cadre de l'usine et de la corporation, terrain privilégié du travail syndical.
Cette expérience doit aujourd'hui nous servir de guide et d'illustration sur la place que peut occuper demain la lutte des chômeurs. En effet, dans une situation générale de développement des luttes, la lutte des chômeurs, parce qu'elle est de fait débarrassée des entraves corporatives et sectorielles, et ne peut se dérouler que sur le "terrain de la rue", jouera nécessairement un rôle important dans l'extension et l'unification de la lutte ouvrière et sera bien plus difficile à contrôler et à encadrer par les syndicats.
Depuis que nous avons eu nos discussions sur les questions du chômage et de la lutte de classe, le développement lent de la crise ne nous a pas donné l'occasion de voir une lutte de chômeurs se développer, à part en Iran. Malgré le peu d'informations auxquelles nous pourrions nous référer nous pouvons tout de même avancer que la question du chômage a été premièrement une question centrale dans la lutte des ouvriers en Iran et deuxièmement qu'elle en a été une force motrice et unificatrice.
Pour toutes ces raisons, nous devons donc dans la situation actuelle de développement extrêmement grave de la crise et du chômage qui va en résulter, ne pas relâcher notre attention sur cette question. Au contraire:, nous devons accorder une attention particulière à son développement, aux réactions qu'il provoque dans la classe ouvrière et à la manière dont la gauche et Les syndicats tentent et tenteront de désamorcer la bombé sociale qu'il constitue.
EXTENSION ET SOLIDARITE.
Dès que la classe ouvrière entre en lutte, dans un secteur ou dans un autre, se pose la question de la solidarité, comme besoin et nécessité de la lutte.
En France, dans les premières attaques des ouvriers à Longwy et Denain, contre les préfectures, les caisses d'impôts, les banques, les chambres patronales, et surtout dans les premières attaques de commissariats en réponse aux actes de répression de la police, UNE SOLIDARITE DIRECTE ET SPONTANÉE DES AUTRES OUVRIERS, DES CHOMEURS ET MEME DE LA POPULATION S'EST REALISEE DANS L'ACTION.
En Grande-Bretagne, malgré le cadre strict imposé au départ par les syndicats à la grève et aux formes de la lutte des sidérurgistes (piquets de grève pour bloquer le trafic de l'acier), les ouvriers ont exprimé leur combativité et leur orientation propres dans les tentatives qu'ils ont faites pour orienter la lutte vers les autres ouvriers, pour aller chercher leur solidarité active. Même si et bien que les syndicats aient réussi à garder le contrôle de l'extension en la limitant au cadre corporatiste qu'ils dominent, c'est sous la pression ouvrière à la recherche de son chemin propre qu'ils l'ont fait, contre l'opposition au départ des bureaucraties syndicales, et C'EST LA QU'ONT RESIDE LE POIDS ET LA FORCE DU MOUVEMENT EN GRANDE-BRETAGNE, en dépit de tous les pièges que lui avait soigneusement tendus la bourgeoisie.
Dans les deux luttes qui se sont dotées d'une organisation propre, en dehors des syndicats, à Rotterdam et à la Sonacotra en France, le problème de la solidarité a été constamment posé. Dés le début, comme on l'a dit plus haut, le comité de grève de Rotterdam était préoccupé de l'extension du mouvement et de la solidarité des autres ouvriers, qui s'est posée, de façon embryonnaire, à Amsterdam. Durant toute la lutte de la Sonacotra, la question de la solidarité des ouvriers français était au cœur des préoccupations du comité de coordination. Les slogans dominants de toutes les manifestations d'immigrés étaient : "français, immigrés, mêmes patrons, même combat ! ; "ouvriers français, immigrés : solidarité!"
Cet effort de la recherche de la solidarité par la classe ouvrière est une manifestation très positive des luttes à l'heure actuelle et des pas qu'elle commence à faire dans la prise de conscience de sa nature fondamentalement unie par les mêmes intérêts.
Mais cet effort encore fragile rencontre face à lui beaucoup d'entraves. La première est bien sûr le niveau général de la lutte de classes. Bien que la solidarité soit un acte volontaire, conscient, elle n'en nécessite pas moins un développement général de la combativité et des luttes ouvrières. Les travailleurs immigrés, en France, en ont d'ailleurs fait l'amère expérience durant toute la période du reflux de la lutte de classe. Cela dit, une autre entrave au développement de la solidarité ouvrière est une conception confuse de la solidarité, conception qui pèse d'autant plus sur la conscience du prolétariat qu'elle se réfère à la "solidarité ouvrière" telle qu'elle pouvait se réaliser dans les luttes du siècle passé.
Alors qu'au 19ème siècle, la solidarité de la classe ouvrière pouvait s'exprimer dans le soutien matériel et financier des grèves, au travers des caisses de grève organisées par les syndicats et qui permettaient aux ouvriers de tenir jusqu’a ce que le patronat cède, aujourd'hui, comme on l'a vu plus haut, la pression économique de la classe ne peut plus s'exercer dans le cadre d'une usine ou même d'une branche d'industrie. Les ouvriers sont nombreux aujourd'hui à avoir fait l'expérience de longues grèves qui, malgré le soutien matériel et la "popularisation" organisée par les syndicats, non seulement n'ont pas fait céder la bourgeoisie, mais encore ont abouti à la démoralisation dans l'isolement.
Alors que fondamentalement, la recherche de la solidarité par la classe ouvrière en lutte aujourd'hui s'impose à travers la nécessité de BRISER L'ISOLEMENT, la bourgeoisie essaie de dévoyer cette orientation, lorsque la lutte contient trop de dangers, de potentialités à l'égard de son pouvoir, en utilisant le besoin de solidarité à son profit. C'est ainsi qu'au Brésil, les ouvriers ont payé le prix du "soutien" que leur ont apporté les bourgeois et les curés qui ont réussi, au nom de ce soutien, à les enfermer dans leurs églises, et à dévoyer le mouvement sur leur propre terrain, celui de la "démocratie" (syndicalisme libre) et de la nation. De même en France, rares sont les grèves qui ont connu un "soutien" aussi massif et aussi "large" de tous les pouvoirs établis, depuis Chirac jusqu'à la presse, comme celle des nettoyeurs du métro : tout le monde y a mis du sien pour aboutir au nom de la solidarité à l'isolement complet des ouvriers.
La conception bourgeoise de la solidarité, c'est la solidarité DES classes, l'union de tous les citoyens derrière un seul drapeau, une "cause" au nom de laquelle on sacrifie un moment ses intérêts particuliers et divergents. La solidarité de la classe ouvrière, elle, est une solidarité DE classe : ce sont leurs intérêts communs que les ouvriers réalisent dans toute action de solidarité. Pour la bourgeoisie, la solidarité est une notion morale; pour la classe ouvrière, elle est sa pratique.
De par les caractéristiques de la lutte de classe dans la période de décadence, LA SOLIDARITE DE LA CLASSE OUVRIERE AUJOURD'HUI, LA SEULE VOIE PAR LAQUELLE ELLE PEUT ARRIVER A S'EXPRIMER, C'EST A TRAVERS LA SOLIDARITE ACTIVE qui veut dire, essentiellement, la participation des autres secteurs à la lutte, L'EXTENSION DE LA LUTTE. La solidarité est à la fois un agent et un produit de l'unification des luttes.
LA QUESTION SYNDICALE
La question syndicale est la pierre de touche de l'avenir de la lutte de classe aujourd'hui. Plus que la répression directe et brutale, c'est dans la mystification et le dévoiement syndicaux que résidera l'offensive bourgeoise contre la classe ouvrière, préparatoire à la répression ultérieure. C'est sur tous les fronts que gauche et syndicats vont attaquer la lutte de classe : isolement, dévoiement, provocation, etc.
Le dégagement du carcan syndical est loin, pour le moment, de s'être exprimé clairement, surtout dans les pays où ils ont une longue tradition historique, comme en Grande-Bretagne. Si en France, le mouvement de Longwy et Denain a commencé par des débordements syndicaux, si, en Italie, la CGIL, par toutes ses actions ouvertement anti ouvrières est particulièrement déconsidérée et les mouvements, comme celui des hospitaliers ont eu lieu directement contre elle, la clarification de la question syndicale dans la conscience ouvrière nécessite un développement plus poussé des luttes.
Il est fondamentalement juste de dire que la question syndicale est une question cruciale, le bras armé de la bourgeoisie dans les rangs du prolétariat et que tant que les syndicats organisent les luttes et les maintiennent dans leur giron, ils constituent l'entrave la plus puissante à tout développement ultérieur.
Cette vérité générale est indispensable à reconnaître pour pouvoir vraiment contribuer au développement de la lutte de classe et à la prise de conscience du prolétariat, et en ce sens, les résistances de nombres de groupes révolutionnaires pour reconnaître cette question est une entrave à l'accomplissement de leur fonction.
Mais cette reconnaissance générale ne suffit pas. Les ouvriers ne répondront pas à la question syndicale en suivant un raisonnement théorique, général, mais en s'y confrontant dans la pratique. Et c'est dans cette pratique qu'il nous faut examiner comment elle se pose et comment nous pouvons contribuer à son éclaircissement véritable. Répéter, comme le font le CWO, le FOR et le PIC que les syndicats sont anti-ouvriers et que ceux-ci doivent s'en débarrasser, ne nous éclaire pas tellement sur la façon concrète par laquelle la classe ouvrière va y aboutir. On peut toujours magnifier l'avenir et exorciser les syndicats en imagination, cela ne nous explique pas le présent, et le chemin qui mène du présent à cet avenir.
La présence des syndicats dans une lutte ne signifie pas que cette lutte est fichue d'avance. Contrairement à ce que peuvent penser le FOR, le PIC ou le CWO, derrière la marche sur Paris appelée par la CGT, dans les mouvements de grève en Grande-Bretagne et malgré le contrôle syndical sur le mouvement, la classe ouvrière a pu exercer une poussée réelle de classe et la lutte contenir des potentialités sans avoir ENCORE rompu avec le cadre syndical. Mais cette poussée s'exprime, de façon positive, AILLEURS, et c'est ça qu'il faut savoir reconnaître.
La rupture avec le terrain syndical est une condition constante d'un réel développement de la lutte, mais elle n'est pas un "but" de la lutte. Son but, c'est son renforcement qui obéit à ses propres nécessités :
1) que la classe ouvrière prenne ses luttes en main (cela veut dire assemblées générales et discussions, auto-organisation)
2) que le combat s'élargisse (l'extension de la lutte).
Et c'est justement lorsqu'elle cherche à répondre à ces nécessités propres que la lutte peut réellement poser la question de la rupture syndicale.
Au cœur de la dynamique de la lutte de classe, la question de l'extension du mouvement à toutes les couches du prolétariat par delà les catégories et les corporations, ainsi que la question de l'autonomie et de l'auto-organisation sont indissolublement liées.
Qu'une classe exploitée, dominée économiquement et idéologiquement, brimée et humiliée quotidiennement, prenne sa lutte en main, l'organise et la dirige collectivement constitue justement le premier acte révolutionnaire, mais celui-ci est irréalisable sans l'unité de la classe par delà les divisions que détermine le capitalisme.
Des premiers surgissements qui annonçaient la période révolutionnaire de 1905, Rosa Luxembourg mettait en avant les caractéristiques de masse de ces mouvements et tirait la conclusion que "ce n'est pas la grève de masse qui produit la révolution, mais la révolution qui produit la grève de masse." Lénine, lui, tirait l'autre facette des enseignements de cette période en disant des Conseils Ouvriers, surgis de ces mouvements, qu'ils étaient "la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat."
En nous basant sur l'expérience passée, nous devons, nous, mettre en avant dans les luttes actuelles l'unité de ces deux aspects que constituent l'auto-organisation et l'extension des luttes. Dans la mesure où les syndicats peuvent et pourront de moins en moins s'opposer ouvertement aux luttes ouvrières dans tous leurs aspects, et même pourront de moins en moins garder l'initiative et la tête de toutes luttes qui vont surgir brusquement, l'un des aspects essentiels de leur travail de sabotage sera de s'attaquer et de CONTRECARRER LA CLASSE OUVRIERE SUR LES ASPECTS LES PLUS FAIBLES DES MOUVEMENTS. Ainsi, dans un cas, ce sera tout faire pour empêcher l'extension et l'unification des luttes ; dans un autre, pour empêcher l'auto-organisation, le pouvoir souverain des assemblées générales, et cela car seule L'UNITE de ces deux aspects de la lutte permettra à la classe ouvrière de plonger des racines profondes dans le terrain de sa pratique révolutionnaire.
Dans ce travail de sabotage, le "syndicalisme de base" va être l'arme des syndicats dans les luttes à venir. Et cette arme est d'autant, plus pernicieuse qu'elle semble s'adapter, à chaque moment, aux besoins du mouvement, répondre à ses initiatives, et, en fin de compte, exprimer le mouvement lui-même. Sa souplesse, sa capacité d'adaptation peuvent lui faire prendre des formes nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas, et dans lesquelles ne sera pas inscrit le mot "syndicat".
Le danger du syndicalisme ne réside pas seulement dans la forme syndicale, mais également dans son esprit. L'ESPRIT SYNDICAL pèse sur la conscience ouvrière, à la fois comme poids du passé et comme mystification actuelle. Aussi doit-on être particulièrement vigilant par • rapport à ce danger et déceler comment, sous des formes d'apparence ouvrière, il s'exprime. Les conférences des dockers extra-syndicaux ou les tentatives du comité de grève de Rotterdam d'appel à la solidarité financière nous ont montré comment l'esprit, les conceptions syndicales peuvent peser sur des expressions vivantes des luttes actuelles.
LA GAUCHE ET LES SYNDICATS DANS L'OPPOSITION
Le "vide social" laissé par la fin de la perspective électorale et de la "gauche au pouvoir", face au mécontentement profond de la classe ouvrière, exacerbé par l'application des plans d'austérité, explique en grande partie que de toutes les luttes que nous avons vu se dérouler, durant ces deux dernières années, les luttes de Longwy et Denain sont celles qui sont allé le plus loin et ont le mieux POSE les problèmes de la lutte.
La radicalité de ces luttes a à la fois été le produit de la fin de la perspective électorale et a, en réaction, accéléré le passage de la gauche et des syndicats dans l'opposition.
Depuis lors et dans différents pays, nous nous sommes rendus compte du frein et du poids que représentent pour le développement de la lutte (et d'ailleurs pour notre intervention aussi) la gauche et les syndicats dans l'opposition.
Mais la situation actuelle que semblent en apparence bien contrôler la gauche et les syndicats ne doit pas nous amener, malgré' les difficultés que rencontrent les ouvriers dans leurs luttes, à assimiler la période actuelle à la période de recul des années passées. Nous sommes à l'heure actuelle dans une phase où, après avoir repris le chemin de la lutte, la classe ouvrière digère, en quelque sorte, et fait l'expérience de la gauche dans l'opposition.
CONCLUSION
La lutte de classe a repris à l'échelle mondiale ; de l'Iran à l'Amérique, du Brésil à la Corée, de la Suède aux Indes, de l'Espagne à la Turquie, les luttes du prolétariat se sont multipliées depuis les deux dernières années.
Dans les pays sous-développés, avec l'approfondissement terrible de la crise, l'embrigadement de la "libération nationale" tend à diminuer. A peine la Rhodésie (Zimbabwe) accédait-elle à son "indépendance" et à son "auto-détermination noire" que des grèves éclataient pour des augmentations de salaires. Aux yeux de toute l'Amérique Latine, le mythe de "l'homme nouveau de Cuba" vient de subir un dernier coup mortel avec l'exode des populations. Les illusions sur la libération nationale qui ont fait les beaux jours des gauchistes et mobilisé la révolte de la jeunesse des années 60 dans les pays avancés aux cris de "Castro, Ho Chi Min et Che Guevara" sont terminées.
Dans les pays sous-développés on a vu se développer des mouvements qui contiennent la rupture avec l'idéologie nationaliste de la guerre. En Iran, l'énorme mouvement qui a amené à la chute du Shah et au sein duquel le prolétariat a pris une place déterminante, n'a pas été embrigadé derrière l'étendard nationaliste de Khomeiny et de Bani Sadr. Les manifestations où les slogans disaient : "Gardiens de la révolution Savak" en sont une expression très claire. En Corée, ce verrou inter-impérialiste entre les deux blocs, les mouvements des étudiants et surtout des ouvriers tournent le dos à "l'intérêt national" qu'on veut leur imposer.
Le non-embrigadement du prolétariat derrière le char de la nation et de la guerre s'exprime dans des zones où justement la guerre n'a pas cessé depuis trente ans.
Dans un tel contexte mondial, et en l'absence de fractions de la bourgeoisie dans les pays développés qui mobilisent la population et obtiennent un consensus' national, le battage des gouvernements sur la troisième guerre mondiale peut se tourner en son contraire.
En effet, la bourgeoisie dans le, passé n'a pas mobilisé le prolétariat pour la guerre en lui annonçant simplement la guerre. Au contraire, la social-démocratie, avant la première guerre mondiale l'a désarmée derrière les bannières du pacifisme. Avant la seconde, le consensus national s'est fait autour de l'antifascisme, et la classe ouvrière n'était pas consciente que la guerre d’Ethiopie, puis celle d'Espagne étaient des moments préparatoires à la guerre mondiale.
Aujourd'hui, la bourgeoisie qui n'a rien d'autre à proposer, cherche à présenter la guerre comme un fait inéluctable, inscrit dans l'histoire de l'humanité, espérant la faire accepter en habituant les populations à cette idée. Tout le monde sait que l'Afghanistan est un pas en avant vers une troisième guerre mondiale.
Le niveau et le développement de la lutte de classes s'expriment dans les luttes elles-mêmes, et également dans les groupes qui surgissent et manifestent l'effort de prise de conscience de la classe.
Aujourd'hui, la reprise est encore lente et difficile. Contrairement à la première vague de luttes, il y a dix ans, qui a fait revivre l'idée de la révolution dans la société, cette perspective est, aujourd'hui, encore sous-jacente et ne s'exprime pas aussi ouvertement qu'à l'époque, où l'on avait vu surgir une multitude de groupes qui défendaient une orientation révolutionnaire. Mais le mouvement révolutionnaire était alors fortement marqué par les inférences petite-bourgeoises de la révolte estudiantine, ce qui s'est exprimé dans toutes les variations d'activisme, d'ouvriérisme, de modernisme, qu'on a connu et qui avaient en commun une conception facile de la révolution.
De telles influences et illusions ont de moins en moins de place aujourd'hui dans le mouvement prolétarien qui se dessine. La réflexion qui commence à se faire dans la classe ouvrière s'exprime en partie dans les groupes et cercles qu'on tonnait déjà en Italie et qui vont se développer des profondeurs de la classe ouvrière elle-même.
Le processus de développement d'un milieu révolutionnaire sera plus lent et plus dur qu'il y a dix ans, à l'image du mouvement lui-même, mais il sera également plus profond et plus enraciné dans la pratique de la classe ouvrière. C'est pourquoi une de nos orientations essentielles est d'être attentifs et ouverts à ses premières manifestations, quelles que soient leurs confusions.
JUIN 1980.
Conscience et organisation:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme
- 3844 reads
"La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d'ordre, leurs costumes..."
(Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte
Dans la période présente de reprise historique des luttes du prolétariat, celui-ci se heurte, non seulement à tout le poids de l'idéologie secrétée directement et souvent délibérément par la classe bourgeoise, mais également à tout le poids des traditions de ses propres expériences passées. La classe ouvrière, pour parvenir à son émancipation, a absolument besoin d'assimiler ces expériences; c'est uniquement à travers elles qu'elle forge ses armes en vue de l'affrontement décisif qui mettra fin au capitalisme. Cependant, le danger existe pour elle de confondre enseignements de l'expérience et tradition morte, de ne savoir distinguer ce qui,' dans les luttes du passé, dans leurs méthodes et leurs moyens, reste encore vivant, avait un caractère permanent et universel, de ce qui appartient de façon définitive à ce passé, n'était que circonstanciel et temporaire.
Comme Marx l'a souvent souligné, ce danger n'a pas épargné la classe ouvrière de son temps, celle du siècle dernier. Dans une société en évolution rapide, le prolétariat a traîné longtemps avec lui le boulet des vieilles traditions de ses origines, les vestiges des sociétés de compagnonnage, ceux de l'épopée babouviste ou de ses combats aux cotés de la bourgeoisie contre le féodalisme. C'est ainsi que la tradition sectaire, conspirative ou républicaine d'avant 1848 continue à peser dans la Première Internationale fondée en 1864. Cependant, malgré ses mutations rapides, cette époque se situe dans une même phase de la vie de la société : celle de la période ascendante du mode de production capitaliste. L'ensemble de cette période détermine4 pour les luttes de la classe ouvrière des conditions bien spécifiques : la possibilité d'arracher des améliorations réelles et durables de ses conditions de vie à un capitalisme prospère, mais l'impossibilité de détruire ce système justement à cause de sa prospérité.
L'unité de ce cadre donne aux différentes étapes du mouvement ouvrier du 19ème siècle un caractère continu : c'est progressivement que s'élaborent et se perfectionnent les méthodes et les instruments du combat de classe, en particulier l'organisation syndicale. A chacune de ces étapes, les ressemblances avec l'étape antérieure l'emportent sur les différences. Dans ces conditions, le boulet de la tradition ne pèse pas trop lourd pour les ouvriers de ce temps : pour une bonne part, le passé montre la voie à suivre.
Mais cette situation change radicalement à l'aube du 20ème siècle, la plupart des instruments que s'est forgée la classe durant des décennies ne lui servent plus à rien, pire, ils se retournent contre elle et deviennent des armes du capital. Il en est ainsi des syndicats, des grands partis de masse, de la participation aux élections et au Parlement. Et cela, parce que le capitalisme est entré dans une phase complètement différente de son évolution celle de sa décadence. Le cadre du combat prolétarien en est complètement bouleversé : désormais la lutte pour des améliorations progressives et durables au sein de la société perd sa signification. Non seulement le capitaliste aux abois ne peut plus rien accorder, mais ses convulsions remettent en cause nombre des conquêtes prolétarienne du passé face a un système moribond, la seule véritable conquête que le prolétariat puisse obtenir est de le détruire.
C'est la première guerre mondiale qui signe cette coupure entre les deux périodes de vie du capitalisme. Les révolutionnaires, et c'est ce qui les fait révolutionnaires, prennent conscience de l'entrée du système dans sa phase de déclin.
"Une nouvelle époque est née. L'époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement interne. L'époque de la révolution communiste du prolétariat" proclame en 1919 l'Internationale Communiste dans sa plate-forme. Cependant, dans leur majorité, les révolutionnaires restent marqués par les traditions du passé. Malgré son immense contribution, la Troisième Internationale est incapable de pousser jusqu'au bout les implications de son analyse.. Face a la trahison des syndicats, elle ne propose pas de les détruire mais de les reconstruire. Constatant "que les réformes parlementaires ont perdu toute importance pratique pour les classes laborieuses" et que "le centre de gravité de la vie politique est complètement et définitivement sorti du Parlement" (Thèses du 2ème congrès), l'Internationale Communiste n'en continue pas moins de prôner la participation à cette institution. Ainsi, la constatation faite par Marx en 1852, se confirme magistralement. Mais également tragiquement. Après avoir provoqué en 1914.1a débandade du prolétariat face à la guerre impérialiste, le poids du passé est le principal responsable de l'échec de la vague révolutionnaire commencée en 1917 et de la terrible contre-révolution qui l'a suivie pendant un demi-siècle.
Si elle était déjà un handicap pour les luttes du passé, la "tradition de toutes les générations mortes" est un ennemi encore bien plus redoutable des luttes de notre époque. Comme condition de sa victoire, il appartient au prolétariat de s'arracher les vieux oripeaux qui lui collent à la peau afin qu'il puisse revêtir la tenue appropriée aux nécessités que la "nouvelle époque" du capitalisme impose à son combat. Il lui appartient de bien comprendre les différences qui séparent la période ascendante de la société capitaliste et sa période de décadence, tant du point de vue de la vie du capital que des méthodes et des buts de sa propre lutte.
Le texte qui suit se veut une contribution à cette compréhension. Sa présentation, bien qu'un peu inhabituelle, nous a cependant paru la plus apte à mettre en évidence tant l'unité qui existe au sein de chacune des deux périodes entre les diverses expressions de la vie de la société que la différence souvent considérable qui sépare ces expressions d'une époque à l'autre.
LA NATION
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
Une des caractéristiques du 19ème siècle est la constitution de nouvelles nations (Allemagne, Italie,...) ou la lutte acharnée pour celles-ci (Pologne, Hongrie,...). Ce n'est nullement un fait fortuit, mais correspond à la poussée exercée par l'économie capitaliste en plein essor qui trouve dans la nation le cadre le plus approprié à son développement. A cette époque, l'indépendance nationale a, un sens véritable : elle s'inscrit dans le sens du développement des forces productives et dans celui de la destruction des empires féodaux (Russie, Autriche) qui sont les bastions de la réaction.
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
Au 20ème siècle, la nation est devenue un cadre trop étroit pour contenir les forces productives. Au même titre que les rapports de production capitalistes, elle devient un véritable carcan qui entrave le développement de celles-ci. Par ailleurs, l'indépendance nationale devient un leurre dès lors que l'intérêt bien compris de chaque capital national lui commande de s'intégrer dans un des deux grands blocs impérialistes et donc de renoncer à cette indépendance. Les prétendues "indépendances nationales" du 20ème siècle se résument au passage des pays d'une zone d'influence à une autre.
LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES UNITES CAPITALISTES
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
Un des phénomènes typiques de la phase ascendante du capitalisme est son développement inégal suivant les pays et les conditions historiques particulières rencontrées par chacun d'entre eux. Les pays les plus développés montrent la voie aux autres pays dont le retard ne constitue pas nécessairement un handicap insurmontable. Au contraire, la possibilité existe pour ces derniers de rattraper ou même de dépasser les premiers. C’est même là une règle quasi générale :
"Dans le cadre général de cette ascension prodigieuse, l'augmentation de la production industrielle prit dans les divers pays intéressés des proportions extrêmement variables. C'est dans les Etats industriels européens les plus avancés avant 1860 que l'on observe durant la période suivante l'accroissement le moins rapide. La production anglaise tripla "seulement", la production française quadrupla, alors que la production allemande passa du simple au septuple et qu'en Amérique, la production de 1913 fut plus de douze fois supérieure à celle de 1860. Ces différences de cadences provoquent le bouleversement total de la hiérarchie des puissances industrielles entre 1860 et 1913.
Vers 1880, l'Angleterre perd au profit des Etats unis la première place dans la production mondiale. Au même moment, l'Allemagne surclasse la France. Vers 1890, l'Angleterre, dépassée par l'Allemagne, rétrograde au troisième rang".
Fritz Sternberg. (Le conflit du siècle. Ed. du Seuil. p 1314)
A la même période, un autre pays se hisse au rang de puissance industrielle moderne : le Japon, alors que la Russie connaît un processus d'industrialisation très rapide mais qui sera étouffé par l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence.
Cette aptitude pour des pays arriérés de rattraper leur retard résulte des raisons suivantes :
1) leurs marchés intérieurs offrent de larges possibilités de débouchés et partant de développement pour le capital industriel. L'existence de larges secteurs de production pré capitalistes (artisanale et surtout agricole) relativement prospères y constituent ce sol nourricier indispensable à la croissance du capitalisme.
2) Leur utilisation du protectionnisme contre les marchandises moins chères des pays plus développés leur permet momentanément de préserver, à l'intérieur de leurs frontières, un marché pour leur propre production nationale.
3) A l’échelle mondiale, il existe un vaste marché extra-capitaliste, en particulier dans les territoires coloniaux en cours de conquête, dans lequel se déverse le "trop plein" des marchandises manufacturées des pays industriels.
4) La loi de l'offre et de la demande joue en faveur d'une possibilité réelle des pays les moins développés. En effet, dans la mesure où, globalement, pendant cette période, la demande dépasse l'offre, le prix des marchandises sont déterminées par les coûts de production les plus élevés et qui sont ceux des pays les moins développés, ce qui permet au capital de ces pays de réaliser un profit permettant une accumulation réelle (alors que les pays les plus développés encaissent des surprofits).
5) Les dépenses militaires, pendant la période ascendante du capitalisme sont des frais généraux relativement limités et qui sont facilement compensés et même rentabilisés par les pays industriels développés sous forme, notamment, de conquêtes coloniales.
6) Au 19ème siècle, le niveau de la technologie, même s'il représente un progrès considérable par rapport à la période antérieure, n'exige pas l'investissement de masses considérables de capital.
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
La période de décadence du capitalisme se caractérise par l'impossibilité de tout surgissement de nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n'ont pas réussi leur "décollage" industriel avant la 1ère guerre mondiale sont, par la suite, condamnés à stagner dans le sous-développement total, ou à conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui "tiennent le haut du pavé". Il en est ainsi,-de grandes nations comme l'Inde ou la Chine dont "l'indépendance nationale" ou même la prétendue "révolution" (lire l'instauration d'un capitalisme d'Etat draconien) ne permettent pas la sortie du sous-développement et du dénuement. Même l’URSS n'échappe pas à la règle, les terribles sacrifices imposés à la paysannerie et surtout à la classe ouvrière de ce pays, l'utilisation massive d'un travail ,pratiquement gratuit dans les camps de concentration, la planification et le monopole du commerce extérieur présentés ,par les trotskistes comme de "grands acquis ouvriers" et le signe de "l'abolition du capitalisme", le pillage économique systématique des pays de son glacis d'Europe centrale, toutes ces mesures n'ont pas suffi à l'URSS pour accéder au peloton des pays pleinement industrialisés, pour faire disparaître a l'intérieur de ses frontières des marques tenaces de sous-développement et d'arriération (cf. l'article sur "La crise capitaliste dans les pays de l'Est").
Cette incapacité de surgissement de nouvelles grandes unités capitalistes s'exprime entre autres dans le fait que les six plus grandes puissances industrielles d'aujourd'hui (USA, Japon, Russie, Allemagne, France, Angleterre) l'étaient déjà (bien que dans un ordre différent) à la veille de la 1ère guerre mondiale.
Cette incapacité des pays sous-développés à se hisser au niveau des pays les plus avancés s'explique par les faits suivants :
1) Les marchés représentés par les secteurs extra-capitalistes des pays industrialisés sont totalement épuises par la capitalisation de l'agriculture et la ruine presque complète de l'artisanat.
2) Les politiques protectionnistes connaissent au 20ème siècle une faillite totale. Loin de constituer une possibilité de respiration pour les économies moins développées, elles conduisent à l'asphyxie de l'économie nationale.
3) Les marchés extra-capitalistes sont saturés au niveau mondial. Malgré les immenses besoins et le dénuement total du tiers-monde, les économies qui n'ont pu accéder à l'industrialisation capitaliste ne constituent pas un marché solvable parce que complètement ruinées.
4) La loi de l'offre et de la demande joue contre tout développement de nouveaux pays. Dans un monde ou les marchés sont saturés, l’offre dépasse la demande et les prix son détermines par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les pays ayant les coûts de production les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est pas à perte. Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas et, même avec une main d’œuvre très bon marché, ils ne parviennent pas à réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition massive d'une technologie moderne, ce qui a pour résultat de creuser encore plus le fossé qui sépare ces pays des grandes puissances industrielles.
5) Les dépenses militaires deviennent, dans un monde plus en plus livré à la guerre permanente, un poids très lourd, y compris pour les pays les plus développés. Elles conduisent à la faillite économique complète des pays sous-développés.
6) Aujourd'hui, la production industrielle moderne fait appel à une technologie incomparablement plus sophistiquée qu'au siècle dernier et donc à des investissements considérables que seuls les pays déjà développés sont en mesure d'assumer. Ainsi, des facteurs d'ordre technique viennent encore aggraver les facteurs strictement économiques.
LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE CIVILE
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
Dans la période ascendante du capitalisme, il existe une séparation très nette entre la politique -domaine réserve aux spécialistes de la fonction étatique- et l’économique qui reste le domaine du capital et des capitalistes privés. A cette époque, l'Etat, tout en cherchant déjà à se hisser au-dessus de la société, est encore largement dominé par des groupes d'intérêts et des fractions du capital qui s'expriment pour une bonne part au niveau du législatif. Celui-ci domine encore nettement l'exécutif : le système parlementaire, la démocratie représentative est une réalité, un terrain où s'affrontent les divers groupes d'intérêt.
L'Etat, ayant pour charge de maintenir l'ordre social au bénéfice du système capitaliste dans son ensemble et à long terme, il en découle certaines réformes en faveur de la main d’œuvre, contre les excès barbares de l'exploitation ouvrière dont sont responsables les appétits immédiats, insatiables des capitalistes privés (cf. "Bill des 10 heures" en Grande-Bretagne, ainsi que les lois limitant le travail des enfants, etc.).
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
La période de décadence du capitalisme se caractérise par une absorption de la société civile par l'Etat. De ce fait, le législatif, dont la fonction initiale est de représenter la société, perd tout son poids devant l'exécutif qui est le sommet de la pyramide étatique.
Cette période connaît une unification du politique et de l'économique, l'Etat devenant la principale force dans l'économie nationale et sa véritable direction.
Que ce soit par une intégration graduelle (économie mixte) ou par un bouleversement brusque (économie entièrement étatisée), l'Etat cesse d'être un organe de délégation des capitalistes et des groupes pour devenir le capitaliste collectif soumettant à sa férule tous les groupes d’intérêts particuliers.
L'Etat, en tant qu'unité réalisée du capital national, défend les intérêts de celui-ci aussi bien à l'intérieur du bloc d'appartenance que contre le bloc antagoniste. De même, il prend directement à sa charge d'assurer l'exploitation et la soumission de la classe ouvrière.
LA GUERRE
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
Au 19ème siècle, la guerre a, en général, la fonction d'assurer à chaque nation capitaliste une unité et une extension territoriale nécessaires à son, développement. En ce sens, malgré les calamités qu'elle entraîne, elle est un moment de la nature progressive du capital.
Les guerres sont donc, par nature, limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes et comportent les caractéristiques suivantes :
- elles sont de courte durée
- elles provoquent peu de destructions
- elles déterminent, tant pour les vaincus que pour les vainqueurs un nouvel essor.
Ainsi se présentent, par exemple, les guerres franco-allemandes, austro-italienne, austro-prussienne ou de Crimée.
La guerre franco-allemande est un exemple typique de ce genre de guerre :
- elle constitue une étape décisive dans la formation de la nation allemande, c'est à dire la création des bases pour un formidable développement des forces productives et la constitution du secteur le plus important du prolétariat industriel d'Europe (et même du monde si on considère son rôle politique)
- en même temps, cette guerre dure moins d'un an, n'est pas très meurtrière et ne constitue pas, pour le pays vaincu, un réel handicap : après 1871, la France poursuit son développement industriel sur la lancée du Second Empire et conquiert l'essentiel de son empire colonial.
Quant aux guerres coloniales, elles ont pour but la conquête de nouveaux marchés et de réserves de matières premières. Elles relèvent d'une course entre pays capitalistes dans leurs besoins d'expansion pour le partage de nouvelles zones du monde. Elles s'inscrivent donc dans le cadre de l'expansion de l'ensemble du capitalisme et du développement des forces productives mondiales.
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
Dans une période où il ne peut plus être question de formation d'unités nationales viables, où l'indépendance formelle de nouveaux pays résulte essentiellement des rapports entre les grandes puissances impérialistes, les guerres ne relèvent plus des nécessités économiques du développement des forces productives de la société mais essentiellement de causes politiques : le rapport de forces entre les blocs. Elles ont cessé d'être "nationales" comme au 19ème siècle pour devenir impérialistes. Elles ne sont plus des moments de l'expansion du mode de production capitaliste, mais l'expression de l’impossibilité de son expansion.
Elles ne consistent pas dans un partage du monde, mais dans un repartage de celui-ci, dans une situation où, désormais un bloc de pays ne peut développer mais simplement maintenir la valorisation de son capital que directement aux dépens des pays du bloc adverse, avec, comme résultat final, la dégradation de la globalité du capital mondial.
Les guerres sont des guerres généralisées à l'ensemble du monde et ont pour résultat d'énormes destructions de l'ensemble de l'économie mondiale menant à la barbarie généralisée.
Comme celle de 1870, les guerres de 1914 et de 1939 opposent la France et l'Allemagne, mais d'emblée les différences sautent aux yeux et ce sont justement ces différences qui sont à la mesure de l'opposition existant entre la nature des guerres du 19ème siècle et celle des guerres du 20ème :
- d'emblée, la guerre touche l'ensemble de l'Europe pour se généraliser au monde entier,
- c'est une guerre totale qui mobilise pendant des années la totalité de la population et de la machine économique des pays belligérants, qui réduit à néant des décennies de travail humain, qui fauche des dizaines de millions de prolétaires, qui jette dans la famine des centaines de millions d'êtres humains.
Nullement des "cures de jouvence" (comme le prétendent certains), les guerres du 20ème siècle ne sont rien d'autre que les convulsions de l'agonie d'un système moribond.
LES CRISES
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
Dans un monde au développement inégal, avec des marchés internes inégaux, les crises sont marquées par le développement inégal des forces productives dans les différents pays et les différentes branches de production.
Elles sont la manifestation que le marché antérieur se trouve saturé et nécessite un nouvel élargissement. Elles sont donc périodiques (tous les 7 à 10 ans -temps approximatif de l'amortissement du capital fixe-) et trouvent leur solution dans l'ouverture de nouveaux marchés.
Il en découle pour elles les caractéristiques suivantes :
1) Elles éclatent brusquement, en général à la suite d'un krach boursier.
2) Leur durée est courte (de 1 an à 3 ans pour les plus longues).
3) Elles ne sont pas généralisées à tous les pays. C'est ainsi que :
- la crise de 1825 est surtout britannique et épargne la France et l'Allemagne,
- la crise de 1830 est surtout américaine, la France et l'Allemagne y échappent encore,
- la crise de 1847 épargne les USA, et affecte faiblement l'Allemagne,
- la crise de 1866 affecte peu l'Allemagne et celle de 1873 épargne la France.
Par la suite, les cycles industriels tendent à se généraliser à tous les pays développés mais on constate que les USA échappent encore à la récession de 1900-1903 et la France à celle de 1907.
Par contre, la crise de 1913, qui va déboucher sur la première guerre mondiale touche, elle, pratiquement tous les pays.
4) elles ne sont pas généralisées à toutes les branches. Ainsi :
- c'est essentiellement l'industrie du coton qui souffre des crises de 1825 et 1836,
- par la suite, si les textiles souffrent encore des crises, c'est la métallurgie et les chemins de fer qui tendent à être les secteurs les plus affectés (en particulier en 1873).
De même, il n'est pas rare de voir certaines branches connaître un boom important, alors que la récession touche d'autres branches.
5) Elles débouchent sur un nouvel essor industriel (les chiffres de croissance donnés plus haut par Sternberg sont significatifs à cet égard).
6) Elles ne posent pas les conditions pour une crise politique du système, et, encore moins, pour l'explosion d'une révolution prolétarienne.
Sur ce dernier point, il est nécessaire de constater l'erreur commise par Marx, à la suite de l'expérience de 1847-48, quand il écrit en 1850 : "Une nouvelle révolution ne sera possible qu'a la suite d'une nouvelle crise. Mais elle est aussi sûre que celle-ci". (Neue Rheinische Zeitung). Son erreur ne réside pas dans la reconnaissance de la nécessité d'une crise du capitalisme pour que la révolution soit possible, ni dans le fait d'annoncer qu'une nouvelle crise allait survenir (celle de 1857 est bien plus violente encore que celle de 1847) mais dans l'idée que les crises de cette époque étaient déjà des crises mortelles du système.
Par la suite, Marx a évidemment rectifié cette erreur, et c'est justement parce qu'il sait que les conditions objectives de la révolution ne sont pas mûres qu'il se heurte dans l'AIT aux anarchistes qui veulent brûler les étapes, et qu'il met en garde le 9 septembre 1870 les ouvriers parisiens contre "toute tentative de renverser le nouveau gouvernement... (qui) serait une folie désespérée" (Seconde Adresse du Conseil général de l'AIT sur la guerre Franco-allemande).
Aujourd'hui, il faut être anarchiste ou bordiguiste pour s'imaginer que "la révolution est possible à tout moment" ou que ses conditions matérielles existaient déjà en 1848 ou en 1871.
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
Depuis le début du 20ème siècle, le marché est désormais international et unifié. Les marchés intérieurs ont perdu de leur importance (notamment du fait de l'élimination des secteurs précapitalistes). Dans ces conditions, les crises sont la manifestation, non pas de marchés provisoirement trop étroits, mais de l'absence de toute possibilité de leur élargissement mondial. D'ou leur caractère de crises généralisées et permanentes.
Les conjonctures ne sont pas déterminées par le rapport entre la capacité de production et la taille du marché existant à un moment donné, mais par des causes essentiellement politiques : le cycle de guerre-destruction-reconstruction-crise. Dans ce cadre, ce ne sont nullement des problèmes d'amortissement du capital qui déterminent la durée des phases du développement économique mais en grande partie, l'ampleur des destructions subies au cours de la guerre précédente. C'est ainsi qu'on peut comprendre que la durée de l'expansion liée à la reconstruction soit deux fois plus longue (17 ans) après la seconde guerre mondiale qu'après la première (7 ans).
Contrairement au siècle dernier caractérisé par le "laisser faire", l'ampleur des récessions au 20ème siècle est limitée par des mesures artificielles mises en place par les Etats et leurs institutions de recherche pour retarder la crise générale. Il en est ainsi des guerres localisées, du développement des armements et de l'économie de guerre, de l'utilisation systématique de la planche à billets et de la vente à crédit, de l'endettement généralisé, de tout un éventail de mesures politiques qui tendent à rompre avec le strict fonctionnement économique du capitalisme.
Dans ce cadre, les crises du 20ème siècle ont les caractéristiques suivantes :
1) Elles n'éclatent Pas brusquement mais se développent progressivement dans le temps. En ce sens, la crise de 1929 comporte encore à ses débuts certaines caractéristiques des crises du siècle passé (brusque effondrement faisant suite à un krach boursier) qui relèvent, non pas tellement du maintien de conditions économiques similaires à celles d'avant, mais d'un retard des institutions politiques du capital par rapport à la modification de ces conditions. Mais, par la suite, l'intervention massive de l'Etat (New Deal aux USA, production de guerre en Allemagne....,) étale ses effets sur une décennie.
2) Une fois qu'elles ont débuté, elles se caractérisent par leur longue durée. Ainsi, alors que le rapport récession/prospérité était d'environ 1 à 4 au 19ème siècle (2 années de crise sur un cycle de 10 ans), le rapport entre la durée du marasme et celle de la reprise passe à 2 au 20ème siècle. En effet, entre 1914 et 1980, on compte 10 années de guerre généralisée (sans compter les guerres locales permanentes), 32 années de dépression (1918-22, 192939, 194550, 1967-80), soit au total 42 années de guerre et de crise, contre seulement 24 années de reconstruction (1922-29 et 1950-67). Et le cycle de la crise n'est pas encore terminé !...
Alors qu'au 19ème siècle, la machine économique était relancée par ses propres forces à l'issue de chaque crise, les crises du 20ème siècle n'ont du point de vue capitaliste d'autre issue que la guerre généralisée.
Râles d'un système moribond, elles posent pour le prolétariat la nécessité et la possibilité de la révolution communiste.
Le 20ème siècle est bien "l'ère des guerres et des révolutions" comme l'indiquait, à sa fondation l'Internationale Communiste.
LA LUTTE de CLASSE
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
Les formes que prend la lutte de classe au 19ème siècle est déterminée à la fois par les caractéristiques du capital de cette époque et par celles de la classe ouvrière elle-même :
1) Le capital du 19ème siècle est encore très éparpillé entre de nombreux capitaux : rares sont les usines qui dépassent 100 ouvriers, beaucoup plus fréquentes sont les entreprises à caractère semi artisanal. Ce n'est que dans la seconde partie du 19ème siècle qu'on voit, avec l'essor des chemins de fer, l'introduction massive du machinisme, la multiplication des mines, se développer la prédominance de la grande industrie telle qu'on peut la connaître aujourd'hui.
2) Dans ces conditions, la concurrence s'exerce entre un grand nombre de capitalistes.
3) Par ailleurs, la technologie est encore peu développée. La main-d’œuvre peu qualifiée, se recrutant largement à la campagne, est en général de première génération. La plus qualifiée se trouve dans l'artisanat.
4) L’exploitation est basée sur l’extraction de plus value absolue : longue journée de travail, salaire très bas.
5) Chaque patron, ou chaque usine, affronte directement et isolément les ouvriers qu'il exploite;
Il n'y a pas d'unité patronale organisée : ce n'est que dans le troisième tiers du siècle que se développent des syndicats patronaux. Dans ces conflits séparés, il n'est pas rare de voir des capitalistes spéculer sur les difficultés d'une usine concurrente en conflit, en profiter pour s'approprier sa clientèle.
6) L'Etat en général, se tient en dehors de ces conflits. Il n’intervient qu'en dernier ressort, lorsque le conflit risque de troubler "l'ordre public".
Du côté de la classe ouvrière, on peut observer les caractéristiques suivantes :
1) Comme le capital, elle est très dispersée. C'est une classe en cours de formation. Ses secteurs les plus combatifs sont très liés à l'artisanat et sont donc très marqués par le corporatisme.
2) Sur le marché du travail, la loi de l'offre et la demande joue à fond et directement. Ce n'est que dans les moments de haute conjoncture, d'expansion rapide de la production qui provoque un manque d'ouvriers, que ces derniers peuvent opposer une résistance efficace aux empiètements du capital et même arracher des avantages substantiels sur les salaires et les conditions de travail.
Dans les moments de basse conjoncture, ils perdent de leur force, se démoralisent et se laissent reprendre une partie des avantages acquis.
Expression de ce phénomène, la fondation de la Première Internationale comme celle de la Seconde Internationale, qui expriment un point élevé de la combativité ouvrière, prennent place en pleine prospérité économique (1864 pour l'AIT, 3 ans avant l'éclatement de la crise de 1867, 1889 pour l'Internationale Socialiste, à la veille de la crise de 1890-93).
3) Au 19ème siècle, l'émigration constitue un exutoire pour le chômage et la terrible misère qui s’abattent périodiquement sur le prolétariat à l'occasion des crises cycliques. La possibilité pour des secteurs importants de la classe de fuir vers le nouveau monde quand les conditions de vie deviennent trop insupportables dans les métropoles capitalistes d'Europe est un élément qui permet d'éviter que des crises ne provoquent des situations explosives comme celle de juin 1848. Ainsi, au 19ème siècle, a travers le phénomène de l'émigration lui aussi, les capacités d'expansion du capitalisme sont un garant de la stabilité d'ensemble du système.
4) Ces conditions particulières, tant du point de du capital que de la classe ouvrière, conditionnent la nécessité d'organisations de résistance économique pour les ouvriers : les syndicats qui ne peuvent prendre que la forme locale, professionnelle d'une minorité ouvrière dont la lutte -la grève- est particularisée, longtemps préparée a l’avance, attend en général une situation de haute conjoncture pour affronter telle ou telle branche du capital ou même une seule usine. Malgré toutes ces limitations, les syndicats n'en sont pas moins d'authentiques organes de la classe ouvrière, indispensables dans 1a lutte économique contre le capital, mais également comme foyers de vie de la classe, comme écoles de la solidarité où les ouvriers comprennent leur appartenance à une même communauté, comme "écoles du communisme", suivant l'expression de Marx, propices à la propagande révolutionnaire.
5) Au 19ème siècle, les grèves sont en général de longue durée; c'est là une des conditions, de leur efficacité elles mettent les ouvriers à l'épreuve de la famine, d'où la nécessité de préparer d'avance des fonds de soutien, des "caisses de résistance" et d'avoir recours à la solidarité financière des autres ouvriers dont le maintien au travail peut être un élément positif pour l'efficacité de la lutte des ouvriers en grève (en menaçant les marchés du capitaliste en conflit par exemple).
6) Dans ces conditions, la question de l'organisation préalable, matérielle, financière du prolétariat devient la question primordiale pour pouvoir mener les luttes et bien souvent prime sur le contenu, sur les gains réels qu'elle permet d'obtenir, pour devenir un objectif en soi (comme le constatait Marx en répondant aux bourgeois qui ne comprenaient pas que les ouvriers puissent dépenser plus d'argent pour leur organisation que celle-ci ne leur permettait d'arracher au capital).
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
La lutte de classes, dans le capitalisme décadent, est déterminée, du point de vue du capital par les caractéristiques suivantes :
1) Le capital a atteint un haut niveau de concentration et de centralisation.
2) La concurrence est plus réduite qu'au 19ème siècle du point de vue du nombre mais elle est plus âpre.
3) La technologie est hautement développée. La main d’œuvre est de plus en plus qualifiée, les tâches les plus simples tendant à être exécutées par des machines. Il y a génération continue de la classe ouvrière : celle-ci ne se recrute plus que très faiblement la campagne mais essentiellement parmi les enfants d'ouvriers.
4) La base dominante de l'exploitation est l'extraction de plus-value relative (augmentation des cadences et de la productivité).
5) Il existe, face à la classe ouvrière, une unité et une solidarité bien plus grandes qu'auparavant entre les capitalistes. Ceux-ci ont créé des organisations spécifiques afin de ne plus affronter individuellement la classe ouvrière.
6) L'Etat intervient directement dans les conflits sociaux soit, comme capitaliste lui-même, soit comme "médiateur", c'est à dire élément de contrôle, tant sur le plan politique qu'économique de l'affrontement afin de maintenir celui-ci dans les limites de "l'acceptable", soit, tout simplement, comme agent de la répression.
Du côté ouvrier, on peut relever les traits suivants :
1) La classe ouvrière est unifiée et qualifiée, d'un niveau intellectuel élevé. Elle n'a plus que des liens très lointains avec l'artisanat. Le centre de la combativité se trouve donc dans les grandes usines modernes et la tendance générale des luttes est au dépassement du corporatisme.
2) Contrairement à la période précédente, c'est dans les moments de crise de la société que les grandes luttes décisives éclatent et se développent (les révolutions de 1905 et 1917 en Russie font suite à cette forme aiguë de la crise qu'est la guerre, la grande vague internationale de luttes de 1917 à 1923 prend place à l'intérieur d'une période de convulsions -guerre puis crise économique- pour s'épuiser avec la reprise liée à la reconstruction).
C'est pour cela, que, contrairement aux deux précédentes, la Troisième Internationale est fondée en 1919 au plus profond de la crise de la société à laquelle correspond le moment de plus forte combativité prolétarienne.
3) Les phénomènes d'émigration économique auxquels on assiste au 20ème siècle, notamment dans la seconde après guerre, ne sont, tant dans leur origine que dans leurs implications, nullement comparables aux grands courants du siècle précédent. Exprimant, non l'expansion historique du capital vers de nouveaux territoires, mais au contraire l'incapacité du développement économique des anciennes,/ colonies dont les ouvriers et paysans fuient la misère vers les métropoles que les ouvriers quittaient par le passé, ils n’offrent aucune possibilité d’exutoire au moment de la crise aiguë du système. La reconstruction terminée, l'émigration n'offre plus aucune possibilité de surmonter le chômage qui s'étend aux pays développés comme il touchait antérieurement les pays sous-développés. La crise met la classe ouvrière au pied du mur sans lui laisser la moindre échappatoire.
4) L'impossibilité d'améliorations durables pour la classe ouvrière lui interdit la constitution d'une organisation spécifique, permanente, basée sur la défense de ses intérêts économiques. Les syndicats perdent la fonction pour laquelle ils avaient surgi : ne pouvant plus être des organes de la classe, et encore moins des "écoles du communisme", ils sont récupérés par le capital et intégrés à l'Etat, phénomène qui est facilité par la tendance générale de cet organe à absorber la société civile.
5) La lutte prolétarienne tend à dépasser le cadre strictement économique pour devenir sociale, s'affrontant directement à l'Etat, se politisant et exigeant la participation massive de la classe C'est ce que relève dès 1906 Rosa Luxemburg, a la suite de la première révolution russe, dans "Grèves de masse, parti et syndicats". C'est la même idée qui est contenue dans la formule de Lénine : "Derrière chaque grève se profile le spectre de la révolution".
6) Un tel type de lutte, propre à la période de décadence, ne peut se préparer d'avance sur le plan organisationnel. Les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser. Elles se situent plus sur un plan local ou territorial que sur un plan professionnel, leur processus est plus horizontal que vertical : ce sont là des caractéristiques qui préfigurent l'affrontement révolutionnaire où ce ne sont pas des catégories professionnelles ou les ouvriers de telle ou telle entreprise qui agissent, mais la classe ouvrière comme un tout à l'échelle d'une unité géopolitique (province, pays).
De même, la classe ouvrière, en vue de ses luttes, ne saurait se doter d'avance de moyens matériels Compte-tenu de la façon dont est organisé le capitalisme, la longueur d'une grève n’est en général pas une arme efficace (l'ensemble des capitalistes pouvant venir en aide à celui des leurs qui est affecté). En ce sens, le succès des grèves ne dépend pas des fonds financiers recueillis par les ouvriers mais bien fondamentalement de leur capacité d'élargissement, élargissement qui seul peut créer une menace pour l'ensemble du capital national.
Dans la période actuelle, la solidarité à l'égard des travailleurs en lutte ne réside plus dans le soutien financier de la part d'autres secteurs ouvriers (il s'agit là d'un ersatz de solidarité qui peut être mis en avant par les syndicats pour détourner les travailleurs des véritables méthodes de lutte) mais par l'entrée en lutte de ces autres secteurs.
7) De même que l'organisation ne précède pas la lutte mais se crée au cours de la lutte elle-même, l'auto-défense du prolétariat, son armement, ne se préparent pas d'avance, en entassant quelques fusils dans des caves comme le pensent des groupes comme le GCI. Ce sont des étapes dans un processus qu'on ne peut atteindre sans être passé par les précédents.
LE ROLE DE L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME
L'organisation des révolutionnaires, produit de la classe et de sa lutte, est une organisation-minoritaire constituée sur la base d'un programme. Sa fonction comporte :
1) l'élaboration théorique de la critique du' monde capitaliste,
2) l'élaboration du programme de la finalité historique de la lutte de classes,
3) la diffusion de ce programme dans la classe,
4) la participation active à tous les moments de la lutte immédiate de la classe et sa défense con tre l'exploitation capitaliste.
A ce dernier titre, elle acquiert, au 19ème siècle une fonction d'initiation et d'organisation. active des organes unitaires, économiques, de la classe à partir d'un certain degré de développement des organismes embryonnaires produits parla lutte antérieure.
De par cette fonction, et étant donné le contexte de la période -la possibilité de réformes et la tendance à la propagation des illusions réformistes au sein de la classe- l'organisation des révolutionnaires (les partis de la Seconde Internationale) est, elle-même, entachée du réformisme qui finit par brader le but final révolutionnaire pour des réformes immédiates. Elle en est conduite à faire du maintien et du développement des organisations économiques (les syndicats) leur tache pratiquement unique (l'économisme).
Seule, une minorité, au sein de l'organisation des révolutionnaires résistera à cette évolution et défendra l'intégrité du programme historique de la révolution socialiste. Mais, en même temps, une partie de cette minorité, par réaction contre l'évolution réformiste, tend à développer une conception étrangère au prolétariat et selon laquelle le parti est l'unique siège de la conscience, le détenteur d'un programme achevé dont la fonction serait, suivant le schéma qui prévaut pour la bourgeoisie et ses partis de "représenter" la classe, d'être, de droit, appelé à constituer l'organe de décision de celle-ci, notamment pour la prise du pouvoir. Cette conception, le substitutionnisme, si elle imprègne une majorité parmi les éléments de la gauche révolutionnaire de la Seconde Internationale, trouve son principal théoricien avec Lénine (Que faire?, Un pas en avant, deux pas en arrière).
PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
Dans la période de décadence du capitalisme, l'organisation des révolutionnaires conserve les caractéristiques générales de la période précédente avec cette donnée nouvelle que la défense des intérêts immédiats ne peut plus être séparée du but final désormais mis à l'ordre du jour de l'histoire.
Par contre, en accord avec ce dernier fait, elle perd la fonction d'organiser la classe, ce qui ne peut-être que l’œuvre de la classe elle-même en lutte aboutissant à un type d'organisation nouvelle, à la fois économique de résistance et de défense immédiate- et politique, s'orientant vers la prise du pouvoir : les conseils ouvriers.
Reprenant à son compte la vieille devise du mouvement ouvrier : "l'émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes", elle ne peut que combattre toute conception substitutionniste comme conception se rattachant à une vision bourgeoise de la révolution. En tant qu'organisation, la minorité révolutionnaire n'a pas à charge d'élaborer préalablement 'une plate-forme de revendications immédiates pour mobiliser la classe. Elle a, par contre, la possibilité de se montrer un participantes plus résolus aux luttes, de propager une orientation générale en dénonçant les agents et les idéologues de la bourgeoisie au sein de la classe. Dans la lutte, elle met l'accent sur la nécessité de la généralisation, seule voie qui mène à son aboutissement inéluctable : la révolution. Elle n'est ni un spectateur ni un porteur d'eau.
L'organisation des révolutionnaires a pour but de stimuler toute apparition de cercles ou de groupes ouvriers et de travailler en leur sein. Pour ce faire, elle doit les reconnaître comme des formes éphémères et immatures répondant, en l'absence de toute possibilité de création de syndicats, à une nécessité réelle de regroupement et de discussion existant dans la classe dans l'attente de pouvoir se donner l'organisation unitaire achevée : les conseils.
En accord avec la nature de tels cercles, l'organisation des révolutionnaires doit combattre toute tentative de les créer de façon artificielle, toute prétention d'en faire des courroies de transmission des partis, toute conception tendant à en faire des embryons de conseils ou autres organismes politico-économiques qui ne peuvent que paralyser le développement d'un processus de maturation de la conscience et de l'organisation unitaire de la classe. Ces cercles n'ont de valeur et n'accompliront leur fonction, importante mais transitoire, que dans la mesure où ils éviteront de s'enfermer sur eux-mêmes en se donnant des plates-formes bancales, afin de rester un milieu de rencontre ouvert à tous les ouvriers intéressés aux problèmes de leur classe.
Enfin, dans la situation d'extrême dispersion des révolutionnaires, suite à la période de contre-révolution qui a pesé pendant un demi-siècle sur le prolétariat, l'organisation des révolutionnaires a pour tâche d’œuvrer activement au développement d'un milieu politique sur le plan international, d'établir des débats et des confrontations ouvrant le processus vers la constitution du parti politique international de la classe.
La plus profonde contre-révolution de l'histoire du mouvement ouvrier a constitué une épreuve terrible pour l'organisation des révolutionnaires elle-même. N'ont pu survivre que les courants qui, contre vents et marées ont su préserver les principes fondamentaux du programme communiste. Cependant, cette attitude indispensable en soi, la méfiance à l'égard de toutes les "conceptions nouvelles" qui, en général, étaient le véhicule de l'abandon du terrain de la classe sous la poussée de l'idéologie bourgeoise triomphante, ont souvent eu pour effet d'empêcher les révolutionnaires de comprendre dans toute leur étendue les changements qui étaient intervenus dans la vie du capitalisme et la lutte de la classe ouvrière. La forme la plus caricaturale de ce phénomène se trouvant dans la conception qui considère comme "invariante" les positions de classe, pour qui le programme communiste "surgi d'un bloc en 1848, n'a plus besoin d'être modifié d'une virgule".
Si elle doit constamment se garder des conceptions modernistes qui, souvent, ne font que proposer des vieilles marchandises avec un nouvel emballage, l'organisation des révolutionnaires doit, pour être à la hauteur des tâches pour lesquelles elle a surgi dans la classe, se montrer capable de comprendre ces changements dans la vie de la société et les implications qu'ils ont pour l'activité de la classe et de son avant-garde communiste.
Face au caractère manifestement réactionnaire de toutes les nations, celle-ci doit combattre tout soutien aux mouvements dits "d'indépendance nationale". Face au caractère impérialiste de toutes les guerres, elle doit dénoncer toute participation à celles-ci sous quelque prétexte que ce soit. Face à l'absorption par l'Etat de la société civile, à l'impossibilité de réformes réelles du capitalisme, elle doit combattre toute participation aux parlements et aux mascarades électorales.
Face aux conditions économiques, sociales et politiques nouvelles dans lesquelles se situe la lutte d de classe aujourd'hui, l'organisation des révolutionnaires doit combattre toute illusion dans la classe de redonner vie à des organisations qui ne peuvent être que des obstacles à sa lutte -les syndicats- et mettre en avant les méthodes et mode d'organisation des luttes déjà expérimentés par la classe lors de la première vague révolutionnaire de ce siècle : la grève de masse, les assemblées générales, l'unité du politique et de l'économique, les conseils ouvriers.
Enfin, pour être en mesure d'accomplir pleinement son rôle de stimulation des luttes, d'orientation vers leur issue révolutionnaire, l'organisation de des communistes doit renoncer aux taches qui ne sont plus les siennes "d'organiser" ou de "représenter" la classe.
Les révolutionnaires qui prétendent que "rien n'a changé depuis le siècle dernier" tendent à vouloir donner au prolétariat le comportement de Babine, ce personnage d'un conte de Tolstoï qui répétait face à toute nouvelle rencontre ce qu'on lui avait dit qu'il aurait dû dire face à sa rencontre précédente, ce qui lui valait à chaque fois de se faire rosser copieusement. Aux fidèles d'une église, il adressait les paroles qu'il aurait dû prononcer devant le Diable, à l'ours il parlait comme on doit le faire à un ermite. Mais le malheureux Babine paie sa sottise de sa vie.
Une telle "mise à jour" des positions et du rôle des révolutionnaires ne constitue nullement un "abandon" ou une "révision" du marxisme mais au con traire une réelle fidélité à ce qui fait son essence. C'est cette capacité de comprendre, contre les mencheviks, les conditions nouvelles de la lutte et les exigences qui en découlent pour le programme qui a permis à Lénine et aux bolcheviks de contribuer activement et de façon décisive à la révolution d'octobre 1917.
De même, Rosa Luxemburg se place sur ce même point de vue révolutionnaire lorsqu'elle écrit en 1906 contre les "orthodoxes" de son parti :
"S’il est vrai que la révolution russe oblige à réviser fondamentalement l'ancien point de vue marxiste à l'égard de la grève de masse, pourtant, seul le marxisme, ses méthodes et ses points de vue généraux remportent à cet égard la victoire sous une nouvelle forme".
(Grève de masse, parti et syndicats. Ch.1.)
Heritage de la Gauche Communiste:
Le parti défiguré : la conception bordiguiste
- 3631 reads
La Troisième Conférence Internationale des groupes de la Gauche Communiste s'est échouée sur un banc de sable. Formellement c'était la question du parti qui en était la cause.
Il ne fait de doute pour personne que ce n'était là qu'un prétexte. La vérité est que Battaglia Comunista et la Communist Workers Organisation se sentaient mal à l'aise depuis la deuxième Conférence, et plus soucieux des intérêts immédiats de leur groupe -caractéristique de l'esprit de secte- que de l'importance que peuvent présenter dans la période présente de montée de la lutte de classe, des Conférences Internationales de groupes communistes. Ils ont tout fait pour les faire échouer.
Voilà qui fera grand plaisir aux bordiguistes du "P.C.International" qui ont depuis toujours prétendu qu'il n'y a rien de bon à attendre des Conférences entre groupes communistes, et d'autant moins que le Parti International Unique existe depuis 1943, c'est à dire leur petit groupe. Logiques avec eux-mêmes, les bordiguistes considèrent qu'ils sont le seul groupe communiste du monde. Toujours "logiques" avec leur postulat suivant lequel le Programme de la révolution communiste a été défini en 1848 par Marx et que depuis il ne peut varier d'un iota, ils affirment en outre que le parti est unique (comme Dieu) et monolithique (comme le parti de Staline) ([1] [114]), les bordiguistes refusent toute discussion, avec qui que ce soit, exigeant l'adhésion individuelle pure et simple à leur parti de tous ceux qui entendent militer pour le communisme.
Battaglia Comunista semble plus ouvert à la discussion. Mais c'est là plus apparence que réalité. La discussion, pour BC, n'est pas une confrontation de positions, mais l'exigence de le reconnaître comme le VRAI parti, seul habilité à parler au nom de la Gauche Italienne. Pas plus que Programma, il ne comprend le processus de regroupement des groupes communistes, dispersés par la pression de 50 ans de contre-révolution, ce processus qui s'ouvre avec la montée de la lutte de classe du prolétariat, et qui se déroule sur la base d'un réexamen critique des positions énoncées au cours de la dernière vague révolutionnaire et l'expérience qui s'en est suivie, permettant le dépassement des immaturités et des erreurs d'autrefois, et déterminant une plus grande cohérence théorico-politique rendant possible une plus grande cohésion et unité d'un futur parti communiste international.
Cet article n'a pas pour objectif de revenir sur les incompréhensions des nombreux "héritiers" de ce que fut le courant de la Gauche Communiste en ce qui concerne le processus inévitable de regroupement des forces communistes et la place qu'occupent dans ce processus les conférences internationales. Nous avons traité ce sujet dans de nombreux textes parus dans notre presse, et notamment dans le dernier numéro de la revue internationale. Nous nous bornerons ici à une question particulière, mais de la plus haute importance : la question du parti, sa fonction, la place qu'il occupe dans le développement de la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie et le système capitaliste.
LE CONSEILLISME ET LE PARTI : DIVERGENCES REELLES ET DIVERGENCES FACTICES
Pour pouvoir avancer dans la discussion sur le parti, il faut avant tout savoir et vouloir établir correctement le cadre du débat. La plus improductive méthode de mener le débat consiste dans la malhonnête façon d'effacer les cadres distinctifs qui délimitent ce qu'on appelle le conseillisme d'avec les partisans convaincus de la nécessité du parti. En brandissant à tort et à travers l'épouvantail du conseillisme contre tous ceux qui ne partagent pas la conception bolchevik du parti, et surtout sa caricature outrée des bordiguistes, on ne fait qu'entretenir et développer la confusion aussi bien sur ce qu'est le conseillisme que sur la notion du parti.
Le mouvement conseilliste surgit dans les années tourmentées de la première vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale. Il partage avec la Gauche Communiste (sauf celle d'Italie) l'idée fondamentale que non seulement le mouvement syndical tel qu'il existe a cessé d'être une organisation de défense de la classe ouvrière, mais que la structure même de l'organisation syndicale ne correspond plus aux nécessités de la lutte du prolétariat dans la nouvelle période historique ouverte avec la guerre et posant à l'ordre du jour la révolution communiste. Les taches quo se posent à la classe ouvrière dans cette période nouvelle exigent un nouveau type d'organisation qui ne soit pas fondée sur des critère particuliers, professionnels, corporatistes et strictement de défense économique, mais qui soit réellement unitaire, ouverte à l'activité dynamique de toute la classe, ne séparant pas la défense des intérêts économiques immédiats de son but historique : émancipation de la classe ouvrière et destruction du capitalisme. Une telle organisation ne peut être autre que les Conseils d'usine coordonnés et centralisés.
Ce qui a séparé les conseillistes de la Gauche Communiste, c'est que les premiers, non seulement nient toute utilité à l'existence d'un parti politique, mais qu'ils ont considéré toute existence de parti comme nuisible à la lutte de classe. Les .conseillistes préconisaient la dissolution des partis au sein de l'organisation unitaire : les conseils. C'est ce point qui les a séparés de la Gauche Communiste et les a conduit à rompre avec le KAPD.
Comme tel, le conseillisme représente une réactualisation de l'anarcho-syndicalisme d'avant-guerre. Et tout comme l'anarcho-syndicalisme, qui était une réaction épidermique contre l'électoralisme et l'opportunisme de la social-démocratie, le conseillisme est une réaction contre les tendances ultra-partidistes dans l'organisation communiste qui commentait par identifier et confondre la dictature du prolétariat avec celle du parti, et finit par substituer purement et simplement l'une à l'autre.
Les ultra-partidistes ou néo-bolcheviks se plaisent à esquiver la critique de leurs conceptions ultra-léninistes, en insistant lourdement sur le fait que le courant conseilliste provient d'une scission de la Gauche Communiste - en Allemagne en particulier. Cette constatation qui entacherait à jamais la Gauche Communiste en dehors d'Italie du péché originel de conseillisme leur sert d'ultime argument.
Cet argument a autant de valeur que de reprocher à la gauche révolutionnaire d'avoir milité dans les rangs de la deuxième Internationale avant la guerre. Il n'est pas moins stupide que de condamner les bolcheviks pour avoir "engendré" le stalinisme.
La Gauche Communiste n'est pas -quoiqu'en pensent et disent les ultra-partidistes- le sein maternel du conseillisme, car ce dont le conseillisme se nourrit, ce sont les conceptions erronées, l'image que certains révolutionnaires donnent du parti, et de son rapport avec la classe. Les aberrations des uns nourrissent et renforcent les aberrations des autres et réciproquement.
Quand pour les besoins de leur cause, les bordiguistes nous taxent de conseillistes, c'est une mauvaise polémique et non une réponse à notre critique de leurs aberrations. Au lieu de se donner la peine de répondre à des arguments, il est certes plus facile de recourir à la méthode "qui veut tuer son chien l'accuse de la rage". Cette méthode, qui consiste à inventer n'importe quoi et à l'attribuer à l'adversaire est peut-être payante sur le moment, mais s'avère complètement inefficace et négative à la longue. Elle ne fait qu'embrouiller le débat au lieu de clarifier et mettre en lumière les positions des uns et des autres.
Quand Battaglia, par exemple, critique le conseillisme à une conférence de groupes communistes, il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Mais quand il l'attribue au CCI pour justifier son sabotage de la Conférence on peut se demander : que penser d'un groupe comme Battaglia à qui il a fallu pas moins de 10 ans pour s'apercevoir qu'il discutait avec un groupe ... conseilliste, et encore, après avoir pendant 4 ans organisé avec lui des Conférences Internationales, sans s'en apercevoir? Comme perspicacité organisée et flair politique, ça laisse beaucoup à désirer. Plutôt que de convaincre qui que ce soit de la fable du conseillisme du CCI, Battaglia ne fait que se discréditer elle-même comme groupe politique sérieux et responsable.
Nous n'avons pas l'intention ici de nous laver de l'accusation de conseillisme. C'est à nos contradicteurs de le démontrer. Il suffit de connaître un tant soit peu la presse des groupes du CCI et notamment la plateforme, pour savoir que nous avons toujours rejeté et combattu les aberrations du conseillisme.
Mais n'est-il pas drôle d'entendre le même reproche de conseillisme de la part du CWO avec qui il nous a fallu de longs mois de discussion pour les faire revenir de leur analyse de la révolution d'octobre comme révolution bourgeoise et du parti bolchevik taxé par eux de parti bourgeois, lorsqu'il fallait les tirer par les oreilles pour les faire sortir du bourbier moderniste de Solidarity? Après l'ultra-anti-partidisme, le CWO s'est jeté maintenant dans l'ultra-partidisme et le combat des conceptions du parti du CCI.
Laissons donc là toutes les sottes fabulations sur le conseillisme du CCI ([2] [115]) et voyons les divergences réelles qui nous séparent sur la conception du parti.
LA NATURE DU PARTI
Bien des groupes ont du mal à se dégager clairement de la thèse de Kautsky, reprise et défendue par Lénine dans "Que faire?" Cette thèse énonce que la lutte de classe du prolétariat et la conscience socialiste émane de deux prémices absolument différentes. Selon cette thèse, la classe ouvrière ne peut élaborer qu'une conscience "trade unioniste", c'est à dire limitée à la lutte pour ses revendications économiques immédiates dans le capitalisme. La conscience socialiste, celle de l'émancipation historique de la classe, n'est que l’œuvre des intellectuels se penchant sur les questions sociales. D'où il résulte logiquement que le parti est l'organisation de ces intellectuels radicaux qui se donnent pour tache d'"IMPORTER CETTE CONSCIENCE DANS LA CLASSE OUVRIERE". Ainsi nous avons non seulement un être séparé de sa conscience, un corps séparé de son esprit, mais encore un esprit sans corps existant en soi. C'est là une vision idéaliste du monde, reprise aux néo hégéliens que Marx et Engels ont si implacablement fustigé dans la "Sainte Famille" et "l'idéologie allemande".
Avec Trotsky du "Rapport de la délégation sibérien ne", Rosa Luxemburg et tant d'autre révolutionnaires, le CCI rejette catégoriquement une telle théorie qui n'a rien à faire avec le marxisme et qui lui tourne carrément le dos. Lénine lui-même a reconnu publiquement dix ans après, d'avoir sur ce point par trop "tordu la barre", entraîné qu'il était dans sa polémique contre l'économisme. Toutes les contorsions du PCI (Programma) et toutes les galipettes "dialectiques" du PCI (Battaglia) pour justifier cette théorie de Kautsky (pour marquer leur "fidélité" à Lénine) ne font que les amener à s'emmêler chaque fois plus dans des affirmations de plus en plus contradictoires. Aucun anathème contre le spontanéisme ni l'exorcisme contre le "conseillisme" ne sauraient les sauver de l'obligation de se prononcer une fois pour toutes sur ce point fondamental. Il ne s'agit pas ici d'un différend entre léninisme et conseillisme, mais entre marxisme et kautskysme. ([3] [116])
Plus graves encore que les aspects philosophiques et méthodologiques de la question, sont les implications politiques auxquelles mène cette théorie. Elle réduit le prolétariat à une pure catégorie économique alors que Marx y reconnaît une classe historique qui porte en elle la solution de toutes les contradictions dans lesquelles s'est empêtrée l'humanité à travers la succession de sociétés divisées en classes. C'est précisément cette classe qui porte avec son émancipation l'émancipation de toute l'humanité qu'on rabaisse au point de lui nier la capacité de prendre conscience dans sa lutte de soi-même et de son rôle dans l'histoire. On ne voit dans cette classe que ses côtés encore hétérogènes et on ne voit pas qu'elle est la plus homogène, la plus "socialisée", la plus concentrée et la plus nombreuse dans l'histoire. On ignore le fait qu'elle est la moins aliénée par les intérêts de propriété privée et que sa misère est plus que sa misère propre mais la misère accumulée de toute l'humanité. On ne comprend pas qu'elle constitue la première classe dans l'histoire capable d'une conscience véritablement globale et non aliénée. Et c'est du haut de cet amoncellement d'ignorance et d'incompréhension sur la nature de la classe ouvrière qu'on prétend lui "injecter la conscience"... Une telle théorie ne peut-être le produit que de petits cerveaux mégalomanes et de l'Intelligentsia petite-bourgeoise.
Et le Parti ? Et le Programme Communiste ? Contrairement à Kautsky, Lénine et n'en déplaise à tous les bordiguistes de toutes nuances et de toutes variantes, ils ne sont pour nous aucune révélation mystérieuse, mais très simplement le produit de l'existence, de la vie et de l'activité de la classe. Et nous partageons, sans crainte de spontanéisme la critique de Rosa opposant à la formulation de Lénine "le parti au service du prolétariat" celle "du parti de la classe". En d'autres termes, un organisme secrété par la classe pour ses besoins. Le parti n'est pas ce Messie délégué par l'histoire auprès du prolétariat pour le sauver, mais un organe que la classe se donne dans sa lutte historique contre l'ordre capitaliste.
La discussion ne porte pas sur la question de savoir si le parti est ou non un facteur de la prise de conscience. Un tel débat a sa place uniquement face aux anarchistes ou conseillistes mais non pas entre des groupes qui se réclament de la gauche communiste. Mais si Battaglia insiste tant pour ramener le débat sur ce plan, c'est uniquement pour esquiver de répondre à la question de la nature du parti : à savoir de quoi et de qui il est le produit. La répétition obstinée de Battaglia sur le "parti-facteur apparaît pour ce qu'elle est : un faux-fuyant pour ne pas reconnaître qu'avant tout, le parti est un produit de la classe et que son existence comme son évolution relèvent de l'existence et de l'évolution de la classe ouvrière.
Les bordiguistes "orthodoxes" de Programme n'ont même pas besoin de recourir aux sophismes (dits "dialectiques") de Battaglia, et proclament carrément que la classe n'existe que par la grâce du parti. A les entendre, c'est l'existence du parti qui détermine l'existence de la classe. Le parti existe pour eux depuis "Le Manifeste Communiste", avant cette date, il n'y avait ni parti et donc pas de prolétariat. Admettons. Mais ce parti aurait du même coup la vertu miraculeuse de rendre son existence invisible, car selon eux, il n'a jamais cessé d'exister depuis 1848. Si on regarde l'histoire, on constate que cela ne colle pas très bien avec les faits. La Ligue des Communistes a existé... 4 ans; la Première Internationale 10 ans; la Seconde Internationale 15 ans et la Troisième Internationale 8 ans (en comptant large !), soit au total 37 ans sur 132. Que s'est-il donc passé avec le parti pendant près d'un siècle ? Cette question ne peut embarrasser nos bordiguistes -qui ont inventé une théorie du "Parti réel" et du "Parti formel". D'après cette "théorie", c'est l'habit, formel, extérieur donc matériel, visible qui peut disparaître, mais le parti réel, pur esprit, lui, demeure, on ne sait trop où, invisible. Une telle aventure est arrivée au parti bordiguiste lui-même, qui, en comptant large, aurait disparu de 1927 à 1945 (juste le temps pendant lequel Bordiga dormait !). Et c'est ce galimatias éhonté qu'on présente comme la quintessence du marxisme restauré ! Quant au "Programme achevé et invariant", et le "parti historique réel", ils se trouvent aujourd'hui incarnés dans ... quatre partis (!) tous P.C.I. et se réclamant tous du monolithisme ! Tous, grands, pourfendeurs et chasseurs émérites du... conseillisme ! Difficile, très difficile de discuter sérieusement avec des partis de cet acabit.
Les bordiguistes croient pouvoir appuyer leur conception du parti sur des citations de Marx et Engels arbitrairement extraites de leurs contextes. Ce faisant, ils ne font que commettre les pires abus contre le fond et l'esprit qu'animent l'œuvre de ces grands penseurs et fondateurs du socialisme scientifique ([4] [117]). Il en est ainsi de cette fameuse phrase du Manifeste : "l'organisation du prolétariat en classe, donc en parti politique". Sans vouloir faire de l'exégèse sur la validité littéraire de la traduction ([5] [118]), il suffit de relire tout le chapitre d'où cette phrase est extraite pour se convaincre que, cela n'a rien à faire avec l'interprétation que lui donnent les bordiguistes en faisant du petit mot "donc" une condition préalable à l'existence de la classe, là où pour Marx, elle signifie un résultat du processus de la lutte de la classe ouvrière.
Ce qui préoccupe Marx et Engels dans Le Manifeste, est la nécessité inéluctable pour la classe de s'organiser, et non précisément l'organisation du parti. L'organisation d'un parti précis reste très floue dans le Manifeste. C'est ainsi qu'ils peuvent aller jusqu'à proclamer que "les communistes ne constituent pas un parti distinct des autres partis ouvriers" et terminer le manifeste par l'appel, non pas à la constitution d'un parti communiste, mais "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous".
On peut citer des centaines de pages où Marx et Engels envisagent l'organisation sous l'angle de l'organisation générale, de la classe à qui ils attribuent la fonction, non seulement de la défense des intérêts immédiats, économiques mais également l'accomplissement du but historique du prolétariat: la destruction du capitalisme et l'instauration d'une société sans classe.
Citons seulement le passage suivant d'une lettre de Marx à Bolte du 23/2/1871 :
"Le mouvement politique de la classe ouvrière a naturellement pour but final la conquête du pouvoir politique, et il faut naturellement pour cela une organisation de la classe ouvrière ayant un certain degré de développement préalable et qui se forme et grandisse dans les luttes économiques mêmes. Mais d'autre part, chaque mouvement dans lequel la classe ouvrière s'oppose en tant que classe aux classes dominantes et cherche à les faire plier par une pression de l'extérieur est un mouvement politique. Par exemple, tenter d'arracher à des capitalistes individuels dans une seule fabrique ou une seule branche d'industrie, par le moyen de grèves, etc., une réduction du temps de travail est un mouvement purement économique; par contre, le mouvement visant à arracher la loi de 8 heures, etc... est un mouvement politique. Et c'est de cette façon que de tous les mouvements économiques isolés des ouvriers surgit partout un mouvement de la classe pour faire triompher ses intérêts sous une forme générale, sous une forme ayant force de contrainte sociale générale".
Et Marx d'ajouter :
"Si ces mouvements supposent une certaine organisation préalable, ils sont tout autant de leur coté, des moyens de développer cette organisation".
(Idem)
Tout ce mouvement se déroule ici sans la baguette magique détenue par le Parti. En parlant de l'organisation, Marx envisage ici l'Association Internationale des Travailleurs (la Première Internationale) dans laquelle les partis proprement politiques, comme celui de Bebel et Liebknecht en Allemagne ne sont qu'une partie parmi d'autres. C'est toujours cette Internationale, organisation générale de tous les ouvriers, que Marx considère comme la : "constitution du prolétariat en parti politique indispensable pour assurer le triomphe de la révolution sociale et de son but final- l'abolition des classes".
C'est si évident que le texte continu en ses termes : "qu'il faut que l'union des forces de la classe ouvrière qui a déjà été réalisée par les luttes économiques serve également de levier pour la masse de la classe dans sa lutte contre la puissance de ses exploiteurs". Résolution de la Conférence de Londres de l'A.I.T. Septembre 1871 "qui rappelle aux membres de l'Internationale que, dans l'état de luttes de la classe ouvrière, son activité économique et son activité politique sont inséparablement liées".
Comparons à ces textes de Marx ces autres affirmations des bordiguistes et Cie : "Tant qu'existent des classes, il sera impossible aussi bien aux classes qu'aux individus d'obtenir consciemment un résultat. Seul le parti le peut". (Travail du groupe n°3. Mars-Avril 1957 p.38) Mais d'où vient cette vertu au "parti seul" Et pourquoi à lui exclusivement ?
"Or le prolétariat n'est classe que dans la mesure où il se groupe derrière un programme, c'est à dire, un ensemble de règles d'action déterminées par une explication générale et définitive du problème propre à la classe et du but d atteindre pour le résoudre. Sans ce programme.... son expérience ne dépasse pas l'aspect le plus étroit de la misère que lui impose sa condition". (Travail du groupe n°4. Mai-Juin 1957 p.10) ([6] [119])
Mais d'où sortent donc ces "règles d'action" qui constituent "le programme" D'après les bordiguistes, ce programme ne peut absolument pas venir de l'expérience de la lutte de la classe ouvrière pour la simple raison que cette "expérience ne dépasse pas l'aspect le plus étroit de la misère que lui impose sa condition". Mais alors, d'où lui vient, ou peut lui venir -au prolétariat- la conscience de son être ? Les néo-bolchéviks répondent : "par une explication générale et définitive du problème propre à la classe". Les bordiguistes affirment, non seulement que de par "sa condition" la classe est dans l'incapacité absolue de "dépasser l'aspect le plus étroit de la misère" mais plus catégoriquement encore, ils prétendent que l'être même, le prolétariat n'est pas classe, et ne peut avoir d'existence comme telle, sans la condition première qu' il existe au préalable un Programme.... "une explication générale et définitive" derrière laquelle il peut se grouper pour devenir une classe.
Qu'il y a t-il de commun entre cette vision, et celle de Marx pour qui :
"Les conditions économiques avaient d'abord transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a crée à cette masse une situation commune, des intérêts communs. Ainsi, cette masse est déjà une classe vis a vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans la lutte dont nous n'avons signalé que quelques phases, cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. Mais la lutte de classe à classe est une lutte politique", et cela après avoir affirmé plus haut : Dans cette lutte -véritable guerre civile- se réunissent et se développent tous les éléments nécessaires à une bataille à venir. Une fois arrivée à ce point là, l'association prend un caractère politique".
(Misère de la philosophie. Chap I, "Grèves et coalitions". Ed. La Pléiade)
Là où avec Proudhon, les bordiguistes ne voient dans la condition de la classe que "la misère", nous voyons avec Marx une classe en mouvement qui passe de la résistance à la coalition, de la coalition à l'association, et de la lutte d'abord économique à la lutte politique pour l'abolition de la société de classe. De même, nous pouvons souscrire et prendre pleinement à notre compte cette autre pensée de Marx :
"On a fait bien des recherches pour retracer les différentes phases historiques que la bourgeoisie a parcourue... Mais quand il s'agit de se rendre compte exactement des grèves, des coalitions et des autres formes dans lesquelles les prolétaires effectuent devant nos yeux leur organisation comme classe, les uns sont saisis d'une crainte réelle, les autres affichent un dédain transcendantal". (Ibidem)
Ce qui caractérise tous les "néo" et "ultras" qui se disent "lénininistes", c'est leur profond dédain pour la classe, pour son mouvement réel et ses potentialités. C'est leur manque de confiance profonde dans la classe, dans ses capacités qui les amène à chercher une position de sécurisation, un nouveau Messie, qui ne serait autre qu'eux-mêmes. Ainsi transforment-ils leur propre sentiment d'insécurité en un complexe de supériorité, frisant la mégalomanie.
ROLE ET FONCTION DU PARTI DANS LA CLASSE
Si le parti est un organe produit par le corps de la classe, il est nécessairement aussi un facteur actif dans la vie de la classe. S'il est la manifestation du processus de la prise de conscience de la lutte de la classe, il a pour fonction fondamentale de contribuer à ce processus de prise de conscience et d'être le creuset indispensable de l'élaboration théorique et programmatique, fonction pour laquelle la classe l'a engendré. Dans la mesure où la classe ne peut échapper dans la société capitaliste où elle vit, ni à la pression, ni aux entraves qui empêchent son homogénéisation, le parti est le moyen de son homogénéisation; dans la mesure où l'idéologie bourgeoise dominante pèse et entrave la prise de conscience de la classe, le parti est l'organe chargé de détruire ces entraves, l'antidote à l'idéologie de la classe ennemie qui empoisonne sans cesse le cerveau du prolétariat. La portée de sa fonction évolue nécessairement avec les changements qui se produisent dans la société et dans le rapport de forces changeant entre le prolétariat et la bourgeoisie. Ainsi, par exemple, si au début de l'existence de la classe il est un facteur décisif et direct dans l'organisation de la classe, cette tâche diminue pour le parti dans la mesure où la classe s'est développée, a acquis une longue expérience et a atteint une maturité plus grande. Si les partis ont joué un rôle prépondérant pour la naissance et le développement des organisations syndicales, il n'en a pas été de même pour l'organisation des Conseils, qui s'est faite avant que le parti ne comprenne ce phénomène, et en partie contre la volonté explicite du parti.
Le parti ne vit donc pas indépendamment de la classe; il grandit et se développe avec le développement de la classe. Il subit également -comme la classe- la pression et la pénétration en son sein des influences de la classe ennemie. Et, en cas de grave défaite de la classe, peut dégénérer et passer à l'ennemi, ou disparaître momentanément. Ce qui reste une constante, c'est le besoin qu'éprouve la classe de cet organe qui lui est indispensable. Et, tout comme l'araignée dont on a détruit la toile, la classe continue à secréter les éléments pour reconstituer cet organe qui lui reste nécessaire. C'est cela le processus de formation continue du parti.
Le parti n'est pas l'unique siège de la conscience de la classe, comme le prétendent, avec outrance, tous les épigones qui s'intitulent léninistes. Il n'est ni infaillible, ni invulnérable. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est là pour en témoigner. Et l'histoire est aussi là pour montrer que la classe dans son ensemble accumule des expériences et les assimile directement. Le récent mouvement formidable de la classe ouvrière en Pologne témoigne de sa capacité remarquable à accumuler et assimiler ses expériences de 70 et 76 et à les dépasser, et cela malgré l'absence, qui se fait cruellement sentir, d'un parti. La Commune de Paris est un autre exemple des immenses capacités de conscience de la classe. Cela ne diminue en rien le rôle du parti, dont l'activité efficace est une des conditions majeures de la victoire finale du prolétariat. Une condition majeure, mais pas unique. Le parti est le siège principal de l'élaboration de la théorie (et non l'unique), mais encore ne faut-il pas le voir comme un corps indépendant, extérieur à la classe. Il est un organe, la partie d'un tout, qu'est la classe.
Comme tout organe chargé d'une fonction spécifique dans un tout, le parti peut accomplir bien ou mal cette fonction. Parce qu'il fait partie d'un corps total vivant qu'est la classe, et est donc lui-même un organe vivant, il est sujet à des défaillances dues soit à des causes extérieures, soit à son propre mauvais fonctionnement. Ce n'est pas un corps immobile, assis sur un programme achevé une fois pour toutes et invariant. Il a constamment besoin de veiller et travailler sur lui-même, de chercher à se donner les meilleurs moyens pour son entretien et son développement. Au lieu d'exalter en lui le restaurateur et le conservateur de musée, comme le font les néo-bolcheviks, nous devons être vigilants contre une maladie particulière qui le guette (et contre laquelle, Rosa, dans sa lutte contre le "marxisme orthodoxe" d'avant 1914, Lénine, dans sa lutte contre les "vieux bolcheviks" à son retour de Russie en 1917, et Trotsky dans "les leçons d'Octobre", ont mis en garde les révolutionnaires), sa tendance au conservatisme. Il n'y a pas de garantie ni de recette à priori. Raison de plus pour être attentif. Le symptôme de cette maladie se manifeste par une stricte fidélité à la lettre plutôt qu'à la méthode vivante du marxisme.
Le parti accuse des défaillances, non seulement par le poids du passé et sa tendance au conservatisme, mais aussi parce qu'il est confronté à des situations nouvelles, à des problèmes nouveaux. Or rien ne permet d'affirmer qu'il peut, face à des situations jamais vues auparavant dans l'histoire, donner toujours et tout de suite une réponse juste. L'histoire le démontre amplement : le parti peut se tromper. Qui plus est, les conséquences de ses erreurs peuvent être très lourdes et altérer gravement le rapport existant entre lui et la classe. Le Parti Bolchevik au pouvoir en a commis pas mal, l'Internationale Communiste pas moins. C'est pourquoi le parti ne peut prétendre être toujours dans la vérité et chercher à imposer à la classe, par tous les moyens (y compris la violence), sa direction et ses décisions. Il n'est pas un "dirigeant de droit divin".
Le parti n'est pas ce pur esprit, cette conscience absolue et infaillible, devant lequel la classe ne peut et ne doit que s'incliner. Il est un corps politique, une force matérielle, agissant dans la classe, qui reste responsable devant elle, et à qui il doit toujours rendre des comptes.
Le C.W.O. ironise sur notre "frayeur" devant le "mythe" (sic) du danger du substitutionnisme. Le parti étant la partie la plus consciente de la classe, cette dernière ne peut que lui faire confiance et c'est donc lui qui prend tout naturellement et d'office le pouvoir. Ce qu'il fallait démontrer ! On pourrait se demander pourquoi Marx a écrit "la guerre civile en France", où il mettait l'accent sur les mesures prises par la Commune de Paris pour pouvoir garder toujours le contrôle sur ceux qu'elle déléguait à des fonctions publiques, et dont la plus importante était la possibilité de révocabilité à tout moment ? Marx et Engels auraient-ils été des conseillistes avant la lettre?
Le C.W.O. ne se rend lui-même pas compte de la différence qui existe encore entre un délégué élu et révocable, et la délégation de tout le pouvoir à un parti, et qui n'est rien d'autre que la différence qui sépare le fonctionnement du prolétariat des structures bourgeoises. Dans un cas, il s'agit d'une personne chargée de l'exécution d'une tâche et responsable à chaque moment devant ceux qui l'ont élu, et donc révocable ; dans l'autre cas, il s'agit de déléguer le pouvoir, tout le pouvoir, à un corps politique sur lequel on n'a aucun contrôle : ses membres, eux, sont responsables devant leur parti, et leur parti uniquement. Le C.W.O. voit dans notre souci du danger du substitutionisme un simple formalisme, alors que ce serait tomber dans le pire formalisme, c'est à dire la pire tromperie, que de faire croire qu'on a changé quelque chose en changeant simplement le nom du comité central du parti en comité exécutif des conseils ! C'est directement que la classe exerce son contrôle sur chacun de ses délégués, et non en abandonnant ce contrôle à quelqu'un d'autre, serait-ce son parti de classe.
Le parti prolétarien n'est pas comme les partis bourgeois, candidat au pouvoir de l'Etat, un parti étatique. Sa fonction ne peut être celle de gérer l'Etat, ce qui risque d'altérer son rapport avec la classe -qui consiste à l'orienter politiquement- en un rapport de forces. En devenant un gérant de l'Etat, le parti changera imperceptiblement son rôle, pour devenir le parti des fonctionnaires; avec tout ce que cela comporte comme tendances à la bureaucratisation. L'exemple bolchevik est à ce sujet très édifiant.
Mais ce point relève d'une toute autre recherche, celle du rapport entre le parti et l'Etat dans la période de transition. Ici nous avons voulu nous limiter à démontrer, comment sous prétexte de chasse au conseillisme, on arrive à l'erreur de survaloriser de manière outrancière le rôle et la fonction du parti. On arrive tout simplement à une caricature faisant du parti une élite de droit divin.
M.C.
[1] [120] L'histoire du mouvement ouvrier ne connaît aucun exemple d'un tel parti monolithique.
[2] [121] Rappelons, pour en finir avec ces "critiques" inventées de toutes pièces, que dans l'exigence des critères politiques pour la participation aux conférences que nous avons proposés dès le début, figure la reconnaissance de la nécessité du parti. Ainsi, dans la lettre que nous avons adressée au P.C.I. en préparation de la Ière Conférence le 15/7/76, nous écrivions : "Les critères politiques de participation à une telle rencontre doivent être strictement délimités par: …..6- affirmation que 1"émancipation de la classe ouvrière sera l’œuvre de la classe elle-même" et que cela implique la nécessité de l'existence de l'organisation des révolutionnaires au sein de la classe." De même, dans le "Projet de résolution sur les taches des communistes" que nous avons présenté à la deuxième Conférence le 11/11/1978, nous écrivions:
"L'organisation des révolutionnaires constitue un organe essentiel de la lutte du prolétariat, tant avant qu'après l'insurrection et la prise du pouvoir ; sans elle, sans le parti prolétarien et parce que cela exprimerait une immaturité de sa prise de conscience, la classe ouvrière ne peut réaliser sa tache historique: détruire le système capitaliste et édifier le communisme:"
Et, si la deuxième Conférence a montré qu'il existait des divergences sur le rôle et la fonction du parti, elle a accepté à l'unanimité la "reconnaissance de la nécessité historique du parti" comme critère d'adhésion et de participation aux futures conférences internationales.
[3] [122] Il est largement temps de bannir de notre vocabulaire cette terminologie de "léninisme" et "anti léninisme", derrière laquelle se cache n'importe quoi et qui ne veut rien dire. Lénine était une très grande figure du mouvement ouvrier et son apport est énorme. N'empêche qu'il n'était pas infaillible et que ses erreurs ont pesé très lourdement dans le camp du prolétariat. On ne peut accepter le Lénine de Kronstadt parce qu'il y avait un Lénine d'Octobre, et vice versa.
[4] [123] C'est à dire d'une méthode scientifique et non, selon la formulation de Battaglia, d'une science marxiste qui n'existe pas.
[5] [124] Dans l'édition en français de "La Pléiade", M. Rubel traduit ce passage de la façon suivante: "cette organisation des prolétaires en une classe et, par suite, en un parti politique", traduction certainement plus fidèle à la pensée réelle développée dans tout ce chapitre du Manifeste.
[6] [125] Revue bordiguiste du PCI(Programma)
Courants politiques:
- Bordiguisme [126]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1981 - 24 à 27
- 3746 reads
Revue Internationale no 24 - 1e trimestre 1981
- 2631 reads
La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne
- 2430 reads
1) Dans la Revue Internationale du CCI n°20, nous définissions les années 80 dans lesquelles nous allions entrer comme "les années de vérité", celles où allait se décider pour une bonne part l'alternative historique ouverte par la crise aiguë du capitalisme : guerre mondiale ou révolution prolétarienne.
Première année de cette
décennie, l'année 80 est venue illustrer de façon on ne peut plus significative
cette perspective. Ainsi, alors que la
première moitié de l'année est, malgré les mouvements sociaux importants comme
celui de la sidérurgie en Grande-Bretagne, dominée par l'aggravation
considérable des tensions inter-impérialistes faisant suite à l'invasion de
J'Afghanistan, la seconde moitié est déjà marquée par une accentuation sans
précèdent des luttes du Prolétariat qui atteignent en Pologne le point le plus
élevé depuis la reprise historique des combats de la classe ouvrière mondiale
en 1968. Si, pendant six mois, la bourgeoisie a paru avoir les mains libres
pour déchaîner ses campagnes bellicistes et pour préparer un troisième
holocauste mondial, l'inquiétude qui s'exprime aujourd'hui dans la classe
dominante de tous les pays face aux luttes ouvrières de Pologne, 1’unité
qu'elle manifeste dans sa tentative de les faire taire, constituent une
nouvelle illustration du fait que le prolétariat, par sa lutte, est la seule
force dans la société qui peut empêcher le capitalisme d'apporter sa réponse
guerrière à la crise de son économie.
2) L'heure n'est pas encore venue de faire un bilan définitif des luttes du prolétariat en Pologne car le mouvement est encore en cours et na pas épuisé toutes ses potentialités présentes . Cependant 5 mois après le début des luttes, on peut dores et déjà en tirer un certain nombre d’enseignements importants et il est nécessaire de situer le point où il est parvenu aujourd'hui.
Dès à présent, en effet, on peut mettre en évidence deux éléments :
- l’énorme importance de ce mouvement, le pas considérable qu'il représente pour le prolétariat de tous les pays,
- le fait qu'on ne peut le
comprendre et qu'on ne peut en dégager les perspectives que dans le
cadre mondial.
3) Un peu partout, la bourgeoisie et ses valets de presse s'emploient à essayer de démontrer que les luttes ouvrières en Pologne s'expliquent par des caractéristiques propres à la Pologne ou, au mieux, par des caractéristiques propres aux pays d'Europe de l'Est. A Moscou, on raconte que, s'il y a des difficultés en Pologne (ce qu'on ne peut plus cacher), cela résulte "d'erreurs"'de la précédente direction polonaise. Rien à voir avec la situation en Russie, évidemment ! A Paris, Bonn, Londres et Washington, on aime dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de "libertés" à l'occidentale, qu'il manque la démocratie et qu'ils sont fatigués des queues devant les magasins, que les ouvriers d'Europe de l'Est sont mécontents. En Occident, par contre, ils n'ont aucune raison majeure de se plaindre. Que les ouvriers en Pologne résistent contre les atteintes d'une même crise, qu'ils luttent contre une même exploitation que celles que subissent leurs frères de classe de l'Ouest et de partout ailleurs, qu'ils montrent le chemin en quelque sorte : quelles idées absurdes !
Lorsque quelque part dans le
monde se dévoile un pan du tableau qui risque d'être son cauchemar : la
lutte généralisée du prolétariat contre le capitalisme, la bourgeoisie
s'empresse de hurler bien fort : "cas particulier" et s'emploie
fébrilement à découvrir toutes les différences qui distinguent ce "quelque
part" des autres endroits. Et ces
différences, elle n'a pas besoin de les inventer toutes. C'est vrai que dans les pays du monde, tous
ne sont pas dans une situation identique.
C'est vrai que certaines caractéristiques du mouvement en Pologne sont
données par le cadre spécifique de ce pays, de sa situation économique,
politique et sociale propre, de ses particularités historiques, comme aussi par
le cadre des pays de l'Est et du bloc russe.
Mais, pour les révolutionnaires et la classe ouvrière, il doit être
clair également que les caractéristiques particulières ont une importance
seulement circonstancielle et qu’elles ne peuvent se comprendre elles-mêmes que
dans une vision qui, évidemment tient compte des rythmes différents selon les
pays d'enfoncement dans la crise mais qui englobe l'ensemble du monde
capitaliste.
4) Le cadre général dans lequel se déroulent les évènements de Pologne est donné par les éléments suivants :
a) le caractère mondial et général de la crise économique;
b ) l'aggravation inexorable de celle-ci et les sacrifices de plus en plus cruels qu'elle impose aux exploités;
c) la reprise historique du prolétariat mondial depuis la fin des années 60;
d) la nature des problèmes et des difficultés auxquels se heurte la classe ouvrière, les nécessités qui s'impose à elle dans sa lutte ;
- la confrontation avec l'obstacle syndical,
- l'auto organisation de sa lutte, l'importance des assemblées générales,
- l'élargissement du combat, l'emploi de la grève de masse;
e) les moyens mis en avant par la bourgeoisie pour briser le combat prolétarien et imposer à la classe les exigences économiques et militaires du capital national :
- emploi d'une répression et d'un encadrement policiers de plus en plus systématiques,
- utilisation de multiples mystifications destinées soit à prévenir, soit, quand ce n'est plus possible, à dévoyer dans des impasses les explosions ouvrières.
Les différents secteurs de
la bourgeoisie des pays avancés se partageant en général aujourd'hui le travail
avec une droite au gouvernement et une gauche dans l'opposition.
5) Les conditions particulières dans lesquelles s inscrivent les évènements en Pologne relèvent, soit de son appartenance au bloc de l'Est,' soit à des spécificités propres à ce pays.
Comme pour l'ensemble des pays de ce bloc, la situation en Pologne se caractérise par :
a) l'extrême gravité de la crise qui jette aujourd'hui des millions de prolétaires dans une misère proche de la famine ;
b) la grande rigidité des institutions qui ne laissent pratiquement aucune place pour une possibilité de surgissement de forces politiques bourgeoises d'opposition capables de jouer le rôle de tampons : en Russie et par suite dans ses pays satellites, tout mouvement de contestation risque de cristalliser l'énorme mécontentement qui existe au sein d'un prolétariat et d'une population soumis depuis des décennies à la plus violente des contre-révolutions. laquelle est à la hauteur du formidable mouvement de la classe qu'elle eut à écraser : la révolution de 1917
c) l'énorme importance de la terreur policière comme moyen
pratiquement unique de maintien de l'ordre;
Par ailleurs, la Pologne se distingue par
a) l'oppression nationale plus que séculaire subie de la part surtout de la Russie et qui, en se perpétuant aujourd'hui sous d'autres formes donne un poids très grand au nationalisme parmi les mystifications qui pèsent sur la classe ouvrière ;
b) l'importance de la religion catholique ressentie depuis des
siècles comme une manifestation de résistance contre cette oppression, comme un
symbole de l'identité nationale de la Pologne (qui est le seul pays catholique du monde
slave) et qui a canalisé depuis 30
ans une part du mécontentement contre le régime stalinien.
6) Les spécificités de la situation en Pologne permettent
d'expliquer certains aspects des mystifications que le capitalisme fait peser
sur le cerveau des prolétaires :
- les illusions démocratiques relèvent directement du caractère totalitaire du régime qui règne dans les pays d'Europe de l'Est ;
- le nationalisme et l'opium religieux résultent pour une grande part de l'histoire de la nation polonaise.
En fait, les aspects du mouvement des ouvriers de Pologne qui sont les plus tributaires des spécificités de ce pays concernent justement les faiblesses de ce mouvement : ce qui relève encore l'influence des idées bourgeoises et du poids du passé dans les rangs prolétariens trouve dans les particularités son meilleur complice dans la mesure où elles sont l'expression d'un monde divisé, déchiré en nations, en classes, en catégories de toutes sortes, comme d’une classe qui ne peut vivre que par la reproduction de ces divisions.
Par contre, ce qui fait la force du prolétariat en Pologne n'est nullement spécifique aux luttes qu'il mène dans ce pays. Est un élément de force pour le prolétariat tout ce qui exprime son autonomie de classe, sa rupture avec l'atomisation et les divisions du passé, tout ce qui annonce les objectifs généraux et ultimes de son mouvement, tout ce qui rejète les aliénations locales et ancestrales pour se tourner avec audace vers le seul avenir possible pour l'humanité : le communisme qui abolira les antagonismes entre les hommes, qui réalisera la communauté humaine.
Dans ce contexte, les spécificités de la situation en Pologne ont surtout pour résultat de faire apparaître, souvent de façon beaucoup plus nette qu'ailleurs et parfois caricaturale, les caractéristiques fondamentales -et qui demain concerneront tous es pays- tant, du mouvement prolétarien de notre époque, que des conditions qui le font surgir et des bouleversements qu'il provoque dans la société et au sein de la classe dominante.
Extrême gravité de la crise économique, brutalité de l'attaque contre la classe ouvrière, rejet croissant par le prolétariat du cadre syndical, auto-organisation de la classe, grève de masse, convulsions politiques de la bourgeoisie : autant de "spécificités" qui ne sont pas "polonaises", mais qui sont celles de notre époque et concernent toute la société.
7) La situation catastrophique de l'économie des pays du bloc de l'Est, et notamment de la Pologne, non seulement ne peut s'expliquer hors du cadre de la crise générale du capitalisme (ce qui à l'Est et à l'Ouest devient une évidence même pour ces ânes qu'on appelle "économistes") mais montre, par bien des aspects, le chemin dans lequel s'engage de plus en plus l'économie de tous les pays, y compris celle des grandes puissances industrielles les plus épargnées jusqu'ici. L'état de misère de plus en plus intolérable qui se développe aujourd'hui dans le prolétariat polonais préfigure, quant à lui, celui qui va tendre à frapper de plus en plus le prolétariat de ces grandes puissances, même si les modalités immédiates de cette misère (bas salaires et pénurie à l'Est, chômage à l'Ouest), diffèrent suivant que le régime est capable d'éjecter de la production tout un secteur de la classe ouvrière, ou incapable de le faire sous peine de voir sa production chuter encore plus et de perdre tout contrôle sur cette masse d'ouvriers qui seraient soustraits à l'encasernement des bagnes industriels.
Enfin, de la même façon que l'aggravation de la
misère en Pologne (notamment par les brusques augmentations des prix de la
nourriture) a été l'élément décisif qui a poussé le prolétariat à se révolter
malgré une terreur policière et un écrasement physique comparables à l'état de
siège des temps de guerre, l'aggravation de la misère dans les autres pays
contraindra le prolétariat à secouer le joug de la répression et des
mystifications bourgeoises.
8) De même, si c'est la
totale et évidente intégration des syndicats dans l'appareil étatique, telle
qu'elle existe dans les régimes staliniens qui a d’emblée posé pour les
ouvriers polonais le nécessité de rejeter ces organes, ces ouvriers n'ont fait
en cela que montrer le chemin à leurs frères de classe des pays où les
syndicats n'ont pas encore dévoilé aussi clairement leur nature
capitaliste. Mais la démarche du
prolétariat en Pologne ne s'est arrêtée à la dénonciation des syndicats
officiels, il tend de plus en plus à déborder les syndicats "libres"
à l'idée desquels il s'était rallié dans son aspiration à se pourvoir
d'organisations indépendantes de l'Etat afin de se prémunir contre la riposte
prévisible de la bourgeoisie. En
quelques mois, l'expérience vivante des ouvriers de Pologne a fait la démonstration
de 1 'impossibilité pour la classe ouvrière, dans la période de décadence, du
capitalisme de se doter, sans qu'ils deviennent des obstacles à la lutte, d'organes permanents de type syndicats. Là encore le prolétariat de Pologne ne fait que montrer le chemin au reste de la classe qui devra, à son tour, repousser les chants de sirène de toutes les formes de syndicalisme "radical", "de combat" ou"de base" dans sa lutte contre le capital.
9\ La Pologne constit,ue une nouvelle illustration de cette loi qui veut que dans les périodes de crise aiguë de la société on assiste à une accélération de l'histoire. Dans le domaine de la dénonciation du rôle des syndicats, les ouvriers de Pologne ont accompli en quelques mois le chemin que le prolétariat des autres pays a mis plusieurs générations à parcourir. Mais ces progrès accélérés ne concernent pas seulement le problème des syndicats. Sur deux autres plans également, celui de l'auto organisation et celui de la généralisation des luttes, (évidement liés entre eux et à la question syndicale), la classe ouvrière de Pologne a été projetée à l'avant-garde du prolétariat mondial.
Là encore, les "particularités" de la situation en Pologne et en Europe de 1"Est (qui sont des caractéristiques générales du capitalisme décadent mais poussées encore plus loin qu'ailleurs) ont conduit les ouvriers de ce pays à réouvrir des voies dans lesquelles devront s'engouffrer les prolétaires du monde entier.
Ainsi, l'habituel emploi massif et systématique du mensonge par les autorités de même que le contrôle totalitaire exercé par l'Etat sur chaque aspect de la vie sociale a poussé les ouvriers polonais à faire faire à l'auto organisation de la classe d'immenses progrès par rapport à ce que nous avions connu jusqu'ici. La mise a profit de la technique moderne (hauts parleurs branchés sur les salles de négociation, répercussion à la base des débats en assemblées centrales grâce à leur enregistrement sur cassettes) pour permettre un meilleur contrôle des assemblées générales sur les organes dont elles se sont dotées, une plus grande participation des travailleurs à leur lutte, sont un exemple à suivre pour les ouvriers de tous les pays.
De même, face à un Etat ayant une forte propension à employer la répression sanglante, qui gouverne par la terreur et par une atomisation extrême des individus, le prolétariat polonais, malgré les tentatives gouvernementales de diviser le mouvement, a su employer de façon efficace cette arme si importante de ses combats dans la période actuelle et seule capable de paralyser le bras de la répression comme de surmonter l’atomisation : la grève de masse, la généralisation de ses luttes. Son aptitude à se mobiliser de façon massive non seulement pour la défense de ses intérêts spécifiques mais aussi en solidarité avec la lutte des autres secteurs de la classe est une expression de l'être profond de la classe ouvrière, de cette classe qui porte en elle le communisme, et qui devra partout dans le monde manifester cette unité qui lui est vitale pour être à la hauteur de ses tâches historiques.
10) Ce n'est pas seulement sur le plan de la lutte du prolétariat que les événements de Pologne préfigurent la situation qui va tendre à se généraliser dans tous les pays industrialisés. Sur le plan des convulsions internes de la classe dominante ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays donne une idée y compris dans ses aspects caricatu raux, de ce qui couve dans les entrailles de la société. Depuis le mois d'août c'est une véritable panique qui s'est emparée des sphères dirigeantes du pays. Dans les sphères gouvernementales, c'est, depuis 5 mois, la valse des porte-feuilles ministériels dont on est allé jusqu'à en confier un à un catholique. Mais c'est dans la principale force dirigeante, le parti, que se manifestent avec le plus de violence ces convulsions. A l'heure actuelle, le POUP donne l'impression d'une immense foire d'empoigne où les différentes cliques se tirent dans les jambes à qui mieux mieux, règlent leurs vieux comptes, satisfont des vengeances personnelles, font passer leurs intérêts particuliers par dessus l'intérêt du parti et du capital national. Dans l'appareil, les limogeages vont bon train; l'instance suprême, le Bureau Politique, est bouleversée. L'homme "qui savait parler aux ouvriers", Gierek, subit le même sort qu'il avait infligé en 71 à Gomulka. Il est même chassé comme un malpropre du Comité Central, en violation de la loi du parti. A tous les échelons, on trouve des boucs émissaires, au point qu'on doit faire appel pour les remplacer à des vieux chevaux de retour, déjà déconsidérés en leur temps comme l'anti-sémite virulent Moczsar. Même la base du parti, cette base d'habitude si servile, si silencieuse, est atteinte par ces bouleversements. Plus de la moitié des militants ouvriers ont quitté les syndicats officiels (ces "forces saines" comme dit "la Pravda") pour rejoindre les syndicats indépendants. On voit même des organismes de base se coordonner en dehors des structures officielles et dénoncer "le bureaucratisme de l'appareil".
Cette panique qui s'est abattue sur le parti est à la mesure de l'impasse dans laquelle se trouve la bourgeoisie polonaise. Face à l'explosion du mécontentement ouvrier, elle a été conduite à laisser apparaître et se développer des forces d'opposition -les syndicats indépendants- dont la fonction s'apparente à la gauche dans l'opposition telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. Même langage, en apparence "radical" et "ouvrier" pour mieux canaliser et dévoyer la combativité prolétarienne, même solidarité de fond avec "l'intérêt national". Mais, pas plus aujourd'hui qu'hier, le régime stalinien ne peut tolérer sans dommage ni danger l'existence de telles forces d'opposition. Sa fragilité et sa rigidité congénitales n'ont pas disparu par enchantement, par la grâce de l’explosion des luttes ouvrières. Bien au contraire! Ainsi, contraint de tolérer dans ses entrailles un corps étranger, dont il a besoin pour survivre, bien qu'il arrive à peine à tenir son rôle, mais que rejette toutes les fibres de son organisme, le régime est plongé aujourd'hui dans les convulsions les plus douloureuses de son histoire.
Les antagonismes au sein de la classe dominante d'un pays ne sont chose nouvelle. Ce sont ces antagonismes -réels- qui sont aujourd'hui utilisés en occident pour désorienter la classe ouvrière avec une droite au gouvernement qui prend des mesures d'austérité de plus en plus violentes, et une gauche qui les dénonce avec fracas pour mieux les faire accepter par les ouvriers. En "temps normal", ces divisions au sein de la bourgeoisie, si d'un côté elles constituent une faiblesse, notamment dans la compétition internationale, d'un autre côté, sont un facteur de renforcement face à la classe ouvrière, lorsqu'elles sont exploitées correctement comme élément de mystification. Mais, à un certain degré de ces divisions et de puissance de la lutte de classe. elles se retournent contre la classe dominante elle-même. Incapable de faire adhérer plus longtemps les ouvriers à l'une ou l'autre des fausses alternatives qu'elle présente, celle-ci, par ses déchirements, fait au contraire la preuve qu'elle devient incapable de gouverner la société. De facteur de paralysie pour, le prolétariat, ces antagonismes deviennent alors des stimulants de sa lutte.
Ainsi, alors que les réticences de l'appareil devant l'acceptation du principe des syndicats indépendants (fin août) et devant l'enregistrement de leurs statuts (fin octobre) avaient permis, en polarisant une bonne part de l'attention des ouvriers sur cette question, d'affaiblir leurs revendications économiques, l'arrestation (fin novembre) de deux militants de "solidarité" a abouti à une reculade sans gloire du pouvoir, y compris sur une question aussi épineuse que le contrôle sur les forces de répression, devant la menace d'une nouvelle grève généralisée.
L'exemple donné par les convulsions de la bourgeoisie polonaise nous montre d'une certaine façon à quoi ressemble une classe dominante lorsqu'elle est acculée par la lutte de classe. Ces dernières années, les crises politiques n'ont pas manqué (comme celle du Portugal en 1974-75) mais, jusqu'à présent, nulle part le prolétariat n'avait été un facteur aussi important des convulsions internes de la bourgeoisie. Des crises politiques au sein de la classe dominante provoquées directement par la lutte de classe : voilà un phénomène qui lui aussi, va se généraliser dans les années qui viennent!
11) Ce que traduit l'ampleur des convulsions de la bourgeoisie polonaise, c'est évidemment la grande fragilité de son régime, mais c'est aussi, d'une manière beaucoup plus fondamentale, la force du mouvement des ouvriers de Pologne, de cette lame de fond qui depuis 5 mois bouleverse le pays et secoue l'Europe et même le monde.
La force du mouvement, on l'a déjà mise en évidence, dans sa capacité à briser le carcan syndical, à déborder celui des syndicats de rechange, à se donner les moyens d'une réelle auto-organisasation de la classe, d’une généralisation effective et efficace des luttes. Mais elle réside également dans sa durée : 5 mois de mobilisation quasi permanente des ouvriers, de discussions incessantes et de réflexion sur les problèmes qui se posent à leur classe.
5 mois, pendant lesquels, loin de s'essouffler, le mouvement s'est durci, où il est passé d'une simple réaction contre les hausses de prix de la viande à une suite d'épreuves de force frontales avec l'Etat, culminant avec une mobilisation de 1a concentration ouvrière la plus décisive du pays, celle de la capitale, pour faire capituler les autorités et leur imposer la libération des travailleurs arrêtés.
5 mois pendant lesquels le combat a assumé de plus en plus ses implications politiques, où les revendications économiques ont gagné en ampleur et en profondeur, où les revendications politique ont acquis un caractère de plus en plus radical, passant de demandes encore influencées par l’idéologie bourgeoise. comme celle des syndicats libre ou du droit d'expression à la télévision pour l'Eglise, aux exigences carrément intolérables pour n'importe quel gouvernement au monde -parce que relevant d'une dualité de pouvoir- de contrôle et de limitation de l'appareil répressif.
5 mois au cours desquels ceux qui au début, tel Walesa faisaient figure de "radicaux" , "d'extrémistes" sont devenus de véritables pompiers volants, dépêchés par les autorités vers chaque nouvel incendie, au cours desquels la petite minorité qui avait rechigné pour accepter les accords de Gdansk est devenue une forte minorité qui ne s'en laisse plus compter facilement par tous les Kuron et Walesa réunis, où, même si ces "dirigeants" conservent leur popularité, la dynamique n'est pas à un renforcement de leur autorité mais-à une remise en cause croissante de l'orientation "responsable" qu'ils préconisent de la part des assemblé ouvrières lesquelles ne se laissent plus convaincre en quelques minutes de "la nécessité des compromis" comme à Gdansk , le 30 août, mais font la sourde oreille pendant des heures aux chants de sirène du "réalisme", comme à Huta Warsawa le 27 novembre.
5 mois enfin, pendant
lesquels le prolétariat a gardé l'initiative face à des réactions brouillonnes
et incohérentes de la bourgeoisie.
12) Il en est qui font grand cas des faiblesses -réelles- du
mouvement des ouvriers en Pologne illusions démocratiques, et néo-syndicales,
influence de la religion et du nationalisme, pour conclure à la faible
importance ou profondeur de ce mouvement.
Il est évident que si l'on s'attend à ce que la classe ouvrière, dès
qu'elle surgit quelque part, ait totalement rompu avec l'ensemble des mystifications
que le capitalisme fait peser sur elle depuis des siècles, qu'elle ait du jour
au lendemain une claire vision des buts ultimes et des moyens de son mouvement,
qu'elle ait, en d'autres termes, une conscience communiste, alors effectivement
on risque d'être déçu par ce qui se passe en Pologne, comme d'ailleurs par tout
mouvement ouvrier avant le triomphe de la révolution. L'inconvénient avec une telle vision qui en
général se targue de "radicalisme", c'est qu'en plus d'exprimer
l'impatience et le scepticisme, typiques de la petite bourgeoisie, elle tourne
complètement le dos au mouvement vivant de la lutte de classe. Le mouvement du
prolétariat est un processus qui se dégage péniblement de la gangue du
capitalisme dans lequel il est né. Comme
les révolutionnaires, et en particulier Marx, l'ont souvent souligné, les oripeaux du vieux monde lui collent
longtemps à la peau et ce n'est qu'à travers une expérience douloureuse, à la
suite de tentatives répétées, qu'il parvient progressivement à s'en dépouiller
pour découvrir et affirmer ses desseins propres et véritables. Le "révolutionnaire" de la phrase
confond le début et la fin du mouvement.
Il voudrait qu'il soit arrivé avant d'être parti. Il en fait une photographie et, après avoir
confondu l'image et son modèle, il accuse ce dernier d'être immobile. Dans le cas de la Pologne, au lieu de voir
la rapidité avec laquelle les ouvriers ont franchi des étapes essentielles de
leur mouvement : le rejet de la peur, de l'atomisation, la conquête de la solidarité,
de l'auto organisation, l'emploi de la grève de masse, il ne voit que le
nationalisme et la religion, que l'expérience ne leur a pas encore permis de
surmonter. Au lieu de voir la dynamique
de rejet et de débordement de la structure syndicale, il ne voit que les
illusions qui subsistent à l'égard de celle-ci.
Au lieu de prendre la mesure du chemin considérable déjà parcouru par le
mouvement , il n’a d'yeux que pour celui qui lui reste à faire et s’en
décourage.
Les révolutionnaires ne cachent jamais à leur classe la longueur du chemin et les difficultés qui J'attendent. ils ne sont pas des "docteurs tant mieux! ". Mais, pour qu'ils puissent jouer leur rôle de stimulation de la lutte, qu'ils participent réellement à une prise de conscience par la classe de sa propre force, il ne sont jamais des "docteurs tant pis".
Ceux qui font aujourd'hui la moue devant les luttes des ouvriers de Pologne auraient pu dire en mars 1871 : "Bah! les ouvriers parisiens, sont nationalistes" et en janvier 1905 :"Bof! les ouvriers russes manifestent derrière des icônes."et ils seraient passés à côté des deux expériences révolutionnaires du prolétariat mondial les plus importantes avant 1917.
13) Une autre façon de sous-estimer l'importance du mouvement actuel en Pologne consiste à considérer qu'il serait allé moins loin qu'en 1970 ou 1976 parce qu'il ne se serait pas affronté de façon violente à l'Etat et à ses hordes répressives . Ce qu'ignore une telle conception, c est que :
-le nombre de tués que laisse la classe ouvrière dans un combat n'a jamais été une manifestation
de sa force,
-ce qui a fait reculer la bourgeoisie polonaise en 1976 ou en 1970, ce n'est pas l'incendie de quelques sièges du parti, mais bien la menace d'une généralisation du mouvement, notamment après le massacre des ouvriers,
- en 1980, la bourgeoisie s'est interdit jusqu présent d'employer la répression sanglante car c'était le meilleur moyen de radicaliser le mouvement surtout tant qu'il est ascendant,
- forts de leur expérience passée, les ouvriers savaient que leur force véritable ne résidait pas dans affrontements ponctuels avec la police, mais dans l'organisation et l'ampleur du mouvement de grève,
-si l'insurrection armée est
une étape indispensable du prolétariat sur le chemin du pouvoir et de son
émancipation, elle est une toute autre chose que les émeutes qui jalonnent en
grand nombre sa lutte contre l'exploitation.
L'émeute, telle qu'on l'a vu
en 1970 et 1976 par exemple, à Gdansk, à Gdynia, à Radom est une réaction
élémentaire, ponctuelle et relativement peu organisée de la classe sous le coup
de la colère ou du désespoir. Sur le
plan militaire, elle est finalement condamnée à la défaite même si, par
ailleurs, elle peut faire reculer momentanément la bourgeoisie. L'insurrection, par contre, telle qu' elle
prend place au point culminant d'un processus révolutionnaire comme en octobre
1917, est un acte délibéré, réfléchi, organisé et conscient de la classe.
Parce qu'elle a pour objectif la prise du pouvoir, elle vise non pas à faire
reculer la bourgeoisie, à lui arracher des concessions, mais bien à la battre
militairement et à détruire de fond en comble ses organes de pouvoir et de
répression. Cependant, bien plus qu'une
question militaire et technique, l’insurrection est une question politique :
ses armes essentielles sont l'organisation et la conscience du
prolétariat. C'est pour cela que, malgré
les apparences, et quel que soit le chemin qu'il lui reste encore à parcourir
pour arriver à une telle issue, le prolétariat de Pologne, parce que plus
organisé, plus expérimenté et plus conscient, est plus proche de l'insurrection
aujourd’hui! qu'il ne 1’était en 1970 ou en 1976
14) La thèse d'une moindre importance du mouvement en 1980 qu'en 1970, si elle pouvait avoir une apparence de vérité en juillet, au début du mouvement, est devenue après 5 mois parfaitement indéfendable. Que l'on juge le mouvement présent par sa durée, ses revendications, son extension, son organisation, sa dynamique, de même que sur le niveau des concessions faites par la bourgeoisie, et la gravité de sa crise politique, et l'on peut aisément constater qu'il est bien plus puissant qu'en 1970.
Cette différence entre les deux mouvements s'explique par l'expérience accumulée par les ouvriers polonais depuis 70. Mais c'est là un cadre partiel et encore insuffisant d'explication. En fait, on ne peut comprendre l'ampleur du mouvement présent en le replaçant dans le contexte général de la reprise historique du prolétariat mondial a la fin des années 60 et en tenant compte des différentes phases de cette reprise.
L'hiver 70 polonais s'inscrit dans une première vague de luttes -celle qui inaugure la reprise historique- qui va de mai 68 en France aux grèves de l'hiver 73-74 en Grande-Bretagne en passant par "l'automne chaud" italien de 1969, le "Cordobazo" argentin et les grèves sauvages d'Allemagne de la même année et par une multitude d'autres luttes qui touchent TOUS les pays industrialisés. Déclenchée alors que la crise commence à peine à faire sentir ses effets (bien qu'en Pologne la situation soit déjà catastrophique), cette offensive ouvrière surprend la bourgeoisie (comme elle surprend le prolétariat lui-même) qui, un peu partout, se trouve momentanément désemparée. Mais elle se reprend rapidement et, à travers toutes sortes de mystifications, elle réussit à repousser jusqu'en 78 la deuxième vague de luttes où l'on voit tour à tour les mineurs américains en 78, les ouvriers de la sidérurgie en France début 79, les travailleurs du port de Rotterdam à l'automne 79, les ouvriers de la sidérurgie de Grande-Bretagne début 80 ainsi que les métallurgistes brésiliens durant toute cette période... reprendre le chemin du combat! C'est à cette deuxième-vague de luttes qu'appartient le mouvement présent du prolétariat polonais.
Celle-ci se distingue de la première, par :
- la gravité bien plus catastrophique de la crise du capitalisme.
- une meilleure préparation de la bourgeoisie face aux luttes.
- une expérience plus grande de la classe ouvrière, et notamment sur le problème syndical, expérience qui s'est manifestée ces dernières années par une dénonciation explicite des syndicats par des minorités significatives d'ouvriers de même que par une clarification des positions de classe de certains groupes révolutionnaires sur cette question.
Dans ces conditions, la
deuxième vague des luttes ouvrières s'annonce, malgré tous les pièges que
tendra une bourgeoisie avertie, bien plus considérable que la précédente. C'est
ce que confirme aujourd'hui la lutte des ouvriers de Pologne.
15) Le constat de l'ampleur sans précédent, tant du mouvement
de luttes en Pologne que de la crise politique de la bourgeoisie et de la
gravité de la situation économique dans le monde entier peut suggérer que s'est
créé dans ce pays une situation révolutionnaire. Ce n'est nullement le cas.
Lénine définit la crise révolutionnaire par le fait que "ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant" et "ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant". A première vue, telle est la situation en Pologne. Cependant, dans la période présente, après l'expérience historique accumulée par la bourgeoisie notamment avec octobre 17, il serait illusoire de croire qu'elle va laisser ses secteurs les plus faibles affronter tous seuls le prolétariat. De même qu'on a pu voir toutes les "bonnes fées" du bloc occidental se pencher sur le berceau de la nouvelle née "démocratie" en Espagne en 1976 pour lui éviter tout faux pas face à un des prolétariats les plus combatifs du monde à l'époque, on peut constater aujourd'hui que "ceux d'en haut" ne sont pas seulement à Varsovie mais également surtout à Moscou ainsi que dans d'autres capitales importantes. Cette unité que manifeste la bourgeoisie face à la menace prolétarienne, notamment dans le cadre du bloc, signifie qu’une période révolutionnaire ne pourra s'ouvrir réellement que lorsque le prolétariat de tous les pays susceptibles de prêter main forte à une bourgeoisie aux abois sera sur le pied de guerre.
A un autre titre encore, cette maturité internationale du mouvement est indispensable pour que puisse s'ouvrir une période révolutionnaire. Elle seule en effet peut permettre aux ouvriers polonais de rompre complètement avec le nationalisme qui obscurcit encore leur esprit et qui leur interdit d' atteindre le niveau de conscience sans lequel il n'y a pas de révolution possible. Enfin, un tel niveau de conscience se manifeste nécessairement par l'apparition d'organisations politiques communistes au sein de la classe. Or la terrible contre-révolution qui s'est abattue en Russie et dans les pays de son bloc a liquidé physiquement et de façon totale tous les courants politiques du prolétariat de ces pays et ce n'est qu'en desserrant l'étau de la contre-révolution comme il le fait aujourd'hui qu'il peut commencer à recréer ces organismes.
Si l'heure n'est pas encore venue pour une insurrection en Pologne, par contre une première brèche s'est ouverte dans le bloc de l'Est, après un demi siècle de contre-révolution permettant que prenne place le processus de reformation des organisations politiques révolutionnaires.
16) De même que les causes et les caractéristiques du présent mouvement en Pologne ne peuvent être comprise que dans le cadre mondial, c'est ce cadre mondial seul qui permet de définir ses perspectives.
Avant même qu'elle ne puisse se traduire sur le plan des combats de classe, la dimension mondiale des événements en Pologne et de leur futur est mise en évidence par les manœuvres présentes de la bourgeoisie de toutes les grandes puissances, qui soit s'inquiètent avec insistance des "menaces qui pèsent sur le socialisme" dans ce pays, soit se disent "disposées à répondre aux préoccupations des autorités polonaises dans les différents domaines où elles se sont exprimées" (Giscard d'Estaing recevant Jagielski le 21 novembre) et mettent en garde l'URSS contre toute intervention en Pologne.
La préoccupation de la bourgeoisie de tous les pays est réelle et profonde. En fait, si elle peut tolérer que des événements comme ceux de Pologne affectent comme c'est le cas encore aujourd'hui, des pays de second plan (comme elle supportait la crise tant qu'elle bouleversait des pays de la périphérie), elle ne peut supporter qu'une telle situation s'installe dans des pays du centre, des métropoles comme l'URSS, la France, l'Angleterre, ou l'Allemagne. Or la Pologne est comme une flammèche sur une traînée de poudre qui risque de s'étendre à l'ensemble de l'Europe de l'Est, y compris la Russie, et mettre le feu a certains des grands pays d'Europe de 1'ouest parmi les plus touchés par la crise. C'est pour cela que l'évolution de la situation en Pologne est prise en charge par la bourgeoisie mondiale. Dans cette opération les deux blocs se partagent le travail :
- à l'Occident échoie la responsabilité d'essayer de donner un peu d'oxygène à une économie polonaise au bord de la banqueroute : dans les prêts consentis par l'Allemagne, la France et les USA et qui viennent s'ajouter aux 20 milliards de dollars de dettes de l'Etat polonais, il n'y a nulle perspective de rentabilisation économique : chacun sait que ce sont des prêts à fonds perdus qui doivent permettre de donner à manger aux ouvriers polonais pendant l'hiver et les empêcher de se révolter.
- à la Russie revient le rôle de menacer aujourd'hui et éventuellement d'apporter demain une "aide fraternelle" blindée à la bourgeoisie polonaise si elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule.
Malgré les mises en garde de l'Occident, contre toute "aventure" de l'URSS et malgré les dénonciations par celle-ci des "menées de l'impérialisme américain et des revanchards de Bonn", il existe une solidarité de fond entre les deux blocs pour faire taire le plus vite possible le prolétariat de Pologne.
Les diatribes moscovites, tchèques et est-allemandes appartiennent à l'arsenal classique de la propagande. Elles révèlent une certaine inquiétude que Occident n'utilise à son profit la dépendance financière à son égard dans laquelle se trouve chaque jour plus la Pologne et les autres pays de l'Est. Mais elles ont surtout comme fonction d'exercer un avantage sur les ouvriers de Pologne et de préparer e éventuelle intervention bien que cette "solution" n'ait été envisagée que comme dernier recours (en cas de liquéfaction de l'Etat polonais), tant est réelle l'appréhension qu'elle n'allume un incendie social en Europe de l'Est.
Quant aux mises en garde occidentales, si elles font partie, elles aussi des armes classiques de la propagande anti-russe, elles ont une toute autre signification que celles énoncées dans le passé, par exemple, à propos du Golfe Persique à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. La Pologne fait partie intégrante du bloc de l'Est et une entrée plus massive sur son territoire de troupes russes (dont on dégarnirait de toute façon les avant-postes de l’Allemagne de 1 'Est) ne changerait rien au rapport de forces entre les blocs. Le Secrétaire Général de OTAN, Luns, n'a-t-il pas déclaré nettement que son organisation ne bougerait pas en cas d'intervention soviétique ? Fondamentalement, le destinataire de ces mises en garde répétées n'est pas le gouvernement de l'URSS, bien qu'à travers elles on puisse partie tenter de dissuader une bourgeoisie moins subtile et expérimentée que celle d'Occident de se lancer dans une"aventure"aux conséquences sociales prévisibles non seulement à l'Est mais également l'Ouest. Ce que visent essentiellement ces mises garde, c'est de faire un barrage idéologique préventif auprès du prolétariat occidental, afin que, cas d'intervention russe, celle-ci ne soit pas comprise par lui comme ce qu'elle serait réellement, c’est-à-dire une opération de police de tout le capitalisme contre la classe ouvrière mondiale, mais comme une nouvelle manifestation de la "barbarie du totalitarisme "soviétique" contre la "liberté des peuples. L'indignation et la colère qu'une telle intervention ne manquerait pas de provoquer parmi les ouvriers d'occident, la bourgeoisie se donne pour tâche de les dévier contre le "méchant russe afin de "souder la solidarité" au sein du "camp démocratique" entre toutes les classes de la société et empêcher le prolétariat de manifester solidarité de classe en engageant partout le combat contre son ennemi véritable : le capital. Quel que soit le caractère dramatique de leur ton, les mises en garde occidentales ne traduisent donc pas une nouvelle aggravation des tensions entre blocs impérialistes. Pour que les choses soient en claires et comme gage de la "bonne foi" et des bonnes intentions" des Etats-Unis, Reagan s'est empressé d'envoyer, fin novembre, son ambassadeur personnel Percy, à Moscou, annoncer aux dirigeants du bloc de l'Est que son pays était prêt à réexaminer de façon positive la négociation Salt. En réalité, malgré certaines apparences, la lutte des ouvriers de Pologne est venue réchauffer les relations Est-Ouest que l'invasion de l'Afghanistan avait considérablement refroidies il y a moins d'un an.
Ainsi se trouve de nouveau illustré le fait que le prolétariat est la seule force dans la société capable, par sa lutte, d’empêcher le capitalisme de déchaîner un troisième holocauste impérialiste.
17) Les évènements de Pologne font apparaître deux grands dangers qui menacent le prolétariat :
- la capitulation devant la bourgeoisie : les ouvriers cèdent à l'intimidation, se rendent aux arguments de Walesa sur "l'intérêt national", acceptent les terribles sacrifices que requière le sauvetage (qui de toute façon ne saurait être que momentané) du capital national sans pour cela s'épargner un développement progressif de la répression qui n'aura de cesse avant que ne soit rétablie la chape de plomb dont ils s'étaient dégagés ;
- l'écrasement physique sanglant : les troupes du Pacte de Varsovie (car les forces de police et militaires polonaises ne seraient ni suffisantes ni sûres) apportent "une aide fraternelle au socialisme et à la classe ouvrière de Pologne" (lire au capitalisme et à la bourgeoisie).
Face à ces deux menaces, le prolétariat de Pologne ne peut que :
- maintenir sa mobilisation face aux tentatives de normalisation que la bourgeoisie a engagées, conserver cette solidarité et cette unité qui jusqu'à présent ont fait sa force, mettre à profit cette mobilisation, non pour se lancer immédiatement dans un affrontement militaire décisif contre la bourgeoisie qui serait prématuré tant que les ouvriers des autres pays de l'Est n'auront pas développé leur combativité, mais pour continuer son effort d'auto organisation, pour assimiler l'expérience de son mouvement, en tirer un maximum de leçons politiques pour les combats de demain et s'atteler à la tâche de formation de ses organisations politiques révolutionnaires
- lancer un appel aux ouvriers de Russie et des pays satellites dont seule la lutte peut paralyser le bras meurtrier de leur bourgeoisie et permettre aux ouvriers de Pologne de mettre en échec les manœuvres de leurs faux amis à la Walesa préparant la "normalisation" à la Kania.
Le prolétariat de Pologne n'est pas seul. Partout dans le monde se créent les conditions qui pousseront ses frères de classe des autres pays à le rejoindre dans le combat. Il est du devoir des révolutionnaires et des prolétaires conscients d'opposer à la solidarité manifestée par la bourgeoisie de tous les pays pour mettre au pas les ouvriers de Pologne, la solidarité de la classe ouvrière mondiale.
Ce que la bourgeoisie veut à tout prix empêcher, le prolétariat doit le réaliser : les combats de Pologne ne doivent pas rester sans lendemain mais doivent être au contraire l'annonce d'un nouveau pas de la combativité et de la prise de conscience du prolétariat de tous les pays.
Si le mouvement des ouvriers polonais a atteint aujourd’hui un palier, il n'y a nul lieu de considérer que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, ce palier se situe à un niveau élevé et, en ce sens, la classe ouvrière de Pologne a d'ores et déjà répondu à l'exigence pour le prolétariat mondial de faire reculer la menace de guerre en "portant son combat à un niveau supérieur" comme le constatait la prise de position du CCI du 20 janvier 1980 à la suite de l'invasion de l'Afghanistan. D'autre part, ce mouvement n'est condamné à rester à ce stade que s'il reste isolé, mais rien ne le condamne à un tel isolement. C'est pour cela que, paraphrasant ce qu'écrivait en 1918 Rosa Luxemburg de la révolution russe, on peut dire avec espoir :
"En Pologne, le problème ne peut être que posé, c'est au prolétariat mondial de le résoudre."
CCI 4/12/80
Géographique:
- Pologne [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
A la lumière des évènements en Pologne, le rôle des révolutionnaires
- 2544 reads
Dans un monde aux sinistres perspectives, menacé de famines et de guerre, les grèves de masse des ouvriers polonais jettent un éclat lumineux d'espoir.
Comparé à la période effervescente de la fin des années 60 et du début des années 70, époque où le réveil international de la lutte de classe avait tiré des poubelles l'idée de la révolution, le reste des années 70 a semblé sinistre et troublant. Au moins dans les pays capitalistes majeurs, la lutte de classe est entrée dans une phase de retrait; et, alors que l'économie mondiale se désintégrait visiblement, parmi toutes les classes montait la prise de conscience que la seule lumière au bout du tunnel du capitalisme était le feu sinistre des bombes thermonucléaires.
Parmi les jeunes générations de la classe ouvrière et d'autres couches opprimées, les drapeaux de la révolte totale qu'ils avaient dressés dans ces dernières années, laissèrent place à l'apathie et au cynisme. Beaucoup de jeunes ouvriers mécontents ont dérivé vers la violence nihiliste, pendant qu'un nombre considérable d'étudiants révoltés d'hier optait pour les pâturages plus calmes du retour à la vie organique et à la cuisson du pain complet. Le mouvement communiste révolutionnaire qui était né de cette première vague de luttes sociales atteignit un certain point de développement et de maturité, mais il est resté remarquablement petit et avec un impact direct encore bien faible sur la lutte de classe. En réponse à cette situation objective, certains courants révolutionnaires se sont égarés dans l'individualisme et les théories sur l'intégration du prolétariat dans l'ordre bourgeois. D'autres ont cherché à compenser leur manque de confiance dans la classe et leur isolement politique, en s'adonnant à des rêves sur le parti omniscient qui, comme Jésus descendant des cieux dans toute sa gloire, sauvera le prolétariat de ses pêchés originels.
Mais, en regardant au-delà des apparences -ce qui est, par définition la méthode du marxisme- il était possible de discerner un autre processus se développant dans cette période. Oui, la lutte prolétarienne était en reflux, mais un reflux n'est pas la même chose que l'écrasement de la défaite. Derrière l'apathie apparente, des millions de prolétaires réfléchissaient avec simplicité et sérieux se posant des questions telles que : pourquoi ne gagnons nous plus rien lorsque nous nous mettons en grève ? Pourquoi les syndicats agissent-ils de cette façon ? Y a t’il quelque chose qui puisse être fait par rapport à la menace de guerre ? Pour la plupart de telles questions se sont posées d'une façon incohérente, inorganisée, et la conclusion première à laquelle est arrivée la plupart des ouvriers, c'est qu'il valait peut-être mieux ne pas secouer le bateau, et qu'il pouvait être plus sage d'attendre pour voir si la crise allait montrer des signes de ralentissement. Mais une minorité d'ouvriers a commencé à se poser ces questions de façon plus organisée, et est arrivée à des conclusions beaucoup plus radicales. Ainsi, l'apparition de cercles de discussion ouvriers dans des pays comme l'Italie, où la crise économique et sociale est extrêmement avancée, fut une expression de quelque chose de beaucoup plus large et plus profond, d'un processus souterrain de réflexion qui se poursuivait dans l'ensemble de la classe. Et, par dessus tout, alors que la population entière subissait de plus en plus les attaques du chômage et de l'inflation, le mécontentement qui s'accumulait dans les entrailles de la société portait nécessairement en lui le potentiel d'énormes explosions imprévues de la lutte de classe -d'autant plus qu'il devenait clair que la bourgeoisie était incapable de faire quoi que ce soit contre la crise de son système.
Les années 78-79 ont vu à la fois un approfondissement net de la crise, et les premiers signes d'une réaction contre celle-ci de la part du prolétariat des pays avancés : la grève des mineurs américains, la grève des sidérurgistes en Allemagne de l'Ouest, 1"'hiver de mécontentement" anglais qui a précipité la chute du gouvernement travailliste. Qu'une nouvelle phase de la lutte de classe se soit ouverte, les violentes bagarres à Longwy et Denain, l'auto organisation des hospitaliers italiens et des dockers hollandais, la grève prolongée et combattive des sidérurgistes anglais l'ont confirmé. Mais la grève de masse en Pologne -à cause de sa large extension, de son niveau d'auto organisation, de ses répercussions internationales, de son caractère politique évident a pleinement confirmé qu'en dépit des bruits de bottes de toutes les bourgeoisies et des dangers réels de guerre mondiale, la classe ouvrière peut encore agir à temps pour empêcher le système capitaliste de précipiter le monde dans l'abîme.
Le but de cet article n'est pas de tirer toutes les leçons de cette expérience immensément riche, ni de décrire la situation présente en Pologne, qui continue à être marquée par des signes d'extrême fermentation et d'instabilité, même si les aspirations des ouvriers sont dans une certaine mesure canalisées vers les fausses solutions de la démocratie et du syndicalisme "indépendant". Pour un plus grand développement sur cette question et sur la situation récente, nous renvoyons le lecteur à l'article d'orientation de la Revue Internationale n°23, à l'article dans ce numéro, ainsi qu'aux publications territoriales du CCI. Notre intention est ici d'examiner comment les événements polonais éclairent une question qui est presque toujours la principale pierre de touche des désaccords dans le mouvement révolutionnaire d’aujourd’hui, tout comme elle l’a été dans le passé : la nature et la fonction de l’organisation des révolutionnaires.
Il est vrai que les groupes du mouvement révolutionnaire actuel ne sont pas tous parvenus aux mêmes conclusions sur d’autres aspects des événements polonais – loin de là. Il a été particulièrement difficile pour un bon nombre de groupes révolutionnaires d’éviter la tentation de voir les syndicats « indépendants » comme une sorte d’expression prolétarienne, en particulier parce qu’il semble en continuité avec les organes authentiques de la lutte de la classe ouvrière : les comités de grève. Cette difficulté s'est surtout rencontrée chez les groupes 1es plus éloignés des sol ides racines de la tradition communiste de gauche.
Ainsi, les ex-maoïstes du Bochevik en France crient : " Longue vie aux syndicats " 1ibres" des ouvriers polonais", pendant que le Marxist Workers Comittee américain, également ex-maoïste, les voit comme un acquis positif de la lutte, même si le manque de direction révolutionnaire les expose au danger de la corruption. Les libertaires du groupe anglais Solidarity ont été si enthousiasmés par ces instituons apparemment "autonomes", "auto-gérées" (qu'importe si elles s'appellent syndicats !) qu'ils ont applaudi (de façon critique) les trotskistes du SWP anglais pour leur soutien aux syndicats libres. Pire encore, Solidarity a organisé un meeting à Londres pour exprimer son accord avec l'idéal des syndicats indépendants pour les ouvriers polonais et ne s'est guère sentie embarrassé de partager une plate-forme avec un conseiller du parti travailliste et les sociaux-démocrates polonais. Dans sa dernière revue (n°14), Solidarity tente; de s'en sortir en disant qu'il n'a pas réellement partagé une telle plate-forme; il a simplement donné cette impression à cause de l'arrangement "traditionnel" des sièges à la réunion (c'est à dire une table d’orateurs faisant face à l'audience assise sur des rangées de chaises, au lieu de la pratique plus libertaire de s'asseoir en cercle !). En tout cas, Solidarity se défend lamentablement d'avoir mis en place un front uni avec ces autres groupes, et prétend n'avoir fait qu'organiser un "forum ouvert" où chacun pouvait donner son point de vue. C'est ainsi que les libertaires se dévoilant comme les défenseurs de la mystification bourgeoise libérale selon laquelle les points de vue sont également intéressants, également sujets à discussion. Les frontières de classe disparaissent, et seules les formes restent.
Les groupes de la gauche communiste ne se sont pas laissés prendre tout à fait aussi facilement, bien qu'à la fois, le PCI (Programme Communiste) le GCI (Groupe communiste internationaliste) montrent à quel point il est dangereux de ne pas avoir une compréhension claire que nous vivons l'époque décadente du capitalisme et que le syndicalisme est mort. Le PCI semble rejeter les syndicats libres actuels mais veut laisser la porte ouverte à l'idée qu’ils pourraient exister de réels syndicats libres à condition qu'ils soient dirigés par un parti révolutionnaire. Quant au GCI, tout comme les bordiguistes officiels, il défend l’idée d'un "associationnisme ouvrier" éternel qui serait la forme "immédiate" d'organisation créée par les ouvriers en lutte, et dont le nom et la forme sont indifférente, quelle que soit la période de l’histoire. Selon eux, syndicat, groupe ouvrier, soviet, peu importe : seuls les formalistes, comme le CCI, par exemple se soucient des formes ! L’important, c’est que ces expressions de l’associationnisme sont "des épisodes dans l’histoire du parti, que ce soit dans le temps ou dans l’espace" (cf. "Rupture avec le CCI, p9). Ainsi, fidèle à son anti-formalisme, le GCI a ardemment soutenu l’idée d’une possible transformation des syndicats libres en Pologne en "vrais organismes ouvriers, larges, ouverts à tous les prolétaires en lutte, coordination et centralisation des comités de grève" et a également soutenu l’idée que ces syndicats libres pourraient se transformer en organes d'Etat sous la pression des autorités et des dissidents (cf."Le Communiste" n°7. -p. 4). Mais ces hésitations se sont placées plus dans le domaine de la spéculation que dans le monde matériel d'aujourd'hui : le dernier numéro du Communiste (n°8) est très clair quant à la dénonciation des nouveaux syndicats.
Dans l'ensemble, les groupes
de la gauche communiste ont su apprécier l'importance des évènements en Pologne
et défendre les positions de classe de base : opposition au capitalisme à l'Est
et à l'Ouest, soutien à l'organisation et à l'unité de la lutte des ouvriers
polonais, rejet des mystifications démocratiques et des syndicats libres. Mais si vous interrogiez le CCI, la CWO, le PCI Battaglia
Communista, le GCI, le PIC (Pour une Intervention communiste) ou
d'autres au sujet de ce que les évènements en Pologne nous enseignent sur le
rôle de l'organisation révolutionnaire, vous seriez certains d’avoir une
grande variété de réponses. En fait,
c'est l'incapacité des groupes communistes à se mettre d'accord sur cette
question de base qui a sapé la possibilité pour le mouvement révolutionnaire
international de faire une intervention commune en réponse aux grèves
polonaises : peu de temps avant qu'elles n'éclatent, les conférences
internationales des groupes communistes ont échoué à cause d'une incapacité à
se mettre d'accord ne serait-ce que sur le sujet, comment doit-on mener le
débat sur le rôle du parti révolutionnaire (voir la Revue Internationale
n°22).
Etant donné que l'humanité vit encore dans la phase préhistorique où l'inconscient tend à dominer le conscient, il n'est pas surprenant que l'avant-garde révolutionnaire puisse être également affligée de cette difficulté générale qui rend plus facile aux hommes de comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur, que de comprendre leur propre nature subjective.
Mais comme nous n’avons jamais cessé de le répéter lors des conférences internationales, les débats théoriques entre révolutionnaires, y compris le débat sur leur propre nature et fonction, ne peuvent être simplement résolus à travers l'auto-analyse ou les discussions " entre nous". Ils ne peuvent être posés qu'à travers l'interaction de la pensée révolutionnaire et l'expérience pratique de la lutte de classe.
Pour nous, la classe ouvrière n'a pas encore accumulé une expérience historique suffisante pour dire aujourd'hui, que toutes les questions sur le rôle de l’organisation révolutionnaire sont résolues une fois pour toutes. même si nous pouvons être clairs sur ce que l'organisation ne peut pas faire.
C'est sans aucun doute un débat qui continuera -à la fois chez les révolutionnaires et la classe dans son ensemble- bien après que d'autres problèmes, comme la nature des syndicats aient cessé d'être controversés. En fait, seule la révolution elle-même rendra clairs à l'ensemble du mouvement révolutionnaire les principaux points de la "question du parti".
Mais si aujourd'hui le débat doit quitter le domaine de la grandiose abstraction et des vagues affirmations, il doit être mené en rapport avec le développement actuel de la lutte de classes.
Depuis sa constitution, le CCI a mené un combat implacable contre les deux principales distorsions de la compréhension marxiste du rôle de l'organisation révolutionnaire : d'un côté, contre le conseillisme, le spontanéisme, les libertaires ... etc., toutes ces conceptions qui minimisent ou nient l'importance de l'organisation révolutionnaire, et en particulier son expression la plus avancée, le parti communiste mondial; de l'autre côté, contre le fétichisme du parti, l'idée qu'une minorité révolutionnaire peut se substituer à l’action de la classe ..., toutes ces conceptions qui surestiment et exagèrent le rôle du parti. Nous pensons que les récents évènements en Pologne ont été dans le sens de notre lutte sur ces deux faits et nous allons à présent essayer de montrer pourquoi et comment.
LA BANQUEROUTE DU SPONTANEISME
Les courants révolutionnaires qui ont surgi à la fin des années 60 et au début des années 80 ont été fortement marqués par différentes formes d'idéologie spontanéiste. En partie, c'était une inévitable réaction aux aberrations du stalinisme et du trotskisme. Durant des décennies, ces tendances contre-révolutionnaires sont apparues comme des expressions du marxisme, et pour beaucoup de gens, l'idée même du parti révolutionnaire était irrémédiablement associée aux répugnantes caricatures offertes par les partis communistes et leurs acolytes trotskistes et maoïstes. En outre, après mai 68 et d'autres expressions de la révolte prolétarienne, les révolutionnaires furent naturellement enthousiastes face au fait que les ouvriers montraient alors leur capacité à lutter et à s'organiser sans la "direction" des partis officiels de gauche. Mais, étant donné le caractère purement viscéral de leurs réactions au stalinisme et au trotskisme, nombre de révolutionnaires sont arrivés à la conclusion facile qu'un parti révolutionnaire, et dans certains cas, toute forme d'organisation révolutionnaire ne pouvait être qu'une barrière au mouvement spontané de la classe.
Une autre raison à la prédominance des idées spontanéistes dans cette phase initiale de reprise du mouvement révolutionnaire, fut que les révoltes sociales qui avaient donné naissance à beaucoup de ces courants n'étaient pas toujours clairement le fait de la classe ouvrière et n'étaient pas dirigées de façon évidente contre une économie en crise profonde. Mai 68 en est l'exemple classique, avec son interaction entre les révoltes étudiantes et les grèves ouvrières, et donnait l'impression que c'était un mouvement contre les excès de la "société de consommation" plutôt qu'une réponse aux premières manifestations de la crise économique mondiale qui s'annonçait. La majorité des groupes révolutionnaires, nés dans cette période, était composée d’éléments qui venaient, soit directement du mouvement étudiant, soit de secteurs marginaux du prolétariat. Les attitudes de ces couches de la société qu'ils apportaient avec eux, prirent différentes formes "théoriques", mais elles étaient souvent marquées par le sentiment général que la révolution communiste était une activité ludique, plutôt qu'une lutte sérieuse, d'une portée historique. Il est vrai que les révolutions sont "la fête des opprimés" et qu'elles auront toujours des aspects humoristiques et ludiques, mais ceux-ci ne peuvent être que le contre-point lumineux du drame révolutionnaire qui se joue, tant que la classe ouvrière doit encore gagner une guerre civile dure et violente contre un ennemi de classe sans pitié. Mais les situationnistes et courants apparentés ont souvent parlé comme si la révolution allait apporter une réalisation immédiate de tous les désirs. La révolution devait être faite pour le plaisir ou ne valait pas le coup d'être faite, et on ne devenait révolutionnaire que pour ses propres besoins. Tout autre chose n'était que "sacrifice" et "militantisme".
Les attitudes comme celles-ci se basaient sur un une incapacité fondamentale à comprendre que les révolutionnaires, qu'ils le sachent ou non, sont produits par les besoins de la classe dans son ensemble. Pour le prolétariat, classe associée par excellence, il ne peut y avoir de séparation entre les besoins de la collectivité et les besoins de l'individu. Le prolétariat donne constamment naissance à des fractions révolutionnaires parce qu'il est appelé à devenir conscient de ses buts généraux, parce que sa lutte ne peut se développer qu'en brisant la prison de l'immédiatisme. Qui plus est, le seul facteur qui puisse appeler le prolétariat à lutter de façon massive, est la crise du système capitaliste. Les mouvements majeurs de classe ne se produisent pas parce que les ouvriers en ont assez et veulent protester contre l'ennui de la vie quotidienne dans le capitalisme De tels sentiments existent certainement dans la classe ouvrière, mais ne peuvent donner jour qu'à de sporadiques explosions de mécontentement. La classe ouvrière ne bougera à une échelle massive que lorsqu'elle sera forcée de défendre ses conditions d'existence, comme les ouvriers polonais l'ont montré en plusieurs occasions mémorables. La guerre de classe est une affaire sérieuse car c'est une question de vie ou de mort pour le prolétariat.
Alors que la crise balaye la dernière illusion selon laquelle nous vivons une société de consommation dont l'abondante richesse peut nous tomber dans les mains grâce à la volonté situationniste, il devient clair que le choix qui nous est offert par le capitalisme n'est pas socialisme ou ennui, mais socialisme ou barbarie. La lutte révolutionnaire de demain dans ses méthodes et ses buts, ira bien au delà des mouvements révolutionnaires de 1917-1923, mais elle ne perdra rien du sérieux et de l'héroïsme de ces jours-là. Au contraire, avec le menace de l'anéantissement nucléaire suspendue sur nos têtes, bien plus lourd sera l'en jeu. Tout cela nous conduit a la conclusion que les révolutionnaires d'aujourd'hui doivent avoir le sens de leurs propres responsabilités.
Alors que la guerre de classes commence à s'intensifier, il devient clair que la seule façon "authentique" de vivre sa vie quotidienne est de déclarer la guerre totale au capitalisme, et que ce besoin individuel correspond au besoin collectif qu' a le prolétariat que ses éléments révolutionnaires s'organisent et interviennent de la façon la plus efficace possible. Et comme de plus en plus de révolutionnaires sont engendrés directement par la lutte de classe, du cœur du prolétariat industriel, ce rapport entre les besoins collectifs et individuels ne sera plus ce grand "mystère" qu'il reste encore pour beaucoup de libertaires et de spontanéistes d'aujourd'hui.
A vrai dire, la banqueroute des spontanéistes apparaissait déjà pendant le reflux qui a suivi la première vague de lutte de classes internationale. La majorité des courants conseillistes et modernistes qui ont fleuri au début de la décennie 70, I.C.O., l'Internationale Situationniste, le GLAT, Combate, Mouvement Communiste, et beaucoup d'autres, ont simplement disparu : c'était après tout, la conséquence logique de leurs théories anti-organisationnelles. Parmi les groupes qui ont pu survivre à la période de reflux, ce furent en majorité ceux qui, même à partir de points divergents, ont pris au sérieux la question de l'organisation : le CCI, la CWO, le PCI-Battaglia Comunista, le PCI-Programma Communista, etc.
Dans les Conditions actuelles, simplement survivre est déjà un pas important pour un groupe révolutionnaire, tant la pression de l'isolement et de l'idéologie dominante est grande. En fait, il est absolument crucial que des groupes révolutionnaires fassent montre d'une capacité à continuer leur marche dans les périodes difficiles ; sinon ils ne sont pas capables d'agir comme pôle de référence et de regroupement lorsque les conditions de la lutte de classe redeviennent plus favorables. Mais si le reflux a déjà révélé l'inadéquation des idées et de la pratique spontanéistes, alors la résurgence de la lutte de classe va achever leur déroute. Les événements polonais en sont , de loin, l'exemple le plus éloquent.
LA NECESSITÉ D'UNE ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
Personne n ' a pu suivre les récentes luttes de masse en Pologne, sans être frappé par les éléments profondément contradictoires dans la conscience de classe des ouvriers. D'un côté, les ouvriers polonais ont montré qu'ils se considéraient comme une classe, parce qu’ils ont placé la solidarité de classe au-dessus des intérêts immédiats de tel ou tel groupe d'ouvriers et parce qu'ils ont considéré leur patron, l'Etat polonais, comme une force tout à fait étrangère à eux et ne méritant pas un iota de confiance et de respect de leur part. Ils ont montré une claire connaissance des principes de base de la démocratie ouvrière dans la façon dont ils ont organisé leurs assemblées et leurs comités de grève. Ils ont montré leur compréhension du besoin d'aller du terrain économique vers le terrain politique en établissant des revendications politiques et en faisant face à l'appareil d'Etat tout entier. Et pourtant, au même moment, la conscience d'eux-mêmes comme classe a été sévèrement entravée par la tendance à se définir comme des polonais ou des catholiques ; le rejet de l'Etat a été compromis par les illusions sur les possibilités de le réformer; la capacité d'auto organisation s'est trouvée détournée vers la dangereuse illusion des syndicats "indépendants". Ces faiblesses idéologiques ne sont pas, bien sûr, une justification pour sous-estimer la force et la signification des grèves. Comme nous l'avons montré dans la Revue Internationale n°23, dans la révolution de 1905, les ouvriers qui marchaient derrière le pope Gapone en portant des images du Tsar, brandissaient la minute d'après les drapeaux rouges de la Social-Démocratie. Mais nous ne devons pas oublier qu'un des facteurs qui a permis aux ouvriers de faire cette transition si rapidement en 1905 fut précisément la présence du parti révolutionnaire marxiste au sein de la classe ouvrière. De tels bonds soudains de la conscience politique seront plus durs aujourd'hui pour la classe ouvrière, surtout dans le bloc russe, car la contre-révolution stalinienne a anéanti le mouvement communiste.
Néanmoins, le mouvement en Pologne a inévitablement fait surgir des groupes d'ouvriers qui sont plus intransigeants dans leur hostilité à l'Etat, moins impressionnés par les appels au patriotisme et l'intérêt national, plus préparés à repousser les limites de l'ensemble du mouvement. Ce sont ces ouvriers qui ont hué Walesa lorsqu'il a annoncé les accords à la fin de la grève du mois d'août, criant "Walesa, tu nous a vendu". Ce sont ces ouvriers qui, même après la "grande victoire" de la reconnaissance du syndicat Solidarité -qui était supposée suffire à faire rentrer joyeusement tout le monde au travail pour l'économie nationale- ont fait pression pour que les structures des nouveaux syndicats soient complètement séparées de l'Etat (signe de combativité, même si ce but en soi est illusoire. Ce sont ces ouvriers, qui, avec ou sans la bénédiction de Solidarité, ont continué à secouer l'économie nationale avec des actions de grèves sauvages. Nul doute que c'est à ce genre d'ouvriers que se référait récemment un député catholique de la Diète polonaise en les qualifiant "d'extrémistes de part et d'autre, qui, objectivement forment une sorte d'alliance contre les forces de dialogue" (Le Monde 23/11/80).
C'est des rangs d'ouvriers de ce genre que nous verrons, tout aussi inévitablement, l'apparition de groupes ouvriers, de publications"extrémistes", de cercles de discussion politique, et d'organisations qui, même si c'est de manière confuse, tentent de se réapproprier les acquis du marxisme révolutionnaire. Et, sauf si on en est au spontanéisme le plus rigide et le plus dogmatique, il n'est pas difficile de voir quelle fonction une telle avant-garde prolétarienne sera appelée à jouer : elle aura à essayer de mettre en lumière pour l'ensemble des ouvriers, les contradictions entre les actions radicales qu'ils font en pratique et les idées conservatrices qu'ils ont toujours dans la tête, idées qui ne peuvent que bloquer le développement futur du mouvement.
Si cette avant-garde est capable de devenir de plus en plus claire sur la signification réelle de la lutte des ouvriers polonais; si elle est capable de comprendre la nécessité de mener un combat politique contre les illusions nationaliste, syndicaliste, religieuse et autres qui existent dans la classe ; si elle voit pourquoi la lutte doit devenir internationale et révolutionnaire ; et si, en même temps, elle est capable de s'organiser effectivement et de faire connaître ses positions, le mouvement entier sera alors capable de faire d'énormes pas vers l'avenir révolutionnaire. D'un autre côté, sans l'intervention d'une telle minorité politique, les ouvriers polonais seront plus vulnérables aux pressions de l'idéologie bourgeoise, politiquement désarmés face à une opposition sans merci.
En d'autres termes, le
développement de la lutte elle-même démontre qu'il y a un besoin criant d'une
organisation de révolutionnaires basée sur une plate-forme communiste
claire. La classe ouvrière ne sera pas
capable d'atteindre la maturité politique requise par le haut niveau de la
lutte, si elle ne donne pas naissance aux organisations politiques
prolétariennes. Les spontanéistes qui
clament que les ouvriers développeront une conscience révolutionnaire sans
organisations révolutionnaires oublient le simple fait que les organisations
révolutionnaires sont un produit "spontané" des efforts du
prolétariat pour briser le carcan de l'idéologie bourgeoise et ouvrir une
alternative-révolutionnaire.
Ce n'est pas en opposant à
la légère les "luttes autonomes" et 1"intervention d'une
organisation politique que les spontanéistes peuvent échapper à ce fait que le
mouvement ne peut rester autonome -c'est à dire indépendant de la bourgeoisie
et de son Etat- que s'il est clair politiquement sur ce qu'il veut et où
il va. Comme l'ont montré les événements de la fin de la grève d'août 80, les
formes d'organisation de la classe ouvrière les mieux organisées et les plus
démocratiques ne sont pas capables de se maintenir si elles sont confuses sur
des questions vitales telles que le syndicalisme : plus les conceptions syndicalistes
ont dominé dans le MKS, plus celui-ci a commencé à échapper des mains des
ouvriers. Et les organisations de masse
de la classe ne seront pas capables de dépasser de telles confusions s'il
n'existe pas de minorité communiste combattant en leur sein, exposant les
manœuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents et traçant une perspective
claire pour le mouvement. L'organisation
révolutionnaire est le meilleur défenseur de l'autonomie des ouvriers. 1
LA STRUCTURE DE L ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
Si les événements de Pologne montrent que l'organisation révolutionnaire est un élément indispensable de l'autonomie prolétarienne, ils nous aident également à clarifier quelle forme une telle organisation doit prendre. Les travailleurs en Pologne, comme beaucoup d'autres secteurs de la classe dans les maillons les plus faibles du capital (Pérou, Corée, Egypte, etc. ... ) ont été contraints de se lancer dans des luttes de masse contre l'Etat alors qu'ils étaient cruellement isolés des courants révolutionnaires qui n'ont qu'une existence limitée dans les principaux pays occidentaux industrialisés. L'isolement politique de tels mouvements primordiaux de la classe ouvrière prouve que c'est un leurre de vouloir limiter le rôle des organisations révolutionnaires à un niveau local, celui d'une ville ou d'un pays. Cependant, beaucoup de groupes spontanéistes théorisent vraiment de telles limitations locales au nom du fédéralisme ou des organisations "autonomes". Ainsi alors que les ouvriers polonais faisaient face à l'Etat stalinien et que les organisations révolutionnaires qui existent principalement en Europe Occidentale et en Amérique du Nord, étaient obligées de se résigner à un rôle de propagande éloignée, dans l'incapacité de participer directement au mouvement, les tenants du fédéralisme ne peuvent que considérer cet isolement réciproque que comme une bonne chose! Nous pouvons donc nous rendre compte à quel point le localisme est une barrière au développement de l'autonomie de la classe ouvrière: en effet, si le mouvement révolutionnaire, là où il est le plus fort, ne comprend pas la nécessité de créer un pôle international de regroupement, de clarté politique, comment pourra t-il être d'une utilité quelconque à des groupes de travailleurs radicaux du bloc de l'Est ou du Tiers Monde, à ceux qui essaient de surmonter l'actuelle faiblesse idéologique de la lutte de classe dans ces régions? Devons-nous condamner ces travailleurs à tout retrouver par eux-mêmes, sans essayer de les aider, sans chercher à accélérer leur évolution politique? Quelle serait la signification de la solidarité de classe si nous ne faisions pas d'efforts pour aider les idées des révolutionnaires à briser les innombrables remparts du capitalisme ?
Si l'organisation des révolutionnaires doit être crée sur une base internationale, elle doit de plus être également centralisée. En créant les comités de grève inter entreprises, les ouvriers polonais ont montré que non seulement, la centralisation est le seul moyen pour organiser et unir réellement la lutte de classe, mais encore qu'elle est entièrement compatible avec la plus profonde démocratie ouvrière. Si les ouvriers polonais le comprennent, pourquoi est-ce un tel problème pour beaucoup de révolutionnaires aujourd'hui, pour ces camarades qui sont terrorisés par le seul mot de centralisation et pensent que le fédéralisme ou une simple addition de petits groupes autonome est la vraie manière de s'organiser? Il est étrange que les"conseillistes" soient à ce point effrayés par la centralisation, alors que les Conseils Ouvriers, tout comme le M.K.S, expriment simplement la compréhension qu'ont les ouvriers de la nécessité de centraliser toutes les assemblées et comités d'usine locaux dans un seul organe unifié ! Bien qu'une organisation révolutionnaire ne suive pas exactement la forme d'organisation des Conseils , les principes organisationnels de base -centralisation, élection et révocabilité des organes centraux, etc.- sont les mêmes.
Quelques conseillistes ou semi-conseillistes peuvent faire valoir une dernière démarcation défensive. Ils peuvent être d'accord sur la nécessité d'une organisation révolutionnaire; qu'elle doit être internationale et même centralisée. Mais ils se fixent comme politique de ne jamais considérer un tel organe comme un parti. Par exemple, le PIC, dans sa dernière publication (Jeune Taupe n°33), nous informe qu'il est en train d'écrire une brochure de 100 à 150 pages dans laquelle il montre que "le concept de parti est lié au processus de la révolution bourgeoise et doit en conséquence être rejeté par les révolutionnaires". Mais, dans la même publication (page 4), il est dit que l'intervention des révolutionnaires. "ce n'est pas simplement d’être parmi les travailleurs, c'est faire connaître ses positions et proposer des actions afin d'aller dans le sens d'une clarification politique de l’ensemble du mouvement". Selon nous un jour nous avons la chance d'avoir une organisation communiste internationale capable de faire connaître ses positions à des millions de travailleurs dans tous les principaux centres capitalistes, de "proposer des actions" qui soient prises en charge et menées par un grand nombre d'ouvriers, alors, dans notre vocabulaire, qui est peut-être plus modeste que 150 pages sur ce point particulier, nous parlerons de parti communiste international . Le PIC peut préférer 1 'appeler autrement, mais qui alors sera intéressé par de telles discussions sémantiques en plein milieu de la guerre civile révolutionnaire ?
LES CONTRADICTIONS DU SUBSTITUTIONISME
Jusque là, certains courants du mouvement révolutionnaire pourraient être d'accord avec nos critiques du spontanéisme. Mais cela n'est pas suffisant pour les convaincre qu'ils ont beaucoup de points communs avec le CCI. Pour des groupes comme la CWO, le GCI, Battaglia Comunista, etc., le CCI est mal placé pour attaquer les conseillistes parce qu'il est trop fondamentalement conseilliste; parce que, tout en admettant "formellement" la nécessité d'un parti, nous le réduirions à un rôle purement propagandiste. Ainsi, le GCI dit : "Là où les communistes, depuis l'aube de leur existence, ont toujours cherché à assumer toutes les tâches de la lutte, à prendre une part active à tous les domaines du combat communiste, (... ) le CCI, quant à lui, estime avoir une fonction en propre : la propagande" ' (Rupture avec le CCI , p. 5). Et, plus loin, le GCI cite Marx contre nous, quand il dit que: "la tâche de l’internationale est d'organiser et de coordonner les forces ouvrières pour le combat qui les attend". L'Internationale, dit Marx, est "l 'organe central " pour 1 'action internationale des travailleurs. Le GCI et d'autres groupes considèrent donc que nous sommes vraiment des conseillistes parce que nous insistons sur le fait que la tâche de l'organisation révolutionnaire n'est pas d'organiser la classe ouvrière.
Ce n'est pas un hasard si le GCI essaie de confronter notre position sur le parti à celle de Marx. Pour cette organisation, peu de choses ont changé depuis le 19ème siècle. Pour nous, l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence n'a pas seulement altéré l'approche que pouvaient avoir les communistes des questions "stratégiques" comme les syndicats ou les luttes de libération nationales elle a aussi rendu nécessaire la réévaluation des rapports entre le parti et la classe. Avec le changement des conditions de la lutte de classe, il est impossible de conserver les conceptions initiales que les révolutionnaires avaient de leur rôle et de leurs fonctions. Au 19ème siècle, la classe ouvrière pouvait être organisée dans des organisations de masse comme les syndicats ou les partis sociaux-démocrates. Les partis politiques agissaient comme les "organisateurs" de la classe, dans la mesure où ils le pouvaient, par un travail quotidien ; ils impulsaient la formation de syndicats et autres organisations ouvrières de masse (la première Internationale était en fait un parti constitué d'organes syndicaux, d'associations et de sociétés ouvrières, etc.). A cause de leurs liens étroits avec ces organisations, ils pouvaient planifier, préparer et déclencher des grèves et autres actions de masse. Puisque les partis de la classe ouvrière agissaient encore dans le cadre du parlementarisme, et qu'ils se concevaient comme les seuls organes spécifiques de la classe ouvrière, il est également compréhensible qu'ils aient pu se concevoir comme les organisations au travers desquelles la classe ouvrière se saisirait éventuellement du pouvoir politique. Selon cette conception, le parti était naturellement "l'organe central", le quartier général "militaire" du mouvement prolétarien dans son ensemble.
Il n 'est pas ici de notre propos de donner une description détaillée de la manière dont les nouvelles conditions de la lutte de classes apparues avec le 20ème siècle, ont rendu ces conceptions caduques. Dans sa brochure "Grève de Masse partis et syndicats", Rosa Luxemburg a montré comment, dans la nouvelle période, le mouvement de la classe ne pouvait pas être déclenché et arrêté à travers les directives du comité central du parti. Dans la décadence, la lutte de classe explose de manière inopinée et imprévisible:
"La révolution russe (1905) nous apprend une chose: c'est que la grève de masse n'est ni 'fabriquée' artificiellement ni 'décidée'.. ou 'propagée', un éther immatériel et abstrait, mais que c’est un phénomène historique résultant à un certain moment d'une situation sociale à partir d'une nécessité historique ... Entreprendre une propagande en règle pour la grève de masse comme forme de l 'action prolétarienne, vouloir colporter cette idée pour y gagner peu à peu la classe ouvrière serait une occupation aussi oiseuse, aussi vaine et insipide que d'entreprendre une propagande pour l'idée de la révolution ou du combat sur les barricades". ("Grève de masse". Ch 2)
D'autres révolutionnaires ont souligné la signification des Soviets surgis dans les révolutions 1905 et 1917: en tant qu'organes du pouvoir politique de la classe ouvrière, ils remettent effectivement en cause l'idée du parti prenant et détenant le pouvoir au nom de la classe ouvrière.
Bien sûr, cette compréhension ne s'est pas développée parmi les révolutionnaires de manière homo gène : au contraire, les partis communistes qui furent construits pendant la période révolutionnaire de 1917-1923 étaient empreints de beaucoup des conceptions social-démocrates sur le parti en tant qu'organisateur de la lutte de classes et de la dictature du prolétariat. Et plus la vague révolutionnaire perdait de sa force vive, plus la vie de la classe cessait de s'exprimer dans les soviets, et plus ces relents social-démocrates infestèrent l'avant-garde révolutionnaire. En Russie en particulier, l'identification du parti à la dictature de la classe est devenue un facteur supplémentaire de dégénérescence de la révolution.
Aujourd'hui, alors que nous émergeons d'une longue période de contre-révolution, le mouvement communiste a encore très inégalement compris ces problèmes. Une des raisons à cela est que, alors que nous avons eu 50 ans ou plus pour comprendre la nature des syndicats ou des luttes de libération nationale, tout ce siècle ne nous fournit quasiment pas d'expérience concernant les rapports entre parti et classe. Pendant la plus grande partie de ce siècle, la classe ouvrière n'a pas eu de parti politique du tout. Ainsi, quand le CCI essaie de convaincre les groupes "partidistes" qu’il est nécessaire d'examiner le rôle du parti à la lumière des nouvelles circonstances historiques, quand il dit que les révolutionnaires ne peuvent plus se concevoir comme les organisateurs de la classe, ils mettent cela sur le compte d'un manque de volonté de notre parti d'une peur névrotique d'altérer la spontanéité pure et originelle du prolétariat. Le problème réel, que nous posons est immanquablement éludé dans leurs polémiques.
Ce n'est pas une question de volonté qui fait qu'il est impossible aux organisations révolutionnaires d'être "l'organe central" de la classe ouvrière, mais les changements historiques, structurels et irréversibles qui sont intervenus dans la vie du capitalisme. Mais plutôt que d'essayer de le démontrer abstraitement, voyons de quelle manière les événements de Pologne ont démontré dans la pratique ce qu'une organisation révolutionnaire ne peut pas faire ainsi que ce qu'elle peut et doit faire pour assumer ses responsabilités.
LA POLOGNE : UN EXEMPLE DE GREVE DE MASSE
Peut-être plus que toute autre lutte depuis la dernière vague révolutionnaire, les récentes grèves de Pologne donnent un modèle exemplaire du phénomène de la grève de masse. Elles ont explosé brutalement et se sont étendues comme une traînée de poudre; elles ont fait surgir des formes autonomes d'organisation de classe ; elles ont rapidement amené les ouvriers à faire face aux conséquences politiques de leurs luttes économiques ; elles ont tendu à unir les ouvriers comme classe au-delà des divisions corporatistes, et contre ensemble de l’ordre bourgeois. Comment cela nous permet-il de comprendre le rôle des révolutionnaires aujourd'hui ?
D'abord, cela montre que les grands mouvements de classe ne peuvent plus être planifiés et préparés à l'avance (au moins jusqu'à ce que la classe soit déjà en train de commencer à s'organiser elle-même de manière explicitement révolutionnaire). Les conditions des grèves de masse mûrissent presque imperceptiblement dans les profondeurs de la société bien qu'elles surgissent généralement en réponse une attaque particulière de la classe dominante, il est impossible de prédire avec précision quelle attaque est susceptible de provoquer une réponse massive.
La plupart des groupes révolutionnaires aujourd'hui sont d'accord sur le fait que la classe n'a plus aucune organisation de masse permanente pour préparer la lutte à l'avance, mais ils parlent encore de la préparation matérielle, technique ou organisationnelle des luttes prise en charge par une minorité combative ou par des groupes de communistes dans les usines. C'est un des thèmes favori du GCI par exemple.
Mais quels sortes de préparatifs matériels pourrait apporter une poignée de communistes ou de groupes ouvriers à un mouvement de l'ampleur de la vague de grèves de l'été 80 en Pologne ?
Il serait ridicule de les imaginer récoltant quelques sous pour un fond de grèves ou traçant des plans pour montrer aux ouvriers les routes les plus rapides pour traverser la ville pour appeler les autres usines à la grève. Il serait également absurde d'envisager des groupes de révolutionnaires dressant des listes précises de revendications économiques qui pourraient séduire les ouvriers et les encourager à entrer en grève massivement. Comme le disait Rosa Luxemburg, on ne peut gagner les ouvriers à "l'idée" de la grève de masse par une "agitation méthodique".
De tels préparatifs "matériels" seraient tout aussi ridicules hors d'une période où les ouvriers sont organisés massivement. Mais, comme le montrent les événements de Pologne, ces organisations ne peuvent être créées que par la lutte elle-même. Ceci ne veut pas dire que les révolutionnaires, dans ou hors des usines, ne peuvent rien faire jusqu'à ce que la lutte éclate à une échelle massive. Cela signifie que la seule préparation sérieuse qu'ils peuvent entreprendre est essentiellement une préparation politique : encourager les ouvriers les plus combatifs des différentes usines à se grouper et discuter les leçons de la lutte et ses perspectives, en propageant les formes et les méthodes les plus efficaces de lutte, en démontrant la nécessité de voir la lutte dans une usine ou une ville comme partie d'une lutte historique et mondiale.
Sur la question particulière des revendications économiques, des buts immédiats de la lutte, les grèves de Pologne démontrent que, comme les formes organisationnelles de la lutte, les revendications immédiates sont aussi le produit de la lutte elle-même, et suivent de près son évolution générale.
Les ouvriers polonais ont montré qu'ils étaient tout à fait capables de décider quelles revendications économiques avancer, quelles sortes de revendications peuvent être une réponse efficace à l'offensive de la bourgeoisie, quelles revendications peuvent le mieux servir l'unité et l'extension du mouvement. Confrontés aux augmentations de prix du gouvernement, ils se sont groupés et ont dressé des listes de revendications sur des principes de classe élémentaires : rejet des augmentations des prix, augmentation des salaires. Avec le développement des luttes, les revendications se sont posées de façon plus systématique.
Le MKS à Gdansk a publié des articles informant les ouvriers sur les revendications qu'ils devaient émettre et sur la manière de conduire les grèves. Par exemple, il a conseillé aux ouvriers de demander une augmentation uniforme pour tous, et insisté pour "qu'elle soit effectivement uniforme, simple et facilement compréhensible pour tous dans son application"(Solidarnosc no3, cité par Solidarity n°14)
Lorsque la lutte s'est élargie, lorsqu'elle a pris une dimension de plus en plus sociale et politique, les revendications économiques ont vu leur importance se réduire relativement. Ainsi, les mineurs silésiens déclarèrent simplement qu'ils se battraient pour les "revendications de Gdansk", rien de plus. A de tels moments, la lutte elle-même commence à aller au-delà des buts qu'elle s'était consciemment fixés. Ceci ne fait qu'amplifier le fait qu'il serait ridicule pour les révolutionnaires en de telles circonstances de limiter à l'avance les buts de la lutte en présentant une liste fixe de revendications que les ouvriers devraient reprendre. Les révolutionnaires prendront certainement part à la formulation des revendications économiques par les assemblées de travailleurs, mais ils doivent également insister sur la souveraineté des assemblées dans la décision finale des revendications à avancer. Cela ne tient pas à un respect abstrait pour la démocratie, mais au fait que le processus d'élaboration des revendications dans son ensemble - et qui va au-delà de cet aspect - n'est rien d'autre que le développement de la conscience du prolétariat à travers sa pratique.
Les revendications avancées pendant les grèves en Pologne illustrent un autre aspect de la lutte de classe à notre époque : la manière dont elle passe rapidement du terrain économique au terrain politique. Contrairement à ce que beaucoup de "partidistes" peuvent clamer, les luttes immédiates de la classe ne sont pas "purement économiques", leur caractère politique ne pouvant se développer que par la médiation du parti. Dans Workers'Voice n°l (nouvelle série), la CWO reproche à Rosa Luxemburg sa sous-estimation du rôle du parti qui, dit-elle, a sa source dans une incompréhension des rapports entre les luttes politiques et les luttes économiques :
"Son culte de ‘spontanéité' l’a conduite à dire que les grèves politiques et économiques sont la même chose. Elle n'a pas compris que, bien que les luttes économiques constituent le terrain pour que se développent les luttes politiques, elles ne conduisent pas automatiquement au renversement du capitalisme sans une décision consciente des travailleurs".
Il semble que Rosa Luxemburg maîtrisait mieux la dialectique que la CWO. Elle n'a jamais dit que les grèves politiques et les grèves économiques sont la même chose, pas plus que la grève politique conduit automatiquement au renversement du capitalisme, ni que le capitalisme peut être renversé "sans une décision consciente des travailleurs", ou encore sans l'intervention d'un parti révolutionnaire, comme la CWO l'admet d'ailleurs quand elle expose dans les pages voisines les positions de Luxemburg sur le rôle des révolutionnaires. Par contre, ce que Luxemburg a dit, c'est que, particulièrement dans notre siècle, la lutte de classe n'est pas une série "d'étapes", mais un mouvement unique, dynamique, dialectique :
"Grèves économiques et politiques, grèves de masse et grèves partielles, grèves de démonstration ou de combat, grèves générales touchant des secteurs particuliers ou des villes entières, luttes revendicatives pacifiques ou batailles de rue, combats de barricades - toutes ces formes de lutte se croisent ou se côtoient, se traversent ou débordent l'une sur l'autre : c'est un océan de phénomènes éternellement nouveaux et fluctuants".
("Grève de masse...")
De plus, il est sans intérêt de vouloir séparer chaque phase du processus :
"La théorie subtile dissèque artificiellement à l'aide de la logique, la grève de masse pour obtenir une "grève politique pure " ; or une telle dissection comme toutes les dissections- ne nous permet pas de voir le phénomène vivant, elle nous livre un cadavre".("Grève de masse...")
La lutte de classe comme Marx le soulignait, est toujours une lutte politique ; mais, dans les conditions de la décadence et du capitalisme d'Etat, le mouvement qui va des grèves économiques aux grèves politiques est beaucoup plus rapide, puisque chaque lutte ouvrière sérieuse est amenée à faire face à l'Etat. En Pologne, les ouvriers étaient clairement conscients du caractère politique de leur lutte, à la fois parce qu'ils insistaient sur la nécessité de passer par-dessus la tête des représentants locaux en négociant avec le vrai "manager" de l'économie, l'Etat, et à la fois parce que, de plus en plus, ils comprenaient que leur lutte ne pourrait aller de l'avant qu'en avançant des revendications politiques et en se posant en adversaire de l'organisation du pouvoir politique en place.
Il est vrai que la plupart -sinon toutes- des revendications politiques des ouvriers polonais étaient confuses, empreintes de l'illusion de pouvoir réformer l'Etat capitaliste. Il est vrai que cela met en évidence la nécessité de l'intervention d'une minorité communiste qui sache expliquer la différence entre les revendications prolétariennes (qu'elles soient économiques ou politiques) et des revendications qui ne peuvent qu'embarquer la lutte hors de ses rails propres. Mais rien de tout ceci ne change le fait que même sans l'intervention d'un parti, la classe ouvrière est capable d'élever ses luttes à un niveau politique important. C'est d'ailleurs ce fait là qui fera que les ouvriers seront de plus en plus réceptifs aux idées révolutionnaires. C'est seulement quand les ouvriers sont déjà en train de réfléchir et de parler en termes politiques qu'une minorité révolutionnaire peut espérer avoir un impact direct sur la lutte.
AUTO-ORGANISATION DES OUVRIERS OU "ORGANISER LA CLASSE"
"La conception clichée, bureaucratique et mécanique veut que la lutte soit seulement un produit de l'organisation à un certain niveau de sa force. L'évolution dialectique vivante fait au contraire naître l'organisation comme un produit de lutte. Nous avons déjà vu un exemple grandiose de ce fait en Russie, où un prolétariat presque pas organisé s'est en un an et demi de luttes révolutionnaires orageuses, créé un vaste réseau d'organisations.,,
("Grève de masse...")
A nouveau les termes de R. Luxemburg s'appliquent quasiment à la perfection aux récentes grèves de Pologne. Tout comme la Russie de 1905 -où le caractère "inorganisé" du prolétariat était moins une expression de 1'arriération des conditions russes qu'un signe avant-coureur de la situation qui attendait l'ensemble du prolétariat tout entier, à une époque où commençait à surgir le capitalisme d'Etat, les ouvriers polonais sont entrés en lutte sans aucune organisation préalable. Et pourtant, sans avant-garde révolutionnaire pour leur dire ce qu'il fallait faire ou pour leur apporter des structures organisationnelles toutes prêtes, ils ont montré une formidable capacité à s'organiser en assemblées de masse, comités de grève d'usines, comités de grève inter-usines, milices ouvrières ...
En réalité, l'auto organisation des ouvriers polonais a montré que, sous beaucoup d'aspects,,ils ont assimilé les leçons de la décadence de façon bien plus pénétrante que beaucoup de nos super-partidistes. Le GCI par exemple, tout en reconnaissant que les comités de grève inter-usines constituaient un réel acquis organisationnel du mouvement, s'est retenu d'en tirer les conclusions logiques. Quand le CCI dit que les assemblées de masse, les comités de grève et les conseils sont la forme d'organisation unitaire du prolétariat à notre époque, le GCI nous accuse de formalisme. Pourquoi le GCI ne critique t'il pas les ouvriers polonais d'avoir créé "formellement" des assemblées de masse et des comités de grève centralisés, composés de délégués élus et révocables. Le fait est qu'alors que le GCI voudrait quitter la table à la recherche de quelque forme nouvelle, mystérieuse d'organisation de classe, les ouvriers polonais ont montré que la forme des assemblées, des comités de grève et des conseils est la forme la plus simple, efficace, unifiante et démocratique pour l'organisation de la lutte de classe à notre époque. Là, il n'y a pas de mystère, seulement l'admirable simplicité d'une classe qui recourt à des réponses pratiques posées par des problèmes pratiques.
Au contraire du GCI, la CWO n'a pas oublié que le capitalisme est un système décadent et que les vieilles formes de 1"associationisme ouvrier" ne sont plus utiles. Dans Workers'Voice n°l, elle montre qu'elle a compris l'importance certaine des assemblées générales, des comités de grève et de la forme soviet. Dans son article sur la Pologne, la CWO dit que "la façon dont ils ont relié les comités de grève à Gdansk pour former un corps unifié représentant plus de 200 usines, et leur refus d'accepter le prix de la crise capitaliste, ont fait des ouvriers polonais l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale". Et elle publie un long article célébrant le 75ème anniversaire du premier soviet, montrant que la démocratie ouvrière de la forme soviet est qualitativement supérieure à la "démocratie" des institutions parlementaires bourgeoises :
"Il ne fait pas de doute que la différence la plus importante avec la démocratie capitaliste est l'idée de "délégation". Cette idée fut d'abord utilisée par la classe dans la Commune de Paris de 1871 et permit aux ouvriers de révoquer leurs représentants à tout moment (au lieu d'attendre 5 ans avant l'élection suivante). De plus le délégué n'est pas un libre agent comme les députés du parlement. Quand un délégué ouvrier parle et vote sur un problème, il ne peut se contenter de dire ce qu'il sent à ce moment. Il vote sur la base des ordres des ouvriers qui l'ont élu. S'il faillit à défendre et mettre en oeuvre leur volonté, il peut être révoqué instantanément... "
La CWO conclut que le système du soviet "a prouvé en pratique à tous les sceptiques que les ouvriers peuvent se diriger eux-mêmes". Plus loin, il attaque même le "partidisme", l'idée social-démocrate (et, selon elle, bordiguiste) selon laquelle "tout ce dont la révolution a besoin, c'est d'un général pour dresser des plans de campagne, et la classe ouvrière suivra son chef". Elle insiste sur le fait que "les révolutions ne peuvent être soigneusement organisées, quand le voudraient et comme le voudraient les "partidistes et que tout d'abord doivent exister une situation politique et des conditions qui amènent les masses des gens à la révolte ouverte".
La CWO exagère lorsqu'elle attribue des vues aussi grossières aux bordiguistes. Mais c'est néanmoins un signe positif qu'elle soit si enthousiaste à défendre les formes de démocratie ouvrière créées par la classe, dans le passé et dans le présent. Mais lorsqu'elle tente de combiner cet enthousiasme avec son idée bien arrêtée selon laquelle le parti doit organiser la classe et prendre le pouvoir en sa faveur, elle se met dans toutes sortes de contradictions. Ainsi, d’un côté elle montre clairement comment les ouvriers polonais ont "spontanément" créé les comités de grève inter usines (à savoir sans l'intervention d'un parti révolutionnaire). Mais en même temps, elle se sent obligée d'avancer que le soviet de 1905 -qui était à sa façon un comité de grève inter-usines ne fut pas créé spontanément mais fut en réalité "produit" par le parti. Comment arrive t'elle à démontrer cela, alors qu'ailleurs elle admet qu'initialement les bolcheviks "ramenaient le Soviet à un simple corps syndical" ? Principalement en reproduisant soigneusement une citation de Trotsky sortie de son contexte. Selon la CWO, Trotsky disait que le soviet n'a pas émergé spontanément, mais "a été en fait un produit des divisions existant dans le parti social-démocrate, entre les fractions bolcheviks et mencheviks. Comme Trotsky le dit dans 1905, le Parti produisit Le Soviet". Ce que disait en fait Trotsky, c'est que les divisions entre les fractions social-démocrates "rendaient la création d'une organisation non affiliée au parti absolument essentielle". Mais Trotsky ne disait pas que , parce qu'un tel corps était essentiel, il pouvait être produit par le parti à volonté. En fait, la nature divisée du parti le rendit moins capable de jouer un rôle d'avant-garde dans ces événements ; et de toutes -façons, s'il n'y avait pas eu des centaines de milliers d'ouvriers formant déjà des comités d'usines, tendant déjà vers la centralisation de leur mouvement de grèves, le parti n'aurait pas été du tout capable de contribuer à la création des soviets. La CWO oublie aussi cela quand elle montre que les "mencheviks prirent l'initiative d'opérer à rejoindre le soviet qui avait commencé avec seulement 30 ou 40 délégués ne représentant pas plus que quelques milliers d'ouvriers". "Appeler" au soviet, n'est pas la même chose que le "produire". Les mencheviks et d'autres révolutionnaires ont certainement pris une admirable initiative lorsqu'ils ont appelé activement à la formation d'un comité de grève central, mais personne ne les aurait entendus s'ils n'avaient été en relation avec un puissant mouvement de classe qui allait déjà de l'avant.
"Quand la vague de grève s'étendit de Moscou à St Petersbourg, le11 octobre, les ouvriers sortirent spontanément pour des actions concertées. Des députés furent élus dans plusieurs usines, y compris les usines de Poutilov et Obukhov; un certain nombre de députés avaient été auparavant membres de comités de grève ... Le 10 octobre., une scission du groupe menchevik (de St Petersbourg) proposa de fonder un "comité ouvrier" à
l’échelle de la ville, pour conduire la grève générale, et commencer la propagande pour son élection. Le jour suivant environ cinquante agitateurs commencèrent à faire circuler parmi les ouvriers un appel proposant l'élection d'un député pour 500 ouvriers.. "
(0. Answeiler "Les soviets en Russie" Ed. Gallimard)
L'intervention des mencheviks -dans ce cas précis les mencheviks étaient bien en avance sur les bolcheviks- est un bon exemple de comment une organisation révolutionnaire peut accélérer et pousser en avant l'auto organisation de la classe. Mais elle montre aussi que les organisations que sont les soviets, ne sont pas "produites" par les partis dans le sens propre du terme. En proclamant cela, la CWO oublie qu'elle insiste elle-même sur le fait que "tout d'abord, il doit exister une situation politique et des conditions qui amènent des masses de gens à la révolte ouverte". Si les ouvriers ne sont pas déjà en train de créer leurs propres organisations dans le feu de la lutte, alors les appels des révolutionnaires à des formes d'organisations autonomes et centralisées tomberont dans des oreilles sourdes, et si les révolutionnaires essayent de se substituer au mouvement réel en dressant artificiellement des structures alternatives de différentes sortes (par exemple des unités de combat du Parti
ou des comités ouvriers auto-proclamés), ou bien ils se rendront ridicules, ou bien ils se transformeront en de dangereux obstacles au développement de la conscience de la classe.
Les contradictions de la position de la CWO peuvent être perçues en creusant un peu leur distinction entre délégation et représentation. Nous sommes d'accord sur le fait que la délégation prolétarienne est tout à fait différente de la "représentation" capitaliste. Mais pourquoi la CWO n’en tire t'elle pas la conclusion logique que dans le système du soviet, où tous les délégués sont sujets à être révoqués à tout moment, il ne peut être question d'ouvriers élisant le parti au pouvoir, parce que c'est précisément la façon dont opèrent les parlements bourgeois ? Jusqu'à présent nous n'avons remarqué aucune prise de position de la CWO montrant qu'elle a changé sa position sur le parti prenant le pouvoir. Au lieu de cela, écrivant à propos des grèves polonaises, elle dit que nous pouvons apprendre beaucoup de Walesa et autres activistes des syndicats libres (c'est à dire des militants qui ont défendu une orientation politique bourgeoise) parce qu'ils ont su s'implanter dans la classe et "contrôler" la lutte :
"Les amis politiques de Walesa ont contrôlé la lutte jusqu'à la"victoire" parce qu'ils avaient la confiance et le soutien des ouvriers -une confiance qui s'est construite pendant 10 ans de sacrifices et de lutte. Cette minorité a su assurer une présence dans la classe ouvrière. Dans ses actions (mais en clair PAS dans sa politique) il y a des leçons à suivre pour les communistes".
C'est un argument extrêmement dangereux, et il embrasse l'idée trotskyste que le problème qu'affronte la classe ouvrière est sa "direction bourgeoise" et que tout ce dont elle a besoin est de la remplacer par une direction prolétarienne. En fait, pour le prolétariat, il ne peut y avoir aucune séparation entre les moyens et les fins, les"actions" et la "politique". Dans le cas de Walesa, il y a un lien clair entre ses idées politiques et une tendance à se séparer de la masse des ouvriers et devenir une "idole" du mouvement (un processus que la presse occidentale a tout fait pour accélérer bien sûr). De même, une des expressions de l’immaturité politique des ouvriers polonais fut une certaine tendance, spécialement vers la fin de la grève, à remettre les prises de décision à des "experts" et à des personnalités individuelles comme Walesa. La "direction" pour une minorité communiste, ne peut obéir à la même logique. L'intervention communiste ne cherche pas à avoir le "contrôle" des organes de masse de la classe, mais à encourager les ouvriers à prendre tout le pouvoir dans leurs mains, à abandonner toute idée de se remettre en confiance à des "sauveurs venus du ciel" (pour citer l'Internationale). il n'y a aucune contradiction entre cela et "gagner les ouvriers au programme communiste" car le programme communiste, dans son essence, signifie que la classe ouvrière assume la maîtrise consciente des forces sociales qu'elle a créées elle-même.
LA CONSCIENCE DE CLASSE ET LE ROLE DES REVOLUTIONNAIRES
"La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient des produits des circonstances et de l'éducation, que, par conséquent, des hommes transformés soient des produits d'autres circonstances et d'une éducation modifiée, oublie que ce sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que l'éducateur lui-même a besoin d'être éduqué. C'est pourquoi elle tend inévitablement à diviser la société en deux parties dont l'une est au-dessus de la société (par exemple chez Robert Owen). La coïncidence du changement des circonstances et de l'activité humaine ne peut être considérée et comprise rationnellement qu'en tant que révolutionnaire. "
Marx – Thèses sur Feuerbach Ed. Sociales p.88)
La théorie kautskyste selon laquelle la conscience de classe socialiste n'est pas produite par la lutte de classe, mais est importée dans la classe "de l'extérieur", sous-tend toutes les conceptions substitutionistes que nous avons critiquées dans cet article. Bien que seuls quelques groupes, comme Battaglia Comunista, défendent explicitement cette thèse, les autres y glissent constamment parce qu'ils n'ont pas de théorie claire de la conscience de classe à y opposer. Tous ceux qui soutiennent que la classe ouvrière est trop aliénée pour devenir consciente d'elle même sans la médiation "extérieure" d'un parti, oublient que "les éducateurs ont besoin d'être éduqués"- que les révolutionnaires font partie de la classe et sont donc sujets aux mêmes aliénations. Ils oublient aussi que c'est précisément parce que le prolétariat souffre d'aliénation dans sa situation au sein du capitalisme, qu'il est une classe communiste, une classe capable de donner naissance à un parti communiste et d'aller vers une vision du monde, claire, démystifiée et unifiée. Nous ne pouvons entrer ici dans une longue discussion sur ces questions difficiles. Mais un exemple évident de la façon dont l'héritier moderne de Kautsky "tend inévitablement à diviser la société en deux parties, dont l'une est au-dessus de la société" c'est sa vision du mouvement "spontané" de la classe, c'est à dire tout mouvement non dirigé par le parti, comme un mouvement essentiellement inconscient.
Battaglla Comunista l'a clairement exprimé en disant que, sans le parti, on peut parler d"'instinct de classe", mais pas de "conscience de classe" (cf. "Classe et Conscience" , Prometeo n" 1978). Ainsi, le mouvement spontané de la classé n’est rien qu'un instinct, une force naturelle aveugle qui nécessite le parti comme cerveau ; en termes philosophiques un "ça" sans "moi". De telles conceptions laissent penser que la classe est aiguillonnée dans l'action par les circonstances matérielles, comme le chien qui salive dans les expériences de Pavlov. Elles peuvent aller jusqu'à admettre que de telles réactions spontanées puissent donner naissance à un certain niveau d'auto organisation. Mais sans le parti, insiste t’on, de tels mouvements ne peuvent devenir vraiment conscients : comme les animaux, les ouvriers ne peuvent avoir de mémoire ni de vision du futur. Ils sont condamnés à vivre le présent immédiat car le parti est leur mémoire, leur conscience. Une fois de plus, les ouvriers polonais ont démenti de telles théories. Comme nous l'avons écrit dans la Revue Internationale n°23:
"Le parti n'est pas 1'unique siège de la conscience de la classe, comme le prétendent., avec outrance, tous les épigones qui s'intitulent léninistes. Il n'est ni infaillible, ni invulnérable. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est là pour en témoigner. Et l'histoire est aussi là pour montrer que la classe dans son ensemble accumule des expériences et les assimile directement. Le récent mouvement formidable de la classe ouvrière en Pologne témoigne de sa capacité remarquable à accumuler et assimiler ses expériences de 70 et 76 et à les dépasser, cela malgré l’absence qui se fait cruellement sentir, d'un parti. "
Les ouvriers polonais ont montré que la classe possède en fait une mémoire. Ils se sont rappelés l'expérience des luttes passées et ont tiré les leçons appropriées. Les ouvriers de Lublin, ont démoli les voies de chemin de fer parce qu'ils se souvenaient qu'en 1970, les troupes avaient été envoyées par rail pour briser le soulèvement ouvrier. Les ouvriers se sont rappelés que les mouvements de 70 et 76 avaient été au départ vulnérables face à la répression à cause de leur isolement, aussi, ils ont étendu leurs grèves et les ont coordonnées par les comités de grève. Ils se sont souvenus que à chaque soulèvement contre l'Etat, le gouvernement a essayé de les apaiser en faisant sauter la clique dirigeante du moment et en la remplaçant par une brochette de bureaucrates plus "populaires" et plus "libéraux". Mais quand on voit comment le "libéral" Gomulka de 1956 est devenu le Gomulka de la "ligne dure" de 1970, et comment le "libéral" Gierek de 1970 est devenu le Gierek de la "ligne dure" de 1980, les ouvriers n'ont pas été dupes une seule minute de la dernière série de purges dans le gouvernement. Déjà en 1970, les ouvriers polonais se racontaient la blague suivante :
Question : "Quelle est la différence entre Gomulka et Gierek ?"
Réponse : "Aucune, mais Gierek ne le sait pas encore
En 1980, le cynisme des ouvriers sur tout ce que fait ou dit le gouvernement est même plus profondément enraciné : d'où leurs efforts pour s'assurer que les acquis de la lutte seraient imposés et sauvegardés par la force et non pas en mettant une confiance quelconque dans le gouvernement.,
Mais peut-être la preuve la plus certaine de la capacité des ouvriers à assimiler les leçons du passé, s'est montrée dans leur attitude par rapport à la question de la violence. Ils n'ont pas oublié l'expérience de 1970, où furent tués des centaines d'ouvriers alors engagés dans des affrontements avec l'Etat impréparés et non coordonnés. Ceci n'en fait pas des pacifistes : ils ont organisé rapidement des milices ouvrières dans les usines occupées. Mais ils ont compris que la force réelle de la classe, son auto-défense véritable, se trouve sans sa capacité à organiser et étendre sa lutte à une échelle de plus en plus massive. Ici encore, les ouvriers se sont montrés plus avancés que ces groupes d"'avant-garde" qui jacassent sur le terrorisme ouvrier et condamnent comme "kautskyste" l'idée que la violence de classe doit être sous le contrôle et la direction des organes de masse de la classe. Les ouvriers étaient préparés à la violence, mais ils ne voulaient pas être entraînés dans des affrontements militaires prématurés, ou laisser des groupes isolés d'ouvriers engager des assauts désespérés contre la police ou l'armée. Le fait que les ouvriers polonais aient commencé à penser la "question militaire" comme un aspect de l'organisation générale de la lutte augure bien de l'avenir : parce que lorsque le moment arrivera de prendre d'assaut directement l'Etat, les ouvriers seront d'autant mieux placés comme force unie, organisée, consciente.
Cette "mémoire
prolétarienne" n'est pas transmise génétiquement Les ouvriers polonais ont
pu assimiler les expériences du passé parce que, même en l'absence d'une
organisation révolutionnaire, il y a toujours des discussions et des débats
dans la classe, à travers des centaines de canaux, certains plus formels
-assemblées de masse, cercles ouvriers de discussion, etc.- d'autres moins
formels -discussions dans les cantines d'usines, dans les cafés, les autobus
... Et comme ces canaux assurent la mémoire collective de la classe ouvrière,
ils permettent aussi aux ouvriers de développer une vision du futur -et pas
seulement le futur d'une industrie ou d'une usine particulière, mais l'avenir
du pays entier et même de la planète entière.
Ainsi, les ouvriers polonais ne pouvaient pas simplement éviter
d'essayer de comprendre l'effet que leurs grèves auraient sur l'économie
nationale, sur le gouvernement futur du pays ; ils ont été obligés de discuter
ce que la Russie
ferait au sujet des grèves, comment la réaction de la Russie serait affectée par
son intervention en Afghanistan, comment l'Ouest répondrait, etc. ... Ce n'est
pas l'intervention du parti qui oblige les ouvriers à regarder plus loin que la
porte de l'usine et plus loin devant eux que le jour suivant : c'est le
mouvement historique de la société capitaliste dans son ensemble.
Mais, attendez, crient nos adorateurs de parti, si la classe ouvrière est son propre cerveau, à quoi donc sert le parti ? Ce n'est là une question réelle que pour ceux dont la pensée est enfermée dans des schémas poussiéreux, qui voient la lutte de classe comme une série d'étapes fragmentées sans
liens sous-jacents.
Oui, la classe ouvrière en tant que tout a sa propre mémoire. Mais l'organisation révolutionnaire constitue une partie particulière et cruciale de cette mémoire . Seule l'organisation révolutionnaire peut offrir un point de vue qui englobe le tout de l'histoire de la classe ouvrière, qui la rend capable, non seulement de relier l'expérience polonaise de 1980 avec les expériences polonaises de 1956, 1970 et 1976, mais encore de relier toutes ces expériences aux leçons de la révolution de 1917 en Russie, à l'expérience que les ouvriers de l'Ouest ont faites des syndicats soi-disant libres depuis 1914, à ce que Marx, Lénine, Bordiga, Pannekoek, et d'autres révolutionnaires ont écrit sur la façade que constitue la démocratie bourgeoise, etc... Parce que les révolutionnaires peuvent offrir une vue globale du système capitaliste entier, ils peuvent aussi fournir une estimation réaliste du rapport de forces de classes à tout moment. De plus, une telle vision globale peut aider les ouvriers à voir qu'il ne peut y avoir de solutions nationales à la crise, que la lutte doit s'étendre au-delà des frontières nationales si elle veut survivre et grandir. En bref, seuls les révolutionnaires peuvent clairement montrer le lien entre la lutte d'aujourd'hui et la révolution de demain. Les révolutionnaires ne peuvent "injecter" la conscience chez les ouvriers, mais ils contribuent à donner des réponses aux questions que les ouvriers sont déjà en train de se poser, ils peuvent mettre ensemble tous les différents enchaînements dans la pensée collective de la classe et présenter dans la classe ouvrière un tableau global et clair de la signification et de l'orientation de sa lutte.
Les superpartidistes
objecteront probablement : cela sonne comme du simple propagandisme. Quelles sont les tâches "pratiques"
du parti ? En posant de telles questions, ils oublient la remarque de Marx "La théorie aussi devient force
matérielle dès qu'elle étreint les masses" (Contribution à la critique de la philosophie du droit de
Hegel). Dans le feu de la guerre de
classe, les ouvriers deviennent théoriciens, et ainsi, ils transforment la
théorie en propagande, la propagande en agitation, et 1 'agitation en
action. En d'autres termes, plus les
idées des révolutionnaires correspondent à ce que la classe ouvrière est en
train de mettre en pratique, moins elles sont abstraites : ce qui était hier
une critique théorique de la démocratie bourgeoise peut, dans une situation
révolutionnaire, devenir un slogan agitatoire pratique comme "Tout le
pouvoir aux soviets". Et pour
l'organisation révolutionnaire, ce n'est pas de l'activité "simplement
propagandiste" dans le sens d'une répétition pédante de vérités générales,
issues de la lutte. L'organisation
révolutionnaire doit rechercher constamment à rendre ses analyses de plus en
plus concrètes, de plus en plus liées à des suggestions pratiques pour l'action
; et elle ne peut le faire que si elle est dans la lutte, si ses membres sont
sur le front du mouvement de classe, s'ils interviennent dans chaque expression
de la lutte du prolétariat, depuis le piquet de grève jusqu'au soviet central .
Il est pourtant ironique de voir que ceux qui soulignent le fait que la classe ne peut être consciente sans le parti, sont les mêmes qui ricanent presque toujours à l'idée que la tâche centrale et spécifique du parti est d'approfondir et d'étendre la conscience de la classe. Pour eux, tout ce qui parle de généralisation de la conscience de classe n'est que "propagandisme" : pour eux, ce qui distingue l'organisation révolutionnaire sont les tâches "pratiques", "organisationnelles".
Quand on leur demande d'être plus précis sur ces tâches, soit ils répondent avec encore plus de ces généralités que personne ne pourrait désavouer ("le parti doit jouer un rôle d'avant-garde dans les soviets", "les révolutionnaires doivent être préparés à se mettre à la tête des grèves", etc.), soit ils sortent des fantasmes semi-terroristes sur les groupes de combat du parti stimulant les ouvriers à résister (quand donc cela a-t-il été le cas dans l'histoire de la classe ouvrière ?). Ou bien, encore plus ridicule, ils iront jusqu'à vous dire comment, un jour, le parti va "avoir le pouvoir"sur le monde entier.
La vérité est que la classe ouvrière n'a pas besoin de révolutionnaires parce qu'ils seraient de bons administrateurs ou spécialistes pour faire sauter les ponts. Très certainement, les révolutionnaires auront des tâches administratives et militaires, mais ils ne peuvent mener effectivement de telles tâches que s'ils les assument en tant que partie du vaste mouvement prolétarien, comme membres des conseils ouvriers ou des milices ouvrières. La chose réellement précieuse, irremplaçable, qu'ont les révolutionnaires est leur clarté politique, leur capacité à synthétiser l'expérience historique, collective de la classe et la renvoyer au prolétariat sous une forme qui puisse être aisément comprise et utilisée comme guide pour l'action. Sans cette synthèse, la classe ouvrière n'aura tout simplement pas le temps d'assimiler toutes les leçons de l'expérience passée : elle sera condamnée à répéter les erreurs du passé et être ainsi défaite une fois de plus. Certains révolutionnaires peuvent voir ça comme une piètre tâche pour le formidable parti révolutionnaire, mais le succès ou la faillite de la révolution dépendra de la capacité du parti à s'en acquitter.
La lutte des ouvriers polonais est un avant-goût de ce qui s'accumule partout pour le capitalisme. Parce que la bourgeoisie sera appelée, par la logique de la crise, à attaquer de plus en plus sauvagement la classe ouvrière, et parce que la classe ouvrière reste invaincue, il y aura d'autres "Pologne", pas seulement dans le tiers-monde et le bloc de l'Est, mais aussi dans les principaux pays de l'impérialisme occidental . L'issue de ces confrontations déterminera le sort de l'humanité. Si la classe ouvrière est capable de développer son autonomie politique et organisationnelle dans ces batailles, si ces batailles fournissent une ouverture pour l'intervention des révolutionnaires et un élan vers la formation d'un parti communiste international, alors elles seront les répétitions de la 2ème révolution prolétarienne du 20ème siècle. Si par contre, les cauchemars du passé pèsent trop lourd sur les cerveaux des vivants, si les ouvriers sont incapables de voir les mensonges de l'ennemi de classe, si le prolétariat reste isolé de son avant-garde révolutionnaire, alors ces batailles finiront en défaites qui peuvent ouvrir la porte à la 3ème guerre mondiale. L'unique chose sûre est que la classe ouvrière ne peut briser les chaînes de l'aliénation et de l'oppression en faisant appel à une quelconque force en dehors d’elle-même. La minorité révolutionnaire comme partie de la classe partagera le sort de la classe, dans la défaite ou dans la victoire. Pourtant, parce que ce que font les révolutionnaires dès aujourd’hui sera demain un des facteurs déterminants pour la victoire ou la défaite de la classe ouvrière, une immense responsabilité pèse sur leurs épaules ; Ils ne peuvent être fidèles à cette responsabilité que s’ils se libèrent à la fois du dilettantisme et de la mégalomanie et apprennent à regarder en face la réalité sans illusions.
C.D. Ward
Novembre 1980
Géographique:
- Pologne [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le mouvement révolutionnaire et la question syndicale après la défaite des années 20
- 3496 reads
Les courants prolétariens
qui ont échappé à la dégénérescence de l'Internationale Communiste (IC )
se sont retrouvés face à l’énorme tâche de résister à l'offensive contre-révolutionnaire
sur tous les plans, politique, théorique et organisationnel. Cette résistance s'est accomplie dans une
situation de déboussolement généralisé dont une des raisons majeures tenait
dans les erreurs de l'IC elle-même, notamment sur les questions parlementaire
et syndicale. Le recul de l'activité
révolutionnaire de la classe ouvrière n'avait pas permis que les débats sur ces
questions se déroulent de façon positive.
Les critiques des gauches communistes (italienne, allemande et
hollandaise) à l'égard de la politique de l'IC n'avaient pu être réellement
approfondies. A la fin des années 20, au
moment du stalinisme triomphant, c'est donc dans des conditions encore plus
difficiles et plus complexes que ce débat va se continuer. Ainsi, sur la question syndicale, l'évolution
des différentes branches de l'opposition communiste internationaliste (gauche
italienne, communistes de conseils, opposition de gauche animée par Trotsky,
etc.) va être tâtonnante. En fait, le courant révolutionnaire se trouvait
devant une double situation en ce qui concernait l'évolution des
syndicats. D'une part, il s'agissait de
reposer la question du syndicalisme dans la période de décadence, et d'autre
part de comprendre les effets de la contre-révolution sur ce plan. Il s'agissait de saisir toutes les
implications politiques du passage des syndicats dans le camp bourgeois et en
même temps de passer au crible la tactique de l'IC d'entrisme dans les
syndicats "réformistes" afin d'y provoquer des scissions qui devaient
permettre l'émergence de syndicats de classe dirigés et contrôlés par les
révolutionnaires.
Les orientations au sein de l’internationale communiste
Dès la formation de la 3ème Internationale, la question syndicale fut au centre de toute une série de discussions et de polémiques. C'est au sein du mouvement révolutionnaire allemand que ce problème fut posé de la façon la plus cruciale et que se dessina la compréhension la plus nette de la nécessité de la rupture avec les syndicats, mais aussi avec le "syndicalisme". Au Congrès de constitution du Parti Communiste d'Allemagne (KPD) fin décembre 1918, c'est-à-dire dans une période pré-révolutionnaire, une tendance majoritaire se prononçait pour la sortie des syndicats. Ainsi Paul Frölich disait: "Nous posons en principe que la séparation des ouvriers entre organisations politiques et organisations syndicales, nécessaire jadis doit maintenant prendre fin. Pour nous, il ne peut y avoir qu'un mot d'ordre : 'Hors des syndicats ! "'.
Rosa Luxemburg refusait ce mot d'ordre, mais d'un point de vue tactique :
"(les syndicats) ne sont plus des organisations ouvrières, mais les protecteurs les plus solides de l'Etat et de la société bourgeoise. Par conséquent, il va de soi que la lutte pour la socialisation ne peut pas être menée en avant sans entraîner celle pour la liquidation des syndicats. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais mes opinions diffèrent en ce qui concerne la voie à suivre. J'estime erronée la proposition des camarades de Hambourg tendant à former des organisations uniques économico-politiques (einheitsorganisation), car à mon avis, les tâches des syndicats doivent être reprises par les Conseils d'ouvriers, de soldats et d'usines." (Congrès de la Ligue Spartacus, Ed.Spartacus n°83B).
Malheureusement, la même clairvoyance n'animait pas la direction de l'IC, bien au contraire. Si l'IC dénonçait les syndicats dominés par la Social-démocratie, elle n'en conservait pas moins l'illusion de pouvoir arracher à celle-ci la direction des syndicats. Malgré les critiques de la gauche, surtout la gauche allemande qui scissionnera du KPD pour former le Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne (KAPD), l'IC développait une analyse erronée. En mars 1920, dans une "Adresse aux syndicats de tous les pays", après une analyse sommaire de la dégénérescence des "vieux" syndicats réformistes, l’IC expliquait :
"Les syndicats reprendront-ils à nouveau la vieille voie éculée, réformiste, c'est-à-dire effectivement bourgeoise ? Telle est la question décisive qui se pose à présent précisément au mouvement ouvrier international. Nous sommes fermement convaincus que cela ne se produira pas. Un courant d'air frais a pénétré dans les bâtiments étouffante de vieux syndicats. La décantation a déjà commencé dans les syndicats. Dans un ou deux ans, les vieux syndicats seront méconnaissables. Les vieux bureaucrates du mouvement syndicat deviennent des généraux sans armée. La nouvelle époque produira une nouvelle génération de dirigeants prolétariens dans les syndicats renouvelés". ("Du 1er au 2ème Congrès de l'IC",Ed. EDI).
Dans la même "Adresse" dirigée en fait contre les thèses du KAPD qui prônait la sortie des syndicats et la mise sur pied d'organismes unitaires d'usines, Zinoviev allait même jusqu'à travestir la réalité des syndicats en Europe :
"Dans toute une série de pays s’opère une
forte décantation dans les syndicats. Le
bon grain se sépare de l'ivraie. En
Allemagne, sous la direction de Legien
et de Noske, qui fut le soutien principal du mouvement syndical jaune bourgeois, un grand nombre de syndicats tournent le dos aux social-damocrates jaunes et passent au côté de la révolution prolétarienne. Les
syndicats d'Italie se tiennent presque
sans exception sur le terrain du pouvoir
soviétique. Dans les syndicats de Scandinavie, le courant révolutionnaire
prolétarien grandit de jour en jour.
En France, en Angleterre, en Amérique, en Hollande et en Espagne, la masse des membres des syndicats se défait de la vieille
bourgeoisie et exige de nouvelles
méthodes révolutionnaires".
Bien loin d'aider les Partis Communistes à rompre avec la Social-démocratie, cette orientation fondée sur l'illusion d'un véritable syndicalisme de classe prônait au contraire la même pratique -quoique concurrentielle- que la contre-révolution sur le plan du "contrôle des masses".
Cette orientation entrava fortement la possibilité d'un approfondissement de la question syndicale au sein des différentes organisations qui composaient l'IC. Qui plus est, l'analyse de la nature des syndicats et du syndicalisme restait souvent confuse et contradictoire, compte-tenu de l'influence de plusieurs courants qui subissaient la tradition du syndicalisme révolutionnaire, ce qui rendait le problème encore plus complexe.
En février 1920, la Conférence Internationale d'Amsterdam adopte les thèses présentées par Fraina, secrétaire du Communist Party of America et militant des IWW dans lesquelles on peut lire : "(… ) 11. L'agitation pour la construction de syndicats d'industrie fournit de façon immédiate et pratique la possibilité de mobiliser l'esprit militant de mécontentement qui se développe dans les vieux syndicats, de mener la lutte contre la bureaucratie corrompue et 'l’aristocratie ouvrière'. Le syndicalisme d'industrie fournit en outre la possibilité d'appeler à l’action les ouvriers non qualifiés, inorganisés, et de libérer les ouvriers non qualifiés, organisés dans les syndicats de la tutelle des couches réactionnaires de la classe ouvrière. La lutte pour le syndicalisme révolutionnaire d'industrie est un facteur de développement de la connaissance communiste et pour la conquête du pouvoir". (idem).
Cette analyse reprenait la thèse ambiguë de "l'aristocratie ouvrière" conçue comme une des bases du caractère conservateur du syndicalisme et faisait par ailleurs des syndicats de métier la forme réactionnaire du syndicalisme opposée à celle des syndicats d'industrie. Tout en tentant de cerner l'évolution des syndicats en fonction de l'impérialisme et de la tendance au capitalisme d'Etat, tout en mettant l'accent sur les limites du syndicalisme, cette orientation ne parvenait qu'à s'opposer à une forme de syndicalisme sans remettre en question le syndicalisme
" ( ... ) 5. Le développement de l'impérialisme intègre définitivement les syndicats de métier dans le capitalisme (…)
(…)
(…) 8. La forme d'expression gouvernementale du travaillisme est le capitalisme d'Etat, la fusion dans l'Etat des capitalistes, de la petite bourgeoisie et des couches supérieures de la classe ouvrière qui dominent les syndicats (...) .
(… ) 10. (…) La lutte contre cette forme de syndicalisme (le syndicalisme de métier) est par conséquent une phase inséparable de la lutte contre le travaillisme à travers :
a) de façon générale, l'agitation du parti communiste pour pousser les syndicats à une action plus résolue ;
b) l'encouragement à tout mouvement dans les syndicats qui tend à briser la permanence de la bureaucratie et à donner le contrôle aux masses au moyen de délégués directement mandatés et révocables ;
c) la formation d'organisations comme les comités de Shop-stewards, les comités ouvriers, les conseils ouvriers économiques et des organisations directes du Parti Communiste dans les ateliers, les usines, les mines, qui ne servent pas seulement à lancer les masses et les syndicats vers une action plus révolutionnaire, mais peuvent aussi, au moment de la crise se développer en soviets ;
d) l’effort pour transformer
les syndicats de métier en syndicats d'industrie, c’est à-dire, un syndicalisme
dans une forme parallèle à l'intégration économique du capitalisme moderne et
dans un esprit inspiré par la lutte pour le pouvoir politique et la domination
économique." (idem).
Certaines de ces thèses
étaient en fait très proches des positions régnant au sein des gauches
allemande et hollandaise. Elles
tentaient de dépasser et de critiquer l'économisme, le réformisme et le
syndicalisme "apolitique", mais elles restaient sur le terrain de la
"forme" d'organisation.
L'impossibilité de nouvelles organisations unitaires de masse permanentes
n'était pas encore entrevue. L'idée
était de trouver des formes organisationnelles préservant l'indépendance de
classe et préparant le surgissement des conseils ouvriers. Cette vision était loin d'offrir une garantie
d'indépendance au prolétariat par rapport à la bourgeoisie ; démarche
consistant à faire de la rupture avec le syndicalisme une simple question de
forme d'organisation.
C'est peut-être le
révolutionnaire italien Gramsci qui, au nom de la critique du syndicalisme a
été le plus loin dans la détermination d'une ligne Politique erronée qui
contribua grandement à désorienter la classe ouvrière italienne dans les années
20. Dans un article publié dans son
journal, L'Ordine Nuovo en novembre 1919, Gramsci développait
apparemment une critique prometteuse du syndicalisme : "La théorie syndicaliste a complètement échoué dans I’expérience
concrète des révolutions prolétariennes.
Les syndicats ont démontré leur incapacité organique à incarner la
dictature du prolétariat. Le développement normal du syndicat est caractérisé par une ligne de décadence de
l'esprit révolutionnaire des masses : la force matérielle augmente t'elle ?
L'esprit de conquête s'affaiblit ou disparaît. tout à fait, l'élan vital se
brise, la pratique de l'opportunisme, "du pain et du beurre" succède
à l’intransigeance héroïque ( ... ), le syndicalisme n'est pas un moyen pour la
révolution, n'est pas un élément de la révolution prolétarienne, n’est pas la
révolution qui se réalise, qui se fait : Le syndicalisme n'est révolutionnaire
que par sa possibilité grammaticale d'accoupler les deux expressions. Le syndicalisme s'est révélé n'être rien
d'autre qu-une forme de la société capitaliste et non un développement
potentiel de la société capitaliste."
Mais derrière cette critique résidait en fait une incapacité à tirer les leçons de la révolution russe et à comprendre la base de surgissement des conseils ouvriers. Bien loin d'être un organe politique de pouvoir et un lieu de développement de la conscience de la classe ouvrière, le Conseil Ouvrier était pour Gramsci un organe de gestion économique. Et c'est sur ce plan qu'il bâtissait une critique des syndicats, critique insuffisante pour contribuer à ce que les ouvriers prennent conscience de la fonction des syndicats :
"Le syndicat de métier ou de l'industrie, en groupant entre eux les compagnons de métier ou de telle industrie, qui, dans le travail utilisent le même instrument ou qui transforment la matière première contribue à renforcer cette psychologie, contribue à empêcher toujours davantage les travailleurs à se concevoir comme producteurs..." (Ordine Nuovo. 8/11/19).
Chez Gramsci, cette analyse consistait à évacuer la question de la destruction de l'Etat bourgeois et à faire du prolétariat et de l'usine des catégories économiques : "les lieux où l'on travaille, où les producteurs vivent et oeuvrent ensemble, seront demain les- centres de l’organisme social et devront remplacer les organes directeurs de la société contemporaine" (Ordine Nuovo. 13/9/19). En restent sur le terrain de la production et de la gestion économique, c'est donc en fin de compte la sauvegarde de l'économie que Gramsci défendait dans sa propagande auprès de la classe ouvrière, et donc de la défense du capitalisme :
"Les ouvriers veulent en, finir avec cette situation de désordre, de marasme, de gaspillage industriel L’économie nationale va à vau-l'eau, le taux de change augmente, la production diminue, tout l'appareil, national de production industrielle et agricole s 'achemine vers la paralysie(…) Si les industriel ne sont plus capables d'administrer l'appareil de production et de le faire produire au maximum (qu'ils n'en soient pas capables, chaque jour le démontre davantage) pour sauver de la ruine et de la banqueroute la société, les ouvriers assumeront cette tâche, consciente de la grave responsabilité qu'ils assument et ils l’expliqueront avec leurs méthode et leurs systèmes communistes à travers leurs conseils de productions. " (L'Avanti. 21/11/19).
La fraction animée par Bordiga dénonça ces analyses :
"C'est une grave erreur de croire qu'en introduisant dans le milieu prolétarien actuel, parmi les
salariés du capitalisme, des structures formelles dont on pense qu'elles pourront se constituer pour la gestion de la production communiste, on développe des forces intrinsèquement et par elles même révolutionnaires. Cela a été l'erreur des syndicalistes et c'est aussi l’erreur des zélateurs trop enthousiastes des conseils d’ usine". (Il Soviet. ler février 1920, cité par Programme Communiste n°72).
Cependant, ce que la gauche italienne n'expliquait pas, c'est pourquoi le surgissement d'une nouvelle forme d'organisation unitaire de la classe antagonique aux syndicats et au syndicalisme. Mais la critique juste de solutions préconisées au niveau de formes d'organisation devait amener à l'erreur bordiguiste caricaturée aujourd'hui par le PCI (Programme Communiste), de tirer un trait d'égalité entre toutes les formes d'organisations de la classe et d'insister uniquement sur le rôle prépondérant du parti. On pourra même lire dans "Il Soviet" du 21/9/19 que les soviets de demain doivent avoir leur source dans les sections locales du parti communiste ",(dans Programme Comuniste n°74, p.64). A l'ouvriérisme et à l’usinisme, on finit par opposer le fétichisme du parti et non pas une analyse matérialiste de la phase déclinante du capitalisme et de son incidence sur le mode d'organisation de la classe. Seule une telle analyse permet de cerner les causes de la faillite des syndicats comme organes prolétariens et de comprendre en quoi le contenu du syndicalisme "classique" de la période ascendante du capitalisme est devenu caduc dans l'ère des "guerres et des révolutions", c'est à dire dans la période de décadence du capitalisme.
Dans les années qui vont suivre, ce débat qui se déroulait dans l'ensemble des sections de l'IC va s'enliser. Le recul généralisé de la classe ouvrière en Europe, les défaites du prolétariat allemand, l'isolement de la Russie, la cristallisation des erreurs de l'IC, sa dégénérescence accélérée, tout cela va favoriser les thèses de la défense du bastion prolétarien menant à des conciliations et étouffant la voie des communistes de gauche. Puis, à l'opportunisme ouvert va succéder une phase de liquidation directe de toute position révolutionnaire marquant la mort de l'IC comme organisation prolétarienne internationale. Les syndicats contrôlés par l'IC furent les premières forces qui permirent au stalinisme en Europe d'isoler les communistes restés fidèles à l'internationalisme et à la révolution et de faire reprendre à la classe ouvrière le chemin de la soumission à l'Etat et à la nation capitaliste.
Contradictions et limites des analyses du milieu révolutionnaire
Bien qu'exclu du Parti Bolchevik par la clique de Staline et exilé de Russie, Trotsky n'en avait pas moins une lourde responsabilité dans les orientations de l'IC et dans la politique menée par l'Etat russe, notamment la répression des grèves de Kronstadt. Trotsky avait soutenu Lénine contre"la maladie infantile du communisme" (les gauches communistes, Confronté à la dégénérescence de l'IC et à la politique contre-révolutionnaire de l'Etat russe, Trotsky ne remit pas en cause les fondements de la politique de l'IC. Il ne relia pas son combat à celui des gauches. Cette attitude exprimait toutes les limites de l'opposition de Trotsky au stalinisme contre-révolutionnaire. Toute l'orientation de l'opposition de gauche ralliée autour de sa personne fut marquée par la même faiblesse, c'est-à-dire l'incapacité à réévaluer la politique de l'IC sur les questions parlementaire et syndicale, l'incapacité à comprendre et reconnaître le processus contre-révolutionnaire en Russie même.
l.Trotsky
Paradoxalement, la question syndicale est abordée par Trotsky sur deux plans. Trotsky défendait au sein du Parti Bolchevik au pouvoir dans les années 20 la nécessité de l'intégration des syndicats à l'Etat soviétique contrairement à Lénine :
"Notre Etat actuel est tel que la totalité du pro1étariat organisé doit se défendre lui-même. Nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour la défense des ouvriers contre leur Etat".
Quel aveu de Lénine sur le caractère conservateur de l'Etat de la période de transition et sur la nécessité du maintien de l'indépendance de la classe ouvrière par rapport à l'Etat ! Mais la position de Lénine comme celle d'ailleurs de l'opposition 0uvrière de Kollontaï qui prônait un renforcement des syndicats était illusoire et n'ouvrait pas sur une réelle compréhension de la nature des syndicats. La position, étatiste jusqu'au bout, était plus "logique". Pour Trotsky, le syndicat était un instrument étatique par excellence et en cela il ne se trompait pas ; c'est sur la question de l'Etat "prolétarien" que Trotsky se trompait !
En ce qui concerne l'intervention des révolutionnaires dans les syndicats, Trotsky défendait au sein de l'IC les analyses "officielles" :
"L'importance du syndicat consiste en ce que sa majorité est ou doit être composée d’éléments qui ne sont pas encore soumis l’influence d'un parti. Mais il est évident qu'il y a dans les syndicats des couches différentes : des couches tout à fait conscientes, des couches conscientes avec un reste de préjugés, des couches qui cherchent encore à former leur conscience révolutionnaires . Alors, qui doit prendre la direction ? ( ... ) Oui, nous voulons subordonner la conscience de la classe ouvrière aux idées révolutionnaires. C'est notre prétention". (Rapport au 4ème Congrès mondial, décembre 1922).
Une fois dans l'opposition, face à la contre-révolution, Trotsky nuança ses analyses ou plutôt dépassa le simplisme de la propagande des premières années de l'IC. Dans un texte de septembre 1933, Trotsky résumait une position beaucoup plus lucide sur la question syndicale :
"Les syndicats sont apparus dans la période de croissance et de montée du capitalisme. Leur tâche était d'élever le niveau matériel et culturel du prolétariat et d'étendre ses droits politiques. Ce travail, qui s'est étendu en Grande-Bretagne sur plus d'un siècle, a donné aux trade-unions une autorité immense au sein du prolétariat. La décadence du capitalisme britannique, dans les conditions du déclin du système capitaliste mondial, a sapé les bases même du travail réformiste des trade-unions Le rôle des syndicats, nous l'avons dit plus haut n'est plus un rôle progressif mais un rôle réactionnaire". (Trotsky,Oeuvres T.II, EDI, p.178).
Certes Trotsky conservait l'illusion d'un travail possible et nécessaire des communistes dans ces organes :
"C'est précisément à l’époque actuelle, où la bureaucratie réformiste du prolétariat s'est transformé en police économique du capital, que le travail révolutionnaire dans les syndicats, mené avec intelligence et persévérance, peut donner des résultats décisifs dans un délai relativement bref". (souligné par nous) (idem). Dans le même temps, Trotsky fixait une perspective de rupture avec les syndicats : "il faut absolument préparer dès maintenant les ouvriers avancés à l'idée de créer des comités d'ateliers et des conseils ouvriers au moment d'un tournant brutal". (idem).
Mais une telle vision restait abstraite et tout à fait contradictoire avec l'expérience du mouvement ouvrier lui-même. Trotsky réduisait en fait la question de l'apparition de véritables organes de lutte prolétariens à une simple tactique pouvant être décidée par l'organisation des révolutionnaires. Le volontarisme de Trotsky masquait mal un manque de confiance dans les capacités de la classe. Certes, les capacités commençaient à se réduire dès la fin des années 20, mais, tout à la défense de la révolution russe, Trotsky comme beaucoup de révolutionnaire ne pouvait se résoudre à voir la défaite du prolétariat et à en tirer les conclusions nécessaires tant sur le plan théorique qu'organisationnel.
2. La Gauche Italienne, Bilan.
C’est une toute autre démarche que développa la fraction de la gauche italienne regroupée autour de la revue "Bilan" :
"Affirmer aujourd'hui que l'on veut fonder des nouveaux partis sur la base des quatre premiers Congrès de l'IC, c'est commander à l'histoire de faire machine arrière de dix ans, c'est s’interdire la compréhension des évènements survenus après ces Congrès et c'est, en définitive, vouloir placer les nouveaux partis dans un endroit historique qui n'est pas le leur. L'endroit où devront se placer demain les nouveaux partis est d'ores et déjà délimité par l'expérience issue de l'exercice du pouvoir prolétarien et par toute l'expérience du mouvement communiste mondial. Les quatre premiers Congrès sont, dans ce travail, un élément d'étude qui doit être passé au crible de la critique la plus intense".(Bilan n°l, novembre 1933).
Comprenant la défaite politique du
prolétariat, la gauche italienne envisagea le problème de la présence des
révolutionnaires dans les syndicats uniquement du point de vue de la lutte
défensive et revendicative. La possibilité
resurgisse ment d'organes révolutionnaires de classe du type des conseils étant
repoussée pour toute une période, Bilan comprenait qu'il n'y avait plus de
place pour une activité misant, sur un
tel processus. De la même façon,
l'effondrement de 1’IC excluait la reconstitution à court terme du parti de
classe international. Il ne s'agissait
donc pas pour Bilan de déterminer une stratégie syndicale perpétuant
l’orientation de l'IC"de Lénine", mais de préserver la capacité
défensive de la classe. Bilan conservait
donc beaucoup d'illusions sur la continuité du rôle historique des syndicats
"Même aux mains des réformistes, les syndicats restent, pour nous, les endroits où les ouvriers doivent se rassembler, et d’où peuvent surgir des élans de conscience prolétarienne balayant toute la pourriture actuelle (... ). Si des mouvements se produisaient en dehors des syndicat, il faudrait évidemment les soutenir(…)". (Bilan n°25, nov.déc. 35)[1] [127]
La gauche italienne comme Trotsky restait donc prisonnière des analyses erronées de l'IC et surtout d'une période où il était difficile de tirer toutes les conclusions d'une vague révolutionnaire qui n'avait pas pu aller à terme et n'avait de ce fait pas pu trancher de façon suffisamment nette la question de la rupture avec le syndicalisme. De plus, le triomphe de la contre-révolution fasciste, démocratique et stalinienne ne favorisait pas la défense des thèses s'appuyant sur les capacités d'organisation spontanée du prolétariat démontrées par le surgissement des conseils ouvriers. La période était surtout marquée par le constat des insuffisances des révolutionnaires tant en Allemagne lors de la vague révolutionnaire qu'en Russie, là où le prolétariat avait conquis le pouvoir. La question décisive du parti, de sa nature et de sa fonction était la plus discutée et formait en quelque sorte un écran qui empêchait les fractions révolutionnaires de prendre du recul et d'avoir une vision plus globale de ce qu'avait été le processus révolutionnaire du point de vue du développement de l'activité et de la conscience du prolétariat dans son ensemble. Sans une telle vision d'ensemble de ce qu'avait été le mouvement de classe confronté au capitalisme décadent, il n'était pas possible de clarifier la question syndicale.
3. Les communistes de conseils.
C'est aux mêmes limites que se heurtèrent les communistes de conseils dans leur critique du syndicalisme. Ce courant, issu en partie de la gauche hollandaise et allemande développait dans les années 30 une critique cinglante du "léninisme" qui remettait en cause la nature même de la révolution russe, jusqu'à la qualifier de "bourgeoise". En fait, recourant conseilliste finissait par reprendre une série de préjugés "anti-parti" (empruntés à la tradition anarchiste et syndicaliste révolutionnaire). Au parti et aux syndicats, les conseillistes opposaient le "pouvoir des conseils ouvriers", seule forme d'organisation de la classe où celle-ci pouvait acquérir par elle-même la conscience de ses buts historiques et assurer ses taches historiques. La critique du syndicalisme consistait donc essentiellement en une critique des structures syndicales impropres à une véritable vie et activité autonome de la classe ouvrière :
"Les syndicats croissent à mesure que se développe te capitalisme
et la grande industrie, jusqu'à devenir de gigantesques organisations qui
comprennent des milliers d'adhérents à travers tout un pays et ont des
ramifications dans chaque ville et dans chaque usine. Des fonctionnaires y sont nommés ( ces
fonctionnaires sont les dirigeants du syndicat. Ce sont eux qui conduisent les
pourparlers avec les capitalistes, tache dans laquelle ils sont passés maîtres
(... ). Une telle organisation n'est plus uniquement une assemblée d'ouvriers ;
elle forme un corps organisé, qui possède une politique, un caractère, une
mentalité, des traditions et des fonctions qui lui sont propres. Ses intérêts sont différente de ceux de la
classe ouvrière et elle ne reculera devant aucun combat pour les
défendre". (A.Pannekoek, Janvier 1936,
in "International Council Correspondence").
Toutes ces critiques étaient justes et restent aujourd'hui un aspect important de la position des révolutionnaires sur les syndicats. Mais ne voir dans les syndicats que leur bureaucratisme, leur mentalité rétrograde, leur impuissance à combattre le capitalisme restait insuffisant. Ce caractère bureaucratique était apparu relativement rapidement dès la fin du 19ème siècle. Ce constat avait le mérite de rappeler ce que depuis longtemps le marxisme avait décelé : le caractère "étroit"'du syndicalisme. Dans "Salaire, prix et profit", Marx en 1865, en définissait très bien les limites : "Les syndicats agissent utilement en formant des centres de résistance aux empiètements du capital. Ils manquent en partie leur but quand ils font un usage peu judicieux de leur force. Ils le manquent entièrement lorsqu’ils se contentent de mener une guerre d'escarmouches contre les effets du système actuel, au lieu d'essayer en même temps de le changer en se servant de leur force organisée comme d'un levier pour l'émancipation finale de la classe ouvrière, c'est-à-dire pour abolir une fois pour toutes le salariat".
Même en ce qui concerne la fin des syndicats comme mode d'organisation de la classe, le mouvement marxiste avait développé les bases d'une analyse de ce processus. Engels, dans un article publié dans "Labour Standard", organe des syndicats anglais, en mai-juin 1881, expliquait :
"Qui plus est, de nombreux symptômes
indiquent que la classe ouvrière de ce pays commence à se rendre compte qu’elle
s'est engagée depuis quelques temps, sur la mauvaise voie. En effet, elle commence d comprendre que
l'agitation actuelle, parce qu’elle tourne exclusivement autour de questions
d'augmentations de salaires et de diminutions d'horaires de travail, la maintient
dans un cercle vicieux sans issue, car le mal fondamental ne réside pas dans le
bas niveau des salaires, mais dans le système du salariat lui-même. Si elle se répand largement au sein de la
classe ouvrière, cette prise de conscience doit changer considérablement la
position des syndicats : ils ne jouiront plus longtemps du privilège. d'être
tes seules organisations de la classe ouvrière.
A côté ou au-dessus des syndicats de chaque branche d'industrie surgira
une Union générale, une organisation politique de la classe ouvrière dans son
ensemble".
La critique des syndicats par les conseillistes consistait donc en une reprise à peine approfondie de certains points de l'analyse des marxistes, mais à moins de faire des syndicats des organes ayant toujours appartenu à la bourgeoisie (position à la quelle aboutissent certaines sectes comme le PIC aujourd'hui), ce courant ne parvenait pas à saisir le fondement matériel du passage des syndicats dans le camp bourgeois, leur intégration dans l'Etat et leur fonction contre-révolutionnaire. D'ailleurs Pannekoek, dans une critique de certaines positions de Grossmann sur l'écroulement nécessaire du capitalisme exprimait son incompréhension et son rejet de la notion de décadence du capitalisme :
"L'impuissance de l'action syndicale, impuissance qui est apparue depuis longtemps déjà, ne doit pas être attribuée à un écroulement économique mais à un déplacement des pouvoirs au niveau de la société (…). Le parlementarisme et la tactique syndicale n'ont pas attendu la crise présente pour s'avérer incapables, ils l’ont déjà démontré au long de plusieurs décennies. Ce n'est pas à cause de l'écroulement économique du capitalisme, mais à cause du monstrueux déploiement de sa puissance, de son extension à toute la terre, de l'exacerbation en lui des oppositions politiques, du renforcement violent de sa force interne, que le prolétariat doit passer à l'action de masse, déployer la force de toute la classe". (A.Pannekoek, juin 1934, n°l de Rätekorrespondenz, organe du Groupe des Communistes Internationalistes de Hollande):
L'article était dirigé contre les thèses de Rosa Luxemburg schématisées par Grossmann. La critique de l'économisme mécaniste de Grossmann était facile, mais Pannekoek ne répondait pas au problème de fond posé : est-ce que le syndicalisme avait toujours été caduc, est-ce que la possibilité de réformes économiques et politiques dans la période ascendante n'avait pas été la base matérielle du parlementarisme et du syndicalisme ? Il ne suffisait pas de comprendre les effets néfastes de cette réalité sur le mouvement ouvrier (réformisme, économisme, opportunisme, au sein de la Social-démocratie), il fallait encore comprendre que cette phase particulière du développement de l'activité de la classe était irrémédiablement finie, que, par exemple, le stalinisme n'était pas une déviation "néo-réformiste" ou "néo-opportuniste" du mouvement ouvrier, mais une expression du capitalisme décadent. Reconnaître l'entrée du capitalisme mondial dans sa phase de décadence, de déclin historique, ne signifiait pas le développement d'une vision fataliste et attentiste de l'histoire, mais la rupture de classe avec les thèses social-démocrates et les méthodes politiques et organisationnelles qui avaient prévalu dans la phase ascendante du capitalisme.
Les conseillistes avaient une vision de la nécessité de cette rupture, mais elle restait partielle. D'une part, ce courant était loin d'être homogène (cf nos articles sur la Gauche Hollandaise dans les Revues Internationales n°.16, 17 et 21). D'autre part, les conseillistes recherchaient les causes de la défaite dans la seule politique erronée de l'IC et du Parti Bolchevik. Ceci devait les amener à une sous-estimation de l'activité des communistes et à un abandon de la nécessité de la préparation révolutionnaire sur le plan de la reconstitution du parti. Progressivement, Pannekoek abandonnera la défense de la nécessité du parti pour se, limiter à un plaidoyer en faveur de l'autonomie de la classe.
Mais même si cette faiblesse du courant conseilliste mène à des erreurs profondes sur la question du parti, oublier que ce courant a approfondi la question de l'auto-organisation de la classe et a ainsi abordé un problème crucial de la période de décadence serait une profonde erreur. A partir du moment où les syndicats et le syndicalisme étaient compris comme des forces antagoniques à l'activité révolutionnaire de la classe ouvrière, il s'agissait de cerner les modalités nouvelles des luttes ouvrières elles-mêmes. Pannekoek va aborder cette question dans un ouvrage sur les conseils ouvriers écrit pendant la 2ème Guerre Mondiale :
"L'action directe, c'est donc l'action des travailleurs, celle qui ne passe pas par l'intermédiaire des bureaucrates syndicaux. Une grève est dite "sauvage" (illégale ou non-officielle) par opposition aux grèves déclenchées par les syndicats en respectant les règlements et les Lois (… ). Ces grèves sauvages sont les annonciatrices des grandes luttes du futur que, poussées par les nécessités sociales importantes, par une répression toujours plus lourde et une détresse plus profonde, les masses seront conduites à engager". (Pannekoek, Les Conseils Ouvriers)
Pannekoek insistait donc sur l'importance de la capacité des ouvriers amener leurs luttes par eux-mêmes, à faire 1'expérience de leurs propres possibilités et de leur force collective sans pour autant tomber dans une sorte de "spontanéisme" béat ou dans une vision schématique et linéaire du processus d'auto organisation de la classe :
"L'auto-organisation des travailleurs en lutte, ce n'est pas une de ces exigences déduites de l'étude théorique, à partir de discussions sur sa nécesaité et ses possibilités d'utilisation, c'est simplement la constatation d'un fait, découlant de la pratique. Il est souvent arrivé au cours de grands mouvements sociaux - et sans aucun doute il arrivera encore - que les actions menées ne soient pas conformes aux décisions prises. Parfois, des comités centraux lancent un appel à la grève générale et ne sont suivis qu'ici ou là, par de petits groupes. Ailleurs, les comités pèsent tout minutieusement sans s’aventurer à prendre une décision et les travailleurs déclenchent une grève de masse. Il est possible aussi que les mêmes travailleurs qui s'étaient résolus à la grève avec enthousiasme, reculent au moment d'agir ou, inversement, qu'une hésitation prudente se reflète dans les décisions et que, soudain, résultat de l'action de forces intérieures cachées, une grève non décidée éclate irrésistiblement. Alors que dans leur manière de pensée consciente, les travailleurs utilisent de vieux mots d'ordre et de vieilles théories qui s'expriment dans leurs opinions et leurs arguments, ils font preuve, au moment de la décision dont dépend leur bonheur ou leur malheur d'une intuition profonde, d'une compréhension instinctive des conditions réelles qui finalement déterminent leurs actes. Cela ne veut pas dire que ces intuitions sont toujours un guide sûr ( …). Ainsi s'opposent Les deux formes d'organisation et de lutte. L'ancienne, celle des syndicats et des grèves réglementées ; la nouvelle, celle des grèves spontanées et des conseils ouvriers. Cela ne signifie pas que la première sera tout simplement remplacée un jour par la seconde. Des formes intermédiaires peuvent être imaginées. Elles constitueraient des tentatives pour corriger les maux et les faiblesses du syndicalisme tout en sauvegardant les bons principes". (idem)
La défense de Pannekoek d'une véritable autonomie du prolétariat dans la lutte reflétait certes des ambiguïtés et des faiblesses, mais celles-ci exprimaient bien plus profondément l’état général du milieu révolutionnaire dans une phase de contre révolution triophante à laquelle venait s'ajouter l'horreur d'une deuxième Guerre Mondiale rendant encore plus difficile l'activité de le classe et des révolutionnaires. Ce qui était important, décisif, dans ce texte, comme dans ceux des autres courants prolétariens internationalistes, c'était la confiance dans le prolétariat comme force révolutionnaire.
- C'est pourquoi il serait erroné d'opposer la trajectoire de la Gauche Italienne à celle des communistes de conseils et de chercher dans l'un ou l'autre de ces courants l'expression pure et dure de la continuité "marxiste". Par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de faire une synthèse écléctique des positions politiques développées par ceux-ci dans les années 30 puis dans les années de l'immédiat après-guerre. Le mérite de la Gauche Communiste de France qui publia Internationalisme fut justement d'éviter un certain fétichisme de la "tradition" vue comme la simple glorification apologique d'un courant contre les autres vers laquelle malheureusement s'achemina une partie de la Guache Italienne remettant en cause l'esprit de Bilan. Pour accomplir cette démarche, la courant bordiguiste dû rejeter Bilan est sa conclusion aux oubliettes, permettant à Bordiga de reprendre le travail théorique à zéro, c'est à dire à retourner aux erreurs leninistes contre les acquis de la Gauche Italienne, notamment sur la question nationale ou la question de la décadence.
[1] [128] Fort peu de textes de Bilan traitent directement de la question syndicale, mais même s'il y avait une sorte de position officielle qui restait attachée à l'optique léniniste, la reconnaissance de la décadence du capitalisme amena une tendance au sein de Bilan à réévaluer ce point sur les syndicats.
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Notes sur la question paysanne
- 3965 reads
Nous voulons montrer dans cet article :
- que le prolétariat doit considérer d'un oeil différent les différentes couches de la population agricole et s'appuyer sur les ouvriers agricoles et les paysans pauvres
- que la question paysanne s'est aggravée avec la décadence du capitalisme, ce qui laisse un legs très lourd au prolétariat
- que toutes les tentatives de "réformes agraires" sont des mystifications bourgeoises; que seule la révolution prolétarienne mondiale est la SEULE et VRAIE solution à la misère croissante dans les campagnes du Tiers-Monde.
QU’EST CE QUE LA PAYSANNERIE ?
A la différence des sociologues qui parlent de manière indifférenciée de la paysannerie comme d'une catégorie sociale homogène, les marxistes ont toujours montré son hétérogénéité. Ils ont démontré l'existence à la campagne de différentes classes sociales antagoniques, et à l'intérieur de celles-ci de strates produites par le régime juridique de la propriété foncière ou la possession de moyens de production. C'est en étudiant les clivages de classe existant au sein des campagnes et dans les différentes aires géographiques que le marxisme peut saisir les contradictions sociales explosives qui règnent à la campagne et saisir leurs liens avec la lutte du prolétariat industriel.
Il est d'autant plus nécessaire de définir les classes sociales à la campagne, que consciemment la bourgeoisie occulte leur existence. Pour elle, les ouvriers agricoles, les sans-travail, les paysans sans terre qui s'entassent dans les villages, c'est du pareil au même. Un fermier capitaliste est pour elle identique à un fermier du tiers-monde; un capitaliste de plantation sera défini comme "exploitant agricole" au même titre que le petit paysan disposant tout juste d'un lopin de terre.
En second lieu, il faut bien prendre soin de distinguer la population rurale (l'ensemble des classes vivant à la campagne) de la population agricole (ensemble des classes vivant de l'agriculture). Il est évident qu'un ouvrier vivant et travaillant à la campagne n'est pas un paysan, et inversement, un paysan travaillant et vivant à la ville ou dans un gros bourg n'est pas ni commerçant, ni ouvrier. Il existe une différence qualitative entre la campagne industrialisée des pays hautement développés et la campagne sans industrie des pays du tiers-monde.
En troisième lieu, on doit mettre en évidence le fait que la population agricole ne recouvre pas la population active. Si 50% de la population allemande ou japonaise travaille ce chiffre tombe souvent à moins de 30% dans les pays sous-développés. Il faut insister aussi sur le fait que dans ces derniers, le chômage et le sous-emploi touchent de 20 à 40% de la population agricole.
Toutes ces précisions sont d'autant plus nécessaires que la bourgeoisie, par tous les moyens (idéologiques, statistiques) cache l'existence des classes à la campagne et donc les antagonismes de classes sous la catégorie fourre-tout : "paysannerie".
Il n'existe pas de paysannerie en soi, mais un prolétariat rural d'un côté et différentes couches sociales du paysannat de l'autre côté depuis le grand propriétaire jusqu'au sans-travail.
LES OUVRIERS AGRICOLES
Les ouvriers agricoles ne font pas partie de la paysannerie, même si bien souvent, ils peuvent en partager les préjugés et l'idéologie. Ils sont un détachement du prolétariat à la campagne et leurs intérêts de classe ne se distinguent en rien de ce ceux du prolétariat tout entier. Ils constituent sans doute la catégorie la plus exploitée de la classe ouvrière par leurs salaires extrêmement bas et la précarité de leurs conditions d'existence qui les mettent à la merci des propriétaires fonciers : chômage, violence de ces derniers qui bien souvent disposent de véritables armées privées pour les mettre à raison en cas de révolte, comme c'est le cas en Amérique Latine. Le fait que, bien souvent, à l'exception des pays industrialisés et des régions de plantations, ils soient faiblement concentrés et minoritaires au sein des campagnes souligne leur dramatique isolement du reste du prolétariat. Ce sera précisément une tâche du prolétariat urbain de porter la lutte de classe à la campagne et de s'appuyer solidement sur les prolétaires ruraux. Cette tâche sera néanmoins difficile, compte tenu de l'éparpillement, et dans la majorité des cas, de la faiblesse numérique de ces ouvriers : bien souvent, ils ne dépassent guère le chiffre de 10 à 20% de la population agricole dans l'ensemble du monde.
Cependant, le principal obstacle à l'union du prolétariat urbain et rural réside dans la perméabilité des couches sociales à la campagne; souvent des ouvriers agricoles sont propriétaires d'un lopin de terre qui leur permet de survivre du point de vue alimentaire; fréquent peut-être aussi le cas de paysans-ouvriers qui font une double journée de travail. Bien souvent encore, dans le tiers-monde, une masse énorme de sans-travail ne vend qu'une partie de l'année sa force de travail. Nous verrons plus loin que les réformes agraires opérées dans les pays de l'Est et du tiers-monde, donnant des lots de terre aux ouvriers agricoles ont souvent occulté leur différenciation d'avec la paysannerie et atténué ainsi momentanément les clivages sociaux.
L'existence de grands domaines non cultivés ou sous-utilisés dans les pays du tiers-monde peut pousser les ouvriers agricoles à les occuper en période révolutionnaire. Dans ce cas, comme le montre l'exemple de la Russie en 1917-18, ils cessent d'être des ouvriers agricoles. En opérant le partage des terres, ils deviennent alors des petits exploiteurs agricoles, avec tous les privilèges que cela implique. L'existence d'une idéologie "partageuse" (on se partage les terres entre tous) est un frein dans la prise de conscience de classe des ouvriers. Elle permet toutes les manœuvres des fractions bourgeoises de gauche qui se font les porte-parole de la petite propriété.
Tout autre est le cas des ouvriers agricoles des pays développés. La disparition progressive des journaliers agricoles et la concentration des ouvriers dans de vastes usines (ou coopératives) alimentaires, dans des unités mécanisées, ont simplifié favorablement la situation. Les ouvriers effectuent un travail associé, sont de véritables ouvriers d'industrie, pour lesquels le partage des terres et des usines agricoles n'a aucun sens. C’est pourquoi, étrangers à l'idéologie "partageuse" ils s’intégreront sans problème dans la lutte révolutionnaire qui secouera les pays développés.
Le poids du passé, l'archaïsme des structures agraires rendent par contre extrêmement hétérogène e paysannat qui coexiste avec les ouvriers agricoles.
LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PAYSANS
Elles sont délimitées en fonction de 3 critères :
- les structures juridiques : possession ou non possession de la terre; propriété pleine ou usufruit de la terre (fermage et métayage); coopératives agricoles
- la taille des exploitations : grande, moyenne ou petite
- l'importance de la capitalisation et la mécanisation des exploitations.
C'est en fonction de ces critères que l'on pourra limiter les clivages de classes existant dans les campagnes. Il est bien évident que la domination du capitalisme, même formelle, à la campagne, fait passer au premier plan pour cette délimitation, le critère économique au détriment du critère juridique. Ce qui prime du point de vue du capital, c’est moins la propriété juridique que la possession des moyens de production et du capital permettant de mettre en exploitation la force de travail et la terre. De plus, dans les pays industriels, la question de la taille de l'exploitation a perdu beaucoup de son importance: à la culture extensive a succédé la culture intensive, à la "faim de terre", la faim de capital.
Pour définir les classes à la campagne, il faudra essentiellement tenir compte de deux critères
- le revenu du "paysan",
- sa place dans les rapports de production selon qu'il se trouve en situation d'exploiteur de la
force de travail ou non, de dépendance absolue ou non vis à vis du capitaliste ou du propriétaire foncier,
Enfin, les différenciations géographiques doivent nécessairement être prises en considération. Il n'y a aucune mesure entre le petit propriétaire de la Beauce ou du Middle West et le petit propriétaire du Cameroun.
LA BOURGEOISIE RURALE
L'une des grandes mystifications développées par la bourgeoisie consiste très souvent à considérer purement et simplement les grands propriétaires fonciers ou les fermiers capitalistes comme ... des "paysans". Non moins pernicieuse est l'idée que dans les pays du tiers-monde, de l'Asie à l'Amérique Latine, les "latifundiaires", les "aghas" musulmans ou les "zamindar" indiens seraient des ... féodaux comme il en existait au Moyen-Age.
A cela on peut répondre
1) Si jadis, sous l'Ancien Régime, les "riches laboureurs" de la fable pouvaient être considérés comme une couche supérieure de la paysannerie, l'emprise de la bourgeoisie sur la terre et sa domination sur cette couche dès l'aube de l'essor capitaliste ont définitivement créé dans les pays même les plus arriérés une bourgeoisie agraire organiquement reliée à l'ensemble de cette classe par le triomphe économique et politique des nouveaux rapports de production. Elle est une bourgeoisie, non en fonction d'un formalisme juridique, ou du degré de ses revenus, mais par sa possession des moyens de production (terre, capital technique) et l'exploitation capitaliste de la force de travail (salariat en argent ou en nature), et enfin, par son insertion dans le marché capitaliste (produire pour vendre).
2) Ce ne sont pas les titres nobiliaires, ni la dimension et l'origine féodale des grands domaines (latifundia), ni même la domination quasi féodale des grands propriétaires sur des paysans encore soumis à des corvées et à des rapports de servage (Moyen-Orient, les pays les plus arriérés d'Amérique Latine) qui définissent et délimitent aujourd'hui les rapports de production dans les zones les plus arriérées, mais le marché mondial. La pénétration du capitalisme, la nature capitaliste de l'Etat soumis aux lois du capital tendent à transformer en bourgeois les anciens féodaux. Qu'ils soient latifundiaires, usuriers ou chefs de tribus, le capital en les intégrant dans le marché et surtout au sein de l'Etat, les a progressivement lié à l'ensemble de la classe dominante capitaliste. Qu'ils circulent à cheval ou en voiture, qu'ils soient en "boubous" ou en costume de ville, ils sont irréversiblement devenus partie intégrante de la bourgeoisie, à laquelle ils participent par l'appropriation de la rente foncière et par le profit des marchandises agricoles qu'ils écoulent sur le marché capitaliste.
C'est cette vision mondiale qui permet de déterminer qu'il ne peut y avoir en aucun cas une classe "féodale réactionnaire" et une "classe bourgeoise progressiste" dans les pays les plus arriérés. Il s'agit d'une seule et même classe réactionnaire dans la décadence capitaliste : la classe dominant les exploités !
3) Il ne s'agit pas, bien sûr, de nier l'existence de restes de modes de production antérieurs au capitalisme. Au 20ème siècle, on peut voir co-exister en Océanie, par exemple, aussi bien les plantations les plus modernes que des tribus cultivant la terre avec des outils de l'âge de pierre. Cette réalité qui est le produit même de la perpétuation du système capitaliste devenu stérile, ne contredit pas la domination mondiale du capital dans tous les pays. C'est essentiellement dans la sphère de la circulation des marchandises (échange) que le capital s'est imposé partout. Même les grands "féodaux" de l'Asie doivent écouler leur production sur un marché capitaliste.
4) La théorie qui parle aujourd'hui de possibilité de révolutions"anti-féodales" bourgeoises, en se basant sur l'existence de vestiges de modes de production non capitalistes, rappelle étrangement la vieille conception du "développement inégal" chère ,à feu Staline, voire celle de la "révolution par étapes".
Une telle théorie n'est pas neutre; elle part d’une vision nationale et donc nationaliste, des rapports de production dominants; elle est le cache-sexe de tous les mouvements bourgeois tiers-mondistes trotskystes, etc. qui affirment que l'ennemi du prolétariat agricole et des paysans pauvres dans les pays sous-développés, c'est ... le"féodal".
LA PETITE BOURGEOISIE
A cette catégorie appartiennent les petits paysans, petits propriétaires indépendants ou non (exploitant ou non la force de travail), petits fermiers et métayers des pays développés. L'hétérogénéité de cette couche est le produit historique de l'interpénétration des rapports précapitalistes avec le capitalisme moderne. Elle trouve sa source dans les structures juridiques, économiques, géographiques les plus diversifiées. On pourrait même affirmer que cette situation complexe détermine l'existence de véritables "sous-classes à l'intérieur de cette petite bourgeoisie. Toutes se trouvent dans un état de dépendance vis à vis du marché, mais d'inégale indépendance par rapport au capital. Deux couches principales peuvent ainsi se dégager
- les exploitants agricoles à leur compte, véritables artisans puisqu'ils sont possesseurs de leurs moyens de production (terre, tracteurs, bâtiments). A l'intérieur de cette couche se délimitent les exploitants qui achètent la force de travail, et ceux dont la main d’œuvre est purement familiale.
- les exploitants dépendants ne possédant pas la terre dont ils sont les locataires (usufruitiers: métayers et fermiers). Ces deux couches s'opposent puisque les premiers ne disposent pas de leurs moyens de travail qu'ils louent, alors que les seconds possèdent nécessairement leurs outils de travail, mais l'évolution du capitalisme a transformé les fermiers peu à peu en petits capitalistes qui se différencient eux-mêmes selon la grandeur de leur capital. Quant aux métayers, héritage précapitaliste en voie de disparition dans les pays développés comme la France, l'Italie, etc., ils sont directement soumis à l'arbitraire du propriétaire et aux aléas de leur récolte, compte tenu du fait que leur mode d'exploitation est primitif et qu'ils doivent donner en nature une partie déterminée de leur récolte comme loyer de la location de terre et d'outils.
C'est dire toute la complexité du problème et l'extraordinaire difficulté du prolétariat à intervenir dans ces couches.
En fait, c'est la force même
du prolétariat, sa division inébranlable qui sera à même de créer des clivages
au sein de la petite bourgeoisie agricole.
Dans les pays sous-développés, un prolétariat décidé peut entraîner derrière
lui ces couches petites bourgeoises que la crise jette dans le paupérisme absolu. Dans les pays développés, le prolétariat
s'affrontera à l'hostilité la plus vive de ces couches qui s'identifient à la
propriété privée. Dans le meilleur des
cas, si la révolution internationale s'étend rapidement, le prolétariat pourra
compter au moins sur la "neutralité" résignée de ces couches
particulièrement rétrogrades.
LES PAYSANS PAUVRES ET SANS TERRE
Dans le tiers-monde, ils constituent une véritable couche de miséreux et de crève-la-faim, vivant dans des conditions inhumaines. Qu'ils soient métayers dans les pays musulmans, petits propriétaires végétant sur un maigre lopin de terre (microfundia), ou sans terre, proie des usuriers, vagabonds ou entassés dans des villages-bidonvilles, tous vivent la même situation de misère absolue, sans espoir de s'intégrer dans la société capitaliste où ils vivent en marge. Bien souvent, ils sont à la fois petits propriétaires, ouvriers agricoles, métayers et fermiers quand une partie de leur terre a été hypothéquée. Selon les statistiques officielles, 900 millions d'hommes sont définis comme paysan sans terre. Leur situation se rapproche de celle des sans-travail, puisque la majorité d'entre eux ne travaille que 80 jours par an en moyenne, entre 20 et 40% de la population agricole du tiers-monde. En proie aux famines, aux violences des propriétaires fonciers, ils vivent dans un état d'apathie profonde jalonnée de révoltes brutales et sans espoir, écrasées férocement. C'est cette couche majoritaire dans les campagnes arriérées qui illustre de façon frappante qu'ils n'ont que leurs chaînes à perdre, et un monde à gagner lors de la révolution prolétarienne.
Cependant, leur adhésion à la révolution prolétarienne sera fonction de l'esprit de décision du prolétariat. La situation de vagabonds, voire du lumpenprolétariat en ont fait dans le passé, et peuvent en faire aujourd'hui, des instruments des propriétaires fonciers ou de mouvements capitalistes d'Etat ("libération nationale"), des mercenaires utilisés contre les ouvriers.
Si cette couche, hybride, dont l'unité est la misère absolue, n'a rien à perdre, elle ne pourra être gagnée par la flamme révolutionnaire que si le prolétariat lutte sans merci contre la bourgeoisie rurale en la réduisant à néant.
LE POIDS DE LA DECADENCE
1) Le marxisme et la question paysanne au 19e siècle
Si à la veille de la "révolution industrielle", la paysannerie représentait encore plus de 90% de la population mondiale, le développement du capitalisme s'est traduit par une prolétarisation considérable des paysans jetés brutalement dans les nouveaux bagnes industriels. Toute l'histoire du capitalisme depuis ses origines est celle d'une expropriation violente des petits propriétaires agricoles par le capitalisme agricole, paysans sans terre contraints au vagabondage afin de les transformer brutalement en prolétaires. L'accumulation primitive en Angleterre étudiée par Marx dans le Capital en est l'exemple le plus cruel.
La mécanisation de l'agriculture au 19ème siècle en Europe occidentale, signe d'une capitalisation croissante de la terre, n'a fait que précipiter ce phénomène en ne laissant aux paysans pauvres que le choix entre mourir lentement asphyxiés par la concurrence de l'agriculture capitalisée (ce fut le cas des paysans irlandais qui laissèrent un million de morts lors de la grande famine de 1847) ou devenir des prolétaires d'usines. Ce que le capitalisme avait obtenu à ses débuts par la violence physique, il l'obtenait dorénavant par la violence de ses lois économiques : trouver une force de travail abondante et bon marché pour la pressurer impitoyablement dans les nouveaux centres industriels.
Le second avantage pour le capitalisme de cette expropriation n'était pas moindre. En concentrant et remembrant les terres, le capital pouvait produire des aliments bon marché susceptibles autant de répondre à la brutale croissance démographique que de faire pression sur les salaires, en réduisant le coût de production des biens nécessaires de la reproduction de la force de travail.
Sur le plan théorique, Marx, lorsqu'il mit en relief les lois auxquelles était soumis le capitalisme, divisait la société en trois grandes classes sur le plan économique : la bourgeoisie, le prolétariat, et la classe des grands propriétaires agricoles (landlords) accaparant la rente foncière. Sur le plan politique, il dégageait deux classes historiques fondamentales : l'ancienne classe révolutionnaire (la bourgeoisie) et son fossoyeur, le prolétariat.
Cependant, à la fin du siècle dernier, si le capitalisme dominait l'ensemble du monde, on était loin d'une intégration des paysans au niveau mondial dans la production, et cela même en Europe. Kautsky, étudiant d'ailleurs uniquement le cas de l'agriculture européenne et américaine, pensait que la tendance générale du développement capitaliste allait dans le sens de la disparition de la petite propriété au profit de la grande, et donc de l'industrialisation de l'agriculture. Il soulignait la prolétarisation des paysans transformés en ouvriers agricoles en Allemagne[1] [130]
Cette vision optimiste d'une fusion entre industrie et agriculture, sur la "résolution pacifique" par le capital du problème paysan et agraire reposait en fait sur la croyance en une impossibilité d'une décadence du capitalisme et sur l'espoir (inavoué encore chez Kautsky) réactionnaire d'une croissance harmonieuse et infini de ce système.
La décadence du capitalisme n'a fait que pousser à son comble le problème paysan et agraire. Ce n'est pas, si l'on prend un point de vue mondial, le développement de l'agriculture moderne qui s'est réalisé, mais son sous-développement. La paysannerie, comme il y a un siècle constitue toujours la majorité de la population mondiale.
2) Développement et sous-développement dans le tiers-monde
Ces pays représentent 69% de la population mondiale et n'entrent que pour 15,4% du PNB mondial[2] [131]. Ils ne produisent que 7% de la production industrielle mondiale et leur taux d'analphabétisme est d'environ 75%. Leur part dans le commerce international n'a fait que continuer à diminuer passant de 31,2% en 1948 à 17% en 1972[3] [132].
Mondialement la population agricole n'a pas diminué depuis la seconde guerre mondiale mais elle a augmenté en absolu. Elle passe de 700 millions d'hommes en 1950 à 750 en 1960, pour atteindre sans doute -par déduction statistique- environ 950 millions d'actifs agricoles. Si l'on considère que le nombre d'actifs considérés comme tel, selon ces "critères capitalistes" est de 1,7 milliard, on a une idée du poids écrasant de la population agricole. Quant à la part active de cette population, elle a à peine diminué : 60% de la population active en 1950; 57% en 1960; peut-être 55% en 1980. (Tous ces chiffres prennent uniquement en considération l'ensemble du monde).
Bien entendu ces chiffres sont incertains faute de statistiques sérieuses, non manipulées par les économistes bourgeois.
Dans la réalité, 66% de la
population mondiale semble vivre à la campagne dont l'immense majorité, à
l'exception du monde industriel, est constituée de paysans pauvres avec ou sans
terre.
Non seulement, le capitalisme ne peut intégrer les paysans dans l'industrie, mais il les fait croupir dans la misère la plus absolue. Sur 60 millions de décès annuels, en majorité dans le tiers-monde, 20 millions sont dus à la faim ou à ce que les économistes appellent pudiquement "malnutrition" L'immense majorité de la population ne dépasse pas l'âge de 40 ans, et la moitié des enfants meurt avant un an. Officiellement, 900 millions de paysans sont considérés comme vivant au seuil de la pauvreté absolue, et peut-être plus puisque les chômeurs (les paysans du tiers-monde trouvent souvent un appoint comme ouvriers agricoles) ne sont pas comptabilisés (cf. R.Fabre. "Paysans sans terre")
Cette misère absolue, les famines menaçantes comme au Sahel et en Asie, condamnent d'autant plus le capitalisme que les possibilités existent aujourd'hui de nourrir bien au-delà des besoins toute la population mondiale :
- un tiers seulement de la surface agricole utile mondiale est cultivée
- la surproduction agricole des pays développés par rapport aux marchés solvables entraîne une gigantesque sous-production par rapport aux besoins vitaux; les USA préfèrent transformer leurs excédents en alcool, et même diminuer la surface de blé cultivée plutôt que de voir la chute des cours
- le développement constant de l'économie de guerre, en développant toujours plus les stocks stratégiques en vue de la guerre mondiale, entraîne une réduction constante de la consommation de produits vivriers.
Les menaces de faim sont aujourd'hui tout aussi réelles qu'elles l'étaient dans les économies antérieures : la production agricole par habitant est intérieure au niveau de 1940 (cf. R.Fabre, "Paysans sans terre"). Signe de l'anarchie totale du système capitaliste, la plupart des anciens pays agricoles producteurs du tiers-monde sont devenus depuis la seconde guerre mondiale importateurs : l'Iran, par exemple, importe 40% de ses produits alimentaires consommés. Contrairement aux encenseurs du capital qui parlent sans rire de "pays en voie de développement", la cause en est, non l'arriération du tiers-monde, mais l'existence du capitalisme qui a pénétré partout dans le monde.
3) Pénétration du capitalisme
Plus aucune région du monde, même en Afrique ou en Asie, ne vit en état d'autarcie et d'autosubsistance, à l'exception des tribus primitives d'Amazonie et d'Afrique Centrale qui font les délices des ethnologues. Par la violence, par l'emprise croissante de l'Etat, le capital a pénétré toutes les campagnes à l'aide de l'économie de traite, soumettant les paysans à l'échange et par l'imposition de l'impôt. Désormais, chaque paysan producteur, même le plus arriéré, vend une partie toujours croissante de sa production pour le marché.
Le capitalisme a imposé partout la culture de produits agricoles destinés non à la consommation locale mais à l'exportation sur le marché mondial. La polyculture traditionnelle répondant à l'autosubsistance a été démantelée au profit de la monoculture, que ce soit dans les grandes plantations ou les petites exploitations agricoles.
Cependant, si les produits agricoles circulent comme marchandises, le capitalisme n'a pas pu et ne peut socialiser l'agriculture, développer une fusion entre la ville et la campagne.
C'est pourquoi l'immense majorité de la population agricole cultive toujours dans des conditions moyenâgeuses :
- sans tracteurs, voire sans charrue et sans outils,
- sans engrais, ni pesticides, etc.,
- en sous-utilisant la terre cultivée au rythme des saisons,
- en sous-employant les bras disponibles,
- en étant soumise à un état de surmortalité ou d'épuisement physique faisant chuter les rendements agricoles.
Par ses lois juridiques et économiques, le capitalisme a achevé sa domination formelle des campagnes, mais il n'a pu les intégrer réellement dans l'économie capitaliste.
On pourrait cependant objecter à cela la réelle prolétarisation des paysans d'Europe et d'Amérique, surtout depuis la seconde guerre mondiale, avec la période de reconstruction. Il est vrai que la population agricole active ne représente plus aux USA en en Grande-Bretagne que 3% de la population active totale; en France, pays de petits paysans, que 10%; en RFA 7%; en RDA 10%; en Tchécoslovaquie 14%, etc.. Il est vrai aussi que la production agricole de ces pays s'est considérablement modernisée par l’utilisation de machines et d'engrais modernes. Mais on ne saurait en aucun cas tirer du cas européen une généralisation à l'ensemble du monde. Plus des 2/3 du paysannat mondial vit encore dans des conditions moyenâgeuses et n'a bénéficié aucunement de la "manne" de la reconstruction.
LA DANSE MACABRE DE LA SURPRODUCTION ET DE LA SOUS-PRODUCTION AGRICOLE
Cette domination mondiale du capitalisme s'est accompagnée d'une véritable régression des forces productives dans l'agriculture. Là où elles se sont développées, c'est uniquement dans les secteurs agroalimentaires destinés non au marché intérieur mais au marché mondial. C'est pourquoi la crise du capitalisme se traduit sur le plan de la production alimentaire par :
- l'impossibilité d'écouler les stocks agricoles sur le marché saturé en corrélation avec la chute de la production industrielle,
- l'impossibilité de développer la production agricole en raison du manque de capital dans les pays sous-développés et du surplus de capital dans les pays industrialisés.
Même si, par hypothèse, on
envisageait dans le tiers-monde un développement considérable de la production
agricole, celle-ci se heurterait aux lois du capitalisme. Elle entraînerait un effondrement des cours
mondiaux agricoles, du profit capitaliste, et en fin de compte, de la production
mondiale agroalimentaire.
D'un autre côté, la faible
productivité dans les campagnes arriérées où s'entassent des millions d'hommes
sous-employés, sans moyens techniques modernes, rend nécessairement non
rentable cette agriculture. Pour donner
un exemple : la culture de 1’hectare de riz demande plus de 100 jours de
travail en Asie, tandis que celle de 1’hectare de blé aux USA ne demande qu'un
jour de travail, et ce pour le même rendement (cf. J.Klatsmann, "Nourrir 10 milliards
d'hommes ?". Ed. PUF 1975).
Enfin, le capitalisme d'Etat,
en prélevant une partie croissante du produit agricole, diminue la part
revenant à la subsistance du paysan producteur.
D'où la situation absurde et générale de la quasi totalité des pays
agricoles du tiers-monde obligés d'importer de plus en plus des produits
alimentaires de base, pour limiter les famines.
Le résultat, l'endettement, ne fait que pousser encore plus à la
désagrégation de cette agriculture arriérée.
De par les lois capitalistes, il est plus avantageux à l'Etat
capitaliste d'acheter une tonne de blé produite à bas prix en Europe ou en
Australie, qu’au propriétaire foncier ou au petit paysan dont le rendement est
au moins 100 fois plus faible.
Tous ces facteurs montrent quelle est la voie du capitalisme mondial : dislocation de l'agriculture, chute de la production alimentaire, exacerbation des antagonismes sociaux à la campagne et à la ville, où s'entassent toujours plus les sans-travail chassés de la terre par la faim et la misère.
A cette misère sans nom, on a prétendu opposer le "bilan positif" des "réformes agraires" accomplies dans différents pays du tiers-monde.
LA MYSTIFICATION DES REFORMES AGRAIRES
Lorsque la révolution bourgeoise en France éclata, en 1789, elle expropria les seigneurs et démantela les biens communaux villageois, amenant le triomphe de la propriété privée. Elle libéra le paysan des corvées et redevances féodales, le transforma en "citoyen", c'est à dire en petit propriétaire capable de produire pour vendre "librement", d'échanger ses produits avec la ville, brisant juridiquement le cadre autarcique dans lequel croupissait la communauté villageoise. La bourgeoisie trouvait ainsi la possibilité d'acheter "librement" la terre, avec en prime, une base sociale solide pour sa révolution.
Cependant, la tendance naturelle du capitalisme ne pouvait être de développer la petite propriété et de parcellariser l'exploitation de la terre. Comme le montre l'exemple de l'Angleterre et des Etats-Unis où le capitalisme s'est développé de la façon la plus classique, le but du capitalisme est fondamentalement la concentration de la terre et des instruments de production agricoles, et non leur démembrement. Sa domination à la campagne passe par l'existence de grands domaines de cultures extensives d'abord, puis intensives par le développement du capital technique. Pour répondre aux besoins de l'industrie naissante, il doit non seulement exproprier le paysan et le soumettre au travail salarié, mais encore développer la productivité par la concentration des terres et des machines. Le but de toute agriculture capitaliste est en effet, de produire pour le marché mondial, et non pour le marché national trop étroit malgré des fortes concentrations de population.
Cela entraîne donc remembrement et non partage des terres, exode rural et non fixation d'une masse de producteurs agricoles excédentaires. Tournée directement vers le marché, l'agriculture capitaliste connaît inévitablement les crises de surproduction déterminées par le degré de solvabilité de l'ensemble du marché mondial. La crise avec la diminution de la demande solvable n'a fait qu'exacerber cette tendance. Aujourd'hui, les grands pays capitalistes agricoles doivent pousser leurs exploitants à diminuer leur production et les surfaces cultivées pour ne pas occasionner une chute catastrophique des cours des grands produits agricoles de base. A la surproduction succède la sous-production par rapport aux capacités réelles de production de la grande agriculture mécanisée capable de nourrir, selon les spécialistes bourgeois eux-mêmes, à elle seule l'ensemble de l'humanité. Et pourtant la moitié de l'humanité vit à la limite des famines, 100 millions de chinois sont menacés de mourir de faim. Dans les pays du tiers-monde, en dépit du fait qu'en 30 ans la population a fait plus que doubler, la production alimentaire par tête diminue régulièrement. Condamnation sans appel du capitalisme qui pousse l'humanité vers sa perte !
Face à une telle situation, déjà existante au 19éme siècle mais exacerbée par la décadence du capitalisme, idéologues bourgeois, agronomes, tiers-mondistes, gauchistes, n'ont pas manqué, pour préconiser, qui la "collectivisation", qui la "réforme agraire", qui la "révolution verte" ou "blanche" selon les goûts de chacun. Sur tous les tons, ils ont chanté les "communes populaires" chinoises, "l'agriculture collectivisée" à Cuba, "la révolution bourgeoise" en Algérie, où la terre des colons a été expropriée et partagée. Il n'est pas un pays du tiers-monde qui n'ait prétendu et prétende avoir réalisé sa "révolution" ou sa "réforme" agraire et n'ait trouvé toute une meute de supporters gauchistes et "progressistes" pour psalmodier alléluia ou hosanna.
LES CAUSES DES
"REFORMES AGRAIRES" DANS LE TIERS MONDE ET DANS LE BLOC RUSSE.
Comme nous l'avons vu, la clef des contradictions insolubles du capitalisme se trouve dans le marché mondial et la concurrence entre les multiples fractions du capital mondial pour le conquérir et se le partager.
Dans le Tiers-Monde, la colonisation par les grands pays industriels a eu un double but : en premier lieu, non seulement trouver des débouchés à leurs produits industriels, mais réaliser leurs surplus agricoles que leur marché intérieur était trop étroit pour absorber. En second lieu, par un contrôle militaire, politique et économique, empêcher que puisse se développer une économie nationale capable de concurrencer l'industrie et l'agriculture des métropoles. C'est pourquoi le capital des pays industrialisés a laissé l'économie agricole des pays colonisés en état de léthargie, à la seule exception des grandes plantations ou des grands domaines dont la production était orientée vers le marché mondial et la métropole et qui, pour des raisons climatiques fournissaient des denrées non cultivables en Europe. Le perfectionnement de la division internationale du travail délimitant pays industriels et pays agricoles a achevé de donner leur physionomie d'arriération aux pays colonisés : Ceylan pour le thé; la Malaisie pour l'hévéa; la Colombie pour le café; le Sénégal pour 1 'arachide, etc.
Cette division internationale s'est accompagnée nécessairement de la monoculture au détriment de la polyculture de subsistance. En détruisant peu à peu l'économie naturelle, elle a intégré progressivement une fraction croissante de petits paysans dans le marché, en les contraignant de cultiver les cultures obligatoires, voire en les soumettant à de véritables corvées sur les plantations ou les domaines coloniaux. En concentrant la terre, en se l'appropriant, en forçant le petit paysan à abandonner ses terres aux mains des usuriers et des grands propriétaires par l'impôt forcé ou par la force, la culture d'autosubsistance s'est rapidement effondrée occasionnant des famines qui, comme en Chine, en Inde, en Afrique, laissaient des millions de cadavres.
Les innombrables révoltes paysannes qui ont éclaté de l'Inde (Cipayes et tenanciers) à la Chine (Taïping) jusqu'au Mexique avec Zapata ont montré la situation explosive que créait le capitalisme mondial dans 1es zones arriérées précapitalistes .
Elles ont montré autant la vanité pour les paysans de compter sur une bourgeoisie nationale "progressiste et antiféodale" toujours alliée aux grands propriétaires fonciers, que l'impossibilité d'améliorer leur sort dans le cadre d'un capitalisme fut-il en apparence le plus "libéral" et "démocratique". C'est ce que montrent les révoltes paysannes du Mexique au début de ce siècle où le paysannat fut le jouet des différentes fractions bourgeoises pro-anglaises ou pro-américaines.
Face à cette révolte permanente menaçant d'ébranler la cohésion de la société (mais dans un sens révolutionnaire en l'absence d'une révolution prolétarienne), la bourgeoisie comprit qu'à défaut de supprimer les causes de la révolte, elle pouvait du moins en atténuer les effets, par des concessions. Au risque de diminuer la productivité agricole, elle officialisa le partage des terres au Mexique, espérant s'attacher les paysans pauvres et sans terre qui se retrouvaient avec un lot de terre ou élargissaient leur champ.
Mais c'est surtout après la deuxième guerre mondiale que la question va se poser dans les ex-colonies proclamées "indépendantes", ou les semi-colonies. Les tensions interimpérialistes, l'avancée du bloc russe par le biais des "luttes de libération nationale" vont contraindre le bloc américain à prendre une attitude "réaliste", particulièrement en Amérique Latine, où sa politique au Guatemala et surtout à Cuba s'était révélée désastreuse. Tout le programme de Kennedy élaboré en 1961 à Punta del Este et pompeusement nommé "Alliance pour le progrès" ne visait qu'à contraindre les bourgeoisies locales à adopter des mesures de "réformes agraires", pour éviter de nouveaux Cuba. De 1964 à 1969 au Pérou, on redistribua 600 000 ha; au Chili de 1964 à 1967, 1 050 000 ha furent expropriés pour être redistribués; 8 000 000 ha entre 67 et 72[4] [133]. Dans d'autres pays, des mesures similaires furent prises.
Au Maghreb, l'appropriation
par l'Etat des terres des colons permit de lotir des paysans sans terre ou
microfundiaire qui furent organisés de force en coopératives
"autogérées". On pourrait
multiplier les exemples dans l'ensemble du Tiers-Monde.
Dans le bloc russe, pour des raisons politiques aussi, l'URSS poussa au lendemain de la guerre au démembrement des grands domaines et redistribua les terres appartenant aux nationaux allemands et aux grands propriétaires fonciers.
Toutes ces mesures visaient à limiter les tensions agraires et à s'attacher une fraction de la paysannerie pauvre, et surtout moyenne, quitte à sacrifier, dans les cas extrêmes, la bourgeoisie rurale. Cependant, a surtout prévalu la nécessité économique pour le capital national de freiner la chute vertigineuse de la production agricole sur une immense majorité de petites exploitations ou tenures microscopiques, coexistant avec d'immenses latifundias dont une infime partie est cultivée. Autant dire que dans ces conditions la productivité agricole, et la capacité de concurrence sont quasi nulles. Si l'on ajoute que mondialement la population est passée de 3 milliards d'hommes en 1965 à 4,2 en 1980, on aura une idée de l'entassement ou plutôt du pourrissement sur place de myriades de paysans pauvres sur quelques hectares et même ares, à côté de latifundias de 100 000 ha à peine défrichées. Dans cette situation, les petites parcelles concédées pour l'exploitation sont plus productives en fournissant parfois l'essentiel d'une production agricole nationale; même sans engrais et machines, elles sont plus intensément cultivées avec une main d’œuvre pléthorique. Les différents pays capitalistes arriérés qui ont partagé une partie des grands domaines et créé des "'coopératives" de paysans rêvaient ainsi d'augmenter la production agricole autant pour des raisons sociales qu’économiques. Chaque pays du tiers monde peu industrialisé tentait de dégager des surplus agricoles pour l'exportation sur le marché mondial. Et l'imposition de cultures forcées, l'impôt, en échange de ce "cadeau" de la terre, soumettait plus que jamais le petit paysan, fermier ou propriétaire, aux lois du marché et à ses fluctuations.
Une autre méthode a consisté à racheter les terres expropriées aux latifundiaires, pour les capitaliser.; celles-ci se trouvaient ainsi dorénavant cultivées de façon capitaliste par l'Etat ou le capital industriel, et transformaient en prolétaires des paysans. Une grande majorité d'entre eux n’eurent plus que le choix de fuir vers la ville, s'entassant dans de monstrueuses métropoles-bidonvilles regroupant, comme au Mexique, jusqu'au tiers de la population du pays.
LES RESULTATS
Du point de vue capitaliste, le seul résultat "positif" a été de développer dans certains pays, en Inde particulièrement, une couche de "koulaks", paysans moyens qui se sont enrichis et forment à la campagne un tampon social entre grands propriétaires et paysans parcellaires. Attachés par ce biais à la bourgeoisie, ils ne forment cependant qu'une couche très mince compte tenu de l'arriération et du pourrissement de l'économie.
Dans la réalité, les "riches" se sont enrichis, et les "pauvres" appauvris; les contrastes entre les classes se sont accrus. Le partage successoral des parcelles s'est perpétué, en dépit des quelques hectares concédés; la productivité a continué de s 'effondrer.
Sa chute s'est même accélérée dans les grandes propriétés ex-coloniales partagées, faute de machines et d'engrais: les campagnes algériennes ont aujourd'hui 40% de chômeurs. Là où la terre a été capitalisée et cultivée mécaniquement, la masse des sans-travail s'est gonflée démesurément.
Là où la propriété privée a été transmise aux mains de l'Etat, comme dans le bloc russe, si le chômage a officiellement disparu dans les campagnes, la productivité s'est effondrée : un cultivateur américain de blé produit 13 fois plus qu'un cultivateur russe.
Sachant que, du point de vue économique, la bourgeoisie ne pourrait pas grand chose, elle a prétendu par la bouche de ses agronomes que la "révolution verte" allait au moins, à défaut d'augmenter la productivité, assurer l'alimentation de l'humanité par des plantes à plus fort rendement et plus nutritives. On fit ainsi grand battage dans les années 60-70 sur les blés et maïs hybrides. Les famines en Afrique et Asie montrent éloquemment le résultat ... Seule la bourgeoisie rurale du tiers monde, disposant de capital, de machines, et d'engrais a pu en profiter et y a trouvé là son compte ; autant dire une minorité infinitésimale.
- Ainsi , la décadence du capitalisme a rendu encore plus lourde et difficile la question paysanne. Le legs terrible du capitalisme au prolétariat, c'est la destruction des forces productives à la campagne ou leur complète inutilisation; la misère pour des milliards d'hommes.
- Il serait faux de considérer seulement les effets négatifs de cette misère. Celle-ci est lourde de potentialités révolutionnaires dans les campagnes
- - Le prolétariat saura les utiliser, s’il est capable d’agir de façon autonome, avec la plus grande décision, sans abandonner son programme.
Ce ne sont pas les
révolutions bourgeoises qui sont à l’ordre du jour. Dans les villes, comme dans
les campagnes, le seul espoir des milliards d’être paupérisés, misérables,
réside dans le triomphe mondial de la révolution prolétarienne.
Chardin
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 25 - 2e trimestre 1981
- 2695 reads
El Salvador, Espagne, Pologne : Face a la menace proletarienne , la bourgeoisie se prepare
- 2821 reads
Espagne, Pologne, El Salvador, c'est en des lieux bien éloignés et différents que se sont manifestés dernièrement les soubresauts d'une société en crise mortelle. mais, si ces pays appartiennent à des mondes très dissemblables, l'occident développé pour le premier, le bloc de l'Est pour le second, le tiers monde pour le troisième, si les circonstances immédiates des évènements qui les ont placés au devant de l'actualité n'ont rien à voir les unes avec les autres, il n'en demeure pas moins que c'est une même logique qui traverse ces évènements et qui exprime l'unité fondamentale de destinée de la société humaine aujourd'hui.
LA CRISE ÉCONOMIQUE DU CAPITALISME MONDIAL
Au Salvador, c'est la poursuite de la plongée dans l'abîme avec des massacres quotidiens, une illustrations tragique de ce que les révolutionnaires n'ont cessé de répéter depuis plus d'un demi siècle : le caractère parfaitement réactionnaire du mode de production capitaliste, son incapacité absolue d'assurer un quelconque développement significatif des forces productives dans les zones qui n'avaient pas encore bénéficié d'un tel développement à l'aube de ce 20ème siècle. Au Salvador, c'est une image insoutenable de la réalité du monde d'aujourd'hui avec son cortège de famines et de massacres, de terreur et de déchéance de l'être humain, qui sont le lot quotidien de la plus grande partie des membres de la société et qui attend les autres demain avec l'aggravation de la crise et des convulsions qui l'accompagnent.
En Pologne, c'est la fin du mythe du soi-disant "socialisme" de l'Europe de l’Est qui aurait mis fin aux crises du capitalisme, à exploitation de l'homme par l'homme et à l'antagonisme entre classes. La crise violente qui frappe aujourd'hui la Pologne et les pays "frères" fait la démonstration éclatante de l'absurdité de l'idée de l'existence dans ces pays de quelconques "acquis" économiques. Ces fameux "acquis ouvriers", tant vantés par les trotskystes, que sont la planification et le monopole étatique du commerce extérieur se sont révélés totalement inefficaces pour endiguer la crise du capitalisme, pour s’opposer à l'anarchie croissante de la production, à la pénurie des biens les plus nécessaires et, par rapport à l'extérieur, à un endettement astronomique.
Ainsi s'illustre une fois de plus la nature parfaitement capitaliste des pays soi-disant "socialistes", de même que l'incapacité totale de toutes les mesures d'étatisation de l'économie à faire face aux affres de la crise mondiale.
En Espagne, c'est un autre mythe qui s'est effondré ces dernières années, celui de "Japon européen". La crise s'est chargé de liquider de façon spectaculaire l'expansion économique de la copie européenne du "modèle japonais" célébré par les technocrates des années 60. Exploitant les derniers fastes de la reconstruction de l'après 2ème guerre mondiale pour tenter de s'arracher à marche forcée de son arriération, l'économie espagnole paye aujourd'hui à la crise le prix fort pour ses exploits passés : après le record d'Europe du taux d'expansion, c'est maintenant le record du taux de chômage (officiellement 12,6% de la population active).
Qu'elle se manifeste par une nouvelle aggravation de la famine dans les pays du tiers-monde, par une montée du chômage sans précédent en occident, par la pénurie généralisée dans les pays de l'Est, la crise révèle que le monde est un, que toute la société humaine est embarquée dans la même galère.
Cette unité du monde ne s'exprime pas seulement dans l'universalité des manifestations de la crise économique. Elle s'exprime également dans le type de réponses que donne la classe dominante sur tous les continents face à la menace de révolte des exploités contre l'aggravation insupportable de leurs conditions de vie.
LA RÉPONSE DE LA BOURGEOISIE DE TOUS LES PAYS A LA CRISE ÉCONOMIQUE FACE A LA MENACE DE LA LUTTE DE CLASSE
Cette réponse s'articule autour de différents axes complémentaires :
- La mise en place de gouvernements"forts", ouvertement répressifs, utilisant abondamment l'intimidation à l'égard de la classe ouvrière, gouvernements qui sont pris en charge par les secteurs de droite de l'appareil politique bourgeois.
- Le rôle assuré par les secteurs de gauche de cet appareil dans l'opposition (et non plus au gouvernement comme il y a quelques années), pour saboter de l'intérieur les luttes prolétariennes, pour immobiliser la classe ouvrière face aux coups portés par le capital.
- La prise en charge par les grandes puissances de la conduite du maintien de l'ordre social au sein de leur bloc et leur collaboration étroite, par dessus leurs antagonismes, pour museler la classe ouvrière.
Ce sont des illustrations de cette politique qui sont en bonne partie à la base des évènements au Salvador depuis de nombreux mois, en Espagne avec le "coup d'Etat" de février 1981, et en Pologne avec les grèves ouvrières de 1980-81.
Au Salvador, on voit se réaliser concrètement la "doctrine Reagan" de soutien à des gouvernements musclés et de "lutte contre la subversion". L'heure n'est plus à de nouveaux Nicaragua où, par social-démocratie internationale interposée, les USA avaient laissé accéder au pouvoir les partis de gauche. Aujourd'hui, les USA ne parlent plus des "droits de l'homme" mais prêchent la croisade"contre le terrorisme international fomenté par l'URSS". En réalité, ce n'est pas tellement l'URSS que vise cette politique car cette puissance a des moyens limités en Amérique Latine même si elle ne répugne pas à favoriser l'instabilité dans les chasses gardées de l'adversaire américain. La véritable "subversion", le réel "terrorisme", ce sont ceux que représente la lutte de classe sur le continent américain.
Reagan est très clair pour annoncer que son aide à la Junte qui gouverne de façon sanglante le Salvador dépasse en portée le cadre de ce pays et le type d'affrontements qui s'y déroulent. La guérilla populiste qui agit dans ce pays n'est pas plus dangereuse pour l'impérialisme américain que celles qui ont existé par le passé dans d'autres pays d'Amérique Latine. Cuba est resté une exception et l'appartenance de ce pays au bloc russe ne menace pas les USA. Par contre, ce qui inspire une crainte certaine à la bourgeoisie américaine, c'est le développement de luttes de classe comme celles des années passées au Brésil par exemple, et qui ne sont pas une spécialité réservée à des pays"exotiques" mais une "déstabilisation" qui risque d'atteindre les métropoles impérialistes elles-mêmes.
En apportant un soutien actif aux massacres au Salvador, c'est un avertissement limpide que Reagan adresse aux ouvriers des deux Amériques : "Pas de 'terrorisme' - entendez pas de luttes contre l'aggravation des conditions d'existence - sinon je n'hésiterai pas à faire donner la répression". Et pour être sûr que ce message sera bien compris, qu'il ne sera pas interprété comme un "coup de gueule" sans lendemain d'un ancien cowboy, Reagan a pris le soin de s'assurer le soutien de Trudeau, premier Ministre du Canada (au départ réticent) en même temps qu'il appelle les gouvernements européens à suivre l'exemple de son acolyte canadien. C'est à l'échelle de tout le bloc américain que la bourgeoisie se donne comme tâche de maintenir l'ordre social.
C'est également à l'échelle de tout le bloc que la gauche ("Internationale Socialiste", Willy Brandt en tête) "proteste" contre cette politique de Reagan et qu'elle apporte son soutien à l'opposition "démocratique" du Salvador. Pour elle, toutes les occasions sont bonnes (surtout maintenant que ses déclarations sont destinées à rester platoniques) pour tenter de détourner le mécontentement ouvrier vers les impasses de la "défense de la démocratie" et autres thèmes bourgeois. C'est là une des façons par lesquelles la gauche bourgeoise s'attache dans "l'opposition" à saboter les luttes du prolétariat.
En Espagne, c'est également la "défense de la démocratie" qui est aujourd'hui à la mode suite au putsch manqué du 23 février 1981. Cependant, ce n'est pas de façon identique que cette mystification est mise en oeuvre : ici, c'est le pouvoir central qui se présente comme le meilleur garant de la "démocratie menacée". Cela ne veut pas dire que la logique globale à laquelle obéissent les évènements en Espagne est différente de la logique des évènements au Salvador quant à la réponse de la bourgeoisie. Bien au contraire. En réalité, la tentative de putsch du 23 février a eu pour la bourgeoisie les "mérites" suivants :
- renforcement du pouvoir central, notamment en la personne du roi (comme ce fut le cas quelques mois auparavant en Italie avec la mise en avant du président de la République Pertini) ;
- renforcement de l'orientation a droite du gouvernement espagnol : le Putsch"manqué"a apporté à Calvo Sotelo les voix toutes cuites de la droite ("Alliance Populaire") qui lui faisaient défaut, d'autre part la tentative de certains secteurs du centre et du Parti Socialiste de constituer une alliance de centre-gauche est mise en sourdine, au nom du veto de l'armée ;
- renforcement du chantage au coup d'Etat militaire auprès de la classe ouvrière : il s'agit s'insuffler une nouvelle vie au croquemitaine franquiste qu'on dit se profiler derrière chaque caserne, afin de dissuader les ouvriers de renouer avec leurs luttes de 1976 face à une misère de plus en plus intolérable.
Il est clair que ce n'est pas avec cette perspective que se sont lancés dans l'aventure les putschistes Tejero, Milans del Bosch et Armada : c'est bien à la prise du pouvoir qu'ils aspiraient. Mais les avantages que tire la bourgeoisie de leur tentative et de son échec (nous ne sommes pas en 1936: l'heure n'est pas en Europe occidentale aux dictatures militaires) incite à croire que ces officiers se sont laissés manipuler par les secteurs les plus lucides de la classe dominante. S'agit-il là d'une vision par trop "machiavélique" ? Il est évidemment difficile de faire la part entre ce qui a été minutieusement préparé par la bourgeoisie et ce qui revient à sa capacité d'adaptation et d'improvisation. Il serait cependant dangereux pour la classe ouvrière et pour les révolutionnaires de sous-estimer la force et l'intelligence de l'ennemi de classe. Souvenons-nous seulement que, depuis 7 mois, c'est la cinquième fois qu'on nous sort un scénario qui, à chaque fois, a le"miraculeux"effet de créer un grand sursaut de "solidarité nationale" face à un "ennemi fasciste" assez fantomatique : Bologne en août 80, Munich en septembre 80, attentat de la rue Copernic à Paris en octobre 80, attentat à Anvers en Belgique en novembre 80, putsch à Madrid en Espagne en février 81. S'agit-il de hasards ?
En Poloqne, c'est également la menace des chars qu'on agite pour inciter les ouvriers à être raisonnables même si, dans ce cas, ce n'est pas tant ceux de l'armée nationale que ceux du "grand frère". Mais le mécanisme idéologique est du même type : dans les deux cas, le gouvernement en place justifie sa politique dure,-ce refus des concessions et les appels au calme non pas tant en menaçant de réprimer directement lui-même mais par son prétendu souci d'épargner à la population et à la classe ouvrière le déchaînement d'une répression féroce qui se ferait contre sa volonté. Réprimer pour éviter une répression plus grande: la ficelle est ancienne et serait peu crédible si justement la gauche ne venait prêter main forte au chantage de la droite :
- en Espagne, en s'associant à tous les autres partis bourgeois pour agiter la menace d'un "retour du fascisme" et organiser de grandes manifestations de soutien à la démocratie et au roi ;
- - en Pologne en protestant bien fort contre le refus du gouvernement de tenir ses promesses, contre le développement de la répression, mais en appelant en même temps les ouvriers à la"modération"'afin de ne pas "mettre en danger la Pologne", ce qui signifie en fait l'acceptation passive de l'offensive bourgeoise contre la classe ouvrière.
Ainsi, s'est mise en place en Pologne une orientation de la vie politique qui a déjà fait ses armes ces dernières années dans les pays industrialisés d'occident : le partage des tâches entre d'une part une droite au pouvoir qui n'aspire nullement à une quelconque popularité auprès des ouvriers mais est chargée de mettre en oeuvre avec cynisme un renforcement de l'exploitation et de la répression, et d'autre part une gauche dans l'opposition chargée, grâce à la confiance qu'elle peut conserver parmi les travailleurs de par son langage radical, vise à casser toute tentative de s'opposer à l'offensive de la droite.
Par une ironie de l'histoire, c'est un parti soi-disant "communiste" qui joue en Pologne le rôle de la"droite" (mais dans le domaine de l'impopularité et du cynisme, les équipes dirigeantes dans l'Europe de l'Est battent tous les records mondiaux),alors que c'est un intime d'un cardinal, Primat d'une des Eglises les plus réactionnaires du monde qui prend celui de porte-parole de la"gauche".
Mais, au delà de ces particularités, les mécanismes politiques sont les mêmes et la nomination en février de Jaruzelski au poste de Premier Ministre qui constitue la première initiative cohérente de la bourgeoisie polonaise depuis août 80, exprime la prise en charge consciente par l'équipe dirigeante de ces nécessités. En effet, pour la bourgeoisie polonaise, il s'agit de "rétablir l'ordre" (en tant que militaire, le nouveau premier Ministre est un homme à poigne) : c'en est assez d'une situation où le pouvoir est à chaque fois obligé de reculer devant les exigences ouvrières, ce qui ne peut qu'inciter à des nouvelles exigences.
Mais ce rétablissement de l'ordre ne pourra s’appuyer, comme par le passé, sur la seule répression, il devra compter sur la collaboration du syndicat "Solidarité" (Jaruzelski s'est fait la réputation d'être favorable à la négociation) : il s'agit pour le moment de neutraliser les éléments de l'appareil politique qui n'avaient pu "se faire" à l'existence d’une force d'opposition dans le pays.
Mais la situation en Pologne n'illustre pas seulement la tactique adoptée par la bourgeoisie au niveau interne. Elle fait une nouvelle démonstration que c'est à l'échelle internationale que la bourgeoisie fourbit ses armes contre la lutte ouvrière.
C'est en premier lieu au niveau du bloc russe tout entier qu'est prise en charge la situation en Pologne : par la menace d'une intervention des forces du Pacte de Varsovie (et éventuellement par sa réalité si les autorités polonaises perdent le contrôle de la situation) et aussi par l'élaboration depuis Moscou de la politique à suivre localement. En effet, celle-ci ne doit pas seulement tenir compte des intérêts particuliers du capital national. Elle doit être conforme à ceux de tout le bloc : même si les autorités polonaises étaient trop enclines à lâcher du lest, Moscou se chargerait de leur rappeler que trop de "laxisme" en Pologne risque de donner du crédit à l'idée que "la lutte paye" parmi les ouvriers des autres pays du bloc.
Mais cette prise en charge
de la situation en Pologne dépasse le cadre du bloc russe ; elle concerne toute
la bourgeoisie mondiale et notamment celle des grandes puissances occidentales
qui, par leur aide économique, ont tenté de calmer le mécontentement ouvrier
permettant la distribution de quelques miettes et qui, à leur façon, ont
collaboré en compagnie de "Solidarité", au chantage à l'intervention
russe. En effet, toute la campagne
occidentale sur la menace d'une telle intervention, entre autres, avait pour
but par Radio Europe Libre et BBC interposées, de persuader les ouvriers
d'Europe de l'Est peu enclins à croire la propagande de l'Agence Tass, que
cette menace est bien réelle.
Ainsi, c'est de façon mondiale que la bourgeoisie fourbit son offensive. Cette classe a tiré les leçons du passé. Elle sait que, face au danger prolétarien, elle doit faire preuve d'unité et de coordination de son action, même si celle-ci passe par un partage des tâches entre différentes fractions de son appareil politique. Pour la classe ouvrière, la seule issue réside dans le refus de se laisser piéger par les chausse-trappes que lui tend la classe dominante, et d'opposer sa propre offensive de classe à l'offensive bourgeoise :
- face au partage des tâches entre droite et gauche, rejet en bloc de ces deux forces du capital ;
- face à l'intimidation et au chantage à la répression, lutte résolue la plus large possible : seule la menace d'une riposte massive du prolétariat peut arrêter la main criminelle de la bourgeoisie
- face au sabotage des luttes par les partis de gauche et les syndicats, auto-organisation de la classe et extension de ses luttes ;
- face à la prise en charge à l'échelle internationale de l'offensive anti-ouvrière de la bourgeoisie, extension des luttes à l'échelle internationale, seule capable d'éviter un écrasement par paquets du prolétariat mondial.
Plus que jamais est à l'ordre du jour le vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les pays unissez-vous ! "
Mars 81 F. M.
Géographique:
- Espagne [107]
- Amérique Centrale et du Sud [138]
- Pologne [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
L'aristocratie ouvrière : une théorie sociologique pour diviser la classe ouvrière
- 7294 reads
Il y aurait un antagonisme de classe au sein de la classe ouvrière elle-même, un antagonisme entre les couches "les plus exploitées" et les couches "privilégiées". Il y aurait une "aristocratie ouvrière jouissant des plus hauts salaires, des meilleures conditions de travail, une fraction ouvrière qui partagerait avec "son impérialisme" les miettes des sur profits tirés de l'exploitation coloniale. Il y aurait donc une frange de la classe ouvrière qui en fait n'appartiendrait pas à la classe ouvrière, mais à la bourgeoisie, une couche d"'ouvriers-bourgeois".
Voila les grandes lignes communes à toutes les théorisations sur l'existence d'une "aristocratie ouvrière". C'est un instrument théorique dont la principale utilité est de permettre d'estomper dans un flou plus ou moins étendu, suivant les besoins, les frontières qui opposent la classe ouvrière au capital mondial.
Cette théorisation "permet" de taxer des parties entières de la classe ouvrière (les ouvriers des pays les plus industrialisés par exemple) de "bourgeois", et de qualifier des organes bourgeois (les partis de "gauche", les syndicats, par exemple) d"'ouvriers".
Cette théorie trouve son origine dans les formulations de Lénine pendant la 1ère Guerre Mondiale, formulations reprises par la 3ème Internationale. Certains courants politiques prolétariens, ceux qui tiennent à se désigner par l'étrange qualificatif de "léninistes", traînent encore aujourd'hui avec eux cet avatar théorique dont ils ne savent pas toujours que faire, si ce n'est de maintenir un flou sur des questions de première importance dans la lutte de classe. La contre-révolution stalinienne, elle, s'est depuis des décennies servi de cette théorie à tout propos pour tenter de recouvrir ses politiques du prestige de Lénine.
Mais cette théorie est aussi reprise avec plus ou moins d'aménagements et de variantes par des groupes en provenance du stalinisme -via le maoïsme- et qui ont rompu avec beaucoup des principaux mensonges du stalinisme officiel (en particulier le mythe des Etats socialistes, que ce soit la Russie, la Chine ou autre).
Ces groupes, tels "Operai e teoria" en Italie, "Le Bolchevik" en France, le "Marxist Workers' Committee "aux USA, affichent une intervention très radicale contre les syndicats et les partis de gauche. Ils parviennent ainsi, dans certains cas, à faire illusion parmi des travailleurs combatifs. Mais cette critique repose pour ces courants ex-"tiers-mondistes" sur une exaltation de la DIVISION de la classe ouvrière entre les "couches les plus basses" - le vrai prolétariat d'après eux - et "l'aristocratie ouvrière".
Voila comment Operai e Teoria formule cette théorisation de la division de la classe ouvrière :
"Ne pas reconnaître l'existence de différenciation interne parmi les ouvriers productifs, l'importance de la lutte contre l'aristocratie ouvrière, la nécessité pour les révolutionnaires de travailler en vue de la réalisation d'une scission, d'une rupture nette entre les intérêts des couches basses et ceux de l'aristocratie ouvrière, cela signifie, non seulement ne pas avoir compris un événement de l'histoire du mouvement ouvrier, mais -et ceci est plus grave- laisser le prolétariat à la traîne de la bourgeoisie".
(Operai et Teoria n°7, oct-nov 80, c'est nous qui soulignons) ([1] [139])
Dans cet article, nous ne nous attacherons pas tant à suivre les groupes "léninistes" dans leurs contradictions théoriques, qu'à démontrer l'inconsistance théorique et la nocivité politique de la théorie de l'aristocratie ouvrière, telles que la propagent des groupes ex-maoïstes semant la plus néfaste confusion parmi les travailleurs qui croient y reconnaître une explication de la nature contre-révolutionnaire des 'syndicats et des partis de gauche.
Pour cela, nous mettrons en évidence :
1°) que cette théorie repose sur une analyse sociologique qui ignore le caractère de CLASSE HISTORIQUE du prolétariat ;
2°) que la définition, ou plutôt LES définitions de "l 'aristocratie ouvrière" sont d'autant plus floues et contradictoires que le capitalisme a multiplié les divisions au sein de la classe ouvrière;
3°) que le RESULTAT PRATIQUE de ce genre de conceptions n'est autre que celui DE DIVISER LES TRAVAILLEURS pour la lutte, d'isoler les travailleurs des "couches les plus exploitées" du reste de leur classe;
4°) qu'elles entretiennent des confusions sur une soi-disant nature "ouvrière-bourgeoise" des syndicats et des partis "de gauche" (ambiguïté qui existait déjà au sein de l'Internationale Communiste);
5°) que c'est à tort qu'elle prétend se réclamer de "Marx, Engels, Lénine" dont les formulations plus ou moins précises sur l'existence d'une "aristocratie ouvrière" ou sur "l'embourgeoisement de la classe ouvrière anglaise au XIXème siècle" n'ont jamais soutenu une théorie de la nécessité de DIVISER LES OUVRIERS, au contraire.
U n e t h e o r i e s o c i o l o g i q u e
On peut voir la classe ouvrière de deux façons : on peut la voir seulement telle QU’ELLE EST la plupart du temps, c'est à dire : soumise, divisée et même atomisée en des millions d'individus solitaires, sans rapports entre eux.
On peut la voir aussi en tenant compte SIMULTANEMENT de ce qu'elle est HISTORIQUEMENT, c'est à dire en prenant en considération le fait qu'il s'agit d'une classe sociale qui a un passé de plus de 2 siècles de luttes et qui a comme avenir d'être le protagoniste du plus grand bouleversement de l'histoire de l'humanité.
La première vision, IMMEDIATISTE est celle de la classe défaite, alors que la seconde est celle de la classe en lutte. La première est celle que mettent en avant les "sociologues" de la bourgeoisie, pour dire "c'est ÇA la classe ouvrière", la seconde est celle du marxisme qui comprend ce qu'est la classe ouvrière non seulement à partir de ce qu'elle est MAINTENANT, mais aussi et surtout de CE QU'ELLE EST APPELEE A DEVENIR. Le marxisme n'est pas une étude sociologique du prolétariat vaincu. Il est l'effort de comprendre comment lutte le prolétariat, et c'est toute autre chose.
La théorie selon laquelle il y aurait des ANTAGONISMES FONDAMENTAUX AU SEIN DE LA CLASSE OUVRIERE est une conception qui repose sur la seule prise en compte de la réalité immédiate de la classe ouvrière vaincue, atomisée. Quiconque connaît l'histoire des révolutions ouvrières sait que le prolétariat n'est parvenu à ses moments les plus élevés de combat que par une généralisation maximum de son unité.
Dire que l'unité de la classe ouvrière, de ses éléments les plus exploités à ses éléments les moins exploités, est impossible, c'est ignorer toute l'histoire du mouvement ouvrier. L'histoire de toutes les grandes étapes de la lutte ouvrière est traversée par le problème de parvenir à l'union la plus large possible des prolétaires.
Il y a un sens précis dans le mouvement qui va des premières corporations d'ouvriers artisans, aux soviets, en passant par les syndicats de métier. Ce sens est celui de la recherche de la plus grande unité. Les CONSEILS, créés pour la première fois spontanément par les ouvriers en Russie en 1905 constituent le système d'organisation le plus unitaire qui puisse être conçu pour permettre la participation du plus grand nombre d'ouvriers, puisqu'il repose sur les assemblées générales.
Cette évolution ne reflète pas seulement un développement de la conscience de la classe et de son unité et de la nécessité de celle-ci. L'évolution de cette conscience trouve elle-même son explication dans l'évolution des conditions matérielles dans lesquelles travaillent et luttent les prolétaires.
Le développement du machinisme détruit les spécialisations héritées de l'artisanat féodal et antique. IL UNIFORMISE le prolétaire pour en faire une marchandise qui peut produire aussi bien des chaussettes que des canons, sans pour autant être ni tisserand, ni forgeron.
En outre, le développement du capital entraîne le développement de gigantesques centres urbains industriels où les prolétaires sont entassés par millions. Dans ces centres, la lutte prend un caractère explosif par la rapidité même avec laquelle ces millions d'hommes peuvent s'organiser et se coordonner pour agir unis.
"Le développement de l'industrie n'a pas pour seul effet d’accroître le prolétariat, mais aussi de l'agglomérer en masses de plus en plus compactes. Le prolétariat sent sa force grandir. Les intérêts, les situations se nivellent de plus en plus au sein du prolétariat, à mesure que le machinisme efface les différences du travail et ramène presque partout le salaire à un niveau également bas ."
(Marx Engels. Le Manifeste Communiste.: Bourgeois et prolétaires.
Dans les récentes luttes en Pologne où les ouvriers ont déployé des capacités d'unification et d'organisation qui n'ont pas fini d'étonner le monde, ce n'est pas à un affrontement entre ouvriers qualifiés et non qualifiés qu'on a assisté mais à leur unification dans les assemblées pour la lutte et dans la lutte.
Mais, il faut pour comprendre de tels miracles ne pas avoir les yeux fixés, tels les sociologues, sur la réalité IMMEDIATE de la classe ouvrière LORSQU'ELLE NE LUTTE PAS. Lorsque le prolétariat ne lutte pas, lorsque la bourgeoisie parvient à subvenir au minimum social nécessaire pour la subsistance des ouvriers, ceux-ci se retrouvent effectivement totalement divisés.
Dès sa naissance, le prolétariat, cette classe qui subit la dernière mais aussi la plus absolue exploitation sociale qu'une classe exploitée ait connue dans l'histoire, vit de façon totalement différente lorsqu'il est soumis et passif face à la bourgeoisie, ou lorsqu'il relève la tête face à son oppresseur.
Cette séparation entre ces deux formes d'existence (uni et en lutte, divisé et passif) n'a cessé de se creuser avec l'évolution même du capitalisme. A l'exception des années de la fin du XIXème siècle où le prolétariat parvient à imposer momentanément à la bourgeoisie l'existence de véritables syndicats et partis de masse ouvriers, les ouvriers tendent à être de plus en plus unitaires lorsque le combat les rassemble, mais aussi à être de plus en plus divisés et atomisés dans les périodes de "calme social"
La même évolution des conditions de vie et de travail qui conduit la classe ouvrière à LUTTER de façon DE PLUS EN PLUS UNIE, cette même évolution matérielle conduit, en dehors des périodes de lutte, à la concurrence, à la division et même à l'atomisation, en individus solitaires que nous connaissons aujourd'hui.
La concurrence entre ouvriers en dehors des périodes de lutte est une caractéristique du prolétariat depuis sa naissance. Mais elle était MOINS forte aux premiers temps du capital, lorsque les ouvriers "avaient un métier", lorsque l'éducation n'était pas généralisée et que le savoir de chaque prolétaire était un précieux outil de travail. "Le tisserand n'était pas un concurrent pour le forgeron". Mais au fur et à mesure que "n'importe qui peut produire n'importe quoi", grâce aux progrès de la machine et de l'éducation, cela se traduit dans le capitalisme par : "n'importe qui peut prendre le travail de n'importe qui."
Face au problème de trouver du travai1, 1 'ouvrier dans le capitalisme industriel sait que cela dépend du nombre de postulants au même emploi. LE DEVELOPPEMENT DU MACHINISME TEND AINSI A OPPOSER LES OUVRIERS INDIVIDUELLEMENT DE PLUS EN PLUS LORSQU'ILS NE SONT PAS EN LUTTE. Marx décrivait ainsi ce processus : "L'accroissement du capital productif implique l'accumulation et la concentration des capitaux. La concentration des capitaux amène une plus grande division du travail et une plus grande application des machines. La plus grande division du travail détruit la spécialité du travail, détruit la spécialité du travailleur, et en mettant à la place de cette spécialité un travail que tout le monde peut faire, elle augmente la concurrence entre les ouvriers." ("Discours sur le libre échange", p.8 -publié en général avec "Misère de la philosophie".)
Le développement du machinisme crée donc les conditions matérielles pour l'existence d'une humanité unie et consciente, mais en même temps, dans le cadre des lois capitalistes où la survie du travailleur dépend du fait qu'il puisse vendre sa force de travail, ce qu'il engendre c'est une concurrence plus grande que jamais.
Prétendre fonder une théorie de ce que sera le prolétariat en lutte, en ignorant l'expérience historique des luttes passées au profit de l'étude IMMEDIATISTE du prolétariat défait, divisé, conduit inévitablement à concevoir le prolétariat comme un corps qui ne parviendra jamais à s'unifier. Et, plus on fait appel à une vision A-HISTORIQUE, IMMEDIATISTE, -sous couvert de "il faut être concret", "il faut faire quelque chose qui ait des résultats immédiats"- et plus on tourne le dos à une véritable compréhension de ce qu'est réellement le prolétariat.
Une conception qui nie la possibilité de l'unité de la classe ouvrière est de prime abord une théorisation de la défaite du prolétariat, des moments où il ne lutte pas. Elle traduit la vision qu'ont les bourgeois des ouvriers : des individus ignorants, divisés, atomisés, vaincus. Elle relève de l'espèce des sociologues.
Une conception "ouvrieriste".
Ne parvenant pas à voir la classe ouvrière en tant que sujet historique, cette conception la conçoit comme une SOMME D'INDIVIDUS REVOLUTIONNAIRES. L'"OUVRIERISME", ce n'est pas la mise en avant du caractère révolutionnaire de la classe ouvrière mais le culte sociologique des INDIVIDUS OUVRIERS en tant que tels. Imbus de ce genre de vision, les courants d'origine maoïste attachent la plus grande importance à 1 'origine sociale des membres d'une organisation politique. Au point qu'une grande partie de leurs militants d'origine bourgeoise ou petite bourgeoise ont abandonné -surtout dans la période qui suivit 1968- leurs études pour devenir ouvriers en usine (ce qui par la suite ne pouvait que renforcer ce culte de l'ouvrier individuel).
Ainsi, le Marxist Workers'Committee, un groupe qui est parvenu cependant à évolue jusqu'à considérer aujourd'hui qu'il n'existe plus d'Etat ouvrier et que la Russie est bourgeoise depuis 1924 (mort de Lénine), écrit dans un article du n°l de leur publication "Marxist Worker's" (été 79), intitulé: "25 ans de lutte - notre histoire"
"Notre expérience dans le vieux parti révisionniste CPUSA (Parti communiste des USA) et dans le AWCP (American Workers Communist Party -organisation maoïste) nous a conduit à conclure que les fondateurs du socialisme scientifique avaient raison en affirmant qu'un véritable parti ouvrier doit développer un cadre d'OUVRIERS THEORIQUEMENT AVAN CES, que non seulement l'ensemble de ses membres mais aussi sa direction doivent provenir en premier lieu de la classe ouvrière".
Quelle conception de la classe ouvrière peut-on bien "apprendre" dans une organisation bourgeoise stalinienne ? Rappelons ici deux occasions dans l'histoire du mouvement ouvrier où ce principe ouvriériste a sévi.
Rappelons la lutte de "l'ouvrier" TOLAIN, délégué français aux premiers congrès de l'AIT, contre l'acceptation de Marx comme délégué. Pour Tolain, il fallait rejeter Marx, au nom du principe "l'émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes", car Marx n'était pas un ouvrier mais un intellectuel. Après un débat, la motion de Tolain fut rejetée. Quelques années plus tard, Tolain, l'ouvrier, se retrouvait aux côtés des Versaillais contre l'insurrection ouvrière de la Commune de Paris.
Rappelons encore comment la Social Démocratie allemande réussit à interdire en novembre 1918 à Rosa Luxembourg de prendre la parole au Congrès des conseils ouvriers parce qu'elle n'était pas elle non plus ouvrière, et la fit assassiner quelques semaines plus tard par les corps francs aux ordres de l'ouvrier Noske, qui écrasèrent dans le sang l'insurrection de Berlin en janvier 1919. CE N'EST PA CHAQUE INDIVIDU OUVRIER QUI EST REVOLUTIONNAIRE, C'EST LA CLASSE OUVRIERE QUI L'EST.
L'ouvriérisme ne comprend pas cette différence et du coup il ne comprend ni l’ouvrier individuel, ni la classe ouvrière comme classe.
L'aristocratie ouvriere: u n e d e f i n i t i o n i m p o s s i b l e
Qu'il y ait des différences de salaires, de conditions de vie et de travail parmi les ouvriers est une évidence. Que, en règle générale, plus un individu a une situation confortable dans la société, plus il tend à vouloir la conserver, c'est aussi ne trivialité. Mais de là à définir au sein du prolétariat une couche stable dont les intérêts seraient antagonistes à ceux du reste de leur classe et la rattacheraient au camp de la bourgeoisie, ou encore vouloir établir un lien mécanique entre exploitation et conscience et combativité, il y a un saut particulièrement périlleux.
Aux premiers temps du capitalisme, lorsqu'en grande partie les ouvriers étaient encore quasiment des artisans, avec des qualifications très particulières, avec des prérogatives de "corporation", on pouvait momentanément, pendant les périodes de prospérité économique, discerner plus facilement des parties de la classe ouvrière ayant des privilèges particuliers.
Ainsi, Engels pouvait reconnaître circonstancielle ment dans une correspondance personnelle, une aristocratie ouvrière "dans" les mécaniciens, les charpentiers et menuisiers, les ouvriers du bâtiment", qui constituaient au XIXème siècle des travailleurs organisés à part et jouissant de certains privilèges par l'importance et le monopole qu'ils avaient de leur qualification.
Mais avec l'évolution du capitalisme, avec d'une part la déqualification du travail, et avec d'autre part la multiplication des divisions artificielles parmi les travailleurs, tenter de définir une "aristocratie ouvrière" au sens d'une couche précise ayant des privilèges qui la distingueraient de façon qualitative du reste des ouvriers, c'est se condamner à nager dans l'arbitraire. Le capitalisme a systématiquement divisé la classe ouvrière tentant toujours de créer des situations où l'intérêt des uns soit opposé à l'intérêt des autres travai11eurs.
Nous avons insisté déjà sur comment le développement du machinisme conduit, dans les périodes de non lutte du prolétariat, par la "destruction de la spécialité du travailleur" au développement de la concurrence entre ouvriers. Cependant le capitalisme ne se contente pas des divisions que peut engendrer le processus de production lui-même. Comme les classes exploiteuses du passé, la bourgeoisie connaît et applique le vieux principe : DIVISER POUR REGNER. Et elle le fait avec un cynisme et une science sans précédent dans l'histoire.
Le capitalisme a repris des sociétés du passé l’emploi des divisions "naturelles" par sexe et par âge. Alors que la force physique, prérogative du mâle adulte disparaît progressivement avec le développement des machines, le capital entretient sciemment ces divisions dans le seul but de diviser et de payer moins cher la force de travail de la femme, de l'enfant ou du vieux.
Le capitalisme reprend aussi du passé les divisions raciales ou d'origine géographique.
Dans sa genèse, le capital, encore essentiellement sous sa forme de capital commercial, s'est enrichi entre autres grâce au commerce des esclaves. Dans sa forme achevée, le capital n'a cessé de se servir des différences d'origine ou de race pour exercer une pression permanente vers la baisse des salaires. De la situation faite aux travailleurs irlandais dans l'Angleterre du XVIIIème et XIXème siècle, à celle des ouvriers turcs ou yougoslaves dans l'Allemagne de 1980, il y a la poursuite d’une même politique de division. Le capital sait parfaitement tirer profit des divisions tribales en Afrique, comme des divisions religieuses en Ulster, des différences de castes en Inde ou des différences raciales aux USA ou dans les principales puissances européennes reconstruites après la guerre avec l'importation massive de travailleurs d'Asie, d'Afrique et des pays moins développés d'Europe (Turquie, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, etc..)
Mais le capitalisme ne se contente pas d'entretenir et d'attiser ces divisions dites "naturelles" parmi les travailleurs. En généralisant le salariat et l'organisation "scientifique" de l'exploitation en usine (taylorisme, système de primes, etc.), il a porté le travail de division des ouvriers au niveau des professionnels : sociologues, psychiatres, syndicalistes travaillent la main dans la main avec les managers du personnel pour mieux concevoir une organisation "rentable" de la production et faire régner dans les ateliers et les bureaux la loi du chacun pour soi, l'intérêt de chacun est antagoniste de celui de tout autre. C'est dans le capitalisme que la fameuse sentence: "l'homme est un loup pour l'homme" s'est le mieux concrétisée. En faisant dépendre le salaire des uns de la productivité des autres, en multipliant les différences de salaire artificielles pour un même travail (ce qui est actuellement poussé à l'extrême grâce à l'emploi de l'informatique dans la gestion des entreprises), il s'attache à créer des antagonismes entre les exploités.
Dans ces conditions, il est presque impossible de ne pas trouver pour chaque catégorie de travailleurs, une autre catégorie qui soit moins "privilégiée" ou plus "privilégiée".
Si l'on tient compte des privilèges que peut donner à un ouvrier son âge, son sexe, sa race, son expérience, le contenu de son travail: manuel ou non, sa position dans le processus de production, les primes qu'il reçoit, etc., etc., on peut multiplier à l'infini les définitions de ce que pourrait être une "aristocratie ouvrière". On aura coupé la classe ouvrière en tranches sociologiques comme un salami, mais on aura pas avancé d'un pas dans la compréhension de son être révolutionnaire.
Les élucubrations d'origine maoïstes sur l'aristocratie ouvrière incluent en toute logique "antiaristocratie-ouvrière", la nécessité d'organiser le "vrai prolétariat" : "les couches les plus exploitées". Il faut donc à ces groupes non seulement se livrer à un travail de définition sociologique de ce que peut bien être une "aristocratie ouvrière", mais encore de ce que sont les couches "pures" du prolétariat. Ils dépensent une grande partie de leur travail "théorique"à cela et les résultats varient suivant le groupe, la tendance, le pays, la période, etc...
Ainsi, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre, la France ou l'Allemagne, ce sont les travailleurs immigrés qui constituent le vrai prolétariat, le reste, les travailleurs blancs étant "l'aristocratie". Aux Etats Unis, suivant une telle conception, toute la classe ouvrière peut être considérée comme embourgeoisée (le niveau de vie d'un ouvrier noir aux USA pouvant être 100 fois supérieur à celui d'un ouvrier de l'Inde), mais on peut aussi, suivant la même idée, trouver que ce ne sont que les ouvriers blancs qui sont des "aristocrates" les ouvriers noirs américains étant des"aristocrates" d'un certain point de vue, mais "les plus exploités" d'un autre. Pour "Operai e Teoria", ce seraient les ouvriers qui travaillent à la chaîne qui constituent "la vraie classe ouvrière". Dans les pays sous-développés, les ouvriers de l'industrie sont de la même façon catalogués par certains groupes comme des "aristocrates", leur niveau de vie étant souvent beaucoup plus élevé que celui des masses de "sans-travail" qui s'entassent à la périphérie des villes.
Les définitions de cette fameuse "aristocratie" peuvent ainsi varier d'un groupe à l'autre, passant allègrement de 100% des travailleurs à 50% ou 20% suivant les humeurs des théoriciens de service.
Une theorie pour diviser la classe
En attendant de déterminer ou de préciser leurs différentes définitions sociologiques des couches du prolétariat, le travail d'intervention de ces organisations parmi les ouvriers est d'agir à des degrés divers pour la DIVISION des ouvriers, comme ils le disent eux-mêmes.
Cela consiste essentiellement à créer des organisations qui regroupent uniquement des ouvriers dont ils croient avoir la certitude qu'ils ne font pas partie de 1"'aristocratie ouvrière". Des organisations d'ouvriers noirs, des organisations d'ouvriers à la chaîne, des organisations d'ouvriers immigrés, etc ...
C'est ainsi par exemple que certains groupes développent parmi les travailleurs immigrés dans les pays les plus industrialisés d'Europe un racisme particulier qui remplace le racisme classique "anti-blancs" en un racisme "marxiste-léniniste" anti-aristocratie-ouvrière-blanche. Dans des pays moins développés, exportateurs de main d’œuvre, c'est à faire de 1"'anti-ouvrier-qualifié" parmi les ouvriers les moins qualifiés que se dédient les défenseurs de cette théorie.
Au sein de ces organisations, on cultive la méfiance envers "l'aristocratie ouvrière" qui devient rapidement l'explication de tous les maux qui frappent "les couches les plus exploitées".
On prétend, dans le meilleur des cas, que l'unification SEPARFE des secteurs les plus exploités de la classe constitue un exemple et un facteur vers une unification plus large de la classe. Mais c'est tout ignorer de comment se fait 1'unification des ouvriers.
L'exemple vivant de la Pologne 80 est parfaitement clair sur la question. L'unification des ouvriers n'a pas été le résultat d'une série d'unifications partielles cumulées les unes à la suite des autres, un secteur après l'autre, au cours de plusieurs années d'un travail de fourmi. C'est sous la forme d'une explosion que cette unification se réalise en quelques jours ou quelques semaines. Le point de départ de la lutte, le cheminement de la généralisation du combat sont imprévisibles et multiples.
La Pologne n'a d'ailleurs fait que confirmer à nouveau ce qu' avaient déjà mis en évidence toutes les explosions de lutte ouvrières depuis 1905 en Russie. Depuis 75 ans le prolétariat ne s'unifie que dans la lutte et pour la lutte. Mais, quand il le fait, il le fait d'emblée à l'échelle la plus large possible. Depuis 75 ans, lorsque les ouvriers luttent sur leur terrain de classe, ce à quoi on assiste, ce n'est pas à un pugilat entre fractions de la classe ouvrière, mais au contraire à une unification sans précédent dans l'histoire. LE PROLETARIAT EST LA PREMIERE CLASSE DANS L'HISTOIRE QUI N'EST PAS DIVISEE EN SON SEIN PAR DE REELS ANTAGONISMES ECONOMIQUES. Contrairement aux paysans, aux artisans, le prolétariat ne possède pas ses moyens de production. Il ne possède que sa force de travail et sa force de travail, elle, est COLLECTIVE.
La seule arme du prolétariat face à la bourgeoisie armée, c'est le NOMBRE. MAIS LE NOMBRE SANS L'UNITE, CE N'EST RIEN. La conquête de cette unité, c'est le combat fondamental du prolétariat pour affirmer sa force. Ce n'est pas par hasard que la bourgeoisie s'acharne tant à briser tout effort en ce sens.
C'est se moquer du monde que d'affirmer, comme le fait Operai e Teoria, que l'idée de la nécessité de l’unité de la classe ouvrière est une idée bourgeoise :
" ... pas une voix de la bourgeoisie ne s'élève aujourd'hui pour soutenir cette division (entre les couches les plus basses et "l'aristocratie") au contraire, ils font de la propagande tous en chœur en faveur de la nécessité des sacrifices parce que "nous sommes tous dans la même barque". " (0. et T. n°7, page 10).
Ce n'est pas d'unité de la classe ouvrière que la bourgeoisie parle dans tous les pays, mais d'UNITE DE LA NATION. Ce qu'elle dit, ce n'est pas "tous les ouvriers sont dans la même barque", mais "les ouvriers sont dans la même barque que la bourgeoisie de leur pays". Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais cela est difficile à comprendre pour ceux qui ont "appris" le marxisme de la bouche des nationalistes à la Mao, Staline ou Ho-chi-Minh. Face à toutes ces élucubrations d'origine stalinienne, les communistes ne peuvent qu'opposer les leçons de la pratique historique du prolétariat. Et, tout comme le préconisait déjà le Manifeste en 1848 : "METTRE EN AVANT ET FAIRE VALOIR LES INTERETS COMMUNS DU PROLETARIAT TOUT ENTIER" (Prolétaires et Communistes - souligné par nous
Une conception ambiguë des partis et des syndicats
Comment une telle théorie peut-elle avoir un minimum d'écho parmi les travailleurs ?
Probablement, la raison principale pour laquelle cette conception peut être entendue par certains travailleurs sans rire ni colère, c'est parce qu'elle semble donner une explication du pourquoi et du comment de l’écœurant travail de sabotage mené par les centrales syndicales dites "ouvrières ".
D'après cette théorie, les syndicats, ainsi que les partis de gauche, seraient l'expression des intérêts matériels de certaines couches du prolétariat, les couches les plus privilégiées, "l'aristocratie ouvrière". En temps de "calme social", pour certains ouvriers, victimes du racisme des ouvriers blancs, du mépris ou du contrôle d'ouvriers plus qualifiés, écœurés par l'attitude de "gestionnaire du capital" des partis de gauche et leurs syndicats, cette théorie semble d'une part donner une explication cohérente de ces phénomènes et d'autre part offrir une perspective IMMEDIATE d'action : s'organiser séparément des "aristocrates". Malheureusement, cette conception est fausse théoriquement et néfaste politiquement.
Voici, par exemple, comment "Le Bolchevik" (Organisation communiste bolchevik) en France, formule cette idée :
"Le PCF n'est pas un parti ouvrier. Par sa composition, en grande partie intellectuelle, petite bourgeoise, et surtout par sa ligne politique réformiste, ultra-chauvine, le PCF de Marchais et Séguy est un parti bourgeois.
Il n'est pas le représentant politique et idéologique de la classe ouvrière. Il est le représentant des couches supérieures de la petite bourgeoisie et de l'aristocratie ouvrière." ("Le Bolchevik" n'112, février 1980.
En d'autres termes, les intérêts d'une fraction de la classe ouvrière, "l'aristocratie", seraient les mêmes que ceux de la bourgeoisie, puisque le parti qui en représente les intérêts est "bourgeois". Cette identité de ligne politique entre les partis de "l'aristocratie ouvrière" et ceux de la bourgeoisie, reposerait sur des bases ECONOMIQUES, l'aristocratie recevant des "miettes" des surprofits arrachés par leur capital national aux colonies et semi-colonies.
Lénine formula une théorie analogue pour tenter d'expliquer la trahison de la Social Démocratie lors de la 1ère guerre mondiale.
"L'opportunisme (c'est le nom que donne Lénine aux tendances réformistes qui dominaient les organisations ouvrières et qui ont participé à la 1ère guerre mondiale) a été engendré, tout au long de décennies par les particularités d'un certain développement du capitalisme, dans lequel une couche d'ouvriers privilégiés, qui avaient une existence relativement tranquille et civile, avait été "embourgeoisée", recevait quelques miettes du profit de leur propre capital national et parvenait ainsi à être dégagée de la misère, de la souffrance et de l'état d'esprit révolutionnaire de masses misérables et ruinées." (... ) "La base économique du chauvinisme et de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier est le même ; l'alliance des couches supérieures, peu nombreuses, du prolétariat et de la petite bourgeoisie, qui reçoivent les miettes des privilèges de "leur" capital national contre les masses ouvrières et contre les masses travailleuses opprimées en général".
("La faillite de la II" Internationale)
Critique de l‘explication de Lenine de la trahison de la seconde internationale
Avant de traiter des théories des épigones, arrêtons nous quelque peu sur la conception définie par Lénine pour rendre compte de la nouvelle NATURE DE CLASSE des partis ouvriers social-démocrates qui venaient de trahir le camp prolétarien.
L'histoire posait aux révolutionnaires la question suivante : on savait que pendant des décennies, la Social-Démocratie européenne, fondée en particulier par Marx et Engels, formée au prix de luttes ouvrières acharnées, avait constitué un véritable instrument de défense des intérêts de la classe ouvrière. Maintenant que la quasi-totalité de la Social Démocratie, partis de masse et syndicats y compris, s'était alignée dans chaque pays derrière SA bourgeoisie nationale CONTRE les ouvriers des autres nations, comment devait-on définir la nature de classe de ce monstrueux produit de l'histoire ?
Pour donner une idée du choc que provoqua cette trahison sur la toute petite minorité d'éléments restés sur les positions révolutionnaires internationalistes, rappelons, par exemple, l'étonnement de Lénine lorsqu'il eut devant les yeux le numéro du "VORWARTS" (organe du Parti Social-démocrate en Allemagne) annonçant le vote des crédits de guerre par les parlementaires socialistes : il crut qu il s'agissait d"'un faux" destiné à renforcer la propagande en faveur de la guerre. Rappelons encore les difficultés des spartakistes allemands, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht en tête, pour rompre définitivement le cordon ombilical qui les liait organiquement à 1"'organisation mère".
Lorsque explose la guerre, la politique social-démocrate est ouvertement bourgeoise, mais la majorité des membres de ses partis et syndicats reste ouvrière. Comment expliquer une telle contradiction ?
Les social-démocrates, devenus patriotes, disaient : "voilà la preuve que l'internationalisme n'est pas une idée véritablement ouvrière". Pour rejeter une telle analyse Lénine répondit -en se situant sur le même plan- que ce n'était pas TOUS les ouvriers qui avaient rejeté l'internationalisme, mais seulement "une minorité privilégiée" qui s'était "dégagée de la misère, de la souffrance, et de l'état d'esprit révolutionnaire de masses misérables et ruinées". Lénine a un souci parfaitement juste : montrer que le fait que le prolétariat européen se soit laissé embrigader dans la guerre inter-impérialiste ne signifiait pas que ce genre de guerre répondait aux intérêts de la classe ouvrière de chaque pays. Mais les arguments qu'il emploie sont faux et démentis par la réalité vivante. Lénine dit que les ouvriers "patriotes" sont ceux qui ont des intérêts économiques communs avec "'leur' capital national". Ce dernier corromprait une "aristocratie ouvrière" en lui octroyant une partie, "quelques miettes du profit".
Combien grande est cette partie corrompue de la classe ouvrière ? Une "partie infinitésimale" répond Lénine dans "La faillite de la II° Internationale" ; "Les chefs ouvriers et la couche supérieure de l'aristocratie ouvrière" dit-il dans sa préface à "L'impérialisme stade suprême du capitalisme".
Mais la réalité démontre
1°) que ce n'est pas une minorité "infinitésimale" du prolétariat qui a profité, à la fin du XIX°, et au début du XX° siècle, de l'expansion du capital européen, mais l'ensemble des ouvriers de l'industrie. L'interdiction du travail des enfants, la limitation du travail des femmes, la réduction de la journée de travail à 10 heures, la création d'écoles et d'hôpitaux publics, etc., toutes ces mesures arrachées par la lutte ouvrière au capital en pleine expansion, ont bénéficié en premier lieu aux couches les plus "basses", les plus exploitées de la classe ouvrière;
2°) que la vision de Lénine d'une infime minorité d'ouvriers corrompus, isolés au milieu de gigantesques masses d'ouvriers misérables et possédés par un "état d'esprit révolutionnaire" est, à la veille de la première guerre mondiale, une pure invention de l'esprit. C'est la quasi-totalité des ouvriers, pauvres et riches, qualifiés et non qualifiés, syndicalisés et non syndicalisés qui dans les principales puissances vont, "la fleur au fusil", étriper "l'ennemi" et se faire massacrer pour la défense de "ses" maîtres nationaux;
3°) que "l'explication économique" des "miettes du profit" que les impérialismes partageraient avec leurs ouvriers les plus qualifiés n'a aucun sens. D'abord parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas une toute petite minorité d'ouvriers qui a vu sa situation s'améliorer fortement avec l'expansion capitaliste, mais L'ENSEMBLE des ouvriers des pays industrialisés. Ensuite parce que par définition, les capitalistes ne partagent ni leurs profits, ni leurs surprofits, avec les exploités.
Les augmentations de salaires, la puissante élévation du niveau de vie des ouvriers des pays industrialisés fut le résultat non pas de la générosité de capitalistes prêts à partager leurs profits, mais de la pression que les ouvriers pouvaient à cette époque exercer sur leurs capitaux nationaux avec succès. La prospérité économique du capitalisme de la fin du XIX° siècle réduit partout la masse des chômeurs de "l'armée de réserve" du capital. Sur le marché où se vend la force de travail, cette marchandise est d'autant plus rare et donc chère que les usines tournent à plein et se multiplient. C'est ce qui se produit au cours de cette période. Les ouvriers parviennent ainsi, en s'organisant même partiellement (syndicats et partis de masse), à vendre leur force de travail à un prix plus élevé et à obtenir des améliorations réelles de leurs conditions d'existence.
L'ouverture du marché mondial aux quelques centres industriels de la planète, localisés essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, permettait au capital de se développer avec une puissance foudroyante. Les crises périodiques de surproduction étaient surmontées avec une rapidité et une énergie qui semblait toujours plus puissante. Dans certaines régions, la grisaille des centres industriels se développait comme une tâche d'huile absorbant un nombre toujours croissant de paysans et d'artisans qui se voyaient ainsi transformés en ouvriers, en prolétaires. La force de travail des ouvriers qualifiés, ceux qui avaient appris le métier de longue date, devenait une marchandise précieuse pour les capitalistes.
Il y a donc bien un lien entre expansion mondiale du capitalisme et élévation du niveau de vie des ouvriers de l'industrie, mais ce lien n'est pas celui décrit par Lénine. L'amélioration de la condition prolétarienne ne touche pas une minorité "infinitésimale", mais l'ensemble de la classe. Elle n'est pas le résultat d'une "corruption" des ouvriers par une magie capitaliste, mais de la lutte ouvrière en période de prospérité capitaliste.
Si les ouvriers européens et américains ont, en masses, identifié leurs intérêts avec ceux de leur capital, avec en tête leurs organisations politiques et syndicales, c'est parce qu'ils avaient subi, pendant des décennies, l'ivresse de la période la plus prospère matériellement que l'humanité ait jamais connu. Si l'idée de la possibilité du passage pacifique au socialisme faisait tant de ravages dans le mouvement ouvrier ([2] [140]), c'est parce que la prospérité sociale semblait parfois maîtrisée par les forces conscientes de la société. La barbarie de la première guerre mondiale jeta dans la boue des tranchées de Verdun toutes ces illusions. Mais ces illusions n'avaient pas moins permis entre temps aux généraux du capital d'envoyer à la boucherie inter-impérialiste plus de 2O millions d'hommes.
La guerre mondiale signe définitivement la fin de toute cohabitation possible entre "réformistes" et révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier.
En se transformant en sergents recruteurs des armées impérialistes, les tendances réformistes majoritaires dans la Social-Démocratie sont passées corps et âme dans le camp de la bourgeoisie.
DES LORS, ELLES N’ETAIENT PLUS DES TENDANCES OUVRIERES FORTEMENT INFLUENCEES PAR L'IDEOLOGIE DE LA CLASSE DOMINANTE, MAIS DES ROUAGES, DES ORGANES DE L'APPAREIL POLITIQUE DE LA BOURGEOISIE.
Les partis social-démocrates NE SONT PLUS DES OR GANISATIONS "OUVRIERES EMBOURGEOISEES", mais des organisations BOURGEOISES TRAVAILLANT AU SEIN DE LA-CLASSE OUVRIERE. Ils ne représentent plus les intérêts de la classe ouvrière, ni même d'une fraction de celle-ci. Ils incarnent les intérêts du capital national tout entier.
La Social-Démocratie n'est pas plus "ouvrière" parce qu'elle encadre des ouvriers que les barreaux d'une cage sont fauves parce qu'ils encadrent des fauves. Le massacre des ouvriers allemands au lendemain de la guerre par la Social Démocratie au gouvernement, confirma dans le sang de quel côté de la barricade elle se situait désormais.
La théorie suivant laquelle les partis de gauche et leurs syndicats seraient les défenseurs des intérêts d'une "aristocratie ouvrière" entretient d'une façon ou d'une autre l'idée qu'il s'agit tout de même d'organisations ouvrières, même si ce n'est que partiellement.
Cette question "théorique" prend toute son importance pratique lorsque les masses ouvrières sont confrontées à une attaque d'une fraction de la bourgeoisie contre ces organisations. C'est au nom de la défense de ces organisations "ouvrières" que les "démocraties occidentales" ont conduit les ouvriers à la lutte "contre le fascisme" de l'Espagne 1936 à Hiroshima.
C'est cette "ambiguïté" que les épigones actuels revendiquent. Le courant maoïste provient des partis communistes. Ce sont des pans du bloc stalinien qui se sont détachés sous les coups du développement des conflits inter-impérialistes (en particulier entre la Chine et la Russie) et de l'intensification de la lutte de classe.
Beaucoup de groupes d'origine maoïste affirment que les PC sont des organisations "bourgeoises", mais ils s'empressent toujours de préciser qu'elles s'appuient sur l’ "aristocratie ouvrière", et que par-là elles sont partiellement des organisations "ouvrières embourgeoisées" ... On peut deviner l'importance que peut avoir cette "nuance" pour des groupes qui, tels le "Marxist Worker’s Committee", se revendiquent fièrement de leur "25 ans de lutte ([3] [141]) dont plus des 3/4 chez les staliniens. On ne travaillait pas pour la bourgeoisie... on travaillait pour "l'aristocratie ouvrière".
Toute ambiguïté sur savoir de quel côté de la barricade se trouvent les partis de gauche et les syndicats est meurtrière pour la classe ouvrière. Depuis 60 ans, presque tous les mouvements ouvriers importants ont été écrasés par "la gauche" ou avec sa complicité. La théorie de "l'aristocratie ouvrière", en cultivant cette ambiguïté, désarme la classe en rendant flou ce qui doit être le plus clair et le plus net possible au moment d'engager une bataille : QUI EST AVEC QUI.
Une deformation grossière du marxisme
Nous avons montré en quoi la théorie de l'aristocratie ouvrière, telle qu'elle est défendue par les groupes maoïstes et ex-maoïstes, traduit une vision sociologique de la classe ouvrière, vision acquise par ces courants au cours de leur expérience stalinienne.
L'incapacité à concevoir la véritable dimension historique du prolétariat s'accompagne chez ces groupes qui se disent prolétariens de l'ignorance de toute la pratique réelle historique des masses ouvrières.
La compréhension de cette expérience est remplacée par une étude quasi religieuse de certains textes sacrés des évangélistes "prolétariens" dont on cite des extraits comme la preuve absolue de la véracité de ce qu'ils disent. (L'évolution des groupes maoïstes se mesure au nombre de têtes d'évangélistes qu'ils éliminent de leurs icônes : au début il y avait Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao ; bientôt il n'y eut plus Mao et, à un stade plus avancé, lorsque certains d'entre eux commencent à ouvrir les yeux sur ce que fut la contre-révolution stalinienne, on élimine aussi Staline. Mais, du coup, les 3 restants voient leur valeur religieuse encore plus renforcée).
Pour savoir si telle idée ou telle position politique est juste, ou fausse, on ne se pose pas la question : est-ce que cela a été confirmé ou non par la pratique réelle et vivante des luttes ouvrières dans le passé, mais : est-ce que ça peut être justifié par une citation de Marx, Engels, Lénine ou non.
C'est ainsi que, pour démontrer "scientifiquement la justesse de leur théorie de l'aristocratie ouvrière, ces groupes abreuvent leurs lecteurs et leur public de citations savamment choisies de Marx, Engels, Lénine.
Ces ultra-léninistes se réfèrent aux erreurs de Lénine sur "l'aristocratie ouvrière", mais ils "oublient" que Lénine n'en déduisit jamais des positions aberrantes, telles celle d'Operai e Teoria, suivant laquelle les révolutionnaires ne doivent plus "mettre en avant et faire valoir les intérêts communs du prolétariat tout entier" -comme le disait le Manifeste- mais "travailler en vue" de la réalisation d'une scission, d'une rupture nette entre les intérêts des couches basses et celles de l'aristocratie ouvrière" (O et T).
Jamais Lénine ne préconise que les ouvriers ne s'organisent indépendamment et contre le reste de leur classe. Au contraire, autant Lénine combattit la Social-Démocratie patriotarde comme courant politique, autant il défendit la nécessité de l'unité de l'ensemble des ouvriers dans leurs organisation unitaires. Le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux Soviets", c'est à dire tout le pouvoir aux organisations les plus larges et unitaires que la classe ait pu engendrer, mot d'ordre dont il fut un des plus puissants défenseurs, ne constitue pas un appel à la division mais au contraire un appel à l'unité la plus forte pour la prise du pouvoir.
Quant aux références de ces courants à certaines citations de Engels, elles sont tout simplement une tentative de faire dire à des phrases isolées d'Engels quelque chose qu'elles n'ont jamais dit. Engels parle à plusieurs reprises d'une "aristocratie" au sein de la classe ouvrière. Mais de qui parle-t-il ?
Dans certains cas, il parle de la classe ouvrière anglaise, qui dans son ensemble jouit de conditions de vie et de travail bien supérieures à celles des travailleurs des autres pays.
Dans d'autres cas, il parle d'ouvriers au sein de la classe ouvrière anglaise elle-même, des plus spécialisés, possédant encore des connaissances artisanales (les mécaniciens, les charpentiers et menuisiers, les ouvriers du bâtiment). Mais s'il en parle, c'est pour combattre les illusions que pouvait entretenir la classe ouvrière anglaise d'être effectivement une "aristocratie" et pour insister sur le fait que l'évolution du capitalisme et surtout les crises économiques auxquelles il est condamné égalisent par le bas les différences entre ouvriers et détruisent les bases mêmes des" privilèges" de certaines minorités, même au sein de la classe ouvrière en Angleterre. Ainsi, dans un débat au sein de l'Association Internationale des Travailleurs (1ère Internationale), il dit: "En l'occurrence, cela (l'adoption de la motion de Halos sur la section irlandaise dans l'AIT) ne ferait que renforcer l'opinion déjà trop longuement répandue parmi les ouvriers anglais selon laquelle, par rapport aux irlandais, ils sont des êtres supérieurs et représentent une sorte d'aristocratie comme les blancs des états esclavagistes se figuraient l'être par rapport aux noirs"([4] [142]). Et Engels annonce comment c'est la crise économique qui va se charger de balayer cette opinion déjà trop largement répandue:
"Avec la ruine de la suprématie industrielle, la classe ouvrière d'Angleterre va perdre sa condition privilégiée. Dans son ensemble -y compris avec sa minorité privilégiée et dirigeante- elle se verra alignée au niveau des ouvriers de l'étranger". (idem)
Et parlant des vieux syndicats qui regroupaient exclusivement et jalousement les ouvriers les plus spécialisés:
"Finalement, elle (la crise aiguë du capitalisme)devra éclater, et il faut espérer qu'elle mettra fin alors aux vieux syndicats".
L'expérience pratique des luttes ouvrières au XXème siècle avec ses "nouvelles" formes d'organisation fondées sur les assemblées générales et leurs délégués organisés en comités ou en conseils a effectivement mis fin non seulement aux vieux syndicats d'ouvriers spécialisés, mais aussi aux syndicats de tout genre, inévitablement fondés sur des catégories strictement professionnelles. C'est pour renforcer le mouvement par l'indispensable unité de la classe ouvrière qu'Engels parlait d'une "sorte d'aristocratie" ouvrière.
C'est une falsification grossière que d'en déduire la nécessité de diviser la classe ouvrière.
Pour en finir avec les références "marxistes", signalons ponctuellement la trouvaille de "Operai e Teoria" qui prétend trouver dans Marx une explication aux antagonismes qui opposeraient les ouvriers entre eux.
"Tous les ouvriers ensemble organiquement produisent de la plus-value, mais pas tous la même quantité parce qu'il ne sont pas tous soumis à l'extorsion massive de plus-value relative".
De toute évidence, ces gens ne se sont même pas donné la peine de savoir ce qu'est la "plus-value relative". Par ce terme, Marx définit le phénomène de l'accroissement du temps de travail volé par le capital à la classe ouvrière grâce à l'accroissement de la productivité.
Contrairement à l'extraction de la "plus-value absolue" qui dépend essentiellement de la durée du temps de travail, la "plus value relative dépend de la productivité sociale en premier lieu de l'ensemble des ouvriers.
L'accroissement de la productivité se traduit par le fait qu'il faut moins d'heures de travail pour produire une même quantité de biens. L'accroissement de la productivité sociale se traduit par le fait qu'il faut moins de temps de travail social pour produire les biens de subsistance.
Les produits nécessaires à l'entretien de la force de travail, ceux que l'ouvrier doit acheter avec son salaire contiennent de moins en moins de valeur. Même s'il peut désormais s'acheter deux chemises au lieu d'une, ces deux chemises ont coûté moins de travail à être produite qu'une seule auparavant grâce à l'élévation de la productivité. La différence entre la valeur du travail fourni par l'ouvrier et la valeur de la contre-partie qu'il reçoit sous forme de salaire, la plus-value que s'approprie le capitaliste, augmente même si la durée absolue de son travail reste inchangée.
La plus-value relative c'est l'exploitation par le renforcement de la domination de 1'emprise de domination du capital sur toute la vie sociale.([5] [143]) Elle est la forme d'exploitation la plus collective dont soit capable une société de classe.(C'est pourquoi elle est la dernière.)
En ce sens elle est subie par tous les ouvriers avec une intensité égale.
Le développement du recours à la
plus-value relative ne conduit pas à un développement d'antagonismes
économiques au sein de la classe ouvrière comme le prétend 0 et T", mais
au contraire à 1'uniformisation de sa situation objective face au capital.0
On ne peut lire Marx avec des yeux de sociologues staliniens.
Certains courants politiques en provenance du maoïsme affichent un anti-syndicalisme radical. Cela crée des illusions en paraissant être un pas en avant vers des positions de classe. Mais la théorie qui soutend cette position ainsi que les conclusions politiques auxquelles elle conduit font de cet anti-syndicalisme un nouvel instrument de division de classe ouvrière.
Ce qui a rendu caduque
historiquement la forme d'organisation syndicale pour le combat ouvrier, c'est
précisément son incapacité à permettre une véritable unification de la classe.
L’organisation par branches, par métiers, sur un plan strictement économique ne
permet plus l'unification indispensable à l'efficacité de toute lutte dans le
capitalisme totalitaire.
Rejeter les syndicats pour
diviser autrement, c'est à cela que conduit l'anti-syndicalisme fondé sur
"l'anti-aristocratie ouvrière".
R.V.
[1] [144] il s'agit d'un article où 0 e T tente de répondre aux critiques de Battaglia Comunista (Pcint.) qui, tout en étant "léniniste" leur reproche :
-de"favoriser le processus capitaliste de division de la classe ouvrière" ;
-de faire reposer leur théorie sur"la fausseté objective des privilèges" au sein de la classe ;
-de ne pas comprendre "la tendance du capitalisme dans sa phase de crise à provoquer un appauvrissement progressif des conditions de vie de tout le prolétariat et donc à réaliser l'unification économique de celui-ci".
BC a certainement raison dans ces critiques, mais ne va pas jusqu'au bout, de crainte de mettre en question la parole du "maître".
[2] [145] Les "compromis"que devait faire passer la IIIème Internationale avec les partis sociaux-démocrates dès 1920, au détriment de tendances ouvrières taxées d"ultra-gauchisme", ont trouvé une justification théorique dans l'ambiguïté du terme "ouvrier-bourgeois" employé à l'égard des partis social-démocrates patriotes. L'Internationale de Lénine en arriva ainsi jusqu'à demander aux communistes anglais de s'intégrer dans le parti "travailliste" !
[3] [146] Marxist Worker, N°l, en 1979. "25 years of struggle. Our history".
[4] [147] Extrait d'une intervention à la séance du conseil général de l'AIT en Mai 1872. Cité par Dangeville dans K-Marx. F-Engels - Syndicalisme, Tome 1.
[5] [148] La prédominance par la plus value relative sur la plus value absolue constitue une des caractéristiques essentielles de ce que Marx appelle "la domination réelle de capital".
Courants politiques:
- Bordiguisme [126]
Heritage de la Gauche Communiste:
La question syndicale, après 1920 : comment les groupes révolutionnaires ont tire les leçons du passe
- 3796 reads
L'après-guerre va marquer une sorte de tournant, une sorte de croisée des chemins pour les groupes communistes internationalistes : le trotskisme et sa logique étaient passés dans le camp bourgeois, la nature de classe capitaliste de l'URSS était définitivement tranchée, les illusions sur une éventuelle vague révolutionnaire s'évanouirent rapidement; dans ce contexte, il s'agissait donc de tracer des lignes générales pour le futur, tant du point de vue du développement du capitalisme mondial que du point de vue de la lutte de classes.
LA GAUCHE COMMUNISTE
En ce qui concerne la question syndicale, la gauche communiste de France ("Internationalisme") issue du courant de la gauche italienne, après quelques hésitations, sut développer une analyse claire de la nécessaire rupture avec les syndicats
"Les luttes ouvrières ne peuvent se mouvoir et se faire qu'en dehors des syndicats par la constitution dans chaque lutte d'organismes nouveaux que sont les comités de grève, les comités locaux de lutte, les conseils ouvriers. Ces organismes ne vivent qu'autant que subsiste la lutte elle-même et disparaissent avec elle. Dans la période présente, il est impossible de construire des organisations de masse permanentes. Cela ne deviendrait possible que dans la période de lutte généralisée du prolétariat, posant à l'ordre du jour la révolution sociale. Vouloir maintenir une organisation permanente actuellement sous la forme de minorités ou de fractions dans les anciens syndicats ou en formant de nouvelles centrales syndicales, ou syndicats autonomes et syndicats d'usine, ne mène à rien et trouble le processus de prise de conscience des ouvriers. Finalement, les nouveaux syndicats ne se maintiendront qu'en devenant autant d'organisations anti-ouvrières que les anciennes ou deviendront simplement des sectes. ( ) C'est en cela que réside la différence fondamentale entre l'attitude des révolutionnaires face aux syndicats réformistes d'hier qu'ils pouvaient chercher à transformer et à faire servir pour la défense des intérêts immédiats des ouvriers et les syndicats dans la période présente du capitalisme d'Etat qui ne sont et ne peuvent être que des organismes de l'Etat, et qui, tout comme l'Etat capitaliste, doivent être dénoncés et combattus par les révolutionnaires et brisés par l'action de classe du Prolétariat". ("Internationalisme"N°22, mai 1947)
Cette position n'était pourtant ni une innovation théorique, ni une rupture avec l'esprit de la fraction italienne regroupée autour de "Bilan" ([1] [150]).'Déjà, au sein de "Bilan" s'étaient dégagées certaines orientations remettant en cause à terme l'engagement des révolutionnaires dans les syndicats. Dans un rapport sur la situation internationale, Vercesi, un des principaux animateurs de "Bilan" avait jeté les bases d'une remise en cause du syndicalisme
"L'époque impérialiste du capitalisme se révèle être celle où la zone déterminant le contraste de classe est celle dont les objectifs ne sont plus limités aux luttes partielles, mais seulement à la lutte suprême pour la révolution communiste. ( Les fractions de gauche se relient au processus réel de la lutte de classes à la condition toutefois de ne pas conditionner l'appartenance de leurs membres aux organisations syndicales, à la discipline que ces dernières, encastrées dans 1'appareil de l'Etat capitaliste (souligné par nous), pourraient leur imposer. Les tendances qui agissent au sein des organisations syndicales dans le but de déboucher sur une action de classe des ouvriers, et qui proclament leur discipline aux directions (devenues des représentants de l'Etat capitaliste au sein des masses), proclament par voie détournée leur discipline à l'Etat capitaliste lui-même." ("Bilan" n°41, mai-juin 1937)
C'est contre cette optique que Bordiga et sa tendance vont lutter au sein du Parti Communiste Internationaliste d'Italie (PCI), reconstitué après-guerre sur des bases volontaristes. Dans un premier temps, on assista donc à un retour aux Thèses de l'Internationale Communiste
"Le parti aspire à la reconstruction d'une confédération syndicale unitaire, indépendante des commissions d'Etat et agissant avec les méthodes de la lutte de classe et de l'action directe contre le patronat, depuis les revendications locales et de catégories jusqu'aux revendications générales de classe. (…) Les communistes ne proposent et ne provoquent la scission des syndicats du fait que les organismes de direction seraient conquis ou détenus par d'autres partis"
(Plate-forme politique du P.C.I. 1946)
Pourtant, deux ans plus tard, le congrès du PCI déclarait à propos de la question syndicale
"Le Parti affirme catégoriquement que le syndicat actuel est un organe fondamental de l'Etat capitaliste, ayant pour but d'emprisonner le prolétariat dans le mécanisme productif de la 'collectivité nationale'. Cette caractéristique d'organe étatique est imposée aux organismes syndicaux et de masse par les nécessités internes du totalitarisme capitaliste. (… ) C'est pourquoi, on doit rejeter catégoriquement toute perspective de redressement du syndicat, toute tactique visant à la "conquête" de ses organes centraux ou locaux, toute participation à la direction des commissions internes et organismes syndicaux en général. La classe ouvrière, au cours de son attaque révolutionnaire, DEVRA DETRUIRE LE SYNDICAT comme un des mécanismes les plus sensibles de la domination de classe du capitalisme". ("Battaglia Communista" n'19. 3-10 juin 1948)
Malgré les aspects positifs de cette déclaration, le PCI n'avait pas véritablement tranché la question syndicale et laissait la porte ouverte à l'activité "syndicaliste" du Parti. En fait, le courant bordiguiste était tiraillé par plusieurs tendances qui exprimaient l'immaturité d'une organisation qui se voulait "le Parti", indépendamment du niveau de la lutte de classe, indépendamment de l'état du milieu révolutionnaire international, indépendamment même de l'absence d'une clarification théorique suffisante sur des points aussi cruciaux que les enseignements de la contre révolution en Russie, la nature de la période historique du capitalisme, la question du parti, etc.. Toutes ces contradictions vont aboutir à la scission du PCI en 195Z, la tendance de Bordiga publiant une nouvelle revue "Il Programma Comunista" et la tendance Damen continuant la parution de "Battaglia Comunista". Il faut noter qu'en France, le courant bordiguiste (Fraction française de la gauche communiste) avait déjà souffert deux scissions dont la seconde avait vu une bonne partie du groupe rejoindre "Socialisme ou Barbarie", groupe issu de la Quatrième Internationale trotskiste et qui rejetait l'analyse de l'URSS comme "Etat ouvrier", sans d'ailleurs se rattacher à la tradition de la gauche communiste.
Le groupe de Bordiga va exprimer un véritable recul théorique au sein d'un milieu révolutionnaire considérablement déboussolé. Rejetant tout le travail et les acquis de "Bilan", Bordiga va développer une orientation soi-disant orthodoxe de retour au "marxisme invariant" qui sera en fait une caricature dogmatique de certaines positions de l'Internationale Communiste et un retour aux erreurs de Lénine sur les questions nationale et syndicale.
Si "Battaglia Comunista" va se tenir à une position ambiguë sur le problème de l'activité syndicale des révolutionnaires, "Programma Comunista" va devenir un modèle d'inconstance et d'hésitation dans les années qui vont suivre ([2] [151]).
AUJOURD’HUI, LE PCI - PROGRAMME COMMUNISTE
Au moment où des groupes issus du trotskisme comme "Socialisme ou Barbarie" ou le groupe de Munis (aujourd'hui "Alarme" tentaient d'élaborer une critique du syndicalisme, le P.C.1. (Programme Communiste) allait se retrouver en deçà même de certaines positions de Trotski et de celles de "Bilan". Ainsi, dans les années 60, on pouvait lire dans les premiers numéros du "Prolétaire"(journal en France du PCI) des analyses qui ne sont pas à la gloire du mouvement révolutionnaire et qui relevaient de la myopie la plus avancée. Dans un article intitulé "Les révolutionnaires doivent-ils militer dans les syndicats révolutionnaires ?", on pouvait lire :
"Mais la contre-révolution ne peut détruire le programme communiste, l'âme même, la conscience impersonnelle de la classe où sont consignés le but qu'elle doit atteindre et les moyens qu'elle doit employer pour y parvenir. Le travail qui incombe aux quelques éléments qui sont restés sur le terrain de la défense de ce programme, est d'expliquer celui-ci. Ils doivent le faire dans les organisations réactionnaires que sont devenus les syndicats, parce que ceux-ci, bien que momentanément dirigés par des équipes de bonzes qui font adopter des positions allant à l'encontre des intérêts les plus immédiats des ouvriers, sont des organes de la classe prolétarienne : "car toute la tâche des communistes est de savoir convaincre les retardataires, de savoir travailler parmi eux et non de se séparer d'eux par des mots d'ordre "de gauche"d'une puérile invention' (Lénine)".
("Le Prolétaire" n°6)
Cette perspective était d'autant plus erronée que le PCI traçait une frontière de classe entre la C.G.T. stalinienne et les autres syndicats considérés comme "jaunes" :
"La C.G.T. est en France la seule organisation syndicale rattachée à une tradition authentiquement prolétarienne (!) (... ) C'est donc au sein de la C.G.T. que le parti de classe de demain doit s'efforcer de faire entendre sa voix... "
("Programme Communiste" n°31 - 1965)
Dans cette vision, le PCI allait jusqu'à dénoncer les tractations unitaires de la C.G.T. à l'égard de F.O. et de la C.F.T.C. comme si cela était contre-nature. Dans sa lancée, il posa même la possibilité de quitter le syndicat :
"Lorsque statutairement, il ne sera plus possible de préconiser la lutte de classe et sa ligne politique dans les syndicats, ces organismes n'auront plus rien de prolétarien et agir en leur sein n'aura plus de sens pour des révolutionnaires". Peut-être faudra-t-il en passer par-là".
("Le Prolétaire" n°6)
Non seulement le PCI distinguait encore des syndicats "prolétariens" à côté des syndicats "jaunes", mais encore il ne fixait rien de moins que le but de les conquérir, remettant en cause ses propres positions de 1'après-guerre ! Jusqu'en 72, le PCI va développer une orientation de "syndicalisme de classe" au sein de la C.G.T., critiquant l'entrisme dans les autres syndicats, comme l'expliquait un article intitulé "Pas dans les syndicats jaunes ! "
"Là où les militants du parti de classe pourraient parler, il n'y a rien à faire pour la défense des intérêts du prolétariat, là où il y aurait une seule chance d'agir, on se garde bien de les laisser parler. La lutte de classe, dans la phase totalitaire et impérialiste passe A L'INTERIEUR du syndicat. On DOIT lutter contre l'opportunisme dans la C.G.T.. on NE PEUT PAS le faire dans les syndicats jaunes 1".
("Le Prolétaire" n°75 - février-mars 1970)
S'apercevant, un peu tard, qu'on ne pouvait attribuer à la C.G.T. une nature de classe différente des autres syndicats, que sa fonction était similaire, c’est à dire tout à fait contre révolutionnaire, le PCI décida en 1972 de rejeter "les directives de défense du syndicat de classe, puis de reconstitution du syndicat de classe comme une répétition vide des années 20... " ("Le Prolétaire" N°128 - mai-juin 1972) tout cela, pour justifier l'entrisme... dans les syndicats 1
Pour ce faire, le PCI n’hésita pas à aller chercher des arguments chez Trotski qui défendait en 1940 l'intervention des révolutionnaires dans tous les syndicats, y compris les syndicats fascistes.
Le plus étonnant dans ce revirement n'était pas la décision somme toute "logique" d'intervenir dans les syndicats et dans tous les syndicats, mais l’absolue insouciance théorique et historique des bordiguistes, qui, tout en rejetant la théorie de la décadence impérialiste ne voyaient aucun lien entre cette question et celle du syndicalisme. Au moins, Trotski d'avant-guerre, dans la lignée de l'Internationale Communiste comprenait que la décadence du capital modifiait les données du problème syndical. Malheureusement, il en tira des conclusions "tactiques" désastreuses qui firent ultérieurement du trotskisme un appendice de la contre-révolution, notamment à travers son activité syndicale !
Le PCI, incapable de tirer les leçons d'une telle expérience, au moment où la classe reprenait le chemin de sa lutte historique, était tout juste capable de rebalbutier les erreurs faites trente années auparavant ! En fait, en 1972, le PCI venait confirmer son incompréhension totale de la période historique et s'investissait encore plus dans le travail syndical au moment où les prolétaires commençaient à rompre avec les syndicats, les déborder et même à les affronter !
Mis à part le PCI et les différentes ruptures "orthodoxes" qu'il a subies ces dernières années ("Il Partito Comunista"notamment) dont la sclérose avancée ne semble plus pouvoir être enrayée, i1 faut prendre en considération l'évolution de tout un courant qui a subi la double influence des thèses conseillistes et des positions de "Socialisme ou Barbarie" (I.C.O.,Pouvoir Ouvrier, GLAT en France, Solidarity en Grande-Bretagne, Collegamenti en Italie, divers groupes conseillistes américains, etc.) et qui a développé sur la question syndicale des positions incomplètes et surtout ambiguës. Faute d'une analyse sérieuse de la décadence capitaliste, ce courant n'a pas su créer les caractéristiques de la lutte du prolétariat dans la phase historique actuelle et s'est fourvoyé dans une série d'impasses qui a provoqué la disparition de la plupart des groupes qui le composaient.
"SOCIALISME OU BARBARIE"
Pour comprendre ces
positions et leurs dangers, i1 est nécessaire de revenir sur la trajectoire du
groupe "Socialisme ou Barbarie" qui a dans un sens cumulé les
erreurs à ne pas faire sur le problème syndical, erreurs qui restent
d'actualité notamment pour les nouveaux groupes prolétariens confus qui
surgissent aujourd'hui. Après avoir
rompu avec le trotskisme, "Socialisme ou Barbarie" va
s'engager dans la voie de l'innovation et du rejet de la tradition des Gauches
Communistes, notamment de la Gauche Italienne.
Cette orientation se concrétisa par
la thèse que le bloc russe représentait le pouvoir d'une nouvelle classe
exploiteuse : la bureaucratie opposée aussi bien à la bourgeoisie capitaliste
classique qu'à la classe ouvrière. "Socialisme
ou Barbarie" ne sut pourtant pas se prononcer clairement sur le
caractère progressiste ou non d’une telle classe non "prévue" par le
marxisme, et, de là, il s'ensuivit chez ce groupe une incapacité à déterminer
des positions solides à l'égard des partis staliniens (représentants d'une
nouvelle classe ?), des forces nationalistes du "tiers-monde", des
contradictions inter-impérialistes, et aussi des syndicats. Dans un article de 1958, "Socialisme
ou Barbarie" exprimait sa vision des rapports entre les syndicats et
la classe ouvrière :
"Les Syndicats ne sont plus que des "intermédiaires" entre les travailleurs et le patronat, dont le rôle est de calmer les travailleurs, de les maintenir attachés à la Production, d'éviter qu’il y ait des luttes en obtenant de temps en temps, et lorsque cela ne gêne pas trop le patronat, quelques concessions (...). Si les syndicats peuvent agir ainsi, c'est que, depuis longtemps, ils ne sont plus dirigés par la masse de leurs adhérents. La bureaucratie qui les dirige, formée de permanents privilégiés, échappe entièrement au contrôle de la base. Il y a certainement beaucoup de professions, de localités ou d'entreprises où les sections syndicales ou bien les syndicats locaux restent liés à leurs adhérents et essaient d'exprimer leurs aspirations. Et certainement la grande majorité des militants syndicaux de base sont des militants ouvriers sincères et honnêtes. Mais, ni ces militants, ni les sections qu'ils animent, ne peuvent influer sur l'attitude des Fédérations ou des Confédérations. Plus on s'approche des sommets de l'organisation syndicale, plus on constate que celle-ci mène sa propre vie, suit sa propre politique, indépendamment de sa base" ("Socialisme ou Barbarie", n°23, janvier-février 1958).
C'est de cette base syndicale que "Socialisme ou Barbarie" qui continuait à défendre le travail à l'intérieur des syndicats attendait en fait un renouveau, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau syndicalisme réellement contrôlé par les travailleurs. Et si "Socialisme ou Barbarie" prônait la nécessité de l'auto-organisation des ouvriers dans la lutte, c'était avec le secret espoir d'y voir les bases de nouvelles organisations permanentes de la classe
"Il faut que les organes de lutte créés par les travailleurs, et en particulier les comités de grève démocratiquement élus, ne se dissolvent pas une fois les revendications satisfaites. Il faut que ces organes se maintiennent, qu’ils organisent leurs contacts permanents d'entreprise à entreprise et de localité à localité, qu'ils proclament publiquement leur intention de contrôler l'évolution de la situation en général et du Pouvoir d'achat en particulier, et d'appeler à nouveau les travailleurs à la lutte à la moindre tentative, d'où qu'elle vienne d’attenter à leur niveau de vie" (idem).
Puis ces illusions vont peu à peu disparaître pour laisser la place à une Vision plus "moderniste" mais toujours aussi ambiguë et confuse :
"Les organisations traditionnelles s'appuyaient sur l'idée que les revendications économiques forment le problème central pour les travailleurs, et que le capitalisme est incapable de les satisfaire. Cette idée doit être catégoriquement répudiée car elle ne correspond en rien aux réalités actuelles. L'organisation révolutionnaire et l'activité des militants révolutionnaires dans les syndicats ne peuvent pas se fonder sur une surenchère autour des revendications économiques tant bien que mal défendues par les syndicats et réalisables par le système capitaliste sans difficulté majeure (souligné par nous). C'est dans la possibilité des augmentations de salaire que se trouve la base du réformisme permanent des syndicats et une des conditions bureaucratique irréversible. Le capitalisme ne peut vivre qu'en accordant des augmentations de salaire, et pour cela, des syndicats bureaucratisés et réformistes lui sont indispensables. Cela ne signifie pas que les militants révolutionnaires doivent nécessairement quitter les syndicats ou se désintéresser des revendications économiques, mais que ni l'un, ni l'autre ce ces points n'ont l'importance centrale qu'on leur accordait autrefois". ("Socialisme ou Barbarie", n°35, janvier-mars 64).
Deux erreurs de fond caractérisaient ces thèses, erreurs qui allaient amener la disparition de ce groupe et son tronçonnement en plusieurs appendices. La première résidait dans l'incapacité à reconnaître la décadence du mode de production capitaliste et la nature catastrophique des crises économiques dans cette phase. Pour "Socialisme ou barbarie" qui avait vu l'émergence d'une nouvelle classe historique et qui n'avait connu comme groupe que la phase de reconstruction de l'après guerre, il y avait certes une nouvelle époque de restructuration, de revitalisation de la société divisée en classes et non pas une période de déclin posant la question de la nécessité historique de la révolution communiste. La vision profondément pessimiste de "Socialisme ou Barbarie" de la période était en même temps liée à une incapacité à rompre avec une des principales forces de la contre-révolution : le syndicalisme. En accordant aux syndicats un rôle encore "réformiste", "Socialisme ou Barbarie" justifiait en quelque sorte leur existence auprès des travailleurs, perpétuait l'illusion des réformes toujours possibles et posait la révolution comme un besoin moral détaché des contingences immédiates. Cette position était une rupture franche avec le marxisme et ouvrait la voie au modernisme, c'est-à-dire au rejet du prolétariat comme SEULE force révolutionnaire. Dans la mesure où le capitalisme était censé améliorer la condition immédiate du prolétariat de façon permanente, il n'y avait plus de raisons pour que celui-ci devienne son fossoyeur. C'est donc en toute logique que le principal animateur de ce groupe, Chaulieu-Cardan-Castoriadis, rejeta le marxisme au moment même où le prolétariat mondial recommençait à lutter contre les premiers effets de la crise.
Cependant, tout un courant issu de "Socialisme ou Barbarie" perpétua le côté "ouvriériste" et volontariste du groupe. Ce fut le cas de "Pouvoir ouvrier" qui justifiait sa présence dans les syndicats en les présentant comme des organes défendant les "intérêts immédiats" des travailleurs tout en voulant conserver le capitalisme, comme des organes ayant une "double nature", ouvrière en temps de calme social, "contre-révolutionnaire" en période de lutte de classe. Non seulement "Pouvoir Ouvrier" rééditait la vieille erreur consistant à opposer intérêt immédiat de la classe et lutte…, pour la révolution mais en plus prétendait comme les gauchistes en tant que groupe révolutionnaire assurer des tâches à ces deux niveaux antagoniques ! Au moins le modernisme était logique en dénonçant les luttes revendicatives comme des moments de soumission au capital, "Pouvoir Ouvrier ", au contraire, se complaisait dans une position semi-trotskisante, se bornant à regretter l'étroitesse de vue des directions syndicales quand même utiles au prolétariat.
On peut dire que cette
confusion entre luttes revendicatives de la classe et action des syndicats est
un des points cruciaux de l'incompréhension de ce que doit être l'attitude des
groupes révolutionnaires face aux syndicats.
Si les révolutionnaires combattent les syndicats, c'est justement parce
que ceux-ci ont comme rôle de faire avorter les luttes revendicatives, de détruire
leur potentialité POLITIQUE et REVOLUTIONNAIRE.
Ce sont les syndicats et les gauchistes qui tentent justement d'opposer
le caractère revendicatif des luttes ouvrières à leur contenu objectivement
POLITIQUE dans la décadence. Ce contenu
révolutionnaire est d'autant plus latent qu'il n'y a plus de place pour une
POLITIQUE REFORMISTE EFFECTIVE comme au XIXème siècle. C'est pourquoi la lutte contre les syndicats
est un point crucial pour la classe à tout moment de sa lutte.
Aujourd'hui, le développement général des luttes revendicatives de la classe
ouvrière mondiale est le creuset dans lequel se forge l'activité consciente du
prolétariat à travers la rupture avec l'encadrement contre-révolutionnaire des
syndicats. Cette activité consciente ne
peut que s'opposer à la FORME
et au CONTENU des syndicats ce point essentiel qui est à la base du rejet
de" l'activité des révolutionnaires au sein des syndicats a donné lieu à
des caricatures ou des incompréhensions dues d'abord à un bilan insuffisant de
la vague révolutionnaire des années 20.
AUJOURD'HUI : LE FOR, LE GCI, LE PIC
C'est sur ce dernier plan qu'il faut développé la critique de groupes comme le FOR, le Groupe Communiste Internationaliste (GCI) et aussi le PIC (Jeune Taupe) ([3] [152]). Tous ces groupes font la critique des syndicats et rejettent tout travail en leur sein. Mais, en même temps, ces groupes ne parviennent pas à saisir ce qu'a représenté le surgissement des Conseils Ouvriers en tant que forme d'organisation unitaire de la classe.
Ce qu'a représenté le Conseil Ouvrier, le soviet, comme nouvelle forme d'organisation du prolétariat, c'était une rupture de fond avec l'organisation syndicale. Le Conseil était d'abord un organe POLITIQUE de masse dont la pratique ne pouvait qu'être antagonique aux syndicats, la nature "anti-bureaucratique" du Conseil Ouvrier n'est pas une question formelle mais une question de vie du Conseil lui-même. Ce caractère déterminant des Conseils Ouvriers fut ainsi décrit par Trotski dans son ouvrage sur 1905
"Le Conseil des députés ouvriers fut formé pour répondre à un besoin objectif, suscité par les conjonctures d'alors : il fallait avoir une organisation jouissant d'une autorité indiscutable, libre de toute tradition, qui grouperait du premier coup les multitudes disséminées et dépourvues de liaison ; cette organisation devait être un confluent pour tous les courants révolutionnaires à l'intérieur du prolétariat ; elle devait être capable d'initiative et se contr6ler elle-même d'une manière automatique ; l'essentiel, enfin, c'était de pouvoir la faire sortir de terre dans les 24 heures. L'organisation sociale-démocrate qui unissait étroitement, dans ses retraites clandestines, quelques centaines, et, par la circulation des idées, plusieurs milliers d'ouvriers à Petersbourg, était en mesure de donner aux masses un mot d'ordre qui éclaircirait leur expérience naturelle à la lumière fulgurante de la pensée politique, mais le parti n'aurait point été capable d'unifier par un lien vivant, dans une seule ORGANISATION, les milliers et les milliers d'hommes dont se composait la multitude... Le soviet organisait les masses ouvrières, dirigeait les grèves et les manifestations, armait les ouvriers, protégeait la population contre les pogroms. Mais d'autres organisations révolutionnaires remplirent la même tâche avant lui, à côté de lui et après lui ; elles n'eurent pourtant pas l'influence dont le soviet jouissait. Le secret de cette influence est en ceci : cette assemblée sortit ORGANIQUEMENT du prolétariat au cours de la lutte directe, prédéterminée par les événements, que mena le monde ouvrier POUR LA CONQUETE DU POUVOIR... Le soviet réalisait le pouvoir dans la mesure où la puissance révolutionnaire des quartiers ouvriers le lui garantissait... Le soviet devient immédiatement l'organisation même du prolétariat ; son but est de lutter POUR LA CONQUETE DU POUVOIR REVOLUTIONNAIRE".
(Trotski, extraits de 1905).
Ce que Trotski indiquait, c'est que le Conseil Ouvrier était en fait la FORME la plus apte à exprimer l'activité révolutionnaire du prolétariat et il ne s'agissait pas pour lui de nier le rôle des organisations révolutionnaires, du Parti, mais de montrer- la SUPERIORITE fondamentale des Conseils Ouvriers comme centre vital de l'action consciente de la classe. C'est la permanence de l'activité révolutionnaire des masses ouvrières qui permet au Conseil d'exister. Bien au contraire, ce qui caractérisa au départ les syndicats, c'était leur tendance au conservatisme de par leur fonction et leurs liens avec la classe ouvrière. C'est ce point qu'un groupe comme le GCI ne comprend absolument pas
"Pour plusieurs raisons, le problème fondamental d'une alternative ouvrière face aux syndicats n'est pas une question de forme d'organisation. En premier lieu, le remplacement de la forme syndicale par une forme différente (le conseil, par exemple), n'implique pas obligatoirement la rupture avec le réformisme et peut même représenter l'une ou l'autre de ses formes extrêmes"
("Le Communiste", n° 4, page 29).
L'indifférence à la question des formes d'organisation du prolétariat est en fait une indifférence à son expérience historique qui est à la base de la compréhension de l'importance de cette question. Il ne s'agit pas de faire ici une idéalisation des Conseils Ouvriers qui peuvent dégénérer rapidement dans certaines conditions, qui peuvent être détruits de l'intérieur par des forces bourgeoises. Il s’agit de RECONNAITRE le processus qui exprime l'activité révolutionnaire de la classe dans la phase de décadence. Un groupe incapable d'assurer cette analyse ne peut qu'osciller entre l'attentisme et le volontarisme. C'est le cas du FOR qui, ne sachant pas comment la classe lutte et s'organise, porte sur le passé et le présent les jugements les plus contradictoires; ainsi, pour ce groupe, il y avait une révolution prolétarienne en 36 en Espagne
"En Espagne 36 par contre, il n'existait pas un seul conseil avant que le prolétariat ne mit en pièces l'armée nationale et, avec elle, toutes les structures capitalistes".
(Texte présenté par le FOR à la 2ème Conférence Internationale - compte-.rendu page 36).
L'indifférence par rapport à la question de l'organisation du prolétariat amène ainsi à des erreurs tragiques qui consistent à voir la révolution alors qu'il n'y a que la mobilisation contre-révolutionnaire du prolétariat derrière des intérêts qui lui sont étrangers. En Espagne, non seulement il n'y avait plus de groupes communistes internationalistes conséquents, mais il n'y avait même pas la base même d'une action organisée et consciente de la classe qui fut entraînée au massacre. Aujourd'hui, le FOR, malgré la multiplicité des signes qui révèlent une reprise de la vie de la classe ouvrière, prononce une sentence tout aussi arbitraire et irresponsable :
"Aujourd'hui, la majorité des grèves sont des grèves misérables qui, loin de démontrer la combativité révolutionnaire du prolétariat, marquent en fait sa profonde soumission... Les grèves d'aujourd'hui pour la grande majorité des cas sont en fait des NON-GREVES qui, loin de faire trembler le système dans son ensemble, le renforcent".
("Alarme" n° 3, janvier 1979).
En
voulant opposer aux luttes et aux grèves encore encadrées par les syndicats un
contenu réellement "subversif", ces groupes se contentent d'émettre
des vœux pieux, des souhaits qui, aussi justes soient-.ils, n'aident en rien
l'action de la classe ouvrière. Nous
sommes dans une période où les positions des révolutionnaires sur le contenu et
la forme des luttes peuvent commencer à avoir une influence sur le cours des
choses. La critique, la dénonciation des
syndicats doit porter sur tous les aspects de leurs interventions dans la
classe; à ce moment-là, la question de savoir "comment lutter ?" est
un point décisif pour la classe ouvrière.
Des révolutionnaires attachés à la seule critique des mots d'ordre
revendicatifs de la classe seraient tout aussi inutiles à la classe ouvrière
que des révolutionnaires obnubilés par la question du mode d'organisation de la
lutte. En ce sens, la rupture avec les
syndicats et le syndicalisme n'est pas une simple position abstraite ou
"de principe", elle prend aujourd'hui tout son sens PRATIQUE. Si, dans la période de contre-révolution, la
question syndicale, en l'absence de toute vie de la classe, avait pu avoir un
caractère non directement essentiel, aujourd'hui, la compréhension HISTORIQUE
de cette question est directement liée à
la compréhension de ce qu’est 1’auto-organisation du prolétariat. La bataille au sein des luttes pour des
Assemblées générales souveraines, pour des comités de grève élus et révocables
est un ASPECT ESSENTIEL de l'intervention des révolutionnaires. Et cela n'a rien à voir avec du fétichisme
démocratique : la vie et l'activité consciente de la classe ouvrière est une
condition nécessaire pour que celle-ci assume ses tâches révolutionnaires. Contrairement à ce que pense le FOR, sans
organes unitaires de masse, le prolétariat ne peut pas affronter l'Etat
capitaliste. Les petites organisations
révolutionnaires, quand bien même elles gagneraient une influence, seraient
bien incapables d'assurer ce rôle irremplaçable d'unificateur de la classe
ouvrière. Cette bataille pour
l'auto-organisation de la classe dans ses luttes est inséparable de la
dénonciation des syndicats et de leurs tactiques multiples partout où les
ouvriers se posent la question de "comment lutter ?".
Les révolutionnaires doivent montrer en quoi ce mode d'organisation de lutte préfigure la lutte révolutionnaire du prolétariat, c'est-à-dire exige la rupture avec les forces contre-révolutionnaires de gauche et des syndicats. Les assemblées générales doivent être la concrétisation de la rupture de la classe avec les syndicats, les comités de grève élus et révocables doivent être les embryons des Conseils d'usine et des Soviets. Les groupes révolutionnaires qui sous-estimeraient l'importance cruciale pour la classe de se doter de tels organes s'avéreraient être des facteurs d'affaiblissement et de dispersion de l'activité de la classe ouvrière. Ce que le FOR et le GCI perpétuent, c'est un manque de confiance dans la force autonome du prolétariat qui les amène à développer une analyse parcellaire de son mouvement, à mythifier certains aspects secondaires des luttes, à sous-estimer d'autres aspects décisifs.
Le PIC, quant à lui, reproduit aujourd'hui les vieux préjugés conseillistes "anti-parti", ce qui l’a amené à plusieurs reprises à des contorsions politiques tout à fait stériles sur la question de l'intervention des révolutionnaires l'amenant à faire une séparation entre les "groupes ouvriers" et les organisations communistes (voir RI n° 43) et à développer un type de propagande abstrait axé sur la défense des buts finaux du prolétariat (abolition du salariat, des rapports marchands, à bas le droit au travail, etc.), comme si de tels mots d'ordre diffusés au sein des luttes pouvaient accélérer l'auto-organisation de la classe. Là encore, il s'agit d'une démarche consistant à insister sur ce qui sépare, au niveau de la conscience, les révolutionnaires des autres prolétaires au lieu de mettre l'accent sur les nécessités des luttes telles qu'elles sont, de dire clairement ce que les prolétaires pensent confusément. S'il est essentiel de défendre les buts historiques de la classe, de les mettre en avant à chaque étape des luttes, cela est insuffisant et procède d'ailleurs d'une démarche partitiste typique qui consiste à agir dans le seul but de gagner la classe aux "idées" communistes. Le rôle des communistes dans la période est aussi de participer à toutes les étapes pendant lesquelles la classe reprend confiance en sa force et en sa capacité d'organisation autonome.
Aujourd’hui dans une certaine mesure, la question syndicale comme telle commence à être dépassée. De plus en plus nettement, la lutte réelle va saper les dernières illusions syndicalistes auxquelles certains groupes restent attachés. Pour ces groupes il va falloir choisir et même choisir rapidement s'ils ne veulent pas se retrouver au service de la contre-révolution, se traînant derrière le tacticisme anti-prolétarien des trotskistes. Sur ce plan, il ne suffit pas de nuancer ses positions comme le fait actuellement le courant bordiguiste, il faut répondre clairement à la question de savoir si l'existence d'associations économiques prolétariennes est encore possible dans la décadence, si le ressurgissement de telles associations est un préalable à la révolution. Mais pour toutes les autres organisations prolétariennes qui ont su dépasser cette fausse problématique se pose maintenant la question du mouvement autonome de la classe, la question de l'intervention des révolutionnaires dans ce mouvement, en fait, la question du Parti et de son rôle et aussi la question de sa formation. Ce débat va devenir une question de plus en plus pratique et dans un sens, la résolution de ce qu'a été le problème syndical nous donne une partie des éléments de la résolution de ces "nouveaux" problèmes qui n'ont pas pu être tranchés lors de la dernière vague révolutionnaire.
Août 1980 - Chénier
[1] [153] Fort peu de textes de "BILAN" traitent directement de la question syndicale, mais même s'il y avait une sorte de position officielle qui restait attachée à l'optique léniniste, la reconnaissance de la décadence du capitalisme amena une tendance au sein de "BILAN" à réévaluer ce point des syndicats comme l'exprime notamment l'extrait du rapport de Vercesi cité plus loin dans cet article.
[2] [154] Aujourd'hui, Battaglia Comunista reste toujours aussi confuse sur le point de l'activité syndicale des militants révolutionnaires. D'un côté, ce groupe prône la formation de groupes d'usines "intemationalistes", sorte de courroie de transmission du Parti dans les entreprises, d'un autre côté, Battaglia Comunista défendait clairement lors de la Première Conférence Internationale la nécessité de la présence de ses militants dans les syndicats et parlait même d'une plate-forme syndicale du Parti (page 53 du compte-rendu), tout cela au nom de la tactique.
[3] [155] En ce qui concerne la CWO, nous n'avons pas de divergences de fond et de principe sur la question syndicale avec ce groupe. Cependant, à la lecture des critiques incessantes que la CWO porte au CCI sur la question de l'intervention dans les luttes immédiates, on peut relever que ce groupe, bien que virant au partitisme de secte, continue à défendre des préjugés conseillistes typiques faisant une distinction entre luttes partielles du prolétariat et luttes généralisées. Ainsi, ce groupe se refuse à intervenir dans les organes de lutte des ouvriers si la lutte n'a pas atteint un certain niveau d'extension et d'auto-organisation. Par ailleurs, la CWO s'est mise à découvrir le caractère "positif" de certaines revendications économiques immédiates par rapport à d'autres qui seraient négatives. Cette constatation empirique que chaque prolétaire peut faire par lui-même sans le secours au marxisme et qui consiste à comprendre par exemple que les augmentations en pourcentage sont moins "unificatrices" que les augmentations uniformes fait maintenant partie de 1 'arsenal programmatique de la CWO qui, dans ce cas-là, ne fait que reprendre les préjugés des bordiguistes. Malheureusement, ce n'est pas en reprenant les erreurs des différents courants politiques qu’on arrive à développer une orientation cohérente, et, sur ce plan, la CWO a encore beaucoup à apprendre.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Réponse au COMMUNISME DE CONSEIL (Danemark)
- 2738 reads
Les "21 Thèses du Communisme de Conseil aujourd'hui" écrites par un groupe de communistes de Conseil du Danemark expriment le fait que la résurgence des groupes et des idées révolutionnaires entamée en 1968 continue. Ce n'est pas un hasard si ces Thèses sont parues au printemps 80, à la suite d'un haut niveau de lutte de classe en France, en Grande Bretagne, en Hollande, etc, et seulement quelques semaines avant la grève générale en Suède. Nous ne pouvons ignorer en outre l'exemple magnifique donné récemment par la grève de masse en Pologne, qui confirme que nous sommes dans une période de montée de luttes de classe ouvrant la voie à une série d'insurrections prolétariennes. Les contributions des camarades danois ne sont vues que dans cette optique -comme un autre signe des temps que nous vivons. Espérons que leurs contributions stimuleront d'autres discussions et aideront à clarifier les positions dont les révolutionnaires ont besoin pour leur intervention dans cette période décisive de l'histoire.
Nous ne croyons pas que la discussion entre révolutionnaires serve à marquer des points contre les autres groupes ou à comparer différentes informations locales de façon académique. Nous croyons que les groupes révolutionnaires ont la responsabilité de discuter dans le but de clarifier leurs idées. Ils le font parce qu'il est crucial d'avoir des idées claires quand on intervient dans la lutte de classe. En fin de compte, c'est dans le feu de la lutte de classe, dans la pratique, que la validité des positions révolutionnaires est testée. Les discussions entre groupes révolutionnaires sont donc une partie vitale de leur activité. Avec ceci en tête, nous pensons que la façon la plus efficace pour les révolutionnaires d'intervenir dans la lutte de classe internationale, c'est de regrouper leurs forces sur des bases claires, et à une échelle internationale. C'est un processus qui ne peut s'établir que grâce à une clarification politique systématique et fraternelle, qui permette la confrontation ouverte des idées. C'est dans cet esprit, avec ce but ultime, que nous contribuons à la discussion entre révolutionnaires avec ces remarques critiques, en réponse aux "Thèses du communisme de conseil"
I."LE CAPITALISME, LA CRISE, LA REVOLUTION, LE COMMUNISME"
Cette partie des Thèses défend beaucoup de positions de classe qui font partie intégrante du mouvement communiste. Les camarades affirment, avec Marx, que la seule solution progressive à la crise capitaliste, c'est la révolution prolétarienne. Ils défendent donc la dictature du prolétariat, sans l'identifier avec la domination d'un parti, comme le font les substitutionistes d'aujourd'hui. Au lieu de cela, la dictature du prolétariat est identifiée avec la domination des conseils ouvriers :
"Le résultat de la révolution c'est la prise de possession autonome du pouvoir et de la production pour les besoins humains. Le conseil ouvrier est donc l'élément fondamental de la lutte anti-capitaliste, de la dictature de la classe ouvrière re et de la société communiste future." (Thèse n°4).
Cependant, il est aussi affirmé que :
" ... le capitalisme sera et devra être détruit dans le procès de production, c'est à dire dans la lutte autonome des ouvriers pour le contrôle de telle ou telle usine. Les ouvriers sont directement et pratiquement les maîtres des machines." (Thèse n°2).
Cette conception nous semble fallacieuse parce qu'elle place tout le centre de la lutte de classe au niveau de la production ou dans le procès de production, comme le fait la tradition anarcho-syndicaliste. Mais l'histoire a prouvé que cette perspective est fausse. De plus, il n'est pas vrai que les ouvriers sont directement et pratiquement les maîtres des machines. Il est clair que le capitalisme possède et maîtrise les machines, et le capitalisme, ce n'est pas simplement du capital fixe, c'est avant tout un rapport social basé sur l'exploitation du travail salarié. C'est vrai, les ouvriers ne peuvent s'émanciper sans détruire tout l'appareil hiérarchisé servant à l'exploitation qui règne dans l'industrie. Mais, ce n'est pas seulement le despotisme à l'usine qui assure les conditions d'exploitation de la classe ouvrière. Tout l'appareil politique de l'Etat aide à assurer, indirectement et directement, à l'aide de mystifications ou en utilisant ouvertement la terreur, la subordination totale du prolétariat au capitalisme. L'Etat, comme nous le savons, fait partie de la superstructure du capitalisme. Mais cela ne l'en rend pas moins décisif ou moins important. Au contraire, en tant que gardien de tous les intérêts capitalistes, il joue un rôle bien plus pernicieux pour la classe ouvrière que les patrons ou les contremaîtres de telle ou telle usine particulière.
Les ouvriers devront donc détruire cette domination politique de l'Etat sur la société. Les ouvriers prendront conscience de cette nécessité quand ils commenceront à se voir eux-mêmes comme une force capable de transformer l'ensemble de la société, et pas seulement une somme d'usines particulières, grâce à leur action de masse unitaire. A partir de ce moment là, le mouvement de la lutte de classe prendra des proportions réellement insurrectionnelles. Il est clair que les ouvriers ne peuvent apprendre à agir collectivement à cette échelle, s'ils restent à l'intérieur de "leur" usine particulière. Ils doivent dépasser les séparations artificielles que leur impose le capitalisme, et qui sont symbolisées par les portes des usines. Nous ne sommes donc pas d'accord non plus avec cette conception :
"La base de la révolution c'est le pouvoir économique des conseils, organisé sur la base de chaque usine, mais quand l'action des ouvriers est devenue si puissante que les organes même du gouvernement s'en trouvent paralysés, alors les conseils doivent aussi prendre en charge des fonctions politiques".
Ici, nous voudrions faire remarquer que le "pouvoir économique des conseils", sur la base de chaque usine, est illusoire tant que l'Etat capitaliste domine encore la société et défend l'économie nationale. La condition préalable de toute transformation économique et sociale réelle et durable, c'est l'abolition de l'Etat capitaliste. Les conseils ouvriers, bien loin de devoir attendre de passer par une période de "pouvoir économique" avant d'assumer des fonctions politiques, doivent adopter immédiatement des fonctions politiques s'ils veulent survivre aux manœuvres de l’Etat.
La récente grève de masse en Pologne confirme amplement cette tendance qui n'émerge clairement que dans la décadence du capitalisme (voir notre éditorial : "La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne" dans la Revue Internationale n°24). Là, les mesures prises par les ouvriers pour se défendre économiquement se sont mêlées à des poussées politiques qui tendent vers la confrontation avec l'Etat, qui visent à exposer sa police terroriste secrète, etc. Imaginer que pendant une grève de masse, les ouvriers devraient limiter leurs actions aux occupations d'usines, comme ils l'ont fait, malheureusement, en Italie en 1920, revient à limiter arbitrairement l'ampleur révolutionnaire de leurs activités. La classe ouvrière n'a pas besoin de passer par une sorte d'apprentissage scolaire de "maîtrise de la production" pour pouvoir confronter l'Etat.
L'Etat ne peut pas être isolé ou paralysé si les ouvriers mènent des actions essentiellement défensives et isolées sur le lieu de production. La seule façon de saper 1’Etat, c'est par un processus de double pouvoir, dans lequel les organes de domination de masse du prolétariat imposent sans cesse davantage leur volonté politique à l'Etat. Ceci ne peut pas être un processus permanent, et très certainement, ça ne peut pas être non plus une "période d'apprentissage" permettant d'acquérir des qualifications en une prétendue maîtrise économique. La période de double pouvoir, qui combine dès le début les offensives économiques et politiques, doit tôt ou tard aboutir à une tentative insurrectionnelle par les conseils ouvriers. C'est la seule façon de renverser l'Etat. Ne croyons pas que l'Etat, cette machine de terreur si rusée, acceptera tout simplement sa défaite du fait des occupations d'usines.
D'accord, il y aura un moment où l'offensive des conseils ouvriers sera si puissante que l'Etat devra reculer, et commencera même à se désintégrer. Mais cela n'arrivera que si, dès le début, les organes ouvriers de masse réussissent à combiner les méthodes de lutte économiques et politiques. Le processus de la grève de masse implique non seulement le contrôle des usines (de l'ensemble des usines, et non pas "une par une"), mais aussi l'armement croissant du prolétariat et de la population qui se range du côté des ouvriers (l'analyse de la grève de masse par Rosa Luxemburg dans "Grève de masse, parti et syndicats" nous parait être fort à propos pour la période actuelle. Particulièrement les parties qui traitent des rapports entre les luttes politiques et économiques du prolétariat).
Les conceptions que défendent les Thèses sur les conseils ouvriers nous paraissent similaires à celles d'Antonio Gramsci, le révolutionnaire italien, qui a théorisé son point de vue dans le journal "L'Ordine Nuovo" au début des années 20. Gramsci déclarait que ses idées résultaient des expériences concrètes du prolétariat russe. Mais en cela, il avait tort. Toute la dynamique des soviets ouvriers en Russie de février à octobre 17 a consisté à s'opposer à l'Etat capitaliste de Kerenski. Le mouvement des comités d'usine et pour le "contrôle ouvrier" faisait partie dès le début de cette attaque massive. C'est un cas classique de dualité de pouvoir, comme Trotski le décrit si bien dans son "Histoire de la révolution russe". C'était facile pour la classe ouvrière en mouvement de comprendre que si elle ne jetait pas Kerenski dehors, rien de durable ne pourrait être fait dans les usines. Ce n'est qu'après le renversement de Kerenski en octobre qu'il a été possible de réorganiser les ressources économiques internes du prolétariat russe afin de les mettre à la disposition de la révolution mondiale. Que la révolution d'Octobre se soit trouvée isolée à la fin, et qu'elle ait encore plus dégénéré sous la politique erronée des bolcheviks et du Kominterm n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Ce que nous essayons d'expliquer c'est que Gramsci a déformé l'expérience des soviets ouvriers en Russie. Nous allons développer cette idée.
Gramsci a théorisé pour
l'Italie une révolution fondée sur une prise de contrôle graduelle de la
société par les soviets ouvriers.
D'après les conceptions de Gramsci, les comités d'usine russes et les
soviets ouvriers avaient assumé ce processus de prise de contrôle économique en
Octobre. Mais cela ne s'est pas passé
ainsi : en Russie, les comités d'usines et leurs tentatives en vue du
"contrôle ouvrier" étaient des armes politiques de la classe
ouvrière, non seulement contre les patrons, mais aussi contre le
gouvernement. Ce que les ouvriers ont
appris dans ce processus de dualité de pouvoir était politique, en d'autres
termes, ils ont appris comment gagner l'hégémonie politique sur la société
contre l'Etat capitaliste. Mais d'après
le point de vue de Gramsci, l'ouvrier devrait d'abord se concevoir lui-même
comme un "producteur" dans telle ou telle usine particulière. Ensuite seulement il pourrait gravir quelques
échelons de plus sur l'échelle de la conscience de classe
"Partant de sa totalité originelle, l'usine (sic) vue comme unité, comme acte qui crée un produit particulier, l'ouvrier en arrive à la compréhension d'unités toujours plus vastes, et cela jusqu'au niveau de la nation elle-même".([1] [156])
A partir de cette hauteur sublime, la nation, Gramsci a élevé son ouvrier individuel jusqu'au niveau du monde, puis du communisme :
"A ce point précis, il est conscient de sa classe; il devient communiste, parce que la propriété privée n'est pas nécessaire à la productivité; il devient révolutionnaire parce qu'il voit le capitaliste, le détenteur de la propriété privée, comme un poids mort, comme une gêne dans le processus productif qu'il faut supprimer". ([2] [157])
Du haut de cette "conscience accrue" (que certains pourraient appeler du délire technocratique) Gramsci fait atteindre à son ouvrier le pinacle de l'illumination : la prise de conscience de l'Etat ce "gigantesque appareil de production" qui développera "l'économie communiste" d'une façon "harmonieuse et hiérarchique". ([3] [158])
D'après le schéma de Gramsci, les ouvriers parviennent à la conscience de classe non pas au travers de la lutte de classe, comme Marx l'a décrit, mais en passant par un processus pédagogique graduel d'acquisition d'une "maîtrise économique". Gramsci voyait les ouvriers comme une somme de fourmis isolées qui, à partir de leur vile existence, ne pouvaient atteindre la rédemption qu'en prenant conscience de leur place dans un plan économique grandiose, dans une fourmilière étatique. Mis à part l'aspect entomologique, c'est une vision idéaliste de la lutte de classe, et qui a été un élément dans l'évolution de Gramsci vers l'opportunisme. La révolution prolétarienne n'est pas déterminée par le niveau d'éducation préalable des ouvriers, ni par leur culture ou leur habileté technique. Au contraire, la révolution prolétarienne a lieu précisément pour obtenir et généraliser à toute l'humanité ces progrès culturels et techniques qui existent déjà dans la société. La révolution est produite par la crise du système capitaliste. Vous l'affirmez correctement quand vous dites :
"Les actions capitalistes surgissent de façon spontanée. C'est le capitalisme qui force les ouvriers à les mener. L'action n'est pas proclamée à l'avance avec une intention consciente; elle surgit spontanément et irrésistiblement " (thèse n°3)
C'est pourquoi il est faux d'imaginer que la révolution prolétarienne se développera graduellement, partant de l'unité cellulaire d'une usine particulière pour arriver à la société toute entière, à travers le processus pédagogique envisagé par Gramsci. Historiquement, les grands surgissements révolutionnaires de la classe ouvrière ne se sont pas développés de cette façon schématique. C'est vrai, des incidents particuliers ont servi de détonateurs à des actions de masse dans le passé, et cela arrivera encore. Mais ceci n'a rien à voir avec l'idée que la conscience de classe croit comme un conglomérat de tous ces petits incidents, ou comme le résultat de 1"'expérimentation" du "contrôle ouvrier". En tous les cas, les incidents particuliers qui peuvent servir de détonateurs à une réaction de masse ne sont pas limités à telle ou telle usine et encore moins au lieu de production. Ils peuvent arriver lors d'une manifestation, à un piquet de grève, dans une queue devant une boulangerie, à un bureau de chômage, etc. En ce qui concerne le contrôle ouvrier, Paul Mattick est tout à fait correct quand il dit :
"Le contrôle ouvrier de la production présuppose une révolution sociale. Il ne peut être réalisé graduellement par des actions de la classe ouvrière au sein du système capitaliste".
Les idées de Gramsci avaient fondamentalement une substance réformiste et ouvraient la porte à l'idée que les ouvriers peuvent apprendre à contrôler la production capitaliste de façon permanente au sein même du capitalisme. Cette idée est doublement incorrecte puisque la raison d'être de la révolution ouvrière n'est pas le contrôle de la production capitaliste, et ce n'est pas non plus 1"'autogestion" ou la "maîtrise de la production" au sein du capitalisme. Tout ça, ce sont des mythes capitalistes, même s'ils sont présentés à la façon vénérable et "violente" des anarcho-syndicalistes.
Comme vous en faites la remarque, les conseils ouvriers apparaissent spontanément et massivement dans la société durant une situation pré-révolutionnaire. Ils ne sont pas préparés à l'avance, "techniquement" ou "économiquement". La crise du capitalisme pousse finalement les ouvriers à s'unifier à tous les niveaux. -économique, politique, social - dans les usines, dans les quartiers, dans les docks et les mines, dans tous les lieux de travail. Leur but final ne peut être que la destruction de l'Etat capitaliste. Leur but "immédiat" est donc de se préparer pour le pouvoir politique. Quelles que soient les mesures "de contrôle ouvrier" prises dans les lieux de travail ou dans la société en général, ces mesures sont strictement subordonnées à ce but urgent et immédiat : désorganiser et isoler le pouvoir de l'Etat capitaliste. Sans ce but, les actions autonomes des ouvriers seront désordonnées et fragmentées, car elles n'auraient ni axe, ni but à poursuivre. Le but de "la maîtrise économique" de chaque usine fournirait une myriade de "petits objectifs particuliers", qui tous disperseraient les forces unifiées des ouvriers. Ce but émousserait l'offensive des conseils ouvriers, réduisant leur tâche à celle de faibles "comités d'usine" préoccupés uniquement des affaires de leur "usine particulière". Mais, de la même façon que le socialisme ne peut être préparé ou réalisé dans un seul pays, de même il ne peut l'être dans une seule usine.
La dernière Thèse de cette partie (n°7) explique que le fondement de la société communiste, c'est la production de valeurs d'usage :
"Il est décisif pour l'économie politique du communisme que le principe du travail abstrait ait été aboli : que la loi de la valeur ne domine plus la production de valeur d'usage. L'économie politique du communisme est tout à fait simple : les deux éléments fondamentaux sont le temps de travail concret et les statistiques."
Ceci est correct mais incomplet puisqu'il n'est pas fait mention de la dimension internationale de la révolution prolétarienne. En fait, c'est l'élément décisif dans l'élimination graduelle de la loi de la valeur : la révolution mondiale qui permettra à la classe ouvrière d'avoir un accès illimité à toutes les ressources crées précédemment par le capitalisme. Nous n'appellerions pas le mode de production communiste une "économie politique du communisme" puisque cette formule implique la survivance de la politique et de l'économie qui sont les traits fondamentaux du capitalisme. Nous remarquons aussi que la période de transition du capitalisme au communisme n'est pas mentionnée mais la révolution mondiale n'arrivera pas en un jour. Nous devons donc nous attendre à toute une période historique, plus ou moins longue, durant laquelle l'Etat capitaliste sera renversé partout, et les vestiges du capitalisme éliminés sur toute la planète. Ce n'est qu'alors que la classe ouvrière sera vraiment capable de rejeter les vestiges de la loi de la valeur et de dépasser les mesures temporaires, quelles qu'elles soient, qu'elle a dû prendre contre la pénurie ou les difficultés techniques. Supposer l'existence "d'une économie communiste" dans un seul pays serait donc une erreur fondamentale. C'est l'une des ambiguïtés qui apparaissent dans les "Principes fondamentaux de la production et de la distribution communistes" écrit par le GIK-H (Groupe des communistes internationaux de Hollande) et une question que les révolutionnaires aujourd'hui doivent clarifier.
Avant de discuter de la deuxième partie de vos Thèses, nous voudrions vous signaler que, votre analyse même courte des causes de la crise capitaliste ne mentionne pas un principe fondamental du matérialisme dialectique. A savoir, est-ce que, le mode de production capitaliste est devenu caduque ? Ou, pour employer le concept même de Marx, est-ce qu'il est entre dans son déclin ? C'est une question décisive pour les révolutionnaires et la classe ouvrière. Pour le CCI, le système capitaliste est un système de production décadent depuis la première guerre mondiale. Cette position est au cœur de notre plate-forme politique.
Affirmer que le capitalisme est encore ascendant ou jeune (même si ce n'est "que" dans certaines zones du monde), équivaudrait à dire que la révolution communiste ne serait pas à l'ordre du jour au moins pour cette période historique a venir. Une pratique politique, spécifique et fausse, résulterait de cette affirmation.
D'autre part, nier que le concept marxiste de décadence s'applique aussi au mode de production capitaliste serait une grave erreur méthodologique, conduisant à des pratiques aberrantes.
Vous mentionnez aussi le fait que la surproduction n'est pas la raison de la crise économique. Ceci peut sembler être une critique à l'encontre de Rosa Luxemburg, qui a précisément analysé ce problème dans "L'accumulation du capital ". Cependant l'analyse de Luxemburg est avant tout une analyse du déclin historique du système capitalistes et de son époque impérialiste. C'est clairement une question pertinente ici que de poser la question du marché et donc de la surproduction, et non quelque chose qu'on peut ignorer en invoquant l'idée de "sous-consommation" (ce qui n'était pas la position de Luxemburg). Même Mattick, qui a critiqué les conceptions de Luxemburg de façon consistante ne peut laisser de côté la question des marchés
"(…) la crise doit d'abord faire son apparition à la surface du marché, même si elle était déjà présente dans les rapports de valeur modifiées dans le procès de production. Et c'est par la vole du marché que la réorganisation nécessaire du capital est accomplie, même si ceci doit être rendu réel par des changements dans les rapports d'exploitation capital-travail au niveau de la production". (5)
Nous n'avons pas à suivre le réductionnisme de Mattick qui transforme la crise de surproduction en une simple manifestation du changement des rapports de valeur au niveau de la production. Mais il est évident que la crise des marchés exprime la limite historique du capitalisme dans son époque impérialiste. Cette limite est violemment confirmée par la guerre impérialiste de 1914. Mattick n'a pas répondu clairement à cette question le capitalisme est-il entré dans sa phase décadente ou non ? Luxemburg a répondu OUI et a fourni l'analyse pour appuyer cette affirmation matérialiste. Ceux qui insistent pour dire que la seule raison de la crise, c'est la baisse du taux de profit, avec sa lutte de la classe correspondante "au niveau de la production", passent généralement sous silence la question de la décadence, et laissent donc de côté l'analyse globale du capital faite par Marx, qui incluait les crises de surproduction. Depuis 1914, cette crise est devenue permanente, au moment où l'expansion capitaliste atteignait une limite structurelle dans un marché mondial divise par l'impérialisme.
Comment et quand le capitalisme atteindrait son apogée, puis son déclin, de même que les modes de production précédents avaient connu un déclin, cela, Marx ne pouvait pas le comprendre complètement. Mais c'est certainement une question légitime pour les révolutionnaires. Elle était au cœur du débat entre Luxemburg et Bernstein à propos du réformisme, et plus tard entre Luxemburg et la gauche de la Social-démocratie allemande (marxiste) contre la droite et le "centre" de Kautsky dans le SPD. Nous disons donc sans hésitation que le problème vraiment fondamental contenu dans la question : "quelle est la raison de la crise capitaliste ? " c'est le problème de la DECADENCE CAPITALISTE.
Nous sommes d'accord sur le fait que le capitalisme décadent souffre de façon interne de la croissance de la composition organique qui rendra impossible (tendanciellement) davantage d'accumulation, et qu'il souffre aussi d'un problème externe (qui affecte aujourd'hui l'ensemble de l'économie mondiale) qui consiste dans le manque de marché profitable.
Comment ces deux crises mortelles réagissent réciproquement et comment elles se complètent l'une l'autre est un problème très complexe. La question n'est pas de nier l'une au profit de l'autre, la question c'est de voir comment elles expriment le pourrissement total du système aujourd'hui.
POUR LES MARXISTES, LA QUESTION DE LA DECADENCE CAPITALISTE EST UNE QUESTION CRUCIALE ET TRES PRATIQUE.
II "LES ORGANISATIONS OUVRIERES CAPITALISTES"
"La base de la social-démocratie, c'est la conscience immédiate des masses".
Mais cette définition ambiguë implique que la social-démocratie est une étape dans la conscience de la classe ouvrière. Rien ne peut être plus loin de la vérité. L'histoire des partis sociaux-démocrates montre qu'à partir de 1914, ils sont passés du côté du capitalisme. La première guerre mondiale a été le test décisif quand ils ont soutenu la boucherie impérialiste. Ce test allait bientôt être confirmé encore davantage par l'attaque de la révolution d'Octobre par ces partis -social-démocratie, menchévisme, "Internationale socialiste"- quel que soit le nom sous lequel se présente cette répugnante faction capitaliste, elle a définitivement traversé la frontière de classe. Dans tous les pays où ils existent, les partis sociaux-démocrates font partie de l'appareil politique de la bourgeoisie. La social-démocratie n'est pas au service de la bourgeoisie, ELLE EST UNE FRACTION DE LA CLASSE CAPITALISTE.
Dire que les ouvriers ont des illusions sur la social-démocratie est une chose. Mais c'en est une autre de dire que ces illusions constituent quelque chose comme un niveau ou une phase de la conscience propre à la nature de la classe ouvrière. La conscience de classe n'est pas une masse d'illusions et de mystifications. C'est la perception juste de sa position de classe dans la société, de son rapport aux moyens de production, à l'Etat, aux autres classes, et, avant tout, la perception de ses buts révolutionnaires. Les illusions, l'idéologie, les mystifications, sont produites par la société capitaliste qui affectent inévitablement le prolétariat en déformant sa conscience de classe. Marx dit que les idées dominantes d'une société sont les idées de sa classe dominante. C'est vrai en général, mais pour le prolétariat, cela veut seulement dire qu'il peut être sous l'influence de ces idées étrangères à lui-même, et non pas qu'il a une "conscience bourgeoise". L’idéologie social-démocrate faisant partie de l'idéologie capitaliste, affecte donc des couches de la classe ouvrière. Vous dites vous-mêmes que :"la social-démocratie est un mouvement contre-révolutionnaire" (thèse n°8). Pour un parti aujourd'hui, être contre-révolutionnaire, signifie être capitaliste. Autrement le mot "contre-révolutionnaire" ne serait rien de plus qu'une insulte, et non pas une définition sociale et politique comme cela l'est pour le marxisme.
La même chose s'applique aux syndicats. Ils ne prennent pas, comme vous le dites, "une part plus ou moins grande de plus-value au capital" (thèse n°9). Au contraire, en tant qu'organes capitalistes, ils aident le capitalisme à extraire le maximum de plus-value possible. Ils le font en termes relatifs, ou absolus, mais quel que soit le cas, ils le font. Dans les moments de crise profonde comme aujourd'hui, ils aident, à "rationaliser" l'économie en soutenant les mesures d'austérité draconiennes du gouvernement contre la classe ouvrière. Ils contribuent directement à l'accroissement du chômage. Ils essaient de dévoyer, de fragmenter et de disperser la combativité des ouvriers. Quand les ouvriers réussissent, ici ou là, à maintenir provisoirement leur niveau de vie précaire, ils ne le doivent qu'à leur propre détermination, à leur propre auto-organisation et non aux syndicats.
Les syndicats sont, comme vous le dites, "opposés aux conseils ouvriers révolutionnaires" (thèse n°9). Mais pourquoi projeter leur rôle réactionnaire seulement pour le futur ou pour le passé ? (Quand, par exemple, les syndicats du SPD se sont opposés à la révolution allemande de 1918-19).
Ils s’opposent AUJOURD'HUI à toute forme de lutte pouvant préparer les conseils ouvriers de demain. Les syndicats ne jouent pas un rôle de médiateur dans la vente de la force de travail. Ils ne sont pas les "intermédiaires" des ouvriers sur le marché du travail. En réalité, ils font baisser constamment la valeur de la force de travail. Ils sont une force de police capitaliste dans le prolétariat. Quand la situation l'exige, les syndicats défendent physiquement l'Etat capitaliste de concert avec les autres forces de répression. Les syndicats sont tout aussi capitalistes et contre-révolutionnaires que la Social-Démocratie. Si les cinquante années de défaites prolétariennes passées nous montrent quelque chose, c'est bien cela.
Le terme "organisations ouvrières capitalistes" est fallacieux, puisqu'il implique que les organes capitalistes ont une double nature, mi-prolétarienne et mi-capitaliste. Cette formulation pourrait faire aussi supposer que pendant les périodes de boum économique, ces organes capitalistes "serviraient" les ouvriers, pour ne s'opposer à eux que dans les périodes de dépression ou de crise. Ceci est faux. En tous les cas, ce terme ne peut pas définir avec précision leur nature de classe, ce qui ouvre donc la porte à toutes sortes d'opportunismes "trade-unionistes".
Lénine et le Kominterm ont inventé 1’idée confuse de "parti ouvrier capitaliste", en référence au parti travailliste britannique et aux partis sociaux-démocrates. C'était pour des motifs opportunistes, comme la tactique du "Front Unique" en 1921 allait le montrer. Le Kominterm appelait à "l'unité d'action" avec ces partis, qui étaient passés clairement dans le camp de la bourgeoisie pour toujours. Une fois qu'une organisation ouvrière a trahi et est devenue capitaliste, elle ne peut redevenir prolétarienne à nouveau. En faisant des offres à ces ennemis de classe, le Komintern hâtait son propre déclin et sa propre dégénérescence. Le fait que les partis sociaux-démocrates et les syndicats avaient des millions d'ouvriers ne change rien au fait fondamental, irréfutable, que politiquement, et donc aussi sociologiquement, ces organisations étaient devenues une partie intégrante du système capitaliste.
Les partis "communistes" font aussi partie de l'appareil politique de la bourgeoisie. Avec le stalinisme, ils sont devenus les instigateurs actifs de la contre-révolution qui a écrasé la révolution d'octobre et corrompu le Komintern dans les années 20 et 30. Ces faux partis communistes ne sont cependant pas des agents de Moscou ou de Pékin, mais les fidèles serviteurs de leurs Etats nationaux respectifs. Les nommer "partis léninistes", c'est un travestissement de l'histoire. Le parti de Lénine, le parti bolchevique, ainsi que le Komintern à ses débuts, étaient des organes de la classe ouvrière en dépit de toutes les déformations qu'ils contenaient. Les identifier avec la contre-révolution la plus brutale que le prolétariat ait jamais subi, est une erreur profonde.
Ceci nous amène à la question de la révolution russe. Vous déclarez que : "c'était une révolution paysanne" (Thèse n°10). Une révolution BOURGEOISE par conséquence ? Mais ceci révèle une incompréhension fondamentale de ce qu'est une révolution prolétarienne et de ce qu'est une révolution bourgeoise. Voyons tout d'abord la question de la nature prolétarienne de la révolution.
Le fait que la révolution d'octobre 17 fut une révolution prolétarienne a été reconnue par l'ensemble du mouvement communiste international de l'époque. Affirmez-vous que tous les révolutionnaires étaient incapables de voir la vraie nature de la révolution d'octobre ? Ceci est une hypothèse tout à fait gratuite, qui fait partie des préjugés mencheviks et sociaux-démocrates. Ce ne sont pas seulement R.Luxemburg et les Spartakistes qui se sont reconnus dans la révolution d'octobre, mais aussi Görter, Pannekoek, les "Etroits" bulgares Pankhurst, etc. ... Et aussi, les ouvriers révolutionnaires de l'époque. En fait, ce qui a arrêté la première guerre mondiale impérialiste, c'est que les gouvernements impérialistes avaient peur d'une "contagion bolchevique" dans leurs armées et dans leurs populations. Les révolutionnaires pensaient que la révolution d'octobre serait la première d'une série de révolutions internationales dans cette époque de décadence capitaliste. C'est pour cela que le Komintern fut fondé en 1919, afin de hâter le processus de la révolution mondiale. Finalement, la vague révolutionnaire a échoué, mais ce n'est pas parce qu'octobre était condamné à n'être qu'une "révolution paysanne".
A propos de l'idée que la révolution d'octobre était une "révolution bourgeoise". Beaucoup de "communistes de gauche" et plus tard, des "communistes de conseil" ont défendu cette idée, alors qu'ils subissaient le poids et l'isolement de la contre-révolution. A l'origine, ceci était une conception menchevik. Mais ce point de vue ne tenait pas compte de la décadence du système mondial, manifestée par la guerre impérialiste. Partout la bourgeoisie était devenue une classe socialement décadente, la période des "révolutions bourgeoises" avait donc touché à sa fin. La révolution communiste était posée objectivement dans le monde entier. La Russie était mûre pour le socialisme, non pas du fait de ses ressources intérieures (qui étaient arriérées) mais parce que toute l'économie mondiale nécessitait de toute urgence une réorganisation communiste et la socialisation des forces productives, qui elles, étaient "plus que mûres" pour le socialisme. Les bolcheviks ont vu cela clairement et ils ont placé tous leurs espoirs dans l'extension de la révolution mondiale. Les mencheviks, qui voyaient tout en terme d'économies nationales isolées, et "d'étapes" furent incapables de saisir la nature de la nouvelle période du capitalisme. Ils furent ainsi amenés à s'opposer à la révolution prolétarienne la considérant comme "prématurée" ou "anarchiste". Les "communistes de gauche" qui ont défendu cette idée de la "révolution bourgeoise" en Russie, ne s'étaient sûrement pas, eux, opposés à la révolution ouvrière. Mais ils défendaient néanmoins un cadre politique incohérent.
Le parti bolchevik que vous représentez faussement comme "un parti d'avant-garde bien discipliné et uni" (Thèse n°10) était un parti prolétarien basé sur les conseils ouvriers et les comités d'usine. Ses idées, son programme révolutionnaire (en dépit de ses imperfections) provenaient de la classe ouvrière internationale. A qui d'autre pouvaient appartenir des slogans comme "A bas la guerre impérialiste", "Transformez la guerre impérialiste en guerre civile", et "Tout le pouvoir aux soviets" ? A la bourgeoisie ? A la paysannerie ? Non, ces slogans exprimaient les besoins du prolétariat mondial à cette époque. L'idée que le parti bolchevik représentait la "bureaucratie"-"la nouvelle classe dominante"- est une idée anti-marxiste. Tout d'abord, parce que c'est complètement faux en ce qui concerne le parti bolchevik, et en deuxième lieu, parce que cette conception, non seulement, défend l'idée d'une nouvelle classe, mais aussi suggère l'existence d'un nouveau, d'un "troisième" mode de production, qui n'est ni capitaliste ni communiste. Le dilemme de l'humanité ne serait plus "Socialisme ou barbarie", puisque la solution prolétarienne semblerait avoir échoué, mais "capitalisme ou barbarie" (sic !). Les premiers à soutenir des variantes de cette théorie furent les pontes sociaux-démocrates Kautsky, Hilferding et Bauer compris, dans les années 20. Elle fut ensuite défendue par de nombreux renégats du marxisme, comme Burnham, Wittfogel, Cardan, etc... Ce type d"'anti-léninisme" est complètement capitaliste.
Encore une fois, ce n'est pas vrai que le but de la révolution prolétarienne est que "... les ouvriers eux-mêmes soient les maîtres de la production" (Thèse n°l0). Ceci est en désaccord avec 1 'objectif que vous défendez dans la première section, c'est à dire la création d'un mode de production fondé sur le besoin, sur les valeurs d'usage. Il est évident que le communisme ne peut être crée par une élite ou par un "parti d'avant-garde" d'aucune sorte. Son avènement exige la plus large participation de l'ensemble de la classe, de l'ensemble de la population, à la construction d'un monde débarrassé des nations, libéré de la guerre, de la famine et du désespoir. Un monde de solidarité humaine, où l'individu ne sera plus en contradiction avec la communauté, et vice-versa. Voilà certainement le but de la révolution ouvrière ! Sur la voie menant vers ce but, les ouvriers, bien sûr, seront les"maîtres de la production", non pas pour conserver leur statut d'ouvrier atomisé, mais pour se transformer en libres producteurs associés. Si le communisme est une société sans classes, alors la classe ouvrière doit disparaître, en tant que catégorie de production spéciale ou même "privilégiée". L'humanité communiste essaiera sans cesse de maîtriser l'ensemble de la société, pas seulement les procès de production et de distribution.
III "LA SITUATION PRESENTE"
Quand vous affirmez que "la reproduction du capital n'a pas encore été jetée dans une crise qui change totalement toute la vie sociale" (Thèse n°1l) pour expliquer que les besoins immédiats de la classe ouvrière, en Europe occidentale ne sont pas révolutionnaires, que voulez vous dire ?
Quels faits vous convaincront que le capitalisme en Europe occidentale (sans parler du reste du monde) connaît la crise la plus profonde depuis les années 30 ? La recherche d'un niveau de profondeur adéquat de la chute du taux de profit n'est sûrement pas ce que vous proposez, car cela, ce serait le fatalisme le plus sûr. Les circonstances objectives pour un bouleversement révolutionnaire sont mûres. En fait, elles le sont depuis 60 ans Ce qui est important, décisif, c'est que le capitalisme sombre dans sa crise économique la plus grave, et c'est cela qui fournira à la classe ouvrière l'occasion de perdre ses illusions sur la possibilité de survivre dans le capitalisme. Les révolutionnaires doivent donc se préparer pour être capable d'intervenir systématiquement dans cette période, pour être capable d'expliquer avec patience les buts du mouvement, de participer à la lutte de classe et d'apprendre d'elle, afin que leur intervention serve réellement de facteur actif dans la prise de conscience communiste.
Les temps sont mûrs, si mûrs que les conditions pour la révolution pourraient "pourrir" si la classe ouvrière échouait à détruire le capitalisme. Le seul résultat de cet échec serait une troisième guerre mondiale impérialiste, et peut-être l'anéantissement de tout futur monde communiste.
Dire que l'Europe occidentale est dans une "situation pré-révolutionnaire" (Thèse n°l1) ne peut vouloir dire qu'une chose : qu'AUJOURD'HUI, la lutte de classe se prépare, qu'elle mûrit les conditions de toute une série d'assauts contre le système capitaliste. Ignorer cette conclusion serait de l'aveuglement. La violence étatique croissante et ouverte en Europe occidentale confirme cette tendance : la bourgeoisie se prépare pour la guerre civile contre la menace de la révolution prolétarienne. Dire que le niveau de conscience de la classe n'est pas encore assez homogène et actif pour tenter un bouleversement révolutionnaire est une chose. Mais il est faux de dire que les besoins de la classe ne sont pas révolutionnaires. Que seraient-ils d'autre alors ? De passer par d'autres niveaux sociaux-démocrates de "conscience immédiate" ? De recevoir d'autres leçons sur les "justifications et les limites" des syndicats aujourd'hui ?
Vous semblez dire que la défense des intérêts économiques immédiats des ouvriers est capitaliste, et que les syndicats assument cette fonction (bien ou mal, selon les conditions économiques). Mais c'est ignorer le fait que la classe ouvrière est à la fois une classe EXPLOITEE et une classe REVOLUTIONNAIRE. Elle DOIT défendre ses conditions d'existence au sein du capitalisme. En fin de compte, à cause de la crise, et à cause de la menace d'une nouvelle guerre impérialiste, elle comprendra qu'elle ne peut se défendre qu'en passant à l'offensive politique. Autrement dit, les natures de classe exploitée et de classe révolutionnaire du prolétariat sont toujours entremêlées, et elles tendent à fusionner consciemment lorsque le système capitaliste se décompose et devient la barbarie totale. Le système n'a jamais été objectivement aussi vulnérable qu'aujourd'hui. Et la classe ouvrière s'en rendra compte, à un certain moment de sa lutte. Comme nous l'avons dit plus haut, le rôle des syndicats est de troubler cette unité de la conscience, de séparer les luttes économiques des luttes politiques, afin de saboter et de détruire LES DEUX. Les syndicats défendent le capitalisme, et non pas une quelconque absurdité "ouvrière capitaliste".
Dans votre thèse n°l7, vous parlez du "mouvement de l'aile gauche". Nous supposons que vous voulez dire les groupes d'extrême gauche. Ces groupes défendent, d'une façon ou d'une autre, les syndicats, la social-démocratie, le stalinisme et le capitalisme d'Etat. Ils participent aux farces électorales, ils soutiennent les luttes inter-impérialistes ou entre factions bourgeoises (au Salvador, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc...) Ils ne sont que des annexes capitalistes de groupes capitalistes plus grands. Ils font partie de la "gauche du capital". Ils ne sont pas opportunistes ou réformistes. L'opportunisme, le réformisme et le révisionnisme étaient des déviations historiques spécifiques dans le mouvement ouvrier avant l4. Le Komintern aussi a souffert de ces maux, quoique pas longtemps, avant de mourir. Ces déviations n'existent nulle part sous forme de phénomène de masse aujourd'hui. La décadence du capitalisme, qui a érodé toute possibilité matérielle d'un mouvement ouvrier de masse permanent (comme l'était la seconde Internationale), a éliminé aussi indirectement la base de ces déformations historiques dont a souffert le prolétariat au siècle dernier. Au sein du petit milieu révolutionnaire qui existe aujourd'hui, on peut encore trouver des formes d'opportunisme, allant de pair généralement avec une autre maladie jumelle : le sectarisme. Mais ceci est du à la sclérose théorique et au conservatisme, pas à une quelconque "base de masse réformiste". Les groupes d'extrême gauche, cependant, sont d'une nature différente de ce milieu. Les sociaux-démocrates de gauche (et leurs groupes "de jeunesse"), les trotskistes, les "communistes", les maoïstes, et le reste du menu fretin populiste et gauchiste, font partie complètement du camp capitaliste.
La destruction de tout l'appareil politique du capitalisme, de sa gauche et de sa droite, et y compris de ses chiens de garde gauchistes, est la tâche de l'ensemble de la classe ouvrière. Ce que doivent faire les révolutionnaires, c'est dénoncer sans trêve les idées et les actions réactionnaires, capitalistes, de ces groupes, et particulièrement des gauchistes, puisqu'ils affectent la classe directement. Il faut le faire ouvertement, face à la classe. Si la social-démocratie est, comme vous le dites, "...l'obstacle le plus sérieux pour la révolution et ... le dernier espoir de la bourgeoisie" (thèse n°17), il s'ensuit que tous ses parasites politiques sont aussi des ennemi de la classe ouvrière. Le dire à notre classe est une responsabilité élémentaire.
EN CONCLUSION
Le terme "communiste de gauche" est impropre aujourd'hui car le précédent mouvement communiste de masse de la première vague révolutionnaire (1917-19Z7) est mort. Les "communistes de gauche" de la fin des années 20, et des années 30 et 40 étaient des fractions marxistes minuscules qui essayaient de survivre à la contre-révolution et donc de préparer le réarmement théorique et pratique du futur. Les camarades du GIK de Hollande et d'Allemagne en faisaient partie, ainsi que les camarades en exil de la Gauche Italienne, qui publiaient Bilan, etc. Des tendances diverses, issues théoriquement de ces fractions, existent aujourd'hui et croissent. Mais il n'est pas nécessaire de nous donner le nom de "communistes de gauche", puisque nous constituons une partie du SEUL mouvement communiste, c'est à dire marxiste, qui existe aujourd'hui. L'appareil de la gauche du capitalisme n'a rien à voir avec le marxisme. C'est l'ennemi mortel du communisme et de la classe ouvrière. C'est un mouvement décadent qui défend le capitalisme d'Etat et la contre-révolution. Nous ne sommes pas sa
"gauche".
De la même façon, le nom "communisme de conseil" est inadéquat, puisqu'il identifie le communisme avec les conseils ouvriers. C'est une affirmation mal venue. Les conseils ouvriers expriment encore le fait que la société est divisée en classes. Le terme n'est donc pas synonyme avec le mode de production communiste. Ce terme implique aussi qu'il y a des "variétés" diverses de communistes - les "communistes de parti", les "communistes d'Etat", les "communistes de village", ou les "communistes de ville" ? Mais, en fait nous sommes tout simplement des COMMUNISTES.
Nous attribuer le nom de "groupes ouvriers anti-capitalistes" serait aussi impropre. Les révolutionnaires se définissent de façon affirmative, et ne cachent pas leurs points de vue. "Ouvrier anti-capitaliste" est une définition purement négative. Les groupes révolutionnaires aujourd'hui ne peuvent se borner à être des "centres d'information", ou des lieux où discuter d'expériences locales. Ils ne sont pas non plus des cercles de discussion
ouvriers, qui eux sont par nature temporaires. Bien que vitaux pour l'ensemble de la classe, ces cercles n'assument pas et ne peuvent assumer le travail actif et systématique de propagande et d'agitation au niveau international. De même, les groupes révolutionnaires ne sont pas des comités de grève ou des "porteurs d'eau" au service des grèves. Un groupe révolutionnaire est une partie de la classe, mais il en est une partie politique, et volontaire. Il essaie de défendre une plate-forme politique claire et cohérente, il met en avant les buts généraux et finaux de la révolution prolétarienne. La tâche d'auto organisation véritable de la classe retombe sur la classe elle-même, à travers son action de masse spontanée. Les révolutionnaires ne peuvent prendre l'initiative de cette tâche unitaire, qui ne peut être effectuée que par des centaines de milliers, si ce n'est des millions, d'ouvriers. La tâche des révolutionnaires c'est de s'organiser eux-mêmes, de clarifier leurs idées, de façon à pouvoir participer et aider à fertiliser l'ensemble du mouvement de masse de demain avec les leçons de l'expérience historique du prolétariat mondial. La lutte de la classe ouvrière a un passé, un présent, et un futur plein de promesses. Il y a un lien organique qui unit ces différents moments de sa trajectoire historique. Les révolutionnaires essaient de démêler ce lien, tout d'abord sous sa forme théorique. Participer pleinement à cette tâche, avec toute sa volonté et son enthousiasme, apporter la contribution de ses meilleures idées et de ses meilleures années à cette lutte pour l'émancipation humaine, voilà le seul sens qu'on peut donner à l'espoir et au bonheur auJourd'hui
Courant Communiste International
Janvier 1981-.
[1] [159] Antonio Gramsci, "Le syndicalisme et les Conseils", article de l'Ordine Nuovo, 8 novembre 1919
[2] [160] idem
[3] [161] Pour une critique plus étendue de cette période (y compris des occupations d'usines), voir "Révolution et contre-révolution en Italie" dans la Revue Internationale du CCI n°2.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Le Communisme de Conseil [162]
Les confusions du « Fomento Obrero Revolucionario » sur RUSSIE 1917 et Espagne 1936
- 3686 reads
"Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites qu'on n'aurait qu'à mettre en application, la réalisation pratique du socialisme comme système économique, social et juridique est une chose qui réside dans le brouillard de l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne sont que quelques grands poteaux indicateurs, montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indications, d'ailleurs d'un caractère surtout négatif. Nous savons à peu près ce que nous aurons à supprimer tout d'abord pour rendre la voie libre à l'économie socialiste; mais, par contre, de quelle nature sont les mille et mille mesures pratiques, grandes et petites, propres à faire entrer les principes socialistes dans l'économie, dans le droit, dans tous les rapports sociaux, là-dessus il n'y a pas de programme de parti, pas de manuel socialiste qui donne des renseignements. Ce n'est pas un défaut : c'est au contraire l'avantage du socialisme scientifique sur le socialisme utopique." [1] [163]
C'est ainsi que Rosa Luxemburg pose la question des mesures économiques et sociales que doit assumer la dictature du prolétariat. Cette affirmation reste toujours vraie aujourd'hui. Le prolétariat doit avant tout s'assurer d'avoir détruit l'appareil d'Etat capitaliste. Le pouvoir politique est l'essence de la dictature du prolétariat. Sans ce pouvoir, il lui sera impossible d'effectuer aucune transformation sociale, économique, juridique dans la période de transition du capitalisme au communisme.
L'expérience de la contre-révolution stalinienne a apporté d'autres indications très concrètes de caractère négatif. Les nationalisations par exemple, ne peuvent être identifiées à la socialisation des moyens de production. La nationalisation stalinienne, et même celle de la période du "communisme de guerre"(1918-1920), ont consolidé le pouvoir totalitaire de la bureaucratie étatique russe, lui ouvrant l'accès direct à la plus-value extraite des travailleurs russes. La nationalisation est devenue partie intégrante de la tendance au capitalisme d'Etat, basé sur une économie de guerre croissante et permanente. En Russie, la nationalisation a directement stimulé la contre-révolution.
Pourtant il existe des tendances dans le mouvement révolutionnaire actuel qui, bien que prétendant défendre cette position générale du marxisme, la déforment et la"révisent" avec toutes sortes de recettes "économiques et sociales" ajoutées au pouvoir politique de la dictature du prolétariat.
Parmi ces tendances, nous pensons que le F.O.R ("Fomento Obrero Revolucionario": : Ferment ouvrier révolutionnaire, qui publie Alarma, Alarme, Focus, entre autres) se distingue par de dangereuses confusions. Notre critique portera sur les positions de ce groupe sur les mesures politiques et économiques que doit prendre la dictature de la classe ouvrière.
L"EXPERIENCE D'OCTOBRE
1917, SELON LE F.O.R
Pour le F.O.R, l'expérience de la révolution russe montre la nécessité de socialiser les moyens de production dès le premier jour de la révolution. La révolution communiste, selon le F.O.R, est en même temps sociale et politique, et :
"..la révolution russe constitue un avertissement décisif, et la contre-révolution qui l'a supplantée, la plus cruelle leçon : La dégénérescence de la révolution a été facilitée en 1917 par l'étatisation des moyens de production qu'une révolution ouvrière doit socialiser. Seule l'extinction de l'Etat, telle que l'envisageait le marxisme aurait permis de transformer en socialisation l'expropriation de la bourgeoisie. Or, l'étatisation
s'est avérée l'étrier de la contre-révolution." [2] [164]
Le F.O.R se trompe en affirmant qu'en 1917, il y a eu étatisation des moyens de production. Mais c'est nécessaire de le dire pour présenter ensuite le "communisme de guerre" comme un "dépassement" du projet bolchevik initial. La vérité, c'est que :
"Presque toutes les nationalisations qui se font avant l'été 1918 sont dues à des raisons punitives,
provoquées par l'attitude des capitalistes, qui se refusent à collaborer avec le nouveau régime ." [3] [165]
En 1917, le parti bolchevik n'a aucune intention d'étendre à une grande échelle le secteur étatisé. C'est déjà un secteur énorme qui montre toutes les caractéristiques bureaucratiques et militarisées de l'économie de guerre. Au contraire, ce que les bolcheviks veulent, c'est CONTROLER POLITIQUEMENT ce capitalisme d'Etat, dans l'attente de la révolution mondiale. La désorganisation du pays et de l'administration est si profonde qu'il n'existe pratiquement aucun impôt d'Etat. Les bolcheviks contribueront sans le vouloir à une inflation monstrueuse, étant donné que les banques ne les aidaient pas, obligés à émettre ainsi leur propre papier-monnaie (en 1921, il y a plus de 80 000 roubles-billets pour 1 rouble-or).
Les bolcheviks n'ont aucun plan économique concret en 1917 , seulement le maintien du pouvoir ouvrier des soviets, dans l'attente de la révolution mondiale, particulièrement en Europe. Le mérite des bolcheviks, comme disait Rosa Luxemburg, est "d'avoir pris la tête du prolétariat international en conquérant le pouvoir politique" [4] [166]. Sur le plan économique et social, R. Luxemburg les critique sévèrement, non parce qu'ils défendent une somme de recettes théoriques, mais parce que beaucoup des mesures du gouvernement soviétique ne sont pas adéquates en la circonstance. Elle les critique parce qu'elle voit dans ces mesures empiriques des obstacles pour le développement futur de la révolution.
Le "communisme de guerre" qui s'est développé durant la guerre civile, marque cependant une théorisation dangereuse des mesures prises. Pour le FOR, cette période contient des "rapports non capitalistes" [5] [167]. En réalité, le FOR ignore romantiquement que c'était une ECONOMIE DE GUERRE, laissant entendre que c'était une production et une distribution "non capitalistes". Les bolcheviks, Lénine, Trotski, Boukharine, entre autres, en sont arrivés à affirmer que cette politique économique les menait vers le communisme. Boukharine, de façon délirante, écrit en 1920 :
"La révolution communiste du prolétariat s'accompagne, comme toute autre révolution, d'une diminution des forces productives. La guerre civile, les dimensions gigantesques à la mesure de la guerre de classes moderne où non seulement la bourgeoisie, mais aussi le prolétariat, sont organisés en pouvoir d'Etat, signifie une pure perte sur le plan économique." Mais, il n'y a rien à craindre, nous console Boukharine : "Vus dans cette perspective, les faux-.frais de la révolution et de la guerre civile apparaissent comme une diminution temporaire des forces productives, qui crée néanmoins la base de leur puissant développement ultérieur en ceci que les rapports de production ont été reconstruits selon un nouveau plan." [6] [168].
Le FOR remarque : "L'échec de cette tentative (le "communisme de guerre"), dû à la chute verticale de la production (au-dessous de 3% de celle de 1913) provoqua le retour au système mercantile qui reçut le nom de Nouvelle Politique Economique (N.E.P.)." [7] [169]
Mais le FOR ne critique pas le"communisme de guerre" de façon sérieuse. Si on suit sa critique contre la NEP, c'est comme si cette politique avait marqué un " retour au capitalisme". Etant donné que, pour le FOR, le "communisme de guerre" était une politique "non capitaliste", il est logique de supposer que la NEP était son contraire. Mais ceci est faux.
Il faut dire ouvertement que le "communisme de guerre" n'a rien à voir avec la "production et la distribution communistes". Identifier le communisme et la guerre est une monstruosité, même entre guillemets. La Russie soviétique de 1918-1920 est une société militarisée au plus haut point. LA CLASSE OUVRIERE A PERDU SON POUVOIR DANS LES SOVIETS PENDANT CETTE PERIODE que le FOR idéalise. C'est vrai que la guerre contre la contre-révolution devait être menée et gagnée, et elle ne pouvait se faire qu'en conjonction avec la révolution mondiale et la formation d'une armée rouge. Mais la révolution mondiale n'a pas eu lieu et toute la défense de la Russie a reposé sur l'Etat organisé comme une caserne. La classe ouvrière et les paysans ont appuyé de manière héroïque et fervente cette guerre contre la réaction mondiale, mais il ne faut pas idéaliser, ni dépeindre les choses de manière différente de ce qui s'est passé en réalité.
La guerre civile et les méthodes sociales, économiques et policières, en plus des méthodes militaires, ont énormément accru la bureaucratie étatique infectant le parti et écrasant les soviets. Cet appareil répressif, qui n'avait déjà plus rien de "soviétique" est celui que la NEP a organisé. Entre le "communisme de guerre" et la NEP il y a une indubitable continuité. Le FOR ne répond pas à la question : quel était le mode de production dans le "communisme de guerre" ? "Non capitaliste" n'explique rien et ne fait au contraire que tout embrouiller. Une économie de guerre ne peut être autre que capitaliste. C'est l'essence de l'économie décadente, de la production systématique d'armements, de la domination totale du militarisme.
Le "communisme de guerre" était un effort POLITIQUE ET MILITAIRE de la dictature du prolétariat contre la bourgeoisie. Ce qui importe, c'est L'ASPECT POLITIQUE DE CONTROLE ET D’ORIENTATION PROLETARIENS, plus que tout. C'était un effort temporaire, passager, qui est devenu nocif par le fait que la révolution mondiale se faisait attendre. C'était un effort qui contenait des dangers énormes pour le prolétariat, déjà organisé dans les casernes, pratiquement sans voix propre. Ce contenu "non capitaliste" n'existe pas, sauf au niveau politique déjà mentionné. S'il n'en était pas ainsi, l'empire inca et sa production et distribution "non capitaliste serait un bon précurseur de la révolution. Communiste !
Le "communisme de guerre" russe se basait sur ces procédés dits "anti-capitalistes" :
- concentration de la production et de la distribution à travers des départements bureaucratiques (les "glavki") ;
- administration hiérarchique et militaire de toute la vie sociale ;
- système "égalitaire" de rationnement
- utilisation massive de la force de travail à travers des "armées industrielles" ;
- application des méthodes terroristes de la Tcheka dans les usines, contre les grèves et les éléments "contre-révolutionnaires" ;
- accroissement énorme du marché noir
- politique de réquisition à la campagne
- élimination des stimulants économiques et utilisation effrénée des méthodes de choc (udarnost) pour éliminer les déficiences dans les secteurs industriels ;
- nationalisation effective de toutes les branches qui servaient à l'industrie de guerre
- élimination de la monnaie ;
- utilisation systématique de la propagande étatique pour relever le moral de la classe ouvrière et du peuple ;
- service gratuit des transports, communication et loyers d'habitation ;
Si nous ne considérons pas l'aspect politique du pouvoir de la classe ouvrière -quoique celui-ci existe- c'est là une description d'une économie de guerre, UNE ECONOMIE DE CRISE. Il est intéressant de noter que le "communisme de guerre" n'a jamais pu être planifié. Une telle mesure, qui aurait signifié une consolidation rapide, permanente et totalitaire de la bureaucratie, aurait rencontré une résistance de la classe ouvrière. La planification militaire n'était possible que sur un prolétariat complètement écrasé et défait. C'est pour cela que le stalinisme en 1928 et après, a ajouté la planification (décadente) à une économie qui, pour le reste, ressemblait au "communisme de guerre". La différence fondamentale était que la classe ouvrière AVAIT PERDU LE POUVOIR POLITIQUE EN 1928. Si en 1918-20, elle pouvait contrôler quelque peu le "communisme de guerre" (qui en fin de compte exprimait des nécessités passagères, quoique urgentes), et même l'utiliser pour battre la réaction extérieure, pendant les dernières années de la NEP, elle avait déjà perdu tout le pouvoir politique. Mais, autant sous le "communisme de guerre" que sous la NEP, et le plan quinquennal stalinien, la loi de la valeur continue à dominer. Le salariat pu être déguisé, la monnaie a pu "disparaître", mais le capitalisme n'a pas cessé d'exister pour autant. Il ne peut être détruit par des mesures administratives ou purement politiques dans un seul pays.
Que le parti bolchevik bureaucratisé se soit rendu compte que le "communisme de guerre" ne pourrait survivre à la fin de la guerre civile, montre que ce parti ouvrier conservait un certain contrôle politique sur l'Etat qui surgit de la révolution russe. Il faut dire "un certain contrôle", car ce contrôle était relatif, et toujours plus faible. Il ne faut pas oublier non plus que la nécessité d'en finir avec le "communisme de guerre", ce sont les ouvriers et les marins de Petrograd et Kronstadt qui l'ont rappelé aux bolcheviks. Ces derniers ont payé très cher leur audace. En réalité, la rébellion de Kronstadt s'est faite contre les soi-disant "production et distribution non capitalistes" et contre tout l'appareil terroriste étatique et du parti unique déjà dominant en Russie durant la guerre civile.
Nous ne pouvons pas simplement répéter sans cesse que tout ceci était du à l'isolement de la révolution. C'est vrai. Mais c'est insuffisant. La manière dont un tel isolement s'est manifesté A L'INTERIEUR de la révolution russe est aussi important, parce qu'elle nous donne des exemples et des leçons concrètes pour la future révolution mondiale. Le "communisme de guerre" fut une expression inévitable mais funeste de cet isolement Politique de la classe ouvrière en Russie vis-à-vis de ses frères de classe en Europe.
En théorisant le "communisme de guerre", certains bolcheviks, comme Boukharine, Kritsman, etc.. ont défendu implicitement une sorte de COMMUNISME DANS UN SEUL PAYS. Bien sûr, aucun bolchevik en 1920, n'en était arrivé à le dire ouvertement. Mais c'était contenu dans l'idée de la "production et la distribution non capitalistes" faites dans un pays ou un "Etat prolétarien" (conception également fausse que le FOR semble tantôt défendre, tantôt réfuter).
L'erreur fondamentale INTERNE de la révolution russe fut celle d'avoir identifié la dictature du parti et la dictature du prolétariat qui était la dictature des conseils ouvriers. Ce fut une erreur substitutionniste fatale de la part des bolcheviks Sur un plan historique plus général, cette erreur exprimait toute une période de pratique et de théorie révolutionnaire qui n'existe plus. Chez les bordiguistes, on retrouve des restes caricaturaux de cette vieille conception substitutionniste désormais caduque et réactionnaire. Mais l'erreur des bolcheviks, ou la limitation de la révolution russe si on veut, n'est pas qu'ils n'ont pas dépassé le niveau "purement politique" de la révolution sociale. Comment y parvenir si la révolution reste isolée ? Ce qui s'est fait sur le plan économique et social est le plus qui pouvait se faire. Cela est vrai par rapport au "communisme de guerre" et même à la NEP. Ces deux politiques contenaient des dangers profonds et des pièges insoupçonnés pour le pouvoir politique du prolétariat. Mais tant que le prolétariat se maintient au pouvoir, les erreurs économiques peuvent se résoudre et s'arranger tout en attendant la révolution mondiale. S'il n'était pas possible d'arriver au communisme "intégral" (formule creuse de la "Comunist Workerls Organisation" en Grande-Bretagne), ce n’était pas parce que la classe ouvrière ne cherchait pas ou n'avait pas d'autres "grandes expériences" (comme les collectivités de 1936 en Espagne ...) La pauvreté en Russie, le niveau culturel très bas, la saignée par la guerre mondiale et la guerre civile, tout cela n'a pas permis à la classe ouvrière de conserver son pouvoir politique, et la trahison des bolcheviks doit aussi être ajoutée comme une raison interne fondamentale.
Mais l'absence de mesures "non capitalistes", comme la disparition de la loi de la valeur, du salariat, de la marchandise, de l'Etat et même des classes (dans un seul pays ?), tout ceci peut-il expliquer la défaite interne de la révolution russe ? C'est ce que semble dire le FOR.
"Le capitalisme s'ouvrira toujours une brèche, si dès le début sa source n'est pas asséchée : la production et la distribution basées sur le travail salarié. Ce qui doit compter pour chaque prolétariat est le niveau industriel du monde, et pas celui de "sa" nation seulement." [8] [170]
Pourtant, contrairement à ce que le FOR suggère ici, la "source" du capitalisme mondial ne se trouve pas dans de petites plaques à assécher pays par pays. Le FOR semble ne pas prendre en compte que le capitalisme, comme système social, existe à l'échelle mondiale, comme un rapport international. Pour cela, la loi de la valeur ne peut être éliminée qu'à l'échelle mondiale. Comme elle touche tout le prolétariat mondial, il est impossible de penser qu'un secteur isolé du prolétariat puisse échapper à ses lois. C'est une mystification typique du volontarisme anarchiste qui pensait que l'Etat et le capitalisme pouvaient être éliminés à travers un faux communautarisme de village et de canton. Dans la tradition anarcho-syndicaliste, l'idée a trouvé sa variante "industrielle" mais suit la même mystification localiste, étroite, égoïste.
Dans l'article de Munis cité plus haut, on nous dit que le prolétariat ne doit pas compter"seulement"sur le niveau industriel de "sa" nation. Sage conseil, mais peu clair. S'il s'agit de la possibilité et la nécessité de prendre le POUVOIR POLITIQUE dans un pays, quel qu'il soit, c'est un bon conseil, quoique pas tellement nouveau !
C'est vrai que ce qui importe c'est le niveau mondial, non celui de chaque pays. Cependant, si on met en avant l'idée que la production et la distribution communistes peuvent commencer "immédiatement", comme le fait le FOR, ceci implique que le niveau industriel de chaque pays est absolument important. Il serait l'aspect fondamental, décisif. Il est clair qu'une telle affirmation amènerait le FOR -bien qu'il soit une tendance révolutionnaire- dans la tradition chauviniste d'un Volmar ou d'un Staline. Mais ce qui est réellement tragique est qu'il devrait accepter, pour être logique avec lui-même, que le communisme est impossible, étant donné qu'il n'est pas possible dans un pays. Le FOR répondra avec colère qu'il ne défend pas l'idée du "socialisme en un seul pays". C'est bien, mais on ne peut nier que sa manière de poser la question des taches économiques et sociales, considérées de son point de vue comme aussi importantes que les tâches politiques, suggère une sorte de "communisme en un seul pays". Quel autre sens peut avoir l'affirmation que le capitalisme s'ouvrira toujours une brèche, à moins d"'assécher" sa "source" ? Nous avons déjà dit qu'on ne peut "assécher" dans un seul pays
Est-ce que le travail salarié peut être éliminé dans un seul pays ou une seule région ?
Selon le FOR, il semble que oui. C'est là la question. Si on accepte cela, on accepte le socialisme dans un seul pays. Il faut être cohérent.
Dans une polémique (excellente sur d'autres aspects) contre les bordiguistes du "Prolétaire", Munis répète :
"Dans notre conception ... c'est là le plus important de ce que doit imposer la dictature du prolétariat, et sans cela, il n'existera jamais de période de transition au communisme".[9] [171]
On se réfère ici à la nécessité d'abolir le travail salarié, quant à la nécessité du pouvoir politique, Munis la taxe de "... lieu commun plus que centenaire". Mais on peut en dire autant de l'abolition du salariat !
Maintenant, il est certain que sans abolition du salariat, il n'y aura pas de communisme. La même chose s'applique aux frontières, à l'Etat, aux classes. Il n'est pas nécessaire de répéter que le communisme est un mode de production basé sur la libération la plus complète de l'individu, sur la production de valeurs d'usage, sur la disparition complète des classes et de la loi de la valeur. Là dessus, nous sommes d'accord avec le FOR.
La différence apparaît lorsque nous abordons la primauté des mesures économiques et sociales. Nous allons voir que la question du pouvoir politique, loin d'être un "lieu commun", est ce qui est décisif pour la révolution mondiale. Pas pour le FOR.
L'insistance de Munis est enfermée dans toute l'optique (myope) des oppositions trotskistes et même boukhariniennes, à la contre-révolution stalinienne. Il pense que les garanties contre la contre-révolution, ce sont les mesures économiques et sociales de type "non capitaliste" qui vont les donner. Malgré l'importance de beaucoup d'écrits de Préobrajensky, Boukharine et autres économistes bolcheviks, leurs apports n'éclairent pas sur les problèmes réels qu'a affronté la classe en 1924-1930. Préobrajensky parlait d'une "accumulation socialiste", de la nécessité d'établir un équilibre économique entre la ville et la campagne, etc. Boukharine, malgré ses divergences politiques avec l'opposition de gauche, a utilisé des arguments semblables. Tous sont restés prisonniers de l'idée qu"'on peut faire quelque chose économiquement dans un seul pays" pour survivre.
C'est un faux problème qui a surgi quand la classe ouvrière a déjà perdu son pouvoir de classe, son pouvoir politique. A ce point, toute discussion sur 1"'économie" soviétique devient une pure charlatanerie et une mystification technocratique. La racaille stalinienne a donné la réponse définitive à ces faux débats avec ses plans quinquennaux barbares, avec sa terreur policière, et le massacre définitif du parti bolchevik déjà vaincu.
S'il est vrai que la révolution prolétarienne d'aujourd'hui se produira dans des conditions plus favorables qu'en 1917-27, nous ne pouvons nous consoler en pensant que les énormes problèmes vont disparaître. Le prolétariat héritera d'un système économique en putréfaction et décadent. La guerre civile accentuera encore cette usure. Le délire apologétique de Boukharine par rapport à cette accentuation doit être évité à tout prix, comme tout type de pensée apocalyptique ou messianique sur une révolution communiste "immédiate". Il ne s'agit pas de gradualisme. Il s'agit d'appeler les choses par leur nom.
Il est évident que si la classe ouvrière prend le pouvoir, en Bolivie par exemple (même momentanément), sa capacité à "socialiser" sera très limitée. Il est possible que pour le FOR, cet inconvénient ne soit pas gênant. Le prolétariat bolivien pourrait, par exemple, ressusciter l'esprit "communiste" aymara et même ressusciter Tupac Amarù comme commissaire du peuple. Au Paraguay, pour donner un autre exemple, le prolétariat pourrait retourner à une vieille forme de "communisme" jésuite du temps de la conquête. Il faut bien, comme on peut embellir les mauvais jours. Marx lui-même ne parlait-il pas d'un "communisme barbare", basé sur la misère généralisée ? On pourrait arguer : est-ce que cela ne serait pas un type de "communisme" ? Mais, est-il applicable à notre époque ? Que le FOR nous le dise. Il semble que son attachement aux "Collectivités" en Espagne lui a transmis une nostalgie particulière sur le "communisme primitif"
Si on laisse de côté les blagues (que nous espérons que le FOR ne prendra pas de travers), il faut dire que le prolétariat prend le pouvoir politique dans la perspective de la révolution communiste mondiale. Pour cette raison, les mesures sur le plan économique et social doivent être dirigées dans ce sens. Pour cela, elles sont subordonnées la nécessité de conserver le pouvoir politique des conseils ouvriers, libres, souverains et autonomes en tant qu'expression de la classe révolutionnaire dominante. Le pouvoir politique est la CONDITION PREMIERE de toute "transformation sociale" ultérieure, immédiate, médiate, ou comme on voudra l'appeler. LA PRIMAUTE, C'EST LE POUVOIR POLITIQUE. On ne peut rien y changer. Sur le plan économique il y a un énorme champ d'expérience (relativement) et donc aussi le risque de commettre des erreurs qui ne doivent pas être fatales. Mais toute altération sur le plan politique implique rapidement le retour complet du capitalisme.
La profondeur des transformations sociales possibles dans chaque pays dépendra, bien sûr, du niveau matériel concret de ce pays. Mais en aucun cas, ces transformations ne tourneront le dos aux nécessités de la révolution mondiale. Dans ce sens, on peut imaginer un type de "communisme de guerre", ou bien une économie de guerre sous le contrôle direct des conseils ouvriers. Non pas les nationalisations, mais la participation active et responsable d'un appareil de gouvernement soviétique contrôlé par la classe ouvrière. Le FOR pense t'il que c'est impossible ? C'est cela être "trop attaché au modèle russe" ?
Donner la primauté à l'abolition du salariat en pensant qu'avec cela, on arrive à "l'affaiblissement immédiat de la loi de la valeur (échange d'équivalents) jusqu'à sa disparition médiate..."[10] [172], est une pure fantaisie "moderniste". C'est ce type d'illusion qui, à certains moments, aidera à désarmer le prolétariat, l'isolant du reste de la classe ouvrière mondiale. Lui dire qu'il a"socialisé""son" secteur de l'économie mondiale, qu'il a "brisé" la loi de la valeur dans "sa" région, c'est lui dire qu'il doit défendre ce secteur "communiste" qualitativement supérieur au capitalisme extérieur. Rien ne serait plus faux que cette démagogie. Ce que nous défendons est le POUVOIR POLITIQUE DE LA CLASSE.
Ce qui abattrait tout secteur de la classe ouvrière ayant pris le pouvoir, c'est l'isolement de la révolution, c'est à dire le manque de conscience claire de la part du reste de la classe mondiale sur la nécessité d'étendre la solidarité et la révolution mondiale. C'est là le vrai problème. Le FOR ne le met pas en évidence, même si parfois il daigne porter son attention sur la question. Le problème n'est pas que le capitalisme va "resurgir", là où n'a pas été "asséchée" sa "source", mais que le capitalisme CONTINUE A EXISTER à l'échelle mondiale bien qu'un ou quelques Etats capitalistes aient été détruits. Penser qu'on peut le détruire dans un seul pays est une charlatanerie pure qui implique une profonde ignorance de l'économie capitaliste selon l'analyse de Marx. Ou alors, il s'agit d'une "révolution simultanée" dans tous les pays, capable d'écourter énormément la période de guerre civile pour passer à la période de transition proprement dite (à l'échelle mondiale). Ce serait l'idéal, mais il est probable que cela ne se passera pas ainsi, de manière simultanée, malgré les efforts du FOR. Avoir des espoirs, être ouvert aux possibilités inespérées idéales est une chose. Mais c'est autre chose de baser toute la perspective révolutionnaire là-dessus et jusqu'à écrire un "Second Manifeste Communiste" dans cet esprit. La liberté véritable, c'est la reconnaissance de la nécessité qui nous la donne et non les simagrées volontaristes.
Malgré ses confusions de base sur ce qu'a été le "communisme de guerre" dans la révolution d'Octobre, le FOR comprend au moins qu'il s'agissait d'une révolution prolétarienne, d'un effort politique de la classe pour conserver le pouvoir. Mais voyons maintenant ce que dit le FOR sur l'Espagne 36.
LES COLLECTIVITES DE 1936 EN ESPAGIE,
SELON LE F.O.R.
Selon le FOR, la tentative du "communisme de guerre", même si elle a introduit des rapports "anti-capitalistes", n'a jamais dépassé le stade de l'exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière. Comme exemple beaucoup plus profond de mesures ou rapports "non-capitalistes", le FOR présente les collectivités de 1936-37 en Espagne. Munis les décrit ainsi :
"Les collectivités de 1936-37 en Espagne ne sont pas un cas d'autogestion... Certaines organisèrent une sorte de communisme local (sic), sans autre rapport marchand que vers l'extérieur, précisément comme les anciennes sociétés de communisme primitif. D'autres étaient des coopératives de métier ou de village, dont les membres se distribuaient les anciens bénéfices du capital. Toutes abandonnèrent plus ou moins la rétribution des travailleurs selon les lois du marché de la force de travail -et certaines plus que d'autres- en fonction du travail nécessaire et du surtravail d'où le capital tire la plus-value et toute la substance de son organisation sociale. De plus, les collectivités firent aux milices de combat des dons en espèces aussi abondants que répétés. On ne peut pas alors définir les collectivités sinon par leurs caractéristiques révolutionnaires (sic !), en somme par le système de production et de distribution en rupture avec les notions capitalistes de valeur (d'échange nécessairement)..." [11] [173]
Dans son livre "Jalons de défaite; promesse de victoire" (1948), Munis est encore plus enthousiaste :
"Ayant pris l’industrie, sans autre exception, que celle de petite échelle, les travailleurs la remirent en marche, organisés en collectivités locales et régionales par branches d'industrie. Phénomène qui contraste avec celui de la révolution russe, qui met en évidence l'intensité du mouvement révolutionnaire espagnol, la grande majorité des techniciens et des gens spécialisés en général, loin de se montrer hostiles à l'intégration dans la nouvelle économie, collaborèrent valeureusement dès le premier jour avec les travailleurs des collectivités. La gestion administrative et la production en bénéficièrent : le pas vers l'économie sans capitaliste s'effectua sans les heurts et la perte de productivité que le sabotage des techniciens infligea à la révolution russe de 1917. Bien au contraire, l'économie régie par les collectivités réalisa des progrès rapides et énormes. Le stimulant d'une révolution considérée triomphante, la jouissance de travailler pour un système qui substituerait à l'exploitation de l'homme son émancipation du joug de la misère salariée, la conviction d'apporter à tous les opprimés de la terre une espérance, une occasion de victoire sur les oppresseurs, réalisèrent des merveilles. La supériorité productive du socialisme sur le capitalisme a été éminemment démontrée par l’œuvre des collectivités ouvrières et paysannes, tant que l'intervention de l'Etat capitaliste régi par les voyous politiques du Front Populaire n'a pas reconstitué le joug détruit en juillet (de 1936) " [12] [174]
Ce n'est pas là le lieu de poursuivre une polémique sur la guerre civile d'Espagne. Nous avons déjà souvent publié des textes sur ce chapitre tragique de la contre-révolution qui a ouvert la marche au second massacre impérialiste [13] [175]. Nous dirons ici brièvement que Munis et le FOR ont toujours défendu l'idée erronée qu'en Espagne a eu lieu une "révolution". Rien n'est plus étranger à la réalité. S'il est bien sûr que la classe ouvrière en Espagne a bousculé l'appareil bourgeois en 1936 et qu'en mai 1937 elle s'est, bien tardivement, soulevée contre le stalinisme et le gouvernement de front populaire, ceci n'élimine pas le fait que la lutte de classe a été déviée et absorbée par la lutte inter-impérialiste entre la République et le fascisme. La classe a succombé idéologiquement sous le poids de cette vile campagne antifasciste; elle a été massacrée dans la guerre et écrasée par la dictature franquiste, une des pires du siècle.
Les collectivités furent idéales pour dévier l'attention du prolétariat de son véritable objectif immédiat : la destruction totale de l'appareil d'Etat bourgeois et de tous ses partis, de gauche inclus. Ces derniers revitalisèrent l'appareil d'Etat bousculé en 1936 par les ouvriers armés. Mais, après cela, la classe fut séduite par la lutte du front populaire contre le soulèvement franquiste. Les collectivités et les comités de fabrique se plièrent devant cette ignominie. L'appareil d'Etat se reconstitua en intégrant la classe ouvrière à son front militaire, déviant ainsi la lutte ouvrière vers le massacre entre fractions bourgeoises.
Le groupe "Bilan" (de la fraction italienne de la Gauche Communiste) s'opposa à toute idée d'appuyer cette "révolution espagnole". "Bilan" écrivit correctement : " ... quand le prolétariat n'a pas le pouvoir -et c'est le cas en Espagne- , la militarisation des usines équivaut à la militarisation des usines dans n'importe quel Etat capitaliste en guerre" [14] [176]. "Bilan" appuyait la classe ouvrière en Espagne en ces heures tragiques ; il lui indiquait le seul chemin à suivre :
"Quant aux prolétaires de la péninsule ibérique, ils n'ont qu'une sortie : celle du 19 juillet : grèves dans toutes les entreprises, qu'elles soient de guerre ou non, tant du côté de Companys que du côté de Franco ; contre les chefs des organisations syndicales et du Front Populaire et pour la destruction du régime capitaliste" [15] [177].
Combien ces paroles sont loin des bavardages sur la "supériorité du socialisme sur le capitalisme" démontrée par les collectivités ! Non, la vérité doit être dite clairement : IL N'Y A PAS EU EN ESPAGNE DE REVOLUTION SOCIALE. Le capitalisme a survécu parce que la classe ouvrière en Espagne, isolée de la révolution mondiale agonisante, fut entraînée à "autogérer" l'économie de guerre "collectivisée", en faveur du capitalisme espagnol. Dans ces conditions, affirmer que la "révolution espagnole" alla plus loin que la révolution russe au niveau des rapports "non capitalistes" est une tricherie idéologique.
Munis et le FOR révèlent ici une incapacité à comprendre ce que fut la révolution d'Octobre et ce que fut la contre-révolution d’Espagne. Erreur de taille pour une tendance révolutionnaire ! Minimiser le contenu de la première en faveur de la seconde est tout simplement incroyable. En réalité, en défendant les collectivités, Munis et le FOR "théorisent" l'appui donné au gouvernement républicain par les trotskistes pendant la guerre civile. Il n'y a pas d'autre manière d'expliquer cet attachement fanatique aux "collectivités", appendices de la bourgeoisie républicaine en 1936-37. Nous savons que selon le FOR, la tradition trotskyste est révolutionnaire -le FOR étant son héritier historique. Mais voyons en passant ce que disaient les trotskistes de la section bolchévik-léniniste d'Espagne (pour la 4ème Internationale)
"Vive l'offensive révolutionnaire !
"Pas de compromis. Désarmement de la Garde Nationale Républicaine (garde civile) et de la Garde d'Assaut réactionnaire. Le moment est décisif. La prochaine fois, il sera trop tard. Grève générale dans toutes les industries qui ne travaillent pas pour la guerre. Seul le pouvoir prolétarien peut assurer la victoire militaire.
Armement total de la classe ouvrière ! Vive l'unité d'action CNT-FAI-POUM ! Vive le front révolutionnaire du prolétariat ! Dans les ateliers, dans les usines, dans les quartiers : comités de défense révolutionnaire" [16] [178].
Le caractère réactionnaire
de la position trotskyste saute aux yeux : assurer la victoire
militaire". De qui ? De la République ! Cette
"victoire militaire" ne doit pas être menacée par des grèves
irresponsables dans les industries de guerre, selon les trotskistes
Oui, il y avait -il y a- une différence fondamentale entre le trotskisme et le marxisme. Les premiers ne savaient pas distinguer la révolution de la contre-révolution, et les seconds, non seulement le savaient, mais confirmèrent aussi la position marxiste sur la primauté, la nécessité fondamentale d'assurer le pouvoir politique comme condition première à toute tentative de "réorganiser" la société. Si la guerre bourgeoise d'Espagne a apporté quelque chose pour la théorie révolutionnaire, ce fut de confirmer cette leçon de la classe ouvrière.
Dans le chapitre XVII de "Jalons...", intitulé "La propriété", Munis dit ouvertement qu'en Espagne "naissait un nouveau système économique, le système socialiste" [17] [179]. La révolution communiste future, nous dit il, devra continuer et perfectionner cette oeuvre. Peu importe pour Munis que tout cet effort "socialiste" était attaché à une guerre 100 % capitaliste, un massacre et la préparation à la seconde boucherie mondiale avec ses 60 millions de cadavres. Au fond, Munis continue à appuyer la guerre antifasciste de 1936-39 et dans ce sens, il n'a pas rompu avec les mythes du trotskisme La mystification subie par le prolétariat, Munis l'admet, mais sans savoir quoi dire : "Le prolétariat a continué de considérer l'économie comme sienne, et le capitalisme a définitivement disparu " [18] [180].
Au lieu de critiquer les mystifications qui illusionnent le prolétariat, Munis s'adapte à elles, les idolâtre et les "théorise". C'est là ce qu'il y a de négatif, de rétrograde dans le FOR et ses litanies sur la "révolution espagnole". Sa critique est purement économique : elle se réfère surtout au manque de planification à l'échelle nationale. Pour Munis, "la prise et la mise en marche des centres productifs par les travailleurs de ces centres, étaient un premier pas obligatoire. Rester à ce niveau devait avoir des résultats funestes" [19] [181]. Il parle ensuite aussi du pouvoir politique qui était"décisif" (!) pour la révolution. Mais c'est pour dire que la CNT n'était pas à la hauteur des choses, admettant par là que la CNT était un organisme des travailleurs, autre mensonge. Selon le FOR, la CNT était une organisation prolétarienne qui oublia le "lieu commun" de la nécessité du pouvoir politique. C'est ainsi que le FOR, clair et tranchant, pose la question de la "révolution espagnole".
Le livre de Munis est paru en 1948, Il se peut que ses idées aient changé. Mais au moins, dans sa "Réaffirmation" de mars 1972 (à la fin du livre), il ne fait ni commentaire, ni critique des activités trotskistes en Espagne. Dans ce sens, Munis n'a pas changé ses idées sur la "révolution espagnole" en plus de 45 ans. Etre trop attachés au "modèle russe" n'est pas un crime pour les révolutionnaires ; cela peut être une "entrave conservatrice", mais la révolution russe appartient à l'histoire de notre classe et pour cela nous devons en tirer toutes les leçons, car il s'agit d'une révolution prolétarienne. C'est le contraire pour 1a dite "révolution espagnole". Là, notre classe n'a jamais pris le pouvoir politique -au contraire, elle fut convaincue, en partie à travers l'expérience des "collectivités", que c'était un "1ieu commun" à laisser entre les mains de ces messieurs de la CNT-FAI-POUM. Ainsi la classe fut immobilisée et massacrée par les républicains et par leurs bourreaux staliniens, puis par les franquistes. Pour Munis, ce massacre n'enlève rien à la sublime oeuvre des collectivités. Face à un tel lyrisme, nous disons qu'être attaché -même un peu- au "modèle espagnol", est une monstrueuse erreur pour les révolutionnaires
Pour Munis et le FOR, le pouvoir politique de la classe apparaît parfois comme quelque chose d'important et de décisif, et parfois comme quelque chose qui peut -et même doit- venir après. Un "lieu commun" qui n'a pas à soulever de grandes discussions puisque "on le sait déjà". Mais en vérité, le FOR ne le sait pas. L'expérience d'Espagne montre, de manière négative la PRIMAUTE DU POUVOIR POLITIQUE SUR LES DITES MESURES OU RAPPORTS "SOCIALISTES". Munis et le FOR ne voient pas que dans la guerre d'Espagne, pouvoir politique et mystification "collectivistes" ont existé en proportion inverse l'un de l'autre. L'un niait l'autre, et il ne pouvait en être autrement. [20] [182].
Dans sa "Réaffirmation", Munis écrit : "Plus nous regardons rétrospectivement les années qui vont jusqu'en 1917, plus la révolution espagnole acquiert de l’importance. Elle fut plus profonde que la révolution russe... dans le domaine de la pensée, on ne peut élaborer aujourd'hui que de méprisables ersatz de théorie, si on se passe de l'apport de la révolution espagnole, et précisément en ce qu’il diffère, en le dépassant et en le niant, de l'apport de la révolution russe".
Pour notre part, nous préférons baser nos orientations sur les expériences véritables du prolétariat et non sur les "innovations"modernistes comme celle du FOR.
En tant que classe exploitée et révolutionnaire, la classe ouvrière exprime au travers de ses luttes cette nature complémentaire. C'est ainsi qu'elle utilise ses luttes revendicatives, pour s'aider à avancer dans la compréhension de ses tâches historiques. Cette compréhension révolutionnaire trouve son obstacle immédiat dans chaque Etat capitaliste, qui doit être détruit par la classe ouvrière dans chaque pays.
Mais la classe ne peut se dissoudre comme catégorie exploitée qu'à l'échelle universelle, parce que cette possibilité est intimement liée à l'économie mondiale qui dépasse les recours existant au niveau de chaque économie nationale. Mais le caractère capitaliste de l'économie mondiale, du marché mondial, ne peut être éliminé qu'à l'échelle universelle. La classe ouvrière peut instaurer sa dictature (quoique pour peu de temps) dans un seul pays ou dans une poignée de pays isolés, mais ne peut pas créer le communisme dans un seul pays ou une région du monde. Son pouvoir révolutionnaire s'exprime par son orientation nettement internationaliste, engagé surtout à détruire l'Etat capitaliste partout, à détruire cet appareil terroristo-policier dans le monde entier. Cette période peut durer quelques années, et tant qu'elle n'est pas terminée, il sera difficile, sinon impossible, de prendre des mesures réellement et définitivement communistes. La destruction totale des bases économiques du mode de production capitaliste ne peut être la tâche que de toute la classe ouvrière mondiale, centralisée et unie, sans nation ni échange marchand. D'une certaine manière, jusqu'à ce que la classe ouvrière atteigne ce niveau, elle restera une classe économique, étant donné que les conditions de pénurie et de déséquilibre économique subsistent encore. C'est ainsi que les deux caractères de la nature de classe du prolétariat (classe exploitée et classe révolutionnaire) tendent à fusionner consciemment dans le feu du processus historique qui est la dictature du prolétariat et la transformation communiste totale.
ooooooooooo
Nous ne prétendons pas en finir avec une discussion aussi importante. Mais nous voulons présenter nos critiques des conceptions du FOR sur ces problèmes de la révolution prolétarienne. Rien de ce qui est défendu par rapport au "communisme immédiat" ne nous convainc que l'affirmation de Rosa Luxemburg citée au début de cet article est erronée. Les idées du FOR sur les taches de notre époque, sont liées à cette vision d'un socialisme qui peut être atteint à tout moment et quand le prolétariat en aura envie. Cette conception immédiatiste, volontariste, a déjà été critiquée plusieurs fois dans nos publications [21] [183]
Les confusions dangereuses du FOR cachent une incapacité à comprendre ce qu'est la décadence du capitalisme et quelles sont les tâches de la classe ouvrière dans cette période historique. De même, le FOR n'a jamais été capable de comprendre la signification des cours historiques qui se sont manifestés au cours de ce siècle depuis 1914. Il n'a jamais compris, par exemple, que la lutte du prolétariat espagnol en 1936 ne pouvait changer le cours vers le second conflit mondial. La confirmation cruciale de cela fut la confusion politique terrible du prolétariat en Espagne, qui, au lieu de continuer sa lutte contre l'appareil d'Etat et toutes ses ailes politiques et syndicales, s'est laissé immobiliser par ces dernières, abandonnant son terrain de classe [22] [184].
Là est la véritable tragédie du prolétariat mondial en Espagne ! Mais, pour le FOR, ce "jalon de défaite" a confirmé la "supériorité du socialisme sur le capitalisme".
Combien est fausse cette
appréciation sur la révolution communiste, appréciation incapable de montrer à
quel moment ce mouvement pour la libération totale de l'humanité s'est vue précipiter
dans l'abîme le plus barbare. Si le
prolétariat est incapable de comprendre quand et comment sa lutte, ses
perspectives et ses forces les plus dévouées, ont été vaincues par la classe
ennemie, et récupérées par elle momentanément, le prolétariat ne sera
jamais à la hauteur de sa mission historique.
Sa future libération mondiale requiert constamment un bilan profond des
50 dernières années. Que le FOR prenne
conscience de cette nécessité et surtout de ce qu'a été le trotskisme et la
dite "révolution espagnole", alors seulement il pourra réellement
avancer et réaliser la promesse de cette énorme passion révolutionnaire
contenue dans ses publications.
MACK.
[1] [185] Rosa Luxembourg, "la révolution russe", ed. Spartacus, dans "démocratie et dictature"
[2] [186] FOR, "Pour un second manifeste communiste" Losfeld, Paris 1965, p.24.
[3] [187] cité dans l'intéressant fascicule de José Antonio Garcia Diez, "URSS, 1917-1929 : de "la révolution à la planification" (traduit par nous), Madrid 1969, p.53. Cela est aussi développé par d'autres historiens de la révolution russe comme Carr, Davies, Dobb, Erlich, Lewin, Nove, etc...
[4] [188] Luxembourg, idem.
[5] [189] FOR, idem, p.25.
[6] [190] Nicolas Boukharine, "théories économiques de la période de transition" ed. EDI.
[7] [191] FOR, idem, p.25.
[8] [192] Grandizo-Munis, "Classe révolutionnaire organisation politique, dictature du prolétariat dans "Alarma" n°24, ler trimestre 73, p.9 (traduit par nous)
[9] [193] Munis, idem, dans "Alarma" n°'25, deuxième trimestre 1973, p.13 (traduit par nous).
[10] [194] Munis, idem, "Alarma" n'25,p.6 (traduit par nous).
[11] [195] Munis, "Lettre de réponse à la revue autogestion et socialisme" dans "Alarma n° 22, 23, 3ème et 4ème trimestre, 1972, p11.
[12] [196] Munis, "Jalons de défaite et promesse de victoire'(Espagne 1930-39), Mexico 1948, p.340. (traduit par nous).
[13] [197] Nous citons ici les articles de "Bilan" parus dans la "Revue Internationale" du CCI Nos 4, 6, 7 et l'article "Le mythe des collectivités anarchistes" dans le N°15.
[14] [198] Bilan, "textes sur la révolution espagnole"'(sic !), 1936-38, Barcelone 1978, p.103.
[15] [199] Idem, p.116.
[16] [200] Munis dans "Jalons ... " p.305
[17] [201] Munis idem, p. 339-340.
[18] [202] Munis idem, p.346.
[19] [203] Munis, idem, p. 345.
[20] [204] Comme nous l'avons dit, Munis insiste parfois sur le fait que le pouvoir politique est décisif. Voir par exemple, dans "Jalons..." p.357-58. C'est un dualisme auquel n'échappe pas le FOR
[21] [205] Nous mentionnons entre autres : des articles dans "Révolution internationale" Nos 7, 14,54, 56, 57, 58, la "Revue Internationale" n°l6, la "critique à Focus" dans "Internationalism" (USA) n°25, "Le FOR, une confusion dangereuse" dans "Accion Proletaria" n°'17.
[22] [206] Dans une récente polémique, plus qu'acerbe, le FOR répète ses affirmations habituelles sur l'Espagne 36, sans ajouter rien de nouveau, en continuant à parler de la fameuse "révolution espagnole" (voir l'article "la trajectoire tordue de révolution Internationale").
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [207]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [108]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (1ère partie)
- 4312 reads
Quand le groupe de la Gauche Communiste en France (G.C.F) décide de traduire et de publier "Lénine philosophe" de A. Pannekoek, c'est non seulement son pseudonyme de J. Harper, mais le nom même de Pannekoek qui est pratiquement inconnu en France. Ceci ne peut être expliqué comme un fait "français", même en tenant compte du fait que la France n'a jamais brillé par son empressement dans la publication des oeuvres du mouvement ouvrier et marxiste, car cela est vrai pour tous les pays d'Europe et du monde, cet "oubli" ne concerne pas particulièrement Pannekoek. C'est toute la Gauche Communiste -à commencer par Rosa Luxemburg- qui s'est trouvée à la pointe des combats révolutionnaires de la classe ouvrière à la sortie de la première guerre mondiale, c'est toute son oeuvre théorique, son action politique, et ses luttes passionnées qui se trouvent englouties dans 1"'oubli". On a peine à croire qu'il a suffit d'une dizaine d'années de dégénérescence de l'I.C. et de contre-révolution stalinienne pour "effacer" des mémoires les enseignements d'un mouvement révolutionnaire pourtant si riches, si denses, d'une génération qui venait elle-même de le vivre. On dirait qu'une épidémie d'amnésie venait de frapper brusquement ces millions de prolétaires qui avaient participé activement à ces événements et de les plonger dans un désintérêt total pour tout ce qui est la pensée révolutionnaire. De cette vague qui a failli "ébranler le monde", ne subsistent que quelques traces, représentées par les maigres groupes dispersés de par le monde, isolés les uns des autres, et donc incapables d'assurer la continuation de la réflexion théorique, autrement que dans des petites revues à tirage réduit à l'extrême, et souvent même pas imprimées.
Rien d'étonnant que le livre de Harper, "Lénine philosophe" paru en 1938 en allemand à la veille de la guerre, ne rencontre aucun écho et passe complètement inaperçu, même dans le milieu extrêmement réduit des révolutionnaires, et c'est le mérite incontesté d d'"Internationalisme", une fois la bourrasque de la guerre passée, d'avoir été le premier à le traduire et le publier en feuilleton, dans ses numéros 18 à 29 (février à décembre 1947).
En saluant le livre de Harper "comme une contribution de premier ordre, au mouvement révolutionnaire et à la cause de l'émancipation du prolétariat", "Internationalisme" ajoute dans son avant propos (n°18, février 1947) : "que l'on soit d'accord ou non, avec toutes les conclusions qu'il donne, personne ne saurait nier la valeur énorme de son travail qui fait de cet ouvrage, au style simple et clair, un des meilleurs écrits théoriques des dernières décades".
Dans ce même avant-propos, "Internationalisme" exprime sa préoccupation fondamentale en écrivant: "La dégénérescence de l'I.C. a entraîné un désintéressement inquiétant dans le milieu de l'avant garde pour la recherche théorique et scientifique. A part la revue "Bilan" publiée avant-guerre par la fraction italienne de la Gauche Communiste et les écrits des Communistes de Conseil dont fait partie le livre de Harper, l'effort théorique du mouvement ouvrier européen est quasi inexistant. Et rien ne nous paraît plus redoutable pour la cause du prolétariat que l'engourdissement théorique dont font preuve ses militants."
C'est pourquoi "Internationalisme", tout en considérant hautement sa valeur, ne se contente pas de publier simplement l'ouvrage de Pannekoek, mais se propose et soumet cet ouvrage à la discussion et en fait la critique dans une série d'articles qui vont du n°30 (janvier 48) au n°33 (avril 48). Si "Internationalisme" accepte et partage pleinement la démonstration de Pannekoek sur le fait que, dans sa polémique contre les tendances idéalistes des néo-machistes (Bogdanov), Lénine tombe dans des arguments qui relèvent du matérialisme bourgeois (mécaniste et positiviste), il (Internationalisme) rejette catégoriquement les conclusions politiques que Pannekoek se croit en droit d'en tirer, pour faire du Parti Bolchevique un parti non-prolétarien, une "intelligentsia" (?), et de la révolution d'Octobre une révolution bourgeoise.
Cette thèse servira de fond à toute une analyse de la révolution d'Octobre et du parti Bolchevique par le courant conseilliste et qui le distingue nettement de la Gauche Communiste, et également du K.A.P.D, du moins à ses débuts. Le conseillisme se présente ainsi comme une involution de la Gauche allemande de laquelle il se réclame. Avec quelques variantes, on retrouvera cette thèse, aussi bien dans "Socialisme ou Barbarie" que dans "Socialisme des Conseils", allant de Chaulieu à P. Mattik , de M. Rubel à K. Korsch. Ce qui est le plus frappant dans cette démarche et commun à tous, y compris les modernistes, consiste dans la réduction de la révolution d'Octobre à un phénomène strictement russe, perdant complètement de vue sa signification internationale et historique.
Une fois arrivé là, il ne restait plus qu'à rappeler l'état arriéré du développement industriel de la Russie, pour conclure à l'absence des conditions objectives pour une révolution prolétarienne. L'absence d'une vision globale de l'évolution du capitalisme comme un tout, amène le conseillisme, par un détour propre, à la position de toujours des mencheviks : l'immaturité des conditions objectives en Russie et l'inévitabilité du caractère bourgeois de la révolution.
De toute évidence, ce qui a motivé le travail de Pannekoek n'est pas tant la rectification théorique de la démarche erronée de Lénine dans le domaine philosophique, mais fondamentalement le besoin politique de combattre le parti Bolchevik, considéré par lui , à priori et par nature, comme un parti marqué par le caractère "mi-bourgeois, mi-prolétarien du bolchevisme et de 1a révolution russe elle-même,, ([1] [208]). C'est pour "élucider la nature du bolchevisme et de 1a révolution russe" comme l'écrit P Mattick, "que Pannekoek entreprit un examen critique de ses fondements philosophiques en publiant en 1938 son "Lénine Philosophe". On peut douter de la validité d’une telle démarche et sa démonstration est loin d'être convaincante. Faire découler la nature d'un événement historique aussi important que celui de la révolution d'Octobre ou le rôle joué par le parti Bolchevik d'une polémique philosophique -pour si importante qu'elle pouvait être- est loin de pouvoir constituer la preuve de ce qu'on avance. Les erreurs philosophiques de Lénine en 1908 pas plus que le triomphe ultérieur de la contre-révolution stalinienne ne prouvent pas qu'Octobre 17 n'était pas une révolution prolétarienne, mais ... la révolution d'une troisième classe : l'intelligentsia (?). En fondant artificiellement ses confusions politiques fausses sur des prémisses théoriques justes, en établissant un lien à sens unique entre causes et effets, Pannekoek tombe à son tour dans la même démarche non marxiste qu'il venait de critiquer à juste raison chez Lénine.
Avec 1968 et la reprise de la lutte de classes, le prolétariat renoue le fil rompu par près d'un demi-siècle de contre-révolution triomphante et se réapproprie les travaux de cette gauche qui avait survécu au naufrage de l'Internationale Communiste.
Aujourd'hui, les écrits et les débats de cette Gauche, longtemps ignorés, ressortent et trouvent des lecteurs de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, "Lénine philosophe" de Pannekoek -comme tant d'autres ouvrages d'autres auteurs- a pu être imprimé et lu par des milliers de militants ouvriers. Mais pour que ces travaux théorico-politiques puissent vraiment servir au développement de la pensée et de l'activité révolutionnaire aujourd'hui, ils doivent être étudiés dans un esprit critique, en se gardant de l'esprit d'un certain milieu d'universitaires qui, découvrant tel ou tel auteur, sont prompts à en faire une nouvelle tarte à la crème, une nouvelle idolâtrie, et s'en font les apologistes inconditionnels.
Face à un "néo anti-bolchevisme" à la mode aujourd'hui chez certains groupes et revues comme le PIC ou l'ex-Spartacus, qui raye tout simplement tout le mouvement socialiste et communiste de Russie, y compris la révolution d'Octobre, de l'histoire du prolétariat, nous pouvons reprendre ce qu'écrivait Internationalisme dans son avant propos au livre de J. Harper :
°Cette déformation du marxisme, que nous devons aux "marxistes" aussi empressés qu'ignorants, trouve son pendant en ceux qui, non moins ignorants, font de 1"'anti-marxisme" leur spécialité propre. L'anti-marxisme est devenu aujourd'hui l'apanage de toute une couche de semi-intellectuels petits bourgeois déracinés, déclassés, aigris et désespérés qui, répugnant au monstrueux système russe issu de la révolution prolétarienne d'Octobre, et répugnant au travail ingrat, dur, de 1a recherche scientifique, s'en vont par le monde, les cendres de deuil sur la tête, dans une "croisade sans croix", à la recherche de nouveaux idéaux, non à comprendre, mais à adorer".
Ce qui était vrai hier pour le marxisme, l'est aujourd'hui également pour le bolchevisme et la révolution d'Octobre.
M.C.
POLITIQUE ET PHILOSOPHIE DE LENINE A HARPER
I1 est indiscutable, après la lecture du document de Harper sur Lénine, que nous nous trouvons devant une étude sérieuse et profonde sur l'oeuvre philosophique de Lénine et devant une esquisse très claire et très nette de la dialectique marxiste que Harper oppose à la conception philosophique de Lénine.
Le problème pour Harper s'est posé de la façon suivante : plutôt que de séparer les conceptions du monde d'un Lénine de son activité politique, il est préférable, pour mieux voir et comprendre ce que le révolutionnaire a entrepris, de discuter et de saisir ses origines dialectiques. L'oeuvre qui, pour Harper, caractérise le mieux Lénine, sa pensée, est "Matérialisme et Empiriocriticisme", où, partant à l'attaque d'un net idéalisme qui pointait dans l'intelligentsia russe avec la conception philosophique d'un Mach, Lénine essaye de revivifier un marxisme qui venait de subir des révisions, non seulement de la part de Bernstein, mais également de la part de Mach.
Harper introduit le problème par une analyse très perspicace et approfondie de la dialectique chez Marx et Dietzgen. Bien mieux, tout au long de son étude, Harper tâchera de faire une discrimination profonde entre le Marx des premières études philosophiques et le Marx mari par la lutte de classe et se dégageant de l'idéologie bourgeoise. Au travers de cette discrimination, il dégage les fondements contradictoires du matérialisme bourgeois de l'époque prospère du capitalisme qu'il caractérise dans les sciences naturelles, et du matérialisme révolutionnaire concrétisé dans les sciences du développement et du devenir social. Harper s'efforcera de réfuter certaines assertions de Lénine qui, à son avis, ne correspondent pas à la pensée "machiste", mais sont uniquement du ressort de la polémique de la part de ce Lénine qui aurait cherché plus à résoudre "l'unité du parti socialiste russe qu'à réfuter la vraie pensée de Mach".
Mais si le travail de Harper présente un intérêt dans son étude sur la dialectique, ainsi que dans la correction de la pensée de Mach à la manière de Lénine, la partie la plus intéressante parce que lourde de conséquences, est sans conteste l'analyse des sources du matérialisme chez Lénine, et leur influence sur l'oeuvre et l'action de ce dernier dans la discussion socialiste internationale et dans la révolution de 1917 en Russie.
La première phase de la critique commence par l'étude des ancêtres philosophiques de Lénine.
De d'Holbach, en passant par certains matérialistes français tels Lamétrie et jusqu'à Avenarius, la pensée de Lénine s'y dessine noir sur blanc. Tout le problème réside sur la théorie de la connaissance. Même Plekhanov n'a pas échappé à cette embûche du matérialisme bourgeois. Marx est précédé par Feuerbach. Et ceci sera un lourd handicap dans la pensée sociale de tout le marxisme russe, Lénine en tête.
Harper, très justement, délimite, dans la théorie de la connaissance, les sources du matérialisme bourgeois qui sombrera par statisme, et du matérialisme révolutionnaire qui ne suit pas ou ne dépasse pas la dialectique bourgeoise, mais est de nature et d'orientation différentes.
D'une part, la bourgeoisie considère la connaissance comme un phénomène purement réceptif (Engels -d'après Harper- sur ce point seulement partagera cette conception). Qui dit connaissance dit perception, sensation du monde extérieur, notre esprit se comportant comme un miroir reflétant plus ou moins fidèlement le monde extérieur. On comprend à ce moment-là que les sciences naturelles furent le cheval de bataille du monde bourgeois. La physique, la chimie, la biologie dans leurs premières expressions, représentent plus un travail de traduction de phénomènes du monde extérieur qu'une tentative d'interprétation. La nature semble être un grand livre grâce auquel on transcrit en signes intelligibles des manifestations naturelles. Tout parait ordonné, rationnel, ne souffrant aucune exception, si ce n'est l'imperfection de nos moyens de réception. En conclusion, la science devient une photographie d'un monde dont les lois sont toujours les mêmes, indépendantes de l'espace et du temps, mais dépendantes de l'un et de l'autre pris séparément.
Cette tentative première des sciences doit naturellement prendre pour objet ce qui est extérieur à l'homme, car ce choix exprime une facilité plus grande à saisir le monde extérieur sensible, que le monde humain plus enchevêtré et dont les lois se refusent aux signes équationnels à un seul sens, des sciences naturelles. Mais aussi doit-on voir là surtout un besoin pour la bourgeoisie dans son développement de saisir rapidement et empiriquement ce qui extérieur à elle, peut servir le développement de sa force sociale de production. Rapidement, car les assises du système économico social ne sont pas encore solides, empiriquement, car la genèse du capitalisme se déroule sur un terrain fertile, qui, aux yeux des humains fait ressortir surtout les résultats et les conclusions, plutôt que le cheminement parcouru pour y arriver.
Les sciences naturelles dans le matérialisme bourgeois devaient influencer la connaissance des autres phénomènes et donner naissance aux sciences humaines, histoire, psychologie, sociologie, où les mêmes méthodes de la connaissance étaient appliquées.
Et le premier objet de la connaissance humaine qui préoccupe les esprits se trouve être la religion, laquelle est étudiée comme un problème historique pour la première fois, et non comme un problème philosophique. Cela aussi exprime le besoin d'une bourgeoisie jeune à se débarrasser du fixisme religieux qui nie la rationalité naturelle du système capitaliste.
Cela s'exprime par l'éclosion d'une floraison de savants bourgeois, comprenant Renan, Strauss, Feuerbach, etc. Mais c'est toujours une dissection méthodologique qui s'opère, l'homme cherchant non à critiquer socialement un corps idéologique, tel la religion, mais plutôt à retrouver ses fondements humains, pour la réduire au niveau des sciences naturelles et avec un scalpel permettre la photographie des documents poussiéreux et des altérations subies dans le cours des siècles. Enfin, le matérialisme bourgeois normalise un état de fait, fixe pour l'éternité un mode immuable de développement. C'est regarder la nature comme une répétition indéfinie de causes rationnelles. L'homme ramène la nature à un désir de statisme conservateur. I1 sent qu'il domine la nature d'une certaine manière, il ne voit pas que ses instruments de domination sont en train de se libérer de l'homme et de se retourner contre lui. Le matérialisme bourgeois est une étape progressive dans la connaissance humaine. I1 devient conservateur jusqu'à être rejeté par la bourgeoisie elle-même quand le système capitaliste à son apogée dessine déjà sa chute.
De ce mode de pensée qui se fait encore sentir dans l'oeuvre de jeunesse de Marx, Harper voit dans la prise de conscience de la lutte de classe, chez les masses travailleuses, au travers des premières contradictions importantes du régime capitaliste, le chemin qui conduit la pensée de Marx vers le matérialisme révolutionnaire.
Le matérialisme révolutionnaire, insiste Harper, n'est pas un produit rationnel ; si le matérialisme bourgeois éclot dans un milieu économico social spécifique, le matérialisme révolutionnaire aura lui aussi besoin d'un milieu économico social spécifique. Marx à ces deux époques prend conscience d'une existence qui se modifie. Mais là où la bourgeoisie n'a vu que rationalisme, répétition de cause à effet, Marx sent, dans le milieu économico social évoluant,un élément nouveau qui s'introduit dans le domaine de la connaissance. Sa conscience n'est pas une photographie du monde extérieur, son matérialisme est animé de tous les facteurs naturels, l'homme en premier lieu.
La bourgeoisie pouvait négliger la part de l'homme dans la connaissance, car son système à ses débuts se déroulait comme les lois astronomiques, avec une régularité précise, de plus son système économique laissait l'homme en dehors.
Cette négligence du système par rapport à l'homme commence vers le milieu du 19ème siècle à se faire sentir dans les rapports sociaux. La conscience révolutionnaire alors mûrit, sa connaissance n'est pas seulement un miroir du monde extérieur, comme le prétend le matérialisme bourgeois, l'homme entre dans la connaissance du monde comme un facteur réceptif et de plus comme un facteur agissant et modifiant.
La connaissance pour Marx devient alors le produit de la sensation du monde extérieur et de l'idéeaction de l'homme facteur moteur de la connaissance.
Les sciences du développement social et du devenir social sont nées, éliminant les vieilles sciences humaines, exprimant une progression et un déroulement senti et agi. Les sciences naturelles elles-mêmes sortent de leur cadre étroit. La science du 19ème siècle bourgeois s'écroule à cause de sa cécité.
C'est ce manque de praxis dans la connaissance qui spécifiera la nature idéologique de Lénine. Si Harper recherche les sources philosophiques de Lénine, il ne leur attribuera pas d'influence décisive dans l'action de Lénine.
L'existence sociale conditionne la conscience. Lénine est issu d'un milieu social retardé, la féodalité règne encore, et la bourgeoisie n'est pas une classe forte et capable révolutionnairement. Le phénomène capitaliste en Russie se présente à une période où la bourgeoisie développée et mûrie en Occident dessine déjà sa courbe décadente. La Russie devient un terrain capitaliste, non par le fait d'une bourgeoisie nationale s'opposant à l'absolutisme féodal du Tsar, mais par l'ingérence du capital étranger, qui crée ainsi, de toutes pièces, l'appareil capitaliste en Russie. Parce que le matérialisme bourgeois s'enlise par le développement de son économie et de ses contradictions, l'intelligentsia russe ne trouve pour lutter contre l'absolutisme impérial que le matérialisme révolutionnaire. Mais l'objet de la lutte dirigera le matérialisme révolutionnaire contre la féodalité et non contre le capitalisme qui ne représente aucune force effective. Lénine fait partie de cette intelligentsia en ce que puisant dans la seule classe révolutionnaire, le prolétariat, il tente de réaliser la transformation capitaliste retardée de la Russie féodale.
Cette énonciation n'est qu'une interprétation de Harper qui verra dans la révolution russe une maturité objective de la classe ouvrière et un contenu politique bourgeois exprimé par Lénine qui subit dans sa conscience des tâches de l'heure en Russie. l'existence économico sociale de ce pays se comportant au point de vue du capital comme une colonie, dont la bourgeoisie nationale serait nulle, et dont les deux forces en présence serait l'absolutisme et la classe ouvrière.
Le prolétariat s'exprime alors en fonction de ce retard qui est caractérisé par l'idéologie matérialiste bourgeoise d'un Lénine.
Voila la pensée d'un Harper sur Lénine et la révolution russe. Une phrase de Harper :
"Cette philosophie matérialiste était précisément la doctrine qui convenait parfaitement à 1a nouvelle masse d'intellectuels russes qui dans les sciences physiques et dans la technique ont vite reconnu avec enthousiasme la possibilité de gérer la production et comme nouvelle classe dominante d'un immense empire ont vu s'ouvrir devant eux l'avenir -avec la seule résistance de la vieille paysannerie religieuse". (« Lénine philosophe » Ch.VIII)
La méthode de Harper, ainsi que son mode d'interprétation du problème de la connaissance, sont dignes avec "Lénine philosophe" de figurer parmi les meilleures oeuvres du marxisme. I1 nous entraîne cependant, quant à ses conclusions politiques, vers une telle confusion, que nous nous sentons obligés de l'examiner de près pour tenter de dissocier l'ensemble de sa formulation du problème de la connaissance d'avec ses conclusions politiques qui nous paraissent erronées et ne pas même être en rapport avec le niveau général du travail.
Harper nous dit : "...le matérialisme n'a dominé l'idéologie de la classe bourgeoise que pendant un temps très court...". Ce qui lui permet par la suite -après avoir prouvé que la philosophie de Lénine dans "Matérialisme et Empiriocriticisme" était essentiellement matérialiste bourgeoise- de dire que la révolution bolchevik d'octobre 1917 était une "révolution bourgeoise appuyée sur le prolétariat".
Harper s'enferme ici dans sa propre dialectique et ne nous explique pas ce premier phénomène de sa pensée et de l'histoire : comment se fait-il que la révolution bourgeoise produisant elle-même sa propre idéologie, cette idéologie étant dans la période révolutionnaire, matérialiste, comment se fait-il qu'au moment où s'engage la crise la plus aigue du capitalisme (entre 1914 et 1920), crise qui ne semble pas troubler Harper, comment se fait il qu'à ce moment une révolution bourgeoise ait été propulsée exclusivement par la partie la plus consciente et l'avant-garde des ouvriers et des soldats russes, avec qui se solidarisèrent des ouvriers et des soldats du monde entier, et, principalement, du pays (l'Allemagne) où le capitalisme était le plus développé ? Comment se fait-il que justement à cette époque, les marxistes, les dialecticiens les plus éprouvés, les meilleurs théoriciens du socialisme défendant aussi bien sinon mieux que Lénine la conception matérialiste de l'histoire , comment se fait-il que par exemple des Plekhanov et des Kautsky se trouvaient justement dans le camp de la bourgeoisie contre les ouvriers et les soldats révolutionnaires du monde entier en général, et contre Lénine et les bolcheviks en particulier ? Harper ne pose même pas toutes ces questions ; comment pourrait-il y répondre ? Mais c'est justement le fait qu'il ne les ait pas posées qui nous étonne.
De plus, le long développement philosophique, quoique juste dans l'ensemble de son développement, comporte certaines affirmations qui en altèrent la portée. Harper tend à faire (parmi les théoriciens du marxisme) une séparation entre deux conceptions fondamentalement opposées, au sein de ce courant idéologique, quant au problème de la connaissance (et la manière de l'aborder). Cette séparation qui remonterait à l'oeuvre et à la vie de Marx lui-même est quelque peu simpliste et schématique. Harper voit d'une part dans l'idéologie de Marx lui-même deux périodes :
1) Jusqu'à 1848, Marx matérialiste bourgeois progressiste : "...la religion est l'opium du peuple...", phrase reprise ensuite par Lénine et que pas plus Staline que la bourgeoisie russe n'ont cru nécessaire d'enlever des monuments officiels ni même en tant que but de propagande du parti ;
2) Ensuite, Marx 2ème manière, matérialiste et dialecticien révolutionnaire, l'attaque contre Feuerbach, le Manifeste Communiste, etc. : « ...1'existence conditionne la conscience ».
Harper pense que ce n'est pas un hasard que l'oeuvre de Lénine ("Matérialisme et Empiriocriticisme") soit essentiellement représentative du marxisme première manière, et il en arrive, partant de là, à l'idée selon laquelle l'idéologie de Lénine était déterminée par le mouvement historique auquel il participait et dont la nature profonde apparaîtrait selon Harper, être fournie par la nature même, matérialiste bourgeoise de l'idéologie de Lénine (Harper ne s'en tenant qu'à "Matérialisme et Empiriocriticisme").
Cette explication mène à la conclusion de Harper, selon laquelle 1"'Empiriocriticisme" serait aujourd'hui la bible des intellectuels techniciens et autres, représentants de la nouvelle classe capitaliste d'Etat montante : la révolution russe et les bolcheviks en tête, aurait été une préfiguration d'un mouvement plus général d'évolution révolutionnaire, du capitalisme au capitalisme d'Etat, et de mutation révolutionnaire de la bourgeoisie libérale en bourgeoisie bureaucratique d'Etat, dont le stalinisme serait la forme la plus achevée.
Cette conception de Harper laisse ainsi à penser que cette classe qui prendrait partout pour bible "Empiriocriticisme" (que Staline et ses amis continueraient à défendre) s'appuierait essentiellement sur le prolétariat pour faire sa révolution capitaliste d'Etat et, d'après Harper, ce serait la raison qui déterminerait cette nouvelle classe à s'appuyer sur le marxisme dans cette révolution.
Cette explication tendrait donc à prouver, pour qui le voudrait bien, que le marxisme première manière, conduit directement à Staline en passant par Lénine (ce que nous avons déjà entendu de la bouche de certains anarchistes pour ce qui est du marxisme en général, dont Staline serait l'aboutissement logique -la logique anarchiste!?) et qu'une nouvelle classe révolutionnaire capitaliste appuyée sur le prolétariat surgirait dans l'histoire justement au moment où le capitalisme lui-même entre dans une crise permanente du fait d'un hyper développement de ses forces productives dans le cadre d'une société basée sur l'exploitation du travail humain (la plus-value).
Ces deux idées que Harper tend à introduire dans son ouvrage "Lénine philosophe" qui date d'avant la guerre de 1939-45, sont elles-mêmes énoncées par d'autres que lui, venant de milieux sociaux et politiques différents que lui, et sont devenues très en vogue après cette guerre. Elles sont défendues actuellement, la première par de très nombreux anarchistes, et la seconde par de très nombreux bourgeois réactionnaires dans le genre de James Burnham.
Que les anarchistes arrivent à de telles conceptions mécanistes et schématiques, selon lesquelles le marxisme serait à la base du stalinisme et de "l'idéologie capitaliste d'Etat", ou de la nouvelle classe "directoriale", ceci n'est pas étonnant de leur part. Ils n'ont jamais rien compris aux problèmes de la philosophie comme les révolutionnaires l'entendent : ils font découler Marx d'Auguste Comte, comparent cette assimilation à Lénine, et font découler de là "l'idéologie bolcheviste staliniste" et y rattachent tous les courants marxistes, sans exception, prenant pour leur, en tant que mode de pensée philosophique, tous les dadas à la mode, tous les idéalismes, de l'existentialisme au nietzschéisme, ou de Tolstoi à Sartre.
Or, cette affirmation de Harper selon laquelle "Empiriocriticisme" de Lénine serait un ouvrage philosophique dont l'interprétation du problème de la connaissance n'y dépasserait pas la méthode d'interprétation matérialiste bourgeoise mécaniste, et faisant découler de cette constatation la conclusion selon laquelle les bolcheviks, le bolchevisme et la révolution russe ne pouvaient pas dépasser le stade de la révolution bourgeoise, ces affirmations, comme nous le voyons, ne nous mènent pas seulement aux conclusions des anarchistes et de bourgeois comme Burnham ; cette affirmation est avant tout en contradiction avec une autre affirmation de Harper qui est, celle-là, en partie juste :
"Le matérialisme n'a dominé l'idéologie de la classe bourgeoise que pendant un temps très court. Tant que celle-ci pouvait croire que la société avec son droit à la propriété privée, sa liberté individuelle et sa libre concurrence pouvait résoudre tous les problèmes vitaux de chacun grâce au développement de la production sous l'impulsion du progrès illimité de la science et de la technique, elle pouvait admettre que la science avait résolu les principaux problèmes théoriques et n'avait plus besoin d'avoir recours aux forces spirituelles supranaturelles. Mais le jour où la lutte de classe du prolétariat eût révélé le fait que le capitalisme n'était pas en mesure de résoudre le problème de l'existence des masses, sa philosophie optimiste et matérialiste du monde disparut. Le nouveau, le monde apparût plein d'incertitudes et de contradictions insolubles, plein de puissances occultes et menaçantes...".
Nous reviendrons par la suite sur le fond de ces problèmes, mais nous sommes contraints de noter, sans vouloir faire de vaine polémique, les contradictions insolubles dans lesquelles Harper s'est mis lui-même, d'une part en attaquant le problème si complexe qu'il a attaqué d'une manière quelque peu simpliste et d'autre part les conclusions auxquelles il devait être amené quant au bolchevisme et au stalinisme.
Comment peut-on expliquer, répétons-nous, d'après les idées de Harper, le fait que, au moment où la lutte de classe du prolétariat apparut, la bourgeoisie devenait idéaliste et que c'est justement au moment où la lutte de classe se développe avec une ampleur inconnue jusque là dans l'histoire, que naît, de la bourgeoisie un courant matérialiste donnant naissance à une nouvelle classe bourgeoise capitaliste. Ici Harper introduit une idée selon laquelle, si la bourgeoisie devait devenir absolument idéaliste, si on peut déceler chez Lénine un courant matérialiste bourgeois, Lénine "était obligé d'être matérialiste pour entraîner derrière lui les ouvriers". Nous pouvons nous poser la question suivante : que ce soient les ouvriers qui aient adopté l'idéologie de Lénine, ou Lénine qui se soit adapté aux besoins de la lutte de classe, selon les conclusions de Harper, ou bien le prolétariat suivait un courant bourgeois, ou un mouvement ouvrier se promouvait en sécrétant une idéologie bourgeoise. Mais de toute façon, le prolétariat ne nous apparaît pas ici avec une idéologie propre. Quel piètre matérialiste marxiste pourrait affirmer une telle chose : le prolétariat entre en action indépendante en produisant une idéologie bourgeoise. C'est là que nous mène Harper.
Du reste, il n'est pas entièrement exact que la bourgeoisie soit elle-même à une certaine époque totalement matérialiste et à une certaine autre totalement idéaliste. Dans la révolution bourgeoise de 1789, en France, le culte de la Raison n'a fait que remplacer celui de Dieu et était typique du double caractère des conceptions à la fois matérialiste et idéaliste de la bourgeoisie en lutte contre le féodalisme, la religion et le pouvoir de l'Eglise (sous la forme aiguë de persécutions des prêtres, des incendies d'églises, etc.). Nous reviendrons également sur ce double aspect permanent de l'idéologie bourgeoise ne dépassant pas, même aux heures les plus avancées de la "Grande Révolution" bourgeoise en France, le stade de "...la religion est l'opium du peuple".
Cependant, nous n'avons pas tiré encore toutes les conclusions vers lesquelles Harper nous entraîne, nous en tirerons quelques unes et nous ferons quelques rappels historiques qui peuvent intéresser tous ceux qui "rejettent" la révolution d'octobre dans le camp bourgeois.
Si ce premier regard jeté sur les conclusions et les théories philosophiques de Harper nous a entraîné vers certaines réflexions qui seront l'objet de développements ultérieurs, il y a des faits que nous devons pour le moins relever immédiatement car il s'agit de faits historiques que Harper semble n'avoir pas même voulu effleurer.
En effet, Harper nous parle pendant des dizaines de pages de la philosophie bourgeoise, de la philosophie de Lénine, et arrive à des conclusions pour le moins osées et qui demandaient, tout au plus, un examen sérieux et approfondi. Or, quel matérialiste marxiste peut accuser un homme, un groupe politique ou un parti de ce dont Harper accuse Lénine, les bolcheviks et leur parti, d'avoir représenté un courant et une idéologie bourgeoise « ...s'appuyant sur 1e prolétariat... », sans avoir auparavant examiné -au moins pour mémoire- le mouvement historique auquel ils ont été mêlés : ce courant, la Social-démocratie russe et internationale, d'où est issue (au même titre que toutes les autres fractions de gauche de la Social-démocratie) la fraction des bolcheviks.
Comment s'est formée cette fraction ? Quelles luttes a-t-elle été amenée à entreprendre sur le plan idéologique pour arriver à former un groupe à part, puis un parti, puis l'avant-garde d'un mouvement international ?
De la lutte contre le menchevisme, de l'Iskra et de "Que faire ?" de Lénine et de ses camarades, de la révolution de 1905 et du rôle de Trotski, de sa "Révolution permanente" (qui devait l'amener à fusionner avec le mouvement bolchevik entre février et octobre 1917), de la seconde révolution de février à octobre (sociaux-démocrates, socialistesrévolutionnaires de droite, etc., au pouvoir), des thèses d'avril de Lénine, de la constitution des soviets et du pouvoir ouvrier, de la position de Lénine dans la guerre impérialiste, de tout cela Harper ne dit mot. On ne peut croire que cela soit un hasard.
Mousso et Philippe
(à suivre)
[1] [209] "Lénine philosophe", introduction de Paul Mattick, édition Spartacus, 1978.
Courants politiques:
- Le Conseillisme [210]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 26 - 3e trimestre 1981
- 2632 reads
Présentation des rapports et résolutions du 4eme congrès du CCI.
- 2619 reads
« Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi »
L'histoire s'accélère. Les plaies béantes du vieux monde s'approfondissent et se multiplient.
En un an dans les pays sous-développés, la faim a tué autant d'hommes que l'a fait la Deuxième Guerre Mondiale en six ans de feu. Les prolétaires des pays dits "communistes" connaissent les pénuries alimentaires des temps de guerre. L'économie du bloc occidental s'enlise de plus en plus, irréversiblement, jetant des millions de prolétaires dans la rue.
La seule production qui augmente réellement c'est celle de l'armement.
Simultanément, la réponse de la classe ouvrière - du Brésil à la Chine, de la Grande Bretagne à la Pologne - s’accélère, se confirme et s'approfondit posant de plus en plus dans les faits la question de la nécessité de 1'INTERNATIONALISATION de l'action des prolétaires de tous les pays.
Avec les luttes en Pologne, à nouveau le monde entier a été obligé de dire : "Les ouvriers ont fait ...". La classe révolutionnaire que porte en elle la classe ouvrière est une fois de plus apparue au grand soleil.
Et cela a donné un violent coup d'accélérateur à l'histoire. Le vieux monde craque de toutes parts alors même que son fossoyeur relève la tête.
Le vent de Gdansk annonce de prochaines tempêtes révolutionnaires.
Il y a deux ans, au IIIe Congrès nous disions que les années 80 seraient "LES ANNEES DE VERITE". Les événements ont déjà entrepris de vérifier cette affirmation.
De plus en plus les révolutionnaires seront confrontés à la difficulté de comprendre et d'analyser "calmement" les choses, alors que tout va de plus en plus vite.
Le IVe Congrès a été traversé par le nouveau rythme de l'histoire et l'organisation a pu prendre l'exacte mesure des nouvelles difficultés qu'entraine pour les révolutionnaires cette "accélération" tant attendue.
Marx disait dans le Manifeste Communiste que "du point de vue théorique, (les communistes) ont sur la masse prolétarienne l'avantage de comprendre les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier." Mais cet "avantage" ne leur est donné ni automatiquement ni miraculeusement par le simple fait qu'ils se constituent en organisation politique. S'ils l'acquièrent c'est par un constant travail COLLECTIF de confrontation permanente de leurs analyses avec la réalité historique et vivante ainsi que par un débat généralisé et conséquent au sein de leurs organisations.
Les textes du IVe Congrès que nous publions dans ce numéro illustrent l'effort du Courant pour réellement comprendre "les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier".
Les rapports et les résolutions sont des textes introductifs ou de conclusion des débats. La "contre-résolution sur la lutte de classe" a été une contribution et un instrument du débat, développant un point de vue différent de celui "majoritaire" adopté finalement par le Congrès.
Le rapport "CRISE ECONOMIQUE GENERALISEE ET CONFLITS INTER-IMPERIALISTES" ainsi que la RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE" tracent la perspective de l'aggravation de la crise économique capitaliste et de l'évolution des tensions entre puissances et blocs capitalistes.
Le rapport "PERSPECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE INTERNATIONALE (UNE BRECHE OUVERTE EN POLOGNE)" et la «RESOLUTION SUR LA LUTTE DE CLASSE" font le point sur l'évolution de l'affrontement entre les deux principales classes de la société. Ils analysent aussi bien les forces et les faiblesses du prolétariat que celles de son ennemi : la bourgeoisie mondiale.
Le texte "LES CONDITIONS HISTORIQUES DE LA GENERALISATION DE LA LUTTE DE LA CLASSE OUVRIERE" aborde le principal problème posé par les luttes ouvrières en Pologne : la nécessité de l'internationalisation des combats prolétariens pour qu'ils puissent épanouir leur puissance révolutionnaire.
La "CONTRE-RESOLUTION SUR LA LUTTE DE CLASSE" (signée Chénier) se penche surtout sur le rapport entre le développement de la crise politique de la bourgeoisie et celui de la lutte prolétarienne.
Contrairement à la résolution adoptée par le Congrès qui insiste sur les efforts de la bourgeoisie pour mettre en place internationalement une même stratégie face au prolétariat {"la gauche dans l'opposition") et pour répondre de façon coordonnée à la menace ouvrière internationale, le texte du camarade Chenier insiste surtout sur "la bourgeoisie décadente, sénile et incapable d'homogénéité face à son ennemi historique".
L'ensemble de ces travaux donneront au lecteur l'analyse générale de la situation historique au point où est parvenu le CCI lors de son 4ème congrès international.
"Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés par tel ou tel réformateur du monde.
Elles ne font qu'exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d'une lutte de classe qui existe, d'un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux".
(Manifeste Communiste)
Conscience et organisation:
Perspectives de la lutte de classe internationale (une brèche ouverte en Pologne)
- 2779 reads
1/LES ANNEES DE VERITE
"Dans les années 60, la bourgeoisie nous a donné de la misère en échange de miettes, dans les années 70, elle nous a donné encore plus de misère en échange de promesses ; pour les années 80, elle nous réserve beaucoup plus de misère. en échange de l a misère." ([1] [211])
.1. La situation actuelle de la crise capitaliste oblige les deux classes fondamentales de la société -le prolétariat et la bourgeoisie- à lutter à mort, sans ambigüité, pour imposer leurs alternatives historiques respectives : la Révolution ou la Guerre, le Communisme ou la Barbarie.
.2. D'une part la bourgeoisie a vu la faillite de tous les plans de "relance" économique expérimentés par tous les moyens dans les années 70, et prouvant chaque fois plus que sa seule "solution" est une 3ème guerre mondiale impérialiste.
D'autre part, le fait que le prolétariat n'est pas vaincu et les manifestations constantes de résistance de la classe ouvrière (dont la Pologne est l'expression la plus haute) obligent la bourgeoisie à poser radicalement la "question sociale", c'est-à-dire que toute son activité politique et économique en direction de la guerre ne peut avoir comme axe qu'une stratégie conséquente d'affrontement et de défaite du prolétariat.
.3. Pour le prolétariat, la perspective d'une "solution" à la crise à l'intérieur du capitalisme, qui a pu désorienter et freiner sa lutte au cours des années 70, laisse la place à une réalité amère de dégradation permanente et absolue de ses conditions d'existence. La misère que lui impose le capitalisme cesse d'être un simple phénomène quantitatif pour devenir une réalité QUALITATIVE de dégradation, d'insécurité et d'humiliation de toute son existence.
Le prolétariat apprend que les luttes purement économiques et les affrontements exclusivement partiels et limités finissent par n'avoir aucun effet sur la bourgeoisie et que les miettes RELATIVES ET MOMENTANEES arrachées comme fruit des grands combats de 1965 à 1973 ont disparu sans laissé de trace au cours de ces 5 dernières années et ont cédé le pas à une chute sans précédent et sans frein de son niveau de vie. Tout cela indique une seule perspective : l'affrontement généralisé avec le capital dans la dynamique de la révolution.
.4. C'est à partir de cet ensemble de conditions historiques globales que nous devons évaluer l’état actuel de la lutte de classe. La question est : comment le prolétariat et la bourgeoisie répondent-ils à cette situation historique de croisée des chemins ? C'est en partant de là que nous allons analyser la stratégie et les armes qu'emploie la bourgeoisie et faire le bilan des expériences, des forces et des faiblesses des luttes développées par la classe ouvrière.
2/LA REPONSE DE LA BOURGEOISIE
.5. Au 3ème Congrès international du CCI (cf. "Revue Internationale" n°18), nous avons constaté la réalité d'une crise politique généralisée de la bourgeoisie mondiale et analysé en détails les caractéristiques et manifestations de cette réalité. Ses causes -nous pouvons aujourd'hui les déterminer avec plus de perspective- provenaient de l'INADEQUATION de la politique bourgeoise à la conjoncture imposée par l'aggravation de la crise et des conflits impérialistes, étant donnée la reprise de la lutte ouvrière commencée en 1978 et, plus globalement, à cette situation de croisée des chemins que nous avons définie dans le premier point comme les années de vérité.
Le dénouement de cette crise politique a été la REORIENTATION TOTALE de la stratégie bourgeoise face à la situation et en particulier face au prolétariat. La réorientation de l'appareil et de l'action politique de la bourgeoisie lui ont permis une plus grande cohérence et une offensive plus systématique, plus concentrée et plus efficace contre le prolétariat. Dans l'immédiat la bourgeoisie S'EST RENFORCEE, quoique, comme nous le verrons, plus loin, ce renforcement s'inscrive da dans un affaiblissement à long terme de la bourgeoisie.
.6. L'axe essentiel de cette réorientation est, comme nous l'avions mis en évidence au 3ème congrès du CCI, le passage de la gauche dans l'opposition, ce qui a pour conséquence l'accès de la droite au pouvoir. Mais avant d'analyser en détail cet axe, il faut déterminer le cadre idéologique qui caractérise l'ensemble de la politique bourgeoise dans la situation actuelle.
La domination capitaliste s'appuie sur deux piliers. L'un est la répression et la terreur, l'autre, cachant et renforçant le premier, est la mystification, le mensonge idéologique. Ce second pilier doit toujours s'appuyer sur une base matérielle qui le rend crédible. S'il existe, dans l'idéologie bourgeoise, toute une série de mystifications qui s'appuient dans les fondements les plus profonds du capitalisme (démocratie, "droits de l'homme"), l'ensemble de l'idéologie bourgeoise, c'est-à-dire 1'ensemble des mystifications et des choix qui cimentent sa domination, doit se modifier suivant les différentes conjonctures imposées par la crise, la lutte de classe, et les conflits impérialistes, sous peine de perdre toute crédibilité et, pour autant, affaiblir son contrôle sur le prolétariat.
Dans les années 70, ce cadre idéologique tournait autour de l'illusion que les ouvriers, en faisant toute une série de sacrifices et en acceptant une politique d'austérité croissante, pourront "sortir de la crise" et retrouver la "prospérité" perdue. A travers le mythe d'une solution nationale et négociée à la crise, qui était incarnée dans la perspective de la gauche au pouvoir et dont l'idéologie constante était "l'avance des forces progressistes et le changement social", la bourgeoisie a pu maintenir sa domination en freinant et en paralysant momentanément la lutte des ouvriers, en leur faisant avaler des doses croissantes d'austérité et en reconstruisant l'union nationale autour de ses plans.
Le 3ème congrès du CCI a pris acte de la crise de cette orientation idéologique et a analysé l'ensemble des conditions objectives qui l'ont jetée par terre ; en même temps, il a fait le bilan de la reprise de la lutte prolétarienne qui, conséquence et cause à la fois de cet affaiblissement de la domination bourgeoise, se développait. Si la bourgeoisie avait continué avec les mêmes orientations politiques et idéologiques que celles de l'étape antérieure, elle aurait aggravé le vide dangereux qui se produisait dans son contrôle sur la société. Les deux dernières années (1977-79) montraient à travers toute une série de crises politiques et idéologiques, le processus par lequel la bourgeoisie réorientait sa stratégie et son idéologie.
La bourgeoisie reconnait ouvertement la gravité de ïa crise, et nous présente, même en l'exagérant, un cadre terrorisant de catastrophes et de dangers qui menacent la "communauté nationale", elle parle sans détour de la perspective de la guerre...C'est le nouveau "langage" de la "sincérité" et de la "vérité".
Dans ce sombre cadre démoralisant et sans perspectives, où la " communauté nationale" serait soumise à toutes sortes de dangers produits par toutes sortes de forces ténébreuses et difficiles à situer quelque part -le "terrorisme", 1'"encerclement impérialiste ", le "totalitarisme", etc.- il ne resterait plus d'autre remède que d'accepter les pires sacrifices et avaler la politique "de sang, de sueur et de larmes" pour sauver "le peu que nous avons".
La bourgeoisie tente de refaire l'union nationale à travers la "sincérité" en cherchant la démoralisation totale des ouvriers. Ainsi la bourgeoisie s'adapte à la situation de chaos et de décomposition de son système social, tente d'y enfoncer le prolétariat et cherche à profiter de l'attitude actuelle de la classe ouvrière de préoccupation et de maturation face à la gravité du moment historique et face aux énormes responsabilités que pose celui-ci, en la transformant en son contraire : DEMORALISATION, APATHIE, DESESPOIR, DEBANDADE...
Naturellement, cette orientation idéologique de la bourgeoisie ne peut avoir comme finalité que la déroute du prolétariat et sa soumission inconditionnelle aux plans de guerre, et ne peut être appliqué qu'au moyen de la gigantesque action d'usure et de division que réalisent la gauche et les syndicats à partir de l'opposition.
.7. Sous le capitalisme décadent, l'Etat, "démocratique" ou "dictatorial", se transforme en un appareil totalitaire monstrueux qui étend ses tentacules sur toute la vie sociale et soumet le prolétariat à une OCCUPATION absolue et systématique. Dans les pays du totalitarisme "démocratique" cette occupation est la FONCTION SPECIFIQUE des partis de gauche (staliniens, social-démocrate avec leurs appendices gauchistes) et des syndicats.
Comme nous l'avons souligné au 3ëme congres du CCI, l'orientation de la gauche au pouvoir qui a dominé les années 70, a produit une usure énorme de ses appareils, affaiblissant son contrôle sur le prolétariat, manquant ainsi à cette FONCTION SPECIFIQUE au sein de l'Etat bourgeois, qui est l'encadrement du prolétariat. Tout cela a produit une crise profonde au sein de ces appareils qui ont été conduits à se situer sur un terrain d'où ils peuvent réaliser d'une façon plus adéquate leur rôle, c'est à dire l'opposition.
En effet, c'est seulement à partir de l'opposition (libérés des responsabilités gouvernementales directes) que la gauche et les syndicats peuvent se consacrer à fond, sans hypothèque ni ambigüité, à leur rôle spécifique d'étrangler toute tentative de lutte ouvrière et d'encadrer les ouvriers derrière le plan de solidarité nationale et de guerre qu'organise le capital.
Mais le passage de la gauche dans l'opposition n'obéit pas simplement à un changement de tactique pour restaurer le contrôle sur les ouvriers, mais constitue la meilleure adéquation de cette fraction bourgeoise à la stratégie de l'ensemble du capital, dont les bases sont, comme nous l'avons analysé plus haut, la démoralisation et la déroute du prolétariat pour ouvrir les portes d'un cours vers la guerre :
1°- parce que c'est seulement dans une orientation générale d'opposition que la gauche et les syndicats peuvent enfermer les ouvriers dans une tactique de "lutte" fondée sur la défensive et le désespoir :
- des luttes isolées, corporatives, atomisant les ouvriers dans toutes sortes de divisions en usine, profession, secteur, etc..
- des actions humiliantes et désespérantes: grèves de la faim, enchaînements publics, sitting, pétitions aux autorités et personnalités publiques ;
- la solidarité réduite à des formes individualistes et moralistes qui produisent systématiquement le sentiment d'impuissance et de division,
- la méfiance consciencieusement entretenue des ouvriers pour leur propre auto-activité et auto-organisation, en leur faisant confier la "médiation" de l'action à tout type d'institution, d'organisme, de personnalités 'progressistes', etc.
2°- Parce que c'est seulement à partir de Top-position que la gauche et les syndicats peuvent rendre crédible leur alternative de se "partager la misère en se soumettant aux impératifs de l'économie nationale" qui imprègne toutes les luttes.
En s'adaptant à la conscience instinctive des ouvriers que, dans la situation actuelle, il n'y a pas de possibilité d'imposer les revendications immédiates, et pour éviter le passage nécessaire à un niveau supérieur de luttes massives, la gauche et les syndicats essaient de convertir cette prise de conscience en un défaitisme où l'unique chose qui reste à faire face à la crise est de SE PARTAGER LA MISERE ENTRE TOUS. Un tel projet -qui est 100% cohérent avec la stratégie de l'isolement et l'usure des luttes- est la meilleure forme pour mener les ouvriers vers la SOLIDARITE NATIONALE : ainsi, dans le cadre d'une "communauté nationale" menacée, les ouvriers devraient accepter les plus grands sacrifices, à condition qu'on leur accorde un traitement "juste et équitable" en luttant pour cela contre tous les partis et patrons '!non solidaires", anti-démocratiques", et apatrides.
Mais pour paraphraser Marx, toute la démarche de la gauche et des syndicats repose sur l'idée que les ouvriers NE VERRAIENT DANS LA MISERE QUE LA MISERE et vise a empêcher qu'ils comprennent que de leur misère actuelle surgissent les bases pour L'ABOLIR DEFINITIVEMENT.
3°- Parce que c'est uniquement à partir de l'opposition que la gauche peut noyer les ouvriers dans l'idéologie de la démoralisation et du nihilisme qui imprègne l'orientation d'ensemble de la bourgeoisie. Dans cette ligne, la gauche :
- présente, en mettant la réalité à l'envers, son passage dans l'opposition COMME LE RESULTAT DE L'ASCENSION DE LA DROITE AU POUVOIR, donnant à entendre que c'est là le résultat d'une' défaite des ouvriers et de l’échec des tentatives de "changement social" et de 'réformes profondes" qui ont dominé les années 70, inculquant de toutes parts que la société se "droitise" et, avec elle, les ouvriers ;
- présente le phénomène actuel de maturation de la conscience des ouvriers, avec ses conséquences d'apathie apparente et négative, comme une "preuve" de la "défaite" et de la "droitisation" des ouvriers, cherchant ainsi effectivement leur démoralisation et leur défaite ultérieure ;
- consciemment, elle ne donne aucune alternative à la situation actuelle, sauf les alternatives démoralisantes d'accepter la misère, de se sacrifier pour la nation et de se battre pour des vieux mythes auxquels plus personne ne croit : le "socialisme", la "démocratie", etc. Tout cela est essentiellement dû à la nécessité de démoraliser et de désanimer les ouvriers pour faire d'eux la chair et le sang de la situation de barbarie qu'impose la bourgeoisie. En réalité, le rôle de la gauche dans l'opposition ressemble à celui d'un avocat défenseur des ouvriers qui prétend faire tout son possible pour eux, mais, comme les "circonstances sont mauvaises", comme "l'ennemi est puissant" et comme "les clients ne coopèrent pas", il ne peut rien faire de plus.
4°- Parce que c'est exclusivement à partir d'un rôle d'opposition que la gauche et les syndicats peuvent déployer L'EVENTAIL DES TACTIQUES AVEC UN PLUS GRANDE AMPLITUDE ET UNE PLUS GRANDE FACILITE D'ADAPTATION que par le passé, face aux luttes ouvrières, pour développer une ligne générale de dispersion et d'usure. Ainsi, l'expérience de ces dernières années nous a montré cette variété :
- accepter la généralisation de la lutte y compris ses réactions de violence de classe mais en jugulant totalement 1'auto-organisation (comme on a pu le voir à Longwy-Denain en France en 1979) ;
- permettre un développement local et ponctuel de l'auto-organisation et de la généralisation de la lutte ouvrière mais en maintenant un ferme contrôle à l'échelle nationale (sidérurgie anglaise) ;
- établir un cordon sanitaire autour d'une lutte radicale et auto-organisée en empêchant totalement sa généralisation (dockers de Rotterdam) ;
- se répartir les rôles de "modération" et de "radicalisme" entre deux fractions d'un syndicat (le métro de New-York), entre deux syndicats (France, Espagne) ou entre le parti et le syndicat (Fiat), avec comme objectif le maintien du contrôle de l'ensemble des ouvriers ;
- prévenir le mécontentement ouvriers par des simulacres de lutte qui peuvent même atteindre des caractéristiques massives et spectaculaires (Suède) ;
- empêcher la maturation de la force ouvrière en provoquant des combats limités, dans des moments et dans des conditions défavorables.
Cet éventail varié de tactiques permet de plus à la gauche et aux syndicats de se couvrir mieux face aux ouvriers; il permet de diluer ses responsabilités, de se laver les mains de la situation et de ne pas se présenter comme un appareil unifié et monolithique, mais comme un organe "vivant", "démocratique", où "il y a de tout", ce qui rend plus difficile et plus complexe la dénonciation des syndicats et de la gauche.
D'une manière générale, nous pouvons conclure que le tournant de la gauche dans l'opposition signifie un renforcement à court terme de son contrôle sur le prolétariat, en lui permettant de développer une tactique d'usure, d'isolement et de démoralisation des luttes ouvrières, en les encadrant dans la stratégie générale de la bourgeoisie de démoralisation et de défaite du prolétariat.
Mais, à plus long terme, ce tournant ne traduit pas, à la différence des années 30, une capacité de la gauche pour enfermer le prolétariat sur un terrain bourgeois à travers des alternatives propres a coloration ouvrière, mais toute une réalité d'encadrement physique du prolétariat, c'est-à dire la tentative de la soumettre à un contrôle éhonté asphyxiant sans aucune perspective politique pour le justifier.
.8. La ligne de la gauche dans l'opposition est complétée par deux autres éléments de l'actuelle stratégie globale de la bourgeoisie :
1°- Le renforcement systématique de la répression et de la terreur d'Etat ;
2°- Les campagnes idéologiques d'hystérie guerrière et nationaliste.
1) En se cachant derrière les feuilles de vigne de 1'"anti-terrorisme" et de la "sécurité des citoyens", tous les Etats du monde développent quantitativement et qualitativement des forces gigantesques, des instruments policiers, juridiques, militaires et propagandistes de leur appareil de répression et de terreur. L'objectif de toute cette orientation est chaque fois plus évident :
- créer un dispositif adéquat pour, en combinaison avec la tactique d'usure et de dispersion qu'emploient la gauche et les syndicats, intervenir efficacement contre les luttes ouvrières ;
- prévenir les affrontements généralisés qui mûrissent.
Ce renforcement massif de l'arsenal terroriste de l'Etat est justifié et appuyé par la gauche qui participe sans faiblir aux campagnes anti-terroristes et réclame sans arrêt le renforcement répressif de 1'Etat :
- au nom de 1'antifascisme ou de 1'antiracisme (Belgique), elle exige toujours plus de répression et plus de police ;
- elle ne cesse pas de réclamer l'augmentation des budgets militaires au nom de la défense de la souveraineté nationale.
Ces soi-disant protestations contre les actes répressifs ne mettent jamais en question ce renforcement et la gauche se limite à formuler des plaintes pieuses sous les aspects les plus éhontés et extrêmes, et à fustiger (au nom de la paix sociale et de l'intérêt national) l'utilisation peu intelligente, excessivement partisane et trop provocatrice de la répression.
En réalité, malgré leur séparation formelle, les appareils syndicaux, de gauche et l'appareil policier SE COMPLETENT face à la lutte ouvrière. La répression s'abat sur les ouvriers une fois qu'ils sont isolés et désarmés par la politique et les pratiques de la gauche et des syndicats. En même temps, la répression se dirige sélectivement contre les secteurs ouvriers les plus combatifs et pousse la majorité à accepter les méthodes et les alternatives boiteuses de la gauche et des syndicats.
2) Sur le terrain des orientations idéologiques fondamentales que nous avons expliqué dans le point 6, la bourgeoisie a tenté de développer des campagnes d'hystérie guerrière et nationaliste pour, d'un côté affaiblir politiquement le prolétariat et pour, d'un autre côté, le mobiliser avec le reste de la population pour ses plans de sacrifice et de guerre.
La très forte usure des vieux thèmes de mystifications ("antifascisme", anti-terrorisme, démocratie et défense nationale, etc.) a fait que ces campagnes ont eu en général peu de succès et que, loin de prendre une forme cohérente et systématique, elles ont été plus des mouvements ponctuels basés sur l'exploitation d'événements particuliers tels que :
- les otages utilisés par les Etats Unis pour développer une campagne de solidarité nationale ;
- les attentats perpétrés par 1'extrême-droite en France, en Italie, et en Belgique qui ont servi de base à des campagnes antifascistes;
- la menace d'invasion de la Pologne par la Russie employée comme plateforme de paix sociale et d'union nationale;
- 1'anti-terrorisme en Espagne et en Italie; les élections générales en Allemagne, base d'une gigantesque campagne pacifiste de préparation à la guerre.
Le bilan de ces campagnes n'est pas positif pour la bourgeoisie : elles n'ont pas eu un impact réel sur le prolétariat, du moins immédiatement. Elles se sont vues discréditées et démystifiées par les contradictions internes de la bourgeoisie et l'impact même des événements (le tremblement de terre en Italie, ou le cas Arregui en Espagne en relation avec l'hystérie anti-terroriste). Elles ont plus cherché à créer un climat d'insécurité, de confusion et de démoralisation, qu'à présenter un cadre cohérent de mobilisation idéologique du prolétariat, cadre que la bourgeoisie, pour le moment, est loin de trouver.
.9. Tout au long de ce chapitre, nous avons analysé en détail la réponse qu'a développée la bourgeoisie face à la situation actuelle qui est un carrefour historique. La question que nous devons nous poser est : cette réponse signifie-t-elle un renforcement de la bourgeoisie face au prolétariat ? Peut-elle détruire la reprise de la lutte prolétarienne commencée en 1978?
Toute la réorientation de la politique de la bourgeoisie qui s'est produite les trois dernières années, si elle a signifié un renforcement à court terme, constitue une position de faiblesse et d'affaiblissement à long terme.
Nous allons développer cette thèse apparemment contradictoire.
A court terme, cette réorientation renforce la bourgeoisie :
1) Elle lui permet d'utiliser de façon cohérente, sans compromis et sans ambiguïté l'ensemble de ses forces politiques et sociales :
- la droite au pouvoir se dédie à organiser l'attaque frontale contre le prolétariat, sans courir le risque de se voir contredite par sa base sociale ;
- la gauche dans l'opposition peut se consacrer, sans le handicap de la responsabilité des affaires gouvernementales, à démobiliser les ouvriers, à user et à épuiser les luttes en facilitant ainsi le succès des attaques capitalistes, et en créant un climat de démoralisation et d'immobilisation.
2) Elle lui permet de concentrer de façon cohérente toutes ses forces et tous ses instruments contre le prolétariat. Aujourd'hui, malgré les conflits internes du capital, et malgré les faiblesses et les anachronismes qui subsistent, nous assistons à une OFFENSIVE SYSTEMATIQUE et COORDONNEE de l'ensemble des forces de la bourgeoisie contre les travailleurs. Il y a une tentative de synchronisation des efforts, une capacité à se compléter et une unité des stratégies entre les différentes fractions de la bourgeoisie jamais vues par le passé. La gauche et la droite, les patrons et les syndicats, les corps de répression, les moyens de communication, les médias, l'Eglise et les institutions laïques, etc., coordonnent leurs efforts dans un même sens anti-prolétarien, en faisant converger les attaques partants de différents points, divergents et contradictoires, vers un même front : celui de la défense de l'ordre bourgeois. Ceci constitue un NIVEAU SUPERIEUR de l'action bourgeoise contre le prolétariat par rapport à la période précédente, période dans laquelle, ou bien la bourgeoisie utilisait la répression sans s'unifier réellement dans la mystification, ou bien la bourgeoisie utilisait la mystification sans recourir à la répression ouverte.
3) Elle lui permet de développer une stratégie d'isolement et d'épuisement des surgissements de la lutte ouvrière, en essayant de les noyer dans un climat général de démobilisation, sans perspective, en cherchant à immobiliser et à désorienter le prolétariat , pour tenter en fin de compte de créer les conditions d'une défaite totale et d'ouvrir ainsi définitivement un cours vers la guerre.
Cette "réorientation de l'appareil d’"Etat bourgeois" connaît une efficacité immédiate, car elle parvient à maintenir dans certaines limites le développement des antagonismes de classe dans les principales concentrations ouvrières, en lui donnant une apparence spectaculaire.
Ceci dit, même si nous NE DEVONS JAMAIS SOUS-ESTIMER, de quelque façon que ce soit, la force de la bourgeoisie et que nous devons pousser le plus possible et dans les détails la dénonciation de ses campagnes et de ses manœuvres, une telle dénonciation demeurerait inutile si elle ne mettait pas clairement en évidence la situation de FAIBLESSE et de FRAGILITE, les PROFONDES CONTRADICTIONS, que cache cette apparente supériorité que se donne aujourd'hui le pouvoir bourgeois.
Nous ne devons jamais oublier que toute cette réorientation s'est faite POUR AFFRONTER la réémergence prolétarienne de 1978, c'est à dire que son point de départ est une position de faiblesse et de surprise de la part de la bourgeoisie.
Comme l'a démontré la bataille de la classe ouvrière en Pologne, la situation actuelle est toujours dominée par TIMPOSSIBILITE POUR LA BOURGEOISIE DE FAIRE PLIER LE PROLETARIAT ET D'ESTOMPER LES ANTAGONISMES DE CLASSE. A ce niveau de la crise capitaliste, une telle incapacité constitue un danger très grave pour le pouvoir, car elle l'affaiblit aussi bien économiquement que politiquement, et elle approfondit ses contradictions et accroît son impuissance à imposer à la société la "solution" guerrière.
Pour cela, la cohérence et la puissance actuelles de la politique bourgeoise doivent être interprétées dans leur essence comme le dernier recours, l'effort suprême de l'Etat bourgeois pour éviter un affrontement de classe généralisé.
CECI NE PEUT NOUS CONDUIRE A SOUS-ESTIMER LA FORCE DE LA BOURGEOISIE : LES POSSIBILITES OUVERTES PAR LA REORIENTATION DE SA POLITIQUE SONT LOIN D'ETRE EPUISEES, ET LE PROLETARIAT VA TRAVERSER UNE PERIODE DURE, OU LE DANGER D'ETRE ECRASE PAR LA CONCENTRATION ACTUELLE DES RESSOUR CES COMBINEES DE LA BOURGEOISIE GARDERA SA PLEIN VIGUEUR. Mais en même temps, nous ne pouvons oublier que le PROLETARIAT CONTINUE A AVOIR LE MOT DE LA FIN. Tant que celui-ci sera capable d'ELAR GIR LA BRECHE OUVERTE PAR LES LUTTES MASSIVES EN POLOGNE, il pourra surmonter la terrible concentration des forces ennemies et ouvrir un processus DE RUPTURE DU FRONT BOURGEOIS, au cours duquel TOUS LES ASPECTS QUI AUJOURD'HUI APPARAISSENT COMME DES POINTS FORTS DU CAPITAL SE TRANSFORMERONT EN AUTANT DE LEVIERS DE SA FAIBLESSE.
Comme nous avons vu au début, la ligne actuelle de la bourgeoisie, qui reconnaît ouvertement la faillite de son système et la réalité qu'elle n'a rien à offrir à l'exception de la guerre, peut avoir pour effet immédiat et dangereux de démoraliser le prolétariat et de l'enliser dans la barbarie qu'impose le capital; mais dans la mesure où le prolétariat parvient à élargir son front de combat et à rompre la chaîne d'isolement et d'usure, cette ligne de "sincérité" crée un immense vide dans lequel les ouvriers peuvent développer leur alternative révolutionnaire, étant donné qu'ils ont une certitude claire du fait que le seul avenir, c'est le chaos, et l'incapacité de gouverner de la part de la bourgeoisie :
"Que la bourgeoisie indique ouvertement que son système est en faillite, qu'elle n'a rien d'autre à proposer que la boucherie impérialiste, contribue à créer les conditions pour que le prolétariat trouve le chemin de son alternative historique au système capitaliste." ([2] [212])
La gauche dans l'opposition démontre son efficacité momentanée pour contenir les luttes ouvrières. Peut-elle finir par épuiser et noyer l'immense combativité ouvrière actuelle ?
A la fois cette orientation contient un danger, et à la fois, comme nous l'avons montré, du fait qu'elle repose sur un manque total de perspectives capables de créer chez les ouvriers des illusions dans le camp bourgeois, cette orientation dévoile que la CARACTERISTIQUE FONDAMENTALE de la gauche et des syndicats est celle de constituer de simples compléments d1"opposition" à la politique de guerre et de misère du capital, et les fait apparaître ouvertement comme des instruments d'encadrement physique et de surveillance du prolétariat.
De même, si le renforcement de la répression et de la terreur de l'Etat bourgeois, crée dans les rangs prolétariens momentanément un climat de peur et d'impuissance, à la longue ce renforcement dévoile de plus en plus son caractère de classe, mettant en évidence la nécessité de l'affrontement violent, sans illusion pacifiste, démocratique et légaliste.
Enfin, les campagnes d'hystérie nationaliste et guerrière qu'entreprend le capital peuvent intoxiquer le prolétariat avec des poisons chauvinistes et interclassistes. Mais la faiblesse de leur base idéologique et les contradictions capitalistes qui les démystifient peuvent finir par se transformer en leur contraire, en facteurs supplémentaires qui obligent le prolétariat à préciser son alternative révolutionnaire et à approfondir son autonomie de classe.
La tendance à la gauche dans l'opposition et au renforcement de l'appareil répressif expriment un processus de RENFORCEMENT FORMEL de l'Etat bourgeois qui cache un autre aspect, plus profond : sa FAIBLESSE REELLE.
En fin de compte, la façade actuelle de cohésion et de renforcement momentané du front bourgeois cache les pieds d'argile que constitue l'incapacité profonde de la bourgeoisie à surmonter ses contradictions internes et à canaliser l'ensemble de la société vers ses alternatives. Tout ceci, qui aujourd'hui reste dans l'ombre, peut apparaître brusquement à la lumière du jour si le prolétariat développe un front de combat massif sur son terrain de classe. Ceci, loin d'être une simple hypothèse, ou l'écho lointain de vieilles expériences historiques, est une possibilité réelle, clairement annoncée par la grève de masse en Pologne :
"Ce n'est pas seulement sur le plan de la lutte prolétarienne que les événements de Pologne préfigurant une situation qui tend à se généraliser à tous les pays industrialisés. Sur le plan des convulsions internes de la classe dominante, ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans ce pays donne une idée, même dans ses aspects caricaturaux, de ce qui est en train de mûrir dans les entrailles de la société. Depuis le mois d'août 80, c'est une véritable panique qui s'est emparée des sphères dirigeantes du pays. Depuis 5 mois, la danse des portefeuilles ministériels s'est installée au sein du gouvernement jusqu'à faire échoir un de ces portefeuilles aux mains d'un catholique, biais c'est au sein de la principale force dirigeante, le parti, que se manifestent avec la plus grande violence ces convulsions." ([3] [213])
3/LA REPONSE DU PROLETARIAT
.10. Après avoir vu la stratégie de la bourgeoisie, il nous faut faire maintenant un bilan de la réponse qu'est en train de donner le prolétariat à l'actuelle situation historique. Pour cela, nous avons à nous poser trois questions:
1) Est-ce que le prolétariat prend conscience du carrefour historique que nous sommes en train de vivre et des graves responsabilités qui en découlent pour lui ?
2} Dans quelle mesure ses luttes les plus récentes traduisent une telle conscience et constituent un pas en avant vers son alternative : la révolution ?
3) Quelles sont les leçons et les perspectives qui découlent de ces luttes ?
L'objet du présent chapitre est de répondre à ces trois questions.
"Lorsqu'il s'agit de rendre compte des grèves, des coalitions, et des autres formes dans lesquelles les prolétaires devant nos yeux s'organisent en tant que classe, les uns sont pris d'une véritable épouvante, les autres étalent un dédain transcendantal". ([4] [214])
Le processus à travers lequel la classe ouvrière mûrit sa compréhension de la situation historique et des tâches que celle-ci lui impose n'a rien de simple ni d'évident.
La réponse, la pensée et la volonté de la classe s'expriment exclusivement dans ses actes massifs de lutte contre l'ordre bourgeois et même pour comprendre la véritable signification historique de ces actes, il est nécessaire d'en saisir la dynamique objective, car il existe toujours un violent décalage ENTRE L'IMPACT OBJECTIF DES LUTTES ET LA REPRESENTATION SUBJECTIVE QUE S'EM FONT LES OUVRIERS.
La situation concrète présente de façon exacerbée ces difficultés à saisir la direction réelle des luttes ouvrières. Le 3ème congrès du CCI. annonçait une nouvelle période de montée des luttes prolétariennes à partir de 78, mais il signalait aussi qu'une telle montée suivrait un cours contradictoire, lent et pénible, qui se manifesterait dans une succession de luttes brusques et explosives et non de façon linéaire, progressive, cumulative, graduelle. Les luttes de 79-80, et en particulier la grève en Pologne, sont venues confirmer de façon éclatante cette prévision. Cependant, saisir la dynamique montante du mouvement et en apprécier les pas en avant est devenu quelque chose de très difficile, aussi bien pour la classe que pour ses groupes révolutionnaires.
Ceci est apparu clairement face aux événements de Pologne. De nombreux groupes ont manifesté à leur égard un "dédain transcendantal", ne les voyant que superficiellement -sous la forme déformée qu'en donne la bourgeoisie- , n'y voyant que des ouvriers en train de communier, des drapeaux polonais, Walesa, etc. Le CCI a du combattre toutes les manifestations de ce type d'évaluation, qui révèlent en fait une conception du développement de la lutte et de la conscience de classe absolument néfaste dans la situation actuelle.
Laissons clair une fois pour toutes que le prolétariat constitue la classe qui porte en elle toute l'inhumanité de la société bourgeoise et qui souffre d'une dépossession et d'une aliénation radicales. En conséquence, dans son existence se manifeste de façon extrêmement aiguë une plaie fondamentale de la société bourgeoise : LA SEPARATION ENTRE L'ETRE ET SA CONSCIENCE, c'est-à-dire le décalage, voire même l'opposition, entre la réalité objective des actions sociales et les représentations subjectives que s'en font les protagonistes de ces actions. La classe ouvrière n'est pas étrangère à ce phénomène, et ce décalage existera toujours, jusqu'à la fin de son mouvement d'émancipation.
Mais la classe ne répond pas à ce décalage en créant une "nouvelle culture" ou en élaborant une "nouvelle science", mais en rompant dans son combat la séparation entre l'être et la conscience, en faisant de ses luttes la conscience en action, le mouvement qui, par delà les différentes représentations subjectives qu'on puisse se faire de lui, tend à abolir les conditions objectives qui engendrent ce décalage (exploitation capitaliste, division en classes).
Ainsi, si l'on analyse en profondeur les événements de Pologne, nous voyons que, malgré toutes ses faiblesses, le prolétariat y a MANIFESTE, DANS LA LUTTE, UNE COMPREHENSION DES BESOINS FONDAMENTAUX DE LA SITUATION HISTORIQUE ACTUELLE :
1°- sa capacité à généraliser sa lutte, en exerçant de manière soutenue et à plusieurs reprises une PRESSION MASSIVE sur l'Etat, soutenue par des coups de force, mais évitant à la fois des affrontements prématurés ou en position de faiblesse, met en évidence une compréhension active du moment présent au niveau historique et des responsabilités de la classe ouvrière dans cette situation;
2°- sa volonté d'auto-organisation et d'unité démontre qu'il a clairement compris l'affrontement de classes qu'il doit livrer;
3°- le fait d'avoir répondu par la lutte aux divers appels de la bourgeoisie à la responsabilité face à l'économie nationale, met en évidence qu'il comprend instinctivement l'opposition irréconciliable qui existe entre l'intérêt de classe et l'intérêt national et la nécessité d'une alternative révolutionnaire.
Il ne s'agit pas de glorifier cette compréhension plus ou moins instinctive mais de reconnaître sa réalité et de la prendre comme base pour l'action des minorités communistes du prolétariat et le développement de nouvelles luttes.
Ceci dit, la question qui se pose immédiatement est : le reste du prolétariat mondial a-t'il compris le "message" de ses frères polonais ? Pouvons-nous affirmer avec certitude que l'ensemble du prolétariat mondial se prépare et répond devant la croisée des chemins actuelle ?
A première vue, il semblerait que les combats de Longwy-Denain en France, des sidérurgistes anglais, des travailleurs du port de Rotterdam, et surtout de Pologne, n'ont laissé aucune trace immédiate puisqu'on n'a pas vu à leur suite l'extension des luttes à l'échelle internationale. Est-ce que cela veut dire que ce que nous annoncions au 3ème Congrès sur un nouveau cycle dans la lutte de classe était erroné ? Pas du tout l'analyse des conditions historiques que nous avons faite dans la première partie de ce rapport et celle que nous ferons postérieurement en tant que bilan des luttes vécues, nous confirment clairement une telle perspective ; cependant, ce que nous devons préciser, c'est le CHEMIN CONCRET que le prolétariat est en train de parcourir pour s'y rendre.
Longwy-Denain, la sidérurgie anglaise, Rotterdam, etc., ont été les premières tentatives, les premiers jalons de cette nouvelle vague ; en quelque sorte une RECONNAISSANCE DU TERRAIN. Leur dénouement immédiat qui, en général a été la défaite, a montré à la classe ouvrière l'énorme chemin qu'elle doit parcourir, la concentration féroce de forces qu'elle a en face d'elle, la faiblesse des moyens dont elle dispose, une réalité où, pour l'instant, il y a bien plus de problèmes posés que de problèmes résolus. Tout cela l'a fait reculer, se replier, mûrir souterrainement.
Apparemment la Pologne a accentué le repli du prolétariat occidental. Bien qu'elle ait fourni des réponses à beaucoup des problèmes que se posaient les luttes de Longwy-Denain, de la sidérurgie anglaise, etc., elle n'a aussi que trop clarifié l'énorme envergure qu'ont aujourd'hui les luttes prolétariennes, la quantité de conditions qu’elles doivent remplir pour lutter avec un minimum de possibilités de vaincre. Tout cela pousse, jusqu'à un certain point, à accentuer le calme tendu que nous sommes en train de vivre.
Cependant, nous devons affirmer clairement l'énorme impact qu'a eu la lutte du prolétariat polonais sur ses frères de classe dans le reste du monde. Le cri magnifique des ouvriers de la Fiat "Gdansk, Turin, même combat." en témoigne ; les luttes qui ont eu lieu par la suite en Roumanie, en Hongrie, en Russie, en Tchécoslovaquie, celle des employés du chemin de fer de Berlin, le mettent en- évidence ; l'anxiété qu'elle a éveillée parmi les ouvriers d'Allemagne, d'Espagne, de France, en est une manifestation...
La situation actuelle de la conscience de classe peut être formulée ainsi : les ouvriers ressentent instinctivement, d'une part l'énorme gravité du moment historique, l'énorme responsabilité que contient chaque lutte, la réalité que chaque lutte doit affronter une concentration et une combinaison maximale d'armes que l'ennemi peut opposer, et d'autre part la précarité des armes de lutte avec lesquelles ils peuvent compter. Tout cela pousse vers une certaine paralysie, vers un processus de réflexion donnant une atmosphère de doutes qui n'est pas exempte de désorientation,
Cette situation de maturation difficile contient de grands dangers. En face, la bourgeoisie agit de manière décidée, cherchant à isoler et à épuiser chaque surgissement de lutte, présentant ce qui est une maturation comme une défaite entraînant la démoralisation. Le danger existe ! Mais ce serait abdiquer face à lui que de ne pas voir la dynamique objective de luttes qui est en train de se développer et ne pas intervenir résolument pour transformer tout ce magma actuel d'anxiété, d'apathie apparente, de recherche, en DEBUTS DE LUTTES qui accéléreront et fortifieront l'immense processus de luttes qui est en train de mûrir.
.12. Lors du 3ème congrès international, avec les données encore embryonnaires des luttes des mineurs aux USA, de la sidérurgie en Allemagne, d'Iran et de Longwy-Denain, nous prenions le risque, fondé sur une analyse solide et globale, de voir dans ces luttes l'annonce d'une nouvelle vague de luttes prolétariennes qui mettrait fin au reflux relatif de 1973-78. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer catégoriquement une telle annonce :
- septembre 1979 : grève de Rotterdam ;
- janvier-avril 1980 : grève des sidérurgistes anglais ;
- mars-avril 1980 : révoltes sociales en Syrie, Algérie et Hollande ;
- avril 1980 : mouvement de grèves au Brésil dont le centre est la grève des métallos de Sao Paulo ;
- mai 1980 : grèves au métro de New-York, des autobus à Gorki et Togliattigrad, dans les deux métropoles de l'impérialisme ;
- mai 1980 : mouvement semi-insurrectionnel en Corée du Sud et grèves en Afrique du Sud et au Zimbabwe ;
- juillet-août 1980 : grève de masse en Pologne ;
- après la Pologne, des grèves à la Fiat de Turin, à Berlin, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Hongrie, en Russie, en Bulgarie; -:octobre-novembre 1980 : vague de luttes relativement vaste au Portugal et en Irlande;
- à partir de décembre 1980 : mouvement ouvrier et paysan au Pérou.
A l'épicentre de ce cours de lutte de classe se trouve la Pologne. Les luttes qui la précèdent développent des aspects partiels positifs, mais, globalement, ils ratent :
- les affrontements de Longwy-Denain mettent en avant la violence de classe et la poussée à la généralisation, mais 1'auto-organisation ne se fait pas:
- les sidérurgistes anglais développent à l'échelle locale l'auto-organisation et la généralisation, mais ils ne réussissent pas au niveau national;
- en Corée du Sud, le mouvement semi-insurrectionnel s'écrase devant une absence totale de coordination et d'auto-organisation;
- au Brésil et à Rotterdam 1'auto-organisation triomphe, mais la généralisation rate.
Ce que fait le mouvement de classe en Pologne c'est unifier toutes les tendances partielles de ces luttes en une grande grève de masse qui, à son tour, donne une réponse -ou début de réponse- à toutes les questions non résolues par les premières. La Pologne est le mouvement de classe le plus important non seulement depuis la reprise prolétarienne de 1978 mais depuis l'écrasement de la vague de 1917-26. Elle place tout le cycle actuel |de la lutte de classe à un niveau supérieur, rien qu'en cristallisant tout un ensemble de tendances ; qui ont mûri dans les luttes antérieures. Evidemment, les leçons de la Pologne mettront du temps à être assimilées par ses frères de classe et cela va coûter du temps et du travail avant qu'elles ne se cristallisent dans des combats supérieurs. Mais cela ne doit pas nous cacher l'immense pas qu'a fait le prolétariat en Pologne et la nécessité de généraliser ses leçons à l'ensemble de la classe.
4/ PERSPECTIVES FONDAMENTALES POUR LES LUTTES FUTURES
.13. Les leçons de la grève de masse en Pologne, à la lumière des positions de classe tracées par la lutte historique du prolétariat, nous fournissent la plateforme de principes que doivent réunir les prochaines luttes pour être à la hauteur de ce NIVEAU SUPERIEUR qu'exige la situation historique et auquel la Pologne a contribué de manière fondamentale.
L'AUTONOMIE DE LA CLASSE.
.14. La révolte du prolétariat contre l'ordre bourgeois ouvre un immense processus d'auto-organisation et d'auto-activité des masses ouvrières dont l'expression unitaire et centrale sont les assemblées générales et les comités élus et révocables.
Ces organismes représentent le minimum commun qui unifie l'ensemble du mouvement de classe à une étape donnée de son développement, car s'ils fournissent une plateforme pour le développement des tendances plus avancées de la classe, ils ont en même temps des difficultés, de par leur liaison avec une étape déterminée du mouvement à évoluer selon les nécessités d'avancées du mouvement de classe. Cela fait qu'ils n'ont jamais une forme et une composition achevées, et qu'ils souffrent une évolution de brusques ruptures ou de recompositions selon les nécessités de la lutte prolétarienne.
Ces limitations les rendent vulnérables à l'action de la bourgeoisie. Celle-ci n'abandonne pas le terrain des organes ouvriers mais, au contraire elle essaie, à travers ses forces syndicales et d'opposition, de les occuper, de bombarder de l'intérieur l'action prolétarienne et de les dénaturer totalement même si elle en conserve la forme et le nom pour mieux tromper les ouvriers. Cela fait des organes ouvriers, tant que la révolution n'aura pas triomphé, un champ de bataille entre le prolétariat et la bourgeoisie (en utilisant les syndicats et la gauche).
Cependant, cette réalité, produit du caractère totalitaire du capitalisme décadent, ne doit pas nous conduire à considérer les organes ouvriers comme de simples formes dépourvues de contenu ou comme es organismes hybrides sans caractère de classe défini. Et surtout, cela ne doit pas nous conduire à l'erreur, encore plus grave, de les comparer à des organismes créés par les syndicats pour devancer 1'auto-organisation prolétarienne (intersyndicale en France, ou "comités de grèves" en Angleterre) ou aux divers types d'organismes syndicaux.
Les organes qui émanent des grèves de masses expriment la volonté de la classe pour :
- se constituer comme force organisée contre le capital ;
- unifier et centraliser son effort d'auto-activité et d'auto-organisation;
- prendre le contrôle souverain de la lutte.
Ceci, malgré leurs limitations temporaires liées à leur composition et leur forme et à la pénétration des forces bourgeoises dont ils souffrent, les place dans un camp diamétralement opposé à celui de tout type d'organisation para-syndical.
LA GENERALISATION
.14. Dans la période actuelle, la solidarité de classe, la généralisation des luttes, prennent pour le prolétariat un caractère plus profond que celui qu'elles avaient dans les années 60-70.
Dans les années 60-70, la classe ouvrière a été le protagoniste de grands mouvements de solidarité et d'auto-organisation. Mais les conditions de cette période permettaient encore des luttes partielles relativement victorieuses parce que, soit elles arrachaient des améliorations momentanées, soit, elles faisaient reculer temporairement le capital. Dans un tel cadre, la généralisation, malgré toutes ses potentialités, n'était comprise que de façon très limitée, comme un simple appui ou comme l'idée : "qu'ils gagnent, eux, après nous gagnerons nous".
Ces idées tout en étant élémentaires pour toute lutte ouvrière, sont insuffisantes face à la situation actuelle. Dans les conditions actuelles, la solidarité de classe ne peut être conçue que dans le sens de se joindre à la lutte, d'étendre l'affrontement avec une volonté de se constituer comme FORCE SOCIALE qui s'oppose victorieusement à l'Etat bourgeois et ouvre le chemin vers la révolution. Dans la situation actuelle, la solidarité de classe doit se poser comme une question de vie ou de mort : à partir de la compréhension que telle ou telle bataille commencée par tel ou tel secteur de la classe ouvrière, exprime inéluctablement la bataille que doit livrer l'ensemble de la classe ouvrière.
LUTTE REVENDICATIVE ET LUTTE REVOLUTIONNAIRE
.16. Un des problèmes qui rend pour le moment plus difficile le surgissement des luttes, c'est l'impossibilité, chaque fois plus évidente, d'obtenir des victoires économiques qui durent au moins quelques mois. Ceci est apparu clairement en Pologne : la gigantesque grève de masse n'a pu obtenir satisfaction que sur quelques points des accords de Gdansk.
Cela veut-il dire que la lutte économique ne sert à rien et qu'elle doit être abandonnée au profit d'"une lutte politique" abstraite ou d'une non moins éthérée grève générale et simultanée pour le jour J ?
Pas du tout ! La lutte revendicative est la base profonde de la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière parce qu'elle est à la fois la classe exploitée et la classe révolutionnaire de la société capitaliste, parce que ses intérêts immédiats de résistance contre l'exploitation coïncident avec ses intérêts historiques d'abolition de l'exploitation.
On l'a vu en Pologne, où la lutte politique de masse (grèves du mois d'août) est préparée par une vague de luttes économiques partielles (grèves depuis juillet) et cède le pas à un nouveau torrent de luttes économiques.
La base révolutionnaire de la lutte revendicative du prolétariat réside en ce qu'elle exprime une logique diamétralement opposée à celle qui régit la société capitaliste. La logique du capital exige que les ouvriers subordonnent leurs intérêts et besoins à la marchandise et à l'intérêt national. Face à elle, les ouvriers opposent la logique de leurs besoins humains, ce qui est le fondement profond du communisme : A CHACUN SELON SES BESOINS, DE CHACUN SELON SES POSSIBILITES.
"Les ouvriers doivent déclarer qu'en tant qu'hommes, ils ne peuvent se plier aux conditions existantes, mais que les conditions elles-mêmes doivent s'adapter à eux, hommes" ([5] [215]).
La lutte politique du prolétariat n'est pas "d'abandonner" ou de "dépasser" la lutte revendicative mais de prendre comme base la logique profonde qu'elle contient, en la prenant sur le seul terrain où elle peut donner toute sa potentialité : celui de l'affrontement de classes, celui de la lutte à mort contre l'Etat bourgeois. Elle ne réside pas dans une soi-disant "réforme politique de l'Etat", ni en un simple programme de transition, ni dans l'attente du jour J où "on" appellera à la grève générale politique; elle réside dans la compréhension qu'avec l'aggravation inexorable de la crise- les fils qui meuvent les destinées de l'humanité dépendent exclusivement du rapport de force entre bourgeoisie et prolétariat, dont If intérêts objectifs sont diamétralement opposés. De ce point de vue, le problème "politique" de la classe ouvrière est : comment se constituer en une FORCE SOCIALE capable de détruire l'Etat bourgeois ?
Si l'on part de ce point de vue, disparaît la question métaphysique : lutte économique OU lutte politique. Le problème de chaque lutte n'est pas seulement le résultat immédiat mais, surtout, sa contribution au changement de rapport de force en tre les classes, en faveur du prolétariat. Ce ne sera pas son éventuelle victoire temporaire, qui ne durera que quelques jours, mais sa capacité à exprimer et donner des réponses à des problèmes qui sont ceux de l'ensemble de la classe. Dans ce sens, les luttes revendicatives prennent toute leur valeur :
"En général, les grèves ne sont que des escarmouches d'avant-garde, parfois ce sont des affrontements d'une certaine ampleur : elles ne décident rien par elles-mêmes mais elles sont la meilleur preuve que la bataille entre la bourgeoisie et le prolétariat est en train as se rapprocher. Elles sont l'école de guerre des ouvriers dans laquelle ils se préparent pour la grande lutte désormais inévitable ce sont les soulèvements de certains secteurs ouvriers pour leur adhésion au grand mouvement ouvrier" ([6] [216]).
L'INTERNATIONALISATION
.17. Lors du 3ème congrès du CCI, nous avons noté comme "principale et première caractéristique" de la reprise prolétarienne ouverte en 1978 "l'internationalisation objective des luttes". Une telle internationalisation se basait sur le fait que "nous avançons vers une EGALISATION DANS LA MISERE des ouvriers de toutes les entreprises, de tous les pays, de toutes les régions". La dynamique des événements vécus depuis cette époque confirme une telle analyse et ouvre la porte à des perspectives que nous devons éclaircir et approfondir.
La maturation du nouveau cycle de luttes ouvrières n'est pas le produit d'une addition de processus nationaux mais elle se réalise selon une dynamique directement mondiale. Ainsi, la continuation de Longwy-Denain ne se trouve pas malgré les conséquences que cette lutte a pu avoir pour le prolétariat en France, mais à Rotterdam ou dans la sidérurgie anglaise, la grève de masse en Pologne est, comme nous l'avons démontré, la synthèse des luttes de Longwy-Denain, Rotterdam, Brésil, de l'acier anglais, de la Corée, de la Russie. Las ouvriers polonais connaissaient par exemple les grèves de Gorki-Togliattigrad et s'en sont servi pour leur lutte. Mais, ce qui est plus important : les problèmes qu'a soulevée la dynamique postérieure des grèves polonaises (contrôle de l'appareil répressif étatique, des moyens de communication, poursuite des affrontements) sont l'expression des problèmes qui ne peuvent être résolus que si la lutte prolétarienne se généralise à l'échelle internationale.
Tout cela exige que la classe ouvrière conçoive l'internationalisme moins comme une question de simple appui mutuel mais plus comme une compréhension qu'elle EST UNE CLASSE MONDIALE, avec des intérêts communs et un ennemi commun, et, surtout, avec une responsabilité historique correspondante à cette croisée des chemins : guerre ou révolution.
LA LUTTE CONTRE LA GUERRE
.18. S'il y quelque chose que l'expérience des trois dernières années nous a démontré de façon écrasante, c'est que le prolétariat est la seule, force sociale capable de s'opposer à la tendance capitaliste à la guerre.
La lutte du prolétariat a déstabilisé l'Iran -bastion pro-américain - en coulant son armée -la cinquième du monde- sans laisser de chances au bloc russe de profiter de cette conjoncture, c'est à dire, en attaquant de front la machine de guerre de l'ensemble du capital mondial. Mais en 1980, la lutte du prolétariat polonais a déstabilisé brutalement un bastion pro-russe sans que le bloc américain n'est pu profiter de l'occasion en dehors d'une pression purement propagandiste.
Qui plus est, l'année 1980, qui a commencé avec un pas très grave vers la guerre -l'invasion russe en Afghanistan- s'est terminée sous le poids écrasant des événements de Pologne, dans une limitation relative de conflits inter-impérialistes et avec le phénomène de la COOPERATION INTER-IMPERIALISTE des deux blocs pour affronter leur ennemi commun : le prolétariat. Tout cela nous démontre la force décisive qu'a le prolétariat contre les plans de guerre du capital. Une telle force ne se situe pas sur le terrain d'une "pression morale" pour "obliger les deux bloc-à vivre en paix". Avec ou sans lutte de classes, les tensions inter-impérialistes se poursuivent et s'aggravent car elles trouvent leur source dans les contradictions insolubles du capital. L'effet de la lutte du prolétariat est de déstabiliser les plans du capital, d'aggraver ses contradictions internes et ainsi de changer le rapport de forces dans le sens de la révolution. En faisant cela, elle bloque et détruit l'issue historique à laquelle est liée l'existence du capital : la guerre.
L'expérience de guerres locales en 1980, comme celle entre l'Irak et l'Iran ou entre le Pérou et l'Equateur, nous démontre que, si au niveau historique, l'alternative du prolétariat est de lutter contre le capital pour le détruire et empêcher son issue guerrière, au niveau des guerres locales et, en tant que moment de cette alternative, la lutte ouvrière dans ces pays doit tourner autour des principes du défaitisme révolutionnaire : désertion massive, fraternisation des soldats des deux camps, retourner les fusils contre leurs propres chefs capitalistes, transformation de la guerre impérialiste en guerre civile de classe.
Les guerres locales du genre -Pérou-Equateur ou Iran-Irak, constituent à la fois des opérations de police à l'intérieur d'un bloc et des tentatives des capitaux nationaux impliqués pour ramener le - prolétariat derrière le drapeau national. En ce sens, elles ne sont pas un pas vers la guerre mais sont le produit des contradictions du capital exacerbées. Ceci implique que, malgré le leurs éventuels succès immédiats dans la reconstitution d'une union nationale, à terme elles l'affaiblissent aiguisant encore plus et de façon plus violente les antagonismes de classe.
LA LUTTE CONTRE LA REPRESSION
.19. Au 3ème congrès du CCI, nous avons affirmé clairement que face à une répression chaque fois plus systématique et féroce, la défense des ouvriers n'est pas dans les "garanties démocratiques" ni dans les groupes armés qui prépareraient militairement la classe, mais dans sa lutte massive et violente.
L'expérience de la grève de masse en Pologne a confirmé catégoriquement cette idée, tout en nous permettant de mieux la préciser, en relation avec l'expérience historique du prolétariat.
"Les ouvriers -polonais ont neutralisé la répression -de l'Etat non pas par- leur "pacifisme " mais parce que, depuis le début, ils ont pris toutes les mesures de force pour- la désarmer à la racine : en occupant les usines jour et nuit avec des piquets massifs, en restant mobilisés dans les quartiers ouvriers face à n'importe quelle provocation policière, en préparant partout des mesures D'AUTO-DEFENSE OUVRIERE DE MASSE et surtout, en faisant le pas qui donne un sens à tout ce qui précède : EN ETENDANT ET UNIFIANT LES GREVES DANS TOUT LE PAYS" ([7] [217]).
L'expérience polonaise nous clarifie en profondeur sur le sens de la violence prolétarienne et de sa lutte contre l'appareil répressif du capital. La classe ouvrière ne peut jamais tomber dans le légalisme et la mansuétude, mais cela ne veut pas dire que sa lutte consiste à chercher l'affrontement à tout prix, à fabriquer des "héros", à verser le sang ou à imposer un "châtiment exemplaire". Ces deux alternatives sont radicalement fausses et elles se cachent l'une l'autre : la première est 1'hypocrisie cynique du capital qui cache la deuxième, sa pratique réelle de la violence aveugle, inhumaine et irrationnelle.
La lutte de la classe ouvrière se situe sur un autre terrain, social et politique à la fois : celui de se constituer au moyen de la lutte de masse, en une FORCE REVOLUTIONNAIRE capable :
- d'exercer sur le capital et son Etat une pression chaque fois plus asphyxiante;
- d'isoler politiquement le capital et l'Etat;
- de multiplier les contradictions internes y compris au sein de l'appareil répressif;
- de diviser, disperser et finalement neutraliser le dit appareil.
"Tout le secret et toute la force de l'assurance de la victoire de la révolution des travailleurs réside dans le fait qu'à la longue, aucun gouvernement du monde ne peut se maintenir en lutte contre une masse populaire consciente, si cette lutte s'étend sans cesse et grandit en ampleur. Le carnage et la domina lion brutale du gouvernement ne constitue qu'une supériorité apparente sur la masse" ([8] [218]).
Naturellement, cette tendance historique de la lutte de classe ne constitue pas une formule infaillible pour "solutionner" le problème de la répression, et même celui de l'insurrection, de la façon la "plus pacifique possible" mais c'est une orientation de base pour toutes les étapes de l'affrontement prolétarien avec le capital. C'est pourquoi nous ne défendons pas l'idée d'un écroulement spontané de l'Etat sous la pression de la grève de masse mais deux autres choses totalement différentes :
1) qu'une explosion de grève de masse affaiblit et paralyse momentanément la répression de 1'Etat capitaliste;
2) que c'est ce terrain massif et déterminant d'une immense force sociale qu'il faut conserver et sur lequel il faut se baser pour passer à des affrontements supérieurs.
Pour un affrontement supérieur -l'insurrection- il serait très dangereux de compter sur un simple écroulement spontané de l'Etat. Il faut savoir que l'Etat, devant une situation décisive, tire des forces de sa faiblesse, il se recompose, se réoriente et se réorganise et, généralement concentré autour de "forces ouvrières" (par exemple, les menchéviks en Russie), essaie d'écraser de manière sanglante le mouvement de classe. Donc, si celui-ci veut passer à un stade supérieur -révolutionnaire- il doit se poser le problème de la destruction totale de l'Etat bourgeois au moyen de l'INSURRECTION, laquelle, comme le disait Marx, et un ART qui requiert une préparation consciente et minutieusement organisé de la part de la classe ouvrière. Ceci dit, cette ART se trouve uniquement sur le terrain de la MOBILISATION ET ORGANISATION MASSIVES DE LA CLASSE.
LE PROLETARIAT ET LES COUCHES NON-EXPLOITEUSES
.20. "Les mouvements de révolte sociale contre l'ordre existant participent, d'une part au processus d'isolement de l'Etat, et d'autre part, ils constituent le contexte social dans lequel le prolétariat émerge et trouve sa propre voix comme seule force capable de présenter une alternative".
Cette affirmation peut nous servir de base pour continuer à approfondir la question du rapport entre le prolétariat et les autres couches non-exploiteuses.
La grève de masse crée un terrain de rébellion, d'action directe et de remise en question de l'ordre bourgeois, auquel finissent par se joindre, avec une intensité différente, les différents secteurs des couches opprimées et non-exploiteuses. Cela ne veut pas dire évidemment, que celles-ci doivent attendre que le prolétariat saute sur la scène sociale pour se lancer dans la bagarre. Personne ne prétend "donner des leçons" sur l'action de ces couches sans avenir ni s'opposer à un processus qui est inévitable, ni d'un autre côté les prendre comme plateforme pour un soi-disant réveil du prolétariat. Il s'agit au contraire de les reconnaitre comme une maturation des contradictions qu'accumulent le capitalisme, de les stimuler dans le sens profond de leur révolte contre une existence chaque fois plus inhumaine et de leur donner comme perspectives leur union à la lutte prolétarienne qui est en train de mûrir partout.
5/ LA PERSPECTIVE DE LA REVOLUTION
.21. Une conclusion claire s'impose : nous vivons une époque décisive où sont en gestation les affrontements de classe qui détermineront le cours futur de l'humanité vers la révolution ou vers la guerre. Comme nous l'avons indiqué plus haut (point 2) une des armes principales de la bourgeoisie face à la situation actuelle est de noyer le prolétariat dans un manque total de perspective, en lui faisant croire qu'il n'existe aucune issue au monde de catastrophes et de barbarie qu'elle nous impose. Ce manque de perspectives n'est pas seulement un produit de son action idéologique, mais surtout de l'action matérielle immédiate de ses appareils de gauches et syndicaux chargés d'isoler et d'épuiser les luttes.
Les luttes massives qui se préparent doivent avoir une conscience claire de la situation qu'elles vont trouver : leur but n'est pas de conquérir des satisfactions immédiates, pas même momentanément; leur véritables effet va être de mettre en lumière le chaos latent de l’économie capitaliste en le précipitant dans une gigantesque déstabilisation de sa structure politique, économique et sociale. Certes, dans le cadre de cette déstabilisation, la classe ouvrière, protégée par le rapport de force en sa faveur qu'elle a su imposer, va pouvoir satisfaire une quantité de revendications immédiates, mais au pris d'aggraver jusqu'au paroxysme le chaos capitaliste et d'aller jusqu'aux conséquences révolutionnaires de son action. Si face à cela, la classe ouvrière se perd en une multitude d'actions locales et partielles aussi radicales soient-21'les, elle finira à la longue par se disperser dans 1s chaos de l'ordre bourgeois et du capital qui opère de façon mondiale et centralisé, et qui reprend le contrôle une fois l'épidémie passée. C'est pourquoi, face à ces futures mobilisations massives de la classe ouvrière, une des principales lignes de défense que le capital va utiliser, c'est l'action de la gauche et des syndicats qui vont tenter d'enfermer ces explosions en une multitude d'actions chaotiques et radicales, dans les ornières de l'autogestion, du fédéralisme, du populisme.
La réponse à ce problème n'est en aucun cas que les ouvriers renoncent à cette salutaire et implacable action revendicative; il s'agit de la concentrer dans l'attaque révolutionnaire contre l'Etat bourgeois pour le détruire et élever sur ces ruines LA DICTATURE DES CONSEILS OUVRIERS, seule plate-forme possible pour qu'elle passe à un niveau supérieur et développe ses immenses possibilités historiques.
En conséquence, une des nécessités fondamentales de la situation actuelle est que la PERSPECTIVE DE LA REVOLUTION prenne corps chaque fois plus clairement et plus concrètement dans la préoccupation et la conscience des ouvriers. L'alternative révolutionnaire est l'orientation indispensable pour vivifier et pour renforcer les batailles de classe qui vont être livrées. Les révolutionnaires doivent contribuer activement par leurs analyses et leur défense des expériences historiques du prolétariat à cette orientation.
.22. Une autre nécessité impérieuse de la situation actuelle, directement liée à la précédente, c'est le développement à un stade supérieur des forces communistes de la classe qui doivent converger dans son PARTI DE LA REVOLUTION MONDIALE.
Si la première étape de l'actuelle reprise historique de la lutte du prolétariat (années 60 et 70) a donné comme fruit le développement de toute une série de noyaux communistes capables de se réapproprier programmatiquement les expériences historiques de la classe et de reprendre le fil de la continuité avec les organisations ouvrières du passé, coupé par 50 ans de contre-révolution, il faut comprendre que la nouvelle étape de cette reprise doit entraîner également un stade supérieur. La classe ouvrière doit créer, au cours des luttes à venir, les forces révolutionnaires qui, autour des pôles communistes internationalistes qui sont déjà constitués aujourd'hui, concentreront ses énergies, orienteront ses luttes et renforceront ses mouvements en direction de la REVOLUTION COMMUNISTE ET SON PARTI MONDIAL.
[1] [219] Accion Proletaria n°28 "Révolution communiste ou barbarie capitaliste" (Edito)
[2] [220] Revue Internationale n°23 "La lutte de classes internationale"
[3] [221] Revue Internationale n°24 "La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne"
[4] [222] K. Marx "Misère de la philosophie"
[5] [223] F.Engels "La situation de la classe ouvrière en Allemagne"
[6] [224] F.Engels "La situation de la classe ouvrière en Angleterre"
[7] [225] Accion Proletaria n°33 "Pologne au centre de la situation mondiale"
[8] [226] R. Luxemburg "A l'heure révolutionnaire" Œuvres choisies T.1 (traduit de l'espagnol par nous)
Géographique:
- Pologne [111]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière
- 3604 reads
CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES: LUTTE ECONOMIQUE ET LUTTE POLITIQUE.
1- Si toute lutte économique du prolétariat contient en elle un élément politique et vice-versa, si, contrairement à la thèse de Lénine il n'est pas possible de séparer dans le fond la lutte du prolétariat en lutte trade-unioniste et lutte socialiste (ces deux volets constituant un seul but) comme il est impossible de séparer ce caractère du prolétariat unique dans l'histoire d'être à la fois une classe exploitée et le sujet révolutionnaire, il ne reste pas moins vrai que ces deux aspects -la lutte économique et la lutte politique- qui sont des données constantes dans une même lutte unique de la classe, représentent des moments particuliers dans le temps et des niveaux différents de la lutte, et en conséquence ne restent pas toujours dans un même rapport. Autant il faut rejeter toute idée tendant à séparer lutte économique et lutte politique de la classe (et donc tendant a diviser l'unité de la classe elle-même), autant on doit se garder de méconnaitre (comme l'avait fait le syndicalisme révolutionnaire à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle) les spécificités significatives de chacun de ces deux aspects de la lutte et ce qu'ils recouvrent.
2- On peut aussi établir une correspondance entre le rapport lutte économique et lutte politique dans la lutte générale du prolétariat, avec des périodes historiques de la société capitaliste. Ce rapport se modifie avec le changement de période, jusqu'au point de se renverser complètement.
Le changement de rapport de forces entre classes sociales est déterminé par le changement de période; le changement de période est lui-même a son tour déterminé par l'évolution du capitalisme et le développement interne de ses contradictions. Dans la période ascendante du capitalisme et dans la mesure où la révolution n'est pas posée objectivement et pratiquement à l'ordre du jour, la lutte pour la défense des intérêts économiques ([1] [227]) prend nécessairement le pas sur la lutte politique dans la lutte générale du prolétariat. Les explosions révolutionnaires (politiques) pour si importantes qu'elles soient, ne sont à cette époque que des phénomènes circonstanciels et isolés. Cela est vrai pour les journées de Juin 1848 comme pour la Commune de Paris. La lutte économique est alors l'aspect prédominant dans la lutte globale de la classe. Ce rapport tend à se renverser au fur et à mesure que le capitalisme entre dans sa phase de déclin (1905 est la manifestation de cette tendance dans cette période charnière), et ce renversement trouve son achèvement à partir de la première guerre mondiale.
3- Comme nous l'avons déjà montré dans d'autres textes ([2] [228]), la lutte économique dans la période ascendante se déroule inévitablement sous la forme corporatiste, professionnelle, autrement dit limitée et en ordre dispersée. Et il en est ainsi parce que les prolétaires trouvent face à eux le capital lui-même dispersé en des millions de patrons et de petites fabriques dispersées et isolées. A ce stade, les syndicats sont la forme appropriée: à ce contenu de la lutte. Mais avec le changement de période, lorsque le capitalisme fortement concentré et-centralisé entre en décadence et prend la forme politico-économique du capitalisme d'Etat, déterminant la prédominance du caractère politique de la lutte du prolétariat, la lutte économique de la classe subit également des changements profonds:
-impossibilité du maintien d'une organisation unitaire permanente de défense strictement économique,
-inévitabilité d'une fusion entre la défense économique et le caractère général politique de la lutte, -nécessité de la participation massive et active dans la lutte,- grève de masse et assemblées générales.
Les conditions nouvelles de la lutte "économique" posent l'exigence impérative qui peut se formuler en deux points : l'autonomie et auto-organisation de la classe et l’extension de la lutte.
4- L'extension de la lutte qui est absolument inséparable de son auto organisation ouverte et généralisée à l'ensemble de la classe, doit être fondamentalement comprise comme un dépassement indispensable de toute parcellisation catégorielle, corporatiste, professionnelle, usiniste, régionale, de toute division entre chômeurs et ouvriers dans les usines, entre ouvriers immigrés et ouvriers du pays. Nous appellerons l'extension de la lutte un tel dépassement qui reste encore dans un cadre national, dans les frontières politico-géographiques d'un pays .L'extension a encore généralement pour point de départ le terrain les revendications économiques, la lutte contre l'austérité et les conséquences de la crise sur la vie quotidienne des ouvriers. Nous distinguerons la notion d'extension de la notion de généralisation dans laquelle nous entendons mettre en évidence essentiellement les deux caractères suivants: la généralisation est la lutte s'étendant au delà des frontières à d'autres pays, la généralisation ne peut se faire qu'en prenant d'emblée un caractère politique et_ révolutionnaire.
L'objet de ces thèses est l'examen des conditions historiques de cette généralisation. Cela ne pouvait se faire tant que nous ne l'avions pas dégagé de toutes autres considérations et questions adjacentes dont il faut tenir compte mais qui risquaient d'embrouiller et entraver cet examen. C'est ce que nous espérons avoir réussi à faire dans ces préliminaires, et pouvons donc maintenant passer directement à l'examen de la généralisation.
L'IMMATURITE DES CONDITIONS DE LA REVOLUTION
La lutte de classe au 19ème siècle
5-Dans "Principes du Communisme", fascicule écrit en Octobre-Novembre 1847 et qui devait servir d'ébauche au "Manifeste Communiste") Engels écrit:
"Question 19: Cette révolution se fera-t-elle dans un seul pays? Réponse; Non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà rapproché si étroitement les uns des autres les peuples de la terre, et notamment les plus civilisés, que chaque peuple dépend de ce qui se passe chez les autres. Elle a, en outre, uniformisé dans tous les pays civilisés le développement social à un tel point que, dans tous ces pays, la bourgeoisie et le prolétariat sont devenues les deux classes décisives de la société, et que la lutte entre ces deux classes est devenue la principale lutte de notre époque. La révolution communiste, par conséquent, ne sera pas une révolution pure ment nationale; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c'est à dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France, en Allemagne".
Ici, il ne s'agit pas de répondre a la théorie aberrante du "socialisme en un seul pays" au nom de laquelle devait s'accomplir la contre-révolution stalinienne: il s'agit de la révolution elle-même qui "se produira en même temps dans tous les pays civilisés". Cette thèse énoncée pour la première fois par Engels, certes pas suffisamment développée ni étayée dans sa démonstration, est néanmoins fondamentale et servira de pilier à la théorie et au mouvement marxistes, car elle contient l'idée du caractère obligatoire de la généralisation internationale, dans son contenu comme dans son étendue, de la révolution prolétarienne.
6- Nous retrouvons cette thèse à la base du "Manifeste Communiste", comme des autres écrits de Marx et Engels précédents et suivants la révolution de 1848. Dans "Les luttes de classe en France" par exemple, Marx commentant la défaite de Juin écrit:
" Enfin, les victoires de la Sainte Alliance ont donné à l'Europe une forme telle que tout nouveau soulèvement prolétarien en France sera immédiatement le signal d'une guerre mondiale. La nouvelle révolution française sera obligée de quitter aussitôt le terrain national et de conquérir le terrain européen, le seul où pourra l'emporter la révolution sociale au 19ème siècle".
Non seulement est réaffirmée avec force la thèse a caractère obligatoirement international de la révolution "le seul (terrain) où pourra l'emporter la révolution sociale du 19èrne siècle", mais elle se trouve encore renforcée en précisant le fondement historique de cette révolution: la crise du système économique du capitalisme.
" Nous voyons se dérouler actuellement sous nos yeux un processus analogue. Les conditions bourgeoises de production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus maîtriser les puissances infernales qu’il a invoqué"(Manifeste Communiste),
7- On peut mettre en doute"l'actualité" (en 1848!) du déclin du système capitaliste. L'histoire devait démentir cette "actualité" et les révolutionnaires, à commencer par Marx et Engels eux-mêmes devaient corriger cette erreur. Seuls des gens qui s'attachent à la lettre plutôt qu'à l'esprit du "Manifeste Communiste", peuvent encore soutenir aujourd'hui, que dés 1848, la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour de l'histoire, que dès 1848, la révolution était une possibilité, voir une nécessité. On trouve en effet dans le "Manifeste Communiste":
" Les forces productives dont vile dispose ne servant plus à faire avancer le régime de la propriété bourgeoise, -elles sont devenues au contraire pour elle, qui leur fait obstacle. . Les rapports bourgeois sont devenus trop étroits pour contenir les richesses qu'ils ont crées".
Si 1848 n'a pas vu la généralisation de la révolution prolétarienne (à commencer par l'Angleterre et l'Amérique), cela est indubitablement du au fait que les conditions historiques n'étaient pas encore présentes, contrairement à ce que pouvaient penser Marx et Engels. 1848 annonçait l'ouverture d'une ère d'épanouissement du capitalisme. Mais ce qui est fondamental et qui reste un acquis de granit du "Manifeste" est l'analyse qui détermine l'inévitabilité de la révolution prolétarienne par la crise du système économique du capitalisme, ce qui constituera la colonne vertébrale de la théorie marxiste.
8- Cette double affirmation du déterminisme que constitue la crise, et de la nécessité impérieuse de l'internationalisation de la révolution reste par trop générale, c'est à dire trop abstraite et sans lien précis interne tant qu'on n'est pas parvenu à démontrer concrètement les conditions historiques nécessaires à la généralisation de la révolution. Par exemple, comprenant le caractère bourgeois de la révolution en Allemagne en 1848, et dans le feu des événements, Marx et Engels croyaient, durant un temps, pouvoir greffer sur elle la révolution prolétarienne. C'était leur vision de "la révolution en permanence" proclamée dans "L'adresse du Conseil Central à la Ligue'' en Mars 1850. Mais cette fois encore, la réponse sera infirmée et rapidement abandonnée par eux. Ils devaient se rendre compte que la révolution bourgeoise ne constitue pas la détermination de la révolution prolétarienne, et encore moins la condition de la généralisation. Ils devaient, comme le disait Engels dans ses "Quelques mots sur l'histoire de la Ligue des Communistes" en Octobre 1885, prendre conscience "qu'une nouvelle période de prospérité inouïe s'était ouverte" et de se rappeler ce qu'ils écrivaient dans la "Neue Rheinische Zeitung" fin 1850:
En présence de cette prospérité générale où les forces productives de la société bourgeoise s'épanouissent avec toute la luxuriance somme toute possible dans le cadre bourgeois, il ne saurait être question d'une véritable révolution. Une telle révolution n'est possible que dans des périodes où il y a conflits entre ces deux facteurs, les formes productives modernes et les formes de production bourgeoise.
9- Suite à l'expérience et aux enseignements de la révolution de 1848-50, Marx et Engels rompront avec "ces radicaux faiseurs de révolutions" et se maintiendront fermement au prémisse de la crise économique, fondement de la révolution. Ils attendront et scruteront impatiemment le retour de la crise (voir leur correspondance de 1854-55) et décèleront effectivement son arrivée en 1856. Mais leurs espoirs seront de nouveau déçus, car ils restent encore attachés à la vision du Manifeste qui voit dans les crises cycliques un retour constant de la prémisse de la révolution. Il y a ici une ambiguïté entre la crise cyclique et la crise historique, permanente du capitalisme.
Les crises cycliques indiquent bien la contradiction existante dans le système capitaliste entre forces productives et rapports de production, mais qui reste latente et non explosive, et même stimulante, Citant que le capitalisme trouve des solutions, notamment dans la rencontre de nouveaux marchés. En effet, les crises cycliques qui se sont succédées dans la deuxième moitié du 19ème siècle, ne donneront jamais lieu à des explosions révolutionnaires et encore moins à leur généralisation. Marx et Engels seront parfaitement convaincus désormais de cette réalité, et les premiers à mettre en garde les ouvriers de Paris contre une insurrection prématurée et vouée à l'échec. Ils seront les plus sévères critiques du blanquisme, et les plus acharnés contre les aberrations volontaristes de Bakounine et de ses adeptes champions de la phraséologie révolutionnaire et des actions volontaristes.
10- L'écrasement sanglant de la Commune de Paris devait apporter la preuve, non pas de l'inanité de la révolution communiste (qui reste une nécessité et possibilité historique), ni de la nécessité indispensable de sa généralisation pour triompher mais de l’immaturité de ses conditions infirmant et confirmant à la fois la perspective émise par Marx dans "Les luttes de classe en France" que "la nouvelle révolution française sera obligée de quitter aussitôt le terrain national et de conquérir le terrain européen, le seul où pourra l'emporter la révolution sociale, du 19ème siècle".
La défaite de la Commune et l'épanouissement plus fort que jamais du capitalisme mondial devaient jeter pour des décennies un grand désarroi dans le mouvement ouvrier, donnant naissance d'une part à 1'anarcho-syndicalisme qui, désorienté et jetant par dessus bord toute investigation théorique, et emporté par son "impatience" cherchait coûte que coûte dans la lutte économique immédiate la révolution et les conditions de sa généralisation, et croyait les avoir enfin découvertes dans la "grève générale" faisant des artifices de leur imagination et de leur désir de panacée universelle; d'autre part produisant une séparation dans la lutte de classe entre la lutte économique (syndicats) et la lutte politique (partis), et provoquant au sein même du mouvement socialiste l'affrontement entre une majorité subissant les nouvelles conditions qui va évoluer de plus en plus ouvertement vers le gradualisme et le réformisme de la démocratie bourgeoise, et une minorité dispersée qui s'efforçait de se maintenir sur les bases du marxisme révolutionnaire.
En dépit de la persistance de la lutte de classe et de son élargissement, la révolution et les conditions de sa généralisation semblaient s'éloigner de la réalité, au fur et à mesure du développement du capitalisme, et le socialisme devenait un idéal lointain. La révolution et le socialisme deviennent l'objet de recherches essentiellement théoriques et de spéculations abstraites. La caractéristique de la lutte de classes dans les dernières décades du 19ëme siècle n'est pas tant dans les difficultés qu'éprouvent les révolutionnaires à trouver la réponse adéquate, mais dans la situation elle-même, qui parait ne pas la contenir, ou plus exactement ne pas vouloir révéler son secret.
LA GREVE DE MASSE : LA REVOLUTION DE 1905
11 - 1905 sera un coup de tonnerre dans un ciel serein. Non pas que des mouvements de bouleversements n'étaient prévus, au contraire. Tout le monde les .attendait, et plus particulièrement les socialistes qui s'y préparaient. Déjà le vieil Engels les avait, annoncés quelques temps avant sa mort. Mais ce qui surprenait, c'était la force impétueuse du jeune prolétariat russe et la .pusillanimité de la bourgeoisie. Les socialistes s'y préparaient, mais dans quel désordre et confusion politique! Les menchéviks y voyaient une stricte révolution antiféodale et assignaient au prolétariat un simple soutien au gouvernement de la bourgeoisie. Les bolcheviks de leur coté y voyait une révolution démocratico-bourgeoise avec une participation prépondérante de la classe ouvrière et préconisait une "dictature démocratique des ouvriers et paysans". D'autres comme Trotsky-Parvus parlaient de "gouvernement ouvrier" et reprenaient en l'actualisant le vieux slogan de la "révolution permanente". Pour tous, le modèle auquel ils se référaient était la révolution bourgeoise de 1789 et de 1848. A la base de toutes les analyses était la spécificité des conditions en Russie. Le contexte de la situation mondiale et la période historique du capitalisme passaient au second plan. Et pourtant, nous assistions à des phénomènes absolument nouveaux: une totale impuissance de la bourgeoisie se réfugiant dans le giron de la monarchie tsariste; une immobilité de l'immense population de la paysannerie et de l'armée dont elle était la principale composante; un mouvement spontané encore jamais vu entrainant l'immense majorité des ouvriers, s'auto-organisant, prenant des initiatives dans toutes les villes, faisant reculer le pouvoir, débordant largement les partis socialistes et leurs consignes, et enfin le surgissement d'un type nouveau d'organisation du prolétariat unifiant la lutte économique et politique: les Soviets ouvriers. Et alors que les partis socialistes se chamaillaient sur la nature des événements et les perspectives, les masses agissaient spontanément, montrant une capacité créative surprenante. Ce dernier fait remet en question le concept classique du rôle et de la fonction du parti politique, son rapport à la classe, son rôle qu'il avait joué au 19ëme siècle d'organisateur de la classe ainsi que le mode d'action classique de la lutte d'autrefois -les grèves corporatistes et syndicales- dépassé par un mode nouveau à caractère de masse et plus dynamique, ce que Rosa Luxembourg mettra en évidence: la grève de masses. 1905 est le type même de l'extension et de l'auto-organisation spontanée de la lutte du prolétariat. La répercussion dans d'autres pays est encore faible, mais elle est néanmoins une indication d'une tendance à la généralisation.
L'aile droite de la 2ème Internationale, majoritaire, surprise par la violence des événements ne comprend rien à ce qui vient de se passer sous ses yeux, mais manifeste bruyamment sa réprobation et sa répugnance face au développement de la lutte de classe, annonçant ainsi le processus qui va l'amener rapidement à passer dans le camp de l'ennemi de classe. L'aile gauche trouve dans ces événements une confirmation de ses positions révolutionnaires, mais elle est loin de saisir toute sa signification, à savoir que le monde capitaliste se trouve dans une période charnière de son évolution, de son apogée vers son déclin. La nouvelle situation leur imposera le besoin d'une profonde réflexion théorique, d'un réexamen du mouvement du capital, et surtout d'une analyse de sa phase finale: l'impérialisme et la marche vers l'effondrement du capitalisme. Cette étude est à peine ébauchée et très insuffisamment développée et comprise quand les événements se précipitent.
LES CONDITIONS DE LA GENERALISATION DE LA LUTTE DE CLASSE
La guerre de 1914-18, la révolution de 1917, la 2ème Guerre Mondiale
12- 1914 viendra confirmer pleinement et globalement l'analyse de la nouvelle période historique, qui sera résumée par Lénine dans la formule ; "l'ère des guerres impérialistes et des révolutions prolétariennes"
Les points forts de cette analyse sont:
a) Le capitalisme comme système connait des périodes de développement et de déclin.
b) Les crises cycliques de la période ascendante ne pouvaient amener la révolution prolétarienne. Seule la période de déclin de l'ensemble du système économique capitaliste fait de la révolution une nécessité et une possibilité.
c) Cette révolution ne peut donc être que mondiale et, plus vite elle se généralise à un plus grand nombre des pays industrialisés, plus grandes sont ses chances de triompher.
On peut constater ici, non seulement un retour en force aux positions énoncées par Engels dans les "Principes du Communisme", mais encore leur renforcement avec la précision apportée sur la période historique de la révolution que seule la réalité a permis de dégager pleinement. Mais il subsistait encore toute une série de questions qui demeurent non clarifiées : la définition de l'impérialisme et le problème de la saturation des marchés ([3] [229]), la théorisation d'une soi-disant '' loi du développement inégal du capitalisme" ([4] [230]), la théorisation du "chainon le plus faible" ([5] [231]) et l'anachronisme de se tenir aux anciens modes de lutte, absolument inadéquat dans la nouvelle période ([6] [232]). C'est à dire que ce sont 'précisément, les questions qui touchent le plus directement aux problèmes de la généralisation qui restent le moins élaborées ou auxquelles on donne des réponses carrément fausses.
13- De plus, si les révolutionnaires trouvent dans l'éclatement de la guerre mondiale la preuve irréfutable de "l'effondrement catastrophique" du capitalisme sous le poids de ses propres contradictions internes arrivées à terme, fondant ainsi la détermination objective de la révolution, ils croient trouver également en elle les conditions nécessaires de sa généralisation.
N'est-il pas vrai que les révolutions à ce jour étaient étroitement liées à des guerres capitalistes? Ceci est vrai pour la Commune de Paris -suite directe de la guerre prusso-française - et est également vrai pour 1905 qui suit la guerre russo-japonaise. S'appuyant sur ces exemples, les révolutionnaires devaient logiquement raisonner en ces termes: la guerre étant mondiale crée les conditions de la généralisation de la révolution.
L'éclatement effectif de la révolution russe et la vague révolutionnaire qui l'a suivie servant de preuve, devaient renforcer cette conviction qui reste dominante parmi les révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, n'est-il pas vrai que les bordiguistes et bien d'autres attachent si peu d'importance à la question du "Cours Historique" parce qu'ils misent sur la guerre qui, à leurs yeux, devraient donner naissance à la révolution? Or, si nous examinons de plus prés les expériences de l'histoire, les arguments avancés en faveur de cette conviction sont loin d'être aussi convaincants qu'ils ne l'apparaissent. Il est vrai que les guerres déterminent des convulsions sociales allant jusqu'à des explosions révolutionnaires et même à des triomphes. Mais ces triomphes sont isolés et de courte durée, comme c'était le cas pour la Commune de Paris ou pour la révolution de 190b (qui de plus se produit dans une période d'immaturité historique) ou pour la Hongrie, et même si le prolétariat parvient à garder le pouvoir pour un temps assez long, son isolement le condamne rapidement à la dégénérescence et finalement à la contre révolution comme le montre la révolution russe.
14- Pourquoi cela? Parce qu'il ne peut y avoir de mouvement révolutionnaire triomphant s'il ne contient pas et ne développe pas la tendance à l'internationalisation de la lutte, comme il ne peut y avoir de réelle internationalisation sans qu'elle soit révolutionnaire. Cela implique que les conditions de la révolution triomphante soient données à la fois dans la situation économico-politique et dans le rapport de forces favorables au prolétariat contre le capitalisme, à l'échelle mondiale. La guerre est certainement un haut moment de la crise du capitalisme, mais on ne doit pas perdre de vue que c'est aussi une réponse du capitalisme à sa crise, c'est à dire un moment avancé de sa barbarie qui, comme tel, ne favorise pas les conditions de la généralisation de la révolution.
Voyons cela de plus près. Déjà durant la première guerre mondiale, Rosa Luxembourg jetait un cri d'alarme et attirait l'attention, de sa prison, sur le fait que la bourgeoisie était en train de massacrer, sur ses champs de bataille, la fine fleur du prolétariat, sa jeunesse, les meilleurs combattants de la classe révolutionnaire. La deuxième guerre mondiale devait démontrer, dans la technique et l'organisation, la capacité de la bourgeoisie de multiplier le massacre (au moins par 2 et demi), d'étouffer toute velléité de lutte de classe et de faire table rase de tout organisme de la classe ouvrière. Et cela aussi bien dans l'armée que dans la population civile.
Sur le plan du massacre, ce que pouvait être les implications d'une guerre, avec toute la technique moderne, mieux vaut ne pas y penser. Sur un autre plan: la première guerre mondiale était une guerre de tranchée, ce qui permettait dans une certaine mesure le contact entre soldats des camps ennemis, d'où le mot d'ordre et une certaine possibilité de sa réalisation effective: la fraternisation. Ce n'est plus le cas dans la deuxième guerre mondiale au cours de laquelle l'infanterie joue déjà un rôle secondaire. Dans une prochaine guerre, les gens seraient massacrés par centaines de mille comme à Hiroshima, sans même avoir vu "l'ennemi".
Dans le mouvement de la révolution en Russie il est à constater que les soldats sont les derniers bastions à être gagnés ou simplement neutralisés. Ce sont les marins, ces "prolétaires flottants", qui sont le bras armé de la révolution. Cela est encore plus net en Allemagne. La raison en est très simple: parce que l'armée n'est pas le lieu de la concentration ouvrière mais le lieu où les ouvriers sont noyés dans une masse de paysans et autres couches.
La bourgeoisie a montré dans la deuxième guerre comment elle a parfaitement assimilé les enseignements de la première pour ce qui concerne les dangers de révoltes ouvrières.
En 1943, c'est volontairement que l'Angleterre ne profite pas de l'avantage donne par l'effondrement de l'armée de Mussolini et s'abstient d'envahir le nord de l'Italie, laissant à l'armée allemande le soin de réprimer les luttes des ouvriers de Milan et de Turin. Comme l'expliquait Churchill, c'était la politique de "laisser les italiens mijoter le temps nécessaire dans leur jus". La même politique sera employée par l'armée russe qui pendant 3 jours reste devant les portes de Varsovie et de Budapest qui sont soulevées, pour laisser le temps nécessaire à l'armée allemande en déroute pour accomplir la saignée judicieuse. Ce sera ensuite l'avance précipitée des armées aussi bien russes qu'américaines, en Allemagne pour relever au plus vite l'appareil défaillant hitlérien afin d'écraser dans l'œuf toute tentative de soulèvement.
Mais ce qui reste important et qui diminue de beaucoup l'efficacité du défaitisme révolutionnaire est le fait que la guerre produit des vainqueurs aussi bien que des vaincus, en même temps que la rage révolutionnaire contre la bourgeoisie se produit également dans la population une tendance revancharde. Et cette tendance revancharde pénètre jusque dans les rangs des révolutionnaires comme en témoigne la tendance du national-communisme dans le K.A.P.D. et la lutte contre le traité de Versailles qui va devenir l'axe de la propagande du K.P.D. Pire encore est l'effet produit sur les ouvriers dans les pays vainqueurs. Comme l'a démontré déjà le premier après-guerre et encore plus le second, ce qui prévaut, à coté d'une réelle et lente reprise de la lutte déclasse, c'est un esprit de la lassitude sinon un délire chauvin tout court.
15- Non, la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la généralisation. Contrairement à la thèse misant sur la guerre et qui implique la vision d'un cours extrêmement rapide surprenant la bourgeoisie -modèle russe- la révolution se présente - comme l'a dit Rosa Luxembourg au Congrès de fondation du PC en Allemagne - comme un long et douloureux processus, plein d'embûches, d'avancées et de reculs de la lutte. C'est dans ce processus que mûrissent les conditions de la généralisation, de la prise de conscience et de la capacité de la classe à s'organiser. Les révolutionnaires devaient cesser de faire de leur impatience un point de référence et apprendre à travailler à long terme, comme la réalité l'indique.
16-Nous avons défini la période de reconstruction comme un intervalle dans le mouvement de "crise-guerre- reconstruction- crise" qui est 1° mouvement du capital dans sa décadence. Ce qui est fondamental dans ce mouvement ce ne sont pas les termes intermédiaires (la guerre et la reconstruction), mais le point de départ et le point d'arrivée. Aucun des termes intermédiaires n'est fatal. Seuls les termes extrêmes "crise-crise" déterminent la caractéristique permanente de la période historique.
La guerre n'est possible qu'après une défaite du prolétariat laissant les mains libres à la bourgeoisie pour conduire la société aux pires catastrophes.
Depuis le début de la crise aiguë, à la fin des années 60, le prolétariat a repris sa lutte et à travers des hauts et des bas, il n'a fait que la développer pour atteindre aujourd'hui avec la Pologne le point le plus haut depuis un demi-siècle.
Mais la Pologne n'est pas le point final, et ce serait pur verbiage aventuriste de lui demander autre chose que ce qu'elle est. En Pologne, c'est une position avancée atteinte et occupée par un section de l'armée prolétarienne. Il importe maintenant que le gros de la classe l'ait rejoint. En attendant le prolétariat n'a aucun intérêt à sacrifier une de ses parties les plus combatives dans des affrontements militaires prématurés qui, isolée, est inévitablement vouée à la défaite. La victoire ne peut s'obtenir que par un avancement généralisé de la classe.
Les conditions de la généralisation se trouvent dans la crise elle-même. L'inexorable enfoncement du capitalisme dans une crise de plus en plus profonde crée 1'inexorabilité de la marche vers la généralisation de la lutte, condition de 1'ouverture de la révolution à l'échelle mondiale et sa victoire finale.
[1] [233] Pour éviter toute équivoque, précisons que sous le terme "économique" nous entendons tout ce qui concerne l'aménagement des conditions de vie générales et immédiates de la classe, en la distinguant du terme "politique" qui se réfère strictement au devenir et buts historiques dont le prolétariat est porteur.
[2] [234] Voir RINT n°23: "La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme".
[3] [235] La non définition exacte de la nature de l'impérialisme conduira à une division du monde en pays impérialistes et pays anti-impérialistes et de ce fait, à un lien qui existerait entre la révolution prolétarienne et les luttes de libération nationale.
[4] [236] Ce qui remettra en question 1'unité indispensable de la vague de révolutions simultanées et permettra ensuite à Staline de fonder là-dessus sa théorie du "Socialisme en un seul pays". L'inégalité du développement du capitalisme agit dans le sens du développement de l’interdépendance et donc de l'unification de la production mondiale qui trouve son achèvement dans la période de déclin en entrainant tous les pays dans la barbarie.
[5] [237] Prise à la lettre et en en faisane n axe, cette "théorie" finit par privilégier la maturité des conditions de la révolution dans les pays sous-développés aux dépens des pays hautement industrialises avec un prolétariat le plus concentré, le plus expérimenté, ce qui renverse complètement la vision juste de Marx et Engels à ce sujet.
[6] [238] Parlementarisme, syndicalisme, question nationale, front unique etc...
Questions théoriques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Résolution sur la lutte de classe
- 2483 reads
C'est sur trois plans, complémentaires mais distincts, qu'il est nécessaire d'analyser la lutte de classe aujourd'hui pour en comprendre les caractéristiques et en dégager les perspectives :
- sur le plan historique général de la décadence du capitalisme,
- sur le plan de la reprise de la lutte du prolétariat à partir de la fin des années 60 à la suite d'un demi-siècle de contre-révolution,
- sur le plan du moment présent de ces luttes marquées par un nouveau déploiement qui succède à la pause observée par la classe à la suite de la première poussée des années 68-74.
1) Comme l'ensemble des luttes ouvrières dans la période de décadence du capitalisme, les luttes d'aujourd'hui ont les caractéristiques suivantes :
- elles se développent en même temps que s'aggrave la crise de la société capitaliste, contrairement à celles du siècle dernier (surtout sa 2e moitié) à qui les crises cycliques de cette époque étaient en général fatales,
- elles n'ont pas de ce fait, comme perspective une amélioration progressive des conditions de vie du prolétariat au sein du système mais elles participent directement des préparatifs de son renversement,
- leur dynamique les pousse à dépasser les catégories (métiers, branches industrielles) pour préfigurer et créer les conditions de l'affrontement révolutionnaire futur où ce ne sera pas une somme de secteurs partiels de la classe ouvrière qui entrera en action mais l'ensemble du prolétariat comme classe,
- comme en tous temps, elles sont organisées mais el les ne peuvent l'être de façon préalable : bien que les ouvriers ne puissent à aucun moment renoncer à la lutte pour la défense de leurs intérêts économiques, bien au contraire, toute organisation permanente basée sur la défense de ces intérêts (syndicats) est condamnée à être récupérée par le capitalisme et intégrée au sein de son Etat; depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase de période de décadence, il n'est plus possible au prolétariat de s'organiser pour la lutte, il organise la lutte et cette organisation prend la forme des assemblées générales, des comités de grève élus et révocables, et, dans les périodes révolutionnaires, des conseils ouvriers,
- face à un capitalisme ultra-concentré, elles ne peuvent avoir d'efficacité réelle que si elles tendent à s'élargir; contrairement au passé, la durée n'est plus une arme véritable d'une lutte si elle reste isolée et de ce fait, la véritable solidarité prolétarienne ne peut plus s'exercer sous forme de collectes, de soutien aux grévistes mais bien par une extension du combat; dans la période de décadence du capitalisme, l'arme la plus importante du prolétariat pour repousser les attaques féroces d'un système aux abois et pour préparer son renversement, la véritable manifestation de la solidarité de classe, c'est la grève de masse.
2) Depuis 1847, il est clair pour les révolutionnaires que "la révolution communiste ...ne sera pas une révolution purement nationale, (qu') elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés.." (Engels. "Les principes du communisme"). Et, effectivement, c'est à l'échelle mondiale que s'est déployée la première vague révolutionnaire de ce siècle (1917-23). Sur ce plan, la présente reprise de la lutte de classe qui devra culminer dans la révolution communiste ne se distingue pas de la précédente : d'emblée, elle a eu le monde entier pour théâtre. Mais les conditions spécifiques dans lesquelles elle se développe (crise économique aigue du capitalisme et non guerre impérialiste) lui donnent de bien meilleurs atouts que n'en a disposés la précédente pour conduire à son terme le processus de mondialisation du combat révolutionnaire.
En effet, si la guerre impérialiste a eu comme résultat de plonger brutalement le prolétariat des pays belligérants dans une situation commune de misère atroce et de massacres absurdes ce qui, lors de la première guerre, a provoqué une dislocation rapide des mystifications capitalistes et a contraint la classe à se poser d'emblée le problème de la politisation et du caractère mondial de sa lutte, cette même guerre impérialiste portait en elle toute une série d'obstacles à la généralisation des luttes révolutionnaires à 1'échelle mondiale :
- la division entre pays belligérants et pays "neutres" : dans ces derniers pays, le prolétariat ne subit pas de dégradation massive de ses conditions de vie;
- la division entre "pays vainqueurs" et "pays vaincus" : dans les premiers, le prolétariat a été le plus souvent une proie facile pour la fierté chauvine déversée massivement par la bourgeoisie; dans les seconds, si la démoralisation nationale créait de meilleures conditions pour le développement de l'internationalisme, elle ne fermait pas la porte, au contraire, au développement de sentiments de revanche (cf. "national bolchévisme" en Allemagne);
- face à un mouvement révolutionnaire né de la guerre impérialiste, il restait comme recours à la bourgeoisie d'interrompre celle-ci (cf. Allemagne en novembre 1918),
- une fois la guerre impérialiste terminée, la possibilité de reconstruction qui s'offre au capitalisme et donc d'une certaine amélioration du fonctionnement de son économie a brisé l'élan prolétarien en le privant de son aliment de base : la lutte économique et le constat de faillite du système.
Par contre, le développement progressif d'une crise générale de l'économie capitaliste, s'il ne permet pas une prise de conscience aussi rapide des véritables enjeux de la lutte ni de la nécessité de l'internationalisme, élimine cependant les obstacles énumérés ci-dessus en ce sens :
- qu'il tend à mettre le prolétariat de tous les pays sur le même plan : la crise mondiale n'épargne aucune économie nationale,
- qu'il n'offre à la bourgeoisie aucune porte de sortie sinon celle d'une nouvelle guerre impérialiste qu'elle ne pourra déchaîner tant que le prolétariat n'aura pas été battu.
3) Si c'est dès le resurgissement historique de la lutte de la classe ouvrière à la fin des années 60 que se sont imposées à elle les exigences que nous avons signalées, ce n'est que progressivement, à travers tout un processus, que le prolétariat pourra acquérir une claire conscience de ces exigences. Dès les combats qui commencent en 1968 et s'étendent jusqu'en 74 (76 pour l'Espagne) la classe est confrontée à l'obstacle syndical, au besoin d'auto-organisation et d'extension de la lutte, de même qu'au caractère mondial de son combat. Cependant, c'est encore de façon tout à fait embryonnaire et minoritaire que se fait jour dans la classe une conscience de ces enjeux et de ces exigences (grève générale en France mais contrôlée par les syndicats; débordement des syndicats en Italie, mais récupération par les "comités de base"; mouvement des assemblées en Espagne mais canalisé vers un "syndicalisme de base"; impact international des grèves en France ou en Italie mais reçu de façon passive par les ouvriers des autres pays, etc.).
Et c'est en particulier en s'appuyant sur ces faiblesses du prolétariat, résultant notamment du poids du demi-siècle de contre-révolution d'où il sort.que la bourgeoisie a pu mener de façon efficace au milieu des années 70 sa contre-offensive basée sur la carte de la "gauche au pouvoir" ou sur "le chemin du pouvoir". Mais ce type d'offensive de la bourgeoisie était également permis par le caractère relativement supportable de la crise jusqu'en 74 et sur l'illusion amplement partagée dans toutes les couches de la société que l'effondrement de 74-75 n'était qu'un incident de parcours sans lendemain.
Avec la nouvelle aggravation de la crise économique qui prend place à la charnière des deux décennies 70 et 80 s'ouvre une situation nouvelle tant pour la vie de la bourgeoisie que pour celle du prolétariat. Après les "années d'illusion" viennent maintenant "les années de vérité", celles où se posera avec une bien plus grande acuité l'alternative historique guerre mondiale ou révolution, celles où seront balayées les illusions sur une possible "alternative" permettant au système de sortir de sa crise, celles où les exigences et les enjeux de la lutte de classe se poseront au prolétariat avec une insistance inconnue jusqu'à présent.
4) Ces "années de vérité" imposent à la bourgeoisie un autre type de contre-offensive face à la classe ouvrière, un type d'offensive beaucoup moins basée sur les illusions et la croyance en des "lendemains qui chantent" et beaucoup plus basée, justement, sur des "vérités" qu'on n'arrive plus â dissimuler et qu'on tente d'employer pour démoraliser le prolétariat.
Cette offensive se base également sur un partage systématique des tâches entre les différents secteurs de la bourgeoisie afin que cette classe puisse couvrir, à travers les diverses manifestations de son Etat, l'ensemble de la scène sociale, qu'elle puisse colmater du mieux possible les fissures que la crise provoque de plus en plus dans son système de domination.
Dans ce partage, il revient à la droite -c'est à dire le secteur politique qui, au delà des étiquettes n'est pas directement lié à l'encadrement et à la mystification des ouvriers- la tâche de 'parler franc" et d'agir en conséquence depuis la position gouvernementale qu'elle tend à occuper de plus en plus. De l'autre côté, il revient à la gauche -c'est à dire lés fractions bourgeoises qui, de par leur langage et leur implantation en milieu ouvrier ont pour tâche spécifique de mystifier et encadrer les travailleurs- depuis l'opposition où elle tend à passer dans presque tous les pays, de faire en sorte que ce "franc parler" ne puisse servir au prolétariat pour développer une conscience claire de la situation ni l'encourager à pousser plus avant sa riposte de classe.
C'est ainsi que lorsque la droite au pouvoir affirme que la crise est internationale et qu'elle n'a pas de solution à l'échelle nationale, la gauche dans l'opposition clame bien fort le contraire pour empêcher la classe ouvrière de prendre conscience de la faillite de l'économie capitaliste et de la dimension mondiale de ses luttes.
Lorsque la droite avance de plus en plus l'idée que la guerre est une menace réelle, il revient à la gauche de masquer cette réalité à travers toutes sortes de bavardages pacifistes et empêcher le prolétariat de comprendre le véritable enjeu de la situation présente. Lorsque la droite présente comme inévitable l'augmentation de l'austérité et du chômage, il revient à la gauche de prétendre le contraire en parlant de la "mauvaise gestion" des partis de droite, du "rôle des grands monopoles" et en appellent à "faire payer les riches", afin de masquer aux ouvriers le fait qu'il n'y a pas de solution de rechange, que, quel que soit le remède, c'est le capitalisme sous toutes ses formes qui est condamné et porte avec lui une misère croissante.
Lorsque la droite au pouvoir augmente les moyens et mesures de répression au nom de "l'insécurité, de la menace "terroriste" ou même "fasciste", il revient à la gauche de les faire accepter par la classe ouvrière en évoquant fébrilement ces mêmes dangers ou, en appelant à une utilisation plus "démocratique" de cette répression, de l'empêcher de prendre conscience que c'est toute la société d'exploitation, quelles que soient les forces qui la dirigent, qui porte en elle l'oppression et la répression.
Ainsi, dans tous les domaines où la bourgeoisie mène son offensive, il appartient aux secteurs de gauche, ceux en qui la classe ouvrière garde le plus d'illusions, de faire en sorte que cette offensive ne rencontre pas une résistance croissante, qu'elle n'ouvre de plus en plus les yeux des prolétaires jusqu'à leur faire comprendre qu'il n'y a d'autre issue que le renversement du capitalisme, de faire en sorte que cette offensive ne provoque et ne rencontre que désorientation, résignation et désespoir.
Le fait qu'aujourd'hui, la bourgeoisie soit conduite à jouer la carte de "la gauche dans l'opposition" contre la classe ouvrière ne signifie pas que cette carte soit la seule jouable en tout temps et toutes circonstances. En particulier, dans certaines situations, la gauche joue mieux son rôle en participant au pouvoir : soit dans des gouvernements "d'union nationale" lors des guerres impérialistes, soit directement à la tête du gouvernement dans des périodes révolutionnaires. D'autre part, si sa prise en charge d'un rôle d'opposition "décidée" correspond à une exigence générale pour la bourgeoisie dans la période actuelle de reprise des luttes de classe à la suite de la pause du milieu des années 70, cela ne veut pas dire que cette exigence trouve en toutes circonstances une concrétisation immédiate ou optimale. Mais tous les exemples spécifiques d'incapacités (qu'elles soient de nature électorale ou autre) pour la bourgeoisie de mettre résolument ses partis de gauche dans l'opposition doivent être compris comme expression des faiblesses particulières de cette classe qui manifestent sa crise politique et ne peuvent que l'aggraver à terme,
5) Seul le passage ou le maintien de la gauche dans l'opposition lui permet de se faire encore écouter par les travailleurs, de leur faire avaler ses mensonges, seul ce passage ou ce maintien lui permet également de saboter efficacement, de l'intérieur, les luttes que l'aggravation de la misère provoque et provoquera nécessairement.
Libérée de ses responsabilités gouvernementales, la gauche peut aujourd'hui tenir un langage plus "radical", plus "ouvrier". Elle peut reprendre à son compte, afin de pouvoir mieux les détourner, certaines aspirations de la classe. Elle peut appeler à la lutte, appeler à l'extension de celle-ci, même à son "auto-organisation" quand elle a la garantie que ses syndicats contrôlent bien cette "extension" ou que cette "auto-organisation" reste isolée.
Dans la période qui vient, la gauche et les syndicats, comme ils ont commencé à le faire, ne ménageront aucun effort pour assourdir les prolétaires d'un tapage "combatif", pour les désorienter par une intransigeance de façade et par un adroit partage des tâches entre les appareils syndicaux et le syndicalisme "de base". Tout cela dans le but d'épuiser la combativité prolétarienne, de l'épar piller, de lui interdire d'accéder à une classe consciente des véritables enjeux de la lutte.
6) Même si elle est menée de façon préventive, systématique et coordonnée à l'échelle mondiale, cette nouvelle offensive de la bourgeoisie n'a pas rencontré jusqu'à présent un succès complet. En effet, depuis deux ans, avec la grève de Rotterdam (septembre 1979), celle des sidérurgistes de Grande-Bretagne (janvier-avril 80), celle des métallurgistes du Brésil (avril 80), celle des transports à New York et des ouvriers de Gorki et Togliatti rad en URSS (mai 80), les affrontements en Corée du Sud (mai 80), et surtout l'immense mouvement des ouvriers de Pologne, s'est trouvée confirmée la perspective dégagée par le 3ème Congrès du CCI : "... Après une période de relatif recul des luttes couvrant le milieu, des années 70, la classe ouvrière tend â renouer aujourd'hui avec une combativité qui s'était manifestée de façon généralisée et souvent spectaculaire à partir de 1968" (Résolution sur la situation internationale).
Ainsi, si le passage de la gauche dans l'opposition a pu représenter pour la bourgeoisie un renforcement de ses positions, il s'agit d'un renforcement par rapport à la formule antérieure de "gauche au gouvernement" qui devenait caduque face à l'aggravation de la crise et la reprise des combats de classe et nullement d'un renforcement absolu face à la classe ouvrière.
7) De la même façon, ce renforcement, s'il est pour le moment indiscutable, ne saurait être que momentané. Au fur et à mesure que les luttes vont se développer, seront dépassés les obstacles que la gauche oppose à la prise.jie conscience de la classe. Ainsi dans les deux années passées s'est également trouvée confirmée l'analyse du 3ëme Congrès : "Bien qu'elle n'apparaisse vas immédiatement en pleine lumière, une des caractéristiques essentielles de cette nouvelle vague de luttes sera de redémarrer au niveau qualitatif le plus élevé atteint par la vague précédente. Cette caractéristique se manifestera essentiellement par une tendance plus marquée que par le passé à un débordement des syndicats, à l'élargissement des combats au-delà des limites catégorielles et professionnelles} à une conscience plus claire du caractère international de la lutte de classe". (Résolution sur la situation internationale).
Cette confirmation, c'est essentiellement la lutte des ouvriers de Pologne qui l'a apportée. En effet, cette lutte a donné une réponse à toute une série de questions que les luttes précédentes avaient posée sans pouvoir y répondre ou le faire clairement :
- la nécessité de l'extension de la lutte (grève des dockers de Rotterdam) ;
- la nécessité de son auto-organisation (sidérurgie en Grande-Bretagne) ;
- l'attitude face à la répression (lutte des sidérurgistes de Longwy-Denain).
Sur tous ces points, les combats de Pologne représentent un grand pas en avant de la lutte mondiale du prolétariat et c'est pour cela que ces combats sont les plus importants depuis plus d'un demi-siècle. Mais ces combats ont à leur tour posé une nouvelle question, fondamentale, au prolétariat à laquelle les ouvriers de Pologne ne peuvent répondre par eux-mêmes : la nécessité de la généralisation mondiale du combat de classe.
Cette question, c'est le capitalisme qui a déjà commencé à y répondre par son unité face à la classe ouvrière, unité au sein des blocs impérialistes, et également, malgré tous les antagonismes inter-impérialistes, entre les blocs. De l'ouest à l'est, face à la menace prolétarienne, tous les pays capitalistes font passera l'arrière-plan leurs divisions internes; ils tirent des leçons communes au niveau de l'efficacité des mesures à prendre face à la classe ouvrière : utilisation de la mystification nationaliste, démocratique, syndicaliste; menaces d'interventions militaires ; répression.
Dans des zones comme l'Amérique Centrale (El Salvador), le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-est, le prolétariat se trouve isolé, n'étant pas fortement concentré et avec des traditions de lutte moindres qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Dans ces zones se mène une répression féroce et sanglante derrière les larmes hypocrites des ai de-fossoyeurs, les chefs d'Etat des grandes puissances.
Il importe de souligner par conséquent que c'est en Europe et dans les principaux pays industrialisés que seront posés les réels solides jalons pour la prochaine vague révolutionnaire qui concernera et entraînera par contrecoup le prolétariat de tous les pays "sous-développés" ou faiblement industrialisés. Il n'est jamais possible d'envisager une simultanéité complète, mais c'est dans le sens d'une généralisation de la lutte de classe à plusieurs pays à la fois que se trouvera posé sérieusement le chemin de l'internationalisation de la lutte de classe mondiale.
De la réponse à cette question de la généralisation de la lutte, dépend un nouveau développement et approfondissement de la lutte prolétarienne internationale. Et cela y compris en Pologne même où les obstacles présents : menaces d'intervention, nationalisme, illusions syndicales et illusions démocratiques, ne pourront être levés que par le développement des luttes mondiales et plus particulièrement dans le bloc russe pour les deux premiers, dans le bloc occidental pour les deux autres.
En Pologne, le problème crucial de la généralisation mondiale de la lutte de classe ne pouvait être que posé. Il appartient au prolétariat mondial d'y répondre.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Contre résolution sur la lutte de classe
- 2452 reads
Contre résolution sur la lutte de classe ([1] [240])
La lutte prolétarienne en
Pologne a marque une nouvelle étape décisive dans le processus de grève de
masse qui a commencé à s'enclencher avec les luttes de Denain-Longwy-Rotterdam-sidérurgie
anglaise et qui ont posé à des niveaux divers la nécessité de
l'auto-organisation, de l'extension
et de la généralisation de la lutte.
1) Ces luttes ont confirmé le caractère nouveau de la lutte prolétarienne dans la phase de décadence. Si elles ont été une réponse à l'aggravation de la crise économique, elles ne peuvent avoir connue but une réelle amélioration des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Au delà des revendications économiques qui sont à la base du démarrage des luttes, il y a la préfiguration et la préparation de l'assaut généralisé futur qui est la seule réponse historique à la crise généralisée du capitalisme.
Dans ces luttes, on a pu voir le véritable antagonisme entre les besoins et la pratique de la classe ouvrière et toutes les thèses et stratégies relevant du syndicalisme. Ces stratégies ont toutes été des réponses de la bourgeoisie au prolétariat, elles ont toutes tenté de SAPER l'auto-organisation de la dynamique de la généralisation, de DEVOYER la prise de conscience politique du prolétariat qui commençait à s'amorcer.
2) Dans le futur, la seule voie pour le prolétariat résidera dans l'accentuation du dépassement du corporatisme, de l'usinisme, du nationalisme, à travers la mise sur pied dans la lutte d'assemblées générales, de comités de grève élus et révocables, et l'approfondissement de l'antagonisme POLITIQUE entre toutes les fractions bourgeoises agissant dans la classe et le prolétariat organisé.
3) L'autre aspect fondamental des luttes actuelles réside en ce qu'elles constituent le frein historique à la tendance à la guerre contenue dans les contradictions aveugles du système capitaliste décadent en crise. Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes dans une phase où le prolétariat a su imposer a la bourgeoisie son initiative de la lutte. Contrairement aux années 30 où la crise économique est venue accentuer la défaite prolétarienne des années 20, les années 70 ont vu la reconstitution lente et chaotique de la force prolétarienne. Cette reprise de la lutte prolétarienne a empêché la bourgeoisie d'entraîner la société dans la guerre mondiale. Cette incapacité de la bourgeoisie réside dans le fait que les partis susceptibles d'embrigader le prolétariat dans un nouvel holocauste, les PARTIS DE GAUCHE sont justement ceux qui ont été remis en cause par la reprise prolétarienne.
4) Face à un prolétariat qui retrouve ses forces, la gauche a vu se réduire son champ de manœuvre, sa capacité de mystification accumulée pendant des décennies de contre-révolution. Cette situation a vu, au cours de ces dix dernières années, développement de la crise de ces partis, crise faite de scissions, d'usure, d'apparition de nouvelles fractions (gauchisme) qui correspondent toutes à des réponses à la lutte du prolétariat mais qui en même temps constituent autant de faiblesses potentielles pour le futur.
5) Cette usure de l'édifice contre-révolutionnaire stalinien et social-démocrate s'est répercutée sur l'ensemble de l'appareil politique de la bourgeoisie. Cet appareil, partie intégrante de l'Etat, possède toutes les caractéristiques de la bourgeoisie décadente, sénile et incapable d'homogénéité face à son ennemi historique. En fait, c'est l'Etat lui-même qui s'est affaibli face aux coups portés par la classe ouvrière. CET AFFAIBLISSEMENT N'EST PAS UN EFFONDREMENT. Chaque parti bourgeois, avec ses méthodes, avec ses armes spécifiques, tente de le freiner. Face au prolétariat qui menace, mais aussi contrainte de prendre les mesures d'austérité indispensables pour éviter la faillite, la bourgeoisie tente, 1à où elle le peut, de riposter, de répondre à travers une série de tournants et de tactiques politiques fondés essentiellement sur les mystifications et les illusions démocratiques. L'autre aspect de ces tentatives de la bourgeoisie réside dans 1a nécessité de casser les luttes de l'intérieur soit par le sabotage ouvert, soit par le dévoiement politique.
6) Aujourd'hui, l'action des partis de gauche est au centre des problèmes posés à la bourgeoisie : comment battre le prolétariat, comment lui faire accepter 1'austérité puis la guerre ? En fait, nous allons assister dans les temps qui viennent à une instabilité croissante de la politique de la bourgeoisie au sens où les partis de gauche vont être contraints de développer des orientations politiques de plus en plus incohérentes :
- dans l'opposition, ils "risquent de perdre leur influence faute d'être capables de se présenter éternellement comme des défenseurs du prolétariat, et par là-même, ils risquent de perdre leur capacité de sabotage;
- au pouvoir, organisant l'austérité, ils perdront rapidement tout crédit auprès de la classe ouvrière qui oubliera de moins en moins les actes de la gauche au pouvoir.
7) Les années qui viennent vont voir le mûrissement de la crise politique généralisée de la bourgeoisie. Mais contrairement aux années précédentes où le prolétariat n'avait pu utiliser cette crise pour son propre compte, nous entrons dans la période où il va devenir crucial pour la classe ouvrière de tirer profit de cette crise. En ce sens, le caractère POLITIQUE contenu dans les luttes que nous venons de vivre, va devenir de plus en plus explicite posant en termes plus clairs l'importance du rôle et de l'intervention des groupes révolutionnaires. Dans cette phase, la capacité des révolutionnaires à analyser les contradictions de la bourgeoisie, de chaque bourgeoisie, dans le cadre de la compréhension de l'homogénéisation du prolétariat mondial, sera un facteur décisif dans la maturation de la conscience de classe.
Ch.
[1] [241] Le projet de contre résolution proposé a été : reprendre les points 1, 2, 7, de La Résolution et remplacer le reste par la résolution ci-dessus
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Crise économique généralisée et conflits inter-impérialistes
- 3792 reads
LE COURS DE LA CRISE ECONOMIQUE
Dans le rapport sur "La crise et les conflits inter-impérialistes" adopté au 3ème Congrès du CCI. en 1979, nous avions souligné l'échec de tous les palliatifs que le capital mondial avait utilisés pour relancer l'économie après la récession de 1974-75 (la 3ème et la plus grave des récessions depuis la crise ouverte de surproduction en 1967).
La capacité industrielle excédentaire, la baisse des taux d'investissement dans les pays avancés du bloc américain, la quasi-banqueroute des pays sous-développés de l'orbite occidentale, la faillite des différents plans quinquennaux dans le bloc russe, tous ces indices nous avaient amené alors à conclure que le capitalisme mondial était au bord d'un autre déclin de la production, de l'investissement et du commerce -plus aigu que les chutes de 1971-74- pour le début des années 80" ([1] [242]).
Dans le 3ème tome du Capital, Karl Marx met à nu le lien entre la baisse du Taux de profit et la saturation des marchés ([2] [243]). Que ce soit sous sa forme cyclique dans la phase ascendante, ou sous la forme de la crise historique qui caractérise la phase de décadence (et qui pose l'alternative: guerre impérialiste ou révolution prolétarienne), selon Marx, la crise du capitalisme éclate et se caractérise par trois manifestations principales liées entre elles : la surproduction des marchandises, la surproduction du capital, et la surproduction de la force de travail. Nous pouvons juger du bien-fondé de notre prévision de 1979 selon laquelle le capitalisme "est au bord d'une nouvelle catastrophe économique encore plus dévastatrice" ([3] [244]), en étudiant aujourd'hui les effets de la crise économique sur ces trois plans dans les grands pays industriels de l'Occident, ceux qui dominent l'économie mondiale.
LE MONDE OCCIDENTAL
Le ralentissement dans la croissance de la production industrielle ([4] [245]) qu'ont subi les pays de la C.E.E., le Japon, et les U.S.A. en 1979 s'est transformé aujourd'hui en une chute accentuée de la production industrielle dans le marché commun.
C'est en Grande-Bretagne qu'on voit le mieux la nature catastrophique de cet effondrement de la production : en Grande-Bretagne, la production manufacturière est tombée de 15% depuis 1979 pour arriver aujourd'hui au point le plus bas depuis 1967. On mesure l'étendue de la surproduction dans les industries-clé en observant le contrôle imposé par le Marché Commun sur la sidérurgie : la production sidérurgique, cette marchandise de base, baissera de 20% en Avril 1981 par rapport à 1979. La production automobile tombera de 10 à 12% cette année dans la C.E.E, pendant qu'en même temps les entreprises japonaises tentent de contrecarrer la saturation du marché mondial en faisant du dumping en Europe.
En Allemagne de l'Ouest, le plus grand secteur de la métallurgie, qui était responsable des excédents commerciaux de ce pays ces dernières années, a suivi la sidérurgie et l'automobile dans un déclin de la production.
Aux U.S.A, La stagnation de la production industrielle depuis 1979 est devenue une chute brusque en 1980. La petite amélioration à la fin de l'année 1980 s'est vite transformée en nouveau déclin, une récession "en deux temps" qui montre le seul genre de "relance" dont le capitalisme est capable aujourd'hui.
On voit l'ampleur du déclin de la production dans les industries-clé aux U.S.A par le fait qu'en février 1981 la production d'acier et de bois (la base de l'industrie de construction) était au même niveau qu'en 1967.
Seul le Japon, parmi les géants du bloc américain, a échappé à cette baisse de la production ([5] [246]). Mais les industries japonaises sont tellement dépendantes de l'exportation que la demande intérieure est incapable de contrecarrer le choc qui viendra, soit d'un protectionnisme de la part de ses partenaires commerciaux, soit d'une baisse du commerce mondial, ou des deux facteurs à la fois.
L'énorme surproduction de marchandises qui a produit ce déclin de la production industrielle, a déjà amené à une chute des investissements de capital, et le début d'un effondrement des profits dans la manufacture. En 1981, on s'attend à ce que les dépenses réelles en usines et équipements tombent de 2 à 3% en R.F.A, de 7% en Italie et de 10,25% en Grande-Bretagne. Aux U.SA, l'utilisation de la capacité industrielle a baissé et les investissements sont tombés en dessous du niveau nécessaire pour maintenir la compétitivité des, produits industriels américains.
De plus, les 4 milliards de dollars perdus par l'industrie automobile américaine en 1980 sont certainement le signe avant-coureur le plus spectaculaire de l'effondrement général des profits qui sera le résultat inévitable de cette surproduction de marchandises.
L'obstacle que constitue le marché mondial saturé le manque de demande solvable par rapport à la capa cité productive hyper-développée du capitalisme mondial , signifie, que, au niveau du capital global, tout effort pour contrebalancer la baisse du taux de profit par de nouveaux investissements en vue d'accroitre la productivité du capital, ne peut qu'exacerber la difficulté de réalisation de la masse de plus-value en venant ajouter aux stocks des marchandises invendables. Au fur et à mesure que la production industrielle baisse, une masse grandissante de capital non-utilisé, assoiffée de profit est jetée dans la spéculation. Il est possible que la surproduction du capital ait déjà jeté un million de milliards de dollars dans cette spéculation. C'est une véritable inondation de capital non-utilisé cherchant un placement rentable à court terme qui a fait continuellement augmenter le prix du pétrole, alors que la demande a baissé de 6% dans le bloc américain en 1980. L'agitation fébrile sur les marchés de l'or face à un déclin de la demande d'or pour l'industrie, a amené les spécialistes des métaux précieux à dire que "50% de la demande est aujourd'hui orientée vers la spéculation"([6] [247]). Le fiasco des frères Hunt dans leur tentative de monopoliser le marché de l'argent, le fait que les grandes sociétés mondiales ainsi que les institutions financières s'orientent de plus en plus vers le commerce des devises, témoignent de la recherche frénétique de profits à court terme de la part du capital inutilisé. En effet aujourd'hui, le prix des principales devises du monde est de plus en plus déterminé par les hauts et les bas des taux d'intérêts -dont les fluctuations font passer des milliards de dollars d'un pays à l'autre, presque du jour au lendemain. Cette vaste surproduction de capital a donné naissance à une énorme bulle de spéculation qui risque d'éclater avec des conséquences catastrophiques pour le capital mondial.
Avec la baisse de la production en 1980-81, le chômage a augmenté à un taux accéléré dans tous les pays industrialisés du bloc américain.
On voit les vraies dimensions de cette "population excédentaire" (Marx) qui est une des manifestations des plus cruelles de la crise économique du capitalisme, dans les prévisions de l'O.C.D.E selon lesquelles il y aura officiellement à la mi-81 23 MILLIONS DE CHOMEURS dans les pays industriels du bloc américain. En Hollande, il n'y a jamais eu autant de chômage depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. A la mi-81, il y aura 3 millions de chômeurs en Angleterre, chiffres non atteints même pendant les années 30. En R.F.A, les économistes de la Commerzbank prévoient non seulement une augmentation du chômage qui atteindra le chiffre de 4,8% de la population active, mais aussi une augmentation du nombre d'ouvriers réduits au chômage partiel : de 130.000, ce chiffre passera à 520.000 ouvriers au travail partiel cette année. Les attaques racistes contre les ouvriers immigrés en France (orchestrées par le gouvernement et la gauche dans l'opposition), les projets d'entreprises géantes telles que la Fiat en Italie qui a annoncé 24000 licenciements, et Rhône-Poulenc en France qui projette une réduction de 25% de la force de travail qu'elle utilise, et qui cherchent encore à réduire leurs effectifs, sont les signes du destin tragique que le capital réserve à des millions d'ouvriers dans les années 80.
On doit ajouter à ces manifestations dévastatrices de la crise ouverte de surproduction (surproduction de marchandises, de capital et de la force de travail), une autre manifestation non moins dangereuse pour le capital : l'inflation galopante en même temps que l'effondrement de la production et des profits. Pris dans l'engrenage de la crise permanente, le capital a réagi en utilisant la drogue de l'inflation (création d'argent et de crédit) dans un effort désespéré pour contrebalancer le manque de demandes solvables dû à la saturation définitive du marché mondial. Ce gonflement continuel et délibéré de la masse d'argent en circulation a tellement accru les frais de production qu'il a contribué à accélérer la baisse du taux de profit et à accentuer les difficultés mêmes auxquelles il voulait remédier dans la production. Tandis que l'inflation avait baissé au cours des 3 précédentes récessions -1967, 1971 et 1974-75- l'inflation a grimpé davantage dans la récession actuelle
Dans les pays sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine qui produisent les matières premières vitales et constituent des marchés nécessaires pour le bloc américain, on a vu depuis 2 ans l'augmentation de la masse de sans-travail et des paysans réduits à la misère. Selon la Banque Mondiale (une des institutions grâce à laquelle l'impérialisme américain maintient sa mainmise sur ces trois continents), il y a aujourd'hui 800 millions d'êtres humains sous-alimentés qui subsistent dans des conditions de "misère absolue".
LES PAYS SOUS-DEVELOPPES
A part quelques pays producteurs de pétrole (et leurs dollars finissent dans les mains de producteurs d'armements de l'Occident ou dans les banques occidentales, les pays du "tiers-monde" sont réduits à la banqueroute par des déficits croissants des balances commerciales et de paiement, et aussi par des dettes extérieures écrasantes. Une dépendance absolue en ce qui concerne la nourriture qui est importée- le sinistre produit de la crise agricole permanente provoquée par le capitalisme- veut dire que les déficits globaux de ces pays ont encore augmenté allant de 12 milliards de dollars en 1973 à 82 en 1981. De plus, les emprunts continuels auprès des banques privées et publiques de l'Occident, en grande partie pour couvrir des dettes, ont donné comme résultats une dette extérieure astronomique : un total de 290 milliards de dollars pour l'ensemble de ces pays affamés.
Durant les deux dernières années, toute une série de pays, en commençant par le Zaïre, la Jamaïque et le Pérou, et en continuant avec la Turquie et plus récemment avec le Soudan et la Bolivie, ont sombré dans la banqueroute et ont dû demander une réorganisation des échéances- de leurs remboursements à leurs créditeurs impérialistes. Dans chacun des cas, la seule alternative à la faillite et à l'arrêt immédiat des importations a été d'accepter, sous une forme ou une autre, un contrôle "de facto" du F.M.I. - l'instrument principal de la domination de l'impérialisme américain sur les pays sous-développés de son bloc. Ce contrôle a généralement pris 3 formes complémentaires ;
1) La dévaluation des devises du pays débiteur, ce qui veut dire que pour la même somme d'argent les créditeurs peuvent prélever davantage de matières premières.
2) Des prix alimentaires plus élevés, ce qui signifie encore plus de famine dans ces pays.
3) Un blocage des salaires pour pouvoir extraire encore plus de plus-value de la population travailleuse afin de rembourser les dettes.
Avec un taux d'inflation de 7 à 15% et un déficit budgétaire de 11 milliards de dollars de l'année dernière, la Chine a suivi le chemin de tant d'autres pays arriérés du bloc américain jusqu'à aller au F.M.I quémander l'argent. Au cours de sa première année comme membre du F.M.I (ce qui a parachevé son intégration au sein du bloc U.S) la Chine a emprunté prés de 1,5 milliards de dollars. De plus, confirmant notre prévision de 1979 (qui disait que la Chine n'allait pas combler les espoirs des hommes d'affaires occidentaux et ne constitueraient pas un marché énorme dans lequel ils pourraient se débarrasser de leur surproduction), la Chine a déjà annulé ou "reporté" cette année des contrats d'investissements de capital avec des entreprises occidentales, qui se montaient à 3,5 milliards de dollars. La réduction de 13% des dépenses étatiques annoncée en Février montre que le régime de Pékin est officiellement embarqué sur le même chemin d'austérité draconienne que connait le reste du monde capitaliste.
L'exemple de la Pologne montre comment l'activité économique a été maintenu face à un marché mondial saturé et à une pénurie de capital. En 1971, la dette extérieure de la Pologne se montait à un minuscule 800 millions de dollars. En 1980 (juste avant la grève de masse en Août) elle atteignait 23,5 milliards de dollars-Déjà en 1979, la plus grande partie des emprunts servaient à rembourser les anciens, plutôt qu'à une expansion de la production. Par conséquent, même avant la grève de masse, 1'économie polonaise commençait à s'effondrer.
LE BLOC RUSSE
Dans le rapport sur "La crise et les conflits inter-impérialistes" de 1979, nous avons dit qu'une des manifestations les plus importantes de la crise économique dans le bloc russe était une pénurie chronique de capital. Pendant les années 70, le bloc russe a évité la baisse de production à laquelle cette pénurie de capital l'aurait condamné en empruntant massivement auprès des banques et des Etats occidentaux. Ce flot de capital-argent à l'Est (qui a financé l'importation de marchandises et de technologie occidentale) a permis la croissance des économies du bloc russe, bien qu'à un taux de croissance moindre qu'avant la crise ouverte de surproduction mondiale.
L'effondrement économique de la Pologne ne se distingue de la récession dans laquelle s'enfonce tout le bloc russe que par son acuité. La production russe a baissé de 3% en 1980 et la production dans les secteurs industriels-clé tel que le charbon et l'acier, les réacteurs nucléaires et l'électricité n'ont pas atteints, et de loin, les niveaux prévus dans le dernier plan quinquennal.
LE COMMERCE MONDIAL
Le déclin économique qui a atteint simultanément tous les secteurs du capital mondial -aussi bien les pays avancés et arriérés du bloc américain que l'ensemble du bloc russe, a déterminé un déclin constant et même plus rapide du taux de croissance du commerce mondial.
Une brève description de la façon dont le capital mondial a cherché à "se reprendre" de la récession de 1974-75, et de l'échec de sa tentative, est nécessaire pour démontrer pourquoi le commerce mondial est actuellement quasiment stagnant.
Deux stratagèmes économiques-clé ont été utilisés pour créer une reprise temporaire de l'activité économique. D'abord, les Etats-Unis sont devenus la "locomotive" de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de son bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux.
Entre 1976 et 1980, les U.S.A ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendues. Seuls les U.S.A -parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale- pouvaient mettre en œuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement sa monnaie. Ensuite, les U.S.A ont inondé le monde de dollars avec une expansion sans précédent du crédit sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe (ces derniers essentiellement au moyen d'institutions financières existants en Europe). Cette masse de papier monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer. L'actuelle banqueroute des pays sous-développés du bloc américain, qui les a amenés l'un après l'autre à se mettre sous la coupe de la dictature fiscale du F.M.I et à se soumettre à ses plans d'austérité pour éviter le pire, a déjà supprimé l'une des béquilles qui avait soutenu le commerce mondial durant ces dernières années. La réduction drastique des importations de ces pays -nécessaire si l'on s'attend à un train de banqueroutes et éventuellement à un coup mortel contre le système monétaire international- aura un effet catastrophique sur les géants industriels du monde : 55% des exportations de la C.E.E (pris comme un tout commercial), 46% des exportations du Japon, et 46% de celles des Etats Unis et du Canada trouvent actuellement leur débouché dans les pays sous-développés.
Cet effondrement des pays sous-développés en tant que marchés met en danger la moitié des exportations des pays industrialisés! Les risques économiques croissants que constitue la poursuite de prêts massifs au bloc russe, sont en train de retirer au commerce mondial une autre béquille qui l'a soutenu. Et pour finir, les Etats-Unis ont commencé à faire sérieusement marche arrière en vue de réduire leurs-propres déficits du commerce et des paiements, afin de prévenir une nouvelle et encore plus dévastatrice crise du dollar. Cependant, une telle politique de la part de la Maison. Blanche signifie que les Etats Unis ne peuvent plus jouer le rôle de locomotive de l'économie mondiale, un rôle qu'aucun autre pays ne pourra jouer à sa place.
La stagnation et l'irréversible déclin du commerce mondial qui va en résulter, auront des effets dévastateurs sur la production industrielle des Etats Unis, du Japon et de l'Europe où le marché intérieur est déjà -nous l'avons vu- sursaturé. Le Japon et l'Europe ont longtemps été dépendants de leurs exportations vers les Etats-Unis, les pays sous-développés et particulièrement pour l'Europe -le bloc russe, dans le développement de leur activité industrielle. Le capitalisme américain, longtemps protégé des vicissitudes du marché mondial par l'existence d'un énorme marché intérieur, est aujourd'hui à peine moins dépendant de ses exportations que les autres : les exportations atteignent maintenant le taux sans précédent de 20% de la production industrielle nationale.
C'est cette réalité d'un enfoncement économique mondial qui a amené des représentants de la bourgeoisie comme les auteurs du nouveau plan économique de 5 ans pour la France, à dire avec assurance "que demain sera pire qu'aujourd'hui". Les révolutionnaires marxistes (qui seuls peuvent comprendre pourquoi le cours de la crise économique mène le capitalisme à l'abîme), qui comprennent que cette CRISE HISTORIQUE a créé les conditions mêmes pour la destruction du capitalisme par le prolétariat, ne peuvent que dire de tout cœur :. Salut à la crise !
LA REPONSE DE LA BOURGEOISIE
Ayant tracé le cours de la crise économique, il nous faut maintenant examiner brièvement les politiques économiques que la classe capitaliste, dans chacun des blocs russe et américain, va tenter de mettre en place face au déclin général.
LE CAPITALISME D'ETAT
Dans le bloc américain, la crise économique accélère fortement la tendance au capitalisme d'Etat ([7] [248]). Le capitalisme d'Etat ne peut se réduire seulement à la nationalisation des moyens de production, qui n'est qu'une de ses manifestations. L'un des architectes du capitalisme d'Etat dans les années 30, Hjalman Schacht, premier conseiller économique d'Hitler a montré qu'en réalité, le principe fondamental du capitalisme d'Etat était : "l'Etat, gouvernail de l'économie". Dans le contexte de l'anarchie du marché mondial dont le seul régulateur est, en dernière instance, la loi de la valeur, c'est l'Etat qui guide la voie économique à chaque capital national ; on a pu voir clairement cela en France, sous le gouvernement de centre-droit de Giscard-Barre. L'Etat a sélectionné les industries "stratégiques" comme la force nucléaire, l'aérospatiale et les télécommunications, dans lesquelles il a prévu d'investir, ou de guider des investissements, en milliards de dollars, pendant qu'il décide, par ailleurs, de restreindre certaines industries traditionnelles comme la sidérurgie, la construction navale et le textile. Combinant les nationalisations, le financement par l'Etat, les plans indicatifs et les pressions politiques, l'Etat français a organisé des fusions (la réorganisation des industries d'aciers spéciaux, la centralisation de la construction mécanique de camions entre les mains de la firme nationalisée de Renault), créant de nouveaux groupes industriels (la formation d'un trust des télécommunications, commençant avec l'absorption de Hachette par Matra), et manœuvre pour éloigner les capitaux étrangers des secteurs clés de l'économie (l'absorption d'Empain-Schneider par Paribas).
Complétant ce processus d'organisation de chaque capital national en une seule unité économique, l'Etat capitaliste doit affronter le dilemme de la mise en place d'une politique monétaire et fiscale cohérente qui permette à l'économie de naviguer entre l'effondrement simultané de la production industrielle ET l'inflation galopante. Aujourd'hui, aucun pays occidental important n'envisage une politique réflationniste élaborée. Le spectre de l'hyperinflation et de l'effondrement définitif de la monnaie interdit la mise en place de programmes de travaux publics massifs tels qu'Hitler en Allemagne, le Front Populaire en France ou Roosevelt aux Etats-Unis ont pu en promouvoir dans les années 30, lorsque l'effondrement de la production avait entraîné avec lui une chute rapide des prix. Cependant l'alternative d'une politique déflationniste, si elle semble la seule issue pour prévenir 1'hyperinflation n'amènera ultérieurement qu'une diminution désastreuse de la production industrielle, des profits et des investissements (tout comme un chômage croissant). En Grande-Bretagne, où le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher a eu recours à une politique déflationniste (bien qu'avec des exceptions), les résultats ont été catastrophiques pour le capital : une diminution de la production industrielle de 15% depuis 1979 ; les principales "multinationales", comme GKN et LUCA, qui ont fait des profits même dans les mauvaises passes économiques de 67, 71 et 74-75, ont enregistré des pertes; les faillites ont augmenté de 50% en 1980 (pendant que le chômage croissait de 900 000 personnes rien qu'en un an). Cette désindustrialisation qui est en train de faire du cœur industriel de la Grande-Bretagne un désert, a également provoqué pour les finances une victoire à la Pyrrhus : le taux annuel d'inflation a baissé de 20% à un encore dangereux 13%. On ne devrait pas s'étonner que la Confédération de l’industrie Britannique (l'organe du capital industriel) ait désespérément demandé un renversement de la politique déflationniste de Thatcher au moyen d'un programme de réflation massif des investissements publics (routes, pipelines, énergie nucléaire, transport et communications) en vue de les sauver de la catastrophe.
LE "SUPPLY-SIDE ECONOMICS" L'ECONOMIE DE L'OFFRE
La banqueroute des politiques déflationnistes orthodoxes comme des politiques réflationnistes classiques, face aux attaques combinées de la surproduction et de l'inflation, a poussé a la recherche désespérée de "nouvelles" panacées économiques de la part de la bourgeoisie et de ses épigones intellectuels. La dernière de ces panacées est le "supply-side économies" ("économie de l'offre") qu'une importante partie de l'Administration Reagan aux Etats-Unis veut appliquer fermement. La base du "supply-side économies" c'est de croire que des réductions importantes des impôts (d'abord pour les affaires et pour les riches) produiront un tel accroissement des investissements et une augmentation conséquente de la production industrielle que les revenus du gouvernement augmenteront et qu'il pourra atteindre l'équilibre de son budget. La fausseté de ce "raisonnement" se révélera vite si les 54 milliards de dollars de réduction des impôts sont vraiment mis en œuvre sans modification et sans restriction drastique des budgets que les déflationnistes, qui dirigent le "treasury and fédéral reserve Board" (ministère des finances et banques d'Amérique) demandent ; les réductions sur les impôts n'iront pas en investissements dans de nouvelles usines ou affaires productives, à une époque où il y a déjà une surproduction démesurée de capital. Ces milliards soutiendront plutôt la spéculation, avançant ainsi sur le chemin, de l'effondrement de la valeur monétaire nominale, ou bien ils permettront un boom à court terme de la consommation improductive chez les riches, ce qui développera encore l'inflation qui ravage l'économie. Plus encore, derrière la rhétorique d'extrême-droite de ses partisans, le "supply-side économies" n'est qu'une variante du keynésianisme qui a dominé l'économie mondiale depuis les années 30. Les projets de travaux publics du keynésianisme traditionnel comme les réductions d'impôts du "supply-side économies" cherchent tous deux vainement à compenser le manque chronique de demande solvable par rapport à la masse de marchandises que vomit un appareil industriel hyper-développé. Et, dans un monde marqué par l'inflation galopante, toute tentative de cette sorte de compenser le manque de demande par des déficits budgétaires, risque de pousser le capitalisme vers l'abîme.
L'ATTAQUE CONTRE LES CONDITIONS DE VIE DE LA CLASSE OUVRIERE
Plus les coups dévastateurs de la crise mondiale détruisent la possibilité même de poursuivre une politique économique cohérente, plus la bourgeoisie doit se livrer à un assaut direct contre les conditions de vie du prolétariat comme première réaction à une réalité objective qui échappe à son contrôle. En tentant de modifier de façon drastique le rapport entre les salaires et la plus-value, la bourgeoisie ne peut résoudre le problème de la surproduction globale qui empêche la reprise, quel que puisse être le taux de profit ; cependant une telle politique -si elle réussit - peut accroître la compétitivité d'un capital national aux dépens de ses rivaux. Ceci a amené une double offensive de la part du capital. Premièrement contre 1'emploi : des réductions drastiques de la force de travail employée et leurs conséquences : la "rationalisation" et l'augmentation des cadences pour les ouvriers qui restent, sont vitales pour chaque entreprise (bien que l'augmentation du chômage ne fasse qu'exacerber les difficultés de chaque économie nationale prise comme un tout). En Grande-Bretagne, par exemple, GKN a diminué de 27% la force de travail qu'elle employait, dans les 15 derniers mois, pendant que British Steel licenciait 60 000 ouvriers et prévoyait 20 000 licenciements de plus. Deuxièmement contre les salaires : en Belgique, les syndicats et les patrons, sous l'impulsion du gouvernement, ont signé un pacte de deux ans sur les salaires en février, et le gouvernement a proposé depuis de supprimer l'indexation des salaires (qui s'accroissent sous la poussée de l'inflation) ainsi qu'une réduction de 10% des salaires des ouvriers dont les entreprises reçoivent une aide financière de 1'Etat-La stabilité économique des pays du bloc américain est maintenant complètement dépendante du succès de cette offensive contre le prolétariat.
LE BLOC DE L'EST
La situation économique du bloc russe est encore plus désespérée que celle des pays du bloc américain. Les effets cumulatifs de la pénurie chronique de capital, les obstacles croissants auij prêts venant de l'Ouest, avec lesquels le bloc russe peut se munir de la technologie qui lui manque, le marché toujours chancelant pour ses exportations, se sont combinés pour mettre fin au "socialisme du Goulash" avec lequel Kroutchev d'abord, Brejnev ensuite ont cherché à contenir des explosions de lutte de classe que la mort de Staline avait rendues possibles. Dans tout le bloc, une austérité draconienne et un nouvel assaut direct contre les conditions de vie et de travail misérables du prolétariat constituent la seule base du nouveau plan quinquennal adopté au 26ëme Congrès du Parti Communiste (sic!) Russe cette année. Dans son rapport au congrès, Brejnev a dit que la Russie "fera plus, tout en utilisant! Moins de ressources, dans la production" avec le plan de 1981-85. C'était la reconnaissance voilée d'une pénurie de capital. L'orientation vers des méthodes de travail plus intensives n'était plus selon Brejnev une question "de choix, mais de nécessité". L'effort pour accroître la productivité de 17 à 20% dans les cinq prochaines années, avec moins de capital investi que dans les cinq précédentes, ne peut que vouloir dire que, non pas la productivité (qui dépend du capital constant), mais l'intensité du travail doit s'accroître. Donc le rapport de Brejnev annonçait que l'économie russe devra de plus en plus dépendre de l'extraction de la plus-value absolue plutôt que de la plus-value relative -précisément la même orientation qu'a dû prendre le bloc américain. A l'Est aussi, l'existence même du régime capitaliste dépend du succès de la bureaucratie dans son attaque contre la classe ouvrière.
LES ANTAGONISMES INTER-IMPERIALISTES
Au fur et à mesure que la courbe de la crise économique se prolonge et s'amplifie, elle intensifie les antagonismes inter-impérialistes jusqu’au point de rupture. Il y a un lien direct et immédiat entre l'approfondissement de la crise économique mondiale et les affrontements entre les blocs impérialistes. Pour le capital, il n'y a qu'une "solution" à sa crise historique : la guerre impérialiste mondiale. Plus vite les différents palliatifs prouvent leur futilité, plus délibérément chaque bloc impérialiste doit se préparer à un repartage violent du marché mondial.
La présidence de Reagan correspond à une nouvelle détermination de la bourgeoisie américaine d'assurer une position belliqueuse croissante dans le monde. Derrière cette agressivité grandissante, c'est la reconnaissance de plus en plus claire par la bourgeoisie que la guerre avec la Russie est la seule option réelle -un point de vue qui n'est pas exprimé habituellement de façon aussi ouverte que l'a fait Richard Pipes, le spécialiste russe au Conseil national de sécurité, lorsqu'il a dit en mars que la guerre était inévitable si les russes n'abandonnaient pas le "communisme". La stratégie qui se dégage des cercles dirigeants de l'impérialisme américain n'est plus simplement basée sur le point de vue que l'ennemi russe ne doit pas sortir de son cadre euro-asiatique : aujourd'hui, la conviction va croissant, et au Pentagone et à Wall Streets, qu'après avoir établi sa domination militaire jusqu'aux rives de l'Elbe après deux guerres mondiales, l'Amérique doit maintenant achever son œuvre et étendre son hégémonie au-delà de l'Oural. Telle est la signification réelle de la détermination de l'Administration Reagan d'accroître ses dépenses militaires de 1% chaque année en termes réels (ce qui veut dire plus d'un tiers du budget fédéral). Les 200 000 hommes de la force d'intervention rapide, le renforcement des bases au Moyen-Orient (y inclus les installations ultramodernes du Sinaï que les américains espèrent reprendre lorsque Israël se retirera l'année prochaine), le nouveau "consensus stratégique" que le secrétaire d'Etat Haig est en train de forger dans cette région, de la Palestine à l'Egypte (et de façon significative en Irak), le projet d'une force navale de 600 bateaux pour 1990 et le nouveau bombardier pour l'Air Force, constituent autant de préparatifs directs pour une offensive guerrière dans les années à venir.
Pendant que l'équilibre entre les blocs américain et russe a continué de pencher en faveur de Washington (l'armée russe est bloquée en Afghanistan, le surgissement de la classe ouvrière en Pologne peut encore forcer le Kremlin à tenter d'écraser le prolétariat ce qui, même si il y arrive, nécessiterait une immense armée d'occupation et des problèmes pour le Pacte de Varsovie), cela ne veut pas dire que l'impérialisme russe va adopter désormais une stratégie défensive. Comme on l'a mis en évidence dans le rapport du 3ème congrès du CCI, le bloc russe, plus faible économiquement ne peut espérer contrecarrer la domination industrielle américaine qu'en gagnant l'infrastructure industrielle de l'Europe ou du Japon. La stratégie russe qui recherche la domination sur le Moyen-Orient riche en pétrole, a comme premier but, de rendre l'Europe et le Japon aussi dépendants de Moscou pour s'approvisionner en pétrole nécessaire à leur industrie, qu'ils le sont actuellement des Etats-Unis, et donc, de les détacher du bloc américain.
La belliquosité croissante des USA ne peut qu'accroître la peur du Kremlin de perdre au Moyen-Orient alors qu'il y a encore des chances de succès. Il faut encore ajouter à cela un autre facteur qui pousse l'impérialisme russe sur le chemin de l'aventure militaire : la pénurie de capital avec lequel il pourrait développer ses ressources en pétrole de Sibérie, signifie qu'à la fois son industrie de guerre et sa capacité à contrôler le bloc en lui fournissant cette ressource vitale, courront vite des risques -tout cela ne peut qu'intensifier la pression pour gagner les champs de pétrole arabes dans les années a venir.
La poursuite de ces stratégies guerrières par l'impérialisme russe et américain, dépend de la consolidation et du renforcement de leurs blocs respectifs. Cependant, l'approfondissement même de la crise qui pousse l'impérialisme américain à faire des plans plus directs en vue de la guerre, crée également des tiraillements au sein de l'Alliance occidentale. L'offensive japonaise d'exportations massives qui a provoqué un déficit du commerce de la C.E.E. avec Tokyo de 115 milliards de dollars, et un déficit du commerce américain avec le Japon de 122 milliards de dollars en 1980, a provoqué un sentiment protectionniste croissant de la part de puissantes fractions de la bourgeoisie en Europe et aux Etats-Unis. Pendant que les Etats-Unis s'orientaient rapidement vers l'affirmation de leur cohésion en tant que bloc, à travers une pression sur le Japon pour qu'il limite "volontairement" ses exportations et supprime ses propres barrières contre les importations et l'investissement étranger, les demandes de protectionnisme (et même d'autarcie) de la part des fractions bourgeoises en Europe constituent un danger croissant auquel Washington doit répondre.
Pendant que la France et la Grande-Bretagne soutenaient résolument les Etats-Unis dans leur position de plus en plus agressive vis à vis des russes, la pression américaine sur l'Europe pour réduire ses liens commerciaux avec le bloc russe et pour revoir sa participation au projet de construction d'un pipe-line de gaz naturel venant de Sibérie, a amené une résistance croissante, surtout de la part de l'Allemagne de l'Ouest. L'Europe et la Russie constituent l'un des quelques marches où le capital allemand (et plus généralement, le capital européen) ne rencontre pas de concurrence aiguë de la part du Japon et des U.S.A. La limitation des liens économiques et commerciaux avec la Russie, que sous-entend la stratégie américaine, réduira considérablement le faible degré d'autonomie qu'a acquis le capital allemand depuis la seconde guerre mondiale. A ces considérations économiques, il faut ajouter que d'importantes parties de la bourgeoisie européenne hésitent encore à accepter toutes les conséquences de la stratégie que Washington veut imposer (les bases de missiles Pershing II en Europe) parce qu'une guerre transformerait immédiatement l'Europe en champ de bataille. Néanmoins, et dans la mesure où ces hésitations ne sont pas une simple façade pour dévoyer le prolétariat de son terrain de classe, ou un écran derrière lequel se cachent des fractions de la bourgeoisie pro-Moscou, elles laisseront en dernière instance la place à 1'impérieuse nécessité de renforcer le bloc dans la préparation à la guerre.
Comme l'impérialisme russe évolue vers le renforcement de son bloc, il rencontre de la résistance de la part de certaines bureaucraties à l'Est. Les bureaucraties roumaines et hongroises, en particulier, sont peu tentées de risquer leurs propres liens économiques et commerciaux complexes avec l'Europe occidentale, dans la mesure où c'est seulement à travers ces liens qu'elles ont acquis un peu d'autonomie vis à vis de Moscou. Néanmoins, la dépendance croissante vis à vis des prêts russes (car ces pays atteignent les limites de leurs crédits à l'Ouest), leur dépendance pour les matières premières, et la doctrine "pure" de Brejnev prévaudront en dernière instance sur les hésitations des petits Staline...
Si la courbe de la crise économique mène inexorablement la bourgeoisie vers la guerre impérialiste, l'issue de la crise historique n'est pas déterminée par le cours de la crise économique seulement. C'est l'intersection entre la courbe de la crise économique et la COURBE DE LA LUTTE DE CLASSES qui détermine si la crise historique se terminera en guerre mondiale ou en REVOLUTION PROLETARIENNE. Si la courbe ascendante de la crise économique croise une courbe descendante de la lutte de classes (comme dans les années 30), la guerre impérialiste est inévitable. Si, cependant, la courbe de la crise économique croise une courbe ascendante de la lutte de classe, alors la voie à la guerre est barrée et un cours historique vers LA GUERRE DE"CLASSE entre la bourgeoisie et le prolétariat est à l'ordre du jour. Le cours ascendant actuel de la lutte de classes constitue aujourd'hui la véritable clé de la situation internationale. La menace du prolétariat détermine de façon croissante les actes de la classe capitaliste, partout, dans le monde entier. Le vaste arsenal d'armes avec lequel les classes capitalistes des deux blocs se sont armées pour une guerre inter-impérialiste est maintenant préparé en vue d'une guerre de classe. Le renforcement des blocs, qui constitue une pré-condition pour la guerre contre le bloc rival, est aujourd'hui également une préparation immédiate et directe pour confronter le prolétariat où qu'il soit, qui est en train de mettre en cause la domination du capital.
[1] [249] Revue Internationale n° 18, p.9.
[2] [250] Le fait que Marx n'ait pas pu écrire les tomes sur le "commerce extérieur" et le "marché mondial", éléments de sa vaste analyse du "système économique bourgeois" fait que son analyse se présente de façon unilatérale ayant comme axe la suraccumulation du capital due à la baisse du taux de profit Aujourd'hui, en se basant sur les analyses de Marx lui-même dans " Le Capital" et "Les théories de la Plus-value", il revient au marxisme révolutionnaire de clarifier l'interaction complexe entre la surproduction de capital et la surproduction de marchandises. Seule une compréhension correcte de la tendance imminente du capitalisme à saturer le marché mondial rend cette tâche possible.
[3] [251] Revue Internationale n° 18, p.3.
[4] [252] Bien que les statistiques officielles et officieuses soient truquées dans les pays et ne traduisent pas la réalité de l'économie, les chiffres pour la production industrielle correspond mieux au vrai niveau de 1'activité économique que les chiffres du PNB dans lequel -entre autre- la distinction entre travail productif et non-productif (essentielle pour comprendre la situation réelle d'une économie capitaliste) est complètement escamotée.
[5] [253] Une baisse de 2,6% de la production industrielle pendant l'automne 1980 a été vite suivie d'un dumping massif sur les marchés extérieurs (essentiellement les USA. et la CEE) qui continue toujours.
[6] [254] "New York Times", International Economie Survey, 8 février 81.
[7] [255] Dans le bloc russe, en partie à. cause de l'expropriation des capitalistes privés par la révolution prolétarienne de 17-18, en partie comme résultat de l'arriération économique qui a rendu la nationalisation des moyens de production absolument vitale si le capitalisme voulait survivre et poursuivre une politique impérialiste, le capital "privé" a été éliminé.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Résolution sur la crise
- 3100 reads
1) En juin 1979, le Sème congrès du CCI affirmait :
"Dans la période qui vient, nous allons assister à un nouvel approfondissement de la avise mondiale du capitalisme sous forme, notamment d'une nouvelle flambée d'inflation et d'un ralentissement sensible de la production qui risque de faire oublier celui de 1974-75 et provoquera une aggravation brutale du chômage". (Résolution sur la situation internationale)
Nullement basée sur une prophétie mystique mais bien sur l'application de la théorie marxiste aux conditions actuelles de vie de la société et sur une analyse de la faillite inévitable des palliatifs usés par le capitalisme pour tenter de sortir de l'effondrement des années 74-75, cette prévision s'est trouvée confirmée ces deux dernières années. La situation présente illustre bien ce que le CCI a toujours dit de la nature de la crise : qu'il s'agit d'une crise générale de surproduction qui s'exprime, dans les métropoles du capitalisme, par une surproduction de marchandises, de capital et de force de travail.
2) La surproduction de marchandises trouve sa manifestation dans la chute de la production industrielle qui atteint des sommets avec un pays comme la Grande-Bretagne (- 15% entre 1979-80) mais frappe également de façon violente des puissances comme l'Allemagne Fédérale (où, après la sidérurgie et l'automobile, c'est un secteur aussi décisif pour ce pays que la métallurgie qui est en recul), et comme les USA, où une récession en deux temps (phénomène qui illustre la vanité croissante des politiques de "reprise") a provoqué un recul de la production à acier à son niveau de 1967 et de celle d'automobiles à un niveau encore inférieur à celui de cette date là. Seul, le Japon, grâce à son exceptionnelle productivité dans ces secteurs a échappé pour le moment à un tel sort; ceci n'est que partie remise, compte-tenu du développement du protectionnisme à son égard et de la poursuite du déclin des capacités d'absorption de ses marchés aux USA et en Europe occidentale.
3) Le recul de la production industrielle a provoqué et tendra à provoquer de plus en plus une chute des investissements et des profits. En une année (79-80), on a assisté à des baisses de 3% pour la RFA, 7% pour l'Italie, 10,25% pour la Grande- Bretagne dans les dépenses en usines et équipements industriels. Quant à la chute des profits, elle s'est illustrée de façon spectaculaire par des pertes de 4 milliards de dollars dans l'industrie automobile aux USA en 1980.
La tentative mise en évidence par Marx dans "Le Capital" de contrecarrer la baisse du taux de profit par une augmentation de la masse de plus-value se heurte à la saturation croissante des marchés. Plutôt que de s'investir dans une production pour laquelle on sait ne pouvoir trouver d'acquéreurs solvables, les capitaux existants se jettent dans la spéculation ce qui explique notamment les flambées sur le prix de l'or et la hausse des prix du pétrole alors que la consommation de ce bien est en baisse. Ce sont ainsi plus de 1000 milliards de dollars de capitaux "flottants" qui se meuvent dans le monde au gré des fluctuations des prix des matières premières, des devises et des taux d'intérêt et qui, dans leur recherche au jour le jour de placements rentables sont complètement stérilisés pour le développement de la production.
4} La surproduction de capital et de marchandise s’accompagne, notamment dans les pays occidentaux, d'une surproduction de la marchandise-force de travail. En deux ans, ce sont 5 millions de chômeurs supplémentaires qui sont venus rejoindre, dans les seuls pays avancés de l'OCDE, l'armée déjà immense des sans-travail jusqu'à atteindre 23 millions à la mi-81. A ceux qui s'obstinent à vouloir trouver des différences de nature entre la crise des années 30 et la crise présente, les chiffres sont en train d'apporter un démenti cinglant : avec 3 millions de chômeurs à la mi-81, la Grande-Bretagne a d'ores et déjà dépassé les chiffres d'avant-guerre et bien d'autres pays d'Europe sont en passe de battre à leur tour ce type de record avec des taux de chômage dépassant les 10% de la population active.
5) Résultant de l'effort désespéré pour contre balancer le manque de demande solvable par la création de crédit et de monnaie, l'inflation s'est maintenue à des taux élevés malgré la récession présente, contrairement à 67, 71 et 74-75 où le recul de la production s'était accompagné d'un certain recul du taux de hausse des prix. Ainsi se trouve confirmée la gravité croissante de la crise, qui ne peut plus naviguer entre l'inflation et la récession mais se manifeste simultanément sous ces deux formes. Se trouve ainsi confirmé l'échec patent de la politique qui avait permis une certaine "reprise" après la récession de 74-75 : la mise en œuvre d’énormes déficits tant budgétaires que commerciaux par les USA à qui était dévolu le rôle de "locomotive" de l'économie mondiale. Seul ce pays, par son importance économique et parce que sa monnaie est la principale monnaie de réserve, pouvait jouer un tel rôle. Mais ce rôle ne pouvait être que de courte durée car, véritable fuite en avant basée sur un simple fonctionnement accéléré de la planche à billets verts, ce mécanisme qui avait permis la "reprise" ne faisait qu'accélérer l'inflation tant aux USA que dans le monde et qu'accumuler les risques d'explosion de tout l'édifice monétaire international et, avec lui, de toute l'économie mondiale. C'est une béquille importante du commerce mondial qui se casse avec l'incapacité pour les USA de poursuivre leur rôle de locomotive.
6) Cette aggravation sans précédent de la crise économique ne touche donc pas seulement les pays occidentaux les plus industrialisés. Un des événements les plus significatifs de ces dernières années a été l'effondrement définitif du mythe des pays dits "socialistes", pouvant échapper à la crise générale du système. La grève de masse en Pologne a ouvert les yeux du monde entier sur la faillite économique et le caractère capitaliste des pays de l'Est. Ces pays, dépendants d'une puissance impérialiste - la Russie- arrivé trop tard sur l'arène d'un marché mondial déjà dominé par un capitalisme en déclin, ont depuis des décennies subi le poids de leur faiblesse concurrentielle vis à vis des pays les plus industrialisés du bloc occidental, et n'ont d'autre recours que de s'engager totalement dans l'économie de guerre en vue d'une domination militaire de l'ensemble da bloc impérialiste sur des zones de conquêtes. Cette situation a engendré une stérilisation des capitaux dans des secteurs improductifs ou non rentables, qui traduit une même incapacité a utiliser les forces productives que celle qui caractérise les pays plus industrialisés, mais avec des conséquences bien plus tragiques dans la mesure où ces pays tendent à être toujours perdants sur le marché mondial. Pendant les années 70, le bloc russe, acculé par cette pénurie relative de capital vis-à-vis des pays plus forts économiquement, n'a reculé la baisse de la production à laquelle le retour de la crise mondiale le condamnait qu'en empruntant massivement auprès des banques et Etats occidentaux. Ainsi, le maintien à flot de ces économies s'est effectué au prix d'un endettement colossal, qui les place dans une situation semblable à celle des pays du "tiers-monde" :
- la dette extérieure d'un pays comme la Pologne est passée de 800 millions de dollars en 1971, à 23,5 milliards de dollars en 1980, faisant un bond de près de 10 milliards de dollars ces deux dernières années ;
- le déficit annuel global des pays du "tiers-monde", est passé de 12 milliards de dollars en 1973, a 82 milliards de dollars en 1981 pour porter le total des dettes de ces pays à 290 milliards de dollars.
Cet endettement ne peut plus se poursuivre à ce rythme dans la mesure où :
- les marchandises produites grâce aux investissements réalisés dans ces pays trouvent de plus en plus difficilement à se vendre et quand elles le peuvent, c'est au détriment des marchandises produites par les pays bailleurs de fonds ;
- le simple paiement des intérêts absorbe une part croissante des exportations de ces pays (souvent plus de la moitié), de même qu'il ne peut être effectué que par de nouveaux endettements, ce qui met en péril les organismes financiers préteurs qui ont de moins en moins de perspectives d'être un jour remboursés.
Malgré les besoins immenses existant dans ces pays, leur capacité d'absorption des marchandises jetées sur le marché mondial s'amenuise donc de plus en plus, avec ses conséquences catastrophiques :
- la prise en charge par le FMI de l'économie des pays arriérés de son bloc qui tend à réduire encore plus leur consommation (dévaluation de leurs devises, blocage des salaires ouvriers) ;
- les réductions drastiques des dépenses d'Etat de la Chine (- 13% en 1980), l'annulation ou le report de 3,5 milliards de dollars de commandes faites par ce pays à l'étranger ;
- les difficultés économiques inextricables des pays du bloc russe (incapacité générale à atteindre les objectifs pourtant modestes du plan) qui auront de moins en moins de quoi échanger avec l'Occident.
7) Ainsi se sont trouvées épuisées en quelques années les recettes ("locomotive" américaine, endettement des pays sous-développés) qui avaient permis une certaine reprise de l'activité économique après 1976. Ces recettes-miracles dont la bourgeoisie faisait grand cas, se sont révélées en fin de compte pires que le mal dans la mesure où elles ne constituaient qu'une simple fuite en avant. Et ce n'est pas la nouvelle panacée baptisée "économie de l'offre" (chère aux Reagan et Thatcher) qui sera en mesure de changer quoi que ce soit : le fait d'alléger la fiscalité pesant sur le capital risque de ne pas avoir d'autre effet que de jeter les capitaux ainsi dégagés dans la spéculation et non dans les investissements productifs pour lesquels, de toute façon, les marchés sont saturés.
Une telle politique ne peut avoir d'autre objectif que de réduire massivement le coût de la fore de travail (à travers de nouvelles mises au chômage et baisses du salaire), ce qui pourra permettre une amélioration de la compétitivité commerciale des pays qui la mettent en œuvre, mais au détriment des autres pays et sans bénéfice aucun pour le marché mondial dont les capacités d'absorption iront de toute façon en s'amenuisant.
8) A l'aube des années 80, le capitalisme mondial se trouve donc confronté à une impasse économique totale. Les illusions que la bourgeoisie a pu avoir et véhiculer dans les années 70 sur une possible "reprise", "sortie du tunnel", se sont effondrées tant pour elle-même que pour l'ensemble de la société. Les années 80 se présentent donc comme les "années de vérité" : celles où se posera a la société avec toute son acuité l'alternative historique définie par l'Internationale Communiste ; "guerre impérialiste mondiale ou guerre de classe".
L'année 1980 a résumé de façon claire à la fois cette alternative, et à la fois la tendance qui domine cette alternative : le cours vers l'intensification de la lutte de classe entravant les tendances guerrières de la bourgeoisie. Si sa première moitié est dominée par une aggravation très sensible des tensions impérialistes à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, sa deuxième moitié les relègue au second plan et est au contraire dominée par 1 riposte de la classe ouvrière a la misère crois santé que lui impose la crise capitaliste et qui a trouvé son expression la plus haute dans les formidables combats de Pologne.
9) Tant que la révolution prolétarienne ne l'au pas balayé, le capitalisme ne cessera de fourbi ses préparatifs en vue d'un nouvel holocauste mondial. Ainsi, on assiste aujourd'hui à une nouvelle escalade dans ces préparatifs, notamment à travers une augmentation considérable des dépenses d'armement qui n'ont nullement une fonction de relance de l'économie, mais bien et uniquement de renforce ment des positions militaires de chaque bloc comme conséquence :
- de la préparation de la guerre ;
- du renforcement de la concurrence inter impérialiste ;
- de la mise au pas de toute la société.
Bien que l'approfondissement de la crise économique puisse provoquer des déchirements politiques au sein de certaines bourgeoisies nationales, affaiblissant leur participation à l'unité et la solidarité de leur bloc, les préparatifs se poursuivent également sur le plan du renforcement politique des blocs en vue de leur affrontement : les velléités d'indépendance de quelques pays basées sur des intérêts économiques et politiques particuliers (commerce avec le bloc de l'Est pour la RFA, "indépendance" de la Roumanie à l'égard de l'URSS) ou sur la réticence à se trouver en 1ère ligne d'un éventuel conflit (réserves à l'égard des fusées Pershing II) devront de plus en plus céder la place à une solidarité sans arrière-pensée derrière leurs chefs de file respectifs seuls capables de garantir leur sécurité militaire et la survie de leur économie.
10) L'élection de Reagan à la tête de la 1ère puissance mondiale s'inscrit dans cette orientation de chaque bloc vers encore plus de préparatifs politiques d'une confrontation généralisée. Mais elle n'a pas cette seule fonction ; elle s'inscrit également et encore plus dans le cadre de l'offensive présente de la bourgeoisie contre le prolétariat mise en œuvre par des gouvernements de plus en plus "forts" et "muscles", qui ont remplacé le "langage des illusions" du passé par celui de "la vérité". Car, si d'un côté la crise pousse de plus en plus la bourgeoisie vers la guerre généralisée, elle pousse également son ennemi mortel, le prolétariat, vers le développement de ses combats de classe.
Le seul fait que la guerre mondiale n'ait pas encore eu lieu alors que ses conditions objectives et ses préparatifs militaro-stratégiques sont plus que mûrs, démontre la force de l'obstacle que représente aujourd'hui la combativité prolétarienne face au jeu de l'impérialisme. Si l'aggravation de la crise ne pourra qu'attiser de plus en plus les antagonismes entre Etats capitalistes, le développement de la lutte de classe, comme l'ont mis en évidence les événements de Pologne, contraindra de plus en plus ces Etats à reporter une partie croissante de leurs forces vers le front principal, celui qui menace leur existence même, et les obligera à manifester leur solidarité jamais démentie dans l'histoire face au prolétariat.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Revue Internationale no 27 - 4e trimestre 1981
- 2623 reads
Un an de luttes ouvrières en Pologne.
- 2670 reads
Les luttes ouvrières de Pologne constituent le mouvement le plus important du prolétariat mondial depuis plus d'un demi-siècle. Un an après leur début, le bilan est riche d'enseignements pour la classe ouvrière de tous les pays et pour ses secteurs les plus avancés, les groupes révolutionnaires. Ce sont des éléments pour un tel bilan, ainsi que pour les perspectives qui s'en dégagent, que nous donnons dans cet article. Des éléments seulement, car cette expérience du prolétariat est tellement importante et riche, qu’on ne saurait la traiter de façon exhaustive dans le cadre d'un seul article. De même, la situation créée en Pologne est, par certains côtés, tellement nouvelle, elle évolue encore à une telle rapidité, qu'elle commande aux révolutionnaires la plus grande ouverture d'esprit, beaucoup de prudence et d'humilité dans les jugements qu'il convient de porter quant au devenir du mouvement.
UN BILAN QUI CONFIRME LES POSITIONS DE LA GAUCHE COMMUNISTE
Le mouvement ouvrier a une longue histoire. Chacune de ses expériences successives constitue un pas dans un chemin qui a commencé il y a près de deux siècles. En ce sens, si toute nouvelle expérience est confrontée a des conditions et circonstances inédites qui permettent d'en tirer des leçons spécifiques une des caractéristiques de ce mouvement est qu'à chacune de ses étapes, il est en général conduit, avant que de pouvoir aller glus loin, à redécouvrir des méthodes et des enseignements qui avaient déjà été siens dans le passe.
Au siècle dernier, et au cours des premières années de ce siècle, ces enseignements du passé faisaient partie de la vie quotidienne des prolétaires à travers notamment l'activité et la propagande de leurs organisations : syndicats et partis ouvriers. Avec l'entrée du capitalisme dans une autre phase de son existence, celle de sa décadence, le mouvement de la classe avait du s'adapter aux nouvelles conditions ainsi créées : la révolution de 1905 dans l'Empire russe constitue la première expérience d'une nouvelle époque de la lutte de classe, celle qui doit aboutir au renversement violent du capitalisme et à la prise du pouvoir par le prolétariat mondial. Ce mouvement de 1905 était riche d'enseignements pour les combats qui allaient suivre et tout particulièrement pour la vague révolutionnaire qui va de 1917 à 1923. Il avait fait découvrir au prolétariat deux instruments essentiels de sa lutte dans la période de décadence du capitalisme : la grève de masse et son auto-organisation en conseils ouvriers.
Mais si les enseignements de 1906 étaient présents dans la mémoire des prolétaires russes en 1917, si l'exemple d'octobre 1917 a éclairé les combats du prolétariat en Allemagne, en Hongrie, en Italie et dans beaucoup d'autres pays entre 1918 et 1973 et jusqu'au 1927 en Chine, la période suivante a connu une toute autre situation. En effet, cette vague révolutionnaire qui suit la première guerre mondiale a laissé la place à la plus longue et profonde contre-révolution de l'histoire du mouvement ouvrier. Tout l'acquis des luttes du premier quart du 20ème siècle a progressivement été perdu pour les masses prolétariennes et seuls quelques petits groupes ont été en mesure de conserver et défendre contre vents et marées ces acquis : les groupes de la gauche communiste (la fraction de gauche du Parte Communiste d'Italie, le KAPD, les Communistes Internationalistes de Hollande et les noyaux qui se sont rattachés politiquement à ces courants).
Ce qui se dégage des événements de Pologne, c'est-à-dire de l'expérience la plus importante du prolétariat mondial depuis la reprise historique de ses combats à la fin des années 60, c'est une confirmation éclatante des positions défendues par la gauche communiste depuis des décennies. Que ce soit sur la nature des pays soi-disant ''socialistes'' sur l'analyse de la période actuelle de la vie du capitalisme, sur la fonction des syndicats, et les caractéristiques du mouvement prolétarien dans cette période, sur le rôle des révolutionnaires dans ce mouvement, les luttes ouvrières en Pologne ont constitué une vérification vivante de la justesse de ces positions progressivement élaborées par les différents courants de l'entre-deux guerres et qui devaient trouver: avec la Gauche Communiste de France (qui publiait ''Internationalisme'' jusqu'au 1952) et avec le CCI aujourd'hui, leur formulation la plus complète et synthétique.
LA NATURE DES PAYS DITS ''SOCIALISTES''
Tous les courants de la gauche communiste n'ont pas su analyser avec la même clarté et la même promptitude la nature de la société qui s'était établie en URSS à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire du premier après-guerre et de la dégénérescence du pouvoir issu de la révolution d'octobre 1917 en Russie. Pendant longtemps, la gauche italienne a parlé d'un ''Etat ouvrier'' alors que, dès les bénies 20, la gauche germano-hollandaise a analysé cette société comme un ''capitalisme d'Etat''. Mais le mérite commun de tous les courants de la gauche communiste a été, contre le stalinisme , évidemment, et également contre le trotskyste, de dire de façon claire que le régime existant en URSS était contre-révolutionnaire, que le prolétariat y était exploité comme partout ailleurs, qu'il n'avait dans ce pays aucun ''acquis'' à défendre et que tout mot d'ordre de ''défense de l’URSS'' n'était pas autre chose qu'un drapeau de ralliement pour la participation è une nouvelle guerre impérialiste.
Depuis, la nature capitaliste de la société existant en Russie et dans les pays dits ''socialistes'' est parfaitement claire pour l'ensemble des courants de la gauche communiste. Dans la classe ouvrière mondiale cette idée est également en train de se développer à tel point que certains sociaux-démocrates n'hésitent pas à parler de ''capitalisme d'Etat'' pour qualifier ces pays? Dans le but de damer le pion aux partis staliniens et de tenter de propager les prolétaires à une défense de l'occident capitaliste certes, mais ''démocratique'', contre le bloc de l'Est capitaliste et totalitaire.
Mais, contre les mystifications que continuent à faire peser les staliniens et les trotskistes sur la véritable nature de ces régimes, les luttes ouvrières de Pologne constituent une arme décisive. Elles mettent en évidence pour les ouvriers de tous les pays que dans le ''socialisme réel'' comme partout ailleurs, la société est diviser en classes aux intérêts irréconciliables, qu'il existe des exploiteurs avec des privilèges tout à fait semblables à ceux des exploiteurs d'occident et des exploités sur qui pèse une misère et une oppression croissantes au fur et è mesure que sombre l'économie mondiale. Elles jettent une lumière crue sur ces prétendues ''conquêtes'' ouvrières dont les prolétaires de ces pays n'ont entendu parler que dans les discours de la propagande officielle. Elles font justice des ''mérites'' de ''l'économie planifiée'' et du ''monopole du commerce extérieur'' chantés par les trotskistes : ces grands ''acquis'' n'ont pas empêché l'économie polonaise d'être totalement désorganisée et endettée jusqu'au cou. Ces luttes, enfin, par leurs objectifs et leurs méthodes, font la preuve que le combat prolétarien est le même dans tous les pays et cela parce que partout il est mené contre un même ennemi : le capitalisme.
Ce coup porté par les ouvriers de Pologne aux mystifications sur la nature véritable des pays dits ''socialistes'' est de la plus haute importance pour la lutte du prolétariat mondial même si, depuis quelque temps l'étoile du ''socialisme réel'' était quelque peu ternie. En effet, c'est la mystification de l'URSS ''socialiste'' qui avait été au centre de l'offensive contre-révolutionnaire du capitalisme avant et après la seconde guerre mondiale : soit pour dévoyer les luttes prolétariennes vers la ''défense de la patrie socialiste'' soit pour écœurer les ouvriers et leur faire tourner le dos à toute lutte et à toute perspective révolutionnaire.
Pour pouvoir aboutir, le mouvement révolutionnaire dont on voit aujourd'hui les signes avant- coureurs devra faire la plus grande clarté sur le fait qu'il est confronté partout à un même ennemi, qu'il n'existe aucun ''bastion ouvrier'' même dégénéré, dans le monde. Les luttes de Pologne lui ont fait accomplir un grand pas dans cette direction
LA PERIODE PRESENTE DE LA VIE DU CAPITALISME
A la suite de l'Internationale Communiste, la gauche communiste ([1] [256]) qui s'en est dégagée au cours des années 20, a basé ses positions sur l'analyse de la période ouverte par la première guerre mondiale comme celle de la décadence du capitalisme. La période où ce système ne se survit plus qu'à travers un cycle infernal de crise aiguë, guerre, reconstruction, nouvelle crise, etc.
Après toutes les illusions sur un ''capitalisme enfin libéré des crises'' que les prix Nobel d'économie et leurs comparses ont pu répandre è la faveur de la reconstruction du deuxième après-guerre, la crise qui depuis glus de dix ans frappe tous les pays a commencé a redonner corps è cette position classique du marxisme. Cependant, la thèse a longtemps été maintenue par des idéologies de à gauche, et non sans succès parmi certains secteurs du prolétariat, que l'étatisation de l'économie ne pouvait constituer un remède à cette maladie. Un des grands enseignements des luttes ouvrières en Pologne, avec tout le délabrement de l'économie nationale qu'elles mettent en évidence, est que ce ''remède'' n'en est pas un, et qu'il est même capable d'être pire que le mal. La faillite dans 1aquelle s'enfonce le modèle de capitalisme qui prime en occident n'est pas liée au ''Jeu des grands monopoles'' et autres ''multinationales''. La faillite des modèles complètement étatisés fait la preuve que ce n'est pas telle ou telle forme de capitalisme qui est caduque et en putréfaction. C'est le mode de production capitaliste comme un tout qui se trouve dans ce cas et qui doit donc laisser la place à un autre mode de production.
LA NATURE DES SYNDICATS
Un des enseignements les plus importants des luttes de Pologne concerne le rôle et la nature des organisations syndicales déjà mis en évidence par la gauche allemande et hollandaise.
En effets ces luttes ont démontré que le prolétariat n'a pas besoin de syndicats pour engager le combat de façon massive et déterminée. S'ils existaient en aout 1980 en Pologne, 1es syndicats n'étaient pas autre chose - et chaque ouvrier en avait conscience - que l'auxiliaire servile du Parti gouvernant et de la police. C'est donc en dehors et contre les syndicats que le prolétariat s'est mis en action en Pologne, se dotant de ses organes de combat, les MKS (comités de lutte reposant sur les assemblées générales et les délégués élus et révocables de celles-ci), au cours de la lutte et non de façon préalable.
Depuis août 1980 toute l'action de Solidarité a fait la démonstration que même ''libres'', ''indépendants'' et jouissant de la confiance des travailleurs les syndicats étaient les ennemis de la lutte de classe. L’expérience que vivent aujourd'hui les ouvriers de Pologne est riche d'enseignement pour le prolétariat mondial. Elle est une preuve vivante du fait que si partout dans le monde la lutte de classe se heurte aux syndicats, ce n est pas seulement parce que ceux-ci sont bureaucratisés ou que leurs dirigeants sont des vendus. L'idée que la lutte de classe va redonner une vie prolétarienne aux syndicats existants ou bien celle que les travailleurs doivent créer de nouveaux syndicats qui échapperont aux tares des anciens, sont démenties chaque jour en Pologne. Dans ce pays, à peine créé et avec à sa tête les principaux dirigeants de la grève d'août 1980, le nouveau syndicat ne fait pas autre chose que ce que faisaient les anciens et que font partout dans le monde les organisations syndicales : saboter les luttes, démobiliser et décourager les ouvriers, dévoyer leur mécontentement vers les voies de garage de ''l'autogestion'' et de la défense de l'économie nationale. Et ce n'est nullement ici une affaire de ''mauvais dirigeants, de ''manque de démocratie'' : la structure syndicale, c'est-à-dire une organisation permanente basée sur la défense des intérêts immédiats des travailleurs, ne peut se maintenir du côté de la classe ouvrière. Dans le capitalisme décadent, à l'époque où il n'y a plus de réformes possibles dans un système en putréfaction, où l'Etat tend à intégrer en son sein toute la société civile, une telle structure ne peut être qu'aspirée par l'Etat et devenir un instrument de sa devenue et de celle du capital national. Et une telle structure se donne les dirigeants et les rouages qui correspondent à sa fonction. Le meilleur militant ouvrier deviendra un bonze syndical cogne les autres s'il accepte de prendre une place dans cette structure. La plus grande démocratie formelle comme celle qui existe en principe dans Solidarité, ne pourra empêcher un Walesa de négocier directement avec les autorités les conditions et les modalités du sabotage des luttes, de passer son temps à jouer les ''pompiers volants'' aux quatre coins du pays lorsque se déclenche le moindre incendie social.
Le bilan d'une année de luttes en Pologne est clair. Jamais le prolétariat n'a été aussi fort que lorsqu'il n'y avait pas de syndicats, lorsque c'étaient les assemblées des ouvriers en lutte qui avaient l'entière responsabilité de la conduite de celle-ci, qui élisaient, contrôlaient et éventuellement révoquaient les délégués envoyés dans les organes de centralisation du mouvement.
Depuis, la création et le développement de Solidarité, ont permis qu'à une aggravation de leurs conditions de vie sans commune mesure avec celle qui avaient provoqué les grèves de l'été 1980 les ouvriers n'aient pu apporter qu'une réponse bien plus faible et disperser. C'est Solidarité qui a permis de faire accepter ce que les anciens syndicats ne pouvaient plus imposer : un allongement de la semaine de travail (renonciation aux samedis libres), un triplement du prix du pain et des augmentations massives des prix d'autres biens de première nécessité, une pénurie chaque jour plus intenable. C'est Solidarité qui a réussi à engager les prolétaires polonais dans l'impasse de l'autogestion dont ils se détournaient l'année dernière et qui va les conduire à désigner eux-mêmes (quand cela sera compatible avec les vues du Parti règnent) celui qui va se charger d'organiser leur exploitation. C'est Solidarité enfin qui a préparé, en démobilisant chaque lutte, le terrain de l'offensive présente des autorités sur le plan de la censure et de la répression.
Le prolétariat de Pologne est beaucoup plus faible aujourd'hui avec une organisation syndicale ''libre'' et en qui ''il a 'confiance'' que lorsqu'il ne comptait sur aucun syndicat pour défendre ses intérêts. Et toutes les éventuelles ''rénovations'' du syndicat par des éléments plus ''radicaux'' que Walesa n'y pourront rien. Dans tous les pays du monde, le syndicalisme ''de base'' ou ''de combat'' a fait ses preuves : il n'a d'autre fonction, quelles que soient les illusions de ses promoteurs: que de redorer le blason d'un mode d'organisation qui ne peut servir d'autres intérêts que ceux du capitalisme.
Voila ce que les courants les plus lucides de la gauche communiste affirment depuis longtemps. Voila ce que devront finir par comprendre les courants communistes qui, à travers des bavardages sur ''l’associationnisme ouvrier'' maintiennent des illusions sur la possibilité pour le prolétariat de se doter d'organisations de type syndical.
Les luttes de Pologne, même si aujourd'hui les ouvriers de ce pays sont en bonne partie enfermés dans le piège de Solidarité, et justement à cause de cela, ont mis les pieds dans le plat d'une des mystifications les plus tenaces et dangereuses pour le prolétariat : la mystification syndicale.
Aux prolétaires et aux révolutionnaires de tous les pays d'en tirer les enseignements.
LES CARACTERISTIQUES DES LUTTES PRESENTES DE PROLETARIAT ET LE ROLE DES REVOLUTIONNAIRES
Dans les colonnes de cette revue, nous avons amplement traité de cette question (''Grève de masse en Pologne 1980'', n°23 ; ''Notes sur la grève de masse, hier et aujourd'hui dans ce n° ; ''A la 1umière des évasements de Pologne, le rôle des révolutionnaires'', n°24). Nous n'y reviendrons brièvement dans cet article que pour mettre en évidence deux points :
1) en renouant avec le combat, le prolétariat retrouve nécessairement l'arme de la grève de masse ; 2) le développement de la lutte en Pologne éclaire la nature des tâches des révolutionnaires dans la période actuelle de décadence du capitalisme.
C'est Rosa Luxemburg (cf. article dans ce no de la revue) qui, la première en 1906, a mis en évidence les caractéristiques nouvelles du combat prolétarien et a analysé avec profondeur le phénomène de la grève de masse. Elle basait son analyse sur l'expérience de la révolution de 1905- 1906 dans l'empire russe et notamment en Pologne où elle se trouvait au cours de cette période.
Par une ironie de l'histoire c'est encore en Pologne au sein du bloc impérialiste russe, que le prolétariat a renoué avec le plus de détermination avec cette méthode de lutte. Ce n'est d'ailleurs pas totalement le fruit du hasard. Comme en 1905, le prolétariat de ces pays est un de ceux qui subit le plus violemment les contradictions du capitalisme. Comme en 1905, il n'y avait pas dans ces pays de structures syndicales ou ''démocratiques'' capables de constituer des tampons face au mécontentement et à la combativité des ouvriers.
Mais au delà de ces analogies, il est nécessaire de mettre en évidence l'importance de l'exemple des grèves de masse en Pologne, et notamment le fait que la lutte prolétarienne de notre époque, contrairement à ce qui était le cas au siècle dernier et à ce que pensaient les bonzes syndicaux contre lesquels polémiquait Rosa Luxemburg: que cette lutte ne résulte pas d’une organisation préalable, mais qu’elle surgit spontanément du sol de la société en crise. L’organisation ne précède pas la lutte, elle se crée dans la lutte.
Ce fait fondamental donne aux organisations révolutionnaires une fonction très différente de celle qui était la leur au siècle dernier. Lorsque l'organisation syndicale était une condition de la lutte (voir ''La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme, Revue Internationale no23), le rôle des révolutionnaires était de participer activement à 1’édification de ces organes de combat. On peut considérer que, d'une certaine façon, à cette époque, les révolutionnaires ''organisaient'' la classe ouvrière en vue de ses luttes quotidiennes contre le capital. Par contre, lorsque l'organisation est un produit de la lutte, laquelle surgit spontanément à partir des convulsions qui assaillent la société capitaliste, il ne saurait plus être question pour les révolutionnaires « d’organiser » la classe ou de « préparer » ses mouvements de résistance contre les attaques croissantes du capital. Le rôle des organisations révolutionnaires se situe alors sur un tout autre il plan : non la préparation des luttes économiques immédiates, mais la préparation de la révolution prolétarienne par une défense au sien de ces luttes de leurs perspectives mondiale, globale et historique et plus généralement de l'ensemble des positions révolutionnaires.
L'expérience des luttes ouvrières en Pologne, les enseignements que des secteurs importants du prolétariat mondial commencent à en tirer (comme ces ouvriers de la FIAT de Turin qui manifestaient en scandant ''Gdansk, Gdansk !''), sont une illustration vivante de comment procède le développement de la conscience révolutionnaire de la classe ouvrière. Comme on l'a vu, un grand nombre des enseignements des luttes de Pologne faisaient depuis des décennies partie du patrimoine programmatique de la gauche communiste. Mais toute la propagande patiente et obstinée des groupes de ce courant pendant des décennies a moins fait, et de très à loin, que quelques mois de luttes des ouvriers en Pologne pour faire assimiler au prolétariat mondial ces enseignements. La conscience du prolétariat ne précède pas son être mais accompagne l'épanouissement de celui-ci. Et cet épanouissement ne se réalise que par ce combat contre le capitalisme et par son auto-organisation dans et pour ce combat.
Ce n'est que lorsqu’il commence à agir comme classe, donc à lutter à une échelle massive, que le prolétariat est en mesure de tirer les leçons de ses luttes tant présentes que passées. Cela ne veut pas dire que les organisations révolutionnaires n'ont aucun rôle à jouer dans ce processus. Leur fonction est justement de systématiser ces enseignements de les intégrer dans une analyse globale et cohérente, de les rattacher à toute l'expérience passée de la classe et aux perspectives d'avenir de son combat: Mais leur intervention et leur propagande au sein de la classe ne peuvent réellement rencontrer d'écho dans les masses ouvrières que lorsque celles-ci sont confrontées, dans 1a pratique, par une expérience vivante, aux questions fondamentales soulevées par cette intervention.
Ce n'est qu'en s'appuyant sur les premiers éléments d'une prise de conscience, prise de conscience dont elles sont elles-mêmes une manifestation, que les organisations révolutionnaires sont en mesure de se faire entendre par l'ensemble de la classe, de féconder son combat.
LES PROBLEMES NOUVEAUX QUE LES LUTTES DE POLOGNE METTENT EN EVIDENCE
Si les mouvements importants du prolétariat sont en général l'occasion d'une redécouverte par les travailleurs de méthodes et d'enseignements déjà valables dans le passé, il ne faudrait pas en déduire que la lutte de classe est constituée d'une simple répétition monotone du même scénario. Dans la mesure où il se déroule dans des conditions en évolution constante, chaque mouvement de la classe apporte ses propres enseignements qui viennent enrichir le patrimoine de son expérience globale. A certains moments cruciaux de la vie de la société, copie les révolutions ou les périodes charnière entre deux époques de celle-ci, il arrive même qu'une lutte particulière apporte au prolétariat mondial des éléments nouveaux si fondamentaux pour son mouvement historique que c'est toute la perspective de celui-ci qui en est affectée. Il en fut ainsi de la Commune de Paris, des révolutions de 1905 et 1917 en Russie. La première fit découvrir au prolétariat la nécessité de détruire de fond en comble l'Etat capitaliste. La deuxième, située au tournant de la vie du capitalisme, entre sa phase ascendante et sa phase de décadence, lui montra de quels instruments elle avait besoin dans cette nouvelle période, tant pour résister aux attaques du capital que pour partir à l'assaut du pouvoir : la grève de masse et les conseils ouvriers. La troisième, seule expérience sérieuse à ce jour de la prise du pouvoir politique par le prolétariat dans un pays, doit lui permettre d'aborder, mieux armé que par le passé, les problèmes de la dictature du prolétariat, de ses rapports avec l'Etat de la période de transition et de la place du parti prolétarien dans l'ensemble du processus révolutionnaire.
Les luttes ouvrières en Pologne: malgré toute leur importance, n'ont pas apporte è l'expérience du prolétariat des éléments aussi fondamentaux que ceux qu'on vient d'évoquer. Cependant, il est nécessaire de signaler certains problèmes auxquels la pratique n'a pas encore donné de réponse décisive, bien qu'ils se soient posés depuis longtemps sur le plan théorique, et que les évasements de Pologne remettent au premier plan des préoccupations de la classe.
En premier lieu, les luttes de Pologne sont une illustration claire d'un phénomène général que nous avons déjà signalé dans notre presse et qui est nouveau dans l'histoire du mouvement ouvrier le développement d'une vague révolutionnaire du prolétariat non à partir de la guerre (comme en 1905 et 1917 en Russie, en 1918 en Allemagne et dans le reste de l'Europe), mais à partir d'un effondrement économique du capitalisme, ''conformément'' pourrait-on dire, au schéma que Marx et Engels avaient envisagé au siècle dernier. Nous avons dans d'autres textes amplement analysé les caractéristiques qu'imposent à la vague présente des combats ouvriers les conditions dans lesquelles elle se développe : mouvement de longue durée, mobilisation à partir de revendications essentiellement économiques (alors qu'en 1917, par exemple, la revendication principale, la paix, était directement politique). Nous n'y reviendrons pas ici sinon pour constater que ces circonstances nouvelles exigent des révolutionnaires vigilance, esprit critique, modestie, ouverture d'esprit afin d'éviter d'être empêtrés dans des schémas du passé devenus caducs aujourd'hui. C'est dans de tels schémas rigides que se sont enfermés les groupes qui considèrent que le prochain mouvement révolutionnaire de la classe surgira, comme par le passé, de la guerre impérialiste. Les luttes de Pologne démontrent justement que le capitalisme ne sera en mesure d'apporter sa réponse propre à la crise générale de son économie qu'après avoir mis au pas le prolétariat. Tant que les diverses fractions nationales de la bourgeoisie seront menacées dans leur survie comme classe par la combativité ouvrière, elles ne prendront pas le risque de laisser leurs luttes pour l'hégémonie mondiale dégénérer en une confrontation centrale qui les affaiblirait devant leur ennemi commun et mortel : le prolétariat. C'est ce qu'a démontré l'année 1980 : si la première partie est marquée par une aggravation très sensible des tensions entre les deux blocs impérialistes, ces tensions, tout en se maintenant, passent au second plan pour la bourgeoisie mondiale après les grèves du mois d'août. Ce qui importe à la bourgeoisie, après ces luttes, c'est de faire tout son possible, et de façon coordonnée, pour étouffer la combativité ouvrière. Et pas un de ses secteurs ne manque à l'appel. L'URSS et ses acolytes font force manœuvres militaires et promesses d'''aide fraternelle'' pour intimider les ouvriers polonais ; ils dénoncent soigneusement Walesa et Kuron chaque fois que ceux-ci ont besoin de redorer un blason qui a tendance à se ternie au fil de leurs incessantes opérations antigrèves. Les pays occidentaux accordent des reports de dettes et des livraisons de denrées de base à bas prix ; ils envoient leurs syndicalistes apporter matériel de propagande et bons conseils à Solidarité ; ils font tout leur possible pour rendre crédible la thèse d'une intervention du Pacte de Varsovie au cas où l'agitation ne se calmerait pas, ils confient au chancelier ''socialiste'' d'Autriche Kreisky et à Brandt, président de l'''internationale Socialiste'' , le soin d'exhorter les prolétaires polonais ''au travail '' .
En d'autres termes, si les différents gangsters qui se partagent le monde ne perdent pas une occasion de se tirer dans le dos, ils sont prêts à réaliser l'''union sacrée'' dès que se manifeste l'ennemi prolétarien. La lutte de la classe ouvrière, telle qu'elle est engagée aujourd'hui, est bien le seul obstacle à une nouvelle guerre généralisée. Les événements de Pologne démontrent une nouvelle fois que la perspective n'est pas à celle-ci, mais à la guerre de classe. La prochaine révolution ne surgira pas de la guerre mondiale, c'est uniquement sur le cadavre de la révolution que la guerre pourra éventuellement surgir.
L'autre problème que posant les évasements de Pologne concerne plus spécifiquement la nature des armes bourgeoises que la classe ouvrière devra affronter dans les pays du bloc russe.
En Pologne, on a pu constater que la bourgeoisie a du adopter , à son corps défendant , la tactique couramment employée en occident : le partage du travail entre des équipes gouvernementales à qui revient la tâche de ''parler clair'' le langage de 1'austérité de la répression et de 1'intransigeance (modèle Reagan ou Tchatcher) , et des équipes d'opposition au langage ''ouvrier'' chargées de paralyser la riposte ouvrière face aux attaques capitalistes . Mais alors que les bourgeoisies occidentales sont rompues à ce genre de partage des responsabilités pour lequel elles disposent d'un système ''démocratique'' bien rodé , les bourgeoisial du bloc de 1'Est dont le mode de domination est basé sur l'existence d'un parti-Etat , maître absolu de tous les rouages de la société , ces bourgeoisies éprouvent les plus grandes difficultés à maitriser un tel jeu .
En décembre 1980, nous mettions déjà en évidence cette contradiction : ''...pas plus aujourd'hui qu'hier, le régime stalinien ne peut tolérer sans dommage ni danger l'existence de telles forces d'opposition. Sa fragilité et sa rigidité congénitales n'ont pas disparu par enchantement par la grâce de l'explosion des luttes ouvrières. Bien au contraire ! Ainsi, contraint de tolérer dans ses entrailles un corps étranger dont il a besoin pour survivre, mais que rejettent toutes les fibres de son organisme , le régime est plongé aujourd'hui dans les convulsions les plus douloureuses de son histoire (Revue Internationale n°24, p.3).
Depuis, le Parti a réussi, notamment après son 9ème Congrès et grâce, une fois encore, à la collaboration des grandes puissances, à stabiliser sa situation interne autour de Kania et à établir un modus vivendi avec Solidarité. Ce modus vivendi n'est pas exempt d'attaques et de dénonciations acerbes. Comme en occident, elles font partie du jeu qui permet è chacun des protagonistes d'être crédible dans son rôle : en montrant les dents, le ''méchant'' veut faire la preuve que, si c'est nécessaire, il n'hésitera pas à réprimer et en même temps, il attire la sympathie du public sur le ''gentil'', lequel, en bravant le premier, se donne des allures de ''héros''.
Mais, les affrontements entre Solidarité et le POUP ne sont pas uniquement du cinéma, comme n'est pas uniquement du cinéma l'opposition entre droite et gauche dans les pays occidentaux. En occident, cependant, le cadre institutionnel permet en général, de ''gérer'' ces oppositions afin qu'elles ne menacent pas la stabilité du régime et que les luttes pour le pouvoir soient contenues et se résolvent dans la formule la plus appropriée pour affronter l'ennemi prolétarien. Par contre, si en Pologne même, la classe dominante est parvenue, avec beaucoup d'improvisation, mais momentanément avec succès, à instaurer des mécanismes de ce style, rien ne dit qu'il s'agisse d'une formule définitive et exportables vers d'autres pays ''frères''. Les mêmes invectives qui servent à crédibiliser un partenaire-adversaire quand celui-ci est indispensable au maintien de l'ordre, peuvent accompagner son écrasement quand il n'est plus utile (celles relations entre fascisme et démocratie entre les deux guerres mondiales).
En la contraignant à un partage des tâches auquel la bourgeoisie d'Europe de l'Est est structurellement réfractaire, les luttes prolétariennes de Pologne ont créé une contradiction vivante. Il est encore trop tôt pour prévoir comment elle se résoudra. Face è une situation historiquement inédite (''une époque des jamais vus'' comme disait un leader de Solidarité, Gwiazda), la tâche des révolutionnaires est de se mettre modestement à 1’écoute des faits.
LES PERSPECTIVES
Prévoir dans le détail de quoi demain sera fait est une tâche qui échappe, comme on vient de le voir, à la compétence des révolutionnaires. Par contre, ils doivent être capables de dégager de l'expérience les perspectives plus générales du mouvement, d'identifier le prochain pas que devra accomplir le prolétariat sur son chemin vers la révolution. Et ce pas, nous l'avons défini dès le lendemain des luttes d'août 1980 dans le tract international diffusé par le CCI, ''Pologne: à l'Est conte à l'Ouest, une même lutte ouvrière contre l'exploitation capitaliste'' (6/9/82) : la généralisation mondiale des combats.
L'internationalisme est une des positions de base du programmer prolétarien si non la plus importante. Il est exprimé avec force par la devise de la Ligue des Communistes de 1847, ainsi que par l’hymne de la classe ouvrière. C'est la 1igne de partage entre courants prolétariens et courants bourgeois dans les 2ème et 3ème Internationales dégénérescences. Cette place privilégiée de 1'internationalisme n'est pas la traduction d'un principe général de fraternité humaine. Elle exprime une nécessité vitale de la lutte pratique du prolétariat. Dès 1847, Engels pouvait écrire : ''La révolution communiste ne sera pas une révolution purement nationale. Elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés . . .''( ''Principes du communisme'' ) .
Les événements de Pologne mettent en évidence combien était juste cette affirmation. Ils démontrent la nécessité d'une unité mondiale du prolétariat face à une bourgeoisie qui, de son côté, est capable d'agir de façon concertée et solidaire par dessus tous ses antagonismes impérialistes. Puisqu'elle est face à son ennemi mortel. En ce sens, on ne peut que dénoncer le mot d'ordre parfaitement absurde de la ''Communist Workers' organisation'' qui dans le n°4 de ''Workers'voice'' appelle les ouvriers polonais à la ''révolution maintenant ! '' . Dans cet article, la CWO prend soin de préciser que ''appeler à la révolution aujourd'hui: n'est pas de l'aventurisme propre à un simple d'esprit, tout en précisant que : ''Du fait que l'ennemi de classe a eu 12 mois pour se préparer à écraser la classe et que les ouvriers polonais n'ont pas encore créé une direction révolutionnaire consciente de l'enjeu de la situation, les chances de victoire apparais- sent très minces. Malgré son inconscience: la CWO se rend quand même compte que I'URSS ne laisserait pas impunément le prolétariat faire la révolution a ses portes, mais elle a trouvé la solution : ''Nous appelons les travailleurs de Pologne à prendre le chemin de la lutte armée contre l'Etat capitaliste et à fraterniser avec les travailleurs en uniforme qui seront envoyés pour les écraserai. Voila ! Il suffisait d'y penser : il n'y a qu'à '' fraterniser avec les soldats russes''. Il est sûr qu'une telle possibilité n'est pas à exclure : c'est une des raisons qui expliquent que l'URSS ne soit pas intervenue en Pologne pour mettre au pas le prolétariat. Mais de là à penser que le Pacte de Varsovie ne pourrait déjà plus trouver en son sein les moyens d'exercer une répression, c'est se faire d'incroyables illusions sur la maturité présente des conditions de la révolution dans toute l'Europe de l'Est et dans le monde entier. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : le prolétariat ne pourra faire la révolution dans un pays que si, partout ailleurs, il est déjà en marche. Et ce ne sont pas les quelques grèves qui ont pu se produire en tchécoslovaque, en Allemagne de l'Est, en Roumanie et même en URSS depuis août 1980 qui permettent de dire que la situation est mûre dans ces pays pour l'affrontement de classe généralisé.
Le prolétariat ne pourra faire la révolution ''par surprises''. Un tel bouleversement sera le résultat et le point culminant d'une vaque de luttes internationales dont nous n'avons vu jusqu'à présent qu'un tout petit début ; Toute tentative du prolétariat dans un pays donné de se lancer à l'assaut du pouvoir sans tenir compte du niveau des luttes dans les autres pays est condamnée à un échec sanglant. Et ceux, comme la CWO, qui appellent les prolétaires à se lancer dans de telles tentatives sont des imbéciles irresponsables.
L'internationalisation des luttes n'est pas seulement indispensable en tant qu'étape vers la révolution prolétarienne, comme moyen d'arrêter le bras meurtrier de la bourgeoisie face aux premières tentatives de prise du pouvoir par le prolétariat. Elle est une condition du dépassement par les prolétaires polonais et ceux des autres pays à des mystifications qui pèsent sur eux et conduisent à une paralysie de leur combat. En effet, si on examine les causes du succès présent des manœuvres de Solidarité, on constate qu'elles tiennent pour l'essentiel, à l'isolaient où se trouve encore le prolétariat en Pologne
Tant que le prolétariat des autres pays du bloc de l'Est, et notamment de Russie, n'aura pas engagé le combat, le chantage è l'intervention des '' frères'' pourra fonctionner, le nationalisme pays anti-russe et la religion qui va avec conserveront un poids.
Tant que les ouvriers d'occident n'auront pas développé les luttes contre ''leurs'' syndicats l'indépendants'' et ''leurs'' régimes ''démocratiques'' ceux de l'Est ne pourront combattre jusqu'au bout leurs illusions sur le ''syndicalisme libre'' et la ''démocratie'' Tant que la pratique même d'une lutte mondiale n'aura pas fait comprendre aux prolétaires qu'ils n'ont pas d’''économie nationale'' à défendrezà qu'il n'y a pas de possibilité d'améliorer la gestion de celle-ci dans le cadre d'un pays et des rapports de production capitalistes, les sacrifices au nom de l'''intérêt national'' pourront être acceptés, les mystifications sur l'''autogestion'' avoir un impact.
En Pologne, comme partout, le prochain pas qualitatif des luttes dépend de leur généralisation à l'échelle mondiale. C'est ce que les révolutionnaires doivent dire clairement a leur classe au lieu de présenter les luttes ouvrières de Pologne
Comme le résultat des conditions historiques particulières de ce pays. En ce sens, un article comme celui de ''Programme Communiste'' n'en qui remonte aux partages de 1773. 1792 et 1796 et à ''l'héroïsme de Kosciuszko'' pour expliquer les luttes présentes au lieu de les resituer dans le cadre de la reprise mondiale des combats de classe, un article qui fait du prolétariat polonais l'héritier héroïque de la bourgeoisie polonaise révolutionnaire du siècle dernier et brocards la bourgeoisie polonaise aujourd'hui pour sa soumission à la Russie, un tel article, malgré les phrases internationalistes qu'on peut y trouver, n'est pas fait pour contribuer à une prise de conscience de la classe ouvrière.
Plus que jamais il s'agit d'affirmer clairement comme nous le faisions en décembre 1980 : ''En Pologne, le problème ne peut être que posé, c'est au prolétariat mondial de le résoudre'' (Revue Internationale, n°24, p.7). Et c'est le capitalisme mondial lui-même qui, par la généralisation de son effondrement économique, est en train de créer les conditions de ce surgissement mondial de la lutte de classe.
FM 03/10/81
[1] [257] Bordiga, de fondateur de la gauche italienne réfutait l’analyse de la décadence du capitalisme: ce courant par contre, notamment avec ''Bilan'', s’est tenu ferme sur cette analyse jusqu’à la 2ème guerre.
Géographique:
- Pologne [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
Lutte de classe en Europe de l'est (1920-1970) : la nécessite de l'internationalisation des luttes
- 3668 reads
REVOLUTION ET CONTRE-REVOLUTION
Ce n'est pas un hasard si la contre-révolution qui s'est abattue contre les soulèvements de l'après première guerre et qui devait maintenir son étreinte sinistre jusqu'à la fin des années 60 prit sa forme la plus vicieuse précisément dans les pays où la résistance prolétarienne avait été la plus forte : en Russie, en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne et dans tous les pays frontaliers, de la Finlande à la Yougoslavie. Les ouvriers vivant entre l'Oural et le Rhin furent les premiers et les plus déterminés dans la révolte contre le massacre impérialiste de 14-18, et contre les souffrances endurées par leur classe à cause d'un capitalisme historiquement en faillite. C'est pourquoi ils sont devenus la principale cible d'une bourgeoisie mondiale momentanément unie contre un ennemi commun. La bourgeoisie des pays de l'ouest victorieux armèrent et renforcèrent les gouvernements et les gangs armés dans toute cette zone d'autant plus qu'ils attaquent plus violemment les ouvriers. Ils ont même envoyé leurs propres armées pour tenter d'occuper l'URSS, les Balkans, la Ruhr, etc., se battant entre eux pour le butin mais toujours unis contre la résistance prolétarienne.
Déjà en 1919, après la chute de la république des soviets, la terreur blanche régnait ouvertement en Hongrie. De Budapest en 1919 à Sofia ou Cracovie en 1923, tous les soulèvements révolutionnaires furent écrasés et les jeunes partis communistes dramatiquement affaiblis, souvent à la limite de l'extermination physique. Ceci fut par exemple le cas pour la Yougoslavie, où des centaines et des milliers de militants communistes furent tués ou emprisonnés.
LA CONTRE-REVOLUTION NATIONALISTE
Ainsi, alors que la défaite de la classe ouvrière dans les pays avancés de l'ouest devait être complétée par la mobilisation idéologique pour la guerre des Etats "démocratiques" dans les années 30, l'écrasement du prolétariat à l'Est devint très vite un anéantissement physique. Mais ce ne furent pas tant les machines de guerre et les chambres de torture de la terreur d'Etat qui brisèrent l'échiné du prolétariat dans ces années fatales de l'après guerre, que le poids du NATIONALISME dans les pays de l'Est et celui de la SOCIAL-DEMOCRATIE en Allemagne et en Autriche. La création d'une mosaïque d'Etats nationaux en Europe de l'Est à la fin de la 1ère guerre mondiale remplit le rôle immédiatement contre-révolutionnaire de dresser une barrière nationale entre le prolétariat russe et la classe ouvrière allemande. C'est pourquoi les communistes polonais, déjà en 1917, étaient opposés à l'indépendance nationale pour la bourgeoisie polonaise que proclamaient les bolcheviks en URSS. Continuant le combat contre le nationalisme polonais, en lien surtout avec Rosa Luxembourg, ils déclaraient effectivement la guerre aux sociaux-démocrates polonais, à cette pourriture chauvine, dont nous retrouverons plus tard un dernier héritier avec le KOR. Les bolcheviks avaient raison d'insister sur les droits culturels et linguistiques des ouvriers et des opprimés des minorités nationales et d'insister sur ce droit surtout en Europe de l'Est. Mais ils auraient dû savoir que ces "droits" ne seraient jamais respectés par la bourgeoisie! En effet, le jeune Etat polonais de l'après guerre, par exemple, a commencé immédiatement à établir une discrimination insidieuse contre les lithuaniens, les russes blancs et autres minorités culturelles existant à l'intérieur de ses frontières. Mais par dessus tout, les bolcheviks eurent tort de fixer aux ouvriers le but de défendre ou de créer des ETATS NATIONAUX, ce qui ne peut être qu'un moyen de se soumettre à la direction politique de la bourgeoisie, et ceci à une époque où la révolution prolétarienne destruction de tous les Etats nationaux était historiquement à l'ordre du jour.
Quand l'armée rouge a essayé de prendre Varsovie en 1920, les ouvriers polonais se sont ralliés derrière leur bourgeoisie, repoussant l'offensive. Ceci montre l'impossibilité d'étendre la révolution prolétarienne militairement. Ceci montre aussi la force de l'idéologie nationaliste dans les pays où l'Etat national vient juste d'être crée, et où l'exploitation s'est toujours accomplie avec l'assistance pesante de parasites étrangers, de telle sorte que les parasites autochtones peuvent se donner plus facilement une image populaire. Le nationalisme, qui dans ce siècle a toujours signifié une sentence de mort pour notre classe, a continué a peser sur la lutte de notre classe pour sa libération dans les pays de l'Est, et il pèse encore aujourd'hui.
L'UNITE DU PROLETARIAT DE L'EST A L'OUEST
Le fait que la révolution prolétarienne tant attendue ait éclaté en Europe de l'Est et non dans les cœurs de la puissance industrielle, causa une grande confusion chez les révolutionnaires de l'époque. Ainsi les bolcheviks par exemple voyaient les événements de février 1917 comme une révolution bourgeoise dans une certaine mesure, et même par la suite existaient dans le parti, certaines positions voyant des tâches bourgeoises à accomplir dans la révolution prolétarienne. Mais s'il était juste de considérer que l'Europe de l'Est était le maillon faible de la chaine de l'impérialisme, qui de plus manquait de tradition démocratique bourgeoise, de syndicats établis et d'une social-démocratie forte, il n'était pas moins vrai que ce jeune prolétariat numériquement faible, était très combatif.
Dans l'immédiat après-guerre, la préoccupation du mouvement prolétarien était d'étendre la vague révolutionnaire vers l'ouest, vers les centres industriels du capitalisme. A cette époque, comme aujourd'hui, la tâche centrale du prolétariat international ne pouvait être que de construire un pont au dessus du fossé qui séparait l'est et l'ouest, fossé creusé par la division de l'Europe en nations victorieuses et nations vaincues, division due à la loi de la guerre. A cette époque, comme aujourd'hui où toute la bourgeoisie entretient le mensonge qu'il y aurait deux systèmes différents à l'Est et à l'Ouest, les révolutionnaires avaient à combattre bec et ongles contre l'idée qu'il y ait quelque chose de fondamentalement différent dans les conditions ou les buts de la lutte des ouvriers de l'est ou de l'ouest. Ce combat était nécessaire, par exemple, contre les mensonges de la social-démocratie allemande, selon laquelle la domination de classe était spécialement brutale et totalitaire à l'Est, mensonges destinés à justifier le support du SPD à son gouvernement dans la guerre contre la Russie. Il était nécessaire d'insister sur le fait que cette brutalité particulière était conjoncturelle, et que les démocraties de l'ouest sont tout autant sauvages et dictatoriales en réalité. Cette guerre politique menée par les communistes contre ceux qui défendaient l'impérialisme démocratique, contre ceux qui versaient des larmes de crocodile sur le massacre d'ouvriers dans la lointaine Finlande ou la Hongrie pendant qu'ils tuaient tranquillement les prolétaires en Allemagne, cette guerre doit être encore menée aujourd'hui contre les social-démocrates, les staliniens, les gauchistes. De tous temps, la tâche des communistes est de défendre l'unité fondamentale de la lutte internationale du prolétariat; de montrer que le rideau de fer ne doit pas être une barrière empêchant la lutte collective des ouvriers du monde entier. Aujourd'hui, comme pendant la vague révolutionnaire, les tâches du mouvement sont les mêmes partout. Aujourd'hui comme hier; l'Europe de l'Est est le maillon faible de l'impérialisme mondial, et les ouvriers de ces pays peuvent pendant un temps devenir l'avant-garde du prolétariat mondial. Comme en 1917, quand les ouvriers du monde avaient à suivre l'exemple de leurs frères de classe russes aujourd'hui ils ont à tirer des leçons de la lutte de classe en Pologne. Mais ils doivent aller au delà de cet exemple, comme l'Internationale Communiste l'avait compris, et devenir à leur tour une source d'inspiration et de clarification pour les ouvriers de l'Est.
L'HERITAGE DE LA CONTRE REVOLUTION
La terreur ouverte qui s'abattit sur l'Europe de l'Est et du centre dans les années 20 et les années 30, associée à jamais à des noms comme Noske, Morthy, Pilsduski, Hitler, Staline, a fini par éliminer presque physiquement la social-démocratie aussi, lorsque les besoins des différents capitaux nationaux changèrent radicalement dans une région où la classe ouvrière avait été lourdement vaincue et dominée par l'Allemagne et la Russie. Mais cela ne pouvait en rien aboutir à l'affaiblissement des ILLUSIONS sociale-démocrates au sein de la classe, qui ne peuvent être dépassées qu'à travers l'expérience de la lutte de classe. PRECISEMENT PARCE QUE le capitalisme décadent a pris si vite la forme d'une dictature ouverte dans ces pays, se passant de raffinements tels que le cirque parlementaire ou les "syndicats indépendants", le leurre de ces organes, qui, autrefois, dans la jeunesse du capitalisme, ont fait avancer les positions de la classe, devient de plus en plus évident avec l'avancée de la contre-révolution. Ni le fascisme, ni le stalinisme ne pouvaient effacer la nostalgie qu'avaient les ouvriers à l'Est pour des instruments qui, aujourd'hui, à l'ouest, sont le corps des forces anti-prolétariennes. L'héritage social-démocrate,1a, croyance en la possibilité de transformer la vie des ouvriers à l'intérieur du capitalisme, qui ne peut offrir aujourd'hui que misère et destruction, et l'héritage nationaliste de la période qui a suivi la1ère guerre mondiale sont aujourd'hui le cauchemar qui pèse sur la lutte pour un nouveau monde, et la freine, une époque où la base matérielle de ces illusions disparaît rapidement. Le coup le plus mortel que "la contre-révolution ait porté contre le mouvement ouvrier fut le renforcement de ces illusions.
Les ouvriers n'ont pas simplement subi passivement les défaites de 1930. Partout en Europe centrale et en Europe de l'Est, nous trouvons des exemples de batailles héroïques d'arrière-garde qui ne furent toutefois pas assez fortes pour changer le mouvement de la marée. Nous pourrions parler par exemple de la résistance acharnée des ouvriers chômeurs en Allemagne au début des années 30, ou de la vague massive de grèves sauvages et d'occupations qui a ébranlé la Pologne dans les années 30, mouvement ayant pour centre le bastion de Lodz. En Russie même, le prolétariat a continué à résister à la contre-révolution victorieuse jusque dans les années 30.
Mais ce furent réellement des tentatives désespérées d'auto-défense d'une classe qui n'était plus capable de développer une perspective propre. Le caractère de plus en plus désespéré de la situation avait déjà été mis en évidence par le soulèvement de Cronstadt en 1921, qui a essayé de restaurer le rôle central des Conseils Ouvriers en Russie. Le mouvement fut écrasé par le même parti bolchevik qui avait été quelques années auparavant l'avant-garde du prolétariat mondial mais désormais englouti dans l'Etat dit "ouvrier". La dégénérescence de toute l'Internationale Communiste face à la retraite mondiale et l'écrasement final des luttes révolutionnaires de la classe ouvrière, a ouvert la voie à un triomphe complet du stalinisme. Le stalinisme fut la forme la plus perverse que prit la contre-révolution bourgeoise, parce qu'il a détruit les organisations, enterré les acquis programmatiques du prolétariat DE L'INTERIEUR, transformant les partis d'avant-garde du COMINTERN en organisations défendant le capitalisme d'Etat et la terreur, et réprimant la classe au nom du "socialisme". Ainsi furent effacées toutes les traditions du mouvement ouvrier, d'abord en Russie et ensuite dans toute l'Europe de l'Est. Les noms de Marx et de Lénine, brandis par les staliniens pour travestir leur nature capitaliste, furent identifiés à l'exploitation aux yeux des ouvriers comme Siemens ou Krupp en Allemagne. En 1956, les ouvriers hongrois en révolte ont même entrepris de brûler ces "livres sacrés" du gouvernement dans les rues. Rien ne symbolisait mieux le triomphe du stalinisme.
LA RESISTANCE DES OUVRIERS DANS LA PERIODE D'APRES 1945
L'enterrement de la révolution d'octobre et de la révolution internationale, l'anéantissement du parti bolchevik et de l'Internationale Communiste de l'intérieur, la liquidation du pouvoir des conseils ouvriers : telles furent les principales conditions à remplir pour l'avènement de l'impérialisme "rouge" "soviétique". Rouge du sang des ouvriers et des révolutionnaires qu'il a massacrés, symbolisé par Staline le bourreau, qui était le digne successeur du tsarisme et de l'impérialisme international contre lequel Lénine avait déclaré une guerre civile en 1914.
Les nazis affichaient le slogan "liberté de travail" "le travail rend libre" sur les grilles d'Auschwitz. Mais ils gazaient leurs victimes. Dans la Russie stalinienne, de l'autre côté, les mots de national socialisme furent repris littéralement. Dans les camps de Sibérie, c'est par millions qu'ils étaient conduits à la mort. Trotski dans les années 30, oubliant les critères politiques de classe, oubliant les ouvriers, appela ce sinistre bastion de la contre-révolution un "Etat ouvrier dégénéré" à cause de la façon spécifique dont les exploiteurs organisaient leur économie. Ses disciples finirent par saluer les conquêtes de l'URSS en Europe de l'Est comme une extension des acquis d'octobre.
La fin de la guerre de 39-45 amena une explosion de combativité des ouvriers en Europe, non seulement en France et en Italie, mais aussi en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie. Mais les ouvriers n'étaient pas capables d'affronter le capitalisme comme une classe autonome, ou même de se défendre effectivement. Au contraire, la classe tout entière était aveuglée par 1'antifascisme et la fièvre patriotique, et les comités qu'elle a fait surgir à cette époque n'ont fait que servir de soutien à l'Etat antifasciste et à l'organisation de la reconstruction de l'économie sous la botte de Staline/Churchill/Roosevelt. A la fin de la guerre, il y eut des actes suicidaires de rébellion contre la terreur nazie d'Etat. Par exemple, les grèves à Lodz et dans d'autres villes de Pologne, les révoltes dans les ghettos juifs et dans les camps de concentration, résistance ouvrière armée -même en Allemagne- et des moments de mutinerie ou même de fraternisation chez les prolétaires en uniforme. Mais ces soubresauts de résistance, qui pendant un moment ont pu raviver les espoirs des quelques révolutionnaires qui restaient en Europe, de ceux qui n'avaient pas été supprimés par les Etats démocratiques, staliniens ou fascistes, restaient une exception. La seconde guerre mondiale fut en fait le sommet de la défaite la plus écrasante que le prolétariat ait jamais souffert. Il n'y a qu'à voir la barbarie sans précédent que fut le front de l'Est, où les classes ouvrières allemandes et russes furent lancées l'une contre l'autre dans un combat fratricide et sanglant qui fit presque 25 millions de morts.
LE SOULEVEMENT DE VARSOVIE
Sans espoir de perspective propre ; prolétariat pouvait être conduit à des actes de désespoir complet. Le meilleur exemple en fut le soulèvement de Varsovie qui a commencé en août 1944. L'insurrection fut déclarée par le "Conseil Polonais d'Unité Nationale", comprenant toutes les forces antiallemandes de la bourgeoisie, incluant le vieux général Pilsduski et le SP polonais, qui avaient à eux deux réprimé plus d'un mouvement des ouvriers. Bien que les staliniens furent forcés de participer pour ne pas perdre leur dernière influence sur les ouvriers et leur "place d'honneur" dans la bourgeoisie dans l'après-guerre, le soulèvement fut autant antirusse qu'antiallemand. C'était supposé être le dernier grand pas par lequel les polonais se "libéreraient eux-mêmes" et leur capitale, avant que Staline ne le fit. L'armée russe stationnait à 30 km de Varsovie. Les ouvriers polonais n'avaient besoin d'aucune aide. Ils avaient combattu la Gestapo pendant 63 jours, tenant tous les quartiers de la ville pendant de longues périodes. Les instigateurs bourgeois du mouvement, qui siégeaient à Londres, savaient très bien que la Gestapo ne quitterait pas la ville sans avoir détruit la résistance des ouvriers. Ce qu'ils voulaient en réalité, ce n'était pas une "libération polonaise de Varsovie"- ce qui n'a jamais été mis en question- mais plutôt un bain de sang qui scellerait l'honneur national et l'unité pour les années à venir. Et quand la Gestapo eut écrasé toute résistance, elle abandonna la ville à Staline, laissant un quart de million de morts derrière elle. Et l'armée soviétique qui 12 ans auparavant aurait été si rapide à entrer dans Budapest et à écraser les conseils ouvriers, attendit patiemment que ses amis fascistes eussent fini leur travail. Le Kremlin ne voulait pas avoir affaire à des ouvriers armés ou aux fractions populaires pro-occidental es de la bourgeoisie polonaise.
L'ETABLISSEMENT DU REGIME STALINIEN
Pour tempérer l'orage des dernières hostilités et de la démobilisation et pour ne pas aiguiser trop tôt les tensions inter-impérialistes entre les alliés victorieux, les staliniens ont réuni des gouvernements de front populaire dans les pays de l'Est à la fin de la guerre; des gouvernements qui comprenaient des sociaux-démocrates, des gouvernements de droite et même fascistes.
Du fait de la présence des armées staliniennes en Europe de l'Est, la mise en place d'un contrôle absolu de l'Etat par les staliniens ne fut pas un problème et s'imposa presque "organiquement" partout. En Tchécoslovaquie, quelques manifestations furent organisées par les PC avec l'aide de la police à Prague en 1948, manifestations qui s'inscrivirent dans les livres d'histoire staliniens comme héroïque insurrection tchécoslovaque? Seule la complète étatisation de l'économie et la fusion de l'Etat et des PC en Europe de l'Est pouvaient garantir le passage définitif des "démocraties populaires" sous l'influence russe; le principal problème auquel furent confrontés les nouveaux dirigeants fut l'établissement de régimes qui devaient avoir un certain soutien dans la population, particulièrement chez les ouvriers.
Dans l'Europe de l'Est de 1'entre-deux-guerres, les staliniens avaient été peu nombreux et isolés dans beaucoup de ces pays et même dans les endroits où ils étaient le plus influents comme en Tchécoslovaquie, en Allemagne, en Pologne, ils avaient eu à combattre sur un autre front les sociaux-démocrates.
Néanmoins, les staliniens en Europe de l'Est étaient en mesure de gagner certaines bases de soutien dans la société. Ils n'avaient pas imposé leur règne dès le début au travers de la terreur d'Etat, à la différence des régimes staliniens en URSS. En aucun endroit en dehors de la Russie les staliniens ne furent identifiés à des instruments directs de la contre-révolution jusqu'en 1945, les staliniens avaient toujours été un parti d'opposition, non un parti de gouvernement. Plus encore, le racisme acharné, le chauvinisme et 1'antifascisme de cette fraction du capital lui attira des bénéfices dans les débuts de son règne. Le stalinisme en Europe de l'Est bénéficia du fait qu'il venait au pouvoir au point le plus profond de la contre-révolution. Dès le début, il put utiliser l'anti-germanisme pour diviser la classe ouvrière, expulser des millions de paysans et d'ouvriers du bloc selon les théories raciales les plus "scientifiques". Plus de cent mille ex-occupants des camps de concentration de langue allemande, qui avaient résista à la terreur nazie, furent ainsi par exemple expulsés de Tchécoslovaquie. Mais même 1'anti-germanisme ne fut qu'un complément et n'a pu remplacer le déjà traditionnel antisémitisme de l'arsenal stalinien.
Après 1948, il y eut un accroissement des tensions impérialistes entre les blocs dominés par les américains et les russes, qui s'exprima principalement par une compétition accrue au niveau militaire. Mais, de plus à cette époque, la période de reconstruction d'après-guerre commençait à battre son plein. A l'Est et à l'Ouest, cela signifiait la même chose pour les ouvriers :
- de plus hauts niveaux d'exploitation, des salaires réels plus bas, un accroissement de la répression étatique, et une plus grande militarisation de la société. Ce processus contribua à un renforcement de l'unité au sein de chaque bloc, qui dans le camp russe ne pouvait être accompli que par des méthodes terroristes : voir les procès anti-titistes..
Vu la faiblesse économique relative du bloc de l'Est, les attaques contre le niveau de vie ouvrier dans le camp russe devaient être plus brutales qu'à l'Ouest. La répression étatique amorça une nouvel-la escalade pour étouffer l'agitation sociale.
LES LUTTES DE 1953
En 1953, la résistance prolétarienne surgit ouvertement pour la première fois depuis la guerre. En l'espace de deux mois, trois éclats de lutte de classe ébranlèrent la confiance en soi de la bourgeoisie. Au début de juin, des émeutes à Pilsen, en Tchécoslovaquie, durent être écrasées par l'armée. Dans le vaste camp de travail de Vorkuta en Russie, un demi-million de prisonniers se révoltèrent, conduits par mille mineurs, déclarant la grève générale. Et en Allemagne de l'ouest, il y eut le 17 juin une révolte ouvrière qui paralysa les forces nationales de répression, et dut être écrasée par les tanks russes.
Le jour où les ouvriers d'Allemagne de l'Est se soulevèrent, des manifestations et des émeutes se produisirent dans sept villes polonaises. La loi martiale fut promulguée à Varsovie, à Cracovie et en Silésie, et les tanks russes durent participer pour réprimer les désordres. Presqu'au même moment également, les premières grandes grèves depuis les années 40 surgirent en Hongrie dans les grands centres du fer et de l'acier Matyas Rakosi de Csepel à Budapest. Les grèves s'étendirent à beaucoup de centres industriels de Hongrie, et des manifestations de masse paysannes eurent lieu dans la grande plaine hongroise ([1] [258]).
Le 16 juin, des ouvriers du bâtiment à Berlin Est posèrent leurs outils, marchèrent sur les immeubles gouvernementaux et commencèrent à appeler à une grève générale contre l'accroissement des normes de production et l'abaissement des salaires réels. 24 heures plus tard, la plupart des centres industriels du pays étaient paralysés. Des comités de grève spontanément créés, coordonnant leurs luttes au niveau de villes entières organisèrent l'extension de la grève. Les bâtiments de l'Etat et du Parti furent attaqués, les prisonniers relâchés, la police était combattue partout où elle apparaissait. POUR LA PREMIERE FOIS MEME, LA TENTATIVE FUT FAITE D'ETENDRE LA LUTTE AU DELA DES FRONTIERES DES BLOCS IMPERIALISTES. A Berlin, les manifestants marchèrent vers le secteur ouest de la ville, appelant à une solidarité des ouvriers de l'Ouest. Les alliés occidentaux, qui auraient certainement préféré que le mur de Berlin ait déjà été construit à cette époque, durent fermer leur secteur pour éviter la généralisation. ([2] [259])
La révolte en Allemagne de l'Est, soumise comme elle l'était à des illusions sur la démocratie occidentale, le nationalisme, etc...ne pouvait pas menacer le pouvoir de classe de la bourgeoisie. Mais elle a par contre, certainement affaibli la stabilité des régimes staliniens et l'efficacité de: la RDA comme remparts du bloc russe. Les événements de 1953 encouragèrent la bourgeoisie du bloc à prendre des initiatives :
- réduction de la terreur étatique permanente et ouverte contre le prolétariat, qui devenait trop dangereuse,
- diminution de l'emploi de la terreur intérieure dans le Parti comme méthode de résoudre les combats de factions. De cette façon, on espérait devenir plus souple pour traiter avec une situation sociale de plus en plus difficile,
- moins de terreur ouverte employée dans la production, méthode plus appropriée à la période de dépression mondiale et de guerre des années 30 et 40 qu'à la stabilité relative de la période de reconstruction d'après-guerre,
- déclaration de l'ouverture d'une période de 'coexistence pacifique" avec le bloc américain" dans l'espoir de bénéficier du boom d'après-guerre de 1'Ouest.
La mort curieusement propice de Staline permit à Kroutchev d'introduire l'initiative politique et économique dans cette direction. Mais 1953 sembla menacer l'exécution de ce changement de politique. La bourgeoisie craignait que ce changement lui-même puisse être interprété comme un signe de faiblesse, à la fois par les ouvriers et par ses "rivaux impérialistes occidentaux. En conséquence, le stalinisme suivit une course en zig-zag pendant 3 ans oscillant entre l'ancien style et le nouveau. En fait, l'expression classique d'une crise politique ouverte en Europe de l'Est n'est pas les purges et les procès massifs, qui ne font que révéler qu'une fraction a pris le dessus, mais ces oscillations hésitantes entre différentes fractions et orientations
LE SOULEVEMENT DE 1956
Attention ! Citoyens de Budapest ! Soyez sur vos gardes ! Presque dix millions de contre-révolutionnaires se sont répandus dans le pays. Dans les anciens quartiers aristocratiques comme Csepel et Kispest, plus de 10000 anciens propriétaires, capitalistes, généraux et évêques se sont retranchés. A cause des ravages de ces gangs, seuls six ouvriers sont restés en vie, et ils ont formé un gouvernement sous la présidence de Janos Kadar." (Affiche sur un mur de Budapest, novembre 1956
En 1956, la lutte de classe éclata en Pologne et en Hongrie. Le 28 juin, une grève quasi insurrectionnelle éclata à Poznam, en Pologne, et dut être réprimée par l'armée. Cet événement, qui était le point culminant d'une série de grèves sporadiques en Pologne -centrées en Silésie et sur la côte Baltique- accéléra la venue au pouvoir de la fraction "réformiste" conduite par Gomulka, nationaliste ([3] [260]), acharné. Gomulka comprit l'importance de 1'anti stalinisme et de la démagogie nationaliste dans une situation dangereuse. Mais le Kremlin craignait que son nationalisme extrême n'encourage la croissance de tendances antistaliniennes organisées en Pologne, et il s'opposa aux plans de Gomulka qui voulait isoler le prolétariat en faisant des concessions à la paysannerie sur la question de la collectivisation. Mais malgré la désapprobation des russes qui allèrent jusqu'à menacer d'une invasion militaire, Gomulka était convaincu de son rôle messianique de sauveur du capital polonais face à un surgissement prolétarien. En fait, il savait qu'afficher leur opposition à Moscou ne pouvait que raffermir la popularité légèrement entamée des staliniens en Pologne. Il ordonna donc à l'armée polonaise de bloquer les frontières avec la Russie et menaça même d'armer les ouvriers de Varsovie dans l'éventualité d'une invasion. Mais contrairement à ce que disent encore par exemple les trotskistes aujourd'hui,- c'est à dire que Gomulka a-vait menacé les russes d'un soulèvement populaire-ce que faisait alors le stalinisme polonais n'était qu'essayer d'AVERTIR ses amis du Kremlin du DANGER d’un tel soulèvement.
Kroutchev savait très bien que la Pologne, coincée comme elle est entre la Russie et ses avant-postes militaires en Allemagne, ne pouvait pas s'allier avec le bloc américain, qu'elle soit gouvernée par Gomulka ou par un autre. Les russes furent ainsi persuadés de céder, et ce "triomphe national" ajouta de l'auréole aux mensonges qui faisaient vivre les partisans de Gomulka. Bien que la bourgeoisie polonaise ait de façon évidente réussi à empêcher des explosions plus fortes, la situation est restée critique. Le 22 octobre il y eut de violents affrontements entre les ouvriers et la police à Wroclaw. Un jour plus tard, il y eut des manifestations orageuses à Gdansk, et des grèves éclatèrent dans différents endroits du pays, y compris dans le secteur clé de l'automobile Zeran à Varsovie.
Le même jour, le 23 octobre, une manifestation appelée par des groupes d'étudiants staliniens oppositionnels à Budapest en Hongrie, en solidarité avec la Pologne, attira des centaines de milliers de gens. La manifestation était comprise comme une manifestation de soutien à Gomulka, et non aux ouvriers qui étaient en grève contre le gouvernement. Son but immédiat était de mettre au pouvoir l'aile "réformiste" de la bourgeoisie hongroise, conduite par Nagy. La manifestation finit par de violents affrontements entre de jeunes ouvriers et la police politique aidée par des unités de tanks russes. Les batailles de rue firent rage toute la nuit. Les ouvriers avaient commencé à s'armer. ([4] [261])
Quand les premières dramatiques nouvelles des évènements de Budapest arrivèrent à Varsovie, Gomulka était en train de tenir un meeting d'un quart de million de gens. Il avertit les ouvriers polonais qu'il ne fallait pas "se mêler des affaires hongroises". La principale tâche de l'heure était de "défendre les acquis de l'octobre polonais", et de s'assurer qu'aucune dissension ne déchire plus la patrie.
24 heures après les premiers affrontements à Budapest, un gouvernement "progressiste" conduit par Nagy était instauré, et appela immédiatement à la restauration de l'ordre avec la collaboration étroite et constante des généraux russes. Le soir du même jour, la révolte s'était développée jusqu'à un niveau insurrectionnel. 2 jours après, le pays tout entier était paralysé par une grève de masse de plus de 4 millions d'ouvriers. L'extension de la grève de masse, la diffusion des nouvelles et le maintien des services essentiels avaient été pris en charge par les conseils ouvriers. Ces derniers avaient surgi partout, élus dans les usines et responsables devant les assemblées. Pendant des jours, ces conseils assuraient la centralisation de la grève. En une quinzaine de jours, cette centralisation était établie dans l'ensemble du pays.
Les régimes du bloc de l'Est sont rigides comme des cadavres, insensibles aux besoins changeants de la situation. Mais quand ils voient leur existence directement menacée, ils deviennent remarquablement souples et ingénieux. Quelques jours après le début de la lutte, le gouvernement Nagy arrêta de dénoncer ces résistances et essaya même d'en prendre la tête, pour éviter une confrontation directe avec l'Etat. On annonça que les conseils ouvriers seraient reconnus et légalisés. Puisqu'il n'était pas possible de les écraser, il fallait les étrangler par la bureaucratie, en les intégrant à l'Etat capitaliste. Et on promit le retrait des forces armées russes.
Pendant 5 jours, les divisions de l'armée russe, durement touchées, se retirèrent. Mais pendant ces 5 jours, la position politique des staliniens hongrois empira dangereusement. La fraction de Nagy, qui avait été présenté comme le "sauveur de la nation", après seulement UNE SEMAINE au pouvoir, était en train de perdre rapidement la confiance de la classe ouvrière. Maintenant avec le temps qui passait, elle n'avait plus d'autre alternative que de se faire le faux porte-parole du mouvement, utilisant à plein toutes les mystifications bourgeoises qui pouvaient empêcher la révolte de devenir une révolution. Les illusions démocratiques et surtout nationalistes des ouvriers devaient être renforcées, pendant que le gouvernement essaierait d'arracher la direction du mouvement aux conseils ouvriers qui le tenaient en main. Pour cela, Nagy déclara la neutralité de la Hongrie, et son intention de retirer sa participation à l'alliance militaire du Pacte de Varsovie. C'était un pari désespéré, une tentative de faire un nouveau Gomulka mais dans des circonstances beaucoup plus défavorables. Et il échoua. D'un côté, parce que Moscou n'était pas prêt à retirer ses troupes d'un pays en bordure du bloc de l'Est. D'un autre côté, parce que les conseils ouvriers bien qu'en majeure partie sous l'emprise du mouvement de Nagy ne voulaient pas perdre le contrôle de leurs propres luttes.
Ce qui était décisif pour le sort de la révolte prolétarienne en Hongrie alors, c'était l'évolution de la situation en Pologne. Des manifestations de solidarité avec la Hongrie avaient encore lieu dans de nombreuses villes. Un meeting de masse en solidarité fut tenu à Varsovie. Mais, fondamentalement, les Gomulkistes avaient le contrôle de la situation. L'identification des ouvriers polonais avec "la patrie" était encore forte. Une lutte internationale des ouvriers polonais et de leurs frères de classe hongrois n'était pas encore à l'ordre du jour.
Avec Gomulka et le poison nationaliste qui assuraient l'ordre en Pologne, les forces armées russes avaient une main libre pour s'occuper du prolétariat hongrois. 5 jours après avoir quitté Budapest, l'armée soviétique revint pour écraser les soviets ouvriers. Ils rasèrent les quartiers ouvriers, tuant 30.000 personnes selon les estimations. Mais malgré cette occupation, la grève de masse continua pendant des semaines, et ceux qui défendaient la position de l'arrêt de la grève dans les conseils étaient révoqués. Et même après que la grave de masse fut terminée, des actes de résistance continuèrent à se produire régulièrement jusqu'en janvier 1957. En Pologne, les ouvriers manifestèrent à Varsovie et s'affrontèrent à la police à Bydgoscz et Wroclaw, et essayèrent de saccager le consulat de Russie à Szczecin. Mais les ouvriers en Pologne n'avaient pas identifié leurs PROPRES exploiteurs aux massacreurs du prolétariat hongrois. Et même en Hongrie, les conseils ouvriers continuèrent, jusqu'à leur dissolution, à négocier avec Kadar et ne voulaient pas croire que lui et son mouvement avaient collaboré avec le Kremlin à écraser la classe ouvrière.
1956 : QUELQUES CONCLUSIONS
Les grèves de 1953-56 dans les pays de l'Est n'inauguraient pas un surgissement de la lutte de classe au niveau mondial, ou même une nouvelle période de résistance de la part des ouvriers des pays de l'Est eux-mêmes. Elles représentaient plutôt le dernier grand combat du prolétariat mondial prisonnier de l'étau de la contre-révolution. Et pourtant, dans l'histoire du mouvement de libération du prolétariat, elles étaient d'une grande importance. Elles affirmaient le caractère révolutionnaire de la classe ouvrière, et montraient clairement que les revers qu'essuyait la classe ouvrière dans le monde entier n'étaient pas éternels. En tant que telles, elles annonçaient déjà la venue d'une remontée de la lutte prolétarienne, qui arriva plus de 10 ans plus tard. Elles commençaient à montrer le chemin pour un second assaut contre le capitalisme, qui aujourd'hui pour la première fois depuis la fin de la 1ère guerre mondiale, entre en mouvement, lentement mais sûrement. Les luttes de 1956 ont prouvé :
- que la bourgeoisie ne peut pas garder éternellement le prolétariat sous son contrôle, une fois qu'elle a commencé à perdre son contrôle IDEOLOGIQUE,
- que la classe ouvrière, loin d'avoir besoin de "syndicats indépendants" et de "droits démocratiques" pour mener sa lutte, développe sa résistance et s'affronte à l'Etat capitaliste d'autant plus tôt que ces organes de la bourgeoisie sont plus absents ou inefficaces,
- que les organes de masse de la lutte prolétarienne, les conseils ouvriers, et les assemblées et les comités d'ouvriers en lutte qui les précèdent, sont la seule forme d'organisation des ouvriers possible clans la période de décadence du capitalisme,
- plus encore, 1953-56 prouva que les buts et les méthodes de la lutte des ouvriers sont aujourd'hui les mêmes partout. La notion d'une différence entre l'Est et l'Ouest ne peut sa baser que sur :
-soit un mensonge contre-révolutionnaire des staliniens et des trotskistes pour soutenir le "socialisme" ou "l'Etat ouvrier" dans le bloc russe
-soit une légende occidentale selon laquelle il y aurait un "monde libre" en conflit avec un "monde totalitaire"
-soit une conception bordiguiste sur l'existence d'un "jeune capitalisme" dans la Russie stalinienne et dans les pays de l'Est après la guerre, qui achèverait les tâches de la révolution bourgeoise
-soit la tendance, très forte dans les premiers temps dans le KAPD, et clairement formulée par Gorter dans sa "Réponse au camarade Lénine" à diviser l'Europe en Est et Ouest suivant une ligne
- disons de Gdansk à Venise! - et à croire que les ouvriers à l'ouest de cette ligne sont plus capables de s'organiser de façon autonome qu'à l'Est.
Tout cela est faux! Il n'y a PAS DE DIFFERENCE QUALITATIVE entre l'Est et l'Ouest. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation à l'Est est un exemple extrême, sous beaucoup d'aspects, des conditions générales du capitalisme décadent partout dans le monde. Les manifestations et l'évolution différentes de la MEME lutte de classe, que nous devons analyser, nous montre que la lutte de classe dans le bloc russe est EN AVANCE sous certains aspects et en RETARD sous d'autres aspects par rapport à l'ouest. Et cela prouve seulement Ta nécessite que l'ensemble de la classe tire les leçons de ses luttes où qu'elles aient lieu.
Il est vital que les ouvriers et les révolutionnaires de l'ouest tirent les leçons de la façon dont leurs frères de classe à l'Est AFFRONTENT IMMEDIATEMENT ET SOUVENT VIOLEMMENT L'ETAT PAR LA GREVE DE MASSE, ETENDANT LEUR MOUVEMENT A AUTANT D'OUVRIERS QU'IL EST POSSIBLE, et faisant de cette généralisation la préoccupation la plus pressante de tout le combat. Cette nature particulièrement explosive de la lutte de classe à l'Est est le résultat de plusieurs circonstances :
- Le manque d'amortisseurs, comme les syndicats "indépendants", de partis politiques d'"alternative", de procédures légales et "démocratiques", qui pourraient détourner les heurts directs avec l'Etat
- Du fait que les ouvriers de l'Europe de l'Est ont de façon plus évidente le même employeur -l'Etat- la mystification des ouvriers ayant des intérêts différents selon l'entreprise, l'industrie, la ville etc., a beaucoup moins de poids. Plus encore, l'Etat est l'ennemi immédiat de tout mouvement de classe ; même les plus simples revendications de salaire prennent plus vite une nature politique. Il est d'une évidence claire que l'Etat est l'ennemi collectif de tous les ouvriers.
- La menace omniprésente de la répression étatique ne laisse aux ouvriers AUCUNE ALTERNATIVE AUTRE que d'étendre leur lutte, s'ils ne veulent pas être massacrés.
Ces conditions existent aussi à l'Ouest, mais sous une forme moins aiguë. Mais l'important est de voir comment la généralisation de la crise économique mondiale ne pourra qu'accentuer inévitablement ces conditions à l'ouest. Ainsi, la crise internationale du capitalisme est en train aujourd'hui de jeter les bases d'une résistance internationale demain. Elle ouvre déjà la perspective de l'internationalisation des luttes.
En fait il n'y a rien de plus naturel pour les ouvriers, qui ont partout les mêmes intérêts à défendre, que d'unir leurs forces et de lutter comme une seule classe. C'est la bourgeoisie divisée en d'innombrables capitaux nationaux au sein desquels existent d'aussi innombrables factions, qui a besoin d'ordre dans l'Etat capitaliste pour défendre ses intérêts de classe communs. Mais dans la période où le capitalisme se désagrège, l'Etat n'a pas seulement à maintenir par la force le tissu social et: économique, mais il doit aussi s'organiser en permanence pour éviter l'unification de la classe ouvrière. Il renforce la division du prolétariat en différentes nations, industries, régions, blocs impérialistes etc., de toute sa puissance, travestissant le fait que ces divisions représentent des conflits d'intérêts à l'intérieur du camp des exploiteurs. C'est pour cela que l'Etat entretient si soigneusement ces armes, du nationalisme aux syndicats, qui empêchent l'unification du prolétariat.
Les limites des luttes ouvrières des années 50 étaient en dernière instance déterminées par la période de contre-révolution dans laquelle elles se situaient, même si ces limites ont pu être quelquefois dépassées, ici et là. En Pologne, et même en Hongrie, le mouvement n'est jamais au-delà d'une tentative de faire pression sur le parti stalinien ou d'en soutenir une fraction contre une autre. En Allemagne de l'Est en 1953, les illusions démocratiques et nationalistes sont restées intactes s'exprimant dans les sympathies des ouvriers pour "l'ouest" et la social-démocratie allemande. Tous ces surgissements furent dominés par le nationalisme, et par l'idée que ce n'est pas le capitalisme qui est à blâmer mais "les russes". En dernière analyse, alors que les Gomulka et Nagy s'étaient trop exposés, le nationalisme restait la seule protection de l'Etat, détournant la colère ouvrière vers l'Armée russe coupable de tout. C'étaient des mouvements ouvriers, pas des mouvements nationalistes, et c'est pour ça que le nationalisme les a détruits. Il empêcha l'extension de la lutte au delà des frontières, et ceci fut décisif. En 1917, il fut possible au prolétariat de prendre le pouvoir- en Russie- alors que la lutte de classe restait souterraine dans la grande majorité des autres pays. Cela était du au fait que la bourgeoisie mondiale était enfermée dans le conflit mortel de la 1ère guerre mondiale, et les ouvriers de Petrograd et de Moscou purent entreprendrai le renversement de la bourgeoisie russe, seuls. Mais déjà en 1919, alors que la vague révolutionnaire commençait à s'étendre à d'autres pays, la bourgeoisie commença à s'unir contre elle. Aujourd'hui comme en 1919 et en 1956, les exploiteurs sont unis à travers le monde entier contre le prolétariat. En même temps qu'ils se préparent à la guerre les uns contre les autres, ils se viennent mutuellement en aide lorsque leur système comme un tout est mis en danger.
En novembre 1956 le prolétariat hongrois était confronté à la réalité que MEME LE RENFORCEMENT DU MOUVEMENT DES CONSEILS, LE MAINTIEN D'UN SOLIDE FRONT DE GREVE COMPRENANT DES MILLIONS D'OUVRIERS, PARALYSANT L'ECONOMIE, ET LA COMBATIVITE INTACTE DE LA CLASSE MALGRE LA POIGNE DE L'OCCUPATION MILITAIRE RUSSE RESTAIENT INSUFFISANTS. La classe ouvrière hongroise, avec son cœur de lion, RESTAIT DESEMPAREE, PRISONNIERE DES FRONTIERES NATIONALES, DE LA PRISON NATIONALISTE;
Ce fut l'isolement national, et non les panzers de l'impérialisme moderne, qui les a vaincus. Quand la bourgeoisie sent que son règne est en danger, elle ne se préoccupe plus guère de l'état de son économie, et elle aurait pu se préparer à une grève totale pendant des mois et des mois, si elle pensait qu'elle pourrait de cette façon briser son adversaire. Ce fut précisément l'idéologie nationaliste, cette ordure ingurgitée et revomie par les ouvriers sur les "droits du peuple hongrois", cette pourriture dont les a gavés le parti stalinien, mais aussi la BBC et Radio Free Europe, qui a épargné au parti stalinien et à l'Etat capitaliste d'être malmenés sévèrement. Malgré toute la puissance de leur mouvement, les ouvriers hongrois n'ont pas réussi à détruire l'Etat ou une de ses institutions. Pendant qu'ils s'attaquaient à la police politique hongroise et aux tanks russes, dans les premiers jours de la révolte, Nagy était en train de réorganiser la police régulière et les forces armées, dont certaines unités l'avaient rejoint, lui et sa croisade nationaliste. Certains conseils ouvriers semblent avoir pensé que ces unités avaient rejoint les rangs du prolétariat mais en fait ils ne faisaient que faire semblant de faire cause commune avec les ouvriers à condition qu'ils servent les intérêts nationaux. 48 heures après que Nagy ait restructuré la police et l'armée, elles étaient déjà envoyées contre des groupes intransigeants d'ouvriers insurgés! Les conseils ouvriers, fascinés par le tambour patriotique, ont même voulu participer au recrutement d'officiers pour cette armée. Voilà comment le nationalisme sert à attacher le prolétariat à ses exploiteurs et à l'Etat.
L'extension de la lutte de la classe ouvrière au delà des frontières nationales est aujourd'hui une PRE-CONDITION absolue pour renverser l'Etat dans n'importe quel pays. La valeur des luttes des années 50 a été de montrer à quel point elle était indispensable. Seule la lutte internationale peut aujourd'hui être efficace et permettre au prolétariat d'accomplir ses réelles potentialités.
Comme le montre 1956, avec la généralisation de la crise et la simultanéité de la lutte de classe dans différents pays, une autre clé de l'internationalisation du combat prolétarien est la prise de conscience de la part des ouvriers qu'ils s'affrontent A UN ENNEMI UNI A L'ECHELLE MONDIALE. En Hongrie, les ouvriers chassèrent les troupes, la police et les douaniers des régions frontalières, pour rendre possible une aide de l'extérieur. Les bourgeoisies russes, tchèques et autrichiennes réagirent en fermant les frontières autour de la, Hongrie avec leurs armées.
Les autorités autrichiennes invitèrent même les russes à inspecter le bon déroulement de l'opération. ([5] [262]) Face au front uni de la bourgeoisie mondiale, à l'Est et à l'Ouest, les ouvriers commencèrent à briser la prison nationale et à lancer des appels à leurs frères de classe des autres pays. Les conseils ouvriers dans plusieurs zones frontalières commencèrent à en appeler directement au soutien des ouvriers en Russie, en Tchécoslovaquie et en Autriche, et la proclamation des conseils ouvriers de Budapest à l'occasion des dernières 48 heures de grève générale des ouvriers en décembre, appelait des ouvriers du monde entier à des grèves de solidarité avec les luttes du prolétariat en Hongrie ([6] [263]).
Condamnée par la période de défaite mondiale pendant laquelle elle se produisit, la vague de l'Europe de l'Est et des années 50 fut isolée par la division du monde industriel en deux blocs impérialistes, dont l'un d'eux, le bloc américain, connaissait alors "l'euphorie" du boom de la reconstruction d'après-guerre. Les conditions objectives pour une internationalisation, surtout par delà les frontières des blocs -c'est à dire la généralisation de la crise et de la lutte de classe- n'existait pas à l'échelle mondiale, ce qui empêcha la rupture décisive avec le nationalisme en Europe de l'Est. Seul un combat ouvert des ouvriers dans différentes parties du monde pourra permettra de démontrer aux ouvriers du monde entier que ce n'est pas CE gouvernement ou CE syndicat mais toutes les parties et tous les syndicats qui défendent la barbarie capitaliste contre les ouvriers et qu'ils doivent être détruits. Aucune perspective fondamentale de la révolution prolétarienne ne peut être défendue autrement qu'à l'échelle mondiale.
LA FIN DE LA CONTRE REVOLUTION
LA LUTTE DE CLASSE EN RUSSIE
Dans cette étude de la lutte de classe en Europe de l'Est nous n'avons pas encore parlé de la Russie, le chef de file du bloc de l'Est. Comme partout dans le monde, les années 1948 ont vu en URSS une attaque frontale contre le niveau de vie ces exploités comme dans les pays satellites, cette attaque a provoqué une réaction décidée des ouvriers. Mais si nous parlons de la Russie séparément c'est à cause de certaines conditions spécifiques qui jouent dans la situation du pays :
- le niveau de vie des ouvriers et des paysans en URSS est beaucoup plus bas que dans les autres pays de l'Est, surtout quand on tient compte de la Russie asiatique ;
- la bourgeoisie en URSS exerce un contrôle sur tous les aspects de la vie à un degré inimaginable dans d'autres pays de l'Est, même en RDA
- le stalinisme en Russie ne jouit d'aucune confiance de la part de la classe ouvrière ; il n'y a jamais eu des Nagy et des Gomulka pour induire les ouvriers en erreur.
Mais la force des illusions que les ouvriers peuvent nourrir à l'égard de leurs oppresseurs -et en Russie c'est très peu- n'est qu'un des éléments qui déterminent le rapport de forces entre les classes. Un autre élément, et de taille, est la capacité du prolétariat à développer une perspective propre, une alternative de classe. Pour les ouvriers de la Russie stalinienne cette tâche est plus difficile qu'elle n'a jamais été dans toute l'histoire du mouvement ouvrier. On doit ajouter à cette situation la profondeur de la contre-révolution en Russie et aussi les énormes distances qui séparent les centres ouvriers, d'une part en URSS les uns des autres et, d'autre part des concentrations ouvrières de l'Europe occidentale. Cet isolement géographique est exacerbé politiquement et militairement par 1'Etat.
Au début des années 50 ce prolétariat russe qui trente années auparavant avait ébranlé le monde capitaliste commence à reprendre le chemin de sa lutte. Les premiers épisodes de résistance ont eu lieu dans les camps de concentration en Sibérie: à Ekibadus en 1951; dans toute une série de camps -Pestscharij, Wochruschewo, Oserlag, Goxlag, Norilsk- en 1952; a Retschlag-Vorkuta en juil-letl953 et à Kengir et Kazakstan en 1954. Ces grèves insurrectionnelles, touchant des millions d'ouvriers, ont été férocement réprimées par le KGB. Soljenitsyne, un des hommes le mieux documenté sur les camps staliniens, insiste sur le fait que ces luttes n'ont pas été vaines et qu'elles ont contribué à des fermetures de ces institutions du "réalisme socialiste".
La première grève des ouvriers "libres" que nous connaissons dans la période d'après -guerre concerne l'usine Thalmans de Voroneschen en 1959. Cette grève a gagné le soutien de l'ensemble de la ville ; elle s'est terminée avec l'arrestation de tous les grévistes par le KGB. L'année d'après; dans un chantier à Ternir-Tau au Kazakstan une grève violente a éclaté pour protester contre les "privilèges" dont jouissent les ouvriers bulgares. Ce conflit, où les ouvriers se sont divisés les uns contre les autres, a crée un terrain favorable à la répression du KGB. Ce dernier a rempli des camions entiers de cadavres.
Dans les années 1960-62 une série de grèves éclate dans la métallurgie du Kasaskstan et dans la région minière de Dombass et le Kouzbass. Le point culminant de cette vague est atteint à Novotschkesk où une grève de 20.000 ouvriers de l'usine de locomotives contre l'augmentation des prix et des cadences provoque une révolte de toute la ville. Le KGB est envoyé par avion après que la police et les unités de l'armée locales aient refusé de tirer sur les ouvriers. Le KGB fit un massacre ; ensuite il renvoya tous les "meneurs" en Sibérie et fusilla les troupes qui avaient refusé de tirer. C'était la première fois que les ouvriers répondaient par la violence de classe au KGB : ils tentèrent de prendre les casernes et les armes. Un des slogans de cette grève était : "tuer Kroutchev".
Dans les années 1965-69 de grandes grèves éclatent pour la première fois dans les CENTRES urbains de la Russie européenne, dans l'industrie chimique à Leningrad, dans la métallurgie et l'automobile à Moscou. A la fin des années 60 on a beaucoup de témoignages de grèves dans plusieurs endroits en URSS : à Kiev, dans la région de Sverdlovsk, en Moldavie, etc..
La bourgeoisie russe, consciente du danger d'une généralisation des grèves, réagit toujours immédiatement à de tels événements. En quelques HEURES elle fait des concessions ou elle envoie le KGB ou les deux à la fois. L'histoire de la lutte de classe en Russie dans les années 50-60 est une série d'éclatements brusques, spontanés, violents ; souvent les grèves ne durent pas plus que quelques heures et n'arrivent pratiquement jamais à rompre l'isolement géographique. Dans toutes les grèves -et nous n'en mentionnons qu'un petit nombre ici- nous ne connaissons pas de formation de comités de grève bien qu'il y eut des assemblées de masse. Ces luttes d'un courage et d'une détermination incroyables témoignent aussi d'un élément de désespoir, d'un manque de perspective pour une lutte collective contre l'Etat. Mais le seul fait qu'elles aient surgi était le signe annonçant que la longue période de contre-révolution mondiale prenait fin. ([7] [264])
LA TCHECOSLOVAQUIE 1968
Un autre signe de la fin de la contre-révolution est le développement des luttes ouvrières en Tchécoslovaquie à la fin des années 60. La Tchécoslovaquie dans les années 40 et 50 avait l'économie la plus développée et prospère de toute l'Europe de l'Est. Elle était un moteur de la reconstruction d'après-guerre en exportant des capitaux à ses voisins ; elle avait le niveau de vie le plus élevé du Comecon. Mais elle commence à perdre sa compétitivité rapidement dans les années 60. Le meilleur moyen pour la bourgeoisie de contrecarrer cette tendance était de moderniser l'industrie à travers des accords commerciaux et technologiques avec l'occident, financés par une réduction des salaires réels. Mais le danger d'une telle politique apparut dès les années 50 et fut confirmé par l'éclatement de grèves dans différents endroits du pays dans la période 1966-67.
C'était cette situation de crise qui amena la fraction Dubcek de l'appareil du Parti-Etat au pouvoir. Cette fraction inaugura une politique de libéralisation dans l'espoir d'amener les ouvriers à accepter l'austérité; comme contrepartie les ouvriers avaient le "privilège" de lire des "mots durs" de critiques contre certains leaders dans la presse du parti. Le "printemps de Prague" en 1968, se déroulant sous l'œil paternel du gouvernement et de la police, défoulait le zèle nationaliste et régionaliste des étudiants, des intellectuels et des petits fonctionnaires du parti qui se sentaient tout fraichement solidaires avec l'Etat. Mais cette ferveur patriotique, rapprochée d'une réapparition des partis oppositionnels -le tout ayant pour unique but de faire croire à un stalinisme "à visage humain" et venant en même temps qu'une ouverture économique vers 1'occident est allé trop loin pour Moscou et Berlin/Est.
L'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie était plus une réaffirmation de l'unité militaire et politique du bloc russe qu'un coup porté directement contre le prolétariat. Dubcek, qui croyait avoir la situation bien en main et qui ne nourrissait aucune illusion sur la possibilité d'un détachement du bloc russe, était furieux contre cette invasion. Tout en utilisant cette occasion pour renforcer les sentiments nationalistes, Dubcek avait le souci d'éviter une réaction ouvrière à l'invasion. En réalité le "Dubcekisme" qui inspirait tant d'intellectuels avait très peu d'impact sur les ouvriers. Pendant le "printemps de Prague", toute une série de grèves sauvages surgirent un peu partout dans le pays surtout dans les secteurs industriels et dans les transports. Des comités de grèves se sont formés pour centraliser la lutte et pour protéger les grévistes contre la répression de l'Etat. Dans toutes les usines principales on a revendiqué des augmentations de salaire en compensation des années de pénurie. Dans plusieurs usines, les ouvriers ont voté des résolutions condamnant la pierre angulaire du "réformisme" à la Dubcek -la fermeture des usines non-rentables. Les ouvriers sont restés indifférents aux efforts de l'Etat pour former des "conseils ouvriers" de cogestion qui devaient mêler les ouvriers à l'organisation de leur propre exploitation. Quand les élections à ces "conseils" ont finalement eu lieu, moins de 20% des ouvriers ont participé au vote.
Cette réponse de classe au "Dubcekisme" a été brisée par 1'invasion d'août 1968 qui "enfin" commençait à ramener les ouvriers sous la bannière de l'hystérie nationaliste, La lutte de classe a aussi été brisée par une radicalisation importante des syndicats. Après avoir soutenu le programme d’austérité de Dubcek ils se sont mis dans l'opposition, soutenant les hommes de Dubcek qui restaient au gouvernement. (Ces derniers pour leur part, se sont attachés à rétablir l'ordre en collaboration avec les forces armées autochtones et "invitées"). Pendant que les étudiants et les oppositionnels appelaient les ouvriers à des manifestations de masse -des réaffirmations bien encadrées de patriotisme et de condamnations de la trahison de Dubcek (par rapport au capital national)- les syndicats menaçaient en même temps de déclencher des grèves générales si les Dubcekistes étaient éliminés du gouvernement. Mais le rôle historique de Dubcek s'est achevé, pour le moment en tout cas. Et quand les pontes de Dubcek ont tranquillement disparu du haut de l'appareil, les syndicats ont laissé tomber leurs projets "combatifs", ayant plus peur de "leurs" ouvriers, qui pouvaient échapper à leur contrôle, que des russes. Ils se sont adaptés à nouveau à des formes plus paisibles de patriotisme.
LA POLOGNE 1970
La lutte de classe des ouvriers tchèques au printemps et en été 1968 est significative non seulement de cette résistance momentanée des ouvriers face au barrage nationaliste et démocratique de la bourgeoisie (cette résistance a effectivement marque une brèche importante) mais surtout parce que cette lutte se situe dans le contexte d'un surgissement mondial de la lutte prolétarienne en réponse a la crise de l'économie mondiale à la fin de la période de reconstruction. Les ouvriers en Tchécoslovaquie ne sont pas allés aussi loin que leurs frères de classe en France au printemps 1968, surtout parce que le poids des mystifications nationalistes s'est montré une fois de plus, trop fort à l'Est. Mais il y a beaucoup de points communs entre les deux situations, ce qui confirme la CONVERGENCE fondamentale des conditions auxquelles se heurtent les ouvriers à l'Est et à 1"Ouest dans la crise du capitalisme ; par exemple :
- l'éclatement brusque et inattendu de la lutte de classe, prenant de court les syndicats qui se sont trouves dans des situations compromettante ; ébranlant la confiance des équipes gouvernemental les (Dubcek, de Gaulle) qui croyaient avoir la situation bien en main ;
- une réponse claire des ouvriers refusant de payer la crise capitaliste;
- le poids de l'idéologie oppositionnelle, véhiculée essentiellement par les étudiants, empêchant le développement de la conscience prolétarienne et l'autonomie de classe.
Mais l'affirmation la plus définitive et dramatique de la fin de la nuit de la contre-révolution vient avec la Pologne 1970-71.
En décembre 1970 la classe ouvrière polonaise réagit massivement, totalement, spontanément, à une hausse des prix de plus de 30%. Les ouvriers détruisent les sièges du parti stalinien à Gdansk, Gdynia et Elblag. Le mouvement de grève s'étend de la côte bal tique à Poznan, à Katowice, et à la Haute-Silésie, à Wroclav et à Cracovie. Le 17 décembre Gomulka envoie ses tanks dans les ports de la Baltique. Plusieurs centaines d'ouvriers sont tués. Des batailles de rue ont lieu à Stettin et à Gdansk. La répression ne réussit pas à écraser le mouvement. Le 21 décembre une vague de grèves éclate à Varsovie, Gomulka est renvoyé ; son successeur Gierek devait aller tout de suite négocier personnellement avec les ouvriers des docks de Warski à Stettin. Gierek fait quelques concessions mais refuse d'annuler les hausses de prix. Le 11 février une grève de masse éclate à Lodz, déclenchée par 10.000 ouvriers du textile. Gierek cède alors , les augmentations des prix sont annulées. ([8] [265])
LA GENERALISATION du mouvement à travers le pays a eu raison de la répression de l'Etat polonais. Mais pourquoi les forces du pacte de Varsovie ne sont-elles pas intervenues comme deux ans auparavant à Prague?
- Les luttes des ouvriers polonais se situent fermement sur le terrain des revendications ouvrières ; les ouvriers ont résisté aux attaques contre leur niveau de vie et n'ont pas appelé à un quelconque "renouvellement national". Les ouvriers ont compris que l'ennemi est autant dans leur propre pays et pas seulement en Russie.
- Il n'y avait pas d'appels à des forces démocratiques ni dans le PC polonais ni en Occident. Il y avait des ouvriers qui croyaient en la possibilité de "réconcilier" le parti et les ouvriers mais il n'y avait plus de fractions dans l'appareil qui jouissaient de la confiance des ouvriers et donc il n'y avait personne qui pouvait mystifier les ouvriers.
- Pour la première fois depuis la vague révolutionnaire de 1917-23, l'Europe de l'Est a connu une lutte de masse qui s’est GENERALISEE AU DELA DES FRONTIERES NATIONALES. Les événements polonais ont déclenché une vague de grèves et de protestations dans les républiques baltiques de l'URSS et dans la Russie occidentale, centrée sur les villes de Lvov et Kaliningrad.
Le surgissement polonais a été le produit de tout un processus de maturation dans la classe au cours des années 50 et 60. D'une part le prolétariat retrouve sa confiance en soi et sa combativité au fur et à mesure qu'une nouvelle génération d'ouvriers grandit avec les promesses d'après-guerre sur un monde meilleur, une génération qui n'est pas aigrie par les défaites amères de la période contre-révolutionnaire, qui n'est pas résignée à accepter la misère. D'autre part, ces années ont vu l'affaiblissement de toute une série de mystifications au sein de la classe'. Le poids de 1'antifascisme de la guerre et de la période d'après-guerre S'est beaucoup affaibli quand on s'est rendu compte que les "libérateurs" eux-mêmes ont employé des camps de concentration, la terreur policière et le racisme ouvert pour assurer leur domination de classe. Et l'illusion en une espèce de "socialisme" ou en l'abolition des classes dans le bloc russe était brisée par les informations sur l'incroyable richesse dans laquelle vit "la bourgeoisie rouge" et par la constante détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière. De plus, les ouvriers ont vite compris que la défense de leurs intérêts de classe les amènerait à des confrontations violentes avec "l'Etat ouvrier". Si la Hongrie en 1956 a montré la futilité de lutter dans une perspective nationaliste, les luttes de 1970-71 en Pologne et le nord-ouest de l'URSS ont montré la voie à suivre. Depuis la Hongrie en 56 et la Tchécoslovaquie en 68, l'idée qu'il y aurait des fractions radicales du parti stalinien qui se mettraient du côté des ouvriers a été largement discréditée. Aujourd'hui, dans les pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie; la Roumanie ou l'URSS, seuls des oppositionnels EN DEHORS du PC peuvent gagner l'oreille des ouvriers C'est vrai que les ouvriers ont encore des illusions à perdre à propos des oppositionnels mais au moins ils savent où ils en sont par rapport aux staliniens et c'est un pas énorme. Enfin l'accélération de la crise elle-même détruit les illusions sur la possibilité de "réformer" le système. La crise actuelle agit comme un catalyseur dans le processus de prise de conscience révolutionnaire du prolétariat.
L'affaiblissement de la mainmise de l'idéologie bourgeoise sur le prolétariat a permis le développement d'une AUTONOMIE ouvrière -et la Pologne 1970-71 en était le premier exemple- à un niveau beaucoup plus élevé que dans les années 50. L'autonomie ouvrière n'est jamais une question purement organisationnelle bien que l'organisation indépendante de la classe dans ses assemblées de masse et comités de grève soient absolument indispensables à la lutte prolétarienne. L'autonomie est aussi indissolublement liée à L'ORIENTATION POLITIQUE que les ouvriers se donnent. Dans la période de totalitarisme du capitalisme d'Etat, la bourgeoisie réussira inévitablement à infiltrer les organes de lutte des ouvriers en utilisant ses fractions syndicales et radicales. Mais c'est précisément pourquoi les organes de masse, regroupant les ouvriers indépendamment des autres classes dans la société, sont si vitaux. Avec ces organes autonomes la lutte idéologique continuelle entre les deux classes se poursuit sur un terrain favorable à la classe ouvrière. Voilà le monde de la lutte collective, de la participation massive de tous les ouvriers.
C'est le chemin qu'ont suivi les ouvriers en 1970 en Pologne et sur lequel ils sont restés depuis. Ce n'est pas seulement le chemin de la lutte généralisée, de la grève de masse, mais c'est aussi la condition première pour la politisation de la guerre de classe, pour la création du parti de classe et pour la discussion dans l'ensemble de la classe, afin de se rendre capable de briser de fond en comble toute la structure de l'idéologie bourgeoise. En 1970-71 la base radicalisée du parti stalinien et des syndicats, même les fonctionnaires de l'Etat, pouvaient rentrer dans les comités de grève et assemblées pour y défendre le point de vue de la bourgeoisie. Et cependant, à la fin, c'est le prolétariat qui est sorti renforcé du conflit.
En 1970-71 a eu lieu la première lutte importante de la classe ouvrière en Europe de l'Est depuis la révolution d'Octobre, une lutte que la bourgeoisie n'est pas arrivé à canaliser ni à réprimer immédiatement. Cette brèche s'est produite dès que l'hégémonie de l'idéologie bourgeoise s'est affaiblie. L'Etat a reculé provisoirement parce que sa tentative d'écraser son ennemi a échoué. La violence étatique et le contrôle idéologique ne sont pas deux méthodes alternantes que la bourgeoisie peut utiliser séparément l'une de l'autre. La répression ne peut être efficace que si elle est renforcée par le contrôle idéologique qui empêche les ouvriers de se défendre ou de riposter. La lutte de classe en Pologne, déjà en 1970 a montré que la classe ouvrière n'a pas été intimidée par l'Etat terroriste si elle est consciente de ses propres intérêts de classe et si elle s'organise de façon autonome et unie pour les défendre. Cette autonomie politique et organisationnelle est le facteur le plus important favorisant la généralisation et la politisation de la lutte. Cette perspective révolutionnaire, le développement parmi tous les ouvriers du monde entier de la compréhension de la nécessité d'une lutte unie et internationale contre une bourgeoisie prête à s'unir contre le danger prolétarien, voilà la seule perspective que les communistes peuvent offrir à leurs frères de classe à l'Est et à l'Ouest.
Krespel
[1] [266] Ces événements sont décrits par Lomax dans "The working class in the Hungarian Révolution", Critique n°l2
[2] [267] Voir la Revue Internationale du CCI, n°15 "L'insurrection ouvrière en Allemagne de l'Est de juin 1953"
[3] [268] Voir F.Lewis "The Polish Volcano", N.Bethell "Gomulka".
[4] [269] Sur la Hongrie 1956, voir par exemple : "Pologne-Hongrie 1956" (JJ Maireand) "Nagy" (P.Broué) ; Laski "Hungarian révolution" pour documentation, les proclamations des Conseils Ouvriers, etc. Voir aussi A.Andersen "Hungary 1956" (Solidarity London), ou Goszotony "Der Ungarische Volksaufstand in Augen zeugenberichten". Dans la presse du CCI, "Hungary 1956 : The Sceptre of the Workers Councils", dans World Révolution n°9
[5] [270] "Le gouvernement autrichien ordonna la création d'une zone Interdite le long de la frontière austro- hongroise Le ministre de la Défense Inspecta la zone, accompagné des attachés militaires des quatre grandes puissances, y inclus l'URSS. Les attachés militaires pouvaient ainsi constater par eux-mêmes 1'efficacité des mesures prises pour protéger la sécurité des frontières autrichiennes et de la neutralité." Tiré d'un mémorandum du gouvernement autrichien, cité dans "Die Ungarische Révolution der Arbeiterràte", p.83-84.
[6] [271] Reportage du Daily Mail, 10 décembre 1956
[7] [272] cf. par exemple : "Arbeiteropposition in der Sowjetunion'.' A. Schwendtke (Hrg) ; "Workers Against the Goulag"; "Politische Opposition in der Sowjetunion 1960-72"
Sakarov "Die URSS ist ein grosses Konzentrationslager"; Soljénitsyne. "L'archipel du Goulag";
T. Cliff. "State capitalism in Russia". Dans la presse du CCI : "La lutte de classe en URSS" (Révolution Internationale n°30 et 31); (World Révolution n°10).
[8] [273] cf. Paul Barton."Misère et révolte de l'ouvrier polonais";
"Pologne : Le crépuscule des Bureaucrates", Cahiers Rouges n°3
"Rote Fahnen Polen" (Minutes of the Debate between Gierek and the Workers on the Warski Docks in Szczecin).
La meilleure source : "Capitalisme et luttes de classe en Pologne 1970-71". ICO
La presse du CCI : voir Révolution Internationale n°80 : "Pologne. De 1970 à 1980. Un renforcement de la classe ouvrière".
Géographique:
- Europe [274]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [112]
Heritage de la Gauche Communiste:
Notes sur la grève de masse
- 3011 reads
La vague da grèves de l'été 80 en Pologne a été très justement décrite comme un exemple classique du phénomène de la grève de masse analysé par Rosa Luxemburg en 1906. Une telle clarté de corrélation entre les mouvements récents en Pologne et les évasements décrits par Luxemburg dans sa brochure ''Grève de masse, partis et syndicats''([1] [275]) il y a 75 ans, impose aux révolutionnaires de réaffirmer pleinement la validité de l'analyse de Luxemburg applicable à la lutte de classe aujourd'hui.
Pour poursuivre dans ce sens, nous essaierons dans cet article de voir jusqu'à quel point la théorie de Luxemburg correspond à la réalité des combats actuels de la classe ouvrière.
LES CONDITIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES DE LA GREVE DE MASSE.
Pour Rosa Luxemburg, la grève de masse était le résultat d'une étape particulière dans le développement du capitalisme, étape observable au tournant de ce siècle. La grève de masse ''est un phénomène historique se produisant à un certain moment par une nécessité historique sortant des conditions sociales''. La grève de masse n'est pas une chose accidentelle; elle ne résulte pas plus de la propagande que de préparatifs qui seraient faits d'avance; elle ne peut être créée artificiellement; elle est le produit d'une étape définie de l'évolution des contradictions du capitalisme. Bien que Rosa Luxemburg se réfère souvent à des grèves de masse particulières, tout le sens de sa brochure est pour montrer qu'une grève de masse ne peut pas être vue isolément; elle ne prend son sens que comme produit d'une nouvelle période historique.
Cette nouvelle période était valable pour tous les pays. En argumentant contre l'idée que la grève de masse était particulière à l'absolutisme russe, Luxemburg montre que ses causes doivent être trouvées non seulement dans les conditions de la Russie mais aussi dans les circonstances de l'Europe occidentale et de l'Afrique du Nord, c'est à dire ''dans l'industrie à grande échelle avec toutes ses conséquences, divisions de classe modernes, contrastes sociaux aigus''. Pour elle, la révolution russe de 1905, dans laquelle la grève de masse a tenu une place si importante, ne s'est concrétisée que "... dans les affaires particulières de la Russie absolutiste: résultats généraux du développement capitaliste international''. La révolution russe était, selon Luxemburg, le "prélude d'une nouvelle série de révolutions prolétariennes à l'Ouest".
Les conditions économiques qui ont engendré la grève de masse, selon Luxemburg, n'étaient pas circonscrites à un pays, mais avaient une signification internationale. Ces conditions avaient fait surgir un type de lutte aux dimensions historiques, une lutte qui était un aspect essentiel du surgissement des révolutions prolétariennes. Pour conclure, selon les propres termes de Rosa Luxemburg, la grève de masse ''n'est rien d’autre que la forme universelle de la lutte de classe prolétarienne résultant de l'étape actuelle du développement capitaliste et de ses rapports production''.
Cette ''étape actuelle'' était le fait que le capitalisme vivait ses dernières années de prospérité. La croissance des conflits inter-impérialistes et la menace de la guerre mondiale: la fin de toute amélioration graduelle des conditions de vie de la classe ouvrières en bref, la menace croissante contre l'existence même de la classe ouvrière dans le capitalisme, telles étaient les circonstances historiques nouvelles accompagnant l'avènement de la grève de masse.
Luxemburg a vu clairement que la grève de masse était un produit du changement des conditions économiques à un niveau historique, conditions que nous savons aujourd'hui être celles de la fin de l'ascendance capitaliste, conditions qui préfiguraient celles de la décadence capitaliste.
Des concentrations puissantes d’ouvriers existaient alors dans les pays capitalistes avances, habitués à la lutte collective, dont les conditions de vie et de travail étaient partout semblables. La bourgeoisie, comme conséquence du développement économique, devenait une classe plus concentrées et s'identifiait de manière croissante avec l'appareil d'Etat. Comme le prolétariat, les capitalistes avaient appris à faire face ensemble contre leur ennemi de classe.
Tout comme les conditions économiques rendaient plus difficiles pour les ouvriers l'obtention de réformes au niveau de la production, de même. les ''ruines de la démocratie bourgeoise'' que Luxemburg mentionne dans sa brochure, rendaient de plus en plus difficile pour le prolétariat la consolidation des gains au niveau parlementaire. Ainsi, le contexte politique, tout comme le contexte économique de la grève de masse n'était pas le contexte de l'absolutisme russe mais celui de la décadence croissante de la domination bourgeoise dans tous les pays.
Dans chaque domaine économique, social et politique, le capitalisme avait jeté les bases pour des énormes affrontements de classe è l'échelle mondiale.
LE BUT DE LA GREVE DE MASSE
La grève de masse n'a pas exprimé un nouveau bu de la lutte prolétarienne. Elle a exprimé plutôt le ''vieux'' but de cette lutte d'une manière appropriée aux nouvelles conditions historiques. La motivation derrière chaque combat de la classe ouvrière sera toujours la même : la tentative de limiter l'exploitation capitaliste au sein de la société bourgeoise et d'abolir l'exploitation en même temps que la société bourgeoise elle-même. Dans la période ascendante du capitalisme, la lutte ouvrière était, pour des raisons historiques, séparée entre un aspect défensif, immédiat, impliquant mais repoussant l'offensive révolutionnaire pour le futur.
Mais la grève de masse de par les causes objectives déjà mentionnées (liée l'impossibilité pour la classe de se défendre elle-même au sein du système) a rassemblé dans la lutte ces deux aspects du combat prolétarien. C'est pourquoi, selon Luxemburg, n'importe quelle petite grève apparemment défensive peut exploser en confrontations généralisées, ''au contact du souffle de la révolution''. Par exemple, ''le conflit des deux ouvriers renvoyés des chantiers de Poutilov s'est transformé en prologue de la plus grosse révolution des temps modernes''. Réciproquement, le surgissement révolutionnaire, lorsqu'il marque le pas peut se disperser en de nombreuses grèves isolées, qui, plus tard, fertiliseront un nouvel assaut général contre le système.
Tout comme les combats offensifs, les luttes généralisées ont fusionné avec les combats localisés, défensifs, faisant ainsi réagir l'un sur l'autre les aspects économiques et politiques de la lutte ouvrière dans la perfide de grève de masse. Dans la période parlementaire (c'est à tire, à l'apogée de l'ascendance capitaliste) les aspects économiques et politiques de la lutte étaient séparés artificiellement, une fois encore pour des raisons historiques déterminées. La lutte politique n'était pas dirigée par les masses elles-mêmes dans l'action directe, mais en correspondance avec la forme de l'Etat bourgeois, de manière représentative par la présence de députés. Mais, ''dès que les masses apparaissent sur la scène'' tout ceci change, parce que ''dans une action révolutionnaire de masses la lutte politique et économique forme une unité''. Dans ces conditions, la lutte politique des ouvriers devient intimement liée à la lutte économique, en particulier du fait que le combat politique indirect, (par l'intermédiaire du parlement) n'est plus réaliste.
En décrivant le contenu de la grève de masse, Luxemburg met en garde, par dessus tout, contre la séparation de ses différents aspects. Ceci parce que la caractéristique de la période de la grève de masse est la convergence des différentes facettes d'une lutte prolétarienne: offensive/défensive, généralisée/localisée, politique/économique -le mouvement dans son ensemble menant à la révolution-. La véritable nature des conditions auxquelles le prolétariat répond dans la grève de masse crée une interconnexion indissociable entre les différents aspects de la lutte de la classe ouvrière. Vouloir les disséquer, vouloir trouver par exemple ''la brève de masse politique pureté, mènerait par cette direction, ''comme pour toute autre, non pas à percevoir le phénomène dans son essence, mais à la tuer''.
LA FORME DE LA LUTTE DANS LA PERIODE DE LA GREVE DE MASSE
L'objectif de la forme d'organisation syndicale -obtenir des acquis au sein de système- est de moins en moins réalisable dans les conditions qui font surgir la grève de masse. Comme le dirait Luxemburg dans sa polémique avec Kautsky, dans cette période, le prolétariat n'entrait pas en lutte avec la perspective certaine de gagner de véritables acquis. Elle montre statistiquement qu'un quart des grèves n'obtenaient absolument rien, Mais les ouvriers se mettaient en grève parce qu’il n’y avait pas d'autres moyens de survivre; une situation qui ouvrait inévitablement à son tour la possibilité d'une lutte offensive généralisée. Par conséquent, les acquis du combat n'étaient pas tellement une amélioration économique graduelle, mais la croissance intellectuelle, culturelle du prolétariat malgré les défaites au niveau économique. C'est pourquoi, Rosa Luxemburg dit que la phase insurrection ouverte ''ne peut venir d'aucune autre voie que l’école de séries de défaites en apparences''.
En d'autres termes: la victoire réelle ou la défaite de la grève de masse ne sont pas déterminées par aucun de ses épisodes mais par son point de culmination, le soulèvement révolutionnaire lui-même.
Ainsi, il n'était pas accidentel que les réalisations économiques et politiques des ouvriers en Russie, obtenues par l'orage révolutionnaire de 1905 et avants, aient été ré arrachées après la défaite de la révolution.
Le rôle des syndicats, gagner des acquis économiques au sien du système capitaliste, était donc éclipsé. Il y a d'autres implications révolutionnaires qui découlent de l'ébranlement des syndicats par la grève de masse :
1) la grève de masse ne pouvait pas être propagée d'avance, elle a surgi sans plan du style ''méthode de mouvement de la masse prolétarienne. Les syndicats, dédiés à une organisation permanente préoccupés par leurs comptes en banque et leurs lestes d’adhésions ne pouvaient même pas espérer être à la hauteur de l'organisation des grèves de masse, forme qui a évolué dans et par la lutte elle-même.
2) Les syndicats ont divisé les ouvriers et leurs intérêts entre toutes les différentes branches de l'industrie alors que la grève de masse ''a fusionné à partir des différents points particuliers, de différentes causes'', et ainsi a tendu à éliminer toutes les divisions dans le prolétariat.
3) Les syndicats n'organisaient aucune minorité de la classe ouvrière alors que la grève de masse a rassemblé toutes les couches de la classe syndiqués et non syndiqués.
Plus les nouvelles formes de luttes s’imposaient à celles propres aux syndicats plus les syndicats eux-mêmes n’appuyaient l'ordre capitaliste contre la grève de masse. L'opposition des syndicats à la grève de masse s'est exprimée de deux manières selon Rosa Luxemburg. L'une était l'hostilité directe des bureaucrates tels que Bomelberg accentuée en plus par le refus du Congrès des syndicats à Cologne ne serait-ce que de discuter de la grève de masse. Le faire était, selon les bureaucrates ''jouer avec le feu''. L’autre forme de cette opposition était le soutien apparent des syndicalistes radicaux et des syndicalistes français et italiens. Ils étaient beaucoup plus en faveur d'une ''tentative'' de grève de masse, comme si cette forme de lutte pouvait se plier aux quatre volontés de l'appareil syndical.
Mais ceux qui s'y opposaient comme ceux qui la soutenaient partageaient tous sur la grève de masse le point de vue qu'elle n'est pas un phénomène émergeant des profondeurs de l'activité de la classe ouvrière mais des moyens techniques de lutte décidés ou repoussés au gré de la volonté des syndicats. Inévitablement, les représentants des syndicats à tous les niveaux ne pouvaient pas comprendre un mouvement dont l'impulsion non seulement ne pouvait pas être contrôlée par eux mais exigeait de nouvelles formes antagoniques aux syndicats.
La réponse de l'aile radicale et de base des syndicats ou des syndicalistes à la grève de masse était sans aucun doute une tentative d'être à la hauteur des nécessités de la lutte de classe. Mais c’était la forme et la fonction du syndicalisme lui-même -quelle que soit la volonté de ses militants- qui était dépassé par la grève de masse.
Le syndicalisme radical exprimait une réponse prolétarienne au sein des syndicats. Mais après la trahison définitive des syndicats lors de la première guerre mondiale et de la vague révolutionnaire qui s'en est suivis le syndicalisme radical a aussi été récupéré et est devenue une arme de valeur pour émasculer la lutte de classe.
Nous ne disons pas que telle était la conception de Rosa Luxemburg dans sa brochure sur la grève de masse. Pour elle, la banqueroute de l'approche syndicaliste pouvait encore être corrigée et c'était compréhensible à l'époque, alors que les syndicats n'étaient pas encore devenus que les simples agents du capital qu'ils sont aujourd'hui. Le dernier chapitre de la brochure suggère que la subordination des syndicats à la direction du parti social-démocrate pourrait enrayer les tendances réactionnaires. Mais ces tendances étaient irrémédiables.
Luxemburg voyait aussi l'émergence en nombre de syndicats pendant les grèves de masse en Russie comme un résultat sain et naturel de la vague de luttes. Mais nous pouvons voir aujourd’hui, alors que seule l'auto-organisation peut développer de véritables luttes, que cette démarche compréhensible était la perpétuation d'une tradition qui a été rapidement dépassée. De plus, Luxemburg voit le Soviet de Petrograd de 1905 comme une organisation complémentaire des syndicats. En fait, l'histoire a prouvé que seuls ouvriers devaient exprimer l'époque des grèves de masse et des révolutions. Les syndicats étaient les organes de l'ère des luttes ouvrières défensives et localisées.
Ce n'est pas un hasard si le premier conseil ouvrier a surgi dans le sillage des grèves en Russie. Créés par et pour la lutte avec des délégués élus et révocables, ces organes pouvaient non seulement regrouper tous les ouvriers en lutte, mais pouvait centraliser tous les aspects du combat économique et politique, offensif et défensif, dans la vaque révolutionnaire. Ce fut le conseil ouvrier anticipant la structure et le but des futurs comités de grèves et assemblées générales qui était naturellement le plus conforme à la direction et aux buts du mouvement de grève de masse en Russie.
Même s'il était indispensable pour Rosa Luxemburg de tirer tontes les leçons pour l'action de la classe ouvrière dans la nouvelle période ouverte a tournant du siècle, les révolutionnaires aujourd’hui sont redevables de la compréhension des conséquences organisationnelles de la grève de masse. La plus importante est que la grève de masse et les syndicats sont, par essence, antagoniques, conséquence implicite quoique non explicite dans la brochure de Rosa Luxemburg.
Nous devons essayer de comprendre comment appliquer ou ne pas appliquer l'analyse de Rosa Luxemburg pour la période actuelle de la lutte de classe ; pour voir à quel degré la lutte prolétarienne en période de décadence du capitalisme, confirme ou contredit les lignes générales de la grève de masse telles qu'elle les a analysées.
LES CONDITIONS OBJECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE DANS LA PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME
La période depuis 1968 exprime le point culminant de la crise permanente du capitalisme, l'impossibilité d'expansion du système, l'accélération des antagonismes inter-impérialistes, dont les conséquences menacent toute la civilisation humaine.
Partout, l'Etat, avec l'extension terrible de son arsenal répressif, prend en charge les intérêts de la bourgeoisie. En face, il trouve une classe ouvrière qui, quoiqu’affaiblie en nombre par rapport au reste de la société depuis les années 1900, est encore plus concentrée, et dont les conditions d'existence ont été égalisées dans tous les pays à un degré sans précédent. Au niveau politique, la ''ruine de la démocratie bourgeoise'' est si évidente que sa véritable fonction l'écran de fumée de la terreur d'Etat capitaliste est à peine voilée.
De quelle manière les conditions objectives de lutte de classe actuelle correspondent aux conditions de la grève de masse décrites par Rosa Luxemburg ? Leur identité réside dans le fait que les caractéristiques de la période actuelle constituent le point le plus aigu atteint par les tendances à développement capitaliste, qui commençaient à prévaloir dans les années 1900.
Les grèves de masse des premières années de ce siècle étaient une réponse à la fin de l‘aire ascendance capitaliste et à l’aube des conditions de la décadence capitaliste.
Si on considère que ces conditions sont devenues absolument ouvertes et chroniques aujourd'hui, on peut penser que ce qui pousse objectivement vers la grève de masse est mille fois plus large et plus fort aujourd'hui qu'il y a 80 ans.
Les "résultats généraux du développement capitaliste international" qui, pour Luxemburg, étaient la racine de l'émergence du phénomène historique de la grève de masse, n'ont pas cessé de mûrir depuis le début du siècle. Aujourd'hui, ils sont plus évidents que jamais.
Bien sûr, les grèves de masse que Luxemburg a décrites ne se produisaient pas strictement dans la période de décadence capitaliste définie en général par les révolutionnaires. Nous savons que la date de 1914 marque un événement vital de l'entrée du capitalisme dans sa phase sénile pour les positions politiques qui en découlent, l'éclatement de la 1ère guerre mondiale a été la confirmation de l'impasse économique des dix années qui l'ont précédée. 1914 a été une preuve irréfutable que les conditions économiques, sociales et politiques de la décadence capitaliste, étaient désormais pleinement et réellement réunies.
Dans ce sens, les nouvelles conditions historiques qui ont fait surgir la grève de masse au premier plan sont encore présentes aujourd'hui. Sinon, il faudrait montrer comment les conditions qu'affronte l'infrastructure du capitalisme aujourd’hui sont différentes de celles qu'elles étaient il y a 80 ans. Ce qui serait difficile, parce que les conditions du monde en 1905 - exacerbation des contradictions inter impérialistes et développement de confrontations de classe généralisées - existent aujourd'hui plus que jamais ! La première décade du 20ème siècle n'était certainement pas l'apogée du capitalisme ! Le capitalisme était déjà dépassé et engagé vers le cycle de crise-guerre mondiale-reconstruction-crise : "...la révolution russe actuelle arrive à un point historique qui a déjà passé le sommet, qui est de l’autre coté du point culminant de la société capitaliste. Quelle perspicacité sur les phases d'ascendance et de déclin du capitalisme de la part de cette révolutionnaire en 1906 !
LA GREVE DE MASSE ET LA PERIODE DE REVOLUTION
La grève de masse est donc le résultat des circonstances du capitalisme en déclin. Mais, pour Luxemburg, les causes matérielles qui ont été en dernier ressort responsables de la grève de masse ne sont pas entièrement suffisantes pour expliquer pourquoi ce type de combat a surgi à ce moment. Pour elle, la grève de masse est le produit de la période révolutionnaire. La période de déclin ouvert du capitalisme doit coïncider avec le mouvement ascendant non battu de la classe, pour que la classe soit en état d'utiliser la crise comme un levier pour mettre en avant ses propres intérêts de classe à travers la grève de masse. Réciproquement, après des défaites décisives, les conditions de la décadence vont tendre à renforcer la passivité du prolétariat plutôt qu'à donner naissance à des grèves de masse.
Ceci permet d'expliquer pourquoi la période de grève de masse disparaît au milieu des années 1920 et n'a resurgi que récemment, dans la période actuelle depuis 1968.
La période actuelle mène-t-elle alors à une révolution comme dans les années 1896-1905 en Russie ? Oui sans aucun doute.
1968 a marqué la fin de la contre-révolution et ouvert une époque menant à des confrontations révolutionnaires, pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. On peut dire que, malgré le fait que 1968 a marqué la fin de l'ère de la défaite prolétarienne, nous ne sommes pas encore cependant dans une période révolutionnaire. Ceci est tout à fait juste si par "période révolutionnaire", nous entendons seulement la période de double pouvoir et d'insurrection armée. Mais Luxemburg entendait" période révolutionnaire" dans un sens beaucoup plus large. Pour elle, la révolution russe n'avait pas commencé à la date officielle du 22 janvier 1905 ; elle trace ses origines à partir de 1896 - neuf ans avant - l'année des grandes grèves de Saint-Pétersbourg. L'époque de l'insurrection ouverte de 1905 était pour Luxemburg le point culminant d'une longue période de révolution de la classe ouvrière russe.
En fait, c'est la seule manière d'interpréter de façon cohérente le concept de période révolutionnaire. Si une révolution est l'exercice du pouvoir par une classe aux dépends de l'ancienne classe dominante, alors, le renversement souterrain de l'ancien rapport de forces entre classes en faveur de la classe révolutionnaire est une part vitale de la période révolutionnaire au moment du combat ouvert, des heurts militaires, etc. Ceci ne veut pas dire que ces deux aspects de la période révolutionnaire soient exactement la même chose - 1896=1905 -, mais qu'on ne peut les diviser arbitrairement et séparer et opposer la phase d'insurrection ouverte et sa phase préparatoire.
En le faisant, on serait incapable d'expliquer pourquoi Luxemburg date le début du mouvement de grève de masse en Russie en 1896, ou pourquoi elle donne de nombreux exemples de grève de masse dans des pays où aucune insurrection ne s'est produite à l'époque.
Qui plus est, la fameuse affirmation de Luxemburg selon laquelle la grève de masse était "l'idée de ralliement" d'un mouvement qui devait "s'étendre sur des décades" serait incompréhensible si on ne voit que la période d'insurrection elle-même comme responsable des grèves de masse.
Bien sûr au moment du renversement de l'ancienne classe dominante, les grèves de masse atteindront leur plus haut développement, mais ceci ne contredit pas du tout le fait que la période de grèves de masse commence quand en premier lieu la perspective de la révolution est ouverte. Pour nous, ceci signifie que l'époque de grèves de masse d'aujourd'hui commence en 1968.
LA DYNAMIQUE DE LA LUTTE ACTUELLE
Nous avons déjà dit que le contenu fondamental de la lutte prolétarienne reste le même mais qu'il s'exprime différemment selon la période historique. La tendance des différents aspects de cette lutte à se fondre ensemble - la tentative de limiter l'exploitation et la tentative de l'abolir -dans des grèves de masse, qui est décrite par Luxemburg, est aujourd'hui poussée par les mêmes nécessités matérielles qu'il y a 80 ans. La nature caractéristique de la lutte des 12 dernières années (c'est-à-dire ce qui distingue la lutte depuis 1968 de la lutte pendant les 40 années précédentes) est l'interaction constante de la défensive et de l'offensive, l'oscillation entre confrontation économique et politique.
Il n'est pas nécessaire de faire intervenir une question de plan conscient de la classe ouvrière ; c'est le résultat du fait que la perspective de ne serait-ce que préserver son niveau de vie, devient de moins en moins possible aujourd'hui. C'est pour cette raison que toutes les grèves tendent à devenir une bataille pour la survie, des "grèves qui s'accroissent, toujours plus fréquentes, qui se terminent pour la plupart sans 'victoire définitive' aucune, mais qui, malgré cela ou à cause de cela, sont d'une plus grande signification comme explosions de contradictions intenses profondes qui surgissent sur le terrain politique" (Theory and Practice, Brochure News and Letters).
Ce sont les conditions de crise ouverte qui, comme dans les années 1900, mettent en avant la dynamique de la grève de masse et commencent à concentrer les différents aspects de la lutte de la classe ouvrière.
Mais peut-être qu'en décrivant la phase actuelle comme une période de grève de masse, nous faisons erreur. La plupart des luttes de ces 12 dernières années ne sont-elles pas appelées, menées et terminées par les syndicats ? Ceci ne signifie-t-il pas que les luttes actuelles sont syndicales, qu'elles sont motivées par des intérêts strictement défensif et économique qui n'ont pas de lien avec le phénomène de la grève de masse ? A côté du fait que les plus significatives des batailles de ces dernières années ont brisé l'encadrement syndical, une telle conclusion échouerait à prendre en compte une caractéristique de base de la lutte de classe en période de décadence du capitalisme : dans chaque grève qui apparaît contrôlée par les syndicats, il y a deux forces de classe en action. Dans toutes les grèves contrôlées par les syndicats aujourd'hui, c'est un combat réel même s'il est encore dissimulé qui se mène entre les ouvriers et leurs soi-disant représentants : les bureaucrates syndicaux de la bourgeoisie. Ainsi les ouvriers sous le capitalisme décadent ont une double malchance : non seulement leurs adversaires reconnus comme les patrons et les partis de droite sont leurs ennemis, mais leurs prétendus amis, les syndicats et tous ceux qui les soutiennent, le sont aussi.
Aujourd'hui, les ouvriers sont poussés par la crise et la confiance qu'ils prennent en eux-mêmes en tant que classe non vaincue, à se poser le problème des limitations de la pure défense économique et sectorielle imposées à leurs luttes. Les syndicats ont pour tâche de maintenir l'ordre dans la production et de terminer les grèves. Les organisations capitalistes tentent sans cesse de dévoyer les ouvriers dans les impasses du syndicalisme. La bataille entre les syndicats et le prolétariat, parfois ouverte, mais plus souvent encore cachée, n'est fondamentalement pas une conséquence de plans conscients des ouvriers ou des syndicats, mais un résultat de causes économiques objectives qui, en dernière analyse, les forcent à agir les uns contre les autres.
La force motrice de la lutte de classe actuelle ne doit donc pas être recherchée dans la profondeur des illusions des ouvriers dans les syndicats à un moment donné, ni dans les actions les plus radicales des syndicats pour coller à la lutte à un certain moment, mais dans la dynamique des intérêts de classe antagoniques des ouvriers et des syndicats.
Ce mécanisme interne de la période qui mène à des confrontations révolutionnaires, avec la force et la clarté grandissantes de l'intervention communiste, révèle aux ouvriers la nature de la lutte qu'ils ont déjà engagée, alors que la tentative des syndicats à la fois de mystifier les ouvriers et de défendre l'économie capitaliste de plus en plus en faillite, amènera les ouvriers à détruire en pratique ces organes de la bourgeoisie.
Il serait donc désastreux pour qui se prétend révolutionnaire de juger la dynamique de la lutte des ouvriers par son apparence syndicaliste, comme le font toutes les variantes de l'opinion bourgeoise. La pré condition pour mettre en lumière et clarifier les possibilités révolutionnaires de la lutte ouvrière est évidemment la reconnaissance que ces possibilités existent réellement. Il n'est pas accidentel que l'été polonais de 1980, le moment le plus haut dans la période actuelle des grèves de masse depuis 1968, a révélé clairement la contradiction entre la véritable force de la lutte des ouvriers et celle du syndicalisme.
La vague de grèves en Pologne a embrassé littéralement la masse de la classe ouvrière dans ce pays, touchant toutes les industries et les activités. De points dispersés et pour des causes différentes au départ, le mouvement s'est fondu, à travers les grèves de soutien et les actions de 'solidarité, en une grève générale contre l'Etat capitaliste. Les ouvriers ont commencé à tenter de se défendre eux-mêmes contre le rationnement et la hausse des prix. Face à un Etat brutal, intransigeant, et une économie nationale en faillite, le mouvement est passé à l'offensive et a développé des objectifs politiques. Les ouvriers ont rejeté les syndicats et créé leurs propres organisations : les assemblées générales et les comités de grève pour centraliser leur lutte, engageant l'énergie énorme de la masse prolétarienne. C'est un exemple incomparable de grève de masse.
Le fait que la revendication de syndicats libres est devenue prédominante dans les objectifs de la grève, le fait que les MKS (comités de grève inter-entreprises) se sont eux-mêmes dissout pour ouvrir la voie au nouveau syndicat Solidarité, ne peuvent cacher la véritable dynamique de millions d'ouvriers polonais qui ont fait trembler la classe dominante.
De façon historique, le point de départ pour l'activité révolutionnaire en 1981 est de reconnaître que la grève de masse en Pologne est annonciatrice de futures confrontations révolutionnaires, tout en reconnaissant les illusions immenses que les ouvriers ont encore dans le syndicalisme. aujourd'hui. Les événements de Pologne ont porté un coup cruel à la théorie que la lutte de classe de notre époque est syndicaliste, malgré les impressions qui découlent des apparences superficielles.
Mais si une théorie prétend que la lutte de classe est par nature une lutte trade-unioniste, même a ses moments les plus hauts, une autre théorie est que ces moments les plus hauts exprimés dans les grèves de masse, sont un phénomène exceptionnel, tout à fait distinct dans ses caractéristiques des épisodes moins dramatiques du combat de classe. Selon cette supposition, la plupart du temps, la lutte des ouvriers est simplement défensive et économiste et tombe ainsi organiquement sous l'égide des syndicats, alors que par ailleurs, en des occasions isolées comme en Pologne, les ouvriers passent à l'offensive, mettant en avant des revendications politiques, en reflétant un objectif qui serait différent. Outre son incohérence -impliquant que la lutte prolétarienne peut être syndicaliste (c'est à dire capitaliste), ou prolétarienne à différents moments- cette vision tombe dans le piège de la séparation entre les différents aspects de la grève de masse -offensive/défensive, économique/politique- et ainsi, comme le disait Luxemburg, sape l'essence vivante de la grève de masse et la vide de son contenu d'ensemble. Dans la période de grève de masse, toute lutte défensive, même modeste, contient le germe ou la possibilité d'un mouvement offensif, et toute lutte offensive est basée sur la nécessité constante de la classe de se défendre. L'interconnexion entre lutte économique et politique est identique.
Mais la vision qui sépare ces aspects interprète la grève de masse de manière isolée -comme une grève avec des masses de gens surgissant tout d'un coup- comme résultat fondamentalement de circonstances conjoncturelles, telles que la faiblesse des syndicats dans un pays donné, ou l'amélioration de telle ou telle économie. Cette vision ne voit la grève de masse que comme une offensive, une affaire politique, sous-estimant le fait que cet aspect de la grève de masse est nourri par les luttes défensives, localisées et économiques. Par dessus tout, ce point de vue ne voit pas que nous vivons dans une période de grève de masse aujourd'hui, provoquée non par des conditions locales ou temporaires, mais par la situation générale de la décadence capitaliste qui se retrouve dans chaque pays.
Cependant, le fait que quelques uns des exemples de grève de masse les plus significatifs ont eu lieu dans les pays arriérés et du bloc de l’Est, semble donner du crédit à l'idée de la nature exceptionnelle de ce type de luttes, tout comme l'apparition de la grève de masse en Russie dans les années 1900 semblait justifier la vision qu'on ne la verrait pas surgir en Occident. La réponse que Rosa Luxemburg a donné à l'idée de l'exclusivité russe de la grève de masse, est parfaitement valable encore pour aujourd'hui. Elle admettait que l'existence du parlementarisme et du syndicalisme à l'Ouest pouvait temporairement repousser l'impulsion vers la grève de masse, mais pas l'éliminer, parce que celle-ci a surgi des bases mêmes du développement capitaliste international. Si la grève de masse en Allemagne et ailleurs, a pris un caractère "caché et latent", plus qu'une qualité pratique et active comme en Russie, ceci ne peut cacher le fait que la grève de masse était un phénomène historique et international. Cet argument s'applique aujourd'hui à l'idée que la grève de masse ne peut surgir à l'Ouest. H est vrai que la Russie en 1905 a représenté un pas qualitatif énorme dans le développement de la lutte de classe tout comme la Pologne 1980 aujourd'hui. Mais il est vrai également que ces points forts, comme la Pologne, sont intimement liés aux manifestations "cachées et latentes" de la grève de masse à l'Ouest, parce qu'elle émerge des mêmes causes et s'affronte aux mêmes problèmes. Ainsi, même si le parlementarisme et les syndicats sophistiqués de l'Ouest peuvent étouffer ces tendances qui explosent en d'énormes grèves de masse comme en Pologne, ces tendances n'ont pas disparu. Au contraire, les grèves de masse ouvertes qui ont, jusqu'à présent été contenues à l'Ouest auront accumulé d'autant plus de forces lorsque les obstacles seront bousculés. En fin de compte, c'est l'échelle des contradictions du capitalisme qui déterminera l'ampleur de l'explosion des grèves de masse futures : "(...) plus l'antagonisme entre capital et travail est développé plus effectives et décisives devront être les grèves de masse". Plus que par une rupture brutale et complète avec les luttes économiques, défensives contenues par les syndicats, les bonds qualitatifs de la conscience, de l'auto-organisation de la grève de masse avanceront en une spirale accélérée de luttes ouvrières. Les phases cachées et latentes du combat, qui suivront souvent les confrontations ouvertes, comme cela s'est déroulé en Pologne, continueront à fertiliser les explosions futures. Le mouvement d'oscillations d'avances et de reculs, d'offensive et de défensive, de dispersion et de généralisation, deviendra plus intense, en liaison avec l'impact grandissant de l'austérité et la menace de guerre. Finalement,"(...) dans l'orage de la période révolutionnaire, le terrain perdu est repris, les inégalités sont égalisées et le pas d'ensemble du progrès social change, double d'un coup son avance".
Cependant, si nous avons présentée la possibilité objective de l'évolution de la grève de masse, on ne doit pas oublier que les ouvriers devront devenir de plus en plus conscients de la lutte qu'ils ont engagée pour la mener à la conclusion victorieuse. C'est particulièrement vital en ce qui concerne les syndicats, qui se sont mieux adaptés au cours de ce siècle à contenir la grève de masse. Ce n'est pas le lieu ici d'envisager tous les moyens d'adaptation que peuvent employer les syndicats; nous mentionnerons qu'ils prennent généralement la forme de faux substituts pour les véritables choses : semblant de généralisation des luttes, tactiques radicales vides de toute efficacité, revendications politiques qui poussent à soutenir un clown dans le cirque parlementaire.
Le développement victorieux de la grève de masse dépendra en derniers recours de la capacité de la classe ouvrière à battre la "cinquième colonne" que constituent les syndicats aussi bien que ses ennemis "ouverts" comme la police, les patrons, les politiciens de droite, etc.
Mais le but de ce texte n'est pas de définir les obstacles de la conscience sur la voie, vers le point culminant, victorieux de la grève de masse. Il est plutôt de tracer les possibilités objectives de la grève de masse à. notre époque, à l'échelle de la nécessité et de l'organisation économique.
LES FORMES DE LA LUTTE DE CLASSE AUJOURD'HUI
La période de grève de masse tend à briser les syndicats à long terme. La forme apparente de la lutte de classe moderne -la forme syndicaliste- n'est que cela : une apparence. Son but réel ne correspond pas à la fonction des syndicats mais obéit à des causes objectives qui poussent la classe dans la dynamique de la grève de masse. Quelle est alors la forme adéquate, la plus appropriée de la grève de masse à notre époque ? L'assemblée générale des ouvriers en lutte et ses comités élus et révocables.
Cependant, cette forme, qui est animée du même esprit que les soviets eux-mêmes, est l'exception et non la règle de l'organisation de la majorité des luttes des ouvriers aujourd'hui. C'est seulement au plus haut niveau de la lutte que surgissent des assemblées générales et des comités de grèves hors du contrôle syndical. Et même dans ces situations, comme en Pologne 1980, les organisations des ouvriers succombent souvent à la fin au syndicalisme. Mais nous ne pouvons pas expliquer ces difficultés des luttes actuelles en affirmant que, parfois, elles sont trade-unionistes, et parfois sous la direction de l'auto-organisation, prolétariennes. La seule interprétation cohérente des faits est qu'il est extrêmement difficile pour une auto-organisation véritable des ouvriers d'émerger.
La bourgeoisie a les avantages suivants en ce domaine : tous ses organes de pouvoir, économiques, sociaux, militaires, politiques et idéologiques sont déjà en place de manière permanente, essayés et testés depuis des décades. En particulier, les syndicats ont l'avantage de dévoyer la confiance des ouvriers du fait du souvenir historique de leur nature autrefois ouvrière. Les syndicats ont aussi une structure organisationnelle permanente au sein de la classe ouvrière. Le prolétariat n'a surgi que récemment de la plus profonde défaite de son histoire sans aucune organisation permanente pour le protéger. Combien est donc difficile pour le prolétariat de trouver la forme la plus appropriée à sa lutte ! A peine le mécontentement lève t-il la tête que les syndicats sont là pour le "prendre en charge" avec la complicité de tous les représentants de l'ordre capitaliste. De plus, les ouvriers n'entrent pas en lutte aujourd'hui pour réaliser des idéaux, pour combattre délibérément les syndicats, mais pour des buts très pratiques et immédiats -pour essayer de préserver leurs moyens de vie. C'est pourquoi, dans la plupart des cas aujourd'hui, les ouvriers acceptent la "direction" autoproclamée des syndicats. Il n'est pas étonnant que ce soit principalement lorsque les syndicats n'existent pas ou sont ouvertement contre les grèves que la forme de l'assemblée générale émerge. C'est seulement après des confrontations répétitives avec les syndicats, dans le contexte d'une crise économique mondiale et avec le développement en force de la grève de masse que la forme de l'assemblée générale deviendra vraiment la caractéristique générale plutôt que l'exception qu'elle est encore à l'étape présente de la lutte de classe. En Europe de l'Ouest, ceci signifiera l'ouverture de confrontations avec l'Etat.
Malgré cela, les ouvriers se confronteront cependant à d'autres problèmes même si le contrôle conscient élémentaire de leur lutte aura déjà donné une énorme impulsion sur la voie de la révolution. La présence permanente de syndicats au niveau national continuera d'être une énorme menace pour la classe.
Parce que la grève de masse n'est pas un simple événement mais l'idée de ralliement à un mouvement qui s'étend sur des années, sa forme, comme résultat, n'émergera pas immédiatement, parfaitement, de façon pleinement mûre. Cette forme adéquate prendra des formes en réponse au rythme accéléré de la période de grève de masse, ponctuée par des sauts qualitatifs dans l'auto-organisation, comme par des retraites partielles et des récupérations, sous le feu constant des syndicats, mais aidés par l'intervention claire des révolutionnaires. Plus que tout autre, la loi historique du mouvement de la lutte de classe aujourd'hui ne réside pas dans sa forme mais dans les conditions objectives qui la poussent en avant. La dynamique de la grève de masse "ne réside pas dans la grève de masse elle-même ni dans ses détails techniques, mais dans les dimensions sociales et politiques des forces de la révolution".
Ceci signifie t-il que la forme de la lutte de classe n'a pas d'importance aujourd'hui, qu'il in porte que les ouvriers restent ou ne restent pas dans l'encadrement syndical ? Pas du tout. Si la force motrice derrière ces actions reste l'intérêt économique, ces intérêts ne peuvent se réaliser que par le niveau nécessaire de conscience et d'organisation. Et l'intérêt économique de la classe ouvrière -abolir l'exploitation- requiert un degré d'auto-organisation et de conscience jamais réalisée par aucune autre classe dans l'histoire. Par conséquent, harmoniser sa conscience subjective avec ses intérêts économiques est la tâche primordiale du prolétariat. Si le prolétariat s'avère incapable de se libérer lui-même aux moments décisifs de l'emprise organisationnelle et politique des syndicats, alors la classe ne réalisera jamais la promesse de la grève de masse -la révolution- mais sera écrasé par la contre-offensive de la bourgeoisie.
Cet article a essayé de montrer que le mouvement en Pologne en été 1980 n'était pas un exemple isolé du phénomène de là grève de masse, mais plutôt la plus haute expression d'une tendance internationale générale dans la lutte de classe prolétarienne dont les causes objectives et la dynamique essentielle étaient analysées par Rosa Luxemburg il y a 75 ans.
FS
[1] [276] Sauf lorsque cela est mentionné, toutes les citations sont extraites de cette brochure.
Heritage de la Gauche Communiste:
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (2ème partie)
- 2960 reads
La première partie de cet article est parue dans la Revue Internationale n° 25.
Il existe un phénomène dans le tracé de la connaissance en société bourgeoise et dont Harper n'a pas parlé. C'est celui de l'influence de la division du travail capitaliste sur la formation de la connaissance et la synthèse des sciences de la nature, d'une part; d'autre part le procès de la formation de la connaissance dans le mouvement ouvrier.
Harper dit à un certain moment que la bourgeoisie doit à chaque révolution apparaitre différente de ce qu'elle était précédemment et de ce qu'elle est en réalité dans le moment même et cacher ainsi son but réel.
Ceci est vrai, mais Harper, en ne nous parlant pas du processus de formation de la connaissance dans l'histoire et en ne posant pas de problème explicitement, le pose implicitement de la manière aussi mécaniste que celle qu'il reproche lui-même à Plekhanov et à Lénine.
Le processus de formation de la connaissance dépend des conditions de production des conceptions scientifiques et des idées en général conditions qui sont liées aux conditions de la production en général, c'est à dire aux applications pratiques.
La société bourgeoise en se développant, développe, (en même temps que ses conditions de production - c'est à dire que son mode d'existence économique-) sa propre idéologie : ses conceptions scientifiques ainsi que ses conceptions du monde et sur le monde.
La science est une branche bien particulière dans la production des idées nécessaires à la vie de la société capitaliste, la continuation, l'évolution et la progression de sa propre production.
Le mode de production économique, de même qu'il applique pratiquement ce que la science élabore, a une grande influence sur la façon dont s’élaborent pratiquement les idées et les sciences. La division du travail capitaliste, de même qu'elle contraint à l'extrême spécialisation dans tous les domaines de la réalisation pratique de la production, contraint à l'extrême spécialisation et à l'ultime division du travail dans le domaine de la formation des idées et principalement dans le domaine des sciences.
Les sciences et les savants confirment, par leur présence et leurs spécialisations, la division universelle du travail capitaliste, ils sont aussi nécessaires que les généraux d'armée et la science militaire, ou les administrateurs et directeurs.
La bourgeoisie est parfaitement capable de faire la synthèse dans le domaine particulier des sciences qui ne touche pas directement à son mode d'exploitation. Aussitôt qu'elle touche à ce dernier domaine, elle tend inconsciemment à travestir la réalité : histoire, économie, sociologie, philosophie.
Elle ne peut donc qu'arriver à des essais de synthèse incomplets.
La bourgeoisie se borne aux applications pratiques, aux investigations scientifiques, et elle est dans ce domaine essentiellement matérialiste. Mais comme elle ne peut arriver à une synthèse complète, comme elle est obligée inconsciemment de masquer le fait de sa propre existence contre les lois scientifiques du développement de la société, -découvertes par les socialistes- elle ne peut réaliser cette barrière psychologique de la réalité de son existence historico-sociale qu'au travers de l'idéalisme philosophique qui embue toute son idéologie. Ce travestissement nécessaire à la société bourgeoise en tant que mode d'existence sociale, elle est capable de l'élaborer elle-même au travers de sa propre philosophie, (de ses différents systèmes) mais elle est égale ment encline à prendre dans les anciennes philosophies et idéologies de l'existence sociale d'anciens modes d'exploitation, du fait qu'elles ne touchent pas sa propre existence mais peut au contraire continuer a voilera et aussi parce que toutes les classes dominantes dans l'histoire, en tant que classes conservatrices arrivent a avoir besoin des anciens modes de conservation qu'elles arrangent bien entendu, selon leurs propres à besoins -c'est è dire qu’elles les déforment a leur propre forme.
C'est pour cela que même les philosophes bourgeois, au début de l'histoire de la bourgeoisie, pouvaient être, dans une certaine mesure, matérialistes (dans la mesure où ils mettaient l'accent sur la nécessité du développement des sciences de la nature), mais qu'ils étaient foncièrement idéalistes aussitôt qu'ils essayaient de raisonner sur l'existence de la bourgeoisie elle-même et de la justifier. Ceux qui mettent plus l'accent sur les premiers aspects de la pensée bourgeoise pouvaient apparaisse plus matérialistes, ceux qui tentaient plus de justifier l'existence de la bourgeoisie étaient appelés à être plus idéalistes.
Seuls les socialistes scientifiques à partir de Marx, sont capables de faire une synthèse des sciences et du développement social humain. Et même cette synthèse est nécessaire au préalable pour leur point de départ révolutionnaire. C'est ce que Marx a fait.
Dans la mesure où ils posaient de nouveaux problèmes scientifiques, les matérialistes de l'époque révolutionnaire de la bourgeoisie étaient tentés et contraints de faire la synthèse de leurs connaissances et de leurs conceptions du développement social, mais sans jamais toucher à l'existence sociale de la bourgeoisie, au contraire en justifiant cette existence. C'est ainsi que des individualités ont pu surgir qui tentèrent de faire cette synthèse, de Descartes è Hegel. Il est bien difficile en toute honnêteté de séparer le matérialisme de l'idéalisme, dans la philosophie de Descartes ou de Hegel. Leur essai de synthèse a voulu être complet, il a voulu embrasser d'un regard dialectique l'évolution et le mouvement du monde et des idées, qu'ils n'ont pu faire autrement que traduire d'une manière totale et absolue le comportement idéologique de la bourgeoisie sous son double aspect contradictoire. Mais ils sont des exceptions.
Ce qui a contribué à pousser des individus vers cette activité reste encore dans l'ombre, la connaissance sociale, historique, économique et psychologique n'en étant qu'à son stade primaire. Nous ne pouvons que dire cette banalité qu'ils obéissaient à des préoccupations de leur société en général.
Dans le capitalisme, et quoique tendant vers l'édification d'une nouvelle société, les socialistes d'une part et le prolétariat d'autre part, sont contraints, par leur existence et leur développement au sein du capitalisme, d'obéir, dans le domaine de la connaissance, à ses propres lois.
La politique devient la spécialisation des militants communistes, quoique des connaissances et une vue de synthèse universelle leur seraient utiles.
C'est ce qui fait que la division l'opère dans le mouvement ouvrier, entre les courants politiques d'une part, et d’autre part, souvent même de la politique d'avec les théoriciens dans les domaines scientifiques de l’histoire, de économie, de la philosophie. Le processus de formation des théoriciens du socialisme s'est opéré assez sensiblement de la même façon que celle des savants et des philosophes bourgeois de l'époque révolutionnaire.
L'influence ambiante de l'adulation et du milieu bourgeois restant toujours une forte influence dans le procès de formation des idées dans le mouvement ouvrier. Le développement de la société elle-même, d'une partie des sciences d'autre part, sont des facteurs décisifs dans l'évolution du mouvement ouvrier. Cela peut apparaitre comme une tautologie, et cependant, on ne le répète jamais assez.
C'est cette constante évolution parallèle à l'évolution du prolétariat et des socialistes qui est pour eux une lourde entrave.
Les restes des religions: c'est à dire des époques historiques pré-capitalistes deviennent un atavisme de la bourgeoisie ''réactionnaire'' certes, mais surtout de la bourgeoisie en tant que dernière classe exploiteuse de l'histoire. Malgré cela, la religion n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux dans idéologie des classes exploitantes, mais cette idéologie dans son en- semble, où voisinent à côté des religions, du chauvinisme et de tous les idéalistes verbeux, un matérialisme sec, étriqué et statique. A l'aspect idéaliste de la pensée de la bourgeoisie, il est donc nécessaire d'y joindre son matérialisme des sciences de la nature qui fait partie intégrante de son idéologie. Ces différents aspects de l’idéologie bourgeoise, s’ils ne font pas partie d'un tout pour la bourgeoisie qui tend à masquer l'unité de son existence sociale sous la pluralité de ses mythes, doivent être conçus comme tels par les socialistes.
C'est ainsi que l'on s'aperçoit que le mouvement ouvrier a du mal à se dégager de 1'idéologie bourgeoise dans son ensemble, de ses idéalistes comme de son matérialisme incomplet. Bergson n'a t-il pas influencé la formation de courants dans le mouvement ouvrier en France?
La grande difficulté consiste à faire de chaque nouvelle idéologie ou formulation d'idée, l'objet d'une étude critique et non l'objet d'un dilemme adoption-rejet. Elle consiste également à concevoir tout progrès scientifique, non comme un progrès réel, mais comme un progrès ou un enrichissement (dans le domaine de la connaissance) seulement en puissance dans la société, et dont, en dernier ressort, les possibilités réelles pratiques d'application sont soumises aux fluctuations de la vie économique du capitalisme.
Dans ce sens là, les socialistes en arrivent donc à avoir uniquement une position critique permanente, Faisant des idées l'objet d'une étude; ils ont face à la science uniquement une position d'assimilation chronique de ses résultats en en comprenant les applications pratiques comme ne pouvant servir l'humanité réellement pour ses besoins que dans une société évoluant vers le socialisme.
Le processus de la connaissance dans le mouvement ouvrier considère comme une acquisition sienne, le développement théorique des sciences, mais il l’intègre dans un ensemble de connaissances dont l'axe est la réalisation pratique de là révolution sociale, axe de tout progrès réel de la société.
C'est ce qui fait que le mouvement ouvrier se trouve spécialisé de par son existence sociale révolutionnaire, luttant au sein du capitalisme contre la bourgeoisie, dans le domaine strictement politique qui est jusqu'à l'insurrection (1a prise de conscience), le point névralgique de la lutte de classe bourgeoisie-prolétariat.
C'est ce qui fait le double aspect du développement de la connaissance dans le mouvement ouvrier, différent et relié, se développant au fur et à mesure de la libération REELLE du prolétariat : politique d'une part (qui pose les problèmes immédiats et brulants); théoriques et scientifiques, qui évoluent plus lentement, se poursuivent surtout (jusqu'à présent) dans les époques de recul du mouvement ouvrier, et aborde d problèmes certes au moins aussi importants, certes en rapport avec des problèmes politiques, mais d'une façon moins immédiate et brulante.
Dans la politique se marque, au fur mesure du développement de la société, la frontière immédiate de classe, au travers de la lutte politique du prolétariat. C'est donc dans le développement de la lutte politique du prolétariat que se suit pas à pas l'évolution de la lutte de classe et le processus de formation du mouvement ouvrier révolutionnaire en opposition à la bourgeoisie dont les formes de lutte politique évoluer en fonction de l'évolution constante de la société capitaliste.
La politique de classe du prolétariat varie donc au jour le jour et même dans une certaine mesure localement (nous verrons plus tard dans quelle mesure). C'est dans cette lutte au jour le jour, dans ces divergences de partis et de groupes politiques, dans la tactique du lieu et du moment que se traduisent immédiatement les frontières de classe. Viennent ensuite, d'une façon plus générale, moins immédiate, et posant ils objectifs plus lointains, les buts de la lutte révolutionnaire du prolétariat, qui sont contenus dans les grands principes directeurs des partis et des groupes politiques.
C'est donc dans les programmes d'abord, ensuite dans l'application pratique, dans l’action journalière, que se posent les divergences dans l'action politique, reflétant dans leur évolution, en même temps que l'évolution générale de la société, l'évolution des classes, de leurs méthodes de lutte, de leurs moyens et de leurs idéologies, de la théorie et de la pratique du mouvement de leur lutte politique.
Au contraire, la synthèse de la dialectique scientifique dans le domaine purement philosophique de la connaissance, se développe non pas à la manière dialectiquement immédiate de la lutte de classe pratique politique, mais bien d'une manière dialectique beaucoup plus lointaines sporadique, sans lien apparent, ni avec le milieu local, ni avec le milieu social, a peu près comme le développement des sciences appliquées, sciences de la nature, de la fin du féodalisme et de la naissance du capitalisme.
Harper n'a pas fait ces différenciations, il n'a pas su nous montrer la connaissance comme différentes manifestations de la pensée humaine, extrêmement divisée en spécialisations, dans le temps, dans les différents milieux sociaux, au cours de leur évolution, etc.
La connaissance humaine se développe (grossièrement et vulgairement) en fonction des besoins auxquels les différents milieux sociaux ont à faire face et les différents domaines de la connaissance se développent en fonction du développement des applications pratiques envisagées. Plus le domaine de la connaissance touche immédiatement et de près l'application pratique, plus est sensible son évolution; au contraire , glus nous avons affaire à une tentative de synthèse et moins il est possible de suivre cette évolution car la synthèse ne se fait que suivant les lois purement accidentelles du hasard, c'est à dire des lots tellement compliquées, découlant de facteurs tel- moment divers et complexes qu'il est pratiquement impossible de nous plonger aujourd'hui dans de telles études.
De plus, la pratique englobe de grandes masses sociales alors que la synthèse s'opère très souvent par des individualités. Le social tombe sous les lois générales plus facilement et plus immédiatement contrôlables. L'individu tomba sous l'angle des particularités quasi imperceptibles pour ce qui est de la science historique qui n'en est encore qu'à ses premiers pas.
C'est pour cette raison que nous relevons, en premier liquidée grave erreur de ce côté chez Harper, d'avoir engagé une étude sur le problème de la connaissance en ne nous parlant que de la différence qui existe entre la manière bourgeoise d'aborder les problèmes et la manière socialiste et révolutionnaire: en laissant dans l'ombre le processus historique de formation des idées. En opérant de cette manicle, la dialectique de Harper reste impuissante et vulgaire.
D'un petit essai intéressant, critiquant la manière dont Lénine aborde la critique de l’empiriocriticisme, et montrant ce qui est vrai (c'est à dire que c'est un mélange de mauvais goût dans la polémique de vulgarité dans le domaine scientifique -ainsi d'ailleurs que de choses erronées- de matérialisme bourgeois et de marxisme), Harper nous livre cet essai intéressant, plus des conclusions d'une platitude encore plus criante que la dialectique de Lévige dans matérialisme et Empiriocriticisme.
Le prolétariat se dégage révolutionnairement du milieu social capitaliste par un combat continuel, cependant il n'a acquis totalement une idéologie indépendante dans le plein sens du terme, que le jour de la réalisation pratique de l'insurrection généralisée faisant de la révolution socialiste une réalité vivante et lui permettant de marcher ses premiers pas. En même temps que le prolétariat arrive à une indépendance politique et idéologique totale, à la seule conscience de la seule solution révolutionnaire au marasme économico-social du capitalisme, la construction d'une société sans classes, au moment du développement généralisé de l'insurrection du prolétariat, à ce moment précis, ça n'existe déjà plus en tant que classe pour le capitalisme, et, par la dualité de pouvoir acquise en sa faveur, il a créé un milieu historico-social favorable à sa propre disparition en tant que classe.
La révolution socialiste comporte donc deux actions du prolétariat : avant et après l'insurrection.
Il n'arrive à développer totalement une idéologie indépendante que lorsqu'il a créé le milieu favorable a sa disparition, c'est à dire après l'insurrection. Avant l'insurrection, son idéologie a surtout comme but d'arriver à réaliser pratiquement l'insurrection: la prise de conscience de la nécessité de réaliser cette insurrection ainsi que de l'existence des possibilités et des moyens de la réaliser. Après l'insurrection se posent pratiquement de front, d'une part la gestion de la société, d'autre part la disparition des contradictions léguées par le capitalisme. Au premier rang de ces préoccupations se pose donc, après l’insurrection, d'évoluer vers le socialisme et le communisme, c'est à dire résoudre pratiquement ce que doit être la période transitoire. La conscience sociale, même celle du prolétariat, ne peut être totalement libérée de l'idéologie bourgeoise qu'à partir de cette période, jusqu'à cet acte de libération par la violence; toutes les idéologies bourgeoises, toute la culture bourgeoise la science et l'art, commandent aux socialistes jusque dans la réaction de leur raisonnement. Ce n'est qu'avec lenteur qu'une synthèse socialiste se dégage de l'évolution du mouvement ouvrier et de son étude.
Dans l'histoire de l'évolution du mouvement ouvrier, on voit que très souvent il est arrivé que ceux qui sont capables de raisonner et d'analyser très profondément les choses de la des classes et de l'évolution du capitalisme ou sur un mouvement insurrectionnel, ont été, en dehors du mouvement réel lui-même, plus comme des observateurs que comme des acteurs. C'est le cas pour Harper comparé à Lénine.
De même il peut arriver un décalage dans le mouvement de la connaissance du point de vue du socialisme, décalage qui fait que certaines études théoriques restent valables alors que les hommes qui les ont formulées pratiquent une politique qui n'est plus adéquate à la lutte du prolétariat. Il arrive également l'inverse.
Dans le mouvement qui a entraîné les classes russes dans trois révolutions successives en douze ans, les taches pratiques de la lutte de classe furent tellement prenantes, les besoins de la pratique de la lutte, puis la prise du pouvoir, puis du pouvoir lui-même, appelaient beaucoup plus la formation de politiciens du prolétariat comme Lénine et Trotsky, des hommes d'actions, des tribuns et des polémistes, que des philosophes et des économistes, les hommes qui l'ont été dans la 2ème ou la 3ème Internationale étaient très souvent en dehors du mouvement pratique révolutionnaire et en tout cas dans des périodes de recul du cours révolutionnaire.
Lénine entre 1900 et 1924, a été poussé par le flot de la révolution montante, toute son œuvre est palpitante de l'âpreté de cette lutter de ses hauts et de ses bas, de toute sa tragédie historique et humaine avant tout. Son œuvre est surtout politique et polémique, de combat. Son œuvre essentielle pour le mouvement ouvrier est donc surtout cet aspect politique et non sa philosophie et ses études économiques d'une qualité plus douteuse, parce que manquant de profondeur dans l'analyse, de connaissances scientifiques et de possibilités de synthèse théorique. A coté de cette houleuse situation historique de la Russie, la situation calme de la Hollande en marge de la lutte de classe d'Allemagne, permet le développement idéologique d'un Harper, dans une période de reflux de la lutte de classe.
Harper attaque violemment Lénine dans son point faible, en laissant dans l'ombre la partie la plus importante et la plus vivante de son neutre, et il tombe à faux quand il veut en tirer des conclusions sur la pensée de Lénine et sur le sens de la portée de son neutre.
D'incomplètes et erronées quant à Lénine, les conclusions de Harper tombent dans des platitudes journalistiques quant à celles qu'il tend à tirer sur la révolution russe dans son ensemble. Pour ce qui est de Lénine, cela prouve qu'il n'a rien compris à son œuvre principale pour s'attacher à ''Matérialisme et Empiriocriticisme'' uniquement. Pour ce qui est de la révolution russe, c'est beaucoup plus grave et nous y reviendrons.
(A suivre)
Philippe
Courants politiques:
- Le Conseillisme [210]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : contre la guerre Pérou-équateur
- 3424 reads
Nous publions ci-dessous un tract rédigé et diffusé par des contacts en Equateur au moment de la guerre Pérou-Equateur en janvier 1981.
Les évasements guerriers qui en ce moment provoquent des morts et des tensions entre des populations du Pérou et d'Equateur ont une explication historique et matérielle. La paix dans le capitalisme n'est pas autre chose que la continuation de la guerre par des moyens diplomatiques. Les Etats capitalistes s'arment pour défendre leur base territoriale et les ressources sur les- quelles se développe le processus d'accumulation.
Au nom de la souveraineté nationale, les bourgeoisies nationales demandent au peuple de verser son sang pour sauvegarder ses intérêts économiques.
Ce n'est pas une coïncidence si peu de jours après que l'impérialisme ait installé aux commandes de l'Etat un gouvernement conservateur, se soient réveillés les foyers guerriers de ces pays semi-coloniaux. La crise du capitalisme est une crise mondiale qui conduit follement les sociétés du capital vers la guerre. Les USA ont reçu le poids de la crise avec force: mais ils ont la capacité politique, le pouvoir militaire et le pouvoir économique pour le transférer vers les sociétés dépendantes de la périphérie. L'enjeu est de taille.
Les courants de démocratisation des peuples en Amérique Latine qui, pour la plupart , se déguisent avec les droits de 1'homme, n'ont cessé de constituer un déséquilibre pour les plans et les stratégies globales de 1'impérialisme. Quand les affrontements du capitalisme international, menés par les deux grandes puissances, sont des affrontements de blocs, 1'impérialisme yankee essaie d'homogénéiser les gouvernements sous des régimes militaires marionnettes qui peuvent répondre d'une seule voix aux patrons du nord. D'un autre côté, 1a revitalisation de 1'économie yankee, qui souffre des effets de la crise capitaliste - étroitesse de la base d’accumulation, inflation, saturation des marchés, difficultés a trouver des investissements productifs , chômage massif et tensions - nécessite de se consolider à travers une concurrence guerrière . Ainsi la balance des paiements yankee peut tendre vers un équilibre, imbibé du sang des ouvriers et des paysans d ' Equateur et du Pérou.
En temps de guerre, il n'y a ni agresseur, ni agressé. Chaque Etat essaie de justifier la raison de sa lutte par la déraison de l'ennemi. Avec le nationalisme, il essaie de mater le prolétariat et de le lancer dans la défense de ses ressources, les ressources de la bourgeoisie. Le territoire équatorien et le territoire péruvien ne sont pas ceux des équatoriens et des péruviens. Ils appartiennent à la bourgeoisie. Les soldats du peuple, équatoriens et péruviens doivent prendre les armes et tirer en 1’air. L’ennemi, c'est le capital.
La crise du capitalisme mondial se manifeste avec une profonde gravité pour les peuples des pays périphériques et dépendant de l'impérialisme yankee. Cette crise est relativement plus profonde au Pérou où les gens, particulièrement dans les villes s'entassent dans les rues à la recherche d'emplois et de nourriture. L'inflation et le coût de la vie au Pérou amènent à un état de décomposition et de tension sociale qui peuvent être difficilement contrôlés sauf par la répression et les armes. La bourgeoisie péruvienne, influencée par une politique continentale formulée bien avant que Reagan ne vienne au pouvoir, a opté pour lancer l'armée péruvienne dans une invasion. Ainsi, les contradictions que provoque le capital - la misère humaine, la famine la malnutrition, le chômage - peuvent être oubliées temporairement au nom de l’unité nationale.
La politique du cow-boy Reagan vis-à-vis de l'Equateur a aussi son explication. Un gouvernement social-démocrate en gestation, qui s'exprime faiblement par Roldos, contaminé par la démocratie- chrétienne, alliée de l'impérialisme, a porté comme drapeau national le drapeau mystificateur des droits de l'homme. Dans le peu de temps de vie démocratique, les alliés extérieurs de l'Equateur sont les pays les plus faibles politiquement de l'Amérique Latine : E1 Salvador et le Nicaragua. Le Mexique ne constitue pas un allié direct, malgré la coïncidence de quelques thèses avec le gouvernement capitaliste équatorien. Isoler l'Equateur, le mettre dans une situation de dépendance plus grande, déstabiliser la fausse démocratie qui, de toute manière. se trouve être une barrière au pian de subordination continental, est le plan de l'impérialisme. Ainsi, le pétrole coulera avec plus de fluidité, les armes se vendront plus, les multinationales ne trouveront plus d'obstruction à l'intérieur du Pacte Andin, et en politique, l'impérialisme pourra instaurer une démocratie dictatoriale menée par la démocratie-chrétienne.
Le peuple sortira dans la rue mobilisé par la droite du capital. Il coulera beaucoup de sang si les négociations diplomatiques n'aboutissent pas, au nom de l’impérialisme, du nationalisme, et avec la bénédiction internationale du pape qui appellera sans doute à la paix des peuples.
Les prolétaires du monde n'ont pas de patrie ; leur véritable ennemi est le capital. C'est le moment de prendre les terres et les usines, au Pérou et en Equateur.
CCI
REPONSE DU C. C. I.
Les maîtres des médias, à l'Est comme à l'Ouest, entretiennent depuis des décennies un chiche publicitaire : en Amérique Latine, la révolte contre la misère est toujours et inévitablement une révolte patriotique, nationaliste. Son symbole-vedette serait Guevara dont on vend l'image imprimée sur des tee-shirts ou des cendriers.
Et pourtant, s'il est une partie du monde où, depuis 1968, la classe ouvriers a commencé à relever la tête en se situant sur son propre terrain de classe, s'opposant non seulement à 1''impérialisme yankee'' mais aussi à ''son'' capital national, aux patrons ''patriotes '' et aux exploiteurs ''autochtones'' c'est en Amérique du sud. Les luttes massives et violentes des ouvriers de l'automobile en Argentine en 1969, les grèves des mineurs chiliens sous le gouvernement Allende (grèves que Fidel Castre a tenté en personne d'arrêter au nom durera défense de la patries), les grèves des mineurs boliviens, les luttes des ouvriers du pétrole et des mineurs de fer au Pérou au début de 1981, la récente grève massive des métallurgistes de Sac Prolo au Brésil , ce ne sont là que quelques-uns des plus puissants mouvements de la classe ouvrière sur ce continent.
Ces luttes prolétariennes ont mis en question le nationalisme plus de façon intrinsèque, dans les faits - par le refus de faire des distinctions entre capitaux du pays et capitaux étrangers - que de manière explicite et claire. Il n'y a pas encore de force politique prolétarienne importante capable de défendre et impulser de façon explicite le contenu internationaliste des luttes ouvrières elles-mêmes, qui plus est, c'est dans les organisations politiques plus spécialisées dans l'encadrement des travailleurs que se recrutent les éléments les plus nationalistes.
Fin janvier 1981 une ''guerre'' a éclaté entre le Pérou et l'Equateur ; l'enjeu : des territoires qui pourraient éventuellement recéler du pétrole et sur le plan interne de chaque pays, une tentative de rétablir ''l'enthousiasme nationaleste'' et le fouet des lois militaires, un minimum d'unité nationale, en particulier au Pérou violemment secoué par des luttes ouvrières à la fin 1980.
Comme d'habitude, toutes les forces politiques ''nationalistes'', des militaires aux syndicalistes radicaux, ont appelé, au Pérou comme en Equateur, les prolétaires et les paysans à la défense de ''leur'' patrie.
C'est dire l'importance qu'a dans ces conditions une voix, aussi faible soit-elle, qui se dresse dans un des pays belligérants pour dire : ''Au nom de la souveraineté nationale, les bourgeoisies nationales demandent au peuple de verser son sang pour sauvegarder ses intérêts économiques. Les prolétaires du monde n'ont pas de patrie, leur véritable ennemi est le capital. Une telle voix exprime le mouvement réel et profond qui murit dans les entrailles de la société capitaliste mondiale et doit le prolétariat inter national est le premier protagoniste.
Le texte publié ci-dessus a été rédigé et diffusé en Equateur pendant les évasements. Il est signé CCI mais il ne s'agit pas d'un texte de notre organisation. Les camarades qui ont élaboré ce texte ont probablement choisi de signer ainsi par sympathie avec nos idées ; en aucun cas parce qu'ils feraient partie de notre organisation.
L'aspect essentiel de ce texte réside dans sa claire position internationaliste. Le document aborde cependant d'autres questions. Parmi elles, celle de la ''démocratie'' en Amérique Latine et ses rapports avec l'impérialisme US. Et à ce sujet, ,il est écrit que le plan de 1’impérialisme (...) est de déstabiliser la fausse démocratie qui de toute manière se trouve être une barrière au plan de subordination continentales. Une telle formulation laisse entendre que la mise en place dans les pays d'Amérique Latine de mascarades démocratiques irait à l'encontre des plans de l’impérialisme US dans la région.
Dans la période actuelle et dans les pays semi coloniaux, le problème n°1 pour la métropole de l'empire US, c'est de s'assurer d'un minimum de stabilité : stabilité du pays sous la botte du bloc, stabilité sociale, entre autre pour diminuer tout risque de ''déstabilisation'' par l'infiltration des partis prosoviétiques dans les mouvements sociaux.
Dans les pays sous-développé, où l'armée constitue la seule force administrative cohérente et centralisée è l'échelle nationalistes dictatures militaires constituent le moyen le plus simple de constituer une structure de pouvoir. Mais lorsque le développement de mouvements sociaux, ouvriers, ''incontrôlés'' menace trop l'ordre social, les USA savent à l'occasion mettre en place des régimes ''plus démocratiques, permettant essentiellement l'existence au grand jour de véritables appareils d'encadrement des travailleurs (partis ''de gauche'', syndicats). Ces démocraties ne sont en général que des paravents qui couvrent le pouvoir réel et maintenu de l'armée. Les stratèges du capital américain responsables de la stabilité de la région peuvent aussi bien s'accommoder de régimes militaires durs que de ''démocraties'' tout aussi dures d'ailleurs, du moment qu'ils pensent que celle contribue à maintenir l'ordre.
Il s'agit peut-être dans le texte simplement d'une question de formulation peu précise. Ainsi, quelques lignes plus loin, il est question de « démocratie dictatoriale menée par la démocratie chrétienne » comme « plan de l’impérialisme ». Mais alors pourquoi tous ces développement sur les pays « alliés de l’Equateur » ?
Si le nationalisme est un piège pour les ouvriers d’Amérique Latine, la démocratie bourgeoise en est un autre. Les ouvriers chiliens savent à quel prix ils ont dû payer leurs illusions sur Allende et les appels à rester fidèle à l’armée nationale « démocratique ». ([1] [277]).
C’est pourquoi il est indispensable d’éviter toute ambiguïté sur la question.
[1] [278] Au lendemain du coup d’Etat qui avait échoué, Allende avait convoqué des meetings de masse pour appeler la population au calme et à obéir aux troupes restées fidèles, il y avait fait applaudir entre autres noms celui de Pinochet….
Géographique:
Questions théoriques:
- Guerre [279]
Revue Int. 1982 - 28 à 31
- 3912 reads
Revue Internationale no 28 - 1e trimestre 1982
- 2541 reads
Situation internationale : Crise économique et lutte de classe
- 3408 reads
Nous avons fréquemment, dans notre presse, analysé le années 1980 comme les "années de vérité" (cf. la Revue Internationale n°20 et 26 notamment). Les deux premières années de cette décennie ont pleinement confirmé cette? analyse. En effet, 1980 et 1981 auront été le théâtre d'événements de la plus haute importance et particulièrement significatifs de l'enjeu qui, pour une bonne part, va se jouer dans les années 80 : guerre impérialiste généralisée ou révolution prolétarienne mondiale.
Sur le plan de la situation économique, celle qui détermine l'ensemble de la vie sociale, ce fut une fin brutale aux illusions : 1980 et 1981 se présentent comme les années d'une nouvelle récession de 1'économie mondiale, d'une poussée massive de 1'inflation et d'un développement sans précédent du chômage.
La réponse bourgeoise à cette crise : l'aggravation des tensions inter-impérialistes et des préparatifs de guerre n'a pas manqué, pour sa part, de se porter à la hauteur des causes qui l'engendrent. L'année 80 avait débuté avec 1'invasion de 1'Afghanistan, l'année 1981 se termine par l'annonce d'un formidable renforcement des armements partout dans le monde et par l'ouverture, à Genève, de nouvelles négociations entre l'URSS et les USA sur le "désarmement" : on connaît leur rôle d'écran de fumée destiné à masquer la course vertigineuse aux moyens d'holocauste.
La réponse ouvrière, elle aussi, a été à la hauteur de l'aggravation de l'enjeu : durant l'été 1980, prenait corps en Pologne le plus formidable mouvement de masse du prolétariat mondial depuis plus d'un demi-siècle. Mouvement que la bourgeoisie de tous les pays s'est employée à étouffer et dont elle n'est pas encore venue à bout. Mouvement qui a mis en évidence tant la solidarité que sait se donner la classe capitaliste face à la lutte prolétarienne, que la nécessité d'une extension mondiale de cette lutte.
C'est un point sur ces trois aspects indissociables et fondamentaux pour le destin de l'humanité la crise du capitalisme, la réponse bourgeoise à celle-ci et la réponse prolétarienne) que se propose de faire cet article.
UNE CRISE ECONOMIQUE QUI CESSE DE S'AGGRAVER
En 1959, le dirigeant de la première puissance mondiale déclarait triomphant : "Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue" ([1] [280]). Un an plus tard, les Etats-Unis connaissaient leur récession la plus sérieuse de l'après-guerre : - 0,1% de croissance du Produit Intérieur Brut (bien en deçà évidemment ce qu'ils allaient connaître par la suite).
En 1975, Chirac, premier ministre de la 5ème puissance mondiale jouait à son tour les "Nostradamus" : "Nous voyons le bout du tunnel". Un an après, il devait céder sa place au "meilleur économiste de France", le professeur Barre, qui, à son départ, en mai 81, laissait une situation encore pire qu'il ne l'avait trouvée (nombre de chômeurs deux fois plus important, 14 d'inflation au lieu de 117).
Il y a un an, Reagan était choisi par la bourgeoisie américaine pour régler son compte à la crise (c'est du moins ce qu'il déclarait). Mais les potions préparées par le Prix Nobel d'Economie Milton Friedman et quelques autres adeptes de "l'économie de l'offre" n'y ont rien pu. L'économie américaine replonge dans la récession, le chômage approche des 10 millions (chiffre record dans 1'après-guerre) et le directeur du Budget, David Stockman, reconnaît lui-même qu'il ne croyait pas tellement au succès de la politique économique dont, il était le principal animateur.
Aussi régulièrement que l'automne succède à l'été et l'hiver à l'automne, les dirigeants de ce monde se sont trompés et ont trompé leur auditoire en annonçant "la sortie du tunnel". Comme dans un film surréaliste, cette sortie a semblé s'éloigner au fur et à mesure qu'avançait le train jusqu'à n'être plus qu'un petit point de lumière qui sera bientôt invisible.
Mais les dirigeants de l'Ouest n'ont pas le monopole des prédictions hasardeuses.
En septembre 80, Gierek était remplacé par Kania à la tête du POUP pour avoir mené l'économie polonaise à la catastrophe. Avec Kania, ça allait changer ! Et effectivement, ça a changé. La situation économique de l'été 80 prend, avec le recul des airs de prospérité à côté de celle d'aujourd'hui. Une chute de la production de 15% a suivi une chute de 4%. Réélu triomphalement à la tête de son parti en juillet, Kania est descendu aux oubliettes en octobre de la même année.
Quant aux pronostics de Brejnev régulièrement démentis, ils ont au moins aussi nombreux que les cessions plénières du Comité Central du PCUS. Dans un sursaut de lucidité et avec un certain humour, probablement involontaire, Brejnev a fini récemment par constater en substance que lorsque trois années de suite, la production agricole est mauvaise à cause des intempéries, il convient de réviser les analyses sur le climat de 1'URSS.
L'ensemble des pays du COMECON s'est distingué ces dernières années par une incapacité chronique à réaliser les objectifs du plan de 1976-80. Si le plus "sérieux", la RDA a réussi à réaliser 80% de l'augmentation prévue du revenu national, ce chiffre tombe à 50% pour la Hongrie. Quant à la Pologne, sa croissance par rapport à 76 se réduit à 0, ce qui revient à dire qu'elle ne produit aujourd'hui que 70% de ce que les planificateurs avaient prévu. Et vive le "formidable acquis ouvrier" que, d'après les trotskystes, représente la planification !
L'autre "acquis ouvrier majeur", selon les trotskystes, le monopole étatique du commerce extérieur, a lui aussi fait la preuve de sa redoutable efficacité : les pays du Comecon sont aujourd'hui parmi les plus endettés du monde. Quant au mythe de l'absence d'inflation dans ces pays, il a fait long feu depuis qu'on assiste régulièrement à des augmentations massives des prix "officiels" pouvant aller jusqu'à 200% (plus de 170% sur le prix du pain en Pologne).
En 1936, Trotski voyait dans les progrès économiques de l'URSS la supériorité du socialisme sur le capitalisme : "Il n'y a plus lieu de discuter avec MM. les économistes bourgeois : le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, mais dans une arène économique qui couvre le sixième de la surface du globe; non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de 1'électricité". ([2] [281]).
Avec la même logique il faudrait aujourd’hui arriver à la conclusion opposée : le capitalisme est supérieur au socialisme tant est évidente la faiblesse et la fragilité de l’économie des pays dits "socialistes"! C'est d'ailleurs le cheval de bataille que chevauchent les économistes occidentaux pour justifier leur défense irréductible du mode de production capitaliste. En fait, la crise qui frappe les pays de l'Est est une nouvelle illustration de ce ont que les révolutionnaires dit depuis toujours, l'URSS et ses satellites n'ont rien de socialiste. Ce sont des économies capitalistes, et qui plus est, relativement sous développées.
Mais les cris de satisfaction que poussent les tenants du capitalisme privé en montrant du doigt les pays de l'Est ne réussissent pas, bien que ce soit là leur fonction, à masquer la gravité de la crise au cœur même des citadelles du capitalisme mondial.
Les graphiques qui suivent, donnent une image de l'évolution de trois indicateurs majeurs de l'économie de l'ensemble des pays de l'OCDE (c'est à dire, les pays les plus développés d'Occident) le taux d'inflation, la variation annuelle du Produit Intérieur Brut et le taux de chômage.
Plus que les valeurs annuelles, elles-mêmes déjà significatives, il est intéressant d'examiner les valeurs moyennes sur des périodes de plusieurs années (61-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-81). On constate une détérioration constante de la situation du capitalisme occidental sur les trois plans considérés.
Evidemment, pour certains, ce n'est pas encore la "vraie" crise puisqu'on n'assiste pas sur une longue période, à un recul massif de la production comme ce fut le cas dans les années 30 : pour le moment, les taux de croissance moyens restent encore positifs. A cet argument, on peut apporter deux réponses :
1) Comme nous l'avons déjà mis en évidence dans d'autres articles, si la bourgeoisie n'a "pas appris" (et pour cause ! à surmonter une crise insoluble, elle a par contre appris, depuis 1929, à en ralentir le rythme, notamment par l'emploi massif de mesures de capitalisme d'Etat et par la prise en charge par les pays leaders de chaque bloc de la conduite des affaires des divers pays qui composent ces blocs (à travers le Comecon, pour le bloc de l'Est, via notamment l'OCDE et le FMI pour le bloc de l'Ouest). Il est d'ailleurs à noter, que, malgré les antagonismes inter-impérialistes, le bloc le plus riche, peut à l'occasion, venir en aide à l'économie en détresse d'un pays du bloc adverse, notamment lorsque ce pays est menacé d'explosions sociales. L'aide de l'occident à la Pologne et l'adhésion de ce pays ainsi que de la Hongrie au FMI l'illustrent bien.
2) Il n'y a pas qu'un recul de la production qui puisse indiquer l'existence d'une réelle situation de crise. Le simple recul continu des taux moyens de croissance, tel qu'il apparaît clairement sur le graphique, montre que quelque chose se dérègle, et de façon définitive, dans le fonctionnement de l'économie mondiale. De plus aujourd’hui, avec la mise en œuvre massive des techniques d'automation, le taux annuel d'augmentation le la productivité du travail est tel que, bon an mal an, même si un nombre important d'entreprises ferment leurs portes, le volume total de ce qui est produit peut se maintenir à un niveau supérieur à celui de l'année précédente, sans que cela n'indique une quelconque santé de l'économie ([3] [282]).
En fait, parmi les indices de 1'aggravation de la crise il faut retenir l'augmentation du chômage. Ce phénomène est une expression directe de l'incapacité du capitalisme à intégrer de nouveaux travailleurs dans son appareil productif. Pire, c'est une expression du fait qu’il a commencé à les rejeter massivement de celui-ci. Et cela, non seulement dans les pays du tiers-monde, comme c'était le cas durant la période de reconstruction du 2ème après-guerre, mais dans les métropoles même du capitalisme : les pays avancés. C'est là un signe flagrant de la faillite historique d'un mode de production qui avait pour vocation d'étendre au monde entier les rapports de production sur lesquels il est basé, l’exploitation du travail salarié, et qui aujourd’hui n'est même plus capable de maintenir l’étendue de celle-ci dans ses bastions mêmes (sans parler de la situation dans le Tiers-Monde où le chômage sévit de façon tragique depuis des décennies).
L'évolution du taux d'inflation est un autre indicateur très significatif de la dégradation constante du fonctionnement du capitalisme. L'inflation est une expression directe de la fuite en avant forcenée qui est devenue le mode de survie du capitalisme. Incapable de trouver des débouchés solvables pour sa production, ce système tire des traites sur l'avenir en s'endettant de façon massive et continue. Ce sont les Etats qui montrent le chemin dans ce domaine. Par des déficits budgétaires en croissance constante, par l'utilisation intensive de la planche à billets, ils tentent de créer des marchés artificiels pour remplacer ceux qui se dérobent à la production nationale. De plus en plus, les monnaies deviennent des monnaies de singe, des reconnaissances de dettes émises par des Etats qui ne sont plus solvables eux-mêmes. Et cette monnaie de singe ne peut que perdre de sa valeur de façon croissante d'où l'augmentation de l'inflation.
Quand elles tentent de limiter ce phénomène les politiques économiques n'aboutissent en fin de compte qu'à entraîner la récession : en essayant d’hypothéquer un peu moins l'avenir, on comprimait encore plus le présent. On connaît le résultat du "traitement de choc" de Mme Thatcher qui a fait augmenter le chômage de 68% en 1 an jusqu’à dépasser les 3 millions (chiffre plus élevé que dans les années 30) La potion Reagan aussi a fait merveille : 9 millions de chômeurs, 8,4 de la population active en novembre 81 (Reagan s'était engagé à ne pas dépasser les 8%). Quant à l'élixir Schmidt il a également fait ses preuves : augmentation du chômage de 54% en un an.
En réalité, la bourgeoisie de tous les pays se trouve de plus en plus coincée entre les deux lames d'une paire de ciseaux : la récession et l'inflation. Et chaque tentative de se dégager d'un des fléaux aboutit à se heurter à l'autre sans qu'on ait réussi pour autant à échapper au premier. Ainsi, Reagan avait-il, parmi ses nombreuses promesses, annoncé une réduction à 42,5 milliards de dollars du déficit budgétaire pour l'exercice 1981-82 : on envisage maintenant un chiffre de l'ordre de 100 milliards pour cet exercice, 125 milliards et 145 milliards pour les deux suivants.
On pourrait ainsi multiplier les chiffres qui, tous, aboutiraient à mettre en évidence l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. En fait, le simple bon sens suffit à constater qu'il n'y a pas de solution à la crise de ce système : si les conditions qui existaient aux cours des années 65-69 ont abouti aux conditions dégradées des années 70-74 (voir tableau n°4), si ces dernières ont abouti aux conditions encore plus mauvaises des années 75-79, on ne voit pas comment, ni par quel miracle, les choses pourraient d'un seul coup s'améliorer.
Déjà en 1974, dans un accès de lucidité, le président français d'alors, Giscard-d'Estaing, déclarait-il : "Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que, s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe" (24-10-74).
Plus récemment, l'OCDE, dans ses "Perspectives économiques" de juillet 1981, donnait un exemple touchant de cette angoisse qui étreint la bourgeoisie quand elle regarde son futur. Echaudé par des années de prévision qui s'étaient révélées trop optimistes, se refusant à sonder avec lucidité l'avenir économique du monde par peur de "découvrir qu'il va à la catastrophe", cet organisme, sérieux s'il en est, écrivait :
"Dans la plupart des pays, les perspectives immédiates sont complexes et difficiles... Les prévisions ne peuvent jamais être tenues pour sûres. Même les comportements, dont la régularité, base même de toutes les prévisions, paraît bien établie, peuvent se modifier, quelquefois très brutalement. .. Si, comme cela arrive souvent, les nombreuses hypothèses sur lesquelles les prévisions sont fondées ne se réalisent pas, 1'avenir peut se présenter de façon très différente..."
En clair, l'OCDE avouait qu'elle ne servait plus à rien ... Cette incapacité de la bourgeoisie de prévoir son avenir est la traduction du fait que c'est une classe qui n'a plus aucun avenir à proposer à l'humanité sinon, celui d'un holocauste généralisé.
L'avenir de l'humanité, seule la classe ouvrière peut le mettre en œuvre. C'est pour cela qu'elle seule est capable, notamment avec ses courants révolutionnaires qui s'appuient fermement sur la théorie marxiste, de comprendre les perspectives du monde actuel. C'est pour cela que, sans disposer d'aucun des énormes moyens d'étude et d'investigation mobilisés par la bourgeoisie, les révolutionnaires pouvaient écrire, dès 1972 :
"(...) la crise qui s'annonce est bien du type de celles qui ont plongé le monde du XXème siècle dans les plus grandes catastrophes et barbaries de son histoire. Ce n'est pas une crise de croissance comme celles du siècle dernier mais bien une crise de 1 'agonie.
Sans vouloir faire de pronostics sur le délai, on peut donc tracer ainsi les perspectives du monde capitaliste :
- ralentissement massif des échanges internationaux
- guerres commerciales entre les différents pays
- mise en place de mesures protectionnistes, et éclatement des unions douanières (CEE, etc..)
- retour à l'autarcie
- chute de la production
- augmentation massive du chômage
- baisse des salaires réels des travailleurs".
("Révolution Internationale" Ancienne Série n°7, mars-avril 72)
C'est pour les mêmes raisons que, dès 1968, alors que personne ne parlait encore de crise, les révolutionnaires écrivaient déjà :
"L'année 67 nous a laissé la chute de la Livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson, la lutte inter-capitaliste s 'aiguise rendant chaque jour plus réelle la menace de guerre mondiale, voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière 1'ivresse du "progrès" qui avait succédé à la Seconde Guerre Mondiale (...) Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les événements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement conscients et sûrs, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de 1'arrêter avec des réformes, des dévaluations ni aucun autre type de mesures économiques capitalistes et qu'il mène directement à la crise".
("Internacionalismo", janvier 1968. Publication du CCI au Venezuela)
LA REPONSE BOURGEOISE A LA CRISE
De plus en plus, la bourgeoisie tire des traites sur l'avenir. Elle le fait par un endettement vertigineux, par l'inflation. Mais sa fuite en avant ne se limite pas au plan économique. Comme par le passé, au fond du gouffre économique, il y a la guerre impérialiste généralisée. Aussi sûrement, que la grande crise des années 30 a conduit à la 2ème guerre mondiale, la crise actuelle pousse le capitalisme vers un 3ème holocauste.
La menace de guerre n'est plus à démontrer, elle est de plus en plus présente dans les préoccupations quotidiennes de la grande majorité de la population. Elle est inscrite dans l'énorme accélération des efforts d'armements de tous les pays et notamment du pays le plus puissant. Présentant le programme militaire de ce pays, Reagan déclarait le 2 octobre : "Depuis Eisenhower, aucune administration américaine n'avait présenté un projet nucléaire de cette envergure". Elle se manifeste par la mise au point et l'installation de nouvelles armes de plus en plus perfectionnées : bombardier "Backfire" et SS 20 du côté russe; bombe à neutrons et "cruise-missiles", fusées Pershing 2 du côté américain. Elle est révélée par le fait que, de plus en plus, c'est l'Europe, c'est à dire le théâtre central des deux guerres mondiales précédentes qui devient le terrain privilégié des préparatifs militaires : la controverse actuelle ainsi que les négociations russo-américaines de Genève sur les "Euromissiles" l'illustrent bien. De même que la crise a d'abord frappé avec violence les pays de la périphérie du capitalisme avant de déferler sur ses métropoles, la guerre, qui pendant longtemps a réservé ses ravages aux pays du Tiers-Monde (extrême Orient, Moyen-Orient, Afrique) étend maintenant sa menace vers ces métropoles.
Mais les préparatifs pour un troisième holocauste ne se situent pas uniquement sur le plan de l'accumulation d'armements. Ils passent aussi par un resserrement des rangs des différents pays autour des leaders de leurs blocs respectifs. C'est particulièrement net du côté occidental où, malgré toutes les déclarations et campagnes des différents partis, les gouvernements sont amenés à s'aligner sur les positions américaines. Par exemple, Schmidt semblait agir en franc-tireur et désobéir aux consignes américaines. En réalité, sa rencontre avec Brejnev du 22 novembre n'a pas été une occasion de faire des infidélités à son bloc de tutelle. Bien au contraire : les positions qu'il a prises lors de cette rencontre lui ont même valu les félicitations de l'opposition de droite au Bundestag.
Mitterrand, pour sa part, s'est donné des grands airs d’indépendance par rapport aux USA en ce qui concerne le Tiers-Monde. Au sommet Nord-Sud de Cancun, il a fait, contre les positions de Reagan, son numéro en faveur de "négociations globales" entre les pays développés et les pays sous-développés pour que les premiers viennent en aide aux seconds. Deux jours avant, à Mexico, il avait prononcé un grand discours emphatique, préparé par son conseiller Régis Debray (ex-admirateur de "Che" Guevara), dans lequel il s'adressait à "ceux qui prennent le les armes pour défendre les libertés", "à tous les combattants de la liberté", pour leur dire "Courage, la liberté vaincra"!
Ces déclarations, de même que la reconnaissance des mouvements de guérilla du Salvador, apparaissaient comme des pavés dans la mare de la politique américaine. En réalité, il s'agissait d'un simple partage des tâches au sein du bloc occidental entre ceux qui parlent fort et utilisent le langage de l'intimidation (et c'est celui qui aujourd'hui prime à l'égard du Tiers-Monde et ceux qui ont pour tâche spécifique de permettre au bloc occidental de contrôler les mouvements d'opposition et de guérilla, et d'empêcher qu'ils ne basculent du côté russe.
Depuis longtemps déjà, le bloc américain a délégué à 1'impérialisme français la responsabilité du maintien de l'ordre Sans certaines zones du Tiers-Monde. Mitterrand a repris de Giscard la tâche d'être le gendarme de l'Afrique (comme on a pu le voir récemment avec le Tchad). Compte-tenu de son profil "humaniste" et "socialiste", il a reçu en plus mandat, en compagnie de son acolyte mexicain, Lopez Portillo, d'être le "public-relations" de ce bloc à l'égard des mouvements bourgeois qui luttent contre les régimes militaires d'Amérique Latine.
Mais la véritable nature des liens qui unissent l'impérialisme français au bloc américain ne s'exprime pas dans ces déclarations "déviantes". Elle se révèle bien plus dans d'autres déclarations de Mitterrand, à la suite de la rencontre avec Reagan à Yorktown, le 18 octobre :
"Il s'agissait de bonnes conversations. Entre amis, le dialogue est facile. Nous avons la franchise de vieux amis qui peuvent tout se dire sans rien détruire" et Mitterrand a souligné "la bonne santé de 1'amitié franco-américaine, qui n'est pas menacée par les divergences".
La thèse souvent agitée dans les médias bourgeois d'une montée du neutralisme (et qui trouve son pendant avec la thèse chère au groupe du PIC et de Volonté Communiste de "l'effritement des blocs") n'est fondamentalement qu'un argument de propagande destiné à permettre la poursuite du raffermissement des liens au sein du bloc occidental face à la tension impérialiste avec le bloc russe.
Une dernière illustration de cette tendance au renforcement du bloc occidental a été donnée par l'assassinat de Sadate dans lequel on a voulu voir, propagande oblige, "la main de Moscou". En réalité, la mort de Sadate a arrangé les affaires du bloc occidental. D'une part, elle a permis le remplacement d'un dirigeant de plus en plus impopulaire qui affrontait un mécontentement social croissant et dont le maintien risquait d'aboutir à une situation à l'iranienne. D'autre part, elle a ouvert la voie, comme l'a déclaré crument Cheysson, ministre français des relations extérieures, à un rapprochement entre les pays arabes, et notamment entre les deux plus puissants, l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Et cette reconstitution de l'unité arabe, défaite depuis les accords de Camp David, et qui ne peut se réaliser que sous l'égide américaine, constitue bien un des fers de lance de l'impérialisme occidental dans cette région du monde face à l'instabilité iranienne et la percée russe en Afghanistan. S'il y a "la main de quelqu'un" derrière les extrémistes religieux qui ont commis l'attentat, ce n'est certainement pas celle du KGB mais bien celle de la CIA qui avait, par ailleurs, la responsabilité du dispositif de sécurité de Sadate.
L'assassinat de Sadate a été présenté comme une "atteinte à la paix". En un sens, c'est vrai, mais pour des raisons totalement opposées à celles que présente la propagande occidentale. Si cet événement participe à la marche vers la guerre, ce n'est pas parce que Sadate était "l'homme de la paix": il ne l'a jamais été, ni en 73 quand il a pris l'initiative de la guerre contre Israël, ni à Camp David, dans le cadre d'une "Pax Americana" destinée à renforcer les positions politiques et militaires de l'occident au Moyen-Orient. La mort de Sadate s'inscrit dans les préparatifs de guerre en ce sens qu'elle ouvre la voie à l'établissement d'une paix au Moyen-Orient. Et comme toujours par le passé, dans le capitalisme décadent, la paix en un endroit du monde n'est pas autre chose que le moyen de préparer ailleurs une guerre encore plus étendue et plus meurtrière.
C'est là une cruelle réalité du monde actuel, la paix et les paroles de paix n'ont d'autres fonctions que de préparer la guerre. C'est ce qui se manifeste en ce moment même avec les énormes campagnes pacifistes qui se déchaînent en Europe occidentale.
L'histoire nous enseigne que les guerres mondiales ont toujours été préparées par des campagnes pacifistes. Déjà avant 1914, l'aile réformiste de la Social-démocratie, notamment sous la conduite de Jaurès, avait fait tout un battage pacifiste : ce fut pour mieux appeler les ouvriers à la guerre en août 1914 au nom de "la défense de la civilisation", cette "civilisation" qu'on se proposait de préserver auparavant en manifestant pour la paix. Si Jaurès, assassiné à la veille de la guerre, n'a pas eu l'occasion de faire ce dernier pas de sa démarche, par contre Léon Jouhaux, dirigeant de la CGT, qui avait été en première ligne pour les campagnes pacifistes, s'est retrouvé, pour sa part, au gouvernement d'Union Nationale. Dès avant 1914, le pacifisme, promu par les réformistes, fut donc un des moyens employés par le capitalisme pour jeter le prolétariat pieds et poings liés dans la boucherie impérialiste.
De même en 1934, sous l'égide des partis staliniens et de leurs "compagnons de route", avec la participation des socialistes et l'adhésion enthousiaste des trotskystes (et même des anarchistes), le mouvement Amsterdam-Pleyel (du nom du lieu où s'étaient tenues les deux conférences qui avaient préparé l'action) s'était donné comme objectif la lutte pour la paix. Ce mouvement aboutira aux "Fronts Populaires" contre le fascisme (considéré comme le principal fauteur de guerre) et aura été un des moyens de mobilisation du prolétariat pour la 2ème guerre mondiale.
La même manœuvre sera rééditée au début des années 50, lorsque la "guerre froide" apparaît comme la prémisse à une 3ème guerre mondiale. A la suite de "l'appel de Stockholm" contre l'armement atomique, les partis staliniens développent une énorme campagne de signatures "pour la paix" qui obtient un succès non négligeable (à tel point que les prostituées surprises en train de racoler des clients se défendent en affirmant qu'elles leur proposaient de signer la pétition pacifiste !). Si cette fois là, les tensions n'avaient pas abouti à une nouvelle guerre mondiale, les méthodes pour la préparer avaient, de nouveau, été mises en œuvre.
Pourquoi les campagnes pacifistes précèdent-elles toujours les guerres ?
En premier lieu, en se proposant de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils "sauvegardent la paix", ou "renoncent aux armements", elles accréditent l'idée que ces gouvernements ont le choix entre plusieurs politiques, que la guerre impérialiste n'est pas un mal inévitable que porte le capitalisme décadent, mais résulte d'une politique "belliciste" de tel ou tel secteur de la bourgeoisie, A partir d'une telle idée, quand elle est bien ancrée dans la tête des prolétaires, on peut ensuite les convaincre que c'est la bourgeoisie de "l'autre pays" qui est "belliciste", qui "veut la guerre", et que, par conséquent, il faut faire 1' "union sacrée" pour la combattre et l'empêcher de sévir. C'est comme cela qu'en 1914, les socialistes français ont appelé à la lutte contre le "militarisme prussien", les socialistes allemands au combat contre "le tsarisme et ses alliés". C'est comme cela que staliniens et sociaux-démocrates ont préparé la croisade "antifasciste" de la 2ème guerre mondiale.
En second lieu, les campagnes pacifistes, en ce sens qu'elles rassemblent tous les citoyens qui sont "contre la guerre", tendant à nier les différences et les antagonismes de classe. Ce faisant, elles canalisent et diluent la combativité prolétarienne dans un magma interclassiste, où se retrouvent tous les "hommes de bonne volonté" mais où le prolétariat perd de vue ses intérêts de classe. Elles sont donc un barrage redoutable contre la lutte de classe qui constitue le seul obstacle réel qui puisse entraver la marche vers l'issue bourgeoise aux contradictions du capitalisme : la guerre impéria1iste généralisée.
C'est pour ces raisons qu'avant et pendant la première guerre mondiale (notamment sous la conduite de Lénine) les révolutionnaires ont combattu le pacifisme, ont opposé aux mots d'ordre réformistes le mot d'ordre révolutionnaire de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" et ont expliqué que le fléau de la guerre ne pourrait disparaître qu'avec le capitalisme lui-même. De même, entre les deux guerres et pendant la seconde guerre mondiale, seuls sont restés sur un terrain de classe les groupes et fractions qui ont maintenu cette position contre les pacifistes d'alors.
Les campagnes pacifistes d'aujourd'hui ont exactement la même fonction que celles du passé. Elles prennent la suite des campagnes précédentes de "défense des droits de l'homme" promues par Carter et de "défense du monde libre" promues par Reagan. Mais alors que les précédentes avaient en grande partie échoué, les campagnes pacifistes rencontrent un succès bien plus grand car elles s'appuient sur une inquiétude réelle qui a saisi les populations notamment en Europe occidentale. Pour l'heure, elles ne sont pas directement dirigées contre l'URSS comme l'étaient les précédentes. En certains endroits, elles bénéficient même de l'appui du bloc de l'Est via les partis staliniens. Mais même si, pour le moment, elles se donnent pour cible principale la politique militaire du bloc de l'Ouest (notamment les fusées Pershing, les Cruise missiles et la bombe à neutrons), c'est d'une importance secondaire car elles ne sont qu'une première étape dans l'opération de mobilisation du prolétariat d'occident derrière son bloc. Le moment venu, il sera temps de mettre en évidence que le véritable danger pour la paix c'est "l'autre", le bloc de l'Est. Pour l'heure, ce qu'il s'agit surtout d'obtenir, c'est que le prolétariat cesse d'apparaitre comme une force autonome dans la société comme il a recommencé à le faire, notamment depuis les grèves de Pologne.
Ce qui importe le plus à la bourgeoisie, c'est que les ouvriers soient incapables de comprendre le lien qui existe entre les luttes qu'ils sont conduits à mener contre l'austérité et la lutte contre la menace de guerre. Rien n'inquiète plus la classe capitaliste qu'une prise de conscience par le prolétariat du véritable enjeu de ses combats, du fait que ceux-ci n'ont pas seulement de sens par rapport aux revendications économiques qui les motivent, mais sont un réel obstacle aux préparatifs bourgeois pour la guerre impérialiste, constituent des préparatifs de la classe en vue du renversement du capitalisme.
Les campagnes pacifistes sont donc un rideau de fumée destiné à dévoyer la classe ouvrière, à l'entrainer sur un terrain qui n'est pas le sien, à enfermer ses luttes sur le strict terrain économique. Elles visent à désamorcer le resurgissement de la lutte de classe et, de ce fait, à détruire le seul véritable obstacle que rencontre le capitalisme sur le chemin de la guerre impérialiste généralisée.
Le rôle des révolutionnaires est de les dénoncer comme telles.
QUELLES PERSPECTIVES POUR LA CLASSE OUVRIERE
Parce qu'elle menace les fondements mêmes de la société d'exploitation, et non tel ou tel secteur de celle-ci, parce qu'elle oblige de ce fait la bourgeoisie mondiale à resserrer les rangs, la lutte de la classe ouvrière constitue la seule force dans la société capable d'enrayer l'engrenage de la guerre impérialiste. C'est ce qu'on a pu constater une nouvelle fois au cours de l'année .1980. La première partie de cette année a été dominée, suite à l'invasion de l'Afghanistan, par une aggravation sans précédents des tensions entre blocs. Par contre, dès que surgissent les grèves de masse en Pologne, le panorama de la situation se transforme.
L'escalade de la propagande belliciste s'interrompt pour un temps, et avant même son investiture, Reagan envoie, en novembre 80 son ambassadeur personnel, Percy, reprendre avec le gouvernement russe un contact interrompu depuis la fin 1979. Si les diatribes américaines se poursuivent néanmoins à propos de la Pologne, elles ont une toute autre signification que celles qui avaient suivi l'invasion de l'Afghanistan. Certes, et c'est toujours bon à prendre, on continue à présenter auprès de l'opinion occidentale l'URSS comme le "méchant", celui qui en veut à "l'indépendance du peuple polonais". Mais la fonction essentielle des mises en garde américaines à l'URSS contre toute velléité d'intervention en Pologne est justement de rendre crédible cette menace auprès des ouvriers polonais et de les inciter à la "modération".
Face au prolétariat de Pologne, on a assisté à la constitution d'une Sainte Alliance de toute la bourgeoisie mondiale qui s'est répartie les tâches tant à l'extérieur (bloc de l'Ouest et bloc de l'Est) qu'à l'intérieur (POUP et "Solidarité") afin d'isoler le prolétariat et de venir à bout de sa lutte ([4] [283]). C'est pour cela que la question de la généralisation mondiale des combats prolétariens est devenue si fondamentale comme nous l'avons souligné souvent dans ces colonnes ([5] [284]).
Faute d'une telle généralisation, on peut constater aujourd'hui comment, progressivement, la bourgeoisie reprend le terrain qu'elle avait du céder au mois d'août 80. En décidant le 2 décembre d'employer la force contre les élèves pompiers en grève (6000 policiers des forces antiémeutes contre 300 étudiants), les autorités polonaises ont marqué un nouveau point contre la classe ouvrière. Le processus de reprise en main remonte à février 81 avec la nomination du général Jaruzelski à la tête du gouvernement. Il se déploie en mars avec l'affaire des violences policières de Bydgoszcz où c'est de façon délibérée que les autorités provoquent la classe ouvrière (même si Walesa se plait à présenter ces violences comme un "complot contre Jaruzelski")afin de pouvoir lui infliger la première gifle qui doit inaugurer la mise au pas. Cette gifle, ce n'est d'ailleurs pas tant le gouvernement qui l'assène mais "Solidarité" qui, après tout un battage sur la grève d'avertissement de 4 heures et la préparation d'une grève générale illimitée, signe avec le gouvernement un compromis en forme de capitulation et le fait avaler aux travailleurs.
Cette reprise en main s'est poursuivie par la nomination en octobre de Jaruzelski au poste de 1er secrétaire du POUP. Désormais ce général cumule trois postes clé : la direction du parti, du gouvernement et de l'armée. Et comme après sa nomination de février, celle d'octobre est suivie (cette fois sous sa responsabilité explicite) d'une nouvelle apparition brutale et bien plus massive de la police.
Aujourd'hui encore, il revient à "Solidarité" de dévoyer, par un langage radical s'il le faut, le mécontentement ouvrier qui s'accumule tant contre la contre-offensive gouvernementale que contre des conditions d'existence qui n'ont jamais été aussi catastrophiques. Ainsi, le 7 décembre, le gouvernement se paye le luxe de diffuser de façon répétée des propos radicaux tenus par Walesa lors de la réunion des dirigeants de Solidarité du 3 décembre, à la suite de l'intervention de la police :
"Je n'ai plus d'illusions, les choses sont allées si loin qu'il faut tout dire aux gens, leur dire quel est l'enjeu, que ce n'est rien de moins que de changer la réalité. Aucun changement de système ne peut se faire sans casse. L'essentiel est d'être vainqueur. "
Le but de la manœuvre gouvernementale est évident : intimider la population en laissant planer la menace de graves répercussions à de tels propos. L'autre but de cette opération est de redorer le blason de Walesa auprès des ouvriers les plus combatifs, car le gouvernement aura encore besoin de lui pour les calmer le moment venu.
La stratégie de la bourgeoisie est claire. Elle consiste à acculer le prolétariat à l'alternative : capituler ou engager une épreuve de force frontale qu'il sait perdue compte-tenu de son isolement présent.
C'est pour cela que la généralisation des combats de classe apparaît chaque jour plus comme une nécessité impérieuse.
Pour l'heure, cette généralisation tarde à venir. En Europe de l'Est, on a pu constater une montée de la combativité là où la crise frappe le plus violemment les ouvriers: La Roumanie (dont le gouvernement reprend à son compte la campagne pacifiste d'occident!). Cette combativité ne pourra s'exprimer pleinement dans tous les pays, tant à l'Ouest qu'à l'Est, que lorsque la pression économique sera devenue intolérable pour les masses ouvrières. Partout, avec l'aggravation de la crise, cette pression se développe. Mais dans un premier temps, elle a tendance à provoquer une plus grande passivité du prolétariat (bien que la signification de tels chiffres soit toujours à examiner avec précaution, les statistiques mettent en évidence pour 1980 et le début 81 une baisse presque générale en Europe occidentale et aux USA du nombre des conflits sociaux et des jours perdus pour faits de grève). Ce n'est pas là un signe que le prolétariat aurait déjà perdu la partie (quoique si cette passivité se prolonge une telle issue deviendrait menaçante). C'est plutôt la manifestation d'une prise de conscience diffuse au sein de la classe de l'importance de l'enjeu de ses prochaines luttes, de l'ampleur des tâches qui l'attendent.
Si aujourd'hui le prolétariat hésite encore, c'est qu'il est en train de se rendre compte qu'il est entré dans les "années de vérité".
F.M. 8-12-81
[1] [285] Richard Nixon, discours prononcé à son "inauguration" en janvier1969).
[2] [286] "La révolution trahie", chapitre 1er, section 1ère.
[3] [287] Le développement de nouvelles techniques dans le domaine de 1'automation n'empêche pas cependant certains pays comme les USA de connaître un ralentissement dans les gains de productivité et même, à certains moments, un recul de celle-ci. Il ne faut pas voir là "un échec de la technique", mais un effet de la crise elle-même qui vient amoindrir les taux d'utilisation du potentiel industriel et ralentir l'investissement productif (par manque de débouchés solvables). C'est ce que constate 1'OCDE dans son langage aseptisé ".un des objectifs essentiels des politiques gouvernementales doit être de créer un environnement dans lequel les stimulants du marché incitent les firmes à améliorer leur capacité d'innovation et leurs performances bien évidemment, le renouvellement technologique que l'on préconise ne peut avoir lieu qu'en présence de conditions économiques favorables. Or les perspectives actuelles n'encouragent pas à faire le saut de l'innovation. Il y a donc un grand risque que les entreprises n'innovent pas à un rythme suffisant, préférant attendre que le climat des affaires se stabilise. "
(Les Enjeux des transferts de technologie Nord-Sud. OCDE. Paris 1981) Ainsi, en s'aggravant, la crise vient saper les bases de ce qui avait permis au capitalisme d'en masquer pour un temps la profondeur.
[4] [288] voir nos différents articles dans les Revues Internationales n°23, 24, 25
[5] [289] voir notamment les textes du 4ème Congrès du CCI dans la Revue Internationale n°26
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Lutte de classe en Europe de l'est (1970-1980)
- 3928 reads
La première partie de cet article est parue dans la REVUE INTERNATIONALE n°27. Cette deuxième partie reprend 1'évolution de la lutte de classes dans les pays de 1'Est à partir de la reprise mondiale de la fin des années 1960, et jusqu'aux événements de la fin des années 1970, notamment les événements de 1976 en Pologne. La dernière partie, qui paraîtra dans le prochain n° de cette revue traitera de la reprise mondiale de la lutte inaugurée par les événements de Pologne de 1980.
L'importance de la vague révolutionnaire de 1917-23, et même de la vague de lutte de classe qui a parcouru l'Europe de l'Est en 1953-56, a montré le potentiel qui existait pour l'internationalisation de la lutte prolétarienne, pour la constitution véritable de la classe ouvrière en force révolutionnaire unique, unifiée à l'échelle mondiale. Mais comme nous l'avons vu dans la première partie de cet article (voir Revue Internationale n° 27), ce potentiel n'a pas pu se réaliser à cette époque. Ces mouvements de classe de millions d'ouvriers ont été brisés par leur isolement à l'échelle mondiale. Comme nous l'avons vu, l'histoire des grands soulèvements de l'Europe de l'Est et du centre, des années 1920 aux années 50, est avant tout l'histoire de leur isolement du reste du prolétariat. Ce fut le résultat, en plus des obstacles permanents que le capitalisme impose à la classe ouvrière (usines, branches d'industrie, nations, etc.) d'un changement global du rapport de forces entre les classes en faveur de la bourgeoisie, qui a déterminé l'ensemble du développement de la lutte de classe durant six décennies. Le moment décisif de ce processus fut l'incapacité du prolétariat à empêcher l'explosion de la première guerre mondiale. Le résultat de cette défaite sans précédent que fut août 1914, fut de laisser le champ libre à la barbarie du capitalisme décadent, à la guerre impérialiste qui divisa le prolétariat en plein milieu. La tendance du capitalisme dans cette période de déclin n'est pas seulement de renforcer l'unité de chaque capital national autour de l'Etat, mais aussi de diviser le monde en deux grands camps guerriers impérialistes. Le résultat, pour le prolétariat, qui ne fut pas assez fort pour affronter et détruire ce système avant que celui-ci ne s'effondre dans la barbarie, fut que les organisations, les leçons politiques, les traditions de lutte de la classe ouvrière furent noyées dans un océan de sang et de misère.
Comme nous l'avons vu dans la première partie, la vague révolutionnaire fut principalement limitée aux pays défaits de la première guerre mondiale, tandis que les luttes des années 50 émergeant du massacre de 1939-45 restèrent au sein du bloc russe, qui dut concentrer brutalement ses forces et attaquer frontalement le prolétariat pour tenter de maintenir la paix avec le bloc américain, et ainsi bénéficier péniblement du boom de la reconstruction d'après-guerre, Les conséquences de cet isolement international de parties combatives du prolétariat, imposé par les divisions mêmes de l'impérialisme, sont extrêmement graves :
- il devient impossible pour le prolétariat comme un tout de simplement commencer à s'attaquer aux racines du système d'exploitation contre lequel il combat, car ceci ne peut se faire qu'à 1'échelle mondiale ;
- la puissance de la bourgeoisie mondiale reste intacte, elle est dirigée contre le prolétariat de façon unifiée et coordonnée ;
- la classe ouvrière est entravée dans sa pleine compréhension des tâches de la période, car une conscience révolutionnaire est précisément basée sur la compréhension que les expériences quotidiennes de lutte (les défaites organisées par les syndicats, la réalité brutale derrière le masque de la démocratie, etc...), font partie des mêmes conditions des ouvriers, partout, son indissolublement liées et convergent vers la nécessité de détruire le système à l'échelle mondiale. Cette perspective profonde ne peut être le produit que des luttes des ouvriers à l'échelle mondiale, qui se trouvent dans les mêmes conditions, avec les mêmes tâches, et le même ennemi partout. C'est au creuset de la généralisation mondiale des luttes que l'unité internationale du prolétariat se forgera.
Dans cette deuxième partie de cet article, nous examinerons le développement de la lutte prolétarienne dans les années 70 jusqu'aux années 80. C'est la fin de la contre-révolution, le commencement d'un resurgissement international du combat prolétarien. C'est la fin de l'isolement des ouvriers de l'Est. C'est la période du redressement du rapport de forces global entre les classes, qui depuis plus d'un demi-siècle, était resté en faveur du capitalisme. Pour la première fois, la période qui s'ouvre est une période de généralisation simultanée de la crise économique, et de la résistance prolétarienne dans toute la planète. La réponse internationale du prolétariat a forcé la bourgeoisie mondiale à unifier ses forces, à se préparer à affronter et à défaire les ouvriers pour ouvrir la voie à sa propre "solution" à la crise, la guerre mondiale. Dans ce sens, en bloquant la voie à la guerre impérialiste, en faisant surgir le spectre de la révolution prolétarienne, la classe ouvrière a progressivement repoussé et résorbé la division dans ses rangs, imposée par deux guerres impérialistes. La dernière décade a montré que les conditions de la lutte des ouvriers, et la réponse de la bourgeoisie, s'unifient de plus en plus. C'est un monde qui se dirige, non vers la guerre, mais vers la guerre de classe mondiale.
LES CONDITIONS DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LES "PARADIS SOCIALISTES"
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la vie quotidienne pour les ouvriers en Europe de l'Est ressemble à un monde en état de guerre permanente. La croyance naïve de la classe ouvrière d'Europe de l'Est dans la possibilité d'une vie meilleure sous le capitalisme est un bon exemple du fait que, â l'époque du capitalisme mondial, les conditions qui prévalent au niveau global, sont plus importantes pour déterminer l'état de conscience de la classe dans n'importe quelle région du globe que ne le sont les conditions spécifiques prévalant dans la région. Il n'y avait rien dans la vie quotidienne des ouvriers de l’Est pour nourrir des illusions sur la nature progressiste de "leur" régime. Ils devaient souffrir de faim pour qu'on puisse construire des tanks. Ils devaient faire la queue des heures durant pour les choses les plus élémentaires. Toute protestation, toute résistance de classe, était considérée comme une mutinerie et traitée comme telle. Dans un monde encore dominé par l'antagonisme entre blocs impérialistes rivaux, et non par la bataille entre classes, les illusions des ouvriers -particulièrement à l'Est- portaient par dessus tout sur les conditions dans 1'AUTRE bloc. Les illusions à l'Ouest dans la nature progressiste de l'Est "socialiste" et les illusions à l'Est sur la nature paradisiaque et permanente de la reconstruction occidentale d'après-guerre, avec l'espoir pour les ouvriers que "leur" bourgeoisie y arriverait tôt ou tard, étaient les deux faces d'une même pièce. C'était une période où les conditions de lutte dans les deux blocs étaient radicalement différentes, ce qui accréditait le mythe que deux systèmes sociaux opposés étaient à l'œuvre à l'Est et à l'Ouest. A l'Ouest, on déclarait que la lutte de classe était dépassée. A l'Est, où elle était supposée ne plus exister non plus, c'était plus difficile à cacher. Les luttes y étaient explosives mais isolées, et pouvaient être présentées aux ouvriers à l'Ouest comme des mouvements de libération nationale ou comme des réactions aux imperfections d'un socialisme authentique. Pour l'Est comme pour l'Ouest, la crise du bloc russe était devenue si lourde et si permanente qu'il était possible pour la bourgeoisie mondiale de déclarer : "Ce n'est pas la crise, c'est le socialisme" !
L'AUTARCIE ET L'ECONOMIE DE GUERRE
C'est seulement par une sévère autarcie que les pays du bloc russe ont pu empêcher de tomber eux-mêmes sous le contrôle du bloc américain. Ce contrôle direct et illimité de l'économie et du commerce extérieur exercé par l'Etat dans ces pays, les restrictions dans l'investissement direct de capital de l'Ouest, dans le commerce Est-Ouest, dans le mouvement de main-d’œuvre, etc. ne sont pas du tout des preuves de la nature non-capitaliste du COMECON, comme le prétendent les trotskysmes. Elles servent exclusivement à la préservation du bloc russe contre la domination occidentale.
En étant contraints de s'isoler eux-mêmes des principaux centres du capitalisme mondial, les capitaux nationaux de l'Est, déjà non compétitifs, ont accentué leur retard technologique par rapport à l'Ouest. Leur perte progressive de compétitivité signifie qu'ils ne peuvent réaliser qu'une partie de leur capital investi sur le "marché mondial". La plus grande partie des marchandises produites par la COMECON est vendue à l'intérieur de ses frontières. Comme pour tout capitaliste individuel qui doit acheter ses propres produits parce qu'il ne trouve personne d'autre pour les prendre, les lois du capitalisme dictent au bloc russe d'entrer tôt ou tard sur le marché. Au niveau du capital national et des blocs impérialistes, le verdict de faillite ne tombe qu'avec le surgissement de la guerre mondiale impérialiste.
Pour éviter ce verdict de l'histoire, la bourgeoisie d'Europe de l'Est doit essayer de faire face à l'Ouest sur le niveau MILITAIRE. Pour ce faire, elle doit investir une beaucoup plus forte proportion de sa richesse dans le secteur militaire que la bourgeoisie de l'Ouest. En se basant pendant des années sur l'autarcie derrière les lignes tracées à Yalta et Potsdam, les "pays socialistes" ont été capables de réaliser des taux de croissance spectaculaires pendant les années 1950 et 1960. Mais à part dans le domaine militaire, il n'y a eu que peu de croissance réelle, juste une pléthore de biens industriels souvent inutilisables qui à l'Ouest ne trouveraient un marché qu'au rebut.
Dans les années 1970, le COMECON a commencé à s'ouvrir un peu plus vers l'Ouest. Ce ne fut pas, comme le disent les trotskystes, pour élever le niveau de vie des ouvriers. Ce ne fut pas non plus, comme beaucoup de politiciens occidentaux l'ont cru à l'époque, une capitulation du Kremlin face à l'argent occidental. L'ouverture était sensée bannir le danger d'une guerre mondiale, et ouvrir une nouvelle ère d'expansion économique. Pour les ouvriers de l'Est, cette modernisation signifia un accroissement temporaire de la fourniture de biens de consommation, et augmenta les possibilités de visiter ou même de travailler à l'Ouest. La Pologne, qui possédait et qui possède encore de grandes réserves de charbon, une ouverture maritime non prise par les glaces et de larges réserves de force de travail bon marché sous-employées dans l'agriculture, fut spécialement choisie par le Kremlin pour devenir la force motrice de cette modernisation. C'est pourquoi la Pologne devint le point central de la contradiction entre les fausses illusions nourries par, d'un côté, la modernisation, et, d'un autre côté, l'accélération de l'économie de guerre. Elle devint ainsi le centre le plus important du développement de la lutte de classe pendant plus d'une décade.
Les années 1970 ont vu apparaître les premières brèches dans les illusions concernant l'Ouest, à cause de l'accroissement de la crise et de la lutte de classe. Néanmoins, cette décade a été caractérisée avant tout par la chute des conditions de vie des ouvriers accompagnée d'un renforcement des illusions sur un futur de paix et de prospérité. Cette contradiction explosive entre illusion et réalité surgit à la surface après le tournant de l'économie mondiale de la fin des années 1970. Les premiers fruits dans les années 80, les années de vérité, ont été les grèves de masse en Pologne et l'écho mondial que ces luttes ont rencontré.
LES "ACQUIS D'OCTOBRE"
Que ce soit à l'Est comme à l'Ouest, il ne manque pas de défenseurs des "acquis de la révolution d'Octobre" dont sont supposés jouir les ouvriers du bloc russe. Nous examinerons quelques uns de ces "acquis". Par exemple, la soi-disant élévation des salaires réels et baisse des heures de travail. En se basant sur les chiffres officiels et sur des sources telles que les propres mémoires de Nikita Kroutchev, Schwendtke et Ksikarlieff, qui viennent de cercles dissidents russes, calculent ceci :
"En un mot, que ce soit selon l'URSS ou l'information étrangère, le revenu moyen des ouvriers industriels en Russie avant la 1ère guerre mondiale peut être établi à 60 - 70 roubles par mois. Ceci signifie que les gains actuels, correspondant à la valeur nominale en roubles, sont deux fois plus hauts qu'avant la révolution, et ceci face aux prix qui sont 5 à 6 fois supérieurs, et donc, qu'aujourd'hui les ouvriers en URSS vivent deux fois et demie à trois fois moins bien qu'avant la révolution. Le nombre de jours de travail dans l'année, malgré l'introduction de la semaine de cinq jours, est plus fort qu'avant la révolution, et résulte des nombreuses fêtes religieuses qui étaient observées dans l'ancienne période. Alors qu'aujourd'hui, il y a huit jours fériés par an et que le nombre total de jours travaillés est de 252, l'année de travail avant la révolution n'était que de 237 jours, ce qui revient en fait à une semaine de travail moyenne de 4 jours 1/2... Si nous divisons le revenu mensuel -150 roubles soviétiques contre 70 roubles tsaristes- par le nombre de jours travaillés dans le mois (21 jours en URSS, 19,75 en Russie), nous obtenons un revenu quotidien de 7,14 roubles pour l'URSS et 3,54 pour la Russie. Voici maintenant les prix des plus importantes denrées alimentaires :
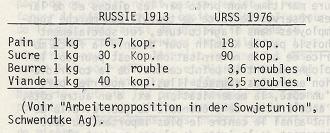
"Un guide des statistique du travail de l'URSS de 1967 montrait que plus de 20 % des ouvriers employés dans le secteur le mieux payé, l'industrie de la construction, se trouvaient au-dessous du seuil de pauvreté, et que plus de 60 % de ceux des industries les moins payées des industries textile et alimentaire se trouvaient au-dessous de ce seuil de pauvreté" ("The Soviet Working Class, Discontent and Opposition" Holubenko dans Critique).
Dans le bloc russe, les femmes travaillent presque toutes. L'Allemagne de l'Est par exemple a le plus haut taux de femmes employées dans l'industrie dans le monde. Elles jouent un rôle semblable à celui des ouvriers immigrés à l'Ouest,
en percevant en moyenne la moitié d'un salaire d'homme. Elles sont employées non seulement dans les usines, mais aussi sur les chantiers, dans la construction des routes et des chemins de fer, par exemple en Sibérie, etc. "Récemment, la route de Revda à Sverdlovsk a été élargie par la construction d'une deuxième voie. Ce travail physique extrêmement dur a été fourni à 90 % par des femmes. Elles ont travaillé à la pioche, à la pelle et à la barre à mine. En fait, les femmes des minorités nationales prédominent (Mordva, Tachunaschi, Marejer). Si à l'Ouest il est parfois possible de prendre un jeune homme pour une fille, à cause des vêtements et du style de coiffure, en Russie c'est le contraire, du fait des vêtements de travail sales, des mains, de la manière de marcher, de courir et de boire" (Schwendtke, P.62).
A notre avis, ces rapports sur la misère des conditions des ouvriers dans les "pays socialistes" tendent malgré tout à SOUS-ESTIMER la situation. Par exemple, les données de la journée de travail ci-dessus ignorent l'accroissement constant des heures supplémentaires -souvent NON PAYEES- obligatoires. En 1970, les ouvriers des docks Warskin à Stettin disaient avoir à effectuer plus de 80 heures supplémentaires par mois (voir "Rote Fahne liber Polen"). Et même si le niveau de vie est beaucoup plus bas en URSS, particulièrement dans les régions asiatiques, qu'en Europe de l'Est, les conséquences de l'austérité permanente n'ont pas épargné les ouvriers des pays satellites non plus :
"Une étude de la révolution et de ses causes publiée clandestinement en Hongrie au début de 1957 sous le pseudonyme de Hungaricus, montre à partir des statistiques hongroises officielles que le niveau des salaires réels est tombé de 20 % pendant les années de la construction socialiste de 1949 à 1953. Le salaire mensuel moyen était inférieur au prix d'un costume neuf, et la paye journalière d'un travailleur de ferme d'Etat était insuffisante pour acheter un kilo de viande. Bien sûr, la brochure d'Hungaricus ne prend en compte que 15 % des familles hongroises, qui vivaient sous le régime déclaré "niveau de vie minimum", avec 30 % qui l'atteignaient et 55 % qui vivaient au-dessous de ce niveau. Ceci signifiait que parmi les 15 % de familles de la classe ouvrière, tous les membres n'avaient pas de couverture pour dormir et 20 % des ouvriers n'avaient même pas de manteau d'hiver. Ce furent ces sans-manteaux, suggère Hungaricus, qui fournirent le gros des troupes qui affrontèrent les tanks russes en octobre 1956" (Comax, "The working class in the Hungarian Révolution of 1956). Il n'y a pas à chercher plus loin la cause principale de la vague de lutte de classe de 1953-56 !
Si on considère la fameuse "disparition du chômage" dans le bloc russe, on peut citer l'oppositionnel "Osteuropa" n°4, "Unterbeschafbigung un Arbeitslosigkeit in der Sowjetunion" :
"Avec le début des plans quinquennaux staliniens, les échanges de main d'œuvre furent terminés. Ceux qui voulaient travailler étaient envoyés dans les chantiers de construction socialiste dans les régions les plus éloignées... En déclarant le chômage aboli, et en arrêtant le paiement d'indemnités de chômage, le gouvernement condamna des mil liions de gens à la misère et à la faim. Staline utilisa aussi les camps de concentration dans sa "lutte contre le chômage", ce qui fit disparaître la force de travail en surplus dans les régions les plus peuplées. Selon le calcul de l'expert de la BBC, Pospelowski, 2 % à 3 % de la population laborieuse était inemployée en 1960, ce qui veut dire 3 à 4 millions de gens. Dans ce calcul ne sont pas inclus ceux qui sortent de l'école, les gens qui pour des raisons technologiques sont inutilisés et en attente de travail, les saisonniers, les paysans kolkhoziens et ouvriers des sovkhozes. Si on les compte pour 1 % de la population, le calcul se monte à plus de chômage que durant la récession de 1967-69 en Allemagne de l'Ouest et en chiffres absolus à plus de chômeurs que dans les années d'après-guerre aux USA. Pospelowski ajoute que c'est le tableau général du chômage complet selon les chiffres de 1957. Il considère que, si on inclut le chômage partiel, on atteint un chiffre de 5 % de la population laborieuse sans emploi... avec un nombre de chômeurs complets qui s'est considérablement accru."
C'est une manifestation claire de l'anarchie du mode de production capitaliste que le chômage soit un problème pour des pays où la bourgeoisie doit compenser une faible composition organique du capital et un faible niveau technologique par une utilisation accrue de main-d’œuvre, et qui fait que le chômage s'accroît en même temps que s'accroît la pénurie de main-d’œuvre.
Depuis 1967, les bureaux de chômage ont rouvert dans toutes les grandes villes de Russie. Ils envoient les chômeurs dans le grand nord et en Extrême-Orient. Le résultat des "rationalisations" de l'économie russe pendant le plan quinquennal de 1971-75, a été que 20 millions d'ouvriers ont perdu leur travail. En plus, il faut compter plus de 10 millions de travailleurs saisonniers. Depuis le début des années 70, les camps de travail et les "colonies de pionniers" de Sibérie sont devenus une fois de plus une soupape pour l'explosion du chômage et pour l'exode rural.
Malgré le silence discret de la gauche prorusse à l'Ouest, l'existence du chômage à l'Est est connue depuis des années. Nous mentionnerons comme exemple une lettre de lecteur au journal des enseignants russes "Utschiteskaja Gazeta", du 18 janvier 1965 :
"Comment peut-on se réconcilier avec de telles circonstances honteuses, quand dans une ville de taille moyenne il y a encore des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé et qui ne vont plus à l'école depuis des années. Livrés à eux-mêmes, ils traînent dans les rues pendant des années, font les pickpocket, vendent des objets, et se saoulent à la gare" (Schwendtke p. 75). En plus du chômage direct -le gouvernement polonais menace actuellement de licencier 2 millions d'ouvriers- l'industrie est affaiblie par les arrêts dus au manque d'approvisionnement en pétrole, en pièces de rechange, matières premières ou services d'entretien.
En 1979, le KOR déclarait que près d'un tiers de l'industrie polonaise était inutilisée à un moment donné pour ces mêmes raisons, ce qui doit être encore plus vrai aujourd'hui. Pour les ouvriers qui travaillent à la pièce, cela signifie une chute encore plus brutale de leur paye. L'industrie est aussi affaiblie par des taux astronomiques de rotation de main-d’œuvre, car les ouvriers affamés cherchent désespérément de meilleurs contacts. Aujourd’hui, la bourgeoisie russe est obligée de permettre aux ouvriers de changer de travail deux fois par an, pour éviter des explosions sociales. "La rotation de la main-d’œuvre est la principale plaie du système économique soviétique. La perte d'heures de travail due à la rotation en URSS est beaucoup plus grande que la perte due aux grèves aux USA. Par exemple, dans une usine où j'ai travaillé, avec une équipe de 560 personnes, plus de 500 employés quittèrent pendant l'année 1973 (Nikolaï Dragosch, fondateur d'"Unification démocratique de l'URSS" "Wir mussen die Angst uberwinden").
Face à l'impérieuse nécessité de survivre, les ouvriers vivent du pillage des usines dans lesquelles ils travaillent. Ces actions sont une expression de 1'atomisation extrême de la classe ouvrière en dehors des périodes de lutte, mais elles révèlent aussi l'absence de toute identification avec les profits de "leur" compagnie ou avec les objectifs du plan quinquennal.
"L'usine d'automobiles de Gorki maintient à ses frais un secteur criminel de la milice d'environ 40 personnes, qui confisquent aux ouvriers au cours de contrôles quotidiens l'équivalent de 20 000 roubles en outils et pièces détachées. Le désespoir chez les ouvriers va si loin qu'ils coupent des carrosseries de Volga en plusieurs morceaux au chalumeau, les jettent par dessus les murs, les ressoudent et les vendent". (Cité de Lomax, p. 32)
Face aux réalités crues de la crise économique permanente, le contrôle policier et la répression ouverte ont été longtemps les principaux moyens de tenir en échec le prolétariat. Nous allons voir comment une petite terreur d'Etat a réussi à paralyser un prolétariat conduit à se révolter face à la détérioration de la situation, une rareté croissante des biens de consommation, des prix élevés, particulièrement sur le marché noir, l'accroissement des cadences dans les usines, l'effondrement des services sociaux, la plus forte suppression de logements depuis 1954, l'humiliation constante de la part de la police et de l'administration. Les ouvriers ont commencé à se poser des questions sur tous les aspects du contrôle capitaliste, des syndicats à la police jusqu'à la bouteille de vodka.
LE SURGISSEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE EN URSS
"Les journalistes estiment que jusqu'au milieu des années 70, des actions spontanées des ouvriers, pas plus de 10 % ont été connues publiquement ou par les gens à l'Ouest (Schwendtke, p.148). Holubenko commente dans le même sens :
"... le samizdat n'a fait connaître que très peu sur la question de l'opposition de la classe ouvrière; le samizdat dont aujourd'hui 1 000 documents par an parviennent à l'Ouest, est écrit principalement par l'aile libérale ou de droite de l'intelligentsia, et reflète les préoccupations de cette intelligentsia" ( Holubenko, ibid, p. 5).
Mais le problème va plus loin que çà. Les services d'espionnage occidentaux sont extrêmement bien informés de ce que fait la classe ouvrière dans le bloc russe, tout comme les services de radio qui transmettent vers l'Est (Radio Liberty, BBC, Deutscher Welle, etc.) qui collaborent étroitement avec ceux-ci. Ce que nous avons ici, c'est un black-out massif sur les nouvelles de la lutte de classe de la part du "monde libre". Cette censure concerne d'abord l'information fournie aux ouvriers de l'Est, pour enrayer le danger de généralisation. Un des exemples les plus connus est la décision de Radio Free Europe de Munich de refuser de transmettre une série de lettres envoyées par les mineurs roumains en grève pour informer les autres roumains et les ouvriers d'Europe de l'Est de leurs actions. Ensuite, ceci concerne l'information qu'on laisse passer vers les ouvriers à l'Ouest. Par exemple, les grèves russes de Kaliningrad, Wor et d'autres villes en Biélorussie qui éclatèrent en solidarité avec le soulèvement polonais de 1970, sont bien connues en Pologne, mais n'ont été apportées à l'Ouest qu'en 1974, et encore, à travers le service de presse Hsinhua de Pékin (9.1.1974).
La bourgeoisie occidentale a de bonnes raisons de collaborer avec sa contrepartie russe en cachant les activités des ouvriers particulièrement en Russie par le silence. Les ouvriers à l'Ouest doivent continuer à croire que "les Russes" sont sur le point de "nous" envahir plutôt que de savoir que le prolétariat russe est engagé dans une lutte presque permanente avec sa propre bourgeoisie. D'un autre côté, cela donnerait au prolétariat mondial un plus grand sentiment de force et d'unité de savoir qu'un des plus forts de ses détachements a repris le chemin de la guerre de classe. Dans la première partie de cet article, nous avons traité de la reprise de la lutte de classe en URSS dans les années 1950 et 60. Dans cette première partie, écrite en novembre 1980, et traitant de la vague de grèves du début des années 60, avec son point culminant à Novocherkask en 1962, nous disions -à tort, il semble- qu'il y avait eu une absence de comités de grève et autres moyens d'organiser et de coordonner la lutte après les premières explosions. Un reportage dit comment : "Les insurgés de la région du Donbass considéraient les manifestations de Novotcherkask comme un échec parce qu'ils s'étaient rebellés là-bas sans l'assentiment des bureaux d'organisation de grève de Rostov, Urgansk, Tagourog et d'autres villes. Ceci confirmerait les rumeurs et les rapports concernant un quartier général d'une opposition organisée dans le Donbass" (Cornelia Gersten-maïer, "Voices of the Silent").
La vague de grèves de 1962 fut provoquée par l'annonce de l'augmentation du prix de la viande et des produits quotidiens. "Grèves sur le tas, manifestations de masse de protestation dans les usines, manifestations de rue, et dans beaucoup de parties de l'URSS, des émeutes de grande échelle se produisirent. De source sure, on parle de tels événements à Grosny, Krasnovar, Donetsk, Yaroslav, Idanov, Gorki et même à Moscou où il semble qu'un meeting de masse ait eu lieu à l'usine d'automobiles Morkvitch" (Holubenko, p.12). Holubenko, en se basant sur les reportages d'un stalinien canadien nommé Kolasky, qui passa deux ans en URSS, mentionne aussi une grève des ouvriers du port d'Odessa contre le rationnement de nourriture, et une grève dans une usine de motos à Kiev. Le texte de Chanvier ("La classe ouvrière et les syndicats dans les compagnies soviétiques") parle d'une grève à Vladivostok contre le rationnement de nourriture, qui déboucha sur un soulèvement sanglant. Jusqu'en 1969, un calme relatif est revenu sur le front des grèves. La nouvelle direction Brejnev-Kossyguine a commencé par faire plus de compromis sur les salaires. Depuis 1969 cependant, les salaires ont fortement baissé en dessous même de ceux de l'ère Kroutchev. Déjà alerté par les grandes grèves du bassin du Donetz et à Kharkov en 1967, les forces de répression ont été renforcées.
Depuis 1965, et particulièrement depuis 1967, beaucoup de nouvelles organisations ont été établies pou renforcer les secteurs de la police et des agents spéciaux. Le pouvoir de la police s'est élargi, le nombre de policiers et d'officiers de sécurité professionnels s'est beaucoup accru, des postes de police de nuit et des unités de police motorisées ont été mises en place. De plus, une série de nouvelles lois a été établie pour "renforcer l'ordre social dans tous les domaines de la loi". Des ordonnances, des décrets et des lois tels que la loi votée en 1969 qui insistait sur la suppression des opposants politiques dangereux, des émeutes de masse, des meurtres de policiers, révèlent une nouvelle insistance- sur la "loi et l'ordre". Il y a aussi la promotion sans précédent de chefs du KGB à des postes dans les bureaux politiques centraux". (Holubenko, p.18).
La vague de grèves de 1969-73 en URSS fut une des plus importante, quoique moins bien connue, de la reprise internationale du prolétariat mondial en réponse à la rentrée du système capitaliste dans une crise internationale ouverte. Partout, les ouvriers de l'Union soviétique commencèrent à protester contre le rationnement de nourriture, la hausse des prix et les mauvaises conditions de logement. Quelques grèves de 1969 que nous connaissons :
- "Mi-mai 1969, des ouvriers de l'usine hydro-électrique de Kiev dans le village de Beujozka se rencontrèrent pour discuter du problème du logement. Beaucoup d'entre eux étaient encore logés dans des baraques préfabriquées et des wagons de chemin de fer malgré les promesses des autorités de fournir des logements. Les ouvriers déclarèrent qu'ils ne croyaient plus les autorités locales, et décidèrent d'écrire au Comité central du parti communiste. Après leur meeting, les ouvriers manifestèrent avec des banderoles telles que "tout le pouvoir aux soviets"" (Reddaway,"Uncensored Russia") Le reportage provient d'un journal clandestin oppositionnel "chronique des événements récents".
- Un mouvement de grève éclata à Sverdlovsk contre une chute de 25 % des salaires avec l'introduction de la semaine de 5 jours et de nouvelles normes de salaires. Concentration autour d'une grosse usine de caoutchouc, la grève, selon Schwendtke, prit des formes semi-insurrectionnelles. La milice de guerre civile ("B0M" et "MWD") dut être retirée et les revendications des ouvriers accordées.
- A Krasnovar, Kuban, les ouvriers refusèrent d'aller à l'usine jusqu'à ce que l'approvisionnement en nourriture soit correct dans les magasins.
- A Gorki, les femmes travaillant dans une usine d'armements lourds "quittèrent le travail en déclarant qu'elles allaient acheter de la viande et qu'elles ne reprendraient pas le travail tant qu'elles n'en auraient pas assez acheté" (Holubenko, p.16).
- En 1970, un mouvement de grève éclata dans plusieurs usines à Wladimir.
- En 1971, dans la plus grande usine d'équipements d'URSS, l'usine de Kirov à Kopeyske, la grève se termina par l'arrestation des militants de la grève par le KGB.
''Les plus importants désordres dans cette période eurent lieu à Dniepropetrovsk et Dniprozerzkinsk dans une région d'industrie lourde du sud de l'Ukraine. En septembre 1972, à Dniepropetrovsk, des milliers d'ouvriers partirent en grève, réclamant des salaires plus hauts et une amélioration générale du niveau de vie. Les grèves englobèrent plus d'une usine et furent réprimées au prix de nombreux morts et blessés. Cependant, un mois plus tard, en octobre 1972, des émeutes éclatèrent à nouveau dans la même ville. Les revendications: un meilleur approvisionnement, une amélioration des conditions de vie, le droit de choisir un travail au lieu qu'il soit imposé... Par chance, à cause de l'existence d'un document récent du Samizdat, on a plus d'informations sur les émeutes qui se produisirent à Dnipropetrovsk, ville de 270 000 habitants, à plusieurs kilomètres de Dniepropetrovsk. En particulier, la milice arrêta un petit nombre de gens saouls à un mariage, les emmena dans la voiture de police qui explosa. La foule assemblée marcha en colère sur l'immeuble de la milice centrale de "la ville et le mit à sac, brûlant les fichiers de police et causant d'autres dégâts. La foule marcha ensuite sur le quartier général du Parti où la personne de service ordonna à la foule, avec des menaces, de se disperser, et où deux bataillons de la milice ouvrirent le feu. Il y eut dix morts, dont deux miliciens tués par la foule. L'émeute est un exemple de la tension des rapports sociaux en Union Soviétique -un exemple de comment un petit incident apparemment peut être l'étincelle d'un événement qui dépasse de loin l'importance de l'incident lui-même (Holubenko, la source du Samizdat est Ukrain'ska Slovo) (Le Douban ukrainien a été depuis longtemps un centre de résistance prolétarienne et participa déjà à la vague de grèves de 1956 qui secoua l'Europe de l'Est. La vague de 1956 dans le Douban est mentionné par Holubenko aussi bien que par 1'"Opposition Socialiste tchèque" dans sa publication en Allemagne de l'Ouest "Listy Blàtter", septembre 1976. "Listy" mentionne aussi "des manifestations de masse du prolétariat à Krasnodar, Naltschy, Krivyj Rik" et le soulèvement populaire de Tachkent en 1968).
Pour 1'année 1973, le point final de la deuxième vague de grèves de l'après-guerre en URSS, nous pouvons mentionner les actions importantes suivantes :
- Une grève dans la plus grande usine de Kytebsk, contre une chute de 20 % des salaires. Le KGB essaya sans succès de traquer les "meneurs".
-"En mai 1973, des milliers d'ouvriers de l'usine de construction de machines du Brest-Litovsk Chausee à Kiev partirent en grève à 11 heures en demandant des augmentations de salaires. Le directeur téléphona immédiatement au comité central du PC d'Ukraine. A 15 heures, les ouvriers étaient informés que leurs salaires seraient augmentés et la plupart des grands administrateurs de l'usine furent démis. Il est important de noter que, selon cette information, la population locale attribua le succès de cette grève au fait qu'elle avait un caractère organisé et que le régime avait peur que la grève ne s'étende au "Stettin ukrainien" (Holubenko, source "Sucharnist", Munich).
- Le soulèvement populaire de Karina en Lituanie en 1973 qui déboucha sur des combats de rue et la construction de barricades, et qui fut réprimé de façon sanglante (mentionné par "Listy"). Cette explosion de rage populaire, provoquée par la détérioration de la situation économique et par l'accroissement de la répression policière, eut une lourde résonnance nationaliste. Une révolte similaire eut lieu à Tiflis en Géorgie le 1er mai 1974, qui se développa hors de la manifestation officielle du 1er mai.
- Finalement, au cours de l'hiver 1973, la vague de grève atteignit les métropoles occidentales de Moscou et Leningrad avec des records d'arrêts de travail sur les chantiers de construction qui ont été rapportés.
L'INTERLUDE POLONAIS 1970-76
La réapparition du combat prolétarien dans les années 70 a été internationale dans ses dimensions. Mais elle n'a cependant pas été généralisée. En URSS, les luttes ont été nombreuses et violentes, mais elles sont restées isolées et souvent inorganisées. Elles eurent lieu principalement en dehors des centres industriels de la Russie même. Ceci ne signifie pas que ce ne fut pas de grandes masses d'ouvriers qui s'y trouvèrent engagées. Il y a des concentrations énormes du prolétariat, particulièrement dans des endroits de l'Ukraine et de la Sibérie occidentale. Mais ces ouvriers sont plus isolés les uns des autres ainsi que des principales concentrations industrielles du prolétariat mondial. Plus important encore, ces luttes peuvent être limitées au travers de l'utilisation des mystifications nationale, régionale et linguistique (le "soviet" du prolétariat parle plus de 100 langues) qui présente le combat comme étant contre les "russes". En assurant des approvisionnements plus favorables en denrées alimentaires et en biens de consommation d'un côté, et un formidable déploiement des forces de répression de l'autre, l'Etat a été capable de maintenir son contrôle social à Moscou et à Leningrad, là où le prolétariat a été le plus décimé par la défaite de la vague révolutionnaire des années 20, et par la guerre et la terreur d'Etat qui s'en suivirent, que dans n'importe quel autre endroit du monde. Ce contrôle sur la Russie soviétique est décisif.
Dans les années 70, la Pologne est devenue le principal centre dans le bloc russe, de la reprise mondiale de la lutte de classe.
Le prolétariat en Hongrie et en Allemagne de l'Est était encore sous le coup de la double défaite des années 20 et 50, les ouvriers tchécoslovaques avaient, de plus, à se remettre du coup de la défaite de 1968-69. Ce sont précisément les principaux pays du bloc dans la perspective de l'extension de la révolution mondiale, hautement industrialisés, avec des concentrations significatives d'ouvriers riches en tradition de lutte, proches d'autres cœurs industriels, ceux de l'Europe de l'ouest, dont le plus important, l'Allemagne de l'ouest.
Comme pour la Pologne qui a appartenu autrefois à la "ceinture agricole" avec la Roumanie et la Bulgarie, mais qui entreprit une industrialisation importante après la guerre, son rôle historique consiste à devenir une courroie de transmission révolutionnaire entre le front des pays industrialisés du bloc à l'Ouest, et l'URSS à l'Est. Parce que les ouvriers de l'Europe de l'Est et du centre doivent porter le plus lourd fardeau de la contre-révolution des années 20 aux années 50, la réponse du prolétariat à la réapparition de la crise mondiale ouverte du système capitaliste, y a été PLUS HESITANTE ET INEGALE qu'à l'Ouest. Comme résultat, la courroie de transmission polonaise est apparue bien AVANT l'extension des grèves de masse à l'Est ou à l'Ouest qu'elle pourrait relier les unes aux autres. C'est la véritable base de toutes les illusions sur la Pologne-Exception -ou la notion que la Pologne est le centre du monde- qui continue à attacher les ouvriers aux "solutions" nationales, au capital national polonais, quelle que soit par ailleurs la haine que ceux-ci portent au capitalisme et à son Etat, jusqu'à ce que les grèves de masse explosent ailleurs. Les ouvriers polonais n'étaient pas seuls dans cette période que ce soit au niveau mondial ou à l'Est. Nous avons déjà mentionné la grève-solidarité en URSS avec la révolte polonaise de 1970. Cette explosion était précédée d'une importante grève de mineurs roumains et par la grande vague de grèves en URSS qui avait commencé 18 mois plus tôt. La bourgeoisie de l'ensemble du bloc fut surprise par ce Soulèvement. "Partout les plans quinquennaux étaient corrigés en faveur de 1'approvisionnement en biens de consommation et en nourriture. En Bulgarie, les augmentations de prix qui étaient prévues pour le 1/1/71 furent supprimées, en URSS en mars, on fit grand cas de 1'effondrement de certains prix. En RDA, les événements en Pologne accélérèrent 1'explosion d'une crise politique latente qui fut marquée par le remplacement de Walter Ulbricht par Honecker. Le SED baissa les prix des textiles et autres produits industriels, après qu'il y eut des troubles sur les hausses de prix cachées, et l'augmentation des pensions" (Koenen, Kuhn, "Freiheit, Unabhàugigkeit und Brot").
En novembre 1972, après un gel des prix pendant deux ans en Pologne imposé à Gierek par les ouvriers de Lodz en février 1971 et qui doit se terminer, les dockers de Gdansk et Stettin se mettent en grève, juste au moment où le Congrès des Syndicats réuni à Varsovie devait voir comment se prononcer contre la prolongation du gel des prix. Gierek se rendit à Gdansk pour calmer les ouvriers. En son absence, les ouvriers du textile de Lodz et les mineurs de Katowice partirent en grève. Le président Jaroszewicz dut passer à la télévision pour annoncer la poursuite du blocage des prix (voir Green dans "Die Internationale", n°13, p.26). Les ouvriers défendirent leur niveau de vie sans hésitation. Dans les chantiers navals de la Baltique en 1974, par exemple, une nouvelle norme de productivité provoqua une grève de protestation massive. Des récits d'incidents similaires viennent de beaucoup d'endroits du pays. En mars 1975, il n'y avait plus de viande dans les magasins. Pour empêcher une explosion prolétarienne, les réserves de viande du l'armée furent envoyées rapidement dans les ports de la Baltique et dans les mines de Silésie. Immédiatement, des ouvriers du textile de Lodz se mirent en grève. Il y eut des émeutes de la faim à Varsovie. A Radom, les ouvriers des Cartoucheries imposèrent la libération de 150 femmes qui avaient été arrêtées après une grève (rapporté dans "Der Spiegel, 15 mars 1975).
En juin 1976, une tentative fut faite d'augmenter le prix de la nourriture de 60%. La réaction fut immédiate. A Radom, une manifestation des ouvriers des Cartoucheries appela tous les ouvriers de la ville à sortir. Le Quartier général du parti fut incendié et 7 ouvriers furent tués en combattant sur les barricades. Une vague de répression s'ensuivit : 2 000 ouvriers furent arrêtés. Au même moment, dans l'immense usine de tracteurs d'Ursus près de Varsovie, 15 000 ouvriers lâchèrent les outils et coupèrent les lignes de chemin de fer Paris-Moscou, prenant en otage le train. La police arrêta 600 ouvriers, et mille autres furent renvoyés immédiatement. A Plock, les ouvriers marchèrent sur le siège du parti, en chantant l'Inter nationale, et sur les casernes pour fraterniser avec les soldats. Là encore, 100 ouvriers furent arrêtés. Cet usage de la répression massive dans des centres industriels secondaires n'a pas pu arrêter le mouvement, parce que les dockers de la Baltique, les ouvriers de l'automobile de Varsovie, les ouvriers de Lodz, Poznan, etc., débrayèrent. Il semble que ce fut qu'une question d'heures qu'ils ne soient rejoints par les mineurs de Silésie. Gierek fut contraint d'annuler immédiatement les hausses de prix. Mais cette concession fut suivie d'une vague d'arrestations massives, de tortures, d'atrocités policières Les augmentations de prix furent faites plus lentement, moins ouvertement, mais sûrement. Face à cette contre-attaque féroce de la bourgeoisie, et du fait que le niveau de vie se détériorait encore malgré les grèves même les plus résolues, le prolétariat en Pologne entra dans une période de repli et de réflexion.
La période de 1976-80 a été un calme relatif sur le front des grèves en Pologne. Pour ceux qui ne voient que la surface des événements, ça a pu paraître une période de défaite. Mais l'approfondissement de la lutte de classe internationalement, la maturation lente mais sûre de la seconde vague mondiale de résistance prolétarienne depuis 1968, qui a déjà dans cette période de 1976-81 atteint un niveau qualitativement supérieur, va révéler le mûrissement des conditions d'une future VAGUE REVOLUTIONNAIRE qui court sous la surface.
Krespel
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire
- 3125 reads
Depuis quelques mois, le milieu révolutionnaire vit une série de convulsions politiques, Certaines organisations disparaissent ou se disloquent:
- le PIC (Pour l'Intervention Communiste -France-) vient de se dissoudre; seule une fraction de celle-ci, le "Groupe Volonté Communiste", continue une existence politique (cf. RI mensuel n° 88)
- le FOR-Alarma (Ferment Ouvrier Révolutionnaire) a dissous sa section en Espagne et se sépare de ses camarades aux USA.
D'autres vivent des départs importants de militants :
- le PCI (Programme communiste) vient d'exclure les sections du sud de la France et des sections en Italie dont celle de Turin ;
- au CCI également il y a eu des départs et des exclusions de militants. Il y a encore d'autres groupes qui subissent un recul politique profond :
- le NCI (Nuclei -Italie- à l'origine une scission du PCI et donc du milieu révolutionnaire) vient de publier un projet d'unification politique avec le groupe crypto-trotskyste, "Combat Communiste" en France ou des déboussolements momentané :
- le CWO (Communist Workers'Organisation -Grande Bretagne- après avoir défendu contre vents et marées la nécessité d'une "insurrection" en Pologne, fait une volte-face dans son appréciation de la situation. (dans le n°4 de Workers'Voice le CWO appelait à la "Révolution tout de suite" en Pologne. Dans le numéro suivant le CWO critique honnêtement son erreur d'analyse qu'il considère maintenant "un appel aventuriste" Le CWO est un des rares groupes dans le milieu révolutionnaire capable de corriger ouvertement et publiquement ses erreurs).
Pourquoi tous ces bouleversements? Pourquoi l'infime minorité de la classe ouvrière qui constitue son milieu politique se réduit-il encore davantage et que faut-il en conclure? Pourquoi ces échecs et désorientations politiques?
C'est d'autant plus difficile de répondre à ces questions que le "milieu politique révolutionnaire" n'est qu'une juxtaposition de groupes politiques, chacun gardant jalousement ses secrets, ses crises et sa vie dans le silence, en pensant qu'il suffirait de jubiler sur les problèmes des autres pour être à la hauteur de la situation générale. Le milieu politique avec ses divergences politiques et ses différentes organisations n'a pas de cadre pour débattre ses problèmes, pour confronter et clarifier les positions politiques s'il ne s'assume ni par rapport à lui-même ni face à la classe.
Il est donc difficile de dire avec certitude quelles sont les raisons politiques précises qui ont provoqué ces convulsions. Mais il faut tout de même tenter de faire un premier bilan de la situation actuelle, quitte à le développer ou le corriger ensuite. Fous pensons que le milieu politique révolutionnaire actuel :
- paie le prix des immaturités politiques et organisationnelles qui existent depuis longtemps dans le milieu ravagé par le sectarisme.
- subit des convulsions politiques dues à une inadéquation de ses positions politiques et de sa pratique face à la nouvelle situation ouverte par la grève de masse en Pologne.
Les problèmes du CCI s'inscrivent, comme ceux des autres groupes, dans ce contexte : comment contribuer à la prise de conscience de la classe ouvrière dans ces "années de vérité".
L'ECHEC DES CONFERENCES INTERNATIONALES
Les immaturités politiques du milieu qui se paient aujourd'hui et qui se paieront encore demain, se sont déjà clairement révélées dans l'échec des Conférences Internationales de 1977 à 1980, l'échec d'un milieu politique tel qu'il est sorti de la première vague de la lutte de classe en 1968, tel qu'il a subi le reflux des années 70.
Le cycle des Conférences Internationales proposé par Battaglia Comunista et appuyé à fond par le CCI ([1] [290]) marquait la première tentative sérieuse depuis 1968 de briser l'isolement des groupes révolutionnaires.
Depuis le début des Conférences, le PCI (Programme Communiste), dans son isolement dédaigneux, a refusé toute participation, convaincu que le Parti historique formel, indivisible et invariant, existe déjà dans son propre programme et organisation. Croyant vivre seul au monde, le PCI refusait de prendre sa place dans une discussion politique internationale, préférant attribuer aux autres sa propre vision des Conférences : c'est à dire un lieu pour "la pêche à la ligne", du recrutement qui soi-disant ne l'intéressait pas.
Le FOR, après avoir donné son accord de principe à la 1ère Conférence et être venu à la 1ère séance de la 2ème Conférence, s'est retiré dans un coup de théâtre qui cachait mal son incapacité de défendre ses positions, surtout celle qui nie la signification de la crise économique du système en faveur d'une vague théorie d'une "crise de civilisation''.
Le PIC, après avoir communiqué son accord par correspondance, a brusquement changé d'avis. Il a refusé de participer à la discussion en la stigmatisant d'avance comme "dialogue de sourds"...Mais c'est le PIC qui était sourd et le résultat, c'est qu'il ne risque pas d'entendre, puisqu'aujourd'hui il est mort.
Mais le sectarisme ne s'arrêtait pas aux portes de la Conférence; l'esprit de chapelle et le refus d'assumer une discussion jusqu'au bout entravaient tous les travaux de la Conférence.
Il est vrai que les Conférences ont aidé à démanteler le mur de suspicions et de malentendus qui existaient entre les groupes. Elles ont débattu des questions essentielles pour le milieu révolutionnaire : où en est la crise du capitalisme; quelle est l'évolution de la lutte de classe et le rôle des syndicats; le nationalisme et la "libération nationale" ; le rôle des organisations révolutionnaires. Ces débats ont été publiés dans des brochures et diffusés publiquement en trois langues. Dans ce sens, les Conférences constituent un acquis important pour l'avenir.
Mais elles n'ont jamais réellement compris pourquoi elles existaient, ni la gravité de l'enjeu. La sclérose politique, la peur d'aller jusqu'au bout dans la confrontation des analyses et des positions politiques ont fait des débats plus des "matchs" entre groupes "rivaux" qu'une recherche réelle de compréhension et de confrontation fructueuses. Les Conférences, en tant que telles, ont toujours refusé de se prononcer sur des résumés de débats définissant de façon claire les points d'accord et de désaccord pour cerner les divergences. Plus grave encore : sous prétexte que les organisations révolutionnaires n'étaient pas d'accord sur tout, Battaglia Comunista, le CWO et l'Eveil ont refusé d'affirmer en commun avec le CCI et le NCI les principes révolutionnaires de base contre le danger de guerre impérialiste dans le monde actuel! La Conférence est restée "muette" par rapport à ses responsabilités politiques, face à la classe ouvrière. L'idée qu'un groupe révolutionnaire est issu de la classe ouvrière et doit rendre des comptes historiques de sa fonction, qu'il n'est pas un cercle qui peut se permettre de bavarder ou faire la girouette, cette idée n'a pas encore même aujourd'hui pénétré l'esprit de tout le milieu politique,
A la 3ème Conférence, voulant faire une sélection politique a priori, B.C. et le CWO proposaient comme nouveau critère pour la participation aux prochaines Conférences une résolution sur le Parti de classe qui le mettrait, disait-il, à l'abri des "spontanéistes du CCI". Sans discussion réelle, le CCI s'est trouvé ainsi exclu d'emblée des Conférences à venir par une manœuvre sordide.
Des groupes parlaient beaucoup à l'époque du besoin d'une "sélection stricte" parmi les groupes révolutionnaires. Ils voulaient déjà limiter la discussion sur le Parti et sur d'autres questions pour ne pas avoir à confronter les "trouble-fêtes" du CCI. 'Au lieu d'encourager la poursuite d'une confrontation de positions politiques, cette "sélection" par manœuvre qui a préféré attribuer au CCI des positions fantaisistes issues de leur propre imagination que d'entendre celles que le CCI défendait réellement sur le Parti, a étouffé les débats et les Conférences ; il n'y a jamais eu depuis d'autres Conférences. Croyant pouvoir précipiter un "regroupement" prématuré, -séduit par des flirts de B.C.- le milieu politique est passé à côté de la possibilité de créer un cadre responsable pour la discussion politique internationale indispensable.
"La sélection, c'est la pratique de la classe qui 1a fait et non quelques conciliabules entre organisations. C’est pourquoi il ne faut pas surestimer la capacité "de auto-sélection". La vraie sélection, on en parlera en temps voulu".([2] [291])
Et c'est en effet la réalité objective d'aujourd'hui qui se charge d'une décantation dans le milieu politique. Mais nous n'avons plus de cadre organisé pour débattre les difficultés actuelles ; nous n'avons que des convulsions violentes qui se déroulent surtout dans la confusion et la dispersion.
LES ANNEES DE VERITE
Les Conférences Internationales se sont disloquées en mai 1980, trois mois avant l'éclatement de la grève de masse en Pologne.
Cette grève de masse est le signe le plus significatif de la montée internationale d'une nouvelle vague de la lutte de classe. Elle marque le début d'une phase décisive au cours de laquelle commenceront des affrontements de classe d'une envergure sans précédent et qui, à terme, décideront du sort de l'humanité : guerre capitaliste ou révolution prolétarienne.
C'est la réalité de cette nouvelle période qui jette un défi aux groupes révolutionnaires dispersés : sont-ils suffisamment armés politiquement pour comprendre et faire face à la nouvelle situation?
Pour comprendre les exigences nouvelles il faut saisir l'essentiel de l'accélération du processus historique depuis deux ans :
- L'accentuation grave de la crise économique qui atteint tous les pays du globe y inclus et d'une façon brutale les pays de l'Est mais aussi les géants du bloc occidental : l'Allemagne et le Japon. Aujourd'hui la crise, le chômage, ne parviennent plus à se limiter aux catégories particulières de la société mais touchent au noyau central de la classe ouvrière occidentale; le rationnement et la pénurie à l'Est annoncent l'avenir que la société réserve aux ouvriers partout dans le monde.
- L'effort de repousser la crise vers les pays périphériques ,1e "Tiers-Monde", n'amortit plus le choc économique pour les grandes puissances ; quant aux pays sous-développés il n'amène qu'un génocide sans espoir, chaque jour plus difficile à cacher.
- L'aggravation des conflits inter-impérialistes et surtout des tensions entre les deux blocs. La crise contient déjà les prémisses de la guerre, et son déroulement actuel se double d'une préparation accélérée à la guerre. Le danger de guerre existe parce que le capitalisme existe toujours, mais aujourd'hui le chemin vers la guerre généralisée est barré par la combativité du prolétariat.
- L'accentuation des effets de la crise a provoqué le début d'une nouvelle montée des luttes de classe internationale ; la grève de masse en Pologne en août 1980 annonce les affrontements de classe décisifs des années à venir. Tous les éléments de la situation actuelle convergent dans les leçons de la Pologne et la nécessité de l’internationalisation des luttes ouvrières.
- La bourgeoisie à l'échelle internationale reconnaît le danger mortel pour son système contenu dans la combativité ouvrière. Par-dessus les frontières nationales et même celles du bloc, la classe capitaliste collabore pour faire face au danger de la grève de masse. Dans les affrontements décisifs de cette période le prolétariat n'aura pas devant lui une bourgeoisie surprise et déconcertée comme dans la période de la 1ère vague de 1968 ; il affrontera une bourgeoisie avertie, préparée à utiliser au maximum ses capacités de mystification, de dévoiement et de répression.
- La stratégie bourgeoise contre le prolétariat s'appuie essentiellement sur la Gauche et atteint le maximum de son efficacité quand la Gauche est en "opposition" aux partis gouvernementaux cachant ainsi la convergence de tous les partis bourgeois et syndicats englobés dans le capitalisme d'Etat, l'Etat totalitaire de la décadence du système. Le clivage principal de la société, entre la bourgeoisie sénile réfugiée et transmutée dans l'Etat capitaliste hypertrophié et la classe ouvrière, est ainsi caché par la façade du "jeu démocratique" destiné à travers les syndicats et les campagnes idéologiques de la Gauche à désarmer la résistance de la classe ouvrière pour que la répression puisse s'abattre le moment venu. La clé du cours de l'histoire se joue dans la capacité de la classe ouvrière à résister à l'embrigadement derrière la Gauche.
Ces grands traits de la situation actuelle, le prolétariat des principaux centres industriels ne les saisit que partiellement pour le moment. Mais le mûrissement de la conscience de classe face à l'aggravation de la situation objective qui s'est manifesté dans la grève de masse en Pologne n'est pas un phénomène "polonais", mais l'annonce de tout un processus pénible, long et tortueux à l'échelle internationale qui ne se voit pas toujours à la surface jusqu'au jour du débordement. C'est l'annonce d'un processus d'unification de la classe par dessus les barrières capitalistes et ses frontières nationales.
Mais pour les minorités révolutionnaires, celles qui doivent contribuer au processus de prise de conscience de leur classe, les années de vérité posent un défi immédiatement plus tangible dans la mesure où les organisations révolutionnaires opèrent au niveau conscient ou pas du tout. Seront-elles le simple reflet des hésitations et confusions de la classe ouvrière, le reflet de 1'éparpillement du passé ou seront-elles à la hauteur de la grève de masse pour y devenir un facteur actif dans le processus historique? L'histoire ne pardonne pas et si les organisations révolutionnaires d'aujourd'hui ne sont pas capables de répondre aux exigences de l'évolution de la situation, elles seront balayées sans recours.
LES EXIGENCES DE LA PERIODE ACTUELLE
Il est inévitable que les exigences de cette nouvelle période d'accélération des événements secouent un milieu politique composé essentiellement des groupes constitués pendant les années de reflux et sur la lancée de ce qui restait de -1968. Mais 1968 et la première vague des luttes ouvrières contre la crise n'ont pas laissé suffisamment d'acquis en profondeur pour assurer une stabilité politique aujourd’hui. Par ailleurs, les groupes comme le PCI ou B.C. qui viennent directement des fractions politiques constituées dans la période de contre-révolution d'avant 1968, s'ils assurent une stabilité politique à un certain niveau important, sont atteints d'un processus de sclérose des positions politiques et de la vie de l'organisation qui les expose autant que les autres aux bouleversements de la période actuelle.
De plus, et de façon générale, la pression de la terreur de l'Etat bourgeois s'accroit et détermine en elle-même une décantation en nos rangs de ceux qui n'ont pas encore compris l'enjeu de l'engagement politique.
Nous pouvons très globalement définir les exigences de cette époque de la façon suivante :
- la nécessité d'un cadre programmatique cohérent, synthétisant les acquis du marxisme à la lumière d'une critique principielle des positions de la 3ème Internationale.
- la capacité d'appliquer ce cadre à une analyse de la situation actuelle des rapports de force entre les classes,
- une compréhension de la question de l'organisation des révolutionnaires comme une question politique à part entière, la nécessité de créer un cadre international et centralisé pour cette organisation, de définir clairement son rôle et sa pratique dans le processus d'unification de la classe ouvrière vers le regroupement des révolutionnaires.
En examinant la trajectoire actuelle de certains groupes politiques y inclus le CCI, nous verrons que ces trois aspects sont liés mais demandent tout de même une attention particulière pour chacun.
1) En ce qui concerne le cadre programmatique des principes de l'histoire du mouvement ouvrier, ne pas se baser sur les acquis du marxisme, c'est se condamner à l'échec sans recours. Des groupes comme le PIC qui dans sa phase finale jetait par-dessus bord les acquis de la 1ère, 2ème et 3ème Internationale en les considérant toutes dégénérées et contre-révolutionnaires, quittent le terrain historique du marxisme pour aller tout droit à la disparition pure et simple. Sans la dimension historique et réelle du marxisme, tout soi-disant "principe" devient une pure abstraction.
Mais il est aussi vrai que nous ne pouvons pas réduire le marxisme à une bible à laquelle on s'accrocherait à la lettre. C'est aussi la voie de la facilité bien que, dans une certaine mesure, moins immédiatement catastrophique pour un groupe. Encore faut-il dire que l'idéologie bourgeoise utilise toujours les erreurs du mouvement ouvrier du passé comme véhicule pour une pénétration en milieu ouvrier et sa trahison.
Un cadre programmatique adéquat aujourd'hui implique forcément un réexamen critique des erreurs de la 3ème Internationale. Les continuateurs directs de la Gauche italienne aujourd'hui se sont arrêtés à mi-chemin du bilan critique des positions de TIC. C'est pour cela qu'un groupe issu de la Gauche italienne et qui s'en revendique, le NCI, peut aujourd'hui penser s'unir à une variante du trotskysme : sur la question syndicale, sur la "libération nationale" et même sur le parlementarisme. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour trouver un terrain "d'entente" avec le trotskysme. Ce que le NCI fait dans la réalité reste un danger implicite -le glissement vers le gauchisme- pour tous ceux qui se réclament "intégralement" des positions du 2ème Congrès de l'IC après 60 ans d'expérience syndicale, nationale et parlementaire. Nous l'avons vu avec les "groupes syndicaux" et le "Front unique à la base" de B.C. et les scissions qui ont suivi en 1980. Nous voyons ce danger aujourd'hui dans le PCI (Programme) avec sa "tactique" de Front contre la répression qui semble être un des éléments qui a provoqué la scission récente.
De plus, l'aveuglement de la plupart de ces groupes par rapport aux contributions positives de la Gauche allemande des années 1917-21 les laisse sans cadre pour comprendre réellement la grève de masse en Pologne et sa signification politique. (Pour une analyse de la grève de masse aujourd'hui, voir la Rint n°27 "Notes sur la grève de masse, hier et aujourd’hui")
La grève de masse en Pologne soulève concrètement pour la première fois depuis 1917,1a question du rôle des Conseils ouvriers ce que mai 68 en France n'a posé que confusément en paroles à travers les "comités d'action" où se mélangeaient la contestation étudiante et le début d'un réveil du prolétariat. Pour ceux de la Gauche italienne, ou ceux qui subissent son influence comme le CWO, le schéma d'une classe ouvrière et ses conseils comme simple masse de manœuvre pour le Parti qui, lui, prendrait le pouvoir, colle de moins en moins à la réalité de notre époque parce que c'est une erreur théorique pour laquelle la classe ouvrière a déjà payé très cher. (Pour les implications de la Pologne au niveau de la question du Parti, voir la Rint n°24 "A la lumière des événements en Pologne, le rôle des révolutionnaires"). De plus, pour le PCI (Programme) par exemple, les syndicats, les comités de grève, les conseils ouvriers sont tous au même niveau des manifestations de "1'associationnisme ouvrier" à subordonner au Parti ; de cette façon non seulement ce groupe ne saisit pas la dynamique même de la grève de masse mais les événements de la Pologne révèlent leur ambiguïté de principes sur la question syndicale. Les confusions sur le rôle des syndicats aujourd'hui et les illusions sur un travail "syndical" soi-disant "à la base" ou "radical" aboutissent à faire le jeu de Solidarnosc et, qu'on le veuille ou non,. contribuent à enchainer le prolétariat à l'Etat.
L'éclatement de la grève de masse a mis en évidence les insuffisances programmatiques de beaucoup d'organisations. Des groupes n'ayant pas un cadre théorique leur permettant de reconnaitre une grève de masse quand ils en voient une, n'ayant pas un cadre d'analyse qui leur permet de comprendre la période actuelle et de pouvoir réagir rapidement aux surgissements brusques de la classe ouvrière, tombent facilement dans des prises de positions superficielles et erronées. Quand on ne comprend pas que la prise de conscience du prolétariat est un processus, on devient facilement blasé sur les efforts des ouvriers, en ne voyant que les faiblesses, en ignorant les enseignements positifs et les potentialités. De plus, les tendances activistes des groupes les poussent à une vision localise : ce qui se passe "chez soi" semble avoir plus d'importance que des grèves "lointaines" en Pologne dans lesquelles il est difficile d'avoir une présence "physique" (locale) directe. Ainsi la signification politique la plus importante de la Pologne n'a pas été comprise la nécessité pour les organisations politiques de généraliser les leçons de la Pologne au prolétariat international.
Si dans un premier temps, des groupes ont eu tendance à sous-estimer l'importance historique de cette expérience, certains sont ensuite tombés dans l'excès contraire : ils appelaient à une "insurrection" dans la seule Pologne. Ce genre d'appel, de toute façon aventuriste dans le contexte actuel soulève une question de fond sur le mûrissement des conditions de la révolution. Nous avons commencé une discussion sur 1' internationalisation dans la Rint n°26 "Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière", sans beaucoup d'écho dans le milieu.
Les incompréhensions et faiblesses politiques ont toujours des répercussions au niveau de la vie organisationnelle des groupes. Le PIC par exemple a sérieusement sous-estimé l'envergure de la grève de masse. Deux exemples. A la suite des événements d'août 1980 le PIC n'avait d'yeux que pour les "curés" et le syndicalisme. Cette prise de position erronée a donné lieu à une discussion au sein du groupe qui aboutissait à une rectification de sa position dans sa revue la 'Jeune Taupe'! Mais des divergences ont sans doute subsisté se rapportant au niveau d'une discussion sur le rôle des organisations révolutionnaires. Trois idées sur l'organisation sont sorties de ce débat donnant lieu à trois tendances, les trois, plus floues les unes que les autres. Ceux qui défendaient l'idée la moins floue sont partis pour former "Volonté Communiste" à Paris laissant ainsi le PIC se dissoudre. En effet c'était l'aboutissement logique quand on ne sait pas pourquoi on existe.
Le FOR de son côté est aussi passé à côté de la signification profonde de la Pologne. Ce groupe, qui n'a jamais fait d'analyse des conditions objectives menant à une prise de conscience révolutionnaire, croit que la révolution est "toujours possible", et n'est qu'une question de "volonté". C'est pour cela qu'il a pu écrire : "Le mouvement (en Pologne) montre plus d'insuffisances du point de vue révolutionnaire que d'aspects positifs" (Alarme fin 80) et en même temps il appelait à la formation des conseils ouvriers et à la révolution communiste. C'est comme son tract enflammé à l'époque de la grève Longwy-Denain en France qui appelait à la prise du pouvoir! Une divergence sur l'appréciation des événements en Pologne semble être une des raisons du départ (ou exclusion?) des camarades du FOR (groupe Focus) aux USA.
C'est tout de même grave que des organisations politiques de la classe ouvrière puissent se tromper si lourdement face à des événements d'une telle portée historique. De plus, des appels aventuristes peuvent, dans un contexte de demain, avoir des répercussions d'une gravité désastreuse. Si le milieu politique actuel n'arrive pas à être à la hauteur de sa tâche au niveau des principes il sera voué à la décomposition.
2) Au niveau de la concrétisation des principes pour dégager des analyses et des orientations politiques ponctuelles," l'accélération des événements a aussi inévitablement posé des problèmes aux groupes. Le PIC avec sa théorie de "l'effritement des blocs" (tandis qu'en réalité les deux grands blocs s'affrontent de plus en plus nettement) s'est perdu à ce niveau parce qu'il ne savait pas distinguer entre les intérêts économiques particuliers de certains pays (le Japon et 1'Allemagne) et le besoin militaire, stratégique et économique beaucoup plus puissant et global qui pousse à l'intégration dans un bloc au risque de périr. La nature profonde du capitalisme d'Etat et la tendance totalitaire de la bourgeoisie en décadence échappaient au PIC comme d'ailleurs au FOR.
BC voyait la contre-révolution jusqu'en 1980 mais prévoyait la "social-démocratisation des partis staliniens"(en prenant pour argent comptant "1'Eurocommunisme") tandis qu'en réalité le jeu de 1'"opposition" les pousse vers le contraire. Le CCI avait du mal à concrétiser les aspects de la nouvelle période dans l'analyse de la gauche dans l'opposition et s'est livré à des pronostics électoraux locaux qui se sont avérés erronés clans la réalité. Aujourd'hui nous voyons plus clairement comment approfondir ce cadre d'analyse mais cet effort a causé des secousses dans l'organisation.
C'est inévitable que la situation actuelle où l'on voit un surgissement lent et douloureux de la conscience de classe en réponse à une CRISE ECONOMIQUE DU SYSTEME, déroute un peu les organisations révolutionnaires. Dans l'histoire de 1871, de 1905 et de 1917 c'était la guerre impérialiste qui a directement et brusquement fait surgir l'insurrection. Pour tous les groupes (surtout ceux comme le PCI qui refusent de voir la révolution venant d'autre chose qu'une guerre même aujourd'hui) cette situation pose de nouvelles questions qui n'ont pas de parallèle directe avec les luttes ouvrières face aux crises~~cycliques du capitalisme ascendant. La capacité de s'orienter clairement dans la pratique dépend surtout de la solidité et du bien-fondé des principes. C'est la clarté théorique et programmatique qui seule peut nous orienter tous et qui décidera de notre sort en tant que groupes politiques.
Ce qu'il ne faut pas faire dans cette période de montée des luttes, c'est se paniquer de ne pas rencontre^ un écho immédiat dans la classe et glisser à travers des tendances activistes vers le gauchisme. On a vu où cela mène le NCI. On a vu l'activisme du PIC se résoudre dans le néant. On croit voir ceux qui prônent la tactique du "front anti répression" exclure les non-convaincus du PCI ; nous voyons le contraire dans le CCI : ce sont entre autres, les tendances activistes et gauchistes qui nous quittent. On a vu aussi l'impatience de "l'insurrection", on a vu miroiter des projets pour des "comités ouvriers" dans les usines à tout bout de champ - mais on n'a rien vu encore. La lutte de classe risque de nous secouer encore plus durement si nous ne savons pas développer notre intervention SANS TOMBER DANS L'ACTIVISME. Et surtout si la question principielle du rôle de l'organisation des révolutionnaires n'est pas claire.
3) La question d'organisation est généralement celle qui cristallise toutes les autres dans un moment de bouleversement. Des aspects à souligner ici se résument essentiellement à la nécessité de répondre aux exigences de l'époque actuelle par un cadre organisationnel international. Seule une organisation internationale peut faire face aux besoins du prolétariat et son unification comme classe à travers l'internationalisation des luttes. La dislocation de l'effort international du FOR montre ce que nous disons depuis longtemps : ce n'est pas si facile de créer une organisation internationale dans laquelle existe une vie politique intense mais unie. On ne l'improvise pas et surtout pas sans une vision cohérente de l'activité et d'analyse révolutionnaires. Le CCI a aussi subi une crise récemment qui tournait essentiellement autour de la question : centralisme ou fédéralisme ; l'unité de l'organisation ou agitation individuelle. Ces difficultés nous amènent à réexaminer profondément si toute notre organisation a bien assimilé les principes de la centralisation et nos statuts du fonctionnement. Nous allons développer ce point plus loin.
Les scissions, 1'éparpillement des organisations révolutionnaires vont évidemment à rencontre de la tendance générale de cette période historique de montée des luttes : La tendance vers l'unification de la classe et de ses expressions politiques. ([3] [292]) Nous avons toujours dit que l'attitude du PIC qui avait scissionné du CCI pour une histoire d'un tract sur les événements au Chili (tract que d'ailleurs le CCI a sorti quatre jours après) était un acte irresponsable. On ne rentre et on ne sort pas d'un groupe politique comme d'un magasin. Il est possible et même probable que des actes irresponsables de ce genre cachent des divergences de fond mais ce comportement interdit la discussion : on ne sait pas quels sont alors réellement les points de désaccords, ni si leur gravité exigerait un départ. En agissant ainsi on n'aide en rien le développement du milieu politique.
De la même façon, plusieurs groupes ayant abouti à la même plateforme de base du CCI (dont le CWO et l'ancien Workers Voice) refusaient en 1975 de s'associer à la formation du CCI, une attitude que nous avons également considérée irresponsable. Un groupe se définit par sa plateforme ; on ne fait que discréditer l'idée même du rôle des révolutionnaires en maintenant une existence séparée pour des raisons secondaires ou localistes. Par la suite les groupes de cette époque, dans la mesure où ils ont survécu, ont trouvé bien des "raisons" et de nouvelles positions pour justifier une vie séparée sans réellement vouloir confronter le problème du sectarisme.
Mais si nous pensons que le processus d'unification doit s'entamer à la lumière de la lutte de classe, nous ne considérons pas la décantation actuelle comme une chose entièrement négative. Nous ne regrettons pas qu'un groupe confus comme le PIC disparaisse et élimine ainsi un écran de fumée des yeux de la classe ouvrière. Nous ne regrettons pas non plus que des éléments qui virent vers le gauchisme ou la démoralisation nous lâchent la main.
Si le milieu politique doit payer ses immaturités, que cela se fasse le plus complètement possible. On s'est souvent demandé comment allait se forger l'unité de demain :par un processus graduel d'élargissement du milieu des années 70 ? Maintenant nous avons en partie la réponse : ce ne sera pas à travers un élargissement progressif mais à travers des convulsions, des heurts, des crises qui balaieront les débris qui ne servent pas à l'avenir, à travers des épreuves pour tester la validité politique et organisationnelle du cadre existant. Le vent de la destruction n'a pas fini de souffler mais quand la lutte de classe aura éprouvé ce milieu d'aujourd'hui il y aura alors des bases plus claires pour un nouveau point de départ.
LES DEBATS DANS LE CCI nos activités et de nos réflexions.
Les exigences de la nouvelle période ont aussi provoqué un certain bouleversement dans le CCI. L'origine de ces difficultés se trouve, comme toujours, dans des faiblesses au niveau politique et organisationnel.
Au 3ème Congrès du CCI en 1979 nous avons décidé de répondre à l'ouverture de la nouvelle période de montée des luttes ouvrières par une accélération et un élargissement de notre intervention. Cette orientation était juste et nécessaire, mais elle était souvent mal interprétée au sein de l'organisation.
L'intervention du CCI dans la grève des dockers à Rotterdam, à Longwy-Denain ([4] [293]) ou à la Sonacotra en France, dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne par exemple, révélait certaines: incompréhensions politiques. Est-ce qu'une organisation révolutionnaire intervient au niveau des collectes d'argent, principalement en tant que "porteurs d'eau" aux ouvriers en lutte ou est ce qu'elle doit intervenir au niveau politique dans les assemblées générales? Que dire quand les ouvriers sont embrigadés dans des "comités de grève" syndicaux destinés à étouffer la lutte.
Il est normal que de telles questions et bien d'autres surgissent quand une organisation commence à être "testée" par la lutte. Nous avons répondu au niveau global par une étude approfondie des conditions générales de la lutte ouvrière dans la période de décadence en insistant sur les différences entre aujourd'hui et le l9ème siècle et sur l'impossibilité et le danger d'employer les mêmes tactiques du passé sans réexamen profond et critique. (Voir la Revue Internationale n°23 "La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme"). Mais nous avons eu du mal à concrétiser cette appréciation synthétique et l'organisation a eu tendance à rester à la surface de la discussion, ce qui ne permettait pas une réelle assimilation de ces nouvelles données.
De plus, nous avons eu à réagir contre une tendance à glisser sur les principes surtout dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne. Bien que l'organisation en tant que telle se soit prononcée clairement sur la nature syndicale de ces "comités de grève" qui étouffaient l'énorme combativité ouvrière, certains camarades par activisme ou par démoralisation commençaient à mettre en question la base même de notre position sur les syndicats aujourd’hui, en voulant voir dans les émanations syndicales une forme "hybride" permettant "un pas en avant". Cette discussion rejoignait celle sur les dangers du "syndicalisme de base" ou "radical", sur le danger d'un glissement vers le gauchisme et des pratiques gauchistes.
De façon générale l'élargissement de notre intervention était trop souvent compris comme un feu vert aux tendances immédiatistes ou localistes au détriment d'une intervention politique à long terme, au détriment de notre unité internationale. On avait tendance à surestimer les possibilités d'un écho immédiat dans la classe, â surestimer des luttes qui n'étaient que des préludes aux affrontements plus décisifs. La fixation d'une partie de l'organisation sur la grève de l'acier en G.B. a failli les aveugler aux événements de la Pologne. Mais en fait, c'était la grève de masse en Pologne qui nous a aidés à rectifier le tir à ce niveau de
Le CCI, qui s'est formé pendant la période de reflux momentané en 1975 a trop souvent pensé que lorsqu'une montée de luttes commencerait de nouveau, tous nos problèmes allaient s'évanouir dans l'enthousiasme général. Maintenant on comprend que ce n'est pas le cas et que c'est une vision bien infantile de l'épreuve de l'histoire. Si au niveau de nos analyses de la lutte de classe nous avons pu arriver assez rapidement à clarifier le débat, l'organisation avait tendance à vouloir voir seulement du côté du prolétariat et non pas un rapport de force entre les classes. Bien que nous avons développé le débat sur le Cours historique au niveau théorique, au niveau quotidien immédiat il y avait une résistance à analyser la réponse de la bourgeoisie comme un tout, sa stratégie globale contre la lutte ouvrière. Des camarades croyaient qu'on allait se transformer en "chercheurs bourgeois" à force de tant discuter sur la stratégie de la bourgeoisie! On avait du mal à saisir le fait qu'il est de la plus grande importance de comprendre le jeu de son ennemi de classe.
Au début de la période de montée des luttes en 1978-79 nous avons écrit sur les "années de vérité sur le potentiel de la situation qui allait s'ouvrir et l'effort de l'Etat bourgeois de se protéger en utilisant à fond le syndicalisme de base et la "gauche dans l'opposition". Quand on commence à énoncer une nouvelle analyse, elle apparait forcément limitée à des grandes lignes, donnant l'impression d'un schématisme. Par exemple, notre courant politique en parlant de la crise du capitalisme en 1967-68 a passé pour "fou" du fait que superficiellement il y avait beaucoup de données qui semblaient contredire cette thèse. Pourtant, elle était juste. De la même façon, l'analyse de la période actuelle et de la "gauche dans l'opposition" nécessitait un approfondissement surtout qu'apparemment et "formellement" il semblait que nous nous soyons trompés en voulant l'appliquer à des pronostics électoraux locaux à un niveau trop ponctuel sans tenir compte des dérapages toujours possibles. Néanmoins nous continuons la recherche et la rectification dans le cadre général « qui reste pour nous toujours fondamental. Il y avait cependant des camardes qui, à la suite des élections en France ont voulu abandonner toute référence à un cadre, jetant l'enfant avec l'eau sale. Nous avons ouvert ce débat publiquement. dans notre presse (cf. la revue n°26; RI n°87; World Révolution août 1981) et nous le continuerons s'il le faut. Nous publierons dans un prochain numéro une étude, fruit de notre discussion interne, sur la bourgeoisie en période de décadence, liée au développement du capitalisme d'Etat. Pour nous, ce n'est pas l'existence de divergences qui représente la faiblesse la plus dangereuse en notre sein mais des réactions impulsives quand on oublie la nécessité des analyses cohérentes ou quand on nie tout besoin de cadre théorique. C'est se résigner à un déboussolement total. Sur le fond et dans ce cadre nous continuerons la discussion sur la gauche dans l'opposition et ses implications.
Sans vouloir se laisser aller à une autosatisfaction dangereuse, il faut dire que malgré des faiblesses politiques conjoncturelles, le CCI dispose d'un cadre de principes cohérents qui lui a permis de répondre aux événements et de continuer son travail en rectifiant s'il le faut ses erreurs. Contrairement aux groupes politiques qui ne sont pas armés pour faire face à la période actuelle et à venir, le CCI, s'il reste dans la rigueur de l'application de sa méthode et de ses principes, est capable de tenir le coup et de contribuer beaucoup au combat du prolétariat C'est là toute la différence entre une appréciation conjoncturelle erronée sur des élections en France et une incapacité de comprendre une grève de masse ou le Cours historique.
LES DIFFICULTES ORGANISATIONNELLES
Comme nous l'avons dit, des faiblesses politiques traduisent au niveau organisationnel, en l’occurrence pour le CCI, un manque de rigueur dans les analyses immédiates, conjoncturelles et les activités qui ont donné lieu à toute une série de discussions sur le fonctionnement interne :
- Sommes-nous des "individus" face à la classe ouvrière (le mythe du révolutionnaire "franc-tireur") ou est-ce-que la classe ouvrière secrète des organisations politiques qui assument une responsabilité collective devant la classe?
- Sur le droit des minorités par rapport à l'unité de l'organisation. Nous pensons qu'une minorité, tant qu'elle n'a pas convaincu l'organisation de la validité de ses positions, doit se tenir au seul mode de fonctionnement que nous connaissons, l'exécution des décisions collectives prises majoritairement. Ces décisions ne sont pas obligatoirement justes (l'histoire a souvent montré le contraire) mais tant que l'organisation n'a pas changé d'avis, elle parle avec une seule voix, celle de son unité internationale. Cela ne veut pas dire que nous gardons nos divergences "secrètes"- au contraire nous pensons qu'il est nécessaire d'ouvrir publiquement nos discussions internes.
Mais aucune minorité ne peut se livrer à saboter le travail global. Certes, il est difficile de vivre avec des désaccords sur des questions d'analyse, il est difficile de faire vivre une organisation non monolithique mais nous sommes convaincus que c'est le seul moyen principiel de faire en sorte que la vie politique du prolétariat traverse réellement une organisation révolutionnaire.
- Le centralisme contre le fédéralisme. Des tendances localistes peuvent toujours surgir dans une organisation internationale mais ce serait notre mort que d'y céder ([5] [294]). Nous avons aussi assisté à des débats qui parfois dégénéraient vers la calomnie sur le fonctionnement interne que certains stigmatisaient comme "bureaucratique" pour la seule raison que notre règle de prise de décision est conçue de façon centralisée.
Nous ne prétendons pas exposer ici tous les aspects de ces débats. Nous y reviendrons. Mais si toutes les critiques n'étaient pas entièrement sans fondement, il y avait surtout des problèmes à revoir et des erreurs à corriger concernant une assimilation incomplète de nos positions de fond sur l'organisation, une tendance à accepter des adhésions à la va-vite, un manque de rigueur de notre pratique organisationnelle, etc.
Ce qu'il faut surtout retenir est que les grandes lignes de cette discussion recouvraient des divergences de fond. L'histoire du mouvement ouvrier nous montre qu'une question d'organisation a souvent été un critère de discrimination d'une gravité profonde ; on n'a qu'à se rappeler des débats dans l’AIT sur le centralisme et le fédéralisme entre Marx et Bakounine, ou le débat sur les critères d'adhésion au 2ème Congrès du parti social-démocratie russe qui a déterminé la scission entre bolcheviks et menchéviks. Aujourd'hui la question de l'unité internationale d'une organisation politique prolétarienne est un point capital, de même la question de l'engagement militant et la responsabilité collective d'un groupe. Le mouvement d'aujourd'hui souffre encore de la hantise des pratiques staliniennes inqualifiables et cette hantise continue à entraver un véritable travail organisationnel. Le mouvement souffre soit d'un étouffement des débats et des minorités, comme dans le PCI, soit des minorités ne reconnaissant ni leurs devoirs envers l'organisation ni l’acquis précieux pour le prolétariat que représente une organisation révolutionnaire comme cela s'est manifesté parfois dans le CCI.
Après notre 4ème Congrès où nous avons tous constaté des incompréhensions organisationnelles, nous avons décidé d'engager une période de discussion à fond sur les questions organisationnelles devant aboutir à une Conférence extraordinaire du CCI. Cette Conférence devrait nous permettre de tirer un bilan sur l'expérience organisationnelle du CCI depuis ses débuts et d'améliorer son fonctionnement.
Nous prenons la responsabilité collective pour les incompréhensions qui avaient surgi en notre sein. Ce n'est pas notre intention, ni à l'intérieur de notre organisation, ni à l'extérieur, de faire de ceux qui sont partis du CCI les boucs-émissaires de nos erreurs. Les faiblesses de notre organisation sont un produit de l'ensemble et c'est souvent des raisons secondaires, même accidentelles qui font que certains individus cristallisent plus que d'autres (d'autres qui souvent partagent leurs idées à un moment donné) les difficultés de l'ensemble.
Mais les événements dans le CCI se sont précipités cet été. Alors que nous commencions la discussion dans les bulletins internes, une "tendance" s'est déclarée précipitamment, sans document précisant ses positions, faisant circuler "clandestinement" et en dehors de l'organisation toute une série d'écrits la dénigrant. Trois jours après que l'organisation ait enfin reçu officiellement un document collectif annonçant la formation de la tendance/ certains de ses membres avaient préféré à la discussion un départ précipité et chemin faisant, de voler le matériel et de retenir l'argent de l'organisation en leur possession. Sans autre clarification des divergences, sans attendre la Conférence, d'autres sont partis, plus simplement, par démora1isation.
LES RECENTS EVENEMENTS
Pourquoi ces discussions ont tourné si brusquement au pire et si mal? Pourquoi s'accompagnaient-elles d'une campagne de calomnies sans précédent de la part de ces ex-camarades contre le CCI? En partie sans doute parce que nous avons mis trop de temps à réagir politiquement. Mais la raison principale est que derrière cette précipitation se trouve la manipulation d'un élément particulièrement dangereux, le nommé Chénier. Nous disposons actuellement de documents montrant l'existence de tout un complot secret et sordide, planifié minutieusement de sang froid faisant circuler des ragots et toutes sortes de "projets" et des instructions, de la part de Chénier sur comment torpiller l'organisation, de se débarrasser des tâches organisationnelles, du comment jouer sur les cordes sentimentales, et de multiplier des intrigues par un réseau clandestin personnel, du comment "noyer" les organes centraux et faire un travail de sape et "sans scrupules". On peut regretter qu'un certain nombre de camarades se soient laissés entraîner par lui dans une fièvre de contestation et dans une correspondance et des réunions clandestines créant une organisation clandestine surprenante au sein de l'organisation. La trajectoire de Chénier dans le milieu politique montre qu'il a agi pareillement dans tous les groupes où il est passé aboutissant' chaque fois à leur désorganisation.
Quand le CCI a publié dans sa presse "l'avertissement" contre les agissements de ce Chénier, il n'a fait que son devoir envers le milieu politique. Certains ont cru lire et interpréter dans ce que nous avons publié une dénonciation plus précise ; ils sont dans Terreur. Nous n'avons pas de preuves formelles de son appartenance à une agence de l'Etat ou quelque chose de similaire et nous ne l'avons jamais prétendu. Nous avons dit par contre que c'est un élément dont le comportement trouble est dangereux pour les organisations politiques et de cela nous sommes profondément convaincus. Quiconque voudrait ignorer cet avertissement doit savoir qu'il le ferait à ses propres dépens comme le CCI l'a appris par expérience. Tout groupe politique peut s'informer de sa trajectoire auprès des uns et des autres. Ce que l'on peut affirmer, c'est que ceux qui travaillent délibérément à la destruction des organisations révolutionnaires pour le compte de l'Etat ou d'autres appendices n'agissent pas autrement que ne l'a fait Chénier.
La réponse du milieu politique à cet avertissement montre ses faiblesses. C'est comme si une telle éventualité n'avait jamais traversé l'esprit de certains groupes. Croit-on réellement que le problème de la sécurité ne se pose pas? De toute façon le sectarisme de certains, comme le GCI, fait qu'il utilise notre effort simplement pour mieux dénigrer le CCI. Il croit que "cet avertissement ne sert qu'à jeter le discrédit sur un militant en rupture et l'ensemble de sa tendance", (lettre du 17/11/81 au CCI). Le CCI a vu bien des départs de camarades (y inclus le GCI) et il n'a jamais "utilisé" autre chose que la discussion politique pour répondre aux questions politiques. Dans les 13 ans d'existence de notre courant politique nous n'avons jamais exclu ([6] [295]) des militants pour divergences politiques, et encore moins descendu au niveau d'inventer des histoires sur le plan de la sécurité. Si nous avions voulu faire des "manœuvres", nous aurions agi comme Chénier : dans le secret, dans le complot, en ne disant rien à personne. Mais notre but n'est pas de nous "débarrasser" des personnes énonçant des désaccords politiques, au contraire, c'est le départ précipité et éhonté de certains membres de cette "tendance" manipulés par Chénier qui a fermé la porte à la clarification des désaccords avec eux. Et pour cause - un manipulateur craint toujours la discussion ; la discussion ouverte lui coupe les moyens de tirer les ficelles qui lui permettent de travailler les individus. C'est pour éviter la discussion que Chénier a précipité les départs et nous le dénoncions pour son travail de destruction.
Il est normal que des groupes politiques sérieux nous posent des questions ; on peut, dans une certaine mesure, se méfier des accusations. Nous regrettons que le milieu politique n'a pas aujourd'hui le moindre cadre pour s'entendre et régler des problèmes de cette nature en même temps qu'il poursuit la confrontation des positions politiques, parce que nous aurions tout de suite ouvert cette question à la collectivité. Cette collectivité n'existant pas, nous avons pris nos responsabilités et nous avertissons les autres, même ceux qui préfèrent utiliser ces avertissements pour alimenter leurs mesquins sentiments "anti-CCI". Aujourd'hui que nous avons récupéré la plupart du matériel volé, nous considérons l'affaire Chénier close. Maintenant que Chénier est arrivé au terme de son travail de destruction, profitant d'un moment de faiblesse du CCI, il peut se retirer de la politique.
En volant l'organisation, les autres ex-camarades (Chénier mis à part) ne réalisaient pas , sans doute, la gravité de leur acte. Surtout quand on vient du milieu gauchiste c'est une pratique courante. En réagissant par rapport à cet acte révoltant, le CCI a défendu non seulement son organisation mais une POLITIQUE GENERALE PAR RAPPORT AUX MOEURS DANS LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE.
Voler les ressources collectives d'une organisation révolutionnaire, c'est la réduire au silence. C'est un acte politique d'une signification grave. Nous avons averti par" écrit tous les éléments concernés que nous condamnons cet acte et que nous allions réagir. Ils ont répondu en disant que le CCI est une bande de "propriétaires outragés" en nous disant que le matériel volé est "une compensation pour leurs cotisations" versées antérieurement! Ainsi un trésorier, en décidant de partir pourrait enlever la caisse. Une organisation révolutionnaire serait-elle une entreprise d'investissements – et quand on en a marre, on retire "ses" actions avec intérêts si possible? ;
Le CCI n'est pas un groupe de pacifistes. Nous avons, récupéré notre matériel. Devant notre effort légitime et tout à fait contrôlé de récupération, nos ex- j camarades ont, à plusieurs reprises, menacé de faire appel ...à la police. Tout cela sans doute en raison de leur lâcheté autant que de leurs confusions politiques.
La non violence au sein du milieu révolutionnaire, l'interdiction de régler les désaccords par le vol et la violence est un principe qu'il est absolument indispensable de défendre et sans lequel toute activité révolutionnaire est impossible. Nous l'avons défendu non seulement pour le CCI mais pour le milieu révolutionnaire dans son ensemble. Peut-on, en quittant un groupe révolutionnaire tenter de le détruire? A-t-on le droit, parce que "cela vous arrange" de décider du jour au lendemain qu'un groupe est "dégénéré", "mort", "inutile" ou "bureaucratique", pour mieux lui nuire par le vol de ses moyens d'intervention? Ce sont des mœurs du marasme gauchiste et si des groupes révolutionnaires ne prennent pas clairement et publiquement position là-dessus, le mi' lieu révolutionnaire n'existe pas. Si les organisations révolutionnaires ne réagissent pas contre le sectarisme qui fait que le groupe révolutionnaire voisin devient l'ennemi n°1, il ne restera plus rien du milieu politique dans la période à venir. Par cette porte entrera toute la pression de l'Etat bourgeois pour détruire les organisations révolutionnaires. La question de la non violence au sein des organisations révolutionnaires et entre elles n'est qu'un petit aspect d'une question beaucoup plus profonde et fondamentale : celle de la non violence au sein de la classe ouvrière. Cette question, nous l'avons soulevée et développée et il serait temps que les autres groupes qui se disent révolutionnaires se prononcent clairement là-dessus.
Le CCI continue ses préparations pour la Conférence extraordinaire et cela même en l'absence des individus directement concernés nous continuerons à débattre leurs positions politiques pour mieux définir notre orientation.
Pour l'ensemble du milieu politique, comme pour le CCI, ou on saura être à la hauteur des années de vérité ou on sera amené à disparaitre.
J.A.
[1] [296] Les participants aux Conférences Internationales étaient Battaglia Comunista (Italie), le NCI (Italie),le CCI, le CWO (Angleterre), Internationell Révolution (Suède- aujourd’hui une section du CCI) et à la 3ème Conférence, également l’Eveil internationaliste (France).
Le GCI (Gauche Communiste Internationaliste- Belgique) une scission du CCI en 1978 est venu comme observateur à la 3ème Conférence. Leur "participation" consistait à dénoncer la Conférence et à saboter l'ordre du jour. Pour les critères politiques sur lesquels on jugeait la participation à ces Conférences de discussion, voir les trois Bulletins des Conférences.
[2] [297] "Le Sectarisme, un héritage de la contre-révolution à dépasser" Rint n°22 sur le bilan de la 3ème Conférence internationale.
[3] [298] Bien que cette tendance vers le regroupement des révolutionnaires soit la meilleure expression des besoins de classe, nous ne la considérons pas comme un absolu. Cette tendance ne s’achève pas toujours dans la création d’un seul parti de classe avant la révolution. Nous rejetons la conception bordiguiste qui n1admet, par principe, qu'une seule expression politique du prolétariat.
[4] [299] cf. la Rint n°20 "Réponse à Nos Censeurs".
[5] [300] Les ex-camarades qui forment aujourd'hui le groupe News of War and Révolution ont quitté le CCI en juin et expriment un aspect de cette faiblesse localiste et fédéraliste. Pour eux, seule une organisation petite et locale peut être réellement démocratique. Pour eux comme pour nos ex membres à Manchester, l'effort de former le CCI "était prématuré". Nos ex-membres à Manchester pensent travailler avec des éléments venant du milieu "libertaire" en décomposition de Solidarity se dédiant aussi à un travail local, aussi bien en théorie qu'en pratique, (cf. WR nov. 1981) L'Ouvrier Internationaliste à Lille semble s'arrêter après 2 numéros, après avoir fait du "porte à porte" (dans la pure tradition de L.O.) pour "intervenir" et "vendre'.'
[6] [301] Le CCI a exclu les camarades qui ont volé l'organisation pour "comportement indigne de militants communistes". Contrairement aux bruits qui circulent (notamment dans la lettre du GCI) les 2ex-membres du CCI en Angleterre qui forment News of War and révolution n'ont rien à voir ni avec le vol, ni avec la récupération, ni avec les exclusions. Leurs prises de positions profondément erronées dans cette affaire et que nous critiquons par ailleurs, ne sont pas à mettre au même niveau.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (3ème partie)
- 3053 reads
Cette critique de "Lénine philosophe" de Harper (Pannekoek) d'INTERNATIONALISME (1948) est la suite des articles parus dans les n°25 et 27 de la REVUE INTERNATIONALE (Se reporter à 1'introduction du n°25).
"... LA REVOLUTION RESERVE UNE CHAIRE D'HISTOIRE ANCIENNE A KAUTSKY..." ET DE PHILOSOPHIE A HARPER
Après les quelques critiques que nous avons pu adresser à la philosophie de Harper, nous voulons maintenant montrer comment le point de vue politique qu'il en dégage s'éloigne dans les faits des positions des révolutionnaires, (Nous n'avons pas voulu, d'ailleurs, approfondir, mais simplement bien montrer que toutes les critiques de Harper faites d'un matérialisme soi-disant mécaniste, partaient d'une exposition assez juste, quoique par trop schématique, du problème de la connaissance humaine et de la praxis marxiste et révolutionnaire, et aboutissaient dans leur application politique pratique, à un point de vue mécaniste et vulgaire.)
Pour Harper :
1) La Révolution russe, dans ses manifestations philosophiques, (critique de l'idéalisme), était uniquement une manifestation de pensée matérialiste bourgeoise...typiquement empreinte du milieu et des nécessités russes.
2) La Russie du point de vue économique, colonisée par le capital étranger, éprouve le besoin de s'allier avec la révolution du prolétariat, "et même", dit-il :
"...Lénine a été obligé de s'appuyer sur la classe ouvrière et comme la lutte qu'il menait devait être poussée à l'extrême, sans ménagement, IL A AUSSI adopté la doctrine la plus radicalisée du prolétariat occidental ([1] [303]) en lutte contre le capital mondial, le marxisme".
Mais, ajoute-t-il :
"Comme la révolution russe présentait un mélange des deux caractères du développement occidental : la révolution bourgeoise quant à sa tâche et la prolétarienne quant à sa force active, aussi la théorie bolchevique qui l'accompagnait était un mélange du matérialisme bourgeois quant à ses conceptions fondamentales et du matérialisme prolétarien quant à la doctrine de la lutte de classe..."
Et là Harper de nommer les conceptions de Lénine et de ses amis de marxisme typiquement russe seul, dit-il, Plekhanov est peut- être le marxiste le plus occidental, quoique encore pas dégagé complètement du matérialisme bourgeois.
Si il est effectivement possible qu'un mouvement bourgeois puisse s'appuyer sur "un mouvement révolutionnaire du prolétariat en 1utte contre le capitalisme mondial" (Harper), et que le résultat de cette lutte soit 1'établissement d'une bureaucratie comme classe dominante qui a volé les fruits de la révolution prolétarienne internationale, alors la porte est ouverte à la conclusion de James Burnham, conclusion selon laquelle la technobureaucratie établit son pouvoir dans une lutte contre l'ancienne forme capitaliste de la société, en s'appuyant sur un mouvement ouvrier, et selon laquelle le socialisme est une utopie
Ce n'est pas par hasard que le point de vue de Harper rejoint celui de Burnham. La seule différence est que Harper "croit" au socialisme et que Burnham "croit" que le socialisme est une utopie ([2] [304]). Mais où ils se rejoignent c'est dans la méthode critique qui est tout à fait étrangère d'avec une méthode révolutionnaire et à la fois objective.
Harper qui a adhéré à la 3ème Internationale, qui a formé le parti communiste hollandais, qui a participé à l'I.C. pendant les années cruciales de la révolution, qui a participé à entraîner le prolétariat de l'Europe à la participation de cet "Etat russe contre-révolutionnaire", Harper s'explique là dessus en disant :
"...si on l'avait connu à ce moment là...", (Matérialisme et Empiriocriticisme de Lénine),"...on aurait pu prédire..."(le sort de la dégénérescence de la révolution russe et du bolchévisme en un capitalisme d'Etat appuyé sur les ouvriers).
On peut répondre à Harper que des marxistes "éclairés" avaient prédit, et étaient arrivés aux mêmes conclusions que Harper sur la révolution russe, et cela bien avant lui, nous voulons citer Karl Kautsky.
La position de Kautsky au sujet de la Révolution russe a été suffisamment rendue publique par le large débat qui eut lieu entre lui Lénine et Rosa, Luxembourg, pour qu'il soit besoin d’insister là dessus, (Lénine, "Contre le courant" "Le Socialisme et la guerre" "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", "L'Etat et la Révolution"; Kautsky, "La dictature du prolétariat" ; Rosa Luxemburg, "La révolution russe", Kautsky, "Rosa Luxemburg et le Bolchévisme").
Dans la suite d'articles de Kautsky, Rosa Luxembourg et le Bolchévisme" (Kampf de Vienne), publiés en brochure, en français, en Belgique, en 1922,on peut, très largement montrer comment, en plus d'un point, les conclusions de Harper peuvent lui être comparées.
"...Et cela ("La Révolution russe" de Rosa Luxembourg) nous (Kautsky) met dans cette posture paradoxale, d'avoir ici ou là, à défendre les bolcheviks contre plus d'une accusation de Rosa Luxembourg..." (Kautsky "Rosa Luxembourg et le Bolchévisme".)
Cela de la part de Kautsky, pour défendre les "erreurs" des bolcheviks (que Rosa critique dans sa brochure), comme des conséquences logiques de la révolution bourgeoise en Russie, et de bien montrer que les bolcheviks ne pouvaient pas faire autre chose que ce à quoi le milieu russe était destiné, à savoir, la révolution bourgeoise.
Pour citer quelques exemples, disons que Rosa critique l'attitude des bolcheviks dans le mot d'ordre et dans la pratique de la prise individuelle de possession dans le partage des terres par les petits paysans, ce qui amènerait, pensait-elle, des difficultés inouïes ensuite à cause du morcellement de la propriété foncière ; elle préconisait au contraire la collectivisation immédiate des terres. Lénine avait déjà répondu à ces arguments que Kautsky avait, d'un autre point de vue (chapitre "Servilité à l'égard de la bourgeoisie sous prétexte d'analyse économique", "La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky"), déjà avancé.
Kautsky: "...Pas de doute que cela (la propriété parcellaire) ait suscité un obstacle puissant pour le progrès du socialisme en Russie. Mais c'est une marche des choses qu'il était impossible d'empêcher : elle aurait pu seulement cire mise en train plus rationnellement que cela ne fut fait par les bolcheviks. Preuve justement que la Russie se trouve essentiellement au stade de la révolution bourgeoise. C'est pourquoi la réforme agraire bourgeoise du bolchévisme lui survivra, tandis que ses mesures socialistes ont été déjà reconnues par lui-même incapables de durer et préjudiciables. . ."
On sait que la "puissante" vue de Kautsky a été totalement infirmée par cet autre "socialiste" Staline qui a collectivisé les terres et "socialisé" l'industrie alors que la révolution était déjà totalement étouffée.
Et voici un long échantillon de Kautsky sur le développement du marxisme en Russie qui se rapproche étrangement de la dialectique de Harper (voir "Lénin als philosophe" -La Révolution russe-);
"Comme il était arrivé chez les français, les révolutionnaires parmi les russes reçurent des réactionnaires cette croyance à l'importance exemplaire de leur nation sur les autres nations .Lorsque le marxisme vint de l'Occident pourri en Russie, il dut combattre très énergiquement cette illusion et démontrer que la révolution sociale ne pouvait sortir que d'un capitalisme supérieurement développé. La révolution à laquelle marchait la Russie serait forcément d'abord une révolution bourgeoise sur le modèle de celle qui s'était produite en Occident. Mais à la longue, cette conception parut vraiment aux plus impatients des éléments marxistes trop restrictive et trop paralysante, surtout à partir de 1905, de la première révolution où le prolétariat russe avait combattu si victorieusement, remplissant d'enthousiasme le prolétariat de toute l'Europe.
Chez les plus radicaux des marxistes russes se forma dès lors une nuance particulière de marxisme. La partie de la doctrine qui fait dépendre le socialisme des conditions économiques du haut développement du capitalisme industriel, alla désormais pâlissant de plus en plus à leurs yeux. En revanche, la théorie de la lutte de classe revêtit des couleurs de plus en plus fortes. Elle fut toujours davantage considérée comme la seule lutte pour le pouvoir politique par tous les moyens, détaché de sa base matérielle. Dans cette manière de concevoir les choses, on arrivera finalement à voir dans le prolétariat russe un être extraordinaire, le modèle de tout le prolétariat du monde. Et les prolétaires des autres pays commencèrent à le croire et à saluer dans le prolétariat russe le guide de l'ensemble du prolétariat international vers le socialisme. Il n'est pas difficile de se l'expliquer. L'Occident avait ses révolutions bourgeoises derrière lui et devant lui les révolutions prolétariennes. Mais celles-ci exigeaient une force qu'il n'avait encore atteinte nulle part. C'est ainsi qu'en Occident, nous nous trouvions dans un stade intermédiaire entre deux époques révolutionnaires, ce qui mettait dans ces pays la patience des éléments avancés à une dure épreuve. La Russie, elle, au contraire, était si en retard qu'elle avait encore devant elle la révolution bourgeoise, la chute de 1'absolutisme. Cette besogne n'exigeait pas un prolétariat aussi fort que la conquête de la domination exclusive par la classe ouvrière en Occident. La Révolution russe se produisit donc plus tôt que celle de l'Occident. Elle était essentiellement une révolution bourgeoise, mais cela put un certain temps ne pas éclater aux yeux par le fait que les classes bourgeoises sont aujourd'hui en Russie bien plus faibles encore qu'elles n'étaient en France à la fin du 18ème siècle. Si l'on négligeait le fond économique, à ne considérer que la lutte de classe et la force relative du prolétariat, il pouvait, durant un temps réellement semblé que le prolétariat russe fut supérieur au prolétariat de 'Europe occidentale et destiné à lui servir de guide."
("Rosa Luxemburg et le Bolchévisme", Kautsky).
Harper reprend un à un, philosophiquement, les arguments de Kautsky :
Kautsky oppose deux conceptions du socialisme :
1) la première selon laquelle le socialisme n'est réalisable qu'à partir de bases capitalistes avancées... (La sienne et celle des menchéviks, valable pour la critique de la révolution russe pour des sociaux-démocrates allemands parmi lesquels s'est trouvé un Noske...conception qui conduisait réellement à faire la politique capitaliste d'Etat en s'appuyant sur "une partie de la masse populaire" contre le prolétariat révolutionnaire).
2) Une autre conception, selon laquelle la lutte pour le pouvoir politique "...par tous les moyens, détachée de sa base matérielle..." permettait "même en Russie" de construire le socialisme... (ce qui aurait été, déformée à souhait, la position des bolcheviks).
En réalité, Lénine et Trotski disaient : la révolution bourgeoise en Russie ne peut être faite QUE par l'insurrection du prolétariat -l'insurrection du prolétariat ayant une tendance objective à se développer sur une échelle internationale-,il nous est permis d'espérer, de par le degré de développement des forces productrices MONDIALES, que cette insurrection russe provoque un mouvement général.
La révolution russe poussant à la révolution bourgeoise du point de vue du développement des forces productives en Russie, la réalisation du socialisme est très possible à condition d'un déclenchement mondial de la révolution. Lénine et Trotski, de même que Rosa Luxembourg, pensaient que le niveau de développement des forces productives dans le monde entier, non seulement rendait le socialisme possible, mais encore le rendait nécessaire, ce niveau ayant atteint un stade qu'ils qualifiaient en commun accord "l'Ere des guerres (mondiales) et des révolutions", en désaccord seulement sur les facteurs économiques de cette situation. Il fallait pour que le socialisme fût possible que la révolution russe ne restât pas isolée.
Kautsky répond, avec les menchéviks, que Lénine et Trotski ne voyaient dans la révolution qu'un seul facteur "volontariste" de prise de pouvoir par un "putsch" bolchevik allant même jusqu'à comparer le bolchévisme au blanquisme.
Tous ces marxistes et socialistes "éclairés" étaient justement ceux que Harper semble citer en exemple, ceux qui avaient "...multiplié les avertissements...", qui étaient contre "...la direction du mouvement ouvrier international par les Russes...", comme Kautsky :
"Mais que Lénine n'avait pas compris le marxisme en tant que théorie de la révolution prolétarienne, qu'il n'avait pas compris la nature profonde du capitalisme, de la bourgeoisie, du prolétariat dans l'ultime phase de leur développement, on en a la preuve immédiatement après 1917, quand le prolétariat international devait être conduit à la révolution prolétarienne par la III° Internationale sur les ordres de la Russie et quand les avertissements des marxistes occidentaux restèrent sans écho..."
Comparé à toute la distinction savante de Kautsky entre Russie retardataire et Occident, entre "marxistes russes" et occidentaux, on retrouve ici toutes les critiques des marxistes "centristes" apparentés à Kautsky.
Ils reprochaient tous, Kautsky en tête, de ne pas avoir considéré le fait de l'état arriéré de l'économie russe, alors que Trotski avait depuis longtemps, et le premier dès 1905, répondu d'une façon magistrale à tous ces "honnêtes pères de famille" (Lénine), comment l'état avancé de la concentration industrielle en Russie, d'une part, et d'autre part, sa situation retardataire du point de vue social (retard de la révolution bourgeoise) en faisant un pays prédisposé à un état révolutionnaire constant et ou la révolution NE POUVAIT - QU'ETRE PROLETARIENNE OU NE PAS ETRE.
Pour Harper bâtissant sa théorie et sa critique philosophique sur la théorie et la critique historico-économique de Kautsky, il dit que, du fait de la situation arriérée de l'économie russe, et du fait de 1'inéluctabilité de la révolution bourgeoise en Russie, du point de vue économique, la philosophie de la révolution russe était obligée de prendre le marxisme première manière, c'est à dire révolutionnaire-démocrate-bourgeoise-feuerbachien, "...la religion est l'opium du peuple..." (critique de la religion), et que c'est normal que Lénine et ses amis n'aient pas pris le marxisme deuxième manière, dialectique-révolutionnaire-prolétarien : "...L'existence sociale conditionne la conscience..." ; (il oublie seulement de dire qu’il est impossible que Harper ne sache pas cela- que la lutte essentielle des bolcheviks était axée contre tous les courants à leur droite dans la social-démocratie, gouvernementaux et centristes -avant I918-et cela très largement, à travers toute la presse européenne et des brochures en toutes les langues, alors que "Matérialisme et Empiriocriticisme" n'a été connu que très tard par un large public russe, traduit encore plus tard en allemand et encore plus tard en français et presque pas lu en dehors de la Russie, on est en droit de se demander si l'esprit de "Matérialisme et Empiriocriticisme" était contenu dans ces articles et brochures, choses que Harper n'a même pas tenté de démontrer, et pour cause !) ; -et il conclut de là, comme Kautsky, que "malgré" la conception volontariste de la lutte de classe de Lénine et Trotski, qui voulaient "...faire du prolétariat russe le chef d'orchestre de la révolution mondiale...",1a révolution était fatalement vouée à être bourgeoise, philosophiquement, du fait que Lénine et ses amis avaient émis un mode de pensée philosophique-matérialiste-bourgeois-feuerbachien-(Marx première manière).
Ce fait, fait rejoindre dans leur critique de la révolution russe, Kautsky et Harper quant au fond du problème, mais aussi quant à la forme qu'ils donnent à leur pensée et à leur critique des bolcheviks où ceux-ci sont accusés d'avoir voulu diriger la révolution mondiale du Kremlin,
Mais il y a mieux, Harper démontre dans son exposé philosophique qu'Engels n'était pas un matérialiste dialecticien, mais encore profondément attaché, quant à ses .conceptions dans le domaine de la connaissance aux sciences de la nature et au matérialisme bourgeois. Cette théorie pour être vérifié demanderait une exégèse que Harper n'a pas fournie au passif d'Engels, alors que Mondolfo, dans un ouvrage important sur le matérialisme dialectique, semble vouloir démontrer le contraire ; ce qui prouve que cette querelle n'existe pas d'aujourd'hui ; quoi qu'il en soit, je crois que des jeunes générations pourront voir dans les générations qui les ont précédées ce que nous pouvons constater chez Lénine ou chez Engels qui faisaient une critique des philosophies de leur temps en partant d'un même niveau de connaissance scientifique et parfois par trop schématisé, alors qu'on doit surtout étudier leur attitude générale non en tant que philosophes, mais d'abord vérifier s'ils se situent sur le terrain de la praxis, des thèses de Marx sur Feuerbach dans leur comportement général.
Dans ce sens, on admettra comme se rapprochant beaucoup plus de la réalité, ce que Sydney Hook dit de l'œuvre de Lénine dans "Pour comprendre Marx" :
"….Ce qui est bien étrange, c'est que Lénine néglige l'incompatibilité entre son activisme politique et sa philosophie dynamique d'action réciproque exprimée dans "QUE FAIRE" d'un côté, et la théorie de la connaissance selon une correspondance absolument mécanique, défendue si violemment par ' lui dans son "Matérialisme et Empiriocriticisme" de l'autre. Ici il suit mot pour mot Engels dans son affirmation que les "sensations sont les copies, les photographies, les images, les reflets de miroir des choses", et que l'esprit n'est pas actif dans la connaissance. Il semble croire que si l'on soutient la participation de l'esprit comme un facteur actif à la connaissance, conditionné par le système nerveux et toute l'histoire du passé, il s'en suit que l'esprit crée tout ce qui existe, y compris son propre cerveau. Cela serait de l'idéalisme le plus caractérisé, et idéalisme signifie religion et croyance en Dieu.
Mais le passage de la première à la seconde proposition est le NON SEQUITUR (elle ne suit pas) le plus manifeste que l'on puisse imaginer. En réalité dans l'intérêt de sa conception du marxisme comme théorie et pratique de la révolution sociale, Lénine dut admettre que la connaissance est une affaire active, un processus dans lequel matière, culture et esprit réagissent réciproquement les uns sur les autres, et que les sensations ne constituent pas la connaissance mais une partie des matériaux travaillés par la, connaissance.
C'est la position prise par Marx dans ses "Thèses sur Feuerbach" et dans l'"Idéologie allemande". Quiconque considère les sensations comme les copies exactes du monde extérieur amenant elles-mêmes à la connaissance, ne peut éviter le fatalisme et le mécanisme. Dans les écrits politiques et non techniques de Lénine, on ne trouve aucune trace de cette épistémologie dualiste lockéenne ; son "QUE FAIRE", ainsi que nous l'avons déjà vu, contient une acceptation franche du rôle actif de la connaissance de classe dans le processus social. C’est dans ses écrits pratiques s'occupant des problèmes concrets d'agitation, révolution et reconstruction que l'on trouve la vraie philosophie de Lénine.. " ("Pour comprendre Marx"- Sydney Hook- p.57-58) ([3] [305])
Le témoignage vivant et l'expression la plus vraie de ce que dit Sydney Hook et qui rejette Harper du côté des Plekhanov-Kautsky est cette illustration de Trotski (Ma Vie) :
Parlant de Plekhanov il dit : " Ce qui le démolissait c'était précisément ce qui donnait des forces à Lénine : l'approche de la révolution. Plekhanov fut le propagandiste et le polémiste du marxisme, mais non pas le politique révolutionnaire du prolétariat. Elus la révolution devenait imminente, plus il entait le sol lui glisser sous les pieds. .. "
On voit donc que n'est pas tant la thèse philosophique de Harper -qui est originale (elle est au contraire une mise au point après tant d'autres), mais surtout la conclusion qu'il en tire.
Cette conclusion et une conclusion fataliste du genre de celle de Kautsky. Kautsky, dans sa brochure « R. Luxemburg et le Bolchévisme", cite une phrase que Engels lui aurait écrite dans une lettre personnelle :
« …les fins véritables et non les fins illusoires d’une révolution sont toujours réalisées par suite de cette révolution…»
C'est ce que Kautsky veut démontrer dans sa brochure, c'est ce que Harper arrive à démontrer (pour ceux qui veulent le suivre dans sa conclusion) dans "Lénin als philosophe", et après avoir combattu le matérialisme bourgeois chez Lénine et chez Engels, il en arrive à une conclusion mécaniste des plus vulgaires de la révolution russe, ".produit fatal" ".fin véritable et non illusoire..." "...la révolution russe a produit ce qu'elle devait produire, c'était écrit dans Empiriocriticisme et dans les conditions de développement économiques russes..." ".le prolétariat mondial devait simplement lui servir de couverture idéologique marxiste..."; "..la nouvelle classe au pouvoir s'emparant tout naturellement de cette forme de penser du Léninisme, matérialiste bourgeoise, pour s 'emparer du pouvoir et lutter contre les ouches de la bourgeoisie capitaliste établie, qui sont philosophiquement retombées vers le crétinise religieux, le mysticisme et l'idéalisme, en même temps qu'ils sont devenus conservateurs et réactionnaires ; ce vent frais, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle classe capitaliste d'Etat, d'intellectuels et de techniciens, trouve sa raison d'être dans Empiriocriticisme et dans le Stalinisme et elle "monte" dans tous les pays, etc. .etc. "
Donc en quelque sorte :
Marx première manière = Lénine Empiriocriticisme =Staline !!!
C’est ce que Burnham a très bien compris, sans connaître Harper, c'est ce que de nombreux anarchistes se plaisent à répéter sans en rien comprendre. Il est- bien évident que Harper ne dit pas cela avec autant de brutalité, mais le fait qu'il ouvre la porte à toutes les conclusions des apologistes bourgeois et anarchistes de Burnham, suffisent à démontrer la tare constitutive de son « Lénin als philosophe »
Ensuite quand il est amené à tirer les enseignements « prolétariens purs » de la révolution russe (je fais remarquer qu'on dit toujours dans le langage Harper-Kautsky "la révolution russe" et rarement « la révolution d'octobre" » distinction qui doit leur écorcher la plume) quand il tire cet enseignement « prolétarien pur », en séparant l'action de la classe ouvrière russe, et « l'influence bourgeoise des bolcheviks » , il en arrive à dire que c'est surtout dans ses grèves généralisées, et dans les soviets (ou conseils) "en soi", qu'a produits la révolution russe, qu'elle est un enseignement positif pour le prolétariat :
1) le prolétariat doit se détacher idéologique « homme par homme » de l'influence bourgeoise.
2) Il doit apprendre progressivement à gérer seul les usines et a organiser la production.
3) Les grèves généralisées et les Conseils sont les armes exclusives du prolétariat.
Et il s'avère que cette conclusion est un type achevé de réformisme, et que de plus c'est totalement anti-"dialectique".
Le détachement "homme par homme" de l'idéologie bourgeoise, en plus que si elle était réalisable remettrait le devenir du socialisme à la fin des siècles, et ferait apparaître la doctrine de Marx comme une belle légende qu'on raconte aux enfants des prolétaires pour leur donner du courage à envisager la vie, de plus nous sommes dans une société bourgeoise dont le caractère social primordial est que chaque homme, pris homme par homme, dans le prolétariat lui-même , ne se détache pas homme par homme, mais pas du tout de l'idéologie dominante ce qui fait de cette idée une "idée" qui garde éternellement sa qualité d'idée. Au contraire la classe ouvrière, dans son ensemble, parvient à s'en détacher dans certaines conditions historiques où elle entre plus violemment en heurt avec le vieux système que dans d'autres. Il n'y a pas de socialisme réalisable "homme par homme" à la manière des vieux réformistes qui croyaient qu'il fallait "réformer d'abord l'homme avant de réformer la société", alors que les deux ne sont pas séparables. La société change quand l'humanité entre en mouvement pour la faire changer, et le prolétariat entre en mouvement, non "homme par homme", mais "comme un seul homme" quand il se trouve placé dans des conditions historiques spéciales.
Le fait que Harper répète sous une forme apparemment nouvelle les vieilles sornettes réformistes, lui permet, sous un verbiage philosophico-dialectique, d'escamoter les problèmes, principaux axes, de la révolution russe, et de les reléguer dans les oubliettes des "raisons d'Etat russes" qui ont tout de même un peu bon dos en ce moment. Il s'agit de la position de Lénine contre la guerre et de la théorie de Trotski de la révolution permanente.
Eh bien oui! Messieurs Kautsky-Harper, on peut toucher des points justes dans une critique purement négative des théories philosophiques ou économiques de Lénine et de Trotski, mais cela ne veut pas dire que vous ayez acquis pour cela une position révolutionnaire, et dans leurs positions politiques, au cours de la révolution russe dans la phase cruciale de 1'insurrection, c’étaient Lénine et Trotski qui étaient vraiment des révolutionnaires marxistes...
Il ne suffit pas, philosophiquement, 20 après la bataille, et après y avoir participé soi-même parmi les chefs de file, de s'apercevoir que tout cela n'a eu pour résultat que l'Etat stalinien et de dire que ceci est le produit de cela. Il faut aussi se demander COMMENT Lénine et Trotski pouvaient s'appuyer sur le mouvement ouvrier international, et POURQUOI, et nous dire franchement si c'est le stalinisme qui est le produit fatal de ce mouvement.
Cela, Harper est comme Kautsky, incapable de nous le dire, parce que dans leurs positions politiques, face à. la bourgeoisie, dans la guerre impérialiste, ou dans une période révolutionnaire montante, ils n'ont pas de conceptions qui leur permettent seulement d'aborder ces problèmes, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent ainsi Lénine "en tant que philosophe" ou en tant que "chef d'Etat", mais ils ne connaissent pas Lénine en tant que marxiste révolutionnaire, le vrai visage de Lénine, face à la guerre impérialiste, et celui de Trotski face à la conception mécaniste du développement capitaliste "fatal" de la Russie. Ils ne connaissent pas le vrai visage d'Octobre qui n'est pas celui des grèves de masses et pas non plus uniquement celui des soviets, soviets auxquels Lénine n'était pas attaché d'une manière absolue (comme Harper), parce qu'il jugeait lui que les formes du pouvoir du prolétariat sortaient spontanément de sa lutte en même temps qu'elle. Et en cela je crois que Lénine était aussi plus marxiste, parce qu'il n'était pas attaché aux soviets ni au syndicat, ni au parlementarisme (même s'il se trompait) d'une manière définitive, mais d'une manière appropriée à un moment de la lutte de classe créée par et pour elle.
Tandis que l'attachement quasi théologique de Harper à ses conseils le fait aujourd'hui, de ce côté également, prendre une forme de cogestion des ouvriers dans le régime capitaliste, comme un apprentissage du socialisme. Ce n'est pas le rôle des révolutionnaires de perpétrer un apprentissage de ce genre. Avec celui de l'apprentissage "homme par homme" de la théorie du socialisme» l'humanité est condamnée à être l'esclave éternelle et éternellement aliénée, avec ou sans conseils avec ou sans "raden communisten" et leurs méthodes d'apprentissage du socialisme en régime capitaliste, vulgaire réformisme, l'envers de la médaille kautskiste.
Quant à la lutte de classe "propre", "par les moyens appropriés" la grève etc.. On en a vu les résultats, elle rejoint la théorie de la gréviculture trotskiste, des trotskistes actuels et des anarchistes, qui perpétuent actuellement la vieille tradition des "trade-unionistes" et des "économistes " et que dès "Que faire" Lénine critiquait si violemment. Ce qui fait que la position antisyndicale des "Raden-Kommunisten", pour être juste pour nous du point de vue purement négatif, n'en est pas moins fausse "en elle même" parce que les syndicats sont remplacés par des petits frères, les soviets, et jouent le même rôle. On croit qu'il faut remplacer le nom pour changer le contenu. On n'appelle plus le Parti, parti, les Syndicats, syndicat, mais on les remplace par les mêmes organisations qui ont les mêmes fonctions et qui portent un autre nom. Qu'on appelle un chat "Raminagrobis", il aura pour nous la même anatomie et le même rôle sur la terre, sauf pour certains pour qui il sera devenu un mythe, et c'est curieux que des philosophes, des matérialistes "dialecticiens" aient l'esprit aussi borné et les vues aussi étroites pour tenter de nous faire avaler comme un monde nouveau le monde de leurs constructions mythologiques, de "Raminagrobis" par rapport au monde des chats.
C'est dans le fond assez normal, dans l'ancien monde un Kautsky était un vulgaire réformiste, dans le monde nouveau, trotskistes, anarchistes et raden-communistes sont des "Révolutionnaires authentiques"; alors qu'ils sont beaucoup plus grossièrement réformistes que le fin théoricien du réformisme, Kautsky.
Le fait que Harper reprenne des arguments classiques du réformisme bourgeois, menchéviks et kautskistes, (et plus récemment la rencontre de ce point de vue et de celui de Burnham), contre la révolution russe ne peut pas tellement étonner. Au lieu de chercher dans cette époque révolutionnaire à tirer des enseignements en marxiste, (tels que Marx et Engels ont, par exemple, tiré des enseignements de la Commune de Paris), Harper veut condamner "en bloc" la révolution russe et le bolchévisme qui y est attaché (tout autant que blanquisme et proudhonnisme étaient attachés à la Commune de Paris).
Harper se rapproche très près de la réalité, et si au lieu de chercher à condamner les bolcheviks appropriés au milieu russe", il s'était demandé quel était le niveau de pensée de cette gauche de la social-démocratie, dont tous étaient issus, il aurait pu tirer de toutes autres conclusions de son livre parce qu'il aurait vu que ce niveau (même chez les plus développés du point de vue de la dialectique) ne permettait pas de résoudre certains problèmes auxquels se heurtait la révolution russe (dont le problème du Parti et de l'Etat), problèmes sur lesquels à la veille de la révolution russe aucun marxiste n'avait des idées précises (et pour cause).
Dans l'ensemble du niveau des connaissances, philosophiques, économiques et politiques, nous l'affirmons et nous allons tenter de le démontrer, ce sont les bolcheviks qui étaient, en 1917, parmi les plus avancés des révolutionnaires du monde entier, et cela en grande partie grâce à la présence de Lénine et de Trotski.
Si les événements sont venus apparemment les contredire, ce n'est pas à cause de leur développement intellectuel approprié au "milieu russe, mais cela est dû au niveau général du mouvement ouvrier international, ce qui également pose des problèmes philosophiques que Harper n'a même pas voulu aborder.
Philippe
[1] [306] Voir plus loin les citations de Kautsky sur "la doctrine du prolétariat occidental".
[2] [307] Dans un prochain n°, nous verrons comment un des disciples de Harper, Cannemeyer va aboutir quoiqu'avec regret et tristesse, au même constat que Burnham sur le "socialisme comme utopie". Fondamentalement, avec beaucoup de bavardage en plus, ce sera 1'aboutissement du groupe Socialisme ou Barbarie et de son mentor Chaulieu.
[3] [308] Et ceci pour le "milieu spécifiquement russe" de Harper-Kautsky : ".la doctrine matérialiste - écrit Marx- affirmant que les hommes sont les produits de leur milieu et de leur éducation, et que les hommes différents sont les produits de milieux et d'éducations différents, oublie que le milieu lui-même a été transformé par 1'homme et que l'éducateur doit à son tour être éduqué. C'est pourquoi elle sépare la société en deux parties dont l'une est élevée au-dessus de 1'ensemble. La simultanéité des changements parallèles dans le milieu et dans l'activité humaine ne peut être rationnellement comprise qu'en tant que pratique révolutionnaire..." (D'après Marx-Engels "Thèses sur Feuerbach", S.Hook, op.ci
Courants politiques:
- Le Conseillisme [210]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 29 - 2e trimestre 1982
- 2607 reads
Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales
- 2794 reads
Le coup de force du 13 décembre 1981 en Pologne a mis fin à l'épisode le plus important depuis un demi-siècle du long combat entre classe ouvrière mondiale et capital. Depuis le resurgissement historique de la lutte prolétarienne à la fin des années 60, jamais la classe ouvrière n'était allée, en effet, aussi loin dans la combativité, la solidarité et 1'auto organisation. Jamais elle n'avait employé avec autant d'ampleur cette arme essentielle de sa lutte dans la période de décadence du capitalisme : la grève de masse. Jamais elle n'avait infligé à la bourgeoisie de telles craintes, ne l'avait contrainte à déployer autant de moyens de défense ([1] [309]). Aujourd'hui, le prolétariat est muselé en Pologne. Une nouvelle fois, il a versé son sang et, contrairement à ce qui s'était passé en 70 et en 76, c'est pour subir une exploitation décuplée, une misère accrue proche de la famine, une terreur déchaînée. C'est donc par une défaite pour la classe ouvrière que se clôt cet épisode. Mais au moment où la coalition de toutes les forces bourgeoises et la force des armes l'obligent à quitter la scène en Pologne, il importe que le prolétariat mondial tire un maximum de leçons de l'expérience qu'il vient de vivre. Il importe qu'il puisse répondre, et avec lui son avant-garde communiste, à la question : Où en sommes-nous? Quelle perspective pour la lutte de classe?
POLOGNE 1980-81 : LE DEBUT DES"ANNEES DE VERITE"
Depuis plusieurs années le CCI a présenté les années 80 comme les "années de vérité", celles où "la réalité du monde actuel (se) révélera dans toute sa nudité", où se "décidera pour une bonne part l'avenir de l'humanité" (Revue Internationale n°20). Cette analyse ne tombait pas du ciel. Elle s'appuyait sur un examen sérieux de l'évolution de la situation économique du système capitaliste concrétisé notamment dans la résolution sur la situation internationale du 3ème Congrès du CCI en juin 1979:
"Après plus d'une décennie de dégradation lente mais inéluctable de son économie et d'échec de tous les "plans de sauvetage" mis en œuvre, le capitalisme a administré la preuve de ce que les marxistes n'ont cessé d'affirmer depuis longtemps : ce système est entré dans sa phase de déclin historique et il est absolument incapable de surmonter les contradictions économiques qui 1'assaillent aujourd’hui. Dans la période qui vient, nous allons assister à un nouvel approfondissement de la crise mondiale du capitalisme, sous forme, notamment, d'une nouvelle flambée d'inflation et d'un ralentissement sensible de la production qui risque de faire oublier celui de 1974-75 et provoquera une aggravation brutale du chômage."(Revue Internationale n°18, p.28)
La caractérisation des années 80 comme "années de vérité" s'appuyait également sur le fait :
"Qu’après une période de relatif recul des luttes couvrant le milieu des années 70, la classe ouvrière tend à renouer aujourd'hui avec une combativité qui s'était manifestée de façon généralisée et souvent spectaculaire à partir de 1968."
Par la détérioration inéluctable qu'elle continuera à provoquer sur les conditions de vie des ouvriers, la crise obligera même les plus hésitants à reprendre le chemin de la lutte" (Revue Internationale n°18, p.29) .
Les luttes ouvrières de Pologne qui se développent au cours de l'été 80 et qui, pendant près d'un an et demi, vont occuper une place de premier ordre sur la scène internationale, constituent à ce jour la manifestation la plus important de cette tendance à la reprise des luttes.
Elles ont fait suite à des mouvements sociaux qui ont touché à partir de 1978 un nombre important de pays industriels comme les USA (grève des mineurs des Appalaches), l'Allemagne (sidérurgie), les Pays-Bas (dockers), la France (explosions de Longwy et Dënain) et surtout la Grande-Bretagne qui connait en 1979 le nombre le plus élevé de journées de grève depuis 1926 (29 millions). Mais seules les luttes du prolétariat en Pologne illustrent la tendance "de la nouvelle vague de luttes à redémarrer au niveau qualitatif le plus élevé atteint par la vague précédente." (Idem)
Le fait que ce soit en Pologne qu'aient pris place les premiers grands combats des "années de vérité" résulte de la faiblesse de la bourgeoisie dans les pays dits "socialistes". Faiblesse qui s'exprime tant sur le plan économique que sur le plan politique. En effet, l'explosion ouvrière de l'été 80 provenait directement de la catastrophe économique qui accable le capital polonais, un des maillons les plus faibles de cet ensemble de pays faiblement développés et particulièrement vulnérables à la crise que constitue le bloc de l'Est.
Mais cette explosion a pu avoir lieu parce que, sur place, la bourgeoisie ne disposait pas d'une des armes essentielles qu'elle utilise aujourd'hui contre le prolétariat : une gauche chargée, grâce à son langage "ouvrier" et sa place dans l'opposition, de saboter de l'intérieur, de dévoyer et d'épuiser les luttes ouvrières.
Dans les grandes concentrations ouvrières d'Occident, frappées elles aussi, ces dernières années, d'une manière cruelle par la crise, comme en témoigne entre autres le niveau de chômage (presque 30 millions de chômeurs pour l'OCDE), c'est de façon préventive que la bourgeoisie a fait face à la tendance à la reprise des combats prolétariens.
Elle s'est appuyée fondamentalement sur les manœuvres de la gauche, partis "ouvriers" et syndicats, à qui il revenait la tâche essentielle d'immobiliser la classe ouvrière, de lui lier les mains pendant que les équipes gouvernementales se chargeaient de mettre en œuvre une austérité accrue. L'exemple le plus clair nous en a été donné par la Grande-Bretagne où, dès 1978, face aux luttes ouvrières, les travaillistes et les trade-unions passaient dans l'opposition, renonçaient au "contrat social" chargé de faire adhérer les travailleurs aux objectifs gouvernementaux et radicalisaient de façon notable leur langage contre la politique de Thatcher. C'est grâce à cette "gauche dans l'opposition" que la bourgeoisie anglaise, une des plus aguerries du monde, a réussi à venir à bout des luttes de 78-79, et en 80-81 à faire taire en bonne partie le prolétariat au moment où celui-ci subissait une des attaques les plus violentes de son histoire.
En Europe de l'Est, les régimes en place, directement issus de la contre-révolution, basant leur pouvoir essentiellement sur la terreur policière, n'ont pas la même souplesse. En 1980, en Pologne, face à l'ampleur du mouvement de grèves et dans un contexte international de reprise des luttes, la bourgeoisie ne peut pas employer comme en 70 et en 76 la répression sanglante. En août, elle est débordée par la situation et c'est dans la brèche ouverte dans ses lignes de défense que s'est engouffré le prolétariat pour mener les combats les plus importants depuis un demi-siècle.
Ainsi, ce n'est pas seulement à cause de la gravité de la crise et de l'attaque contre le niveau de vie des travailleurs que les luttes en Pologne ont pris une telle ampleur. L'incapacité de la bourgeoisie locale à utiliser les armes politiques qui ont fait leurs preuves en Occident est un facteur au moins aussi important pour expliquer ce phénomène.
Ce n'est qu'à chaud" avec la création du syndicat "Solidarité", que la classe dominante a pu se doter d'une telle arme efficace contre le prolétariat. Et c'est à l'échelle internationale que la bourgeoisie a mené sa contre-offensive. En août 80, elle a compris à son tour de façon claire que nous étions entrés dans les années "dé vérité" et elle a accéléré ses préparatifs pour les affronter.
LE DEPLOIEMENT DES FORCES DE LA BOURGEOISIE
Ayant compris la dimension mondiale de son combat contre le prolétariat, c'est donc bien à l'échelle du monde entier que la bourgeoisie a développé son dispositif. Pour cela, elle a su faire passer au second plan ses antagonismes inter-impérialistes quitte à employer ses divisions réelles comme moyen d'un partage des tâches.
Dans ce partage, il est revenu aux gouvernements du bloc de l'Est le soin d'intimider les ouvriers de cette région par des menaces d'intervention et de répression violente de la part du "grand frère". Ces gouvernements avaient également la tâche de déconsidérer à leurs yeux les luttes ouvrières de Pologne au moyen de campagnes nationalistes sur le mode : "les polonais sont des paresseux et des énergumènes", "c'est pour cela que leur économie s'effondre", "leur agitation est responsable de nos propres difficultés économiques". ..
Mais l'essentiel du travail est revenu aux grandes puissances occidentales qui ont accompli de front toute une série de tâches :
-sauvetage économique du capital polonais en faillite, notamment à travers un rééchelonnement de sa dette,
-crédibilisation des campagnes d'intimidation développées par Moscou au moyen notamment de "mises en garde contre toute intervention extérieure en Pologne", amplement répercutées dans ce pays par les médias du type "Radio Free Europe" et BBC,
-campagnes en direction des prolétaires d'Occident sur le thème : "les problèmes affrontés par les ouvriers en Pologne sont spécifiques à ce pays ou à ce bloc" (gravité de la crise économique, pénurie, misère, "totalitarisme")
-prise en charge, tant matérielle que politique, par la gauche et les syndicats de l'Ouest, de la mise en place de l'appareil de "Solidarnosc" (envois de fonds, de matériels d'impression, de délégations chargées d'enseigner au nouveau-né les diverses techniques de sabotage des luttes...)
-sabotage systématique des luttes ouvrières dans les pays de l'Ouest par ces mêmes organisations qui ont employé tout l'arsenal classique ("journées d'action", "grèves" bidon, divisions de la classe en secteurs professionnels ou géographiques) mais auquel elles ont ajouté ces derniers mois d'énormes campagnes pacifistes destinées à détourner vers une impasse démobilisatrice l'inquiétude réelle et justifiée des travailleurs face à la menace de guerre (cf. article "crise et lutte de classe" dans la Revue Internationale n°28). Il est remarquable que, pour faciliter leur travail de sabotage de la combativité ouvrière, les syndicats d1 Occident -juste retour des choses- se soient servis, pour redorer leur blason, de la popularité de "Solidarité" auprès des ouvriers qu'ils ont pour tâche d'encadrer : le cynisme et la duplicité de la bourgeoisie, surtout celle de gauche, n'ont pas de limites!
En Pologne même, cette offensive bourgeoise d'affaiblissement de la classe ouvrière mondiale a eu pour résultat :
-le développement du "syndicat indépendant" au détriment de la plus grande conquête d'août 80 : la grève de masse, l'auto-organisation de la lutte.
-le développement des illusions nationalistes, démocratiques, et autogestionnaires promues par ce syndicat et qui trouvaient un des leur principaux aliments dans la passivité du prolétariat des autres pays.
Contrairement aux inepties débitées par ceux qui pensaient qu'en Pologne le prolétariat radicalisait sa lutte et s'apprêtait à livrer au capitalisme un combat décisif (voire même la révolution!), il est important donc de comprendre comment s'est produit, entre août 80 et décembre 81, cet affaiblissement progressif, malgré les énormes réserves de combativité de la classe ouvrière en Pologne; de comprendre et de mettre en évidence pourquoi, entre ces deux dates, la bourgeoisie a attendu presque un an et demi pour déchainer sa répression. Il s'agit de faire apparaître clairement que cette répression n'est pas intervenue parce que la bourgeoisie et son agent au sein du prolétariat "Solidarité" auraient été débordés, mais bien, au contraire, parce que, face à leur offensive, le prolétariat s'est retrouvé en POSITION DE FAIBLESSE. Et cette faiblesse, C'EST AU NIVEAU MONDIAL QU'ELLE S'EST REVELEE.
LA DEFAITE OUVRIERE.
Avec l'instauration de l'état de guerre en Pologne, le prolétariat a subi une défaite ; il serait illusoire et même dangereux de se le cacher. Seuls des aveugles ou des inconscients peuvent prétendre le contraire.
C'est une défaite parce que, dans ce pays, les ouvriers sont aujourd'hui emprisonnés, déportés, terrorisés, astreints de travailler le fusil dans le dos pour des salaires encore plus misérables qu'avant. Leur résistance de plusieurs semaines face au coup de force, pour courageuse et déterminée qu'elle fut, était vouée à l'échec.
Les différentes formes de résistance passive elles-mêmes seront vaincues à la longue, car elles ne sont plus le fait de larges mouvements de masse, d'une action collective et organisée de la classe, mais d'une somme d'ouvriers dont la répression et la terreur ont rétabli 1'atomisation.
C'est une défaite parce qu'en Pologne, le prolétariat s'est laissé tromper et démobiliser par les mystifications mises en avant par la bourgeoisie et que, du fait que son ennemi le plus pernicieux, "Solidarité" ,ne s'est pas clairement démasqué et de plus, jouit maintenant de l'auréole du martyr, la répression qu'il subit aujourd'hui ne lui donne pas réellement les moyens de tirer pleinement les leçons de son expérience, de prendre clairement conscience des enjeux de sa lutte.
C'est enfin et fondamentalement une défaite parce que ce coup de force atteint le prolétariat de tous les pays sous forme de démoralisation et surtout d'une réelle désorientation, d'un déboussole-ment certain face aux campagnes déchaînées par la bourgeoisie depuis le 13 décembre 81 et prenant le relais de celles d'avant cette date.
Cette défaite, le prolétariat mondial l'a subie dès lors que le capitalisme, d'une façon concertée, est parvenu à isoler le prolétariat de Pologne du reste du prolétariat mondial, à l'enfermer idéologiquement dans le cadre de ses frontières de bloc (pays "socialistes" de l'Est) et nationales ("la Pologne est une affaire de polonais"); dès lors qu'il est parvenu, grâce à tous les moyens dont il dispose, à faire des ouvriers des autres pays des SPECTATEURS, inquiets, certes, mais PASSIFS, à les détourner de la seule forme que peut avoir la solidarité de classe : la généralisation de leurs luttes dans tous les pays, en mettant en avant une caricature hideuse de solidarité : les manifestations sentimentales, les pétitions humanistes et la charité chrétienne avec ses envois de colis pour Noël.
LA NON GENERALISATION DE LA LUTTE OUVRIERE EST EN SOI UNE DEFAITE. C'est la première et la plus essentielle des leçons des événements de Pologne.
Le coup du 13 décembre, sa préparation et ses suites sont une victoire de la bourgeoisie. Ce sont des exemples douloureux pour le prolétariat de l'efficacité de la stratégie mondiale du capital de "gauche dans l'opposition". Cet exemple illustre une fois de plus que, dans la décadence du capitalisme, la bourgeoisie n'affronte pas le prolétariat de la même façon qu'au siècle dernier. A cette époque les défaites infligées au prolétariat, les répressions sanglantes, ne lui laissaient pas d'ambiguïté sur qui étaient ses amis et ses ennemis : ce fut notamment le cas lors de la Commune de Paris et même de la révolution de 1905 qui, tout en annonçant déjà les combats de ce siècle (la grève de masse et les conseils ouvriers) comportait encore des caractéristiques propres au siècle dernier (notamment quant aux méthodes de la bourgeoisie). Aujourd'hui par contre, la bourgeoisie ne déchaîne la répression ouverte qu'à la suite de toute une préparation idéologique, dans laquelle la gauche et les syndicats jouent un rôle décisif, et qui est destiné tant à affaiblir les capacités de défense du prolétariat qu'à l'empêcher de tirer tous les enseignements nécessaires de la répression.
Le capitalisme n'a pas renoncé et ne renoncera jamais à l'emploi de la répression ouverte et brutale contre le prolétariat. C'est son arme de prédilection dans les pays arriérés, là où le prolétariat est le moins concentré. Mais son champ d'action ne se limite pas à ces régions. Partout, c'est une arme destinée à parachever une défaite du prolétariat, à le dissuader le plus longtemps possible de reprendre le combat, à "faire un exemple" à l'égard de l'ensemble de la classe ouvrière, à la démoraliser. C'est en cela que consistait la fonction du coup de force du 13 décembre 81 en Pologne.
Cependant, dans les grandes concentrations ouvrières, l'arme essentielle de la bourgeoisie est l'arme idéologique. C'est pour cela que le prolétariat doit se garder d'une accumulation de défaites idéologiques comme celle d'aujourd'hui, qui viendrait saper le potentiel de combativité de ses bataillons décisifs et l'empêcherait d'engager le combat frontal contre le capitalisme.
QUELLES PERSPECTIVES ?
Premier assaut d'envergure des "années de vérité" contre la forteresse capitaliste, les luttes ouvrières de l'été 80 en Pologne constituaient, même si leurs protagonistes n'en n'étaient pas conscients, un appel au prolétariat mondial.
Brouillé par tous les bruits de la propagande bourgeoise, cet appel à la généralisation du combat n'a pas été entendu. Bien au contraire.
Si on se réfère par exemple aux statistiques du nombre de jours de grèves (qui sans être un critère absolu, indiquent quand même une tendance), les années 80 et 81 comptent parmi celles depuis 1968 où la combativité ouvrière s'est manifestée le moins. A l'heure présente, dans des grandes puissances capitalistes comme les USA et l'Allemagne, la bourgeoisie est capable de faire accepter aux ouvriers, sans réaction de leur part, des baisses importantes de leur niveau de vie (cf. accords dans l'automobile aux USA, dans la métallurgie en RFA). Le "cordon sanitaire" mis en place par la bourgeoisie mondiale autour du prolétariat "pestiféré" de Pologne a été efficace. Relativement désarçonnée en août 80, la bourgeoisie a finalement remporté, et de manière nette, ce premier affrontement.
Est-ce à dire que le prolétariat est d'ores et déjà battu, que dès à présent la bourgeoisie a les mains libres pour apporter à la crise de son système sa propre réponse : l'holocauste impérialiste?
Ce n'est pas le cas. Pour cruelle qu'elle soit, la défaite subie par le prolétariat à la suite de ses combats en Pologne n'est que partielle. Pour les mêmes raisons qui ont fait que le premier engagement des "années de vérité" a eu lieu dans ce pays (faiblesse de son économie et de son régime), qui ont permis à la bourgeoisie d'isoler aussi facilement les combats qui s'y sont déroulés (pays de second ordre, relativement excentré par rapport aux grandes concentrations industrielles et prolétariennes), pour ces mêmes raisons, les combats de Pologne n'étaient pas décisifs. La défaite est partielle parce que l'affrontement n'était que partiel C'est un bataillon détaché du prolétariat mondial parti en éclaireur qui a engagé le combat. Par contre, le gros des troupes, celui qui est basé dans les énormes concentrations industrielles d'Occident, et notamment en Allemagne, n'est pas encore entré dans la bataille. Et c'est pour tenter de l'en empêcher que s'est développée la campagne actuelle de la bourgeoisie d'Occident sous la conduite du chef d'orchestre Reagan (ce n'est pas un hasard si on a parlé du "Reagan show").
Cette campagne est la continuation de celle qui avait été mise en place bien avant le coup de force du 13 décembre 81 et qui l'avait rendu possible.
La seule différence consiste dans le fait qu'avant cette date, la campagne visait simultanément les ouvriers d'Occident et ceux de Pologne dans la mesure où ceux-ci restaient en première ligne des affrontements de classe, alors que maintenant la bourgeoisie occidentale vise primordialement le prolétariat de son bloc. Après avoir fait taire le détachement le plus combatif du prolétariat mondial, il revient au capital de concentrer l'attaque idéologique en direction des bataillons les plus importants : ceux dont dépendra l'issue du combat.
C'est en ce sens qu'on ne doit pas considérer ces campagnes comme des préparatifs idéologiques directs en vue de la guerre impérialiste. Certes, chacun des blocs ne perd aucune occasion de marquer des points dans ce domaine dans la mesure où les conflits entre blocs ne disparaissent jamais. De même il est clair que l'aboutissement d'une éventuelle défaite générale du prolétariat serait un nouvel holocauste impérialiste. Cependant, il est important de souligner que l'objectif prioritaire de la présente campagne est de prévenir les surgissements prolétariens dans les principales métropoles du capitalisme en tentant de faire coller les ouvriers de ces pays au char de l'Etat "démocratique". L'utilisation du repoussoir du "totalitarisme du bloc de l'Est" n'a pas pour fonction immédiate l'embrigadement guerrier contre l'autre bloc, mais la DEMOBILISATION DES LUTTES OUVRIERES qui est la condition PREALABLE à cet embrigadement.
De la même façon que dans les campagnes pacifistes, la peur de la guerre est exploitée pour détourner le prolétariat de son terrain de classe, dans le "Reagan Show" actuel, la division entre blocs et entre pays est utilisée pour briser la combativité du prolétariat et son front de lutte. Face à lui, on assiste, non pas à une division entre secteurs de la bourgeoisie, mais à une division du travail entre ces secteurs.
Quelles sont les chances de réussite de cette campagne de la bourgeoisie?
Même si cette classe n'a pas encore aujourd'hui les mains libres pour apporter sa propre réponse guerrière à la crise, ne faut-il pas craindre qu'elle réussisse à maintenir sa chape de plomb idéologique jusqu'à étouffer complètement et définitivement la combativité prolétarienne?
Ce danger existe et nous l'avons signalé plus haut. Mais il est important de mettre en évidence les atouts dont dispose aujourd'hui le prolétariat et qui distinguent la situation présente de celles qui existaient à la veille de 1914 ou dans les années 30 à des moments où le rapport de forces global penchait en faveur de la bourgeoisie. Dans ces deux cas, le prolétariat avait été directement battu dans les grandes métropoles (en particulier, dans celles d'Europe occidentale : Allemagne, France, Grande-Bretagne), soit sur un plan uniquement idéologique (à la veille de 1914 grâce au poids du réformisme et à la trahison des partis socialistes) soit sur les deux plans physique et idéologique (après la terrible défaite des années 20).
Tel n'est pas le cas aujourd'hui ([2] [310]), où les générations ouvrières dans les grands centres industriels n'ont pas subi de défaite physique, où les mystifications démocratiques ou antifascistes n'ont plus le même impact que par le passé, où le mythe de la "patrie socialiste" est moribond, où les anciens partis ouvriers passés à l'ennemi capitaliste, le PC et le PS, ont un pouvoir d'embrigadement du prolétariat bien moindre qu'au moment de leur trahison.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les réserves de combativité du prolétariat sont encore pratiquement intactes et, comme on l'a vu avec la Pologne, énormes.
Cette combativité, la bourgeoisie ne pourra pas la contenir indéfiniment, malgré toutes les campagnes, manœuvres, mystifications qu'elle déploie à l'échelle internationale. Toute mystification, pour être efficace, a besoin de s'appuyer sur une apparence de vérité.
Or les mystifications grâce auxquelles la bourgeoisie réussit encore à empêcher la classe ouvrière mondiale d'engager un combat massif sont destinées à être directement attaquées par l'aggravation de la crise :
-le mythe des "Etats socialistes" qui, en son temps, fut une des armes majeures de l'embrigadement de la classe ouvrière par le capitalisme, vit aujourd'hui ses dernières heures face à la déroute économique de ces Etats, à la misère croissante qui s'abat sur la classe ouvrière qui y vit et aux explosions sociales qui en résultent;
-l'idée qu'il existe des "spécificités nationales" ou de bloc, qui a permis l'isolement du prolétariat en Pologne, sera de plus en plus battue en brèche par le nivellement par le bas de la situation économique de tous les pays ainsi que des conditions de vie de tous les travailleurs;
-l'illusion qu'en acceptant des sacrifices on pourra s'éviter une situation bien pire (illusion qui a pesé sur les ouvriers américains ou allemands lorsqu'ils ont consenti à des baisses de salaires en échange d'une hypothétique garantie de l'emploi) ne pourra pas résister indéfiniment à l'aggravation inexorable de cette situation;
-la croyance dans les vertus de telle ou telle potion miracle ("économie de l'offre", nationalisations, autogestion, etc.), capable, sinon de rétablir (on n'en n'est plus là], mais d'empêcher l'aggravation de la situation économique, se heurte de plus en plus durement à la réalité des faits.
Plus généralement, c'est l'ensemble des piliers idéologiques du système actuel qui subira l'assaut de son effondrement économique :
-toutes les grandes phrases des politiciens sur "la civilisation", la "démocratie", les "Droits de l'homme", la "solidarité nationale", la "fraternité humaine", la "sécurité", "l'avenir de la société", etc. apparaîtront de plus en plus pour ce qu'elles sont : de vulgaires rodomontades, des mensonges cyniques;
-à des masses croissantes de prolétaires, y compris ceux des pays jusqu'à présent les plus "prospères", le système actuel dévoilera sa véritable nature et deviendra synonyme pour eux de barbarie, de terreur étatique, d'égoïsme, d'insécurité et de désespoir.
Malgré et à cause des terribles épreuves que l'aggravation de la crise impose au prolétariat, celle-ci constitue donc un atout pour lui. C'est un atout d'autant plus important que le développement de la crise présente est bien plus apte à lui ouvrir les yeux que celui de la crise de 1929. En effet, après la violente chute du début des années 30, le capitalisme avait donné pendant quelques années l'illusion d'un rétablissement grâce aux interventions étatiques massives et notamment le développement d'une économie de guerre. Ce rétablissement momentané qui s'est achevé en 1938 a permis cependant de finir de démobiliser le prolétariat, déjà considérablement affaibli par les défaites des années 20, et de le jeter, pieds et mains liés, dans la seconde boucherie mondiale.
Aujourd'hui, par contre, la bourgeoisie a épuisé toutes les ressources des politiques néo-keynésiennes et a depuis des décennies déjà développé pleinement son économie de guerre. Elle ne peut plus offrir à la société aucune illusion de rétablissement : le caractère absolument inexorable de la crise s'impose à tous avec d'autant plus de force. Et cela, au point même que même les plus fervents défenseurs universitaires du capitalisme, les économistes, avouent leur totale impuissance » Après que le prix Nobel "néo-keynésien", Paul Samuelson ait constaté amèrement en 1977, "la crise de la science économique", c'est son rival, le prix Nobel "monétariste" Milton Friedman, qui avoue en septembre 1977 : "Je ne comprends pas ce qui se passe" (Newsweek).
Si la récession de 1971 avait été suivie jusqu'en 73 d'une reprise euphorique, celle de 1974-75 n'avait laissé la place qu'à une reprise languissante et celle qui commence en 1980 n'en finit pas de traîner et de démentir les prévisions sur une "nouvelle reprise". C'en est bien fini de toutes les potions administrées au long des années 70 pour retarder les échéances et qui deviennent aujourd’hui un facteur d'aggravation du mal. Confrontées à la surproduction de marchandises, les grandes puissances capitalistes ont tenté de vendre celles-ci en usant et abusant du crédit. Le résultat est remarquable rentre 71 et 81, la dette totale du Tiers-Monde est passée de 86,6 à 524 milliards de dollars avec une augmentation de 118 milliards pour 1981. La plupart de ces pays sont maintenant en cessation de paiement : au pays du "miracle", le Brésil, champion du monde de l'endettement, sur 100 dollars empruntés il n'y en a aujourd'hui que 13 qui soient investis productivement; les 87 autres sont destinés à payer les intérêts et les amortissements des dettes antérieures. Mais cet endettement du Tiers-Monde n'est qu'une partie de l'endettement total, qui dépasse de loin les 1000 milliards de dollars et grâce auquel le capitalisme a tenté d'esquiver la crise au cours des années 70. La banqueroute du Tiers-Monde signe celle de toute l'économie mondiale.
Alors que la crise trouve son origine au centre du capitalisme, les pays où il est le plus développé, ceux-ci ont tenté pendant une décennie d'y résister en repoussant les effets les plus brutaux vers la périphérie. Mais telles les ondes à la surface d'un bassin qui reviennent vers le centre après avoir atteint ses bords, les convulsions les plus violentes de la crise reviennent, avec une force accrue, frapper les métropoles du capital y compris cette "Allemagne modèle" qui faisait tant d'envieux et qui connait aujourd'hui une des progressions du chômage les plus fortes d'Europe.
C'est maintenant le prolétariat de ces métropoles qui est frappé de plein fouet par la crise et qui sera contraint, malgré toutes les manœuvres de la gauche dans l'opposition qui ne pourront à la longue que s'user, de reprendre le combat, comme a commencé à le faire celui des pays périphériques (Brésil 78-79, Pologne 80-81 par exemples). Ce prolétariat, la bourgeoisie ne pourra pas l'isoler aussi facilement qu'elle l'a fait avec celui de Pologne.
Alors seront données les conditions d'une réelle généralisation mondiale des luttes prolétariennes, comme les combats de Pologne en ont mis en évidence la nécessité ([3] [311]). Cette généralisation n'est pas une étape simplement quantitative du développement de la lutte de classe. C'est un pas réellement QUALITATIF qu'accomplira le prolétariat en la réalisant :
-elle seule permettra de surmonter les illusions nationalistes, syndicalistes, démocratiques, véhiculées notamment par la gauche, qui pèsent sur le prolétariat,
-elle seule permettra de mettre en échec la solidarité et la coopération réalisée par la bourgeoisie face à la lutte de classe,
-elle seule créera les conditions où pourra se poser le problème du renversement de l'Etat capitaliste, de la prise du pouvoir par le prolétariat (contrairement à ce que pensent certains, dont le GCI, qui posaient déjà comme tâche aux ouvriers de Pologne de prendre les armes.
-elle seule donnera les moyens au prolétariat de prendre conscience de sa force, et du fait que sa lutte représente le seul espoir de toute l'humanité, que la véritable signification de ses multiples combats est de constituer autant de préparatifs pour la révolution communiste, dont Vidée lui deviendra de nouveau familière après plus d'un demi-siècle d'éclipsé."
C'est donc parce que la crise frappe maintenant de plein fouet les grandes métropoles capitalistes que cette généralisation devient possible. Son chemin en sera long et heurté et comportera encore d'autres défaites, partielles mais douloureuses. L'essentiel de ces combats est devant nous; pendant longtemps encore, le prolétariat se heurtera aux sabotages de la gauche et en particulier de ses fractions "radicales" comme le "syndicalisme de base". Ce n'est qu'après avoir débusqué ses multiples pièges et avoir engagé le combat contre elle qu'il pourra s'attaquer frontalement à l'Etat capitaliste en vue de le détruire.
C'EST UNE LONGUE ET DIFFICILE BATAILLE QUI S'ANNONCE, MAIS RIEN N'INDIQUE QU'AVEC POUR ALLIE L'EFFONDREMENT IRREVERSIBLE DE L'ECONOMIE CAPITALISTE, LE PROLETARIAT NE SOIT PAS EN MESURE DE LA REMPORTER.
F.M. 12-3-82
[1] [312] Sur la portée des luttes ouvrières en Pologne, la grève de masse, les moyens déployés par la bourgeoisie mondiale contre le prolétariat, le lecteur pourra se reporter aux articles parus dans la Revue Internationale n°23,24,25,26,27 et 28 ainsi que dans la brochure à paraitre prochainement.
[2] [313] Voir à ce sujet le Rapport sur le cours historique au 3° congrès du C.C.I. dans la Revue Internationale n°18
[3] [314] Voir le texte sur "La généralisation mondiale des luttes" dans la Revue Internationale n°26
Géographique:
- Pologne [111]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [315]
Heritage de la Gauche Communiste:
Lutte de classes en Europe de l’est (1970 -1980)
- 3093 reads
L'unification internationale du prolétariat dans le processus de la révolution mondiale est la condition matérielle la plus décisive du communisme. Après avoir mis en relief la puissance des luttes ouvrières dans les pays de l'Est de l920 à 1970 et les limites que leur a imposé leur isolement international (Revue Internationale n° 27 et 28), la fin de cette étude montre comment les luttes des années 80 ouvrent la perspective de la fin de cet isolement.
LA VAGUE DE LUTTES DES ANNEES 70 A L’EST
En septembre 1976, les oppositionnels tchèques faisaient état dans le journal "Listy Blâtter" du développement d'une nouvelle vague de résistance en URSS :
"Le 8 novembre de 1'année dernière, soixante marins russes, Lettoniens et Estoniens de la flotte du Drapeau Rouge, se mutinèrent à bord du destroyer "Storoschewoi". Le bateau après avoir quitté le port de Riga fut attaqué en haute mer par des hélicoptères et des sous-marins. La bataille passe pour avoir été très sanglante, la majorité des marins ayant été tués et les survivants passés en cour martiale ou exécutés. La cause de la rébellion : des conditions sociales insupportables et des traitements inhumains, similaires à ceux du vaisseau tsariste "Potemkine" en 1905 à Odessa. Il y a également 1'agitation continuelle dans la métropole géorgienne 'Tiflis' qui fut rapportée en avril par 1'organe du parti "Sarja Wostoka". Manifestations de rue de lycéens et d'étudiants, assassinats de fonctionnaires du parti russe et de leurs collaborateurs, des manifestations spontanées pour la liberté d'ouvriers et de femmes, et même des affrontements de rues, barricades et attentats à la bombe contre les palaces du parti. L'agitation a pris un caractère de masse, et ne peut être complètement contenue par la police secrète.
En dernier lieu, nous devons mentionner la vague de grèves récentes provoquée par le rationnement alimentaire, concentrée ici encore, dans les centres industriels des régions en dehors de la Russie (Baltique, Ukraine). Le ravitaillement échauffe 1'atmosphère de pré-révolution; des arrêts de travail spontanés, des rassemblements de masse, des marches, des meetings de protestations ont été rapportés, venant des villes de Rostov sur le Don, Lvov, Kiev, Dniepropetrovsk, Riga et Dnieprodzeijinsk Dans la métropole ukrainienne de Kiev, des affrontements sanglants eurent lieu entre des femmes ouvrières et la milice en face des magasins d'alimentation vides. Les rationnements les plus importants concernent 1'approvisionnement en aliments de première nécessité -viande, pain, produits laitiers. Dans les entreprises de machine-outil Tscheljabinsk et d'industrie chimique Schtschokino, des grèves ont éclaté en réaction aux lock-out".
Mis à part le caractère aberrant de l'expression "une atmosphère prérévolutionnaire", il ne peut y avoir aucun doute sur l'étendue des troubles sociaux qui ont saisi de larges régions d'URSS vers la fin des années 1970. Un rapport raconte à quelle vitesse Brejnev fut obligé de se rendre à Toula en 1977 à cause d'un mouvement de grève oui s'y était déclenché. Les ouvriers, là, avaient refusé d'aller chercher leurs salaires durant deux mois, parce qu'ils ne pouvaient rien acheter avec. Brejnev décida -33 ans après la fin de la dernière guerre- de proclamer Toula "ville héroïque" pour son rôle dans la victoire contre Hitler. Ce statut impliqua un meilleur approvisionnement en nourriture (rapporté dans "Osteuropakomitee, Info 32" Socialist review, été 80).
Au mois de décembre de la même année eut lieu une violente grève dans la grande usine de caoutchouc de Kaunas en Lituanie et peu après, une grève perlée dans l'industrie mécanique (Poutilov) à Leningrad, celle qui fut au cœur de la révolution d'octobre, en protestation contre le mauvais traitement des prisonniers travaillant dans l'usine (rapporté dans "Listy").
En 1973, des grèves de protestations éclatèrent dans les mines de Roumanie. Comme en 70, elles furent violentes mais elles restèrent sporadiques et isolées (rapporté dans "Der Spiegel, 12.12.77). En 1977, les mineurs, le cœur militant de la classe ouvrière en Roumanie, reprenaient le flambeau de la lutte. La grève éclata à Lupeni et s'étendit immédiatement à toutes les vallées minières voisines. En tout, 90.000 personnes se mirent en grève, dont 35.000, retranchées dans Lupeni pour prévenir le danger d'une répression. Le second jour, plusieurs des membres d'une délégation du sommet du parti, envoyés pour "négocier" furent fait prisonniers, et d'autres eurent le visage barbouillé de l'infâme nourriture que l'on donne à manger aux ouvriers. Ceausescu vint alors en personne et eut beaucoup de chance de s'en tirer vivant. Les ouvriers tentèrent de le lyncher. Il s'enfuit immédiatement au Kremlin pour s'entretenir avec Brejnev. Un détachement de l'Armée Rouge envoyé pour disperser les ouvriers changea d'avis quand il rencontra leur résistance. Puis, alors que la grève commençait à s'étendre au delà des bassins miniers de la vallée de Jiul -aux chemins de fer, à une usine textile de Brasov, à une usine de machinerie lourde de Bucarest- Ceausescu revint pour satisfaire les revendications ouvrières. Deux semaines durant, la situation de l'approvisionnement s'aggrava gravement. L'armée revint alors : 2000 hommes appartenant aux troupes de choc furent envoyés à Lupeni. Ils attaquèrent les ouvriers, et en battirent un grand nombre jusqu'à les rendre infirmes à vie. Puis ils déportèrent 16.000 mineurs avec leurs familles dans différentes parties du pays. Beaucoup furent envoyés travailler dans les mines d'uranium où ils perdirent leurs cheveux en quelques semaines; le cancer se répandit parmi eux en quelques mois. Le slogan principal des mineurs de Lupeni était "à bas la bourgeoisie prolétarienne". Dans leur cinquième lettre à "Radio free Europe", les ouvriers écrivirent :
"De tout notre cœur, nous vous demandons de lire cette lettre au micro; n'ayez pas peur qu'il soit connu qu'il y a des grève dans un Etat socialiste. Il y en aura encore plus car nous n'avons pas d'autre solution que de rendre la justice nous-mêmes avec nos manches de pioches".
En septembre, l'agence allemande d'informations DPA parla de nouvelles grèves dans la région. A partir du 1er janvier 1978, la vallée de Jiul fut déclarée "zone interdite", isolée de tout contact extérieur.
Les problèmes de l'isolement des ouvriers de Roumanie sont semblables à ceux rencontrés en URSS. Ceci explique la nature pernicieuse du régime de Ceausescu, tant exalté à l'ouest pour son "indépendance" vis à vis de Moscou et son soi-disant "engagement à la paix". Le gouvernement de Ceausescu est en fait le plus haï de tous ceux du bloc de l'Est, à l'exception du régime de Honecker en RDA.
Vers la fin des années 70, le mécontentement de la classe ouvrière a commencé à se manifester dans la partie ouest du bloc. Déjà en 1971, une série de grèves ont eu lieu à Budapest selon certains rapports. En 1975, "Der Spiegel" rapporte ce qui suit sur la situation en Tchécoslovaquie :
"Des tracts distribués dans de nombreuses usines parlent d'actions de protestations qui montrent un mécontentement des ouvriers dirigé contre le régime : dans le complexe industriel de Prague, dans des entreprises sidérurgiques de 1'est de la Slovaquie, parmi les cheminots". (Der Spiegel n°18).
Des rapports sur des comités de grève de protestation sont parvenus de Tchécoslovaquie de manière fréquente depuis lors, par exemple, dans l'usine CKD de construction de machines à Pragueen lutte contre la hausse des prix (rapporté dans "Intercontinental Press" n°49. 1978).
La paix sociale fragile qui a régné en Allemagne de l'Est depuis 1953, en raison de la hausse dissimulée des prix prit fin à l'automne 1977. En octobre de cette année là, un mouvement de grève éclata à Karl-Marx Stadt qui fut violemment écrasé par des troupes de choc et par la police politique. 50 ouvriers furent arrêtés. Les chefs de l'administration locale furent décorés de la "médaille Karl Marx" en récompense pour le rôle qu'ils ont joué dans l'écrasement de la révolte. Le 7 octobre, une foule de jeunes gens se battirent contre la police dans le centre de Berlin-Est alors qu'elle tentait de disperser un concert de rock. Plusieurs personnes furent tuées dont deux policiers. La population dans les quartiers ouvriers voisins du lieu ("Prenz lauerberg") protégèrent les jeunes gens en les cachant dans leurs maisons et en jetant de l'huile bouillante sur les policiers qui les poursuivaient. Quelques jours après, les ouvriers des ateliers de Narva à Berlin-Est entrèrent en grève, demandant qu'un tiers de leur salaire soit payé en devises occidentales. La Stasi (police politique) dut se rendre chez les ouvriers chaque jour, les forcer à travailler, et les ramener chez eux le soir (rapporté par R. Havemann dans une interview avec "Le Monde" du 21/1/78).
Une série de grèves eurent lieu aussi à Dresde où la même revendication fut soulevée. Au cours du même mois, les ouvriers du bâtiment se mirent en grève ("Der Spiegel". 17/10/77). Une nouvelle loi fut promulguée le 1/1/78 prévoyant des amendes d'un demi-million de marks pour les ouvriers en grève! De telles mesures n'ont pas réussi à intimider les ouvriers. En mai 1978, dans les villes de Witten-berge et d'Erfurt, des affrontements violents avec la police furent signalés. Dans la seconde moitié de 1979 jusqu'en 1980, des rapports sur des grèves et des actions de protestations furent connus à l'ouest; par exemple, une grève des dockers de Rostock qui retinrent du matériel de guerre en partance pour le Vietnam ainsi qu'une grande grève à Walterhausen qui se termina par une série d'arrestations.
LES EFFETS DE LA CRISE
La progression quantitative et qualitative de la lutte de classe dans les pays de l'Est ne peut être comprise que dans le contexte d'une aggravation de la crise de l'économie mondiale qui a éliminé les dernières illusions sur le fait que les pays de l'est pourraient offrir un débouché à la surproduction du bloc occidental. L'exacerbation de la crise et donc de la concurrence sur le marché mondial rend de plus en plus difficile pour le C0MEC0M de vendre ses produits à l'étranger et donc d'obtenir des devises, nécessaires au remboursement de ses dettes aux pays du bloc de l'Ouest Plus la crise mondiale se développe, plus s'exacerbe la concurrence sur les marchés et plus les pays membres du C0MEC0N tendent à chancelier vers la faillite.
Par ailleurs la crise exacerbe les conflits in-ter-impérialistes entre les deux blocs et force la bourgeoisie de chaque bloc à attaquer le prolétariat plus âprement afin de fournir un effort militaire grandissant. La solution bourgeoise à la crise, c'est la guerre. Si la crise a provoqué une chute rapide du niveau de vie de la classe ouvrière (hausse des prix et rationnement de plus en plus fort dans tous les pays du COMECON), elle a rendu aussi nécessaire en 1979 l'invasion de l'Afghanistan. Et ce tournant dans l'accélération de la militarisation appelle à des attaques encore plus dures contre la classe ouvrière.
La rivalité entre les blocs et la lutte entre classes sont les deux pôles autour desquels tourne le capitalisme décadent. De ces deux pôles, celui de la lutte de classe est fondamental. En 1'ABSENCE de guerre de classe, la rivalité entre les blocs devient dominante. Quand nous parlons de guerre de classe, nous voulons parler du combat prolétarien car l'attaque de la bourgeoisie contre la classe ouvrière est, elle, permanente. Depuis la fin des années 60, la guerre de classe a été le facteur dominant dans le monde pour la première fois depuis presque un demi-siècle. L'invasion russe en Afghanistan n'est pas venue altérer ce fait. Celle-ci a exprimé une tension grandissante entre les blocs, mais cette tension reste secondaire si, en retour, elle provoque de la part des ouvriers une réponse à un niveau qualitativement plus élevé. Les deux pôles dominant dans le capitalisme décadent, la rivalité entre les blocs et la guerre de classe sont déterminés par leur objectif respectif : guerre ou révolution. Ceux-ci sont diamétralement opposés l'un à l'autre, mais étant donné que la pleine participation du prolétariat est essentielle pour les deux, la trajectoire de la société dépend de la réponse ouvrière à la crise.
Les luttes des années 50 ont nécessité une collaboration temporaire de la bourgeoisie mondiale. Mais du fait de la restriction de ces luttes à un bloc (en opposition avec la période révolutionnaire de 1917-23 où les deux fronts de guerre étaient touchés par la lutte de classe spécialement sur le front de l'est), elle ne remettait pas en question la domination des rivalités inter-impérialistes sur la société. En face du prolétariat, la bourgeoisie a installé des gouvernements populaires (Gomulka, Naqy, Kroutchev même) soutenus par de nombreuses oppositions de gauche, qui ont essayé d'attacher les ouvriers à ces gouvernements. Le régime de Dubcek en Tchécoslovaquie fut la dernière tentative réussie de contrôler les ouvriers par un gouvernement "populaire". De même, la terreur de masse de l'époque stalinienne touchait à sa fin. Elle était remplacée par une terreur sélective qui avait pour fonction d'aligner immédiatement contre les murs les militants ouvriers dans les usines, mais qui laissait tout de même assez de place aux oppositionnels bourgeois pour mieux manœuvrer contre la classe ouvrière. Ce changement de climat ne correspondait pas encore à une altération dans l'équilibre des forces entre les deux classes antagoniques. Les oppositionnels étaient là pour faire du battage sur l'image démocratique des régimes comme ceux de l'URSS où les "plaintes" du "Samizdat" circulaient sous les yeux du KGB .Et ce dans le même temps où il y avait au moins un million de prisonniers politiques détenus, la plupart prolétaires !
Ces oppositions étaient présentées comme une garantie au fait que le régime pourrait accorder une pleine démocratie aux ouvriers, si ceux-ci étaient prêts à se battre pour la mère-patrie de Kroutchev. Elles étaient "antistaliniennes" et mettaient en garde contre un "retour aux méthodes de Staline". Même quand elles se sont déclarées "marxiste-léniniste", considérant l'URSS comme un Etat capitaliste, (concession évidente à une opinion couramment répandue chez un grand nombre d'ouvriers !), ces oppositions déclaraient habituellement leur loyauté à la constitution (de Staline !), au parti communiste contre "la restauration de la bourgeoisie" (sic) etc. A cette époque, ceux qui étaient pro-occidentaux étaient immédiatement réprimés ou déportés. La principale thèse des "Démocrates" de Russie, d'Ukraine et de la Baltique par exemple (mouvement prétendant avoir 20.000 militants et 180.000 sympathisants) consistait à dire que c'était dans l'intérêt même des gouvernements de se réformer.
UNE NOUVELLE PERIODE DE LUITES
Le resurgissement international de la lutte de classe dans les années 70 a change" l'équilibre des forces entre classes et a laissé la bourgeoisie, y compris ses fractions oppositionnelles dans le désarroi.
En Pologne, les ouvriers ont fini de croire qu'il était possible de "régénérer" une quelconque partie de l'appareil stalinien; ainsi les oppositionnels issus de la crise de 1956 et du mouvement étudiant des années 1960 (comme Kuron) n'eurent que cela comme objectif de propagande et se sont trouvés complètement isolés de la classe. Cela a créé un dangereux vide politique dans lequel la lutte de classe a pu se développer. Après les mouvements de grève de 1970/71, des ouvriers combatifs de Szczecin et d'autres centres ont essayé de résister à la dissolution des comités de grève en les transformant en noyau d'un syndicat oppositionnel. Les oppositionnels, à l'intérieur et à l'extérieur du parti communiste purent ainsi canaliser les illusions des ouvriers dans le syndicalisme à l'aide d'un projet de transformation des syndicats existants en des organes "indépendants du gouvernement". Le projet de contrôler les ouvriers de cette manière échoua misérablement parce que les ouvriers avaient perdu toute confiance dans les syndicats existants, et d'autre part, parce que la bourgeoisie était préparée à organiser une façade démocratique pour les syndicats mais ne pouvait leur permettre d'organiser des qrèves et des actions revendicatives, a l'Ouest, les syndicats maintiennent leur pression sur les ouvriers en organisant des actions mort-nées afin de les empêcher de prendre leur destinée en main . A l'Est, les staliniens se sont traditionnellement reposés sur la police pour maintenir l'ordre dans la mesure où chaque arrêt de la production, même organisé par les syndicats, entraîne un retard considérable des pays de l'Est dans la course aux armements avec les pays de l'Ouest.
Les années 70 ont connu d'importants changements dans l'atmosphère sociale au sein du bloc de 1'Est» spécialement en URSS. La nouvelle génération d'ouvriers qui n'ont pas vécu sous la période de contre-révolution stalinienne sont beaucoup plus décidés et moins dominés par la peur. Sur les places des marchés de Tachkent ou dans le métro de Moscou, ils critiquent ouvertement le régime. Mais ils ont encore beaucoup d'illusions sur les régimes à l'Ouest, particulièrement sur les "syndicats libres" et la démocratie occidentale. En URSS, les grèves sont devenues des faits journaliers habituels dans les petites et moyennes entreprises où, de toute façon, la production est très faible. Les ouvriers sont sous-alimentés, souvent affamés et la productivité est plus que médiocre.
Dans les grandes usines produisant pour l'économie de guerre en Silésie, la police surveille les ouvriers, armée de mitraillettes, pour les garder au travail. Dans ces usines, il ne peut y avoir de grèves. La seule alternative est : production ou guerre civile. Là généralisation de la lutte de classe en URSS et dans les autres pays du monde peut seule permettre que ces ouvriers se révoltent aussi; ceci n'est qu'une question de temps. La vague de grèves des années 70 a rendu ce fait très clair à la bourgeoisie. Elle est assise sur un baril de poudre.
L'invasion de l'Afghanistan a exacerbé encore plus la tension sociale. Il devient très clair que le motif des sacrifices des ouvriers n'est pas un avenir meilleur, le "communisme" mais celui de la guerre mondiale. Cette perspective a renforcé la détermination du prolétariat de ne faire aucun sacrifice pour assurer la défense du système. Les désertions massives en Afghanistan de l'armée russe ne sont qu'un symptôme de cette vérité première.
De manière très significative en Russie, la dernière identification avec la mère-Patrie qui pouvait subsister de la seconde guerre mondiale est morte avec l'Afghanistan. La contradiction absolue entre les intérêts du prolétariat et ceux de la mère-Russie est en train de devenir particulièrement claire.
LA NECESSITE DE LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION
Avec l'entrée en lutte des ouvriers à l'Est contre leurs propres gouvernements, lutte freinée uniquement par l'étendue de l'appareil de répression, le développement d'une "opposition" forte et crédible est devenu un souci majeur de la bourgeoisie mondiale!
Il est nécessaire de rappeler ici, qu'étant donné l'absence d'une presse développée par les groupes oppositionnels dans les pays de l'est (le KOR à la fin des années 70 ne distribuait que 30.000 exemplaires de "Robotnik" à chaque numéro), leurs analyses politiques sont transmises à des millions d'ouvriers nuit et jour par l'intermédiaire des émissions des radios occidentales .Ce sont ces organes de propagande que les ouvriers écoutent, et non "La Pravda" ou "Neues Deutschland".
Le nationalisme est une arme primordiale pour contrôler les ouvriers et les attacher à la défense du système capitaliste. Dans les années 50 et 60, les gouvernements des pays de l'Est avaient la possibilité de l'utiliser pour renforcer leur contrôle sur la classe ouvrière (Gomulka, par exemple). En URSS, la réforme de décentralisation de Kroutchev tentait de donner aux PC d'Ukraine, de Géorgie, etc. plus de liberté de mouvement afin de dévier le mécontentement contre "les russes". De plus, elle opposait les différentes nationalités les unes aux autres. En 1978, par exemple, une vague de grève déferla sur la province autonome d'Abkhazie appartenant à la Géorgie, saisit la capitale Soukhoumi et les districts miniers, gagnant également un soutien actif des ouvriers agricoles et des paysans. Ce mouvement social intense resta complètement isolé parce qu'il fut dévié vers une lutte de libération nationale contre les "géorgiens". "L'Abkhazien" vend sa production industrielle et agricole à la Géorgie à un prix fixé et Tbilissi est libre d'en revendre une partie à la Russie avec profit. Dans de telles circonstances, il ne fut pas difficile aux oppositionnels de mener le mouvement ouvrier dans une impasse bourgeoise engageant les ouvriers dans une "guerre des douanes" à la frontière (rapporté par "Schwendtke).
Au début des années 70, la capacité des partis communistes au pouvoir à renforcer la mystification nationaliste en Europe de l'Est ou dans la partie non russe de l'URSS était en train de disparaître. Plus personne ne croyait ce qu'ils disaient; d'autre part, le seul nationalisme convaincant dans le bloc de l'Est devait être fatalement si antirusse qu'aucune équipe gouvernementale ne, pouvait et ne peut toujours se le permettre. Pour éviter cela, le Kremlin décida de laisser cette tâche à l'opposition. La position officielle du gouvernement contre le nationalisme antirusse, sous n'importe quelle manière ou forme ne pouvait que renforcer la crédibilité de l'opposition. C'est ce raisonnement qui est présent derrière les "doctrines" de Brejnev:
- après l'invasion de Prague, la soi-disant "souveraineté" limitée des Etats socialistes;
- en décembre 1972, la proclamation de la "solution" de la question nationale en URSS avec la création d'un "unique grand peuple soviétique".
Comme en Pologne et en Tchécoslovaquie, les réformistes du parti et les oppositionnels favorables aux "Droits de l'homme" et aux occidentaux en URSS, entrèrent en crise avec le resurgissement de la lutte de classe. L'avenir appartenait alors clairement à ceux qui avaient la capacité de se radicaliser et d'avoir une présence à l'intérieur du prolétariat.
En Ukraine et dans d'autres régions d'URSS où la lutte de classe est devenue particulièrement puissante, les oppositionnels sont radicaux, et depuis longtemps, se sont attachés à gagner de l'influence parmi les ouvriers. Parmi de tels groupes, on pouvait compter: "Tout le pouvoir aux Soviets" (Moldavie, 1964), "Les Jeunes 0uvriers"(Alma-Ata,, 1977), "Les Groupes de La Commune", "Les Ouvriers de l'Oural" (Sverdlovsk 1970), "Pour la réalisation des idées de Lénine" (Vorochilovgrad 1970) (Voir Die Politische Opposition in der Ukraine dans Sozialistisches Osteuropakomitee, Info 32). Nous ne possédons pas suffisamment de documentation pour juger si quelques-uns de ces groupes ont ou non représenté une quelconque expression du prolétariat. Ce qui est certain, pour la majorité de ces groupes, malgré tout leur radicalisme verbal, c'est qu'ils ont représenté des programmes de "démocratisation" du capitalisme russe, afin d'éviter les explosions sociales. Le fait que ces groupes aient été obligés, dans nombre de cas, de parler d'un "capitalisme soviétique" et d'une "nouvelle bourgeoisie" en URSS afin d'avoir un impact sur les ouvriers, reflète certainement l'attitude répandue parmi les militants ouvriers vis-à-vis de la "patrie socialiste". Les radicaux ont été divisés entre différentes lignes nationalistes dures, travaillant dans la clandestinité la plus stricte, faisant de la propagande pour la lutte armée, et même s'y entraînant ; tandis que d'autres courants plus orientés vers la classe ouvrière, mélangeaient le poison nationaliste avec des revendications pour les "syndicats 1ibres". Pendant les années 70, en Ukraine par exemple, de tels gauchistes ont développé une activité dans les usines. Il y a des centaines d'organisations de ce genre dans toute l'URSS.
De plus, vers la fin des années 1970, une série de tentatives ont été faites pour installer de larges syndicats oppositionnels républicains, le plus connu et récent étant le SMOT, avec des sections dans une douzaine de villes. Alors que les ouvriers qui font grève dans les usines d'importance stratégique vitale sont purement et simplement exécutés, les oppositionnels, ces robustes défenseurs de l'Etat capitaliste, ne connaissent que tracasseries et arrestations par le KGB. Si la police les laissait absolument tranquilles, les ouvriers pourraient difficilement avoir confiance en eux.
La formation du KOR en Pologne en 1976, qui eut comme effet immédiat de canaliser la réponse ouvrière à la répression de 76 vers une impasse légaliste et démocratique, cette formation est un bon exemple de développement d'un courant oppositionnel et radical, qui se proclame le défenseur des ouvriers contre le gouvernement, afin de décapiter la montée de la lutte de classe.
Le KOR abandonna la revendication portant sur la réforme du stalinisme pour appeler les ouvriers à s'organiser "en dehors et contre l'Etat capitaliste') mais de toute façon en organes étatiques, en syndicats qui entretiennent l'illusion chez les ouvriers de pouvoir, de manière permanente, se défendre, sans maintenir leur lutte et leur organisation dans cette lutte. Ce travail de propagande (des membres du KOR ont été par exemple milité et travailler aux chantiers "Lénine" avant l'été 1980), a aidé à former les bases sur lesquelles allait se former Solidarnosc, aujourd'hui la force numéro 1 travaillant pour la loi et l'ordre en Pologne.
Nous n'avons pas l'intention ici de revenir en détails sur tous les aspects de la grève de masse en Pologne, et ses répercussions internationales. Nous renvoyons nos lecteurs aux articles parus dans notre presse territoriale et dans les Revues Internationales parues depuis août80.
Le tournant à gauche de l'opposition et la volonté de l'Etat de tolérer leur activité furent des facteurs clés de la stratégie bourgeoise contre la classe ouvrière, après l'Afghanistan et surtout après l'éruption en 1980 en Pologne. Comprenant l'impossibilité d'empêcher l'éclatement de la grève de masse, la bourgeoisie s'affaire à restreindre à un seul Etat national toute la portée de ce mouvement. La menace d'une invasion en Pologne qui était plutôt dirigée vers les ouvriers des autres pays d'Europe de l'Est pour les tenir en échec, fut renforcée et complétée par la mise en avant dans le mouvement, de buts bourgeois (par l'opposition fraîchement radicalisée) qui mena à un enfermement du mouvement et un renforcement de l'Etat à travers la consolidation de l'aile oppositionnelle de son appareil avec les nouveaux syndicats.
L'idéologie de la démocratie et du syndicalisme libre n'a pas seulement réussi -après un an de lutte- à stopper la grève de masse. Elle a aussi permis à la bourgeoisie mondiale- en Europe de l'Est par l'intermédiaire des oppositionnels-de présenter des leçons fausses d'une lutte en Pologne qui captait l'attention des ouvriers de toute la surface du globe. Si les ouvriers d' Europe de l'Est ne se sont pas joints au mouvement de masse, ce n'est pas seulement du fait qu'en Allemagne de l'Est, et en Hongrie par exemple, l'approvisionnement soit moins précaire qu'en Pologne, ou du fait de l'omniprésence de l'armée russe dans ces pays, ou encore parce que les gouvernements auraient pu persuader leurs populations que le mouvement de grève détruisait l'économie polonaise, mais c'est avant tout parce que l'opposition dans ces pays disait à la classe que les ouvriers de Pologne avaient réussi à opposer une telle résistance massive parce qu'ils s'étaient d'abord organisés en syndicats libres. Ainsi la tâche du prolétariat d'Europe de l'Est ne serait pas de se joindre au combat, suivant ainsi leurs camarades dans les luttes de masse, organisés dans les assemblées ouvrières, et les comités de grèves élus et révocables, pour s'affronter à l'Etat. Il s'agirait plutôt d'attendre et de construire des syndicats libres, chacun dans son propre pays, chaque fraction ouvrière démocratisant "son propre" Etat terroriste: Cette capacité de stopper la grève de masse en Pologne qui menaçait d'extension au-delà des frontières, fut un tournant crucial ; celui de la persuasion des ouvriers qu'il n'y aurait d'autre perspective à la lutte qu'une perspective nationale. Et ceci est le message du Congrès de Solidarité à Gdansk avec son fameux appel à la formation de "syndicats libres et indépendants" dans les autres pays du bloc de l'Est.
Cette internationalisation falsifiée se résume à dire "Pour vous également, il n'y a que des solutions nationales". La vague de grève de 1980-1981 ne fut pas "nationale", cela nous est montré par le fait que cet événement était la continuation du vaste mouvement de grèves de la fin des années 1970 qui toucha l'Allemagne à l'Est et à l'Ouest, la Grande-Bretagne, la France, le Brésil, l'URSS, la Corée du Sud etc. Elle fut immédiatement précédée par un court mais massif mouvement de grèves en URSS. Au début de mai 1980,
170 000 ouvriers de l'usine automobile de Togliattigrad se mettent en grève en solidarité avec les conducteurs d'autobus ; leurs revendications aboutissent deux jours après. Aussitôt, 200 000 travailleurs de l'usine automobile de Gorki cessent le travail pour protester contre les rationnements. La grève fut précédée par une distribution massive de tracts. C'est le plus grand débrayage de l'histoire de l'URSS. Selon certains rapports, il y aurait eu ensuite, une nouvelle grève dans l'usine de camions de Kama. En août et septembre, alors que le mouvement polonais atteignait son point culminant, une série de protestations et de troubles sont signalés dans les régions minières de Roumanie, puis en Hongrie (Budapest) et en Tchécoslovaquie. Le chef du Parti tchèque, Husak, fut contraint de se précipiter aux mines d'Ostrava, afin de mettre un terme à cette situation. Dans cette région, de nombreuses mines s'étendent au-delà de la frontière avec la Pologne, rendant particulièrement intense le contact avec les mineurs silésiens. Prague réagit en verrouillant pratiquement la frontière avec la Pologne. Pour les européens de l'Est, les frontières séparant Pologne, Allemagne de l'Est et URSS devinrent pratiquement infranchissables. Tous les trains entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne furent momentanément annulés. En même temps, les armées du Pacte de Varsovie se massaient aux frontières de la Pologne, et d'interminables manœuvres commencèrent jusqu'à l'intérieur même du pays. On rapporte également qu'au début du mois d'octobre, des manifestations de rue et des affrontements eurent lieu dans la capitale d'Estonie, Tallin, événements qui ont débordé vers d'autres centres importants des républiques baltes de l'URSS. Des grèves éclatèrent à Kaunas, et Vilnius en Lituanie villes où de nombreuses personnes parlent polonais.
Comme la situation se développait, les ouvriers en Pologne, reprenant l'exemple des chantiers navals à Gdansk, commencèrent à démystifier le bluff de la menace d'invasion russe, conscients que jamais les ouvriers des pays voisins ne laisseraient faire une telle chose. Cette conviction fut renforcée par les nombreux discours diffusés par les médias de l'ouest dans lesquels étaient affirmé ceci par exemple : "Les autorités soviétiques craignent qu'une intervention de l'armée de 1'Allemagne de 1'est en Pologne ne provoque un mouvement généralisé de grèves en RDA. Déjà les mouvements sociaux ont progressé dans le pays depuis trois mois maintenant, mouvements que les autorités ont réussi à cacher."("Lettre de 1'Expansion" du 22.12.80). Dans ces mouvements, il faut inclure le mouvement de grève autour de Magdebourg en novembre, et les grèves de solidarité dans les villes proches de la frontière polonaise telles que Gorlitz et Francfort sur Oder.
Le second exemple, tiré du "Financial Times" (13/12/81) concerne les tentatives de mobilisation des réservistes d'Ukraine pour envahir la Pologne :
"Selon les rapports, 1'appel aux réservistes des Trans-Carpates en août a donné lieu à des scènes approchant du chaos. Les habitants de la région étaient recrutés dans les rues, les voitures réquisitionnées sur les routes et les réservistes désertaient les points de rassemblement en masse. Les désertions des réservistes qui, pour la plupart quittaient régulièrement les points de rassemblement pour aller dormir dans leur famille, furent interprétées comme le reflet du moral très bas qui affectaient les gens de cette région, bien informés des événements en Pologne et sympathisant fortement avec les ouvriers polonais."
L'année 1981 se poursuivit avec d'importantes luttes ouvrières dont les plus importantes furent celles de Roumanie en novembre, luttes où les mineurs furent rejoints par les sidérurgistes et d'autres ouvriers dans une série de grèves, d'affrontements avec la police, d'attaques contre des bâtiments de l'Etat, et qui firent plusieurs morts.
"L'hélicoptère qui devait transporter sur place le président Ceausescu pour un dialogue avec les mécontents dans les régions minières fut lapidé".
Ce même rapport parle d'un accroissement de l'activité des oppositionnels dans les Républiques de la Baltique et dans d'autres parties de l'URSS, de la formation de syndicats "indépendants", et, par exemple, de la distribution de tracts en Estonie, appelant à une grève pour le début décembre en protestation à la montée des prix du 1er août. Des appels similaires ont été rapportés de Lithuanien et de Lettonie. Ce qui est assez significatif pour une région où les mystifications nationalistes et séparatistes sont très persistantes; le rapport explique que c'est la détérioration de la situation économique qui anime les ouvriers.
En même temps que la lutte du prolétariat, on a pu voir d'importantes explosions sociales dans des régions où le séparatisme et le nationalisme jouent un rôle important, mais où, maintenant plus que jamais, l'appauvrissement des ouvriers et des autres secteurs tend à devenir l'aspect dominant de la situation sociale. Ce qui se manifeste, par exemple, dans les violents affrontements qui ont eu lieu en Géorgie et dans le Kosovo(Yougoslavie) pendant le printemps 81.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que le potentiel de généralisation de la lutte de classe en Europe de l'Est est de manière évidente plus élevé que jamais depuis les années 20, mais que l'accalmie relative de la lutte sur le front occidental en Europe (qui n'est que le calme avant la tempête !) ainsi que l'enfermement de la grève de masse en Europe de l'Est dans les limites de la frontière nationale par les oppositionnels, ont empêché le baril de poudre d'exploser. La perspective de luttes majeures dans les métropoles occidentales dans la période à venir et l'accélération de la crise qui se produit maintenant également en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, montrent que le potentiel pour la généralisation des luttes au niveau mondial s'accroit, en dépit de la grande contre-offensive de la bourgeoisie au niveau mondial dans le sillage de la Pologne.
VERS L'UNIFICATION DU PROLETARIAT MONDIAL
Du point de vue marxiste, la réalisation la plus révolutionnaire du capitalisme est d'avoir créé son propre fossoyeur : le prolétariat international, et d'avoir développé les forces productives à une échelle mondiale avec lesquelles le prolétariat pourra abolir la société de classe. Pour ce "service", nous serons éternellement reconnaissant à nos impitoyables exploiteurs et leur système barbare. Le capitalisme a créé les conditions matérielles préalables au communisme, mais seulement à une échelle mondiale. Le capitalisme a conquis le globe, non d'une manière planifiée, mais à travers des siècles de compétition qui ont créé la division du travail, l'interdépendance de chaque partie de l'économie mondiale. VOILA POURQUOI L'UNIFICATION INTERNATIONALE DU PROLETARIAT DANS LE PROCESSUS DE LA REVOLUTION MONDIALE EST LA CONDITION MATERIELLE PREALABLE LA PLUS DECISIVE POUR LE COMMUNISME.
Aujourd'hui, chaque lutte du prolétariat est une lutte contre le capitalisme comme un tout, parce que le système affronte les ouvriers, telle une seule et unique masse réactionnaire dont chaque partie est également pourrie. C'est pour cette raison que les ouvriers ne peuvent plus s'organiser de manière corporative ou nationale. Le secret de l'existence des conseils ouvriers dans les luttes de masse dans le capitalisme décadent est la poussée permanente, souterraine -mais visible à la surface- d'une tendance à l'unification de la classe ouvrière.
"Le prolétariat produit une nouvelle forme d'organisation qui englobe la classe ouvrière dans sa 'totalité sans distinction de profession, ni de maturité politique, un appareil élastique qui est capable de renouvellement, d'extension et d'intégration de nouveaux secteurs de manière constante".
Manifeste de l'Internationale Communiste.1919.
Les conseils ouvriers sont apparus dans le contexte de la grève de masse, de la généralisation autonome du combat prolétarien qui menace toujours de déborder les barrières érigées par le capitalisme. De plus, comme le résultat de l'immaturité des conditions subjectives pour la révolution mondiale, les conseils ouvriers ont également, de manière paradoxale, toujours reflété l'hétérogénéité du prolétariat mondial. Les conseils ouvriers de 1905 en Russie ont annoncé la fin de la période ascendante du capitalisme à une échelle mondiale. Mais ils ont mis aussi en évidence le rôle d'avant-garde du jeune prolétariat russe qui, autour d'un pôle de regroupement, le parti bolchevique, a poussé à la formation en 1919 de l'Internationale Communiste. De la même manière, durant la vague révolutionnaire de 17/23, les conseils ouvriers ont joué un rôle important dans les pays vaincus pendant la guerre. Les conseils ouvriers ont exprimé, pas seulement la lutte pour l'unité de la classe, mais également ses propres divisions dues aux conséquences de la guerre. De même, l'apparition des conseils ouvriers en Hongrie 1956 ne signifiait pas un signe de maturation de la classe ouvrière internationale, mais une continuité avec la vague révolutionnaire de 1917-23 qui touchait à sa fin. Les défaites des années 50 représentent la cassure définitive d'avec cette continuité. Les ouvriers en Hongrie se souviennent encore de l'expérience des conseils en 1919, mais comme cela a été exprimé dans un appel aux conseils :
"Non au gouvernement de Nagy ou de Kadar, oui a celui de Bêla Kun".
Aujourd'hui, les ouvriers en Pologne se sont confrontés à la résistance unifiée de la bourgeoisie mondiale, unie autour d'une stratégie de renforcement de ses fractions oppositionnelles de gauche comme Solidarnosc, organe de l'Etat bourgeois implanté parmi la classe ouvrière pour contrôler ses réactions. Du fait de cette unité de la bourgeoisie mondiale, il ne peut y avoir "de maillon faible de l'impérialisme" comme en Russie 1917. C'est pourquoi, il n'y a pas eu de conseils ouvriers en Pologne pendant le mouvement de 1980-81, non pas du fait de la faiblesse du secteur polonais de la classe, mais parce que la grève de masse qui a surgi a été l'expression la plus développée d'UNE MATURATION INTERNATIONALE, D'UNE REELLE HOMOGENEISATION DU PROLETARIAT MONDIAL. En de telles circonstances, les conseils ouvriers et le parti de classe futur apparaîtront directement au niveau international; ils naîtront comme produit d'une prise de conscience grandissante de la nécessité de combattre et de détruire le capitalisme mondial.
Dans la perspective de la révolution mondiale, l'Europe devient la clef du futur, le centre du prolétariat mondial et des rivalités entre les blocs. Le prolétariat de l'Europe de l'Ouest jouera le rôle le plus crucial,
-du fait de sa concentration, de son niveau d'industrialisation et de culture; -du fait d'une grande expérience de la démocratie bourgeoise et des "syndicats libres", les armes les plus redoutables de la classe ennemie; -parce que les économies nationales de cette région du monde sont si intimement liées qu'une lutte limitée au cadre national devient vite une absurdité;
-parce que les ouvriers en Allemagne de 1'ouest ou en France parlent de cinq à dix langues, non dans différentes régions, mais dans une seule et même partie du pays, et ceci permet d'avoir une vision beaucoup plus globale des tâches de la classe ouvrière mondiale; -parce qu'une grève de masse peut se produire en Pologne et être tranquillement massacrée en Sibérie, tandis que si elle éclatait dans un pays majeur de l'ouest, elle paralyserait une grande partie de l'économie mondiale et ainsi forcerait les ouvriers, partout, à en tenir compte; -enfin, les ouvriers de l'ouest, se sont vus épargnés l'écrasement du double échec de la lutte de classe dans les années 20 et 50. C'est pourquoi, ils devront jouer le premier rôle dans la préparation de la REPUBLIQUE INTERNATIONALE DES CONSEILS et du parti communiste mondial futur.
La dernière vague révolutionnaire des années 20 s'est pratiquement terminée avec la suppression quasi totale du prolétariat révolutionnaire de Russie et d'Allemagne. Demain, la classe ouvrière d'URSS, plus grande, plus concentrée, plus puissante que jamais, prendra sa place au côté du combat révolutionnaire mondial de ses frères de classe. Et le prolétariat en Allemagne devra prendre en charge le rôle clé de charnière entre l'Est et l'Ouest, faisant voler en éclat le mur de Berlin, ce symbole d'un prolétariat mondial déchiré par deux guerres mondiales. L'isolement des ouvriers à l'Est touche à sa fin. Voilà la leçon de la lutte de classe du début des années 80.
Krespel. novembre 1981
Géographique:
- Europe [274]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [112]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
Théories des crises : le véritable dépassement du capitalisme, c’est l'élimination du salariat
- 4052 reads
(à propos de la critique des thèses de Rosa Luxembourg par Nicolas Boukharine)
Le communisme est un vieux rêve de l'humanité. Un rêve aussi vieux que la société divisée en classes. Depuis que les hommes se sont vus contraints, pour subsister matériellement dans la nature de diviser leur communauté en classes antagoniques, ils rêvent plus ou moins d'une société humaine, réunifiée, d'une société communiste.
Ce rêve tend à apparaitre avec plus de force lorsque la société de classes entre en crise. Aujourd'hui, ce projet a plus de réalité que jamais. Il existe une classe qui peut le concrétiser : la classe ouvrière. Mais c'est en comprenant DE QUELLE CRISE souffre la société que l'on peut à la fois comprendre POURQUOI cette classe est révolutionnaire, historiquement, et DANS QUEL SENS elle doit agir. C'est pour cela que le marxisme reste indispensable à la conscience de la révolution. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir sur les débats qui ont eu lieu dans le mouvement ouvrier sur la conception de la crise du capitalisme et sur les conséquences de ces conceptions.
COMPRENDRE LES CRISES, C'EST COMPRENDRE COMMENT DEPASSER LE CAPITALISME.
"En tant qu'idéal d'un ordre social reposant sur l'égalité et la fraternité entre les hommes, en tant qu'idéal d'une société communiste, le socialisme datait de milliers d'années. Chez les premiers apôtres du christianisme, chez diverses sectes religieuses du Moyen-âge, lors de la guerre des paysans, l'idée socialiste n'a cessé de jaillir comme expression la plus radicale de la révolte contre l'ordre existant. Mais justement comme idéal recommandable en tout temps et en tout lieu historique, le socialisme n'était que le beau rêve de quelques exaltés, un songe doré hors d'atteinte, comme l'arc en ciel dans les nuages.
(...) Un homme a tiré les dernières conséquences de la théorie du mode de production capitaliste, en se situant dès l'abord du point de vue du prolétariat révolutionnaire: Karl Marx. Pour la première fois, le socialisme et le mouvement ouvrier moderne se placèrent sur le terrain inébranlable de la connaissance scientifique." (Rosa Luxembourg, "Introduction à l'économie politique, Ch.1, partie5).
Les avenues emplies de voitures brillant aux éclairs des néons ont fait croire pendant des années qu'il n'y aurait plus jamais de crise économique. On avait rangé les photos jaunies des chômeurs des années 30 à côté des images de batailles napoléoniennes et des famines du Moyen Age. Les révolutionnaires marxistes qui, comme toujours depuis déjà près d'un siècle passaient leur temps à annoncer l'inévitabilité de la crise du capitalisme, étaient classés plus ou moins dans la même catégorie que les témoins de Jéhovah et leurs litanies sur :"la fin du monde est proche". Bourgeois, bureaucrates, spécialistes des "affaires sociales" proclamaient la "retentissante faillite du marxisme".
Aujourd'hui, la une des journaux du monde entier est régulièrement consacrée à l'aggravation d'une crise économique dont personne n'ose plus prédire la date de la fin... et dont personne ne prévoyait l'ampleur.
Belle revanche pour ceux qui depuis le milieu du siècle dernier s'efforcent de définir une vision du monde débarrassée des lunettes idéologiques de ceux qui profitent du système: une vision qui rejette l'idée suivant laquelle le capitalisme serait un système de production éternel ; une vision qui sache concevoir en permanence le capitalisme dans sa dimension historique, c'est à dire comme un système appelé à disparaitre tout comme l'esclavagisme et le servage féodal.
Le marxisme est essentiellement l'effort théorique de percevoir le monde du point de vue de la classe exploitée directement par le capitalisme, le prolétariat, dans le but d'un bouleversement révolutionnaire. Il est l'effort de comprendre SUR QUELLES BASES OBJECTIVES S'APPUIENT AUJOURD'HUI LA NECESSITE ET LA POSSIBILITE D'UNE ACTION REVOLUTIONNAIRE DE CETTE CLASSE.
Pour le marxisme, la révolution communiste n'est possible et nécessaire que dans la mesure où le capitalisme s'avère incapable de remplir la fonction historique pour laquelle surgit tout système économique dans l'histoire : permettre aux hommes de subvenir à leurs nécessités matérielles. L'incapacité de continuer à remplir cette fonction se traduit dans les faits par la crise économique qui paralyse l'appareil de production.
Il n'y a jamais eu de lutte prolétarienne importante en dehors des périodes de crise économique. Il ne peut y avoir de révolution ouvrière sans crise économique. Seul cet effondrement de l'économie peut avoir la force de déstabiliser l'ordre social au point de permettre aux forces vives de la société, le prolétariat mondial, et avec lui à l'ensemble des exploités du monde de bâtir un nouveau monde conçu par eux, adapté aux techniques et aux possibilités d'une humanité unifiée par la volonté des producteurs eux-mêmes.
Les lignes de force de l'existence du capitalisme, l'évolution de ses formes de vie, trouvent aussi une explication dans la lutte permanente du système contre ses propres contradictions, pour éviter ses crises économiques. Les gérants du capital mondial ne sont pas passifs face au développement des contradictions internes de leur système et aux crises de plus en plus dévastatrices que l'exacerbation de ces contradictions provoque. L'impérialisme, les guerres, la tendance à l'étatisation de la société, par exemple, sont incompréhensibles si on ne sait ce qui contraint le capitalisme à y recourir de façon de plus en plus systématique. Pour comprendre les palliatifs que le capitalisme tente d'appliquer à sa maladie, il faut comprendre la nature et les causes mêmes de cette maladie, donc de ces crises.
Dans l'article "Les théories des crises, de Marx à l'Internationale Communiste" (paru dans la Revue Internationale n°22), nous avions insisté sur le lien qui existe entre les débats théoriques sur l'analyse des crises du capitalisme et des problèmes aussi cruciaux pour le mouvement ouvrier que l'alternative REFORME OU REVOLUTION, ou la participation du prolétariat aux GUERRES IMPERIALISTES.
A travers la critique formulée par Boukharine aux analyses des crises de Rosa Luxembourg, c'est surtout la question du CONTENU du communisme, la définition de la nouvelle société qui se trouve posée.
Pour être viable historiquement, la nouvelle société qui succédera au capitalisme devra avoir la capacité d'empêcher que ne se reproduise ce qui bloque actuellement la société. La seule certitude que nous pouvons avoir, c'est que le communisme s'il existe sera tel qu'il aura dépassé les contradictions actuelles du capitalisme.
Le féodalisme s'est imposé à l'esclavagisme parce qu'il permettait à une population de subsister par elle-même sans dépendre du pillage d'autres populations; le capitalisme s'est à son tour imposé historiquement devant l'effondrement du féodalisme par sa capacité à permettre la concentration de forces productives matérielles et humaines que l'émiettement de la société en fiefs autonomes et jalousement isolés les uns des autres rendait impossible.
Si l'on veut savoir ce que sera le communisme, il faut commencer par savoir qu'est ce qui ne va pas dans la société présente ; où est ce que se bloque la machine ; qu'est ce qui dans les rapports de production capitalistes a fini par empêcher les hommes de produire à leur faim ; si nous parvenons à déterminer où se trouve le cœur de la maladie capitaliste, nous pouvons en déduire ce que devront être les caractéristiques HISTORIQUEMENT VITALES de la société future.
Comprendre les causes des crises du capitalisme, c'est donc comprendre en quoi et pourquoi le socialisme est une nécessité et une possibilité historique. C'est aussi comprendre COMMENT le capitalisme peut être dépassé, ce qu'il faut détruire et quelles sont les bases d'une communauté réelle de l'humanité.
Derrière les différences théoriques qui opposent les analyses des crises de Rosa Luxembourg et celles de Boukharine, se dessinent deux conceptions radicalement différentes de ce que sont les fondements économiques de la société à construire sur les ruines de l'ancienne.
Rosa Luxembourg place au centre des contradictions du capitalisme la limite imposée à son développement par la généralisation du salariat. De ce point de vue, la question cruciale dans la construction d'une société communiste, c'est donc L'ELIMINATION DU SALARIAT, l'abolition du travail salarié.
Pour Boukharine, l'incapacité fondamentale du capitalisme est celle de dépasser ses divisions internes et de maitriser "L'ANARCHIE" de sa production. En conséquence, la CENTRALISATION DES MOYENS DE PRODUCTION aux mains de l'Etat et la PLANIFICATION apparaissent en elles-mêmes comme un dépassement du capitalisme. Ainsi, se référant à l'Union Soviétique, où étatisation et planification de la production ont été développées mais où subsiste le salariat, Boukharine parle, en 1924, de "la contradiction entre le monde capitaliste et le NOUVEAU système économique de l'Union Soviétique".
C'est en ayant en vue cet aspect qu'il est le plus important de répondre à la brochure écrite par Boukharine en 1924 pour critiquer l'analyse de Rosa Luxembourg : "L'impérialisme et l'accumulation du capital."
L'ANALYSE DES CRISES DE SURPRODUCTION PAR ROSA LUXEMBOURG.
Les crises du capitalisme prennent la forme de crises de surproduction. Les usines ferment, noyées dans des stocks de marchandises qui n'ont pas trouvé d'acheteurs alors qu'en même temps on jette à la rue des chômeurs et réduit le salaire de ceux qui restent au travail. Le capitalisme a détruit le pouvoir d'achat de la population non intégrée au capitalisme en détruisant son mode de production. Les mieux lotis parmi cette population se sont intégrés comme esclaves dans le système capitaliste. Les autres, plus nombreux, sont réduits à la famine (2/3 de l'humanité).
Il y a "surproduction" non pas vis à vis des besoins "absolus" de la société, mais vis à vis des besoins "solvables", c'est à dire de la capacité d'achat de la société dominée par le capital.
L'originalité des thèses de R.L. ne consiste pas dans l'analyse de la cause fondamentale, "ultime" des crises économiques du capitalisme. Au niveau de la "cause" elle ne fait que reprendre l'analyse de Marx:
"La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n 'avaient pour limites que le pouvoir de consommation absolu de la société" ([1] [316]).
Tout comme pour Marx, pour Luxembourg, la contradiction qui condamne le capitalisme aux crises économiques est celle, d'une part entre sa nécessité de développer en permanence sa capacité de production, sous la pression de la concurrence, et d'autre part l'impossibilité de créer lui-même des débouchés suffisants pour absorber cette masse toujours croissante de marchandises. Le capital est simultanément contraint de jeter sur le marché une masse toujours croissante de produits à vendre, et de limiter par ailleurs la capacité d'achats des masses salariées.
"La surproduction, écrit Marx, a spécialement pour condition la loi générale de la production du capital : produire à la mesure des forces productives (c'est à dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse possible de travail avec une masse donnée de capital) sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables, et en y procédant par un élargissement constant de la production et de l'accumulation donc par une reconversion constante du revenu en capital, tandis que d'autre part, la masse des producteurs demeure et doit nécessairement demeurer limitée à un niveau moyen de besoins de par la nature de la production capitaliste." ([2] [317]) (souligné par nous)
Rosa Luxembourg reprend à son compte la même analyse de la cause essentielle des crises capitalistes. Son apport se situe à un niveau plus concret et historique. La question à laquelle elle répond est la suivante : à partir de quand cette contradiction transforme-t-elle les rapports de production capitalistes en une lourde entrave au développement des forces productives de l'humanité?
R.L. répond : à partir du moment où le capitalisme a étendu sa domination au monde entier.
"Le mode de production capitaliste pourrait avoir une puissante extension s'il devait refouler partout les formes arriérées de production. L'évolution va dans ce sens. Cependant, cette évolution enferme le capitalisme dans la contradiction fondamentale : plus la production capitaliste remplace les modes de production plus arriérés, plus deviennent étroites les limites du marché créé par la recherche du profit, par rapport aux besoin d'expansion des entreprises capitalistes existantes" (R.Luxembourg : Introduction à l'Economie Politique -dernier chapitre)
Pour Rosa Luxembourq, les marchés supplémentai-dont le capital a besoin pour se développer, il les trouve dans les secteurs "non-capitalistes"; l'expansion coloniale du capitalisme, qui atteint son apogée au début de ce siècle, traduit la recherche par les premières puissances capitalistes de ces nouveaux débouchés. (Rosa Luxembourg ne fait d'ailleurs que développer l'idée du Manifeste
Communiste en 1848 : "Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe").
Au 19ème siècle, du vivant de Marx, le capitalisme connait une série de crises économiques.
"La bourgeoisie, nous dit le Manifeste, les surmonte, d'une part en imposant la destruction d'une masse de forces productives; d'autre part en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens."
Pour Rosa Luxembourg, un changement qualitatif se produit dans la vie du capitalisme mondial à partir du moment où les "nouveaux débouchés" deviennent de plus en plus rares et insuffisants en égard du développement des puissances capitalistes. L'arrivée de nouvelles puissances, telles que l'Allemagne et le Japon sur le marché mondial au début du siècle conduit ainsi à de nouvelles crises. Mais contrairement à celles du 19ème siècle, celles-ci ne pourront pour ainsi dire plus être surmontées par la conquête de "marchés nouveaux". Des "solutions" indiquées par Marx et Engels dans le Manifeste, celles qui vont passer au premier plan, c'est la meilleure exploitation des anciens marchés, et SURTOUT LA DESTRUCTION DE FORCES PRODUCTIVES. La première guerre mondiale avec ses 24 millions de morts, la guerre totale et à outrance entrainant la destruction systématique de l'appareil productif des capitaux concurrents afin de s'emparer de leurs anciens marchés, traduit dans toute son horreur barbare la fin de l'époque florissante du capitalisme.
La contribution de Rosa Luxembourg à la théorie marxiste consista donc essentiellement dans l'explication de comment la contradiction entre production et consommation qui caractérise le capitalisme depuis sa naissance, conduit celui-ci -à partir du moment où il a étendu sa domination à la planète entière- à l'IMPERIALISME et à l'autodestruction de l'humanité, mettant définitivement à l'ordre du jour de l'histoire son dépassement par une société basée sur des rapports de production nouveaux.
Si les usines ferment par manque de débouchés solvables alors que la misère matérielle de l'humanité se développe, il n'y a d'autre issue historique que l'élimination de la planète des lois du marché, et plus particulièrement DU SALARIAT.
En généralisant le salariat, le capitalisme a généralisé le marché comme médiation entre l'activité des hommes en tant que producteurs, et leur activité en tant que consommateurs. Dépasser le capitalisme, c'est de ce point de vue, détruire cette médiation et rétablir le lien direct entre la production et la consommation. Du point de vue de l'analyse de R.Luxembourg, la marche révolutionnaire s'identifie avec le combat contre le salariat (c'est à dire contre l'utilisation de la force de travail comme marchandise); son objectif immédiat ne peut être autre que celui de soumettre la production à la consommation, d'orienter la production directement en fonction des nécessités matérielles des hommes. Autrement, c'est l'impasse.
REPONSE AUX CRITIQUES DE BOUKHARINE A ROSA LUXEMBOURG
Au delà de son objectif théorique immédiat : l'analyse des crises du capitalisme, le travail de Boukharine s'inscrivait dans le cadre de la "bolchévisation" des partis de l'Internationale Communiste ([3] [318]). Boukharine se donne pour tâche de "détruire" l'analyse de R.Luxembourg et pour cela il fait flèche de tout bois. Il critique tout ce qui lui passe sous les yeux sans chercher toujours à voir quelle peut être la cohérence générale de ce qu'il analyse et sans crainte d'aboutir à des contradictions. Cependant, on trouve dans sa brochure la formulation des principales critiques qui ont été reprises soit l'une, soit l'autre aussi bien par les staliniens et les trotskystes que par les bordiguistes ou des ex-trotskystes comme Raya Dunayevskaya.
L'essentiel de cette critique peut être formulée de la façon suivante :
Luxembourg se trompe lorsqu'elle affirme que le capital ne peut pas créer ses propres débouchés pour assurer son développement; le problème posé par R.Luxembourg -"pour qui produire"- est un faux problème; les ouvriers peuvent constituer un débouché suffisant pour assurer cette expansion; enfin, Luxembourg ignore ou néglige dans son explication des crises, les principales contradictions mises en lumière par Marx -et en particulier "l'anarchie de la production capitaliste".
LE CAPITAL PEUT-IL CREER SES PROPRES DEBOUCHES ?
Voici comment Rosa Luxembourg pose le problème :
"Ce qu'il faut expliquer, ce sont les grands actes d'échanges sociaux, qui sont provoqués par des besoins économiques réels. (...) Ce qu'il nous faut trouver, c'est la demande économique du surproduit ...".("L'accumulation du capital". Chapitre 9).
Pour R.Luxembourg, suivant les théories de Marx, le développement du capital, son accumulation se traduit par un accroissement de la capacité de production et donc, du produit de l'exploitation des ouvriers: le surproduit. Etudier les conditions de ce développement, c'est donc déterminer entre autre, qui achète ce surplus de production, qui achète la part de la production sociale qui reste une fois que les prolétaires ont dépensé leur salaire et que les capitalistes ont d'une part remplacé les matières premières et l'usure des outils de production, et d'autre part prélevé leur part de profit pour leur consommation personnelle. En d'autres termes, qui achète la part du profit destinée à être transformée en nouveau capital, en nouveaux moyens d'exploitation du travail !
La production capitaliste crée elle-même un marché, un "besoin économique réel" pour la plus grande partie de la production : la masse des salaires versés (capital variable), les dépenses pour restaurer l'usure de l'appareil productif et les matières premières consommées (capital constant) et enfin, les dépenses des capitalistes pour leur consommation personnelle (part de la plus-value non réinvestie), tout cela constitue un besoin "économique réel", "une demande solvable" du point de vue du capital. Tout cela constitue la partie de la production que le capitalisme peut "s'acheter à lui-même". Mais il reste une part de la production à vendre : la part du surtravail que les capitalistes -contrairement à ce que faisaient les seigneurs féodaux et les maîtres d'esclaves de l'antiquité qui consommaient personnellement tout leur profit- ne consomment pas afin de pouvoir accroître leur capital, afin de pouvoir le reproduire non plus "simplement", tel qu'il était au départ du cycle de production, mais de façon "élargie". Cette part de la production est très petite en comparaison avec la masse totale produite. Mais, de sa "réalisation", c'est-à-dire de sa vente, dépend que le capitalisme puisse ou non continuer son accumulation, son élargissement. R.Luxembourg affirme que cette partie de la plus-value ne peut, dans les conditions capitalistes, être vendue, ni aux ouvriers, ni aux capitalistes, Elle ne peut être employée, ni à l'accroissement de la consommation de la classe dominante -comme dans les systèmes passés- ni à la consommation des ouvriers.
"... La consommation croissante de la classe capitaliste ne saurait en tout cas être considérée comme le but final de l'accumulation; au contraire pour autant que cette consommation s'effectue et s'accroit, il ne peut y avoir d'accumulation; la consommation personnelle des capitalistes entre dans la catégorie de la reproduction simple. Il s 'agit au contraire de savoir pour qui les capitalistes produisent lorsqu'ils "pratiquent l'abstinence" au lieu de consommer eux-mêmes leur plus-value, c'est à dire, lorsqu’ils accumulent. A plus forte raison, le but de 1'accumulation ne saurait être du point de vue capitaliste, l'entretien d'une armée d'ouvriers toujours plus nombreuse. La consommation des ouvriers est une conséquence de l'accumulation, elle n'en est jamais ni le but ni la condition, à moins que les bases de la production capitaliste ne soient bouleversées. D'ailleurs les ouvriers ne peuvent jamais consommer que la partie du produit correspondant au capital variable, et pas un sou de plus. Qui donc réalise la plus-value toujours croissante ? " ("L'accumulation du capital". Chapitre 25).
Et R. Luxemburg répond : les secteurs non-capitalistes. Le capital ne peut pas constituer un marché pour toute sa production.
Pour qui produisent les capitalistes ?
Boukharine reproduit ce morceau dans sa brochure et pour y répondre commence par mettre en question la façon même de poser le problème.
"Avant tout, peut-on poser la question du point de vue du BUT subjectif (même subjectif de classe) ? Que signifie soudainement une telle TELEOLOGIE (étude de la finalité) dans les sciences sociales ? Il est clair que la problématique même est incorrecte méthodologiquement, pour autant qu'il s'agit là d'une formulation sérieuse et non d'une tournure métaphorique. En effet, prenons par exemple une loi économique reconnue par la camarade R. Luxembourg elle-même, par exemple la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. "Pour qui", c'est à dire, dans l'intérêt de qui cette baisse se produit-elle ? La question est évidemment absurde, il n'est pas permis de la poser, car la notion de but est exclue ici, à priori. Chaque capitaliste (Souligné par nous) cherche à obtenir un profit différentiel (et y réussit parfois); d'autres le rattrapent, et comme résultat nous avons un fait SOCIAL : la baisse du taux de profit. De la sorte, la camarade Luxembourg abandonne la voix de la méthodologie marxiste en renonçant à la rigueur conceptuelle de l'analyse de Marx." (Boukharine."L'impérialisme et l'accumulation du capital". Chapitre 1).
Boukharine a raison de dire qu'il est absurde de poser la question "POUR QUI baisse le taux de profit". La baisse du taux de profit est une tendance concernant la mesure d'une proportion économique (profit sur capital engagé). C'est une tendance qui n'a pas "de destinataire". Elle n'est pas créée par quelqu'un en vue de la fournir à quelqu'un d'autre. La question "pour qui" n'a aucun sens. Mais il en est tout autrement de la question "Pourquoi les capitalistes décident-ils d'augmenter leur production ?".
Le capitaliste produit pour vendre et réaliser un profit. Il n'augmente sa production que s'il sait qu'il aura un débouché, des acheteurs capables de réaliser le travail qu'il a extirpé à ses ouvriers en argent comptant. Le capitaliste ne développe sa production que s'il sait A QUI VENDRE, ce qui est la traduction capitaliste de la question plus générale : POUR QUI PRODUIRE ? Et cette question est pour lui tellement cruciale que s'il ne sait y répondre, il est condamné à la faillite.
Boukharine accepte finalement de répondre à la question mais à condition, dit-il, de la poser d'un point de vue OBJECTIF. Voilà comment il commence donc sa réponse : "...sa question... ne devient significative que sous une forme objective, à savoir : tout système social croissant quelle que soit son enveloppe historico-économique, quelques contradictions qu'il développe, quelques soient les motifs qui guident ses agents dans leur activité économique, suppose un lien absolument objectif (même s'il est INDIRECT) entre la production et la consommation. En outre, L'ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION, comme résultat de L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION, comme autre côté de cet accroissement, est la CONDITION FONDAMENTALE DE LA CROISSANCE DE TOUT SYSTEME SOCIAL." (p.29. souligné par Boukharine).
En d'autres termes, la production crée elle-même son propre débouché. Plus on produit, et plus on consomme. Si on applique le raisonnement de Boukharine aux situations de crise capitaliste, on aboutit à l'absurdité suivante : que doivent faire les capitalistes lorsqu'ils sont confrontés à une crise généralisée de surproduction et qu'ils n'arrivent pas. à écouler des stocks de marchandises invendues ? Le docteur Boukharine leur répond : produisez encore plus ! Ne vous en faites pas, OBJECTIVEMENT, l'accroissement de la consommation n'est que le RESULTAT, "L'AUTRE COTE" de l'accroissement de la production !
C'est peut-être une raisonnement logique, qui satisfait l'esprit théorique de Boukharine, mais il n'arrange pas beaucoup les affaires du capitaliste qui ne sait plus où entreposer ses marchandises produites, mais invendues.
Répondant à l'économiste français J.B. Say et à sa fameuse loi selon laquelle la production créé automatiquement son marché, Marx écrivait dans "La critique de l'économie politique" :
"L'équilibre métaphysique des achats et des ventes se ramène à ceci : chaque achat est une vente et chaque vente, un achat. Cela n'a rien de bien consolant pour les détenteurs de marchandises qui n'arrivent pas à les vendre, ni donc à acheter". (Partie sur "La métamorphose des marchandises")
On appelle "sophisme" un raisonnement qui est conforme aux règles de la logique mais aboutit à des conclusions fausses, c'est à dire contredites par la réalité qu'elles prétendent cerner. C'est le cas du raisonnement de Boukharine.
Boukharine dit une vérité : quel que soit le type de société qu'on envisage, il y a un lien "objectif" entre la production et la consommation. Pour produire, il faut consommer, ne fut-ce que des aliments pour ceux qui produisent. Pour consommer, il faut produire de quoi consommer. C'est une vérité, mais elle n'est ni très originale, ni très utile ici. De l'âge de pierre au capitalisme, il y a toujours un lien "absolument objectif" entre production et consommation. Mais CE LIEN n'est pas le même dans tous les systèmes de production qui se sont succédés dans l'histoire.
Dans le capitalisme en particulier, CE LIEN "ABSOLUMENT OBJECTIF" se trouve totalement bouleversé par la généralisation du salariat. Le capitalisme fait connaître à l'humanité un phénomène qu'elle ne pouvait même imaginer pendant les millénaires précédents : les crises de surproduction. Pour la première fois dans l'histoire, il peut y avoir accroissement de la production de biens aptes à la consommation, sans que cela s'ensuive d'une augmentation de la consommation. Qui plus est, pendant les crises de surproduction, la consommation baisse, du fait des licenciements et des baisses de salaire, et les ouvriers qui restent au travail doivent travailler plus dur que jamais sous la menace du chômage. En ce sens, la platitude de Boukharine sur le lien "absolument objectif" qui existe entre production et consommation "dans tout système social croissant" ne fait pas avancer la question d'un iota. Au contraire, en noyant le capitalisme dans la nuit des temps des systèmes précédents, on ne fait qu'embrouiller le problème, voire le rendre insoluble.
Cependant, Boukharine persiste et signe. "L'ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION, -dit-il- comme résultat de L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION, est LA CONDITION FONDAMENTALE DE LA CROISSANCE DE TOUT SYSTEME SOCIAL".
Ce faisant, il nous dit :
1)une trivialité
2) une stupidité qui fut le cheval de bataille de la plupart des économistes bourgeois au 19ème siècle.
Une trivialité : l'accroissement de la consommation présuppose un accroissement de la production. Il est assez évident que pour consommer plus, il faut d'abord qu'il y ait plus de biens à consommer, donc plus de biens de consommation produits. On peut difficilement consommer ce qui n'existe pas. Une stupidité : l'accroissement de la consommation est un résultat de l'accroissement de la production. Dans le capitalisme, on peut produire plus sans que pour autant il y ait augmentation de la consommation. Il n'y a que dans le capitalisme qu'une telle chose est possible -la surproduction-mais c'est justement du capitalisme et de ses crises qu'il est question ici, et non des systèmes précapitalistes.
L'accroissement de la consommation n'est systématiquement un produit de l'accroissement de la production que dans des systèmes sociaux où la production est orientée vers la consommation immédiate des producteurs.
Dans les sociétés sans classes du "communisme primitif", les hommes se répartissaient plus ou moins égalitairement le résultat de leur production. Lorsque le produit de la chasse, de l'élevage ou de l'agriculture augmentait, la consommation augmentait automatiquement d'autant.
Dans les sociétés du type de l'esclavagisme antique ou du féodalisme, la classe dominante s'emparait du surproduit du travail des exploités et elle le consommait. Lorsque la production se développait, cela se traduisait d'une part, par une éventuelle augmentation de la consommation des travailleurs, (cela dépendait en partie du bon vouloir des maîtres), et, de la consommation de la classe dominante. Sous une forme ou sous une autre, un accroissement de la production avait systématiquement pour résultat une augmentation de la consommation.
Dans le capitalisme, ce lien systématique est rompu. Le lien entre le producteur et le consommateur est devenu contradictoire. Le capital ne se développe qu'en réduisant la part de la consommation.
"Le mode de production capitaliste a cette particularité que la consommation humaine qui, dans toutes les économies antérieures, était le but, n'est plus qu'un moyen au service du but proprement dit : l'accumulation capitaliste. La croissance du capital apparaît comme le commencement et la fin, la fin en soi et le sens de toute la production. L'absurdité de tels rapports n'apparaît que dans la mesure où la production capitaliste devient mondiale. Ici, à l'échelle mondiale, l'absurdité de l'économie capitaliste atteint son expression dans le tableau d'une humanité entière gémissant sous le joug terrible d'une puissance sociale aveugle qu'elle a elle-même créée inconsciemment : le capital. Le but fondamental de toute forme sociale de production : l'entretien de la société par le travail, la satisfaction des besoins apparaît ici complètement renversé et mis la tête en bas puisque la production pour le profit est non plus pour l'homme devient la loi sur toute la terre et que la sous-consommation, l'insécurité permanente de la consommation et par moments la non-consommation de l'énorme majorité de l'humanité deviennent la règle." (R. Luxembourg, "Introduction à l'Economie politique". Ch. sur "Les tendances de l'économie capitaliste".)
Tout comme les économistes bourgeois qui croient que les lois de production capitaliste ont existé de tout temps car elles sont "naturelles", Boukharine ne parvient pas à cerner ce qui distingue fondamentalement le capitalisme des autres types de sociétés dans l'histoire. Cela le conduit aussi bien à imaginer un capitalisme avec des caractéristiques du communisme qu'à concevoir un communisme ou du moins la rupture avec le capitalisme comme du capitalisme d'Etat -ce qui est beaucoup plus lourd de conséquences politiques .
LES OUVRIERS PEUVENT-ILS CONSTITUER LA DEMANDE SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE AU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL ?
Pour argumenter contre l'analyse de R.Luxembourg, Boukharine prétend que l'accroissement de la consommation des ouvriers peut constituer le débouché nécessaire à la réalisation du profit capitaliste et donc à l'expansion de l'accumulation du capital.
"La production de la force de travail est indiscutablement la condition préalable de la production des valeurs matérielles, de la plus-value du capital. La production de la force de travail SUPPLEMENTAIRE est indubitablement la condition préalable de l'accroissement de l'accumulation." "(...) En réalité, le fait est que les capitalistes embauchent des OUVRIERS SUPPLEMENTAIRES, qui représentent ensuite précisément une demande supplémentaire". (Boukharine, Idem, Ch.1)
"Indubitablement" Boukharine évolue dans un monde théorique étranger à la réalité du capitalisme et de ses crises. théorique d'un capitalisme planifié et centralisé, qui, suivant ses directives se débarrasserait des crises :
"Représentons-nous (...) un régime CAPITALISTE COLLECTIF (capitalisme d'Etat) où la classe capitaliste est unie en un trust unique, et où, par conséquent, nous avons, une économie organisée, mais en même temps antagoniste du point de vue de classes (...) l'accumulation est-elle possible en ce cas ? Certes oui. Il n'y a pas de crise car, LES DEMANDES RECIPROQUES DE LA PART DE CHAQUE BRANCHE DE LA PRODUCTION A L'EGARD DE CHAQUE AUTRE BRANCHE AUSSI BIEN QUE LA DEMANDE DE CONSOMMATION, tant de la part des capitalistes que de la part des ouvriers sont données d'avance (il n'y a pas "d'anarchie de la production", il y a un plan rationnel du point de vue du capital). En cas de "mécompte" dans les moyens de production, 1'excédent est stocké, et, la rectification correspondante est effectuée au cours de la période de production suivante. D'autre part, en cas "d'erreur de calcul " pour les moyens de consommation des ouvriers ON DONNE CE SUPPLEMENT COMME "FOURRAGE" AU MOYEN D'UNE DISTRIBUTION GRATUITE, OU BIEN ON A-NEANTIT LA PORTION CORRESPONDANTE DU PRODUIT (souligné par nous). En cas de mécompte dans la production de produits e luxe,"l'issue" est également claire. Par conséquent, il ne peut y avoir dans ce cas de crise de surproduction". (Boukharine, idem, fin du Ch.3)
Boukharine prétend résoudre théoriquement le problème en l'éliminant. Le problème des crises de surproduction du capitalisme ., c'est la difficulté à vendre". Boukharine nous dit : on n'a qu'à procéder à "UNE DISTRIBUTION GRATUITE" ! Si le capitalisme avait la possibilité de distribuer gratuitement ce qu'il produit, il ne connaitrait effectivement jamais de crise majeure. Sa principale contradiction étant de ce fait résolue. Mais un tel capitalisme ne peut exister que dans la tête d'un Boukharine en mal d'arguments. La distribution "gratuite" de la production, c'est-à-dire l'organisation de la société de sorte que les hommes produisent directement pour eux-mêmes, cela constitue effectivement la seule solution pour l'humanité. Seulement, cette solution, ce n'est pas un capitalisme "organisé" mais le communisme.
Dans la réalité, une nation capitaliste qui s'amuserait à distribuer gratuitement sa production aux producteurs perdrait toute compétitivité économique face aux nations concurrentes par l'élévation de ses "coûts" de main d'œuvre. Dans la jungle du marché mondial, les capitaux qui survivent sont ceux qui vendent à meilleur prix, donc ceux qui font produire leurs exploités avec les coûts les plus bas. La consommation ouvrière est un coût, une charge pour le capital -non un but. Marx avait déjà répondu à ce genre d'élucubrations théoriques :
"Dans des régimes où les hommes produisent pour eux-mêmes, il n'y a pas de crise, mais il n'y a pas de production capitaliste non plus. (...) Dans le capitalisme, (...) un homme qui a produit n'a pas le choix entre vouloir vendre et ne le vouloir pas. Il lui faut vendre"
"Il ne faut jamais oublier que dans la production capitaliste, il ne s'agit pas de valeur d'usage, mais de valeur d'échange, et spécialement de l'augmentation de la plus-value. C'est là le moteur de la production capitaliste et c'est vouloir embellir les faits que de faire abstraction de sa base même dans le seul but d'évacuer les contradictions de la production capitaliste et d'en faire une production qui est orientée par la consommation immédiate des producteurs". Marx. ([4] [319])
Un des arguments les plus fréquemment employés contre l'analyse de Rosa Luxembourg, Boukharine le formule de la façon suivante :
"Rosa Luxembourg se rend l'analyse trop aisée. Elle privilégie une contradiction, à savoir, celle entre les conditions de la production de la plus-value et les conditions de la réalisation, la contradiction entre la production et la consommation dans les conditions du capitalisme. (...
R. Luxembourg négligerait des contradictions, telle celle entre "les différentes branches de production, la contradiction entre l'industrie et l'agriculture limitée par la rente foncière, l'anarchie du marché et la concurrence, la guerre en tant que moyen de cette concurrence, etc." (Boukharine, idem. Ch. 5)
Nous traiterons de cette question dans la suite de cet article. (à suivre )
R.V
{C}{C}{C}{C}{C}{C}[1]{C}{C}{C}{C}{C}{C} [320] K.Marx. « Le Capital », livre 3, 5° section III ;
{C}{C}{C}{C}{C}{C}[2]{C}{C}{C}{C}{C}{C} [321] K.Marx « Théories sur la plus-value ». Fin du 17° chapitre ;
{C}{C}{C}{C}{C}{C}[3]{C}{C}{C}{C}{C}{C} [322] "Un certain nombre de camarades du parti communiste d'Allemagne étaient, et pour une part sont encore d'avis, qu'on ne saurait baser un programme révolutionnaire que sur la théorie de l'accumulation de la camarade R. Luxemburg. L'auteur du présent ouvrage, qui est d'un avis différent, dut nécessairement se "charger d'un travail analysant d'un point de vue critique l'Accumulation du capital. CELA FUT D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QUE, PAR SUITE DU MOT D'ORDRE DE BOLCHEVISATION des partis membres de l'Internationale Communiste, on commença à discuter de questions telles que la question nationale, agraire et coloniale, sur lesquelles la camarade R. Luxembourg avait adopté une attitude différente de l'attitude orthodoxe du bolchévisme. Il fallait donc examiner si il n'y avait pas de rapport entre les erreurs qu'elle avait commise dans ces questions et les erreurs théoriques de son Accumulation du capital.". (Boukharine, Préface de 1925 à "L'Impérialisme et l'accumulation du capital")
{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[4] [323] K.MARX, « Théories sur le plus-value ».
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire
- 3959 reads
L'accélération des évènements et les enjeux des "années de vérité" obligent les révolutionnaires à approfondir leurs conceptions de l'organisation de l'avant-garde du prolétariat, sur la nature et la fonction de l'organisation, sur la structure et le fonctionnement.
Ce rapport sur la nature et la fonction de l'organisation a été adopté par la Conférence Internationale du CCI de janvier 82. Dans un prochain numéro, nous publierons le second rapport, sur la structure et le fonctionnement de l'organisation.
1) Depuis qu'il s'est créé, le CCI a toujours souligné l'importance décisive d'une organisation internationale des révolutionnaires dans le surgissement d'un nouveau cours de luttes de classe à l'échelle mondiale. Par son intervention dans la lutte, même à une échelle encore modeste; par ses tentatives persévérantes d'oeuvrer à la création d'un lieu véritable de discussions entre groupes révolutionnaires, il a montré dans la pratique que son existence n'était ni superflue, ni imaginaire. Convaincu que sa fonction répondait à un profond besoin de la classe, il a autant combattu le dilettantisme que la mégalomanie d'un milieu révolutionnaire, marqué encore par les stigmates de l'irresponsabilité et de l'immaturité. Cette conviction s'appuie, non sur une croyance religieuse mais sur une méthode d'analyse : la théorie marxiste. Les raisons du surgissement de l'organisation révolutionnaire ne sauraient se comprendre en dehors de cette théorie, sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable mouvement révolutionnaire.
2) Les récentes scissions que vient de subir le CCI ne sauraient être comprises comme une crise fatale. Elles traduisent essentiellement une incompréhension sur les conditions et la marche du mouvement de classe qui secrète l'organisation révolutionnaire :
- que le cours vers la révolution est un phénomène mondial, et non local;
- que l'ampleur de la crise et des luttes n’ouvre pas mécaniquement une période immédiatement révolutionnaire;
- que la nécessité de l'organisation n'est ni contingente, ni épisodique mais couvre toute une période historique jusqu'au triomphe du communisme mondial;
- qu'en conséquence, le travail de l'organisation doit être compris à long terme, et se préserver de tous les raccourcis artificiels sécrétés par l'impatience immédiatiste, et qui mettraient en danger l'organisation.
3) L'incompréhension de la fonction de l'organisation des révolutionnaires a toujours conduit à la négation de sa nécessité :
- dans la vision anarchiste et conseilliste, l'organisation est considérée comme un viol de la personne de chaque ouvrier, et se réduit à un conglomérat d'individus, dont le rassemblement est purement fortuit;
- le bordiguisme classique, qui identifie parti et classe, rejette indirectement cette nécessité en confondant la fonction de l'organisation des révolutionnaires et la fonction de l'organisation générale de la classe.
4) Hier, comme aujourd'hui, cette nécessité d'une organisation de révolutionnaires demeure, et ne saurait se prévaloir ni de la contre-révolution, comme repoussoir, ni de l'ampleur de la lutte de classe (comme en Pologne où n'existait pas de fraction révolutionnaire organisée) :
- depuis la constitution du prolétariat en classe au 19ème siècle, le regroupement des révolutionnaires a été et reste un besoin vital. Toute classe historique porteuse du bouleversement social se donne une vision claire du but et des moyens de la lutte qui la mènera au triomphe de ses buts historiques;
- la finalité communiste du prolétariat engendre une organisation politique qui, théoriquement (programme) et pratiquement (activité), défend les buts généraux de l'ensemble du prolétariat;
- sécrétée en permanence par la classe, l'organisation révolutionnaire dépasse et donc nie toute division naturelle (géographique et historique) et artificielle (catégories professionnelles, lieux de production). Elle traduit la tendance permanente au surgissement d'une conscience unitaire de classe, s'affirmant en s'opposant à toute division immédiate;
- face au travail systématique de la bourgeoisie de dévoyer et briser la conscience du prolétariat, l'organisation révolutionnaire est une arme décisive pour combattre les effets pernicieux de l'idéologie bourgeoise. Sa théorie (le programme communiste) et son action militante dans la classe sont un puissant contrepoison aux miasmes de la propagande capitaliste.
5) Le programme communiste dont découle le principe d'action militante est le fondement de toute organisation révolutionnaire digne de ce nom. Sans théorie révolutionnaire, il ne saurait y avoir de fonction révolutionnaire, c'est à dire organisation pour la réalisation de ce programme. De ce fait, le marxisme a toujours rejeté toute déviation immédiatiste et économiste, visant à dénaturer et à nier le rôle historique de l'organisation communiste.
6) L'organisation révolutionnaire est un organe de la classe. Qui dit organe, dit membre vivant d'un corps vivant. Sans cet organe, la vie de la classe se trouverait privée d'une de ses fonctions vitales, et momentanément diminuée et mutilée. C'est pourquoi, de façon constante, cette fonction renaît, croit, s'épanouit en créant nécessairement l'organe dont elle a besoin.
7) Cet organe n'est pas un simple appendice physiologique de la classe, se contentant d'obéir à ses impulsions immédiates. L'organisation révolutionnaire est une partie de la classe. Elle n'est ni séparée, ni confondue (identique) avec la classe. Elle n'est ni une médiation entre l'être et la conscience de classe. Elle en est une forme particulière, la partie la plus consciente. Elle regroupe donc, non la totalité de la classe, mais sa fraction la plus consciente et la plus active. Pas plus que le parti n'est la classe, la classe n'est le parti.
8) Partie de la classe, l'organisation des révolutionnaires n'est pas la somme de ses parties (les militants), ni une association de couches sociologiques (ouvriers, employés, intellectuels). Elle se développe comme une totalité vivante dont les différentes cellules n'ont d'autre fonction que d'assurer son meilleur fonctionnement. Elle ne privilégie, ni des individus, ni des catégories particulières. A l'image de la classe, l'organisation surgit comme un corps collectif.
9) Les conditions du plein épanouissement de l'organisation révolutionnaire sont les mêmes que celles qui ont permis l'essor de la classe prolétarienne :
- sa dimension internationale; à l'image du prolétariat, l'organisation naît et vit en brisant le cadre national imposé par la bourgeoisie, en opposant au nationalisme du capital l'internationalisation de la lutte de classe dans tous les pays;
- sa dimension historique; l'organisation, comme fraction de la classe la plus avancée porte une responsabilité historique devant la classe. Mémoire de l'expérience irremplaçable du mouvement ouvrier passé, elle est l'expression la plus consciente des buts généraux et historiques du prolétariat mondial.
Ce sont ces conditions qui donnent à la classe comme à son organisation politique sa forme unitaire.
10) L'activité de l'organisation des révolutionnaires ne peut être comprise que comme un ensemble unitaire, dont les composants ne sont pas séparés mais interdépendants :
- son activité théorique, dont l'élaboration est un effort constant, et le résultat ni figé, ni achevé une fois pour toute. Elle est aussi nécessaire qu'irremplaçable;
- activité d'intervention dans les luttes économiques et politiques de la classe. Elle est la pratique par excellence de l'organisation où la théorie se transforme en arme de combat par la propagande et l'agitation;
- activité organisationnelle oeuvrant au développement, au renforcement de ses organes, à la préservation des acquis organisationnels, sans lesquels le développement quantitatif (adhésions) ne saurait se changer en développement qualitatif.
11) Bien des incompréhensions politiques et organisationnelles qui se sont manifestées dans notre Courant sont nées de l'oubli du cadre théorique dont le CCI s'est doté dès sa naissance. Elles ont pour origine une mauvaise assimilation de la théorie de la décadence du capitalisme, et des implications pratiques de cette théorie dans notre intervention.
12) Si, dans son essence, l'organisation des révolutionnaires n'a pas changé de nature, les attributs de sa fonction se sont qualitativement modifiés entre la phase d'ascendance et la phase de décadence du capitalisme. Les bouleversements révolutionnaires du premier après-guerre ont rendu caduques certaines formes d'existence de l'organisation révolutionnaire, et en ont développées d'autres qui au 19ème siècle encore n'apparaissaient que de façon embryonnaire.
13) Le cycle ascendant du capitalisme a donné une forme singulière et donc transitoire aux organisations politiques révolutionnaires :
- une forme hybride : aussi bien les coopératives, les syndicats que les partis pouvaient coexister dans une même organisation. Malgré les efforts de Marx, la fonction politique de l'organisation s'est retrouvée reléguée au second plan, la lutte syndicale passant au premier plan;
- la formation d'organisations de masse regroupant des fractions significatives de groupes sociaux particuliers (jeunes, femmes, coopérateurs), voire la majorité de la classe ouvrière de certains pays, a doté l'organisation socialiste d'une forme lâche, amenant un amoindrissement de sa fonction originaire d'organisation révolutionnaire.
La possibilité de réformes immédiates, tant économiques que politiques, déplaçait le champ d'action de l'organisation socialiste. La lutte immédiate, gradualiste primait sur la vaste perspective du communisme, affirmée dans le Manifeste Communiste.
14) L'immaturité des conditions objectives de la révolution a entraîné une spécialisation des tâches organiquement liées, une atomisation de la fonction de l'organisation :
- tâches théoriques réservées à des spécialistes (écoles de marxisme, théoriciens professionnels);
- tâches de propagande et d'agitation menées par des permanents ("révolutionnaires professionnels") syndicaux et parlementaires;
- tâches organisationnels, exercées par des fonctionnaires rétribués par le parti.
15) L'immaturité du prolétariat dont les grandes masses sortaient des campagnes ou des ateliers d'artisans, le développement du capitalisme dans le cadre de nations à peine formées, ont obscurci la fonction réelle de l'organisation des révolutionnaires :
- la croissance énorme de masses prolétarisées, sans tradition politique et organisationnelle, soumises aux mystifications religieuses, et prisonnières encore de la nostalgie de leur ancien état de producteurs indépendants, a donné une place démesurée au travail d'organisation et d'éducation du prolétariat. La fonction de l'organisation était conçue comme une injection de conscience et de "science" au sein d'une classe encore inculte et à peine sortie des illusions de la prime enfance;
- la croissance du prolétariat dans le cadre des nations industrialisées, a obscurci la nature internationale du socialisme (on parle plus de "socialisme allemand", de "socialisme anglais" que de socialisme international). La 1ère et 2ème Internationale se présentaient comme une fédération de sections nationales plus que comme une même organisation mondiale centralisée;
- la fonction de l'organisation était comprise comme une fonction nationale: édification du socialisme dans chaque pays, couronnée par une fédération associée d'Etats "socialistes" (Kautsky);
- l'organisation était considérée comme celle du peuple "démocrate", amené à se rallier peu à peu par les élections, au programme socialiste.
16) Ces caractéristiques passagères de cette période historique faussèrent les rapports entre parti et classe :
- le rôle des révolutionnaires apparaissait comme dirigiste (formation d'un Etat-major). De la classe étaient exigées des vertus de discipline militaire, de soumission à ses chefs. Comme toute armée, elle ne pouvait exister sans "chefs", à qui elle s'en remettait dans l'accomplissement de ses buts substitutionnisme, et même de ses moyens (syndicalisme)
- le parti était le parti du "peuple tout entier" gagné à la "démocratie socialiste". La fonction classiste du parti disparaissait dans le marécage du démocratisme.
C'est contre cette dégénérescence de la fonction du parti, que luttèrent et la Gauche de la 2ème Internationale et la 3ème Internationale à ses débuts. Que l'Internationale Communiste ait repris certaines conceptions de l'ancienne Internationale faillie (partis de masse, frontisme, substitutionnisme, etc.) est une réalité qui ne saurait avoir vertu d'exemple pour les révolutionnaires aujourd'hui. La rupture avec les déformations de la fonction de l'organisation est une nécessité vitale qui s'est imposée avec l'ère historique de la décadence.
16 bis) La période révolutionnaire surgie de la guerre a signifié un changement profond, irréversible, de la fonction des révolutionnaires :
- l'organisation, qu'elle soit encore réduite en dimension, ou parti développé, ne prépare plus ni n'organise la classe, et à fortiori la révolution secrétée par le prolétariat tout entier;
- elle n'est ni l'éducatrice, ni l'état-major, préparant et dirigeant les militants de la classe. La classe s'éduque dans la lutte révolutionnaire et les "éducateurs" eux-mêmes ont besoin d'être "éduqués" par elle;
- elle ne reconnaît plus des groupes particuliers (jeunes, femmes, coopérateurs, retraités, etc...)
17) L'organisation révolutionnaire est donc immédiatement unitaire, bien qu'elle ne soit pas l'organisation unitaire de la classe, représentée par les conseils ouvriers. Elle est une unité d'une unité plus vaste : le prolétariat mondial qui l'a engendrée .
- elle ne surgit plus nationalement, mais mondialement, comme une totalité secrétant ses différentes branches "nationales";
- son programme est identique (unicité) dans tous les pays, à l'Est comme à l'Ouest, dans le monde capitaliste développé comme dans les pays sous-développés. S'il subsiste encore aujourd'hui des "spécificités" nationales, produit d'une inégalité du développement capitaliste et de persistance d'anachronismes précapitalistes, celles-ci ne sauraient en aucun cas amener au rejet de l'unicité du programme. Celui-ci est mondial ou n'est rien.
18) La maturation des conditions objectives de la révolution (concentration du prolétariat, plus grande homogénéisation de la conscience d'une classe plus unifiée, plus qualifiée, d'un niveau intellectuel et d'une maturité supérieure à ceux du siècle dernier) a profondément modifié et la forme et la démarche de l'organisation des révolutionnaires:
a) par sa forme :
- elle est une minorité plus restreinte que par le passé, mais plus consciente, sélectionnée par son programme et son activité politique;
- elle est plus impersonnelle qu'au 19ème siècle, et cesse d'apparaître comme une organisation de chefs dirigeant la masse des militants. La période des chefs illustres et des grands théoriciens est révolue. L'élaboration théorique devient une tâche véritablement collective. A l'image des millions de combattants prolétariens "anonymes", la conscience de l'organisation se développe par l'intégration et le dépassement des consciences individuelles dans une même conscience collective;
- elle est plus centralisée dans son mode de fonctionnement, contrairement aux 1ère et 2ème Internationales, qui restèrent en grande partie une juxtaposition de sections nationales. Dans l'ère historique où la révolution ne saurait être que mondiale, elle est l'expression d'une tendance mondiale au regroupement des révolutionnaires. Cette centralisation, à la différence des conceptions dégénérescentes de l'Internationale Communiste après 1921 n'est pas une absorption de l'activité mondiale des révolutionnaires par un parti national particulier. Elle est l'autorégulation des activités d'un même corps existant dans plusieurs pays, sans qu'une partie puisse prédominer sur les autres parties. Cette primauté du tout sur les parties conditionne la vie même de celles-ci.
b) par sa démarche :
- dans la phase historique des guerres et des révolutions, elle retrouve sa véritable finalité: lutter pour le communisme, non plus par la simple propagande pour un but lointain, mais par son insertion directe dans le grand combat pour la révolution mondiale;
- comme l'a démontrée la révolution russe, les révolutionnaires surgissent et n'existent que dans et par la classe, de laquelle ils n'ont ni droits ni privilèges à exiger. Ils ne se substituent pas à la classe, de laquelle ils n'ont ni procuration de pouvoir, ni pouvoir étatique à recevoir;
- leur rôle consiste essentiellement à intervenir dans toutes les luttes de la classe, et à remplir pleinement leur fonction irremplaçable jusqu'après la révolution;
- de catalyser le processus de maturation de la conscience prolétarienne.
19) Le triomphe de la contre-révolution, la domination totalitaire de l'Etat, ont rendu plus difficile l'existence même de l'organisation révolutionnaire et réduit l'étendue même de son intervention. Dans cette période de profond recul, sa fonction théorique a prévalu sur sa fonction d'intervention et s'est révélée vitale pour la conservation des principes révolutionnaires. La période de contre-révolution a montré:
- que, petits cercles, noyaux, minorités insignifiantes isolées de la classe, les organisations révolutionnaires ne peuvent se développer qu'après l'ouverture d'un nouveau cours historique vers la révolution;
- que "recruter" à tout prix se traduit par la perte de leur fonction, en sacrifiant les principes pour le mirage du nombre. Toute adhésion est volontaire : elle est une adhésion consciente à un programme;
- que l'existence de l'organisation se perpétue par le maintien ferme et rigoureux de son cadre théorique marxiste. Ce qu'elle perd en quantité, elle le gagne en qualité, par une sévère sélection théorique, politique et militante;
- que -plus que par le passé- elle est le lieu privilégié de la résistance des faibles forces prolétariennes à la pression gigantesque du capitalisme, fort de 50 années de domination contre-révolutionnaire.
C'est pourquoi, même si l'organisation n'existe pas pour elle-même, il lui est vital de conserver de façon résolue l'organe que lui a confié la classe, en le renforçant, en oeuvrant au regroupement des révolutionnaires à l'échelle mondiale.
20) La fin de la période de contre-révolution a modifié les conditions d'existence des groupes révolutionnaires. Une nouvelle période s'est ouverte, favorable au développement du regroupement des révolutionnaires. Cependant, cette période nouvelle floraison reste encore une période charnière, les conditions nécessaires pour le surgissement du parti ne se sont pas transformées -par un véritable saut qualitatif- en conditions suffisantes. C'est pourquoi, pendant tout un laps de temps, se développeront des groupes révolutionnaires qui, par la confrontation, voire des actions communes, et finalement par leur fusion, manifesteront la tendance vers la constitution d'un parti mondial.
La réalisation de cette tendance dépend et de l'ouverture du cours vers la révolution et de la conscience même des révolutionnaires.
Si certaines étapes ont été franchies depuis 1968, si une sélection s'est opérée dans le milieu révolutionnaire, il doit être clair que le surgissement du parti n'est ni automatique ni volontariste, compte tenu du développement lent de la lutte de classe et du caractère immature et souvent irresponsable du milieu révolutionnaire.
21a) En effet, après le resurgissement historique du prolétariat en 1968, le milieu révolutionnaire s'est retrouvé trop faible et trop immature pour affronter la nouvelle période. La disparition ou la sclérose des anciennes Gauches Communistes -qui avaient lutté contre le courant pendant toute la période de contre-révolution- a été un facteur négatif dans le mûrissement des organisations révolutionnaires. Plus que les acquis théoriques des Gauches -redécouverts peu à peu et lentement réassimilés- ce sont les acquis organisationnels (la continuité organique) qui ont fait défaut, acquis sans lesquels la théorie reste une langue morte.
La fonction de l'organisation, sa nécessité même ont été le plus souvent incomprises, quand elles n'ont pas été tournées en dérision.
21b) Faute de cette continuité organique, les éléments surgis de l'après 68 ont subi la pression écrasante du mouvement étudiant et contestataire:
- adhésion à la théorie individualiste de la vie quotidienne et de l'auto-réalisation de soi,
- l'académisme de cercles, où la théorie marxiste est comprise soit comme une "science", soit comme une éthique personnelle,
- activisme-immédiatisme, où l'ouvrièrisme cachait mal un abandon total à la pression du gauchisme.
La décomposition du mouvement étudiant, le désabusement devant la lenteur et la sinuosité de la lutte de classe ont été théorisés sous la forme du modernisme. Mais le véritable milieu révolutionnaire s'est épuré de ces éléments les moins fermes, les moins sérieux, pour lesquels le militantisme était soit une occupation dominicale, soit le stade suprême de l'aliénation.
22) Malgré la confirmation éclatante, surtout depuis la grève de masse en Pologne, que la crise ouvrait un cours vers des explosions de classe de plus en plus généralisées, les organisations révolutionnaires -dont le CCI- ne se sont pas libérées d'un autre danger, non moins pernicieux que l'académisme et le modernisme : l'immédiatisme ; dont les frères jumeaux sont l'individualisme et le dilettantisme. C'est à ces fléaux que l'organisation des révolutionnaires doit aujourd'hui résister, si elle veut conserver son existence.
23) Le CCI, ces dernières années, a subi les effets désastreux de l'immédiatisme, forme typique de l'impatience petite bourgeoise, et ultime avatar de l'esprit confus de mai 68. Les formes les plus éclatantes de cet immédiatisme ont été :
a) l'activisme, apparu dans l'intervention et théorisé sous la forme de la conception volontariste du "recrutement". Il a été oublié que l'organisation ne se développe pas artificiellement, mais organiquement, par une sélection rigoureuse sur la base d'une plate-forme. Le développement "numérique" n'est pas un simple fait de volonté, mais le fruit d'une maturation de la classe et des éléments qu'elle sécrète.
b) le localisme s'est manifesté dans des interventions ponctuelles. On a vu certains éléments du CCI présenter "leur" section locale comme une propriété personnelle, une entité autonome, alors qu'elle ne peut être qu'une partie du Tout. La nécessité de l'organisation internationale a été même niée, voire ridiculisée, en ne voulant y voir qu'un "bluff" ou mieux qu'un "lien" formel entre sections.
c) l'économisme -déjà combattu par Lénine- s'est traduit par un esprit gréviculteur, chaque grève étant considérée en soi et non replacée et intégrée dans le cadre mondial de la lutte de classe. Souvent, la fonction politique de notre Courant a été reléguée au second plan. En se considérant parfois comme des "porteurs d'eau" ou des "techniciens" de la lutte au service des ouvriers, on a préconisé la préparation matérielle de la lutte future.
d) le suivisme (ou "queuisme"), ultime avatar de ces incompréhensions du rôle et de la fonction de l'organisation, s'est concrétisé par une tendance à suivre les grèves, en dissimulant son drapeau. Des hésitations sont apparues dans la dénonciation claire et intransigeante de toute forme nouvelle de syndicalisme. Les principes étaient mis de côté pour mieux "coller" au mouvement, et trouver un écho plus immédiat -être "reconnus" à tout prix par la classe.
e) l'ouvriérisme a été finalement la synthèse achevée de ces aberrations. Comme chez les gauchistes, certains éléments ont cultivé la démagogie la plus grossière en opposant "ouvriers" et "intellectuels", "base et sommet" au sein de l'organisation.
Le départ d'un certain nombre de camarades montre que l'immédiatisme est une maladie qui laisse des séquelles très graves, et qu'il débouche inévitablement sur la négation de la fonction politique de l'organisation, comme corps théorique et programmatique.
24) Toutes ces déviations, de type gauchiste, ne sont pas le fruit d'une insuffisance théorique de la plate-forme de l'organisation. Elles traduisent une inassimilation du cadre théorique, et en particulier de la théorie de la décadence du capitalisme, qui modifie profondément les formes d'activité et d'intervention de l'organisation des révolutionnaires.
25) C'est pourquoi le CCI doit combattre vigoureusement tout abandon du cadre programmatique, abandon qui mène fatalement à l'immédiatisme dans l'analyse politique. Il doit lutter résolument:
- contre l'empirisme, où la fixation sur l'événementiel, le phénomène contingent, mène fatalement à la vieille conception des "cas particuliers", éternelle matrice de tout opportunisme,
- contre toute tendance à la superficialité, qui se manifeste par un esprit de routine, voire une paresse intellectuelle,
- contre une certaine méfiance ou hésitation devant le travail théorique. Aux « couleurs roses »-de l'intervention, ne s'oppose pas la "grisaille" de la théorie. Celle-ci ne saurait être comprise comme un domaine réservé à des spécialistes en marxisme. Elle est le produit d'une réflexion collective et de la participation de tous à cette réflexion.
26) Pour préserver les acquis théoriques et organisationnels, il est nécessaire de liquider les séquelles du dilettantisme, forme infantile de l'individualisme :
- travail par à coups, sans méthode, à court terme,
- travail individuel, expression du "dilettantisme artisanal",
- irresponsabilité politique dans la constitution de tendances prématurées ou artificielles,
- démission ou fuite devant ses responsabilités. L'organisation n'est pas au service des militants dans leur vie quotidienne; au contraire, les militants luttent quotidiennement pour s'insérer dans le vaste travail de l'organisation.
27) La compréhension claire de la fonction de l'organisation en période de décadence est la condition nécessaire pour notre propre essor dans la période décisive des années 80.
Si la révolution n'est pas une question d'organisation, elle a des questions d'organisation à résoudre, des incompréhensions à surmonter, pour que la minorité des révolutionnaires puisse exister comme organisme de classe.
28) L'existence du CCI est garantie par une réappropriation de la méthode marxiste qui est sa boussole la plus sûre dans la compréhension des évènements et dans son intervention. Tout travail d'organisation ne saurait être compris et développé qu'à long terme. Sans méthode, sans esprit collectif, sans effort permanent de l'ensemble des militants, sans esprit persévérant excluant toute impatience immédiatiste, il ne saurait y avoir de véritable organisation révolutionnaire. Le prolétariat mondial a confié au CCI un organe dont l'existence est un facteur nécessaire dans les combats futurs.
29) Contrairement au siècle passé, la tâche de l'organisation révolutionnaire est plus difficile. Elle exige plus de chacun; elle subit encore les derniers effets de la contre-révolution, et les contrecoups d'une lutte de classe marquée encore par des avancées et des reculs, un cours en dents de scie.
Si elle ne subit plus l'atmosphère étouffante et destructive de la longue nuit de la contre-révolution triomphante, si aujourd'hui, elle déploie son activité dans une période favorable à l'éclosion de la lutte de classe et à l'ouverture d'un cours vers des explosions généralisées au niveau mondial, l'organisation doit savoir -une fois la lutte retombée- reculer en bon ordre, quand la classe momentanément recule.
C'est pourquoi, jusqu'à la révolution, l'organisation révolutionnaire devra savoir résolument lutter contre le courant ambiant d'incertitudes, voire de démoralisation dans la classe. La défense de l'intégrité de l'organisation dans ses principes et sa fonction est primordiale. Savoir résister, sans faiblesses ni repliement sur soi, c'est pour les révolutionnaires préparer les conditions de la victoire future. Pour cela, la lutte théorique la plus acharnée contre les déviations immédiatistes est vitale pour que la théorie révolutionnaire puisse s'emparer des masses.
En se libérant des séquelles de l'immédiatisme, en se réappropriant la tradition vivante du marxisme, préservé et enrichi par les Gauches Communistes, l'organisation démontrera dans la pratique qu'elle est bien l'instrument irremplaçable que le prolétariat a sécrété pour qu'elle puisse être à la hauteur de ses tâches historiques.
additif
C'est dans les périodes de luttes généralisées et de mouvements révolutionnaires que l'activité des révolutionnaires aura un impact direct, décisif même, car :
- la classe ouvrière se trouve alors face à une confrontation décisive avec son ennemi mortel: imposer la perspective prolétarienne ou céder aux mystifications, aux provocations et se laisser écraser par la bourgeoisie,
- elle subit en son propre sein, jusque dans ses assemblées et conseils, le travail de sabotage et de sape des agents bourgeois qui utilisent tous les moyens pour ralentir et dévoyer la lutte.
La présence des révolutionnaires en vue d'avancer des orientations politiques claires au mouvement et d’accélérer le processus d’homogénéisation de la conscience de classe, est alors, comme l’ont démontré les expériences de la révolution en Russie et en Allemagne, un facteur déterminant pouvant faire pencher la balance dans l’un ou l'autre sens. En particulier, on ne peut manquer de rappeler le rôle capital joué par les révolutionnaires tel que Lénine le définit dans ses "Thèses d'avril" :
Reconnaître que notre parti est en minorité, et ne constitue, pour le moment, qu'une faible minorité dans la plupart des Soviets de députés ouvriers, en face du bloc de tous les éléments opportunistes petits-bourgeois tombés sous l'influence de la bourgeoisie et qui étendent cette influence sur le prolétariat (...) Expliquer aux masses que les Soviets des députés ouvriers sont la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire, et que, par conséquent, notre tâche, tant que ce gouvernement se laisse influencer par la bourgeoisie, ne peut être que d'expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement aux masses les erreurs de leur tactique, en partant essentiellement de leurs besoins pratiques,' (Thèse 4)
Dès aujourd'hui, l'existence du CCI et la réalisation de ses tâches présentes représentent un travail de préparation indispensable pour être â la hauteur des tâches futures. La capacité des révolutionnaires a remplir leur rôle dans les périodes de lutte généralisée est conditionnée par leur activité actuelle.
1) Cette capacité ne naît pas spontanément mais est développée à travers tout un processus d'apprentissage politique et organisationnel. Des positions cohérentes et clairement formulées, tout comme les capacités organisationnelles pour les défendre, les diffuser et les approfondir ne tombent pas du ciel mais exigent une préparation, dès aujourd'hui. Ainsi, l'histoire nous montre comment la capacité des bolcheviks à développer leurs positions en tenant compte de l'expérience de la classe (1905 - la guerre) et à renforcer leur organisation, leur a permis, contrairement, par exemple, aux révolutionnaires en Allemagne, à jouer un rôle décisif dans les combats révolutionnaires de la classe.
Dans ce cadre, un des objectifs essentiels pour un groupe communiste doit être de dépasser le niveau artisanal de ses activités et de son organisation qui, en général, marque ses premiers pas dans la lutte politique. Le développement, la systématisation, l'accomplissement régulier et sans à-coups de ses tâches d'intervention, de publication, de diffusion, de discussion et de correspondance avec des éléments proches doit figurer au centre de ses préoccupations. Cela suppose un développement de l'organisation à travers des règles de fonctionnement et d'organes spécifiques lui permettant d'agir non comme une somme de cellules dispersées mais comme un corps unique doté d’un métabolisme equilibre.
2) Dès aujourd'hui, l'organisation des révolutionnaires représente également un pôle de regroupement politique international cohérent face aux groupes politiques, aux cercles de discussion et aux groupes ouvriers épars qui surgissent et surgiront un peu partout dans le monde avec le développement des luttes. L'existence d'une organisation internationale communiste avec une presse et une intervention crée la possibilité pour ces groupes, à travers une confrontation des positions et des expériences de se situer, de développer la cohérence révolutionnaire de leurs positions, et le cas échéant, de rejoindre l'organisation communiste internationale. En cas d'absence d'un tel pôle, les possibilités de disparition, de découragement, de dégénérescence (à travers par exemple l'activisme, le localisme, le corporatisme) de tels groupes sont d'autant plus grandes. Avec le développement des luttes et l'approche de la période de confrontation révolutionnaire, ce rôle gagnera encore en importance par rapport aux éléments sortant directement de la classe en lutte.
De plus en plus, la classe ouvrière est amenée à heurter son ennemi mortel de plein fouet. Même si le renversement du pouvoir de la bourgeoisie n'est pas immédiatement réalisable, le choc sera violent et risque d'être décisif pour la poursuite de la lutte de classe. C'est pourquoi les révolutionnaires se doivent d'intervenir dès maintenant, dans la mesure de leurs moyens, au sein de la lutte de classe:
- pour pousser les luttes ouvrières aussi loin que possible pour que toutes les potentialités qu'elles contiennent soient réalisées,
- pour réaliser qu'un maximum de problèmes soient posés, qu'un maximum de leçons puissent être tirées dans le cadre des perspectives politiques générales.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : Russie 1917 et Espagne 1936 - Focus (usa)
- 3071 reads
"Les ouvriers espagnols sont allés beaucoup plus loin que les ouvriers russes de 1917. La Russie en 1917 était une lutte entre le féodalisme et la bourgeoisie, cette dernière manipulant les ouvriers, l'Espagne 1936 était strictement une réponse des ouvriers au capital." FOCUS ([1] [324])
Internationalism répond : "En Russie en 1917, à la différence de l'Espagne 1936, l'appareil d'Etat capitaliste a été balayé par les organes de masse du prolétariat. (...) L'insurrection désespérée des ouvriers à Barcelone en mai 1937 était le dernier sursaut du prolétariat, un effort vain pour renverser l'appareil d'Etat capitaliste?
REMARQUES INTRODUCTIVES
Depuis quelques temps, dans la presse de la tendance politique qui se dit le Courant Communiste International (CCI), ont paru des polémiques avec le groupe politique international auquel nous appartenons, Fomento Obrero Revolucionario (FOR). Ces polémiques ont couvert beaucoup de questions, et on peut constater que le CCI défend certaines positions fondamentales proches de celles du FOR : principalement l'opposition aux syndicats et aux "guerres de libération nationale". Cependant, ces points d'accord.de fait, aussi importants qu'ils soient dans le monde actuel, n'impliquent aucune identité de vue ou accord fondamental entre le CCI et le FOR.
Les axes pour interpréter ces positions, les voies de l'intervention, les méthodes de recherche, et les analyses historiques du CCI et du FOR sont complètement et totalement différentes.
Par exemple, bien que les deux tendances attaquent les syndicats, la base théorique pour le faire est entièrement opposée. Le CCI commence par une reconnaissance subjective, honnête et nécessaire de la fonction anti-ouvrière des syndicats. Puis, en utilisant quelques instruments théoriques limités, il tente de projeter en remontant l'histoire une théorie rétrospective du syndicalisme, basée sur le concept que les syndicats étaient progressistes au siècle dernier, lorsque le capitalisme était ascendant et pouvait satisfaire les besoins de base des ouvriers, alors qu'aujourd'hui, le capitalisme est décadent et doit utiliser les syndicats pour aider à réduire la consommation. Cette analyse ignore le rôle quotidien des syndicats dans la vente de la force de travail, et donc comme un secteur organique du capital. Pour nous du FOR, ce qui ne va pas dans les syndicats, ce n'est pas qu'ils fournissent ou ne fournissent pas des salaires plus élevés, mats c'est que dans la négociation des salaires, ou du prix du travail, ils fortifient le système dans lequel le travail est acheté et vendu comme marchandise. Les fonctions ouvertement répressives des syndicats ne dérivent pas non plus du besoin épisodique de la bourgeoisie d'avoir un "tampon" entre elle et les ouvriers, aspect du problème qui dans sa logique peut détourner les ouvriers en suggérant que de "nouveaux" syndicats, ou des syndicats "de lutte de classe", sont la réponse à la corruption des bureaucrates syndicaux. La véritable origine des syndicats est dans 1'inévitabilité, étant donné la vente de la force de travail comme marchandise, de la concurrence entre le vendeur (l'ouvrier) et l'acheteur (l'employeur) sur le prix.
Les ouvriers aujourd'hui tendent à s'opposer aux syndicats à cause de leur rôle dans la classe ouvrière comme police et régulateur de la production, aspect inchangé de leur rôle économique, et non produit des caprices d'une quelconque médiation politique, réelle ou imaginaire. La propagande du CCI sur les syndicats, bien qu'excellente par sa vigueur, reste néanmoins trop incorrectement sur-"théorisée" pour contribuer directement au développement d'un mouvement ouvrier antisyndical. Un attachement à la "théorie" en amateur et un aveuglement à l'expérience, dont la question syndicale n'est qu'un exemple, caractérise l'ensemble de l'activité polémique et politique du CCI. Ceci est particulièrement évident dans la plus récente communication du CCI avec le FOR, le texte "Les confusions du FOR sur Russie 1917 et Espagne 1936" dans la Revue Internationale n°25, 1981 (cité dans la suite de cet article sous le nom "1917-1936"). Le but du présent texte est de fournir une base pour une réponse complète aux points soulevés par le CCI dans "1917-1936".
Avant de passer à ce texte, quelques clarifications sont nécessaires. Bien que l'auteur de ces lignes soit membre du FOR, ce travail n'est pas et ne doit pas être considéré comme un texte "officiel" du FOR sur la Russie 1917 et l'Espagne 1936. Il est de l'avis de l'auteur que l'activité dans une organisation politique, tout en supposant l'accord sur le programme et sur les principales questions politiques de l'heure, ne peut pas et ne devrait pas automatiquement requérir l'accord sur tous les points de l'analyse du passé. Les raisons de ceci sont d'abord la nécessité pour les militants de développer des habitudes de recherche indépendante, et en second lieu, la futilité et l'infantilisme de rechercher des réponses simples et absolues dans l'analyse des événements historiques. Les positions de l'auteur sur l'Espagne 1936 ne diffèrent pas de celles du FOR en général et de ses principaux porte-paroles, G.Munis en particulier. Ce n'est pas le cas sur la Russie 1917, sur laquelle l'auteur est arrivé plus tard à être en désaccord avec les principaux points de l'analyse mise en avant par Munis. Nous disons plus tard, car notre position actuelle sur la Russie, comme nous le verrons, diffère beaucoup de celle développée par l'auteur dans une lettre sur Trotski publiée dans "Marxist Worker" n°2, 1980. La lettre de "Marxist Worker" développait une position défendue jusqu'à cette année.
Nous examinerons les positions du CCI sur l'Espagne et la Russie. Puis nous aborderons la position de Munis sur la Russie. Enfin, nous présenterons notre propre vision sur la Russie. (Ces deux derniers points ne sont pas publiés dans cette Revue, note de la rédaction).
Nous devons ajouter une dernière remarque. Notre critique du CCI est extrêmement dure, dans la lignée du texte "La fausse trajectoire de Révolution Internationale" qui sera bientôt publié dans notre bulletin "The Alarm". Ceci n'exclut pas une perspective de travail politique commun avec le CCI. Le FOR et le CCI sont aujourd'hui les seuls groupes qui ont une position de classe combative sur la contre-révolution de la "libération nationale", la question la plus urgente du moment. Dans nos attaques contre la "gauche" Salvadorienne, nous sommes seuls. Même si nos traditions et nos méthodes diffèrent radicalement empêchant un plein accord, ceci n'a pas d'effet sur des projets spécifiques pour des actions politiques conjointes. Sur ce point, l'auteur de ces lignes est pleinement soutenu par les autres membres de FOCUS.
1. LE CCI ET LE FOR SUR L'ESPAGNE 1936
Nous ne pouvons cacher notre inquiétude dans ce que nous voyons comme les défauts majeurs du système théorique et polémique du CCI qui ne se sont jamais aussi bien exprimés que dans leur position sur l'Espagne 1936. Pour commencer, dans "1917-1936" le CCI emploie des méthodes critiques contre Munis qui se situent dans les pires traditions de la fausse "gauche". Plutôt que d'étudier et analyser sans illusions les vues de Munis, le CCI fabrique puis démolit adroitement un homme de paille, en présentant comme les positions de Munis ce qu'il espère faire croire à ceux qui ne connaissent pas le travail de Munis. "1917-1936" tente d'étiqueter l'insistance de Munis (et notre insistance) sur la phase espagnole plus que russe dans les convulsions révolutionnaires mondiales de 1917 à 1937 comme "erreur fondamentale", puis attaque les "origines de l'erreur" en les réduisant à une prétendue "insistance sur les mesures sociales plus que politiques" dans les écrits de Munis. L'un "découle" évidemment de l'autre, car la dialectique doit être respectée. Le CCI est entraîné dans une sorte de chasse aux sorcières sur l'Espagne, non pas comme conséquence d'une recherche sur l'histoire politique Ibérique entre 1930 et 1939, mais par un désir de protéger et justifier à tout prix le "pacte" qu'il a passé avec les Bordiguistes, qui nient qu'une révolution ait eu lieu en Espagne parce qu'aucun parti "Bolchevik" n'a surgi. Le CCI n'affirme pas ceci aussi crûment : il parle d'une "organisation ouvrière de la gauche communiste", qui est ce qu'il décrit comme le parti Bolchevik dans sa position sur la Russie. Nous verrons où cela les conduit. Ce qui nous frappe dans ce "principe" du Bordiguisme et du CCI, c'est qu'il a un arrière-goût d'Hégélianisme. Mais l'Espagne est un événement d'histoire : nous ne sommes ni préparés ni désireux d'avoir une discussion de philosophie. Ce que nous avons dit sur cette position lorsque les Bordiguistes l'ont défendue au départ, est que leur point de référence, Bilan, était extrêmement ferme sur l'événement, puisqu'il appelait les ouvriers espagnols à "aller de l'avant" vers une révolution sociale sur la base d'une ... répétition du 19 juillet 1936, reconnaissant ainsi la signification pleinement révolutionnaire et communiste de cet événement majeur de la Révolution Espagnole.
L'article "1917-1936" du CCI n'est hélas pas organisé pour faciliter le débat sur l'Espagne, puis qu’il procède par la méthode d'aborder un sujet puis de glisser soudain et sans transition à un autre dès qu'on arrive en terrain solide. En somme, le CCI fait un peu plus que de répéter les arguments Bordiguistes : "Munis dit qu'il a eu révolution sociale en Espagne mais pas en Russie; mais ceci est évidemment faux, parce que... Munis fait aussi l'éloge des collectivités économiques espagnoles, et qu'elles n'étaient pas authentiquement communistes". Mais le caractère de la Révolution Espagnole n'est pas déterminé par celui des collectivités. Se concentrer sur celles-ci, c'est improviser. On peut pardonner une improvisation brillante et utile, comme celle de Rosa Luxemburg sur la Révolution Russe, mais il est évident que le CCI essaie simplement de justifier une contre-vérité à laquelle il adhère religieusement. Sur les collectivités, un point doit être fait immédiatement : les aspects positifs de leur travail cités par Munis n'ont pas été inventés par lui. Ils existaient, ni plus ni moins que les espoirs des ouvriers du monde dans la malheureuse "expérience Russe" existaient. "Harceler" les collectivités espagnoles aujourd'hui n'apporte pas plus de crédit au CCI que ce ne fut le cas pour les Bordiguistes de Programme Communiste il y a dix ans (voir "Alarma" n°25, 1973, en réponse au Prolétaire). En analysant la soi-disant "insistance sur les mesures sociales plus que politiques" en citant le "contenu social" des collectivités comme preuve qu'il n'y a pas eu de Révolution en Espagne, le CCI pratique lui-même ce qu'il attaque. En général le discours du CCI est caractérisé par un genre d'improvisation qui tend à rejeter ce qu'on attaque hors de la tradition communiste. C'est une des raisons pour lesquelles le FOR et Munis tendent soit à ignorer le CCI, soit à lui répondre avec un "excès de vitriol ".
Dans le FOR, nous admettons certainement que l'Espagne est la question la plus cruciale. Mais nous ne réduisons pas notre analyse des révolutions au critère qui se base sur l'activité du Parti ou les mesures étatiques. Ce qui décide de l'ampleur d'une lutte politique, c'est 1'étendue de 1'action autonome des ouvriers, par une quelconque "mesure'' particulière. Aussi, la supériorité de l'Espagne sur la Russie consiste en certains aspects-clés de l'Espagne 1936-39 qui sont absents de l'expérience russe :
La destruction de l'Etat, de la police et de l'armée par les ouvriers et non par un seul parti ou groupe, le 19 juillet 1936 ;
La prise en mains des principales industries par les ouvriers, suivie par la collectivisation de l'économie, dans laquelle le rôle de l'Etat et même, dans une certaine mesure, des syndicats, a été au départ secondaire par rapport à l'élan de masse non-institutionnel. Par exemple, en Russie 1917, les comités de ravitaillement ouvriers des villes étaient organisés pour prendre le blé aux koulaks; mais, en tant que mesures économiques, ce type d'action était remplacé rapidement par les nationalisations. A Barcelone en 1936, tous les marchés et les industries alimentaires ont été collectivisés par les travailleurs eux-mêmes. Ce qui s'est produit en Russie était une confiscation "révolutionnaire", une arme temporaire contre la famine. Ce qui s'est produit en Espagne était une explosion de classe contre le capital et le système du salariat.
3 mai 1937 à Barcelone : soulèvement ouvrier armé victorieux contre le stalinisme, défait par les seuls soins de la trahison des chefs de l'anarcho-syndicaliste CNT.
Plus important, ces événements eurent lieu après plusieurs années de confrontations de classe massives et de préparations ouvertes de la classe ouvrière pour la révolution, symbolisées surtout par la Commune des Asturies de 1934.
C'est tout à l'honneur de Trotski, malgré ses nombreuses erreurs, d'avoir reconnu que dans la période 1936-37 les ouvriers espagnols sont allés beaucoup plus loin que les ouvriers russes en 1917. La Russie en 1917 était une lutte entre le féodalisme et la bourgeoisie, cette dernière manipulant les ouvriers. L'Espagne 1936 était strictement une réponse des ouvriers au capital.
A ceci, le CCI ne répond qu'une chose: l'Espagne n'était pas autre chose qu'une répétition de la seconde guerre mondiale et un précurseur du Vietnam; une guerre entre puissances impérialistes antagonistes. Dans sa vision des liens entre l'Espagne et la Seconde Guerre Mondiale, il exagère quelque chose de juste, mais qui est pour les révolutionnaires une vérité secondaire, exactement à la manière des commentateurs politiques bourgeois et des historiens staliniens de la guerre d'Espagne, qui voient aussi dans l'Espagne une "guerre antifasciste", et rien d'autre. Ce qu'ils veulent tous ignorer, c'est que bien que la Révolution Espagnole se soit transformée d'une guerre civile en une guerre impérialiste (une revanche éloquente de l'histoire sur la formulation fameuse de Lénine, mais vide de sens, sur la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile), elle a d'abord été une révolution sociale, et les masses ont résisté à sa transformation en guerre impérialiste, en proportion directe de la violence et des mensonges utilisés par les Staliniens en 1936-39 qui se comparent aux Sociaux-démocrates dans la période 1914-23. Si les ouvriers espagnols n'avaient pas résisté à la campagne de guerre de la bourgeoisie, la réaction stalinienne n'aurait pas été aussi nécessaire.
La résistance des ouvriers espagnols au bellicisme de la bourgeoisie internationale et aux staliniens les distingue beaucoup en comparaison des ouvriers en France et en Allemagne en 1914 - la première guerre mondiale n'a certainement pas été précédée directement d'un 19 juillet ou d'un 3 mai -et aussi des ouvriers d'Europe de l'Est depuis 1945, où ni un 19 juillet ni un 3 mai ne se sont produits. Ce sont là les principaux points à discuter sur l'Espagne, bien que le CCI choisisse de les ignorer.
2. LE CCI SUR LA RUSSIE 1917
Comme pour l'Espagne, le CCI traite la Russie avec une approche de bluff. Examinons un peu quelques-uns des points importants de la question russe tels qu'ils apparaissent dans "1917-1936", qui ne révèlent pas seulement une caricature des positions de Munis, mais aussi une caricature du marxisme qui tend à discréditer fortement le CCI. Un point formel est à remarquer : le CCI, en polémiquant contre Munis sur la Russie, choisit d'ignorer son principal travail sur le sujet, le livre "Parti-Etat, Stalinisme, Révolution" publié par Spartacus en 1975, Paris. Mais nous traiterons de cela plus loin. Ce qui saute aux yeux dans "1917-1936", c'est la présence de perles telles que l'affirmation que le "parti des ouvriers (c'est-à-dire Bolchevik, note de l'auteur) exerçait encore (pendant la période du "communisme de guerre", note de l'auteur) un certain contrôle politique sur l'Etat qui a surgi de la Révolution Russe. Nous disons 'certain' parce que ce contrôle était relatif". La réaction de n'importe qui, même connaissant superficiellement l'histoire du bolchevisme, à cette affirmation doit être la surprise pour ne pas dire la stupeur. Qui n'a jamais sérieusement suggéré que le contrôle bolchevik sur l'Etat ait "diminué" de quelque manière que ce soit après 1917 ? Faire une telle proclamation, c'est suggérer que Staline n'était pas un bolchevik par exemple. Dire que le régime stalinien ne représentait pas les intentions révolutionnaires des Léninistes est une chose ; mais proclamer que le Parti-Etat ne s'est pas développé à partir de la dictature du parti Bolchevik, c'est s'engager à fabriquer une histoire qui ne trouve pire que celle des faux "Spartacistes" de Robertson, sinon celle des staliniens eux-mêmes. Le fait que le parti Bolchevik ait continué à dominer pendant la période "révolutionnaire" et "contre-révolutionnaire" de l'histoire russe d'après 1917, c'est précisément ce qui doit être analysé. Une habitude scolaire de jouer avec les concepts, visible dans cette remarque ridicule sur une "diminution" du contrôle étatique Bolchevik, montre à quel point d'excès le CCI est conduit par sa sollicitude envers les Bolcheviks, attitude malheureusement partagée par Munis, bien que Munis soit allé plus loin que tout autre "loyaliste à Lénine" par une démystification d'octobre 1917. Cette "loyauté à Lénine" mène aussi le CCI à traiter de manière apologétique et hésitante des aspects du bolchévisme même s'il ne peut les tolérer. Par exemple, dans "1917-1936", il dit : "ce qu'ils (les Bolcheviks) ont fait au niveau économique et social était le plus qui pouvait être fait". Ce que les Bolcheviks ont fait, c'est de mettre en place le capitalisme d'Etat ! Est-ce réellement tout ce qui pouvait être fait ? Plus loin, le CCI affirme que "la trahison du Bolchévisme doit être ajoutée comme une cause fondamentale interne" de la contre-révolution, comme si cette "trahison" n'était qu'une note de plus en bas de page ! Le CCI ne fait et n'a fait aucune tentative pour analyser les racines de cette "trahison" au-delà de cette remarque éculée que "l'erreur fondamentale interne de la Révolution Russe était d'avoir identifié la dictature du parti avec la dictature du prolétariat, la dictature des Conseils Ouvriers. Ce fut l'erreur subsistutionniste fatale des Bolcheviks". Une fois encore, cette position est partagée par Munis et par ceux qui au sein du FOR sont d'accord avec lui. Sur ce point, l'auteur de ces lignes est en désaccord total avec le CCI et Munis. D'abord, ce qui n'allait pas dans la dictature des bolcheviks, ce n'était pas le fait qu'elle se "substituait" aux masses. L'argument contre le"substitutionnisme" est un argument démocratique bourgeois contre la dictature en général. Toutes les dictatures sans exception sont substitutionnistes. Une dictature des Conseils Ouvriers se substituera elle-même aux ouvriers pas moins qu'une dictature d'un parti. Une dictature du prolétariat doit se subsister à coup sûr au reste de la société. En fait, la "substitution aux masses" est absolument nécessaire dans certaines situations. Le rejet du "substitutionnisme" du CCI est, ironiquement, exactement l'erreur faite par la FAI anarchiste en Espagne 1936, erreur reconnue, à leur crédit, par les anarchistes réellement révolutionnaires du groupe des Amis de Durutti, qui ont combattu avec les prédécesseurs du FOR, avec les masses à Barcelone en mai 1937. La question n'est pas dictature, mais dictature de qui? Le problème avec la dictature Bolchevik, comme nous allons essayer de le démontrer plus loin, est que c'était la dictature d'un parti non prolétarien.
Une critique complète du CCI, comme nous l'avons dit, devrait laisser de côté le domaine de la politique pour celui de la philosophie, puisque les réminiscences hégéliennes subsistent, par exemple dans la remarque que " toute altération du niveau politique (dans une révolution, note de l'auteur) implique un retour au capitalisme". Pour nous, c'est plus la persistance du capitalisme qui détermine toute altération de la forme politique. Le reste de 1'"arsenal" théorique du CCI est de la même piètre qualité. Parler de l'isolement de la Russie après la révolution comme facteur déterminant dans l'histoire de l'Etat bolchevik est bien et juste, mais après prés de 60 ans de répétitions, ce point a été au moins partiellement transformé en prétexte. Après tout, le pays "isolé" était le "sixième du monde". Et bien que nous rejetions les théories de Vollmar ou Staline sur le "Socialisme en un seul pays", il reste 1'"acceptation" curieuse de l'isolement russe de Zinoviev et d'autres "vieux bolcheviks"" en 1923, 1926 et 1927, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et en Chine; un aspect de l'histoire bolchevik suffisamment expliqué par les analyses psychologiques de Trotski.
Sur la question des "révolutions isolées", le CCI se laisse aller à quelque chose qui frise la calomnie dans la polémique avec Munis, alors que Munis a toujours insisté sur le fait que la victoire de la révolution espagnole, et de toute autre révolution, dépend avant tout de la destruction des frontières nationales et de l'extension de la révolution à d'autres pays. Finalement, que prouverait le pays révolutionnaire "isolé" en question, si au lieu d'être la Bolivie, comme c'est suggéré par le CCI, c'était les USA, la Russie, l'Allemagne de l'Ouest ou le Japon? Ou même la France ou l'Italie, la Chine ou le Brésil? Est-ce qu'un tel événement ne tendrait pas à contribuer à une révolution mondiale "simultanée", possibilité que le CCI choisit d'écarter? On peut nous railler, le FOR, pour fonder toute une perspective et un Second Manifeste Communiste sur cette possibilité, mais c'était précisément la perspective de Marx et Engels, qui fondaient leurs espoirs sur l'Angleterre et la France, les Etats-Unis et la Russie de leur époque, également capables d'emmener le monde entier avec elles, "simultanément".
FOCUS- 1981-
Réponse du CCI
Avant de discuter de la nature de classe des événements de Russie 1917 et d'Espagne 1936, qui sont les questions centrales dans le texte de Focus, quelques commentaires sont nécessaires. Sur la nature des syndicats, Focus écarte l'analyse du CCI selon laquelle le rôle des syndicats a différé dans les phases ascendantes et décadentes du capitalisme et offre à la place l'argument suivant: les syndicats ont toujours été contre 1a classe ouvrière parce que "en négociant les salaires ou le prix du travail ils fortifiaient le système dans lequel le travail est acheté et vendu comme une marchandise."
Ici, Focus présente une vue moraliste et a-historique de la nature du syndicalisme et un manque de compréhension de la différence qualitative entre les phases ascendante et décadente du capitalisme c'est-à-dire des conditions différentes dans lesquelles le prolétariat lutte.
Dans le capitalisme ascendant, quand il était encore historiquement un système progressiste, développant les forces productives, créant le marché mondial et établissant les bases matérielles pour la révolution communiste, la révolution prolétarienne n'était pas encore à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour pour la classe ouvrière, c'était un combat pour se constituer elle-même en tant que classe défendant ses intérêts de classe, participant à la lutte pour renverser le féodalisme où cela n'avait pas encore été accompli et pour arracher des réformes et des concessions à la bourgeoisie, afin de faire progresser son niveau de vie qui, réellement, incluait une lutte pour l'amélioration des conditions de la vente de la force de travail. Les syndicats ne furent jamais révolutionnaires, mais ils ont réellement offert les moyens pour le prolétariat, il y a un siècle, de lutter pour ses intérêts de classe propres, et pour développer les capacités politiques et organisationnelles requises dans la confrontation avec l'Etat capitaliste. C'est pourquoi les révolutionnaires à cette époque, Marx et Engels compris, avaient raison dans leur vision selon laquelle les syndicats étaient des écoles pour le socialisme. Cependant, quand le capitalisme entre dans sa phase décadente, ce qu'annonce de manière sanglante l'éclatement de la première guerre inter-impérialiste (1914), quand la possibilité de gagner des réformes durables arrive à son terme et que le capitalisme devient un frein au développement ultérieur des forces productives, la révolution prolétarienne est alors à l'ordre du jour et elle seule, peut constituer un progrès pour l'espèce humaine. La base matérielle pour l'existence du syndicat comme organe de la classe a été détruite par la crise historique du mode de production capitaliste, et les syndicats sont désormais, définitivement incorporés dans l'appareil d'Etat capitaliste.
Focus veut insister sur le fait que les syndicats ont toujours été contre la classe ouvrière par nature, parce qu'ils ont seulement lutté pour -des améliorations de conditions de vie de la classe ouvrière. Ce n'est pas le CCI qu'il doit attaquer, mais la conception en elle-même qui est la base du marxisme : le capitalisme dans sa phase ascendante constitue un pas nécessaire et progressiste pour l'humanité et le prolétariat doit défendre ses intérêts de classe directement opposés à ceux de la bourgeoisie, à travers une lutte politique et économique. Le capitalisme a créé les conditions humaines et matérielles de sa propre destruction.
MESURES POLITIQUES CONTRE MESURES ECONOMIQUES
Pour commencer, plusieurs choses doivent être clarifiées en rapport avec l'article "Russie 1917 et Espagne 1936, critique de Munis et du FOR" qui est publié dans la Revue Internationale n° 25.
Cet article souligne le point crucial : le renversement de l'Etat capitaliste et la prise du pouvoir par la classe ouvrière est le premier pas décisif dans la révolution prolétarienne. Ce sont la destruction révolutionnaire de l'Etat capitaliste et l'établissement d'une dictature prolétarienne à travers les conseils ouvriers qui sont les conditions préalables indispensables pour la transformation des relations économiques. Les mesures économiques entreprises par la révolution ouvrière quand elle triomphe dans n'importe quel pays, ne sont pas sans conséquence ou secondaires. Des mesures économiques correctes peuvent accélérer le processus de la révolution, contribuer à l'internationalisation de la révolution et à l'oblitération la plus rapide de la persistance de la loi de la valeur. Des mesures politiques incorrectes peuvent certainement retarder ce processus mais le point crucial est que, les mesures économiques doivent être observées dans leur contexte politique. Le pouvoir politique est la base de la révolution.
Le CCI ne pense pas que "ce qu'ont fait (les Bolcheviks) sur le plan social et économique était le maximum que l'on puisse faire". Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, les bolcheviks ont fait des erreurs de politique dont certaines étaient même de nature bourgeoise, mais nous insistons sur le fait que, aussi longtemps que le prolétariat exerce son pouvoir politique, de telles erreurs peuvent être corrigées (cf. Revue Int.85)
La plus claire et la plus radicale des politiques économiques entreprises par le prolétariat quand il prend le pouvoir dans quelque pays que ce soit, ne pourrait en elle-même opérer une transition au communisme. C'est seulement l'extension de la révolution à travers la guerre civile internationale entre le prolétariat et le capital et le renversement de l'appareil d'Etat capitaliste dans chaque pays qui peuvent rendre possible la transition au communisme nécessitant l'abolition de la production de marchandises, du travail salarié et de la loi de la valeur. Les erreurs, économiques et même politiques qui sont objectivement des concessions aux rapports sociaux capitalistes, peuvent être corrigées, mais seulement si le pouvoir politique prolétarien ,1a dictature de classe est intact. Et de la même manière, toute défaillance dans l'extension de la lutte de classe à un double pouvoir, à un assaut direct et à une destruction de l'Etat capitaliste, a pour conséquence de rendre toute tentative de transformation économique sans signification et de toute façon sans contenu révolutionnaire. L'article de la Revue Internationale 25 souligne que ce pouvoir politique du prolétariat, cette condition préalable à la transformation qui amène au communisme, était complètement absente dans l'Espagne de 1936.
L'ESPAGNE DE 1936-1937
Le FOR et FOCUS proclament que l'Etat bourgeois a été détruit par les ouvriers en Espagne 1936, mais cela est totalement faux. Il y eut sans aucun doute une insurrection ouvrière qui empêcha le coup d'Etat de Franco de triompher, mais en l'espace bref de quelques semaines, les anarchistes, staliniens, trotskystes furent tous intégrés dans le même Etat bourgeois avec les bourgeois républicains,
L'insurrection ouvrière fut rapidement transformée en une guerre entre fractions capitalistes rivales -chaque fraction étant armée et soutenue par un bloc impérialiste en compétition avec l'autre - grâce au travail de ces organisations capitalistes: absence d'organes unitaires de masse du prolétariat avec des comités élus et révocables pour coordonner la lutte (conseils ouvriers), contrôle des milices armées par ces organisations (Staliniens, sociaux-démocrates, CNT anarchiste), arrêt de la grève générale dans des villes-clefs telles que Barcelone, dispersion par celles-ci des ouvriers armés sur le front, pour gagner du terrain sur l'armée de Franco (au lieu de combattre sur le front de la lutte de classe et de renverser l'Etat capitaliste à son moment de faiblesse). C'est ce travail qui sanctionne la véritable intégration de ces organisations dans le gouvernement de l'Etat capitaliste espagnol. De tout ceci, devait découler une guerre dans laquelle le prolétariat allait être massacré pour la sauvegarde du capitalisme.
Le fait que l'Etat n'ait pas été détruit, que le prolétariat n'ait pas exercé sa dictature de classe, signifie que les collectivisations exaltées par Focus étaient vides de toute signification révolutionnaire. Elles ont été en fait utilisées contre les ouvriers pour empêcher les grèves dans l'industrie de guerre, pour augmenter le taux d'exploitation, pour allonger la journée de travail, etc. Aussi longtemps que l'appareil d'Etat bourgeois existe, de tels actes économiques "révolutionnaires" deviennent des obstacles à la tâche révolutionnaire primordiale : la destruction de l'Etat capitaliste. Tout comme le récent battage de la bourgeoisie sur l'autogestion en Pologne (et comme le démontre pleinement l'évolution vers l'autogestion des entreprises américaines en perdition), les illusions sur les pas économiques que les ouvriers peuvent faire sans détruire l'Etat capitaliste, ne peuvent que conduire à l'auto-exploitation sous le capitalisme.
Si l'Etat bourgeois fut détruit en 1936, comme le prétend Focus, de quelle manière la classe ouvrière a-t-elle exercé sa dictature de classe ? Mais même Focus trouve bien difficile de croire que la classe ouvrière a réellement pris le pouvoir politique en Espagne, et ils sont ainsi forcés de se contredire comme ils le font quand ils écrivent : "il y a eu une insurrection victorieuse d'ouvriers armés contre le stalinisme qui ne devait être vaincue que par la faute de la trahison des leaders de la CNT anarcho-syndicaliste le 3 mai 1937 à Barcelone". Pourquoi les ouvriers devraient-ils faire une révolution contre quelque chose qu'ils auraient déjà détruit ? Et que sommes-nous susceptibles de comprendre par la curieuse formulation : "une insurrection victorieuse... vaincue... " ?
L'insurrection désespérée des ouvriers à Barcelone en mai 1937 était le dernier sursaut du prolétariat, un effort vain pour renverser l'appareil d'Etat capitaliste, qui, mortellement blessé un an plus tôt, a été sauvé par les forces combinées de la social-démocratie, du stalinisme, de l'anarchisme et du trotskysme.
L'insurrection ne fut pas écrasée par la faute de la trahison de quelques leaders anarchistes comme voudrait nous le faire croire Focus, mais par l'armée, que ces organisations capitalistes -et pas seulement ses leaders- ont elles-mêmes précisément créée, et par l'influence idéologique permanente qu'ont eue ces mêmes organes de l'Etat capitaliste sur la classe ouvrière.
RUSSIE 1917
Quant il parle de la Révolution Russe, Focus montre une confusion et une inconsistance extrêmes. Le texte conclut sur le fait que, en Russie, en 1917, ce n'est pas une révolution prolétarienne mais une révolution bourgeoise contre le féodalisme qui a eu lieu. Cela implique que ces camarades, soit ne comprennent pas que le capitalisme, comme système global, est entré dans sa phase décadente au début de ce siècle et que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour, soit qu'ils ne parviennent pas à saisir le capitalisme dans sa globalité de système mondial et croient que la phase décadente du capitalisme est commencée dans certains pays et pas dans d'autres. Ces deux visions sont erronées.
Si réellement la révolution bourgeoise était à l'ordre du jour en 1917 nous ne comprenons vraiment pas l'hostilité de Focus à l'égard de ce qu'ils appellent à tort une tendance bourgeoise radicale (les Bolcheviks), dans la mesure où les marxistes soutiennent la bourgeoisie progressiste dans son dépassement des résidus du féodalisme qui bloquent le développement des forces productives, dans la phase ascendante du capitalisme. Mais en fait le capitalisme en 1917 était un système mondial, dominant tout le marché mondial, miné par des contradictions insurmontables. Cela en fit un obstacle au développement des forces productives, au niveau mondial, et en ce sens la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour en Russie comme partout ailleurs.
En Russie en 1917, à la différence de l'Espagne en 1936, l'appareil d'Etat capitaliste a été balayé car les organes de masse du prolétariat -les Soviets-, et cet événement monumental a été clairement saisi comme n'étant que le premier pas de la révolution mondiale de la classe ouvrière. Ni le renversement de l'Etat capitaliste, ni la reconnaissance de la nécessité vitale de la révolution mondiale, n'auraient été possibles sans le rôle décisif de la minorité révolutionnaire de la classe, le Parti Bolchevik... Et ce, malgré d'un côté toutes les erreurs et même les conceptions carrément capitalistes de son programme (le Parti se substituant à la classe, etc.) et de l'autre, le rôle non moins décisif que ce Parti a joué dans la contre-révolution qui a écrasé la classe ouvrière.
Nous ne pouvons qu'être d'accord avec G.Munis, qui parle au nom du FOR (quoique pas à celui de FOCUS) quand il écrit : "Une analyse révolutionnaire de la contre-révolution doit rejeter 1'une après 1'autre toutes les idioties sur la soi-disant nature bourgeoise des Bolcheviks, aussi bien que les commentaires teintés de ragots sur leur cruauté et leur avidité de pouvoir. De tels arguments conduisent à un reniement de la révolution russe et de la révolution en général ; Ils sont le produit des sceptiques, et pas seulement d'eux, mais surtout, et de plus en plus, de staliniens défroqués. "
Après avoir rejeté la nature de classe prolétarienne de la Révolution de 1917, Focus est incapable de tirer une quelconque leçon pour le futur de cet événement essentiel. Au lieu de cela, il opte pour un exercice littéraire de déformation, comparant la révolution russe à la révolution française, ce qui est permis par le point de vue erroné de Focus, selon lequel la Révolution en Russie en 1917 était (comme la révolution française), une révolution bourgeoise. Pour le prolétariat, les leçons tirées de sa révolution à propos du besoin d'internationalisation de la révolution, de la dictature des conseils ouvriers et du rejet du substitutionnisme, sont par conséquent complètement ignorées par Focus.
En fait, quand il rejette "les clichés à propos du substitutionnisme bolchevik" FOCUS voit dans toutes les dictatures, sans exception, le substitutionnisme :
"Une dictature des conseils ouvriers se substituerait aux ouvriers autant qu'un Parti. La dictature du prolétariat se substituerait encore plus au reste de la société. En fait, "le substitutionnisme des masses" est absolument nécessaire dans certaines situations".
Parce qu'il rejette la nature ouvrière de la révolution russe, il ne peut voir que la révolution russe montre que ce substitutionnisme sonne le glas de la mort de la révolution ouvrière. Ce substitutionnisme a été un puissant facteur de la contre-révolution en Russie qui a contribué à la destruction du pouvoir de la classe ouvrière organisée dans les conseils ouvriers, et a amené au capitalisme d'Etat. Quand Focus parle des conseils se substituant à la classe ouvrière, il ne comprend pas la relation dynamique entre la classe ouvrière et les conseils ouvriers; que les conseils ouvriers ne peuvent pas se permettre d'être une institution au-dessus de la classe ouvrière, mais doivent être conservés comme des organes unitaires pour la classe ouvrière dans lesquels la plus large démocratie ouvrière est maintenue.
Si le substitutionnisme est inévitable et nécessaire, comme le prétend Focus, on peut se demander si ce groupe a une quelconque conception ou engagement vis à vis de la démocratie ouvrière !
J.G. & M.I. Internationalism (Section du CCI. aux U.S.A.)
[1] [325] Nous publions deux parties de cette lettre. Dans le numéro précédent de la Revue International, nous parlons de la rupture de FOCUS avec le FOR, cette lettre a été écrite lorsque FOCUS faisait partie du FOR
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [207]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [108]
Courants politiques:
Revue Internationale no 30 - 3e trimestre 1982
- 2706 reads
Guerre des malouines : manoeuvres militaires, manoeuvres idéologiques, un piège pour le prolétariat
- 4786 reads
La guerre des îles Malouines vient alimenter une propagande intensive de la bourgeoisie. Le spectre d'une 3ème guerre mondiale vient hanter la conscience des prolétaires. Pourtant, la préoccupation essentielle de la bourgeoisie, ce n'est pas la guerre, c'est la perspective des affrontements de classe dans les centres du capitalisme. Le cours historique est à la révolution. C'est ce cours que la bourgeoisie essaie de renverser pour ouvrir le chemin vers la guerre mondiale. Sur son chemin, elle doit s'affronter au prolétariat qui n'est pas embrigadé. Les campagnes incessantes n'ont pas d'autre but que d'affaiblir le prolétariat avant cet affrontement.
La lutte de classe en Pologne est venue montrer que le prolétariat n'est pas vaincu, que son potentiel de combativité est énorme. La crise est là qui frappe toujours plus fort et pousse le prolétariat vers la révolution. Le conflit des îles Malouines est utilisé par la bourgeoisie pour "distraire" le prolétariat de cette perspective, pour lui faire oublier qu'il ne peut être mis fin à la guerre sans d'abord mettre fin au capital.
L'enjeu du conflit n'est pas aux îles Malouines, il est au coeur du prolétariat mondial, là où se dessine 1'avenir de 1'humanité.
LES CAUSES DE LA GUERRE
Depuis le début des hostilités, le 2 avril 1982, le conflit des îles Malouines a fait des centaines de morts et de blessés. Déclenchée par le débarquement des troupes argentines, entamée au rythme lent de la mise en place du blocus naval par la marine britannique, la guerre a été brutalement débarrassée de ses oripeaux folkloriques sous les coups des armes les plus sophistiquées de la marine et de 1'aviation.
Toute l'histoire de la bourgeoisie et de ses guerres nous montre que les alibis humanistes ne sont que des mensonges. Ce conflit ne fait pas exception à la règle : le régime des tortionnaires de Buenos-Aires se fait le chantre de 1'anti-colonialisme, de 1'anti-yankee, lui qui a toujours survécu grâce au soutien politique, militaire et économique des Etats-Unis ; la bourgeoisie anglaise se pose comme le défenseur intransigeant des valeurs démocratiques, elle dont l'histoire est jalonnée de massacres coloniaux, de guerres impérialistes, elle qui aujourd'hui s'est faite la spécialiste de la répression en Irlande du Nord. Tout cela n'est que de la propagande. Mais où sont donc les intérêts en jeu qui peuvent justifier un tel conflit ?
QUELS INTERETS ECONOMIQUES ?
Quasiment inconnues il y a encore quelques mois, les îles Malouines se retrouvent propulsées aujourd'hui au centre de l'actualité mondiale. 1800 habitants, dont la richesse ne reposait que sur 300 000 moutons et sur la pêche se retrouvent aujourd'hui prisonniers sous un déluge de bombes. Ce ne sont pas ces pauvres activités économiques qui peuvent réellement susciter des convoitises et une guerre de cette envergure. Alors, les Malouines recèlent-elles des ressources cachées ? La presse a pu parler à loisir des richesses cachées des océans : pétrole, krill, nodules poly-métalliques, etc. pour essayer d'expliquer le conflit. Pourtant, à l'heure de la crise de surproduction généralisée, qui va investir dans l'Atlantique Sud, surtout dans la région des Malouines, près du cercle polaire, aux conditions climatiques terribles? L'Atlantique Sud n'est pas la mer du Nord, entourée de pays industrialisés qui ont permis l'exploitation pétrolière dans des conditions climatiques comparables et on sait avec quelles difficultés.
Il n'y a pas d'enjeux économiques majeurs aux Malouines. Ces rochers perdus au milieu de l'océan, balayés par des vents glacés, sont-ils des enjeux stratégiques ?
QUELS ENJEUX STRATEGIQUES ?
Les îles Malouines étaient jusqu'à présent éloignées des préoccupations militaires. Les vieilles revendications territoriales des argentins semblaient faire partie du folklore latino-américain, tandis que la présence militaire de la Grande-Bretagne était symboliquement constituée avant le débarquement des troupes argentines par une poignée de soldats. Ces îles ne constituent un enjeu stratégique ni pour la Grande-Bretagne, ni pour 1'Argentine
Pour l'ensemble du bloc occidental qui voit deux de ses piliers s'affronter, les îles Malouines ne représentaient pas plus un enjeu stratégique crucial. Le bloc adverse, contrôlé par l'URSS, est bien incapable d'intervenir militairement dans cette région du globe. L'Amérique du Sud est la chasse gardée des Etats-Unis. A mille kilomètres des côtes du continent sud-américain, les îles Malouines sont à des milliers de kilomètres des bastions militaires pro-russes les plus proches, Cuba et l'Angola. Quant aux mythiques bases russes de l'Antarctique, elles se trouvent de l'autre côté du pôle sud. La plus importante présence militaire de l'URSS dans cette région, c'est encore l'oeil de ses satellites.
Le danger"russe"viendrait-il alors de l'Argentine elle-même ? On peut en effet difficilement soupçonner la Grande-Bretagne de sympathie prorusse. Le principal argument à l'appui de cette thèse réside dans le commerce argentin avec l'URSS, et notamment les exportations de blé à destination du bloc de l'Est. L'Argentine ne s'est-elle pas opposée ainsi à l'embargo sur le blé qu'avait décidé le président des Etats-Unis, Carter, après l'invasion de l'Afghanistan. Cet argument tombe à l'eau de lui-même, lorsqu'on sait que les exportations de céréales des Etats-Unis vers l'URSS sont bien supérieures à celles de l'Argentine. Ce serait quoi qu'il en soit7faire bien peu de cas du contrôle exercé par les Etats-Unis sur l'Argentine, dont le gouvernement et l'armée vivent au rythme des conseillers américains ([1] [327]). Un tel conflit n'a pu se déclencher sans que ceux-ci soient au courant.
Malgré la prétendue surprise affichée à Londres et Washington devant le débarquement des troupes argentines, celui-ci n'a pu se préparer et s'effectuer sans que les principales puissances occidentales ne soient au courant.
Dans ces conditions, s'il n'y a pas d'enjeux économiques et militaires qui justifieraient un tel déploiement de forces, pourquoi cette guerre, pourquoi ces morts ?
En voyant ce que le conflit des Malouines n'est pas, nous devinons ce qu'il cache : un gigantesque mensonge, son but est double : tester les armes navales modernes, et surtout nourrir une campagne intense de propagande qui vise à annihiler la prise de conscience du prolétariat mondial et notamment immobiliser les gros bataillions du prolétariat des pays industrialisés d’Europe.
DES GRANDES MANOEUVRES MEURTRIERES
Le bloc occidental contrôlé par les Etats-Unis trouve là l'occasion dans des conditions réelles de tester ses armes les plus sophistiquées. Tout cela loin de toute possibilité d'ingérence de l'URSS, en toute "tranquillité" vis-à-vis du grand rival impérialiste : le bloc de l'Est.
Cette guerre, qui met aux prises deux alliés fidèles et importants des Etats-Unis, n'est pas un affaiblissement pour le bloc occidental, bien au contraire. Elle lui sert à organiser pour l'avenir sa stratégie aéronavale et à orienter les milliards de dollars d'investissement nécessaires à la modernisation de son armement.
La Guerre des Six-Jours entre Israël et l'Egypte avait bouleversé les conceptions des stratégies de la mort moderne sur les batailles de blindés. Des centaines de chars détruits en quelques heures avaient montré l'importance des missiles et de l'électronique dans la guerre moderne sur terre. Le conflit des îles Malouines vient clarifier dans le même sens les conceptions actuelles de la bataille navale.
Au milieu de la tempête, dans des eaux glacées qui tuent en quelques minutes ceux qui tombent dedans, avec des nuits qui durent 15 heures, la bourgeoisie fait manoeuvrer ses troupes, expérimente ses armements les plus sophistiqués avec tout le mépris de la vie humaine que cela implique. Sous-marins atomiques, destroyers ultra-modernes aux noms ronflants, avions et missiles aux noms "innocents", transports de troupes dans le "luxe" des grands paquebots transatlantiques, bombardiers à long rayon d'action : la bourgeoisie nous demande de nous extasier devant la sophistication technologique et la perfection mortelle de sa panoplie guerrière, comme autrefois la presse alliée avait salué le bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki comme un "grand progrès scientifique" !
La bourgeoisie française trahit l'hypocrisie de toute la bourgeoisie lorsqu'elle s'extasie et se frotte les mains devant 1'efficacité des avions Mirage et Super-Etendard et des missiles Exocet qui sont pourtant employés contre son allié britannique.
Un capitaine de vaisseau britannique trahit les préoccupations militaires réelles de la bourgeoisie occidentale lorsqu'il déclare que, si le missile Exocet a coulé le destroyer Sheffield, c'est parce que ce dernier n'avait pas de défense contre ce système d'arme, mais que de toute façon, les russes n'ont pas d'armes équivalentes à l'Exocet. Derrière le conflit des îles Malouines, la bourgeoisie occidentale prépare le réarmement des forces aéronavales de l'OTAN face à l'URSS.
Mais là n'est pas encore l'essentiel. Dans ce conflit, la bourgeoisie vise un autre but, autrement important dans la période actuelle : la propagande pour égarer, déboussoler et museler le prolétariat.
LA CAMPAGNE IDEOLOGIQUE
Depuis le 2 avril 82, le spectacle de la guerre entre l'Argentine et la Grande-Bretagne fait la une et mobilise les médias du monde entier. La guerre entre l'Irak et l'Iran qui a fait plus de 100 000 morts et qui continue, n'a jamais eu un tel "succès". Ce ne sont certainement pas des motifs humanistes ou simplement la volonté de l'information qui animent une telle campagne, lancée à l'échelle internationale.
Dans la période de décadence du capitalisme, la bourgeoisie maintient sa domination sur la société par la terreur et le mensonge. Jamais l'humanité n'avait vécu une telle barbarie. Ce siècle a fait plus de 100 millions de morts dans les guerres ; des milliards d'hommes croupissent dans la famine et la misère les plus extrêmes. Chaque jour, dans ses usines, la bourgeoisie assassine plus d'ouvriers soumis à des conditions de travail désastreuses, qu'en deux mois de conflit aux îles Malouines. Chaque jour, les conditions de vie désespérantes qu'impose le capital, poussent des milliers de nouvelles victimes vers le suicide. C'est cette réalité de la barbarie du capitalisme en faillite que la bourgeoisie veut toujours faire oublier par sa propagande.
La campagne sur la guerre des îles Malouines ne fait pas exception à la règle. Déjà, la manière dont la bourgeoisie argentine se lance dans le conflit, utilisant celui-ci comme dévoiement du mécontentement social grandissant, la manière dont la bourgeoisie britannique réagit en développant un matraquage chauvin, nous montrent de façon caricaturale le poison idéologique que veut semer la bourgeoisie : accentuer la division du prolétariat mondial par le nationalisme. De ce processus, seule la bourgeoisie sort renforcée, aussi bien l'union nationale ([2] [328]) que la fausse opposition entre "pacifistes" et "bellicistes" sont autant de thèmes dont le seul but est d'empêcher la classe ouvrière de se concevoir de façon autonome par rapport à ses exploiteurs, et de l'entraîner derrière la bourgeoisie.
Mais si cette campagne trouve son expression la plus claire en Argentine et en Grande-Bretagne, les deux pays directement engagés dans la guerre, l'essentiel, même si cela peut paraître moins évident, c'est sa dimension internationale, à l'échelle du bloc de l'Ouest. C'est tout le prolétariat du bloc impérialiste contrôlé par les Etats-Unis qui est visé.
Pourquoi une telle campagne idéologique de la part de la bourgeoisie ? D'abord pour semer la confusion au sein du prolétariat. La crise pousse toujours plus la bourgeoisie vers la faillite économique ; elle est de plus en plus obligée d'attaquer le prolétariat, d'amputer son niveau de vie, de le réduire à des conditions de misère toujours pires. Après celui des pays sous-développés, c'est au tour du prolétariat des pays développés à être soumis à une paupérisation accélérée.
Dans les années 70, face à une attaque limitée de la bourgeoisie, le prolétariat a montré dans les métropoles du capitalisme qu'il n'était pas vaincu. La crise est là qui vient balayer les dernières illusions. Les grèves en Pologne sont venues montrer que le potentiel de combativité est intact. Au coeur historique, au centre de gravité du prolétariat mondial, en Europe, les conditions s'accumulent qui poussent vers une situation explosive, qui poussent le prolétariat vers la prise de conscience de la nécessité et de la possibilité de la révolution prolétarienne. C'est cette prise de conscience que la bourgeoisie veut entraver, dévoyer, affaiblir au travers d'incessantes campagnes menées depuis deux ans : sur l'Iran, sur l'Afghanistan, sur le Salvador, sur la Pologne, sur le pacifisme, etc...([3] [329]). La campagne sur la guerre des îles Malouines se situe dans cette continuité ; c'est dans ce cadre qu'elle prend tout son sens.
La propagande de la bourgeoisie sert d'abord un but : faire oublier au prolétariat le terrain de la lutte de classe. Avec la guerre locale des îles Malouines, après l’Afghanistan, l'Iran, le Salvador, la bourgeoisie occupe la tête des prolétaires et tente de faire oublier l'essentiel. Elle cherche à habituer à l'idée de la guerre, à en faire le centre des préoccupations de la classe ouvrière, et ainsi la déboussoler. La propagande bourgeoise cherche à hypnotiser le prolétariat, comme le serpent qui paralyse ainsi sa proie avant de la tuer et de la dévorer.
Le corollaire des campagnes bellicistes, c'est la pacifisme. Enfermer le prolétariat dans le faux choix "guerre ou paix" ne vise qu'un but : faire accepter au prolétariat la "paix" capitaliste, c'est-à-dire la misère. La "paix" capitaliste n'est qu'un leurre, ce n'est que la préparation de la guerre impérialiste dans un système qui, depuis des dizaines d'années, ne survit que par et pour la guerre.
Tant que le sang n'avait pas coulé, l'aspect folklorique du conflit ne permettait pas un plein développement de la campagne à partir du conflit des îles Malouines. La bourgeoisie a tué ce qu'il fallait (des centaines de soldats) pour crédibiliser aux yeux du prolétariat mondial le danger de guerre. Faire peur avec la guerre, afin d'amener le prolétariat à oublier la perspective révolutionnaire qui se dessine, seule alternative réelle à la crise de l'économie capitaliste. Créer au sein de la classe ouvrière le réflexe de l'autruche afin que le prolétariat plonge la tête dans les sables mouvants du nationalisme.
La bourgeoisie n'avait pas procédé autrement lors des campagnes anti-terroristes : créer un sentiment d'insécurité en alimentant les campagnes à coup de bombes sanglantes, de statistiques et faits divers sur la délinquance, afin de justifier le renforcement de l'appareil policier, de diviser le prolétariat et renforcer son atomisation au nom de l'ordre social.
L'impact de la campagne sur les îles Malouines ne se mesure pas tant dans un embrigadement du prolétariat en Argentine ou en Grande-Bretagne derrière l'étendard national (ce qui reste on ne peut plus hypothétique et de toute façon provisoire), mais dans la peur de la guerre mondiale et les réflexes isolationnistes induits, derrière lesquels rode le nationalisme ([4] [330]).
La campagne sur ia guerre des îles Malouines rejoint les campagnes qui l'ont précédée dans la tentative d'utiliser la peur de la guerre comme moyen de paralyser le prolétariat en lui faisant croire que toute instabilité sociale accélère le danger de guerre mondiale. Ce fut le thème véhiculé lors des grèves en Pologne : prétendre que la lutte des ouvriers polonais serait un facteur d'accroissement des tensions inter-impérialistes. C'est exactement l'inverse : la grève de masse en Pologne a constitué un frein aux tendances bellicistes de l'ensemble de la bourgeoisie mondiale. Le dispositif militaire du Pacte de Varsovie a été paralysé en même temps que l'économie polonaise ; les bourgeoisies des pays occidentaux, inquiètes des risques de généralisation de la lutte de classe en Europe, ont du également mettre leurs préoccupations militaires vis-à-vis du bloc adverse au second plan.
Pour isoler le prolétariat dans chaque pays, pour l'affaiblir, le nationalisme est une arme essentielle. C'est un réflexe isolationniste et nationaliste que la bourgeoisie s'évertue à recréer derrière le pacifisme, le neutralisme, le bellicisme, 1'anti-américanisme, 1'anti-totalitarisme, etc. Derrière le conflit des îles Malouines, la stratégie de la bourgeoisie se prof4-le : diviser le prolétariat pour mieux l'affronter.
Ce conflit truqué permet à la bourgeoisie au travers des "divisions" entre camps belligérants d'essayer d'opposer des fractions du prolétariat mondial à d'autres.
- Le déchaînement d'une violente campagne anti-USA en Amérique Latine a pour but, après la campagne sur le Salvador d'exacerber les sentiments anti-gringos, anti-yankee très vivaces en Amérique latine et ainsi d'opposer le prolétariat d'Amérique du Sud à celui d'Amérique du Nord. De la même manière les thèmes anti-coloniaux de la propagande argentine face à l'Alliance des pays développés, USA et Marché Commun visent à opposer le prolétariat des pays sous-développés à celui des pays développés. Dans les pays d'Europe de l'Ouest le prolétariat est appelé à soutenir l'effort de guerre de sa bourgeoisie au nom des valeurs occidentales, de la démocratie face au militarisme et au totalitarisme, les mêmes thèmes de propagande utilisés contre le bloc adverse, des forces du pacte de Varsovie.
Les grandes campagnes internationales de la bourgeoisie ont pour but essentiel dans la période actuelle, quelque en soit le prétexte, de développer les divisions au sein du prolétariat mondial, d'isoler chaque fraction de la classe ouvrière par rapport aux autres. Diviser pour régner, c'est toujours la même vieille recette éprouvée de la domination des exploiteurs.
La victoire que la bourgeoisie de tous les pays attend de la guerre des Malouines, ce n'est pas celle des armes, c'est celle de la propagande, du mensonge. Son but, ce n'est pas la domination sur un archipel de rochers, mais la domination sur le prolétariat.
GUERRE OU REVOLUTION
Avec le conflit des îles Malouines, ce qui se profile ce n'est pas immédiatement le spectre d'une troisième guerre mondiale, contrairement à ce que veut faire croire la classe dominante, c'est d'abord la préparation d'une attaque du prolétariat sur le plan économique, idéologique et militaire que la bourgeoisie met en place. C'est de cet ennemi-là que la bourgeoisie a peur.
Tous les palliatifs de la classe capitaliste pour faire face à la crise se révèlent impuissants. Les centres industriels sont touchés de plein fouet et le pire est à venir. L'affaissement du système économique mondial en son centre créé les conditions d'une explosion sociale au cœur du prolétariat mondial, là d'où le capital s'est élancé à la conquête du monde, là où se trouve l'enjeu des guerres mondiales, là où, au début du siècle, a été concrètement posée la question de la révolution prolétarienne : l'Europe.
La Pologne a été un avertissement pour la bourgeoisie mondiale. La dégradation accélérée de ses conditions de vie pousse la classe ouvrière vers un nouveau saut qualitatif de sa lutte et de sa conscience, au niveau international.
Les campagnes de division de la bourgeoisie ont pour but d'entraver ce processus qui mène vers la révolution communiste parce que c'est lui qui est à 1'ordre du jour.
Le chemin vers la guerre mondiale est barré par la dynamique de la lutte de classe prolétarienne. Le cours historique est vers des affrontements révolutionnaires et la bourgeoisie ne parvient pas^à embrigader le prolétariat mondial pour l'entraîner vers une guerre mondiale. La nature même du conflit des Malouines montre paradoxalement que la guerre mondiale n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. L'importance des moyens mis en œuvre pour cette campagne est à la hauteur des appréhensions de la bourgeoisie.
Pourtant s'il n'est pas immédiat au niveau mondial, le danger de guerre,est toujours présent. Le capitalisme ne peut vivre sans guerre; d'une certaine manière le conflit des Malouines vient encore le démontrer. Le prolétariat, s'il ne veut pas être entraîné dans la guerre capitaliste, doit détruire le capital. Les armes qui sont expérimentées dans l'Atlantique Sud donnent un avant-goût de ce que prépare la bourgeoisie. Si le prolétariat ne réagit pas, elle n'en restera pas là.
Mettre fin à la guerre, c'est mettre fin au capital car les deux sont indissolublement liés. C'est ce que la bourgeoisie veut nous faire oublier. Plus que jamais, l'alternative reste la division du prolétariat et la guerre ou l'union de la classe ouvrière et la révolution.
J.J.
"Mais les "faucons ", comme les "colombes ", commencent à s'interroger 1 'effort militaire en temps de paix est-il la meilleure façon de sortir de la crise économique? Jusqu'où l'austérité peut-elle être imposée sans menacer les équilibres internes? " ("Le monde diplomatique", avril 82)
"Le problème de la défense européenne est sérieux, mais il est avant tout d'ordre politique et économique. Le risque en Europe n'est pas 1 ' invasion peu probable par l'URSS mais l'échec moral économique et politique qui pourrait faire le jeu de ce pays."(Citation du co-directeur de l’Institut des Sciences politiques de Washington idem)
Le problème numéro un que confronte la bourgeoisie aujourd'hui, c'est le danger d'affrontement avec la classe ouvrière. La presse et les théoriciens de la bourgeoisie eux-mêmes l'expriment de plus en plus clairement.
[1] [331] Par ailleurs, 1'affrontement met face à face 1 'Argentine et la Grande-Bretagne, qui{, culturellement (150 000 argentins d'origine britannique), économiquement (la City de Londres a d'énormes investissements en Argentine) et militairement (la Grande-Bretagne fournit une part notable des armes qui massacrent ses propres soldats), sont des pays étroitement liés. Le Japon de son côté, aide 1'Argentine à faire face à ses dépenses de guerre en acceptant le report du paiement des dettes de celle-ci. Tous ces éléments ne peuvent que faire douter de la réalité des antagonismes
[2] [332] En Argentine les tortionnaires sont soutenus par leurs anciennes victimes, les torturés de l'opposition. Le nationalisme efface tout. Là est le rêve de la bourgeoisie que les victimes acceptent leurs bourreaux et que les exploités vénèrent leurs exploiteurs.
[3] [333] Sur la Pologne, voir Revue Internationale, N°27, 28 et 29. Sur le Salvador, voir le N° 25. Sur 1'Iran, voir Revue Internationale N°20 et 22.
[4] [334] La bourgeoisie est friande de sondages, instruments d'intoxication sur le thème de "1 'opinion publique" et qui lui servent aussi d'indications sur l'impact de ses campagnes idéologiques. L'Institut Gallup a ainsi fait un sondage international sur le thème de "la défense de la patrie". En France, à un sondage IFRES-Wickert, 47 % des personnes interrogées pensent que 1 'affaire des Malouines peut déboucher sur un conflit mondial, tandis que 87 % des allemands de l'Ouest estiment que les risques d'une guerre mondiale a augmenté à cause de ce conflit. Corollairement, face à cette peur, le vieux réflexe nationaliste joue au travers de la volonté saine mais détournée de rester en dehors du conflit : 61 % de gens en France s 'opposent au soutien à la Grande-Bretagne si cela devait impliquer un engagement ; 75 % des allemands réclament une stricte neutralité. En partie, ces chiffres montrent un manque d'adhésion à la guerre.
Géographique:
- Argentine [335]
- Grande-Bretagne [336]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
Pourquoi l'alternative guerre ou révolution : La guerre est-elle une condition favorable pour la révolution communiste ?
- 4759 reads
De 1845 à 1847, le monde, particulièrement l'Europe, par suite de mauvaises récoltes agricoles, va connaître une grave crise économique : le prix du blé double en France, éclatent alors des émeutes de la faim. Les paysans ruinés ne peuvent plus acheter aux industriels, la construction de chemins de fer s'arrête, le chômage se généralise, les salaires baissent, les faillites se multiplient. La classe ouvrière engage une lutte pour des réformes : pour la limitation de la durée de travail pour un salaire minimum, pour l'obtention de travail, pour un droit de coalition et de grève, pour l'égalité civique et la suppression des privilèges, etc. Consécutivement : les journées explosives de février 1848 en France, si bien condensées dans le fameux opuscule de Marx "Les luttes de classe en France", devaient léguer comme leçon majeure à la postérité la nécessité pour la classe ouvrière de se démarquer désormais de la classe bourgeoise, de préserver une indépendance de classe. On oubli un aspect essentiel de cette révolution, pourtant : elle n'avait pas été provoquée par une guerre. Les causes en étaient oubliées, l'attention se concentrait sur l'écrasement de l'insurrection de juin 48 et la question d'un meilleur armement des ouvriers, de combats de rue mieux organisés, à l'encontre des leçons tirées par Marx et Engels sur la période historique et la nature de la lutte de classe.
Plus tard, si le désastre de Sedan entraîna l'effondrement de l'Empire en septembre 1870 puis la constitution d'un "gouvernement de Défense Nationale" avec le bourgeois Thiers à sa tête - qui allait échouer à désarmer la population parisienne et entraîner en réaction l'érection de la Commune au mois de mars - ce fût certes la première insurrection prolétarienne victorieuse de l'histoire, ce fut malgré tout un "accident" comme le reconnut Marx en cette période encore ascendante du capitalisme. Une nouvelle fois la bourgeoisie triomphait du prolétariat en train de se constituer. L'invocation de la Commune de Paris réitérée en oubliant son caractère accidentel conforta bien des confusions sur les possibilités pour une révolution prolétarienne de sortir victorieuse à long terme d'une guerre. Certes comme le notait Engels dans une introduction à "La Guerre Civile en France" : "... dès le 18 mars, le mouvement parisien avait un caractère de classe jusqu'alors dissimulé par la lutte contre l'invasion étrangère". Mais les conditions objectives n'étant pas réunies les communards étant en avance sur la marche de l'histoire, deux facteurs contribuèrent à la défaite : l'isolement (une ville assiégée) et le terrain militaire propre à la bourgeoisie ("la guerre contre l'armée versaillaise, sans cesse renforcée, absorba toutes les énergies" Engels), sans oublier le poids de l'entier soutien des forces prussiennes à la bourgeoisie française. Incroyable "ironie" de l'histoire, la Commune, tout en montrant concrètement la possibilité et la nécessité de la dictature du prolétariat, laissait accroire que toute révolution pouvait désormais émerger d'une guerre, et par vacuité théorique entraîna de fausses théorisations dans le mouvement ouvrier ; par exemple Franz Mehring et Jules Guesde théorisèrent la guerre "révolutionnaire" ; cette thèse confinera chez Guesde avec la thèse nationaliste de soumission à sa propre bourgeoisie. Or, surtout avec la fin du siècle consacrant l'entrée en décadence du capitalisme, il n'y avait plus de guerre "révolutionnaire", il n'y en avait d'ailleurs jamais eu pour le prolétariat. Nous verrons tout au long de ce texte pourquoi la guerre n'est pas en soi un "mal nécessaire" à la révolution.
Evidemment, comme toute expérience originale, la Commune -bien qu'à l'origine réaction ultime de "Défense Nationale"- confrontait pour la première fois en temps de guerre une bourgeoisie surprise et inexpérimentée face à la menace prolétarienne et révélait qu'une guerre est inévitablement stoppée par l'éruption du prolétariat ou en tout cas qu'elle ne peut pas être menée n'importe comment s'il subsiste le moindre îlot de résistance prolétarienne. L'arrêt de la guerre dans de telles conditions permet un repli des forces bourgeoises, la fin temporaire de leurs antagonismes guerriers et impérialistes afin de contourner puis étrangler conjointement le prolétariat.
En dépit de ce type de situation plus favorable à la bourgeoisie, pendant des décennies on accepta comme un axiome dans le mouvement ouvrier que les guerres créaient ou pouvaient créer les conditions les plus favorables à la généralisation des luttes et ainsi à l'explosion révolutionnaire. On s'abstint de considérer le handicap presque insurmontable créé par les situations de guerre mondiale qui limite ou réduit à néant une réelle extension victorieuse de la révolution. C'est véritablement à l'orée de la période décadente du capitalisme que l'enjeu va apparaître plus clairement dans le cours vers la 1ère guerre mondiale à travers la question : Guerre OU Révolution, et non pas Guerre ET Révolution.
La lutte de classe dans les conditions de guerre
Les révolutions de 1905 et 1917 dans le cours vers la guerre mondiale
N'en déplaise aux glorificateurs d'un passe considéré comme sans failles, les minorités révolutionnaires russes et allemandes à l'intérieur de la IIème Internationale n'ont pas considéré suffisamment les conditions imposées par le changement de période du capitalisme. Même s'il est vrai qu'il était terriblement difficile de s'extraire du processus d'involution de la IIème Internationale, les futurs fondateurs de l'Internationale Communiste furent surpris par l'entrée en guerre et ne se sont pas consacrés à tout le travail de préparation nécessaire pour le prolétariat.
Depuis quelques années, le CCI est parvenu à dégager l'importance de la notion de cours historique et le poids défavorable des conditions de guerre par le passé pour les révolutions (il est utile de se reporter à l'article "Le cours historique" Revue Internationale n°26). Rétrospectivement, on peut considérer qu'il revient à l'audacieux et lucide Trotsky avec sa fraction au début du siècle, non seulement d'avoir compris dès avant 1914 mieux que la majorité des bolcheviks qu'il n'y avait plus de révolution bourgeoise à l’ordre du jour en Russie, mais d'avoir aussi commencer à déblayer le terrain des fausses théorisations en délimitant les conditions aggravantes de cette révolution de 1905 en Russie "attardée" et "ratée" selon ses propres termes :
"La guerre, incontestablement, a joué un rôle énorme dans le développement de notre révolution, elle a désorganisé matériellement l'absolutisme : elle a disloqué l'armée, elle a donné de l'audace à la masse des habitants. Mais heureusement elle n'a pas créé la révolution et c'est une chance parce que la révolution née de la guerre est impuissante : elle est le produit de circonstances extraordinaires, repose sur une force extérieure et en définitive se montre incapable de conserver les positions conquises". (Notre révolution) La minorité autour de Trotsky, publiant "Naché Slovo" (Notre parole), produit et cristallisation d'une forte poussée de la classe au début du siècle en Russie, sera une des plus aptes à tirer des leçons cruciales sur la spontanéité historique du prolétariat se dotant de Conseils ouvriers, mais aussi mettra en lumière une raison essentielle à l'échec de 1905 : la situation de guerre. Dans son article "Catastrophe militaire et perspectives politiques" (Naché Slovo, avril-sept 1915), Trotsky, au nom de sa fraction, se refuse à spéculer sur la guerre en soi, non par motifs d'ordre humanitaires, mais pour des conceptions internationalistes. Il met en évidence le clivage insurmontable introduit par le processus de guerre : si la défaite ébranle le gouvernement vaincu et peut par conséquent favoriser sa décomposition, il n'en est rien pour le gouvernement victorieux qui est au contraire renforcé. De surcroît, dans le pays défait, rien n'est joué s'il n'existe pas un prolétariat fortement développé et apte à déstabiliser complètement son gouvernement vaincu militairement par homologue ennemi. Les contradictions entraînées par la guerre constituent un facteur très douteux d'impulsion historique du prolétariat dans la voie du succès ; constatation qui ne peut être infirmée à posteriori par aucun des échecs révolutionnaires, y compris la courte vague de bouleversements sociaux ouverte par l'année 1917.
La guerre n'est pas un tremplin assuré pour la révolution, elle est un phénomène dont le prolétariat ne peut avoir un parfait contrôle ou en disposer de son plein gré pour la faire disparaître alors qu'elle sévit mondialement. Trotsky au cours de ces années d'apprentissage, conçoit ainsi parfaitement l'impuissance d'une révolution basée uniquement sur des "circonstances extraordinaires". Les circonstances défavorables d'une révolution issue d'une défaite militaire dans un pays, sont, outre d'être circonscrite à ce seul pays, de trouver en héritage : "Une vie économique détruite, des finances exsangues et des relations internationales peu favorables" (Naché Slovo). Par conséquent, la situation de guerre ne peut conduire qu'à une réalisation plus difficile, voire impossible, des objectifs d'une révolution. Sans nier qu'une situation de défaitisme puisse préfigurer la catastrophe militaire et politique d'un Etat bourgeois et doive être utilisée par les révolutionnaires, Trotsky répète que ceux-ci ne font pas à leur guise les circonstances historiques mais représentent une des forces du processus historique. D'ailleurs ces révolutionnaires n'avaient-ils pas été induits en erreur en 1903 croyant à l'imminence d'une révolution avec un développement massif des grèves en Russie, qui devaient être paralysées dans un premier temps par la guerre russo-japonaise, puis, malgré le sursaut de 1905, défaites avec l'arrêt de cette même guerre ? Trotsky peut tracer une analogie historique avec les importantes grèves de 1912-1913 qui tiraient profit, à un niveau plus élevé pourtant des expériences précédentes, pour être en fin de compte bloquées à nouveau par la préparation de la guerre mondiale cette fois-ci. La défaite russe dans ces nouvelles circonstances ne dit rien qui vaille à Trotsky, d'autant plus que les sociaux- patriotes Lloyd George, Vandervelde et Hervé envisagent favorablement cette défaite comme propre à éveiller "le bon sens gouvernemental des classes dirigeantes", autrement dit spéculent en vulgaires défaitistes sur "la force automatique du krach militaire, sans intervention directe des classes révolutionnaires". Cette méfiance se justifiait d'autant plus que la défaite militaire en soi n'est pas la voie royale à la victoire révolutionnaire ; il faut, dit encore Trotsky insister sur l'importance de l'agitation des révolutionnaires dans cette période de bouleversements qui s'ouvre bien que défavorablement compte tenu de l'expérience historique antérieure.
La catastrophe militaire en épuisant les moyens de domination économique et politique de l'autocratie capitaliste ne risque-t-elle pas de ne provoquer mécontentement et protestations que dans une certaine limite ? Le risque ne demeure-t-il pas que l'épuisement des masses consécutif à la guerre ne les conduise à l'apathie ou au désespoir ? Le poids de la guerre est colossal, il n'y a pas d'automatisme vers une explosion révolutionnaire. Les dégâts prolongés de la guerre peuvent couper l'herbe sous le pied à toute alternative révolutionnaire. Malheureusement Trotsky se trompe sur un point, il croit que l'accumulation de défaites guerrières ne favoriserait pas la révolution, tout le contraire est vrai, c'est justement pour éviter cela que la bourgeoisie mondiale, prévoyante et inspirée par son passé, arrêtera la guerre en 1918. D'autre part, il utilise encore le mot d'ordre de "lutte pour la paix" au lieu de défaitisme révolutionnaire plus conséquent et défendu fermement par Lénine. Cependant, et déjà dans les circonstances tragiques et défavorables à long terme de la 1ère guerre mondiale, Trotsky détermine clairement le saut qualitatif nécessaire par rapport à 1905 : le mouvement révolutionnaire ne peut plus être "national" mais "de classe" à l’encontre des pleurnicheries des sociaux-patriotes mencheviks et libéraux alignés derrière le slogan capitaliste de "victoire", c'est à dire de prolongation de la guerre. Le prolétariat en Russie est confronté à toutes les fractions bourgeoises qui veulent l'isoler et l'empêcher de réagir sur son terrain de classe ; contrairement à 1905, il ne peut plus bénéficier de la "neutralité bienveillante" de la bourgeoisie. En 1905, il était faible car sans aide externe, isolé des masses prolétariennes d'Europe, quand au contraire le tsarisme bénéficiait de l'appui des Etats européens. En 1915, se posent deux questions : faut-il recommencer une révolution nationale où le prolétariat serait de nouveau dépendant de la bourgeoisie, ou bien faut-il faire dépendre la révolution russe de la révolution internationale ? Trotsky répond par l'affirmative à la deuxième question. Plus nettement qu'en 1905, le mot d'ordre "A bas la guerre !" doit se transformer en "A bas le pouvoir !". En conclusion : "seule la révolution internationale peut créer les forces grâce auxquelles le combat du prolétariat en Russie peut être mené jusqu'au bout". Ce long résumé de l'intéressant article de Trotsky nous fournit, par sa pertinence dans l'analyse des circonstances défavorables au prolétariat en période de guerre impérialiste, des éléments pour pourfendre les idéologies gauchistes et trotskistes de nos jours qui veulent nous faire avaler que les luttes de classe auraient toujours pris leur véritable essor révolutionnaire dans le cadre du nationalisme et de la guerre ; ainsi ces idéologues ne font que révéler que leur camp d'appartenance est celui de la bourgeoisie.
L’explosion d'octobre 17 contraignit le monde capitaliste à faire cesser la guerre, mais, bien que compte tenu de la faiblesse et maladresse de la bourgeoisie russe, le capitalisme mondial ait été pris de vitesse par le prolétariat des centres industriels de Russie, il saura se ressaisir pour stopper la vague révolutionnaire soulevée par ce premier succès. L'écrasement du mouvement révolutionnaire en Allemagne portera un coup décisif à l'internationalisation de la révolution. Ce ressaisissement de la bourgeoisie mondiale condamnera le prolétariat en Russie à l'isolement et par conséquent à une longue mais inéluctable dégénérescence fatale pour toute cette période à l'ensemble du prolétariat mondial. Cette première gigantesque apparition du prolétariat sur la scène du XXème siècle aura été brièvement victorieuse, la bourgeoisie le lui fera payer très cher par une contre-révolution dont le prolétariat international ne devait pas se relever de sitôt, même au cours de la IIème guerre mondiale.
L'absence de réaction du proletariat pendant et après la deuxième guerre mondiale
Au milieu de ce demi-siècle de contre-révolution triomphante, la IIème guerre mondiale ne fera que parachever la défaite dans l'isolement des années 20, On ne verra pas surgir de mouvements révolutionnaires un tant soit peu comparables à ceux de 1905 ou 1917-19. On peut citer bien sûr la dite Commune de Varsovie social-démocrate de 1944- réaction désespérée d'une population martyrisée et décimée sous la botte militaire- qui tint 63 jours puis fut exterminée par les hitlériens avec le consentement de Staline. On peut aussi citer les grèves de 1943-44 en Italie réprimées avec l'aval des "Alliés" anglais. Aucun de ces cas n'est probant pour estimer qu'il y aurait eu amorce d'un resurgissement du prolétariat à l'échelle mondiale menaçant la continuation de la guerre impérialiste.
Dans l'ensemble ce fut le coma le plus intense, le plus tragique du mouvement ouvrier dont les meilleures forces avaient été décimées par la contre-révolution stalinienne et achevées par le déchaînement terrible des belligérants capitalistes démocrates et hitlériens avec leurs blocs de résistance et leurs bombardements aveugles. Ce deuxième carnage impérialiste mondial montait un degré plus haut dans l'horreur que le précédent. Une révolution allait-elle mettre fin, surgir dans ou après cette tuerie planétaire ? Des révolutionnaires isolés et dispersés ont pu l'espérer vainement, quand les contre-révolutionnaires des maquis de "libération nationale" l'ont fait croire impunément dans le cadre de leurs idéologies chauvines, avec pour toute perspective une "libération" dans l’ordre, par étape, avec les démocrates briseurs de grève, les Churchill, De Gaulle et Eisenhower aux côtés de leur"camarade" Staline. La guerre cessa enfin, non sous une nouvelle menace prolétarienne, mais parce que les limites de la destruction totale avaient été atteintes, parce que plusieurs capitalistes "alliés" étaient venus à bout de la volonté d'hégémonie mondiale de l'un d'entre eux. Aucun nouvel Octobre 17 n'avait vu le jour. Le capitalisme retrouvant des airs de jeunesse, comme les herbes qui poussent sur les charniers humains, amorçait une période de reconstruction sur des ruines. Période de reconstruction temporaire qui ne devait pas l'empêcher de retomber un peu plus de deux décennies plus tard dans le marasme économique, poursuivant implacablement le développement de son économie de guerre en préparation...d'une 3ème guerre mondiale. Les quelques révoltes ouvrières dans le monde qui se produisirent les années suivantes restèrent fragmentées et isolées, que ce soit en France, en Pologne ou dans le tiers-monde, elles furent canalisées et étouffées dans l'ornière de la reconstruction capitaliste ou dans les dites libérations des colonies planifiées par les deux "Grands". Fondamentalement le cours de l'histoire était encore défavorable au prolétariat, il devait mettre longtemps à se remettre de l'échec physique et idéologique des années 20. Il faut se rendre compte de la profondeur d'une telle défaite pour comprendre comment la guerre mondiale a pu se reproduire inéluctablement dans les années 40.
Les limites du processus révolutionnaire dans les conditions de guerre
La guerre mondiale est le plus haut moment de la crise du capitalisme décadent, elle ne favorise pas en soi les conditions de la généralisation de la révolution. Prendre conscience de cela est mettre en évidence la responsabilité historique du prolétariat contre une possible 3ème guerre mondiale. En examinant la période de la 1ère guerre mondiale, nous pouvons considérer que, après avoir été battu idéologiquement et bien que ressurgissant en Russie, en Allemagne et en Europe centrale, le prolètariat resta cloisonné dans chaque nation. La bourgeoisie stoppant la guerre pour mieux faire face à l'attaque prolétarienne renforçait les barrières nationales. Bien que produites par la situation d‘aggravation économique et reprise des fortes luttes du début des années 1910, ces actions combatives du prolétariat ne pourront pas dépasser l'illusion véhiculée par la IIème Internationale traître selon laquelle la révolution devait se produire graduellement pays par pays et malgré la fondation justifiée d'une 3ème Internationale réellement communiste, la boucle du nationalisme étant refermée par le social-chauvinisme. En outre, avec cet arrêt de la guerre, l'inégalité des retombées économiques dans les pays vaincus et vainqueurs maintiendra et favorisera une division illusoire dans le prolétariat international. En avançant l'idée de "paix" la bourgeoisie mondiale était consciente des dangers du défaitisme révolutionnaire et des risques de contagion malgré tout des pays vaincus aux pays vainqueurs. Seul l'armistice entre les différents belligérants capitalistes pouvait leur permettre de souder leurs rangs pour rétablir la "paix sociale". Ainsi Clemenceau pût venir prêter main forte à Hindenbourg et Noske contre le prolétariat en Allemagne. Le prolétariat isolé sera ainsi acculé à des insurrections rapides et défavorables. Les conditions de l'échec sont réunies contre le prolétariat par cet arrêt de la guerre en Allemagne, la réussite est isolée en Russie dans des conditions exceptionnelles de "maillon faible" c'est à dire ne frappant pas de façon décisive au coeur géographique du capitalisme: l'Europe. Dans ce premier affrontement historique déterminant et inévitable entre la bourgeoisie réactionnaire et la classe révolutionnaire, la bourgeoisie restait maîtresse du terrain. Nous pouvons donc considérer que toute la période de la 1ère guerre mondiale n'a pas sécrété les meilleures conditions pour favoriser la révolution prolétarienne. Répétition sanglante de la barbarie capitaliste, la 2ème guerre mondiale était issue directement des clauses de l’"Armistice" de 1918, une paix provisoire et hypocrite pour justifier un nouveau partage capitaliste du monde. Cette répétition était d’autant plus possible qu'après la défaite physique du prolétariat au début des années 20, triomphaient les idéologies contre-révolutionnaires du stalinisme, du fascisme et de 1'anti-fascisme. Si le prolétariat a pu entraver sérieusement le processus de la 1ère guerre mondiale c'est bien sûr parce qu'il n'avait pas été écrasé physiquement et frontalement auparavant, c'est parce que en se battant sur son terrain de classe il avait été amené inévitablement à s'opposer à la guerre, c'est aussi parce que le type de guerre de tranchées favorisait, par la proximité des combattants la contagion révolutionnaire. Ce dernier facteur n'existait déjà plus au cours de la seconde avec l'utilisation des bombardiers et des sous-marins. Le capitalisme en perfectionnant les capacités de destruction à longue portée de ces engins de mort, et en mettant au point ses premières armes nucléaires -"testées" à Hiroshima par la très "démocratique" bourgeoisie américaine - faisait déjà des préparatifs en 1945 pour "aller plus loin" dans une 3ème guerre mondiale, pour empêcher toute possibilité de révolte interne en pouvant détruire des villes entières, en instaurant la menace de guerre sur n'importe quel recoin de la planète. Faire état de ce danger de gradation dans la destruction de la part du capitalisme n'a rien de mystique, mais rehausse la responsabilité du prolétariat qui a pour tâche historique de s'opposer à cette marche à la destruction généralisée avec les armes de la lutte de classe avec une vigueur au moins comparable à celle de la vague révolutionnaire du début du siècle. Pouvons nous croire une 3ème guerre mondiale inévitable pourtant ? Ces dernières années peuvent incliner à établir des comparaisons avec les périodes qui ont précédé les deux guerres mondiales : "paix armée", détérioration des relations internationales capitalistes, guerres locales, accroissement illimité du militarisme, social-pacifisme, bourrage de crânes tout azimut. La comparaison est facile et les arguments ne sont pas solides face à la réalité sociale. Il ne s'agit pas de prendre ses désirs pour des réalités mais de prendre la réalité des années 80 à bras le corps.
QUATRE CONDITIONS POUR LA REVOLUTION A NOTRE EPOQUE
Si nous restions obnubilés en surface par les phénomènes et les conséquences des deux plus grands carnages impérialistes de l'histoire de l'humanité, nous pourrions dire avec dépit : "jamais deux sans trois !", comme le philistin superstitieux du bistrot à côté. Mais, en utilisant la méthode marxiste,
nous répétons que "les grands événements de l'histoire se répètent pour ainsi dire deux fois : la première fois comme tragédie la seconde fois comme farce"! Mais que le communisme ne soit pas inéluctable si le prolétariat ne se hausse pas à la hauteur de sa responsabilité historique, nous le savons bien, mais la 3ème guerre mondiale n'est pas fatale non plus si sont comprises les potentialités immenses du prolétariat à notre époque. Plus que jamais, il revient aux révolutionnaires qui ont tiré le bilan des défaites passées de montrer à la racine la voie laissée ouverte par les générations mortes.
Il faut constater cependant, aujourd'hui encore, que les masses prolétariennes dans leur grande majorité ne sont pas encore pleinement conscientes de 1'enjeu, ni prêtes â engager les batailles décisives ; elles sont malgré tout amenées de plus en plus à poser de sérieux jalons de préparation. Nous ne prouverions rien en parlant vaguement des mécontentements sociaux ou en décomptant des millions d'heures de grèves dans tous les pays depuis 20 ans. Les courbes de ces grèves ont été plutôt décroissantes, et la plupart des luttes échouent régulièrement. La bourgeoisie réussit même à organiser de fausses grèves, des simulacres de luttes et à illusionner des ouvriers pour l'autogestion de leurs usines en faillite. Mais, malgré le tableau peu reluisant et à signification limitée des statistiques et données journalistiques, un certain nombre d'événements et d'explosions de luttes ouvrières se sont produits depuis près de deux décennies aux quatre coins du globe du Brésil à la Pologne, accumulant toute une série d'expériences internationales. Cette série de jalons, bien qu’irrégulière, révèle par contre-coup des conditions essentielles pour la révolution mondiale.
Le marasme économique mondial
La première véritable condition favorable pour la révolution réside dans le marasme économique mondial qui a endeuillé définitivement toutes les espérances bourgeoises en un monde capitaliste en perpétuel développement. Cette crise économique mondiale imparable et inguérissable est venue mieux que tout discours révolutionnaire déchirer la mystification du progressisme vers une humanité capitaliste heureuse (reléguant l'avenir de la classe ouvrière au 19ème siècle).
Bien supérieure en longueur et en intensité aux crises économiques cycliques du 19ème siècle ou à la période charnière du début de ce siècle, cette crise atteint indifféremment tous les recoins de la planète, pas un seul capitaliste n'en réchappe, pas un seul pays, pas un seul bloc. Ses effets concernent, mutilent, aggravent la situation de l'ensemble de la classe ouvrière mondiale. L'infrastructure économique s'effondre lentement révélant les vices de forme du système. Ce n'est plus la faute à l'ennemi de l'autre côté du Rhin ou des Pyrénées, c'est "partout pareil". Malgré les diverses censures, déformations ou désinformations à l'Est comme à l'Ouest, "ils" ne peuvent plus gouverner comme avant. Dans sa décadence avérée ce système capitaliste dévoile sa nature rétrograde et doit renouveler incessamment ses panoplies de mystifications. En tant que force étatique de contrainte, "ils" ce n'est plus seulement les patrons de droit divin mais surtout une superstructure d'encadrement social : gouvernements, syndicats, partis de gauche et de droite au langage commun d'austérité. L'effritement de l'infrastructure économique n'est pas sans ébranler la superstructure politique bourgeoise mais celle-ci tente de freiner et d'empêcher l'entière prise de conscience par le prolétariat des causes du marasme économique. Trouver des dérivatifs aux responsabilités du capitalisme n'est pas tâche aisée car ce système en crise fondamentale dans ses soubassements -ne disposant plus de débouchés réels comme dans sa phase ascendante du 19ème siècle- peut difficilement cacher à l'humanité que sa seule perspective n'est que la destruction, le gaspillage et la paupérisation, culminant dans une nouvelle guerre mondiale.
La perspective de guerre mondiale
Cette unique perspective de guerre mondiale dans l'optique capitaliste, particulièrement invoquée partout depuis deux ans, devient ainsi la deuxième condition impliquant la nécessaire émergence de l'alternative prolétarienne. Ce n'est pas paradoxal. Deux guerres mondiales laissent encore des traces indélébiles malgré la vanité capitaliste des "libérateurs". Au départ, la bourgeoisie à travers toutes ses composantes, avait toujours préparé et présenté ces deux guerres mondiales comme : - permettant la résolution des difficultés économiques ("exporter ou périr")
- inévitables, indépendamment des bonnes volontés conciliatrices ("la faute aux autres", "on ne peut faire autrement" ).
L'exacerbation de la compétition impérialiste et la paupérisation consécutives à ces deux guerres, de même que la gigantesque crise économique mondiale aujourd'hui, révèlent l'inanité du premier argument. La barbarie de deux guerres mondiales n'a pu se produire qu'en fonction d'une bourgeoisie impuissante à résoudre les aberrations de son système, et même si une fraction de celle-ci -le stalinisme- a pu se parer outrageusement du terme, entraver et retarder d'autant plus la marche vers le "communisme".
Quant à l'idée d'inévitabilité de guerre au futur, elle est d'autant plus mensongère que les capitalistes n'en sont pas persuadés eux-mêmes tant que le prolétariat et l'immense population de la planète n'en sont pas convaincus. Guerre inévitable s'il fallait s'en tenir simplement à l'argument militaire, mais en réalité la bourgeoisie n'est pas simplement son appareil militaire, même si celui-ci est aux rênes de commande pendant la guerre ou aux premiers rangs pour la répression physique. La bourgeoisie ne pourrait pas faire fonctionner sa société avec les seuls militaires ; elle n'a jamais pu entraîner à la guerre et réprimer le prolétariat simplement autour de cartes d’Etat-major qui ne recouvrent pas la réalité sociale. Un raisonnement d'Etat major militaire ne peut pas permettre de comprendre pourquoi le prolétariat ne se laisse pas soumettre par la bourgeoisie, il n'y a pas de troupes dans un camp donné avec des uniformes distincts, des généraux, des munitions, face à un camp adverse. La menace provient de l'intérieur même de tous les pays capitalistes amis ou ennemis, elle a pour nom conscience et unité prolétarienne. L'hypothèse à court terme d'une 3ème guerre mondiale supposerait une parfaite imbécillité, folie suicidaire ou tout au moins une incapacité à vouloir en contrôler le déclenchement et le déroulement de la part de la bourgeoisie. Il ne faut jamais oublier que les capitalistes et leurs généraux ne peuvent faire une guerre sans troupes. Les guerres mondiales précédentes n'ont pas été des conflits d'armées de métier ou de seuls mercenaires.
Il ne s'agit pas de croire que les capitalistes voudraient préparer de nouvelles guerres de tranchées ou d'arquebuses dépassées, mais de comprendre qu'en regard du monde entier, ils ne peuvent apparaître comme des assassins de l'humanité ; il y a toujours un Hitler ou un vaincu pour être gratifié de cette réputation. Le capitalisme en tant que tel doit être exempté de cette responsabilité pour être perpétué. Jamais ni Foch, ni Clemenceau, ni Churchill, ni Wilson, ni Staline, ni Eisenhower n'ont avoué organiser la guerre pour les mesquins intérêts de rapine capitaliste, ils invoquaient la "liberté", le "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", le "socialisme". Chacun se parait d'une mystification pour entraîner ses troupes au massacre et tous se retrouvèrent en fin de compte pour parader devant les catafalques de ceux qu'ils y avaient expédiés au nom de "la patrie ou la mort". Aujourd'hui 1'administration Reagan peut-elle invoquer les intérêts de l'humanité sans honte, l'administration Brejnev ou Mitterrand le socialisme sans faire vomir ? Seule la révolution prolétarienne peut permettre de rejeter à jamais les guerres locales et mondiales dans les ordures du passé capitaliste.
LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA CLASSE V OUVRIERE
Troisième condition fondamentale pour l'affaiblissement de la perspective de guerre, mais surtout en faveur de la révolution, qui transparaît dans les deux premières, c'est le sursaut conscient organisé et centralisé de la seule force révolutionnaire :1e prolétariat en action depuis la fin des années 60.
Il n'était pas resté endormi après la fin de la 2ème guerre mondiale, mais pendant les années de reconstruction ses réactions furent des coups de butoir isolés et la prospérité relative retrouvée par le capitalisme avait permis des concessions économiques. Tournant capital, l'année 1968 fût marquée par la grève massive de mai en France, mais surtout par le fait que des luttes ouvrières se produisaient en plusieurs endroits du monde simultanément. Le début des années 70 fut marqué par une succession de luttes importantes dans plusieurs pays européens; mais avec le sabotage réussi de la gauche bourgeoise déviant plus spécialement dans cette zone le mécontentement sur le terrain électoral, on pouvait croire jusqu'à la fin des années 70 que le prolétariat avait été calmé. D'ailleurs la bourgeoisie avec sa ribambelle de larbins sociologiques à la Marcuse, Bahro ou Gorz semblait vouloir faire croire à sa nouvelle disparition (et énième), quand les prolétaires en Pologne se sont chargés de la ramener sur terre. Tant pis pour les idéologues, aujourd'hui comme en 1918 le prolétariat est la seule classe apte dans les faits à stopper la perspective de guerre et à présenter à l'humanité l'alternative communiste. Contre tous ceux qui encouragent d'une façon ou d'une autre la survie du capitalisme le prolétariat doit opposer le cri "Guerre OU Révolution". Ce cri on ne l'a pas entendu monter de la Pologne, mais une affirmation de la lutte de classe comme celle d'août 80, cela revient au même. Alors que depuis deux ans on nous rebattait les oreilles en occident avec l'invasion de l'Afghanistan "confirmant" la "menace russe", qu'on renchérissait sur le soi-disant retard du potentiel militaire américain comparé à celui du pacte de Varsovie, tout à coup le spectre prolétarien est revenu hanter l'Europe et l'ensemble des capitalistes et, confirmer, malgré des luttes inégales dans le temps, le sursaut de la classe ouvrière depuis la fin des années 60.
Ce sursaut du prolétariat s'il prend racine dans la lutte contre l'austérité capitaliste, mûrit également grâce aux contradictions du capitalisme décadent.
L'essentiel, la conscience de classe, se développe à partir de l'usure d'un certain nombre de mystifications bourgeoises. Au 19ème siècle déjà Marx pouvait considérer dans le "Manifeste communiste' que la bourgeoisie produisait ses propres fossoyeurs, de même aujourd'hui nous pouvons considérer que "la bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation, c'est à dire des armes contre elle-même" (Le Manifeste p. 45). Au tournant du siècle, certains pouvaient douter encore de la proximité de la révolution en fonction d'une classe ouvrière sortie peu à peu de l'artisanat ou émergeant des campagnes, en fonction des résidus du féodalisme, de l'analphabétisme. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hésitations possibles, dans les principaux pays industrialisés, le prolétariat est vraiment constitué en classe, de même dans beaucoup de pays du tiers-monde, il existe comme une force contrainte historiquement de dépasser les faiblesses et les échecs de son passé. Aujourd'hui les leçons de toute l'histoire du mouvement ouvrier peuvent être réappropriées beaucoup plus vite dans les fanges du capitalisme, il n'y a pas nécessité d'une "éducation socialiste" ni d'écoles de cadres du parti. En combattant les lois économiques du Capital, le prolétariat introduit du même coup le chambardement dans la superstructure idéologique de domination bourgeoise. Ceci à travers deux facteurs, avec les réserves d'usage : l'éducation dispensée par la société bourgeoise et les moyens de communication moderne,
Il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de l'éducation bourgeoise qui a pour but de reproduire les inégalités sociales, ni d'exalter le savoir qui n'est pas un gage de conscience de classe. D'ailleurs cette éducation dispensée et fabriquée par le capitalisme est pour une grande part un moyen de manipulation considérable qui, en un sens, vulnérabilise les individus, les discipline socialement, remplace l'obscurantisme religieux féodal. Mais il s'agit de comprendre que, à un certain degré de dégénérescence de toute société, même les meilleurs pare-feux peuvent provoquer un retour de flamme. L'analphabétisme n'existe pratiquement plus dans les principaux pays industrialisés, de nombreux prolétaires ont suivi des études secondaires et pratiquent une autre langue que la leur. En soi ce "progrès" et cette "éducation" ne sont pas "révoltants" ; s'ils favorisent la révolte c'est uniquement parce qu'ils sont synonymes de DEQUALIFICATION et de chômage car la bourgeoisie a développé anarchiquement la formation scolaire et universitaire. Nombreux sont les ouvriers ou les employés bacheliers, nombreux les chômeurs diplômés d'université, donc sans qualification "productive". Après avoir été bercé tout au long de ses études par la promesse de pouvoir échapper à la condition ouvrière, l'ancien élève ou étudiant confronte durement la réalité capitaliste s'il ne l'a pas sérieusement appréhendée auparavant, un ouvrier analphabète pouvait avaler des discours de maître d'école, croire à l'inégalité d'intelligence à la naissance, s’en remettre à ceux qui "savaient", s'en laisser compter sur "1'ennemi" ; est-ce comparable aujourd'hui? Les moyens de communication électronique modernes sont également une arme à double tranchant. Si au premier abord l'émission radio et TV, avec son caractère veule et son usage du mensonge par omission atteint jusqu'à la moindre cellule d'immeuble, jusqu'au moindre prolétaire atomisé même s'il ne veut pas lire un journal, et tente d'endormir la conscience de classe, en revanche ces émissions de propagande sophistiquée de la bourgeoisie -il faut bien les appeler par leur nom- ne peuvent plus à un certain moment prétendre jouer un rôle de "directeur de conscience" quand les conditions de vie sont aggravées ou que l'huissier frappe à la porte, elles ne peuvent même pas cacher l'horreur du capitalisme en décomposition. . Cette crise générale des valeurs idéologiques bourgeoises d'abrutissement est d'autant plus avérée par la simple comparaison avec le 19ème siècle. De 1’ouvrier analphabète, recevant tardivement les nouvelles du monde, gavé de patriotisme, le système en est venu à procréer un ouvrier constamment insatisfait et pénétré d'un doute tout aussi constant quant aux promesses des diverses idéologies. De démoralisants en soi en l'absence de lutte de classe ces facteurs d'aliénation de la société contemporaine se retournent contre la bourgeoisie avec le développement de cette même lutte de classe, et hâtent la remise en cause de son système d'oppression.
L'internationalisation des luttes proletariennes
L'internationalisation des luttes prolétariennes est ce quatrième facteur qui va non seulement favoriser, mais être l'étape décisive vers la révolution mondiale. Au 19ème siècle encore, le développement des luttes pouvait être perçu au sein des nations, et, comme l'exprimait Marx : "Les nations ne peuvent constituer le contenu de l'action révolutionnaire. Elles ne sont que des formes à l'intérieur desquelles fonctionne le seul moteur de l'histoire : la lutte des classes". Dans la 1ère et 2 ième Internationale, on conçut ainsi l'idée de la réalisation du socialisme mondial : des luttes s'additionneraient d'abord entreprises par entreprises (nationalisations), puis elles deviendraient des révolutions pays par pays, ceux-ci se "fédérant" ensuite entre eux ; c'est encore la vision de l'aile bordiguiste du mouvement révolutionnaire. Cependant, si les conditions du changement de période historique du capitalisme déclinant ont brisé cette vision, l'idée de Marx n'est pas remise en cause, elle est prolongée : la forme à l'intérieur de laquelle fonctionne la lutte de classe est l'ensemble du monde capitaliste, par delà ses barrières nationales ou de blocs. La bourgeoisie mondiale exploite tout prolétaire en n'importe quel pays, le tourneur italien, le maçon russe comme l'électricien américain. L'ouvrier sud-américain employé dans une filiale de Renault sait que son principal patron réside en France, le métallurgiste polonais qu'il dépend d'un commanditaire en Russie. Si tout ceci explique concrètement, à la racine, l'intérêt de tous les capitalistes à serrer les coudes contre toute grève ou lutte de masse, par contre l'appartenance corporative à une même branche industrielle n'a jamais permis réellement à la solidarité ouvrière de franchir les clivages nationaux. La nature de la classe ouvrière ne passe pas par la définition corporatiste mais indépendamment des diverses professions. Les aiguilleurs du ciel américain ont fait récemment la tragique expérience de l'absence de solidarité internationale de corporation, l'idéologie de gauche du capitalisme laissant croire à cette illusion. Dans une concurrence capitaliste débridée, les métallurgistes anglais en grève ont pu voir un acier "étranger" préféré au "leur" et à meilleur coût, les mineurs français voir livrer du charbon "polonais" ou "allemand". Le terrain de la défense ou de l'exaltation du produit d'une corporation est celui où le capital règne en maître, en particulier par l'entremise des syndicats, c'est un lieu où le chauvinisme peut encore être entretenu. Espérer l'extension de la lutte à la même branche ou filiale c'est placer les prolétaires sur le même terrain concurrentiel que les diverses firmes qui fabriquent un même produit, c'est sous-estimer le patriotisme d'entreprise lié à la production d'une marchandise donnée quand les capitalistes font accroire que le produit de leur travail appartiendrait aux ouvriers ; ainsi les prolétaires sont limités et déterminés aux bornes de l'entreprise, au mode de fabrication déviés de la remise en cause de l'ensemble du mode de production capitaliste.
Le prolétariat dans son entier produit toutes les richesses, la production capitaliste parcellisée et mercantile lui est étrangère, et il n'a pas droit de regard sur son utilisation en bout de chaîne. Dans ces conditions un prolétaire se définit avant tout comme être salarié, sujet exploité dans un système social marchand qui lui est hostile. Lorsque les prolétaires luttent, ils ne luttent pas au premier abord pour un meilleur charbon français ou un meilleur acier anglais, ils luttent -quelles que soient leurs professions- contre les condition d'exploitation et de soumission, et en prolongement au niveau plus élevé du développement de leurs luttes- s'ils ne se laissent pas entraver par les barrages syndicalistes- remettent en cause l'Etat capitaliste. La généralisation des luttes au niveau international ne peut donc provenir d'une extension corporative. La grève massive de mai 68 en France et les grèves dans le monde au même moment, ou la grève de masse d'août 80 en Pologne ne se sont pas produites par une addition de corporations en lutte, par la même branche puis les unes aux côtés des autres. C'est en dépassant la vision d'une somme de corporations que les prolétaires en Pologne ont trouvé le réel chemin de la lutte contre l'Etat, en posant les mêmes objectifs des usines vers la rue ; leur révolte contre les conditions d'exploitation devint lutte contre l'ordre capitaliste et non pas meilleure gestion ou production de marchandises. La réaction de l'Etat polonais témoigna de la solidarité des divers Etats capitalistes contre la lutte ouvrière, derrière lui se tenaient à la fois l'Etat russe et les Etats occidentaux. Cette coalition de la bourgeoisie est une leçon de choses en ce qui concerne le manque d'unité internationale du prolétariat. A charge de revanche cette coalition bourgeoise montre la nécessité d'une unité de combat de l'ensemble du prolétariat contre la force capitaliste qui sait faire cesser momentanément ses divisions intrinsèques pour parer à la lutte de classe. Si toutes les fractions de la bourgeoisie mondiale se sont jetées comme un seul homme sur l'incendie polonais, cela prouve que, malgré ses difficultés économiques insurmontables, cette classe rétrograde veille à empêcher à tout prix sa destruction par le prolétariat ; cela prouve qu'elle a la hantise de 1'imitation et de la contagion. La répression organisée de longue main internationalement pour apparaître comme un "règlement de compte" entre "polonais", ne peut cacher que derrière la milice et l'armée polonaise se tenait toute la bourgeoisie mondiale (il était plus lucide d'avoir recours à la mystification nationaliste de "charbonnier maître chez soi"). L'utilisation renouvelée des barrières nationales est encore un trait dominant de la politique bourgeoise et rend plus difficile à envisager une simultanéité absolue d'explosions de luttes de classe dans plusieurs pays à la fois où les prolétaires, hors des corporations, se tendraient la main par-dessus les frontières. Mais l'approfondissement de la crise économique brise ces barrières dans la conscience d'un nombre grandissant de prolétaires à travers les faits qui montrent qu'il s'agit d'une MEME lutte de classe. Il faut tirer les leçons du fait que les principales luttes de ces dernières années se soient succédées étalées dans le temps, sans liens de classe directs d'un pays à l'autre. En effet, d'autant plus que la crise économique ne frappe pas un pays puis un autre, le premier remontant la pente quand l'autre la redescend, comme dans la période de reconstruction suivant la 2ème guerre mondiale, elle tend à frapper en même temps l'ensemble des pays et surtout les plus industrialisés et têtes de pont capitalistes florissants jusque là. Ainsi le tourbillon du marasme économique, s'il procède avec lenteur, tend à rapprocher le moment où comme pendant l’année 68 et avec une accélération soudaine, les luttes ouvrières se produiront dans plusieurs pays à la fois sur les mêmes bases : lutte contre l'austérité capitaliste, contre la menace du chômage et implicitement contre la menace de guerre. Beaucoup plus qu'à travers ces luttes qui se sont succédées ces dernières années, c'est à travers une simultanéité dans la mesure du possible de nouvelles luttes en plusieurs pays que se posera le problème de la jonction par delà les barrières nationales et de blocs impérialistes, contraignant la bourgeoisie mondiale à une réaction dispersée, encourageant la prise de conscience que 1'ennemi capitaliste est le même partout. Qu'il le veuille ou non, c'est la prochaine étape qualitative nécessaire pour le prolétariat, possible dans la conjoncture mondiale, obligatoire pour son renforcement. Dans une telle situation un mouvement de masse comparable à celui de la Pologne en 1980 ne restera pas isolé mais trouvera la solidarité par le développement d'autres mouvements de masse.
En ces années 80 le prolétariat devra frapper au coeur des principales métropoles capitalistes s'il veut donner un solide élan à son combat international. C'est particulièrement au vieux coeur du capitalisme, l'Europe, que les échanges entre zones de lutte ne devront plus être une caricature de bons offices syndicaux. La concrétisation d'échanges internationaux sera là exemplaire pour le monde entier. Cela sera décisif pour la révolution internationale. Le problème de la destruction des Etats bourgeois sera posé plus abruptement mais ne sera pas résolu pour autant.
Gieller
"La guerre, incontestablement, a joué un rôle énorme dans le développement de notre révolution, elle a désorganisé matériellement l'absolutisme : elle a disloqué 1'armée, elle a donné de 1'audace à la masse des habitants. Mais heureusement, elle n'a pas créé la révolution, et c'est une chance parce que la révolution née de la guerre est impuissante : elle est le produit de circonstances extraordinaires, repose sur une force extérieure et en définitive se montre incapable de conserver les positions conquises. "(Trotsky, "Notre Révolution").
Cette juste conception que Trotsky développe après le mouvement de 1905 en Russie, sera contredite par les théories que Trotsky développera après la révolution de 1917, elle aussi déclenchée à la suite d'une guerre.
Pourtant, l'échec de la révolution russe après son isolement fut une vérification supplémentaire du caractère défavorable que constituent les conditions que crée la guerre.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Approfondir:
Questions théoriques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Théories des crises : le véritable dépassement du capitalisme c’est l'élimination du salariat
- 3087 reads
(à propos de la critique des thèses de Rosa Luxembourg par Nicolas Boukharine)
"Si on veut savoir ce que sera le communisme, il faut commencer par savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la société présente". Dans l'article précédent ([1] [338]), nous avons montré comment d'un point de vue marxiste, l'idée que l'on se fait du socialisme dépend de l'analyse que l'on partage des contradictions internes du capitalisme. Derrière les critiques que formule en 1924 Nicolas Boukharine, bolchevik, "théoricien" de l'Internationale Communiste, aux analyses des contradictions capitalistes par Rosa Luxemburg ([2] [339]), se dessinent les bases de la théorie de la possibilité du socialisme en un seul pays et de l'identification du capitalisme d'Etat avec le socialisme. Pour démontrer cela, nous avions commencé par rejeter certaines des principales objections avancées par Boukharine. Nous avons ainsi répondu à l'argument suivant lequel le problème de base posé par Rosa Luxemburg -l'incapacité du capitalisme de créer en permanence ses propres débouchés- n'existerait pas. Nous avons rappelé en quoi et pourquoi les crises de SURPRODUCTION étaient et restent une donnée essentielle et inévitable du capitalisme, et montré la vacuité de l'argument suivant lequel les ouvriers, leur consommation, pourraient constituer un débouché suffisant pour absorber la surproduction capitaliste.
Nous nous attacherons dans cette 2ème partie à répondre à un des arguments les plus fréquemment employés contre l'analyse de Rosa Luxemburg. Boukharine le formule ainsi : "Rosa Luxemburg se rend l'analyse trop aisée. Elle privilégie une contradiction, à savoir, celle entre les conditions de la production de la plus-value et les conditions de la réalisation, la contradiction entre la production et la consommation dans les conditions du capitalisme". (L'impérialisme et l'accumulation du capital. Chap.5).
Y-A-T-IL DANS LE CAPITALISME UNE CONTRADICTION PLUS DETERMINANTE QUE LES AUTRES ?
Comme tout ce qui est vivant, le système de production capitaliste est et a toujours été traversé de multiples contradictions, c'est-à-dire de nécessités s'excluant et s'opposant les unes aux autres. Sa vie, son développement, sa marche impétueuse dans l'histoire, bouleversant en quelques siècles des millénaires d'histoire et modelant un monde à son image, furent le résultat non pas d'une volonté idéaliste de domination en soi, mais le produit de sa lutte permanente pour dépasser ses contradictions internes.
Ce fut l'essentiel de l'oeuvre de Marx que de montrer comment et pourquoi ces contradictions devaient conduire un jour le capitalisme, tout comme les sociétés passées (esclavagisme antique, féodalisme) à connaître une phase de décomposition, de décadence, mettant à l'ordre du jour l'instauration de nouveaux rapports sociaux, l'avènement d'une nouvelle société qui devrait être le communisme.
Marx a mis en lumière un grand nombre de ces contradictions. Boukharine en reprochant à Rosa Luxemburg de "privilégier une contradiction" en cite quelques-unes que Rosa Luxemburg néglige selon lui : "La contradiction entre les branches de production; la contradiction entre 1'industrie et 1'agriculture limitée par la rente foncière ; 1'anarchie du marché et la concurrence ; la guerre en tant que moyen de cette concurrence ; etc." (Id.)
Il faudrait ajouter, parmi les plus importantes:
la contradiction entre d'une part le caractère de plus en plus social de la production (techniquement parlant, le monde tend à produire comme une seule usine, chaque produit contenant du travail des quatre coins de la planète) et d'autre part le caractère parcellarisé, limité, privé de l'appropriation de cette production ;
la contradiction entre le fait que le capital ne peut tirer de profit que de l'exploitation du travail vivant (le capitaliste ne peut pas "exploiter" la machine) alors que dans le processus de production, la part du travail vivant par rapport à celle du travail mort (les machines) tend à se restreindre au fur et à mesure du progrès technique (contradiction qui s'exprime dans la "baisse tendancielle du taux de profit");
enfin, et surtout, la contradiction vivante que constitue l'exploitation elle-même, l'antagonisme de plus en plus aigu entre les producteurs et le capital.
C'est l'ensemble de toutes ces contradictions qui -après avoir été pendant des siècles un stimulant à l'expansion- conduit dans sa décadence le capitalisme, à l'étouffement, à la paralysie et à la banqueroute historique.
L'objet du débat n'est pas de reconnaître ou non l'existence de ces contradictions. Mais d'abord de savoir pourquoi,à un moment donné de leur développement, ces contradictions internes, de stimulants, d'aiguillons du développement se transforment en entraves ?
Rosa Luxemburg y répond effectivement en "privilégiant" une contradiction : celle entre les conditions de la production de la plus-value et celles de sa réalisation sur le marché mondial; cette contradiction est elle-même un produit de celle entre valeur d'usage et valeur d'échange au sein de la marchandise capitaliste.
LA CONTRADICTION ENTRE LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION ET CELLES DE LA REALISATION DE LA PLUS-VALUE COMMANDE A TOUTES LES AUTRES CONTRADICTIONS DU CAPITALISME.
Pour Rosa Luxemburg, c'est lorsque le capitalisme ne parvient plus à élargir ses marchés "par rapport aux besoins d'expansion des entreprises capitalistes existantes", que toutes ses contradictions internes tendent à éclater dans leur plus grande évidence. La contradiction découverte par Marx entre les conditions de production de la plus-value, (le profit) et les conditions de la réalisation de cette plus-value (la réalisation sous forme argent, la vente du sur-travail extirpé), cette contradiction commande à toutes les autres. Si la contradiction entre la nécessité de produire à une échelle toujours plus large et celle de réduire la part de la production qui revient à la masse des salariés est dépassée, surmontée, toutes les autres contradictions se trouvent atténuées, voire transformées en simples stimulants. Tant que le capitalisme trouve des marchés, des débouchés à la taille des nécessités de son expansion, toutes ses difficultés internes sont aplanies.
C'est ainsi que les crises éclatent lorsque les marchés sont devenus trop restreints, et elles sont dépassées lorsque de nouveaux débouchés sont ouverts. C'est au niveau du marché mondial et de ses crises que toutes les contradictions internes au mode de production éclatent ou sont aplanies. C'est ce qu'exprime Marx lorsqu'il écrit :
- "Les crises du marché mondial doivent être vues comme la synthèse réelle et l'applanissèment violent de toutes les contradictions de cette économie, dont chaque sphère manifeste les divers aspects réunis dans ces crises". ("Matériaux pour l'économie". Ed. La Pléiade. T.II p. 476)
Le caractère déterminant de cette contradiction sur les autres contradictions apparaît clairement lorsqu'on analyse les conditions concrètes dans lesquelles d'autres contradictions importantes se trouvent exacerbées ou atténuées. Considérons le cas des deux contradictions les plus fréquemment mises en avant par les critiques de Rosa Luxemburg : la concurrence entre capitalistes, la baisse tendancielle du taux de profit.
LA CONCURRENCE EST UN STIMULANT LORSQUE LES MARCHES SONT SUFFISANTS.
Tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ont cherché à théoriser l'idée de l'existence d'un système de production "non capitaliste" en URSS ont toujours -tel Boukharine- accordé une place prépondérante à la concurrence entre capitalistes parmi les contradictions internes du capitalisme.
L'URSS ne serait pas capitaliste parce qu'elle serait parvenue à éliminer la concurrence et donc l'anarchie dans la production. Et pourtant, il suffit d'analyser quelle est la réalité de cette concurrence pour comprendre qu'il s'agit d'une contradiction dont l'ampleur et la nature dépendent étroitement de l'abondance des débouchés solvables existants.
L'objet de la concurrence entre capitalistes, ce sont les marchés.
L'objet des luttes entre tribus primitives anthropophages, c'était les corps humains à dévorer; les cités esclavagistes se battaient pour piller les richesses d'autres populations et pour des esclaves; les seigneurs féodaux pour des terres, des serfs, des animaux. Les capitalistes, eux, se battent pour quelque chose de beaucoup plus abstrait et universel : des marchés. Certes, ils ne se privent pas de piller lorsqu'ils le peuvent, à la façon de leurs ancêtres, mais ce qui leur est plus spécifique, c'est de s'affronter sans pitié et par tous les moyens pour le contrôle des marchés.
De ce fait, 1'exacerbation de la concurrence entre capitalistes et l'intensité de ses effets dépendent étroitement de l'ampleur des marchés qui sont l'objet de cette concurrence. Dans les périodes où le capitalisme dispose de débouchés solvables suffisants pour l'élargissement de la production, la concurrence joue un rôle de stimulant pour la compétition. Sans limite de marchés, la "libre concurrence" pourrait apparaître comme un simple affrontement sportif entre capitalistes. Mais dès que ces débouchés se restreignent, les capitalistes s'entre-déchirent dans des affrontements meurtriers, les survivants se nourrissant des cadavres des victimes du manque de débouchés. La concurrence se transforme alors en une entrave au développement du capital et des forces productives de la société en général. Ainsi, depuis plus d'un demi-siècle, la concurrence capitaliste, non seulement conduit la société à des guerres mondiales de plus en plus destructrices, mais en outre, en temps de "paix", elle provoque des frais de plus en plus lourds, destinés non pas à entretenir ou accroître la production, mais à"faire face à la concurrence" : développement de la bureaucratie d'Etat, des dépenses militaires, des dépenses en "marketing" ou publicité.
Ce n'est pas la concurrence qui engendre la pénurie des marchés, c'est la pénurie des marchés qui exacerbe et rend destructrice la concurrence.
C'est de la capacité du capitalisme à faire reculer les limites du marché mondial que dépend le degré d'exacerbation et de "nocivité" de la concurrence capitaliste.
LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT DEVIENT EFFECTIVE EN PRESENCE D'UNE INSUFFISANCE DES MARCHES.
Il en est de même de la tendance permanente à la baisse du taux de profit. Cette tendance, mise en lumière pour la première fois par Marx, est une tendance provoquée par :
{C}{C}{C}{C}1) {C}{C}{C}{C}la nécessité pour le capitalisme de "moderniser" en permanence sa production, introduisant dans le processus de production une part toujours plus grande de machines par rapport au travail vivant;
{C}{C}{C}{C}2) {C}{C}{C}{C}l'impossibilité pour les capitalistes d'extraire du surtravail d'autre source que de l'exploitation du travail vivant lui-même.
Mais, si cette loi est dite "tendancielle", c'est justement parce qu'elle est constamment contrecarrée, freinée, ou compensée par d'autres tendances au sein du système. Marx a aussi clairement mis en évidence les facteurs qui la contrecarrent et ceux qui en compensent les effets.
La tendance à la baisse elle-même est freinée principalement par la baisse des coûts réels de" production (salaires, machines, matières premières) que provoque l'accroissement de la productivité du travail. Il faut moins de temps de travail pour produire les biens nécessaires à l'entretien d'un ouvrier, une machine ou telle matière première.
Les effets de cette baisse du taux de profit lui-même, tendent à être compenses par l'accroissement de la masse de profit. Un taux de 20% de profit est plus faible qu'un taux de 22%, mais un profit de 20% sur 2 millions de dollars investis, c’est beaucoup plus que 22% sur un million. Mais pour le capitaliste la capacité d’augmenter sa productivité comme celle d’accroître la masse de son profit, sont étroitement dépendantes de sa capacité à élargir l’échelle de sa production et donc de sa capacité de « vendre plus » (cette question est plus longuement développée dans l’article « les théories des crises de Marx à l’Internationale Communiste » déjà cité).
La baisse du taux de profit, de TANDANCIELLE devient EFFECTIVE et DESTRUCTRICE de capital, lorsque que les forces qui la contrecarrent et la compensent « en temps normal » s’affaiblissent, ce qui se produit essentiellement lorsque l’élargissement de la production est devenu impossible par l’insuffisance des marchés solvables où réaliser la plus-value. Tout comme pour la concurrence, la baisse tendancielle du taux de profit, est une contradiction qui DEPEND elle-même de celle qui existe au niveau des conditions de réalisation de la plus-value.
Rosa Luxemburg ne privilégie pas une contradiction au hasard parmi d'autres. Elle souligne celle où se concentrent toutes les autres, celle qui traduit la pression et les tensions de l'ensemble des contradictions internes au capitalisme. Et cela permet de déterminer à quel moment l'ensemble des contradictions du capitalisme se transforme en entrave.
Boukharine, après avoir affirmé qu'il ne faut privilégier aucune contradiction du capitalisme pour comprendre ses crises, se trouve cependant confronté à la question : à quel moment ces contradictions deviennent des limites définitives ? Et la seule réponse qu'il peut donner, c'est :
- "Des limites sont données par un degré déterminé de tensions des contradictions capitalistes".(Idem. p.134).
"Un degré déterminé" ? Mais quel degré ? Quel est le degré de "concurrence" à atteindre ? Quel est le taux de profit minimum ? Ce sont des questions auxquelles Boukharine ne répond pas, parce qu'il n'y a pas de réponse à ces questions sans se référer spécifiquement à la capacité du capitalisme à trouver des débouchés.
L'analyse de Luxemburg permet par contre de déterminer comment ces limites sont celles du marché mondial, et en son sein, plus particulièrement «les marchés extra-capitalistes.
LA CONTRADICTION MISE EN AVANT PAR ROSA LUXEMBURG EST-ELLE "EXTERIEURE" AU PROCESSUS DE PRODUCTION CAPITALISTE?
Comment -d'après Rosa Luxemburg- le capitalisme a-t-il pu surmonter la contradiction entre sa nécessité d'élargir toujours plus ses débouchés et la nécessité de réduire toujours plus la part de production revenant aux exploités? En trouvant des acheteurs en dehors du processus de production capitaliste. Pour l'entreprise capitaliste mondiale, vendre et racheter elle-même ses propres produits n’a aucun sens. Il lui faut des "clients" extérieurs à son entreprise auxquels vendre ce surplus, cette part de la plus value que ne peuvent acquérir ni l’ouvrier, ni le capitaliste. Ces clients, ces « tierces personnes » -explique Rosa Luxembourg– le capitaliste les a trouvé dans les premiers temps du capitalisme, principalement dans les seigneurs féodaux.
Dans la période de la révolution industrielle, il la trouve surtout dans les secteurs agricoles et artisanaux demeurés en dehors de son contrôle, en particulier dans les territoires coloniaux que les puissances finirent par se disputer dans deux guerres mondiales.
Dans sa phase de décadence, c’est dans la reconstruction des centres industriels détruits pendant les guerres que le capitalisme trouvera une compensation momentanée à son manque de débouchés extérieurs. Et depuis la fin des années soixante, depuis la fin de la reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale, le capitalisme a eu recours à une fuite en avant par des crédits de plus en plus massifs aussi bien aux pays moins développés qu'aux capitaux des métropoles.
L'introduction dans l'analyse des contradictions du capital de cet élément que constituent les secteurs extra-capitalistes, l'élargissement du cadre de l'analyse au niveau de sa réalité la plus globale, celle du marché mondial, est considérée par les critiques de Luxemburg comme une "hérésie" par rapport à Marx, et comme une recherche des contradictions du capitalisme en dehors du processus de production capitaliste. Ainsi, pour Boukharine par exemple, le manque de clients n'appartenant pas aux entreprises capitalistes, de "tierces personnes" est une contradiction qui ne serait pas "interne". "Le capitalisme -oppose-t-il à Luxemburg- développe ses contradictions internes. Ce sont elles et non le manque de "tierces personnes" qui la fait finalement périr". (Idem. p. 140).
En d'autres termes, pour comprendre les contradictions du capitalisme, il faudrait s'en tenir à la réalité du capitalisme dans 1'usine et ignorer ce qui se passe sur le marché mondial ; le marché mondial serait en quelque sorte "extérieur" à la réalité profonde du capitalisme!
Cette critique de Luxemburg est formulée de façon particulièrement nette par Raya Dunayevskaya (ancienne collaboratrice de Trotsky) dans un article écrit à la fin de la seconde guerre mondiale sur les analyses "de l'Accumulation du Capital" :
"Pour Marx, le conflit fondamental dans une société capitaliste, c'est celui entre le capital et le travail ; tout autre élément lui est subordonné. S'il en est ainsi dans la vie, la première nécessité dans la théorie, beaucoup plus même que dans la société, c'est de poser le problème comme un problème entre le capitaliste et 1'ouvrier, purement et simplement. D'où l'exclusion des "tierces personnes" et, comme il le dit lui-même à plusieurs reprises, 1'exclusion du marché mondial comme n'ayant rien à voir avec le conflit entre ouvriers et capitalistes". (Raya Dunayevskaya "Analysis of R.Luxemburg's Accumulation of capital". Publié en 1967 en appendice de la brochure "State Capitalism and Marx's Humanism").
Il est vrai que pour expliquer comment le capitaliste extirpe du surtravail à l'ouvrier, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le marché mondial et plus particulièrement les secteurs extra-capitalistes. Mais si l'on veut comprendre les conditions pour que cette exploitation puisse se prolonger et se développer, ou être bloquée dans le temps, il est indispensable d'avoir en vue le processus global de reproduction et d'accumulation du capital. Cela ne peut être fait qu'à l'échelle d'existence réelle du capital : celle du marché mondial
En lui-même, le marché constitué par les secteurs extra-capitalistes n'est pas le produit de l'exploitation de l'ouvrier par le capital, mais sans lui, l'exploitation ne peut se reproduire à une échelle élargie.
Si le capital a un besoin vital de ce type de marchés pour survivre, c'est parce que le rapport entre ouvrier et capital est tel que, ni l'ouvrier, ni le capitaliste ne peuvent constituer une demande solvable pour réaliser la part du profit destiné à être réinvesti. Sans la consommation des masses limitée par le salaire, sans l'exploitation de l'ouvrier par le capitaliste, si les ouvriers pouvaient consommer directement ou indirectement tout ce qu'ils produisent, bref, si le salaire n'existait pas, le problème des marchés extérieurs ne se poserait pas; mais ce ne serait plus du capita1isme.
L'extension du marché mondial n'est pour le capitalisme une limite que dans la mesure où il est indispensable à l'existence de la reproduction du capitalisme dans des conditions contradictoires.
En ce sens, il n'y a pas une opposition entre ce que seraient "les contradictions internes" du capitalisme et la nécessité de ces débouchés extra-capitalistes. Aussi bien la nécessité de ces débouchés, que l'incapacité du capitalisme de les élargir indéfiniment jusqu'à intégrer l'ensemble de l'humanité directement au sein du processus de production capitaliste, ne sont pas des phénomènes déterminés par des forces ou des lois extérieures au capitalisme, mais par le caractère contradictoire de ses lois internes.
Pour mieux éclairer cet aspect de la question, considérons le cas des convulsions de la fin du mode de production féodal.
Pour beaucoup d'historiens bourgeois, les catastrophes qui caractérisent la société féodale, en particulier au cours du XIVème siècle, trouvent leur explication dans le manque de terres défrichables. Les famines, les épidémies, les guerres, la stagnation ou le recul général qui couvraient l'Europe au XIVème siècle, auraient ainsi traduit une limite en quelque sorte "naturelle".
Il est vrai que le féodalisme s'est heurté -entre autre- à la difficulté d'étendre les surfaces cultivables dans sa période de déclin. Mais s'il en était ainsi, ce n'était pas du fait d'une mauvaise volonté de la "mère nature" mais parce que les rapports sociaux de production ne permettaient pas la mise en place des moyens techniques et humains indispensables pour entreprendre des défrichements plus difficiles.
L'économie féodale était trop cloisonnée en millions de fiefs, de corporations, de privilèges pour permettre la concentration des forces productives qu'exigeait la situation. Ce n'est pas "la nature" qui explique l'effondrement historique du féodalisme, mais les incapacités propres, les contradictions internes de celui-ci.
La nature par elle-même n'est ici, ni une contradiction "externe", ni une contradiction "interne". Elle n'est que le mi1ieu dans lequel et face auquel les contradictions du système s'exacerbent.
Il est un peu de même avec le capitalisme et sa pénurie de marchés extra-capitalistes. La vie même du capitalisme, son expansion, est synonyme de transformation de nouveaux hommes en prolétaires et le remplacement d'anciennes formes de production en rapports de production capitalistes. Une entreprise capitaliste qui se développe est une entreprise qui embauche plus de prolétaires. Une entreprise particulière peut prendre des ouvriers à une autre.
Mais l'ensemble constitué par tout le capitalisme mondial ne peut embaucher que des travailleurs non-capitalistes. Le capital, doit, pour vivre, absorber le monde non-capitaliste (artisans, petits commerçants, paysans) comme sa nourriture. Mais ce n'est pas uniquement pour se procurer de la main d'oeuvre que la capital vit aux dépens du secteur non-capitaliste. Comme on l'a vu, c'est surtout parce qu'il y trouve des clients, une demande solvable pour la part du surproduit qu'il ne peut acheter lui-même.
Malheureusement pour lui, le capital ne peut faire du commerce avec des clients non-capitalistes sans les ruiner. Qu'il vende des biens de consommation ou des moyens de production, il détruit automatiquement l'équilibre précaire de toute économie pré-capitaliste (donc moins productive que lui). Introduire des habits bon marchés, implanter un chemin de fer, installer une usine suffisent à détruire toute organisation économique pré-capitaliste.
Le capital aime ses clients pré-capitalistes comme l'ogre aime les enfants : en les dévorant.
Le travailleur des économies pré-capitalistes qui a eu "le malheur de toucher au commerce avec les capitalistes" sait que tôt ou tard, il finira, dans le meilleur des cas, prolétarisé par le capital, dans le pire -et c'est chaque jour le plus fréquent depuis que le capitalisme s'enfonce dans la décadence- dans la misère et l'indigence, au milieu de champs stérilisés, ou marginalisés, dans les bidonvilles d'une agglomération.
Le capital est ainsi confronté à la situation suivante : d'une part, il a besoin de plus en plus de clients non-capitalistes pour écouler une partie de sa production; d'autre part, au fur et à mesure qu'il commerce avec eux, il les ruine. L'impérialisme, la décadence du capitalisme, la vie suivant le cycle crise-guerre-reconstruction- sont la manifestation du fait que, depuis plus d'un demi-siècle, les débouchés non-capitalistes sont devenus insuffisants en égard aux nécessités d'expansion du capital mondial.
Mais, tout comme la nature par rapport aux rapports de production féodaux, les secteurs non-capitalistes ne sont ni une contradiction "interne" ni un élément "externe" aux rapports capitalistes. Ils font partie du milieu dans lequel et face auquel le capital existe.
En formulant sa critique à Rosa Luxemburg : ce sont les contradictions internes du capitalisme et non le manque de "tierces personnes" qui font finalement périr le capitalisme, Boukharine bataille contre des hommes de paille. Rosa Luxemburg n'a pas plus prétendu que c'étaient les économies pré-capitalistes qui "faisaient périr" le capitalisme qu'el le n'a affirmé que c'était les cailloux des terres européennes qui ont fait périr le féodalisme.
Ce qu'elle a fait, c'est replacer les contradictions internes du capitalisme, découvertes non par elle, mais par Marx, dans leur milieu vivant : le marché mondial.
LE MILIEU DU CAPITAL, C'EST LE MARCHE MONDIAL
Boukharine comme Raya Dunayevskya prétendent pouvoir comprendre les mécanismes les plus fondamentaux du capitalisme, ceux qui le conduisent à la crise, sans se soucier du milieu dans lequel vit le système. Autant vouloir comprendre le fonctionnement d'un poisson sans tenir compte du fait qu'il vit dans l'eau ou d'un oiseau, sans intégrer dans l'analyse ses rapports avec l'air. Ne pas comprendre l'importance du marché mondial pour l'analyse des crises du capitalisme, c'est en fait ne pas comprendre la nature même du capitalisme.
C'est oublier qu'avant d'être producteur, le capitaliste est d'abord et avant tout UN MARCHAND, UN COMMERÇANT.
Dans la mythologie bourgeoise, le capitaliste est toujours présenté comme un petit producteur qui, grâce à son travail, est devenu un grand producteur. Ce serait le petit artisan du Moyen-Âge devenu le grand industriel ou l'Etat patron de nos jours. La réalité historique est autre.
Dans le féodalisme en décomposition, ce ne sont pas tant les artisans des villes qui se dégagent comme la classe capitaliste, c'est plutôt les marchands. Qui plus est, les premiers prolétaires n'ont souvent été autres que les artisans soumis à la "domination formelle".
Le capitaliste est un marchand dont le commerce principal est celui de la force de travail. Il achète du travail sous la forme de marchandises de force de travail et il le revend sous la forme de produits ou services. Son profit, la plus-value, c'est la différence entre le prix de la marchandise force de travail et celui des marchandises que celle-ci produit. Le capitaliste est contraint de s'occuper du processus de production dont il est le maître mais il n'en reste pas moins ainsi un marchand. Le monde d'un marchand, c'est le marché et dans le cas du capitaliste : le marché mondial.
Les secteurs non-capitalistes font partie du marché mondial.
Ceux qui rejettent l'analyse de Rosa Luxemburg ont généralement du marché mondial -lorsqu'ils finissent par en admettre l'existence- une vision totalement fausse. Celui-ci est considéré que comme l'ensemble des capitalistes et des salariés des capitalistes. Ce faisant, ils nient les conditions pour comprendre la réalité des crises capitalistes et pourquoi elles prennent la forme de crise du marché mondial.
L'ensemble des capitalistes et leurs salariés constituent le marché de la plus grande partie de la production capitaliste; c'est le marché "intérieur" du capitalisme; mais il y a aussi tous les secteurs non-capitalistes : le marché "extérieur". Voici comment Rosa Luxemburg définit ces deux parties du marché mondial :
- "Le marché intérieur et le marché extérieur tiennent certes une place importante et très différente l'une de l'autre dans la poursuite du développaient capitaliste; mais ce sont des notions non pas de géographie, mais d'économie sociale. Le marché intérieur du point de vue de la production capitaliste est le marché capitaliste, il est cette production elle-même dans le sens où elle achète ses propres produits et où elle fournit ses propres éléments de production. Le marché extérieur pour le capital est le milieu social non-capitaliste qui l'entoure, qui absorbe ses produits et lui fournit des éléments de production et des forces de travail."
Le marché mondial c'est tout cet ensemble et c'est comme tel qu'il doit être intégré dans toute analyse de ses crises.
L'ANALYSE DE ROSA LUXEMBURG PERMET DE MIEUX COMPRENDRE POURQUOI A LA BASE DE TOUTES LES CONTRADICTIONS DU CAPITALISME, IL Y A LA MARCHANDISE ET DONC LE SALARIAT.
Dans les travaux du "Capital", Marx a très souvent fait abstraction du marché mondial, car il s'attachait, dans cette partie de ses travaux essentiellement à analyser les rapports internes du fonctionnement du système. Certains épigones y ont vu un argument contre les analyses de Rosa Luxemburg. En intégrant cette analyse dans son cadre plus général, et plus concret du marché mondial, Rosa Luxemburg n'a fait que développer les travaux inachevés de Marx, poursuivant le cheminement que celui-ci s'était méthodologiquement fixé :
- "S'élever de l'abstrait au concret"
Qu'on la privilégie ou pas, la contradiction entre les conditions de production de la plus-value et celle de sa réalisation, cet antagonisme "interne" découvert par Marx, ne peut être réellement compris si on ne connaît pas toutes les "conditions de sa réalisation". Or la réalisation de la plus-value induit la vente d'une part de celle-ci à des clients autres que les capitalistes ou leurs salariés, c'est à dire à des secteurs non-capitalistes. En introduisant ces derniers dans l'analyse des contradictions du capitalisme, Rosa Luxemburg ne nie pas les contradictions internes au mode de production capitaliste ; au contraire, elle donne les moyens de les comprendre dans toute leur réalité concrète et historique.
Mais en privilégiant la contradiction entre production et réalisation de la plus-value, elle "privilégie" la contradiction de base du capitalisme : celle entre la valeur d'usage et la valeur d'échange de la marchandise en général, et de la principale marchandise en particulier : la force de travail et son prix en argent : le salaire. C'est l'existence même du salariat qui apparaît à la base de l'impasse capitaliste.
La réalisation de la plus-value, la métamorphose en argent des marchandises produites par le surtravail des ouvriers, est contradictoire parce que le salariat limite inévitablement la consommation des ouvriers eux-mêmes.
Dans les théories sur la plus-value, Marx écrivait :
"... C'est la métamorphose de la marchandise elle-même qui renferme, en tant que mouvement développé, la contradiction -impliquée dans l'unité de la marchandise- entre valeur d'échange et valeur d'usage, puis entre argent et marchandise. "
La contradiction entre la valeur d'usage de la force de travail et sa valeur d'échange, le salaire, n'est autre que celle de l'exploitation du prolétaire par le capital.
Aussi est-ce seulement dans le cadre de l'analyse de Rosa Luxemburg que l'élimination du salariat apparaît de façon cohérente comme la caractéristique PREMIERE du dépassement du capitalisme.
La question prend toute son importance politique lorsqu'il s'agit d'un problème comme l'évaluation de la nature de classe de l'URSS: "socialiste" ou "en marche vers le socialisme" selon les partis "socialistes ou "communistes" et l'ensemble des partis de centre et de droite ; "Etat ouvrier dégénéré" selon Trotsky et les trotskystes; il revient à la "gauche allemande" des années 20 d'avoir la première analysé d'un point de vue marxiste l'URSS comme du capitalisme d'Etat ; ce n'est pas un hasard si c'était un des seuls courants dans le mouvement ouvrier à connaître et partager l'analyse des crises de Rosa Luxemburg.
Dans sa brochure de critique à l'"Accumulation du Capital", Boukharine affirme nettement la nature non capitaliste de l'URSS :
"A toutes les contradictions du système capitaliste mondial s'ajoute encore une autre contradiction cardinale: la contradiction entre le monde capitaliste et le nouveau système économique de l'Union Soviétique."(Idem p.136)
Ce n'est pas non plus un hasard. Lorsque, dans l'analyse des crises du capitalisme, on "privilégie" des contradictions telles que "la concurrence et l'anarchie capitaliste", on tend inévitablement à voir dans les nationalisations d'entreprises, dans le développement 'du pouvoir d'Etat, dans la planification, des preuves de rupture réelle avec le capitalisme. Lorsqu'on ignore la réalité du marché mondial et son importance dans la vie du capitalisme, on laisse la porte ouverte à l'idée de la possibilité du socialisme en un seul pays.
A travers la critique théorique de l'analyse de Rosa Luxemburg, Boukharine jetait les bases des théories qui sous le stalinisme serviront à présenter avec un verbiage marxiste un régime d'exploitation capitaliste, comme du socialisme.
La compréhension des problèmes économiques de la période de transition du capitalisme au communisme est étroitement dépendante de l'analyse des crises du capitalisme. Il faudra demain avoir tiré toutes les leçons de l'expérience pratique de la révolution russe dans ce domaine. Cela comporte aussi d'avoir dépassé toutes les aberrations théoriques que la dégénérescence de la révolution a engendrées.
R.V.
Sont déjà parus sur les théories des crises dans la Revue Internationale, les articles suivants :
Marxisme et théories des crises - n° 13
Théories économiques et lutte pour le socialisme - n°16
Sur l'impérialisme (théories de Marx, Lénine, Boukharine, R.Luxemburg) - n°19.
Les théories des crises, de Marx à l'Internationale Communiste - n°22.
{C}{C}{C}{C}
{C}{C}{C}{C}[1]{C}{C}{C}{C} [340] Revue Internationale N°29. Voir aussi "Lesthéories des crises,de Marx à l'Internationale Communiste" dans la Revue Internationale N°22, 3ème trimestre 80).
{C}{C}{C}{C}[2]{C}{C}{C}{C} [341] Nicolas Boukharine. "L'impérialisme et l'accumulation du capital". Ed.EDI.
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (4ème partie)
- 2753 reads
LES CONCLUSIONS DE HARPER SUR LA REVOLUTION RUSSE ET L'ASPECT DE LA DIALECTIQUE MARXISTE QU'IL A CRU BON DE LAISSER DANS L'OMBRE...
Il y a trois façons de considérer la révolution russe :
a) La première est celle des "socialistes" de tout poil, droite, centre et gauche, révolutionnaires et Cie (en Russie), indépendants et tutti quanti, ailleurs.
Avant la révolution, leur perspective était : la révolution russe sera une révolution bourgeoise démocratique, au sein de laquelle, -démocratie bourgeoise,- la classe ouvrière pourra lutter "démocratiquement" pour "ses droits et libertés".
Tous ces messieurs étaient, en plus de "révolutionnaires démocrates sincères", de fervents défenseurs du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", et arrivaient à la défense de la nation par le détour d'un internationalisme à sens unique partant du pacifisme et aboutissant à la lutte contre les agresseurs et les oppresseurs. Ces gens là étaient des"moralistes" dans le plus pur sens du terme, défendant le "droit" et la "liberté", avec un grand D et un grand L des pauvres et des opprimés.
Bien entendu, quand la première révolution, celle de février éclata, ce fut un torrent de larmes de joie et d'allégresse, la confirmation de la sainte perspective, enfin, la sainte révolution tant attendue.
Ils avaient seulement oublié que le coup de pouce donné par l'insurrection générale de février ne faisait qu'ouvrir les portes à la vraie lutte de classe des classes en présence.
Le tzar tombé, la révolution bourgeoise en voie d'accomplissement au sein même de la vieille autocratie, signifiait le pourrissement de cet appareil, et la nécessité de son remplacement : février ouvre la porte à la lutte pour le pouvoir.
Au sein de la Russie même, quatre forces se révèlent en présence :
- l'autocratie, bureaucratie féodale gouvernant un pays où le grand capital est en train de s'installer,
- la bourgeoisie et petite bourgeoisie, grand capital, directeurs d'industrie et élite intellectuelle, moyenne propriété foncière, etc...
- la grande masse de la paysannerie pauvre à peine sortie du servage.
- les intellectuels et petite bourgeoisie prolétarisés par la crise du régime et du pays, et le grand prolétariat industriel.
Les éléments "réactionnaires" (les soutiens du régime tsariste), s'étaient convaincus de l'inéluctabilité et de la nécessité de l'introduction du grand capitalisme industriel en Russie, et ils n'aspiraient pas à autre chose qu'à être les gérants et les gendarmes du grand capital financier étranger, au prix d'un conservatisme social à eux favorable, le maintien du système bureaucratique impérial, la "libération" du servage, nécessaire à fournir une main- d'oeuvre à l'industrie, tout en maintenant le haut contrôle de la bureaucratie et de la noblesse sur la moyenne paysannerie, considérée comme une classe de métayers.
Ceci était, évidemment, déjà, la "révolution bourgeoise". Mais les forces sociales qui entraient sur l'arène de l'histoire ne tenaient pas compte des desideratas de la bureaucratie. Le capital introduit en Russie, cela signifiait, d'un côté le prolétariat, de l'autre la classe capitaliste, qui ne se compose pas que des possesseurs de capitaux, mais de toute la classe sociale qui dirige effectivement l'industrie et administre la circulation des capitaux.
L'importation du capital eut pour conséquence de révéler aux classes dirigeantes russes, dans le sens le plus large du terme, toutes les possibilités énormes de développement que pouvait fournir le capitalisme à la Russie.
Se créaient donc,au sein de ces classes, deux tendances ambivalentes : la première, nécessité de se servir du capital financier étranger pour le développement capitaliste en Russie ; la deuxième, une tendance à l'indépendance nationale, et donc, à se libérer de l'emprise de ce capital.
Dès l'ouverture du cours révolutionnaire, les pays qui avaient investi des capitaux en Russie, tels la France et l'Angleterre et bien d'autres encore, comprirent surtout le danger du point de vue des intérêts de "leurs" capitaux. Or, on sait que la mentalité du possédant, en général, est la pleutrerie, la peur,et, par réaction le déchaînement et l'explosion de la force dont il peut disposer.
Ces pays savaient très bien qu'un gouvernement démocratique sauvegarderait leurs intérêts, mais comme tout capitaliste, ils voyaient dans l'installation d'un quelconque putsch réactionnaire, la possibilité de dicter leur politique et celle d'avoir effectivement la mainmise sur un territoire extrêmement riche. Les pays étrangers misaient donc sur tous les tableaux, soutenaient tout le monde, Kerinsky et Dénikine, les bandes réactionnaires et le gouvernement provisoire, etc.. Les uns recevaient de l'argent, des armes et des conseillers techniques militaires, les autres recevaient les "conseils désintéressés" de la part d'ambassadeurs ou autres consuls. De plus, à travers cette grande bagarre pour le pouvoir, se faisaient jour avec d'autant plus d'acuité les luttes pour la prépondérance d'influence, les rivalités d'impérialismes, unis pour un jour, se tirant dans le dos et complotant par derrière contre l'allié, etc..
Le terme le plus adéquat pour caractériser la géographie politique de la période qui va de la première révolution (février) à la seconde, (octobre), c'est le marasme, le chaos, où l'histoire contemporaine n'a pu mettre son nez que très peu de temps grâce aux publications, par le gouvernement bolchevik,de tous les accords secrets officiels.
b) La guerre impérialiste elle-même était dans une impasse, les cadavres pourrissaient dans les "no man's land" séparant les tranchées d'un front couvrant tout l'est de l'Allemagne et de l'Empire Austro-Hongrois, et le sud de ces mêmes pays, sans que la guerre, ne sembla être en passe de trouver une issue.
Dans ce chaos général, un petit groupe politique qui avait représenté l'internationalisme révolutionnaire aux conférences de Zimmerwald et de Kienthal, et qui avait posé comme principe premier de la renaissance d'un mouvement ouvrier révolutionnaire sur le cadavre de la IIème Internationale :
Le prolétariat devra AVANT TOUT proclamer son internationalisme en entrant en lutte, QUOI QU'IL ARRIVE contre sa propre bourgeoisie, ayant bien en vue que ce mouvement n'est qu'un mouvement international du prolétariat qui doit, pour permettre de réaliser le socialisme, s'étendre aux principales puissances bourgeoises.
La seule divergence qui existait entre sociaux-démocrates et le noyau de la future Internationale Communiste était ce point fondamental :les sociaux-démocrates pensaient réaliser le socialisme par des"progrès dans l'élargissement de la démocratie intérieure" du pays, et de plus ils pensaient que la guerre était un "accident" dans le mouvement de l'histoire, et que pendant la guerre, plus de luttes de classe, qui devaient être mises à la naphtaline, en attendant la victoire sur le méchant ennemi qui venait empêcher cette "lutte" de s'opérer "pacifiquement".
(Il faudrait avoir plus de place et montrer les manifestes des différents partis, S.D, S.R etc.. de l'époque de la guerre de 1914 à 1917-et des extraits d'articles de journaux de ces partis destinés aux troupes russes en France, et où le "socialisme" y était défendu avec une ardeur., vraiment héroïque).
La gauche qui commença à se regrouper après les deux conférences de Suisse, avait ses assises politiques les plus solides autour de la personnalité de Lénine, à l'époque presque totalement isolé, de ses propres ex-partisans du parti bolchevik et même dans la gauche de la social-démocratie, considéré comme un illuminé, Lénine proclamait en substance :
"... Prêcher la collaboration des classes, renier la révolution sociale et les méthodes révolutionnaires, s1adapter au nationalisme bourgeois 3 oublier le caractère changeant des frontières nationales et des patries, ériger en fétiche la légalité bourgeoise, renier l'idée de classe et la lutte de classe par crainte d1éloigner la "masse de la population" (lisez : la petite bourgeoisie) voilà, sans nul doute la base théorique de l’opportunisme .."
"...La bourgeoisie abuse les peuples en jetant sur le brigandage impérialiste le voile de l’ancienne idéologie de la "guerre nationale". Le prolétariat démasque le mensonge en proclamant la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. C'est le mot d'ordre indiqué par les résolutions de Stuttgart de Baie, qui prévoyaient, non la guerre en général, mais bien cette guerre-ci, et qui parlaient non pas de la "défense de la patrie", mais "d'accélérer la faillite du capitalisme" et d'exploiter à cet effet la crise produite par la guerre, en donnant l'exemple de la Commune. La Commune a été la transformation de la guerre nationale en guerre civile.
Cette transformation n'est pas facile à faire et ne s'opère pas au gré de tel ou tel parti. Et c'est précisément ce qui correspond à l'état objectif du capitalisme en général, et de sa phase terminale en particulier. C'est dans cette direction et dans cette direction seulement, que doivent travailler les socialistes. Ne pas voter les. crédits de guerre, ne pas approuver le "chauvinisme" de SON pays et des pays alliés, mais au contraire, combattre avant tout autre le chauvinisme de SA bourgeoisie, et ne pas se cantonner dans les moyens légaux lorsque la crise est ouverte et que la bourgeoisie elle-même a annulé la légalité créée par elle, voilà la LIGNE DE CONDUITE qui MENE à la guerre civile et qui amènera fatalement à un moment ou à un autre de l'incendie qui embrase l'Europe. .. "
"... La guerre n'est pas un accident, un "péché" comme pensent les curés (qui prêchent le patriotisme, l'humanité et la paix, au moins aussi bien que les opportunistes), mais une phase inévitable du capitalisme, une forme de 'la vie capitaliste aussi légitime que la paix. La guerre actuelle est une guerre des peuples. De cette vérité il ne résulte pas qu'il faille suivre le courant "populaire" du chauvinisme, mais que pendant la guerre, à la guerre, et sous des aspects guerriers, continuent à exister et continueront à sa manifester les antagonismes sociaux qui déchirent les peuples... "
"... A bas les niaiseries sentimentales et les soupirs imbéciles après "la paix à tout prix"! L'impérialisme a mis en jeu le sort de la civilisation européenne. Si cette guerre n'est pas suivie d'une série de révolutions victorieuses, elle sera suivie à bref délai d'autres guerres. La fable de la "dernière guerre" est un conte creux et nuisible, un "mythe" petit bourgeois (selon l'expression très juste du Golos).
Aujourd'hui ou demain, pendant cette guerre ou après elle, actuellement ou bien lors de la prochaine guerre, l'étendard prolétarien de la guerre civile ralliera non seulement des centaines de milliers d'ouvriers conscients, mais des millions de semi-prolétaires et des petits bourgeois abêtis actuellement de chauvinisme et que les horreurs de la guerre pourront effrayer et déprimer, mais surtout instruiront,éclaireront, éveilleront, organiseront, tremperont et prépareront à la guerre contre la bourgeoisie, celle de "leur" pays et celle des pays "étrangers"...."
".. La IIème Internationale est morte, vaincue par l’opportunisme. A bas l'opportunisme et vive l'Internationale épurée non pas seulement des "transfuges" (comme le désire le Golos) mais aussi de l'opportunisme, la IIIème Internationale !
La IIème Internationale a accompli sa part de travail utile. (…)
A la IIIème Internationale appartient l'organisation des forces prolétariennes pour l'offensive révolutionnaire contre les gouvernements capitalistes, pour la guerre civile contre la bourgeoisie de tous les pays, pour la conquête du pouvoir, pour la victoire du socialisme..."
En comparant cela à Marx, on voit combien, contrairement à ce qu'Harper veut bien nous faire croire, Lénine a compris le marxisme et a su Rappliquer au moment adéquat :
".,. Il va absolument de soi que, pour pouvoir lutter d'une façon générale, la classe ouvrière doit s'organiser chez elle EN TANT QUE CLASSE et que l'intérieur du pays est le théâtre immédiat de sa lutte. C'est en cela que sa lutte de classe est nationale, non pas quant à son contenu, mais comme le dit le Manifeste Communiste, "quant à sa forme". Mais le "cadre de l'Etat national actuel", c'est à dire de l'Empire allemand, entre lui-même à son tour, économiquement, "dans le cadre" du système des Etats. Le premier marchand venu sait que le commerce extérieur et la grandeur de Mr Bismarck réside précisément dans une sorte de politique internationale.
Et à quoi le Parti Ouvrier allemand réduit-il son internationalisme ? A la conscience que le résultat de son effort "sera la fraternité internationale des peuples" phrase empruntée à la bourgeoise Ligue de la liberté et de la paix, et qu'on fait passer comme un équivalent de la fraternité internationale des classes ouvrières dans la lutte commune contre les classes dominantes et leurs gouvernements. " (Critique du Programme de Gotha) (1-5)
Ce qui distinguait donc cette gauche de la S.D de l'ensemble du mouvement ouvrier, c'était ses positions politiques :
1- SUR LA NOTION DE LA PRISE DU POUVOIR (la querelle démocratie bourgeoise et démocratie ouvrière intégrale par la dictature du prolétariat)
2- sur la nature de la guerre et la position des révolutionnaires dans cette guerre.
Sur tout le reste, notamment sur l'organisation "économique" du socialisme, on en était encore aux mots d'ordre des nationalisations de la terre et de l'industrie, comme beaucoup gardaient en politique le mot d'ordre de la "grève générale insurrectionnelle". Quoi qu'il en soit, il est bon de rappeler que très peu nombreux étaient les militants socialistes, même dans la gauche, qui avaient compris les positions de Lénine au cours de la guerre, et qui se rallieront APRES COUP à la Révolution Russe, quand la théorie se sera trouvée réalisée dans les faits.
Ceci est tellement vrai, que dans la querelle de Kautsky-Lénine, il n'est pas soufflé mot de la part de Kautsky, de ce côté du problème et pourtant, Lénine le fait remarquer, Kautsky avait pris position antérieurement, au Congrès de Baie, pour des positions analogues et très avancées sur le pouvoir ouvrier et sur l'internationalisme. Cependant il ne suffit pas de signer des résolutions, faut-il encore savoir les appliquer pratiquement. C'est là, est quand on trouve transposé du plan théorique au plan pratique qu'on voit le vrai marxiste. Toute la valeur d'un Plékhanov et d'un Kautsky, des hommes considérables dans le mouvement ouvrier socialiste de la fin du 19ème siècle, s'effondre comme statue de sel à côté de ce petit groupe de bolcheviks qui a du transposer sur le plan pratique leurs théories, d'abord pour la prise du pouvoir, ensuite devant la guerre, face aux S.R de gauche et à la fraction bolchevique qui était pour la "guerre révolutionnaire" à Brest-Litovsk, et devant l'offensive allemande, et devant la guerre civile intérieure qui se poursuivait.
En attendant que la révolution gagne internationalement, on ne pouvait faire en Russie qu'une organisation bourgeoise de l'économie, mais sur le modèle du capitalisme le plus avancé : le capitalisme d'Etat.
Seul le règlement ultérieur de la révolution internationale, (QUI AVAIT EU SON POINT DE DEPART INTERNATIONALEMENT, sur les positions et devant L'EXEMPLE DES BOLCHEVIKS), permettrait la possibilité d'une évolution et d'une transformation de la société vers le socialisme. En dehors de cela, on pourrait citer cent exemples de fausses positions, avant et après la révolution, de ce même Lénine.
En 1905, Trotsky lui donne une sévère leçon dans "Nos différents"et c'est sur la synthèse de la position de Trotsky dans "Nos différents" et de Lénine dans "Que faire ?" que s'est opérée la prise de position dans la guerre. Après la prise du pouvoir, une somme formidable d'erreurs ont été commises de part et d'autres à l'intérieur du parti, chez Lénine, Trotsky etc.. Il ne s'agit pas ici de se voiler les yeux sur toutes ces erreurs, nous y reviendrons par la suite en d'autres endroits, où il s'agira surtout des "léninistes purs". Mais les enseignements qu'on peut tirer après 30 ans de recul, alors que les conditions économiques ont changé, que les caractères se sont accentués, cette méthode est différente de celle qui consiste à faire face aux événements qui se présentent d'une façon anarchique et imprévue. Aujourd'hui on peut dire quelles furent les erreurs des bolcheviks, on peut étudier la révolution russe comme un événement historique, on peut voir quels étaient les groupes politiques en présence, analyser et étudier leurs documents, leur action etc..
Mais, pour hier, avec toutes leurs positions retardataires, les bolcheviks, Lénine et Trotsky en tête, étaient-ils engagés dans un mouvement qui avait pour fin immédiate d'être un mouvement vers le socialisme ? Les chemins pris par les bolcheviks y conduisaient-ils ? Ou bien ceux pris par Kautsky, ou ceux pris par X, Y, ou Z ?
Nous répondons, il n'y avait qu'une seule base de départ pour que le mouvement s'engage dans la voie de la révolution socialiste, et cette base, seuls les bolcheviks, -en Russie-, (et encore pas tous, loin de là), l'avaient mis en avant et l'avaient appliquée. C'est cette base qui faisait que leur action était engagée dans une lutte de classe où le but était le renversement du capitalisme à l'échelle internationale et où les positions politiques générales conduisaient réellement à ce renversement.
Sorti de là, de ces bases qui ont présidé dans les grandes lignes à l'éclosion du mouvement bolchevik octobriste, il y aurait bien des choses à dire, et la discussion, loin d'être close là dessus, ne fait au contraire que commencer, mais elle ne peut avoir lieu et ne peut avoir pour bases que au minimum, le programme révolutionnaire d'octobre et bien entendu, au travers de ce programme, valable pour une époque et toute l'expérience du mouvement ouvrier de ces 30 dernières années.
Le mouvement révolutionnaire qui s'est engagé en 1917 en Russie A PROUVE qu'il était international, de par les répercussions qu'il a eues en Allemagne l'année d'après.
Au début du mois de novembre 1918, les marins allemands se révoltent, les soviets se propagent dans toute l'Allemagne.
Mais quelques jours après, l'armistice était signé, quelques mois après, Noske avait fait son travail de répression, enfin en 1919,,.quand le 1er Congrès de l'I.C s'est tenu, -et quoique le grand mouvement provoqué par la révolution russe-allemande ait secoué le prolétariat encore pendant de longues années,- le point culminant de la révolution était déjà dépassé, la bourgeoisie s'était ressaisie, la paix retrouvée émoussait la lutte de classe peu à peu, le prolétariat refluait idéologiquement au fur et à mesure que la révolution allemande était brisée par morceaux. L'échec de la révolution allemande avait laissé la Russie isolée, devant poursuivre son organisation économique et attendre une nouvelle vague révolutionnaire.
Mais l'histoire est ainsi faite qu'un mouvement ouvrier ne peut être victorieux par étapes. La Révolution russe n'étant qu'une victoire partielle, le résultat final du mouvement qu'elle a déchaîné ayant été une défaite à l'échelle internationale, la "soi-disant" construction du "socialisme" en Russie devait surtout être l'image de cette défaite du mouvement ouvrier international.
L'I.C tenant ses congrès à Moscou montrait déjà que la révolution était stoppée, le reflet de cette défaite se traduit, dans l'étude des congrès, qui marquent à chaque nouveau congrès, un nouveau recul du mouvement ouvrier international, sur le plan théorique à Moscou, physiquement à Berlin.
De nouveau, les révolutionnaires se trouvaient mis en minorité puis exclus. L'Internationale Communiste, après la IIème et la 1ère, les partis communistes après tant d'autres partis "socialistes", "ouvriers" et autres, voyaient leur idéologie embourgeoisée peu à peu.
Mais à côté de ce recul du mouvement ouvrier, deux phénomènes marquant se produisent, un parti ouvrier dégénéré gardait le pouvoir d'un Etat pour lui seul et le capitalisme dans une nouvelle ère, se trouvait entré en 1914 et, par la suite replongé, au fur et à mesure du recul du mouvement ouvrier, dans des crises internes à un degré bien plus élevé qu'auparavant.
C'est pensons nous, l'analyse de ces deux phénomènes que seule la Fraction Italienne de la G.C (en publiant "Bilan", dont le nom seul est tout un programme, de 1933 à 1938), a su dégager d'une façon claire, et qui aurait du permettre de donner naissance à un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire.
c) Devant cette dégénérescence du mouvement ouvrier, devant l'évolution du capitalisme moderne, devant l'Etat stalinien russe, devant les problèmes qui se sont posés aux insurrections de soviets, il y a une troisième position qui consiste à ne pas se fatiguer dans une recherche trop approfondie des pourquoi et des comment HISTORIQUES ET POLITIQUES de ces 30 dernières années, et à tout mettre sur le dos d'une "tête de turc". Les uns choisissent comme "tête de turc" Staline, et font de 1'antistalinisme qui les conduit à la participation à la guerre dans le camp américain "démocratique" ; d'autres choisissent un "dada" quelconque. Le "dada" varie selon les besoins de la mode politique. En 1938-42, la mode était de mettre sur le dos du fascisme la guerre et la dégénérescence de la société dues au maintien du système capitaliste dans son ensemble. Aujourd'hui c'est le stalinisme qui sert de "tête de turc". Alors les théories et les théoriciens fleurissent : Burnham, contre la bureaucratie, Bettelheim pour, etc.. Sartre et la "liberté" et toute la clique des écrivains salariés des partis politiques de la bourgeoisie et du journalisme moderne pourri d'arrivistes. Dans le tableau, l'accusation de Harper contre le "léninisme", dont le "stalinisme serait le produit fatal", n'est qu'une pièce à conviction de plus et une surenchère.
Dans une heure ou le "marxisme" subit sa plus grande crise (espérons seulement que c'est une crise de croissance), Harper ne fait que mettre un peu plus de confusion là où il y en a déjà de trop.
Quand Harper affirme :
".., Mais non, on ne trouve rien chez Lénine qui indiquerait que les idées sont déterminées par la classe. Les divergences théoriques chez lui planent dans l'air. Bien entendu,une opinion théorique ne peut être critiquée qu'à l'aide d'arguments théoriques. Mais quand les conséquences sociales sont mises au premier plan avec une telle violence, on ne devrait pas laisser dans l'ombre l'origine sociale des conceptions théoriques. Ce coté essentiel du marxisme, visiblement, n'existe pas chez Lénine. . "
("Lénine als philosophe" -Harper La science de la nature -Lénine-)
Il va ici plus loin que la simple confusion, plus loin que ne pourrait l'être, entraîné par la polémique, un excès de langage. Harper est un de ces nombreux marxistes qui ont vu dans le marxisme l'affirmation plus d'une méthode philosophique et scientifique en théorie, mais qui restent dans le ciel astronomique de la théorie sans jamais l'appliquer à la pratique historique du mouvement ouvrier. Pour ces "marxistes" la "praxis" est encore un objet de philosophie, pas encore un sujet agissant.
N'y a-t-il pas une philosophie à tirer de cette période révolutionnaire ?
Si certainement. Je dirai même que pour un marxiste, on ne peut tirer de philosophie que d'un mouvement de l'histoire, pour en tirer les leçons pour la suite du mouvement historique. Or, que fait Harper ? il philosophe sur la philosophie de Lénine en l’enlevant de son contexte historique. S’il n’y avait que cela, il aurait été amené seulement à exprimer une demi-vérité. Mais voilà qu’il veut appliquer cette conclusion, cette demi-vérité, à un contexte historique qu’il ne s’est même pas donné la peine d’examiner. Là il nous fournit la preuve qu’il n’a pas fait mieux, sinon pire que Lénine dans « Matérialisme et Empiriocriticisme ». Il a parlé du marxisme, et la montré dans sa position par rapport au problème de la connaissance. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce que Harper a dit ; il y a surtout à dire que l’aspect principal de la position du problème de la PRAXIS et de la connaissance, pour un marxisme, ne se fait pas en dehors de l’aspect politique immédiat que revêt la « praxis » véritable révolutionnaire, c'est-à-dire le développement du mouvement de la pensée et de l’action révolutionnaire !!! Or Harper répète comme une litanie : « Lénine n’était pas un marxiste !!! Il n’a rien compris à la lutte de classe !!! », et il s’avère que, point par point Lénine suit les enseignements de Marx, dans le développement de sa pensée politique révolutionnaire pratique.
La preuve que Lénine a compris et appliqué à la révolution russe les enseignements du marxisme, est contenue dans la « préface » de Lénine au « lettres de Marx à Kugelmann », où il a puisé l’enseignement que Marx a tiré de la commune de Paris ; on trouve encore une curieuse analogie entre les texte de Lénine que nous avons cité et ce passage de Marx, critique du programme de Gotha « I-5 ».
Lénine et Trotski sont en plein dans la ligne du marxisme révolutionnaire. Ils ont suivi ses enseignements pas à pas. La théorie de « Révolution permanente » de Trotski n’est autre que la leçon du Manifeste Communiste et du marxisme en général, son aspect non dégénéré : la révolution russe en reproduit d’ailleurs fidèlement les schémas et obéit à ce marxisme. On a oublié une seule chose, chez Harper comme chez tant d’autres marxiste : la perspective valable pour les révolutions du 19° siècle, pendant la période ascendante du capitalisme, et sur laquelle encore se trouve à cheval la révolution russe, est-elle valable pour la période dégénérescente de cette société ?
Lénine avait bien dégagé la nouvelle perspective en parlant d’une nouvelle période dite « des guerres et des révolutions » ; Rosa avait bien dégagé l’idée que le capitalisme entré dans une époque de dégénérescence, cela n’a pas empêché l’I.C. et à sa suite tout le mouvement ouvrier trotskiste et autre opposition de gauche de resté sur l’ancienne perspective, ou d’y revenir, comme Lénine le fit après l’échec de la révolution allemande. Harper pense bien qu’il y a une nouvelle perspective, mais il prouve par son analyse de Lénine et à travers lui de la révolution russe, qu’il n’a pas su après tant d’autres l’a dégager et qu’il s’est perdu dans des tas de considérations vague ou fausses comme tant d’autres avant lui.
Et ce n’est pas un hasard que se soient les héritiers d’une partie du bagage idéologique de « Bilan » qui lui répondent, comme ils répondent d’ailleurs au « léninistes » pure.
Les « pro » et les « anti » Lénine oublient seulement une chose c’est que si les problèmes d’aujourd’hui ne se comprennent qu’à la lueur de ceux d’hier ils sont cependant différent.
Philippe
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 31 - 4e trimestre 1982
- 2702 reads
Moyen-Orient : la barbarie des impérialismes
- 2557 reads
Le battage sur la tuerie dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth ouest, tuerie et battage menés par la bourgeoisie occidentale, constitue un rappel de plus, s'il en était besoin que la survie des lois du système capitaliste mène le monde à la barbarie. Ce déluge de fer et de sang (subi pendant trois jours par hommes, femmes et enfants), complaisamment étalé pour des besoins de propagande, est un massacre de plus marquant l'agonie d'un système qui fournit quotidiennement son lot de victimes, des accidents du travail aux catastrophes "naturelles", des répressions aux guerres.
Le Moyen-Orient n'a jamais cessé, depuis le début de ce siècle, d'être un champ de bataille des grandes puissances, un terrain privilégié de guerre pour le capitalisme. C'est la guerre que se livrent les deux grands blocs impérialistes qui s'y est poursuivie depuis la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, le bloc occidental, en repoussant son adversaire, le bloc de l'est, accentue sa mainmise sur la région. Il vise à la transformer en un bastion militaire face au bloc russe. La "pax americana" parachève une étape de sa stratégie d'élimination de toute présence significative de l'URSS, consolidant sa position, en partie pour compenser et contrer la déstabilisation de l'Iran et répondre à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. L'invasion du Liban par Israël au cours de l'été 1982 et l'installation de troupes américaines, françaises et italiennes s'inscrivent dans cette stratégie où ce sont les populations qui paient le prix de ce jeu sanglant.
Pourquoi la bourgeoisie occidentale a t-elle monté un battage sur ce massacre des camps de palestiniens ?
Au Liban même, ce genre d'opération s'est déjà souvent produit et ceci d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de combats meurtriers ou de vagues d'assassinats de ce genre qui se déroulent dans le monde ne bénéficient pas d'autant de "faveur". Ce battage revêt en fait essentiellement un double aspect : d'une part, signifier clairement l'impossibilité de tout appel à l'aide du bloc adverse et consacrer la victoire occidentale, et d'autre part, poursuivre les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur les thèmes véhiculant un sentiment d'impuissance et de terreur (comme le pacifisme, l'anti-terrorisme, l'agitation du danger de guerre) et présentant les interventions militaires comme les seules chances d'assurer la paix. La guerre des Iles Malouines était montée de toute pièce principalement dans le but de tester l'impact idéologique d'une expédition militaire d'un grand pays capitaliste ([1] [343]). Avec l'expédition de troupes au Liban, c'est en utilisant un événement dont les racines sont profondément différentes, l'affrontement entre blocs impérialistes, que la propagande bourgeoise poursuit ce même but.
Aux prises avec la crise ouverte qui offre des perspectives de plus en plus catastrophiques, la bourgeoisie n'a d'autre possibilité que de pousser vers sa "solution", la guerre impérialiste généralisée. Mais cette voie est barrée par la classe ouvrière qui n'a pas subi de défaite décisive Malgré l'annihilation relative des luttes surtout après les mouvements de 1980-81 en Pologne, la classe ouvrière n'adhère massivement à aucun des idéaux de la bourgeoisie. C'est ce qui impose à cette dernière la répétition constante de campagnes idéologiques pour occuper tout le terrain, tenter d'enrayer la reprise entamée dans les grands pays à la fin des années 70, empêcher qu'elle ne débouche sur une lutte massive et internationale de la classe ouvrière, la seule force capable d'offrir une alternative à la barbarie du système capitaliste.
La barbarie du capitalisme
Toute l'histoire de l'humanité est jalonnée de massacres, de guerres et de génocides. Le capitalisme, dernière société d'exploitation de l'homme par l'homme, en subsistant depuis plus de 60 ans, après la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution, a poussé cette barbarie jusqu'à faire peser sur l'humanité la menace de sa disparition définitive dans une troisième guerre mondiale général isée.
De toutes les guerres de l'histoire, de l'Antiquité à la guerre de 100 ans, des guerres féodales aux guerres napoléoniennes, celles du 20ème siècle ont laissé des millions de victimes : 20 millions de morts pendant la guerre de 1914-18, 50 millions dans celle de 1939-45, plusieurs dizaines de millions depuis. Et la classe dominante dispose dans ses arsenaux de quoi faire sauter plusieurs fois la planète.
De même, des millions de morts sont tombes sous les coups d'opérations de répression et dans la contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière : en Allemagne en 1917-23 et sous le nazisme, en Russie après l'échec de la révolution de 1917 et sous le stalinisme, en Chine en 1927, en Espagne dans la "guerre civile" de 1936-39, etc. Le nombre de victimes est tel que tous les massacres additionnés depuis la révolte des esclaves de Spartacus jusqu'à la répression des Communards de 1871 ne représentent qu'une faible partie des saignées qu'a du subir l'humanité dans son évolution.
Le capitalisme, en faisant faire un bond gigantesque à l'humanité, a aussi développé jusqu'à un degré jamais égalé l'exploitation. Il a surgi en jetant dans la misère des populations entières, en les dépossédant de leurs anciens moyens de subsistance pour les transformer en prolétaires, ne disposant plus que de leur force de travail. Dans la période ascendante du capitalisme, cette situation constituait un lourd tribut payé à un développement véritable des forces productives. Dans la période de décadence, elle est la conséquence que le capitalisme est devenu incapable de se développer dans le sens d'un accroissement de la satisfaction des besoins humains. Il n'a survécu au contraire que par la destruction.
Les tueries du capitalisme sont la partie visible de l'iceberg. La partie immergée est constituée par la barbarie et l'absurdité quotidiennes de l'exploitation et de l'oppression.Lorsque la bourgeoisie fait campagne sur un massacre, elle le monte en épingle pour s'en servir de paravent ou d'alibi ([2] [344]) pour d'autres massacres, pour justifier un système qui vit dans un cycle infernal de crise-guerre-reconstruction-crise. Ce cycle qui s'est déjà reproduit deux fois au 20ème siècle ne peut aller qu'en s'amplifiant vers la destruction totale de l'humanité si le prolétariat ne détruit pas de fond en comble le capitalisme mondial.
La liste est longue des hauts faits de la terreur du capitalisme. La mise en avant à un moment ou à un autre par la bourgeoisie d'un épisode de cette série noire n'est que l'arbre qui cache la forêt.
Au Liban, la bourgeoisie a tenté un coup double : parachever le"nettoyage" en semant la terreur, feindre l'indignation à des fins de propagande. Avec l'imbroglio impérialiste du Liban, après plusieurs mois de pilonnages et de bombardements intensifs, les lamentations sont de l'hypocrisie. C'est la bourgeoisie mondiale, de l'Ouest à l'Est, en particulier celle des pays "démocratiques", qui porte le sang sur ses mains.
Ce sont tous les Etats capitalistes -et tous les Etats du monde sont capitalistes, y compris les Etats "potentiels" comme celui de l'OLP- avec leurs organismes, leurs partis et leurs syndicats qui sont les garants de l'ordre bourgeois et de la défense de la patrie, qui sont les responsables des massacres. Au Liban, Reagan, Castro, Thatcher, Mitterrand et Brejnev, tous y sont allés de leur larme sur une tuerie commise en un lieu où près de onze armées d'occupation sont présentes. Le thème de "personne n'a rien pu faire" est destiné à prêcher la passivité et à introduire l'idée que "la seule chose à faire " est de ramener en beauté les armées des Etats-Unis, de la France et de l'Italie, "pour la sécurité". Et tel était effectivement le but de l'opération,
Conflits inter-impérialistes et campagne idéologiques
De par sa situation géographique, voie de passage entre Europe, Asie et Afrique, et ses ressources pétrolières, le Moyen-Orient a toujours été un des enjeux stratégiques au coeur des guerres du 20ème siècle, un "théâtre d'opération" comme le disent les stratèges de la bourgeoisie. C'est le capitalisme mondial qui a façonné le Moyen-Orient en une constellation d'Etats, par les traités internationaux et les armées des grands Etats capitalistes.
Après la domination turque au début de ce siècle, la domination franco-anglaise entre les deux guerres, et la domination anglo-américaine à la fin de la 2ème guerre (Conférence de Téhéran et Traité de Yalta), le Moyen-Orient est en voie de repasser aujourd'hui tout entier sous l'hégémonie occidentale, après avoir été disputé par le bloc russe pendant plus de vingt ans.
Depuis une dizaine d'années, on assiste à un renversement systématique des positions que l'URSS avait péniblement acquise dans les années 50. C'est d'abord le retour de l'Egypte dans le camp américain après la guerre Israélo-égyptienne de 1973. Des 1974, le retrait américain du Viêt-Nam, outre qu'il correspondait à un marchandage avec la Chine, marquait aussi une accentuation de l'offensive diplomatique et militaire américaine au Moyen-Orient. C'était la stratégie des "petits pas" de Kissinger, qui avait ouvert des pourparlers avec toutes les parties en présence, et dont un des aboutissements devait être les accords de Camp David entre Israël et l'Egypte. Une fois le front égyptien neutralisé sous contrôle américain, avec le retrait d'Israël du Sinaï, c'est vers le nord (Syrie, Irak, Liban) que l'offensive s'est poursuivie :
- mise au pas de l'Irak ;
- immobilisation de la Syrie par les manipulations sur le plan intérieur, en particulier des "Frères Musulmans", l'intimidation militaire et l'aide financière considérable de l'Arabie ([3] [345]) ;
- jusqu'à la neutralisation de toute influence prorusse au sein de l'OLP, avec le ralliement de celle-ci aux plans occidentaux, et la dispersion de son appareil militaire dans différents pays.
Cette dernière évolution se dessinait aussi depuis plusieurs années déjà, avec le discours d'Arafat à l'ONU en 1976 qui marquait officieusement le début du passage de l'OLP sous le contrôle de la diplomatie occidentale qui est effectif aujourd'hui. Israël a été l'exécuteur sur le terrain, de ce "nettoyage".
Aujourd'hui, la phase qui s'engage du terrain militaire vers le terrain plus "diplomatique" risque de faire perdre à Israël son rôle d'allié privilégié et de place forte militaire unique, et ne se passe pas sans frictions. Il est possible même qu'Israël ait quelque peu outrepassé les objectifs qui lui étaient fixés par l'administration Reagan, ou que cette dernière ait laissé faire. Quoi qu'il en soit, cela n'enlève rien pour autant à la responsabilité américaine dans les massacres. •Au contraire. Dans cette hypothèse, cela ne fait que montrer la perfidie qui consiste à liquider les exécuteurs des basses oeuvres une fois leur tâche accomplie, à fabriquer un bouc émissaire pour se blanchir de son forfait; cela ne fait que révéler quelles sont les méthodes de gangsters de la bourgeoisie dans la défense de ses intérêts.
La bourgeoisie israélienne est de toute façon, contrainte de se plier. Sa force militaire et son pouvoir économique, elle ne les détient que par les bonnes grâces de ses puissants alliés. Comme tous les Etats de la région, l'Etat d'Israël est un pion dans la guerre impérialiste, et sa population comme toutes celles de la région, une victime exploitée, militarisée et embrigadée pour des intérêts qui ne sont pas les siens.
Feindre la réprobation et l'indignation envers l'Etat d'Israël vise plusieurs objectifs pour l'impérialisme américain :
- mener à bien son plan stratégique en reprenant à Israël des privilèges militaires et territoriaux ;
- passer à la phase d'une opération de"nettoyage" à celle de la diplomatie repoussant le front impérialiste vers l'Iran et l'Afghanistan ;
- tenter de blanchir ses responsabilités dans les massacres et aider à ce que la mystification de la défense de la "cause palestinienne" ne perde pas toute crédibilité aux yeux des populations du Moyen-Orient avec le retournement de veste de l'OLP.
C'est la "cause palestinienne" qui a été la justification idéologique de l'embrigadement dans le camp prorusse, faisant miroiter le "retour au pays" aux milliers de réfugiés qui ont servis pendant 40 ans de masse de manoeuvre et de chair à canon; tout comme"l'holocauste des juifs" a servi de "grand alibi" ([4] [346]) à l'idéologie de guerre de l'anti-fascisme puis à l'embrigadement au Moyen-Orient.
La "guerre civile" au Liban n'a rien d’une guerre d'opprimés contre des oppresseur, ou d’une guerre de libération contre l'impérialisme, plus qu'aucune des guerres de ce siècle. Contrairement à ce que proclame la gauche du capital et jusqu'aux bordiguistes, les prolétaires n’ont aucun camp à soutenir ou à rejoindre dans la guerre au Moyen-Orient. La population est encadrée par de multiples milices de tous bords armées par tous les marchands de canons de la planète.
Plus encore que l'Iran où surgirent des luttes ouvrières, qu'Israël où des mouvements contre la hausse des prix et les blocages des salaires se sont produits, que l'Egypte où les ouvriers manifestèrent à plusieurs reprises contre la faim, le Liban où le prolétariat est très faible, constitue, avec cette "guerre civile", un concentré de l'absurdité de la guerre impérialiste. Dans ce sens, si ces événements marquent une victoire du bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est, un renforcement du premier par une collaboration plus étroite en son sein, ils marquent aussi une victoire de la bourgeoisie sur le prolétariat qui nulle part n'a réagi,
La clé se trouve dans les pays développés
La situation ne dépend pas de ce qui se passe au niveau local, mais de ce qui se passe dans les métropoles capitalistes. Le rapport de force ne peut s'établir en faveur du prolétariat qu'au niveau mondial. Si le prolétariat, là où il est le plus fort et le plus concentré reste paralysé et subit les attaques de la bourgeoisie sans réagir, alors la voie sera ouverte pour la poursuite et la poussée à un niveau supérieur de la guerre capitaliste.
Après plus de dix années de crise ouverte du capitalisme, ce qui a fait que la guerre ne s'est pas généralisée, c'est la reprise de la lutte de classe depuis la fin des années 60 dans les pays développés et dans le monde entier. La nouvelle poussée des luttes de la fin des années 70, après une période de reflux, a également ressurgi dans les principaux pays développés (USA, Allemagne, France, Grande-Bretagne). Elle a culminé en Pologne où la classe ouvrière mondiale s'est engagée dans la grève de masse et a posé la question de l'internationalisation des luttes ouvrières ([5] [347]), et mis en évidence l'importance décisive du développement de la lutte de classe dans les pays industrialisés et en Europe de l'Ouest en particulier ([6] [348]).
L'obstacle que constitue la classe ouvrière à la perpétuation de son système, la bourgeoisie l'a ressenti. Elle s'est unifiée au niveau mondial pour faire face au mouvement de Pologne. Toute sa propagande est plus destinée à abasourdir le prolétariat qu'à trouver des alibis aujourd'hui introuvables à un embrigadement dans la guerre face au bloc russe, bloc impérialiste historiquement plus faible, encore affaibli par la crise économique et menacé par la combativité prolétarienne.
"Le renforcement des blocs, qui constitue une pré condition pour la guerre contre le bloc rival, est aujourd'hui également une préparation immédiate et directe pour affronter le prolétariat où qu'il soit, s'il met en cause la domination du capital" ([7] [349]).
Avec les événements du Liban, la propagande s'est déchaînée pour imposer un sentiment de terreur et de fatalité d'une part, pour renforcer le mensonge du capitalisme "démocratique", "humain" "pacificateur". Le but est pour l'impérialisme de tirer profit d’une de ses victoires militaires en 1'utilisant contre le prolétariat, en le perdant dans le dédale de la recherche du coupable", alors que le seul coupable c'est le capital et tous ses agents.
C'est au prolétariat mondial qu'il appartient, en engageant la lutte internationalement, de répondre à l'offensive de la bourgeoisie. Seule la classe ouvrière est la force capable, en mettant fin au capitalisme, d'en terminer à jamais avec toutes les formes de la barbarie.
MG.
[1] [350] Voir la Revue Internationale n° 30 : "La guerre des Malouines [351]".
[2] [352] Lire sur cette question "Auschwitz ou le grand alibi" (PCI) sur la justification de l’"antifascisme".
[3] [353] Lors des combats aériens, la Syrie a perdu 86 de ses avions contre 0 à Israël.
[4] [354] Lire sur cette question "Auschwitz ou le grand alibi" (PCI) sur la justification de l’"antifascisme".
[5] [355] Voir les n° 23 à 29 [356] de la Revue Internationale sur les enseignements de la lutte de classe en Pologne.
[6] [357] Lire dans ce n° l'article p.5.
[7] [358] "Rapport sur la crise et les conflits inter-impérialistes [359]" au 4ème Congrès du CCI, Revue Internationale n° 26.
Géographique:
- Moyen Orient [10]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [360]
Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie
- 3505 reads
Les deux articles qui suivent sont le produit de discussions qui ont animé le CCI ; ils visent notamment à resituer le niveau de conscience et la capacité de manœuvre de la bourgeoisie dans la période de décadence. Ce débat est lié à un autre, sur le machiavélisme de la bourgeoisie, sur lequel s'est cristallisée entre autre la "tendance" qui s'est formée et a quitté le CCI durant l'hiver 1981[1] [361].Cette tendance plutôt informelle a éclaté en plusieurs groupes en quittant le CCI : "L'ouvrier internationaliste" en France qui a disparu depuis, "News of war and révolution" et "The bulletin" en Grande-Bretagne qui portent tous la même critique au CCI ; celui-ci aurait une vision machiavélique de la bourgeoisie et policière de l'histoire. De même, dans le milieu politique des groupes tels que "Volonté communiste" ou "Guerre de classe"[2] [362] en France accusent le CCI de surestimer la conscience de la bourgeoisie.
Mais cette discussion ne pose pas seulement la question concrète de comment la bourgeoisie manœuvre dans la période de décadence ; elle pose la question plus générale de ce qu'EST la bourgeoisie, et de ce que cela IMPLIQUE pour le prolétariat.
Pourquoi la bourgeoisie est machiavélique
Voyons d'abord qui était Machiavel ; cela permettra de comprendre ce qu'est le machiavélisme, de voir de quoi il est effectivement question.
Il ne s'agit pas ici de faire une analyse exhaustive de l'œuvre de Machiavel et de son temps, mais de comprendre ce qu'il apporte du point de vue de l'idéologie bourgeoise en construction.
Machiavel est un homme d'Etat florentin, de l'époque de la Renaissance, essentiellement connu pour son oeuvre principale Le Prince. Bien sûr, Machiavel comme tout homme est borné par les limites de son temps, et sa compréhension est conditionnée par les rapports de production de son époque, marquée par la décadence du féodalisme. Mais précisément, son temps est aussi celui d'une nouvelle classe qui vient postuler pour le pouvoir : la bourgeoisie qui commence à assurer sa domination sur l'économie, classe révolutionnaire de l'époque qui aspire à la domination politique de la société. Le Prince de Machiavel n'est pas seulement une peinture fidèle du temps où il a été écrit, un reflet de la perversité et de la duplicité des gouvernements du XVI/XVII° siècle. Machiavel a d'abord compris la "vérité effective" de la politique des Etats de son époque : peu importent les moyens ; l'essentiel est le but, conquérir et conserver le pouvoir. Son souci est avant tout d'enseigner aux princes de son époque comment conserver le domaine conquis, comment ne pas s'en trouver dépossédé par quiconque. Machiavel est le premier à séparer la morale de la politique, c'est à dire la religion de la politique. Il se place du point de vue "technique". En effet, le prince ne gouverne pas son cheval pour le bien de ce dernier. Mais durant la féodalité, le prince n'a pas bien compris la raison d'Etat, et c'est ce que Machiavel se propose de lui enseigner. Machiavel ne nous révèle rien en disant que les princes doivent mentir pour gagner, et aussi lorsqu'il constate qu'ils tiennent rarement parole en politique : tout ceci, on le sait déjà depuis Socrate. La vie des princes, leur cynisme et leur peu de foi conditionnent le pouvoir grossier qu'ils détiennent déjà. Ayant assimilé le cynisme, il ne reste à Machiavel qu'à remettre en cause la foi, et c'est ce qu'il fait en remettant en cause la morale et son support : la religion. Peu importent les moyens pour la raison d'Etat. Ainsi, en rejetant tout préjugé d'ordre moral pour l'exercice du pouvoir, Machiavel justifie l'emploi de la coercition et opère le rejet de la religion pour la domination d'une minorité d'hommes sur une majorité de leurs semblables.
C'est pour cela qu'il est le premier idéologue politique de la bourgeoisie ; il émancipe la politique de la religion. Pour lui, comme pour la classe montante, le mode de domination peut être athée tout en se servant de la religion. Si l'histoire antérieure du Moyen Age ne connaissait pas d'autre forme idéologique que la religion, la bourgeoisie va cristalliser peu à peu son idéologie propre en se débarrassant de la religion, tout en la conservant accessoirement. En détruisant le lien entre politique et morale, entre politique et religion, Machiavel détruit l'idée féodale du pouvoir de droit divin ; il fait le lit de la bourgeoisie.
En fait, les princes à qui Machiavel enseigne, ce sont les "princes de la bourgeoisie", future classe dominante, car les princes féodaux ne peuvent entendre son message sans détruire du même coup les bases de domination du système féodal. Machiavel exprime le point de vue révolutionnaire à l'époque, de sa classe : la bourgeoisie.
Même dans ses limites, la pensée de Machiavel n'exprime pas seulement les limites de son époque, mais les limites de sa classe. Lorsqu'il pose la "vérité effective" comme une vérité éternelle, ce n'est pas tant l'illusion de son époque qu'il exprime que l'illusion de la bourgeoisie qui, comme toutes les classes dominantes qui l'ont précédée dans l'histoire, est aussi une classe exploiteuse. Machiavel pose explicitement ce qui a été implicite pour toutes les classes dominantes et exploiteuses dans l'histoire. Le mensonge, la terreur, la coercition, le chantage, la corruption, le complot et l'assassinat politiques ne sont pas des moyens de gouvernement nouveaux ; toute l'histoire de l'antiquité comme celle de la féodalité le démontrent abondamment. Comme les patriciens de la Rome antique, comme l'aristocratie féodale, la bourgeoisie, elle aussi classe exploiteuse ne fait pas exception à la règle si ce n'est que patriciens et aristocrates "faisaient du machiavélisme sans le savoir" alors que la bourgeoisie est machiavélique et le sait. Elle en fait aussi une "vérité éternelle" parce qu'elle se vit comme éternelle, parce qu'elle suppose l'exploitation comme éternelle.
Comme toutes les classes exploiteuses, la bourgeoisie est aussi une classe aliénée. Parce que son chemin historique la mène vers le néant, elle ne peut en avoir conscience, elle ne peut admettre consciemment ses limites historiques.
Contrairement au prolétariat qui, comme classe exploitée et classe révolutionnaire dans la période présente est poussée vers l'objectivité révolutionnaire, la bourgeoisie est prisonnière de sa subjectivité de classe exploiteuse. La différence entre la conscience de classe révolutionnaire du prolétariat et la "conscience" de classe exploiteuse de la bourgeoisie n'est donc pas seulement une question de degré, de quantité, c'est une différence qualitative.
La vision du monde de la bourgeoisie porte inévitablement les stigmates de sa situation de classe exploiteuse et de classe dominante, qui de plus aujourd'hui, n'exprime plus rien de révolutionnaire, de progressiste pour l'ensemble de l'humanité depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Elle exprime obligatoirement au niveau de son idéologie, la réalité du mode de production capitaliste, basé sur la recherche effrénée du profit, sur la concurrence de plus en plus exacerbée, sur une exploitation effrénée.
Comme toute classe exploiteuse, la bourgeoisie ne peut, malgré toutes ses prétentions, que trahir dans la pratique son mépris absolu pour la vie humaine. La bourgeoisie a d'abord été une classe de commerçants pour qui "les affaires sont les affaires", pour qui "l'argent n'a pas d'odeur". Machiavel ne fait rien d'autre que de traduire dans la séparation entre "politique" et "morale", la séparation que la bourgeoisie fait entre "affaires" et "morale". Dans ces conditions, pour la bourgeoisie, la vie humaine n'a d'importance qu'en tant que marchandise, que valeur d'échange.
Cette réalité, la bourgeoisie ne l'exprime pas seulement dans son rapport global aux classes exploitées et notamment à la principale, la classe ouvrière, mais en son sein même, dans son être, dans sa manière d'exister. Expression d'un mode de production basé sur la concurrence, toute sa vision ne peut être que celle d'une rivalité qui va se traduire par la rivalité de tous les individus entre eux, c'est à dire au sein même de la bourgeoisie. Parce qu'elle est une classe exploiteuse, elle ne peut qu'avoir une vision hiérarchique. Dans sa division, la bourgeoisie ne fait qu'exprimer la réalité d'un monde divisé en classes, c'est à dire où l'exploitation existe.
Depuis qu'elle est classe dominante, la bourgeoisie a toujours appuyé son pouvoir par le mensonge de l'idéologie. La devise de la République française triomphante de 1789 : "Liberté, égalité, fraternité" en est la plus parfaite illustration. Les premiers Etats démocratiques du monde qui s'imposent contre la féodalité en Angleterre, en France, aux Etats Unis n'ont pas hésité, lorsqu'il s'agissait d'étendre leurs conquêtes territoriales et coloniales, à employer sans vergogne les moyens les plus répugnants, et pour augmenter leurs profits, à imposer à la classe ouvrière l'exploitation la plus terrible, la répression la plus féroce.
Cependant, si jusqu'au début du XXè siècle, le pouvoir de la bourgeoisie repose essentiellement sur le pouvoir de son économie triomphante, sur l'expansion tumultueuse des forces productives, sur le fait que réellement par sa lutte, la classe ouvrière peut parvenir à arracher une amélioration de sa situation matérielle, depuis l'entrée du monde capitaliste dans sa période de décadence caractérisée par la tendance à l'écroulement de l'économie, la bourgeoisie voit la base matérielle de sa domination sapée par la crise de son économie. Dans ces conditions, les aspects idéologiques et répressifs de sa domination de classe vont devenir essentiels. Le mensonge et la terreur vont devenir les moyens du gouvernement de la bourgeoisie.
Le machiavélisme de la bourgeoisie n'est pas l'expression d'un anachronisme ou une perversion de l'idéal bourgeois de "démocratie", il est conforme à son être, à son existence réelle. Ce n'est pas une "nouveauté" dans l'histoire, c'est une de ses plus sinistres banalités. Si toutes les classes exploiteuses l'ont exprimé à différents niveaux, la bourgeoisie va le porter à un seuil qualitatif jamais atteint auparavant. En faisant éclater le cadre idéologique de la domination féodale : la religion, la bourgeoisie émancipe la politique de la religion, ainsi qu'elle le fait du juridique, des sciences et de l'art. Elle en fait un instrument conscient de sa domination. C'est sur ce plan que résident à la fois l'avancée et les limites de la bourgeoisie.
Ce n'est pas le CCI qui a une vision machiavélique de la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie qui, par définition, est machiavélique. Ce n'est pas le CCI qui a une vision conspirative et policière de l'histoire, c'est la bourgeoisie. Cette vision, elle n'arrête pas de l'étaler à toutes les pages de ses livres d'histoire, exaltant les individus, s'étalant sur les complots, sur les aspects superficiels des rivalités de cliques sans réellement voir les déterminations profondes, déterminantes dont ces épi phénomènes ne sont que l'écume de la vague.
Finalement, pour les révolutionnaires, constater que la bourgeoisie est machiavélique est relativement secondaire et banal. Ce qui est l'essentiel est d'en tirer les implications pour la lutte du prolétariat.
Toute l'histoire de la bourgeoisie montre son intelligence manoeuvrière et particulièrement la période de décadence, martelée par deux guerres mondiales où la bourgeoisie a montré qu'elle ne reculait devant aucune barbarie, aucun mensonge[3] [363].
Croire qu'aujourd'hui la bourgeoisie n'est pas capable de développer la même habileté manoeuvrière et le même manque de scrupule qu'elle manifeste dans ses rivalités internes face à son ennemi de classe historique, le prolétariat, conduit à une profonde sous-estimation de l’ennemi que la classe ouvrière doit affronter.
Les exemples historiques de la Commune de Paris et de la Révolution Russe montrent déjà que face au prolétariat, la bourgeoisie peut mettre ses antagonismes les plus forts, ceux qui la poussent à la guerre, sous le boisseau pour s'unir face à la classe capable de la détruire.
Mais surtout, la classe ouvrière qui pour la première fois dans l'histoire est à la fois classe révolutionnaire et classe exploitée, ne peut s'appuyer sur aucune force économique pour réaliser sa révolution politique. Sa conscience est sa force essentielle. Cela, la bourgeoisie l'a bien compris : "Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser" disait déjà Machiavel ; cela est on ne peut plus vrai aujourd'hui.
Parce que la terreur ne peut seule suffire, toute la propagande bourgeoise n'a pas d'autre rôle que de maintenir le prolétariat dans les chaînes de l'exploitation, de l'embrigader pour des intérêts qui lui sont étrangers, d'entraver le développement de sa conscience de la nécessité et de la possibilité de la révolution communiste.
Si la bourgeoisie aujourd'hui entretient à grands frais tout un appareil politique d'encadrement et de mystifications du prolétariat (parlement, partis, syndicats, associations diverses, etc.), instaure un contrôle absolu sur tous les médias (presse, radio, T.V.), c'est bien parce que la propagande -le mensonge- est une arme essentielle de la bourgeoisie. Pour alimenter cette propagande, la bourgeoisie n'hésite pas à provoquer l'évènement au besoin.
Ne pas voir cela revient à rejoindre le camp des idéologues que Marx raillait en écrivant : "Tandis que, dans la vie quotidienne, tout shopkeeper, tout boutiquier sait fort bien distinguer entre ce qu 'un individu prétend être et ce qu 'il est en réalité, notre historiographie n 'est pas encore parvenue à ce savoir banal. Elle croit sur parole tout ce que chaque époque affirme et s 'imagine à son propre sujet". Cela revient à ne pas voir la bourgeoisie parce qu'on n'est pas à même de comprendre ses manoeuvres et leur ampleur, parce qu'on n'en croit pas la bourgeoisie capable.
Pour ne citer que deux exemples, particulièrement illustratifs, prenons :
- les campagnes anti-terroristes internationales dont le but est de créer un climat d'insécurité afin de polariser l'attention du prolétariat et de lui imposer un contrôle policier renforcé et toujours plus sévère. La bourgeoisie n'a pas seulement utilisé les actes désespérés d'une petite-bourgeoisie égarée, mais devant l'intérêt de telles campagnes, n'a pas hésité à provoquer l'évènement, a fomenter et organiser des attentats terroristes meurtriers afin d'alimenter sa propagande. Depuis longtemps, la bourgeoisie a compris le rôle essentiel de la gauche pour contrôler les ouvriers. Faire croire que les PC, les PS, les gauchistes, les syndicats défendent les intérêts de la classe ouvrière est une des tâches essentielles de la propagande capitaliste. C'est le mensonge qui pèse le plus lourdement sur la conscience du prolétariat.
Là est le machiavélisme de la bourgeoisie face au prolétariat. C'est simplement la manière d'être et d'agir de la bourgeoisie, rien de nouveau en soi dans tout cela. Dénoncer la bourgeoisie, c'est avant tout dénoncer ses manœuvres, ses mensonges, c'est le rôle des révolutionnaires.
La question de l'efficacité de la bourgeoisie dans ses manœuvres et sa propagande face au prolétariat est une autre question. La bourgeoisie, dans les secrets de ses ministères, peut préparer les complots, les manœuvres les plus habiles, leur réussite dépend de facteurs autres et notamment de la conscience du prolétariat. Le meilleur moyen de renforcer cette conscience est pour la classe ouvrière de rompre avec toutes les illusions qu'elle peut avoir sur ses ennemis de classe et sur leurs manœuvres.
Le prolétariat a devant lui une classe de gangsters sans scrupules qui ne recule et ne reculera devant aucune manœuvre pour le maintien dans les fers de l'exploitation capitaliste. Cela, il doit le savoir.
J. J.[1] [364] Lire "Crise du milieu révolutionnaire", Revue Internationale n°28.
[2] [365] News of War and Révolution", 70 High Street, Leicester, Grande-Bretagne.
"The Bulletin", Ingram, 580 George St. Aberdeen, Scotland, Grande-Bretaqne.
"Révolution Sociale", BP 30316 75767 Paris Cedex 16, France.
"Guerre de Classe" c/o Parallèles 47 rue St Honoré 75001 Paris, France.
[3] [366] Les scandales épisodiques qui remontent à la surface comme les gaz nauséeux du marais, viennent montrer le répugnant état de décomposition de cette classe machiavélique qu'est la bourgeoisie. Affaire Lockheed qui montre la corruption réelle du commerce international ; affaire de la Loge P2 en Italie qui illustre à souhait le fonctionnement occulte de la bourgeoisie au sein de l'Etat, loin de tout principe "démocratique" ; affaire De Broglie où un ancien ministre influent apparaît tout d'un coup à la croisée de trafic de fausse monnaie, d'armes, et d'escroquerie financière internationale ; affaire Matesa en Espagne, la liste serait longue qui trahit le manque de scrupules de cette classe de gangsters qu'est la bourgeoisie. La scène de la politique internationale de la bourgeoisie est riche d'assassinats politiques, de Sadate à Béchir Gemayel, de complots, de coups d'Etat fomentés à l'aide des services secrets d'une des fractions dominantes de la bourgeoisie mondiale.
Questions théoriques:
- Aliénation [367]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [368]
Notes sur la conscience de la bourgeoisie décadente
- 3825 reads
1. Le prolétariat est la première classe révolutionnaire dans l'histoire qui n'a pas de pouvoir économique au sein de l'ancienne société, le prolétariat n'est pas une classe exploiteuse. Sa conscience, la conscience de soi, est donc d'une importance cruciale pour le succès de sa révolution, alors que pour les précédentes classes révolutionnaires, la conscience était un facteur secondaire, ou même négligeable pour la construction d'un pouvoir économique antérieur à la prise du pouvoir politique.
Pour la bourgeoisie, dernière classe exploiteuse dans l'histoire, la tendance vers un développement d'une conscience de classe a été poussée beaucoup plus loin que pour les classes qui l'ont précédée, car elle avait besoin d'une victoire théorique et idéologique pour cimenter son triomphe sur l'ancien ordre social. La conscience de la bourgeoisie a été poussée par deux facteurs-clés :
- par le bouleversement constant des forces productives, le système capitaliste est toujours plus étendu et en créant le marché mondial, il a porté le monde à un niveau jamais atteint d'interrelations ;
- dès les premiers jours du système capitaliste, la bourgeoisie a eu à faire face à la menace de la classe destinée à être son fossoyeur : le prolétariat.
Le premier facteur a poussé la bourgeoisie et ses théoriciens à développer une vision du monde alors que son système socio-économique était dans une phase d'ascendance, c'est à dire alors qu'il était encore basé sur un mode de production progressiste. Le second facteur a constamment rappelé à la bourgeoisie que, comme classe, quels que soient les conflits d'intérêts entre ses membres, elle devait s'unifier pour la défense de son ordre social contre les luttes du prolétariat. Quelle que soit l'avance dans la conscience qu'a représentée la bourgeoisie par rapport aux classes dominantes qui l'ont précédée, la vision du monde de celle-ci était inévitablement tronquée par le fait que sa position de classe exploiteuse dans la société lui masquait la nature transitoire de son système.
2. L'unité fondamentale de l'organisation sociale au sein du capitalisme a été l'Etat-nation. Et dans les limites de l'Etat-nation, la bourgeoisie a organisé sa vie politique d'une façon compatible avec sa vie économique. Classiquement, la vie politique était organisée à travers des partis qui s'affrontaient les uns, les autres dans l'arène parlementaire.
Ces partis politiques, reflétaient au premier chef les conflits d'intérêts entre différentes branches du capital au sein de l'Etat-nation. Dès la confrontation des partis dans cette arène, les moyens de gouvernement étaient créés pour contrôler et diriger l'appareil d'Etat qui orientait alors la société vers les buts décidés par la bourgeoisie. Dans ce mode de fonctionnement, on pouvait voir la capacité de la bourgeoisie à déléguer son pouvoir politique à une minorité d'elle-même. (On peut remarquer que cette organisation "classique" de la vie politique bourgeoise, selon le schéma parlementaire n'était pas un schéma d'application universelle, mais une tendance pendant la période ascendante du capitalisme. Les formes réelles variaient selon les différents pays en fonction de facteurs tels que : la rapidité du développement capitaliste; la capacité à résoudre les conflits avec l'ancien ordre social dominant; l'organisation concrète de l'appareil d'Etat; les pressions imposées par la lutte du prolétariat, etc..).
3. Le passage du système capitaliste dans sa période de décadence a été rapide, car le développement accéléré de la production capitaliste s'est violemment heurté à la capacité du monde à l'absorber. En d'autres termes, les rapports de production ont imposé de manière brutale leurs entraves sur les forces productives. Les conséquences apparurent très rapidement dans les événements mondiaux de la deuxième décade de ce siècle : en 1914, lorsque la bourgeoisie a démontré ce que signifiait l'époque de l'impérialisme; en 1917, lorsque le prolétariat a montré qu'il pouvait avancer sa solution historique pour l'humanité.
La leçon de 1917 n'a pas été perdue par la bourgeoisie. A l'échelle mondiale, la classe dominante a su comprendre que sa première priorité dans cette période est de défendre son système social contre le soulèvement du prolétariat. Elle tend donc à s'unir face à cette menace.
4. La décadence est l'époque de la crise historique du système capitaliste. De manière permanente, la bourgeoisie doit faire face aux principales caractéristiques de la période: le cycle de crise-guerre-reconstruction, et la menace contre l'ordre social que constitue le prolétariat. En réponse, trois développements profonds se sont produits dans l'organisation du système capitaliste:
- le capitalisme d'Etat;
- le totalitarisme ;
- la constitution de blocs impérialistes.
5. Le développement du capitalisme d'Etat constitue le mécanisme par lequel la bourgeoisie a organisé son économie au sein de chaque nation pour affronter une crise qui s'approfondit sans cesse pendant la période de décadence. Mais si le capitalisme d'Etat est en premier lieu la réponse à la crise au niveau de la production, ce processus d'étatisation ne s'arrête pas là. De plus en plus, d'autres institutions ont été absorbées par la voracité de la machine étatique pour en devenir des instruments, et là où elles n'existaient pas, elles ont été créées. L'appareil d'Etat s'est aussi immiscé dans tous les aspects de la vie sociale. Dans ce contexte, l'intégration des syndicats dans l'Etat a été de la plus grande nécessité et a acquis la plus haute signification. Non seulement, ils existent dans la période décadente pour faire en sorte que la production continue, mais encore, en tant qu'encadreurs du prolétariat, ils sont devenus des agents importants de la militarisation de la société.
Les différences et les antagonismes au sein de la bourgeoisie ne disparaissent pas dans chaque capital national pendant la période de décadence, mais ils sont l'objet d'une mutation considérable à cause du pouvoir de l'Etat. En somme, les antagonismes au sein de la bourgeoisie à l'échelle nationale ne se sont atténués que pour réapparaître dans une concurrence encore plus acharnée entre les nations à l'échelle internationale.
6. L'une des conséquences du capitalisme d'Etat est que le pouvoir dans la société bourgeoise tend à passer des mains du législatif à l'appareil exécutif de l'Etat. Ceci a une profonde conséquence sur la vie politique de la bourgeoisie puisque cette vie a lieu dans le cadre de l'Etat. Dans la période de décadence, la tendance dominante dans la vie politique bourgeoise est au totalitarisme, tout comme elle est à l'étatisation dans sa vie économique.
Les partis politiques ne sont plus l'émanation des divers groupes d'intérêts comme ils l'étaient au 19ème siècle. Ils deviennent des expressions du capital d'Etat envers des secteurs spécifiques de la société. En un sens, on peut dire que les partis politiques de la bourgeoisie dans n'importe quel pays, ne sont que des fractions du parti totalitaire étatique. Dans certains pays, l'existence d'un parti unique étatique se voit très clairement comme en URSS. Cependant, dans les "démocraties", ce n'est qu'à certains moments qu'on peut voir exister clairement un seul parti étatique. Par exemple :
- le pouvoir de Roosevelt et du Parti Démocrate aux USA à la fin des années 30 et pendant la seconde guerre mondiale ;
- "l'état d'exception" en Grande-Bretagne pendant la seconde guerre mondiale et la création du Cabinet de Guerre.
7. Dans le contexte du capitalisme d'Etat, les différences qui séparent les partis bourgeois ne sont rien en comparaison de ce qu'ils ont en commun. Tous partent d'une prémisse générale selon laquelle les intérêts du capital national sont supérieurs à tous les autres. Cette prémisse fait que les différentes fractions du capital national sont capables de travailler très étroitement ensemble, surtout derrière les portes fermées des commissions parlementaires et aux plus hauts échelons de l'appareil d'Etat. En réalité, ce n'est qu'un petit bout des débats de la bourgeoisie qui se montre au parlement. Et les membres du parlement, sont en fait, devenus des fonctionnaires d'Etat.
8. Néanmoins, dans toutes les nations, il existe des divergences au sein de la bourgeoisie. Mais il est très important de distinguer parmi elles :
- celles qui constituent des divergences d'orientation réelles: ces différentes fractions du capital national peuvent à un moment donné ne pas voir un des aspects de l'intérêt national, comme par exemple ce qui divisa le Parti Conservateur et Travailliste dans les années 40 et 50 sur ce qu'il fallait faire de l'Empire britannique. La question de l'appartenance à un bloc impérialiste est également une divergence possible, comme on le voit très souvent dans les pays du Tiers-Monde dans les guerres localisées. A de tels moments, de grands schismes peuvent se développer dans l'Etat, et même des blocages importants de son fonctionnement ;
- les divergences qui viennent des pressions sur les différentes parties selon la position et la fonction qu'elles occupent dans la société : il peut ainsi y avoir un accord général sur des orientations, mais un désaccord sur la façon de les mettre à l'oeuvre. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne à propos des efforts de renforcement de l'emprise syndicale sur la classe ouvrière à la fin des années 60 et au début des années 70 ;
- les divergences qui ne sont que des "salades" pour détourner l'attention et mystifier les populations : par exemple, tout le "débat" sur les accords Salt et leur ratification par le Congrès américain au cours de l'été 79 était une opération idéologique qui couvrait le fait que la bourgeoisie avait pris d'importantes décisions concernant les préparatifs d'une troisième guerre mondiale et la stratégie qu'elle voulait mettre en place pour continuer d'aller vers la guerre.
Il y a souvent des aspects de chacune de ces divergences dans les désaccords de la bourgeoisie, surtout au moment des élections.
9. Comme les antagonismes entre les Etats se sont aiguisés tout au long de cette période de la vie du capitalisme, le capital mondial a tendu à pousser les caractéristiques du capitalisme d'Etat à l'échelle internationale, à travers la formation de blocs. Et si la formation des blocs a permis une certaine atténuation des antagonismes entre les Etats membres de chaque bloc, elle n'a fait que porter la rivalité à un niveau supérieur, entre les blocs, clivage final du système capitaliste mondial où toutes les contradictions économiques se trouvent concentrées.
Avec la formation des blocs, les anciennes alliances entre groupes d'Etats capitalistes (d'importance plus ou moins égale) ont été remplacées par deux groupements au sein desquels les capitaux plus faibles sont subordonnés à un capital dominant. Et de même que dans le développement du capitalisme d'Etat, l'appareil d'Etat s'immisce dans tous les aspects de la vie économique et sociale, de même l'organisation du bloc pénètre tout Etat qui en est membre. Deux exemples :
- la création de moyens de régulation de toute l'économie mondiale depuis la dernière guerre mondiale (les accords de Bretton Woods, la Banque Mondiale, le FMI, etc.) ;
- la création d'une structure de commandement militaire dans chaque bloc (OTAN, Pacte de Varsovie).
10. Marx a dit que c'est seulement en temps de crise que la bourgeoisie devient intelligente. C'est vrai, mais comme beaucoup de visions de Marx, il faut le considérer dans le contexte de la nouvelle période historique. La vision d'ensemble de la bourgeoisie s'est considérablement rétrécie avec sa transformation de classe révolutionnaire en classe réactionnaire dans la société. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a plus la vision du monde qu'elle avait au siècle précédent et en ce sens, elle est beaucoup moins intelligente. Mais au niveau de sa propre organisation pour survivre, pour se défendre, la bourgeoisie a montré une capacité immense de développement des techniques de contrôle économique et social bien au delà des rêves de la classe dominante du 19ème siècle. En ce sens, la bourgeoisie est devenue "intelligente" face à la crise historique de son système socio-économique.
Malgré ce que nous venons de mentionner sur les trois évolutions significatives de la vie bourgeoise dans la décadence, il faut réaffirmer les contraintes qui pèsent au départ sur la conscience de la bourgeoisie, son incapacité à avoir une conscience unie ou à comprendre pleinement la nature de son système.
Mais si le développement du capitalisme d'Etat et d'une organisation à l'échelle du bloc n'ont pas pu réaliser l'impossible, ils ont procuré à la bourgeoisie des mécanismes hautement développés qui lui permettent d'agir de manière concertée : la capacité de la bourgeoisie à organiser le fonctionnement de toute l'économie mondiale depuis la seconde guerre mondiale, ce qui lui a permis de prolonger la période de reconstruction et de repousser la réapparition d'une crise ouverte et qui fait que des types de krach comme celui de 1929 n'ont pas recommencé, en est un témoignage. Ces actions étaient toutes basées sur le développement d'une théorie sur les mécanismes et les "imperfections" (comme la bourgeoisie aime les appeler) du mode de production. En d'autres termes, c'est consciemment que la bourgeoisie l'a fait.
La capacité de la bourgeoisie à agir de façon concertée au niveau diplomatique et militaire s'est également manifestée plusieurs fois : les actions, et non des moindres, qui ont eu lieu plusieurs fois au Moyen-Orient depuis 30 ans par exemple.
Cependant, si la bourgeoisie a relativement les mains libres pour agir au niveau purement économique et militaire, là où elle n'a affaire qu'à elle-même, le fonctionnement de l'Etat est plus complexe là où il faut s'occuper des questions sociales car celles-ci comprennent les mouvements des autres classes, en particulier du prolétariat.
11. Par rapport au prolétariat, l'Etat peut utiliser différentes branches de son appareil dans une division du travail cohérente : même dans une seule grève, les ouvriers peuvent avoir à faire face à une combinaison des syndicats, de la propagande et des campagnes de presse et de télévision avec leurs différentes nuances et de celles des différents partis politiques, de la police, des services sociaux, et parfois de l'armée. Comprendre que ces différentes parties de l'Etat agissent de façon concertée ne veut pas dire que chacune d'entre elles est consciente de tout le cadre général au sein duquel elle accomplit ses tâches et sa fonction.
La bourgeoisie n'a pas besoin que toutes ses parties comprennent ce qui se passe. La bourgeoisie peut déléguer ses pouvoirs à une minorité de ses membres. C'est pour cela que l'Etat n'est pas entravé d'une façon significative par le fait que l'ensemble de la classe dominante ne se rende pas compte de tous les aspects de la situation. Il est donc possible de parler de "plans" de la bourgeoisie même si ce n'est qu'une partie de celle-ci qui les fait.
Ceci ne peut fonctionner que par la façon dont les différentes armes se complètent. Les différentes armes de l'Etat ont différentes fonctions, et comme elles sont aux prises avec la partie de la société à laquelle elles correspondent, elles transmettent également aux plus hauts niveaux de l'organisation de l'Etat, les pressions qu'elles subissent, et participent donc à ce qu'il décide et détermine ce qui est possible ou pas.
Au plus haut niveau de l'appareil d'Etat, il est possible, pour ceux qui commandent, d'avoir une sorte de tableau global de la situation et des options qu'il faut prendre de façon réaliste pour y faire face. Tout en disant cela, il est cependant important de noter :
- que ce tableau n'est pas l'expression claire, non mystifiée (une conscience du type de celle que peut avoir le prolétariat) de la situation, mais une approche pragmatique de celle-ci ;
- que celle-ci n'est pas unitaire, mais divisée, c'est à dire que les différentes fractions de la bourgeoisie peuvent ne pas la "partager" ;
- que les inévitables contradictions de la bourgeoisie créent des discordances considérables.
Dans l'appréciation du fonctionnement de tout appareil étatique, il est important de reconnaître les points suivants :
- il faut faire une distinction entre une conscience qui ouvre à la compréhension du système social capitaliste (celle du prolétariat) et celle qui ne se développe que pour défendre ce système (la conscience de la bourgeoisie]; c'est ainsi que l'armée "d'analystes sociaux" qu'utilise l'Etat peut aider à défendre le système social, mais jamais à le comprendre ;
- l'activité de la bourgeoisie n'est pas dominée par les caprices subjectifs des individus ou de parties de la classe dominante mais en réponse aux forces fondamentales qui agissent dans la société à un moment donné.
12. En conséquence, les manœuvres de la bourgeoisie, que cette dernière en soit consciente ou non, sont déterminées, structurées et limitées par et dans le cadre :
- de la période historique (décadence) ;
- de la crise conjoncturelle (ouverte ou non) ;
- du cours historique (vers la guerre ou vers la révolution) ;
- du poids momentané de la lutte de classe (avancée/reflux).
En fonction de l'évolution de la situation, l'importance relative de secteurs-clés de la bourgeoisie se renforce au sein de l'appareil d'Etat, selon que leur rôle et leur orientation deviennent plus clairs. Dans la plupart des pays du monde, ce processus mène automatiquement au gouvernement l'équipe choisie, comme résultat de l'existence du seul parti unique.
Cependant, dans les "démocraties" en général dans les pays les plus forts, le processus de renforcement de certaines fractions de l'appareil d'Etat et le processus de choix des équipes gouvernementales ne sont pas les mêmes. Par exemple, on a vu pendant plusieurs années en Grande-Bretagne se renforcer la gauche dans les syndicats au niveau local de l'appareil d'Etat, alors que le Parti Travailliste perdait le pouvoir politique. La dictature totalitaire de la bourgeoise reste, et par un tour de prestidigitation adroit: la population choisit "librement" ce que les conjurés ont déjà choisi pour elle. Le plus souvent, la ruse marche et les "démocraties" ne maintiennent le mécanisme électoral que parce qu'elles ont appris à le manipuler.
Le "libre choix" de l'équipe dirigeante par l'électorat est conditionné par :
- les programmes que ces partis choisissent de défendre ;
- la propagande de la presse et la télévision ;
- le soutien (ou autre) apporté par des institutions d'importance comme les syndicats et les organismes patronaux, à un parti ou à un autre ;
- l'existence de partis tiers qui agissent comme alternateurs ou comme ciment ;
- la réorientation de certaines parties des programmes électoraux selon les effets sur l'électorat comme le montrent les sondages d'opinion ;
- après les élections, les manoeuvres des différentes composantes de la bourgeoisie pour obtenir ce que les nécessités imposent.
Sans entrer dans les détails, les exemples suivants illustrent des utilisations récentes de ces mécanismes :
- peu avant l'élection présidentielle américaine de 1976, il devint clair qu'une victoire de Carter était en jeu. Ce n'est qu'à ce moment là que l'AFL-CIO décida de soutenir Carter et mobiliser les ouvriers pour voter. Le succès de Carter ne fut assuré que pendant la dernière quinzaine de la campagne ;
- en 1980, l'élection présidentielle de Reagan a été assurée par deux stratagèmes : Kennedy a permis que la nomination de Carter par le Parti Démocrate ne bénéficie pas d'un soutien clair. Anderson a été présenté comme un troisième candidat "sérieux" afin de prendre des votes à Carter tout en lui permettant de trouver les fonds pour faire sa campagne ;
- l'adaptation minutieuse des plateformes électorales en réponse aux résultats des sondages est ouvertement explicitée aux USA par les médias ;
- en Grande-Bretagne, le Lib-Lab Pact (Pacte entre les Libéraux et les Travaillistes) a rendu possible à une minorité travailliste de rester au gouvernement malgré les crises parlementaires;
- grâce au soutien de partis minoritaires aux Conservateurs par un vote de non-confiance aux Travaillistes, il fut possible aux Travaillistes de regagner l'opposition face aux luttes qui surgissent en 1979 ;
- en février 1974, Heath a appelé aux élections en vue d'obtenir un soutien pour briser la grève des mineurs. Cela lui a permis de former un gouvernement avec l'appui des Libéraux. Cependant, tout en reconnaissant le besoin pour le Parti Travailliste d'aller au pouvoir pour contrôler la lutte des ouvriers, les Libéraux ont refusé et ouvert la voie à Wilson et à la période du "Contrat Social".
Ces quelques exemples illustrent les mécanismes dont dispose la bourgeoisie et le fait qu'elle sait les utiliser. Cependant, selon les pays, la bourgeoisie a un appareil plus ou moins flexible. A cet égard, les USA et la Grande-Bretagne disposent probablement de la machine la plus efficace des "démocraties". On peut voir en France, par contre, un exemple d'un appareil relativement moins souple, et dans les élections présidentielles de 1981, les défaillances de la bourgeoisie.
13. On a déjà mentionné le cadre imposé par la période aux manoeuvres de la bourgeoisie. Dans les périodes où la lutte de classe est relativement faible, la bourgeoisie choisit ses équipes dirigeantes en fonction de critères avant tout économique et de politique étrangère. Dans de tels cas, on voit relativement clairement les objectifs que poursuit la bourgeoisie dans ce que fait le gouvernement. Ainsi, dans les années 50, le gouvernement anglais -la fraction Eden du Parti Conservateur- répondait à la nécessité pour la bourgeoisie de défendre l'Empire Britannique contre les assauts américains. Cet effort fut anéanti avec l'affaire de Suez en 1956. L'économie britannique pouvait cependant fonctionner sous l'égide du Parti Conservateur (durant la période de la fraction Macmillan, le Parti Conservateur a mis en oeuvre la plupart des orientations des Travaillistes), et elle le fit jusqu'en 1964. Il n'y a pas nécessairement de critère absolu pour juger si un gouvernement donné est le meilleur ou non pour la bourgeoisie.
Ce n'est pas le cas dans les périodes de surgissement de la lutte de classe, comme celle ouverte depuis 1968. Au fur et à mesure que la crise elle-même et la lutte de classe s'intensifient, le cadre imposé à la bourgeoisie devient plus défini et plus contraignant et les conséquences d'une erreur par rapport à ce cadre deviennent plus dangereuses pour elle.
Dans les années 70, la bourgeoisie a cherché en même temps à résoudre sa crise économique, de pallier à la lutte de classe et de se préparer à la guerre. Dans les années 80, elle n'essaie plus de résoudre la crise économique; il est devenu généralement clair que c'est impossible. Le cadre qui est imposé à la bourgeoisie est déterminé par la lutte de classe et les préparatifs de guerre; il est devenu clair que ces derniers dépendent de sa capacité à répondre à la première. Dans une telle situation, la façon dont la bourgeoisie présente à la classe ouvrière sa politique, est cruciale, car en l'absence de solutions réelles, les mystifications prennent de plus en plus d'importance.
La bourgeoisie doit s'affronter au problème de la lutte de classe aujourd'hui alors que :
- ses palliatifs économiques sont arrivés à leur fin ;
- la classe ouvrière a déjà eu droit à toute la période de "contrat social" ou autre et ne peut plus être mobilisée sur ce terrain ;
- la bourgeoisie doit imposer des niveaux plus forts d'austérité à une classe ouvrière non battue;
La bourgeoisie est confrontée à la nécessité immédiate d'écraser la classe ouvrière. C'est ce qui rend le cadre de la gauche dans l'opposition un facteur fondamental de la situation actuelle pour la bourgeoisie. Cela devient un critère d'évaluation des préparatifs de la bourgeoisie pour faire face à la classe.
14. On a déjà montré que face au prolétariat, la bourgeoisie tend à s'unir et que sa conscience tend à devenir plus "intelligente". On a vu de claires expressions de ce processus depuis 10 ans et plus :
- lors des événements de 1968 et leur suite immédiate, chaque capital national a tâché de traiter avec "son" prolétariat. Là, on peut voir une bourgeoisie unie derrière l'Etat confrontant une classe ouvrière montante pour la première fois ;
- comme la lutte de classe a continué à se développer, la bourgeoisie s'est vue forcée de faire face au prolétariat au niveau du bloc. On l'a vu pour la première fois au Portugal en 1974 et en Italie, où ce n'est que grâce au soutien d'autres pays du bloc, qu'on a trouvé des ressources et des mystifications face à la lutte ouvrière ;
- avec la Pologne en 1980-81, où la bourgeoisie a dû pour la première fois s'organiser entre blocs face au prolétariat. En cela, nous pouvons voir les débuts d'un processus où la bourgeoisie doit mettre de côté ses rivalités impérialistes afin de faire face au prolétariat, phénomène jamais vu depuis 1918.
Nous sommes donc dans une période où la bourgeoisie commence à s'organiser à l'échelle mondiale pour faire face au prolétariat, utilisant des mécanismes créés en grande partie pour répondre à d'autres nécessités.
15. Comme le prolétariat entre dans une période de confrontation de classe décisive, il devient impératif de mesurer la force et les ressources de l'ennemi de classe. Les sous-estimer reviendrait à désarmer le prolétariat qui a besoin de clarté et de conscience, et qui doit se débarrasser des illusions pour faire face à l'enjeu historique.
Comme ce texte a tenté de le montrer, l'appareil d'Etat de la bourgeoisie se renforce dans le monde entier pour faire face au prolétariat. Nous pouvons nous attendre à ce que ce processus se poursuive, que l'Etat devienne plus sophistiqué et que la conscience de la bourgeoisie devienne plus alerte et un facteur plus actif dans la situation. Cependant, cela ne veut pas dire que l'ennemi du prolétariat devient de plus en plus fort. Au contraire, le renforcement de l'Etat a lieu sur des fondements qui s'effondrent. Les contradictions de l'ordre bourgeois sont la cause du fait que la société fait "craquer ses habits". Car même si l'Etat se renforce, il ne sera pas capable de redresser le déclin du système que déterminent des facteurs historiques. L'Etat peut être fort, mais sa force est fragile.
Parce que le système social se désintègre, le prolétariat sera capable d'affronter l'Etat au niveau social en attaquant ses fondements, en élargissant la brèche provoquée par les contradictions sociales. Le succès du mouvement du prolétariat tendant encore à élargir cette brèche dépendra de la confrontation avec la première ligne de défense de l'Etat bourgeois : les syndicats.
Marlowe
Questions théoriques:
- Aliénation [367]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [368]
Les conditions de la révolution crise de surproduction, capitalisme d'état et économie de guerre
- 5686 reads
(EXTRAIT DU RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE, 5ème Congrès de RI)
La compréhension de la critique de la "théorie des maillons faibles" ne doit pas nous faire oublier ce qu'ont fait les ouvriers polonais. En effet, cette lutte a montré au prolétariat international ce qu'était un mouvement de masse, a posé la question de l'internationalisation même si elle ne pouvait y répondre, et donc du contenu révolutionnaire de la lutte ouvrière à notre époque qui ne peut être indépendant de l'internationalisation. Le CCI a largement traité la question de l'internationalisation et de la lutte de classe en Pologne ([1] [369]). Par contre nous avons insuffisamment posé la question du contenu révolutionnaire de la lutte auquel s'était heurté sans pouvoir le comprendre les ouvriers polonais. Pourtant cette question s'est posée, et en particulier à propos de la question"économique" quand, pour la première fois, les ouvriers ont commencé à critiquer Solidarité"de façon ouverte et directe: lorsque au nom de l'économie nationale" et de l"autogestion" il s'est opposé directement aux grèves qui se sont développées durant l'été 81. Durant ces grèves, pour employer leurs propres termes, les ouvriers étaient prêts "à mettre au placard" les dirigeants de "Solidarité" les plus populaires, Walesa et Cie, et à continuer les grèves "jusqu'à la Noël et même plus s'il le fallait". La seule chose qui les ait arrêtés, c'est la question des perspectives. Dans la situation de pénurie généralisée qui domine dans les pays de l'Est, les ouvriers polonais livrés à eux-mêmes ne pouvaient pas les mettre en avant. Cette situation ne manquera pas de se reposer, mais dans les pays développés, l'existence tout à la fois d'une surproduction généralisée et d'une technicité productive ultradéveloppée pourra permettre aux ouvriers de mettre en avant leur propre perspective révolutionnaire et internationaliste.
Le développement actuel de la lutte de classe et des conditions objectives, la crise du capitalisme qui la détermine, signent la faillite des conceptions idéalistes qui niaient le caractère fondamental de la "crise catastrophique" du capitalisme, comme base objective de la Révolution Communiste Mondiale.
Cette faillite est la faillite de toute une conception de la révolution dont le moteur serait "idéologique", conception qui n'est en fait que le rejet de la théorie marxiste où les rapports de production déterminent l'ensemble des rapports sociaux. C'est la faillite des théories de" l'Internationale Situationniste" qui déclarait en 1969 contre l'analyse de la crise que faisait Révolution Internationale que la "crise économique était la présence eucharistique qui soutendait toute une religion". C'est la faillite des pauvres conceptions du FOR selon lesquelles seule la"volonté" est le moteur de la révolution. C'est, enfin, la faillite des théories issues de Socialisme ou Barbarie selon lesquelles le capitalisme d'Etat et le militarisme sont une troisième voie, une solution historique aux contradictions du capitalisme.
Affirmer que la catastrophe historique est la base objective et nécessaire de la révolution communiste ne suffit pas. Il faut encore montrer, et cela est aujourd'hui vital, pourquoi et comment elle l'est. C'est l'objet de cette étude.
Il n'est pas étonnant que les groupes cités ci-dessus aient tous de la transformation révolutionnaire de la société une conception"autogestionnaire". La situation historique ne signe pas seulement la faillite des conceptions idéalistes déjà citées. Mais aussi la faillite des conceptions populistes, misérabilistes et tiers-mondistes, animées en particulier par les théories des "maillons faibles" et de "l'aristocratie ouvrière", défendues particulièrement par le courant bordiguiste.
Nous devons montrer non seulement que la crise est nécessaire parce qu'elle paupérise de façon absolue la classe ouvrière et la pousse à la révolte, mais surtout comment elle mène à la révolution parce qu'elle est la crise d'un mode de production, la crise d'un rapport social où la nature de la crise, la surproduction, pose à la fois la nécessité de la révolution, et sa possibilité, où cette nature de la crise désigne d'un même mouvement, le sujet et l'objet de la révolution, la classe exploitée et la fin des sociétés d'exploitation et de pénurie.
Dans un premier temps, il faut cerner le mieux possible la nature du bond qualitatif que franchit la crise économique en plongeant les métropoles industrialisées dans la récession et la surproduction généralisée. La période de décadence du capitalisme n'est pas un moment figé, une éternelle répétition mais possède son histoire, son évolution. Pour comprendre les bases objectives de la lutte de classe aujourd'hui, nous devons donc situer l'évolution de la surproduction, du capitalisme d'Etat et de leur rapport réciproque. C'est ainsi que nous pourrons mieux cerner la nature et le contenu de ce qu'on appelle "le pas qualitatif de la crise économique11 et de ses conséquences pour la lutte de classe.
En montrant que sous ses différents aspects, surproduction, capitalisme d'Etat, militarisme, ce pas qualitatif de la crise du capitalisme ne s'effectue pas seulement par rapport aux années70 mais aussi et surtout par un pas qualitatif par rapport à toute l'évolution de la décadence du capitalisme. En montrant que la crise actuelle est aussi la crise des moyens dont la bourgeoisie a usé pour faire face à la crise de son système et de toute l'importance historique que revêt cette situation.
"L’anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe" disait Marx, c'est à dire que la forme supérieure de développement d'une espèce révèle dans sa forme achevée quelles étaient les tendances et les voies de développement des formes embryonnaires dans les espèces inférieures. Il en est de même de la situation historique actuelle qui "révèle" dans la plus haute expression de décadence, toute la réalité et la vérité de l'époque qui va de la première guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
SURPRODUCTION ET CAPITALISME D'ETAT
Le capitalisme d'Etat n'a jamais été l'expression de la santé, de la vigueur du capitalisme, l'expression d'un nouveau développement historique et organique du capitalisme, mais seulement:
- l'expression de sa décadence;
- l'expression de sa capacité à réagir vis-à-vis de cette décadence.
C'est pour cela que nous devons essayer d'analyser dans la situation actuelle, les rapports qu'entretiennent la crise du capitalisme et le capitalisme d'Etat, sous leurs divers aspects : social, économique et militaire.
Nous commencerons par ce dernier.
1-1. SURPRODUCTION ET ARMEMENT
La crise de surproduction n'est pas seulement la production d'un excédent sans débouchés, mais aussi la destruction de cet excédent.
"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque eut semblé absurde : l'épidémie de la surproduction." (Le Manifeste Communiste).
Ainsi, la surproduction implique un procès d'auto-dévalorisation du capital, un procès d'auto-destruction. La valeur du surproduit non-accumulable n'est pas figée ou stockée, mais doit être détruite.
Cette nature de la crise de surproduction s'exprime de façon nette et sans ambiguïté dans les rapports qu'entretiennent à l'heure actuelle, la crise et l'économie de guerre.
Toute la période de décadence montre que la crise de surproduction implique un déplacement de la production vers l'économie de guerre. Considérer cela comme "une solution économique" même momentanée, serait commettre une grave erreur, ayant à la racine justement l'incompréhension que la crise de surproduction est un procès d’autodestruction. C'est ce procès d'autodestruction issu de la révolte des forces productives contre les rapports de production, qui s'exprime dans le militarisme.
Ce déplacement de "l'économique" vers le "militaire" a pu cacher un temps la surproduction générale. Dans les années 30 et après-guerre, le militarisme a pu faire illusion. Aujourd'hui, la situation de l'économie de guerre dans la crise générale du capitalisme révèle toute la vérité.
Ainsi, nous assistons aujourd'hui à un développement extrêmement important de l'armement comme par exemple aux USA où :
"Le Sénat a battu un record historique, le 4 décembre, en votant 208 milliards de dollars pour le budget de la défense pour 1932. Jamais une loi financière américaine n'avait atteint un tel montant. Ce chiffre est supérieur de 8 milliards aux exigences du Président Reagan". (Le Monde du 9.11.81).
Mais dans la situation globale du capitalisme mondial actuellement et en l'état dans lequel se présente la situation financière des différents Etats du monde, il faut être conscient qu'une telle politique de dépenses d'armement est un facteur extrêmement grave d'approfondissement de la crise économique, de la récession, comme de l'inflation.
Dans la situation actuelle, de tels budgets pour l'armement, et cela non seulement aux USA mais dans tout le bloc (en particulier en RFA et au Japon) n'ont aucun effet, même immédiat, comme dans les années 30 ou après-guerre, de soutien d'un certain niveau de la production industrielle mais au contraire, accélère très rapidement la baisse de cette production.
Contrairement aux années 30, la politique actuelle de l'armement ne créera pas d'emplois, sinon en infime partie par rapport à ceux qu'elle supprime. Situation encore renforcée par le fait que le développement de l'armement ne s'accompagne pas d'une politique de déficit social ou de politique des "grands travaux" comme dans les années 30, mais aujourd'hui se réalise en opposition directe à ces politiques. De plus, les emplois créés par le développement actuel de l'armement ne concernent qu'une petite partie des ouvriers, ceux très qualifiés, ou des techniciens de formation scientifique à cause du haut degré de technicité de l'armement moderne.
Ainsi, aujourd'hui, le développement de l'armement ne peut plus masquer la crise générale de surproduction et, de plus, l'inflation que provoque l'investissement dans l'armement est à son tour un facteur accélérateur de la crise économique du capitalisme.
"Le gouvernement de M. Reagan ne pourra se permettre des dépenses militaires qu'en imposant une politique monétaire plus restrictive encore, associée également à une politique fiscale restrictive et à une limitation des dépenses publiques non militaires et de l'emploi public. Tous ces efforts aboutiront à une augmentation du chômage. Ce qui s'annonce au delà du keynésianisme militaire, c'est la première dépression militaire du vingtième siècle" ("Un nouvel ordre militaire" - Le Monde Diplomatique - Avril 82).
Dans cette situation, le poids de l'armement existant et son développement présent sont vécus par la population et en particulier par la classe ouvrière, comme une cause directe de la paupérisation générale et du chômage, en plus des menaces de guerre apocalyptique qu'il fait planer sur toute la planète. C'est pour cela que la révolte contre la guerre est contenue dans la révolte générale du prolétariat même si la guerre n'est pas une menace immédiate.
Il serait simpliste de considérer que la planification de la production d'un armement ultra-moderne est la caractéristique de l'administration "Reagan". Une telle préparation industrielle et conceptuelle ne se réalise pas du jour au lendemain ni en plusieurs mois. La vérité, c'est que l'armement qui voit le jour aujourd'hui a été longuement préparé dans les années 70 sous la responsabilité des démocrates, mais ceux-ci ne pouvaient pas en prendre la responsabilité politique sans laisser complètement dégarni le front social.
Ce n'est pas pour rien si, dans une telle situation historique et pour la première fois dans toute l'histoire de la décadence, c'est la droite, les républicains aux USA, qui sont les animateurs d'une politique de surarmement.
"L'économie d'expansion militaire est résolument non républicaine aux USA. Les booms militaires des cinquante dernières années -l'expansion de 1938, la seconde guerre mondiale, le réarmement de la guerre de Corée et de la guerre froide en 1950-1952, le boom de l'espace et des missiles de 1961-1962, la guerre du Viêt-Nam ont tous été inspirés par des gouvernements démocrates." (Idem.)
Ce n'est pas un hasard non plus qu’aujourd’hui le pacifisme soit un des thèmes préféré de l'opposition. Il serait faux de ne considérer le pacifisme, ou les campagnes à propos du Salvador comme- seulement une préparation à long terme. A court terme et dans l'immédiat, elles ont bien largement contribué à isoler la lutte des ouvriers polonais mais aussi à faire passer les budgets dits "d'austérité" au profit en particulier de 1'armement.
"Nous devons donc faire aujourd'hui une distinction entre les campagnes pacifistes d'aujourd'hui et celles qui ont précédé la seconde guerre mondiale. Les campagnes pacifistes d'avant la seconde guerre mondiale préparaient directement l'embrigadement dans la guerre d'une classe ouvrière déjà embrigadée dans l'idéologie anti-fasciste."
"Aujourd'hui ces campagnes pacifistes ont bien sur pour tâche de préparer la démobilisation vis-à-vis de la guerre, mais ce n'est pas leur tâche directe, immédiate, qui est de contrer la lutte de la classe et d'empêcher que n'éclatent des mouvements de masse dans lés pays développés. Le pacifisme joue aujourd'hui le rôle de l’anti-fascisme d'hier.
" Pour la bourgeoisie il est vital que l'unité entre la lutte contre la guerre et la crise ne se fasse pas, que l'alternative "guerre ou révolution" ne se pose pas"
"En cela le pacifisme est une arme particulièrement efficace car tout en répondant à une véritable anxiété dans les populations, il sépare la question de la guerre et de la crise, pose une fausse alternative "guerre ou paix" et tente de faire renaître les sentiments nationalistes au travers d'un pseudo-neutralisme".
"Face à la question de la guerre la fausse alternative "guerre ou paix" vient compléter face aux questions de la crise économique l'autre alternative "prospérité ou austérité"."
Ainsi avec la lutte "contre l'austérité" d'un coté et la lutte "pour la paix" d'un autre, la bourgeoisie occupe tout le terrain de la révolte sociale. C'est la meilleure illustration de ce qu'on appelle la "gauche dans l'opposition".
1.2. SURPRODUCTION ET KEYNESIANISME
De même que le militarisme n'a jamais été un champs d'accumulation pour le capital, le capitalisme d'Etat sous ses aspects économiques n'a jamais été l'expression d'un développement organique et supérieur du capitalisme, le produit de sa concentration et de sa centralisation, mais au contraire l'expression des difficultés rencontrées dans son processus d'accumulation, de centralisation, et de concentration ([2] [370]). Tout comme le militarisme, le capitalisme d'Etat, en particulier sous ses formes keynésiennes, a pu faire illusion avant et après-guerre ainsi que dans les années 70 Aujourd'hui, la réalité balaie le mythe.
Nous avons souvent mis en lumière l'endettement, gigantesque auquel étalent parvenus les pays sous-développés sans que cela leur ait jamais permis un véritable "décollage" économique. Bien au contraire, ils sont arrivés à une situation où les 3/4 des crédits qu'ils contractent vis-à-vis des puissances occidentales ne servent qu'à rembourser les dettes passées. Mais cet endettement n'est pas le privilège des pays sous-développés. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'endettement est une des caractéristiques de l'ensemble du capitalisme, à l'Est comme à l'Ouest ([3] [371]), et le fait qu'il prenne des formes plus multiples dans les pays développés ne change rien à l'affaire. Pour ce qui est du .capitalisme d'Etat comme gouvernail de l'économie, c'est finalement cette politique d'endettement et de déficit qui a pris le dessus, qui s'est imposée massivement, bien plus que "l'orientation" de l'économie elle-même. C'est l'économie qui a imposé ses lois à la bourgeoisie, et non pas la bourgeoisie qui a "orienté" l'économie. (Cf. RINT N° 26).
"Les USA sont devenus "la locomotive" de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de son bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendus. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale- pouvaient mettre en œuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement sa monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer", (RINT N026, P. 4.)
Nous pouvons prendre ici l'exemple de la seconde puissance économique mondiale, la RFA, pour illustrer un autre aspect de la relance par l'endettement et les déficits d'Etat :
"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître, des autres pays (...). L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant 1,7 fois comme le produit national, A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les pouvoirs publics (...) Ainsi, la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18% du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 25% en 1975, puis à 35% cette année; sa part a donc doublé en dix ans. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de l'entre-deux guerre (...). Les allemands qui n'ont pas la mémoire courte, voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la République de Weimar!" ([4] [372]) (L'Expansion, 5.11.81)
Et un peu comme dans les pays sous-développés, l'endettement est tellement fort que "le service de la dette absorbe plus de 50% des crédits nouveaux".
Voilà la face cachée de la "reprise" de la fin des années 70, le "secret révélé" de remèdes qui se sont avérés pire que le mal.
Au 4ème Congrès International du CCI ainsi qu'à l'occasion d'autres rapports et articles publiés depuis, nous avons largement montré que cette politique économique des années 70 était parvenue à sa fin. Les différents Etats du monde en ont tellement usé que s'ils la poursuivaient, ils iraient très vite à la catastrophe financière et à l'écroulement économique immédiat. La crise du dollar en 79 a été le premier signe de cette catastrophe, elle a été le signal le plus net d'une nécessité de changement de politique économique, la fin des "locomotives" et de l'endettement ([5] [373]).
A la lumière du développement de la situation économique, nous pouvons déjà faire un premier bilan des résultats de la "nouvelle politique économique" dite "d'austérité". Ici aussi, les USA peuvent nous servir de référence. Les plus en avant dans la politique d'endettement, ils ont été aussi les plus en avant dans la politique "monétariste". Le résultat n'est pas brillant; ils ont certes évité jusqu'à aujourd'hui l'effondrement, mais à quel prix...
Dans tous les domaines de la production sauf l'armement, la production a chuté de manière incroyable et d'ores et déjà, 15% de la classe ouvrière se trouve au chômage... Pourtant, ces derniers mois nous pouvons assister à une baisse de l'inflation dans tous les pays développés... sauf en France. Mais ici aussi cette baisse de l'inflation est essentiellement due à la baisse fantastique de la production:
" La Maison Blanche n'a pas manqué de célébrer ce succès. En réalité, pour le moment, c'est plus la récession qui explique la considérable décélération de l'inflation que celle-ci n'annonce la possibilité d'une reprise". (Le Monde de l'Economie, 6.4.82)
De toutes façons, dans les mois qui viennent, la question "du financement de la crise" va se poser de manière encore plus forte pour l'ensemble du capitalisme mondial car :
1- La baisse de la production entraîne une baisse proportionnelle des rentrées pour l'Etat, baisse encore renforcée par les allégements fiscaux que sont obliges d'établir les différents Etats pour maintenir un minimum de production;
2- L'augmentation des budgets militaires est une ponction considérable, pour l'ensemble des budgets ;
3- L'augmentation du chômage est elle-même une cause de déficit du au système d'allocations.
De tous ces budgets, il n'y a guère que les systèmes d'allocations qui puissent être remis en cause ainsi que tous les autres budgets dits "sociaux"; la baisse de la production entraîne... la baisse de la production.
"S'étant présenté comme le champion de l'équilibre pendant sa campagne, M.Reagan est en train de battre tous les records : on prévoit un déficit d'une centaine de milliards en l982 et plus l'année suivante" (Le Monde, 3.4.82),
En fait le capitalisme est "coincé": pour faire face à l'effondrement et à la catastrophe financière, il provoque l'effondrement de la production avec le seul avantage, et encore ce n'est pas certain, de pouvoir le contrôler, l'accompagner.
Quand les économistes interprètent les politiques de Reagan ou de Thatcher comme "moins étatistes", c'est une absurdité. Ce n'est pas parce que la politique économique de l'Etat change d'orientation qu'elle n'est plus d'Etat, au contraire. Si avec le jeu keynésien, c'est tout un aspect du capitalisme d'Etat qui a changé, cela ne veut pas dire que le capitalisme d'Etat est mort, et que le système économique est abandonné à son sort. Ne pouvant plus repousser l'effondrement dans une fuite en avant, l'Etat n'abandonne pas pour autant la partie. Il se résout à la seule politique économique qui lui reste : accompagner, ralentir, homogénéiser à l'ensemble de la planète l'effondrement du capitalisme.
Ainsi, les différents Etats du monde organisent-ils la descente dans la récession généralisée, et cela de façon mondiale. Nous pouvons tirer quelques implications d'une telle situation historique.
1- Avec la fin du keynésianisme qui soutenait le capital à un niveau d'activité artificiel, c'est aussi sa capacité à polariser la "richesse" à un pôle de nations et la "pauvreté" à un autre gui s'épuise. La situation en Belgique offre à une petite échelle peut-être, mais caricaturalement, une illustration frappante de ce processus :
La Belgique est devenue l'homme malade de l'Europe. Sa prospérité au lendemain de la guerre que ses voisins qualifiaient "d'insolente" s'est progressivement dégradée au point qu'aujourd'hui, sa situation est devenue au sens littéral du terme, catastrophique. Un déficit budgétaire quintuple de celui de la France, une balance des paiements de plus en plus déséquilibrée, un endettement intérieur et extérieur extraordinairement élevé, un chômage touchant 12% de la population active, et surtout, une désindustrialisation croissante, risquent de faire de cette nation, autrefois plaque tournante de l'Europe, un pays sous-développé. Une chose est certaine et de nature à inquiéter tous les européens : pour la Belgique, mais aussi pour les Dix, l'heure de la vérité a sonné". (Le Monde, 23.2.82)
2- Durant les années 70, les déficits de l'Etat et l'endettement ont été une des armes les plus efficaces pour enrayer la "lutte de classe dans les pays développés et illusionner les ouvriers des pays de l'Est. La fin de cette situation et la mise en place dans les pays développés d'un"Etat forteresse", d'un Etat policier et militariste à outrance Nui accompagne le capitalisme dans sa chute en faisant directement payer la crise aux ouvriers parce qu'il ne peut plus faire autre chose, pose d'autres conditions objectives.
Nous assistons donc aujourd'hui à un changement qualitatif dans les conditions objectives par rapport aux années 70. Mais ce n'est pas seulement par rapport aux années 70 que la situation actuelle implique un changement qualitatif, mais aussi par rapport à toute la période de décadence. Par rapport aux années 30, la bourgeoisie ne possède pas les moyens économiques d'un encadrement de la classe ouvrière. Les années 30 étaient la période de"grande envolée" du capitalisme d'Etat, en particulier sous ses aspects keynésiens. Si l'on prend l'exemple des USA dans les années 30, on constate que :
" L'écart qui séparait à ce moment la production de la consommation fut attaqué de 3 côtés à la fois :
1°. Contractant une masse de dettes sans cesse accrue, l'Etat exécuta une série de vastes travaux publics (...)
2°. L'Etat augmenta le pouvoir d'achat des masses laborieuses :
a) En introduisant le principe d'accords collectifs garantissant des salaires minimum et édictant des limitations de la durée du travail, tout en renforçant la position générale des organisations ouvrières et notamment du syndicalisme
b) en créant un système d'assurance contre le chômage et par d'autres mesures sociales destinées à empêcher une nouvelle réduction du niveau de vie des masses.
3°. De plus l'Etat tenta, par une série de mesures telles que des limitations imposées à la production agricole et des subventions destinées à soutenir les prix agricoles, d'augmenter le revenu de la population rurale de façon à permettre à la majorité des exploitants de rejoindre le niveau de vie des classes moyennes urbaines". (Le Conflit du Siècle, Sternberg.p.389).
Dans les années 30, les mesures du"New-Deal" .furent prises après le plus fort de la crise économique. Aujourd'hui non seulement le "New-Deal" des années 70 est derrière nous alors que le plus fort de la crise est devant nous sans possibilité d'issue dans la guerre, mais encore nous n'avons pas assisté dans les pays développés à cette vague de syndicalisation et d'embrigadement idéologique qui a aussi caractérisé les années 30. Au contraire, dés le milieu des années 70, on assiste à une désyndicalisation générale, contrairement aux années 30 ou comme le rapporte Sternberg dans Le Conflit du siècle :
" Du fait des modifications décisives qui s'étaient opérées sous l'égide du New-Deal dans la structure sociale américaine, la situation du syndicalisme changea du tout au tout. Le New-Deal encouragea en effet le mouvement syndical par tous les moyens (...). Au cours d'un bref espace de temps qui va de 1933 à 1939, le nombre de syndiqués a fait plus que tripler. A la veille de la deuxième guerre mondiale, il y a plus de deux fois plus de cotisants qu'aux meilleurs moments d'avant la crise, bien plus "qu'à aucun moment de l'histoire syndicale américaine". (Ibid, p. 395)
3-. La situation historique actuelle est une réfutation totale de la théorie du capitalisme d'Etat comme "solution" aux contradictions du capitalisme. Le keynésianisme a été le principal écran qui cachait la réalité du capitalisme décadent. Avec sa faillite et du fait que les Etats ne peuvent plus que se résoudre à accompagner le capitalisme dans son effondrement, le capitalisme d'Etat apparaît clairement pour ce qu'il a toujours été : une expression nette de la décadence du capitalisme.
Ce constat ne revêt pas seulement un intérêt théorique et polémique, à l'encontre de ceux qui se représentaient le capitalisme d'Etat comme une "troisième voie". Il est devenu d'une extrême importance du point de vue des conditions objectives et de leur lien avec les conditions subjectives de la lutte de classe par rapport à la question de l'Etat.
Considérer que le capitalisme d'Etat a été une expression de la décadence du capitalisme ne suffit pas. Le capitalisme n'a pu "s'installer" pour des décennies dans la décadence qu'après avoir cassé les reins du prolétariat révolutionnaire, et dans cette tâche, le capitalisme d'Etat a été à la fois un des plus grands résultats et un des plus puissants moyens de la contre-révolution. Pas seulement du point de vue militaire, mais surtout du point de vue idéologique.
Dans la vague révolutionnaire du début du siècle, dans les années 30 ou durant la reconstruction, la question de l'Etat est toujours au centre de l'illusion politique du prolétariat et de la mystification idéologique de la bourgeoisie. Que ce soit l'illusion que l'Etat, même transitoire est l'outil de la transformation de la société, le représentant de l'unité et de la collectivité prolétarienne comme dans la révolution russe; que ce soit le mythe de la défense de l'Etat "démocratique" contre11!'Etat fasciste" dans les années 30 et la guerre; que ce soit encore l'Etat "social" de la reconstruction ou enfin l'Etat "sauveur" de la gauche au pouvoir des années 70, toujours le prolétariat est amené à penser que tout se joue dans la "forme" de l'Etat, qu'il ne peut s'exprimer qu'au travers d'une forme particulière de l'Etat. Toujours, la bourgeoisie entretient dans la classe ouvrière un esprit de délégation de pouvoir à un représentant ou à un organe de l'Etat et également un esprit et une attitude "d'assisté". Ce sont ces mythes largement diffusés par la pensée dominante et ces illusions constamment entretenues dans la classe ouvrière que Marx combattait déjà en déclarant :
"Parce que (le prolétariat) pense dans la forme de la politique, il aperçoit la raison de tous les abus dans la volonté, tous les moyens d'y remédier dans la violence et dans le renversement d'une forme d'Etat déterminée", (souligné dans le texte. Gloses critiques marginales à l'article : "Le roi de Prusse et la réforme sociale par un prussien", Marx 1844, "Ed, Spartacus, p. 87).
Durant toutes les dernières décennies, la classe ouvrière a vécu toutes les formes possibles et inimaginables de la dernière forme de l'Etat bourgeois, le capitalisme d'Etat -"stalinien, fasciste, démocratique" et "keynésien". Des Etats fascistes ou keynésien, il ne reste pas grand chose comme mystification; le peu d'illusions qui restait sur l'Etat stalinien a été balayé par la lutte des ouvriers polonais. Par contre, l'Etat "démocratique et keynésien" a maintenu les illusions finalement les plus fortes sur le prolétariat.
La fin de l'Etat keynésien dans les pays développés donc clés, ne veut pas dire que la question de l'Etat est réglée. Au contraire, elle commence à se poser réellement avec la mise en place du combat ouvert, celui qui rejette la gauche dans l'opposition et s'apprête à affronter la classe ouvrière. Mais dans ce combat, le prolétariat aura eu l'expérience des diverses formes d'Etat que pouvait revêtir le capitalisme décadent et des diverses façons dont il s'est fait happer dans ses diverses formes.
Dans l'unité des conditions objectives où le capitalisme d'Etat n'apparaît pas comme une forme supérieure mais comme une forme décadente et dans les conditions subjectives constituées par l'expérience du prolétariat, c'est la question de la destruction de l'Etat par le prolétariat qui est posée.
Dans ce combat, notre tâche est, premièrement de rappeler au prolétariat son expérience passée, deuxièmement, de le mettre en garde contre toute prétendue facilité à mener le combat, en montrant justement à travers 1'expérience que si le capitalisme d'Etat est une expression décadente, il est en même temps l'expression de la capacité de la bourgeoisie à s'adapter, à réagir et à ne pas lâcher le morceau facilement.
1.3. L'ETAT FORTERESSE
Si l'on doit tirer une première conclusion des rapports entre la crise économique, le militarisme et le capitalisme d'Etat avec toutes les implications tant objectives que subjectives que nous avons tenté de tracer sur chacun de ces points, nous devons mettre en avant :
1°. L'Etat de la bourgeoisie; n'abandonne, pas la partie; il se transforme en Etat-forteresse, policier et militarisé à outrance.
2°. Ne pouvant plus jouer sur les aspects économiques et sociaux du capitalisme d'Etat pour repousser et reporter les échéances de la crise, 1'Etat-forteresse n'attend pas non plus les bras croisés que le prolétariat lui livre l'assaut en se cantonnant purement dans sa"forteresse ". Au contraire, il prend l'initiative du combat en dehors de sa forteresse, sur le terrain où tout se joue : le terrain social. Telle est la profonde signification de ce qu'on appelle aujourd'hui la "gauche dans l'opposition", mouvement que l'on peut voir aujourd'hui de façon évidente dans les principales métropoles industrialisées.
3°. Ne pouvant plus jouer sur les aspects économiques et sociaux pour repousser et reporter les échéances de la lutte de classe, et en plus de la gauche dans l'opposition qui prépare le terrain, l'Etat développe deux aspects essentiels de sa politique :
- la répression et le quadrillage policier;
- de vastes campagnes idéologiques de plus en plus spectaculaires -véritable terrorisme idéologique- sur toutes les questions que pose la situation mondiale : guerre, crise et lutte de classe.
Telle est la profonde signification des campagnes "pacifistes", de "solidarité" avec la Pologne, des campagnes sur le Salvador, du conflit des Iles des Malouines et des incessantes campagnes anti-terroristes.
4°. La question de l'Etat, de ses rapports avec la lutte de classe et de sa destruction ne peut-être véritablement posée que dans les pays développés, là où l'Etat est le plus fort tant du point de vue matériel qu'idéologique.
Même si l'anachronisme des structures étatiques dans les pays développés ou encore dans les pays de l'Est, formes issues de la contre-révolution, est peu adapté pour faire face à la lutte de classe, l'expérience nous a montré comment en Pologne la bourgeoisie pouvait retourner cet anachronisme, cette faiblesse, en moyens de mystification contre la lutte tant que les ouvriers des pays développés ne rentraient pas eux-mêmes dans le combat. La lutte pour la "démocratie en Pologne" en est la meilleure illustration.
De toutes façons, la faiblesse ou l'inadaptation des pays peu développés est largement compensée par l'unité de la bourgeoisie mondiale et de ses différents Etats face à la classe ouvrière.
Dans le même sens, il serait dangereux et erroné de croire que les Etats des pays développés sont affaiblis devant la lutte de classe à cause de la profonde unité qu'a manifestée la bourgeoisie de ces pays, contrairement à des pays moins développés où la bourgeoisie peut jouer sur ses divisions pour dévoyer les ouvriers.
Face aux enjeux de la situation mondiale et de la lutte de classe, ce n'est pas tant les divisions "régionales" par exemple qui seront l'axe du travail de la bourgeoisie contre le prolétariat. L'axe essentiel du travail de sape de la bourgeoisie ne peut être qu'une fausse division de classe entre droite et gauche, et cette capacité de mettre en place cette fausse vision dépend justement de la force de la bourgeoisie, de la force de son unité.
1-4. SURPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT TECHNIQUE
Nous avons essayé de montrer dans les premières parties de ce rapport comment la surproduction était aussi destruction, gaspillage, et impliquait pour le prolétariat 1'intensification de 1'exploitation et un rabaissement de ses conditions d'existence. Cet aspect de la critique de l'économie est extrêmement important, premièrement pour comprendre bien sûr l'évolution de la crise, et deuxièmement pour notre propagande. En effet, la bourgeoisie n'a pas manqué (déjà en Pologne)et ne manquera pas de mettre en avant que la lutte des ouvriers aggrave la crise économique et se fait donc "au détriment de tous". A ce point, nous devons déjà rétorquer : tant mieux si le prolétariat accélère la crise économique et l'effondrement du capitalisme sans laisser le temps à la bourgeoisie et à la crise de détruire une grande partie des moyens de consommation et de production, parce que justement, la crise de surproduction est aussi une destruction.
Mais en montrant comment la crise de surproduction est destruction, nous n'avons montré qu'un aspect de la crise historique et catastrophique du capitalisme. En effet, la crise de surproduction ne détermine pas seulement une destruction mais aussi un développement technique important (nous verrons plus tard que ce n'est nullement contradictoire, au contraire). Ce que nous montre le développement de la crise de surproduction, c'est que la surproduction ne s'accompagne pas seulement d'une destruction ou "gel" des marchandises et des forces productives, mais que le capital, pour compenser la surproduction générale et la baisse du taux de profit dans une situation de concurrence acharnée, tend à développer la productivité du capital. Ainsi, ces dernières années, à côté de la désindustrialisation de vieux secteurs comme la sidérurgie, le textile, la construction navale, etc., nous avons vu se développer d'autres secteurs de pointe déjà mentionnés plus haut, le tout accompagné par une centralisation des capitaux.
Ainsi, de la même manière que toutes les mesures prises pour faire face à la crise de surproduction, en particulier le keynésianisme, n'ont fait que provoquer une crise de surproduction encore plus gigantesque, le développement technique n'a fait, lui, que pousser à son extrême la contradiction entre les rapports de production et le développement des forces productives.
En effet, durant cette dernière décennie, en particulier, nous avons pu voir un développement assez fantastique des moyens techniques sur tous les "fronts" :
1°. - développement et application à la production des automatismes, de la robotique, de la biologie;
- développement et application de l'informatique à la gestion et à l'organisation;
- développement des moyens de communication : transports (aéronautique en particulier), communication audio-visuelle, télématique et télétraitement.
2°. Et pour animer l'ensemble de ces forces, des moyens d'énergie ("à la hauteur", en particulier le nucléaire).
Pour la bourgeoisie, dans son idéologie c'est une troisième "révolution industrielle" qui est à l'ordre du jour. Mais pour elle, cette troisième "révolution industrielle", premièrement ne peut pas ne pas provoquer des bouleversements sociaux importants, et deuxièmement ne peut se réaliser sans guerre mondiale, sans un "nettoyage" gigantesque et un repartage du monde. Les politiques économiques et militaires du monde capitaliste actuel sont mises-en place en fonction de cette perspective et pas seulement pour taire face aux données" immédiates de la crise économique
De façon immédiate, la bourgeoisie mondiale s'efforce de maintenir un tant soit peu la production et d'éviter un effondrement économique brutal. Mais ici, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques ou militaires, nous devons comprendre que la bourgeoisie n'agit pas au coup par coup, qu'elle s'est donnée une perspective, et nous aurions tort de ne pas en tenir compte. Nous aurions tort et paierions cher le fait de crier victoire simplement parce que le taux de chômage a augmenté de façon incroyable et de nous contenter de dire : "Ah ! que les économistes sont bêtes." Nous aurions tort de ne pas tenir compte et accorder toute son importance à ces phénomènes et idéologies actuelles. Cela non seulement pour critiquer la bourgeoisie par rapport à la Question de ce qu'elle appelle la Restructuration" -et qui est en fait le chômage- mais encore pour renverser son argumentation quant à l'avenir de cette "troisième révolution industrielle" et qui est notre propre vision de ce qui est en jeu dans l'époque actuelle de 1'histoire humaine.
Le développement de certaines techniques de productivité du travail dans les secteurs qui survivent n’est en rien contradictoire avec le développement de la crise économique. "Car le développement technique s'est investi essentiellement dans les secteurs improductifs :
1°. Premièrement militaire : la "guerre des Falklands" et les moyens techniques ultramodernes (satellites électroniques, etc..) mis en oeuvre nous ont donné une petite idée de cette fameuse "troisième révolution industrielle";
2°. Deuxièmement, dans les secteurs des "services" : bureaux, banques, etc..
Ainsi, le développement de la productivité (qui n'est en fait, pour l'essentiel que potentiel) s'accompagne d'une désindustrialisation générale et ne compense pas, loin s'en faut, la chute vertigineuse de la production. C'est le cas de la principale puissance mondiale qui assure, à elle seule, un tiers de la production mondiale, les USA :
"Divisant l'ensemble de la force de travail en deux catégories -celles qui produisent des biens de consommation ou d'équipement et celles qui produisent des services-, l'hebdomadaire "Business Week" montre que les emplois diminuent dans la première catégorie au profit de la seconde : 43,4% en 1945 ... 33,3% en 1970... 28,4% en 1980... 26,2% en prévision pour 1990 et augmentent en proportion inverse dans le second secteur : respectivement, 56% en 1945, 66,7% en 1970, 71,6% en 1980, 73,8% en prévision pour 1990 (...). Le grand patronat américain s'est engagé depuis quelques années dans une sorte de grève de l'investissement productif". (Le Monde Diplomatique, mars 1982).
D'autre part, le développement de la productivité quand il s'effectue dans la production, provoque premièrement un chômage gigantesque et, deuxièmement, développe pour les ouvriers qui conservent du travail une déqualification du travail, et des conditions de travail très pénibles et très policières . Seule une infime minorité de techniciens très qualifiés y trouvent "son compte".
Quant à la question de la "révolution industrielle" elle-même, la bourgeoisie est consciente parce qu'elle y est directement confrontée, que le marché mondial, tel qu'il est aujourd'hui, déjà sursaturé par l'ancien état de la production, ne peut offrir le tremplin pour son développement.
Dans son idéologie, seule une guerre mondiale "pourrait préparer le terrain" pour un développement et une application sur une large échelle, des techniques de production moderne. De toute façon, elle n'a pas le choix.
C'est pour cela que l'essentiel de la préparation de cette "fameuse révolution industrielle" s'effectue sur le terrain militaire, c'est là que s'est développé et appliqué tout ce que l'humanité a produit de meilleur du point de vue scientifique.
Il en va donc de même pour le développement de la productivité et de la surproduction : toutes deux sont dans le cadre du système bourgeois pure destruction. C'est ce que nous devons dire à la classe ouvrière. Non seulement cela, mais aussi, qu'au travers du développement des moyens techniques actuelles et de la surproduction, le capitalisme a poussé à ses extrêmes limites l'antagonisme entre les forces productives et les rapports de production.
"A l'époque où l'homme avait besoin d'un an pour confectionner une hache en pierre, de plusieurs mois pour fabriquer un arc, ou faisait un feu en frottant pendant des heures deux morceaux de bois l'un contre l'autre, 1'entrepeneur le plus rusé et le plus dénué de scrupules n'aurait pu extorquer d'un homme le moindre surtravail. Un certain niveau de productivité du travail est nécessaire pour que l'homme puisse fournir du surtravail". (Rosa Luxemburg. Introduction à l'économie politique, p.255).
En effet, pour qu'un rapport d'exploitation puisse s'implanter et diviser la société en classes, un certain niveau de productivité était nécessaire. Il fallait qu'à côté du travail nécessaire pour assurer la subsistance des producteurs puisse se développer un surtravail assurant la subsistance des exploiteurs et permettant l'accumulation des forces productives.
Toute l'histoire de l'humanité depuis la dissolution de la communauté primitive jusqu'à nos jours est l'histoire de l'évolution du rapport entre travail nécessaire et surtravail -rapport déterminé lui-même par le niveau de productivité du travail- déterminant telle ou telle société de classe, tel ou tel rapport d'exploitation entre producteurs et exploiteurs.
Notre époque historique qui commence au début du siècle a totalement renversé ce rapport entre travail nécessaire et surtravail. Avec le développement technique, la partie du travail constitué par le travail nécessaire est devenue infime par rapport au surtravail.
Ainsi, si l'apparition du surtravail a pu permettre dans certaines conditions l'apparition de la société de classes, son développement historique par rapport au travail nécessaire a complètement renversé la problématique des sociétés d'exploitation et pose la nécessité et la possibilité de la révolution communiste, la possibilité de la société d'abondance, sans classes et sans exploitation.
La crise historique du capitalisme, la crise de surproduction déterminée par le manque de marchés solvables a poussé cette situation jusqu'à son extrême. Pour faire face à la surproduction, la bourgeoisie a développé la productivité du travail qui, à son tour, a aggravé la crise de surproduction et cela de manière d'autant plus forte que la guerre mondiale n'était pas possible.
Aujourd'hui, cette révolte des forces productives contre les rapports de production bourgeois, s'exprimant dans la surproduction, la productivité du travail et leurs rapports réciproques, a atteint un point culminant et éclate au grand jour.
LES CONDITIONS DE LA LUTTE DE CLASSE DANS LES PAYS DEVELOPPES
"Tant que le prolétariat n’est pas encore assez développé pour se constituer en classe, que, par conséquent, la lutte même du prolétariat avec la bourgeoisie n'a pas encore un caractère politique, et que les forces productives en se sont pas encore assez développées dans le sein de la bourgeoisie elle-même pour laisser entrevoir les conditions matérielles nécessaires à l'affranchissement du prolétariat et à la formation d'une société nouvelle, ses théoriciens ne sont que des utopistes (...) et ils ne voient dans la misère que la misère, sans y voir le coté subversif qui renversera la société ancienne". (Misère de la Philosophie, Marx).
C'est à partir de la situation que nous venons de décrire dans les points précédents que nous pouvons comprendre que la crise économique n'est pas seulement nécessaire pour la révolution parce qu'elle exacerbe la misère de la classe ouvrière, mais aussi et surtout parce qu'elle pose tout autant la nécessité de la révolution qu'elle en révèle la possibilité. C'est pour toutes ces raisons que la crise économique du capitalisme n'est pas une simple "crise économique" au sens strict du terme, mais la crise d'un rapport social d'exploitation qui contient la nécessité et la possibilité de l'abolition de toute exploitation : elle est dans ce sens la crise de l'économie tout court.
De ce point de vue, ce n'est que dans les pays développés que sont posées les conditions objectives et subjectives de l'initiative révolutionnaire, de la possibilité de la généralisation internationale de la lutte de classe et c'est de ces pays que dépend fondamentalement toute la dynamique révolutionnaire. Cela n'est rien d'autre que ce que les révolutionnaires ont toujours pensé ;
" Quand Marx et les socialistes imaginaient la révolution à venir, ils pensaient toujours qu'elle surviendrait dans le coeur industriel du monde capitaliste, d'où elle communiquerait à la périphérie. C'est ainsi que s'exprime encore F. Engels dans une lettre à Kautsky du 12 novembre 1882, où il traite des différentes étapes d'une transformation ainsi que du problème posé par la pensée socialiste par les colonies, des puissances impérialistes : du moment que l'Europe sera réorganisée, ainsi que l'Amérique du Nord, ces ensembles posséderont une puissance si colossale et donneront un tel exemple que les pays semi civilisés ne pourront que se laisser entraîner par eux, ne fût-ce que sous la pression de leurs besoins économiques". (Le Conflit du Siècle. Steinberg, P. 242).
Le processus de la révolution communiste n'est pas autre chose que le processus de l'unification de la lutte du prolétariat à l'échelle mondiale. La lutte des ouvriers des pays moins développés, en particulier la lutte des ouvriers des pays de l'Est, fait partie intégrante de ce processus. Mais du point de vue des conditions subjectives et objectives, ce n'est que des pays développés que peut être impulsée la dynamique révolutionnaire de ce processus. Cette compréhension est vitale pour l'unité de la classe ouvrière mondiale, elle ne remet pas en question cette unité, au contraire. L'être de la classe ouvrière a toujours été révolutionnaire, même quand les conditions objectives ne l'étaient pas. C'est cette situation qui a déterminée la grande tragédie du mouvement ouvrier. Mais jamais les grandes luttes révolutionnaires n'ont été vaines, sans conséquences historiques. Les luttes des ouvriers de 1848 ont montré la nécessité de l'autonomie du prolétariat; les luttes de la Commune de 1871, la nécessité de détruire de fond en comble l'Etat bourgeois. Quant à la révolution russe et la vague révolutionnaire des années 1917-23, qui se sont déroulées dans des conditions historiques mûres mais défavorables (la guerre), elles sont une source inépuisable d'enseignements pour le prolétariat. La reprise de la lutte ouvrière au coeur du capitalisme dans la fin de la contre-révolution a déjà commencé à confirmer quelle sera la dynamique révolutionnaire de notre époque dans des conditions de crise économique généralisée.
ANNEXE 1 : SURPRODUCTION ET CRISE AGRICOLE
La crise agricole est une question que nous avons rarement traitée; pourtant aujourd'hui le développement de la crise générale du capitalisme implique aussi un développement de la crise agricole qui ne pourra pas ne pas avoir de conséquences importantes sur la condition de vie ouvrière. De plus, au travers de la crise agricole, on peut voir une illustration frappante des deux aspects de la crise historique du capitalisme, premièrement son caractère généralisé, deuxièmement, sa nature de surproduction.
Sur l'aspect généralisé de la crise agraire, F. Sternberg écrit dans "Le conflit du siècle" :
"La crise de 1929 se caractérise ... de plus par sa nature à la fois industrielle et agraire... C'est là un autre phénomène spécifique de la crise de 1929 qui ne s'était jamais produit au cours des crises du 19ème siècle... La catastrophe de 1929 frappe les USA aussi violemment que l'Europe et l'ensemble des pays coloniaux. De plus, elle n'est pas seulement une crise céréalière, mais ses effets touchent à toute la production agricole... Celle-ci, dans ces conditions, ne peut qu'aggraver encore la crise industrielle", (p. 334-335)
Et sur l'illustration de la nature de la crise générale qu'apporte la crise agricole, on ne saurait être plus clair que l'auteur déjà cité :
"Nulle part en effet, le caractère particulier de la crise capitaliste n'éclate aussi nettement que dans la crise agricole. Sous le règne des formes d'organisation sociale qui précédèrent le capitalisme, les crises avaient été marquées par un déficit de la production et, étant donné le rôle prépondérant tenu alors par la production agricole, par un déficit de la production des denrées alimentaires. (...) Mais pendant la crise de 1929, on produisait trop de denrées alimentaires et les fermiers, menacés par centaines de milliers d'être chassés de leurs fermes ... tandis que les gens des villes ne parvenaient pas, dans bien des cas, à acheter les denrées indispensables", (p.336).
Nous aurions tort de sous-estimer la question de la crise et de la surproduction agricole tant dans nos analyses que dans nos interventions et notre propagande.
Dans nos analyses de la crise, parce que la crise en se développant va devenir une donnée de plus en plus importante dans la condition ouvrière. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à dire durant les années 70, la surproduction agricole a pu être masquée et épongée par les aides, et les subventions des différents Etats qui maintenaient ainsi les prix et donc la production agricole. A l'heure actuelle, cette politique de soutien, tout comme la production industrielle touche à sa fin, et ou du moins, est considérablement réduite. Il suffit de considérer la situation de la surproduction agricole en Europe et tous les remous qu'elle a provoqués ces derniers mois pour s'en convaincre. Cela vaut pour l'Europe mais aussi pour les USA qui sont un des premiers producteurs agricoles du monde, ainsi :
"Les agriculteurs américains s'arrachent les cheveux. 1982 sera, disent-ils, leur pire année depuis la grande dépression... La crise est due essentiellement à la surproduction comme si les progrès techniques dont le Middle West avaient tant profité, commençaient à se retourner contre lui... En 1980, ils assuraient à eux seuls 24,3% des ventes mondiales de riz, 44,9% du blé, 70,1% du mais et 77,8% des arachides. Actuellement, un hectare cultivé sur trois "travaille" pour l'exportation. Les américains sont donc très sensibles au rétrécissement des marchés extérieurs provoqué par les difficultés de l'économie mondiale". (Le Monde).
Du point de vue de notre propagande, une telle situation de surproduction dans le domaine de l'alimentation illustre on ne peut mieux l'anachronisme total de la perpétuation du capitalisme et ce que l'humanité serait capable de réaliser, débarrassée du système marchand et du secteur d'armement, des secteurs improductifs;!'humanité se trouve dans une situation inconnue jusqu'à aujourd'hui où :
"La production actuelle de céréales à elle seule' pourrait fournir à chaque homme, femme et enfant, plus de 3 000 calories et 65 g de protéines par jour, ce qui est bien supérieur aux besoins, même calculés largement. Pour éliminer la malnutrition, il suffirait de réorienter réellement 2% de la production céréalière mondiale vers ceux qui ont besoin".(Banque Mondiale : "Rapport sur le développement dans le monde").
[1] [374] Voir Revue Internationale n°23 et n°27.
[2] [375] Il est intéressant de noter ici le parallèle que fait Keynes lui même entre le militarisme et les mesures de capitalisme d'Etat qu'il préconisait:
"Il est semble-t-il politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d'organiser les dépenses à l'échelle nécessaire pour réaliser les expériences grandioses qui confirmeraient ma démonstration - sauf dans des conditions de guerre". (Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie).
[3] [376] Voir Annexe II.
[4] [377] Voir Annexe II, (graphiques sur l'endettement).
[5] [378] Cette réalité vaut autant pour les pays de l'Est que pour ceux de l'Ouest. Mais il est intéressant de noter que la limitation des crédits de la part du bloc occidental qui fait partie de la politique générale dite d'"austérité" ait été présentée comme une mesure de "solidarité" vis-à-vis des "polonais".
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
- L'économie [90]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [342]
Revue Int. 1983 - 32 à 35
- 4374 reads
Revue Internationale no 32 - 1er trimestre 1983
- 2896 reads
La crise de surproduction capitaliste mondiale : une tourmente qui pose la question de la révolution
- 8126 reads
Alors que l'humanité a développé ses forces productives qui, bien employées", permettraient d'éliminer en quelques années toute pénurie de moyens de subsistance (alimentation, santé, logement, communication, éducation, etc..) et ce sur toute la surface de la terre, ces forces, cette potentialité productive se voient aujourd'hui de plus en plus paralysées, détruites par les mécanismes et les contradictions internes aux rapports de production capitalistes.
De plus en plus, le monde manque de tout, plongé dans une crise de surproduction capitaliste.
A la fin de 1982, le nombre de chômeurs dans les principaux pays industrialisés bat tous les records depuis la seconde guerre. Qui plus est, la croissance du chômage s'accélère: près d'un demi million de chômeurs de plus en un seul mois aux USA.
Même record et même accélération pour le nombre d'entreprises en faillite et de pays en banqueroute financière. Les famines se multiplient et s'étendent dans les zones sous-développées du monde.
Dans les pays de l'Est le rationnement alimentaire prend les allures des pires années de la dernière guerre alors qu'au coeur de la première puissance mondiale, à Détroit, les queues de chômeurs sans ressources s'allongent devant les soupes populaires.
Pendant ce temps, les usines ferment, ou tournent en employant une part toujours moindre de leur capacité productive (moins de 70% aux USA, l'industrie de l'acier en Europe est immobilisée à 50%!); des excédents agricoles sont détruits et le cours des matières premières, alimentaires ou industrielles, s'effondre par manque d'acheteurs.
Quant aux perspectives, les gouvernements ont abandonné la rhétorique des "nous voyons déjà le bout du tunnel" pour celle des "nous devons nous préparer à des années de rigueur, d'austérité et de sacrifices".
La réalité devient de plus en plus évidente: ce ne sont pas des raisons "NATURELLES" (manque d'énergie ou de matières premières) qui bloquent les forces productives: les marchands internationaux ne savent plus quoi faire des stocks de pétrole ou de lait invendus. Ce n'est pas non plus le manque de force de travail (éduquée ou non): le chômage touche aussi bien les ouvriers analphabètes que les porteurs de diplômes universitaires.
Ce n'est pas un manque d’innovation technique: les secteurs les plus avancés de 1’industrie moderne (électronique, informatique), longtemps épargnés par la crise, sont frappés à leur tour de plein fouet (la "Silicon Valley" californienne, haut lieu mondial de l'électronique de pointe, connaît pour la première fois l'épidémie du chômage). Ce n'est pas enfin, un manque de "bonnes politiques de gestion capitaliste". Toutes les politiques économiques font faillite: les politiques à la Reagan qui annonçaient la relance par la rigueur et l'équilibre budgétaire, n'ont obtenu ni relance ni équilibre: aux USA la production recule et le déficit de l'Etat est un des plus élevés de l'histoire du pays. Les politiques à la Mitterrand qui au contraire annonçaient la reprise par l'augmentation de la consommation populaire et du déficit de l'Etat, ont bien réussi à creuser le déficit public, mais la croissance industrielle en France continue de s'effriter tout comme le niveau de vie des travailleurs. Quant au capitalisme d'Etat des pays de l'Est, il étouffe dans l'hypertrophie de la production d'armements.
A chaque convulsion de la crise une réalité apparaît de plus en plus crûment : c'est dans le système social mondial de production lui-même que se trouve la source de l'étranglement des forces productives.
Une fois de plus, depuis plus d'un demi siècle, l'humanité est en train de vivre l'impitoyable démonstration pratique de la caducité historique des lois de production capitalistes.
Qu'elles le veuillent ou non, les classes exploitées, sont confrontées aux questions que leur pose un horizon de plus en plus chargé de nuages sombres.
Y aura-t-il de nouveau une période de relative "reprise économique" comme ce fut le cas après les convulsions de 1967, de 1970, ou de 1974-75? Une solution de type véritablement communiste est-elle autre chose qu'un joli rêve?
Y-AURA-T-IL UNE REPRISE ECONOMIQUE A COURT OU MOYEN TERME?
Voyons d'abord ce qu'en disent les experts des organismes économiques internationaux occidentaux. Le Financial Times du I7/11/82 rendait compte des conclusions de la réunion du comité d'Economie Politique de l'OCDE au sujet des prévisions pour l'année 83, dans les termes suivants: "Le secrétariat de l'organisation doute désormais que les prévisions qu'il avait faites auparavant d'une augmentation de la production de 2,5% en 83 puissent être atteintes, étant donnée la stagnation en 82. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de croissance en Europe 1'année prochaine, et que 1 'économie Japonaise continue à ralentir, en partie à cause des accords sur la limitation des exportations. L'OCDE est moins optimiste que Washington quant à une reprise économique solide aux Etats-Unis."
Pour le proche avenir, ceux qui théoriquement ont pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de l'économie capitaliste, ne voient aucune relance possible. Tout au plus, certains d'entre eux envisagent aux USA, et seulement là, un ralentissement momentané de la dégradation de la situation économique, le temps des élections présidentielles... mais, à juger par l'évolution actuelle, même cette mièvre perspective semble irréaliste.
A moyen et à long terme, certains de ces "savants" de la bourgeoisie décadente, parlent bien d'une éventuelle reprise économique. Mais ils ne savent ni quand, ni comment, ni par quoi ou par qui une telle relance pourrait être amorcée.
Ce manque de perspective traduite le désarroi de la bourgeoisie devant l’inefficacité croissante de toutes ses politiques économiques, mais aussi devant l’accumulation de difficultés que ces mêmes politiques ont à leur tour engendré.
Comme nous l'écrivions au début de 1980: "... non seulement les remèdes que les états administrent a la crise depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. "(Revue Internationale N°20, "Années 80 : l'accélération de la crise").
L'insolvabilité financière des gouvernements du Mexique, de l'Argentine, de la Pologne et du Zaïre, ne constitue pas un problème "localisé" dans les zones moins industrialisées. Elle sanctionne la faillite de la politique du capital international fondée sur l'endettement généralisé.
Les médias parlent beaucoup de l'endettement des pays moins développés. Mais les 500 milliards de dollars auxquels est évalué aujourd'hui l'ensemble de l'endettement de ces pays paraît dérisoire lorsqu'on le compare à l'endettement des économies des pays les plus puissants... et en premier lieu à celui des USA. Dans la première métropole industrielle du monde l'endettement global de l'économie a été entre i960 et 1980, multiplié par 5,4! Entre 1970 et 1980 la dette des pouvoirs publics américains est passée de 450 milliards de dollars à 1069 milliards et celle du secteur privé de 975 à 2840 milliards!
Aujourd'hui, de plus en plus de dettes viennent à échéance, mais les débiteurs n'ont pas plus les moyens réels de payer qu'au moment où ils ont commencé à s'endetter massivement. Dans ces conditions aucun gouvernement n'ose plus parler de relance véritable. L'insuffisance, le handicap congénital du capitalisme c'est son incapacité à créer par lui même ; des débouchés en mesure d'absorber, d'acheter toute la production qu'il est potentiellement capable de réaliser. Contrairement au féodalisme et à l'esclavagisme antique, lorsque le système capitaliste devient historiquement incapable d'assurer à la société ses moyens matériels de subsistance, ce n'est pas par manque de moyens de production (il en a "trop" à ce moment-là) mais par manque de marchés solvables.
Le capitalisme décadent, dont la pénurie de marchés l'a entraîné à deux reprises à des guerres mondiales, qui soumet l'ensemble de la vie sociale, et entre autres la recherche scientifique la plus avancée, aux impératifs militaires que lui impose "la protection des marchés" des uns contre les autres5 ce système sénile et barbare donc, a cru pouvoir trouver dans le crédit un palliatif à ce manque de débouchés devenu chronique. Et cela surtout depuis la fin des années 60, fin de la reconstruction d'après-guerre.
Mais le développement du crédit ne peut faciliter le fonctionnement de l'économie que s'il s'accompagne entre temps d'une augmentation correspondante des moyens de paiement effectif de ceux qui s'endettent. Autrement il ne sert qu'à masquer les problèmes de fond, qu'à retarder les échéances tout en les aggravant. Or, ce à quoi on a assisté pendant ces années, c'est à une croissance de plus en plus accélérée du crédit alors que la croissance de la production réelle n'a cessé dans le même temps "5e" se ralentir jusqu'à" reculer.
A travers le crédit, le capitalisme est parvenu à retarder l'explosion violente de ses contradictions, mais il n'a fait que cela : a retarder.
Pour y parvenir il a dû payer très cher. Il lui a fallu détruire les fondements d'un de ses instruments les plus vitaux: le système monétaire international.
C'est ainsi que le capitalisme a créé méticuleusement dans les dernières années les conditions d'une tourmente économique qui concentrera en elle simultanément les traits de l'effondrement de 1929 et ceux du marasme des années 20 en Allemagne, lorsque pour acheter un timbre-poste il fallait une brouette de papier-monnaie.
Fin 82, la crainte d'un effondrement financier déclenché par le nombre croissant de débiteurs insolvables fait courir un vent de panique dans le monde des finances. Quelle solution?
L'accélération de la fuite en avant : augmenter la masse de la monnaie du FMI, les DTS (on parle de b0% de plus!).
Pour empêcher l'explosion d'un krach financier sanctionnant l'impossibilité du capital de pallier au manque de débouchés solvables par le crédit, par l'excès de papier, celui-ci n'a d'autre issue que de créer plus de papier.
Pour les capitalistes, le problème est de moins en moins: "comment assurer une relance" pour devenir "comment empêcher un effondrement incontrôlé".
Finies les illusions de ceux qui croyaient au caractère purement "monétaire"de la crise ou à la thèse de la"restructuration". C'est au coeur même des rapports de production, dans la façon même dont les différentes classes de la société sont en rapport pour produire que se trouve le noyau de la crise.
Pour les ouvriers, le capital n'a qu'une perspective à offrir: le chômage, la misère, 1'exclusion de la société civile. De moins en moins capable de gouverner par la puissance de son économie, le capital gouverne et gouvernera de plus en plus par la force et la terreur. C'est le langage de la "rigueur", de 1'"austérité", du chantage au chômage, des sacrifices imposés.
La misère cependant n'ouvre aucune porte vers la reprise économique: au contraire, elle rétrécit encore plus les faibles marchés existants. Mais chaque capital national y est contraint par la concurrence internationale.
Lentement mais inexorablement, l'effondrement du capital prépare de gigantesques affrontements de classes. De 1'issue de ces batailles qui verront s'affronter capital et prolétariat mondial, dépend l'avenir de l'humanité.
Si la bourgeoisie parvenait un jour à briser violemment la résistance prolétarienne et à embrigader les prolétaires dans une nouvelle folie guerrière, c'est le sort même de l'espèce humaine qui se trouverait mis en question.
Mais si les ouvriers du monde entier parviennent à engager une lutte internationale pour la défense intransigeante de leurs intérêts de classe ils ouvriront la porte à la seule issue possible pour l'humanité: le communisme.
LE COMMUNISME N'EST PAS UNE UTOPIE MAIS LA SEULE ISSUE REALISTE.
Parce que le mal se trouve à la racine du système, c'est à la racine qu'il faut l'extirper.
Les institutions capitalistes, le capital, le salariat, l'échange, la marchandise, les nations sont devenus des absurdités vivantes eu égard aux capacités et aux nécessités de l'humanité.
Les fondements de ces lois datent de la fin du Moyen-âge. A cette époque, un serf pouvait à peine nourrir par son travail et celui de toute sa famille un individu membre de la noblesse. Aujourd'hui un agriculteur salarié américain peut nourrir 80 personnes. Cependant, tout comme pour les ouvriers de la Renaissance, son revenu n'est déterminé ni en fonction de ses besoins ni en fonctions des possibilités productives de la société, mais par la valeur sur le marché de sa force de travail comme marchandise. En outre, tout comme à l'époque des marchands de Venise, le capital n'a jamais produit et ne produira jamais qu'en fonction des besoins de sa propre accumulation.
Lorsque cette accumulation, pour des raisons marchandes devient impossible, la production capitaliste s'effondre, quelles que soient les forces productives dont la société dispose, quels que soient les besoins des hommes.
L'humanité ne pourra faire l'économie d'une révolution sociale mondiale, violente, bouleversant de fond en comble l'organisation de la société.
Il lui faudra faire tourner les usines en fonction exclusivement des besoins humains, il faut pouvoir distribuer la production en fonction des nécessités et des possibilités des hommes, et donc éliminer l'échange et le salariat. Il lui faut unifier consciemment la production mondiale. Bref, il lui faut construire le communisme.
La crise, qui n'en est qu'à ses débuts, se chargera de démontrer par les dévastations de ses effets que ce qui peut sembler encore aujourd'hui un rêve utopique, constitue en réalité la seule issue possible pour échapper à l'apocalypse nucléaire.
La crise économique .mondiale met chaque jour plus le prolétariat international devant ses responsabilités historiques: ou briser les chaînes du vieux monde ou périr avec lui.
OU EN EST LA CRISE ?
La production industrielle au niveau de 1973
Pour la quatrième fois depuis le début de la crise à la fin des années 60, la capital connaît une nouvelle chute de la croissance industrielle qui comme par le passé devrait être plus profonde que les précédentes.
Depuis 1979 la production industrielle a globalement reculé dans les principaux pays occidentaux. Fin 1982 elle est tombée au niveau de 1973 dans la plupart d'entre eux, soit le niveau d'il y a dix ans. Le Japon est à son tour frappé : la croissance s'y ralenti de plus en plus et sa chute ne sera que plus violente, comme en 1974-75.
Le chômage s'accélère
Le nombre de chômeurs et 1a proportion de ceux-ci dans la population active sont les plus élevés depuis la guerre. Mais la croissance du chômage, loin de se ralentir, s'accélère depuis 1980 à des rythmes sans précédents
"La bourgeoisie ... ne peut régner, car elle ne peut plus assurer 1'existence de 1'esclave à 1'intérieur de son esclavage : elle est forcée de le laisser déchoir si bas qu'elle doit le nourrir au lieu d'être nourrie par lui. La société ne peut plus vivre sous la bourgeoisie; c'est à dire que 1'existence de la bourgeoisie et 1'existence de la société sont devenues incompatibles ".
MARX et ENGELS, Le manifeste du parti communiste.
La crise est devant nous
Les taux de chômage sont généralement encore loin de ceux atteints pendant la dépression économique des années 30. Il ne faut pas y voir une "consolation" mais une illustration de jusqu'où peut aller le capitalisme en crise, si le prolétariat international n'a pas la force d'imposer sa propre issue révolutionnaire.
L'explosion de l'endettement
La fuite en avant par le crédit apparaît clairement dans l'évolution de l'endettement des pays moins développés (celui-ci a presque quintuplé en dix ans).
Il ne constitue cependant qu'une petite partie de l'endettement global du capital mondial.
La baisse des matières premières
La crise de SURPRODUCTION se traduit par une chute de la demande et des prix des matières premières, surtout depuis 1981. Pour les pays moins développés, producteurs essentiellement de matières premières, c'est la certitude de nouvelles banqueroutes. Pour le système financier international c'est le danger d'effondrements en chaîne.
La baisse du prix du pétrole au moment où la crise s'aggrave, ruine le mythe de "la crise du pétrole".
Le ralentissement du commerce mondial
La croissance du commerce mondial, tout comme celle de la production, n'ont cessé de se ralentir depuis 1977.
En 1982, lai croissance des échanges internationaux recule de façon absolue et plus rapidement que celle du volume de la production, ce qui traduit et annonce une tendance au développement du protectionnisme.
Sources : Rapport annuel du GATT,1981/82 ; Newsweek,; OCDE, Principaux Indicateurs Economiques
Questions théoriques:
- L'économie [90]
- Décadence [2]
Convulsions dans le milieu révolutionnaire : le P C I (Programme Communiste) à un tournant de son histoire
- 4265 reads
Depuis la fin des années 60, la classe ouvrière, en engageant la lutte internationalement (1968 en France, 1969 en Italie, 1970 en Pologne, 1975-76 en Espagne, etc.) a mis un terme à cinquante ans de contre-révolution. La grève de masse en Pologne en 1980-81 a marqué jusqu'à présent le point le plus haut d'une nouvelle reprise qui mène à des affrontements de classe décisifs qui décideront du sort de 1'humanité : révolution ou guerre.
La bourgeoisie à 1'échelle internationale reconnaît le danger mortel pour son système contenu dans la combativité ouvrière. Par dessus les frontières nationales et même celle des blocs impérialistes, la classe capitaliste collabore pour faire face au danger de la grève de masse. Le prolétariat n'aura pas devant lui une bourgeoisie surprise et déconcertée comme dans la première vague de lutte de 1968, il affrontera une bourgeoisie avertie, préparée à utiliser au maximum ses capacités de mystification, de dévoiement et de répression. Le processus d'unification internationale de la classe ouvrière dans sa lutte pour la destruction du capitalisme s'annonce comme un processus long et difficile.
C'est à cette réalité que les minorités révolutionnaires qui participent du processus d'unité et de prise de conscience de la classe ouvrière se trouvent confrontées. Loin d'être à la hauteur des exigences de la période actuelle, les organisations révolutionnaires sont extrêmement minoritaires et se débattent dans une confusion politique et une dispersion organisationnelle profondes.
Depuis plus d'un an, les faiblesses n'ont fait que s'accentuer dans des disparitions de groupe et des scissions. Ce phénomène culmine aujourd'hui avec la crise qui secoue le Parti Communiste International (Programme Communiste). Après une vague d'exclusions et de nombreux départs, c'est une majorité de 1'organisation qui va rejoindre les positions les plus chauvines et nationalistes de la bourgeoisie, en prenant position pour un camp dans la guerre impérialiste au Moyen-Orient. Cette organisation paye le prix de sa sclérose politique et organisationnelle.
Son incapacité à tirer un bilan critique de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et de la contre-révolution qui 1'a suivie, des positions de 1'Internationale Communiste et des fractions de gauche qui s'en sont dégagées, - en particulier sur la question nationale et syndicale et sur la question de 1'organisation des révolutionnaires et du parti -, son incapacité à comprendre les enjeux de la période actuelle, l'ont mené tout droit à 1'opportunisme et à 1'activisme, jusqu'à la dislocation de 1'organisation.
C'est une responsabilité de 1'ensemble des organisations révolutionnaires de tirer les leçons de cette crise qui exprime la faiblesse générale du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, et de contribuer activement à ce que la décantation nécessaire et inévitable ne se transforme en dispersion des énergies révolutionnaires. L'histoire ne pardonne pas, et si les organisations révolutionnaires aujourd'hui ne sont pas capables de répondre aux exigences de la situation, elles seront balayées sans recours, affaiblissant la classe ouvrière dans sa tâche de défense des perspectives du communisme au cours de ses combats.
"Une crise qui est pour nous très grave et dont les répercussions sur toute notre organisation seront probablement décisives, vient d'éclater dans le Parti" (Le Prolétaire n°367, Il Programma Comunista n°20, "Mieux vaut moins mais mieux"). Les articles de la presse nous informent de départs en cascade :
En France ;
- la scission de ceux qui Se regroupent autour d'El Oumami, autrefois organe du PCI pour l'Algérie, aujourd'hui devenu l’"organe des communistes léninistes algériens", pour défendre des positions nationalistes bourgeoises dans le plus pur style tiers-mondiste ;
- le départ de la majorité des membres à Paris et d'autres un peu partout en France "parmi les quels ceux qui avaient des responsabilités de di rection", apparemment sur des positions proches d'El Oumami, avec pour certains le projet de sortir une revue, Octobre.
"En Italie, la crise a secoué toutes les sections du fait même de sa précipitation, mais à la liquidation n 'ont adhéré que quelques camarades de Turin et - nous ne savons pas encore combien - quelques camarades de Florence" (Il Programma Communista 29-10-82).
En Allemagne, la disparition de la section et de la publication Proletarier.
La presse du PCI, en donnant ces nouvelles, ne parle pas :
- de l'expulsion l'an dernier des sections du sud de la France dont Marseille, par la même direction qui est partie actuellement en France, et des sections en Italie, dont Ivrea. Il semblerait que les expulsés mettaient en question toute la politique consistant à mettre en place une panoplie de "comités" ("comité contre les licenciements", "comité anti-répression", comités dans l'armée, féministes, de squatters, etc.), ayant tous pour objectif de mieux "implanter" le Parti au sein des "luttes sociales".
- des départs d'autres éléments ensuite, pour protester contre ces expulsions, et des démissions individuelles pour des raisons non encore claires.
- de la disparition du "secteur Amérique Latine".
Ce sont des pans entiers du PCI qui se sont volatilisés en quelques mois sans aucune clarté réelle. Pourquoi cette crise ? Pourquoi maintenant ?
Les événements de la période de montée des luttes de classe aujourd'hui commencent à dissiper le brouillard de l'idéologie bourgeoise dans la tête des ouvriers. De même, ils mettent à l'épreuve les positions politiques des minorités révolutionnaires en balayant les débris des groupes gangrenés par l'idéologie bourgeoise, en secouant, plus, disloquant des groupes ambigus et inutiles.
Dans ce sens, la crise du PCI est la manifestation la plus spectaculaire des convulsions du milieu révolutionnaire aujourd'hui. Il y a un an, quand nous avons parlé des convulsions, des scissions, des régressions politiques dans le milieu révolutionnaire (Revue Internationale n°28) face aux "années de vérité", tout le milieu politique a fait la sourde oreille. Aujourd'hui, peut-être ces messieurs vont-ils se réveiller ! Le milieu révolutionnaire (y inclus le PCI) n'a pas voulu créer un cadre de Conférences internationales, permettant la décantation des positions politiques dans la clarté ; aujourd'hui, il subit la décantation par la "force des choses", avec tous les risques de perte des énergies militantes que cela comporte. Même si aujourd'hui, il est clair que la réalité sanctionne les insuffisances programmatiques du PCI, il est de la responsabilité des révolutionnaires de tirer le bilan qui s'impose impérieusement pour éviter de répéter les mêmes erreurs à 1'infini.
On ne peut ignorer que pendant longtemps le PCI a été un pôle de référence dans plusieurs pays pour des éléments qui cherchaient la voie des positions de classe. Mais en se basant sur un programme politique inadéquat et erroné, sur une structure interne de secte, le PCI s'est sclérosé au fil des années. Sa régression politique s'est révélée à l'épreuve des événements : devant le massacre au Liban, le PCI a appelé les prolétaires au Moyen-Orient à lutter "jusqu'à la dernière goutte de sang" pour défendre la cause palestinienne à Beyrouth. Quelques mois après, 1'organisation éclate.
La crise ne s'explique pas comme semblent le croire aussi bien les scissionnistes que le PCI "maintenu" par des erreurs "de la direction" ou par des erreurs "tactiques". Ce sont des erreurs programmatiques, à la base même de la constitution du PCI qui se payent aujourd'hui. Le "retour à Lénine" pour appuyer la "glorieuse lutte de libération nationale" que préconisent les scissionnistes, pour couvrir tout simplement leur démarche maoïsante est toute proche de la position du PCI. Si le PCI ne tient qu'à un fil aujourd'hui, cette manière d'expliquer la crise en termes d'"erreurs de direction" et de "tactique" va le couper définitivement.
UNE CRISE QUI ILLUSTRE LA FAILLITE D'UNE CONCEPTION DE L'ORGANISATION
LE BLUFF DU PCI
La crise aujourd'hui laisse un bilan accablant pour "le parti compact et puissant de demain".
Elle se traduit, selon la presse du PCI, "par 1'effondrement organisatif du centre international et la disparition de 1'ancienne Rédaction du Prolétaire, par le départ de tous les responsables centraux de France" (Le Prolétaire n°367). Les militants qui restent dans le PCI n'étaient au courant de rien. Ils en sont réduits à faire des appels dans la presse pour que les membres qui veulent rester dans le parti se manifestent en écrivant à la Boite Postale ! C'est incroyable d'être acculé ainsi à donner à l'Etat un moyen de repérage si facile.
Les fameux et arrogants "responsables centraux" sont partis en emportant le matériel, l'argent, "y compris les cotisations qui avaient été payées le jour même" (d'après un militant du PCI à Paris), des locaux. Voila des moeurs de gangstérisme politique de la bourgeoisie totalement étrangères au prolétariat que nous avions stigmatisées sans ambiguïté lors de l"Affaire Chénier" pendant la crise du CCI (voir Revue Internationale n°28).
Les grands mots ronflants sur le parti pur et dur, "centralisé", n'étaient qu'un bluff. Le PCI s'effondre comme un château de cartes : "La crise s'est traduite par une activité décentralisée et localiste, couverte seulement en apparence par une centralisation de façade" (Il PC 29-10-82). Les grands discours sur le "centralisme organique" cachaient un fédéralisme de la pire espèce où chaque partie de l'organisation finit par n'en faire qu'à sa tête, une structure molle ouverte à tous les vents de l'idéologie bourgeoise, véritable pépinière d'irresponsables, d'apprentis-bureaucrates, de futurs sergents-recruteurs pour les massacres impérialistes, comme déjà aujourd'hui pour le Moyen-Orient.
Après s'être gargarisé de mots pendant 40 ans sur le parti qui "organise" la classe ouvrière, on ne peut tomber de plus haut.
Peut-être que cette crise servira de leçon à tous les groupes dans le mouvement actuel qui réduisent tout débat à la question du parti, qui se décernent des titres de gloire qu'ils n'ont rien fait pour mériter, qui entravent tout progrès réel vers un véritable Parti de la classe ouvrière par leurs prétentions absurdes d'aujourd'hui. Expliquer les difficultés de la lutte de classe dans la situation internationale par l'absence du parti, tracer comme seule perspective celle de sa présence eucharistique qui résoudra tout, comme l'a ressassé le PCI depuis des années, est non seulement faux et ridicule, ça se paye. Comme nous le disions : "Le drame du bordiguisme est de vouloir être ce qu'il n'est pas : le Parti, et de ne pas vouloir être ce qu'il est : un groupe politique. Ainsi, il n'accomplit pas - sauf en paroles - les fonctions du parti qu 'il ne peut accomplir, et n'assume pas les tâches, mesquines à ses yeux, d'un vrai groupe politique" ("Une caricature de parti : le parti bordiguiste", Revue Internationale n°14).
Où est donc le fameux parti "bloc monolithique" ? Sans failles ? Ce "monolithisme", revendiqué par le PCI, n'a jamais été qu'une invention stalinienne. Il n'y a jamais eu d'organisations "monolithiques" dans l'histoire du mouvement ouvrier. La discussion constante et la confrontation politique organisées dans un cadre unitaire et collectif, est la condition d'une véritable solidité, homogénéité et centralisation d'une organisation politique prolétarienne. En étouffant tout débat, en cachant les divergences derrière le mot de "discipline", le PCI n'a fait que comprimer les contradictions jusqu'à l'éclatement. Pire, en empêchant la clarification à l'extérieur comme à l'intérieur de l'organisation, il a endormi la vigilance de ses militants. La sécurisation bordiguiste de la vérité pyramidale, la direction des chefs, a laissé les militants dépourvus d'armes théoriques et organisationnelles devant les scissions et les démissions. C'est ce que le PCI semble reconnaître lorsqu'il écrit : "Nous entendons traiter (ces questions) de façon plus ample dans notre presse, en mettant nos lecteurs devant les problèmes qui se posent à l'activité du parti" (Il PC, id.). Ces mots semblent être pour le moment plus un clin d'oeil aux militants qui sont partis dans une confusion politique complète, et dont certains ne se doutent certainement pas du bourbier dans lequel ils se sont enfoncés, qu'une véritable reconnaissance de la faillite de l'étouffoir du PCI "seul au monde". La reconnaissance de la nécessité d'ouvrir le débat sur "les problèmes qui se posent à l'activité", et l'ouverture effective de discussions à l'intérieur et à l'extérieur est une des conditions pour garder le PCI au prolétariat, pour lutter contre la pourriture politique qui ronge l'organisation. Le PCI a connu d'autres scissions dans ses quarante ans d'existence, mais celle d'aujourd'hui ébranle non seulement son cadre organisationnel, mais les fondements de sa trajectoire politique, et le met devant l'alternative : tiers-mondisme ou marxisme.
L’INTERNATIONALISME CONTRE TOUTE FORME DE NATIONALISME
LE NATIONALISME AVOUE D1EL OUMAMI
El Oumami a scissionné avec le PCI parce que le jusqu'auboutisme dans la défense de l'OLP a Beyrouth devait y rencontrer des résistances. Ces résistances doivent être bien faibles si on en juge par la position du PCI sur la question. On peut cependant supposer qu'elles portent sur le degré d'engagement, El Oumami intitulant le document dans lequel il Se présente : "Du parti-programme au parti d'action révolutionnaire". Tout un programme !
El Oumami défend le caractère progressiste du mouvement national palestinien contre "le cancer greffé sur le corps arabe qu'est 1'entité sioniste", "1'Etat-colon, mercenaire, raciste et expansionniste d'Israël". Pour El Oumami, il est hors de question de mettre sur un pied d'égalité "l'Etat-pied-noir" et les "Etats légitimes" du "monde arabe".
Ce type de distinction a toujours été l'argument de la bourgeoisie pour embrigader la classe ouvrière dans la guerre. Oui, tous les Etats capitalistes sont ennemis de la révolution, nous dit-on, mais il y a l'ennemi n°1 et l'ennemi n°2. Pour la première guerre mondiale, "battons-nous contre "le despotisme russe" disait en substance la Social-Démocratie allemande ; pour l'autre camp, c'était se battre contre "le militarisme prussien". Dans la 2ème guerre mondiale, c'est avec le même langage que les "antifascistes" de tous bords, staliniens en tête, ont embrigadé les prolétaires en appelant et en participant à "abattre l'ennemi n°1", "l'Etat fasciste", pour défendre "l'Etat démocratique".
Pour El Oumami, 1'"union sacrée juive" fait disparaître les antagonismes de classe à l'intérieur d'Israël. Inutile donc de faire des appels au prolétariat d'Israël. C'est exactement le "peuple allemand, peuple maudit" des staliniens pendant la 2ème guerre mondiale. Et quand, au cours d'une manifestation "OLP-Solidarité", aux cris de "Sabra et Chatila, vengeance !", El Qumami se vante d'avoir "capturé un sioniste qui a reçu une terrible raclée", on est au niveau de "à chacun son boche" du PCF à la fin de la 2ème guerre.
El Oumami se joint aux rangs de la bourgeoisie au niveau du chauvinisme le plus abject. A ce niveau, c'est un groupe maoïsant, tiers-mondiste virulent, qui ne mérite pas qu'on s'attarde particulièrement. Mais ce qui frappe, en lisant les textes, c'est que ces chauvins nationalistes ont plein la bouche de la Gauche Italienne, cette fraction de la Gauche Communiste Internationale qui fut une des rares et la plus conséquente pour résister à la contre-révolution et maintenir l'internationalisme prolétarien dans la tourmente de la 2ème guerre impérialiste.
Comment le PCI, "continuateur" de la Gauche Italienne, a-t-il pu laisser se développer un tel poison nationaliste en son sein ? Et c'était la direction de Paris, la rédaction du Prolétaire, la rédaction d'EI Oumami, la section en Allemagne ?
Nous rappellerons dans la troisième partie de cet article comment le PCI a conçu cet enfant dans l'oubli de toute une période de l'histoire de la Gauche Italienne entre 1926 et 1943, comment il s'est formé avec des groupes de "Partisans" de la "Résistance" en Italie, le "comité anti-fasciste de Bruxelles" en 1945, comment les confusions politiques sur le rôle de 1'"antifascisme" et la nature des camps en présence à la fin de la 2ème guerre mondiale que le(s) PCI n'ont jamais clarifiées, sont à la racine de ce qui éclate au grand jour aujourd'hui.
Parce que le PCI a nourri cet enfant et le reconnaît même aujourd'hui, ce dernier est le produit légitime de sa propre incohérence et dégénérescence.
LE NATIONALISME HONTEUX DU P.CI.
"Pour le vrai révolutionnaire naturellement, il n'y a pas de 'question palestinienne', mais uniquement la lutte des exploités du Moyen-Orient, arabes et juifs y compris, qui fait partie de la lutte générale des exploités du monde entier" (Bilan n°2).
El Oumami s'en fout d'une telle position : à l'école de la "tactique" du PCI, il pose la question non pas en terme de classes, mais en terme de nations. Le futur "parti d'action révolutionnaire" met donc son géniteur, le PCI, au pied du mur, connaissant fort bien son incohérence congénitale, et lui lance un défi : "Imaginons un instant 1'invasion de la Syrie par 1'Armée Sioniste. Devons-nous rester indifférents ou pire (sic) appeler au défaitisme révolutionnaire sous prétexte que 1'Etat syrien est un Etat bourgeois à abattre ? Si les camarades du Prolétaire sont conséquents, ils doivent le déclarer publiquement. Quant à nous, nous prenons position ouvertement contre Israël". Et encore : "Le Prolétaire se prononce pour la destruction de 1'Etat pied-noir d'Israël. Soit. Mais en même temps, il soutient que les Palestiniens subissent une oppression nationale dans les pays arabes, qu'Israël est entré au Liban continuer 1'oeuvre de la Syrie. Alors, où réside la spécificité d'Israël? Devons-nous comprendre que la destruction de1'Etat pied-noir a la même signification que la destruction des Etats arabes, aussi réactionnaires soient-ils ?".
Pour El Oumami, c'est net : le critère réactionnaire ne doit pas jouer pour un prolétaire arabe. Son Etat, c'est un Etat arabe, un point c'est tout. D'abord la guerre, après les lendemains qui chantent.
Mais que répond le PCI ? Que répondent les défenseurs intransigeants, les héritiers de la Gauche Italienne, le Parti Historique ? Tout juste un petit "oui, mais"...
L'article "La lutte nationale des masses palestiniennes dans le cadre du mouvement social au Moyen-Orient" publié dans Le Prolétaire et II Programma commence en nous sermonnant sur le sentiment panarabe, le capital arabe, la tendance unitaire arabe et la nation arabe : le rêve d'un étudiant universitaire qui a du rater la fin du cours sur le panslavisme, la négritude, et autres guevarismes des années 60.
Le "capital arabe" n'est pas inféodé au capital américain... Ce serait une vision "superficielle". Par contre, "l'Etat colon juif" l'est "constitutionnellement". Le PCI ne dit pas qu'Israël est totalement un bloc sans classes, niais que les prolétaires là-bas lui semblent "plus anti-arabes que les bourgeois". Et les sentiments xénophobes ne touchent jamais les prolétaires palestiniens ou français ou italiens comme de bien entendu. Et pour finir, on nous sort la vieille cuisine du niveau le plus bas du"maoïsme"le plus répugnant qu'on pouvait trouver chez les "Students for Démocratie Socialism" américains, sur la classe ouvrière ayant "le privilège de peau blanche" qui exploiterait les ouvriers noirs d'Amérique.
Quant à l'OLP, il reste un défenseur de la veuve et de l'orphelin à "la pointe la plus avancée des luttes sociales gigantesques du Moyen-Orient".
Le PCI affirme : "C'est précisément sur le terrain de la lutte commune (entre bourgeoisie et prolétariat) que les prolétaires palestiniens et arabes peuvent acquérir la force pour se dresser contre leurs alliés apparents, mais en réalité déjà leurs ennemis d'aujourd'hui". De qui ? De quoi ? Ah, mais ce n'est que "1'apparence qui est inter-classiste" nous dit la science bordiguiste... En réalité la guerre des Classes "vit à l'intérieur des sujets physiques eux-mêmes", (...) "au-delà et en dehors et même contre la conscience des individus eux-mêmes". Le PCI remplace la politique par la psychologie individuelle.
"Il faut renforcer la lutte nationale en la remplissant de contenus que la bourgeoisie se garde bien de lui donner". Ceci s'appelle défendre la "révolution double", sans y être et tout en y étant.
Cet article de clarification (?) finit tout simplement dans le délire. Il faut "construire une armée à direction prolétarienne grâce au travail organisatif des communistes" pour créer un "cobelligérant" avec l'armée de l'OLP !!
Le PCI déverse exactement les mêmes lamentations que la scission : "Le prolétariat dans les métropoles ne se mettaient pas vraiment en mouvement"; alors "à sa place, on a cherché les mouvements de jeunes, de femmes, anti-nucléaire, pacifiste" (Le Prolétaire n°367). C'est le triste refrain de tous les tiers-mondistes, les étudiants, les blasés et les modernistes : le prolétariat les "déçoit".
Comme le PCI prétendait être déjà le parti, ses enfants n'ont fait que vouloir le mouvement "tout de suite" ; de là ses qualificatifs de "mouvementistes" pour les démissionnaires et les scissionnistes. Une scission "propre", El Oumami ? Cette scission est proprement tombée dans le gauchisme du PCI.
Sortir de ce marasme gauchiste ne sera pas facile pour le PCI. Il n'en prend pas le chemin. Pour le moment, il gémit des "mea culpa" exactement sur le même terrain qu'El Oumami. Le Parti n'aurait pas su faire "le lien tactique" avec les masses ; il serait resté trop "abstrait", trop "théorique". Tout cela est faux. Le PCI a utilisé le mot "programme communiste" pour couvrir un vide théorique et justifier une pratique de soutien au nationalisme et d'activisme sans principes. Ce vide théorique et sa pratique actuelle, c'est ce que nous allons voir maintenant.
LA SOURCE DES ERREURS : LE VIDE THEORIQUE
"Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants" (Marx. "Le 18 Brumaire").
L'IC ET LES GAUCHES
Pour expliquer la crise du PCI, il faut remonter aux sources de sa régression politique, au manque de compréhension des erreurs de 1'Internationale Communiste (IC), au nécessaire réexamen critique du passé que le milieu actuel n'a jamais su ni voulu faire jusqu'au bout.
La Gauche Communiste des années 20 n'a pas cherché à expliquer la dégénérescence de l'IC par une "crise de direction", comme le fait le PCI aujourd'hui, pour lui-même, ni seulement par des"erreurs tactiques". Ce serait la réduire au tronc commun du trotskisme : "la crise du mouvement révolutionnaire se résume à la crise de sa direction" (Programme de transition de Trotsky). La Gauche Communiste se rendait compte que l'IC fondée sur une vague révolutionnaire internationale surgissant brusquement de la guerre, n'arrivait pas à saisir toutes les exigences de la nouvelle"période de guerre et de révolution". Chacun des Congrès de l'IC témoigne à un degré grandissant des difficultés à saisir les implications de la crise historique du capitalisme, à se débarrasser des anciennes tactiques social-démocrates, à comprendre le rôle du parti et des conseils ouvriers. Dans la situation tourmentée de l'époque, tirer toutes les implications programmatiques d'une telle situation était impossible. Vouloir aujourd'hui ériger tout ce qu'a produit l'IC en dogmes serait justement tourner le dos à la Gauche Communiste.
Au sein de l'IC, les Gauches allemande, italienne, hollandaise, anglaise, russe, et américaine étaient l'expression de 1'avant-garde du prolétariat des grands centres industriels. Avec ses formulations hésitantes et souvent confuses, la Gauche a essayé de poser les vrais problèmes de la nouvelle époque : est-ce que les syndicats restent des organes de la classe ouvrière ou ont-ils été happés dans l'engrenage de l'Etat bourgeois ? Faut-il en finir avec la tactique "parlementaire"? Comment comprendre la lutte nationale dans l'ère globale de l'impérialisme ? Quelle est la perspective pour ce nouvel Etat russe ?
La Gauche Communiste n'a jamais réussi à s'assumer en tant que fraction au sein de la 3ème Internationale, à confronter les positions en son sein. Dès 1921 (moment de l'interdiction "provisoire" des fractions dans le Parti bolchevik en Russie), la Gauche allemande (KAPD) est exclue de l'IC. L'élimination successive de toutes les Gauches va suivre jusqu'à la mort de l'IC avec l'acceptation du "socialisme en un seul pays".
Si les Gauches étaient déjà disloquées au sein de l'IC, elles allaient l'être encore plus en dehors. Quand l'IC est morte, la Gauche allemande est déjà dispersée en plusieurs morceaux, tombant dans l'activisme, l'aventurisme, et est éliminée sous les coups d'une répression sanglante; la Gauche russe est dans les prisons de Staline ; les faibles Gauches anglaise et américaine ont disparu depuis longtemps. En dehors du trotskysme, c'est essentiellement la Gauche italienne, et ce qui restait de la Gauche hollandaise qui vont, à partir de 1928, maintenir une activité politique prolétarienne, sans Bordiga et sans Pannekoek, en partant chacune de bilans différents de l'expérience vécue.
Le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui a encore tendance à voir la Gauche Communiste uniquement sous sa forme disloquée et partielle léguée par la contre-révolution. Il parle des apports positifs ou négatifs de telle ou telle Gauche en dehors du contexte global de l'époque. Le PCI a accentué et aggravé cette tendance en réduisant toute la Gauche Communiste à la Gauche italienne, et uniquement celle de la période de 1920 à 1926. Pour le PCI, la Gauche allemande devient une bande d'"anarcho-syndicalistes", identique à la tendance de Gramsci. Ce n'est pas qu'il ne faut pas critiquer sévèrement les erreurs de la Gauche allemande, mais chez le PCI cela devient une caricature totale. L'idée de restaurer l'héritage de la Gauche Communiste enseveli par la contre-révolution, se réduit dans le PCI à la republication à l'infini des textes de Bordiga. L'héritage de la Gauche est surtout une oeuvre critique ; le PCI l'a réduit à une liturgie de secte jalouse. Ainsi, toute une génération de militants du PCI ne connaît qu'une vision déformée de la réalité de la Gauche Communiste Internationale, et les questions politiques qu'elle a posées.
LA PERIODE DE LA "FRACTION" ET BILAN (1926-1945)
Jamais les bordiguistes ne parlent de cette époque de la Gauche italienne : ni vu, ni connu pour le PCI. Que devient la "continuité organique" dont se réclame le PCI pour se proclamer le seul et l'unique héritier de la Gauche Communiste ? Un trou de 20 années de travail militant. Mais pendant toutes ces années, Bordiga n’était pas là. La seule explication qu'on peut trouver, c’est que la "continuité organique" est en fait la présence d'un "chef génial".
La Gauche italienne dans l'émigration autour de la revue Bilan a continué le travail de la Gauche Communiste, avec la consigne de l'heure : "Ne pas trahir". Le lecteur trouvera le détail de cette période dans la brochure La Gauche Communiste d'Italie, publiée par le CCI.
Pour continuer son activité, et dans une période autrement plus difficile que la notre, elle a rejeté la méthode qui consiste à se raccrocher à Lénine comme à une bible. Elle s'est donnée la tâche de tirer les enseignements de la défaite en passant l'expérience au crible de la critique "sans aucun interdit ni ostracisme" (Bilan n°1). A l'étranger, la Fraction a pu s'enrichir des apports de l'héritage luxembourgiste à travers, entre autre, l'apport des militants de Belgique qui se sont ralliés à la Gauche italienne. En tant que "Fraction italienne de la Gauche Communiste", elle a repris le travail de la Gauche toute entière : en rejetant la défense des libérations nationales, en mettant en question la nature "prolétarienne" des syndicats (sans aboutir à une position définitive); en analysant la dégénérescence de la révolution russe, le rôle de l'Etat et du parti. Elle a tracé la perspective historique de son époque de cours vers la guerre impérialiste mondiale avec une lucidité telle, qu'elle lui a permis d'être une des seules organisations à rester fidèle aux principes prolétariens, en dénonçant 1'anti-fascisme, les fronts populaires et la participation à la défense de l'Espagne "républicaine".
La guerre a numériquement affaibli la Fraction mais le PCI occulte complètement le fait qu'elle a maintenu son activité politique pendant la guerre comme en témoignent les 9 bulletins et les tracts les Conférences et la constitution (en 1942) du noyau français de la Gauche Communiste qui publiera Internationalisme.
Vers la fin de la guerre, la Fraction exclut un de ses dirigeants, Vercesi, condamnant sa participation au "Comité anti-fasciste de Bruxelles" (comme elle avait exclue la minorité qui s'était laissée entraîner dans l'embrigadement anti-fasciste de la guerre d'Espagne). Par contre, le PCI naissant en Italie en 1943 a flirté avec des "Partisans" et a adressé des Appels pour un front unique de classe au P.C stalinien et au Parti Socialiste d'Italie (Voir l'article "Le PCI tel qu'il prétend être et tel qu'il est" dans ce numéro de la Revue Internationale).
LA FORMATION DU PCI
Le Partito Communista Internazionalista d'Italie se forme sur la base d'un regroupement politique hétérogène : il exige la dissolution pure et simple de la Fraction tandis que des groupes du "Mezziogiorno" qui avaient des rapports ambigus avec 1'anti-fascisme, les trotskystes et même le PC stalinien sont intégrés en tant que groupes constitutifs et avec la caution de Bordiga. Vercesi et l'ancienne minorité exclue sur la question de l'Espagne sont également intégrés sans discussions. " Le nouveau parti n'est pas une unité politique mais un conglomérat, une addition de courants et de tendances qui ne manqueront pas de se heurter. L'élimination de l'un ou l'autre courant est Inévitable. Tôt ou tard, la délimitation politique et organisationnelle s 'imposera" (Internationalisme n° 7, Février 1946).
En effet, en 1952, la tendance Damen a scissionné du parti avec la majorité de ses membres, le journal Battaglia Comunista, ainsi que la revue Prometeo. ([1] [379])
Tout le travail politique et théorique de la Fraction disparaît pour le PCI formé dans un regroupement immédiatiste et sans principes. Le PCI tourne le dos à tout l'héritage de Bilan sur 1'anti-fascisme, la décadence du capitalisme, les syndicats, la libération nationale, la signification de la dégénérescence de la révolution russe, l'Etat dans la période de transition. Tout cet héritage, le PCI le considère comme des "lâchages" du programme "invariant". Pour le nouveau PCI, les partis staliniens sont réformistes", la Russie, un impérialisme moins dangereux que l'ennemi numéro1, l'impérialisme américain, la décadence historique du capitalisme devient des "crises cycliques et structurelles", les approfondissements théoriques de Bilan sur le programme cèdent complètement la place au retour de la "tactique léniniste". C'est ainsi que le PCI a contribué à ramener le débat dans le mouvement révolutionnaire 20 ans en arrière, au moment de l'IC, comme si rien n'avait existé entre 1926 et 1945.
Alors que Bilan insiste sur le fait qu'un parti ne se forme que dans une période de montée des luttes de classe, le PCI s'autoproclame le "Parti" en pleine période de réaction. Ainsi, il a créé une "tradition" selon laquelle n'importe qui peut se proclamer qui n'était que trop contente de constater leur refus. Mais, même un début de clarification politique était trop dur pour le PCInt et la Communist Workers'Organisation. Ils ont "exclu" le CCI à la 3ème Conférence pour des désaccords sur la question du parti, non pas après un débat profond, mais a priori par une manoeuvre digne des plus sinistres intrigues à la Zinoviev de l'IC dégénérescente. Quelle école que celle du bordiguisme ! Et surtout si on touche à son fétiche, "le parti", que seuls les bordiguistes savent construire comme on peut en voir aujourd'hui le résultat. A une réunion récente, appelée "la 4ème Conférence Internationale de la Gauche Communiste", considérée par le PCInt comme un"indiscutable pas en avant par rapport aux Conférences précédentes" (Battaglia Comunista, du 10-11-82), le PCInt et la CWO ont "commencé à aborder les vrais problèmes du futur parti" ... avec un groupe d'étudiants iraniens mal dégagé du tiers-mondisme. Après tout, chacun a son peuple à libérer : Programma ses Palestiniens, Battaglia ses Iraniens.
Mais à cette époque, de 1976 à 1980, le PCI a tout de même fini par sentir qu'il fallait bouger". Ayant tourné le dos à la clarification politique internationale et sans analyse cohérente de la période nouvelle, le PCI a simplement troqué son immobilité pour un activisme frénétique : les deux faces de la même médaille. Aujourd'hui, en constatant que l'organisation part en lambeaux, sur quoi insiste le PCI ? De nouveau sur la "tactique", et pas seulement sur la question nationale, mais sur toutes les questions.
Le PCI a transformé 1'anti-parlementarisme de la Fraction abstentionniste en "tactique" pour ensuite appeler à participer à des élections et des référendums. Il appelle à la défense des "droits démocratiques" dont le droit de vote, pour les ouvriers immigrés. Pour quoi faire ? Pour après leur dire de ne pas aller voter ? On voit aujourd'hui 1'"après". 1'"antiparlementarisme" est devenu purement verbal, séparé de toute cohérence sur la période historique du capitalisme.
N'importe quelle "tactique" syndicale, de comités frontistes, d'appui critique aux groupes terroristes comme Action Directe en France, est bonne pour "organiser" les masses.
Et en Pologne, le PCI a vu dans les saboteurs de l'autonomie de la classe ouvrière, Solidarnosc et ses conseillers du KOR, les "organisateurs" du mouvement de la classe, eux qui ont tout fait pour le ramener sur le terrain de la défense de l'économie nationale. Et le PCI réclame la "légalisation" de Solidarnosc aux côtés de la bourgeoisie démocratique !
Ne voulant pas discuter avec les "déchets du réveil de la classe", le PCI a préféré "recruter" dans les résidus de la décomposition du maoïsme. Lorsque le PCI se fit le flic du"service d'ordre" contre le "danger fasciste" des manifestations de la lutte des foyers de travailleurs immigrés en France, interdisant en fait la distribution de la presse révolutionnaire, ce fut un symbole de sa descente à grande vitesse sur la pente glissante du gauchisme.
PERSPECTIVES
Le PCI aurait du rejeter les positions de El Oumami depuis longtemps, avant que cette gangrené n'ait pénétré toute l'organisation. El Oumami entonne le chant des sirènes pour attirer le PCI vers la cohérence de la bourgeoisie. Le PCI ne peut plus se réfugier dans l'incohérence et le charabia pour y résister. Des replâtrages ne tiendront plus le coup dans la période actuelle. En premier lieu, le PCI et tout le milieu révolutionnaire doivent reconnaître clairement que l'internationalisme è notre époque ne peut se développer qu'en rupture totale avec toute forme de nationalisme, ne peut signifier qu'une lutte intransigeante contre tout mouvement national qui ne peut être aujourd'hui qu'un moment des luttes entre puissances impérialistes, petites ou grandes. Toute défaillance sur cette question ouvre une brèche immédiate à la pression de l'idéologie bourgeoise qui entraînera une organisation inéluctablement et rapidement dans la contre-révolution.
Il ne serait pas trop tard pour le PCI de se ressaisir, à condition qu'il ait la force et la volonté de regarder la réalité en face, de réexaminer les leçons du passé, de revoir de façon critique ses propres origines.
Il y a eu d'autres départs du PCI au cours de l'année passée, mais nous ne savons pas exactement ce que deviennent ces militants. A Marseille subsisterait un cercle pour qui "le parti formel est mort, seul vit le parti historique". Ce vocabulaire bordiguiste n'est pas très clair pour le commun des mortels ; est-ce que "le parti historique" dans ce sens veut dire le programme bordiguiste ? Le marxisme ? Quel bilan faut-il tirer et pourquoi le silence de ces éléments aujourd'hui ?
D'autres ont quitté le PCI à cause de l'étouffement organisationnel et par réaction instinctive à la dégénérescence. Mais il faut aller plus loin qu'un constat, jusqu'à la racine du mal. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, en croyant "restaurer" un "vrai" bordiguisme qui n'existe pas, le pur bordiguisme "de Bordiga" qui n'a jamais existé. Ce chemin mène tout droit aux cénacles, à la création de "Partiti" de plus en plus réduits, chacun se disputant le titre légitime en ignorant les autres comme ont fait bon nombre de scissionnistes-bordiguistes depuis des années, chacun se disputant la "direction" de la classe ouvrière pour l'emmener au "paradis".
La clarification politique ne peut pas venir de rafistolages ni de 1'isolement. Elle ne peut se faire qu'avec et dans le milieu révolutionnaire. Il faut rompre le silence en ouvrant un débat public, dans la presse, dans des réunions, pour en finir avec les erreurs du passé, pour assurer que cette décantation se fasse de façon consciente, pour éviter la dispersion et la perte d'énergies révolutionnaires. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra déblayer le terrain pour le regroupement des révolutionnaires qui contribuera au processus de l'unification de la classe ouvrière internationale. Voilà la tâche de l'heure, voilà la vraie leçon de la crise du PCI.
J.A.
[1] [380] Le parti de Bordiga devient après la scission II Partito Comunista Internazionale. Beaucoup d'ex-membres de la Fraction sont partis avec Damen et le programme de Battaglia Comunista (PCInt.) en 1952 contient certaines positions importantes de Bilan : sur la question nationale, la question syndicale, sur la Russie. Malheureusement, les quarante années qui nous séparent des débuts de Battaglia Comunista ont vu ce groupe s'engager dans un processus de sclérose qu'une lecture de sa presse aujourd'hui, comparée à sa plateforme de 1952, ne manquera pas de révéler.
Courants politiques:
- Bordiguisme [126]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le parti communiste international (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est.
- 5384 reads
Introduction
Dans le milieu politique prolétarien, on connaît, plus ou moins bien, le courant bordiguiste tel qu'il prétend être, à savoir un "Parti dur et pur" avec un "Programme achevé et invariant".
Cela tient, de toute évidence, davantage de la légende que de la réalité. Dans la réalité, en fait du "Parti", par exemple, nous connaissons au moins 4 ou 5 groupes provenant du même tronc, dont le PC International (Programme), qui prétendent être chacun l'unique héritier, le seul légitime, de ce que fut la Gauche Italienne, et incarner le "Parti historique" de leur rêve. C'est probablement là la "seule invariance" qui leur soit commune. On connaît par contre, très mal, ou pas du tout –et cela est vrai avant tout pour la majorité des militants de ces partis– les véritables positions de ce "Parti" à son origine, c'est-à-dire à sa fondation, en 1943-1944, après et suite à l'effondrement du régime de Mussolini en Italie au milieu de la 2ème guerre mondiale.
Pour pallier à cette ignorance, nous estimons très important de publier ci-dessous un des premiers documents de ce nouveau parti (PC.Int) paru dans le premier numéro de son journal Prometeo. Ce document qui porte sur une question cruciale : la position des révolutionnaires face à la guerre impérialiste et les forces politiques qui y participent, permettra à tout militant de se faire une idée exacte sur l'état de clarté et de maturité des positions politiques qui ont présidé à la fondation de ce Parti, et l'action pratique que cela impliquait nécessairement.
Ce que le parti communiste internationaliste prétend être
Pour mieux faire ressortir la différence (entre ce qu'il prétend être et ce qu'il a été et continue d'être), il serait bon de commencer par rappeler ce qu'il prétendait être. Pour ce faire, nous nous limiterons à quelques citations extraites d'un article qui se voulait fondamental et qui sert toujours de point central de référence : Sur le Parti "compact et puissant de demain" paru dans le numéro 76 de Programme Communiste en Mars 78.
- "Son existence (du Parti) n'est pas attestée par le fait qu'il est "fini" plutôt qu'en construction, mais par le fait qu'il grandit comme un organisme qui se développe avec les cellules et la structure qu'il avait en naissant ; qu'il grandit et se renforce sans s'altérer, avec les matériaux qui ont servi à le constituer, avec ses membres théoriques et son squelette organisationnel". (p15).
En laissant de côté le style toujours pompeux propre aux bordiguistes, et en faisant de grandes réserves sur l'affirmation que les "matériaux... théoriques" sont l'unique et exclusive condition de la proclamation du Parti, indépendamment du facteur de flux ou reflux de la lutte de classe, nous pouvons retenir l'idée que l'évolution ultérieure d'une organisation dépend largement de ses positions politiques et de sa cohérence à ses débuts. Le PC.Int (Programme) en est une excellent illustration !
Polémiquant contre nous, l'auteur de l'article se trouve contraint de s'expliquer (une fois n'est pas péché mortel !) sur les positions défendues par la Fraction Italienne de la Gauche Communiste et de l'énorme contribution théorique et politique de cette dernière dans sa revue Bilan et ensuite dans la revue Octobre dans les années 30 à 451.
- "Revendiquer aujourd'hui la continuité que la Fraction a réussi, grâce à une splendide bataille, à maintenir fermement... signifie également comprendre les raisons matérielles pour lesquelles la Fraction nous a légué, à côté de tant de valeurs positives, des éléments caducs." (p7)
Ces éléments caducs sont entre autres : qu'il "ne s'agit pas de chercher dans ses propres armes théoriques et programmatiques, mais au contraire de redécouvrir sur tous les points leur force et leur puissance, et de se référer à elles comme à un bloc monolithique pour repartir de l'avant... arriver, en reprenant les armes d'origine à l'exclusion de toute autre, à la compréhension complète des causes de la défaite en même temps que des conditions d'une future offensive".
D'avoir commis l'imprudence de soumettre à la critique les positions et orientations de l’I.C. "a conduit la Fraction à certains lâchages, comme par exemple sur la question nationale et coloniale, ou encore à propos de la Russie.... que dans la recherche d'une voie différente de celle des bolcheviks dans l'exercice de la dictature, ... et aussi, en un certain sens, dans la question du Parti ou de l'Internationale."
Et, plus loin, Programme cite comme illustration des hérésies de la Fraction, Bilan qui écrit "les fractions de gauche ne pourront se transformer en parti, que lorsque les antagonismes entre la position du parti dégénéré et la position du prolétariat menacent tout le système des rapports de classe..."
"Des passages de ce genre nourrissent évidemment la spéculation de ceux qui, tel le groupe Révolution Internationale, théorise aujourd'hui comme inévitable la dégénérescence opportuniste de tout parti de classe qui prétend se constituer avant la vague révolutionnaire future, et .qui, en attendant cette vague et sous prétexte de "Bilan" préliminaire à la renaissance du parti formel, se livrent à une révision complète des thèses constitutives de l'Internationale." (p9)
Le parti bordiguiste ne conçoit absolument pas que l’on puisse mettre en critique, à la lumière de l'expérience vivante, des positions qui se sont avérées fausses ou inadéquates. Invariance oblige. Retenons toutefois, qu'après avoir tiré un coup de chapeau à la "fermeté", à la "splendide bataille" aux "valeurs positives", le porte-parole du PCI rejette aussi "fermement" ce qui constitue justement l'essentiel de l'apport véritable dans l'oeuvre de la Fraction. Quant à nous, le CCI, nous reconnaissons volontiers que cet apport de la Fraction nous a grandement nourris dans notre propre développement, et cela non seulement dans la question du moment de la constitution du Parti, mais dans tant d'autres questions que l'article désigne comme du "lâchage". Le "bloc monolithique" dont parle l'article, en plus de nous paraître comme une phrase ronflante, n'indique rien d'autre qu'un retour en deçà des positions de la Fraction, et même une régression par rapport à l’I.C.
- "Ce qui définit comme Parti un tout petit noyau de militants, c'est la conscience claire de devoir conquérir sur la classe une influence qu'il ne possède que virtuellement, et l'effort consacré à atteindre ce but non seulement par la propagande pour son programme, mais par la participation active aux luttes et aux formes de la vie collective de la classe ; et c'est ce qui, dès ce moment, nous définissait bien comme Parti." (p14)
Voilà une nouvelle définition de la constitution du Parti. Cette fois l'accent est mis sur "l'activisme". On connaît cet activisme qui démange tous les gauchistes, des différents partis des trotskistes aux maoïstes. Le PCI n'a pas manqué de tomber dans cette ornière hier comme aujourd'hui, depuis sa fondation durant la guerre en 43 jusqu'à son soutien actif de la guerre au Liban dans le camp palestinien, en passant par la participation, aux côtés des trotskistes et maoïstes, à toutes sortes de Comités fantômes, celui des soldats, de soutien de la lutte de Sonacotra, des immigrés, etc. Dans ses actions fébriles, il était en effet moins question de "défense de programme" que de se faire les porteurs d'eau afin de "conquérir sur la classe une influence". Mais cela ne l'empêche pas de retomber, comme un chat, sur ses pattes pour écrire :
- "Remarquons en passant que la Fraction à l'étranger ne s'est nullement limitée à la "recherche théorique", mais a mené une rude bataille pratique ! Si elle n'a pas encore été Parti mais seulement son prélude ce n'est pas faute d'activité pratique, mais plutôt à cause de l'insuffisance du travail théorique." (Note p13)
Passons sur "l'insuffisance du travail théorique" de la Fraction. Cette dernière n'a jamais eu la prétention d'avoir dans sa poche un "programme achevé" à l'instar de Programme Communiste, et se contentait humblement de vouloir être une contribution au développement du programme à la lumière d'un examen critique de l'expérience de la première grande vague révolutionnaire et de ta contre-révolution qui l’a suivie. La Fraction manquait, certes, de cette mégalomanie propre au bordiguisme du lendemain de la 2ème guerre mondiale qui, sans la moindre gêne et sans rire, peut écrire :
- "L'histoire de notre petit mouvement a d'ailleurs prouvé.... que le Parti ne naît pas parce que et lorsque la classe a retrouvé, sous la poussée de déterminations matérielles, la voie unique et nécessaire de la reprise. Il naît parce que et lorsque un cercle forcément "microscopique" de militants a atteint la compréhension des causes de la situation objective immédiate et la conscience des conditions de son retournement futur ; parce qu'il a tiré la force, non pas de "compléter" le marxisme par des nouvelles théories.... mais de réaffirmer le marxisme dans son intégralité, inchangée et intacte ; parce qu'il était capable, sur cette base,.... de tirer le bilan de la contre-révolution en tant que confirmation totale de notre doctrine dans tous les domaines." (p10)
- "C'est parce qu'il (le courant bordiguiste) l'avait atteint (le "Bilan global du passé") qu'il a pu 25 ans plus tard se constituer en conscience critique organisée, en corps militant agissant, en Parti ;" et de continuer ainsi : "nous verrons (plus loin) dans quelles conditions et sur quelles bases, mais nous pouvons dire d'emblée que ce n'est pas porté par un mouvement ascendant, mais au contraire en le précédant de loin." (p5)
Cette base est définie en ces termes :
- "... la base du bloc unitaire des positions théoriques, programmatiques et tactiques reconstitué par le petit, le "microscopique" parti de 1951-52 (?) ou d'aujourd'hui, et elle ne peut se faire que dans ses rangs."(p5-6)
Retenons bien cette conclusion "elle ne peut se faire que dans ses rangs". Il est arrivé pourtant à ce Parti un regrettable accident en cours de route, un accident dont on parle avec quelque gêne :
- "En 1949.... fut rédigé l'Appel pour la réorganisation internationale du mouvement révolutionnaire marxiste. Ce qu'on proposait là aux petits noyaux éparpillés d'ouvriers révolutionnaires qui voulaient réagir.... contre le cours désastreux de l'opportunisme, ce n'était certes pas un bazar.... de ceux qui voulaient construire... l'édifice bancal de "l'unité des forces révolutionnaires" dont tout le monde radote. On leur proposait au contraire une méthode de lutte homogène, fondée sur le rejet des solutions présentées par les "groupes influencés ne serait-ce que partiellement (sic !) et indirectement (reste !) par les suggestions et le conformisme... .qui infestent le monde, solution dont "la critique doctrinale" confirmait l'inanité". (p15)
Passons sur toutes ces contorsions, en guise d'explication d'une démarche qui est suffisamment claire par son titre même. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que le Parti bordiguiste lançait de tels Appels –et pas seulement "aux petits noyaux éparpillés d'ouvriers révolutionnaires". Comme nous verrons de suite, un tel Appel s'adressait en pleine guerre impérialiste, à des forces autrement plus "sérieuses" pour la constitution d'un "Front Ouvrier" pour "l'Unité de classe du prolétariat".
Voyons donc ce Parti à l’œuvre tel qu'il est, tel qu'il a été "en naissant".
Appel du "Comité d'Agitation" du PCI (Prometeo n°1, avril 1945)
Le présent appel est adressé par le Comité d'agitation du Parti Communiste Internationaliste aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne et des mouvements syndicaux d'entreprise pour donner à la lutte révolutionnaire du prolétariat une unité de directives et d'organisation à la veille d'événements sociaux et politiques qui devront révolutionner la situation italienne et européenne ; dans ce but, il est proposé un rassemblement de ces divers comités pour mettre au point un plan d'ensemble.
Pour faciliter une telle tâche, le Comité d'Agitation du PC.Int. expose brièvement son point de vue programmatique que l’on pourrait considérer comme base initiale de discussion.
Pourquoi avons nous pensé qu'il était opportun de s'adresser aux comités d'agitation d'usines plutôt qu'aux comités centraux des différents partis ?
Un regard panoramique sur le milieu politique qui s'est précisé non seulement dans la lutte antifasciste mais aussi dans celle plus spécifique du prolétariat, nous a convaincus (et cela pas seulement aujourd'hui) de l'impossibilité de trouver un minimum de dénominateur commun idéologique et politique pour jeter les fondements d'un accord sur l'action révolutionnaire. Les différentes appréciations portées sur la guerre (sa nature et ses buts), les différentes appréciations sur la définition de l'impérialisme et dont les divergences existant dans les méthodes de lutte ou syndicale, ou politique, ou militaire démontrent suffisamment une telle impossibilité.
D'un autre côté, nous sommes tous d'accord pour considérer la crise ouverte par la guerre comme la plus profonde et la plus incurable qui se soit abattue sur le régime bourgeois ; (d'accord aussi) pour considérer que le régime fasciste est fini socialement et politiquement, même si les armes allemandes lui apportent encore de l'oxygène, même si on doit le combattre durement et de façon sanglante pour l'extirper du sol italien, pour considérer enfin que le prolétariat est le seul protagoniste de cette nouvelle histoire du monde qui doit surgir de ce conflit inhumain.
Mais le triomphe du prolétariat est possible à la seule condition qu'il ait résolu préventivement le problème de son unité dans l'organisation et dans la lutte.
Et une telle unité ne s'est pas réalisée, et elle ne pourra jamais se réaliser sur la base du Comité de Libération Nationale, surgi de raisons contingentes dues à la guerre, qui a voulu assumer un aspect de la guerre idéologique contre le fascisme et l'hitlérisme mais qui a été impuissant constitutionnellement à poser les problèmes pour surpasser de telles contingences. Il n'a pas repris a son compte les revendications et les objectifs historiques de la classe ouvrière, qui se seraient du reste heurtés aux raisons et aux buts de la guerre démocratique dont le Comité de Libération nationale (C. de LN) fut l'instigateur et l'animateur, il s'est montré aussi incapable de rassembler dans l'unité les profondes forces de travail.
Face à la guerre, mis à part les pressions idéologiques, on peut voir les uns à côte des autres les représentants de la haute finance, du capitalisme industriel et agraire et ceux des organisations ouvrières; mais qui oserait penser a un C. de LN, centre moteur de la lutte de classe et de l'assaut du pouvoir bourgeois, dans lequel siégeraient des De Gasperi, des Gronchi, des Solen, des Gasparotto, des Croce, des Sforza, etc. ?
Si le C. de LN peut être historiquement capable de résoudre les problèmes dus à l’état d'urgence et à la continuation de celle-ci dans le cadre de l’Etat bourgeois, il ne sera en aucun cas l’organe de la révolution prolétarienne, dont la tâche revient au parti de la classe qui aura compris les exigences fondamentales du prolétariat et aura profondément adhéré à la nécessité de sa lutte.
Mais ce même parti sera impuissant à accomplir sa mission historique s'il trouve devant lui un prolétariat moralement et physiquement divisé, désabusé par l’inanité des luttes intestines, sceptique sur la validité de son propre avenir.
C'est cette situation bloquée que nous avons connue dans tous les moments de crise de ces dernières années, et contre lesquels viennent se briser les grosses lames de la révolution prolétarienne. Un prolétariat désuni ne peut aller à l'attaque du pouvoir bourgeois, et nous devons avoir le courage de reconnaître qu'actuellement le prolétariat italien est désuni et sceptique comme l'ensemble du prolétariat européen.
La tâche impérieuse de l'heure est donc l’unité de classe du prolétariat qui trouvera, dans les usines et tous les postes de travail, le milieu naturel et historique idéal pour l'affirmation d'une telle unité. C'est à cette seule condition que le prolétariat sera capable de tourner à son avantage la crise du capitalisme que la guerre a ouverte mais qu'elle est impuissante à résoudre.
Nous concluons notre appel en rassemblant en quelques points notre pensée :
-
puisque les raisons, la finalité, la pratique de la guerre divisent le prolétariat et ses forces de combat, à la politique qui veut subordonner la lutte de classe à la guerre, on doit opposer la subordination de la guerre et de toutes ses manifestations à la lutte de classe ;
-
nous souhaitons la création d'organismes unitaires du prolétariat qui soient l'émanation des usines et des entreprises industrielles et agricoles ;
-
de tels organismes seront de fait le front unique de tous les travailleurs, et auxquels les comités d'Agitation participeront démocratiquement ;
-
tous les partis liés aux luttes du prolétariat auront le droit de cité pour faire la propagande de leurs idées et de leurs programmes : bien plus, nous pensons que ce sera en ces lieux de débats d'idées et de programmes, que le prolétariat parviendra a sa maturité politique et au libre choix de quelle direction politique le conduira à la victoire ;
-
la lutte du prolétariat, des agitations partielles à l'insurrection armée, devra se développer, pour triompher sur une base de classe, pour culminer dans la conquête violente de tout le pouvoir qui constitue l’unique et sérieuse garantie de victoire.
10 février 1945
Commentaires de Prometeo aux réponses à l'appel
A cet appel, nous retenons la réponse du Comité d'Agitation du PDA et celle du Parti du Travail (de Milan) qui déclarait ne pouvoir prendre en compte notre proposition, bien qu'ils l'eussent fait dans des conditions plus favorables, parce que la ligne politique spécifique suivie par le PIL, bien que vouée à la révolution prolétarienne ne lui permet pas d'exercer une quelconque influence sur les masses de l'Italie septentrionale.
Notre appel recevait l'entière adhésion des syndicats révolutionnaires, qui acceptaient explicitement de collaborer à la création d'organismes de base et qui se déclaraient pleinement d'accord avec notre point de vue sur la lutte contre la guerre.
Réponse aussi des Communistes Libertaires, qui reconnaissaient dans les termes de la proposition le terrain sur lequel eux-mêmes se trouvaient "tant du point de vue de la situation politique générale, que du point de vue de l'attitude par rapport à la guerre et de la nécessité d'une organisation de classe des travailleurs qui ait pour objectif la révolution expropriatrice à travers la constitution de conseils ouvriers de gestion", et ils se satisfaisaient qu'un tel point de vue soit partagé par des camarades communistes internationalistes.
Il est par contre stupéfiant que le PCI ait refusé de nous répondre par des communications verbales, ayant déjà exprimé son point de vue sur nous dans sa presse. Peu de temps après, à la fin d'une campagne sporadique de dénigrement contre nous (nous accusant d'être des fascistes masqués) il sortait un entrefilet dans la revue "Usine" qui nous traitait de provocateurs et dans lequel on se référait directement à notre proposition de constitution d'organismes de front unique ouvrier et en mars, suivait une circulaire de la Fédération Milanaise invitant tes organismes de base "à intervenir énergiquement pour épurer..."
Traditionnellement incapable de répondre oui ou non, le PS a au contraire répondu :
- "Chers camarades, en réponse à votre appel, nous vous confirmons que notre Parti n'a rien contre le fait que vos camarades participent aux Comités d'Agitation périphériques dans les usines où votre Parti a réellement une assise et que leur collaboration se fasse dans le cadre de la lutte générale de masse, pour laquelle les comités d'agitation ont surgi."
A cette lettre qui éludait élégamment la question, nous avons répondu :
- "Chers camarades, nous aurions préféré que votre réponse fut plus conforme aux questions posées dans notre document, et en ce sens plus concluantes, évitant la perte de temps, d'autant plus que la situation politique, suite aux événements militaires, s'aggrave de plus en plus et pose des tâches toujours plus graves et urgentes aux masses et aux partis prolétariens en particulier."
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur 2 points :
-
Notre proposition ne posait pas la question d'une adhésion à des comités déjà existants, de tel ou tel parti, mais un accord entre tes organismes dirigeants de tels comités pour concrétiser un plan d'action commun, pour résoudre unitairement tous les problèmes surgis de la crise du capitalisme.
-
Il était implicite que notre initiative ne pouvait avoir pour objectif une "lutte générale de masses" mais la création d'organismes à représentation proportionnelle sur le terrain de classe et avançant vers des objectifs de classe.
Il va de soi que de tels comités ne peuvent avoir rien en commun avec tes comités surgis sur la base de la politique du CLN, qui comme vous le dites, ne peuvent être considérés comme des organismes de classe.
Nous vous sollicitons pour une réponse plus précise sur ces points dont dépend la possibilité d'un travail commun.
A cette heure il n'y a eu aucune réponse.
(Prometeo n°1 avril 1945)
Conclusion
Nous pouvons nous épargner la peine de faire des commentaires. Un tel Appel adressé aux (forces vives du prolétariat !) PC et PS pour la construction de l'unité prolétarienne parle de lui-même, et cela en dépit de l'astuce tactique qui consiste à ce que ce ne soit pas le Parti lui-même qui l'adresse directement aux autres partis mais par le biais d'un "Comité d'Agitation" fantôme du Parti qui l'adresse aux "Comités d'agitation" des autres partis.
Il faut ajouter, que rien n'est sorti (et pour cause !) de cet Appel –sauf de nous laisser un témoignage, une indication d'un parti qui a "grandi.... avec les matériaux qui ont servi a le constituer, avec ses membres théoriques et son squelette organisationnel".
Mais il serait inexact de dire que cet Appel n'ait rien produit. Voilà quel était son résultat :
- "En suivant les directives données par nos organes dirigeants, sous la pression des événements, nos camarades –après avoir préventivement mis en garde les masses contre les coups de tête prématurés et après avoir de façon répétée indiqué quels objectifs (objectifs de classe) ils devaient atteindre– se sont unis sans distinction aux formations en mouvement dans l’œuvre de destruction de l'odieux appareil fasciste en participant à la lutte armée et à l'arrestation des fascistes..." (Coup d’œil panoramique sur le mouvement des masses dans les usines, in Prometeo n°2, 1er mai 1945 ; Cité par A.Peregalli, l'Altra Resistanza, la dissidema di sinistra in Italia 1943-45)
Voilà pour ce qui concerne le Parti dans le nord du pays. Quant au sud du pays nous pouvons citer en exemple la Calabre (Catanzaro) où les militants bordiguistes regroupes autour de Maruca futur dirigeant du groupe de Damen, restent au sein du PCI stalinien jusqu'en 1944, date à laquelle ils passent à la "Frazione" :
- "Maruca affirme (en 1943) que la victoire du front antifasciste est la condition historique indispensable pour que le prolétariat et son parti soient mis en condition d'accomplir leur mission de classe". (cité par Peregalli, op. cité, p57)
En conclusion, en ce qui concerne le parti bordiguiste, nous pouvons dire :
- dis moi d'où tu viens et je saurais où tu vas.
M.C.
1 L'auteur parle de l'activité de la Fraction de "30 à 40" passant complètement sous silence son existence et activité entre 40 et 45, date de sa dissolution. Est-ce par simple ignorance ou pour s'éviter d'être obligé de faire une comparaison entre les positions défendues par la Fraction durant la guerre et celles du PC.Int. constitué en 43-44 ?
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [381]
Courants politiques:
- Bordiguisme [126]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]
Heritage de la Gauche Communiste:
La tache de l'heure formation du parti ou formation des cadres. Internationalisme (août-1946)
- 3258 reads
Après la présentation, le texte que nous publions ci-dessous est un article paru dans "Internationalisme" n°12 en Août 46.
Présentation
Aujourd'hui, 36 ans après, il présente un intérêt, non seulement comme témoignage d'une période historique, celle qui s'est ouverte au lendemain de la guerre, mais aussi un intérêt d'actualité, quant au fond du débat soulevé dans ce texte sur le moment où s'ouvre la nécessité et la possibilité d'un processus de la constitution du parti.
Pour ceux qui nient purement et simplement la nécessité du parti politique de classe, les questions de son rôle, de sa fonction et du moment de sa constitution, ne présentent évidemment aucun intérêt.
Il en va tout autrement pour ceux qui ont compris et acceptent l'idée du Parti comme une nécessité qui se manifeste pour la classe ouvrière dans sa lutte historique contre l'ordre capitaliste. Pour ces militants et dans le cadre de la compréhension de cette nécessité, situer le problème de la constitution du Parti dans le cours historique est une question de la plus grande importance, car elle se rattache à la conception-même qu'on a du Parti: le Parti est-il le produit de la stricte volonté d'un groupe de militants ou le produit de la classe en lutte?
Dans le premier cas, le Parti peut se construire et exister dans n'importe quel moment, dans le deuxième cas son existence et sa construction sont nécessairement liées aux périodes de flux et de reflux de la lutte de classe du prolétariat.
Dans le premier cas, nous avons à faire à une vision volontariste, idéaliste de l'Histoire, dans le second, à une vision matérialiste, déterministe de l'Histoire et de sa réalité concrète.
Que l'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit là nullement de spéculations abstraites. Loin d'être un débat oiseux sur les mots et les noms à donner à l'organisation, Parti ou Fraction (groupe), ce débat implique des démarches diamétralement opposées. La démarche erronée, la non compréhension du moment historique de la proclamation du Parti, implique nécessairement la conséquence pour l'organisation révolutionnaire, de vouloir être ce qu'elle ne peut pas encore être, et de ne pas être ce qu'elle devrait être. En prenant des vessies pour des lanternes, en s'agitant en guise d'agir, en se drapant de"principes" devenus des dogmes à la place d'une ferme défense des positions politiques claires, acquises à la lumière de l'examen critique des expériences, une telle organisation, à la recherche à tout prix d'une audience immédiate, se trouve non seulement en porte-à-faux de la réalité présente mais compromet encore plus son devenir en négligeant ses vraies tâches à plus long terme, et ouvre toutes grandes ses portes à l'opportunisme et à toutes sortes de compromissions politiques.
C'est là-dessus que portait la critique d'Internationalisme en 46, et 36 années d'activité du Parti bordiguiste sont là pour confirmer pleinement la validité de celle-ci.
Certaines formulations d'Internationalisme peuvent prêter le flanc à des malentendus. Il en est ainsi de la formulation: "Le Parti, c'est l'organisme politique que se donne le prolétariat au travers de l'activité duquel le prolétariat unifie ses luttes..." (page 2). Ainsi formulé, cela laisserait entendre que le Parti est l'unique moteur de cette unification des luttes, ce qui ne correspond pas à la position exacte défendue par Internationalisme comme le montre une lecture attentive de la Revue. Ce qu'on doit comprendre dans cette formulation c'est qu'une des tâches majeures du Parti est d'être un facteur, le facteur conscient oeuvrant comme tel dans le processus de l'unification des luttes de la classe en les orientant "vers une lutte frontale en vue de la destruction de l'Etat et de la société capitaliste et à l'édification de la société communiste" (ibid).
En ce qui concerne une troisième guerre, elle ne s'est pas réalisée selon la perspective d'Internationalisme, en une guerre généralisée mais en une succession de guerres localisées et périphériques dites de "libération" et d'"indépendance" nationale ou de décolonisation, mais toujours sous l'égide et les exigences des intérêts des grandes puissances en lutte pour l'hégémonie mondiale.
Il reste néanmoins fondamentalement vrai que la seconde guerre mondiale a débouché, comme l'avait annoncé Internationalisme, sur une longue période de réaction et de profond reflux de la lutte de classe qui a duré jusqu'à la fin de la période de reconstruction.
Certains lecteurs pourront peut-être être choqués par les termes de "formation de cadres" qu'Internationalisme annonçait comme "la tâche de l'heure" à l'époque. Sous ce terme on entend aujourd'hui la formation de forces d'encadrement du prolétariat. A l'époque et sous la plume d'Internationalisme, la "formation des cadres" signifiait que la situation ne présentait pas les conditions nécessaires pour permettre aux révolutionnaires d'exercer une large influence dans les masses ouvrières, et de ce fait, le travail de recherche et d'élaboration théorique prenait inévitablement le pas sur le travail d'agitation.
Nous vivons aujourd'hui une toute autre période, une période de crise ouverte du capitalisme et de reprise de la lutte de classe. Une telle période pose à l'ordre du jour la nécessité et la possibilité de regroupement des forces révolutionnaires. Cette perspective ne saurait être assurée positivement par les groupes révolutionnaires existants et dispersés qu'en se dégageant résolument de toute théorisation de leur isolement passé; en ouvrant largement les portes à la confrontation des positions héritées du passé, et pas pour autant forcément valables aujourd'hui; en s'engageant consciemment dans un processus de décantation, ouvrant ainsi la voie à un regroupement des forces.
C'est cela la voie ouverte aujourd'hui à la reconstruction du Parti.
MOMENT DE LA CONSTITUTION DU PARTI
Il existe deux conceptions sur la formation du Parti ; deux conceptions qui se sont heurtées depuis l'apparition historique du prolétariat c'est-à-dire non son existence en tant que catégorie économique, mais dans sa tendance à se poser en tant que classe indépendante, ayant une fonction et une mission propres à assumer dans l'histoire.
Ces deux conceptions peuvent être résumées brièvement de la manière suivante :
La première conception stipule que la formation du Parti relève essentiellement, sinon exclusivement, du désir des individus, des militants, de leur degré de conscience, en un mot cette conception voit dans la formation du Parti un acte subjectif et volontariste.
La deuxième conception considère la formation du Parti comme un moment de la prise de conscience, en rapport direct et étroit avec la lutte de la classe ; du rapport de forces existant entre les classes, tel qu'il résulte, dans une situation donnée, des luttes passées, de la situation économique, sociale et politique présente, et de l'orientation générale de la lutte de classe, en connexion avec les perspectives immédiates et lointaines.
La première conception, essentiellement subjective et volontariste se rattache d'une façon plus ou moins consciente à une conception idéaliste de l'histoire ; le Parti cesse d'être déterminé, il devient un phénomène indépendant, libre, se déterminant lui-même, et de ce fait, le moteur déterminant de la lutte de classe, de l'évolution de la lutte de classe.
Nous trouvons des défenseurs acharnés de cette conception dans le mouvement ouvrier, depuis sa naissance tout au long de son long développement, jusqu'à nos jours.
Weitling et Blanqui furent les figures les plus représentatives de cette tendance, à l'aube du mouvement ouvrier.
Quelle que puisse être la grandeur de leur erreur, et la critique sévère et méritée qu'en fit Marx, nous devons les considérer, eux et leurs erreurs, comme des produits historiques ; ce qui ne nous empêche pas de reconnaître, comme le fit Marx lui-même, leur immense apport dans le mouvement, par leur valeur révolutionnaire incontestable, leur dévouement à la cause de l'émancipation, et leur mérite de pionniers, insufflant partout et toujours dans les masses, l'ardente volonté de destruction de la société capitaliste.
Mais ce qui fut un défaut chez Weitling et chez Blanqui, leur méconnaissance des lois objectives du développement de la lutte de classe, devait devenir chez les continuateurs de cette conception, la base de leur activité. Le volontarisme se transformait chez ces derniers en un aventurisme caractérisé.
Les représentants typiques sont incontestablement, aujourd'hui, le trotskisme et tout ce qui s'y rattache. Leur action et agitation ne connaissent pas d'autres limites que celles de leur imagination et caprice.
On construit et on dissout des "partis" et des "internationales" à volonté ; on lance des mots d'ordre, on agite et on s'agite tout comme un malade pris de convulsions.
Plus près de nous, nous trouvons les R.K.D ([1] [383]) et ( [2] [384]) les C.R. , qui ayant séjourné trop longtemps dans le trotskisme, d'où ils ne se sont dégagés que très tard, reproduisant encore, cette agitation pour l'agitation, c'est-à-dire l'agitation dans le vide, faisant de cela le fondement de leur existence en tant que groupe.
La deuxième conception peut être définie comme objectiviste et déterministe. Non seulement elle considère le Parti déterminé historiquement, mais encore elle considère son existence et sa constitution déterminées aussi immédiatement, contingentement, présentement. Pour que le Parti puisse exister effectivement, il ne suffit pas de démontrer sa nécessité en général, mais il faut qu'il repose sur des conditions présentes, immédiates, telles, qui rendent son existence possible et nécessaire.
Le Parti, c'est l'organisme politique que se donne le prolétariat, au travers de l'activité duquel le prolétariat unifie ses luttes, et les oriente vers une lutte frontale, en vue de la destruction de l'Etat et de la société capitaliste, et en vue de l'édification de la société communiste.
En l'absence d'un cours de développement réel de la lutte de classe qui a ses racines, non dans la volonté des militants révolutionnaires mais dans la situation objective, en l'absence des luttes de classe ayant atteint un degré avancé de crise sociale, le Parti ne peut exister, son existence est inconcevable. ([3] [385])
Le Parti ne peut se construire dans une période de stagnation de la lutte de classe. Il n'existe aucun exemple de constitution de parti révolutionnaire dans ces conditions dans toute l'histoire du mouvement ouvrier. Par contre, l'histoire nous apporte une série d'exemples où les partis construits dans des périodes de stagnation, ne parviennent jamais à influencer et à diriger effectivement les mouvements de masse de la classe. Restent des formations qui n'ont de parti que le nom, et leur nature artificielle fait qu'au lieu d'être un élément de futur parti ils deviennent un handicap à sa construction. De telles formations sont condamnées à n'être que de petites sectes dans tout le sens du terme, et qui ne sortent de leur état de secte que pour tomber, ou dans l'aventurisme et le donquichottisme, ou à évoluer dans le plus crasseux opportunisme. La plupart du temps elles tombent dans les deux à la fois, (voir le trotskisme).
LA POSSIBILITÉ DU MAINTIEN DU PARTI DANS UNE PÉRIODE DE REFLUX
Ce que nous venons de dire plus haut pour la constitution du Parti est également vrai pour le maintien d'un parti, après des défaites décisives, dans une période de reflux révolutionnaire prolongée.
C'est à tort qu'on citerait l'exemple du parti bolchevik comme démenti à notre affirmation. C'est là une vue formelle.
Le parti bolchevik qui se maintient après 1905 ne peut être considéré comme un PARTI mais comme une FRACTION du PARTI social-démocrate russe, lui-même disloqué en plusieurs fractions et tendances.
C'est à cette condition que la fraction bolchévik pouvait subsister et servir de noyau central à la constitution du parti communiste en 1917. Tel est le sens réel de l'histoire du parti bolchévik.
La dissolution de la 1ère Internationale nous montre que Marx et Engels ont eu une conscience aiguë de l'impossibilité du maintien de l'organisation internationale révolutionnaire de la classe dans une période prolongée de reflux. Il est vrai que les esprits bornés et formalistes voient dans la dissolution de la 1ère Internationale l'effet d'une manœuvre de Marx contre Bakounine.
Nous n'entendons pas entrer ici dans la question de procédure ni de justifier en tous points la manière dont Marx s'y est pris.
Que Marx ait vu dans les bakouninistes un danger menaçant l'Internationale et ait entrepris une lutte pour l'écarter est absolument exact (et nous sommes de ceux qui estimons que Marx avait absolument raison sur le fond. L'anarchisme depuis, a eu l'occasion de révéler plus d'une fois sa nature idéologique foncièrement petite-bourqeoise).
Mais ce ne fut pas ce danger qui le convainquit de la nécessité de la dissolution de l'organisation.
A maintes reprises, au moment de la dissolution et par la suite, Marx s'est expliqué à ce sujet. C'est à la fois lui faire une injure gratuite et lui attribuer une force démoniaque que de voir dans la dissolution de la 1ère Internationale le simple effet d'une manoeuvre, d'une intrigue personnelle. Il faut vraiment être aussi borné que James Guillaume, pour voir dans les événements d'une importance historique, le simple produit de la volonté des individus. Au delà de la légende anarchiste il faut voir et saisir la signification de la dissolution de la 1ère Internationale.
Et on saisit cette signification en rapprochant ce fait d'autres disparitions et dissolutions des organisations politiques dans l'histoire du mouvement ouvrier.
Ainsi, le profond changement de la situation sociale et politique survenu, qui se produit en Angleterre au milieu du XIXème siècle entraîne la dislocation et la disparition du mouvement chartiste.
Un autre exemple est celui de la dissolution de la Ligue Communiste après les années orageuses de la révolution de 1848-50. Tant que Marx croit que la période révolutionnaire n'est pas encore passée, en dépit de lourdes défaites et des échecs subis, il tend à maintenir la Ligue, à regrouper les cadres dispersés, à renforcer l'organisation. Mais dès qu'il s'est convaincu de la fin de la période révolutionnaire, de l'ouverture d'un long cours historique réactionnaire, il proclame l'impossibilité du maintien du parti, il se prononce pour un repli de l'organisation vers des tâches plus modestes, moins spectaculaires et plus réellement fécondes : l'élaboration théorique et la formation des cadres.
Il n’y a vraiment pas eu nécessité de l'existence de Bakounine, ni besoin de "manoeuvres urgentes" pour que Marx, 20 ans avant, comprenne l'impossibilité de l'existence d'un parti et d'une internationale dans une période révolutionnaire.
25 ans après, Marx, rappelant la situation de 1850-51 et les luttes de tendances qui se produisirent au sein de la Ligue Communiste, écrit :
- "La répression violente d'une révolution laisse dans les esprits des acteurs de cette révolution, de ceux en particulier qui ont été chassés de leur patrie et jetés dans l'exil, une commotion telle que même les personnalités de valeur deviennent pour un temps plus ou moins long, en quelque sorte irresponsables. Ils ne peuvent s'accommoder de la marche qu'a prise l'histoire et ils ne veulent pas comprendre que la forme du mouvement s'est modifiée..." (Epilogue aux révélations sur le procès des communistes de Cologne, 8 janvier 1875)
Dans ce passage nous trouvons la pensée fondamentale de Marx s'élevant contre ceux qui ne veulent pas comprendre que la forme du mouvement, de l'organisation politique de la classe, les tâches de l'organisation, ne restent pas toujours identiques, elles suivent la situation et se transforment, se modifient avec les changements survenus dans la situation objective. Pour réfuter ceux qui voudraient voir dans ces lignes une justification a posteriori, il n'est pas sans intérêt de citer les arguments de Marx, tels qu'il les a formulés au moment même de la lutte contre la Fraction Willich-Schapper. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de scission qu'il a présenté au Conseil Central de la Ligue le 15 septembre 1850 Marx disait entre autres :
- "A la place de la conception critique, la minorité met une conception dogmatique et à la place de la conception matérialiste une conception idéaliste. Au lieu de la situation réelle, c'est la simple volonté qui devient la force motrice de la révolution. ..
- .. . Vous leur dites (aux ouvriers), "il nous faut immédiatement arriver au pouvoir ou bien nous n'avons qu'à dormir sur nos deux oreilles."
- . . .De même que les démocrates ont fait du mot peuple une entité sacrée, vous faites, vous, une entité sacrée du mot prolétariat. Tout comme les démocrates, vous substituez à l'évolution révolutionnaire, la phraséologie révolutionnaire. "
Nous dédions ces lignes tout particulièrement aux camarades tels que R.K.D, et C.R. qui pendant longtemps nous ont reproché de ne pas vouloir "construire" le parti nouveau.
Dans la lutte contre l'aventurisme du trotskisme que nous avons soutenue depuis 1932, dans la question de formation du nouveau parti et de la IVème Internationale, le R.K.D. voyait surtout on ne sait quelle "hésitation" subjective. Le R.K.D. n'a jamais compris la notion de "Fraction" c'est-à-dire une organisation particulière, avec des tâches particulières correspondant à une situation particulière dans laquelle ne peut exister ni être constitué le parti. Cette notion de "Fraction" le RKD n'a jamais fait d'effort pour le comprendre. Il préférait se livrer à la traduction simpliste étymologique du mot "Fraction" pour voir dans le "bordiguisme" des "redresseurs" de l'ancien parti. Ils appliquaient à la Gauche Communiste, la mesure de leur nature propre, la mesure trotskiste par excellence : "On est pour le redressement de l'ancien parti, ou on est pour la proclamation du nouveau parti".
La situation objective et les tâches des révolutionnaires, en correspondance avec la situation, cela est bien trop prosaïque, trop compliqué pour ceux qui se plaisent dans la facilité de la phraséologie révolutionnaire, La lamentable expérience de l'organisation C.R. ne semble avoir guère profité à ces camarades. Dans l'échec de l'O.C.R. ils ne voient pas la rançon de la formation précipitée d'une organisation qu'ils voulaient achevée, et qui fut en réalité artificielle, hétérogène, groupant des militants sur un vague programme d'action, imprécis et inconsistant. Ils attribuent leur échec à une mauvaise qualité de l'élément humain, ne voyant surtout pas l'échec en corrélation avec l'évolution de la situation objective.
LA SITUATION PRÉSENTE
Il peut paraître étrange à première vue que des groupes se réclamant de la Gauche Communiste Internationale, et qui pendant des années ont combattu avec nous l'aventurisme trotskiste de la création artificielle de nouveaux partis aient enfourché aujourd'hui ces mêmes dadas et soient devenus les champions de cette construction à un rythme accéléré.
On sait qu'en Italie existe déjà le Parti Communiste Internationaliste, qui quoique très faible numériquement, tend néanmoins à jouer le rôle du parti. Les récentes élections à la Constituante auxquelles participait le PCI d'Italie, ont révélé l'extrême faiblesse de son influence réelle sur les masses, ce qui nous montre que ce parti n'a guère dépassé les cadres restreints d'une fraction. La Fraction belge de son coté, lance des appels pour la construction du nouveau parti. La FFGC, récente formation sans base de principe bien définie emboîte le pas et se donne pour tâche pratique la construction du nouveau parti en France.
Comment expliquer ce fait? Cette nouvelle orientation? Qu'un certain nombre d'individualités ([4] [386]) qui ont rejoint ce groupe récemment ne fassent qu'exprimer leur incompréhension, leur non assimilation de la notion de la "fraction", qu'il continuent à exprimer dans les divers groupes de la GCI les conceptions trotskistes qu'ils ont eues hier et qu'ils continuent à professer sur le Parti, aucun doute à cela.
D'autre part, il est également exact de voir dans la contradiction existant entre l'énonciation théorique abstraite et la politique pratique, concrète, dans la question de la construction du parti, une contradiction supplémentaire dans le lot des contradictions dont se sont rendus coutumiers ces groupes. Cependant tout cela n'explique pas encore la conversion de l'ensemble de ces groupes. Cette explication doit être recherchée dans l'analyse qu'ils font de la situation présente et les perspectives qu'ils entrevoient.
On connait la théorie sur "l'économie de guerre" professée avant et pendant la guerre par la tendance Vercesi dans la GCI. D'après cette théorie, l'économie de guerre et la guerre sont des périodes de plus grand développement de la production, de l'essor économique. Il en résultait qu'aucune crise sociale ne peut surgir pendant cette période de "prospérité". Il fallait attendre "la crise économique de l'économie de guerre", c'est-à-dire le moment où la production de guerre ne parviendrait plus à répondre au besoin de la consommation de la guerre, la pénurie des moyens matériels à la poursuite de la guerre, pour que cette crise nouvelle manière ouvre la crise sociale et la perspective révolutionnaire.
Il était logique, d'après cette théorie, de mer toute possibilité d'éclosion de convulsions sociales pendant la guerre. De là aussi la négation absolue et obstinée de toute signification sociale dans les événements de juillet 43 en Italie ([5] [387]) De là également l'incompréhension totale de la signification de l'occupation de l'Europe par les forces armées des alliés et Russes, et plus particulièrement l'importance qu'acquérait la destruction systématique de l'Allemagne, la dispersion du prolétariat allemand transformé en prisonnier de guerre, exilé, disloqué rendu momentanément inoffensif et incapable de tout mouvement indépendant.
Pour ces camarades, la reprise de la lutte de classe, et encore plus précisément, l'ouverture d'un cours ascendant de la révolution ne pouvait se faire qu'après la fin de la guerre, non parce que le prolétariat était imprégné d'une idéologie nationaliste patriotique mais parce que les conditions objectives d'une telle lutte ne pouvaient exister dans la période de guerre. Cette erreur démentie par l'histoire (la Commune de Paris et la révolution d'Octobre) et partiellement dans cette guerre-ci (se rappeler les convulsions sociales des événements de 43 en Italie et certaines manifestations de l'esprit défaitiste dans l'armée allemande au début de 45 devait être fatalement doublée par une erreur non moins grande que la période de l'après-guerre ouvre automatiquement un cours de reprise de luttes de classe et de convulsions sociales.
La formulation théorique la plus achevée de cette erreur a été donnée par la Fraction belge dans l'article de Lucain publié dans l'Internationaliste. D'après son schéma, dont il veut de force faire endosser à Lénine la paternité, la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, reste vraie, à condition que l'on élargisse cette position à la période de l'après-guerre. En d'autres termes, c'est dans la période d'après-guerre que se réalise la transformation de la guerre en guerre civile.
Une fois cette théorie systématisée et postulée, tout deviendra simple et il ne restera plus qu'à examiner l'évolution de la situation et des événements au travers et partant d'elle.
Ainsi l'analyse de la situation présente serait celle d'une situation de transformation en guerre civile. Partant de cette analyse centrale, on proclamera la situation en Italie particulièrement avancée, justifiant la constitution immédiate du Parti, on verra dans les troubles aux Indes et en Indonésie ou dans d'autres colonies, dont les ficelles sont étroitement tenues par les divers impérialismes en compétition et par la bourgeoisie indigène, la manifestation du commencement de la guerre civile anti-capitaliste. Le massacre impérialiste en Grèce fera aussi partie de la révolution en marche. Inutile de dire que l'idée ne leur viendra pas de mettre un seul instant en doute le caractère révolutionnaire des grèves en Amérique et en Angleterre, et même celles de France. Récemment l'Internationaliste a salué la formation de cette petite chapelle qu'est la CNT en France, comme un indice "entre autres" de l'évolution révolutionnaire de la situation en France. La FFGC ira jusqu'à prétendre que la reconduction du tripartisme gouvernemental s'est faite en fonction de la menace de classe du prolétariat, et insistera sur la haute signification objective qu'acquiert l'adhésion de quelques cinq camarades du groupe "Contre le Courant" ([6] [388]) à leur groupe.
Une telle analyse de la situation, avec la perspective de batailles de classe décisives dans le proche avenir, conduit tout naturellement ces groupes à l'idée de la nécessité urgente de construire le plus rapidement possible le Parti. Cela devient la tâche présente, la tâche du jour, sinon de 1'heure.
Le fait que le capitalisme international ne semble nullement inquiet de cette menace de lutte du prolétariat qui pèserait sur lui, et se livre tranquillement à ses affaires, à ses intrigues diplomatiques, à ses rivalités internes, à ses conférences de paix dans lesquelles il étale publiquement ses préparatifs de guerre prochaine, tout cela ne pèse pas lourd dans l'analyse de ces groupes.
On n'exclue pas complètement l'éventualité d'une prochaine guerre, d'abord parce que cela peut servir de thème de propagande et ensuite parce que se souvenant de l'aventure de 37-39, où également on niait la perspective de la guerre mondiale, on préfère être plus prudent cette fois-ci et se laisser une porte de sortie pour le cas échéant. De temps à autre on dira,à la suite du PCI d'Italie, que la situation en Italie est réactionnaire, mais cela ne portera pas à conséquence et restera une phrase épisodique, sans rapport avec l'analyse fondamentale de la situation qui mûrit "lentement mais sûrement" vers des explosions révolutionnaires décisives.
Cette analyse est également partagée par d'autres groupes comme le CR qui oppose à la perspective objective de la 3ème guerre impérialiste celle de la révolution inévitable, ou encore celle du RKD qui, plus prudent, se réfugie dans la théorie du double cours, de la croissance parallèle et simultanée du cours de la révolution et du cours de la guerre. Le RKD n'a évidemment pas encore compris que la croissance du cours vers la guerre est en premier lieu conditionnée par l'affaiblissement du prolétariat et 1'éloignement de la menace de la révolution, à moins d'épouser la théorie de la tendance Vercesi avant 39 pour qui la guerre impérialiste n'est pas une lutte d'intérêt entre les différents impérialistes, mais un acte de plus haute solidarité impérialiste en vue du massacre du prolétariat, une guerre de classe directe du capitalisme contre la menace révolutionnaire du prolétariat. Les trotskistes qui donnent également la même analyse, paraissent infiniment plus logiques avec eux-mêmes, car pour eux il n'y a pas nécessité de nier la tendance vers la 3ème guerre, la prochaine n'étant pour eux que la lutte armée généralisée entre le capitalisme d'une part et le prolétariat groupé autour de"l'Etat Ouvrier" russe de 1 ' autre.
En fin de compte, ou on confond d'une façon ou d'une autre la prochaine guerre impérialiste avec la guerre de classe, ou on minimise la menace de la guerre en la faisant précéder d'une indispensable période de grandes luttes sociales et révolutionnaires. Dans le deuxième cas, l'aggravation des antagonismes inter impérialistes, l'accélération des préparatifs de guerre auxquels nous assistons est expliquée par une myopie, une inconscience dans laquelle se trouve, le capitalisme mondial et ses chefs d'Etat.
On peut rester bien sceptique sur une analyse basée sur nulle autre démonstration que son désir propre, s'accordant le bénéfice d'une clairvoyance tandis qu'on attribu-2 généreusement à l'ennemi de classe un aveuglement total. Le capitalisme mondial a plutôt donné des preuves d'une conscience autrement plus aiguë des réalités que le prolétariat. Sa conduite en 43 en Italie et en 45 en Allemagne, prouve qu'il a diablement bien assimilé les enseignements de la période révolutionnaire de 1917, bien mieux que ne le fit le prolétariat et son avant-garde. Le capitalisme a appris à mater le prolétariat non seulement par la force mais à écarter le danger en utilisant le mécontentement même des ouvriers et en dirigeant ce mécontentement vers un sens capitaliste. Il a su faire, avec les armes d'hier du prolétariat, des chaînes contre lui. Il suffit de constater que le capitalisme se sert volontiers aujourd'hui des syndicats, du marxisme, de la Révolution d'Octobre, du socialisme, communisme, anarchisme, du drapeau rouge, du 1er mai, comme moyens les plus efficaces pour duper le prolétariat. La guerre de 39-45 fut menée au nom de "l'antifascisme" qui a été déjà expérimenté dans la guerre espagnole. Demain c'est sous le drapeau de la lutte contre le fascisme russe ou au nom de la Révolution d'Octobre que les ouvriers seront, une fois de plus, jetés sur le champ de bataille.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 1ibération nationale, reconstruction, revendications "économiques", participation ouvrière à la gestion, contrôle ouvrier, et autres slogans du même acabit, sont devenus les moyens les plus efficaces du capitalisme pour la destruction de la conscience de classe du prolétariat. C'est avec ces slogans qu'on mobilise les ouvriers dans tous les pays. Les troubles qui éclatent de ci de là, et les grèves restent dans ce cadre et ont pour résultat un plus grand enchaînement des ouvriers à 1'Etat capitaliste.
Dans les colonies, les masses se font massacrer dans une lutte, non pour la destruction de l'Etat mais pour sa consolidation, son indépendance à l'égard de la domination d'un impérialisme au bénéfice d'un autre impérialisme. Aucun doute possible sur la signification du massacre en Grèce, quand nous voyons l'attitude protectrice que prend la Russie, quand nous voyons Jouhaux devenir l'avocat de la CGT grecque en conflit avec le gouvernement. En Italie les ouvriers "luttent" contre la monarchie au nom de la république, ou se font massacrer mutuellement pour la question de Trieste. En France, les ouvriers donnent le spectacle écœurant de défiler en bleu de travail au pas cadencé, dans le défilé militaire du 14 juillet. Telle est la réalité prosaïque de la situation présente.
Il n'est pas vrai que les conditions pour la reprise de la lutte de classe, se présentent dans l’après guerre. Quand le capitalisme a "terminé" une guerre impérialiste mondiale qui a duré 6 ans sans voir l'embrasement d'une révolution, cela signifie la défaite du prolétariat et que nous ne sommes pas à la veille de grandes luttes révolutionnaires mais à la veille d'une d'une défaite. Cette défaite a eu lieu en 45, dans la destruction physique du centre de la révolution que représentait le prolétariat allemand, et elle fut d'autant plus décisive que le prolétariat mondial n'avait même pas pris conscience de la défaite qu'il venait de subir.
Le cours vers la 3ème guerre impérialiste mondiale est ouvert. Il faut cesser de jouer à l'autruche et chercher à se consoler en ne voulant pas voir la gravité du danger. Dans les conditions présentes, nous ne voyons pas la force susceptible d'arrêter ou de modifier ce cours,La pire chose que peuvent faire les faibles forces des groupes révolutionnaires c'est de lever le pied dans un cours de marche descendant. Fatalement ils aboutiront à se briser le cou.
La Fraction belge croit être quitte en disant que, si la guerre éclate, cela prouverait que la formation du parti aurait été prématurée. Quelle naïveté ! Cela ne se fera pas impunément, il faudra payer chèrement l'erreur.
En se jetant dans l'aventurisme de la construction prématurée et artificielle de partis, on commet, non seulement une erreur d'analyse de la situation, mais on tourne le dos à la tâche présente des révolutionnaires, on néglige l'élaboration critique du programme de la révolution, on abandonne l'oeuvre positive de formation de cadres.
Mais il y a encore pire, et les premières expériences du parti en Italie sont là pour nous le confirmer. Voulant à tout prix jouer au parti dans une période réactionnaire, voulant à tout prix faire du travail de masse, on descend au niveau de la masse, on lui emboîte le pas, on participe au travail syndical, on participe aux élections parlementaires, on fait de l'opportunisme.
A l'heure présente, l'orientation de l'activité vers la construction du Parti ne peut être qu'une orientation opportuniste.
Que l'on ne vienne pas nous reprocher d'abandonner la lutte quotidienne des ouvriers, de nous extraire de la classe. On ne reste pas avec la classe parce qu'on s'y trouve physiquement et encore moins en voulant garder à tout prix la liaison avec les masses, 1iaison qui, en période réactionnaire, ne peut être maintenue qu'au prix d'une politique opportuniste. Que l'on ne vienne pas nous reprocher de vouloir nous isoler dans notre tour d'ivoire, nous accuser de tendre vers des sectes de doctrinaires qui renoncent à toute activité, après nous avoir accusés d'activisme dans les années 43-45.
Le sectarisme n'est pas l'intransigeance de principes, ni la volonté d'études critiques, ni même le renoncement momentané à un large travail extérieur. Le vrai caractère du sectarisme est sa transformation du programme vivant en un système mort, les principes guidant l'action en dogmes, que cela soit braillé ou chuchoté.
Ce que nous proclamons nécessaire dans la période réactionnaire présente, c'est le besoin de faire des études objectives, de comprendre la marche des événements, leurs causes, et oeuvrer pour les faire comprendre à un cercle d'ouvriers forcément restreint dans une période de réaction.
La prise de contact entre les groupes révolutionnaires de divers pays,la confrontation de leurs idées, la discussion internationale organisée en vue de la recherche d'une réponse aux problèmes brûlants, soulevés par l'évolution, un tel travail est autrement plus fécond, et se rattache autrement à la classe, que la vaine agitation creuse, dans le vide.
La tâche de l'heure des groupes révolutionnaires est la formation des cadres, tâche moins tapageuse, moins portée à des succès faciles, immédiats et éphémères, et infiniment plus sérieuse, car la formation des cadres aujourd'hui est la condition et la garantie du FUTUR PARTI DE LA REVOLUTION.
Marco.[1] [389] R.K. D. -Communistes Révolutionnaires d’Allemagne- , Groupe trotskiste autrichien qui s'est oppose à la fondation d'une 4ème Internationale lors de la Conférence Internationale qui l'avait proclamée en 1938, l'estimant largement prématurée. Ce groupe en exil prendra de plus en plus de distance par rapport à cette Internationale (et notamment en ce qui concerne la participation à la 2ème guerre sous prétexte de défense de l'URSS) et finalement contre la théorie de l'Etat ouvrier dégénéré, chère au trotskisme. Ce groupe en exil avait le mérite politique incontestable de mener une campagne intransigeante contre la guerre impérialiste et contre toute participation, sous quelque prétexte que ce soit. A ce titre il a pris contact avec la Fraction de la Gauche Communiste Italienne et Française durant la guerre et a participé à la publication, en mai 45, d'un tract en commun avec la Fraction française, adressé aux ouvriers et aux soldats de tous les pays, et en plusieurs langues, dénonçant la campagne chauvine lors de la "libération" de la France et appelant au défaitisme révolutionnaire et à la fraternisation. Après la guerre ce groupe s'est rapidement orienté vers l'anarchisme dans lequel il finit par se dissoudre.
[2] [390] Le C.R. (Communistes Révolutionnaires) est un groupe de trotskistes français que le R.K.D. a réussi à détacher du trotskisme vers la fin de la guerre et qui a suivi une évolution identique au R.K.D. Ces deux groupes ont participé à la Conférence Internationale en 47-48 réunie en Belgique à l'initiative du groupe de la Gauche Hollandaise, qui réunissait tous les groupes restés internationalistes et qui rejétaient toute participation à la guerre.
[3] [391] Il faut absolument se garder contre une erreur couramment commise et qui consiste à identifier le Parti avec 1'activité toujours possible et nécessaire des groupes révolutionnaires et le déterminisme avec un fatalisme impuissant et désespéré. La tendance Vercesi de la G.C.I., est tombée dans cette erreur pendant la guerre.
Considérant que les conditions du moment ne permettaient, ni l'existence d'un parti, ni l'entreprise d'une large agitation dans les masses, elle a conclu à la condamnation de tout travail révolutionnaire et a nié la possibilité de l'existence même des groupes révolutionnaires. Elle a oublié que les hommes ne sont pas simplement des produits de l'histoire mais que... "Les hommes font leur propre histoire."(Marx)
L'action des révolutionnaires est forcément limitée par les conditions objectives. Mais cela n'a rien à voir avec les cris désespérés du fatalisme : quoi que tu fasses tu n'arriveras à rien.
Le marxisme révolutionnaire au contraire dit : "En prenant conscience des conditions existantes et agissant dans leurs limites dans un sens révolutionnaire, on fait de sa participation une force complémentaire réagissante qui à son tour influence et est susceptible de modifier le cours de événements." (Trotsky - "Cours nouveau"-)
[4] [392] Il s'agit des anciens membres de l'Union Communiste, groupe qui publiait "L'Internationale" dans les années 30 et qui a disparu à la déclaration de la Guerre en 1939.
[5] [393] Chute du régime de Mussolini et refus des masses ouvrières à continuer la guerre.
[6] [394] Un petit groupe qui s'est constitué après la guerre qui a connu une existence éphémère, et dont les membres, après un bref passage au P. CI s’est perdu dans la nature.
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]
Heritage de la Gauche Communiste:
Critique du Groupe Communiste Internationaliste
- 3467 reads
LUTTE REVENDICATIVE, LUTTE REVOLUTIONNAIRE : LA DYNAMIQUE DE LA CLASSE OUVRIERE
Le "Groupe Communiste Internationaliste", formé en 1979 par des militants ayant quitté le CCI, est une illustration typique des difficultés et de la faiblesse dans lesquelles se trouve aujourd'hui le milieu révolutionnaire. La constitution hâtive par ces camarades d'une"tendance" dans notre organisation sur des bases hétéroclites et incohérentes, leur départ précipité sans qu'ils aient essayé de mener un débat de fond permettant de clarifier pleinement leurs divergences, exprimaient certains des travers les plus répandus aujourd'hui dans le milieu révolutionnaire : 1'immédiatisme, le volontarisme, et le sectarisme. En effet, le point de départ de leur démarche était une impatience devant la stagnation des luttes de classe au milieu des années 70. Déçus par le prolétariat, ils se sont réfugiés dans la vision propre aux bordiguistes qui fait du Parti le "deus ex machina" du mouvement de la classe. De même, frustrés de n'avoir pas convaincu immédiatement 1 'ensemble de 1 'organisation, ils ont préféré la quitter avant même d'avoir rédigé un document synthétisant l'ensemble de leurs divergences. A un travail révolutionnaire sérieux qui implique aussi de se trouver en minorité dans une organisation vivante du prolétariat, ils ont préféré se livrer aux penchants typiquement gauchistes et estudiantins de multiplication de petits cercles où chacun peut s'adonner à coeur joie à 1'ambition petite-bourgeoisie d'être "maître chez soi". En un mot, le sectarisme.
Sur la lancée de ses origines, le GCI n'a eu de cesse, depuis son apparition, de dénigrer systématiquement le CCI, en s'acharnant à trouver des contre-exemples destinés à démentir nos analyses, en utilisant massivement la déformation de nos positions en lieu et place d'une polémique véritable et fructueuse.
Quand à 1'argumentation de leurs positions de départ, elle a conduit ces camarades a développer des théories fumeuses et des schémas abstraits auxquels ils "adaptent" la réalité. Ainsi, ils ont abandonné rapidement une compréhension réelle de ce qu'est la classe ouvrière et de son mouvement; ils ont rejeté aux poubelles de l'histoire une partie du mouvement ouvrier, et notamment toute la seconde Internationale.
Cet abandon est à la base, comme pour beaucoup de groupes révolutionnaires aujourd'hui, des graves confusions du GCI sur de multiples problèmes, notamment le processus de prise de conscience du prolétariat et le rôle des minorités révolutionnaires, la nature et le rôle de la violence de classe, les perspectives actuelles de la lutte de classe et le cours historique de notre période, confusions qui interdisent d'apporter une contribution fructueuse aux combats qui se préparent.
C'est ce que nous proposons de montrer dans cet article.
CONSCIENCE DE CLASSE ET ROLE DU PARTI
Le GCI ([1] [395]) reconnaît très clairement que la révolution prolétarienne, à la différence des révolutions bourgeoises, sera une révolution CONSCIENTE :
" Les conditions et les déterminations de la lutte prolétarienne sont donc radicalement différentes de ce qui conditionnait les luttes de classe du passé, pour le prolétariat qui n'a aucun nouveau système d'exploitation à imposer, la connaissance de son être en mouvement (et donc de son but) est une nécessité pour sa victoire" (Le Communiste n°6, page 3).
Malheureusement, s'il accepte cette prémisse générale, c’est pour aussitôt la déformer, en 1'"adaptant" à sa propre vision de la classe et du parti. Le préjugé bien ancré du GCI est que seule une minorité du prolétariat peut arriver à une conscience claire des buts et moyens de la révolution : " exiger que la conscience soit générale au sens où l'ensemble des ouvriers soient conscients des objectifs, des moyens pour y arriver et de l'expérience accumulée, c'est demander l'impossible : les conditions même de l'exploitation l'empêchent" (Rupture avec le CCI, page 10). La conscience de classe est vue comme l'apanage de ceux qui ("noyaux, groupes, fractions, voire individus, communistes") doivent se constituer en parti communiste mondial. Quant aux larges masses d'ouvriers, ce n'est que plus tard, après la prise du pouvoir, pendant la dictature du prolétariat, qu'elles acquerront cette donnée précieuse. Le GCI se trouve ainsi prisonnier de ses deux affirmations, qui s'excluent réciproquement; d'une part l'affirmation que"pour le prolétariat, la connaissance de son être en mouvement (et donc de son but) est une nécessité pour sa victoire" et d'autre part l'affirmation que "exiger que la conscience soit générale, au sens où l'ensemble des ouvriers soient conscients... c'est demander l'impossible". C'est dans l'emploi du mot "ensemble" et le sens abusif qu'il lui donne que le GCI s'enfonce dans la confusion tout en croyant s'en tirer. Faut-il rappeler que pour le marxisme, "l'ensemble" n'a nullement un sens arithmétique d'une somme d'ouvriers additionnés un à un? L'"ensemble" se rapporte à la classe comme une entité sociale, avec sa dynamique propre, historique. Il se rapporte à la conscience de la classe comme un tout, et non à la conscience de chaque ouvrier comme individu. C'est cette difficulté à saisir le concept de classe comme un tout, un ensemble, cette difficulté commune à toute démarche petite-bourgeoise, qui plonge le GCI dans cet embarras insurmontable, et ne lui permet de s'en dégager qu'en recourrant à une autre et vieille aberration .
Comment selon le GCI, le prolétariat pourra-t-il donc faire la révolution? C'est au parti que revient l'essentiel de cette tâche.
Cette position n'est pas sans poser quelques difficultés, lorsqu'on aborde des problèmes plus concrets. Si les ouvriers ne sont que des moutons inconscients, pourquoi suivront-ils le parti, les mots d'ordre révolutionnaires, plutôt que la bourgeoisie? Pourquoi les ouvriers, en Allemagne, n'ont-ils pas suivi leurs partis (KPD, KAPD) qui décrétèrent l'Action de Mars en 1921? "Il y a eu putsch car impréparation (cf. Les changements de positions du VKPD, du jour au lendemain) et erreurs d'appréciation de l'état d'esprit des masses, du rapport de force entre les deux classes antagoniques" (Le Communiste, n°7, pagel6).
En quoi consistait cette préparation, réussie en Russie et ratée en Allemagne? "Dans l'action de Mars, il n'y a aucune "conspiration sérieuse", aucun "complot insurrectionnel, aucune insurrection massive, et encore moins un déforcement de la bourgeoisie" (Idem). Voilà comment le GCI se "sort" de la position difficile dans laquelle il s'est placé : en éliminant totalement le facteur "conscience de classe".
Les facteurs déterminant une insurrection victorieuse sont réduits du coté du parti...à une "conspiration", un "complot", et du coté de la classe à... une"insurrection massive". Un point c'est tout.
Si le GCI peut éliminer aussi facilement la conscience de classe de l'analyse des mouvements révolutionnaires, alors qu'il en parle tellement dans d'autres textes, c'est parce que fondamentalement, il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il ne comprend pas ce qu'est la conscience de classe.
La conscience de classe est la conscience qu'a la classe ouvrière de son être propre, de ses perspectives et des moyens qu'elle se donne pour les réaliser. Elle n'est pas une conscience sur un objet, extérieur au prolétariat, mais une" conscience de soi, et dans cette mesure, elle s'accompagne d'une modification du prolétariat. La conscience de classe n'existe que par l'existence d'une classe consciente. Que la classe soit consciente ne signifie pas que tous les prolétaires, pris individuellement, aient cette conscience, mais c'est un fait matériel : la classe consciente est une classe qui s'affirme par la destruction matérielle du système capitaliste. Toute tentative de dissocier conscience de classe - classe consciente-destruction matérielle du capitalisme - ne consiste qu'à réintroduire l'idéologie bourgeoise, ses séparations et ses spécialisations, dans la théorie révolutionnaire.
La conscience de classe, collective, ne peut donc, par sa nature même,être détenue par une minorité. Le parti, les noyaux révolutionnaires ont bien une compréhension théorique des problèmes de la révolution, mais ne peuvent prétendre être les détenteurs exclusifs de la conscience de classe.
En fait le GCI ne voit pas d'où vient la conscience de classe, comment elle s'élabore. Sous prétexte que "l'action précède la conscience", il refuse de comprendre que la conscience de classe s'élabore au travers des luttes quotidiennes de la classe ouvrière et de la réflexion forcée et inévitable de ses expériences. Et que c'est parce que le prolétariat devient plus conscient qu'il est capable de modifier sa façon de lutter. Le prolétariat ne fera pas une "insurrection massive" poussé uniquement par la misère, comme semble le penser le GCI. Le prolétariat ne fera la révolution que s'il sait ce qu'il fait et vers où il va.
Sur ce point, le GCI se pi ait à répandre l'idée que le CCI est, entre autre, profondément "démocrate". "Avec son culte de la conscience généralisée (dont il fait un fétiche devant lequel il se met à genoux), le CCI est retombé tout droit dans l'idéologie"démocratique bourgeoise" (Rupture avec le CCI, page 11). Le GCI affirme par ailleurs que "l'aspect minoritaire de la conscience de classe restera une donnée certaine jusqu'à un stade avancé du processus révolutionnaire, pour s'élargir à des couches de plus en plus larges d'ouvriers pendant la période de dictature. La révolution communiste est donc principalement anti-démocratique".
Contrairement à ce que pense le GCI, la question réelle n'est pas "minorité" ou "majorité" en soi. Nous ne sommes pas attachés à des images de mécanismes de vote, à des forêts de bras levés, à de belles majorités qui 1'emportent...mais à comprendre les conditions qui rendent la révolution possible. Ni la révolution, ni la transformation ultérieure ne seront possibles avec pour seul atout une "minorité consciente". La transformation de la société capitaliste, dont les forces aveugles dominent le prolétariat comme toute la société, ne se fera pas par décrets, mais elle n'est possible que par l'action consciente et collective du prolétariat. C'est la mobilisation du prolétariat, sa capacité à assumer l'entièreté du pouvoir, qui seront les garanties de la transformation de la société. C'est pour cette raison que la dictature du prolétariat signifiera la démocratie ouvrière, c'est à dire une égalité réelle, une liberté sans précédent pour toute la classe ouvrière.
Cela signifiera aussi le refus de toute contrainte, de toute violence au sein du prolétariat. A ce sujet, on peut se demander ce que signifie concrètement le fait que pour le GCI, la révolution communiste sera anti-démocratique au sein même du prolétariat?
Avec la même virulence, le GCI reproche au CCI son"assembléisme", ou "formalisme" ou "fétichisme des Assemblées générales" - le terme varie selon les jours- bref, le fait que le CCI fait, dans son intervention en général, de la propagande pour certaines formes d'organisation de la lutte ouvrière : les Conseils Ouvriers en période révolutionnaire, et, dans les luttes actuelles, les organes qui les préfigurent, Assemblées Générales, comités de grève, délégués élus et révocables... L'argument du GCI en la matière étant que toutes les formes d'organisations (Conseils, comités de grève, unions etc..) pouvant être récupérées par la bourgeoisie (ce qui est tout à fait exact), peu importe la forme que prend l'organisation des ouvriers, ce qui importe, c'est le contenu . Le GCI a ainsi développé un schéma, où le lien entre la forme et contenu de la lutte est banni.
Nous ne sommes pas attachés à une forme d'organisation en tant que telle, mais à un contenu: le développement de la conscience de classe par la participation active des ouvriers â la lutte, le fonctionnement collectif, le dépassement des séparations entre "économique" et "politique", la rupture des divisions sectorielles, usinistes, entre les ouvriers. A ce contenu ne correspondent pas 36 organisations, et en tout cas, pas les syndicats (même si le GCI en juge certains de "classes" ni les unions. Le manque de clarté d'un groupe politique sur les organisations où s'exprimera la dynamique révolutionnaire est dangereux. La position du GCI sur les formes d'organisation de la lutte aujourd'hui l'a conduit à avoir, par rapport à la Pologne, une intervention totalement inadéquate. D'une part, en cherchant à prouver l'idée selon laquelle on ne peut prétendre à l'avance et en dehors de la vie réelle que les formes "syndicats de classe", "unions", "conseils", "communes", "soviets" ont toutes épuisé complètement leur cycle historique et ne ressurgiront plus comme expression du mouvement prolétarien (Le Communiste n° 4, page 29), au lieu de dénoncer les syndicats libres, le GCI écrit : " Ceux-ci peuvent en effet être de réels organismes ouvriers, larges, ouverts à tous les prolétaires en lutte, la coordination, centralisation des comités de grève, mais également sous pressions conjointes des autorités et des "dissidents", se transformer en organismes de l'Etat bourgeois" (Le Communiste n°7, page 4).
D'autre part, le GCI s'est contenté de mettre l'accent sur le caractère massif et centralisé du mouvement, sans se résoudre à parler des fermes d'organisations que cela supposait : Assemblées Générales, délégués élus et révocables, sans doute parce que cette réalité était trop "démocratique" à son goût?
Le silence dont fait preuve le GCI par rapport aux formes d'organisation de la lutte est d'autant plus profond que finalement, il n'est pas intéressé à comprendre le mouvement de la lutte de la classe ouvrière. En effet, à ses yeux, c'est le parti qui organise la classe.
LE ROLE CONCRET DU PARTI
" (les communistes) ne s'opposent pas aux nombreuses associations qui surgissent parmi les prolétaires et qui luttent pour des objectifs particuliers (...) . Ils agissent pour élever leur niveau, généraliser leurs tâches et leurs objectifs les fondre ensemble organiquement : c'est-à-dire les réunir en une seule organisation, ou du moins, si ce n'est pas possible directement, les centraliser autour du pôle le plus avancé" (Rupture avec le CCI, page 8). Le parti centralisant tendanciellement toute la classe, la fonction que joua la Première Internationale au 19ème siècle : "organiser et coordonner les forces ouvrières pour le combat qui les attend" (Marx, 1871), constitue l'idéal absolu du GCI. Ce que le GCI méconnaît totalement, c'est que l'évolution de la classe ouvrière d'une part, le changement de période historique de l'autre, ont modifié le rôle des révolutionnaires dans l'histoire : "Il était normal que dans un premier temps, la nécessité, d'organisations communistes distinctes remplissant une fonction propre ne se soit pas faite sentir de manière plus impérieuse : la première tâche d'organisation que des révolutionnaires comme Marx se sont donnée fut de tenter de faire exister le prolétariat comme force autonome, et organisée, en unifiant les expressions de classe existantes qui restaient éparpillées. Ce fut le sens de la Première Internationale, qui tenait autant du parti politique au sens strict du terme, que de l'organisation générale de la classe (associations et sociétés ouvrières, organes syndicaux). Avec la Deuxième Internationale, une plus grande distinction s'était opérée entre d'une part le parti politique et d'autre part les organismes plus généraux tels les syndicats. Cependant, l'immaturité du prolétariat en pleine croissance, la possibilité de mener des luttes permanentes pour des réformes et donc de créer et maintenir en vie des organisations de lutte permanentes (syndicats) donnaient toujours un poids à l'influence"organisatrice" des révolutionnaires; les partis eux-mêmes étaient des organisations de masse liées aux syndicats. Cette pratique s'est reflétée dans l'idée que les marxistes se faisaient de leur tâche. Pendant toute cette période en fait, l'absence d'expérience révolutionnaire décisive (l'exemple de la Commune de Paris demeurait tout à fait isolé), les marxistes ne parvenaient pas à concevoir le parti politique autrement que comme un organisme qui organiserait plus ou moins progressivement la majorité de la classe, et qui par ce caractère de masse, serait amené à exercer la dictature du prolétariat. Cette conception s'était particulièrement renforcée sous la social-démocratie.
Mais dés 1905 en Russie, cette conception s'est effondrée. L'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin et la période de la révolution mondiale surgie de la première guerre mondiale changent définitivement et profondément les conditions de la lutte ouvrière, et donc également les caractéristiques de ses organisations. La crise du capitalisme empêche la survivance des luttes permanentes, les organisations de masses (syndicats et partis) sont englouties par l'appareil d'Etat; parallèlement, la plus grande maturité du prolétariat lui permet de se lancer dans des affrontements révolutionnaires et de créer spontanément des organisations de classe unitaires abolissant la frontière entre politique et économique, les Conseils Ouvriers. Les Conseils Ouvriers sont "la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" (Lénine). Dans cette situation, la fonction propre des organisations révolutionnaires prend tout son sens: les révolutionnaires, même lorsqu'ils forment des partis, constituent une minorité dont l'impact organisateur se réduit vis-à-vis de la masse de prolétaires en mouvement, alors que leur tâche politique, en tant qu'organe spécifique, de développement de la conscience de classe devient cruciale pour la marche de la Révolution"(Internationalisme n563 : Nécessité et Fonction du Parti).
A l'époque actuelle, où le prolétariat tend à se lancer dans des luttes massives, les ouvriers à s'organiser par millions, la vision d'un parti réunissant les associations ouvrières en "une seule organisation" révèle une mégalomanie et un anachronisme profonds chez ceux qui la véhiculent. Le GCI pense avoir trouvé un support historique à sa conception : le KAPD en 20-21 en Allemagne, qui travaillait essentiellement dans les "Unions". Cette forme d'organisation bénéficie de ses faveurs pour deux raisons : parce que les "Unions" dépendaient étroitement d'un parti politique, et parce qu'il y avait un critère politique d'adhésion : l'accord sur la dictature du prolétariat.
Le GCI glorifie donc le KAPD : "Force nous est de trouver, dans la pratique du KAPD, les indications sur le contenu du futur mouvement révolutionnaire" (Le Communiste, n° 7, pagel8-19). Aveuglé par le fait d'avoir trouvé enfin la forme d'organisation qu'il cherchait et un parti qui l'a créée, le GCI se défend d'envisager en quoi, et la création des Unions et l'intervention du KAPD étaient à maints égards le produit de la faiblesse du mouvement révolutionnaire en Allemagne. Les Unions sont créées après l'échec des Conseils Ouvriers, que la bourgeoisie avait réussi à neutraliser. La désorientation politique du prolétariat qui s'en suivit se refléta dans ces organes, qui étaient clairement un repli sur l'usine, et que les ouvriers considéraient comme des syndicats plus radicaux. Cette désorientation va aussi influencer l'intervention des révolutionnaires : le KAPD va adopter une attitude volontariste dans son intervention, tenter de reconstruire le mouvement de masse grâce aux Unions. La centralisation dans le KAPD sera le reflet du manque de centralisation réelle dans la classe, d'une dispersion des forces. Finalement les attitudes putschistes du KAPD (Action de Mars) n'aboutiront qu'à 1'échec.
Armé de tout ce bagage "historico-théorique", le GCI conçoit son rôle comme étant prioritairement "d'organiser la classe", du moins les éléments qui veulent bien se laisser organiser par lui. Ses entreprises se sont soldées par un échec, soit parce que ses"appels" ne rencontrent aucun écho auprès des groupes concernés (cf. son appel â "une coordination des ouvriers en lutte", dans Le Communiste n°2, critiqué dans Internationalisme n° 35), soit parce que ayant bâti artificiellement des comités de tout genre, ceux-ci dé pourvus d'une vie réelle interne, succombaient rapidement à leurs contradictions. Ces expériences désastreuses devraient suffire pour démontrer au GCI que ce n'est pas là le sens du travail révolutionnaire aujourd'hui. Dans la période actuelle, les révolutionnaires doivent intervenir au sein des luttes générales de la classe pour y défendre des perspectives claires : ce que le GCI ne faisait quasiment plus jusqu’aux récents mouvements début 82 en Belgique, étant trop préoccupé par l'organisation et l'activation de ses "comités" fantômes.
LA CLASSE OUVRIERE
Emporté dans sa recherche de "minorités agissantes", "historiques",1e GCI a été amené à définir d'une façon très particulière ce que constitue pour lui la classe ouvrière : "Le CCI méconnaît que l'existence de la classe ouvrière ne se manifeste pas dans 1'énumération statique des prolétaires, ni même forcement dans une majorité d'entre eux, mais souvent dans des minorités d'entre eux parmi lesquelles s'exprime la tendance à la constitution en classe"(Rupture avec le CCI, page 3). Le GCI a ainsi développé une vision totalement abstraite de la classe ouvrière. Une vision qui se situe en dehors du marxisme parce qu'elle efface tout simplement et complètement les déterminations économiques de la classe. D'où yient en effet le "mouvement" qu'il retient comme critère pour définir la classe, quel est le moteur matériel de la lutte, sinon l'exploitation des prolétaires?
C'est cette définition de la classe ouvrière qui a été le support de l'intervention du GCI. Il a ainsi progressivement centré cette intervention vers des secteurs de la classe ouvrière, essentiellement les chômeurs, sans doute parce qu'il les jugeait susceptibles de se mettre plus rapidement en mouvement que les ouvriers au travail des concentrations industrielles. On peut voir à quel point le GCI est arrivé dans son culte du "mouvement", indépendamment des forces sociales qui animent celui-ci, dans sa position sur la lutte des squatters à Berlin : "La lutte à Berlin, surtout menée par des jeunes,se rattache de fait au prolétariat, parce que l'occupation correspond à la satisfaction autoritaire d'un besoin ouvrier général, parce que pour mener ces occupations, le mouvement doit s'affronter à l'Etat bourgeois, et il remet en cause le sacré principe de la propriété privée" ( Action Communiste n° 4, page 6).
Si le GCI a refusé les "déterminations économiques statiques", c'est pour être prêt à glorifier un mouvement avec pour critère qu'il s'affronte avec l'Etat et au nom de critères moraux : "satisfaction autoritaire", "propriété privée" etc..
Le mouvement squatter est une expression de l'impasse du capitalisme qui provoque des convulsions dans toute la société.
Mais celles-ci ne sont pas pour autant porteuses du dépassement de ce système. Seule la classe ouvrière est porteuse de ce dépassement et peut et doit développer sa lutte pour rassembler toutes ces révoltes sociales. Le GCI préfère assigner des perspectives particulières au mouvement des squatters : centraliser les luttes pour le logement au-delà des frontières. L'attirance aveugle pour "tout ce qui bouge" du GCI lui fait remettre en question une base essentielle de la lutte révolutionnaire et du marxisme: la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire aujourd'hui.
LA VIOLENCE DE CLASSE
Le GCI, ne comprenant pas la capacité de la classe ouvrière à s'organiser de façon unitaire et à développer sa conscience de classe, ne saisit pas non plus comment, par sa violence de classe organisée, le prolétariat pourra avoir raison de la bourgeoisie. Cela le conduit à bon nombre de confusions, dont le point commun est l'idée que les affrontements physiques joueront un rôle central dans le développement de la perspective révolutionnaire. Le GCI défend aussi le terrorisme "ouvrier", insiste sur la "préparation militaire" de l'insurrection', sur la nécessité pour le prolétariat de développer une terreur rouge. Parce que nous ne partageons pas ces conceptions, le GCI nous accuse de "pacifisme" et de "légalisme" : "Le CCI ne s'est jamais dégagé du "social-pacifisme"" (Rupture avec le CCI, page 14).
Il ne fait aucun doute pour le CCI que la lutte de classe est une violence permanente entre deux classes irréductiblement antagonistes et que la révolution sera violente. Mais la question réelle est : quel rôle joue la violence dans la révolution prolétarienne?
A cette question, Rosa Luxembourg répondait : " Dans les révolutions bourgeoises antérieures ce sont les partis bourgeois qui avaient pris en main l'éducation politique et la direction de la masse révolutionnaire, et d'autre part, il s'agissait de renverser purement et simplement l'ancien gouvernement; alors le combat de barricades, de courte durée, était la forme la plus appropriée de la lutte révolutionnaire. Aujourd'hui, la classe ouvrière est obligée de s'éduquer, de se rassembler, et de se diriger elle-même au cours de la lutte et ainsi, la révolution est dirigée autant contre l'exploitation capitaliste que contre le régime d'Etat ancien; si bien que la grève de masse apparaît comme un moyen naturel de recruter, d'organiser et de préparer à la révolution les couches prolétaires les plus larges, de même qu'elle est en même temps un moyen de miner et d'abattre l'Etat ancien ainsi que d'endiguer l'exploitation capitaliste (...) Ce qui autrefois était la manifestation extérieure principale de la révolution : le combat de barricades, l'affrontement direct avec les forces de l'Etat, ne constitue dans la Révolution actuelle que le point culminant, qu'une phase du processus de la lutte de masse prolétarienne" (Grève de Masse).
Les combats pour la révolution prolétarienne seront peut-être plus violents, plus meurtriers que ceux qu'a menés la bourgeoisie pour faire sa révolution. Mais ce sera la conscience et la capacité du prolétariat à s'organiser qui déterminera l'efficacité de sa violence et non une "préparation militaire en soi" comme le pense le GCI. Pour cette raison, le rôle du parti prolétarien dans la préparation de l'insurrection comme à un niveau plus général consiste avant tout à développer la conscience de classe.
Les incompréhensions du GCI sur la question de la violence de classe déterminent par conséquent des erreurs dans son intervention. Pour le GCI, la classe ouvrière aurait à faire un apprentissage spécifique de la violence. Cela le conduit à applaudir à chaque acte violent posé par des groupes isolés de la classe ouvrière. " La violence est aujourd'hui un besoin immédiat de toute lutte qui veut marquer des points" (Voir leur article sur Longwy-Denain dans Le Communiste n° 1). Et parce qu'il craint que cela affaiblisse sa propagande pour la violence, la GCI s'interdit formellement de penser que ces manifestations de violence recouvrent bien souvent une combativité exemplaire associée à un manque de perspectives, comme dans la sidérurgie en France ou en Belgique. L'intervention du GCI ne correspond pas aux réels besoins de la classe.
La classe ouvrière n'a pas à apprendre à être violente, comme elle n'a pas à apprendre à faire grève. La classe ouvrière fait surgir des organisations révolutionnaires en son sein, pour ses besoins de comprendre et d'analyser la situation et de tracer des perspectives claires au cours de la lutte, non pour applaudir à ce qu'elle fait de plus immédiatement spectaculaire.
Dans ses tracts, le GCI ne manque pas de mettre en avant des mots d'ordre tels que "séquestration des patron", "destruction des stocks de marchandises". Pourtant les"exploits" du syndicalisme de base (destruction de sièges de banque, chambres syndicales, hôtels des impôts, séquestration de patrons) devraient lui faire comprendre que ces mots d'ordre ne sont pas plus que d'autres, en eux-mêmes, une manifestation de la radicalité de la lutte autonome du prolétariat.
Activisme organisateur, culte des mouvements partiels, apologie des "minorités" et de la violence dans un contexte d'immaturité de la classe ouvrière qui, jusqu'à présent, a encore laissé place aux illusions sur le parti "dirigeant la classe", 1'"organisant", "centralisant sa violence", voilà les facteurs qui ont permis que l'intervention du GCI ait produit un relatif développement numérique et éphémère en Belgique. Les bases du GCI sont peu solides. Nous venons de voir qu'elles reposent sur une incompréhension fondamentale de la nature de la classe ouvrière, de la façon dont celle-ci forge sa prise de conscience et du rôle des organisations révolutionnaires et du parti. Il s'agit de fait d'une incompréhension de la dynamique de la lutte de classe.
Lorsque l'on quitte le domaine des définitions et de la théorie, devenue pure abstraction pour le GCI, on peut voir dans toute son ampleur les conséquences des erreurs théoriques. Celui-ci s'avère en effet incapable de fournir une analyse sérieuse du mouvement de la lutte de classe. La cause essentielle de ce déficit est son refus de prendre en compte les conditions objectives, c'est-à-dire les conditions matérielles, qui, au sein du système capitaliste, sont un facteur déterminant dans les potentialités - ou les limites - de toute la lutte. Sa démarche idéaliste se dénote aussi bien dans son incompréhension historique (lutte en période ascendante et décadente du capitalisme) que dans son incompréhension du développement de la lutte à un niveau international aujourd'hui.
LE REJET DE LA 2ème INTERNATIONALE ET DES SYNDICATS
Le GCI a très vite rejeté le concept de périodisation du système capitaliste en une phase ascendante et une phase décadente, concept qui cimente la plateforme du CCI. Entendons-nous : il n'a jamais procédé à une critique réelle, mais en a touché un mot de-ci de-la ([2] [396]). Il rejette également les implications qu'a cette périodisation sur les potentialités de la lutte ouvrière. A savoir : au 19ème siècle, époque ou le capitalisme était en pleine expansion, la révolution n'était pas directement 4 l'ordre du jour. Dans ce contexte d'expansion, la lutte du prolétariat pouvait aboutir à des réformes, à des améliorations de sa condition, tant sur le plan économique (diminution du temps de travail, augmentation des salaires) que sur le plan politique (acquisition du droit d'association, de réunion, de presse, extension du droit de yote..). Au-delà de ces objectifs immédiats, c'est au travers de ces luttes que les prolétaires développaient leur organisation, leur unité, leur conscience de classe; au travers de cette expérience se préparait la lutte révolutionnaire. Social-démocratie et syndicats étaient les organisations qui, à l'époque, regroupaient les prolétaires autour de ces objectifs immédiats et à long terme. Un siècle plus tard, le GCI juge, quant à lui, que toute réforme intégrable par le capitalisme était par essence anti-prolétarienne: "Par suite de l'amélioration des conditions de travail et de la hausse des salaires, rendue possible par le haut niveau d'accumulation du capital, les luttes ouvrières furent chaque fois transformées en lutte pour des réformes (et par conséquent détruites en tant que combat prolétarien.), facteurs de l'expansion capitaliste et du progrès (Le Communiste n° 6, page 32). Pour quel objectif le prolétariat devait-il lutter alors? Selon le GCI, "il n'y a qu'un seul cas de conquête partielle envisageable, réalisé par notre classe : lorsque les ouvriers arrachent au capital une diminution du taux d'exploitation" (Le Communiste n°4, page 14). Nous avons déjà répondu à cette absurdité sans nom : "Jamais les luttes ouvrières ne se sont fixées comme objectif, en dehors des moments révolutionnaires, de mettre fin à l'accroissement du taux d'exploitation pour la bonne et simple raison qu'une telle chose aurait signifié l'arrêt de l'accumulation du capital, et donc du capital lui-même (Lutte revendicative et révolution, Internationalisme n° 40). Cette "analyse" illustre bien la démarche du GCI, oui se pi ait à élaborer des schémas stériles. La réalité de la lutte à la fin du 19ème siècle n'y entre-t-elle pas? Elle est simplement rejetée comme déchet à la poubelle de l'histoire. Les organisations du prolétariat à l'époque? Social-démocratie et syndicats sont décrétés "contre-révolutionnaires" les uns dès leur naissance, les autres dés leur légalisation par l'Etat bourgeois.
Au-delà du grotesque politique de ce genre d'affirmation, cet exemple est significatif. Ce que le GCI refuse en fait, c'est que la classe ouvrière est non seulement une classe révolutionnaire, mais aussi une classe exploitée. Ceci implique qu'elle lutte d'abord pour des objectifs immédiats (pour l'amélioration ou contre la détérioration de ses conditions d'existence), et que cette lutte ne peut réaliser sa potentialité révolutionnaire que dans des circonstances historiques déterminées : la période de décadence du capitalisme.
Pour le GCI, la classe ouvrière devrait être révolutionnaire dans toutes les conditions historiques et dans chaque lutte ponctuelle. Il tente de faire coller la réalité à son schéma, en affirmant jusque dans ses moindres tracts, que les ouvriers luttent aujourd'hui "pour une augmentation des salaires et des allocations de chômage", "pour une diminution de temps de travail", prêtant à toute lutte un caractère d'offensive directe vis-à-vis de la bourgeoisie, et ce, sur le terrain économique. Cette vision est, à maints égards, une absurdité profonde. Même dans la période actuelle, où la question de la Révolution est directement contenue dans les luttes décidées de la classe, l'aspect défensif est un caractère présent dans toute lutte. C'est la résistance à la dégradation de ses conditions d'existence qui pousse la classe ouvrière à développer son combat jusqu'à en faire une lutte révolutionnaire, moment où l'aspect défensif passe au second plan, mais est toujours présent. La transformation de sa lutte de résistance en lutte révolutionnaire nécessite toute une maturation de la classe ouvrière, de sa lutte et de sa conscience, C'est une vision totalement idéaliste de la classe ouvrière que celle du GCI qui ne reconnaît comme "lutte" que les mouvements qui posent la question de la révolution, et selon laquelle celle-ci serait directement contenue dans chaque lutte, dans chaque usine.
INTERNATIONALISATION DE LA LUTTE ET COURS HISTORIQUE
L'INTERNATIONALISATION DE LA LUTTE
Le GCI ignore généralement le problème de l'internationalisation de la lutte et quand il le pose, c'est toujours d'une façon erronée parce qu'il ne comprend pas les conditions matérielles qui déterminent les potentialités des combats ouvriers actuels.
Pour le GCI, la Révolution prolétarienne est à l'ordre du jour partout dans le monde; le prolétariat affronte sa tâche historique de façon unitaire tout en présentant des différences secondaires entre les divers pays. Le sort de la Révolution prolétarienne se jouera dans les pays centraux du capitalisme, là où le prolétariat est le plus concentré, où il y a la plus grande expérience de lutte, là où justement la bourgeoisie est le mieux développée, avec tout ce que cela comporte. C'est pourquoi nous avons toujours situé la reprise internationale des luttes en 68, au moment où toute l'Europe est secouée par des convulsions sociales. Nous rejetons explicitement la théorie "des maillons faibles" selon laquelle la Révolution se déclenchera dans les pays où la bourgeoisie est faible et mal armée contre le prolétariat. Nous avons réaffirmé cette position en essayant de comprendre la perspective qui s'ouvrait à la grève de masse en Pologne en 80-81, Nous avons mis l'accent sur le fait que le développement de la lutte en Pologne comme, à terme, la question de la Révolution, dépendait essentiellement de l'entrée en lutte du prolétariat des pays centraux du capitalisme.
A propos de cette question, le GCI jusqu'à présent fait preuve d'une incapacité notoire à comprendre la dynamique de la lutte de classe dans la période actuelle : quels en sont les grands moments? Où se situera au sein du mouvement international de la classe ouvrière, le noeud des confrontations entre bourgeoisie et prolétariat? Etc.,,
Ainsi, sous prétexte qu'il y a eu des luttes antérieures à 1968, le GCI se croit original à ignorer et minimiser ce que constitue comme ouverture la période de 1968. De même, lorsque nous analysons la Pologne comme "le mouvement ouvrier le plus important depuis 1917", le GCI (plus pour faire valoir une"originalité" que pour affirmer une autre analyse) pérore-t-il, que cette "affirmation grandiloquente et apologétique est un réel oubli actif (rien que ça!) des importants mouvements de classe, qui, ces dernière années, de l'Amérique Latine à l'Iran, de la Turquie à la Corée, de l'Italie à la Chine, ont ébranlé le monde capitaliste" (Le Communiste n913, page 13). Que le GCI soit rassuré, nous n'oublions aucune de ces luttes. Mais tous ces mouvements n'ont pas la même importance ([3] [397]). Il ne s'agit pas de juger des caractéristiques d'un mouvement dans l'absolu (de ce point de vue, la lutte en Amérique Latine a souvent été plus violente, plus généralisée que les combats en Europe) mais de voir comment il a pu s'intégrer -ou non- dans la dynamique générale qui anime la classe ouvrière mondiale, de par la maturité - historique- d'une situation. De ce point de vue, la Pologne marquait bien une avancée qualitative du mouvement, tout comme les mouvements de 68 en Europe, et ce dans la conscience ouvrière mondiale.
Le GCI, lui, met tout sur le même plan. Pire, il inverse parfois l'ordre d'importance des événement Ainsi, alors que "en Pologne, c'est le schéma de la contre-révolution qui se déroule" (après le 13 décembre), la "lutte du prolétariat au Salvador a marqué un grand pas dans la lutte communiste et à la formation du parti mondial". Si la première chose qu'il affirme à propos de la défaite en Pologne, c'est que celle-ci montre pleinement "la carence se matérialisant par l'inexistence d'une direction communiste", la leçon qu'il tire du Salvador est que : "Nous savons par notre propre expérience de classe que dans es conditions présentes au Salvador (...) il y a malgré tout des minorités révolutionnaires" (Le Communiste n°12). L'importance totalement démesurée que le GCI accorde ici au Salvador, et en général aux luttes en Amérique Latine et Centrale ([4] [398]) provient de son culte de la violence dans les luttes, des affrontements "militaires" entre bourgeoisie et prolétariat.
L'incapacité qu'il a de comprendre que seule la lutte dans les pays centraux du capitalisme offrira une perspective à la combativité des ouvriers des pays périphériques et de défendre cette perspective face à la classe ouvrière, le condamne à n'être qu'un spectateur admiratif des massacres qui se perpétuent là-bas, à faire l'apologie de l'isolement de cette fraction du prolétariat mondial.
Dans de telles conditions, il ne faut pas s'étonner du fait que le GCI ne comprenne rien au problème de l’internationalisation de la lutte de classe. "Depuis toujours le marxisme révolutionnaire analyse que la meilleure façon de généraliser un mouvement n’est ni d'"envahir" les autres pays, (...) ni d’"attendre" que simultanément le mouvement se déclenche partout (...). Au contraire, la meilleure manière de généraliser, de mondialiser un mouvement, c'est de répondre coup pour coup contre "sa propre" bourgeoisie ou les représentants directs de la bourgeoisie mondiale; c'est d'intensifier, le plus possible la guerre de classe là où elle s'est déclenchée" (Le Communiste n°13, page 9-10), avançait-il comme réponse aux questions posées par la Pologne: quand, comment, une telle lutte pourra-t-elle s'internationaliser? A nouveau l'affirmation du GCI est, par son aspect partiel, à moitié juste et donc aussi à moitié fausse. Il est certain que pour les ouvriers d'un pays donné, la meilleure façon de favoriser l'internationalisation d'un mouvement n'est pas d'attendre, mais de prendre des initiatives dans ce sens. Mais il était nécessaire d'aller plus loin que ces banalités, et de répondre aussi aux questions suivantes : est-ce que la situation était mûre pour qu'un tel dépassement des frontières nationales voit le jour à partir du mouvement en Pologne? Quelles sont les conditions objectives de maturité d'une telle situation? Il s'agit essentiellement de la mise en branle du prolétariat des pays centraux du capitalisme. De ce point de vue on ne pouvait que constater une immaturité de la lutte de classe internationale (Voir Revue Internationale n°24, 25, 26..., et Internationalisme n°59 et 60). Le GCI semble incapable de se situer à ce niveau d'analyse, de comprendre que les conditions de l'internationalisation sont avant tout des conditions mondiales.
LE COURS HISTORIQUE
Le doute profond qu'a le GCI par rapport aux potentialités de la classe ouvrière, 1'empêche d'avoir une réponse claire à la question : vers où va la société? Vers la guerre généralisée? Ou vers des affrontements de classe?
Le CCI a mis en évidence que depuis le début de la crise, le prolétariat a recommencé à lutter au niveau mondial, contrairement à la situation que la classe a connue dans" les années 30. Alors que la guerre est la seule "solution" que la bourgeoisie puisse apporter à la crise, celle-ci ne peut la déclencher tant qu'elle n'a pas réussi à briser la résistance du prolétariat, et ce au niveau mondial. L'avenir est donc à ces combats de classe, d'où dépendra la victoire du prolétariat (et donc la Révolution) ou sa défaite (et la possibilité pour la bourgeoisie de déclencher la guerre).
Le GCI reconnaît bien la différence entre la situation d'aujourd'hui et celle des années 30 : il affirme très justement que dans cette période de noire contre-révolution, le cours était inévitablement à la guerre. Mais pour lui, aujourd'hui, la tendance vers la guerre et celle vers la Révolution se développeraient simultanément, et en prenant appui l’une sur l'autre.
A propos de la lutte en Pologne, le GCI écrivait par exemple : "et il est clair que les événements d'aujourd'hui qui matérialisent la force historique de notre classe,renforcent dialectiquement l'intensification de la marche forcée de la bourgeoisie mondiale vers "sa solution" à la crise, la guerre généralisée. Le développement de la lutte prolétarienne est aussi un développement des mesures et des mystifications anti-ouvrières, renforçant ainsi la lutte entre les classes" (Le Communiste n° 7, page 7).
L'"apport" du GCI à la théorie marxiste est d'avoir complété "dialectiquement" le mot d'ordre que Lénine adressait aux ouvriers pendant la première guerre mondiale: "Transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" en son complément pour la bourgeoisie. Celle-ci aurait la capacité de "transformer (...) le danger de la guerre civile en la réalité de la préparation matérielle et idéologique à la guerre impérialiste" (Le Communiste n° 13, page 3). Cette nouvelle théorie fumeuse dissimule mal la méfiance profonde, l'incompréhension du GCI de ce que signifie pratiquement la lutte du prolétariat. Le GCI ne comprend pas réellement que lorsque le prolétariat lutte, il a tendance à prendre conscience de ses intérêts propres, à lutter sur son terrain de classe, à s'organiser en dehors du contrôle de la bourgeoisie et tant qu'il aura cette capacité, la bourgeoisie ne pourra l'emmener à la guerre. Le GCI, au contraire, voit le prolétariat comme une masse manipulée, soit par un parti, soit par la bourgeoisie. Celle-ci en effet, pourrait faire face aux luttes, sécréter des mystifications qui entraîneraient directement le prolétariat de son terrain de classe (où il est solidaire, internationaliste, où il lutte en même temps contre la crise et contre la guerre) vers la guerre impérialiste (où le prolétariat est divisé, soumis à l'idéologie nationaliste et belliciste)! Cette position conduit le GCI à de nombreuses erreurs: sur le plan théorique, il véhicule sans complexe l'idée bourgeoise que la lutte de classe accentue les dangers de guerre. Son analyse de situations plus ponctuelles est tout aussi erronée: n'a t-il pas qualifié de guerre inter impérialiste (entre les USA et l'URSS) le conflit des Malouines, destiné en réalité à donner plus de consistance aux campagnes idéologiques actuelles de la bourgeoisie sur la guerre (Voir la Revue Internationale n°30) Ces positions erronées ne peuvent que rendre plus stérile son intervention au sein de la classe ouvrière.
CONCLUSION
Ce texte ne constitue pas une critique exhaustive des positions du GCI. Nous nous sommes surtout efforcés, au travers de cette polémique d'opérer une clarification sur une série d'idées confuses qui règnent encore dans le milieu révolutionnaire. En effet, pour le GCI comme pour d'autres groupes, la source essentielle des confusions est l'incompréhension de la nature de la classe ouvrière, de sa dynamique réelle, des différents aspects de sa lutte. L'étendue des confusions sur ce problème montre bien les difficultés qu'a le milieu révolutionnaire à se réapproprier la théorie marxiste. Elle fait également ressortir la nécessité, pour les organisations prêtes à faire un travail de clarification, de répondre à ces confusions, que ce soit dans des réunions publiques, ou dans des articles dans la presse.
A notre avis, le GCI ne fait pas partie des groupes qui sont une expression de l'effort de clarification des perspectives révolutionnaires. Jusqu'à présent, la fonction essentielle du GCI dans le milieu révolutionnaire (y compris parmi les éléments qu'il "organisait" au sein de ses comités) a été de répandre la confusion.
Outre la régression théorique qu'il a opérée depuis son départ du CCI et la somme d'innovations "historico-théoriques" qu'il déverse régulièrement dans ses publications, son attitude par rapport au milieu révolutionnaire actuel en constitue une autre preuve. En effet, par son refus de tenir des réunions de discussions publiques, ou de participer à celles que nous organisons, par son attitude de sabordage de la 3ème Conférence Internationale des Groupes de la Gauche Communiste, le GCI n'a jusqu'à présent réussi à démontrer qu'une seule chose : le sectarisme profond qu'il n'a cessé de développer. Le GCI a en effet pour souci principal de s'auto satisfaire, de justifier son existence par une vision "originale" tant de l'histoire du mouvement ouvrier que des problèmes posés aujourd'hui.
Malheureusement, ces "découvertes" du GCI ne mènent pas à grand chose, sinon à une remise en question de plus en plus profonde du marxisme. Le fait que ce groupe, après nous avoir promis depuis plus de 3 ans des "Thèses d'orientation politique définissant les bases théoriques de notre groupe" (Le Communiste n°1, mai 79), ne soit toujours pas parvenu à publier l'ensemble de ces "bases théoriques", en dit long sur les difficultés qu'il éprouve à se définir une nouvelle cohérence.
A ceux qui, comme le GCI, se réclament tant de Lénine, il convient de rappeler que rien ne l'irritait plus que la "phraséologie radicale, grandiloquente et creuse ".
A ceux qui ont du "bolchevisme" plein la bouche, rappelons la réponse donnée par Lénine à l'occasion d'un appel au "bolchevisme à l'échelle de 1'Europe occidentale":
"Je n'attache pas d'importance au désir de s'accrocher au mot "bolchevisme", car je connais certains "vieux bolcheviks" dont je souhaite que le ciel nous préserve...
A mon avis, c'est faire preuve de légèreté et d'un manque d'esprit de parti absolument inadmissible que d'annoncer à son de trompe pendant toute une année un nouveau bolchevisme et d'en rester là . N'est-il pas temps de réfléchir et de donner aux camarades quelque chose qui expose en un tout cohérent ce "bolchevisme à l'échelle de l'Europe occidentale"? (Lénine, Oeuvres Complètes, Tome 23, page 18).
J
[1] [399] Groupe Communiste Internationaliste: BP 54 Bruxelles 31 1060 BRUXELLES
[2] [400] Avec le GCI, on apprend que la notion de "décadence du capitalisme", défendue par la Gauche Communiste sur la base de l'analyse économique de Luxemburg, n'était en fait "qu'une des deux thèses bourgeoises dominantes de l'époque - en 1936- (soutenues par les sociaux-démocrates, les trotskistes, les staliniens.)" (Le Communiste n° 6, page 46), affirmation qu'ils ne songent pas un instant a démontrer!
Le GCI pense réfuter cette notion en déclarant simplement que "le capitalisme n'avait pas cessé de croître, comme cela s'est vérifié par la suite : la guerre impérialiste de 39 à 45, la croissance infernale du capitalisme après la guerre. "(Idem). Mais par cet argument, il n'a rien montré, sinon qu'il s'est englué dans le marais de la propagande bourgeoise qui, à coups de taux de croissance , veut démontrer la vie éternelle du capitalisme!
[3] [401] Par contre, ce que le GCI, lui, Ignore, ou n'a jamais appris, c'est de savoir distinguer la portée de telle ou telle lutte, la signification et l'impact qu'elle a dans le développement mondial de la lutte de classe. Pour lui,"tous les chats sont gris".
[4] [402] Ainsi, c'est en Argentine et au Pérou qu'ont existé, selon le GCI,des"syndicats de classe", organisations "ouvrières" dont il serait par ailleurs incapable de donner un exemple dans une autre partie du monde. Le GCI ne manque pas non plus d'illustrer la vague révolutionnaire de 17-23 par l'exemple de la lutte de classe .en Patagonie (Le Communiste n° 5). Enfin plus récemment, le GCI a"découvert" qu'au Salvador, une des organisations populaires dirigées par des gauchistes, le BPR, constitué en 1975, était à 1'origine un organe prolétarien! (Le Communiste n°12).
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 33 - 2e trimestre 1983
- 3423 reads
Où va la lutte de classe ? : vers la fin du repli de l'apres-Pologne
- 2651 reads
" Les révolutions prolétariennes, par contre,comme celles du XIX° siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculer constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient:" Hic Rhodus, hic salta" ([1] [404])
MARX, Le 18 Brumaire.
Années de vérité, les années 80 ont commencé marquées par la lutte prolétarienne. La grève de masse d'Août 80 en Pologne montra d'emblée, par la puissance de son choc contre l'Etat/que la lutte ouverte entre prolétariat et classe dominante était devenue et, devrait de plus en plus devenir la caractéristique première de la période à venir. Cependant, les ouvriers polonais se sont retrouvés isolés. De 1980 à 1982 le nombre des luttes ouvrières, en particulier dans les pays les plus industrialisés, n'a cessé de diminuer de façon générale.
Comment comprendre ce recul au moment même où s'accélère l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme ? Quelles sont les perspectives de la lutte de classe ?
1968-1982, 15 ans de crise économique et de luttes ouvrières
C'est seulement envisagée dans ses dimensions MONDIALE ET HISTORIQUE que la lutte prolétarienne peut être comprise, car elle n'est pas une mosaïque de mouvements nationaux sans passé ni avenir. Pour comprendre le mouvement actuel de la lutte de classe mondiale il. faut d'abord le resituer dans son cadre historique et plus particulièrement dans le mouvement général commencé par la rupture de 1968.
De la compréhension de la dynamique des rapports entre classes dans ces années de crise économique ouverte du capitalisme décadent, on pourra dégager des perspectives pour la lutte de classe.
On peut, dans les grandes lignes, distinguer quatre périodes entre 1968 et 1982 suivant les caractéristiques majeures du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie : ([2] [405])
1968-1974 : développement de la lutte de classe ;
1975-1977 : reflux, contre-offensive de la bourgeoisie ;
1978-1980 : reprise de la lutte ;
1980-1982 : reflux, contre-offensive.
1968-1974 : RUPTURE AVEC UN DEMI-SIECLE DE CONTRE-REVOLUTION TRIOMPHANTE
Le coup de tonnerre des 10 millions de grévistes en France en Mai-Juin 68 ouvrit une période de luttes prolétariennes qui rompait ouvertement avec 50 ans de contre-révolution. Depuis le milieu des années 20, les ouvriers du monde entier avaient vécu, marqués par l'écrasement de la vague révolutionnaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le stalinisme, le fascisme, 1'anti-stalinisme, l'anti-fascisme, l'idéologie des mouvements de libération nationale, la démocratie bourgeoise avaient maintenu les prolétaires dans un état d ' atomisation , de soumission matérielle et idéologique, voire d'embrigadement derrière les drapeaux des différents capitaux nationaux.
Des "penseurs" à la mode, à la veille de 1968, ne théorisaient-ils pas la "disparition de la classe ouvrière" dans "l'embourgeoisement" et la soi-disant "société de consommation"?
La vague de luttes de 1968 à 1974 qui a touché, à des degrés divers, presque tous les pays (développés ou non) a constitué, par elle-même, un éclatant démenti à toutes les théorisations de la "paix sociale éternelle" et, ce ne fut pas là son moindre apport.
De Paris à Cordoba, en Argentine, de Détroit à Gdansk, de Shanghai à Lisbonne, 1968-1974 fut la réponse de la classe ouvrière aux premières secousses de la crise économique mondiale dans laquelle le capitalisme commençait à s'enfoncer depuis l'achèvement, au milieu des années 60, de vingt ans de reconstruction d'après-guerre.
Cette première grande période de lutte posa, dès ses débuts, tous les problèmes auxquels le prolétariat devait se confronter dans les années suivantes : 1'encadrement syndical et des partis bourgeois dits "ouvriers", les illusions dans les possibilités d'une nouvelle prospérité capitaliste, dans le mécanisme de la démocratie bourgeoise, la vision nationaliste de la réalité de la lutte de classe. Bref, les difficultés à développer son autonomie et son auto organisation face aux forces politiques de l'Etat bourgeois.
Presque partout les luttes ouvrières durent s'affronter, souvent violemment, non seulement aux gouvernements locaux, mais aussi et surtout aux forces d'encadrement de la bourgeoisie : syndicats, partis de gauche.
Mais, ces affrontements sont restés généralement dans le cadre des illusions d'une époque où les réalités de la crise économique étaient encore à leurs premiers développements.
Le capitalisme venait de connaître, pendant vingt ans, une période de relative stabilité économique. L'idée qu'un retour à la situation précédente était possible dominait encore la société. Et cela, d'autant plus qu'en 1972-73; le capital occidental, pour sortir de la récession de 70-71, se débarrassa des contraintes des taux de change fixes et de la convertibilité du dollar en or et connut une croissance sans précédent.
Entre 1968 et 1974, le chômage augmente sensiblement dans beaucoup de pays occidentaux, mais le niveau de celui-ci reste encore relativement bas ([3] [406]).L'attaque subie par la classe ouvrière dans cette période se situe surtout au niveau des prix à la consommation ([4] [407])
Devant la montée de la lutte de classe, les forces de gauche de la bourgeoisie ont su, en un premier temps, radicaliser leur langage et réadapter 1eurs structures, afin de pouvoir garder, d'une façon ou d'une autre, le contrôle des 1uttes. L'exemple des syndicats italiens pendant 1'"automne chaud" de 1969 est peut-être un des plus significatifs et spectaculaires: après avoir été violemment contestés par les assemblées d'ouvriers en lutte, ils savent instaurer des "conseils d'usine" formés de délégués de base pour mieux asseoir leur pouvoir dans les usines.
Cela s'avère insuffisant. Devant la nouvelle accentuation de la crise économique en 74-75, la bourgeoisie devra imposer encore de nouveaux sacrifices aux exploités. Se reposant sur les illusions encore for tes quant à la possibilité d'un "retour à la prospérité d'antan" (illusions dont elle est elle-même prisonnière) elle va développer la perspective de "la gauche au pouvoir".
A travers cette première vague de luttes, le prolétariat mondial a affirmé son retour au centre de l'histoire. Mais l'évolution de la situation objective ne permet pas encore à la classe révolutionnaire de posséder la force et l'expérience pour comprendre les perspectives et résoudre les problèmes que pose la lutte.
1975-1978 : CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE, LA GAUCHE AU POUVOIR
La récession de 74-75, que la presse appelait "le choc pétrolier", marque le véritable début des effets réels de la crise. Il se produit un changement profond dans la vie sociale. Les restrictions sur le niveau de vie des travailleurs deviennent de plus en plus sensibles. Le chômage augmente irréversiblement en Europe et, s'il diminue momentanément aux Etats-Unis, il reste toujours à un niveau élevé. En 76, les partis de gauche ont déjà formé des gouvernements aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. En France, la gauche accroît ses triomphes électoraux et lance la campagne "ne pas faire de grèves pour ne pas effrayer la population et permettre le triomphe de la gauche.
En Italie, après ses victoires électorales retentissantes, le PCI pratique le partage du pouvoir par le "compromis historique" avec le gouvernement démocrate-chrétien.
Le nombre de grèves diminue de façon générale dans la majorité des pays.
La réalité des faits se charge, cependant, de détruire peu à peu les illusions. La crise économique ne cesse de s'approfondir. Les triomphes électoraux des partis de gauche n'y changent rien. Les appels aux sacrifices se multiplient alors que leur efficacité apparaît de moins en moins évidente.
Dès 1978, les signes qui annoncent la fin de cette période de repli se font jour.
1978-1980 : LA DEUXIEME VAGUE DE LUTTES, LA POLOGNE
Au début 1981, nous parlions de cette "deuxième vague de luttes (...) où l'on voit tour à tour les mineurs américains en 78, les ouvriers de la sidérurgie en France début 79, les travailleurs du port de Rotterdam à l'automne 79, les ouvriers de la sidérurgie en Grande-Bretagne début 80, ainsi que les métallurgistes brésiliens durant toute cette période... reprendre le chemin du combat!
C'est à cette deuxième vague de luttes qu'appartient le mouvement présent du prolétariat polonais" ("La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne" (Revue Internationale N°24 ).
Les luttes ouvrières qui précédent celles de Pologne sont moins nombreuses que celles de 68-74. Mais 1orsqu'on les envisage dans leur ensemble, on s'aperçoit qu'elles résument, en un peu plus d'un an, l'essentiel de l'expérience de la première vague de luttes.
En se heurtant aux syndicats pour les déborder, comme les mineurs des USA, en se donnant dans la grève une forme d'auto organisation indépendante .des syndicats, comme les travailleurs du port de Rotterdam, en tentant de porter la lutte vers les centres du pouvoir et de force de la classe, comme les sidérurgistes français et leur "marche sur Paris", en faisant de la solidarité l'axe de leur combat, comme les sidérurgistes britanniques et leurs piquets de grève volants, les ouvriers,1ors de ces batailles,ont repris certains problèmes de la lutte au niveau où les avaient laissés les affrontements de la première vague.
La grève de masse en Pologne apporta dans la pratique d'importants éléments de réponse à ces problèmes. La grève de masse a démontré la capacité du prolétariat à s'unifier, à se battre sans distinction de catégories ou de secteurs de production. Elle a mis en évidence la capacité d'auto organisation par les assemblées et les comités de délégués à une échelle inconnue pendant la première vague. Et surtout, elle a illustré concrètement comment; en s'unifiant par la généralisation et en s'auto organisant, le prolétariat peut parvenir à développer une force et une maîtrise de soi capable d'affronter et de faire reculer les gouvernements les plus totalitaires.
Mais, en développant cette force, en désarçonnant et faisant reculer le gouvernement national, et avec lui le bloc militaire soviétique, le prolétariat s'est trouvé porté à un niveau supérieur d'affrontement avec l'Etat. Jamais, depuis les années 20, la classe ouvrière n'avait imposé un tel rapport de force politique à la bourgeoisie. Les luttes en Pologne ont démontré concrètement qu'à ce degré de confrontation entre les classes, les choses ne se jouent plus au niveau national. La bourgeoisie a affronté les prolétariats polonais avec la contribution de toutes ses forces économiques, mi1itaires et idéologiques dont elle dispose au niveau international. Même s'ils n'en ont pas toujours eu conscience, les ouvriers ont été mis devant la réalité des conséquences de leur propre force : s'ils voulaient pouvoir répondre à la riposte de la bourgeoisie, s'ils voulaient aller plus loin dans leur combat, seul moyen de ne pas reculer, il leur fallait LA GENERALISATION INTERNATIONALE de la lutte prolétarienne.
Cette généralisation était indispensable non seulement pour d'évidentes raisons militaires et économiques, mais d'abord et surtout parce qu'elle conditionnait l'évolution de la conscience même des ouvriers en Pologne. Les ouvriers en Pologne sont restés prisonniers de deux mystifications importantes : le nationalisme et les illusions sur la démocratie bourgeoise (lutté" pour un syndicat légal, etc.). Or, seule la lutte massive des ouvriers des autres pays de l'Est et surtout celle des principaux pays industrialisés d'Occident, pouvait apporter au prolétariat de Pologne, dans les faits, la démonstration pratique:
1°) de la possibilité d'unification internationale du prolétariat et donc de se débarrasser des perspectives nationales et de percevoir le caractère diviseur et anti-prolétarien de l'idéologie nationale,
2°) du caractère illusoire et dictatorial de la "démocratie" bourgeoise, avec ses syndicats et ses Parlements à l'occidentale.
Comme son être matériel, la conscience du prolétariat a une réalité mondiale. Elle ne pouvait se développer indéfiniment en un seul pays. Les ouvriers polonais ne pouvaient que poser objectivement le problème de la généralisation internationale. Seul, le prolétariat des autres pays industrialisés, en particulier en Europe occidentale, pourra y apporter une réponse pratique. Ce fut là le principal enseignement du mouvement prolétarien en Pologne.
1980-1982 : LA NOUVELLE CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE, LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION :
RECUL DES LUTTES OUVRIERES
Lorsque explose la grève de masse en Août 80 en Pologne, la bourgeoisie occidentale a déjà entamé une contre-offensive face à la nouvelle montée de la lutte de classe. Elle a commencé à réorganiser la disposition de ses forces politiques. La priorité est donnée à un renforcement de l'appareil d'encadrement du prolétariat sur le terrain même de l'usine et de la rue. Face à l'effritement des illusions, les gouvernements de gauche cèdent la place à des gouvernements de droite au langage "franc", ferme et menaçant...Thatcher et Reagan en deviennent les symboles. Les partis de gauche reprennent leur place dans l'opposition pour assurer leur fonction de contrôle des mouvements prolétariens en se mettant à leur tête et les étouffant dans la logique de la défense de l'intérêt national.
La façon dont la bourgeoisie mondiale a fait face à la lutte des ouvriers en Pologne même, les campagnes qu'elle a développées internationalement pour mieux en cacher le véritable contenu et la profonde portée, illustrent les caractéristiques les plus essentielles de cette contre-offensive.
En Pologne même, ce fut la construction de l'appareil de "Solidarnosc" avec la collaboration, le soutien financier et les conseils expérimentés de tous les syndicats du bloc US, soutenus par leurs gouvernements. Cette gauche dans l'opposition "à la polonaise" sut exploiter le sentiment "anti-russe" de la population pour enfermer les prolétaires dans une vision nationaliste de leur lutte. Elle sut détourner systématiquement les luttes ouvrières contre l'intensification de l'exploitation et de la misère, en combats pour une "Pologne démocratique". Elle sut maintenir l'ordre et saboter ouvertement les grèves au nom des intérêts de l'économie nationale et de la paix sociale'(Bydgoszcz) sans trop perdre de sa crédibilité:
-grâce au développement d'un appareil de base du syndicat, capable de prendre la tête des mouvements qui s'opposaient à la direction syndicale, tout en les maintenant dans le cadre syndicaliste,
-grâce au langage "anti-Solidarnosc" que développa le gouvernement qui fit de ses dirigeants des victimes et des martyrs et redora son blason.
Complémentarité et partage du travail entre gouvernement et opposition pour faire face au prolétariat, complémentarité et partage du travail au sein des forces de gauche entre les directions "modérées" et une base politique et syndicale "radicale" La Pologne fut un laboratoire vivant pour la construction de la contre-offensive de la bourgeoisie.
La façon dont la bourgeoisie affronte les luttes des sidérurgistes belges au début 1982, celles des ouvriers italiens en janvier 1983, constitue presque une caricature schématique de ce qu'elle fit en Pologne: durcissement du gouvernement devenu plus "de droite", radicalisation du langage de la gauche dans l'opposition, utilisation du syndicalisme de "base" ou de "combat" pour mieux contrôler les mouvements qui tendent à mettre en question le carcan syndical.
Sur le plan international, Va campagne organisée par la bourgeoisie occidentale à propos de la Pologne est un exemple typique de la série de campagnes idéologiques orchestrées internationalement et ayant comme objectif conscient le déboussolement, la désorientation des prolétaires. ([5] [408])
Pour dénaturer l'exemple de la réponse des ouvriers polonais à la crise économique mondiale, pour détruire la tendance des ouvriers du monde entier à se reconnaître dans la combativité des prolétaires polonais, la bourgeoisie occidentale, avec la collaboration explicite de celle de l'Est, à coup de "Reagan show" le Pape en tête/développe le thème "La lutte des ouvriers polonais n'a rien à voir avec votre situation ; son objectif c'est vivre comme en Occident . Nous ne nous battons pas pour abolir l'exploitation mais pour avoir un régime comme le votre".
Le coup de force du 13 décembre fut le premier résultat de cette contre-offensive. Les campagnes de déboussolement et l’instauration d'un climat de terreur: El Salvador, la guerre des Malouines, le terrorisme, les massacres du Liban, ont contribué à en étendre les bâti vite prolétarienne.
Cette contre-offensive de la bourgeoisie au début des années 80 n'a pas été seulement idéologique. La répression policière et bureaucratique a connu des développements spectaculaires. Tous les gouvernements ont multiplié les brigades "antiémeutes" et la collaboration internationale des polices face à ceux qui mettent en question "la sécurité de l'Etat".
Mais la pire forme de répression que subissent les ouvriers n'est autre que les effets de la crise économique: les heures de queue devant les magasins et la jungle du marché noir dans les pays de l'Est, la misère du chômage et la baisse des salaires dans les pays occidentaux.
La violente accélération de la crise entre 1980 et 1982 se traduit concrètement par un rapide resserrement de l'étau qui soumet les prolétaires à 1'atomisation et à la concurrence entre eux. La bourgeoisie mondiale a su en tirer momentanément le maximum de profit.
Dans les principaux pays occidentaux, le nombre des grèves diminue fortement à partir de 19807 En 1981, dans des pays aussi importants pour la lutte de classe que les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France ou l'Italie le nombre des grèves enregistré est le plus bas ou un des plus bas depuis plus de 10 ans.
Comme au milieu des années 70, la bourgeoisie a réussi à dresser un barrage contre la montée de la combativité ouvrière.
Mais les barrages du capital sont faits de matériaux périssables et les flots qu' ils ont pour tâche de contenir puisent leur source dans les plus profondes nécessités historiques de l'humanité.
Les facteurs objectifs et subjectifs sur lesquels a reposé la dernière contre-offensive de la bourgeoisie s'usent d'autant plus vite que la décomposition du système économique s'accélère.
PERSPECTIVES : VERS LA FIN DU REPLI
De façon générale la bourgeoisie -comme toutes les classes exploiteuses dans l'histoire - a assuré son pouvoir:
1°) par la capacité du système économique qu'elle gère à assurer un minimum de moyens de subsistance à 1 a principale ; classe productrice et exploitée
2°) par sa domination idéologique ;
3°) par la répression.
Mais lorsque les rouages économiques se grippent et que 1'obsolescence des rapports de production est démontrée chaque jour par la réalité, ce sont les bases matérielles qui sous-tendent le pouvoir idéologique de la classe dominante qui s'effondrent. Dans ces conditions, 1a répression pour le maintien de 1'"ordre", pour le maintien de la "rentabi1ite", apparaît de plus en plus comme la défense barbare des privilèges d'une minorité.
Telle est la tendance depuis le début de la crise ouverte à la fin des années 60. Elle s'est accélérée avec le début des années 80.
Les conditions du repli de la lutte de classe ne peuvent que s'effriter car la tendance générale n'est pas vers une plus grande union entre bourgeoisie et prolétariat mais au contraire vers l'exacerbation de l'antagonisme entre les deux classes principales de la société.
En 15 ans, les contradictions, les tensions générales que provoque la crise du capitalisme en déclin n'ont cessé de s'exacerber: contradiction entre, d'une part la nécessité et la possibilité du développement des forces productives et, d'autre part, les lois et les institutions sociales dans lesquelles ces forces sont utilisées ; contradiction entre la réalité concrète de décomposition et l'impasse d' une société en ruines d'un côté, et l'idéologie dominante qui chante les louanges des fondements de ce type de société de l'autre; contradiction entre les intérêts de l'immense majorité de la population soumise à une misère croissante et ceux de la minorité qui gère et profite du capital ; contradiction entre la nécessité objective de la révolution communiste mondiale et le renforcement de la répression- capitaliste.
Si, avant 1968;la bourgeoisie pouvait faire croire que le capitalisme était devenu un système éternel, sans crises économiques, si en 1975-78 elle a encore pu accréditer l'idée que la crise était momentanée et qu' elle serait surmontée par des économies de pétrole et les restructurations industrielles nécessaires, si elle a pu développer à la fin des années 70 l'idée qu'en "travaillant plus et gagnant moins" les prolétaires permettraient le recul du chômage, aujourd'hui la réalité rend quotidiennement évident qu'il ne s'agit, dans tout cela, que de mystifications destinées à la sauvegarde du système.
Il en est de même pour des mystifications qui pendant des décennies (et en particulier pendant la crise des années 30) ont pesé sur le prolétariat mondial: la nature "ouvrière" des régimes des pays de l'Est, (la Pologne a joué un rôle décisif dans la destruction de ce mensonge), le caractère "progressiste" des luttes de libération nationale, l'efficacité des mécanismes électoraux et des partis "ouvriers" pour empêcher l'intensification de l'exploitation et de la misère de la vie, le mythe de l'Etat-providence et protecteur.
Cela se traduit dans la réalité par le caractère de plus en plus précaire de l'efficacité des grandes campagnes idéologiques de la bourgeoisie mondiale. Les prolétaires croient de moins en moins dans les valeurs idéologiques qui justifient le système capitaliste.
QU'EN EST-T-IL AU NIVEAU DE LA LUTTE OUVRIERE ELLE-MEME?
Que ce soit l'affaiblissement de la force du prolétariat en Pologne enfermé dans les impasses du nationalisme et des illusions sur la "démocratie occidentale", que ce soit l'isolement de la lutte des sidérurgistes belges au début de 1982 ou l'incapacité à s'unifier des mouvements des prolétaires en Italie au début 1983, la réalité de la lutte de classe montre clairement que la lutte ouvrière dans les années à venir connaîtra deux problèmes essentiels et interdépendants :
1°) la nécessité de généraliser la lutte,
2°) la nécessité de ne pas laisser la conduite du combat aux mains des forces de gauche du capital travaillant dans les rangs ouvriers.
LA GENERALISATION
En Août 80, les ouvriers polonais ont démontré, dans la pratique, deux vérités essentielles pour la lutte ouvrière:
- la classe ouvrière peut étendre sa lutte, par elle-même sans recours à aucun appareil syndical ;
- seule, la force que donne cette extension peut faire reculer la puissance de 1'Etat.
Un an d'isolement international du mouvement en Pologne à3 en outre, démontré que la lutte ouvrière ne peut développer sa pleine puissance qu'en se généralisant par-delà les frontières nationales.
En ce sens, la perspective tracée au début des années 80 par la lutte en Pologne c'est celle de la généralisation au niveau international. Cette perspective dépend fondamentalement de l'action du prolétariat d'Europe occidentale, du fait de son nombre, de sa puissance, de son expérience, et…. de sa vie divisée en une multitude de petites nations. Elle ne s'y concrétise pas du jour au lendemain. Une telle généralisation sera inévitablement précédée de toute une série de luttes à l'échelle locale, voire "nationale", expériences qui seules pourront en démontrer dans la pratique, le caractère vital, indispensable.
Les récentes luttes des ouvriers en Belgique et en Italie ont toutes deux vu se manifester nettement des tendances spontanées à l'extension. Le prolétariat européen se prépare effectivement à suivre le chemin ouvert en Pologne en août 1980. Mais il lui faut certainement encore développer sa propre expérience de lutte pour y parvenir. D'autant plus que sur ce chemin, il trouve et trouvera devant lui le barrage systématique des organisations syndicales et des forces politiques de la gauche de la bourgeoisie.
LA GAUCHE DANS LES RANGS OUVRIERS
Le mouvement en Pologne en 1981, en Belgique en 1982 illustre concrètement comment les forces radicales de la gauche bourgeoise peuvent parvenir à détourner et conduire dans des impasses les poussées ouvrières vers la généralisation.
Au moment de l'établissement de l'état de guerre en Pologne, les conséquences de l'isolement international du mouvement apparurent dans toute leur violence. La nécessité de faire appel aux ouvriers des autres pays apparaissait comme une question cruciale. "Solidarnosc" et ses tendances radicales surent détourner cette nécessité vers des appels...aux gouvernements de la bourgeoisie occidentale (voir les banderoles de décembre 1981 aux portes des chantiers de Szczecin).
En Belgique, lorsque dans les assemblées des sidérurgistes des différentes villes en grève se sont manifestées de plus en plus de critiques aux directions syndicales et des poussées vers une unification directe et l'extension de la lutte, les tendances radicales du syndicat ont su prendre la tête de ces mouvements et les canaliser dans des actions "unifiées" sous le contrôle des centrales syndicales soigneusement isolées de tous les autres secteurs de la classe ouvrière.
Le prolétariat, jusqu'à son émancipation définitive, trouvera devant lui, dans ses rangs, ces habiles forces de la classe dominante. Mais poussé par la nécessité de réagir à l’attaque du système en crise, il apprend et apprendra à les contrer et à les détruire de la même façon qu'il a tout appris : par l’expérience de la lutte.
Il faudra, certainement, encore beaucoup de combats, de défaites partielles, momentanées, pour que la classe ouvrière parvienne à prendre systématiquement ses affaires en main et aller vers la généralisation. C'est un processus qui se déroule à l’échelle mondiale et dans lequel, constamment, les luttes ouvrières, comme dit Marx, "reviennent sur ce qui semble accompli pour le recommencer à nouveau".
VERS LA REPRISE DES LUTTES
Les hésitations, les reculs momentanés sont inévitables dans le développement de la lutte d'une classe exploitée. Ce Qu'il faut comprendre c'est qu'au travers de ses hauts et ses bas, la tendance générale de la lutte ouvrière depuis 15 ans, renforcée avec l'entrée dans les années 80, va dans le sens d'un dégagement de l'idéologie dominante, vers des heurts de plus en plus violents avec les forces de gauche du capital et vers la généralisation des combats.
Le développement de la crise économique est devant nous. Ses effets, l'attaque qu'ils constituent contre la classe ouvrière mondiale, iront s'accentuant, contraignant les prolétaires à hisser leur combat à des niveaux de plus en plus élevés, globaux, généraux.
Le chômage, effet principal de la crise, qui frappe les ouvriers comme une des pires formes de répression (qu'il soit effectif le ou sous forme de menace) peut, momentanément constituer un facteur de frein à la lutte. En mettant les ouvriers en concurrence entre eux pour les postes de travail, il peut rendre plus difficile l'unification du prolétariat. Mais il ne peut l'empêcher. Au contraire la lutte contre les licenciements, contre les conditions de vie des chômeurs constituera une des bases luttes ouvrières à venir. Ce qui en un premier temps peut constituer un frein 'se' transformera en accélérateur contraignant les ouvriers, chômeurs et non chômeurs, à envisager leur lutte de façon toujours plus générale, à assumer toujours plus le contenu politique, social et révolutionnaire de leur combat.
La gravité même de la crise du système, son ampleur poussent les luttes ouvrières à, comme le disait Marx, " reculer constamment à nouveau devant 1 ' immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soi t créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles mêmes crient "Hic Rhodus, tic saita."
R. V.
"F.ENGELS DIT QUE LA VICTOIRE DEFINTIVE DU PROLETARIAT SOCIALISTE CONSTITUE UN BOND QUI FAIT PASSER L'HUMANITE DU REGNE DE L'ANIMALITE A CELUI DE LA LIBERTE. MAIS CE "BOND" N'EST PAS ETRANGER AUX LOIS D'AIRAIN DE L'HISTOIRE, IL EST LIE AUX MILLIERS DE MAILLONS DE L'EVOLUTION QUI LE PRECEDENT, EVOLUTION DOULOUREUSE ET ËIEN TROP LENTE. ET CE BOND NE SAURAIT ETRE ACCOMPLI SI, DE L'ENSEMBLE DES PREMISSES MATERIELLES ACCUMULEES PAR L'EVOLUTION, NE JAILLIT PAS L'ETINCELLE DE LA VOLONTE CONSCIENTE DE LA GRANDE MASSE POPULAIRE JAMAIS LA VICTOIRE DU SOCIALISME NE TOMBERA DU CIEL COMME LE FATUM ANTIQUE, CETTE VICTOIRE NE PEUT ETRE REMPORTEE QUE GRACE A UNE LONGUE SERIE D'AFFRONTEMENTS OPPOSANT LES FORCES ANCIENNES AUX NOUVELLES, AFFRONTEMENTS AU COURS DESQUELS LE PROLETARIAT INTERNATIONAL FAIT SON APPRENTISSAGE (...) ET TENTE DE PRENDRE EN MAIN SES PROPRES DESTINEES, DE S'EMPARER DU GOUVERNAIL DE LA VIE SOCIALE. (...)
LA CLASSE OUVRIERE NE DOIT JAMAIS AVOIR PEUR DE REGARDER LA VERITE EN FACE, MEME SI CETTE VERITE CONSTITUE POUR ELLE L'ACCUSATION LA PLUS DURE, CAR SA FAIBLESSE N'EST QU'UN ERRE- MENT ET LA LOI IMPERIEUSE DE L'HISTOIRE LUI REDONNE LA FORCE, LUI GARANTIT SON SUCCES FINAL."(Rosa Luxembourg, "La crise de la social-démocratie")
[1] [409] "Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter". Proverbe latin inspiré d'une fable d'Esope qui signifie : c'est le moment de montrer ce dont on est capable.
[2] [410] Il n'est pas toujours aisé dé déterminer de façon précise des périodes dans l'histoire. Il n'y a pas une simultanéité stricte de la crise sociale dans tous les pays. Suivant le développement économique, suivant la situation géographique, suivant les conditions politiques caractérisant telle ou telle zone de la planète, les tendances générales internationales de la lutte de classe s'y manifesteront plus ou moins rapidement avec plus ou moins d'ampleur et d'intensité. En ce sens, dire "Telle année marque la fin de la période de repli de la classe et commence une période de reprise" ne veut pas dire que l'année en question tous les ouvriers du monde ont brisé leur atomisation pour engager le combat. Ce dont il s'agit, c'est de déterminer des points de repère indispensables pour dessiner les tendances générales du mouvement mondial. Par ailleurs, la vie de la lutte de classe dans les pays les plus industrialisés qui concentrent les forces les plus nombreuses et les plus expérimentées du prolétariat et de la bourgeoisie a inévitablement une place prépondérante dans la détermination de telles périodes.
[3] [411] Le taux de chômage moyen des pays industrialisés du bloc occidental tourne autour de 3% à la fin des années 60; (il dépasse aujourd'hui les 10%). En 1974 il n'a augmenté que de 1 ou 2 points. En 1975, année la plus noire de la récession de 74-75 il est autour de 5% en moyenne.
[4] [412] Entre 1968 et 1975 l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, passe de 4,2 à 9,1 aux USA, de 5,3 à 11,8 au Japon, de 2,9 à 6% en Allemagne, de 4,1 à 11,3% dans l'ensemble de l'OCDE.
[5] [413] Il nous a souvent été reproche par certains de nos critiques d'avoir une vision machiavéliste de l'histoire lorsque nous parlons de telles campagnes. Nous avons longuement répondu à cette question dans les articles "Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie" dans le n°31 (4e trimestre 82) de cette revue. Pour ceux qui ont la mémoire courte rappelons que de telles campagnes n'ont rien de nouveau. Dès la fin de la Seconde guerre mondiale, dans la période de la "guerre froide", les deux nouvelles puissances militaires qui se partageaient le monde devaient se livrer à de gigantesques campagnes idéologiques internationales au sein de leur bloc pour incruster dans le cerveau des populations les nouvelles alliances impérialistes: les ennemis d'hier étaient devenus alliés, et les alliés ennemis. 40 ans après il serait candide de croire que la bourgeoisie serait devenue, aujourd'hui, moins manipulatrice.
Géographique:
- Pologne [111]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise?
- 2429 reads
LE CHOMAGE DANS LES ANNEES 30
Après une progression du chômage foudroyante qui s'est traduite, notamment aux Etats-Unis, par une situation sociale explosive, la mise en oeuvre des politiques de relance par l'Etat a permis de faire régresser le nombre des sans-emploi jusqu'à l'ouverture de la guerre. De plus la mise en place de systèmes d'allocation pour les chômeurs et d'aides sociales diverses constitue pour un prolétariat encore marqué par l'écrasement sanglant de la révolution, le piège qui va permettre à la bourgeoisie de désamorcer la bombe politique que constitue un fort taux de chômage au coeur du capitalisme industriel.
Source: A.Madisson, « Economic Grouth ».
LE POIDS DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE DES ANNEES 30
L'Etat prend une part de plus en plus importante dans l'économie nationale que ce soit par l'économie de guerre comme en Allemagne, le New Deal aux Etats-Unis, ou les nationalisations du Front Populaire en France. L'Etat s'endette, cela permet de retarder les effets de la crise qui rejaillit. Ce répit permet une politique d'embrigadement du prolétariat dans la guerre derrière les illusions de l'Etat social: national-socialiste, stalinien et derrière le Welfare-State démocratique.
LE CHOMAGE AUJOURD'HUI
La progression du chômage suit une courbe différente aujourd'hui de celle de la grande crise des années 30. La progression est lente mais croît régulièrement durant toutes les années 70. Le début des années 80 montre une flambée de la progression. Plus de 11 millions de chômeurs aux USA, plus de 3 millions en GB, plus de 2,5 millions en RFA. Pour l'ensemble des 24 pays de l'OCDE c'est un total de 32 millions de chômeurs (comme si plus personne ne travaillait en RFA, en Belgique et aux Pays-Bas). De ce point de vue la situation est inverse de celle des années 30. La crise se développe sur l'usure (qui se traduit par une inefficacité croissante) des mesures qui avaient permis à la bourgeoisie de faire face à la crise de 29. Le chômage se développe inexorablement et de plus en plus vite, tandis que les aides sociales, elles, diminuent. La situation sociale va devenir de plus en plus explosive. L'emploi ne va pas se développer alors que les investissements chutent.
LA CHUTE DES INVESTISSEMENTS
L'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé les marchandises produites, le sous-emploi du potentiel productif qui en résulte, poussent la bourgeoisie à réduire ses investissements industriels et à destiner une part croissante de ses capitaux à la spéculation (monnaies, or, matières premières). Elle est conduite à concentrer l'essentiel de ses investissements dans la recherche de la compétitivité par une mécanisation, une automation intensives. Ce qui, de fait, supprime beaucoup plus d'emplois qu'il n'en est créé . Même une hypothétique relance -dont on parle tant- ne ferait qu'accélérer cette tendance. Le chômage, dans ces conditions, ne peut que s'accroître.
Source : OCDE, "Perspectives Economiques", déc.82
L’ENDETTEMENT MONDIAL
La politique de relance se fonde sur l'endettement de l'Etat. Au début des années 30, cette politique était nouvelle : l'Etat n'était pas encore surendetté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les USA, qui ont été le moteur des relances successives dans les années 70 se sont surendettés à l'extrême : la dette publique et privée avoisine un total de 5000 milliards de $. Pour rembourser cette dette, il faudrait que les travailleurs américains travaillent de 1,5 à 2 ans sans être payés.
La politique d'austérité qui visait à résorber cet endettement se heurte non seulement à la difficulté d'attaquer le niveau de vie de la classe ouvrière toujours combative, mais aussi à l'instabilité du système monétaire international. Le colossal déficit budgétaire américain (plus de 100 milliards de $ en 1982 et on parle pour l'année qui vient d'un déficit de 200 milliards de $), la nécessité de venir au secours du tiers-monde afin d'éviter un écroulement financier, impose de faire marcher la pompe à finances du FMI (qui a augmenté récemment ses avoirs de 74%). La bourgeoisie doit faire marcher la planche à billets : la potion Reagan-Tchatcher est impuissante à faire face à l'endettement et au danger d'une relance de l'inflation qui menace. La relance ne peut être qu'une relance de l'inflation.
Source : OCDE, id.
UNE INFLATION TOUJOURS PRESENTE
Pour justifier la politique de récession menée ces dernières années, la bourgeoisie se targue d'avoir jugulé l'inflation. En fait, l'inflation sévit toujours et surtout, les pressions inflationnistes augmentent malgré la récession.
La politique de relance relance l'inflation, sans empêcher la tendance à la récession de s'imposer ; la politique de récession plonge l'économie dans le marasme sans enrayer les tendances inflationnistes.
La baisse de l'inflation de ces dernières années est momentanée ; les années qui viennent vont voir se développer une inflation croissante parallèlement à un chômage croissant.
La classe ouvrière n'a pas d'illusions à se faire : toutes les politiques économiques de la bourgeoisie sont impuissantes à faire face à la crise.
Source : OCDE, id.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Cent ans après la mort de Marx : l'avenir appartient au marxisme
- 3099 reads
Karl Marx est mort le 14 mars 1883. Il y a donc un siècle que s'est tu celui que le mouvement ouvrier considère comme son théoricien le plus important.
Cet anniversaires la bourgeoisie -cette classe que Marx a combattue sans relâche toute sa vie et qui le lui a bien rendu- s'apprête à le célébrer à sa façon en déversant de nouveaux tombereaux de mensonges sur Marx et son oeuvre.
Suivant sa coloration, les intérêts plus particuliers qu'il a charge de défendre ou sa place spécifique dans l'appareil de mystification, chaque secteur bourgeois y va de sa petite spécialité.
Ceux pour qui Marx était "un être malfaisant", une sorte "d'incarnation du mal, une créature du démon", ont pratiquement disparu. De toute façon ils sont les moins dangereux aujourd'hui.
Par contre, il en reste bon nombre pour qui Marx, "au demeurant un homme très intelligent et cultivé, s'est complètement trompé" ; une variante de ce mensonge consistant à affirmer que : "Si l'analyse de Marx était valable au I9ème siècle, elle est aujourd'hui complètement dépassée".
Cependant, les plus dangereux ne sont pas ceux qui rejettent explicitement les apports de Marx. Ce sont ceux qui s'en réclament, qu'ils appartiennent à la branche social-démocrate, à la branche stalinienne, à la branche trotskyste ou à ce qu'on pourrait appeler la branche "universitaire" les "marxologues".
A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marx, on verra tout ce beau monde s'agiter fébrilement, faire du bruit, parler avec autorité, envahir les colonnes des journaux et les écrans de télévision. Il revient donc aux révolutionnaires, et c'est là le véritable hommage qu'ils puissent rendre à Marx et à son oeuvre, de réfuter ces mensonges abondamment diffusés, de balayer les dithyrambes intéressés pour rétablir la simple vérité des faits.
MARX DEPASSE ?
Marx découvrit le profond secret du mode de production capitaliste : le secret de la plus-value appropriée par les capitalistes grâce au travail non payé des prolétaires. Il montra qu'au lieu de s'enrichir par son travail, le prolétaire s'y appauvrissait, que les crises devenaient de plus en plus violentes parce que le besoin de débouchés s'accroissait tandis que le marché mondial se rétrécissait davantage. Il s'attacha à montrer que le capitalisme, en vertu de ses propres lois, court à sa perte et crée avec une nécessité d'airain les conditions de l'instauration du communisme. Etant venu au monde couvert de sang et de boue, s'étant nourri en cannibale de la force de travail des prolétaires, le capitalisme quitterait la scène dans un cataclysme.
C'est pour cette raison que, depuis un siècle, la bourgeoisie s'est employée à combattre les idées de Marx. Des légions d'idéologues ont fait tentative sur tentative pour anéantir sa pensée. Des professeurs, des savants, des prédicateurs ont fait de la "réfutation" de Marx leur métier. Par ses écoles, ses universités, la bourgeoisie a dirigé un feu nourri contre Marx. A l'intérieur même du mouvement ouvrier, le révisionnisme se dressa contre les principes fondamentaux du marxisme au nom d'une "adaptation" de celui-ci aux nouvelles réalités de l'époque (fin du 19ème siècle). Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Bernstein, le théoricien du révisionnisme, s'était proposé d'attaquer le marxisme sur deux points fondamentaux :
- le capitalisme aurait découvert le moyen de surmonter ses crises économiques catastrophiques;
- l'exploitation de la classe ouvrière pourrait s'atténuer progressivement jusqu'à disparaître.
Ce sont ces deux idées essentielles que la bourgeoisie a agité frénétiquement chaque fois que la situation économique du capitalisme a semblé s'améliorer permettant la distribution de quelques miettes à la classe ouvrière. Ce fut notamment le cas dans la période de reconstruction qui a suivi la seconde guerre mondiale où l'on a pu voir les économistes et les politiciens prédire la fin des crises. Ainsi, le prix Nobel d'économie Samuelson s'exclamait dans son livre "Economies" (p.266) : "tout se passe aujourd'hui comme si la probabilité d'une grande crise- d'une dépression profonde, aiguë et durable comme il a pu s'en produire en 1930, 1870 et 1890 se trouvait réduite à zéro".
De son côté, le président Nixon n'avait pas peur de déclarer, le jour de son "inauguration" (janvier 1969) : " Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue".
Ainsi, jusqu'au début des années 70, c'est avec beaucoup d'autorité que se sont exprimés ceux pour qui "Marx est dépassé" ([1] [414]).
Depuis, les clameurs se sont tues. Inexorablement la crise se déploie. Toutes les potions magiques préparées par les prix Nobel des différentes écoles ont échoué et ont même aggravé le mal. Pour le capitalisme l'heure est aux records : record d'endettement, du nombre de faillites, de la sous-utilisation des capacités productives, du chômage. Le spectre de la grande crise de 29 revient hanter la bourgeoisie et ses professeurs appointés. Leur optimisme béat a fait place à un noir pessimisme et au désarroi. Il y a déjà quelques années, le prix Nobel Samuel son constatait avec détresse "la crise de la science économique" qui se révélait incapable d'apporter des solutions à la crise. Il y a un an et demi, le prix Nobel Friedmann avouait "qu'il n'y comprenait plus rien". Plus récemment, le prix Nobel Von Hayek constatait que le "krach est inévitable" et qu'il n'y a rien à faire".
Dans la postface de la 2ème édition allemande du Capital, Marx constatait que la "crise générale, par l'universalité de son champ d'action et l'intensité de ses effets, allait faire entrer la dialectique dans la tête même aux tripoteurs qui avaient poussé comme champignons" à l'occasion d'une phase de prospérité du capitalisme. Ces spécialistes du tripotage que sont les économistes en font une nouvelle fois l'expérience : la crise qui se déchaîne aujourd'hui commence à les rendre intelligents. Ils commencent à comprendre, à leur grand effroi, que leur "science " est impuissante, qu'il n'y a "rien à faire" pour sortir leur cher capitalisme du gouffre.
Non seulement Marx n'est pas "dépassé" aujourd'hui, mais il est nécessaire d'affirmer bien net que jamais ses analyses n'ont été autant à l'ordre du jour.
Toute l'histoire du 20ème siècle est une illustration de la validité du marxisme. Les deux guerres mondiales, la crise des années 30 étaient la preuve du caractère insurmontable des contradictions qui assaillent le mode de production capitaliste. Le surgissement révolutionnaire des années 1917-23, malgré sa défaite, confirmait que le prolétariat est bien la seule classe révolutionnaire d'aujourd'hui, la seule force de la société capable de renverser le capitalisme, d'être le "fossoyeur" (suivant l'expression du Manifeste Communiste) de ce système moribond.
La crise aiguë du capitalisme qui se développe aujourd'hui balaye les illusions semées par la reconstruction du 2ème après-guerre. Illusions sur un capitalisme définitivement prospère, illusions sur la "coexistence pacifique" entre grands blocs impérialistes, illusions sur "l'embourgeoisement" du prolétariat et la "fin de la lutte de classes" comme Ta montré, dès mai 68, le ressurgissement historique de la classe ouvrière qui n'a fait que se confirmer depuis, notamment par les combats en Pologne en 1980. Une nouvelle fois se découvre dans toute sa clarté l'alternative indiquée par Marx et Engels : "Socialisme ou chute dans la barbarie".
Ainsi, le premier hommage qui soit rendu à la pensée de Marx au moment du centième anniversaire de sa mort nous vient des faits eux-mêmes : de la crise, de l'aggravation inéluctable des convulsions du capitalisme, du resurgissement historique de la lutte de classe. Quel meilleur hommage à celui qui écrivait en 1844 :
"La question de savoir si la pensée humaine peut prétendre à la vérité objective n'est pas une question de théorie mais une question pratique. C'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance, la matérialité de sa pensée".
(Thèses sur Feuerbach)
L'UTILISATION DE MARX CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
Les grands révolutionnaires ont toujours été persécutés durant leur vie: leur doctrine a toujours été en butte à la haine ''la plus féroce, aux campagnes de mensonge et de diffamation les plus ineptes de la part des classes oppresseuses. Après leur mort on tente de les convertir en icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une auréole de gloire pour la consolation des classes opprimées et pour leur duperie, en même temps qu'on émascule la substance de-leur ''enseignement révolutionnaire, qu'on en émousse le tranchant, qu'on l'avilit".
Lénine "L'Etat et la Révolution"
Ces mots de Lénine écrits en 1917 contre la Social-Démocratie et notamment son "Pape", Karl Kautsky, se sont illustrés par la suite à une échelle que leur auteur était loin de soupçonner. Lui-même fut transformé après sa mort "en icône inoffensive" et cela au sens propre puisque sa momie est encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage.
La Social-Démocratie dégénérescente, celle qui en 1914 allait passer ouvertement aux côtés de la bourgeoisie, avait déjà beaucoup fait pour "émasculer" la pensée de Marx, pour la vider de tout contenu révolutionnaire. Si la première offensive contre le marxisme, celle de Bernstein à la fin du 19ème siècle, se proposait de "réviser" cette théorie, celle de Kautsky autour de 1910 se fit au nom de "l'orthodoxie marxiste". Par un choix judicieux de citations de Marx et Engels, on leur faisait dire l'exact contraire de leur pensée véritable. Il en fut ainsi notamment de la question de l'Etat bourgeois. Alors que depuis la Commune de Paris la nécessité de détruire celui-ci avait été affirmée clairement par Marx, Kautsky fit silence sur cette affirmation pour partir à la recherche de formulations qui pourraient accréditer l'idée opposée. Et comme les révolutionnaires, y compris les plus grands, ne sont pas à l'abri des ambiguïtés ou même des erreurs, Kautsky parvint à ses fins au grand bénéfice des pratiques réformistes de la Social-Démocratie, c'est-à-dire au grand détriment du prolétariat et de sa lutte.
Mais l'ignominie Social-Démocrate ne s'est pas arrêtée à une falsification du marxisme. Cette falsification, après avoir préparé la démobilisation totale du prolétariat face à la menace de guerre annonçait une trahison complète, un passage avec armes et bagages dans le camp bourgeois. C'est au nom du "marxisme" qu'elle sauta les pieds joints dans le sang et la boue de la première guerre impérialiste, qu'elle aida la bourgeoisie mondiale à colmater la brèche ouverte dans l'édifice croulant du capitalisme par la révolution de 1917, qu'elle a froidement fait assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ainsi que des milliers de spartakistes en 1919. En usurpant le nom de Marx, la Social-Démocratie a obtenu des fauteuils ministériels dans les gouvernements bourgeois, des postes de préfet de police, de gouverneur aux colonies. Au nom de Marx elle s'est faite le bourreau du prolétariat européen et des populations coloniales.
Cependant, aussi loin qu'ait pu aller la Social-Démocratie dans l'abjection elle fut dépassée sur tous les plans par le stalinisme.
Les falsifications sociales-démocrates du marxisme n'étaient encore rien à côté de celles que les staliniens devaient lui faire subir. Jamais idéologues de la bourgeoisie n'avaient fait preuve d'un tel cynisme pour déformer la moindre phrase et lui faire dire l'exact contraire de son sens véritable.
Alors que l'internationalisme, le rejet de tout chauvinisme, avait été la pierre angulaire tant de la révolution d'octobre 17 que de la fondation de l'Internationale Communiste, il revint à Staline et à ses complices d'inventer la théorie monstrueuse de la "construction du socialisme dans un seul pays". C'est au nom d'Engels et de Marx qui écrivait dès 1847 :
"La révolution communiste... ne sera pas une révolution purement nationales elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés….Elle est une révolution universelle"
(Principes du communisme) "Les prolétaires n'ont pas de patrie (Manifeste Communiste) ; c'est en leur nom que le parti, bolchevik dégénéré et les autres partis dits "communistes" appelèrent à la "construction du socialisme en URSS", à la défense de la "patrie socialiste" et plus tard à la défense de l'intérêt national, de la patrie, du drapeau dans leur pays respectif, A côté de l'hystérie chauvine des partis staliniens avant, pendant et au lendemain de la 2ème boucherie impérialiste, à côté des "A chacun son boche" et "Vive la France éternelle" (l'Humanité en 1944), le "jusqu'au-boutisme" des socialistes de 1914 en vint à faire pâle figure.([2] [415])
Ennemi de l'Etat (et de façon bien plus conséquente que l'anarchisme), ennemi de la religion, le marxisme est devenu entre les mains des staliniens une religion d'Etat, une religion de l'Etat. Alors qu'il jugeait incompatibles l'existence de l'Etat et celle de la liberté, qu'il considérait comme indissolublement liés l'Etat et l'esclavage, Marx est utilisé comme knout idéologique des pouvoirs en place en URSS et ses satellites, il est devenu le pilier porteur de l'appareil de répression policier. Alors qu'il entra dans la vie politique en luttant centre la religion considérée par lui comme "l'opium du peuple", Marx est récité tel un catéchisme par des centaines de millions d'éco1iers.
Alors que Marx voyait dans la dictature du prolétariat la condition de l'émancipation des exploités et de toute la société, c'est au nom de cette "dictature du prolétariat" que la bourgeoisie règne par la terreur la plus brutale sur des centaines de millions de prolétaires.
Après la vague révolutionnaire du 1er après-guerre, la classe ouvrière a subi la plus terrible contre-révolution de son histoire. Le principal fer de lance de cette contre-révolution, ce fut la "patrie socialiste" et les partis qui s'en réclamaient. Et c'est au nom de Marx et de la révolution communiste pour laquelle il avait lutté toute sa vie qu'a été menée cette contre-révolution avec ses dizaines de millions de cadavres des camps staliniens et du second holocauste impérialiste. Toutes les ignominies dans lesquelles s'était vautrée la Social-Démocratie, le stalinisme les a renouvelées, au décuple. ([3] [416])
MARX SAVANT OU MILITANT ?
La bourgeoisie n'en a pas eu assez de transformer Marx et le marxisme en symboles de la contre-révolution. Pour parachever son oeuvre, il lui fallait en faire également des disciplines universitaires, des sujets de thèse en philosophie, en sociologie, en économie. A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marx, à côté des socialistes et des staliniens, on verra donc s'agiter les "marxologues" (qui sont aussi souvent socialistes ou staliniens d'ailleurs). Quelle sinistre ironie : Marx qui avait refusé de faire carrière à l'université pour pouvoir se consacrer à la lutte révolutionnaire est mis au rang des philosophes, économistes et autres idéologues de la bourgeoisie.
C'est juste que dans beaucoup de domaines de la pensée, il y a un "avant" et un "après" Marx. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'économie : après l'énorme contribution de Marx à l'intelligence des lois économiques de la société, cette discipline fut complètement transformée. Mais on ne peut y voir un phénomène identique à celui de la découverte d'une grande théorie en physique par exemple. Dans ce dernier cas, la découverte est le point de départ de tout un progrès dans la connaissance (ainsi "l’après" Einstein constitue un approfondissement considérable dans la lecture des lois de l'univers). Par contre, les découvertes de Marx en économie n'inaugurent pas, pour les pontifes économistes de la bourgeoisie, des progrès dans cette discipline mais au contraire une énorme régression. A cela, il existe une raison très simple. Les économistes qui ont précédé Marx étaient les représentants intellectuels d'une classe qui portait avec elle le progrès historique, d'une classe révolutionnaire dans la société féodale : la bourgeoisie. Les Smith et les Ricardo, malgré leurs insuffisances, étaient capables de faire avancer la connaissance de la société parce qu'ils étaient les défenseurs d'un mode de production -le capitalisme- qui, à leur époque, constituait une étape progressive dans l'évolution de cette société. Face à l'obscurantisme propre à la société féodale, ils avaient besoin de déployer le maximum de rigueur scientifique que leur permettait leur époque.
Marx salue et utilise les travaux des économistes classiques. Cependant son objectif est complètement différent du leur. S'il étudie l'économie capitaliste ce n'est nullement pour tenter d'améliorer son fonctionnement mais pour la combattre et préparer son renversement. C'est pour cela qu'il n'écrit pas une "Economie politique" mais une "Critique de l'Economie Politique". Et c'est justement parce qu'il se situe de ce point de vue dans l'étude de la société bourgeoise, du point de vue de son renversement révolutionnaire, qu'il est capable d'en comprendre aussi bien les lois. Seule une classe qui n'a aucun intérêt à la préservation du capitalisme, le prolétariat, pouvait mettre à nu ses contradictions mortelles. Si Marx a fait faire un tel progrès à la connaissance de l'économie capitaliste, c'est avant tout parce qu'il était un combattant de la révolution prolétarienne.
Après Marx, tout nouveau progrès dans la connaissance de l'économie capitaliste ne pouvait se faire qu'à partir de ses découvertes et donc en partant du même point de vue de classe. Par contre, l'économie politique bourgeoise qui, par essence, se refusait un tel peint de vue, ne pouvait plus être que de l'apologétique, une discipline destinée à justifier par n'importe quel argument la conservation du capitalisme et incapable de ce fait de comprendre ses lois véritables. C'est pour cette raison que les économistes, même les plus huppés, font figure aujourd'hui de crétins.
Le marxisme est la théorie du prolétariat, il ne peut être une discipline universitaire. Seul un militant révolutionnaire peut être marxiste. Cette unité entre la pensée et l'action est justement un des fondements du marxisme. Elle s'exprime avec clarté dès 1844 dans les thèses sur Feuerbach et notamment dans la dernière :
"Jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières; il s'agit maintenant de le transformer". Certains ont voulu faire de Marx un pur savant enfermé avec ses livres et coupé du monde. Rien n'est plus étranger â la vérité. Lorsqu'un jour ses filles lui font subir un questionnaire (publié par Riazanov sous le nom de "Confession") et lui demandent quelle est son idée du bonheur, il répond : "la lutte". Et c'est bien la lutte qui est au centre de sa vie comme elle est au centre de la vie de tout militant révolutionnaire.
Dès 1842, alors qu'il n'a pas encore adhéré au communisme, il commence le combat politique contre l'absolutisme prussien à la rédaction puis à la tête de la "Gazette Rhénane". Par la suite, c'est un lutteur infatigable que les différentes autorités européennes expulsent d'un pays à l'autre des années durant jusqu'au moment (août 49) où il viendra se fixer définitivement à Londres. Entre temps, Marx a pris part directement aux combats de la vague révolutionnaire qui a secoué toute l'Europe en 1848-49. A ces combats il a participé avec sa plume à la tête de la "Nouvelle Gazette Rhénane", quotidien publié à Cologne entre juin 48 et mai 49 et dans lequel il avait investi toutes ses économies personnelles. Mais sa contribution la plus importante à la lutte du prolétariat, c'est au sein de la Ligue des Communistes qu’il l’a donnée. Car c'est une constante dans la démarche de Marx : contrairement à certains pseudo-marxistes d'aujourd'hui, il considère l'organisation des révolutionnaires comme un instrument essentiel de la lutte du prolétariat. Ainsi, le texte le plus célèbre et le plus important du mouvement ouvrier, le "Manifeste Communiste" rédigé par Marx et Engels en 1847, s'intitulait en fait "Manifeste du Parti Communiste" et constituait le programme de la Ligue des Communistes à laquelle avaient adhéré les deux amis quelques mois auparavant après "que fut éliminé des Statuts tout ce qui favorisait la superstition autoritaire" (Marx),
De même qu'il avait joué un rôle majeur dans le développement de la Ligue des Communistes, Marx prit une part prépondérante dans la fondation et la vie de l’A.I.T, c'est-à-dire la première grande organisation mondiale du prolétariat. C'est à lui que nous devons l'Adresse inaugurale et les statuts de TAIT ainsi que la plupart des textes fondamentaux de celle-ci, notamment l'Adresse sur la guerre civile en France écrite pendant la Commune de Paris. Mais sa contribution à la vie de l’AIT ne s'est pas limitée à cela. En fait, entre 1864 et 1872, il exerça une activité quotidienne et infatigable au sein du Conseil Général de l'Internationale dont il était le véritable animateur sans pour cela d'ailleurs en tirer une gloire quelconque. Sa participation à la vie de l’AIT lui prit des quantités énormes de temps et d'énergie qu'il ne put consacrer à l'achèvement de son travail théorique, Le Capital, dont le Livre I fut publié en 1867 et dont les autres livres ne furent publiés qu'après sa mort par Engels. Mais c'était un choix délibéré de sa part. Il considérait son activité militante au sein de l’AIT comme fondamentale parce que c'était T organisation vivante de la classe ouvrière mondiale, de cette classe qui en s'émancipant elle-même devait émanciper l'humanité. Comme Ta écrit Engels : "La vie de Marx sans l'Internationale aurait été comme une chevalière à laquelle il manquerait le diamant".
Par la profondeur de sa pensée et la rigueur de son raisonnement, par l'étendue de sa culture et sa quête infatigable de nouvelles connaissances, Marx ressemble incontestablement à ceux qu'on nomme les "savants". Mais ses découvertes ne furent jamais pour lui l'occasion de bénéficier ni d'honneurs et titres officiels, ni d'avantages matériels. Son engagement au côté de la classe ouvrière, et qui motivait l'énergie avec laquelle il mena son travail théorique, lui valut au contraire la haine et les attaques permanentes de la "bonne société" de son temps. Il lui valut également de se débattre la plus grande partie de sa vie contre une extrême misère matérielle. Comme l'écrivait son biographe Franz Mehring :
"Non seulement dans la pauvreté de son train de vie mais dans l'insécurité totale de toute son existence, Marx a partagé le sort du prolétariat moderne". Mais, à aucun moment, l'adversité de même que les plus cruelles défaites enregistrées par le prolétariat ne put le détourner de son combat.
Bien au contraire. Comme il l'écrivait-lui même à Johann Phi 1ipp Becker :
"...toutes les natures vraiment bien trempées une fois qu'elles se sont engagées sur la voie révolutionnaire, puisent continuellement de nouvelles forces dans la défaite, et deviennent de plus en plus résolues à mesure que le fleuve de l'histoire les emporte plus loin".
ETRE MARXISTE AUJOURD'HUI
Dans l'histoire de la pensée humaine, il n'y a pas de maître qui n'ait été involontairement trahi par l'un ou l'autre de ses disciples. Marx n'a pas échappé au sort commun qui,, de son vivant même, vit sa méthode d'analyse du réel se transformer en facile passe-partout. Par avance, il avait décliné toute responsabilité pour l'usage édulcoré qu'en faisaient certains sociaux-démocrates. A la place d'une scolastique morte, il entendait que ceux-ci étudient une société en constante évolution à l’aide d'une méthode et non qu'ils utilisent à tort et à travers chacune de ses paroles comme une loi invariante.
Chercher chez Marx des solutions toutes faites à transplanter artificiellement d'une époque révolue à une époque nouvelle, c'est figer une pensée toujours en éveil et aiguillonnée par le souci de rester une arme critique en une rêche cristallisation. Ainsi, plutôt que d'accepter sans examen tout ce qui vient de Marx, le marxiste d'aujourd'hui doit déterminer exactement ce qui continue à servir la lutte de classe et ce qui a cessé d'avoir cette fonction. Une série de lettres t d'Engels à Sorge (1886-1894) invite à se préserver de la bigoterie car, d'après les propres termes du co-auteur du "Manifeste Communiste" et de "L'Idéologie Allemande", Marx ne prétendit jamais construire une théorie rigide, une orthodoxie. Dans le rejet d'un doctrinarisme dit "invariant", il y a, de notre part, le rejet d'un contresens absolu : une théorie vraie de toute éternité, Verbe qui engendre l'action et qui n'attend plus que des catéchumènes pour devenir Action.
Cette "invariance" ne se trouve nulle part dans l'oeuvre de Marx car elle est incapable de distinguer le transitoire du permanent*. Ne correspondant plus aux situations nouvelles et multiformes elle est disqualifiée comme méthode d'interprétation des faits. Sa vérité est trompeuse, malgré les rodomontades qui l'accompagnent.
"De telles idées n'ont d'intérêt que pour "une classe rassasiée qui se sent à son aise "et se voit confirmée dans la situation pré-"sente. Elles ne valent rien pour une classe "qui lutte et s'efforce de progresser et que "la situation atteinte laisse nécessairement "insatisfaite". Korsch "Au coeur de la conception matérialiste".
Etre marxiste aujourd'hui ce n'est donc pas se réclamer à la lettre de chacun des écrits de Marx. Cela poserait d'ailleurs de sérieux problèmes dans la mesure où Ton trouve dans l'oeuvre de
Marx nombre de passages qui se contredisent. Ce n'est nullement d'ailleurs la preuve d'un manque de cohérence dans sa pensée : même ses adversaires ont reconnu au contraire l'extraordinaire cohérence de sa démarche et de son oeuvre. C'est en réalité la marque du fait que sa pensée était vivante, qu'elle était constamment en éveil et à l'écouta du réel et de l'expérience historique. A l'image des "révolutions prolétariennes (qui).. "se critiquent elles-mêmes constamment, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent "impitoyablement les hésitations et les faiblesses. .. de leurs premières tentatives". (K. Marx le 18 Brumaire), Marx n'a jamais hésité à remettre en question ses analyses antérieures. Ainsi, dans la préface à l'édition allemande du Manifeste Communiste de 1872, il reconnaît qu' "il ne faut pas attribuer trop d'importance "aux mesures révolutionnaires énumérées à la "fin du chapitre II. Ce passage serait, à "bien des égards, rédigé tout autrement aujourd'hui.. .La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se "contenter de prendre possession telle quelle "de la machine d'Etat et de la faire fonctionner pour ses propres fins. " Cette démarche est celle des véritables marxistes...C'est celle de Lénine qui en 1917 combat les mencheviks qui s'appuyaient sur la lettre de Marx pour soutenir la bourgeoisie et s'opposer à la révolution prolétarienne en Russie. C'est celle de Rosa Luxemburg qui, en 1906, se heurte aux bonzes syndicaux qui condamnaient la grève de masse en se basant sur un texte de Engels de 1873 écrit contre les anarchistes et leur mythe de "la grève générale". Sa défense de la grève de masse comme arme essentielle de la lutte prolétarienne dans la nouvelle période c'est justement au nom du marxisme qu'elle la conduit :
"Si donc la Révolution russe rend indispensable une révision fondamentale de l'ancien point de vue marxiste à l'égard de la grève de masse, ce n'en sont pas moins les méthodes et les points de vue généraux du marxisme qui, sous une nouvelle forme, en sortent vainqueurs. .." ( Grève de masse, Parti,Syndicats). Etre marxiste aujourd'hui c'est utiliser "les méthodes et les points de vue généraux du marxisme" dans la définition des tâches fixées au prolétariat par la nouvelle période ouverte dans la v vie du capitalisme avec la première guerre mondiale : la période de décadence de ce mode de production.
C'est en particulier dénoncer tout syndicalisme avec la même démarche qui conduisait Marx et l'A.I.T. à encourager la syndicalisation des ouvriers. C'est combattre toute participation au Parlement et aux élections avec le même point de vue qui animait le combat de Marx et Engels contre les anarchistes et leur abstentionnisme. C'est refuser tout soutien aux prétendues luttes de "libération nationale" d'aujourd'hui en employant la même méthode que la Ligue des Communistes et l'A.I.T. faisaient leur pour comprendre la nécessité d'appuyer certaines luttes nationales de leur temps.
C'est rejeter la conception du Parti de masses pour la révolution future pour les mêmes raisons fondamentales qui faisaient de la première et la deuxième Internationales des organisations de masse.
Etre marxiste aujourd'hui, c'est tirer les enseignements de toute l'expérience du mouvement ouvrier, des apports successifs de la Ligue des Communistes, de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème Internationales et des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière lors de sa dégénérescence, afin d'en féconder les combats prolétariens que la crise du capitalisme a fait surgir à partir de 1968, et les armer pour le renversement du capitalisme.
RC/FM
"LE MARXISME N'EST PAS UNE CHAPELLE OU L'ON SE DELIVRE DES BREVETS D1 "EXPERTISE" ET DEVANT LAQUELLE LA MASSE DES CROYANTS DOIT MANIFESTER SA CONFIANCE AVEUGLE. LE MARXISME EST UNE CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE DU MONDE, APPELEE A LUTTER SANS CESSE POUR ACQUERIR DES RESULTATS NOUVEAUX, UNE CONCEPTION QUI N'ABHORRE RIEN TANT QUE LES FORMULES FIGEES ET DEFINITIVES ET QUI N'EPROUVE SA FORCE VIVANTE QUE DANS LE CLIQUETIS D'ARMES DE L'AUTOCRITIQUE ET SOUS LES COUPS DE TONNERRE DE L'HISTOIRE."
(Rosa Luxembourg. "L'accumulation du capital")
[1] [417]
Il
est important de signaler que les défenseurs avoués du système capitaliste ne
furent pas les seuls avocats de cette idée. Au cours des années 1950. et 60, on
a vu se développer, parmi des groupes et éléments se réclamant pourtant de la
révolution communiste, une tendance à la remise en cause des acquis essentiels
du marxisme. C’est ainsi que le groupe « Socialisme ou Barbarie » a
échafaudé, sous la conduite de son grand théoricien (allias Chailieu-Cardan),
une thèse sur la « dynamique du capitalisme »affirmant que Marx avait
fait simplement fausse route en tentant de démontrer le caractère insoluble des
contradictions économiques de ce système. Depuis, les choses sont revenues à
leur place : le professeur Castoriadis s'est distingué comme caution
"de gauche" de l’effort de guerre du Pentagone en publiant un livre
qui "démontre" que les USA ont un énorme retard sur l'URSS en matière
d'armements (!). D une façon toute naturelle, le rejet par Castoriadis du
marxisme lui a ouvert toutes grandes les porter de la bourgeoisie.
[2] [418] Il est clair que cela n'excuse en rien les crimes Sociaux-démocrates ou n'atténue leur gravité. Le prolétariat n'a pas à faire un choix entre la peste social-démocrate et le choléra stalinien. L'une et l'autre poursuivent le même but : la conservation du régime capitaliste avec des méthodes parfois différentes dues aux conditions particulières des pays où ils agissent. Ce qui fait du stalinisme un dépassement de la social-démocratie dans l'ignominie c'est la place extrême qu'il occupe dans le capitalisme décadent, dans son évolution vers sa forme historique de capitalisme d'Etat et le développement du totalitarisme étatique. Ce processus inexorable du capital nécessite dans les pays arriérés, où la bourgeoisie privée est moins développée et déjà sénile, une force politique particulièrement brutale capable d'instaurer de la façon la plus sanglante le régime du capitalisme d'Etat. Selon les pays, cette force politique se présente sous la forme du stalinisme qui, en plus d'exercer une oppression sanglante, prétend instaurer le capitalisme d'Etat au nom du "Socialisme", du "Communisme" ou du "marxisme" battant ainsi tous les records d'ignominie et de cynisme.
[3] [419] Avec leurs modestes moyens, les trotskystes ont emboîté le pas à leurs grands frères sociaux- démocrates et staliniens. C'est avec une véhémence exacerbée qu'ils se réclament de Marx et du marxisme (Ainsi, le Parti Communiste Internationaliste, tendance "lambertiste", a lancé une souscription pour republier la biographie de Marx écrite par Franz Mehring), alors que depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas manqué une occasion d'apporter un soutien "critique" aux ignominies staliniennes (résistance, défense de l'URSS, exaltation des prétendues "luttes de libération nationale", soutien des gouvernements de gauche).
Heritage de la Gauche Communiste:
Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - présentation
- 4136 reads
Ce texte d'Internationalisme est extrait d'une série d'articles publiés tout au long de l'année 1947, intitulée "Problèmes actuels du mouvement ouvrier". Dans ces articles, Internationalisme entend par "mouvement ouvrier" ou "mouvement révolutionnaire", les groupes et les organisations politiques. Il polémique contre l'activisme ambiant qui existe parmi les groupes qui voient, avec la fin de la 2ème guerre mondiale, la possibilité d'une répétition du processus révolutionnaire tel qu'il s'était déroulé à la fin de la 1ère guerre mondiale de 1917 à 1923.
Internationalisme analyse au contraire la fin de la 2ème guerre comme une défaite profonde pour la classe ouvrière internationale. Les conditions ne sont pas les mêmes qu'à la fin de la 1ère guerre mondiale ; la classe ouvrière a été physiquement et idéologiquement vaincue ; la survie du capitalisme a accentué la tendance au capitalisme d'Etat qui modifie les données pour la lutte de classe ; les conditions ne sont pas réunies pour une reprise générale de la lutte révolutionnaire.
Internationalisme combat le volontarisme des groupes qui mettent en avant la formation immédiate du parti, sans prendre en compte ces nouvelles données de la période, avec pour seul cadre politique une répétition à leur échelle microscopique des positions et des orientations du Parti bolchevik de la période révolutionnaire, sans un bilan de la défaite et des erreurs de ce parti. Ces groupes sont des scissions du trotskysme, mais surtout les fractions de la Gauche Communiste Internationale qui appuient la constitution d'un Parti Communiste Internationaliste (PCI) en Italie en 1943.
Poursuivant la critique qu'il faisait dès le moment de la constitution du PCI1, Internationalisme rappelle quelles sont les conditions de la constitution d'un parti. L'histoire du mouvement ouvrier montre que la naissance et le développement, tout comme la fin, la dégénérescence ou la trahison des organisations politiques du prolétariat (Ligue des communistes, AIT, 2ème Internationale, Internationale Communiste, Parti bolchévik), sont étroitement liés à l'activité de la classe ouvrière elle-même. Au sein de la classe ouvrière, un parti, c'est-à-dire une organisation capable d'influer sur le cours des événements de la lutte de classe de manière décisive, ne peut surgir que s'il s'exprime dans la classe une tendance à s'organiser et à s'unir contre le capitalisme, dans une montée de lutte de classe.
Cette tendance n'existe pas à la fin de la 2ème guerre mondiale. Les mouvements de grève de 1943 en Italie, les manifestations contre la faim en 1945 en Allemagne où l’on voit même parfois la police se retourner contre le pouvoir, sont circonscrites et isolées. S'ils attestent d'une combativité de classe que tous les groupes politiques reconnaissent, ils restent limités et prisonniers de l'idéologie et des forces d'encadrement de la bourgeoisie, partis de gauche et syndicats.
Pour Internationalisme, l'heure n'est certainement pas à la formation du parti. Contre ceux qui voient dans sa position un "défaitisme", un rejet de l'activité révolutionnaire. Internationalisme réaffirme que le débat n'est pas "construction du parti" ou "rien", mais quelles tâches pour les groupes révolutionnaires, et sur quel programme. Ce qui tient lieu de théorie est pour beaucoup un bavardage incohérent répétant les positions de l'Internationale Communiste comme si rien ne s'était passé depuis la période révolutionnaire et faisant le silence sur tous les débats d'avant la guerre.
On trouve à la constitution du PCI des éléments qui, comme Vercesi, récusaient pendant la guerre toute possibilité d'activité révolutionnaire, refusant de prendre position contre la guerre, théorisant la "disparition du prolétariat" pour aboutir à participer à des "comités antifascistes"2. On y trouve aussi beaucoup d'éléments qui n'avaient pas participé ni suivi le travail politique et théorique de la Gauche Communiste de 1'entre-deux-guerres et qui, à l'appel des anciens des années 20 restés à l'écart de ce travail comme Damen et surtout Bordiga, rejoignent les rangs du PCI, sans que jamais ne soient discutées les positions politiques de la Gauche.
Pour Internationalisme, qui se situe résolument dans la continuité de ce travail, il n'a jamais été question de rejeter la nécessité de l'activité révolutionnaire. Comme il le dit : "le cours de la lutte de classe ne se modifie pas par la volonté des militants, pas plus qu'il ne se modifie indépendamment de leur volonté".
Quelle activité, avec quelles méthodes ? Telle est la question qu'Internationalisme pose aux organisations révolutionnaires.
La "construction du parti" du PCI veut dire en fait se jeter dans un activisme sans principes, et le parti est un regroupement fait de bric et de broc, de tendances diverses, y inclus des groupes qui ont participé aux côtés de la bourgeoisie à la "résistance antifasciste".
Pour Internationalisme au contraire, il faut poursuivre un travail de fraction communiste, continuer le bilan de la vague révolutionnaire précédente en tirant les leçons de la défaite et de la période de guerre, assurer dans la mesure de ses moyens une propagande constante à contre-courant, entretenir le plus possible la confrontation et la discussion dans le milieu révolutionnaire nécessairement réduit dans les conditions de la période.
En 1947, Internationalisme peut déjà faire le constat de l'échec des divers groupes qui prennent leur propre agitation pour 1'activité de la classe depuis quelques années, ce qui entraîne la démoralisation et la dispersion de forces militantes immatures et hâtivement regroupées à qui on a fait miroiter, sans discussion aucune, des perspectives qui ne correspondent en rien à la réalité.
Des groupes qui ont scissionné avec le trotskysme abandonnent le marxisme, se disloquent. De 3000 membres environ que compte le PCI à ses débuts, celui-ci se trouve engagé dans un processus de défections massives et de dispersion. Des dirigeants de ce parti, des éléments des fractions française et belge qui l'appuie, loin de se rendre compte des causes réelles de ce phénomène, l'expliquent par une pirouette philosophique, la "transformation de la quantité en qualité" !
Contre cette aberration, Internationalisme explique ce qui se passe d'une part par l'incapacité à comprendre la période, mais aussi d'autre part par les méthodes défendues et en vigueur dans le PCI : le rejet du travail d'approfondissement politique et théorique par l'ensemble des militants.
Ces méthodes reposent sur la reprise d'une conception erronée de la lutte et de la prise de conscience de la classe, selon laquelle la conscience ne peut être apportée à la classe que "de l'extérieur". Cette conception, que Lénine dans "Que faire ?" reprit de Kautsky, ne voit pas la prise de conscience comme le fait de l'ensemble de la classe ouvrière, dont le parti en son sein est l'expression la plus claire et la plus décidée sur les moyens et les buts généraux du mouvement. Elle la voit comme le fait d'une minorité éclairée détentrice des connaissances théoriques qu'elle doit "importer" dans la classe.
Rapportée sur le plan du parti, cette conception amène à théoriser que seules des individualités particulières ont la capacité d'approfondir la théorie révolutionnaire, pour la distiller et la transmettre en quelque sorte "toute mâchée" aux membres de l'organisation.
C'est cette conception d'un chef génial, seul capable de mener le travail théorique de l'organisation, que critique l'extrait de "Problèmes actuels du mouvement ouvrier" que nous publions ci-dessous. L'attitude que le PCI défendait par rapport à Bordiga, et défend toujours en général en ce qui concerne les questions théoriques dans le mouvement ouvrier, relève de cette conception. Elle sert de base au rejet de la discussion ouverte de toutes les questions et orientations de l'organisation. Elle implique pour les militants une obéissance servile et une confiance aveugle dans les orientations politiques élaborées par le seul centre de l'organisation et une absence de véritable formation. Nous publierons la suite de cet article dans un prochain numéro de la Revue Internationale, article intitulé "La discipline, force principale..." qui combat cette vision militaire du travail militant dans une organisation révolutionnaire.
La vision sclérosée du PCI des méthodes d'une organisation révolutionnaire qu'Internationalisme combattait en 1947, sévit encore aujourd'hui, en particulier dans les groupes qui se réclament du "léninisme". Face aux difficultés que fait surgir l'accélération de l'histoire actuelle, cette vision ne fait qu'accentuer l'opportunisme et le sectarisme dans un milieu révolutionnaire en difficulté.3
A l'inverse de cette vision, le parti, comme toute organisation révolutionnaire, ne peut remplir sa fonction que s'il est un lieu d'élaboration constante collective par tous ses membres des orientations politiques. Ceci implique nécessairement la discussion la plus ouverte et la plus large possible, à l'image de la classe ouvrière dont la condition de son émancipation est l'action consciente collective à laquelle participent toutes les parties et tous les membres de la classe.
1 Lire "La tâche de l'heure : formation du parti ou formation des cadres [420]" – REVUE INTERNATIONALE n°32
2 Lire la brochure publiée par le CCI "Contribution à une histoire de la Gauche Communiste d’Italie".
3 Lire "Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire [421]" – REVUE INTERNATIONALE n°28.
Lire "Problèmes actuels du milieu révolutionnaire" – REVUE INTERNATIONALE n°32, en particulier "Le Parti Communiste International (Programme Communiste) à un tournant de son histoire [422]".
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
- Bordiguisme [126]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]
Heritage de la Gauche Communiste:
Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - La conception du chef génial
- 3410 reads
Ce n'est pas nouveau en politique qu'un groupe change radicalement ses façons de voir et d'agir en devenant une grande organisation, un parti de masses. On peut citer maints exemples de telles métamorphoses. On pourrait, avec raison, l'appliquer également, en partie tout au moins, au Parti bolchevik après la révolution. Mais ce qui frappe, pour le Parti Communiste Internationaliste d'Italie, c'est la rapidité surprenante avec laquelle l'esprit de ses principaux dirigeants a subi ce changement. Et cela est d'autant plus surprenant que, somme toute, le Parti italien représente, aussi bien numériquement que fonctionnellement, tout au plus une fraction élargie.
Comment expliquer alors ce changement ?
Par exemple : le Parti Communiste italien à sa fondation, animé par la direction de la Gauche et de Bordiga, a toujours été l'enfant terrible dans l'I.C. Ne reconnaissant pas la soumission "a priori" à l'autorité absolue des chefs, même de ceux envers qui il portait la plus grande estime, le PC d'Italie entendait discuter librement, et combattre, s'il le fallait, toute position politique qu'il ne partageait pas. Dès la fondation de l’IC, la fraction de Bordiga se trouvera sur bien des points en opposition et exprimera ouvertement ses désaccords avec Lénine et autres dirigeants du Parti bolchevik, de la révolution russe et de l’IC. On connaît les débats qui ont eu lieu entre Lénine et Bordiga au 2ème Congrès. Personne ne songeait alors à contester ce droit de libre discussion et il ne serait venu à personne de voir en cela une atteinte à l'autorité des "chefs". Peut-être que des hommes, aussi veules et serviles que Cachin[1] [424], pouvaient dans leur for intérieur en être scandalisés, mais ils n'osaient même pas le montrer. Mieux que cela : la discussion n'était même pas considérée comme un droit mais comme un DEVOIR, l'unique moyen permettant, par la confrontation des idées et l'étude, l'élaboration des positions programmatiques et politiques courantes nécessaire pour l'action révolutionnaire.
Lénine écrivait : "il est du devoir des militants communistes de vérifier par eux-mêmes les résolutions des instances supérieures du Parti. Celui qui, en politique, croit sur parole est un indécrottable idiot". Et on sait quel mépris Lénine mettait dans ces termes d'"indécrottable idiot". Sans cesse Lénine insistait sur la nécessité de l'éducation politique des militants. Apprendre, comprendre, ne peut se faire que par la libre discussion, par la confrontation générale des idées par l'ensemble des militants .sans exception. Ce n'est pas là simplement une question de pédagogie mais une condition première de l'élaboration politique, de la marche en avant du mouvement de l'émancipation du prolétariat.
Après la victoire du stalinisme et l'exclusion de la gauche de l’IC, la fraction italienne n'a cessé de combattre le mythe du chef infaillible, et face a Trotsky réclamait dans l'opposition de gauche le plus grand effort dans le réexamen critique des positions passées et la recherche théorique par la plus large discussion des problèmes nouveaux. La Fraction italienne a fourni cet effort avant la guerre. Elle n'a cependant pas prétendu avoir résolu tous les problèmes et se trouvait elle-même, comme on le sait, très divisée sur des questions de première importance.
Or on doit constater que toutes ces bonnes dispositions et traditions se sont évanouies avec la constitution du Parti. Le PCI est actuellement le groupement où la discussion théorique et politique est la moins existante. La guerre, l'après-guerre ont soulevé un grand nombre de problèmes nouveaux. Aucun de ces problèmes n'a été et n'est abordé dans les rangs du Parti italien. Il suffit de lire les écrits et journaux du Parti pour se rendre compte de leur extrême pauvreté théorique. Quand on lit le procès-verbal de la Conférence constitutive du Parti, on se demande si cette conférence a eu lieu en 1946 ou en 1926. Et un des dirigeants du Parti –si nous ne nous trompons pas c’était le camarade Damen–, avait raison de dire que le Parti reprenait et repartait des positions de...1925. Mais ce qui pour lui représente une force (les positions de 1925) exprime, on ne peut mieux, le terrible retard théorique et politique et souligne précisément l'extrême faiblesse du Parti.
Aucune période, dans l'histoire du mouvement ouvrier, n'a tant bouleversé les données acquises et posé tant de nouveaux problèmes que cette période, relativement courte, de 20 ans, entre 1927 et 1947, pas même la période pourtant si mouvementée de 1905 à 1925. La plus grande partie des Thèses fondamentales qui étaient à la base de l’IC ont vieilli et sont périmées. Les positions sur 1a question nationale et coloniale, sur la tactique, sur les mots d'ordre démocratiques, sur le parlementarisme, sur les syndicats, sur le Parti et ses rapports avec la classe sont à réviser radicalement. D'autre part, la réponse est à donner aux questions de l’Etat après la révolution, la dictature du prolétariat, sur les caractères du capitalisme décadent, sur le fascisme, sur le capitalisme d'Etat, sur la guerre impérialiste permanente, sur les nouvelles formes de lutte et d'organisation unitaire de la classe. Autant de problèmes que l’IC a à peine entrevus et abordés, et qui sont apparus après la dégénérescence de l’IC.
Quand, devant l'immensité de ces problèmes, on lit les interventions à la Conférence de Turin où on a répété comme des litanies les vieilles positions de Lénine de la "Maladie infantile du Communisme", déjà périmées à l'époque même où il l’a écrit, quand on voit le Parti reprendre, comme si rien ne s'était passé, les vieilles positions de 1924 de participation aux élections bourgeoises et de lutte à l'intérieur des syndicats, on mesure tout le retard politique de ce Parti et tout ce qu'il a à rattraper.
Et cependant c'est ce Parti qui est de loin le plus en retard, répétons-le, par rapport aux travaux de la Fraction d'avant-guerre, qui s'oppose le plus à toute discussion politique intérieure et publique. C'est dans ce Parti ou la vie idéologique est la plus terne.
Comment cela s'explique-t-il ? L'explication nous a été donnée par un des dirigeants de ce Parti, dans une conversation qu'il a eue avec nous[2] [425]. Il nous a dit :
- "Le Parti italien est composé, dans sa grande majorité, d'éléments nouveaux sans formation théorique et politiquement vierges. Les anciens militants, eux-mêmes, sont restés pendant 20 ans isolés, coupés de tout mouvement de la pensée. Dans l’état présent les militants sont incapables d'aborder les problèmes de la théorie et de l’idéologie. La discussion ne ferait que troubler leur vue et ferait plus de mal que de bien. Ils ont pour le moment besoin de marcher sur la terre ferme, serait-ce même les vieilles positions actuellement périmées, mais déjà formulées et compréhensibles pour eux. Pour le moment il suffit de grouper les volontés pour l'action. La solution des grands problèmes soulevés par l'expérience d'entre les deux guerres exige le calme de la réflexion. Seul un "grand cerveau" peut les aborder avec profit et donner la réponse qu'ils nécessitent. La discussion générale ne ferait qu'apporter de la confusion. Le travail idéologique n'est pas le fait de la masse des militants mais des individualités. Tant que ces individualités géniales n'auront pas surgi, on ne peut espérer d'avancer en idéologie. Marx, Lénine étaient ces individualités, ces génialités dans une période passée. Il faut attendre la venue d'un nouveau Marx. Nous, en Italie, sommes convaincus que Bordiga sera cette génialité. Ce dernier travaille actuellement sur une oeuvre d'ensemble qui contiendra la réponse aux problèmes qui tourmentent les militants de la classe ouvrière. Quand cette oeuvre paraîtra, les militants n'auront qu'à l'assimiler, et le Parti à aligner sa politique et son action sur ces nouvelles données".
Ce discours que nous reproduisons presque textuellement contient trois éléments. Premièrement une constatation de fait : le bas niveau idéologique dès membres du Parti. Deuxièmement, le danger qui consiste à ouvrir d'amples discussions dans le Parti, parce que ne pouvant que troubler les membres et disloquer ainsi leur cohésion. Et troisièmement que la solution aux problèmes politiques nouveaux ne peut être QUE l’œuvre d'un cerveau génial.
Sur le premier point le camarade dirigeant a absolument raison, c'est là un fait incontestable. Mais cette constatation devrait inciter, croyons-nous, à poser la question de la valeur de ce Parti. Que représente un tel Parti pour la classe ? Que peut-il apporter à la classe ?
Nous avons vu la définition que donne Marx sur ce qui distingue les communistes de l'ensemble du prolétariat : leur conscience des fins générales du mouvement et les moyens pour y parvenir. Si les membres du Parti italien ne représentent pas cette distinction, si leur niveau idéologique ne dépasse pas celui de l'ensemble du prolétariat, peut-on alors parler d'un Parti communiste ?
Bordiga formulait justement l'essence du Parti, par un "corps de doctrine et une volonté d'action". Si ce corps de doctrine manque, mille regroupements ne forment pas encore le Parti. Pour le devenir réellement, le PCI a pour première tâche : la formation idéologique des cadres, c'est-à-dire le travail idéologique préalable pour pouvoir devenir un parti réel.
Ce n'est pas la pensée de notre dirigeant du PCI, qui estime au contraire qu'un tel travail n'est susceptible que de troubler la volonté d'action des membres. Que dire d'une telle pensée sinon qu'elle nous paraît MONSTRUEUSE. Faut-il rappeler les remarquables passages du "Que faire" où Lénine cite Engels sur la nécessité de la lutte sur trois fronts : l'économique, le politique et le front idéologique ?
De tous les temps existaient ces socialistes qui craignaient que la discussion et la manifestation des divergences puissent troubler la bonne action des militants. Ce socialisme peut être appelé le socialisme borné ou le socialisme de l'ignorance.
Contre Weitling, le chef reconnu, le jeune Marx fulminait en s'écriant : "Le prolétariat n'a pas besoin de l'ignorance" ! Si la lutte des idées peut troubler l'action des militants, combien cela serait encore plus vrai pour l'ensemble du prolétariat ? Et alors c'en est fini du Socialisme à moins de professer que le socialisme c'est de l'ignorance. C'est là une conception d'Eglise, qui elle aussi craint de troubler les cerveaux de ses fidèles, par trop de questions doctrinales.
Contrairement à l'affirmation que les militants ne peuvent agir que dans la certitude, "fusse-t-elle même fondée sur des positions fausses", nous opposons qu'il n'y a pas de certitude, mais un continuel dépassement des vérités. Seule l'action basée sur les données les plus récentes, en continuel enrichissement, est révolutionnaire. Par contre, l'action faite sur la base d'une vérité d'hier, mais déjà, périmée aujourd'hui, est stérile, nuisible et réactionnaire. On veut nourrir les membres de bonnes vérités certaines et absolues, alors que seules les vérités relatives contenant leur antithèse du doute donnent une synthèse révolutionnaire.
Si le doute et la controverse idéologique doivent troubler l'action des militants, on ne voit pas pourquoi cela serait un phénomène uniquement valable pour aujourd'hui. A chaque étape de la lutte, la nécessité surgit de dépasser les positions antérieures. A chaque moment la vérification des idées acquises et des positions prises sont mises en doute. Nous serons donc placés dans un cercle vicieux : ou de réfléchir, de raisonner et en conséquence ne pas pouvoir agir, ou d'agir sans savoir si notre action repose sur un raisonnement réfléchi.
Belle conclusion à laquelle doit aboutir notre dirigeant du PCI s'il était logique avec ses prémisses. C'est en tout cas l'idéalisation du type de "l'indécrottable idiot" contre lequel Lénine n'avait pas assez de sarcasmes. C'est le "parfait crétin" hissé à la hauteur de membre idéal du PCI d'Italie !
Tout le raisonnement de notre dirigeant sur l'impossibilité "momentanée" de la recherche et de la controverse théorico-politique, au sein du PCI, ne contient pas l'ombre d'une justification.
Le trouble provoqué par de telles controverses est justement la condition de la formation du militant, la condition que son action puisse reposer sur une conviction sans cesse vérifiée, comprise et enrichie. C'est la condition fondamentale de l'action révolutionnaire, en dehors de laquelle il n'y a qu’obéissance, crétinisme et servitude.
Mais la pensée intime de notre dirigeant se trouve exprimée dans le troisième point. C'est là sa pensée profonde. Les problèmes théoriques de l'action révolutionnaire ne sont pas résolus par des controverses et des discussions mais par le cerveau génial d'un individu, du chef. La solution n'est pas une oeuvre collective mais individuelle du penseur isolé dans son cabinet de travail, tirant de sa génialité les éléments fondamentaux de la solution. Ce travail achevé, la solution donnée, il ne reste à la masse des militants, à l'ensemble du Parti que d'assimiler cette solution et d'aligner sur elle leur action politique. Cela rendrait les discussions sinon nuisibles du moins un luxe inutile, une perte de temps stérile. Et pour appuyer cette thèse, de citer entre autres l'exemple de l’œuvre de Marx.
Notre dirigeant se fait une drôle d'idée de Karl Marx. Jamais penseur n'a été moins "l'homme-de-cabinet-de-travail" que Marx. Moins que chez tout autre, on ne peut séparer chez Marx l'homme de l'action, le militant du mouvement et le penseur. La pensée de Marx mûrit en correspondance directe non de l’action des autres mais de son action avec les autres dans le mouvement général. Pas une idée contenue dans son oeuvre que Marx n'ait déjà exposée, opposée, sous forme de conférences et de controverses, à d'autres idées au cours de son action. C'est pourquoi son oeuvre garde cette fraîcheur d'expression et de vitalité. Toute son œuvre, et même le Capital, n'est qu'une incessante controverse où les recherches théoriques les plus ardues et les plus abstraites voisinent, et sont étroitement mêlées à la discussion et à la polémique directe. Curieuse façon de concevoir l’œuvre de Marx que de la considérer comme le produit de la composition biologique miraculeuse du cerveau de Marx !
D'une façon générale c'en est fini du génie dans l'histoire humaine. Que représentait le génie dans le passé ? Rien d'autre que le niveau extrêmement bas de la connaissance de la moyenne des hommes en rapport de qui la connaissance de quelques éléments d'élite faisait une différence incommensurable. A un stade inférieur du développement de la connaissance humaine, la connaissance toute relative pouvait être un acquis individuel, tout comme le moyen de production pouvait avoir un caractère individuel. Ce qui distingue l'outil de la machine c'est son changement de caractère qui de produit rudimentaire d'un travail privé, devient un produit compliqué d'un travail social collectif. Il en est autant pour la connaissance en général. Tant qu'elle restait élémentaire, un individu isolé pouvait l'embrasser dans sa totalité. Avec le développement de la société et de la science, la connaissance cesse de pouvoir être embrassée par l'individu pour être mieux saisie par l'humanité tout entière. L’écart entre le génie et la moyenne des hommes diminue dans la proportion même où la somme des connaissances humaines s’élève. La science, comme la production économique, tend à se socialiser. Du génie l'humanité est passée au savant isolé et du savant à l'équipe de savants. La division du travail tend à grandir. Pour produire aujourd'hui il est nécessaire de compter sur la coopération des grandes masses d'ouvriers. Cette même tendance à la division est dans la production "spirituelle" et assure précisément par là son développement. Le cabinet du savant cède la place au laboratoire où coopèrent dans leurs recherches des équipes de savants, comme l'atelier de l'artisan a cédé sa place aux grandes usines.
Le rôle de l'individu tend à diminuer dans la société humaine, non en tant qu'individu sensible mais en tant qu'individu émergeant de la masse confuse, surnageant le chaos humain. L'homme-individu cède la place à l'homme social. L'opposition de l'unité individuelle à la société est résolue par la synthèse d'une société où tous les individus retrouvent leur personnalité véritable. Le mythe du génie n’est pas l’avenir de l’humanité. Il doit aller rejoindre le mythe du héros et du demi-dieu dans le musée de la préhistoire.
On peut penser ce que l'on veut de la diminution du rôle de l'individu dans l'histoire humaine. On peut applaudir ou le regretter. On ne peut contester ce processus. Pour pouvoir continuer la production techniquement évoluée le capitalisme était forcé d'instaurer l'instruction générale. La bourgeoisie a été obligée d'ouvrir un nombre de plus en plus grand d'écoles, dans une certaine mesure compatible avec ses intérêts. Elle s'est vue obligée de laisser accéder les fils des prolétaires à une instruction supérieure.
Dans cette même mesure elle a élevé la culture générale de la moyenne de la société. Mais elle ne peut dépasser un certain degré sans atteindre à sa propre domination et devient ainsi une entrave au développement culturel de la société.
C’est là une des manifestations de la contradiction historique de la société bourgeoise que seul le socialisme peut résoudre. Le développement de la culture et de la conscience sans cesse dépassée est la résultante mais aussi la CONDITION du socialisme et voilà un homme qui se dit marxiste, qui prétend être un dirigeant d'un Parti communiste qui nous parle et nous demande d'attendre le Génie sauveur.
Pour nous convaincre, il nous a conté cette anecdote : se présentant après la guerre chez Bordiga, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, il a soumis à sa critique des écrits théoriques et politiques. Après lecture, Bordiga trouvant leur contenu erroné, lui aurait demandé ce qu'il comptait en faire. Les publier dans les revues du Parti, a répondu notre dirigeant. Sur quoi Bordiga aurait répliqué que ne pouvant les combattre, n'ayant pas le temps de faire les recherches théoriques nécessaires pour réfuter le contenu de ces articles, il s'opposait à leur publication. Et si le Parti passait outre, il retirerait sa collaboration littéraire. La menace de Bordiga a suffi pour faire renoncer notre dirigeant à la publication de ses articles.
Cette anecdote qu'on nous donnait en exemple devait nous convaincre de la grandeur du maître et du sens de mesure de l'élève. Elle nous laisse plutôt un sentiment pénible. Si cette anecdote est vraie, elle nous donne une idée de l'esprit qui règne dans le PCI d'Italie, un esprit absolument lamentable. Ainsi ce n'est pas le Parti, la masse des militants, la classe ouvrière dans son ensemble qui est appelée à juger de la justesse ou de l'erreur de telle ou telle position politique. Cette masse ne doit pas même être informée. Le "maître", seul juge de ce qu'elle peut comprendre et de ce dont elle doit être renseignée. Quel sublime souci de ne pas "troubler" la quiétude de la masse. Et si le "maître" se trompe ? s'il est dans l'erreur ? Cela ne peut être, car si le "maître" se trompe, comment voulez-vous qu'un simple mortel puisse, lui, avoir même la possibilité de juger ! Pourtant cela est bien arrivé à d'autres "maîtres" de se tromper : à Marx, à Lénine. Eh bien, cela n'arrivera pas à "notre maître", au VRAI. Et si cela arrivait, il ne peut appartenir qu'à un "maître" futur de le corriger. C'est là une conception typiquement aristocratique de la pensée. Nous ne nions pas la grande valeur que peut avoir la pensée du spécialiste, du savant, du penseur, mais nous rejetons la conception authentiquement monarchiste de la pensée, le Droit Divin sur la pensée. Quant au "maître" lui-même, il cesse d être un être humain dont la pensée se développe au contact des autres humains, pour devenir en quelque sorte un phénix, un phénomène se mouvant par lui-même, l'Idée pure se cherchant, se contredisant et se saisissant soi-même comme chez Hegel.
L'attente du génie c'est la proclamation de sa propre impuissance, c'est la masse attendant au pied du mont Sinaï la venue d'un je ne sais quel Moïse, apportant on ne sait quelle Bible d'inspiration divine. C'est la vieille et éternelle attente du Messie juif venant libérer son peuple. Le vieux chant révolutionnaire du prolétariat, l'Internationale dit : "il n'y a pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun", Il faudrait veiller à l'avenir d'ajouter "ni génie" à l'intention particulière des membres du PCI d'Italie.
Il existe bien des présentations modernes de cette conception messianique : le culte du "chef infaillible" des staliniens, le “Führer prinzip” des hitlériens, l'appartenance au Duce des chemises noires. Elles sont l'expression de l’angoisse de la bourgeoisie décadente prenant vaguement conscience de sa fin prochaine et cherchant à se sauver en se jetant au pied du premier aventurier venu. Le concept du génie fait partie de la même famille des divinités.
Le prolétariat n'en a que faire et n'a pas à craindre d'être troublé en regardant la réalité en face car l'avenir du monde lui appartient.
(A suivre [426])
[1] [427] Vieux parlementaire du Parti socialiste, chef de cabinet du ministre socialiste Sembat durant la 1ère guerre mondiale. Chauvin invétéré chargé de porter des fonds de l'Etat français à Mussolini pour faire campagne pour l'entrée en guerre de l'Italie au côté de l'Entente... Converti en 1920 en partisan de l’IC où il continue sa carrière de parlementaire et est le plus veule partisan, jusqu'à sa mort, de Staline.
[2] [428] Conversation avec Vercesi
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la structure et le fonctionnement des organisations revolutionnaires - conference internationale (janvier 82)
- 4772 reads
1) La structure dont se dote l'organisation des révolutionnaires correspond à la fonction qu'elle assume dans la classe ouvrière. Comme cette fonction comporte des tâches valables à toutes les étapes du mouvement ouvrier, mais aussi des tâches plus particulières à telle ou telle époque de ce mouvement, il existe des caractéristiques constantes de l'organisation des révolutionnaires et des caractéristiques plus circonstancielles, plus déterminées par les conditions historiques dans lesquelles elle surgit et se développe.
Parmi les caractéristiques constantes, on peut relever :
-
l'existence d'un programme valable pour toute l'organisation. Le programme en tant que synthèse de l'expérience du prolétariat dont l'organisation est une partie et parce qu'il relève d'une classe n'ayant pas seulement une existence présente mais aussi un devenir historique :
-
exprime ce devenir par la formulation des buts de la classe et du chemin à suivre pour les atteindre ;
-
rassemble les positions essentielles que l'organisation doit défendre dans la classe ;
-
sert de base d'adhésion ;
-
son caractère unitaire, expression de l'unité de son programme et de celle de la classe ouvrière dont elle est l'émanation, unité qui se traduit pratiquement par une centralisation de sa structure.
Parmi les caractéristiques plus circonstancielles, on peut mettre en évidence :
-
le caractère plus ou moins large de son étendue, suivant qu'on se situe aux balbutiements du mouvement ouvrier (sociétés secrètes, sectes), à son étape de plein développement au sein de la société capitaliste (partis de masse de la 2ème Internationale), à son étape d'affrontement direct avec le capitalisme en vue de sa destruction (période ouverte avec la Révolution de 1917 et la fondation de l'Internationale Communiste) qui impose à l'organisation des critères de sélection plus stricts et plus étroits ;
-
le niveau auquel se manifeste le plus directement son unité programmatique et organique : niveau national lorsque la classe ouvrière était confrontée à des tâches plus spécifiques, au sein d'un capitalisme en plein développement, dans les différents pays où elle menait la lutte (partis de la 2ème Internationale), niveau international lorsque le prolétariat n'a plus qu'une tâche à l'ordre du jour : la Révolution Mondiale.
2- Le mode d'organisation du CCI participe directement de ces différentes données :
-
unité programmatique et organique à l'échelle mondiale,
-
organisation "étroite", aux critères d'adhésion stricts.
Mais le caractère unitaire au niveau international est d'autant plus marqué pour le CCI que, contrairement aux organisations ayant surgi auparavant dans la période de décadence (Internationale Communiste, fractions de gauche), il n'y a pas de lien organique avec les organisations venant de la 2ème Internationale où la structure par pays était plus marquée. C'est pour cela que le CCI a surgi d'emblée comme organisation internationale suscitant progressivement l'apparition de sections territoriales, et non comme résultat d'un processus de rapprochement d'organisations déjà formées au niveau national.
Cet élément plus "positif" résultant de la rupture organique est cependant contre-balancé par tout une série de faiblesses liées à cette rupture, et concernant la compréhension des questions d'organisation. Faiblesses qui ne sont pas propres au CCI mais concernent l'ensemble du milieu politique révolutionnaire. Ce sont ces faiblesses qui se sont manifestées une nouvelle fois dans le CCI et qui ont motivé la tenue d'une Conférence Internationale et le présent texte.
3) Au centre des incompréhensions qui pèsent sur le CCI figure la question du centralisme. Le centralisme n'est pas un principe abstrait ou facultatif de la structure de l'organisation. C'est la concrétisation de son caractère unitaire : il exprime le fait que c'est une seule et même organisation qui prend position et agit dans la classe. Dans les rapports entre les différentes parties de l'organisation et le tout, c'est toujours le tout qui prime. Il ne peut exister face à la classe de position politique ou de conception de l'intervention particulière à telle ou telle section territoriale ou locale. Celles-ci doivent toujours se concevoir comme partie d'un tout. Les analyses et positions qui s'expriment dans la presse, les tracts, les réunions publiques, les discussions avec les sympathisants ; les méthodes employées dans notre propagande comme dans notre vie interne, sont celles de l'organisation dans son ensemble, même s'il existe des désaccords sur tel ou tel point, en tel ou tel lieu, ou chez tel ou tel militant et même si l'organisation porte à l'extérieur les débats politiques qui se déroulent en son sein. La conception selon laquelle telle ou telle partie de l'organisation peut adopter face à la classe ou à l'organisation des positions ou des attitudes qui lui semblent correctes au lieu de celles de l'organisation qu'elle estime erronées est à proscrire absolument car :
-
si l'organisation fait fausse route, la responsabilité des membres qui estiment défendre une position correcte n'est pas de se sauver eux-mêmes dans leur coin, mais de mener une lutte au sein de l'organisation afin de contribuer à la remettre dans "le droit chemin"[1];
-
une telle conception conduit une partie de l'organisation à imposer arbitrairement sa propre position à toute l'organisation par rapport à tel ou tel aspect de son travail (local ou spécifique).
Dans l'organisation, le tout n'est pas la somme des parties. Celles-ci reçoivent délégation pour l'accomplissement de telle activité particulière (publications territoriales, interventions locales, etc.) et sont donc responsables devant l'ensemble de ce mandat qu'elles ont reçu.
4) Le moment privilégié où s’exprime avec toute son ampleur l’unité de l’organisation est son Congrès International. C’est au congrès international qu’est défini, enrichi, rectifié le programme du CCI, que sont établies, modifiées ou précisées ses modalités d’organisation et de fonctionnement, que sont adoptées ses analyses et orientations d’ensemble, qu’il est fait un bilan de ses activités passées et élaboré ses perspectives de travail pour le futur. C’est pour cela que la préparation du Congrès doit être prise en charge avec le plus grand soin et la plus grande énergie par l’ensemble de l’organisation. C’est pour cela que les orientations et décisions du Congrès doivent servir de références constantes à l'ensemble de la vie de l'organisation après celui-ci.
5) Entre deux Congrès, l'unité de même que la continuité de l'organisation s'exprime par l'existence d'organes centraux nommés par le Congrès et responsables devant lui. C'est aux organes centraux que revient la responsabilité (suivant le niveau de compétence : international ou territorial) :
-
de représenter l'organisation face à l'extérieur,
-
de prendre position chaque fois que nécessaire sur la base des orientations définies au Congrès,
-
de coordonner et d'orienter l'ensemble des activités de l'organisation,
-
de veiller à la qualité ce l'intervention face à l'extérieur et notamment celle de la presse,
-
d'animer et de stimuler la vie interne de l'organisation notamment par la mise en circulation de bulletins internes et par des prises de positions sur les débats quand c'est nécessaire,
-
de gérer les ressources financières et matérielles de l'organisation,
-
de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité de l'organisation et son aptitude à remplir ses tâches,
-
de convoquer les Congrès.
L'organe central est une partie de l'organisation et comme tel, il est responsable devant elle, lorsqu'elle est réunie en Congrès. Cependant, c'est une partie qui a comme spécificité d'exprimer et de représenter le tout, et de ce fait, les positions et décisions de l'organe central priment toujours sur celles des autres parties de l'organisation prises séparément.
Contrairement à certaines conceptions, notamment celles dites "léninistes", l'organe central est un instrument de l'organisation et non le contraire. Il n'est pas le sommet d'une pyramide suivant une vision hiérarchique et militaire de l'organisation des révolutionnaires. L'organisation n'est pas formée d'un organe central plus les militants, mais constitue un tissu serré et uni au sein duquel s'imbriquent et vivent toutes ses composantes. Il faut donc plutôt voir l'organe central comme le noyau de la cellule qui coordonne le métabolisme d'une entité vivante.
En ce sens, c'est de façon constante que l'ensemble de l'organisation est concerné par les activités de ses organes centraux, lesquels sont tenus de faire des rapports réguliers sur leurs activités. Même si c'est uniquement au Congrès qu'ils rendent leur mandat, les organes centraux sont tenus d'avoir des oreilles toujours ouvertes à la vie de l'organisation et de tenir constamment compte de cette vie.
Suivant les nécessités et circonstances, les organes centraux peuvent être conduits à désigner en leur sein des sous-commissions à qui il revient la responsabilité d'exécuter et de faire exécuter les décisions adoptées lors des réunions plénières des organes centraux ainsi que d'accomplir toute autre tâche (notamment les prises de positions) qui s'avère nécessaire entre deux réunions plénières.
Ces sous-commissions sont responsables devant ces réunions plénières. D'une façon plus générale, les rapports établis entre l'ensemble de l'organisation et les organes centraux valent également entre ceux-ci et leurs sous-commissions permanentes.
6) Le souci de la plus grande unité du sein de l'organisation préside également à la définition des mécanismes qui permettent les prises de position et la nomination des organes centraux. Il n'existe aucun mécanisme idéal garantissant le meilleur choix quant aux décisions à prendre, aux orientations à adopter et aux militants à nommer dans les organes centraux. Cependant, le vote et l'élection sont ceux qui permettent le mieux de garantir tant l'unité de l'organisation que la plus grande participation de l'ensemble de celle-ci à sa propre vie.
En général, les décisions à tous les niveaux (Congrès, organes centraux, sections locales) sont prises (quand il n'y a pas d'unanimité) à la majorité simple. Cependant, certaines décisions qui peuvent avoir une répercussion directe sur l'unité de l'organisation (modification de la plate-forme ou des statuts, intégration ou exclusion de militants) sont prises à une majorité plus forte que la majorité simple (3/5, 3/4, etc..).
Par contre, dans le même souci d'unité, une minorité de l'organisation peut provoquer la convocation d'un Congrès extraordinaire à partir du moment où elle est significative (par exemple les 2/5) : en règle générale, il revient au Congrès de trancher sur les questions essentielles, et l'existence d'une forte minorité demandant sa tenue est l'indice de l'existence de problèmes importants au sein de l'organisation.
Enfin, il est clair que le vote n'a de sens que si les membres qui sont en minorité appliquent les décisions qui ont été prises et qui deviennent celles de l'organisation.
Dans la nomination des organes centraux, il est nécessaire de prendre en considération les trois éléments suivants :
-
la nature des tâches à accomplir par ces organes,
-
l'aptitude des candidats par rapport à ces tâches,
-
leur capacité à travailler de façon collective.
C'est en ce sens que l'on peut dire que l'assemblée (Congrès ou autre) qui doit désigner un organe central nomme une équipe : c'est pour cela qu'en général, l'organe central sortant fait une proposition de candidats. Cependant, il revient à cette assemblée (et c'est le droit de tout militant) de proposer d'autres candidats si elle l'estime nécessaire et, en tout état de cause, d'élire individuellement les membres des organes centraux. Seul ce type d'élections permet à l'organisation de se doter d'organes en qui elle a un maximum de confiance.
L'organe central a pour responsabilité de mettre en application et de défendre les décisions adoptées par le Congrès qui l'a élu. En ce sens, il est opportun que figure en son sein une forte proportion de militants, qui, lors du Congrès, se sont prononcés en faveur de ces décisions et orientations. Cela ne veut pas dire cependant que seuls ceux qui ont défendu dans le Congrès les positions majoritaires, positions qui sont devenues à la suite de celui-ci celles de l'organisation, puissent faire partie de l'organe central. Les trois critères définis plus haut restent valables quelles que soient les positions défendues lors des débats par tel ou tel candidat éventuel. Cela ne veut pas dire non plus qu'il doit exister un principe de représentation -par exemple proportionnelle- des positions minoritaires au sein de l'organe central. C'est là une pratique courante dans les partis bourgeois, notamment les partis sociaux-démocrates, où la direction est constituée par les représentants des différents courants ou tendances en proportion des voix recueillies dans les Congrès. Un tel mode de désignation de l'organe central correspond au fait que, dans une organisation bourgeoise, l'existence de divergences est basée sur la défense de telle ou telle orientation de gestion du capitalisme, ou plus simplement sur la défense de tel ou tel secteur de la classe dominante ou de telle ou telle clique, orientation ou intérêts qui se maintiennent de façon durable et qu'il s'agit de concilier par une "répartition équitable" des postes entre représentants. Rien de tel dans une organisation communiste où les divergences n'expriment nullement la défense d'intérêts matériels, personnels ou de groupes de pression particuliers, mais sont la traduction d'un processus vivant et dynamique de clarification des problèmes qui se posent à la classe et sont destinés comme tels à être résorbés avec l'approfondissement de la discussion et à la lumière de l'expérience. Une représentation stable, permanente et proportionnelle des différentes positions qui sont apparues sur les divers points de l'ordre du jour d'un Congrès tournerait donc le dos au fait que les membres de organes centraux :
-
ont comme première responsabilité de mettre en application les décisions et orientations du Congrès,
-
peuvent parfaitement changer de position personnelle (dans un sens ou dans un autre) avec l'évolution du débat.
7) L'utilisation des termes "démocratique" ou "organique" pour qualifier le centralisme de l'organisation des révolutionnaires est à proscrire :
-
parce qu'elle ne fait pas avancer d'un pas la compréhension correcte du centralisme ;
-
parce que ces termes sont eux-mêmes entachés par les pratiques qu'ils ont couverts dans l'histoire.
En effet, le "centralisme démocratique" (terme que l'on doit à Lénine) est marqué aujourd'hui du sceau du stalinisme qui l'a employé pour masquer et recouvrir le processus d'étouffement et de liquidation de toute vie révolutionnaire au sein des partis de l'Internationale, processus dans lequel d'ailleurs Lénine porte une responsabilité pour avoir demandé et obtenu au l0ème Congrès du PCUS (1921) l'interdiction des fractions, qu'il estimait à tort nécessaire (même à titre provisoire) face aux terribles difficultés traversées par la Révolution. D'autre part, la revendication_ d'un "véritable centralisme démocratique" qui était pratiqué dans le parti bolchevique n'a pas de sens non plus dans la mesure où :
-
certaines conceptions défendues par Lénine (notamment dans "Un pas en avant, deux pas en arrière") sur le caractère hiérarchisé et "militaire" de l'organisation, et qui ont été exploitées par le stalinisme pour justifier ses méthodes, sont à rejeter ;
-
le terme "démocratique" lui-même n'est pas le plus approprié tant étymologiquement ("pouvoir du peuple") que par le sens qu'il a acquis dans le capitalisme qui en a fait un fétiche formaliste destiné à masquer et faire accepter la domination de la bourgeoisie sur la société.
D’une certaine façon, le terme « organique » (que l’on doit à Bordiga), serait plus correct pour qualifier la nature du centralisme qui existe dans l’organisation des révolutionnaires. Cependant, l’usage qu’en fait le courant bordiguiste pour justifier un mode de fonctionnement qui exclut tout contrôle des organes centraux et de sa propre vie par l’ensemble de l’organisation, le déqualifie et il est nécessaire de le rejeter également. En effet, pour le bordiguisme, le fait –juste en soi- que l’existence d’une majorité en faveur d’une position ne garantisse pas que celle-ci soit correcte, ou que l’élection des organes centraux ne soit pas un mécanisme parfait prévenant ceux-ci de toute dégénérescence, est utilisé pour défendre une conception de l’organisation où le vote et l’élection sont bannis. Dans cette conception, les positions correctes et les "chefs" s’imposent "d’eux-mêmes" à travers un processus soi-disant "organique", mais qui en pratique, revient à confier au "centre" le soin de décider seul et en tout, de trancher tout débat, et conduit ce "centre" à s’aligner sur les positions d’un "chef historique" qui serait investi d’une sorte d’infaillibilité divine. Combattant toute forme d’esprit religieux et mystique, les révolutionnaires ne sauraient remplacer le pontife de Rome par celui de Naples ou Milan.
Encore une fois, le vote et l’élection, aussi imparfaits qu’ils soient, sont encore le meilleur moyen, dans les conditions actuelles, pour garantir un maximum d’unité et de vie dans l’organisation.
8) Contrairement à la vision bordiguiste, l'organisation des révolutionnaires ne peut être "monolithique". L'existence de divergences en son sein est la manifestation que c'est un organe vivant qui n'a pas de réponses toutes faites à apporter immédiatement aux problèmes qui surgissent devant la classe. Le marxisme n'est ni un dogme, ni un catéchisme. C'est l'instrument théorique d'une classe qui, à travers son expérience et en vue de son devenir historique, avance progressivement, avec des hauts et des bas, vers une prise de conscience qui est la condition indispensable de son émancipation. Comme toute réflexion humaine, celle qui préside au développement de la conscience prolétarienne n'est pas un processus linéaire et mécanique, mais bien contradictoire et critique. Il suppose nécessaire la confrontation des arguments. En fait, le fameux "monolithisme" ou la fameuse "invariance" des bordiguistes est un leurre (ce qu'on peut vérifier fréquemment dans les prises de positions de cette organisation et de ses diverses sections), ou bien l'organisation est complètement sclérosée et n'est plus en prise avec la vie de la classe, ou bien elle n'est pas monolithique et ses positions ne sont pas invariantes.
9) Si l'existence de divergences au sein de l'organisation est un signe qu'elle est vivante, seul le respect d'un certain nombre de règles dans la discussion de ces divergences permet que celles-ci soient une contribution au renforcement de l'organisation et à l'amélioration des tâches pour lesquelles la classe l'a fait surgir.
On peut ainsi énumérer un certain nombre de ces règles :
-
réunions régulières des sections locales et mises à l'ordre du jour de celles-ci des principales questions débattues dans l'ensemble de l'organisation : d'aucune façon le débat ne saurait être étouffé,
-
circulation la plus ample possible des différentes contributions au sein de l'organisation au moyen des instruments prévus à cet effet (les bulletins internes),
-
rejet par conséquent des correspondances secrètes et bilatérales, qui loin de favoriser la clarté du débat, ne peuvent que l'obscurcir en favorisant les malentendus, la méfiance, et la tendance à la constitution d'une organisation dans l'organisation,
-
respect par la minorité de l'indispensable discipline organisationnelle (comme on l'a vu au point 3),
-
rejet de toute mesure disciplinaire ou administrative de la part de l'organisation à l'égard de ses membres qui soulèvent des désaccords : de même que la minorité doit savoir être une minorité au sein de l'organisation, la majorité doit savoir être une majorité et, en particulier, ne pas abuser du fait que sa position est devenue celle de l'organisation pour annihiler le débat par quelque moyen que se soit, par exemple en obligeant les membres de la minorité à être les porte-parole de positions auxquelles il n'adhèrent pas,
-
l'ensemble de l'organisation est intéressé à ce que la discussion (même si elle porte sur des divergences de principes qui ne peuvent qu'aboutir à une séparation organisationnelle) soit menée le plus clairement possible (sans pour cela évidemment paralyser ou affaiblir les tâches de l'organisation) pour se convaincre mutuellement de la validité de leurs analyses respectives ou, tout au moins, permettre que la plus grande clarté soit faite sur la nature et la portée des désaccords.
Dans la mesure où les débats qui traversent l'organisation concernent en général l'ensemble du prolétariat, il convient que celle-ci les porte à l'extérieur, en respectant les conditions suivantes :
-
ces débats concernent les questions politiques générales et ils ont atteint une maturité suffisante pour que leur publication constitue une réelle contribution à la prise de conscience de la classe ouvrière ;
-
la place donnée à ces débats ne doit pas remettre en cause l'équilibre général des publications ;
-
c'est l'organisation comme un tout qui décide et prend en charge cette publication en fonction des critères valables pour la publication de n'importe quel article dans la presse : qualités de clarté et de forme rédactionnelle, intérêt qu'ils présentent pour la classe ouvrière. Sont donc à proscrire les publications de textes en dehors des organes prévus à cet effet sur l'initiative "privée" d'un certain nombre de membres de l'organisation. De même, il n'existe aucun "droit" formel pour quiconque dans l'organisation (individu ou tendance) de faire publier un texte si les organes responsables des publications n'en voient pas l'utilité ou l'opportunité.
10) Les divergences existant dans l'organisation des révolutionnaires peuvent conduire à l'apparition de formes organisées des positions minoritaires. Si, face à un tel processus, aucune mesure de type administratif (comme l'interdiction de telles formes organisées) ne saurait se substituer à la discussion la plus approfondie possible, il convient également que ce processus soit pris en charge de façon responsable, ce qui suppose :
-
que cette forme organisée des désaccords ne peut se baser que sur une position positive et cohérente et non sur une collection hétéroclite de points d'oppositions et de récriminations,
-
que l'organisation soit en mesure de comprendre la nature d'un tel processus ; qu'elle connaisse notamment la différence entre une tendance et une fraction.
La tendance est avant tout l'expression de la vie de l’organisation du fait que la pensée ne se développe jamais de façon rectiligne, mais à travers un processus contradictoire et de confrontation des idées. Comme telle, une tendance est en général destinée à se résorber dès lors qu'une question est devenue suffisamment claire pour que l'ensemble de l'organisation puisse se donner une analyse unique soit comme résultat de la discussion, soit par l'apparition de données nouvelles venant confirmer telle vision et réfuter l'autre.
Par ailleurs, une tendance se développe essentiellement sur des points conditionnant l'orientation et l'intervention de l'organisation. Sa constitution n'a donc pas comme point de départ des questions d'analyse théorique. Une telle conception de la tendance aboutirait à un affaiblissement de l'organisation et à une parcellisation à outrance de l'énergie militante.
La fraction est l'expression du fait que l'organisation est en crise de par l'apparition d'un processus de dégénérescence en son sein, de capitulation face au poids de l'idéologie bourgeoise. Contrairement à la tendance qui ne s'applique qu'à des divergences sur l'orientation face à des questions circonstancielles, la fraction s'applique à des divergences programmatiques qui ne peuvent trouver d'aboutissement que dans l'exclusion de la position bourgeoise ou par le départ de l'organisation de la fraction communiste et c'est dans la mesure où la fraction porte en elle la séparation de deux positions devenues incompatibles au sein du même organisme qu'elle tend à prendre une forme organisée avec ses propres organes de propagande.
C'est parce que l'organisation de la classe n'est jamais garantie contre une dégénérescence que le rôle des révolutionnaires est de lutter à chaque moment pour l'élimination des positions bourgeoises pouvant se développer en son sein. Et c'est quand ils se trouvent en minorité dans cette lutte que leur tâche est de s'organiser en fraction soit pour gagner l'ensemble de l'organisation aux positions communistes et exclure la position bourgeoise soit, quand cette lutte est devenue stérile de par l'abandon du terrain prolétarien par l'organisation - généralement lors d'un reflux de la classe - de constituer le pont vers une reconstitution du parti de classe qui ne peut alors surgir que dans une phase de remontée des luttes.
Dans tous les cas, le souci qui doit guider les révolutionnaires est celui qui existe au sein de la classe en général. Celui de ne pas gaspiller les faibles énergies révolutionnaires dont dispose la classe. Celui de veiller sans cesse au maintien et au développement d'un instrument aussi indispensable mais aussi fragile que l'organisation des révolutionnaires.
11) Si l'organisation doit s'interdire l'usage de tout moyen administratif ou disciplinaire face à des désaccords, cela ne veut pas dire qu'elle doit se priver de ces moyens en toutes circonstances. Il est au contraire nécessaire qu'elle recourre à de tels moyens, comme la suspension temporaire ou l'exclusion définitive, lorsqu'elle est confrontée à des attitudes, comportements ou agissements qui sont de nature à constituer un danger pour son existence, sa sécurité ou son aptitude à accomplir ses tâches. Cela s'applique à des comportements au sein et en dehors de l'organisation qui seraient incompatibles avec l'appartenance à une organisation communiste.
Par ailleurs, il convient que l'organisation prenne toute disposition nécessaire à sa protection face à des tentatives d'infiltration ou de destruction de la part des organes d'Etat capitalistes ou de la part d'éléments qui, sans être directement manipulés par ces organes, ont des comportements de nature à favoriser leur travail.
Lorsque de tels comportements sont mis en évidence, il est du devoir de l'organisation de prendre des mesures non seulement en faveur de sa propre sécurité, mais également en faveur de la sécurité des autres organisations communistes.
12) Une condition fondamentale de l'aptitude d'une organisation à remplir ses tâches dans la classe est une compréhension correcte en son sein des rapports qui s'établissent entre les militants et l'organisation. C'est là une question particulièrement difficile à comprendre à notre époque, compte tenu du poids de la rupture organique avec les fractions du passé et de l'influence de l'élément estudiantin dans les organisations révolutionnaires après 68 qui ont favorisé la résurgence d'un des boulets du mouvement ouvrier du l9ème siècle : l'individualisme.
D'une façon générale, les rapports qui s'établissent entre les militants et l'organisation relèvent des mêmes principes que ceux évoqués plus haut concernant les rapports entre les parties et le tout.
Plus précisément, il convient d'affirmer sur cette question les points suivants :
-
la classe ouvrière ne fait pas surgir des militants révolutionnaires mais des organisations révolutionnaires : il n’existe pas de rapport direct entre les militants et la classe. Les militants participent au combat de la classe en tant qu'ils deviennent membres et prennent en charge les tâches de l'organisation. Ils n'ont pas de "salut" particulier à conquérir face à la classe ouvrière ou à l'histoire. Le seul "salut" qui leur importe est celui de la classe et de l'organisation dont elle s'est dotée ;
-
le même rapport qui existe entre un organisme particulier (groupe ou parti) et la classe existe entre l'organisation et le militant. Et de même que la classe n'existe pas pour répondre aux besoins des organisations communistes, de même celles-ci n'existent pas pour résoudre les problèmes de l’individu militant. L'organisation n'est pas le produit des besoins des militants. On est militant dans la mesure où on a compris et adhéré aux tâches et à la fonction de l'organisation ;
-
dans cet ordre d'idées, la répartition des tâches et des responsabilités dans l’organisation ne vise pas une "réalisation" des individus-militants. Les tâches doivent être reparties de sorte que l'organisation comme un tout puisse fonctionner de façon optimale. Si l'organisation veille autant que possible au bon état de chacun de ses membres, c'est avant tout dans l’intérêt de l’organisation. Cela ne veut pas dire que soient ignorés l'individualité du militant et ses problèmes, mais signifie que le point de départ et le point d'arrivée sont l'aptitude de l'organisation à accomplir sa tâche dans la lutte de classe ;
-
il n'existe pas dans l'organisation de tâches "nobles" et des tâches "secondaires" ou moins"nobles". Le travail d'élaboration théorique comme la réalisation des tâches pratiques, le travail au sein des organes centraux comme le travail spécifique des sections locales, sont tous aussi importants pour l'organisation et ne sauraient de ce fait être hiérarchisés (c'est le capitalisme qui établit de telles hiérarchies). C'est pour cela qu'est parfaitement à rejeter, comme bourgeoise, l'idée suivant laquelle la nomination d'un militant dans un organe central constituerait pour lui une "ascension", l'accession à un "honneur" ou à un privilège. L'esprit de carriérisme doit être résolument banni de l'organisation comme totalement opposé au dévouement désintéressé qui est l'une des caractéristiques dominantes du militantisme communiste ;
-
s'il existe effectivement, surtout entretenues et renforcées par la société de classes, des inégalités d'aptitude entre individus et entre militants, le rôle de l'organisation n'est pas, à l'image des communautés utopistes, de prétendre les abolir. L'organisation se doit de renforcer au maximum la formation et les aptitudes politiques de ses militants comme condition de son propre renforcement mais elle ne pose jamais le problème en terme d'une formation scolaire individuelle de ses membres, ni d'une égalisation de ces formations. La véritable égalité qui peut exister entre militants est celle qui consiste pour chacun d’eux à donner le maximum de ce qu'ils peuvent donner pour la vie de l'organisation ("de chacun selon ses moyens", formule de Saint -Simon reprise par Marx). La véritable "réalisation" des militants, en tant que militants, consiste à tout faire de ce qui est de leur ressort pour que l'organisation puisse réaliser les tâches pour lesquelles la classe l'a fait surgir ;
-
l'ensemble de ces données signifie que le militant ne fait pas un "investissement" personnel dans l'organisation dont il attendrait des dividendes ou qu'il pourrait retirer s'il est amené à la quitter. Sont donc à proscrire absolument comme totalement étrangères au prolétariat toutes les pratiques de "récupération" de matériel ou de fonds de l'organisation même en vue de constituer un autre groupe politique ;
-
de même, "les rapports qui se nouent entre les militants de l'organisation, s’ils portent nécessairement les stigmates de la société capitaliste ne peuvent être en contradiction flagrante avec le but poursuivi par les révolutionnaires... Ils s'appuient sur une solidarité et une confiance mutuelles qui sont une des marques de l'appartenance de l’organisation a la classe porteuse du communisme. (Plate-forme du CCI, le 23-10-81)
1. Cette affirmation n'est pas seulement à usage interne ; elle ne vise pas uniquement les scissions qui se sont produites (ou pourront encore se produire) dans le CCI. Dans le milieu politique prolétarien, nous avons toujours défendu cette position. Ce fut le cas notamment lors de la scission de la section d'Aberdeen de la "Communist Workers' Organisation" et de la scission du Nucleo Comunista Internazionalista d'avec "Programme Communiste". Nous avions alors critiqué le caractère hâtif des scissions basées sur des divergences apparemment non fondamentales et qui n'avaient pas eu l'occasion d'être clarifiées par un débat interne approfondi. En règle générale, le CCI est opposé aux "scissions" sans principes basées sur des divergences secondaires (même lorsque les militants concernés posent ensuite leur candidature au CCI, comme ce fut le cas d'Aberdeen). Toute scission sur des questions secondaires relève en réalité d'une conception monolithique de l'organisation qui ne tolère aucune discussion ni divergence au sein de celle-ci. C'est le cas typique des sectes.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 34 - 3e trimestre 1983
- 2919 reads
Europe de l'Est : crise économique et armes de la bourgeoise contre le prolétariat
- 3895 reads
La lutte des ouvriers de Pologne est venue montrer de manière éclatante aux yeux du prolétariat mondial que le soi-disant "paradis socialiste" du bloc de l'Est n'était qu'une des facettes de l'enfer capitaliste qui, partout sur la planète, impose le joug de 1 'exploitation de l'homme par l'homme.
Ce mythe des pays "socialistes" a eu la vie dure. C'est que tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale, à 1'Est comme à 1'Ouest, avaient intérêt à son maintien soit comme thème d'embrigadement des ouvriers dans les conflits impérialistes, soit comme moyen de les écoeurer et de les détourner de toute perspective de transformation de la société. Depuis un demi-siècle, les révolutionnaires ont combattu sans relâche cette mystification qui a constitué la meilleure arme de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat mondial à partir des années 20 et a duré jusqu 'aux années 60. Mais, comme le disait Marx, "un seul pas du mouvement réel est plus important qu'une douzaine de programmes". En ce sens, les luttes ouvrières de l'été 80 ont plus fait pour clarifier la conscience du prolétariat international que des décennies de propagande des groupes communistes. Et ce n'est pas fini. Sous les coups de boutoir de la crise économique mondiale, les mystifications bourgeoises se lézardent et s'effondrent, et notamment celle sur la prétendue nature "socialiste" des pays d'Europe de l'Est. Où en est aujourd'hui cette prétendue "prospérité économique" des pays de 1 'Est, ce développement magnifique des forces productives tant chantés par les staliniens et par les trotskystes ? Où en est la situation du prolétariat dans ces "paradis des travailleurs" où il n'y aurait plus d'exploitation, plus de bourgeoisie ? C'est ce que nous abordons dans le premier article qui suit.
Les formidables combats du prolétariat en Pologne n'ont pas constitué seulement une confirmation de ce que les révolutionnaires répétaient depuis des décennies. Ils ont également remis au premier plan "certains problèmes auxquels la pratique n'a pas encore donné de réponse décisive, bien qu'ils se soient posés depuis longtemps sur le plan théorique", comme nous 1'écrivions dans la "Revue Internationale" n° 27 (4ème trimestre 81). Parmi ces problèmes nous signalions, dans cet article, "la nature des armes bourgeoises que la classe ouvrière devra affronter dans les pays du bloc russe" et plus précisément, la contradiction existant entre, d'un côté, la nécessité pour la classe dominante d'utiliser comme en Occident, une gauche dans 1'opposition ayant pour tâche de saboter de 1'intérieur les luttes ouvrières et, de 1'autre côté, 1'incapacité de ces régimes à tolérer une opposition organisée.
L'instauration de l'état de guerre en décembre 81 et l'interdiction officielle de "Solidarnosc" en octobre 82 ont permis d'apporter plus d'éléments sur cette question. Ce sont ces éléments que nous donnons dans le second article ci-dessous.
CRISE DU CAPITAL ET OFFENSIVE CONTRE TES TRAVAILLEURS
L’enfoncement du bloc de l'est dans la crise capitaliste
Pour n'importe quelle entreprise capitaliste, le fait de ne plus pouvoir payer ses dettes signifie la faillite. Même si certains Etats ne peuvent fermer leur porte comme ils ferment les entreprises, l'incapacité de la Pologne et de la Roumanie à rembourser les dettes contractées sur le marché mondial auprès des banques occidentales montre la faillite économique du capitalisme à l'Est au même titre que la situation similaire du Mexique ou du Brésil le montre à l'Ouest. Ces dernières années, l'endettement des pays du bloc russe s'est considérablement aggravé atteignant des sommes vertigineuses :
- en Pologne, la dette de plus de 25 milliards de dollars représente le tiers du Produit National Brut annuel ;
- en Roumanie, la dette de 10 milliards de dollars représente aussi le tiers du PNB.
Comme sa consoeur occidentale, la bourgeoisie du bloc de l'Est a, durant les années 70, fui en avant avec le recours au crédit pour tenter de masquer et de retarder les échéances économiques d'un effondrement de la production. Pourtant, les dettes se payent toujours, et la tricherie par rapport à la loi de la valeur trouve ses limites aujourd'hui. Comme à l'Ouest, le capitalisme à l'Est est entré dans la récession.
Il est bien difficile d'accorder une confiance absolue aux chiffres officiels fournis par la bourgeoisie ; cela est vrai de manière générale, et en Russie plus qu'ailleurs. Cependant, ces chiffres, dans leur évolution, correspondent tout à fait à ce qui se passe en Occident. Pour 1982, la croissance du revenu national sera officiellement de 2%, taux le plus bas jamais atteint et en constante régression depuis plusieurs années. Il faudrait que ce taux soit doublé pour pouvoir réaliser le plan quinquennal ambitieux décidé sous l'égide de Brejnev. La croissance industrielle a été la plus faible depuis la guerre : en 82, la production de produits sidérurgiques, de ciment, de matières plastiques a diminué par rapport aux années précédentes.
Endettement, récession, à ce tableau il ne manque plus que l'inflation pour que l'on retrouve les mêmes caractéristiques fondamentales de la crise capitaliste telle qu'elle se manifeste à l'Ouest. Eh bien cette inflation existe aussi à l'Est ! Sans parler de l'inflation des prix à la consommation, sur laquelle nous reviendrons, la hausse moyenne des prix de gros dans l'ensemble de l'industrie serait de 13,4% dont 42% pour le charbon, 20% pour les produits sidérurgiques, 70% pour 1'énergie thermique ([1] [429]) .
Les mêmes phénomènes sont donc à l'oeuvre, à l'Est comme à l'Ouest, la crise économique mondiale accélère ses effets dévastateurs sur la production capitaliste. Le bloc de l'Est, beaucoup plus faible économiquement, subit encore plus durement l’effet de la crise. Le PNB de l'URSS par habitant est inférieur à celui de la Grèce, celui de la RDA, pays le plus développé du bloc russe, et à peu près égal à celui de l'Espagne. Le bloc russe, économiquement sous-développé,n'a aucune chance, dans une période de surproduction mondiale, de parvenir à une quelconque compétitivité économique ; il éprouve les plus grandes difficultés à vendre ses marchandises sur le marché mondial. Cette situation n'est pas nouvelle pour l'URSS et son bloc, arrivés trop tardivement sur la scène capitaliste mondiale ; il est bien loin le mythe du rattrapage de l'Occident tant mis en avant par Staline et Kroutchev ! L'heure est à une crise économique qui met à nu tous les mensonges, qui montre toutes les faiblesses du capitalisme russe et de ses satellites.
Dans ces conditions se trouve accentuée la tendance qui a permis au bloc russe de survivre depuis son origine : la concentration de plus en plus forte de l'économie entre les mains de l'Etat au service de l'économie de guerre.
L'ACCROISSEMENT DE L'ECONOMIE DE GUERRE
Dans la mesure où le bloc de l'Est ne peut rivaliser économiquement avec le bloc occidental, la seule façon qu'il a de maintenir sa place sur la scène mondiale est de développer son économie de guerre, de mobiliser tout son appareil productif pour la production militaire. En URSS, ce phénomène existe depuis Staline, mais, ces dernières années, il s'est encore accentué.
Face à la pression économique et militaire de l'Occident, l'URSS n'a d'autre choix que de sacrifier toujours plus son économie au profit de l'économie de guerre.
Prenons un exemple : le secteur des transports est un des points noirs du capitalisme russe, paralysant l'ensemble de l'activité économique. La pénurie de moyens est la première cause de la défaillance du secteur des transports ; pourtant, en 82 ont été produits à peine plus de wagons qu'en 70. Cela peut sembler paradoxal alors que les 4/5 des transports terrestres sont réalisés sur le réseau ferroviaire. On comprend mieux ce qui se passe lorsqu'on sait que la production de wagons a été sacrifiée pour donner la priorité à la satisfaction des besoins militaires (la principale usine de wagons, à Niznij Taghil, construisant également des chars).
Ce qui est vrai pour les wagons est vrai pour tous les secteurs de l'économie russe; pour toutes les usines, la priorité absolue est donnée à la production d'armements, ce qui entrave toutes les autres productions.
Contrairement aux biens d'équipement qui sont utilisés dans un nouveau cycle productif ou aux biens de consommation qui servent à la reproduction de la force de travail, les armes n'ont aucune utilité dans le procès de production. De ce fait, leur production massive équivaut à une gigantesque destruction de capital qui ne peut qu'accentuer toujours plus les effets de la crise.
L'URSS à elle seule réalise 40% de la production militaire mondiale alors qu'elle ne produit que 10% du produit mondial brut. Ce pays ne peut maintenir sa place sur la scène mondiale qu'au prix d'un effort militaire toujours plus important qui renforce toujours plus la banqueroute économique.
Il est difficile de trouver des chiffres exacts, le domaine militaire étant par définition celui du secret. Selon la "Military balance", les dépenses militaires de l'URSS seraient équivalentes au PNB de l'Espagne (1000 milliards de Francs) ; ce qui signifie que chaque année, c'est la production d'un pays comme l'Espagne qui est détruite en URSS dans l'économie d'armement, sans compter le coût de la désorganisation de l'économie qui en résulte, c'est-à-dire 20 ou 30% de la production, au bas mot.
Pour le prolétariat du bloc russe, le choix "du beurre ou des canons" prend caricaturalement tout son sens. Les effets conjugués de la crise et de l'économie de guerre signifient pour la classe ouvrière une misère sans cesse accrue au "paradis des travailleurs".
L'AUSTERITE POUR LA CLASSE OUVRIERE
L'absence officielle d'inflation et le plein emploi ont toujours été parmi les arguments principaux des staliniens et des trotskystes pour affirmer que les travailleurs des pays de l'Est bénéficient d'"acquis socialistes". Pourtant, c'est bien un euphémisme de parler d'austérité pour la classe ouvrière dans les pays dits "socialistes". La misère de la situation économique et sociale de la classe laborieuse dans ces pays n'est plus à démontrer et l'attaque menée aujourd'hui par la bourgeoisie de ces pays contre le niveau de vie des ouvriers signifie encore plus d'austérité dans l'austérité.
La bourgeoisie russe elle-même ne peut plus masquer la réalité derrière des chiffres truqués. Officiellement, en URSS, 1982 n'aura pas marqué une progression du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Les augmentations en cascades des prix montrent que l'absence d'inflation dans les pays de l'Est est un mythe qui a fait son temps. Ce sont bien les augmentations brutales du prix des denrées de base nécessaires à la survie des ouvriers qui ont provoqué l'explosion de mécontentement en Pologne avec des tarifs qui grimpaient jusqu'à 100% pour certains produits. Le niveau de vie de la classe ouvrière a été attaqué brutalement ; comme en Occident, l'inflation des prix à la consommation est présente avec en plus, pour l'essentiel des produits, une pénurie et un rationnement draconiens. (Xiand on produit toujours plus de canons, il y a toujours de moins en moins de beurre.
Quant au plein emploi, il existe réellement. Mais il n'est pas le produit d'une quelconque générosité de la classe dominante qui ne voudrait pas laisser ses pauvres ouvriers au chômage. Ce plein emploi n'est que l'expression de la pénurie de capital, de l'absence de machines et de la paralysie de l'appareil productif. Tout le capital qui n'est pas investi dans le capital constant et qui est détruit dans la production de machines de guerre est remplacé par le "capital humain". L'huile de coude remplace l'huile de machine. De plus, le niveau de vie est si faible que la plupart du temps les ouvriers sont tenus d'avoir deux emplois, de faire une double journée de travail pour assurer leur survie et celle de leur famille.
Le plein emploi est aussi un moyen d'assurer une surveillance draconienne du prolétariat. L'arrivée d'Andropov au pouvoir s'est concrétisée par une surveillance accrue sur les lieux de travail :
pointeuses, contrôles d'identité et de présence, opérations "coup de poing" dans les magasins pour voir si les ouvriers ne font pas leurs achats durant les heures de travail etc..., toutes choses bien dans la ligne policière de cet ancien chef du KGB. Tout cela au non de la lutte pour la productivité, contre l'absentéisme et le laisser-aller. La discipline du travail est un thème aujourd'hui martelé par la propagande de l'Etat russe et qui marque une répression accrue contre la classe ouvrière.
Comme dans les pays occidentaux, les années 80 sont marquées en Europe de l'Est par une attaque sévère contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Si les formes changent (plein emploi policier, pénurie, rationnement) le fond reste le même : crise du capitalisme, économie de guerre ; et les conséquences pour la classe ouvrière sont les mêmes dans les deux blocs : une misère sans cesse accrue.
Face à cette situation, les ouvriers de Pologne ont montré l'exemple de la lutte de classe. Cet exemple ne saurait rester sans lendemain. A l'Est comme à l'Ouest, la bourgeoisie, sous la pression de la crise, est amenée à attaquer toujours plus durement la classe ouvrière.
Une telle situation généralisée à toute la planète ne peut que pousser le prolétariat au développement de la lutte de classe.
J.J.
LES ARMES DE LA BOURGEOISIE CONTRE LE PROLETARIAT
Les luttes prolétariennes de 1980-81 en Pologne n'ont pas surpris les révolutionnaires. Ceux qui, contre les reniements et les attaques de tous bords, ont maintenu une défense ferme des principes marxistes savaient et disaient depuis des décennies que les pays soi-disant "socialistes" étaient aussi capitalistes que tous les autres, que leur économie était soumise aux mêmes contradictions qui assaillent l'ensemble du capitalisme, que dans ces pays la classe ouvrière est exploitée autant qu'ailleurs et qu'elle lutte comme partout contre son exploitation. Ils ont compris et ont dit à leur classe que, depuis le milieu des années 60, le capitalisme mondial, ayant épuisé le répit que lui avait donné la reconstruction du second après-guerre, entrait dans une nouvelle phase de convulsions économiques aiguës qui n'épargnerait aucun pays et qui, partout provoquerait des réponses prolétariennes. Ils surent reconnaître dans la grève générale de Mai 68 en France, dans 1'"automne chaud" italien de 69, dans les soulèvements de 70 en Pologne et dans de multiples autres mouvements entre 68 et 74 les premières de ces réponses et purent prévoir que ces luttes ne seraient pas sans lendemain.
Cependant, si l'immense mouvement de 1980 constituait une confirmation des analyses des révolutionnaires, il leur imposait de faire preuve de prudence et d'humilité face à des situations différentes de tout ce que nous avions connu jusqu'à présent. En ce sens, tout en analysant le développement du syndicat indépendant "Solidamosc" came étant la forme prise en Pologne de la politique de gauche dans l'opposition déployée à l'échelle mondiale par la bourgeoisie pour saboter et étouffer les luttes ouvrières, nous nous gardions bien d'annoncer que les pays de l'Est allaient connaître une évolution politique vers les formes démocratiques telles qu'elles existent dans les pays avancés d'Occident.
".. les affrontements entre Solidarité et le POUP ne sont pas uniquement du cinéma, comme n'est pas uniquement du cinéma l'opposition entre droite et gauche dans les pays occidentaux. En Occident, cependant, le cadre institutionnel permet, en général, de "gérer" ces oppositions afin qu'elles ne menacent pas la stabilité du régime et que les luttes pour le pouvoir soient contenues et se résolvent dans la formule la plus appropriée pour affronter l'ennemi prolétarien. Par contre, si, en Pologne même, la classe dominante est parvenue, avec beaucoup d'improvisation mais momentanément avec succès, à instaurer des mécanismes de ce style, rien ne dit qu'il s'agisse d'une formule définitive et exportable vers d'autres pays "frères". Les mêmes invectives qui servent à crédibiliser un partenaire adversaire quand celui-ci est indispensable au maintien de 1'ordre peuvent accompagner son écrasement quand il n'est plus utile. "En la contraignant à un partage des tâches auquel la bourgeoisie d'Europe de l'Est est structurellement réfractaire, les luttes prolétariennes de Pologne ont créé une contradiction vivante. Il est encore trop tôt pour prévoir comment elle se résoudra. Face à une situation historiquement inédite, la tâche des révolutionnaires est de se mettre modestement à l'écoute des faits" (Revue Internationale n° 27, 3/10/81).
Depuis, les faits ont parlé. Le coup de force du 13 décembre 81 a suspendu toutes les activités du syndicat "Solidarité". La décision de la "Diète" (Parlement) polonaise du 8 octobre 1982 l'a définitivement interdit. Comment interpréter ces faits? Cette interdiction est-elle révocable comme le prétendent les dirigeants de "Solidarité" clandestine qui, à côté de déclarations au ton radical, continuent à en appeler à l'entente nationale" et à la "liberté syndicale" ?
Les régimes de l'Est peuvent-ils employer contre la classe ouvrière les mêmes armes "démocratiques" crue ceux d'Occident.
LES REGIMES DE L'EST PEUVENT-T-ILS SE "DEMOCRATISER"
Les 15 mois d'existence légale de "Solidarité" ont semblé donner une réponse positive à cette question. C'était la période où Kuron, le théoricien du KOR, pouvait pérorer sur la perspective d'une démocratisation de la Pologne suivant la "voie espagnole". Cette perspective était au centre de toute la propagande de "Solidarité" : il s'agissait de savoir faire des "sacrifices" sur le plan économique, de ne pas "abuser" de l'arme de la grève, de se montrer "responsable" et "modéré" afin de préserver et d'élargir les "acquis démocratiques" des accords de Gdansk.
Depuis, l'histoire a montré que cette "modération" n'avait nullement favorisé la "démocratie" mais qu'elle avait, par contre, fait le lit de la défaite ouvrière et de la répression qui s'est abattue sur les travailleurs à partir de décembre 1981.
En fait, si l'instauration de l'état dé guerre concrétisait cette défaite, sa signification allait au-delà. Elle visait, comme toutes les répressions, à infliger une punition cuisante au prolétariat, à l'intimider, à lui ôter, par la terreur, le goût de la lutte. Mais elle visait également à mettre hors-la-loi le syndicat "Solidarité", c'est-à-dire le principal agent de la démobilisation et de la défaite ouvrière.
Depuis sa reprise historique de 1968, le prolétariat mondial a subi d'autres défaites que celle de Pologne en 81. En particulier, l'épreuve de force de Mai 68 en France entre la classe ouvrière et la bourgeoisie s'était conclue par une victoire de cette dernière. Les principaux instruments de cette victoire furent, on le sait, les syndicats et notamment la CGT contrôlée par le PCF. Et, fort logiquement, les syndicats furent récompensés de leur action par la reconnaissance de la part du patronnât de la section syndicale d'entreprise, la CGT ayant droit à un petit cadeau supplémentaire sous la forme du rétablissement d'une subvention gouvernementale qui lui avait été retirée quelques années auparavant. En Pologne, par contre, "Solidarité" n'a eu droit à aucune récompense pour ses bons et loyaux services de 1980-81. Au contraire, ses principaux dirigeants furent emprisonnés et, si le plus célèbre d'entre eux est maintenant en liberté et a retrouvé son travail, il en reste encore de nombreux dans les geôles de Jaruzelski tels Gwiazda, Jurczyk, Modzelewski, Rulewski en compagnie des dirigeants du KOR comme Kuron et Michnick. Est-ce à dire que la bourgeoisie de l'Est serait plus ingrate que celle d'Occident ? Ce n'est certainement pas une question de gratitude. Il y a belle lurette, qu'en Occident même, la bourgeoisie s'est départie de ce type de sentiment "pour ne laisser subsister d'autre lien entre 1'homme et 1'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant... qu'elle a noyé tout cela dans l'eau glaciale du calcul égoïste" ("Le manifeste Communiste"). En fait, la raison majeure pour laquelle les autorités polonaises n'ont pas, à l'opposé de leurs consoeurs occidentales, laissé subsister une opposition officielle ou légale c'est que "le régime stalinien ne peut tolérer sans dommage ni danger 1'existence de telles forces d'opposition*dans la mesure où celles-ci constituent "un corps étranger... que rejettent toutes les fibres de son organisme" (Revue Internationale n° 24, 4/12/81).
En effet, si on ne peut comprendre la nature et la portée des événements survenus en Pologne ces trois dernières années qu'en les replaçant dans leur contexte international, qu'en les considérant comme un moment -important- de l'affrontement historique qui oppose à l'échelle mondiale les deux principales classes de la société -le prolétariat et la bourgeoisie- on ne peut tirer tous leurs* enseignements si on ne tient pas compte des différences qui distinguent les conditions de la lutte de classe existant à l'Est de celles que l'on connaît dans les pays avancés d'Occident.
LE CAPITALISME D'ETAT DANS LES PAYS DE L'EST : L'ECONOMIE...
La caractéristique la plus évidente, la plus généralement connue des pays de l'Est, celle sur laquelle repose d'ailleurs le mythe de leur nature "socialiste", réside dans le degré extrême d'étatisation de leur économie.
Comme nous l'avons souvent mis en évidence dans nos publications, le capitalisme d'Etat n'est pas un phénomène propre à ces pays. C'est un phénomène qui relève avant tout des conditions de survie du mode de production capitaliste dans la période de décadence : face aux menaces de dislocation d'une économie et d'un corps social soumis à des contradictions croissantes, face à 1'exacerbation des rivalités commerciales et impérialistes que provoque la saturation générale des marchés, seul un renforcement permanent de la place de l'Etat dans la société permet de maintenir un minimum de cohésion de celle-ci et d'assumer sa militarisation croissante. Si la tendance au capitalisme d'Etat est donc une donnée historique universelle, elle n'affecte cependant pas de façon identique tous les pays. Elle prend ses formes les plus extrêmes là où le capitalisme connaît ses contradictions les plus brutales, où la bourgeoisie classique est la plus faible. En ce sens, la prise en charge directe par l'Etat de l'essentiel des moyens de production qui caractérise le bloc de l'Est (et dans une large mesure, le Tiers-Monde) est en premier lieu une manifestation de l'arriération et de la fragilité de son économie (cf. l'article précédent). Dans la mesure même où la tendance au capitalisme d'Etat est une donnée mondiale irréversible, où, d'autre part, les convulsions présentes de l'économie capitaliste atteignent les pays arriérés encore plus violemment que les autres, il n'existe aucune possibilité pour que se relâche dans ces pays -et notamment ceux du bloc de l'Est- une étatisation de l'économie qui, partout, se renforce y compris dans les pays les plus développés.
La question "les pays de l'Est peuvent-ils se démocratiser ?" trouve donc un premier élément de réponse dans la constatation du fait que tout retour vers des formes classiques du capitalisme est impossible dans ces pays. En effet, il existe un lien étroit entre les formes de domination économique de la bourgeoisie et les formes de sa domination politique : à l'étatisation presque complète des moyens de production correspond le pouvoir totalitaire d'un parti unique ([2] [430]).
... LE PARTI UNIQUE ...
Le régime de parti unique n'est pas propre aux pays de l'Est ni à ceux du Tiers-Monde. Il a existé durant des décennies dans des pays d'Europe occidentale comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal. L'exemple le plus marquant est évidemment celui du régime nazi qui dirige entre 1933 et 1945 le pays le plus développé et puissant d'Europe. En fait, la tendance historique vers le capitalisme d'Etat ne comporte pas seulement un volet économique. Elle se manifeste également par une concentration croissante du pouvoir politique entre les mains de l'exécutif au détriment des formes classiques de la démocratie bourgeoise, le Parlement et le jeu des partis. Alors que, dans les pays développés du 19ème siècle, les partis politiques étaient les représentants de la société civile dans ou auprès de l'Etat, ils se transforment, avec la décadence du capitalisme, en représentants de l'Etat dans la société civile ([3] [431]). Les tendances totalitaires de l'Etat s'expriment, y compris dans les pays où subsistent les rouages formels de la démocratie, par une tendance au parti unique qui trouve ses concrétisations les plus nettes lors des convulsions aiguës de la société bourgeoise : "Union Nationale" lors des guerres impérialistes, rassemblement de toutes les forces bourgeoises derrière les partis de gauche dans les périodes révolutionnaires, prééminence massive et de longue durée du Parti Démocrate aux USA entre 1933 et 1953, du parti gaulliste en France de 1958 à 1974, de la Social-Démocratie en Suède de 1931 à 1977, etc.
La tendance au parti unique trouve rarement son achèvement complet dans les pays les plus développés. Les USA, la Grande Bretagne, les Pays Bas, la Scandinavie n'ont jamais connu un tel achèvement. Lorsque ce fut le cas en France, sous le régime de Vichy, c'était essentiellement lié à l'occupation du pays par l'armée allemande. Le seul exemple historique d'un pays pleinement développé où cette tendance soit parvenue à son terme est celui de l'Allemagne. Et cela n'a duré que 12 années, c'est-à-dire huit de moins que la domination démocrate aux USA. Le phénomène fasciste a été amplement analysé depuis les années 30 par la gauche communiste et dans de précédents numéros de la Revue Internationale ([4] [432]) . Aussi ne donnons, nous ici qu'un résumé succinct des causes de l'accession au pouvoir du parti nazi :
- la violence des convulsions économiques (l'Allemagne est le pays d'Europe le plus touché par la crise de 1929) ;
- l'écrasement physique de la classe ouvrière lors de la révolution de 1919-1923 rendant inutiles et inefficaces les mystifications démocratiques ;
- l'usure des partis "démocratiques" qui ont assumé cette contre-révolution ;
- la frustration ressentie, après la paix de Versailles, par des secteurs importants de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie qui se sont détachés de leurs partis traditionnels au bénéfice de celui qui leur promettait la revanche.
Si, dans les autres pays avancés, les structures politiques et les partis traditionnels se sont maintenus, c'est qu'ils se sont révélés suffisamment solides du fait de leur implantation ancienne, de leur expérience, de leur lien avec la sphère économique, de la force des mystifications qu'ils colportaient, pour assurer la stabilité et la cohésion du capital national face aux difficultés qu'ils ont affrontées crise, guerre, luttes sociales).
Mais ce qui n'existe qu'à l'état d'exception dans les pays les plus développés est la règle dans les pays arriérés dans la mesure où il n'existe aucune des conditions qu'on vient d'énumérer et où ces pays sont ceux qui subissent le plus violemment les convulsions de la décadence capitaliste. Dans le lot des pays arriérés, ceux de l'Est occupent une place particulière. Aux facteurs directement économiques expliquant le poids qu'y occupe le capitalisme d'Etat se superposent des facteurs historiques et géopolitiques : les circonstances de la constitution de l'URSS et de son empire.
L'Etat capitaliste en URSS se reconstitue sur les décombres de la révolution prolétarienne. La faible bourgeoisie de l'époque tsariste a été complètement éliminée par la révolution de 1917 (c'est d'ailleurs sa faiblesse qui explique le fait que la Russie soit le seul pays où le prolétariat a réussi à prendre le pouvoir lors de la vague révolutionnaire du premier après-guerre) et par l'échec des armées blanches. De ce fait, ce n'est ni elle, ni ses partis traditionnels qui prennent en charge en Russie même l'inévitable contre-révolution résultant de la défaite de la révolution mondiale.
Cette tâche est dévolue à l'Etat qui a surgi après la révolution et qui a rapidement absorbé 3e parti bolchevik qui avait commis la double erreur de se substituer à la classe ouvrière et de s'attribuer des responsabilités étatiques ([5] [433]). Par ce fait, la classe bourgeoise s'est reconstituée non à partir de l'ancienne bourgeoisie (sinon de façon exceptionnelle et individuelle) ni à partir d'une propriété individuelle des moyens de production, mais à partir de la bureaucratie du parti-Etat et de la propriété étatique de ces moyens de production. En URSS, le cumul des facteurs : arriération du pays, débandade de la bourgeoisie classique, écrasement physique de la classe ouvrière (la contre-révolution et la terreur qu'elle subit étant à la mesure de son avancée révolutionnaire), ont donc amené la tendance universelle au capitalisme d'Etat à ses formes les plus extrêmes : l'étatisation presque complète de l'économie, la dictature totalitaire du parti unique. N'ayant plus à discipliner les différents secteurs de la classe dominante ni à composer éventuellement avec les intérêts économiques de ceux-ci, puisqu'il a complètement absorbé la classe dominante, qu'il s'est confondu totalement avec elle, l'Etat a pu donc se passer définitivement des formes politiques classiques de la société bourgeoise (démocratie et pluralisme) y compris comme fiction ([6] [434]).
... LA DOMINATION IMPERIALISTE . . .
A la fin de la seconde guerre mondiale, lorsque l'URSS étend son empire vers l'Europe centrale et, rnomentanément, vers la Chine, elle exporte son modèle économique et politique. Cela n'a rien à voir, évidemment, avec l'idéologie comme le prétendent les bourgeois bornés d'Occident.
La raison pour laquelle l'URSS installe dans ses pays satellites des régimes comme le sien tient fondamentalement dans sa faiblesse en tant que tête de bloc impérialiste, faiblesse qui s'exprime d'abord sur le plan économique. Alors que les USA sont en mesure de renforcer leur suprématie sur l'Europe occidentale grâce aux dollars du plan Marshall, l'URSS n'a d'autre moyen de garantir son emprise sur les zones qu'elle occupe militairement qu'en portant au pouvoir des partis qui lui sont dévoués corps et âme : les partis "communistes". Cette dévotion ne signifie pas que les partis staliniens sont de simples agences de l'impérialisme russe : tous les partis bourgeois sont avant tout des partis du capital national. Ce qui les distingue c'est la façon dont ils entendent gérer ce capital national, dont ils entendent assurer sa sécurité extérieure dans une arène mondiale dominée par deux blocs impérialistes. En tant que représentants les plus déterminés de la tendance générale au capitalisme d'Etat, les partis staliniens sont, dans l'éventail politique de leurs pays respectifs, les plus favorables à leur insertion dans le bloc dominé par l'URSS. Cette orientation en politique extérieure est liée au fait que ces partis ne peuvent accéder au pouvoir que par la force des armes, en général au sein d'un conflit impérialiste. En effet, partis capitalistes par excellence, les partis staliniens ont comme particularité de n'avoir aucun soutien de la part des secteurs classiques de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie (tant les gros et les petits détenteurs individuels de moyens de production que les membres des professions libérales) dans la mesure où leur programme comporte l'expropriation de ces secteurs au bénéfice de l'Etat. S'ils peuvent dans certains pays, compter sur le soutien d'une partie du prolétariat, ils n'ont pas la possibilité d'en faire un usage bien important puisque le prolétariat, privé de tout moyen de production, ne constitue une force réelle dans la société que par la lutte sur son terrain de classe, c'est-à-dire une lutte qui met potentiellement en question la domination de tous les secteurs de la bourgeoisie et de tous ses partis. Les partis staliniens ont pu utiliser des luttes ouvrières pour faire pression sur d'autres secteurs de la bourgeoisie (comme en 1947 en France, lorsque le PCF, chassé du gouvernement en Mai, espère obtenir son retour à la faveur des grandes grèves qui se poursuivent jusqu'à la fin de l'année). Mais ils n'ont jamais encouragé ces luttes au renversement du gouvernement en place : en dernier ressort, la solidarité de la classe bourgeoise a toujours été la plus forte. C'est pour cela que les circonstances les plus favorables à l'accession au pouvoir de ces partis ont été celles :
- où la classe ouvrière était faible, défaite ou embrigadée (ce dernier cas englobant évidemment les précédents) ;
- où ils ont pu se faire valoir comme les meilleurs défenseurs du capital national, ce qui leur a permis de faire alliance avec d'autres secteurs bourgeois qu'ils ont ensuite éliminés ;
- où ils ont bénéficié de l'aide directe ou indirecte de la force militaire de l'URSS.
Ces circonstances se sont présentées dans et à la suite de la seconde guerre mondiale pour laquelle ils ont été les meilleurs sergents recruteurs dans le cadre des mouvements de "résistance" (sauf en Pologne où l'A.K. dirigée de Londres était beaucoup plus puissante que le mouvement dirigé de Moscou) et où ils ont pu, dans la plupart des cas, s'appuyer sur la présence de l'armée "rouge". De telles circonstances se sont présentées également dans certaines guerres de décolonisation ou "d'indépendance nationale" (notamment en Chine et en Indochine) ou tout simplement à l'occasion de coups d'Etat militaires (Ethiopie, Afghanistan, ..».).
En fait, la grande aptitude des partis staliniens à employer les moyens militaires, à diriger ou à constituer eux-mêmes des armées, s'explique par le caractère ultra militarisé de leur structure et de la forme de capitalisme dont ils sont les agents. La tendance historique au capitalisme d'Etat trouve une de ses sources et s'exprime dans la militarisation de la société. Les partis qui prennent en charge de façon la plus déterminée cette tendance ne sont jamais autant à la fête que lorsqu'il s'agit de caporaliser et d'encaserner, d'aboyer des ordres,.de faire régner la soumission aveugle à l'autorité et à la hiérarchie par l'abrutissement , la terreur, les prisons, les juridictions d'exception, les pelotons d'exécution, de cultiver le chauvinisme et la xénophobie, bref de réaliser toutes ces choses magnifiques qui font la grandeur de l'institution militaire.
En fin de compte, le fait que l'URSS, qui est un des pays les moins développés de son bloc, ne puisse maintenir son emprise sur celui-ci que par la force armée détermine le fait que ses satellites soient dotés de régimes qui, tout comme le sien, ne peuvent maintenir leur emprise sur la société que par la même force armée (police et institution militaire). D'une certaine façon, il existe le même type de liens entre l'URSS et les pays de son bloc qu'entre les USA et les "républiques bananières" d'Amérique latine : les régimes de ces derniers pays sont vomis par la majorité de la population et ne tiennent en place que par l'aide militaire indirecte ou directe des USA. En échange, les USA peuvent compter sur une fidélité à toute épreuve de ces régimes à l'égard de leurs intérêts économiques et militaires. Cependant, ce type de contrôle des USA sur leur bloc n'est que marginal. Pays de loin le plus développé de celui-ci, première puissance économique et financière du monde, les USA s'assurent leur domination sur les principaux pays de leur empire, qui sont également des pays pleinement développés, sans faire appel à tout bout de champ à la force militaire de la même façon que ces pays n'ont pas besoin de la répression permanente pour assurer leur stabilité. Il est clair que les blocs impérialistes sont avant tout des blocs militaires. Le principal pilier du bloc américain est la puissance militaire des USA, la première du monde. Mais cette puissance militaire n'est pas mise à contribution pour maintenir la domination américaine sur ces pays ou leur stabilité interne, ni de façon directe (comme ce fut le cas en Hongrie en 56, en Tchécoslovaquie en 68) nr comme moyen d'intimidation des populations (Pologne 80-81). C'est de façon "volontaire" que les secteurs dominants des principales bourgeoisies occidentales adhèrent à l'alliance américaine : ils y trouvent des avantages économiques, financiers, politiques et militaires (le parapluie américain face à l'impérialisme russe). En ce sens, il n'existe pas parmi les principaux pays du bloc US de "propension spontanée" à passer dans l'autre bloc comme on a pu le constater dans l'autre sens (changement de camp de la Yougoslavie en 48, de la Chine à la fin des années 60, tentatives de la Hongrie en 56, de la Tchécoslovaquie en 68). La force et la stabilité des USA leur permet de 3 ' accommoder de l'existence de toutes les formes de régimes au sein de leur bloc : du régime "communiste" chinois au très "anti-communiste" Pinochet, de la dictature militaire turque à la très "démocratique" Angleterre, de la république française bicentenaire à la monarchie féodale saoudienne, de l'Espagne franquiste à l'Espagne social-démocrate. Par contre, la faiblesse et l'arriération économique de l'URSS ne lui permet de contrôler que des régimes staliniens ou militaires. De ce fait :
- si un régime stalinien peut toujours envisager de "passer à l'Ouest" sans qu'il soit remis en cause à l'intérieur de ses frontières, un régime "démocratique" court les plus grands risques pour sa survie comme telle en "passant à l'Est" ,
- si le bloc américain peut parfaitement "gérer" la " démocratisation" d'un régime fasciste ou militaire quand cela devient utile (Japon, Allemagne, Italie, au lendemain de la guerre ; Portugal, Grèce, Espagne, dans les années 70), l'URSS ne peut s'accommoder d'aucune "démocratisation" au sein de son bloc.
UNE "DEMOCRATISATION" IMPOSSIBLE
Ainsi la "voie espagnole" préconisée par Kuron est aussi absurde que la prétention de Walesa de faire de la Pologne un "deuxième Japon". C'est un double non-sens :
1°) malgré l'importance du secteur étatisé en Espagne, la bourgeoisie classique conservait le contrôle de secteurs décisifs du capital national : le changement de régime n'affectait nulle ment ce partage ni les privilèges d'aucun secteur de la classe dominante et cela quelles que fussent les forces politiques qui pourraient diriger l'Etat (Centre ou Social-démocratie) ; par contre, toute "démocratisation" en Pologne signifierait la perte immédiate des pouvoirs et privilèges de l'actuelle bourgeoisie dans la mesure où celle- ci se confond avec la sphère dirigeante du parti, où tous ces pouvoirs et privilèges découlent de la domination complète du parti sur l'Etat, de la fusion ce ces deux institutions ([7] [435]), et où des élections "libres" ne donneraient qu'un nombre insignifiant de voix au parti (celles de ses membres , et encore)
2°) le bloc américain, de façon prudente, systématique et coordonnée (notamment avec la collaboration étroite de la social-démocratie allemande et du président français Giscard) a pris en charge la "transition démocratique" à la mort de Franco ; cette prise en charge s'est effectuée sans problèmes pour ses protagonistes : il s'agissait simplement d'aligner les structures politiques espagnoles sur celles existant déjà dans les pays avancés d'Occident, les gouvernements de ces pays pouvant même toucher des dividendes de cette opération auprès de leurs "opinions publiques" traditionnellement hostiles au franquisme ; par contre, on ne voit pas comment l'URSS pourrait contrôler un tel processus dans son glacis : même si les éventuelles forces "démocratiques" de remplacement s'engageaient fermement à "respecter les alliances traditionnelles", leur arrivée et leur maintien au pouvoir dans un des pays d'Europe de l'Est donneraient le signal de processus similaires dans les autres pays où la très grande majorité de la population aspire à de tels changements ; on assisterait alors à une réaction en chaîne qui déstabiliserait l'ensemble du bloc et le régime en URSS même : non seulement ce régime (le plus "dur" de son bloc) ne pourrait servir "d'exemple" mais il serait gravement compromis par "l'exemple" d'une "démocratisation" venant de ses vassaux.
Si, donc, le bloc de l'Est ne peut, en aucune façon ,3faccommoder d'une quelconque "voie espagnole" à la "démocratisation", il ne peut s'accommoder davantage d'une formule intermédiaire comme celle qui s'était établie en Pologne à partir de septembre 80. En effet, bien que "Solidarnosc" ait été depuis le début un défenseur inconditionnel du capital national, un ennemi indiscutable du prolétariat dont la fonction .et la préoccupation essentielles étaient de saboter les luttes ouvrières, bien que ce syndicat n'ait prétendu à aucun moment disputer le pouvoir central au parti ni remettre en question la place de la Pologne dans le bloc russe, il était porteur d'un programme parfait rendent incompatible avec le régime stalinien. C'est avant tout pour déboussoler les ouvriers que "Solidarité" avait mis en avant ses revendications d'une "République Autogérée" où le pouvoir serait soumis au contrôle de la société "au niveau des entreprises, des communes et des voïvodies, où il y aurait une "Diète démocratiquement élue", des tribunaux indépendants", où la "culture, l'instruction et les média seraient au service de la société (Programme de "Solidarnosc"). Mais, ces revendications, maintenues de façon durable par une organisation de 9 millions de membres et dans laquelle se reconnaissaient 90% de la population, constituaient une menace pour un régime et un bloc aussi fragiles et rigides que ceux de 1'Est.
Dans les pays avancés d'Occident, les secteurs dominants de la bourgeoisie peuvent tolérer l1existence dans leur jeu politique, et bien qu’ils fassent tout leur possible pour les affaiblir au bénéfice de la social-démocratie, des partis staliniens dont le programme comporte pourtant l'élimination de ces secteurs. Ayant la garantie que ces partis n'obtiendront jamais une majorité parlementaire, ils peuvent leur laisser un libre accès aux joutes électorales et même leur concéder des parcelles de pouvoir : cela ne fait que redorer à peu de frais le blason de la"démocratie" qui tend à se défraîchir. Mais c'est là un luxe de riche, d'une bourgeoisie forte qui maîtrise, grâce à sa puissance économique, l'ancienneté de ses institutions et le poids de ses mystifications, les rouages de cette "démocratie" (aussi formels qu'ils soient) et les mécanismes de 1'"alternance". C'est un luxe que ne peuvent se payer les bourgeoisies au pouvoir à 1'Est. Elles n'ont pas la capacité de"fixer" de façon durable dans un rôle bien délimité des forces politiques qu'elles ne contrôlent pas directement comme peuvent le faire les secteurs dominants de la bourgeoisie en Occident avec les PC. La seule présence officielle, même comme simple opposition, de forces politiques de masse contestant le caractère absolu du pouvoir du parti-Etat constitue une remise en cause des fondements du régime, un facteur d'instabilité permanente de celui-ci.
Ainsi, le destin de "Solidarité" était scellé dès sa constitution. Si la bourgeoisie du bloc de l'Est a été contrainte de légaliser et de laisser la bride sur le cou au syndicat "indépendant" tant que c'était absolument nécessaire pour affronter les luttes ouvrières, celui-ci ne pouvait qu'être mis hors-la-loi dès qu'il aurait affaibli ces luttes.
A l'Est encore plus qu'à l'Ouest, les discours sur la démocratie ne sont que des songes creux, des mystifications destinées à mener le prolétariat dans une impasse, à la défaite.
F.M.
[1] [436] Le Courrier des pays de l'Est, n°27.
[2] [437] On sait que dans plusieurs pays de l'Est, il existe officiellement d'autres partis que le parti "communiste". Ainsi, en Pologne, à côté du "Parti Ouvrier Unifié de Pologne" on trouve le "Parti Démocrate" et le "Parti paysan unifié", les trois étant regroupés dans le "Front d'Unité Nationale" qui, officiellement, gouverne le pays. En Allemagne de 1'Est, ce ne sont pas moins de 5 partis qui ont pignon sur rue. On y trouve, comme en RFA, un parti libéral et un parti chrétien-démocrate et même un parti national-démocrate. Il est clair que ces partis ne sont que des appendices du parti dirigeant stalinien.
[3] [438] Le phénomène est particulièrement net en ce qui concerne les partis ouvriers de la 2ème Internationale. Avant 1914, ces partis représentaient (malgré leurs tendances de plus en plus réformistes et opportunistes) les intérêts de la classe ouvrière au sein des parlements, des municipalités et autres institutions électives, ce qui leur permettait, dans certaines circonstances, de faire pression sur l'Etat. A partir de la première guerre mondiale, ces partis ont été absorbés par l'Etat capitaliste qui en fait ses agents en milieu ouvrier, chargés de mettre à profit leurs origines et leur langage pour participer à 1'embrigadement du prolétariat dans la guerre impérialiste et saboter -sinon réprimer directement- ses luttes. Le même processus a affecté les partis communistes, avant-garde de la classe ouvrière dans la vague révolutionnaire du premier après-guerre et qui, lors de l'échec et de la défaite de cette vague, ont dégénéré encore plus rapidement que ne 1'avaient fait les partis socialistes auparavant : à mesure que s'avance la décadence capitaliste se renforce le pouvoir d'absorption de l'Etat à l'égard des organisations prolétariennes qui prétendent "utiliser" les institutions bourgeoises. La trahison du courant trotskyste lors de la seconde guerre mondiale en constitue une autre illustration.
Bien qu'à un degré moindre, ce même renversement de fonction a touché les partis bourgeois classiques. Après avoir été les représentants des différents secteurs de la classe capitaliste dans 1'Etat, ils ont tendu de plus en plus à être les représentants de celui-ci auprès de leurs clientèles respectives. Cependant, le fait que ces clientèles appartiennent à la classe économiquement dominante contraint ces partis dans certaines circonstances, et, contrairement aux partis soi-disant "ouvriers", à faire valoir de façon effective bien que limitée certains des intérêts spécifiques qu'ils sont censés représenter.
[4] [439] Voir notamment "Les causes économiques, politiques et sociales du fascisme" (Revue Internationale n°7), Voir également les n°14 et 21 de Révolution Internationale.
[5] [440] Voir Revue Internationale n°3, La dégénérescence de la révolution russe, les leçons de Kronstadt, n°8, La Gauche Communiste en Russie. Voir la brochure "La période de transition...", t.1.
[6] [441] Il est clair que lorsque nous parlons de "démocratie" pour qualifier les régimes occidentaux, c'est par facilité de langage : la décadence du capitalisme a vidé la démocratie bourgeoise de son contenu politique réel pour ne lui conserver qu'une fonction essentiellement mystificatrice.
[7] [442] Dans les pays de l'Est, il n'existe aucune fonction quelque peu importante dans la société qui ne relève de la "Nomenklatura", c'est-à-dire de la liste des postes dont le titulaire est choisi par la sphère dirigeante du parti et auxquels sont associés les privilèges matériels en rapport avec leur position dans la hiérarchie. Cela va du commandant en chef de la police aux directeurs d'hôpitaux, du chef d'Etat-major aux secrétaires des organisations de base du parti dans les entreprises, des directeurs d'usine au président régional de l'Association volontaire des pompiers, des ambassadeurs aux présidents des comités de district de culture physique. Ainsi, un directeur de ferme d'Etat n'est pas nommé par le ministère de 1'agriculture, mais par le comité de district du parti, ce n'est pas le ministère de la défense ou le chef d'Etat-major qui peut faire général un colonel mais le Bureau Politique ou le Secrétariat du parti.
Géographique:
- Pologne [111]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [112]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [342]
- Stalinisme, le bloc de l'est [443]
Où en est la crise ?
- 2552 reads
"Dans chaque crise, la société étouffe sous le faix de ses propres forces productives et de ses propres produits inutilisables pour elle, et elle se heurte impuissante à cette contradiction absurde : les producteurs n'ont rien à consommer parce qu 'on manque de consommateurs". Cette phrase écrite par Engels en 1876 pour 1'Anti-Durhing montre toute l'actualité du marxisme aujourd'hui.
L'économie capitaliste s'effondre par manque de débouchés solvables, c'est-à-dire de consommateurs qui puissent payer. Voila la contradiction qui se traduit dans l'horrible paradoxe qui voit la majorité de la population mondiale menacée de famine, qui voit le niveau de vie du prolétariat plonger dans la misère non pas parce qu'on ne produit pas assez, mais parce que l'industrie capitaliste produit plus qu'elle ne peut vendre, non pas parce qu'il n'y a "pas assez", mais parce qu'il y a "trop" par rapport aux lois capitalistes.
Parce qu'il y a surproduction généralisée sur un marché mondial trop étriqué, la concurrence entre capitalistes se fait toujours plus effrénée. Les politiques de relance par un recours intensif à l'endettement, qui élargissent artificiellement le marché se heurtent aux limites de l'inflation qui menace de faire exploser le système monétaire international. La bourgeoisie voit les mécanismes de l'économie lui échapper, elle ne peut empêcher des plongées de plus en plus profondes dans la récession alors que les pressions inflationnistes se font toujours plus fortes.
Le graphique I montre que les politiques de relance ont depuis 1967, par trois fois, permis une reprise du commerce mondial, c'est-à-dire de la demande pour maintenir la production. Elles ne sont pas cependant parvenues à entraver la chute de la croissance de celle-ci ni finalement la récession de 1974-75 ni celle encore plus forte qui débute en 1980.
Pourquoi ce phénomène ? Parce que, classe exploitée, le prolétariat produit plus qu'il ne consomme. Cette production supplémentaire, la plus-value, le capitalisme ne peut en réaliser et accumuler la valeur qu'en la vendant à des secteurs extra capitalistes. Avec la disparition de ceux-ci, le capital ne peut plus écouler la totalité de la production. Pour vendre, il faut être le plus compétitif, faire baisser les salaires pour réduire les coûts de production. Comme chaque nation capitaliste ne peut que suivre la même politique, il en découle un rétrécissement toujours plus fort du marché mondial. Dans ces conditions, la production s'effondre, les usines ferment et les ouvriers se retrouvent au chômage, ce qui ne fait pas de bons consommateurs ! Les politiques d'austérité qui s'imposent à chaque bourgeoisie par la nature concurrente de l'économie capitaliste ne font qu'accélérer la chute de la demande mondiale et donc l'effondrement de la production.
Le graphique II montre la chute du taux d'utilisation de l'appareil productif aux USA, 1ère puissance mondiale avec 20% delà production mondiale : 68% en 1982, cela équivaut à près d'une usine sur trois qui ferme ses portes. En RFA, fin 1982, l'appareil productif est utilisé à 76% -comme si une usine sur quatre fermait-, en Grande-Bretagne, seulement 30% des usines tournent à pleine capacité.
Le capitalisme ne peut sortir de ses contradictions, il ne peut que plonger de plus en plus dans le chaos économique et fuir en avant dans les rivalités impérialistes. Le prolétariat est soumis aujourd'hui à une attaque comme il n'en avait pas connu depuis la dernière guerre mondiale. Inflation, chômage, misère sont le lot quotidien qui annonce pire encore. De la capacité de réaction du prolétariat mondial dépend l'avenir de l'humanité. Le capitalisme n'a plus rien à offrir que la misère et la mort. La catastrophe économique actuelle n'a pas d'issue dans le capitalisme. 15 ans d'échec des entreprises de relance économique montrent que la bourgeoisie n'a aucune perspective.
Au prolétariat mondial d'être capable d'affirmer la sienne.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Les communistes et la question nationale (1900-1920) 1ere partie
- 3508 reads
Débat sur la question nationale a l'aube de la décadence
"Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !". Cet appel qui terminait le Manifeste Communiste rédigé par Marx et Engels en 1848 n'était pas une simple exhortation généreuse, mais il exprimait une des conditions vitales pour la victoire et 1'émancipation de la classe ouvrière. Dès sa naissance, le mouvement de la classe ouvrière s'affirme comme mouvement d'une classe internationale contre les frontières nationales au sein desquelles se développe la domination de la classe capitaliste sur le prolétariat. Au 19ème siècle cependant, le capitalisme n'a pas encore épuisé toutes les potentialités de son développement contre les rapports de production pré-capitalistes. A certains moments et dans certaines conditions, les communistes envisagent la possibilité pour la classe ouvrière d'appuyer des fractions de la bourgeoisie, parce que le capitalisme en se développant accélère le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne. Mais dès le début du 20ème siècle, avec la constitution du marché mondial sanctionnant l'extension du mode de production capitaliste à toute la planète, le débat est ouvert sur la nature du soutien des révolutionnaires aux mouvements nationaux. L'article ci-dessous, première partie d'une série consacrée à 1'attitude des communistes sur la question nationale, rappelle dans quels termes et avec quel souci le débat s'est mené entre Lénine et Rosa Luxemburg.
L'échec de la vague révolutionnaire de 1917-23, le triomphe de la contre-révolution en Russie et la soumission du prolétariat pendant 50 ans à la barbarie du capitalisme décadent n'ont pas permis une clarification complète sur la question nationale dans le mouvement ouvrier. Tout au long de cette période, la contre-révolution s'est acharnée à dénaturer le contenu de la révolution prolétarienne, en ne cessant de présenter une continuité entre la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le capitalisme d'Etat instauré en URSS, entre l'internationalisme prolétarien de la période révolutionnaire et la politique impérialiste de l'Etat capitaliste russe menant ses opérations de brigandage au nom de 1 ' "autodétermination", du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", de la "libération nationale des peuples opprimés". Les positions d'un Lénine étaient transformées en un dogme infaillible dans tous ses aspects. C'est ainsi que la possibilité pour le prolétariat d'utiliser les mouvements nationaux comme un "levier" pour la révolution communiste, tactique préconisée avec le reflux de la révolution des pays centraux et la nécessité de la défense de"l'Etat prolétarien" en Russie, tendait à être considérée comme un acquis dans les rangs mêmes des révolutionnaires sauf quelques minorités.
Aujourd'hui, la dispersion et la crise des organisations révolutionnaires, en particulier la crise du parti bordiguiste, le PCI (Programme Communiste), ont mis en lumière l'importance, pour les communistes, de défendre une position de principe claire sur les soi-disant luttes de "libération nationale", s'ils veulent éviter de succomber au poids énorme de l'idéologie bourgeoise sur cette question cruciale. L'abandon par le PCI d'une position internationaliste dans le conflit inter-impérialiste du Moyen-Orient au profit d'un soutien critique aux forces capitalistes de l'Organisation de. Libération de la Palestine -position qui a provoqué la dislocation du groupe et donné naissance à une scission ouvertement nationaliste et chauvine ([1] [444])- est un exemple récent du danger de toute concession du prolétariat vis-à-vis du nationalisme dans la période de décadence du capitalisme.
La source des faiblesses théoriques des bordiguistes, comme de toute la tradition dite "léniniste", sur la question nationale, réside dans la défense de là position soutenue par Lénine dans la jeune Internationale Communiste du soutien aux mouvements nationaux, sous le mot d'ordre du "droit des nations à disposer d'elles-mêmes" Le CCI rejette tout soutien de ce genre à l'époque de l'impérialisme. Ce rejet est lui-même basé sur la critique des idées de Lénine faite par Rosa Luxemburg au tout début du siècle. Aujourd'hui, à la lumière des expériences du prolétariat, ces soixante dernières années, nous ne pouvons, que réaffirmer que c'est la position de Luxemburg, et non celle de Lénine qui a été vérifiée par l'histoire, et qui offre la seule base claire pour une approche marxiste de la question.
Il y a, aujourd'hui, beaucoup d'autres éléments émergeant dans le milieu révolutionnaire, ou qui ont fait une rupture partielle avec le gauchisme, qui prennent la position de Lénine contre Luxemburg sur cette question. Au vu de l'importance qu'il y a à rompre clairement avec tous les aspects de l'idéologie gauchiste, nous publions une série d'articles qui examinent de façon critique les débats qui eurent lieu dans le mouvement révolutionnaire avant comme pendant la première guerre impérialiste mondiale. Cela afin de montrer pourquoi c'est la position de Luxemburg qui prend en compte de façon cohérente toutes les implications de la décadence capitaliste sur la question nationale, mais aussi afin de restituer la réelle position de Lénine, qui était une erreur faite dans le mouvement ouvrier de 1 'époque, par rapport aux distorsions et aux censures manifestes de la gauche du capital.
Lénine et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes
"Le marxisme ne peut se concilier avec le nationalisme, celui-ci serait-il le ""plus juste", le "plus pur", et d'une "facture plus raffinée et civilisée".
Lénine "Remarques sur la question nationale"
Au vu des grossières distorsions que les épigones de Lénine infligèrent à la question nationale, il est nécessaire avant tout de souligner que Lénine, en marxiste, basait son attitude de soutien aux mouvements nationalistes sur les fondements mis en place par Marx et Engels dans la Première Internationale; comme pour toute question sociale, il affirmait que les marxistes doivent examiner la question nationale:
- au sein de limites historiques définies et non comme un "principe" abstrait ou a-historique.
- du point de vue de l'unité du prolétariat et du besoin primordial de renforcer sa lutte pour le socialisme.
Ainsi, lorsque Lénine défendait l'idée que le prolétariat doit reconnaître le "droit des nations à l'autodétermination", c'est-à-dire le droit d'une bourgeoisie de se séparer et d'établir un Etat capitaliste indépendant, si nécessaire, il insistait sur le fait que ce droit ne devait être soutenu que dans les cas où il allait dans le sens des intérêts de la lutte de classe, et que le prolétariat "en même temps qu'il reconnaît l'égalité et des droits nationaux à un Etat national, tient par-dessus tout et place au-dessus de tout l'alliance des prolétaires de toutes les nations, et évalue toute revendication nationale, toute séparation nationale, sous l'angle de la lutte de la classe ouvrière". (Lénine "Le droit des nations à disposer d'elles-mêmes" 1914)
Pour Lénine, le droit à l'autodétermination était une revendication nécessaire dans la lutte du prolétariat pour la démocratie, de même que l'égalité des droits, le suffrage universel, etc. Il posait la question fondamentale en terme d'achèvement de la révolution bourgeoise, qui était encore à venir en Europe de l'est, en Asie et en Afrique. Les mouvements nationalistes étaient historiquement inévitables pour la destruction du féodalisme par la bourgeoisie montante et l'extension des rapports sociaux capitalistes à travers le monde. Là où ces mouvements nationalistes bourgeois démocratiques surgissaient, selon Lénine, les marxistes devaient les soutenir et combattre pour un degré maximum de démocratie, pour aider à balayer les vestiges féodaux et à supprimer toute oppression nationale, pour se débarrasser de tous les obstacles à la lutte de classe contre le capitalisme.
Cette tâche avait une signification particulière en Russie pour les Bolcheviks qui cherchaient à gagner la confiance des masses dans les nations opprimées par l'empire tsariste. Lénine voyait dans le nationalisme "Grand Russe" l'obstacle principal à la démocratie et aux luttes prolétariennes, dans la mesure où il était plus "féodal que bourgeois" : dénier le droit à ces petites nations de faire sécession signifierait, en pratique, soutenir les privilèges de la nation oppresseuse, et subordonner les ouvriers à la politique de la bourgeoisie et des seigneurs féodaux Grands Russes.
Mais, Lénine était très conscient des dangers du soutien du prolétariat aux mouvements nationalistes parce que, même dans les pays "opprimés", les luttes du prolétariat et celles de la bourgeoisie, étaient diamétralement opposées:
- le prolétariat soutenait le droit à l'autodétermination dans le seul but de hâter la victoire de la démocratie bourgeoise sur le féodalisme et l'absolutisme, et de s'assurer au mieux les conditions les plus démocratiques pour la lutte de classe;
- la bourgeoisie formulait des revendications nationales pour obtenir des privilèges pour sa propre nation et pour défendre sa propre exclusivité nationale.
Pour ces raisons, Lénine insistait sur le fait que le soutien du prolétariat au nationalisme était "strictement limité à ce qui était progressiste dans de tels mouvements"; il soutenait la bourgeoisie « conditionnellement » "seulement dans une certaine direction". Du point de vue de l'achèvement de la révolution bourgeoise, à travers la lutte pour la démocratie contre l'oppression nationale, le soutien à la bourgeoisie d'une nation opprimée ne pouvait être accordé que là où celle-ci combattait réellement la nation oppresseuse: "...dans la mesure où la bourgeoisie des nations opprimées défend son propre nationalisme bourgeois, nous la combattons. Nous combattons les privilèges et la violence de la nation oppresseuse, nous ne fermons en aucun, cas les yeux sur la lutte pour les privilèges de la part de la nation opprimée" (Ibid. )
Autrement dit, les mouvements nationalistes bourgeois ne devaient être soutenus que pour leur contenu démocratique, c'est-à-dire pour leur capacité à contribuer à l'instauration de meilleures conditions pour la lutte de classe et pour l'unité de la classe ouvrière :"Le nationalisme bourgeois de toute nation opprimée a un contenu démocratique général qui est dirigé contre l'oppression, et c 'est ce contenu que nous soutenons inconditionnellement. En même temps, nous le distinguons strictement des tendances à l'exclusivisme national."(Ibid. souligné dans l'original)
Ainsi, sur les limites historiques de la lutte pour la démocratie et la nécessité d'avancer le mot d'ordre de l'autodétermination, Lénine était, en 1913, tout à fait explicite. Dans l'Europe continentale de l'Ouest, l'époque des révolutions démocratiques bourgeoises était terminée depuis 1871: "Par conséquent, chercher le droit à l'autodétermination dans les programmes des socialistes ouest-européens, à cette époque, c 'est trahir sa propre ignorance de l'A.B.C du marxisme" (Ibid.). Ma i s, en Europe de l'Est et en Asie, la révolution bourgeoise devait être achevée, et "c'est précisément et seulement parce que la Russie et les pays voisins sont dans cette phase, que nous devons avoir une clause dans notre programme sur les droit des nations à disposer d'elles-mêmes"(Ibid. nous soulignons)
Dès le début, le mot d'ordre d'autodétermination était rempli d'ambiguïtés. Par exemple Lénine était forcé d'admettre que c'était une revendication négative , pour un droit de former un Etat séparé, pour lequel le prolétariat ne pouvait donner aucune garantie ,et qui ne pouvait pas être accordé aux dépens d'une autre nation. Ses écrits sur le sujet sont remplis d'avertissements, de limitations et d'exceptions, dont certaines contradictoires, et il s'agissait par-dessus tout de l'utiliser comme thème de propagande pour les socialistes des pays "opprimés". Mais selon la même méthode strictement historique de Lénine, à la racine,ceci se basait sur la capacité maintenue de la bourgeoisie, dans ces aires du monde où le capitalisme était encore en expansion, de lutter pour la démocratie contre le féodalisme et l'oppression nationale ; la conclusion de cela était que quand cette période prendrait fin, tout le contenu démocratique de ces luttes disparaîtrait et que la seule tâche progressiste du prolétariat serait de faire sa propre révolution contre le capitalisme.
La critique de l'autodétermination par Rosa Luxemburg
La critique de R.Luxemburg de la reconnaissance par les Bolcheviks du mot d'ordre du "droit des nations à l'autodétermination" était inséparable de la lutte de l'aile gauche des partis sociaux-démocrates d'Europe de l'Ouest contre les tendances grandissantes à l'opportunisme et au révisionnisme dans la II° Internationale, vers le début du XX° siècle, il était possible de voir dans les pays capitalistes avancés la tendance naissante vers le capitalisme d'Etat et l'Impérialisme, et celle qui en découle, la tendance de là machine étatique à absorber les organisations permanentes du mouvement ouvrier - les syndicats et les partis de masse. Au sein de l'Internationale, des théoriciens comme Bernstein sont apparus pour "réviser" le marxisme révolutionnaire, afin de justifier leur accommodement avec cette évolution dans le capitalisme. Luxemburg fut une des premières parmi les théoriciens de la Gauche à combattre ce "révisionnisme" et à chercher à en exposer les causes profondes.
Elle rejetait la notion "d'autodétermination" très énergiquement parce qu'elle y voyait le signe des influences "social-patriotes" dans l'Internationale : des forces nationalistes réactionnaires qui se déguisaient sous des couleurs socialistes et qui étaient justifiées par des théoriciens dirigeants, tels que Kautsky. L'adoption, en 1896, par l'Internationale, d'une résolution reconnaissant "le droit absolu de toutes les nations à l'autodétermination" fut une réponse à la tentative du Parti Socialiste Polonais d'obtenir un soutien officiel pour la restauration de la souveraineté nationale polonaise. Cette tentative du PSP fut rejetée, mais l'adoption de la formule générale, de l'avis de Luxemburg, évitait les questions sous-jacentes: la base historique du soutien du prolétariat aux mouvements nationalistes, et la nécessité de combattre le social-patriotisme dans l'Internationale.
Luxemburg commença sa critique en acceptant le même cadre de base que Lénine, à savoir:
-la révolution démocratique bourgeoise doit encore être achevée en Russie, en Asie, en Afrique;
-dans l'intérêt du développement des conditions de la révolution, le prolétariat ne peut pas ignorer les mouvements nationalistes pour leur contenu démocratique dans les aires du monde où le capitalisme est encore en train de détruire le féodalisme ;
-le prolétariat est naturellement opposé à toute forme d'oppression, y compris l'oppression nationale, et n'est en aucune manière, indifférent aux conditions des nations opprimées.
Mais sa première tâche était de défendre l’approche marxiste de la question nationale contre ceux qui, comme les sociaux- patriotes polonais, utilisaient les écrits de Marx pour soutenir l'indépendance de la Pologne et justifier leurs propres projets réactionnaires de restauration nationale, S'efforçant " de transformer une vision particulière de Marx sur une question du moment, en un véritable dogme, hors du temps, inchangeable, indifférent aux contingences historiques, et échappant aux doutes et à la critique après tout 'Marx lui-même l'a déjà dit'. Ce n'était rien d'autre qu'un abus du nom de Marx pour sanctionner une tendance qui, dans son esprit même, était en contradiction avec les enseignements et la théorie du marxisme" (Avant-propos à l'anthologie "La question polonaise et le mouvement socialiste" 1905)
Contre cette fossilisation de la méthodologie historique du marxisme, R.Luxemburg affirmait que :"Sans un examen critique des conditions historiques concrètes, rien de valable ne peut être apporté au problème de l'oppression nationale" ("La question polonaise" Congrès de l'Internationale 1896). A partir de là, elle continuait en esquissant ses arguments principaux contre le mot d'ordre d'autodétermination :
-la dépendance ou l'indépendance des Etats nationaux est une question de pouvoir, pas de "droits", et est déterminée par le développement socio-économique et les intérêts matériels des classes ;
-c'est un mot d'ordre utopique dans la mesure où il est clairement impossible de résoudre tous les problèmes de nationalité, de race et d'origine ethnique dans le cadre du capitalisme ;
- c'est une formule métaphysique qui n'offre pas d'orientation pratique ou de solution à la lutte quotidienne du prolétariat, et qui ignore la théorie marxiste des classes sociales et des conditions historiques des mouvements nationalistes. Elle n'est pas, non plus, assimilable à la lutte pour les droits démocratiques car elle ne représente pas une forme légale d'existence, dans une société bourgeoise adulte, comme le droit d'organisation ;
-ce mot d'ordre ne distingue pas la position du prolétariat de celle des partis bourgeois les plus radicaux, ou celle des partis pseudo-socialistes et petits-bourgeois et, ce n'est pas du tout lié de façon spécifique, au socialisme ou à la politique ouvrière
- ce mot d'ordre conduirait à une fragmentation du mouvement ouvrier, non à son unification en laissant au prolétariat, dans chaque nation opprimée, le soin de décider sa propre position nationale avec d'inévitables contradictions et conflits.
La majeure partie de ses arguments qui, dans beaucoup de cas, ne faisaient que répéter les positions marxistes de base sur l'Etat et la nature de classe de là société, resta sans réponse de la part de Lénine. Contre l'idée du prolétariat soutenant l’autodétermination, elle insistait sur la deuxième partie de la résolution générale adoptée par l'Internationale en 1896, qui appelait les ouvriers de tous les pays opprimés « à rejoindre les rangs des ouvriers conscients du monde entier, afin de combattre avec eux pour la défaite du capitalisme international et pour atteindre les buts de la sociale démocratie internationale » (« La question nationale et l’autonomie »-1908).
Luxemburg sur l'indépendance de la Pologne
La critique par R. Luxemburg de 1'auto-détermination a été développée en référence particulière à la Pologne, mais les raisons qu'elle a données pour le rejet du soutien de son indépendance vis-à-vis de la Russie, ont une importance générale dans la clarification de l'approche marxiste de telles questions et des implications des changements de conditions dans le capitalisme sur la question nationale comme dans son ensemble.
Marx et Engels, apportèrent à l'origine leur soutien au nationalisme polonais comme partie d'une stratégie révolutionnaire pour défendre les intérêts de la révolution démocratique-bourgeoise en Europe de l'Ouest, contre la Sainte-Alliance des régimes féodaux et absolutistes de l'Europe de l'Est. Ils allèrent jusqu'à appeler à la guerre contre la Russie et à des insurrections en Pologne pour sauvegarder la démocratie bourgeoise. Luxemburg mit en évidence le fait que ce soutien au nationalisme polonais était accordé à un moment où il n'y avait pas de signe d'action révolutionnaire en Russie même, et où il n'y avait pas un prolétariat significatif en Russie ou en Pologne pour engager la lutte contre le féodalisme : "Non pas une théorie ou une tactique socialiste, mais les exigences politiques brûlantes de la démocratie allemande du moment -les intérêts pratiques de la révolution bourgeoise en Europe de l'Ouest -c'est ce qui déterminait le point de vue que Marx, et plus tard Engels, adoptèrent à propos de la Russie et de la "Pologne", (Ops.cité)
La réaffirmation par Luxemburg de l'approche marxiste était basée sur une analyse du développement historique du capitalisme : dans la dernière moitié du XIX° siècle, la Pologne faisait l'expérience de "la danse frénétique du capitalisme et de l'enrichissement capitaliste sur la tombe des mouvements nationalistes et de la noblesse polonaise" (Ibid) qui donna naissance à un prolétariat polonais et à un mouvement socialiste qui, dès le début, défendit les intérêts de la classe, comme opposés au nationalisme. Cela allait de pair avec des développements en Russie même où la classe ouvrière commença à engager ses propres luttes.
En Pologne, le développement capitaliste créa une opposition entre l'indépendance nationale et les intérêts de la bourgeoisie qui renonça à la cause nationaliste de la vieille noblesse en faveur de l'intégration plus étroite des capitaux polonais et russes, basée sur le besoin du marché russe, marché dont la bourgeoisie serait privée si la Pologne devait rompre comme Etat indépendant. De cela, Luxemburg concluait que la tâche politique du prolétariat en Pologne n'était pas de reprendre la lutte utopique, mais de rejoindre les ouvriers russes dans une lutte commune contre l'absolutisme, pour la démocratisation la plus large, afin de créer les meilleures conditions possibles pour la lutte contre le capital, russe et polonais.
La reprise du soutien de Marx en 1848 au nationalisme polonais par le Parti Socialiste Polonais était, ainsi, une trahison du socialisme, un signe de l'influence du nationalisme réactionnaire au sein du mouvement socialiste qui utilisait les mots de Marx et d'Engels, en même temps qu'il tournait le dos à l'alternative prolétarienne à l'oppression nationale : la lutte de classe unie qui s'est révélée en 1905 quand la grève de masse s'est étendue de Moscou et Petrograd jusqu'à Varsovie. Le nationalisme en Pologne était devenu " un vaisseau pour tous les genres de réactions, un champ nature pour la contre-révolution" ; il était devenu une arme dans les mains de la bourgeoisie nationale qui, au nom de la nation polonaise, attaquait et assassinait les ouvriers en grève, organisait des "syndicats nationaux" pour contrecarrer la combativité de là classe, menait campagne contre les grèves générales "anti-patriotiques" et utilisait des bandes armées nationalistes pour assassiner les socialistes. Luxemburg concluait : "Maltraitée par l'histoire, l'idée nationale polonaise traversa toutes sortes de crise et tomba en déclin. Ayant commencé sa carrière politique comme rébellion romantique, noble, glorifiée par la révolution internationale, elle prend fin, maintenant, en hooliganisme national, en volontaire des Cent Noirs de l'absolutisme et de l'impérialisme russe" ("La question nationale et l'autonomie" 1908)
Grâce à un examen des changements concrets apportés par le développement capitaliste, Luxemburg parvint à liquider les phrases abstraites sur les "droits" et l’"autodétermination" et, plus important, à réfuter l'ensemble du raisonnement de la position de Lénine selon lequel il était nécessaire de soutenir 1'autodétermination polonaise, afin de faire avancer la cause de la démocratie et de précipiter l'érosion du féodalisme. Le nationalisme lui-même était devenu une force réactionnaire partout où il était confronté à la menace de la lutte de classe unifiée. Quelles que soient les spécifiés de la Pologne, les conclusions de R.Luxemburg ne pouvaient qu'avoir de plus en plus une application généralisée dans une période dans laquelle les mouvements bourgeois de libération nationale ouvraient la voie à un antagonisme existant entre la bourgeoisie comme classe et le prolétariat.
L'émergence de l'impérialisme et les Etats de conquête
Le rejet par Luxemburg de I'autodétermination et de l'indépendance polonaise était inséparable de son analyse de l'émergence de l'impérialisme et de ses effets sur les luttes de libération nationale. Bien que ce fut une des questions essentielles dans le mouvement socialiste en Europe de 1'Ouest, les commentaires de Luxemburg ne furent pas du tout pris en compte par Lénine jusqu'à l'éclatement de la première guerre mondiale.
L'émergence de l'impérialisme capitaliste, selon Luxemburg, rendait désuète toute idée d'indépendance nationale ; la tendance était à la "destruction continue de l'indépendance d'un nombre croissant de nouveaux pays et peuples, de continents entiers "par une poignée de pouvoirs dirigeants. L'impérialisme, en étendant le marché mondial, détruisait toute apparence d'indépendance économique : "ce développement, ainsi que les racines des politiques coloniales, gît dans les fondations mêmes de la production capitaliste... seuls les inoffensifs apôtres bourgeois de la "paix", peuvent croire à la possibilité, pour les Etats d'aujourd'hui, d'éviter cette voie". (Ibid.)
Toutes les petites nations étaient condamnées à l'impuissance politique, et lutter pour leur assurer leur indépendance au sein du capitalisme signifierait , en fait, revenir au premier stade du développement capitaliste, ce qui était clairement une utopie.
Cette nouvelle caractéristique du capitalisme donnait naissance non pas à des Etats nationaux sur le modèle des révolutions démocratiques bourgeoises d'Europe, mais à des Etats de rapine, mieux adaptés aux besoins de la période. Dans de telles conditions, l'oppression nationale devenait un phénomène généralisé et intrinsèque au capitalisme, et son élimination est rendue impossible sans la destruction du capitalisme lui-même par la révolution socialiste. Lénine rejetait cette analyse de la dépendance croissante des petites nations comme n'ayant pas de rapport avec la question des mouvements nationaux ; il ne niait pas l'existence de l'impérialisme ou du colonialisme mais pour lui, seule l'autodétermination politique était en cause, et, sur cette question, il défendait Kautsky qui soutenait la restauration de la Pologne contre Luxemburg.
Le développement de l'impérialisme comme condition du système capitaliste mondial, n'était pas encore complètement clair et Luxemburg ne pouvait mettre en avant que quelques exemples comme "modèle" - Angleterre, Allemagne, Amérique - en même temps qu'elle reconnaissait que le marché mondial était encore en expansion et que le capitalisme n'était pas encore entré dans sa crise mortelle. Mais la valeur de son analyse résidait dans le fait qu'elle examinait quelques-unes des tendances fondamentales du capitalisme et leurs implications pour la classe ouvrière et la question nationale : son rejet des luttes de libération nationale reposait sur une compréhension des conditions nouvelles de l'accumulation capitaliste et non pas sur des considérations morales ou subjectives.
Quelques conclusions sur l'attitude des révolutionnaires sur l'autodétermination dans le capitalisme ascendant
Le mot d'ordre de l'autodétermination servait, pour Lénine, un double but : en tant que revendication importante dans la lutte du prolétariat pour la démocratie au sein de la société capitaliste ; en tant que tactique de propagande à utiliser contre le chauvinisme national dans l'empire tsariste. Mais dès le début, ce mot d'ordre renfermait des ambiguïtés théoriques et des dangers pratiques qui devaient miner la défense, par les Bolcheviks, de l'internationalisme prolétarien au début de la phase impérialiste du capitalisme :
- comme revendication démocratique c'était une utopie. L'obtention de l'indépendance nationale par quelque fraction bourgeoise que ce soit était déterminée par des rapports de force et non par des droits, et était un produit de l'évolution du mode de production capitaliste. La tâche du prolétariat était avant tout de garder son autonomie de classe et de défendre ses propres intérêts contre la bourgeoisie.
- l'élaboration de l'unité du prolétariat était sans aucun doute, dans l'empire tsariste et partout ailleurs, un problème pour les communistes, dans leur lutte contre l'influence de l'idéologie bourgeoise. Mais cela ne pouvait se faire que sur les fondements solides de la lutte de classe, et non par des concessions au nationalisme qui, dès la fin du 19ème siècle, étaient devenues une arme dangereuse dans les mains de la bourgeoisie contre le prolétariat.
De plus, l'utilisation par Lénine, des termes de nations "opprimée" et "oppresseuse" était inadéquate même dans le capitalisme ascendant. Il est vrai à que Luxemburg utilisait elle-même ces termes pour décrire l'émergence d'une poignée de "grandes puissances" qui se partageaient le monde ; mais pour elle, ces "Etats de conquête" n'étaient que des exemples d'une tendance générale au sein du capitalisme dans son ensemble. Une des valeurs de ses écrits sur le nationalisme polonais était de démontrer que, même dans les soi-disant nations opprimées, la bourgeoisie utilisait le nationalisme contre la lutte de classe, et agissait comme agent des puissances impérialistes dominantes. Tous les discours sur les nations "opprimées" et "oppresseuses" conduisent à faire de la "nation" bourgeoise une abstraction qui masque les antagonismes de classe.
Toute la stratégie de 1'"autodétermination" était héritée non de Marx et Engels, mais de la 2ème Internationale qui, à la fin du 19ème siècle, était corrompue par l'influence du nationalisme et du réformisme. La position de Lénine était partagée par le centre des partis Social-Démocrates et sur cette question il soutenait Kautsky, le théoricien le plus "orthodoxe", contre Luxemburg et l'aile gauche de l'Internationale. Combattant du point de vue de la situation en Russie, Lénine ne parvint pas à montrer que l'autodétermination était en premier lieu une concession au nationalisme ; pour aller aux racines de la dégénérescence de la social-démocratie il était donc nécessaire de rejeter le "droit des nations à 1'auto-détermination".
La véritable importance de la position de Luxemburg était qu'elle résidait sur une analyse des tendances dominantes au coeur du mode de production capitaliste, et en particulier l'émergence de l'impérialisme en Europe, comme indicateurs de la nature de l'ensemble de l'économie mondiale à l'époque impérialiste. La position de Lénine, au contraire, était basée sur l'expérience et les besoins des pays des aires arriérées du monde, dans lesquels la révolution bourgeoise n'était pas encore achevée, à l'aube de l'époque dans laquelle il n'était plus possible pour le prolétariat d'obtenir des réformes de la part du capitalisme et dans laquelle le nationalisme ne pouvait plus jouer aucun rôle progressiste. C'était une stratégie pour une époque historique en voie de disparition, qui était incapable de répondre aux besoins de la classe ouvrière dans les conditions nouvelles de la décadence capitaliste.
MT
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Approfondir:
- La question nationale [446]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [447]
Problèmes actuels du mouvement ouvrier (Internationalisme n°25 août-1947) - Contre la conception de la discipline du PCI
- 3430 reads
Ce texte d'Internationalisme est extrait d'une série d'articles publiés tout au long de l'année 1947, intitulée "Problèmes actuels du mouvement ouvrier". Nous renvoyons le lecteur à la présentation de la première partie publiée dans la Revue Internationale no 33 - 2e trimestre 1983 [448] qui situe la critique que fait Internationalisme des conceptions de l'organisation du Parti Communiste Internationaliste d'Italie dans le contexte historique de l'époque.
Après avoir critiqué "la conception du chef génial" qui théorise que seules des individualités particulières ont la capacité d'approfondir la théorie révolutionnaire, dans la partie ci-dessous, Internationalisme poursuit sa critique contre le corollaire de cette vision,"la discipline" qui conçoit les militants de l'organisation comme de simples exécutants qui n 'ont pas à discuter des orientations politiques de l'organisation. Internationalisme réaffirme que "l'organisation et l'action concertée communistes ont uniquement pour base la conscience des militants qui les fonde. Plus grande et plus claire est cette conscience, plus forte est l'organisation, plus concertée et efficace est son action".
Depuis cette époque, les scissions répétées du tronc commun initial que constituait le PCI d'Italie avec la même vision de l'organisation, jusqu'à la dislocation actuelle du plus fort d'entre eux, le Parti Communiste International (Programme Communiste), n'ont fait que confirmer la validité de la mise en garde d'Internationalisme contre ces conceptions.
La discipline... force principale...
Lors des élections parlementaires en Italie, à la fin de 1946, un article leader, qui était un programme à lui seul, est paru dans l'organe central du PCI d'Italie. Il avait pour titre "Notre Force" et pour auteur le secrétaire général du Parti. De quoi s'agissait-il ? Du trouble provoqué dans les rangs du PCI par la politique électorale du Parti. Toute une partie des camarades, obéissant plus, parait-il, au souvenir d'une tradition abstentionniste de la Fraction de Bordiga, qu'à une position claire d'ensemble, se révoltait contre la politique de participation aux élections. Ces camarades réagissaient plus par une mauvaise humeur, par un manque d'enthousiasme, par des "négligences" pratiques dans la campagne électorale que par une franche lutte politique et idéologique au sein du Parti. D'autre part un certain nombre de camarades, poussaient leur enthousiasme électoraliste jusqu'à prendre part dans le Référendum "pour la Monarchie ou la République" en votant évidemment pour la République, en dépit de la position d'abstentionnisme sur le Référendum qui était, cette fois, celle du Comité Central.
Ainsi en voulant éviter de "troubler" le parti par une discussion générale sur le parlementarisme, en reprenant la politique périmée dite de "parlementarisme révolutionnaire", on n'a fait que troubler effectivement la conscience des membres, qui ne savaient plus à quel "génie" se vouer. Les uns participant trop chaudement, les autres trop froidement, le Parti en a attrapé un chaud et froid, et il est sorti tout malade de l'aventure électoraliste. ([1])
C'est contre cet état de fait que s'élève avec véhémence le secrétaire général dans son éditorial. Brandissant la foudre de la discipline il pourfend les improvisations politiques locales de droite ou de gauche. Ce qui importe, n'est pas la justesse ou l'erreur d'une position, mais de se pénétrer qu'il y a une ligne politique générale, celle du Comité Central,à qui on doit obéissance. C'est la discipline. La Discipline qui fait la principale force du Parti... et de l'armée ajouterait le premier sous-off venu. Il est vrai que le secrétaire spécifie une discipline librement consentie. Que Dieu soit loué ! Avec cet appendice nous sommes complètement rassurés
Des résultats bienfaisants n'ont pas manqué de suivre ce rappel à la discipline: du Sud, du Nord, de la droite et de la gauche un nombre de plus en plus grand de militants ont traduit à leur façon "la discipline librement consentie" par la démission librement exécutée. Les dirigeants du PCI ont beau nous dire que c'est la "transformation de la quantité en qualité" et que la quantité qui a quitté le Parti a emporté avec elle une fausse compréhension de la discipline communiste, nous répliquerons à cela que notre conviction est faite que ceux qui sont restés, et le Comité Central avec en premier lieu ont gardé, non pas une fausse compréhension de la discipline communiste mais une fausse conception du Communisme tout court.
Qu'est-ce que la discipline ? UNE IMPOSITION DE LA VOLONTÉ D'AUTRUI. L'expression qualitative ajoutée "librement consentie" n'est qu'un ornement de plume au derrière pour rendre la chose plus attrayante. Si elle émanait de ceux qui la subissent, il n'y aurait nul besoin de la leur rappeler, et surtout de leur rappeler sans cesse qu'elle a été "librement consentie".
La bourgeoisie a toujours prétendu que SES lois, SON ordre, SA démocratie, sont 1'émanation de la "libre volonté" du peuple. C'est au nom de cette "libre volonté" qu'elle a construit des prisons sur le fronton desquelles elle a inscrit en lettres de sang "Liberté, Egalité, Fraternité." C'est toujours en ce même nom qu'elle embrigade le peuple dans les armées, où pendant les entractes des massacres elle leur révèle leur "libre volonté" qui s'appelle Discipline.
Le mariage est un libre contrat, paraît-il, aussi le divorce, la séparation devient une dérision intolérable. "Soumets toi à TA volonté" a été le summum de l'art jésuitique des classes exploiteuses. C'est ainsi, enveloppée dans des papiers de soie et joliment enrubannée, qu'elles présentaient aux opprimés, leur oppression. Tout le monde sait que c'est par amour, par respect de leur âme divine, pour la sauver, que l'inquisition chrétienne brûlait les hérétiques qu'elle plaignait sincèrement. L'âme divine de l'inquisition est devenue aujourd'hui "le libre consentement".
"Une, deux, une, deux, gauche,droite en avant marche !" Exercez votre discipline "librement consentie" et soyez heureux !
Quelle est donc la base de la conception communiste -et nous le répétons, non de la discipline mais- de l'organisation et de l'action ?
Elle a pour postulat que les hommes agissent librement qu'en ayant pleinement conscience de leurs intérêts. L'évolution historique, économique et idéologique conditionnent cette prise de conscience. La "Liberté" n'existe que lorsque cette conscience est acquise. Là où il n'y a pas de conscience, la liberté est un mot creux, un mensonge, elle n'est qu'oppression et soumission, même si c'est formellement "librement consenti".
Les communistes n'ont pas pour tâche d'apporter on ne sait quelle liberté à la classe ouvrière. Ils n'ont pas de cadeaux à faire. Ils n'ont qu'à aider le prolétariat à prendre conscience "des fins générales du mouvement" comme s'exprime d'une manière remarquablement juste le Manifeste Communiste.
Le Socialisme, disions nous, n’est possible qu'en tant qu'acte conscient de la classe ouvrière. Tout ce qui favorise la prise de conscience est socialiste, MAIS UNIQUEMENT CE QUI LA FAVORISE. On n'apporte pas le socialisme par la trique. Non pas parce que la trique est un moyen immoral, comme le dirait un Koestler, mais parce que la trique ne contient pas d'élément de la conscience. La trique est tout à fait morale, quand le but qu'on s'assigne est l'oppression et la domination de classe, car elle réalise concrètement ce but, et il n'existe pas et ne peut exister d'autres moyens. Quand on recourt à la trique, et la discipline est une trique morale -pour suppléer au manque de conscience, on tourne le dos au socialisme, on réalise les conditions de non-socialisme. C'est pourquoi nous sommes catégoriquement opposés à la violence au sein de la classe ouvrière après le triomphe de la révolution prolétarienne, et sommes des adversaires résolus du recours à la discipline au sein du Parti.
Qu'on nous entende bien!
Nous ne rejetons pas la nécessité de l'organisation, nous ne rejetons pas la nécessité de l'action CONCERTEE. Au contraire. Mais nous nions que la discipline ne puisse jamais servir de base à cette action étant dans sa nature, étrangère à elle. L'organisation et l'action concertée communistes ont UNIQUEMENT pour base la conscience des militants qui les fonde. Plus grande, plus claire est cette conscience, plus forte est l'organisation, plus concertée et efficace est son action.
Lénine a plus d'une fois dénoncé violemment le recours à la "discipline librement consentie", comme une trique de la bureaucratie. S'il employait le terme de discipline, il l'entendait toujours -et il s'est maintes fois expliqué là dessus- dans le sens de la volonté d'action organisée, basée sur la conscience et la conviction révolutionnaire de chaque militant.
On ne peut exiger des militants, comme le fait le Comité Central du PCI, d'exécuter une action qu'ils ne comprennent pas, ou qui va à l’encontre de leurs convictions. C'est croire qu'on peut faire oeuvre révolutionnaire avec une masse de crétins ou d'esclaves. On comprend alors qu'on ait besoin de la discipline, hissée à la hauteur d'une divinité révolutionnaire.
En réalité, l'action révolutionnaire ne peut être le fait que des militants conscients et convaincus. Et alors cette action brise toutes les chaînes y compris celles forgées par la sainte discipline.
Les vieux militants se souviennent quel guet-apens, quelle arme redoutable contre les révolutionnaires, constituait cette discipline entre les mains des bureaucrates et de la direction de l'IC. Les hitlériens en formation avaient leur sainte Vehme, les Zinovievs à la tête de l’IC avaient leur sainte Discipline. Une véritable inquisition, avec ses commissions de contrôle torturant et fouillant dans l'âme de chaque militant.
Un corset de fer passé sur le corps des partis, emprisonnant et étouffant toute manifestation tendant à la prise de conscience révolutionnaire. Le comble du raffinement consistait à obliger les militants à défendre publiquement ce qu'ils condamnaient dans les organisations, dans les organismes dont ils faisaient partie. C'était l'épreuve du parfait bolchevik. Les procès de Moscou ne diffèrent pas de nature, avec cette conception de la discipline librement consentie.
Si l'histoire de l'oppression des classes n'avait pas légué cette notion de "discipline", il aurait fallu à la contre-révolution stalinienne la réinventer.
Nous connaissons des militants, et de premier ordre, du PCI d'Italie, qui pour échapper à ce dilemme, de participer à la campagne électorale contre leurs convictions, ou de manquer à la discipline, n'ont rien trouvé d'autre que la ruse d'un voyage opportun. Ruser avec sa conscience, ruser avec le Parti, désapprouver, se taire et laisser faire voilà les plus clairs résultats de ces méthodes. Quelle dégradation du Parti, quel avilissement des militants !
La discipline du PCI ne s'étend pas seulement aux membres du Parti d'Italie, elle est également exigée de la part des fractions belge et française.
L'abstentionnisme était une chose qui allait de soi dans la GCI ([2]). Aussi une camarade de la fraction française écrit dans son journal un article essayant de concilier l'abstentionnisme avec le participationnisme du PCI d'Italie, Selon elle, ce n'est point une question de principe, donc parfaitement admissible la participation du PCI. Cependant, elle croit qu'il eut été "préférable" de s'abstenir. Comme on le voit une critique pas très "méchante" dictée surtout par les besoins de justifier la critique de la fraction en France contre la participation électorale des trotskistes en France.
Bien mal lui en a pris. Il ne lui en fallait pas plus pour se faire tirer les oreilles, et se faire rappeler à l'ordre par le secrétaire du Parti en Italie. Fulminant, le dit secrétaire déclare inadmissible la critique à l'étranger de la politique du Comité Central d'Italie. Pour peu on reprenait l'accusation du "coup de couteau dans le dos" mais cette fois l'accusation venait de l'Italie contre la France.
Marx, Lénine disaient : enseigner, expliquer, convaincre. "...discipline... …discipline..." leur répond en écho le Comité Central.
Il n'y a pas de tâche plus importante que de former des militants conscients, par un travail persévérant d'éducation, d'explication, et de discussion politique. Cette tâche est en même temps l'unique moyen garantissant et renforçant l'action révolutionnaire. Le PCI d'Italie a découvert un moyen plus efficace : la discipline. Cela n'a rien de surprenant après tout. Quand on professe Te concept, du Génie se contemplant et se réfléchissant en lui d'où jaillit la Lumière, le Comité Central devient l'Etat major distillant et transformant cette lumière en ordres et oukases, les militants en lieutenants, sous-off et caporaux, et la classe ouvrière en masse de soldats à qui on enseigne que la "discipline est notre principale force..."
Cette conception de la lutte du prolétariat et du parti est celle d'un adjudant de carrière de l'armée française. Elle a sa source dans une oppression séculaire et une domination de l'homme par l'homme. Il appartient au prolétariat de l'effacer à jamais.
LE DROIT DE FRACTION ET
LE RÉGIME INTÉRIEUR DE L'ORGANISATION RÉVOLUTIONNAIRE.
Il peut paraître ahurissant après les longues années passées de luttes épiques au sein de l'IC sur le droit de fraction, de revenir aujourd'hui sur cette question. Elle semblait résolue, pour tout révolutionnaire, par l'expérience vécue. C’est pourtant ce droit de fraction que nous sommes obligés de défendre aujourd'hui contre les dirigeants du PCI d'Italie.
Aucun révolutionnaire ne parle de la liberté ou de la démocratie en général, car aucun révolutionnaire n'est dupe des formules en général car il cherche toujours à mettre en lumière leur contenu social réel, leur contenu de classe. Plus qu'à tout autre, on doit à Lénine d'avoir déchiré les voiles et d'avoir mis à nu les mensonges éhontés que couvraient les beaux mots de "liberté et démocratie", en général.
Ce qui est vrai pour une société de classes, l'est aussi pour les formations politiques qui agissent en son sein. La 2ème Internationale fut ; très démocratique, mais sa démocratie consistait à noyer l'esprit révolutionnaire dans un océan d'influence idéologique de la bourgeoisie. De cette démocratie où toutes les vannes sont ouvertes pour éteindre l'étincelle révolutionnaire, les communistes n'en veulent pas. La rupture d'avec ces partis de la bourgeoisie qui se disaient socialistes et démocratiques fut nécessaire et justifiée. La fondation de la 3ème Internationale sur la base de l'exclusion de cette soi-disant démocratie fut une réponse historique. Cette réponse est un acquis définitif pour le mouvement ouvrier.
Quand nous parlons de démocratie ouvrière, de démocratie à l'intérieur de l'organisation, nous l'entendons tout autrement que la Gauche socialiste, les trotskistes et autres démagogues. La démocratie à laquelle ils nous convient avec des trémolos dans la voix et le miel sur les lèvres, est celle où l'organisation est libre de fournir des ministres pour la gestion de l'Etat bourgeois, celle de participer "librement" à la guerre impérialiste. Ces démocraties organisationnelles ne nous sont pas plus proches que les organisations non-démocratiques d'Hitler et Mussolini et Staline qui font exactement le même travail. Rien n'est plus révoltant que l'annexion (les partis socialistes s'y connaissent en matière d'annexion impérialiste) de Rosa Luxembourg, faite par les Tartuffe de la Gauche socialiste pour opposer son "démocratisme" à "l'intolérance bolchevik". Rosa, comme Lénine, n'a pas résolu le problème de la démocratie ouvrière, mais l'un comme l'autre savaient à quoi s'en tenir sur la démocratie socialiste et ils la dénoncèrent pour ce qu'elle valait.
Quand nous parlons de régime intérieur, nous entendons parler d'une organisation basée sur des critères de classe et sur un programme révolutionnaire et non ouvert au premier avocat venu de la bourgeoisie. Notre liberté n'est pas abstraite en soi, mais essentiellement concrète, c'est celle des révolutionnaires groupés cherchant ensemble les meilleurs moyens d'agir pour l'émancipation sociale. Sur cette base commune et tendant au même but, bien des divergences surgissent immanquablement en cours de route. Ces divergences expriment toujours, soit l'absence de tous les éléments de la réponse, soit les difficultés réelles de la lutte, soit l'immaturité de la pensée. Elles ne peuvent être ni escamotées ni interdites mais au contraire doivent être résolues par l'expérience de la lutte elle même et par la libre confrontation des idées. Le régime de l'organisation consiste donc, non à étouffer les divergences mais à déterminer les conditions de leur solution. C'est à dire, en ce qui concerne l'organisation, de favoriser, de susciter leur manifestation au grand jour au lieu de les laisser cheminer clandestinement. Rien n'empoisonne plus l'atmosphère de l'organisation que les divergences restées dans l'ombre. Non seulement l'organisation se prive ainsi de toute possibilité de les résoudre, mais elles minent lentement ses fondations, A la première difficulté, au premier revers sérieux, l'édifice qu'on croyait en apparence solide comme un roc, craque et s'effondre, laissant derrière lui un amas de pierres. Ce qui n'était qu'une tempête se transforme en catastrophe décisive.
Il nous faut un Parti fort disent les camarades du PCI -un parti uni, or l'existence des tendances, la lutte de fractions le divisent et l'affaiblissent. Pour appuyer cette thèse, ces mêmes camarades invoquent la résolution présentée par Lénine et votée au l0ème Congrès du PC russe interdisant l'existence de fractions dans le Parti. Ce rappel de la fameuse résolution de Lénine et son adoption aujourd'hui, marque, on ne peut mieux, toute l'évolution de la fraction italienne devenue Parti. Ce, contre quoi la Gauche italienne et toute la gauche dans TIC s'est insurgée et a combattu pendant plus de 20 ans est devenu aujourd'hui le credo du "parfait" militant du PCI. Rappellerons-nous aussi que la résolution en question a été adoptée par un parti 3 ans après la révolution (elle n'aurait jamais pu être envisagée même auparavant) qui se trouvait aux prises avec des difficultés innombrables : blocus extérieur, guerre civile, famine et ruine économique à l'intérieur ? La révolution russe était dans une impasse terrible. Ou la révolution mondiale allait la sauver ou elle succombait sous la pression conjuguée du monde extérieur et des difficultés intérieures. Les bolcheviks au pouvoir subissent cette pression et reculent sur le plan économique et, ce qui est mille fois plus grave, sur le plan politique. La résolution sur l'interdiction des fractions que Lénine présentait, d'ailleurs comme provisoire , dictée par les conditions contingentes terribles dans lesquelles se débattait le parti, fait partie d'une série de mesures, qui loin de fortifier la Révolution n'ont fait qu'ouvrir un cours de sa dégénérescence.
Le l0ème congrès a vu à la fois le vote de cette résolution, l'écrasement par la violence étatique de la révolte ouvrière de Cronstadt et le début de la déportation massive des opposants du Parti, en Sibérie.
L'étouffement idéologique à l'intérieur du Parti ne se conçoit qu'allant de pair avec la violence au sein de la classe. L'Etat, organe de violence et de coercition, se substitue aux organismes idéologiques, économiques et unitaires de la classe : le parti, les syndicats et les soviets. La Guépéou remplace la discussion. La contre-révolution prend le pas sur la révolution sous le drapeau du socialisme, c'est le plus inique régime du capitalisme d'Etat qui se constitue.
Marx disait, à propos de Louis Bonaparte, que les grands événements de l'histoire se produisent pour ainsi dire deux fois, et il ajoutait : "la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce".
Le PCI d'Italie reproduit en farce ce que fut la grandeur et la tragédie de la Révolution russe et dii Parti bolchevik. Le Comité de coalition antifasciste de Bruxelles pour le Soviet de Pétrograd, Vercesi à la place de Lénine, le pauvre Comité Central de Milan pour l'Internationale communiste de Moscou où siégeaient les révolutionnaires de tous les pays, la tragédie d'une lutte de dizaines de millions d'hommes par les petites intrigues de quelques chéfaillons. Autour de la question du droit de fraction se jouait, en 1920 le sort de la révolution russe et mondiale. "Pas de fraction" en Italie en 1947 est le cri des impuissants ne voulant pas être forcés de penser par la critique et être dérangés dans leur quiétude. "Pas de fraction" menait à l'assassinat d'une révolution en 1920. "Pas de fraction" en 1947 est tout au plus une petite fausse couche d'un parti non viable.
Mais même en tant que farce, l'interdiction de fraction devient un handicap sérieux de la reconstruction de l'organisation révolutionnaire. La reconstruction du Bureau International de la GCI pourrait nous servir d'exemple palpable de la méthode en honneur.
On sait que ce Bureau International s'est trouvé disloqué avec l'éclatement de la guerre. Pendant la guerre des divergences politiques se sont manifestées dans les groupes et entre les groupes se réclamant de la GCI. Quelle devait être la méthode de reconstruction de l'unité organisationnelle et politique de la GCI ? Notre groupe préconisait la convocation d'une Conférence internationale de tous les groupes se réclamant de la GCI, et se fixant pour objectif la discussion la plus large pour toutes les questions en divergence. Contre nous prévalait l'autre méthode qui consistait à mettre le maximum de sourdine sur les divergences, et à exalter la constitution du Parti en Italie et autour de qui devait se faire le nouveau regroupement. Aussi aucune discussion ou critique internationale ne fut tolérée et un simulacre de Conférence eut lieu à la fin de 1946. Notre esprit de critique et de franche discussion fut considéré: intolérable et inacceptable et en réponse à nos documents, (les seuls qui avaient été soumis à la discussion de la Conférence) on a préféré, non seulement de ne pas les discuter mais en plus, on a estimé préférable de nous éliminer tout simplement de la Conférence.
Nous avons publié dans l'Internationalisme n°16 de décembre 1946 notre document destiné à tous les groupes se réclamant de la GCI en vue de la Conférence. Dans ce document, nous avons, selon notre vieille habitude, énuméré toutes les divergences politiques existant dans la GCI et expliqué franchement notre point de vue. Dans le même numéro d’Internationalisme on trouvera également la "réponse" de ce singulier Bureau international. "Puisque", dit cette réponse, votre lettre démontre une fois de plus la constante déformation des faits et des positions politiques prises soit par le PCI d'Italie, soit par les fractions française et belge" et plus loin, "que votre activité se borne à jeter la confusion et de la boue sur nos camarades, nous avons exclu à l'unanimité la possibilité d'accepter votre demande de participation à la réunion internationale des organisations de la GCI".
On pensera ce que l'on voudra de l'esprit dans lequel a été faite cette réponse mais on doit constater qu'à défaut d'arguments politiques elle ne manque pas d'énergie et de décision bureaucratique. Ce que la réponse ne dit pas et qui est un très haut point caractéristique de la conception de la discipline vraiment générale, professée et pratiquée par cette organisation, est la décision suivante prise en grand secret.
Voici ce que nous écrit, à ce sujet, un camarade du PCI d'Italie le lendemain de cette réunion internationale:
"Dimanche 8 décembre a eu lieu la réunion des délégués du Bureau politique International du PCI.
En référence à votre lettre adressée aux camarades des fractions de la GCI et du PCI d'Italie, réponse officielle vous sera faite et envoyée prochainement. En se référant à votre demande de réunions communes pour d'ultérieures discussions, votre ... proposition a été rejetée. En plus, ordre a été donné à tout camarade de rompre toute communication avec les fractions dissidentes. J'ai donc le regret de vous prévenir de ne pouvoir, pour l'avenir continuer mes liaisons avec votre groupe", signé JOBER- le 9 décembre 1946 ([3])
Cette décision intérieure et secrète a-t-elle encore besoin d'être commentée ? Vraiment pas. Nous ajouterons seulement qu'à Moscou, Staline a évidemment des moyens plus appropriés pour isoler les révolutionnaires : les cellules de la Loubianka, (prison de la Guépéou) les isolateurs de Verkhni Ouralsk et, au besoin, la balle dans la nuque. Dieu merci la GCI n'a pas encore cette force et nous ferons tout pour qu'elle ne l'ait pas et jamais, mais ce n'est vraiment pas de sa faute. Ce qui importe en définitive c'est le but poursuivi et la méthode, consistant à chercher à isoler, à vouloir faire taire la pensée de l'adversaire, de ceux qui ne pensent pas comme vous. Fatalement et en correspondance avec la place qu'on occupe et la force qu'on possède, on est amené à des mesures de plus en plus violentes. La différence avec le stalinisme n'est pas une question de nature mais uniquement de degré.
Le seul regret que doit avoir le PCI c'est d'être obligé de recourir à ces misérables moyens "d'interdire aux membres tout contact avec les fractions dissidentes".
Toute la conception sur le régime intérieur de l'organisation et de ses rapports avec la classe se trouve illustrée et concrétisée par cette décision, à notre avis, monstrueuse et écoeurante . Excommunication, calomnie, silence imposé, tels sont les méthodes qui se substituent à l'explication, la discussion et la confrontation politiques. Voilà un exemple type de la nouvelle conception de l'organisation.
CONCLUSION
Un camarade de la GCI nous écrit une longue lettre pour "décharger" -comme il dit- son estomac de tout ce qui lui pèse, depuis la coalition antifasciste jusqu'à la nouvelle conception du Parti. "Le parti -écrit-il dans la lettre- n'est pas le but du mouvement ouvrier, il est seulement un moyen". Mais la fin ne justifie pas tous les moyens. Ceux-ci doivent être imprégnés du caractère de la fin qu'ils servent pour l'atteindre, la fin doit se retrouver dans chacun des moyens employés, par conséquent le parti ne pourra pas être érigé suivant les conceptions léninistes, car cela signifierait, une fois de plus, absence de démocratie : discipline militaire, interdiction de la libre expression, délits d'opinion, monolithisme et mystification du parti.
Si la démocratie est la plus belle fumisterie de tous les temps, cela ne doit pas nous empêcher d'être pour la démocratie prolétarienne dans le Parti, le mouvement ouvrier et la classe. Ou bien qu'on propose un autre terme. L'important est que la chose reste. Démocratie prolétarienne signifie droit d'expression, liberté de pensée, liberté de ne pas être d'accord, suppression de la violence et de la terreur sous toutes leurs formes, dans le parti et naturellement dans la classe.
Nous comprenons et partageons entièrement l'indignation de ce camarade quand il s'élève contre l'édification du parti caserne et de la dictature sur le prolétariat. Combien est loin cette saine et révolutionnaire conception de l'organisation et du régime intérieur de cette autre conception que nous a donnée récemment un des dirigeants du PCI d'Italie. "Notre conception du Parti"; a-t-il dit textuellement "est un parti monolithique, homogène et monopoliste".
Une telle conception jointe au concept du chef génial, à la discipline militaire, n'a rien à voir avec l'oeuvre révolutionnaire du prolétariat, où tout est conditionné par l'élévation de la conscience, par la maturation idéologique de la classe ouvrière. Monolithisme, homogénéité et monopolisme est la trilogie divine du fascisme et du stalinisme.
Le fait qu'un homme ou un parti, se disant révolutionnaire, puisse se revendiquer de cette formule, indique tragiquement toute la décadence, toute la dégénérescence du mouvement ouvrier. Sur cette triple base on ne construit pas le parti de la révolution, mais plutôt une nouvelle caserne pour les ouvriers. On contribue effectivement à maintenir les ouvriers à l'état de soumission et de domination. On fait une action contre-révolutionnaire.
Ce qui nous fait douter de la possibilité du redressement du PCI d'Italie, plus que ses erreurs proprement politiques, ce sont ses conceptions de I l'organisation, et de ses rapports avec l'ensemble de la classe. Les idées par lesquelles s'est manifestée la fin de la vie révolutionnaire du parti bolchevik et qui marquèrent le début de la déchéance :l’interdiction de fraction, la suppression de la liberté d'expression dans le parti et dans la classe, le culte de la discipline, l'exaltation du chef infaillible, servent aujourd'hui de fonde ment, de base au PCI d'Italie et à la GCI. Persistant dans cette voie le PCI ne pourra jamais servir! la cause du socialisme. C'est avec pleine conscience et mesurant toute la gravité que nous leur crions: " Halte là. Il faut rebrousser chemin, car ici la pente est fatale".
Marc
[1] Aux dernières nouvelles le PCI d'Italie ne participerait pas aux prochaines élections. Ainsi en a décide le Comité Central. Est-ce à la suite d'un réexamen de la position, et d'une discussion dans le Parti, détrompez-vous. Il est toujours trop prématuré d'ouvrir une discussion qui risquerait de troubler les camarades, nous dit notre dirigeant bien connu. Mais alors ? Tout simplement le Parti a perdu beaucoup de membres et la caisse est vide. Ainsi, faute de munitions le Comité Central a décidé d'arrêter la guerre et de ne pas participer aux PROCHAINES élections. C'est une position commode qui arrange tout le monde et a en plus l'avantage de ne troubler personne. C'est ce que notre dirigeant appelle encore "la transformation renversée de la quantité en qualité".
[2] Gauche Communiste Internationale
[3] Il s'agit du camarade JOBER qui était alors en discussion avec nous, au nom de la fédération de Turin du PCI qu'il représentait. Depuis, la Fédération de Turin protestant contre les méthodes du Comité Central, est devenue autonome et à ce titre a participé à la Conférence Internationale de contact (Voir Internationalisme n° 24).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
- Bordiguisme [126]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]
Heritage de la Gauche Communiste:
"Battaglia Comunista" - A propos des origines du Parti Communiste Internationaliste
- 3187 reads
Beaucoup de camarades, pour n'être pas très familiers de l'histoire de la Gauche Communiste, pourraient avoir quelques difficultés à s'orienter dans les références à une période du mouvement révolutionnaire dont on ne sait que peu de chose, sinon rien. Nous nous en rendons compte et c'est justement pour combler ce "trou" dans la compréhension de notre passé que le CCI s'est fixé la tâche de republier tout une série de vieux textes. Après l'article de Battaglia Comunista, qui est reproduit ici, la republication de "1'Appel" de 45 a aussi incité la CWO (Communist Workers Organisation) à répondre avec un article dans le n°20 de Revolutionary Perspectives (nouvelle série). En attendant de répondre avec l'ampleur nécessaire aux critiques qui nous sont faites par ces camarades, nous nous limiterons à une brève observation sur la méthode.
Pour la CWO, le CCI ment en parlant d'appel aux staliniens, laissant ainsi entendre "qu'il se serait ainsi retourné vers les partis staliniens et non pas simplement vers les ouvriers tombés sous leur influence". (Revolutionary Perspectives n°20, p.36). A ce point, il y a deux objections à faire. En premier lieu, ce n'est pas vrai : ''1’Appel" n’est pas adressé aux travailleurs influencés par les partis contre-révolutionnaires mais au Comité d'Agitation des Partis Staliniens, sociaux-démocrates, etc. En deuxième lieu, même si le CCI s'était trompé dans l'évaluation de "1'Appel", il n'a rien "laissé entendre", mais il a republié le texte intégralement de façon à ce que tous les camarades puissent seuls les juger en connaissance de cause. A ce propos, sur le contenu du texte, quel est l'appréciation de CWO ?
Des attitudes de ce type ne sont pas productives, et surtout sont en contradiction avec l'excellente initiative de publier dans le même numéro de Revolutionary Perspectives toute une série de textes de discussion interne sur la Gauche Italienne, pour "poser le débat dans l'ensemble du Mouvement Révolutionnaire". Jusqu'à aujourd'hui, le CCI était pratiquement la seule organisation à publier dans sa presse quelques-unes de ses discussions internes. Pour le CCI et CWO, il ne reste plus qu'à souhaiter que Battaglia Comunista suive leur exemple.
« II arrive souvent que dans les polémiques partiales qui n'ont pas d'arguments trop valables, on recourt à des fourberies, au milieu de la rhétorique et de la démagogie. C'est ainsi que le CCI, par exemple, en argumentant sur la crise de Programme Communiste dans Revue Internationale n°32, fait semblant de trouver dans les origines du Parti Communiste Internationaliste, et donc dans la période 1943-45, des péchés originels qui vouaient le Parti Communiste Internationaliste à la damnation (ou au moins une des fractions qui a scissionné en 1952).
Nous ne voulons pas répondre longuement ici, mais faire seulement quelques notes télégraphiques :
-
Le document "Appel du Comité d'Agitation du PCInt.", contenu dans le numéro de Prometeo d'Avril 45 fut-il une erreur ? D'accord. Ce fut la dernière tentative de la Gauche Italienne d'appliquer la tactique de "front unique à la base" préconisé par le PC d'Italie dans sa polémique avec l'IC dans les années 21-23. En tant que tel, nous la cataloguons dans les "péchés véniels" parce que nos camarades ont su l'éliminer tant sur un plan politique que théorique, avec une clarté qui aujourd'hui nous rend sûrs de nous face à quiconque.
-
Ça et là, quelques autres erreurs tactiques ont été commises et sans attendre le CCI, nous les avons déjà révisées tout seul depuis un bon moment, et nous les revoyons continuellement pour nous éviter de les répéter. Mais ces erreurs là ne nous ont pas empêchés d'aller de l'avant, en les corrigeant justement, et nous n'avons jamais quitté le terrain qui nous est propre, celui du marxisme révolutionnaire.
-
C'est ceux qui ne bougent pas qui ne se trompent jamais, ou ceux qui n'existent pas. Et alors, au cœur de la guerre impérialiste, pendant que les masses exploitées et données au massacre manifestaient quelques premières réactions et tendances à desserrer l'étau des forces interclassistes liées aux blocs impérialistes, les "pères" du CCI ayant jugé que le prolétariat était défait parce qu'il avait ... accepté la guerre, restaient au chaud, sans penser le moins du monde à se "salir les mains" dans le mouvement ouvrier.
-
Après quoi, ayant émis le jugement que le prolétariat n'était plus prostré et défait, ils ont réapparu, ils ont ramassé quelques étudiants et quelques intellectuels captieux pour "féconder" les nouvelles luttes révolutionnaires qui se présenteront ou sont latentes, qui nous amèneront de façon grandiose à la Révolution. Et nous voilà donc en présence de la véritable erreur fondamentale du CCI. Le péché originel du CCI réside justement dans la façon de poser les problèmes : celui-là, comme sur celui du rapport classe-conscience-Parti. Si (et nous disons si, parce qu'il y a une forte probabilité) la guerre éclate avant que la classe ouvrière ne surgisse, le CCI ne pourra que retourner à la maison, tandis que nous, encore une fois, nous nous "salirons les mains" en travaillant avec toutes les possibilités que nous donnera notre force organisationnelle, pour le défaitisme révolutionnaire, pendant, après, comme avant la guerre.
-
En ce qui concerne les erreurs de Programma, elles sont aussi grandes que son opportunisme de fond. (Voir numéro précédent de Battaglia Communista). Dans Programme Communiste des questions sont restées ouvertes (bien qu'ils disent le contraire), des questions importantes : celles de l'impérialisme, des guerres de libération nationale, et celle, sûrement pas par hasard, du syndicalisme. C'est sur ces questions que Programme est entré en crise, de même que 1e CCI. Et, si on nous le permet, c'est bien cela que nous écrivions dans les numéros 15 et 16 de décembre 81. Dans l'article "Crise du CCI ou crise du mouvement révolutionnaire ?" où nous disions que ce sont "des organisations bien précises" qui sont en crise, le CCI et Programma. Ces organisations qui n'ont pas les idées claires sur des problèmes très importants, "sautent" quand ceux-ci, d'une manière ou d'une autre, ne répondent pas au schéma prévu et surgissent avec force. Ce sont des "organisations-crise" qui n'arrivent pas à intervenir dans le mouvement. Elles sont "vivantes" seulement quand la situation est "ferme", solide. Elles survivent comme un poids mort tant que l'équilibre n'est pas dérangé. »
Battaglia Communista n°3 – Février 1983
Notre réponse
En premier lieu, nous prenons acte que BC confirme l’authenticité et la fidélité de l’original des textes que nous avons publiés.
Ceci éclaircit, BC se demande : "Est-ce que ça a été une erreur ? Admettons.", mais elle en traite comme s’il s’agissait tout au plus d’un "pêché véniel". On ne peut que rester admiratif devant la délicatesse et l’habileté avec lesquelles elle ménage son amour propre. Si une proposition de front unique avec les bouchers staliniens et sociaux-démocrates n’est qu’un " pêché véniel", qu’aurait alors dû faire le PC.Int. en 45 pour qu’on puisse parler explicitement d’erreur… Entrer au gouvernement ? Mais BC nous rassure : ses errements, elle les a révisés depuis un bon moment, sans attendre le CCI, et elle n’a donc jamais eu de raisons de les cacher. C’est possible. Mais quand, en 77, nous avons mis pour la première fois l’accent, dans notre presse, sur la série d’erreurs du PC.Int., dans l’après-guerre immédiat, Battaglia a répliqué dans une lettre indignée qu’elle admettait des défaillances, mais soutenait qu’elles étaient sous l’exclusive responsabilité des camarades1 qui étaient sortis en 52 pour constituer le PC.Int.
Nous avons répondu à l’époque qu’il nous semblait étrange que Battaglia se lave les mains de tout. En substance, Battaglia nous dit :
"Nous avons participé à la constitution du PC.Int., nous et eux. Ce qui était bon, c’était nous. Ce qui était mauvais, c'était eux". "En admettant qu'il en ait été ainsi, reste le fait que le "mauvais" existait et ... que personne n'a rien trouvé à redire." (Extrait de Rivoluzione Internazionale n°7 – 1977)
C'est trop facile d'accepter en silence, compromis sur compromis, pour faire le Parti avec Bordiga (dont le nom rassemble des milliers d'adhérents) et avec Vercesi (qui anime un réseau de contacts à l'extérieur d'Italie), et ensuite quand les choses vont mal, de se mettre à crier que c'est uniquement la faute des bordiguistes. Pour faire un compromis, il faut au moins être deux...
A part ça, la prétention de jeter la faute sur les "mauvais" n'est plus de règle. L'appel de 45 n'a pas été écrit par les "Groupes du Sud" qui faisaient référence à Bordiga, mais par le centre du Parti au Nord, constitué par la tendance Damen, aujourd'hui Battaglia Communista. Pour donner encore un exemple, entre mille possibles, il faut se souvenir que les pires erreurs localistes et activistes provenaient de la Fédération de Catanzaro, dirigée par Francesco Maruca, qui était membre du PCI stalinien jusqu'à son expulsion en 44. Cependant, au moment de la scission de 52, la Fédération de Catanzaro n'a pas rejoint Programme Communiste et est restée à Battaglia Comunista et, en fait, un article dans les n°26/27 de Prometeo citait encore Maruca comme un militant exemplaire. C'est vrai que l'article (une espèce d'apologie) ne parlait pas des positions défendues par Maruca ; au contraire, pour faire plus joli, l'article faisait dater de 1940 son exclusion du PCI, c'est-à-dire anticipait de 4 ans. Voila comment Battaglia Comunista règle continuellement les comptes à ses erreurs.
Au début, Battaglia se vantait publiquement d'avoir un passé sans tâche. Ensuite, quand ses errements ont été révélés, elle les a attribués aux "programmistes". Quand elle n'a plus pu nier sa propre participation, elle nous les a présentés en les réduisant à de simples péchés véniels. Mais cependant, il faut se décharger de ces errements sur quelqu'un, et cette fois-ci, c'est sur nous que c'est tombé, ou mieux, sur nos "pères" qui ayant prononcé le jugement que le prolétariat était défait parce qu'il avait accepté la guerre, sont restés au chaud sans penser le moins du monde à "se salir les mains dans le mouvement ouvrier".
L'accusation de désertion du combat de la classe est une accusation grave et le CCI tient à répondre immédiatement, pas tant pour se disculper lui-même ou ses "pères" –il n'en a pas besoin–, mais pour défendre le milieu révolutionnaire de pratiques inadmissibles telles que celles de porter des accusations très graves sans ressentir un minimum le besoin de prouver ce qu'on affirme.
Il est hors de doute que tout une partie de la Fraction Italienne et la Fraction Belge de la Gauche Communiste Internationale durant la guerre, considérait le prolétariat comme non existant socialement et a abandonné en conséquence toute activité de classe jusqu'à participer vers la fin de la guerre au Comité Antifasciste de Bruxelles. Contre cette tendance conduite par Vercesi, la majorité de la Fraction italienne réagit et se regroupe à Marseille dès 1940. A partir de 1942 est formé à côté et avec l'aide de la Fraction italienne, le noyau français de la Gauche Communiste qui commence à publier la revue Internationalisme et le journal d'agitation l’Etincelle en 1944. Le débat se focalise sur la nature de classe des grèves des années 43 en Italie :
"Une tendance dans la fraction italienne, la tendance Vercesi et en partie aussi la fraction belge, niait, et cela jusqu'à la fin des hostilités, l'apparition du prolétariat italien sur la scène politique. Pour cette tendance, les événements de 1943 n'étaient qu'une manifestation de la crise économique, dite crise de l'économie de guerre, ou bien une révolution de palais, une chamaillerie dans les hautes sphères dirigeantes du capitalisme italien et rien de plus. Le prolétariat italien, pour cette tendance, était et continuait d'être absent aussi bien politiquement que socialement. Cela devait cadrer avec toute une théorie échafaudée par cette tendance sur "l'inexistence sociale du prolétariat pendant la guerre et pendant toute la période de l'économie de guerre". Aussi, après 43 comme avant, ils préconisaient la passivité absolue allant jusqu'à la dissolution organisationnelle de la Fraction. Avec la Fraction Italienne, nous avons combattu pied à pied cette tendance liquidationniste dans la GCI. Avec la Fraction Italienne, nous avons analysé les événements de 43 en Italie comme une manifestation avancée de la lutte sociale et de l'ouverture du cours vers la révolution et préconisé l'orientation de la transformation de la Fraction en Parti." (Internationalisme n°7 – Février 46. A propos du 1er Congrès du PC. Internationaliste d'Italie.)
En 1945, on a tout une série de coups de théâtre. Quand on a su qu'en Italie s'est effectivement constitué un parti à la fin de 1943, la tendance Vercesi. grâce à un triple saut périlleux, se retrouve dans la direction de ce parti, aux côtés de la tendance exclue en 1936 pour sa participation à la Guerre d'Espagne et de la majorité de la Fraction italienne qui l'avait exclue à ce moment- là !
Les seuls étrangers à cette embrassade opportuniste, ce sont nos "pères" d'Internationalisme. Et ce n'est pas sans raison. C'est justement parce que, au contraire de Vercesi, ils ont été au premier rang dans le travail illégal pendant la guerre pour la reconstitution de l'organisation prolétarienne, qu'ils n'ont pas ressenti le besoin de se cacher en criant "vive le parti". Au contraire, en constatant que le capitalisme a réussi à défaire les réactions ouvrières contre la guerre (mars 43 en Italie, printemps 45 en Allemagne) et à prévenir toute possibilité d'ouverture d'une situation pré-révolutionnaire, ils ont commencé à se poser la question de savoir si la perspective de la transformation de la Fraction en Parti était encore valable. De plus, la Gauche Communiste de France, tout en continuant à défendre la nature prolétarienne du PC.Int., même face aux attaques des autres groupes2, n'a pas accepté pour autant de voiler pieusement sa non homogénéité politique et ses errements continuels. Au contraire, elle n'a cessé d'exiger une rupture politique avec toutes les tentations opportunistes :
"Ou la tendance Vercesi exécute publiquement devant le Parti et le prolétariat sa politique de coalition anti-fasciste et toute sa théorie opportuniste qui l'ont conduite à cette politique, ou bien c'est au Parti, après une discussion critique ouverte d'exécuter théoriquement, politiquement et organisationnellement la tendance opportuniste de Vercesi." (Idem)
Quelle fut la réaction du PC.Int. ? Pendant plus d'un an, il a fait la sourde oreille et a ignoré les appels répétés d'Internationalisme. A la fin de 46, à l'occasion de la reconstitution du Bureau International de la Gauche Communiste sous l'impulsion du PC.Int. et des noyaux français et belge qui s'y référaient, Internationalisme a envoyé une énième lettre ouverte dans laquelle il demandait à participer à la Conférence afin d'avoir une discussion franche sur les points passés sous silence et d'arriver à cerner politiquement définitivement les glissements opportunistes. Pour toute réponse, il y eut cette lettre :
"Puisque votre lettre démontre une fois de plus la constante déformation des faits et des positions politiques prises soit par le PC.Internationaliste d'Italie, soit par les Fractions française et belge ; que vous ne constituez pas une organisation politique révolutionnaire et que votre activité se borne à jeter de la confusion et de la boue sur nos camarades, nous avons exclu a l'unanimité la possibilité d'accepter votre demande de participation à la Réunion Internationale des organisations de la GCI." Signé : "Pour le PCI d'Italie" (Internationalisme n°16 ; réponse du Bureau International de la GCI à notre lettre).
C'est ainsi que les "pères" de Battaglia pour conserver l'alliance opportuniste avec la tendance Vercesi, ont liquidé l'unique tendance de la Gauche Communiste Internationale qui avait eu le courage politique de ne pas s'adapter au fait d'avoir des chapelles et la mémoire courte.
Quant au courage physique, ce n'est pas notre habitude de nous en vanter, mais nous pouvons assurer à Battaglia qu'il fallait beaucoup plus de courage pour coller des affiches défaitistes contre les résistants pendant 1a "1ibération" de Paris qu'il n'en fallait pour participer, encadré dans les rangs des partisans, à la chasse aux fascistes pendant la "libération" du nord de l'Italie.
Pour revenir à aujourd'hui, Battaglia dit que ce n'est pas le mouvement révolutionnaire qui est en crise, mais le CCI, Programme Communiste, tous les autres groupes de la Gauche Italienne (à l'exception de Battaglia) et en plus tous les groupes des autres pays qui n'ont pas participé à la Conférence Internationale organisée par Battaglia et la CWO. Mais, pardon, si on enlève ces groupes, qu'est-ce qui reste ? Seulement Battaglia et la CWO ! Il vaudrait mieux alors soutenir que le mouvement révolutionnaire n'existe pas et qu'en conséquence il ne peut pas être en crise. En plus, la crise ne se manifeste pas que par 1a désintégration des groupes ou des scissions, elle se manifeste aussi par des glissements politiques, comme quand la CWO soutenait qu'en Pologne il fallait faire "la révolution maintenant !", ou quand Battaglia a présenté des forces plus que douteuses comme l’UCM iranienne et KOMALA kurde comme des organisations communistes et les a poussées jusqu'à soutenir de façon critique "l'échange de prisonniers" (!) entre KOMALA et 1'armée iranienne.
Il faut noter que tant Battaglia que la CWO ont corrigé leurs erreurs après les critiques fraternelles qui ont paru dans notre presse, anglaise en particulier. Mais ça démontre justement que les hésitations momentanées de tout groupe peuvent être corrigées aussi grâce à l'effort des autres groupes et qu'aucune organisation révolutionnaire ne peut donc se considérer comme totalement indépendante de l'ensemble du milieu révolutionnaire.
Battaglia croit qu'en republiant les documents du mouvement révolutionnaire, le CCI veut démontrer que Battaglia a une histoire pleine d'erreurs et se trouve donc en dehors du camp prolétarien. En cela, Battaglia commet une grave erreur ; les hésitations d'un Maruca n'appartiennent pas à Battaglia, pas plus que ne lui appartient le défaitisme cohérent d'un Damen, pas plus que les erreurs et les contributions d'un Vercesi n'appartiennent à Programme Communiste. Tout cela, en bien comme en mal, fait partie du patrimoine de tout le mouvement révolutionnaire et il incombe à l'ensemble du mouvement d'en faire un bilan critique qui permettra d'en tirer toutes les leçons.
Ce bilan ne peut être tiré par des groupes isolés, réduits à panser chacun ses propres plaies, mais réclame la possibilité d'un débat ouvert et organisé comme cela était possible dans le cadre des Conférences Internationales des groupes de la Gauche Communiste (1977, 78, 79). Battaglia a contribué à enterrer les Conférences3 ; il n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui, elle ne comprenne pas comment contribuer au débat.
Beyle
1 Jusqu'en 1952, la tendance de Bordiga et la tendance de Damen étaient dans la même organisation, le P.C.Internationaliste. On ne saurait donc faire porter la responsabilité des événements du PC.Int. sur la seule tendance de Bordiga, d'autant plus que celle-ci était minoritaire, de sorte qu'au moment de la scission, c'est elle qui est partie du PC.Int. pour fonder le P.C.International (Programma Comunista), la tendance de Damen conservant les titres "Prometeo" et "Battaglia Comunista". BC a beau polémiquer durement avec Programme Communiste, elle ne s'attaque jamais à ses origines parce que ce sont ses propres origines.
2 Voir dans l'article cité le paragraphe "Les révolutionnaires (en Italie) doivent adhérer au PCI italien en réponse aux Communistes Révolutionnaires de France et d'Allemagne".
3 Revue Internationale n°16, 17, 22 – Textes, compte-rendus, procès-verbaux des Conférences Internationales (Milan 77 ; Paris 78. 79).
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [381]
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [449]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique : les doutes sur la classe ouvrière
- 3855 reads
Lorsque la classe ouvrière montre ouvertement sa force, menaçant de paralyser la machine de production, faisant reculer l’Etat, déchaînant un bouillonnement de vie dans l'ensemble de la société, carme ce fut le cas, par exemple, pendant la grève de masse de l'été 1980 en Pologne, la question : "la classe ouvrière est-elle la force révolutionnaire de notre époque ?" semble saugrenue. En Pologne, comme dans toutes les luttes sociales qui ont ébranlé le capitalisme, le coeur du mouvement social n'était autre que le coeur de la classe ouvrière : les chantiers navals de la Baltique, la sidérurgie de Nova Huta, les mines de Silésie. Que les paysans polonais se mettent en lutte, que les étudiants ou les artistes décident de combattre l'Etat, ils n'ont d'autres réflexes que "d'aller voir les ouvriers".
Quand les ouvriers parviennent à briser les forces qui les atomisent en une poussière impuissante, lorsque leur union explose à la face des classes dominantes ébranlant tout leur édifice, les contraignant à faire marche arrière, il est aisé, sinon évident; de comprendre comment et pourquoi la classe ouvrière est la seule force capable de concevoir et d'entreprendre un bouleversement révolutionnaire de la société.
Mais, dès que le combat ouvert cesse, dès que le capital reprend le dessus et repose sa chape de plomb sur la société, ce qui semblait si évident à un moment donné, paraît s'estomper, même dans le souvenir, et le capital décadent impose sur ses sujets sa propre vision sinistre du monde : celle d'une classe ouvrière soumise, atomisée, entrant en rangs silencieux tous les matins à l'usine, incapable de rompre ses chaînes par elle-même.
Il ne manque pas alors de "théoriciens" pour expliquer à qui veut bien l'entendre, que la classe ouvrière, en tant que telle est, en fait, partie intégrante du système, qu'elle y a une place à défendre et que seuls des illuminés aveuglés par leur propre fanatisme peuvent voir en cette masse d'individus "près de leurs sous", la porteuse d'une nouvelle société.
Ceux qui défendent toujours ouvertement les bienfaits du système capitaliste, que ce soit sous sa forme "occidentale" ou stalinienne, n'ont jamais d'autre credo à la bouche. Mais les périodes de recul de la lutte ouvrière font aussi régulièrement réapparaître des groupes ou publications qui théorisent les "doutes" sur la nature historique de la classe ouvrière, même parmi ceux qui se réclament de la révolution communiste et qui, en outre, n'ont d'illusions ni sur la nature des pays dits "socialistes" ni sur celle des partis occidentaux dits "ouvriers".
Les vieilles idées d'origine anarchiste et populiste suivant lesquelles la révolution sera essentiellement l'oeuvre non pas d'une classe économique spécifique, mais de l'ensemble des hommes qui, d'une façon ou d'une autre, subissent l'inhumanité du capitalisme, gagnent du terrain.
Tout comme au moment du recul des luttes ouvrières après la vague de 1968-74, l'idéologie "moderniste", l'idéologie de la "théorie moderne de la révolution" qui rejette "le vieux mouvement ouvrier" et son "marxisme poussiéreux" semble connaître, actuellement, avec le repli des luttes ouvrières de l'après Pologne un certain regain. En témoignent, entre autres, en France l'apparition de la revue "La Banquise" ([1] [450]) et le passage au rythme trimestriel de la revue "La Guerre Sociale" ([2] [451]), et en Grande Bretagne la réapparition de "Solidarity" ([3] [452]) ([4] [453])
Ces publications sont relativement différentes entre elles. "La Guerre Sociale" et "La Banquise" s'inscrivent plus directement dans une ligne théorique qui passe par Invariance et Le Mouvement Communiste. Mais elles partagent toutes le même rejet de cette idée de base du "vieux" marxisme : la classe ouvrière est la seule force véritablement révolutionnaire de la société ; la destruction du capitalisme et l'ouverture vers une société communiste exigent une période de transition caractérisée par la dictature politique de cette classe.
Nous n'avons pas l'intention de développer ici une critique complète de l'ensemble des idées défendues par ce type de courant. La polémique avec ces tendances est d'ailleurs souvent stérile et ennuyai se, étant donné, premièrement, qu'il s'agit de groupes assez informels (et fiers de l'être) regroupant divers individus "indépendants", ce qui fait que d'un article à l'autre on trouve dans la même publication des concepts, des idées qui se contredisent i deuxièmement, les tenants du modernisme cultivent en permanence les ambiguïtés, les "oui, mais", les "non, mais", en particulier vis-à-vis du marxisme dont ils manient souvent avec aisance le vocabulaire (on cite Marx dès que l'on peut) tout en en rejetant l'essentiel. De ce fait, ils peuvent toujours répondre aux critiques par le classique "ce n'est pas ce que nous disons, vous déformez".
 Ce qui nous importe c'est
de réaffirmer, dans un moment de recul provisoire des luttes de la classe ouvrière
et de mûrissement accéléré des contradictions sociales qui
conduisent à la révolution communiste, le rôle central de cette classe,
pourquoi elle est la classe révolutionnaire et pourquoi, du nouent
qu'on ignore cette réalité essentielle de notre époque, on se
condamne d'une part à ne pas comprendre le cours de l'histoire qui se déroule sous
nos yeux (voir le pessimisme larvé de "La Banquise"),
et d'autre part à tomber dans les pièges les plus grossiers de l'idéologie
bourgeoise (voir les ambiguïtés de "La Guerre Sociale" et de
"Solidarity" sur le syndicat "Solidarité" en
Pologne) .
Ce qui nous importe c'est
de réaffirmer, dans un moment de recul provisoire des luttes de la classe ouvrière
et de mûrissement accéléré des contradictions sociales qui
conduisent à la révolution communiste, le rôle central de cette classe,
pourquoi elle est la classe révolutionnaire et pourquoi, du nouent
qu'on ignore cette réalité essentielle de notre époque, on se
condamne d'une part à ne pas comprendre le cours de l'histoire qui se déroule sous
nos yeux (voir le pessimisme larvé de "La Banquise"),
et d'autre part à tomber dans les pièges les plus grossiers de l'idéologie
bourgeoise (voir les ambiguïtés de "La Guerre Sociale" et de
"Solidarity" sur le syndicat "Solidarité" en
Pologne) .
Cela est d'autant plus nécessaire que tout comme les étudiants "radicaux" de 1968, certains groupes modernistes développent souvent une analyse lucide et fouillée de certains aspects du capitalisme décadent, ce qui ne peut qu'ajouter à la crédibilité de leurs fadaises politiques.
QU'EST-CE-QUE LE PROLETARIAT ?
Chez Marx, comme chez tous les marxistes, les termes de classe ouvrière et de prolétariat ont toujours été synonymes. Cependant, parmi ceux qui remettent en question la nature révolutionnaire de la classe ouvrière comme telle, sans pour autant oser se réclamer directement de l'anarchisme ou du populisme radical de la fin du siècle dernier, il est fréquent d'inventer une distinction entre les deux mots. La classe ouvrière, ce serait les ouvriers et les employés tels qu'on les voit tous les jours sous la domination du capital avec leurs luttes pour de meilleurs salaires et des emplois. Le prolétariat, ce serait une force révolutionnaire aux contours plus ou moins indéterminés, englobant un peu tout ce qui, à un moment ou à un autre, peut se révolter contre l'autorité de l'Etat. Cela peut aller de l'ouvrier de la métallurgie au voyou professionnel en passant par les femmes battues, riches ou pauvres, les homosexuels ou les étudiants, suivant le "penseur moderniste". (Voir la fascination qu’exerçait sur 1'Internationale Situationniste ou sur Le Mouvement Communiste les "hors-la-loi" ; voir le journal "Le Voyou" au milieu des années 70 ; voir l'emballement de "Solidarity" dans le féminisme).
Pour la revue Invariance (Camatte), en 1974, la définition du prolétariat finit par être élargie à son maximum : l'humanité entière. Ayant compris que la domination du capital était devenue de plus en plus totalitaire et impersonnelle sur la société, on en déduisait que c'est toute la "communauté humaine" qui devrait se révolter contre le capital. Ce qui revenait à nier la lutte de classes comme dynamique de la révolution.
Aujourd'hui, "La Guerre Sociale" nous offre une autre définition, plus restrictive, mais à peine plus précise :
"Le prolétaire, ce n'est pas 1'ouvrier ou même 1'ouvrier et l'employé, travailleur au bas de l'échelle. Le prolétaire, ce n'est pas le producteur, même si le producteur peut être prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui est coupé de',c'est 1' 'exclu', c'est le sans réserve '" ("La Guerre Sociale" n°6, "Lettre ouverte aux camarades du Parti Communiste International maintenu", décembre 82).
Il est vrai que le prolétaire est exclu, coupé de toute emprise réelle sur la conduite de la vie sociale et donc de sa vie ; il est vrai que contrairement à certaines classes exploitées pré-capitalistes, il ne possède pas ses moyens de production et vit sans réserve. Mais il n'est pas que cela. Le prolétaire n'est pas seulement un "pauvre" comme un autre. Il est aussi un producteur, le producteur de la plus-value qui est transformée en capital. Il est exploité collectivement et sa résistance au capital est immédiatement collective. Ce sont des différences essentielles.
Elargir ainsi la définition du prolétariat, ce n'est pas agrandir la classe révolutionnaire, mais la diluer dans le brouillard de l'humanisme.
"La Banquise", à la suite d'invariance, croit pouvoir se référer à Marx pour élargir la notion de prolétariat.
"A partir du moment (...) où le produit individuel est transformé en produit social, en produit d'un travailleur collectif dont les différents membres participent au maniement de la matière à des degrés très divers, de près ou de loin, ou même pas du tout, les déterminations de travail productif, de travailleur productif, s'élargissent nécessairement. Pour être productif, il n'est plus nécessaire de mettre soi-même la main à 1'oeuvre, il suffit d'être un organe du travailleur collectif ou d'en remplir une fonction quelconque". (Marx. Le Capital, Livre 1, Oeuvres, Gallimard, I, 1963, p.1001-1002).
Pourtant, ce que Marx met ici en relief, ce n'est pas l'idée que tous et n'importe qui dans le monde seraient devenus productifs ou prolétaires. Ce qu'il souligne, c'est que la qualité spécifique de la tâche accomplie par tel ou tel travailleur ne constitue pas dans le capitalisme développé un critère, une détermination valable pour savoir s'il est productif ou pas. En modifiant le processus de production suivant ses besoins, le capital exploite l'ensemble de la force de travail qu'il achète, comme celle d'un travailleur productif. L'utilisation concrète qu'il fait de chacun des membres de celui-ci, ouvrière de boulangerie ou employé de bureau, productrice d'armes ou balayeur, est secondaire du point de vue de savoir qui est exploité par le capital. C'est l'ensemble collectif qui l'est. Le prolétariat, la classe ouvrière inclut bien aujourd'hui la plupart des employés dans le secteur dit "tertiaire".
Pour autant qu'elle se soit développée, la domination du capital n'a pas généralisé à toute la société la condition de prolétaire. Le capital a engendré de gigantesques masses de marginaux sans-travail, surtout dans les pays sous-développés. Il a laissé survivre des secteurs pré-capitalistes, comme le petit paysannat individuel, le petit commerce, l'artisanat, les professions libérales.
Le capital domine tous les secteurs de la société. Et tous ceux qui subissent sa domination dans la misère ont des raisons de se révolter contre elle. Mais seule la partie qui est directement liée au capital par le salariat et la production de la plus-value, est véritablement antagonique au capital : elle seule constitue le prolétariat, la classe ouvrière.
POURQUOI LE PROLETARIAT EST LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE ?
Avant Marx, la dynamique de l'histoire de la société demeurait un mystère. Il fallait avoir recours à des notions de type religieux, telles "la Providence", le génie des chefs militaires, ou l’Histoire avec un grand H, pour tenter, en vain, d'en dresser un tableau cohérent. En démontrant la place centrale de la lutte de classes dans cette dynamique, le marxisme a, pour la première fois, permis de la comprendre.
Cependant, ce faisant, il n'a pas fourni une façon d'interpréter le monde mais une vision du monde permettant de le transformer. Marx considérait que sa découverte fondamentale n'était pas l'existence de la lutte de classes en soi -ce que les théoriciens bourgeois avaient déjà établi-, mais, le fait que cette lutte de classes conduit à la dictature du prolétariat.
L'antagonisme irréconciliable entre classe ouvrière et capital -dit Marx- doit conduire à une lutte révolutionnaire pour la destruction des rapports sociaux capitalistes et l'établissement d'une société de type communiste. Cette révolution aura comme protagoniste la classe ouvrière ; celle-ci devra s'organiser de façon autonome, en tant que classe, par rapport au reste de la société et exercer une dictature politique afin de détruire de fond en comble les bases de l'ancien régime.
C'est cette analyse que les modernistes rejettent : "Pour transformer réellement leurs conditions d'existence, les prolétaires ne doivent pas se soulever en tant que 'classe ouvrière' ; mais c'est ce qui est difficile, puisqu'ils se battent précisément à partir de leurs conditions d'existence. La contradiction ne sera tout à fait éclaircie théoriquement qui lorsqu'elle aura été surmontée dans la pratique." ("La Banquise" n°1, "Avant la débâcle", p.11). "Le prolétariat n'a pas à se poser d'abord en force sociale avant de changer le monde". (id. n°2, "Le roman de nos origines", p.29).
"Mais, dès maintenant, on ne fait que 'enfermer dans cette oppression si on ne s'y attaque pas en tant que prolétaires, ou en tant qu'humains, et non sur la base d'une spécificité -qui devient de plus en plus illusoire- à conserver ou à défendre. Le pire c'est de faire de cette spécificité 1e dépositaire d'une capacité de révolte". (souligné par nous, "La Guerre Sociale" n, "Vers la communauté humaine", p.32).
Les modernistes ne savent pas ce qu'est le prolétariat fondamentalement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il est révolutionnaire. Pourquoi devrait-il donc s'organiser séparément, en tant que classe, puisqu'il doit se battre pour l'élimination des classes? Pour les modernistes, la classe ouvrière, en tant que classe, n'est pas plus révolutionnaire que quiconque : en tant que classe, sa lutte reste limitée aux améliorations de salaires, et à la défense de l'emploi d'esclave. Au lieu de se constituer en classe politique, le prolétariat devrait commencer par se nier comme classe et s'affirmer en tant que ... "humains".
Le pire, dit "La Guerre Sociale',', c'est de faire d'une spécificité -être ouvrier par exemple- "le dépositaire d'une capacité de révolte".
Avec les modernistes, l'histoire semble toujours commencer avec eux. La Commune de Paris, la grève de masse en Russie en 1905, la révolution d'octobre 1917, le mouvement révolutionnaire en Allemagne en 1919, tout cela n'a rien démontré, rien enseigné. "La contradiction ne sera tout à fait éclaircie théoriquement que lorsqu'elle aura été surmontée dans la pratique", dit "La Banquise". Mais qui a mené les luttes révolutionnaires contre le capital depuis plus d'un siècle si ce n'est la classe ouvrière qui se battait pour la défense de ses aspirations spécifiques.
Pourquoi en a-t-il toujours été ainsi ?
"C'est parce que dans le prolétariat développé 1’abstraction de toute humanité, et même de toute apparence d'humanité est achevée en pratique ; c'est parce que les conditions d 'existence du prolétariat résument toutes les conditions d'existence de la société actuelle parvenues au paroxysme de leur inhumanité ; c'est parce que, dans le prolétariat, l'homme s'est perdu lui-même, mais a acquis en même temps la conscience théorique de cette perte et, qui plu est, se voit contraint directement, par la misère désormais inéluctable impossible à farder, absolument impérieuse expression pratique de la nécessité- à se révolter contre cette inhumanité : c'est pour ces raisons que le prolétariat peut et doit se libérer lui-même. Toutefois, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions d'existence. Il ne peut abolir ses propres conditions d'existence sans abolir toutes les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle que sa propre situation résume" (Marx, "la Sainte Famille", chap.4, Oeuvres, Gallimard, III, p.460).
Telle est la spécificité de la classe ouvrière : ses intérêts immédiats et historiques coïncident avec ceux de l'humanité entière, ce qui n'est le cas pour aucune autre couche de la société. Il ne peut se libérer du salariat capitaliste, forme la plus achevée de l'exploitation de l'homme par l'homme, sans éliminer toute forme d'exploitation, "toutes les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle". Mais il n'en découle nullement que toutes les parties de l'humanité possèdent la force matérielle et la conscience indispensable pour entreprendre une révolution communiste.
La classe ouvrière tire sa force d'abord de sa situation centrale dans le processus de production. Le capital, ce ne sont pas les machines et les matières premières ; le capital, c'est un rapport social. Lorsque, par sa lutte, la classe ouvrière refuse ce rapport, le capital est immédiatement paralysé. Il n'y a pas de capital sans plus-value, pas de plus-value sans travail des prolétaires. C'est là que réside la puissance des mouvements de grève de masse. Cela explique en partie pourquoi la classe ouvrière peut entreprendre matériellement la destruction du capitalisme. Mais cela ne suffit pas pour expliquer pourquoi elle peut jeter les bases d'une société communiste.
Les esclaves de Spartacus, dans l’antiquité, ou les serfs dans le féodalisme avaient aussi une situation centrale, déterminante dans le processus de production. Cependant, leurs révoltes ne pouvaient déboucher sur une perspective communiste.
"La scission de la société en une classe exploiteuse et une classe exploitée, en une classe dominante et une classe opprimée était une conséquence nécessaire du faible développement de la production dans le passé. Tant que le travail total de la société ne fournit qu'un rendement excédent à peine ce qui est nécessaire pour assurer strictement 1'existence de tous, tant que le travail réclamerions tout ou presque tout le temps de la grande majorité des membres de la société, celle-ci se divise nécessairement en classes." (Engels, "Anti-Durhing", partie 3, chap. 2).
Le prolétariat est porteur du communisme parce que la société capitaliste a créé les moyens matériels de sa réalisation. En développant les richesses matérielles de la société au point de permettre une abondance suffisante pour supprimer les lois économiques, c'est-à-dire les lois de gestion le la pénurie, le capitalisme a ouvert une perspective révolutionnaire pour la classe qu'il exploite.
En dernier lieu, le prolétariat est porteur de la révolution communiste parce qu'il est le porteur de la conscience communiste. Si l'on écarte les visions semi religieuses pré-capitaliste d'une société sans exploitation, le projet d'une société communiste .sans propriété privée, sans classe, où la production est orientée directement et exclusivement en fonction des besoins humains, apparaît et se développe avec l'existence de la classe ouvrière et de ses luttes. Les idées socialistes de Babeuf, Saint-Simon, Owen, Fourier traduisent le développement de la classe ouvrière à la fin du 18ème et au début du 19ème siècles. La naissance du marxisme, première théorie cohérente et scientifiquement fondée du communisme coïncide avec l'apparition de la classe ouvrière en tant que force politique spécifique (Mouvement Chartiste en Angleterre, Révolutions de 1848). Depuis lors, d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de clarté suivant les cas, toutes les luttes importantes de la classe ouvrière ont repris les idées communistes.
Les idées communistes, la théorie révolutionnaire, ne se sont développées que par et en vue de la compréhension des luttes ouvrières. Tous les grands pas en avant de la théorie de la révolution communiste ont été le produit, non pas de pures déductions logiques de quelques penseurs en chambre, mais de l'analyse militante et engagée des grands pas du mouvement réel de la classe ouvrière.
C'est pour cela aussi que c'est seulement la classe ouvrière qui a entrepris en pratique (la Commune de Paris, Octobre 17) la destruction du pouvoir capitaliste dans un sens communiste.
L'histoire du mouvement communiste n'est autre que l'histoire du mouvement ouvrier.
Est-ce à dire que le prolétariat peut faire la révolution tout seul en ignorant le reste de la société ? Depuis le 19ème siècle, le prolétariat sait que le communisme doit être "l'unification du genre humain". L'expérience de la révolution russe lui a clairement démontré l'importance pour son combat de l'appui de toutes les couches exploitées. Mais l'expérience a aussi mis en évidence que le prolétariat seul était capable d'offrir un programme révolutionnaire cohérent. L'unification de l'humanité, et dans un premier temps de tous les exploités, ne peut se faire que sur la base de l'activité et du programme de la classe ouvrière. En s'organisant séparément, le prolétariat ne divise pas la société. Il se donne les moyens de conduire son unification communiste.
C'est pour cela que, contrairement à ce qu'affirment les modernistes, la marche vers la révolution communiste commence par l'organisation unitaire de la classe ouvrière comme force, par la dictature du prolétariat.
LE DEBOUSSOLEMENT DU MODERNISME
La période historique
Comprendre la période historique actuelle en ignorant que c'est la classe ouvrière qui est la force révolutionnaire, est aussi difficile que comprendre la fin du régime féodal sans tenir compte du développement de la bourgeoisie révolutionnaire .
On peut difficilement savoir si les conditions d'un bouleversement révolutionnaire se développent ou non si on ne sait pas encore identifier le protagoniste d'une telle révolution.
Quiconque connaît l'histoire du mouvement ouvrier et comprend sa nature révolutionnaire, sait que le processus qui conduit le prolétariat à la révolution communiste n'a rien de linéaire ni d'automatique. C'est une dynamique dialectique faite de reculs et d'avancées, où seules une longue pratique et expérience de la lutte permet à des millions de prolétaires, sous la pression de la misère, de s'unifier, de retrouver les leçons des luttes passées, de soulever la chape idéologique de la classe dominante, pour se lancer dans un nouvel assaut contre l'ordre établi.
Mais lorsqu'on ne voit, dans les luttes ouvrières en tant que classe, que des luttes sans issue, sans les comprendre dans leur dynamique et potentialité révolutionnaires, on ne peut qu'être "déçu". Si l'on ne voit dans des luttes comme celles de la Pologne en 80 que des luttes "au sein du capital", il est normal que l'on soit déprimé, 15 ans après Mai 68 ; il est normal que l'on ne voit pas la signification du fait que, malgré le recul momentané des luttes ouvrières depuis 1980, les grèves qui, ponctuellement, éclatent ici et là au coeur des pays industrialisés (Belgique 82, Italie 83), on n'assiste pas à un embrigadement des ouvriers derrière les intérêts de l'économie nationale et ses représentants syndicaux, mais au contraire, à des heurts de plus en plus violents entre ouvriers et syndicats.
C'est ainsi que le n° 1 de "La Banquise" s'ouvre sur cette phrase marquée par la nostalgie des barricades de 1968 à Paris et par un ton dépressif :
"Sous les paves, la plage, disions-nous avant la grande glaciation. Aujourd'hui la banquise a recouvert tout cela. Dix, vingt, cent mètres de glace par dessus les pavés. Alors, la plage.".
C'est une dépression aussi sénile qu'était infantile l'emballement des étudiants radicaux de 1968 qui croyaient qu'on pouvait "tout, tout de suite".
L'impuissance et la confusion du modernisme face a la lutte ouvrière
Ce n'est pas par hasard que des publications modernistes comme "Solidarity" ou "La Guerre Sociale" ont cessé de paraître au moment des luttes ouvrières en Pologne. Comme la petite-bourgeoise dont il est une expression"radicale", le courant moderniste vit dans l'ambiguïté et l'hésitation entre le rejet de l'idéologie bourgeoise et un mépris pour les luttes terre à terre des ouvriers. Lorsque la force de la révolution s'affirme, même de façon encore embryonnaire, comme en Pologne, l'histoire a tendance à se débarrasser des ambiguïtés et donc des idéologies qui y pataugent. C'est ce qui est momentanément arrivé au modernisme pendant l'année 80.
Mais le déboussolement politique de ce courant ne s'arrête pas malheureusement à l'impuissance. Il peut conduire à la défense des positions les plus platement gauchistes, au moment de se prononcer sur une lutte ouvrière.
C'est ainsi que "La Guerre Sociale" se retrouve à côté des trotskystes et autres démocrates à répéter aujourd'hui que le syndicat "Solidarité" -l'organisateur de la défaite du prolétariat en Pologne- est un organe prolétarien : "Incontestablement 'Solidarité' est un organe du prolétariat. Le fait qu'à sa tête se soient installés des éléments issus des couches sociales non ouvrières (intellectuels et autres) n'ôte rien au fait que le prolétariat dès le début s'est reconnu en lui. Comment expliquer, sinon, 1'adhésion de la quasi-totalité du prolétariat polonais ? Comment expliquer 1'influence du syndicat sur celui-ci ?" ("La Guerre Sociale", n° 6).
C'est le mode de raisonnement borné typique des gauchistes dans l'esprit de la 3ème Internationale dégénérescente. Suivant cette logique, l'Eglise polonaise qui a plus de fidèles ouvriers que "Solidarnosc", devrait être aussi "incontestablement un organe du prolétariat"... et le Pape, Lénine !
"La Guerre Sociale" parle aussi en termes généraux de la nature des syndicats, mais c'est pour ressortir la vieille soupe ambiguë du groupe "Pouvoir Ouvrier" (fin des années 60, en provenance également de "Socialisme ou Barbarie") de la"double nature des syndicats" : "Le syndicat n'est pas un organe du capital, une machine de guerre contre le prolétariat, mais 1'expression organisationnelle de son rapport au capital, antagonisme et coopération. Il exprime à la fois que le capital n'est rien sans le prolétariat et, de façon immédiate, réciproquement." (Idem)
Il n'y a pas dans le capitalisme décadent de coopération entre capitalistes et ouvriers au profit de l'ouvrier. La vision qui identifie, à notre époque, les syndicats à la classe ouvrière, n'est autre que celle de la propagande des classes dominantes (qui savent par ailleurs coopérer au niveau mondial pour construire un "Solidarnosc" crédible). Elle repose sur l'idée qu'il peut y avoir conciliation entre l'intérêt du capital et l'intérêt du prolétariat ; elle ignore la nature révolutionnaire de la classe ouvrière. C'est ainsi que "La Guerre Sociale" peut faire candidement la constatation suivante :
"La différence essentielle entre Solidarité et le prolétariat polonais est que le premier prenait en compte les intérêts économiques nationaux et internationaux, nécessaires à la survie du système, alors que le second a poursuivi la défense de ses intérêts immédiats sans se soucier le moins du monde des problèmes de valorisation du capital." (Idem).
Seul en ignorant la nature révolutionnaire du prolétariat, en considérant celui-ci essentiellement comme une partie du capital et non comme son destructeur, peut-on voir une identité quelconque entre "les intérêts économiques nationaux et internationaux" du capital et "les intérêts immédiats"du prolétariat.
Le déboussolement que provoque la non reconnaissance de la classe ouvrière conduit ainsi à la même vision que celle des gauchistes, tant critiquée par le modernisme radical.
Le prolétariat est la première classe révolutionnaire de l'histoire qui soit une classe exploitée. Le processus de luttes qui le conduit à la révolution communiste est inévitablement marqué de périodes de recul, de repli. Ces replis ne se concrétisent pas seulement par une diminution du nombre de luttes ouvrières. Sur le plan de la conscience, le prolétariat subit aussi un désarroi qui se traduit par l'affaiblissement de ses expressions politiques révolutionnaires et facilite le resurgissement des courants politiques qui cultivent "le doute" sur la classe ouvrière.
La rupture de 1968, après près d'un demi-siècle de contre-révolution triomphante, a ouvert un cours vers le développement des affrontements de classe de plus en plus décisifs. Ce cours n'a pas plus été renversé par le repli de l'après-Pologne qu'il ne le fut par le recul de 1975-78. Les conditions historiques de ce recul s'usent à la même vitesse que s'approfondit la crise économique du capitalisme et que sa réalité se charge de détruire, lentement, mais systématiquement les piliers de l'idéologie bourgeoise décadente (nature ouvrière des pays de l'Est, Etat-providence, démocratie parlementaire, syndicats, luttes de libération nationale, etc.).
Toutes les conditions mûrissent pour que, dans toute sa force, la lutte du prolétariat revienne rappeler l'avenir de l'humanité et balayer tous les doutes sur sa nature révolutionnaire.
rv
[1] [454] "La Banquise", B.P. 214 ; 75623 Paris Cedex 13
[2] [455] "La Guerre Sociale", B.P. 88, 75623 Paris Cedex 13. Annuelle de 1977 à 1979, cette publication cesse momentanément de paraître en 1980, au moment des plus grands combats en Pologne. Elle ne réapparaît qu'en Mai 1981 et est devenue trimestrielle depuis Juin 82.
[3] [456] Le groupe"Solidarity"a ses origines dans les années 60. Il a tout au long des années 70 publié assez régulièrement la revue du même nom. Mais, à l'automne 80, incapable de prendre une position cohérente face aux luttes en Pologne et de se prononcer sur 1'attitude à adopter face à "Solidarnosc", la revue disparaît. La revue vient de réapparaître (nouvelle série) début 83 (leur crise de 1980 y est racontée).
("Solidarity", c/o 123 Lathom Road, London E6, Grande-Bretagne)
[4] [457] Ces trois groupes sont directement ou indirectement liés à "Socialisme ou Barbarie", revue des années 50-60, dont le principal animateur, Castoriadis (alia Chaulieu, Cardan, Coudray) théorisa longuement le dépassement du marxisme.
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : la perspective du CCI de "la gauche dans l'opposition"
- 2772 reads
LA CRITIQUE EMPIRIQUE ET LE ROLE DES REVOLUTIONNAIRES.
INTRODUCTION DU CCI
L'immaturité du milieu politique actuel, dont les manifestations les plus évidentes sont le sectarisme et l'immédiatisme, a empêché - et particulièrement depuis l'échec des conférences internationales -qu'un débat de fond se mène conjointement et publiquement sur les principales questions du moment.
L'analyse que le CCI a développée sur les perspectives de la lutte de classe, à la lumière du passage de la gauche dans l'opposition, sur le rôle des révolutionnaires n'a pas rencontré - à de rares exceptions - tout l'écho souhaité. Des sarcasmes, une politique du "silence" se sont bien souvent substitués à une attitude sérieuse et responsable dans la confrontation des positions. Comprendre que les débats soulevés dépassent l’existence de tel ou tel groupe ou organisation, que les idées avancées ne sont pas la propriété privée ou le label d'une chapelle politique, mais le fruit d'une réflexion commune, voilà qui est loin d'être encore compris. La vision qu'il n'y aurait qu'une seule organisation révolutionnaire, la sienne, s'est concrétisée par un immédiatisme effréné, à la longue destructeur, et par un appauvrissement des débats qui pèse lourdement sur l'évolution de tout le milieu révolutionnaire.
Il est particulièrement encourageant de constater que, malgré cet état de fait, des éléments révolutionnaires surgissent avec le souci de prendre position sur les grandes questions politiques, en comprenant que celles-ci sont "l'affaire de tout le milieu". Il est significatif que le texte que nous publions ici ("la perspective du CCI de la gauche dans l'opposition; la critique empirique et le rôle des révolutionnaires") émane d'un camarade de Hongkong - issu du groupe anarchisant "Minus" - isolé géographiquement du milieu politique d'Europe. Sa contribution au débat sur "la gauche dans l'opposition" est la preuve concrète que cette question n'est ni un hobby du CCI ni une affaire du milieu "occidental". Toute question politique de fond concerne l'ensemble du milieu politique sur les cinq continents, car elle traduit l'effort du prolétariat mondial de parvenir à une cohérence théorique et politique, et donc à une unité dépassant le morcellement géographique et politique des groupes révolutionnaires. Comme l'écrit le camarade, il s'agit que "le faible milieu actuel" soit "à la hauteur des tâches immenses qui l'attendent dans les années à venir".
Dans cette brève présentation, nous n'entrerons pas dans tous les points soulevés par le camarade qui, par exemple, reproche au CCI sa "fausse analyse du cours historique". Tout en étant d'accord que la bourgeoisie est unie contre le prolétariat - ce qu'il appelle "conspiration" - le camarade fait une distinction entre deux bourgeoisies : la bourgeoisie I (en quelque sorte les "managers") et la bourgeoisie II (les "idéologues").
Nous ne pensons pas que cette distinction apporte une grande clarification.
1. A l'échelle historique, les rapports de production capitalistes créent deux classes antagonistes : le prolétariat et la bourgeoisie. Le ralliement des éléments hésitants de la petite bourgeoisie est fonction de la dynamique sociale surgie de la lutte de classe. L'expérience montre, que dans les moments décisifs, il y a unité de toutes les fractions de la bourgeoisie contre le prolétariat, de la gauche à la droite, ce dont semble douter le camarade, pour qui la lutte pour le pouvoir politique dans l'Etat est la raison d'être des partis. A cette vision il convient d'opposer l'expérience historique qui montre que la division entre droite et gauche n'est qu'apparence.
2. Il est fondamental de ne pas confondre division du travail au sein de la bourgeoisie (les fonctions assumées au sein de l'appareil économique politique et idéologique) avec une division de nature.
L'existence de fractions complémentaires au sein de la bourgeoisie n'est pas contradictoire avec la nature unitaire de cette classe. Ces fractions ont des fonctions complémentaires qui leur permettent de mieux remplir leurs tâches de mystification du prolétariat.
3. Le rôle de la droite n'est pas spécifiquement de préparer la guerre : cette préparation est le fait de toute la bourgeoisie, gauche comprise qui y participe essentiellement par ses campagnes pacifistes. Le rôle de la gauche dans l'appareil politique de la bourgeoisie se manifeste en permanence depuis la première guerre mondiale : son rôle anti-ouvrier ne s'exerce pas "pour plus tard" mais aujourd'hui avec la tactique bourgeoise de la gauche dans l'opposition.
En dépit de ces quelques remarques, nous pensons que ce texte montre une réelle implication dans le débat sur la gauche dans l'opposition et le machiavélisme de la bourgeoisie "avec le souci non pas de discréditer les autres organisations du milieu mais avec le souci de clarification pour tout le milieu". Un tel esprit est particulièrement encourageant.
LETTRE DE LLM (HONG-KONG)
Durant ces trois dernières années ou à peu près, le CCI a systématiquement mis en avant sa perspective de la "Gauche dans l'opposition", très sévèrement critiquée par beaucoup. Ce court article n'essaie ni de la défendre ni de la rejeter, mais tente 'seulement de discuter de quelques questions ouvertes par le débat et qui semblent avoir été en grande partie négligées par le milieu révolutionnaire.
Avant d'aller plus avant sur ces questions, je voudrais établir deux points généraux :
1- Par le passé, des tiers sont rarement intervenus dans les débats entre organisations; l'attitude générale semble avoir été : "c'est leur affaire". J'ai la ferme conviction que les débats sur des questions importantes ne sont pas seulement "l'affaire" des parties impliquées, mais sont l'affaire de tout le milieu. Des tiers doivent se préparer et prendre position publiquement. Ce n'est pas une question de jeter son poids dans la balance derrière la partie avec laquelle on est d'accord (si on est d'accord avec l'un des protagonistes), ni une question de jouer l'arbitre, mais bien une question de clarification par tout le milieu. C'est une des conditions préalables à la progression du faible milieu actuel, s'il veut progresser pour être à la hauteur des tâches immenses qui l'attendent dans les années à venir. Les longs débats en cours entre la CWO et le CCI, le rejet du concept de décadence par le KPL, etc.. sont, par exemple, autant de questions que des tiers devraient amplement discuter. La perspective de la "Gauche dans l'opposition" est un autre exemple ; en privé j'ai entendu un bon nombre de critiques sur ce sujet mais je n'en ai jamais lues en détail imprimées sur papier (il est vrai que ma seule langue étrangère est l'anglais ; je peux donc avoir manqué des critiques publiées en d'autres langues; il se peut également qu'il y en ait quelques-unes en anglais que j'ignore).
2- Plus d'une fois, on m'a fait remarquer que le CCI a dégénéré ces dernières années, un des signes de cette dégénérescence étant qu'aujourd'hui le plus souvent sjs analyses ne sont que des affirmations journalistiques régurgitées et vides de sens alors qu'auparavant, il offrait des analyses intelligentes. Il peut y avoir une certaine réalité dans cette dernière accusation ainsi que dans la première si par là, on veut dire que le CCI est en train de transiger de plus en plus sur les positions de classe, mais je ne suis pas d'accord, si par là on veut dire que le CCI a dégénéré orqanisationnellement, car je ne suis pas en position d'en juger. Revenons à la dernière accusation. Je pense que si elle est partiellement justifiée, elle passe aussi à côté d'un point très important.
Il est très facile de discourir, disons sur la théorie des crises de Marx, ou sur pourquoi et comment l'Internationale Communiste dégénéra à partir de son 3ème congrès. Mais c'est très difficile et c'est quelque chose d'entièrement différent d'arriver à l'analyse, disons de l'état actuel de la crise, ou du rapport de force actuel entre les classes. Dans ce dernier type d'analyse, parce que les événements sont seulement en train d'émerger, parce que beaucoup de choses sont, au mieux, à moitié connues, parce que nous manquons de recul, etc., leur nature même est d'être basée sur des preuves insuffisantes, et ainsi, elle comporte inévitablement une certaine marge de simples affirmations. Si nous regardons, par exemple, la Revue Internationale, ses premiers numéros s'attachaient principalement à se réapproprier les leçons de la lutte prolétarienne depuis la 1ère guerre mondiale. Dans ce type d'analyse, on peut amasser des preuves documentées considérables pour étayer sa perspective, et plus important encore, on a la sagesse que nous accorde le recul. Mais les révolutionnaires ne sont pas des intellectuels, des académiciens ; ils ne font pas qu'analyser le passé, mais doivent aussi analyser le présent et prévoir le futur. Ils ne font pas de l'élaboration théorique pour elle-même, mais se servent de la théorie pour analyser l'équilibre présent du rapport de force entre les classes, l'état actuel du développement du capital, pour tracer l'avenir de la lutte de classe, pour concevoir la stratégie et les tactiques du prolétariat. Ainsi, lorsque nous faisons la critiqua de la perspective de la "Gauche dans l'opposition", ou l'analyse du CCI sur le cours historique, nous ne devons pas tomber dans le piège d'un rejet empirique par manque de preuves évidentes (voir ci-dessous), mais nous devons examiner si ces analyses sont compatibles avec la méthode marxiste : nous ne devons pas en rester, comme le font les intellectuels ou les académiciens, à un niveau "purement" théorique (par exemple, la théorie matérialiste de l'histoire contre la théorie "conspirative"), mais, nous devons considérer les questions auxquelles ces analyses tentent de répondre. C'est de cette façon que je me propose d'examiner la perspective de la " Gauche dans 1'opposition".
Cette perspective est fondamentalement critiquée comme étant basée sur une vision machiavélique de la bourgeoisie et une conception conspirative de l'histoire ; elle serait développée par le CCI pour justifier sa (fausse) analyse du cours historique, contre toute évidence du contraire. A une époque je partageais cette critique, comme l'attestent les remarques suivantes que je fis au CCI à la fin de l'année dernière :
"...Cette question contient la question de l’idéologie.. .Qu'est ce que l'idéologie ?
Est-elle créée par des "professionnels" de façon consciente, délibérée, machiavélique ?... Si Marx lui-même n'a jamais fait d'exposé systématique sur la nature de l'idéologie, c'est néanmoins implicite dans ses derniers travaux ; son discours sur l'idéologie de l'économie politique (bourgeoise) dans le tome 3 du Capital l'illustre particulièrement bien. Pour aller droit au but :sur la base du fait que c'est l'existence qui détermine la conscience, il est "naturel" que la bourgeoisie - qui occupe une position particulière dans les rapports de production - conçoive de tels rapports selon sa position privilégiée en leur sein. Le résultat, c'est qu'elle conçoit ces rapports en termes de catégories particulières (rente, intérêts, vertu de l'abstinence, etc...). Si nous nous souvenons de ce qu'écrit Marx dans le tome 3 du Capital, c'est évident que pour lui, de telles catégories sont "naturelles" pour l'économiste politique bourgeois, et il n'y a rien de machiavélique dans tout cela. D'un autre côté, c'est tout aussi "naturel" que le prolétariat soit incapable de penser ou de s'approprier de telles catégories parce qu'il occupe une position différente, en fait opposée dans les rapports de production. Il était "naturel" pour Marx de penser en termes de catégories telles que la plus-value. Si nous acceptons la formulation ci-dessus il est alors évident que dans la mesure où l'idéologie bourgeoise est concernée, elle ne sait pas que l'ennemi numéro I de la bourgeoisie est le prolétariat, qu'une telle connaissance lui est impossible...Mais pour la bourgeoisie qui est directement impliquée dans la "gestion" des rapports de production (les capitalistes, les échelons élevés des bureaucrates d'Etat, les dirigeants syndicaux etc.- je les appellerai bourgeoisie I, pour la présentation), le fait qu'elle soit directement aux prises avec la lutte de classe, lui donne cette compréhension. Alors que de toute évidence, ils souscrivent, à des degrés divers, aux catégories de l'idéologie bourgeoise, ils savent bigrement bien que l'existence de ces catégories et ce qu'elles signifient dépendent de l'exploitation et de l'oppression du prolétariat. D'un autre côté, cette connaissance manque à bien des idéologues de la bourgeoisie (les intellectuels, les académiciens, les employés des mass média, les trotskistes, les syndicalistes de base etc.. nous les appellerons bourgeoisie II). Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la bourgeoisie I soit capable d'unité de façon subjective et conspirative, alors que la bourgeoisie II ne s'unit avec la bourgeoisie I que dans le sens où toutes les fractions de la bourgeoisie sont toujours unies contre le prolétariat. Personnellement je ne pense pas, par exemple, que les trotskistes, les syndicalistes de base etc..ne coopèrent jamais avec la bourgeoisie I d'une façon subjective et conspirative... Il serait par conséquent fatalement incorrect d'affirmer que de telles conspirations entre la bourgeoisie I et la bourgeoisie II existent car cela découlerait de la "nature" de l'idéologie. Même pour la bourgeoisie I nous devons faire attention à ne pas surestimer sa capacité à s'unifier subjectivement en conspiration contre les ouvriers ; sinon c'est oublier que les contradictions fondamentales au sein de la bourgeoisie I sont aussi insolubles (...). L'une de ces contradictions internes fondamentales est celle qui existe entre les divers aspirants au pouvoir politique. A ce que j'en vois, il n'y a aucune possibilité que les partis politiques de gauche et ceux de droite puissent s'asseoir et travailler ensemble à savoir quelle fraction formera le gouvernement. L'empoignade pour le pouvoir politique est la raison d'être des partis politiques, et même si les politiciens savaient que l'arrivée de la révolution sonnait le glas de tous, ils ne viendraient pas ensemble à des négociations dire qu'ils sont capables de le faire, c'est leur attribuer une sagesse dont ils sont incapables. Bien sûr, les partis politiques prennent souvent des décisions tactiques comme lorsqu'ils "se mettent au vert", ou quand ils doivent provoquer des crises gouvernementales etc. mais elles sont de nature totalement différente. De telles décisions sont prises dans le but de s'emparer du pouvoir. Le type de négociations dont nous parlons ici entraîne de la part d'un parti la décision de renoncer au pouvoir lorsqu'il l'a déjà, ou d'abandonner sa quête lorsqu'il a la chance de s'en emparer - deux occasions antithétiques à leur raison d'être. Ma propre interprétation de la Gauche (allant) dans l'opposition est la suivante (...) : ce n'est pas que la Gauche doive aujourd'hui rester dans l'opposition car aller au pouvoir signifierait perdre toute crédibilité. Cette vision représente une demi-vérité parce qu'elle n'est pas menée jusqu'à sa conclusion logique. Même si la Gauche perd sa crédibilité...en allant au pouvoir, cela ne signifie pas que la bourgeoisie sera à court d'imagination en termes d'idéologie politique. A la gauche de la Gauche "établie", il y a encore les trotskistes etc. Si la Gauche "établie" doit perdre sa crédibilité en^allant au pouvoir, son extrême gauche prendra sûrement sa place actuelle. Il n'y aura pas de scission "de droite" dans le parti travailliste, mais plutôt une scission de gauche (...). La Gauche est contrainte à l'opposition à cause des politiques économiques qu'elle incarne traditionnellement (keynésianisme) et dont l'inefficacité a été prouvée aujourd'hui... Demandez aujourd'hui à l'homme de la rue ce qui empêche le rétablissement de l'économie, il vous répondra que ce sont les taux d'intérêts élevés. Depuis un bout de temps maintenant, à cause de la faillite des économies keynésiennes, les idéologues de la bourgeoisie ont vigoureusement propagé l'idée qu'un retour aux économies smithiennes (Adam) fera l'affaire. Avec toute l'aide sophistiquée des mass média..., on a créé un climat où chacun se transforme brusquement en économiste, et "est sûr" que des taux d'intérêts bas apporteront un rétablissement."
Ce que je disais, fondamentalement, était qu'en mettant en avant la perspective de la "Gauche dans l'opposition", le CCI courait le danger d'ignorer la "nature" de l'idéologie et était inconscient lorsqu'il supposait que la bourgeoisie est capable de résoudre quelques-unes de ses contradictions internes et fondamentales.
En examinant ce texte aujourd'hui, la distinction entre bourgeoisie I et bourgeoisie Il est encore fondamentalement correcte, mais le point sur la lutte pour le pouvoir, raison d'être des partis politiques, ainsi que le point sur la Droite arrivant au pouvoir pour des raisons de philosophie économique sont trop simplistes. J'expliquerai pourquoi avec plus de détails par la suite. Comme le CCI disait dans sa réponse : "La raison d'être des fractions (de la bourgeoisie) n'est pas une simple convoitise du pouvoir...une insistance trop grande sur l'idée de "pouvoir" détenu par un parti au "parlement" peut tendre à détourner l'attention du cadre qu'est le capitalisme d'Etat et du totalitarisme. Nous ne devons pas tomber dans les faux antagonismes auxquels la bourgeoisie voudrait nous faire croire". Plus important, nulle, part dans mes observations, je n'avais fait des évaluations de l'état actuel de la crise ou du rapport de forces actuel entre les classes. Nous pouvons certainement débattre de la perspective de la "Gauche dans l'opposition", mais pour ce faire, nous devons baser notre critique sur une analyse de ces deux aspects essentiels de la lutte de classe, ce que sans s'occuper de la validité de la perspective, le CCI est exactement en train de faire ; et c'est précisément ce qui manque dans la plupart des critiques de cette perspective qui sont lourdement intellectualistes dans leur approche, j'en suis conscient.
Plus je considère cette perspective, moins je peux comprendre pourquoi c'est scandaleux de dire que la bourgeoisie est capable de conspirer contre le prolétariat. Aujourd'hui, nous rêverons tous l'analyse de Bilan sur la République espagnole et sur la guerre civile espagnole dans les années 30. Mais si nous lisons soigneusement ses articles, il ne fait aucun doute que Bilan suggérait une conspiration entre l'aile fasciste de la bourgeoisie et l'aile anti-fasciste du Front populaire pour entraîner les ouvriers dans la seconde guerre mondiale. Bilan formula clairement que face à la résistance du prolétariat en Espagne, la bourgeoisie comprit que l'écraser de front était une stratégie moins valable que de le faire dérailler par le moyen de la République espagnole, et que les Fronts populaires anti-fascistes, à travers toute l'Europe, étaient le moyen par lequel la bourgeoisie des "démocraties" mobilisa son prolétariat pour le transformer en chair à canon. Aujourd'hui c'est un fait pour nous tous que les analyses de Bilan étaient exactes, et elles l’étaient en effet. Mais pourquoi une théorie conspirative, qui se révélait exacte est si révêrêe9 alors qu'une théorie similaire aujourd’hui est tenue pour scandaleuse ?
Pour tous les groupes de la Gauche Communiste, c'est évident qu'aujourd'hui les syndicats sont, la police d'Etat dans les rangs ouvriers. Les syndicats ne trahissent pas les ouvriers uniquement parce que dans le capitalisme décadent ils ne peuvent obtenir des gains durables, mais parce qu'ils jouent consciemment leur rôle de flic. Un examen superficiel de toutes les publications de la Gauche Communiste aujourd'hui montrera cette attitude ou position. Pourquoi, alors, est-il si difficile d'imaginer les partis politiques de Gauche et de Droite de la bourgeoisie en train de conspirer, alors que la conspiration entre les syndicats et les patrons s'effectue sans la moindre hésitation ?
Je suis sûr, que personne ne niera que les différents Etats soient capables de conspirer pour atteindre des buts communs. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, la conspiration entra les USA et la G.B. dans la guerre des Falkland, la conspiration entre les USA et Israël lors de la dernière invasion du Liban, etc.. sont claires comme la lumière du jour. Ou, si nous remontons un peu dans l'histoire, les leçons de la Commune de Paris et de la Révolution russe ne sont-elles pas suffisantes pour enfoncer à fond la leçon que, menacée par le prolétariat, la bourgeoisie est capable de mettre de côté ses antagonismes même les plus forts pour s'unir contre lui, comme l'a montré correctement le CCI ? Pourquoi, alors, lorsqu'il se produit une conspiration entre la Droite et la Gauche de la bourgeoisie à l'intérieur des frontières nationales, cela devient inimaginable ? Est-ce que Noske assassina le prolétariat allemand inconsciemment ou consciemment ? Ne ririons-nous pas tous si quelqu'un nous disait que la Gauche de la bourgeoisie I aux mains pleines de sang, a dans les faits réels, subjectivement à coeur les intérêts des ouvriers alors qu'objectivement elle ne peut que trahir les ouvriers dans le capitalisme décadent ?
Dire que la bourgeoisie est constamment impliquée dans des conspirations, ce n'est pas la même chose que d'avoir une vision de l'histoire de mauvais garçons conspirateurs. La bourgeoisie conspire non parce qu'elle est composée de mauvais garçons, mais parce que le capitalisme la force à conspirer. Si la bourgeoisie est capable de conspirer, alors ce n'est pas si extraordinaire qu'une de ses fractions conspire à être en dehors du pouvoir. Les exemples de la Commune de Paris et de la Révolution russe ont été déjà mentionnés et récemment nous avons vu aussi plusieurs dictateurs militaires en Amérique du Sud renoncer volontairement au pouvoir dans des circonstances défavorables.
La validité de la perspective de la "Gauche dans l'opposition" est une question ouverte, mais sa méthode est certainement valable. Il est évident que la crise est chaque jour de plus en plus aiguë ; il est évident que la bourgeoisie se prépare à la guerre ; il est évident que pour le faire, elle doit mobiliser le prolétariat et les autres secteurs de la population. La perspective part de ces prémisses, et si nous voulons faire une critique véritable, nous devons aussi partir de ces prémisses et ne pas se soucier, comme le font les empiristes, de savoir s'il existe une preuve formelle, si la bourgeoisie a été surprise en flagrant délit de conspiration. Bilan ne se souciait pas de telles choses, nous non plus. Ceci ne signifie pas, bien sûr, que nous n'analyserons pas concrètement les manoeuvres de la bourgeoisie, mais ceci doit signifier que nos analyses doivent être celles de la dynamique des rapports sous-jacents du système, le sceau de la méthodologie marxiste. "Tomber dans les faux antagonismes auxquels la bourgeoisie voudrait nous faire croire" c'est revenir à la pseudoscience phénoménologique de la bourgeoisie.
Dans la Revue Internationale 31, le CCI dit que les manoeuvres de la bourgeoisie "sont déterminées, structurées et limitées par et dans le cadre :
- de la période historique (décadence),
- de la crise conjoncturelle (ouverte ou non),
- du cours historique (vers la guerre ou vers la révolution),
- du poids momentané de la lutte de classe (avancée - reflux).
- En fonction de l'évolution de la situation, l'importance relative de secteurs-clés de la bourgeoisie se renforce au sein de l'appareil d'Etat, au fur et à mesure que leur rôle et leur orientation deviennent clairs pour la bourgeoisie" (p. 15)
Je pense que c'est fondamentalement correct, bien que l'on puisse certainement améliorer la façon dont c'est formulé en le liant moins à la perspective de la "Gauche dans l'opposition" ; mais aussi je m'empresse d'ajouter que la perspective ne doit pas nécessairement se déduire de cela. En utilisant le même cadre, il est possible d'arriver à une perspective très différente, comme celle qui suit. La crise a pour un temps touché un stade où il y aura une période de stagnation fluctuant autour du niveau actuel le plus bas. A cause de cela, la bourgeoisie a réalisé que la guerre éclatera, et a alors commencé à s'y préparer en vue de réellement la faire. Mais comme dans les années 30, la bourgeoisie a besoin d'une idéologie pour mobiliser le prolétariat et les autres classes laborieuses ; cette idéologie peut très bien être une croisade "morale" contre l'agression soviétique, c'est-à-dire que le mouvement pacifiste (sic) joue le rôle assumé par l'anti-fascisme dans les années 30. En d'autres termes, lorsque le craquement se produira, le prolétariat de l'ouest devra être conduit à la guerre par "les champions" de la paix d'aujourd'hui, c'est à dire la Gauche de la bourgeoisie (le même vieux "faire une guerre pour en finir (sic) avec toutes les guerres" remis au goût du jour). Ceci signifie que le travail de fond de construction de la machine de guerre doit être assumé par la Droite. La Gauche, par conséquent, a un rôle oppositionnel aujourd'hui non pour faire dérailler les ouvriers de leur combativité (plusieurs débats) mais pour se préparer à son vrai rôle plus tard. Lorsque WR n°25 ([1] [458]) l'écrivait il y a quelques temps de cela : "De façon générale, la participation de la Gauche au pouvoir est absolument nécessaire dans deux situations extrêmes : dans une "Union Sacrée" pour entraîner les ouvriers dans la défense nationale en préparation directe à la guerre, et dans une situation révolutionnaire lorsque le reste de la bourgeoisie remet volontairement ou autrement le pouvoir à la Gauche (cf. mon premier point erroné sur la raison d'être des partis politiques) dont l'arrivée au pouvoir est présentée comme le but ultime de la révolution elle-même", (p.6 souligné par moi).
Ceci n'est qu'une perspective improvisée qui comporte bien des lacunes mais ce qui est implicite dans tout cela, c'est une évaluation du cours historique vers la guerre. Cela montre que la perspective du CCI de "la Gauche dans l'opposition" ne découle pas nécessairement de son propre cadre.
Pour résumer cette petite contribution, je ferai essentiellement deux points :
1) Dire que la bourgeoisie (classe I) est capable de conspirer contre le prolétariat, est entièrement en accord avec la méthode marxiste. En ce qui concerne la bourgeoisie II je suis d'accord avec le CCI lorsqu'il dit : " Il est donc possible de parler de "plans" de la bourgeoisie même si ce n'est qu'une partie de celle-ci qui les fait". (Revue Internationale 31, p.14)
2) En mettant en avant la perspective de la "Gauche dans l'opposition", avec laquelle j'ai évidemment beaucoup de divergences, le CCI montre une remarquable compréhension du rôle des révolutionnaires et une volonté d'assumer ce rôle, ce qui est encore rare dans le milieu aujourd'hui. Nous avons certainement besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour dépasser l'attitude intellectuelle qui prévaut encore dans notre pratique théorique.
Enfin, je souhaite faire un point de plus sur l'attitude empiriste qui existe à divers degrés dans le milieu. Quand le CCI dit qu'aujourd'hui, le cours historique est à la révolution, bon nombre lève les bras au ciel protestant que toutes les évidences sont contre une telle vision. Mais comment suppose-t-on que le CCI est capable de présenter une preuve pour étayer sa vision ? En menant un examen de conscience avec la classe ouvrière ?! Etant donné la nature même de la conscience révolutionnaire, à savoir qu'elle ne se développe pas de façon cumulative, nous pouvons dire sans danger, que, de toute évidence, elle ne peut suggérer que la révolution est à l'ordre du jour qu'à la veille de celle-ci. Il y aura, pour sûr, des heurts sporadiques plus violents entre les ouvriers et I'Etat, mais jusqu'à la veille de la révolution, ces luttes seront inévitablement plus ou moins rapidement englouties par le syndicalisme. Ainsi toutes les analyses sur le cours historique ne peuvent qu'être très abstraites, basées sur des schémas généraux tels qu'une vision historique du développement du capitalisme (c'est-à-dire la décadence), de ce que ce développement signifie en termes d'emprise idéologique de la bourgeoisie sur le prolétariat (voir la préface de Marx à "Une contribution à la critique de l'économie politique"), etc. Les preuves n'ont pas de place dans ce type d'analyse.
L.L.M. (avril 83)
P.S. Pour élargir quelque peu le point 1 fait tout au début du texte alors que l'esprit de critique ouverte et 1'auto-critique existent dans l'actuel milieu, il laisse encore à désirer. Non seulement l'attitude qui prévaut c'est : "c'est leur affaire" même dans les parties concernées directement, mais encore on garde souvent le silence ou un demi silence sur les arguments qu'on ne défend plus. Pire encore, dans plusieurs occasions, on continue à s'accrocher à leurs positions caduques, et même, dans quelques cas on a recours à ce que l'on peut seulement qualifier de calomnies qui sont basées, soit sur des positions non défendues par leurs victimes, soit sur des dénigrements à 1'emporte-pièce qui, quand ils ne sont pas prouvés, induisent for cément en erreur (tels que : "A la différence de X, Y ou Z qui se trompent, nous, nous disons..."). Ceci existe à des degrés divers dans tous les groupes et je peux citer une demi-douzaine d'exemples au pied levé. Nous ne sommes pas des gauchistes, nous nous impliquons dans les débats, avec le souci non pas de discréditer les autres organisations du milieu, mais avec le souci de clarification pour tout le milieu. Pour les familiers des positions des parties calomniées, les mensonges n'ont pas d'emprise, mais pour le nouvel initié, cela crée des préjudices. Si même un ex-maoïste comme Sweezy était capable d'admettre publiquement qu'il avait été convaincu par un autre ex-maoïste Bettelheim, de la fausseté de sa position (voir leur débat "Entre Capitalisme et Socialisme (sic)" Modem Reader), je pense que nous sommes en droit d'attendre un milieu plus ouvert que ce qu'il est aujourd'hui.
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 35 - 4e trimestre 1983
- 2609 reads
Tensions inter-imperialistes : la bourgeoisie met a profit le recul de la lutte de classe
- 2263 reads
Cet éditorial trace les grandes lignes de l’analyse des événements de l'été 83, au moment de la parution de ce numéro de la Revue Internationale qui est consacré aux rapports et résolutions du Sème Congrès du CCI. Ces événements illustrent sur les menaces de guerre et les campagnes idéologiques de la bourgeoisie les orientations des textes de ce Congrès sur la situation internationale.
L'été 83 a été marqué par un réchauffement des tensions inter-impérialistes sur la scène mondiale:
- Le conflit du Tchad en plein centre de l'Afrique, endémique depuis plusieurs années, est passé à un niveau supérieur, par l'intervention déterminée de forces armées du bloc occidental, et notamment de la France.
- Le conflit du Liban, après plusieurs mois de relative accalmie, s'est brutalement rallumé, et Beyrouth est de nouveau sous les bombes.
- Enfin, la destruction du Bœing 747 sud-coréen par la chasse russe est venu montrer l'hypocrisie du bloc américain, qui n'hésite pas à utiliser les passagers civils comme otages dans une sinistre affaire d'espionnage, tandis que l'URSS n'a pas hésité à les tuer pour la sacro-sainte défense du territoire national et du secret militaire.
Une propagande intense est venue répercuter les bruits de bottes comme un écho amplifié par tous les médias qui assourdit les consciences et rallume la peur d'une troisième guerre mondiale. C'est le rôle de toute propagande de montrer que c'est l'adversaire l'agresseur, le barbare, le fauteur de guerre, et dans cet art, le bloc de l'Ouest est passé maître : si des troupes interviennent au Tchad, c'est pour faire face à l'agression du "fou mégalomane" Kadhafi, l'allié des russes ; si les armées américaines, françaises, italiennes et britanniques campent à Beyrouth, c'est pour "protéger" la liberté et l'indépendance du Liban face à l'impérialisme syrien soutenu par la Russie, etc. Autant d'alibis qui masquent l'essentiel : c'est le bloc de l'Ouest gui est à l'offensive et gui marque sa supériorité en tentant de faire disparaître les vestiges de l'influence du bloc de l'Est en Afrique et au Moyen-Orient.
Alors même que les grandes puissances négocient tous azimuts sur les euromissiles et 1'armement en général, au nom de la "paix" (Madrid, Genève, etc.), jamais l'effort de guerre n'aura été aussi intense depuis la deuxième guerre mondiale. Des armements toujours plus sophistiqués et meurtriers sont mis au point, produits en grande série et implantés partout dans le monde. Pour utiliser cet armement technologique, de plus en plus les grandes puissances sont amenées à intervenir directement dans les opérations militaires : l'URSS en Afghanistan, mais aussi la France au Tchad, La France encore avec les USA, l'Italie, la Grande-Bretagne au Liban, etc., sans compter les nombreuses bases militaires stratégiques installées et entretenues tout autour de la planète.
Les soi-disant divergences au sein du bloc américain, entre la France et les Etats-Unis par exemple, ne sont qu'un rideau de fumée de la propagande qui cherche à masquer l'unité profonde et le partage des tâches entre alliés contre le bloc russe. Cela montre que si les discours, de droite de Reagan, de gauche de Mitterrand, sont différents, les buts et les résultats sont les mêmes : militarisme et impérialisme pour la défense des intérêts du même camp.
Face à cette pression, l'URSS est en position de faiblesse, tant sur le plan économique, que militaire et politique. Incapable de réellement soutenir ses alliés de la périphérie (Libye, Syrie, Angola, etc.), doté d'un armement qui accuse un important retard technologique et empêtré dans le conflit d'Afghanistan, le bloc de l'Est est le plus fragilisé dans la mobilisation de son potentiel militaire, par la faiblesse de son contrôle sur le prolétariat comme l'ont montré les grèves en Pologne en 80-81.
Si le bloc de l'Ouest peut tenter de mettre à profit cette situation, c'est parce qu'il est parvenu jusqu'à présent à enrayer la lutte de classe dans les principaux pays- industrialisés, par une utilisation intensive des mystifications démocratiques et syndicales, et des campagnes forcenées sur la guerre (Malouines, Salvador, Moyen-Orient) qui, en déboussolant la classe ouvrière, renforcent sa passivité. Les différents conflits qui amènent leur lot quotidien de massacres viennent rappeler au prolétariat ses responsabilités historiques. Tenaillée par la crise, la bourgeoisie mondiale intensifie ses préparatifs militaires pour la guerre. Le seul obstacle qu'elle rencontre sur ce chemin, c'est la lutte de classe du prolétariat. Tout le verbiage diplomatique sur la paix n'est que pure propagande ; toutes les guerres sont faites au nom de la paix. Il n'y a pas de paix dans le capitalisme ; seule la révolution communiste, en mettant fin au capital, peut mettre fin à la guerre et aux menaces de guerre.
Cependant, si c'est la passivité présente du prolétariat mondial, notamment dans sa principale concentration en Europe, qui permet l'accentuation des tensions inter-impérialistes, le chemin vers une troisième guerre mondiale n'est pas ouvert. La classe ouvrière est passive, mais elle n'est pas encore embrigadée et elle n'a pas été écrasée. La bourgeoisie de tous les pays en est bien consciente, et le bloc occidental procède avec prudence, n'engageant que ses troupes professionnelles, et développant toute une propagande qui n'a pas pour but immédiat l'embrigadement direct, mais qui vise, en martelant la peur de la guerre, à démoraliser la classe ouvrière et 1'empêcher de développer sa lutte.
A 1'heure où la bourgeoisie s'engage militairement de plus en plus clairement, où les budgets militaires dévorent les budgets sociaux, où le chômage touche des millions d'ouvriers, où la misère imposée par l'austérité est toujours plus dramatique, la réponse du prolétariat occidental est de plus en plus déterminante pour offrir une perspective aux luttes du prolétariat mondial.
De la capacité des fractions centrales de la classe ouvrière à secouer la chape de plomb de l'idéologie de résignation véhiculée par la propagande bourgeoise dépend l'avenir de l'humanité : guerre ou révolution.
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Présentation – 5°congrès du CCI.
- 2572 reads
La vie des organisations révolutionnaires fait partie de la vie de la classe révolutionnaire. Même si leur taille et leur influence sont peu importantes, même si parfois certaines d'entre elles ont tendance à l'oublier, les organisations politiques prolétariennes sont sécrétées par le prolétariat et sa lutte historique pour le communisme. Le comprendre, c'est avoir conscience de sa responsabilité.
Le 5ème Congrès du CCI, juillet 83, qui réunit des délégations en provenance de dix pays, fut ainsi, avec ses forces et ses faiblesses, non pas un événement "privé", oeuvre de quelques individus, mais un moment de la vie de la classe ouvrière. C'est dans cette optique que nous en rendons publics les principaux documents dans ce numéro de la Revue Internationale.
Comme à l'habitude, notre Congrès s'est attaché aussi bien à définir les caractéristiques et les perspectives qui se dégagent de la période historique présente, qu'à faire le point sur 1'état de 1'orqanisation et à tracer les lignes d'orientation de son activité dans le proche avenir. Il s'est en outre penché plus spécifiquement sur la question générale du parti politique prolétarien et a adopté une "Adresse aux groupes politiques prolétariens", mettant en avant la nécessité d'oeuvrer -face à la crise qui a durement secoué depuis plus de deux ans un milieu révolutionnaire déjà faible vers un plus grand esprit de débat et de confrontation fraternels, combattant plus énergiquement que jamais tout esprit de chapelle et de sectarisme.
LA SITUATION INTERNATIONALE
"A l'aube des années 80, nous avons analysé la décennie qui commençait comme les années de vérité, les années où les convulsions et la faillite ouverte du mode de production capitaliste allaient dévoiler dans toute sa clarté l'alternative historique : révolution communiste ou guerre impérialiste généralisée. A la fin du premier tiers de cette période, on peut constater que cette analyse s'est pleinement confirmée: jamais, depuis les années 30, l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste ne s'était révélée avec une telle évidence ; jamais depuis la dernière guerre mondiale, la bourgeoisie n'avait déplacé de tels arsenaux militaires, n'avait mobilisé de tels efforts en vue de la production de moyens de destruction ; jamais depuis les années 20, le prolétariat n'avait mené des combats de l'ampleur de ceux qui ont secoué la Pologne et l'ensemble de la classe régnante en 1980-81. Cependant, ce n'est là qu'un début. En particulier, si aujourd'hui les dirigeants bourgeois semblent se consoler en bavardant sur la 'reprise économique', ils ont du mal à masquer que le plus fort de la crise est devant nous. De même, le recul mondial des luttes ouvrières qui a suivi les formidables combats de Pologne ne constitue qu'une pause avant les énormes affrontements de classe qui mettront en mouvement les détachements décisifs du prolétariat mondial, celui des grandes métropoles industrielles et notamment d'Europe occidentale". (Résolution sur la situation internationale).
Le rapport (en deux parties) et la résolution sur la situation internationale publiés dans ce numéro, adoptés par le Congrès, ont ainsi particulièrement souligné, sur le plan de la vie du capital :
- l'impossibilité pour la bourgeoisie mondiale de définir une quelconque politique économique lui permettant de relancer véritablement sa machine économique ;
- le fait que le capital apparaît de plus en plus comme ce qu'il est : un rapport social devenu anachronique et dont la survivance ne peut plus engendrer que misère et barbarie ;
Et sur le plan de la lutte de classe :
- le fait que le recul des luttes ouvrières, surtout en Europe occidentale, depuis 1980, produit d'une contre-offensive de la bourgeoisie au niveau international, est inévitablement momentané, les conditions de son dépassement ne cessant de se développer avec 1'approfondissement de la crise et l'usure inexorable des mystifications bourgeoises ;
- le fait que le prolétariat, s'il se trouve encore souvent paralysé, déboussolé devant 1'ampleur de l'attaque économique et politique du capital, maintient une combativité intacte et -contrairement aux années 30- échappe à tout embrigadement idéologique réel ;
- le fait qu'en ce sens, le cours historique actuel demeure celui ouvert depuis 1968 : vers le développement d'affrontements de classe de plus en plus décisifs, ouvrant la possibilité du triomphe de la révolution communiste mondiale.
L'ETAT DU CCI. ET LA CRISE DU MILIEU REVOLUTIONNAIRE
Dans ces conditions, peut-on estimer que le CCI et plus généralement l'ensemble du milieu révolutionnaire a été et est à la hauteur de la situation ?
Comment se sont adaptées, comment se préparent les organisations révolutionnaires aux échéances de l'histoire ? Voici ce qu'en dit la Résolution sur la vie et les activités du CCI adoptée par le 5ème Congrès :
"Depuis son 4ème Congrès (1981), le CCI a connu la crise la plus grave de son existence. Une crise qui, au delà des péripéties particulières de 'l'affaire Chénier' ([1] [461]), a secoué profondément l'organisation, lui a fait frôler l'éclatement, a provoqué directement ou indirectement le départ d'un quarantaine de ses membres, a réduit de moitié les effectifs de sa deuxième section territoriale. Une crise qui s'est traduite par tout un aveuglément, une dés orientation comme le CCI n'en avait pas connus depuis sa création. Une crise qui a nécessite pour être dépassée, la mobilisation de moyens exceptionnels : la tenue d'une Conférence Internationale extraordinaire, la discussion et l'adoption de textes d'orientation de base sur la fonction et le fonctionnement de l'organisation révolutionnaire ([2] [462]), l'adoption de nouveaux statuts".
Dès janvier 1982, le CCI affirmait dans une résolution de sa Conférence Internationale extraordinaire que : "les difficultés que traverse, le CCI ne lui sont pas propres et sont une expression d'une crise qui touche l'ensemble du milieu révolutionnaire. Cette crise est l'expression du fait que les convulsions des 'années de vérité', qui touchent toute la société, n'épargnent pas les groupes communistes. Pour eux, également les années 80 sont les 'années de vérité' et l'histoire ne leur pardonne aucune faiblesse".
Le 5ème Congrès a tiré un bilan positif de la façon dont le CCI a fait face à cette crise : "Le CCI porte avec lui l'ensemble des faiblesses qui affectent tout le milieu prolétarien. S1il a mieux résisté à ces faiblesses, s'il a pu s'éviter l'éclatement dont d'autres groupes ont été victimes, s'il a pu retrouver l'essentiel de son équilibre après la crise de 1981, il le doit essentiellement au cadre solide de sa plateforme et de ses statuts, basé sur l'expérience de toute la Gauche Communiste (même s'il l'a négligée, oubliée, ignorée pendant quelque temps)". (Résolution sur la crise et les activités du CCI).
Avoir les moyens programmatiques et organisationnels pour permettre à 1'organisation de comprendre et de s'adapter aux exigences de la période historique, tel est un objectif permanent pour toute organisation communiste si elle ne veut pas vivre à la merci de débandades de plus en plus destructrices dans la tourmente sociale gui se lève.
Voici comment le 5ème Congrès a concrétisé cet effort dans sa Résolution d'activités : "Le 4ème Congrès du CCI, tenu neuf mois après les grèves de masse en Pologne, ne pouvait encore percevoir la tendance au repli des luttes. Le Sème Congrès, par contre, prend acte du fait que, depuis deux ans, l'offensive de l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, basée sur la carte de la 'gauche dans l'opposition, a été couronnée d'un certain succès, ce qui a comme conséquence, non seulement une diminution très sensible des combats de classe, mais également de l'audience des idées révolutionnaires (baisse des ventes, des participants aux réunions publiques, etc.). Cette situation n'est que temporaire, mais, tant qu'elle dure, les révolutionnaires doivent en tenir compte afin de ne pas gaspiller leurs forces et ne pas arriver épuisés aux batailles décisives. En ce sens, reste on ne peut plus valable, la consigne donnée par la Conférence extraordinaire : l'organisation devra, lorsque nécessaire, opérer un repli dans l'ordre afin de consacrer le meilleur de ses efforts à ce qui est essentiel dans la période présente : le renforcement du cadre politique et organisationnel. Mieux vaut moins mais mieux".
La maîtrise que doit avoir une organisation révolutionnaire sur sa propre activité est d'autant plus importante que la période historique n'en demeure pas moins, dans ses tendances profondes, une période de montée de la lutte de classe. L'organisation doit être prête à pouvoir accentuer son activité d'intervention en très peu de temps et sans débandades activistes, comme ce fut trop souvent le cas dans la période de luttes de 1978-80.
LES STATUTS
Il ne suffit cependant pas, pour une organisation communiste, de posséder une bonne analyse de la situation historique et des orientations générales d'activité. Encore faut-il qu'elle dispose d'une structure et d'une forme de vie organisationnelles qui lui permet de concrétiser dans sa pratique quotidienne et avec une réelle homogénéité dans toutes ses sections, ces orientations.
Les statuts de l'organisation sont des instruments de cet objectif. Produits de l'expérience historique de toutes les organisations communistes du passé et de la capacité de l'organisation à assimiler cette expérience et à s'en servir face aux problèmes de son époque, les statuts d'une organisation traduisent la maturité organisationnelle et politique de celle-ci.
Ils sont une concrétisation pratique de toutes les conceptions de l'organisation en ce qui concerne des questions aussi essentielles que : la compréhension du déroulement du processus révolutionnaire, de la prise de conscience de classe, la place des révolutionnaires dans ce processus, centralisation et démocratie ouvrière, les rapports devant exister au sein de la classe révolutionnaire en lutte, et donc au sein de ses organisations politiques. C'est ainsi que, en cohérence avec ses conceptions générales, le CCI matérialise dans ses statuts, le rejet des conceptions fédéralistes, monolithiques et substitutionnistes par exemple (voir "Le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires" dans la Revue Internationale n°33, 1er trimestre 1983).
En se donnant de nouveaux statuts ([3] [463]), le CCI a renforcé sa capacité à être à la hauteur des tâches de la période.
Mais si les statuts sont un cadre organisationnel immédiat, ils sont en même temps une préparation pour l'avenir. Cette préparation passe aussi par une compréhension toujours renouvelée et enrichie de ce que sont et seront la forme, la fonction et le fonctionnement des organisations communistes du prolétariat. C'est ainsi gue le 5ème Congrès a placé dans son ordre du jour la question du parti.
LE PARTI
Le texte adopté par le Congrès, publié dans ce numéro, n'apporte pas d'innovations particulières à ce qu'a été l'analyse du CCI depuis ses débuts. Il est surtout une affirmation de la méthode avec laquelle cette question doit être abordée, c'est-à-dire historiquement.
Trop souvent, les débats sur la question de l'organisation communiste se sont laissés enfermer dans des analyses idéologiques (conseillisme, partidisme) où les syllogismes abstraits ignorent et manquent l'essentiel : la pratique, l'expérience historique du mouvement réel.
Les conférences de la Gauche Communiste avaient été sabordées par le PCI (Battaglia Comunista) et par la CWO (Communist Workers'Organisation) au nom des désaccords avec le CCI sur la question du parti. Au lieu de mener, comme le demandait le CCI, le débat sur ces problèmes au sein des conférences, publiquement, ouvertement, ces organisations ont préfère "fuir" la confrontation et imposer l'adoption de leur analyse sur le parti comme critère de participation aux conférences, excluant de ce fait le CCI.
La publication du document adopté par le 5ème Congrès se veut ainsi une contribution pour la poursuite de ce débat sur la seule base gui puisse servir de référence objective : l'expérience de notre classe. Il est par là un appel aux autres organisations révolutionnaires à assumer leurs responsabilités et à prendre conscience de leur importance réelle sans surestimation mégalomaniaque ni sous-estimation auto castratrice.
L'ADRESSE AUX GROUPES PROLETARIENS.
Les classes dominantes ne craignent rien autant -et pour cause- que la perspective d'une révolution communiste.
Les groupes politiques prolétariens sont les défenseurs principaux de la perspective révolutionnaire ; leur affaiblissement est un renforcement des classes exploiteuses.
Face à la situation actuelle, face à la crise qui secoue encore le milieu révolutionnaire, au moment où les responsabilités de ce qui devrait être une avant-garde du prolétariat mondial décuplent, plus que jamais, doivent être combattues les tendances à l'atomisation, à 1'éparpillement activiste ou académiste, à l'esprit de chapelle, au sectarisme et au dénigrement des autres groupes que soi. Plus que jamais, il est indispensable que les groupes révolutionnaires sachent se donner les moyens d'une vie politique où les uns n'ignorent pas les autres, où le débat et la confrontation théorique ouverts permettent de dépasser les divergences et servent de point de référence pour toutes les forces communistes qui naissent et naîtront avec l'intensification et la généralisation des combats de classe. Tel est le sens de l'adresse adoptée par le Congrès.
[1] [464] A propos de "l'affaire Chénier", voir Revue Internationale n°28, "La crise du milieu révolutionnaire", et le "Communiqué à tous les militants révolutionnaires" publié dans la presse territoriale du CCI.
[2] [465] "La fonction de l'organisation révolutionnaire", Revue Internationale n°29; "Le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires", Revue Internationale n°33.
[3] [466] Il s'agit en fait d'une reformulation et précision de certains points en fonction de l'expérience acquise depuis l'adoption des premiers statuts du CCI en 1976.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Rapport sur la situation internationale (1ere partie)
- 2650 reads
CRISE ECONOMIQUE : LA DESCENTE DANS L'ABIME ET L'IMPASSE DE LA CLASSE CAPITALISTE
Cette partie du rapport sur la situation internationale traite du cours de la crise économique capitaliste mondiale qui est, en dernière analyse, le facteur déterminant dans le développement des antagonismes inter impérialistes et l’axe autour duquel oscille le rapport de forces entre la classe capitaliste et le prolétariat, ([1] [467]). L'évolution actuelle des antagonismes inter impérialistes et le cours de la lutte de classe ne peuvent être analysés que sur la base d'une compréhension claire du cours de la crise économique elle-même.
Au contraire des années 1929-33 qui ont vu une chute brutale de l'économie capitaliste mondiale, la consolidation de la tendance universelle au capitalisme d'Etat a rendu possible un étalement de la crise mondiale actuelle de surproduction durant les années 70. Le recours systématique à une expansion massive du crédit orchestrée par les banques centrales des pays industrialisés du bloc américain et, en particulier, au moyen des armes financières internationales du capitalisme d'Etat américain, le FMI, la Banque mondiale, l'Import-Export Bank, etc., a permis momentanément au capitalisme mondial de compenser le manque croissant de demande effective sur le marché mondial saturé. La création d'une énorme masse de capital fictif, auquel ne correspond aucun capital fixe véritable, n'a pu faire plus, en fait, que de fournir à l'économie mondiale, une décennie de stagnation chronique ponctuée par deux chutes brutales d'une gravité croissante de la production industrielle (1970 et 1974-75) et une inflation galopante. Cette dernière a, en 1970-80, amené les métropoles capitalistes elles-mêmes au bord d'une hyper-inflation qui pourrait amener à son tour rapidement un effondrement brutal de l'économie mondiale. La seule voie ouverte au capital mondial, si elle n'avait pas été bloquée par le tourbillon de l'hyper-inflation, était un tournant vers une politique économique de déflation et d'austérité. Cependant, parce que cette dernière ne peut plus être relayée par une politique keynésienne de véritable expansion du crédit, dont les doses toujours plus massives n'ont fait que permettre un étalement de la crise, le capital mondial, ces trois dernières années, a plongé tête la première dans le sombre abîme d'une dépression qui au niveau économique a déjà confirmé les analyses du CCI sur les années 80, années de vérité.
Bans ce texte nous ferons d'abord un survol de la situation économique présente du capital mondial en se centrant sur les indices clé qui montrent clairement la condition désespérée de l'économie globale aujourd'hui. Nous démontrerons ensuite la Marge de manoeuvre toujours plus étroite des politiques économiques utilisables par le capital pour essayer de ralentir la descente vers l'abîme.
En montrant l'impasse dans laquelle la crise a. conduit la classe capitaliste, nous montrerons comment, du simple point de vue de la perspective économique ([2] [468]), la situation de la classe capitaliste est aujourd'hui bien pire que celle d'il y a cinquante ans, en 1933.
LA SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE DU CAPITAL MONDIAL
L’indice le plus infaillible de l'existence d'une sursaturation du marché mondial est peut être donné par les chiffres de la production industrielle et le pourcentage de capacité industrielle inutilisée, La production industrielle dans les sept principaux pays du bloc américain (USA, Japon, RFA, France, Italie, Canada) a été réellement stagnante en 1981 augmentant d'un minuscule 0,8% par rapport à 1980. En 1982, la production industrielle a plongé dans ces mêmes pays tombant de 4f5% dans l'année. Aux USA, la production industrielle a commencé à chuter dans la deuxième moitié de 1981 et a décliné de plus de 12% à la fin de 1982. En Grande Bretagne, la baisse de la production industrielle depuis son point le plus haut de 1979, est de 16% tandis qu'au Canada, la production en août 82 a été de 14,75% au dessous du point le plus haut de 1981 en juin. En Allemagne de l'Ouest, en France et en Italie où la chute a commencé un peu plus tard, la production industrielle est tombée de 6% en juillet, août et septembre 1982 ; 31,6% des installations industrielles aux USA et 31,8% au Canada ont été inemployées, expression claire de l'hypertrophie de la capacité productive face au manque chronique de demande effective,ce qui est la caractéristique essentielle de la crise permanente du capitalisme.
La contrepartie de ce fort déclin de la production et d'une masse énorme d'usines inutilisées dans les pays du bloc américain, pays qui représentent de loin la partie la plus importante de la production industrielle mondiale, a été une chute non moins dévastatrice des investissements productifs. Ainsi, aux USA, entre le premier et le quatrième trimestre 1982, l'investissement d'affaires dans de nouvelles industries et dans les machines est tombé de 14,5 %. En même temps, en Allemagne de l'Ouest, l'investissement en machines et équipements a chuté de 6,5 % et l'investissement dans la construction de 15 % dans la première moitié de 1982..
Dans les pays avancés du bloc américain, la saturation du marché mondial se manifeste dans la forme d'une masse croissante de marchandises invendables et une surproduction de capital pour lequel aucun investissement productif n'est possible. Dans les pays du bloc russe, la même crise globale de surproduction se manifeste par les longues files d'attente devant les magasins vides et le rationnement des biens de première nécessité pour la classe ouvrière en même temps que par une pénurie chronique de capital du fait de laquelle il est vain de tenter de dépasser l'arriération qui est l'héritage historique d'un bloc impérialiste arrivé sur le marché mondial en pleine décadence du capitalisme. L'impact de la crise capitaliste sur les régimes staliniens peut se voir dans le fait qu'en Russie même, la production industrielle a crû d'un anémique 2,8 % en 1982 au lieu des 4,7 % d'accroissement qui étaient prévus par la planification, la plus faible croissance depuis la deuxième guerre mondiale. Etant donné que le secteur militaire -qui, bien qu'absolument essentiel en termes de compétition inter impérialiste, représente une stérilisation de capital- compte pour 25 % dans la production russe et que la production dans ce secteur s'accroît à un rythme extrêmement rapide, ceci signifie qu'il y a eu un ralentissement très brusque de la production du secteur productif de l'économie russe. Dans les économies du bloc russe plus immédiatement liées aux conditions du marché mondial, la situation est encore plus dure. En Pologne, la production industrielle a décliné en 1982 de 5 % par rapport à 1981. En Hongrie et en Tchécoslovaquie, la production a été de fait stagnante, s'accroissant seulement de 1 % tandis que la production industrielle de la Roumanie a augmenté de 2,5 % au lieu des 5,5 % qu'avaient prévus les planificateurs.
Dans la poignée de pays du tiers-monde qui ne sont pas totalement dépendants de la production de denrées alimentaires et de matières premières pour l'exportation, mais qui ont aussi un secteur industriel significatif, en retrouve le même tableau d'un déclin ou d'une stagnation dans la production industrielle. Au Mexique, terre du dernier "miracle économique" des années 70, le mythe a éclaté comme une bulle et la production industrielle a commencé à s'enfoncer tentent à 1 % en 1982. En Argentine, la production industrielle est tombée de près de 4 % alors qu'au Brésil et en Inde, la production du secteur industriel a été stagnante.
Cette même crise de surproduction qui a amené ce déclin dans la production industrielle a aussi amené la chaos dans cette partie de l'économie consacrée à la production de denrées alimentaires et de matières premières. Ainsi, dans un monde où une masse toujours plus grande de la population est condamnée à la famine, 16 % de la production mondiale de céréales en 1982 a été invendable, s'ajoutant aux 35 millions de tonnes de céréales qui pourrissent déjà dans les stocks mondiaux.
La saturation du marché alimentaire et des matières premières pour lesquels il n'y a pas de demande effective a amené une chute des prix en 1982 :
Pour les paysans, ceci a signifié une crise dans des proportions dévastatrices jamais vues depuis les années 30. Toutes les récoltes (maïs, coton, sucre, soja) sent maintenant vendues en dessous des coûts de production réels des agriculteurs. Aux USA, le géant agricole de l'économie mondiale, le revenu net des agriculteurs a chuté depuis 1979 de 50 %, de 32,3 milliards de dollars à 16,5 en 1982. En même temps, l'intérêt des dettes agricoles était à lui seul de 22 milliards de dollars en 1982, bien supérieur au revenu net. Le résultat a été une cascade de faillites et des ventes forcées d'exploitations agricoles qui se répandent comme un fléau dans les campagnes.
La saturation du marché mondial a conduit à un déclin du volume du commerce mondial pendant deux ans de suite, ceci pour la première fois depuis la fin de la guerre mondiale et la création du G.A.T.T., lorsque l'impérialisme américain victorieux imposa sa version du commerce libre sur un monde prostré. A cela doit être ajouté tout l'effilochage du réseau financier complexe mis en place par l'Etat américain pour faciliter le flux du commerce sur le marché mondial, dont la plus grande part était tombée sous sa domination en 1945. En 1982, c'est 30 % du commerce mondial (ce qui ne s’était jamais vu), à côté des 2 % il y a deux ans, qui a pris la forme de troc. Le recours au troc a été imposé par la raréfaction des échanges extérieurs, la chute de la valeur de la plupart des monnaies et le manque de crédit disponible pour la plupart des pays du monde. Ce fait est une indication de plus que les mécanismes financiers élaborés par le capital pour relier les différentes parties du marché mondial sont en train de se désintégrer devant ses yeux-
Le recours massif au crédit qui a permis d'éviter une chute brutale de l'économie mondiale pendant les années 70, mais qui a dû être restreint lorsque les pays avancés se sont heurtés à l'hyper inflation, a laissé au capital mondial un fardeau de dettes énorme et insupportable, La dette extérieure du tiers-monde et des pays du bloc russe a maintenant atteint le niveau astronomique de 853 milliards de dollar! Pris entre le poids écrasant de la dette d’un côté et la baisse de la production, des prix et du commerce de l'autre, les trois plus grands débiteurs, le Mexique (81 milliards de dollars), le Brésil (70) et l'Argentine (40), dont les "miracles économiques" avaient été bâtis sur du papier, se sont brutalement retrouvés en faillite en 1982. Les plus grands débiteurs du bloc russe, la Pologne (27 milliards de dollars) et la Roumanie (10 milliards de dollars) ont aussi été déclarés insolvables. C'est seulement un rééchelonnement forcené des dettes et un moratoire des paiements accordé par le F.M.I., la Banque Mondiale, et les prêteurs "privés" qui ont empêché que l'ensemble du système monétaire international ne s'effondre corme un château de cartes.
De plus, la dette et le danger de faillite du tiers-monde et des pays du bloc de l'Est ne sont tous deux que la partie visible de l'iceberg.
La dette des pays avancés du bloc américain éclipse de loin les dettes des pays pauvres et a rendu précaire la situation financière de ces géants industriels eux-mêmes. Aux USA le résultat cumulatif de l'hypertrophie du crédit est une dette du secteur public et privé qui a maintenant atteint le niveau incroyable de 5 000 milliards de dollars !
Oie crise capitaliste est toujours une crise du profit dans laquelle, non seulement le taux de profit, mais également la masse de profit s'effondrent. La situation du capital américain, capital national dominant dans le monde, peut probablement illustrer l'état de plus en plus précaire de l'indice le plus important de la santé de l'économie capitaliste. Aux USA, les profits industriels avant impôts, qui atteignaient un montant annuel de 260 milliards de dollars au premier trimestre de 1980, sont tombés à un montant de 170 milliards à la fin de 1982. Les profits après impôts des plus grandes compagnies américaines sont tombés de presque 20 % en 1982. Dans l'industrie clé du pétrole, les profits des vingt-cinq plus grandes compagnies américaines sont tombés de 27 % en 1982. Derrière cette chute .dramatique de la masse de profit, il y a le fait que des secteurs critiques des industries de base aux USA travaillent à perte : acier, automobiles, machines-outils, matériel agricole, métaux non ferreux, mines.
L'industrie américaine de l'acier, pour prendre un exemple significatif, a perdu 684 millions de dollars en 1982.
L'accroissement énorme du chômage est à la fois et en même temps l'expression de la barbarie du capitalisme qui condamne une masse toujours croissante de l'humanité au rebut, et la démonstration de la faillite historique d'un mode de production qui ne peut plus exploiter de manière rentable la force de travail de ses esclaves salariés. Dans les pays industrialisés du bloc américain, il y a maintenant 32 millions de chômeurs sur la base des chiffres officiels des gouvernements, qui cachent évidemment la profondeur réelle de la catastrophe (ainsi, si le chômage aujourd'hui était mesuré sur la même base que dans les années 30 aux USA, le taux de chômage des ouvriers américains serait à son plus haut niveau depuis 1935 !) L'extension de 1'accroissement du chômage dans ces pays est un des indices les plus clairs de la plongée du capitalisme dans l'abîme :
En même temps, dans les pays arriérés, le capitalisme poursuit -à un taux plus rapide encore un processus effroyable de création d'une masse permanente de sans emplois vivant dans des conditions sous humaines dans d'énormes bidonvilles ou mobilisés pour travailler à la campagne dans des bataillons de travail d'esclave (Chine, Vietnam. ) .
Trois ans de politique déflationniste dans les métropoles du bloc américain, après une décennie durant laquelle une chute abrupte à la 1929 n'a été évitée que par la création d'une masse de valeurs-papier, ont accéléré la plongée sans cependant écarter le spectre de l'hyper-inflation. Un grand nombre d'économies de premier plan sont restées soumises à une inflation à deux chiffres à la fin de 1982 :
TAUX ANNUEL D'ACCROISSEMENT DES PRIX A LA CONSOMMATION
Un déficit budgétaire aux USA de plus de 200 milliards de dollars pour 1983 ; des emprunts extérieurs massifs de pays comme la France, le Canada, l'Espagne et l'Italie pour soutenir leurs économies qui s'effondrent, et ceci avec des taux d'intérêt qui restent à des niveaux historiques tant ils sont élevés ; tout indique que le tourbillon inflationniste reste un danger réel pour l'économie capitaliste définitivement malade.
Tous les indices montrent donc qu'au cours de ces trois dernières années, la crise économique mondiale a franchi un pas qualitatif à partir duquel -comme nous allons le montrer maintenant -aucune reprise n'est possible.
L'impasse de la classe capitaliste.
Même à l’époque d'une crise historique du mode de production capitaliste qui pose l'alternative de la guerre impérialiste mondiale ou de la révolution prolétarienne comme seules sorties possibles de l'effondrement économique, le cours de la crise n'est jamais linéaire. La crise garde sa caractéristique d'avancer en zigzags, bien que fondamentalement elle tende à être toujours plus profonde. Par conséquent, la descente du monde capitaliste dans l'abîme de la dépression n'est pas incompatible avec des reprises courtes, cycliques, limitées dans le temps et dans l'espace. De fait, l'économie américaine commence probablement déjà à faire l'expérience d'une telle reprise. Cependant, contrairement à la situation d'après 1933, lorsqu'il a été possible pour le capital de stimuler l'économie pour une période de cinq ou six ans à travers la consolidation du capitalisme d'Etat et une variété de politiques économiques keynésiennes, aujourd'hui, de telles politiques, et par conséquent une reprise du même type, sont exclues.
L'année 1933 a vu Roosevelt et Hitler arriver au pouvoir respectivement aux Etats-Unis et en Allemagne, au milieu d'un effondrement économique quasi-total. En Allemagne, Hitler et son tsar de l'économie, Hjalmar Schacht, lancèrent un programme de relance basé sur l'autarcie et le financement déficitaire de grands travaux publics et de projets d'armements. La production en Allemagne s'accrût de 90 % entre 1933 et 1938, alors que le chômage tombait de 3,7 millions d'ouvriers à 200 000 dans la même période. Roosevelt et son "brains trust" utilisèrent le protectionnisme, à commencer par le "Scoot-Hawley tariff" de 1930 et une combinaison de politiques keynésiennes consistant en des dépenses déficitaires, l'expansion du crédit, l'inflation monétaire et la création d'un "salaire social" pour compenser le manque de demande effective ([3] [469]), qui amenèrent une croissance annuelle du produit national brut de 9,1 % de 1933 à 1935 et de 9,8 % de 1935 à 1938. Il est certain que la grande expansion du capitalisme d'Etat et l'utilisation des politiques keynésiennes, qui furent à la base des cinq années de relance, n'ont pu fournir aucune solution à la crise historique du capitalisme. Aux Etats-Unis, de septembre 1937 à juin 1938, la production industrielle a chuté de 30 % alors que le chômage augmentait de 22 %. Avant que cette nouvelle étape dévastatrice de la crise économique n'ait pu s'étendre à 1'Europe, la deuxième boucherie inter impérialiste avait commencé et le capitalisme avait de ce fait apporté à la crise économique la seule "solution" dont il est capable.
La situation à laquelle fait face le capital mondial aujourd'hui est qualitativement différente
de celle qui prévalait en 1933. Le type de politique qui a permis à la classe capitaliste d'effectuer une reprise économique pendant cinq ans, durant lesquels les préparatifs économique, militaire et idéologique pour la guerre mondiale impérialiste ont été parachevés, n'est pas possible dans la conjoncture actuelle. La tendance universelle au capitalisme d'Etat, qui a été la réponse du capital à la nécessité de centraliser et d'organiser son appareil productif pour la guerre mondiale en 1914-1918, avait été atténuée de façon considérable durant la phase de reconstruction des années 20. Par conséquent, l'utilisation pendant de nombreuses années, de mesures capitalistes d'Etat après 1933, ont eu pour effet de rationaliser un appareil productif et financier qui était devenu obsolète par rapport aux besoins du capital lui-même confronté à une crise permanente.
Aujourd'hui, cependant, après cinquante ans d'expansion quasi-ininterrompue du capitalisme d'Etat, que ce soit sous la forme stalinienne ou "démocratique", la base économique capitaliste s'écroule sous l'énorme poids du parasitisme de l'Etat Léviathan. Les mesures capitalistes d'Etat supplémentaires -cependant nécessaires du fait que le capital réagit aux antagonismes inter impérialistes croissants et au danger de la lutte de classe prolétarienne- loin de stimuler une reprise économique, ne font que constituer un fardeau encore plus lourd sur une économie qui étouffe sous le poids improductif d'une bureaucratie parasitaire.
Les politiques économiques inflationnistes introduites après 1933 faisaient suite à quatre ans de déflation et de chute rapide des prix, période pendant laquelle d'énormes dettes furent liquidées. Il en résulta une vaste expansion du crédit et un financement déficitaire massif qui pouvaient compenser un manque de demande effective sans provoquer immédiatement une inflation galopante ou un effondrement du système monétaire. Aujourd'hui, bien qu'après des décennies durant lesquelles la drogue du crédit a été administrée à profusion à une économie capitaliste embourbée dans une crise permanente, le capital mondial titube à la limite d'une hyper-inflation et suffoque sous une montagne de dettes. Ces politiques économiques très keynésiennes doivent être maintenant abandonnées si le malade capitaliste ne veut pas mourir d'une overdose de la drogue mortelle qui a été utilisée pour le maintenir en vie ces dernières années.
Après 1933, l'expansion du "salaire social", cette partie du coût de production et de reproduction de la marchandise force de travail (capital variable) payée directement par l'Etat, qui a été au départ un moyen de soumettre la classe ouvrière à l'Etat capitaliste, a aussi agi comme un stimulant de l'économie en crise. La croissance du salaire social a toujours été liée aux politiques inflationnistes keynésiennes ; il s'ensuit que dans la situation présente, le salaire social est partout soumis à une attaque en règle et sauvagement amputé. Le démantèlement du "Welfare State" (Etat "providence"), nécessairement pris en charge tout autant par les gouvernements de gauche que de droite, supprime un des appuis idéologiques clé de la domination capitaliste sur le prolétariat ; en même temps, ceci amènera un rétrécissement accru d'un marché qui est déjà trop petit pour absorber la pléthore de marchandises que l'industrie est capable de produire.
L'économie de guerre, qui a été le véritable axe autour duquel le capitalisme d'Etat s'est développé, et qui a commencé dans les années 30, n'a jamais été une politique économique en aucune manière, une tentative de vaincre les barrières intrinsèques de l'accumulation du capital, car la production d'armements constitue une stérilisation de capital. Elle est par nature improductive en termes capitalistes. La fonction véritable de l'économie de guerre est toujours une préparation directe à la guerre inter impérialiste elle-même. Néanmoins, après 1933, dans le cadre de la période de déflation sauvage qui venait juste de se produire, l'économie de guerre pouvait avoir l'effet subsidiaire d'un stimulant momentané de l'économie. Aujourd'hui, alors que la production d'armement doit croître à un taux toujours plus rapide du fait que les deux blocs se préparent pour la guerre, son impact économique -tout au contraire des années 30- sera désastreux pour le capital. Face à des déficits budgétaires déjà incontrôlables, l'augmentation massive des dépenses militaires, que la croissance des antagonismes inter impérialistes rend nécessaire, est un fardeau économique qui ne fait qu'accélérer la descente du capitalisme dans l'abîme.
Après 1933 l'autarcie et le protectionnisme ont été utilisés par Hitler et Roosevelt, en même temps qu'un financement déficitaire, pour combattre temporairement la saturation du marché intérieur alors même que le commerce mondial stagnait. Aujourd'hui l'extrême interdépendance des économies capitalistes avancées du bloc américain sous la domination des Etats-Unis, est telle que les fractions dominantes du capital dans chaque pays sont liées à là version américaine imposée du "libre-échange" qui a prévalu depuis 1945. Il est certain qu'il y a des voix et des secteurs croissants du capital dans chaque pays qui réclament un retour au protectionnisme, mais ceux-ci restent concentrés dans les secteurs les plus anachroniques et les plus faibles de chaque économie. Une politique de protectionnisme ou d'autarcie est combattue par les secteurs les plus puissants de la classe capitaliste parce qu'elle menace directement d'exacerber l'effondrement du commerce mondial et le système monétaire international, aussi bien que la cohésion même du bloc américain. La valeur réelle du protectionnisme pour le capital aujourd'hui n'est pas celle d'une politique économique comme dans les années 30, mais celle d'une mystification nationaliste pour tenter de dévoyer la lutte de classe, un instrument particulièrement important pour la gauche du capital dans l'opposition
Ce que nous constatons maintenant n'est rien moins que la faillite complète du keynésianisme, des politiques économiques sur lesquelles le capitalisme s'est appuyé depuis les années 30. L'Etat ne peut plus compenser le manque de demande effective sur un marché saturé au travers de politiques inflationnistes qui ont été la cheville ouvrière du keynésianisme. Qui plus est, alors que la direction de l'Etat et le contrôle sur l'économie -qui est l'autre base du keynésianisme -vont continuer à s'accroître à un taux toujours plus rapide, il est maintenant plus que clair que ceux-ci ne peuvent fournir aucune "solution" à la crise économique. La faillite du keynésianisme est la manifestation éclatante de l'impasse de la classe capitaliste, la confirmation du fait qu'en termes économiques, la perspective à laquelle fait face le capital mondial est beaucoup plus sinistre qu'elle ne l'était en 1933.
Le long recours au keynésianisme ayant brisé les véritables bases qui permettaient la poursuite de ces politiques inflationnistes, le capital n'a plus de nouveau palliatif économique pour les remplacer. La seule politique ouverte au capital aujourd'hui est la déflation et l'austérité, politique économique qui ne peut que pousser le capital plus loin dans l'abîme de la dépression mondiale, tout en détruisant en même temps les bases sur lesquelles il a cherché à maintenir un semblant de contrôle idéologique sur le prolétariat (Welfare State, "salaire social", etc.).
Empêcher l'éclatement de l'ensemble du système monétaire international -véritable colonne vertébrale du capital mondial- par l'hyper-inflation, exige des politiques d'austérité et de déflation qui vont accélérer le plongeon de la production industrielle et du commerce mondial. Cependant, ces politiques vont elles-mêmes toujours générer de nouvelles pressions vers une faillite généralisée des nations et entreprises débitrices, ce qui a aussi pour résultat l'effondrement véritable du système monétaire que les mesures d'austérité tentent de prévenir. Le dilemme est insoluble, sinon par une destruction des valeurs capitalistes et une re division du marché mondial qui ne peut se faire qu'à l'échelle d'une troisième guerre mondiale -quoique la destruction physique d'un tel holocauste rendrait probablement problématique toute sorte de "reconstruction". Néanmoins, c'est le seul pas que le capital -par la nature de ses propres contradictions- doive faire. Ceci signifie que le capital doit tenter de répondre à cette nouvelle étape dans le déroulement de sa crise historique, non par des politiques économiques, qui ne sont aujourd'hui rien de plus qu'une opération de colmatage à très court terme, mais par une stratégie politique destinée d'abord à dévoyer ensuite à défaire la classe ouvrière. Seule une telle défaite peut ouvrir la voie à la "solution" capitaliste.
[1] [470] Ceci, bien sûr, ne doit pas nous amener à ignorer le fait que les moyens par lesquels la bourgeoisie réagit aux antagonismes inter impérialistes et à la lutte de classe peuvent eux-mêmes affecter la manière dont s'étend la crise économique.
[2] [471] La situation de la classe capitaliste vis-à-vis du prolétariat est traitée dans l'autre partie du rapport sur la situation internationale.
[3] [472] Il est clair que la fonction objective de toutes ces politiques était de soumettre le prolétariat à l'Etat capitaliste et permettre à l'impérialisme de parachever sa mobilisation pour la guerre mondiale.
Conscience et organisation:
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Rapport sur la situation internationale : (2ème partie)
- 2493 reads
LE RAPPORT DE FORCES ENTRE CLASSE OUVRIERE ET BOURGEOISIE
"Le coup de force du 13 décembre 1981 a mis fin à 1'épisode le plus important depuis un demi-siècle du long combat entre classe ouvrière mondiale et capital. Depuis le resurgissement historique de la lutte prolétarienne à la fin des années 60, jamais la classe ouvrière n 'était allée en effet aussi loin dans la combativité, la solidarité et 1'auto-organisation. Jamais elle n'avait employé avec autant d'ampleur cette arme essentielle de sa lutte dans la période de décadence du capitalisme : la grève de masse. Jamais elle n'avait infligé à la bourgeoisie de telles craintes, ne l'avait contrainte à déployer autant de moyens de défense. Aujourd'hui, le prolétariat est muselé en Pologne. Une nouvelle fois, il a versé son sang et, contrairement à ce qui s'était passé en 1970 et 1976, c'est pour subir une exploitation décuplée, une misère accrue proche de la famine, une terreur déchaînée. C'est donc par une défaite pour la classe ouvrière que se clôt cet épisode. Mais au moment où la coalition de toutes les forces bourgeoises et la force des armes l'obligent à quitter la scène en Pologne, il importe que le prolétariat mondial tire un maximum de leçons de l'expérience qu'il vient de vivre. Il importe qu'il puisse répondre, et avec lui son avant-garde communiste, à la question : Où en sommes-nous ? Quelle perspective pour la lutte de classe ?", (Revue Internationale n°29 "Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales", 2ème trim.82) .
OU EN EST LA LUTTE DE CLASSE?
Par la grève de masse, les ouvriers de Pologne ont donné en Août 80 une réponse aux questions posées dans la lutte, et non résolues par leurs frères de classe d'Europe occidentale :
- la nécessité de l'extension de la lutte (grèves des dockers de Rotterdam en automne 79) ,
- la nécessité de son auto organisation (sidérurgie en Grande-Bretagne au printemps 80) ,
- l'attitude face à la répression de l'Etat (lutte des sidérurgistes de Longwy-Denain en hiver 79).
Leur combat a ainsi confirmé ce que les grèves de 78-80 en Europe occidentale annonçaient : la fin du reflux de la lutte de classe, reflux qui avait marqué le milieu des années 70.
Il a montré au prolétariat mondial la véritable nature -capitaliste- des soi-disant "pays socialistes", levant ainsi une mystification déjà bien entamée, mais jusque là toujours vivace au sein de la classe ouvrière.
Ce combat a constitué concrètement un frein aux tensions impérialistes, paralysant le dispositif militaire russe en Europe de l'Est, montrant; à l'ensemble de la bourgeoisie mondiale la combativité du prolétariat au coeur de l'Europe.
Cependant, les ouvriers de Pologne sont restés isolés, l'appel que constituait leur lutte n'a pas été entendu. La question à laquelle ils ne pouvaient répondre par eux-mêmes c'est celle de la généralisation des combats de classe, l'entrée dans la lutte des prolétaires des autres pays.
La défaite en Pologne n'est pas uniquement une défaite des ouvriers de Pologne, elle est celle de l'ensemble du prolétariat. Elle est l'expression de la faiblesse du prolétariat mondial. Les mystifications qui ont permis à la bourgeoisie de dévoyer la lutte de classe et d'imposer la répression sont fondamentalement les mêmes auxquelles se sont trouvés confrontés les ouvriers d'Europe occidentale : démocratisme, nationalisme, syndicalisme. Ce sont les mêmes qui ont permis à la bourgeoisie d'imposer un recul des luttes aux ouvriers d'Europe de l'Ouest, dont la défaite en Pologne est le résultat.
Le prolétariat d'Europe occidentale est au coeur du monde capitaliste. Fraction du prolétariat mondial ayant le plus d'expérience, il est aussi confronté aux mystifications bourgeoises les plus élaborées. Si la lutte en Pologne a pu faire prendre conscience de la nature capitaliste des pays de l'Est, seule la lutte du prolétariat occidental pourra réellement purger la conscience des ouvriers du monde entier des illusions démocratiques, nationalistes et syndicalistes qui sont une entrave à la lutte du prolétariat partout.
Après les grèves de 78 à 80, on a assisté à un recul des luttes en Europe occidentale. La contre-offensive de la bourgeoisie a commencé à la fin des années 70 avec la réorganisation de l'appareil politique (gauche dans l'opposition), le développement du syndicalisme de base, les campagnes idéologiques de désorientation du prolétariat. Toute cette stratégie, orchestrée de manière de plus en plus organisée et unifiée au niveau mondial, a abouti à un affaiblissement de la lutte ouvrière en Europe de l'Ouest. De plus, l'absence de réaction ouvrière claire contre la participation directe des contingents français et italiens au Liban ainsi que du contingent britannique au conflit des Malouines, dans le contexte d'un alourdissement constant des budgets militaires et des bruits de bottes assourdissants répercutés par les médias, a pu faire douter certains de la capacité du prolétariat d'Europe occidentale à assumer ses responsabilités historiques, à s'opposer à la réponse bourgeoise à la crise du capitalisme : la guerre impérialiste généralisée.
La première et la seconde guerre mondiale ont été déterminées par la capacité de la bourgeoisie à mettre à profit les faiblesses du prolétariat européen pour l'embrigader derrière ses objectifs impérialistes.
Aujourd'hui, avec le recul du prolétariat mondial concrétisé par la défaite en Pologne, et les tambours guerriers qui résonnent, vient se profiler sur la classe ouvrière le spectre des années 30 et de la seconde guerre mondiale. Tirer le bilan de ce recul des luttes de classe ne doit pas nous amener à des conclusions alarmistes. La bourgeoisie a entamé une nouvelle offensive contre le prolétariat, mais les conditions, les raisons et la nature même de cette offensive en montrent les limites.
Aujourd'hui, la situation est bien différente de celle des années 30. C'est ce que nous démontrons dans la partie qui suit.
LA DIFFERENCE ENTRE LES ANNEES 30 ET LA PERIODE ACTUELLE
1. Le prolétariat n'est pas vaincu aujourd'hui.
La génération de prolétaires qui se trouve confrontée à la crise ouverte du capitalisme qui commence en 1929 et va déboucher sur la guerre de 1939-45 est la même qui a vécu 1' écrasement de la vague révolutionnaire des années 1917-23. De cet échec le prolétariat mondial en sort avec un potentiel de combativité profondément diminué, notamment là où la perspective révolutionnaire s'est manifestée avec le plus de force, en Allemagne et en Russie.
Mais, même dans les pays où cet écrasaient n'a pas été aussi violent, comme pour les démocraties occidentales (France, Grande Bretagne, USA), la combativité du prolétariat s'est trouvée profondément affectée par son déboussolement idéologique lié à la défaite de la révolution et à l'effondrement de la 3ème Internationale qui en a découlé.
L'échec de la révolution est une défaite du prolétariat mondial et c'est au niveau mondial que le prolétariat a été affaibli. Tel fut le facteur essentiel qui a permis à la bourgeoisie d'organiser l'embrigadement des prolétaires dans la seconde guerre mondiale.
Aujourd'hui, la situation est bien différente. La génération de prolétaires qui se trouve confrontée à la crise du capital qui, de nouveau, a ressurgi de manière ouverte, ne se relève pas de la défaite d'une vague révolutionnaire. Dans la période du second après-guerre, la bourgeoisie a assuré son contrôle sur le prolétariat bien plus grâce aux illusions permises par la relative prospérité liée à la reconstruction que par la répression directe. Ainsi, alors que l'aggravation lente mais inexorable de la crise entame ces illusions, le potentiel de combativité de cette nouvelle génération de prolétaires demeure intact.
Le prolétariat, bien que déboussolé par son manque d'expérience -produit de 50 années de contre-révolution-, n'en est pas pour autant démoralisé et surtout il n'est pas embrigadé derrière la défense de l'Etat, laquelle ouvre le chemin à la guerre. De ce point de vue, la condition première de l'éclatement d'une 3ème guerre mondiale est absente.
2. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie s'est restreinte
Cependant, la différence entre la situation présente et celle des années 30 ne se situe pas seulement au plan des conditions historiques de la lutte du prolétariat.
L'histoire ne se répète pas : depuis son entrée dans la période de décadence, le capitalisme a continué de se transformer. Et si les causes de sa crise ouverte sont fondamentalement les mêmes, les caractéristiques de son développement ont changé. Cette réalité se traduit au niveau des formes de contrôle que la bourgeoisie essaye d'établir sur le prolétariat.
Malgré toutes les politiques de capitalisme d'Etat systématisées depuis les années 30, la crise économique présente ne fait que s'aggraver. Cette aggravation montre de manière limpide la réelle inefficacité, dans la période actuelle, des politiques d'étatisation de 1'économie qui, lors de la crise des années 30, avait permis à la bourgeoisie d'obtenir le répit lui permettant de parachever l'embrigadement du prolétariat pour la guerre.
En effet, pour qu'une mystification soit à même de jouer son rôle vis-à-vis du prolétariat, il faut qu'elle s'appuie sur un semblant de réalité. L'"efficacité" des mesures de capitalisme d'Etat dans les années 30 qui ont permis à la bourgeoisie de redresser provisoirement la situation économique est avant tout liée à leur nouveauté. Les illusions sur l'économie ont permis à la bourgeoisie d'asseoir les illusions politiques, de désamorcer la combativité ouvrière. Le capitalisme d'Etat s'est caché derrière le mythe de 1'Etat-social : national-socialiste en Allemagne, populaire en France ou en Espagne, Etat-providence ou Welfare state aux USA. L'Etat social est le volet politique destiné au prolétariat, corollaire du capitalisme d'Etat sur le plan économique, qui a permis jusqu'à aujourd'hui à la bourgeoisie de maintenir la classe ouvrière dans les fers de la contre-révolution derrière l'étendard de la démocratie.
Grâce aux mesures de capitalisme d'Etat, la bourgeoisie a pu contenir momentanément les manifestations les plus flagrantes de la crise économique et grâce au Welfare state, elle a pu éviter la crise politique. Mais la crise qui se développe aujourd'hui, malgré l'intervention intensive de l'Etat dans la vie économique, tend à rendre caduques les illusions liées au Welfare state et, de manière générale, les illusions démocratiques. La bourgeoisie ne parvenant plus à réellement freiner les effets de la crise, toute la base de son contrôle sur le prolétariat durant des décennies se trouve donc sapée; elle est ainsi poussée vers la crise politique.
La crise économique du capitalisme pousse aujourd'hui la bourgeoisie dans une impasse face à; la classe ouvrière. Elle pousse les deux classes vers l'affrontement parce que les armes idéologiques de la bourgeoisie sont rendues caduques par la faillite économique de son système. Durant les années 30, la bourgeoisie avait pu faire croire que l'effondrement de 1929 exprimait uniquement la faillite du capitalisme privé, ce qui lui permettait ainsi de préserver l'essentiel : l'idée que l'Etat se posait au-dessus des classes, qu'au sein de l'Etat la classe ouvrière avait sa place, qu'elle pouvait y défendre ses intérêts. La crise économique montre aujourd’hui à l'évidence, ainsi que l'ont toujours proclamé les révolutionnaires, que tout cela n'est qu’illusion.
Dans la réalité pratique de son existence, le prolétariat commence à voir l'Etat pour ce qu'il est : un instrument de coercition au service d'une classe, la classe dominante. Ainsi tendent à devenir caduques toutes les mystifications qui ont masqué aux yeux du prolétariat la réalité totalitaire de l'Etat capitaliste.
3. Une illustration de ces différences : la question du chômage
Le krach de 1929 va précipiter des millions de prolétaires dans le démènent le plus total. De 1929 à 1934, le chômage ne cesse de s'accroître. Mais la mise en place des mesures de capitalisme d'Etat va permettre ensuite de le réduire momentanément : politique des grands travaux aux USA (Tennessee Valley Authority), développement de l'économie de guerre en Allemagne et en Grande-Bretagne, sans que pour autant le taux de chômage ne redescende jamais au niveau d'avant 1929. Mais cela va permettre à la bourgeoisie de renforcer l'idée qu'il existe une solution réelle à la crise du capital : l'intervention de l'Etat. De plus, la mise en place par l'Etat d'allocations-chômage, d'aide aux chômeurs sous différentes formes -aide qui n'existait pas auparavant- , va permettre de renforcer au sein du prolétariat la confiance dans l'Etat, protecteur des ouvriers face au capitalisme privé et "sauvage".
Durant les années 30, la bourgeoisie a pu ainsi désamorcer la bombe sociale que constituait le chômage. Après les luttes déterminées des chômeurs, notamment aux USA en 1930, 31, 32, la politique de l'Etat va permettre de résorber la combativité ouvrière et de préparer l'embrigadement idéologique du prolétariat derrière l'Etat de gauche, démocratique, qui défend les ouvriers face au grand capital ([1] [473]). C'était ainsi préparer le futur embrigadement dans la guerre impérialiste.
Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Le chômage se développe régulièrement, inexorablement, sans que la bourgeoisie n'ait de mesure économique à sa disposition pour l'endiguer ni d'illusion politique pour le faire accepter. D'ores et déjà dans les pays développés, le niveau de chômage atteint des taux qui étaient ceux de la fin des années 30. Comme l'a montré l'échec des politiques de relance durant les années 70, aucune relance future ne pourra le résorber; au contraire, face à la concurrence exacerbée sur le marché mondial, les investissements ont pour objectif bien plus l'augmentation de la productivité que l'élargissement de la production.
De plus, à l'inverse des années 30, l'Etat capitaliste ne peut plus asseoir son contrôle sur sa soi-disant "générosité" par le renforcement de la protection sociale des chômeurs; au contraire, il ne peut qu'attaquer les "acquis" du Welfare state, mis en place après la crise de 1929 et perfectionnés durant la reconstruction. L'Etat capitaliste n'a plus les moyens économiques de sa politique de mystification du prolétariat, politique qui lui a permis d'assurer sa domination jusqu'à aujourd'hui. Dans la pratique, la bourgeoisie est ainsi amenée à détruire les bases de son contrôle idéologique sur le prolétariat.
4. La question de la guerre
Une des caractéristiques des années 30 consistait dans la préparation à la seconde guerre mondiale d'une part par l'augmentation des programmes militaires, et d'autre part par le développement de conflits localisés à la périphérie tels que les conflits entre la Chine et le Japon, l'invasion italienne en Ethiopie, la guerre en Espagne, l'Anschluss de l'Allemagne nazie sur l'Autriche.
De ce point de vue, sommes-nous dans la même situation que celle qui précéda la seconde guerre mondiale ?
L'augmentation, ces dernières années, des programmes militaires dans tous les pays -et notamment ceux les plus puissants, qui étaient déjà les plus armés- montre que, comme dans les années 30, la pression de la crise pousse la bourgeoisie vers des tensions impérialistes croissantes. Chaque bloc renforce effectivement de manière accélérée son dispositif militaire.
Par ailleurs, certains conflits se déployant à la périphérie rappellent les conflits qui ont précédé la seconde guerre mondiale : l'invasion de l'Afghanistan avec la présence directe de 100 000 soldats russes, l'intervention israélienne au Liban pour expulser la présence soviétique de la région, les différents conflits en Afrique et en Asie, où le bloc russe se bat par soldats cubains, libyens ou vietnamiens interposés, et même la guerre entre l'Irak et l'Iran qui a fait déjà 300 000 morts et blessés, où l'URSS n'est pas présente mais qui a pour but de restaurer efficacement le dispositif militaire du bloc occidental affaibli en Iran, face à l'offensive russe en Afghanistan.
Tous ces conflits sont, en effet, l'expression des tensions impérialistes réelles qui déchirent le monde.
Cependant, -et là réside toute la différence entre la situation présente et celle des années 30- d'autres conflits ouverts, tels que ceux du Salvador ou des Malouines, bien qu'ils se situent dans le contexte de l'impérialisme mondial, ne sont pas l'expression de réelles rivalités impérialistes, ni locales, ni mondiales. Ces "guerres" servent d'abord à alimenter le matraquage idéologique intense auquel la bourgeoisie soumet le prolétariat. Tous ces bruits de bottes sont amplifiés démesurément par les vociférations des médias qui étalent dans tous les foyers les horreurs de la guerre, semant la crainte d'une 3ème guerre mondiale.
Les événements de Pologne montrent le but d'un tel battage. Les grèves en Pologne ont été le prétexte d'une propagande hystérique des deux blocs, l'URSS dénonçant les "ingérences inacceptables" de l'Occident, les USA et leurs alliés poussant des cris d'orfraie devant la menace d'une intervention russe. L'histoire se répétait-elle, la Pologne où avait débuté la seconde guerre mondiale serait-elle à l'origine d'une troisième ?
En réalité, derrière cette façade belliciste se cachait le fait que les deux blocs travaillaient en sous mains ensemble pour mater les luttes ouvrières en Pologne. Par l'envoi de crédits, l'occident a permis à la bourgeoisie de l'Est de tenir face au prolétariat, grâce à sa propagande relayée par ses radios style Free Europe ou BBC international en Polonais, l'occident a accrédité le danger d'une intervention russe pour intimider les ouvriers de Pologne. En occident même, la bourgeoisie a tout fait pour en faire un problème polonais afin d'isoler le prolétariat en claironnant que la grève de masse en Pologne créait un danger de guerre, elle a répandu l'idée que la lutte de classe menait à la guerre impérialiste.
On voit quel usage la bourgeoisie fait de sa propagande belliciste : diviser et intimider le prolétariat. Cette préoccupation est déterminante pour la bourgeoisie, dans la mesure où le prolétariat mondial, et notamment le prolétariat européen n'est pas embrigadé dans la guerre.
Là est la différence fondamentale par rapport aux années 30. A cette époque, le prolétariat de Russie et d'Allemagne physiquement écrasé dans les années 20 était incapable de s'opposer à la guerre. En occident, les campagnes antifascistes ont réussi à permettre l'enrôlement derrière l'étendard démocratique.
Le prolétariat aujourd'hui, n'est pas embrigadé en Europe, au coeur même des contradictions capitalistes, là où se sont déjà déchaînées deux guerres mondiales : l'Europe qui est l'enjeu d'une éventuelle 3ème guerre mondiale. Cela se traduit dans le fait que les conflits restent à la périphérie où des fractions plus isolées et plus faibles du prolétariat peuvent être embrigadées derrière les illusions nationalistes. Mais même en Israël, où la bourgeoisie a eu beau jeu de jouer sur des spécificités historiques et locales, il est de plus en plus difficile de justifier aux yeux du prolétariat la nécessité de la guerre, contre l'ont montré les résistances parmi les soldats face à l'intervention au Liban en 82.
Le manque de réaction du prolétariat de différents pays d'Europe face à l'envoi de contingents professionnels aux Malouines et au Liban n'est certes pas un signe de la force de la classe ouvrière, mais il n'exprime pas cependant une adhésion du prolétariat. Le seul moment où on a vu de réelle réaction de la classe ouvrière face à la guerre, c'est dans la guerre elle-même, que ce soit en 1917 sur le front de la Marne ou sur le front russe, en 1943 en Italie ou en 1945 en Allemagne.
La lutte du prolétariat contre la guerre passe par sa lutte contre les attaques de la bourgeoisie sur le plan économique. C'est de cette lutte que surgira la conscience de la nécessité de mener le combat contre la guerre impérialiste. Car c'est à ce niveau que se concrétisera l'alternative : du beurre ou des canons.
Tant que cette fraction déterminante du prolétariat mondial que constitue le prolétariat d'Europe n'est pas vaincue sur le terrain de la lutte pour la défense de ses conditions d'existence, il n'est pas possible de l'embrigader dans la guerre, de lui faire accepter le sacrifice de sa vie.
Le cours historique aujourd'hui n'est pas ouvert à la guerre. Le cours à la guerre, comme dans les années 30, suppose l'écrasement au préalable de la seule force capable de s'opposer au déchaînement des rivalités impérialistes : le prolétariat.
Le cours historique actuel, au contraire, est au développement des affrontements de classe dont dépendra la mise en avant de la perspective révolutionnaire.
Cependant, cela ne signifie pas que ce cours ne puisse être renversé, que la révolution soit inéluctable, qu'elle soit un fait acquis.
Dans la situation actuelle, tous les efforts de la bourgeoisie visent à défaire le prolétariat, à le démobiliser d'abord pour tenter ensuite, de l'embrigader, ouvrant ainsi un cours à la guerre.
C'est une pression permanente qui s'exerce sur la classe ouvrière et qui se traduit par les aléas, les avancées et les reculs de la lutte de classe.
Face au prolétariat, la bourgeoisie adapte ses armes aux conditions présentes
1. Pour la bourgeoisie aussi ; la fin des illusions
Durant les années 70, la bourgeoisie a vécu dans l'illusion de la répétition des années 30, dans l'illusion qu'aux mêmes maux pouvaient correspondre mécaniquement les mêmes remèdes. Les Etats se sont endettés pour financer les politiques de relance qui devaient mettre fin à la crise et surtout différer le plus fort de l'attaque nécessaire contre le niveau de vie des prolétaires des centres industriels du capitalisme mondial. C'était la condition essentielle pour tenter de conforter l'emprise de l'Etat sur le prolétariat des métropoles capitalistes, là où la classe exploitée est la plus concentrée, là où l'essentiel des richesses est produit.
Cette politique économique avait son corollaire dans l'attaque idéologique menée contre le prolétariat -c'est-à-dire la politique de gauche au pouvoir- après le resurgissement de la lutte de classe partout dans le monde (et en particulier avec Mai 68 en France et le Mai rampant italien en 69). C'est cette politique qui a permis à la bourgeoisie d'imposer le reflux de la lutte de classe au milieu des années 70 : Programme commun en France, compromis historique en Italie, contrat social en Grande Bretagne, social démocratie au pouvoir en Europe du Nord, démocrates au pouvoir avec Carter aux USA. A la fin des années 70, derrière les campagnes sur "les droits de l’homme" se cachaient les mêmes thèmes humanistes qui, durant les années 30, avaient permis d'embrigader le prolétariat occidental dans la guerre derrière la bannière de l’antifascisme. Cependant, l'échec des politiques de relance, qui ne parvenaient pas à résorber le chômage et ne faisaient qu1accélérer l'inflation, a réduit à néant l'illusion pour la bourgeoisie qu'il serait possible d'enrôler le prolétariat aussi facilement. Les années 70 montrent à la bourgeoisie d'une part, que le prolétariat n'est pas dans la situation de faiblesse des années 30, et d'autre part, qu'avec l'aggravation des contradictions du capitalisme tout au long de la décadence, elle n'a plus aujourd'hui la même marge de manoeuvre sur le plan économique. Ces deux aspects se manifestent sur le plan politique dans le rapport entre prolétariat et bourgeoisie.
Parce que les "recettes" héritées des années 30, tant sur le plan économique que politique, ne sont plus efficaces, parce que, dans ces conditions nouvelles pour elle, les vieilles formes de mystification et d'encadrement ne sont plus suffisantes pour entraver le processus de prise de conscience politique de la classe révolutionnaire, la bourgeoisie doit, de manière urgente, s'adapter si elle veut conserver son contrôle sur le prolétariat. Elle est poussée à être plus intelligente, à renforcer et à homogénéiser son système de contrôle. Mais, dans une situation générale d'affaiblissement de la classe dominante, ce renforcement est fondamentalement un renforcement de l'Etat, telle une forteresse dont on renforcerait les défenses en construisant sur du sable mouvant.
2. Unité de la bourgeoisie et campagnes idéologiques
La nécessité de faire face à la classe ouvrière est devenue la première préoccupation de la bourgeoisie qui tend à repousser au second plan ses tensions internes, aussi bien sur le plan national qu'international.
Alors que la crise économique pousse la bourgeoisie vers 1'exacerbation des rivalités inter impérialistes, le fait actuel que toutes les fractions de la bourgeoisie se trouvent confrontées en même temps au même ennemi réel, la classe ouvrière, -dont la force réside dans sa capacité à s'unifier et à développer sa conscience politique-les pousse à faire preuve de plus d'unité.
Ce n'est pas un phénomène nouveau, l'histoire nous donne des exemples limpides de cette réalité:
- face à la Commune de Paris, les armées belligérantes de France et d'Allemagne unissent leurs efforts pour écraser l'insurrection parisienne;
- face à la révolution en Russie et qui menace en Allemagne, la bourgeoisie met fin à la première guerre mondiale et unifie ses efforts pour écraser la vague révolutionnaire.
Cette unité est aussi rendue possible par des décennies de décadence, de concentration des pouvoirs au sein de l'Etat. C'est une réalité qui tend à devenir permanente et qui marque toute la situation internationale du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie.
Cela s'est traduit, ces dernières années, après l'échec des méthodes classiques (comme celles des années 30) par la mise en place au niveau international d'une stratégie plus adaptée de la bourgeoisie. Cette stratégie s'est manifestée non seulement dans le renforcement de son arsenal répressif, mais surtout par une utilisation plus intensive et plus appropriée des campagnes idéologiques au travers d'un contrôle plus strict des médias de masse.
Les campagnes idéologiques de la bourgeoisie se sont développées internationalement sur deux thèmes essentiels, corollaires l'un de l'autre : la guerre et le pacifisme. Ces campagnes constituent apparemment un paradoxe, après l'échec des campagnes d'embrigadement dans la guerre que constituait l'idéologie des "droits de l'homme", à une période où le chemin vers la guerre n'est pas ouvert. Pourtant, précisément parce que ce n'est pas le problème de la guerre qui se pose dans l'immédiat au prolétariat, ce ne sont pas de réelles campagnes pour la guerre, mais essentiellement des campagnes de déboussolement qui visent à entraver le développement de la prise de conscience du prolétariat en lui masquant l'alternative révolutionnaire.
La bourgeoisie essaie d'utiliser le même réflexe de peur que lors des campagnes anti-terroristes, qui visaient à justifier et à faire accepter le contrôle policier. En étalant sur les écrans T.V. ou sur les pages des journaux les horreurs de la guerre, le but n'est pas de mobiliser la classe ouvrière vers une guerre immédiate mais de l'immobiliser face à l'austérité en la jetant dans les bras de la gauche "pacifiste", tout en induisant des sentiments nationalistes derrière l'illusion du neutralisme.
En effet, ces campagnes sur la guerre ne prennent sens et ne sont efficaces que dans la mesure où une gauche dans l'opposition est capable d'en tirer les fruits avec le pacifisme et le neutralisme qui en découle.
3. La gauche dans l'opposition
Face à la dégradation de son économie, le maintien de la gauche au gouvernement devient incompatible avec la préservation de son image de défenseur des ouvriers.
La gauche de l'appareil politique de la bourgeoisie est la fraction spécifiquement destinée à exercer le contrôle idéologique de l'Etat sur le prolétariat; cela n'est possible que dans la mesure où cette gauche se réclame des traditions de la classe ouvrière au niveau politique et syndical. Ne pouvant maintenir la gauche crédible, et donc la crédibilité de l'Etat avec la gauche au gouvernement, la bourgeoisie est obligée de se réorganiser pour mettre la gauche dans l'opposition. Derrière cette question, c'est tout le rapport du prolétariat à l'Etat qui est en jeu.
La crise pousse au divorce de plus en plus accentué entre l'Etat et la société civile. Le prolétariat, en particulier, perd ses illusions sur le Welfare state et tend à prendre conscience du rôle anti-ouvrier de l'Etat, il est contraint à perdre ses illusions démocratiques. La bourgeoisie essaie d'entraver ce processus en tentant de faire identifier l'Etat à la droite et en maintenant dans l'opposition l'illusion d'un Etat de "gauche", d'un "bon" Etat.
Dans les années 70, parce que les effets de la crise dans les pays centraux étaient encore relativement faibles, la bourgeoisie pouvait se permettre, à coup de campagnes électorales, de diluer le prolétariat dans la population en général. Au sein de la gauche, le rôle déterminant était joué par les partis politiques, électoraux et le travail des syndicats consistait essentiellement à ramener les ouvriers sur le terrain électoral. La relance de la combativité ouvrière à la fin des années 70 va montrer que les mystifications électorales ne suffisent plus. La bourgeoisie devait affronter le prolétariat aux racines mêmes de sa luttes. Le rôle des syndicats est devenu prépondérant. La radicalisation du langage et de l'activité syndicale à la base a pour but d'entraver, de démoraliser, de diviser, d'empêcher l'extension et l'auto organisation des grèves ouvrières. Dans les pays avancés, le syndicalisme "radical" devient le fer de lance de l'offensive de la bourgeoisie contre les ouvriers : on a pu en mesurer l'efficacité face aux luttes ouvrières ces dernières années.
Cette stratégie globale de la gauche dans l'opposition telle qu'elle se concrétise dans les pays centraux (USA, RFA, GB, Belgique, Hollande) n'est pas contredite par l'arrivée de la gauche au pouvoir dans certains pays.
En effet, la bourgeoisie n'est pas une classe homogène, elle est divisée et éprouve des difficultés à surmonter ses tensions internes. Au sein de l'Etat, ces tensions se manifestent et se traduisent au niveau de la souplesse de l'appareil politique. Le partage des tâches qu'impose la nécessité de mettre la gauche dans l'opposition implique une homogénéisation de la bourgeoisie derrière l'Etat qui peut se heurter à la faiblesse idéologique de certains secteurs de la droite traditionnelle. La venue de la gauche au gouvernement en France a mis en lumière cette faiblesse et a surpris la bourgeoisie mondiale. Au coeur de l'Europe industrielle, ce "raté" de la bourgeoisie constitue un affaiblissement important de sa capacité d'encadrement du prolétariat. La gauche au gouvernement doit assumer directement la politique d'austérité nécessaire au capital national. Ce faisant, la gauche en vient à montrer le même visage que la droite et perd de son pouvoir de mystification et de contrôle sur une fraction du prolétariat mondial qui, dans l'histoire, s'est distingué par son sens politique et qui n'a pas oublié l'expérience des grèves de Mai 68, qui a marqué la reprise historique des luttes du prolétariat après 50 années de contre-révolution.
L'arrivée des socialistes au gouvernement en Grèce, en Suède ou en Espagne, ne peut avoir la même importance parce que le prolétariat de ces pays joue un rôle moins central. D'ailleurs, l'arrivée de la gauche au pouvoir dans ces pays n'a pas constitué une surprise pour la bourgeoisie. La situation a été préparée parce que la bourgeoisie ne pouvait faire autrement. La faiblesse de la droite dans ces pays est une faiblesse congénitale : poids du passé fasciste en Espagne ou de la dictature militaire en Grèce, inexpérience de la droite en Suède où la social-démocratie a monopolisé le pouvoir pendant des décennies. Néanmoins, la droite, dans ces pays comme partout, sera amenée à revenir au gouvernement dans le cadre du partage des tâches droite au pouvoir/gauche dans l'opposition, partage des tâches qui tendra de plus en plus à s'imposer dans le futur canne une nécessité face au développement de la lutte de classe. Ce n'est que par une cure d'opposition que cette droite peut se restructurer afin de pouvoir assumer efficacement sa fonction future à la tête du gouvernement.
Parce que tout développement de la lutte de classe dans un pays (et surtout dans un pays central) a des répercussions internationales, la bourgeoisie doit se serrer les coudes au niveau international. Avec la lutte de classe en Pologne nous avons vu comment la bourgeoisie est capable de surmonter ses divisions impérialistes pour affronter de manière unie le prolétariat et pour rendre crédible le mythe de 1'"opposition" de la gauche sous sa forme syndicale au travers de Solidarnosc. Cette "vie" de Solidarnosc en Pologne, en opposition à toute la rigidité de l'appareil stalinien, n'a été rendue possible que grâce à l'union de toutes les forces de la bourgeoisie mondiale face aux ouvriers.
L'offensive que mène la bourgeoisie maintenant n'a pas pour but d'embrigader la classe ouvrière, parce que ce n'est pas possible, mais d'abord de l'affronter, d'entraver sa marche vers l'unité, de l'endetter et de la démoraliser. Dans ces conditions, l'impact d'une telle offensive ne peut se mesurer à court terme. Mais d'ores et déjà, on peut en mesurer l'efficacité dans le recul de la lutte de classe en 1981 et 1982, recul qui s'est concrétisé et accentué par la défaite en Pologne, renforçant le déboussolement du prolétariat mondial.
Cependant, parce que celui-ci, et notamment sa fraction d'Europe occidentale, au coeur des rivalités impérialistes mondiales, n'est pas embrigadé dans la guerre impérialiste, son potentiel de combativité est fondamentalement intact, et ceci malgré sa défaite partielle en Pologne, malgré toutes les illusions qui continuent de peser encore sur lui. Parce qu'elle le contraint à lutter, à abandonner ces illusions, la crise du capitalisme est la meilleure alliée du prolétariat.
"Ce qui est important, ce n 'est pas ce que pense tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat dans son ensemble à un moment donné de son histoire, mais ce qu 'il sera contraint historiquement de faire, conformément à son être."
K. Marx, "La Sainte Famille".
QUELLES PERSPECTIVES?
Si, jusqu'à présent, le prolétariat des pays centraux avait subi moins brutalement que ses frères de classe de la périphérie les rigueurs de l'austérité, l'enfoncement du capitalisme dans la crise contraint la bourgeoisie à une attaque de plus en plus sévère du niveau de vie de la classe ouvrière au sein de la plus importante concentration industrielle mondiale, celle d'Europe occidentale.
Dans la mesure où la condition subjective essentielle est satisfaite -le prolétariat n'étant pas écrasé- il possède en son centre aussi un énorme potentiel de combativité; l'approfondissement accéléré de la crise est la condition objective nécessaire à l'ouverture d'une période révolutionnaire. Cette crise, que le prolétariat vit carme une contrainte, le pousse à généraliser ses luttes et sa conscience, à mettre pratiquement en avant la perspective révolutionnaire.
1. La question du chômage et la généralisation des luttes
De plus en plus, c’est la question du chômage qui signifie le plus clairement pour la classe ouvrière dans les pays développés ce qu'est la crise : .32 millions de chômeurs pour les pays de l'OCDE, c’est-à-dire toute la population active de RFA, de Belgique et des Pays-Bas réunis. Et pas d'amélioration devant nous; de ce point de vue, le pire de la crise est à venir.
Dans un premier temps, la bourgeoisie a pu utiliser la croissance lente du chômage pour diviser et intimider la classe ouvrière. "Accepter les licenciements pour sauver l'entreprise", "les chômeurs sont des privilégiés", "expulser les travailleurs immigrés pour maintenir l'emploi" : autant de mensonges qui volent en éclats devant le développement accéléré du chômage.
Jusqu'à présent, la bourgeoisie a pu limiter l'impact du chômage sur la combativité du prolétariat, d'abord en versant des allocations, ensuite en développant l'illusion que le chômage est un sacrifice nécessaire pour mettre fin à la crise. Cette situation va s'éroder, la bourgeoisie est obligée de s'attaquer toujours plus au niveau de vie des chômeurs, corme à celui de tous les autres prolétaires, car la crise s'approfondit inexorablement.
L'ensemble du prolétariat est touché par le chômage, par delà les divisions nationales, ethniques, de corporation; le chômage montre aux prolétaires ce qui les menace tous et pose ainsi la base de l'unité de la classe ouvrière.
Le problème du chômage, dans tous les pays industrialisés, se pose au niveau international; il montre que quels que soient les mensonges de chaque bourgeoisie nationale, la situation est la même partout.
Par son accroissement inévitable le chômage ne peut que pousser le prolétariat à la lutte. Lutter ou sombrer dans la misère du chômage, c'est l'alternative qui se pose concrètement aux ouvriers. Les files de chômeurs devant les soupes populaires donnent une image de ce qui attend toute la classe ouvrière. Les prolétaires luttent et lutteront, ne serait-ce que parce que c'est leur survie qui est en jeu.
Tous les mensonges de la bourgeoisie se démasquent sous la pression de la crise et par la résistance de la classe ouvrière. Le développement de la crise dans la période actuelle ne peut se traduire que par un affaiblissement de la bourgeoisie et par le renforcement du prolétariat dans la lutte historique qui les oppose. La dynamique de cette lutte dépend de la capacité de la bourgeoisie à faire face à son ennemi de classe.
Durant toutes les années 70, on peut dire que dans ses luttes le prolétariat a plus montré sa combativité que la conscience de ses buts et des moyens d'y parvenir. Ce phénomène s'est vérifié encore en Pologne où l'énorme combativité du prolétariat révélée par le caractère massif de son combat et par sa capacité à braver la menace de la répression est venue se heurter aux pires illusions démocratiques bien classiques -pluralisme, syndicalisme, nationalisme- qui ont fini par épuiser la dynamique de la grève de masse : l'extension et 1'auto-organisation.
La grève de masse en Pologne a illuminé la scène mondiale durant les premiers mois par la force de sa dynamique, sa rapidité. Si cette dynamique montre la vitalité du prolétariat, elle a été aussi rendue possible par la faiblesse locale de la bourgeoisie faiblesse liée aux spécificités des pays de l'Est dont la rigidité de l'appareil politique laisse peu de place à des forces d'opposition destinées à encadrer et à mystifier le prolétariat. La bourgeoisie du bloc russe n'a pu surmonter cette faiblesse congénitale pour faire face à la lutte de classe en Pologne qu'avec l'aide de la bourgeoisie mondiale, tant sur le plan économique que politique, ce qui lui a permis de "faire vivre" avec Solidarnosc l'illusion d'un syndicalisme indépendant.
D'une façon similaire, l'explosion de la lutte de classe en mai 68 en France a aussi été facilitée par la surprise et l'impréparation de la bourgeoisie qui vivait encore dans l'illusion d'un prolétariat passif, tel qu'elle l'avait connu durant 40 ans.
Le prolétariat d'Europe de l'Quest se trouve aujourd'hui dans une situation différente. En effet, 15 ans de crise économique et de lutte de classe ont permis à la bourgeoisie, avertie, de se préparer, de réorganiser, d'adapter son appareil politique pour tenter de faire face au développement prévisible de la lutte de classe. Le prolétariat d'Europe de l'Ouest doit faire face à la fraction la plus expérimentée de la bourgeoisie mondiale, aux mystifications les plus élaborées, à l'appareil d'encadrement le plus sophistiqué dont la carte de la gauche dans l'opposition constitue un des éléments les plus importants.
2. L'obstacle syndical et la généralisation de la conscience
Depuis la reprise de la lutte de classe en 1968, tous les combats significatifs de la classe ouvrière ont été marqués par le débordement, à des degrés divers, de l'appareil syndical.
Les syndicats sont le fer de lance de l'appareil de contrôle de la classe dominante sur le prolétariat. Dans tous les lieux de travail, ils organisent le quadrillage de l'Etat avec pour tâche d'abord d'empêcher la lutte ouvrière de se déclencher, ensuite de la saboter. Ils sont les troupes avancées de la bourgeoisie sur le front de la lutte de classe.
En 1917, la question de la guerre impérialiste a joué un rôle central dans la prise de conscience du prolétariat. Cependant, dans la question de la généralisation de la révolution en Europe occidentale, l'obstacle syndical est revenu au premier plan.
Dans les conditions actuelles, où le chemin vers la guerre n'est pas ouvert, la question syndicale est centrale dans la prise de conscience générale du prolétariat, parce que c'est l'obstacle essentiel auquel il se confronte le plus directement dans sa lutte et à chaque moment de celle-ci.
Aucune lutte ne peut dépasser le cadre national sans développement de la grève de masse, avant tout sans débordement de l'appareil syndical. La question nationale et la question syndicale sont intimement liées. Le prolétariat en Pologne a posé implicitement la question de la généralisation internationale sans pouvoir y répondre, car cette question est liée à la capacité à dépasser les illusions sur le syndicalisme, la gauche et la démocratie. Par sa situation et son expérience spécifique, la classe ouvrière de Pologne, seule, ne pouvait y répondre.
Par contre, le prolétariat d'Europe occidentale, parce qu'il n'est pas dans la même situation d'isolement, parce qu'il a accumulé depuis des décennies toute une expérience de luttes où il s'est confronté aux syndicats, à la gauche, parce qu'aujourd'hui plus que jamais la crise le pousse à lutter, parce que son potentiel de combativité est intact, se trouve aujourd'hui dans des conditions meilleures qu'il n'en a jamais connues pour clarifier aux yeux du prolétariat mondial la véritable nature des syndicats, de la gauche et de la démocratie.
Le prolétariat d'Europe occidentale est le mieux placé pour balayer les obstacles qui se dressent devant lui et l'ensemble du prolétariat mondial, obstacles visant à l'empêcher de mettre en avant dans ses luttes la perspective révolutionnaire.
Ce prolétariat n'est plus dans la situation de mai 68 et n'est pas dans celle de la Pologne 80. La gauche dans l'opposition et le développement du syndicalisme de base ont rendu plus difficile le débordement de l'appareil syndical, débordement sans lequel la dynamique de la grève de masse ne peut s'enclencher. C'est dans la lutte que le prolétariat doit faire le dur apprentissage du fait que la gauche et les syndicats sont ses ennemis. Cette prise de conscience ne peut se faire du jour au lendemain; le chemin vers la généralisation sera marqué par des avancées et des reculs, c'est-à-dire par des moments de déboussolement, manifestation de rupture avec les illusions.
Cependant, le creux de ces deux dernières années n'est pas dû uniquement à l'offensive politique de la bourgeoisie, il est aussi la manifestation inhérente aux difficultés mêmes du processus de prise de conscience du prolétariat. Jusqu'à présent, depuis la reprise de 68, le niveau de conscience contenu dans la combativité du prolétariat était empreint des illusions sur la possibilité de sortir de la crise économique. Ces illusions ne peuvent que tomber. Alors que toute l'activité de la bourgeoisie tend à enfermer, à isoler les luttes derrière le contrôle syndical afin de les mener dans l'impasse, toute l'expérience d'échecs du prolétariat qui n'obtient rien dans ces grèves isolées, le pousse de plus en plus à assumer les aspects politiques contenus dans la base économique de ses luttes. Parce que le problème est général, le prolétariat est poussé à généraliser ses luttes et sa conscience.
De sa capacité à clarifier ces questions dans ses luttes futures où il sera obligé de se confronter aux syndicats -et donc de développer son auto organisation-, dépend sa capacité à développer la grève de masse et à mettre en avant pratiquement la perspective révolutionnaire par la généralisation.
La perspective révolutionnaire n'est pas seulement une question théorique, c'est avant tout une question pratique. Fn mai 68, la question de la révolution a été posée par les ouvriers en grève -bien qu'ils n'aient pu y répondre pratiquement -donnant ainsi une perspective pour toute la période qui s'ouvrait. Dans les années qui ont suivi, la bourgeoisie par sa contre-offensive a tout fait pour masquer la nécessité de la révolution et surtout sa possibilité.
C'est dans la capacité du prolétariat européen à lutter, à montrer concrètement qu'il est possible d'opposer une alternative à la barbarie capitaliste par la généralisation de ses luttes, que va se développer la conscience dans la classe ouvrière mondiale non seulement de la nécessité de la révolution communiste, mais surtout de sa possibilité.
3. L'importance du prolétariat d'Europe de l'Ouest
C'est l'écrasement du prolétariat allemand qui a fait échouer l'extension de la révolution nasse, c'est 1 'embrigadement du prolétariat d'Europe qui a permis la première et la seconde guerre mondiale, c'est le réveil de la lutte de classe en Europe qui marque la fin de la période de contre-révolution, c'est le recul du prolétariat européen face aux mystifications de la gauche au pouvoir qui détermine le reflux des années 70, c'est l'usure de ces mystifications qui permet la reprise de la lutte de classe à la fin des années 70, et c'est la contre-offensive de la bourgeoisie notamment en Europe avec la gauche dans l'opposition qui est à l'origine du recul de 1981-82.
Aujourd'hui plus que jamais, le rôle du prolétariat d'Europe de l'Ouest est crucial, tant sur le plan des conditions objectives dans lesquelles se développe sa lutte (évidence de la nature de la crise comme crise de surproduction rendant possible la révolution), que des conditions subjectives (expérience des mystifications bourgeoises les plus sophistiquées).
Des affrontements de classe de demain, de la capacité du prolétariat d'Europe à tirer les leçons de ses échecs et de ses victoires dépend la perspective révolutionnaire et l'avenir de l'humanité.
Rosa Luxemburg disait : "Le prolétariat est la seule classe qui parvient à la victoire après toute une série de défaites".
La défaite des ouvriers en Pologne est de celles qui annoncent les perspectives futures de la lutte de classe. Manifestation de la force de l'ennemi, cette défaite a conduit à une désorientation du prolétariat mondial. Cependant, les luttes qui l'ont précédée dans ce pays ont été un élément de clarification pour l'ensemble du prolétariat mondial sur la nature des pays de l'Est et des mystifications staliniennes.
A une échelle bien plus grande encore, la lutte du prolétariat en Europe occidentale devra être une clarification pour l'ensemble du prolétariat mondial; elle seule pourra donner un sens, une perspective, une unité à toutes les luttes de la classe ouvrière face à la crise économique, face à la guerre, face à la barbarie du capital sous toutes ses formes.
Parce qu'aujourd'hui, le terrain pour le développement des luttes et de la prise de conscience du prolétariat est celui d'une crise économique inexorable et non celui de la guerre impérialiste, parce que le prolétariat n'a pas subi de défaite historique, jamais les conditions n'ont été aussi bien réunies pour la mise en avant d'une perspective révolutionnaire.
Plus que jamais, l'avenir appartient au prolétariat, et dans cet avenir, le prolétariat du coeur du monde capitaliste, de la vieille Europe, a un rôle essentiel à jouer.
[1] [474] En Allemagne, l'Etat nazi impose son image "populaire" grâce en particulier au développement de l'économie de guerre qui permet de relancer l'embauche.
Conscience et organisation:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Résolution sur la situation internationale 1983
- 2574 reads
1. A l'aube des années 80, nous avons analysé la décennie qui commençait comme "les années de vérité", les années où les convulsions et la faillite ouverte du mode de production capitaliste al laient dévoiler dans toute sa clarté l'alternative historique : révolution communiste ou guerre impérialiste généralisée. A la fin du premier tiers de cette période, on peut constater que cet te analyse s'est pleinement confirmée : jamais, depuis les années 30, l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste ne s'était révélée avec une telle évidence ; jamais, depuis la dernière guerre mondiale, la bourgeoisie n'avait déployé de tels arsenaux militaires, n'avait mobilisé de tels efforts en vue de la production de moyens de destruction ; jamais, depuis les années 20, le prolétariat n'avait mené des combats de l'ampleur de ceux qui ont secoué la Pologne et l'ensemble de la classe régnante en 1980-81. Ce pendant, ce n'est là qu'un début. En particulier, si aujourd'hui les dirigeants bourgeois semblent se consoler en bavardant sur la "reprise économique", ils ont du mal à masquer que le plus fort de la crise est devant nous. De même, le recul mondial des luttes ouvrières qui a suivi les formidables combats de Pologne ne constitue qu'une pause avant les énormes affrontements de classe qui mettront en mouvement les détachements décisif s du prolétariat mondial, celui des grandes métropoles industrielles et notamment d'Europe occidentale. C'est ce que la présente résolution essaie de montrer.
2. La récession qui a marqué le début des années 80 s'est confirmée comme "la plus longue et la plus profonde" de l'après-guerre (comme nous le prévoyions au 3ème congrès du CCI en 1979) Dans les principaux pays avancés, le coeur du capitalisme mondial, cette récession se caractérise par:
- une chute brutale de la production industrielle (-4,5% pour les 7 pays les plus importants de l'OCDE en 1982 après une stagnation en 1981) ;
- une sous-utilisation massive des forces productives, tant du potentiel industriel (près d'un tiers non utilisé au Canada et aux USA en 82) que de la force de travail (32 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE, soit plus de 10% de la population active) ;
- un recul très net des investissements productifs (-14% en 82 aux USA par exemple) ;
- une régression du commerce mondial (-1% en 81, -2% en 82).
Tous ces éléments mettent en évidence que la crise dont souffre le capitalisme trouve ses racines dans la saturation des marchés à l'échelle mondiale, dans la surproduction de marchandises eue égard à la demande solvable.
Cette incapacité d'écouler les marchandises produites se répercute directement sur ce qui constitue l'objet de la production capitaliste : le profit. C'est ainsi que dans la principale puissance mondiale, le montant annuel des profits industriels (avant impôts) a chuté de 90 milliards de dollars (-35%) entre 80 et 82, alors que de nombreux secteurs de base, comme l'acier et l'automobile, travaillent à perte. Ainsi se trouve confirmée une des thèses classiques du marxisme : de tendancielle, la baisse du taux de profit devient effective dès lors que les marchés sont saturés.
3. La crise du capitalisme trouve ses sources dans les métropoles industrielles. Cependant, et pour cette même raison, elle est mondiale, aucun pays n'y échappe. Ceux de la périphérie, en particulier, en subissent la rigueur sous ses formes les plus extrêmes. Alors que la décadence du mode de production capitaliste a placé ces pays dans l'incapacité de connaître un réel développement industriel et de rejoindre les nations les plus avancées, la crise aiguë de ce mode de production les a mis au premier rang de ses victimes. En fait, les économies les plus puissantes ont, dans un premier temps, reporté vers les plus faibles une part importante des effets de la crise.
Aujourd'hui, la crise mondiale provoque dans les pays du tiers-monde une aggravation tragique des maux endémiques dont souffrent ces pays : multitude de sans-travail entassés dans les bidonvilles, développement des famines et des épidémies. Parmi ces pays, ceux pour lesquels on parlait de "miracle", tels le Brésil ou le Mexique, administrent la preuve qu'il n'y a pas d'exception à la règle: leur tentative de se doter d'un appareil industriel moderne dans un monde où même les plus forts subissent maintenant de plein fouet les rigueur de la crise, les a conduit à la banqueroute, à une accumulation astronomique de dettes dont chacun sait qu'ils ne pourront pas s'acquitter et qui les contraint, sous la houlette du FMI, à des politiques d'austérité draconiennes qui vont enfoncer encore plus leurs populations dans la misère totale.
Dans le peloton des pays insolvables, ils sont rejoints par ceux qui se prétendent "socialistes". L'économie arriérée et fragile de ces derniers subit maintenant de plein fouet la crise mondiale par une incapacité permanente et croissante à atteindre des objectifs du plan pourtant de moins en moins ambitieux, ainsi que par le développement de pénuries de plus en plus catastrophiques qui règlent leur compte tant aux mensonges staliniens et trotskystes sur leur nature "socialiste" qu'aux élucubrations échafaudées au sein de courants prolétariens sur leur aptitude à "échapper à la loi de la valeur".
4. Les convulsions récentes de l'économie mondiale, notamment les menaces qui se profilent à intervalles réguliers d'une explosion de l'édifice financier international, ont conduit nombre d'économistes à rapprocher la situation présente de celle de 1929 et des années 30, pour conclure d'ailleurs la plupart du temps que la crise actuelle était moins grave que celle d'il y a 50 ans. Il appartient aux révolutionnaires, aux marxistes, de mettre en évidence tant les points communs que les différences entre ces deux crises afin de situer la gravité réelle de celle que nous vivons et ses perspectives.
Ces deux crises ont pour point commun de constituer la phase aiguë de la crise historique du mode de production capitaliste entré dans sa période de décadence depuis la 1ère guerre mondiale. Elles résultent de l'épuisement du stimulant qu'a constitué la reconstruction à la suite de chacune des deux guerres impérialistes généralisées. Elles sont la manifestation brutale de la saturation mondiale des marchés résultant de l'absorption ou de la destruction par le capitalisme, pratiquement achevée au début de ce siècle, des secteurs extra capitalistes qui avaient constitué son sol nourricier depuis son apparition.
Cependant, si le fond de ces deux crises est le même, elles diffèrent quant à la forme et au rythme du fait des caractéristiques différentes du capitalisme d'aujourd'hui et de celui d'il y a un demi-siècle.
La crise de 1929 touche un capitalisme qui, par bien des aspects, continue de vivre suivant des règles qu'il a héritées de sa période de pleine prospérité du 19ème siècle. En particulier, l'étatisation de l'économie qui avait été menée tambour battant lors de la première guerre mondiale a en bonne partie cédé la place au vieux "laisser-faire". De même, les blocs impérialistes qui s'étaient constitués lors de cette guerre ont relâché sensiblement leur emprise, notamment avec le développement de l'illusion que celle-ci était la "der des der". De ce fait, à peine la reconstruction terminée, la réémergence des contradictions du capitalisme provoque un effondrement brutal de celui-ci. Les banques, les entreprises réagissent en ordre dispersé, ce qui ne fait qu'aggraver l'effet "château de cartes" du krach financier. Et lorsque les Etats interviennent, c'est encore en ordre dispersé qu'ils le font sur la scène internationale sous forme de fermeture quasi totale des frontières et de dévaluations sauvages.
Le capitalisme d'aujourd'hui est bien différent de celui de 1929. Le capitalisme d'Etat qui connaît son grand essor au cours des années 30 sous les formes du stalinisme, du fascisme et en particulier des politiques keynésiennes, n’a cessé depuis d'étendre et de renforcer son emprise sur l'économie et la société. De plus, si les blocs impérialistes se recomposent à la fin de la seconde guerre mondiale, leur existence et leur force ne sont nullement remises en cause. Au contraire: si leur ciment de base est l'alliance militaire autour de chacune des deux nations dominantes, ils étendent de plus en plus leurs prérogatives à la sphère économique (COMECON à l'Est ; FMI, OCDE, etc., à l'Ouest).
Pour ces raisons, ce ne sont pas des entreprises privées qui affrontent individuellement l'aggravation des contradictions économiques qui marque la fin de la reconstruction du 2ème après-guerre au milieu des années 60. Ce sont les Etats. Et ces derniers mènent leur politique non en ordre dispersé mais en accord avec les orientations définies à l'échelle de chacun des blocs. Cela ne veut nullement dire que les rivalités commerciales entre les différentes nations d'un bloc ont disparu. Bien au contraire : la saturation croissante des marchés ne fait que les attiser et les tendances protectionnistes, pour être exploitées dans les campagnes nationalistes, n'en sont pas moins réelles. Cependant, la situation commande à chacun des blocs de ne pas laisser libre cours à ces rivalités et à ces tendances protectionnistes sous peine d'un effondrement immédiat de toute l'économie mondiale.
5. Le développement du capitalisme d'Etat et la prise en charge des politiques économiques au niveau des blocs impérialistes rendent de même très improbable un krach financier comme celui de 29. Si l'enfoncement dans la crise depuis le milieu des années 60 connaît de brusques accélérations (67, 70-71, 74-75, 80-82), le capitalisme a toutefois appris, depuis les années 30 à en ralentir et contrôler le rythme global, à s'épargner les collapsus brutaux. Cela ne veut pas dire cependant que la situation présente du capitalisme soit moins grave que celle qu'il connaissait en 1929. Bien au contraire : elle est en réalité beaucoup plus grave. En effet, les mesures qui avaient permis un certain rétablissement de l'économie mondiale au milieu des années 30 ont été employées déjà massivement depuis la fin de la deuxième guerre et se sont renforcées encore au cours des années 70.
Les dépenses massives d'armements, les politiques keynésiennes de grands travaux, de "soutien à la demande" par les déficits budgétaires et l'endettement des Etats qui étaient momentanément possibles après 1929 alors qu'on sortait d'une période de déflation et que les caisses des Etats n'étaient pas encore vides, sont devenues complètement incapables de procurer un quelconque répit après des décennies d'inflation résultant d'efforts d'armement intensifs et de l'abus des drogues néo-keynésiennes. Ces drogues, auxquelles on doit le montant astronomique des dettes sur lequel repose aujourd'hui l'économie mondiale (les 750 milliards de dettes du tiers-monde ne doivent pas masquer les 5000 milliards de dettes de la seule économie américaine, sans compter celles des autres pays avancés), ne pouvaient aboutir qu'à la mort du malade par un emballement apocalyptique de la spirale inflationniste et l'explosion du système financier international. En particulier, le développement des dépenses militaires qui, dans les années 30, avait momentanément contribué à la reprise, apparaît clairement aujourd'hui corme un facteur aggravant de l'acuité de la crise.
Les politiques "monétaristes" orchestrées par Reagan et suivies par la totalité des dirigeants des pays avancés rendent compte de cette faillite des politiques néo-keynésiennes en laissant émerger la cause profonde de la crise du capitalisme, la surproduction généralisée et ses conséquences inéluctables : la chute de la production, l'élimination du capital excédentaire, la mise au chômage de millions d'ouvriers, la dégradation massive du niveau de vie de l'ensemble du prolétariat.
En ce sens, la prétendue "reprise" dont on a pu faire grand cas il y a quelques mois ne fera pas long feu. La timidité avec laquelle elle se manifeste et le nombre réduit des pays qui en bénéficient (USA et Grande Bretagne) traduisent bien le fait qu'il est aujourd'hui hors de question pour le capitalisme de rééditer l'opération de 76-78 où les prêts massifs aux pays du tiers-monde avaient permis une certaine relance de la production des pays avancés. Un des indices de l'aggravation continue de la crise consiste dans le fait que les mouvements de récession sont de plus en plus longs et profonds alors que les mouvements de reprise sont de plus en plus courts et insignifiants.
6. L'aggravation inexorable de la crise confirme bien que nous sommes entrés dans les "années de vérité", celles où se dévoilera dans toute son évidence la véritable nature des contradictions du mode de production capitaliste. Années de vérité qui s'illustreront non seulement au plan économique mais également et surtout au plan des enjeux historiques essentiels de la société avec l'émergence de l'alternative déjà annoncée par l'Internationale Communiste : Guerre ou Révolution ; ou bien la réponse prolétarienne à la crise : le développement des luttes de classe menant à la révolution, ou bien son aboutissement bourgeois : l'holocauste impérialiste généralisé.
Pour sa part, la bourgeoisie poursuit et poursuivra ses préparatifs militaires tant que sa domination de classe ne sera pas directement menacée. Mais il importe de mettre en évidence ce qui aujourd'hui et dans la période qui vient détermine fondamentalement la politique bourgeoise : ces préparatifs de guerre ou bien les préparatifs à un affrontement décisif avec la classe ouvrière. En ce sens il est important de distinguer,y compris au plan des gesticulations bellicistes des gouvernements, ce qui participe directement de l'aggravation des conflits impérialistes de ce qui relève avant tout d'une politique globale contre le prolétariat .
7. Dans la dernière période, l'aggravation des tensions impérialistes s'est manifestée en premier lieu par une nouvelle avancée du bloc américain dans une des zones essentielles en conflit : celle du Moyen-Orient. L'opération "Paix en Galilée" me née par Israël, la mise au pas de l'OLP et l'expulsion de ses troupes du Liban, l'installation des corps expéditionnaires occidentaux dans ce pays, constituent une nouvelle étape vers la liquidation complète de la présence dans cette partie du monde, de l'URSS. C'est ce qui explique la tentative désespérée de cette puissance d'y conserver un der nier point d'appui par l'armement intensif de la Syrie.
La poursuite de l'instauration de la "pax americana" au Moyen-Orient trouve par ailleurs un complément dans la mise au pas progressive de l'Iran et le renforcement de l'intégration de l'Irak dans le bloc de l'Ouest, dans la mesure même où les livraisons d'armement à ces deux pays pour alimenter la guerre du Golfe les rendent plus dépendants du monde occidental. La liquidation du parti stalinien en Iran (Toudeh) illustre que ces manoeuvres réduisent progressivement les espoirs de l'URSS d'accéder un jour aux "mers chaudes", que l'invasion de l'Afghanistan avait pu lui procurer.
L'autre volet de l'aggravation des tensions impérialistes consiste dans le nouveau pas franchi par l'ensemble des principaux pays et notamment des USA dans le renforcement des armements et particulièrement le déploiement en Europe -théâtre et enjeu essentiels d'une éventuelle 3ème guerre mondiale- des Pershing II et des missiles de croisière. Cette dernière opération confirme bien, s'il en était encore besoin, l'indéfectible fidélité des pays d'Europe occidentale à l'alliance américaine.
8. Autre est la signification qu'il faut attribuer aux bruits de bottes qui se sont fait entendre ces derniers temps aux Malouines et en Amérique centrale. Dans le premier cas, il s'agissait d'une opération interne au bloc occidental destinée avant tout, à travers une campagne idéologique assourdissante, à déboussoler la classe ouvrière des pays avancés (comme on a pu le voir notamment en Grande Bretagne) et accessoirement à servir de test en réel des armements les plus modernes. Dans le deuxième cas, la présence de conseillers cubains et d'armements russes au Nicaragua comme le soutien de ce pays à la guérilla salvadorienne n'impliquent nullement une menace pour les USA de l'apparition d'un nouveau Cuba à leurs frontières. Les campagnes de Reagan sur cette question, auxquelles s'opposent les secteurs "pacifistes" ou "colombes" de la bourgeoisie américaine participent fondamentalement d'une politique concertée de tous les secteurs de la classe dominante en occident en vue de détourner le prolétariat de ses combats et de ses intérêts de classe.
De même, les grandes campagnes pacifistes qui touchent -avec un certain succès- la plupart des pays occidentaux n'ont pas la mené vocation que celles des années 30 qui préparaient directement la 2ème guerre mondiale. Là encore, l'objectif majeur de ces campagnes, qui s'appuient sur une réelle inquiétude suscitée, par les préparatifs guerriers, est de constituer un facteur de déboussolement de la classe ouvrière en vue de limiter et d'éparpiller son inévitable riposte de classe à l'aggravation inexorable de la crise et de ses conditions de vie. Ces campagnes s'intègrent dans le partage des tâches qui s'opère de plus en plus clairement à l'échelle mondiale entre les secteurs "de droite" de la bourgeoisie, chargés d'appliquer au gouvernement des politiques d'austérité de plus en plus dures à l'égard de la classe ouvrière et les secteurs "de gauche" chargés de saboter ses luttes.
9. Ce partage des tâches entre secteurs de la bourgeoisie, la mise en place de la carte de la "gauche dans l'opposition" que le CCI avait signalé dès 1979, s'est encore confirmé ces derniers mois avec l'arrivée des chrétiens-démocrates au gouvernement en' Allemagne et la récente victoire éclatante des Tories en Grande-Bretagne au détriment d'un parti travailliste qui s'était "suicidé" au plan électoral par son "extrémisme" et son "pacifisme" aux dires mêmes des observateurs bourgeois, dans le but de renforcer son contrôle sur la classe ouvrière. Cette perspective de "la gauche dans l'opposition" n'est nullement démentie par l'arrivée des forces de gauche ces derniers temps dans des pays couine la France, la Suède, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Dans l'ensemble de ces cas, il ne s'agit nullement d'une manifestation de force de la bourgeoisie, mais au contraire d'éléments de faiblesse. Dans le cas des trois derniers pays, c'est fondamentalement l'expression des difficultés de la classe dominante à constituer de solides forces de droite au sortir d'une longue période de régime militaire ou fasciste. Dans le cas de la Suède, c'est le résultat de la très longue hégémonie de la social-démocratie qui n'avait pas permis aux forces de droite de s'aguerrir à l'exercice du pouvoir. Quant au cas de la France, c'est une illustration a contrario très probante de la perspective de "la gauche dans l'opposition". Alors que dans les autres pays, la nécessaire arrivée de la gauche au pou voir aura été consciemment assumée par la bourgeoisie, la victoire de Mitterrand en 81 avait constitué un"accident", ce qui se confirme de jour en jour par les difficultés de son gouvernement à mener une politique cohérente et par les préparatifs du PC et de la gauche du PS à un prochain passage dans l'opposition. Si, dans la majorité des pays les plus avancés d'occident (USA, RFA, GB, Belgique, Pays-Bas, Italie) la venue ou le maintien au pouvoir des forces de droite laisse les mains libres à la gauche et aux syndicats pour saboter de l'intérieur les luttes ouvrières, notamment grâce à une radicalisation de leur langage, la présence "forcée" de la gauche au gouvernement en France (c'est-à-dire la 2ème puissance d'Europe occidentale) qui dévoile claire ment la nature bourgeoise des partis soi-disant "ouvriers", constitue un facteur de faiblesse pour la bourgeoisie, non seulement dans ce pays, mais aussi à l'échelle mondiale.
10. La carte de "la gauche dans l'opposition" jouée globalement par la bourgeoisie en Occident ne limite pas son champ d'application à cette seule partie du monde. Elle a été jouée et continue d'être jouée dans le bloc de l'Est, en Pologne, avec l'action anti-ouvrière du syndicat "indépendant" Solidarnosc. Bien que la fragilité et la rigidité congénitales des pays staliniens n'aient pas permis que se mette en place dans ce pays un jeu"démocratique" à l'occidentale ni même de conserver l'existence légale de Solidarnosc plus longtemps que ne l'exigeait strictement le degré de combativité de la classe ouvrière, les mécanismes de base et l'efficacité de "la gauche dans l'opposition" s'y sont révélés tout à fait comparables à ceux d'Occident non seulement avant le 13 décembre 81, mais également après. Si, avant cette date, grâce à son apparente opposition intransigeante aux autorités, "Solidarnosc" a constitué, avec le soutien de la bourgeoisie occidentale et dans le cadre d'une offensive d'ensemble de celle-ci, un instrument essentiel de sabotage des luttes ouvrant la porte à la répression militaire et policière, sa fonction n'a pas disparu avec sa mise hors-la-loi. En fait, les persécutions dont sont victimes les dirigeants de cette organisation facilitent, en lui conférant l'auréole du martyr, la poursuite de son action de déboussolement de la classe ouvrière, tout comme les attaques de Thatcher contre les syndicats en G.B ne font que renforcer leur efficacité anti ouvrière. En fin de compte, "la gauche dans la clandestinité" apparaît comme une des formes extrêmes de "la gauche dans l'opposition".
11. C'est donc à la redoutable efficacité, tant à l'Est qu'à l'Ouest, de la politique de "gauche dans l'opposition" qu'il faut principalement attribuer la défaite du prolétariat mondial en Pologne et son recul général en 81-82 qui a permis cette défaite. Ce recul est indiscutable. Alors que les années 78-79-80 avaient été marquées par une reprise mondiale des luttes ouvrières (grève des mineurs américains, des dockers de Rotterdam, des ouvriers de la sidérurgie en G.B, des ouvriers de la métallurgie en Allemagne et au Brésil, affrontements de Longwy-Denain en France, grèves de masse en Pologne) , les années 81 et 82 se sont distinguées par un net reflux de ces luttes; ce phénomène étant particulièrement évident dans le plus "classique" des pays capitalistes, la Grande-Bretagne, où l'année 81 connaissait le nombre le plus faible de grèves depuis la 2ème guerre mondiale alors qu'en 79 celles-ci avaient atteint leur niveau quantitatif le plus élevé de l'histoire avec 29 millions de jours d'arrêt de travail. Ainsi, l'instauration de l'état de guerre en Pologne et la violente répression qui s'est abattue sur les ouvriers de ce pays n'arrivaient pas comme un éclair dans un ciel bleu. Point le plus marquant de la défaite ouvrière après les formidables combats de l'été 80, le coup de force de décembre 81 participait d'une défaite de tout le prolétariat.
Cette défaite, le prolétariat l'a subie dès lors que le capitalisme, d'une façon concertée et grâce notamment à ses forces de gauche, est parvenu à isoler les ouvriers de Pologne du reste de leur classe, à les enfermer idéologiquement dans le cadre de ses frontières de bloc (pays "socialistes" de l'Est) et nationales ("la Pologne est l’affaire des polonais") ; dès lors qu'il est parvenu à faire des ouvriers des autres pays des spectateurs, inquiets certes, mais passifs, à les détourner de la seule forme que peut prendre la solidarité de classe : la généralisation de leurs luttes dans tous les pays, en mettant en avant une caricature de solidarité : les manifestations sentimentales, les pétitions humanistes et la charité chrétienne avec ses envois de colis pour Noël. Dans la mesure où elle n'apporte pas de réponse adéquate aux exigences de la période, la non généralisation des luttes est en soi une défaite.
12. Ainsi, comme nous le signalions déjà en 81, un des enseignements essentiels des affrontements de classe en Pologne est la nécessité pour le prolétariat, face à la sainte alliance de la bourgeoisie de tous les pays et en vue de son assaut révolutionnaire contre le capitalisme, de généraliser ses luttes à l'échelle mondiale.
L'autre enseignement majeur de ces combats et de leur défaite est que cette généralisation mondiale des luttes ne pourra partir que des pays qui constituent le coeur économique du capitalisme : les pays avancés d'occident et, parmi eux, ceux où la classe ouvrière a acquis l'expérience la plus ancienne et la plus complète : l'Europe occidentale. La bourgeoisie mondiale a pu établir un "cordon sanitaire" autour du prolétariat de Pologne parce que ce pays appartient à un bloc arriéré, où pèse avec le plus de dureté la contre-révolution, où le prolétariat n'a pas été confronté directement pendant des décennies aux mystifications démocratiques et syndicales. Ces conditions expliquent que, d'emblée, le prolétariat y ait employé son arme fondamentale de la grève de masse. Elles expliquent également qu'il ait pu, par la suite, être enfermé dans les impasses syndicalistes, démocratiques et nationalistes. Dans les pays avancés d'occident, et notamment en Europe de l'Ouest, le prolétariat ne pourra déployer pleinement la grève de masse qu'à l'issue de toute une série de combats/ d'explosions violentes, d'avancées et de reculs, au cours desquels il démasquera progressivement tous les mensonges de la gauche dans l'opposition, du syndicalisme et du syndicalisme de base. Mais alors, sa lutte pourra réellement montrer le chemin aux ouvriers de tous les pays, frapper les trois coups de la généralisation mondiale des combats de classe ouvrant la voie à l'affrontement révolutionnaire contre la domination bourgeoise.
Si l'acte décisif de la révolution se jouera lorsque la classe ouvrière aura terrassé les deux monstres militaires de l'Est et de l'Ouest, son premier acte se jouera nécessairement au coeur historique du capitalisme et du prolétariat : l'Europe occidentale.
13. Un autre enseignement des événements de Pologne est que la classe ouvrière restera à la merci des défaites, de défaites souvent tragiques tant qu'elle n'aura pas abattu le capitalisme. Si, comme l'écrit Rosa Luxemburg : "la révolution est la seule forme de 'guerre'... où la victoire finale ne peut être préparée que par une série de défaites V le prolétariat -et notamment ses organisations révolutionnaires- doit se garder qu'une série de défaites partielles n'aboutisse à une défaite complète, à la contre-révolution. Certains éléments communistes ont affirmé que c'était déjà le cas avec la défaite du prolétariat en Pologne et au vu de la stagnation présente de ses luttes au niveau mondial. Pour notre part, nous affirmons le contraire. Depuis le ressurgissement prolétarien de 1968, nous avons dit que le cours historique n'était pas à la guerre impérialiste généralisée mais à l'affrontement de classes. Cela ne veut pas dire que ce cours ne puisse être renversé.
L'existence d'un cours vers la guerre, comme dans les années 30, signifie que le prolétariat a subi une défaite décisive qui l'empêche désormais de s'opposer à l'aboutissement bourgeois de la crise.
L'existence d'un cours à"l'affrontement de classes" signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale; auparavant, elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de l'issue de cet affrontement, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de "cours à la révolution".
Quelle que soit la gravité de la défaite enregistrée ces dernières années par la classe ouvrière, elle ne remet pas en cause le cours historique dans la mesure où :
- ce ne sont pas les bataillons décisifs du prolétariat mondial qui se sont trouvés en première ligne de l'affrontement,
- la crise qui maintenant atteint de plein fouet les métropoles du capitalisme obligera le prolétariat de ces métropoles à exprimer ses réserves de combativité qui n'ont pas été jusqu'à présent entamées de façon décisive.
Ainsi, en provoquant une dégradation de plus en plus brutale, simultanée et universelle des conditions de vie du prolétariat, en particulier par l'intensification massive du chômage dans les grands centres industriels, la crise se révèle la meilleure alliée du prolétariat mondial. Elle développe de façon jamais égalée dans l'histoire les conditions objectives et subjectives de l'internationalisation des luttes, d'une prise de conscience révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui il n'existe aucune perspective de rétablissement, même momentané, de l'économie capitaliste (contrairement aux années 30 où la reprise avait permis à la bourgeoisie de parachever la défaite d'un prolétariat déjà battu) la perspective historique reste aux affrontements de classe.
Les plus grands combats de la classe ouvrière sont encore à venir.
2/7/83
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Conscience et organisation:
Sur le parti et ses rapports avec la classe
- 3360 reads
1. C'est dans le cadre de nos textes de base sur la fraction de l'organisation des révolutionnaires, et dans la suite de cette vision, que doit être abordée la question du Parti Communiste et de ses rapports avec la classe[1].
2. Le Parti Communiste est une partie de la classe, un organisme que, dans son mouvement, elle sécrète et se donne pour le développement de sa lutte historique jusqu'à sa victoire, c'est-à-dire la transformation radicale de l'organisation et des rapports sociaux pour fonder une société qui réalise l'unité de la communauté humaine : chacun pour tous et tous pour chacun.
3. En opposition à la thèse défendue par Lénine dans Que faire ? du Parti "au service de la classe" et contrairement à la caricature stupide du "léninisme" dont les différentes tendances du bordiguisme se sont faites les championnes, suivant laquelle c'est "le Parti qui fonde la classe", nous affirmons avec Rosa Luxembourg que "le Parti est un produit de la classe elle-même" au sens où la constitution du Parti traduit et exprime un processus de prise de conscience qui s'opère dans la classe en lutte ainsi que le degré de conscience auquel la classe est parvenue. Cette formulation n'a rien de commun avec cette autre conception provenant du bordiguisme renversé, qui, durant les années 70 trouvait son expression la plus achevée dans la revue Invariance, conception selon laquelle "le Parti c'est la classe". Une telle conception simpliste remplace le Tout, l'Unité du Tout et son mouvement réel par une stricte identification des éléments, ignorant les différenciations qui existent et se produisent, et le lien dialectique entre ces éléments au sein même de l'unité dont ils sont partie intégrante.
4. Cette conception identificatrice ne peut comprendre le rôle que jouent les différents éléments à l'intérieur de l'unité dont ils sont issus. Elle ne voit pas le mouvement. Elle est statique et non dynamique. Elle est fondamentalement a historique. Cette conception rejoint la vision idéaliste, moralisante des modernistes -ces épigones modernes du conseillisme dégénérescent- qui opèrent avec la vieille dichotomie du blanc et du noir, du bien et du mal et pour lesquels toute organisation politique au sein de la classe est le mal absolu par définition.
5. Le défaut principal du conseillisme de la Gauche hollandaise, sous l'influence de Pannekoek, est de n'attribuer aux courants et groupes qui surgissent dans la classe qu'une fonction éducatrice et pédagogique. I1 escamote leur rôle politique, c'est-à-dire de constituer une partie prenante et militante au sein de la classe, élaborant et défendant en son sein des positions communistes cohérentes cristallisées dans un programme, le programme communiste, en vue duquel ces groupes agissent de façon organisée. En ne leur attribuant uniquement qu'une fonction d'éducation et non de défense d'un programme communiste, Pannekoek fait de son organisation conseilliste, le Conseiller de la classe, rejoignant ainsi la vision de Lénine d'une organisation au service de la classe, Les deux conceptions se retrouvent ainsi dans la négation de l'idée que le Parti fait partie de la classe, est un des organismes actifs de la classe.
6. La société politique est le monde social uni de l'humanité qui s'est perdu en se divisant en classes, et auquel l'humanité en la personne du prolétariat et au travers de la lutte de celui-ci tend péniblement à parvenir. Dans ce sens, la lutte du prolétariat prend encore nécessairement un caractère politique (dans la mesure où il s'agit encore de la lutte d'une classe).
En effet, la lutte du prolétariat est fondamentalement sociale dans le plein sens du terme. Elle porte, dans son triomphe, la dissolution de toutes les classes et de la classe ouvrière elle-même dans la communauté humaine reconstituée à 'échelle de la planète. Cependant, cette solution sociale passe nécessairement par la lutte politique -c'est-à-dire en vue de l'établissement de son pouvoir sur la société- pour laquelle la classe ouvrière se donne les instruments que sont ses organisations révolutionnaires, les partis politiques.
7. La formation de forces politiques exprimant et défendant des intérêts de classe n'est pas propre au prolétariat. Elle est le fait de toutes les classes de l'histoire. Le degré de développement, de définition et de structuration de ces forces est à l'image des classes desquelles elles émanent. Elles trouvent leur forme la plus achevée dans la société capitaliste - la dernière société de classes de l'histoire - là où les classes sociales connaissent leur développement le plus complet, où les antagonismes qui les opposent se manifestent avec le plus de netteté.
Cependant, s'il existe des points communs incontestables entre les partis du prolétariat et ceux des autres classes - et notamment de la bourgeoisie - les différences qui les opposent sont également considérables.
Comme pour les autres classes historiques du passé, l'objectif de la bourgeoisie, en établissant son pouvoir sur la société, n'était pas d'abolir l'exploitation mais de la perpétuer sous d'autres formes, n'était pas de supprimer la division de la société en classes, mais d'instaurer une nouvelle société de classes, n'était pas de détruire l'Etat mais au contraire de le perfectionner. Le type d'organismes politiques dont se dote la bourgeoisie, leur mode d'action et d'intervention dans la société, sont directement déterminés par ces objectifs : les partis bourgeois sont des partis étatiques qui ont pour rôle spécifique la prise et l'exercice du pouvoir d'Etat comme émanation et garant de la perpétuation de la division de la société en classes.
Par contre, le prolétariat est la dernière classe de l'histoire, celle dont la prise du pouvoir politique a pour objectif l'abolition de la division de la société en classes et l'élimination de l'Etat, expression de cette division. En ce sens, les partis du prolétariat ne sont pas des partis étatiques. Ils n'ont pas pour vocation la prise et l'exercice du pouvoir d'Etat, leur but ultime tant au contraire la disparition de l'Etat et des classes.
8. I1 faut mettre en garde contre les interprétations abusives de la phrase malencontreuse du Manifeste Communiste (qui ne se comprend que dans le contexte politique d'avant 1848) où il est dit que « les communistes ne forment pas un parti distinct…»
Prise à la lettre, cette phrase est en contradiction évidente avec le fait qu'il s'agissait du manifeste d'une organisation qui s'intitulait précisément La Ligue des Communistes et à laquelle i1 servait de programme. C'est d'autant plus surprenant venant de deux hommes qui ont rédigé ce manifeste, Marx et Engels, qui ont été, leur vie durant, tant des militants du mouvement général de la classe que des hommes de partis et d'actions politiques.
Le lien entre la vie de la classe et celle de ses organisations politiques
9. Parties du mouvement général de la classe ouvrière qui leur donne jour, ces organismes politiques que sont les partis évoluent avec le développement de la lutte de classe. Comme tout organisme vivant, ces partis politiques du prolétariat ont une histoire qui est indissolublement liée à l'histoire du mouvement général de la classe avec ses hauts moments de lutte et avec ses reculs momentanés.
On ne peut étudier et comprendre l'histoire de cet organisme, le Parti, qu'en le situant dans le contexte général des différentes étapes que parcourt le mouvement de la classe, des problèmes qui se posent à elle, de l'effort de sa prise de conscience, de sa capacité à un moment donné de répondre de façon adéquate à ses problèmes, de tirer les leçons de son expérience et d'en faire un nouveau tremplin pour ses luttes à venir.
S'ils sont un facteur de premier ordre du développement de la classe, les partis politiques sont donc, en même temps, une expression de l'état réel de celle-ci à un moment donné de son histoire.
10. Tout au long de son mouvement, la classe a été soumise au poids de l'idéologie bourgeoise qui tend à déformer, à corrompre les partis prolétariens, à dénaturer leur véritable fonction. A cette tendance, se sont opposées les fractions révolutionnaires qui se sont donné pour tâche d'élaborer, de clarifier, de préciser les positions communistes. C'est notamment le cas de la Gauche Communiste issue de la 3ème Internationale : la compréhension de la question du Parti passe nécessairement par l'assimilation de l'expérience et des apports de l'ensemble de cette Gauche Communiste Internationale.
Il revient cependant à la Fraction italienne de la Gauche Communiste le mérite spécifique d'avoir mis en évidence la différence qualitative existant dans le processus d'organisation des révolutionnaires selon les périodes : celle de développement de la lutte de classe et celle de ses défaites et de ses reculs. La FIGC a dégagé avec clarté, pour chacune des deux périodes, la forme prise par l'organisation des révolutionnaires et les tâches correspondantes : dans le premier cas la forme du parti, pouvant exercer une influence directe et immédiate dans la lutte de classe; dans le second cas, celle d'une organisation numériquement réduite, dont l'influence est bien plus faible et peu opérante dans la vie immédiate de la classe. A ce type d'organisation, elle a donné le nom distinctif de Fraction qui, entre deux périodes de développement de la lutte de classe, c'est-à-dire deux moments de l'existence du Parti, constitue un lien et une charnière, un pont organique entre l'ancien et le futur Parti.
La Fraction italienne a combattu les incompréhensions d'un Trotski qui croyait pouvoir créer un Parti et une Internationale dans n'importe quelle situation -par exemple dans les années 30- et qui n'a réalisé que des scissions et un éparpillement encore plus grand des éléments révolutionnaires. Elle s'est refusée aux astuces théoriques d'un Bordiga[2] jonglant avec les mots et se contorsionnant, en guise de théorie, dans des abstractions vides de sens et des sophismes tels que "l'invariance du programme" et la distinction entre "Parti formel" et "Parti historique". Contre ces différentes aberrations, la Fraction italienne de la Gauche Communiste a démontré la validité de sa thèse en s'appuyant sur la terre ferme de l'expérience d'un siècle d'histoire du mouvement ouvrier et de ses organisations.
11. L'histoire réelle et non fantaisiste nous montre que l'existence du parti de la classe parcourt un mouvement cyclique de surgissement, de développement et de dépérissement, dépérissement qui se manifeste par sa dégénérescence interne, par son passage dans le camp de l'ennemi ou encore par sa disparition pure et simple et qui laisse des intervalles plus ou moins longs jusqu'à ce que, de nouveau, se présentent les conditions nécessaires pour son resurgissement. Cela est vrai aussi bien pour la période pré-marxiste -à commencer par le babouvisme et le surgissement successif d'organisations révolutionnaires- que durant la vie et l'activité de Marx et Engels, ainsi qu'après leur mort, jusqu'à nos jours. La Ligue des Communistes n'a vécu que 5 ans (1847-1852), la Première Internationale 9 ans (1864-73), la 2ème Internationale 25 ans (18891914), la 3ème Internationale 8 ans (en comptant large, 1919-1927). S'il existe un lien évident de continuité (leur continuité provient du fait qu'elles étaient toutes des organismes de la même classe, des moments successifs de cette unité qu'est la classe qui, tel le système solaire à l'égard des planètes, paraît présenter un Tout stable à l'intérieur duquel se meuvent les divers organismes), il n'existe par contre aucune stabilité, aucune fixité de cet organisme appelé Parti.
La pseudo-théorie bordiguiste sur le "Parti historique" et 1e "Parti formel" est entachée de mysticisme. D'après cette théorie, le Parti "historique" -tout comme le Programme- serait une donnée fixe, immuable, invariante. Mais ce Parti ne saurait manifester sa réalité que dans le Parti "formel". Mais qu'advient-il du Parti "historique quand le formel vient à disparaître ? Il devient invisible et inopérant, mais subsiste cependant, quelque part on ne sait où, parce qu'immortel. Nous retrouvons ici les thèmes et interrogations de la philosophie idéaliste et religieuse séparant l'esprit et la matière, l'âme et le corps, l'un dans la béatitude éternelle et l'autre dans la mortalité.
12. Aucune théorie illuministe, volontariste, de la génération spontanée ou de l'intelligence géniale, ne saurait rendre compte du phénomène du surgissement et de l'existence du Parti, et encore moins des raisons de sa périodicité, de l'ordre de succession de ses différents moments. Seule une démarche qui tient compte du mouvement réel de la lutte de la classe, lui-même conditionné et déterminé par l'évolution du système capitaliste et de ses contradictions peut donner une réponse valable au problème du Parti, en l'insérant dans la réalité du mouvement de la classe.
13. La même démarche doit être appliquée quand on examine la variabilité, constatée dans l'histoire, de certaines fonctions du Parti.
Tout comme la philosophie, dans l'antiquité, englobait des disciplines diverses, le Parti, produit du mouvement de la lutte de classe du prolétariat, assure, à ses débuts dans l'histoire, l'accomplissement d'un grand nombre de tâches dans la classe, en particulier :
- il est le creuset de l'élaboration théorique de la classe;
- il explicite les buts finaux potentiellement contenus dans les luttes de celle-ci;
- il est un organe actif, militant dans la classe, prenant place au premier rang pour la défense de ses intérêts immédiats -économiques et politiques;
- il est éducateur, multipliant et diversifiant ses interventions dans la classe et assurant cette éducation à tous les niveaux, par la presse et par des conférences, par l'organisation de cours du soir, par la création d'universités ouvrières, etc.;
- il assure la propagande, la diffusion des idées révolutionnaires dans la classe;
- il combat avec acharnement et sans relâche les idées, les préjugés de l'idéologie bourgeoise pénétrant sans cesse dans la pensée des ouvriers et entravant leur prise de conscience;
- il se fait agitateur, organisant et multipliant les manifestations ouvrières, meetings, réunions et autres actions de la classe;
- il se fait organisateur, créant, multipliant et soutenant toutes sortes d'associations ouvrières, culturelles et de défense des conditions matérielles immédiates (mutuelles, coopératives de production, caisses de grève, de solidarité financière) et surtout la formation d'organisations unitaires et permanentes de défense des intérêts économiques immédiats de la condition ouvrière : les syndicats;
- il assure, notamment par la présence de représentants ouvriers dans les parlements, 1a lutte pour des réformes politiques dans l'intérêt immédiat des ouvriers.
Quatre grandes étapes dans la vie du prolétariat: 1848, 1870, 1914, 1917
14. L'histoire des dernières 140 années, a connu quatre grands bouleversements dans le capitalisme :
- 1848 : achèvement du cycle des révolutions antiféodales de la bourgeoisie;
- 1870 : achèvement, avec la guerre franco prussienne, de la constitution de grands ensembles, des grandes unités économico politiques du capitalisme, des nations, et ouverture d'une longue époque d'expansion capitaliste à travers le monde -le colonialisme.
- 1914 : point culminant de la phase impérialiste. L'exacerbation des contradictions du système et son entrée dans la phase de déclin avec la première guerre mondiale;
- 1917 : craquement du système posant la nécessité de la transformation sociale imminente.
15. Comment réagit le prolétariat à ces 4 événements capitaux ?
- 1848 : Derrière la bourgeoisie apparaît l'ombre géante du jeune prolétariat (journées de juin, soulèvement des ouvriers de Paris), évènement annoncé quelques mois auparavant par la constitution de la Ligue des Communistes. Premier véritable Parti du prolétariat moderne, cette organisation, rompant avec le romantisme des sociétés conspiratives, annonce et démontre dans un Programme cohérent, critique du capitalisme ("Le Manifeste") , l'inévitable écroulement de ce système sous le poids de ses insurmontables contradictions internes. Elle désigne le prolétariat comme sujet de la solution historique, sujet qui, par sa révolution, devra mettre fin à la longue histoire de la division de la société humaine en classes antagoniques et de l'exploitation de l'homme par l'homme. S'opposant à toute phraséologie révolutionnaire et au volontarisme, la Ligue reconnaît, en 1852, la victoire du capitalisme sur les premiers soulèvements du prolétariat dans une situation d'immaturité historique des conditions rendant possible le triomphe de la Révolution Socialiste. Et c'est dans cette situation nouvelle de défaite que la Ligue est appelée inévitablement à disparaître comme organisation politique agissante et centralisée.
- 1870 : Les militants de la Ligue n'ont pas disparu dans la nature. Dans l'attente de la maturation des conditions d'une nouvelle vague de luttes ouvrières, ils ont poursuivi un travail d'élaboration théorique, d'assimilation des expériences au sein de la classe, suite à la grande convulsion sociale de 1848. Pour sa part, la bourgeoisie, remise de cette convulsion, a poursuivi à grands pas son développement et son expansion. Quelques 15 ans après, nous nous trouvons en présence d'un prolétariat plus nombreux, élargi à d'autres pays, plus mûr et décidé à engager de grandes batailles non pas encore, certes, pour une révolution (du fait de l'immaturité des conditions objectives pour un tel objectif immédiat) mais pour la défense de ses conditions économiques d'existence immédiate. C'est dans ce contexte, qu'en 1864, est fondée, à l'initiative des ouvriers de France et d'Angleterre, la 1ère Internationale groupant par dizaines de milliers les ouvriers de tous les pays industrialisés ou en voie d'industrialisation, de l'Amérique à la Russie. Les anciens militants de la Ligue des Communistes se retrouveront tout naturellement dans les rangs de cette Association Internationale des Travailleurs (A.I.T) où ils occuperont les postes de plus haute responsabilité avec Marx à la tête.
D'année en année, dans tous les coins du monde, l'Internationale deviendra le drapeau d'ouvriers de plus en plus nombreux, de plus en plus combatifs, au point de devenir une préoccupation majeure pour tous les gouvernements d'Europe. C'est dans cette organisation générale de la classe que s'affronteront le courant marxiste, authentique expression du prolétariat, et le courant anarchiste de Bakounine, représentant de l'idéologie petite-bourgeoise ayant encore une grande influence parmi les prolétaires de la première génération et parmi les artisans semi-prolétarisés.
La guerre franco-prussienne, la défaite misérable du second Empire et sa chute en France, la félonie de la bourgeoisie républicaine, la misère et la faim des ouvriers de Paris cernés par l'armée de Bismarck, la provocation du Gouvernement... Tout poussait les ouvriers parisiens à un affrontement armé prématuré pour en finir avec le gouvernement bourgeois et proclamer la Commune. L'écrasement de la Commune était inévitable. Et, en même temps qu'elle témoignait de la combativité et de la volonté exaspérées de la classe ouvrière montant à l'assaut contre le capital et son Etat, laissant aux générations à venir de la classe ouvrière mondiale des enseignements inestimables, sa défaite, dans un immense bain de sang, avait pour conséquence immédiate d'entraîner également et irrémédiablement la disparition de l'Internationale.
- 1914 : Le triomphe sanglant du capital, le massacre de la Commune et la disparition de l'Internationale qui l'a suivi, devaient peser pendant de longues années et marquer toute une génération du prolétariat. Les blessures une fois cicatrisées, c'est peu à peu que le prolétariat reprend confiance en lui et en sa capacité d'affronter le capital. Lentement se reconstituent les organisations de la classe : Bourses de travail, syndicats, partis politiques, qui vont tendre à se centraliser, à l'échelle nationale d'abord, et enfin à l'échelle internationale donnant naissance en 1889 (18 ans après la Commune) à la constitution de la 2ème Internationale, organisation strictement politique.
Mais le monde capitaliste est alors à l'apogée de son développement au niveau international, il tire un maximum de profit du fait de l’existence d'un marché qui semble illimité. C'est l'âge d'or du colonialisme, du développement des moyens de production et de la plus-value relative, se substituant à la plus-value absolue. La lutte du prolétariat pour la diminution de la journée de travail, pour l'augmentation des salaires, pour des réformes politiques est largement payante. Cette situation semble pouvoir se poursuivre sans fin, aboutissant à l'illusion que, par des réformes successives, le monde capitaliste pourrait se transformer graduellement en une société socialiste. Cette illusion, c'est le réformisme, cette maladie qui va pénétrer profondément dans la tête des ouvriers et dans leurs organisations tant politiques qu'économiques (surtout économiques), va ronger la conscience de la classe et lui faire perdre de vue son but et sa démarche révolutionnaires.
Le triomphe du réformisme constituera finalement la défaite du prolétariat. C'est le triomphe de la bourgeoisie parvenant à le rattacher à ses valeurs, avant tout nationalistes, patriotiques, à corrompre définitivement ses organisations, partis et syndicats, passés sans retour possible dans le camp du capital.
- 1917 : Endormi, chloroformé, trahi par le passage de ses organisations dans le camp bourgeois saoulé du nationalisme et du patriotisme dont la bourgeoisie l'abreuve à dose renforcée, le prolétariat, mobilisé dans la guerre, se réveillera dans le fracas assourdissant des obus, au milieu de millions de cadavres des siens, plongé dans un océan de sang, de son sang. Il ne lui a fallu pas moins de ce cataclysme de 3 années de guerre impérialiste mondiale pour se dégriser et pour commencer à reprendre conscience de la réalité.
1917 était la première explosion d'une vague révolutionnaire qui va durer des années. C'est au cours de cette explosion que le prolétariat sera amené à reconstruire de nouvelles organisations de classe correspondant à ses tâches nouvelles, non plus sous la forme de syndicats devenus à jamais impropres à la période nouvelle de décadence du capitalisme, mais sous la forme de Conseils Ouvriers; non plus ressusciter la Social-démocratie à jamais perdue et passée dans le camp ennemi, mais un Parti Communiste mondial (la 3ème Internationale) à la hauteur de la tâche qui s'imposait : contribuer à la marche vers la révolution mondiale du prolétariat. C'est avec les Fractions et les minorités de gauche issues de la 2ème Internationale qui ont combattu durant de longues années l'idéologie réformiste, qui ont dénoncé la trahison de la vieille Social-démocratie, qui ont lutté contre la guerre et contre l'idéologie de la défense nationale, en un mot qui sont restées fidèles au marxisme et à la révolution prolétarienne, que se constitue le nouveau Parti , la nouvelle internationale, l'Internationale communiste.
L'épreuve de la contre-révolution
16. Du fait qu'elle a surgi au cours de la guerre -qui ne constitue pas 1a condition la plus favorable à la révolution- cette grandiose première vague de la révolution prolétarienne a échoué. Cet échec était dû également à l'immaturité de la conscience du prolétariat qui s'est manifestée, entre autres, par la survivance, au sein de la nouvelle internationale, de bien des positions erronées héritées de la vieille Social-démocratie :
- les fausses réponses concernant le rôle du Parti dans la révolution et le rapport Parti-classe - l'assimilation de la dictature du prolétariat à la dictature du Parti;
- la confusion, particulièrement dangereuse, sur la question de l'Etat dans la période de transition proclamé "Etat prolétarien" ou "Etat socialiste".
Ces différentes erreurs, la survivance de l'Etat soviétique proclamé "Etat ouvrier", l'insuffisance des analyses de "l'Opposition de Gauche" sur sa dégénérescence (prétendue préservation de son caractère "prolétarien" et des "acquis d'octobre"), tous ces facteurs, se combinant entre eux et aux défaites successives du prolétariat dans les autres pays (pour lesquelles ils portent une part de responsabilité) ont contribué au rétablissement d'un rapport de forces en faveur de la bourgeoisie mondiale, ont été responsables d'un écrasement historique de la classe. Cet ensemble d'éléments entraînera également la déchéance, la dégénérescence et finalement le passage à la bourgeoisie du Parti bolchevik, de l'ensemble des partis de l'Internationale Communiste et la mort de celle-ci.
La profondeur de la défaite subie par le prolétariat sera en proportion directe de la hauteur de la vague révolutionnaire qui a précédé cette défaite. Ni la grande crise mondiale qui éclate en 29, ni la 2ème guerre mondiale, ni la période de reconstruction de l'après-guerre ne connaîtront de luttes d'ampleur significative du prolétariat. Même dans les rares pays où la combativité ouvrière persistait encore pour n'avoir pas été directement mise à l'épreuve, cette combativité sera facilement détournée de son terrain de classe par les forces politiques de la Gauche en vue de la guerre mondiale. Ce fut le cas notamment lors de la grève générale de 1936 en France et, la même année, du soulèvement du prolétariat espagnol rapidement dévoyé dans une guerre "civile" entre fascisme et antifascisme, servant de préparation et de répétition générale pour la seconde guerre mondiale. Dans d'autres pays, comme la Russie, la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, les pays des Balkans, l'Espagne et le Portugal, le prolétariat est soumis à la plus noire répression : par millions, il est jeté dans les prisons et autres camps de concentration. Toute condition pour le surgissement d'un Parti de classe est absente. Seuls, le volontarisme et l'incompréhension totale de la réalité d'un Trotski, qui va jusqu'à saluer, en 36, le commencement de la Révolution en France et en Espagne, qui confond le capitalisme d'Etat en Russie avec la "survivance des conquêtes d'Octobre", lui permettent de se lancer, avec ses partisans, dans l'aventure de la proclamation de nouveaux partis et d'une Internationale prétendument révolutionnaires, après que son courant ait fait un retour et un séjour dans les partis socialistes de la défunte 2ème Internationale de triste mémoire.
Loin d'être une période de mouvement centripète, de convergence des forces révolutionnaires allant vers l'unification et vers la formation du Parti de la classe, ce qui caractérise cette période, c'est un mouvement catégoriquement centrifuge, d'éparpillement et de dispersion des groupes et des éléments révolutionnaires : la gauche anglaise depuis longtemps disparue, la gauche russe inexorablement exterminée physiquement dans les geôles de Staline, la gauche allemande complètement liquidée. Les groupes révolutionnaires qui subsistent s'isolent et se replient sur eux-mêmes, s'amenuisent au fil des mois et des années.
La guerre de 36 en Espagne fera une sélection sévère parmi ces groupes, entre ceux qui se sont pris dans les filets de l'antifascisme et ceux qui se maintiennent fermement sur le terrain de classe : les Fractions de la Gauche Communiste Internationale qui poursuivent et développent un travail de compréhension théorique en soumettant, sans aucun ostracisme, les positions politiques passées de l'internationale Communiste à son apogée , à la critique la plus sévère, la plus féconde, fondée sur l'expérience réelle du mouvement depuis 1917. La Gauche Communiste Internationale subira elle-même les contrecoups des évènements. Une première fois, par la scission d'une minorité en 36, optant pour la participation à la guerre d'Espagne du côté républicain antifasciste, une deuxième fois par le départ, au début de la guerre d'une minorité proclamant la "disparition sociale du prolétariat" en temps de guerre et, par suite, l'impossibilité de poursuivre toute activité et de maintenir l'organisation des Fractions. La troisième crise -qui sera définitive- surgit fin 1945 avec la scission de la Fraction française de la Gauche Communiste (la GCF) s'opposant à la décision de dissolution de la Gauche Communiste Internationale et l'engloutissement pur et simple de ses membres, à titre individuel, dans un parti proclamé en Italie dont on ignorait tout de la plateforme et des positions, sachant seulement qu'il s'était constitué autour de 0. Damen et Bordiga, deux éminentes figures de la Gauche Italienne des années 20. Ainsi finit tristement la Fraction Italienne de la Gauche Communiste.
Les principaux enseignements d'un siècle d'histoire sur la nature et la fonction du Parti
17. Ce rapide survol de l'histoire du mouvement ouvrier nous enseigne :
a) La nécessaire existence d'un lien étroit entre la classe comme un tout et le Parti comme organisme particulier de ce tout. I1 y a des périodes où la classe existe sans le Parti mais il ne peut jamais exister de Parti sans la classe.
b) La classe secrète le Parti comme un organisme indispensable, chargé de fonctions dont la classe a besoin dans et pour sa maturation et sa prise de conscience lui permettant ainsi de se rendre apte à atteindre la victoire finale. Il est impossible de supposer le triomphe final du prolétariat sans qu'il ait développé les organes qui lui sont indispensables : notamment l'organisation générale unitaire de la classe groupant en son sein tous les ouvriers, et l'organisation politique -le Parti- qui se constitue sur un programme général et composé de positions cohérentes montrant le but ultime de 1a lutte du prolétariat, le communisme, et les moyens pour l'atteindre.
c) Une différence substantielle existe, dans leur évolution, entre les organisations générales ouvertes à tous les ouvriers et l'organisation politique qu'est le Parti.
Dans la période ascendante du capitalisme, l'organisation générale qui se donne pour tâche la défense des intérêts économiques immédiats de la classe, a tout en subissant des modifications importantes de structure, une existence permanente; cela n'est pas le cas pour l'organisation politique, le Parti, qui n'existe que de façon intermittente, dans les périodes de développement de la lutte et de combativité de la classe. Cette constatation souligne fortement l'étroite dépendance de l'existence du Parti avec l'état de 1a lutte de classe. Dans le cas d'une période de montée de la lutte, les conditions sont données pour le surgissement et l'activité du Parti; dans les périodes de reflux, avec la disparition de ces conditions, le Parti tend à disparaître. Dans le premier cas, c'est la tendance centripète qui l'emporte, dans le second cas, c'est la tendance centrifuge qui s'impose.
d) Sur ce point, il faut noter qu'il en est sensiblement différent dans 1a période décadence du capitalisme. Dans cette période où ne sont même plus possibles le maintien et l'amélioration réels et durables des conditions de vie de la classe ouvrière, il ne saurait exister une organisation permanente dont ce but serait la raison d'être. C'est pour cela que le syndicalisme est vidé de tout contenu ouvrier. Les syndicats ne peuvent garder leur existence et leur permanence que comme appendices de l'Etat, chargés d'encadrer, contrôler et dévoyer toute action et lutte de la classe. Dans cette période, seules les grèves sauvages tendant vers la grève de masse, contrôlées et dirigées par les assemblées générales, présentent la forme possible d'un contenu de classe. De ce fait, ces assemblées ne peuvent exister de façon permanente à leur début. Une organisation générale de la classe ne peut exister et devenir permanente que lorsque la défense des intérêts immédiats se conjugue avec la possibilité de la révolution, dans la période révolutionnaire. C'est l'organisation des Conseils Ouvriers. C'est le seul moment dans l'histoire du capitalisme où la permanence de cette organisation est vraiment générale, constitue une concrétisation de l'unité réelle de la classe. Il n'en est pas de même pour ce qui concerne le parti politique qui peut parfaitement surgir avant ce point culminant que sont les Conseils Ouvriers. Il en est ainsi parce crue son existence n'est pas conditionnée par le moment final, mais simplement par une période de montée de la lutte de classe.
e) Nous avons pu constater au cours de l'histoire comment, avec l'évolution de la lutte de classe, se modifient certaines fonctions passées du Parti. Enumérons-en quelques exemples :
- Au fur et à mesure de l'évolution de la lutte de classe, de l'accumulation d'expériences, de l'élévation générale de la culture des ouvriers, le Parti perd graduellement son rôle d'éducateur général.
- C'est encore plus vrai pour ce qui concerne son rôle d'organisation de la classe. Une classe ouvrière comme celle des ouvriers anglais de 1864 qui est capable de prendre l'initiative de fonder une Association Internationale de Travailleurs n'avait vraiment pas besoin d'un tuteur pour l'organiser. La démarche consistant à "aller au peuple" ou "vers les ouvriers" pour les organiser, avait encore un sens dans un pays arriéré comme la Russie à la fin du 19ème siècle. Une telle fonction avait perdu tout sens pour les pays industrialisés comme l'Angleterre, la France, etc. La fondation de l'AIT en 1864 n'était l'œuvre d'aucun parti. Il n'en existait pratiquement pas, et dans les rares cas où ils existaient, comme le chartisme en Angleterre ou le blanquisme en France, ils étaient en pleine décomposition.
La 1ère Internationale est beaucoup plus proche de l'organisation générale que d'une organisation du type de la Ligue des Communistes, c'est-à-dire du type Parti, strictement groupé et sélectionné sur la base d'un programme théorique et politique cohérent. C'est pour cela que pouvaient coexister et s'affronter, en son sein, divers courants : marxiste (collectiviste), ouvriériste, proudhonien, anarchiste et même, au début, un courant aussi bizarre que le mazzinisme. L'Internationale était un creuset où se décantaient les idées et les courants. Un parti est déjà le produit d'une décantation. C'est pourquoi les courants restent encore informels en son sein. Un seul parti politique dans le plein sens du mot est né depuis la dissolution de la Ligue des Communistes et durant l'existence de la 1ère Internationale en 1868 : le Parti Social-démocrate eisenachien, à tendance marxiste sous la direction de W. Liebknecht et de Bebel. I1 faudra attendre 1878, à l'occasion des élections, pour que naisse, sous la direction de Guesde et de Lafargue avec la participation directe de Marx (qui en écrivit la plateforme politique) le Parti Ouvrier en France.
Ce n'est qu'à partir des années 80 avec le développement accéléré du capitalisme et la remontée de la lutte de classe que se font sentir le besoin et la possibilité de formation de partis politiques pour la lutte politique proprement dite, distincts des organisations à caractère de défense des intérêts immédiats sur le plan économique, les syndicats. C'est à partir des années 1880, un peu dans tous les pays industrialisés ou en voie d'industrialisation, que s'engage véritablement un processus de formation de partis, à l'image de la Social-démocratie allemande qui prendra l'initiative de la constitution de la 2ème Internationale en 1889.
La 2ème Internationale sera le résultat d'une décantation politique opérée dans le mouvement ouvrier depuis la dissolution de la 1ère Internationale (16 ans) et d'unification du courant marxiste à l'échelle internationale. Elle se réclamera du "socialisme scientifique" tel qu'il a été formulé 40 ans auparavant par Marx et Engels dans le Manifeste de la Ligue des Communistes en 1848. Elle ne se donnera plus pour tâche, comme l'avait fait la 1ère Internationale, de procéder à une enquête sur les conditions de la vie ouvrière dans différents pays, ni d'élaborer des cahiers de revendications économiques. Les activités de ce type qui, à ses débuts, sont encore siennes, seront progressivement et définitivement laissées aux syndicats. Par contre, elle prendra comme tâche la lutte pour des revendications politiques immédiates : suffrage universel, droit de réunion et liberté de la presse, participation aux campagnes électorales, luttes pour des réformes politiques, contre la politique colonialiste de la bourgeoisie, contre sa politique étrangère, contre le militarisme, etc., tout en poursuivant un travail d'élaboration théorique et de défense des buts finaux du mouvement, la révolution socialiste.
C'est avec raison qu'Engels (dans une de ses préfaces au Manifeste Communiste) signale, dans les années 80, que la 1ère Internationale avait rempli complètement sa tâche dans la période historique où elle avait surgi. I1 a tort, sur sa lancée, de conclure hâtivement que le mouvement politique de la classe, la formation de partis dans différents pays, a pris un tel essor que la classe ouvrière "n'a plus besoin d'une organisation internationale". Avec toutes ses insuffisances, avec toutes ses erreurs, avec toute la pénétration réformiste (trouvant son appui principal dans les syndicats) -qui va triompher en son sein et la perdre comme organisation de la classe-, la 2ème Internationale a également accompli une œuvre entièrement positive dans la classe, une œuvre qui reste un acquis du mouvement, ne serait-ce que d'avoir servi de terrain inégalable à la confrontation et à la clarification théoriques dans plus d'un domaine, de terrain d'affrontement des positions politiques de la gauche contre le révisionnisme Bernsteinien et le centrisme Kautskien. C'est en son sein que vit et s'aguerrit la gauche révolutionnaire.
Quand les moralistes-modernistes de ces se plaisent aujourd'hui à dresser uniquement négatif dans l'histoire -dans la mesure où ils ont quelque connaissance de l'histoire-, de ce que fut la 2ème Internationale à une certaine époque et de son apport au mouvement ouvrier, ils ne font preuve que de leur propre ignorance totale de ce qu'est un mouvement historique en développement. Dans leur ingénuité, ils ne se rendent même pas compte que le peu qu'ils connaissent aujourd'hui, ils l'ont appris, ils le doivent à l'histoire, au passé d'un mouvement vivant de la classe ouvrière ! Ceux-là mêmes qui s'empressent de jeter l'enfant avec l'eau sale ne se doutent même pas que leurs idées et "inventions", qu'ils croient être originales, ils n'ont fait que les ramasser là où elles se trouvaient -pour être devenues depuis longtemps inutiles et inutilisables-, dans les corbeilles à papier de l'époque utopique de l'histoire du mouvement ouvrier. Même les bâtards ont des géniteurs ; inavoués, il est vrai.
Tout comme les modernistes, les bordiguistes se contentent d'ignorer l'histoire du mouvement, l'histoire vivante d'une classe ouvrière en mouvement et en évolution, avec ses moments faibles et ses moments forts. Au lieu de l'étudier et de la comprendre, ils la remplacent par des dieux morts, éternellement immobiles et momifiés par le Bien et le Mal absolus.
18. Le réveil du prolétariat après trois ans de massacre impérialiste et la mort honteuse de la 2ème Internationale portant le manque infâme de la trahison ouvrent une période de montée de luttes et de reconstitution du parti de la classe. Cette nouvelle période d'intenses luttes sociales -qui voit s'écrouler comme de vulgaires châteaux de cartes des citadelles et des forteresses qu'on croyait la veille encore imprenables, qui voit s'effondrer en l'espace de quelques jours un appareil militaire considérable, des monarchies et des empires qu'on croyait invulnérables tels que ceux de la Russie, de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne prussienne- constitue, non pas un simple moment mais un formidable bond qualitatif dans l'évolution de l'histoire et pour le mouvement ouvrier, car elle pose d'emblée la question de la révolution, de sa marche et de la stratégie de la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière. C'est pour la première fois de leur histoire que la classe ouvrière et ses partis communistes récemment constitués se doivent de répondre à toute une série de questions cruciales -dont chacune se pose en ternies de vie ou de mort de la révolution. Des réponses à ces questions, la classe et les partis en son sein, ont une idée très vague, ou pas d'idée du tout, ou encore franchement anachronique et erronée. Seuls des nains minuscules, mais dotés d'une incommensurable mégalomanie -qui n'ont jamais vu une révolution, même de loin (et la révolution prolétarienne est le plus grand saut de toute l'histoire humaine à ce jour)- peuvent de leur petite hauteur pointer, soixante ans après, leur petit doigt plein de mépris et de suffisance, contre les erreurs et les tâtonnements de ces géants qui ont osé monter à l'assaut du ciel capitaliste en s'engageant résolument dans la voie de la révolution.
Oui, la classe ouvrière, et avant tout les partis et l'Internationale Communiste, ont souvent tâtonné, improvisé et, commis de graves erreurs qui ont largement entravé la marche de la révolution. Mais ils nous ont non seulement légué des acquis inappréciables, mais aussi une riche expérience que nous devons étudier minutieusement afin de comprendre les difficultés rencontrées, d'éviter les pièges dans lesquels ils sont tombés, de dépasser les erreurs commises par eux, et, sur la base de leur expérience, de pouvoir mieux répondre aux problèmes que soulève la révolution. Il s'agit de mettre à profit le recul dans le temps qui nous été donné pour tenter de résoudre, ne serait-ce que partiellement, ces problèmes, sans pour cela dans la prétention ni perdre de vue le fait que la prochaine révolution apportera avec elle les problèmes nouveaux que nous ne pouvons pas complètement prévoir.
19. Pour revenir au problème précis du parti et de sa fonction dans la période présente et dans a révolution, nous pouvons énoncer la réponse surtout sous la forme de ce qu'elle n'est pas pour dégager ce qu'elle devrait être.
a) Le parti ne peut pas prétendre être le seul et exclusif porteur ou représentant de la conscience de la classe. I1 n'est pas prédestiné à un tel monopole. La conscience de la classe est inhérente à la classe comme une totalité et dans sa totalité. Le parti est l'organe privilégié de cette conscience et rien de plus. Cela n'implique pas qu'il soit infaillible, ni que parfois, à certains moments, il soit en deçà de la conscience prise par certains autres secteurs ou fractions de la classe. La classe ouvrière n'est pas homogène, mais tend à l'être. Il en est de même en ce qui concerne la conscience de classe qui tend à s'homogénéiser et à se généraliser. I1 appartient au Parti, et c'est là une de ses principales fonctions, de contribuer consciemment à accélérer ce processus.
b) A ce titre, le parti a pour tâche d'orienter la classe, de féconder sa lutte ; il n'en est pas le dirigeant au sens de celui qui décide seul, en lieu et place de la classe.
c) A ce titre nous devons reconnaître la possibilité de surgissement de groupes (qu'ils s'intitulent parti ou non ne change rien) au sein de la classe et dans son organisation unitaire que sont les Conseils Ouvriers. Non seulement le Parti Communiste ne peut, à aucun titre, s'arroger le droit d'interdire leur existence ou faire pression dans ce sens, mais il doit au contraire combattre énergiquement de telles tentatives.
d) A l'instar de la classe qui, comme un tout, peut être traversée par plusieurs courants révolutionnaires plus ou moins cohérents, le Parti, dans le cadre de son Programme, connaît la possibilité de divergences, de tendances. Le Parti Communiste rejette catégoriquement la conception d'un parti monolithique.
e) Le parti, à aucun titre, ne saurait prétendre établir un cahier de recettes pour répondre à toutes les questions (et dans leur détail) qui peuvent se poser dans les luttes et dans la conduite de celles-ci. I1 n'est ni un organe exécutif ni administratif ni technique de la classe. Il est et doit rester un organe politique. Ce principe s'applique tant aux luttes qui précèdent la révolution qu'à celles de la période révolutionnaire elle-même dans laquelle le Parti ne saurait notamment jouer un rôle d’« état-major » de l'insurrection.
f) La discipline d'organisation et dans l'action que le Parti exige de ses membres, ne peut être une réalité que dans le cadre de la constante liberté de discussion et de critique, dans le cadre de la plateforme qu'il s'est donnée. Il ne saurait exiger de ses membres qui sont en divergence avec certaines de ses positions importantes de présenter et défendre face à l'extérieur, contre leur conviction, ces positions, de s'en faire les porte-parole au nom du Parti. Et cela aussi bien dans le souci de respecter la conscience de ces membres que dans l'intérêt général de l'organisation comme un tout. Confier la défense de positions importantes de l'organisation à des militants qui ne les partagent pas aboutit à une mauvaise défense de celles-ci. Dans ce même sens, le Parti ne saurait recourir à des mesures de répression pour faire pression sur ses membres. Par principe, le Parti rejette l'utilisation de la force et de la violence comme moyen de persuasion et en guise de conviction en son sein, tout comme il rejette la pratique de la violence et des rapports de force physique au sein de la classe et dans son rapport à la classe.
g) Le parti en tant que tel ne demande pas à la classe de lui "faire confiance", de lui déléguer en tant que Parti le pouvoir de décision. Car, par principe, le parti communiste est contre toute délégation par la classe du pouvoir à un organisme, groupe ou parti qui ne relève pas comme tel de son contrôle constant. Le principe communiste exige la pratique réelle de délégués élus et révocables à tout moment, toujours responsables devant l'assemblée qui les a élus ; en ce sens, il proscrit tout mode d'élections par listes présentées par les partis politiques. Toute autre conception mène inéluctablement à une pratique substitutionniste.
S'il est du droit du parti d'exiger la démission d'un de ses membres d'un poste, d'un comité, d'un organisme ou mP1ne d'un poste de l'Etat, auquel ce militant a été élu par une assemblée et devant laquelle il est et reste responsable, il ne saurait imposer son remplacement par un autre membre, de son propre chef et de par sa propre décision.
h) Enfin, et à la différence des partis bourgeois, le parti prolétarien n'est pas un organe destiné à s'emparer de l'Etat ou à le gérer. Ce principe découle tant de ce qui vient d'être vu que de la nécessaire indépendance de la classe ouvrière par rapport à l'Etat de la période de transition. L'abandon de ce principe conduit inéluctablement à la perte par le Parti de son caractère prolétarien.
i) De tout ce qui précède, il découle que le Parti prolétarien de notre époque ne saurait être un parti de masse . N'ayant aucune fonction étatique ni d'encadrement de la classe, sélectionné autour d'un programme -le plus cohérent possible- le Parti sera nécessairement une organisation minoritaire jusqu'à et pendant la période révolutionnaire. En ce sens, la conception de l'Internationale Communiste du "Parti révolutionnaire de masse" qui, en son temps, était déjà fausse et relevait d'une période révolue, doit être rejetée catégoriquement.
Vers le futur Parti
20. Le CCI analyse la période ouverte par le surgissement des luttes ouvrières à partir de 1968 comme une période de reprise historique des combats de la classe répondant à la crise ouverte qui se développe à la fin de la reconstruction du 2ème après guerre. En accord avec cette analyse, il considère donc cette période comme posant les prémisses de la reconstitution du Parti. Cependant, même s'ils la font dans des conditions indépendantes de leur volonté, ce sont les hommes qui font l'histoire.
En ce sens, la formation du futur Parti sera le résultat d'un effort conscient, délibéré, effort auquel les groupes révolutionnaires existants doivent s'atteler dès à présent. Cet effort nécessite une compréhension claire tant des caractéristiques générales, valables à toutes les époques, du processus de formation du parti, due des conditions spécifiques, inédites dans l'histoire, qui président au surgissement de celui de demain.
21. Une des spécificités majeures du surgissement du futur parti réside dans le fait qu'il prendra place d'emblée à L'échelle mondiale contrairement à ce qui s'est produit par le passé.
Dans le passé déjà, les organisations politiques du prolétariat étaient mondiales, tendaient vers l'unité mondiale. Cependant, les organisations mondiales résultaient du regroupement de formations plus ou moins constituées au niveau national et autour d'une formation émanant d'un secteur national particulier du prolétariat occupant une position d'avant-garde dans l'ensemble du mouvement ouvrier.
Ainsi, en 1864, l'AIT se constitue essentiellement autour du prolétariat d'Angleterre (la Conférence constitutive se tient à Londres qui est aussi le siège du Conseil Général jusqu'en 1872, les Trade-unions constituent longtemps les contingents les plus importants de l'AIT) qui est le pays de loin le plus développé de l'époque, où le capitalisme est le plus puissant et concentré.
De même, en 1889, la 2ème Internationale se constitue principalement autour de la Social-démocratie allemande qui est, -en Europe et dans le monde- le parti ouvrier le plus ancien, le plus développé et le plus puissant, ce qui résulte, avant tout, du formidable développement du capitalisme allemand dans la seconde moitié du 19ème siècle.
Enfin, la 3ème Internationale a pour pôle indiscutable le Parti bolchevik, non pas à cause d'une quelconque prééminence du capitalisme de Russie (qui, bien qu'au 5ème rang mondial, reste très arriéré) mais parce que le prolétariat de ce pays est, par des circonstances spécifiques, le premier (et le seul) à renverser l'Etat capitaliste et à prendre le pouvoir lors de la grande vague révolutionnaire du premier après-guerre.
La situation d'aujourd'hui se distingue notoirement de celle qui prévalait à ces différents moments du passé. D'une part, la période de décadence du capitalisme n'a pas permis l'éclosion de nouveaux grands , secteurs du prolétariat mondial qui auraient pu constituer un nouveau pôle pour l'ensemble du mouvement ouvrier (comme ce fut le cas en Allemagne au siècle dernier).
D'autre part, le capitalisme décadent -du fait notamment de sa décadence- a été l'objet d'un nivellement considérable de ses caractéristiques économiques, sociales et politiques, et tout particulièrement dans les pays avancés. Jamais, dans l'histoire, le monde capitaliste, malgré ses insurmontables divisions nationales et de bloc n'a atteint, du fait, entre autres, du développement du commerce mondial et de l'usage des moyens modernes de communication, un tel degré d'homogénéité, d'interdépendance entre ses différentes parties. Cette évolution s'est traduite, pour la classe ouvrière, par un nivellement, sans exemple dans le passé, de ses conditions et mode de vie ainsi que, d'une certaine manière, de son expérience politique.
Enfin, les circonstances présentes du développement historique de la lutte de classe vers la révolution (aggravation simultanée dans tous les pays de la crise économique et non pas guerre impérialiste comme en 1917, degré considérable d'unité de la bourgeoisie face au prolétariat) assignent à ce développement de tendre vers une simultanéité, une unité et une généralisation du combat inconnues par le passé.
L'ensemble de ces conditions pousse non pas à la constitution du futur Parti mondial autour de tel ou tel secteur national du prolétariat, comme par le passé, mais à son surgissement d'emblée à l'échelle internationale autour des positions et du pôle politiques les plus clairs, cohérents et développées.
C'est en particulier pour cette raison que, encore plus aujourd'hui que dans tout le passé du mouvement ouvrier, il est fondamental que les différents groupes communistes existant dans le monde mobilisent et unifient leurs efforts en vue de la constitution de ce pôle et, en premier lieu, de la clarification des positions politiques prolétariennes.
Ces tâches essentielles participent donc également, et de façon majeure, à la prise en charge consciente et volontaire -évoquée plus haut- par les révolutionnaires de leurs responsabilités dans le processus de formation du futur Parti.
22. En accord avec cette perspective, le CCI défend l'idée de la nécessité urgente de rompre avec l'isolement dans lequel se trouvent les groupes communistes existants, de combattre l'esprit faisant de la nécessité (objective) d'hier une vertu pour aujourd'hui - qui ne peut relever que d'un esprit de chapelle et de secte - pour que s'engage une véritable discussion internationale entre ces groupes. Cette discussion devra manifester la ferme volonté d'éliminer les malentendus, les incompréhensions, les fausses interprétations des positions des uns et des autres – résultant de la polémique ou de l'ignorance de ces positions afin d'ouvrir une véritable confrontation des divergences politiques et de permettre que s'enclenche un processus de décantation et de regroupement.
Le CCI n'ignore pas les énormes difficultés que va rencontrer la réalisation de cette tâche. Ces difficultés sont liées en grande partie au poids de la terrible contre-révolution subie par la classe ouvrière pendant plus de 40 ans, contre révolution qui est venue à bout des fractions de gauche issues de l'Internationale Communiste et à rompre la continuité organique ayant existé entre les différentes organisations politiques prolétariennes depuis le milieu du siècle dernier. Du fait de cette rupture de la continuité organique, le futur Parti ne pourra pas se constituer suivant le processus mis en évidence par la Fraction italienne, processus dans lequel la Fraction constituait un pont entre l'ancien et le nouveau Parti.
Cette situation rend encore plus indispensable cette tâche de confrontation et de décantation en vue du regroupement des organisations du camp communiste. Le CCI s'est efforcé d'y contribuer par des contacts avec ces groupes; il a suggéré la tenue de conférences internationales de groupes se situant dans le camp prolétarien et y a participé activement. I1 faut constater l'échec de ces premières tentatives, dû avant tout à l'esprit de secte des groupes - débris de la Gauche italienne - passablement sclérosés et qui, au nombre de cinq, se proclament tous Le "Parti historique". Ces soi-disant "partis" sont voués à une sclérose irréversible s'ils persistent dans cette attitude.
Pour ce qui le concerne, le CCI est convaincu qu'il n'existe pas d'autre voie. C'est la voie qui a toujours triomphé dans l'histoire du mouvement ouvrier, la voie de Marx Engels, la voie de Lénine et de R. Luxemburg, la voie suivie par la Gauche Communiste Internationale et Bilan dans les années 30. C'est la seule voie féconde et riche de promesses, et c'est cette voie que, plus que jamais, le CCI est décidé à poursuivre fermement.
[1] Sans être exhaustif, on peut signaler les textes suivants :
- point 16 de la Plateforme du CCI
- contribution du CCI à la 2ème Conférence Internationale des groupes de la Gauche Communiste
- brochure du CCI n° 3 : "Organisations communistes et conscience de classe".
[2] Les analyses aberrantes développées par Bordiga - notamment à partir de 1945 - ne sauraient atténuer sa contribution de premier plan dans la fondation du Parti Communiste d'Italie et dans la lutte de la Gauche contre la dégénérescence de l'Internationale Communiste. La reconnaissance de l'importance de cette contribution ne doit pas servir à justifier l'adhésion à ces aberrations, à les considérer comme l'alpha et l'oméga des positions communistes.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Adresse aux groupes politiques prolétariens
- 2531 reads
Les années 80 se confirment comme des "années de vérité" pour l'avenir de l'humanité.
Par son aggravation inexorable, la crise économique mondiale gui, depuis une quinzaine d'années secoue le capitalisme, révèle chaque jour plus l'impasse totale dans laquelle se trouve ce système. Elle démontre de plus en plus clairement la réalité de l'alternative historique déjà constatée par l'Internationale Communiste : guerre ou révolution, ou bien la réponse prolétarienne à la crise : le développement des luttes de classe menant à la révolution ; ou bien son aboutissement bourgeois : l'holocauste impérialiste généralisé menaçant de mort toute l'humanité. C'est dire si sont aujourd'hui considérables les responsabilités des groupes révolutionnaires comme facteur actif de la capacité du prolétariat à donner une issue positive à cette alternative. Pourtant, pour l'ensemble du milieu politique constitué par les organisations révolutionnaires, l'accélération de l'histoire de ces dernières années s'est traduite, non par un renforcement, mais par une série de crises organisationnelles internes, des débandades activistes ou des paralysies aux moments de montée de la lutte (Pologne 80 en particulier) et par des tendances à la démoralisation, à l'usure, au repli sur soi dans les moments de reflux de la lutte. Au lieu de servir de repère, de phare dans la tourmente sociale gui se développe, l'avant-garde politique du prolétariat se révèle au contraire souvent ballottée, secouée au gré des flots du tourbillon engendré par la crise historique du capitalisme.
Dans l'immédiat, la contre-offensive déclenchée par la bourgeoisie à l'ouverture des années 80 frappe la classe révolutionnaire, mais aussi son avant-garde politique. Et cela d'autant plus que celle-ci a été incapable de se donner les moyens de dépasser son éparpillement et ses divisions gui sont un legs de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat entre les années 1920 et les années 60.
Les conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste (1977-80) auraient pu constituer un pôle de référence au niveau mondial, un cadre pour entreprendre le dépassement de ces faiblesses. Mais le poids de l'immaturité, de la sclérose et du sectarisme, après les avoir maintenues "muettes" par le refus de toute prise de position commune, a finalement mis un terme à cet effort.
Dans les conditions historiques actuelles, il est de la plus haute importance que l'ensemble des organisations révolutionnaires prennent conscience de la gravité de la situation et des responsabilités gui sont les leurs, et sachent notamment opposer une résistance réelle, efficace aux pressions destructrices du capital aux abois. Ces responsabilités ne sauraient être assurées par une simple somme d'efforts de chaque groupe pris individuellement. Il s'agit d'établir une coopération consciente entre toutes les organisations, non pas pour réaliser des regroupements hâtifs, artificiels, mais pour engendrer une volonté et une démarche qui donnent toute son importance à un travail systématique de débats, de confrontations fraternels entre forces politiques prolétariennes.
En ce sens, le travail qui avait été entrepris avec les trois premières conférences de la Gauche Communiste devra être repris. Il devra se baser sur les mêmes critères de délimitation que ceux qui avaient été retenus pour ces conférences, parce que ces critères n'étaient pas de circonstance, mais résultaient de toute une expérience historique de la classe ouvrière depuis la vague révolutionnaire suivant la 1ère guerre mondiale. Il devra se baser également sur les enseignements de l'échec de ces conférences, et notamment sur le fait de les concevoir non comme de simples forum de discussions mais comme un effort militant se donnant notamment comme objectif de prendre position face aux événements cardinaux de la lutte de classe et de la vie de la société. L'heure n'est pas venue pour l'appel à de nouvelles conférences des groupes communistes. Il reste encore tout un chemin à faire pour que soient réunies les conditions d'un tel effort. Cependant, c'est dès aujourd'hui qu'il faut préparer le développement de telles conditions.
C'est dans cette perspective qu'au moment de son 5ème Congrès International, le CCI adresse à toutes les organisations révolutionnaires un appel pour qu'elles prennent résolument en charge les responsabilités gui sont les leurs face à la gravité et aux enjeux de la situation historique :
- reconnaissance de l'existence d'un milieu politique prolétarien ; les groupes communistes doivent rejeter la prétention mégalomane d'être chacun le seul détenteur des positions de classe ;
- développement systématique d'un esprit et d'une volonté de débat et de confrontation des positions politiques gui sont la condition première d'une décantation et d'une clarification dans l'ensemble de ce milieu et de toute la classe, et gui doivent prendre place dans les presses respectives, les réunions publiques, etc.
- rejet dans ce débat des bavardages dilettantes et irresponsables, du sectarisme et du dénigrement systématique des autres organisations.
Les formidables affrontements de classe gui se préparent seront également une épreuve de vérité pour les groupes communistes : ou bien ils seront capables de prendre en charge ces responsabilités et ils pourront apporter une contribution réelle aux développements des luttes ; ou bien ils se maintiendront dans leur isolement actuel et ils seront balayés par le flot de l'histoire sans avoir pu mener à bien la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir.
CCI
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Int. 1984 - 36 à 39
- 3552 reads
Revue Internationale no 36 - 1e trimestre 1984
- 2457 reads
Conflits inter impérialistes, lutte de classe: l'histoire s'accélère
- 2542 reads
"Jamais depuis les années 30, l'impasse totale dans laquelle se "trouve l'économie capitaliste ne s'était révélée avec une tel-"le évidence ; jamais depuis la dernière guerre mondiale, la "bourgeoisie n'avait déployé de tels arsenaux militaires, n'avait mobilisé de tels efforts en vue de la production de moyens "de destruction ; jamais depuis les années 20, le prolétariat "n'avait mené des combats de l'ampleur de ceux qui ont secoué "la Pologne et l'ensemble de la classe régnante en 1980-81. "Cependant, ce n'est là qu'un début. En particulier, si aujourd'hui les dirigeants bourgeois semblent se consoler en bavardant sur "la reprise économique"; ils ont du mal à masquer que "le plus fort de la crise est devant nous. De même, le recul "mondial des luttes ouvrières qui a suivi les formidables combats de Pologne ne constitue qu'une pause avant les énormes "affrontements de classe qui mettront en mouvement les détachements décisifs du prolétariat mondial, celui des grandes métropoles industrielles et notamment d'Europe occidentale" (Résolution sur la situation internationale, 5e Congrès du CCI Revue Internationale n°35)
Les années80, à la suite des années 70, dominées par l'illusion d'une reprise économique, sont bien des ANNEES DE VERITE. Si, après 1'invasion de 1'Afghanistan par les troupes russes, le développement de la grève de masse des ouvriers en Pologne a montré, dès 1'aube des années 80, comment se concrétisait 1'alternative historique : guerre impérialiste ou révolution communiste, les années qui ont suivi la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne, ont été marquées par une avancée des tensions impérialistes sans que la classe ouvrière se manifeste de façon significative.
Déboussolée par 1'activité de la gauche dans 1'opposition et par d'intensives campagnes idéologiques centrées sur la guerre, en partie démoralisée par la défaite en Pologne, la classe ouvrière a marqué une pause dans ses luttes qui a d'autant plus facilité la forte accélération des préparatifs guerriers de la bourgeoisie.
Cependant, 1'enfoncement toujours plus rapide du capitalisme dans la crise, alors que le prolétariat mondial n'est pas vaincu, pas écrasé, fait que cette pause des luttes ne pouvait être que provisoire. Aujourd'hui, le renouveau de la combativité de la classe ouvrière dans les pays centraux, vient montrer que le repli se termine.
L'histoire s'accélère sous la poussée de 1'aggravation de la crise. Comprendre cette accélération, tant sur le plan des tensions inter impérialistes que sur celui de la lutte de classe, constitue une tâche essentielle des organisations révolutionnaires aujourd'hui si elles veulent être à même de remplir leur fonction dans la classe demain.
L’AGGRAVATION DES TENSIONS IMPERIALISTES
Depuis l'invasion russe de l'Afghanistan, le prolétariat est soumis à une propagande intensive sur la guerre. Rien que ces derniers mois : un bœing 747 avec des centaines de passagers à bord abattu par les russes au dessus de l'île Sakhaline ; des centaines de soldats américains et français tues dans des attentats meurtriers à Beyrouth ; un débarquement de marines américains dans une minuscule île des Caraïbes, la Grenade ; des avions français et israéliens qui bombardent au Liban, avec, en toile de fond, des conflits anciens qui non seulement n'en finissent pas mais, au contraire, s'exacerbent : la guerre Iran-Irak qui a fait déjà des centaines de milliers de morts et de blessés, les guerres au Tchad, Angola, Mozambique, Sahara occidental, Nicaragua, Salvador, Cambodge, etc. La liste des conflits qui viennent illustrer l'exacerbation des tensions guerrières est longue. Et pas un qui ne soit prétexte à une intensification du matraquage obsédant du bloc occidental destiné à paralyser le prolétariat en lui faisant peur et en lui communiquant un sentiment d'impuissance, et à dénoncer l'agressivité du bloc russe, même si parfois, l'influence de celui-ci y est insignifiante.
Comme toute propagande, celle-ci s'appuie sur une réalité : avec l'entrée dans les"années de vérité", s'aggravent toutes les grandes tendances propres à la décadence capitaliste, notamment la tendance à l'aiguisement des tensions militaires.
"Face la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions... Aujourd'hui, la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante, elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise... Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre". (Les années 80, années de vérité, Revue Internationale n°20).
C'est dans ce contexte qu'on assiste à une modification qualitative de l'évolution des conflits impérialistes. Contrairement à la propagande assénée quotidiennement par tous les médias du bloc occidental, la caractéristique majeure de cette évolution consiste en une offensive du bloc américain contre le bloc russe. Celle-ci vise à parachever l'encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle a pour but d'expulser définitivement l'URSS du Moyen-Orient en réintégrant la Syrie au sein du bloc occidental. Elle passe par une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce majeure de son dispositif militaire. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise, en fin de compte, à étrangler complètement l'URSS; à lui retirer son statut de puissance mondiale.
Une des caractéristiques principales de cette offensive, c'est l'emploi de plus en plus massif de sa puissance militaire par le bloc US, notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux du bloc (France, GB, Italie) sur le terrain des affrontements. Cette caractéristique correspond au fait que la carte économique, employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire, ne suffit plus :
- du fait des ambitions présentes du bloc US ;
- du fait surtout de l'aggravation de la crise mondiale elle même qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays secondaires sur lesquels s'appuyait auparavant le bloc US.
A cet égard, les événements d'Iran ont été un révélateur. L'effondrement du régime du Shah et la paralysie que cela a occasionnée pour le dispositif américain dans cette région, ont permis à l'URSS de marquer des points en Afghanistan. Ils ont convaincu la bourgeoisie américaine de mettre sur pied sa force d'intervention rapide (et lui ont permis de faire "avaler" facilement cette décision à la population traumatisée par l'exploitation de l'affaire des otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979) et de réorienter sa stratégie impérialiste.
De même aujourd'hui, le meilleur bastion militaire du bloc occidental au Proche-Orient : Israël, se retrouve dans une situation économique et sociale difficile, ce qui impose une présence militaire directe accrue du bloc au Liban.
La difficulté de plus en plus grande du bloc US à entretenir son avancée contre le bloc russe par sa puissance économique alors que la crise frappe toujours plus fort, le pousse à subordonner de plus en plus totalement son économie à ses besoins militaires. Depuis longtemps, étant donnée sa faiblesse économique, l'URSS a du, pour maintenir sa domination sur son bloc, sacrifier la compétitivité de son économie aux besoins de sa puissance militaire par un développement hypertrophié de son économie de guerre. La primauté du militaire sur l'économique est une tendance générale de la décadence du capitalisme qui s'accélère aujourd'hui et que les années de vérité mettent à nu.
Cette tendance ne manifeste pas la force du capital, mais constitue au contraire la preuve de son affaiblissement. La fuite en avant dans l'économie de guerre et vers la guerre elle-même est le produit de l'affaissement du marché mondial sursaturé. La production d'armements a ceci de particulier qu'elle n'est destinée ni à la reproduction de la force de travail, ni à la production de moyens de production, mais à la destruction ; elle est elle-même une stérilisation et une destruction de capital.
Dans tous les pays, les programmes d'armements se développent depuis la fin des années 70. Les commandes d'armes de l'Etat américain sont un des facteurs déterminants de la "reprise" économique actuelle. Mais cette destruction massive de capital ne fait qu'accentuer à terme les effets de la crise et accélérer la faillite du capitalisme mondial (voir article dans ce n°).
LE PROLETARIAT : FREIN A LA GENERALISATION DES CONFLITS
La banqueroute du capital mondial pousse la bourgeoisie vers la guerre comme l'ont dramatiquement montré les deux holocaustes impérialistes de ce siècle. La crise économique aujourd'hui est plus profonde et plus forte que toutes celles qui ont précédé. Dans ces conditions, comment se fait-il qu'aucun des multiples conflits impérialistes ne se soit encore généralisé dans une 3e guerre mondiale ?
La classe ouvrière reste un obstacle décisif à la guerre mondiale. Ce n'est pas l'accumulation des armements les plus destructeurs qui freine les tendances bellicistes de la bourgeoisie. Mais depuis 1968, celle-ci n'est pas parvenue à assurer la soumission de cette principale force sociale du monde capitaliste qu'est le prolétariat.
La guerre impérialiste généralisée serait une guerre totale. Il faut à la bourgeoisie un prolétariat docile qui fasse tourner à plein les usines, qui accepte une militarisation totale du travail, de la vie sociale, qui subisse sans broncher le rationnement alimentaire le plus draconien, qui joue le rôle d’exécutant soumis de l'Etat bourgeois, au nom de la patrie, au nom du drapeau national, au coude à coude avec ses exploiteurs.
Le développement des luttes ouvrières contre les effets de la crise depuis 1968, au coeur du capitalisme mondial : en Europe, c’est-à-dire au centre des rivalités impérialistes entre les deux blocs qui se partagent le monde, démontre que cette condition n'est pas remplie. C'est cette reprise des combats du prolétariat à l'échelle mondiale à la fin des années 60 qui a imposé à la bourgeoisie américaine de retirer ses 400 000 hommes du ViêtNam devant les risques de conflagration sociale qui s'accumulaient.
La classe capitaliste doit entamer et briser cette résistance du prolétariat pour avoir les coudées franches et en découdre sur le terrain des affrontements impérialistes. Les campagnes idéologiques sur la guerre menées de façon intensive depuis l'invasion de l'Afghanistan par les troupes du bloc russe, n'ont pas d'autre but que de paralyser le prolétariat et lui faire accepter un effort de guerre et des interventions militaires croissantes. Ces campagnes s'adressent d'abord aux fractions de la classe ouvrière dans les pays industrialisés, et notamment d'Europe dont le rôle a toujours été déterminant par le passé pour permettre une marche à la guerre généralisée. En effet, l'embrigadement du prolétariat européen derrière l'étendard national et les mystifications bourgeoises a permis les deux guerres mondiales. Nous ne sommes pas dans la même situation aujourd'hui. Nulle part, des fractions importantes du prolétariat ne se trouvent vaincues, soumises, embrigadées par la bourgeoisie. Partout les luttes de résistance contre l'austérité montrent que le potentiel de combativité de la classe ouvrière est intact, loin d'être brisé.
Il y a deux ans, Reagan, devant le tollé suscité par l'envoi de quelques dizaines de milliers de "conseillers anti-guérillas" au Salvador, avait affiché son but : surmonter le "syndrome du ViêtNam", c'est-à-dire les réticences de la population des Etats Unis à l'envoi de soldats américains dans des conflits ouverts. On peut voir aujourd'hui, avec les milliers de soldats dépêchés au Liban ou à la Grenade, que la bourgeoisie occidentale, à coup de campagnes intensives, a avancé sur ce plan. Cependant, nous sommes encore loin de la période de contre-révolution durant laquelle les Etats Unis pouvaient, sans coup férir, envoyer 16 000 hommes au Liban pour rétablir l'ordre. La bourgeoisie a encore du chemin à parcourir si elle veut briser la résistance de la classe ouvrière et s'ouvrir la route de la 3e guerre mondiale.
Ainsi, depuis 1968, le prolétariat reste une préoccupation déterminante de la bourgeoisie car elle sait qu'il est le principal danger auquel elle se trouve confrontée. Un exemple marquant de cette situation réside dans l'organisation actuelle de l'appareil politique de la bourgeoisie : de plus en plus, elle tend, pour faire face à la lutte de classe, à mettre ses fractions de gauche dans l'opposition, alors que les besoins de la guerre mondiale nécessitent l'union nationale, ce qu'elle ne peut faire pour le moment. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la lutte de classe.
Mais même si la classe ouvrière joue un rôle de frein aux tendances bellicistes, cela ne signifie pas pour autant que les tensions inter impérialistes cessent d'exister. Au contraire, celles-ci ne peuvent que s'exacerber sous la poussée de la crise. La lutte du prolétariat ne peut empêcher l'éclatement des multiples conflits impérialistes localisés ; ce qu'elle empêche, c'est leur généralisation dans un troisième holocauste.
Les tensions inter impérialistes ne disparaissent pas dans le capitalisme : le capital suppose la guerre; et les illusions pacifistes, c'est-à-dire d'un capitalisme pacifique, sont un des pires poisons pour la classe ouvrière. Même durant la grève de masse en Pologne 80, quand les deux blocs se sont entendus comme "larrons en foire" pour isoler le prolétariat de Pologne et lui imposer la défaite, les tensions inter impérialistes -même si elles ont été mises au second plan- n'ont pas disparu pour autant : les conflits ont continué à la périphérie et les programmes d'armements ont fait un bond en avant dans les budgets des principales puissances impérialistes.
Le niveau de lutte de classe actuel, s'il empêche l'ouverture d'une 3e guerre mondiale, n'est pas suffisant pour faire reculer la bourgeoisie sur le plan militaire. Les ouvriers de Pologne ont posé la question de la généralisation internationale de la grève de masse au coeur de l'Europe, question à laquelle ils ne pouvaient répondre par eux-mêmes dans la situation d'isolement où ils se trouvaient. C'est seulement cette perspective qui peut faire reculer la bourgeoisie à l'échelle mondiale et préparer le terrain de la révolution communiste qui, mettant fin au capital, mettra fin à toutes les guerres. Cette perspective est entre les mains du prolétariat d'Europe occidentale, le plus à même, par son histoire, par son expérience, sa concentration, de la mettre en avant. De sa capacité de lutter, de s'opposer aux attaques de la bourgeoisie dépend l'avenir de l'humanité.
LA REPRISE DE LA LUTTE DE CLASSE
Alors que le thème de la guerre est omniprésent, obsédant, à travers le battage permanent de tous les médias ; alors que le prolétariat est soumis à un martelage incessant où, dans l'infernale logique du capitalisme, les cadavres viennent justifier les cadavres, tous les moyens d'information sont par contre soumis à un black-out sur les luttes de classe.
Pourtant, après un creux réel au lendemain de la défaite en Pologne, les grèves qui se déroulent depuis quelques mois en Europe sont significatives d'une reprise des combats de classe ; elles viennent confirmer que le prolétariat, loin d'être vaincu, garde intact son potentiel de combativité et qu'il est prêt à s'exprimer avec ampleur.
A cet égard, la grève du secteur public en Belgique durant le mois de septembre est exemplaire ; elle constitue le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis les combats de Pologne 80. Il en est ainsi par la conjonction des éléments suivants :
- le nombre de travailleurs impliqués (plusieurs centaines de milliers dans un pays qui ne compte que 9 millions d'habitants) ;
- le fait que ce mouvement a touché un des pays les plus industrialisés du monde, de plus vieux capitalisme, situé en plein coeur des énormes concentrations prolétariennes d'Europe occidentale ;
- la dynamique qui s'est exprimée au démarrage du mouvement : surgissement spontané des luttes qui a pris de court et a débordé les syndicats ; tendance à l'extension ; dépassement des clivages communautaires et linguistiques ;
- l'énorme mécontentement qui s'est révélé dans ces luttes et qui va croissant ;
- le fait que ce mouvement prend place dans un contexte international de surgissements sporadiques mais significatifs de la combativité ouvrière (en Grande Bretagne dans l'automobile ; en France, dans les centres de tris postaux ; en Hollande dans les services publics, etc.).
Le black-out imposé par les Etats aux moyens d'information sur cette grève durant une dizaine de jours dans les pays riverains de la Belgique (France, RFA, GB) met en évidence la crainte que la classe dominante éprouve d'une extension des explosions de mécontentement en Europe occidentale.
Ces luttes paraissent bien insignifiantes si on les compare à la flambée magnifique qu'avait constituée la grève de masse en Pologne 80. Pourtant, elles se développent dans un contexte différent qui leur donne toute leur valeur et leur sens.
La faiblesse de l'encadrement syndical "officiel" et la rigidité de l'Etat polonais ont permis la dynamique (extension et auto organisation) de la grève de masse à l'échelle nationale. Cependant, dans leur isolement, les travailleurs de Pologne se sont cassés le nez sur les illusions du syndicalisme à l'occidentale, "démocratique", véhiculées par Solidarnosc.
"Par contre, le prolétariat d'Europe occidentale, parce qu'il n'est pas dans la même situation d'isolement, parce qu'il a accumulé depuis des décennies toute une expérience de luttes où il s' est confronté aux syndicats, à la gauche, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crise le pousse à lutter, parce que son potentiel de combativité est intact, se trouve aujourd'hui dans des conditions meilleures qu'il n'en a jamais connues pour clarifier aux yeux du prolétariat mondial la véritable nature des syndicats, de la gauche et de la démocratie". (Rapport sur la situation internationale, 5e Congrès du CCI, Revue Internationale n° 35).
La grève en Belgique a manifesté des faiblesses qui continuent de peser sur la classe ouvrière et qui se sont notamment révélées par l'absence de remise en cause claire des syndicats et par l'absence d'auto organisation des luttes. Cependant, ces faiblesses ne sauraient atténuer ou masquer 1'importance du mouvement. En fait, alors que la "gauche dans l'opposition" mise en place activement à partir de 79 dans la plupart des pays avait réussi à épuiser et à venir à bout de la poussée ouvrière des années 78-80, les grèves de Belgique de septembre 83 constituent la première remise en cause d'envergure de l'efficacité de cette carte bourgeoise. Elles sont un indice indiscutable du fait que la classe ouvrière se remet de la défaite subie en Pologne 81, que le recul de ses combats qui marque les années 81-82, a pris fin.
A l'heure où la crise économique atteint maintenant de plein fouet les métropoles du capitalisme, la bourgeoisie ne peut plus différer ses programmes d'austérité,ni les étaler dans le temps. La classe exploiteuse est obligée de plus en plus d'attaquer toutes les fractions du prolétariat en même temps, au coeur du monde industriel de la vieille Europe. Ainsi la classe ouvrière est de plus en plus poussée à exprimer à une échelle toujours plus massive ses réserves de combativité. Les conditions de l'extension et de la généralisation se réunissent car le prolétariat doit faire face à une attaque générale de la bourgeoisie. Les conditions de l'auto organisation se rassemblent parce que le prolétariat est amené à se confronter à la gauche et à ses syndicats en luttant contre l'austérité de l'Etat et que l'approfondissement de la crise se traduit par une usure des mystifications démocratiques et syndicales imposées depuis 50 ans par la bourgeoisie derrière le mythe de 1'Etat-providence.
Les luttes en Belgique, en France, en Hollande, etc., annoncent les luttes d'envergure qui prendront place dans le futur. La reprise de la lutte de classe de l'automne 83 n'en est qu'à ses débuts, "Dans les pays avancés d'Occident et notamment en Europe de 1'Ouest, le prolétariat ne pourra déployer pleinement la grève de masse qu'à 1'issue de toute une série de combats, d'explosions violentes, d'avancées et de reculs, au cours desquels il démasquera progressivement tous les mensonges de la gauche dans 1'opposition, du syndicat et du syndicalisme de base". (Résolution sur la situation internationale du 5e Congrès du CCI, Revue Internationale n° 35)
Dans la mesure où le cours historique est la résultante du rapport de forces entre les classes, il peut sembler paradoxal dans la période actuelle d'assister en même temps à une accélération des tensions inter impérialistes et à la reprise de la lutte de classe. Le rapport entre les classes, entre le prolétariat et la bourgeoisie, n'est pas un rapport mécanique, immédiat ; c'est un rapport de forces historique. Devant 1 'exacerbation des contradictions provoquées par la crise, il faut une réponse à un degré qualitatif supérieur de la lutte de classe pour faire reculer la bourgeoisie et préparer l'assaut final contre le règne barbare du capital.
Ce que la reprise de la lutte de classe annonce aujourd'hui, ce sont les futures grèves de masse de dimension nationale d’abord, et leur généralisation internationale ensuite qui permettront au prolétariat de mettre en avant la perspective révolutionnaire. Sur ce chemin le prolétariat d'Europe, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte impérialiste, il est confronté au problème de la guerre de manière de plus en plus directe, devra assumer consciemment son opposition à celle-ci.
Plus que jamais, le prolétariat mondial aujourd'hui sera contraint de faire sien le mot d'ordre du prolétariat révolutionnaire du début du siècle : GUERRE ou REVOLUTION !
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Où en est la crise? : Le poids des dépenses militaires
- 2897 reads
C'est avec une vigueur retrouvée que les grands pays industrialisés ont renforcé leur présence armée sur des théâtres d'opérations militaires, présence qui s'était ralentie depuis le retrait des troupes américaines du Vietnam en 1975. En 1982, le "wargame" grandeur nature des îles Malouines a clairement confirmé un tournant de la politique militaire du bloc de l'Ouest, prélude à l'"interposition" au Liban de corps expéditionnaires américain, français, britannique et italien la même année, "interposition" devenue intervention directe en 1983.
A cette politique correspond une intensification des dépenses militaires qui manifeste la fuite en avant du capitalisme vers la seule issue qu'il peut donner à la crise définitive de son système d'exploitation, la guerre généralisée. Cependant, le poids massif de l'économie de guerre remonte aux années 1930 ; aujourd'hui, la politique d'armements ne peut en aucune façon fournir un palliatif à la crise comme ce fut le cas à l'époque. Au contraire, cette politique ne fait qu'accélérer la plongée du capitalisme dans l'abîme de la crise ; elle se révèle incapable de résorber le chômage massif au coeur des centres industriels ; elle ne permet pas une reprise économique réelle. Ainsi s'accentuent les conditions d'une riposte de la classe ouvrière qui commence à s'engager dans les pays du coeur du capitalisme.
L'ACCELERATION DES DEPENSES MILITAIRES
Les grands pays capitalistes vont assurer de plus en plus directement les basses besognes de l'affrontement militaire entre rivaux impérialistes qui s’étaient poursuivi par petits pays interposés. Dans les années 1970, les grandes puissances ont tendu à ralentir 1’accélération des dépenses militaires, déléguant leur rôle de gendarme à leurs alliés du tiers-monde face au bloc russe. Cependant, ce ralentissement relatif n'a jamais été une diminution. Les dépenses militaires mondiales n'ont jamais cessé de croître, particulièrement dans le tiers-monde et dans le bloc de l'Est.
Après avoir tenté d'utiliser principalement leur prépondérance économique sur le marché mondial contre le bloc adverse, avec 1'accélération actuelle de la crise, les grands pays de l'Ouest sont à nouveau contraints d'accélérer leur politique d'armements.
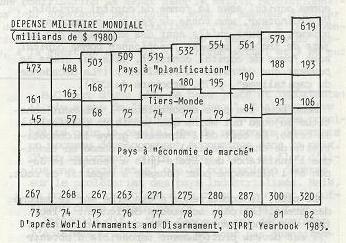
La production industrielle de ces pays tourne aujourd'hui au mieux à 75 % de ses capacités et 1'investissement se tasse : même les analystes de la bourgeoisie les plus convaincus de la "reprise" économique américaine -d'ailleurs de moins en moins nombreux- restent perplexes face au fait que cette soi-disant "reprise" s'accompagne d'une chute des investissements. La pression à la baisse du taux de profit s'accélère, et ceci d'autant plus pour les puissances industrielles que la productivité ne cesse de s'accroître.
Aux Etats-Unis, y compris dans des secteurs de pointe comme l'électronique, les faillites se multiplient. Dans l'automobile et l'aéronautique, les compagnies géantes comme Chrysler, Boeing, Mac Donnell Douglas, etc. ne doivent leur survie que grâce aux commandes militaires : chars pour Chrysler, avions Awacks pour Boeing, avions de combat pour Douglas.
La France, second producteur d'armements du bloc de l'Ouest, subit un nouveau freinage sans précédent dans l'industrie -agro-alimentaire, mines, sidérurgie, électronique. La construction aéronautique est de plus en plus fusionnée entre secteur civil et militaire et dominée par les responsables nationaux de l'armement : l'aviation civile stagne (Airbus) ; le secteur militaire est le seul qui résiste encore quelque peu à la récession.
Avec les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, le Japon prend une part grandissante dans la production d'armements, notamment dans l'électronique indispensable à la stratégie militaire actuelle. De même, l'Allemagne de l'Ouest, qui, tout comme le Japon, est un pays soi-disant à "bas profil" en matière militaire, dépense autant que la France dans ce domaine.
De plus, les chiffres officiels ne dévoilent qu'une partie de ce qui est réellement consacré à l'armement. En 1981 par exemple, 25 % de la recherche mondiale étaient officiellement consacrés au domaine militaire ; en fait, 90 % des programmes de recherche sont sous le contrôle de l'armée. Tous les "progrès techniques" dans la société civile ne sont que des retombées de l'industrie des armes. En informatique par exemple, les standards internationaux de programmation scientifique ou de gestion sont décidés par le Pentagone.
La crise ouverte révèle que c'est toute l'économie capitaliste qui est orientée vers la guerre, une économie de guerre qui n'est plus capable d'assurer l'accumulation du capital, et moins encore de développer une quelconque satisfaction des besoins humains. Au contraire, la proportion d'investissements dans les moyens de destruction ne cesse d'augmenter : selon la Banque Mondiale, 10 % des dépenses mondiales d'armements représentent ce que coûterait la résolution du problème de la faim dans le monde ; ces dépenses atteignent aujourd'hui la somme astronomique de plus d'un million de dollars... par minute.
LES DEPENSES MILITAIRES ACCELERENT LA CRISE DU CAPITALISME
"Les armes ont cette particularité majeure de posséder une valeur d'usage qui ne leur permet en aucun cas d'entrer sous quelque forme que ce soit dans le processus de production. Une machine à laver peut servir à reconstituer la force de travail, tout comme du pain ou des chemises. Par le contenu de leur valeur d'usage, ces biens peuvent servir comme capital sous la forme de capital variable. Un ordinateur, une tonne de fer ou une machine à vapeur, en tant qu'ils sont des moyens ou des objets de travail peuvent fonctionner comme capital sous forme de capital constant. Mais des armes ne peuvent que détruire ou rouiller". ("La décadence du capitalisme", p. 75, brochure du CCÏ).
Même pour les pays exportateurs l'armement constitue aujourd'hui moins que jamais un palliatif à la crise. Le coût de l'armement grève la compétitivité de chaque capital national comme en témoigne l'insistance des Etats-Unis à réarmer le Japon et l'Allemagne pour pousser à répartir ce coût.
De plus, la concurrence s'exacerbe sur le marché des armes. Les pays acheteurs deviennent à leur tour des concurrents dans beaucoup de domaines :
"Il est devenu pratiquement impossible d'obtenir des contrats à l'exportation sans accepter de rétrocéder aux clients une partie du savoir-faire". (L'Expansion, p.83, 1er déc.83).
Enfin, les achats ne peuvent se faire que grâce à des prêts des grandes puissances que de plus en plus de pays sont totalement incapables de rembourser. L'armement ne permet pas de retarder les effets de la crise : il ne sert qu'au maintien et à l'accentuation des positions stratégiques dans la rivalité entre Est et Ouest derrière les chefs de file des deux blocs : URSS et USA.
De même que l'URSS fait payer son armement par ses alliés, les USA font payer leur armement grâce à la place particulière du dollar comme monnaie refuge internationale. En drainant par des taux d'intérêts élevés les capitaux spéculatifs sur le dollar les USA font financer leur déficit budgétaire par les autres pays ; de plus,du fait du renchérissement du dollar,ils payent moitié prix leurs achats à ces pays. En 1982, le déficit budgétaire ([1] [475]) américain correspond d'ailleurs exactement au budget de la défense nationale (Survey of Current Business, 7/83). La "reprise" américaine ne repose que sur l'utilisation de la planche à billets, sur du papier, et la pression inflationniste que cela va inévitablement engendrer mène vers une nouvelle poussée d'hyper-inflation menaçant le système monétaire international, danger contre lequel précisément la bourgeoisie avait du réorienter sa politique à la fin des années 1970.
Mais c'est dans l'extension du chômage massif que le capitalisme signe sa faillite complète. Alors qu'avant la 2ème guerre mondiale la production d'armements avait permis une résorption spectaculaire du chômage -de 5 331 000 à 172 000 chômeurs aux USA entre 1933 et 1938, de 3 700 000 à 200 000 en Allemagne-, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le gigantesque accroissement de la productivité des techniques de pointe, le niveau du réarmement actuel des grands pays industrialisés n'a d'effet que négligeable sur le chômage. Celui-ci n' a cessé d ' augmenter et ne peut que s ' accélérer.
Moins que jamais la production d'armements ne fournit un véritable débouché pour le capitalisme. Elle devient une charge de plus en plus lourde pour chaque économie nationale.
MG.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Débat avec Battaglia Comunista sur les thèses de son 5ème congrès
- 2517 reads
COURS HISTORIQUE: LES ANNEES 80 NE SONT PAS LES ANNEES 30
Savoir dans quel sens se dessine 1'histoire, vers où va la société : allons-nous vers une nouvelle guerre mondiale ? Allons-nous, au contraire, vers des affrontements de classe qui poseront la question de la révolution prolétarienne ?
C'est là une question de base, fondamentale, pour quiconque prétend jouer un rôle actif et conscient dans la lutte de classe.
C'est pourquoi, lors de ses congrès, une organisation politique prolétarienne consacre toujours une bonne partie de ses travaux à l'analyse de la situation mondiale, cherchant à cerner le mieux possible quelle est la dynamique générale du rapport de force entre les classes.
Battaglia Comunista (Parti Communiste Internationaliste), a tenu au début de novembre 82 son 5ème Congrès et vient de rendre publics ses travaux dans le n°7 de sa revue Prometeo de juin 1983. La question y est abordée même si c'est en partie pour affirmer qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions
B.C a affirmé dans un texte récent (distribué à la réunion publique du CCI à Naples, en juillet 83) qu'il considère les thèses du dit congrès comme une contribution au débat dans le milieu révolutionnaire et qu'elles"attendent encore d'être discutées dans leur substance politique". Nous ne pouvons discuter ici de toutes les questions abordées par le congrès de B.C ("crise et impérialisme", "tactique d'intervention du parti révolutionnaire la "phase de transition du capitalisme au communisme") sous peine de rester sommaires. Nous nous tiendrons, dans cet article, à la question du cours historique actuel et à ce qui s'en dégage au travers des thèses du congrès de B.C.
PEUT-ON ALLER EN MEME TEMPS VERS LA GUERRE MONDIALE ET VERS LA REVOLUTION ?
A la question de savoir quelle est la perspective actuelle pour la lutte de classe, Battaglia répond que tout ce qu'on peut dire pour le moment c'est que ce sera peut-être la guerre, peut-être la révolution, peut-être les deux. Il n'y a, d'après B.C, aucun élément sérieux qui permette d'affirmer que l'une de ces issues soit plus probable que les autres. Voici un exemple de comment elle formule cette idée.
"L'effondrement général de 1'économie se traduit de façon immédiate par 1'alternative : guerre ou révolution. Mais la guerre elle-même en marquant un virage en soi catastrophique dans la crise du capitalisme et un brusque bouleversement dans les échafaudages superstructures du système, ouvre les possibilités de1'effondrement de ceux-ci et donc 1'ouverture, au sein-même de la guerre, d'une situation révolutionnaire et de la possibilité d'affirmation du parti communiste. Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social, au sein duquel le parti trouvera les conditions de sa croissance rapide et de son affirmation, que ce soit dans la période qui précède le conflit, pendant le conflit ou immédiatement après celui-ci, ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu (exemple polonais). " Tactique d'intervention du parti révolutionnaire/ Prometeo, juin 83.
B.C part d'une idée de base juste et importante: il n'y a pas de "troisième issue". L'alternative est guerre ou révolution et il n'y a aucune possibilité pour le capitalisme de reprendre désormais un nouveau développement économique dans la paix. C'est important, entre autres, face au flot d'illusions "pacifistes" que la bourgeoisie déverse sur le prolétariat des pays industrialisés. Mais, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est insuffisant comme détermination d'une perspective.
Battaglia dit : "Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social (...) ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu".
Mais, ce dont il s'agit ce n'est pas de déterminer le jour et l'heure d'une éventuelle révolution prolétarienne, mais plus simplement et plus sérieusement de savoir si la bourgeoisie mondiale dispose des moyens de conduire le prolétariat des pays industrialisés à une troisième guerre mondiale ou bien si, au contraire, non embrigadée et poussée par la crise, la classe ouvrière se prépare à des affrontements qui poseront la question de la révolution communiste mondiale.
En disant que la situation révolutionnaire peut se produire avant, pendant ou après une prochaine guerre, Battaglia s'avoue incapable de se prononcer sur la perspective historique actuelle.
B.C justifie cette incapacité en disant que la situation de crise économique peut conduire simultanément à l'une ou à l'autre issue historique.
Il y aurait en quelque sorte deux tendances parallèles et ayant des chances égales de se concrétiser l'une corme l'autre. Il est vrai que du point de vue objectif, la crise économique exacerbe simultanément les antagonismes d'intérêt entre les classes sociales et les antagonismes entre puissances capitalistes rivales. Mais l'aboutissement de l'un ou l'autre de ces antagonismes dépend en dernière instance d'un seul et même facteur: la conscience et la pratique du prolétariat.
C'est la même classe, la classe exploitée, qui, soit s'affirme comme protagoniste de la révolution, soit, disloquée, sert de chair à canon et de producteur des moyens matériels de la guerre impérialiste.
L'état d'esprit, la conscience d'une classe, prête à bouleverser 1'ordre social capitaliste et à bâtir une nouvelle société est radicalement différent de celui qui caractérise des ouvriers atomisés, brisés, "solidaires" de leur classe dominante au point d'accepter de s'entretuer sur les champs ide bataille au nom de"leurs" patries respectives. Marcher avec des drapeaux rouges vers la construction d'une humanité unifiée, ce n'est pas la même chose que marcher en rangs par quatre derrière un drapeau national pour égorger les prolétaires du ploc impérialiste adverse. La classe ouvrière ne peut pas partager en même temps ces deux états d'esprit qui s'excluent totalement.
C'est là une évidence que certainement Battaglia accepterait sans réticences. Mais ce qu'elle semble ignorer c'est que les processus qui conduisent à l'une ou l'autre de ces situations s'excluent tout autant.
Le processus qui conduit vers 1'issue révolutionnaire est caractérisé par un dégagement croissant du prolétariat de l'emprise de l'idéologie dominante et un développement de sa conscience et de sa combativité ; celui qui conduit vers la guerre, à l'inverse, se traduit par une adhésion croissante des ouvriers aux valeurs capitalistes ( et à leurs représentants politiques et syndicaux ) et par une combativité qui, soit tend quasiment à disparaître, soit ne s'exprime que dans une perspective politique totalement contrôlée par la bourgeoisie.
Ce sont là deux processus bien différents, antagoniques, s'excluant aussi l'un l'autre.
Quiconque analyse l'histoire en sachant voir le rôle de protagoniste central du prolétariat, sait que la marche vers la guerre ne peut pas être la même que la marche vers des situations révolutionnaires.
Affirmer que les deux processus peuvent se dérouler simultanément sans que l'on puisse déterminer quelle tendance tend à l'emporter, c'est tout simplement raisonner en mettant entre parenthèses, en faisant abstraction de la classe révolutionnaire, de sa conscience et de sa combativité.
COMMENT RECONNAITRE LE COURS VERS LA GUERRE ?
Battaglia clame aujourd'hui être le seul héritier authentique des acquis de la Fraction de la Gauche Italienne pendant l'entre deux guerres. Mais un des mérites principaux de ce dernier courant,qui a traversé sur un terrain de classe la période noire de la contre-révolution triomphante,n'est autre que sa capacité à avoir reconnu lucidement le recul de la révolution dès les années 20 et l'ouverture d'un cours vers la guerre dans les années 30. S'il a été capable de voir dans la guerre d'Espagne et dans les grèves de 36 en France non pas "le début de la révolution en Europe", comme un Trotski pouvait le croire, mais des moments qui s'inscrivaient déjà dans une marche vers la guerre mondiale, c'est parce qu'il avait su raisonner en termes de cours historique et replacer les événements particuliers immédiats dans la dynamique globale du rapport de forces entre classes au niveau historique et mondial. Il suffit de se pencher sur l'histoire des périodes qui ont précédé les deux guerres mondiales pour voir à quel point ces événements majeurs n'ont pas éclaté comme des éclairs dans un ciel bleu, mais furent le résultat d'un processus de préparation au cours duquel la conscience du prolétariat fut systématiquement détruite par la bourgeoisie jusqu'à permettre l'embrigadement des prolétaires.
La Gauche Communiste de France, en 1945, en reprenant la méthode qui fut celle de la Gauche Italienne donna un remarquable résumé de ce que fut ce processus de préparation à la guerre :
"C'est l'arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la. déviation de ses luttes que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, envidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire, en les engageant sur les, rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de 1'éclatement de la guerre impérialiste.
Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.
Ainsi, la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constaté en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la Deuxième Internationale, n'est aient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier, miné et pourri par 1'opportunisme régnant en maître devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.
La réalité ne se traduit pas dans la photo chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates.
On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à 1'ordre chronologique de 1'histoire et présenter la guerre de 1914 comme la cause de 1'effondrement de la 2ème Internationale quand. en réalité, l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste se faisaient sentir d'autant plus extérieurement qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, 1'embourgeoisement des partis de la 2ème Internationale, la substitution de leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de la bourgeoisie nationale.
Ce processus interne de destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans 1'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionné.
L'éclatement de la seconde guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.
On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerre impérialistes.
La première s'achève avec 1'épuisement de la grande vague révolutionnaire de 1'après 17 et consiste dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme a travers de la théorie de la pratique du "socialisme en un seul pays".
La deuxième étape est celle de 1'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue 1'alternative historique du capitalisme/socialisme:1'Allemagne par 1'écrasement physique du prolétariat et 1'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de gauche de Trotski qui, incapable de regroupe le énergies révolutionnaires, s'engage dans la coalition de la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la 4ème Internationale.
La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays "démocratiques". Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a, en réalité, cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de la bourgeoisie nationale, de sa patrie capitaliste. L'anti-fascisme était la plateforme, 1'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres au prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.
Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses, par 1'idéologie anti-fasciste, 1'adhésion des masses la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936. La guerre anti-fasciste espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'Etat en Russie se manifestant entre autres, par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN, son intégration dans un bloc impérialiste et 1'instauration de 1'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des Communistes de Gauche surgis de la crise de l'IC et qui, au travers de 1'adhésion à l'idéologie anti-fasciste à la défense de "l'Etat ouvrier en Russie", sont happés dans 1'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. A l’avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduite quantitativement à de petits îlots négligeables.
L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte qu 'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale". Rapport à la Conférence de juillet de la Gauche Communiste de France.( 1945)
Comme on le voit, le cours historique qui conduit à la guerre a des manifestations spécifiques, prolongées dans le temps et reconnaissables - même si elles ne sont pas "quantifiables" comme le voudrait Battaglia- pour pouvoir se risquer à se prononcer.
On peut, peut-être, affirmer qu'il n'est pas toujours aisé de reconnaître un tel processus, mais c'est tourner le dos aux responsabilités des révolutionnaires, c'est se résigner à l'impuissance et à l'inutilité que de prétendre qu'il est, de façon générale, impossible de déterminer le cours historique.
COMMENT RECONNAITRE LE COURS VERS DES AFFRONTEMENTS DE CLASSE DECISIFS ?
Le processus qui conduit à la création de situations révolutionnaires est très différent de celui qui conduit à la guerre . La marche vers la guerre est un mouvement qui ne rompt pas avec la logique même du système dominant.
Pour les prolétaires, aller à la guerre, c'est aller au bout de leur soumission au capital sur tous les plans... jusqu'au sacrifice de la vie elle-même. Il n'y a pas de changement fondamental dans le rapport entre classe dominante et classe exploitée. Le rapport "normal", dans"les règles de l'ordre" est simplement poussé à une de ses formes les plus extrêmes.
En réalité, le cours qu'on pourrait appeler 'normal ' de la société capitaliste est vers la guerre. La résistance de la classe ouvrière qui peut remettre en cause ce cours apparaît comme une sorte "d'anomalie", comme allant à "contre-courant" d'un processus organique du monde capitaliste. C'est pour cela que, si on examine les huit décennies de notre siècle, on en trouvera à peine un peu plus de deux, au cours desquelles le rapport de forces aura été suffisamment en faveur du prolétariat, pour qu 'il puisse barrer le chemin à la guerre impérialiste (1905-12, 1917-23, 1968-80) ". (Revue Internationale n°21, 2ème trimestre 1980, "Révolution ou guerre").
En ce sens, le cours de montée de la lutte de classe est beaucoup plus fragile, instable et heurté que celui vers la guerre. De ce fait, il peut être interrompu et renversé par une défaite décisive face à la bourgeoisie, alors que le cours vers la guerre ne peut être interrompu, éventuellement, que par la guerre elle-même.
" Alors que le chemin de la victoire est unique pour le prolétariat : 1'affrontement armé et généralisé contre la bourgeoisie; celle-ci dispose de divers moyens pour défaire son ennemi : soit en épuisant la combativité dans des impasses (c'est la tactique présente de la gauche), soit en l'écrasant paquet par paquet (comme en Allemagne 1919 et 1923), soit en l'écrasant physiquement lors d'un choc frontal (qui est toutefois le type d'affrontement le plus favorable au prolétariat)." (ibid.)
Cours vers la révolution et cours vers des affrontements de classe décisifs.
C'est pour tenir compte de cette "réversibilité" du cours vers la révolution que, lorsque nous cherchons à rendre compte de la situation présente, nous préférons parler de "cours vers des affrontements de classe".
" L'existence d'un cours à 'l'affrontement de classe' signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale ; auparavant, elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de 1'issue de cet affrontement, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de 'cours à la révolution'. (Revue Internationale n° 35, Résolution sur la situation internationale, 5ème Congrès du CCI).
C'est pour cela que nous employons moins le terme de "cours vers la révolution"... et non parce que nous aurions bouleversé notre analyse sur la question du cour actuel, comme le prétend Battaglia dans un souci de fausse polémique qui évite les vraies questions (cf. la réponse publique à notre "Adresse aux groupes politiques prolétariens" du 5ème Congrès du CCI).
Le terme de cours vers la révolution se justifie essentiellement en fonction de la nécessité d'affirmer qu'il n'y a pas de troisième issue en dehors du dilemme : guerre ou révolution. Mais, sans autre précision, cette formulation peut laisser entendre une conclusion qui, elle, ne peut être affirmée avec certitude, du moins au stade actuel du développement du cours historique : nous savons que nous allons vers des affrontements de très grande ampleur entre prolétariat et bourgeoisie qui, une fois encore poseront la question de la révolution, et non vers la guerre. Mais on ne peut préjuger de l'issue de cet affrontement.
La révolution PENDANT la guerre ?
L'histoire fournit beaucoup plus d'exemples de situations où le rapport de forces est totalement en faveur de la classe dominante que de périodes où le prolétariat a ébranlé ou limité réellement son pouvoir. De ce fait, il y a moins de références historiques pour définir les caractéristiques de ce que peut être le cheminement vers des affrontements révolutionnaires que dans le cas d'un cours vers la guerre. Et cela est d'autant plus vrai que l'expérience des mouvements révolutionnaires prolétariens importants dans le passé s'est généralement inscrite dans des guerres ou immédiatement après (la Commune de Paris 1871, 1905 et 1917 en Russie, 1918-19 en Allemagne). Or, la guerre crée des conditions telles que, même si, comme en 1914-18, elle provoque le développement d'une vague de luttes révolutionnaires, celle-ci ne parvient pas - du fait même de la guerre - à devenir véritablement internationale.
La guerre peut provoquer des mouvements révolutionnaires et cela de façon extrêmement rapide :
les premières grèves significatives en Russie et en Allemagne ont lieu en 1915 et 1916 ; la révolution éclate "à peine" deux ou trois ans après. Deux ou trois ans qui sont cependant des périodes de guerre mondiale, d'histoire accélérée qui équivalent, au niveau du rapport entre les classes, à des décennies d'exploitation et de crise "pacifique" .
Cependant, ".cette même guerre impérialiste (1914-18) portait e elle toute une série d'obstacles à la généralisation des luttes révolutionnaires à 1'échelle mondiale :
- la division entre pays belligérants et pays "neutres" : dans ces derniers pays, le prolétariat ne subit pas de dégradation massive de ses conditions de vie;
- la division entre"pays vainqueurs" et "pays vaincus": dans les premiers, le prolétariat a été le plus souvent une proie facile pour la fierté chauvine déversée massivement par la bourgeoisie; dans les seconds si la démoralisation nationale créait de meilleures conditions pour le développe ment de 1 'internationalisme, elle ne fermait pas la porte, au contraire, au développement de sentiments de revanche (cf. le "national bolchevisme" en Allemagne) ;
- face à un mouvement révolutionnaire né de la guerre impérialiste, il restait comme recours à la bourgeoisie d'interrompre celle-ci (cf. Allemagne en novembre 1918) ;
- une fois la guerre impérialiste terminée, la possibilité de reconstruction qui s'offre au capitalisme et donc d'une certaine amélioration du fonctionnement de son économie a brisé 1'élan prolétarien en le privant de son aliment de base : la lutte économique et le constat de faillite du système.
Par contre,le développement progressif d'une crise générale de l'économie capitaliste, s'il ne permet pas une prise de conscience aussi rapide des véritable enjeux de la lutte ni de la nécessité de 1'internationalisme, élimine cependant les obstacles énumérés ci-dessus en se sens :
- qu'il tend à mettre le prolétariat de tous les pays sur un même plan : la crise mondiale n'épargne aucune économie nationale,
- qu'il n'offre à la bourgeoisie aucune porte de sortie sinon celle d'une nouvelle guerre impérialiste qu'elle ne pourra déchaîner tant que le prolétariat n'aura pas été battu". (Revue Internationale numéro 26, 3ème trimestre 81, "Résolution sur la lutte de classe" du 4ème Congrès du CCI).
L'histoire ne peut donc fournir toutes les caractéristiques de ce que peut être un cours ascendant de lutte en une période comme l'actuelle, caractérisée non par la guerre mais par un lent enfoncement de la société dans la crise économique.
On peut cependant identifier un tel cours, premièrement de façon "négative", c'est-à-dire par le fait qu'il ne possède pas les caractéristiques essentielles du cours vers la guerre ; deuxièmement, par le fait qu'il est marqué aussi bien par un dégagement de la part du prolétariat de l'emprise de l'idéologie dominante que par un développement de sa propre conscience et combativité de classe.
LE COUPS HISTORIQUE ACTUEL
Le 5ème congrès de Battaglia ne se prononce pas véritablement sur les perspectives de la lutte de classe. Il maintient un flou tout comme le 2ème congrès du PCInt. en. 1948 sur la rnême question. (Voir article dans ce numéro). Mais à propos de la situation actuelle les thèses du congrès affirment : "Si aujourd'hui le prolétariat, face à la gravité et aux coups subis par les attaques répétées de la bourgeoisie, ne s 'est vas encore montré en mesure de répondre, cela signifie seulement que le long travail de contre-révolution mondiale est encore à 1'oeuvre au sein des consciences ouvrières". (Synthèse du rapport de politique générale)
Battaglia n'a jamais compris l'importance de la rupture historique avec la contre-révolution que constitua la vague de grèves ouverte par 1968 en France. B.C considère qu'en réalité aujourd'hui, tout comme dans les années 30, "le long travail de la contre-révolution mondiale est encore à 1'oeuvre au sein des consciences ouvrières".
Dans une grande mesure B.C ne voit pas encore la différence qualitative qu'il y a entre les années 80 et les années 30. Elle ne perçoit pas comment le fait que la crise économique détruise systématiquement les mystifications idéologiques qui écrasent le prolétariat et qui ont permis dans le passé de l'embrigader dans la guerre, crée des conditions historiques qualitativement différentes pour la lutte prolétarienne.
"Le fait - disent les thèses du 5ème congrès de B.C. - d'avoir cédé pendant des décennies à l'opportunisme, en un premier temps, à la contre-révolution des partis centristes ensuite, le fait d'avoir subi le poids de 1'écroulement des mythes politiques comme celui de la Russie et de la Chine, la frustration d'espérances émotivo-politiques comme celles créées artificiellement avec la guerre du Viêt-Nam, a engendré dans le choc avec cette vaste et destructrice crise économique, un prolétariat fatigué et déçu, mais pas pour autant vaincu définitivement ". (idem)
Il est normal que B.C. constate, au moins, que depuis la 2ème guerre mondiale le prolétariat n'a pas été massivement écrasé et n'est pas "vaincu définitivement". Mais au delà de cette constatation B.C. ne continue à voir dans le prolétariat et ses luttes que le "long travail de la contre-révolution", la fatigue et la déception.
Qu'en est-il en réalité ?
Comme on l'a vu précédemment, l'existence d'une combativité ouvrière ne suffit pas à caractériser un cours vers des affrontements révolutionnaires : les luttes à la veille de la 1ère guerre mondiale, imbues d'esprit réformiste, d'illusions sur la démocratie et sur une intarissable prospérité capitaliste, celles de la 2ème moitié des années 30 détournées et annihilées dans l'impasse de"l'anti-fascisme" et donc de la défense d'un capitalisme "démocratique", démontrent que sans développement de la conscience prolétarienne la combativité de classe ne suffit pas à entraver le cours vers la guerre.
Depuis la fin des années 60, la combativité ouvrière a connu aux quatre coins de la planète, à travers des périodes de recul et de reprise, un renouveau qui tranche sans équivoque avec les périodes précédentes. De Mai 68 en France à la Pologne de 1980-81 la classe ouvrière a démontré que loin d'être déçue et fatiguée, elle possédait des potentialités de combat intactes et qu'elle savait les rendre effectives.
Mais qu'en est-il au niveau de sa conscience ?
On peut ici distinguer deux processus qui, tout en étant étroitement liés n'en sont pas pour autant identiques. Il y a d'une part le développement de la conscience prolétarienne par son dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante et, d'autre part, le développement "en positif" de cette conscience par l'affirmation de 1'autonomiefde l'unité et de la solidarité de classe.
Sur le premier plan, la crise économique et ses effets dévastateurs qu'aucun régime, d'Est ou d'Ouest, aucun parti au gouvernement de droite ou de gauche ne parvient à enrayer, ont porté les plus rudes coups aux mystifications bourgeoises sur la possibilité d'un capitalisme éternellement prospère et pacifique, sur le "Welfare state", sur la nature ouvrière des pays de l'Est et autres régimes soi-disant "socialistes", sur la démocratie bourgeoise et le vote comme moyen de "changer les choses", sur le chauvinisme et le nationalisme dans les pays les plus industrialisés, sur la nature ouvrière des partis de gauche et leurs centrales syndicales... (nous renvoyons nos lecteurs à nos textes qui ont plus largement développé cette question, en particulier "le cours historique", rapport adopté par le 3ème congrès du CCI -Revue Internationale N° 18, 3ème trimestre 1979).
Sur le 2ème plan, le développement "en positif" de la conscience de classe, celui-ci ne peut être évalué qu'en regard des manifestations de lutte ouverte du prolétariat considérées non pas de façon locale ou statique mais dans leur dynamique au niveau mondial. Or, les luttes des 15 dernières années de mai 68 aux grèves du secteur public en Belgique en septembre 83, si elles n'ont pas encore atteint des degrés de conscience révolutionnaire généralisée -ce qu'il serait enfantin de leur exiger au stade actuel de leur développement- n'en sont pas moins marquées par une nette évolution vers l'autonomie à l'égard des appareils d'encadrement de la bourgeoisie (syndicats, partis de gauche) et vers des formes d'auto organisation et d'extension de la lutte. Le seul fait que la bourgeoisie soit de plus en plus systématiquement contrainte d'avoir recours au "syndicalisme de base", surtout dans les "pays démocratiques" pour contenir et dévoyer la combativité ouvrière, parce que le mouvement de désyndicalisation s'accélère et que les directions syndicales sont de moins en moins capables de se faire obéir, suffit à lui seul à démontrer le sens de la dynamique de la conscience ouvrière. Contrairement à ce qui s'est produit dans les années 30, où les luttes se sont accompagnées d'un développement du syndicalisme et de l'emprise des forces bourgeoises sur le mouvement, les luttes de notre époque tendent à affirmer leur autonomie et leur capacité d'extension par dessus les barrières que ces forces leur opposent.
Il reste, bien sûr, encore un long chemin à parcourir au prolétariat pour parvenir à l'affirmation de sa conscience révolutionnaire pleinement épanouie. Mais s'il faut attendre que ce point soit atteint pour se prononcer sur le sens du mouvement actuel, -comme semble le faire Battaglia -il faut renoncer à toute analyse sérieuse du cours historique présent.
Le 5ème congrès de B.C semble avoir consacré beaucoup d'efforts à l'analyse de la crise économique actuelle. Et c'est là un aspect important pour la compréhension de l'évolution historique présente -à la condition toutefois que cette analyse soit correcte, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais la meilleure analyse économique devient inutile pour une organisation révolutionnaire si elle ne s'accompagne pas d'une juste appréciation de la dynamique historique de la lutte de classe. Et dans ce domaine le congrès de B.C se présente avec plus de 40 ans de retard.
A en juger par les travaux de son 5ème congrès, tout indique, que Battaglia, au niveau de son analyse de la lutte de classe, n'est pas encore entrée dans les années de vérité, les années 80.
R.V.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [449]
Questions théoriques:
A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5eme congres du CCI
- 2490 reads
REPONSE AUX REPONSES
A son 5ème Congrès International,le CCI a adressé à tout le milieu politique prolétarien un Appel (cf. Revue Internationale n°35) pour qu'il prenne conscience de ses responsabilités dans la gravité de la situation historique actuelle. Les contradictions destructrices du système capitaliste, aiguisées par la crise mondiale, précisent chaque jour davantage 1'alternative devant la classe ouvrière : guerre ou révolution. "Mais 1'avant-garde politique du prolétariat, au lieu de servir de phare dans la tourmente sociale qui se développe, est au contraire souvent ballottée par les événements incapable de dépasser son éparpillement et son sectarisme qui sont le legs de la contre-révolution." (Adresse du 5ème Congrès).
L'"Appel" du CCI ne contient pas de solution miracle à cette situation. Nous avons voulu insister sur le fait que 1'intervention dans les luttes et surtout la préparation aux combats futurs "ne sauraient être assurées par une simple somme d'efforts de chaque groupe pris individuellement. Il s'agit d'établir une coopération consciente entre toutes les organisations non pas pour réaliser des regroupements hâtifs, artificiels, mais pour engendrer une volonté et une démarche qui donnent toute son importance à un travail systématique de débats, de confrontations fraternelles entre forces politiques prolétariennes". (Ibid.).
Nous avons dit clairement dans l "Adresse" : "l'heure n'est pas venue pour l'appel à des nouvelles conférences des groupes communistes." Après l'échec des Conférences Internationales de 1977 à 1980, il s'agit aujourd'hui d'en tirer les leçons et poursuivre par d'autres moyens le débat sur les questions politiques qui restent à clarifier, notamment la question sur laquelle les Conférences se sont disloquées sans clarté réelle : le rôle, la fonction du futur parti du prolétariat.
Nous allons répondre ici brièvement aux propositions qui nous ont été faites et aux arguments mis en avant par ceux qui ont répondu.
Il faut dire tout de suite que le fait même que des organisations politiques aient ressenti le besoin de répondre et de s'expliquer est déjà une chose positive. Nous sommes contents de constater que les organisations politiques du prolétariat ne sont pas sourdes.
Mais les révolutionnaires ont beau être optimistes par nature, nous avons parfois la fâcheuse impression que les réponses à 1'"Adresse" expriment moins une conviction profonde qu'une réaction "réflexe" : on sauve la face en répondant mais on se lave les mains par ailleurs en n'allant pas au POND de la question. On continue à penser dans son for intérieur : si d'autres organisations ont des problèmes, tant mieux ! Qu'elles débarrassent le plancher au plus vite. Chacun construit "son" parti et défend "son" territoire. On est pour la confrontation des positions politiques, bien sûr, mais c'est plutôt un "pourquoi pas". On ne la considère pas comme une nécessité vitale, une activité à part entière.
On se réveille à la nécessité de penser ou agir collectivement seulement quand il y a des événements ponctuels, mais comme activité systématique, comme préoccupation constante, on ne comprend toujours pas.
On continue à opposer l'intervention dans la classe" à l'intervention "dans le milieu", cette dernière étant vue comme une activité annexe, voire stérile, même si on ne le dit pas à haute voix. Pourtant, si les groupes politiques étaient réellement convaincus que :
- la conscience de classe ne vient pas de l'extérieur de la classe elle-même et n'est pas injectée de dehors comme le prétend la position léniniste de "Que faire ?" ;
- la classe ouvrière donne naissance à son milieu politique pour que les idées de la classe puissent s'exprimer et se clarifier ; alors, tous les groupes comprendraient dans les faits, et pas seulement dans des phrases, que les débats dans le milieu sont le reflet des besoins de la classe. Ils comprendraient que les discussions ne sont pas superflues et que les thèmes de débat ne sont pas le fait du hasard. Ils comprendraient enfin que la clarification nécessaire à la classe ouvrière internationale doit aussi s'exprimer dans un mouvement vers la clarification de son milieu politique. Il ne suffit pas de faire la comptabilité des groupes en voie de disparition dans le milieu comme si on assistait à un "match" macabre : sans la clarification réelle des erreurs, le milieu dans son ensemble continuera à traîner des incompréhensions qui nuiront inévitablement à la possibilité d'une révolution victorieuse.
Aujourd'hui, on reconnaît qu'une décantation de grande envergure se produit dans le milieu politique. Les groupes politiques sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Mais ils sont passifs face à ce processus. Ils ne reconnaissent pas la nécessité d'une clarification consciente active pour faire en sorte que cette décantation ne soit pas une pure perte. Ils ne reconnaissent pas non plus que c'est le sectarisme et la peur qui ont saboté les Conférences Internationales, empêchant le milieu politique prolétarien de s'assumer consciemment. Aujourd'hui, seule la confrontation des positions peut aider tous les groupes à évoluer vers une cohérence politique et à assurer une intervention à la hauteur des exigences historiques.
Nous avons reçu des lettres du Communist Bulletin Group (Grande-Bretagne) , du Groupe Communiste Internationaliste (Belgique), de la Communist Workers’Organisation (Grande-Bretagne) et du PCI-Battaglia Comunista (Italie) . Le Fomento Cforero Revolutionario nous promet une réponse en décembre 83. Les éléments du Groupe Volonté Communiste prévoient un bilan de leur trajectoire politique pour bientôt. En commençant par le petit bout...
COMMUNIST BULLETIN GROUP (Grande-Bretagne)
Comment distinguer le bavardage d'un discours sincère ? En s'assurant que les paroles se concrétisent par des actes en conséquence. Talk is cheap (parler n'engage à rien). Le CBG écrit : "Nous voulons exprimer notre solidarité avec la démarche et les préoccupations exprimées dans 1'Adresse. " ; "Le débat ouvert, fraternel et constant, est une nécessité matérielle pour le milieu révolutionnaire" ."Nous devons combattre pour la reconnaissance de 1'existence d'un milieu politique prolétarien.". (Lettre du CBG). Parfait ! Le seul hic -et il est de taille- c'est que, à l'origine de ce groupe,se trouve 1'ex-section du CCI d'Aberdeen (également ex-section de la CWO ; ce sont les mêmes) qui a couvert et justifié le vol du matériel et de 1 ' argent du CCI en péchant dans les eaux troubles de Chénier (Voir Revue Internationale n°28) . Ces "camarades" ont eu connaissance des manoeuvres de Chénier pendant des mois et ils ont justifié le vol une fois celui-ci accompli, comme "normal en cas de scission". Notre condamnation de ces pratiques était qualifiée de "réaction de petits bourgeois propriétaires". Jusqu'à aujourd'hui, le CBG dans son ensemble a justifié politiquement ces actes et ces prises de position. Jusqu'à aujourd'hui, il a refusé de nous rendre ce qu'il a pris lui. Dans les premiers numéros de The Bulletin, il se revendiquait de ce comportement en se vautrant dans le colportage de racontars aussi vils que stupides contre le CCI. Maintenant, (sans doute en voyant que l'attitude précédente n'a pas mené au résultat escompté) il essaye de se blanchir les mains en défendant hypocritement "la nécessité de polémiques saines". Que le ton soit hystérique ou douceâtre ne change rien au fait qu'on ne peut lire nulle part dans la presse du CBG un désaveu politique du vol qui a été à l'origine du groupe.
Comment oser parler de"solidarité", de "reconnaissance du milieu politique du prolétariat" quand le fondement n'existe pas? Le CBG a le toupet d'oser nous écrire : "L'existence de ce milieu engendre une communauté d'obligations et de responsabilités".
Mais cela se traduira en vol le jour où vous serez en désaccord avec le CBG et il justifiera le vol comme "anti-petit-bourgeois". Peut-être pourrions-nous le formuler ainsi : quand on scissionne, on peut voler ce qu'on veut, mais quand on a enfin un groupe à soi, enfin maître chez soi... 1!accession à la propriété assagit les petits voyous. Ou peut-être en ayant attiré vers eux de nouveaux camarades, les anciens espèrent-ils se cacher derrière. Changez de nom, changez de vie. Ce n'est pas sérieux. S'il y a des camarades un tant soit peu sincères dans le CBG, la moindre des choses serait qu'ils fassent un effort pour comprendre et agir en conséquence. On ne peut pas parler de reconnaître- l'existence du milieu politique dans un texte et faire le contraire dans les faits.
Quand El Oumami a scissionne du PCI en volant du matériel en France, nous avons montré une solidarité sur cette question primaire. Nous aurons à l'avenir la même attitude de défense du milieu politique prolétarien contre les attaques destructrices quel que soit le groupe concerné. Au moins dans le cas d'El Oumami, ce dernier avait-il des positions politiques gauchistes cohérentes avec ses actes. Mais qu'en est-il pour le CBG ?
Quelles sont les positions du CBG ? Celles (plus ou moins) du CCI ! Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. Que représente-t-il face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus. Mais il y a sans doute une évolution dans l'air. La plupart des petits cercles qui scissionnent sans avoir préalablement clarifié les positions commencent par suivre le chemin de la facilité en adoptant la même plateforme que le groupe d'origine. Mais bientôt, pour justifier une existence séparée, on découvre maintes questions secondaires divergentes et à la fin on change les principes. Ce fut le cas du PIC (Pour une Intervention Communiste, aujourd'hui disparu), du GCI dans une certaine mesure, et le CBG prend déjà le même chemin en rejetant la cohérence sur la question de l'organisation. Cependant, cela ne nous a jamais empêchés de polémiquer avec ces autres groupes, ni de les considérer comme partie du milieu prolétarien en général, ni d'en inviter certains aux Conférences Internationales. Mais il n'en va pas de même pour le CBG. Un groupe politique qui ne respecte pas "la communauté des obligations et responsabilités" au point de participer aux actes visant à nuire à d'autres organisations du prolétariat, se met de lui-même en dehors du milieu politique et mérite l'ostracisme qu'il recueille. Jusqu'à ce que la question fondamentale de la défense des organisations politiques du prolétariat ne soit comprise, nous répondons par une fin de non-recevoir à la lettre du CBG. Ils se sont trompés d'adresse.
GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE (Belgique)
Le GCI nous écrit : "Nous sommes donc principiellement en accord avec la nécessité du regroupement, de la centralisation mondiale des forces communistes sur base du programme. Mais ceci signifie pour nous non pas le primat de la conscience sur 1'être (préalable des discussions et échanges d'idées), mais la nécessité d'une convergence réelle pratico-théorique comme base, comme ciment sur lequel les débats et polémiques peuvent et doivent se développer. C'est pourquoi, nous formulons de réelles propositions de travail et non les éternelles palabres en circuit fermé que ont, pour 1 'instant, vos réunions publiques :
1) Nous estimons qu'il est vital que le peu de groupes ouvriers développent ensemble des mesures et des pratiques élémentaires de sécurité et de solidarité afin d'opposer un front compact aux attaques de plus en plus virulentes de la répression étatique et para-étatique. Qu'en pensez-vous ?
2) Face à 1'importante vague de luttes que nous venons de connaître et au rôle de briseurs de grève qu'ont une fois de plus joué les syndicats, nous estimons qu'il est fondamental et opportun de développer une campagne de propagande, d'agitation, d'actions, centrées sur cette question : syndicats=briseurs de grève ; organisation autonome en dehors et contre eux ; solidarité avec les victimes de la répression, etc. Nous pensons que c'est sur ce terrain, et uniquement sur celui-là que se démontre la réelle volonté de lutte". (Lettre du GCI, 29/9/83).
Nous n'avons rien contre les actions communes s'il se présente des situations qui les requièrent. Sur la défense des organisations politiques du prolétariat, au moins, nous partageons le soucis du GCI et telle a toujours été notre pratique (la prise de position de la section du CCI en Belgique face aux calomnies d'Amada maoiste contre le GCI ; la position sur Chénier ; contre les attaques d'El Oumami à la Fête de LO en France). D'autres cas peuvent se présenter. Cependant, pour nous, l'efficacité de ce "type d'actions" ne relève pas d'une préparation contre la répression "en soi" (groupes de défense ? préparation militaire ?) ni de fronts sans principes pour la défense des victimes, mais d'accords de principe solides sur l'existence et la nécessité de la défense du milieu prolétarien. Ceci ne peut pas se faire "uniquement sur le terrain d'actions" mais en passant nécessairement par ce que le GCI voit comme les "éternelles palabres" -discussions et débats, prises de position publiques dans nos réunions, dans la presse, etc. Il en est de même pour la dénonciation des syndicats : pour nous, celle-ci ne se réduit pas à des bombages ou "campagnes de propagande". Nous ne connaissons que trop ce que sont les "campagnes" dont le PIC fut si friand pendant des années et qui ne font que cacher la confusion et l'incapacité d'un véritable travail révolutionnaire. La dénonciation des syndicats est un travail de longue haleine requérant un cadre permettant que l'intervention ne soit pas une agitation ponctuelle, mais s'intègre dans une activité constante de presse, tracts, grèves, manifestations, etc., et ceci au niveau international. Mettre en avant les "projets d'actions communes" comme base, c'est mettre l’activité révolutionaire sur la tête et la conduire au casse-gueule.
Il semblerait que le GCI tombe dans l'idée que l'agitation est le"seul terrain"de la confrontation. Une telle démarche introduit en permanence une séparation entre "théorie" et "action" qui mène en fait la théorie dans les ornières d'un académisme stérile, et d'autre part 1'"action" dans celles non moins stériles de l'activisme. Cette logique mènerait au bout du compte à priver la lutte de classe de son arme essentielle, la prise de conscience.
Le GCI nous accuse d'idéalisme, d'hégélianisme, de donner "le primat de la conscience sur 1'être". Dans la réponse de la section du CCI en Belgique à la lettre du GCI (Internationalisme, déc.83), nous avons écrit : "Tout comme un homme ne respire pas pour respirer, mais pour vivre, le CCI, s'il existe et discute, ce n'est pas pour discuter comme dans un salon de thé, mais pour dégager une intervention claire au sein des luttes. L'alternative n'est donc pas entre la théorie ou la pratique, mais la question est de savoir quelles interventions, sur quelles bases, sur quelles positions ?
Tout comme ce fut au nom du primat de 1’être sur la conscience que 1'IC fit passer sa politique de front unique, c'est au nom de ce même argument que le PCI interdisait toute discussion et intervention politique dans la lutte des immigrés, que le GCI a fait un foin autour de comités fantômes disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus (France) et a fait expulser de fait le CCI du comité de chômeurs de Bruxelles, car il fallait choisir entre 'coller une affiche ou discuter de la décadence',
Nous avons vu le résultat de toutes ces démarches : la faillite de 1'IC, 1'éclatement du PCI, la disparition de tous les comités du GCI, une scission dans ce même GCI... Cette logique qui veut à tout prix que 1'agitation soit le seul terrain de la confrontation mène à 1'apolitisme et à l'activisme". (Réponse d'Internationalisme).
Nous ne refusons pas des actions communes ; ajoutons même que le mouvement de grèves en Belgique en septembre 83 aurait requis de telles actions. Mais elles ne s'improvisent pas ; elles nécessitent une analyse et un accord politique commun qui passent nécessairement par ce que le GCI appelle des"éternelles palabres".
Si nous nous sommes attardés autant sur les implications de la démarche de la lettre du GCI, c'est parce que cette démarche n'est pas propre à ce groupe. Loin de là. Combien de fois n'entendons-nous pas des groupes dire: "de toute façon, chacun a ses positions ; personne ne va changer ; alors pourquoi parler?" Et dans la mesure où des groupes politiques ne cherchent pas à défendre leurs positions par des arguments rationnels et dans un cadre de principes, mais plutôt à se fuir et à s'ignorer les uns les autres, le milieu politique du prolétariat stagne effectivement. Alors, certains concluent, comme le GCI, qu'il faut se rapprocher par des "actions ponctuelles" (en ce sens, le bilan que nous promettent les éléments du GVC, ex-PIC, sera très intéressant sur ce point) ; d'autres,au contraire,veulent bien polémiquer, mais à condition qu'aucune prise de position commune ne ressorte ; c'était le cas dans les Conférences Internationales "muettes" (Voir Bévue Internationale n°17) . Et voila l'impasse.
BATTAGLIA CQMUNISTA (PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE, Italie)
Ce groupe, avec ses racines dans la Gauche Italienne, sa plateforme, est un groupe révolutionnaire qui représente un courant d'idées sérieux dans le milieu politique. Sa volonté de polémiquer, de confronter les positions politiques dans la presse et les réunions publiques est un fait indiscutable. Battaglia a participé à une réunion publique du CCI à Naples sur le thème "Crise du milieu révolutionnaire : comment répondre ?", en élaborant un document pour l'occasion. Ensuite, il a répondu à notre adresse par une lettre envoyée à tous les groupes qui ont participé aux Conférences Internationales.
Battaglia commence cette réponse en critiquant le CCI : "Nous refusons la conception du CCI relativement au camp révolutionnaire lui-même. C'est-à-dire, qu'il n 'est pas clair en ne distinguant pas camp révolutionnaire et camp des forces politiques prolétariennes". Si on entend par "organisations révolutionnaires" les groupes munis d'une plateforme politique cohérente, avec une structure organisationnelle et une intervention régulière et systématique dans la lutte de classe et si on entend par "milieu politique prolétarien" les groupes révolutionnaires, mais aussi des groupes sans plateforme, sans cohérence, sans racines historiques, qui, dans une mouvance générale, se réclament du prolétariat, nous pouvons être d'accord. Malgré des erreurs occasionnelles de vocabulaire, nous avons toujours défendu la nécessité de cette distinction. C'est pour cela que nous avons tant insisté auprès de Battaglia en 1977 pour que les Conférences Internationales se délimitent par des critères politiques clairs.
Malheureusement, Battaglia utilise cette distinction à sa manière : "Qui est en crise ? Certainement le CCI. Certainement le PCI. Certainement pas les forces (peu nombreuses) qui ont évalué la situation et les problèmes de 1'expérience polonaise, qui n'ont pas été victimes de positions mécanistes ou idéalistes, et qui ont en substance, de solides positions doctrinaires" (sic) ([1] [477]). "Ce n'est pas une crise du milieu révolutionnaire, mais un nettoyage? Du camp prolétarien". Merci pour lui. Alors quelles sont les organisations du vrai camp révolutionnaire ? Ta. CWC ? si on en juge par sa surestimation de la lutte de classe en Pologne (lorsqu'elle appelait les ouvriers à "la révolution maintenant !"), ce n'est pas elle non plus l'heureuse élue. Mais Battaglia se tait à ce sujet. Il reste... Battaglia ! Il faut croire que le triste aboutissement de la mélomanie du PCI-Proqramma n’a rien appris à Battaglia.
Mais attendez. Il veut bien réhabiliter la CWO. L'objectif de toute cette argumentation est de justifier l'élimination du CCI des Conférences Internationales. Les polémiques dans la presse, c'est pour le milieu "vaste et agité", mais les Conférences sont "pour le travail vers la formation du parti". Selon Battaglia, et la CWO, au fur et à mesure des trois Conférences, ils se sont aperçus que le CCI ne défend pas la même position qu'eux sur le Parti. Face à cette révélation, BC a "assumé la responsabilité qu'on est en droit d'attendre d'une force sérieuse dirigeante"(sic) en introduisant, sur cette question, un critère sélectif supplémentaire inacceptable par le CCI. Que BC et ses amis cessent de jouer la candeur surprise. Depuis toujours, depuis bien avant les Conférences en 1977, le CCI n'a jamais eu une position léniniste sur le Parti. Si c'est cela qui a empêché les Conférences de continuer, il ne fallait pas les commencer. Quant à "assumer sa responsabilité", nous citons un extrait de notre lettre de juin 1980 :
"Faut-il considérer que votre décision d'éliminer le CCI n'a été prise qu'au cours de la Conférence elle-même ? Si tel était le cas, on ne pourrait que rester pantois devant votre sous-estimation irresponsable de l'importance tant d'une telle décision que des Conférences elles-mêmes et devant votre démarche improvisée et précipitée qui tournerait complètement le dos aux exigences d'un travail patient et systématique qui est tellement indispensable aux révolutionnaires.
Mais, à la Conférence, vous avez affirmé qu'il ne s'agissait nullement d'une décision improvisée mais que vous aviez déjà évoqué ,dans le passé, la nécessité d'une 'sélection'. Faut-il vous rappeler, camarades, que lors de la réunion du comité technique de novembre 79, nous vous avons clairement interrogés sur vos intentions quant à l'avenir des conférences ainsi que sur votre apparente volonté d'écarter le CCI et que c'est tout aussi clairement que vous avez répondu être favorables à leur poursuite avec tous les participants y compris le CCI,
Si, effectivement, vous pensiez qu'il était temps, d'introduire un critère supplémentaire beaucoup plus sélectif pour la convocation de futures conférences, la seule attitude sérieuse, responsable et compatible avec le souci de clarté et discussion fraternelle qui doit animer les groupes révolutionnaires, aurait été de demander explicitement que cette question soit mise à l'ordre du jour de la Conférence et que des textes soient préparés sur cette question. Mais, à aucun moment au cours de la préparation de la 5ème Conférence, vous n'avez explicitement soulevé une telle question. Ce n'est qu'à la suite de tractations de coulisse avec la CWO que vous avez en fin de conférence lancé votre petite bombe." (Procès Verbal de la 3ème Conférence des Groupes de la Gauche Communiste, p. 2 de la lettre du CCI).
Et après avoir écarté le CCI, B.C et la CWO font une 4ème Conférence, point culminant de la décantation du "camp prolétarien" vers le "camp révolutionnaire", de la formation du Parti, avec le SUCM, ("Supporters étudiants du Mouvement de l'Unité Communiste"), un groupe qui est en voie de "former le Parti" en Iran avec le Komala qui pratique la lutte armée pour la libération du Kurdistan en alliance militaire avec le PDK (Parti Démocratique Kurde). Quel est ce groupe avec lequel B.C a "pris ses responsabilités" ? Selon les lettres que B.C a envoyées au SUCM en juillet et septembre 83, l'UCM "sous-estime le défaitisme révolutionnaire", et sa position de "défense des acquis de la révolution (islamique) n'exclut pas la participation à la guerre Iran/Irak". L'UCM défend les guerres "justes" et B.C fait la leçon à ses étudiants "supporters" sur comment comprendre la baisse du taux de profit sur trois pages de sa lettre. Bien sûr, B.C proteste contre le "social-chauvinisme" de l'UCM - mais si gentiment- et il chuchote au SUCM de ne pas, tout de même, aller jusqu'à la défense de l'Etat.
Au CCI, B.C écrit en parlant de notre "incapacité congénitale", notre "inconsistance théorique", que "seuls des militants incompétents et incurables" peuvent avoir nos idées. Au SUCM, il écrit par contre quelque chose dans le style : "Permettez-nous de vous dire, chers camarades, que l'organisation dont vous êtes les supporters pourrait être caractérisée par un net penchant stalinien (osons-nous le dire ! ) ". Que de douceurs pour nos frères "en évolution" du Tiers-Monde. Pour le CCI n'importe quelle grossièreté suffirait. La seule fois où B.C perd son calme, c'est quand il apprend que l'UCM a fait une réunion du "Comité International de Solidarité avec l'Iran"... "pour fêter la constitution d'un comité pour la construction du Parti Communiste de 1' Iran" une réunion en Italie avec le 'Nuclei', 'Lega Leninista’ et d'autres, mais sans B.C !
En réalité, le vrai problème de B.C et de la CWO (qui le suit fidèlement), ce n'est pas d'établir une distinction entre camp prolétarien et camp révolutionnaire, mais de ne pas voir la différence entre camp prolétarien et camp bourgeois. Au moins le SUCM semble-t-il plus clair ; il écrit à BC : "soit vous êtes avec le CCI, soit vous êtes avec nous".
Aujourd'hui, B.C semble vouloir faire un peu machine arrière sur le SUCM et il envoie à différentes organisations la correspondance qu'il a échangée récemment avec ce groupe. Mais dans sa lettre de réponse à l'Appel du CCI, il s'obstine à défendre sa démarche. Un pas en avant, deux pas en arrière.
Comment se fait-il qu'une organisation politique comme B.C avec toute son expérience ait pu se laisser entraîner dans un flirt avec le SUCM, un groupe de supporters des organisations bourgeoises, style stalinien ?
Il est vrai que les organisations politiques ne sont pas infaillibles. Mais il ne s'agit pas ici d'une erreur d'enthousiasme à propos d'un groupe inconnu. Depuis plus d'un an et en connaissance de cause, nous mettons BC et la CWD en garde contre le contenu bourgeois des positions politiques du SUCM. Aujourd'hui, la fusion en cours entre UCM/ Iran et Komala, les communiqués militaires que nous recevons du SUCM sur la lutte armée en Iran (combien de tanks détruits, combien de personnes tuées pour la libération du Kurdistan) ainsi que des documents et des tracts en langage stalinien ne laissent aucun doute (pour des militants qui ne seraient pas "incompétents ou incurables") à leur sujet. Le seul doute qui existe à propos du SUCM c'est de savoir exactement qui est derrière. B.C ne s'est jamais posé la question de savoir d'où venaient les fonds énormes dont dispose ce groupe de dissidents iraniens, capable de couvrir en un an et demi tous les pays principaux d'Europe avec sa propagande ? D'où vient son intérêt à pénétrer les petits groupes du milieu prolétarien actuel sans influence par rapport aux objectifs de Komala ? Le SUCM est un groupe très "fin" qui sait parler le langage de tout un chacun dans le milieu, qui sait flatter les flatteurs.
Il n'est pas, comme prétend toujours B.C, un "groupe en évolution". Comment un groupe venant du stalinisme, en alliance avec la bourgeoisie, peut-il "évoluer" vers le prolétariat ? Cette frontière de classe est infranchissable pour une organisation politique. A force de patauger dans cette boue, c'est B.C et la CWO qui vont évoluer vers la bourgeoisie. "Savoir faire une ligne de démarcation nette vis-à-vis des groupes infestés de social- patriotisme c'est le minimum que nous puissions exiger d'organisations du sérieux et de 1'importance de B.C et du CWO." (Rivoluzione Internazionale, n°33, nov.83)
BC s'est laissée prendre par le bout du nez parce que le SUCM, UCM et Komala parlent du parti, et BC et la CWO sont obnubilés par le mot "parti". Ils venaient d'écarter le CCI sous prétexte que nous serions "contre le parti" ; alors combien attirant était cet SUCM exotique "pour le parti". Que ce soit le parti bourgeois du nationalisme kurde n'est que secondaire.
B.C s’est trompe parce qu'il a un penchant (peut-on dire "congénital") pour les opérations opportunistes. D'après leur réponse à l'Adresse, B.C et la CWO "sont les seuls à faire ce travail vers le Tiers-monde". Si B.C avait réellement fait un travail vers le prolétariat du Tiers-monde, il aurait su être intransigeant dans la dénonciation du nationalisme, comme le CCI peut l'être dans son intervention par rapport aux "guérilleros" en Amérique latine et ailleurs. Toute cette argumentation de condescendance envers les militants du Tiers-monde (qui seraient pour ainsi dire tellement arriérés qu'il faut juger leurs positions avec 1'"indulgence" d'un Battaglia) n'est qu'une insulte aux communistes anti-nationalistes dans le Tiers-monde et un alibi pur et simple pour BC. Battaglia n'est pas plus clair sur le programme à suivre en Europe qu'ailleurs. Ce n'est pas une question de géographie et ne date pas de 1983. Dans la Revue Internationale n° 32, nous avons publié les documents du PCI d'Italie de 1945 quand Battaglia et Programma étaient ensemble dans le PCI. Leurs ambiguïtés par rapport aux partisans, des "forces en évolution" pendant la "libération" de l'Italie parlent d'elles-mêmes. Battaglia nous a répondu qu'il faut savoir se salir les mains. Eh bien, l'aventure avec le SUCM n'est pas étonnante.
Mais la principale raison qui détermine la politique oscillante de BC quant au milieu politique du prolétariat, la délimitation de ce milieu et les responsabilités de BC dans ce cadre, c'est l'insuffisance de sa plateforme criblée de questions "tactiques" sur le syndicalisme, l'électoralisme, la libération nationale.
Battaglia se vante de ses "solides positions doctrinaires". Mais où sont-elles ? Certainement pas dans la nouvelle édition de sa plateforme.
Par contre, il faut croire que le CCI hante son sommeil. Il n'a de cesse d'attribuer au CCI ses propres faiblesses. Selon BC, le CCI souffre de "questions ouvertes". Que veut-il dire par là exactement ? Tout ce que nous savons, c'est que la plateforme de BC n'a évidemment pas de "questions ouvertes" ; ce sont des trous béants qui ne permettent pas de distinguer les frontières de classe. Sur toutes les questions principales, y compris la question du parti, BC ne fait que reprendre et répéter les positions de la 3ème Internationale, y compris les erreurs en les aggravant par des formulations vagues et contradictoires.
Dans les positions du PCI-Battaglia, on ne trouve jamais un rejet franc, clair, des positions erronées de l'Internationale Communiste sur les questions nationale, syndicale et électorale, ni même un rejet des erreurs du PCI depuis 1943, mais seulement, à l'occasion, des atténuations dans les affirmations, et rien de plus. Lorsque BC affirme parfois le contraire de ces positions de l'IC, ce n'est que du bout des lèvres, et c'est enveloppé de tant d'ambiguïtés "diplomatiques", "tactiques", que tout reste fondamentalement la même chose. BC continue à se tortiller et à se plaire dans l'équivoque.
Marx constatait que l'histoire se répète, d'abord en tragédie, ensuite en farce.
Au début des années 20, la majorité centriste de l'Internationale Communiste, les Bolcheviks en tête, préfère éliminer la Gauche pour s'allier à la Droite (Indépendants en Allemagne, etc.). C'était une politique fatale, une tragédie pour le mouvement communiste.
En 1945, le P.C.I. d'Italie, nouvellement créé, préfère éliminer la G.C.F. (cf., l'article sur le 2ème Congrès du P.C.I. dans ce n° de la Revue), pour s'allier avec les rescapés de la participation volontaire dans la guerre impérialiste en Espagne-36, avec les rescapés de la participation au Comité Anti-fasciste de Bruxelles, avec les rescapés du flirt avec la Résistance et la Libération Nationale. C'était encore une tragédie pour le milieu communiste, mais tenant déjà de la farce jouée par des mégalomanes.
Aujourd'hui, on préfère saboter les Conférences Internationales, afin d'éliminer le courant communiste le plus intransigeant, pour chercher alliance avec l'U.C.M. et autres défenseurs des Libérations Nationales d'Iran et du Kurdistan, transfuges de 60 ans de stalinisme, et qu'on prend pour les pauvres "embryons du futur Parti Communiste" dans le Tiers Monde.
Cette fois, c'est la farce complète !
C'est d'autant plus une farce, que ce n'est pas l'unité massive du prolétariat qui, comme Lénine, préoccupe Battaglia, mais plus prosaïquement la défense de sa petite chapelle.
En cela, les "juniors" d'aujourd'hui ne se distinguent pas de leurs "seniors" de 1 945 : même démarche, mêmes positions. Peut-être un peu édulcorées, mais avec une bonne dose d'hypocrisie et de mauvaise foi en plus.
Si l'histoire se répète en farce, l'opportunisme reste, lui, toujours le même.
Le problème avec BC, c'est que sa réponse à l'Adresse, comme ses positions politiques, est insaisissable. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Contrairement au PCI-Programma qui est fermé à tout rapport avec d'autres organisations révolutionnaires, le PCI-Battaglia est plus ouvert vers l'extérieur avec des positions plus évoluées sur certains points. Mais si Programma a une cohérence dans ses erreurs, Battaglia a ses erreurs dans l'incohérence.
CQMMUNIST WORKERS ORGANISATION (Grande-Bretagne)
La CWO nous écrit dans sa lettre de septembre 83: "Nous sommes d'accord que la classe ouvrière et ses minorités se trouvent dans une situation difficile et dangereuse aujourd’hui mais quand vous parlez de crise dans le milieu révolutionnaire, ce n'est pas de la même crise dont nous parlons... C'est notre isolement en tant que communistes de la classe." (Lettre au CCI, septembre 83). Mais l'isolement comme tel ne provoque pas de crise. Pour la CWO, la perte des énergies militantes aujourd'hui est à mettre sur le même plan que dans le passé. Sommes-nous alors en pleine contre-révolution ?
La CWO considère que l'Adresse "est 1 'expression de la crise du CCI". Rejette-t-il donc la discussion ? Finalement non. "Bien qu'il ne soit pas possible de poursuivre des rapports entre nos deux tendances au niveau des Conférences Internationales, cela n'exclut pas le débat. " Ainsi, la CWO propose une réunion publique de confrontation des positions de la CWO et du CCI sur "la situation actuelle de la lutte de classe et la responsabilité des révolutionnaires". Nous avons accepté cette proposition tout à fait valable.
Mais dans sa lettre, la CWO fait part d'un certain nombre de reproches au CCI et nous profitons de cette réponse pour parler de certaines d'entre elles (parler de toutes serait au-dessus des forces d'un Hercule).
- Selon la lettre de la CWO, le CCI n'est pas "sérieux" parce que "la CWO a offert au CCI l'occasion de se solidariser avec l'intervention internationaliste (de la CWO) sur la guerre Iran-Irak, mais le CCI a refusé pour des raisons ridicules". (Pour notre réponse voir World Révolution n°59, avr.83).
La CWO refuse dans le cadre principiel des Conférences internationales, de prendre une position commune contre la guerre impérialiste et les tensions inter impérialistes parce que, selon la même lettre, ce n'était que des"positions communes vagues et sans signification à propos de banalités évidentes1.' Mais elle veut que le CCI cautionne ses ambiguïtés dangereuses par rapport au SUCM ? La CWO ne sort pas de tract pour chaque guerre locale dans le monde, mais juste pour Iran-Irak, et bien que le tract ait pu prendre position sur des "banalités", il s'est concrétisé par le rapprochement SUCM-CWO.
- De même, dans la réponse à l'Adresse, la GOnous reproche de ne pas l'inviter aux Congrès duCCI tandis qu'elle nous invite aux siens.
Pendant des années, nous avons invité BC et la CWO à nos différents Congrès et ils sont venus ainsi que des délégations d'autres groupes politiques. Mais après la rupture des Conférences Internationales, après avoir été écartés par les manoeuvres de BC et de la CWO, nous considérons qu'inviter ces groupes à nos réunions internes serait un non-sens. La CWO ne veut pas que le CCI assiste à des Conférences entre groupes, mais il veut venir à nos Congrès ? Elle nous rejette des Conférences, mais nous invite à ses Congrès ? A-t-elle une pensée logique ? Mesure-t-elle la portée de ses actes ? Dans l’article "Le soi-disant bordiguisme de la CWO" (RP n°20, 2ème Série) , la CWO ne veut pas parler d'elle. Elle préfère défendre son frère aîné Battaglia Comunista contre un sinistre complot : le CCI a appelé BC "bordiguiste". Si le mot vous gêne, camarades, retirez-le. Cela ne change rien au fond. La vérité, c'est que dans l'article comme dans sa lettre, la CWO est furieuse contre le CCI parce que nous avons publié les documents concernant l'opportunisme du PCI par rapport aux "partisans". En fait ces articles visaient surtout Programma, mais le chapeau brûle sur la tête de Battaglia et la CWO. Remarquez, ils ont raison. BC était entre 1945 et 1952 à la tête du PCI "uni". Mais, que répond la CWO : elle crie "maman" et tape du pied. "Mensonges !" Mais elle n'explique rien et justifie tout.
- Selon la CWO, "avant 1975, le CCI n'a jamais mentionné le peint", comme si on avait "caché" l'existence de BC à la CWO par peur que ces deux titans ne se rencontrent. Nous avons parlé de Battaglia, mais la CWO avait les oreilles bouchées à l'époque. Au début des années 70, ce groupe sortait du milieu libertaire et considérait la révolution russe comme une révolution bourgeoise, le parti bolchevik comme un parti bourgeois. Même quand, en fin, il a reconnu la révolution d'octobre et l'IC, ce n'était que du bout des lèvres. Pour la CWD, la contre-révolution aurait été définitive en 1921 (elle ne précisait pas si c'était en janvier ou en décembre), mais cela suffisait pour dénoncer le CCI comme "groupe contre-révolutionnaire" à cause de cette date fatidique de 1921. A l'époque, nous étions léninistes parce que nous parlions de Bilan, mais aujourd'hui, on nous taxe de conseillistes parce que la CWO a découvert Battaglia. Le CWO a connu tellement de zigzags dans sa vie qu'il n'est pas à un "zig" près. C'est parce que la CWO est née en ignorant tout de l'histoire du mouvement ouvrier, c'est parce qu'elle n'a jamais voulu suivre une vraie cohérence dans son attitude par rapport aux organisations politiques prolétariennes qu'elle en est réduite à des polémiques du style de RP n°20.
- Nous ne pouvons pas répondre à tout ici, mais nous voulons encore traiter un dernier point important : la CWO nous accuse dans RP n°20 de condamner son rapprochement avec BC. C'est faux. Nous sommes toujours pour le regroupement des organisations dès qu'elles se trouvent sur les mêmes positions politiques principielles. Nous n'aurions jamais condamné le regroupement de BC et de la CWO au sein des Conférences Internationales... Nous avons suivi le même chemin nous-mêmes avec la formation de notre section en Suède à la même époque. Nous sommes contre la perpétuation de petites chapelles. Si des groupes sont d'accord, qu'ils s'unissent. Cela ai de à la clarification des positions pour le prolétariat.
Nous allons encore plus loin : nous connaissons la CWO depuis longtemps et en comparant son rapprochement actuel avec BC aux mésalliances que ses réactions "anti-CCI" ont failli produire par le passé (avec le PIC, le Revolutionary Workers Group de Chicago, etc.), nous disons : très bien !
La question que nous posons à la CWD est la suivante : pourquoi maintenez-vous une existence séparée ? De deux choses l'une : soit vous êtes d'accord avec la plateforme de BC et alors ses ambiguïtés sur les questions électorale, syndicale et nationale sont les vôtres ; soit, vous n'êtes pas d'accord et alors où pont les textes de discussion entre vous.
La CWO veut attendre de voir si le CCI est "réellement sérieux", si son Adresse est "sincère". Notre Adresse exprime notre position de toujours sur la nécessité d'un dialogue dans le milieu politique du prolétariat. Depuis plus de quinze ans, nous n'avons pas varié d'un iota sur ce point. Nous ne sommes pas des caméléons comme la CWD qui change de couleur tous les deux trois ans. Si la CWO a la mémoire courte, nous nous chargerons de la lui rafraîchir.
PERSPECTIVES
Les groupes nous écrivent : vos suggestions sont vagues. Que voulez-vous au juste avec cette Adresse ?
Nous voulons appeler à un changement d'esprit dans le milieu politique de notre classe : la fin des prétentions et de l'arrogance dans l'isolement; la fin des faux-fuyants, de l'activisme dangereux, du flou artistique sur les principes.
D'abord sur le fond. Il faut cesser de faire de la question du parti un alibi. Il faut la discuter sérieusement sans anathèmes, et sans tourner en rond sur des formules creuses. Il faut répondre clairement sur des questions élémentaires pour que le débat puisse s'approfondir ensuite :
- la conscience de classe vient-elle de l'extérieur de la classe comme Lénine l'a écrit dans "Que faire ?" ?
- le parti de classe a-t-il été dans l'histoire ou sera-t-il demain l'unique creuset ou dépositaire de la conscience de classe ?
- est-ce le parti qui devra prendre le pouvoir ?
- le parti peut-il s'imposer à la classe par des rapports de force comme dans les événements de Kronstadt en 1921 ?
- que nous apportent comme critique, modification, élaboration sur la question du parti la révolution russe et l'expérience de la première vague révolutionnaire ainsi que la dégénérescence en Russie et de l'Internationale Communiste ?
Voila les questions de base auxquelles il faut _ apporter une réponse en poussant à fond la critique des erreurs ou insuffisances du passé et en profitant de l'ensemble de l'apport de la Gauche Communiste Internationale, sans exclusive "italienne", "allemande" ou autre.
Même Programma, après quarante ans de fermeture et de suffisance, est obligé aujourd'hui par les événements d'ouvrir un débat en son sein sur le parti, sa fonction et son organisation. Mais pourquoi seulement à l'intérieur ? Est-ce une maladie honteuse que la discussion politique avec le milieu que notre classe produit aujourd’hui canne elle l'a produit dans tous les moments importants de son histoire ? Est-ce que la confrontation des positions politiques est un luxe, une annexe à l'activité "normale", quelque chose qu'on fait si on a le temps, ou est-ce une nécessité, la seule façon de vérifier le bien-fondé de nos contributions politiques vitales pour les combats décisifs de notre classe ?
Il est indiscutable que l'absence des Conférences Internationales pèse aujourd'hui : pour répondre à l'accélération de l'histoire, pour aider à ce que les énergies militantes ne se perdent pas dans les convulsions du milieu politique, pour présenter un cadre principiel aux nouveaux éléments de la classe qui surgissent, pour orienter la clarification dans tous les pays, surtout dans les pays qui n'ont pas eu le temps de développer des traditions marxistes. Et il est aussi indiscutable que les Conférences Internationales se sont disloquées à cause du sectarisme dans le milieu : le PIC qui refusait le "dialogue de sourds", le FOR qui ne voulait pas "discuter la crise économique" et qui s'est retiré avec éclat de la 2ème Conférence, Programma qui n'y voyait qu'une empoignade entre "fouteurs" et "foutus", les actions de Battaglia et de la CWO que nous avons critiquées.
Créer ce nouvel esprit est la seule façon de rendre possibles à l'avenir de nouvelles Conférences, la seule façon d'assurer une décantation consciente dans le milieu, de travailler vers de nouveaux efforts de regroupement qui seront absolument nécessaires.
Car qui oserait prétendre que le milieu politique du prolétariat ne sera jamais rien d'autre que ce qu'il est aujourd'hui ?
JA
[1] [478] Dans Battaglia, la crise ne se traduit jamais clairement, franchement par des oppositions et confrontations de divergences politiques pour la simple raison qu'il n'y a pas de discussions ni de vie politique véritables dans l'organisation. On ne confronte pas, on vote simplement avec les pieds en quittant individuellement, silence et discrètement 1'organisation. C'est moins visible mais pas pour autant moins critique. Quant à se targuer d'avoir "en substance des solides positions doctrinaires", nous nous contenterons de renvoyer à la lecture/dans ce numéro de la Revue, de l'article sur le 2ème Congrès du PCI d'Italie de 1948. Cette lecture donnera l'exacte mesure de ces "solides positions doctrinaires" de Battaglia.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Le deuxième congres du parti communiste internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948)
- 3201 reads
Le texte d'Internationalisme n°36 (juillet 1948) publié ci-dessous est une critique des faiblesses politiques et organisationnelles du Parti Communiste Internationaliste à ses débuts. Nous avons déjà réédité à plusieurs reprises des articles polémiques d'Internationalisme contre le PCI (Voir les Revues Internationales n°32, 33, 34 notamment). Le texte ci-dessous, en passant en revue l'ensemble des positions du PCI à son 2ème Congrès, permet de donner une idée précise de ce qu'étaient les orientations de ce groupe. Les faiblesses critiquées à l'époque existent encore aujourd'hui -flou sur les questions nationale et syndicale, sur le rôle, la fonction et le fonctionnement de 1'organisation révolutionnaire, absence de perspectives claires sur la période, etc.- et n'ont fait que s'accentuer jusqu'à provoquer la dislocation quasi-totale du principal continuateur du PCI, Programme Communiste, 1'an dernier (Voir la Revue Internationale n°32). Elles ne sont pour autant pas les faiblesses du seul PCI-Programme Communiste et ces questions doivent être abordées par 1 'ensemble des groupes révolutionnaires. C'est pourquoi nous republions ce texte à 1'occasion de la discussion suscitée par 1' "Adresse aux groupes politiques prolétariens" (Revue Internationale n°35) que le CCI a lancée face à la crise et à la dispersion actuelles du milieu révolutionnaire (Voir l'article de réponse aux réponses à 'adresse dans ce numéro). L'avant-propos, extrait de la réédition précédente de ce texte, fait allusion à plusieurs textes : nous n'en republions ici qu'un seul ; les autres textes se trouvent dans le Bulletin d'Etudes et de Discussion de Révolution Internationale n°7, juin 1974.
AVANT-PROPOS
Les textes que nous publions plus loin sont des controverses souvent passionnés qui ont agité les extraits ([1] [479]) et des articles parus dans "Internationalisme", organe du groupe Gauche Communiste de France. Ces textes, qui datent de près de 30 ans, totalement inconnus pour la grande majorité des militants, présentent cependant un grand intérêt aujourd'hui encore.
La lutte révolutionnaire du prolétariat pour son un mouvement historique. Une fois surgies, on ne saurait concevoir les luttes comme un commencement nouveau telle que le prétendent tant de groupes qui viennent de surgir ([2] [480]) , mais seulement comme leur continuation et leur dépassement. L'histoire de la lutte révolutionnaire n'est pas une addition de moments morts mais tout un mouvement vivant qui se poursuit et se continue contenant en lui son"passé". Il ne saurait y avoir de dépassement sans contenir les acquis des expériences passées. En publiant ces écrits vieux de 30 ans, nous entendons contribuer à une meilleure connaissance d'une période particulièrement obscure et ignorée, celle qui suit la 2ème guerre mondiale, et les débats et controverse souvent passionné qui ont agité les faibles groupes révolutionnaires d'alors. Si la proche perspective est aujourd'hui tout autre qu'alors, les problèmes soulevés dans la discussion, leur compréhension et solution demeurent toujours au centre de la préoccupation des groupes et militants révolutionnaires d'aujourd'hui. Tels sont : les problèmes de l'analyse de la période historique que nous vivons, les guerres impérialistes, la nature et la fonction des syndicats, les mouvements dits de libération nationale, le parlementarisme, les problèmes de la révolution prolétarienne, les tâches des révolutionnaires, les rapports Parti Classe, et tout particulièrement celui du moment historique de la constitution du Parti
LA GAUCHE ITALIENNE : MYTHE ET REALITE
Le PCI (Programme Communiste) prétend être la continuation organique ininterrompue de la Gauche Italienne, continuation à la fois organisationnel et politique. C’est là un mythe. Seule l’ignorance de la plupart des propres membres du PCI et le silence prudent des autres lui donnent force et un semblant de vérité. Une fois exclue du PC, la Gauche Italienne se constitue en Fraction à l’étranger (Pantin 1929). Jusqu'en 43-45, la Fraction à l'étranger sera la seule organisation de la Gauche Italienne. En Italie même ne subsistera aucun groupe organisé et les anciens militants seront dispersés et réduits par la répression à une inactivité totale. Quand en 43-45 se constitue en Italie le PCI, cela se fait indépendamment de la Fraction et séparément d'elle - aussi bien sur le plan organisationnel que politique. Le PCI ne s'est d'ailleurs jamais réclamé comme continuité organique de la Fraction et est toujours ambigu quant à considérer la Fraction comme une expression et continuité de la Gauche Italienne. Il s'ensuit que la continuité organique tant réclamée a existé avec un trou d'interruption de près de 20 ans (et quels 20 ans !) , ou bien qu'elle n'a jamais existé et n'est qu'un mythe qu'elle entretient pour des raisons de convenance particulière et de mystification.
L'activité de la Fraction Italienne jusqu'à sa dissolution en 1945 constitue une très importante contribution au développement de la théorie communiste, de même que ses prises de position politiques face aux événements sont profondément enracinées sur le terrain de la classe révolutionnaire et c'est autour de la Fraction Italienne que vont se former des groupes en Belgique et en France pour constituer la Gauche Communiste Internationale.
Il est nécessaire de prendre connaissance des positions de la GCI, de lire leurs textes, et tout particulièrement la revue BILAN, même dans leur forme de "balbutiement" (comme ils le disaient eux-mêmes) pour se rendre compte et mesurer tout le recul et régression que représentent les positions politiques actuelles du PCI par rapport à la GCI.
LA CRISE ET LA FIN DE LA "GAUCHE COMMUNISTE INTERNATIONALE".
La GCI ne représente pas, en vérité, tout le courant de la Gauche Communiste issu de la 3ème Internationale, mais seulement une de ses branches ; les autres branches sont la Gauche Allemande, la Gauche Hollandaise et aussi la Gauche Anglaise. Mais elle se présente d'une façon plus homogène, plus organisée et dans une certaine mesure plus cohérente. Cela lui permettra de résister plus longtemps à la pression terrible qu'exercent sur les révolutionnaires les défaites successives du prolétariat, la dégénérescence de l'I.C, le triomphe de la contre-révolution stalinienne en Russie et l'ouverture d'un cours de réaction généralisée et enfin la guerre impérialiste. Subissant cette écrasante pression des événements, la GCI s'efforce de dégager les enseignements, afin qu'ils puissent servir de matériaux programmatiques pour et dans la reprise de la lutte de classe du prolétariat. Un tel travail pour si grand qu'ait été l'effort et le mérite de la GCI, n'allait pas sans défaillances et vacillations.
Dans une période générale de recul, chaque nouvel événement devait produire une nouvelle réduction numérique de l'organisation, et provoquer de graves perturbations politiques. Aucun groupe révolutionnaire ne peut prétendre être à l'abri et présenter une garantie à l'influence pernicieuse des événements. Pas plus que d'autres, la GCI n'y a échappé. La guerre d'Espagne a été une première secousse, provoquant discussion et scission, l'approche et l'éclatement de la seconde guerre mondiale a profondément ébranlé la GCI, provoquant des divergences gui allèrent se creusant, ouvrant une crise profonde en son sein. Les textes que nous publions ci-dessous donnent une idée assez exacte des divergences qui opposaient les tendances, et qui devaient aboutir à la dissolution des Fractions et leur absorption par le nouveau Parti créé en Italie d'une part, et au surgissement de la Gauche Communiste de France et sa séparation d'avec la GCI d'autre part.
LA DISSOLUTION DES FRACTIONS.
Les deux premiers textes portent essentiellement sur la question de la dissolution de la Fraction Italienne. C'est alors une question centrale, non seulement parce que la dissolution signifiait un arrêt brusque de clarification nécessaire des problèmes débattus mais aussi parce que cela constituait un abandon de positions défendues de façon acharnée par la Fraction durant toute son existence, et touchant à la conception même du Parti et impliquant une analyse fausse de la période et de la perspective.
L'existence du Parti est étroitement liée et conditionnée par la période et l'état de la lutte de classe du prolétariat. Autant dans une période de développement des luttes la classe sécrète en son sein l'organisation politique : le Parti ([3] [481]) organe de mobilisation politique de la classe, autant les défaites décisives ouvrant une longue période de recul entraînent inévitablement la disparition ou la dégénérescence du Parti. Dans de telles périodes, quand la contre-révolution a eu raison de la classe et de ses organisations, vouloir reconstituer le Parti à nouveau relève d'une conception volontariste et mène à l'aventurisme et au pire opportunisme. C'est contre une telle conception volontariste de construction artificielle, préconisée par Trotski que la Gauche Communiste a livré, dans les années 30, les plus violentes batailles.
La proclamation du PCI en Italie s'est faite sans s'embarrasser d'aucune analyse du moment ni de la perspective. Tout comme les trotskystes, cela fut un acte de pur volontarisme. Mais plus fondamental encore est le fait que la constitution du nouveau Parti, le PCI d'Italie, s'est faite sans aucun lien ni organisationnel, ni politique, avec la Fraction Italienne de la Gauche Communiste. La Fraction est cet organisme révolutionnaire vivant qui surgit et subsiste une fois que l'ancien Parti a été happé dans l'engrenage de la contre-révolution et détruit comme organisation de classe.
La Fraction ne saurait "se dissoudre" pour renter ensuite et individuellement dans un Parti, constitué à part et indépendamment d'elle. Ceci est par définition impossible et politiquement inconcevable. La dissolution de la Fraction Italienne et l'entrée de ses membres dans le PC d'Italie, formé hors et indépendamment d'elle, constituaient le pire liquidationnisme et un suicide politique. On comprend que la GCF se soit catégoriquement refusée à s'associer à une telle politique et qu'elle l'ait critiquée violemment.
La continuité organique de la Fraction n'existe pas aujourd'hui. Elle a été coupée, interrompue par cinquante ans de réaction. Cependant, la question de la dissolution garde tout son intérêt pour les révolutionnaires qui surgissent aujourd'hui. Ces groupes sont le produit et l'expression de la nouvelle période que nous vivons de reprise de luttes de classe. Ils sont donc les noyaux du futur Parti. Ce futur Parti ne sera pas un surgissement spontané du néant mais bien le résultat du développement et de l'accentuation de la lutte de classe et de l'oeuvre de groupes révolutionnaires existants. On ne saurait parler de la dissolution de ces groupes précédant un hypothétique Parti, sorti on ne sait trop d'où. Une telle vision enlève toute signification et toute valeur à l'activité de ces groupes. Au contraire, on doit voir dans l'existence et l'activité de ces groupes les matériaux avec lesquels se construira le futur Parti. Leur dissolution et la constitution du Parti ne sont pas des actes séparés dans le temps mais un acte simultané. On peut, avec plus de raisons, parler de leur transformation en Parti que de leur "dissolution" parce qu'ils sont des éléments constitutifs du futur Parti. Loin d'être prétention et auto flatterie, cette vision donne le sens et la gravité de la responsabilité que portent les groupes et leur activité, et qu'ils doivent savoir assumer pleinement. Toute autre vision est bavardage et dilettantisme.
Le PCI prétend à une continuité invariante de son programme et de ses positions. Sa pratique politique serait irréprochable et est donnée en exemple de pureté révolutionnaire. La lecture des textes que nous publions fait table rase de cette légende. C'est avec surprise et étonnement que beaucoup de lecteurs apprendront la véritable histoire et la somme de confusions et d'erreurs sur lesquelles se constitue le PCI. De la proclamation du Parti à l'analyse de la période de l'après-guerre, des élucubrations sur l'économie de guerre à la participation au Comité anti-fasciste à Bruxelles, de la participation aux élections à la prise de position sur la question des syndicats, tout annonce un éclectisme et un opportunisme politique. Cela donne toute la mesure qui sépare le PCI de la Fraction et l'énorme régression du premier par rapport à la seconde. C'est avec intérêt qu'on lira les critiques acerbes qu'en fait INTERNATIONALISME. On doit constater que ces critiques se sont avérées pleinement justifiées et restent valables aussi aujourd'hui en face des erreurs invariables du PCI.
Juan.
LE DEUXIEME CONGRES DU P.C.I. EN ITALIE (1948)
Sur la base de divers compte-rendus, écrits et oraux, on peut se faire une idée assez précise de ce qu'a été le Congrès du PCI d'Italie,
Nous avons d'abord celui publié dans notre dernier Internationalisme, qui donne une idée assez complète des débats du Congrès.
Dans la Battaglia Communista) organe du PCI d'Italie et dans Internationalisme, organe de la fraction belge, nous trouvons des articles traitant des travaux du Congrès.
Enfin la réunion publique organisée par la fraction française.
L'impression générale qui se dégage est comme l'a écrit le camarade Bernard en tête de son article, que cela " aurait pu ne pas être un Congrès car les problèmes traités l'ont été d'une manière plutôt étriquée ".
Pour s'en convaincre, il suffit de lire la presse du PCI d'Italie, et de ses sections en Belgique et en France. Le délégué de France a dit dans son compte-rendu oral :"Le Congrès n'a traité d'aucun des problèmes fondamentaux n'a fait aucune analyse poussée de l'évolution actuelle du capitalisme et de ses perspectives. De tout son ordre du jour, il n'a discuté que les possibilités d'action du parti dans la situation présente"
De son côté, la fraction belge, dans son dernier bulletin, consacre au Congrès un article d'une petite page ronéotypée dans lequel elle se contente de donner "résumées grosso modo les deux tendances qui se révélèrent au Congrès" et de conclure que celui-ci a décidé "d'entreprendre une discussion approfondie sur l'analyse du capitalisme dans son stade actuel".
Que nous sommes loin des fanfaronnades qui accompagnèrent la formation du Parti en 1945, des salutations enthousiastes et grandiloquentes sur la " reconstruction du premier Parti de classe dans le monde par le prolétariat italien", et de tout le bluff qui a continué pendant deux années autour de l1 activité et des succès de masses de ce Parti.
Aujourd'hui, le résultat de trois années d'activisme a ramené les camarades à plus de modestie et à des réflexions plutôt amères malgré certains jeunes néophytes comme la déléguée française qui ne peut terminer son compte-rendu sans finir, comme c'est la tradition en Russie, par cette phrase : " Et nous disons merci au PCI d'Italie".
LE RECRUTEMENT: OBJECTIF NUMERO UN DU PARTI
Pendant la première période, le Parti s'est laissé griser par son recrutement. A ce recrutement il a sacrifié la clarté des positions politiques, évitant de pousser trop à fond les problèmes pour ne pas "gêner"la campagne de recrutement et ne pas "troubler" les adhérents déjà acquis. Farouchement et catégoriquement il a tenu a ne pas porter, ni devant les ouvriers ni devant les membres du Parti ni devant la Conférence constitutive de fin 1945, la discussion sur la lamentable expérience de la participation d'une de ses sections et des camarades, futurs dirigeants du Parti, au Comité de Coalition Antifasciste italien de Bruxelles. Expérience qui a duré depuis la libération jusqu'à la fin de la guerre et que ces camarades continuèrent à revendiquer comme politique juste et révolutionnaire. Toujours pour ne pas "gêner" le recrutement et peut-être aussi parce qu'on a soi-même partagé cette conception (ce qui serait plus grave), on flatte les ouvriers qui faisaient partie de ces organismes militaires qu'étaient les diverses formations armées de la Résistance. A leur sujet, la plateforme du Parti adoptée à 3a Conférence de 1945 dit :
" En ce qui concerne la lutte partisane et patriotique contre les allemands et les fascistes, le Parti dénonce la manoeuvre de la bourgeoisie internationale et nationale qui avec sa propagande pour la renaissance d'un militarisme d'Etat officiel (propagande qu'elle sait vide de sens) vise à dissoudre et à liquider les organisations volontaires de cette lutte qui dans beaucoup de pays ont déjà été attaquées par la répression armée".
Et tout en mettant en garde contre les illusions suscitées par ces organisations parmi les ouvriers, la plateforme les caractérise ainsi : " ces mouvements qui n'ont pas une organisation politique suffisante (à part d'être "partisane et patriotique", que fallait-il donc de plus au PCI ?) expriment tout au plus la tendance des groupes prolétariens locaux à s 'organiser et à s 'armer pour conquérir et conserver le contrôle des situations locales et donc du pouvoir".
Ainsi, pour ne pas risquer sa popularité et les possibilités de son recrutement, le parti s'est gardé de les dénoncer pour ce qu'elles étaient réellement, et pour le rôle qu'elles jouaient, et a préféré flatter les ouvriers de "ces tendances qui constituent un fait historique de premier ordre".
Tout aussi bien que sur cette question, le PCI n'a pas eu le souci de pousser plus à fond l'analyse de l'évolution du capitalisme moderne.
Nous trouvons, bien sûr, et même très couramment, l'affirmation que le capitalisme évolue vers une forme nouvelle, le capitalisme d'Etat, mais le Parti n'avait pas pour autant une idée précise de ce qu'est exactement le capitalisme d'Etat, ce que cela signifie historiquement et de ce que cela comporte comme transformations profondes des structures du système capitaliste.
Dans le § 14 où est traité le problème du capitalisme d'Etat, la plateforme parle de "ré accumulation des richesses entre les mains des entrepreneurs et des bureaucrates d'Etat qui ont leurs intérêts liés à ces derniers ". N'ayant vu dans le capitalisme d'Etat que l'unité de classe des Etats avec les entrepreneurs privés face au prolétariat, mais n'ayant pas vu ce qui les oppose et distingue les premiers des seconds, la plateforme dénonce "des mots d'ordre ineptes de socialisation des monopoles qui ne servent qu'à travestir ce renforcement". Dans les nationalisations qui sont la structure économique du capitalisme d'Etat, la plateforme ne voit rien d'autre qu'une manoeuvre "des puissants monopoles industriels et bancaires "qui" feront payer à la collectivité le passif de la reconstruction de leurs entreprises".
Avec une telle analyse du capitalisme moderne et de ses tendances, qui n'allait pas plus loin que celle déjà énoncée en 1920, il était normal qu'on reprenne sur le plan de la politique, sans rien changer, les positions essentielles de la IIIème Internationale d'il y a 25 ans : le parlementarisme révolutionnaire et la politique syndicale.
Quels en étaient les résultats ? Après près de trois ans, le Parti enregistre la perte de la moitié de ses adhérents. Des groupes entiers de militants se sont détachés, les uns. pour former le groupe trotskyste POI, les autres la Fédération autonome de Turin, la majorité dans l'indifférence et le dégoût de toute activité militante.
Nous avons, en somme, la reproduction de ce qui s'est passé pour les partis trotskystes dans les autres pays. Le Parti n'a pas renforcé ses positions parmi les ouvriers. La fuite de la recherche théorique, l'imprécision et l'équivoque de ses positions ne lui ont pas davantage gardé ses militants. Dans son objectif numéro un qui était de recruter à tout prix, le renforcement numérique, le Parti enregistre aujourd'hui un fiasco, un échec cuisant qu'il n'était pas difficile de prévoir et de lui prédire.
UN PARTI SANS CADRES
Mais il y a encore une chose plus grave que la défection de la moitié des membres, c'est le niveau idéologique extrêmement bas des militants restant dans le Parti. Bernard nous parle de la " fonction scénique" de la majorité des délégués au Congrès, de leur non-participation aux débats. Frédéric disait que les délégués ouvriers estimaient que les analyses théoriques générales les dépassaient et ne pouvaient être leur fait, que ce travail incombe aux intellectuels.
Vercesi exprime cette vérité : " Pour courir derrière des chimères, le travail d'éducation des militants qui est dans un état déplorable a été négligé ". Encore que Vercesi porte une bonne part de responsabilité pour cet état déplorable auquel il a contribué pendant trois années par son refus de porter publiquement la discussion, de crainte de "troubler" les militants.
C'est le trait typique de toutes ces formations artificielles qui se proclament pompeusement partis, de ne pas comprendre que le fondement subjectif du nouveau parti ne se trouve pas dans le volontarisme mais dans l'assimilation véritable par les militants de l'expérience passée et dans la solution des problèmes contre lesquels l'ancien parti s'est heurté et s'est brisé. Avoir voulu agir sur la base de la répétition d'anciennes formules et positions, fussent-elles celles des Thèses de Rome, sans tenir compte des changements fondamentaux apportés par les 25 dernières années, c'était accrocher l'action dans le vide, user en vain les énergies et gaspiller des forces et un temps précieux qui devait et pouvait utilement servir à la formation des cadres pour le parti et la lutte à venir.
L'absence des cadres et la négligence de leur formation, voilà le plus clair du bilan révélé par le Congrès du PCI.
EXISTE-T-IL UN PARTI EN ITALIE?
Numériquement très réduit par la perte de la moitié de ses membres, absence de cadres, "manque complet d'une analyse de l'évolution du capitalisme moderne"(Vercesi), voilà pour ce qui est des conditions subjectives. Quant aux conditions objectives, période de concentration du capitalisme qui " a été conditionnée par la défaite internationale que le prolétariat a subie et par la destruction de celui-ci comme classe ". (Document de la CE à la suite du Congrès. Voir "Nos directives de marche" dans la Battaglia Communista du 3/10 juillet). Que reste-t-il donc des conditions nécessaires justifiant la construction du Parti ? Rien, strictement rien, sinon le volontarisme et le bluff, familiers aux trotskystes.
Au Congrès, le rapporteur Damen a essayé de justifier la proclamation du Parti. Nous laissons de coté l'argument qui veut que les ouvriers italiens soient "politiquement plus sains"'que ceux des autres pays. De tels arguments ne montrent rien d'autre que la persistance des sentiments nationalistes même chez des militants très avancés. L'ouverture d'un cours révolutionnaire ne peut que se faire à l'échelle internationale, de même la brisure avec l'idéologie capitaliste ne peut être une manifestation isolée du prolétariat révolutionnaire d'Italie en or d'un seul pays. Le patriotisme du prolétariat révolutionnaire d'Italie n'a pas plus de valeur que le patriotisme du socialisme en un seul pays. Cet argument donc mis à part, Damen justifie la proclamation du Parti par le fait qu'une fraction n'aurait pu servir de pôle d'attraction pour les ouvriers^ ce qui est vrai pour une période où les conditions pour la polarisation du prolétariat autour d'un programme révolutionnaire sont présentes, mais qui n'est absolument pas le cas en Italie, ni nulle part ailleurs.
Finalement, Damen énonce que la fraction n'a de raison d'être que tant qu'il s'agit "d'opposition et de résistance idéologique à 1'opportunisme dans le Parti jusqu'au moment de la lutte ouverte qui ne peut être menée que par un organisme politique qui ait les caractéristiques et les tâches du Parti?
Le même thème, nous l'avons entendu développé dans la réunion de la FFGC. Que de chemin à rebours parcouru depuis le Congrès de la Fraction Italienne de 1935 ! C'est là un argument type du trostkysme qui, pendant les années d'avant-guerre soutenait contre nous la thèse qu'avec la mort de l'ancien Parti, la condition est donnée pour la proclamation du nouveau Parti. Alors que c'est le contraire qui est vrai, la mort de ' l'ancien Parti ou son passage à l'ennemi de classe signifiant précisément l'absence de conditions pour l'existence du parti révolutionnaire. Ce Parti étant conditionné par une orientation révolutionnaire se manifestant dans le prolétariat.
Quand les camarades Vercesi et Daniels, au Congrès, nient que le PCI puisse réellement jouer un rôle de Parti, ils ne font que reprendre la thèse que nous avons développée depuis 1945 sur l'absence de conditions de constitution du Parti, et du même coup, ils reconnaissent implicitement que le PCI ne remplit pas davantage les tâches d'une fraction, c'est-à-dire l'élaboration programmatique et la formation de cadres. Nous n'avons ici rien d'autre que la traduction en italien des artifices et du comportement des trotskystes dans les autres pays.
Pour Damen, le Parti est un fait, "un coin enfoncé dans la crise du capitalisme". Si cela peut le consoler, nous lui apprendrons toutefois que les trotskystes ne voient pas différemment leur parti dans les autres pays.
Pour Vercesi n'existent ni le "coin enfoncé", ni "la brisure, même minime du capitalisme", ni le parti qui n'est qu'une fraction élargie.
Malheureusement dirons-nous, il n'existe en Italie ni parti, ni fraction élargie, ni influence sur les masses, ni formation de cadres. L'activité menée par le PCI tendant à compromettre l'immédiat de l'un et l'avenir de l'autre.
LA VERIFICATION DES PERSPECTIVES
Une orientation vers la fondation du parti pouvait avoir sa raison d'être dans la période de 1943 à 1945 qui s'ouvrait avec les événements de juillet 43 en Italie, la chute de Mussolini, le mécontentement grandissant en Allemagne, et qui permettait aux militants révolutionnaires d1 espérer un développement d'un cours de brisure avec la guerre impérialiste et la transformation de celle-ci en un vaste mouvement de crise sociale. L'erreur fondamentale des militants du PCI et surtout de ses sections en France et en Belgique fut de persister dans cette perspective après la fin des hostilités alors que les impérialismes russe et américain sont parvenus à occuper l'Allemagne, à disperser à travers le monde et à encadrer dans les camps de prisonniers les millions d'ouvriers allemands, en un mot à contrôler ce foyer capital de révolte et centre de la révolution européenne.
Mais loin de comprendre que la cessation de la guerre sans mouvement de révolte signifiait une défaite consommée par le prolétariat, une nouvelle période de recul ouvrant avec elle le cours vers la nouvelle guerre impérialiste, la GCI, au contraire, échafaudait des théories sur l'ouverture d'un cours de luttes de classes, voyait dans la fin de la guerre la condition de la reprise des luttes révolutionnaires où comme elle l'écrivait en corrigeant Lénine " la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile commence après la fin de la guerre".
Toute l'orientation de la GCI était basée sur cette perspective, et tous les événements étaient examinés sous cet angle. Ainsi, on prenait les événements sanglants d'Algérie, de Grèce, du Proche-Orient pour des prémisses de la crise révolutionnaire, on saluait les grèves économiques comme les mouvements de radicalisation des masses, on soutenait à fond le mouvement et l'action syndicale dont on se donnait pour tâche de conquérir la direction, enfin on préconisait comme tâche immédiate la construction dans tous les pays du Parti de classe. En même temps on se faisait des gorges chaudes, on raillait ces "pessimistes" que nous étions, ces "docteurs et théoriciens en chambre" pour qui on affichait un hautain mépris.
Aujourd'hui toute cette perspective est par terre. Et Vercesi est absolument dans le vrai, et ne fait que reprendre la critique que nous formulions contre le PCI quand il déclare : "L’interprétation que la guerre aurait ouvert un cycle révolutionnaire s’est révélée complètement fausse"'.
Si l'activité révolutionnaire n'a de valeur que pour autant qu'elle est fondée sur des précisions basées sur une analyse exacte de la situation et du cours, la reconnaissance par le Congrès du non fondé de la perspective signifie la condamnation implicite et l'écroulement de toute la politique et l'activité passée du Parti, basée sur cette perspective.
Toutefois, nous devons mettre en garde contre l'orientation exprimée par la tendance Vercesi postulant son analyse sur les "capacités de renaissance de l’économie capitaliste au travers du système de planification, de la disparition de crises cycliques et de la concurrence à l’intérieur des Etats". Cette conception n'est pas nouvelle; elle se rattache à la vieille théorie de renforcement économique du capitalisme, théorie dite de l'économie de guerre, et que nous avons à maintes reprises, avant et pendant la guerre, eu l'occasion d'analyser et de combattre.
Aujourd'hui, un nombre croissant de militants du PCI a ressenti et compris la stérilité d'un activisme en l'absence d'une analyse de la situation. Bien que cela vienne avec un retard de trois années, nous considérons ce fait comme le seul résultat positif qui s'est manifesté dans le Congrès. Nous souscrivons entièrement à l'idée de Daniels quand il déclare : " Les armes que possède le mouvement sont vieilles de 25 ans et toutes émoussées. Le capitalisme a transformé entre temps toute sa structure et toutes ses méthodes de lutte; le Parti de classe doit en faire autant s1il veut être un jour le guide de la classe ouvrière, et en préparer le réveil".
LA VIE INTERIEURE DU PARTI DISCIPLINE OU CONSCIENCE DES MILITANTS
Nous avons à plusieurs reprises, critiqué la tendance à la bureaucratisation dans le PCI d'Italie. Faisant allusion à cette critique, la déléguée française, dans son compte-rendu, de répliquer : "assistaient au Congrès et à ses débats souvent passionné pouvaient se rendre compte de la démocratie qui règne dans le Parti, et de la gratuité de l1accusation de bureaucratisation".
On pourrait avec autant de raison citer en exemple les assises des partis trotskystes et même des partis socialistes. Là aussi, on discute " librement" et passionnément. Ce qui importe n'est pas la plus ou moins grande démocratie dans les Congrès, mais de savoir sur quoi est basée l'activité des militants, sur la trique de la "discipline librement consentie" ou sur la conviction des positions et la plus grande conscience des militants ? La camarade citait le cas où le PCI excluait des militants pour divergences politique, et elle ajoutait : "comme tout Parti qui se respecte". En effet, le nombre des exclusions prononcées par le PCI est frappant, mais il faut ajouter qu'au grand jamais ces exclusions ne sont faites après les discussions dans l'ensemble du Parti, seule méthode qui aurait permis à ces crises d'être un moment de clarification des idées pour tous les militants, mais sont toujours prononcées par la direction.
Le Congrès a, par exemple, révélé l'existence de divergences profondes dans le Parti, mais en vain cherchera-t-on dans la presse du Parti et cela même dans les semaines précédent le Congrès la moindre discussion et controverse. Cela aurait évidemment risqué de troubler les membres, et porter atteinte au prestige et partant, à la discipline. On préfère non moins évidemment venir au Congrès pour constater, comme Vercesi : " II y a des délégués parlementaristes, d'autres favorables à une espèce de compromis avec le centrisme (stalinisme). La majorité est sans idées claires et suit des voies différentes selon les zones".
Plus catégorique et plus cinglant encore est Daniels, parlant pour ce qui concerne le Congrès lui-même. Il constate : " Il y a une tendance au Congrès à passer sous silence les erreurs du passé et à renoncer à discuter les problèmes qui peuvent provoquer d'amples débats, au travers desquels le Parti pourrait vraiment renaître à une vie nouvelle et mettre à nu tout ce qui, sous l'excuse de la défense des positions traditionnelles, cache d'opportunisme et empêche une claire élaboration idéologique et une conséquente assimilation de la part des militants".
C'est ainsi qu'on doit comprendre la vie intérieure saine de l'organisation et fonder la force, l'efficacité de l'activité de chacun des membres sur la continuelle et plus ample confrontation des idées, suscitée et entretenue par toute la vie du Parti.
Par contre, quand Maffi, grand chef du Parti, déclare s'être "abstenu de traiter tel problème" parce que " je savais que cette discussion aurait pu empoisonner le Parti", nous disons que ce souci manifeste incontestablement et au plus haut point la tendance à l'ossification et à la bureaucratisation de la vie intérieure de l'organisation.
Et c'est parce que c'est cette dernière conception qui prévaut dans le PCI que nous avons pu assister à cette fin absurde du Congrès dont nous parle Bernard, où "Vercesi s'est en quelque sorte excusé d'avoir été un trouble-fête et d'avoir amené le trouble parmi les militants". 'Parce que, en fin de compte, les uns pas plus que les autres n'admettent l'existence des tendances et des fractions au sein du Parti : pour les uns comme pour les autres, le Parti reste une organisation monolithique, homogène et monopoliste
LA QUESTION DE LA PARTICIPATION AUX ELECTIONS
Une des questions qui a provoqué les débats les plus orageux fut celle de la participation aux élections. Bien sur, personne ne préconise une politique de parlementarisme actif. Cela ressort moins d'une certitude de l'inutilité de l'action parlementaire que du fait que les forces présentes du Parti ne lui donnent aucune possibilité d'avoir réellement des élus. Aussi peut-on se permettre d'économiser un débat qui, de toute façon, ne serait que théorique, et comme tout débat théorique ne peut que "troubler inutilement le Parti". C'est pour la même raison que le Parti aux dernières élections pouvait se payer à bon marché d'être révolutionnaire à l'extrême, au point d'inviter les électeurs à ne pas voter, même pour lui. Mais nous connaissons déjà le cas d'un élu au conseil municipal qui a finalement trouvé de bonnes raisons pour garder son mandat d'élu. Après tout, la justification définitive de tout parlementarisme se trouve dans ces arguments théoriques donnés par Damen, pour justifier la participation du PCI à la campagne électorale. Damen dit : " Si la bourgeoisie est contrainte (?) d'adopter un moyen de lutte qui peut être exploité utilement par le parti de classe pour être retourné contre elle, l'avant-garde révolutionnaire ne peut renoncer à l'utiliser et à s'infiltrer dans la composition électorale".
Aucun trotskyste ne manquerait de souscrire à cette argumentation. C'est du pur et du pire Lénine de la Maladie Infantile du Communisme. La vérité est que le prolétariat ne peut utiliser pour sa lutte émancipatrice « le moyen de lutte politique» propre à la bourgeoisie et destinée à son asservissement. Il en était tout autrement à une période antérieure d'avant 1914 quand le prolétariat ne pouvait pas encore poser comme objectif concret immédiat, la transformation révolutionnaire de la société, d'où découlait la nécessité de lutter sur le terrain même du capitalisme pour lui arracher le maximum de réformes. Le parlementarisme révolutionnaire en tant qu'activité réelle n'a, en fait, jamais existé pour la simple raison que l'action révolutionnaire du prolétariat quand elle se présente à lui, suppose sa mobilisation de classe sur un plan extra-capitaliste, et non la prise des positions à l'intérieur de la société capitaliste, ce que Damen a appelle " l'utilisation" et " l'infiltration" intérieure.
La politique du parlementarisme révolutionnaire a largement contribué à corrompre les partis de la IIIème Internationale, et les fractions parlementaires ont servi de forteresses de l'opportunisme, aussi bien dans les partis de la IIIème qu'autrefois dans les partis de la IIème Internationale. Mais le participationniste croit avoir trouvé un argument impressionnant en déclarant : "Le problème abstentionniste est désormais dépassé, car il n'avait de raison d'être que dans une période ou une précision de principe, face au courant parlementaire du vieux parti socialiste, était nécessaire. Aujourd'hui où il n'y a plus de doute possible sur le caractère nettement antiparlementaire du PCI, celui-ci peut adopter cette méthode de lutte". Voilà un raisonnement pour le moins astucieux : dans le vieux parti parlementaire nous devions être antiparlementaires mais maintenant, puisque notre parti est antiparlementaire, alors nous pouvons faire du parlementarisme. Nous ne doutons pas que cette argumentation puisse impressionner les patriotes du parti qui, pas un instant, n'osent mettre en doute son infaillibilité révolutionnaire, garantie a priori et à jamais.
Ceux par contre, qui ont connu l'IC pour y avoir milité ou simplement pour avoir étudié son histoire, seront probablement moins enclins à ouvrir un tel crédit à n'importe quel parti, fût-il même le Parti de Damen et de Maffi.
Croit-on vraiment que le Parti Bolchevik et l'IC dans ses premières années, étaient moins sincèrement révolutionnaires que le PCI d'Italie ? Ils offraient au moins autant de garantie, ne serait-ce que par le fait qu'ils exprimaient les positions programmatiques les plus avancées du prolétariat de l'époque alors que le PCI d'Italie, d'après ses propres aveux, retarde notablement. Cependant, toutes les précautions prises par l'IC (lire les thèses du 11° Congrès sur le parlementarisme révolutionnaire) n'ont pas empêché cette politique de devenir un levier de l'opportunisme. C'est que la dégénérescence du Parti n'est pas uniquement fonction de la situation générale et de rapports de forces entre classes, mais est encore fonction de la politique pratiquée par le Parti. Le prolétariat a trop payé durant ces derniers 25 ans pour que les militants d'avant-garde oublient cette vérité première.
A quel point est savonneuse la pente participationniste, nous le constatons par les résultats obtenus, auxquels on se réfère volontairement à chaque instant pour prouver la force et l'influence du parti.'
Le rapporteur au Congrès n'a pas manqué de citer que dans telle région, la liste du Parti aux dernières élections, a obtenu quatre fois plus de voix. Comme si on pouvait parler de force et d'influence du Parti alors que la vente de la presse baisse, que l'organisation a perdu la moitié de ses membres, et que le niveau idéologique des membres, de l'aveu même des responsables, est "lamentable". En entendant Damen parler des victoires du Parti, on ne peut manquer de penser qu'il y a des victoires qui sont les pires des défaites.
Peut-être ne serait-il pas inutile, pour calmer un peu la fièvre des participationnistes, de leur citer l'exemple du parti trotskyste en France qui en 1946 avait également obtenu un succès groupant sur ses listes près de 70.000 voix.
Cela n'a pas empêché ce parti de voir la masse de ses électeurs fondre comme neige au soleil aux élections suivantes, et un an après, voir fondre ses propres rangs. Une bonne partie de ses militants poussant la logique à aller vers les masses à fond, a fini par aller au Rassemblement Démocratique Révolutionnaire où le nombre est plus grand et où leurs paroles peuvent avoir plus d'écho.
Car c'est exactement ainsi que raisonne le camarade Damen : "En participant aux élections" dit-il aux anti-participationnistes le parti a pu pénétrer dans les grandes masses, porter la nouvelle parole, essayer de donner corps aux vagues aspirations de sortir des chemins battus". Pris par un noble sentiment de semer la bonne parole, l'idée ne lui vient pas à l'esprit que pour lever, la semence doit être faite en terrain approprié, sinon ce n'est qu'un gaspillage de grains et d'énergies. Le révolutionnaire n'a pas à s'inspirer des missionnaires de l'Armée du Salut allant prêcher la parole divine dans les bordels. La conscience socialiste ne s'acquiert pas dans n'importe quelles conditions, elle n'est pas le fait de l'action volontariste, mais présuppose une tendance de détachement des ouvriers d'avec l'idéologie bourgeoise, et ce n'est sûrement pas les campagnes électorales, moments de choix de l'abrutissement des ouvriers qui offrent cette condition.
Il y a longtemps qu'il a été mis en évidence que les racines psychologiques de l'opportunisme sont, aussi paradoxal que cela puisse paraître, son impatience d'agir, son incapacité d'accepter le temps de recul et d'attente. Il lui faut immédiatement " pénétrer dans les masses, porter la nouvelle parole". Il ne prend pas le temps de regarder où il met les pieds. Il est impatient de planter le drapeau du socialisme, oubliant dans sa précipitation que ce drapeau n'a de valeur que pour autant qu'il est planté sur un terrain de classe du prolétariat et non quand il est jeté sur le premier tas de fumier du capitalisme.
Malgré l'orthodoxie léniniste, la trique de la discipline et les succès enregistrés, la résistance des militants contre la politique de la participation augmentait sans cesse. Cela prouve que le PCI d'Italie repose sur des éléments de base très sains. Mais malgré les vives critiques, le Congrès n'a pas résolu la question. Le compromis accepté de renoncer à la participation aux élections de Novembre laisse cependant la question de principe ouverte. Le culte de l'unité et de " ne troublons pas les membres de base" ont prévalu sur la clarté et l'intransigeance des positions. Ce n'est qu'un recul pour mieux sauter. Les militants révolutionnaires ne sauraient se contenter longtemps de ces demi-mesures. Avec ou sans 1 *assentiment des chefs de file, ils devront liquider ces " vieilles armes émoussées " ou se liquider eux-mêmes en tant que révolutionnaires.
LE PROBLEME SYNDICAL
C’est assurément la position prise sur le problème syndical qui présente le fait saillant du Congrès.
Quelle était la position antérieure du PCI ? La plus platement orthodoxe, une copie conforme des thèses de l'IC.
" Le travail au sein des organisations économiques syndicales des travailleurs, en vue de leur développement et de leur renforcement, est une des premières tâches politiques du Parti."
" Le parti aspire à la reconstruction d'une confédération syndicale unitaire, indépendante des commissions d'Etat et agissant avec les méthodes de la lutte de classe et de l'action directe contre le patronat, depuis les revendications locales et de catégories jusqu'aux revendications générales de classes ... Les Communistes ne proposent et ne provoquent la scission des syndicats du fait que les organismes de direction seraient conquis ou détenus par d'autres partis " (Plateforme du PCI - 1946).
C'est sur cette base qu'a été fondé le travail dans les syndicats et allant jusqu'à la participation, là où cela a été possible, surtout en province et dans les petits syndicats, dans les commissions et directions syndicales. Il a soutenu sans réserves les luttes revendicatives économiques considérant ces luttes comme " une des premières tâches politiques du Parti".
Cette conception fut longtemps un principe pour la GCI. Une des raisons de l'hostilité de la GCI à notre égard était notre position antisyndicale. Nous ne pouvons donc qu'exprimer notre satisfaction de voir le PCI abandonner aujourd'hui la plus grande partie de ses vieilles positions concernant l'organisation syndicale, et les revendications économiques.
Nous ne pouvons que souscrire à cette définition:
" Le Parti affirme catégoriquement que le syndicat actuel est un organe fondamental de l'Etat capitaliste y ayant pour but d’emprisonner le prolétariat dans le mécanisme productif de la collectivité nationale " ou encore " la classe ouvrière, au cours de son attaque révolutionnaire3 devra détruire le syndicat comme un des mécanismes les plus sensibles de la domination de classe du capitalisme". Nous souscrivons d'autant plus volontiers que nous retrouvons là, non seulement les idées que nous avons défendues depuis longtemps, mais la reproduction jusqu'à nos propres termes et expressions ([4] [482]).
Remarquons cependant que dans la question syndicale, comme dans bien d'autres questions, le PCI a laissé une fois de plus une petite fenêtre ouverte permettant à l'occasion la repénétration de ces mêmes idées qu'on vient de rejeter par la porte.
Par exemple quand le PCI déclare "son indifférence concernant la question formelle de l'adhésion ou non du travailleur au syndicat", il ne fait que prendre une position passive qui cache mal son attachement affectif au syndicat. Dire que "ce serait pêcher par abstraction que propager le mot d'ordre de la sortie des syndicats; mot d'ordre concevable seulement quand les situations historiques poseront les conditions objectives pour le sabotage du syndicat", c'est chercher des prétextes sophistiqués pour ne pas choquer les sentiments arriérés des masses. Si on est convaincu que le syndicat est et ne peut désormais être qu'un organisme d'Etat capitaliste, avec la fonction d'emprisonner les ouvriers au service de la conservation du régime capitaliste, on ne peut rester "indifférent" au fait que l'ouvrier en fait ou non partie organiquement, pas plus que nous ne restons indifférents au fait que les ouvriers fassent ou non partie des maquis, des comités de libération nationale, des partis ou toutes autres formations politiques du capitalisme.
Il n'est jamais venu à l'esprit d'un militant sérieux que l'abandon par les ouvriers des formations politiques du capitalisme dépend de ce qu'il lancera ou non le mot d'ordre. Il sait parfaitement que cela sera le résultat des conditions objectives; mais cependant cela ne l'empêche pas, mais au contraire, exige de lui de faire de la propagande et d'appeler les ouvriers à déserter ces organisations de la bourgeoisie. La désertion des organisations du capitalisme n'est pas seulement une manifestation mais également une condition de la prise de conscience des ouvriers. Et cela reste valable aussi bien pour les organisations syndicales que pour les organisations politiques. De toutes façons, l'indifférence en matière de positions politiques n'est que le camouflage d'un acquiescement effectif et honteux.
Mais il y a mieux. Le PCI dénonce les syndicats mais préconise le rassemblement des ouvriers dans la fraction syndicale. Qu'est-ce donc que cette fraction syndicale ?
" C'est -dit d'abord le document de la CE déjà cité- le réseau des groupes d'usines du parti qui agissant sur la base unitaire de son programme etc ...constituent la fraction syndicale".
On serait tenté de croire à la première lecture qu'il s'agit tout simplement de cellules du Parti, mais à examiner de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de toute autre chose. Premièrement, on comprend difficilement pourquoi l'ensemble des cellules d'usines se constitueraient en un organisme à part, séparant et divisant l'unité du Parti en deux : d'un côté les ouvriers groupés à part dans les cellules d'usines et d'un autre côté les non-ouvriers groupés on ne sait exactement où, mais également à part.
Deuxièmement, la gauche italienne s'est toujours opposée dans l'IC à l'introduction de cette structure des cellules d'usines, voyant en elles une tendance à l'ouvriérisme et un moyen bureaucratique d'étouffer la vie idéologique du Parti ([5] [483]). Il serait vraiment surprenant que le PCI rompe aujourd'hui avec cette position traditionnelle et plus que jamais valable. Troisièmement, quelles peuvent donc être les tâches spécifiques des membres ouvriers du Parti distinctes des taches de l'ensemble du Parti, et finalement on ne comprend pas que cet organisme centralisé, unifié sur le plan de l'ensemble du pays, constituerait et porterait précisément le nom de ... fraction syndicale.
En vérité la fraction syndicale n'est pas les cellules d'usines du Parti, mais bien une organisation séparée, distincte du Parti créée par celui-ci et dirigée par lui. Certainement le Parti ne se fait pas trop d'illusions sur l'ampleur que peut prendre cette organisation dans l'immédiat : " dans la situation actuelle, c'est la réduction de la fraction syndicale aux seuls membres du parti et_ à quelques sympathisants, agissant dans l'usine ou dans le syndicat, qui se vérifiera le plus souvent". Mais ce n'est pas pour cela que le Parti crée cette organisation; il la destine à une fonction bien plus importante :
" II ne dépend pas d’un effort volontariste du Parti mais de l'évolution de la situation générale et de la dynamique des luttes sociales, que des prolétaires, syndiqués ou non, inscrits ou non à d'autres partis, se rassemblent autour de nos groupes d'usine".
De ces textes, il ressort clairement que la fraction syndicale a une double fonction. Dans l'immédiat " agissant dans l'usine ou dans le syndicat", et de servir dès à présent de noyaux autour desquels se rassembleront demain les ouvriers de toutes les tendances, de tous les partis, en quelques sorte des embryons de soviets.
Il est à remarquer que le PCI qui craint de "pêcher par abstraction" en préconisant la désertion des syndicats en l'absence des conditions objectives nécessaires, ne craint cependant pas le péché de bluff en constituant aujourd'hui les embryons de futurs soviets.
D'une part, le parti a renoncé à son action dans les syndicats et à l'illusion de pouvoir agir, actuellement, dans les masses, d'autre part il reprend la même action syndicale et le travail des masses, non directement mais par l'intermédiaire d'une organisation spéciale créée à cette fin :1a fraction syndicale. Aussi ne pourrait-on rien lui reprocher, chacun a son compte et tout le monde est content.
Ainsi le pas en avant fait dans la question a été immédiatement suivi de deux pas en arrière ([6] [484])
Finalement l'erreur d'hier a été doublée d'une confusion d'aujourd'hui. En ajoutant la confusion nouvelle à l'erreur passée, ça ne fait toujours qu'une confusion dans l'erreur et on n'a pas avancé d'un iota.
CONCLUSIONS
Nous venons de faire l'examen des travaux du P.C.I. Si on ne peut pas parler de son apport dans la clarification des problèmes fondamentaux de l'époque, de l'avis même de ses partisans on peut constater que le plus clair de son travail consistait dans le bouleversement total qu'il a apporté dans les positions et l'orientation prises à sa Conférence constitutive.
On trouverait difficilement un autre exemple dans les annales des groupes politiques, où une plateforme constitutive se trouve être aussi profondément malmenée et infirmée, dans un laps de temps aussi court.
Notre époque peut avec raison être caractérisée par ces changements brusques et la rapidité de son cours. Mais on ne saurait attribuer à cela le vieillissement surprenant de la Plateforme du P.C.I. car elle était déjà hors du cours et frappée de sénilité à sa naissance. Cette constatation faite par les délégués eux-mêmes au Congrès n'est pas le fait du hasard. Elle a ses racines, entre autre, dans la suffisance et la prétention de détenir seule la vérité révolutionnaire, haussant les épaules à la seule idée de pouvoir apprendre quelque chose dans la confrontation d'idées avec d'autres groupes révolutionnaires dans les divers pays.
Deux ans et demi ont suffi pour ne laisser subsister intactes aucune des pages de la Plateforme de Décembre 1945. C'est une leçon sévère mais qui pourrait être salutaire si les camarades de la CCI comprennent et acceptent cette leçon. A cette seule condition l'expérience pourrait ne pas avoir été vaine.
Pour finir, et dans la mesure où il nous est possible et permis de juger de loin et de formuler un avis, nous estimons prématurée la conclusion tirée par le camarade Bernard qui dit" "pour les militants sincèrement révolutionnaires il n'y a pas d'autre voie que la scission et la création d'un nouveau regroupement politique qui ait comme tâche fondamentale la recherche et la formulation des bases idéologiques pour la formation future du vrai parti de classe". Nous ne méconnaissons pas les immenses difficultés auxquelles peuvent se heurter ces camarades dans l'atmosphère qui règne dans le PCI. Mais il est incontestable que le PCI d'Italie reste à ce jour la principale organisation révolutionnaire prolétarienne et probablement la plus avancée en Italie. Tout comme après la Conférence de 1945 nous estimons qu'en son sein sont rassemblés un grand nombre de militants révolutionnaires sains, et de ce fait cette organisation ne peut être considérée comme perdue d'avance pour le prolétariat.
En 1945 nous écrivions que derrière le patriotisme et l'apparence d'unité existent des divergences réelles qui ne manqueront pas de se manifester et de se cristalliser en tendances opportunistes et révolutionnaires. Aider à cette cristallisation, contribuer à dégager les énergies révolutionnaires afin qu'elles puissent trouver leur maturation et leur expression la plus avancée, tel nous paraît être encore aujourd'hui la tâche la plus urgente du révolutionnaire sincère.
(Bulletin de Mai 1948 sur le Congrès du P.C.I. d'Italie).
[1] [485] Faute de place, nous ne pouvons pas publier toujours des articles in extenso. Nous savons combien cela est insatisfaisant, souvent gênant, comportant le risque de la déformation et nous sommes les premiers à le déplorer. Nous nous efforcerons autant que possible de 1'éviter, la meilleure solution étant certainement la publication d'un recueil des principaux articles de cette revue. Un souhait à réaliser.
[2] [486] Voir cette "théorisation" chez les dissidents bordiguistes et situationnistes comme le"Mouvement Communiste", "Négation", et tout particulièrement dans "Invariance" n°2 nouvelle série.
[3] [487] Il est peut-être nécessaire d'insister sur une autre erreur couramment commise et qui consiste à lier l'existence du Parti à la période révolutionnaire et insurrectionnelle. Cette "idée" qui ne conçoit 1 'existence du Parti qu'uniquement en période de révolution est source de bien des confusions.
a) Elle confond le Parti avec les Conseils. Ces derniers parce qu'ils sont 1'organisation spécifique de la classe pour la conduite de la révolution et la prise du pouvoir - ce qui n'est pas la fonction du Parti - ne peuvent apparaître et exister qu'uniquement dans la révolution.
b) Une telle idée reviendrait à dire qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de Parti de la classe ouvrière. Ce qui est une pure absurdité.
c) C'est ignorer les raisons du surgissement du Parti dans la classe et ses fonctions, dont une principale est d'être un facteur actif dans le processus de prise de conscience de la classe.
d) "L'organisation des ouvriers en classe donc en Parti" (Marx) signifie un caractère constant, de 1'existence du Parti, que seule une période de défaite et de réaction profonde vient à mettre en question.
Une période de reprise et de développement des luttes de classe du prolétariat ouvre le processus de la reconstruction du Parti. Ne pas le comprendre c'est maintenir les pieds sur les freins au moment où la route amorce une longue montée.
[4] [488] Voir notamment nos thèses sur les problèmes actuels du mouvement ouvrier. INTERNATIONALISME n°31, Février 1948.
[5] [489] Voir par exemple l'article "LÀ NATURE DU PARTI" publié par Bordiga en 1924.
[6] [490] Pour qu'on ne nous accuse pas de déformation intentionnelle de la pensée du PCI, nous citerons l'explication donnée par la Fraction Belge sur ce point : "s'il y a des ouvriers qui ne veulent pas adhérer au Parti, encadrer ceux-ci dans les fractions syndicales du Parti, qui seront peut-être aussi demain les bases pour la création de nouveaux syndicats".
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [381]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 37 - 2e trimestre 1984
- 2528 reads
La reprise de la lutte de classe
- 2646 reads
Avec les années 80, l’économie capitaliste s’enfonce dans une impasse de plus en plus complète, l’histoire s'accélère. Les caractéristiques profondes et fondamentales de la décadence capitaliste sont mises à nu. En ce sens, les années 80 sont bien des "années de vérité" où les véritables enjeux de la vie de la société apparaissent de plus en plus au grand jour : guerre généralisée et destruction de l'humanité, ou révolution communiste internationale.
Les deux termes de cette alternative existent de façon constante dans la vie de la société depuis l'aube de la décadence : "l'ère des guerres et des révolutions prolétariennes" qu'avait défini l'Internationale Communiste. Mais ils ne se posent pas de façon symétrique et ne pèsent pas du même poids à tout moment sur l'avenir qui se profile. Depuis 68, le prolétariat, seule classe porteuse d'une solution historique à la décadence du capitalisme, a ressurgi sur la scène de l'histoire, ouvrant un cours à des affrontements de classe. Cela ne signifie pas que les conflits inter impérialistes se sont tus. Au contraire, ils n'ont jamais cessé,et, avec les années 80, c'est à 1'exacerbation de ces antagonismes qu'on assiste, à une inféodation croissante de toute la vie économique aux nécessités militaires, à la poursuite et à l'accentuation de la barbarie capitaliste avec ses monceaux de cadavres et de destruction que viennent encore une fois d'illustrer dernièrement la poursuite de la guerre au Liban et les hideux massacres perpétrés dans le renouveau de la guerre Irak Iran. Mais cela signifie que le prolétariat, par sa combativité, par sa non adhésion à l'idéologie dominante, par sa non soumission à la classe capitaliste, barre la route à la généralisation de ces conflits en une troisième conflagration mondiale. ([1] [491])
Cette affirmation du caractère déterminant de la lutte du prolétariat dans la situation actuelle peut paraître gratuite quand on regarde le tableau désolé et sans perspectives que nous offrent les médias bourgeois. Mais la compréhension des grandes tendances qui caractérisent une situation et sa dynamique, ne peut se suffire de l'apparence superficielle et mystifiée des choses présentée par la classe dominante. C'est que la lutte du prolétariat, en tant que lutte d'une classe exploitée,ne peut suivre un cours linéaire, ne peut développer graduellement sa force. Expression du rapport de forces entre deux classes antagoniques, la lutte de classe suit un cours sinueux, en dents de scie, fait d'avancées, de reculs durant lesquels la classe dominante s'efforce d'effacer et de détruire toute trace des avancées précédentes. Cette tendance est exacerbée dans la période de décadence où la forme de domination politico-économique de la bourgeoisie qu'est le capitalisme d'Etat tend en permanence à absorber toute manifestation de la vie sociale. Pour autant, la lutte de classe subsiste comme moteur de 1'histoire et 1'on ne peut comprendre pourquoi la situation de décomposition accélérée dans laquelle la crise historique du système a jeté la société, perdure sans déboucher dans une boucherie généralisée, si l'on ne saisit pas que le prolétariat a constitué et continue d'être l'entrave déterminante à l'aboutissement des tendances guerrières du capitalisme.
LA LUTTE REPREND DANS TOUS LES PAYS
Depuis 1968, nous avons assisté à deux avancées du prolétariat international : de 68 à 74 où la bourgeoisie a été surprise par la réémergence de cette force sociale qu'elle croyait définitivement enterrée, et de 78 à 80 où le mouvement a culminé en Pologne avec une grève de masse développant toutes les caractéristiques de la lutte de classe en période de décadence ([2] [492]). Depuis la mi-83, la tendance à la reprise des luttes du prolétariat dont nous avions annoncé la perspective après deux années de déboussolement et de paralysie à la suite de la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne ([3] [493]), s'est réaffirmée : en BELGIQUE, en HOLLANDE, en ALLEMAGNE, en GRANDE BRETAGNE, en FRANCE, aux ETATS-UNIS, en SUEDE, en ESPAGNE, en ITALIE etc., des grèves ont éclaté contre les mesures d ' austérité draconiennes imposées par la bourgeoisie, touchant tous les pays du coeur du monde industriel où se joue la perspective historique pour l'humanité ([4] [494]). Dans les pays secondaires carme la Tunisie, le Maroc, la Roumanie, des émeutes et des grèves ont explosé. C'est une tendance internationale de résistance à la logique infernale de la crise du capital qui se dessine à nouveau.
Les "Thèses sur la reprise de la lutte de classe" que nous publions plus loin, mettent en évidence les grandes lignes qui ont présidé à l'avancée du prolétariat durant les deux vagues de lut te précédentes et tracent les caractéristiques de celle qui ne fait que commencer.
Si prises séparément, une à une, aucune des luttes qui ont eu lieu dans les pays mentionnés plus haut n'est en soi profondément significative d'un grand pas en avant du prolétariat international, le contexte de crise exacerbée, de décomposition sociale, d'usure des mystifications, de fossé grandissant entre l'Etat et la société civile, le phénomène d'accélération de l'histoire constituent le terrain propice au développement de la conscience du prolétariat révolutionnaire. Ce sont le caractère international et historique de ces réactions, la compréhension du processus de prise de conscience au travers de l'accumulation de ses expériences, de l'évolution de ses luttes et de leur dynamique qui nous donnent la clé des perspectives qui s'ouvrent au prolétariat et existent en germe dans ce renouveau de la combativité.
EN GERME, LES TRAITS DE L'AVENIR
Aucune des luttes que nous avons vu se développer depuis l'importante grève du secteur public en Belgique en septembre 83 n'a permis réellement de faire reculer la bourgeoisie sur les mesures qu'elle voulait imposer à la classe ouvrière. Que ce soit les luttes du secteur public en Hollande ou celle des employés de la compagnie de bus Greyhound aux Etats-Unis contre la baisse des salaires, que ce soit celle des sidérurgistes de Sagunto en Espagne ou des ouvriers de l'usine automobile Talbot-Poissy en France contre les licenciements, ou encore celle des postes en France contre l'augmentation des heures de travail, etc., aucune n'a obtenu de résultat, même momentanément. Cependant, le fa^t que le prolétariat résiste, qu'il ne se laisse pas imposer quasiment passivement ces mesures, comme ça a pu être le cas par exemple aux USA où, pendant 4 ans, de nombreux secteurs ont accepté sans réaction des baisses de salaire, est un signe très positif de sa non soumission aux intérêts de l'économie nationale, de sa combativité. Et la première victoire de la lutte, c'est la lutte elle-même.
Alors que les nécessites d'un développement de la perspective historique de lutte de classe vont imposer à la classe ouvrière, conformément aux caractéristiques des luttes dans la période de décadence, une extension et une auto organisation de ses combats, une confrontation radicale à l'appareil syndical et à toutes les mystifications démocratiques et syndicalistes de la bourgeoisie, une politisation de son mouvement, aucune des luttes qui ont eu lieu n'a réellement réussi à développer pleinement ne serait-ce qu'une seule de ces caractéristiques. Cependant, examinons de plus près, à la lumière de ces nécessités, quelques aspects de ces divers mouvements :
- par rapport à la nécessité de l'extension de la lutte, c'est-à-dire la prise de conscience que le prolétariat ne peut pas se battre de façon isolée, minoritaire, qu'il ne peut pas imposer un rapport de forces en sa faveur sans s'impliquer massivement dans le combat, nous ..avons assisté en Belgique à une tentative spontanée d'extension du mouvement par les cheminots de Charleroi, dépassant dès le départ l'éternelle division communautaire et linguistique Flandres/Wallonie largement usée dans le passé par la bourgeoisie pour dévoyer le prolétariat. Les syndicats se sont trouvés dans l'obligation d'"étendre" la grève à tout le secteur public, visant par là à noyer le mouvement dans des parties moins combatives des travailleurs et à imposer la division catégorielle "secteur public"-"secteur privé". Ce n'est pourtant qu'au bout de trois semaines, après avoir impliqué plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans un pays de 9 millions d'habitants, que la grève s'est terminée. A peine celle-ci finie que démarrait dans le paradis du Welfare State" qu'est la Hollande, une grève du secteur public également, la première depuis 1903, qui allait durer 6 semaines. Celle-ci a commencé sous la poussée de la combativité des cheminots et des chauffeurs de bus, et si, grâce à la collaboration étroite entre syndicats belges et syndicats hollandais, et entre toutes les fractions de droite, de gauche et syndicales de la bourgeoisie nationale, plus l'organisation d'une campagne "pacifiste" en plein milieu du mouvement, celui-ci a abouti dans une impasse, ce n'est pas sans mal que la situation est rentrée "dans l'ordre".
Aux USA, des ouvriers d'autres secteurs ont soutenu la grève des employés du Greyhound en participant aux piquets ; les syndicats ont du organiser leur éternelle "aide financière" sous forme de "cadeaux de Noël" aux employés du Greyhound pour répondre au sentiment de solidarité qui se manifestait dans la population et empêcher la réelle et seule solidarité de classe possible, celle de la lutte, de s’exprimer
- par rapport à la nécessité de l'auto organisation de la lutte, des assemblées générales ont eu lieu dans la plupart des mouvements. Mais la question de l'auto organisation pose et contient le problème de la confrontation aux syndicats, c'est-à-dire un pas que le prolétariat n'a pas encore franchi et qui implique un niveau de confiance en lui-même et de conscience qui n'est encore qu'en germe aujourd'hui. Cependant, la question syndicale a été posée dans de multiples cas, dans ces tous premiers mouvements de la reprise. La plupart de ces grèves ont été déclenchées spontanément, sans attendre les consignes syndicales, ou si les syndicats ont su prendre dès le départ le mouvement sous leur responsabilité, comme en Hollande ou dans les grèves en Italie, c'est bien parce qu'ils comprenaient que les mouvements auraient lieu de toutes façons. En Belgique, c'est en dehors des syndicats qu'a démarré le mouvement qu'ils n'ont pu reprendre en main qu'au bout de trois jours ; en Hollande à de nombreuses reprises dans des assemblées générales çà et là, les consignes syndicales n'ont pas été suivies. En Grande Bretagne, 1200 ouvriers ont manifesté contre des manoeuvres syndicales. Même en Suède où la grève des mineurs de Kiruna qui n'a duré qu'une journée, avait été appelée par le syndicat, la consigne de celui-ci qu'une partie seulement des mineurs fasse grève, a été débordée, et tous les mineurs s'y sont mis. Partout, en Italie, en France, en Espagne, en Hollande, en Belgique, c'est au syndicalisme de base, avec son langage radical qu'ont été laissées les choses en main, les appareils étant de moins en moins suivis, sinon pas du tout. L'usure de la mystification syndicale commence d'ores et déjà à se faire sentir, posant les jalons de la future capacité de la classe à prendre en main son propre destin, de son auto organisation.
- par rapport à la question de la politisation du mouvement, c'est-à-dire l'établissement d'un rapport de forces du prolétariat face à l'Etat comme on a pu le voir pleinement développé en août 80 en Pologne, cette question contient la capacité du prolétariat à s'organiser et à étendre lui-même sa lutte. On n'en est pas encore là. Mais d'ores et déjà la question de l'Etat est posée dans les grèves des fonctionnaires qui sont de moins en moins mystifiés par le caractère soi -disant "social" de l'Etat, dans la résistance aux mesures d'austérité que la crise impose à chaque Etat de prendre contre les ouvriers. Elle est par exemple clairement posée dans la confrontation à Sagunto en Espagne entre sidérurgistes et forces de l'ordre, des forces de l'ordre "socialistes". La démystification du caractère réactionnaire des syndicats en tant que rouages de l'Etat fait aussi partie des jalons de cette prise de conscience politique.
Ce qu'on peut conclure de ces quelques éléments, c'est qu'au tout début de cette reprise, la classe ouvrière se heurte aux obstacles sur lesquels elle avait échoué lors de la vague de 78-80 : face à la nécessité de l'extension, les syndicats proposent une fausse extension catégorielle ; face à la nécessité de l'auto organisation, les syndicalistes de base proposent des comités de grève syndicaux "à la base" ; face à la nécessite de la solidarité active, les syndicats proposent le soutien "matériel" inefficace aujourd'hui ; face au problème de la politisation, les syndicats proposent la fausse radicalisation verbale du syndicalisme "de combat" dont les gauchistes se font les fervents porteurs. Ainsi, tous les ingrédients de la précédente vague sont déjà présents.
En réalité, la mise en place de la gauche dans l'opposition face à la précédente vague de luttes en 78-80, la "radicalisation" soudaine des partis de gauche et des syndicats après des années de langage "responsable" en vue d'accéder au pouvoir, la réapparition du syndicalisme de base et des gauchistes en son sein ont été les anti-corps sécrétés par la bourgeoisie contre le prolétariat et qui l'ont momentanément déboussolé. Aujourd'hui, ces anti-corps existent dès le début des luttes, tentant d'en saboter la dynamique dès l'origine, mais, en même temps, dédorant leur blason.
En ce sens, ce troisième mouvement de reprise ne peut être que plus difficile au départ, le prolétariat occidental se heurtant à la bourgeoisie la plus forte et la plus expérimentée du monde, contrairement à ce qui se présentait en Pologne en 80. Il se fera de façon relativement lente, mais cette difficulté même est porteuse de leçons plus profondes.
Lorsqu'une vague de luttes reprend à l'échelle internationale, on ne peut s'attendre automatiquement à ce qu'un pas qualitatif s'opère à son début. Avant que la progression ne se marque, le prolétariat doit souvent revivre dans la pratique les difficultés auxquelles il a été confronté, et c'est la dynamique même de la lutte combinée à l'accumulation des expériences favorisée justement par l’accélération de la crise qui permettra à la conscience de s'épanouir plus largement.
Les conditions de la révolution communiste ont été définies par Marx et Engels, dès l'origine .du mouvement ouvrier : crise économique internationale, internationalisation des luttes. Aujourd'hui, les conditions de la généralisation des combats de la classe ouvrière qui contient la perspective révolutionnaire, se réunissent. Il y aura encore des avancées et des reculs. Les enjeux de l'histoire ne sont pas joués d'avance, mais ils sont en train de se jouer. Les organisations révolutionnaires doivent être à même de reconnaître la dynamique de la perspective historique, afin d'assumer dans leur classe la fonction déterminante pour laquelle elle les a sécrétées.
CN.
[1] [495] Voir l’article"conflits inter-impérialistes et lutte~de classe":"l’histoire s'accélère", in Revue Internationale n° 36, 1er trimestre 84.
[2] [496] Voir tous les articles sur la lutte de classe en Pologne, ses enseignements et ses implications, in Revue Internationale n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
[3] [497] Voir l'article "Où va la lutte de classe ? Vers la fin du repli de 1'après-Pologne", in Revue Internationale n° 33, 2e trimestre 83.
[4] [498] Voir l'article "Le prolétariat d'Europe de l'ouest au coeur de la généralisation de la lutte de classe" in Revue Internationale n° 31,.4e trimestre 82.
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe
- 2454 reads
1 - Le 5e Congrès du CCI constatait, dans sa ré solution sur la situation internationale ([1] [499]) que "la crise qui maintenant atteint de -plein fouet les métropoles du capitalisme, obligera le prolétariat de ces métropoles à exprimer ses réserves de combativité qui n’ont pas été jusqu'à présent entamées de façon décisive". "La crise se révèle la meilleure alliée du prolétariat mondial". Ce qui n'était qu'annoncé au moment du Congrès, sans qu'il n'en soit prévu l'imminence, est devenu aujourd'hui une réalité. Depuis le milieu de 1983,- la classe ouvrière est sortie du recul marqué du sceau de la défaite en Pologne en 81 et s'est engagée dans une nouvelle vague de combats contre le capitalisme. En moins de 6 mois, ce sont des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la France, les Etats-Unis, l'Espagne et dans une moindre mesure, l'Allemagne, la Grande Bretagne et l'Italie qui ont connu des mouvements importants et significatifs de la classe.
2 - La reprise actuelle des luttes exprime le fait que, dans la période présente d'aggravation inexorable et catastrophique de la crise du capitalisme située dans un contexte général de cours historique aux affrontements de classe, les moments de recul du prolétariat sont et seront de plus en plus de courte durée. Ce qui se révèle dans cette reprise, c'est qu'aujourd'hui, les défaites partielles et la désorientation momentanée qui les permet ou qu'elles provoquent, ne sauraient entraver de façon décisive la capacité du prolétariat à riposter de façon croissante aux attaques économiques de plus en plus violences que lui assène le capital. Elle illustre une nouvelle fois le fait que, depuis 1968, c'est la classe ouvrière mondiale qui détient l'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à une bourgeoisie qui, malgré une défense pas à pas et un déploiement massif et impressionnant de son arsenal anti-ouvrier, n'a pas les mains libres pour apporter sa réponse propre à sa crise : la guerre impérialiste généralisée.
3 - La vague présente de lutte s'annonce d'ores et déjà comme devant dépasser en ampleur et en importance les deux vagues qui l'ont précédée depuis la reprise historique de la fin des années 60 : celle de 1968-74, et celle de 1978-80.
La première vague a eu comme caractéristiques majeures :
- d'annoncer avec fracas et de façon spectaculaire (notamment avec Mai 68 en France, le Mai rampant italien, les affrontements de Pologne) la fin de la période de contre-révolution, l'entrée du capitalisme dans une période nouvelle dominée par la confrontation entre les deux classes décisives de la société,
- de surprendre la classe bourgeoise qui avait perdu l'habitude de voir le prolétariat comme acteur de premier plan dans la vie de la société,
- de se développer à partir d'une situation économique encore relativement peu dégradée, ce qui laissait la place pour de nombreuses illusions au sein du prolétariat et notamment celle de l'existence d'une "alternative de gauche".
La deuxième vague se distingue par les éléments suivants :
- elle se base sur une dégradation beaucoup plus avancée de l'économie capitaliste, des attaques beaucoup plus sévères contre les conditions de vie de la classe,
- elle se situe à une période charnière entre deux moments du développement de la situation historique : les "années d'illusion" et les "années de vérité",
- elle voit la bourgeoisie des pays avancés réorienter sa stratégie face au prolétariat, remplacer la carte de "la gauche au pouvoir" par celle de "la gauche dans l'opposition",
- elle fait pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, avec les combats de Pologne 80, l'expérience de cette arme décisive de la classe dans la période de décadence:1a grève de masse,
- elle culmine dans un pays de la périphérie appartenant au bloc le plus "arriéré", ce qui met en évidence l'aptitude retrouvée de la bourgeoisie des métropoles du capital à opposer des lignes de défense encore considérables aux luttes ouvrières.
La vague de luttes actuelles tire sa source de l'épuisement' de ce\qui avait permis le recul de 1'après-Pologne :
- reste des illusions propres aux années 70 qui ont été définitivement balayées par la très forte récession de 1980-82,
- désarroi momentané provoqué tant par le passage de la gauche dans l'opposition que par la défaite en Pologne.
Elle démarre :
- à partir d'une longue période d'austérité et de montée du chômage, d'une intensification des attaques économiques contre la classe ouvrière dans les pays centraux,
- à la suite de plusieurs années d'utilisation de la carte de la gauche dans l'opposition et de l'ensemble des mystifications qui y sont associées.
Pour ces raisons, elle va se poursuivre par des engagements de plus en plus puissants et déterminés du prolétariat des métropoles contre le capitalisme dont le point culminant se situera de ce fait à un niveau supérieur à celui de chacune des vagues précédentes.
4 - Les caractéristiques de la vague présente, tel les qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :
- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes, tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats,
- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes,
- développement progressif, au sein de l'ensemble du prolétariat,de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes,
- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de l'aptitude à leur auto organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications et qui s'est réalisé une nouvelle fois dans les affrontements de ces derniers mois.
5 - Contrairement à 1968, et en continuité avec ce qui s'était passé en 1978, la reprise actuel le ne trouve nullement devant elle une bourgeoisie sans préparation. Elle va se heurter à l'éventail complet des dispositifs que cette classe a déjà opposé à la combativité et à la prise de conscience du prolétariat, et qu'elle n'aura de cesse de perfectionner :
- mise en oeuvre de sa solidarité à l'échelle internationale qui se manifeste notamment par le black-out sur les luttes ou leur dénaturation par les médias,
- organisation de campagnes de diversions de toutes sortes (pacifisme, exploitation de scandales, etc.)
- mise en avant dans les luttes de revendications bourgeoises (défense de "l'économie nationale" ou de tel secteur économique ou encore des syndicats "menacés par la bourgeoisie"),
- faux appels à "l'extension" ou à la "généralisation" par les syndicats destinés à prévenir la menace d'une réelle extension,
- utilisation sélective et "intelligente" de la répression ayant pour but tant de démoraliser les ouvriers que de créer des "abcès de fixation" destinés à détourner la combativité de ses objectifs initiaux.
6 - La prise en considération et la dénonciation des moyens considérables et des obstacles mis en oeuvre par la bourgeoisie ne doit pas cependant conduire à un manque de confiance envers la capacité du prolétariat à les affronter et les surmonter. Cet arsenal sera responsable du développement lent, progressif des luttes dans les métropoles du capital (ce qui n'exclut pas la possibilité de brusques accélérations à certains moments, notamment là où la bourgeoisie n'a pas pu placer ses forces de gauche dans l'opposition comme en Espagne et surtout en France). En cela, les pays centraux continueront à se distinguer des pays de la périphérie (Europe de l'Est et surtout Tiers Monde) qui pourront connaître des explosions de colère et de désespoir, des "révoltes de la faim" violentes et massives mais sans perspectives propres et condamnées à une répression féroce. Cependant, l'utilisation permanente et de plus en plus intensive et simultanée par la bourgeoisie des pays avancés de tous ses moyens de sabotage des luttes, va nécessairement provoquer leur usure :
- les black-out et falsifications conduiront à une perte de confiance absolue envers les médias bourgeois,
- les campagnes de diversion montreront de plus en plus leur vrai visage face à la réalité des luttes sociales,
- les contorsions, même radicales, de la gauche, des gauchistes, des syndicats et du syndicalisme de base à force de conduire dans des impasses et à la défaite, provoqueront une méfiance croissante envers ces forces du capital comme cela se révèle déjà dans la période actuelle, notamment par une tendance nette à la désyndicalisation (en termes d'effectifs ou d'implication des ouvriers dans la vie syndicale),
- l'emploi de la répression, même s'il sera "modéré" dans les pays avancés dans la période qui vient, conduira en fin de compte à une prise de conscience de la nécessité de s'affronter directement et massivement à l'Etat.
En fin de compte, l'impasse économique totale du capitalisme, la misère croissante dans laquelle ce système va plonger la classe ouvrière, vont épuiser progressivement l'ensemble des mystifications qui ont permis jusqu'à présent à la bourgeoisie de maintenir son contrôle sur la société et, notamment, celles du "Welfare State". S'il est donc vain de s'attendre dans les pays centraux du capitalisme pour la période qui vient à des "sauts qualitatifs" brusques, à de soudains surgissements de la grève de masse, il est par contre nécessaire de souligner la tendance des affrontements qui ont d'ores et déjà commencé, à prendre un caractère de plus en plus massif, puissant, et simultané.
En ce sens, comme il l'a déjà été dit, "la crise reste la meilleure alliée du prolétariat mondial".
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise ? : Le mythe de la reprise économique
- 2602 reads
La bourgeoisie fait grand cas d'une soi-disant "reprise" économique qui marquerait la victoire des politiques d'austérité à la Reagan. L'OCDE, dans ses PERSPECTIVES ECONOMIQUES de décembre 83, commence son rapport par une affirmation presque triomphante : "La reprise de l'activité concerne désormais presque tous les pays de l'OCDE". Et de relever une série de points positifs : croissance du PNB et de la production industrielle, ralentissement de l'inflation, réduction des déficits budgétaires, augmentation des profits. Deux pages plus loin, l'OCDE écrit : "Si cette appréciation se révélait fausse, il faudrait revoir les prévisions quant à la vigueur et à la persistance de la reprise. " ... Ce genre de phrase montre à quel point la bourgeoisie elle-même a confiance en ce qu'elle annonce à grand fracas.
Il est un fait indéniable que plusieurs indicateurs économiques sont devenus positifs en 83 alors qu'ils étaient négatifs en 82, ce qui signifie que l'année 83 est moins pire que la précédente, du moins pour la bourgeoisie. De là à parler de reprise économique réelle il y a plus qu'un pas, il y a un fossé. Avant d'en analyser les causes et les perspectives, examinons brièvement la réalité de cette "reprise".
LA CROISSANCE DU PNB ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Cette croissance est pratiquement limitée aux Etats-Unis, et atteint des chiffres plutôt miserables. Le PNB a progressé de 3.5% en 83 aux Etats-Unis, mais n'atteint péniblement que 1% en Europe. La croissance de la production industrielle atteint 6% aux Etats-Unis, mais ne parvient même pas à compenser la chute de 82 (-8.1%) : au total des deux années le bilan reste à une baisse de -2.6% ! Quant aux pays européens, ils connaissent une croissance de leur production industrielle magnifique, puisqu'elle varie de ... -4.3% en Italie à 1% en Grande-Bretagne !
L'UTILISATION DES FORCES PRODUCTIVES
La sous-utilisation des forces productives est une des manifestations les plus claires de la surproduction. Malgré une augmentation de 10% par rapport à 82, le taux d'utilisation des capacités industrielles n'a pas dépassé 80% aux Etats-Unis. Quant au chômage, contrairement aux miracles annoncés, il n'a baissé, à l'échelle annuelle, que de 0.2% aux Etats-Unis, tandis qu'il a poursuivi sa progression hallucinante dans TOUS les pays Européens.
En pourcentage de la population active chiffres corrigés des variations saisonnières
LES INVESTISSEMENTS
Les investissements des entreprises ont continué à décliner, malgré la "reprise". Comme ces investissements sont la base d'une reprise à long terme, la bourgeoisie montre par là qu'elle ne croit pas elle-même en une telle reprise.
LE COMMERCE MONDIAL
Celui-ci a stagné en 83, après une baisse globale de 2% en 1982.
L'ensemble de ces chiffres (tirés pourtant des statistiques officielles de la bourgeoisie : OCDE) prouve sans conteste que, si le capitalisme connaît un pallier momentané dans l’approfondissement. de la crise, il ne s'agit nullement d'une reprise économique réelle. La seule évolution positive dont peut se targuer la bourgeoisie est la réduction effective de l'inflation, mais nous verrons plus loin ce que signifie cette réduction. L'existence d'un léger mieux temporaire dans un cours général vers l'effondrement ne fait que traduire le profil en dents de scie qui a toujours caractérisé l'évolution de l'économie capitaliste. L'important est de voir dans quel sens est orientée la scie : les dents sont aujourd'hui inclinées vers le bas, sans aucune perspective d'inversion de la tendance.
Après la récession profonde de 1975, la bourgeoisie occidentale a réagi en recourant massivement à l'usage de sa drogue classique : le crédit, l'impression de papier monnaie sans contrepartie économique. Les Etats-Unis ont joué à ce niveau un rôle de premier plan, la multiplication des dollars et le déficit de leur balance de paiements ayant un effet de locomotive sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est la faillite de cette politique au travers d'une inflation mondiale démesurée qui a poussé la bourgeoisie à renverser la tendance et à développer les conceptions monétaristes. L'histoire ne se répète pas, et aujourd'hui la bourgeoisie n'a plus les moyens de reproduire le même scénario, car le spectre d'un effondrement du système financier international, reste présent de façon constante, même sans inflation, ne fut-ce qu'à cause de l'endettement colossal de la plupart des Etats qui n'a fait que s'aggraver avec la hausse du dollar. C'est ainsi que, malgré la fameuse "reprise", les Etats-Unis ont enregistré un record de faillites bancaires en 83.
Le "truc" inventé par la bourgeoisie américaine pour stimuler l'économie sans engendrer d'inflation consiste essentiellement à provoquer un transfert de capitaux entre ses mains. D'une part, grâce à des taux d'intérêts exceptionnellement élevés, les Etats-Unis attirent les capitaux du monde entier et rapatrient la masse des dollars dispersés à l'étranger. D'autre part, la réduction générale des salaires dans le monde et la forte augmentation de la productivité du travail permettent d'accroître sensiblement le capital revenant à la bourgeoisie sous forme de plus-value. Ce double mouvement d'appauvrissement du prolétariat et des autres pays relativement aux Etats-Unis, fournit à ceux-ci les ressources nécessaires pour financer leurs déficits budgétaire, commercial et des opérations courantes. Ces derniers se sont considérablement accrus au cours de la dernière année, montrant que les discours monétaristes de Reagan ne sont en définitive que du bluff. Le déficit du budget fédéral a triplé en deux ans passant de 70 milliards de dollars en 1981 à 179 milliards en 1983 ; celui de la balance commerciale a doublé en un an passant de 36 milliards de dollars en 82 à 63 milliards de dollars en 83 ; celui des opérations courantes a quadruplé en un an, passant de 11 à 42 milliards de dollars.
Ces chiffres astronomiques, qui cependant se sont accompagnés d'une diminution de l'inflation et d'une appréciation du dollar contrairement à la logique économique apparente, traduisent bien l'énorme drainage de capitaux vers les Etats-Unis qui s'opère aujourd'hui. Il dévoile par la même occasion toutes les limites de la "reprise" actuelle. Contrairement à ce qui s'était passé à la fin des années 70, les Etats-Unis ne sont plus aujourd'hui à même de jouer un rôle de "locomotive" pour l'économie mondiale. Bien qu'ils recommencent à importer une grande quantité de marchandises, l'effet d'entraînement que pourrait constituer la poursuite de cette politique est partiellement annulé par le transfert de capitaux dans le même sens et par le renchérissement des matières premières libellées en dollars (exemple : pétrole). L'amélioration de la situation économique aux Etats-Unis, qui - comme nous l'avons vu - n'a pourtant rien de spectaculaire, s'accompagne aussi d'une stagnation des économies européennes, qui n'est pas destinée à se modifier qualitativement.
A plus long terme, le mécanisme actuel de la "reprise" aux Etats-Unis annonce un avenir catastrophique pour l'économie mondiale. La surévaluation actuelle du dollar, conséquence des hauts taux d'intérêt américains, permet aux Etats-Unis d'importer à bon marché, mais détériore la compétitivité de leurs secteurs exportateurs, ce qui aggrave encore le déficit commercial. Sous la pression de la loi de la valeur, le dollar est condamné à dévaluer et toute la belle mécanique à l'oeuvre aujourd'hui éclatera comme une baudruche. A ce moment, les déficits budgétaire et commercial américains, que l'on laisse gonfler de façon spectaculaire, ne seront plus compensés, et l'inflation masquée par les hauts taux d'intérêt et les mouvements de capitaux apparaîtra au grand jour.
Le capitalisme se trouvera alors dans une situation dix fois empirée et sera précipité dans des gouffres de plus en plus profonds.
M.L.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Les communistes et la question nationale (1900-1920) 2ème partie
- 3113 reads
Le débat pendant la guerre impérialiste
Dans le premier article de cette série, paru dans le numéro 34 de la Revue Internationale , nous avons examiné l'attitude des communistes sur la question nationale à l'aube de la décadence du capitalisme et notamment le débat entre Lénine et Rosa Luxemburg sur la question du soutien de la classe ouvrière au "droit des nations à 1'auto-détermination". Nous avons conclu que, même lorsque certaines luttes de libération nationale pouvaient encore être considérées comme progressistes du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, un tel mot d'ordre devait être rejeté.
Avec l'éclatement de la guerre en 1914, toute une série de questions nouvelles se sont posées au mouvement ouvrier. Dans cet article, nous nous proposons d'examiner les premières tentatives des communistes pour en débattre et leurs implications quant à la question du soutien à toutes les luttes nationalistes.
Une des fonctions propres aux révolutionnaires consiste à faire de leur mieux pour analyser la réalité à laquelle la classe se trouve confrontée. Au cours de la première guerre mondiale, le débat au sein des fractions de la "Gauche de Zimmerwald" sur les luttes de libérations nationales, tentait de répondre, pour une bonne part, à ce souci, afin de mettre en évidence les conditions auxquelles la lutte de classe se trouvait confrontée, conditions nouvelles, sans précédent de la guerre capitaliste mondiale, de l'impérialisme déchaîné et du contrôle massif de l'Etat-
Soixante ans plus tard, le débat n'est plus le même; les révolutionnaires se doivent de ne pas répéter ses inadéquations et erreurs. L'expérience de la classe a apporté des réponses, de même qu'elle a soulevé de nouveaux problèmes. Et si les minorités politiques n'adoptent plus le même esprit de critique impitoyable et d'investigation pratique, en restant attachées aux mots d'ordre propres à la période ascendante du capitalisme, elles faillissent à leurs devoirs fondamentaux et rejettent toute la méthodologie de Lénine, Luxemburg et des fractions de gauche. C'est cette méthodologie qui a amené le CCI à rejeter les positions de Lénine sur la question nationale et à développer la contribution faite par Rosa Luxemburg
La question nationale dans la gauche de Zimmerwald
Les révolutionnaires qui sont restés fidèles à l'esprit du Manifeste Communiste et à son cri de ralliement - "Les prolétaires n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se sont regroupés dans le mouvement de Zimmerwald composé des opposants à la guerre mais ils ont été rapidement contraints de s'organiser en aile gauche au sein de ce mouvement afin de défendre une position de classe claire contre les tendances réformistes et pacifistes de la majorité. La gauche de Zimmerwald fut fondée en 1915 sur la base de rassemblement suivante :
- reconnaissance de la nature impérialiste de la guerre, contre le mensonge de « la défense de la patrie »;
- reconnaissance de la nécessité de la lutte pour le pouvoir politique et de la révolution prolétarienne comme unique réponse à l'impérialisme;
- reconnaissance du fait que le début de cette lutte serait une lutte active contre la guerre.
Tout en ne rejetant ni le vieux programme minimum de la social-démocratie ni la lutte pour des réformes au sein du capitalisme, cette lutte devait désormais être menée "en vue d'aiguiser toute crise sociale et politique du capitalisme en général, de même que la crise causée par la guerre et de transformer cette lutte en une attaque contre la forteresse fondamentale du capitalisme .. Sous le mot d'ordre de socialisme, cette lutte rendra les, masses laborieuses imperméables au mot d'ordre de l'asservissement d'un peuple par un autre..."
(Projet de Résolution de la Gauche de Zimmerwald, 1915).
Malgré un attachement persistant au programme minimum, qui était approprié à la période ascendante du capitalisme, les positions de la Gauche de Zimmerwald reflétaient le constat d'une rupture dans la période historique et dans le mouvement ouvrier lui-même. Désormais, il ne pouvait plus être question pour le prolétariat de soutenir les mouvements nationalistes bourgeois en vue de faire avancer la lutte pour la démocratie dans le cadre d'un capitalisme encore en pleine expansion. L'attitude du prolétariat envers la question nationale était maintenant inséparable de la nécessité de lutter contre la guerre impérialiste et, plus généralement, contre le capitalisme impérialiste lui-même, avec comme objectif de créer les conditions pour la prise de pouvoir révolutionnaire du prolétariat.
Dans la Gauche de Zimmerwald, le Parti Bolchevik exprimait déjà clairement l'attitude générale, historique des révolutionnaires face aux luttes de libération nationale :
"Les guerres réellement nationales qui ont eu lieu, notamment dans la période de 1789-1871, étaient 1'expression de mouvements nationaux de masse, d'une lutte contre l'absolutisme et le système féodal, pour 1'abolition de l'oppression nationale et la création d'Etats sur une base nationale, condition préalable du développement capitaliste.
L'idéologie nationale engendrée par cette époque a laissé des traces profondes dans la masse de la petite bourgeoisie et dans une partie du prolétariat. C'est ce dont profitent actuellement, à une époque toute différente, celle de l'impérialisme, les sophistes de la bourgeoisie et les traîtres au socialisme qui rampent à leur suite, afin de diviser les ouvriers et de les détourner de leurs tâches de classe et de la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie.
Les paroles du Manifeste Communiste : "Les ouvriers n'ont pas de patrie", sont aujourd'hui plus justes que jamais. Seule la lutte internationale du prolétariat contre la bourgeoisie peut sauvegarder ses conquêtes et ouvrir aux masses opprimées la voie d'un avenir meilleur. "
(Résolution de la Conférence de Berne des sections à l'étranger du POSDR, mars 1915 - Lénine, Oeuvres T.21, p. 158-159)
C'est dans ce cadre que prit place le débat entre les différentes fractions de la Gauche de Zimmerwald sur la question nationale. Ce débat, mené essentiellement entre les communistes d'Europe occidentale et Lénine s'était focalisé à l'origine sur la question : est-il encore possible pour le prolétariat d'apporter son soutien au "droit des nations à 1'auto-détermination" ? Il reprenait en grande partie les grandes lignes de la polémique d'avant-guerre entre Lénine et Rosa Luxemburg; mais il devait s'élargir et s'ouvrir sur deux questions fondamentales posées par l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste, sa décadence :
1 - Etait-il encore possible pour le prolétariat de lutter au sein du capitalisme pour un "programme minimum" de revendications démocratiques (y compris le "droit à l'autodétermination") ?
2 - Des guerres nationales progressistes étaient-elles encore possibles qui auraient justifié le soutien du prolétariat à la bourgeoisie ?
Alors qu'à ces deux questions Lénine répondit "oui", d'autres telles que les gauches Allemande, Hollandaise et Polonaise, de concert avec le groupe Kommunist autour de Boukharine et Piatakov au sein du Parti Bolchevik, commencèrent timidement à répondre "non", rejetant définitivement le mot d'ordre de l'autodétermination et tentant de définir les taches du prolétariat face aux conditions nouvelles du capitalisme décadent. Ce furent ces fractions, tendant vers des positions cohérentes autour de la théorie de l'impérialisme défendue par Rosa Luxemburg, qui ont le mieux réussi à s'affronter à la question nationale dans la décadence, et non pas les combats d'arrière-garde de Lénine qui répugnait à apporter des éléments quant à 1' obsolescence du programme minimum soi-disant encore apte à jouer un rôle vital dans la révolution prolétarienne en Russie et dans les pays arriérés d'Europe de l'Est et d'Asie.
Est-il encore possible de lutter pour la "démocratie" ?
Quand, à la Conférence de Berne du Parti Bolchevik en 1915, Boukharine s'opposa au droit des nations à l'autodétermination en tant que tactique prolétarienne, Lénine fut le premier à insister sur le fait qu'on ne peut rejeter un seul aspect de la lutte du prolétariat pour la démocratie sans remettre en question cette lutte elle-même dans son ensemble : si la revendication de l'autodétermination était impossible à l'époque de l'impérialisme, pourquoi ne pas rejeter toutes les autres revendications démocratiques ?
Lénine posait le problème de la façon suivante : comment relier l'avènement de l'impérialisme à la lutte pour des reformes et pour la démocratie ? Pourtant, il dénonça la position de Boukharine qu’il qualifia d'"économisme impérialiste", c'est-à-dire un rejet de la nécessité de la lutte politique et, par conséquent, une capitulation devant l'impérialisme.
Mais Boukharine ne rejetait nullement la nécessité de la lutte politique, mais son identification à la lutte pour le programme minimum.
Boukharine et le groupe "Komminist" posaient le problème en termes de nécessité pour le prolétariat de rompre de façon décisive avec les méthodes du passe et d'adopter une nouvelle tactique et des mots d'ordre répondant à la nécessité de détruire le capitalisme par la révolution prolétarienne. Alors que les communistes avaient défendu fermement la lutte pour la démocratie, ils y étaient désormais opposés.
Comme l'exprima de façon plus complète Boukharine dans un développement ultérieur de cette position :
"... il est parfaitement clair, a priori, que les mots d'ordre et buts spécifiques du mouvement dépendent entièrement du caractère de l'époque dans laquelle le prolétariat en lutte doit agir. La période passée était celle d'un rassemblement des forces et d'une préparation pour la révolution. La période présente est celle de la révolution elle-même, et cette distinction fondamentale implique également des différences profondes dans les mots d'ordre et buts concrets du mouvement. Dans le passé, le prolétariat avait besoin de la démocratie parce qu'il n'était pas encore en mesure d'envisager l'établissement de sa propre dictature. La démocratie était précieuse pour autant qu'elle aidait le prolétariat à élever d'un pas sa conscience, mais le prolétariat était obligé de présenter ses revendications de classe dans une forme "démocratique"... Cependant, il n'est pas besoin de faire nécessité vertu... L'heure est venue d'un assaut direct de la forteresse capitaliste et de l'élimination des exploiteurs..."
(La théorie de la Dictature du Prolétariat, 1919)
Puisque l'époque de la démocratie bourgeoise progressiste était désormais révolue et que l'impérialisme était inhérent à la survie du capitalisme, les revendications anti-impérialistes maintenant intacts les rapports de production capitalistes étaient devenus utopiques et réactionnaires.
L'unique réponse à l'impérialisme ne pouvait être que la révolution prolétarienne :
"La social-démocratie ne doit pas avancer de revendications 'minimum' dans les conditions présentes de la politique internationale... Toute mise en avant de tâches 'partielles', de 'libération des nations' dans le cadre du système capitaliste, signifie un détournement des forces prolétariennes de la véritable solution du problème, et leur fusion avec les forces des groupes bourgeois nationaux correspondants.. . Le mot d'ordre d''autodétermination' des nations est avant tout utopique (il ne peut être réalisé dans les limites du capitalisme) et nuisible comme mot d'ordre qui sème des illusions. En ce sens, il ne diffère nullement des mots d'ordre sur les "cours d'arbitrage", sur le "désarmement", etc., qui présupposent la possibilité d'un soi-disant capitalisme pacifique",
(Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915)
Mais Boukharine allait plus loin dans son rejet du programme minimum à l'ère de l'impérialisme, en montrant la nécessité d'utiliser une tactique et des mots d'ordre exprimant la nécessité pour le prolétariat de détruire l'Etat capitaliste.
Alors que dans la période ascendante du capitalisme l'Etat avait assuré les conditions générales de l'exploitation par des capitalistes individuels, l'époque de l'impérialisme a donné naissance à un appareil d'Etat militariste exploitant directement le prolétariat avec le passage de la propriété individuelle du capital à la propriété collective à travers une unification des structures capitalistes (en trusts, syndicats, etc.), et la fusion de ces structures avec l'Etat. Cette tendance au capitalisme d'Etat s'étend de la sphère économique à toutes les sphères de la vie sociale :
"Toutes ces organisations ont tendance à fusionner entre elles, et à se transformer en une seule organisation des exploiteurs. Telle est l'étape la plus récente du développement, étape qui est devenue particulièrement évidente pendant la guerre... Ainsi surgit une organisation unique, absorbant toutes les autres : 1'Etat impérialiste pirate moderne, organisation omnipotente de la domination bourgeoise.. . et si seuls les Etats les plus avancés ont jusque là atteint cette étape, chaque jour, et en particulier chaque jour de guerre, tend à généraliser cet état de fait."
(L'Etat Pirate Impérialiste, 1915).
La seule force capable d'affronter cette unité des forces de toute la bourgeoisie ne pouvait être que 1 'action de masse du prolétariat. Dans ces conditions nouvelles, le mouvement révolutionnaire avait besoin, par dessus tout, de manifester son opposition à l'Etat, ce qui impliquait le rejet de tout soutien à quelque pays capitaliste que ce soit ([1] [501]).
Ce fut contre cette attaque impitoyable du programme minimum et contre le rejet de l'autodétermination exprimés par la majorité des Gauches d'Europe occidentale que Lénine écrivit ses Thèses sur la révolution socialiste et le droit des nations à l'autodétermination au début de 1916.
Dès le début, la nécessité d'éviter tout soutien objectif à la démocratie bourgeoise réactionnaire et à l'Etat démocratique le contraignit à adopter une position défensive. Il devait ainsi tomber d'accord avec Boukharine sur le fait que :
- "La domination du capital financier, comme celle du capital en général, ne saurait être éliminée par quelque transformation que ce soit dans le domaine de la démocratie politique; or, l'autodétermination se rapporte entièrement et exclusivement à ce domaine." (Thèse n°2, Oeuvres, T.22)
- "... toutes les revendications fondamentales de la démocratie politique, qui à l'époque de l'impérialisme, ne sont 'réalisables' qu'incomplètement, sous un aspect tronqué et à titre tout à fait exceptionnel (par exemple, la séparation de la Norvège d'avec la Suède, en 1905). " (Ibid. ) ([2] [502]) .
- La formation de nouvelles nations (Pologne, Inde, etc..) dans le futur, serait le produit de "quelque changement insignifiant" dans la politique et les rapports stratégiques entre les principales puissances impérialistes.
La position de Lénine était également basée sur la reconnaissance du fait que la nature de la nouvelle période exigeait une rupture avec les anciennes méthodes réformistes de lutte :
"... il est nécessaire de formuler toutes ces revendications et de les faire aboutir non pas en réformistes, mais en révolutionnaires ; non pas en restant dans le cadre de la légalité bourgeoise, mais en le brisant, en entraînant les masses à l'action, en élargissant et en attisant la lutte autour de chaque revendication démocratique fondamentale jusqu'à l'assaut direct du prolétariat contre la bourgeoisie, c'est-à-dire jusqu'à la révolution socialiste, qui exproprie la bourgeoisie." (Ibid.)
Le capitalisme et l'impérialisme ne pourraient être renversés qu'à travers une révolution économique. Néanmoins :
"Ce serait une erreur capitale de croire que la lutte pour la démocratie est susceptible de détourner le prolétariat de la révolution socialiste ou d'éclipser celle-ci, de 1'estomper, etc. Au contraire, de même qu'il est impossible de concevoir un socialisme victorieux qui ne réaliserait pas la démocratie intégrale, de même le prolétariat ne peut se préparer à la victoire sur la bourgeoisie s'il ne mène pas une lutte générale, systématique et révolutionnaire pour la démocratie." (Ibid.)
Telle était, dans les grandes lignes, toute l'argumentation de Lénine, mais, si l'on tient compte des arguments avancés contre lui à la même époque, deux questions étaient restées sans réponse :
- à l'époque de l'impérialisme, alors que la démocratie bourgeoise était devenue réactionnaire, quel était le contenu de cette lutte pour la démocratie ?
- comment le prolétariat pourrait-il, dans la pratique, éviter tout soutien à l'appareil militariste et impérialiste de l'Etat ?
Lénine était indéniablement au fait de ces problèmes, mais il ne pouvait pas les résoudre.
Il était d'accord avec le fait que l'impérialisme avait fait de la démocratie une illusion, mais, par ailleurs, il continuait d'encourager les « aspirations démocratiques » des masses; de ce fait, il existait un antagonisme entre l'impérialisme en tant que négation de la démocratie et la "lutte" des masses pour la démocratie. Ce qui était condensé dans la position de Lénine c'était la poursuite de la nécessité, pour la classe ouvrière, de lutter non pas pour détruire l'Etat capitaliste
- du moins, pas dans l'immédiat - mais au sein de celui-ci, d'utiliser ses institutions afin d'obtenir des réformes démocratiques :
"La solution marxiste au problème de la démocratie consiste en l'utilisation par le prolétariat de toutes les institutions démocratiques dans sa lutte de classe contre la bourgeoisie afin de se préparer à leur renversement et d'assurer sa propre victoire."
(Lénine, Réponse à Kiewsky (Y. Piatakov), 1916)
Avant la révolution de Février, Lénine défendait, en compagnie de Kautsky, l'idée suivant laquelle l'attitude marxiste envers l'Etat consistait à pousser le prolétariat à s'emparer du pouvoir d'Etat et à l'utiliser pour construire le socialisme.
Il critiquait la position de Boukharine comme non marxiste et semi- anarchiste, affirmant de nouveau que les socialistes étaient pour l'utilisation des institutions étatiques existantes.
Mais dans l'élaboration de sa propre réponse à Boukharine en 1916, il revint sur sa position et retourna aux écrits originaux de Marx sur la nécessité de détruire l'appareil d'Etat bourgeois, insistant sur la signification réelle de l'apparition des soviets en 1905 : en tant que forme spécifique de la dictature du prolétariat, alternative au pouvoir de l'Etat bourgeois. Sa réfutation de Boukharine fut remplacée par la brochure mieux connue sous le titre de L'Etat et la Révolution, qui appelle clairement à la destruction de l'Etat bourgeois.
Cependant, malgré cette clarification essentielle dans son attitude envers l'Etat, malgré sa lutte acharnée pour la réalisation du mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets" en octobre 17, Lénine n'a jamais renoncé à sa conception théorique de la "révolution démocratique". Ainsi, par exemple, alors que dans ses Thèses d'Avril il concluait que, dans la mesure ou le pouvoir d'Etat était maintenant passé aux mains de la bourgeoisie, "la révolution démocratique bourgeoise en Russie est complète" , il incluait encore dans son programme la nécessité pour le prolétariat d'accomplir des tâches bourgeoises, démocratiques, y compris la défense de l'autodétermination, dans la lutte pour le pouvoir des soviets.
Suivant l'expression de Boukharine, sa position sur la question nationale restait "pro-étatique", encore largement influencée par les conditions auxquelles se trouvait confronté le prolétariat des pays capitalistes sous-développés, et fondée sur des conceptions obsolètes plus appropriées à la période ascendante du capitalisme qu'à la période de décadence impérialiste.
Les guerres nationales sont-elles encore progressistes ?
Puisque la période des guerres nationales correspondait à une période historique déterminée - en gros comprise entre 1789 et 1871 - la question qui était posée était de savoir, premièrement, si cette période était définitivement révolue avec l'éclatement de la guerre en 1914, et deuxièmement, étant donnée la nature incontestablement impérialiste et réactionnaire de cette guerre, si cette nature était devenue une caractéristique générale et irréversible des guerres dans la nouvelle période. De nouveau, alors que les Gauches européennes commençaient timidement à répondre par l'affirmative à ces deux questions, Lénine hésitait à admettre ces réponses, malgré un degré d'accord assez important.
Cette question dans son ensemble était évidemment essentielle pour la Gauche à Zimmerwald, qui dénonça, au milieu de la guerre impérialiste, les mensonges de la bourgeoisie sur la défense de la patrie et la nécessité de mourir pour son pays; si certaines guerres pouvaient encore être qualifiées de progressistes et révolutionnaires, alors les internationalistes pouvaient, dans ce cas particulier, appeler les ouvriers à défendre leur patrie.
Comme Boukharine l'avait mis en avant avec la guerre, cette question était devenue une frontière de classe :
" Le problème de tactique le plus important à notre époque est celui de la prétendue défense nationale. Cette question montre exactement où se trouve tracée la ligne de démarcation entre l'ensemble du monde bourgeois et l'ensemble du monde prolétarien. Ce mot lui-même contient une supercherie car il ne concerne pas réellement le pays en tant que tel, c'est-à-dire sa population, mais son organisation étatique."
(L'Etat Pirate Impérialiste).
Par conséquent : "La tâche de la social-démocratie à l'heure actuelle consiste à mener une propagande pour l'indifférence en ce qui concerne la 'patrie', la 'nation' etc., ce qui présuppose de poser la question non pas d'un point de vue 'pro-étatique'... (protestation contre une 'desintégration' de l'Etat) mais au contraire, d'un point de vue clairement révolutionnaire à l'égard du pouvoir d'Etat et du système capitaliste dans son ensemble,"
(Thèse 7, Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915T
Boukharine démontrait que si le mot d'ordre de l'autodétermination était concrètement appliqué (c'est-à-dire en garantissant l'indépendance et le droit à la sécession) dans les conditions de la guerre impérialiste, il ne deviendrait rien d'autre qu une variante du mot d'ordre de la "défense de la patrie", puisqu'il faudrait défendre concrètement les frontières du nouvel Etat indépendant dans l'arène impérialiste; sinon, que pouvait recouvrir en réalité une telle revendication ? Dans une telle situation, les forces internationalistes du prolétariat seraient éclatées et sa lutte de classe canalisée sur un terrain nationaliste :
" Il découle de là qu'en aucun cas et sous aucun prétexte nous ne soutiendrons le gouvernement d'une grande puissance qui réprime le soulèvement d'une nation opprimée; pas plus que nous ne mobiliserons les forces prolétariennes derrière le mot d'ordre du « droit des nations à l'autodétermination ». Dans une telle situation, notre tâche consiste à mobiliser les forces du prolétariat des deux nations (unies aux autres) derrière le mot d'ordre de la guerre civile, de la guerre de classe pour le socialisme, et à mener campagne contre la mobilisation derrière le mot d'ordre du 'droit des nations'...» (Thèse 8, Ibid. )
La Gauche Allemande, dont les fondements résident dans la théorie de Rosa Luxemburg, qui, dans la Brochure de Junius avait affirmé qu'aujourd'hui "la phrase nationale... ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes", s'éleva elle aussi clairement contre l'idée des guerres nationales progressistes à l'époque de l'impérialisme :
"A l'époque de cet impérialisme déchaîné, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : 1'impérialisme. "
(Thèse 5, Thèses sur les taches de la social-démocratie internationale, complément à la Brochure de Junius, 1916).
Dans sa riposte vigoureuse, Lénine revint en arrière en faisant cette conclusion générale sur la nature de la nouvelle période :
- le caractère incontestablement impérialiste de la guerre mondiale n'impliquait pas que les guerres nationales n'étaient plus possibles. Au contraire, elles étaient à la fois inévitables et progressistes;
- alors que la défense de la patrie était réactionnaire pour ce qui concerne une guerre entre des puissances impérialistes rivales, dans une guerre nationale "authentique" les socialistes n'étaient pas opposés au fait d'appeler à la défense nationale.
Lénine ne pouvait pas concevoir que l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste dictait la nature réactionnaire de toute guerre, insistant sur la nécessité d'une évaluation concrète de chaque guerre prise séparément; il refusa également de voir que la nature impérialiste évidente des pays avancés d'Europe et d'Amérique signifiait qu'un changement s'était opéré dans l'ensemble du système capitaliste, changement auquel même les1 pays arriérés d'Asie et d'Afrique ne pouvaient échapper. Dans les pays capitalistes avancés, la période des guerres nationales était révolue depuis longtemps, mais en Europe de l'Est et dans les pays semi-coloniaux et coloniaux les révolutions bourgeoises étaient encore à l'ordre du jour; dans ces pays, les luttes de libération nationales contre les plus grandes puissances impérialistes n'étaient pas encore lettre morte, et par conséquent, la défense de l'Etat national était encore progressiste. En outre, même en Europe, on ne pouvait considérer les guerres nationales des petites nations annexées ou opprimées par les grandes puissances comme impossibles (bien qu'il sous-entendait qu'elles étaient improbables).
Il citait l'exemple hypothétique de la Belgique annexée par l'Allemagne au cours de la guerre pour illustrer la nécessité pour les socialistes de soutenir même le "droit" de la bourgeoisie belge "opprimée" à l'autodétermination.
L'hésitation de Lénine à adhérer aux arguments, de loin les plus cohérents, de la Gauche Allemande, sur l'impossibilité des guerres nationales résultait principalement de son souci pratique de ne pas rejeter tout mouvement ou événement qui pourrait accélérer une crise dans le système capitaliste, crise que le prolétariat pourrait mettre à profit :
"La dialectique de l'histoire fait que les petites nations, impuissantes en tant que facteur indépendant dans la lutte contre l'impérialisme, jouent le rôle d'un des ferments,d'un des bacilles qui favorisent 1'entrée en scène de la force véritablement capable de lutter contre 1'impérialisme, à savoir : le prolétariat socialiste.
Nous serions de piètres révolutionnaires si, dans la grande guerre libératrice du prolétariat pour le socialisme, nous ne savions pas tirer profit de tout mouvement populaire dirigé contre tel ou tel fléau de l'impérialisme, afin d'aggraver et d'approfondir la crise."
(Bilan d'une discussion sur le droit des nations à |disposer d' elles-mêmes, chap.10. Oeuvres, T. 22 ).
Ce n'était pas le sort des mouvements nationalistes en eux-mêmes qui l'intéressait mais uniquement leur capacité à affaiblir l'emprise des grandes puissances impérialistes au milieu de la guerre mondiale; et par conséquent, il mettait le soulèvement irlandais de 1916 sur le même plan que les révoltes coloniales en Afrique et les mutineries dans les troupes coloniales en Inde, à Singapour etc. , comme autant de signes annonciateurs de l'approfondissement de la crise de l'impérialisme.
Prenons comme exemple concret celui du soulèvement nationaliste irlandais de 1916 pour illustrer certains dangers d'une telle approche. Pour Lénine, cette rébellion était la preuve de la validité de sa position suivant laquelle l'encouragement aux aspirations nationalistes des nations opprimées ne pouvait être qu'un facteur actif et positif dans la lutte contre l'impérialisme; et ceci contre la position de certains autres tels que Radek et Trotsky qui affirmaient qu'il s'agissait d'un putsch désespéré sans appui sérieux montrant, au contraire, que la période des luttes de libération nationale était terminée. Lénine ne soutenait pas qu'il existait un mouvement de masse prolétarien derrière cette rébellion, qui se présentait elle-même comme un "combat de rue menée par un secteur de la petite bourgeoisie urbaine et un secteur de la classe ouvrière" : le problème réel résidait dans la nature de classe de ces révoltes nationalistes ou, en d'autres termes : de tels mouvements participent-ils au renforcement de la "seule force anti-impérialiste, le prolétariat socialiste" (Lénine) ou de la bourgeoisie impérialiste ?
Lénine attribuait de façon dangereuse un potentiel anti-capitaliste à ces actions nationalistes, il disait que, malgré leurs lubies réactionnaires, "elles attaqueront objectivement le capital" (ibid.), et que le prolétariat devait seulement s'y associer et les diriger pour faire avancer le processus de la révolution sociale. Cependant, sans entrer dans toute l'histoire de la "question irlandaise", nous pouvons dire brièvement qu'elle contient des faits contredisant cette idée.
La révolte irlandaise de 1916 marqua du sceau du nationalisme la lutte de classe du prolétariat en Irlande - déjà affaibli par la défaite partielle de ses luttes d'avant-guerre - en mobilisant activement les ouvriers dans la lutte armée du nationalisme catholique de l'Irlande du sud. Malgré le manque de sympathie existant au sein des masses ouvrières pour ce putsch militaire désespéré, les campagnes massives de terreur de l'Etat britannique qui s'ensuivirent n'ont fait qu'achever la désorientation des ouvriers et que les conduire dans le giron des nationalistes réactionnaires; cela s'est traduit par un massacre et le sabotage systématique des dernières manifestations de la lutte autonome de la classe contre le capital, sabotage mené tant par les Anglais "noirs et jaunes" que par l'IRA républicaine. La défaite de cette fraction relativement faible et isolée du prolétariat mondial, défaite imposée par l'unification des forces de la bourgeoisie irlandaise et britannique, ne faisait que traduire un renforcement de l'impérialisme mondial dont l'intérêt majeur est toujours la défaite de son ennemi mortel. La rébellion irlandaise prouvait uniquement que toutes les fractions bourgeoises, y compris les nations soi-disant opprimées, se rangent du côté de l'impérialisme lorsqu'elles se trouvent confrontées à la menace de destruction du système d'exploitation, condition du maintien de leurs privilèges.
A condition d'être clairvoyants, les révolutionnaires, aujourd'hui, ne peuvent que conclure que l'histoire a donné tort à Lénine, et que les Gauches, malgré leurs confusions, avaient vu juste pour l'essentiel. La leçon qu'il s'agit de tirer de la révolte irlandaise réside dans la compréhension que tout soutien au nationalisme conduit directement à subordonner la lutte de classe aux guerres impérialistes de la période de décadence du capitalisme.
LENINE CONTRE LES "LENINISTES"
L'exhortation de Lénine au soutien à toute révolte nationaliste a été inévitablement utilisée par la bourgeoisie comme prétexte pour plonger les ouvriers et les paysans dans d'innombrables bains de sang derrière le drapeau du nationalisme et de 1'"anti-impérialisme". Cependant, une rivière de sang sépare encore les pires erreurs de Lénine des "meilleures" positions défendues par ceux qui prétendent être ses véritables héritiers : les bourreaux du prolétariat, qu'ils soient staliniens, trotskystes ou maoïstes.
Il est également nécessaire de sauver le véritable contenu critique des écrits de Lénine de certaines déformations comme celles du PCI (Programme Communiste) entre autres, qui, bien que celui-ci appartienne au milieu révolutionnaire, préfèrent également rester attachées à toutes les erreurs du passé, même lorsqu'elles mènent dangereusement à la défense des fractions capitalistes les plus réactionnaires sous couvert de "libération nationale" (cf. Revue Internationale n°32, pour une analyse plus développée des erreurs du PCI et de sa récente décomposition).
Lénine a toujours été conscient des dangers pour les révolutionnaires de soutenir le nationalisme; il insistait constamment sur la nécessité pour le prolétariat de préserver son unité et son autonomie face à toutes les forces bourgeoises même si cela devait rendre sa position encore plus inapplicable et contradictoire dans la pratique.
Et même lorsqu'il appelait les révolutionnaires à soutenir chaque révolte contre l'impérialisme, il ajoutait « à condition qu'il ne s'agisse pas de la révolte d'une classe réactionnaire. »
Ce que les Gauches, comme celle â laquelle appartenait R. Luxemburg, ont défendu de façon beaucoup plus cohérente, c'était le fait que les éléments nationalistes dans toutes les révoltes contre la répression sanglante des grandes puissances impérialistes étaient toujours introduits par la classe la plus réactionnaire - la bourgeoisie - pour endiguer la menace d'un réel soulèvement de la classe ouvrière; les révolutionnaires devaient établir une ligne de démarcation très claire entre le nationalisme et la lutte de classe, puisque seule celle-ci représente, dans la période de l'impérialisme, la voie progressiste pour l'humanité.
Au fil de ses écrits, Lénine modéra sa position afin d'éviter le danger toujours présent de subordonner la lutte de classe à la lutte nationale, que ce soit par la capitulation devant l'appareil d'Etat démocratique ou devant la bourgeoisie des nations "opprimées". L'attitude marxiste face à la question nationale devait toujours reconnaître la primauté de la lutte de classe :
"A l'opposé des démocrates petit -bourgeois, Marx voyait dans toutes les revendications démocratiques sans exception non pas un absolu, mais l'expression historique de la lutte des masses populaires, dirigées par la bourgeoisie, contre le régime féodal. Il n'est pas une seule de ces revendications qui, dans certaines circonstances, ne puisse servir et n'ait servi à la bourgeoisie à tromper les ouvriers. Il est radicalement faux, du point de vue théorique, de monter en épingle, à cet égard, l'une des revendications de la démocratie politique, à savoir le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et de l'opposer à toutes les autres. Dans la pratique, le prolétariat ne peut conserver son indépendance qu'en subordonnant sa lutte pour toutes les revendications démocratiques, sans en excepter la république, à sa lutte révolutionnaire pour le renversement de la bourgeoisie."
(La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, Thèse 5, Oeuvres, T.22, avril 1916).
Par conséquent, Lénine devait rectifier concrètement sa position sur l'autodétermination afin de défendre la nécessité de l'unité internationale de la classe ouvrière et de résoudre cette préoccupation cruciale pour les révolutionnaires de sa division théorique du prolétariat en deux camps : celui des nations "opprimées" et celui des nations "qui oppriment". Ceci constituait pour Lénine, "la tâche la plus difficile et la plus importante".
Ainsi, alors que le prolétariat des pays "oppresseurs" devait revendiquer l'indépendance des colonies et des petites nations opprimées par leur "propre" impérialisme,
". . . les socialistes des nations opprimées doivent s'attacher à promouvoir et réaliser l'unité complète et absolue, y compris sur le plan de 1'organisation, des ouvriers de la nation opprimée avec ceux de la nation oppressive. Sans cela, il est impossible de sauvegarder une politique indépendante du prolétariat et sa solidarité dé classe avec le prolétariat des autres pays, devant les manoeuvres de toutes sortes, les trahisons et les tripotages de la bourgeoisie."
(Ibid., Thèse 4, souligné par nous).
Que de fois entendons-nous les "léninistes" d'aujourd'hui s'enthousiasmer pour les luttes de libération nationale en citant Lénine ! Lénine était bien explicite : en l'absence de l'unité de classe du prolétariat, y compris de ses expressions organisationnelles concrètes, la classe ouvrière était incapable de défendre son autonomie face à son ennemi de classe. La lutte de classe ne pouvait ainsi qu'être subordonnée à la lutte nationale, c'est-à-dire, en réalité, à la lutte de l'impérialisme pour une partie du marché mondial; dans cette lutte, les ouvriers ne pouvaient que servir de chair à canon à leur propre bourgeoisie, les mots d'ordre du Manifeste Communiste -"les prolétaires n'ont pas de patrie" prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se retournant en leur contraire : "prolétaires des nations opprimées, défendez votre patrie !".
Dans la position de Lénine, c'est cet élément de réponse, au soutien à l'autodétermination que les gauchistes d'aujourd'hui ignorent ou dissimulent; c'est pourtant un élément central pour la défense de l'internationalisme prolétarien puisqu'il contient encore, malgré une certaine déformation, une vision des intérêts généraux de la classe ouvrière.
Ailleurs, dans ses écrits, Lénine rejette fermement toute approche abstraite et non critique " du soutien aux mouvements nationalistes :
"aucune revendication démocratique ne doit conduire à favoriser des abus; nous ne sommes pas tenus d'appuyer ni 'n'importe quelle' lutte pour l'indépendance ni 'n'importe quel mouvement républicain ou anti-clérical'".
(Bilan d'une discussion...)
Les intérêts généraux de la lutte de classe pouvaient être en contradiction avec le soutien à tel ou tel mouvement nationaliste :
"Il peut arriver que le mouvement républicain d'un pays ne soit que l'instrument d'intrigues cléricales, financières ou monarchiques d'autres pays : nous avons alors le devoir de ne pas soutenir ce mouvement concret donné."
(Ibid., chap.7, Oeuvres, T.22)
Et, suivant l'exemple de Marx qui refusait de soutenir le nationalisme tchèque au 19ème siècle, Lénine tirait cette conclusion : si la révolution prolétarienne éclatait dans un certain nombre de pays européens les plus importants, les révolutionnaires seraient favorables à une "guerre révolutionnaire" contre les autres nations capitalistes qui agiraient comme remparts de la réaction : c'est-à-dire favorables à l'écrasement de celles-ci, quelles que soient les luttes de libération nationale qui surgissent en leur sein.
Donc, pour Lénine, il était possible que des mouvements nationalistes agissent comme autant d'armes des puissances impérialistes contre la lutte de classe; pour Luxemburg et Boukharine, c'était un phénomène général et inévitable de la phase impérialiste du capitalisme. Bien qu'il n'ait pas l'avantage de la cohérence du point de départ théorique de ces derniers, Lénine était contraint par le poids des arguments du moins de s'orienter vers leur position. De façon significative, il était désormais contraint d'admettre que le mot d'ordre de l'indépendance de la Pologne était utopique et réactionnaire dans les conditions contemporaines, allant jusqu'à dire que "... même une révolution en Pologne même ne changerait rien et ne ferait que détourner l'attention des masses en Pologne de la tâche principale le lien entre leur lutte et celle du prolétariat de Russie et d'Allemagne." (Bilan de discussion) . Mais il se refusait encore à tirer une conclusion générale de cet exemple spécifique.
Quelques conclusions sur le débat dans la gauche de Zimmerwald
En plus de leur méthode fondamentale, il est une chose avec laquelle tous les membres de la Gauche de Zimmerwald étaient d'accord, une chose bien souvent ignorée dans les débats où l'on se paie de paroles quant à la possibilité de soutenir les mouvements nationaux : seule la lutte de la classe ouvrière est porteuse d'avenir pour les masses opprimées et pour l'humanité. Nulle part dans les affirmations les plus confuses de Lénine, il n'est sous-entendu que le capitalisme décadent m pourrait être détruit par un autre moyen que la violence de la révolution prolétarienne. Le souci qui animait Lénine, Boukharine, Luxemburg et les autres était de savoir si, et jusqu'où, les luttes nationales pouvaient contribuer à accélérer la crise finale du capitalisme et oeuvrer, ainsi, en faveur de la lutte révolutionnaire en participant à l'affaiblissement de tout l'édifice pourrissant de l'impérialisme.
Malgré son incontestable accord avec le cadre de base du débat, une importante partie du mouvement ouvrier pensait encore qu'une rupture complète avec la théorie et la pratique du passé sur cette question n'était pas déjà justifiée; Lénine pensait que les ouvriers n'avaient rien à perdre à soutenir les mouvements nationalistes parce que ceux-ci allaient tous dans le sens de la destruction du capitalisme.
Aujourd'hui, les innombrables massacres d'ouvriers par les fractions nationalistes nous fournissent suffisamment de preuves pour nous permettre d'apporter notre propre contribution à ce débat en concluant que la lutte de classe et le nationalisme sous toutes ses formes n'ont aucun point de convergence : celui-ci reste toujours une arme entre les mains de l'ennemi contre celle-là.
Les révolutionnaires qui, de façon hésitante, ont eu le courage d’affirmer que le moment était en effet venu de rompre clairement avec le passé, étaient à l'avant-garde des tentatives du prolétariat, pour comprendre le monde dans lequel il vivait et luttait. Leur contribution, et notamment la théorie de R. Luxemburg sur la question de l'impérialisme dans son ensemble et de la crise mortelle du capitalisme, est encore une pierre angulaire essentielle du travail des révolutionnaires dans la période de décadence.
Quant à la position de Lénine sur la question nationale, comme nous le savons tous, elle a été saccagée par la bourgeoisie pour justifier toutes sortes de guerres réactionnaires de "libération nationale". Ce n'est pas non plus par accident que la gauche du capital, en quête de références marxistes pour sa participation aux guerres impérialistes, choisit de régurgiter les écrits de Lénine, qui contiennent suffisamment de dangereuses faiblesses pour laisser la porte ouverte à ce qui est devenu aujourd'hui une des pierres angulaires de l'idéologie bourgeoise.
En vérité, on ne peut faire porter à Lénine la responsabilité de la façon dont la bourgeoisie a déformé sa pensée, dans le sillage de la défaite de la révolution prolétarienne pour laquelle il avait combattu avec acharnement. Contre les anarchistes et les libertaires, pour lesquels Lénine a toujours été un politicien bourgeois n'utilisant le marxisme que pour justifier sa propre lutte pour le pouvoir, nous pouvons insister sur la manière dont la contre-révolution bourgeoise a été contrainte de pervertir tout le cadre du débat auquel Lénine a participé, et de masquer ou de supprimer certains principes fondamentaux qu'il défendait, ceci afin de vider sa contribution de son contenu marxiste révolutionnaire.
Mais ceci dit, à la différence des bordiguistes, il n'est pas nécessaire que nous restions aveugles face aux erreurs du passé. Compte tenu des points que nous venons de mentionner, nous pouvons voir que de dangereuses faiblesses et ambiguïtés étaient présentes dans les écrits de Lénine dès le début, faiblesses qu'il nous faut rejeter définitivement aujourd'hui pour rester sur la défense des positions de classe.
Nous traiterons dans un article à venir des tragiques conséquences pratiques des incompréhensions des bolcheviks sur la question nationale après octobre 1917 à travers la politique de l'Etat soviétique.
S. FAY.
[1] [503] La position de Boukharine sur la nécessité de détruire le pouvoir d'Etat bourgeois et son insistance sur l'action de masse des ouvriers était, en partie assimilée par celui-ci, à partir des travaux de Pannekoek et de la Gauche Allemande avec lesquels le groupe Kommunist en exil avait collaboré pendant la guerre. Dans sa polémique avec Kautsky, dans la période d'avant-guerre, Pannekoek avait insisté sur le fait que :
"La bataille prolétarienne n'est pas seulement une bataille contrée la bourgeoisie pour le pouvoir d'Etat; elle est également une lutte CONTRE LE pouvoir DE L'ETAT" (L'action de masse et la révolution, 1911).
La réponse prolétarienne à la répression sanglante de l'Etat bourgeois était LA GREVE DE MASSE.
[2] [504] On pourrait insister sur le fait que la séparation de la Norvège de la Suède en 1905 était le SEUL exemple concret que Lénine pouvait mettre en avant comme support à sa politique sur l'autodétermination, raison pour laquelle il s'est gardé d'y faire allusion dans tous ses écrits sur ce sujet. Sans chercher trop loin, nous pouvons dire que cet exemple possède suffisamment de spécificités pour rendre fragiles les bases d'une théorie générale : cela s'est passé à l'aube de la décadence capitaliste, dans une région du monde excentrée par rapport aux plus grands pays situés au coeur du capitalisme, dans un pays ayant un prolétariat relativement faible. De plus, la bourgeoisie norvégienne a toujours bénéficié d'une certaine autonomie politique et son indépendance formelle a pu, par la suite, être achevée parce que la bourgeoisie suédoise était entièrement prête à L'accepter. C'est la raison pour laquelle elles ont organisé, d'abord, un référendum...
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Approfondir:
- La question nationale [446]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [447]
La conception de l'organisation dans les gauches allemande et hollandaise
- 3532 reads
Pour les groupes de discussion et les individus qui surgissent aujourd'hui sur des bases révolutionnaires, il est nécessaire que leur travail de clarification se fasse par une réappropriation des positions de la Gauche communiste,y compris celles de la Gauche allemande et de la Gauche hollandaise. Ces dernières, en particulier, ont défendu politiquement et théoriquement les premières, toute une série de positions de classe essentielles : rejet du syndicalisme et du parlementarisme, rejet de la conception substitutionniste du parti, dénonciation du frontisme, définition de tous les prétendus Etats socialistes comme capitalistes d'Etat.
Néanmoins, la réappropriation seulement sous un angle théorique des positions de classe ne suffit pas. Sans une conception claire de l'organisation révolutionnaire, tous ces groupes et individus sont condamnés au néant ... Il ne suffit pas de se proclamer révolutionnaire en paroles et de façon individuelle, il faut encore défendre -collectivement- les positions de classe dans un cadre organisé. La reconnaissance de la nécessité d'une organisation ayant une fonction indispensable dans la classe et fonctionnant comme un corps collectif, centralisé est la condition première de tout travail militant. Toute hésitation ou incompréhension sur la nécessité d'une organisation est sanctionnée terriblement par la désagrégation. Cela vaut en particulier pour les groupes "conseillistes" aujourd'hui.
Tirer les leçons de l'histoire de la Gauche allemande et de la Gauche hollandaise, c'est montrer la nécessité vitale d'une organisation pour que la théorie ne soit pas une pure spéculation mais une arme qui s'empare des masses prolétariennes dans la révolution future.
L'apport de la Gauche allemande - et principalement du KAPD - n'est pas d'avoir reconnu la nécessité du parti dans la révolution. Pour le KAPD, qui se formait en parti en 1920, cela allait de soi. Son apport fondamental est d'avoir compris que la fonction du parti n'était plus la même dans la période de décadence. Non plus parti de masse - organisant et rassemblant la classe -mais parti noyau rassemblant les combattants les plus actifs et les plus conscients du prolétariat. Partie sélectionnée de la classe, le parti intervient dans la lutte de classe et dans les organismes que la classe fait surgir : les conseils ouvriers et les comités de grève. Le parti est un parti combattant pour la révolution et non plus pour des réformes graduelles dans des organismes
où le prolétariat n'a plus rien à faire (syndicats) ou à dire (parlement) sinon d'oeuvrer à leur destruction. Enfin parce que le parti est une partie de la classe et non son représentant, ou son chef, il ne peut se substituer à elle dans sa lutte ou l'exercice du pouvoir. La dictature de la classe est celle des conseils et non celle du parti. Contrairement à la vision bordiguiste ce n'est pas le parti qui crée la classe mais la classe qui crée le parti. (1[1] [505]) Ce qui ne signifie pas - comme dans la vision populiste ou menchevik - que le parti est au service de la classe. Il n'est pas un serviteur qui passivement s'adapte à chaque hésitation ou errements de la classe. Au contraire, il doit "développer la conscience de classe du prolétariat même au prix d'une contradiction extérieure apparente avec les larges masses"([2] [506]).
Le KAPD en Allemagne et le KAPN de Gorter en Hollande n'avaient rien à voir avec la vision de Ruhle, dont se réclament aujourd'hui les "conseillistes". Ruhle et sa tendance à Dresde furent expulsés du KAPD à la fin de l'année 1920. Le KAPD n'avait rien à voir avec les tendances anarchisantes qui proclamaient que tout parti est par essence contre-révolutionnaire ; que la révolution n'est pas une question de parti mais d'éducation. Les conceptions du pédagogue Ruhle n'avaient rien à voir avec celles du KAPD. Pour ce dernier le parti n'est pas la volonté individuelle de chacun ; il est "une totalité élaborée programmatiquement, fondue en une volonté unitaire, organisée et disciplinée de la base au sommet. Il doit être la tête et l'arme de la révolution". (Thèses sur le rôle du parti). Le parti joue en effet un rôle décisif dans la révolution prolétarienne. Parce qu'il cristallise et concentre dans son programme et son action la volonté consciente de la classe, il est une arme indispensable de la classe. Parce que la révolution est fondamentalement politique, qu'elle implique un combat sans merci contre les tendances bourgeoises et les partis qui travaillent contre le prolétariat au sein de ses organismes, le parti est un instrument politique de lutte et de clarification. Cette conception n'a rien à voir avec toutes les visions substitutionnistes du parti. Le parti est sécrété par la classe et par conséquent est un facteur actif dans le développement de la conscience générale de la classe.
Néanmoins, avec la défaite de la révolution en Allemagne, la dégénérescence de la révolution en Russie, certaines faiblesses du KAPD vont paraître au grand jour.
LE VOLONTARISME ET LA DOUBLE ORGANISATION
Constitué au moment où la révolution reflue en Allemagne après la défaite de 1919, le KAPD se mit à défendre l'idée que l'on pouvait se substituer au déclin de l'esprit révolutionnaire dans le prolétariat par une tactique putschiste. Lors de l'action de Mars 1921 en Allemagne centrale, il poussa les ouvriers des usines Leuna (près de Halle) à l'insurrection contre leur volonté. Il manifestait là une profonde incompréhension de la fonction du parti qui contribua à sa désagrégation. Le KAPD gardait encore l'idée d'un parti "état-major" militaire" du prolétariat, alors que le parti est avant tout une avant-garde politique de l'ensemble de la classe ouvrière.
De même, confronté à la désagrégation des conseils ouvriers, prisonnier de son volontarisme, le KAPD s'entêta à défendre l'idée d'une double organisation permanente du prolétariat, ajoutant ainsi à la confusion entre organisme unitaire de classe surgissant dans la lutte et pour la lutte (assemblées, comités de grève, conseils ouvriers) et organisation de la minorité révolutionnaire intervenant dans ces organisations unitaires pour féconder leur action et leur réflexion. Ainsi, en laissant subsister et en poussant au maintien des unions - organisations d'usines nées dans la révolution allemande et se rattachant au parti - tout en étant à côté du parti, il se trouva lui-même incapable de déterminer ses tâches : soit devenir une ligue de propagande ([3] [507]) , un simple appendice politique, d'organisation d'usines aux fortes tendances économistes; soit devenir un parti de type léniniste ayant des courroies de transmission sur le terrain économique au sein de la classe. C'est-à-dire dans les deux cas ne plus savoir qui est qui et qui fait quoi ([4] [508]).
Que les conceptions erronées du KAPD aient largement contribué à sa disparition à la fin des années 20 est indubitable. C'est une leçon pour les révolutionnaires d'aujourd'hui qui, par démangeaison activiste et immédiatiste croient suppléer leur faible existence numérique par la création de"groupes ouvriers" artificiels liés au parti. Telle est par exemple la conception de Battaglia Comunista et de la C.W.O. La différence historique est cependant de taille : autant le KAPD se trouvait confronté à des organismes (unions) qui étaient des tentatives artificielles de maintenir en vie des conseils ouvriers qui venaient de disparaître, autant, la conception actuelle des organisations révolutionnaires aux penchants opportunistes reposent sur du bluff.
LA GENESE DU PARTI
Derrière les erreurs du KAPD sur le plan organisationnel, il y avait une difficulté à reconnaître, après l'échec de l'Action de Mars en 1921,1'arrêt momentané de la vague révolutionnaire et donc de tirer les conclusions pour son action dans une telle situation.
Le parti révolutionnaire en effet, comme organisation ayant une influence directe sur l'action et la réflexion des masses ouvrières, ne peut se constituer que dans un cours montant à la lutte de classe. Et en particulier, la défaite et le reflux de la révolution ne permet pas de maintenir en vie une organisation révolutionnaire assumant pleinement la fonction de parti. Si se prolonge un tel recul de la lutte ouvrière, si la voie se dégage pour une reprise en main de la situation par la bourgeoisie, alors soit le parti dégénère sous la pression de la contre-révolution montante et en son sein surgissent des fractions qui poursuivent l'activité théorique et politique du parti (cas de la Fraction Italienne) , soit le parti voit son influence et son assise militante se réduire et devient une organisation plus restreinte qui ne peut que se fixer pour tâche essentielle de préparer le cadre théorique et politique en vue de la prochaine vague révolutionnaire. Le KAPD ne comprenait pas qu'un arrêt de la montée révolutionnaire s'était produit. D'où la difficulté à faire le bilan de la période précédente et à s'adapter à la nouvelle période.
Ces difficultés ont donné jour à deux réponses fausses et incohérentes au sein de la gauche germano-hollandaise :
- proclamer de façon volontariste la naissance d'une nouvelle Internationale, tel est le cas de la KAI([5] [509]) de Gorter en 1922;
- de ne pas se constituer en fraction mais de s'autoproclamer le parti, au fil des scissions ; le terme "parti" devenant une simple étiquette pour chaque organisation scissionniste, réduite à quelques centaines de membres, quand ce n'est pas moins ([6] [510]).
Qui sait qu'il existe 4 "partis" en Italie se réclamant de la Gauche italienne. Cette mégalomanie de petits groupes se prenant pour le "Parti" ne contribue pas peu aujourd'hui à ridiculiser la notion de parti et à entraver le difficile regroupement des révolutionnaires, qui est la première condition subjective pour que surgisse demain un véritable parti mondial du prolétariat.
Toutes ces incompréhensions allaient être dramatiques. Dans la Gauche allemande allaient coexister trois courants, au fur et à mesure que le KAPD de Berlin s'affaiblissait :
- les uns se ralliaient aux thèses de Ruhle que toute organisation politique est mauvaise en soi ; tombant dans l'individualisme, ils disparurent de la scène politique ;
- d'autres - en particulier dans le KAPD de Berlin en lutte contre les tendances anarchisantes développées dans les Unions - avaient tendance à nier les conseils ouvriers pour ne plus voir que le parti. Ils développaient une vision "bordiguiste" avant la lettre ([7] [511]) ;
- les derniers, enfin, considéraient que l'organisation en parti était impossible. La KAU ([8] [512]), née de la fusion d'une scission du KAPD et des Unions (AAU et AAU-E), ne se considérait pas vraiment comme une organisation, mais comme une union lâche de tendances éparses, décentralisée. Le centralisme organisationnel du KAPD était abandonné.
C'est ce dernier courant, appuyé par le GIC hollandais ([9] [513]) né en 1927, qui allait triompher dans la Gauche hollandaise.
LA GAUCHE HOLLANDAISE : LE GIC, PANNEKOEK ET LE SPARTACUSBOND
Le traumatisme de la dégénérescence de la révolution russe et du parti bolchevik a laissé de lourdes séquelles. La Gauche hollandaise qui reprenait l'héritage théorique de la Gauche allemande,^ en a pas repris les apports positifs dans la question du parti et de l'organisation des révolutionnaires .
Elle rejetait la vision substitutionniste du parti Etat-major de la classe, pour ne plus voir que l'organisation générale de la classe : les conseils ouvriers. L'organisation révolutionnaire n'était plus considérée que comme une "ligue de propagande" des conseils ouvriers.
Le concept de parti était ou bien rejeté, ou bien vidé de son contenu. C'est ainsi que Pannekoek considérait tantôt que "un parti ne peut être qu'une organisation visant à diriger et à dominer le prolétariat" ([10] [514]), tantôt que "les partis - ou groupes de discussion, ou ligues de propagande, peu importe le nom par lequel on les désigne -ont un caractère tout à fait différent de cette organisation en partis politiques que nous avons connue dans le passé"([11] [515]).
D'une idée juste - que l'organisation et le parti changeaient de fonction dans la décadence - on aboutissait à des conclusions fausser. Non seulement on ne voyait plus ce qui différencie l'organisation d'un parti dans la période du capitalisme ascendant de celle d'un parti dans une période révolutionnaire, dans une période de pleine maturation de la conscience de classe, mais on abandonnait la vision marxiste de l'organisation politique comme facteur actif de la lutte de classe.
1. Les fonctions indissociables de l'organisation : théorie et praxis étaient séparées. Le GIC se concevait non corme un corps politique avec un programme, mais comme une somme de consciences individuelles et une somme d'activités séparées. Ainsi le GIC préconisait la formation de "groupes de travail" fédérés, par peur de voir naître une organisation unie par son programme et imposant des règles d'organisation : "Il est préférable que des ouvriers révolutionnaires travaillent à la prise de conscience en milliers de petits groupes plutôt que leur activité soit soumise dans une grande organisation aux tentatives de la dominer et diriger" (Canne-Mejer, Le devenir d'un nouveau mouvement ouvrier, 1935).
Plus grave était la définition de l'organisation comme "groupe d'opinion"qui laissait la porte ouverte à l'éclectisme théorique. Selon Pannekoek, le travail théorique visait à l'auto éducation personnelle, à "1'activité intensive de chaque cerveau". De chaque cerveau surgissait une pensée, un jugement personnel "et dans chacune de ces pensées diverses se trouvait en fait une parcelle de la vérité plus ou moins grande" (Pannekoek, Les Conseils Ouvriers). A la vision marxiste d'un travail collectif d'organisation, réel point de départ "d'une activité intensive de chaque cerveau" était substituée une vision idéaliste. Le point de départ était la conscience individuelle, comme dans la philosophie cartésienne, au point que Pannekoek affirmait que le but était non la clarification dans la classe mais "la connaissance par soi-même de la méthode pour distinguer ce qui est vrai et bon", (ibid.)
Si l'organisation n'était qu'un groupe de travail où se forgeait l'opinion de chacun, elle ne pouvait être qu'un "groupe de discussion" ou "un groupe d' études" se "donnant pour tâche 1'analyse des événements sociaux" (Canne-Mejer : Le devenir d'un nouveau mouvement ouvrier, 1935). La nécessité des "groupes de discussion" dont la fonction était la clarification politique et théorique a certes existé. Mais elle correspondait au stade primaire du développement du mouvement révolutionnaire au siècle dernier. Cette phase où pullulaient-les sectes et les groupes séparés était une phase transitoire. Le sectarisme et le fédéralisme qui existaient dans de tels groupes surgis de la classe, étaient des maladies infantiles. Ces maladies disparaissaient avec l'apparition d'organisations prolétariennes centralisées. Comme le notait Mattick en 1935, cette vision du GIC et de Pannekoek était une régression : "Une organisation fédéraliste ne peut pas se maintenir parce que dans la phase du capital monopoliste où se trouve le prolétariat, elle ne correspond finalement à rien...Elle constituerait un pas en arrière par rapport au vieux mouvement au lieu d'être un pas en avant". (Rate-Korrespondenz n° 10-11, Septembre 1935).
2. Dans les faits, le fonctionnement du GIC a été celui d'une fédération d'"unités indépendantes", incapables de jouer un rôle politique actif. Il vaut la peine de citer un article de Canne-Mejer de 1938 (Radencommunisme n° 3) :
"Le groupe des communistes internationaux n'avait pas de statuts, pas de cotisations obligatoires et ses réunions "internes" étaient ouvertes à tous les autres camarades des autres groupes. Il s'ensuit qu'on ne connut jamais le nombre exact de membres que comptait le groupe. Il n'y avait jamais de vote, cette opération n'étant pas nécessaire, car il ne s'agissait jamais de faire une politique de parti. On discutait un problème et quand il y avait une différence d'opinion importante, les divers points de vue étaient imprimés, sans plus. Une décision à la majorité était sans signification. C'était à la classe ouvrière de décider".
En quelque sorte, le GIC s'auto castrait de peur de violer la classe. Par peur de violer la conscience de chacun par des règles d'organisation ou de violer la classe en lui "imposant" une prise de position, le GIC se niait comme partie militante de la classe. En effet, sans moyens financiers réguliers, pas de possibilité de sortir une revue et des tracts en temps de guerre. Sans statuts, pas de règles permettant à l'organisation de fonctionner en toutes circonstances. Sans centralisation avec des organes exécutifs élus, pas de possibilité de maintenir une vie et une activité en toute période et particulièrement en période d'illégalité où le cloisonnement face au déchaînement de la répression impose la centralisation la plus stricte. Et en période de montée de la lutte de classe, comme aujourd'hui, pas de possibilité d'intervenir de façon centralisée et mondiale dans le prolétariat.
Ces errements du courant conseilliste, hier avec le GIC, aujourd'hui dans des groupes informels se réclamant du communisme des conseils reposent sur l'idée que l'organisation n'est pas un facteur actif, mais un facteur négatif dans la classe. En "laissant la classe ouvrière décider", on laisse entendre que l'organisation révolutionnaire est "au service de la classe" ; en quelque sorte une ronéo et non un groupe politique amené - parfois même dans la révolution- à travailler à contre-courant des idées et actions de la classe. L'organisation n'est pas un reflet de ce que "pensent les ouvriers"([12] [516]), elle est un corps collectif portant la vision historique du prolétariat mondial, qui n'est pas ce qu'il pense à tel ou tel moment mais ce qu'il est contraint de faire : la réalisation des buts communistes.
Il n'est donc point étonnant si le GIC disparut en 1940. Tout le travail théorique du GIC fut transmis par le Spartacusbond né d'une scission du parti de Sneevliet en 1942 (cf. article de la Revue Internationale n° 9, "Rupture avec le Spartacusbondy 1977). Malgré une vision plus saine de la fonction le Bond reconnaissait le rôle indispensable d'un parti dans la révolution comme facteur actif de la conscience - et du fonctionnement -le Bond avait des statuts et des organes centraux -, le Spartacusbond finit par être dominé par les anciennes idées du GIC sur l'organisation.
Aujourd'hui, le Spartacusbond est agonisant, et Daad en Gedachte -qui est sorti du Bond en 1965 -est un bulletin météorologique des grèves ouvrières. Aujourd'hui, la Gauche hollandaise agonise comme courant révolutionnaire. Ce n'est donc pas par elle que peut être transmis tout son héritage théorique aux éléments révolutionnaires qui surgissent dans la classe. La compréhension et le dépassement de cet héritage est l'oeuvre d'organisations révolutionnaires et non d'individus ou de groupes de discussion.
Les idées"conseillistes" sur l'organisation n'ont cependant pas disparu, comme on peut le constater dans différents pays. Faire un bilan critique de la conception de l'organisation dans la Gauche allemande et hollandaise, c'est prouver non la faillite des organisations révolutionnaires, mais au contraire leur rôle indispensable pour tirer les leçons du passé et se préparer aux combats de demain.
Sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, mais sans organisation révolutionnaire, il n'y a pas non plus de théorie révolutionnaire. Ne pas le comprendre, c'est emprunter la voie qui mène au néant pour toute organisation informelle, et pour les individus. C'est la voie qui mène à être désabusé sur la possibilité d'une révolution. (Cf. dans cette revue, le texte de Canne-Mejer).
CH.
[1] [517] "...il n'est même pas possible de parler de classe tant qu 'il n 'existe pas dans celle-ci une minorité tendant à s 'organiser en un parti politique ." (Bordiga : "Parti et classe").
[2] [518] "Thèses sur le rôle du parti dans la révolution prolétarienne", KAPD, 1920.
[3] [519] Comme l'affirmait Franz Pfemfert, l'ami de Ruhle, directeur de la revue "Die aktion", membre du KAPD.
[4] [520] Michaelis, ex-dirigeant du KAPD et membre de la KAU en 1931, déclarait : "Dans la pratique, l'union devint elle-même un second parti...le KAP regroupait même, plus tard, les mêmes éléments que l'union".
[5] [521] KAI : Internationale Communiste Ouvrière.
[6] [522] En 1925, en Allemagne il y avait 3 KAPD : un pour la tendance de Berlin et 2 pour la tendance d'Essen. Cette erreur, qui était une tragédie dans le camp prolétarien à l'époque, s'est répétée sous forme de farce en 1943 en Italie, avec la proclamation - en pleine contre-révolution - du Parti Communiste Internationaliste de Damen et Maffi.
[7] [523] Le même Michaelis avoue en 1931 : "Les choses allèrent même si loin que pour maints camarades, les conseils n'étaient considérés comme possibles que dans la mesure où ils acceptaient la ligne du KAP."
[8] [524] KAU : Union Communiste Ouvrière
[9] [525] GIC : Groupe des Communistes Internationaux.
[10] [526] Parti et classe ouvrière, 1936.
[11] [527] Les Conseils Ouvriers, 1946.
[12] [528] On peut lire dans le même n° cité de Radencommunisme : "Quand il y avait une grève sauvage, les grévistes faisaient souvent faire des tracts par les groupes ; ceux-ci les réalisaient même s'ils n'étaient pas absolument d'accord avec leur contenu" (souligné par nous).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
La faillite du conseillisme
- 2693 reads
En complément de l'article "La conception de l'organisation dans Les Gauches allemande et hollandaise", dans ce numéro, nous publions ci-dessous des extraits d'un texte de CANNE-MEJER qui fut un des militants les plus actifs et un des théoriciens de ce courant politique, notamment dans le GIC dans les années 30. Ce texte écrit à la fin des années 50, intitulé LE SOCIALISME PERDU, illustre un des aboutissements des erreurs contenues dans la conception théorique et politique du "communisme de conseils" : la mise en question du marxisme et de la signification historique de la lutte prolétarienne; la croyance en la pérennité du capitalisme avec la capitulation à la pression de l'idéologie bourgeoise, dans ce cas celle de la période de reconstruction d'après-guerre sur la "société de consommation et de loisirs" qui fit fureur dans les années 60.
Nous faisons précéder ce texte de quelques commentaires introductifs de notre part
UN SOCIALISTE PERDU
A l'époque où le texte est écrit, les quelques rescapés de la Gauche communiste sont pour la plupart isolés et dispersés. La longue période de contre-révolution a épuisé les énergies. La deuxième guerre mondiale n’a pas fait surgir de mouvement révolutionnaire du prolétariat carme en 1917. Ce qui reste des Gauches communistes italienne et germano-hollandaise qui avaient résisté pendant près de 20 ans dans de petites minorités organisées est disloqué et extrêmement réduit ou se trouve dans une terrible confusion politique. Dans cette situation, les erreurs politiques qui n'ont pas été dépassées vont donner le jour à des aberrations grandissantes sur les bases mêmes de la théorie révolutionnaire, sur la compréhension de ce qu'est le marxisme.
Dans la Gauche italienne, le Parti communiste internationaliste se forme dans la confusion en Italie en pleine deuxième guerre mondiale avec le resurgissement des luttes ouvrières en 43.(1) Il rejette l'héritage de la Gauche communiste internationale qui est le seul groupe vraiment conséquent des années 30 (BILAN). Les critiques et les appels répétés de la Gauche communiste de France (INTERNATIONALISME) à reprendre à fond les questions politiques restent sans réponse. Un peu plus tard Bordiga, dans le Parti communiste international, scission du Parti communiste internationaliste va théoriser de plus en plus, par une fidélité dogmatique et bornée à la révolution russe et à Lénine, un monolithisme du marxisme.
Dans la Gauche germano-hollandaise, dont la dislocation et l'incapacité à tirer les leçons de la révolution russe dés les années 30 ont déjà accéléré la dégénérescence, Canne-Mejer va aboutir dans les années 50, à force de rejeter la révolution russe, à une remise en question complète du marxisme et de la lutte de classe.
Le processus qui mène à ces incompréhensions du marxisme n'est donc pas identique et n'a pas la même origine pour ces deux courants politiques. L'origine de l'échec des groupes qui se réclament de la Gauche italienne se trouve dans l'incapacité à assurer la continuité du travail d'élaboration théorique et politique effectué par la GCI avant la guerre D'une part la pression de la guerre et de l'après-guerre va faire céder le travail politique organisé sur les bases de cette continuité par la GCF qui se ra dissoute en 1953. D'autre part, les autres tendances de ce même courant vont, de concession politique en considération tactique, se maintenir en régressai sur les positions politiques et se fossiliser avec des conséquences dont on peut encore voir les résultats aujourd'hui avec la désagrégation du PCI (Programme Communiste) et les dérapages politiques du PCI (Battaglia Comunista) ([1] [529]). Par contre, l'échec de la Gauche germano-hollandaise trouve ses racines antérieurement. Dans les années 20 c'est dans les Gauches allemande et hollandaise qu'on trouve les tentatives de compréhension les plus avancées sur les apports fondamentaux de la nouvelle période ouverte avec la Guerre mondiale et la vague révolutionnaire : l'impossibilité du parlementarisme révolutionnaire ; la nature contre-révolutionnaire des syndicats ; le rejet des luttes de libération nationale; le rejet du parti de masses" et toute tentative de rapprochement et d'unification avec la social-démocratie et ses courants de "gauche" et la tactique dite de "front unique". -Mais dans les années 30, parce qu'il rejette le parti bolchevik et de plus en plus la nature de classe de la révolution d'octobre, l'héritier de cette Gauche, le courant des "communistes de conseil", va saper toute possibilité d'intégrer les nouvelles positions politiques dans une cohérence théorique et organisationnelle. Il se maintiendra sur un terrain de classe, mais sans pouvoir avancer réellement au-delà d'une répétition des positions sans élaboration.
En fait, seul BILAN est capable à cette époque, bien qu'il n'aille pas jusqu'au bout de cette élaboration, de reprendre les leçons de la révolution et de fournir des bases pour une compréhension actuelle de ces questions. BILAN peut apparaître peu clair sur la formulation théorique, de certaines positions et notamment sur le rapport parti/classe, mais, en s'attachant à l'histoire, il comprend la dynamique de la révolution et du reflux beaucoup plus clairement et ce que sont les taches des révolutionnaires qui en découlent. BILAN fournit ainsi un cadre plus global, plus cohérent, en continuité avec le mouvement ouvrier. Au contraire, on trouve dans les bases du "conseillisme" un rejet de ce cadre historique global. La non reconnaissance du parti bolchevik comme un parti du prolétariat empêche ce courant d'aborder une critique méthodique des positions politiques qui se sont exprimées dans la révolution russe. Au plan théorique, ce courant, d'une sous-estimation d'abord, aboutira ensuite à une négation de la fonction active et indispensable de l'organisation politique révolutionnaire dans la révolution prolétarienne. Ce qu'exprime en fait cette conception c'est une incompréhension du processus de prise de conscience de la classe elle même, contrairement à l'insistance constante mais finalement purement formelle de ce courant sur cette question.
C'est cette conception que développe le "communisme de conseils", et sur cette base, dans la période de reconstruction, au cours de laquelle il semble que le capitalisme a retrouvé un second souffle et que le prolétariat n'a plus les moyens et n'exprime plus les buts de sa lutte, Canne-Mejer, qui fut pourtant toute sa vie un militant dévoué à la cause du prolétariat, finira par divaguer sur les "loisirs" et "l'amélioration possible des conditions de vie sur la base de la collaboration de classe" !
Nous reviendrons de façon plus élaborée dans d'autres articles sur cette question de conception qui se pose toujours aujourd'hui.
Le danger n'est certes plus de prendre les feux de la reconstruction pour un nouveau regain du capitalisme, mais l'abandon du combat de classe, face aux difficultés de la période, existe. La sous-estimation des taches des révolutionnaires dans la lutte de la classe - comme partie prenante active et organisée, capable de fournir des orientations claires - l'irresponsabilité et le sectarisme qui règnent parmi les groupes qui se réclament de la révolution dans la mouvance "anti-léniniste" est tout aussi néfaste que la mégalomanie ridicule des groupes qui se réclament du "léninisme". Elle peut parfois l'être plus. La faillite de la conception du marxisme monolithique et du parti injectant la conscience à la classe apparaît évidente dans les échecs spectaculaires des avatars des diverses "tactiques" des groupes qui s'en réclament. La conception "conseilliste" est plus diffuse, mais dans une période où la bourgeoisie tente de profiter des hésitations de la classe ouvrière, et vise à son déboussolement et à son immobilisation, c'est une idéologie qui, dans sa logique, va dans le même sens, tout comme Canne-Mejer finit par entonner les chants de la bourgeoisie dans une autre période. Le texte que nous publions n'a que peu d'intérêt en lui-même, mais il révèle l'aboutissement d'une méthode et d'une conception profondément erronée de la lutte de classe qui mène, en rejetant le marxisme, à rejeter toute perspective de lutte de la classe ouvrière.
Il ne s'agit pas de reprendre du marxisme "tout" à la manière des bordiguistes, c'est-à-dire mot pour mot, à la lettre, mais de comprendre que le marxisme est un matérialisme historique, et si on relègue au rang de "vieillerie à la rigueur valable pour le siècle dernier" la dimension historique et politique du marxisme pour n'en garder que l'analyse des phénomènes, on quitte le terrain de la lutte de classe et de la révolution communiste pour se jeter dans les bras de la bourgeoisie.
Dans ce texte, Canne-Mejer ne voit dans la classe ouvrière qu'une catégorie économique de la société. Il n'aborde les taches du prolétariat que sur la question de la prise en mains des moyens de production et de consommation ; la lutte de classe est évoquée comme une simple "rébellion", rébellion liée non à une nécessité objective historique de l'impasse où les contradictions internes du mode de production capitaliste l'ont amenée : son entrée dans la décadence, ni aux conditions générales et au devenir de la classe, mais au seul "travail lui-même". Canne-Mejer a encore quelques souvenirs : il fait référence à la critique qu'ont toujours faite les marxistes selon laquelle il n'y a pas un "automatisme" de la lutte de classe seulement lié aux mécanismes du capitalisme ; mais il est nécessaire encore que se développe un des facteurs déterminants de cette lutte, la conscience de la classe de son action. Mais ce rappel devient chez Canne-Mejer une question de "psychologie sociale" ou d'"éthique", tout aussi mécanique, parallèle ou alternant avec la "rébellion". Rien n'est plus étranger au marxisme. Il n'est question nulle part chez Canne-Mejer de poser les vraies questions : quelles sont les taches politiques de la classe ouvrière ? Quels sont la nature et le rôle des communistes au sein de la classe ouvrière ? etc. La conception marxiste de la lutte de classe est réduite à la lutte pour des réformes dans les syndicats et les parlements du 19e siècle, sans référence à l'étude des conditions historiques dans lesquelles le marxisme a toujours situé ses luttes en indiquant toujours leurs limites par rapport au but général du combat de la classe, le communisme par la destruction de l'Etat capitaliste. Tout cet aspect est réduit à une vague notion de "lutte acharnée" hors de tout contexte historique des conditions matérielles de la révolution. Et puisque selon la vision "conseilliste", la révolution russe n’est pas ouvrière pour Canne-Mejer, cette "lutte acharnée" n'a donc pas eu lieu au 20ème siècle. Même les conseils ouvriers sont oubliés. Puisqu'il n'y a pas eu "lutte acharnée", Marx s'est trompé. Le massacre de générations de prolétaires dans la contre-révolution et dans les guerres est ignoré, et bien qu'on prétende "attirer l'attention sur deux phénomènes primordiaux de la vie économique durant ce siècle", l'économie de guerre est également ignorée.
LE SOCIALISME PERDU ESPERANCES DU MOUVEMENT MARXISTE D'AUTREFOIS
EXTRAITS D'UN TEXTE DE H.CANNE-MEYER
On rejoint la bourgeoisie dans l'étude de "l'augmentation des capitaux investis" et de "l'immense croissance de la productivité du travail". La classe ouvrière est assimilée aux syndicats et ses conditions de vie actuelle, ce sont principalement les "loisirs". Et c'est ce qui montre les "mécomptes de Marx" selon Canne-Mejer... Tel est le triste aboutissement du conseillisme.
MS.
CERTITUDE DE L'AVENEMENT DU COMMUNISME
Marx n'a jamais donné de description de la société communiste. Il ne faisait que montrer que la production, organisée sur la base de la propriété privée des moyens de produire, finirait par devenir un fardeau insupportable à la grande masse de la population, de sorte que celle-ci mettrait en commun ces moyens, et supprimerait l'exploitation due aux classes sociales. Dans l'esprit de Marx, décrire la société future c'était retomber dans l'Utopisme. Selon lui, une société nouvelle émerge du giron de la vieille sous l'action des forces réelles qui gouvernent le processus du travail social. Marx remarquait que la possession privée des moyens de production développait un processus de travail collectif en rassemblant des milliers et des milliers d'ouvriers. Ces ouvriers deviendraient les fossoyeurs de la possession privée des moyens de production. Car, pendant que croissent misère, oppression, esclavage, dégénérescence et exploitation, augmente également la rébellion de la classe ouvrière, unifiée et organisée par le processus de travail lui-même ([2] [530]).
"La centralisation des moyens de production et le caractère social atteignent un point où ils sont incompatibles avec 1'enveloppe capitaliste. Cette enveloppe éclate. La dernière heure de la propriété privée a sonné." ([3] [531]).Selon Marx, le mode de production capitaliste produit sa propre négation "avec l'inéluctabilité d'une loi de la nature". ([4] [532]).
Cette formulation de Marx, avec l'allusion à "1'inéluctabilité des lois de la nature" a causé beaucoup de malentendus. Souvent elle menait beaucoup de marxistes à une interprétation mécaniste du développement social. On croyait souvent à un écroulement automatique du système capitaliste, soit à cause des crises, soit à cause de l'abaissement du taux de profit, soit par manque de débouchés pour réaliser la plus-value. Lors d'un tel écroulement, la classe ouvrière pourrait, pour ainsi dire, prendre les moyens de production à son compte. Il suffirait plus ou moins à la classe ouvrière d'observer ce que Marx appelait "la décomposition - inévitable et de plus en plus visible -..."([5] [533]) du système. Les modifications, que subissent les capacités intellectuelles de la classe ouvrière pendant une lutte continue et qui la conduisent à pouvoir maîtriser politiquement et économiquement la vie sociale, apparaissent superflues.
Pourtant cette conception d'un écroulement définitif est en contradiction avec la méthode de penser de Marx... Pour lui, cette "inéluctabilité" n'est pas une nécessité extérieure à l'homme, une nécessité immanente qui s'exécute en dépit des hommes, au sens où, par exemple, certains penseurs bourgeois parlent souvent de développement immanent de l'esprit comme de la force motrice du monde. Pour Marx, il s'agit d'une inévitabilité imposée par les hommes eux-mêmes en conséquence de leur expérience de la vie sociale. Marx était persuadé crue les ouvriers devraient constamment s'opposer violemment aux tendances opprimantes du capitalisme, et que cette lutte se poursuivrait jusqu'à ce qu'ils aient vaincu le capitalisme. Ainsi, 1'"inéluctabilité" dont parlait Marx se trouvait découler de la nécessité naturelle de lutter contre le capitalisme.
LE MARXISME EN TANT QUE PSYCHOLOGIE SOCIALE
Donc Marx n'énonçait pas seulement une théorie qui mettait à jour les forces matérielles motrices du système capitaliste, mais, en plus, fournissait une théorie de la psychologie sociale qui prédisait le changement dans les pensées, la volonté, les sentiments et les actions des ouvriers. La pression de l'exploitation du capital concentré serait contrecarrée par la lutte organisée où se serait forgées la solidarité, la promptitude de chacun et de tous au sacrifice, formant ainsi une unité solide de pensée, de volonté, d'action. Le développement de l'individualité d'un ouvrier ne serait possible que comme partie d'un tout actif plus vaste, comme partie de son organisation de lutte. Les idées sur le bien et le mal dans la vie sociale seraient de nouveau remodelées par cette lutte et en accord avec les nécessités de cette lutte. Ces idées nouvelles que l'on peut appeler "valeurs éthiques", serviraient à leur tour de forces motrices pour commencer de nouvelles luttes. Chaque lutte se convertirait en valeurs éthiques et ces nouvelles valeurs éthiques pousseraient à de nouvelles luttes. La nouvelle éthique serait à la fois fille et mère de la lutte.
LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE SOCIETE
Marx puisait sa certitude de l'avènement d'une société sans exploitation et sans classes dans sa certitude d'une lutte acharnée contre le capitalisme. Par cette lutte, la nouvelle société naîtrait du giron de la vieille. Cette lutte se ferait au moyen des syndicats qui amélioreraient les conditions de travail et au moyen des partis socialistes qui développeraient la conscience de classe. Pratiquement pour s'attaquer à ce développement il fallait s'attacher à lutter pour le perfectionnement du système parlementaire bourgeois (du suffrage universel) et pour des réformes sociales.
Ce n'est pas que Marx attendait de grands succès pratiques de la lutte parlementaire et syndicale. Pour lui, le mouvement des salaires n'était à prime abord fonction que de l'accumulation du capital. Dans une période de prospérité où la vie économique se développait, le besoin de main-d'oeuvre croissait et les syndicats pouvaient obtenir un salaire plus haut. Mais si les salaires montaient au point où la production cesserait d'être profitable l'accumulation devrait décroître, avec comme résultat chômage, "surpopulation", et baisse des salaires. Ainsi la base de profit s'élargirait à nouveau ([6] [534]).
"Donc l'augmentation du prix du travail ne reste pas seulement restreinte entre des limites qui ne touchent pas aux fondations du capitalisme, mais ces limites donnent également une certitude d'un élargissement à une plus grande échelle"([7] [535]).
Le sens de la lutte de classe se trouvait, pour Marx surtout dans le développement des caractéristiques intellectuelles qui mèneraient à la chute du capitalisme.
Marx pensait que les syndicats, par eux-mêmes, ne pourraient jamais vaincre le capitalisme aussi longtemps que la classe capitaliste disposerait de l'Etat. Le point cardinal de la lutte politique devait être recherché dans la conquête du pouvoir de l'Etat, soit par les voies parlementaires, (Marx les considérait comme possibles pour l'Angleterre et la Hollande), soit par des méthodes révolutionnaires. Après la Commune de Paris il fut convaincu que l'Etat ne devait pas être conquis mais brisé. En tout cas la tache du gouvernement révolutionnaire ne serait pas d' "établir" le communisme, par exemple en étatisant les moyens de production (quoique la nationalisation de quelques branches ne doive pas être exclue). Marx ne prescrivit pas ce que les révolutionnaires devaient faire en cas de révolution, mais il pensait que le développement devait être confié aux forces révolutionnaires à l'oeuvre dans la société, " quand une véritable révolution éclatera" - dit-il - "on verra également apparaître les conditions ( sans doute pas idylliques ) dans lesquelles elle réalisera ses mesures immédiates les plus urgentes".([8] [536])
Beaucoup de marxistes de cette époque soutenaient l'opinion que la tâche d'un gouvernement révolutionnaire consistait surtout à ne pas entraver les luttes des ouvriers contre les entrepreneurs, il était même de son devoir de les étayer. Les syndicats auraient ainsi les mains libres pour aménager la vie sociale selon leurs besoins, les capitalistes seraient dépossédés, non par le truchement des nationalisations, mais parce que les profits cesseraient d'être payés. Ainsi le capital perdrait toute valeur et pendant ce temps la gestion de la vie sociale tomberait entre les mains de l'association des producteurs libres et égaux. D'un côté la naissance de la nouvelle société au sein de l'ancienne se trouvait liée à l'épanouissement de la conscience politique qui devait mener au pouvoir politique, sous quelque forme que ce soit, de l'autre elle était reliée au processus de déploiement des forces s'opposant aux entrepreneurs, préparant ou bâtissant tout en même temps, les nouveaux organes de gestion sociale.
En illustration de ce qui précède nous pouvons citer un fait historique rapporté par le marxiste bien connu A. Pannekoek. En 1911, il y avait, en Allemagne, une grève et les grévistes tentaient d'empêcher les jaunes de travailler. La presse bourgeoise qualifiait cette action de "terrorisme". Les tribunaux intervinrent et tentèrent d'accuser quelques grévistes de séquestration. Selon les tribunaux, les grévistes avaient contraint les jaunes de les suivre devant le comité de grève, où ils étaient interrogés comme par un tribunal, puis, après quelques mises en garde, relâchés. Lors de leur interrogatoire par la "justice officielle", les jaunes déclarèrent, cependant, qu'il n'était pas question de séquestration; ils avaient suivi les grévistes de leur plein gré. Et le juge, très surpris, de dire : "Ainsi, vous admettez que cette organisation, qui vous est hostile, est une instance si compétente que vous n'osez pas vous soustraire à 1'ordre de les suivre que vous adressèrent les grévistes ?"
Pour Pannekoek, à cette époque, cette anecdote était un exemple de la manière dont les organisations ouvrières travailleraient ensuite comme organes indépendants opposés aux vieux organes de l'Etat. Il suffisait de briser le pouvoir de l'Etat pour permettre l'essor des organisations ouvrières autonomes.
LE MECOMPTE
Ce que Marx attendait du développement du capital, s'est, en général, réalisé. Mais ses prédictions, au sujet de la lutte de classes, sont, jusqu'à présent, apparues fausses. La concentration des capitaux et la centralisation de la vie économique (et politique) se sont effectuées. La classe des salariés devint prépondérante; des milliers d'ouvriers furent rassemblés dans des usines, des millions d'entre eux s'organisèrent en syndicats. Les crises économiques se succédèrent toujours, de plus en plus vite jusqu'en 1939, se montrant de plus en plus destructrices, la première, puis la seconde guerre mondiale, venues de la concurrence des capitaux, causaient le massacre de milliers d'ouvriers et épuisaient l'appareil de production européen. Mais si ces prédictions des vieux marxistes se réalisèrent, il n'en est pas de même de celle concernant l'appauvrissement de la classe laborieuse, au moins si on la considère sous l'angle de la consommation et de la garantie de subsistance. Quantité et diversité des biens de consommation se sont accrues au cours des années; les assurances sociales qui portent sur le chômage, les invalidités, les maladies, la vieillesse etc... sont devenues un appui non négligeable dans l'existence , la réduction du temps de travail, les vacances, la radio, le cinéma, la télévision et les possibilités de voyager assurent des loisirs certains auxquels les vieux marxistes n'avaient sûrement pas rêvé.
Pourtant cette augmentation du niveau de la vie matérielle et cette sécurité plus grande de subsister ne sont pas en soi responsables de l'anéantissement des perspectives ouvrières de société sans classes et sans exploitation. Cette responsabilité incombe plutôt à la façon dont cette amélioration a été obtenue. Si cette amélioration a-vait été conquise au cours des années par des luttes de masse des ouvriers face à une résistance acharnée des entrepreneurs, le processus de développement de nouveaux caractères psychiques, mentionné ci-dessus, serait entré en ligne de compte. La certitude du communisme, son inéluctabilité, se trouvait dans la nécessité d'une lutte permanente et acharnée pour réaliser le prix du travail au niveau de la valeur du travail, avec comme conséquence psychologique la volonté de réaliser le communisme. Les conceptions des ouvriers de la solidarité et d'une solide discipline de classe, l'expression de nouvelles valeurs sociales, d'une nouvelle conscience morale, tout cela est lié à une lutte active des ouvriers eux-mêmes, comme c'était réellement le cas au temps de Marx.
Ici se trouve l'erreur de Marx. Il a sous-estimé les conséquences de l'augmentation prodigieuse de la productivité, qui ouvrait un chemin plus facile à l'augmentation du niveau de vie. Surtout à partir de la première guerre mondiale, le caractère de la lutte de classe devait changer, la collaboration entre le capital et le travail par le truchement des parlements et des syndicats devenait possible sur la base de la productivité accrue du travail, et fournissait une issue à la situation sans que les masses mêmes soient obligées d'intervenir. La lutte acharnée des masses elles-mêmes n'a, jusqu'à présent, pas été absolument nécessaire et il s'ensuit que les prédictions de caractère psychologico-social n'ont pas été réalisées.
TRAVAIL MANUEL ET TRAVAIL INTELLECTUEL
Avant de terminer ce chapitre, nous voulons signaler que l'augmentation du niveau de vie n'est pas en contradiction avec la loi de la valeur de la force de travail formulée par Marx. A première vue cette augmentation, incarnée en radios, cinémas, télévisions, possibilités de voyages etc., semble en contradiction avec cette loi. Mais ce n'est qu'en apparence. Cette loi dit que la valeur du travail est déterminée par les frais de reproduction de la force de travail y compris la reproduction dans la nouvelle génération. Autrefois, ces frais se limitaient en frais d'une méchante habitation, de l'habillement et de la nourriture, le bistrot et l'Eglise assurant une détente suffisante. De nos jours, cette reproduction, exige beaucoup plus, et cela vient du changement de caractère du travail.
C'est la machine qui a modifié ce caractère. Tout le temps où l'on a travaillé avec des machines peu compliquées ou sans machines du tout, le travail avait surtout un caractère manuel, physique. C'étaient surtout les muscles qui comptaient, l'effort intellectuel ou nerveux jouant un rôle secondaire. Ainsi les frais de reproduction de la force de travail se limitaient au rétablissement des facultés physiques et à l'éducation corporelle des enfants. Avec l'extension généralisée du travail mécanisé, aux machines toujours plus compliquées, l'effort intellectuel, une attention constamment soutenue, amenaient une modification du caractère du travail (chauffeurs, chemins de fer, ateliers de confection, travail à la chaîne, emplois de bureaux,). Au lieu du travail musculaire apparaissait l'épuisement corporel et intellectuel. La régénération des facultés physiques cessait d'être suffisante. L'ensemble aboutissait à un raccourcissement du temps de travail et concurremment à une extension des moyens de distraction : cinéma, radio, vacances etc.. Autrement dit : l'épuisement corporel et mental avait pour résultat une augmentation du coût de la valeur du travail qui s'exprimait par une augmentation des frais de reproduction de celle-ci. L’élévation du niveau de vie, loin d'être en désaccord avec la loi de la valeur de la force de travail, en est au contraire une confirmation.
Mais il est sûr que, de nos jours, la classe ouvrière n'a pas réussi à réaliser la nouvelle valeur de sa force de travail malgré le soi-disant pouvoir des syndicats et des partis socialistes parlementaires. Du point de vue du rythme de la vie économique, on doit constater une régression qui ne s'exprime pas en biens de consommation mais en nervosité générale et en maladies nerveuses. Ce n'est pas là ce que Marx attendait.
[1] [537] Voir en particulier les articles consacrés aux premières années des PCI (Internationaliste et International) dans les numéros 32 et 36 de la REVUE INTERNATIONALE.
[2] [538] Voir le Capital 1 chap.24
[3] [539] Voir note 1.
[4] [540] Idem.
[5] [541] Marx, lettre à Domela Neuwenhuis 22-2-1880. p. 317. éd. Institut Marx-Engels-Lénine.
[6] [542] "Le Capital" 1 chap.23 n°1.
[7] [543] "Le Capital" 1 chap.23 n°2.
[8] [544] Voir note 4.
Conscience et organisation:
Débat : à propos de la critique de la théorie du "maillon le plus faible"
- 3122 reads
A la suite de la défaite et de la répression subies par la classe ouvrière en Pologne, en décembre 81, une discussion s'est engagée dans le CCI en vue de tirer un maximum d'enseignements de cette expérience. Les principales questions étaient :
- Pourquoi et comment la bourgeoisie mondiale a-t-elle réussi à isoler les ouvriers en Pologne de leurs frères de classe des autres pays ?
- Pourquoi leur lutte n'a-t-elle pas donné le signal d'un développement des combats dans le reste du monde ?
- Pourquoi, en Pologne même, les travailleurs qui avaient, en août 80, fait preuve d'une telle combativité, d'une telle capacité d'auto organisation, qui avaient utilisé avec autant d'intelligence l'arme de la grève de masse contre la bourgeoisie, ont-ils par la suite été piégés aussi facilement par le syndicat "Solidarnosc" qui les a livrés pieds et poings liés à la répression ?
- Quelle est, pour le prolétariat mondial, l'ampleur réelle de la défaite subie en Pologne? S'agit-il d'une défaite partielle, de portée relativement limitée, ou d'une défaite décisive qui signifie que la bourgeoisie a d'ores et déjà les mains libres pour donner sa propre réponse à 1'aggravation inexorable de la crise économique : la guerre impérialiste généralisée ?
A ces questions, la Revue Internationale du CCI (n°29, 2ème trimestre 82) apportait une réponse dans l'article "Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales". Cependant, la réflexion du CCI ne s'était pas arrêtée aux éléments contenus dans ce texte. Elle l'a conduit à préciser sa critique de la thèse, ébauchée par Lénine et développée par ses épigones, suivant laquelle la révolution communiste débuterait, non dans les grands bastions du monde bourgeois, mais dans des pays moins développés : la "chaîne capitaliste" devait se briser à son "maillon le plus faible". Cette démarche a abouti à la publication dans la Revue Internationale n°31 (4ème trimestre 82) d'un texte dont le titre résume bien la thèse qui y est défendue : "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe, critique de la théorie du maillon le plus faible'".
Elle a conduit également en juillet 83 à l'adoption par le 5ème congrès du CCI d'une résolution sur la situation internationale qui précise que :
"L'autre enseignement majeur de ces combats (en Pologne 80-81) et de leur défaite est que cette généralisation mondiale des luttes ne pourra partir que des pays qui constituent le coeur économique du capitalisme : les pays avancés d'Occident et parmi eux, ceux où la classe ouvrière a acquis 1'expérience la plus ancienne et la plus complète :1'Europe occidentale..,
Si 1'acte décisif de la révolution se jouera lorsque la classe ouvrière aura terrassé les deux monstres militaires de l'Est et de l'Ouest, son premier acte se jouera nécessairement au coeur historique du capitalisme et du prolétariat L'Europe occidentale." (Revue Internationale n°35, page. 21).
L'ensemble du CCI s'est trouvé d'accord sur la nécessité de critiquer la thèse du "maillon le plus faible" dont l'Internationale Communiste dégénérescente a fait un dogme et qui a servi à justifier les pires aberrations bourgeoises, notamment celle du "socialisme dans un seul pays".
Cependant, une minorité de camarades a rejeté l'idée que "le prolétariat d'Europe occidentale serait au centre de la généralisation mondiale de la lutte de classe", que "l'épicentre du séisme révolutionnaire à venir se trouve placé" dans cette région du monde.
"Dans la mesure où les débats qui traversent 1'organisation concernent en général 1'ensemble du prolétariat, il convient que celle-ci les porte à l'extérieur". (Revue Internationale n°33, "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires").
Nous publions donc ci-dessous- un texte de discussion émanant d'un camarade de la minorité et qui synthétise d'une certaine façon les désaccords apparus au cours des débats sur cette question précise.
Dans la mesure où ce texte se réfère à une "Résolution sur la critique de la théorie du maillon faible", adoptée en janvier 83 par l'organe central du CCI, nous avons estimé utile de faire précéder ce texte par celle-ci bien qu'elle n'ait pas été écrite aux fins de publication à l'extérieur mais de prise de position dans le débat interne. C'est pour cela que la langue en est difficile à comprendre pour le lecteur non familiarisé avec nos analyses et que nous incitons à lire au préalable les textes de la Revue Internationale n°29 et 31 déjà cités.
Enfin, outre la résolution et le texte de discussion, nous publions la réponse du CCI aux arguments donnés dans celui-ci.
RESOLUTION DU CCI
1) Le CCI réaffirme l'unité des conditions de la révolution prolétarienne au niveau mondial. L'unification du monde capitaliste dans la période de décadence implique que c'est le monde entier, quel que soit le degré de développement des pays qui le compose, qui est mûr pour la révolution communiste, dont les conditions sont données depuis 1914 mondialement. Il rejette la théorie bordiguiste des révolutions bourgeoises dans certaines aires géographiques du tiers-monde, comme étape première de la révolution prolétarienne. Celle-ci n'est pas seulement nécessaire mais possible pour chaque secteur du prolétariat mondial pour lequel elle constitue la seule perspective à la crise générale du système.
2) De même que l'unité des conditions de la révolution n'est pas la somme de conditions nationales particulières, de même le prolétariat mondial n'est pas la somme de ses parties.
La conception marxiste de la révolution n'est pas une conception matérialiste vulgaire. La révolution est un processus dynamique, et non statique, dont la marche est le dépassement des conditions géo historiques particulières. C'est pourquoi le CCI rejette aussi bien la théorie du "maillon le plus faible du capitalisme" que celle de la "Révolution ouest-européenne".
La première, élaborée par l'Internationale Communiste lors de son déclin, affirmait implicitement que le prolétariat des pays arriérés pourrait jouer un rôle plus révolutionnaire que celui des pays développés (absence d'"aristocratie ouvrière" ; inexistence du poison de la "démocratie"; faiblesse de la bourgeoisie nationale).
La seconde, développée dans la "Réponse à Lénine" de Gorter, soutenait que seuls les prolétaires d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord seraient en mesure de réaliser la révolution mondiale, réduite dans les faits à l'ouest européen, étant données des conditions objectives plus favorables (fortes concentrations ouvrières, tradition de lutte). L'erreur symétrique de ces deux conceptions trouve son origine aussi bien dans les conditions de l'époque (la révolution naît en 17 de la guerre, à la périphérie de l'Europe industrielle, dans un monde capitaliste encore divisé en une constellation d'impérialismes et de capitaux privés) que dans la confusion entre champ d'extension et dynamique de la révolution. En cherchant à déterminer les conditions objectives les plus favorables à l'éclatement de la révolution, les révolutionnaires de l'époque eurent tendance à confondre point de départ et point d'arrivée de tout le processus dynamique d'extension de la révolution. Bien que ces deux théories ne fussent pas des conceptions bourgeoises et expriment la vie du mouvement révolutionnaire de l'époque à la recherche d'une cohérence, elles ont mené aux pires aberrations : la théorie des "maillons faibles" aboutissant au tiers-mondisme ; celle de la "révolution ouest-européenne"à un néo-menchevisme.
3) La grève de masse d'août 80 limitée à la Pologne ne remet pas en cause le schéma classique de la généralisation internationale de la lutte de classe, comme bond qualitatif nécessaire à l'ouverture d'un cours révolutionnaire.
La Pologne a reposé avec acuité la question des conditions objectives les plus favorables au développement de la dynamique internationale de la grève de masse :
- à la différence de 1917-18, la bourgeoisie est beaucoup mieux préparée et plus unie internationalement pour étouffer toute menace de généralisation par-delà les frontières d'un pays ;
- un processus révolutionnaire ne peut naître dans un seul pays en l'absence d'une dynamique brisant le cadre national dans lequel la grève de masse ne peut être qu'étouffée.
4) Déterminer le point de départ de cette dynamique, et donc les conditions optimales de la naissance du séisme révolutionnaire, n'est pas nier l'unité du prolétariat mondial. Elle est le processus même par lequel l'unité potentielle devient unité réelle.
Cependant, unité n'est pas identité des parties qui restent soumises à des conditions matérielles différentes. Il n'y a pas d'égalité naturelle entre les divers organes et le coeur ou le cerveau d'un corps vivant, qui remplissent les fonctions vitales complémentaires.
Comme lors de la première vague révolutionnaire, le prolétariat des pays développés se trouve au coeur même du processus d'internationalisation de la grève de masse. Il est le noyau même de la prise de conscience mondiale par le prolétariat de ses taches révolutionnaires.
5) Le CCI rejette la conception naïvement égalitariste suivant laquelle n'importe quel pays pourrait être le point de départ de la dynamique révolutionnaire. Cette conception repose sur la croyance anarchiste que tous les pays - à l'exemple de la grève générale révolutionnaire - pourraient simultanément initier un processus révolutionnaire.
En réalité, le développement inégal du capitalisme, en creusant un fossé toujours plus grand entre grands pays industrialisés concentrant la majorité du prolétariat d'industrie moderne et pays du tiers- monde, a pour conséquence que les conditions les plus favorables à la naissance du bouleversement, révolutionnaire sont étroitement déterminées par le cadre historique et social.
6) Le point de départ de la révolution mondiale se trouve nécessairement en Europe occidentale, où à la force du nombre, s'ajoute celle de la tradition et de l'expérience révolutionnaire du prolétariat de 1848 à la première vague révolutionnaire, où la classe ouvrière a affronté le plus directement la contre-révolution, où se trouve le champ de batail le ultime de la guerre impérialiste généralisée entre Etats capitalistes. Parce que l'Europe occidentale est :
- la première puissance économique et concentration ouvrière, où l'existence de plusieurs nations contiguës pose plus immédiatement la question du dépassement des frontières nationales ;
- au coeur même des contradictions du capitalisme en crise qui le pousse vers la guerre mondiale ;
- le noeud gordien des mystifications bourgeoises les plus puissantes (démocratiques, parlementaires et syndicales) que le prolétariat devra trancher pour faire le saut libérateur de l'ensemble du prolétariat mondial ;
- elle est au coeur même du cours vers la révolution.
La fin de la période de contre-révolution marquée par la grève de mai 68, la maturation de la conscience prolétarienne en Europe dans les années 70, l’existence d'un milieu politique prolétarien plus développé dans cette partie du monde que partout ailleurs, tous ces facteurs n'ont fait que le confirmer.
7) Ni les pays du tiers-monde, ni les pays de l'Est, ni l'Amérique du Nord, ni le Japon, ne peu vent être le point de départ du processus menant à la révolution :
- les pays du tiers-monde en raison de la faiblesse numérique du prolétariat et du poids des illusions nationalistes ;
- le Japon, et les USA surtout, pour n'avoir pas affronté aussi directement la contre-révolution et avoir subi moins directement la guerre mondiale, et en l'absence d'une profonde tradition révolutionnaire ;
- les pays de l'Est, en raison de leur arriération économique relative, de la forme spécifique (pénurie) qu'y prend la crise mondiale entravant une prise de conscience globale et directe des causes de celle-ci (surproduction), de la contre-révolution stalinienne qui a transformé dans la tête des ouvriers l'idéal du socialisme en son contraire et a permis un nouvel impact des mystifications démocratiques, syndicalistes et nationalistes.
8) Cependant, si le point de départ de la révolution mondiale se trouve nécessairement en Europe de l'Ouest, le triomphe de la révolution mondiale dépend en dernière instance de son extension victorieuse rapide aux USA et en URSS, têtes des deux blocs impérialistes où se jouera le dernier grand acte de la révolution.
Pendant la première vague révolutionnaire, les pays où se trouvait le prolétariat le plus avancé et le plus concentré, étaient en même temps les pays capitalistes militairement les plus puissants et les plus décisifs, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, bien que ce soit encore en Europe de l'Ouest que se trouvent les bataillons les plus avancés et concentrés du prolétariat, les centres de la puissance militaire du capital mondial se sont déplacés vers les USA et l'URSS, ce qui a des conséquences pour le développement d'un mouvement prolétarien révolutionnaire.
Aujourd'hui, une nouvelle Sainte Alliance anti ouvrière du capital russe et américain par dessus leurs rivalités impérialistes, imposera une intervention militaire directe contre l'Europe révolutionnaire, c'est-à-dire une mondialisation de la guerre civile dont l'issue dépendra de l'aptitude du prolétariat des deux têtes de bloc, et notamment des USA, à paralyser et renverser l'Etat bourgeois.
9) Le CCI met en garde contre un certain nombre de confusions dangereuses :
- l'idée que "tout est possible à tout moment, en tout lieu", dès que surgissent à la périphérie du capitalisme des affrontements de classe aigus, laquelle idée repose sur l'identification entre combativité et maturation de la conscience de classe.
- l'assimilation inconsciente entre grève de masse internationale et révolution, alors que la généralisation internationale de la grève de masse est un pas qualitatif qui annonce la révolution -naissance d'une situation pré-révolutionnaire -mais ne peut être confondue avec elle. Celle-ci se traduit nécessairement par la dualité des pouvoirs qui pose l'alternative : dictature des conseils ouvriers ou contre-révolution sanglante, ouvrant un cours vers la guerre.
- la conception d'un développement linéaire de l'internationalisation de la grève de masse, alors que celle-ci suit nécessairement un cours sinueux, avec des avancées et des reculs, à l'exemple de la Pologne.
Il appartient aux révolutionnaires de garder la tête froide et de ne pas céder à l'exaltation immédiatiste qui mène à l'aventurisme, ou aux "coups de cafard", à chaque recul, qui se traduisent par la démoralisation.
Si l'histoire s'accélère depuis août 80 et donne une perspective exaltante pour les révolutionnaires, il appartient de comprendre que notre travail est et reste à long terme.
CRITIQUE DE QUELQUES POSITIONS DU CCI. SUR LA THEORIE DES MAILLONS FAIBLES"
Ces deux dernières années ont mis à l'épreuve les capacités des minorités révolutionnaires. L'approfondissement soudain de la crise dans le monde entier, la brutalité des mesures d'austérité que la bourgeoisie a prises, les préparatifs de guerre massifs et évidents, tout cela semblait exiger une réponse foudroyante du prolétariat mondial. Et pourtant, la classe ouvrière a subi une importante défaite en Pologne cependant que partout ailleurs la lutte stagnait. Les organisations révolutionnaires sont restées minuscules et sans écho significatif. Cette situation a mis â nu les nombreuses faiblesses qui existaient dans le milieu révolutionnaire. La confusion est considérable et compréhensible. Les révolutionnaires ne peuvent plus se limiter à la réaffirmation des leçons du passé. Ils doivent évaluer et expliquer la défaite en Pologne et les difficultés présentes. Ils doivent clarifier les perspectives de la lutte ouvrière, expliquer comment parvenir à une étape supérieure.
Dans ce contexte, le CCI a formulé sa critique de la "théorie du maillon le plus faible" (Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe, Revue Internationale n° 31 ; Résolution sur la critique de la "théorie du maillon faible"). Ces textes rejettent à juste titre la position de Lénine qui considère que le renversement du capitalisme démarrera dans les pays les plus faibles et, à partir de là, s'étendra vers le reste du système. Cette théorie a été un instrument pour ceux qui cherchent le fossoyeur du capitalisme en dehors du prolétariat. Le problème, avec les"léninistes" qui défendent cette position aujourd'hui, n'est pas qu'ils ont des illusions sur la force des ouvriers dans les pays faibles , mais qu'ils ont des illusions sur ces pays faibles eux-mêmes. Pour eux, le prolétariat n'est que de la chair à canon du "mouvement anti-impérialiste".
Mais les textes du CCI vent plus loin que le rejet de cette théorie désastreuse. Ils expliquent la défaite en Pologne par ce fait même que la Pologne est un pays et un Etat faibles. Ils affirment également que "ce n'est donc qu'en Europe occidentale ... qu'il (le prolétariat) pourra développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution" (Revue Internationale n° 31, p.9). Ici, la bourgeoisie ne pourrait pas isoler une grève de masse parce que "la mise en place d'un cordon sanitaire économique deviendra impossible" et "qu'un cordon sanitaire politique n'aura plus d'effets" (ibid.).
Cette vision offre certainement les moyens de digérer la défaite en Pologne et de voir plus clairement cannent avancer. Mais en mené temps :
- elle obscurcit certaines leçons de la Pologne et d'autres luttes qui ont pris place et qui vont se produire en dehors de l'Europe occidentale. Elle voit leurs implications comme nécessairement limitées du fait qu'elles se passent - aux yeux du CCI - en dehors de la zone géographique où les mystifications capitalistes les plus importantes peuvent être dépassées ;
- elle créé la fausse impression que la capacité de la bourgeoisie d'isoler une grève de masse dépendrait du lieu où elle se déroule, de sorte qu'elle ne s'y heurterait pas aux mêmes problèmes qu'en Pologne ou qu'elle pourrait les vaincre plus facilement ;
- elle donne le faux espoir que la conscience révolutionnaire peut se développer pleinement dans la seule Europe occidentale et faire tomber ensuite, par la force de l'exemple, les mystifications capitalistes dans les autres zones industrialisées.
"Ce n'est qu'au moment où le prolétariat de ces pays aura déjoué les pièges les plus sophistiqués tendus par la bourgeoisie (...) qu'aura sonné l'heure de la généralisation mondiale des luttes prolétariennes,1'heure des affrontements révolutionnaires", (ibid., p. 10) .
FORCES DE CLASSE ET CONSCIENCE DE CLASSE.
La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience. Les mystifications ne peuvent être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse. Les luttes se développent en dépit du poids de nombreuses illusions, qui ont toutes corme dénominateur commun la croyance en la possibilité d'obtenir une amélioration des conditions de vie, une victoire, dans le cadre du capitalisme. Ce cadre a beaucoup de nems et il est coloré par des "spécificités" locales, mais c'est toujours le cadre de l’Etat-Nation.
Cette illusion entrave encore la lutte ouvrière dans tous les pays. Mais elle a un effet très différent dans les pays où le prolétariat n'est qu'une petite minorité, éclipsée par les autres classes, à l'opposé des pays où le prolétariat a la force potentielle de paralyser l'économie entière et de détruire l'Etat bourgeois (à condition qu'il n'ait à affronter que sa "propre " bourgeoisie! . Dans le premier cas, cette illusion tend à dévoyer les travailleurs de leur terrain de classe pour les rallier à une fraction de la bourgeoisie (l'Eglise, la gauche, la guérilla, les militaires "progressistes" etc..) tant leurs propres forces potentielles sont réduites dans le cadre de la nation. C'est pourquoi les ouvriers dans ces pays ont besoin des démonstrations de force de la classe dans les pays industrialisées, pour trouver la voie de la lutte autonome, pour que cette voie ne se présente pas comme désespérée.
Ce n'est que dans le deuxième cas que cette illusion d'une possibilité de changement dans le cadre de la nation, fondement de toutes les mystifications capitalistes, est incapable d'empêcher le développement de la lutte de la classe ouvrière sur son propre terrain. Ici, les ouvriers sont assez forts pour ne compter que sur eux-mêmes, même si, pour le moment, ils ne se voient que comme une catégorie sociale qui exerce sa pression dans le cadre de la nation, et pas encore canne une classe mondiale qui détient entre ses mains le sort de l'humanité. C'est donc le développement de la lutte ouvrière dans ces pays qui est la clé de la prise de conscience croissante par l'ensemble du prolétariat de sa propre force. Et c'est cette prise de conscience croissante qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes. Par conséquent, les concentrations majeures du prolétariat dans les pays industrialisés situés au coeur des deux blocs jouent le rôle décisif dans le développement de la conscience de classe révolutionnaire. Ce n'est que là qu'en dépit du poids de l'idéologie bourgeoise, la lutte peut se développer et devenir le levier avec lequel la conscience prolétarienne sera libérée du poids de l'idéologie de la classe dominante.
Mais l'existence de la lutte ne suffit pas en elle-même. Comme le disait Marx, de mène qu'un homme ne se débarrasse de son outil de travail qu ' une fois qu'il lui est devenu inutile et qu'il en ait trouvé un autre pour le remplacer, le prolétariat ne détruira pas le système social existant avant que la nécessité et la possibilité de cette tâche historique ne soient gravées dans sa conscience. Et ce processus n'est pas possible dans les limites de la seule Europe occidentale.
PRENDRE CONSCIENCE DE LA NECESSITE DE LA GENERALISATION.
Pour comprendre la nécessité de la révolution, la classe ouvrière doit être à même de percevoir la destruction des bases objectives des mystifications capitalistes. Toutes ces mystifications sont fondées sur la croyance en la possibilité d'une économie prospère dans le cadre de la nation. Pour que cet espoir s'effondre aux yeux de tous les ouvriers sa fausseté doit être démontrée clairement partout dans le monde, non pas dans les économies les plus faibles, mais dans les nations capitalistes les plus fortes.
Tant que subsiste l'illusion d'une possibilité de reprise significative pour les économies les plus fortes, la croyance que la nation capitaliste peut offrir un cadre pour leur survie subsistera parmi les ouvriers de tous les pays, faibles et forts. Cela implique que la révolution n'est pas pour l'an prochain. Concevoir un assaut révolutionnaire à court terme, tel que certains l'ont fait pendant la grève de masse en Pologne, ne peut mener qu'à la démoralisation. Mais cela signifie également que, pour la première fois dans l'histoire, cette condition essentielle pour la révolution mondiale va être pleinement remplie. Toutes les tentatives révolutionnaires du passé se sont heurtées à ce problème. La mobilisation des ouvriers pour la première guerre mondiale, et plus tard la défaite de la première vague révolutionnaire, ont été rendues possibles, pour une bonne part, par la promesse d'une reprise dans les pays les plus développés. La mobilisation des ouvriers pour la deuxième guerre mondiale, leur défaite dans les pays comme l'Espagne, ont été possibles en raison du poids de la défaite de la première vague révolutionnaire, mais également de la capacité du capitalisme à offrir un nouvel espoir de redressement en développant le capitalisme d'Etat à un niveau sans précédent (en Allemagne, par exemple, entre 1933 et 38, la production industrielle avait augmenté de 90% et le chômage avait diminué de 3,7 millions à 200 000). Aujourd'hui, pour la première fois, le capitalisme s'approche du moment où il n'aura plus aucun moyen économique objectif de maintenir en vie quelque espoir de redressement, pour pouvoir encore apporter une amélioration temporaire à la situation de "ses" ouvriers, même pas de façon limitée ou sur une partie de la planète. Le capitalisme d'Etat a déjà été développé non pas jusqu'à son maximum théorique, mais jusqu'à son maximum d'efficacité. Le développement du capitalisme d'Etat à l'échelle internationale, et la redistribution de la plus-value grâce aux aides gouvernementales , du FMI, de la Banque Mondiale, etc. ne pourraient pas être poussés suffisamment loin pour que les fondements mêmes du capitalisme - la concurrence- puissent imposer une limite de fer à ce développement. Ce développement du capitalisme d'Etat a déjà été utilisé pleinement pendant l'après-guerre, pour créer les marchés requis par le haut degré de développement des forces productives dans les pays les plus industrialisés, ce qui a conduit à une interdépendance sans précédent entre tous les éléments de la machine capitaliste. Il en résulte qu'aucun pays n'a aujourd'hui les moyens de se protéger de la crise. En tentant d'y échapper, ils ne feraient qu'aggraver leur situation.
Pour la première fois, un déclin brusque, sans espoir crédible de redressement devient inévitable pour tous les pays. Cela ne veut pas dire que la situation soit devenue la même dans tous les pays, que partout les ouvriers vont être jetés dans la famine. Cela signifie que certains vont être jetés dans la famine et les autres dans une exploitation barbare, dans la militarisation, la terreur, la concurrence entre eux et, finalement, dans la guerre et la destruction globale s'ils ne savent pas s'y opposer. La situation spécifiques de tous les ouvriers ne deviendra pas la même. Une multitude de différences continuera à exister. Ce qui sera pareil partout, c'est l'attaque totale de la bourgeoisie, les intérêts des ouvriers et les perspectives qu'ils auront.
PRENDRE CONSCIENCE DE LA POSSIBILITE DE LA GENERALISATION.
Mais, pour que la révolution devienne le but conscient de la lutte, il faut non seulement que les ouvriers en voient la nécessité, mais également la possibilité comme étant à la portée de leurs forces. Le niveau de conscience politique est nécessairement limité par les forces dont ils disposent. Une lutte qui se déclenche à partir d'une plateforme de revendications économiques limitées ne peut élargir ses objectifs, ne peut devenir politique que par la croissance des forces dont la classe dispose, par l'extension et l'auto-organisation. Mais les possibilités dépendent aussi de l'opposition que les ouvriers ont à vaincre. Et à ce niveau également, nous voyons d'importantes différences entre la situation de 17 et celle d'aujourd'hui. En 17, la bourgeoisie était divisée et désorganisée par la guerre, désorientée par son manque d'expérience. Dans ces circonstances, il y avait effectivement des "maillons faibles" dans sa ligne de défense, que le prolétariat pouvait mettre à profit. Suivant la logique de la résolution du CCI, les ouvriers en Russie auraient dû rêver de la démocratie bourgeoise puisqu'ils n'avaient pas été directement confrontés aux mystifications les plus sophistiquées de la bourgeoisie occidentale. Mais, malgré les plaidoyers des menchéviks, ils n'ont pas perdu leur temps avec celle-ci parce que le degré atteint dans l'auto-organisation, l'extension de la lutte à travers la Russie, l'agitation ouvrière dans les pays voisins et la faiblesse de la bourgeoisie qu'ils devaient affronter leur permettaient de dépasser largement cette perspective et rendaient possible l'objectif d'une victoire révolutionnaire en Russie, avec l'espoir raisonnable que les autres pays suivraient rapidement.
Aujourd'hui, par contre, chaque fraction prolétarienne en lutte affronte une bourgeoisie mondiale unifiée. Il n'y a plus de "maillon faible" dans la ligne de défense du capitalisme. Ce qui était alors possible ne l'est plus, et puisque la conscience de classe est liée aux possibilités objectives, ceci implique que la maturation de la conscience révolutionnaire prendra plus de temps, pour que les forces de la classe soient supérieures à celles requises en 17. Si ces forces ne sont pas développées à une échelle internationale, au-delà d'une zone limitée telle que l'Europe occidentale, si les mystifications capitalistes parviennent à isoler les luttes entre elles, à empêcher le prolétariat de prendre conscience de ses intérêts et perspectives communs, alors aucune grève de masse, où qu'elle se produise, ne lui permettra de "développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution" (Revue Internationale n°31), parce qu'il sera impossible aux ouvriers de voir quelles sont les forces nécessaires à la tâche du renversement d'une bourgeoisie mondiale unifiée.
En de telles circonstances, une grève de masse ne peut que stagner, ce qui signifie qu'elle dépérira rapidement. Faute d'une perception claire de la possibilité d'un objectif prolétarien plus large qui puisse se graver dans la conscience des prolétaires, le niveau d'auto organisation ne pourra être maintenu et il régressera. Alors, une perspective basée sur des mystifications bourgeoises s'imposera inévitablement. Le CCI ne se rendait pas compte de cela quand il écrivait, plus de trois mois après le démantèlement de l'organisation autonome de la classe en Pologne : "Loin de s'essouffler, le mouvement s'est durci" (Revue Internationale n°24, p.4) , ni quand , par la suite, il attribuait le succès des mystifications capitalistes en Pologne au poids des "spécificités" du bloc de l'Est et, en particulier, de la Pologne.
LE POIDS DES SPECIFICITES.
Comme l'écrivait le CCI, "L'idée qu'il existe des 'spécificités nationales ou de bloc' (...) sera de plus en plus battue en brèche par le nivellement par le bas de la situation économique de tous les pays, ainsi que des conditions de vie de tous les travailleurs" (Revue Internationale n°29, p.51. Ceci ne signifie pas que les révolutionnaires doivent nier l'existence de toutes sortes de différences, entre ouvriers de différents pays, secteurs et régions, utilisés par le capital pour les diviser. Mais sa capacité de division ne résulte pas des "spécificités" elles-mêmes, mais de la capacité globale du capitalisme à maintenir des illusions sur son propre système. Sans la démystification progressive de ces illusions par la crise et la lutte de classe, les ouvriers resteront isolés dans leurs situations "spécifiques", dans les pays "forts" aussi bien que dans les pays "faibles". S'il est possible que la puissance de l'Eglise en Pologne soit spécifique à ce pays, il n'y a rien de spécifique dans les mystifications que cette institution emploie contre la classe ouvrière : nationalisme, pacifisme, légalisme, etc... En d'autres termes, ces mystifications ne sont pas puissantes parce que l'Eglise est puissante, c'est le contraire qui est vrai. L'Eglise joue le rôle d'une gauche dans l'opposition parce que le manque de profondeur de la crise - non pas en Pologne mais à l'échelle internationale - et l'immaturité du développement de la lutte des ouvriers, également au niveau international, permet au capital d'employer ces mystifications avec succès. Cela signifie que les révolutionnaires doivent insister sans cesse sur l'unité mondiale de la lutte du prolétariat et démasquer les mystifications que recouvrent ces spécificités. Cela signifie qu'il faut combattre la peur que l'extension et la généralisation de la lutte ne soient impossibles à cause des différences spécifiques et son corollaire, l'illusion de la possibilité d'une victoire, d'un plein développement de la conscience révolutionnaire dans un seul pays, ou dans une seule partie du continent.
Voyons donc de plus près les spécificités principales que le CCI croient être responsables du fait que les ouvriers en Occident soient seuls sur le chemin vers la conscience révolutionnaire.
La"pénurie" dans le bloc de l'Est.
"La forme spécifique (pénurie) qu'y prend la crise mondiale entravant une prise de conscience globale et directe des causes de celle-ci (surproduction) " .. (Résolution sur la critique de la théorie du maillon faible)...
Pour les ouvriers à l'Est, de même que pour ceux de l'Ouest, la surproduction et la pénurie ne peuvent être comprises que s'ils quittent le point de vue "spécifique" pour voir le système capitaliste comme un tout. Sans cette vision globale, les manifestations de la surproduction à l'Ouest se présentent comme le fait d'une distribution injuste, un manque de protection contre la concurrence étrangère, etc... La surproduction ne peut être localisée uniquement en Occident. En vérité, les pays faibles sont les premiers à la ressentir: à cause de la composition organique plus faible de leurs capitaux, ils se heurtent plus tôt aux limites du marché mondial. Même R. Luxemburg, sur les théories économiques de laquelle se base le CCI, était claire sur le fait que la surproduction n'est pas un phénomène auquel seulement quelques pays sont confrontés, tandis que les autres n'en subiraient que les conséquences : elle la voit comme le résultat d'une disproportion inhérente au processus de production qui est donc présente dans chaque pays. Même dans les pays les plus faibles, les ouvriers peuvent voir comment la surproduction sur le marché mondial abaisse les prix des marchandises qu'ils produisent, provoquant et leur infligeant famine et chômage, tandis qu'en même temps elle pousse "leur" bourgeoisie à détourner une masse croissante de plus-value vers le secteur des moyens de destruction. Même dans un pays sous-développé typique comme le Ghana, l'industrie ne fonctionne qu'à moins de 15% de sa capacité (New York Times, 4/2/83). De la même manière, la pénurie ne peut être comprise que d'un point de vue global.
Si on se place au-delà du point de vue d'un pays particulier, il faut conclure que la pénurie existe dans chaque pays (à divers degré, mais à un taux croissant partout) :
- pénurie de biens de consommation pour les ouvriers et les chômeurs pour qui les produits dont ils ont besoin sont de plus en plus inaccessibles, tandis que la classe dominante en dispose en abondance ;
- pénurie de capital pour la classe dominante qui fait des tentatives désespérées pour augmenter la plu6-value extorquée aux ouvriers afin de protéger sa place sur un marché mondial rétréci.
Ce point de vue global, nécessaire pour percevoir les racines du système et la possibilité de la révolution socialiste, le prolétariat en Occident ne le possède pas de naissance. Il ne peut résulter que de la tendance de la lutte de classe elle-même à se globaliser et à avoir une portée internationale.
L'insuffisance de tradition révolutionnaire, de culture, d'âge.
La vision selon laquelle il n'y a jamais eu de mouvement ouvrier fort en dehors de l'Europe est un préjugé coloré par l'influence d'historiens bourgeois qui ont de bonnes raisons de minimiser le mouvement révolutionnaire. Mais, ce qui est plus important, c'est que ces leçons du passé sont encore latentes dans la mémoire du prolétariat et, qu'elles ne peuvent être réappropriées que par la lutte, avec l'aide de la minorité communiste qui, elle-même est sécrétée par la lutte. La longue contre-révolution a coupé, en Europe, autant qu'ailleurs, les ouvriers des traditions du passé. C'est une aberration de dire, comme la résolution du CCI, que les ouvriers aux USA et au Japon ne se sont pas trouvés confrontés assez directement à la contre-révolution, alors que ceux du bloc de l'Est y ont été trop confrontés, et que, par conséquent, I'"idéal" du socialisme s'est transformé, dans leurs têtes, en son contraire. Partout dans le monde, la vaste majorité des ouvriers identifie le "communisme" au stalinisme ou à ses variantes "eurocommunisme " ou "trotskyste". Ce n'est pas par l'éducation et la culture bourgeoises mais par le développement de la lutte que les ouvriers s'ouvrent aux leçons des expériences de leurs frères de classe dans les autres parties du monde, de même qu'aux leçons du passé. Tous les arguments sur la "tradition", la "culture" et l'"âge" volent en éclat si l'on considère le fait historique que les pays où le prolétariat a réussi le mieux à homogénéiser sa conscience révolutionnaire étaient la Russie et la Hongrie où la classe ouvrière était relativement jeune, privée d'une tradition de longue date, et avec un niveau relativement bas d'éducation bourgeoise. Ceci ne signifie pas que l'expérience ne serait pas importante, que toutes les leçons seraient oubliées au moment où il n'y a pas de luttes ouvertes. Pour les ouvriers en Russie, 1'expérience était très importante, mais elle était directement liée à leur lutte. Ce n'était pas leur situation géographique, ni une confrontation directe avec la démocratie, mais uniquement leur lutte autonome, qui les rendaient capables d'assimiler les expériences de leurs luttes et de celles du reste de la classe, et de les incorporer dans la phase suivante de leur combat.
L'absence d'une confrontation directe avec les mystifications les plus puissantes.
Quand les ouvriers d'Europe occidentale rompront avec les mystifications démocratiques et syndicales ce ne sera pas le résultat de leur confrontation quotidienne à ces pièges. Cela ne se fera que dans et par la lutte, parce que la généralisation de la crise et la lutte simultanée des ouvriers dans les autres pays créent les conditions pour le dépassement de l'isolement que ces mystifications tentent d'imposer. Il en est de même pour les ouvriers de l'Est. En dehors de la lutte, les "syndicats libres" et l'Etat démocratique peuvent être vus comme des produits d'importation de l'Ouest exotiques et attrayants. Mais, dans la lutte, ils deviennent "l'institutionnalisation du mouvement", suivant les termes d'A. Kolodziej, le délégué du MKS de Gdynia qui a refusé de poser_sa candidature aux élections des comités de "Solidarnosc".
Des luttes à l'étranger auraient offert d'autres perspectives aux ouvriers. Elles auraient pu rendre majoritaire la position de Kolodziej, ou du moins, elles auraient ouvert plus de possibilités de succès aux ouvriers dans leurs affrontements avec les syndicats après la mort du MKS. Le fait que cela ne se soit pas passé ne résultait pas de l'absence de confrontation directe à ces mystifications. Sinon, la lutte du prolétariat eût été désespérée. Le capital peut toujours donner une nouvelle enveloppe à ses vieux mensonges, à moins que la base matérielle de toutes les mystifications ne soit dé-. truite par la crise internationale et par la lutte de classe. Si les syndicats en Europe occidentale perdent toute crédibilité par leur pratique quotidienne, il reste toujours les syndicalistes de base pour avancer la mystification d'un nouveau syndicat unitaire, il reste toujours la possibilité d'institutionnaliser des "Conseils Ouvriers" et l'autogestion dans le cadre de l'Etat, il reste la possibilité de gouvernements de gauche radicaux pour préparer la répression, etc.
La conscience de classe révolutionnaire ne peut se développer que par l'assimilation des expériences de la classe dans le monde entier. C'est vrai pour les ouvriers de l'Est aussi bien que pour ceux de l'Ouest."Dans le domaine de la dénonciation du rôle des syndicats, les ouvriers en Pologne ont accompli en quelques mois le chemin que le prolétariat des autres pays a mis plusieurs générations à parcourir" (Revue Internationale n°24, p.3). Ceci s'est fait malgré le manque d'une longue expérience des "syndicats libres". Mais la conscience qu'ils ont acquise ainsi n'est pas un acquis permanent qui subsiste en dehors de la lutte. Elle devra être réappropriée dans les luttes à venir, aussi bien en Pologne qu'ailleurs.
Nous considérons comme limitée la défaite en Pologne. Ceci est correct, non parce que la Pologne n'est qu'un pays secondaire, mais parce que les acquis pour l'ensemble du prolétariat, les leçons de la Pologne, ont plus de poids à long terme que la défaite elle-même. Bien sûr, ce n'était pas une belle retraite. Mais le prolétariat n'est pas une armée, avec un Etat-major et des bataillons, faibles et forts, engagés dans une guerre tactique. Sa lutte n'est pas de nature militaire, mais elle est une lutte pour sa propre conscience révolutionnaire et sa propre organisation. Jamais aucune armée ne connut de telles avancées et de tels reculs suivant le degré d'extension de la conscience de classe. Dans cette bataille, il n'y a pas de belles retraites. Tout arrêt, tout pas en arrière résulte de l'encadrement bourgeois. L'expérience du MKS devra être répétée et améliorée dans plusieurs pays avant que le renversement du rapport de forces entre les classes à l'échelle internationale (le processus d'internationalisation) ne paralyse la classe dominante. Mais les luttes futures pourront tirer profit des leçons de la Pologne. Il est crucial que ces leçons - non seulement celles de la phase ascendante de la lutte, mais, plus encore, celles de sa retombée - ne soient pas obscurcies en attribuant à sa force (tel que le fait la bourgeoisie) ou à ses faiblesses (tel que le fait le CCI) des "spécificités" polonaises. Dans ses luttes prochaines, le prolétariat devra se souvenir de la puissance de l'auto organisation qui a fait ses preuves en Pologne. Il devra se rappeler comment la bourgeoisie lorsqu'elle ne peut empêcher l'auto organisation, tente de contrôler ses organes unitaires pour en faire des instruments destinés à empêcher l'action spontanée de la classe, propager le nationalisme, le légalisme, et d'autres poisons et se transformer finalement en institutions bourgeoises- Il devra se souvenir des affrontements entre "Solidarnosc" et les ouvriers, qui montrent comment chaque syndicat, même nouvellement formé, devient immédiatement l'ennemi mortel de la lutte. Il devra se souvenir comment l'isolement de la lutte la plus radicale depuis des décennies a montré la nécessité de rompre avec toutes les divisions sectorielles ou nationales.
La destruction des principales mystifications capitalistes nécessite une attaque clés deux côtés. D'une part, de l'intérieur, par une lutte qui, grâce à son auto organisation et à sa radicalisation, se tourne activement vers la solidarité des ouvriers des autres pays ; d'autre part, et en lien dialectique avec cela, elle nécessite une attaque de l'extérieur , par l'agitation explosive du reste de la classe qui, en assimilant les expériences des luttes partout dans le monde, prend conscience de l'unité de ses intérêts, permettant ainsi la solidarité.
Pour faire la révolution le prolétariat n'a d'autre arme que celle de sa conscience révolutionnaire et donc internationale. Par conséquent, cette conscience doit se développer dans les luttes qui précèdent la révolution. La généralisation ne débutera pas au moment de l'assaut révolutionnaire en Europe occidentale pour s'étendre par un effet "de domino" touchant pays après pays, parce que le "maillon le plus fort" du capitalisme serait brisé ou, suivant l'expression du CCI, parce que son "coeur et son cerveau" seraient détruits.
La généralisation est un processus qui fait partie de la maturation de la conscience du prolétariat, qui se développe de façon internationale dans ses luttes précédant l'assaut révolutionnaire, assaut rendu possible par l'existence même de ce processus. Le seul "maillon faible" (futur) du capitalisme, c'est l'unité mondiale du prolétariat.
Sander. (5/4/83)
REPONSE AUX CRITIQUES
Une des particularités du texte du camarade Sander, c'est qu'il comporte côte à côte d'excellents passages où il développe très clairement les analyses du CCI et des affirmations également très claires, mais qui malheureusement sont en contradiction avec la vision qui sous-tend les passages précédents.
Ainsi, le camarade Sander reconnaît à la fois qu'il est nécessaire de rejeter fermement la théorie du "maillon le plus faible" et qu'il faut établir une différence nette entre le prolétariat des pays développés et celui du Tiers Monde quant à leur capacité respective de constituer des bataillons décisifs de l'affrontement révolutionnaire futur. Il considère que dans les pays arriérés, "les ouvriers ont besoin de la démonstration de force de la classe dans les pays industrialisés, pour trouver la voie de la lutte autonome, pour que cette voie ne se présente pas comme désespérée". Nous le suivons parfaitement dans ces affirmations. Cependant, là où surgit le désaccord, c'est lorsque :
- il considère que les ouvriers des pays autres que ceux du Tiers Monde (c'est à dire d'Amérique du Nord, du Japon, d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est) se trouvent sur un pied d'égalité quant à leur aptitude à déjouer les mystifications bourgeoises, à constituer en quelque sorte une avant-garde du prolétariat mondial lors des combats révolutionnaires ;
- il estime que "la capacité de la bourgeoisie d'isoler une grève de masse" ne dépend pas "du lieu où elle se déroule" ;
- il rejette l'idée que la généralisation mondiale des luttes se produira par un "effet de dominos" (suivant ses propres termes), qu'il s'agit d'un processus prenant son essor en un point donné de la planète pour se propager ensuite dans le reste du monde,
- il combat l'idée qu'il existe une sorte de "coeur et de cerveau" du prolétariat mondial là où il est à la fois, le plus concentré, le plus développé et le plus riche en expérience.
En fin de compte, le défaut principal du texte de Sander, et qui est à la base de tous les autres, c'est qu'il adopte, pour démontrer sa thèse, toute une démarche qui se veut marxiste mais qui, à certains moments s'écarte en fait complètement d'une réelle vision marxiste.
UNE DEMARCHE QUI S'ECARTE DU MARXISME
Le raisonnement de base du camarade Sander est le suivant :
1°- "La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience";
2°- "C'est le développement de la lutte ouvrière qui est la clé de la prise de conscience croissante par l'ensemble du prolétariat de sa propre force" ;
3 - "C'est cette prise de conscience croissante (de sa force) qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes" ;
4°- "les mystifications ne peuvent (donc) être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe ouvrière de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse" ;
5°- Le capitalisme est dans une impasse économique complète. Partout dans le monde, il dévoile sa faillite et passe à une attaque totale contre les intérêts des travailleurs ;
6°- Partout dans le monde se développe donc la "nécessité" qui est à la base de la lutte ouvrière.
Conclusion : Partout où le prolétariat n'est pas une "petite minorité éclipsée par les autres classes" (pays du Tiers Monde) sont en cours d'apparition, et de façon égale, les conditions d'une prise de conscience révolutionnaire.
Le raisonnement a l'apparente rigueur d'un syllogisme. Malheureusement il est faux. Il s'appuie certes sur des vérités générales admises par le marxisme mais qui, dans ce cas particulier, sont affirmées en dehors de leur champs d'application réel. Elles deviennent des demi vérités et aboutissent à des contrevérités.
Si on peut souscrire à l'étape 5 du raisonnement et (avec des réserves) à l'étape 6, prises en elles-mêmes, on se doit par contre de critiquer et de remettre en cause les autres étapes et donc de remettre en cause l'ensemble du raisonnement.
1 - "La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience" Oui si c'est pour dire que "1'existant précède le conscient" (Marx), que ce sont des intérêts maté riels qui mettent,en dernière instance, les classes en mouvement. Mais le marxisme n'est pas un matérialisme vulgaire. Il est dialectique. C'est pour cela que Marx a pu écrire "quand la théorie s'empare des masses, elle devient force matérielle".
C'est parce que le CCI est fidèle à cette vision dialectique qu'il a pu comprendre que nous étions aujourd'hui dans un cours à l'affrontement de classes et non dans un cours à la guerre. Dès 1968, nous écrivions (Révolution Internationale n°2, ancienne série) :
"Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystifications capables de mobiliser les masses et les jeter dans le massacre. Le mythe russe s'écroule, le faux dilemme démocratie bourgeoise contre totalitarisme est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu'elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir, dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses."
Donc, si le CCI affirme que, dans la période actuelle, l'aggravation de la crise provoquera un développement des luttes de classe, et non une démoralisation croissante ouvrant la voie à l'holocauste impérialiste comme dans les années 30, c'est parce qu'il prend en compte les facteurs subjectifs qui agissent sur la situation : le fait que le prolétariat ne sorte pas d'un écrasement récent (comme dans les années 20), l'usure des mystifications utilisées dans le passé. C'est parce qu'elle avait cette approche, dont nous nous revendiquons, que la Gauche Communiste Italienne a su analyser correctement la nature de la guerre d'Espagne et qu'elle n'est pas tombée dans les absurdités d'un Trotski fondant -parce que les conditions objectives étaient mûres- une nouvelle Internationale un an avant... la guerre.
Tout cela, le camarade Sander le sait et il l'affirme dans un autre passage de son texte. Le problème, c'est qu'il l'oublie dans son raisonnement.
2 - "C'est le développement de la lutte ouvrière . . . qui est la clé de la prise de conscience croissante par 1'ensemble du prolétariat de sa propre force" : nous renvoyons à ce qui vient d'être dit.
3 - "C'est cette prise de conscience croissante (de sa force) qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes". Là encore, Sander énonce une idée juste mais partielle et unilatérale. La conscience du prolétariat est avant tout conscience "de soi" (comme le mot l'indique). Partant, elle comporte la conscience de sa propre force. Mais elle ne se résume pas à cela. Si le sentiment d'être fort "permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes", alors on ne comprend absolu ment pas ce qui s'est passé en 1914, lorsqu'un prolétariat qui se sentait plus fort que jamais a été précipité du jour au lendemain dans le massacre impérialiste. Avant 14, la classe ouvrière semblait voler de succès en succès. En réalité, elle reculait pied à pied devant l'idéologie bourgeoise C'est d'ailleurs là une méthode employée abondamment par la bourgeoisie contre le prolétariat tout au long du 20° siècle : lui présenter ses pires défaites (socialisme dans un seul pays? front populaire, "Libération" de 45) comme des victoires, des éléments de sa force. La phrase de Sander doit donc être complétée par "c'est dans son aptitude à déchirer le filet des mystifications capitalistes que le prolétariat témoigne de sa force, qu'il l'accroît et qu'il accroît la conscience de celle-ci". Cet oubli permet au camarade Sander de poursuivre tranquillement son raisonnement. Mais c'est malheureuse ment sur une faussé piste, dans une voie de garage.
4 - "Les mystifications ne peuvent (donc) être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe ouvrière de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse."Pour la première fois, Sander fait une petite concession à la méthode dialectique ("plutôt que l'inverse"). Cependant, il ne se défait pas de sa méthode unilatérale et partielle, ce qui le conduit à énoncer une idée en total désaccord avec toute l'expérience du mouvement ouvrier. Par exemple, au cours de la première guerre mondiale, ce n'est pas la lutte en soi qui a été le seul, ni même le premier facteur de démystification des ouvriers en Russie ou en Allemagne. En 1914, embrigadés derrière les drapeaux bourgeois par les partis socialistes, les ouvriers des principaux pays d'Europe sont partis "la fleur au fusil" se massacrer mutuellement au nom de la "défense de la civilisation" et de la "lutte contre le militarisme" ou le "tsarisme". Comme l'écrivait Rosa Luxemburg, "la guerre est un meurtre méthodique, organisé, gigantesque". En vue d'un meurtre systématique, chez des hommes normalement constitués, il faut cependant d'abord produire une ivresse appropriée" (Brochure de Junius). Tant que dura cette ivresse, les ouvriers adhérèrent au mot d'ordre stupide de la social démocratie (notamment celle d'Allemagne) expliquant que"la lutte de classe n'est valable qu'en temps de paix". Ce ne sont pas les luttes qui ont dessoûlé le prolétariat; ce sont plusieurs années de barbarie de la guerre impérialiste qui lui ont fait comprendre que, dans les tranchées, il ne se battait pas pour "la civilisation". Ce n'est qu'en prenant conscience qu'il se faisait massacrer et massacrait ses frères de classe pour des intérêts qui n'étaient pas les siens, qu'il a développé ses luttes qui allaient aboutir aux révolutions de 1917 en Russie et 1918 en Allemagne.
La méthode de Sander, faite de juxtapositions de demi vérités partielles le conduit à énoncer une autre contre-vérité totale : "la conscience qu'ils (les ouvriers polonais) ont acquise ainsi n est pas un acquis permanent qui subsiste en dehors de la lutte".
D'abord, nous constatons que cette affirmation contredit ce que dit, par ailleurs, Sander lui-même: "... les luttes futures (de l'ensemble du prolétariat) pourront tirer profit des leçons de Pologne... Il (le prolétariat) devra se souvenir des affrontements entre "Solidarnosc" et les ouvriers, qui montrent comment chaque syndicat,même nouvellement créé, devient immédiatement l'ennemi mortel de la lutte". Ainsi Sander refuse-t-il aux protagonistes directs dés combats de Pologne une "mémoire" de leur expérience que pourraient conserver les ouvriers d'autres pays malgré toutes les déformations des médias bourgeoises. Peut-être considère-t-il que cela résulte du fait qu'en Pologne (et pourquoi pas dans tous les pays de l'Est) les conditions spécifiques dans lesquelles lutte le prolétariat sont moins favorables à une prise de conscience que dans d'autres pays (pourquoi pas ceux d'Europe occidentale). C'est justement la thèse que combat Sander.
Nous découvrons ainsi un élément supplémentaire de la méthode du camarade Sander : le rejet de la cohérence.
Mais revenons sur cette idée que "la conscience n'est pas un acquis permanent". Nous épargnerons à Sander et au lecteur des développements sur le processus de la prise de conscience du prolétariat; c'est une question qui a déjà été traitée dans cette revue et qui le sera à nouveau. Nous nous contenterons ici de poser les questions suivantes :
- pourquoi en Pologne même, les combats de 1980 sont-ils allés bien plus loin que ceux de 70 et de 76 ?
- n'est-ce pas la preuve "qu'il subsiste un acquis des luttes" ?
- ce niveau supérieur des luttes en 80, est-il le seul résultat de l'aggravation de la crise économique ?
- ne faut-il pas y voir aussi le produit de tout un processus de maturation de la conscience du prolétariat qui s'est poursuivi après les luttes de 70 et 76 ?
- plus généralement, quel sens revêt l'idée marxiste de base suivant laquelle le prolétariat tire les leçons de ses expériences passées, qu'il met à profit l'accumulation de ses expériences ? '
- enfin, quelle est la fonction des organisations révolutionnaires elles-mêmes, si ce n'est justement de systématiser ces enseignements, les employer à développer la théorie révolutionnaire afin qu'elle puisse féconder, les combats futurs de la classe qui secrète justement ces organisations à cet effet ?
A toutes ces questions, le camarade Sander sait donner des réponses correctes. Il connaît le marxisme ainsi que les positions du CCI, mais brusquement, il les "oublie". Faut-il croire qu'il a tendance à attribuer au développement de la conscience du prolétariat sa propre démarche de pensée aux accès fréquents d'amnésie ?
Se voulant "matérialiste", la vision de Sander sombre en fin de compte dans le positivisme, elle tend à rejeter le marxisme pour se noyer dans les sophismes du conseillisme le plus plat, celui qui refuse à l'organisation des révolutionnaires toute fonction dans la lutte de classe.
UN CONSEILLISME «HORIZONTAL»
Le propre de la conception conseilliste (nous parlons de la conception conseilliste dégénérée, développée notamment par Otto Rhule, et non de la conception de Pannekoek qui ne tombait pas dans les mêmes aberrations) est de nier le fait qu'il y ait une hétérogénéité dans la classe dans son processus de prise de conscience. Elle se refuse à admettre que certains éléments de la classe parviennent avant les autres à "comprendre les conditions, la marche et les buts généraux du mouvement ouvrier" (Manifeste Communiste). C'est pour cela que, selon elle, il ne peut exister pour le prolétariat d'autre organisation que son organisation unitaire, les conseils ouvriers, au sein de laquelle tous les ouvriers avancent d'un même pas sur le chemin de la conscience. Nous ne ferons évidemment pas à Sander l'injure de lui attribuer une telle conception. Son texte prouve par ailleurs qu'elle n'est pas sienne et si c'était le cas on ne voit pas ce qu'il ferait à militer dans le CCI.
Cependant, la même démarche unilatérale et non dialectique qui conduit Sander à ouvrir involontairement la porte au conseillisme classique, l'amène à entrer de plein pied, et volontairement cette fois, dans une autre variété de conseillisme. Si on peut qualifier de "vertical" le conseillisme de Otto Rhule qui nie que, dans le chemin vers la révolution, certains éléments de la classe puissent se hisser à un niveau plus élevé de conscience que les autres, on peut considérer que le conseillisme de Sander est "horizontal" puisqu'il met un signe d'égalité entre les niveaux de conscience des prolétariats des différents pays ou zones du globe (le Tiers Monde excepté). Sander admet, avec tout le CCI, que même au moment de la révolution, il subsistera une grande hétérogénéité dans la conscience du prolétariat, ce qui se traduira notamment par le fait que,lors de la prise de pouvoir par la classe, les communistes seront encore une minorité. Mais pourquoi cette hétérogénéité ne pourrait-elle pas exister entre des secteurs du prolétariat diversement constitués, ayant des histoires et des expériences différentes, subissant, certes, une même crise, mais sous des formes et avec des degrés divers.
Sander tente de repousser les éléments donnés par le CCI pour expliquer le rôle central du prolétariat Ouest européen dans le futur mouvement de généralisation des luttes, dans la révolution de demain. En fait, ce n'était pas la peine qu'il se donne le mal d'examiner un par un les différents éléments puisque l'unité et l'homogénéité du prolétariat mondial sont posées à priori. Significative de cela est la façon dont il réfute l'idée que les ouvriers d'Occident peuvent plus facilement comprendre que ceux de l'Est la crise du capitalisme comme crise de surproduction :
"Pour les ouvriers à 1'Est, de même que pour ceux de 1'Ouest, la surproduction et la pénurie ne peuvent être comprises que s'ils quittent le point de vue "spécifique" pour voir le système capitaliste comme un tout... Ce point de vie global, nécessaire pour percevoir les racines du système et la possibilité de la révolution socialiste, le prolétariat en Occident ne le possède pas de naissance. Il ne peut résulter que de la tendance de la lutte de classe elle-même à se globaliser et à avoir une portée internationale".
Le "point de vue global" du camarade Sander est sans aucun doute l'analyse que font les révolutionnaires de la nature du capitalisme et de ses contradictions. Ce point de vue global", les révolutionnaires peuvent l'appréhender qu'ils se trouvent dans des pays avancés comme l'Angleterre où vivaient Marx et Engels où qu'ils viennent de pays arriérés comme Posa Luxemburg ou Lénine. Cela provient du fait que les positions politiques et analyses des organisations révolutionnaires ne sont pas une expression des conditions immédiates dans lesquelles se trouvent leurs militants où des circonstances particulières de la lutte de classe dans tel ou tel pays mais une sécrétion, une manifestation de la prise de conscience du prolétariat comme être historique, comme classe mondiale au devenir révolutionnaire.
Disposant d'un cadre théorique qui leur permet, beaucoup mieux que le reste de leur classe/d'aller plus rapidement au-delà des apparences pour appréhender l'essence des phénomènes, ils sont beaucoup plus en mesure de reconnaître dans n'importe quelle manifestation de la vie du capitalisme les résultats des lois profondes qui gouvernent ce système.
Par contre, ce qui est vrai de la minorité révolutionnaire de la classe ne l'est pas en général de ses grandes masses. Dans la société, "les idées dominantes sont les idées de la classe dominante" (Marx). La grande majorité des travailleurs est soumise à l'influence de l'idéologie bourgeoise. Et si elle s'amoindrira progressivement, cette influence se maintiendra néanmoins jusqu'à la révolution. Cependant, la bourgeoisie aura d'autant plus de mal à maintenir cette influence que l'image que donnera d'elle-même sa société trahira plus ouvertement la nature profonde de celle-ci. C'est pour cela que la crise ouverte du capitalisme est la condition de la révolution. Non seulement parce qu’elle obligera le prolétariat à développer ses luttes, mais parce qu'elle permettra que se révèle à ses yeux l'impasse totale dans laquelle se trouve ce système. Il en sera de même pour l'idée que le communisme est possible, que le capitalisme peut céder la place à une société basée sur l'abondance, permettant une pleine satisfaction des besoins humains, "dans laquelle le libre développement de ' chacun est la condition du libre développement de tous". Une telle idée pourra s'imposer d'autant plus facilement parmi les ouvriers que se révélera clairement la cause de la crise : la surproduction généralisée. A l'Est comme à l'Ouest les ouvriers seront plongés dans une misère croissante et contraint à des luttes de plus en plus puissantes. Mais la prise de conscience que cette misère résulte - de façon absurde - d'une surproduction de marchandises se fraiera un chemin bien plus facilement là où des millions de chômeurs côtoieront des magasins pleins à craquer que là où les queues devant des magasins vides pourront être présentées comme résultant d'une production insuffisante ou de la mauvaise gestion de bureaucrates irresponsables.
De même qu'il se refuse à reconnaître le poids des spécificités économiques sur le processus de prise de conscience de la classe, le camarade Sander est très choqué par ce que nous écrivons sur l'importance de toute une série de facteurs historiques ou sociaux sur ce processus :
"Tous les arguments sur la tradition, la culture et l'âge volent en éclat si l'on considère le fait historique que les pays où le prolétariat a réussi le mieux à homogénéiser sa conscience révolutionnaire étaient la Russie et la Hongrie où la classe ouvrière était relativement jeune, privée d'une tradition de longue date et avec un niveau relativement bas d'éducation bourgeoise. "
Cependant, Sander, fâché qu'il semble être avec la cohérence, nous avait déjà donné la réponse avant : "Mais les possibilités (de la lutte et de la prise de conscience politique) dépendent aussi de 1'opposition que les ouvriers ont à vaincre. Et à ce niveau également, nous voyons d'importantes différences entre la situation de 17 et celle d'aujourd'hui. En 17, la bourgeoisie était divisée et désorganisée par la guerre, désorientée par son manque d'expérience. Dans ces circonstances, il y avait effectivement des "maillons faibles" dans sa ligne de défense, que le prolétariat pouvait mettre à profit."
C'est justement une des grandes différences entre la situation actuelle et celle qui prévalait lorsqu’a surgi la révolution en 1917. Aujourd'hui, instruite par son expérience, la bourgeoisie est capable, malgré ses rivalités impérialistes, d'opposer un front uni contre la lutte de classe. C'est ce qu'elle a montré en de multiples reprises et notamment lors des grands combats de Pologne en 80-81 où l'Est et l'Ouest se sont remarquablement partagés le travail pour défaire le prolétariat comme nous l'avons souvent souligné dans notre presse.
Face aux luttes de Pologne, la tâche spécifique de l'occident a été de cultiver , via sa propagande dans les radios en langue polonaise et ses envois de syndicalistes, les illusions sur les syndicats libres et la démocratie. Cette propagande pourra avoir un impact tant que les ouvriers de l'Ouest, et notamment ceux d'Europe occidentale, n'auront pas dénoncé, dans leur propre lutte, le syndicalisme comme agent de l'ennemi de classe et la démocratie comme dictature du capital. Par contre, le seul fait que, dans les pays de l'Est et comme expression de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur cette zone (cf. Revue Internationale n°34, l'article : "Europe de l'Est : les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat"), le système ne soit pas en mesure de tolérer l1existence durable de "syndicats libres", permet régulièrement à ceux-ci, en se couvrant de l'auréole du martyr, de redorer leur blason aux yeux des ouvriers. Si les luttes des ouvriers de Pologne ont porté un coup décisif aux illusions qui subsistaient en occident sur le "socialisme" à l'Est, par contre, elles ont maintenu presque intactes les illusions syndicalistes et démocratiques tant à l’Est qu'à l'Ouest.
Dans l'aide réciproque que s'apportent, face à la classe ouvrière, les bourgeoisies des deux blocs, c'est la bourgeoisie la plus forte qui peut donner le plus. C'est pour cela que la capacité du prolétariat mondial à généraliser ses luttes et à engager le combat révolutionnaire est bien plus déterminé par les coups directs qu'il pourra porter à cette dernière qu'à la première.
C'est également pour cela que, plus que jamais seront déterminants dans la période qui vient les éléments qui sont, dans la vision marxiste, à la base de la force du prolétariat, de sa capacité à développer sa conscience :
- son nombre, sa concentration, le caractère associé du travail des prolétaires;
- la culture qu'est obligée de lui dispenser la bourgeoisie pour augmenter la productivité de leur travail;([1] [545])
- sa confrontation quotidienne avec les formes les plus élaborées des pièges bourgeois.
- son expérience historique;
toutes choses qui existent à plus ou moins grande échelle partout où travaillent des prolétaires mais qui sont le plus pleinement développées là où le capitalisme a surgi historiquement : l'Europe occidentale.
L’UNITE DU PROLETARIAT
Pour le camarade Sander, le maître mot est "l'unité du prolétariat" : "le seul 'maillon faible' (futur) du capitalisme, c'est l'unité mondiale du prolétariat". Nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Le problème c'est qu'il n'en est pas entièrement convaincu. Parce que nous constatons une évidence : les différences qui existent entre les différents secteurs de la classe ouvrière et que nous en déduisons certaines des caractéristiques du processus de généralisation mondiale des luttes ouvrières, il s'imagine que nous ignorons l'unité du prolétariat mondial. Comme le dit la résolution de janvier 83:
"Unité n'est pas identité des parties qui restent soumises à des conditions matérielles différentes. Il n'y a pas d'égalité naturelle entre les divers organes et le coeur ou le cerveau d'un corps vivant, qui remplissent des fonctions vitales complémentaires. . .
Déterminer le point de départ de cette dynamique (de 1'internationalisation de la grève de masse), et donc les conditions optimales de la naissance du séisme révolutionnaire, n'est pas nier l'unité du prolétariat mondial. Elle est le processus même par lequel l'unité potentielle devient unité réelle."
Cette vision s'appuie sur une démarche dialectique, dynamique qui, comme le disait Marx, "pose l'abstrait (l'unité potentielle du prolétariat mondial) pour s'élever ensuite au concret (le processus réel de développement de cette unité) ". Sander passe bien par cette étape mais, fidèle à sa démarche unilatérale et partielle, il oublie par contre la seconde. Ce faisant, il reste à terre, au ras de ses abstractions ce qui l'empêche de découvrir l'horizon et d'apercevoir ce que sera le processus véritable du développement mondial de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
F.M.
[1] [546] Pour le camarade Sander le blanc et le noir existent et ce sont deux couleurs bien distinctes. Cependant pour lui, apparemment, le gris et les différentes variantes de cette couleur, comprises entre le noir et le blanc, n'existent pas. Il admet facilement qu'il existe une différence considérable entre la force du prolétariat des pays avancés et celle du prolétariat du Tiers Monde, différence liée à des facteurs objectifs matériels. Par contre, qu'il puisse exister des situations intermédiaires, cela lui échappe complètement. Ainsi, lorsqu'on prend en considération un certain nombre d'éléments qui peuvent caractériser le degré de développement économique d'un pays et la force du prolétariat qui s'y trouve (voir tableau), on est frappé de constater que l'URSS et l'ensemble des pays de l'Est accusent une arriération très notable par rapport aux Etats Unis, au Japon et à l'Europe Occidentale.
Que l'on prenne des facteurs comme :
- le Produit National Brut par habitant, qui rend compte de la productivité moyenne du travail, et par suite notamment de son degré d'association ;
- la proportion de la population vivant dans les villes qui est une des composantes du degré de concentration de la classe ouvrière ;
- la proportion de la population active occupée dans le secteur agricole, qui illustre le poids de l'arriération campagnarde et est en rapport inverse du niveau de dépendance du travail agricole à l'égard du secteur industriel ;
- la proportion de la population ayant suivi des études du 3° degré qui est un indice du degré de technicité introduite dans la production ;
- la mortalité infantile qui est une des manifestations nettes de l'arriération économique et sociale ; l'URSS et les pays d'Europe de l'Est se trouvent à peu près sur le même plan qu'un pays comme la Grèce, bien loin de la situation qui est le lot commun des pays les plus avancés.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 38 - 3e trimestre 1984
- 2530 reads
Lutte de classe internationale : simultanéité des grèves ouvrières : quelles perspectives ?
- 2436 reads
LE RENOUVEAU INTERNATIONAL DES LUTTES
Dans notre Revue Internationale n°37, la précédente, nous titrions sur la reprise internationale de la lutte de classe. Après la défaite du prolétariat en Pologne, et le recul des luttes qui l'avait suivie en 1981 et 82, nous avons assisté ces derniers temps au resurgissement de luttes massives dans le monde entier, et principalement en Europe occidentale.
Ce resurgissement confirme que la classe ouvrière refuse de se serrer encore plus la ceinture ; qu'elle n'accepte pas de se sacrifier pour "sauver les économies nationales" ; que la bourgeoisie ne réussit pas à obtenir la paix sociale, la discipline sociale, ni une quelconque adhésion à ses projets économiques immédiats : baisse des salaires, licenciements massifs, la misère généralisée. Cette indiscipline sociale du prolétariat signifie que la bourgeoisie n'a pas les moyens politiques pour déclencher sa 3ème guerre mondiale, malgré l'intensification des rivalités et des conflits inter impérialistes. Incapable de faire accepter l'accentuation de la misère, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne réussit pas à l'imposer en grande partie, la bourgeoisie est d'autant plus -incapable d'imposer de plus grands sacrifices, jusqu'au dernier, celui de nos vies qu'impliquerait l'ouverture de la voie à l'issue capitaliste à la crise : la guerre généralisée.
Nous continuons donc d'affirmer que le cours historique de la période ouverte à la fin des années 60 est aux affrontements de classe et non à la guerre.
Dans les années 80, "années de vérité", la bourgeoisie ne peut plus retarder l'attaque économique contre la classe ouvrière. Cette attaque n'est pas improvisée, cela fait plusieurs années que la classe dominante la prépare, et ce au niveau international : __
- au niveau politique, c'est la mise en place de la tactique de la "gauche dans l'opposition", c'est-à-dire en dehors de toute responsabilité gouvernementale ;
- au niveau économique, c'est la planification par des organismes tels que le FMI ou l'OCDE, ou par des accords entre Etats, de l'attaque économique contre la classe ouvrière.
Nous avons maintes fois développé dans cette Revue (notamment dans la Revue Internationale n° 31, sur "le machiavélisme de la bourgeoisie") et dans nos différentes presses territoriales cette question. Inutile d'y revenir ici.
C'est bien à une attaque concertée, planifiée et organisée au niveau international, contre laquelle se défend la classe ouvrière depuis la fin 83 ([1] [547]).
Le silence de la presse.
Le silence, les mensonges déversés par les médias de la bourgeoisie ne doivent pas empêcher les groupes révolutionnaires de reconnaître cette reprise. Depuis septembre dernier, c'est l'ensemble des pays européens qui sont touchés par des grèves, des réactions massives et déterminées du prolétariat. Sans négliger les révoltes de la faim en Tunisie, au Maroc, dernièrement à Saint Domingue, il est nécessaire de constater que les mouvements qui secouent les USA, fait nouveau, le Japon (22 000 dockers en grève), et surtout la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, l'Italie, etc.. se situent dans le centre historique, économique et politique du capitalisme, et à ce titre revêtent une importance particulière.
Malgré le black-out de la presse, nous savons, et une des tâches des révolutionnaires, c'est aussi de faire savoir que :
- en Espagne "les ouvriers désabusés se sont mis à se défendre contre les plans du gouvernement. Il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle grève ne se déclenche..." (Der Spiegel, 20/2/84) ; touchés par les grèves : SEAT, la General Motors, les secteurs du textile, Iberia (aviation), les chemins de fer, les services publics, la sidérurgie (Sagunto) et les chantiers navals ;
- le 24 mars, 700 000 ouvriers manifestaient à Rome contre la remise en cause de "l'échelle mobile" ;
- les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs se mettent en grève en Grande-Bretagne, grève qui se poursuit depuis ;
- en France, après Talbot, les Postes, c'est la sidérurgie, les chantiers navals, les mines et l'automobile qui sont touchés par les réactions ouvrières ;
- en mai, au paradis de la paix sociale en Allemagne de l'Ouest, la grève lancée par le syndicat sur les 35 heures est la réponse de la bourgeoisie à la combativité des ouvriers qui commençait à s'exprimer dans plusieurs grèves sauvages et spontanées.
Du mouvement de grève générale dans les services publics en Belgique de septembre à la grève actuelle des métallos en Allemagne, c'est l'ensemble du prolétariat international qui reprend le chemin du combat de classe, du refus de la logique de sacrifice que nous offre le capitalisme.
LES ARMES DE LA BOURGEOISIE
1- Les campagnes de diversion.
Le silence et les mensonges des journaux ne sont pas la seule arme utilisée par la bourgeoisie. L'organisation de campagnes de diversion permet de déboussoler, de démobiliser les ouvriers : essentiellement ceux qui ne sont pas encore en lutte. C'est tout le sens de la manifestation pacifiste organisée par la gauche et les gauchistes en pleine grève de la fonction publique aux Pays-Bas, l'automne dernier. L'utilisation du scandale des "avions-renifleurs de pétrole" - il fallait l'inventer - durant la grève à Talbot en France, le bruit fait autour du scandale sur le financement de partis politiques en Allemagne - quelle soudaine honnêteté ! - au moment où débutait la grève des métallos, ne visent qu'à passer sous silence les grèves ouvrières.
Toutes ces campagnes, et il y en a bien d'autres, produisent un écran de fumée derrière lequel il est difficile d'entrevoir les réactions ouvrières, ce qui renforce ainsi leur isolement.
2- Les faux appels à l'extension.
Face aux secteurs de la classe qui, eux, sont en lutte, ces écrans de fumée ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a peur que d'une chose : l'extension, la coordination réelles des grèves. Elle ne peut plus empêcher les réactions prolétariennes ; elle n'en est plus capable. Non, alors elle cherche à les étouffer dans la dispersion et l'isolement. Le prolétariat n'étant pas une masse amorphe sans réflexion, la bourgeoisie se doit d'employer des thèmes qui permettent cet isolement et cette division. Cette tâche revient en premier lieu à ses bons serviteurs du capital que sont les syndicats : enfermer les ouvriers dans des impasses, dans la défense de l'économie nationale, "produisons français, consommons français" crie la CGT, le syndicat du PCF, en opposant les ouvriers d'une région à l'autre comme en Belgique, d'un secteur à l'autre comme aux Pays-Bas où les syndicats lors de la grève du secteur public proposaient une... réduction des salaires dans le privé !
Il est de plus en plus clair pour les ouvriers qu'isolés, dispersés par région, par secteur industriel, ils courent à l'échec. Ce sentiment envers la nécessité de l'extension est chaque fois plus affirmée. Pour parer à cette volonté, pour la vider de son contenu prolétarien, la bourgeoisie n'hésite pas à prendre les devants. Elle propose de fausses extensions, de fausses généralisations, de fausses solidarités.
Nous avons déjà vu comment les syndicats avaient "généralisé" la lutte des cheminots et des postiers en Belgique aux secteurs les moins combatifs, les plus encadrés des services publics. Ainsi, ils noyaient le coeur militant de la lutte et lui étaient toute initiative d'extension réelle pour s'assurer du contrôle complet de la grève.
C'est à la recherche du même but que la CGT a organisé, appelé et fait défiler, "protégés" par son service d'ordre, les ouvriers de la sidérurgie lors de la "Marche sur Paris" du 13 avril. A la recherche du même but aussi, l'organisation de la "Marche sur Rome" du 24 mars ; de même le syndicat du PC espagnol, les "commissions ouvrières" ainsi que les gauchistes en voulant appeler pour le 6 mars à une "Marche sur Madrid" avaient la même volonté d'isolement et de dispersion que la FGT belge.
3- Le syndicalisme de base.
L'accumulation de toutes ces manoeuvres déconsidère encore plus les syndicats parmi les ouvriers. Et malgré la radicalisation de leur langage, ils ne réussissent pas à enrayer la baisse du nombre de syndiqués, à empêcher que les dirigeants se fassent de plus en plus huer et chahuter lors de leur apparition et surtout à garder le contrôle complet sur les réactions ouvrières.
C'est là qu'intervient le syndicalisme critique, à la base, "radical" qui tente de ramener dans le giron du syndicalisme, et non plus tant des syndicats eux-mêmes trop démasqués, les ouvriers qui s'en détournent. C'est le syndicalisme? De base, le Collectif 79/84 qui, à Longwy, enferme les ouvriers dans des "actions-commandos" qui no servent qu'à les isoler encore plus dans "leur" région, "leur" ville, "leur" usine. Ce sont les"coordinations de forces syndicales", les "comités de lutte et de solidarité" qui, avec le leader Camacho des "commissions ouvrières" espagnoles, promettent une "grève générale" hypothétique, à une date indéfinie que... seuls les syndicalistes décideront.
Le meilleur exemple du sale travail qu'accomplit le syndicalisme de base se trouve en Italie. Il y avait bien longtemps que les syndicats officiels n'avaient pu mobiliser tant de monde : 700 000 ouvriers sont venus à la "Marche sur Rome?" à l'appel des "assemblées nationales des conseils d'usine". Nous devons d'abord dire que ces "conseils d'usine" n'ont de conseil que le nom. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie usurpe des mots et noms au prolétariat afin d'en dénaturer la signification réelle, leur contenu de classe. Ces "conseils" ne sont qu'une structure syndicaliste à la base qui existe de façon permanente depuis 69. Ils sont tout le contraire d'un organe de lutte produit, contrôlé, dirigé par les ouvriers réunis en assemblées générales. Créés à la fin du mouvement de 69 pour maintenir les luttes dans l'enceinte des usines et des ateliers, ils reviennent en scène aujourd'hui afin de constituer une organisation syndicaliste de base crédible pour les ouvriers au niveau national, et ce dès le début du mouvement ; ils suppléent ainsi à la carence des syndicats officiels. Le mot d'ordre des "conseils d'usine" gauchistes d'Italie est : "nous ne sommes pas contre le syndicat, le syndicat c'est nous". La bourgeoisie utilise le syndicalisme de base pour vider la lutte de son contenu et en prendre le contrôle en appliquant la tactique du "laisser-faire à la base", de "reconnaître toutes les actions". Un des arguments du syndicalisme de base est d'essayer de faire croire aux ouvriers que par leur lutte, leur détermination, leur combativité, ils peuvent exercer une pression sur les syndicats afin de pousser ceux-ci ou leur direction à reconnaître ou à prendre en main les luttes. Cela, c'est toujours ramener les ouvriers dans le giron du syndicalisme, en prenant argument de la radicalisation de son langage.
Ces changements de langage syndical trouvent leur véritable sens dans toutes ces grèves, telles Talbot ou Citroën en France, où l'annonce par le patronat d'un nombre de licenciements plus élevé que celui dont il a vraiment besoin permet d'abord au syndicat de se montrer très radical en refusant tout renvoi et lui permet ensuite de faire croire à sa victoire, à son efficacité, en faisant "reculer" la bourgeoisie jusqu'au nombre de licenciements... qu'elle avait planifié. Ainsi, à Talbot, on annonce d'abord 3000 licenciés, puis, "grâce" à l'action énergique du syndicat c'est "seulement" 2000 ouvriers qui sont renvoyés.
Même si elle n'est pas nouvelle, cette tactique, cette concertation préalable entre patrons et syndicats est aujourd'hui de plus en plus employée.
4- L'utilisation de la répression.
L'Etat ne peut se permettre une répression aveugle et frontale contre les luttes ouvrières qui se développent actuellement. Celle-ci aurait l'effet inverse à celui recherché : accélérer la prise de conscience chez les ouvriers que c'est à l'ensemble de la bourgeoisie, à l'Etat qu'ils doivent s'affronter. Néanmoins, l'Etat doit montrer sa présence et sa force. C'est ainsi qu'il sélectionne l'utilisation de sa répression. Il tente de créer des abcès de fixation qui puissent détourner la combativité des luttes.
C'est le sens des procès faits au syndicat des mineurs en Grande-Bretagne contre l'organisation des piquets de grève. En outre, cela crédibilise le syndicat en lui donnant une "auréole" de réprimé. La bourgeoisie anglaise n'a pas hésité à arrêter plus de 500 mineurs à ce jour. C'était le même but qui était visé en France à Talbot, en faisant intervenir la milice patronale sous les yeux de la police contre les ouvriers en grève. De même, à Longwy, avec les opérations "coup de poing", "commandos". C'est aussi ce qui s'est passé à Sagunto en Espagne avec la violente répression contre une manifestation des ouvriers.
C'est un terrain propice au syndicalisme de base, aux gauchistes, qui peuvent ainsi à l'aide de la violence étatique, au besoin avec des "victimes", crédibiliser leurs actions violentes. L'utilisation de la répression "sélective" et celle du gauchisme sont parfaitement complémentaires et forment un tout.
5- Le maintien de la gauche dans l'opposition.
Tous ces obstacles opposés par la bourgeoisie au prolétariat nécessitent, pour avoir un maximum d'efficacité, le relais, l'existence d'un semblant d'opposition aux gouvernements en place chargés d'attaquer la classe ouvrière. Le maintien de partis de gauche importants, au langage ouvrier, ayant eu la confiance des ouvriers et s'appuyant sur les illusions et les faiblesses que ces derniers conservent, permet une mise en place crédible, efficace des obstacles cités précédemment.
Le renvoi du PS dans l'opposition en Allemagne a permis l'année dernière l'organisation de puissantes manifestations pacifistes ; il permet aujourd'hui au syndicat DGB d'organiser préventivement un mouvement de grève sur les 35 heures. Celui-ci a pour but d'épuiser, de dévoyer, de déboussoler la combativité ouvrière qui commençait à s'exprimer spontanément. De même, l'appel à des manifestations pacifistes en Italie correspond à une opposition plus prononcée du PC envers le gouvernement et à une radicalisation de son langage ; tout comme pour la CGIL d'ailleurs qui, en appuyant le syndicalisme de base style "conseils d'usine", tente d'occuper le terrain social. Bien que participant au gouvernement, le PCF essaie de suivre l'exemple des PC italien et espagnol, des PS allemand ou belge afin de paraître s'opposer à l'attaque qui est faite à la classe ouvrière ; c'est le sens des critiques de plus en plus fortes que porte son syndicat, la CGT, contre Mitterrand.
Pour la bourgeoisie, l'heure n'est pas à changer le dispositif de son appareil politique face au prolétariat. Bien au contraire, il s'agit de renforcer la politique de la "gauche dans l'opposition" afin d'affronter le prolétariat.
LES CARACTERISTIQUES DES LUTTES ACTUELLES
La reprise des luttes actuelles signifie que le prolétariat - attaqué économiquement par la bourgeoisie d'une part, ayant mûri et réfléchi sa défaite en Pologne, perdant de plus en plus, et ses illusions sur une issue à la crise du capitalisme, et sa confiance dans les partis de gauche et les syndicats d'autre part - reprend le chemin du combat de classe qui passe par la défense de ses conditions de vie, par la lutte contre le capital.
La nécessité du maintien de la gauche dans l'opposition, la nécessité d'une force politique de la bourgeoisie qui soit présente dans les luttes pour les contrôler, les saboter, les dévoyer, est une tactique employée maintenant depuis les années 79-80. La reprise actuelle des luttes ouvrières manifeste l'usure progressive de cette tactique. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, l'existence de grands partis de gauche en "opposition" ne suffit plus à empêcher le surgissement des grèves.
En même temps que l'usure progressive de la carte de la gauche dans l'opposition, les luttes ouvrières actuelles manifestent également la fin des illusions sur un renouveau économique du capitalisme. Ces illusions entretenues par la gauche et ses syndicats sur des solutions nationales, protectionnistes, "anti-capitalistes" du style "faire payer les riches", tendent à tomber de plus en plus. C'est ce qu'exprime le refus des ouvriers de la sidérurgie tant en Espagne qu'en France, de se laisser berner par les "plans de reconversion" et de "formation". C'est ce qu'exprime encore plus le retour au combat de classe des ouvriers des USA et d'Allemagne de l'Ouest qui, il y a deux ans, acceptaient les réductions de salaire pour "sauver" leur entreprise.
Cette maturation de la conscience dans la classe ouvrière passe aujourd'hui par la reconnaissance du caractère bourgeois de la gauche dans son ensemble, de 1'inéluctabilité de l'approfondissement de la crise du capitalisme, et que seule la lutte ouvrière déterminée, massive et généralisée peut ouvrir une autre perspective à la dégradation continuelle des conditions d'existence. Cette maturation progressive s'exprime dans les caractéristiques mêmes des luttes qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui :
- tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant un certain débordement des syndicats ;
- tendance à des mouvements de grande ampleur ;
- simultanéité croissante des luttes au niveau international ;
- rythme lent du développement de ces luttes.
1- La tendance au surgissement de mouvements spontanés.
Que ce soit la grève du secteur public en Belgique partie sans les syndicats en septembre 83, que ce soit, en octobre 83 en Grande-Bretagne, le rejet par 65 000 ouvriers des chantiers navals de l'accord passé entre le syndicat et la direction, et le même mois, dans le même pays, la grève de 15 000 mineurs sans l'accord syndical, que ce soit les critiques et le dégoût des ouvriers envers les syndicats à Talbot en décembre 83, ou les violentes manifestations, spontanées, des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals en France en mars 84, que ce soit en Espagne à la General Motors, en Allemagne où des grèves "sauvages" ont éclaté à Duisburg (Thyssen) et à Brème (Klokner), que ce soit même les "révoltes de la faim" en Tunisie, au Maroc, en République Dominicaine le 20 avril, au Brésil etc., toutes ces réactions ouvrières manifestent une tendance générale à déborder spontanément les syndicats.
Ces derniers ne réussissent plus à empêcher les réactions ouvrières, même s'ils arrivent encore à en garder en grande partie le contrôle. La prise de conscience du rôle anti-ouvrier des syndicats grandit. Les mensonges sur leur caractère ouvrier, sur la possibilité et la nécessité d'en passer par eux, sur leur indispensabilité, sont de plus en plus démasqués.
2- La tendance à des mouvements de grande ampleur.
Ce sont des millions d'ouvriers qui, dans le monde entier, et particulièrement dans les grands centres capitalistes, ont participé, et continuent de participer aux luttes actuelles. Nous l'avons vu précédemment : des mouvements d'une très grande ampleur ont touché, et touchent présentement 1'ensemble de l'Europe occidentale, les USA, l'Amérique du Sud, les pays d'Afrique du Nord tout comme l'Afrique du Sud, l'Inde etc.. De plus, ce sont tous les secteurs qui sont touchés par les réactions ouvrières : services publics, automobile, sidérurgie, chantiers navals, mines etc..
Inévitablement, les ouvriers connaissent l'existence de ces mouvements, et ce malgré le silence et les mensonges de la presse. Inévitablement, pour rompre avec leur isolement, la question de l'extension et de la coordination des luttes se pose. Un début de réponse a été donné par les cheminots à Liège et à Charleroi (Belgique) quand ils sont allés chercher les ouvriers des postes et ont réussi à les entraîner dans la grève en septembre dernier. Contre les licenciements massifs, les mineurs de Grande-Bretagne se mettent en grève. 10 000 piquets de grève appellent à l'extension et les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs ont arrêté le travail. C'est là aussi un début de réponse à ce problème de l'extension.
L'extension d'ailleurs ne se fait pas uniquement vers les ouvriers qui ont un travail. Ceux qui sont chômeurs sont tout autant concernés par les luttes de leur classe. Nous avons vu comment les ouvriers sans travail se sont joints aux manifestations ouvrières à Longwy et à Sagunto. En République Dominicaine, les chômeurs, 40% de la population, ont participé à la révolte ouvrière contre les augmentations de 40 à 80% des produits alimentaires de base. Même chose en Tunisie et au Maroc l'hiver dernier.
3- La simultanéité des luttes.
Ni durant la première vague de luttes ouvrières de 68-74, ni durant la seconde de 78-80, une telle simultanéité n'avait existé. Et chacun d'entre nous sait le prix qu'en a payé le prolétariat en Pologne : l'incapacité à rompre avec les filets de la propagande bourgeoise sur la spécificité "de l'Est" de la grève de masse d'août 80, l'incapacité des luttes ouvrières à rompre l'isolement international du prolétariat. Aujourd'hui, cette simultanéité n'est que la juxtaposition des luttes ouvrières et non la généralisation internationale de la lutte de classe. Néanmoins l'idée de la généralisation fait déjà son chemin : en assemblées générales, les ouvriers de Charleroi, face au syndicat, au plus fort des affrontements entre les ouvriers de Longwy et la police française scandaient "à Longwy ! A Longwy !" Il ne faut pas s'y tromper, les grèves en Europe, et principalement et pour des raisons différentes, en Allemagne et en France, suscitent une grande attention et un grand intérêt parmi les ouvriers.
4- L'auto organisation.
Jusqu'à présent, le prolétariat n'a pu étendre, coordonner et encore moins généraliser son combat. Tant que les ouvriers n'arriveront pas à disputer le contrôle de leurs luttes aux syndicats, tant qu'ils ne réussiront pas à les prendre en main eux mêmes, tant qu'ils ne s'affronteront pas aux syndicats sur les buts et le contrôle des luttes, ils ne pourront organiser l'extension. C'est dire l'importance de l'auto organisation pour répondre aux besoins immédiats, premiers de chaque lutte aujourd'hui. C'est aux assemblées générales de décider et d'organiser l'extension et la coordination. Ce sont elles qui se déplacent si elles le peuvent, qui. envoient des délégations massives ou des délégués appeler à la grève dans les autres usines, ce sont elles qui nomment et révoquent à tout moment, si besoin est, les délégués. Or, jusqu'à présent, la bourgeoisie a réussi à vider de leur contenu toutes les assemblées qui ont existé.
Sans auto organisation, sans assemblées générales, il ne peut y avoir de véritable extension, et encore moins de généralisation internationale du combat de classe. Mais sans cette extension, les rares exemples d'auto organisation, d'assemblées générales en Belgique, en France, en Espagne, perdent leur fonction et leur contenu prolétariens, et laissent ainsi la bourgeoisie et ses syndicats occuper le terrain. Les ouvriers sont en train de comprendre que l'organisation de l'extension ne se fera qu'au prix du combat contre le syndicalisme.
5- Le rythme lent du développement des luttes.
La difficulté présente d'auto organisation de la classe ouvrière n'est que l'effet le plus visible du rythme lent du développement des luttes actuelles. L'attaque économique est pourtant très forte. Certains pourraient voir dans ces difficultés et la lenteur de la reprise, dans l'absence d' "un saut qualitatif" dans la grève de masse du jour au lendemain, une faiblesse extrême du prolétariat. Ce serait confondre les conditions de lutte dans lesquelles se trouve le prolétariat dans les grands pays industriels et historiques du capitalisme, avec les conditions qu'il rencontre dans les pays du "tiers-monde" et du bloc russe comme en Pologne. Avant de pouvoir déboucher sur la grève de masse et sur la généralisation internationale, le prolétariat doit affronter et dépasser les obstacles disposés par la bourgeoisie : la gauche dans l'opposition et les syndicats, et en même temps organiser le contrôle et l'extension de ses luttes. Ce processus nécessite une prise de conscience et une réflexion collective de la classe tirant les leçons du passé, et celles des luttes actuelles. Le rythme lent de la reprise des luttes, loin de constituer une faiblesse insurmontable, est le produit de la maturation lente, mais profonde de la conscience dans la classe ouvrière. Nous affirmons donc que nous n'en sommes qu'au débat de cette vague de lutte.
La raison de cette lenteur est due à la nécessité de reprendre les questions qui avaient été posées durant la vague précédente, mais qui n'avaient pas été résolues : le manque d'extension dans la grève du port de Rotterdam en 79 ; l'abscence d'assemblées générales à Longwy Denain la même année ; le sabotage du syndicalisme de base dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne; la nécessité de la généralisation internationale après la grève de masse en Pologne ; le rôle de la "gauche dans l'opposition" dans le reflux et la fin de cette vague de lutte.
Mais contrairement à 78-80, c'est à l'ensemble de ces questions que les ouvriers dans toutes les luttes d'aujourd'hui, se trouvent confrontés. Ce n'est pas une question qui est abordée dans chaque lutte, mais toutes à la fois. D'où la lenteur du rythme actuel des luttes ; d'où la difficulté mais aussi la profondeur de la maturation de la conscience dans la classe ouvrière.
6- Le rôle particulier actuellement du prolétariat en France.
Dans la prise de conscience du prolétariat international, la partie de celui-ci en France a une responsabilité particulière, temporaire et limitée. Du fait de l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir suite aux élections de mai et juin 81, ce pays constitue à l'heure actuelle une brèche dans le dispositif politique international des forces de la bourgeoisie. La participation au gouvernement des partis de gauche, PS et PC, est lourde d'affaiblissement pour la bourgeoisie internationale.
Si la grève de masse d'août 80 en Pologne n'a pas peu contribué à la destruction de la mystification sur le caractère "socialiste" des pays capitalistes du bloc de l'Est, le développement des grèves actuelles en France ne peut que contribuer à démasquer les mystifications et les mensonges colportés par les partis de gauche dans les autres pays et à l'affaiblissement de ces mêmes partis en milieu ouvrier.
Le licenciement de milliers d'ouvriers par ce gouvernement, le soutien qu'il reçoit des syndicats, les grèves, tant dans les services publics (Postes, Chemins de Fer) que dans l'automobile (Talbot, Citroën), les affrontements violents avec la police de "gauche" des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals (Longwy, Marseille, Dunkerque) ne peuvent qu'accélérer la reconnaissance dans l'ensemble de la classe ouvrière internationale du caractère bourgeois des partis de gauche du capital. De cette prise de conscience par le prolétariat dépend en grande partie le développement de la lutte de classe jusqu'à la révolution prolétarienne.
LE ROLE DES COMMUNISTES
Il existe une autre partie du prolétariat qui tient un rôle particulier, sans commune mesure avec la précédente. Cette partie exerce une responsabilité historique, permanente et universelle. Elle est constituée des minorités communistes, des révolutionnaires.
"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire" écrit Lénine dans Que Faire ? Sans programme communiste, sans prise de position claire dans la lutte de classe, pas de révolution prolétarienne possible ; sans organisation politique, pas de programme, pas de position claire et donc, pas de révolution.
Les luttes de la classe ouvrière ne peuvent se développer qu'en affirmant et maintenant leur autonomie et leur indépendance face à la bourgeoisie. Cette autonomie ouvrière dépend de la clarté politique du mouvement de lutte lui-même. Partie intégrante de la classe ouvrière, ses minorités politiques ont un rôle indispensable et irremplaçable dans cette nécessaire clarification politique. Les groupes politiques du prolétariat ont pour responsabilité de participer et d'intervenir dans le processus de prise de conscience de la classe ouvrière. Ils accélèrent et poussent le plus loin possible cette réflexion collective de leur classe. C'est dans ce sens qu'il importe :
- qu'ils reconnaissent la reprise actuelle des luttes ouvrières après la défaite en Pologne ;
- qu'ils dénoncent la "gauche dans l'opposition" comme obstacle majeur opposé par la bourgeoisie aux luttes ouvrières ;
- qu'ils comprennent que l'Europe occidentale est la clef, l'épicentre du renouveau des luttes aujourd'hui et du développement de celles-ci ;
- qu'ils sachent reconnaître que le cours historique est, depuis la fin des années 60, aux affrontements de classe et non à la guerre impérialiste. Seule cette compréhension générale peut leur permettre une intervention claire :
- la dénonciation du syndicalisme sous toutes ses formes. Nous avons pu voir les effets désastreux du syndicat Solidarité en Pologne après la grève da masse d'août 80. C'est non seulement une très grande partie d'ouvriers qui fut aveuglée et abusée sur le caractère profondément syndicaliste et capitaliste de Solidarnosc, mais aussi nombre d'éléments et de groupes révolutionnaires. Le rejet et le dépassement du syndicalisme dans l'organisation de l'extension par les ouvriers eux-mêmes nécessitent la dénonciation sans concession et sans faille des syndicats, du syndicalisme de base et de ses agissements par les minorités communistes organisées pour cela. Celle-ci est indispensable et déterminante pour dépasser les pièges de la bourgeoisie ;
- la mise en avant des perspectives de lutte qui passent par l'organisation de l'extension et de la généralisation dans les assemblées générales. C'est un combat permanent que doivent livrer les ouvriers les plus combatifs, les plus avancés et, parmi eux, les petits groupes communistes dans les luttes, dans les assemblées pour l'organisation de l'extension et de la coordination contre le syndicalisme qui s'y oppose.
L'intervention, la propagande, le combat politique des révolutionnaires détermineront de plus en plus la capacité du prolétariat dans son ensemble à rejeter les pièges tendus par la bourgeoisie et ses syndicats dans les luttes. La bourgeoisie, elle, n'hésite pas à "intervenir", à être présente, à occuper le terrain afin d'enrayer le développement de la prise de conscience des ouvriers, d'obscurcir les questions politiques, de dévoyer les luttes dans des impasses. D'où la nécessité de "minorités communistes combattant en leur sein (les assemblées), exposant les manoeuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents, et traçant une perspective claire pour le mouvement. L'organisation révolutionnaire est le meilleur défenseur de 1’autonomie ouvrière'.' ( Revue Internationale n°24, p. 12, "sur le rôle des révolutionnaires").
Ces minorités communistes, organisées théoriquement, politiquement, matériellement "sont donc la fraction la plus résolue du prolétariat" de tous les pays, la fraction qui entraîne les autres (suivant 1'idée du Manifeste Communiste). Les groupes révolutionnaires doivent marcher au premier rang du combat prolétarien. Ils doivent montrer la voie du combat de classe. Ils "dirigent", au sens où ils orientent la classe ouvrière vers le développement de ses luttes, sur le chemin de la révolution prolétarienne. Ce développement passe aujourd'hui par les nécessaires et inséparables auto organisation et extension des luttes contre les syndicats.
C'est la tâche que le CCI s'est assignée. C'est tout le sens de notre combat dans le mouvement des luttes actuelles.
R.L.
[1] [548] A ce sujet, nous voudrions corriger une formulation que nous avons souvent utilisée, en particulier dans "les thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" parues dans la dernière Revue Internationale ; à la page 4, dans le point 2, il est dit que "c'est la classe ouvrière mondiale qui détient 1'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à la bourgeoisie..." S'il est vrai que la classe ouvrière détient la clef de la situation historique au sens où de son combat dépend l'issue dans la barbarie capitaliste ou dans la révolution prolétarienne et le communisme, par contre, il est faux de dire que la classe ouvrière est passée à l'offensive face au capitalisme. Passer à 1'offensive signifie pour le prolétariat qu'il se trouve à la veille de la révolution, dans une période de double pouvoir, organisé en conseils ouvriers, qu'il se prépare consciemment à attaquer l'Etat bourgeois et à le détruire. Nous en sommes encore loin.
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise ? La crise transforme l'Europe occidentale en une poudrière sociale
- 2754 reads
Il existe une "mémoire collective" historique au sein de la classe ouvrière. Les organisations politiques révolutionnaires en sont une manifestation importante. Mais elle n'est pas unique. Dans 1'ensemble de la classe, les luttes passées, les attaques de la bourgeoisie, on en a tiré les leçons pendant des années, souvent sous forme plus ou moins consciente, souvent sous forme purement négative, sachant plus ce qu'il ne faut pas faire que dégageant une perspective concrète positive précise. La puissance et la profondeur du mouvement ouvrier en Pologne en 1980 étaient en grande partie le fruit direct du souvenir des expériences successives de 1956, 1970 et 1976.
C'est pour cela que dans l'unité du prolétariat mondial, toutes les parties de la classe ne sont pas identiques : il y a des secteurs qui ont une plus grande tradition, une plus grande expérience de la lutte de classe. La vieille Europe occidentale regroupe le prolétariat qui possède le plus important coeur industriel (il y a dans la CEE 41 millions de salariés dans 1’industrie, contre 30 millions aux USA et 20 au Japon) et la plus longue expérience historique : à travers les luttes qui vont de 1848 et la Commune de Paris à la vague révolutionnaire de la fin de la 1ère guerre, à travers la confrontation avec la contre-révolution sous toutes ses formes, stalinienne, fasciste, "démocratique" (parlementarisme, syndicalisme), à travers des centaines de milliers de grèves de toutes sorte et ampleur, s'est forgée une classe plus aguerrie qu'ailleurs [1] [549]().
L 'Europe occidentale est actuellement non seulement la zone concentrant les principaux bataillons du prolétariat mondial, mais aussi, au sein de la partie industrialisée du bloc US, celle où, à court et moyen terme, la classe révolutionnaire est appelée à connaître la plus violente attaque économique. Les capitaux d'Europe occidentale s'effondrent lentement, incapables d'affronter sur le marché mondial et sur leur propre marché la concurrence économique de leurs propres "partenaires", américains et japonais, concurrence devenue d'autant plus agressive et impitoyable que ces derniers sont eux-mêmes plongés dans la plus violente crise depuis les années 30.
Les conditions objectives s'ajoutent aux conditions subjectives pour faire de l'Europe de l'Ouest le formidable détonateur révolutionnaire que Marx a annoncé.
LE DECLIN ECONOMIQUE DE L'EUROPE
LA LOI DU PLUS FORT
Dans la décennie qui va de 1963 à 1973, les économies des Etats de la CEE croissaient en moyenne à un rythme de 4,6 I (PIB). Ce taux tombe à 2 % dans la décennie suivante. Au début des années 80, il est tout simplement nul et recule dans plusieurs pays. A la fin des années 60, le taux de chômage dans la CEE était de 2,3 % ; aujourd'hui, il dépasse 10 % et atteint 17 % dans des pays aussi divers que l'Espagne et les Pays-Bas. Entre 1975 et 1982, "la part de marché" de la CEE (mesurée par sa part dans le total des exportations de produits manufacturés de l'ensemble de l'OCDE) est tombée de57%à53% tandis que celle des USA se maintenait à 18 % et celle du Japon augmentait de 13 à 16 %.
Dans la deuxième moitié des années 70, l'économie d'Europe occidentale a commencé à perdre de plus en plus de terrain par rapport aux USA et au Japon. Cette tendance s'est accélérée avec l'entrée dans les années 80. Simultanément, la dépendance du capital en Europe à l'égard de celui de " la puissance chef de bloc - dépendance qui ne s'est jamais démentie depuis la 2ème guerre -s'est fortement aggravée.
Le déclin économique de l'Europe occidentale au sein de son bloc trouve en partie son explication dans les caractéristiques des rapports entre nations dans le capitalisme décadent et militarisé.
Les lois qui régissent les rapports entre capitaux nationaux - fussent-ils ceux d'un même bloc militaire - sont les mêmes que celles du milieu de la pègre. Lorsque la crise frappe le monde capitaliste, la concurrence économique qui lui sert de mode de vie s'exacerbe jusqu'à son paroxysme, tout comme les gangsters s'entretuent lorsque les butins à conquérir se font plus rares et difficiles à obtenir.
Dans l'époque actuelle, cela se traduit au niveau de la planète par l'aggravation des tensions entre les deux blocs militaires. Au niveau de chaque bloc, en son sein, chaque nation est militairement sous le contrôle absolu de la puissance dominante (Le Japon corn ire la Pologne ne disposent que d'un strict minimum de munitions dans leurs armées ; ce sont les chefs de bloc qui en ont la possession et les leur fournissent). Mais les antagonismes économiques n'en subsistent pas moins.
Dans le bloc le plus riche, l'occidental, une certaine liberté de concurrence - beaucoup moindre que ce que les propagandes officielles prétendent- permet à ces antagonismes économiques d'apparaître au grand jour : c'est la guerre à coup de coûts de production moindres, à coup de subventions d'Etat aux exportations, à coup de mesures protectionnistes et de marchandages de "parts de marché", etc.
Dans le bloc de l'Est, le plus pauvre, le plus ruiné par le gigantesque effort de guerre et de militarisation, les tensions économiques entre capitaux nationaux apparaissent plus difficilement tant elles sont soumises aux impératifs militaires (la PDA est proportionnellement plus industrialisée que l'URSS ; elle n'en est pas moins obligée d'acheter le pétrole de celle-ci à un cours arbitrairement fixé, toujours supérieur au cours mondial et elle doit généralement le payer en devises occidentales).
Cependant, avec l'accélération de la crise et de la décadence capitaliste mondiale, c'est le mode de vie du bloc le plus ruiné qui montre l'avenir au mieux nanti. Comme nous le disions lors de notre second Congrès International (1977) : "Les Etats-Unis vont mettre l'Europe au rationnement". Depuis le début des années 70, l'évolution en occident ne s'est pas faite vers un plus grand libéralisme dans les échanges et la vie économique, mais au contraire vers la multiplication des mesures protectionnistes et un pouvoir de plus en plus impitoyable des USA sur leurs vassaux. Le GATT, organisation chargée de défendre et stimuler le libre-échange entre nations, ne cesse dans ses derniers rapports annuels de s'arracher les cheveux et de crier au sacrilège suicidaire devant la multiplication des barrières douanières et autres mesures qui entravent le "libre-échange" entre nations.
Quant aux relations économiques des USA avec leurs partenaires industrialisés, elles se caractérisent, surtout depuis la dite crise du pétrole (1974-75), par une série de manoeuvres économiques dont le résultat concret est un "pillage". Un pillage dont les fruits sont employés par la puissance dominante essentiellement à financer ses dépenses militaires.
Tout comme l'URSS, les USA portent la plus lourde part des dépenses militaires du bloc ([2] [550]). Depuis Nixon, les USA ont mené au niveau de leur bloc des politiques économico militaires qui leur ont permis d'imposer par la force à leurs vassaux le financement d'une partie de leur politique militaire.
Les violentes augmentations du prix du pétrole (1974-75, 1979-80) dont les USA contrôlent directement ou indirectement l'essentiel de la production et de la commercialisation ont fourni :
1 - à travers le flot de Dollars qui a été déversé sur le Moyen-Orient en provenance du Japon et de l'Europe, les moyens de financer, essentiellement à travers l'Arabie Saoudite la "Pax Americana" ;
2 - à travers l'énorme demande de Dollars provoquée (le pétrole se paie en Dollars) une surévaluation du billet vert qui permettait aux USA d'acheter n'importe quoi, n'importe où, en payant d'autant moins ; c'est une sorte de réévaluation forcée du Dollar.
La politique de taux d'intérêts élevés pratiquée par les USA depuis le début des années 80 se traduit par un résultat analogue. La crise économique fait apparaître une masse de capitaux "oisifs" sous forme argent, qui ne trouvent pas de secteurs productifs rentables où s'investir, le secteur productif se réduisant comme peau de chagrin. Ces capitaux sont contraints, sous peine de disparaître au moins partiellement, de se placer dans des secteurs spéculatifs, de se transformer en capitaux fictifs. Ils se placent là où les taux d'intérêts réels sont les plus élevés. Avec leur politique, les USA attirent chez eux ainsi une masse énorme de capitaux du monde entier et qui doivent, pour se placer, commencer par être transformés en Dollars. Celui-ci devient plus demandé, plus recherché, plus cher : il est surévalué (en janvier 84, certains estimaient la surestimation du prix du Dollar à 40 %). Achetant à bas prix (il faudrait dire : à prix forcé), les USA se paient le luxe du plus grand déficit commercial de leur histoire... sans que pour cela leur monnaie, au moins pour le moment ne soit dévaluée, au contraire. Simultanément, et tout aussi impunément, ils connaissent un déficit des administrations publiques sans précédent (200 milliards de Dollars), soit l'équivalent de leurs dépenses militaires officielles ([3] [551]).
Comme nous l'avons à plusieurs reprises démontré dans des numéros précédents de cette Revue, cette politique ne peut pas être éternelle. Elle constitue une fuite en avant qui prépare de gigantesques explosions financières.
Mener une politique de taux d'intérêt réels élevés veut dire être capable de payer des revenus réels élevés aux capitaux que l'on emprunte. Or, la crise économique, qui dévaste aussi les USA, interdit à ceux-ci de trouver les moyens réels de payer ces intérêts. Quant à la production militaire, la seule qui connaît un véritable développement, elle détruit ces moyens de paiement plutôt qu'elle n'en crée. Les USA paient ces revenus en réalité avec du papier, des Dollars surévalués, qui à leur tour se placent de nouveau aux USA. Au bout c'est la banqueroute du système financier mondial ([4] [552]). Mais les USA n'ont pas véritablement le choix et ils n'en laissent aucun à leurs "alliés". L'économie américaine "soutient" celle de l'Europe occidentale comme la corde soutient le pendu. Tout comme dans le bloc rival, et comme dans l'ensemble de la vie sociale du capitalisme décadent, les rapports économiques sont de plus en plus calqués et soumis aux rapports militaires. Parlant des rapports de l'Europe avec son chef de bloc, Helmut Schmidt - représentant expérimenté du capital allemand - déclarait récemment que Washington avait tendance à "remplacer ou supplanter son leadership politique par un commandement militaire strict, exigeant de ses alliés qu'ils exécutent les ordres sans discuter et dans les deux jours qui suivent" (Newsweek, 9 avril 84).
Dans le bloc de l'Est, l'URSS pille ses vassaux directement, par la pression militaire et policière. Dans le bloc occidental, les USA pillent surtout à travers le jeu des mécanismes économiques du "marché" militairement dominé par eux. Mais le résultat est le même. Le chef de bloc se fait payer sa politique militaire par des prélèvements directs ou indirects sur ses "alliés".
Le retard croissant de l'Europe est en grande partie le résultat de la loi du monde capitaliste, celle du plus fort.
Les faiblesses intrinsèques de l'économie européenne sont celles d'un continent divisé en une multitude de nations, concurrentes entre elles, incapables de dépasser leurs divisions, de concentrer leurs forces pour tenter de résister à la concurrence économique de puissances comme les USA et le Japon.
LE MYTHE DU MARCHE COMMUN
Une des manifestations les plus classiques de la crise économique est la multiplication du nombre de faillites d'entreprises. Celles-ci frappent depuis quelques années les principaux pays du bloc US comme une épidémie qui s'étend de plus en plus rapidement, atteignant des rythmes inégalés depuis la grande dépression des années 30.
Mais les faillites ne sont qu'un aspect d'un phénomène tout aussi significatif : l'accélération des concentrations de capitaux.
Dans la jungle capitaliste en proie à une pénurie croissante de marchés solvables, seules les entreprises les plus modernes, celles capables de produire à meilleur marché peuvent survivre. Mais moderniser l'appareil de production dans la période actuelle nécessite des concentrations de capitaux de plus en plus énormes. Face aux géants américains ou même japonais, les européens divisés, incapables de se mettre d'accord sur autre chose que sur la façon d'attaquer ou de combattre le prolétariat, parviennent de moins en moins à suivre la course technologique. Il est plus facile et plus rentable pour une entreprise européenne en difficulté de s'allier avec des capitaux américains ou japonais qu'avec d'autres européens. Et c'est ce qui se produit dans la réalité, malgré les déclarations ampoulées des prêtres de "l'Europe Unie".
Le "Marché Commun" a été un marché unifié essentiellement pour les capitaux américains et japonais qui ont la puissance et les moyens militaires de contrôler des marchés de cette taille.
La CEE, après des années d'efforts, ne parvient aujourd'hui à planifier et organiser que... la destruction et le démantèlement de l'appareil productif (la sidérurgie n'étant que l'exemple le plus spectaculaire).
Du point de vue des conditions objectives, l'Europe occidentale devient une poudrière sociale parce que la crise économique s'y accélère. Mais pas uniquement à cause de cela. Deux caractéristiques du capitalisme en Europe occidentale rendent plus explosive et profonde la lutte de classe dans cette partie du monde : le poids de l'Etat dans la vie sociale ; la juxtaposition d'une somme de petits Etats-nations.
LE POIDS DE L'ETAT DANS LA VIE SOCIALE REND LA LUTTE OUVRIERE PLUS IMMEDIATEMENT POLITIQUE
Plus l'Etat est présent dans la vie économique, et plus la vie de chacun est directement dépendante de "la politique" de l'Etat. La sécurité sociale, les retraites, les allocations familiales, les indemnités de chômage, l'éducation publique, etc. constituent une part importante du salaire des ouvriers en Europe. C'est une partie directement gérée par l'Etat. Plus ces institutions étatiques sont présentes et plus l'Etat est le patron de tout travailleur. Dans ces conditions, "l'austérité", l'attaque contre les salaires prend une forme directement politique et contraint le prolétariat, lorsqu'il combat, à s'affronter plus directement au coeur politique du pouvoir du capital.
La crise se traduit ainsi, plus en Europe qu'au Japon ou aux USA, par une ouverture plus immédiate du terrain politique pour le combat de classes. Plus qu'ailleurs, ce sont les gouvernements et non les entreprises qui prennent les décisions qui modulent les conditions d'existence des travailleurs. L'austérité en Europe, c'est le gouvernement allemand qui réduit les bourses d'études et les allocations familiales, c'est le gouvernement français qui réduit les indemnités de chômage, c'est le gouvernement espagnol qui propose la réduction du taux des retraites de 90 à 65 %, c'est le gouvernement anglais qui élimine plus d'un demi million de postes de fonctionnaires, c'est le gouvernement italien qui décide de détruire l'échelle mobile des salaires.
Le poids de l'Etat a régulièrement augmenté dans tous les pays du bloc occidental, y compris le Japon et les USA. Si on mesure ce poids par les dépenses totales des administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut, celui-ci est passé au Japon entre 1960 et 1981 de 18 % à 34 % et aux USA de 28 % à 35 %. Mais pendant ce temps, en 1981, ce pourcentage atteignait :
47 % en Grande-Bretagne,
49 % en Allemagne et en France,
51 % en Italie,
56 % en Belgique,
62 % en Hollande,
65 % en Suède.
C'est une des raisons pour lesquelles les luttes ouvrières en Europe occidentale ont et auront tendance à assumer plus immédiatement leur contenu politique.
LA JUXTAPOSITION D'UNE SOMME D'ETATS REND PLUS EVIDENT LE CARACTERE INTERNATIONAL DE LA LUTTE PROLETARIENNE
La nation constitue une institution de base caractéristique du mode de production capitaliste, tout comme le salariat. Elle fut un important progrès historique marquant la fin de 1'endettement féodal. Mais, comme l'ensemble des rapports sociaux capitalistes, elle est devenue une entrave majeure à tout développement ultérieur. Une des contradictions fondamentales qui condamnent historiquement le capitalisme est celle entre la production qui est matériellement réalisée à échelle mondiale et l'appropriation et orientation de celle-ci de façon nationale.
Or, nulle part au monde cette contradiction ne se manifeste de façon aussi criante que dans la vieille Europe occidentale. Nulle part, l'identité d'intérêts des prolétaires de tous les pays, la possibilité et la nécessité de l'internationalisation du combat de classe face à l'absurdité de la crise économique capitaliste, n'apparaissent de façon aussi immédiate.
Cette généralisation de la lutte ouvrière à travers les frontières ne se produira pas du jour au lendemain. Elle ne peut pas être une réponse mécanique aux conditions objectives. Il faudra certainement une longue période de luttes qui se déroulent simultanément dans l'ensemble des petits Etats européens pour qu'au milieu d'une effervescence prérévolutionnaire se forge dans la classe ouvrière la conscience et la volonté d'assumer son être international et révolutionnaire.
La classe ouvrière en Europe possède pour cela l'avantage déterminant d'être la fraction historiquement la plus expérimentée, celle dont les traditions révolutionnaires sont les plus importantes. Ce n'est pas par hasard si c'est en Europe occidentale que se concentrent les principales organisations politiques révolutionnaires du prolétariat, forces qui, pour faibles qu'elles puissent être encore aujourd'hui, ont et auront un rôle déterminant à jouer dans le processus révolutionnaire.
L'effondrement de l'économie capitaliste est un phénomène mondial qui touche tous les pays, créant à l'échelle de la planète les conditions de la révolution communiste. Mais l'Europe occidentale du fait de sa place dans le processus mondial de production, du fait de sa place particulière au sein du bloc militaire américain, du fait de sa structure politique (importance de l'Etat, multiplicité de nations), ainsi que du fait des conditions subjectives d'existence du prolétariat, constitue nécessairement l'épicentre de la révolution mondiale.
RV
[1] [553] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe" Revue Internationale n°31, 4ème trimestre 1982, ainsi que "Critique de la théorie du 'maillon le plus faible'" Revue Internationale n°37, 3ème trimestre 1984.
[2] [554] La relative arriération de 1'URSS par rapport à certains des pays de son glacis, telle la RDA, est le reflet du fardeau de ses dépenses militaires. Les seuls secteurs où l'URSS est en tête dans son bloc sont ceux directement militaires.
[3] [555] Les difficultés croissantes que connaissent actuellement les banques américaines et la multiplication des faillites dans ce secteur sont les premières manifestations du gouffre auquel doit aboutir cette politique.
[4] [556] Idem.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Belgique-Hollande:crise et lutte de classe : Rapport du 5ème Congrès d'Internationalisme
- 4077 reads
Si nous avons décidé de publier dans la Revue Internationale un rapport consacré à la situation économique, politique et sociale dans ces deux pays d'Europe, c'est que justement celle-ci n'a rien de particulier ou de spécifique, mais exprime de façon exemplaire ce que subissent de façon croissante les prolétaires dans tous les pays industrialisés.
L'austérité draconienne dans ces deux pays qui, il y a quelques années encore, étaient vantés pour leur niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe et pour leur niveau de"protection sociale" enviable, est un indice de l'évolution de la crise économique au coeur du capitalisme mondial, de la force de l'attaque des conditions de vie des ouvriers. De même, la capacité de riposte ouvrière à cette attaque et les efforts d'adaptation politique de la bourgeoisie nous fournissent des indications précieuses concernant le développement du rapport de force entre les classes,
Nous estimons donc que ce texte est une excellente illustration de notre démarche générale appliquée à des situations concrètes et qu'il démontre clairement combien l'approfondissement de notre cadre d'analyse par rapport au rôle de la gauche dans l'opposition, le syndicalisme de base, le cours historique ou le processus de généralisation de la lutte de classe, basé sur les leçons de la vague de lutte précédente, se révèle indispensable pour appréhender la situation sociale actuelle.
Le 4ème Congrès de la section du CCI en Belgique (février 1982) se déroula deux mois après le putsch de Jaruzelski en Pologne, en pleine contre-offensive de la bourgeoisie internationale, au nouent où la classe ouvrière, déboussolée, marquait le coup.
Dans ce cadre, ce n'était nullement un hasard si la bourgeoisie belge, après des années de tergiversations et sous la pression directe du bloc, venait d'aligner sa politique sur celle du bloc et engageait l'attaque directe contre la classe ouvrière. La résolution sur la situation nationale, adoptée lors du Congrès, décrivait adéquatement la stratégie mise en place par la bourgeoisie :
"Les élections du 8 novembre 81 légaliseront ce nouvel ordre de bataille de la bourgeoisie face à la lutte de classe, le pas qualitatif dans l'attaque frontale du prolétariat est franchi :
a) une droite dure et arrogante au pouvoir, bien ancrée au pouvoir dans une perspective à long terme et parlant le langage de la vérité,
b) un partage essentiel des tâches au sein de l'appareil politique de la bourgeoisie entre une droite dure au gouvernement et une gauche dans l'opposition face à la lutte de classe, ainsi que diverses sous divisions au sein du gouvernement et dans l'opposition, permettant plus de souplesse dans le développement des mystifications,
c) une gauche dans l'opposition aux accents radicaux dont les thèmes actuels ne sont plus ceux d'une, équipe responsable développant un langage d'illusions dans la perspective d'un retour au gouvernement, mais dont la seule fonction aujourd'hui est de faire dérailler les luttes, face aux réactions engendrées par l'austérité draconienne" (Résolution sur la situation en Belgique et aux Pays-Bas, février 82).
Ainsi, la résolution indiquait clairement dès février 82 les axes fondamentaux de la politique de la bourgeoisie en Belgique pour les deux années à venir. En Hollande, la situation paraissait encore moins tranchée et la gauche venait de revenir au pouvoir. Toutefois, dans le rapport sur la situation aux Pays-Bas, nous soulignions que "L'adhésion du PVDA (SD) au gouvernement n'était rien d'autre qu'une solution de secours temporaire" (Idem), ce qui se confirma bien vite dès la fin de 82. Globalement donc, pour les deux pays, la stratégie de la bourgeoisie dans la période écoulée se caractérisa par une austérité draconienne et le travail de sape de la gauche dans l'opposition.
Sous la pression inexorable de la crise et de l'austérité, l'affrontement entre les classes reprit de plus belle au sein même des pays industrialisés. La Belgique et la Hollande se retrouvèrent au premier rang dans la reprise de la lutte de classe. C'est dans cette perspective que nous évaluerons les résultats de la stratégie de la bourgeoisie, autant sur le plan économique que politique, et son impact sur le développement de la lutte prolétarienne.
BELGIQUE DEUX ANS D'AUSTERITE ET DE "SACRIFICES"
"L'économie belge connaît depuis plusieurs années une situation caractérisée par des déséquilibres multiples et accusés. Ceux-ci trouvent leur origine dans les effets de la crise internationale à laquelle la Belgique est particulièrement sensible en raison de son degré exceptionnel d'ouverture sur l'extérieur. Ils ont également des causes internes, parmi lesquelles les plus importantes tiennent d'une part, à une adaptation insuffisante de la production à l'évolution de la demande intérieure et extérieure et, d'autre part, à un système rigide de formation des revenus qui a conduit à une modification importante dans le partage du revenu national au cours des années 70," (Etudes économiques de l'OCDE, Belgique Luxembourg, mai 83, p.9).
En clair, depuis la fin des années 70, la Belgique se trouve dans une situation économique particulièrement difficile causée :
a) par l'approfondissement de la crise mondiale du capitalisme que la Belgique ressent plus directement et plus brutalement que d1autres à cause de sa dépendance des marchés internationaux, vu l'exiguïté de son marché intérieur.
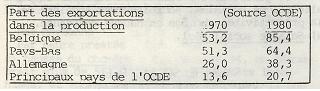
b) par les hésitations de la bourgeoisie belge à mettre en place une politique économique et sociale rigoureuse visant à rationaliser l'économie et « à réduire considérablement les salaires et les allocations sociales.
Aussi, dos son installation, l'action du gouvernement Martens-Gol sera centrée sur :
- le "transfert du revenu des ménages vers les entreprises" (sic !), réalisé par une politique des revenus avec un blocage partiel de l'indexation associé à une dévaluation de 8,5% du franc au sein du SME, et une politique budgétaire restrictive
(l'objectif étant de réduire le déficit public en 82 et 83 chaque fois d'un montant équivalent à 1,5% du PNB, de façon à diminuer le prélèvement des administrations sur les disponibilités de financement de l'économie (Etudes économiques de l'OCDE, p.9).
- Une rationalisation des secteurs non adaptés à "l'évolution de la demande intérieure et extérieure" : sidérurgie (Cockerill-Sambre), chantiers navals (Cockerill-Hoboken, Boel), mines du Limbourg, textile (Fabelta, Motte), métallurgie (Nobels-Peelman, Boomse Metaalwerken, Brugeoise et Nivelles). Comme le reconnaissait cyniquement Gardois, le "conseiller spécial" du gouvernement pour la sidérurgie, il ne s'agit, à travers des fusions, des fermetures partielles, des aides de l'Etat conditionnées par des baisses conséquentes des salaires, que d'une "liquidation socialement camouflée".
Quels sont, après deux ans d'application, les résultats de cette politique d'austérité draconienne ? Une telle observation est importante dans la mesure où, de par sa situation au début des années de vérité, la Belgique a servi de "laboratoire" à la bourgeoisie occidentale pour tester la façon d'imposer une austérité généralisée et une attaque globale contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
La situation de l'économie belge
Malgré les deux années de restriction et de "sacrifices", les indicateurs économiques montrent clairement que la situation économique est loin d'être brillante, comme l'illustre bien la croissance du produit intérieur brut :
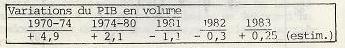
Plus explicite encore est le graphique de la production industrielle qui révèle pratiquement une stagnation permanente de celle-ci depuis 1974.
Même par rapport à l'ensemble des autres pays industrialisés, on ne peut guère dire que l'économie belge a rattrapé le terrain perdu. On pourrait tout au plus parler d'une stabilisation dans la récession.
Cette constatation générale sera étayée en examinant de plus près quatre facteurs permettant de juger plus en profondeur de la santé de l'économie belge :
a) la compétitivité : pour le gouvernement, c'est a ce niveau que se trouve la clé du problème et la solution de la crise : en rendant à l'industrie sa compétitivité, la production pourra reprendre et le chômage se résorber. Et à première vue, en effet, les résultats de la politique gouvernementale semblent spectaculaires.
Toutefois, trois constatations atténuent fortement les conséquences de ce redressement de la compétitivité :
- le redressement de la compétitivité est avant tout lié à la réduction des coûts salariaux et, d'une manière générale, à la diminution des heures travaillées, suite à l'extension du chômage et non pas vraiment au développement de la production ou des exportations (cf. infra);
- comme les autres pays industrialisés ont pris depuis lors des mesures similaires (cf. Rapport sur la Hollande), l'amélioration de la compétitivité sera rapidement annulée.
- la restauration de la position concurrentielle et de la rentabilité des entreprises n'a aucunement conduit à une reprise des investissements productifs. La chute des livraisons de biens d'équipement au marché intérieur ainsi que celle du volume de la formation brute de capital fixe le confirment : la chute des investissements continue.
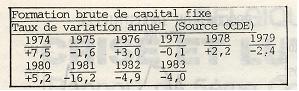
Face à l'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé et au sous-emploi de l'appareil productif, la bourgeoisie préfère utiliser ses capitaux pour la spéculation (or, monnaies, matières premières). Les investissements industriels qui se font malgré tout visent alors surtout à la rationalisation : "En moyenne, les entreprises semblent avoir été surtout soucieuses, face à la faiblesse persistante de la demande et au coût toujours élevé du crédit, de restructurer leurs bilans et d’accroître leurs taux d’auto financement. " (Etudes économiques de l'OCDE, p. 31).
b) les exportations : ici aussi, on constate une hausse de 2% des exportations en 1983.
Mais la balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) est toujours déficitaire. De plus, l'amélioration s'explique :
- par la baisse des importations, causée par la dévaluation et la politique d'austérité
- par la dévaluation qui a rendu les produits belges moins chers à l'exportation.
Toutefois, dans la mesure où la Belgique exporte essentiellement vers d'autres pays industrialisés (83 % vers l'OCDE dont 70 % vers la CEE contre 2 % vers le COMECON et 5 % vers l'OPEP) et que ceux-ci subissent de plus en plus l'austérité et limitent en conséquence leurs importations, les conséquences pour les exportations belges risquent d'être désastreuses.
c) 1'inflation : malgré la stagnation de la production industrielle et la diminution des salaires et de la consommation (cf. infra), l'inflation, après un net recul à la fin des années 70, reprend nettement.
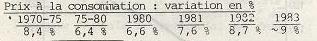
d) déficit et finances publiques : le déficit de l'Etat belge reste catastrophique : 16,2 % du PNB en 1981, 15,8 % en 1982 et,"d'après les estimations gouvernementales, 15,5 % en 1983, alors que la moyenne européenne est de 7 %. Le déficit courant de la Belgique se chiffrait en 1982 à 190 milliards de FB, tandis que la charge des intérêts de la dette représente aujourd'hui déjà 3 % du PNB et 20 % des recettes courantes des administrations.
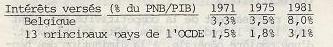
En outre, comme une grande partie de la dette (dette extérieure) est calculée en dollar, la hausse récente de la monnaie US aura des conséquences catastrophiques sur la charge des intérêts.
La "réduction de la charge sociale"
S'il fallait définir succinctement les deux années écoulées, on retiendrait sans nul doute l'attaque brutale du niveau de vie de la classe ouvrière. Certes, dés les années 70, le niveau de vie de la classe ouvrière avait été entamé, mais cela s'était fait de manière détournée, par une hausse des impôts directs et indirects, par un accroissement de la productivité (cf. tableau sur la productivité) et par l'inflation galopante. Mais depuis les "années de vérité", et plus particulièrement depuis la mise en place de la stratégie actuelle de la bourgeoisie (droite au pouvoir, gauche dans l'opposition), l'attaque est brutale, massive et généralisée : baisse des salaires et des allocations sociales, accroissement accéléré de la productivité, chômage en hausse constante, a) Salaire social réel,
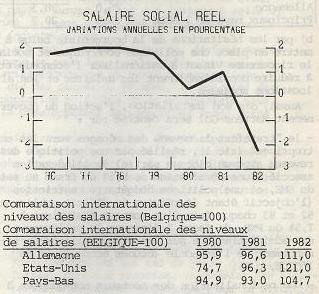
" Au total, les experts belges estiment que, sous l'hypothèse d'une augmentation des prix à la consommation de 7,5 % en 1983 (8,7 % en 1982), l'incidence des mesures de freinage des salaires serait de l'ordre de 7,5 % entre décembre 1981 et décembre 1983, dont 4,5 % au cours de 1982". (Etudes économiques de l'OCDE, p. 16).
Comme l'inflation pour 1983 se chiffrerait, non à 7,5 % mais à plus ou moins 9 %, la baisse des salaires "officielle" devrait s'établir au-delà de 8 %. Pour juger de l'importance de l'attaque, on peut encore relever que, dans l'industrie manufacturière et calculé par rapport aux 15 principaux pays de l'OCDE, l'indice des coûts unitaires relatifs de main d'oeuvre s'est situé en 1982 très en deçà de son niveau en 1970. Parallèlement on assiste à une baisse de la consommation privée, bien illustrée par l'effondrement du volume des ventes au détail :
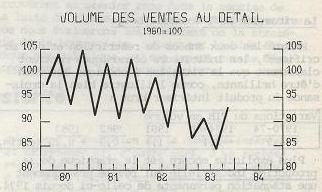
b) 1'augmentation de la productivité : l'amélioration de la compétitivité par la dévaluation et la baisse des salaires n’a nullement débouché sur une baisse du chômage, qui a continué à monter (cf. infra), mais sur une forte augmentation de la productivité à travers une rationalisation (meilleur taux d'utilisation de l'appareil productif) (cf. tableau n° 7) et une mécanisation et une automatisation intensive.
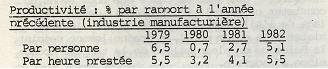
c) hausse du chômage : fin janvier 84, on dénombrait plus de 523.000 chômeurs complets indemnisés, et encore ce chiffre nous donne-t-il une idée fausse de la situation réelle. En vérité, d'après l'OCDE, le nombre de personnes sans emploi (chômeurs indemnisés et autres) s'élevait en mars 83 à environ 600.00, le rythme de progression du chômage s'étant à peine infléchi, dépassant 16 % en mars 83 (contre 20 % pour les 12 mois précédents).
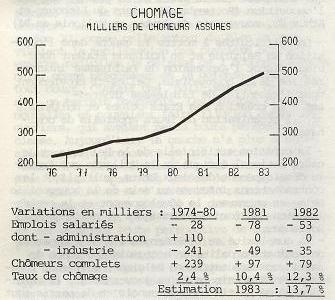
En outre, environ 180.000 personnes bénéficiaient d'un programme public d'aide à l'emploi (chômeurs mis au travail, cadre spécial temporaire, etc.) ou d'une pré pension de sorte crue, au total, près de 19 % de la population active se trouvait en dehors du circuit normal de 1'emploi.
En conclusion, l'austérité draconienne imposée par le gouvernement Martens V a représenté la première attaque directe généralisée contre l'ensemble de la classe ouvrière en Belgique sans qu'elle n'ouvre la voie à une reprise de l'économie qui "ne peut reposer que sur la demande extérieure" (OCDE, p. 46). L'amélioration relative de la compétitivité de l'industrie belge n'est qu'une donnée temporaire et passagère que les programmes d'austérité et de réduction de salaires dans les autres pays industrialisés réduira rapidement à néant. La crise générale du capitalisme ne laisse aucun répit à la bourgeoisie belge en dehors d'un redoublement des attaques contre la classe ouvrière.
HOLLANDE LE CARACTERE INELUCTABLE DE L'PIPASSE ECONOMIQUE
Il y a deux ans, dans le sillage de la locomotive allemande, les Pays-Bas passaient encore pour une des économies les plus fortes, alors qu'aujourd'hui, ils connaissent le chômage le plus étendu et, après la Belgique, le déficit le plus important des pays industrialisés. Les économistes n'y voient plus le bout du tunnel, mais prévoient un long chemin passant par plusieurs législatures qui aboutiraient peut-être à long terme, et ils avancent alors prudemment la date de ... 2005 !
En effet, au cours de 82 et 83, les indicateurs se sont brusquement détériorés :
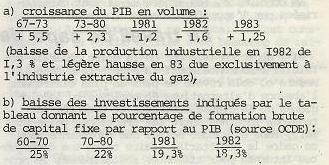
De plus, le taux d'utilisation de l'appareil productif est tombé en 83 à 77 % de la capacité totale de production, le même niveau qu'en 75.
Le taux d'utilisation était en 82 inférieur de 8 % à celui de 73 et de 6,5 % à celui de 79. Le déficit budgétaire qui augmentait de 6,7 % en 81 a augmenté de 9,4 % en 82 et en 83, on prévoit une hausse de 12,5 %. Le graphique n° 9 montre dès lors l'accroissement fulgurant de la dette de l'Etat hollandais, augmentant de 19 % en 81, de 22 % en 82, et atteignant la somme impressionnante de 144,7 milliards de florins.
Les chiffres du commerce extérieur semblent infirmer les données précédentes, puisque l'excédent de la balance des paiements courants a augmenté de 9,8 % en 82 et de 12 % en 83. Ces chiffres n'ont pourtant qu'une signification limitée parce qu'ils s'expliquent surtout par le développement des ventes de gaz naturel et par le recul des importations qui résulte de la chute de la consommation nationale. En vérité, l'industrie hollandaise est en moins bonne posture. " Quelques multinationales puissantes : Philips, Royal Dutch Schell, Unilever ont fait sa réputation. Mais sa structure est faible, peu présente dans les créneaux les plus porteurs. Le déclin est complet dans le textile, la confection, les chantiers navals. Au fil des ans, ce tissu industriel s1est effiloché. Le florin fort et la forte propension à investir à l’étranger y ont contribué." (Le Monde du 5.2.84, p. 9). En conséquence, dès la fin de 82, l'attaque directe contre la classe ouvrière s'accentua en Hollande, après la réorganisation par la bourgeoisie de ses forces politiques avec le passage de la gauche dans l'opposition et la venue de la droite au pouvoir (gouvernement Lubbers). Si la stagnation et le léger recul des salaires était déjà un fait dès le début des années 80 (1972 : 100 - 1980 : 103,9 -1981 : 101,2 - 1982 : 100,1) grâce à un premier gouvernement de droite (Van Agt et Wiegel) et aux mesures plus indirectes du gouvernement de centre-gauche (Van Agt et Den Uyl) en 82, les attaques contre le niveau de vie du prolétariat vont pleuvoir à partir de la fin 82 :
- baisse des salaires de 3,5 % pour la classe ouvrière en 83 et même de 5 % pour les fonctionnaires
- baisse de 3,5 % des salaires des fonctionnaires et des allocations en 84
- diminution des salaires et des allocations de 15 % prévue entre 84 et 86.
En parallèle, on assiste à une véritable explosion du chômage :
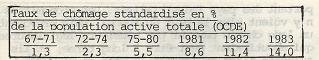
En quelques années, les Pays-Bas ont largement dépassé la moyenne de l'OCDE qui est de 10 %.
En conclusion, les années 82-84 sont caractérisées par l'approfondissement inéluctable de la crise économique qui n'épargne plus aucun pays et par le déclenchement d'une attaque sans précédent contre le niveau de vie de la classe ouvrière. C'est dans ce cadre que nous avons pu constater comment la Hollande qui, dans le sillage de l'Allemagne, semblait encore mieux résister à la crise en 81, a graduellement rejoint la Belgique en plein milieu de la tempête économique et sociale.
Si l'approfondissement de la crise générale affaiblit fondamentalement la bourgeoisie dans la mesure où cela révèle de plus en plus clairement l'absence d'alternatives économiques ou idéologiques de la classe dominante et exacerbe les tensions internes entre ses fractions, celle-ci sait face au danger mortel crue représente dans ce cadre le prolétariat, faire taire ses divergences internes pour affronter solidairement le prolétariat.
Les solutions gui lui font défaut sur le plan économique sont dès lors compensées par une remarquable habileté sur le plan politique. Chaque jour, la bourgeoisie démontre qu'elle est capable de défendre avec beaucoup de hargne et d'intelligence ses privilèges et sa domination. Dans les principaux pays industrialisés, la carte maîtresse du dispositif bourgeois visant à imposer l'austérité généralisée et à faire accepter les préparatifs de guerre est la mise en place de la gauche dans l'opposition. Cela s'est parfaitement illustré en Belgique et en Hollande.
LA NECESSITE DE IA GAUCHE DANS L'OPPOSITION EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE
Depuis la reprise des luttes ouvrières en 1978, le CCI avait mis en avant la nécessité de la gauche dans l'opposition pour briser les luttes de l'intérieur, mais l'expérience nous a appris qu'il y a, entre la nécessité objective pour la bourgeoisie et sa capacité à faire tout ce qui est nécessaire pour la satisfaire, un monde de difficultés à franchir. Si en Belgique et en Hollande, la bourgeoisie a réussi adéquatement à adapter son dispositif de défense aux nécessités de la période, le passage de la gauche dans l'opposition s'est toutefois caractérisé par une grande difficulté à le réaliser concrètement :
- en Belgique, dès 1980, une série de gouvernements "de transition" ont essayé de réaliser les conditions nécessaires au passage de la gauche dans l'opposition (cf. Rapport au 50 Congrès), mais ce n'est qu'à la fin 81 qu'elle pourra avoir lieu;
- en Hollande, la droite était venue au pouvoir dès 78 pour mener une politique d'austérité (gouvernement chrétien-libéral Van Agt et Wiegel). Pourtant, de la mi-8I à la mi-82, la gauche revient au pouvoir, et ceci nettement à contre-courant des nécessités nationales (les socialistes ont perdu les élections, une austérité draconienne doit être imposée) et internationales (crise et austérité se généralisent à tous les pays). Ce n'est qu'après environ un an de paralysie gouvernementale accrue et de dé crédibilisation croissante de la gauche que la bourgeoisie trouva le moyen d'en revenir à la situation du début 81.
Ces atermoiements et ces hésitations n'étaient pas l'expression d'une meilleure résistance à la crise, comme certains l'affirmaient.
- Il s'agit des deux pays les plus axés sur l'exportation. Ils ressentent dès lors plus vite et plus fortement que d'autres la crise mondiale de surproduction.
- Malgré les ressources énergétiques propres (gaz naturel), la Hollande a un tissu industriel en dé clin, ce qui amène dès 78 le gouvernement à prendre des mesures d'austérité et de rationalisation (automobiles DAF, textile, chantiers navals).
- La crise provoque dès 79 des réactions ouvrières qui indiquent que la place de la gauche est dans l'opposition (Rotterdam 79, mines du Ljmbourg et Athus 80, mouvements de luttes en Wallonie en 81).
Les difficultés à mettre la gauche dans l'opposition en Belgique et en Hollande étaient donc bien plutôt l'expression de faiblesses internes réelles de la bourgeoisie. Celles-ci proviennent pour l'essentiel de faiblesses inhérentes à la création des Etats belges et hollandais et à l'organisation de leurs appareils de domination.
- La création artificielle de la Belgique et le cadre national étriqué de la Hollande ont freiné le développement des deux Etats, multipliant les contradictions internes au sein de la bourgeoisie belge et entravant le développement et la centralisation des forces économiques et politiques en Hollande.
- La complexité et l'hétérogénéité de l'appareil de domination politique bourgeois (présence de partis communautaires en Belgique, obligeant longtemps à maintenir le PS au gouvernement, la multiplicité de partis confessionnels et de partis tout court en Hollande, séquelles du développement historique de ces pays, rendait toute manoeuvre de la bourgeoisie fort délicate) a retardé ou empêché pendant un certain temps que la bourgeoisie mette la gauche là où elle pouvait lui rendre les meilleurs services.
Toutefois, malgré ces difficultés internes, les bourgeoisies belge et hollandaise ont montré qu'elles avaient une assise suffisamment solide et une expérience assez riche pour développer, sous la pression économique et face au danger de la lutte de classe, un dispositif redoutable afin d'encadrer et de mystifier les luttes.
LE ROLE DE LA CAUCHE ET LA REPRISE DES LUTTES
Alors que le développement de la crise amène souvent à identifier notre période aux années 30, la comparaison entre le travail de la gauche dans ces deux périodes en Belgique révèle le caractère fondamentalement différent des deux périodes historiques.
Dans les années 30, face à la crise et aux luttes ouvrières (grèves insurrectionnelles de 1932), la gauche (Parti Ouvrier Belge) avance le plan de travail (ou Plan De Man) pour "sortir la Belgique de la crise". De cette façon, la classe ouvrière est massivement mobilisée derrière des perspectives de capitalisme d'Etat (programmes de nationalisations) et est amenée à soutenir l'action parlementaire du P0B et du PCB "pour combattre le fascisme".
Aujourd'hui, la tactique et le travail de la gauche sont fondamentalement différents :
- son langage n'est pas celui du réalisme, de la conciliation nationale, de l'union sacrée. Au contraire, elle se veut critique, radicale, ouvriériste même. Les personnalités équivoques sont éliminées (Cools, Simonet), tandis qu'elle ne fait aucun effort pour retourner au gouvernement;
- sa tactique n'est pas offensive, mais défensive. Loin de tenter de mobiliser les ouvriers derrière la capital national, la gauche essaye aujourd'hui d'empêcher par tous les moyens que la lutte se développe.
Alors que dans les années 30, l'encadrement de la classe ouvrière était pris directement en charge par le POB lui-même, la commission syndicale n'étant qu'un appendice du parti, ce sont aujourd'hui les syndicats qui sont aux avant-postes, dans la lutte même, pour tenter de la dévoyer. Les campagnes de la gauche dans les années 30, comme celle autour du Plan De Man, visaient la mobilisation des ouvriers pour des mesures radicales de défense de l'économie nationale, comme précurseur de la défense nationale tout court. C'était une "politisation" des luttes sur un terrain bourgeois. Les mesures étaient nouvelles et pouvaient faire illusion auprès des ouvriers, qui avaient perdu toute perspective de classe. Aujourd'hui, la gauche n'a plus d'autre alternative à proposer, qu'une austérité mieux "emballée", plus "équitable". Ses plans ne font plus illusion après des années de crise, de ministres socialistes et d'austérité "raisonnable". C'est pourquoi ses efforts se concentrent sur le terrain syndical, pour diviser la classe ouvrière en lui enlevant toute perspective de lutte et pour casser ainsi sa combativité.
Ce comportement différent de la gauche trouve son explication dans la dynamique diamétralement opposée qui caractérise le rapport de force entre les classes en 1930 et aujourd'hui. A la fin des années 20, la classe ouvrière était battue au niveau international et la gauche avait pour but, dans les pays où les prolétaires n'avaient pas été écrasés physiquement, d'embrigader la classe ouvrière pour une nouvelle guerre mondiale derrière le drapeau de 1'anti-fascisme. Aujourd'hui, la lutte contre l'austérité d'un prolétariat non défait tend à l'unification sur le plan national comme sur le plan international, et la gauche essaye d'empêcher son développement et de déboussoler la classe ouvrière.
LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION FACE AUX LUTTES
Tout au long de ces deux dernières années, la classe ouvrière, en Belgique comme en Hollande, s'est constamment heurtée à la gauche dans l'opposition et a fait souvent l'amère expérience de ses techniques raffinées de sabotage au sein des luttes. Ces dernières sont axées sur trois axes centraux :
- Occuper le terrain : la force de la gauche et des syndicats ne résulte pas de perspectives originales ou de solutions nouvelles avancées face à l'approfondissement de la crise. Leur force, c'est leur organisation au sein de la classe, leur appareil d'encadrement des ouvriers, le poids des idées reçues pesant sur le prolétariat,' en parti culier la conviction encore répandue qu'une lutte ne peut se développer, s'organiser, être gagnée qu'à travers l'organisation syndicale. C'est à travers cette occupation du terrain social qu'ils peuvent peser lourdement sur le développement et l'orientation des luttes.
- Isoler ou fractionner la réponse de la classe ouvrière : face à la généralisation de l'austérité et des attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière, la gauche peut désamorcer la puissance du mouvement en empêchant l'extension quantitative de la lutte (limiter à l'usine, au secteur, à la région). A ce propos, il faut constater que la gauche utilise avec beaucoup de raffinement les contradictions internes au système, de fausses oppositions ou diverses campagnes idéologiques de la .bourgeoisie pour diviser ou noyer les luttes prolétariennes :
. Les oppositions régionales (Flandres, Wallonie) sont systématiquement mises en avant pour entraver l'extension des luttes à la Belgique entière
. Le féminisme est exploité en Hollande pour diviser et opposer les travailleurs de sexes différents, tandis que le pacifisme a été directement utilisé pour briser la grève des fonctionnaires..
Toutefois, l'isolement et l'encadrement de la lutte peuvent aussi être réalisés en désamorçant la dynamique même du combat. Ainsi, pendant l'automne 83 en Belgique, c'est par le biais d'une "généralisation" formelle mais vide de la grève que les syndicats parvinrent à prendre le contrôle du mouvement et à le vider de sa substance. En réalité, le travail d'éparpillement tend avant tout à séparer l'extension du mouvement de son auto organisation, qui sont deux composantes indispensables de son développement. Pour ce faire, on peut agir sur différentes facettes de la lutte :
. Au niveau des moyens de lutte : grèves passives, occupations, autogestion, "nouveaux moyens de lutte" (grève de l'épargne, etc.);
. Au niveau de la préparation des luttes : mettre l'accent sur les préparatifs techniques (tracts, piquets de grève, etc.) et financiers;
. Au niveau de l'organisation des luttes, placées sous le contrôle des syndicats ou de comités de grève syndicaux dirigés par des permanents syndicaux et des syndicalistes de base;
. Au niveau des perspectives de la lutte : placer la lutte dans la logique du système et de sa crise : se battre "pour une véritable concertation", le sauvetage de son usine, sa région, pour des "sacrifices équitables", pour "faire payer les riches", pour la nationalisation, ...
- Enfermer le mécontentement ouvrier dans le cadre du syndicalisme : les syndicats, comme nous l'avons vu, jouent un rôle central dans la stratégie de la gauche dans l'opposition et ce rôle est encore accentué en Belgique et en Hollande par la dé crédibilisation subie par les partis socialistes à cause des difficultés internes de la bourgeoisie. Ceci provoque une "usure" accélérée des directions syndicales et explique, avec la combativité ouvrière persistante l'importance croissante du syndicalisme de base qui a joué, en Belgique comme en Hollande, pendant les deux années passées, un rôle central dans les luttes importantes qui ont éclaté (Rotterdam 79, vagues de luttes de 81 et 82 en Belgique, grève des fonctionnaires en Belgique et en Hollande en 83). La fonction essentielle du syndicalisme de base a été confirmée dans la période écoulée:
. Par la concentration de toutes les forces gauchistes sur ce travail syndical à la base,
. Par des tentatives de coordination des forces et des conceptions syndicalistes de base sur un plan national ("Vakbond en Demokratie" en Belgique, "Solidariteit" en Hollande).
Dans les luttes actuelles, le rôle du syndicalisme de base est double :
. Prendre le contrôle des luttes radicales pour empêcher quelles aillent trop loin, donc pour saboter, derrière un vocabulaire radical, derrière des actions spectaculaires (affrontements avec la police : sidérurgie en 82), leur extension et leur radicalisation;
. Ramener les "brebis galeuses" dans le giron syndical en leur faisant croire que "les syndicats, c'est nous", tandis que par leurs discours radicaux, leurs actions dures, leurs conflits continuels avec les directions syndicales, ils gagnent la confiance des ouvriers combatifs (Rotterdam, 79 et 82, lutte dans la fonction publique en Belgique et en Hollande, 83).
Dès à présent, le syndicalisme de base s'impose comme une des armes les plus pernicieuses de la bourgeoisie, maintenant que les syndicats traditionnels seront de plus en plus souvent contestés et dépassés par la lutte ouvrière. De par sa flexibilité qui peut même s'accommoder d'un antisyndicalisme de façade, il sera utilisé par la bourgeoisie jusque dans la période révolutionnaire au sein des conseils pour dévoyer le prolétariat de son combat révolutionnaire vers la logique syndicaliste et gestionnaire. Son utilisation, fréquente dès à présent, si elle permet à la bourgeoisie pour le moment de contrôler les mouvements, d'étouffer toute perspective de lutte révolutionnaire et d'entraver l'auto organisation de la classe, marque l'affaiblissement historique de la bourgeoisie et annonce, à long terme, la dé crédibilisation de ses armes mystificatrices les plus radicales.
Le prolétariat face à la gauche dans l'opposition
Les tergiversations de la bourgeoisie et le retard accumulé dans la prise de mesures draconiennes qui ont nécessité un rattrapage brutal, le rôle de "laboratoire" que la Belgique a joué durant ces années en étant la pointe la plus avancée dans l1attaque de la bourgeoisie mondiale contre les conditions de vie des ouvriers dans les pays occidentaux, ont profondément marqué les conditions de la lutte de classe. Attaquée durement et presque continuellement, la classe ouvrière a été obligée de réagir et l'a fait régulièrement (hiver 81, février-mars 82, septembre-octobre 83). De ce fait, les luttes ouvrières en Belgique et plus tard en Hollande ont exprimé d'une façon particulièrement édifiante les obstacles et les problèmes auxquels la classe ouvrière mondiale est confrontée, surtout dans les pays industrialisés, et qu'elle devra surmonter, mais aussi la dynamique et la force du mouvement.
Dès février 1981, des grèves massives éclatent dans toute une série d'usines (Caterpillar, British Leyland, FN) dans la sidérurgie et les transports publics, aussi bien en Flandres qu'en Wallonie, contre les mesures d'austérité prises par un gouvernement où des ministres socialistes occupent des postes-clés (économie, travail). Elles montrent à la bourgeoisie combien le temps presse, combien les nécessités de l'heure (austérité, attaque directe de la classe ouvrière) exigent une stratégie appropriée. En novembre 81, après des élections anticipées, la droite est au pouvoir, et la gauche dans l'opposition démontrera déjà quelques semaines plus tard sa redoutable efficacité.
LES LUTTES DE FEVRIER-MARS 1982 : LE DESARROI FACE AU REPLI DES LUTTES
Le mouvement de février-mars 82 qui mobilise plusieurs dizaines de milliers de travailleurs autour des sidérurgistes à Liège, à Charleroi et dans le Hainaut contre la réduction draconienne des salaires accompagnant la dévaluation, est sans conteste le mouvement le plus important en Belgique depuis la grève générale de 60-61.
Eclatant quelques semaines après le putsch en Pologne, il démontre, par la grande combativité, par la tendance à une lutte générale, dépassant les secteurs ou les revendications particulières face à l'attaque générale que subit le prolétariat, par la tendance à exprimer la spontanéité de la classe et à remettre en cause l'encadrement syndical, par l'affrontement avec l'Etat et en particulier avec les forces de l'ordre, que la défaite en Pologne n'a pas fondamentalement entamé le potentiel de combativité du prolétariat mondial et que le désarroi de la classe ouvrière face à la contre-offensive idéologique de la bourgeoisie n'est pas éternel et ne traduit pas de recul profond et de longue durée de la lutte de classe.
Toutefois, le désarroi général du prolétariat après la défaite en Pologne, l'inexpérience face aux manoeuvres de la gauche dans l'opposition, vont profondément- marquer les luttes de 82 et ne favorisent pas le développement des luttes et la clarté de leurs perspectives. Ainsi, il faut relever :
- tout d'abord l'isolement de la lutte en Belgique, face à un calme social plat dans les autres pays industrialisés, plongés en plein dans les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur la Pologne
- la limitation du mouvement qui s'est développé, autour des actions des sidérurgistes, à la Wallonie, tandis que les syndicats avaient réussi à désamorcer toute velléité de résistance en Flandres (cf. la longue lutte à Boel et Tamise)
- la facilité relative avec laquelle les syndicats entravent l'extension du mouvement par leurs tentatives de division ouvertes : entre syndicats, entre secteurs, entre régions (Liège contre Charleroi) , permettant à la bourgeoisie de contrôler fermement le mouvement et de conserver un discours particulièrement arrogant sans céder sur quoi que ce soit.
LES LUTTES DE SEPTEMBRE-NOVEMBRE 1983 : AU COEUR DE LA REPRISE DES LUTTES
La longue lutte des services publics en Belgique (septembre octobre), puis en Hollande (octobre-novembre) constitue le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis les combats de Pologne en 1980. Elle reprend les caractéristiques positives du mouvement précédent, mais elle profite de l'accumulation des conditions objectives permettant une reprise internationale de la lutte de classe. :
- longue période d'austérité, de chômage et d'attaques contre la classe ouvrière, qui se sont généralisés à tous les pays industrialisés sans que cela n'amène une amélioration des conditions économiques
- la classe ouvrière en Belgique a fait l'expérience de deux ans de gauche dans l'opposition et de ses mystifications tandis que cette expérience s'est étendue aux pays environnants (la gauche dans l'opposition aux Pays-Bas et en Allemagne)
- les luttes en Belgique et en Hollande s'inscrivent dans une nouvelle vague internationale de combats contre le capitalisme.
Cette maturation des conditions objectives de la reprise de la lutte de classe est confirmée par le développement des caractéristiques suivantes au sein même des combats en Belgique et en Hollande :
- Une tendance vers des mouvements unitaires et massifs impliquant un grand nombre d'ouvriers et touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays. En 1983, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, c'est l'ensemble des services publics, soit 1/5 de la population active, qui lutte. Les travailleurs de toutes les centrales syndicales sont impliqués. En Hollande, jamais dans l'histoire de la classe ouvrière, les services publics n'avaient combattu à cette échelle, tandis qu'en Belgique, le mouvement dépassait la division entre la Flandre et la Wallonie et a même failli s'étendre au privé.
- Une tendance à un surgissement spontané des luttes exprimant, surtout à leur début, un certain débordement des syndicats. C'est spontanément et contre les directives syndicales que les conducteurs de trains en Belgique, les conducteurs de bus et de trains en Hollande, lancent la grève. C'est toujours spontanément que d'autres secteurs (postes, transports communaux) rejoignent le combat en Belgique. La puissance de l'extension peut être mesurée au fait que :
. Les syndicats sont obligés d'entériner et en même temps d'élargir la grève d'une façon formelle et d'adopter une attitude de "laisser faire" à la base pour reprendre le contrôle du mouvement;
. Les syndicats ont eu toutes les peines du monde pour arrêter le mouvement en Hollande.
- Une tendance vers une simultanéité croissante des luttes au niveau international. Les mouvements en Belgique et en Hollande éclatent dans les mêmes secteurs et environ au même moment, tandis que simultanément il y a en France la grève des postes, et ceci dans deux pays voisins à forte concentration ouvrière avec une grande expérience de la lutte, fort tournés vers l'extérieur, et au centre des pays industrialisés. Il n'en faut guère plus pour expliquer la crainte de la bourgeoisie qui s'est manifestée à travers le black-out sur ces mouvements sur le plan international et par une attitude conciliante du gouvernement en Belgique même.
Ces caractéristiques ont été confirmées par les grèves d'avril 84 qui, si elles n'ont pas eu l'ampleur des mouvements de l'automne précédent, ont incontestablement mis en évidence le renforcement des tendances suivantes :
- la simultanéité de plus en plus manifeste des luttes dans un grand nombre de pays industrialisés (luttes en Belgique, en France, en Angleterre et en Espagne en avril) et la confrontation à la fois avec les mystifications de la gauche dans l'opposition (Belgique, Angleterre) et l'austérité de la gauche au pouvoir (France, Espagne)
- l'accélération du rythme de confrontations entre les deux classes (les grèves d'avril viennent seulement cinq mois après les mouvements dans le secteur public),
- la confrontation continuelle avec la gauche dans l'opposition renforçant une tendance à la remise en cause de la stratégie syndicale et la prise en main des luttes par les travailleurs eux-mêmes.
La faiblesse centrale, commune à l'ensemble de ces luttes, est l'incapacité de la classe ouvrière à faire front aux manoeuvres de la gauche dans l'opposition -en particulier des syndicats- au sein même des luttes et d'autre part d'affirmer ses propres perspectives de classe. Si les travailleurs prennent de plus en plus conscience du rôle des syndicats dans leur attitude quotidienne de défenseurs de "l'austérité raisonnable", ils restent désarmés lorsque ces mêmes syndicats déploient toute leur astuce au sein des luttes. Cette faiblesse est liée à un manque d'expérience et de confiance en soi de la part du prolétariat, et à une capacité d'adaptation impressionnante de la bourgeoisie à travers le syndicalisme.
La principale forme que prend la gauche dans l'opposition dans la lutte est celle du syndicalisme de base qui a constitué le fer de lance de la réponse bourgeoise aux luttes. Profitant de luttes ponctuelles ou isolées dans les usines, les syndicalistes de base par leur discours combatif et dans leurs actions pseudo radicales gagnent la confiance de secteurs combatifs de la classe ouvrière et répandent l'idée qu'un type de syndicalisme différent de celui des "directions syndicales" est possible (à l'intérieur de la structure traditionnelle si possible, à l'extérieur si nécessaire). Ainsi, en Belgique, les "syndicalistes de combat" se sont mis aux avant-postes de toute une série de luttes isolées et se sont heurtés parfois durement aux leaders syndicaux (Boel et Tamise, Fabelta, Motte, ACEC, Valfil, FN, Brugeoise et Nivelles, etc.). En Hollande, une grève comme celle du port de Rotterdam en 82 a été entièrement menée par la "base syndicale" sous le slogan "Le syndicat, c'est nous !".
C'est à partir de telles luttes que le syndicalisme de base a tiré les expériences et a gagné l'autorité nécessaire pour dévoyer et saboter des luttes de plus grande envergure : en 82 par exemple, les syndicalistes de base prenaient l'initiative de constituer un comité de grève intersectoriel régional dans la province du Hainaut pour enfermer et épuiser la combativité ouvrière dans le cadre de la région. C'est encore eux qui entraînent les sidérurgistes vers l'affrontement préparé et provoqué par la bourgeoisie pour liquider le mouvement. En 83, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, c'est aux syndicalistes de base que revient la tâche, dans le cadre de la généralisation formelle décrétée par la bourgeoisie, d'épuiser le mouvement dans des actions radicales mais dispersées, isolées et sans perspectives.
Ces éléments confirment et expliquent que le développement de la lutte dans les pays industrialisés sera lent. Toutefois, avec l'impasse économique totale du système, l'attaque croissante des conditions de vie du prolétariat et les réactions ouvrières, l'ensemble des mystifications de la bourgeoisie, même les plus radicales, tendront à s'épuiser progressivement tandis que les affrontements de classe prendront un caractère de plus en plus massif, puissant et simultané.
INTERNATIONALISME, SECTION EN BELGIQUE DU CCI, MARS 1984
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- L'économie [90]
Organisation des revolutionnaires - Sur les conditions du surgissement du parti
- 3086 reads
Les conditions générales de la remontée ouvrière depuis 68 et ses implications sur le processus de regroupement pour le parti.
1- Ce n'est pas comme produit d'une réaction contre la guerre, mais d'un développement lent et en dents de scie de la lutte de classe, face à une crise internationale se développant relativement lentement, que surgira le futur parti. Ceci implique
- la possibilité d'une beaucoup plus grande maturation de la conscience ouvrière avant l'assaut final, maturation s'exprimant en particulier au sein des minorités révolutionnaires ;
- qu'une lutte se développant à l'échelle mondiale jette les bases pour un processus de regroupement des forces révolutionnaires se posant directement au niveau international.
2- Le caractère "original" de la période 17-23 n'est pas tant dans la rapidité des événements à partir de 17 (nous devons nous attendre à une rapidité encore plus grande, face à une bourgeoisie beaucoup mieux avertie, une fois le processus révolutionnaire engagé) mais dans le caractère "charnière" de la période.
Aujourd'hui, 70 ans de décadence capitaliste font qu'une série de questions se pose en des termes beaucoup plus clairs qu'à l'époque : nature des syndicats, de la démocratie et du parlementarisme, question nationale. Alors que nous sommes encore loin de la période insurrectionnelle, chaque lutte ouvrière est contrainte de s'affronter aux forces de mystification et d'encadrement de la bourgeoisie. Même dans la confusion, le milieu prolétarien actuel est contraint de prendre position face aux enseignements de ces 70 ans de décadence. La tâche de clarification des conditions qu'ouvre pour la lutte de classe l'entrée en décadence du système est d'ores et déjà beaucoup plus avancée qu’en 1919.
3- Si la période présente reste caractérisée par l'absence de continuité organique avec le mouvement du passé, et si cela pèse lourdement sur l'état des forces révolutionnaires et les rapports qu'elles entretiennent entre elles aujourd'hui, nous ne devons pas oublier que la continuité organique avec la 2ème Internationale,-même si elle a fourni les forces vives de l'IC- a aussi conditionné beaucoup de ses faiblesses. C'est non seulement sur le plan programmatique que l'avant-garde ne put mener de façon suffisamment approfondie la critique des traditions social-démocrate et cerner l'ensemble des conditions nouvelles qui s'ouvraient. Sur le plan organisationnel, les différentes fractions de gauche ont eu d'énormes difficultés à comprendre ce qu'elles étaient et à dépasser le stade d'exister comme opposition chargée de redresser l'organisation SD dégénérescente. Le processus même de confrontation et de regroupement sera marqué par le modèle de la 2ème Internationale, fonctionnant comme une somme de partis nationaux, et même, à l'intérieur d'une nation comme l'Allemagne par des habitudes de fédéralisme. Ainsi :
- même sans"rupture organique", la mise en place d'un cadre de discussion fut non seulement insuffisamment international, mais fut même très difficile dans la seule Allemagne ;
- l'élaboration de la rupture avec la 2ème Internationale restera une série de processus nationaux, impliquant des décalages dans le temps, une hétérogénéité sur le plan politique.
La longue période de défaite qu'a traversée le prolétariat après l'échec de la révolution a été en même temps le creuset dans lequel la classe a mené le plus loin possible son effort pour tirer les enseignements de la vague révolutionnaire. Nous avons derrière nous, non seulement l'expérience vivante d'Octobre, mais l'effort des fractions, Bilan et Internationalisme, pour en tirer le maximum de leçons en vue de la prochaine vague.
4- Aujourd'hui la rupture organique avec le mouvement du passé fait que les groupes révolutionnaires ne sont plus confrontés à la nécessaire rupture avec les organisations passées à l'ennemi. Ils ne sont pas non plus ce qu'était Bilan, la fraction ayant la tâche essentielle, dans la contre-révolution triomphante, de faire le pont avec la prochaine ouverture d'un cours révolutionnaire, en tirant tous les enseignements de la défaite. Leur existence et leur développement aujourd'hui est avant tout conditionné par la reprise des luttes ouverte en 68.
5- Les conditions sont réunies plus que jamais pour que se réalise ce que le texte du CCI met en avant : dans la période de décadence "le parti politique peut parfaitement surgir avant ce point culminant que sont les conseils ouvriers" ([1] [559]).
Le schéma simpliste qui fait des bolcheviks un "exemple de parti", comparé à l'Allemagne où le regroupement s'avéra beaucoup plus difficile, ne voit pas que l'absence dès 1917 d'un parti international fut une grande faiblesse qui allait peser sur toute la vague révolutionnaire. C'est au niveau international et non au niveau de la seule Allemagne, qu'allait peser le retard avec lequel s'est fait le regroupement pour le parti mondial. Le pôle de clarification que fut l'IC eut lieu trop tard, trop peu de temps et. connaît aujourd'hui des conditions bien meilleures pour se constituer préalablement aux moments décisifs. De même c'est sur une base programmatique beaucoup plus claire qu'il pourra et devra se constituer, englobant comme base minimum l'ensemble des leçons de la première vague révolutionnaire.
6- Aujourd'hui, si les conditions générales montrent la possibilité pour un parti plus clair, plus mûr et plus directement international, elles rendent aussi ces caractéristiques plus nécessaires que jamais. Si la bourgeoisie n'a plus cette arme contre-révolutionnaire essentielle que furent les organisations de masses qui venaient de passer à l'ennemi, elle a par contre appris à développer les moyens d'encadrement les plus subtils et il faut s'attendre à toutes les tentatives de sa part pour tenter de récupérer les organes dont se dotera 1a classe. Et surtout, c'est une bourgeoisie beaucoup plus capable de s'unifier extrêmement rapidement au niveau international que le prolétariat trouvera en face de lui. Dans une telle situation, la clarté de l'avant-garde prolétarienne, son unité et sa capacité à développer une influence internationale seront VITALES.
Le milieu prolétarien et l'effort de regroupement aujourd’hui
1- L'échec du cycle de conférences internationales annonçant la crise que traverse le milieu révolutionnaire, et ce alors que s'ouvre une accélération qualitative de l'histoire, donne la mesure du retard et de la faiblesse des minorités communistes face à leurs responsabilités. Ainsi il ne suffit pas que les conditions objectives telles qu'elles existent aujourd'hui oeuvrent dans un sens favorable à une clarification et un processus d'unification au sein des forces révolutionnaires, pour que le processus de regroupement pour le parti s'engage automatiquement.
2- La rupture organique avec 1e mouvement du passé et les 50 années de contre-révolution impliquent des tâches qualitativement différentes aux minorités communistes. La question ne se pose plus en termes d'assurer la continuité du programme en opérant une rupture claire avec les anciennes organisations dégénérées. Cependant la tâche n'en est pas moins lourde. C'est un long travail de décantation qui incombe aux minorités communistes depuis que le prolétariat a ressurgi en 68. Décantation dans le sens, tant d'une réappropriation des leçons du passé que d'une clarification des conditions nouvelles qui s'ouvrent. Cette décantation implique une compréhension de ce qu'elles sont, ne sont pas, en lien avec l'analyse de la période actuelle. La mégalomanie -le mythe d'être aujourd'hui LE parti en rejetant toute confrontation avec le milieu-, le sectarisme, l'idée que l'histoire commence "avec soi" ou celle que le parti et son programme est une donnée invariante depuis 1848, et les confusions ambiantes sur le processus du regroupement, sont autant d'expressions des difficultés du milieu à prendre conscience de ce qu'il est et de ce que sont ses responsabilités aujourd'hui.
3- En disant que les conditions existent aujourd'hui pour que le parti surgisse avant le momment crucial, nous ne disons pas que toutes les condiions sont réunies pour que le parti se constitue demain matin. Son lien avec le développement de la lutte de classe signifie que le surgissement du parti implique que 1a classe ouvrière réponde à l'appel de l'histoire et développe sa conscience dans une dynamique d'internationalisation de sa lutte.
L'apparition de partis du prolétariat exige une telle dynamique, non seulement pour qu'il soit "entendu", non seulement parce que ce n'est que dans cette phase que les idées révolutionnaires peuvent "devenir forces matérielles", mais aussi parce que seule une telle dynamique peut apporter des éléments indispensables au regroupement des forces révolutionnaires à l'échelle mondiale, en clarifiant pratiquement des questions aussi essenielles que le problème de la généralisation internationale, l'organisation générale de la classe contre les multiples formes syndicales, le rôle de la violence ...et surtout la question du parti, de son rapport avec les conseils ouvriers.
4- Rejetant donc l'idée d'un parti créé artificiellement autour d'un regroupement "PCI + CCI +CWO" et le caractère absurde d'une telle hypothèse, le CCI ne considère pas pour autant le futur parti comme un produit mécanique de la période prérévolutionnaire. Celui-ci exige dès aujourd'hui un effort volontaire de la part des minorités communistes, mais cela sans illusion immédiatiste ou prématurée. Notre volonté de participer aux conférences initiées par le PCI (BC) s'appuyait :
- sur le rejet de toutes les pratiques de sectarisme, de refus du débat ;
- sur 1a compréhension qu'il ne pouvait être question de créer un regroupement prématuré;
- sur le besoin de mettre en place un lieu de confrontation et de décantation le plus large possible, dans le cadre des frontières de classe;
- sur la nécessité d'avoir des critères de participation suffisamment précis, rejetant entre autres les courants"anti-parti" modernistes ou conseillistes, afin que soit clair en particulier l'objet de telles conférences ;
- sur l'objectif que ces conférences constituent, face à l'extérieur, face à la classe, un pôle actif de référence, en étant capable de prendre position sur des questions essentielles;
- sur la nécessité d'ordres du jour allant dans le sens de l'approfondissement de ce qu'est l'effort d'unification des révolutionnaires aujourd'hui : l'analyse de la période actuelle et de la crise d'une part, la question du rôle des révolutionnaires d'autre part, comme une des questions les moins avancées aujourd'hui, qui rend urgente une confrontation.
Nous devions nous rendre compte que le sectarisme et le refus du débat pesaient y compris sur les groupes qui avaient participé activement aux conférences. L'immaturité du milieu s'est aussi traduite par l'idée qu'avaient finalement BC et la CWO de conférences beaucoup plus immédiates, cherchant un regroupement rapide avant que le débat n'ait eu lieu, et finalement n'attendant des premières conférences que les moyens matériels de chasser le CCI... au nom d'un désaccord qui n'a même pas été débattu.
5- Cette expérience nous montre l'étendue du chemin qui reste à parcourir. Si nous avons mis la question du parti à l'ordre du jour dans le CCI, c'est bien parce que nous pensons que cette question cristallise la compréhension des tâches des minorités révolutionnaires aujourd'hui, ainsi que l'attitude qu'elles ont les unes envers les autres. Au coeur du processus de décantation qui, de gré ou de force -et même sous la forme d'une crise ouverte se traduisant par la disparition de groupes tout entiers- est engagé au sein du milieu, se trouve la question du parti et du processus de développement de la conscience de classe.
La crise qui traverse le milieu et qui n'a pas épargné le CCI est une grave alerte. Elle montre en effet que ce sont les confusions sur le rôle des organisations politiques de la classe, la recherche d'un résultat immédiat et l'impatience vis à vis de la lutte de classe qui constituent le meilleur terrain à la destruction des organisations communistes par la pression matérielle et idéologique de la bourgeoisie.
Nous ne pouvons nous réjouir de voir un PCI décimé donner naissance à une organisation bourgeoise, de voir la CWO flirter avec des groupes nationalistes. Cela montre que, sans une claire réaction sur le plan programmatique à la pression de la bourgeoisie, sans non plus développer une capacité à intégrer les nouvelles leçons de la lutte de classe, tout l'effort de décantation au sein du milieu peut se trouver détruit du jour au lendemain.
6- Notre compréhension sur la question du parti est aujourd'hui celle qui va le plus loin dans le bilan de la 1ère vague révolutionnaire. C'est la question sur laquelle règne le plus de confusions dans le milieu, dans la mesure où l'expérience de 17-23 n'a pu l'éclairer complètement. Nous disons souvent que notre position s'inscrit plus en négatif qu'en positif, nous devons cependant comprendre que c'est seulement les prochains mouvements de la grève de masse qui pourront clarifier pleinement cette question au niveau international.
Les événements de Pologne, avec toutes leurs limites, ont constitué pour nous une confirmation éclatante de nos positions sur le développement de la conscience de classe, le rôle des minorités révolutionnaires et les formes d'organisation unitaire de la classe. Ils nous ont aussi contraints à pousser plus loin notre compréhension sur le problème de l'internationalisation, sur le rejet du "maillon faible". C'est en fait tout le milieu qui a été mis à l'épreuve devant ces événements. Devant un tel mouvement dans un pays plus central, le CWO aurait-il pu longtemps appeler à l'insurrection tout de suite ? Le PCI aurait-il pu continuer à prétendre qu'il n'y a pas de mouvement de classe sans organisation préalable des ouvriers par le parti ?
Les prochains mouvements mettront, plus encore que la phase de recul du début des années 80, les groupes révolutionnaires à l'épreuve. I1 y aura sans doute d'autres bouleversements au sein du milieu, on verra aussi surgir de nouveaux groupes. Ceux-ci ne seront pas pour autant à l'abri des confusions du passé. Pour englober les enseignements des prochaines expériences de la classe, pour constituer un point de référence afin que les nouvelles avant-gardes communistes ne refassent pas les mêmes erreurs, l'effort de clarification doit être poursuivi au sein du milieu actuel.
L'ossature du prochain parti n'est pas donnée une fois pour toutes par les courants et groupes existant aujourd'hui, pourtant c'est à eux de poursuivre l'effort de décantation indispensable au regroupement de demain, car c'est pour cela que la classe les a fait naître dès qu'elle a repris le chemin de la lutte.
JU mai 1983
[1] [560] Texte adopté comme résolution au 5ème Congrès du CCI. Cf. Revue Internationale n° 35 sur le parti et ses rapports avec la classe, P.27, point 17d.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : le Communistenbond Spartacus et le courant conseilliste 1942-1948, I
- 4421 reads
Le Communistenbond Spartacus (Union communiste "Spartacus") est né en 1942 d'une scission du "Marx-Lenin-Luxemburg front" lui-même issu du RSAP. Ce dernier dont la figure dominante était Henk Sneevliet, était une organisation qui avant son interdiction en 1940 par le gouvernement hollandais, oscillait entre le trotskisme et le POUM, avec des positions antifascistes, syndicalistes, de défense des "libérations nationales" et de l'Etat russe. Le MLL Front qui lui succéda dans 1'illégalité s'engagea dans un travail internationaliste de dénonciation de tous les fronts de guerre capitaliste ; et en 1941, sa direction à l'unanimité moins une voix trotskyste, décida de ne pas soutenir l'URSS, dénonçant la guerre germano-soviétique comme un déplacement du front de la guerre impérialiste. L'arrestation de la direction du MLL Front - dont Sneevliet - et leur exécution par l'armée allemande, décapitèrent le MLL Front en 1942. Quelques mois plus tard les restes du Front se scindaient en deux : d'un côté, la petite minorité trotskyste qui choisissait le camp capitaliste ; de 1'autre côté, les militants internationalistes qui allaient former, au départ dans une grande confusion, le Communistenbond. Cette organisation évolua progressivement vers le communisme des conseils. Après avoir représenté à partir de 1945 et dans les années 50 le courant révolutionnaire internationaliste en Hollande, elle finit par dégénérer complètement dans 1'idéologie conseilliste. Elle disparut à la fin des années 70 comme groupe, pour ne laisser que des épigones, dont le groupe "Daad en Gedachte".
Si nous présentons cette histoire du"Communistenbond Spartacus" c'est d'abord que son histoire est mal connue, d'autant plus que le Bond en dégénérant considérait que cette histoire "c'est des vieilleries". Pour les révolutionnaires internationalistes, 1'histoire d'un groupe communiste n'est pas une "vieillerie", c'est notre histoire, 1 'histoire d'une fraction politique que le prolétariat a fait surgir. Faire le bilan de ce groupe et du courant conseilliste aujourd'hui, c'est tirer les leçons positives et négatives qui nous permettent de forger les armes de demain. Comme le courant conseilliste est organisationnellement un courant en décomposition en Hollande, qui n 'est plus un corps vivant pouvant tirer les leçons vivantes pour la lutte révolutionnaire, il appartient au CCI de tirer les enseignements de 1'histoire du Communistenbond Spartacus : pour montrer aux éléments qui surgissent sur la base du conseillisme que la logique de ce dernier les mène au néant.
Deux leçons fondamentales sont à tirer :
1) Le rejet d'octobre 17 comme révolution "bourgeoise" mène inévitablement au rejet de toute 1'histoire du mouvement ouvrier depuis 1848. Il s'accompagne nécessairement d'un refus de reconnaître le changement de période historique depuis 1914 : la décadence du capitalisme, et mène logiquement au soutien des "luttes de libération nationale" comme "révolutions bourgeoises progressistes". C'est cette logique qu'avait choisie le groupe suédois "Arbetarmakt" qui devait le plonger jusqu'au cou dans le magma gauchiste.
2) L'incompréhension de la nécessité de la fonction et du fonctionnement centralisé de l'organisation révolutionnaire mène inévitablement au néant ou à des conceptions anarchistes. L'anti-centralisme et l'individualisme dans la conception de l'organisation ouvrent d'abord la porte à 1'ouvriérisme et à l'immédiatisme qui coexistent joyeusement avec l'académisme et l'opportunisme. Le résultat? L'histoire du Communistenbond nous le montre : 1'abdication devant les tendances anarchistes et petites-bourgeoises. Finalement la dislocation ou la capitulation devant 1'idéologie bourgeoise (syndicalisme, luttes de libération nationale).
Puisse cette histoire du Communistenbond Spartacus contribuer à ce que les éléments qui se réclament du "communisme des conseils" comprennent la nécessité d'une activité organisée sur la base de la conception marxiste de la décadence du capitalisme. L'organisation politique des révolutionnaires sur une base internationale et centralisée est une arme indispensable que la classe fait surgir pour le triomphe de la révolution communiste mondiale.
L'évolution du MLL Front vers des positions internationalistes de non défense de l'URSS et de combat des deux blocs impérialistes, sans distinction d'étiquette - "démocratie, fascisme, communisme" - est une évolution atypique. Issu du RSAP, orienté vers le socialisme de gauche, le MLL Front évoluait vers des positions communistes de conseils. Cette orientation s'explique avant tout par la forte personnalité de Sneevliet qui - malgré son âge déjà avancé - était encore capable d'évoluer politiquement, et qui sur le plan personnel n ' avait plus rien à perdre ( [1] [561]). Une transformation politique aussi profonde ne peut être mise en parallèle qu'avec celle - tout aussi atypique - du groupe de Munis et des RKD ([2] [562]).
Cette évolution n'avait pas, cependant, été jusqu'à ses ultimes conséquences. La disparition de Sneevliet et de ses camarades -en particulier Ab Menlst - décapitait totalement la direction du Front. Celui -ci avait dû en partie sa cohésion au poids politique de Sneevliet, qui était plus un militant guidé par sa conviction révolutionnaire et son intuition qu'un théoricien.
La mort de Sneevliet et de la quasi-totalité des membres de la Centrale réduisit à néant pendant plusieurs mois l'organisation. De mars jusqu'à l'été 1942, tous les militants se cachaient et évitaient de reprendre contact, par peur de la Gestapo, dont ils soupçonnaient qu'elle avait démantelé le Front par un indicateur, exerçant son oeuvre au sein même de l'organisation. Les archives de police et du procès de Sneevliet ne laissent pourtant pas d'indice qu'il y eut un agent de la Gestapo à l'intérieur. ([3] [563])
De la direction du Front, seul Stan Poppe avait survécu. C'est sous son influence que fut fondé, au cours de l'été, le "Revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging" (Mouvement ouvrier socialiste-révolutionnaire). Le terme de "mouvement ouvrier" laissait comprendre que l'organisation, qui poursuivait formellement le MLL Front, ne se concevait ni comme un front, ni comme un parti.
A la suite de la formation du groupe de Stan Poppe, les derniers partisans de Dolleman formaient le 22 août 1942 à La Haye leur propre groupe, avec une orientation trotskyste. Ainsi, naissait le "Comité van Revolutionaire Marxisten" (Comité de marxistes révolutionnaires), sur la base de la défense de l'URSS ([4] [564]). Ce groupe était numériquement beaucoup plus réduit que le Mouvement ouvrier socialiste-révolutionnaire. Il publiait un journal : "De Rode October" (L'Octobre rouge), tiré mensuellement à 2.000 exemplaires. Parmi les dirigeants du CRM, on retrouvait Max Perthus, qui avait été libéré de prison. L'ancienne fraction trotskyste du MLL Front se trouvait donc reconstituée. Les éléments les plus jeunes du Front, plus activistes, rejoignaient en majorité le CRM. Logiquement ce dernier se rattachait à la IV° Internationale, dont il se proclamait section aux Pays Bas en juin 1944. ([5] [565])
Cette ultime scission était la conséquence de l'affrontement entre deux positions inconciliables: l'une qui défendait les positions internationalistes prises en juillet 1941 par Sneevliet et ses camarades ; l'autre qui marchait dans la guerre en soutenant la Russie, et par conséquent le bloc militaire des Alliés.
D'autres raisons ont pu jouer dans la scission, à la fois organisationnelles et personnelles. Lors de l'été 1942, Poppe avait pris soin de former une nouvelle direction en éliminant tous les partisans de la défense de l'URSS. D'autre part Poppe, ayant été la dernière personne à voir Sneevliet avant son arrestation, apparaissait pour certains peu sûr sinon suspect ([6] [566]).
Dans les faits, l'organisation constituée autour de Stan Poppe était parfaitement préparée à la clandestinité, et put poursuivre son travail politique jusqu’à la fin de la guerre, sans arrestations. Elle trouvait en Leen Molenaar l'un des plus habiles confectionneurs de faux papiers et de cartes de ravitaillement pour les militants clandestins ([7] [567]).
A la fin de l'été, le groupe qui comptait une cinquantaine de militants commença à éditer un bulletin ronéoté, avec plus ou moins de régularité :"Spartacus". Ce dernier était l'organe du "Communistenbond Spartacus" (Union communiste Spartacus). Plusieurs brochures étaient éditées qui montraient un niveau théorique plus élevé que dans le MLL Front. Vers la fin de l'année 1944, "Spartacus" devenait un organe théorique mensuel. A côté, à partir d'octobre 1944 et jusqu'à mai 1945, était diffusée sous forme de pamphlet une feuille hebdomadaire sur l'actualité immédiate : "Spartacus - actueleberichten" (Nouvelles actuelles).
Politiquement, les membres du Bond étaient plus aguerris car plus anciens que les éléments trotskystes, et plus formés théoriquement. Beaucoup d'entre eux avaient milité dans le NAS, dont ils avaient gardé tout un esprit syndicaliste-révolutionnaire. Ainsi Anton (Toon) van den Berg, militant de l'OSP puis du RSAP, avait dirigé le NAS à Rotterdam jusqu'en 1940. Autour de lui se formait le groupe de Rotterdam du Communistenbond, qui se caractérisa toujours jusqu'au lendemain de la guerre par un esprit activiste. D'autres militants, enfin, avaient tout un passé politique, marqué moins par le syndicalisme que par le socialisme de gauche et même du MLL Eront. Tel était le cas de Stan Poppe.
Stan Poppe avait joué un rôle important dans l'OSP. Il se trouvait à la direction de ce parti, dans la fonction de secrétaire. Lors de la fusion avec le RSP, il était devenu membre du Bureau politique du RSAP. Nommé en 1936 secrétaire trésorier de ce parti, il avait été délégué -avec Menlst - en décembre à la conférence du Centre pour la IV° Internationale. Membre du Bureau politique en 1938, il était en 1940 l'un des responsables du MLL Front. Dans le Front, ccmme plus tard dans le Communistenbond Spartacus, il se faisait connaître sous le pseudonyme de Fjeerd Woudstra. Très orienté vers l'étude économique, son orientation politique était encore un mélange de léninisme et de conseillisme.
La plupart des militants venaient de l'ancien RSAP, sans être passés par le mouvement trotskyste, d'ailleurs très faible aux Pays Bas. Nombre d'entre eux continuèrent - après la guerre - à militer dans le Bond, la plupart jusqu'à la fin de leur vie : Bertus Nansink, Jaap van Otterloo, Jaap Meulenkamp, Cees van der Kull, Wlebe van der Wal, Jan Vastenhouw étaient ce type de militants.
Cependant, pendant deux ans encore, l'évolution de "Spartacus" se signala par des ambiguïtés politiques qui prouvaient que l'esprit du RSAP n'avait pas totalement disparu. Les réflexes socialistes de gauche se manifestèrent encore lors de prises de contact avec un groupe social-démocrate qui avait quitté le SDAP au début de la guerre et dont la personnalité marquante était W. Romljn. Ce dernier -à la fin de l'année 1943- avait écrit, sous le pseudonyme Soc lus, une brochure où il se prononçait pour un soutien "tactique" de la lutte militaire des Alliés. "Spartacus" attaque durement cette position ([8] [568]) et renonça aux négociations de fusion avec Romljn. Le fait moue qu'il y eut des propositions de fusion avec ce groupe montrait que le Bond n'avait aucune caractérisation de classe de la social-démocratie. En cela "Spartacus" était très éloigné des communistes de conseils qui avaient toujours dénoncé comme contre révolutionnaire et bourgeois les groupes socialistes de droite comme de gauche. Cette persistance à chercher des contacts avec des socialistes de gauche se retrouve encore en novembre 1944, lorsque pendant quelque temps un travail commun est mené avec le groupe "De Vonk" (cf. chapitre précédent), travail qui finalement échoue, compte tenu des divergences politiques.
Avec le courant trotskyste, si la rupture organisationnelle était consommée, il n'en était pas de mené idéologiquement avec ses tendances de gauche. Poppe eut au cours de l'année 1944 deux réunions avec le groupe "Contre le courant" (Tegen de Stroom de Vereekenl. Bien que celui-ci refusa la défense de l'URSS en juin 1941, il restait lié au Comité communiste Internationaliste français d'Henri Molinier ; il devait d'ailleurs s'intégrer dans la IV° Internationale, après la guerre ([9] [569]). Plus significatif était le fait que même au sein du Bond "Spartacus" les dernières hésitations sur la défense de l'URSS n'avaient pas été totalement levées. Une petite partie de l'organisation - contre la défense du camp russe dans la présente guerre - se prononçait pour cette défense en cas d'une troisième guerre mondiale entre les Alliés occidentaux et l'URSS ([10] [570]),
Aussi, pendant deux ans - jusqu'à ce que l'apport théorique de l'ex-GIC devint prépondérant - le Bond essaya de clarifier ses positions politiques. Son activité consista en grande partie à réaliser un travail théorique, sous forme de brochures, lequel reposait en grande partie sur les épaules de Bertus Nansink et surtout de Stan Poppe.
La brochure de Stan Poppe sux "Les perspectives de l'impérialisme après la guerre en Europe et la tâche des socialistes -révolutionnaires" fut écrite en décembre 1943 et parut en janvier 1944 ([11] [571]). Le texte, très influencé par le livre de Lénine L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, se réclamait du "socialisme scientifique de Marx, Engels, Lénine" et non de Rosa Luxembourg. Il essayait de définir le cours suivi par le capitalisme et les perspectives révolutionnaires pour le prolétariat.
La cause de la guerre mondiale était "la crise générale du capitalisme" depuis 1914. Dans un sens léniniste, Poppe définissait la nouvelle période de crise comme impérialiste monopoliste :
"Cette phase ultime, la plus haute, Lénine la définissait cpmme impérialiste. L'impérialisme est le côté politique de la société produisant selon un mode capitaliste-monopoliste."
Cette référence à Lénine est particulièrement intéressante, quand on sait que par la suite les "conseillistes" de "Spartacus" se définiront comme anti-léninistes.
On peut voir déjà, pourtant, une certaine réflexion théorique percer sous la référence quasi scolaire à Lénine. Poppe comprend la crise comme une crise de surproduction. Celle-ci se traduit par le capitalisme d'Etat, aboutissement de la phase du monopole, dont l'expression est l'économie d'armements. Celle-ci envahit la production et "le système (capitaliste) ne peut être secouru que par la guerre et par la production pour la guerre".Il ne parle pas, dans sa contribution,de la Russie comme capitaliste d'Etat. Au contraire, il affirme que l'URSS "est soustraite à l'emprise du monopole - production capitaliste - et à la demi-nation du marché" ; qu'elle est "le seul adversaire étatiquement organisé de l'impérialisme". Une telle position était d'autant plus surprenante que Poppe avait été l'un de ceux qui -dans le MLL Front - avait caractérisé l'URSS comme capitaliste d'Etat. Contradictoire était donc la dénonciation dans ce texte des mesures de capitalisme d'Etat dans tous les pays,"qu'ils soient démocratiques ou autocratiques, républicains ou monarchistes", sauf en URSS.
Plus lucide était l'analyse du conflit en Europe :"La guerre touche à sa fin. La défaite militaire de l'Allemagne et de ses alliés n'est pas une spéculation mais un fait..." Poppe, par un paradoxe de style, considérait que la Deuxième guerre mondiale se prolongeait par une Troisième guerre mondiale en Asie, mettant aux prises le Japon et le camp anglo-américain pour la domination des colonies.
Un peu comme Bordiga après 1945 ([12] [572]) Poppe considérait que la guerre menait à la fascisation des démocraties occidentales, sur le plan politique :
"La guerre impérialiste est - sur le plan de la politique extérieure- l'autre face de l'exploitation monopolistique de la force de travail "- tandis que - en politique intérieure - la démocratie bourgeoise, forme de vie du même ordre social, est comme le fascisme."
Les démocraties trouveront - en cas de crise révolutionnaire - dans le fascisme "leur propre futur", sinon s'imposera en économie une forme de néo-fascisme :
"Sous l'apparence de la terminologie, il n'y aura plus de fascisme, mais dans les faits nous vivrons son deuxième âge d'or. Au coeur de la politique sociale néo-fasciste il y aura la dégradation du revenu ouvrier, conséquence nécessaire de la politique de déflation."
Ayant en tête l'exemple des années 30, Poppe pensait que la crise ouverte du capitalisme se poursuivrait après la guerre : en effet, il n'y aurait pas de "conjoncture de reconstruction, sinon très courte et extrêmement modeste."
L'alternative pour le prolétariat était "entre le socialisme ou la chute dans la barbarie", c'est à dire entre la révolution prolétarienne ou la guerre. Faisant cette constatation, le texte se garde de faire des pronostics. Il souligne que la guerre "pour la reconquête et la sauvegarde de l'Indonésie et de l'Extrême-Orient" implique "la perspective d'une guerre inévitable contre l'Union soviétique elle-même", soit au cours de la "troisième" guerre en Orient soit à l'occasion d'une "quatrième" guerre mondiale.
Néanmoins, "la crise générale du capitalisme fait mûrir la crise révolutionnaire du système". Cela n'implique pas que la "révolution surgisse automatiquement" : Elle dépend de l'intervention consciente de la classe révolutionnaire au cours du processus (révolutionnaire) "
Théoriquement, Poppe définit la révolution comme la mise en place de la dictature du prolétariat et la dissolution "de cette dictature et de l'Etat lui-même". Cette dictature sera celle des conseils d'usine qui formeront "les conseils centraux du pouvoir". Il est intéressant de noter que sont exclus ici les soviets de paysans. Dans "la lutte pour le pouvoir" qui n'est autre que "la lutte pour et avec les conseils" le prolétariat d'usine est le coeur de la révolution. Il est symptomatique d'une vision usiniste gramscienne que Poppe prenne comme exemple l'occupation des usines, à l'exemple de l'Italie en 1920 ([13] [573]).
Symptomatique est la séparation faite entre la révolution des conseils dans les pays industrialisés et l'appel lancé au soutien des "luttes de libération nationale" :
"Il ne peut point y avoir de politique socialiste en Europe et en Anérique sans la proclamation de la pleine indépendance des anciens peuples coloniaux."
Dans la question coloniale, Poppe reprend à son compte les positions de Lénine sur le "droit des peuples à l'auto-détermination". Il ne semble pas que ces positions de Poppe reflétassent l'opinion de tous les militants : en 1940, Jan Vastenhouw -membre alors du MLL Front - avait fermement attaqué la conception de Lénine dans un bulletin interne.
Poppe va cependant très loin dans son analyse ; non seulement il considère que "la tâche (des révolutionnaires socialistes) est naturellement d'appeler les ouvriers de tous les pays à chasser les Japonais des territoires occupes par ceux-ci en Chine et en Indonésie", mais il proclame la nécessité de cette "libération" sous la bannière de l'URSS. Mais Poppe ne parle pas d'une URSS stalinienne, mais d'une URSS libérée -grâce à l'instauration du pouvoir des conseils en Europe - par les ouvriers et les paysans du stalinisme. Dans cette optique - mélange de fantasme et de croyance- il y aurait guerre de "libération nationale" révolutionnaire :
"Si les socialistes ne se trompent pas dans leur prévision, alors cela signifie que l'Union soviétique devient le facteur le plus important aussi dans la lutte contre l'impérialisme japonais. Une Union soviétique qui peut s'appuyer sur l'alliance du pouvoir des conseils des autres peuples au lieu des traités douteux avec les gouvernements capitalistes ; une union soviétique qui se sait soutenue sur ses arrières par un système d'Unions des conseils européens . et par la solidarité du prolétariat guidé par le socialisme révolutionnaire doit aussi - sans le secours des armes anglaises et américaines- être capable de chasser les impérialismes japonais du Mandchukuo et des autres parties de territoire de la République chinoise, de même que de l'Indonésie."
Cette idée d'une guerre de "libération révolutionnaire" s'apparentait à la théorie de la guerre révolutionnaire lancée en 1920 par le Komintern. On ne peut manquer de constater ici, cependant, que la "libération" préconisée par Poppe à la pointe des baïonnettes est plus nationale sinon nationaliste- puisqu'elle se propose de restaurer l'intégrité territoriale de la "République de Chine"- que révolutionnaire. Elle apparaît comme une guerre nationale bourgeoise, à l'image des guerres de la Révolution française, qui instaure et non détruit le cadre national. La théorie de Poppe des conseils ouvriers est une théorie nationale des conseils fédérés en Unions. Ici, la conception de la "lutte de libération nationale" est le corollaire d'une conception où la révolution ouvrière qui fait surgir les conseils ouvriers est nationale.
Les positions de Poppe et du Communistenbond sont donc encore très éloignées de celles du communisme des conseils. Elles sont encore un mélange syncrétique de léninisme, de trotskisme, voire de gramscisme. Et cela d'autant plus que jusqu'à l'été 1944, le Bond sera incapable d'avoir une position théorique sur la nature de l'URSS.
C'est finalement par des discussions menées au cours de l'été 1944 avec d'anciens membres du GIC que l'Union communiste Spartacus s'oriente définitivement vers le communisme des conseils. Quelques membres du Bond prirent contact avec Canne Meijer, B.A. Sijes, Jan Appel et Théo Massen, Bruun van Albada pour leur demander de travailler dans leur organisation. Ils acceptèrent de contribuer théoriquement par la discussion et par écrit ([14] [574]) ; mais ils ne voulaient en aucun cas ni dissoudre le propre groupement ni adhérer immédiatement au Bond Ils étaient encore très méfiants vis-à-vis de la nouvelle organisation marquée par une tradition léniniste ; ils voulaient auparavant voir dans quelle mesure le Bond s'orienterait vers le communisme des conseils. Peu à peu ils participèrent aux activités rédactionnelles et d'intervention, en avant un statut hybride d'"hôtes" ([15] [575]). Ils évitaient de prendre partie dans les questions organisationnelles du Bond et ne participaient pas aux réunions lorsque de telles questions étaient soulevées. C'est peu avant mai 1945, qu'ils devinrent membres à part entière de l'organisation, une fois constaté l'accord théorique et politique de part et d'autre.
Le fruit d'une maturation politique du Bond fut la brochure, publiée en août 1944 : "De Strijd cm de macht" (La lutte pour le pouvoir). Cette brochure se prononçait contre toute activité de type parlementaire et syndical, et préconisait la formation de nouveaux organes prolétariens, antisyndicaux, nés de la lutte spontanée : les conseils d'usine, base de la formation de conseils ouvrier La brochure constatait, en effet, .que les changements dans le mode de production capitaliste entraînaient des modifications structurelles au sein de la classe ouvrière et donc mettaient à l'ordre du jour de nouvelles formes d'organisations ouvrières correspondant au surgissement d'u "nouveau mouvement ouvrier". ([16] [576])
A la différence de l'ancien GIC, le Bond - dans cette brochure - préconisait la formation d'un parti révolutionnaire et d'une Internationale. Cependant, à la différence du trotskisme, il était souligné qu'un tel parti ne pourrait surgir qu'à la fin de la guerre, et de lui-même, lorsque seraient formés les organes de lutte du prolétariat.
Lorsque en mai 1945, le Communistenbond "Spartacus" publie légalement la revue mensuelle, Spartacus, il ne peut plus être considéré comme une continuation du MLL Front. Avec l'apport militant des membres du GIC il est devenu une organisation communiste des conseils. Comme devait le noter en 1946, Canne Meijer : "Le Spartacusbond actuel ne peut être considéré comme une continuation directe du RSAP. Sa composition est différente et dans beaucoup de questions, la prise de positions est autre... Beaucoup qui auparavant appartenaient au RSAP ne se sont pas joints à "Spartacus", alors que quelques-uns purent être attirés par les trotskystes. Mais ils ne sont pas nombreux, car les trotskystes de toute façon ne sont pas nombreux." ([17] [577])
En importance, "Spartacus" était la première organisation révolutionnaire en Hollande, et portait donc une lourde responsabilité politique au niveau international dans le regroupement des révolutionnaires en Europe, cloisonnés par l1 Occupation et de nouveau à la recherche de liens internationaux. Cette possibilité de devenir un pôle de regroupement dépendait autant de la solidité de l'organisation, de son homogénéité politique et théorique, que d'une claire volonté de sortir des frontières linguistiques de la petite Hollande.
Numériquement le Bond était relativement fort pour une organisation révolutionnaire, surtout dans un petit pays. En 1945, il comptait une centaine de militants ; il avait à la fois une revue théorique mensuelle et un journal hebdomadaire, dont le tirage était de 6.000 exemplaires ([18] [578]). Il était présent dans la plupart des grandes villes, et en particulier dans les centres ouvriers d'Amsterdam et de Rotterdam, où la tradition communiste des conseils était réelle.
Cependant, l'organisation était loin d'être homogène. Elle rassemblait d'anciens membres du MLL Front, du GIC, mais aussi d'anciens syndicalistes du NAS d'avant guerre. Au Bond s'étaient aussi adjoints des anarchistes de l'ancien "Mouvement socialiste libertaire". Beaucoup de jeunes enfin avaient rejoint "Spartacus", mais sans expérience politique ni formation théorique. Il y avait donc une union de différentes origines mais pas véritablement une fusion, condition même de la création d'un tissu organisationnel homogène. Les tendances centrifuges - comme on le verra plus loin - étaient donc fortes. Les éléments libertaires véhiculaient des conceptions anti-organisation. Les ex-syndicalistes, particulièrement actifs autour de Tbon van den Berg à Rotterdam, étaient très activistes et ouvriéristes. Leur conception était plus syndicaliste que politique. D'autre part, les jeunes avaient une propension - découlant de leur immaturité politique - à suivre l'une de ces deux tendances, et particulièrement la première.
Organisationnellement, le Bond n'avait rien à voir avec l'ancien GIC qui se concevait comme une fédération de groupes de travail. Le Bond était une organisation centralisée et le restera jusqu'en 1947. Son organisation était composée de noyaux (Kerne) ou sections locales de 6 membres, coiffées par des sections territoriales ou urbaines. Le comité exécutif de 5 membres représentait l'organisation à l'extérieur et était responsable devant le congrès du Bond, qui était l'instance suprême. Comme dans toute organisation révolutionnaire digne de ce nom, elle avait des organes de travail élus : une commission politique regroupant la rédaction et chargée des questions politiques ; une commission d'organisation pour les taches courantes ; une commission de contrôle chargée de vérifier que les décisions prises étaient appliquées ; une 'commission de contrôle financier. En tout, en 1945 il y avait entre 21 et 27 personnes dans les organes centraux.
L'adhésion à l'organisation était clairement définie par les statuts adoptés en octobre 1945 ([19] [579]). Le Bond qui avait alors une conception très haute de l'organisation ne voulait accepter de nouveaux membres qu'avec la plus grande prudence et exigeait d'eux "la discipline d'un parti centraliste démocratique" ([20] [580]). Le Bond, en effet, renouait avec la tradition du KAPD.
De cette tradition, cependant, le Communistenbond reprenait certains aspects les moins favorables à l'accomplissement de son travail. Centralisé par ses organes, le Bond était décentralisé au niveau local. Il considérait que chaque "noyau est autonome dans sa propre région" ([21] [581]). Visant à une "décentralisation du travail", il était inévitable que celle-ci entre en contradiction avec le centralisme de l'organisation.
D'autre part, le Bond véhiculait certaines conceptions de l'organisation qui s'étaient épanouies dans les grandes organisations politiques de masses du passé. L'organisation était encore conçue comme une organisation de "cadres" ; d'où la formation, décidée lors de la Conférence des 21 et 22 juillet 1945, d'une "école de cadres marxistes". Elle n'était pas totalement unitaire ; à la périphérie gravitaient les "Associations des amis de Spartacus" (V.S.V.). Le Bond trouvait dans le VSV son organisation de jeunesse autonome. Composée de jeunes entre 20 et 25 ans, cette organisation parallèle était en fait une organisation de jeunes sympathisants. Bien que n'ayant pas de devoirs vis-à-vis du Bond, ils devaient participer à la propagande et contribuer financièrement. Un tel flou entre militants et sympathisants ne contribua pas peu à renforcer les tendances centrifuges au sein de l'organisation.
Un autre exemple du poids du passé est à trouver dans la création en août 1945 d'une "Aide ouvrière" (Arbeidershulp). Il s'agissait de créer dans les entreprises un organisme, ou plutôt une caisse de secours, pour aider financièrement les ouvriers en grève. En filigrane, il y avait l'idée que le Communistenbond devait diriger la lutte des ouvriers et se substituer à leurs efforts spontanés de s'organiser. Néanmoins, l'"Aide ouvrière" n'eut qu'une brève existence. La discussion sur le parti, générale dans le Bond, permit de préciser quelle était la nature et la fonction de l'organisation politique des révolutionnaires.
"Spartacus" pensait en effet que les luttes ouvrières qui éclataient à la sortie de la guerre auguraient d'une période révolutionnaire, sinon dans l'immédiat, du moins dans le futur. Eh avril 1945 la conférence du Spartacusbond proclamait la nécessité d'un parti et le caractère provisoire de son existence comme organisation nationale :
"Le Bond est une organisation provisoire de marxistes, orientée vers la formation d'un véritable parti communiste international, lequel doit surgir de la lutte de la classe ouvrière". ([22] [582])
Il est remarquable que cette déclaration posait la question de la naissance d'un parti en période révolutionnaire. Une telle conception était à l'inverse de celle des trotskystes des années 30, puis des bordiguistes après 1945 qui faisaient du moment de ce surgissement une question secondaire et considéraient que le parti était le produit d'une simple volonté. Il suffisait de le "proclamer" pour qu'il existât. Non moins remarquable était 1'"Adresse inaugurale" - votée à la conférence de juillet- adressée aux groupes révolutionnaires internationalistes. Elle excluait le CRM trotskyste de Hollande, avec lequel la conférence rompit tout contact, en raison de leur position de "défense de l'URSS" ([23] [583]). Enfin elle était un appel au regroupement des différents groupes de la Gauche communiste, qui rejetaient la vision de la prise du pouvoir par un parti :
"C'est dans et par le mouvement même que peut naître une nouvelle Internationale communiste, à laquelle les communistes de tous les pays -débarrassés de la domination bureaucratique mais aussi de toute prétention à briguer le pouvoir pour leur propre compte - peuvent participer". ([24] [584])
On doit cependant constater que cet appel au regroupement des révolutionnaires internationalistes ne se traduisit que par des mesures limitées. La conférence décida d'établir un Secrétariat d'information à Bruxelles dont la tâche était de prendre contact avec divers groupes et d'éditer un Bulletin d'information. En même temps, le contact était repris pour un temps très bref avec le groupe de Vereeken. Il était évident que les positions de son groupe "Centre le courant" (Tegen de stroem) ([25] [585]) étaient incompatibles avec celles du Bond. Mais le fait même de reprendre contact notait une absence de critères politiques dans la délimitation des groupes cemmunistes internationalistes d'autres groupes confus ou anarchistes. Cette même absence de critères se retrouvera en 1947, lors d'une conférence internationale tenue à Bruxelles (cf. infra).
La préparation du Bond au surgissement d'un parti impliquait que la plus grande homogénéité se fasse dans l'organisation sur la conception théorique du parti. C'est pourquoi furent écrites et discutées pour le congrès des 24-26 décembre 1945 des "Thèses sur la tâche et la nature du parti" ([26] [586]). Elles furent adoptées par le congrès et publiées en brochure en janvier 1946 ([27] [587]). Il est très significatif qu'elles furent rédigées par un ancien membre du GIC : Bruun van Albada. Ce fait même montrait l'unanimité qui existait alors dans le Bond sur la question, et surtout traduisait le rejet explicite des conceptions qui avaient régné dans le GIC au cours des années 30.
La tenue de réunions publiques sur le thème du parti, au cours de l'année 1946, montre l'importance que les thèses revêtaient pour l'organisation.
Les Thèses sont centrées sur le changement de fonction du parti entre la période d'ascendance du capitalisme - appelée période du"capitalisme libéral"- et la période de décadence qui suit la première guerre mondiale - période de domination du capitalisme d'Etat. Bien que les concepts d1ascendance et de décadence du capitalisme ne soient pas utilisés, le texte souligne avec force le changement de période historique qui implique une remise en cause des vieilles conceptions du parti :
"La critique actuelle des vieux partis n’est pas seulement une critique de leur pratique politique ou des procédés des chefs, mais une critique de toute la vieille conception du parti. Elle est une conséquence directe des changements dans la structure et dans les objectifs du mouvement de masse. La tâche du parti (révolutionnaire) est dans son activité au sein du mouvement de masse du prolétariat."
Les Thèses, de façon historique, montrent que la conception d’un parti ouvrier agissant sur le modèle des partis bourgeois de la Révolution française et non distinct des autres couches sociales est devenue caduque avec la Commune de Paris. Le parti ne vise pas la conquête de l’Etat mais sa destruction :
"Dans cette période de développement de l'action de masse, le parti politique de la classe ouvrière allait jouer un rôle beaucoup plus grand. Parce que les ouvriers n’étaient pas encore devenus la majorité écrasante de la population, le parti politique apparaissait encore comme l'organisation nécessaire, qui doit oeuvrer à entraîner la majorité de la population dans l'action des ouvriers, tout à fait de la même façon que le parti de la bourgeoisie a agi dans la révolution bourgeoise ; parce que le parti prolétarien devait être à la tête de l'Etat, le prolétariat devait conquérir le pouvoir d'Etat".
Montrant l'évolution du capitalisme après 1900, "période de prospérité croissante du capitalisme", les Thèses montrent le développement du réformisme dans la social-démocratie. Elles ont tendance à rejeter les partis de la II° Internationale après 1900, étant donné leur évolution vers l'opportunisme parlementaire et syndical. Et elles ignorent la réaction des gauches communistes (Lénine, Luxembourg/ Pannekoek) en leur sein. Montrant très bien le "semblant de pleine démocratie" de la social-démocratie classique et la "complète scission entre la masse des membres et la direction du parti", les Thèses concluent négativement et ne montrent pas l'apport positif de l'organisation pour le mouvement ouvrier de l'époque :
"Le parti politique cesse d'être une formation de pouvoir de la classe ouvrière. Il devient la représentation diplomatique des ouvriers dans la société capitaliste. En opposition loyale, il participe au Parlement, participe à l'organisation de la société capitaliste." La Première guerre mondiale ouvrait une nouvelle période, celle de la Révolution prolétarienne. Les Thèses considèrent que c'est la paupérisation absolue du prolétariat et non le changement de période qui est à l'origine de la révolution. De ce fait, on voit mal en quoi la période révolutionnaire de 1917-1923 se distinguait de 1848, période de "paupérisation absolue" caractéristique de la situation du prolétariat naissant :
"L'éclatement de la guerre mondiale signifia qu'à la phase de paupérisation relative succédait celle de la paupérisation absolue. Cette nouvelle évolution doit par la force des choses pousser les ouvriers dans une opposition révolutionnaire au capital. Aussi, en même temps, les ouvriers entraient en conflit avec la social-démocratie".
Les Thèses ne manquent pas de souligner les apports positifs de la vague révolutionnaire de l'après-guerre : naissance spontanée "d'organisations d'entreprise et de conseils ouvriers comme organes de la démocratie ouvrière à l'intérieur des entreprises et organes de la démocratie politique locale". Les Thèses, cependant, minimisent la portée révolutionnaire de 1917 en Russie ; elles ne semblent retenir de 17 que la suite : la contre-révolution et le capitalisme d'Etat. Elles voient même dans la révolution l'origine la contre révolution stalinienne. Le processus de dégénérescence est nié et les ouvriers russes sont ainsi rendus responsables de l'échec de la révolution russe. Ainsi, le développement du "socialisme d'Etat" (c'est-à-dire le capitalisme d'Etat) est considéré "comme résultat de la lutte révolutionnaire des paysans et des ouvriers."
Cependant, c'est avec lucidité que les Thèses notent l'effet pernicieux de la confusion entre socialisme et capitalisme d'Etat dans les rangs ouvriers de l'époque. Cette confusion empêcha la pleine maturation de la conscience révolutionnaire:
"... par la Révolution russe, la conception socialiste d'Etat se para d'une auréole révolutionnaire et cela ne contribua pas peu à entraver la réelle prise de conscience révolutionnaire des ouvriers." ([28] [588])
Le rejet implicite de la Révolution russe et de l'apport du parti bolchevik en 1917 amène le rédacteur des Thèses à établir une identité entre le bolchevisme révolutionnaire des débuts et le stalinisme. Pour lui, il n'y a pas de différence entre bolchevisme et social-démocratie, "sinon de méthode" pour établir une"économie planifiée par l'Etat".
Plus originale est la définition du rôle du parti et des révolutionnaires dans leur intervention. Reprenant la conception du KAPD des années 1920, le Bond souligne que le rôle du parti n'est ni de guider, ni d'éduquer, ni de se substituer à la classe ouvrière :
"Le rôle du parti est maintenant restreint à celui d'une organisation de clarification et de propagande. Il n'aspire pas davantage à instaurer une domination sur la classe".
La genèse du parti dépend étroitement des changements dans le capitalisme - où la période "de capitalisme libéral est définitivement close" -et de la transformation de la conscience de classe des ouvriers. La lutte révolutionnaire qui fait surgir le parti, est avant tout une lutte contre l'Etat produite par l'action de masses, et une lutte consciente pour l'organisation :
"L'Etat est devenu clairement l'ennemi mortel de la classe ouvrière... Dans tous les cas, la lutte des ouvriers se déroule en opposition inconciliable avec cet Etat, non seulement contre les gouvernements mais contre l'ensemble de l'appareil (d'Etat), vieux partis et syndicats inclus. Il y a un lien indestructible entre les trois éléments de la lutte d'émancipation des ouvriers : l'essor de l'action de masse, l'essor de l'organisation et de la conscience."
Les Thèses établissent une interaction dialectique entre le développement de l'organisation révolutionnaire et la lutte révolutionnaire :
"Ainsi se développe dans la lutte l'organisation matériellement et spirituellement ; et avec l'organisation se développe la lutte."
L'aspect le plus significatif des Thèses est de montrer le rôle positif du parti révolutionnaire dans les mouvements de masses et de définir le type de militant révolutionnaire correspondant à la nouvelle période.
Son champ d'action est clairement défini :
a) nécessité du parti : prise de conscience
Les Thèses montrent que le parti est nécessaire, car il est un produit dialectique du développement de la conscience de classe et par conséquent un facteur actif dans ce processus de développement. On est ici très loin de la vision "conseilliste"-qui sera développée par la suite - où les révolutionnaires inorganisés se dissolvent dans la classe ([29] [589]). Est rejetée aussi la conception bordiguiste qui fait du parti un véritable état-major auquel les ouvriers sont subordonnés aveuglément. La nécessité du parti découle non d'un rapport de forces entre cette organisation et la classe, mais d'un rapport organique entre parti et classe, né du développement de la conscience de classe :
"Dans le processus de prise de conscience par la lutte, où la lutte devient consciente d'elle-même, le parti a un rôle important et nécessaire à jouer. En premier lieu il soutient cette prise de conscience. Les leçons qu'on doit tirer autant des victoires que des défaites - et dont les ouvriers, séparément, ont une conscience plus ou moins claire - sont formulées par le parti et diffusées parmi les masses par le moyen de sa propagande. C'est "l'idée", qui, dès qu'elle s'empare des masses, devient une force matérielle".
"Le parti n'est ni un état-major détaché de la classe ni le "cerveau pensant" des ouvriers ; il est le foyer où se focalise et s'exprime la conscience grandissante des ouvriers".
Si le parti et la classe sont dans un rapport organique de complémentarité dans une même unité de conscience, ils ne sont pas identiques ni confondus. Le parti est l'expression la plus élevée de la conscience de classe du prolétariat, comme conscience politique et historique, et non comme conscience reflet de la lutte immédiate (conscience immédiate dans la classe). Le parti est donc une partie de la classe.
"Partie de la classe, la plus consciente dans la lutte et la plus formée, le parti a la capacité de comprendre le premier les dangers qui menacent (la lutte des ouvriers) , de discerner le premier les potentialités des nouvelles organisations de pouvoir : il doit y lutter de façon telle que son opinion soit utilisée à fond par les ouvriers ; il doit la propager par la parole, et s'il le faut par une intervention en acte, afin que son exemple fasse avancer la classe dans sa lutte".
On notera que cette conception du parti dans sa fonction propagandiste "par les mots et par les faits" est identique à celle du KAPD dans les années 20. Le Bond a ici une conception presque volontariste du parti, où l'exemple de l'action du parti est un combat et même une incitation au combat. Cette définition du parti rejoint aussi celle de Bordiga pour lequel un parti c'est un programme plus une volonté d'action. Mais dans la Gauche hollandaise, le programme est moins un ensemble de principes théoriques et politiques que la formulation de la conscience de classe, voire d'une somme de consciences ouvrières :
"Ce que ressent chaque ouvrier, à savoir que la situation est intenable et qu'il est absolument nécessaire de détruire le capitalisme, doit être synthétisé par le parti dans des formules claires".
b) les tâches du parti : théorie et praxis Pour le Communistenbond, il est clair qu'il ne peut être fait une séparation entre travail théorique et intervention pratique. La théorie n'est pas définie comme une somme d'opinions individuelles mais comme une science. Comme le soulignait déjà le Bond en janvier 1945 ; "Le matérialisme dialectique n'est pas seulement la seule méthode exacte mais aussi la seule méthode universelle de recherche " ([30] [590]). Paradoxalement, c'est le scientifique Pannekoek qui rejette dans ses "Conseils ouvriers" l'idée de théorie matérialiste scientifique considérant qu'une organisation exprime des opinions variées sans résultat scientifique et sans méthode. Contrairement au Bond de la période 45-46, Pannekoek défend une méthode éclectique, c'est à dire rejette toute méthode d'investigation théorique, selon le principe qu'une somme d'unités donne une totalité. Il écrit en effet que " dans chacune de ces pensées diverses se trouve en fait une parcelle de la vérité, plus ou moins grande" ([31] [591]). Au contraire, les Thèses affirment :
"Les questions doivent être examinées dans leur cohérence ; les résultats doivent être exposés dans leur clarté et leur déterminisme scientifiques . "
De cette méthode découlent les tâches du parti dans le prolétariat :
- tache"d'éclaircissement" et non d'organisation, cette tâche étant celle des ouvriers dans leur lutte. La fonction d'organisation de la classe disparaît au profit d'une tâche de clarification de la lutte. Cette clarification est définie négativement comme une lutte idéologique et pratique contre "toutes les tentations fourbes de la bourgeoisie et de ses complices de contaminer par leur propre influence les organisations ouvrières".
- tâche"d'intervention pratique dans la lutte de classe". Sa réalisation découle de la compréhension par le parti qu'il ne peut"soustraire aux ouvriers leurs fonctions" :
"(Le parti) ne peut intervenir que comme partie de la classe et non en contradiction avec celle-ci. Sa position dans l'intervention est uniquement de contribuer à 1'approfondissement et à l'extension de la domination du pouvoir de la démocratie des conseils..."
Cette fonction du parti n'implique pas la passivité. A la différence des "conseillistes" des années 50 et 60 (cf. infra), le Spartacusbond n'a pas peur de s'affirmer comme un "moteur" de la lutte de classe qui prend des initiatives qui compensent les hésitations des ouvriers :
"Quand les ouvriers hésitent à prendre certaines mesures, les membres du parti peuvent, comme ouvriers d'industrie révolutionnaires, prendre l'initiative et ils sont même tenus de le faire quand l'accomplissement de ces mesures est possible et nécessaire. Quand les ouvriers veulent remettre à une instance syndicale la décision de déclencher une action, les communistes conscients doivent prendre l'initiative pour une intervention propre des ouvriers. Quand, dans une phase plus développée de la lutte, les organisations d'entreprise et les conseils ouvriers hésitent devant un problème d'organisation de l'économie les communistes conscients ne doivent pas seulement leur montrer la nécessité de cette organisation ; ils doivent aussi étudier eux-mêmes ces questions et convoquer des assemblées d'entreprise pour les discuter. Ainsi, leur activité se déroule dans la lutte et comme le moteur de la lutte, quand celle-ci stagne ou risque de s'égarer sur les voies de garage.
Qui ne manquera pas de relever, dans ce passage, une certaine interprétation ouvriériste de l'intervention dans les conseils ouvriers. Que les membres du parti interviennent comme "ouvriers d'industrie "semble exclure que des "communistes conscients" - d'extraction intellectuelle- puissent défendre comme membres du parti devant les ouvriers leur point de vue. A ce compte là, Marx, Lénine Engels seraient exclus. On sait qu'en 1918, Rosa Luxembourg fut privée du "droit" d'expression dans le Grand Conseil de Berlin sous le prétexte qu'elle était une "intellectuelle". Les défenseurs de la motion d'exclusion étaient les membres du SPD conscients du poids politique de Luxembourg. Ici, les Thèses semblent concevoir que les "intellectuels" membres du parti seraient "étrangers" au prolétariat, bien que le Parti soit défini comme "une partie de la classe".
D'autre part, il est caractéristique que l'intervention du Parti dans les conseils soit centrée d'emblée sur les problèmes économiques de la période de transition : gestion de la production et "organisation de l'économie par la démocratie des conseils ouvriers, dont la base est le calcul du temps de travail". En affirmant que "la nécessité de l'organisation d'une économie communiste planifiée doit être démontrée clairement", le Spartacusbond manifeste une tendance à sous-estimer les problèmes politiques qui se posent en premier dans la révolution prolétarienne, à savoir la prise du pouvoir par les conseils, comme préalable d'une période de transition vers le communisme.
c) le fonctionnement du parti
Les Thèses passent sous silence la question de la centralisation du Parti. Ne sont abordées ni la question des fractions et des tendances, ni la question de la démocratie interne. Le Bond manifeste une tendance à idéaliser l'homogénéité du Parti. Tout comme le PCint bordiguiste de l'après-guerre ([32] [592]), il ne conçoit pas que des divergences puissent surgir dans l'organisation. Mais alors que le parti"bordiguiste" trouve des "garanties" contre les divergences dans un idéal de "programme" immuable, le Spartacusbond croit les trouver dans l'existence de militants idéaux. Le militant, selon le Bond est celui qui est toujours capable d'autonomie de compréhension et de jugement :
"(Les membres du Parti) doivent être des travailleurs autonomes, ayant leur propre faculté de comprendre et de juger..."
Cette définition du militant apparaît comme un "impératif catégorique" et une éthique individuelle à l'intérieur du Parti. Il est à souligner que le Bond pense qu'une composition professionnelle entièrement prolétarienne et que la haute qualité de chaque militant mettent le Parti à l'abri des risques d'une dégénérescence bureaucratique. Cependant on ne peut manquer de relever que les partis composes totalement d'ouvriers, comme les PC dans les années 20 et 30 ne les a pas mis à l'abri de la bureaucratisation stalinienne et que l'organisation du Parti en cellules d'ouvriers d'usine a étouffé la capacité politique de "compréhension et de jugement" des militants ([33] [593]), fussent-ils les meilleurs. D'autre part, dans un parti révolutionnaire, il n'y a pas d'égalité formelle de capacités de tous ; l'égalité réelle est politique par le fait que le Parti est un corps politique avant tout dont la cohésion se reflète dans chacun de ses membres. C'est ce corps qui permet aux militants de tendre individuellement vers une homogénéité politique et théorique.
Plus profond est le rejet par le Bond d'une discipline jésuitique de cadavre - le fameux "perinde ac cadaver" de la Société de Jésus - qui brise les convictions profondes de chaque militant :
"Liés aux conceptions générales et principiel-les du Parti, qui sont en même temps leurs, propres conceptions, (les militants) doivent défendre et appliquer celles-ci dans toutes les circonstances. Ils ne connaissent pas la discipline de cadavre de la soumission sans volonté aux décisions ; ils ne connaissent que l'obéissance par conviction intime, issue d'une conception fondamentale et, dans un conflit au sein de l'organisation, c'est cette conviction qui tranche."
Ainsi est acceptée une discipline de l'organisation librement consentie, qui découle de la défense des positions principielles du Parti. C'est cette notion de discipline qui fut par la suite rejetée quelques années plus tard (cf. infra) par le Bond sous le prétexte qu'elle s'opposait à la libre activité de chacun comme "homme libre pensant par lui-même".
Une idée très importante se trouve exposée dans les Thèses. Le parti n'est pas seulement un programme, mais il est composé d'hommes aminés par la passion révolutionnaire. C'est cette passion, que le Bond appelle "conviction", qui prémunirait le Parti contre toute tendance dégénérescente :
"Cette auto activité des membres, cette éducation générale et cette participation consciente à la lutte des ouvriers rend impossible tout surgissement d'une bureaucratie de parti. Sur le plan organisationnel, on ne saurait trouver des mesures efficaces contre ce (danger) au cas où cette auto activité et cette éducation viendraient à manquer ; dans ce cas-là le parti ne pourrait plus être considéré comme un parti communiste : le parti vraiment communiste, pour lequel l'auto activité de la classe est l'idée de base, le parti dans lequel cette idée s'est incarnée, chair et os, jusque dans ses membres. Un parti avec un programme communiste peut finir par dégénérer, peut-être ; un parti composé de communistes, jamais."
Traumatisé par l'expérience russe, le Bond pensait que la volonté militante et la formation théorique constituaient suffisamment de garde-fous contre la menace de dégénérescence. Il tendait ainsi à édifier l'image d'un militant pur, non soumis individuellement à la pression de l'idéologie bourgeoise. Concevant que le parti est une somme d'individus ayant "les exigences les plus hautes", les Thèses traduisaient un certain volontarisme, voire un idéalisme naïf. La séparation entre programme, fruit d'une constante recherche théorique, et volonté militante aboutissaient à rejeter l'idée d1 un parti, comme corps et programmatique et organique. Si le parti était une somme de volontés militantes, il n'y avait plus d'organe irrigant l'ensemble des cellules militantes. Par la suite, le Bond allait pousser cette séparation à l'extrême, deux ans après (cf .infra).
d) le lien avec la classe
Issu de l'action de masse du prolétariat, le Parti ne trouve finalement d'ultime "garantie" qu'à travers ses liens avec le prolétariat :
"Quand ce lien est inexistant, quand le parti est un organe qui se situe en dehors de la classe, il n'a d'autre choix que de se placer - de façon défaitiste - en dehors de la classe, ou de soumettre les ouvriers à sa direction par la contrainte. Aussi, le Parti ne peut être véritablement révolutionnaire que s'il est ancré dans les masses de telle sorte que son activité n'est, en général, pas distincte de celle du prolétariat, si ce n'est dans le sens que la volonté, les aspirations et la compréhension conscientes de la classe ouvrière sont cristallisées dans le Parti".
Le lien avec la classe apparaît ici -dans sa définition - contradictoire. Le parti catalyse la conscience de la classe en lutte et simultanément fusionne avec le prolétariat. Le Bond ne voit de contradiction entre le Parti et la classe que dans un processus dégénérescent, où se perd le "lien". La cause réside dans la hantise que partageaient les révolutionnaires de cette époque de voir se répéter les horreurs de la contre-révolution en Russie On ne peut, cependant, s'abstenir de remarquer que l'adéquation des buts historiques du prolétariat avec ceux du Parti, n'est point une fusion. L'histoire du mouvement ouvrier, en particulier les révolutions russe et allemande, est l'histoire tourmentée des rapports entre le Parti et la classe. En période révolutionnaire, le Parti peut être en désaccord avec des actions de la classe ; ainsi les bolcheviks étaient en désaccord en juillet 1917 avec les masses ouvrières de Petrograd qui voulaient prendre prématurément le pouvoir. Il peut aussi, comme le Spartakus Bund de Luxembourg, être en accord avec la "volonté des masses" impatientes de prendre le pouvoir à Berlin et se faire décapiter. Dans les faits, la "fusion" entre Parti et masses est rarement accomplie. Le Parti se dirige plus même en période révolutionnaire et totalement dans une phase contre-révolutionnaire - à "contre courant" que "dans le courant". Etant "une partie de la classe" - comme le montrent les Thèses - il est distinct de la totalité de la classe lorsque ses principes et son activité ne sont pas totalement acceptés par la masse des ouvriers ou même rencontrent l'hostilité.
e)Parti et Etat dans la révolution Les Thèses de décembre 1945 n'abordaient pas les rapports entre Parti et Etat, lors de la prise du pouvoir. La question ([34] [594]) fut soulevée au sein du Bond et en mars 1946 parut une brochure consacrée -dans un de ses chapitres - à ce problème : "Van slavenmaatschappij tôt arbeidersmacht" (De la société esclavagiste au pouvoir ouvrier). Il en ressortait que le parti ne pouvait ni prendre le pouvoir ni"gouverner" les ouvriers. En effet, "quel que soit le parti qui forme le gouvernement, il doit gouverner contre les hommes, pour le capital et par une bureaucratie" ([35] [595]). C'est pourquoi le Parti, parti et partie des conseils ouvriers, est distinct de l'Etat :
"C'est un tout autre parti que ceux de la société bourgeoise. Il ne participe lui-même sous aucune forme au pouvoir...la prise du pouvoir prolétarienne n'est ni la conquête du gouvernement de l'Etat par un "parti ouvrier" ni la participation d'un tel parti à un gouvernement d'Etat... l'Etat en tant que tel est complètement étranger par essence au pouvoir des ouvriers ; ainsi les formes d'organisation du pouvoir ouvrier n'ont aucune des caractéristiques de l'exercice du pouvoir par l'Etat." ([36] [596])
Mais en 1946, à l'inverse de ce qui se produira plus tard, c'est Pannekoék qui est influencé par le Ccmmunistenbond ! Dans ces "Cinq thèses sur la lutte de classe" ([37] [597]) il affirme - en contradiction avec ses thèses antérieures- que le travail des partis (révolutionnaires) "est une partie indispensable de l'auto émancipation de la classe ouvrière". Il est vrai qu'il réduit la fonction de ces partis à une fonction uniquement théorique et propagandiste :"Aux partis incombe la deuxième fonction (la première étant "la conquête du pouvoir politique", NDR), c'est à dire diffuser les idées et les connaissance; d'étudier, discuter, formuler les idées sociales et, par la propagande éclairer l'esprit des masses ".
Les oppositions qui naquirent dans le Bond sur la conception du Parti - lors de la préparation du congrès de Noël 1945- apportaient plus des nuances aux Thèses qu'elles ne le critiquaient. Elles étaient en tout cas, un rejet de la théorie éducationniste de Pannekoek. Dans un projet de Thèses - accepté par 2 membres sur 5 de la Commission politique- il était souligné que "le nouveau parti n'est pas l'éducateur de la classe". Ce projet tenait surtout à préciser certains points qui restaient flous dans "Taak en Wszen van de nieuwe Parti ". En premier lieu- pour mieux marquer la rupture avec l'ancien RSAP de Sneevliet - la participation "tactique" aux élections était nettement rejetée :"Le parti naturellement ne participe à aucune activité parlementaire". En second lieu, le rédacteur du projet croyait voir dans les Thèses un retour aux conceptions activistes du KAPD, ou plutôt des tendances "dirigistes" dans la lutte de masses:
"Le parti ne mène aucune action et, comme parti, ne conduit aucune action de la classe. Il combat précisément toute subordination de la classe et de ses mouvements à la direction d'un groupe politique."
Dans cet esprit, le nouveau parti "ne reconnaît point de 'chefs1; il ne fait qu'exécuter les décisions de ses membres... Aussi longtemps qu'une décision subsiste, elle vaut pour tous les membres."
Chardin. (à suivre)
[1] [598] Des deux fils de Sneevliet, l'un s'était suicidé, l'autre était mort en Espagne dans les milices du POUM, sous la bannière de l'antifascisme, victime des positions propagées par le RSAP.
[2] [599] Le groupe de Munis, exilé au Mexique pendant la guerre, prit des positions internationalistes de non-défense de l'URSS. Les RKD, issus eux aussi du trotskisme, et composés de militants français et autrichiens travaillèrent à la fin de la guerre en collaboration avec la Fraction française de la Gauche communiste. Ils s'orientèrent peu à peu vers l'anarchisme pour disparaître en 1948-1949.
[3] [600] Les études de Max Perthus et de Wim Bot sur le MLL Front, qui s'appuient sur les archives allemandes en Hollande, ne donnent aucun fondement à cette hypothèse.
[4] [601] Winkel dans son livre : "De ondergrondse pers 1940-1945" (la Haye, 1954) affirme que l'ex-chef du KAPN et ami de Gorter, Barend Luteraan était rédacteur du CRM ; il semble que Luteraan ait créé pendant la guerre son propre groupe, sur des positions trotskystes. Après la guerre, il devint membre de la social-démocratie hollandaise (Parti du Travail).
[5] [602] Le "Groupe bolchevik-léniniste" constitué sur les positions de la IV° Internationale en 1938 disparut pendant la guerre, après l'arrestation de ses dirigeants. Le CRM se proclama parti en décembre 1945, bien que très faible numériquement, sous l'étiquette de "Parti communiste révolutionnaire" (RCP). Il publiait l'hebdomadaire " De Tribune" qui n'avait rien à voir avec le tribunisme du SPD de Gorter.
[6] [603] Après la guerre, les soupçons se portèrent sur Stan Poppe. Sneevliet avait été arrêté après une visite à Poppe. Dans le dossier du procès de Sneevliet il était affirmé que ce dernier avait été capturé "avec l'aide de Poppe". En décembre 1950 fut constituée une Commission d'enquête composée du RCP, du Ccrmunistenbond et du petit syndicat indépendant 0VB. Elle arriva unanimement à la conclusion que l'attitude de Poppe était irréprochable et qu'aucun blâme ne pouvait être porté contre lui.
[7] [604] 300.000 personnes sur une population de 6 millions d'habitants vivaient dans la clandestinité, avec de faux papiers et de fausses cartes de ravitaillement.
[8] [605] cf. "Spartacus, bulletin van de revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging in Nederland", janvier 1944.
[9] [606] cf. Vereeken :"Le Guépéou dans le mouvement trotskyste", Paris, 1975, chapitre premier.
[10] [607] cf. "Spartacus n°4, octobre 1942 ; et dans la même revue de février 1944 l'article :"De Scwiet-Uhie en Wij" ("L'Union soviétique et nous").
[11] [608] "De perspectiven van het impérialisme na de oorlog in Europa en de taak van de revolutio-naire socialisten", décembre 1943. Il est remarquable que cette brochure, dont les thèses étaient très éloignées du communisme des conseils, soit donnée comme base politique du Bond en 1945, sans qu'aucune critique soit portée sur le contenu de ces thèses. Cf ; "Spartacus, maans-chrift voor de revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging", mai 1945 : Beschouwingen over de situatie : de balans".
[12] [609] cf. "ETOrcéteo", n°3, octobre 19^6 : "Le prespettive del dopoguerra in relazione alla piatta-forma del Fartito" (Tes nerspectives de l'après-guerre en relation avec la plateforme du Parti). Bordiga , auteur de l'article, y affirme que "les démocraties occidentales évoluent progressivement vers les formes totalitaires et fascistes". Sous ces termes, Bordiga, comme la Gauche hollandaise, voulaient souligner la tendance vers le capitalisme d'Etat dans les pays d'Europe occidentale.
[13] [610] Le Bond publia dans sa revue théorique "Maandblad Spartacus"en 1945 (N°9 et 12) une étude sur les occupations d'usines en Italie :"Een bedrijfsbezetting" (Une occupation d'usines). L'article affirme que en 1920 "les usines formaient une unité qui n'était rattachée ni à un parti ni à un syndicat". "... le mouvement finit par un compromis entre les syndicats et les patrons". Il montre que l'occupation d'usines ne suffit pas et que doivent surgir des conseils ouvriers dont la "tâche première n'est pas l'ordonnancement de l'industrie mais l'organisation de la lutte. C'est alors une période de guerre : la guerre civile". Cette vision critique de l'occupation des usines en Italie est bien différente de la vision usiniste défendue par la suite dans le Bond par Pannekoek d'une "gestion de la production" par les conseils.
[14] [611] Pour l'historique de la fusion entre les ex-GIC et le Communistenbond, une lettre de Canne Meijer du 30 juin 1946 au journal "Le prolétaire" (RKD-CR) donne d'utiles précisions. Canne Meijer écrivit en 1944 pour la discussion un texte sur la démocratie ouvrière : "Arbeiders-democratie in de bedrijven". Bruun van Albada publia dans "Spartacus" n°1 de janvier 1945, une étude sur la méthode marxiste : Het marxisme als méthode van onderzoek", comme méthode dialectique scientifique d'investigation.
[15] [612] Ils étaient seulement des "hôtes" - note Canne Meijer dans la même lettre -, faisaient tout le travail… en commun avec les camarades du Bond, mais ils se gardaient de toute ingérence organisation
[16] [613] Cependant en 1943 et 1944, des membres du Bond participaient à la création du petit syndicat clandestin "Eenheidsvakbewweging" (Syndicat unitaire). Pour l'histoire de ce syndicat, cf. "De Eenheidsvakcentra-le (EVC) 1943-1948", Groningen, 1976 par P. Coomans, T. de Jonge et E. Nijhof.
[17] [614] Lettre du 30 juin 1946, déjà citée, Canne Meijer considère que le Bond s'inscrit dans le développement d'un "nouveau mouvement ouvrier qui n'est pas une 'opposition' à l'ancien ni sa 'gauche' ou son 'ultra-gauche', mais un mouvement avec d'autres fondements".
[18] [615] Lettre de Canne Meijer du 27 juin 1946 au journal "Le Prolétaire". En 1946 le tirage de "Spartacus" hebdomadaire était tombé à 4.000 exemplaires.
[19] [616] Décision de la conférence des 21-22 juillet 1945, où étaient présents 21 militants des "Kerne" de Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum-Bussum. Cf "Uit eigen Kring" (UEK) n°2, août 1945.
[20] [617] Décision de la conférence des 21-22 juillet 1945, où étaient présents 21 militants des "Kerne" de Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum-Bussum. Cf "Uit eigen Kring" (UEK) n°2, août 1945.
[21] [618] "Le noyau est autonome dans son propre cercle. Il décide de l'admission et de l'exclusion des membres. Le Comité exécutif central est d'abord consulté pour l'admission et l'exclusion des membres. Par ce point de statut, l'autonomie des noyaux restait limitée en théorie, d'autant plus qu était affirmée la discipline organisative : "Les noyaux (noyaux principaux) sont tenus d'observer les décisions prises par la Conférence du Bond et de diffuser les principes du Bond, tels que ceux-ci étaient et sont établis aux conférences du Bond."
[22] [619] "Uit eigen kring", n°1, avril 1945.
[23] [620] "Uit eigen kring", n°2 août 1945 : "La conférence se met d'accord de rejeter toute collaboration avec le CRM. Décision est prise de ne pas s'engager dans une discussion avec le CRM".
[24] [621] "Uit eigen kring", n°4 août 1945, Projet d'adresse inaugurale "aux travailleurs manuels et intellectuels de tous les pays "
[25] [622] La proposition d'établir un "Secrétariat d'informations" à Bruxelles venait de "Contre le courant" et de la Centrale du Communistenbond. La conférence donna son accord. Cf. "Vit eigen king"n°2, août 1945, point 8 de la résolution.
[26] [623] Les Thèses,-qui étaient l'un des trois projets de thèses, parurent dans "Uit eiqen kring" n°8 décembre 1945, puis sous forme brochure en janvier 1946. Les deux autres projets, sans être rejetés étaient soumis à la discussion.
[27] [624] Les Thèses ne furent remises en question qu'en 1951. Des projets d'amendements furent soumis à l'organisation par le groupe d'Amsterdam. Cf. "Uit eigen kring", 20 octobre 1951.
[28] [625] En 1943, Pannekoek lui-même, en dépit de son analyse de la révolution russe comme "bourgeoise" , montrait qu'Octobre 1917 a eu un effet positif sur la conscience de classe : "Puis, comme une étoile brillante dans un ciel sombre, la Révolution russe illumina toute la Terre. Partout les masses se remirent à espérer ; elles devinrent plus rétives aux ordres de leurs maîtres, car elles entendaient les appels venus de Russie : appels à mettre fin à la guerre, appels à la fraternité entre les travailleurs de tous les pays, appels à la Révolution mondiale contre le capitalisme." ("Les conseils ouvriers", p. 184, Balibaste)
[29] [626] Cf. Bordiga, in "Parti et classe", 1921 (republié dans Le fil du temps, n°8, octobre 1971) : "Un parti vit quand vivent une doctrine et une méthode d'action. Un parti c'est une école de pensée politique et, par conséquent, une organisation de lutte. Tout d'abord, il y a un fait de conscience ; ensuite un fait de volonté, soit plus exactement une tendance vers une finalité."
[30] [627] Cf "Spartacus, maandschrift vcor de revolutionaire-socialistische arbeidersbeweging",n°1 : "Het marxisme als méthode van onderzoek", article écrit par Van Albada, qui était astronome.
[31] [628] Cf. "Les conseils ouvriers", p. 493, Bélibaste.
[32] [629] Le PC internationaliste de Bordiga se concevait comme un parti "monolithique" où ne pouvait exister une "liberté de théorie". Les débats internes étaient rendus impossibles par le "centralisme organique" d'une direction concevant le marxisme comme une "conservation de la doctrine". Dans le Bond, existaient des débats internes, mais sans qu'il définisse dans ses statuts dans quel cadre ils devaient surgir.
[33] [630] Cf . Bordiga, l’Unita n°172, 26 juillet 1925 : « …les chefs d’origine ouvrière ce sont révélés au moins aussi capable que les intellectuels d’opportunisme et de trahison en général, plus susceptibles d’être absorbés par les influences bourgeoises… Nous affirmons que l’ouvrier, dans la cellule, aura tendance à ne discuter que les questions particulières intéressant les travailleurs de son entreprise » .
[34] [631] Un deuxième projet de thèses sur le parti abordait cette question. Il rejetait explicitement la conception que le parti prend et exerce le pouvoir. Cf ."Stellingen,taak en wezen van de Partij", thèse 9,in "Uit eigen kring",n°7, décembre 1945.
[35] [632] La brochure était l'un des fondements programmatiques du Bond. Elle examinait la question du voir à travers l'évolution des sociétés de classe de l'Antiquité jusqu'à la société capitaliste.
[36] [633] Les "Cinq thèses" de Pannékoek ont été republiées par "Informations et correspondance ouvrières" (ICO) dans le brochure : "La grève généralisée en France, mai-juin 1968", supplément à ICO, n°72.
[37] [634] Uit eigen kring", n°7, décembre 1945 : "Stellingen over begrip en wezen van de parti j" (Thèses sur le concept et l'essence du parti). Ces Thèses forment le troisième projet soumis à la discussion et non accepta par le Congrès du Bond.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 39 - 4e trimestre 1984
- 2697 reads
Quelle méthode pour comprendre : la reprise des luttes ouvrières
- 2419 reads
Le développement, dans le contexte général de la reprise historique des combats de classe depuis 68, d'une troisième vague de luttes ouvrières après celles de 68-74 et de 78-80, est maintenant évident. La succession de combats ouvriers qui, depuis le milieu de 1983, a affecté la presque totalité des pays avancés - et notamment ceux d'Europe occidentale - et qui trouve, avec la présente grève des mineurs de Grande Bretagne, son expression la plus élevée, est venue démontrer clairement que la classe ouvrière mondiale est maintenant sortie de l'apathie qui avait permis et suivi sa défaite cuisante en Pologne en décembre 81. C'est ce que nous mettons une nouvelle fois en évidence (après nos articles de la Revue Internationale n°37 et n°38) dans la première partie de cet article. Cette reprise, même avec du retard, tous les groupes révolutionnaires l'ont maintenant reconnue. Cependant, ce retard, manifesté par beaucoup de 'révolutionnaires dans la compréhension de la situation présente, pose le problème de la méthode avec laquelle il faut analyser cette situation. C'est cette méthode, condition de la capacité des communistes d'être un facteur actif dans le développement des luttes de classe, que nous examinons dans la deuxième partie de cet article.
OU EN EST LA REPRISE ACTUELLE DE LA LUTTE DE CLASSE ?
Le prolétariat a mis deux ans pour tirer les leçons et se remettre de la fin de la vague de lutte des années 78-81 marquée notamment par les mouvements dans la sidérurgie en France et en Grande Bretagne, les grèves des mineurs aux USA, celle du port de Rotterdam avec son comité de grève, et surtout la grève de masse en Pologne d'août 80. Le prolétariat international' a mis deux ans pour encaisser, digérer et comprendre la défaite qu'il a subie en Pologne, défaite dont l'aboutissement fut le coup de force du 13 décembre 81 et la terrible répression qui s'en est suivie.
La durée du recul des luttes que cette défaite a provoquée au niveau international ne pouvait qu'être courte. Avant même de pouvoir reconnaître clairement le renouveau de combativité du prolétariat qui allait s'exprimer d'abord aux USA en juillet 83 (grève du téléphone) puis surtout en Belgique en septembre (grève du secteur public), nous affirmions lors du 5ème congrès du CCI, en juillet 83, que .- "Si jusqu'à présent le prolétariat des pays centraux avait subi moins brutalement que ses frères de classe de la périphérie les rigueurs de l'austérité, l'enfoncement du capitalisme dans la crise contraint la bourgeoisie à une attaque de plus en plus sévère du niveau de vie de la classe ouvrière au sein de la plus importante concentrât ion industriel le mondiale, celle d'Europe occidentale"."Cette crise, que le prolétariat vit comme une contrainte, le pousse à généraliser ses luttes et sa conscience, à mettre pratiquement en avant la perspective révolutionnaire. " (Revue Internationale n°35, "Rapport sur la situation internationale, p.14).
L'année 83-84 a largement confirmé cette analyse. Sans revenir dans le détail (cf. Revue Internationale n°37, 38 et les différentes presses territoriales du CCI), nous pouvons rappeler rapidement que cette vague de luttes a touché tous les continents, le Japon et l'Inde, la Tunisie et le Maroc lors des émeutes de la faim de l'hiver dernier, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la République Dominicaine, les USA et l'Europe occidentale. Dans cette dernière, ce sont tous les pays qui ont été touchés et sont encore touchés par les révoltes ouvrières. Aucun n'a été épargné : Espagne, Italie, Grèce, Suède, Hollande, Belgique, France, Grande Bretagne, Allemagne. Là se trouve le coeur économique et surtout historique du capitalisme. Là se trouve la concentration ouvrière la plus grande, la plus vieille et la plus expérimentée du monde.
Après un été où la combativité ouvrière ne s'est démentie ni même ralentie (Angleterre), nous nous trouvons à l'aube d'une année au cours de laquelle les événements vont s'accélérer. Face à l'accentuation de la crise du capitalisme et à la nécessité pour la bourgeoisie d'attaquer encore plus la classe ouvrière, l'heure est toujours au maintien et au renforcement de la tactique bourgeoise de la "gauche dans l'opposition". Cette dernière "opposée" à des équipes gouvernementales de droite, est spécialement chargée maintenant de saboter les réactions ouvrières aux mesures d'austérité et de licenciements prises dans tous les pays. Deux événements sont particulièrement significatifs de cette tactique de la bourgeoisie : l'élection présidentielle aux USA. Pour celle-ci, qui a lieu en novembre, la bourgeoisie américaine possède en Reagan le "ticket" gagnant apte à remplir le rôle dévolu aux gouvernements de droite en place aujourd'hui. Il a déjà largement fait ses preuves. Pour ceux qui douteraient encore du "machiavélisme" de la bourgeoisie (cf. Revue Internationale n°31), de la mise en place réfléchie de sa "gauche dans l'opposition", de la volonté de la bourgeoisie américaine d'éviter toute mauvaise surprise, la publicité des médias sur la feuille d'impôts de la candidate démocrate à la vice-présidence n'est que le dernier, à ce jour, des "scandales" et des manipulations dans lesquels les bourgeoisie occidentales sont passées maîtres pour organiser les élections et... leur résultat. Le maintien dans l'opposition du parti démocrate doit permettre à celui-ci de prendre un langage de plus en plus "populaire", de "gauche", et de renforcer les liens traditionnels avec la grande centrale syndicale américaine, l'AFL-CIO ; - d'autre part, le départ du PC français du gouvernement. Cette décision du PCF, et son opposition croissante et ouverte à Mitterrand le socialiste, visent à regarnir le front social qui était dangereusement découvert. En 81, l'arrivée accidentelle au gouvernement de la France du PS et du PC, ce dernier étant traditionnellement la force principale d'encadrement et de contrôle de la classe ouvrière dans ce pays, avait mis l'appareil politique de la bourgeoisie en état d'extrême faiblesse face au prolétariat. C'était le seul pays a'Europe occidentale sans parti de gauche important dans l'opposition pour saboter les luttes ouvrières "de l'intérieur". La bourgeoisie n'a pas fini de payer son dérapage de mai 81, de trois ans de gouvernement de "l'union de la gauche", gouvernement qui a asséné l'attaque la plus violente contre la classe ouvrière en France depuis la seconde guerre mondiale et la période de "reconstruction" qui l'a suivie. Cependant, le départ du PCF du gouvernement et son passage dans une opposition de plus en plus ouverte et "radicale", constitue une première disposition de la bourgeoisie française tendant à surmonter cette situation de faiblesse.
Ces deux événements, le passage du PCF dans l'opposition, et surtout l'élection présidentielle à venir aux USA, prennent place dans le cadre du renforcement et de la préparation de l'appareil politique de la bourgeoisie pour affronter le prolétariat, et ce au niveau international. Ces deux événements signifient que la bourgeoisie sait que la crise économique du capital va encore s'accentuer et qu'elle, la bourgeoisie, va devoir attaquer encore plus la classe ouvrière ; ils signifient qu'elle a su reconnaître à sa manière la reprise internationale des luttes ouvrières.
A- Les ouvriers en Grande Bretagne au premier rang de la reprise internationale des luttes.
C'est dans cette situation générale que se situe le mouvement de luttes ouvrières en Grande Bretagne. Avec, à sa tête, la grève des mineurs longue maintenant de sept mois (!), ce mouvement de lutte est devenu le fer de lance de la lutte du prolétariat mondial. Il a atteint le niveau le plus haut de lutte depuis la grève de masse d'août 80 en Pologne.
Pourtant, le prolétariat se trouve confronté, dans ce pays, à une bourgeoisie particulièrement forte politiquement et qui s’était préparée de longue date à des affrontements avec la classe ouvrière. La Grande Bretagne est le plus vieux pays capitaliste. La bourgeoisie britannique domine le monde tout au long du siècle dernier. Elle a une expérience de domination politique que ses consoeurs des autres nations capitalistes lui en vient ; en particulier à travers son jeu démocratique et parlementaire. C'est cette expérience politique sans égale qui lui a permis d'être la première à vouloir et à pouvoir mettre en place la tactique de "la gauche dans l'opposition-. Consciente du danger des réactions ouvrières que ne manquaient pas de provoquer les attaques économiques dues à la crise et à l'usure du parti travailliste au pouvoir, elle sut, en mai 79, renvoyer celui-ci dans l'opposition, et trouver en Thatcher la "Dame de fer" qui lui convenait. Elle sut diviser (création du parti social-démocrate) et affaiblir électoralement le parti travailliste, mais aussi le garder suffisamment fort pour empêcher - avec son organisation syndicale, le TUC - le surgissement de luttes ouvrières et les saboter.
La grève des mineurs, tout comme la reprise internationale des luttes, nous enseigne que cette carte bourgeoise de "la gauche dans l'opposition" n'arrive plus à empêcher ni à étouffer le surgissement des réactions ouvrières, même si elle arrive encore assez bien à les saboter. Dans ce sabotage, la bourgeoisie britannique dispose, là encore, d'une arme que lui envient toutes les autres bourgeoisies : ses syndicats. Tout comme dans le jeu parlementaire et électoral, la classe dominante anglaise est passée maître dans l'art de présenter au prolétariat de fausses oppositions : entre la direction nationale du TUC d'un côté et, de l'autre, Scargill (le chef du syndicat des mineurs) et les shop stewards, institutions vieilles de plus de 60 ans et qui jouent le rôle du syndicalisme de base, de dernière barrière du syndicalisme, la plus "radicale" contre la lutte des ouvriers. Mais si la bourgeoisie est ancienne et expérimentée, le prolétariat est aussi ancien, expérimenté et très concentré. C'est dans ce sens que le mouvement de grèves actuel prend une signification particulière.
La lutte des mineurs, dont la renommée et l'expérience ont déjà traversé la Manche pour atteindre le continent européen, a déjà contribué à détruire une mystification importante tant en Grande-Bretagne que dans les autres pays : le mythe de la démocratie britannique et du policier anglais sans arme. La violente répression qu'ont subie les mineurs a peu à envier à celle de n'importe quelle dictature sud-américaine : 5000 arrestations, 2000 blessés et 2 morts ! Les villes et les villages des mineurs occupés par la police anti-émeute, les ouvriers attaqués dans la rue, dans les pubs, chez eux, les stocks de nourriture destinés aux familles saisis, etc. La dictature de l'Etat bourgeois a vite tombé son masque démocratique.
Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle employée une telle violence ? Pour démoraliser les mineurs ; pour décourager les autres secteurs de la classe ouvrière tentés de les rejoindre. Certes. Mais c'est surtout pour empêcher les piquets de grève d'étendre la grève aux autres puits de mine, aux autres usines, pour empêcher une extension générale du mouvement. Car la bourgeoisie a peur. Elle a peur des débrayages spontanés qui ont eu lieu dans les chemins de fer (à Paddington), à British Leyland, des occupations de chantiers navals comme à Birkenhead, ou à l'Aerospace à côté de Bristol.
Et c'est cette peur de l'extension qui l'a retenue d'utiliser cette même violence étatique, une fois les dockers entrés en grève de solidarité au mois de juillet. L'utilisation de la répression aurait risqué en cette circonstance de mettre le feu aux poudres, d'accélérer l'extension de la grève à toute la classe ouvrière. Grâce aux manoeuvres des syndicats (lire World Révolution No 75) et aux médias, cette première grève s'est terminée au bout de 10 jours.
Le mouvement de luttes en Grande-Bretagne reprend toutes les caractéristiques des luttes internationales actuelles que nous avons mises en évidence dans nos "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" dans le No 37 de cette Revue : nous n'y reviendrons pas dans cet article. Mais il nous faut souligner l'extraordinaire combativité qu'exprime le prolétariat en Grande-Bretagne : après 7 mois, malgré une violente répression, des pressions de toutes parts, les mineurs sont toujours en grève. A l'heure où nous écrivons, les travailleurs des docks sont en grande partie de nouveau en grève en solidarité avec les mineurs malgré l'échec de la première tentative du mois de juillet ; ils sont conscients que leur intérêt de classe immédiat est le même que celui des mineurs, et des autres secteurs de la classe ouvrière.
C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui, peu à peu, prend conscience de son intérêt de classe exprimé dans les mines. A travers cette lutte, la question ouvertement posée, est celle de l'extension réelle des luttes. Il faut souligner, qu'outre les dockers, les chômeurs et les femmes des ouvriers luttent avec les mineurs et se battent avec eux contre la police. Avec la question de la solidarité, c'est la perspective de l'extension consciente qui s'affirme aujourd'hui ouvertement en Grande-Bretagne pour le prolétariat mondial, et surtout européen. Et à travers cette extension, et l'affrontement avec les syndicats et les partis de gauche, ce sont les conditions de la grève de masse dans les métropoles du capitalisme que développe le mouvement de luttes ouvrières.
B- La signification des grèves en Allemagne de l'Ouest
Après les combats en Grande-Bretagne, l'un des aspects les plus probants de cette reprise internationale de la lutte de classe a été le retour du prolétariat allemand sur le terrain des affrontements de classe, comme en témoignent les occupations des chantiers navals à Hambourg et à Brème en septembre 83, la grève des métallurgistes et des imprimeurs au printemps 84. C'est la fraction la plus nombreuse, la plus concentrée et aussi la plus centrale de la classe ouvrière d'Europe de l'Ouest. Ce renouveau des luttes ouvrières au coeur de l'Europe industrielle a une signification historique qui va bien au delà de 1'importance immédiate des grèves elles-mêmes. C'est la fin de 1'importante marge de manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Europe que lui assurait le relatif calme social maintenu en RFA dans les années 70.
Ce développement des luttes en Allemagne confirme deux aspects importants de l'analyse marxiste de la situation mondiale développée par le CCI :
- la crise économique dans le contexte historique d'une classe ouvrière non battue, agit comme le principal allié des ouvriers, en poussant progressivement les principaux bataillons du prolétariat mondial dans le combat de classe, et au premier rang de celui-ci ;
- le resurgissement historique de la lutte de classe depuis 1968 a permis au prolétariat de se débarrasser de plus en plus des effets terribles de la contre-révolution la plus longue et la plus sauvage qui se soit jamais abattue sur le prolétariat ; or, l'Allemagne, tout comme la Russie, fut le principal centre de la contre-révolution qui a suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-
Quelle est la signification de la reprise des affrontements de classe en Allemagne, signification que la propagande bourgeoise voudrait cacher? Ces luttes montrent la banqueroute du "miracle économique" de l'après-guerre, la banqueroute de l'affirmation selon laquelle le travail dur, la discipline et la "collaboration capital-travail", la "paix" sociale peuvent éviter la crise économique. Plus important encore : ces luttes montrent que le prolétariat n'a jamais été "intégré" au capitalisme (souvenons-nous des théories de 1968 à la Marcuse), que toutes les attaques de la Social-Démocratie et du nazisme n'ont pas réussi à détruire le coeur du prolétariat européen. Nous affirmons, qu'à l'image du reste du prolétariat international, les ouvriers allemands n'en sont qu'au début de leur retour dans le combat de classe.
Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue que le retour du prolétariat allemand à sa vraie place, à la tête de la lutte de classe internationale, ne fait que commencer, et que ce processus sera long et difficile. En particulier, il faut nous rappeler que :
- le degré de combativité des ouvriers allemands a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau déjà atteint en Grande-Bretagne, où les conditions matérielles des ouvriers sont bien pires qu'en Allemagne, et où la classe ouvrière a déjà développé une tradition de luttes et de combativité tout au long des années 70 ;
- les potentialités à court terme de la situation en Allemagne ne sont en aucun cas aussi riches qu'en France, le voisin, car la bourgeoisie de l'Est du Rhin est bien plus puissante et mieux organisée que celle de l'Ouest (elle a en particulier depuis déjà un certain temps réalisé sa tactique de la mise en place de ses fractions de gauche -syndicats et parti Social-démocrate- dans "l'opposition", mise en place juste entamée en France). De plus, la génération présente des ouvriers allemands manque de l'expérience politique de ses camarades en France ;
- dans les luttes jusqu'aujourd'hui, la proportion des ouvriers directement en grève a été bien plus faible qu'en Belgique, et a touché moins de secteurs qu'en Espagne par exemple.
Loin d'être à la tête du mouvement, les ouvriers d'Allemagne en sont en fait encore à rattraper leur retard sur le reste des ouvriers d'Europe. Ceci est vrai au niveau de la combativité, de l'étendue des mouvements, du degré de politisation et de la confrontation avec la stratégie de la gauche dans l'opposition, en particulier avec le syndicalisme de base, l'arme que la bourgeoisie allemande n'a pas eu encore à employer beaucoup jusqu'à présent. Ce "rattrapage" en Allemagne est devenu un des aspects les plus importants du processus d'homogénéisation de la conscience de classe dans le prolétariat européen et des conditions de la lutte en Europe de l'Ouest.
La présente reprise des luttes ouvrières, le nouveau pas qu'elle représente dans le développement historique des combats de classe depuis 68, assignent aux organisations révolutionnaires des responsabilités accrues, et en particulier celle d'intervenir activement dans le processus de prise de conscience qui s'opère actuellement dans la classe. Une telle intervention s'appuie nécessairement sur la plus grande clarté sur la compréhension des véritables enjeux de la situation présente. C'est dire toute l'importance que revêt pour les révolutionnaires - et pour la classe dans son ensemble - la méthode avec laquelle ils analysent la réalité sociale.
LA METHODE D'ANALYSE DE LA REALITE SOCIALE
La reconnaissance et la compréhension de la reprise internationale des luttes ouvrières ne peut s'acquérir qu'en s'appropriant la méthode marxiste d'analyse de la réalité sociale.
Cette méthode rejette la démarche phénoménologique. Aucun phénomène social ne peut être compris et expliqué à partir de lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est seulement en le situant dans le mouvement social général en développement que le phénomène social, la lutte de classe, peut être saisi. Le mouvement social n'est pas une somme de phénomènes, mais un tout les contenant tous et chacun.
Le mouvement de la lutte prolétarienne est à la fois international et historique. C'est de ces deux points de vue, mondial et historique, que les révolutionnaires peuvent appréhender la réalité sociale, la situation de la lutte de classe.
D'autre part, le travail théorique et d'analyse des révolutionnaires n'est pas une réflexion passive, un simple reflet de la réalité sociale, mais tient un rôle actif, indispensable dans le développement de la lutte prolétarienne. Il n'est pas quelque chose d'extérieur au mouvement de la lutte de classe, mais en est une partie intégrante. Tout comme les révolutionnaires sont une partie, bien précise et particulière, de la classe ouvrière, de même leur activité théorique et politique est un aspect de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
Les communistes ne peuvent s'approprier la méthode marxiste qu'en se situant comme facteur actif dans le mouvement de la lutte de classe, et d'un point de vue mondial et historique.
En prenant chaque lutte en soi, en l'examinant de manière statique, immédiate, photographique, on s'ôte toute possibilité d'appréhender la signification des luttes et,en particulier, de la reprise actuelle de la lutte de classe. Si nous reprenons parmi les principales caractéristiques des luttes d'aujourd'hui (cf. Revue Internationale No 37, "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe"), la tendance au surgissement de mouvements spontanés, à des mouvements de grande ampleur touchant des secteurs entiers dans un même pays, leur tendance à l'extension et à l'auto organisation, si nous reprenons donc toutes ces caractéristiques en soi, de manière statique, mécanique, et si nous les comparons avec la révolte ouvrière d'août 80 en Pologne, il est effectivement difficile de voir une reprise du combat de classe du prolétariat international. Les mouvements spontanés de solidarité des dockers et d'autres secteurs ouvriers avec les 135 000 mineurs en grève en Grande-Bretagne, les manifestations violentes et spontanées débordant les syndicats en mars dernier en France, les 700 000 manifestants ouvriers à Rome le 24 mars, même la grève des services publics en septembre 83 en Belgique, paraissent bien en deçà du niveau de lutte atteint par la vague précédente ; et surtout bien loin de la grève de masse en Pologne. Et pourtant...
Et pourtant, la méthode marxiste ne peut se contenter de comparer deux photos prises à quelques années de distance. Elle ne peut se contenter de rester à la surface des choses. Pour les révolutionnaires conséquents, il s'agit d'essayer de saisir la dynamique profonde, le mouvement des luttes ouvrières.
La reprise de la lutte de classe se situe principalement, mais pas uniquement, dans les principaux centres industriels du monde, en Europe occidentale, et aux USA. Ce n'est donc plus dans un pays du bloc de l'Est, ni seulement en Afrique du Nord, à Saint-Domingue et au Brésil que ces mouvements spontanés et de grande ampleur surgissent. C'est dans les principaux, les plus vieux pays capitalistes, dans les pays "les plus prospères", dans le bastion industriel de l'Europe. C'est le prolétariat le plus ancien, le plus expérimenté et le plus concentré qui réagit aux attaques de la bourgeoisie.
C'est dire que deux des principales armes employées avec succès contre le prolétariat dans la vague de luttes précédente, et particulièrement en Pologne, n'ont plus assez d'efficacité aujourd'hui pour maintenir les ouvriers dans les illusions et la démoralisation :
- l'arme de la spécificité nationale des pays du bloc de l'Est qui avait permis l'isolement en Pologne en présentant la crise économique qui sévissait dans ce pays comme le résultat de la*mauvaise gestion des bureaucrates" locaux. Les luttes actuelles en Europe occidentale mettent à bas les illusions sur des issues nationales, pacifiques à la crise économique. La révolte ouvrière ne frappe plus seulement les pays de l'Est et du Tiers-monde mais aussi les pays "démocratiques" et "riches". C'est la fin des illusions sur la nécessité de sacrifices momentanés pour sauver l'économie nationale. Avec l'apparition de soupes populaires dans les grandes villes d'occident et qui éclairent d'un autre jour les queues et les privations supportées par les ouvriers d'Europe de l'Est, la reprise actuelle des luttes dans les métropoles industrielles de l'Ouest signifie donc la compréhension progressive par le prolétariat international du caractère irréversible, catastrophique et international de la crise du capital.
- l'arme de "la gauche dans l'opposition" qui avait si bien fonctionné, et en Europe de l'Ouest, et à travers le syndicat Solidarité en Pologne. La reprise internationale actuelle nous enseigne que cette arme n'arrive plus à empêcher directement l'éclatement de grèves ouvrières (même si elle est encore très efficace dans leur sabotage). Ce sont donc les illusions sur la "Démocratie de l'Ouest" et sur les partis de gauche et les syndicats qui tendent à tomber.
Cette prise de conscience du caractère inévitable et irréversible de la crise du capital dans le monde entier, et du caractère bourgeois des partis de gauche même sans responsabilités gouvernementales, ne pouvait -et ne peut- se développer qu'à partir des luttes ouvrières dans les pays industriels les plus développés et les plus vieux, dans les pays où la bourgeoisie dispose d'un appareil d'Etat rodé au jeu démocratique et parlementaire, dans les pays où les illusions sur "la société de consommation", sur la "prospérité éternelle", prenaient leur source et avaient été les plus fortes.
C'est en répondant à ces deux obstacles et en les dépassant, que le prolétariat reprend le combat aujourd'hui là où il l'avait laissé en Pologne.
Saisir la signification de la période actuelle de luttes, c'est saisir le mouvement et la dynamique qui les animent ; c'est saisir et comprendre que c'est la maturation de la conscience de classe dans la classe ouvrière, le développement de la prise de conscience chez les ouvriers qui produit et détermine la reprise internationale des luttes ouvrières. C'est cette maturation et ce développement de la conscience qui donnent tout leur sens, toute leur signification aux luttes ouvrières.
En effet, condition indispensable du développement de la lutte de classe, l'approfondissement de la crise ne suffit pas à expliquer le développement de la lutte de classe. L'exemple de la crise de 1929 et des années qui ont précédé la seconde guerre mondiale nous le prouve. Dans les années 30 les attaques terribles de la crise économique n'avaient provoqué qu'une plus grande démoralisation et qu'un plus grand déboussolement dans un prolétariat qui venait d'essuyer la plus grande défaite de son histoire et qui subissait à plein le poids des mystifications "antifascistes" et sur la "défense de la patrie socialiste" visant à l'enchaîner au char de l'Etat bourgeois derrière les partis de gauche et les syndicats. La situation est bien différente à l'heure actuelle. Le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas battu et nous avons vu précédemment que c'est sa capacité à digérer, à mûrir ses défaites partielles, à donner une réponse aux armes idéologiques que lui oppose la bourgeoisie qui détermine la reprise présente de la lutte de classe. Les conditions objectives, la crise économique, la misère qui se généralise, ne sont pas seules ; s'y ajoutent des conditions subjectives favorables : la volonté consciente des ouvriers de ne plus accepter de sacrifices pour la sauvegarde de l'économie nationale, la non adhésion du prolétariat aux projets bourgeois (économique et politique), la compréhension de plus en plus grande du caractère anti-ouvrier de la gauche et des syndicats.
Et plus le facteur subjectif devient important dans le développement des luttes ouvrières, et plus devient crucial le rôle des révolutionnaires dans celles-ci. En effet, expression la plus haute de la conscience de classe, les communistes sont indispensables, non seulement par leur travail théorique, politique, leur propagande ; non seulement ils seront indispensables demain dans la période révolutionnaire, mais déjà, dès aujourd'hui, ils sont indispensables dans le processus actuel de la reprise de la lutte de classe, de maturation de la grève de masse. En dénonçant les pièges et les impasses que le capitalisme oppose au prolétariat, ils stimulent, catalysent, accélèrent le développement dans la classe d'une claire conscience de la nature de ces pièges et impasses, du rôle véritable de la gauche et des syndicats. De plus, même s'ils ne se font pas d'illusion sur l'importance de leur impact immédiat, ils contribuent à orienter les luttes dans le sens de l'autonomie la plus grande de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, dans le sens de l'extension et de la coordination des luttes par l'envoi 02 délégations massives, de piquets de grève, de manifestations, dans le sens de l'organisation par les ouvriers eux-mêmes dans les assemblées générales, de cette extension ; dans le sens du développement le plus larg3 de la lutte de classe.
La non reconnaissance ou la sous-estimation de la reprise actuelle, la vision mécanique du développement de la lutte de classe, l'incompréhension du rôle actif de la conscience de classe dans le processus de développement de cette lutte de classe,, mènent au rejet -au moins implicite- de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires et, partant, du parti communiste mondial de demain.
En effet, il ne suffit pas de clamer à cors et à cris la nécessité du parti, comme le font certains groupes, pour contribuer efficacement au processus qui mène à sa future constitution. C'est, dès aujourd'hui, dans les luttes présentes que se préparent les conditions de son édification, que se forgent les organisations qui en seront des parties constitutives, que- les communistes font la preuve de leur capacité à se trouver à l'avant-garde des combats révolutionnaires à venir. Et ils ne feront une telle preuve que s'ils se montrent capables de défendre avec rigueur la méthode marxiste dont l'ignorance et l'oubli désarment politiquement le prolétariat, le mènent à l'impuissance et à la défaite.
R.L. 9/9/84
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise économique ? : Crise historique de l'économie
- 2563 reads
Le rapport sur la situation internationale adopté au 6ème Congrès de Révolution Internationale (juillet 1984), comportait trois parties : crise historique de l'économie, conflits inter impérialistes et développement de la lutte de classe. Dans la rubrique régulière sur la crise économique de cette Revue, nous publions la première partie de ce rapport ([1] [635]) qui fait le point sur les manifestations actuelles et les perspectives de la crise dans le bloc de l'Ouest vers une nouvelle grande vague de récession.
Nous pouvons aujourd'hui contempler les conséquences désastreuses de la première vague de récession des années 80 sur l'ensemble de la planète, le spectacle désolant des conséquences catastrophiques du choc violent des forces productives contre les rapports sociaux.
On dirait que des populations entières ont subi un cataclysme ou sortent d'un conflit extrêmement violent et meurtrier. Famines, disettes, émeutes de la faim sont aujourd'hui chose courante sur des continents entiers (la seule année 84 a connu des émeutes au Brésil, en Inde, en Tunisie, au Maroc... ou encore des expulsions, l'exode forcé de dizaines de millions de personnes). Dans les pays développés, que ce soit dans les métropoles de la vieille Europe ou dans les Etats Unis d'Amérique, des régions entières, des villes prennent de plus en plus les allures des pays sous-développés. Et pourtant ce ne sont là que les conséquences limitées de la première vague de récession des années 80, qui a culminé en 81-82.
C'est sur ces plaies encore vives qu'une nouvelle grande vague de récession s'annonce aujourd'hui.
UNE NOUVELLE GRANDE VAGUE DE RECESSION
Le grand tournant des politiques économiques mondiales de la fin des années 70 a en quatre années joué un formidable rôle d'accélérateur et bouleversé profondément la situation mondiale à un niveau autrement plus profond que ne l'avaient fait la crise monétaire de 70-71 et la récession de 1974.
Les conséquences des coups portés ces dernières années contre les politiques que nous appelons par commodité "keynésiennes" et qui avaient prévalu avec plus ou moins de force depuis la seconde guerre mondiale ont provoqué la plus grande récession mondiale depuis l'avant-guerre, aux conséquences sociales et humaines que personne n'ignore. Bien que des Etats, comme l'Etat français, ou l'Etat anglais, aient été des précurseurs en la matière, c'est encore l'Etat américain qui a mené la danse. Comme après la seconde guerre, pendant toute la période de reconstruction et depuis la crise ouverte à la fin des années 60, l'économie mondiale a été dépendante de la situation du capitalisme aux USA. Pendant les années de reconstruction, il procurait à l'Europe les moyens de sa reconstruction, de même que dans les années 70, il jouait le rôle de locomotive de l'économie mondiale, par le crédit facile et bon marché, les déficits publics et la planche à billets.
En deux ans, le Tiers-monde s'est effondré, et on se demande vraiment jusqu'où le capitalisme peut enfoncer l'humanité ; les pays sous-développés ou "en voie de développement" sont à genoux, écroulés sous le poids de leurs dettes, leur économie prête à rendre l'âme. Les "miraculés" d'hier deviennent en un espace de temps très réduit les agonisants d'aujourd'hui. Les pays producteurs de pétrole croulent sous la surproduction : Venezuela, Mexique pour l'Amérique latine sont en faillite potentielle (en un an le niveau de vie au Mexique ainsi qu'au Venezuela a chuté de 50%). Le Moyen-Orient est dans un état lamentable : un des principaux financiers international et producteur de pétrole, l'Arabie Saoudite, est en déficit commercial, surproduction aussi, alors que deux autres producteurs très importants, l'Irak et l'Iran ont, à cause de la guerre, fait chuter leur production de 75%. En Afrique, 1e Nigeria, "pays du soleil", exception économique au milieu d'un continent où la misère est indescriptible, à cause aussi de la surproduction de pétrole, expulse un million et demi de personnes en deux semaines (en janvier83). Partout éclatent des émeutes de la faim : Brésil, Colombie, Inde, Maroc, Tunisie, et dernièrement encore aux Caraïbes. Telles sont les conséquences de la surproduction mondiale dans les pays peu ou pas développés. Le bilan historique est rapide à tirer, d'une netteté extrême. Ces pays sont passés de la forme coloniale à la décolonisation pour aboutir aujourd'hui dans l'effondrement. Cela est une manifestation de l'incapacité du capital à assurer son processus d'accumulation et donc d'extension de son mode de production, d'intégration à celui-ci d'autres secteurs de la société.
Dans les pays industrialisés, le choc a là aussi été très rude. Les mesures en vue de mettre fin à la politique d'endettement et de déficit public, le coup de frein brutal à la politique de locomotive mondiale de la part des USA ont brutalement bouleversé le paysage et les habitudes économiques des pays de la métropole, en particulier en Europe. Les pourcentages d'expansion, dans lesquels s'expriment les taux d'accumulation du capital, sont brutalement tombes à zéro ou en dessous.
En 1'esnace de trois ans, 1'évolution du chômage a subi une accélération considérable alors que les salaires continuaient à baisser-. La fraction de salaire versée par l'Etat a elle, sous toutes ses formes, été réduite énormément. En résumé tout ce que la classe ouvrière considérait comme des acquis inaltérables a été brutalement balayé ou est en voie de l'être.
Nous avons toujours mis en avant dans nos analyses que plus nous irions en avant dans la crise, plus les périodes de "reprise" seraient courtes et limitées, alors que les périodes de récession, elles, seraient de plus en plus longues, étendues et profondes. Les faits semblent particulièrement nous donner raison. Mais pour caractériser la situation actuelle, nous devons ajouter que contrairement aux périodes de récession précédentes, la récession de 81-82 n'a pas été suivie d'une nouvelle relance de style keynésien. Au contraire, les conséquences inflationnistes de ces politiques, qui, "à côté" d'une surproduction profonde avaient conduit l'économie mondiale à la limite du krach financier menaçant de faire exploser le système monétaire, ne pouvaient, être poursuivies. C'est ainsi que c'est une politique de "purge" générale qui a suivi la première récession des années 80 et qui se poursuit aujourd'hui. (Les USA constituent sous certains aspects un cas à part mais nous y reviendrons plus loin).
La surproduction ne pouvant plus être épongée par les déficits, nous la voyons ainsi gagner tous les secteurs de la production et les bloquer en partie. Cette caractéristique des crises de la période de décadence, LA CRISE GENERALISEE A TOUS LES SECTEURS DE LA PRODUCTION, ressort aujourd'hui avec une clarté éblouissante :
-secteur de production des moyens de production, de la machine outil à l'industrie lourde (tel l'acier) ;
-secteur des matières premières et de l'énergie;
-secteur de production des moyens de consommation, avec une prime pour l'agriculture et le logement ;
-secteur de production des moyens de transports, de l'aéronautique à l'industrie navale en passant par l'automobile ;
-secteur dit "tertiaire", celui de la circulation du capital (les banques en particulier, principales bénéficiaires de la période "inflationniste" et qui se présentaient comme les institutions les plus assises et les plus solides, ont particulièrement été secouées durant les deux premières années de cette décennie ) ([2] [636]);
-et enfin le secteur appelé "service public", largement gonflé lors des périodes précédentes a particulièrement été visé par la politique générale de purge.
Nous pouvons déjà voir ici l'importance du caractère généralisé de la crise à tous les secteurs pour le développement et l'unification de la lutte de classe. Il nous faut maintenant considérer les années 83 et 84 et plus particulièrement ce qu'on appelle "la reprise" aux USA pour être capables de tirer un bilan de la première moitié des années 80, mais surtout pour dégager une perspective pour les mois et les années à venir.
LA REPRISE AUX USA
Tous les commentateurs de la situation économique s'accordent pour dire que l'ensemble des pays industrialisés (la France mise à part) semblent avoir amorcé une "reprise économique", en particulier les USA. Pour le début de l'année 84, des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne peuvent inscrire à leur actif une baisse assez nette de l'inflation, une stabilisation du chômage et une évolution de la production (PNB) de 2 ou 3% (ce qui correspond d'ailleurs tout juste à l'évolution de la population) . Nous ne nous attarderons pas sur la situation des pays européens dans la mesure où leur évolution est totalement dépendante de la situation économique aux USA. En effet le réajustement des balances commerciales des pays européens ou du Japon n'a pu se faire qu'au prix d'un déficit commercial gigantesque de l'économie américaine.
Seuls les USA peuvent inscrire pour l'année 84 une augmentation de leur PNB d'une moyenne de 5%, mais à quel prix et dans quelle perspective ?
Au delà des aspects de manipulations monétaires, nous pouvons déjà donner un aperçu de la réalité de la "reprise" de l'économie aux USA et de ce qu1 elle contient. Ainsi, fin 83, à un des plus forts moments de ce qui est appelé "reprise", on pouvait apprendre :
"Les commandes de biens durables aux entreprises américaines ont augmenté de 4% en novembre, s'établissant à 37,1 milliards de dollars, annonce le département du commerce. Cette progression, la plus forte depuis le mois de juin dernier (+7,6%) est due en grande partie à la hausse des commandes militaires (+46%) et des commandes d'automobiles et de camions (+17,7%). Les commandes d'appareils domestiques, elles, n'ont progressé que de 3% et les commandes d'équipements de production ont baissé de 4,4%'.' (Le Monde du 24-12-83, nous soulignons).
Ce financement qui pour 50% a été destiné à l'effort de guerre nécessité par l'offensive des USA n'a été rendu possible que par les manipulations sur le dollar, monnaie sur laquelle repose le commerce mondial. La hausse vertigineuse des taux d'intérêts (jusqu'à 18%) a permis de rapatrier vers les USA des millions de dollars qui pendant des années ont été répandus dans le monde entier. Et cela était encore largement insuffisant. Malgré les économies réalisées sur lés dépenses sociales aux USA même, le déficit budgétaire américain passe de 30 milliards de dollars en 79 à 60 milliards en 80 pour atteindre les 200 milliards en 84. Il n'est pas étonnant que dans une telle situation,P. Volcker, président de la Réserve, compare l'immense déficit budgétaire américain à "un pistolet chargé, pointé sur le coeur de l'économie des USA, et dont nul ne peut prévoir quand le coup partira." (Le Monde du 3-3-84).
Voilà les bases de la reprise aux USA :
-hausse des taux d'intérêts, du dollar, du déficit commercial (-28,1 milliards de dollars en 81, -36,4 milliards de dollars en 82, -63,2 milliards en 83, -80 estimés pour 84);
-déficit de la balance des paiements courants (de 4,6, donc positive en 81, elle passe à -11,2 milliards de dollars en 82 et à -42,5 milliards en 83);
-augmentation de la masse monétaire par l'utilisation de la planche à billets (entre juillet 82 et juillet 83, l'expansion monétaire est de 13,5%, LA PLUS PORTE CROISSANCE DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE).
On voit ici, en considérant ces chiffres pharamineux, l'immense baudruche que constitue la reprise aux USA et comment derrière une baisse en chiffres absolus de l'inflation de la monnaie américaine (13,5% en 80, 10,4% en 81, 6,1% en 82, 3,5% en 83) DUE ESSENTIELLEMENT A LA HAUSSE DU DOLLAR (la hausse du dollar a réduit de 10% le prix des marchandises importées), se cache une HYPER INFLATION (la surestimation du prix du dollar étant évaluée en janvier 84 à 40%).
Cette situation économique explosive, telle une bombe atomique amorcée, nous invite à jeter un rapide regard en arrière pour dégager quel peut être l'avenir de la situation.
En 1979, la fuite généralisée devant le dollar, monnaie de référence pour le commerce international, menace de krach le système monétaire international. Face à cette situation qui signe la faillite de plusieurs années de fuite en avant, les autorités américaines portent à 18% le taux d'intérêt de la monnaie américaine pour soutenir leur monnaie et éponger la dette internationale immense que représentent les millions de dollars répandus dans le monde. Résultat : en 81-82, on assiste à la plus forte récession depuis la veille de la seconde guerre mondiale, dans les pays industrialisés (en particulier aux USA), les industries s'écroulent comme des châteaux de cartes, les pays "en développement" ne peuvent plus rembourser leur dette et au delà de leur faillite c'est la faillite de tout le système bancaire des pays développés qui se profile.
En 1982, l'asphyxie générale de l'économie, par les mêmes moyens volontaristes, pousse les autorités américaines à ramener leurs taux d'intérêts à 11%. Taux suffisamment hauts pour continuer à ramener vers les USA des masses de dollars et les capitaux qui dans le reste du monde fuient les investissements et pour permettre aux entreprises américaines d'emprunter à nouveau.
En 83-84, la dégringolade semble marquer une pause, mais comme on l'a vu plus haut, ce n'est qu'au prix de déficits pharamineux. De nouveau, une nouvelle fuite internationale devant le dollar fait trembler le système monétaire international ; en un moi s, le prix du dollar perd en volume (nominal, bien sûr) ce qu'il avait mis six mois à gagner, l'inflation double presque (de 3,5% à 5,5%). Seule solution, les autorités américaines sont obligées à nouveau de hausser les taux d'intérêts et la récession menace à nouveau.
Cette menace ou plutôt cette réalité d'une nouvelle vague de récession aux conséquences encore difficilement calculables (mais que nous laissent imaginer le début# des années 80) et les conditions dans lesquelles elle s'annonce va venir mordre encore plus profondément dans la chair de l'humanité alors que partout dans le monde le champ d'activité du capital se rétrécit de plus en plus.
D'ailleurs la bourgeoisie ne se fait pas d'illusion sur la perspective des mois à venir et c'est à un nouveau choc extrêmement violent qu'elle se prépare. L'attitude du capital aux USA est, à cet égard extrêmement significative. Ces deux dernières années, et ces derniers mois en particulier, on a pu assister aux USA à une considérable accélération de la concentration du capital, financée en grande partie par l'afflux des capitaux étrangers. Mais cette concentration n'a rien à voir avec la concentration du capital qui correspond à une extension de l'activité du capital telle qu1 elle se développe dans les phases d'expansion. Cette concentration, nourrie par un empirisme comme seul le capital peut se le permettre, est l'expression d'une bête blessée à mort qui concentre ses dernières forces en un seul point. La meilleure preuve que nous puissions mettre en avant pour démontrer ce que nous avançons, c'est que la plus grande concentration d'entreprises a eu lieu aux USA dans les industries les plus touchées par la crise de surproduction mondiale : l'industrie du pétrole et celle du bâtiment.
"Quatre ans plus tard, (que 1977), les opérations de fusion sont près de quatorze fois plus importantes et représentent 82.000 millions de dollars. Cette année là, le seul rachat de Conoco (9ème compagnie pétrolière américaine) par Dupont de Nemours (première société chimique) met en jeu 73 milliards de dollars, soit une somme supérieure à la valeur totale des fusions effectuées en 1977V (bilan économique et social 83 "Le Monde").
Ainsi, pour faire face à une chute vertigineuse des taux de profit, et surtout en préparation des prochains chocs, les industries américaines rassemblent leurs dernières forces et rien que cela laisse exsangue le reste du monde qui ressemble de plus en plus à un pantin disloqué, à un corps dont le sang reflue et quitte peu à peu tous les membres pour les laisser engourdis et glacés.
Le déficit commercial américain permet encore pour quelques mois à l'Europe et au Japon de maintenir un certain niveau d'activité. Mais là aussi à quel prix : non seulement celui du déficit commercial américain, mais aussi le prix du dollar, qui est colossal, et, malgré cela, la bagarre pour maintenir un niveau suffisant d'exportation nécessite pour l'Europe déjà à genoux d'asséner des coups de hache et un sabrage des conditions ouvrières sans précédents.
C'est dans ces conditions qu'un nouvel assaut de la récession mondiale qui dégonflera, cette fois -ci, complètement la baudruche de la "reprise" aux USA, se prépare. Quand et comment ? Cela est difficile à dire, mais on peut raisonnablement penser que celle-ci se développera au lendemain des élections aux USA (novembre 84).
Mais qu'importe la date du nouvel assaut, ce qui est certain c'est son proche avenir, et surtout les caractéristiques de la situation mondiale qu' il impliquera et dont les premières années 80, les mois que nous vivons aujourd'hui, nous ont donné un avant-goût.
La dynamite de l'inflation accumulée dans les déficits, concentrée au sein de la puissance économique sur laquelle repose l'économie mondiale donne la mesure de la puissance de la nouvelle vague de récession à venir. La dernière vague de récession a propulsé les taux de chômage à des niveaux record, atteignant dans certains pays des taux sans précédents depuis la veille de la seconde guerre mondiale, (en moyenne pour les pays développés, 12% de la population active). Pour les mois et les années à venir, le taux de chômage qui a presque doublé en seulement trois ans, est encore appelé à doubler, voire tripler, c'est à dire atteindre 20 ou 30% de la population active.
Les chiffres donnés en perspective par l'OCDE en 83 étaient déjà très pessimistes et encore tablaient sur la "reprise internationale" :
"On y apprenait notamment que, pour maintenir le chômage à son niveau actuel, en fonction de l'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de dix huit à vingt millions d'emplois d'ici la fin de la décennie. De plus les experts de l'OCDE estimaient qu'il faudrait encore quinze millions d'emplois supplémentaires si on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit dix-neuf millions de personnes sans travail.
Au total, ajoutaient-ils, cela reviendrait à créer 20.000 emplois par jour entre 84 et 89, alors que, après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, les 24 pays membres n'en avaient dégagé que 11.500 quotidiennement. S'ensuivaient des prévisions très pessimistes, tablant sur 34,75 millions de chômeurs en 1984, dont 19,75 pour l'Europe et 2,45 pour la France." (Rapport de l'OCDE 1983).
Mais plus encore que le nombre absolu de chômeurs, les caractéristiques et les conditions dans lesquelles le chômage se développe de façon accélérée sont significatifs de l'ampleur de la crise. Les allocations sont réduites aux portions les plus congrues, quand elles ne sont pas tout simplement supprimées. Le chômage touche les plus larges fractions de la classe ouvrière, bien que les "jeunes" et les immigrés en subissent encore la plus forte pression ; d'autre part sa durée est de plus en plus longue et sans issue pour des milliers de personnes.
A la suite de son rapport, l'OCDE ne manquait d'ailleurs pas de mentionner certains de ces aspects, et d'en tirer des conclusions :
"Au delà du tollé que provoqua cette projection, l'OCDE mettait en lumière les caractéristiques profondes du chômage...Un premier élément concerne l'allongement de la durée du chômage, qui prive d'activité une part de plus en plus importante de la population. On constate, un peu partout, le découragement des chômeurs de longue durée. Ceux-ci en viennent à prendre des "petits boulots" ou des emplois d'attente, ou pis, à ne même plus se déclarer comme demandeurs d'emplois. Cette situation, à tous égards est lourde de risques sociaux." (idem) .
Le chômage est à la pointe de l'attaque du capitalisme contre la classe ouvrière. En lui, il résume toute la condition ouvrière, il est l'expression au niveau humain de la surproduction, de la surproduction de la force de travail, de la condition de marchandise, chair à travail et à canon. D'autre part, si la crise historique du capitalisme conduit à une paupérisation absolue ([3] [637]) de la 'classe ouvrière, elle opère aussi, et cet aspect est fondamental, une modification des structures de classe de la société telles qu'elles ont pu être modelées dans les périodes de croissance et d'expansion du capital.
Stratification de la classe ouvrière entre plusieurs couches d'ouvriers qualifiés et non qualifiés, entre cols bleus et cols blancs, entre immigrés et non-immigrés. Possibilité pour certaines fractions, couches d'ouvriers les plus qualifiés d'atteindre après des années "d'efforts" une situation qui les rapproche par leurs conditions de couches moyennes, par l'accession aux emplois d'encadrement ou de maîtrise pour eux-mêmes, par l'accession aux emplois de cols blancs, le plus souvent ceux de techniciens pour eux ou leurs enfants. Avec la crise, telle qu'elle se déroule sous nos yeux, tout cela est fini. Ce n'est plus vers le haut que le regard de la classe ouvrière se tourne, mais effrayé, vers le bas, où tout ce qui hier apparaissait encore comme distinction disparaît. Dans ce processus qui se déroule sous nos yeux de façon accélérée, le chômage joue un puissant rôle, et en particulier quand il menace d'atteindre 20 à 30% de la population active. De plus au travers du chômage, les couches moyennes sont déchirées, et rejoignent les rangs de la classe ouvrière dans ce que sa condition a de plus misérable.
Ce n'est pas là une simple projection que nous faisons, mais la description d'un processus qui se déroule concrètement, sous nos yeux, processus qui non seulement met face à face les classes sociales, mais distingue nettement leurs intérêts irréductibles. Cette réalité balaie radicalement l'écran de fumée constitué par la formation de couches moyennes particulièrement gonflée dans l'époque "keynésienne" ainsi que toutes les théories sur l'aristocratie ouvrière.
CONCLUSIONS
1- Le rapide tableau, encore limité et imprécis, du bilan économique des premières années de la décennie 80 et des perspectives pour les années à venir, établit en partie les conditions dans lesquelles la lutte de classe, et sa nouvelle impulsion qui se manifeste aujourd'hui dans tous les pays va s'affronter à la classe dominante. Rosa Luxembourg déclarait à juste raison que "pour que la révolution ait lieu, il faut que le champ social soit labouré de fond en comble, il faut que ce qui était enfoui profondément monte à la surface, que ce qui était à la surface soit enfoui profondément." (Grèves de masses, parti et syndicats).
Cette tâche là, l'unité de la lutte de classe, de l'expérience de la classe ouvrière et d'une crise économique sans précédents est en train de l'accomplir... La paupérisation rapide et absolue qu'opère la crise économique pousse la classe ouvrière avant de pouvoir plonger son regard dans l'avenir,à se plonger dans son passé, et là, c'est soixante dix ans de décadence qu'elle peut contempler.
2-Nous avons consacré une longue partie à l'ana lyse de la situation du capital aux USA dans la me sure où,comme nous l'avons dit, cette économie qui représente 45% de la production des pays occidentaux et un quart de la production mondiale détermine l'évolution du reste de l'économie mondiale. Mais ce n'est pas tout ; il est un autre aspect dans la profonde crise que traversent les USA qui est extrêmement important du point de vue historique : ce n'est que grâce au capitalisme aux USA, qui s'est développé en pleine période de décadence, avec toutes ses caractéristiques (capitalisme d'Etat, militarisme) , au début grâce à un marché extra-capitaliste intérieur immense, ensuite grâce à la guerre mondiale qui a éliminé ses rivaux, que l'Europe en pleine décrépitude, totalement épuisée par deux guerres mondiales, a pu se maintenir depuis les années du milieu de ce siècle : par sa reconstruction capitaliste de 45 aux années 60, pendant la décennie des années 70 où les USA ont joué un rôle de locomotive mondiale, et d'une certaine manière en 83-84 où seul l'immense déficit commercial américain lui permet de ne pas s'effondrer complètement.
Aujourd'hui, cette période est complètement révolue, du point de vue tant idéologique qu'économique. Les USA ne peuvent plus jouer un rôle d'appui matériel, ni celui, idéologique, de faire croire à un développement infini et prospère du capitalisme au travers du "rêve américain", lequel est devenu un véritable cauchemar.
3-La dernière conclusion de cette partie consacrée à la crise de 1'économie nous amène à critiquer un point de vue que nous avons été amenés à mettre en avant en particulier dans le rapport dout le 5ème Congrès de RI ([4] [638]) selon lequel la fin des années 70 signait la fin des politiques d'endettement. Le CCI avait tout à fait raison de dire que les années 80 marquaient la faillite de toutes les politiques keynésiennes de fuite en avant qui avaient marqué les années précédentes, mais de là à en tirer la conclusion que c'était la fin de l'endettement pour le capitalisme, il y avait un pas à ne pas franchir.
La réalité s'est d'ailleurs chargée elle-même de rectifier cette vision erronée. En l'espace de deux ans, tant dans les pays les plus développés (USA) que dans les pays sous-développés, l'endettement sous les forme:; diverses que nous avons décrites plus haut n'a pas seulement "augmenté" mais il a été multiplié par 2,3 ou 4 par rapport à celui accumulé durant une période de dix ou vingt ans.
Cette situation est liée à la nature more de la crise du capitalisme, la crise de surproduction et à l'incapacité d'assumer un processus d'accumulation sans lequel le capital n'existe pas et ne peut exister.
Nous devons distinguer, et c'est cela qui était la préoccupation du CCI au début des années 80, l'endettement tel qu'il s'est développé par exemple dans les années 70 et celui de la situation actuelle. Dans la première période, malgré une large part de déficit dû à l'armement, l'endettement mondial a permis un certain niveau d'accumulation et d'expansion. Mais les années 80 ont largement illustré comment cette tendance générale du capitalisme décadent à substituer à son processus d'accumulation de capital une accumulation d'armement s'amplifie. C'est ainsi que les déficits colossaux, bien supérieurs à ceux des années 70 ont pour l'essentiel eu pour terrain d'investissement l'armement.
Ce n'est un secret pour personne que le déficit du budget américain est en rapport exact avec l'accroissement pharamineux des armements. Les capitaux fuient l'Europe pour participer à l'effort de guerre du bloc occidental, les missiles les remplacent. Partout ailleurs, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud, les "aides" au développement sont remplacées par une accumulation d'armes gigantesques. Aux USA même, à la caution de la force économique, se substitue la caution de la force militaire. C'est ce que Reagan appelle "retrouver la force, la puissance de l'Amérique". Pantin stupide !
Aujourd'hui se manifeste clairement et avec une acuité sans précédent comment la crise du capitalisme, la crise de surproduction, l'impossibilité de continuer un processus d'accumulation entraîne impitoyablement et immanquablement un processus d'autodestruction du capital. Autodestruction non pas du capitalisme, mais du capital et de l'existence de centaines de millions d'êtres humains qu'il a attachés au char de son esclavage.
Cette question de l'autodestruction du capital n'est pas une simple question d'"intérêt théorique'. C'est une question fondamentale, pour plusieurs raisons :
-parce qu'elle illustre et explicite les rapports entre la crise historique du capitalisme et la guerre;
-parce qu'elle montre qu'il ne suffit pas de dire que la crise"joue en faveur du prolétariat". En effet, nous avons eu à combattre pendant des années les conceptions qui ne voyaient la révolution prolétarienne que comme une affaire de volonté, bref, toutes les conceptions idéalistes. Aujourd'hui que la crise est manifeste et se livre sans fard, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur inverse et penser que, de toutes façons la crise est là et qu'elle se transformera nécessairement en révolution sociale. Cette conception est aussi fausse que la première. Nous devons combattre, en nous appuyant sur les faits historiques et présents, 1'idée que la crise du capitalisme, la crise de surproduction se présenterait comme une simple accumulation de biens, invendus et invendables, que cette surproduction liée à une baisse profonde des taux de profit mènerait le capitalisme à s'effondrer de lui-même et qu'ainsi le prolétariat n'aurait qu'à cueillir la révolution comme on cueille une fleur.
Cette vision est fausse et les années 80 que nous avons déjà vécues l'illustrent amplement.
RI.juillet 1984
[1] [639] Pour les orientations du rapport sur les autres points, adoptées à ce Congrès, se reporter à la Résolution sur la situation internationale publiée dans Révolution Internationale n°123, août 1984.
[2] [640] "Le nombre des faillites continue d'être très élevé et jamais les banques américaines n'ont enregistré des pertes aussi importantes que celles qu'elles essuyaient encore pendant la deuxième partie de 1983. Plusieurs d'entre elles ont dû, en conséquence, déposer leur bilan".("Le Monde de l'année économique et sociale-bilan 83", p.11).
[3] [641] Où sont-ils aujourd'hui ces fervents critiques de Marx, qui soumettaient à la critique la plus virulente la notion de paupérisation. Cela, sans jamais d'ailleurs distinguer ce qui était, dans la notion de paupérisation, paupérisation absolue ou paupérisation relative. Non seulement aujourd'hui la paupérisation relative de la classe ouvrière s'est développée de manière accrue par le développement de la productivité, mais de plus celle-ci s'ajoute et se confond par ailleurs à une paupérisation absolue qui chaque jour s'accroît sans cesse. Jamais l'histoire n'a autant donné raison à ce Marx qu'on prétend dépassé et qui déclarait : " le capitalisme est né dans le sang, la boue et les larmes, il finira dans la boue, le sang et les larmes."
[4] [642] Revue Internationale n°31,
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Polémique avec la CWO : comment se réapproprier les apports de la gauche communiste internationale
- 3289 reads
L'histoire du mouvement ouvrier n'est pas seulement l'histoire des grandes batailles révolutionnaires. Lorsque des millions de prolétaires se lancent "à l'assaut du ciel", elle n'est pas seulement deux siècles de résistance permanente, de grèves, de combats inégaux et incessants pour limiter la brutalité de l'oppression du capital. L'histoire du mouvement ouvrier c'est aussi celle de ses organisations politiques, les organisations communistes. La façon dont celles-ci se sont constituées, divisées, regroupées, les débats théoriques-politiques qui les ont toujours traversées comme un sang qui nourrit la passion révolutionnaire, tout cela appartient non pas aux individus particuliers qui les constituent mais à la vie de l'ensemble de la classe. Les organisations politiques prolétariennes ne sont qu'une partie du prolétariat. Leur vie est partie de celle du prolétariat.
Comprendre la vie de la classe révolutionnaire, son histoire, son devenir historique, c'est aussi comprendre la vie des organisations communistes, leur histoire.
L'article que nous publions ci-dessous -une polémique avec la Communist Workers Organisation (CWO) a propos de l'histoire des organisations communistes entre les années 20 et les années 50 - ne répond pas à des soucis académistes d'historiens universitaires, mais à la nécessité pour les révolutionnaires de notre époque de fonder leurs orientations politiques sur le solide granit de l'expérience historique de leur classe.
Pour différentes que soient les années 80 des années 20, l'essentiel des problèmes auxquels se trouvent confrontés les combats prolétariens d'aujourd’hui est le même que pendant les années 20. La compréhension des tendances historiques du capitalisme (décadence, impérialisme), la validité pour le prolétariat des formes de combat syndicalistes ou parlementaires, des luttes de libération nationale, la dynamique de la grève de masse, le rôle des organisations révolutionnaires, toutes ces questions sont au coeur des analyses et prises de position des organisations communistes aussi bien pendant les années 20 (marquées par les révolutions russe et allemande), que pendant les années 30 (marquées par le triomphe de la contre-révolution et l'embrigadement du prolétariat), les années 40 (années de la guerre impérialiste mondiale), que pendant les années 50, au temps du début de la reconstruction.
Pour une organisation politique, ignorer les apports successifs des différents courants du mouvement ouvrier pendant ces années, ou pire, en falsifier la réalité, en déformer le contenu, en altérer l'histoire avec le dérisoire objectif de se dessiner un plus bel arbre généalogique, c'est non seulement tourner le dos à toute rigueur méthodologique -instrument indispensable de la pensée marxiste- mais c'est en outre désarmer la classe ouvrière, entraver le processus qui la conduit à se réapproprier sa propre expérience historique.
C'est à un exercice de ce style que s'est livrée la CWO dans le No 21 de sa publication théorique 9 Revolutionary Perspectives (R.P).
On y trouve un article qui se veut une critique de notre brochure consacrée à l'histoire de La Gauche Communiste d'Italie. La CWO nous avait déjà habitués à des manifestations de son manque de sérieux : pendant des années, elle dénonçait le CCI comme force contre-révolutionnaire parce que nous avons toujours affirmé qu'il y avait encore une vie prolétarienne au sein de l'Internationale Communiste au delà de 1921 (Kronstadt), jusqu'en 1926 (adoption du "socialisme dans un seul pays"). Encore dans le No 21 de R.P., la CWO accuse, avec toujours aussi peu de sérieux, le CCI de défendre des positions "euro-chauvines", ce qui, s'il y avait la moindre rigueur dans la pensée de la CWO, devrait nous exclure ipso facto du camp révolutionnaire.
C'est avec cette même légèreté irresponsable que la CWO a fait de notre brochure une lecture selon une méthode d'échantillonnage de type Gallup : on lit une page sur dix. La critique que cette lecture prétend fonder a en réalité un objectif à peine caché : minimiser sinon effacer de l'histoire du mouvement ouvrier l'apport spécifique -et irremplaçable- des groupes qui ont publié Bilan puis Internationalisme ; c'est-à-dire, éliminer de l'histoire du mouvement ouvrier les courants de la gauche communiste autres que ceux dont se réclament spécifiquement la CWO et son organisation soeur, le Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Comunista).
L'article qui suit, en répondant, s'attache non seulement à rétablir certaines vérités historiques, mais encore à montrer comment les organisations révolutionnaires doivent envisager, comprendre, intégrer et dépasse critiquement les apports successifs de l'ensemble du mouvement communiste et plus particulièrement ceux de la Gauche Communiste Internationale.
- "Le CCI aime se présenter comme la fusion des meilleurs éléments de la gauche allemande (KAPD) et de la gauche italienne, regrettant que l'attitude sectaire de Bordiga les ait empêchés de s'unir contre l'opportunisme du Komintern (...l'idée du CCI selon laquelle seul le sectarisme empêcha la fusion entre la gauche italienne et la gauche allemande contre le Komintern et qu'une fusion similaire est nécessaire aujourd'hui pour la formation d'un nouveau parti, est sapée par leur propre dire) " (R.P. n°21).
Ces extraits montrent clairement dans quelles confusions de départ la CWO s'attache à embrouiller la motivation des différents parcours à travers lesquels s'est historiquement exprimée la Gauche communiste. D'après la CWO le CCI aurait voulu une fusion politique et organisationnelle entre la Gauche italienne et la Gauche allemande dans un front unique contre l'I.C. On ne sait vraiment pas d'où les camarades peuvent tirer une telle bêtise. Même un enfant comprendrait que proposer une telle fusion à une telle époque aurait été une folie. Ceci non seulement parce que la Gauche italienne n'aurait de son côté jamais accepté de s'unir avec une tendance qui condamnait les syndicats et le travail dans les syndicats (même si par ailleurs cette dernière préconisait un néo-syndicalisme "révolutionnaire" sous la forme des "unions") et arrivait par ailleurs sur quelques autres points à remettre parfois en cause l'importance du rôle du parti de classe. Mais aussi parce que la Gauche allemande n'aurait jamais, de son côté, accepté de s'unir à une tendance qui ne comprenait pas l'intégration des syndicats dans l'appareil d'Etat et acceptait les yeux fermés le soutien de Lénine aux luttes de libération nationale. Ce qui était à l'ordre du jour, ce n'était pas une fusion aussi impossible qu'inutile mais une bataille commune contre la dégénérescence dénoncée par les deux tendances. Pour porter en avant avec clarté cette bataille commune, les différentes forces de gauche auraient été obligées de clarifier en premier lieu leurs divergences sur des questions cruciales comme les syndicats, les luttes de libération nationale, le parti. De cette façon, ces débats fondamentaux auraient pu se faire au sein de l'I.C. et non contre l'I.C. En l'absence de ce débat l'I.C. est passée à côté des questions essentielles, proposant des réponses qui n'allaient pas au fond des problèmes et qui ne permettaient pas de se défendre contre la dégénérescence.
Avec le reflux des luttes, la Gauche allemande -qui était plus l'expression d'une profonde poussée de luttes ouvrières que d'une clarté programmatique complète- fut ultérieurement incapable de contribuer à la clarification du programme prolétarien et se transforma rapidement en une myriade de petites sectes. Ce fut la Gauche d'Italie (GI), mieux armée du point de vue théorique, essentiellement sur la nécessité et la fonction de l'organisation des révolutionnaires, qui comprit les caractéristiques de la nouvelle période et qui porta en avant ce débat en terme de bilan que l'I.C. de Lénine n'avait pas réussi à faire et qui était nécessaire pour intégrer dans une solide perspective marxiste la profonde bien qu'incomplète intuition de la Gauche allemande (GA) :
- "Le programme international du prolétariat résultera du croisement idéologique -donc de l'expérience de classe de la révolution russe et des batailles des autres pays, particulièrement de l'Allemagne et de l'Italie (...). Car il est probable, que si dans certains domaines Lénine domine Luxemburg, il est évident que dans d'autres Rosa voit plus clair que celui-ci. Le prolétariat ne s'est pas trouvé dans des conditions permettant, comme en Russie, une clarification absolue des tâches révolutionnaires, mais par contre, évoluant face au capitalisme le plus avancé d'Europe, il ne pouvait pas ne pas percevoir certains problèmes mieux et plus profondément que les bolcheviks (...). Comprendre veut dire compléter des fondements trop étroits, non traversés par l'idéologie résultant des batailles de classe dans tous les pays,les compléter par des notions liées au cours historique dans son ensemble jusqu'à la révolution mondiale. Cela, l'Internationale de Lénine ne pouvait le faire. C'est à nous qu'incombe ce travail. " ("Deux époques : en marge d'un anniversaire" Bilan n°15, janvier 1935).
Quand la CWO se rappelle que le "Réveil Communiste", petit groupe de militants italiens qui avaient rejoint les positions du KAPD, finit dans le conseillisme puis dans le néant, elle ne fait que confirmer notre thèse centrale : qu'il n'était pas possible de fondre mécaniquement 50 % de Gauche italienne et 50 % de Gauche allemande. Il s'agissait au contraire d'ancrer dans un cadre marxiste conséquent "les problèmes que le prolétariat allemand a perçus mieux et de façon plus profonde que les bolcheviks". C'est cela que Bilan s'est donné comme tâche à accomplir.
L'histoire ne se fait pas avec des si. L'incapacité des Gauches Communistes d'imposer au centre du débat de l'I.C. les différents problèmes posés par la classe ouvrière à l'entrée du capitalisme dans la phase décadente, ne peut être imputée ni à Bordiga ni à Pannekoek. Cette incapacité est plutôt le fruit de l'immaturité avec laquelle le prolétariat mondial a affronte ce premier combat décisif, immaturité dont les "erreurs" de l'avant-garde révolutionnaire sont un reflet. Une fois l'occasion passée, le travail fut fait dans de terribles conditions de reflux de la lutte, par la GI et par elle seule parce qu'elle avait une position théorique adéquate pour remplir un tel rôle. Et c'est sur cette voie, la voie de Bilan, que la GI a intégré les contributions et expériences des différentes Gauches Communistes pour parvenir à "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" ("Lettre de Bordiga à Korsch", , 1926). C'est grâce à ce travail de synthèse historique que la GI a réussi à "compléter des fondements trop étroits" et à tracer les grandes lignes du programme de la Gauche Communiste Internationale (GCI), valables encore aujourd'hui pour le prolétariat de tous les pays. L'accusation que la CWO nous porte (de vouloir aujourd'hui fusionner les différentes gauches) ne montre pas seulement son incapacité à distinguer une "gauche historique" d'une union mécanique, mais montre surtout son incapacité congénitale à comprendre que ce travail a déjà été fait et que ne pas en tenir compte signifie retourner en arrière de 60 ans. La conséquence est qu'hier la CWO ne réussissait pas à aller au delà des positions de la Gauche allemande des années 30 et qu'aujourd'hui elle retourne aux positions de la GI des années 20 et plus en arrière encore à celles de Lénine. Les positions changent, la régression reste.
Des années 30 aux années 40 : maintenir la barque dans la tempête
- "En fait pour le CCI,la GI est assimilée à une période d'exil, et c'est dans cette période que les vraies leçons de la vague révolutionnaire auraient été tirées. Quel point de vue pessimiste ! On rejette les périodes pendant lesquelles les idées communistes s'emparent des masses alors que l'on idéalise la période de défaite. Mais cette idéalisation de Bilan est déplacée. Il est certain que ces camarades ont fait des contributions importantes au programme communiste (...) mais ce serait stupide de nier les faiblesses de Bilan (...) sur la question des perspectives, le manque de bases économiques marxistes claires (Bilan était luxemburgiste) les a conduits à des visions erratiques et erronées sur le cours historique. Soutenant que la production d'armes était une solution à la crise capitaliste, ils n'ont pas compris le besoin d'une autre guerre impérialiste. (...) Bilan s'est dissout dans la revue Octobre en 1939 et la Fraction a formé un Bureau International pensant que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour ; ainsi, ils furent totalement bouleversés quand la guerre éclata en 1939, conduisant à la dissolution de la Fraction dans son ensemble. Le CCI essaie de nier que tel était le point de vue de Bilan." (R.P n°21, p.30-31).
Ces extraits posent trois types de problèmes :
- 1) notre "idéalisation" de Bilan ;
- 2) le rôle des révolutionnaires dans les périodes de contre-révolution ;
- 3) la "faillite" finale de la Fraction Italienne à l'étranger.
Procédons par ordre. Premièrement, liquidons cette idée selon laquelle nous idéalisons Bilan : "Bilan n'avait pas la prétention stupide d'avoir apporté une réponse définitive à tous les problèmes de la révolution. Il avait conscience de balbutier souvent, il savait que les réponses définitives ne peuvent être que le résultat de l'expérience vivante de la lutte de classe, de la confrontation et de la discussion Sur bien des questions, la réponse donnée par Bilan restait insuffisante... Il ne s'agit pas de rendre hommage à ce petit groupe..., mais encore d'assimiler ce qu'il nous a légué en faisant nôtre son enseignement et son exemple, et de poursuivre cet effort avec une continuité qui n'est pas une stagnation, mais un dépassement." (Introduction aux textes de Bilan sur la Guerre d'Espagne, Revue Internationale n° 4 1976).
Telle a toujours été notre position. Il est vrai que dans ces années-là la CWO nous définissait comme contre-révolutionnaires justement parce que nous défendions la Gauche italienne aussi au-delà de 1921, année choisie par eux comme date magique au-delà de laquelle l'I.C. devenait réactionnaire. Ceci peut expliquer le peu d'attention avec laquelle la CWO lit aussi bien les textes de Bilan que nous avons republiés que nos introductions.
Passons au second point. Nous ne préférons pas les périodes de défaite à celles de lutte ouverte du prolétariat, mais nous ne nous réfugions pas derrière une telle banalité pour occulter le fait historique essentiel, à savoir que dans les années de la vague révolutionnaire, l'I.C. n'a pas réussi à faire tout le travail de clarification des nouvelles frontières de classe du programme prolétarien. Ce travail, pour l'essentiel, est revenu aux minorités révolutionnaires qui ont survécu à la dégénérescence. Il est sûr que nous aurions aimé aussi que cette synthèse fût faite quand les prolétaires allemands descendaient en armes dans les rues de Berlin, ceci non seulement parce qu'elle aurait été mieux faite, mais parce que cela aurait probablement donné une issue tout autre à la première vague révolutionnaire du prolétariat mondial. Malheureusement, l'histoire ne se fait pas avec des si et ce travail revint principalement à Bilan.
Si nous insistons tant sur le travail de la Fraction Italienne à l'étranger, ce n'est pas parce que nous préférons les années 30 aux années 20, mais parce que les groupes qui devraient en être les "continuateurs" (le PCInt artificiellement constitué à la fin de la guerre) l'ont recouverte d'un mur de silence, permettant ainsi qu'elle soit rayée de la mémoire historique du mouvement ouvrier. Si on regarde la presse de tous les groupes qui se réclament de la Gauche italienne (y compris Battaglia) on ne peut que rester stupéfait du fait qu'au cours de quarante années "le nombre d'articles repris de Bilan peut se compter sur les doigts d'une seule main" (Revue Internationale No 4). Encore aujourd'hui, après que le CCI en ait publié des centaines de pages en différentes langues auxquelles s'ajoute une étude critique de plus de deux cents pages, quelques uns de ces groupes continuent à faire semblant d'ignorer l'existence même de Bilan. Il faut donc a juste titre dire qu'il s'agit de la "politique de l'autruche" et que nous avions pleinement raison d'insister sur cela. Une fois clarifiés ces détails, il reste une question de fond, que la CWO dans son article n'a pas saisie : comment expliquer qu'une telle contribution au programme prolétarien ait été élaborée dans les années de défaite et de recul général et profond du mouvement autonome de classe ?
Dans la logique de la CWO il ne peut y avoir que deux réponses :
- soit nier ou minimiser la contribution théorique de la Fraction italienne de la Gauche communiste du fait que son travail s'est fait dans une période de défaite et dans un cours vers la guerre, c'est ce que font couramment la CWO et Battaglia, ainsi que le PCInt (Programme communiste) ;
- soit reconnaître cette contribution comme illustration de l'idée que la conscience communiste ne naît pas des luttes, mais de l'organisation révolutionnaire qui, nécessairement, doit l'introduire de l'extérieur au sein de la classe ouvrière.
De telles réponses n'expliquent rien et montrent seulement une conception mécanique de l'influence de la lutte de classe sur la réflexion des minorités révolutionnaires. Avec une telle conception, l'unique expérience sur laquelle Bilan aurait pu compter ce sont les défaites des années 30. Mais les origines de Bilan ne se trouvent pas dans les années 30. Elles se trouvent "à l'époque où les idées communistes s'emparaient des masses". Ses militants ne se sont pas formés à la queue des Fronts Populaires, mais à la tête des mouvements révolutionnaires de masse des années 20. Ce qui permet à Bilan de continuer à contre-courant l'approfondissement des positions révolutionnaires, c'est la confiance inébranlable dans la capacité révolutionnaire de la classe ouvrière, confiance acquise non à travers quelques lectures mais dans la participation de militants à la plus grande tentative de cette classe d'instaurer une société sans classes. De ce point de vue, le travail théorique des fractions de gauche n'est absolument pas indépendant ou séparé des expériences historiques des masses prolétariennes. Non seulement le travail de Bilan se fait sous la poussée de la vague révolutionnaire précédente, mais il n'aurait aucun sens en dehors de la perspective d'une nouvelle vague. La preuve a contrario de l'influence très étroite mais non immédiatiste que le mouvement de classe exerce sur la réflexion des révolutionnaires nous est donnée par le fait que la plus grande stagnation des minorités révolutionnaires n'a pas lieu dans les années 30, mais dans les années 50, parce que la bourgeoisie avait réussi à terminer la seconde guerre mondiale sans qu'il y ait eu surgissement d'une nouvelle vague révolutionnaire et que la poussée de la vague précédente était érodée par trente années de contre-révolution.
Nous nous rendons compte qu'une telle conception de l'approfondissement de la conscience de classe, à travers un parcours complexe, non rectiligne, parfois hésitant, est dur à digérer ; mais c'est la seule conception fidèle à la méthode marxiste qui la sous-tend. Il est sans doute plus simple d'imaginer que le parti élabore par lui-même, de son côté, un beau programme tout propre et que, quand le moment arrive, il l'envoie à la classe ouvrière comme une lettre à la poste. Rêver ne coûte rien.
Il reste la dernière question, celle de la faillite de la Fraction du fait de la théorie de Vercesi sur l'économie de guerre qui rendait inutile une nouvelle guerre impérialiste. En premier lieu, nous notons qu'il s'agit d'une nouvelle orientation développée de 1937 à 1939 et qui contredisait toute la perspective affirmée depuis 1928 d'un rapport de force défavorable au prolétariat et s'orientant vers un nouveau conflit mondial. En second lieu, cette position n'était pas la seule existante dans la Gauche Communiste Internationale. Cette analyse fut violemment critiquée par une majorité de la Fraction belge et par une importante minorité de la Fraction italienne. Le résultat de cette bataille fut qu'avec l'éclatement de la guerre la Fraction ne s'est pas dissoute définitivement, comme cherche a le faire croire la CWO, mais fut reconstituée par la minorité regroupée à Marseille, dans le sud de la France non occupé par les Allemands. Le travail s'est poursuivi régulièrement pendant toute la guerre avec une systématisation et un approfondissement remarquables des positions programmatiques. A partir de 1941, se tinrent des conférences annuelles dont sortit entre autres, la condamnation des théories révisionnistes de Vercesi sur l'économie de guerre ("Déclaration politique", mai 1944). Quand la Fraction apprit que le déboussolement de Vercesi avait fini par le conduire à participer à un comité anti-fasciste à Bruxelles, elle réagit immédiatement en l'expulsant pour indignité politique ("Résolution sur le cas Vercesi", janvier 1945). Comme on le voit, la Fraction n'a pas cessé le travail en suivant Vercesi mais l'a poursuivi en expulsant celui-ci.
Notons au passage que la CWO fait la nième pathétique tentative de soutenir une de ses idées fixes, à savoir que ceux qui, comme le CCI, défendent la théorie économique de Luxemburg sur la saturation des marchés ne peuvent maintenir une ligne politique révolutionnaire. Mettons alors au clair que Bilan n'était pas luxemburgiste, au sens strict, mais se limitait surtout à accepter les conséquences politiques des analyses économiques de Rosa (rejet des luttes de libération nationale, etc.). Ce n'est pas un hasard si la défense de ces analyses économiques revient pour une grande part à des camarades provenant d'autres groupes révolutionnaires, comme Mitchell (ex-Ligue des Communistes Internationalistes) ou Marco (ex-Union Communiste). Le luxemburgiste Mitchell sera le chef de file de la critique aux théories révisionnistes de Vercesi avant la guerre, et ce sera le luxemburgiste Marco qui, pendant la guerre, corrigera les points les plus faibles de l'analyse économique de Rosa. Que démontre cela ? Que seuls des luxemburgistes peuvent être des marxistes cohérents? Non, comme le prouve la présence de camarades non luxemburgistes à côté de Mitchell et de Marco. Alors ? Alors, cela montre que la CWO doit arrêter de cacher des faits essentiels derrière des questions secondaires.
Et ceci nous amène au fait essentiel, à savoir que la CWO dans son compte-rendu a carrément fait disparaître six années d'existence de la Fraction (et quelles années : celles de la guerre impérialiste). De façon significative, la même opération désinvolte fut faite par Programma Comunista quand il fut finalement contraint de parler de la Fraction, provoquant de notre part la réponse qu'aujourd'hui nous adressons à la CWO :
- "L'article parle de l'activité de la Fraction de 30 à 40. Passant complètement sous silence son existence et activité entre 1940 et 1945, date de sa dissolution. Est-ce par simple ignorance ou pour s'éviter d'être obligé de faire une comparaison entre les positions défendues par la Fraction pendant la guerre et celles du PCInt constitué en 1943-44 ?" (Revue Internationale No 32, 1983).
Etant donné que notre étude sur la GI consacre pour le moins 17 pages à l'activité de la Fraction entre 1939 et 45, ce n'est pas d'ignorance qu'il faut accuser la CWO, mais de cécité. Pour la CWO aussi, il s'agit de la politique de l'autruche.
Des années 40 aux années 50 :
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIERE.
"Le CCI présente la formation du PCInt comme une régression par rapport à Bilan, idéalisé dans leur presse. Mais pourquoi était-ce un pas en arrière? Selon le rédacteur, 'la gauche italienne avait dégénéré profondément après 1945, jusqu'à se fossiliser complètement', (p. 186). Mais était-ce réellement une fossilisation que d'engager des milliers de travailleurs dans la politique révolutionnaire après les grandes grèves de 1943 ? Et que dire de la plateforme du Parti, publiée en 52? Représentait-elle un pas en arrière ? (...) Et sur la guerre après les confusions et prévarications de Bilan, les positions (du PCInt) constituaient sans aucun doute un pas en avant, (...) en avance sur les théories sur la disparition du prolétariat durant la guerre impérialiste". (Revolutionary Perspectives, n°21, p.31).
- "Quand le 'PCInt fut formé en 1943, les ancêtres du CCI (Internationalisme) refusaient de s'y joindre non seulement parce qu'ils pensaient que les bases théoriques du nouveau Parti étaient peu solides mais aussi parce qu'ils (.. .) croyaient qu'une nouvelle guerre allait éclater à cette époque et concluaient qu'il n'y avait rien à faire '.Quand le capitalisme 'termine' une guerre impérialiste qui a duré 6 ans sans qu'explose aucun surgissement révolutionnaire, cela signifie la défaite du prolétariat". (Internationalisme 1946) (R.P n°20, p.35). "En fait, la Fraction française, qui publiait Internationalisme, fut exclue de la Gauche Communiste pour avoir publié un tract commun avec deux groupes trotskystes français pour le 1er mai 1945.. .." {R.P., No 21, p.31).
Au lieu de procéder par argumentation politique, la CWO semble adopter la technique des spots publicitaires, dans lesquels la propreté des draps lavés avec une super lessive se démontre en les plaçant à côté de draps sales lavés avec une lessive ordinaire. Que prend-on comme point de référence pour déterminer si le PCInt représente un pas en avant ou un pas en arrière ? La théorie révisionniste de Vercesi qui en arrivait à nier toute activité révolutionnaire pendant la guerre, étant donnée "l'inexistence sociale" du prolétariat ! Qu'offre-t-on comme seule alternative ? Un petit groupe qui flirte avec les trotskystes, qui déclare inutile toute activité révolutionnaire et, dans les faits, suspend ses publications en 52 ! Face à ce désolant tableau de "nuit noire", il est trop facile de faire paraître les positions du PCInt brillantes de clarté.
Mais combien de falsifications et d'omissions ont été nécessaires pour faire ce spot publicitaire ? Pour mettre en avant l'activité du PCInt à partir du milieu de la guerre, ils font disparaître 6 années d'activité de la Fraction italienne à partir du début de la guerre et jusqu'à sa conclusion. On identifie la Gauche italienne avec les dernières positions de Vercesi, alors qu'au cours de la guerre, la tendance Vercesi fut d'abord combattue, puis condamnée, enfin expulsée. Toujours dans le but d'effacer toute l'activité de la Gauche Communiste Internationale durant la guerre, on porte ensuite l'attaque la plus féroce contre la Gauche Communiste de France (constituée à partir de 1942) qui fut la plus ardente à soutenir cette activité et la lutte contre Vercesi. Ici, la CWO n'a pas honte d'utiliser les mêmes falsifications que Vercesi, responsable du travail international du PCInt à partir de 1945, pour exclure cette tendance combative de la Gauche Communiste Internationale.
En réalité le RKD allemand et les CR français ([1] [643]), les deux groupes prolétariens avec lesquels Internationalisme diffuse un appel à la fraternisation prolétarienne, rédigé en plusieurs langues, avaient déjà rompu en 1941 avec le trotskysme et maintenu une attitude internationaliste pendant la guerre, comme le prouve totalement la documentation dans la brochure aux pages 153 et 154. Quant au soi-disant refus de toute activité de la part d'Internationalisme après 1945, la CWO devrait nous expliquer comment est-ce possible que la seule force de la gauche communiste présente dans la fameuse grève sauvage de 1947 à Renault et dans son comité de grève, ce fut précisément la Gauche Communiste de France, tandis que la fraction française "bis", liée au PCInt, brillait par son total désintérêt envers le seul mouvement significatif du prolétariat dans le second après-guerre. Même sans se faire d'illusions sur une quelconque possibilité de révolution, les camarades d'Internationalisme n'ont jamais manqué à leurs tâches de militants communistes. C'est ainsi que la GCF a participé activement à la Conférence Internationale de 1947 convoquée par la gauche hollandaise, a publié 12 numéros du journal mensuel "L'Etincelle" et 48 numéros de sa revue "Internationalisme". Sa dissolution en 1952 avait pour raison la dispersion extrême de ses membres (La Réunion, Amérique du Sud, Etats-Unis, Paris où très peu de membres étaient restés), ce qui rendit matériellement impossible la continuation de son existence et la poursuite de son activité.
En vérité, il n'est ni intéressant, ni utile de suivre la CWO dans toutes ses contorsions. Dans R.P n°20, on cite la reconnaissance de "positions claires envers les partisans" du PCInt, faite par nous à la page 170 de la brochure, pour démontrer que, quand nous parlons de déboussolement du PCInt vis-à-vis des partisans, nous mentons en sachant que nous mentons. Mais pourquoi la CWO ne cite-t-elle pas aussi la page 171, où nous montrons le changement de ligne opéré en 1944 et la page 177 ou un dirigeant du PCInt reconnaît à quels désastreux résultats a abouti, en 1945, ce changement ? La CWO ne lit-elle qu'une page sur 10 ? Il est en tout cas certain qu'elle choisit soigneusement chaque page à lire et à citer... Mais cela ne suffit pas. Dans R.P n°21, on cite les discussions d'Internationalisme avec "Socialisme ou Barbarie" comme preuve de son caractère opportuniste. Dans le numéro précédent de R.P, on présentait par contre les discussions de Battaglia Comunista avec Socialisme ou Barbarie comme une preuve du caractère "vivant et non sectaire" de B.C. La même action est utilisée comme preuve d'esprit révolutionnaire lorsqu'elle est le fait de B.C, et comme preuve d'esprit éclectique lorsqu'elle est le fait d'Internationalisme ! Comment répondre sérieusement à de tels arguments ?
Nous n'idéalisons pas plus Internationalisme que Bilan. Nous savons bien combien il a "balbutié" dans son effort permanent de clarification des positions de classe. C'est pour cela que nous ne nous limitons pas à nous les remémorer, mais essayons de les approfondir, sans avoir peur de les dépasser de façon critique, quand c'est nécessaire. Cela ne nous embarrasse nullement de reconnaître que certaines de ces erreurs, qui ont conduit à la dispersion géographique des militants ont contribué à rendre impossible le maintien d'une presse régulière, ce qui fut un grave coup pour l'ensemble du milieu révolutionnaire. La CWO pense au contraire que l'arrêt des publications en 1952 était simplement la démonstration définitive du manque de sérieux d'Internationalisme. En procédant ainsi, la CWO donne le bâton pour se faire battre. La CWO devrait en fait nous expliquer comment et pourquoi la fraction belge et la fraction 'française-Bis’, liée au PCInt, ont suspendu leurs publications dès 1949 (et donc 3 ans avant Internationalisme) sans que le parti italien "fort de milliers de militants" ait remué le petit doigt pour l'empêcher? Comment est-il possible qu'un petit groupe, qui ne pensait à autre chose qu'à s'échapper en Amérique du Sud, ait réussi à résister à contre courant pendant des années, alors que les représentants du PCInt à l'étranger avaient déjà jeté l'éponge ? A la CWO de répondre... En attendant que la CWO s'interroge sur ces "mystérieux" événements, revenons au problème essentiel: le PCInt est-il, oui ou non, une régression par rapport à la Fraction à l'étranger ? Nous avons déjà vu que la Fraction à l'étranger est restée active jusqu'en 1945, clarifiant ultérieurement de nombreux problèmes laissés en suspens par Bilan (par exemple, la nature contre révolutionnaire, capitaliste et impérialiste de l'Etat russe). Nous avons aussi vu comment la Gauche Communiste de France s'est constituée dans la poussée du dernier grand effort de la Fraction italienne, comment elle en a été partie active et le prolongement après la dissolution de la Fraction italienne. Passons maintenant à l'examen de l'autre élément de la comparaison : le PCInt fondé en Italie en 1943.
A première vue, on ne peut que rester abasourdi par la présentation qu'en fait la CWO : non seulement les positions du PCInt étaient parfaitement claires - voir la plateforme de 1952 - mais, en outre, il disposait de milliers d'adhérents ouvriers. Cela apparaît évidemment comme un beau pas en avant par rapport aux "balbutiements" de quelques dizaines d'émigrés à l'étranger ! Mais pour peu qu'on examine ce "pas" avec attention, on remarque immédiatement les premières notes discordantes : pourquoi écrire une plateforme seulement en 1952 alors que le PCInt avait été fondé 10 ans auparavant et que dès 1949 il avait perdu tout suivi de masse ? Cette plateforme n’arrive-t-elle pas un peu en retard ? Qui plus est, la plateforme de 1952 n'existait évidemment pas en 1943 : sur quelle base ont donc adhéré ces "milliers d'ouvriers" ? La réponse est simple. Sur la base de la plateforme du PC Internationaliste écrite par Bordiga en 1945 et diffusée en 1946 par le parti à l'étranger dans une édition française avec une introduction politique de Vercesi ([2] [644]). Cette plateforme n'était claire ni sur la nature capitaliste de l'Etat russe, ni sur les "mouvements partisans" ; elle affirmait, par contre, très clairement que "la politique programmatique du Parti est celle développée... dans les textes constitutifs de l'Internationale de Moscou" et que "le Parti aspire à la reconstitution de la confédération syndicale unitaire". C'est sur la base de ces positions qui constituaient un retour pur et simple à l'Internationale Communiste des années 20, qu'il a été possible d'enrôler "des milliers d'ouvriers", puis plus tard, de les perdre dans la nature. Il s'agissait d'un double pas en arrière, non seulement par rapport aux conclusions tirées par la Fraction dans sa période finale (1939-45), mais même par rapport aux positions de la Fraction dans sa première période (1928-30). Le poids de milliers de nouveaux adhérents, enthousiastes, certes, mais très peu formés, entrava puissamment les efforts de vieux militants qui n'avaient pas oublié le travail de la Fraction. Ainsi, Stefanini, qui, à la Conférence Nationale de décembre 1945 défendit une position anti-syndicale analogue à celle d'Internationalisme ; ainsi, Danielis qui, au Congrès de 1948 devait amèrement reconnaître : "On peut se demander s'il y a vraiment eu une soudure idéologique entre le Parti et la Fraction à l'étranger ; au Congrès de Bruxelles de la Fraction, on nous avait assuré que les matériaux théoriques étaient régulièrement envoyés en Italie" (compte-rendu du 1er Congrès du PCInt, p.20). A travers ces paroles de désillusion d'un dirigeant du Parti même, on peut mesurer l'ampleur du pas en arrière fait pas le PCInt, au regard des apports théoriques de la Fraction.
Il reste une dernière question, à savoir comment situer la plateforme sur laquelle, en 1952, la tendance Damen (Battaglia Comunista) se sépare définitivement de celle de Bordiga, qui devait constituer Programme Communiste aujourd'hui en déroute ?
Il suffit d'un coup d'oeil pour comprendre que les positions centrales de cette plateforme (dictature de la classe et non du Parti, impossibilité de récupération des syndicats, rejet des luttes nationales) représentent un évident pas en avant par rapport à la plateforme de 1945. Nous avons toujours affirmé ceci avec le maximum de clarté, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. LE PROBLEME, C'EST QU’UN PAS EN AVANT NE SUFFIT PAS APRES DEUX PAS EN ARRIERE. De plus, après 7 ans d'affrontements de tendance à l'intérieur du PCInt, on pouvait s'attendre à des progrès substantiels dans la clarté des termes puisque les formulations encore "ouvertes" en 42 ne l'étaient plus 10 ans après. Au lieu de ces pas en avant, sur tous les terrains abordés, B.C fait des petits pas en avant, et puis s'arrête à mi-chemin sans conclure réellement (dictature exercée par la classe et non par le Parti, MAIS c'est le Parti qui organise et dirige la classe comme un état-major ; les syndicats ne sont pas récupérables, MAIS on peut travailler dedans ; le parlementarisme révolutionnaire est impossible, MAIS le Parti ne peut exclure l'utilisation tactique des élections, et ainsi de suite)
Sa plateforme de 1952 fait davantage penser à une vision ultra-extrêmiste des thèses dé l'Internanationale qu'à une synthèse effective du travail effectué jusqu'alors par la GCI. Certes, elle constituait une bonne base de départ pour rattraper le retard accumulé du fait de l'incohérence des bases théoriques de 1943-45. Cependant, le poids du cycle contre-révolutionnaire, qui atteignait en ces années son maximum, empêcha BC de faire des pas substantiels en avant, même si quelques unes des naïvetés les plus grandes ont été récemment éliminées (cf. par exemple, la transformation des "Groupes syndicaux internationalistes" en "Groupes d'usines internationalistes"). S'il suffisait d'éliminer le terme "syndical" pour éliminer les ambiguïtés sur le syndicat, tout serait réglé... Ce qui constituait en 1952 des obstacles inachevés à la pénétration opportuniste, risque aujourd'hui de devenir une espèce de passoire à travers laquelle tout peut se glisser, comme l'a montré la récente mésaventure de BC avec les nationalistes de l'UCI iranien.
Les années 80 ne sont pas les années 30.
- "Le CCI aimait à se présenter comme la fusion des meilleurs éléments des gauches allemande et italienne (...). Bien que le CCI y voie une vertu, la nature a horreur du déséquilibre. Il ne peut y avoir de fusion éclectique entre des traditions politiques dissemblables. Aujourd'hui, les révolutionnaires doivent se placer fermement sur le terrain de la gauche italienne, corrigeant ses erreurs avec ses propres armes, la dialectique marxiste." (Revolutionary Perspectives n°21, p.30).
Dans un article récent, nous avons cherché à montrer comment B.C et la CWO, avec leur vision d'une contre-révolution encore active, n'arrivaient pas à comprendre la différence entre aujourd'hui et les années 30 du point de vue des rapports de force entre les classes. Dans cette conclusion, nous chercherons à montrer comment ce n'est pas seulement "sur ce terrain que B.C et la CWO se présentent avec plus de 40 années de retard" (Revue Internationale n°36, p.19). La CWO nous accuse de faire de l'éclectisme entre gauche allemande et italienne, soutenant qu'elles ne peuvent pas "fusionner". Mais nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. L'involution théorique de "Réveil Communiste" dans les années 30 [et du Groupe Communiste Internationaliste (GCI) plus récemment] le démontre de manière irrévocable. Ce qui était, par contre, possible, c'était de passer ensemble "au crible de la critique la plus intense" (Bilan n°1) l'expérience accumulée par le prolétariat de tous les pays dans la première vague révolutionnaire, pour arriver, à travers des années de travail à une "synthèse historique" (Bilan n°15).
La DONNEE DE FAIT qui ne peut être niée, c'est que cette synthèse historique a été faite, principalement sous l'impulsion et par le travail de la gauche italienne, et qu'elle constitue le point de référence de toute prise de position aujourd'hui. Choisir entre la gauche italienne, la gauche allemande ou un cocktail des deux, c'est dans tous les cas un choix privé de sens parce que ces deux tendances, du point de vue du mouvement historique de la classe, n'existent plus. Le travail de synthèse historique accompli par la Fraction a permis "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" réclamée par Bordiga en 1926. En conséquence, l'unique gauche communiste dont nous pouvons nous sentir partie prenante est la Gauche Communiste Internationale, constituée sur la base de ce travail. Cette acceptation constitue l'unique paramètre acceptable de nos jours. Le CCI, qui s'est constitué sur la base de ce travail et qui a largement contribué à le faire connaître, a clairement choisi. Avec autant d'esprit de décision mais avec une clarté moindre, Programme Communiste a rejeté ce travail, revenant aux positions de base des années 20. Comme nous l'avons vu, B.C (et la CWO) n'arrive pas à se déterminer clairement. Face au choix d'aujourd'hui : se baser sur les pas faits en avant par la Fraction italienne, belge et française ou se baser sur la régression du PCInt, ces camarades restent à mi-chemin de façon éclectique. "Le problème avec B.C, c'est que sa réponse à notre Adresse, comme ses positions politiques, est insaisissable. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. (. . ) Si Programma a une cohérence dans ses erreurs, Battaglia a ses erreurs dans l'incohérence " (Revue Internationale n°36).
La CWO soutient que tout groupe pratiquant l'éclectisme sur les questions fondamentales finit par se déséquilibrer définitivement et mettre ainsi en cause également les pas en avant déjà faits. Nous acceptons sans réserve ce jugement qui est d'autre part confirmé par les faits : le CCI, à une dizaine d'années de sa fondation, n'a altéré aucun de ses points programmatiques de départ ; la CWO, à partir du moment où elle s'est approchée des positions éclectiques de B.C, a retourné comme un gant sa propre plateforme, abandonnant une par une les avancées de la gauche internationale en se retournant vers le léninisme des années 20 sur toutes les questions fondamentales. Avant que ce processus ne devienne irréversible, il serait bon que les camarades de la CWO se rappellent qu'à l'époque actuelle le soi-disant "léninisme", n'ayant plus rien à voir avec l'oeuvre révolutionnaire de Lénine, est seulement une des idéologies contre-révolutionnaires de la gauche du capital.
BEYLE.
[1] [645] Les RKD (Communistes Révolutionnaires d'Allemagne) les CR (Communistes Révolutionnaires) cf. Revue Internationale No 32, p.24, notes
[2] [646] CWO nous reproche amèrement et longuement d’avoir employé dans un article n°32 de la Revue Internationale, le terme de « Bordiguiste » pour qualifier Battaglia Communista et la CWO. Nous voulons bien reconnaître qu’il y avait de notre part un manque de précision qui peut introduire des confusions. Cependant, CWO ne fait que se servir d’une virgule mal placée pour escamoter le débat de fond. Car, premièrement, jusqu’en 1952,la tendance qui allait devenir B.C. se réclame de cette plate-forme de Bordiga. Deuxièmement, parce que les critiques de B.C. à Bordiga, dont CWO se réclame, restent toujours ambiguë, à mi-chemin.
Courants politiques:
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : le Communistenbond Spartacus et le courant conseilliste 1942-1948, II
- 4973 reads
Dans la première partie de cet article (cf. Revue Internationale n°38) consacré à l'histoire de la gauche hollandaise, nous avons montré l'évolution du Communistenbond Spartacus, issu d'un mouvement situé à la droite du trotskisme dans les années 30, vers des positions révolutionnaires, lui conférant entre 1942 et 1945 - malgré de nombreuses confusions théoriques tant sur la période historique du second après-guerre que sur la nature de l'URSS, les luttes de libération nationale etc..- une lourde responsabilité politique au niveau international dans le regroupement des révolutionnaires en Europe occidentale.
Première organisation révolutionnaire en Hollande, et consciente de cette responsabilité, le Communistenbond, en proclamant en décembre 45 la nécessité du parti international du prolétariat comme facteur actif dans le processus d'homogénéisation de la conscience de classe, était, alors, encore loin des conceptions ouvertement conseillistes qu'il va développer à partir de 1947. Conceptions qui, de régression théorique en régression théorique, vont progressivement 1'acheminer vers le conseillisme achevé : rejet de 1'expérience prolétarienne du passé - notamment de 1'expérience de la révolution russe -, abandon de toute idée d'organisation politique, négation de toute distinction entre communistes et prolétaires, tendance à1'ouvriérisme et à 1'immédiatisme, chaque grève étant considérée comme "une révolution en petit".
Cette 2ème partie s'attachera à analyser les différentes étapes de la dégénérescence du courant conseilliste (dont les germes étaient déjà contenus dans les positions du Communistenbond en 45) qui conduira à sa disparition dans les années 70, pour ne laisser aujourd'hui que des épigones, dont le groupe Daad en Gedach se rattachant au courant libertaire anti-parti.
Il était inévitable que l'orientation du Bond vers une organisation centralisée et que l'importance accordée à la réflexion théorique - sous forme de débats et de cours de formation - ne satisfassent pas les éléments les plus activistes du Bond. Ceux-ci, autour de Toon van den Berg, gardaient le vieil esprit syndicaliste-révolutionnaire du NAS. Très présents dans le milieu prolétarien de Rotterdam, lors des grèves du port, ils avaient contribué à la construction d'un petit syndicat, l'EVB (Union syndicale unitaire), né de la lutte. Il est symptomatique que le Bond - lors de son congrès des 24-26 décembre 1945 - acceptât de travailler dans l'EVB. Condamnant l'activité de l'organisation dans les syndicats, appendices de l'Etat, sa position sur les syndicats restait théorique. En quittant le Bond, Toon van den Berg et ceux qui le soutenaient allaient jusqu'au bout dans la logique d'une participation "tactique" à de petits syndicats indépendants. ([1] [649])
Le Bond se trouvait dans une phase de réappropriation des positions politiques du GIC. Et à tâtonnements, il dégageait peu à peu, de façon plus ou moins claire, ses positions politiques et théoriques propres.
D'autre part, la centralisation que requérait ce travail politique heurtait les éléments anarchisants du Bond. C'est à propos du journal hebdomadaire "Spartacus" que se développa un grave conflit dans l'organisation. Certains - soutenus par une partie de la rédaction finale (Eind-redactie) - qui était la Commission de rédaction -trouvaient que le style du journal était "un style journalistique" ([2] [650]). Ils voulaient que le journal soit le produit de tous les membres et non d'un organe politique. Le conflit connut son point le plus haut en mars 1946, lorsqu'un clivage se fit entre la Commission politique, dont Stan Poppe était le secrétaire, et la Commission de Rédaction finale. Il en ressortit que "la Rédaction finale est soumise à la commission politique" ([3] [651]) dans le choix politique des articles, mais non dans le style laissé à l'appréciation de la Rédaction. La commission politique défendait le principe du centralisme par un travail commun entre les deux organes. La Rédaction finale pensait que son mandat était valable uniquement devant l'assemblée des membres du Bond. Elle s'appuyait sur les jeunes qui voulaient que le journal soit l'expression de tous alors que la majorité de la Commission politique et en particulier Stan Poppe, défendait le principe d'un contrôle politique des articles par un organe ; en conséquence, la Rédaction ne pouvait être qu'une "subdivision" de la Commission politique. La participation des membres à la rédaction se faisait selon le principe de la "démocratie ouvrière" qui prévalait dans les organisations de "vieux style" ([4] [652]). Il ne s'agissait pas d'une"politique de compromis", comme l'en accusaient la majorité de la rédaction et des membres à Amsterdam, mais d'une question pratique de travail commun entre les deux organismes, s'appuyant sur le contrôle et la participation de tous les membres du Bond.
Ce débat confus, où se mêlaient des antagonismes personnels et des particularismes de commissions, ne faisait que porter au grand jour la question de la centralisation. La non-distinction au départ entre Rédaction intégrée dans la commission politique et cette dernière n'avait fait qu'envenimer les choses. Cette grave crise du Bond se traduisait par le départ de plusieurs militants, et loin de triompher la centralisation du Bond devint de plus en plus vague au cours de l'année 1946.
Mais dans les faits, le départ des éléments les moins clairs du Bond, ou les plus activistes, renforçait la clarté politique du Bond qui se démarquait plus nettement du milieu politique ambiant. Ainsi -à l'été 1946 - des membres du Bond qui votaient dans les élections pour le PC le quittèrent. Il en fut de même des membres de la section de Deventer qui avaient pris contact avec les trotskystes du CRM pour faire un travail "entriste" dans le Parti communiste néerlandais. ([5] [653])
Ces crises et ces départs étaient en fait une crise de croissance du Communistenbond, qui en"s'épurant" gagnait en clarté politique.
En 1945-1946, sont examinées plusieurs questions théoriques, sur lesquelles le Bond était resté flou pendant sa période de clandestinité : les questions russe, nationale, syndicale. Celles des conseils ouvriers, de la lutte de classe dans l'après-guerre, de la barbarie et de la science, de la caractérisation de la période suivant la Deuxième Guerre mondiale étaient abordées à la lumière de l'apport de Pannekoek.
1) La question russe
La nature de l'Etat russe n'avait pas été vraiment abordée par le Bond, à sa naissance. Les conférences tenues en 1945 et la publication d'un, article théorique sur la question permirent une prise de position sans ambiguïté ([6] [654]). Cet article, tout en rendant hommage à la position de défaitisme révolutionnaire du MLL Front lors de la guerre germano-russe en 1941, notait que "seulement à l'égard de l'Union soviétique, leur attitude était encore hésitante". Cette hésitation était en fait celle du Bond en 1942-1944. Ce n'était plus le cas en 1945.
Les révolutionnaires, notait le rédacteur de l'article, ont eu des difficultés énormes à reconnaître la transformation de la Russie soviétique en un Etat impérialiste comme les autres :
"On ne pouvait et on ne voulait pas croire que la Russie révolutionnaire de 1917 s'était transformée en une puissance semblable aux autres pays capitalistes."
Il est intéressant de noter ici que le Bond, à la différence du GIC des années 30, ne définit pas la Révolution russe comme une "révolution bourgeoise". Il essaye de comprendre les étapes de la transformation de la révolution en contre-révolution. Comme la Gauche Italienne "Bilan"), il voit le processus contre-révolutionnaire surtout dans la politique extérieure de l'Etat russe, qui marque son intégration dans le monde capitaliste. Ce processus se développe par étapes : Rapallo en 1922 ; l'alliance du Komintern avec le Kuomintang en Chine; l'entrée de l'URSS dans la SDN en 1929. Cependant, le Bond estime que c'est en 1939 seulement que la Russie est vraiment devenue impérialiste. La définition qui est donnée ici de l'impérialisme est purement militaire, et non économique : "Depuis 1939, il est devenu clair que aussi la Russie est entrée dans une phase d'expansion impérialiste".
Cependant, le Bond montre que le processus contre-révolutionnaire est aussi interne, dans la politique intérieure, où "sous la direction de Staline naquit une bureaucratie d'Etat". La nature de classe de la bureaucratie russe est bourgeoise :
"La bureaucratie dominante remplit la fonction d'une classe dominante qui, dans ses buts essentiels, correspond au rôle que remplit la bourgeoisie dans les pays capitalistes modernes".
Il est à noter ici que la "bureaucratie" russe est la bourgeoisie par sa fonction plus que par sa nature. Elle est un agent du capital étatisé. Bien qu'il soit clair dans le reste de l'article que cette "bureaucratie" est la forme que revêt la bourgeoisie d'Etat en URSS, l'impression donnée est qu'il s'agit d'une "nouvelle classe". En effet, il est affirmé que "la bureaucratie est devenue la classe dominante". Cette "classe dominante" deviendra - quelques années plus tard, sous l'influence de "Socialisme ou Barbarie" - pour le Bond "une nouvelle classe".
Le Bond montre qu'il existe deux classes dans la société russe, dans les rapports d'exploitation capitaliste basés sur "l'accumulation de plus-value" : la classe ouvrière et lardasse dominante". L'existence du capitalisme d'Etat - comme capital collectif - explique la politique impérialiste de l'Etat russe :
"L'Etat lui-même est ici l'unique capitaliste, en excluant tous les autres agents autonomes du capital ; il est l'organisation monstrueuse du capital global. Ainsi, il y a d'un côté les travailleurs salariés qui constituent la classe des opprimés ; de l'autre côté l'Etat qui exploite la classe opprimée et dont l'assise s'élargit par l'appropriation du surproduit créé par la classe ouvrière. C'est le fondement de la société russe ; c'est aussi la source de sa politique impérialiste".
La distinction faite ici -implicitement, et non explicitement - entre "dominés" et "dominants" n'est pas sans annoncer la future théorie du groupe "Socialisme ou Barbarie" ([7] [655]). Mais à la différence de ce dernier, le Communistenbond "Spartacus" n'abandonna jamais la vision marxiste d'antagonismes au sein de la société capitaliste.
Malgré les hésitations dans son analyse théorique, le Bond était très clair dans les conséquences politiques qui découlaient de son analyse théorique. La non défense de l'URSS capitaliste était une frontière de classe entre bourgeoisie et prolétariat :
"Prendre parti pour la Russie signifie que l'on a abandonné le front de classe entre ouvriers et capitalisme".
La non-défense de l'URSS ne pouvait être révolutionnaire que si elle s'accompagnait d'un appel au renversement de l'Etat capitaliste en Russie par la lutte de classe et la formation des conseils ouvriers :
"Seuls les soviets, les conseils ouvriers -"comme pouvoir ouvrier autonome - peuvent prendre en main la production, dans le but de produire pour les besoins de la population travailleuse. Les ouvriers doivent, en Russie aussi, former le Troisième front. De ce point de vue la Russie ne se distingue pas des autres pays."
2) La question coloniale et nationale
En 1945, la position du Bond sur la question coloniale n'est guère différente de celle du MLL Front. Alors que débutait une longue guerre coloniale en Indonésie qui allait durer jusqu'en 1949, date de l'indépendance, le Bond se prononce pour la"séparation" entre les Indes néerlandaises et la Hollande. Sa position reste "léniniste" dans la question coloniale, et il participe même - pendant quelques mois - à un "Comité de lutte anti-impérialiste" (Anti-imperialistisch Strijd Comité) . Ce comité regroupait les trotskystes du CRM, le groupe socialiste de gauche "De Vonk" et le Com-munistenbond, jusqu'à ce que ce dernier le quitta en décembre 1945. Le Bond avouait ([8] [656]) que ce comité n'était rien d'autre qu'un "cartel d'organisations".
Le Bond, en fait, n'avait pas de position théorique sur la question nationale et coloniale. Il reprenait implicitement les positions du 2° Congrès de l'IC. Il affirmait ainsi que "la libération de l'Indonésie est subordonnée à et constitue une sous-partie de la lutte de classe du prolétariat mondial". ([9] [657]) En même temps il montrait que 1 ' indépendance de 1'Indonésie était une voie sans issue pour le prolétariat local : "Il n'y a aucune possibilité présente d'une révolution prolétarienne (en Indonésie)".
Peu à peu triomphait la conception de Pannekoek. Ce dernier - dans les conseils ouvriers - sans prendre position vraiment contre les mouvements nationalistes de "libération nationale", considérait qu'ils se feraient sous la férule du capital américain et entraîneraient une industrialisation des pays "libérés". Telle était la position officielle du Bond en septembre 1945, à propos de l'Indonésie ([10] [658]). Il considérait que "la seule voie qui reste ne peut être autre qu'une future industrialisation de l'Indonésie et une ultérieure intensification du travail". Le mouvement de décolonisation se ferait avec le"soutien du capital américain". Il se traduirait par l'instauration d'un appareil d'Etat"tourné contre la population pauvre".
Le Bond avait encore beaucoup de mal à se déterminer théoriquement vis-à-vis de la "question nationale". Issu de deux courants, dont l'un acceptait les Thèses de Bakou, l'autre se revendiquait de la conception de Luxembourg, il était amené à se prononcer pour 1'une de ces deux conceptions de façon claire. C'est ce qu'il fit en 1946 dans un numéro de "Spartacus - Weekblad" (N° 12, 23 mars. Dans un article consacré à l'indépendance nationale ("Nationale onafhankelijkheid"), il attaquait la position trotskyste du RCP qui propageait le mot d'ordre : "Indonésie los van Holland, nu!" (Séparation de l'Indonésie d'avec la Hollande maintenant!). Un tel mot d'ordre ne pouvait être qu'un appel à l'exploitation des prolétaires indonésiens par d'autres impérialismes :
"Indonésie los van Holland. Nu! " veut dire : exploitation des prolétaires indonésiens par 1'Amérique-Angleterre, l'Australie et/ou leurs propres dirigeants ; et cela en réalité ne peut être! 'Contre toute exploitation' la lutte des masses indonésiennes doit surgir".
Plus profondément, le Bond se réclamait sans ambiguïté de la conception de Rosa Luxemburg et rejetait tout mot d'ordre 'léniniste' d'un 'droit à 1'autodétermination nationale'. Ce dernier ne pouvait être qu'un abandon de l'internationalisme au profit d'un camp impérialiste :
"Avoir de la sympathie pour ce mot d'ordre c'est mettre la classe ouvrière du côté d'un des deux colosses impérialistes rivaux, tout comme le mot d'ordre pour le ‘droit à l'autodétermination des nations' en 1914 et celui (de lutte) contre le fascisme allemand' au cours de la 2°guerre mondiale. '''
Ainsi, le Bond abandonnait définitivement la position qui avait été la sienne en 1942. Par la suite lors de 1'indépendance de pays comme la Chine ou l'Inde, il se préoccupe surtout de voir dans quelle mesure "l'indépendance" pouvait amener un développement des forces productives, et donc objectivement favoriser le surgissement d'un puissant prolétariat d'industrie. Implicitement, le Bond posait la question des 'révolutions bourgeoises' dans le tiers monde (cf. Infra).
3) La question syndicale
Bien que débarrassée de la tendance syndicaliste de Toon van den Berg, l'Union communiste Spartacus reste marquée jusqu'en 1949-1950 par le vieil esprit syndicaliste révolutionnaire du NAS.
Pendant la guerre, le Bond avait participé - avec des membres du PC hollandais - à la construction du petit syndicat clandestin EVC (Centrale syndicale unitaire). Rejetant tout travail" syndical depuis son congrès de Noël 1945, il avait néanmoins envoyé des délégués au congrès de l'EVC le 29 juillet 1946 ([11] [659]). Mais, par"tactique", le Bond travaillait dans les petits syndicats "Indépendants" nés de certaines luttes ouvrières. Après avoir travaillé dans le syndicat EVB - dont l'origine était la transformation d'un organisme de lutte des ouvriers de Rotterdam en structure permanente - le Bond défendait l'idée d'"organisations d'usine" créées par les ouvriers. Ces organisations étaient des "noyaux" (Kerne) qui devaient regrouper les"ouvriers conscients" par "localité et entreprise". ([12] [660])
Il est évident que le Bond ne faisait que reprendre ici la vieille conception du KAPD sur les Unions et les organisations d'entreprise (Betrieb-organisation). Mais à la différence du KAPD, il menait parallèlement un travail de type syndicaliste, sous la pression des ouvriers qui nourrissaient des illusions sur la formation de véritables syndicats"révolutionnaires". Il en fut ainsi en 1948-1949, lorsque naquit l'OVB (Union indépendante d'organisations d'entreprise). L'OVB était en fait une scission - provoquée en mars 1948 par Van den Berg - de l'EVC à Rotterdam, dont l'origine était la main mise du PC sur l'EVC. Croyant que l'OVB serait la base d'"organisations d'entreprise autonomes", le Bond devait reconnaître tardivement qu'il n'était rien d'autre qu'une"petite centrale syndicale". ([13] [661])
Cette 'tactique' du Bond était en contradiction avec sa position théorique sur le rôle et la fonction des syndicats dans la "société semi-totalitaire" des pays occidentaux. Les syndicats sont devenus des organes de l'Etat capitaliste :
"... Il ne peut être question de lutte pour les conditions de travail par le biais des syndicats. Les syndicats sont devenus une partie intégrante de l'ordre social capitaliste. Leur existence et leur disparition sont irrévocablement liées au maintien et à la chute du capitalisme. Dans l'avenir, il ne peut plus être question que la classe ouvrière puisse encore trouver des avantages dans les syndicats. Ils sont devenus des organes briseurs de grèves, là où les ouvriers passent spontanément à la grève et la dirigent." ([14] [662])
La propagande du Bond était donc une dénonciation sans équivoque des syndicats. Les ouvriers devaient non seulement mener leur lutte contre les syndicats par la"grève sauvage", mais comprendre que toute lutte dirigée par les syndicats était une défaite :
"La propagande révolutionnaire n'est pas d'appeler à la transformation des syndicats ; elle consiste à montrer clairement que dans la lutte les ouvriers doivent écarter toute direction syndicale, comme la vermine de leur corps. Il faudra dire clairement que toute lutte est perdue d'avance, dès que les syndicats parviennent à la prendre en charge".
La"grève sauvage" menée contre les syndicats était la condition même de la formation d'organismes prolétariens dans la lutte.
4) Le mouvement de la lutte de classe et les conseils
La publication des "Conseils ouvriers" en janvier 1946 a été déterminante pour l'orientation du Bond vers des positions typiquement "conseillistes". Alors qu'auparavant l'Union communiste Spartacus avait une vision essentiellement politique de la lutte de classe, elle développe des positions de plus en plus économistes. La lutte de classe était conçue plus comme un mouvement économique que comme un processus d'organisation croissante du prolétariat.
La vision de Pannekoek de la lutte de classe insistait d'avantage sur la nécessité d'une organisation générale de la classe que sur le processus de la lutte. Il affirmait, en effet, que "l'organisation est le principe vital de la classe ouvrière, la condition de son émancipation" ([15] [663]). Cette nette affirmation montrait que la conception du communisme des conseils de cette période n'était pas celle de 1'anarchisme. A la différence de ce courant, Pannekoek soulignait que la lutte de classe est moins une "action directe" qu'une prise de conscience des buts de la lutte, et que la conscience précède l'action.
"Le développement spirituel est le facteur le plus important dans la prise du pouvoir par le prolétariat. La révolution prolétarienne n'est pas le produit d'une force brutale, physique ; c'est une victoire de 1'esprit... au commencement était l'action. Mais l'action n'est rien de plus que le commencement...Toute inconscience, toute illusion sur l'essence, sur le but, sur la force de l'adversaire se traduit par le malheur et la défaite instaure un nouvel esclavage" ([16] [664]).
C'est cette conscience se développant dans la classe qui permettait l'éclatement spontané de grèves "sauvages (illégales ou non officielles) par opposition aux grèves déclenchées par les syndicats en respectant les règlements et les lois"." La spontanéité n'est pas la négation de l'organisation ; au contraire "l'organisation naît spontanément, immédiatement".
Mais ni la conscience ni l'organisation de la lutte ne sont un but en soi. Elles expriment une praxis où conscience et organisation s'inscrivent dans un processus pratique d'extension de la lutte qui conduit à l'unification du prolétariat :
"...la grève sauvage, tel le feu dans la prai rie, gagne les autres entreprises et englobe des masses toujours plus importantes. La première tâche à remplir, la plus importante, c'est faire de la propagande pour essayer d'étendre la grève".
Cette idée de l'extension de la grève sauvage était néanmoins en contradiction avec celle d'occupation des usines propagée par Pannekoek. Pannekoek, comme les militants du Bond, avaient été très marqués par le phénomène d'occupation d'usines dans les années 30. L'action d'occupation des entreprises était passée dans l'histoire sous le nom de "grève polonaise", depuis que les mineurs polonais en 1931 avaient été les premiers à appliquer, cette tactique. Celle-ci s'était ensuite étendue en Roumanie et en Hongrie, puis en Belgique en 1935, et enfin en France en 1936.
A l'époque, la Gauche communiste italienne, autour de"Bilan", tout en saluant ces explosions de lutte ouvrière ([17] [665]), avait montré que ces occupations étaient un enfermement des ouvriers dans les usines, qui correspondait à un cours contre-révolutionnaire menant à la guerre. D'autre part, un cours révolutionnaire se traduisait essentiellement par un mouvement d'extension de la lutte culminant avec le surgissement des conseils ouvriers. L'apparition des conseils n'entraînait pas nécessairement un arrêt de la production et l'occupation des usines. Au contraire, dans la Révolution russe, les usines continuaient à fonctionner, sous le contrôle des conseils d'usine ; le mouvement n'était pas une occupation d'usines mais la domination politique et économique de la production par les conseils sous la forme d'assemblées générales quotidiennes. C'est pourquoi, la transformation des usines du Nord de l'Italie en "forteresses" par les ouvriers en 1920, qui occupaient l'entreprise, traduisait un cours révolutionnaire déclinant. C'est la raison pour laquelle Bordiga avait vivement critiqué Gramsci qui s'était fait le théoricien du pouvoir dans l'usine occupée.
Pour la Gauche communiste italienne il était nécessaire que les ouvriers brisent les liens les rattachant à leur usine, pour créer une unité de classe dépassant le cadre étroit du lieu de travail. Sur cette question, Pannekoek et le Spartacusbond se rattachaient aux conceptions usinistes de Gramsci en 1920. Ils considéraient la lutte dans l'usine comme une fin en soi, considérant que la tâche des ouvriers était la gestion de l'appareil productif, comme première étape avant la conquête du pouvoir :
" dans les occupations d'usines se dessine cet avenir qui repose sur la conscience plus claire que les usines appartiennent aux ouvriers, qu'ensemble ils forment une unité harmonieuse et que la lutte pour la liberté sera menée jusqu'au bout dans et par les usines ... ici les travailleurs prennent conscience de leurs liens étroits avec 1'usine... c'est un appareil productif qu'ils font marcher, un organe qui ne devient une partie vivante de la société que par leur travail." ([18] [666])
A la différence de Pannekoek, le Bond avait tendance à passer sous silence les différentes phases de la lutte de classe, et à confondre lutte immédiate (grève sauvage) et lutte révolutionnaire (grève de masses donnant naissance aux conseils) . Tout comité de grève - quelle que soit la période historique et la phase de la lutte de classe -était assimile à un conseil ouvrier :
"Le comité de grève comprend des délégués de diverses entreprises. On l'appelle alors "comité général de grève" ; mais on peut l'appeler "conseil ouvrier". ([19] [667])
Au contraire, Pannekoek soulignait dans ses "5 Thèses sur la lutte de classe" (1946) que la grève sauvage ne devient révolutionnaire que dans la mesure où elle est "une lutte contre le pouvoir d'Etat ; dans ce cas "les comités de grève doivent alors remplir des fonctions générales, politiques et sociales, c'est-à-dire remplir le rôle des conseils ouvriers".
Dans sa conception des conseils, Pannekoek était loin de se rapprocher des positions anarchistes, qui allaient par la suite triompher dans le mouvement "conseilliste" hollandais. Fidèle au marxisme, il ne rejetait pas la violence de classe contre 1' Etat ni la notion de dictature du prolétariat. Mais celles-ci en aucun cas ne pouvaient être une fin en soi ; elles étaient étroitement subordonnées au but communiste : l'émancipation du prolétariat rendu conscient par sa lutte et dont le principe d'action était la démocratie ouvrière. La révolution par les conseils n'était pas"une force brutale et imbécile (qui) ne peut que détruire". "Les révolutions, au contraire, sont des constructions nouvelles résultant de nouvelles formes d'organisation et de pensée. Les révolutions sont des périodes constructives de 1'évolution de 1'humanité." C'est pourquoi "si l'action armée (jouait) aussi un grand rôle dans la lutte de classe", elle était au service d'un but : non pas briser les crânes, mais ouvrir les cervelles". Dans ce sens, la dictature du prolétariat était la liberté même du prolétariat dans la réalisation de la véritable démocratie ouvrière :
"La conception de Marx de la dictature du prolétariat apparaît comme identique à la démocratie ouvrière de l'organisation des conseils."
Cependant, chez Pannekoek, cette conception de la démocratie des conseils évacuait la question de son pouvoir face aux autres classes et face à l'Etat. Les conseils apparaissaient comme le reflet des différentes opinions des ouvriers. Ils étaient un parlement où coexistaient différents groupes de travail, mais sans pouvoirs ni exécutif ni législatif. Ils n'étaient pas un instrument de pouvoir du prolétariat, mais une assemblée informelle :
"Les conseils ne gouvernent pas; ils transmettent les opinions, les intentions, la volonté des groupes de travail".
Comme très souvent, dans les "Conseils ouvriers", une affirmation est suivie de son antithèse, de telle sorte qu'il est difficile de dégager une pensée cohérente. Autant dans le passage cité, les conseils ouvriers apparaissent comme impuissants, autant plus loin ils sont définis comme un puissant organe "devant remplir des fonctions politiques", où "ce qui est décidé... est mis en pratique par les travailleurs". Ce qui implique que les conseils "établissent" le nouveau droit, la nouvelle loi."
Par contre, nulle part il n'est question d'antagonisme entre les conseils et le nouvel Etat surgi de la révolution. Bien que la question se fût posée dans la Révolution russe, Pannekoek semble implicitement concevoir les conseils comme un Etat, dont les tâches seront de plus en plus économiques, une fois que les ouvriers "se sont rendus maîtres des usines". Du coup, les conseils cessent d'être des organes politiques et "sont transformés...en organes de production". ([20] [668]). Sous cet angle, il est difficile de voir en quoi la théorie des conseils de Pannekoek se différencie de celle des bolcheviks après 1918.
Ainsi, en l'espace de deux ans -de 1945 à 1947 -la conception théorique du Communistenbond Sparta-cus se rapprochait de plus en plus des théories "conseillistes" du GIC et de Pannekoek, bien que ce dernier ne fut en aucune façon militant du Bond. ([21] [669])
Bien des facteurs entraient en jeu qui expliquaient le contraste brutal entre le Bond de 1945 et le Bond de 1947. Dans un premier temps, l'afflux de militants après mai 1945 avait donné l'impression que s'ouvrait une période de cours révolutionnaire ; inévitablement, croyait le Bond, de la guerre surgirait la révolution. L'éclatement de grèves sauvages à Rotterdam, en juin 1945, dirigées contre les syndicats confortait le Bond dans ses espérances. Plus profondément, l'organisation ne croyait pas à une possibilité de reconstruction de l'économie mondiale ; elle pensait en août 1945 que "la période capitaliste de l'histoire de l'humanité touche à sa fin" ([22] [670]). Elle était confortée par Pannekoek qui écrivait : "Nous sommes aujourd'hui témoins du début de l'effondrement du capitalisme en tant que système économique." ([23] [671]).
Bientôt le Bond dut reconnaître que ni la révolution ni l'effondrement économique n'étaient à attendre, avec le début de la période de reconstruction. Cependant le Bond et Pannekoek restèrent toujours convaincus de la perspective historique du communisme : certes "toute une grande partie du chemin vers la barbarie (avait été) parcourue, mais l'autre chemin, le chemin vers le socialisme, restait) ouvert". ([24] [672])
Le début de la "guerre froide" laissait le Bond indécis sur le cours historique de 1'après -guerre. D'un côté il pensait -avec Pannekoek - que l'après-guerre ouvrait de nouveaux marchés pour le capital américain, avec la reconstruction et la décolonisation, voire l'économie d'armements ; de l'autre côté, il lui semblait que chaque grève était une "révolution en petit". Bien que les grèves se déroulassent de plus en plus dans le contexte de l'affrontement des blocs,"Spartacus" pensait - dans cette période - que "c'est la lutte de classe qui freine les préparatifs d'une 3° guerre mondiale" ([25] [673]).
. La révolution escomptée ne venait pas, dans un cours profondément dépressif pour les révolutionnaires de l'époque. L'autorité morale de Pannekoek et de Canne Meijer pesait de plus en plus dans le sens d'un retour au mode de fonctionnement qui prévalait dans l'ex-GIC. Au printemps 1947, les critiques commencèrent à se faire jour sur la conception du Parti. Les anciens membres du GIC préconisaient un retour à la structure des "groupes d'études" et des "groupes de travail". Ce retour avait été en fait préparé dès 1946, lorsque le Bond avait demandé à Canne Meijer ([26] [674]) de prendre la responsabilité d'éditer une revue en espéranto et donc de former un groupe espérantiste. De fait, se créaient des groupes à l'intérieur du Bond. Dans leur intervention, les militants du Bond avaient de plus en plus tendance à se concevoir comme une somme d'individus au service des luttes ouvrières.
Cependant, le Communistenbond n'était pas isolé malgré le cours non révolutionnaire qu'il devait finalement reconnaître ([27] [675]) plus tard. En Hollande, s'était constitué le groupe "Socialisme von onderop" (Socialisme par en bas), de tendance "conseilliste" . Mais c'est surtout avec la Belgique néerlandophone que le Bond avait les contacts les plus étroits. En 1945, s'était constitué un groupe très proche du Bond qui éditait la revue "Arbeiderswil" (Volonté ouvrière). Il avait pris par la suite la dénomination de "Vereniging van Radensocialisten" (Association de socialistes des conseils). Le groupe se déclarait partisan du "pouvoir des conseils" et "antimilitariste". Par son principe d'organisation fédératif, il se rapprochait beaucoup de l'anarchisme.([28] [676]) Un tel environnement politique de groupes localistes n'était pas sans pousser le Bond à se replier sur la Hollande. Cependant, en 1946, le Bond avait pris soin de faire connaître à ses membres les positions du courant bordiguiste, en traduisant la déclaration de principes de la Fraction belge de la Gauche communiste ([29] [677]). En juillet 1946, Canne Meijer s'était déplacé à Paris pour prendre contact avec différents groupes, en particulier "Internationalisme". Théo Maassen avait par la suite renouvelée cet effort de prendre contact avec le milieu internationaliste en France. Il est notable que les contacts étaient pris par d'anciens membres du GIC, et non par les ex-RSAP qui n'avaient eu de contact politique qu'avec le groupe de Vereeken. Issus du mouvement communiste des conseils des années 20 et 30, ils avaient déjà discuté avec le courant "bordiguiste" regroupé autour de la revue "Bilan"»
Le Bond en 1947 restait très ouvert à la discussion internationale et souhaitait briser les frontières nationales et linguistiques où il était enfermé :
"Le Bond ne veut point être une organisation spécifiquement néerlandaise. Les frontières é-tatiques ne sont pour lui - à cause de l'histoire et du capitalisme - que des obstacles à l'unité de la classe ouvrière internationale." ([30] [678])
C'est dans cet esprit que le Communistenbond prit l'initiative de convoquer une conférence internationale des groupes révolutionnaires existant en Europe. La conférence devait se tenir les 25 et 26 mai 1947 à Bruxelles. Comme document de discussion le Bond avait écrit une brochure : "De nieuwe wereld" (Le nouveau monde) qu'il avait traduite par ses soins en français.
La tenue de la première conférence de l'après-guerre des groupes internationalistes devait se fonder sur des critères de sélection. Sans l'affirmer explicitement, le Bond éliminait les groupes trotskystes pour leur soutien à l'URSS et leur participation à la Résistance. Il avait cependant choisi des critères d'adhésion à la conférence très larges, voire vagues :
"Nous considérons comme essentiel : le rejet de toute forme de parlementarisme ; la conception que les masses doivent s'organiser elles-mêmes dans l'action, en dirigeant ainsi elles-mêmes leurs propres luttes. Au centre de la discussion, il y a aussi la question du mouvement de masse, tandis que les questions de la nouvelle économie communiste (ou communautaire), de la formation de partis ou groupes, de la dictature du prolétariat, etc. ne peuvent être considérées que comme conséquences du point précédent. Car le communisme n'est pas une question de parti, mais celle de la création du mouvement de masses autonome". ([31] [679])
En conséquence, le Bond éliminait le PC internationaliste bordiguiste italien qui participait aux élections. Etaient par contre invités la Fédération autonome de Turin, qui avait quitté le PCint en raison de ses divergences sur la question parlementaire et le groupe français "Internationalisme", qui s'était détaché du bordiguisme. Etaient par contre invités les groupes bordiguistes belges et français qui étaient en divergence avec le PCint sur les questions parlementaire et coloniale.
En dehors de ces groupes, issus du bordiguisme ou en opposition, le Communistenbond avait invité des groupes informels, voire des individus ne représentant qu'eux-mêmes, de tendance anarcho-conseilliste : de Hollande, "Socialisme van onderop"; de Belgique, le "Vereniging van Radensocialisten" ; de Suisse, le groupe conseilliste "Klassenkampf" ; de France, les ccmmunistes-révolutionnaires du "Prolétaire". ([32] [680])
L'invitation faite à la Fédération anarchiste française fut vivement critiquée par "Internationalisme" qui tenait à ce que les critères de la conférence soient rigoureux. Pour marquer la nature internationaliste de la conférence, les mouvements anarchistes officiels qui avaient participé à la guerre en Espagne, puis aux maquis de la Résistance devaient être éliminés. "Internationalisme", déterminait quatre critères de sélection des groupes participant à une conférence internationaliste :
- le rejet du courant anarchiste officiel "pour la participation de leurs camarades espagnols au gouvernement capitaliste de 1936-1938"; leur participation "sous l'étiquette de 1'antifascisme à la guerre impérialiste en Espagne", puis "aux maquis de la Résistance en France" faisaient que ce courant "n'avait pas de place dans un rassemblement du prolétariat" ;
- le rejet du trotskisme "comme corps politique se situant hors du prolétariat";
- de façon générale rejet de tous les groupes qui "ont effectivement participé d'une façon ou d'une autre à la guerre impérialiste de 1939-1945".
- la reconnaissance de la signification historique d'Octobre 1917 comme "critère fondamental de toute organisation se réclamant du prolétariat".
Ces quatre critères "ne faisaient que marquer les frontières de classe séparant le prolétariat du capitalisme". Cependant le Bond ne retira pas son invitation au "Libertaire" (Fédération anarchiste), qui annonça sa participation et ne vint pas. Le Bond dut reconnaître de fait que 1'antiparlementarisme et la reconnaissance de l'organisation autonome par les masses étaient des critères flous de sélection.
A ce titre la conférence internationale ne pouvait qu'être une conférence de prise de contact entre groupes nouveaux surgis après 1945 et les organisations internationalistes de l'avant-guerre que le conflit mondial avait condamne à rester isolées dans leur pays respectif. Elle ne pouvait aucunement être un nouveau Zimmerwald, comme le proposait le groupe "Le Prolétaire", mais un lieu de confrontation politique et théorique permettant leur "existence organique" et "leur développement idéologique".
Comme le notait "Internationalisme" qui participa très activement à la conférence, le contexte international n'ouvrait pas la possibilité d'un cours révolutionnaire. La conférence se situait dans une période où "le prolétariat a essuyé une désastreuse défaite, ouvrant un cours réactionnaire dans le monde". Il s'agissait donc de resserrer les rangs et d'oeuvrer à la création d'un lieu politique de discussion permettant aux faibles groupes d'échapper aux effets dévastateurs de ce cours réactionnaire.
Tel était aussi l'avis des membres de l'ex-GIC du Bond. Et ce ne fut pas l'effet du hasard si deux anciens du GIC (Canne Meijer et Willem)- et aucun membre de la direction du Bond - participèrent à la conférence. Les anciens RSAP restaient en effet très localistes, en dépit du fait que le Bond avait crée une "Commission internationale de contact".
De façon générale régnait une grande méfiance entre les différents groupes invités dont beaucoup avaient peur d'une confrontation politique. Ainsi ni la Fraction française ni "Socialisme van onderop" ne participèrent à la conférence. Lucain, de la Fraction belge, ne se laissa convaincre d'assister aux débats que sur la demande expresse de Marco d'Internationalisme. Seuls finalement, 1!Internationalisme" et la Fédération autonome avaient envoyé une délégation officielle. Quant aux éléments de l'ex-GIC, déjà en désaccord au sein du Spartacusbond ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Ils nourrissaient une certaine méfiance vis à vis d'"Internationalisme" qu'ils accusaient de "se perdre dans d'interminables discussions sur la révolution russe". ([33] [681])
Présidée par Willem du Spartacusbond, Marco et un vieil anarcho-communiste qui militait depuis les années 1890, la conférence révéla une plus grande communauté d'idées qu'on aurait pu le soupçonner.
- la majorité des groupes rejetèrent les théories de Burnham sur la "société de managers" et le développement indéfini du système capitaliste. La période historique était celle "du capitalisme décadent, de la crise permanente, trouvant dans le capitalisme d'Etat son expression structurelle et politique".
- sauf les éléments anarchisants présents, les communistes de conseils avec les groupes issus du"bordiguisme" étaient d'accord sur la nécessité d'une organisation des révolutionnaires. Cependant, à la différence de leur conception de 1945, ils voyaient dans les partis un rassemblement d'individus porteurs d'une science prolétarienne : "Les 'partis' révolutionnaires nouveaux sont ainsi les porteurs ou les laboratoires de la connaissance prolétarienne". Reprenant la conception de Pannekoek sur le rôle des individus, ils affirmaient que "ce sont d'abord des individus qui ont conscience de ces vérités nouvelles".
- une majorité de participants soutient l'intervention de Marco, d1"Internationalisme", que ni le courant trotskyste ni le courant anarchiste n'avaient leur place dans une conférence de groupes révolutionnaires" ([34] [682]). Seul le représentant du "Prolétaire" - groupe qui devait par la suite évoluer vers l'anarchisme - se fit l'avocat de l'invitation de tendances non officielles ou "de gauche" de ces courants.
- les groupes présents rejetaient toute "tactique" syndicale ou parlementeriste. Le silence des groupes "bordiguistes" en opposition signifiait leur désaccord avec les positions du Parti bordiguiste italien.
Il est significatif que cette conférence - la plus importante de l'immédiat après-guerre - de groupes internationalistes ait réuni des organisations issues des deux courants "bordiguiste" et communiste des conseils. Ce fut la première et dernière tentative de confrontation politique de l'après-guerre. Dans les années 30, une telle tentative avait été impossible, principalement en raison du plus grand isolement de ces courants et des divergences sur la question espagnole. La conférence de 1947 permettait essentiellement d'opérer une délimitation - sur les questions de la guerre et de 1'antifascisme - d'avec les courants trotskyste et anarchiste. Elle traduisait de façon confuse le sentiment commun que le contexte de la guerre froide clôturait une période très brève de deux années qui avait vu se développer de nouvelles organisations, et ouvrait un cours de désagrégation des forces militantes si, consciemment, celles-ci ne maintenaient pas un minimum de contacts politiques.
Cette conscience générale manquait à la conférence qui se termina sans décisions pratiques ni résolutions communes. Seuls, les ex-membres du GIC et "Internationalisme" se prononçaient pour la tenue d'autres conférences. Ce projet ne put se réaliser en raison de la sortie -le 3 août 1947 ([35] [683]) - du Bond de la plupart des anciens du GIC : sauf Théo Maassen qui jugeait la scission injustifiée, ils pensaient que leurs divergences étaient trop importantes pour rester dans le Communistenbond. En fait ce dernier avait décidé de créer - artificiellement une"Fédération internationale de noyaux d'entreprise" (IFBK) à l'image des "Betriebsorganisationen" du KAPD. Mais la cause profonde de la scission était la poursuite d'une activité militante et organisée dans les luttes ouvrières. Les anciens du GIC é-taient accusés par les miltants du Bond de vouloir transformer l'organisation en un"club d'études théoriques" et de nier les luttes ouvrières immédiates :
" Le point de vue de ces anciens camarades (du GIC-NDR), c'était que - tout en poursuivant la propagande pour 'la production dans les mains des organisations d'usine', 'tout le pouvoir aux conseils ouvriers' et pour une production communiste sur la base d'un calcul des prix en fonction du temps de travail moyen'- le Spartacusbond n'avait pas à intervenir dans la lutte des ouvriers telle qu'elle se présente aujourd’hui. La propagande du Spartacusbond doit être pure dans ses principes et, si les masses ne sont pas intéressées aujourd'hui, cela changera quand les mouvements de masses redeviendront révolutionnaires". ([36] [684])
Par une ironie de l'histoire, les anciens du GIC reprenaient les mêmes arguments que la tendance de Gorter -dite d'Essen - dans les années 20, alors que précisément le GIC s'était constitué en 1927 contre elle. Parce qu'il défendait l'intervention active dans les luttes économiques - position de la tendance de Berlin du KAPD - il avait pu échapper au rapide processus de désagrégation des partisans de Gorter. Ceux-ci avaient soit disparu politiquement soit évolué - comme organisation - vers des positions trotskystes et socialistes de gauche "antifascistes" pour finalement participer à la résistance néerlandaise : Frits Kief, Bram Korper, et Barend Luteraan - chefs de la tendance "gortérienne"- suivirent cette trajectoire ([37] [685]).
Constitués à l'automne 1947 en "Groep van Raden communisten" (Groupe de communistes des conseils), Canne Meijer, B.A. Sijes et leurs partisans eurent quelque temps une activité politique. Ils voulaient malgré tout, maintenir les contacts internationaux en particulier avec "Internationalisme". En vue d'une conférence - qui n'eut jamais lieu - ils éditèrent un "Bulletin d'information et de discussion internationales" en novembre 1947, qui n'eut qu'un seul numéro. ([38] [686]) Après avoir édité deux numéros de "Radencommunisme", en 1948, le groupe disparut. Canne Meijer versa dans le plus grand pessimisme sur la nature révolutionnaire du prolétariat et commença à douter de la valeur théorique du marxisme. ([39] [687]) B.A. Sijes se consacra entièrement à son travail d'historien de la "Grève de février 1941" pour finalement adhérer à un "Comité international de recherche des criminels de guerre nazis" qui le mena à témoigner au procès contre Eichmann, à Jérusalem. ([40] [688]) Bruun van Albada, qui n'avait pas suivi les anciens du GIC dans la scission, cessait bientôt de militer en 1948, alors qu'il était nommé directeur de l'observatoire astronomique de Ban-doeng, en Indonésie. Inorganisé, il ne tarda pas à exprimer qu'il n'avait"plus aucune confiance dans la classe ouvrière" ([41] [689]).
Ainsi, en dehors de toute activité militante organisée, la plupart des militants du GIC finissaient par rejeter tout engagement marxiste révolutionnaire. Seul Théo Maasen, demeuré dans le Bond, maintint cet engagement.
Que la scission fut injustifiée - de l'avis de Théo Maasen - c'est ce que devait montrer l'évolution du Bond dès la fin de 1947, lors de sa conférence de Noël. Cette conférence marquait une étape décisive dans l'histoire du Communistenbond "Spartacus". La conception de l'organisation du GIC triomphait complètement et marquait un abandon des positions de 1945 sur le Parti. C'était le début d'une évolution vers un conseillisme achevé, qui allait mener finalement à la quasi-disparition du Spartacusbond aux Pays-Bas.
L'affirmation d'une participation du Bond à toutes les luttes économiques du prolétariat l'amenait à une dissolution de l'organisation dans la lutte. Le Bond n'était plus une partie critique du prolétariat mais un organisme au service des luttes ouvrières : "Le Bond et les membres du Bond veulent servir la classe ouvrière en lutte". ([42] [690]) La théorie ouvriériste triomphait, et les communistes du Bond étaient confondus avec la masse des ouvriers en lutte. La distinction faite par Marx entre communistes et prolétaires, distinction reprise par les "Thèses sur le parti" de 1945, disparaissait :
"Le Bond doit être une organisation d'ouvriers qui pensent par eux-mêmes, font de la propagande par eux-mêmes, font grève par eux-mêmes, s'organisent par eux-mêmes, et s'administrent par eux-mêmes."
Cependant cette évolution vers l'ouvriérisme n'était pas totale et le Bond n'avait pas encore peur de s'affirmer comme une organisation à la fonction indispensable dans la classe : "Le Bond fournit une contribution indispensable à la lutte. Il est une organisation de communistes devenus conscients
que l'histoire de toute société jusqu'à maintenant est l'histoire de la lutte de classe, basée sur le développement des forces productives". Sans utiliser le terme de parti, le Bond se prononçait pour un regroupement des forces révolutionnaires au niveau international : "Le Bond estime... souhaitable que l'avant-garde ayant la mène orientation dans le monde entier se regroupe dans une organisation internationale".
Les mesures organisatives prises à la conférence étaient en opposition avec ce principe de regroupement, qui ne pouvait se réaliser que si le centralisme politique et organisationnel du Bond était maintenu. Or, le Bond cessait d'être une organisation centralisée avec des statuts et des organes éxécutifs. Il devenait une fédération de groupes de travail, d'étude et de propagande. Les sections locales (ou "noyaux") étaient autonomes, sans autre lien qu'un "groupe de travail" spécialisé dans les rapports inter-groupes locaux, et le Bulletin interne "Uit eigen Kring" (Dans notre cercle). Il y avait autant de groupes de travail autonomes qu'il y avait de fonctions à remplir : rédaction ; correspondance ; administration ; maison d'édition "De Vlam" du Bond ; contacts internationaux ; "activités économiques" liées à la fondation de l'Internationale des noyaux d'entreprise (IFBK) .
Ce retour au principe fédéraliste du GIC amenait en retour une évolution politique de plus en plus "conseilliste" sur le terrain théorique. Le "conseillisme" a deux caractéristiques : la caractérisation de la période historique depuis 1914 comme une ère de "révolutions bourgeoises" dans les pays sous-développés ; le rejet de toute organisation politique révolutionnaire. Cette évolution fut particulièrement rapide dans les années 50. L'affirmation d'une continuité théorique avec le GIC - marquée par la réédition en 1950 des "Principes fondamentaux de la production et de la répartition communiste" ([43] [691]) - signifiait la rupture avec les principes originels du Bond de 1945.
Dans les années 1950, le Bond fit un grand effort théorique en publiant la revue "Daad en Gedachte" {Pote et pensée), dont la responsabilité rédactionnelle incombait avant tout à Cajo Brendel, entré dans l'organisation depuis 1952. Avec Théo Maasen, il contribuait grandement à la publication des brochures : sur l'insurrection des ouvriers est-allemands en 1953, sur les grèves du personnel communal d'Amsterdam en 1955, sur les grèves de Belgique en 1961. A côté de brochures d'actualité, le Bond publiait des essais théoriques qui montraient une influence croissante des théories de "Socialisme ou Barbarie". ([44] [692])
Cette influence de ce dernier groupe - avec lequel des contacts politiques avaient été pris dès 1953 et dont les textes étaient publiés dans "Daad en Gedachte" - n'était pas l'effet d'un hasard. Le Bond avait été le précurseur inconscient de la théorie de Castoriadis sur le "capitalisme moderne" et l'opposition "dominant s /dominés". Mais autant le Bond restait fidèle au marxisme en réaffirmant l'opposition entre prolétariat et bourgeoisie, autant il faisait des concessions théoriques à S.O.B." en définissant la "bureaucratie" russe comme une "nouvelle classe". Mais pour le Bond, cette classe était "nouvelle" surtout par ses origines ; elle prenait la forme d'une "bureaucratie" qui "(faisait) partie de la bourgeoisie" ([45] [693]). Néanmoins, en l'assimilant à une couche de "managers", non propriétaire collectif des moyens de production, le Bond faisait sienne la théorie de Burnham, qu'il avait rejetée à la conférence de 1947. Derechef, le Bond avait été en 1945 le précurseur inconscient de cette théorie, qu'il n'avait jusqu'alors jamais pleinement développée. Le maître devenait le propre "élève" de son disciple : "Socialisme ou Barbarie". Comme ce dernier, il glissait progressivement sur une pente qui devait le mener à sa dislocation.
Cette dislocation a deux causes profondes : -le rejet de toute expérience prolétarienne du passé, en particulier l'expérience russe ; - l'abandon par la tendance du GIC - au sein du Bond- de toute idée d'organisation politique.
Le rejet de l'expérience russe
Après avoir essayé de comprendre les causes de la dégénérescence de la Révolution russe, le Bond cessait de la considérer comme une révolution prolétarienne pour n'y voir - comme le GIC - qu'une révolution "bourgeoise". Dans une lettre à Castoriadis-Chaulieu du 8 novembre 1953 - qui fut publiée par le Bond -([46] [694]) Pannekoek considérait que cette "dernière révolution bourgeoise" avait été "l'oeuvre de la classe ouvrière" russe. Ainsi était niée la nature prolétarienne de la révolution (conseils ouvriers, prise de pouvoir en octobre 1917). Ne voulant pas voir le processus de la contre-révolution en Russie (soumission des conseils à l'Etat, Kronstadt) Pannekoek et le Bond aboutissaient à 1'idée que les ouvriers russes avaient lutté pour la révolution "bourgeoise" et donc pour leur auto exploitation. Si octobre 17 n'était rien pour le mouvement révolutionnaire, il était logique que Pannekoek affirmât que "la révolution prolétarienne appartient au futur". De ce fait, toute l'histoire du mouvement ouvrier cessait d'apparaître comme une source d'expériences du prolétariat et le point de départ de toute réflexion théorique. L'ensemble du mouvement ouvrier, dès le I9ème siècle devenait"bourgeois" et ne se situait que sur le terrain de la "révolution bourgeoise".
Cette évolution théorique s'accompagnait d'un immédiatisme de plus en plus grand vis-à-vis de toutes les grèves ouvrières. Le Bond considérait que sa tache était de se faire l'écho de toutes les grèves. La lutte de classe devenait un éternel présent, sans passé car il n'y avait plus d'histoire du mouvement ouvrier, et sans futur car le Bond se refusait d'apparaître comme un facteur actif pouvant influencer positivement la maturation de la conscience ouvrière.
L'autodissolution de l'organisation Lors de la discussion avec "Socialisme ou Barbarie", le Bond n'avait pas renoncé au concept d'organisation et de parti. Comme l'écrivait Théo Maasen, "l'avant-garde est une partie de la classe militante, se composant des ouvriers les plus militants de toutes les directions politiques". L'organisation était conçue comme l'ensemble des groupes du milieu révolutionnaire. Cette définition floue de l'avant-garde qui dissolvait le Bond dans l'ensemble des groupes était néanmoins un dernier sursaut de vie des principes originels de 1945.Bien que le Parti lui apparut comme dangereux, car ayant "une vie propre" et se développant "selon ses propres lois", le Bond en reconnaissait encore le rôle nécessaire ; il devait "être une force de la classe". ([47] [695])
Mais "cette force de la classe" devait disparaître dans la lutte des ouvriers pour ne pas rompre "leur unité". Ce qui revenait à dire que le parti - et l'organisation du Bond en particulier - était un organisme invertébré, qui devait se "dissoudre dans la lutte".
Cette conception était la conséquence de la vision ouvriériste et immédiatiste du conseillisme hollandais. Le prolétariat lui apparaissait dans son ensemble comme la seule avant-garde politique, "l'instituteur" des militants "conseillistes", qui de ce fait se définissaient comme une "arrière-garde". L'identification entre communiste conscient et ouvrier combatif amenait une identification avec la conscience immédiate des ouvriers. Le militant ouvrier d'une organisation politique ne devait plus élever le niveau de conscience des ouvriers en lutte mais se nier en se mettant au niveau d'une conscience immédiate et encore confuse dans la masse des ouvriers :
"Il en découle que le socialiste ou communiste de notre époque devrait se conformer et s'identifier à l'ouvrier en lutte" ([48] [696]).
Cette conception était particulièrement défendue par Théo Maasen, Cajo Brendel et Jaap Meulenkamp. Elle menait à la scission de décembre 1964 dans le Bond. La tendance qui défendait jusqu'au bout la conception anti-organisation du GIC devenait une revue : "Daad en Gedachte". Cette dislocation ([49] [697]) du Bond avait été en fait préparée par l'abandon de tout ce qui pouvait symboliser l'existence d'une organisation politique. A la fin des années 50, le Cbmmunistenbond Spartacus était devenu le "Spartacusbond". Le rejet du terme "communiste" signifiait un abandon d'une continuité politique avec l'ancien mouvement "communiste des conseils". L'atmosphère de plus en plus familiale du Bond, où avait été banni le mot "camarade" pour celui d'"ami", n'était plus celle d'un corps politique rassemblant les individus sur la base d'une acceptation commune d'une même vision et d'une même discipline collectives.
Désormais, il y avait deux 'organisations'"conseillistes" en Hollande. L'une - le Spartacusbond- après avoir connu un certain souffle de vie après mai 1968 et s'être ouvert à la confrontation internationale avec d'autres groupes finissait par disparaître à la fin des années 1970. S'ouvrant à des éléments plus jeunes et impatients, plongés dans la lutte des "kraakers (squatters) d'Amsterdam, elle se dissolvait dans un populisme gauchiste, pour finalement cesser de publier la revue "Spartacus".([50] [698])
"Daad en Gedachte", par contre, subsiste sous la forme d'une revue mensuelle. Dominée par la personnalité de Cajo Brendel, après la mort de Théo Maassen, la revue est le point de convergence d'éléments anarchisants. La tendance"Daad en Gedachte" a été jusqu'au bout de la logique "conseilliste" en rejetant le mouvement ouvrier du XIX° siècle comme "bourgeois" et en se coupant de toute tradition révolutionnaire, en particulier celle du KAPD, tradition qui lui apparaît comme marquée trop par "1'esprit de parti".
Mais surtout "Daad en Gedachte" s'est progressivement détaché de la tradition véritable du GIC, sur le plan théorique. Elle est avant tout un Bulletin d'information sur les grèves, alors que les revues du GIC étaient de véritables revues théoriques et politiques.
Cette rupture avec la véritable tradition du communisme des conseils l'ont amené progressivement sur le terrain du tiers-mondisme, propre aux groupes gauchistes :
"... Les luttes des peuples coloniaux ont apporté quelque chose au mouvement révolutionnaire. Le fait que des populations paysannes mal armées aient pu faire face aux forces énormes de l'impérialisme moderne a ébranlé le mythe de l'invincibilité du pouvoir militaire, technologique et scientifique de l'Occident. Leur lutte a aussi révélé à des millions de gens la brutalité et le racisme du capitalisme et a conduit beaucoup de gens - surtout parmi les jeunes et les étudiants - à entrer en lutte contre leurs propres régimes." ([51] [699])
Il est frappant de remarquer ici que, comme pour la PV° Internationale trotskyste et le bordiguisme, les luttes qui ont jailli du prolétariat industriel d'Europe sont comprises comme un produit des "luttes de libération nationale". Elles apparaissent comme un sous-produit des révoltes étudiantes, voire sont niées en tant que telles.
Une telle évolution n'est pas surprenante. En reprenant la théorie de "Socialisme ou Barbarie" d'une société traversée non par les antagonismes de classes mais par les révoltes des "dominés" contre les "dominants", le courant "conseilliste" ne peut concevoir l'histoire que comme une suite de révoltes de catégories sociales et de classes d'âge. L'histoire cesse d'être celle de la lutte de classe.
La théorie marxiste du communisme des conseils des années 30 puis du communistenbond des années 40 cède le terrain à la conception anarchiste. ([52] [700])
Aujourd'hui aux Pays-Bas, le communisme des conseils a disparu en tant que courant véritable. Il a laissé subsister des tendances "conseillistes" très faibles numériquement - comme "Daad en Gedachte" - qui se sont rattachées progressivement au courant libertaire anti-parti.
Au niveau international, après la deuxième guerre mondiale, le courant "communiste des conseils" ne s'est maintenu qu'au travers de personnalités comme Mattick, qui sont restées fidèles au marxisme révolutionnaire. Si des groupes - se revendiquant du "Rate-Kommunismus" - ont surgi dans d'autres pays, comme en Allemagne et en France, ce fut des bases bien différentes de celles du "Communistenbond Spartacus",
Chardin
[1] [701] Sur Toon van den Berg (1904-1977), cf. article du Spartacusbond : "Spartacus", n°2, février-mars 1978.
[2] [702] "Uit eigen kring", n°2, mars 1946 : "Nota van de politike commissie" (Notes de la Commission politique)
[3] [703] Cf. UEK n°2 mars 1946, Idem
[4] [704] En même temps que surgissait la question du centralisme se créait un clivage entre éléments "académistes" et militants qui souhaitaient plus de propagande. Ces derniers comme Johan van Dïnkel, dénonçaient le risque pour le Bond de devenir "un club d'études théoriques" Cf. UEK, n°2, mars 1946, "Waar staat de Communistenbond ? Théoretisch studieclub of wordende Party" (Où va le Communistenbond ? Club d'étude théorique ou parti en devenir ?) .
[5] [705] Cf. Circulaire du 17 août 1946 contenant le procès-verbal de la réunion de la commission politique nationale le 14 juillet. Interventions de Stan Poppe, Bertus Nansink, Van Albada, Jan Vastenhouw et Théo MajBsen sur l'état de l'organisation.
(42) "Maandlad Spartacus", n°12, décembre 1945 : "Het russische impérialisme en de revolutionaire arbei-ders".(L'impérialisme russe et les ouvriers révolutionnaires)
[6] [706] Maandlad Spartacus", n°12, décembre 1945 : "Het russische impérialisme en de revolutionaire arbeiders".(L'impérialisme russe et les ouvriers révolutionnaires)
[7] [707] Le groupe "Socialisme ou Barbarie", scission du trotskysme, publia son premier numéro en 1949 Son élément moteur était C. Castoriadis (Chaulieu ou cardan). Ce sont surtout les sous-produits de "Socialisme ou Barbarie : ICO et "Liaisons" d'Henri Simon qui pousseront jusqu'au bout la théorie "dominants/dominos , dirigeants /diriges .
[8] [708] Conférence du Bond des 27 et 28 octobre 1945, Cf UEK n°6, décembre 1945.
[9] [709] Rapport d'un membre de la Commission politique sur la question indonésienne, in UEK, n°6décembre 1945.
[10] [710] "Maandlad Spartacus", n°9 septembre 1945 : "Nederland- Indonésie".
[11] [711] Décision de la Commission politique, le 14 juillet 1946. Cf. Circulaire du 27 août avec le procès-verbal de la réunion de l'organe central.
[12] [712] "Spartacus" (Weekblad) n°23, 7 juin 1947 : "Het wezen der revolutionaire bedrijfsorganisatie" (ia nature de l'organisation révolutionnaire d'entreprise).
[13] [713] En 1951, quelques membres du Bond pensaient que l'OVB n'était rien d'autre qu'un "vieux syndicat", dans lequel ils n'avaient rien à faire. C'était le point de vue de Spartacus en 1978 qui définit l'OVB comme "une petite centrale syndicale", Cf. article "Toon van den Berg (n°2, février-mars) . Le débat sur la nature de l'OVB se trouve dans "Uit eigen kring", n°17, 22 juillet 1951.
[14] [714] "De nieuwe wereld", avril 1947, traduit dans un français maladroit pour la conférence de 1947 et publié en brochure :"Le monde nouveau".
[15] [715] "Les conseils ouvriers" chapitre "l'Action directe".
[16] [716] "Les conseils ouvriers", chapitre "Pensée et action".
[17] [717] Cf."La Gauche communiste d'Italie", chapitre 4.
[18] [718] "Les conseils ouvriers", chapitre 3 :"L'occupation d'usine".
[19] [719] Cf. "Le nouveau monde", 1947, p. 12. Chez le Bond, comme chez Pannekoek, il y a une tendance à considérer les comités de grève comme des organismes permanents, qui subsistent après la lutte. D'où chez Pannekoek l'appel à former - après la grève - de petits syndicats indépendants, "formes intermédiaires., regroupant, après une grande grève, le noyau des meilleurs militants en un syndicat unique. Partout où une grève éclaterait spontanément, ce syndicat serait présent avec ses organisateurs et ses propagandistes expérimentés". ("Les conseils ouvriers", p.157.)
[20] [720] "Les conseils ouvriers", chapitre "La révolution des travailleurs".
[21] [721] Pannekoek n'avait de contacts qu'individuels avec les anciens membres du GIC : Canne Meijer, B.A. Sijes .
[22] [722] "Maandblad Spartacus", n°8, août 1945 : "Het zieke Kapitalisme" (Le capitalisme malade).
[23] [723] "Les conseils ouvriers", p. 419. Cette affirmation d'un effondrement du capitalisme était en contradiction avec l'autre thèse des "Conseils ouvriers" que le capitalisme connaissait avec la décolonisation un nouvel essor : "Une fois qu'il aura fait entrer dans son domaine les centaines de millions de personnes qui s'entassent dans les terres fertiles de Chine et d'Inde, le travail essentiel du capitalisme sera accompli." p.194). Cette dernière idée n'est pas sans rappeler les thèses de Bordiga sur le capitalisme juvénile".
[24] [724] "Maandblad Spartacus", n°8 août 1945, op. cit.
[25] [725] "Spartacus" (Weekblad) n°22, 31 mai 1947 :"Nog twe jaren" (Encore deux ans)
[26] [726] Le Bond avait demandé à Canne Meijer d'assurer la sortie d'une revue espérantiste : "Klasbatalo". Il y eut encore une tentative en 1951 d'éditer "Spartacus" en espéranto. Cette fixation sur cette langue, pratiquée par des intellectuels, explique le peu d'efforts que fit le Bond d'éditer ses textes en anglais, allemand et français.
[27] [727] La préface de 1950 aux "Grondbeginselen der communistische productie en distributie" parle d'une "situation certainement non révolutionnaire" ; elle n'utilise pas le concept de contre-révolution pour définir la période. Cette préface présente un double intérêt : a) examiner la tendance mondiale au capitalisme d'Etat et ses différences : en Russie l'Etat dirige l'économie ; aux USA les monopoles s'emparent de l'Etat ; b) affirmer la nécessité de la lutte économique immédiate comme base de "nouvelles expériences" portant les germes d'une"nouvelle période".
[28] [728] Le Statut provisoire du*Vereniging van Raden-socialisten" a été publié en avril 1947 dans "Uit ei-gen kring" n°5
[29] [729] La traduction et les commentaires du noyau de Leiden sur le "Projet de programme de la Fraction belge" se trouvent dans le bulletin-circulaire du 27 août 1946.
[30] [730] "Uit eigen kring", bulletin de la Conférence de Noël, décembre 1947.
[31] [731] Cité par "Spartakus", n°1, octobre 1947 :"Die internationale Versammlung in Brussel, Pfingsten 1947". "Spartakus" était l'organe des RKD liés au groupe français "Le Prolétaire" (Communistes-Révolutionnaires).
[32] [732] Comptes-rendus de la conférence dans le numéro de "Spartakus", déjà cité, et dans "Internationalisme n°23, 15 juin 1947 : "Lettre de la GCF au Communistenbond 'Spartacus'" ; "Une conférence internationale des groupements révolutionnaires"; "Rectificatif" dans le n°24, 15 juillet 1947.
[33] [733] Compte -rendu d'un voyage de contact avec les groupes français RKD et "Internationalisme" en août 1946. Cf. "Uit eigen kring", n°4, avril 1947.
[34] [734] Citations du compte-rendu du congrès, "Internationalisme", n° 23.
[35] [735] Lettre-circulaire du 10 août 1947 : "De splijting in de Communistenbond 'Spartacus' op zontag 3 augus-tus 1947". Citée par Frits Kool, in "Die Linke gegen die Parteiherrschaft", p. 626.
[36] [736] "Uit eigen kring" numéro spécial, décembre 1947 : "De plaats van Spartacus in de klassenstrijd" (La place de Spartacus dans la lutte de classe).
[37] [737] Frits Kief, après avoir été secrétaire du KAPN de 1930 à 1932, avait fondé avec les Korper le groupe "De Arbeidersraad", qui évolua progressivement vers des positions trotskysantes et antifascistes. Pendant la guerre, Frits Kief participa à la Résistance hollandaise, devint après la guerre membre du "Parti du travail", pour finir par se faire le chantre du "socialisme yougoslave". Bram Korper et son neveu retournèrent au PC. Quant à Barend Luteraan (1878-1970) qui - plus que Gorter déjà malade - avait été le fondateur_du KAPN, il suivit le même itinéraire que_Fris Kief.
[38] [738] La préparation technique de cette conférence (bulletins) devait être prise en charge par le "Groep van Raden-Communisten". Dans une lettre écrite en octobre 1947, "Internationalisme" précisait qu'une future1 conférence ne pouvait se faire sur une"simple base affective" et devait rejeter le dilletantisme dans la discussion.
[39] [739] Sur l'évolution de Canne Meijer, cf, son texte des années 50 : "Le socialisme perdu", publié dans la "Revue internationale" du Courant communiste international, n°37, 1984.
[40] [740] B.A. Sijes (1908-1981) cependant, contribua dans les années 60 et 70 au mouvement communiste des conseils en rédigeant des préfaces à la réédition des oeuvres de Pannekoek. L'édition des "Mémoires" de ce dernier fut son dernier travail.
[41] [741] B. van Albada (1912-1972) , bien que cessant de militer traduisit en hollandais - avec sa femme-"Lénine philosophe" de Pannekoek.
[42] [742] Cette citation et les suivantes sont extraites de "Uit eigen kring", numéro spécial, décembre 1947 : "Spartacus:Eigen werk, organisatie en propaganda".
[43] [743] Les "Principes" ont été écrits en prison, dans les années 20, par Jan Appel. Ils ont été revus, remaniés par Canne Msijer. Jan Appel écrivit - selon le Spartacusbond dans sa préface de 1972 - avec Sijes et Canne Meijer en 1946 l'étude : "De economische grondslagen van de radenmaatqchappij" (Les fondements économiques de la société des conseils) . Or il ne semble pas que Jan Appel devînt en 1945 membre du Bond. Il était en désaccord avec les ex-membres du GIC et avec le Bond qui refusaient de faire un travail révolutionnaire en direction de l'armée allemande. D'autres raisons (tensions personnelles) l'ont tenu à l'écart d'un travail politique militant qu'il aurait souhaité réaliser.
[44] [744] Les brochures citées et la revue "Daad en Gedachte" sont disponibles à l'adresse suivante : Schouw 48-11, Lelystad (Pays-Bas)
[45] [745] Brochure écrite par Théo Maasen en 1961 : Van Beria tôt Zjoekof - Sociaal-economische achter grond van destalinisatie". Traduction en français :"L'arrière-fond de la déstalinisation", in "Cahiers du communisme des conseils", n°5, mars 1970.
[46] [746] Cf. "une correspondance entre A.Pannekoek et P. Chaulieu", avec une introduction de Cajo Brendel, in "Cahiers du communisme des conseils" n°8, mai 1971.
[47] [747] Citations d'une lettre de Théo Maasen à "Socialisme ou Barbarie", publiée dans le n°18, janvier-mars 1956, sous le titre : "Encore sur la question du parti".
[48] [748] Citations de la brochure "Van Beria tôt Zjoekof", déjà mentionnée.
[49] [749] Meulenkamp quitta le Bond en septembre 1964. Cajo' Brendel et Théo Maassen, avec deux de leurs ca-rades, furent exclus en décembre. La scission ne se fit pas en "douceur" : le Bond récupéra les machines et les brochures qui lui appartenaient, bien que ces dernières aient été écrites par Brendel et Maassen. Cf. témoignage de Jaap Meulenkamp, qui parle de "méthodes staliniennes" :"Brief van Jaap aan Radencommunisme", in Initiatief tôt een bijeenkomst van revolutionaire groepen", bulletin du 20 janvier 1981. Par la suite "Daad en Gedachte", malgré les invitations du Bond, refusa de s'asseoir "à la même table" lors de conférences et de rencontres, comme celle de janvier 1981.
[50] [750] Cf. articles du Courant communiste international, dans la "REVUE INTERNATIONALE" :n°2, 1975 : "Les épigones du conseillisme à l'oeuvre 1) "Spartacusbond" hanté par les fantômes bolcheviks, 2) Le conseillisme au secours du tiers-mondisme" ; n°9, 1977 : "Rupture avec Spartacusbond","Spartacusbond : seul au monde ?"; n°16 et 17, 1979 :"La gauche hollandaise".
[51] [751] Cajo Brendel : Thèses sur la révolution chinoise", in "Liaisons" n° 27, Liège (Belgique), février 1975. La citation est extraite de l'introduction à la traduction anglaise, éditée en 1971 par le groupe "Solidarity" d'Aberdeen.
[52] [752] Un résumé des conceptions anarchisantes de "Daad en Gedachte" se trouve dans le Bulletin du 20 janvier 1981 en vue d'une conférence de divers groupes, à laquelle participèrent le CCI et plusieurs individus qui ne représentaient qu'eux-mêmes : Kanttekeningen van 'Daad en Gedachte'" (Notes margina les de 'Daad en Gedachte1). "Daad en Gedachte" participa à la conférence, non comme groupe mais à titre individuel.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Correspondance internationale : conscience et stratégie de la bourgeoisie
- 2679 reads
Dans la Revue Internationale n°34 nous avons publié un texte d'un camarade de Hong Kong, LLM, sur la question de la gauche dans l'opposition, constituant un effort sérieux - hors de notre Courant - pour comprendre les bases des manoeuvres politiques actuelles de la classe dominante, puisque, à la différence des "critiques empiristes" qui n'ont fait que tourner notre analyse en dérision, le texte de LLM, dans la mesure où il va au fond de la question, perçoit l'organisation et la conscience de la bourgeoisie. Le texte soutenait que notre méthode d'analyse était valable, même s'il ne partageait pas toutes les conclusions que nous en avons tirées.
Diverses réactions au sein du milieu révolutionnaire ont poussé LLM à écrire une "élaboration" du texte originel. Dans 1'article ci-dessous, nous répondons aux argumentations développées dans ce second texte que nous ne publions pas et qui, loin d'être une élaboration ou un développement du texte précédent, ne fait qu'exprimer la déroute affolée de LLM retournant dans le camp des empiristes - ce qui montre que, sur cette question comme sur toutes les autres, il n'y a pas de place pour un arbitre impartial distribuant 1es bons et les mauvais points aux diverses parties du mouvement révolutionnaire. La régression dans la pensée de LLM est évidente, tant dans la forme que dans le contenu du texte : dans la forme, de par son attitude condescendante, son argumentation zigzagante et son fréquent recours à des ouï-dire ; mais surtout dans le contenu, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un abandon de tous les aperçus que le camarade avait pu avoir auparavant sur le machiavélisme de la bourgeoisie.
Le texte adopte, par la même occasion, une théorie erronée du cours parallèle vers la guerre et vers la révolution, et de fait, ne se distinguant pas des idées couramment répandues par d ' autres groupes tels que Battaglia Comunista et la Communist Workers' Organisation.
Dans la Revue Internationale n°34, dans son argumentation contre les empiristes qui nient la capacité de la bourgeoisie à s'unifier contre le prolétariat, LLM pouvait écrire :
"Je suis sûr que personne ne niera que les différents Etats sont capables de conspirer pour atteindre des buts communs. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, la conspiration entre les USA et la Grande-Bretagne dans la guerre des Falkland, la conspiration entre les USA et Israël lors de la dernière invasion du Liban, etc... sont claires comme la lumière du jour. Ou, si nous remontons un peu dans 1'histoire, les leçons de la Commune de Paris et de la révolution russe ne sont-elles pas suffisantes pour enfoncer à fond la leçon que, menacée par le prolétariat, la bourgeoisie est capable de mettre de côté ses antagonismes, même les plus forts, pour s'unir contre lui, comme l'a montré correctement le CCI ? Pourquo , alors, lorsqu'il se produit une conspiration entre la droite et la gauche de la bourgeoisie à 1'intérieur des frontières nationales, cela devient-il inimaginable ? Est-ce que Noske assassina le prolétariat allemand inconsciemment ou consciemment ?".
Aujourd'hui, à la suite d'un voyage en Europe - évidence empirique, s'il en fut jamais - LLM a décidé que le CCI avait bien, après tout, une théorie idéaliste conspirative de l'histoire. C'est maintenant à son tour de trouver "inimaginable" que le mouvement pacifiste soit organisé par la bourgeoisie, que le conflit au Salvador ait été exacerbé pour alimenter les mystifications anti prolétariennes à d'autres endroits, de même que les sandinistes soient venus au pouvoir au Nicaragua avec l'approbation de l'impérialisme US ([1] [753]). Dans ce texte, la bourgeoisie de LLM est identique à celle des empiristes.
Par exemple, lorsque le CCI affirme que les campagnes pacifistes font partie de la stratégie de la bourgeoisie pour dévoyer la lutte de classe, LLM chante le vieux refrain de tous ceux qui ne peuvent simplement comprendre ce que signifie le fait de dire que la bourgeoisie agit en tant que classe : "Qui est-elle? La bourgeoisie comme un tout ? Dans ce cas, la bourgeoisie dans son ensemble est marxiste", etc.. Il est certain qu' "elle" est effectivement incompréhensible du point de vue de l'empirisme bourgeois qui, désorienté par l'apparente désunion du monde, a toujours châtié le marxisme pour sa vision conspirative de la vie sociale, tout simplement parce qu'il parle des classes et de leur activité consciente.
Il est vrai que LLM affirme reconnaître qu' "il ne fait aucun doute que la bourgeoisie soit consciente de ses propres besoins" ; mais quand il en vient à l'épreuve consistant à appliquer son observation générale à la réalité concrète telles que les campagnes actuelles, LLM réduit cette conscience à la réaction complètement déterminée, "instinctive" d'une classe incapable d'élaborer quelque stratégie que ce soit :
"Quant aux soi-disant campagnes que la bourgeoisie est supposée mener consciemment contre le prolétariat, il est nécessaire d'ajouter seulement...que le nationalisme (un des fondements principaux de ces 'campagnes ') est 'naturel' pour la bourgeoisie. la bourgeoisie sait 'instinctivement' que le nationalisme fait partie de ses intérêts et elle le stimule à tout moment (match international de football, lancement d'un vaisseau spatial...). Même si on ne tient pas compte du problème de la 'conscience' de la bourgeoisie, on n'a pas besoin de cela pour savoir que la stimulation du nationalisme l'aide à démobiliser le prolétariat ; elle en connaît le revers ' instinctivement ' "
Et parce que le CCI rejette cette vision de la bourgeoisie et toutes les conclusions qui en découlent, on nous dit que "le CCI voit la bourgeoisie comme une classe consciente de ses propres besoins au point d'atteindre une compréhension matérialiste marxiste de l'histoire..."
LA COMPREHENSION BOURGEOISE DE L'HISTOIRE.
Bien entendu, la bourgeoisie ne possède pas une "compréhension matérialiste marxiste de l'histoire". Mais il existe effectivement une vision matérialiste bourgeoise de l'histoire, et il y a une bien grande coupure historique entre cette vision et le niveau de conscience réellement instinctif que les êtres humains ont dépassé quand ils sont sortis du reste du monde animal. Comme l'expliquait Marx dans sa petite parabole à propos de l'abeille et l'architecte, la capacité de réfléchir avant, de planifier à l'avance (et par conséquent, la conscience d'un mouvement temporel, historique entre le passé et le futur) constitue la distinction fondamentale entre l'activité animale et l'activité humaine.
Mais tandis que cette conscience "historique" est caractéristique de l'activité humaine, antérieurement à la société capitaliste, l'homme restait au sein de l'économie naturelle, qui engendrait des visions statiques ou circulaires du mouvement historique. Ces visions cycliques étaient également, par définition, des projections mythico-religieuses. En brisant les limites des économies naturelles, la bourgeoisie a également sapé ces conceptions traditionnelles, et s'est constituée en une classe à l'esprit le plus historique et le plus scientifique de toutes les classes dominantes précédentes.
Certes, toutes ces avancées prennent place aux confins de l'aliénation, et donc de l'idéologie. En fait, la vision du monde "rationnelle", "scientifique" de la bourgeoisie coïncide avec le véritable sommet de l'aliénation (question jamais comprise par ces "marxistes" qui voient le marxisme et la conscience communiste comme une simple continuation ou un simple raffinement du rationalisme et de la science bourgeoise). Sous le règne de l'aliénation, l'activité consciente de l'homme est implacablement subordonnée aux forces qui sont à peine comprises ou contrôlées ; la conscience, bien qu'étant par essence un produit collectif et social, est éparpillée en d'innombrables fragments par la division du travail, surtout dans les conditions d'extrême atomisation qui caractérisent une société dominée par des rapports marchands.
Mais, de même que Rosa Luxemburg a démontré que le capital global est une réalité qui existe malgré et même comme résultat des capitaux individuels antagoniques, le marxisme affirme qu'il existe, malgré toutes ses divisions internes, une bourgeoisie "globale" qui a une conscience "globale", une classe réelle qui s'engage dans une activité vitale- consciente. Le fait que celle-ci reste une activité fragmentée, aliénée, hiérarchique, dominée par des mobiles inconscients, ne l'empêche pas de fonctionner comme facteur actif dans la vie sociale, comme force déterminante et non pas simplement déterminée.
Cela signifie que la bourgeoisie est capable d'élaborer par dessus tout, des stratégies pour la défense de ses intérêts les plus essentiels, même si 1'ensemble de la bourgeoisie ne peut jamais participer à ces plans, et même si chaque bourgeois ne peut embrasser la stratégie comme un tout.
"Stratégie" signifie planification à l'avance, avoir une sérieuse capacité à évaluer les forces en présence et à prévoir les potentialités futures. Dans une grande mesure, et particulièrement à l'époque de la décadence, la bourgeoisie a compris (encore une fois, de son propre point de vue mystifié - bien que nous puissions supposer de façon empirique que la bourgeoisie en dit toujours moins qu'elle n'en sait) que la défense de ses besoins les plus fondamentaux ne peut être confiée à quelque "fraction" du capital ; c'est pourquoi elle a développé d'énormes structures étatiques, et à l'échelle du bloc, pour s'assurer de l'accomplissement de cette tâche quels que soient les caprices de telle ou telle fraction ou parti.
Si nous considérons l'ensemble de la guerre des Falklands, que LLM citait auparavant comme un bon exemple de la capacité de la bourgeoisie à conspirer, nous pouvons avoir quelque idée de la manière dont cette division du travail s'effectue. Il ne fait aucun doute que les différents protagonistes sont entrés dans ce conflit avec différents objectifs immédiats. Galtieri, par exemple, était certainement "aspiré" par les gesticulations des USA et de la Grande-Bretagne. D'autre part, il est évident qu'il existe un fond de vérité dans l'argument des gauchistes suivant lequel la guerre des Falkland était la "guerre à l'image de Maggie", reflétant les ambitions politiques "sectorielles" de Thatcher et du parti Tory. Mais la fonction du gauchisme consiste précisément à se fixer sur ces aspects secondaires de l'activité de la bourgeoisie et donc de détourner l'attention du véritable pouvoir dans ce système social - l'Etat capitaliste, et au-dessus de celui-ci, le bloc impérialiste. En dernière analyse, les Thatcher, Reagan ou Galtieri ne sont que des figures de proue,des acteurs destinés à jouer un rôle particulier à un moment particulier. Les véritables stratégies de la bourgeoisie sont le produit des organismes d'Etat et de bloc qui représentent la véritable "communauté" du capital ; et elles sont élaborées suivant une évaluation des besoins de l'ensemble du système. Ainsi, la guerre des Falkland, malgré toutes les motivations les plus opportunistes et particulières, qui ont participé à son déclenchement, ne peut être véritablement comprise que dans le contexte des plans de guerre du bloc impérialiste occidental dans son ensemble.
Quoi que puissent penser certains révolutionnaires, la classe dominante, en élaborant ces plans, mobilise certainement ses techniques et ses découvertes les plus sophistiquées ; il est vraiment "inimaginable" que la classe dominante puisse élaborer ces plans sans prendre en compte la question la plus brûlante de notre époque - la question sociale, la nécessité de préparer la population, et surtout la classe ouvrière, à accepter la marche à la guerre. Le conflit des Falkland n'était pas simplement un match de football de plus, mais faisait partie d'une stratégie à long terme visant à liquider toute véritable résistance à la marche du capital vers un nouveau bain de sang impérialiste généralisé.
DE FAUST A MEPHISTOPHELES.
LLM nous accuse également de faire de plus en plus usage de notre analyse "machiavélique", de la prendre comme point de départ pour analyser chaque action de la classe dominante. Nous ne faisons ici aucune apologie parce que nous ne faisons que reconnaître une réalité historique - celle qui, puisque nous nous dirigeons vers la plus importante confrontation de classe de l'histoire, nous fait attester que la bourgeoisie devient plus unifiée, plus intelligente qu'à n'importe quel autre moment dans le passé.
Certes, cette intelligence de la bourgeoisie constitue une dégénérescence totale de ses grandes visions historiques, des philosophies optimistes qu'elle a élaborées dans les jours héroïques de sa jeunesse. Si, à l'époque de Goethe, Beethoven et Hegel, la bourgeoisie pouvait être personnifiée par Faust, point culminant dans les fiévreux efforts ascendants de l'humanité; dans la décadence, le côté obscur de la bourgeoisie est entré en possession de son bien - et le côté obscur de Faust c'est Méphistophélès, dont l'intelligence et le savoir immenses sont une mince couverture au-dessus d'un puits de désespoir. Le caractère méphistophélien de la conscience bourgeoise à cette époque est déterminé par les nécessités fondamentales de la période : c'est l'époque où la possibilité et la nécessité sont enfin réunies pour réaliser l'émancipation de l'humanité de la division historique de la société en classes antagoniques, de l'exploitation de l'homme par l'homme; et néanmoins, toute la science de la bourgeoisie, toute sa technologie, tous les vestiges de sa propre sagesse sont dirigés vers la préservation et la conservation du même système de l'exploitation et de l'oppression de l'homme au prix des pires monstruosités. De là le cynisme fondamental et le nihilisme de la bourgeoisie à cette époque. Mais précisément parce que c'est la période de l'histoire qui exige "de l'homme une conscience de soi positive", la maîtrise consciente de l'activité productive et des forces productives, la bourgeoisie, elle, est uniquement capable de survivre en son sein en gérant son système anarchique comme s'il était sous le contrôle conscient de l'homme. Ainsi, le capitalisme, dans la décadence, avec sa planification centralisée, son organisation internationale, et bien sûr son idéologie "socialiste" que l'on trouve partout, tend à se présenter lui-même comme une caricature grotesque du communisme. La bourgeoisie ne peut plus tolérer le libre jeu des "forces du marché" (c'est-à-dire de la loi de la valeur) ni au sein des Etats nationaux, ni entre Etats nationaux : elle a été contrainte de s'organiser et de se centraliser d'abord à l'échelle nationale, ensuite à l'échelle des blocs impérialistes uniquement pour prévenir la tendance accélérée du capital vers l'effondrement économique. Mais cette organisation nationale et internationale de la bourgeoisie atteint son point culminant lorsque la bourgeoisie se sent menacée par le réveil prolétarien - un fait qui, comme le remarque LLM lui-même, a été démontré par la réponse à tous les plus grands soulèvements prolétariens de l'histoire (cf. 1871, 1918). Comparée à ces mouvements, la grève de masse en Pologne 1980 n'était qu'un événement précurseur des événements à venir; néanmoins, la réponse unifiée de la bourgeoisie, basée sur des structures mises en place depuis des décennies, a fonctionné, d'un certain point de vue, à une échelle bien plus grande que toute collaboration antérieure entre les puissances impérialistes. Cela suppose que, dans les luttes révolutionnaires à venir, nous nous trouverons face à un ennemi qui manifestera un degré d'unité sans précédent. Nous nous dirigeons, en somme, vers la concrétisation finale du scénario envisagé par Marx et Engels dans le Manifeste Communiste : "La société dans son ensemble est de plus en plus divisée en deux grands camps ennemis, en deux grandes classes s'affrontant directement : bourgeoisie et prolétariat."
En termes plus immédiats, cela veut dire qu'aujourd'hui, alors que se préparent déjà ces immenses confrontations, nous pouvons discerner une tendance de la bourgeoisie à agir de façon de plus en plus concertée, à tenter de réduire autant que possible les effets regrettables des aspects les plus imprévisibles du système. Ainsi, par exemple, si on compare la manière dont les récentes élections en Grande-Bretagne et en RFA ont été organisées par la bourgeoisie ([2] [754]), la part du hasard a été beaucoup plus réduite qu'il y a une ou deux décennies. Nous pouvons également comparer la manière dont les campagnes pacifistes sont maintenant coordonnées dans tout le bloc occidental (et imitées dans le bloc de l'Est) avec la manière dispersée avec laquelle elles ont été menées dans les années 50 et 60. Même si ces stratégies sont souvent pleines de contradictions, même si elles ne représentent pas encore le point culminant de la conscience et de l'unité bourgeoises, elles expriment une tendance déterminée vers la création d'un unique "parti de l'ordre" pour affronter le danger prolétarien.
Nous le répétons, pour les"durs d'oreilles": cela ne signifie en rien que la bourgeoisie puisse avoir une compréhension marxiste de l'histoire ; elle ne peut surtout pas saisir le postulat marxiste suivant lequel son système peut être remplacé à travers l'action révolutionnaire de la classe ouvrière. Mais, comme nous l'expliquions il y a quelques années en réponse à certains arguments typiques des gauchistes contre notre vision de la complémentarité entre fascisme et anti-fascisme, la bourgeoisie est capable de voir que le prolétariat constitue la principale menace pour la simple préservation de son système :
"S'il est vrai qu'ils ne peuvent croire en la possibilité d'une nouvelle société édifiée par les ouvriers, ils comprennent cependant que, afin d'assurer le fonctionnement de la société, il doit y avoir de 1 'ordre, les ouvriers doivent aller travailler régulièrement, en acceptant leur misère sans broncher, en respectant humblement leurs patrons et leur Etat. L'exploiteur le plus crétin le sait parfaitement, même s'il ne sait ni lire ni écrire.
Lorsque tous ces illettrés de l'histoire commencent a sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur règne, lorsqu'ils sont contraints de fermer les usines, d 'augmenter les prix et de baisser les salaires, lorsque les germes de la révolte commencent à pousser dans les usines.... 1'histoire a mille fois montré que, après une période plus ou moins longue d'affolement, la bourgeoisie finit toujours par mettre sa confiance en une solution politique qui permet le rétablissement de 1'ordre.
Sous la pression de ses intérêts de classe, des événements en général, de façon empirique, pragmatique, telle est la manière dont la bourgeoisie en arrive finalement à accepter des solutions qu'elle avait jusqu'ici considérées comme "subversives" ou "communistes"."
("L'anti-fascisme : une arme du capital", in World Révolution n°5 et Révolution Internationale n"14).
Non, la bourgeoisie ne pourrait jamais devenir marxiste, mais au 20ème siècle, surtout depuis 1917, la bourgeoisie a appris à se draper du manteau du marxisme afin de dénaturer et de dévier les buts véritables de la lutte de classe. Dans la période particulière que nous traversons, le modèle "socialiste" de la bourgeoisie, dans les pays avancés d'occident, est contraint de prendre la forme de la gauche dans l'opposition ; demain, face à la révolution elle-même, elle pourrait bien représenter une nouvelle version, plus extrême, de la gauche au pouvoir. En aucun cas la bourgeoisie ne pourra devenir marxiste, mais elle peut et pourra imaginer des poisons idéologiques suffisamment puissants pour paralyser le mouvement vers la révolution prolétarienne ; c'est ce qui constitue; pour nous le problème essentiel. Aucune faiblesse ne pourrait être plus fatale pour la révolution que le manque de lucidité du prolétariat et de ses minorités politiques en ce qui concerne l'ensemble de toutes les armes dont dispose notre ennemi de classe.
SUR LE COURS HISTORIQUE.
A partir de ce qui vient d’être dit, nous sommes évidemment d'accord avec LLM lorsqu'il signale le lien entre notre vision des stratégies de la bourgeoisie et la question du cours historique. L'argument selon lequel la bourgeoisie tend à unifier ses forces est fondé sur l'idée suivant laquelle la classe dominante s'y trouve contrainte par un mouvement inexorable vers des confrontations de classe majeures.
Mais la régression de LLM dans sa compréhension du mode de vie de la bourgeoisie s'accompagne d'une autre régression celle du cours "parallèle", théorie de Battaglia Comunista et de la CWO, théorie adoptée également maintenant par le Communist Bulletin Group qui prétend même que telle était leur vision dès le début. L'influence du CBG sur la pensée de LLM apparaît sur de nombreuses questions, notamment celle de l'organisation -cf. son texte dans le No 5 de The Communist Bulletin. Dans un numéro antérieur de cette Revue, nous avons consacré un article à la vision de Battaglia sur cette question et nous n'avons pas l'intention ici de nous étendre sur ce point. Nous nous limiterons donc à répondre uniquement à l'une des assertions de LLM, celle qui affirme que le CCI "suspend l'histoire" lorsqu'il prétend que le prolétariat constitue un obstacle à la marche vers la guerre de la bourgeoisie.
Sur ce point, il n'y a personne d'autre que LLM qui "suspend l'histoire". Ainsi, il signale les grèves combatives en Russie avant la guerre de 14 et dit : "Vous voyez, ces grèves n'ont pas arrêté la guerre ; aussi, comment pouvez-vous prétendre qu'aujourd'hui la combativité est un obstacle à la guerre ?". Cette méthode fige l'histoire à 1914 et prend à son compte le fait que la bourgeoisie -limitée, après tout, par l'idéologie, n'est ce pas ?- n'a tiré aucune leçon de son expérience où elle est entrée dans une guerre mondiale avec un prolétariat dont la combativité n'avait pas été complètement écrasée. En fait, l'horrible exemple de 1917 a donné à la bourgeoisie une leçon qu'elle n'oubliera jamais. C'est pourquoi elle consacre toute la période des années 30 à s'assurer que la dernière goutte de la résistance prolétarienne a été effectivement asséchée et c'est précisément ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui à nouveau.
On doit également dire que l'exemple des grèves en Russie, prises hors du contexte, ne prouve rien quant à 1914. Il nous est nécessaire de rappeler ici la citation d'Internationalisme 1945 que nous avons mentionnée dans notre article sur Battaglia:
"Ainsi la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la 2ème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et fourré par 1'opportunisme régnant en maître, devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de la guerre."(Rapport à la conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France).
Et si l'exemple de la Russie 1913 ne tient aucun compte du véritable rapport de forces entre les classes de l'époque, la "preuve" avancée par LLM affirmant que les ouvriers du monde sont prêts à aller à la guerre parce que les ouvriers en Grande-Bretagne ont eu tendance à manifester leur "indifférence" devant le spectacle des Falkland, montre que LLM est lui-même privé de toute méthode sérieuse pour appréhender ces questions.
Il est plutôt amusant de voir le CCI accusé de suspendre l'histoire par quelqu'un qui ne prend pas en considération la force motrice réelle de l'évolution historique -la lutte de classes. Pour LLM le lien entre la crise et la guerre (de même que le lien entre la crise et la conscience de la bourgeoisie de celle-ci) est entièrement mécanique et automatique : "si la dynamique profonde du capital (l'accumulation) requiert la guerre, la guerre éclatera... quelle que soit la situation de la lutte de classe". Donc, les contradictions inhérentes au capital sont réduites à leur aspect le plus réifié -les lois économiques objectives de l'accumulation- tandis que la contradiction entre le capital et le travail, la principale contradiction sociale, est évoquée hors de l'existence. Au lieu d'un combat dynamique entre deux forces sociales, on nous donne un tableau complètement statique : soit le prolétariat fait la révolution, soit il "reste sous l'emprise de l'idéologie dominante" et est "déjà défait idéologiquement" (Battaglia défend la même idée quand il nous dit que nous vivons sous le "joug de la contre-révolution jusqu'au surgissement de la révolution). C'est comme si les deux classes se dressaient telles des statues, l'une face à l'autre, dans leur position de combat, au lieu d'engager une lutte qui monte et descend, qui avance et recule, et sans laquelle le renforcement de l'agression d'un côté exige une réaction correspondante de l'autre. Une véritable suspension du mouvement de l'histoire...
Il est une chose que LLM pouvait reconnaître : c'est le fait que la vision de Battaglia et de la CWO du cours historique est conditionnée par leur incapacité à voir le prolétariat comme une force sociale même quand il n'a pas encore fait surgir le parti mondial. Un tel aveuglement peut conduire les libertaires et conseillistes d'aujourd'hui (voir l'article essentiellement anti-centraliste de LLM dans le Communist Bulletin) à commencer à caresser l'idée que tout est une question de "direction" et que le surgissement du parti est le seul facteur actif dans la situation. Mais pour nous, la possibilité réelle de reconstitution du parti est fondée sur le fait que nous allons vers des affrontements de classe massifs au coeur du système. Ces affrontements, non seulement clarifieront la question du cours historique, mais nous permettront également de faire un gigantesque pas en avant dans notre compréhension du problème de la conscience -non seulement celle de la bourgeoisie, mais plus encore, celle du prolétariat et de la société humaine qui émergera de la révolution. Un saut qualitatif dans la lutte de classe exigera un saut correspondant sur le plan théorique ; mais en cherchant refuge dans les abris des empiristes et des sceptiques du mouvement révolutionnaire, le camarade LLM laisse passer la possibilité de faire une contribution réelle sur cette question fondamental .
CDW
[1] [755] LLM recourt ici à une subtile déformation des mots, laissant supposer que, pour le CCI, les campagnes pacifistes, et même le conflit au Salvador, ont été créés ex nihilo, tels quels, par une bourgeoisie omnipotente. Il laisse même supposer dans une note (que nous n'avons pas mentionnée, faute de place) que cette vision était implicitement contenue dans notre résolution sur la situation internationale au Sème Congrès du CCI, malgré la concurrence interne. Que dit, en réalité, la résolution ? Le texte parle des "grandes campagnes pacifistes qui touchent - avec un certain succès - la plupart des pays occidentaux" et qui "s'appuient sur une réelle inquiétude suscitée par les préparatifs guerriers". En d'autres termes, les campagnes pacifistes existent parce que la bourgeoisie a besoin de récupérer cette inquiétude et de 1'utiliser à des fins anti-ouvrières ; il ne s'agit pas d'une création ex nihilo mais d'un subtil travail de transformation de la combativité. Mais LLM prétend-t-il que ces campagnes ne sont pas organisées par la bourgeoisie ? Peut-être a-t-il momentanément oublié que la gauche, le CND (Campagne pour le Désarmement Nucléaire), etc. font partie de la bourgeoisie ?
Nous aurions pu faire une remarque semblable à propos du Salvador : de tels conflits dans des régions sous-développées ont évidemment leurs bases objectives. La question pour nous est de savoir quel usage la bourgeoisie mondiale fait de ces conflits qui peut inclure, bien sûr, leur exacerbation pour des raisons de propagande et de mystification. Enfin, en ce qui concerne 1'approbation des USA à la prise de pouvoir des sandinistes, voir WR n°27 "Les sandinistes, agents de1'impérialismeUS".
[2] [756] L'organisation des dernières élections en RFA pour mettre en place l'orientation classique droite au pouvoir / gauche dans l'opposition était si évidente que la CWO, qui se situe habituellement sur la ligne de front de la critique empirique, pouvait écrire un article dans Workers'Voice n° 11 prenant clairement comme point de départ l'idée suivant laquelle le gouvernement a été mis en place non pas par la libre décision du "peuple allemand", mais par 1'ensemble du bloc occidental.
Questions théoriques:
- Décadence [2]
- Le cours historique [3]
Revue Int. 1985 - 40 à 43
- 3525 reads
Revue Internationale no 40 - 1e trimestre 1985
- 2906 reads
Accélération de l'histoire : aggravation de la crise, extension des luttes de classe.
- 3303 reads
VERS LA RECESSION DE L'ECONOMIE MONDIALE
L'année 1985 va connaître une nouvelle accélération de la crise économique mondiale. Après la réélection de Reagan à la présidence des Etats-Unis à l'automne 1984, l'ampleur de la crise, qui était cachée par la "reprise américaine", réapparaît dans toute sa brutalité. La dissipation des effets des mesures employées pour cette "relance", qui n'ont eu d'impact que sur quelques indicateurs de l'économie capitaliste, essentiellement aux Etats-Unis, confirme les caractéristiques de la récession inéluctable des années 80, années que nous avons appelées, dès janvier 1980, les "années de vérité". "Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que la récession dans laquelle s'enfonce actuellement le capitalisme, sera la plus large, la plus longue et la plus profonde depuis la guerre ? Trois types de facteurs :
1) L'ampleur de la dégradation que connaît l'économie mondiale ;
2) L'inefficacité croissante des moyens dont se sert le capital pour relancer la croissance économique ;
3) L'impossibilité grandissante pour les Etats de continuer à recourir aux moyens de relance." ([1] [757])
LA FIN DE LA "REPRISE AMERICAINE"
Et en effet, la récession de 1980-82 a été la plus large, la plus longue et la plus profonde depuis la 2ème guerre mondiale, et la reprise de l'économie américaine de 1983-84, la moins efficace depuis l'ouverture de la crise mondiale, à la fin des années 60.
Aujourd'hui, les prévisions, qui étaient optimistes, sont révisées à la baisse : "Le département du commerce vient de faire connaître le chiffre relatif à la croissance du PIB au 3ème trimestre : 1,9 % contre les 2,7 % annoncés précédemment. C'est le taux le plus faible depuis le 4ème tri mestre 1982, date qui avait marqué la fin de la récession." (Libération, 22 nov. 84). La menace d'effondrement du système bancaire international, avec la faillite de la Continental Illinois (10ème banque américaine) et de 43 autres au cours des six premiers mois de 1984, a montré que, plus encore que par le passé, les artifices monétaires (endettement, fixation arbitraire du cours du dollar) n'ont aucune contrepartie dans le domaine de la production. Les "experts" remarquaient d'ail leurs dès le début, 1'"originalité" de cette "reprise" : l'absence de croissance significative des investissements productifs. Comme nous l'avions prévu : "Le mécanisme actuel de la 'reprise' aux Etats-Unis annonce un avenir catastrophique pour l'économie mondiale." ([2] [758]). Contrairement à la propagande de Reagan, le ralentissement de l'inflation n'a pas été le fruit des mesures "monétaristes", mais la conséquence de la récession, de l'engorgement du marché mondial. Ce dernier pousse chaque entreprise à baisser les prix sous peine d'élimination par la concurrence. Et aujourd'hui, à nouveau, la bombe à retardement de l'endettement énorme du monde capitaliste (dettes du Tiers-Monde et des pays industrialisés, déficits budgétaires) amène le retour du spectre de l'inflation, inflation qui est restée la règle dans les pays plus périphériques (1000 % en Israël par exemple). Aujourd'hui, la dette publique s'élève à 1500 mil liards de dollars aux Etats-Unis, 42 % du PNB, contre 25 % en 1979. 40 % des dollars ne sont que du papier, ce qui est pudiquement avoué par les "experts" comme une "surévaluation du dollar de 40 %". Le déficit budgétaire de l'Etat américain dépasse les 200 milliards de dollars
Le capitalisme essaie de tricher avec la loi de la valeur ; il ne fait que reporter chaque fois, à un niveau supérieur et plus explosif, les contradictions du système.
LA PAUPERISATION ABSOLUE DE LA CLASSE OUVRIERE
Un des éléments de la "reprise" économique a été l'attaque massive contre les salaires, justifiée au nom de la "sauvegarde de l'entreprise", "le maintien de l'emploi", la "solidarité nationale". En fait, freinage et blocage des salaires, limitations et suppressions du "salaire social" (santé, retraites, éducation, logement, allocations-chômage, etc.), ont accéléré brutalement, sans que le chômage ne diminue de manière significative, sauf aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans des pays comme la Belgique et la Hollande où l'attaque contre les salaires dans le secteur public a provoqué les premières grandes grèves de la remontée des luttes ouvrières à l'automne 1983, le taux de chômage s'est maintenu à plus de 15 %. Dans un pays comme la France, des chômeurs de plus en plus nombreux comme les jeunes ou les chômeurs "de longue durée", disparaissent purement et simplement des statistiques. Aux Etats-Unis, le chômage a diminué momentanément, mais la classe ouvrière a subi une des plus fortes baisses des salaires de son histoire, jusqu'à plus de 15 % comme aux automobiles Chrysler par exemple.
Les prévisions de licenciements comptent en dizaines de milliers les ouvriers jetés à la rue avec de moins en moins de ressources, dans les mines, la sidérurgie, les travaux publics, les chantiers navals, l'automobile, etc., et ceci de plus en plus simultanément dans différents pays. Dans des régions entières, qui dépendent d'une industrie dominante, ce sont toutes les activités qui sont menacées : en Espagne, en France, en Grande-Bretagne. Les "avantages", primes, congés, allocations diverses, sont supprimés, rognés, soumis à des conditions d'obtention plus restrictives. Les "soupes populaires", disparues depuis la 2ème guerre mondiale, font leur réapparition, dans des pays "riches" comme la France. Ce n'est pas seulement une paupérisation relative, c'est une paupérisation absolue qui s'abat sur la classe ouvrière dans tous les domaines de ses conditions de vie.
La "découverte" par la bourgeoisie, sa presse, ses organismes de "charité", du "quart-monde" ou des "nouveaux pauvres", dans les pays industrialisés, n'exprime pas des réticences morales ou humanitaires, mais l'inquiétude face aux réactions que risque de susciter l'aggravation de la misère. La paupérisation de la classe ouvrière et le chômage massif n'ont pas les mêmes conséquences que dans les pays sous-développés. En effet, les couches pauvres et marginalisées du Tiers-Monde constituent une masse énorme qui n'a pas été intégrée au rapport social capitaliste et au sein de laquelle le prolétariat n'est qu'une petite minorité. La conscience de la classe ne peut s'y développer en dehors de mouvements très puissants du prolétariat ; les mouvements sociaux y prennent la forme d'émeutes de la faim et de la misère, sans possibilité de dégager les buts et les moyens de lutte contre le capitalisme. Dans les pays développés, c'est directement le prolétariat qui est touché. C'est 10, 15, 20 % des ouvriers qui forment le prolétariat constitué, qui sont éjectés de tout moyen de subsistance. Ce sont les familles qui comptent un, puis deux, puis trois chômeurs. C'est le prolétariat comme un tout qui subit l'attaque.
Le chômage massif constitue, avec le développement de la combativité et de la conscience de la classe, un élément décisif de dépassement du cadre sectoriel et corporatiste, favorisant l'extension, la capacité du prolétariat à assumer le caractère social et non catégoriel de son combat. La réelle inquiétude de la bourgeoisie sur les "nouveaux pauvres", c'est le développement de la lutte de classe, et elle utilise ce thème pour renforcer une idéologie des "privilèges" et faire passer les appels à 1'"effort" et les taxes de "solidarité nationale".
Contre la montée du mécontentement ouvrier et les luttes, la bourgeoisie va poursuivre sa politique : austérité, multiplication des campagnes idéologiques de diversion, utilisation de plus en plus systématique de la répression ; et surtout, renforcement de ses fractions de gauche dans les rangs ouvriers, dans leur rôle d'"opposition", pour tenter de contenir et de dévoyer la colère que suscitent les mesures de crise.
L'INTENSIFICATION DES TENSIONS IMPERIALISTES
La seule "issue" que le capitalisme peut donner à sa crise, c'est la fuite en avant vers une tentative de repartage violent du marché mondial, dans la guerre entre les blocs impérialistes. C'est ce que traduit l'effort permanent d'armement auquel se livrent tous les pays, alors que les dépenses militaires constituent pourtant un facteur accélérateur de la crise ([3] [759]). C'est ce que manifeste la tension constante et accrue de l'affrontement Est-Ouest, en particulier dans les zones du monde qui servent de "théâtres d'opérations" : Moyen-Orient, Extrême-Orient. L'offensive américaine contre le bloc russe va se poursuivre. Le battage belliciste de l'administration Reagan, n'a été atténué que pour des raisons intérieures aux Etats-Unis : ne pas faire peur pour assurer la réélection des Républicains. Les manoeuvres diplomatico-militaires visent à dépouiller le bloc russe de tous les restes de son influence en dehors de son "glacis". Elles passent par une reprise en mains de l'Iran et des mises au pas au sein du bloc occidental.
Ces manoeuvres sont réapparues au premier plan de la "tension internationale" dès la fin 1984 : pression sur la France pour régler la situation Tchad-Lybie et voyage de Mitterrand en Syrie ; nouvelle orientation de "paix" d'Arafat, marquant la soumission accrue de l'OLP aux visées occidentales; assassinat d'I. Gandhi, qui est tombé à pic pour ancrer plus fermement l'Inde dans le bloc de l'Ouest.
Nous ne développons pas cette question dans le cadre de cet article. Tant que la bourgeoisie garde l'initiative historique, les tensions inter impérialistes vont s'exacerber. Si la guerre mondiale ne peut pas se généraliser, c'est pour une seule raison : la bourgeoisie n'est toujours pas parvenue à déboussoler la classe ouvrière, au point de la plier aux impératifs de défense de l'économie nationale dans chaque pays, à la discipline et à l'embrigadement idéologique qu'exige la menée de la guerre généralisée, qui si elle s'étendait, signerait la destruction de l'humanité.
L'ACCELERATION DE LA LUTTE DE CLASSE
Les perspectives que nous avions tracées dès le début des années 80 restent valables : la classe ouvrière a ouvert une période de l'histoire qui va mener à des affrontements, des luttes de classes décisives pour l'avenir de l'humanité. Ou le prolétariat est capable internationalement "de paralyser le bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer, démoraliser par ses discours et sa répression, et alors, la voie est ouverte à un nouvel holocauste qui risque d'anéantir la société humaine." ([4] [760]). Depuis 1980, la bourgeoisie a infligé une défaite partielle à la vague de luttes du prolétariat mondial de 1978-81. Elle a annihilé la résistance ouvrière en Europe occidentale par le passage de la gauche capitaliste dans l'opposition, dans la plupart des pays hautement industrialisés. Cette défaite a été sanctionnée par l'isolement du prolétariat en Pologne et l'instauration de l'"Etat de guerre" en décembre 1981. Après cette défaite, la question posée était donc celle de la capacité du prolétariat mondial de poursuivre, dans les pays industrialisés occidentaux, ce que la classe ouvrière n'avait pas pu atteindre en Pologne -."Les ouvriers polonais ne pouvaient que poser objectivement le problème de la généralisation internationale. Seul, le prolétariat des autres pays industrialisés, en particulier en Europe occidentale, pourra y apporter une réponse pratique." ([5] [761]). C'est cette réponse qui a commencé a se manifester dans la situation présente, avec le regain depuis moins de deux ans, des luttes ouvrières dans les pays de l'Ouest, après un repli en 1982-83.
Depuis l'automne 1983, grèves et mouvements de la classe ouvrière se sont multipliés dans le monde entier : des Etats-Unis à l'Inde, du Pérou à l'Afrique du Sud. Nous ne rappellerons ici que les mouvements les plus significatifs contre les licenciements et l'attaque des salaires en Europe de l'Ouest : Belgique, Hollande, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Espagne. Les grèves ont touché des secteurs vitaux de l'industrie : respectivement, en ne citant également que les plus importants : en Belgique, le secteur public, les mines; en Hollande, le secteur public, les docks de Rotterdam (le plus grand port du monde) ; en Allemagne, les chantiers navals, l'imprimerie, la métallurgie ; en Grande-Bretagne, les mines, les docks, l'automobile ; en France, contre la gauche au gouvernement, l'automobile, la sidérurgie, les mines; et en Espagne, la sidérurgie, les chantiers navals. Ces grèves, auxquelles s'ajoutent une kyrielle de grèves et de manifestations, dans ces mêmes pays, dans d'autres pays et dans d'autres secteurs industriels, se poursuivent et vont s'accélérer ([6] [762]). Elles constituent le début d'une troisième vague internationale de luttes ouvrières, après celles de 1968-75 et 1978-81. La période est ouverte au cours de laquelle va se poser la question de la capacité du prolétariat à passer de la résistance contre l'austérité, à la généralisation internationale de son combat contre le capitalisme.
La reprise des luttes a surgi d'une maturation de la conscience de la classe. Elle manifeste la perte des illusions sur la possibilité de sortir de la crise, et la prise de conscience de la nécessité d'engager la lutte ouverte contre les attaques du capitalisme : les luttes reprennent malgré le battage sur la "reprise économique" et les appels à la "solidarité pour l'économie nationale". Dans cette remontée des luttes se manifeste un dégagement lent et tâtonnant de l'emprise des manoeuvres de la gauche, et de ses appendices syndicalistes et gauchistes : après deux années de reflux jusqu'à des niveaux les plus bas, jamais atteints depuis des décennies parfois (Grande-Bretagne en 1982), ces manoeuvres ne suffisent plus à empêcher l'éclatement des grèves. Les fractions de gauche doivent encore plus directement tenter de contenir le mécontentement sur le terrain de la classe ouvrière. Cette orientation accentuée a été illustrée en particulier par le retour du PC dans l'opposition en France et les soins apportés à la réélection de Reagan. Tout a été mis en oeuvre pour éviter tout accident électoral aux Etats-Unis, d'une part pour assurer aux Etats-Unis mêmes la présence du Parti Démocrate, et donc des syndicats dans l'opposition, et d'autre part et surtout, parce qu'en tant que chef de file du bloc, la politique américaine doit impulser et donner l'exemple pour tous les pays, et donc en particulier dans l'orientation des manoeuvres sur le terrain social, contre la classe ouvrière.
LA SIMULTANEITE INTERNATIONALE DES LUTTES OUVRIERES, PREMIER PAS DE LA GENERALISATION
La simultanéité grandissante des grèves constitue un premier pas montrant l'étendue de la riposte internationale du prolétariat. C'est une situation de simultanéité d'ores et déjà la plus importante qu'à tout autre moment de l'histoire du mouvement ouvrier, même si on la compare aux années 1917-23 de la vague révolutionnaire. Elle contribue à mettre au grand jour l'unité profonde des nécessités et des besoins de la lutte de classe, malgré les efforts de black-out, les campagnes de diversion, le travestissement des événements sous des "particularités nationales" ("problème basque" en Espagne face aux mouvements des chantiers navals) ou "sectorielles" ("problème des mines"1 en Grande-Bretagne). Elle est un creuset où, au cours d'une même période, avec de moins en moins de décalage dans le temps, des dizaines de milliers d'ouvriers font des expériences analogues, se confrontent à des obstacles similaires, accélérant les possibilités de dégager des lignes d'action générales pour toute la classe ouvrière.
La force de la classe ouvrière réside dès à présent dans le fait, qu'en multipliant les grèves, elle fait obstacle à la planification et la concertation internationales de la bourgeoisie, dans des moments de lutte ouverte de plus en plus fréquents, imposant des reports et aménagements des mesures de licenciements, contre la "logique" des nécessités capitalistes. Dans la sidérurgie européenne, par exemple, ce sont dès 1982 plus de 100000 licenciements qui sont nécessaires à 1'"assainissement" de l'appareil productif ; si la bourgeoisie n'est pas encore parvenue pleinement à ses fins, c'est à cause du danger que représentent des mouvements prévisibles dans les unités rapprochées de la sidérurgie en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, des secteurs qui ont plusieurs fois montré leur "indiscipline". Et lors des grèves en Belgique, les ouvriers parlaient d'aller à Longwy en France.
La simultanéité des grèves ébauche la réponse politique internationale du prolétariat. Celui-ci, dans la période de décadence du capitalisme et en particulier avec la crise ouverte, se trouve face à " une unité et une solidarité bien plus grande qu'auparavant entre les capitalistes. Ceux-ci ont créé des organisations spécifiques afin de ne plus affronter individuellement la classe ouvrière"([7] [763]). Le déroulement de grèves et de mouvements de la classe ouvrière, d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, entrave les velléités de la bourgeoisie de la démobiliser et de la défaire paquet par paquet, usine après usine, secteur après secteur. La simultanéité des grèves ouvrières, au milieu de ces années 80 que nous avons appelées les "années de vérité", exprime une prise de conscience de la classe de ses intérêts et constitue un pas vers la capacité d'unfier son combat internationalement.
Cette "analyse est optimiste", "le CCI voit la révolution partout", "le CCI surestime la lutte de classe" disent beaucoup de groupes et organisations politiques. Le scepticisme règne encore dans le milieu révolutionnaire ([8] [764]). Ce scepticisme sur l'évaluation de la lutte de classe part du constat des faiblesses de la vague actuelle de luttes, et se base sur les faits suivants, pris ensemble ou séparément :
- les luttes ouvrières restent encadrées par les appareils politiques de gauche et les syndicats ;
- elles restent sur des revendications économiques sans se dégager significativement du corporatisme; il n'y a pas de "saut qualitatif" dans l'évolution des grèves ;
- la classe ouvrière n'a pas constitué ses propres organisations autonomes (comités de grève, comités de coordination, etc.) ;
- il n'y a pas de parti, d'organisation politique influençant et orientant le mouvement des luttes dans un sens révolutionnaire.
Si ces faiblesses sont toutes bien réelles, en rester à ce simple constat est pourtant faux. C'est prendre le début d'un mouvement pour son plein essor, c'est oublier le contexte international du développement de la lutte de classe, sa dimension historique qui requiert la prise de conscience de l'ensemble de la classe ouvrière et sa capacité à forger un véritable parti révolutionnaire mondial. Vouloir la révolution ou même la grève de masse tout de suite, c'est faire preuve d'une vision immédiatiste et étriquée, typique de l'impatience de la petite bourgeoisie "radicale", c'est dédaigner et s'interdire de reconnaître les véritables avancées et potentialités de la situation présente. "En prenant chaque lutte en soi, en 1'examinant de manière statique, photographique, on s'ôte toute possibilité d'appréhender la signification des luttes, et, en particulier, de la reprise actuelle de la lutte de classe." ([9] [765]). C'est ce qui se manifeste dans les critiques de notre "optimisme", notre "surestimation" des luttes, ou de 1'"abstraction" de notre intervention qui, dès à présent, défend l'extension de la lutte. C'était souvent un même scepticisme, mais à l'époque dans l'autre sens, qui régnait face aux positions du CCI sur le recul de la lutte de classe de 1982-83. Le CCI était alors taxé de "défaitisme", d'avoir une conception d'une bourgeoisie "toute-puissante", parce que nous défendions que le prolétariat avait été déboussolé par la capacité de la bourgeoisie de manoeuvrer internationalement contre la lutte de classe. C'est avec retard que les minorités révolutionnaires ont compris le recul, c'est avec retard qu'elles commencent timidement à reconnaître la vague actuelle de la lutte après plus d'un an de grèves dans toute l'Europe. Le prolétariat est sorti d'une période de déboussolement, mais les groupes révolutionnaires montrent une difficulté profonde à comprendre "ce qui se déroule sous nos yeux", où en est la lutte et où elle va.
Le prolétariat est aujourd'hui encore loin de la révolution ; il n'est pas encore passé à l'offensive qui suppose la généralisation internationale des luttes. Les grèves sont des luttes de défense contre les attaques du capitalisme. Mais, par les conditions historiques objectives et subjectives de notre époque, les caractéristiques des luttes actuelles marquent le début d'un processus qui aura une énorme portée historique.
"Dans les pays avancés d'Europe de l'Ouest, le prolétariat ne pourra déployer pleinement la grève de masse qu'à l'issue de toute une série de combats, d'explosions violentes, d’avancées et de reculs, au cours desquels il démasquera progressivement tous les mensonges de la gauche dans 1'opposition, du syndicalisme, et du syndicalisme de base." ([10] [766]). C'est dans cette "série de combats" qu'est engagée la classe ouvrière. En reprenant la lutte, elle étend et approfondit la conscience de l'unité des problèmes auxquels elle est confrontée et de la force qu'elle constitue dans la société. Quelle solidarité ? Comment lutter ? Quelles actions entreprendre et qu'opposer aux "actions" stériles des syndicats ? Que répondre aux discours sur la "défense de l'entreprise" ? Comment affronter la répression ? Toutes ces questions, posées en pratique dans toutes les luttes présentes, affaiblissent le carcan des "spécificités" qui cache l'unité, renforcent la conscience déjà présente que le capitalisme n'a rien à offrir que la misère et la mitraille, que seule la lutte peut entraver puis mettre fin à l'exploitation. C'est sa conscience communiste que la classe ouvrière se réapproprie et étend en poursuivant ses luttes.
Le pas que constitue la reprise ouvrière ne se situe pas dans la forme de chaque lutte, dans une grève "exemplaire" ici ou là, mais dans son contenu politique sous-jacent qui va au delà d'un constat événementiel de l'encadrement qui pèse sur la classe ouvrière. Ce contenu politique, c'est la simultanéité internationale des grèves qui en est l'expression actuelle la plus avancée.
Que le prolétariat parvienne à démystifier la "démocratie" de l'Ouest, et c'est tout un pan de la domination idéologique de la bourgeoisie qui s'écroulera pour toute la classe ouvrière mondiale. C'est cette voie dans laquelle sont engagées les luttes actuelles. Simultanément, la "démocratie" jette son masque et montre son vrai visage, aussi bien dans la "jeune" démocratie espagnole, où les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens dans la grève des chantiers navals, que dans la plus "vieille" démocratie, la Grande-Bretagne, où les ouvriers se battent avec la "police la plus démocratique du monde".
La reprise actuelle trace les contours, forge la pré condition indispensable, de la généralisation internationale des luttes ouvrières. Ce qui va de plus en plus être le catalyseur de la simultanéité vers une généralisation, est déjà contenu dans les luttes actuelles : la tendance à l'extension au delà des secteurs et des barrières catégorielles. Au cours de l'année 1984, c'est la situation de la lutte de classe en Grande-Bretagne qui a illustré le plus clairement cette tendance.
SOLIDARITE ET EXTENSION, UN EXEMPLE : LES GREVES EN GRANDE-BRETAGNE
C'est en Grande-Bretagne que la classe ouvrière est allée le plus loin depuis le mouvement de Pologne en 1980-81. Dans ses forces et dans ses faiblesses, ce mouvement y confirme plusieurs caractéristiques de la période actuelle.
La durée d'une grève, dans un secteur, comme l'a montré la grève des mineurs, n'est pas la force principale pour la lutte, dans des conditions de relatif isolement géographique (bassins miniers) et économique (le charbon est "un secteur en déclin). L'effort pour faire durer la grève, expression au départ de la détermination des mineurs, a été utilisé par l'encadrement syndical pour maintenir l'isolement et le corporatisme, entre autres par les aspects "administratifs" d'une telle grève (paiements et collectes), pour entretenir l'esprit de métier. La bourgeoisie a déployé une pression idéologique contre laquelle ce n'est pas la durée dans l'isolement qui peuvent résister, d'autant plus dans un secteur "sacrifié" : déclarations sur les "services rendus" par les mineurs pendant la 2ème guerre mondiale à la patrie ; image entretenue par le NUM, syndicat des mineurs, d'une sorte de bataillon "héroïque" et "jusqu'auboutisme", etc.
La force de la grève vient de la situation générale d'ébullition de la classe ouvrière dans beaucoup d'autres secteurs et internationalement, et des poussées vers la solidarité et l'extension dans cette situation générale.
La grève des mineurs a ouvert une voie en montrant la détermination à rejeter la logique économique capitaliste des "secteurs non rentables". Elle a contribué à faire tomber le mythe du "pacifisme" et du "fair-play" dans les conflits sociaux "à la britannique". Mais c'est surtout dans les tendances à l'extension que les événements en Grande-Bretagne sont un exemple pour toute la classe ouvrière. Ce sont plus les syndicats que les ouvriers qui ont poussé à la durée, pour écarter ce danger.
Dès le début de la grève des mineurs, la question de la solidarité s'est posée, vis-à-vis des sidérurgistes. Les syndicats ont insisté sur l’"erreur commise" par les mineurs lors de la grève des sidérurgistes en 1980, pour faire renonce à cette idée, 1'"erreur" étant qu'en 1980 les mineurs ne s'étaient pas solidarisés avec les sidérurgistes. Ils ont alors fixé l'attention uniquement sur l'extension dans le même secteur, comme condition première à toute extension, mettant tout en oeuvre pour qu'elle n'ait pas lieu avec l'aide des barrages de police entre grévistes et non grévistes, pour éviter les contacts directs.
La grève a été isolée. C'est le surgissement spontané des grèves des dockers, une première fois en juillet 84, une deuxième fois en septembre, montrant une solidarité explicite avec les mineurs, qui a reposé la question de l'extension. Que les dockers se joignent aux mineurs n'a pas été possible, mais la tendance s'est clairement exprimée et elle a ainsi commencé à briser l'idéologie de "la" grève des mineurs, en ouvrant un second front de résistance, ce qui a constitué un encouragement à la poursuite des luttes. La bourgeoisie a dénoncé la grève. Droite et gauche se sont partagé le travail, la droite dénonçant le caractère "politique" de la grève, la gauche s'en défendant de toutes ses forces pour maintenir les préoccupations des ouvriers sur le terrain corporatiste de l'économie capitaliste. C'est une illustration classique du rôle de la gauche dans l'opposition : la droite parle clair et dit la vérité, la gauche dit le contraire. Le prolétariat qui a des illusions sur le caractère "ouvrier" de la gauche se laisse prendre à ce jeu, et cela exprime une des faiblesses majeures actuelles : la difficulté pour le prolétariat à assumer le caractère politique de sa lutte, la compréhension que c'est l'Etat capitaliste tout entier qui doit être combattu. Tout comme dans les mines, le poids du corporatisme dans les docks, qui est également un vieux secteur, l'a emporté momentanément. La poussée de solidarité a été enrayée, malgré plus de difficultés pour la .bourgeoisie : après la deuxième grève, des mouvements se sont poursuivis dans le docks, à Londres, à Southampton, montrant que le découragement ne l'a pas emporté.
Les grèves dans l'industrie automobile, début novembre 1984, ont porté la situation à un niveau plus large pour le prolétariat et plus dangereux pour la bourgeoisie.
"Si les luttes dans le secteur automobile en Grande-Bretagne, simultanément avec les mineurs et d'autres luttes, n'ont pas soulevé, de manière explicite, la question de la solidarité au sein de la classe dans son ensemble, elles ont néanmoins représenté une accélération plus forte dans l'évolution de la lutte comme un tout, parce que :
- elles ont impliqué des ouvriers au coeur du capital national : un ouvrier sur dix en Grande-Bretagne est employé dans l'automobile ou des secteurs qui en dépendent ;
- elles ont impliqué des ouvriers qui se trouvent physiquement dans ou près des grandes villes, en contact régulier avec les ouvriers des autres secteurs, ni géographiquement ou physiquement isolés comme les mineurs ;
- elles ont eu à surmonter toute une gamme de manipulations pour lancer la lutte, et à faire face à toute la chaîne des mystifications syndicalistes de base, au contraire des mineurs qui, contrairement à la règle, ont fait face à l'appareil syndical dont la rhétorique la plus radicale est généralement venue du "sommet" ;
- elles ont du dépasser une multiplicité de divisions rigides (au moins dix syndicats encadrent les ouvriers à Austin-Rover par exemple), alors que les mineurs, en général, appartiennent tous à un même syndicat ;
- elles ont démontré une solidarité, non pas embrouillée par les mystifications syndicales (telles que les boycotts des transports, etc.), mais de la nécessité de lutter, de faire grève contre les attaques actuelles, pour tenter de renverser le rapport de forces avec la bourgeoisie ;
- elles ont démontré que la lutte pour maintenir le niveau de vie sur le plan des salaires et la lutte contre les licenciements (mineurs), sont une même lutte, face au même ennemi de classe, ses syndicats et sa police ;
- elles ont démontré, comme la lutte des mineurs l'a montré, les limites d'une lutte défensive au travers de l'échec à parvenir à leurs fins, posant ainsi la question d'un niveau plus haut, plus unifié de lutte.
Dans ce sens, les luttes dans l'industrie automobile, luttes explosives courtes, impliquant des secteurs-clés de la classe en grand nombre, contre l'appareil syndical expérimenté, simultanément avec des luttes dans d'autres industries et d'autres pays, sont typiques des luttes dans cette période de capitalisme décadent." (Communiqué de World Révolution, 30 nov.84).
Face à la grève dans l'automobile, la bourgeoisie a immédiatement cédé quelques miettes dans certaines usines (Jaguar par exemple) pour casser l'unité ; elle a redoublé de battage sur la "reprise du travail" dans les mines ; elle a renforcé la répression (plus de 2000 arrestations, plusieurs centaines de blessés, 3 morts, depuis le début de la grève des mineurs). Elle a monté une campagne avec l'attentat de l'IRA à Brighton où un ministre a été blessé, pour faire le parallèle entre la violence des ouvriers et le terrorisme manipulé, pour appeler à la défense de la "démocratie". Elle a multiplié les "révélations" sur les liens Khadafi-Scargill (leader du NUM) et sur les liens URSS-NUM, pour faire passer la classe ouvrière pour une masse "manipulée par l'étranger", etc.
Si les luttes ne convainquent pas certains "révolutionnaires", la bourgeoisie est convaincue du danger que représente pour elle la solidarité active des ouvriers qui se profile dans les tendances à l'extension et la simultanéité des luttes, et ceci internationalement, et même par delà les antagonismes entre les blocs : "La lutte des mineurs en Grande-Bretagne a gagné la sympathie et la solidarité des ouvriers du ronde entier. La bourgeoisie essaie de répondre en torpillant la conscience :
- en France, l'idée que les ouvriers doivent montrer la solidarité par le biais des collectes syndicales et l'envoi de denrées ;
- en Belgique, les tournées de bureaucrates syndicaux qui veulent réduire la solidarité à une attente passive des réunions syndicales, dont le point culminant est... les collectes ;
- en URSS, l'organisation par l'Etat de vacances payées pour les mineurs anglais, et qu'il utilise pour sa propagande." (Ibid.).
1984 ne restera pas dans l'histoire comme le cauchemar imaginé par le romancier britannique Orwell, qui voyait le monde soumis à un "Big Brother" tout puissant. Au contraire, le prolétariat en Europe, en Grande-Bretagne et en Espagne surtout à la fin 1984et dans les autres pays, a accéléré sa réponse, en se dégageant de l'emprise du totalitarisme démocratique, qui partout licencie et réprime, sous la pression de la crise qui ne fait que s'intensifier. Le "bras de fer" des mineurs avec la "dame de fer" laisse la place à un "bras de fer" beaucoup plus général de la classe ouvrière contre le capital. En Europe, c'est dans les grandes villes qui n'ont pas encore été au coeur des luttes, que va se poursuivre, s'étendre et s'approfondir le mouvement du prolétariat.
MG. 6/12/84.
[1] [767] Revue Internationale n.20, 1er trimestre 1975, "Années 80 : l'accélération de la crise".
[2] [768] Revue Internationale n.37, 2ème trimestre 1984, "Le mythe de la reprise économique".
[3] [769] Lire "Le poids des dépenses militaires", Revue Internationale n.36, 1er trimestre 1984.
[4] [770] Revue Internationale n.20, 1er trimestre 1980, "Années 80, années de vérité".
[5] [771] Revue Internationale n.33, 2ème trimestre 1983, "Vers la fin du repli de 1'après-Pologne".
[6] [772] Nous ne pouvons pas donner, dans le cadre de cet article, un compte-rendu détaillé des événements. Le lecteur peut se reporter aux articles parus dans les numéros 37, 38 et 39 de la Revue Internationale et également à la presse territoriale qui essaie, autant que possible, contre le black-out de la bourgeoisie, de rendre compte des luttes. Les lecteurs sont également invités à nous faire parvenir des informations sur les luttes.
[7] [773] Revue Internationale n.23, 4ème trim. 1980, "La lutte prolétarienne dans la décadence du capitalisme".
[8] [774] Nous ne parlons pas ici des groupes gauchistes et syndicalistes dont la problématique, quel que soit le langage "ouvrier" employé, vise à 1'encadrement du prolétariat et ne se situe pas dans le camp ouvrier.
[9] [775] Revue Internationale n.39, 4ème trim. 1984, "Quelle méthode pour comprendre la reprise des luttes ouvrières".
[10] [776] Revue Internationale n.35, 4ème trim.1983, "Résolution sur la situation internationale au 5ème Congrès du CCI".
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
- Luttes de classe [33]
Bilan et perspectives : 10 ans du CCI, quelques enseignements
- 3573 reads
Le Courant Communiste International a dix ans. C'est en effet en janvier 1975 que s'est constituée formellement notre organisation internationale. Cette expérience d'une décennie d' existence appartient à la classe ouvrière mondiale dont le CCI, comme toutes les organisations révolutionnaires, est une partie, un facteur actif en son sein dans sa lutte historique vers son émancipation. C'est en ce sens qu'à l'occasion du 10ième anniversaire de la fondation de notre organisation nous nous proposons de tirer, pour l'ensemble de notre classe, un certain nombre d'enseignements de notre expérience parmi ceux qui nous paraissent les plus importants et notamment ceux qui apportent des réponses à la question : comment construire une organisation révolutionnaire, comment préparer la constitution du parti communiste mondial de demain qui sera un instrument indispensable de la révolution prolétarienne ?
Mais avant que de pouvoir répondre à ces questions, il est nécessaire de faire un très court historique de notre organisation et notamment de la période qui précède sa constitution formelle dans la mesure où c'est au cours de cette période qu'ont été jetées les bases de ce qui allait être 1'ensemble de notre activité.
UNE COURTE HISTOIRE DE NOTRE COURANT.
La première expression organisée de notre courant a surgi au Venezuela en 1964. Elle consistait en un petit noyau d'éléments très jeunes qui ont commencé à évoluer vers des positions de classe à travers des discussions avec un camarade plus âgé ayant derrière lui toute une expérience militante au sein de l'Internationale Communiste, dans les fractions de gauche qui en avaient été exclues à la fin des années 20, et notamment dans la Fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie ([1] [777]), et qui avait fait partie de la "Gauche Communiste de France" jusqu'à sa dissolution en 1952. D'emblée donc, ce petit groupe du Venezuela - qui, entre 1964 et 1968, a publié une dizaine de numéros de la revue Internacionalismo - s'est situé en continuité politique avec les positions qui avaient été celles de la Gauche Communiste et notamment de la GCF. Cela s'est particulièrement exprimé par un rejet très net de toute politique de soutien aux prétendues "luttes de libération nationale" dont le mythe, dans ce pays d'Amérique latine, pesait très lourdement sur les éléments qui essayaient de s'approcher vers les positions de classe. Cela s'est exprimé également par une attitude d'ouverture et de contact vers les autres groupes communistes, attitude qui avait déjà caractérisé la Gauche Communiste Internationale avant la 2de Guerre Mondiale et la GCF après celle-ci.
C'est ainsi que le groupe "Internacionalismo" a établi ou tenté d'établir des contacts et des discussions avec le groupe américain "News and Letters" ([2] [778]) (au congrès duquel, en 1965, il envoie trois représentants et soumet des thèses sur la "libération nationale") et, en Europe, avec toute une série de groupes se situant sur des positions de classe comme le "Fomento Obrero Révolueionario" (Espagne), le "Partito Comunista Internazionalis-ta"-"Battaglia Comunista", le PCI-"Programma Comunista", le "Groupe de liaison pour l'Action des Travailleurs", "Informations et Correspondances Ouvrières", "Pouvoir Ouvrier" (France) ainsi qu'avec des éléments de la gauche hollandaise au Pays-Bas.
Avec le départ de plusieurs de ses éléments vers la France en 67 et 68, ce groupe a interrompu pendant plusieurs années sa publication avant de reprendre Internacionalismo (Nouvelle Série) en 74 et d'être une partie constitutive du CCI en 75. La deuxième expression organisée de notre courant est apparue en France sur la lancée de la grève générale de mai 68 qui marque le ressurgissement historique du prolétariat mondial après plus de 40 ans de contre-révolution. Un petit noyau se forme à Toulouse autour d'un militant d'"Internacionalismo", noyau qui participe activement dans les discussions animées du printemps 68, adopte une "déclaration de principes" ([3] [779]) en juin et publie le premier numéro de la revue Révolution Internationale à la fin de la même année. Immédiatement, ce groupe reprend la politique d'"Internacionalismo" de recherche des contacts et discussions avec les autres groupes du milieu prolétarien tant au niveau national qu'international. Il participe ainsi aux conférences nationales organisées par ICO en 1969 et 70 ainsi qu'à la conférence internationale organisée à Bruxelles en 1969. A partir de 70, il établira des liens plus étroits avec deux groupes qui surnagent au milieu de la décomposition générale du courant conseilliste qui a suivi mai 68 : 1'"Organisation Conseilliste de Clermont-Ferrand" et les "Cahiers du Communisme de Conseils" (Marseille) après une tentative de discussion avec le GLAT qui avait fait apparaître que ce groupe s'éloignait de plus en plus du marxisme. La discussion avec les deux groupes précédents s'avérera par contre beaucoup plus fructueuse et, après toute une série de rencontres où ont été examinées de façon systématique les positions de base de la gauche communiste, aboutira à une unification en 72 de R.I, l'O.C de Clermont et des C.C.C autour d'une plateforme ([4] [780]) qui reprend de façon plus précise et détaillée la déclaration de principes de R.I. de 68. Ce nouveau groupe va publier la revue Révolution Internationale (Nouvelle Série) ainsi qu'un Bulletin d'Etude et de Discussion et va constituer l'animateur du travail de contacts et discussions internationales en Europe jusqu'à la fondation du CCI deux ans et demi plus tard.
Sur le continent américain, les discussions engagées par "Internacionalismo" avec "News and Letters" ont laissé des traces aux Etats-Unis et, en 70, se constitue à New York un groupe (dont font partie d'anciens militants de "News and Letters" auxquels cette organisation n'avait opposé que le dénigrement et des mesures disciplinaires et non un débat sérieux lorsqu'ils avaient tenté de soulever des questions sur ses confusions politiques) autour d'un texte d'orientation ([5] [781]) reprenant les mêmes positions fondamentales que "Internacionalismo" et "R.I.". Ce groupe commence la publication de la revue Internationalism et s'engage dans la même orientation que ses prédécesseurs d'établissement de discussions avec les autres groupes communistes. C'est ainsi qu'il maintient des contacts et discussions avec "Root and Branch" de Boston (qui est inspiré par les positions conseillistes de Paul Mattick), mais qui se révèlent infructueux, ce groupe évoluant de plus en plus vers un cénacle de marxologie. C'est ainsi surtout qu'en 72, "Internationalism" envoie à une vingtaine de groupes une proposition de correspondance internationale dans les termes suivants ([6] [782]) :
"Pendant les cinq dernières années, nous avons vu une remontée de la combativité de la classe ouvrière d'une manière inconnue depuis la seconde guerre mondiale. Ces luttes ont très souvent pris la forme de grèves sauvages et illégales avec la création de comités de base.
Ces luttes ont atteint une intensité particulière et, grâce à l'ampleur de la crise mondiale du capitalisme, elles ont pris un caractère international.
Avec le réveil de la classe ouvrière, il y a eu un développement considérable des groupes révolutionnaires qui se revendiquent d'une perspective communiste internationaliste. Cependant les contacts et la correspondance entre groupes ont été malheureusement négligés et laissés au hasard. C'est pourquoi "Internationalism" propose, en vue d'une régularisation et d'un élargissement de ces contacts, une correspondance suivie entre groupes se réclamant d'une perspective communiste internationaliste.
Evidemment, le choix des groupes appelés à participer à cette correspondance internationale est déterminé par des critères politiques. Les groupes nommés, quoiqu'ils divergent sur certains points fondamentaux, en général :
- reconnaissent la nature contre-révolutionnaire de la Russie, des pays de 1'Est et de la Chine ;
- s'opposent à toutes les formes de réformisme, de frontisme et de collaboration de classe (fronts nationaux, fronts populaires et anti-fascistes) ;
- ont une théorie et une pratique critiques au sujet de la 3ème Internationale ;
- ont de même la conviction que seul le prolétariat est le sujet historique de la révolution ;
- ont la conviction que la destruction du capitalisme nécessite 1'abolition du salariat ;
- ont une perspective internationaliste„"
Dans sa réponse positive "R.I." précise : "Comme vous, nous sentons la nécessité de ce que les activités et la vie de nos groupes aient un caractère aussi international que les luttes actuelles de la classe ouvrière. C'est pour cette raison que nous avons entrepris des contacts épistolaires ou directs avec un certain nombre de groupes européens auxquels a été envoyée votre proposition. Il s'agit des groupes "Workers' Voice" et "Solidarity" pour la Grande-Bretagne, "Sociale Révolution" et "Révolution Kampf" pour 1 'Allemagne, "Spartacus" pour les Pays-Bas, "Lutte de classe" et "Bilan" pour la Belgique
Nous pensons que votre initiative permettra d'élargir le champ de ces contacts et, tout au moins, de mieux connaître et faire connaître nos positions respectives.
Nous pensons également que la perspective d'une éventuelle conférence internationale est la suite logique de l'établissement de cette correspondance sans toutefois penser qu'il faille trop en hâter la venue. Une telle conférence devrait pouvoir se tenir après une période de correspondance politique suivie permettant une pleine connaissance des positions des autres groupes ainsi qu'une décantation des points d'accord et de divergence."
Par sa réponse, R.I. soulignait donc la nécessité de s'acheminer vers la tenue de conférences internationales de groupes de la gauche communiste. Cette proposition se trouvait en continuité des propositions répétées (en 68, 69 et 71) qui avaient été faites au "Partito Communista Internazionalista" ("Battaglia") d'appeler à de telles conférences dans la mesure où cette organisation était à l'époque en Europe la plus importante et sérieuse dans le camp de la gauche communiste (à côté du PCI-Programma Comunista qui, lui, se confortait dans son "splendide isolement". Mais ces propositions, en dépit de l'attitude ouverte et fraternelle de "Battaglia", avaient été à chaque fois repoussées (voir notre article "La constitution du BIPR : un bluff opportuniste" dans ce numéro de la Revue).
En fin de compte, l'initiative d1"Internationalism" et la proposition de "R.I." devaient aboutir à la tenue en 73 et 74 d'une série de conférences et rencontres ([7] [783]) en Angleterre et en France au cours desquelles s'est opérée une clarification et une décantation qui se sont traduites notamment par une évolution vers les positions de "R.I-Internationalism" du groupe anglais "World Révolution" (issu d'une scission de "Solidarity-London") qui allait publier le premier numéro de sa revue en mai 74. Cette clarification et cette décantation avaient également, et surtout, créé les bases qui allaient permettre la constitution du CCI en janvier 75.
Pendant cette même période, en effet, R.I. avait poursuivi son travail de contacts et discussions au niveau international, non seulement avec des groupes organisés mais également avec des éléments isolés lecteurs de sa presse et sympathisant avec ses positions. Ce travail avait conduit à la constitution de petits noyaux en Espagne et en Italie autour de ces mêmes positions et qui, en 74, ont commencé la publication de Acciôn Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
Ainsi, a la conférence de janvier 75 étaient présents "Internacionalismo", "Révolution Internationale", "Internationalism", "World Révolution", "Acciôn Proletaria" et "Rivoluzione Internazionale" partageant les orientations politiques développées à partir de 64 par "Internacionalismo". Etaient également présents "Revolutionary Perspectives" (qui avait participé aux conférences de 73-74), le "Revolutionary Workers Group" de Chicago (avec qui "R.I-Internationalism" avaient engagé des discussions en 74) et "Pour une Intervention Communiste" (qui publiait la revue "Jeune Taupe" et était constitué autour de camarades ayant quitté "R.I" en 73 parce qu'ils estimaient que ce groupe "n'intervenait pas assez dans les luttes ouvrières"). Quant au groupe "Workers'Voice" qui avait participé activement aux conférences des années précédentes, il avait rejeté l'invitation à cette conférence car il estimait désormais que "R.I", "World Révolution" etc. étaient des groupes bourgeois (!) à cause de la position de la majorité de leurs militants (mais qui n'allait être adoptée officiellement par le CCI que quatre ans et demi plus tard) sur la question de l'Etat dans la période de transition du capitalisme au communisme ([8] [784]).
Cette question figurait d'ailleurs à l'ordre du jour de la conférence de janvier 75 et de nombreuses contributions avaient été préparées à cet effet (comme on peut le constater dans le n°1 de la Revue Internationale). Cependant, elle n'y fut pas discutée, la conférence préférant consacrer un maximum de temps et d'attention à des questions beaucoup plus cruciales à ce moment-là : l'analyse de la situation internationale,
- les tâches des révolutionnaires dans celle-ci,
- l'organisation dans le courant international. Finalement, les six groupes dont les plateformes étaient basées sur les mêmes orientations décidaient de s'unifier en une organisation unique dotée d'un organe central international et publiant une revue trimestrielle ([9] [785]) en trois langues
- anglais, français" et espagnol - (la publication de recueils de cette revue en italien, néerlandais et allemand sera entreprise par la suite) qui prenait la relève du Bulletin d'Etude et de Discussion de "R.I.". Le CCI était fondé. Comme l'écrivait la présentation du n°1 de la Revue Internationale : "Un grand pas vient d'être fait." En effet, la fondation du CCI constituait l'aboutisse ment d'un travail considérable de contacts, de discussions, de confrontations entre les différents groupes que la reprise historique des combats de classe avait faits surgir. Elle témoignait de la réalité de cette reprise que beaucoup de groupes communistes contestaient encore à l'époque. Mais surtout, elle jetait les bases pour un travail bien plus considérable encore.
Ce travail, les lecteurs de la Revue Internationale (ainsi que de notre presse territoriale) ont pu le constater depuis dix ans et vient confirmer ce que nous écrivions dans la présentation du n°1 de la Revue :
"D'aucuns pensent que c'est là (la constitution du CCI et la publication de la Revue) une action précipitée. Rien de tel ! On nous connaît assez pour savoir que nous n'avons rien de ces braillards activistes dont 1'activité ne repose que sur un volontarisme autant effréné qu'éphémère." On peut se faire une petite idée de ce travail en constatant que, depuis sa fondation il y a dix ans, le CCI a publié (sans compter-les brochures) plus de 600 numéros de ses différentes publications régulières (alors que pendant les dix années précédentes, les six groupes fondateurs n'avaient publié qu'une cinquantaine de numéros). Evidemment cela n'est rien si on le compare à la presse du mouvement ouvrier du passé avant la première guerre mondiale et dans les années de l'Internationale Communiste. Par contre, la comparaison avec ce qu'ont pu publier les différents groupes de la gauche communiste depuis les années 30 jusqu'à la fin des années 60 témoigne de la vitalité de notre organisation.
Mais les publications du CCI ne sont qu'un aspect de ses activités. Depuis sa fondation, le CCI a été partie prenante des luttes de la classe ouvrière, de ses efforts vers sa prise de conscience. Cela s'est traduit par une intervention aussi large que lui permettaient ses faibles forces dans les différents combats de classe (diffusion de la presse, de tracts, prises de parole dans des assemblées, des meetings, à la porte des usines...) mais également par une participation active à l'effort international de discussion et de regroupement des révolutionnaires et, comme condition de l'ensemble des autres activités, par la poursuite du travail de réappropriation et de développement des acquis de la gauche communiste, du travail de renforcement politique de l'organisation.
QUEL BILAN ?
Tout au long de ses dix années d'existence, le CCI a évidemment rencontré de nombreuses difficultés, a dû surmonter de nombreuses faiblesses dont la plupart étaient liées à la rupture d'une continuité organique avec les organisations communistes du passé, à la disparition ou à la sclérose des fractions de gauche qui s'étaient détachées de l'Internationale Communiste lors de sa dégénérescence. Il a également dû combattre l'influence délétère de la décomposition et de la révolte des couches de la petite-bourgeoisie intellectuelle, influence particulièrement sensible après 68 à la suite des mouvements estudiantins. Ces difficultés et faiblesses se sont par exemple traduites par plusieurs scissions - dont nous avons rendu compte dans notre presse - et par des soubresauts importants en 1981, en même temps que l'ensemble du milieu révolutionnaire ([10] [786]), et qui ont notamment abouti à la perte de la moitié de notre section en Grande-Bretagne. Face à ses difficultés de 81, le CCI a même été conduit à organiser une Conférence extraordinaire en janvier 1982 en vue de réaffirmer et de préciser ses bases programmatiques, en particulier sur la fonction et la structure de l'organisation révolutionnaire ([11] [787]). De même, certains des objectifs que s'était fixés le CCI n'ont pu être atteints. C'est ainsi que la diffusion de notre presse est restée en deçà de nos espérances, ce qui nous a conduits à ralentir le rythme de parution de la Revue Internationale en langue espagnole et de suspendre sa parution en langue néerlandaise (vide en partie comblé par la revue Wereld Revolutie).
Cependant, s'il nous faut faire un bilan global de ces dix années, il faut affirmer qu'il est nettement positif. Il est particulièrement positif si on le compare à celui des autres organisations communistes qui existaient au lendemain de 1968. Ainsi, les groupes du courant conseilliste, même ceux qui avaient fait un effort pour s'ouvrir au travail international comme ICO, ont soit disparu, soit sombré dans la léthargie : le GLAT, ICO, l'Internationale Situationniste, le Spartacusbond, "Root and Branch", le PIC, les groupes conseillistes du milieu Scandinave, la liste est longue (et non exhaustive)... Quant aux organisations se rattachant à la gauche italienne et qui, toutes, s'auto-proclamaient LE PARTI, soit elles ne sont pas sorties de leur provincialisme, soit elles se sont disloquées ou ont dégénéré en groupes gauchistes tel "Programme Communiste", soit elles en sont aujourd'hui encore à imiter ce que le CCI a réalisé il y a dix ans, et ceci de façon poussive et dans la confusion comme c'est le cas de "Battaglia Comunista" et du CWO (voir notre article dans ce n° de la Revue). Aujourd'hui, après l'effondrement comme un château de cartes du (prétendu) Parti Communiste International, après les échecs du FOR (Fomento Obrero Révolutionario) aux USA (Focus), le CCI reste la seule organisation communiste vraiment implantée au niveau international. Depuis sa fondation en 75, le CCI non seulement a renforcé ses sections territoriales d'origine mais il s'est implanté dans d'autres pays. La poursuite du travail de contacts et de discussions à l'échelle internationale, l'effort de regroupement des révolutionnaires a permis l'établissement de nouvelles sections du CCI :
- 1975 : constitution de la section en Belgique qui publie en deux langues (français et néerlandais) la revue, puis le journal Internationalisme et qui comble le vide laissé par la disparition, au lendemain de la 2ème guerre, de la fraction belge de la Gauche Communiste Internationale.
- 1977 : constitution du noyau au Pays-Bas qui entreprend la publication de la revue Wereld Revolutie ; c'est un événement de premier plan dans ce pays qui fut la terre d'élection du conseillisme.
- 1978 : constitution de la section en Allemagne qui commence la publication de la Revue Interna-tionale en langue allemande et, l'année suivante, de la revue territoriale Welt Revolution. La présence d'une organisation communiste en Allemagne est évidemment de la plus haute importance compte tenu de la place prise par le prolétariat de ce pays dans le passé et qu'il prendra dans 1'avenir.
- 1980 : constitution de la section en Suède qui publie la revue Internationell Révolution.
A l'heure actuelle, le CCI a donc dix sections territoriales implantées dans des pays où habitent plus d'un demi-milliard d'êtres humains et eu travaillent plus de 100 millions d'ouvriers. Il publie sa presse en sept langues qui sont parlées -par près d'un quart de l'humanité. Mais, plus important encore, le CCI est présent dans les plus grandes concentrations ouvrières du monde (Europe occidentale, Etats-Unis) qui joueront un rôle décisif au moment de la révolution. Et même si nos forces dans ces différents pays sont encore très faibles, elles sont une première pierre, un point d'appui pour une présence beaucoup plus large et influente dans la lutte de classe lorsque celle-ci se développera avec l'aggravation inévitable de la crise du capitalisme.
Si nous donnons ces éléments, si nous tirons un bilan positif du travail du CCI en constatant la faillite des autres organisations communistes ce n'est nullement pour nous décerner des auto félicitations satisfaites. En réalité, nous ne sommes nullement satisfaits de la faiblesse actuelle de l'ensemble du milieu communiste. Nous avons toujours affirmé que toute disparition, toute dégénérescence ou tout échec des groupes communistes constitue un affaiblissement pour l'ensemble de la classe ouvrière dont ils sont une partie, un gaspillage et une dispersion d'énergies militantes qui cessent d'agir pour l'émancipation du prolétariat. C'est pour cela que notre objectif principal dans nos débats avec les autres groupes communistes n'a jamais été de les affaiblir, encore moins de les détruire pour "récupérer" leurs militants, mais bien de les pousser à surmonter ce que nous considérions être leurs faiblesses et leurs confusions afin qu'ils puissent pleinement assumer leurs responsabilités dans la classe. Si nous soulignons le contraste entre la relative réussite de l'activité de notre Courant et l'échec des autres organisations, c'est parce que cela met en évidence la validité des orientations qui furent les nôtres depuis 20 ans dans le travail de regroupement des révolutionnaires, de construction d'une organisation communiste, orientations qu'il est de notre responsabilité de dégager pour l'ensemble du milieu communiste.
LES ORIENTATIONS INDISPENSABLES POUR UN REGROUPEMENT COMMUNISTE.
Les bases sur lesquelles s'est appuyé, dès avant sa constitution formelle, notre Courant dans son travail de regroupement ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours par le passé constitué les piliers de ce type de travail. On peut les résumer ainsi :
- la nécessité de rattacher l'activité révolutionnaire aux acquis passés de la classe, à l'expérience des organisations communistes qui ont précédé, de concevoir l'organisation présente comme un maillon de toute une chaîne d'organismes passés et futurs de la classe ;
- la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes non comme un dogme mort mais comme un programme vivant, en constant enrichissement et approfondissement ;
- la nécessité d'être armé d'une conception claire et solide sur l'organisation révolutionnaire, sur sa structure et sa fonction au sein de la classe.
1- Se rattacher aux acquis du passé.
"Le CCI se revendique des apports successifs de la Ligue des Communistes, des 1ère, 2ème et 3ème Internationales, des Fractions de gauche gui se sont dégagées de cette dernière, en particulier des Gauche allemande, hollandaise et italienne. Ce sont ces apports essentiels, permettant d'intégrer 1'ensemble des frontières de classe' dans une vision cohérente et générale, qui sont présentés dans la présente plateforme." (Plateforme du CCI, Préambule)
Ainsi, dans sa plateforme adoptée lors de son 1er Congrès en 1976, le CCI réaffirmait ce qui était déjà un acquis lors de la constitution de "Internacionalismo" en 1964. Alors que dans 1'après 68, comme cela avait déjà été le cas auparavant lors de la dégénérescence de l'I.C. (notamment de la part de la Gauche hollandaise), il existait une forte tendance à "jeter le bébé avec l'eau du bain", à remettre en cause non seulement les organisations dégénérées ayant basculé dans le camp bourgeois, non seulement les positions erronées des organisations révolutionnaires du passé mais également les acquis essentiels de ces organisations. De même que le courant conseilliste des années 30 avait abouti à ranger le parti bolchevik, et donc toute l'Internationale Communiste, dans la bourgeoisie dès leur constitution, le courant "moderniste" - dont "Invariance" et "le Mouvement Communiste" furent les mentors - s'est attelé à "faire du neuf", à rejeter d'un revers de main et avec la suffisance propre aux ignorants, les organisations passées du prolétariat d'où ils tenaient justement le peu qu'ils savaient des positions de classe. L'incapacité à reconnaître les apports de ces organisations, notamment de l'Internationale Communiste, incapacité qui a touché également tout le courant qui venait de "Socialisme ou barbarie" tel "Pouvoir Ouvrier" ainsi que les groupes de la mouvance conseilliste (depuis "Spar-tacusbond" jusqu'au PIC) fut directement à l'origine de la disparition de ces organisations. Se refusant tout passé, ces organisations ne pouvaient avoir aucun avenir.
Il n'existe pas de "nouveau" mouvement ouvrier qu'il faudrait opposer au "vieux" mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier est un tout comme la classe ouvrière elle-même qui constitue un même être historique depuis son apparition il y a bien plus d'un siècle jusqu'à sa disparition dans la société communiste. Toute organisation qui ne comprend pas cette chose élémentaire, qui rejette les acquis des organisations du passé, qui refuse de se concevoir en continuité avec celles-ci, aboutit à se mettre en dehors du mouvement historique de la classe, en dehors de la classe elle-même. En particulier dans la mesure où :
"Le marxisme est 1'acquis théorique fondamental de la lutte prolétarienne. C'est sur sa base que 1'ensemble des acquis du prolétariat s'intègre dans un tout cohérent" (Plateforme du CCI, point 1) toute activité révolutionnaire aujourd'hui est nécessairement basée sur des positions et analyses marxistes. Tout rejet du marxisme explicite (comme ce fut le cas de "Socialisme ou Barbarie", et à sa suite de "Solidarity") ou implicite (comme pour le GLAT et "Pouvoir Ouvrier" qui venaient du même "Socialisme ou Barbarie") condamne un groupe,lorsqu'il se maintient,à être un véhicule d'idéologies étrangères au prolétariat, notamment l'idéologie petite-bourgeoise.
2- Un programme vivant, non un dogme mort,
"..bien qu'il ne soit pas un système ni un corps de doctrine fermé, mais au contraire une théorie en élaboration constante, en liaison directe et vivante avec la lutte de classe, et bien qu'il ait bénéficié des manifestations théoriques de la vie de la classe qui l'ont précédé, il (le marxisme) constitue, depuis le moment où ses bases ont été jetées, le seul cadre à partir et au sein duquel la théorie révolutionnaire peut se développer." (Plateforme du CCI, point 1)
Si la réappropriation des acquis du mouvement ouvrier et notamment de la théorie marxiste constitue donc le point de départ indispensable de toute activité révolutionnaire aujourd'hui, encore faut-il comprendre ce qu'est le marxisme, encore faut-il savoir que ce n'est pas un dogme immuable, "invariant", comme diraient les bordiguistes, mais bien l'arme de combat d'une classe révolutionnaire pour qui "l'auto-critique impitoyable n'est pas seule ment un droit vital" mais "aussi le devoir suprême" (Rosa Luxemburg). La fidélité au marxisme qui caractérise les grands révolutionnaires comme Rosa Luxemburg ou Lénine n'a jamais été une fidélité "à la lettre" mais une fidélité à l'esprit, à la démarche. C'est ainsi que Rosa, dans L'accumulation du Capital critique certains des écrits de Marx (dans le Livre II du Capital) en employant la démarche du marxisme, démarche qu'elle avait employée dans Grève de masse, parti et syndicat pour combattre les dirigeants syndicaux qui prenaient à la lettre Marx et Engels afin de rejeter la grève de masse, démarche qu'elle emploiera lors de la fondation du Parti Communiste d'Allemagne pour critiquer les illusions parlementaristes de Engels (dans sa préface de 1895 à Les luttes de classes en France). C'est ainsi que Lénine, pour démontrer la possibilité et la nécessité de la révolution prolétarienne en Russie doit combattre le "marxisme orthodoxe" des mencheviks et de Kautsky pour qui seule une révolution bourgeoise est possible dans ce pays.
C'est ainsi que "Bilan", dans son n°1 (novembre 1933), recommande une "connaissance profonde des causes et des défaites" laquelle "ne peut supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme". Toute la démarche de "Bilan" sera déterminée par ces deux préoccupations :
- partir des acquis de la 3ème Internationale, s'appuyer fermement dessus ;
- soumettre les positions de celle-ci à la critique de l'expérience historique, avancer avec prudence mais de façon résolue dans cette critique.
C'est la démarche de "Bilan" qui lui a permis d'apporter une contribution fondamentale aux positions révolutionnaires, de jeter, par sa critique des positions erronées de l'I.C. (en bonne partie responsables de sa dégénérescence), les bases du programme révolutionnaire d'aujourd'hui.
C'est en particulier parce qu'il a tourné le dos à cette démarche de "Bilan" que le courant bordiguiste, en voulant rester attaché à l'intégralité des positions du 2ème Congrès de l'I.C. (comme les trotskystes se réclamaient des quatre premiers congrès) a régressé en réalité bien en deçà des erreurs de l'I.C. Une même erreur sur une position n'a pas la même valeur à quarante ans d'intervalle. Ce qui peut être une erreur de jeunesse, une immaturité, se transforme, à la suite de toute une expérience de la classe, en une mystification bourgeoise. Une organisation qui aujourd'hui veut reprendre à la lettre les positions du 2ème Congrès de l'I.C. sur la question nationale, le "parlementarisme révolutionnaire", les syndicats, se condamne soit à rejoindre à terme le gauchisme, soit à se disloquer : deux choses qui sont arrivées au courant bordiguiste.
Par contre, c'est la démarche de "Bilan", puis de la Gauche Communiste de France qui a toujours animé notre Courant. C'est parce que le CCI conçoit le marxisme comme une théorie vivante qu'il a à coeur de creuser et approfondir les enseignements du passé. Cela s'est notamment manifesté par la mise à l'ordre du jour de chacun de ses cinq Congrès - à côté de l'examen de la situation internationale et des activités - de questions à approfondir :
- 1er Congrès (janvier 1976) : discussion approfondie de l'ensemble de nos positions en vue de l'adoption d'une plateforme, de statuts et d'un manifeste (voir Revue Internationale n°5) ;
- 2ème Congrès (juillet 1977) : discussion sur la question de l'Etat dans la période de transition, adoption d'une résolution sur les groupes prolétariens permettant de mieux s'orienter face au milieu politique (voir Revue Internationale n°11);
- 3ème Congrès (juillet 1979) : adoption d'une résolution sur l'Etat dans la période de transition et d'un rapport sur le cours historique (voir Revue Internationale n°18) ;
- 4ème Congrès (juin 1981) : rapport sur "les conditions historiques de la généralisation de la lutte historique de la classe ouvrière" qui précise pourquoi les conditions les plus favorables pour la révolution ne sont pas données par la guerre impérialiste (comme en 1917-18) mais par une crise économique mondiale comme c'est le cas aujourd'hui (voir Revue Internationale n°26) ;
- 5ème Congrès (juillet 1983) : rapport "sur le Parti et ses rapports avec la classe" qui, sans apporter d'élément vraiment nouveau sur la question, fait une synthèse de nos acquis (voir Revue Internationale n°35).
Les textes d'approfondissement et de développement de nos positions n'ont pas seulement été préparés et discutés pour les Congrès. Il en fut ainsi des textes sur "la lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme" (voir Revue Internationale n°23) et sur la "critique de la théorie du maillon faible" (voir Revue Internationale n°31 ) qui précisaient et approfondissaient notre analyse sur les conditions présentes et futures de la lutte prolétarienne vers la révolution.
De même, il est nécessaire de souligner les approfondissements que constituent nos différentes brochures sur Les syndicats contre la classe ouvrière, La décadence du capitalisme, Nation ou classe, Organisations communistes et conscience de classe, La période de transition du capitalisme au communisme.
Enfin, c'est la capacité de notre Courant à ne pas être enfermé dans les schémas du passé qui lui a permis de comprendre, dès avant 1968, les enjeux et la perspective de la situation mondiale présente. En effet, alors que la Gauche Communiste de France ne voyait de possibilité de surgissement du prolétariat que dans et au cours d'une 3ème guerre mondiale ([12] [788]), "Internacionalismo" était conduit à réviser cette vision et à ébaucher notre analyse du cours historique vers les affrontements de classe surgissant de la crise économique et empêchant la bourgeoisie d'apporter sa propre réponse à ses contradictions insolubles : la guerre généralisée. C'est pour cela que "Internacionalismo" pouvait écrire dès janvier 1968 (c'est-à-dire avant le surgissement de mai 68 et alors que pratiquement personne n'évoquait la possibilité de la crise) :
"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson. . . voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste qui, durant quelques années, était restée cachée derrière 1'ivresse du 'progrès ' qui avait succédé à la 2ème guerre mondiale. . .
Au milieu de cette situation, lentement et par à coups, la classe ouvrière se fraie un chemin dans un mouvement souterrain qui, par moments, paraît inexistant, explose ici, jette une lumière aveuglante pour s’éteindre subitement et se rallumer plus loin : c'est le réveil de la classe ouvrière, du combat ouvert. .
Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les événements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement sûrs et conscients, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de 1'arrêter. . et qu'il mène directement à la crise. Et nous sommes sûrs également que le processus inverse de développement de la combativité de la classe, qu'on vit actuellement de façon générale, va conduire la classe ouvrière à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'Etat bourgeois." (Internacionalismo n°8 , "1968: une nouvelle convulsion du capitalisme commence")
Ainsi, tout l'effort de notre Courant en direction du regroupement des révolutionnaires s'appuyait sur une base de granit (et non sur du sable comme pour "Battaglia Comunista" pour qui les révolutionnaires devaient organiser des conférences à cause de la "social-démocratisation" des PC).
Cette base de granit c'est la reconnaissance de la fin de la période de contre-révolution, d'un nouvel essor historique de la lutte prolétarienne qui impose aux révolutionnaires d'orienter leur travail vers la reconstitution du parti mondial.
Mais pour que les révolutionnaires puissent oeuvrer efficacement dans ce sens il faut encore qu'ils aient les idées claires sur leur fonction dans la classe et leur mode d'organisation.
3- Etre armé d'une conception claire et solide sur l'organisation révolutionnaire.
La première nécessité pour une organisation révolutionnaire c'est de comprendre quelle est sa fonction dans la classe. Cela suppose qu'elle soit consciente qu'elle a une fonction. De ce fait, la disparition à peu près complète des groupes du courant conseilliste telle qu'on l'a constatée depuis 1968 était logique et prévisible : lorsqu'on théorise sa non existence on a de fortes chances de cesser d'exister.
Mais reconnaître qu'on a une fonction dans la classe, un rôle fondamental à jouer dans la révolution, ne veut pas dire qu'on doit se concevoir ni comme "l'organisateur de la classe", ni comme son "état major" ni son "représentant" dans la prise du pouvoir. De telles conceptions héritées de la 3ème Internationale et reprises en forme de caricature par le courant bordiguiste ne peuvent aboutir qu'à :
- sous-estimer ou même nier toute lutte de classe sur laquelle on n'a pas d'influence directe (ce n'est pas un hasard si le courant bordiguiste et même "Battaglia Comunista" ont traité par le mépris la reprise historique de mai 68) ;
- tenter d'avoir à tout prix une influence immédiate dans la classe, à "se faire reconnaître" comme "direction" par celle-ci : c'est la porte ouverte à l'opportunisme qui a emporté et disloqué le "Parti Communiste International" (Programme) ;
- en fin de compte, discréditer l'idée même de parti révolutionnaire, en faire un repoussoir favorisant les thèses conseillistes.
Une conception claire de la fonction de l'organisation suppose qu'on la conçoive comme partie prenante de la lutte de classe : c'est en ce sens que depuis "Internacionalismo" jusqu'au CCI d'aujourd'hui la nécessité d'une intervention politique dans la classe a toujours été affirmée contre toutes les tendances voulant transformer l'organisation en cénacle de marxologie, en "groupe de travail" ou de "réflexion". C'est également pour cela que le CCI a toujours combattu pour que les trois Conférences Internationales tenues entre 1977 et 1980 ne soient pas "muettes", qu'elles prennent position comme telles sur les enjeux de la période présente.
Intervenir dans la classe ne veut absolument pas dire négliger le travail de clarification et d'approfondissement politique-théorique. Bien au contraire. La fonction essentielle des organisations communistes, contribuer activement au processus de prise de conscience de la classe, suppose qu'elles se dotent des positions les plus claires et cohérentes possibles. C'est en ce sens que les différents groupes qui allaient constituer le CCI se sont tous dotés d'une plateforme, que le CCI en a fait de même à son 1er Congrès. C'est pourquoi nous avons toujours combattu contre tout "recrutement" d'éléments confus, contre tout regroupement dans la précipitation et la confusion et pour la plus grande clarté dans les débats. C'est aussi pourquoi nous avons défendu dès le début, et notamment dans l'appel d'"Internationa-lism" de 72 comme dans notre réponse à l'initiative de "Battaglia Comunista" en 76 (voir l'article sur "la constitution du BIPR" dans ce n° de la Revue), la nécessité de critères politiques pour la tenue de conférences internationales.
Nous n'avons pas la prétention mégalomane d'être les seuls à défendre des positions communistes : ceux qui nous accusent de sectarisme ne savent pas de quoi ils parlent comme le démontre toute notre histoire. Par contre, nous avons toujours affirmé que le regroupement des révolutionnaires, la création du futur parti, ne peuvent se faire que dans la plus grande clarté, la plus grande cohérence programmatiques. C'est pourquoi en 75 nous avons refusé que"Revolutionary Perspectives" s'intègre au CCI comme "minorité" comme ce groupe le proposait avant de s'unifier de façon éphémère avec "Wor-kers' Voice" pour constituer le CWO. C'est pourquoi nous n'avons pas conçu les conférences de 1977 à 1980 comme devant aboutir à un regroupement immédiat contrairement à la vision défendue par "Battaglia Comunista" aujourd'hui (cf. article cité) même si nous n'avons jamais été opposés à une unification entre certains participants de ces conférences dès lors qu'ils se trouvaient sur les mêmes positions politiques. C'est enfin pourquoi nous considérons que la tentative présente de "Battaglia" et du CWO de constituer une organisation internationale bâtarde, à mi-chemin entre une organisation politique centralisée et une fédération de groupes autonomes à la mode anarchiste, a les plus grandes chances de constituer non un pôle de clarté politiques mais un pôle de confusion. En effet, une des conditions essentielles pour qu'une organisation communiste soit en mesure d'assumer sa fonction, c'est la clarté sur sa structure. Depuis ses débuts, notre Courant a défendu la nécessité d'une organisation internationale et centralisée. Ce n'était nullement une conception "nouvelle". Elle se basait sur la nature même de la classe ouvrière qui doit assumer et prendre en charge son unité à l'échelle internationale pour être en mesure d'accomplir la révolution. Elle s'appuyait sur toute l'expérience des organisations prolétariennes depuis la Ligue des Communistes et l'AIT jusqu'à l'Internationale Communiste et la Gauche Communiste Internationale. Cette nécessité était affirmée très clairement à la Conférence constitutive du CCI en 75 (voir le rapport "sur la question de l'organisation de notre courant international" dans la Revue Internationale n°1) mais elle était dès le début à la base de toute notre attitude en faveur des contacts et discussions au niveau international telle qu'elle s'est illustrée tout au long de notre histoire. De même, nous avons affirmé cette nécessité dans tout notre travail de participation aux cycles de Conférences Internationales dont nous avons été partie prenante : 1973-74, 1977-80, Conférences du milieu Scandinave à la fin des années 70 (où nous avons insisté pour que soient invités les groupes se réclamant de la Gauche italienne comme "Battaglia"). Dans ces Conférences, nous avons donc combattu la conception d'une organisation internationale basée sur une sorte de fédération de groupes nationaux avec chacun sa propre plateforme telle qu'elle était défendue par "Battaglia Comunista" en 77 et qu'elle reprend aujourd'hui à son compte dans la pratique avec la constitution du BIPR.
Un autre enseignement qu'il faut dégager de l'expérience du CCI c'est qu'une organisation de combat, comme l'est l'organisation communiste, se construit par le combat. Cet enseignement n'est pas nouveau lui non plus. Ainsi, le parti bolchevik ne put parvenir à jouer son rôle dans la révolution d'octobre 17 et la fondation de l'I.C. que parce qu'il avait été trempé par une série de combats successifs contre le populisme et le socialisme agraire, contre le "marxisme légal", contre le terrorisme, contre l'économisme ouvriériste, contre l'intellectualisme rejetant la notion d'engagement militant, contre le menchévisme, contre les liquidateurs, contre la défense nationale et le pacifisme, contre tout soutien au gouvernement provisoire de 17. De même, notre organisation s'est fondée et trempée par une série de combats contre toutes sortes de déviations, y compris en son sein :
- combat de "Internacionalismo" contre l'ouvriérisme conseilliste de "Proletario" (cf. Bulletin d'étude et de discussion de R.I. n°10) ;
- combat de "R.I" contre le conseillisme d'ICO (1969-70), contre 1'accadémisme des tendances "Parti de classe" (1971) et Bérard (1974), contre l'activisme de la tendance qui allait former le PIC (1973) ;
- combat du CCI contre l'activisme et la vision substitutionniste de la tendance qui allait former le "Groupe Communiste Internationaliste" (1978) ;
- combat du CCI contre 1'immédiatisme, la dilution des principes et pour la défense de l'organisation face à la "tendance Chénier" (1981).
Le dernier enseignement qu'il faut tirer de notre expérience c'est qu'on ne peut pas sérieusement s'acheminer vers la constitution du futur parti si on ne sait pas à quels moments de l'histoire il peut surgir : lors des périodes de développement historique de la lutte de classe. C'est la vision que défendit la Gauche Communiste d'Italie contre la constitution de la "4ème Internationale" trotskyste, que défendit le GCF contre la fondation du PCI en Italie après la guerre. Les organisations qui aujourd'hui s'auto-proclament "Parti" ne sont pas des partis, elles ne peuvent en assumer la fonction mais, ce faisant, elles n'assument pas non plus la fonction qui leur revient à l'heure présente et que "Bilan" assignait aux fractions : préparer les bases programmatiques et organisationnelles du futur parti mondial.
Voilà quelques enseignements "classiques" du mouvement ouvrier que 10 années d'expérience du CCI sont venues reconfirmer et qui sont des conditions indispensables pour contribuer réellement à la constitution du parti révolutionnaire et à la révolution communiste elle-même.
FM.
[1] [789] Sur l'histoire de la "Gauche italienne" voir notre brochure : La Gauche communiste d'Italie.
[2] [790] "News and Letters" : groupe venant du trotskysme, animé par une ancienne secrétaire de Trotsky et qui, mal gré beaucoup de confusions sur les "luttes de libération nationale", sur le problème noir, sur le féminisme, etc. défendait des positions de classe sur la question essentielle de la nature capitaliste et impérialiste de 1'URSS
[3] [791] Voir "R.I" n°2 (Ancienne Série).
[4] [792] Voir "R.I." n°1 (Nouvelle série)
[5] [793] Voir "R.I" n°2 et "Internationalism" n°4."
[6] [794] Voir "R.I" n°2 et"Internationalism " n°4.
[7] [795] Voir "R.I" n°4 et 7, "Bulletin d'Etude et de Discussion" n°5 et 9, "Internationalism" n°4.
[8] [796] Voir les articles "Sectarisme Illimité" dans WR n °3 et "Réponse à Workers' Voice" dans la Revue Internationale n°2
[9] [797] Le fait que nous en soyons aujourd'hui au n°40 de Revue Internationale démontre donc que sa régularité a été maintenue sans défaillance.
[10] [798] Voir 1'article "Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire" dans la Revue Internationale n°28.
[11] [799] Voir les rapports à cette conférence publiés dans la Revue Internationale n°29 et 33
[12] [800] Voir l'article dans le n°46 d'Internationalisme (été 1952): "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective" reproduit dans le Bulletin d’étude et de discussion n°8.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
La fonction des organisations révolutionnaires : le danger du conseillisme
- 4316 reads
Cet article a pour fonction d'exprimer la position du CCI sur le danger du conseillisme. Il porte vers l'extérieur le fruit de discussions internes pour la clarification du milieu révolutionnaire.
Le CCI a toujours eu comme principe de porter à l'extérieur ses propres débats internes, dès le moment où la clarification était suffisante pour que s'exprime le point de vue de l'ensemble de l'organisation. Tout débat théorique et politique n'est pas réservé à usage interne, pas plus qu'il ne vise à la réflexion pour la réflexion. Une organisation révolutionnaire digne de ce nom rejette aussi bien le monolithisme' qui enferme et étouffe les débats que l'esprit de cercle qui débouche sur la logomachie. Organisation militante du prolétariat, l'organisation révolutionnaire se conçoit comme un corps politique sécrété par la classe, où celle-ci n'est pas seulement intéressée mais directement impliquée dans la lutte théorique et politique des organisations qu'elle a fait surgir. Les débats d'une organisation révolutionnaire ne peuvent être secrets pour la classe, car une organisation révolutionnaire n'a pas de secrets à dissimuler au prolétariat. La politique du secret pouvait être le propre des sectes bakouninistes au 19ème siècle, mais jamais celui des organisations marxistes. Le caractère "secret" de ces sectes débouchait inévitablement sur la politique de manoeuvres. L'organisation secrète de l'Alliance de la démocratie socialiste de Bakounine dans la 1ère Internationale ne faisait que manifester une attitude d'extériorité au prolétariat.
Les organisations marxistes ont toujours reflété dans leurs publications les divergences existantes afin de travailler dans le sens d'une prise de conscience toujours plus aigue du prolétariat de son combat pour son émancipation. Les bolcheviks, avant l'interdiction des fractions au sein de leur organisation en 1921, le KAPD et la gauche communiste italienne ont toujours eu cet objectif. Non point pour donner - à la façon des "conseillistes" dégénérés - des "points de vue" dont le prolétariat n'aurait qu'à prendre passivement connaissance, mais pour orienter et trancher de façon ferme les débats afin que la pratique de la classe soit libérée de toute erreur ou hésitation.
Ce mode de fonctionnement de l'organisation marxiste découle tout naturellement de sa fonction dans la classe : être un facteur actif dans la praxis du prolétariat. Le CCI rejette aussi bien les groupes d'opinion des conseillistes dont l'aboutissement est l'éclectisme et la dissolution de l'organisation dans la passivité que les organisations monolithiques du "bordiguisme" dont la vie interne est étouffée et figée par l'interdiction de toute position minoritaire. Dans les deux cas, cette incompréhension de la fonction de l'organisation ne peut mener qu'à la désagrégation. La disparition des principales organisations conseillistes, puis l'éclatement du PCI, est finalement la sanction de cette incompréhension.
LE CCI N'EST PAS CONSEILLISTE.
Le CCI - contrairement aux affirmations gratuites de "Battaglia Comunista", puis du CWO qui, depuis peu, rejette aux orties les acquis du KAPD et se découvre des "sympathies" bordiguistes après avoir été tiré à grand peine par le CCI du marais "conseilliste libertaire" de "Solidarity" - ne vient pas du "conseillisme". Il s'est formé contre lui. L'existence d'Internacionalismo au Venezuela a été possible et s'est consolidée dès la fin des années 60 par une lutte théorique et politique contre la tendance conseilliste de "Proletario" ([1] [801]). La naissance de R.I. en France s'est effectuée en montrant, face au milieu conseillo-libertaire particulièrement présent à l'époque, la nécessité d'une organisation révolutionnaire militante et donc d'un regroupement des révolutionnaires. Après quelques hésitations à reconnaître la nécessité d'un parti révolutionnaire ([2] [802]) R.I n'a cessé de montrer l'importance d'un regroupement sans lequel ne pouvaient être posées les bases du parti. Le regroupement de 1972 entre R.I., l'organisation conseilliste de Clermont Ferrand et les "Cahiers du Communisme des Conseils" n'a pas été un regroupement "conseilliste" mais un regroupement sur la base marxiste de la reconnaissance du rôle irremplaçable de l'organisation dans la classe. Il a été possible après de longues discussions grâce auxquelles ont été levées les confusions conseillistes des groupes de Clermont et Marseille. A l'époque, faute d'une continuité organique avec la gauche communiste allemande et italienne, il était inévitable que les groupes surgissant du bouillonnement de 1'après 68 soient des groupes en recherche des principaux acquis de la gauche. Face au stalinisme et au gauchisme, et sous l'influence du milieu contestataire "anti-autoritaire", ils subissent pleinement les effets de l’idéologie conseilliste anti-organisation et anti-bolchevik. Vis-à-vis de ces groupes en France, Puis en"Grande Bretagne et aux USA, R.I. (puis le CCI après 1975) a mené un patient travail contre cette idéologie qui pénétrait les groupes de discussion en recherche et qui, en réaction au stalinisme, rejetait finalement toute l'histoire du mouvement ouvrier. C'est en reconnaissant la nature prolétarienne de" la révolution russe, en janvier 74, que le groupe "World Révolution" rompt avec le conseillisme. Le même cas se présente pour " Internationalism" aux USA, après discussions avec R.I. et "Internacionalismo".
Certes ; le CCI a eu à combattre jusqu'en son sein les idées bordiguistes sur la conception de l'organisation, sur le rôle du parti et ses rapports avec 1' Etat surgi de la révolution ([3] [803]). Depuis le groupe "Parti de classe" en 1972 jusqu'à la tendance qui allait donner le jour au GCI en 79 le CCI a montré que sa lutte contre les fausses conceptions de l'organisation n'était pas plus une régression vers le conseillisme que vers un "néobordiguisme" façon "Battaglia Comunista" et actuellement CWO. Si le combat politique et théorique dans sa presse s'est surtout essentiellement dirigé contre le bordiguisme et le néo-bordiguisme c'est surtout parce que la disparition du milieu conseilliste - par nature anti-organisation -laissait le champ libre au courant du PCI, qui se développait en raison directe de ses capitulations opportunistes. En quelque sorte, le développement du "bordiguisme" était la rançon que devait payer le milieu révolutionnaire à la disparition progressive des groupes d'orientation conseilliste disparus dans la tourbe de la confusion. Mais d'autre part aussi, le "bordiguisme", avec le PCI, constituait un véritable repoussoir pour les éléments nouveaux et groupes de discussion pouvant surgir. Ses conceptions d'un parti monolithique ("compact et puissant" suivant sa terminologie) devant exercer dans la révolution sa dictature et la "terreur rouge" ont eu pour effet de déconsidérer idée de parti. Incapable de faire, comme 1'avait fait "Bilan", le bilan de la contre-révolution et d'en tirer les implications sur la fonction et le fonctionnement de l'organisation, préférant dialoguer "avec les morts" et "avec Staline" ([4] [804]), le PCI et les sous-produits du bordiguisme n'ont fait qu'apporter de l'eau au moulin du conseillisme anti-organisation. Le bordiguisme, comme courant, véhicule les vieilles conceptions substitutionnistes qui avaient cours dans le mouvement révolutionnaire du passé. Ces conceptions, le CCI les a toujours combattues et les combattra encore demain. Parce que le conseillisme, sur un plan théorique du moins à défaut de le faire politiquement de façon organisée, combat le "substitutionnisme", cela ne signifie nullement que le CCI se trouve aux côtés du conseillisme.
Le CCI, en effet, a eu bien l'occasion de combattre les erreurs et aberrations conseillistes, jusque dans son sein. Face à des conceptions activistes-ouvriéristes, s'exprimant en particulier dans sa section en Grande-Bretagne, le CCI a été contraint de convoquer une conférence extraordinaire de toute l'organisation en janvier 82, afin de rappeler, et non d'établir, quelle était la conception du CCI de la fonction et du fonctionnement d'une organisation révolutionnaire.
Malheureusement les idées conseillistes continuent à s'exprimer de façon indirecte - et cela est d'autant plus dangereux - jusque dans notre organisation. En effet, au début de l'année 84, s'est ouvert un débat sur le rôle de la conscience de classe en dehors des luttes ouvertes. Des hésitations se manifestaient pour reconnaître alors la fin du recul de 1'après Pologne (1981-82), avec la reprise de la lutte de classe en automne 83. Cette reprise montrait de façon évidente une maturation de la conscience dans la classe, qui s'accomplissait de façon souterraine en dehors des périodes visibles de lutte de classe. ([5] [805])
Bien que la question ne soit pas nouvelle pour le CCI, un débat s'est ouvert dans notre organisation sur la conscience de classe. Il prolonge de façon militante le travail déjà accompli dans la brochure "Organisations communistes et conscience de classe". Reprenant la distinction classique du marxisme ([6] [806]), le CCI distingue les deux dimensions de la conscience : sa profondeur et son étendue. De cette façon, le CCI veut souligner plusieurs points fondamentaux :
- la continuité et le développement de la conscience dans la classe en étendue et en profondeur qui se manifeste par une maturation souterraine et s'explique par l'existence d'une conscience collective ;
- la conscience de classe a nécessairement une forme (organisations politiques et unitaires) et un contenu (programme et théorie) ; elle trouve son expression la plus élaborée, à défaut d'être achevée, dans les organisations révolutionnaires sécrétées par la classe ;
- cette conscience ne se développe pas chez les ouvriers pris comme entités individuelles mais collectivement ; elle ne se manifeste pas de façon immédiatiste mais historiquement ;
- contrairement aux assertions mégalomaniaques des bordiguistes, la conscience de classe n'est pas la propriété exclusive du parti ; elle existe nécessairement dans la classe, existence sans laquelle il n'existerait pas d'organisation révolutionnaire ;
- contrairement à la démagogie "ultra-démocratiste" du conseillisme, le CCI affirme que l'expression la plus haute de la conscience n'est pas les conseils ouvriers - où elle se développe de façon heurtée et à travers bien des erreurs - mais l'organisation politique révolutionnaire, lieu privilégié où se cristallise tout le trésor de l'expérience historique du prolétariat. Elle est la forme la plus élaborée, découlant de sa fonction, de concentrer la mémoire collective du prolétariat, qui n'existe qu'à l'état diffus dans la classe avant la période révolutionnaire, moment où la classe se la réapproprie avec le plus d'acuité.
Au cours de ce débat, le CCI a eu à combattre des positions qui soit rejetaient l'idée d'une maturation souterraine, soit (tout en reconnaissant ce processus) sous-estimaient le rôle indispensable des organisations révolutionnaires, en rejetant les dimensions de la conscience de classe ([7] [807]).
Réaffirmant que sans parti il ne peut y avoir de révolution, car la révolution engendre nécessairement des partis révolutionnaires, la majorité du CCI réaffirme que ces partis ne sont pas à la queue des conseils ouvriers mais son avant-garde la plus consciente. Etre une avant-garde ne leur donne aucun droit mais le devoir d'être à la hauteur de leur responsabilité, en raison de leur conscience théorique et programmatique plus élevées.
A la suite de ce débat - qui n'est pas terminé - le CCI a pu relever une tendance chez les camarades "minoritaires"à la conciliation avec le conseillisme (oscillations "centristes" par rapport aux idées conseillistes) . Bien que ceux-ci prétendent le contraire, nous pensons que le conseillisme constitue le plus grand danger pour le milieu révolutionnaire dès aujourd'hui, et bien plus que le " substitutionnisme, il deviendra un très grand péril pour l'intervention du parti dans les luttes révolutionnaires futures.
LE SUBSTITUTIONNISME EST-IL LE PLUS GRAND DANGER DE DEMAIN ?
A- Les bases objectives du substitutionnisme.
Lorsque nous parlons de substitutionnisme, nous entendons par là la pratique de groupes révolutionnaires qui prétendent diriger la classe et prendre le pouvoir en son nom. Dans ce sens, les gauchistes ne sont pas des organisations substitutionnistes : leur activité ne vise pas à se substituer à l'action de la classe, mais à la détruire de l'intérieur pour perpétuer la domination de la classe capitaliste. En tant que telles, elles ne commettent pas d1"erreurs" substitutionistes mais visent à prendre la direction de la lutte de classe pour la dévoyer et la soumettre à l'ordre bourgeois (parlementarisme, syndicalisme). Le substitutionnisme est en fait une mortelle erreur qui s'est développée dans le camp ouvrier, avant 1914, puis après 1920 au sein de l'Internationale Communiste. De la prétention à diriger de façon militaire la classe (cf. la discipline confinant "à la discipline militaire" affichée au 2ème Congrès) il n'y avait qu'un pas à la conception d'une dictature d'un parti unique vidant les conseils ouvriers de leur propre substance. Mais ce pas qui mène progressivement à la contre-révolution ne put être franchi que dans des conditions historiques déterminées. Les ignorer et oublier que de telles conceptions existaient jusque dans la gauche allemande, c'est ne pas comprendre les racines du substitutionnisme comme phénomène unique.
a) L'héritage de la conception social-démocrate du parti, unique porteur de la conscience qui devait être injectée de l'extérieur par des "intellectuels bourgeois" (cf. Kautsky et le "Que faire?" de Lénine) à 1'"armée disciplinée" des prolétaires, a lourdement pesé sur le mouvement révolutionnaire. Il a pesé d'autant plus lourdement qu'il trouvait un terrain fertile dans les pays sous-développés - comme en Russie et en Italie - où le parti était conçu comme un "état-major" représentant les intérêts de la classe et donc amené à prendre le pouvoir en son nom ;
b) de telles erreurs ont pu prendre pied dans une période de croissance numérique du prolétariat, où ce dernier - à peine sorti des illusions petites-bourgeoises rurales et artisanales - était éduqué politiquement par l'action des organisations politiques du prolétariat. Faute d'une riche expérience révolutionnaire capable de le mûrir politiquement et de lui donner une véritable culture politique, les tâches d'organisation et d'éducation des partis avant 1914 prenaient une place considérable. La conception que le parti est " l'état-major" de la classe et apporte aux ouvriers la conscience politique trouva un écho essentiellement dans les pays où le mouvement révolutionnaire manquait encore de maturité, et d'autant plus que son action se déroulait dans la plus stricte clandestinité, avec la centralisation et la discipline la plus stricte.
c) Les idées substitutionnistes, avant 1914, étaient encore une erreur au sein du mouvement révolutionnaire. Déjà les événements de 1905, où se manifestaient de façon incroyablement rapide la spontanéité créative du prolétariat, par la grève de masse, montraient la fausseté de telles conceptions. Lénine, lui-même, n'allait pas tarder à abandonner les thèses qu'il avait défendues dans "Que faire?". La révolution de 1905 entraîna dans la gauche communiste en Europe, et particulière ment chez Pannekoek, une remise en question de la conception kautskyste ; il montrait l'importance décisive de l'auto-organisation du prolétariat, que nul plan d'état major social-démocrate ou syndical ne pouvait susciter. Le change ment de tactique noté par Pannekoek dans les tactiques parlementaire et syndicale, qui passait désormais au second plan, montrait un changement profond dans la fonction de l'organisation révolutionnaire.
d) Il est faux de voir dans Lénine et les bolcheviks les théoriciens du substitutionnisme avant 1917, et même avant 1920. Les bolcheviks en 17 sont portés au pouvoir - avec les socialistes révolutionnaires de gauche - par les conseils ouvriers. L'insurrection, à laquelle participent de nombreux anarchistes dans la Garde Rouge, se fait sous la direction et le contrôle des conseils ouvriers. C'est beaucoup plus tard, avec l'isolement de la révolution russe et le début de la guerre civile, que commence à être théorisée - sous la forme de "léninisme" - la théorie d'une dictature de parti. Le substitutionnisme en Russie, où les conseils se vident de toute vie à mesure qu'ils sont vampirisés par le parti unique, est moins le résultat d'une volonté préexistante des bolcheviks que du tragique isolement de la révolution russe de la révolution en Europe occidentale.
e) Le courant de la gauche communiste italienne -contrairement aux assertions des conseillistes qui amalgament "léninisme" et "bordiguisme" (le "bordigo-léninisme") - a toujours rejeté en 1920 avec Bordiga la conception d'une conscience importée de l'extérieur dans le prolétariat par des "intellectuels bourgeois". Pour Bordiga, le parti est d'abord une partie de la classe ; le parti est le résultat d'une croissance organique issue de lai classe où fusionnent en une même totalité le programme et une volonté militante. Dans les années! 30, "Bilan" a toujours rejeté la conception défendue au 2ème congrès de l'I.C. d'une dictature d'un parti. Il a fallu la profonde régression de la gauche italienne après 1945, sous l'influence de Bordiga lui-même, pour que s'opère un retour à la théorie du substitutionnisme, codifiée après 1923 sous le vocable de "léninisme". C'est justement le rejet de la conception d'une "dictature de parti" qui a été en automne 1952 l'une des raisons de la scission qui donna le jour au groupe actuel "Battaglia Comunista".
B- Un danger moindre.
Aujourd'hui, les conceptions substitutionnistes présentent un moindre danger que par le passé, en raison :
- de la profonde réflexion théorique au sein des gauches communistes allemande, italienne et hollandaise dans les années 30, même si cela s'est fait partiellement au sein de chaque gauche, réflexion issue du bilan de la révolution russe et qui a permis de comprendre les racines de la contre-révolution y
- de la contre-révolution stalinienne qui a développé au sein du prolétariat, dans les pays développés en particulier, un sens plus aigu de la critique à l'égard des organisations politiques surgies de son sein et qui peuvent être amenées à le trahir. Le prolétariat, fort de son expérience historique, n'accordera plus désormais aveuglément et"naïvement sa confiance aux organisations qui se réclament de lui;
- de l'impossibilité d'une révolution dans les pays arriérés, tant que l'épicentre de la révolution mondiale ne se sera pas manifesté au cœur des pays industrialisés d'Europe occidentale. Le schéma d'une révolution isolée surgissant de la guerre impérialiste dans un pays où la bourgeoisie se trouve dans un état de faiblesse comme en Russie en 1917 ne se reproduira plus. C'est à l'issue d'une crise économique touchant tous les pays – et non plus les pays vaincus- là où le prolétariat est le plus concentré et le plus éduqué politiquement que surgira de façon beaucoup plus consciente la révolution communiste. Le prolétariat ne pourra s'organiser qu'internationalement et ne se reconnaîtra dans ses partis que dans la mesure où ils seront une partie des conseils ouvriers internationaux surgis non d'une révolution "française", "allemande", etc., mais véritablement internationale. L'isolement géographique de la révolution dans un seul pays, facteur objectif du substitutionnisme, n'est plus possible. Le danger véritable serait l'isolement sur un seul continent. Mais même dans ce cas, il ne pourrait y avoir prédominance d'un parti national comme en Russie : l'internationale (parti communiste mondial) se développera pleinement au sein des conseils ouvriers internationaux.
Cela ne signifie pas, bien entendu, que le danger de substitutionnisme a disparu à jamais. Dans les phases descendantes du cours révolutionnaire - qui sera étendu dans le temps, comme le montre l'exemple de la révolution allemande -, les hésitations inévitables et même l'épuisement momentané du prolétariat au cours d'une guerre civile longue et dévastatrice, peuvent être le terrain fertile où germe la plante empoisonnée du substitutionnisme ou du putschisme, bien proche de la conception substitutionniste blanquiste. D'autre part, la maturité du milieu révolutionnaire, où se sera opérée préalablement une décantation impitoyable des organisations prétendant être le "cerveau" ou l'"état major" de la classe sera un facteur décisif pour lutter énergiquement contre ce danger.
CONDITIONS D'APPARITION ET CARACTERISTIQUES DU CONSEILLISME.
Mais si le substitutionnisme constitue un danger surtout en période de recul dans la vague révolutionnaire, le conseillisme est un danger bien plus redoutable, surtout dans la période de montée de la vague révolutionnaire et encore plus à son point culminant où le prolétariat a besoin d'agir rapidement et avec la plus grande décision. Cette rapidité dans sa réaction et son sens aigu de la décision culminent dans la confiance qu'il manifeste aux programmes et mots d'ordre de ses partis. C'est pourquoi l'esprit d'indécision et le suivisme des conseillistes qui se trouvent flatter la moindre action des ouvriers sont particulièrement dangereux dans cette période. Les tendances conseillistes qui se manifestèrent entre 1919 et 1921 au sein du prolétariat allemand ne sont pas une expression de force du prolétariat. Si elles ne sont pas responsables de la défaite, elles traduisent une grande faiblesse au sein de la classe. Faire de ces faiblesses une vertu, comme le font les conseillistes, est la voie la plus sûre pour mener demain la révolution à la défaite. Il importe donc de comprendre les réactions de type conseilliste au sein du prolétariat allemand au cours de ces années pour éviter la répétition de ces faiblesses.
Contrairement aux apparences, le conseillisme n'apparaît pas d'abord comme une variété d'anarchisme, lequel trouva son terrain d'élection d'abord dans les pays sous-développés où le prolétariat était à peine sorti d'un état campagnard et artisanal. Il surgit au sein d'un prolétariat de longue souche, déjà aguerri par la lutte de classe et fortement politisé, agissant collectivement et débarrassé de l'individualisme petit- bourgeois.
Les tendances conseillistes surgirent d'abord dans le KPD (Spartakus) puis dans le KAPD, lorsqu'il se forma en avril 1920. Bien que Rühle (ex-IKD) fut le porte-parole de ces tendances, finalement assez isolé dans le KAPD, en dehors de la Saxe, l'écho des idées conseillistes se répercuta finalement dans l'ensemble du prolétariat radical allemand de toutes les régions. L'exclusion de Rühle et de ses partisans saxons par le XAP en décembre 1920 n'empêcha pas un rapide développement des thèses conseillistes qui devinrent celles des Unions unitaires (AAU-E), regroupant à un moment donné quelques centaines de milliers d'ouvriers.
Les caractéristiques du conseillisme allemand qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs en grande part, sont :
- le rejet de tout parti politique du prolétariat comme "bourgeois". Selon Rühle : "le parti est d'essence bourgeoise. Il représente 1'organisation classique pour la représentation d'intérêts de la bourgeoisie. Sa naissance se fait à l'époque où la classe bourgeoise venait au pouvoir. Il naquit justement avec le parlementarisme..."
("Von der bürgerlichen zur prolatarischen révolution", 1924). Ici, Rühle exprime la haine légitime du prolétariat contre le parlementarisme, sans comprendre que la fonction du parti révolutionnaire change dans la décadence, ce que comprend par contre parfaitement le KAPD;
- le rejet du centralisme comme expression de la dictature d'une classe : "L'essence bourgeoise est organisativement représentée par le centralisme." (Otto Rühle, op. cit.)
Les conseillistes ici s'attaquent aux formes en soi, croyant pouvoir éviter par ce moyen 1'apparition" d'une "caste de chefs". En préconisant la décentralisation et en cultivant "l’anti-autorité" ils ne font que favoriser l'absence de contrôle effectif des ouvriers des organisations qu'ils mettent en place. L'anti-centralisme affiché par les "unitaires" partisans de Rühle, n'empêcha pas que l'AAU-E tombe sous la poigne des intellectuels et artistes de "Die Aktion" (Franz Pfempfert en particulier), qui constituèrent véritablement des chefs auto-proclamés;
- le localisme, corollaire de 1'anti-centralisme, débouché nécessairement sur l'usinisme ouvriériste. L'usine devient l'univers borné des unionistes (AAU proche du KAP, comme l'AAU-E) qui y voient une forteresse contre l'influence des partis. Le culte de l'ouvrier dans son entreprise s'accompagne d'un anti-intellectualisme, les non-ouvriers "intellectuels" militants dans le KAPD étant soupçonnés d'aspirer au rôle de "chefs" en se substituant a l'initiative spontanée des ouvriers;
- la confusion entre conseils ouvriers et organisations politiques ramène plusieurs décennies en arrière le mouvement ouvrier lorsque dans l'AIT on trouvait syndicats, partis, coopératives, etc. Ainsi, les Unions ont un programme révolutionnaire inspiré d'ailleurs de celui du KAP, mais sont mi-chèvres mi-chou, mi-politiques et mi-syndicales. Une telle confusion mena inévitablement à un néosyndicalisme révolutionnaire. Ce n'est pas par hasard si l'AAU-E - proche de Rühle et de Pfemfert -collabora rapidement avec les anarcho-syndicalistes de la FAUD
- finalement, le conseillisme politique glisse fatalement vers un semi-anarchisme, dans sa pire forme, l'individualisme. Rühle lui-même glissa progressivement vers un anti-marxisme anarchisant, pour ne voir dans Marx qu'un bilieux impénitent face à Bakounine. Son culte de l'individualisme débouche sur la "pédagogie" de l'ouvrier individuel, dont l'esprit est celui de "la cheminée d'usine", pour reprendre l'ironique expression du KAP définissant l'individualisme saxon.
DANGER "CONSEILLISTE" DANS LA REVOLUTION.
Le conseillisme ne fait qu'exprimer les faiblesses de la classe ouvrière. Il est d'abord une réaction négative, alors que la classe passe d'un état de confiance aveugle dans ses anciennes organisations - gagnées progressivement par l'opportunisme pour sombrer finalement dans la contre-révolution - à un état de défiance à l'égard de toute organisation politique. Les tendances conseillistes en Allemagne, pendant la révolution, furent directement proportionnelles à la naïve confiance qu'accordèrent en novembre-décembre 1918 les ouvriers allemands organisés en conseils à la social-démocratie, qui devait les massacrer pendant 3 années durant. Face à ce que les ouvriers croyaient n'être qu'une trahison des "chefs", chaque organisation sécrétant le "poison" des chefs, se développèrent des tendances anti-parti et "anti-autoritaires" (anti-"bonzes"). Le repliement des ouvriers d'industrie dans des organisations d'entreprise locales (Betriebsorganisation des unions) et des unions corporatives (union des mineurs, union des marins en 1919) n'était pas l'expression d'une force croissante d'une classe se ressaisissant après le massacre de janvier 1919,[mais le produit d'une faiblesse énorme, sous le coup d'un terrible déboussolement.
Parce qu'elle se déroule dans un pays hautement industrialisé, clef de la révolution mondiale, la lutte de classe en Allemagne est beaucoup plus caractéristique de la révolution communiste de demain que celle qui se déroula en Russie. Les réactions de type conseilliste où le prolétariat dans les conseils manifestera la plus grande méfiance pour toute organisation révolutionnaire sont des réactions qu'un parti révolutionnaire devra affronter avec la plus grand fermeté
Ces réactions seront d'autant plus puissantes que la contre-révolution stalinienne et l'image du parti unique dans les pays de l'Est - à côté d'une certaine méfiance des ouvriers pour les partis politiques de gauche - ont rendu la classe viscéralement méfiante à l'égard de toute organisation révolutionnaire. De telles réactions expliquent - conjuguées avec le totalitarisme de l'Etat qui rend impossible toute organisation révolutionnaire de masse - le manque d'engagement politique militant dans la classe. Malgré l'écho grandissant de leurs positions et de leurs interventions, les militants révolutionnaires inévitablement se heurteront à des préjugés tels : "la révolution avec des partis, même révolutionnaires, mène à la dictature". Il est vrai que le bordiguisme, avec sa conception d'un parti unique exerçant la "dictature rouge" par la violence dans la classe, avec son soutien odieux du massacre des ouvriers et marins de Kronstadt, ne peut que renforcer les réflexes conseillistes au sein ae la classe. On peut même dire que le bordiguisme et le néo-bordiguisme sont les meilleurs sergents recruteurs du conseillisme.
Les organisations révolutionnaires, et le CCI en particulier, doivent être conscientes que leur action organisée dans les conseils de demain ne sera pas facile. Elles seront le plus souvent au début interdites de parole, car organisées en partis. La bourgeoisie d'ailleurs, à travers ses agents les plus dangereux que sont les syndicalistes de base, ne manquera pas d'attiser les sentiments anti-organisation des ouvriers, voire leurs réflexes ouvriéristes, en présentant les organisations révolutionnaires comme des organisations d'"intellectuels" voulant "diriger" la classe pour prendre le pouvoir. Comme Rosa Luxemburg en 1918, les militants non ouvriers du parti pourront être exclus de toute prise de parole dans les conseils, sous prétexte qu'ils ne sont pas ouvriers.
Le danger de conseillisme dans les événements révolutionnaires ne doit donc pas être sous-estime, Il peut même être mortel. Dans la mesure où les idées anti-organisation prédominent, le prolétariat peut être en proie aux provocations les plus délibérées de la bourgeoisie. Le culte des minorités agissantes "anti-autoritaires" peut mener au putschisme le plus dévastateur pour la classe. La méfiance pour le programme et la théorie révolutionnaires, censés violer la conscience de l'ouvrier individuel, ne peut que favoriser l'emprise de l'idéologie petite-bourgeoise individualiste véhiculée par la troupe innombrable des petits bourgeois prolétarisés par la crise et le chômages Pire, cette méfiance favorise l'emprise de l'idéologie bourgeoise qui est l'idéologie dominante.
UN DANGER REEL DES AUJOURD'HUI, DANS LE MILIEU REVOLUTIONNAIRE.
le danger du conseillisme - bien qu'il se manifeste pleinement dans les événements révolutionnaires - est un danger dès aujourd'hui. Il guette essentiellement le faible milieu révolutionnaire, faute d’une continuité organique avec les organisations révolutionnaires du passé (Gauches communistes). Il se présente sous des formes diverses, toutes aussi négatives :
- l'activisme immédiatisme qui mène fatalement au marais libertaire, sinon gauchiste. ICO en France, "Arbetarmakt" en Suède ont disparu finalement pour leur activisme ouvriériste proche du gauchisme. Un groupe comme "Arbetarmakt" finissait par tomber sous la pression de l'idéologie petite-bourgeoise, puis bourgeoise, en glissant dans un néo-syndicalisme de base ;
- la conception des groupes de travail et d'études mène à une remise en cause du rôle militant des révolutionnaires ; cénacles d'où l'on observe de haut la lutte de classe. Ces groupes mettent en cause finalement le rôle révolutionnaire du prolétariat et tombent très facilement dans le pessimisme ou le modernisme. Les avatars issus du cercle de Barrot ("le mouvement communiste") en témoignent. De tels cercles n'ont rien à voir avec le milieu révolutionnaire ; ils ne font que patauger dans la confusion distillée par une petite-bourgeoisie en pleine décomposition ;
- l'idéologie "anti-bolchévik" - où tout le passé révolutionnaire des bolcheviks est volontairement nié - ne peut que mener à une remise en cause de] toute l'histoire du mouvement ouvrier et même à une remise en cause du marxisme. L'évolution dur groupe "Pour une Intervention Communiste" en France (P.I.C.) est symptômatique. De l'activisme primitif, il y a glissement vers l'esprit de cercle d'étude académique. Bientôt - à l'exception de la "Gauche polonaise"([8] [808]), dada de certains militants du P.I.C. - l'ensemble du mouvement révolutionnaire est considéré comme marqué par l'esprit de parti. Marx lui-même devient le grand responsable de tous les malheurs du mouvement ouvrier en "inventant" le concept (sic!) de parti. Pire encore, toute cette réaction "anti-bolchévik" ne peut mener qu'à des compromissions avec le socialisme de gauche (cf. la dissolution finale des membres du P.I.C. dans les "cahiers Spartacus", éditeurs de brochures de socialistes de gauche les plus divers) ;
- la sous-estimation du rôle de l'organisation, et ne voyant plus que la conscience des ouvriers pris comme autant d'entités aussi - sinon plus - conscientes que l'organisation, mène à sa propre négation, comme partie militante de la classe. Cette sous-estimation est un véritable suicide pour les militants qui défendent dans des organisations ou cercles des positions conseillistes. C'est ce danger qui menace les groupes se réclamant du "Communisme des Conseils".
Même si aujourd'hui le conseillisme s'est désagrégé, principalement en Europe occidentale, étant un rassemblement hétéroclite de cercles aux positions floues et viscéralement anti-organisation, son idéologie subsiste. Les groupes de discussion qui ont surgi ces dernières années en Scandinavie (Danemark) et au Mexique sont particulièrement vulnérables à ces conceptions. Il est évident que le CCI n'a pas à ignorer de tels groupes et à les laisser s'enfoncer dans leur confusion. Il est conscient que la rupture organique avec les organisations de la Gauche communiste fera de plus en plus surgir des groupes très confus se réclamant du communisme des conseils, et marqués en fait par une idéologie conseilliste individualiste petite-bourgeoise. Le CCI a une responsabilité énorme - en étant devenu avec l'éclatement du PCI le seul véritable pôle révolutionnaire au niveau international - qui pèse sur ses épaules pour faire évoluer de tels cercles vers une conception marxiste militante. De tels cercles, qui bien souvent sortent de la petite-bourgeoisie avec ses préjugés et ses préoccupations académiques, dans le milieu estudiantin, sont particulièrement vulnérables à l'idéologie conseilliste. Le CCI ne pourra amener de tels éléments, comme il a pu le faire en Suède et en Hollande, à une conception révolutionnaire prolétarienne que s'il reste intransigeant dans sa conception d'une organisation centralisée et militante et s'il combat avec la plus grande énergie, sans la moindre hésitation ou oscillation, les concept ions conseillistes.
Ce danger conseilliste ne guette pas seulement les groupes confus ou les cercles de discussion ; il peut se manifester jusque dans les rangs des groupes se revendiquant de la Gauche communiste italienne, tels "Battaglia Comunista" et maintenant l'anguille politique nommée CWO. Leur conception d'une double organisation politique avec le "parti" (mégalomanie oblige) et les groupes d'usine" (groupes fantômes) n'est pas sans rappeler celle du KAPD avec ses organisations d'usine, avec le bluff en plus, et toutes proportions gardées puisqu'il est difficile de comparer des nains avec le géant que fut le KAPD. Demain, la logique du bluff des "groupes d'usine" pourrait les pousser à dissoudre, par pur suivisme, leur organisation politique en en faisant un simple appendice de ces groupes, pour peu qu'ils rencontrent un écho dans la classe. Bien qu'hostiles par principe - par ignorance ou opportunisme, ce qui vaut dans le premier cas pour "Battaglia Comunista" et dans le second pour la CWO champion tous azimuth des tournants politiques - au KAPD, ces deux petits groupes qui se gonflent d'importance feraient bien de modestement étudier l'histoire du KAPD. A force de prêcher la double organisation, le KAPD allait finalement commencer à se désagréger en 1929, la plus grande partie s'organisant en une Union activiste (la KAU), tandis que les restes du KAPD maintenu - hostiles désormais à toute double organisation - ne constituaient plus qu'un tout petit groupe. Le suivisme avéré de "Battaglia Comunista" et du CWO pour des organisations iraniennes nationalistes du type "Komala" ou "parti communiste d'Iran" n'augure rien de bon sur la capacité de ces organisations à maintenir fermement un cadre programmatique et organisationnel intransigeant.
Le danger du conseillisme ne se trouve donc pas seulement chez les négateurs de parti ; il peut menacer même une organisation révolutionnaire aussi armée que le CCI. Il est d'autant plus dangereux que bien souvent le conseillisme n'ose dire\son nom et se cache derrière une reconnaissance formelle du cadre programmatique et organisationnel centralisé.
Le CCI demeure plus que jamais vigilant pour remplir sa fonction militante dans la classe. Il est convaincu que sa fonction est irremplaçable et qu'il explique de la façon la plus 'élevée la conscience de classe. Son fonctionnement centralisé est décisif pour maintenir son cadre programmatique légué par les gauches communistes.
Le CCI, comme le KAPD et "Bilan", est convaincu du rôle décisif du parti dans la révolution. Sans parti révolutionnaire, fruit d'un long travail de regroupement et de bataille politique, il ne peut y avoir de révolution prolétarienne victorieuse. Aujourd'hui, toute sous-estimation du rôle de l'organisation, toute négation de la nécessité d'un parti dans la révolution, ne peut que contribuer à la désagrégation d'un milieu révolutionnaire déjà particulièrement faible.
Le danger conseilliste est un danger face auquel le CCI doit être particulièrement armé, jusque dans son sein. En soulignant le danger des oscillations conseillistes, qui n'osent dire leur nom, le CCI ne tombe pas ou ne régresse pas vers une sorte de "bordiguisme" ou de "léninisme".
L'existence du CCI est le fruit de toutes les fractions communistes du passé. Il défendra leurs acquis positifs - à la fois contre les groupes de tendance conseilliste et les groupes bordiguistes, sans en reprendre les côtés négatifs : substitutionnisme dans la gauche russe, négation du parti dans la gauche hollandaise, double organisation dans la gauche allemande. Le CCI n'est pas une organisation passéiste. Le CCI n'est ni "conseilliste" ni "bordiguiste", il est le produit actuel de la longue histoire de la gauche communiste internationale. C'est par une lutte politique sans concessions contre toute hésitation touchant sa fonction et sa place dans la lutte de classe que le CCI pourra être à la hauteur de ses prédécesseurs et même les dépasser dans le feu du combat.
Chardin.
[1] [809] cf. " Bulletin d'études et de discussions" 1974.
[2] [810] Le 1er numéro de R.I. manifestait des tendances conseillistes. Mais en 1969, fut présenté à la conférence nationale d'ICO, un texte très clair sur la nécessité d'un parti (cf. R.I. ancienne série n°3).
[3] [811] Cf la brochure organisations communistes et conscience de classe,
[4] [812] "Dialogue avec les morts" et "Dialogue avec Staline" (sic!) sont les titres de brochures de Bordiga
[5] [813] Résolution du CCI en janvier 1984 : "Il existe entre les moments de lutte ouverte, une maturation souterraine de la conscience (la "vieille taupe" chère à Marx), laquelle peut s'exprimer tant par l'approfondissement et la clarification des positions politiques des organisations révolutionnaires, que par une réflexion et une décantation dans 1'ensemble de la classe, un dégagement des mystifications bourgeoises.
[6] [814] cf. Marx, "Idéologie Allemande" (La Pléiade, p. 1122) : Marx parle de la "conscience de la nécessité d'une révolution en profondeur". Cette conscience communiste est produite "massivement" par une transformation" qui touche la masse des hommes, laquelle ne peut s'opérer que dans un mouvement pratique, dans un révolution". (p. 1123).
[7] [815] Nous donnons ici des extraits de la résolution adoptée en janvier 84 (et qui a provoqué des "réserves" et désaccords de la part de certains camarades) : "Même si elles font partie d'une même unité et agissent l'une sur l'autre, il est faux d'identifier la conscience de classe avec la conscience de la classe ou dans la classe, c 'est à dire son étendue à un moment donné... Il est nécessaire de distinguer ce qui relève d'une continuité dans le mouvement historique du prolétariat : 1'élaboration progressive de ses positions politiques et de son programme, de ce qui est lié aux facteurs circonstanciels : 1'étendue de leur assimilation et de leur impact dans la classe."
[8] [816] Ces militants font la preuve qu'ils ne connaissent pas grand chose à l'histoire ; le parti bolchevik auquel ils reprochent d'être trop centralisé, l'était bien moins encore que cette Gauche Polonaise, la SDKPiL
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Le Communisme de Conseil [162]
Heritage de la Gauche Communiste:
La constitution du BIPR : un bluff opportuniste – 1° partie.
- 3117 reads
Avec la publication du premier numéro, (avril 1984) en anglais et en français de la "Revue Communiste", le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire récemment formé par le PC Internationaliste (BC) d’Italie et la CWO de Grande-Bretagne, a enfin trouvé une voix. L'événement est d'autant plus important que l'effondrement du PC International (Programme Communiste) avait privé les organisations issues de la tradition "bordiguiste" du PC Int fondé en 1943 de toute expression sur le plan international. Le regroupement de BC et de la CWO est l'aboutissement d'un processus annoncé par la CWO (RP n°18) après la 3ème Conférence Internationale. Le milieu prolétarien aurait été en droit d'attendre un compte rendu des discussions qui avaient permis aux deux groupes de surmonter leurs divergences programmatiques au point de fonder une organisation commune. La formation du BIPR est dans la droite lignée des manoeuvres qui ont saboté les Conférences Internationales ; elle est faite d'un bluff et d'un opportunisme politique qui ne peut que déconsidérer l'importance des organisations révolutionnaires et du rôle qu'elles ont à jouer dans la lutte de classe.
La véritable scission dans les conférences internationales
Incapables de comprendre leurs origines de façon scientifique, historique, les peuples primitifs ont inventé des explications mythiques de la création du monde et de l'humanité. BC et CWO qui ne comprennent guère mieux les origines et les fonctions de l'organisation révolutionnaire, ont inventé une histoire mythique des Conférences Internationales afin d'expliquer la création du BIPR. Si nous ne nous donnons pas le but ici de défendre notre conception des conférences (voir article dans ce numéro), une mise au point historique est néanmoins nécessaire.
D'après ce mythe de la création, c'est grâce à la clarté de BC que les Conférences ont vu le jour :
"Face à la nécessité de serrer les rangs et de relancer de façon systématique et organisative le travail politique des révolutionnaires au sein du prolétariat mondial, une pluralité de groupes et d'organisations non reliés entre eux se présentaient divisés par des divergences politiques et théoriques dont ils ignoraient 1'existence et la nature.
Concentrés dans un travail local ou de pure abstraction théorique ils étaient incapables de se comporter de façon à jouer un rôle dans les événements qui se préparaient alors et qui se préparent encore aujourd'hui...cette situation devait être bousculée, il fallait faire tout ce qui était possible pour la modifier..(..)..A cette nécessité le PC Int. répondait en convoquant une première Conférence internationale entre les groupes qui se reconnaissaient dans les critères suivants ;
- acceptation de la révolution d'Octobre comme révolution prolétarienne,
- reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie opérée par les 1er et 2ème Congrès de 1'Internationale Communiste,
- refus sans aucune réserve du capitalisme d'Etat et de 1'auto-gestion,
- refus des PC et PS en tant que partis bourgeois,
- refus de toute politique de soumission du prolétariat à la bourgeoisie nationale,
- orientation à l'organisation des révolutionnaires qui se réfèrent à la doctrine et à la méthodologie du marxisme comme science du prolétariat." (Revue communiste n°1)
Bravo Battaglia ! Mais pourquoi, en 1976, était-il devenu nécessaire de "serrer les rangs" ? Qu'est-ce qui avait changé depuis 1968, quand le petit noyau qui allait devenir RI vous a demandé de lancer une conférence afin de faire face à la nouvelle situation créée par les grèves de 68 ? Qu'est-ce qui avait changé depuis novembre 1972, quand nos camarades d'Internationalism (qui allait devenir notre section aux USA) ont lancé un appel à une "correspondance internationale" dans la perspective d'une conférence internationale ? A l'époque vous avez répondu :
- "qu'on ne peut pas considérer qu'il existait un développèrent conséquent de la conscience de classe,
- que même le fleurissement de groupes n'exprime pas autre chose que le malaise et la révolte de la petite bourgeoisie,
- qu'il nous fallait admettre que le monde est encore sous le talon de l'impérialisme".
En plus "à la suite des expériences que notre parti a fait dans les temps passés, nous ne croyons pas au sérieux et à la continuité de liens internationaux établis uniquement sur de simples bases cognitives (correspondance, contacts personnels et débats entre groupes sur des problèmes théoriques et de praxis politique) "
(Lettre de BC à Internationalism, 5/12/72 : citée dans la lettre du CCI à BC du 9/6/80. Voir compte-rendu de la 3ème Conférence Internationale). Qu'est-ce qui avait changé en 1976 ? La lutte de classe ? Les tensions entre puissances impérialistes ? C'est en vain qu'on cherche une réponse dans les textes du BIPR.
Par contre, si on relit le texte de convocation de la 1ère Conférence, on se rend compte que la nouvelle situation qui a poussé BC à son appel n'est ni le développement de la lutte de classe (puisque la vague de luttes qui va de 1968 à 74 est vue par BC comme une simple affaire d'étudiants et de couches petites-bourgeoises) ni le développement des tensions inter-impérialistes mais ...la "social-démocratisation des partis Communistes". Depuis ce fameux "Euro-communisme" s'est révélé purement conjoncturel, lié à la période de la gauche au pouvoir face à la lutte de classe. BC, par contre, ne s'est toujours pas révélée capable de comprendre la signification de La rupture avec la contre-révolution constituée par les luttes de 1968-74.
Quant aux critères d'adhésion à la Conférence, On n'en trouvera pas trace dans les textes de BC. Au contraire, c'est le CCI qui répond à BC : "Pour que cette initiative soit une réussite, pour qu'elle soit un véritable pas vers le rapprochement des révolutionnaires, il est vital d'établir clairement les critères politiques fondamentaux qui doivent servir de base et de cadre, pour que la discussion et l'affrontement des idées soient fructueux et constructifs..(..)..Les critères politiques pour la participation dans une telle conférence doivent être strictement délimités par :
- Le rejet de toute mystification sur l'existence 5e pays socialistes ou sur la voie du socialisme,
- le rejet de toute idée que les PC , les PS , et autres sont des organisations ouvrières,
- le rejet de toute alliance et action commune, même temporaire, avec de telles organisations, aussi bien qu'avec ceux qui prônent la possibilité de telles alliances,
- la dénonciation de toutes les guerres de soi-disant libération nationale et indépendance,
- l'affirmation que la révolution communiste est une révolution de classe et que la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire de cette époque.
- l'affirmation que "l'émancipation de la classe ouvrière est la tâche de la classe elle-même, et que ceci implique la nécessité d'une organisation, de révolutionnaires au sein de la classe".
(2ème lettre du CCI au PC Int le 15/7/76, compte-rendu de la 1ère Conférence)
Ce sait les critères que nous avons proposés et défendus dès avant les conférences. Mais BC peut au moins se vanter d'une originalité : la proposition d'un critère supplémentaire, celui de la reconnaissance des conférences comme faisant partie du "processus qui doit conduire à la constitution du parti international du prolétariat, organe politique indispensable à la direction politique du mouvement , révolutionnaire de la classe et du pouvoir prolétarien lui-même." (Revue Communiste n°l) Ce critère est introduit dans le but, on ne peut plus "sérieux", d'exclure le CCI des Conférences et donc d'ouvrir la voie "à la constitution du parti international". "La conclusion de la 3ème Conférence est la prise d'acte nécessaire d'une situation en phase de dégénérescence, c'est la fin d'une phase de travail des Conférences ; c'est la réalisation de la première sérieuse sélection des forces.. .Nous avons assumé la responsabilité qu'on est en droit d'attendre d'une force sérieuse dirigeante". (Réponse de BC à notre "Adresse au milieu").
On ne juge pas un individu d'après l'idée qu'il a de lui-même mais par ce qu'il fait ; de la même façon, une position politique abstraite et platonique ne vaut rien : l'important c'est son application dans la pratique. Il n'est donc pas sans intérêt d'examiner le compte rendu de la 4ème "Conférence Internationale", dont l'ouverture annonce déjà : "maintenant il existe le fondement du début du processus de clarification sur les véritables tâches du parti.. (..)..Bien qu'aujourd'hui nous n’ayons moins de participants qu'aux 2ème et 3ème Conférences, nous commençons sur une base plus claire et plus sérieuse" (c-r 4ème Conférence).
Déjà on peut juger le grand "sérieux" de cette Conférence par le fait :
- que le "Comité Technique" (BC/CWO) est incapable de publier le moindre bulletin préparatoire pour la Conférence, ce qui est d'autant plus gênant que la Conférence est tenue en anglais, et que les textes de référence de BC sont tous publiés en italien,
- que le groupe qui organise la "Conférence" est incapable de traduire la moitié des interventions,
- que la "Conférence" se tient en 1982 et qu'on doit attendre... deux ans pour disposer du compte rendu! A ce rythme là, il faudrait attendre la période de transition pour que le BIPR se décide à prendre le pouvoir !
Mais ce serait mesquin de notre part de nous attacher à de tels détails "pratiques" sans importance. Passons donc en revue les "forces" que BC et CWO ont "sérieusement sélectionnées" pour "commencer le processus de clarification des tâches du parti" :
- il y a "Marxist Worker" des USA ;
- il y a "Wildcat", aussi des USA : on ne sait pas ce que Wildcat -une organisation dans le sillon conseilliste- fait là dedans, mais de toute façon ce n'est pas grave, puisqu'au moment de la "Conférence" ce groupe n'existe plus, pas plus que Marxist Worker d'ailleurs ; il ne risque donc pas d'être appelé à contribuer "sérieusement" à l'édification du parti ;
- ensuite il y a "l'Eveil Internationaliste","qui a été d'accord pour assister, mais malheureusement n'a pas pu (ouverture 4ème Conférence) ; franchement, on ne sait pas pourquoi l'Eveil était invité, étant donné qu'à la 3ème Conférence ils ont refusé de se prononcer sur le critère de BC, en disant que "BC et le CCI ont toujours voulu voir dans les Conférences un pas vers le Parti. Ce n'est pas le cas.. (.-.) On ne peut masquer les divergences derrière des résolutions manœuvrières, ou des critères discriminatoires..(..). .Nous réaffirmons que actuellement nous ne pouvons déboucher sur une clarification qui soit un pas en avant vers la constitution du Parti" (c-r de la 3ème Conférence p. 48,52);
- le Groupe Kommunistische Politik (Kompol) (Autriche) est invité mais n'est pas venu, pour des raisons peu claires ; ce qui est fort instructif, par contre, c'est la correspondance entre Kompol et BC. Kompol demande que l'invitation soit élargie afin d'inclure les groupes italiens "Lega Leninista" et "il Circolo Lenin". BC répond : "Le dernier document que nous avons reçu de vous et de ces organisations n'ajoute rien sur la Pologne à ce qui a été dit déjà par d'autres formations qui se réclament, plus ou moins correctement, de la gauche italienne..(..).. Dans l'ensemble, nous pensons que nous sommes les seuls, du moins en Italie, qui ont fait un examen approfondi, précis, et à jour des tendances récentes, et d'avoir dégagé des conclusions et des lignes d'orientation révolutionnaires, qui attendent encore une réponse des nombreux "révolutionnaires" qui encombrent le milieu "italien", (lettre de la CE du PC Int, c-r de la 4ème Conférence) .Voilà BC qui introduit, en douceur, un critère supplémentaire pour la participation aux Conférences : si on est italien il faut être d'accord avec l'analyse de BC sur la Pologne! La leçon est claire : en Italie au moins, BC a l'intention de rester "maître chez soi" ; en fin de compte la seule "force sérieuse" à la 4ème Conférence est le SUCM d'Iran sur lequel nous reviendrons dans la suite de cet article. Pour l'instant il suffit de dire que si le SUCM est effectivement "pour" le Parti, c'est pour la simple raison qu'il fait partie du courant maoïste ce qui le place irrémédiablement en dehors du camp prolétarien. C'est avec une telle "sélection sérieuse" que BC/CWO entendent aller vers "la constitution du Parti international".
Tous les anciens mythes de la création mettent sur scène trois éléments : le Bien, le Mal et les simples mortels. Dans la mythologie de BC-CWO il y avait aux Conférences, le Bien (BC-CWO), le Mal (le CCI) et de simples mortels constitués par "Divers groupes (qui) se présentaient non seulement désarmés sur le plan théorique et politique, mais de plus, par leur nature même, ils ne pouvaient tirer aucun élément positif de la polémique en cours pour favoriser leur propre croissance politique et la maturation." (Revue Communiste)
Ici, comme dans la Bible, on "arrange" un peu l’histoire; pour les besoins du mythe. Ainsi on "oublie" que pendant les Conférences, et en partie grâce à elles le groupe For Konmunismen a su "favoriser sa propre croissance et: maturation" en devenant la section du CCI en Suède.
Quant au Mal, il est évidemment incarné par le CCI, "faiseurs de résolutions" (CWO), qui "veulent faire passer les divergences pour des problèmes de formulations" (BC : c-r de la 2ème Conférence Internationale). C'est le CCI qui "voulait que les Conférences imitent, sur une échelle plus large, sa propre méthode pour résoudre les divergences politiques –c’est à dire les minimiser- afin de maintenir l'unité de l'organisation" (RP n°18). C'est le CCI, dont "la motivation (en rejetant l'opposition à la libération nationale en tant que critère de participation aux Conférences Internationales) était marxiste dans sa forme, nais opportuniste dans son contenu, puisque le but était de faire accepter l'adhésion aux réunions futures de leurs sbires Nucleo Ccmunista, un groupe bordiguiste avec lequel le CCI a manoeuvré de façon opportuniste contre le PC Int" (RP n°21). C'est le CCI qui "a fait de son mieux pour saboter tout débat significatif à la 3ème Conférence en refusant une résolution parfaitement franche sur le rôle fondamental du parti révolutionnaire proposée par BC. Dans la réalité, le CCI est toujours le premier pour saboter la discussion dans un nuage de verbosité". (WV n°16)
Loin de nous de plaider pour Satan. En tant que marxistes révolutionnaires, ce qui nous intéresse, c'est la réalité historique du prolétariat et de ses organisations politiques. Ainsi, nous rappelons à BC/CWO que ce n'est certainement pas le CCI qui veut faire passer les divergences politiques pour des problèmes de formulation ; même avant la 1ère Conférence, c'est BC qui propose, pour l'ordre du jour, "les moyens de discuter et dépasser les divergences techniques et pratiques entre les groupes (telles que le parti et les syndicats, le parti et les conseils, l'impérialisme et les guerres coloniales et semi-coloniales). " (3ème lettre circulaire du PC Int, c-r 1ère Conférence)
A quoi nous répondions : "Nous devons nous garder de précipiter les choses et escamoter nos divergences, tout en maintenant un engagement solide et conscient envers la clarification et le regroupement des révolutionnaires. Ainsi, bien qu'un accord avec l'ordre du jour proposé, nous ne comprenons pas pourquoi des questions telles que "parti et syndicat, parti et conseils, impérialisme et guerres coloniales ou semi-coloniales" sont vues comme "divergences techniques et pratiques" (c-r 1ère Conférence). Quant aux résolutions que nous avons proposées aux conférences, il suffit de lire la première (c-r 1ère Conférence) pour se rendre compte que son but est de mettre en avant avec le maximum de clarté possible, ce qui réunit le PC Int et le CCI et ce qui les distingue, comme base de discussion et de clarification.
Le BIPR est d'ailleurs fort mal placé pour parler, de "minimisation de divergences" - nous le verrons plus loin.
Pour ce qui est de nos "sbires", si notre but au sein des Conférences était de manoeuvrer, de les "contrôler", de façon opportuniste nous n'avions nullement besoin de "sbires". Il nous suffisait d'accepter l'invitation initiale de BC, adressée non pas au CCI en tant que tel, mais à nos diverses sections territoriales ; le calcul arithmétique est simple : neuf sections territoriales égalent neuf votes dans les Conférences, largement suffisant pour que nous puissions "contrôler" les Conférences du début jusqu'à la fin, voter toutes les résolutions qu'il nous plaisait, faire que les Conférences prennent position autant que nous l'aurions voulu. Au lieu de cela, nous avons répondu : "puisque nous ne sommes pas une fédération de groupes nationaux, mais un Courant international avec des expressions locales, notre réponse ici est celle de tout le Courant". En réalité, la critique principale qu'on peut adresser au CCI lors des Conférences n'est pas celle de l'opportunisme, mais celle de la naïveté. Notre conception de l'action révolutionnaire exclut les majorités de façade, les magouilles, les manoeuvres dignes du crétinisme parlementaire, et nous étions suffisamment naïfs pour penser qu'il en était de même pour BC, pour la CWO ; qu'ils se rassurent nous ne nous tremperons pas une deuxième fois.
Quant à nos "manoeuvres opportunistes", on ne peut que remarquer que la CWO est incapable de donner le moindre exemple concret, et encore moins documenté - et ce n'est pourtant pas l'envie qui leur fait défaut. Après tout ce n'est pas le CCI mais BC et la CWO qui tenaient des réunions intergroupes clandestines dans les coulisses de la 3ème Conférence. Ce n'est pas le CCI mais BC qui, après avoir nié tout désir d'exclure le CCI jusqu'à la veille de la 3ème Conférence, a lancé leur critère d'exclusion à la fin de cette même conférence. Pourquoi ? Pour pouvoir faire voter leur manoeuvre après le départ de la délégation du NCI, dont les interventions avaient soutenu notre rejet de ce critère, (voir le compte rendu de la 3ème Conférence et la lettre du CCI au PC Int suite à leur opération de sabotage). Ce genre de manoeuvre, bien connu dans le parlement américain sous le non de "filibuster", est digne de démocrates bourgeois, pas de révolutionnaires prolétariens.
C'est avec ces méthodes de parlementaires bourgeois que BC/CWO ont l'intention de construire le Parti de Classe qui défendra les principes du communisme au sein du mouvement prolétarien.
Pour quel parti ?
Apparemment pour BC/CWO, la fin justifie les moyens ; et la fin, au moins provisoirement, c'est le fameux BIPR. Le Bureau est un animal véritablement bizarre, qui nous fait penser à cette créature mythique, le Griffon qui est constitué à partir de plusieurs animaux réels : la tête et les ailes d'un aigle, les pattes de devant d'un lion et la queue d'un dauphin. Afin de déterminer la véritable nature du Bureau, il nous semble nécessaire de procéder par élimination, et décider d'abord ce que le Bureau n'est pas.
D'abord, le Bureau n'est pas un simple comité de liaison, canne par exemple l'ancien Comité Technique des Conférences Internationales. La fonction du CT était de coordonner un travail entrepris en commun par plusieurs organisations séparées, sans que cela implique un quelconque regroupement, ni identité de positions politiques. Le CT exécutait des tâches à la fois "techniques" (édition de bulletins etc.) et "politiques" (décisions sur l'ordre du jour des Conférences, sur les groupes devant y participer, etc.) ; tout ceci dans le cadre des critères d'adhésion aux Conférences acceptés par ses participants. Par contre, le Bureau qui se définit comme "produit d'une première sélection et d'un processus d'homogénéisation dans le cadre des quatre premières Conférences Internationales" (Statuts, Revue Communiste n°1) ressemble plus à une véritable organisation politique où l'adhésion est basée sur une plateforme de positions politiques, et dont le fonctionnement est déterminé par des Statuts. On considère apparemment que la plateforme constitue une homogénéité politique, puisque : "Sauf cas exceptionnel et pour une période transitoire, il ne peut exister qu'une organisation adhérente dans un même pays" (Statuts) .Dès le départ le Bureau est infecté par une forte dose de fédéralisme : les organisations adhérentes dans différents pays gardent leur identité distincte, et "le Bureau entretiendra des rapports seulement avec les comités dirigeants de celles-ci" (Statuts). Encore un signe du désir, si cher au petit-bourgeois, de rester "maître chez soi".
Cependant, le BIPR n'est pas non plus une organisation politique, au moins pas dans le sens où nous l'entendons. Le CCI est une seule organisation internationale, basée sur une seule plateforme ([1] [817]), des statuts communs et dont les sections dans chaque pays ne sont que les expressions locales de l'ensemble. Fidèle au principe communiste de la centralisation, le CCI dans son ensemble est représenté par son Bureau International, élu au Congrès International ; les positions du BI sont toujours minoritaires à tous les niveaux de l'organisation, tout comme l'ensemble prime sur la partie.
Le BIPR, par contre, n'est pas une seule organisation ; il doit "organiser et coordonner le travail d'intervention (des organisations affiliées) et favoriser leur homogénéisation politique dans la perspective de leur centralisation organisative" (Statuts). Il n'a pas non plus une seule plateforme, mais trois : celle du Bureau, de BC, de La CWO (sans compter les plateformes "des groupes d'usines", "groupes de chômeurs", etc., un véritable embarras de richesses). En regardant le contenu de la plateforme du BIPR, nous sommes en droit de demander à BC/CWO quelle est leur "méthode pour résoudre les divergences politiques., afin de maintenir l'unité de l'organisation" sinon les "minimiser" ; quelle position, par exemple, doivent défendre les malheureux "camarades français","considérés comme militants du Bureau" (Statuts), sur le parlementarisme révolutionnaire, quand on sait que BC est pour, la CWO plutôt contre, tandis que la plateforme du BIPR, n'en parle pas du tout. Effectivement, nous ne pouvons pas accuser BC et la CWO de "minimiser" leurs divergences : ils les font carrément disparaître !
"Le Bureau n'est pas le Parti, il est pour le Parti" (Revue Communiste). Mais "pour" quel type de Parti est-il ?
Ici n'est pas le lieu pour revenir sur nos conceptions de base sur la constitution et la fonction du Parti de classe : nous renvoyons le lecteur à nos textes, notamment celui "Sur le Parti" du 5ème Congrès du CCI. Cependant, il faut, insister que la notion de Parti ne peut pas inclure tout et n'importe quoi, et un aspect essentiel de cette notion est le lien étroit entre l'existence du Parti et le développement de la lutte de classe. Le Parti est nécessairement une organisation politique avec une large influence au sein de la classe ouvrière, qui la reconnaît comme une de ses expressions.
Cette influence ne saurait être réduite à une simple question d'action mécanique du Parti où les "idées révolutionnaires" gagnent une "audience" de plus en plus grande dans la classe. Ceci, en fin de compte, revient à la vision idéaliste pour qui les "idées" du Parti deviennent la force motrice de la "masse" inerte du prolétariat. Dans la réalité il s'agit d'un rapport dialectique entre parti et classe, où l'influence croissante du Parti dépend de la capacité organisationnelle du prolétariat dans les assemblées et les soviets de faire sien et de mettre en action les orientations politiques du parti. Le programme révolutionnaire n'est pas simplement une question "d'idées" mais une "critique pratique" pour reprendre le terme de Marx. Seulement à travers l'action révolutionnaire de la classe ouvrière les positions du Parti peuvent trouver une vérification concrète : "la question de savoir si le penser humain peut prétendre à la vérité objective n'est pas une question de théorie, mais une question pratique." (Thèses sur Feuerbach)
On ne peut donc parler de Parti, en période de décadence/ en dehors de périodes révolutionnaires où pré-révolutionnaires, ce qui évidemment ne veut pas dire que le Parti se crée du jour au lendemain, à l'image d'Athéna qui est née adulte de la tête de Jupiter. Il sera le fruit d'un long effort de clarification et d'organisation préalable parmi les minorités révolutionnaires, ou il ne sera pas.
Notre conception du Parti est donc radicalement opposée à celle du bordiguisme "pur" de "Programme Communiste", pour qui c'est le parti qui définit la classe. BC et la CWO, par contre, occupent une position centriste entre les aberrations du bordiguisme et la position marxiste.
La définition du parti donnée par les bordiguistes de Proqramma a au moins la vertu de la simplicité : il existe un Parti Communiste International unique, fondé sur un programme qui est non seulement unique, mais invariant depuis 1848. Pour le BIPR également, l'existence du parti n'a rien à voir avec son "influence" dans la classe, mais dépend du programme, bien que le contenu du programme évolue dans l'histoire :
"La résolution théorique et politique des problèmes liés au repli de la grande expérience bolchevique sur le terrain du capitalisme d'Etat a permis, en pleine seconde guerre impérialiste, la réorganisation, autour de la doctrine et du programme communistes, de petites minorités érigées en parti, en ce sens qu'elles s'opposaient sur le plan théorique, sur le plan politique et sur le plan organisationnel à tous les autres partis bourgeois agissant aussi bien à l'extérieur qu'à 1'intérieur de la classe ouvrière" (Plateforme du BIPR)
Le BIPR reconnaît également que les conditions objectives de l'existence prolétarienne font que le même programme est valable pour tous les pays ; pour lui donc, "l'organe de direction politique pour l'assaut révolutionnaire ne peut être que centralisé et international" (Plateforme).
Un seul programme international donc, défendu par un Parti unique au niveau international. Mais alors à quoi sert le BIPR ? Si BC et la CWO sont vraiment convaincus que "les problèmes liés au repli de la grande expérience bolchevique" ont été "résolus" de façon à permettre "l'érection" d'un parti - c'est à dire le PC Int de 1942 (ou 1945 ? 1952 ?) - alors pourquoi un Bureau pour en créer un autre ? Pourquoi la CWO n'est pas devenue la section du PC Int en Grande-Bretagne ? A en croire le BIPR, il y a encore une étape à franchir :
"La fondation du Parti International du Prolétariat interviendra au travers de la dissolution des diverses organisations qui, à l'échelle nationale auront travaillé à la définition de sa plateforme et de son programme d'action et les auront mis en pratique". (Plateforme)
Voilà le Parti International qui sera fondé à partir d'organisations nationales dont certaines, au moins, sont déjà des partis, sur la base d'une plateforme qui reste à définir malgré la "résolution théorique et politique des problèmes liés à la grande expérience bolchevique". Malheureusement, nous devons faire preuve de la plus grande patience révolutionnaire, puisqu'il n'y a pas la moindre indication dans les textes de BC/CWO de ce qui reste "à définir" dans leurs plateformes.
Au moins nous n'aurons pas à attendre longtemps. "Où est-ce que la conscience communiste réside aujourd'hui au début du processus révolutionnaire ?" nous demande la CWO ("Consciousness and the rôle of revolutionaries, WV 16) ; et elle répond : "Elle réside dans le parti de classe. Le parti est dans la lutte quotidienne de la classe, jouant un rôle d'avant-garde à chaque instant afin de renvoyer à la masse prolétarienne d'aujourd'hui (nous soulignons) les leçons politiques de ses luttes d'hier" (WV 16). Formidable ! Le parti de classe existe déjà ! La conscience communiste "réside dans le parti de classe. Elle réside chez ceux qui débattent, définissent et promeuvent les buts basés sur les derniers 150 ans d'expérience de la lutte prolétarienne" (WV 16). Avec une définition pareille, même le CCI pourrait être le Parti !
Eh bien non, tout n'est pas si simple, parce que quelques paragraphes plus loin dans le même article de WV, nous lisons : "C'est pourquoi nous affirmons le besoin d'un parti qui est constamment actif au sein de la classe ouvrière jusqu'aux limites de ses forces et qui s'unit internationalement afin de coordonner le mouvement de classe à travers les frontières nationales. La naissance d'un tel parti à l'échelle internationale dépend à la fois d'une croissance de la conscience de classe chez les ouvriers et de l'activité croissante des minorités communistes dans la lutte quotidienne" (WV 16, nous soulignons).
Voilà donc la situation : le Parti existe et intervient aujourd'hui, c'est lui qui détient la conscience de classe ; mais le parti de demain reste à construire, grâce à la "croissance de la conscience chez les ouvriers". C'est pour cette raison que la CWO et le Parti Communiste Internationaliste ont crée un Bureau "pour le Parti".
Quant à ce que va faire ce Parti, là aussi nous regrettons la clarté bordiguiste, qui affirme sans détours que le Parti gouverne pour la classe et que la dictature du prolétariat est la dictature du parti. La plateforme de Battaglia, par contre, est. moins nette : d'un côté, "Le prolétariat ne cesse à aucun moment et pour aucune raison d'exercer sa fonction antagonique ; il ne délègue pas à d'autres sa mission historique ni ne délivre de procurations générales, même pas à son parti politique " (Plateforme de BC) ; mais de l'autre côté, le Parti doit "diriger politiquement la dictature prolétarienne", tant que "l'Etat ouvrier (est) maintenu sur la voie de la révolution par les cadres du Parti, qui ne devront en aucun cas se confondre avec lui ou s'y intégrer" (Plateforme de BC).
La CWO n'est pas meilleure : d'un côté, "Le communisme a besoin de la participation active de la masse des travailleurs qui doivent être tout à fait conscients des objectifs révolutionnaires propres au prolétariat, et celui-ci, dans son ensemble, participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique communiste par l'intermédiaire de ses organes de masse dont il contrôle les délégués" ([2] [818]) mais d'un autre côté, comme la CWO l'a plusieurs fois affirmé, c'est le Parti qui prend le pouvoir, et "C'est le parti communiste, avant-garde de la classe, qui organise et dirige le soulèvement révolutionnaire et toutes les actions importantes du prolétariat au cours de la période de transition, et le parti n'abandonnera pas ce rôle tant qu'il faudra un programme politique". (CWO, "La Période de Transition")
Nous attendons avec impatience que les camarades de BC/CWO, qui aiment tant le "concret", nous expliquent "concrètement" comment le Parti va "prendre" le pouvoir que la classe ouvrière "ne délègue pas". En tout cas ce n'est pas chez le BIPR qu'on doit chercher une réponse, puisque sa plateforme n'en souffle mot.
Le BIPR, en fin de compte, n'est ni un simple comité de liaison, ni une véritable organisation politique révolutionnaire. Il n'est pas le Parti, il est "pour" le Parti, mais il ne sait pas vraiment "pour" quel parti il est. C'est un animal encore plus monstrueux que le Griffon et, il faut bien le dire, encore moins viable.
L'incohérence dans la défense des positions de classe
S'il ne s'agissait là que de simples bouffons de music-hall, on pourrait en rire. Mais BC et la CWO font partie des maigres forces révolutionnaires dont la responsabilité est de défendre les positions de classe au sein de la lutte prolétarienne ; leurs défaillances, leurs concessions à l'idéologie bourgeoise dans la défense des principes, affaiblissent le milieu révolutionnaire et la classe dans son ensemble.
Parce qu'elle est une classe exploitée, le développement de la conscience de la classe ouvrière passe à travers une lutte permanente et acharnée. La moindre faille théorique devient une brèche par laquelle l'ennemi de classe peut introduire son poison mortel. C'est pourquoi le marxisme est une véritable arme de combat, indispensable à la lutte ; ceci explique aussi pourquoi les révolutionnaires marxistes ont toujours accordé tant de 1’importance aux questions théoriques générales qui peuvent sembler à première vue très éloignées des problèmes pratiques de la lutte de classe. Tout comme un défaut dans les fondations d'un immeuble affecte la stabilité de toute la structure, un défaut dans les conceptions de base d'une organisation révolutionnaire amène immanquablement l'affaiblissement de l'ensemble de son activité.
Les syndicats et le syndicalisme de base
Les positions de BC/CWO sur la question syndicale sont une démonstration éclatante de ce principe.
Les premières déclarations générales de BC/CWO semblent être d'une clarté irréprochable :
"Le Parti affirme catégoriquement que dans la phase actuelle de la domination totalitaire de 1'impérialisme, les organisations syndicales sont indispensables à 1'exercice de cette domination dans la mesure même où elles poursuivent des buts qui correspondent aux exigences de conservation et de guerre de la classe bourgeoise. En conséquence, le parti estime fausse et rejette la perspective selon laquelle ces organisations pourraient, dans 1'avenir, "avoir à remplir une fonction prolétarienne et selon laquelle le parti devrait opérer un virage et adopter la position de conquérir par l'intérieur leurs postes de direction", (plateforme de BC)
"Au même titre que la social-démocratie, les syndicats montrèrent qu'ils étaient passés dans le camp du capitalisme en 1914 par leur soutien à la guerre impérialiste et leur appui à 1'intérêt national(...)...L'activité syndicale a toujours comme but de contrôler et dévoyer la lutte de classe" (Plateforme de la CWO).
Mais, l'explication du pourquoi de cette situation est fondamentalement erronée. Pour BC/CWO, les syndicats, aussi bien dans le capitalisme ascendant que dans le capitalisme décadent, ont été et sont les "médiateurs" entre le capital et le travail. Leur "fonction historique (est celle) de médiateurs avec le capital" ; ils sont les "médiateurs avec le patronat afin de négocier les termes de vente de la force de travail des ouvriers" (Marxism and the TU Question, RP 20). Il est impossible pour le "capitalisme de réaliser les objectifs de la transformation monopoliste de son économie sans la collaboration des syndicats avec une politique salariale qui concilie les exigences des ouvriers avec celles de la grande industrie" (BC, "Plateforme des Groupes Syndicaux Communistes Internationalistes. -Nous soulignons-)
"Le syndicat est l'organe de médiation entre le travail et le capital" (Plateforme du BIPR). Et la CWO finit même par affirmer qu'au début de la décadence "c'était le capitalisme qui a changé, non pas les syndicats" (TU's and Workers Struggles, WV n°16).
Au contraire, le passage du capitalisme au stade décadent, impérialiste, a modifié la nature des syndicats de fond en comble en les transformant en partie intégrante de l'Etat bourgeois. Evidemment, cette transformation n'a pas été réalisée du jour au lendemain : les syndicats anglais, par exemple, étaient déjà associés aux premières mesures de sécurité sociale dès 1911. Le processus n'était pas non plus immédiatement perçu par les révolutionnaires, comme en témoignent les positions souvent contradictoires de l'IC sur la question syndicale ; mais ceci dit, nous rejetons absolument toute idée de "médiation" qui, en introduisant une vision parfaitement interclassiste du syndicalisme, cache la réalité que, d'organes de la lutte ouvrière contre le capital, les syndicats sont devenus des rouages dans l'appareil policier de l'Etat capitaliste. BC et la CWO n'ont toujours pas compris cette réalité, parce qu'ils n'ont pas compris que le capitalisme d'Etat n'est pas une simple question de gestion d'une économie décadente mais aussi -et même surtout- une question d'un encadrement sans faille de toute la société civile.
Nous ne sommes donc pas surpris de voir la notion de syndicats "appartenant" aux ouvriers, que BC/CWO viennent d'éjecter par la porte, revenir par la fenêtre :
"La nature objective, irrémédiablement contre-révolutionnaire et anti-ouvrière des syndicats dans la période impérialiste ne modifie ni leur composition ouvrière, ni le fait que ce sont des organisations au sein desquelles le prolétariat agit collectivement pour s'auto-défendre au niveau immédiat". (Thèses du 5ème Congrès du PC Int (1982), traduit dans WV 16)
Immanquablement, les défaillances théoriques ont amené des concessions au syndicalisme dans la pratique. Déjà en 1952, BC était loin d'être aussi clair que la CWO aime le prétendre. Malgré la dénonciation de la nature bourgeoise des syndicats, "le parti estime que ses militants doivent participer, dans l’intérêt général du prolétariat, à toutes les manifestations intérieures de la vie syndicale, en critiquant et en dénonçant la politique des dirigeants syndicaux ...(...)...le parti ne sous-estime pas l'importance d'être présent, là où les rapports de force le permettent, aux élections des organes représentatifs du syndicat ou de l'usine" (BC, Plateforme de 1952).
L'ambiguïté est encore plus marquée dans un texte intitulé "Formation et devoirs des groupes d'usines": "A la vie du "groupe d'usine " participent autant les inscrits que les non-inscrits au syndicat ; le devoir du groupe est avant tout celui de conduire la lutte contre l'usage et l'abus de la délégation imposée par la direction syndicale qui limite et empêche la libre participation au syndicat adoptant envers les travailleurs une discrimination policière visant à écarter tous ceux qui sont suspects d'être porteurs d'une ligne syndicale en opposition avec la ligne dominante" (nous soulignons) . En somme c'est la lutte pour la démocratie syndicale...
La plateforme de BC adoptée en 1982 n'est pas plus claire mais elle est plus pudique : on ne parle plus des élections syndicales mais seulement de "l'activité du Parti (qui) sera conduite à l'intérieur ou à l'extérieur des organisations syndicales, suivant les conditions matérielles dans lesquelles les communistes se trouvent."
Par contre, la CWO dans ses derniers textes, est en train d'abandonner la clarté (très relative) de sa propre plateforme. D'après la plateforme (adoptée en 1982) :
"A ceux qui disent que les révolutionnaires doivent travailler à 1'intérieur du cadre syndical (par exemple : dans les comités d'atelier, dans les comités de base, dans les réunions de section) afin d'accroître leur influence dans la classe, nous rétorquons qu'une telle activité ne peut que répandre des illusions sur la nature de classe des syndicats et sur la possibilité de les transformer ...la seule façon dont la classe peut commencer à lutter pour ses propres intérêts c'est en sortant du cadre syndical...". Neuf mois plus tard, (dans RP 20) nous lisons : "Si le fait d'être membre des syndicats donne aux communistes un accès aux assemblées générales, aux comités de grève, aux réunions de section (bien que la présence à ces dernières serait inutile actuellement en Grande-Bretagne) (nous soulignons) afin de dénoncer les manoeuvres des syndicats envers la majorité des ouvriers et de mettre en avant une alternative pratique révolutionnaire, nous ne nous abstiendrons pas". Un an plus tard, c'est le vieux refrain gauchiste : "Souvent ceux qui restent dans les syndicats sont parmi les plus militants...Le fait d'être membres ordinaires des syndicats peut permettre aux révolutionnaires de combattre les manoeuvres syndicales plus efficacement". (WV 16)
BC/CWO nous ont accusé de "saboter la discussion". Comment pouvons nous discuter sérieusement avec des gens qui changent de position sur les principes de base, les lignes de classe, d'un mois à l'autre et sans un mot d'explication ?
Le pire c'est que le flou et l'équivoque de BC/CWO sur le travail syndical à la base sont devenus doublement dangereux dans la période actuelle. La CWO déclare ne rien comprendre à notre analyse de "la gauche dans l'opposition" parce qu'elle n'aurait pas d'impact sur notre intervention. Ce que vous n'avez pas compris, camarades, c'est que son but n'est pas tant de modifier notre intervention que de la maintenir face aux tactiques de la gauche bourgeoise. Cette analyse donne un cadre théorique à un processus que tous ceux avec une expérience minime de la lutte quotidienne ont déjà pu constater : face au dégoût croissant pour les partis de gauche, c'est de plus en plus les syndicats qui doivent encadrer les ouvriers, et face à l'abandon progressif des syndicats, c'est de plus en plus le syndicalisme de base qui doit ramener les ouvriers "sur le bon chemin". C'est à partir de ce cadre que nous pouvons comprendre l'implication croissante des gauchistes dans les syndicats, l'apparition de syndicats "autonomes" (France) ou du "syndicalisme de combat" (Italie), la radicalisation et la politisation du syndicalisme de base en général.
Et parce qu'ils n'ont rien compris à cette période, ni au développement de la conscience de classe qu'elle implique, ni à la nature de l'attaque bourgeoise, BC et la CWO sont en train de foncer tête baissée dans les pratiques d'un syndicalisme de base radical.
Dans la grève des mineurs en Grande-Bretagne, toute l'intervention de la CWO tourne autour du slogan "victoire aux mineurs". La dénonciation effrénée des "jaunes", l'insistance sur la nécessité d'empêcher le transport de charbon revient simplement à faire une politique syndicale radicale. Les dizaines de milliers de mineurs qui ont refusé de suivre la ligne syndicale, les dockers qui ont fait de même lors des dernières grèves, ne sont certes pas une expression claire d'une conscience anti-syndicale ; mais la réaction débile de la CWO, qui ne trouve rien de mieux que de surpasser le syndicat dans ses attaques contre les "jaunes" ignore totalement le développement ces dernières années d'une énorme méfiance chez les ouvriers envers tout ce qui est syndical. La bourgeoisie, elle, en est consciente ; elle est prête à tout pour empêcher la jonction de ces deux masses de combativité et de méfiance, de peur qu'elles ne deviennent une masse critique.
Nous nous souvenons des revendications "pratiques" de la CWO dans le passé : celles-ci allaient d’un aventurisme ridicule (l'appel à la "révolution maintenant" en Pologne 1980) à un gauchisme banal (les slogans contre les hausses de salaire en pourcentage et pour les hausses égales pour tous). Evidemment ces glissements dans le gauchisme ne lui ont rien appris, puisque aujourd’hui encore la CWO appelle les mineurs anglais à établir des "revendications précises" (sans toutefois préciser lesquelles). Voir "Miners'Strike Must be Won, WV 16) Une telle attitude envers la lutte met l'intervention des communistes sur sa tête. Dans la réalité, toute lutte importante a sa propre dynamique qui tend à dépasser très rapidement les "revendications spécifiques" avec lesquelles elle a démarré. L'exemple de la Pologne 1980 est frappant à cet égard : la revendication initiale des ouvriers des chantiers navals Lénine pour la réintégration d'un camarade licencié, est devenue parfaitement secondaire quand la lutte s'est étendue aux autres secteurs. La grève des mineurs montre la même tendance : partie sur la question des licenciements, elle a soulevé depuis des revendications pour la réduction des heures de travail, l'augmentation des salaires etc. -
Ceux, par contre, qui se font les spécialistes des "revendications spécifiques", ce sont les syndicats et les syndicalistes de base. Pour les syndicats, les "revendications spécifiques" sont une arme précieuse afin de freiner la lutte, de la figer sur son point de départ, de la dévoyer vers des perspectives bourgeoises, de 1'isoler dans sa spécificité au lieu de la généraliser vers le reste de la classe. Là encore, la Pologne 1980 et la Grande-Bretagne 1984 fournissent des exemples frappants. Ce n'est pas un accident si l'existence du syndicat Solidarnosc est fondée sur les accords de Gdansk. Quant à la grève des mineurs, tout le jeu des soi-disant "négociations" entre le NUM et le patronat sur la définition exacte d'un puits "non rentable" ne sert qu'à cacher la profonde identité de la grève des mineurs avec la lutte du prolétariat dans son ensemble contre une attaque générale de la bourgeoisie.
De la même façon, au niveau de l'extension de la lutte, la CWO reste prisonnière des "précisions". Dans l'article sur la grève des mineurs que nous venons de citer, la solidarité ouvrière est vue simplement en termes de lutte des mineurs et de la nécessité d'empêcher le mouvement du charbon. Mis à part le fait que ce genre d'action est très facilement récupérable (on se rappelle des campagnes nationalistes de la CGT contre le "minerai allemand" lors des dernières luttes en Lorraine), cette perspective "économiste" de la lutte ignore le réel développement politique de la lutte ; surtout, elle passe complètement à côté de ce que doit être l'intervention spécifique d'une organisation communiste : dissiper les nuages de fumée sur le charbon anglais, l'économie nationale, la politique de la droite etc., pour faire apparaître en pleine lumière la nécessité de la solidarité ouvrière et comment la construire. Pour en donner un exemple, la participation des mineurs dans l'occupation des chantiers navals de Camnell Laird n'avait rien à voir avec le mouvement du charbon ; elle avait tout à voir avec la conscience grandissante au sein du prolétariat que sa lutte est une lutte générale et politique contre le capital. C'est cette conscience que les communistes ont le devoir de pousser, de développer en s'attaquant inlassablement à tout ce qui risque de l'empêtrer dans les "spécificités", les "précisions" de chaque lutte.
Là où la CWO est en train de tomber dans les pratiques du syndicalisme de base, BC ne s'en est jamais vraiment sorti. Un article de"Battaglia Comunista" traduit dans WV 16 ("Communist Intervention in Italy") nous montre ce dont les "groupes d'usine" sont réellement capables, et nous ne pouvons que regretter que cet article significatif soit aussi limité dans le détail. Après le nouveau "Décret sur les salaires" du gouvernement Craxi, "Nos camarades (c'est à dire les militants du PC Int, NDLR) avaient du pain sur la planche, rien que pour faire démarrer la première assemblée à la gare de Milan Farini. Ils n'ont réussi qu'en récoltant avec les délégués combatifs (dont un seulement était membre du PC italien), les signatures de tous les ouvriers du secteur marchandises".
L'article ne précise pas d'où venaient ces "délégués combatifs" - des syndicats ? Des "comités de lutte"? On ne nous explique pas non plus pourquoi il est nécessaire de "récolter des signatures" pour démarrer une PG - à moins qu'il ne s'agisse d'une assemblée appelée selon les règles syndicales. En tout cas, le résultat de l'AG est - une grève de 24 heures. Là encore, on ne précise pas quelle était l'attitude de BC envers cette proposition, qui est parfaitement typique des artifices du syndicalisme de base destinés à laisser "échapper la vapeur".
Mieux encore "L'assemblée., décida de ne pas fixer le jour de la grève tout de suite, puisqu'il y avait des nouvelles que des assemblées devaient être appelées dans d'autres ateliers et parmi les ouvriers de Milan Central". Ici, une fois de plus, nous n'avons aucune indication de la position de BC sur cette manoeuvre classique du syndicalisme de base : sous le couvert de la "solidarité" on fait poiroter les ouvriers dans une attente débilitante afin de casser la dynamique vers l'extension et la radicalisation de la lutte.
Et la conclusion que tirent BC et la CWD de cet épisode lamentable ?
"Il reste pour nos camarades la tâche difficile d'organisation et de clarification de l'avant-garde combative qui a émergé pendant cette lutte, dans le but d'empêcher sa réabsorption dans les forces du PC italien et de la majorité (?) de la CGIL" (nous soulignons). Là au moins, BC va "assumer la responsabilité qu'on est en droit d'attendre d'une force sérieuse dirigeante". BC ferait mieux de se demander à quoi correspond une activité qui consiste :
- à travailler avec des "délégués" et des "membres du PC italien"
- à faire des pétitions pour les AG
- à soutenir (apparemment) des "actions" typiquement syndicalistes, du genre grève de 24 heures, grève différée etc.
Avant de conclure sur la question syndicale, il convient de relever une dernière "tactique" particulièrement répugnante que la CWO a puisée dans l'arsenal du syndicalisme de base : le dénigrement des organisations révolutionnaires. Effectivement, dans WV 16 ("Miners Strike and Communist Intervention") nous lisons que le CCI "défend les jaunes et contribue à la démoralisation", qu’il "sème le défaitisme et l'aventurisme", qu'il "sape les tentatives de la classe de frapper le patronat en bloquant le transport de charbon" ; en conclusion, le CCI "défend avec Thatcher et la police, le droit de faire le jaune". Surtout depuis ces derniers mois, nos militants sont systématiquement dénoncés à la police, ou menacés physiquement par les syndicalistes. A plusieurs reprises, ils s'en sont tirés, sous le nez des syndicats, uniquement grâce à la protection des ouvriers. Les syndicats nous accusent de "briser l'unité des ouvriers" d'être des "casseurs" ou des "provocateurs", d'être "à la solde des fascistes" ou de la CIA. Nous avons l'habitude de ce genre d'injure de la part des syndicats et des gauchistes. La CWO vient de nous apprendre que nous devons également nous habituer à l'entendre de la part de révolutionnaires. Pour notre part, nous continuerons d'insister au sein du prolétariat Pour que ses assemblées, réunions, comités de grève soient ouverts à tout ouvrier et à toute organisation révolutionnaire. C'est le seul chemin pour le développement de la conscience politique de la classe prolétarienne.
Dans un prochain article, nous analyserons les glissements de CWO-BC sur le parlementarisme et les luttes de libération nationale.
Arnold
[1] [819] Jusqu'en 1976 plusieurs sections territoriales avaient leur propre plateforme ; mais à l'encontre du BIPR il s'agissait là de simples survivances historiques de la même façon que l'appendice chez l'homme est une survivance de nos origines herbivores. L'élimination de ces survivances a été aussi banale qu’une appendicectomie.
[2] [820] La CWO a depuis (RP n°21) taxé cette position "d'éclectisme". Les camarades devraient nous donner une indication détaillée des positions de leur plateforme auxquelles nous pouvons faire confiance.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
- TCI / BIPR [821]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Milieu révolutionnaire : thèses du collectif communiste Alptraum (Mexique)
- 2750 reads
Les positions politiques d'un groupe révolutionnaire constituent un élément crucial pour comprendre sa réalité. Mais cela ne suffit pas.
Il faut aussi envisager la pratique du groupe et la dynamique globale de son évolution : d'où vient-il, vers où peut-il aller ? Une même erreur politique, par exemple, aura une signification très différente suivant qu'elle est le fait d'un jeune groupe qui tâtonne à la recherche d'une cohérence politique de classe, ou qu'elle soit commise par une "vieille" organisation sur la pente d'une dégénérescence ou sclérose irréversible.
'Les thèses du collectif Alptraum que nous publions ici sont par elles-mêmes un document intéressant du point de vue de classe. Mais leur valeur apparaît plus importante si on les envisage dans leur contexte et leur dynamique.
Dans un pays comme le Mexique, le rejet ferme et explicite de toute démarche nationaliste, la dénonciation - d'un point de vue prolétarien - du capitalisme d'Etat cubain ou nicaraguayen ainsi que des luttes de libération nationale, ont d'autant plus de valeur et d'importance que le prolétariat y est abreuvé du matin au soir par toutes les organisations politiques d'une pernicieuse et omniprésente propagande nationaliste reposant sur l'idéologie de 1'"anti-yankee". Dans ces conditions, une voix qui affirme clairement et fortement le caractère international du combat prolétarien et 1'irréconciliabilité totale de celui-ci avec toute idéologie nationaliste, constitue un souffle d'air et de lumière inestimable
Par ailleurs, ces thèses sont le produit d'une évolution qui, depuis plus de deux ans, ont conduit les éléments du collectif Alptraum à rompre avec leur organisation d ' origine, le PMP (Parti Mexicain du Prolétariat), où des positions politiques authentiquement de classe flottaient dans une totale inconsistance et à s'orienter avec une assurance toujours plus grande vers une cohérence politique réelle.
Ces thèses peuvent ainsi constituer une étape importante vers le développement au Mexique d'une expression communiste véritablement consistante et agissante, et elles doivent être saluées comme telles. Cela ne nous empêche pas, au contraire, de signaler ce qui nous semble y traduire des faiblesses qui doivent être surmontées si les camarades d'Alpatraum veulent mener à bien leur présente dynamique. C'est ce que nous chercherons à faire dans les commentaires qui suivent ces thèses.
THESES :
"La vie de l’industrie se convertit en une suite de périodes d'activité moyenne, de prospérité et de stagnation" Karl Marx, Le Capital.
1- La crise capitaliste actuelle possède une dimension internationale et doit être conçue corme une crise classique de suraccumulation, dans laquelle se vérifie le cycle industriel dont la séquence contient nécessairement les moments de prospérité, de crise et de stagnation.
La nature et le mouvement contradictoire du capitalisme apparaissent clairement dans le déroulement du cycle périodique qui parcourt l'industrie et dans le mouvement final de celui-ci : la crise générale.
Carme crise de suraccumulation, elle explose d’abord dans le domaine de la spéculation pour atteindre plus tard la production, le commerce et le marché financier. La spéculation ne fait que fournir des issues momentanées à la suraccumulation capitaliste. La désorganisation de la production qui suit la spéculation existe nécessairement carme résultat de l'exubérance de la période précédente de prospérité.
Le scénario de la crise est universel, tant par l'extension mondiale du capitalisme, que par l'intensification de son emprise sur la totalité des branches de la production qui constituent l'économie mondiale.
La crise a une dimension mondiale, puisque dans son développement, elle a décrit une orbite qui s'étend, une spirale qui, partant des pays capitalistes développés (avec une composition organique du capital plus grande), a inclus le reste des pays qui constituent avec les nations développées, le système capitaliste mondial. Ses effets se font sentir de manière intense dans l'ensemble de l'économie capitaliste.
La crise que nous vivons est le résultat du choc entre le développement énorme atteint par les forces productives, c'est-à-dire par la richesse existante, et les rapports capitalistes de production qui imposent l'appropriation privée de celle-ci. De cette façon, nous observons comment le développement des forces productives se transforme en obstacle pour le capital. De ce fait, le rapport capitaliste de production se transforme en une barrière pour le développement du travail en tant que force productive.
La crise exprime dans son développement la nature contradictoire de la réalité capitaliste et le caractère historiquement limité de ses rapports de production qui ne peuvent contenir, en leur sein, le développement progressif des forces productives sociales. Les moments de crise sont ceux dans lesquels le capitalisme doit nécessairement détruire une masse croissante de forces productives, mettant en évidence de cette manière sa nature décadente.
Le capitalisme dans cette logique impose alors la destruction violente et périodique d'une masse croissante de forces productives sociales parmi lesquelles se trouve le prolétariat. De cette tendance interne surgit la nécessité des guerres pour prolonger son existence comme un tout. Historiquement, on a vu qu1 après chaque guerre apparaît une période de reconstruction.
2- Avec 1'exacerbation de la crise, le système capitaliste établit les conditions de la possibilité de sa subversion.
La crise, avec son approfondissement croissant, fournit les conditions pour le développement de la conscience prolétarienne et de son auto organisation. En conséquence, le capital tente de détruire le germe de cette conscience en intégrant le prolétariat de chaque pays à ses schémas idéologiques ; en renforçant de cette manière 1'i-déologie nationaliste et les idéologies marginales comme : le féminisme, 1fécologisme, la lutte pour la paix, le mouvement homosexuel, etc, afin de fragmenter et disperser la conscience prolétarienne qui d1 elle-même est internationale et totale.
Le capital sait que l'unique issue à la crise de surproduction est la guerre et pour y arriver, en premier lieu, il doit détruire tout vestige de conscience prolétarienne.
Hier, le fascisme et 1'antifascisme ont été des moyens efficaces pour intégrer la prolétariat à l'idéologie bourgeoise ; aujourd'hui c'est le mythe du"bloc socialiste" contre le "monde occidental démocratique". La défense du capitalisme d'Etat à Cuba, au Nicaragua, et des mouvements de libération nationale au Guatemala, au Salvador, etc, a une intention claire, enrôler le prolétariat mondial pour la cause d'un des deux blocs capitalistes qui s'affrontent, et le conduire à une troisième guerre mondiale.
3- À partir années 60, s'est produit le resurgissement, au niveau mondial, de l'activité révolutionnaire du prolétariat.
Un mouvement international se développe sous la forme de vagues successives d'offensive de recul dans lequel les diverses fractions nationales du prolétariat se lancent contre le pouvoir bourgeois mondial.
Le cours historique de la lutte de classe actuelle est déterminé par les rapports de force entre le capital et le prolétariat en Europe occidentale, étant donné que c'est de cette corrélation que dépend l'ampleur de l'affrontement de la lutte de classes dans le reste des pays qui forment le capitalisme dans son unité mondiale.
A partir de la défaite du mouvement prolétarien polonais, due, fondamentalement aux actions médiatrices du syndicat Solidarnosc, s'est ouverte une période de reflux qui a été dépassée rapidement par le développement des grèves en Hollande et en Belgique, en 1983, et les mobilisations récentes en France, en Angleterre et en Allemagne.
Nous vivons une période qui se caractérise par le réveil du prolétariat dans son unité et sa continuité historique comme sujet. De ce fait le surgissement de groupes communistes constitue un moment du développement de son auto-conscience.
4- Les organisations qui ne reconnaissent pas le rôle révolutionnaire du prolétariat ne pourront pas assumer les tâches que leur impose le mouvement historique de la classe. Les organisations communistes devront se transformer en ponts théorico-politiques qui transmettent et assimilent les expériences et héritages révolutionnaires du mouvement prolétarien dans le sens de son histoire.
Le programme de ces organisations développera et synthétisera l'expérience et l'héritage historique du prolétariat en tant qu'unité. De cette manière, les principes de classe prolétariens exprimeront la dimension historique du mouvement prolétarien et synthétiseront son expérience théorico-politique.
5- Nous reconnaissons l'existence d'un milieu marxiste révolutionnaire international constitué par des organisations révolutionnaires (CCI, OO, PCI (Battaglia Ccmunista) , etc.) qui, malgré leurs multiples faiblesses, soutiennent et défendent les principes politiques essentiels de la lutte prolétarienne.
Les communistes ne sont pas extérieurs à la classe prolétarienne, ils constituent les éléments les plus lucides de celle-ci. Leur rôle ne réside pas seulement à pousser l'organisation du prolétariat comme moment nécessaire de sa propre organisation, mais à développer son activité pour développer l'auto-conscience du prolétariat. Les communistes incarnent la continuité de la lutte historique de classe dans ses moments les plus hauts comme la Commune de Paris, la Révolution Russe, la Révolution Allemande, etc.
Les points centraux qui de notre point de vue vont les différencier du camp bourgeois sont :
- la reconnaissance de la décadence du système capitaliste ;
- la reconnaissance de la classe ouvrière comme sujet de la Révolution ;
- le rejet des syndicats (en se maintenant en dehors d'eux) ;
- le rejet du parlementarisme et de toute opposition électorale ;
- le rejet de tout type d'alliance avec un quelconque secteur de la bourgeoisie ;
- le rejet des fronts populaires et des mouvements de libération nationale ;
- la reconnaissance que dans les pays dits "socialistes" domine le mode de production capitaliste dans sa forme spécifique du capitalisme d'Etat ;
- la reconnaissance que la Révolution Communiste aura un caractère éminemment international ;
- la reconnaissance que le socialisme ne réussira que par l'abolition des rapports capitalistes (Je production, et spécifiquement, avec l'abolition du travail salarié ;
- la reconnaissance de la nécessité de forger le parti du prolétariat, qui aura une dimension internationale.
De notre point de vue, avec l'accélération de la lutte de classes, la discussion entre révolutionnaires et leur intervention organisée à l'échelle internationale sont nécessaires et inévitables.
6- Nous considérons que le capitalisme se trouve en décadence. Décadence qui implique le déclin du mode de production spécifiquement capitaliste, dans lequel domine le capital industriel, comme rapport social de production.
La décadence du système implique l'accentuation de la concurrence et de l'anarchie de la production spécifiquement capitaliste, et en général, 1'exacerbation et l'approfondissement de toutes ses contradictions, parce que le capitalisme a atteint ses limites historiques, celles que lui imposent son propre développement et sa nature contradictoire. Ceci s'exprime dans le choc périodique et chaque fois plus violent entre les forces productives et les rapports de production.
La loi qui nous explique le développement du système capitaliste de production est aussi la base adéquate pour comprendre sa nature décadente. De notre point de vue, aussi bien le développement que le déclin du système reposent sur deux déterminations essentielles, à savoir, une qui se manifeste par la baisse tendancielle du taux de profit et l'autre qui constitue son contenu et s'exprime dans la subordination formelle et réelle du travail au capital.
Dans la baisse tendancielle du taux de profit s'exprime la nature décadente du système capitaliste. Ce système a pour objet la formation ininterrompue et croissante de capital. Cela implique une expansion croissante du capital et l'augmentation concomitante de la productivité sociale du travail qui se traduit à son tour par un développement accéléré des forces productives.
A mesure que s'effectue cet accroissement du capital sa composition organique change, augmente ; il se produit ainsi une augmentation du volume des moyens de production et de la production même par rapport à la composition de la valeur du capital. Ceci aboutit à la baisse graduelle du taux de profit, puisque la partie variable du capital, celle qui produit la plus-value, diminue.
C'est à ce moment qu'apparaît la crise capitaliste, quand le capital accumulé est supérieur par rapport au taux de profit qu'il est capable de fournir ou bien quand la composition organique croissante ne correspond pas à une augmentation équivalente de valeur.
De cette manière, la suraccumulation de capital _ par rapport à la capacité d'exploiter le travail conduit le système capitaliste à la crise, laquelle peut-être contrecarrée par l'accumulation même de capital, au travers de diverses mesures inhérentes au processus même de l'accumulation. L'une d'elles est l'augmentation de la masse de plus-value obtenue par l'augmentation de la masse totale de capital qui emploie un_ plus grand nombre de travailleurs ; ou bien, elle peut être contrecarrée aussi au moyen de la productivité croissante du travail qui implique une augmentation du taux d'exploitation, laquelle s'obtient au moyen de l'extraction de plus-value absolue et relative. Mais ces actions pour contrecarrer la baisse ne peuvent être utilisées indéfiniment, car il arrive un moment où le nombre de travailleurs ne peut plus être augmenté, où le temps de travail ne peut plus être prolongé et où le travail socialement nécessaire ne peut être réduit, du fait des limites naturelles et sociales qui existent. Le développement des forces productives mène ainsi à une contradiction ouverte avec les rapports de production capitalistes, qui portée à ses limites absolues signifierait un manque de plus-value par rapport à la masse du capital accru et à ses exigences d'expansion. C'est à ces limites qu'arrive le capitalisme, qui mené par sa propre nature contradictoire entrave en son sein le développement progressif des forces productives.
Nous reconnaissons corme seul sujet révolutionnaire le prolétariat. A ce marient de la décadence irréversible du système capitaliste (voir thèse 6 ) le prolétariat doit rompre avec toute entente idéologico-politique avec le capital (que ce soit le capital avancé ou privé) .
Nous considérons que toute perspective qui part du cadre national se trouve d'avance aliénée au capital qui fonde son existence dans l'humus de la nation. La lutte prolétarienne se propose d'emblée de rompre avec tout type de barrières nationales.
Toutes les tendances et partis bourgeois (de la droite à la gauche) se trouvent sur des positions inter-classistes (féminisme, fronts populaires, etc.) pour lutter contre le prolétariat.
Le prolétariat s'affronte au capital dans sa totalité, en marge de ses fractions ou secteurs, et même si sa lutte s'effectue de manière formelle dans le cadre national, elle est par son contenu internationale.
8- Nous considérons que le parlement et le syndicalisme ne constituent pas un moyen de lutte pour le prolétariat dans ce pays ou dans n'importe quel autre, puisque ces formes sont utilisées par la bourgeoisie pour médiatiser les luttes prolétariennes et les intégrer. Le parlement et le Syndicalisme constituent une mystification de plus du capital, qui renforce son schéma de domination sur la classe ouvrière, aliénant son activité révolutionnaire.
9- Nous considérons qu'il n'existe aucune fraction bourgeoise progressiste, et que la stratégie du prolétariat ne doit comporter aucune alliance avec un secteur quelconque de la bourgeoisie, pour aissi "progressiste" qu'elle paraisse. La lutte de la classe ouvrière doit être l'oeuvre de la classe ouvrière elle-même.
10- Nous considérons que la notion de capital monopoliste d'Etat ne parvient pas à rendre compte du développement du capitalisme dans ses déterminations essentielles, mais constitue un subterfuge idéologique de plus sur l'interprétation de la réalité capitaliste, qui sert de base à la gauche du capital pour justifier ses alliances avec les secteurs privés de la bourgeoisie. L'intervention croissante de l'Etat dans l'économie obéit uniquement à l'anarchie même de la production capitaliste, et sa présence exprime 1 ' exacerbation des contradictions du système capitaliste.
11- Nous considérons que toute nationalisation.» ou étatisation des moyens de production, loin de nous préparer au communisme, renforce la domination du capital social sur le travail salarié.
Dans le cas de l'étatisation bancaire, et spécifiquement celle qui s'est effectuée il y a deux ans au Mexique, le capital financier en tant que rapport de production spécifique n'a pas été éliminé, puisque le rôle de celui-ci au sein du processus de reproduction du capital continue d'être en vigueur.
Le capital social n'est pas non plus éliminé comme tel, puisque qu'avec l'étatisation, seule est modifiée la propriété juridique sur un mécanisme qui organise la circulation du capital, au sein du cadre des rapports capitalistes de production.
De cette manière, l'Etat se transforme en propriétaire juridique du capital, en une de ses expressions reproductives : le capital qui donne ses intérêts.
Ce qui résulte de ce mouvement, c'est la dépersonnalisation de la fonction qu'accomplit le capital financier, au sein des rapports capitalistes de production et de sa logique reproductive, la préservant à un niveau supérieur de développement.
De cette manière, nous observons que les rapports capitalistes de production adoptent un caractère plus abstrait et impersonnel, rendant ainsi plus évident le fétichisme inhérent à ceux-ci. L'Etat, en tant que capitaliste collectif réel intégrant le personnel bancaire et salarié en général à un schéma de domination plus abstrait et aliénant. L'Etatisation est un moyen pour garantir la logique reproductive du capitalisme national et international, indépendamment et par dessus toute fraction bourgeoise.
Dans ce sens, nous pouvons affirmer que la mesure prise par l'Etat mexicain a, comme but principal celui de préserver la configuration sociale capitaliste.
NOS COMMENTAIRES ET CRITIQUES
Le CCA (Collectif Communiste Alptraum) a réalisé depuis les temps où ses membres faisaient encore partie du PMP, une évolution - déterminée en grande partie par ses contacts avec le CCI - qui les a conduits à rompre avec le flou et l'inconsistance du PMP et à se définir politiquement dans le camp prolétarien. Leurs "thèses" constituent effectivement un cadre politique qui le situe au sein du cadre défini à travers l'histoire par l'expérience théorico-politique du mouvement révolutionnaire prolétarien.
Les thèses se prononcent sur l'ensemble des questions qui ont été au centre des préoccupations du mouvement ouvrier depuis la dernière grande vague de luttes internationales (1917-23) et la 3ème Internationale qui en fut la principale manifestation politique.
En réaffirmant la nature décadente du capitalisme dans sa phase historique actuelle, ainsi que l'ensemble des conséquences de cette réalité sur les formes et le contenu de la lutte ouvrière dans cette époque : impossibilité de la lutte pour des réformes durables au sein du système capitaliste, rejet du syndicalisme, du parlementarisme, des luttes de libération nationale, des politiques de front unique ; en reconnaissant la nature capitaliste des pays dits "communistes" et le caractère universel de la tendance au capitalisme d'Etat ; en réaffirmant la nature internationale de la lutte prolétarienne ainsi que son organisation politique et la nécessité de son intervention, le CCA a su, à travers ses thèses, se définir politiquement en sachant se situer dans la réalité historique du combat de classe.
Les thèses tracent aussi une analyse du cours historique de la lutte de classe et savent reconnaître 1'ampleur et 1'importance des combats prolétariens présents ainsi que la situation centrale du prolétariat d'Europe occidentale.
Tout cela exprime une véritable lucidité de classe qui sait dégager de l'histoire des moyens de comprendre le présent.
Nous avons signalé des qualités importantes de ce texte. Penchons-nous maintenant plutôt sur ce qui nous semble y traduire des manques. Deux faiblesses principales : la première au niveau de l'analyse du rôle des organisations révolutionnaires ; la deuxième au niveau de l'analyse économique, qui tient dans ces thèses tant de place.
Les organisations révolutionnaires.
Les thèses d'Alptraum affirment clairement l'appartenance des organisations communistes au prolétariat et ce qu'elles représentent du point de vue de la clarté de vue et de la continuité du combat historique de leur classe. Mais elles disent peu, trop peu, sur le rôle actif de celles-ci au sein des combats prolétariens et le caractère crucial de leur intervention à l'époque présente.
Alptraum reprend bien cette idée du célèbre extrait du Manifeste Communiste de 1848 suivant laquelle "du point de vue théorique, (les communiste ) ont sur le reste de la masse prolétarienne 1'avantage de comprendre les conditions, la marche et les résultats généraux du mouvement ouvrier."
C'est ainsi que les thèses disent : "Les communistes ne sont pas extérieurs à la classe prolétarienne, ils constituent les éléments les plus lucides de celle-ci. (...) Les communistes incarnent la continuité de la lutte historique de classe dans ses moments les plus hauts comme la Commune de Paris, la révolution russe, la révolution allemande, etc. . " (Thèse 5)
Tout cela est vrai et important à comprendre.
Mais la plus grande "lucidité", les plus grandes "synthèses de l'expérience historique" ne seraient rien si elles n'étaient que moyens "d'interpréter le monde". Les organisations communistes sont un instrument du prolétariat pour s'autotransformateur et pour transformer le monde.
Tournant le dos à tout esprit académiste, les communistes n'analysent pas la réalité pour le goût de l'analyse en soi mais pour mieux participer et orienter le combat réel concret ~di leur classe, c'est-à-dire pour intervenir dans celui-ci.
Sur cet aspect de l'activité des communistes, les thèses se contentent d'affirmer, en passant :
"De notre point de vue, avec 1'accélération de la lutte de classes, la discussion entre révolutionnaires et leur intervention organisée à l'échelle internationale sont nécessaires et inévitables. "
Au moins, au niveau de 1'insistance il manque aux thèses de mieux souligner la place pratique des organisations dans leur classe, leur caractère d'avant-garde la plus résolue au sein des combats.
Il manque cet autre partie de l'extrait déjà cité du Manifeste et qui dit : "Pratiquement, les communistes sont donc la partie la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui va toujours de l'avant."
Ce n'est pas dans un avenir plus ou moins lointain que l'intervention des organisations révolutionnaires sera "nécessaire" et "inévitable". C'est dès à présent, dans les combats actuels, que cette intervention est indispensable.
Dans ses thèses Alptraum rend bien compte de la gravité de la situation historique actuelle :
"Nous vivons une période qui se caractérise par le réveil du prolétariat dans son unité et sa continuité historique comme sujet."
Et de façon plus précise :
"A partir de la défaite du mouvement prolétarien polonais, due fondamentalement aux actions médiatrices du syndicat Solidarnosc, s'est ouverte une période de reflux qui a été dépassée rapidement par le développement des grèves en Hollande et en Belgique en 1983, et les mobilisations en France, Angleterre et Allemagne." (Thèse 3)
On est en droit d'être surpris qu'aucun accent ne soit mis sur l'importance actuelle de l'intervention des organisations communistes dans ces grèves.
Certes, Alptraum n'est encore qu'un "collectif", une sorte de "cercle". Mais, premièrement, cela ne change rien à l'importance de 1'intervention pour définir en termes généraux le rôle des organisations révolutionnaires, et deuxièmement, Alptraum possède déjà un cadre politique qui lui permet et exige de lui d'envisager l'intervention organisée systématique continue dans la classe comme tâche urgente.
L'histoire s'accélère et les révolutionnaires doivent savoir adapter en conséquence leur rythme d'existence.
L'analyse économique.
Il y a peut-être un lien entre cette sorte de "lenteur" ou d'"attentisme" politique et certains aspects de l'analyse économique exposée dans les thèses.
Ainsi, la thèse n°1 dit : "La crise capitaliste actuelle (...) doit être conçue comme une crise classique de suraccumulation." Une crise "classique" de suraccumulation ? Alptraum semble assimiler la crise actuelle à ces crises de croissance que connaissait périodiquement le capitalisme au 19ème siècle.
Il est vrai qu'il y a des mécanismes et des contradictions analogues dans toutes les crises du capitalisme. Mais, alors que dans la phase d'expansion du capital au monde entier ces crises constituaient comme les battements de coeur d'un corps en plein développement, les crises du capitalisme décadent, celui des guerres mondiales et du militarisme universalisé, apparaissent comme les râles d'un corps agonisant. Au 19ème siècle, le capital avait le monde entier à conquérir : il dépassait ses crises par l'ouverture de nouveaux marchés dans le monde. Au 20ème siècle, ses crises le conduisent à la guerre mondiale et totale... et aujourd'hui à la menace d'anéantissement de l'humanité.
Alptraum reconnaît l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin et implicitement parle du cycle crise-guerre-reconstruction suivant lequel le capitalisme vit depuis la 1ère guerre mondiale. Mais au moment d'analyser les fondements, les "déterminations essentielles" qui conduisent le capitalisme aux crises et au déclin, les thèses ne se réfèrent qu'à des éléments insuffisants.
Ignorant ou rejetant l'analyse de Rosa Luxemburg - en réalité de Marx - suivant laquelle la contradiction fondamentale du capitalisme réside dans son incapacité à créer indéfiniment les marchés nécessaires à son expansion, Alptraum écrit :
"De notre point de vue, aussi bien le développement que le déclin du système reposent sur deux déterminations essentielles, à savoir : une qui exprime sa forme dans la loi générale de la baisse tendancielle du taux de profit, l'autre qui constitue son contenu et s'exprime dans la subordination formelle et réelle du procès de travail au capital" (Thèse 6)
Or, ni la distinction entre "domination formelle et domination réelle" du capital, ni la loi de la baisse tendancielle du taux de profit ne suffisent à expliquer pourquoi le capitalisme connaît depuis plus d'un demi siècle un irréversible déclin historique ni pourquoi la crise économique actuelle n'a rien à voir avec les crises de croissance du siècle passé.
La distinction faite par Marx entre "domination formelle" et "domination réelle" du travail par le capital, traduit la différence entre l'époque où les prolétaires étaient encore principalement des artisans "salariés" (les Canuts de Lyon) qui, tout en étant commercialement soumis au capital, continuaient de produire avec pratiquement les mêmes moyens et gestes que leurs ancêtres du féodalisme, et l'époque de la révolution industrielle où les gestes et l'organisation artisanale du travail laissent la place à la grande industrie et ses prolétaires façonnés suivant les nécessités de la grande usine ([1] [822]).
Pour intéressante qu'elle soit, cette distinction ne nous dit en rien pourquoi à un stade donné les rapports de production capitalistes cessent d'être un stimulant du développement des forces productives pour se transformer en entrave chronique et croissante de celui-ci.
Il en est de même de la loi de la baisse tendancielle eu taux de profit. Celle-ci, pour exacte et importante qu'elle soit comme manifestation d'une contradiction du processus de production capitaliste, n'est qu'une loi "tendancielle", c'est-à-dire une tendance constamment contrecarrée. Pour comprendre à quel moment, dans quelles circonstances historiques cette tendance devient effective et se traduit par un effondrement effectif des profits, c'est au niveau des facteurs qui contrecarrent la tendance générale que l'on trouvera une réponse. Depuis Marx, nous savons que c'est par l'augmentation de la masse de plus-value et par l'intensification de l'exploitation (augmentation de la productivité) que le capital ralentit et compense, contrecarre la baisse tendancielle du taux de profit. Or, aussi bien l'un que l'autre de ces moyens dépend essentiellement de la capacité du capital à élargir son champ de production, ce qui, à son tour, dépend de l'existence de marchés solvables - extérieurs à sa sphère de production -Si, comme le fait Alptraum, on ignore la contradiction au coeur du système capitaliste entre d'une part sa nécessité de produire toujours plus pour exister et, d'autre part, son incapacité à créer des marchés solvables suffisants, il faut conclure que le capitalisme, loin d'être à la fin de son existence étouffé par ses propres contradictions, a encore devant lui un bel avenir. Car tant que le capitalisme ne connaît pas de limites à l'expansion de ses débouchés commerciaux, il peut surmonter, compenser toutes ses autres contradictions. C'est le marché qui fait vivre le capital et c'est lui qui en constitue sa dernière limite.
Si, pour que le capitalisme entre en phase de déclin, il fallait attendre - comme semble le dire la thèse 6 - qu'il "arrive un moment où le nombre de travailleurs ne peut plus être augmenté, où le temps de travail ne peut plus être prolongé et où le travail socialement nécessaire ne peut être réduit du fait des limites naturelles (sic !) et sociales qui existent", nous devrions nous résigner à attendre des siècles... voire l'éternité. Jamais le capital n'atteindra des "limites naturelles" qui l'empêcheraient d'augmenter le nombre de travailleurs, d'intégrer tous les chômeurs et marginalités de la terre. Depuis que le capitalisme est en décadence, le nombre de travailleurs non intégrés, de laissés pour compte essentiellement dans les pays sous-développés, ne se réduit pas (approchant de supposées limites naturelles) mais au contraire augmente de façon exponentielle.
Nous ne pouvons ni ne voulons ici développer une polémique détaillée sur l'analyse des contradictions fondamentales du capitalisme ([2] [823]). Ce qui nous importe c'est de signaler :
1°) que 1'analyse présentée par les thèses est insuffisante..sinon erronée ;
2°) qu'elle peut servir de base à la théorisation d'une attitude plus ou moins attentiste qui - en contradiction avec tout ce qui est par ailleurs affirmé dans les thèses - ne comprendrait pas l'importance et l'urgence de l'intervention pratique des communistes aujourd'hui sous prétexte que le capitalisme est encore loin d'avoir attein1; ses "limites naturelles".
Conclusion.
"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire", disait avec raison Lénine. Les thèses du CCA traduisent sans aucun doute un effort théorique réel et une compréhension de l'importance de cet effort pour le prolétariat. Mais elles montrent aussi que cet effort doit être poursuivi et pour ce faire le CCA doit se situer plus directement, plus activement sur le terrain de l'intervention politique au sein du mouvement présent du prolétariat ([3] [824]).
L'intervention des révolutionnaires est nourrie et soutenue par la théorie révolutionnaire ; mais la théorie révolutionnaire ne peut vivre et se développer qu'en vue de cette intervention, et cela d'autant plus dans la période historique présente.
Lorsqu'ils étaient encore membres du PMP les éléments qui aujourd'hui constituent le CCA étaient parmi les plus actifs sur le plan de l'intervention dans la ville de Mexico. C'est avec eux que le CCI tint dans cette ville, pendant l'été 82, une réunion publique sur les luttes ouvrières en Pologne.
Il ne faudrait pas que la période de réflexion, de rupture et de clarification politique qu'ils ont depuis traversée ne leur fasse oublier le souci primordial, comme parfois les thèses peuvent le laisser penser.
R.V.
[1] [825] Avec la publication en français, au début des années 70, du "chapitre inédit du Capital" - où Marx développe plus particulièrement cette distinction - les courants tel le groupe qui publiait "Invariance", et à sa suite certains "modernistes", ont cru trouver dans cette analyse un élément fondamental, "nouveau", pour la compréhension du capitalisme au 20ème siècle. Goût de 1'innovation pour 1'innovation oblige. Mais en réalité les éléments qui constituent cette distinction (transformation concrète du procès de travail et surtout prédominance de la plus-value relative par rapport à la plus-value absolue) caractérisent essentiellement des étapes au sein de 1 'ascendance du capitalisme et non le passage dans la phase décadente. Ainsi, par exemple, le capitalisme se développe en Russie, à la fin du 19ème siècle, en prenant d'emblée les formes les plus modernes de la domination réelle.
[2] [826]cf. "Théorie des crises" (critique de Boukharine), in Revue Internationale n°29 et 30 (2eme et 3éme trimestre 82) ; "Les théories des crises de Marx à l'Internationale Communiste", in Revue Internationale n°22 (3ème trimestre 80) ; "Les théories des crises de la gauche hollandaise", in Revue Internationale n°16, 17, 21 ; "Sur 1'impérialisme", in Revue Internationale n°19(4ème trimestre 79); "Théories économiques et lutte pour le socialisme", in Revue Internationale n°16 (1er trimestre 79) décadence du capitalisme".
[3] [827] Le langage obscur, souvent inutilement abstrait des thèses exprime non seulement un manque de clarté dans la pensée mais aussi 1'absence du souci d'être compréhensible en dehors d'un milieu intellectuel restreint.
Géographique:
- Mexique [36]
Courants politiques:
Revue Internationale no 41 - 2e trimestre 1985
- 2654 reads
Pour comprendre la lutte de classe : la méthode marxiste et non l'empirisme
- 3994 reads
Depuis plus d'un an et demi, le prolétariat mondial - et notamment celui d'Europe occidentale - a repris le chemin des affrontements de classe qu'il avait momentanément abandonné en 1981 lors de la défaite concrétisée par l'état de guerre en Pologne. Cette reprise est maintenant reconnue par la plupart des groupes politiques du milieu révolutionnaire, mais cette reconnaissance a souvent été tardive. En effet, il a fallu l'accumulation de toute une série de mouvements en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne notamment, pour que des groupes comme "Battaglia Comunista" ([1] [828]) ou la "Communi'st Workers' Organisation" ([2] [829]) reconnaissent enfin un nouveau surgissement des combats de classe après le repli des années 1981-82. Quant à certains groupes comme "L'association pour la Communauté Humaine Mondiale" ([3] [830]) (anciennement "Groupe Volonté Communiste") qui avaient éprouvé les plus grandes difficultés à reconnaître le recul et la défaite de 1981, ils sont tout aussi incapables de reconnaître aujourd'hui la reprise des luttes. Pour sa part le CCI a été parmi les premiers à mettre en évidence cette reprise, de même qu'il avait été capable en 1981 de rendre compte du recul. Ce constat n'a pas pour but de vanter les mérites de notre organisation en faisant ressortir les faiblesses des autres organisations du milieu communiste. Nous avons, à de nombreuses reprises, fait la preuve que nous ne concevons pas nos rapports avec celles-ci en termes de "fottenti" et "fottuti" ([4] [831]) suivant les termes de 1'ex-"Programma Comunista" c'est-à-dire en termes de concurrence et de rivalité. Ce qui nous intéresse au premier chef, c'est la plus grande clarté parmi les groupes révolutionnaires afin que l'influence qu'ils exercent et exerceront dans 1'ensemble du prolétariat soit la plus positive possible, qu'elle corresponde pleinement aux tâches pour lesquelles celui-ci les a fait surgir en son sein : être un facteur actif dans le développement de sa prise de conscience. Le but de cet article est donc de poursuivre le travail que nous avions entrepris dans le n.39 de la Revue Internationale ("Quelle méthode pour comprendre la reprise des luttes ouvrières ?") : mettre en évidence le cadre qui seul permet de rendre compte de 1'évolution présente des combats de classe et d'en tracer les perspectives. En d'autres termes, dégager une série d'éléments d'analyse indispensables aux organisations communistes pour être à la hauteur de leurs responsabilités dans la classe, éléments que beaucoup d'organisations repoussent avec obstination ou n'acceptent que du bout des lèvres.
Bien avant la formation du CCI en 1975, les groupes qui allaient le constituer ont basé leur plateforme et leur analyse générale de la période historique actuelle sur deux éléments essentiels (outre, évidemment, la revendication d'une série d'acquis programmatiques qui étaient le patrimoine commun de la gauche communiste issue de la 3ème Internationale dégénérescente) ([5] [832]) :
- la reconnaissance du caractère décadent depuis la 1ère guerre mondiale du mode de production capitaliste;
- la reconnaissance du cours historique ouvert par l'entrée du capitalisme dans une nouvelle crise aiguë à la fin des années 60, non comme un cours à la guerre généralisée semblable à celui des années 30, mais comme un cours aux affrontements de classe généralisés.
Depuis sa constitution, le CCI -comme il revient de le faire à toute organisation révolutionnaire vivante- a poursuivi l'élaboration de ses analyses et a notamment mis en évidence les trois éléments suivants :
- le fait que la révolution prolétarienne ne pouvant, à l'image des révolutions bourgeoises, se dérouler à des moments différents entre les divers pays, serait le résultat d'un processus de généralisation mondiale des luttes ouvrières, processus pour lequel les conditions présentes de développement d'une crise générale et irrémédiable de l'économie capitaliste étaient bien plus favorables que celles - données par la guerre impérialiste- qui avaient présidé au surgissement de la vague révolutionnaire de 1917-23. ([6] [833])
- l'importance décisive des pays centraux du capitalisme, et particulièrement ceux d'Europe occidentale, dans ce processus de généralisation mondiale des combats de classe ([7] [834]).
- l'utilisation dès la fin des années 70 par la bourgeoisie des pays avancés de la carte de la "gauche dans l'opposition" destinée, à travers un langage "radical", à saboter de l'intérieur les combats de classe que l'aggravation inexorable de la crise fait et fera de plus en plus surgir. ([8] [835])
Pour le CCI, l'élaboration de ces analyses n'est nullement un "luxe", une façon "d'être incapable d'affronter la raison d'être de son existence et de son activité, d'être forcé de développer une vie irréelle tournant autour de débats 'nominalistes ' [?] et scholastiques... de rationaliser son inertie" carme le prétend le CWO dans "Workers' Voice" n°17. Au contraire, c'est ce qui a permis à notre organisation d'évaluer correctement le rapport de forces entre les classes - condition élémentaire d'une intervention correcte au sein du prolétariat - comme nous allons le mettre en évidence.
L'ANALYSE DE LA DECADENCE DU CAPITALISME
Tout comme le CCI, les différents groupes évoqués ("Battaglia", CWO et "Volonté Communiste") se réclament de cette analyse (contrairement au courant bordiguiste "pur" qui, pour sa part, rejette ce qui constituait pourtant une position essentielle de l'Internationale Communiste). Cependant, il ne suffit pas d'admettre que depuis la première guerre mondiale le capitalisme est entré dans sa phase de décadence pour en dégager automatiquement toutes les implications. Celles-ci sont nombreuses et ont été examinées à de multiples reprises par notre organisation, notamment dans l'article de la Revue Internationale n°23 : "La lutte du prolétariat dans li décadence du capitalisme". Nous n’évoquerons ici que les plus utiles pour comprendre l'évolution du rapport de forces entre les classes ces cinq dernières années :
- les cours en dents de scie des luttes ouvrières ;
- l'utilisation de la répression par la bourgeoisie ;
- le rôle du syndicalisme ;
a- Le cours en dents de scie des luttes ouvrières.
Depuis qu'il a été magistralement décrit par Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, ce cours en dents de scie de la lutte du prolétariat a souvent été mis en évidence par les révolutionnaires, notamment par Rosa Luxemburg dans son dernier article ("L'ordre règne à Berlin ! "). Il "est lié au fait que, contrairement aux autres classes révolutionnaires du passé, la classe ouvrière ne dispose d'aucune assise économique dans la société Ses seules forces étant sa conscience et son organisation constamment menacées par la pression de la société bourgeoise, chacun de ses faux pas ne se traduit pas par un simple coup d'arrêt de son mouvement mais par un reflux qui vient terrasser 1'une et 1'autre et la plonge dans la démoralisation et 1'atomisation.
Ce phénomène est encore accentué par 1'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence dans laquelle la classe ouvrière ne peut plus se donner d'organisation permanente basée sur la défense de ses intérêts comme classe exploitée comme pouvaient 1'être les syndicats au siècle dernier." (Revue Internationale n°8, décembre 1976, "La situation politique internationale", point 25).
C'est armé de cette vision que le CCI a pu rendre compte du surgissement historique du prolétariat à la fin des années 60 après plus de 40 ans de contre-révolution. Il n'a pas considéré que cette reprise devait s'exprimer par un développement continu des luttes ouvrières mais par une succession de vagues de luttes (1968-74, 1978-80, 1983-?) atteignant chacune un point plus élevé mais entrecoupées par des périodes de recul. Chaque fois que s'annonçait une nouvelle vague de combats ouvriers le CCI (ou, avant sa formation, les groupes qui allaient le constituer) l'a reconnue rapidement : -"Internationalismo" (seul groupe existant à l'époque) des; Janvier 68 (cf. l'article du n°8 cité dans la Revue Internationale n°40,"10 ans du CCI")
- la "Revue Internationale" n°17 (2ème trimestre 1979), "Longwy, Denain : nous montrent le chemin" où l'on peut lire : "On commettrait une lourde erreur si on voyait dans ces affrontements simultanés fin 78 en RFA, début 79 en Grande-Bretagne, Espagne, Brésil] de simples escarmouches prolongeant la vague de luttes de 1968-73. Nous devons savoir reconnaître dans cette simultanéité et cet te combativité les premiers signes d'un mouvement plus vaste, en train de mûrir... Cette reprise de la lutte de classe, ces symptômes d'une nouvelle vague de combats, nous la voyons se dérouler sous nos yeux."
- la "Revue Internationale" n°36 (1er trimestre 84), "Conflits inter-impérialistes, lutte de classe : l'histoire s'accélère", qui écrit : "... après un creux réel au lendemain de la défaite en Pologne, les grèves qui se déroulent depuis quelques mois en Europe sont significatives d'une reprise des combats de classe ; elles viennent confirmer que le prolétariat, loin d'être vaincu, garde intact son potentiel de combativité et qu'il est prêt à s'exprimer avec ampleur." (article écrit en décembre 83).
De la même façon, lorsque se précisait un recul de la lutte de classe, notre organisation n'a pas eu peur de le relever tant à la suite de la première vague qu'à la suite de la deuxième.
Ainsi, dès le 1er Congrès du CCI en janvier 76, il était constaté que "Une accalmie s'est momentanément installée sur le champ de bataille de classe pendant laquelle le prolétariat assimile les leçons de sa lutte récente..." ("Rapport sur la situation internationale", Revue Internationale n°5, p.27), idée qui était précisée quelques mois après en ces termes : "... si contrairement aux années 30 la perspective générale n'est pas guerre impérialiste mais guerre de classe, il faut constater que la situation présente se distingue par 1'existence d'un grand décalage entre le niveau de la crise économique et politique et le niveau de la lutte de classe... Ce n'est donc pas seulement de stagnation de la lutte de classe dont il faut parler mais bien d'un repli de celle-ci..." (Revue Internationale n°8, "La situation politique internationale", point 23).
De même en 1981, alors que se poursuivaient en Pologne les affrontements de classe, le CCI relevait déjà le rétablissement par le capitalisme polonais d'une "situation longtemps compromise. Non sur le plan économique : la situation est pire que jamais. . . mais sur le plan politique. Sur le plan de son aptitude à imposer aux prolétaires des conditions de misère bien pires qu'en août 80 sans que ceux-ci soient capables d'y opposer une riposte à la hauteur des grèves de cette époque.
Cette reconstitution des forces de la bourgeoisie n'a pu se faire que par un recul progressif de la classe ouvrière. Ce recul était normal et prévisible. Il ne pouvait en être autrement après le haut niveau des luttes du mois d'août 80 et en l'absence d'un développement significatif de la lutte de classe dans les autres pays." (Révolution Internationale n°89, "Pologne : la nécessité de la lutte dans les autres pays", 30/8/81).
Cette analyse allait être explicitée après le coup de force de décembre 81 dans les termes suivants : "Avec l'instauration de l'état de guerre en Pologne, le prolétariat a subi une défaite ; il serait illusoire et même dangereux de se le cacher. Seuls des aveugles ou des inconscients peuvent prétendre le contraire. . .
C'est... fondamentalement une défaite parce que ce coup de force atteint le prolétariat de tous les pays sous forme de démoralisation et surtout d'une réelle désorientât ion, d'un déboussolement certain face aux campagnes déchaînées par la bourgeoisie depuis le 13 décembre 81 et prenant le relais de celles d'avant cette date.
Cette défaite, le prolétariat mondial 1 'a subie dès lors que le capitalisme, d'une façon concertée, est parvenu à isoler le prolétariat de Pologne du reste du prolétariat mondial, à l'enfermer idéologiquement dans le cadre de ses frontières de bloc (...) et nationales (...) ; dès lors qu'il est parvenu, grâce à tous les moyens dont il dispose, à faire des ouvriers des autres pays des SPECTATEURS, inquiets, certes, mais PASSIFS, à les détourner de la seule forme que peut avoir la solidarité de classe : la généralisation de leurs luttes dans tous les pays. . ." (Revue Internationale n°29, "Après la répression en Pologne, perspectives des luttes de classe mondiales"/ 12/3/82).
Parce que le CCI avait fait sien un des enseignements classiques du marxisme, enseignement qu'il avait complété à la lumière des conditions créées par la décadence du capitalisme, il a pu s'éviter l'aveuglement qui a frappé d'autres groupes révolutionnaires. Il a pu comprendre notamment que les combats de Pologne n'étaient qu'un des engagements parmi le grand nombre qui sera encore nécessaire à la classe ouvrière avant qu'elle ne livre l'assaut décisif contre la forteresse capitaliste. C'est ce que n'avait pas compris par exemple le CWO qui, durant 1'été 81, alors que le mouvement reculait (comme le CCI l'avait constaté) a appelé en 1ère page de son journal Workers ' Voice (n°4) les ouvriers de Pologne à "la Révolution maintenant ! ". Heureusement que les ouvriers polonais ne lisaient pas Workers ' Voice : ils n'auraient certes pas été assez fous pour suivre le CWO mais, par contre, ils auraient pensé avoir à faire à des provocateurs de la police.
Moins aberrante et ridicule, mais tout aussi grave, a été l'erreur commise par un groupe comme "Volonté Communiste" qui, un an après le coup de force du 13 décembre 81, pouvait écrire :
"Le coup de Jaruzelski est la conséquence directe de la radicalisation des luttes à partir de 1'été 1981, et aussi de 1'incapacité de Solidarnosc à se structurer en véritable syndicat de branche."
"Aujourd'hui, non seulement Jaruzelski , et 'son état de siège' n'ont pas résolu la question de la crise économique, mais on assiste à une radicalisation du mouvement."
"Au lieu du pourrissement tant attendu, c'est la dynamique de lutte qui a continué. A la pointe du combat, les travailleurs polonais sont engagés dans ce qui n'est qu'un moment du 'bras de fer entre prolétariat et bourgeoisie'." (Révolution Sociale ! n°14, décembre 82).
De façon évidente, un tel aveuglement devant une réalité qui était devenue de plus en plus criante ne peut s'expliquer que par un refus délibéré d'admettre que la classe ouvrière pouvait subir une défaite. Pour un marxiste, aussi dramatique que soit, une telle constatation (surtout quand il s'agit de défaites comme celles des années 20 qui plongent la classe dans une effroyable contre-révolution), elle doit s'imposer à chaque fois que le prolétariat subit un revers parce qu'il sait bien que "la révolution est la seule forme de guerre' - c'est encore une des lois de son développement - où la victoire finale ne saurait être obtenue que par une série de 'défaites '". (Rosa Luxemburg, "L'ordre règne à Berlin !", 14 janvier 1919).
Par contre, quand on manque de confiance dans la classe ouvrière, comme c'est le cas lorsqu'on est imbibé d'idéologie petite-bourgeoise à l'image du "Groupe Volonté Communiste", on craint d'admettre que le prolétariat puisse être défait, même de façon partielle, car on s'imagine qu'il ne pourra pas s'en relever. Ainsi une surestimation du niveau des luttes à un moment donné n'est nullement contradictoire avec une sous-estimation de la force réelle de la classe ouvrière, c'en est même le complément inévitable. C'est ce qu'ont démontré les éléments de "Volonté Communiste" qui, dans nos réunions publiques (leur publication qui était parue de façon mensuelle durant la période de recul ayant cessé de paraître quelques mois avant la reprise des luttes) affichent le plus noir scepticisme sur les potentialités des luttes présentes ([9] [836]) . C'est ce qu'a démontré également le CWO qui, après ses accès , d'enthousiasme d'août 82, a eu plusieurs trains de retard en compagnie de son organisation soeur "Battaglia Comunista" avant de reconnaître la reprise.
Mais il convient de relever une autre idée contenue dans l'article de Révolution Sociale : "Le coup de Jaruzelski est la conséquence directe de la radicalisation des luttes à partir de 1'été 81". Elle fait la preuve que ce groupe (comme divers autres) n'a pas compris la question de la répression dans la période historique actuelle.
b- L'utilisation de la répression par la bourgeoisie.
Tirant les enseignements de la défaite de 1981 nous écrivions : "Le coup du 13 décembre, sa préparation et ses suites sont une victoire de la bourgeoisie. . . Cet exemple illustre une fois de plus que, dans la décadence du capitalisme, la bourgeoisie n'affronte pas le prolétariat de la même façon qu'au siècle dernier. A cette époque les défaites infligées au prolétariat, les répressions sanglantes, ne lui laissaient pas d’ambiguïté sur qui étaient ses amis et ses ennemis : ce fut notamment le cas lors de la Commune de Paris et même de la Révolution de 1905 qui, tout en annonçant déjà les combats de ce siècle (la grève de masse et les conseils ouvriers) comportait encore des caractéristiques propres au siècle dernier (notamment quant aux méthodes de la bourgeoisie). Aujourd'hui par contre, la bourgeoisie ne déchaîne la répression ouverte qu'à la suite de toute une préparation idéologique- dans laquelle la gauche et les syndicats jouent un rôle décisif, et qui est destiné tant à affaiblir les capacités de défense du prolétariat qu'à 1 'empêcher de tirer tous les enseignements nécessaires de la répression". (Revue Internationale n°29, "Après la répression en Pologne...").
Ce n'était là nullement une "découverte tardive" après coup, puisqu'en mars 81, on pouvait lire dans un tract du CCI en langue polonaise :
"Il serait catastrophique pour les ouvriers de Pologne de croire que la passivité peut leur éviter la répression. Si 1'Etat a été contraint de reculer, il n'a nullement renoncé à imposer de nouveau à la société sa chape de plomb. S'il s'abstient aujourd'hui d'user de la répression violente, comme il le fit par le passé, c'est qu'il craint une mobilisation ouvrière immédiate. Mais si la classe ouvrière renonce à lutter chaque fois que 1'Etat tente de porter une nouvelle atteinte à ses intérêts, alors la voie sera ouverte à la démobilisation et à la répression "
Il importe donc que les révolutionnaires soient clairs sur les armes qu'emploie la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Si leur rôle n'est jamais d'appeler à l'aventure dans des affrontements prématurés, ils doivent insister sur l'importance de la mobilisation de classe, de l'extension des luttes, comme meilleure prévention contre le danger d'une répression brutale. C'est ce que n'avaient pas compris ni le CWO ni "Volonté Communiste", et qui explique notamment que ce dernier groupe n'ait reconnu la défaite ouvrière qu'avec deux ans de retard, s'imaginant que si la répression s'était déchaînée en Pologne c'est parce que Solidarnosc était complètement débordé. Cela montre aussi qu'il importe d'avoir les idées claires sur le rôle et la façon de faire du syndicalisme dans la période actuelle.
c- Le rôle du syndicalisme.
Dans la période de décadence du capitalisme, les syndicats sont devenus un des instruments essentiels de la bourgeoisie pour encadrer le prolétariat et étouffer ses luttes. Cela, tous les groupes qui se situent sur un terrain de classe l'ont compris. Mais encore faut-il avoir pleinement assimilé ce que cela signifie. En particulier, l'analyse insuffisante faite par le courant bordiguiste de la question syndicale est en bonne partie responsable de son incapacité à reconnaître 1'importance des mouvements comme celui de Pologne en Août 80. En effet, alors que dans la période de décadence du capitalisme : "L'impossibilité d'améliorations durables pour la classe ouvrière lui interdit la constitution d'une organisation spécifique, permanente, basée sur la défense de ses intérêts économiques.
La lutte prolétarienne tend à dépasser le cadre strictement économique pour devenir sociale, s'affrontant directement à l'Etat, se politisant et exigeant la participation massive de la classe. . .
Un tel type de lutte, propre à la période de décadence, ne peut se préparer d'avance sur le plan organisationnel. Les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser." (Revue Internationale n°23, 4ème trimestre 80, "La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme").
Ce courant ne pouvait se faire à l'idée d'un tel surgissement spontané des luttes. Pour que celles-ci aient une certaine ampleur, il fallait qu'existe au préalable une organisation de la classe, que se manifeste d'abord un "associationnisme ouvrier" (suivant ses propres termes). De même qu'en 1968 en France, ce courant avait complètement sous-estimé le mouvement (avant d'appeler les 10 millions d'ouvriers en grève à se ranger derrière son drapeau !), il n'a su reconnaître l'importance des combats de Pologne qu'avec un retard considérable.
Ce manque de clarté sur la question syndicale se retrouve chez "Volonté Communiste" lorsque ce groupe écrit : "Dans le système capitaliste démocratique, le syndicat est un intermédiaire opérant entre les travailleurs et l'Etat. Dans un système capitaliste d'Etat, quand se pose d'emblée l'affrontement entre les prolétaires et l'Etat, le syndicat est une forme inopérante et donc un obstacle immédiat à la lutte contre le pouvoir capitaliste." (Révolution Sociale!" n°14).
Il est clair qu'avec une telle vision du syndicat, tant dans les pays de l'ouest ("intermédiaire entre les travailleurs et l'Etat" et non organe de l'Etat dédié à l'encadrement des travailleurs) que dans les pays de l'Est ("forme inopérante" alors qu'on a pu constater l'extraordinaire efficacité de Solidarnosc contre la lutte de classe), un tel groupe ne pouvait comprendre :
- que le renforcement de Solidarnosc en 1981 en Pologne signifiait un affaiblissement de la classe ;
- que toute l'offensive syndicale en occident de cette même période (radicalisation dès la fin des années 70, campagnes menées autour de la Pologne) allait peser sur le prolétariat de cette partie du monde ;
- que l'affaiblissement continu, ces dernières années, de l'influence des syndicats, le phénomène de désyndicalisation général dans les pays occidentaux, était une des prémisses de la reprise actuelle des luttes.
L'incompréhension des implications de la décadence du capitalisme (quand ce n'est pas le rejet de cette analyse) sur les conditions de la lutte de classe, peut avoir un effet catastrophique sur les positions programmatiques (questions nationale, parlementaire, syndicale, du frontisme) menaçant la survie-même d'une organisation comme instrument de la classe ouvrière (cas de la dégénérescence opportuniste de l'Internationale Communiste, plus récemment décomposition de "Programma Comunista" et évolution vers le gauchisme de son héritier "Combat"). '
Cela situe toute 1'importance de développer l'analyse la plus claire possible sur cette question comme le CCI s'y est toujours attaché depuis ses origines (notamment dans sa plateforme et avec sa brochure sur La décadence du capitalisme). Mais la clarté sur l'autre point qui était à la base de la constitution du CCI, l'analyse du cours historique, revêt également une importance considérable.
L'ANALYSE DU COURS HISTORIQUE
Nous avons suffisamment consacré d'articles de cette revue à cette question (notamment un rapport au 3ème Congrès de CCI dans la Revue (ï^TB^et une polémique avec les thèses du 5ème congrès de "Battaglia Comunista" dans la revue n°36) pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir longuement ici, sinon pour signaler l'incroyable légèreté avec laquelle certains groupes traitent de cette question. C'est ainsi qu'on peut lire dans Workers'Voice n°17 en réponse à nos analyses : "Le CWO a démontré que le cours historique ne peut être appréhendé que dialectiquement (souligné par le CWO) comme menant à la fois vers la guerre et vers la révolution". La dialectique a vraiment bon dos ! Après l'utilisation magistrale qu'en a fait Marx dans toute son oeuvre pour rendre compte de la nature contradictoire des processus sociaux (et en premier lieu pour constater que "L'histoire est 1 'histoire de la lutte de classe" ), ses épigones au petit pied et à l'esprit un peu faible en ont fait un cache-sexe pour tenter de dissimuler les contradictions et 1'incohérence de leur pensée.
L'organisation soeur de CWO,"Battaglia Comunista", ne fait pas preuve de la même stupide prétention pour énoncer la même idée :"on ne peut pas se prononcer sur le cours historique". Elle témoigne même d'une rare humilité dans les thèses de son 5ème Congrès (Prometeo n°7, juin 1983) : "L'effondrement général de 1'économie se traduit de façon immédiate par 1'alternative : guerre ou révolution. Mais la guerre elle-même en marquant un virage en soi catastrophique dans la crise du capitalisme et un brusque bouleversement dans les échafaudages superstructurels du système, ouvre les possibilités de l'effondrement de ceux-ci et donc 1'ouverture, au sein même de la guerre, d'une situation révolutionnaire et de la possibilité d'affirmation du parti communiste. Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social, au sein duquel le parti trouvera les conditions de sa croissance rapide et de son affirmation, que ce soit dans la période qui précède le conflit, pendant le conflit, ou immédiatement après celui-ci, ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu (exemple polonais)".
Quelle avant-garde qui ne sait même pas dire à sa classe si nous allons vers la guerre mondiale ou vers la révolution ! En tout cas, la Gauche italienne dont se réclament le CWO et "Battaglia" aurait eu bonne mine si, face aux événements d'Espagne en 36, elle avait dit : "Il faut appréhender la situation de façon 'dialectique' : comme les facteurs de la situation ne sont pas 'quantifiables', nous disons tout net aux ouvriers : nous allons soit vers la guerre mondiale, soit vers la révolution, soit vers les deux en même temps !". Avec une telle démarche, c'est la fraction toute entière, et non seulement sa minorité, qui se serait laissée enrôler dans les brigades anti-fascistes ([10] [837]).
Nous laissons de côté ici la question de la possibilité d'un surgissement de la révolution dans ou à la suite d'une 3ème guerre mondiale qui est de nouveau traitée dans l'article "La guerre dans le capitalisme"de ce même n°. Par contre, on peut dire qu'avec une vision qui ne permet pas de voir que nous allons vers des affrontements de classe généralisés avant qu'éventuellement -si le prolétariat y est défait- le capitalisme puisse déchaîner une guerre mondiale, une vision qui considère qu'aujourd'hui "le prolétariat est fatigué et déçu" (Prometeo n°7), il n'est pas surprenant que "Battaglia Comunista" n'ait constaté la reprise actuelle des luttes qu'avec huit mois de retard,en avril 84 (Battaglia Comunista n°6), et encore sous forme d'interrogation : "La paix sociale se rompt-elle ?".
En effet, pour interpréter les luttes de l'automne 83 comme les premières d'une reprise générale, il fallait avoir compris que, dans le cours historique actuel aux affrontements de classe, l'accélération de l'histoire provoquée par l'aggravation considérable de la crise dans les années '80 -les "années de vérité"- allait se traduire par une durée de plus en plus courte des moments de ^recul.
De même, il faut constater que la "dialectique" à la sauce CWO n'est certainement pas étrangère à la bourde énorme commise en été 81 à propos de la Pologne. Bourde qui s'explique également par l'incompréhension totale de deux questions analysées* par le CCI.
LA GENERALISATION MONDIALE DES LUTTES ET LE ROLE DU PROLETARIAT D'EUROPE OCCIDENTALE
En effet, si nous avons pu comprendre le recul qui s'était opéré en Pologne, c'est -comme nous l'avons vu plus haut- que le rapport de forces entre les classes dans ce pays était très largement déterminé par le rapport de forces à l'échelle internationale et notamment dans les métropoles industrielles d'occident. L'idée que la révolution fut possible en Pologne alors que dans ces concentrations le prolétariat restait passif, indique qu'on avait perdu de vue des enseignements du marxisme vieux de plus d'un siècle :
"La Révolution communiste... ne sera pas une révolution purement nationale ; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c'est-à-dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne".(Engels, "Principes du communisme", 1847).
C'est sur cette base que le CCI, suite aux combats de Pologne, a développé son analyse sur "la généralisation mondiale de la lutte de classe" (Revue Internationale n°26) et sur "le prolétariat d'Europe occidentale au coeur de la généralisation de la lutte de classe, critique de la théorie du 'maillon le plus faible'" (R.Int.n°31) suivant laquelle : "Tant que les mouvements importants de la classe ne toucheront que des pays de la périphérie du capitalisme (comme ce fut le cas en Pologne) et même si la bourgeoisie locale est complètement débordée, la Sainte-Alliance de toutes les bourgeoisies du monde, avec à leur tête les plus puissantes, sera en mesure d'établir un cordon sanitaire tant économique que politique, idéologique et même militaire, autour des secteurs prolétariens concernés. Ce n'est qu'au moment où la lutte prolétarienne touchera le coeur économique et politique du dispositif capitaliste... que cette lutte donnera le signal de 1'embrasement révolutionnaire mondial... Ce coeur et ce cerveau du monde capitaliste, 1'histoire 1'a situé depuis des siècles en Europe occidentale... 1'épicentre du séisme révolutionnaire à venir se trouve placé dans le coeur industriel de 1'Europe occidentale où sont réunies les conditions optimales de la prise de conscience et de la capacité de combat révolutionnaire de la classe, ce qui confère au prolétariat de cette zone un rôle d'avant-garde du prolétariat mondial".
Evidemment, le CWO avec sa dialectique de café du commerce n'a que mépris pour une telle perspective : "Le CWO a aussi démontré que, bien que les révolutions prolétariennes ne puissent réussir dans n'importe quel pays isolément, les premiers surgissements de la classe ouvrière peuvent venir des pays sous-développés tout comme des pays avancés, et que les communistes doivent être prêts pour les deux possibilités". Workers'Voice n°17). En 1981, le CWO était prêt à toutes les possibilités, même à la révolution en Pologne. Ce qu'il a donc "démontré" de façon convaincante, c'est l'inadéquation de son cadre d'analyse. Cette vision du CCI, si elle lui avait permis de comprendre le recul des luttes et la défaite du prolétariat en 81, lui a également permis de relativiser l'importance de la défaite subie par le prolétariat en Pologne et donc du recul qui allait la suivre : "Pour cruelle qu'elle soit, la défaite subie par le prolétariat à la suite de ses combats en Pologne n'est que partielle. Par contre le il gros des troupes, celui qui est basé dans les énormes concentrations industrielles d'occident, et notamment en Allemagne, n'est pas encore entré dans la bataille:" (Revue Internationale n°29, "Après la répression en Pologne...").
De même, parmi les éléments qui nous ont fait reconnaître toute 1'importance de la grève du secteur public en Belgique de septembre 83 comme annonciatrice de la reprise des combats et comme "le mouvement de lutte ouvrière le plus important depuis les combats de Pologne 80", nous avons signalé notamment (Revue Internationale n°36) :
"- le fait que ce mouvement a touché un des pays les plus industrialisés du monde, de plus vieux capitalisme, situé en plein coeur des énormes concentrations prolétariennes d'Europe occidentale ;
- la dynamique qui s'est exprimée au démarrage du mouvement : surgissement spontané des luttes qui a pris de court et a débordé les syndicats ; tendance à 1'extension ; dépassement des clivages communautaires et linguistiques ;
- le fait que ce mouvement prend place dans un contexte international de surgissement sporadique mais significatif de la combativité ouvrière"
Mais cette présentation des analyses indispensables à la compréhension de la période présente, serait incomplète si on ne parlait pas d'une des questions essentielles à laquelle est confronté aujourd'hui le prolétariat.
LA STRATEGIE BOURGEOISE DE LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION
Pour le CWO, notre analyse sur cette question "est pure scholastique comme toutes les autres, donnant 1'illusion d'une clarification et détour nant 1 'organisation des vraies questions de la politique révolutionnaire" (ibid.).
Pour sa part, "Volonté Communiste" se hérisse à l'idée que la bourgeoisie pourrait avoir une stratégie contre la classe ouvrière : "Se vautrant dans le sang, la bourgeoisie fait de plus en plus preuve de cécité historique et ne peut qu 'essayer de colmater des brèches ouvertes dans son système par le développement de contradictions devenues insurmontables depuis 1'entrée en décadence impuissante et instable, elle se débat désormais, a la différence du 19ème siècle, dans des convulsions permanentes : d'où, au delà des pesanteurs institutionnelles de tel ou tel Etat, le seul mode de gouvernement réel est la fuite en avant, l'empirisme le plus total à tous les niveaux" (Révolution Sociale 1 n°16, "Critique du CCI").
Mais si ces deux groupes et beaucoup d'autres avaient compris cette question, ils auraient su :
- comprendre l'efficacité de cette nouvelle carte jouée par la bourgeoisie à la fin des années 70 et qui porte une très grande responsabilité dans le déboussolement du prolétariat au début des années 80, tant, d'ailleurs, en occident qu'en Pologne ; cela leur aurait permis de s'éviter de dire pas mal de bêtises sur les potentialités des luttes en 81-82 ;
- prévoir, qu'une fois passé l'effet de surprise provoqué par la nouveauté de cette carte, son efficacité allait commencer à s'émousser, ce qui allait permettre la reprise des luttes à la mi-83, reprise qu'ils n'ont pas su voir, sinon avec pas mal de retard ;- ne pas se laisser aveugler par l'omniprésence des syndicats dans les luttes actuelles (qui leur font sous-estimer leur importance) qui sont une composante majeure de la carte de la "gauche dans l'opposition" puisque : "Dans les pays avancés d'occident et notamment en Europe de l'ouest, le prolétariat ne pourra déployer pleinement la grève de masse qu'à l'issue de toute une série de combats, d'explosions violentes, d'avancées et de reculs au cours desquels il démasquera progressivement tous les mensonges de la gauche dans 1'opposition, du syndicat et du syndicalisme de base"-("Résolution sur la situation internationale" du 5ème Congrès du CCI, Revue Internationale n°35).
Comme l'écrivait Marx : "C'est dans la pratique que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée". ("Thèses sur Feuerbach").
Malheureusement, c'est bien souvent complètement à l'envers que les groupes révolutionnaires comprennent cette phrase. Lorsque la réalité s'obstine à contredire leurs analyses, ils ne se sentent pas concernés et continuent, comme si de rien n'était à maintenir leur erreurs et leurs confusions en essayant, à grand renfort de "dialectique", de faire rentrer de force les faits dans un cadre où ils n'ont pas de place.
Par contre, quand cela les arrange, ils donnent à la phrase de Marx un sens que celui-ci aurait rejeté avec vigueur et mépris : la glorification de l'empirisme. Car derrière toutes les phrases du CWO contre les "débats scholastiques" ou les hypo thèses multiples de "Battaglia", ce n'est pas autre chose que l'empirisme que nous trouvons, cet empirisme que Lénine - dont se réclament à cors et à cris ces organisations- raillait chez les économistes du début du siècle : "En effet, quelle attitude prétentieuse et quelle exagération de 1'élément conscient : résoudre théoriquement les questions par avance, afin de convaincre ensuite du bien-fondé de cette solution, 1 'organisation, le parti et la masse".("Que Faire ?").
Le CWO et "Battaglia" ne cessent de répéter qu'ils constituent l'avant-garde, le guide du prolétariat. C'est dans la pratique et non en paroles qu'ils le démontreront. Mais pour cela, ils auront besoin de troquer leur empirisme contre la méthode marxiste ; sinon, ne sachant pas apprécier le rapport de forces entre les classes, identifier les armes de l'ennemi, ils ne pourront "guider" le prolétariat que vers la défaite.
F.M. 3/3/85
[1] [838] "Battaglia Comunista", CasellaPostale 1753, 20100 MILANO, ITALIE
[2] [839] CWO, PO Box 145, Head Post Office, Glasgow, GRANDE-BRETAGNE
[3] [840] BP 30316, 75767 PARIS CEDEX 16,FRANCE
[4] [841] Revue Internationale n. 16 :"2ème Conférence Internationale des Groupes de la Gauche Communiste".
[5] [842] Revue Internationale n.40 : "10 ans du CCI : quelques enseignements".
[6] [843] Revue Internationale n.26 : "Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière".
[7] [844] Revue internationale n.31"Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe"
[8] [845] Revue internationale n.31"Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe"
[9] [846] Ces mêmes éléments avaient évidemment crié au défaitisme lorsque nous avions mis en évidence le recul des luttes en 81 et 82.
[10] [847] Voir sur cette question les articles de la Revue Internationale n°4, n°6 et n°7 et notre brochure "La Gauche Communiste d'Italie".
Heritage de la Gauche Communiste:
Où en est la crise économique ? : Dollar : le roi est nu
- 4155 reads
A l'époque de l'informatique, des communications par satellites, l'information circule à la vitesse de là lumière autour du globe et les échanges font de même. Quelques coups de téléphone et ce sont des milliards de dollars qui s'échangent, ce sont des fortunes qui se font et se défont en quelques minutes. Le dollar poursuit sa sarabande effrénée autour de la planète dans un mouvement incessant : de New York à Chicago, de Chicago à Tokyo, de Tokyo à Hong-Kong, à Zurich, Paris, Londres chaque place financière prend le relais de l'autre pour maintenir le mouvement incessant des capitaux.
LA MONTEE DE LA SPECULATION
Le dollar est la monnaie mondiale par excellence ; plus de 80 % des échanges mondiaux se font en dollars. La variation des cours du dollar affecte l'ensemble de l'économie mondiale. Et le cours du dollar est tout sauf stable : durant les mois de janvier et février 1985, le dollar a poursuivi son ascension fulgurante, grimpant par rapport au franc français de 10 centimes par semaine d'abord, et accélérant son mouvement de 10 centimes par jour ensuite. Le 27 février, après les déclarations alarmistes de Volcker, président de la Banque Fédérale américaine, et l'intervention des grandes banques centrales, c'est la dégringolade. En quelques minutes le dollar passe par rapport au franc français de 10,61 F à 10,10 pour remonter à 10,20 F : 40 centimes de perdus vis-à-vis du franc, 5 % de dévalorisation vis-à-vis du Deutsch Mark. C'est ainsi plus de 10 milliards de dollars qui se sont envolés en fumée sur le marché mondial. Déjà en septembre 1984, le dollar avait en une journée perdu 40 centimes, mais cela ne l'avait pas empêché de reprendre son ascension par la suite sous la pression de la spéculation internationale.
POURQUOI LE DOLLAR GRIMPE-T-IL ?
Les économistes y perdent leur latin. Ainsi, Otto Piehl, gouverneur de la Banque Centrale de R.F.A., lors d'un symposium qui réunissait le gratin de la finance internationale, ironise : "Le dollar est miraculeux et sur ce point notre vision est confuse, mais après la discussion nous serons confus à un niveau supérieur."Voilà qui n'est guère rassurant pour l'économie mondiale.
Qu'y a-t-il donc de si miraculeux dans la "santé" actuelle du dollar par rapport aux autres monnaies ? Simplement que la montée actuelle du cours du dollar ne correspond absolument pas à la réalité économique de la compétitivité du capital américain par rapport à ses concurrents. Le dollar est énormément surévalué.
Dans ce cas, pourquoi une telle spéculation effrénée sur le dollar sur toutes les places financières du monde ? A cela deux raisons essentielles :
1) La politique américaine de déficit budgétaire et commercial crée un énorme besoin de l'économie américaine en dollars pour le combler. Le déficit budgétaire a ainsi atteint 195 milliards de dollars en 1983 et 184 milliards de dollars en 1984 (voir tableau No 3), et le déficit commercial a été de 123,3 milliards de dollars en 1984. Et ce déficit ne se réduit pas comme le montre le tableau No 1 ci-dessous.
Et ce ne sont pas les timides propositions de réduction du déficit budgétaire annoncées par Washington depuis décembre 1984 qui freineront la tendance. Au contraire, cela ne peut que rassurer les spéculateurs et pousser encore plus à la hausse du dollar. Ce qui s'est effectivement produit.
2) Les USA sont la première puissance économique et mondiale. La forteresse du capital international. Devant le ralentissement de la reprise et les risques de la récession qui pointent à l'horizon, les capitaux du monde entier viennent se placer aux USA pour tenter de se préserver du mouvement de reflux qui s'annonce. Le mouvement de spéculation actuel est le signe de 1 ' inquiétude de la finance internationale.
L' ENDETTEMENT : UNE BOMBE A RETARDEMENT PLACEE AU COEUR DE L'ECONOMIE MONDIALE
Pour combler ces déficits, les USA s'endettent. Les USA ne peuvent trop faire marcher la planche à billets de peur de relancer un processus inflationniste incontrôlable ; ils font appel aux capitaux étrangers. Mais comme le dit Volcker, "Les Etats-Unis ne pourront vivre indéfiniment au-dessus de leurs moyens grâce aux capitaux étrangers". En effet, l'endettement actuel est pharamineux.
La dette totale des USA est de 6 000 milliards de dollars. De tels chiffres perdent leur sens, un 6 suivi de 12 zéros, de quoi donner le vertige. Cela représente deux ans de production des USA, six du Japon, dix de l'Allemagne !
La dette publique, avec ses 1 500 milliards de dollars, à elle seule, implique le paiement de près de 100 milliards de dollars d'intérêts en 1984 et ce service de la dette passera à 214 milliards en 1989. A ce rythme les USA vont devenir débiteurs du reste du monde en 1985.
Pour n'importe quel pays sous-développé, une telle situation serait catastrophique. Le FMI interviendrait de toute urgence pour imposer un plan d'austérité draconien. Cela montre à l'évidence que la force actuelle du dollar est une tricherie gigantesque par rapport aux lois économiques. Les USA profitent de leur position de force économique et militaire pour imposer au travers du dollar, leur monnaie nationale mais aussi principale monnaie d'échange internationale, leur loi au monde.
Les lois économiques ne jouent-elles plus leur rôle ? Le dollar échappe-t-il à toutes les règles? Son ascension est-elle inéluctable et inévitable ? Certainement pas. Les politiques de capitalisme d'Etat peuvent repousser l'échéance de la crise par des artifices monétaires, mais cela ne fait que reporter les contradictions à un niveau plus élevé, plus explosif.
Les déclarations de Volcker qui ont provoqué la chute des cours le 27 février sont sans ambiguïté sur ce point. Lui qui, il y a un an, déclarait que l'endettement extérieur était "un pistolet braqué sur le coeur des Etats-Unis", a récidivé en disant que "du fait de la taille du déficit budgétaire, le gonflement des emprunts américains à 1'étranger contient les germes de sa propre destruction" et de préciser à propos de la chute du cours du dollar " Je ne peux prédire quand, mais le scénario est en place".
LA RECESSION SE PROFILE A L'HORIZON
La croissance de l'économie américaine, très soutenue au printemps 1984 s'est ralentie ces derniers mois. Les commandes passées à l'industrie se sont ralenties : août : - 1,7 %, septembre : - 4,3 %, octobre : - 4,1 %, décembre : - 2,1 %. La croissance du P.N.B. qui avait atteint 7,1 % au printemps n'était plus que de 1,9 % au troisième trimestre 1984.
Le déficit américain n'est plus suffisant, malgré son importance, pour maintenir la min ireprise mondiale dont les effets ont d'ailleurs surtout été marquants aux USA alors que l'Europe stagnait. Le spectre de la récession pointe à l'horizon et cette perspective ne peut que remplir les financiers capitalistes d'effroi.
Toutes les grandes banques américaines ont énornément prêté, prêts de dix fois leurs avoirs réels. Comme exemple, prenons simplement l'engagement des principales banques américaines vis-à-vis de cinq pays d'Amérique latine (Argentine, Brésil, Venezuela, Maxique, Chili) : Citicorp 174 % de l'avoir des actionnaires, Bank of America 158 %, Chase Manhattan 154 %, Manufacturers Hanover 262 %, Continental Illinois 107 %, etc. Il y a ainsi environ 14 500 banques américaines qui sont dans le même cas ([1] [848]).
La récession, cela signifie des millions d'ouvriers réduits au chômage, des milliers d'entreprises en faillite, des dizaines de pays en situation de cessation de paiement. Autant de secteurs qui ne pourront ainsi rembourser leurs dettes, jettent à leur tour les banques dans la faillite. La faillite de la Continental Illinois n'a pu être comblée que par l'injection de 8 milliards de dollars frais grâce à l'aide des autres banques et de l'Etat américain, mais ce qui se profile à l'horizon ne pourra être résorbé aussi facilement. Ce qui se prépare c'est la banqueroute du système financier international, avec au coeur de cette banqueroute, le dollar.
Une brève récession de six mois seulement ferait passer le déficit fédéral de 200 à 500 milliards de dollars selon une étude de la Chase Econometrics. Devant une telle situation, les USA n'auraient d'autre recours que de combler ce déficit par le recours massif à la planche à billets car les capitaux du monde entier ne suffiraient pas, relançant ainsi la spirale inflationniste galopante que Reagan se targue tant d'avoir vaincue. Une telle situation ne peut que provoquer une panique sur les marchés financiers, amenant un retour de tendance où la spéculation jouerait cette fois contre le dollar, plongeant l'économie mondiale dans les affres d'une récession comme elle n'en a jamais connue et qui se conjuguera avec une hyperinflation.
Voilà le "scénario" dont parle Volcker. C'est un scénario catastrophe. Le gouvernement américain essaie d'utiliser tous les artifices pour reculer cette échéance : suppression des retenues à la source, internationalisation du Yen, appels de Reagan aux Européens afin que ceux-ci s'endettent encore plus pour soutenir l'effort américain et maintenir l'activité économique. Mais tous ces expédients sont insuffisants et la fuite en avant actuelle ne fait que montrer l'impasse du capitalisme mondial et annoncer la catastrophe future.
QUELLES CONSEQUENCES POUR LA CLASSE OUVRIERE ?
La reprise reaganienne s'est essentiellement limitée aux USA où le taux de chômage a diminué de 2,45 %. En 1984, par contre, pour 1'ensemble des pays sous-développés, elle a signifié une plongée dans une misère insondable, une situation de famine comme en Ethiopie, comme au Brési1, tandis qu'en Europe, le relatif maintien de l'économie n'a pas empêché une progression du chômage : 2,25 % en 1984 dans la CEE. Avec le ralentissement de la reprise, ces derniers mois ont vu une relance du chômage : 600 000 chômeurs de plus pour la CEE en janvier 1984, 300 000 pour la seule RFA qui, avec cette progression, bat son record de 1953 avec 2,62 millions de chômeurs. La perspective de la récession implique une explosion du chômage et une plongée dans la misère tiers-mondiste au coeur du capitalisme industriel. La chute complète de l'illusion sur la possible reprise économique va montrer l'impasse du capitalisme à l'ensemble du prolétariat mondial. Posant toujours plus la nécessité de la mise en avant d'une perspective révolutionnaire' comme seul moyen de survie de l'humanité, alors que le capitalisme la mène à sa destruction.
Le capitalisme mondial est dans l'impasse économique, au bord du vide, et la bourgeoisie elle-même commence à s'en rendre compte. Elle est de plus en plus poussée du terrain économique vers le plan militaire dans sa fuite en avant devant la catastrophe économique.
L'essentiel du déficit budgétaire américain sert à financer son effort de guerre où des capitaux gigantesques sont engouffrés et stérilisés (voir tableau 3 page précédente).
En janvier 1985 les commandes de biens durables ont augmenté de 3,8 % aux USA. Mais si on supprime les commandes militaires, c'est en fait à une chute de - 11,5 % des commandes à laquelle on assiste. Derrière la plongée accélérée dans la crise économique ce qui se profile c'est l'exacerbât ion et l'accélération des tensions inter-impérialistes, la fuite en avant de la bourgeoisie vers la guerre.
Le capitalisme n'a plus d'avenir à offrir à l'humanité. Les dernières illusions sur sa capacité de s'en sortir, sur une hypothétique révolution technologique, vont se fracasser contre la réalité de la banqueroute.
Le président Reagan ne restera certainement pas dans l'histoire comme le matamore qui a vaincu la crise, mais comme le président de la plus grande crise économique qu'ait connue le capital.
Le compte à rebours est commencé, la récession est inéluctable. Cette récession va signifier une nouvelle accélération des tensions, un approfondissement des antagonismes de classe. De la capacité du prolétariat à développer ses luttes, à mettre en avant dans celles-ci une perspective révolutionnaire, dépend l'avenir de l'humanité face à la destruction qui la menace. Car le capitalisme va vers la banqueroute et c'est toute l'humanité qu'il risque d'entraîner dans sa propre perte dans un nouvel holocauste mondial.
Le dollar est encore le dollar-roi qui domine toute l'économie mondiale. Mais le roi est nu et cette évidence va bientôt percer tous les rideaux de fumée de la propagande capitaliste.
J.J. ,2/3/85
[1] [849] Institut d’économie internationale de Washington, 1983.
Géographique:
- Etats-Unis [9]
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Socialisme ou barbarie : la guerre dans le capitalisme
- 2901 reads
La guerre dans le capitalisme décadent est radicalement différente de toutes les guerres du passé. Le caractère totalement irrationnel qu'elle y possède n'est que le reflet de l'absurdité d'un système social mondial devenu historiquement obsolète et barbare. Contrairement à ce qu'affirment très superficiellement certains courants révolutionnaires, une 3ème guerre mondiale - qui menacerait la survie même de l'humanité - ne créerait pas les conditions d'une révolution prolétarienne mondiale triomphante, au contraire.
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve 1'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie ou salut par le socialisme. Il est impossible que la guerre mondiale procure aux classes dirigeantes une nouvelle issue, car il n'en existe plus sur le terrain de la domination de classe du capitalisme. Le socialisme est devenu une nécessité non seulement parce que le prolétariat ne veut plus vivre dans les conditions matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce que, si le prolétariat ne remplit pas son devoir de classe en réalisant le socialisme, l'abîme nous attend tous, tant que nous sommes." R. Luxembourg, Discours sur le Programme, 1919
Enoncée il y a soixante cinq ans, cette mise en garde a connu et connaît encore aujourd'hui une réalité et une actualité brûlantes. Pourtant, la justesse de ce point de vue, le seul qui réponde à la situation historique que nous vivons, malgré la terrible expérience de ces 65 années qui nous séparent du moment où ces lignes ont été écrites, ne représente pas la pensée la plus répandue, loin s'en faut.
De conflagrations internationales en conflits localisés, de conflits localisés en préparations de nouvelles conflagrations internationales, les générations actuelles et celles qui les ont enfantées ont tellement été imprégnées de cette atmosphère et de cette situation de guerre mondiale permanente depuis le début de ce siècle qu'elles ont le plus grand mal à en saisir la portée, la signification et les perspectives.
UNE IDEOLOGIE AMBIANTE
Phénomène historique, la guerre mondiale, de par son caractère omniprésent et permanent, finit par hanter les esprits et à devenir dans la représentation collective un phénomène naturel, inhérent à la nature humaine. Inutile de dire que cette représentation mythique dans le vrai sens du terme est largement entretenue, suscitée et diffusée par les tenants de 1'idéologie dominante qui sont les maîtres d'oeuvre de cette situation de guerre et de préparation à la guerre mondiale permanente. L'idéologie pacifiste est elle-même le complément indispensable de cette pensée par les sentiments d'impuissance qu'elle entretient vis-à-vis de tout préparatif ou situation de guerre.
Au moment où les tensions mondiales s'exacerbent encore et encore, où les moyens de destruction s'accumulent à un rythme difficile à suivre tellement il est rapide, alors que la crise économique mondiale dans laquelle la guerre mondiale trouve ses sources, plonge dans des abîmes sans fond, ce vieux discours réapparaît en force.
"Devant 1'efficacité malgré tout spectaculaire du système militaro-industriel américain, il peut paraître étonnant qu'un consensus ne s 'établisse pas aux USA autour de l'idée que la guerre, ou sa préparation, engendre la prospérité...
Tandis qu'aux périodes de paix ont toujours correspondu de désolantes (sic!) phases de dépression économique, les grandes pointes de la conjoncture économique depuis 4 siècles (à grands traits, il y en a eu huit vues d 'Europe) ont toujours été les périodes de conflit : la guerre de Trente Ans, les guerres de religion (et leur reconstruction) les guerres européennes de 1720, la guerre de succession d'Autriche et la guerre de Sept Ans, avec un sommet de prospérité en 1775, puis - comme après chaque dépression pacifique - les guerres de la Révolution et de 1'Empire français , en attendant celles de la fin du siècle au moment du Second Empire, puis la Première et la Seconde guerre mondiale." J.Grapin, Forteresse America (Ed.Grasset, p.85).
Cette citation résume le fond de la pensée dominante et décadente de notre époque. Habillé des attraits du bon sens et de l'objectivité, son but est de justifier la guerre par une pseudo prospérité; sa méthode est la confusion et l'amalgame historique, sa philosophie se ramène à la plate morale de l'homme belliqueux par nature. Il n'est d'ailleurs pour surprendre personne qu'en exergue du chapitre duquel a été extrait le passage ci-dessus cité, on puisse lire:
"Il semble que l'homme soit organiquement incapable de répondre à la question : "si on ne fait pas la guerre, qu' est-ce qu'on fait ?".
Nous rejetons totalement cette pensée a-historique et métaphysique qui trace un trait d'égalité entre toutes les guerres, du Moyen-Age aux deux dernières guerres mondiales.
Un amalgame entre toutes les guerres pour la période qui va du Moyen Age jusqu'à aujourd'hui est une abstraction et une aberration historique totale. Tant dans leurs déroulements et implications que dans fleurs causes, les guerres du Moyen Age sont différentes des guerres napoléoniennes et des guerres du 18ème siècle autant que les deux guerres mondiales le sont de toutes celles-ci.
En affirmant de telles absurdités, les théoriciens de la bourgeoisie contemporaine sont loin en deçà des théoriciens bourgeois du siècle passé. Par exemple du général Von Clausewitz qui déclarait :
"Tartares à demi incultes, républiques de l'ancien monde, seigneurs et villes marchandes du Moyen Age, rois du 18ème siècle, princes et peuples enfin du 19ème siècle : tous font la guerre à leur manière, la font de différentes façons, avec d'autres moyens et pour un but 'différent " Général Von Clausewitz, De la guerre.
Que les idéologues, conseillers, chercheurs, parlementaires, militaires et hommes politiques, traduisent et défendent - et ils sont appointés pour cela - cette vision du monde où la guerre est présentée comme une force motrice de l'histoire, cela n'a rien d'étonnant. Par contre, cela devient vraiment désolant lorsqu'on retrouve cette même approche chez ceux qui se veulent être une force révolutionnaire. Dépouillée de ses attributs moraux et autres considérations fumeuses sur la nature humaine, c'est, cette fois, auréolée d'une prétendue démarche matérialiste et marxiste que certains groupes en arrivent aux mêmes conclusions sur la guerre considérée comme une force motrice de l'histoire. Que ce soit derrière l'idée que la guerre est une condition objective favorable à une révolution mondiale, que ce soit l'appréhension du militarisme comme débouché à la surproduction, que ce soit encore la vision des guerres - et il s'agit ici des guerres mondiales, propres à notre siècle - comme mode d'expression et solution aux contradictions du capitalisme. Nous ne voulons pas dire ici que ces éléments partagent les préoccupations de la bourgeoisie et de ses conseillers, cela serait gratuit et sans fondement. Nous ne remettons pas en cause leur conviction, mais leurs analyse, démarche et méthode.
Celles-ci, en rayant d'un trait de plume toute l'expérience de ce siècle et de ses deux guerres mondiales, minimisent l'importance actuelle et de premier plan, vitale pour l'action, de l'alternative : révolution ou guerre mondiale, transformation radicale des moyens et des buts de la production, destruction du pouvoir politique et des Etats bourgeois ou destruction tout aussi radicale de la société humaine.
Dans la période de l'entre-deux-guerres, les révolutionnaires voyaient dans la perspective de la seconde guerre mondiale progressant à grands pas chaque année, le futur avenir d'un processus révolutionnaire. Ainsi envisageaient-ils cet avenir non comme une perspective catastrophique mais comme une perspective ouverte, grosse d'un avenir révolutionnaire à l'image des années 1917-18. Le déroulement de la seconde guerre mondiale allait cruellement détruire à jamais cette illusion, la force de ces camarades résida justement, non pas dans cet entêtement aveugle incapable de toute remise en question d'une vision fausse démentie par" la réalité historique mais au contraire dans la capacité à tirer l'enseignement de la réalité historique, permettant ainsi à la théorie révolutionnaire de faire un bond en avant
L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA QUESTION DE LA GUERRE.
Le capitalisme est né dans la boue et le^ sang et son expansion mondiale fut ponctuée au 19ème siècle par une multitude de guerres : les guerres napoléoniennes qui devaient secouer les structures féodales dans lesquelles étouffait l'Europe, les guerres coloniales sur les continents africain et asiatique, les guerres d'indépendance comme aux Amériques, les guerres d'annexions comme celle de 1870 entre la France et l'Allemagne, et une kyrielle d'autres.
Chacune de ces guerres représentait à la fois le point d'aboutissement d'un développement du capitalisme dans sa marche conquérante à travers le monde ou bouleversait les anciennes structures-politiques agraires et féodales en Europe. En d'autres termes, à travers ces guerres, le capital unifiait le marché mondial tout en divisant le monde en nations irréductiblement concurrentes.
Mais tout a une fin et l'ascension vertigineuse du capitalisme dans sa conquête du monde connaît cette fin elle aussi dans les limites du marché mondial. Dès la fin du siècle passé, le monde est partagé en propriétés coloniales et zones d'influence entre les différentes nations capitalistes développées. Dès lors, la guerre et le militarisme commencent à connaître une autre dynamique : 1'impérialisme, la lutte à mort entre les différentes nations pour le partage d'un monde dont l'étendue limitée n'arrive plus à assouvir les appétits expansionnistes de chacun. Appétits devenus immenses de par leur développement antérieur. Pour décrire cette situation, nous ne pouvons pas mieux faire que Rosa Luxemburg qui dresse le tableau suivant :
"Déjà, depuis les années 80, on assistait à une nouvelle ruée particulièrement violente vers les conquêtes coloniales. L'Angleterre s'empare de 1'Egypte et se crée un empire colonial puissant en Afrique du Sud ; en Afrique du Nord, la France occupe Tunis et en Asie Orientale, elle occupe le Tonkin ; l'Italie s’implante en Abyssinie, la Russie achève ses conquêtes en Asie Centrale et pénétre en Mandchourie, l'Allemagne acquiert ses premières colonies en Afrique et dans le Pacifique et finalement les Etats Unis entrent également dans la danse en acquerrant avec les Philippines des "intérêts" en Asie Orientale qui, à partir de la guerre sino-japonaise de 1895, déroule une chaîne presque ininterrompue de guerres sanglantes, culmine dans la grande campagne de Chine et s'achève avec la guerre russo-japonaise de 1904.
Ces événements, qui se succédèrent coup sur coup-, créèrent de nouveaux antagonismes en dehors de 1'Europe : entre 1'Italie et la France en Afrique du Nord, entre la France et 1'Angleterre en Egypte, entre l'Angleterre et la Russie en Asie Centrale, entre le Japon et 1'Angleterre en Chine, entre les Etats Unis et le Japon dans 1'Océan Pacifique.
(...) Cette guerre de tous les Etats capitalistes les uns contre les autres sur le dos des peuples d'Asie et d'Afrique, guerre qui restait étouffée mais qui couvait sourdement, devait Conduire tôt ou tard à un règlement de comptes général ... le vent semé en Afrique et en Asie devait un jour s'abattre en retour sur l'Europe sous la forme d'une terrible tempête, d'autant plus que ce qui se passait en Asie et en Afrique avait comme contre-coup une intensification de la course aux armements en Europe.
(...) la guerre mondiale (devait éclater) aussitôt que les oppositions partielles et changeantes entre les Etats impérialistes trouveraient un axe central, une opposition forte et prépondérante autour de laquelle ils puissent se condenser temporairement. Cette situation se produisit lorsque l'impérialisme allemand fit son apparition." Rosa Luxemburg, La Brochure de Junius.
Avec la première guerre mondiale, la guerre change ainsi radicalement de nature, de forme, de contenu et d'implications historiques.
 Comme son nom 1' indique, elle devient mondiale, et elle imprègne de façon
permanente toute la vie de la société. Le monde capitaliste dans son ensemble ne rétablit un semblant de paix que soit pour écraser un sursaut révolutionnaire comme en 1917-18-19, soit sous la poussée irrésistible de contradictions qu'il ne maîtrise pas pour
préparer un conflit à une échelle supérieure.
Comme son nom 1' indique, elle devient mondiale, et elle imprègne de façon
permanente toute la vie de la société. Le monde capitaliste dans son ensemble ne rétablit un semblant de paix que soit pour écraser un sursaut révolutionnaire comme en 1917-18-19, soit sous la poussée irrésistible de contradictions qu'il ne maîtrise pas pour
préparer un conflit à une échelle supérieure.
Ce fut le cas entre les deux guerres mondiales. Et depuis la seconde guerre mondiale, le monde n'a pas connu un seul instant de paix véritable. Dès la fin de celle-ci, l'axe d'une future guerre mondiale était posé, axe autour duquel s'articule aujourd'hui encore l'antagonisme entre le bloc russe et le bloc américain. De même était établie, par les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima, la dimension qu'elle devrait prendre.
Alors qu'au siècle passé, le militarisme restait une composante périphérique de la production industrielle et que les affrontements guerriers eux aussi avaient pour théâtre d'opération la périphérie des centres industriels développés, à notre époque, la production d'armements se gonfle démesurément par rapport à l'ensemble de la production et tend à s'approprier pour son propre compte l'ensemble des énergies et forces vitales de la société. Les centres industriels deviennent enjeux et théâtres d'opérations militaires.
C'est ce processus où le militaire supplante et s'assujettit l'économique pour ses propres besoins auquel nous assistons depuis le début du siècle. Processus qui connaît aujourd'hui une accélération foudroyante.
C'est dans la crise généralisée de l'économie capitaliste que la guerre mondiale plonge profondément ses racines. Cette crise est son sol nourricier. Dans cette mesure, la guerre mondiale, expression la plus haute de la crise historique du capitalisme, résume et concentre dans sa nature propre toutes les caractéristiques qui ne sont autres que l'autodestruction.
"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque, eut semblé absurde : 1'épidémie de la surproduction. (...). Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de vivres, trop d'industrie, trop de commerce." Le Manifeste Communiste
A partir du moment où cette crise ne peut trouver d'issue temporaire dans une expansion du marché mondial, la guerre mondiale de notre siècle exprime et traduit ce phénomène d'autodestruction d'un système qui, par lui-même, ne peut dépasser ses contradictions historiques.
LE MILITARISME COMME INVESTISSEMENT : GUERRE ET PROSPERITE.
- Le militarisme et l'économie.
La pire des erreurs concernant la question de la guerre est de considérer le militarisme comme un "champ d'accumulation", un investissement en quelque sorte qui serait rentabilisé dans les phases de guerre et la guerre en elle-même comme un mode, sinon "le mode" d'expansion du capitalisme.
Cette conception, quand elle n'est pas une simple justification du militarisme comme chez les idéologues de la bourgeoisie déjà cités et chez les révolutionnaires ayant une vision schématique, provient le plus souvent d'une mauvaise interprétation des guerres du siècle passé.
La place exacte du militarisme dans l'ensemble du procès productif pouvait encore faire illusion dans la phase d'expansion mondiale et la réalisation du marché mondial. Par contre, la situation historique qui s'ouvre avec la première guerre mondiale, en situant la guerre sur un tout autre plan qu'au siècle précédent, enlève toute ambiguïté quant à 1'"investissement militaire". Au siècle dernier, où les guerres restaient locales et ponctuelles, le militarisme n'a pas représenté un investissement productif dans le vrai sens du terme, mais toujours des faux frais. Dans tous les cas, la source de profit ne se trouvait pas dans l'exploitation de la force de travail en uniforme et mobilisée sous le drapeau national, dans les forces productives immobilisées, dans les forces de destruction que sont les armes, mais seulement dans l'élargissement de l'empire colonial, du marché mondial, dans les sources de matières premières exploitables à une grande échelle et à des coûts salariaux presque nuls, dans les structures politiques nouvellement créées permettant une exploitation capitaliste de la force de travail. En période de décadence, hormis les producteurs d'armements, le capital considéré globalement ne tire aucun profit de la production d'armements et du maintien sur pied d'une armée. Au contraire, tous les frais engendrés par le militarisme sont pertes sèches.
Tout ce qui passe dans la production industrielle d'armements pour y être transformé en moyens de destruction ne peut être réintroduit dans le processus de production dans le but de produire de nouvelles valeurs et marchandises. La seule chose que peut engendrer l'armement est la destruction et la mort, un point c'est tout.
Cette argumentation d'un "investissement militaire" et guerrier, s'appuyant sur l'expérience des guerres du siècle passé, n'est pas nouvelle. On la retrouve textuellement défendue par la Social- démocratie lors de la guerre de 14-18. Ecoutons encore Rosa Luxemburg :
"D'après la version officielle reprise telle quelle par les leaders de la social-démocratie, la victoire représente pour 1'Allemagne la perspective d'un essor économique illimité et sans obstacle et la défaite, au contraire, la menace d'une ruine économique. Cette conception s'appuie à peu près sur le schéma de la guerre de 1870. Or, la prospérité que connut 1'Allemagne après la guerre de 1870 ne résultait pas de la guerre, mais bien de 1'unification politique, même si celle-ci n'avait que la forme rabougrie de 1'Empire allemand créé par Bismarck. L'essor économique découla de l'unification politique malgré la guerre et malgré les nombreux obstacles réactionnaires qu'elle entraîna. L'effet propre de la guerre victorieuse, ce fut de consolider la monarchie militaire de 1'Allemagne et le régime des junkers prussiens, alors que la défaite de la France avait contribué à liquider l'Empire et à instaurer la République. Mais aujourd'hui il en va autrement dans tous les Etats impliqués. Aujourd'hui, la guerre ne fonctionne plus comme une méthode dynamique susceptible de procurer au jeune capitalisme naissant les conditions politiques indispensables de son épanouissement 'national'." Rosa Luxemburg (Ibid. opus cité).
D'autre part, cette citation offre un double intérêt, par son contenu, bien sûr, mais aussi parce qu'elle émane de Rosa Luxemburg. En effet, beaucoup de militants révolutionnaires qui défendent l'idée suivant laquelle le militarisme peut constituer un "champ d'accumulation" pour le capital, tirent argumentation d'un texte de la même Rosa Luxemburg, texte écrit bien avant la guerre de 14-18 (L'accumulation du Capital) et qui contient un chapitre ou justement elle défend l'idée erronée suivant laquelle le militarisme constituerait un "champ d'accumulation".
On voit ici comment l'expérience de la première guerre mondiale l'a fait radicalement revenir sur sa position (puissent nos camarades suivre cet exemple!).
- La guerre et la prospérité.
L'autre facette de ce mythe du militarisme comme investissement peut être exprimée de la façon suivante : le domaine militaire grèverait peut-être dans un premier temps les finances publiques, provoquant d'énormes déficits, s'emparant d'une grande partie du salaire social, accaparant une partie importante et essentielle de l'appareil productif qui ne peut plus par lui-même être employé à la production de moyens de consommation ; mais, après les guerres, tous ces "investissements" se retrouveraient justifiés par une nouvelle phase de prospérité. Conclusion : l'investissement militaire ne serait pas productif immédiatement, à court terme, mais il le serait à long terme prétendue "prospérité" qui a suivi la première guerre mondiale a été on ne peut plus relative et limitée. En fait jusqu'en 1924, l'Europe vit dans le marasme économique (notamment en Allemagne où ce marasme prend des allures de cataclysme) de telle sorte qu'en 1929, son niveau de production a rattrapé à peine celui de 1913. Le seul pays où ce terme ait eu un semblant de réalité ce fut les Etats-Unis (d'où ce mot de "prospérité" est parti) pays dont la contribution à la guerre fut des plus limitées en durée et en destructions (aucune sur son sol).
Quant à la période de reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale, si elle a connu l'ampleur que l'on sait entre 1950 et la fin des années 60, c'est fondamentalement parce que l'appareil productif de la première économie mondiale, loin devant les autres, les USA, n'a pas été détruit par la guerre. Avec une production représentant 40% de la production mondiale totale, les USA ont pu permettre à l'Europe et au Japon de se reconstruire malgré les terribles destructions de la seconde guerre mondiale.
Venue tardivement au monde, bénéficiant des immenses ressources que représentait le vaste continent américain tant en matières premières qu'en marchés extra-capitalistes, le capitalisme américain vit jusqu'au milieu des années 20 dans une dynamique quelque peu spécifique tout en devenant la principale économie mondiale alors que la vieille Europe plonge dans la crise (les USA ne participeront d'ailleurs à la première guerre mondiale que de façon minime). Ce n'est que vers 1929 que, ayant épuisé toutes les ressources de sa dynamique propre, le capital US commence à plonger dans la crise, une crise à la dimension de l'économie américaine.
C'est alors que la bourgeoisie américaine, à l'occasion de la seconde guerre mondiale, va tourner toute son énergie - militairement, bien sûr - sur le reste du monde tout en restant à l'abri des destructions de la guerre sur son propre sol.
C'est de cette situation dont une des manifestations est la constitution du bloc russe que vont naître dès la fin. de la seconde guerre mondiale les conditions d'un nouvel affrontement mondial, dont la préparation est aujourd'hui accélérée. En vingt ans le capitalisme mondial a ratissé tous les fonds de tiroirs, exploitant jusqu'à la moindre parcelle du globe toute possibilité d'extension du marché mondial dont une des expressions est la décolonisation qui, en fait a livré directement à la concurrence du marché mondial ces nations pseudo-autonomes, c'est-à-dire à la lutte d'influence entre les deux grands blocs impérialistes. Ce qui a d'ailleurs eu pour résultat d'attiser les conflits locaux qui, d'Asie jusqu'en Afrique, n'ont pas cessé depuis comme moments des affrontements entre les deux grands blocs impérialistes. On peut appeler cela "prospérité" ; nous, nous l'appelons par son nom : boucherie, barbarie et décadence.
LA GUERRE COMME PROCESSUS CONTROLABLE.
Nous avons énoncé plus haut que la caractéristique de la nature de la crise de surproduction, l'autodestruction, trouvait sa plus haute expression dans la guerre mondiale.
Il en est de même de la capacité du capitalisme à contrôler la spirale militariste et l'engrenage de la guerre. De la même manière que la bourgeoisie est incapable de maîtriser le processus qui plonge l'économie dans une crise chronique dont les secousses sont toujours plus fortes, elle n'est pas capable de maîtriser l'engrenage militaire de plus en plus meurtrier qui menace l'existence même de l'humanité.
Mieux encore, comme pour la crise économique, chaque mesure que prend la bourgeoisie pour se mettre à l'abri se retourne contre elle. Que face à la surproduction on décide une politique générale d'endettement et voilà que cette politique de fuite en avant projette la crise de surproduction vers des sommets jamais atteints... et rendant impossible tout retour en arrière. Que face à la menace militaire de l'adversaire, la bourgeoisie décide de mettre en oeuvre un armement d'une puissance décuplée et ne voilà-t-il pas que l'adversaire finit par faire de même et la surenchère ne s'arrête jamais.
Les caractéristiques de l'armement nucléaire éclairent particulièrement cette situation. A la fin de la seconde guerre mondiale, celui-ci devait être une force dissuasive ; l'URSS ne prendrait jamais le risque d'une guerre mondiale sous la menace du parapluie atomique du bloc US. Pourtant, dès la fin des années 50, l'URSS se dotait d'un armement de nature similaire. Pour la première fois de leur histoire les USA se trouvaient menacés sur leur propre territoire.
A ce moment encore, les discours se voulaient rassurants. L'armement nucléaire devait rester une "force dissuasive". Un fossé immense séparait l'armement classique de l'armement nucléaire et ce dernier avait, paraît-il, pour vocation de cantonner les deux grandes puissances mondiales en dehors de toute velléité d'affrontement direct.
L'histoire de ces 15 dernières années, de la fin de la reconstruction à aujourd'hui, est venue balayer ce joli rêve. Au cours de ces 15 années, nous avons pu assister, d'abord lentement puis de manière accélérée, à un processus de modernisation des armements de toutes natures, classique et nucléaire. L'armement nucléaire s'est miniaturisé et s'est diversifié. Aux vecteurs à longue portée d'une puissance de feu massive (missiles intercontinentaux) se sont ajoutés les vecteurs à moyenne portée à la puissance de feu sélective (les fameux SS 20 et Pershing qui poussent comme champignons actuellement en Europe de l'Ouest et de l'Est) qui, dès lors, rendaient possible un affrontement nucléaire géographiquement limité.
D'autre part, aux parades nucléaires qui n'étaient constituées jusqu'alors que de la riposte, s'est ajouté le développement de systèmes de défense, c'est-à-dire de destruction en vol antimissiles, systèmes qui vont culminer dans ce que l'on appelle "la guerre des étoiles" par l'emploi de satellites.
D'un autre côté, l'armement classique, dans son processus d'accumulation et de modernisation, allait lui même intégrer le nucléaire dans sa puissance de feu. Développement qui trouve son apogée contemporaine dans la bombe à neutrons, arme nucléaire dite "de terrain", c'est-à-dire utilisable dans un affrontement classique. Joli tableau et belle réussite !
L'alibi du bombardement de Nagasaki et Hiroshima a été, aussi stupide qu'il peut paraître aujourd'hui, "la paix". De même pour le déploiement de l'arsenal thermonucléaire. Dans la réalité, la crise historique du capitalisme et la course aux armements qui en découle, n'a réussi que le tour de force de combler le vide qui existait entre l'armement classique et l'armement nucléaire, se donnant ainsi les moyens matériels d'une escalade des conflits au niveau classique le plus bas à la destruction massive la plus haute.
En conclusion nous pouvons dire que pas plus que la bourgeoisie n'a été capable de contrôler le développement de l'armement jusqu'à aujourd'hui, elle ne saurait, en cas de conflit mondial, contrôler une escalade ahurissante vers la destruction généralisée.
D'un certain point de vue, le mot d'ordre "socialisme ou barbarie" est aujourd'hui dépassé. Le développement de la décadence du capitalisme fait qu'aujourd'hui celui-ci devrait plutôt s'énoncer : socialisme ou continuation de la barbarie, socialisme ou destruction de l'humanité et de toute forme de vie sur la terre.
Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un point fatidique de l'histoire de l'humanité où celle-ci possède -avec les fantastiques moyens matériels et scientifiques dont elle s'est dotée- les moyens ou de s'autodétruire ou de se libérer totalement du joug des sociétés de classe et de la pénurie.
Nous avons déjà largement écrit sur l'argument que la guerre serait une condition favorable à une initiative révolutionnaire ([1] [850]). Nous ne retiendrons donc ici que quelques aspects.
Ceux qui affirment que la guerre mondiale est une condition favorable, voire nécessaire, pour engager un processus révolutionnaire, appuient cette assertion extrêmement dangereuse sur 1'"expérience historique" : histoire de la Commune de Paris se développant après le siège de Paris de la guerre de 1870, et plus encore, l'expérience de la révolution russe.
Notre façon de voir l'histoire nous enseigne exactement le contraire. L'expérience de la première vague révolutionnaire qui fut un sursaut fantastique où la classe ouvrière réussit à se sortir du bourbier et des charniers de quatre années de guerre et à affirmer son internationalisme révolutionnaire, ne se reproduira plus.
Considérée de plus près,la situation du début de ce siècle nous montre que celle-ci était une situation originale qui ne nous permet plus d'en extrapoler les caractéristiques de notre siècle, si ce n'est en négatif.
En tout état de cause, il faut d'ailleurs bien voir que la première vague révolutionnaire, amorcée en Russie 17, ne parvient pas à s'étendre aux principaux pays vainqueurs : ni en Angleterre, ni en France, encore moins aux USA, la classe ouvrière ne réussit à reprendre le flambeau révolutionnaire allumé en Russie et en Allemagne. Nous n'inventons rien en tirant comme bilan que la guerre est la pire des situations pour que s'amorce un processus révolutionnaire. Dès le début de ce siècle, en Allemagne par exemple, les révolutionnaires tirent le même enseignement.
"C'était la révolution, revenant après quatre ans de guerre, après les quatre ans pendant lesquels le prolétariat allemand, grâce à 1'éducation que lui ont fait subir la social-démocratie et les syndicats, a fait preuve d'une telle mesure de faiblesse et de reniement de ses tâches socialistes. . .
En se plaçant sur le terrain du développement historique, il était certes impossible d'attendre beaucoup de cette Allemagne qui a offert l'image épouvantable de ce 4 août et des quatre années suivantes. On ne pouvait voir tout à coup le 9 novembre 1918, une révolution de classe grandiose, consciente de ses buts ; ce que nous a fait vivre le 9 novembre 1918, c'était pour les trois quarts l'effondrement de 1'impérialisme existant plutôt que la victoire d'un principe nouveau." Rosa Luxemburg, Discours sur le Programme
La seconde guerre mondiale, bien plus dévastatrice et meurtrière, plus longue et colossale, portant à un niveau supérieur le caractère mondial de celle-ci, n'a pas provoqué la moindre amorce de situation révolutionnaire nulle part dans le monde. En particulier, ce qui avait permis les fraternisations sur le front durant la première guerre mondiale : la prolongation des combats de tranchées où les soldats des deux camps se trouvaient en contact direct, n'a pu se répéter lors de la deuxième guerre avec son emploi massif des blindés et de l'aviation. Non seulement la 2ème guerre n'a pas constitué un terrain fertile pour que se dégage une alternative révolutionnaire, mais encore ses conséquences désastreuses se sont prolongées bien au-delà de la guerre elle-même. Après celle-ci, il aura fallu que s'écoulent encore deux décennies avant que le ressort de la lutte, de la combativité et les étincelles de la conscience du prolétariat ne rejaillissent dans le monde à la fin des années 60.
Par deux fois, la guerre mondiale a sonné minuit dans le siècle. La seconde fois, le raz de marée de barbarie qui a déferlé sur l'humanité a été incomparablement plus puissant et destructeur que la première fois. Aujourd'hui, si une telle catastrophe devait à nouveau advenir, c'est dans son existence même que l'humanité serait irrémédiablement menacée. Au delà de la peste idéologique qui, en situation de guerre, infeste la conscience des millions d'ouvriers impliqués, dressant une barrière d'acier devant toute tentative de transformation révolutionnaire, c'est dans la situation objective d'un monde transformé en ruines que cette possibilité serait balayée.
Dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, non seulement serait balayée toute possibilité d'un dépassement historique du capitalisme, mais, de plus, nous pouvons avoir la quasi certitude que l'humanité elle-même n'y survivrait pas. Cela situe toute 1'importance des combats présents du prolétariat comme seul obstacle au déferlement d'un tel cataclysme.
M. Prénat
[1] [851] Voir nos articles dans la Revue Internationale °18 ("Le cours historique") et 30 ("Pourquoi l'alternative guerre ou révolution?").
Questions théoriques:
- Guerre [279]
- Impérialisme [11]
Thèses sur le rôle du parti dans la révolution prolétarienne" (KAPD)
- 2719 reads
PRESENTATION
Les Thèses sur le Parti du K.A.P.D. ont été écrites en juillet 1921 pour être discutées non seulement dans le parti mais au sein de l'Internationale Communiste (I.C.) à laquelle il adhérait depuis décembre 1920 à titre sympathisant.
Le souci qui animait les rédacteurs des Thèses était double :
- d'une part, se démarquer de la section officielle de l'I.C, le K.P.D., qui était devenu un parti typiquement centriste, après l'expulsion de la Gauche en octobre 1919. Né dans l'action, en avril 1920, au milieu des combats armés entre ouvriers de la Ruhr et la Reichswehr, le KAPD traduisait une orientation révolutionnaire face au KPD qui, par la bouche de son chef Levi, proclamait son "opposition loyale" au gouvernement social-démocrate. Le KAPD, comme le PC d'Italie de Bordiga plus tard, était le prototype du parti révolutionnaire né dans la période de décadence : un parti-noyau "étroit" à l'opposé des partis de masses préconisés par l'I.C, et dont le VKPD allait être le modèle après la fusion avec les Indépendants en décembre 1920.
- d'autre part, face aux tendances "conseillistes" anti-parti, incarnées par Ruhle et l'A.A.U.D-E., affirmer le rôle indispensable du parti dans la révolution, comme corps unitaire centralisé et discipliné dans son programme comme dans l'action.
Les Thèses du KAPD -dont nous donnons ici une traduction d'Invariance (No. 8, octobre-décembre 1969) revue et corrigée par nos soins- sont particulièrement actuelles, en dépit de leurs faiblesses. Une lecture attentive démolit la légende d'un KAPD "infantile" et "anti-parti", légende colportée par les courants "bordiguistes". Au contraire, à la différence de la tendance Ruhle évoluant vers l'anarchisme, le KAPD est une partie intégrante de l'ensemble de la Gauche communiste internationale qui s'opposa à la dégénérescence de l'I.C.
C'est donc un non-sens et une contradiction absolue lorsque aujourd’hui des éléments ou des groupes conseillistes se réclament du KAPD. les Thèses du KAPD sont, sans ambiguïté aucune, une condamnation des idées conseillistes.
a) La nature de la révolution prolétarienne
- Contrairement aux éléments anarchisants de la Gauche allemande, le KAPD affirme que la question du pouvoir politique du prolétariat se pose non localement, dans l'usine considérée comme un "bastion de la révolution", mais à l'échelle mondiale. Elle passe par la destruction de l'Etat, laquelle implique une violence concentrée du prolétariat.
- Contre l'usinisme de Ruhle et de l'AAUD-E, qui font de la révolution prolétarienne une simple question économique de gestion des usines, le KAPD souligne l'aspect unitaire de la révolution prolétarienne, comme processus politique (prise du pouvoir) et économique (prise en main de la production).
b) Le rôle et la fonction du parti
Il est frappant de voir, comme chez Bordiga, la même définition du parti : un corps programmatique (conscience) et une volonté d'action. De même, le parti n'est pas identique à la classe ; il en est une partie sélectionnée, la plus consciente. Le parti n'est pas au service de la classe, puisqu'il peut être amené pour la défense des intérêts globaux de la classe révolutionnaire, à entrer dans une "contradiction apparente" avec elle. Le parti n'est pas à la queue mais à l'avant-garde de la classe ouvrière.
Cette insistance sur le rôle politique du parti combat en fait les tendances "conseillistes" qui se développaient dans le prolétariat allemand après la défaite de 1919 et entraînaient un certain apolitisme de type syndicaliste-révolutionnaire dans le mouvement des Unions qui rassemblaient alors des centaines de milliers d'ouvriers. A ce repliement dans l'usine, voire la branche professionnelle, le KAPD oppose la nécessité d'un combat politique intransigeant. Cette vision du parti n'a rien à voir avec celle de Pannekoek, dans les années 30, qui considérait qu'un "parti" ne peut être qu'un groupe d'études ou de travail. Pour le KAPD, comme pour le CCI aujourd'hui, le parti est une organisation militante de la classe ouvrière. Elle est un facteur actif -un "parti de l'action"- dans la lutte de classe dont la fonction est de développer la conscience de classe du prolétariat qui passe par des phases d'hésitations et d'oscillations.
Cette lutte contre les oscillations et les hésitations est un combat politique constant, autant au sein du parti que dans la classe:
- dans le parti, contre les tendances centristes de conciliation avec la bourgeoisie ou avec l'anarchisme petit-bourgeois. C'est ainsi que le KAPD dut exclure la tendance "national-bolchéviste" de Hambourg groupée autour de Wollfheim et de Laufenberg qui préconisait, soutenue par des nationalistes allemands pro-URSS, la "guerre révolutionnaire" contre les pays de l'Entente. De même fut exclue la tendance Ruhle en Saxe qui niait toute nécessité d'un parti politique du prolétariat.
- dans la classe, le parti se trouve à la tête des luttes en maintenant fermement la boussole de son programme, guidé par une volonté d'action révolutionnaire. Si le parti est incapable de juger clairement d'une situation révolutionnaire et de l'orienter par la clarté de ses mots d'ordre, au moment où la classe se trouve dans un état de flottement, il risque de connaître le sort du Spartakusbund en janvier 1919, à Berlin, incapable de proposer une perspective claire aux ouvriers. Au moment décisif, le parti joue un rôle fondamental, soit pour pousser à l'offensive, lorsque la situation est mûre, soit pour appeler au repli (comme le parti bolchevik en juillet 1917), même au prix d'une "contradiction apparente" avec les fractions les plus avancées de la classe, lorsqu'elles sont isolées du reste de la masse prolétarienne.
Pour être la "tête et l'arme de la révolution", aux moments cruciaux de la lutte révolutionnaire, le KAPD a compris les changements profonds qui s'opéraient dans la structure du parti dans la période de décadence du capitalisme.
c) Structure et fonctionnement du parti
En soulignant la nécessité d'un "noyau communiste solide", le KAPD comprend clairement l'impossibilité de partis de masses révolutionnaires. Dans la période historique "des guerres et des révolutions" (suivant les termes de l'I.C), le parti ne peut rassembler qu'une petite minorité de la classe, la plus décidée et la plus consciente de la nécessité de la révolution. Il n'est plus, comme au XIXe siècle, un parti de réformes rassemblant de larges masses ouvrières et les organisant, mais un parti forgé dans le feu de la révolution. Les conditions de la décadence (totalitarisme et illégalité) imposent une sélection rigoureuse des militants communistes. Pour cette raison, mais aussi par le fait que le parti se développe très rapidement sur le plan numérique dans les périodes révolutionnaires, en attirant à lui des masses qui la veille étaient non politisées ou dans la mouvance des partis de la gauche capitaliste (stalinisme, gauchisme, etc.), il est vital qu'il n'accroisse pas "l'effectif de ses membres plus rapidement que ne le permet la force d'absorption du solide noyau communiste" (thèse No 9).
Cette vision du parti est très proche de celle de Bordiga en 1921. De même l'affirmation d'une discipline de parti détruit la légende entretenue naguère par le PCI (Programme Communiste) d'un KAPD anti-centraliste et "anarchisant". La thèse 7 affirme que le parti communiste est "une volonté unitaire, organisée et disciplinée".
d) L'intervention dans les luttes économiques
La question de l'intervention est posée claire ment par le KAPD. La réponse est à l'opposé de celle d'"Invariance" -et par la suite du milieu moderniste- qui dans sa traduction fait un contre sens tout à fait révélateur. En effet, "Invariance" ajoute une négation (ne pas) là où le KAPD affirme que le "parti doit... se lier aux mouvements des masses ouvrières engendrés par la misère économique". Certes, par la suite, en 1922, Gorter et Schrôder (dirigeant du KAPD) feront scission en préconisant la non-participation aux luttes économiques de la classe, sinon "à titre individuel" (sic). Il va de soi que tout parti révolutionnaire participe politiquement aux luttes revendicatives. Ce qui le distingue des "modernistes" c'est l'affirmation que le prolétariat se soude comme classe à travers les luttes partiel les, comme condition de la marche vers la lutte globale politique pour le pouvoir. Ce qui le distingue, en second lieu, des tendances "conseillistes" qui ne voient que la lutte économique (et jouent les vierges effarouchées lorsque la lutte se politise et va dans le sens des mots d'ordre du parti révolutionnaire), c'est son activité politique. Aller dans le sens inverse de la politisation de la lutte, comme le font les "conseillistes", ne peut mener qu'à "renforcer l'esprit de l'opportunisme" (thèse 11), en séparant luttes revendicatives et luttes révolutionnaires. Ce qui le distingue, en troisième lieu, des tendances "bordiguistes", c'est qu'il ne s'érige pas en organisateur et directeur matériel de la lutte : "il doit essayer de clarifier spirituellement de tels mouvements afin de les pousser aux luttes effectives, les élargir et accélérer leur mouvement par l'appel à la solidarité, afin qu'ils prennent des formes révolutionnaires et, si possible politiques". Même si les termes employés ici ne peuvent être les nôtres par une confusion de langage, où "spirituelle" a une résonance idéaliste et où la lutte révolutionnaire semble précéder la lutte politique, le souci profond d'être un facteur actif de la lutte apparaît clairement dans les thèses. Le parti est un facteur de volonté et de conscience.
Cet esprit le CCI le fait sien. Le parti qui surgira demain ne pourra être ni un cercle de phraseurs timorés ni une direction autoproclamée de la classe. Pour être facteur actif, le parti doit d'abord être le produit de la conscience de classe, qui se cristallise alors par une volonté de minorités significatives de la classe.
En republiant ces thèses, nous ne pouvons passer sous silence les faiblesses et les manques qui transparaissent ici et là et font que nous nous réapproprions le programme du KAPD de façon critique. Ces faiblesses ne sont pas seulement dues au caractère hâtif de la rédaction des thèses en vue du Ille congrès de l'I.C, ce qui les rend parfois obscures. Elles découlent de confusions présentes dans le KAPD et qui finalement expliquent pour une grande part sa disparition comme courant.
QUELQUES FAIBLESSES DES THESES DU KAPD
a) La double organisation
Le fait que les Unions (AAUD) aient surgi avant que se créât le KAPD et sur des positions politiques voisines explique que le KAPD se conçoive à la fois comme un produit et comme la "direction spirituelle" des AAU. Il apparaît dans les thèses une conception pyramidale où le parti crée et dirige les Unions, lesquelles créent les conseils ouvriers. Cette conception substitutiste coexiste de façon confuse avec une théorie "éducationniste" ("travail d'éducation" de la classe).
Dans la confusion qui naît d'une série de défaites décisive du prolétariat allemand, le KAPD assimile en fait organisations d'usine révolutionnaires, qui constituent les débris des conseils ouvriers, et Unions. Les comités d'usine ne peuvent devenir permanents que dans une vague de montée révolutionnaire et, soit disparaissent avec sa défaite, soit constituent l'élément moteur des conseils avec son triomphe.
En maintenant ces comités, après la vague révolutionnaire, de façon permanente sous forme de base de masse reconnaissant les thèses du parti ; (dictature du prolétariat, antiparlementarisme, I destruction des syndicats), le KAPD finit par être absorbé par les AAU, amenant la décomposition du parti en 1929.
L'erreur de la double organisation se retrouve jusque dans le fonctionnement du KAPD, puisqu'à ; côté de lui se fonda, en 1921, une organisation de jeunesse (KAJ) autonome par rapport au parti. !
b) Fraction et opposition ;
A la différence de la Fraction italienne, plus tard, le KAPD se concevait comme une "opposition" dans l'Internationale et non comme un corps organisé ayant une continuité organique avec l'ancien parti. Son expulsion du Komintern en septembre 1921 ne lui permit pas de se rattacher avec les gauches les plus significatives, comme celle de Bordiga. L'existence de groupes en Hollande, Bulgarie et Grande-Bretagne sur les positions du KAPD, donna l'illusion à une minorité, et sous l'influence de Gorter, de pouvoir proclamer artificiellement l'existence d'une Internationale communiste ouvrière (KAI), ce qui entraîna une scission dans le KAPD en mars 1922, qui se solda par la désagrégation numérique du parti. Désormais, le KAPD maintenu (tendance de Berlin opposée à celle d'Essen, qui suivait Gorter) devait se survivre jusqu'en 1933. Face à Gorter, il montrait que la nouvelle Internationale ne surgirait que lorsque les conditions objectives et subjectives seraient mûres. Mais les apports sur les questions de la fraction, de l'Internationale, furent ceux de la Gauche italienne après 1933.
Ces faiblesses et manques dans les thèses du KAPD ne doivent pas nous faire perdre de vue ses apports, qui, avec ceux de la Gauche italienne et, en partie, ceux de la Gauche hollandaise,sont ceux dont nous nous revendiquons.
Face au danger conseilliste dans la classe demain et face aux oscillations centristes, ces thèses montrent la nécessité du parti pour remplir sa fonction indispensable afin que triomphe la révolution mondiale. Il doit être clair que son triomphe dépendra de la maturité des minorités communistes et de leur capacité à ne pas être en retard par rapport aux mouvements révolutionnaires. L'histoire du KAPD montre a contrario que l'issue de la révolution dépend en grande partie de la capacité des révolutionnaires à former au niveau international le parti, non pas pendant, mais avant l'éclatement de la révolution. Les années 80 sont des années de vérité pour le mi1ieu révolutionnaire, particulièrement pour le CCI qui doit rester vigilant contre toute sous-estimation conseilliste de la nécessité d'un parti et être l'élément le plus actif pour poser les bases de sa constitution future.
Chardin
THESES ("Proletarier" No 7, juillet 1921)
1- La tâche historique de la révolution prolétarienne est de mettre dans les mains des masses travailleuses les trésors de la terre, d'abolir la propriété des moyens de production, ce qui rend impossible l'existence d'une classe possédante, exploiteuse et dirigeante basée sur la possession des biens privés. Le but est la libération de l'économie sociale de toutes les entraves du pouvoir politique à l'échelle mondiale.
2- L'abolition effective du mode de production capitaliste, l'appropriation de toute la production et sa distribution dans les mains des classes laborieuses, la suppression des antagonismes de classe, le dépérissement des institutions politiques et la construction de la société communiste sont un procès historique dont les moments particuliers peuvent être prévus exactement. En ce qui concerne la question du rôle de la violence politique au sein de ce procès, quelques points peuvent être fixés.
3- La révolution prolétarienne est en même temps procès économique et politique. Elle ne peut ni en temps que procès économique, ni en temps que procès politique, trouver une conclusion dans le cadre national ; bien plus, l'établissement d'une commune mondiale est son but vital, nécessaire. Il découle que, jusqu'à la défaite définitive, â l'échelle mondiale, du pouvoir du capital, les futures fractions triomphantes du prolétariat, ont aussi besoin d'une violence politique pour se préserver et, si possible, pour attaquer la violence politique de la contre-révolution.
4- Aux motifs de politique extérieure qui rendent nécessaire pour les fractions triomphantes du prolétariat la persistance d'une violence politique (dans sa propre sphère de domination aussi) s'ajoutent des motifs d'évolution interne. Considérée en tant que procès politique, la révolution présente un moment décisif : celui de la prise du pouvoir politique. Considérée en tant que procès économique, elle ne présente pas un tel moment décisif parce que la prise en charge concrète de l'économie de la part du prolétariat et la refonte de l'économie de profit en économie de consommation réclame un travail de longue haleine. Il va de soi que la bourgeoisie durant tout ce procès ne négligera rien pour défendre le profit et, dans ce but, pour ravir à nouveau, pour elle, le pouvoir politique. A cette fin, elle tentera, dans les pays ayant une idéologie démocratique évoluée - pays depuis longtemps industrialisés - d'utiliser les mots d'ordre de la tromperie démocratique afin de mystifier les prolétaires. De ce fait, la violence politique forte et impitoyable des ouvriers révolutionnaires est le minimum nécessaire requis, jusqu'à ce que s'accomplisse complète ment la prise en mains de l'économie de la part du prolétariat et, de ce fait, la privation pour la bourgeoisie de tout fondement économique de son existence. C'est cela la dictature du prolétariat.
5- La nécessité d'une violence de domination politique du prolétariat révolutionnaire même après la victoire politique de la révolution fonde, en même temps, la nécessité d'une organisation politique du prolétariat révolutionnaire aussi bien après qu'avant la prise du pouvoir politique.
6- Les conseils ouvriers politiques (soviets) sent la forme large d'organisation historique pour la domination et l'administration prolétarienne ; ils émergent chaque fois que la lutte de classe se radical i se et devient une lutte pour la totalité du pouvoir.
7- La forme historique convenable pour le rassemblement des combattants prolétariens les plus conscients, les plus éclairés, les plus disposés à l'action, est le parti. Comme le but de la révolution prolétarienne est le communisme, le parti ne peut exister qu'en tant que parti où programme et esprit sont communistes. Le parti doit être une totalité élaborée programmatiquement, fondue en une volonté unitaire, organisée et disciplinée à partir de la base. Il doit être la tête et l'arme de la révolution.
8- La première tâche du parti communiste, aussi bien avant qu'après la prise du pouvoir, est - parmi les confusions et les oscillations de la révolution prolétarienne - de maintenir clairement et sans se laisser déconcerter, la seule boussole sûre : le communisme. Le parti communiste doit dans toutes les situations, inlassablement et sans aucune hésitation, montrer aux masses prolétariennes, le but et le chemin, non seulement par des mots mais par des actes. Il doit dans toutes les questions de la lutte politique avant la prise du pouvoir pousser avec l'acuité la plus totale, à la séparation entre réformisme et révolution. Il doit flétrir toute solution réformiste en tant que rafistolage, en tant que prolongation de vie du vieux système d'exploitation, que trahison de la révolution, trahison des intérêts de la classe ouvrière toute entière. De même qu'il ne peut exister la moindre communauté d'intérêts entre exploiteurs et exploités, de même il ne peut exister le moindre lien politique entre révolution et réformisme ; le réformisme social-démocrate, sous quelque masque qu'il puisse se cacher, est aujourd'hui le plus dur obstacle pour la révolution et le dernier espoir de la bourgeoisie.
aucune hésitation, montrer aux masses prolétariennes, le but et le chemin, non seulement par des mots mais par des actes. Il doit dans toutes les questions de la lutte politique avant la prise du pouvoir pousser avec l'acuité la plus totale, à la séparation entre réformisme et révolution. Il doit flétrir toute solution réformiste en tant que rafistolage, en tant que prolongation de vie du vieux système d'exploitation, que trahison de la révolution, trahison des intérêts de la classe ouvrière toute entière. De même qu'il ne peut exister la moindre communauté d'intérêts entre exploiteurs et exploités, de même il ne peut exister le moindre lien politique entre révolution et réformisme ; le réformisme social-démocrate, sous quelque masque qu'il puisse se cacher, est aujourd'hui le plus dur obstacle pour la révolution et le dernier espoir de la bourgeoisie.
9- Le parti communiste doit donc tout d'abord, de façon absolument tranchante, tenir à l'écart de lui tout réformisme et tout opportunisme ; il en est de même pour son programme, sa tactique, sa presse, ses mots d'ordre particuliers et ses actions. En particulier, il ne devra jamais accroître l'effectif de ses membres plus rapidement que ne le permet la force d'absorption du noyau communiste solide.
10- Au cours de la révolution, les masses ouvrières passeront par d'inévitables oscillations. La révolution est un processus dialectique non seulement dans sa totalité mais aussi dans ses phases particulières. Le parti communiste en tant qu'organisation des éléments conscients doit de ce fait essayer de ne pas succomber lui-même à ces oscillations et les surmonter ; il doit aider les masses par la clarté et la pureté de ses mots d'ordre, l'accord entre ses mots d'ordre et ses actions, sa position en tête de la lutte, la rectitude de ses prévisions, à surmonter rapidement et à la racine de telles hésitations. Le parti communiste doit donc, par toute son attitude, développer la conscience de classe du prolétariat même au prix d'une contradiction extérieure apparente avec les larges masses. C'est ainsi seulement que le parti communiste gagnera au cours de la lutte révolutionnaire la confiance des masses et conduira un travail d'éducation sur une vaste échelle.
11- Le parti communiste ne doit naturellement pas se détacher des masses : c'est-à-dire qu'il doit - en dehors du travail qui va de soi d'une propagande inlassable - se lier aux mouvements des masses ouvrières engendrés par la misère économique, les revendications partielles, il doit essayer de clarifier spirituellement de tels mouvements afin de les pousser aux luttes effectives, les élargir et accélérer leurs mouvements par l'appel à la solidarité active, afin qu'ils prennent des formes révolutionnaires et, si possible, politiques. Mais la tâche du parti communiste ne peut être de se poser plus bête qu'il n'est, c'est-à-dire que sa tâche ne peut pas être de renforcer l'esprit de l'opportunisme en développant, sous la responsabilité du parti, des revendications partielles réformistes.
12- Mais le travail pratique le plus important des communistes pour la lutte économique des travailleurs réside dans l'organisation de l'arme de la lutte qui est, dans les époques révolutionnaires, dans les pays hautement développés, la seule arme utilisable pour de telles luttes ; c'est-à-dire les communistes doivent veiller à ce que les ouvriers révolutionnaires (pas seulement les membres du parti communiste) se regroupent dans les entreprises et que les organisations d'entreprises se fondent en Unions pour donner forme à 1'instrument adapté à la prise en charge de la production par la classe ouvrière.
13- Les organisations d'entreprise révolutionnaire (les Unions) constituent l'humus d'où surgiront, dans la lutte, des comités d'action, les cadres pour les revendications économiques partielles et finalement pour la production des travailleurs luttant eux-mêmes, la préparation et l'infrastructure apte à sous-tendre les conseils ouvriers révolutionnaires.
14- En créant ainsi la vaste organisation de classe du prolétariat révolutionnaire, les communistes, outre qu'ils conservent en tant que parti la force d'un corps unitaire programmatique fermé et qu'ils mettent en valeur, dans l'Union comme partout, la pensée communiste en tant que loi suprême, assurent la victoire de la révolution prolétarienne et celle plus éloignée de la société communiste.
15- Le rôle du parti après la victoire politique de la révolution dépend des rapports internationaux et du développement de la conscience de classe des ouvriers. Tant que la dictature du prolétariat (la violence politique de la classe ouvrière victorieuse) est nécessaire, le parti communiste doit tout faire pour sauvegarder le développement dans une direction communiste. Dans ce but, il est indispensable que, dans tous les pays industriels développés, les prolétaires révolutionnaires eux-mêmes, sous la direction spirituelle des communistes, prennent part, de la manière la plus ample, à la prise en charge et à la refonte de la production. L'organisation selon les entreprises et en Unions, l'apprentissage dans les perpétuels conflits partiels, la création de comités d'actions, constituent la préparation qui sera entreprise, au cours de la lutte révolutionnaire, par l'avant-garde des ouvriers eux-mêmes.
16- Dans la mesure où l'Union, en tant qu'organisation de classe du prolétariat, se renforce après la victoire de la révolution et devient capable de consolider les fondements économiques de la dictature sous la forme du système des conseils, elle gagnera en importance vis-à-vis du parti. Dans la mesure où, ultérieurement, la dictature du prolétariat sera assurée grâce à son ancrage dans la conscience des larges masses, le parti perdra de sa signification au profit des conseils ouvriers. Finalement, dans la mesure où la consolidation de la révolution au moyen de la violence politique devient superflue, la dictature se transformant en société communiste, le parti disparaît.
Proletarier, juillet 1921, n°7. (traduction d'Invariance n°8 , oct-déc. 69, revue).
Géographique:
- Allemagne [92]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [852]
Conscience et organisation:
La constitution du BIPR : un bluff opportuniste – 2° partie.
- 3208 reads
Dans la première partie de cet article, nous avons voulu démontrer que la formation du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire par le PCInt (Battaglia Comunista) et la Communist Workers' Organisation, n'avait rien de positif pour le mouvement ouvrier. Ceci, non parce que nous nous amusons à jouer les détracteurs, mais pour deux raisons :
- parce que la pratique organisationnelle du BIPR n a aucun fondement solide, comme nous 1'avons vu lors des Conférences Internationales,
- parce que BC/CWO sont loin d'être clairs sur les positions de base du programme communiste - sur la question syndicale en particulier.
Dans cette deuxième partie, nous revenons sur les mêmes thèmes. Sur la question parlementaire, nous verrons que le BIPR a "résolu" les divergences entre BC et la CWO en les "oubliant". Sur la question nationale, nous verrons comment les confusions de BC/CWO ont entraîné une politique de conciliation envers le gauchisme nationaliste de l'UCM iranien ([1] [853])
La question du parlementarisme
De même que sur la question syndicale, la plateforme de BC de 1982 ne représente ni un changement, ni une clarification sur la question parlementaire par rapport à celle de 1952 : BC a simplement rayé les parties les plus compromettantes. En 1982, comme en 1952, BC écrit : " Depuis le Congrès de Livourne jusqu'à aujourd'hui, le Parti n'a jamais fait sien l'abstentionnisme face aux campagnes électorales comme principe d'orientation de sa propre politique, comme il n'a jamais accepté, ni n'acceptera aujourd'hui, le participationniste systématique et indifférencié. Conformément à sa tradition de classe, le Parti décidera chaque fois du problème de sa participation suivant l'intérêt politique de la lutte révolutionnaire". (Plateforme de BC, 1952 et 1982).
Mais là où en 1952 BC parlait de "la tactique du Parti (participation à la seule campagne électorale avec propagande écrite et orale ; présentation de candidatures ; intervention au sein de l'assemblée)" (Plateforme de 1952), aujourd'hui, "étant donné la ligne de développement de la domination capitaliste, le Parti reconnaît que la tendance est vers des occasions de plus en plus rares pour que les communistes puissent utiliser le parlement en tant que tribune révolutionnaire" (Plateforme de 1982). Au fond, cette argumentation est aussi profonde que celle de n'importe quel parti bourgeois, qui renonce à briguer un siège par peur de perdre sa caution financière.
Pour une fois, la CWO n'est pas d'accord avec son "organisation soeur" :
" Le parlement est la feuille de vigne derrière laquelle se dissimule la dictature de la bourgeoisie. Les véritables organes du pouvoir se trouvent en fait hors du parlement... si bien que le parlement n'est même plus le conseil exécutif de la classe dominante, mais simplement un piège à dupes sophistiqué...(...)... Le concept de choix électoral est aujourd'hui la plus grande fumisterie qui soit." (Plateforme de la CWO) ([2] [854])
Que la CWO prenne BC pour des dupes, soit. Mais qu'ils ne fassent pas de même avec le reste du milieu révolutionnaire, ni avec la classe ouvrière en général. Voici le BIPR, le summum auto-proclamé de clarté programmatique et de volonté militante, qui contient en son sein deux positions non seulement différentes, mais parfaitement incompatibles, voire antagoniques. Et pourtant, nous n'avons jamais vu même l'ombre d'une confrontation entre ces positions.
Comme nous l'avons déjà remarqué ([3] [855]), la plateforme du BIPR résout la question, non pas en la "minimisant", mais en ... 1'"oubliant". C'est peut-être ça, la "responsabilité" que nous sommes "en droit d'attendre d'une force sérieuse dirigeante".
On pourrait nous répondre que le parlementarisme est une question secondaire. Il est effectivement vrai, que nous n'aurons probablement jamais le plaisir d'écouter les discours parlementaires d'un "honorable member" de BC ou de la CWO. Mais accepter ce genre d'argument serait escamoter une question de fond. Le principe abstentionniste était une des positions centrales qui distinguait l'aile gauche du Parti socialiste italien autour de Bordiga (laquelle s'intitulait justement "Fraction abstentionniste"), des réformistes et opportunistes en tout genre. BC aujourd'hui ne défend même pas cette position initiale de Bordiga, mais celle qu'il a adoptée au sein de l'IC, "par discipline" (c.a.d., l'abstentionnisme par tactique et non par principe).
Quant à la CWO, la légèreté avec laquelle elle renie sa propre déclaration qu’"aucun aspect théorique ne doit rester dans 1'ombre aussi bien dans une même organisation qu'entre organisations" (Plateforme de la CWO) ne fait que confirmer que sa position sur la question parlementaire (comme sur tant d'autres) est née de simples observations empiriques.
La position anti-parlementaire doit surgir d'une compréhension profonde de la décadence du capitalisme et de ses implications sur le mode d'organisation de l'Etat bourgeois - le capitalisme d'Etat. Ne pas comprendre la question parlementaire, c'est se rendre incapable de comprendre les manoeuvres politiques des différentes fractions de la bourgeoisie. Pour celles-ci, le pouvoir parlementaire est devenu un problème parfaitement secondaire, par rapport aux besoins de mystification et contrôle social. Pas étonnant donc, que la CWO s'est toujours avouée "incapable de comprendre" nos analyses sur la "gauche dans l'opposition". ([4] [856])
Mais la non compréhension des implications de la décadence capitaliste, et donc des bases matérielles de ses propres positions, n'excuse pas la pratique de la CWO sur la question parlementaire. Dans un article paru dans Workers Voice n°19 en novembre 1984 ("Capitalist Elections and Communism") la CWO réussit le tour de force extraordinaire de publier un long article sur le parlementarisme, en citant les positions de la Fraction abstentionniste (c.a.d. la gauche révolutionnaire organisée autour de Bordiga) du Parti socialiste italien, sans dire un mot des positions de "l'organisation soeur", Battaglia Comunista. Cette pratique, qui consiste à"oublier", ou cacher des divergences de principe dans l'intérêt d'une unité de façade, a un non dans le mouvement ouvrier : c'est l'opportunisme.
La question nationale
et la conciliation avec le gauchisme
Nous avons déjà vu que, pour le BIPR, la différence entre "stratégie" et "tactique" est la même que celle entre la porte fermée et la fenêtre ouverte. La plateforme du BIPR commence par fermer la porte aux mouvements de libération nationale : "L'ère des libérations nationales, en tant qu'événements progressifs de 1'histoire, par rapport au monde du capitalisme, est depuis longtemps définitivement terminée. Il faut donc rejeter sans équivoque toutes les thèses qui, considérant que le problème national se pose encore dans certaines régions du monde, subordonnent les principes, la stratégie et la tactique du prolétariat à une politique d'alliance avec la bourgeoisie nationale, ou pire avec des blocs impérialistes rivaux" (Revue Communiste n°1, p.7.avril 1984). Aussitôt elle ouvre la fenêtre à la conciliation dans la pratique avec le gauchisme : "Indépendamment de la possible prise en charge de la revendication de certaines libertés élémentaires dans 1'agitation politique révolutionnaire, la tactique du parti communiste sera tournée vers la destruction de l'Etat pour l'instauration de la dictature du prolétariat" (ibid, p.8, nous soulignons).
Cette ambiguïté ne nous surprend pas, puisque BC en particulier n'a jamais été capable de mener sa critique de la position de l'IC sur la question nationale jusqu'au bout. Dans ses interventions à la 2ème Conférence Internationale (novembre 1978), BC parle "de la nécessité de dénoncer le caractère des soi -disant luttes de libération nationale, comme supports à une politique impérialiste", mais enchaîne tout de suite : " si le mouvement national ne se pose pas le problème de la révolution communiste , il est nécessairement et inévitablement victime de la domination impérialiste" (2ème Conférence,vol. 2, p. 62). Avec ce petit "si", BC s'arrête à mi-chemin. Ce "si" traduit l'incapacité de BC de comprendre que le "mouvement national" ne peut jamais se poser "le problème de la révolution communiste". Seule la lutte prolétarienne indépendante, sur le terrain de la défense des intérêts de classe, peut se poser ce problème. Tant que le prolétariat lutte sur le terrain national, il est voué à l'échec, puisque,dans la période du capitalisme décadent, toutes les fractions de la bourgeoisie sont unies contre la classe ouvrière, y inclus les fractions soi -disant "anti-impérialistes". Et dès que le prolétariat lutte sur son terrain, il se heurte au nationalisme de la bourgeoisie.
Ce n'est que sur son terrain, de la lutte de classe internationale, et donc anti-national que le prolétariat peut donner une direction aux luttes des masses pauvres des pays sous-développés. Et si l'issue de la lutte de la classe ouvrière dans ces pays sera effectivement déterminée par celle dans le coeur industriel du capital, ceci n'enlève rien de sa responsabilité en tant que fraction du prolétariat mondial, et donc des révolutionnaires au sein de cette fraction. Parce que BC ne l'a pas compris, parce qu'elle est restée incapable de pousser sa critique des positions de l'IC jusqu'au bout, elle finit par affirmer qu'il faut "dresser les mouvements de libération nationale en révolution prolétarienne" (2ème Conférence, vol 2, p.62.novenbre 78), qu'il faut "travailler dans le sens de la rupture de classe dans le mouvement et non en le jugeant du dehors. Cette rupture, maintenant, signifie la création d'un pôle de référence en lien avec le mouvement" (ibid, p. 63, nous soulignons). Pas étonnant que quand l'UCM affirme : "Nous rejetons l'idée que les mouvements (de libération, nationale, NDLR) sont incapables de s'attaquer au capitalisme de façon révolutionnaire. Nous disons que ces mouvements ont failli parce que la bourgeoisie en avait la direction... il est possible pour les communistes d'en prendre la direction" (4ème Conférence, septembre 1982, p.19), ils ajoutent : "Nous sommes d'accord avec la manière de BC de poser la question".
C'est sans doute le désir de "créer un pôle de référence en lien avec le mouvement" qui a amené BC et la CWO à inviter l'UCM à la même Conférence de la Gauche Communiste. Quant à la nature de l'UCM, nous n'aurions que peu de chose à ajouter à la dénonciation du PC d'Iran (formé par l'UCM et Komala) dans la Revue Communiste n°1. Cet article, nous montre, "que le PC d'Iran a les mêmes conceptions capitalistes d'Etat que la gauche européenne" et qu'il "n'a de communiste que le nom". Mais que le BIPR écrive ces mots en 1984 nous fait penser à l'amant qui se rend compte que sa bien-aimée est religieuse.... quand elle se sauve avec le curé. Le BIPR veut nous faire croire que ce Programme date de 1983, et n'existait pas "quand nous polémiquions avec eux (l'UCM) ; c.a.d. avant que l'UCM n'accepte le Programme du PC d'Iran (ibid). Rien n'est moins vrai. Le Programme a été publié en anglais en mai 1982, et une "note" rajoutée par Komala montre que les deux organisations ont tenu des discussions de fusion à partir de 1981. Cinq mois plus tard, l'UCM, qui se revendique explicitement du "Programme du PC d'Iran" est "sérieusement sélectionné" pour "commencer le processus de clarification des tâches du parti" (4ème Conférence). . En plus, avec quelle gentillesse, quelle circonspection, quelle "compréhension" BC et la CVO répondent-ils à l'UCM !
"Nous sommes globalement en accord avec 1'intervention du SUCM (sur les "révolutions bourgeoises démocratiques", NDLR)" (BC). "Le programme de l'UCM semble être celui dé la dictature prolétarienne" (encore BC). " Le terme "révolution démocratique" prête à confusion" (CWO) ; "Nous pensons que c'est une idée (la "révolution ininterrompue") qui a été dépassée"(BC). Même en 1984, le BIPR n'est pas encore prêt à dénoncer le PC d'Iran pour ce qu'il est - une fraction ultra-radicale de la bourgeoisie nationaliste. Non, pour le BIPR, "le PC d'Iran et les éléments qui gravitent dans son orbite" sont encore des "interlocuteurs", tandis que la participation à la guerre impérialiste n'est que "les graves erreurs pratiques auxquelles peut conduire une ligne politique manquant de cohérence sur le plan historique" (Revue Communiste n°2) .
BC et la CWO feraient mieux de se réapproprier dans la pratique, et non pas de façon platonique contre à présent, les mots de Lénine : "celui qui parle aujourd'hui de "dictature révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie" n'est plus dans le coup et, par voie de conséquence,il est de fait dans le camp de la petite bourgeoisie, contre la lutte de classe prolétarienne" ("Thèses d'Avril") ; "On ne jure plus à notre époque que par 1'internationalisme. Jusqu'aux chauvins jusqu'au-boutistes, jusqu'à MM. Plékhanov et Potressov, jusqu'à Kerenski, qui se disent internationalistes. Le parti du prolétariat a le devoir d'autant plus impérieux d'opposer avec une clarté, une précision, une netteté absolues, l'internationalisme en actions à 1'internationalisme en paroles" (Lénine : "Les tâches du prolétariat dans Notre Révolution" ).
Voilà où mène le désir de BC et la CWO d'être "en lien avec le mouvement" : faire des "Conférences" avec une organisation bourgeoise qui participe à la guerre impérialiste. Eh lien avec le mouvement d'accord - mais quel mouvement ?
L'attitude, le comportement pratique, de la CWO et BC, et maintenant du BIPR, ne sont pas nouveaux dans le mouvement ouvrier. C'est celui du "centre" qui hésite entre les social-chauvins et les véritables internationalistes.. .Le "centre" est pour "l'unité", le centre est l'adversaire de la "scission" (ce que la CWO "deuxième série" ([5] [857]) appelle aujourd'hui notre "sectarisme" envers l'UCM) ; "Le "centre", c'est le règne de la phrase petite-bourgeoise bornée de bonnes intentions (et à résonance "ultra-marxiste" ! NDLR), de l'internationalisme en paroles, de l'opportunisme pusillanime et de la complaisance pour les social-chauvins en fait" (Lénine, op. cit). Si aujourd'hui, le gauchisme en tout genre, la bouche pleine d'internationalisme "en paroles", a pris la place du social-chauvinisme ouvert, le comportement centriste dénoncé par Lénine reste le même.
L'émergence des forces communistes
Si BC et la CWO ont tant de mal à "opposer 1'internationalisme en actions à 1'internationalisme en paroles", c'est aussi parce qu'ils sont sérieusement affaiblis par leur vision invraisemblable du surgissement des groupes révolutionnaires, en particulier dans les pays sous-développés. Ainsi, dans RP 21, 1984 ("The Situation in Iran and the tasks of Communists"), la CWO nous explique qu'il n'y a que trois possibilités pour "le développement d'une clarification politique" :
"1) La formation d'une avant-garde communiste est sans importance dans ces régions puisque leurs prolétaires sont sans importance pour la révolution. Nous rejetons cette conception comme frisant le chauvinisme. ..(...)...
2) ...un parti communiste émergera spontanément de la lutte de classe dans ces régions. C'est à dire, sans contact organique avec la gauche communiste... le prolétariat créera une avant-garde directement qui formulera une vision globale du communisme à partir de sa propre existence. Une telle vision est une folie spontanéiste...
3)...certains courants et individus commencent à mettre en question les bases du gauchisme et se mettent à critiquer leurs propres positions...".
La première "possibilité" est soi -disant la position du CCI, ce qui permet à la CWO de nous dénoncer pour "euro-chauvinisme". Encore une fois, la CWO est passée maître dans la polémique de la calomnie voilée: aucun de nos textes n'est cité pour soutenir cette accusation ridicule, et les soi-disant propos d'un de nos militants (cités dans le même article) ont dû être recueillis un jour où la CWO avait oublié de se laver les oreilles. Il nous suffit ici de rappeler, que si nous menons depuis dix ans, un travail de contact et de discussion en Amérique latine, en Australie, en Inde, au Japon, dans les pays de l'Est...ce n'est certainement pas parce que nous estimons "les prolétaires de ces pays" comme "sans importance pour la révolution".
La deuxième position est également censée être la nôtre. Disons d'abord que cette vision du parti qui surgit sur une base nationale, et non pas internationale dès le départ, n'est pas celle du CCI mais de BC (la contradiction n'a jamais gêné la CWO !). Mais en plus, il est évident que le surgissement de groupes basés sur les positions de classe ne peut qu'être le fruit d'une lutte acharnée contre l'idéologie dominante, d'autant plus dans les pays sous-développés où les militants doivent affronter tout le poids du nationalisme ambiant, et de la situation très minoritaire du prolétariat. La survie de ces groupes dépend donc de leur capacité à porter les leçons de la lutte des ouvriers contre "leur" bourgeoisie soi-disant "anti-impérialiste" au niveau théorique et militant, en nouant des liens avec les organisations politiques les plus avancées du prolétariat mondial, au coeur du monde capitaliste en Europe.
La troisième position - celle du BIPR - revient à ceci : chercher le surgissement de groupes prolétariens au sein même de la classe ennemie, parmi les organisations gauchistes dont la fonction est précisément de dévoyer, trompé, et massacrer la classe ouvrière, au nom même du "socialisme". Le BIPR montre ainsi qu'il ne comprend rien au mouvement dialectique des groupes politiques. Si les organisations prolétariennes subissent constamment l'influence de l'idéologie dominante - ce qui peut éventuellement les corrompre à un tel point qu'elles passent au camp de la bourgeoisie – l’inverse n'est pas vrai. Les organisations bourgeoises, du fait même qu'elles appartiennent à la classe dominante ne subissent aucune "pression idéologique" du prolétariat et on n'a jamais vu une organisation gauchiste passer en tant que telle du côté de la classe ouvrière.
De plus les perspectives du BIPR sont fondées sur une supposition fausse : que ces groupes (tel l'UCM) dans la mouvance maoïste surgissent de façon isolée, chacun dans son propre pays. La réalité est tout autre, et démontre la naïveté du BIPR. Dans les faits, ces groupes vivent autant dans les pays d'émigration que dans leur pays "d'origine", surtout dans les milieux d'exilés très fortement infiltrés par le gauchisme "européen" classique. Une lecture rapide de leur presse nous révèle, par exemple, "Bolshevik Message" (de l'UCM) qui publie une lettre de salutations de la part de l'ancien "El Oumami" ([6] [858]) ou le groupe maoïste "Proletarian Enancipation" (de l'Inde) qui publie - sans un mot de critique - le "Programme du PC d'Iran". Le combat que nous menons contre ces organisations est le même que celui que nous menons contre le gauchisme des pays développés et...tant pis pour "l'euro-chauvinisme".
Il est certain que les organisations surgies de la classe ouvrière en Europe, là où la classe est la plus expérimentée organisationnellement et politiquement ont une responsabilité énorme envers les groupes prolétariens des pays sous-développés, qui se battent souvent dans des conditions pénibles de répression physique et de pression de l'idéologie nationaliste ambiante. Mais ce n'est pas en escamotant la séparation de classe entre le gauchisme et le communisme qu'elles la rempliront; un exemple éclatant de ce genre d'escamotage nous est fourni par la publication côte à côte (dans "Proletarian Emancipation") d'un article de la CWO sur la conscience de classe, et du "Programme du PC d'Iran".
Conclusion
Nous ne sommes pas contre le regroupement des révolutionnaires : le travail que nous menons depuis la naissance du CCI est là pour le prouver. Mais nous sommes opposés aux regroupements superficiels qui passent par l'opportunisme envers leurs propres désaccords, et par le centrisme et la conciliation envers les positions bourgeoises. L'histoire de "Programma Communista" a montré que de tels regroupements finissent inévitablement par perdre, et non pas gagner, des forces au camp prolétarien. C'est pourquoi nous appelons BC et la CWO à passer au crible d'une critique sans merci leurs positions et leur pratique actuelles afin qu'ils puissent véritablement contribuer au travail qui doit mener au Parti mondial du prolétariat.
Arnold
[1] [859] Ce n'est pas le but de cet article de démontrer en détail la nature bourgeoise du "Unity of Communist Militants" ou de ses groupes de sympathisants à l'étranger (SUCM). (Voir nos articles dans WR n°57 et 60. Il suffit de dire que le programme initial de 1'UCM est essentiellement le même que celui du PC d'Iran (qui "n'a de communiste que le nom" selon le BIPR), et que Komala -avec qui l'UCM a publié le programme du PC d'Iran en mai 1982 - est une organisation maoiste, alliée militaire du Parti Démocrate Kurde, et dont les camps d'entraînement se situent en Irak. L'UCM et Komala sont donc des participants directs à la guerre impérialiste Iran/Irak.
[2] [860] Soit dit en passant, nous partageons entièrement cette vision du parlement "démocratique" bourgeois
[3] [861] Voir l'article dans la Revue Internationale n°40 (1er trimestre 1985).
[4] [862] Sans entrer dans le détail, notre analyse de " La gauche dans l'opposition" se base :
- sur le fait que, dans le capitalisme décadent, il n'existe plus de "fraction progressiste" de la bourgeoisie - quelles que soient ses querelles internes, toute la classe dominante est unie contre la classe ouvrière (voir Revue Internationale n° 31 et 39);
- sur le fait que, au sein de l'appareil capitaliste d'Etat, 1a fonction essentielle de ses fractions de gauche est de dévoyer la lutte prolétarienne.
Sur cette base, nous considérons que la bourgeoisie, depuis 1'ouverture de la deuxième vague de lutte de classe en 1978, a sciemment adopté la politique du maintien dans l'opposition de ses partis de gauche, afin d'éviter qu'ils soient discrédités aux yeux des ouvriers par l'austérité qu'ils seraient obligés d'appliquer au gouvernement (voir aussi Revue Internationale n°18).
[5] [863] Dans "Revolutionary Perspectives"n°20, la CWO est si gonflée par sa"méthode plus dialectique... qui voit les événements dans leur contexte historique, en tant que processus plein de contradictions, et non pas de façon abstraite, formelle", qu'ils ont décidé d'appeler la revue "Revolutionary Perspective". Second Séries . Avec RP 21, la mention "Second Séries" a déjà disparu de la revue, apparemment, la dialectique a fait long feu chez la CWO.
[6] [864] "El-Oumami", anciennement un organe de Programme Communiste, fut fondé sur des positions franchement nationalistes arabes après une scission du PCI en France.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
- TCI / BIPR [821]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Misère du conseillisme moderne
- 3148 reads
A PROPOS DES LIVRES : "AU-DELA DU PARTI" (Collectif JUNIUS, 1982) "DE L'USAGE DE MARX EN TEMPS DE CRISE" (Les Amis de Spartacus, 1984)
"... Toute cette salade nous la devons surtout à Liebknecht et à sa manie de favoriser les écrivassiers de merde cultivés et les personnages occupant des positions bourgeoises, grâce à quoi on peut faire l'important vis-à-vis du philistin. Il est incapable de résister à un littérateur et à un marchand qui font les yeux doux au socialisme. Or ce sont là précisément en Allemagne les gens les plus dangereux, et depuis 1845, Marx et moi nous n'avons cessé de les combattre. () leur point de vue petit-bourgeois entre à tout moment en conflit avec le radicalisme des masses prolétariennes ou parce qu'ils veulent falsifier les positions de classe."
ENGELS à BEBEL 22 juin 1885.
Les produits des Editions Spartacus en France n'ont pas pour habitude de déroger à une idée fixe : la déformation des acquis principiels du mouvement ouvrier. L'éclectisme des divers ouvrages publiés possède même un point de rencontre primordial : 1'assimilation du bolchevisme au stalinisme et au jacobinisme avec pour objectif la négation de toute activité de parti pour le prolétariat. C'est la référence de base/ le nec plus ultra des deux "cahiers" : Au-delà du parti du collectif Junius ( 1982) et De l'usage de Marx en temps de crise par les "amis de Spartacus" (1984). Ces cahiers ont été réalisés par d'anciens militants du PIC ([1] [865]) et par toute une série d'éléments anarchisants et de notoriétés conseillistes. Les Editions Spartacus ont une diffusion plutôt confidentielle, mais suffisante tout de même pour influencer des éléments de la classe en recherche au niveau international, et pour rendre confuse, voire détruire toute sérieuse réappropriation de 1 'histoire passée du mouvement ouvrier et de son legs théorique aujourd'hui ; c'est pour cela que nous avons pour but de dénoncer ici ce qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant en dépit des citations extirpées des textes mêmes de Marx.
1- LA PRETENTION DE REJETER LA NECESSITE DU PARTI
a) La question de l'organisation en parti est-elle étrangère à la lutte de classe prolétarienne ?
Le sous-titre de Au-delà du parti assure qu'il va traiter de "l'évolution du concept de parti depuis Marx". D'emblée l'introduction précise :
"La critique du concept de parti, y compris par les conseillistes et par les diverses variantes de modernistes (situationnistes, associationnistes, autonomes de tous poils...) évite de situer clairement les origines du caractère erroné de ce concept dans les thèses de Marx lui-même. Pire, elle croit pouvoir opposer la théorie du parti prolétarien chez celui-ci à toutes celles qui, à partir de la Social-Démocratie et du léninisme, ont assimilé le Parti à la représentation du prolétariat, à1' incarnation de sa conscience de classe" Dès le départ l'entreprise des anciens du PIC trahit sa démarche intellectuelle: on ne se situe pas du point de vue des intérêts du mouvement prolétarien dans son ensemble, mais du point de vue abstrait d'un "concept". Toute autre est la démarche marxiste :
". On ne peut étudier et comprendre l'histoire de cet organisme, le Parti, qu'en le situant dans le contexte général des différentes étapes que parcourt le mouvement de la classe, des problèmes qui se posent à elle, de 1 'effort de sa prise de conscience, de sa capacité à un moment donné de répondre de façon adéquate à ses problèmes, de tirer les leçons de son expérience et d'en faire un nouveau tremplin pour ses luttes à venir. " ("Le Parti et ses rapports avec la classe" Revue Internationale n°35).
Mais examinons si ce collectif Junius fait mieux que les modernistes. C'est en effet à partir de l'époque de Marx que le "collectif" va faire remonter ses critiques aux conceptions défendues par les Internationales successives, puis par les fractions qui ont résisté à la dégénérescence d'octobre 1917 et par le CCI. Chemin faisant, en remontant l'histoire, on s'aperçoit qu'il est déjà plus facile de l'interpréter et de la "refaire" à son goût :
". .. . Ainsi, pour Marx, le dépassement de la lutte purement économique (formation de syndicats ) en lutte politique se traduit avant tout par la constitution d'un Parti du prolétariat, distinct et indépendant des autres partis formés par les classes possédantes. Les tâches politiques de ce parti visent à aménager le système capitaliste dans un sens favorable aux intérêts des ouvriers puis à 'conquérir le pouvoir'. Ce parti correspond donc au jeu politique du 19ème siècle qui est favorable à une certaine extension du processus démocratique propre au capital dans sa phase ascendante. . . Ce qui est faux dans la conception de Marx se révèle donc être son assimilation du mouvement politique de la classe ouvrière à la formation et à 1 'action d'un parti prolétarien... Son concept de 'Parti prolétarien' est le produit de sa séparation entre phase politique et but social" (p.10) ([2] [866]). Voici donc la notion de parti prolétarien taxée de vieillerie du 19ème siècle (air connu !). Mais essayons toujours de comprendre pourquoi le collectif Junius estime que Marx sépare en deux la lutte de classe :
".. Pour Marx, il n'y avait pas de rupture entre la démocratie bourgeoise et la réalisation du communisme mais une certaine continuité : la phase politique représentait en quelque sorte la charnière entre les deux car une fois le pouvoir conquis, la garantie de la transformation sociale ultérieure était l'existence d'une fraction communiste dans le parti prolétarien." (p.11).
Tout cela est bien alambiqué, mais constatons que c'est l'enfance de l'art que de juger un moment de la trajectoire de Marx avec de l'a peu près et en figeant chaque étape. Ce que révèle ce galimatias, c'est une profonde incompréhension des conditions de la période ascendante du capitalisme qui permettait au prolétariat - tout en posant au long terme la question de la révolution - d'obtenir de véritables réformes. En réalité, c'est jusqu'au tout début du 20ème siècle - au terme du processus d'ascendance du capitalisme - que devait être mené en complémentarité le combat pour les libertés politiques et la lutte syndicale pour la réduction massive de la journée de travail, une même dynamique pour la constitution du prolétariat en classe consciente d'elle-même et en force politique autonome. Ce combat pour les réformes ne s'opposait pas au but social final puisque, ainsi que les citent malgré eux les auteurs, Marx et Engels précisaient toujours :
". il ne saurait être question de masquer les antagonismes de classe, mais de supprimer les classes ; non pas d'améliorer la société existante mais d'en fonder une nouvelle." (1850)([3] [867]).
Paradoxalement le collectif Junius se permet de se moquer de Marx et Engels parce qu'à certains moments ils ont cru à une révolution européenne, mais il omet de citer la réévaluation faite par Engels en 1895, dans une introduction aux Luttes de classe en France, où celui-ci admet que l'histoire leur a donne tort quant à leurs prévisions : " Elle a montré clairement que l'état du développement sur le continent était alors bien loin d'être mûr pour la suppression de la production capitaliste."
Bien qu'esquivant la vraie problématique fondamentale des partis prolétariens au 19ème siècle, le collectif Junius s'efforce en long et en large de prétendre que Marx n'a fait que modeler la forme du parti prolétarien sur le modèle des partis bourgeois. L'idée n'est pas nouvelle, elle est re prise de Karl Korsch ([4] [868]). Il est vrai que Marx a souvent évoqué la révolution de 1789 d'autant plus qu'il la considérait comme la plus exemplaire des révolutions bourgeoises. A chaque époque, les révolutionnaires sont marqués par le modèle des révolutions antérieures, et ils s'efforcent de les étudier minutieusement pour être à même de dépasser les conceptions anciennes. Et ce n'est pas simplement Marx qui était passionné par la révolution française, mais pratiquement tous les révolutionnaires de son époque, tout autant les anarchistes que les blanquistes. Marx est le premier, cependant, à avoir insisté, après Babeuf, sur les limites de cette révolution bourgeoise - voir comment il tire à boulets rouges sur les hypocrites "droits de l'homme" (in la Question Juive) - et surtout le premier à montrer lai nécessité de la révolution prolétarienne pour l'émancipation réelle de l'humanité (cf. le "caractère universel du prolétariat" in L'Idéologie Allemande).
La phase ascendante du capitalisme ne pouvait pas permettre à Marx et à ses compagnons de lutte de comprendre toutes les fonctions- du parti prolétarien qui diffèrent de celles du parti bourgeois classique : il n'a pas pour fonction la prise du pouvoir politique à la place du prolétariat, il n'a pas à encadrer la classe ouvrière ni à appliquer la terreur, ni à étendre la révolution par une "guerre révolutionnaire" (toutes leçons qui seront tirées à travers les expériences de la Commune de Paris et d'Octobre 1917). Cependant, le mouvement-même de la classe à leur époque -surtout les révolutions de 1848 et 1871 - permit non seulement à Marx et Engels de dépasser le modèle de 1789, mais aussi de tirer des enseignements pour l'ensemble du prolétariat que ne tirèrent pas les quaranthuitards ni les communards eux-mêmes : ces leçons étaient par excellence une activité indispensable en tant que militant d'une organisation révolutionnaire - et non d'historien- qui a fait date dans le mouvement révolutionnaire puisque lorsque l'on y parle de 1848 ou 1871, on ne fait pas référence à l'événementiel mais aux leçons politiques de Marx et d'Engels ! D'ailleurs plutôt que de souligner ces leçons politiques et îa capacité de Marx à remettre en question ses analyses antérieures lorsque la lutte de classe apportait des enrichissements in vivo ([5] [869]), le collectif Junius préfère clamer que la Commune a donné tort à Marx, se gardant bien de rappeler qu'il n'y a pas eu foule pour soutenir l'insurrection parisienne ni pour plaider sa cause après la répression sanglante, alors que Marx l'a soutenue pleinement même si elle n'entrait pas dans ses prévisions ; nous pouvons même ajouter que si la postérité s'est tant intéressée à la Commune c'est en bonne partie grâce à Marx. Le collectif a beau assurer :
"... l'insurrection des ouvriers... allait donner tort aux analyses précédentes de Marx et Engels sur la priorité absolue du processus démocratique" (p.14), ceci pour dénigrer une nouvelle fois toute activité de parti prolétarien, il n'en reste pas moins que la faiblesse des mesures prises pendant la Commune, le manque de coordination, le faible nombre de représentants de l'AIT, ont révélé d'autant plus pour l'avenir la nécessité de la présence d'une minorité révolutionnaire au sein de la classe, dotée d'un programme cohérent et influençant fermement la lutte. Mais, malgré tout, la Commune ne pouvait être, de par son caractère prématuré, qu'un gigantesque éclair annonciateur de la confrontation sociale qui allait pouvoir se produire moins d'un demi siècle plus tard, non pas à l'échelle d'une ville, mais au niveau international du fait de l'entrée en décadence du capitalisme. De la même façon que la Commune ne niait pas l'importance d'un parti prolétarien qui soit à la hauteur des tâches de sa période, de la même façon elle donnait raison à Marx sur la nécessité d'une phase transitoire du fait de la nécessaire réorganisation de la société. Pas question de période de transition, disent par contre nos auteurs, en substance :
"... C'est la théorisation d'une séparation entre la phase politique et le but social encore !), donc de la continuité de certaines fonctions de la société de classes et du capitalisme à travers la phase politique (l'Etat)"(p.15).
Il s'agit du même raisonnement que celui de Proudhon. Vingt ans plus tôt, dans la fameuse lettre à Weydemeyer, Marx avait anticipé le contenu transitoire concrétisé par la Commune : ". . . la lutte de classe mène nécessairement à la dictature du prolétariat.(qui) elle-même ne représente qu'une transition vers 1'abolition de toutes les classes et vers une société sans classe" (1852). La Commune est restée un exemple des prémisses transitoires de." ia lutte pour le communisme ; il faut bien constater que les mesures politiques prises y ont été plus importantes que les timides mesures économiques. A la différence de la classe bourgeoise, le prolétariat ne peut s'appuyer sur l'économie pour garantir ses chances de succès ; il bouleversera, certes, constamment l'économie pendant toute la phase future de transition, mais dans la mesure où il s'affirmera politiquement. De ce point de vue, Marx est resté intraitable face au réformisme qui fut longtemps surtout le fait de ceux qui rejetaient l'action politique et la fonction du parti politique de classe, les différentes variétés de syndicalistes ou d'anarchistes, qui auraient approuvé l'argumentation de nos modernes conseillistes. Enfin, et surtout, en cherchant à nous faire avaler que Marx avait tort face à la Commune de Paris à propos du "processus démocratique", le collectif Junius veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, il cache sous la table la principale leçon de la Commune : LA NECESSITE DE LA DESTRUCTION DE L'ETAT BOURGEOIS, que l'opportunisme dans la 2ème Internationale a longtemps également mise sous le boisseau. Or, de ce point de vue, Marx avait parfaitement raison dès 1852, et il l'affirme à plusieurs reprises dans le 18 Brumaire, comme ceci :
"... Toutes les révolutions politiques n'ont fait que perfectionner cette machine, au lieu de la briser. Les partis qui luttèrent à tour de rôle pour le pouvoir considérèrent la conquête de cet immense édifice d'Etat comme la principale proie du vainqueur."
Le collectif Junius qui n'en est pas à un oubli (de taille) près, reproche surtout, d'une façon générale, à Marx de s'être inspiré du "siècle des lumières". Comme on peut le constater par ce qui précède, il apporte plutôt beaucoup d'ombre aux thèses de Marx lui-même, il colporte pas mal de vieilleries utilisées déjà au siècle dernier, comme cet idéaliste de Bauer que Marx qualifiait de "lumineux" ([6] [870]) sarcastiquement. Marx, au bout du compte, ne s'est pas contenté de copier tel quel l'exemple de la bourgeoisie révolutionnaire - nos doctes historiens ont l'air d'oublier que la bourgeoisie a été aussi une classe progressiste-, il a pris pour point de départ le renversement critique révolutionnaire des principes hégéliens, il a ainsi élaboré une méthode matérialiste traitant des idées et des alternatives de société en connexion avec l'époque historique déterminée et avec la forme spécifique de société propre à ladite époque. Le collectif Junius se soucie fort peu de la méthode marxiste, le matérialisme, historique n'existe pas pour lui : son point de vue étroit d'aujourd'hui lui sert de grille à la compréhension des différentes périodes du passé !
Les partis du prolétariat - nous ne parlons pas ici des partis bourgeois qui prétendent parler et décider en son nom - sont sécrétés par lui, ils lui sont aussi utiles que l'oxygène à l'air. Et c'est le matérialisme historique qui nous permet d'affirmer :
"La formation de 'forces politiques exprimant et défendant des intérêts de classe n'est pas propre au prolétariat. Elle est le fait de toutes les classes de l'histoire* Le degré de développement, de définition et de structuration de ces forces est à 1'image des classes desquelles elles émanent. Cependant, s'il existe des points communs incontestables entre les partis du prolétariat et ceux des autres classes - et notamment de la bourgeoisie - les différences qui les opposent sont également considérables... l'objectif de la bourgeoisie, en établissant son pouvoir sur la société, n'était pas d'abolir 1'exploitation mais de la perpétuer sous d'autres formes, n'était pas de supprimer la division de la société en classes, mais d 'instaurer une nouvelle société de classes, n'était pas de détruire l'Etat mais au contraire de le perfectionner .. Par contre... les partis du prolétariat n'ont pas pour vocation la prise et 1'exercice du pouvoir d'Etat, leur but étant au contraire la disparition de l'Etat et des classes" ("Sur le Parti et ses rapports avec la classe", in la Revue Internationale n°35). Il est logique, cependant, que Marx, même après l'expérience de la Commune de Paris, soit resté marqué par son époque et qu'il ait persisté à soutenir que le parti prolétarien devait prendre le pouvoir, mais l'histoire a tranché depuis, a contrario des bolcheviks sur ce point, que ce n'est pas la fonction du parti. Mais à comparer pour comparer, que dire des contemporains de Marx, des diverses sectes bakouninistes ou blanquistes avec leurs sociétés secrètes et leurs dérisoires projets de coups d'Etat ! Qui peut être placé à côté de la formidable cohérence et lucidité de Marx dont la méthode reste une arme de combat ? Qui, excepté le collectif Junius et sa machine à rebrousser chemin !
b) Conscience de classe et formation des partis
Le collectif Junius qui constate :
" .. une nouvelle fois le poids négatif de la révolution française sur la conscience de Marx-Engels.. La séparation phase politique/phase sociale (cela devient une obsession !) fera apparaître complètement la conception et la mise en pratique du Parti Communiste Jacobin, un parti de spécialistes de la politique, de révolutionnaires professionnels, de théoriciens du prolétariat. Pour la social-démocratie et le bolchevisme, le Parti construit préalablement au mouvement révolutionnaire deviendra l'introducteur d'une conscience idéologique dans le prolétariat considéré uniquement comme trade-unioniste"
Ou encore, puisqu'il faut jeter aux poubelles de la bourgeoisie toute l'histoire de la lutte de classe prolétarienne, après Marx on jette la 2ème Internationale, puis la 3ème, etc.:"Lénine allait appliquer dans la pratique jusqu'à leurs ultimes conséquences, les aspects négatifs de Marx sur la conception organisationnelle que la Social-Démocratie allemande avait déjà amplifiée."
Tout y passe, tout est objet de l'insulte anarchiste : parti élitiste, vision politicienne, manipulation. Il serait fastidieux de répondre à toutes les arguties de cette compilation d'écoliers, que le lecteur soucieux d'une bonne recherche historique se reporte plutôt aux textes de Marx, de Lénine ou aux quelques ouvrages historiques sérieux et aux documents des Internationales. Rappelons simplement ici ce passage toujours valable du Manifeste Communiste :
"(les communistes) n'ont point d'intérêts qui les séparent de l'ensemble du prolétariat." Rappelons simplement que Marx rétorquait à tous les conspirateurs de son temps que la lutte de classe a besoin de clarté comme le jour de la lumière. Quant à l'idée de "conscience introduite de l'extérieur du prolétariat" que ressasse aussi le collectif Junius, elle n'existe pas chez Marx, ni non plus dans les congrès des 2ème et 3ème Internationales. Que Kautsky et Lénine aient tordu la barre dans les débats contre les économistes et les syndicalistes apolitiques est une chose, mais cette idée n'a jamais figuré dans aucun programme des partis ouvriers avant 1914 ; Lénine a publiquement rejeté cette idée en 1907. Il est de bon ton dans certains milieux soixanthuitards de chanter le leitmotiv du "renégat Kautsky et son disciple Lénine", c'est là une vieille mode reprise aux notoriétés de la Gauche hollandaise dégénérée. H est vrai que les erreurs de Kautsky ([7] [871]) et Lénine ont été exploitées par le stalinisme et le trotskysme contre le mouvement ouvrier ; néanmoins, c'est sur la base du combat mené par les Kautsky, Rosa Luxemburg et Lénine contre le révisionnisme, contre les économistes, que la fonction du parti politique de classe a pu être affirmée et précisée. Les débats de leur époque ont constitué un enrichissement indispensable pour le marxisme, pour le développement de la conscience de classe.
Or, pour ce qui est de la conscience de classe, après toute leur entreprise de démolition tout azimut, on se demande où nos vaillants écrivains en herbe vont la chercher, puisqu'il n'y a que le moment spontané qui compte à leurs yeux : le moment des grèves, l'instant des révolutions. Entre temps, le prolétariat a-t-il disparu ? En fait, leur vision est simple : la conscience de classe n'est que le simple reflet des luttes ouvrières, jamais un facteur dynamique. Tout travail d'élaboration théorique, de prise de position, est forcément élitiste, manipulateur, politicien, donc le fait de partis bourgeois. Il n'existe pas pour eux deux dimensions dans le même mouvement prolétarien, celle de ses organisations politiques et celle de l'ensemble de la classe qui réagissent dialectiquement l'une sur l'autre. Dans leur vision, quand la lutte cesse, la classe ouvrière disparaît ([8] [872]) pour renaître de ses cendres six mois ou dix ans plus tard, comme après un coma total, sans que le moindre travail de "taupe" n'ait pu s'effectuer au niveau de la conscience de classe, ni la moindre dynamique de réflexion et de recherche théorique! Tout cela rappelle bien plutôt l'esprit obtus et anti-scientifique des doctes partisans de la génération spontanée combattant Pasteur. De toute façon, l'idée du collectif Junius n'est autre que très scolastique : dépeindre une sorte de parti à travers les âges conçu par le sorcier Marx qui est accusé, une fois de créer le parti avant la révolution et une autre fois de se contredire en disant :
"(le Parti) naît spontanément de la société moderne" (1860).
Tellement obnubilé par l'immédiat et l'événementiel, notre collectif Junius confirme son inaptitude à comprendre le marxisme. Pour Marx, le parti est un produit naturel de la lutte de classe, nullement volontariste ni auto-proclamé ; il n'est pas ce corps statique et omnipotent qu'imaginent nos auteurs, sorte d'invention démoniaque de Marx et Lénine pour saboter la révolution à travers les siècles, c'est un élément dynamique et dialectique :
"…. L'histoire réelle et non fantaisiste nous montre que 1'existence du parti de la classe parcourt un mouvement cyclique de surgissement, de développement et de dépérissement, dépérissement qui se manifeste par sa dégénérescence interne, par son passage dans le camp de 1'ennemi ou encore par sa disparition pure et simple et qui laisse des intervalles plus ou moins longs jusqu'à ce que, de nouveau, se présentent les conditions nécessaires pour son resurgis sèment. S'il existe un lien évident de continuité. . . il n'existe par contre aucune stabilité, aucune fixité de cet organisme appelé parti"
("Sur le Parti et ses rapports avec la classe", Revue Internationale n°35).
Ajoutons que les partis dans le prolétariat sont encore plus indispensables a celui-ci que les partis bourgeois ne l'étaient à l'enfantement de la société bourgeoise ; la tâche est plus immense pour le prolétariat, l'élaboration théorique plus universelle, il doit abolir toutes les divisions de classe et toute société d'exploitation. Le problème de la conscience est donc considérable comparé à la phase du capitalisme progressiste qui, lui, s'est développé "dans la boue et le sang".
c) L'ouvriérisme conseilliste
A rebours dé l'histoire, il y a toute la gauche du capital pour tenter de faire croire que la conscience serait apportée de l'extérieur, mais il y a aussi cette catégorie de révolutionnaires pour qui "les conseils ouvriers" sont une incantation permanente comme pour d'autres la révélation, et dont la logique absurde conduit tout autant à la négation du prolétariat. A force de dire que les partis sont extérieurs au prolétariat, ils finissent toujours par estimer que c'est la lutte de classe qui est extérieure au prolétariat ! Heureusement que le collectif Junius prend la défense du prolétariat contre cet "illuminé" de Marx : "... Les conditions, la marche, les fins... tout est tracé, ce "reste du prolétariat" qui n'a pas ‘l'avantage d'une intelligence claire' n'a donc aucun apport théorique, du moins fondamental ! C'est en quelque sorte un aveugle qui doit se laisser guider par ceux, les communistes, qui possèdent le programme de A à Z." (p.21). Les grandes lignes du Manifeste de 1848 sont, somme toute, "élitistes", concluent nos pourfendeurs de parti. Déduisez : les combats, les sacrifices, les polémiques et les directives des partis prolétariens ont toujours eu pour but de nuire aux ouvriers, ainsi que nous l'explique notre collectif "défenseurs du prolétariat" contre l'odieux Marx :
"... (à propos de la non publication de rectifications au Programme de Gotha)... Même secondaires, ces raisons témoignent de la vision politicienne et donc bourgeoise qu'entretenait Engels sur le mouvement ouvrier : les travailleurs sont incapables d'avoir une conscience claire des choses, le parti peut donc les manipuler à son aise " (p.41). Ici l'outrance passe la mesure, l'invective anarchiste remplace l'argumentation. La démagogie d'épicier couvre à nouveau la négation idéaliste de l'étape réformiste, et surtout des programmes minimum et maximum. Cette défense échevelée de l'ouvrier moyen évoque plutôt ce patron qui s'exclame : "en parlant de grève et d'insurrection aux ouvriers vous leur portez préjudice". Rosa Luxemburg même est accusée de concevoir un parti de chefs avec son "credo" le programme communiste, auquel le collectif Junius (pseudonyme de Rosa pendant la guerre) renvoie son propre credo : "c'est la philosophie des lumières qui continue à faire ses ravages." (p.103)
Une chose est certaine pour le collectif Junius : la classe ouvrière est une classe homogène où ne comptent pas les années d'expérience, où l'ouvrier qui se met en grève pour la première fois de sa vie en sait tout à coup autant que celui qui s'est battu pendant vingt ans ; dix mille ouvriers en grève pendant une journée comptent plus pour ces gens-là du point de vue de l'expérience historique qu'une minorité révolutionnaire qui a combattu pendant quinze ans ! On prétend combattre le mouvement ouvrier "bourgeois" mais en réalité on rend service à la plus plate, à la plus crasse idéologie syndicaliste capitaliste - celle qui favorise par excellence la manipulation - : l'ouvriérisme, et on évacue d'un revers de manche l'existence d'un programme historique du prolétariat I
d) L'ignorance du phénomène de l'opportunisme
Ce qui est frappant, au total, dans cette brochure anti-parti, décousue et indigeste, c'est, non seulement la surdité face à l'évolution de la compréhension du rôle du parti (1848-1871-1905-1917 1921), mais - découlant fondamentalement du reste- l'aveuglement quant à la notion d'opportunisme. Sans traduire la moindre honte de compréhension, le terme est utilisé à plusieurs reprises. Sont évoquées les critiques de l'opportunisme par Pannekoek, Gorter, Rosa, Lénine. Il est même fourni une belle citation de Rosa :
".. il est impossible de se prémunir à l'avance contre la possibilité d'oscillations opportunistes" (p.94).
Se situant hors de la problématique du mouvement ouvrier, il est impossible au collectif Junius de saisir ce qu'il cite de valable. Par contre, il s'identifie très bien à la gauche germano-hollandaise dégénérée, à ce Pannekoek qui a inauguré la formule très moderniste de "nouveau mouvement ouvrier" vers la fin des années 30, et qui est cité avec plaisir :
"... un parti, quel qu'il soit, est petit à l'origine (quelle sagacité !) - mais parce que de nos jours un parti ne peut être qu'une organisation visant à diriger et à dominer le prolétariat"(page 124). CQFD ! Il n'est jamais possible dans ces conditions d'appréhender le phénomène de dégénérescence des partis du prolétariat passés à l'ennemi puisque tout s'explique par : la bourgeoisie, la séparation phase politique/but social, le siècle des lumières. Les apports du mouvement ouvrier sont traités par le collectif Junius comme les étudiants manient les pensées des philosophes : par l'interprétation systématique. La Gauche germano-hollandaise, à ses débuts, ne trouve pourtant pas grâce aux yeux de notre collectif : " « La conception de Gorter sur le parti considéré comme regroupement des 'purs' face à l'opportunisme était encore largement entachée d'une vision inspirée par le processus des révolutions bourgeoises (philosophie des lumières), cela peut expliquer son attitude de 'recherche de la discussion' avec Lénine et les bolcheviks" (p.117). En vérité, c'est le collectif Junius qui se veut "pur", idéalement pur, ou tout au moins en quête de pureté. Il n'est donc pas en mesure de saisir le complexe processus de dégagement de l'idéologie dominante par le prolétariat et ses organisations. Il est si épris de pureté qu'il confond la bourgeoisie avec ses victimes, puisqu'il ne voit pas qu'il s'agit d'un combat. Il est tel un magistrat au-dessus de la mêlée sociale.
L'opportunisme, de façon générale, est une manifestation de la pénétration de l'idéologie bourgeoise dans les organisations prolétariennes et la classe ouvrière ; il conduit au rejet des principes révolutionnaires et du cadre général de l'analyse marxiste. Il menace donc de façon permanente la classe et les organisations ou partis qui en font partie, au mieux il peut être corrigé de la part d'éléments sincères, au pire il entraîne des faiblesses ou des erreurs impardonnables. De ce point de vue, Marx, Lénine et bien d'autres ont commis plus d'une fois des erreurs opportunistes, mais ils n'étaient pas bourgeois pour autant ! Des concessions partielles ou secondaires suivant l'époque et l'expérience générale, ne remettent pas en cause la méthode commune et la fonction des partis pour lesquels ils ont tant combattu, car il n'y a pas eu répétition dans le mouvement révolutionnaire, on s'est efforcé d'affiner progressivement "l'évolution du concept de parti" (si nous reprenons la terminologie universitaire du collectif Junius).
Lorsqu'il s'en tient à rejeter systématiquement les apports successifs des différents partis du prolétariat, lorsqu'il évoque indistinctement la classe ouvrière, lorsqu'il rejette férocement la forme et la fonction du parti, le cahier signé collectif Junius est typiquement conseilliste. Mais l'incantation de "la classe elle-même" ou des "conseils ouvriers" comme panacée, est une forme moderne particulièrement pernicieuse de l'opportunisme, plus répandue que chez les simples lecteurs des publications Spartacus. C'est une idéologie qui, ainsi que le révèle sa forme théorisée par le collectif Junius, fait le plus de concessions auîT idées dominantes de la période de décadence du capitalisme contemporain. Nous l'affirmons fermement : le rejet de l'organisation en parti politique est dangereux. De la thèse "tous les partis sont bourgeois", à 1'anti-thèse "seuls les conseils ouvriers sont révolutionnaires", on aboutit au mépris de la lutte de classe et à la démoralisation, on laisse champ libre à la bourgeoisie. Mais plus fondamentalement, à force de nier deux programmes distincts, maximum et minimum, pour notre époque - ce qui est vrai - on aboutit à nier le programme maximum qui reste seul valable parce qu'on rejette tout rôle et toute fonction de parti révolutionnaire.
Dans l'avertissement au lecteur, la présentation de ce cahier Spartacus précisait qu'il s'agissait de la première partie d'un projet "inachevé", or il s'agit bien de quelque chose qui restera inachevé et insaisissable par définition, car issu d'un groupuscule... dissous dans l'incohérence petite-bourgeoise : le défunt PIC. La suite parle d'elle-même, elle n'existe pas. Le grand néant ! A force de vouloir faire table rase du passé, comme dit la chanson de Pottier si ingénument chantée par les fractions de gauche de la bourgeoisie, on fait table rase de l'avenir de la lutte de classe.
2- LES CHRYSANTHEMES DE LA PETITE-BOURGEOISIE
"Ces messieurs font tous du marxisme, mais de la sorte que vous avez connue en France il y a dix ans et dont Marx disait : 'Tout ce que je sais c'est que je ne suis pas marxiste, moi !' Et probablement il dirait de ces messieurs ce que Heine disait de ses imitateurs : j'ai semé des dragons et j'ai récolté des puces". Engels à Lafargue (27/8/1890)
Nous ne nous étendrons pas autant sur le second cahier Spartacus qui dans l'ensemble n'est pas pire que le précédent ; il précise un peu plus que chez les divers collaborateurs "amis de Spartacus", le plus court chemin pour nier la classe ouvrière est de commencer par nier l'apport du militant Marx. Ce cahier avait, lui, fait l'objet d'un appel d'offre publique, et nous leur avions répondu ceci :
"(cette) démarche... et (ce) projet s'inscrivent comme une suite de toute la campagne de singes savants des universités de la bourgeoisie se livrant, à 1'occasion du centenaire de la mort de Marx, à un dénigrement, à une défiguration systématique du marxisme, en identifiant celui-ci avec le régime stalinien des pays du bloc de l'Est. Merci pour votre invitation, "amis de Spartacus, mais très peu pour nous !... Vous, vous vous placez en juges du mouvement, nous, nous sommes des militants révolutionnaires du mouvement" (Révolution Internationale n°112, 1983). Nous ne nous étions pas trompés en répondant ainsi à cette énième cérémonie funèbre du marxisme. L'introduction de l'hommage rendu soi-disant à Marx par les "amis de Spartacus" est claire et résume bien l'éclectisme des textes présentés : "... Les différentes contributions réunies dans ce cahier sont sur ce point convergentes. Quel que soit l'angle d'attaque [sic !] choisi par les auteurs, tous en sont convaincus : les limites de 1'oeuvre de Marx sont aussi bien les limites de son époque que les limites de sa relation à son époque" (p.9).
Ce bouquet de fleurs fanées résume bien à lui tout seul 120 pages de rejet de l'apport - pourtant toujours actuel - de Marx, et sa réduction à une "oeuvre" d'écrivain. Signalons évidemment toute une série de dénigrements de la même teneur et même repris du cahier précédent : trait d'égalité entre jacobinisme et marxisme (1'"apport" de Korsch est ouvertement revendiqué), trait d'égalité entre Octobre 1917 et le stalinisme, et obsessionnellement "Marx copieur de 1789" ou du "siècle des lumières". Marx est aussi considéré comme marqué par une vision "ontologique" et de s'être inspiré de 1'"hypertrophie du politique de Hegel" (rien que ça !).
Tous ces gens-là défilent devant la tombe de Marx l'air si contrit, qu'on ne peut que se les représenter autrement que comme une procession de vieilles bigottes du vieux monde. Choisissons, par exemple, un nommé Janover qui, après avoir évoqué lui aussi l'influence délétère de 1789, tient à montrer combien il est ignare quant à comprendre toute notion d'opportunisme :
"Le marxisme politique est donc tout à la fois le produit de ce détournement (?) et le résultat d'un accommodement. Sa structure était à l'image de 1'organisation social-démocrate, partie prolétarienne, partie bourgeoise, mais la tendance bourgeoise dominante passera vite au premier plan, avant même que le marxisme-léninisme ne propose ses recettes d'accumulation 'socialiste' aux élites des pays encore au stade pré-capitaliste". Plus actuel, un nommé St James n'en finit pas de tracer des hypothèses et de s'essayer à être plus flou que les autres :
"... Bien entendu, on ne peut pas non plus éliminer 1'hypothèse que la situation actuelle évolue vers une crise franche et ouverte. . . On ne peut m d'ailleurs pas plus éliminer le retour à une nouvelle prospérité. Bien sûr, certains pourront objecter d'abord que nous ne déduisons aucune conclusion certaine de cette analyse. Il est clair qu'une théorie que l'on peut éventuellement plier , à rendre compte de phénomènes opposés ne peut guère être considérée comme scientifique". Et ces gens-là osent se réclamer des enseignements de Marx ! En vérité, ils ont tous un pape, l'intellectuel conseilliste notoire Rubel qui, plus que Marx, est l'inspirateur de toutes leurs stupidités.
A peu près tous rejettent, comme Rubel, le Marx militant, ils le placent à leur niveau de puces intellectuelles. Ils croient comme Rubel que Marx s'est trop contenté d'incertitudes dans son travail scientifique (bien qu'ils abhorrent la méthode scientifique) mais, hélas, sans jamais renier "le combat politique quasi quotidien dans le cadre d'une organisation ou en militant isolé" (Rubel dixit). Deux fois hélas, c'est pourquoi Rubel - incapable comme tous les petits-bourgeois de connaître la passion révolutionnaire de la lutte -s'est spécialisé dans la recherche dans les écrits intimes et les poubelles de Marx de tout ce qui peut corroborer ses propres doutes :
" Même s'il s'est refusé à livrer à la postérité des confessions de caractère introspectif. Mieux que de telles confidences, la masse des inédits, des écrits inachevés et des cahiers d'études témoigne des hésitations et des doutes qu'il devait éprouver en se sachant désarmé devant les triomphes répétés de la contre-révolution.". En fait, puisque le militant Marx dérange, on va lui imaginer ses propres doutes de petit-bourgeois, on va rayer d'un trait de plume son implication dans le mouvement collectif du prolétariat pour n'en extraire que "la poésie" (Rubel). Rubel qui prête ses propres doutes en vain à Marx, affirme pourtant ses certitudes : ". Nous sommes obligés de reconnaître que si le capital est partout, c'est parce que le prolétariat n'est rien et nulle part" (p.43). Ce philistin nous confirma par là que le conseillisme n'est pas seulement un danger opportuniste pour le prolétariat mais que son aboutissement réside dans la négation de la classe ouvrière : le modernisme. Dans sa conclusion, Rubel, après avoir abandonné le prolétariat, rejoint les grands impuissants de l'histoire, les philosophes : "..Nous, les vivants, nous pouvons et devons agir dès maintenant pour mettre en oeuvre un projet de modification visant les forces aliénantes, produit du génie inventif de 1'homme tout autant que ses inventions créatrices".
Les autres philistins n'ont qu'à marquer le pas derrière le grand maître à penser es conseillisme devenu es modernisme. Le représentant du cercle moderniste "Guerre Sociale" peut se lamenter comme le collectif Junius :
"L'oeuvre de Marx exprime les circonstances historiques dans lesquelles elle s'est créée, prolonge les tendances bourgeoises dont elle est issue et qu'elle cherchait à dépasser" (p.90). Un enterrement est toujours une circonstance pénible quand on pense aux "vivants" ; aussi l'anarchiste Pengam chuchote-t-il en inclinant la tête : "... la classe ouvrière vise, par l'intermédiaire des 'partis ouvriers' à se faire reconnaître dans l'Etat en fonction de la place qu'elle occupe dans les rapports de production" (p.103). Enfin, même un vieux routier du milieu révolutionnaire comme Sabatier a mis le crêpe noir, et vient donner le coup de goupillon anti-bolchevik de rigueur pour la cérémonie des "amis de Spartacus": ".., La contre-révolution et ses idéologies mystificatrices triomphèrent en prenant appui sur les médiations introduites par Marx et en noyant toute méthode critique sous les flots d'un langage de bois" (p.83).
Les intellectuels petits-bourgeois finissent toujours par se retrouver en abandonnant le terrain de la défense des principes de classe - d'accord avec la bourgeoisie qui s'est efforcée, elle, consciemment, pendant cinquante ans, de déformer les véritables raisons de la dégénérescence d'Octobre 1917 et de l'échec de la vague révolutionnaire des années 20. C'est contre les arguments de ces philistins que le prolétariat doit lutter dès aujourd'hui s'il' ne veut pas compromettre son combat pour la destruction de l'ordre capitaliste établi.
Gieller.
[1] [873]Le groupe "Pour une Intervention Communiste" (Jeune Taupe) s'est constitué en 1974 autour d'éléments ayant quitté "Révolution Internationale" parce qu'ils estimaient que ce groupe n ' intervenait pas assez ; ce groupe s'est brisé il y a quelques années contre les écueils de 1'activisme, du conseillisme et du modernisme ; son héritier "Révolution Sociale" n'a tiré pratiquement aucune leçon de cette trajectoire désastreuse (cf. sa brochure intitulée pompeusement "Bilan et Perspectives").
[2] [874] Affirmation inconséquente puisque, juste à la page précédente, les auteurs ont repris la célèbre phrase du pamphlet contre Proudhon : "Ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement politique, Il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps." Ajoutons ce que Marx affirmai) déjà en 1844 : "Toute révolution dissout 1 'ancienne société ; en ce sens elle est sociale. Toute révolution renverse l'ancien pouvoir ; en ce sens elle est politique" (Gloses critiques, in La Pléiade, annoté par Rubel).
[3] [875] Remarque qu'on retrouve dans maints autres textes depuis le Manifeste. Mais Lénine souligne justement en quoi c'est une question de méthode : "...A quel point Marx s'en tient strictement aux données de l'expérience historique, on le voit par le fait qu'en 1852, il ne pose pas encore la question concrète de savoir par quoi remplacer cette machine d'Etat qui doit être détruite. L'expérience n'avait pas encore fourni à l'époque, les matériaux nécessaires pour répondre à cette question, que l'histoire mettra à l'ordre du jour plus tard, en 1871." (L'Etat et la Révolution).
[4] [876] Karl Korsch, ancien membre du parti communiste allemand (KPD) dont il est exclu en-1926 ; abandonnant la méthode marxiste, il a théorisé l'idée que le jacobinisme était la source fondamentale de Marx certaines de ces idées ont été reprises par Mattick aux USA. Son principal traducteur en France a été le conseilliste Bricianer.
[5] [877] Voir notre article pour le centenaire de la mort de Marx, Revue Internationale n°33 : "Marx toujours actuel".
[6] [878] "Bataille critique contre la révolution français, Marx (La Pléiade, p.557).
[7] [879] Nous parlons ici évidemment du Kautsky d'avant 1910, celui qui, avant de devenir un centriste puis un renégat, était un authentique militant révolutionnaire, le chef de file avec Rosa Luxemburg de l'aile gauche de la Social-Démocratie dans sa lutte contre 1'opportunisme.
[8] [880]Signalons la vision symétriquement inverse de certains bordiguistes, mais finalement identique selon lesquels lorsque le parti disparaît la classe ouvrière n'existe plus !
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Débat interne : le CCI et la politique du "moindre mal"
- 2851 reads
Dans le n°40 de cette Revue, nous avons publié un article, "Le danger du conseillisme", qui défend la position du CCI, fruit d'un débat interne ouvert depuis plus d'un an. Dans ce débat, d'une part le CCI a réaffirmé que les perspectives de la lutte du prolétariat exigent un ferme rejet des conceptions erronées du "substitutionnisme" (conception que le parti est l'unique porteur de la conscience, menant à la conception de la dictature du parti) et du "conseillisme" (conception de la conscience vue comme simple reflet des luttes immédiates, menant à la minimisation de la fonction et à la négation de la nécessité du parti). D'autre part, le CCI a été amené à repréciser pourquoi, dans les conditions de notre époque, les faiblesses et les erreurs de type "conseilliste" constituent un obstacle plu important du "plus grand danger", que les erreurs et conceptions "substitutionnistes". Le CCI n'a pas hésité à systématiser et préciser ses positions sur la conscience, le centrisme, le conseillisme, l'intervention, etc., en les libérant de toutes les imprécisions, et interprétations confuses. Mais là où le CCI voit dans cette orientation ses positions placées sur un terrain plus profondément rattaché aux bases du marxisme et, en même temps, plus capables de faire face aux questions posées par 1'accélération de 1'histoire, 1'article que nous publions ci-dessous voit une "nouvelle orientation", une adoption d'une théorie du "moindre mal". Il exprime la position de camarades minoritaires qui se sont constitués en tendance au sein du CCI. Nous ne pouvons que regretter que l'article aborde beaucoup de questions, sans souci, selon nous, de répondre à 1'argumentation de 1'article critiqué. De notre point de vue, il exprime une tendance centriste par rapport au conseillisme car, tout en réaffirmant platoniquement le danger du "conseillisme" il s'attache surtout à en atténue la portée, et offre, en fin de compte, comme "perspective" que .toute erreur est dangereuse pour le prolétariat. Nous répondrons aux différents points abordés dans cet article dans le prochain n°.
CCI
Dans la Revue Internationale (R.Int,) No 40 se trouve un article intitulé "Le danger du conseillisme" qui défend la nouvelle orientation du CCI selon laquelle le conseillisme représente aujourd'hui et représentera demain le plus grand danger pour la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires, un danger plus grand que celui du substitutionnisme. Nous voulons par le présent article porter vers l'extérieur la position d'une minorité de camarades au sein du CCI qui n'est pas d'accord avec cette nouvelle orientation.
Il ne s'agit pas de nier le danger des positions conseillistes ou de penser que cette déviation n'a pas eu de poids dans le passé ou n'en aura pas dans l'avenir. Le conseillisme, c'est-à-dire le rejet de la nécessité de l'organisation des révolutionnaires et du parti et de son rôle militant; actif et décisif dans la prise de conscience de la classe ouvrière, représente comme nous l'avons toujours analysé dans le CCI, un danger, surtout pour le milieu révolutionnaire y compris le CCI dans la mesure où sa théorisation a pour conséquence de couper la classe de son outil indispensable .
La divergence ne porte pas sur le danger du conseillisme mais :
a) sur la nouvelle théorie unilatérale du conseillisme le plus grand danger :
- parce qu'elle s'accompagne d'un rabaissement du substitutionnisme au niveau du "moins grand danger" ;
- parce qu'elle détourne l'attention du véritable danger essentiel pour le prolétariat que présente l'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière (les partis de gauche, les gauchistes, le syndicalisme de base et tout le mécanisme de la récupération capitaliste à l'époque du capitalisme d'Etat) pour se focaliser sur de prétendues tares conseillistes du "prolétariat des pays avancés" ;
- parce qu'elle mène à des régressions sur les leçons tirées de la première vague révolutionnaire et du mouvement ouvrier dans la décadence,
b) sur les implications de cette théorie au niveau de la compréhension du développement de la conscience de classe, tendant à réduire la conscience de classe à "théorie et programme" (R.Int. No 40) et le rôle de la classe à l'assimilation du programme.
c) sur la théorie du "centrisme/opportunisme" qui, en considérant la "vacillation" et "l'hésitation" comme le mal permanent du mouvement ouvrier, aboutit à remettre dans le prolétariat des éléments et partis politiques qui l'ont définitivement trahi.
Nous allons aborder ici surtout le premier point : la théorie du conseillisme le plus grand danger. La discussion continuera sur le centrisme et la conscience de classe dans d'autres articles à paraître bientôt dans notre presse.
LE CONSEILLISME, LE PLUS GRAND DANGER ?
L'article de la R.Int.40 développe l'argumentation suivante : le danger du substitutionnisme existe surtout dans les périodes de reflux des luttes révolutionnaires; par contre, "le conseillisme est un danger bien plus redoutable surtout dans la période de montée d'une vague révolutionnaire" ; le substitutionnisme trouverait un terrain fertile dans les pays sous-développés ; les réactions du type conseilliste sont plus caractéristiques des classes ouvrières des pays hautement industrialisés comme les ouvriers d'Allemagne dans la première vague révolutionnaire ; le substitutionnisme est une "erreur" prolétarienne, un "phénomène unique...de l'isolement géographique de la révolution dans un seul pays, facteur objectif du substitionnisme qui n'est plus passible". (R.Int, No 40)
En quoi consisteraient ces "réflexes conseillistes" de la montée de la lutte de classe, comment on les reconnaît ? Selon l'article, ils sont l'ouvriérisme, le localisme, le suivisme, le modernisme, l'apolitisme des ouvriers, la petite-bourgeoisie, 1'immédiatisme, l'activisme et l'indécision. En somme, tous les maux de la terre ! Si chaque fois que la classe hésite, ou que des révolutionnaires tombant dans 1'immédiatisme, si chaque fois qu'on discerne du suivisme ou que les révolutionnaires ne comprennent pas le processus de la formation du parti, c'est une manifestation du "conseillisme", le conseillisme serait à lui tout seul le mal permanent du mouvement ouvrier.
Puisque toutes les faiblesses subjectives de la classe ouvrière deviennent par ce jeu de définitions "des réflexes conseillistes'' le remède est le parti. En d'autres termes, le CCI, le milieu politique prolétarien et la classe ouvrière toute entière se protégeront contre 1'immédiatisme, la petite-bourgeoisie, l'hésitation, etc. en reconnaissant dès à présent le danger No 1 de "sous-estimer", "minimiser" le parti.
Toute la problématique de choisir entre "sous" et "sur"-estimer le parti, toute la politique du moindre mal que le CCI a toujours rejetée au niveau théorique, il l'introduit aujourd'hui au niveau pratique sous couvert de vouloir donner une perspective "concrète" à la classe : il faut dire au prolétariat que le danger conseilliste est plus grand que celui du substitutionnisme, sinon le prolétariat n'aurait pas une "perspective" !
Choisissez, camarades ! Si vous pensez que le substitutionnisme est le plus grand danger, vous êtes vous-mêmes des conseillistes. Si vous refusez de choisir votre camp, vous êtes porteurs des "oscillations centristes par rapport au conseillisme", des"conseillistes qui n'osent pas dire leur nom" (R.Int. No 40).
On prétend que "l'histoire a prouvé" cette théorie du conseillisme le plus grand danger, mais quelle histoire ? Le CCI a toujours reconnu et critiqué dans la révolution allemande les erreurs de Luxembourg et les Spartakistes, les positions de la tendance d'Essen, de la tendance anti-parti de Ruhle expulsée du KAPD en 1920 et la scission de l'AAUD(E), les conséquences désastreuses des hésitations du prolétariat et le manque de confiance parmi les révolutionnaires dans leur rôle. Mais on n'a jamais cherché les causes dans un conseillisme latent du prolétariat des pays avancés. Nous n'avons jamais cité "l'histoire" pour démontrer une théorie cyclique du danger conseilliste plus grand dans la révolution et du substitutionnisme dans le recul.
Outre de simples affirmations, la seule "preuve" donnée dans l'article de la R.Int. pour justifier cette nouvelle théorie, c'est que "comme Luxembourg en 1918, les militants non-ouvriers du parti pourront être exclus de toute prise de parole dans les conseils". (R.Int, No 40) Et aussi dans World Révolution (publication du CCI en Grande-Bretagne); "Le danger devant la classe n'est pas qu'elle fera "trop confiance" aux minorités révolutionnaires mais qu'elle les empêchera tout simplement de parler". Voilà le "conseillisme" du prolétariat allemand contre Luxembourg !
Tout ceci est une déformation grossière de l'histoire. En décembre 1918, au congrès national des conseils ouvriers en Allemagne, l'ensemble de la Ligue Spartacus n'a pas pu défendre ses positions non pas parce que "les ouvriers" l'en ont empêchée mais parce que Spartacus n'était qu'une fraction au sein de l'USPD. "Pour comprendre le destin de ce congrès, il faut d'abord comprendre le rapport entre la Ligue Spartacus et les Indépendants. Vous savez que nous étions là mais qu'est-ce qui s'est passé, où étions-nous passés effectivement ? Si vous avez écouté les discours, vous serez en droit de vous demander quelles étaient les différences fondamentales entre le groupe Spartacus et les Indépendants ?...Nous étions pieds et poings liés par les Indépendants qui ont contrôlé la liste des inscrits et paralysé notre activité à chaque moment." (Leviné ,"Rapport sur le Premier Congrès des Conseils ouvriers").
Les positions révolutionnaires de Spartacus (à savoir que les conseils se déclarent l'organe suprême du pays, qu'ils lancent un appel au prolétariat international, qu'ils soutiennent les soviets en Russie et que Luxembourg et Liebkneeht viennent parler) ont été présentées et défendues par l'USPD qui, lui, voulait dissoudre les conseils dans la Constituante ! Spartacus (comme la majorité de l'Internationale Communiste plus tard) voulait "influencer les masses" en récupérant l'USPD "en voyant ce dernier comme l'aile droite du mouvement ouvrier et non comme une fraction de la bourgeoisie."(R.Int. No 2). Mais le CCI aujourd’hui, selon sa théorie du "centrisme", voit l'USPD, ce parti de Kautsky, Bernstein, Haase et Hilferding comme prolétarien au lieu de le comprendre, avec 70 ans de recul, pour ce qu'il était : l'expression de la radicalisation de l'appareil politique de la bourgeoisie, une première expression du phénomène du gauchisme, cette barrière extrême de l'Etat capitaliste contre la montée révolutionnaire. Déjà à l'époque, c'était Spartacus qui s'était fait récupérer sur ce terrain parce qu'en reproduisant le schéma du passé social démocrate avec sa droite, centre, gauche, il voyait son rôle comme celui d'une opposition révolutionnaire au sein de l'"aile gauche" de la social-démocratie. Refuser de tirer cette leçon du passé, c'est la porte ouverte aux compromissions de demain.
Tout ceci n'a rien à voir avec ce mythe selon lequel les ouvriers auraient refusé d'écouter les révolutionnaires à cause de "réflexes conseillistes".
Les erreurs des révolutionnaires dans la montée de la lutte de classe en Allemagne ne s'expliquent pas par la "sous-estimation du rôle du parti". Les révolutionnaires allemands n'étaient pas trop peu "actifs", ou trop peu présents dans la lutte. La volonté d'assumer leur rôle au sein de la classe était réelle mais ce qui a pesé de façon dramatique c'était de savoir quoi faire, comment le faire et avec qui, c'est-à-dire, de comprendre ce que la nouvelle période impliquait pour le programme communiste.
Le retard des révolutionnaires allemands n'est pas attribuable à un conseillisme du prolétariat allemand ou de son avant-garde même si ces tendances ont effectivement existé, mais essentiellement à la difficulté générale dans tous les pays de se dégager de la social-démocratie, de la conception du parti de masse et du substitutionnisme à cette époque charnière. Au moment de la révolution, la conception prédominant parmi les révolutionnaires et dans l'ensemble du prolétariat en Allemagne n'était pas que les conseils ouvriers allaient tout résoudre par eux-mêmes mais qu'un parti devrait assurer le pouvoir délégué par les conseils. Dans les faits, les conseils ont été amenés à remettre leur pouvoir à la social-démocratie.
Comment nier cette évidence ?
Pour les défenseurs du substitutionnisme c'est facile : quand la classe ouvrière remet son pouvoir à la social-démocratie elle a tort ; quand elle le remet aux Bolcheviks, elle a raison. Le tout est que la classe "fasse confiance" au "bon" parti. Le CCI n'en est pas là. Mais pour lui, maintenant, remettre le pouvoir à la social-démocratie ne montre pas le poids des conceptions substitutionnistes dans la montée de la lutte de classe. Comme dit l'article, c'était simplement de la "naïveté" des ouvriers. Toujours selon l'article, le substitutionnisme ne peut pas s'appliquer aux gauchistes et ceux de la bourgeoisie "qui veulent dévier la lutte". La définition du substitutionnisme serait réservée à ceux qui ne veulent pas dévier la lutte mais se trompent. Ah voila... ainsi, le substitutionnisme est une "erreur" si on a de bonnes intentions ; si on ne les a pas, c'est une position bourgeoise et on ne l'appelle plus substitutionnisme !
LA MINIMISATION DU SUBSTITUTIONNISME
En réalité, contrairement à la position sur les syndicats et 1'électoralisme dans la période ascendante, le substitutionnisme a toujours été une position bourgeoise, appliquant le modèle de la révolution bourgeoise à celle du prolétariat. Puisque la révolution prolétarienne n'était pas encore à l'ordre du jour, les révolutionnaires ne se sont pas rendus compte de toutes les implications de cette position. Au fur et à mesure que la révolution prolétarienne venait à l'ordre du jour, ils ont commencé à sentir la nécessité d'une clarification du programme sans avoir le temps d'aller jusqu'au bout. La première vague révolutionnaire révélera au grand jour la position subs-titutionniste sur le parti et tout ce qu'elle implique sur le rapport parti/classe pour ce qu'elle est : une position bourgeoise, quelles que soient les bonnes intentions subjectives de ceux qui la défendent.
Mais pour la théorie du conseillisme le plus grand danger dans la montée, le substitutionnisme n'est un danger que quand le recul de la lutte donne des forces à la contre-révolution. En d'autres termes, la contre-révolution est le plus danger quand on y est en plein dedans. Voir ses germes, aller à la racine des choses n'est pas nécessaire. Parons au plus pressé i D'abord, contrer le "conseillisme" ; après, on verra bien ce que le prolétariat vô> faire des partis.
Ainsi, la définition de substitutionnisme est encore rétrécie. En parlant de la révolution russe^ T'article de la Revue Internationale n°40 maintient explicitement qu'avant 1920, le substitutionnisme ne pèse pas dans la dégénérescence de la révolution russe.
"C'est seulement dans l'isolement et la dégénérescence de la révolution que le substitutionnisme bolchevik devient un facteur actif dans la défaite de la classe" (World Révolution, décembre 1984). "De la prétention à diriger de façon militaire la classe (cf. la discipline confinant "à la discipline militaire" affichée au 2ème Congrès) il n'y avait qu'un pas à la conception d'une dictature d'un parti unique vidant les conseils ouvriers de leur propre substance" (Revue Internationale n°40)
Mais les conseils ouvriers en Russie ne commencent pas à se vider de vie prolétarienne en 1920 ; c'est en 1920 le moment des derniers soubresauts de la classe contre un étouffement qui a ses racines dès le lendemain de la prise du pouvoir par les conseils. Cela a toujours été la position du CCI :
"Dès après la prise du pouvoir, le parti bolchevik rentre en conflit avec les organes unitaires de la classe et se présente comme un parti du gouvernement" (cf. brochure "Organisation Communiste et conscience de classe) et nous 1'avons démontré dans maints articles depuis le début du CCI tout en affirmant le caractère prolétarien de la révolution russe.
Dire que les conceptions des bolcheviks étaient La cause de la dégénérescence est absolument faux, mais affirmer, comme fait apparemment le CCI aujourd'hui, que les positions des bolcheviks ne jouaient pas un rôle de facteur actif (aussi bien quand ils se sont trompés que quand ils ont en raison) est impossible pour des marxistes conséquents.
En réduisant le substitutionnisme, expression idéologique de la division du travail dans les sociétés de classes, à une quantité négligeable, la nouvelle théorie arrive à une minimisation du danger de l'Etat capitaliste, son appareil politique et le mécanisme de son fonctionnement idéologique.
Il ne faut pas prendre l'exemple de 1905, ou même de 1917 en Russie pour voir comment la bourgeoisie des pays avancés se protégera contre la montée révolutionnaire. La bourgeoisie allemande, plus avertie après la révolution russe; avec un arsenal politique plus sophistiqué, a su pénétrer directement les conseils non seulement à travers les industriels qui "négociaient" avec les conseils mais surtout à travers la social-démocratie qui les sabotait de l'intérieur. La social-démocratie (et les Indépendants^ loin d'"interdire les partis", les acceptait tous et exigeait la représentation proportionnelle des partis au gouvernement ; elle allait jusqu'à demander à Spartacus de se joindre au gouvernement SPD/USPD. Pour récupérer le mouvement, le SPD joue sur tous les tableaux (n'en déplaise aux "définitions" insaisissables de la nouvelle théorie) : dans certaines régions, seuls les ouvriers peuvent voter ; dans d'autres, c'est la "population" ; dans d'autres, seuls les ouvriers syndiqués, ou plutôt les petites usines ; pour ou contre la représentation des soldats. Et le tout, la reconnaissance des conseils, l'ouvriérisme, le démocratisme, la phraséologie de la révolution russe, pour mieux détourner le prolétariat de l'assaut contre l'Etat tout en organisant les provocations et le massacre. Les Spartakistes faisaient eux-mêmes récupérer pour ne pas avoir compris la radicalisation de la bourgeoisie. Aucune voix, pas même celle de la gauche plus claire que les Spartakistes, ne s'est élevée au début pour dénoncer cette vision bourgeoise du rapport parti/conseils.
La bourgeoisie, demain, jouera sur tous les tableaux. Croyons-nous sérieusement que la bourgeoisie n'arrivera pas à pénétrer les conseils ? Ou qu'elle va compter sur les prétendus "réflexes conseillistes" des ouvriers pour défendre son système ? Ou sur des "organisations conseillistes", des "individus petits-bourgeois", comme dit la Revue internationale ? Soi disant les conseils, dans un soubresaut "anti-partidaire", vont interdire tous les partis et la bourgeoisie dirait : "ah bon, au moins, il n'y aura pas le parti prolétarien" ? Du bout des lèvres, la Revue Internationale n°40 semble admettre la présence des "syndicalistes de base" dans des conseils, mais comment? Comme individus ? La bourgeoisie va compter sur de vagues individus ? Et d'ailleurs, qui est derrière les syndicalistes de base sinon les gauchistes, staliniens et d'autres expressions politiques organisées ? La lutte ne se fera pas fondamentalement autour de savoir si nous sommes un parti ou non mais autour du programme et la nécessité de l'assaut révolutionnaire.
Cette théorie détourne l'attention du véritable danger essentiel pour la classe ouvrière - l'Etat capitaliste et ses prolongements
au sein de la classe ouvrière - et ne fait qu'émousser dans la confusion notre critique du substitutionnisme présenté comme le "moindre mal".
AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Un ne peut pas oeuvrer vers la dictature du prolétariat, accélérer le développement de la prise de conscience au sein du prolétariat, en présentant le substitutionnisme et 1'anti-partitisme comme des notions en soi dont on doit comprendre l'une mais où il ne serait pas grave que l'on ne comprenne pas l'autre. La seule façon de contribuer est en comprenant que la véritable critique de ces deux notions ne peut se faire que par une critique de leur fondement commun et par la compréhension du véritable rapport parti/conseils dans l'assaut contre l'Etat.. .
De plus, ce n'est pas comme si la classe n'avait jamais trouvé la voie vers le dépassement de la contradiction substitutionnisme/anti-partitisme. Même au cours de la première vague révolutionnaire, le prolétariat a su donner naissance à des positions politiques du KAPD qui, tout en rejetant le substitutionnisme, réaffirme la nécessité d'un parti avec une esquisse de son véritable rôle. Même à bout de forces, le prolétariat de ce temps-là a laissé un héritage de la résolution de ce problème et, étant le point le plus haut de la dernière vague, sera une base pour la renaissance du mouvement ouvrier de demain.
Une des grandes faiblesses des révolutionnaires a toujours été de vouloir expliquer le développement lent, heurté, difficile de la conscience de classe au travers de toute l'histoire du mouvement ouvrier, par des tares dans le prolétariat lui-même (son "trade-unionisme", son "anarchisme", son "conseillisme", son "intéqration au capitalisme", etc.) .Cette nouvelle théorie ne fait que traduire un découragement face aux difficultés qu'a la classe à entrer dans une lutte générale, à affirmer ses propres perspectives de société et d'organisation. Cette difficulté générale ne disparaîtra qu'au cours du développement des luttes, avec l'expérience acquise au cours de ces luttes, qui lui permettra de redécouvrir toutes ses potentialités historiques. Et ces potentialités, ce n'est pas seulement le parti, mais aussi les conseils et le communisme lui-même. Aller chercher le danger de conseillisme dans la difficulté de la classe à s'affirmer en tant que telle, c'est créer une mystification.
La classe ouvrière n'est pas plus fondamentalement minée par le conseillisme que par le léninisme ou le bordiguisme mais doit péniblement se débarrasser de tout le poids de la contre-révolution.
La preuve que la contre-révolution est en train de se désagréger des deux côtés, c'est la décantation de ces derniers 15 ans dans le milieu politique du prolétariat. Les idées bourgeoises sur le substitutionnisme et 1'"anti-partitisme" trouvent leurs principaux défenseurs dans les rangs de l'appareil politique de la classe ennemie (le gauchisme, les libertaires etc..) mais à cause de la confusion de la contre-révolution, des courants prolétariens sclérosés ont continué à défendre ces positions sous différentes formes. C'est justement la réapparition des luttes prolétariennes qui donne la possibilité de balayer ces positions vestiges du passé, soit par la clarification de ces groupes, soit par la disparition des groupes sclérosés. Ce n'est pas encore une situation révolutionnaire où des organisations défendant des positions bourgeoises passent directement dans le camp ennemi mais la pression de l'accélération de l'histoire, à défaut de la clarification (cf. les conférences internationales) produit (comme le processus de perte des illusions dans la classe) une décantation dans son milieu politique.
Après 15 ans de décantation, aussi bien la tradition de la Gauche hollandaise que celle de la Gauche italienne est tombée dans une décomposition politique et organisationnelle : les conseillistes et le PCI (Programme Communiste). La période de la contre-révolution a vu le développement du conseillisme et du bordiguisme mais le nouveau cours historique de nos jours voit l'inadéquation et la dégénérescence des deux pôles.
Sur la question clef de notre époque, le chemin de la politisation des luttes ouvrières, les deux pôles du passé montrent leur inadéquation historique par une sous-estimation, une incompréhension de la reprise actuelle et tout ce qu'elle contient dans son devenir. Ni le conseillisme, ni le bordiguisme ne peuvent comprendre par quel chemin viendra la révolution de demain, ne peuvent comprendre le cours historique.
Le refus de la discussion de Programme Communiste, le sectarisme et le sabotage des conférences internationales par "Battaglia Comunista" et le CWO ont, autant que la stérilisation des énergies révolutionnaires par le conseillisme, empêché le processus de clarification et de regroupement des révolutionnaires.
L'article de la Revue Internationale n°40 ne donne aucune explication de cette décantation historique dans le milieu prolétarien parce que la nouvelle théorie du "conseillisme, le plus grand danger" ne peut pas l'expliquer.
Où est le conseillisme, le plus grand danger, dans le milieu prolétarien aujourd'hui? Le CCI semble vouloir polémiquer avec des fantômes. Dans la Revue Internationale n°40, c'est "Battaglia" et le CWO qui sont des "conseillistes" parce que leurs groupes d'usines seraient un exemple des erreurs du KAPD sur les "unions". Ainsi, la bonne vieille idée des "courroies de transmission" et des "gruppi sindicali" est devenue aussi la- preuve du "conseillisme" ?
L'article de la Revue Internationale, en cherchant désespérément le "plus grand danger" aujourd'hui, se fixe sur l'idéologie petite-bourgeoise individualiste qui représenterait un danger mortel dans les conseils alors que déjà aujourd'hui, la situation démontre qu'il n'y a plus de possibilité de s'en sortir individuellement, que le temps de la "démerde" est dépassé avec 63 il y a longtemps, qu'il n'y a plus que la lutte collective qui puisse faire face, on ne peut pas sérieusement maintenir que "le plus grand danger" sera "l'individualisme petit-bourgeois" dans la révolution.
L'évolution future du milieu politique ne sera pas la répétition de mai 68. Croire que le poids de la petite-bourgeoisie ne se traduit que par la défense des idées "conseillistes" est un leurre.
Le milieu politique prolétarien de demain se formera sur les leçons de la décantation de ces 15 dernières années. Le conseillisme ne sera pas plus le plus grand danger de demain qu'il ne l'était par le passé.
LES ORIGINES DU DEBAT
Quand une organisation introduit le raisonnement du moindre mal, elle ne dit jamais explicitement qu'il faut tordre les principes. C'est plutôt une logique d'engrenage.
Ainsi, comme dit l'article de la Revue Internationale n°40, une confusion a surgi dans l'organisation à propos de la "maturation souterraine de la conscience de classe" : d'une part, un rejet de la possibilité de développement de la conscience de classe en dehors des luttes ouvertes (et l'idée que la conscience de classe n'est qu'un reflet de la réalité sans la reconnaître comme un facteur actif) et d'autre part, une théorisation selon laquelle les difficultés qu'éprouve le prolétariat à dépasser l'encadrement syndical nécessiteront un saut qualitatif dans la conscience qui s'effectuera à travers une pure "maturation souterraine" pendant un "long recul" après la défaite en Pologne. Outre cette idée d'un long recul qui a été vite démentie par le ressurgissement de la lutte de classe, ce débat a posé (sans la résoudre entièrement) la difficulté de comprendre concrètement - et pas seulement en théorie - le chemin de la politisation des luttes ouvrières à partir des résistances à une crise économique et le cadre général que donne la décadence pour la maturation des conditions subjectives de la révolution.
L'existence d'une maturation souterraine de la conscience de classe, le développement d'une conscience révolutionnaire latente dans la classe ouvrière à travers toute son expérience face à la crise et par l'intervention des minorités communistes en son sein, est un élément fondamental de toute la conception du CCI, la négation à la fois du conseillisme et du bordiguisme. Il était donc nécessaire de réagir contre ces confusions et de clarifier en profondeur. Bien que la maturation souterraine soit rejetée à la fois explicitement par "BattagliaVCWO par exemple (cf. Revolutionary Perspectives n°21), ce rejet étant parfaitement conséquent avec la théorie "léniniste" de la conscience "trade-unioniste" de la classe (que Lénine a défendu à diverses reprises mais pas toujours); à la fois par les théorisations du conseillisme dégénère (mais pas par toute la Gauche hollandaise du temps des communistes des conseils avant la 2ème guerre), l'organisation a décidé que le rejet de la maturation souterraine était en lui-même uniquement le fruit du conseillisme latent en nos rangs. L'apparition dans les débats à un moment donné d'une vision non-marxiste qui a réduit la conscience à un simple épiphénomène, bien que cette vision nie aussi bien le rôle de la conscience révolutionnaire hétérogène mais inhérente à la classe dans son ensemble que le rôle actif des minorités révolutionnaires, a été interprétée aussi unilatéralement comme une négation du parti. Par conséquent, dans une résolution qui voulait résumer ce que nous avons appris de ce débat se trouve la formulation citée dans la Revue Internationale n°40 :
"Même si elles font partie d'une même unité et agissent l'une sur l'autre, il est faux d'identifier la conscience de classe avec la conscience de la classe ou dans la classe, c'est-à-dire son étendue à un moment donné... Il est nécessaire de distinguer ce qui relève d'une continuité dans le mouvement historique du prolétariat : 1'élaboration progressive de ses positions politiques et de son programme, de ce qui est lié aux facteurs circonstanciels : l'étendue de leur assimilation et de leur impact dans la classe."
C'est au moment des "réserves" sur cette formulation que s'est introduite dans l'organisation la nouvelle orientation du "conseillisme, le plus grand danger", du "centrisme par rapport au conseillisme" et da centrisme appliqué à l'histoire du mouvement ouvrier dans la période de décadences-La minorité actuelle qui se constitue en tendance se situe contre 1'ensemble de cette nouvelle orientation, considérant qu'elle pose le danger d'une régression dans notre armement théorique.
L'ENJEU DU DEBAT ACTUEL
Cet article devait se donner pour tâche essentielle de répondre à la théorisation du "conseillisme, le plus grand danger" dans la R.Int No 40. Mais même si ces débats n'ont eu qu'une faible répercussion dans notre presse jusqu'à présent, la façon dont World Révolution (W.R., déc. 84) a exposé 1'ensemble de la nouvelle théorisation fait ressortir beaucoup plus clairement les enjeux. Pour ne citer que notre presse extérieure :
- Dans W.R., la conception kautskyste de la conscience de classe est caractérisée comme un "bug-bear" ("un épouvantail fait de vains fantômes") ; le danger de substitutionnisme n'est qu'une simple diversion introduite par des "conseillistes qui n'osent pas dire leur nom" (R.Int. No 40). On escamote de plus en plus le fait que donner un rôle bourgeois au parti ne défend pas mieux son rôle indispensable que de rejeter toute notion de parti. Les deux conceptions, aussi bien l'une que l'autre, nient la fonction réelle du parti.
- "Le CCI, comme le KAPD et BILAN, est convaincu du rôle décisif du parti dans la révolution. " (R.Int. No 40) Mais le KAPD et BILAN n'ont pas la même conception du rôle et fonction du parti pourquoi escamoter cela ? Il est vrai que la Gauche italienne a subi une régression après BILAN mais elle a toujours fondamentalement adhéré aux conceptions de Bordiga sur le parti pendant toute son histoire. BILAN a commencé à faire une critique très importante notamment sur le parti en tant qu'appareil étatique, mais il republie comme siens les textes de Bordiga sur le rapport parti-classe avec le même manque de compréhension du rôle des conseils (vu unilatéralement sous l'angle de la lutte anti-Gramsci ) et le développement de la conscience et la théorie de la médiation. De plus, les conceptions d ' INTERNATIONALISME des années 40 sur le parti et son rôle ne sont pas identiques à celles de BILAN. Et il y a toute une évolution encore entre les positions d ' INTERNATIONALISME sur le développement de la conscience et celles du CCI.
- Dans Révolution Internationale du mois d'octobre 1984 (N° 125), les éléments chauvins Frossard et Cachin sont rebaptisés "centristes" et "opportunistes", donc prolétariens selon la définition, tandis qu'en réalité ce sont des éléments contre-révolutionnaires. Les appeler "centristes" sur le modèle des tendances au sein du mouvement ouvrier dans l'ascendance n'a servi dans le passé qu'à fournir une couverture idéologique à la politique désastreuse suivie par l'I.C, contre la Gauche, dans la formation des partis communistes en occident (y compris la fusion du KPD avec l'USPD). Mais le grave danger que l'utilisation du concept du "centrisme" dans la décadence représente pour toute organisation révolutionnaire se voit deux mois après dans Révolution Internationale de décembre 1984 (No 127) dans un article qui considère que le PCF était "centriste", c'est-à-dire, dans 1''erreur mais sur le terrain prolétarien, jusqu'en 1934 ! Et ceci en contradiction avec le Manifeste de la fondation du CCI : "1924-1926 : le début de la théorie du "socialisme dans un seul pays" ;cet abandon de l'internationalisme a signifié la mort de l'Internationale Communiste et le passage de ses partis dans le camp de la bourgeoisie". (R.Int. No 5)
Il est largement temps, quelles que soient les confusions sur l'utilisation des termes centrisme-opportunisme dans le passé et même dans notre organisation, de se rendre compte aujourd'hui que la conciliation avec la position de la classe ennemie dans l'époque du capitalisme d'Etat se manifeste par la capitulation directe à l'idéologie capitaliste et son acceptation et non plus - comme à la fin de la période ascendante- par l'existence de positions "intermédiaires", des positions ni marxistes ni capitalistes. Et il faut s'en rendre compte avant que par cette brèche ne se gangrènent tous nos principes de base.
Les débats actuels surgis à la suite d'une accélération de l'histoire, sont le prix que paie le CCI pour l'insuffisance de son approfondissement théorique et historique au cours des années passées.
Toute tentative d'appliquer de façon cohérente les notions de "conseillisme le plus grand danger" ne peut qu'aboutir à une remise en cause des positions du CCI sur la conscience de classe, pierre de touche d'une compréhension correcte de la lutte de classe et du rôle du futur parti en son sein ; sur les leçons de la première vague révolutionnaire ; sur le capitalisme d'Etat et sur les frontières de classe entre bourgeoisie et prolétariat.
De la capacité du CCI à dépasser ses faiblesses actuelles et à mener à bien les débats actuels dépendra en grande partie notre capacité à être à la hauteur des combats de classe futurs.
J.A.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 42 - 3e trimestre 1985
- 2649 reads
Situation internationale : simultanéité des luttes ouvrières et obstacle syndical
- 2578 reads
De la Grande Bretagne à 1'Espagne, du Danemark au Brésil et à l'Afrique du Sud, les luttes ouvertes de la classe ouvrière ne se ralentissent dans une pays que pour exploser plus violemment dans un autre la défaite des mineurs britanniques ne fut pas, comme celle des travailleurs polonais, suivie d'une période de reflux au niveau international.
C'est tout le sous-sol de l'ordre social capitaliste qui continue d'être lentement, mais systématiquement sapé et retourné par l'affirmation d'un mouvement de fond prolétarien. Un mouvement qui comme le montre les récentes grandes luttes ouvrières, tend de plus en plus à toucher les grands centres industriels de chaque pays (souvent encore relativement préservés). Un mouvement qui à travers des heurts de plus en plus répétés avec les appareils syndicaux, leurs stratégies de démobilisation et de démoralisation et avec leurs formes "radicales", "de base", se fraie un chemin en poussant de plus en plus ces combats vers l'extension et 1'auto-organisation.
PERSPECTIVES DE LA TROISIEME VAGUE DE LUTTE DE CLASSE
Nombre d'ouvriers, nombre de groupes révolutionnaires ont cru que la défaite de la grève des mineurs en Grande-Bretagne marquait la fin de l'actuelle vague internationale de lutte, vague que nous vivons depuis septembre 1983, depuis la grève du secteur public qui avait paralyse la Belgique pendant deux semaines. Ils ne voyaient pas de différence entre la défaite subie en Pologne en 1981 et la défaite dans la grève des mineurs en Grande-Bretagne. Il y a défaite et défaite. Le 13 décembre 1981 marquait le début d'une période de recul international de la lutte. Aujourd'hui, il n'en est rien. En plus, cette grève des mineurs dans le plus vieux pays capitaliste a porté un sérieux coup aux illusions colportées par le syndicalisme sur le corporatisme. Dans notre tract distribué dans dix pays sur les leçons de la grève des mineurs, nous soulignons que " la longueur de la lutte n’est pas sa force réelle. Face aux grèves longues, la bourgeoisie sait s’organiser : elle vient de le prouver. La véritable solidarité, la véritable force des ouvriers, c’est l’extension des luttes. " (C.C .I., le 8 mars 1985). Les mouvements de grève au Danemark et en Suède nous enseignent que le prolétariat est en train de tirer immédiatement les leçons.
Ces ouvriers et ces révolutionnaires étaient ainsi les victimes à la fois du silence presque complet des médias sur l'existence de mouvements et de grèves dans le monde entier, et à la fois de la propagande délibérée de l'ensemble des bourgeoisies nationales sur la prétendue absence de combativité ouvrière aujourd'hui.
Cette propagande est mensongère. Nous renvoyons le lecteur à toutes nos Revues Internationales de 1984, ainsi qu'aux différents journaux et revues territoriaux du CCI. Même s'il faut reconnaître que dans certains pays comme l'Italie et la France, le mécontentement ouvrier ne s'est pas vraiment exprimé depuis le printemps 1984. Nous y reviendrons.
Comme nous l'avons souvent déjà dénonce, la censure, le silence, le "black-out" de la presse bourgeoise sont presque totaux sur les grèves ouvrières. De plus en plus une des tâches des organisations révolutionnaires va être de fournir dans leur presse ces informations indispensables. Pour cela, il faut que ces mêmes organisations sachent reconnaître l'existence de cette troisième vague de lutte et obtenir des informations. Ces questions sont politiques. Pour la première, nous renvoyons le lecteur à l'article paru dans le dernier numéro de cette revue, sur la méthode. La seconde dépend de la capacité politique des groupes révolutionnaires à être de réelles organisations centralisées et internationales (Revue Internationale No 40, "10 ans du CCI.")
Jamais dans l'histoire du prolétariat, une telle simultanéité internationale de lutte n'a existe. Jamais. Pas même durant la vague révolutionnaire des années 1917-23. En l'espace d'un an, c'est tous les pays d'Europe occidentale (sauf peut-être la Suisse) qui ont vécu des luttes défensives ouvrières contre l'attaque généralisée du capitalisme. Ces luttes ouvrières ont lieu en même temps. A plusieurs reprises dans les mêmes pays, voire les mêmes secteurs. Elles ont les mêmes causes et les mêmes revendications. Elles se confrontent aux mêmes obstacles que leur opposent les différentes bourgeoisies : l'isolement et la division.
Cette similitude et cette simultanéité internationales des luttes ouvrières dégagent la perspective de la généralisation consciente de ces dernières dans les principaux pays européens. Perspective qui avait été si cruellement absente en 1980-81 et avait laissé la classe ouvrière isolée en Pologne. De la capacité du prolétariat à généraliser son combat dépend sa capacité future à passer à l'offensive contre les différents Etats capitalistes afin de les détruire et d'imposer sa dictature de classe et le communisme.
Nous n'en sommes pas là. Bien loin encore. Cependant, Si peu d'ouvriers en sont conscients, le chemin est déjà entrepris. Non pas dans la généralisation internationale même, mais dans les différentes tentatives encore timides d'extension et d'auto-organisation. Ou plutôt, dans l'effort d'organiser l'extension des différentes luttes, dans l'effort de rompre l'isolement et la division maintenus par les syndicats entre usines, corporations, villes, régions, entre jeunes et vieux, ouvriers avec encore du travail et ouvriers au chômage. Et c'est là que se trouve l'inévitable et nécessaire Chemin vers la généralisation internationale consciente des luttes ouvrières.
Dans la Revue Internationale No 37, nous avons su reconnaître la reprise de la lutte de classe qui venait d'avoir lieu. Nous en avons dégagé la signification par rapport à la défaite subie par le prolétariat en Pologne en 1981 et le recul international des luttes qui s'en est suivi. Nous en avions aussi relevé les caractéristiques qui se sont amplement vérifiées. Dans ces derniers mois et particulièrement en avril :
1) la tendance au surgissement de mouvements spontanés ne s'est pas démentie. En Espagne, à Valence (Ford), dans les postes à Barcelone, à Madrid, se sont déclenchés des mouvements qui ont surpris les syndicats. Dans les postes toujours, dans les mines encore, et dans d'autres secteurs, se sont déroulées des grèves sauvages, "illégales" contre l'avis des syndicats en Grande-Bretagne.
Mais c'est surtout la grève de 300 000 ouvriers au "petit" Danemark de 3 millions d'habitants, qui a le plus clairement exprimé cette tendance au surgissement de mouvements spontanés. Après l'appel du syndicat L.O. à reprendre le travail, 200 000 travailleurs restent en grève presque jusqu'à la mi-avril.
Autre confirmation de cette caractéristique, les surgissements spontanés de manifestations de chômeurs à Barcelone, et de comités de chômeurs en France. Ils sont encore isolés et peu nombreux, mais nous savons qu'ils vont se multiplier.
C'est toujours contre ou malgré les syndicats que surgissent ces mouvements spontanés. Et cela, malgré leur attention et leur "prévoyance", un an et demi après la reprise des luttes. Et cela, malgré la volonté syndicale d'occuper le terrain à coups de "journées d'action".. C'est dire la conscience croissante parmi les ouvriers de la nécessité de prendre l'initiative dès le début des grèves et des luttes, de ne pas la laisser dans les mains des syndicats.
2) la tendance à des mouvements de grande ampleur frappant tous les secteurs est elle aussi toujours présente. Evidemment, la meilleure illustration en est la grève au Danemark qui a paralysé tous les secteurs de la production. Au même moment, en Espagne, c'est dans l'automobile (Ford et Talbot), dans les chemins de fer, les chantiers navals, dans les postes, parmi les ouvriers agricoles, etc.
En Suède, en mai, ce sont 20 000 travailleurs de la fonction publique qui se mettent en grève. Un mois après le Danemark. 80 000 sont lock-outés. Une grande partie du pays est paralysée. Au même moment, de petits mouvements éclatent dans les usines automobiles, vite étouffés.
Au Brésil, 400 000 travailleurs ont pris part au mois de mars, d'avril et de mai, aux mouvements de grèves dans les usines d'automobiles et métallurgiques de Sao Paolo, dans les services publics et les transports.
Ces quelques exemples récents s'ajoutent aux précédents en Belgique, en France l'an dernier, à la Grande-Bretagne l'été passe, etc.
Au moment d'écrire cet article, depuis plusieurs jours, se poursuit aux Pays-Bas, une grève de quelques 150.000 travailleurs de la Construction, tandis que l'aéroport de Schipol-Amsterdam est bloqué par les aiguilleurs et les travailleurs au sol qui sont en grève. Le trafic est détourné sur Bruxelles-Zaventem où des menaces de grève se font aussi sentir. De plus en plus, la question qui se pose au prolétariat dans chaque pays est d'organiser et de coordonner ces luttes massives qui tendent à dépasser tout corporatisme et toute division.
3) la tendance à l'auto organisation et à l'extension s'affirme chaque fois davantage.
En Espagne, les ouvriers des postes à Barcelone et les ouvriers agricoles de Sagunto furent capables de produire des assemblées générales souveraines ouvertes à tous et en particulier aux groupes révolutionnaires. Mais dans la mesure où la principale fonction de ces assemblées -l'extension de la lutte- n'a pu se réaliser, celles-ci furent vidées de leur sang, de leur raison d'être, de leur caractère de classe, d'organe de lutte par les syndicats. Ce sont la C.N.T. (le syndicat anarchiste) et les Comisiones Obreras -CCOO- (syndicat du P.C.) qui finirent par prendre en main le comité de grève de Barcelone. Ce sont eux qui réussirent finalement à exclure le CCI. de l'assemblée générale alors que nous défendions la nécessité d'étendre la grève. Ce sont eux qui sabotèrent la grève en l'étouffant dans l'isolement.
C'est le même problème que n'avaient pas su résoudre les ouvriers des mines et des docks lors de la grève de ces derniers en solidarité avec celle des mineurs en Grande-Bretagne. C'était les syndicats qui avaient gardé le contrôle des assemblées et de l'"organisation" des grèves. Désorganisation plutôt.
Sans extension, l'auto organisation perd son sens et sa principale fonction aujourd'hui, et les assemblées sont vidées de leur contenu par les syndicats.
Par contre, au Danemark, c'est le problème inverse auquel s'est confronté le prolétariat. L'extension fut réalisée parfois par des meetings tenus par les ouvriers de différentes usines. Déjà, dès le 17 mars, juste avant l'éclatement de la grève à tous les secteurs, la section du CCI en Suède écrivait sur l'accélération des événements au Danemark "faisant face à une attaque terrible de leurs conditions de vie, la baisse des salaires et le chômage croissant (environ 14 %, mais beaucoup plus dans la région de Copenhague), les ouvriers du Danemark sont prêts à lutter. Le fait que les dockers, tout comme les conducteurs d 'autobus, victimes des manoeuvres de la bourgeoisie avec la social-démocratie dans 1'opposition lors des grèves de 193.2-84, ne soient pas défaits, mais bien au contraire aux premières lignes de la situation actuelle, confirme notre analyse de la présente période et, plus important encore dans la situation actuel le, le potentiel d'extension exprimé dans les différentes grèves de ces dernières semaines, et même dans le fait que la bourgeoisie se prépare à appeler a une grève générale de manière à s'opposer à la conscience de plus en plus généralisée au sein de la classe de la nécessité de lutter et d'étendre ses luttes." (17 mars 1983) Difficile de mieux prévoir !
Contrairement à l'Espagne, au Danemark l'extension et l'unification se sont dans un premier temps réalisées. Les ouvriers se sont alors heurtés à la difficulté de coordonner leur lutte, de la contrôler, de l'organiser au moyen d'assemblées générales, de comités de grève. Ils laissèrent les mains libres à la bourgeoisie, particulièrement au syndicalisme de base, aux fameux "tillidsmen" tenus par le P.C. ("hommes de confiance", équivalent des "shop-stewards" en Grande-Bretagne) pour désorganiser le mouvement, le dévier, remplacer les revendications initiales sur les salaires par "les 35 heures" et la "démission du gouvernement Schuter", de droite, jusqu'à freiner, puis détruire le début prometteur d'unification de la lutte.
C'est pour cela que le tract que le CCI a distribué le 8 avril à la grande manifestation à Copenhague appelait les ouvriers à"prendre 1'initiative afin de repousser la bourgeoisie qui veut briser l'unité grandissante des luttes ouvrières
Le seul moyen d'y parvenir est d'organiser la lutte eux-mêmes :
- en appelant à des assemblées massives dans les lieux de travail qui élisent des comités de grève responsables uniquement devant 1'assemblée et révocables s'ils n'appliquent pas les décisions de 1'assemblée;
- en envoyant des dé légat ions aux autres lieux de travail pour demander aux autres ouvriers de se joindre à la grève en prenant l'initiative de discussions communes sur les revendications et les besoins de la lutte."
Sans contrôle de l'ensemble des ouvriers en lutte sur leurs organes de combat dont ils se dotent, assemblées, piquets de grève, délégations, comités, pour regrouper et unifier l'ensemble des ouvriers, la bourgeoisie et ses syndicats reprennent pied, occupent le terrain et vident et les organes de lutte et les buts de la lutte et les revendications de leur contenu prolétarien, de leur contenu unificateur. Sans auto organisation, il ne peut y avoir de réelle et durable ex-tension, de réelle unification du combat prolétarien.
4) Nous avons déjà souligné l'existence et l'importance de la simultanéité des luttes d'aujourd'hui : Entre janvier et mai 198 5, c'est la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, où des dizaines de luttes contre les licenciements se déroulent, plus de 200 000 grévistes en Grèce, au Portugal ; 500 000 au Danemark et jusqu'à la Norvège et la Suède, après l'Islande en octobre où toute l'île fut paralysée durant plusieurs semaines par une grève générale de tout le secteur public.
Nous ne pouvons citer tous les pays européens où eurent lieu des mouvements significatifs et où la tension et la combativité sont grandes. Mais malgré le silence de la bourgeoisie, n'oublions pas les grèves ouvrières qui ont eu lieu en Afrique du Sud, au Chili, au Brésil.
La liste pourrait être encore plus longue, surtout si nous la reprenions depuis septembre 1983. Dans cette simultanéité internationale, le prolétariat répond au problème posé en 1981 par l'isolement du prolétariat en Pologne. "Comme en Pologne, la bourgeoisie va essayer d'isoler la lutte des ouvriers au Danemark." (tract du CCI au Danemark, le 8 avril 1983). La simultanéité des grèves ouvrières"exprime une prise de conscience de la classe de ses intérêts et constitue un pas vers la capacité d'unifier son combat internationalement."(Revue Internationale No 40). Avec la simultanéité nationale et internationale des luttes, l'extension et son organisation sont directement et concrètement réalisables. C'est pour cela que la bourgeoisie avec ses partis de gauche dans l'opposition et ses syndicats tente d'occuper le terrain social afin de tuer dans l'oeuf la moindre volonté d'unification des ouvriers en lutte. Ce combat contre les syndicats et la gauche, pour l'extension et l'unification des luttes ouvrières, va déterminer le développement de la perspective de généralisation internationale de ces luttes. Avec la simultanéité, cette généralisation trouve un terrain éminemment favorable.
5) Parmi les caractéristiques de la troisième vague que nous venons de voir, certaines se sont précisées. En particulier :
- de plus en plus, les grèves ont lieu dans les secteurs clé de l'industrie ; de plus en plus, dans les grandes concentrations ouvrières et dans les grandes villes ;
- les revendications tendent à devenir plus globales. Elles portent essentiellement sur les salaires et sur tout sur le chômage. Comme le notait notre section aux Pays-Bas dans un communiqué sur la lutte de classe dans ce pays,"la question du chômage est l'élément essentiel, crucial pour le développement des combats ouvriers. Tous les licenciements annoncés presque sans cesse poussent en permanence les ouvriers à se mettre en lutte."
6) Enfin la dernière caractéristique que nous avions mise en évidence s'est largement confirmée elle aussi: le rythme lent du développement des luttes.
Les ouvriers en Europe se trouvent être au centre de cette troisième vague de lutte ; même si les luttes du prolétariat des autres continents sont importantes, tant dans l'immédiat que pour le futur, même si ces luttes sur les autres continents s'intègrent tout à t'ait dans cette vague. Mais ce sont les ouvriers d'Europe occidentale qui l'ont déclenchée ; c'est eux qui en déterminent le rythme. Ils sont confrontés à l'éventail complet des mystifications bourgeoises et en particulier à la démocratique et à la parlementaire. C'est dans ces vieux pays d'Europe que la bourgeoisie a su le mieux se préparer à attaquer le prolétariat. Pour cela, elle a disposé ses principales forces de gauche (PS, PC, rejoignent les trotskystes et autres gauchistes) dans l'opposition sans responsabilité gouvernementale, leur permettant ainsi de dévoyer et de saboter les luttes de l'intérieur en se présentant comme les défenseurs des ouvriers (cf. Revue Internationale n°26).
Dans cette mesure, il ne fallait pas, et il ne faut toujours pas s'attendre à de brusques surgissements spontanés de la grève de niasse comme c'était arrivé en Pologne en 1980. Non. C'est au contraire à l'issue d'un processus long et difficile d'affrontement à la gauche dans l'opposition et aux syndicats, que le prolétariat sera capable de développer des grèves de masse et la généralisation internationale de son combat.
C'est donc à un rythme lent que se développent les luttes dans^ cette troisième vague. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Bien au contraire, si le rythme est lent, la profondeur de la réflexion, de la maturation de la conscience, de l'affrontement n'en est que plus certaine. A travers cette confrontation au cours des luttes contre la gauche et le syndicalisme, la classe ouvrière cherche la voie de son combat contre le capitalisme, elle commence à reconnaître ses ennemis et surtout ses faux amis, elle apprend à lutter et use les mystifications démocratiques et syndicales pour l'ensemble du prolétariat international. Sa conscience de classe s'étend et s'approfondit.
LE SYNDICALISME : LE FER DE LANCE DE L'ATTAQUE DU CAPITALISME CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
1) Une stratégie de démobilisation
Une des principales armes qu'emploient les syndicats est l'arme des "journées d'action". Oh, non pas pour mobiliser les ouvriers sur des mystifications syndicales comme ils le faisaient dans les années 70. Non, ça ne marche plus d'ailleurs. Il s'agit pour la bourgeoisie d'occuper le terrain par ses syndicats, d'ôter toute initiative aux ouvriers, les déboussoler et les démoraliser en essayant de leur faire rentrer dans la tête que décidemment "la lutte ne paie pas".
Et pour cela, les journées d'action par secteur, par usine, ou par ville ou région - quand elles ne sont pas de grosses concentrations ouvrières- sont utilisées au maximum : un mécontentement, une menace de licenciement, une tension régnant quelque part, immédiatement les syndicats proposent pour "mobiliser", "préparer" et "étendre la lutte" une journée d'action à une date lointaine car "il faut se préparer sérieusement" ; et ils prévoient même parfois une manifestation, voire une marche sur la capitale, mais là aussi, à une date indéterminée et une fois précisée... repoussée une, deux fois, etc.. Ils convoquent à la "journée" sur des revendications catégorielles, ou ils appellent à la manifestation, et surtout aux "marches" sur les capitales en prenant bien soin de ne pas indiquer, ou seulement au dernier moment, l'heure et le lieu ! Ils s'assurent ainsi qu'aucun groupe d'ouvriers d'autres secteurs ne viendra rejoindre la manifestation. Ils s'assurent ainsi contre tout danger de regroupement ouvrier, d'unification et d'extension des luttes et des manifestations. Ils immobilisent ainsi, dans un premier temps, la classe ouvrière pour, dans un deuxième temps, faire croire que ce sont les ouvriers qui sont apathiques, qui ne sont pas combatifs. Ils tentent par cette stratégie d'entretenir dans la classe ouvrière un manque de confiance dans ses propres forces, une passivité qui permette de faire passer les attaques des conditions de vie. Et lorsque la lutte s'enclenche néanmoins ils préviennent le mouvement de masse par une"grève générale", ou une "journée d'action" qui parodient l'extension et sanctionnent la démobilisation des ouvriers.
Des exemples ?
En Espagne, lors des grèves dans les chantiers navals, dans les postes. Les CCOO du P.C. sont très efficaces dans cette tactique de démobilisation. En France, lors de la manifestation des ouvriers de Renault menacés de licenciements le 10 mai dernier.
Parfois ça ne marche pas : comme au Danemark où, après avoir "promis une grève générale" dont l'appel fut repoussé à plusieurs reprises, le syndicat L.O. appela à la grève une fois celle-ci inévitable, vu la combativité. Cette arme, étroitement liée à la tactique de la gauche dans l'opposition, est particulièrement efficace en France jusqu'à présent. Les syndicats réussissent ainsi à déboussoler et à démoraliser les ouvriers; ils renforcent leur apathie et leur passivité en pariant sur la méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats. Le PC et son syndicat la C.G.T. en France. Cette tactique réussit à paralyser momentanément le prolétariat dans ce pays malgré un mécontentement croissant et lourd de menaces pour la bourgeoisie de ce pays.
En Italie, c'est encore plus subtil. La bourgeoisie immobilise l'attention sur l'organisation par les syndicats, le PC et les gauchistes, d'un référendum sur l'échelle mobile des salaires. Il faut donc réunir d'abord les signatures nécessaires pour que le référendum ait lieu. Première campagne de déboussolement. Ensuite sur le vote au référendum proprement dit. Deuxième campagne !
Seuls le Parti Communiste Internationaliste ("Battaglia Comunista"), "Il Partito" de Florence et le CCI ont su dénoncer cette manoeuvre contre la classe ouvrière. Mais celle-là ne pourra éternellement détourner l'attention des ouvriers face à l'accentuation de la crise et face à l'existence et au développement des luttes dans tous les pays.
2) Nous avons déjà à maintes reprises dénoncé le danger du syndicalisme de base pour la classe ouvrière.
C'est avec un langage radical, "opposé" aux dirigeants "modérés" du T.U.C., le syndicat britannique, que Scargill, le chef du syndicat des mineurs (N.U.M.) a pu maintenir la grève dans la corporation, ce qui l'a menée à son échec. Et pour cela, il n'a pas hésité à employer la "violence" des piquets de grève contre les bobbies anglais, du moment que ces piquets ne cherchaient pas à rompre l'isolement dont souffrait la grève. II a même été jusqu'à se faire matraquer, pas trop quand même, et se faire arrêter, pas très longtemps non plus.
Ce sont les "tillidsmen", les délégués à la base, qui ont réussi à ramener et à éteindre la grève au Danemark sur le terrain syndicaliste et bourgeois. C'est la C.N.T. anarchiste qui a saboté l'extension de la grève des postes à Barcelone.
Grâce à son langage radical, gauchiste, parfois violent, grâce à son contrôle sur les organes de lutte dont se dotent les ouvriers, un des dangers du syndicalisme de base pour le prolétariat est de pouvoir accomplir une des priorités de la bourgeoisie aujourd'hui: empêcher par tous les moyens la politisation des luttes, interdire aux organisations révolutionnaires ainsi qu'aux ouvriers les plus combatifs, d'intervenir dans les luttes.
C'est ainsi que les syndicats se sont violemment opposés à ce que le CCI prenne la parole à l'usine d'automobiles Jaguar en Grande-Bretagne. C'est ainsi que le PC danois, contrôlant les "tillidsmen" tentait de répandre le bruit que les militants du CCI étaient des agents de la CI.A. C'est ainsi que la C.N.T. et les CCOO ont fini, au bout de plusieurs jours d'efforts, par nous expulser de l'assemblée générale lors de la grève des postes à Barcelone.
C'est ainsi que les trotskystes de la IVe Internationale ont fini par interdire l'accès au CCI du comité de chômeurs à Pau en France en nous menaçant, entre autres, d'appeler la police !
Enfin, le dernier aspect du sale boulot que jouent le syndicalisme de base et les gauchistes est la tentative d'encadrer les chômeurs en renforçant le rôle des syndicats de chômeurs là où ils existent déjà, en les créant là où ils n'existent pas : en Belgique, où le chômage est depuis longtemps particulièrement important ils agissent au sein des organismes syndicaux destinés aux chômeurs (ceux de la FGTB et d'autres syndicats); en France ce sont principalement les gauchistes, le P.C., qui essaient aujourd'hui de "noyauter" les comités de chômeurs qui commencent à surgir afin d'empêcher qu'ils deviennent des, comités ouverts à tous les ouvriers en lutte ; afin d'éviter qu'ils deviennent des lieux de regroupement ouvrier et de discussion politique ; afin surtout de saboter toute tentative d'unification et de centralisation de ces différents comités ; afin d'isoler les sans-travail du reste de leur classe et les rendre impuissants dans leur combat quotidien à travers leurs revendications pour simplement manger et survivre.
QUE FAIRE ?
Malgré tous ces obstacles, la "gauche dans l'opposition" et le syndicalisme, le prolétariat trouve un "allié" dans l'approfondissement catastrophique de la crise économique du capitalisme. Celui-ci n'a plus rien à offrir à l'humanité, sinon plus de misère, plus de famine, plus de répression et pour fin une troisième guerre mondiale.
Le prolétariat n'est pas battu. L'actualité de cette troisième vague de lutte, sa dynamique, nous le prouvent amplement. Face à la terrible attaque qu'il subit, le prolétariat se doit de développer une réponse qui fasse peur à la bourgeoisie, une réponse qui inverse le rapport de force qui lui est aujourd'hui défavorable, une réponse qui lui permette de s'opposer réellement à l'appauvrissement universel et absolu que lui impose le capitalisme, une réponse qui lui ouvre la perspective de la généralisation internationale de sa lutte. C'est pour cela qu'il se doit de bien reconnaître qui sont ses ennemis, comment il doit les combattre et vers où le mène son combat. C'est tout le sens de la "politisation" de ses luttes.
Le prolétariat ne doit pas laisser l'initiative à la bourgeoisie, à ses partis de gauche et aux syndicats qui vont organiser l'isolement et la défaite. C'est aux ouvriers de prendre l'initiative. "Mais pour accomplir une action politique de masse, il faut d'abord que le prolétariat se rassemble en masse ; pour cela, il faut qu'il sorte des usines et des ateliers, des mines et des hauts-fourneaux et qu'il surmonte cette dispersion et cet éparpillement auquel le condamne le joug capitaliste."(Rosa Luxemburg, "Grève de masse, parti et syndicats"). C'est aux ouvriers à prendre l'initiative de la grève, des assemblées, des délégations aux autres usines, des comités de chômeurs, de leur union, des manifestations et des meetings ouvriers pour étendre et unifier les luttes. La bourgeoisie ne laissant pas le terrain libre, comme nous l'avons vu, c'est un combat qui va devenir de plus en plus permanent et quotidien. Cette bataille se déroule déjà sous nos yeux.
C'est aux éléments les plus combatifs, les plus conscients qui commencent à surgir un peu dans tous les pays, à prendre en main et à proposer l'initiative du combat prolétarien à l'ensemble de leur classe.
C'est aux organisations révolutionnaires qu'échoit "le devoir comme toujours de devancer le cours des choses, de chercher à le précipiter" disait Rosa Luxemburg, car elles sont appelées à en prendre de plus en plus la "direction politique". C'est pour cela que les ouvriers les plus combatifs, les groupes communistes doivent mener cette bataille politique quotidienne dans les usines, dans les assemblées, dans les comités, dans les manifestations. C'est pour cela qu'ils doivent s'imposer contre les manoeuvres des syndicats. C'est pour cela qu'ils doivent mettre en avant et défendre les revendications et les propositions de marche concrètes et immédiates qui vont dans le sens de l'extension, du regroupement et de l'unification des luttes.
De l'issue de cette bataille dépend la capacité du prolétariat à "accomplir une action politique de masse" qui fasse reculer momentanément la' bourgeoisie dans son attaque contre le prolétariat, et surtout, qui ouvre, grâce à la généralisation internationale de son combat, la perspective de l'assaut révolutionnaire du prolétariat contre le capitalisme, de sa destruction et de l'avènement du communisme. Pas moins.
26.3.83 R.L.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Où en est la crise économique? : L’entrée dans la récession
- 3070 reads
L'année 1984 s'est terminée en fanfare pour la capitalisme américain avec la réélection de Reagan à la présidence des Etats-Unis. Pendant toute sa campagne électorale, celui-ci a pu se targuer d'avoir vaincu la crise économique, d'avoir vaincu l'inflation revenue à 3,2 % en 1984, d'avoir résorbé le chômage en le ramenant de 9,6 % en 83 à 7,3 % en 84, d'avoir revitalisé la production avec un taux de croissance record de 6,8 % toujours en 84, et enfin d'avoir restauré la suprématie du roi-dollar dont le cours a culminé a clés sommets jamais atteints. On a ainsi vu s'orchestrer une grande messe à la gloire du capitalisme américain, à sa puissance, à sa santé, pour faire croire qu'enfin, après des années d'échec, la politique économique du matamore Reagan, les fameuses "Reaganomics" étaient la solution enfin trouvée à la crise économique mondiale qui, depuis deux décennies, fait de plus en plus gravement sentir ses effets sur l'économie planétaire.
Le capitalisme américain est puissant, nul ne peut le nier : pas simplement par la puissance de ses armes, mais surtout par la puissance de son économie qui contrôle la plus grande partie de l'économie mondiale. Les USA sont le premier producteur qui fournit 20 à 23 % du total de la production mondiale ; ils sont aussi le premier marché, la principale puissance financière dont la monnaie s'est imposée aux capitalistes du monde entier et avec laquelle se font 80 % des échanges mondiaux, et qui en 1982 constituait 11% des réserves de devises des grandes banques centrales des pays industrialisés. L'ensemble de l'économie mondiale dépend de la bonne santé du capitalisme américain, et si le capitalisme américain est puissant, par contre il est en mauvaise santé, et l'économie mondiale avec lui.
L'euphorie électorale passée, plus question de taux de croissance record du PNB pour 1983. Le ton a changé à Washington, le nouveau mot d'ordre de l'administration Reagan est : "il faut que l'économie américaine atterrisse en douceur." Dans la mesure où un "atterrissage" de l'économie américaine signifie un "atterrissage" de l'économie mondiale, et que nous sommes tous les passagers de cet avion là, on ne peut que se demander ce que signifie cette annonce du pilote.
Pour quelles raisons faut-il atterrir?
Si l'économie américaine se porte si bien que l'a prétendu Reagan, pourquoi faut-il qu'elle atterrisse maintenant ? Les effets de la reprise américaine se sont à peine fait sentir sur l'économie européenne (Voir Tableau 1), alors que les pays sous-développés ont continué à voir leur économie s'effondrer systématiquement.
La reprise américaine n'a pas été une reprise mondiale, elle aura été brève ; c'est en fait une reprise avortée.
Cette situation montre, par rapport aux années 70, une très forte dégradation de l'économie mondiale. Les USA sont aujourd'hui incapables de répéter ce qu'ils avaient pu faire dans le passé : relancer provisoirement l'économie mondiale, jouer le rôle de locomotive. Aucune politique économique ne peut aujourd'hui permettre au capitalisme de masquer longtemps ses contradictions. La reprise américaine n'a pu se faire que par un endettement pharamineux des USA dont la dette publique dépasse aujourd'hui les 1500 milliards de dollars, et la dette cumulée de l'Etat, des entreprises et des ménages, le chiffre astronomique de 6000 milliards de dollars (2 fois le PNB annuel des USA), tandis qu'en 1985 les investissements étrangers aux USA deviennent supérieurs aux avoirs américains à l'étranger, les USA devenant ainsi débiteurs vis-à-vis du reste du monde. (Voir Revue Internationale n°41, "Dollar : le roi est nu"). Mais même les déficits budgétaires et commerciaux gigantesques accumulés par les USA ne sont pas suffisants pour résorber le trop-plein de surproduction de l'économie mondiale. Et cette politique, les USA ne peuvent continuer à la mener sans risquer rapidement une crise monétaire catastrophique autour du dollar. Il faut atterrir d'urgence, les USA ne peuvent maintenir leur taux de croissance, ils ne peuvent continuer à s'autoriser de tels déficits budgétaires et commerciaux. L'avion n'a plus beaucoup de carburant et ses moteurs fonctionnent mal.
UN SEUL TERRAIN D'ATTERRISSAGE : LA RECESSION MONDIALE
Dans la situation de marasme dans laquelle se trouve l'économie mondiale, une chute ou un arrêt de la croissance aux USA ne peut signifier qu'une plongée dans une récession mondiale profonde et durable : les pays sous-développés se sont toutes ces années enfoncés dans la récession sans issue pour en sortir. L'Europe et le Japon n'ont pu maintenir une croissance tout à fait relative que par l'ouverture du marché américain ; si celui-ci se contracte, ils seront les premiers touchés et menacés de voir leurs exportations, et donc leur production s'effondrer.
L'atterrissage dont nous parle le pilote va se faire sur un terrain en pente, sur la pente de la récession. Lors de la précédente récession, la production américaine avait chuté de 11 % entre1981et 1982. Mais le pilote se veut rassurant, il nous annonce un "atterrissage en douceur".
Un atterrissage en douceur?
"Tout va bien" nous dit-on, mais les passagers commencent à être inquiets. Ces derniers mois ont vu le dollar jouer au yoyo, varier de plus de 10 % en quelques mois ; les faillites bancaires aux USA se sont multipliées et, comme en 1929, les épargnants paniques ont fait la queue devant les guichets fermés. Le temps est à la tourmente, l'avion est secoué. Pour le premier trimestre 85, les économistes de Washington prévoyaient un taux de croissance en baisse à 3 %. Après de constantes évaluations en baisse - 2,8 %, 2,1 %, 1,6 % - le gouvernement américain a du annoncer en mai un taux de croissance de 0,7 % pour le 1er trimestre 85, en rythme annuel. Le pilote navigue à vue, il ne sait trop où il va.
De plus, on ne peut qu'avoir quelques doutes sur sa capacité à piloter. L'échec de la reprise à la Reagan marque l'impuissance de la bourgeoisie face à la crise économique mondiale de surproduction. Les recettes de Reagan, malgré toute sa propagande, ne sont pas nouvelles, ce sont celles du capitalisme d'Etat : réduction des impôts pour relancer la consommation intérieure, grands programmes d'armement pour relancer l'industrie (195 milliards de dollars en 83, 184 en 84). Pour atténuer les secousses de la crise économique, pour empêcher l'effondrement de pans entiers de la production, l'Etat présidé par Reagan est obligé, comme tous les autres, d'intervenir de plus en plus fréquemment et de contrôler de plus en plus étroitement les processus économiques (Voir Tableau 2). Contrairement à tous ses discours, Reagan a quasi nationalisé la Continental Illinois en faillite, et subventionné l'agriculture américaine avec un budget de 2 milliards de dollars. Mais ces recettes éprouvées depuis 40 ans ne suffisent plus pour éviter la récession, l'effondrement de l'économie mondiale.
Reagan veut un "atterrissage en douceur", mais cette "douceur" signifie pour le prolétariat 5u monde entier encore plus de misère, encore plus de chômage. Dans la situation de combativité de la classe ouvrière aujourd'hui, avec l'aggravation de la situation économique, la situation sociale va devenir explosive. On comprend dans ces conditions que la bourgeoisie freine le plus possible cette plongée dans la récession, qu'elle veuille cet "atterrissage en douceur". Mais comment y parvenir ? La question qui se pose aux économistes du monde entier, ce n'est plus : comment sortir de la crise ; mais : comment y plonger le plus doucement possible.
Aujourd'hui, Reagan fait appel à ses alliés européens et japonais pour qu'ils relancent leur économie afin de contrebalancer les effets de la baisse de croissance américaine sur l'économie mondiale. Mais cette mesure ne peut être qu'un palliatif provisoire de plus, car c'est tout ce qui reste au capitalisme mondial ; freiner de toutes ses forces l'arrivée de l'inéluctable, la plongée accélérée dans une récession comme l'humanité n'en a pas encore connue.
Freiner la récession revient pour tous les Etats à s'endetter encore plus. Une telle politique, conjuguée avec la récession qui jette les ouvriers au chômage, plonge les entreprises dans la faillite, met les Etats en cessation de paiement, ne peut mener qu'à une explosion de l'inflation. Aujourd'hui, cette inflation continue à faire des ravages à la périphérie du capitalisme, dans les pays les moins développés, et ces derniers mois ont vu dans les pays les plus développés, qui croyaient l'avoir jugulé, son taux remonter : ainsi aux USA, si en 1984 l'inflation a été de 3,2 %, d'avril 84 à avril 85, elle a été de 3,7 %.
L"'atterrissage" dans la récession ne peut qu'avoir lieu, mais ils ne se fera pas "en douceur". Nul économiste de la bourgeoisie n'ose prévoir les conséquences de la fin de la reprise aux USA. Elles sont catastrophiques : chômage, misère, faillites, inflation. Mais si elles sont catastrophiques pour l'économie capitaliste, c'est d'abord sur le plan politique : l'aggravation des conditions de vie qui en découle pour la classe ouvrière ne peut que signifier une accentuation de la reprise de la lutte de classe qui se développe depuis l'automne 83. Avec l'effondrement de l'économie capitaliste, c'est, vu la combativité actuelle du prolétariat, la perspective révolutionnaire qui s'annonce comme seule alternative réelle.
JJ. 9/6/85.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Chômage massif et extension de la lutte de classe
- 2882 reads
Impitoyablement, le chômage fauche aujourd'hui des millions d'existences et s'impose comme le phénomène le plus important et marquant de la vie sociale dans tous les pays. Les mois et années à venir ne verront que se confirmer cette hémorragie.
Les grandes vagues de licenciements alimentent cette progression du chômage dont il y a quelques années, dans les pays industrialisés, l'arrivée sur un marché du travail bouché des jeunes générations était encore la principale source. Ces grandes vagues de licenciements n'épargnent aucune couche de la population ouvrière. Ouvriers d'industrie et employés, techniciens ou main d'oeuvre non qualifiée, jeunes ou adultes, hommes ou femmes, immigrés ou non. Le chômage pénètre ainsi toute la vie sociale et lui impose sa marque de fer rouge. Des millions de personnes se retrouvent directement sous sa coupe, des millions d'autres en vivent quotidiennement la menace, tous en subissent la pression.
Cette situation de chômage massif qui, loin de régresser dans les mois et années qui viennent, va se développer à un rythme soutenu, conduit irrésistiblement à une paupérisation absolue de toute la classe ouvrière. Ce chômage massif est la manifestation la plus aiguë et directe de la crise historique du capitalisme. Il en exprime de façon nette et tranchée la nature et les causes, crise de surproduction, en l'occurrence, surproduction de force de travail, crise où le rapport capitaliste du travail salarié se révèle trop étroit pour contenir toutes les richesses produites par le travail des générations passées et présentes,et qu'il promet ainsi à la destruction y compris la "force de travail", source de toutes les richesses.
Manifestation la plus criante de la crise historique du capitalisme, ce chômage massif et chronique qui gangrène en largeur et profondeur toute la vie sociale n'est pas une "première" historique. Avant d'être "résorbé" par la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes dans la seconde guerre mondiale, il a aussi profondément marqué toute la période des années 20 jusqu'à la fin des années 30 .
Contrairement à toutes les idées reçues et curieusement entretenues par l'idéologie dominante, la profonde démoralisation, démobilisation et finalement soumission de la classe ouvrière à tous les embrigadements fascistes, staliniens ou démocratiques, n'est pas à mettre sur le compte des chômeurs "toujours prêts à se jeter dans les bras de la première dictature venue", mais sur celui de la profonde contre-révolution et de la trahison des organisations politiques du prolétariat qui a accompagné cette puissante contre-révolution. Même durant ces années, le chômage a, malgré tout, déterminé de grandes luttes, en France et aux USA,par exemple. Mais l'époque n'étant plus à la révolution, mais à la guerre, ces luttes ont finalement été dévoyées grâce aux organisations politiques staliniennes et social-démocrates, dévoiement grandement facilité par un développement gigantesque du capitalisme d'Etat avec les politiques de grands travaux et de réarmement massif.
Aujourd'hui, le chômage massif fait sa réapparition, mais dans un contexte totalement différent, et dans cette situation radicalement différente- des années 30 où le joug de la contre-révolution n'écrase plus la classe ouvrière, la lutte des chômeurs qui commence à poindre, menace de contribuer grandement au bouleversement gigantesque de tout l'ordre social établi. Et ce n'est sûrement pas la maladresse avec laquelle s'expriment les premiers mots d'ordre et les premières revendications de cette lutte qui nous amèneront à penser le contraire, car comme le disait K.Marx, en tirant le bilan des révolutions de 1848 :
"Dans le premier projet de constitution rédigé avant les journées de juin, se trouvait encore le droit au travail, première formule maladroite où se résument les exigences révolutionnaires du prolétariat On le transforma en droit à l'assistance Or, quel est l'Etat moderne qui, d'une manière ou d'une autre, ne nourrit pas ses indigents ! Le droit au travail est au sens bourgeois un contresens, un désir vain, pitoyable; mars derrière le droit au travail, il y a le pouvoir sur le capital; derrière le pouvoir sur le capital, l'appropriation des moyens de production, leur subordination à la classe ouvrière associée, c'est à dire la suppression du salariat, du capital et de leurs rapports réciproques. Derrière le droit au travail, il y avait l'insurrection de juin" (K. Marx. "Les luttes de classe en France", Ed. Sociales, p.81)
L'IMPACT DU CHOMACE
Le chômage est un signe particulièrement distinctif du mode de production capitaliste, et d'une manière ou d'une autre, à chaque stade de son évolution historique, il s'est imposé comme un situation inhérente à la condition ouvrière. Lors de l'apparition du capitalisme, au sortir du mode de production féodal, lors de son développement ultérieur avec la réalisation du marché mondial, durant toute la période de décadence, époque des grandes crises, guerres mondiales et révolutions, que nous vivons.
Mais, si le chômage est inhérent à la condition ouvrière où le travail prend la forme de marchandise "force de travail" qui s'achète et se vend en échange d'un salaire selon les conditions du marché, on ne peut tirer de cette vérité générale, que de tout temps, le chômage a toujours eu la même signification, le même impact et les mêmes déterminations sur la classe ouvrière, sa conscience et sa lutte.
Le chômage des centaines de milliers de sans-travail dans toute l'Europe de la fin du féodalisme, où serfs, paysans, artisans étaient arrachés à leurs conditions, moyens de travail, de subsistances, avec lesquels ils faisaient corps, par l'avènement et le développement du machinisme et de la manufacture, n'a déjà pas la même signification et le même impact que le chômage qui s'impose lors de la marche en avant du machinisme et de la grande industrie. Dans cette période historique qui s'étend grossièrement de 1830 à 1900, on assiste à un chômage permanent certes, toujours- alimenté par la paupérisation de paysans et d'artisans, mais à une échelle bien plus limitée qu'au début du 19ème siècle, ainsi qu'à un chômage limité à certaines corporations ou branches d'industrie, dû aux crises passagères et ponctuelles limitées à ces branches d'industrie.
Avec la première guerre mondiale, la crise généralisée et permanente de l'ensemble du mode de production capitaliste, qui n'épargne aucun pays, aucune corporation et branche d'industrie détermine un chômage d'u ne autre signification et d'une autre sorte au sein de la population ouvrière. Ce chômage dont les caractéristiques sont propres à notre période de décadence est bien plus différent des autres formes antérieures du chômage que celles-ci ne le sont entre elles.
Le chômage enfanté par les secousses de la crise mondiale du capital tend premièrement à devenir permanent. Mis à part les périodes de guerre où les ouvriers, comme le reste de la population, sont occupés soit à s'entretuer ou à produire les armes nécessaires aux massacres, le chômage massif domine la condition ouvrière : de 1920 à 1940, 20 ans de chômage généralisé dans tous les pays industrialisés. L'immense boucherie de la seconde guerre mondiale avec ses 50 millions de morts et plus, et l'occupation des bras qui restaient valides après la guerre pendant la reconstruction d'un monde ravagé par les destructions, ne permettra de repousser la question du chômage que pour une dizaine d'années, ou guère plus. Dès la fin des années 60, le chômage, comme problème de fond,fait sa réapparition et il ne sera contenu et cantonné à la jeunesse pendant les années 70 que par le faux fuyant économique des politiques inflationnistes d'endettement généralisé des années d'illusions. Aujourd'hui, la crise reprend tous ses droits, s'impose, et le chômage à nouveau, explose littéralement.
C'est dans ces conditions que la question du chômage acquiert ne signification différente pour le développement de la conscience de classe et la lutte de classe, signification très différente de celle qui dominait au siècle dernier.
Au siècle passé, la conscience que pouvait déterminer le chômage au sein de la classe ouvrière ne pouvait qu'être très limitée. Jamais, à cette époque, le chômage n'apparaît comme une situation irréversible. Le chômage est extrêmement cruel pour la classe ouvrière lorsqu'elle est atteinte, mais l'époque, est, elle, totalement différente. Le capitalisme bouleverse constamment les conditions de la production; dans chaque crise, il tire une énergie nouvelle, en sort renforcé pour continuer sa marche triomphale à travers le monde. Une grande partie des chômeurs, ou anciens paysans sont aspirés dans le sillage de cette marche triomphale. C'est l'époque de la colonisation où des centaines de millions de personnes émigrent vers des continents gigantesques : Amérique, Afrique, Asie... A côté de l'émigration massive de populations d'Europe, l'origine sociale des chômeurs, serfs, paysans, ou artisans permet aussi souvent à la bourgeoisie de se servir de cette masse de chômeurs pour faire une pression générale sur l'ensemble de la classe ouvrière, ses conditions de travail et d'existence et ses salaires, voire les employer comme "jaunes" et briseurs de grèves. Même s'il s'agissait du chômage produit par une crise dans une branche d'industrie déterminée, le cloisonnement, sinon l'opposition qui régnait entre les différentes branches d'industrie, rendait l'impact du chômage sur toute la classe ouvrière et sa conscience très limité. De même, quand il s'agissait du "volant de chômage" ou "armée de réserve industrielle", la pression sur les salaires qui en résultait, ne permettait pas plus à cette forme de jouer un rôle particulièrement positif dans l'unification et le développement de la conscience de classe de la classe ouvrière. Mis à part la grande crise de 1847 qui n'épargna aucune catégorie ou secteur ouvrier, et le mouvement ludiste durant les tous premiers développements du machinisme, les chômeurs et le chômage en général, ne furent pas amenés à jouer un rôle particulier dans l'avancée de la lutte de classe du siècle dernier.
Cette situation change radicalement avec l'ouverture et la course effrénée de la décadence du capitalisme. Les chômeurs, dans leur immense majorité, ne sont plus des anciens paysans ou artisans, mais des ouvriers ou employés, qui, depuis des générations étaient insérés dans la production industrielle. Ce n'est plus une catégorie ou une corporation particulière, où les ouvriers sont victimes du chômage, mais toutes, comme c'est le cas pour toutes les villes, régions, pays. Ce chômage n'est plus conjoncturel, mais irréversible, sans avenir. Ce chômage qui concentre toutes les caractéristiques de la décadence du capitalisme et est une de ses principales manifestations ne peut déterminer dans la classe ouvrière que des réactions qualitativement différentes de celles du siècle dernier.
Ainsi, dès l'après première guerre mondiale, ce sera en Allemagne par exemple, les chômeurs qui souvent seront à l'avant-garde du mouvement révolutionnaire. Alors que les syndicats du siècle dernier ne regroupaient pas de chômeurs dans leurs rangs, toujours en Allemagne, où, avec la Russie, la classe ouvrière était l'avancée de la révolution internationale, on trouve dans les organisations révolutionnaires une forte proportion de chômeurs.
En pénétrant profondément et indistinctement toutes les couches de la classe ouvrière, le chômage détermine dans l'ensemble de la population ouvrière, une situation commune où toutes les barrières catégorielles, corporatistes, usinistes, locales, régionales, nationales, disparaissent pour ne laisser apparaître que ce que la classe ouvrière dans son ensemble a de commun -situation, condition, intérêts - effaçant ou mettant de côté toute spécificité face aux conditions et perspectives qu'impose la crise du capitalisme, situation où la classe ouvrière prend conscience "qu'on ne lui a pas fait un tort particulier, mais tous les torts". C'est ainsi que même en dehors de toute période de luttes ouvertes, le chômage généralisé qui se développe, en emportant comme des têtus de paille toutes les petites mesures par lesquelles la bourgeoisie et les Etats essaient de l'entraver, de le ralentir sans oser même espérer le stopper, tend à dissoudre rapidement tout esprit corporatiste inculqué et entretenu par les syndicats depuis des années.
Non seulement, le chômage tend à dissoudre tout esprit corporatiste, mais dans le même mouvement, il place l'ensemble de la classe ouvrière face à un problème de fond, qui réclame de manière on ne peut plus pressante, des solutions de fond impliquant toute la classe ouvrière.
Pour que la révolution sociale soit possible, Rosa Luxemburg déclarait déjà au début de ce siècle : ".il faut que le terrain social soit labouré de fond en comble, que ce qui est en bas apparaisse à la surface, que ce qui est en haut soit enfoui profondément..."
(Grève de masse, parti et syndicats. Editions Maspéro, page 1 13).
Et bien, ce travail là, nous pouvons constater que le chômage massif, généralisé, chronique et sans avenir, est en train de particulièrement contribuer à le réaliser. Et il n'y a rien de plus fort aujourd'hui que le développement du chômage pour enfouir profondément toutes les illusions passées, les séparations qui les ont couvées et faire remonter à la surface tout ce qui unit la classe ouvrière face à la crise généralisée du capitalisme.
LE CHOMAGE ET L'ILLUSION DU CAPITALISME D'ETAT
Nous avons ici défendu qu'à notre époque, le développement du chômage avait joué et jouera un rôle extrêmement important dans le développement de la conscience de classe et dans la lutte de classe en général. Dans l'introduction de cet article, nous disions aussi que, même dans une des plus noires périodes du mouvement ouvrier, les années 30, un des* derniers sursauts de la classe ouvrière/ avant d'être embrigadée dans la seconde guerre mondiale, avait eu pour base la lutte contre le chômage. Il faut constater qu'à cette époque, l'écrasement de toute perspective révolutionnaire avec la grande vague de contre-révolution et le travail d'embrigadement des partis qui avaient trahi la classe prolétarienne, ne pouvaient permettre à la classe ouvrière de dégager une perspective révolutionnaire, vouant ainsi toutes ses luttes à l'échec Ceci est le fond de la question.
Mais pour mieux cerner ce qui distingue notre époque au sein même de cette période de décadence, et en particulier, la différence avec les années 30, il faut prendre en considération l'immense développement du capitalisme d'Etat qui est venu accompagner et faciliter cet embrigadement de la classe ouvrière dans la guerre.
Pendant ces années qui précèdent la seconde guerre mondiale, les différents Etats nationaux engagent toutes les réserves économiques, s'endettent sans compter pour financer, sous l'égide de l'Etat tout puissant, grands travaux et armement massif, qui, à la veille de la guerre épongent en grande partie le chômage. Ainsi, aux USA par exemple :
"L'écart qui séparait à ce moment la production de la consommation fut attaqué de 3 côtés à la fois : 1° Contractant une masse de dettes sans cesse accrue, 1 'Etat exécute une série de vastes travaux publics (. . .)
2° L'Etat augmenta le- pouvoir d'achat des masses laborieuses ;
a) en introduisant le principe d'accords collectifs garantissant des salaires minimum et édictant des limitations de la durée du travail, tout en renforçant la position générale des organisations ouvrières et notamment du syndicalisme
b) en créant un système d'assurance contre le chômage et par d'autres mesures sociales destinées à empêcher une nouvel le réduction du niveau de vie des masses
3° De plus, l'Etat tenta, par une série de mesures telles que des limitations imposées à la production agricole et des subventions destinées à soutenir les prix agricoles, d'augmenter le revenu de la population rurale de façon à permettre à la majorité des exploitants de rejoindre le niveau de vie des classes moyennes urbaines" (F.Sternberg. "Le conflit du siècle", p.389).
Il ne faut d'autre part pas oublier que cette intervention des Etats s'accompagne en même temps d'un quadrillage et d'un encadrement de la population extrêmement poussé. Pour continuer avec l'exemple des USA, nous pouvons citer :
"Du fait des modifications décisives qui s'étaient opérées sous 1'égide du New-Deal dans la structure sociale américaine, la situation du syndicalisme changea du tout au tout. Le New-Deal encouragea en effet le mouvement syndical par tous les moyens ('...). Au cours d'un bref espace de temps qui va de 1933 à 1939, le nombre de syndiqués a fait plus que tripler. A la veille de la deuxième guerre mondiale, il y a plus de deux fois plus de cotisants qu'aux meilleurs moments d'avant la crise, bien plus que dans toute 1'histoire des USA" (Idem).
LA PERSPECTIVE DU CHOMAGE MASSIF
L'on ne peut saisir l'impact décisif du chômage sur la situation sociale des pays industrialisés si l'on n'a pas clairement pris conscience que celui-ci, loin d'être conjoncturel, est irréversible, pas plus d'ailleurs, si l'on ne comprend pas que celui-ci, loin d'être à son apogée, n'en est encore qu'à ses débuts. Avant de répondre à la question : est-ce que le chômage va continuer à se développer, et si oui, comment ? on peut déjà essayer de considérer quelles conditions devraient être réunies pour qu'il soit simplement maintenu à son niveau actuel. Même en comptant sur une reprise de l'économie mondiale qui aujourd'hui a fait long feu, l'OCDE, qui pourtant n'est jamais avare d'affirmations optimistes établissait dès 1983 dans son rapport sur les perspectives économiques :
"Pour maintenir le chômage à son' niveau actuel, en fonction de 1 'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de 18 à 20 millions d'emplois d'ici la fin de la décennie De plus, il faudrait encore 15 millions d 'emplois supplémentaires si l'on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit 19 mi liions de personnes sans travail
Cela reviendrait à créer 20 000 emplois par jour entre 1984 et 1989, alors qu 'après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, _les 24 pays membres n'en avaient dégagés que 11 500 respectivement" (Rapport OCDE 1983)
D'ores et déjà, tout retour en arrière se révèle donc impossible et si l'on fait le point sur la situation actuelle, on peut établir que :
"Ce sont déjà plus de 2,5 millions de chômeurs que recensent en France les statistiques officiel les, 2,7 en Espagne, 3,2 mi 11 ions en Grande-Bretagne, 2,5 millions en RFA, et dans- la première puissance économique du monde, les USA, 8,8 millions.C'est déjà 17,1% de la population active qui est au chômage aux Pays-Bas, 19,3% en Belgique, 25% au Portugal , suivant ces mêmes chiffres officiels' ("Manifeste sur le problème du chômage". R.I., mai 83).
Le résultat est donc là, simple, net et terriblement tangible. Le chômage représente à l'heure actuelle 10 à 12% en moyenne de la population active des pays industrialisés. Il est irréversible, et plus grave encore, la nouvelle récession qui s'annonce menace d'emporter avec elle, dans les mois et les prochaines années qui viennent, une masse encore plus considérable de personnes dans le tourbillon du chômage. Dans le dernier numéro de cette revue, nous notions déjà cette accélération :
"Avec le ralentissement de la reprise, ces derniers mois ont vu une relance du chômage : 600.000 chômeurs de plus pour la CEE en janvier, 300. 000 pour la seule RFA qui, avec cette progression, bat son record de 1953 avec 2,62 millions de chômeurs".
(Revue Internationale n°1. "Dollar, le roi est nu", p.7).
L'évolution du chômage est d'autant plus rapide, ses conséquences plus graves et profondes, qu'elle est de plus en plus alimentée directement par les licenciements. Quand le chômage se manifestait encore principalement par la difficulté de nouvelles générations à trouver un emploi, son évolution n'avait pas forcément pour corollaire une baisse du nombre de salariés en activité. Aujourd'hui, oui.
Cette augmentation croissante de la masse des chômeurs et son corollaire, la diminution de la population salariée, a pour conséquence directe la quasi-faillite de toutes les caisses d'assurance chômage. Un nombre plus grand d'allocations à verser et de moins en moins de cotisants rend tout système d'assurance ou de couverture sociale impossible. Les systèmes d'assurance chômage, dans la mesure où ils existent - ce qui n'est le cas que pour un petit nombre de pays- n'ont jamais été un cadeau de l'Etat, "une oeuvre sociale"; les allocations versées comme indemnités aux chômeurs temporaires sont une ponction sur les caisses alimentées par des cotisations obligatoires retirées directement aux salaires. Dans des situations où les taux de chômage sont peu élevés et les périodes d'inemploi courtes, un tel système peut même financièrement s'avérer "juteux" pour l'Etat qui le gère comme tout système d'assurance, mais il devient carrément impossible dans une situation de crise et de chômage massif. Forcément, dans de telles situations comme aujourd'hui, les cotisations augmentent sans cesse, les allocations sont réduites à peau de chagrin pour des périodes de plus en plus courtes, et les caisses sont constamment déficitaires avec un déficit croissant.
En conclusion de ce survol rapide sur les perspectives du chômage, nous pouvons affirmer :
- le chômage sera dans les mois et les années qui viennent de plus en plus massif, les chômeurs devenant la catégorie la plus importante et de loin de la population. La grande période de chômage qui s'ouvre devant nous et qui a commencé depuis longtemps par ce que l'on appelle le chômage des jeunes n'a rien de conjoncturel; elle est irrémédiable. Elle est la manifestation la plus directe et criante de la crise historique du capital, du salariat et de leurs rapports réciproques;
- tous les systèmes d'assurance, de couvertures diverses ne sont pas devant nous, mais derrière. Le capitalisme ne pouvant digérer un chômage massif, les chômeurs n'ont pas à attendre que l'Etat leur fasse de cadeau, ils n'auront que ce qu'ils gagneront. En effet, si le capital, même avec le concours, l'assistance et l'intervention massive de l'Etat, ne parvient plus dans le cadre de ses lois juridiques, économiques et sociales à assurer un lien entre les forces et moyens de production, les marchandises produites et les besoins de la société, face à ces besoins, ces moyens de production et de subsistance n'en continuent pas moins à exister, et par leur lutte, les chômeurs doivent et peuvent continuellement essayer de les arracher aux mains du capitalisme.
Au sein de la lutte générale du travail contre le capital, la lutte des chômeurs contre la situation qu'on leur impose exprime de façon limpide le fond, la nature et la perspective de la lutte ouvrière : l'assujettissement de toutes les richesses à la satisfaction des besoins de l'humanité, et cela, même si comme le disait K.Marx : " ces exigences révolutionnaires sont exprimées dans des formules maladroites". Cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où dans le chômage se trouve condensée et résumée toute la condition ouvrière. Situation où la classe ouvrière touche le fond de sa condition face à un monde dont l'anachronisme des lois éclate au grand jour avec cette immense surproduction qui n'engendre que misère, dégénérescence et mort alors qu'elle pourrait soulager et libérer l'humanité d'un immense fardeau.
C'est dans un tel contexte que les propagandes humanitaristes dans la bouche desquelles le mot "solidarité" prend le sens de "mendicité", où le geste prend les allures de l'assistance, révèlent leurs caractères caricaturalement réactionnaires.
LEUR SOLIDARITE ET LA NOTRE
L'exploitation de la notion de "solidarité" a des fins qui n'ont rien à voir ni avec les besoins des luttes ouvrières, et encore moins, avec la perspective d'émancipation de la classe ouvrière, n'est pas nouvelle. On l'a vu à l'oeuvre ces dernières années, dans le travail de cloisonnement corporatiste réalisé par les divers syndicats, et en particulier, dans la grève des mineurs, en Angleterre. Avec le développement du chômage, -ce dévoiement prend une forme caricaturale, ce qui a au moins l'avantage d'en éclairer toute la tartufferie et l'inefficacité.
Depuis que les systèmes d'assurance sociale manifestent leur faillite et leur incapacité à faire face ou tout au moins à cacher les aspects les plus criants de la condition de chômage, les appels à la solidarité "contre le fléau social" ne cessent plus. L'Etat, pour commencer, instaure de nouvelles cotisations sociales à prélever sur les salaires au nom bien sûr de "la solidarité", les organisations charitables en appellent au don, les syndicats, nouveaux ou anciens -quand ils ne se cantonnent pas aux slogans nationalistes du style "produisons allemand, français, etc..."-en appellent au "partage du travail".
Pour commencer, les nouvelles cotisations sociales ou l'augmentation des anciennes ne résoudront rien et ne peuvent avoir qu'un impact très limité sur la condition des chômeurs. Avec l'augmentation constante du chômage, l'augmentation de ces cotisations deviendrait une spirale sans fin, grevant d'autant les salaires sur lesquels vivent déjà souvent plusieurs personnes. De fait, ce ne sont plus des "cotisations", encore moins un "geste de solidarité", mais un impôt sur la crise du capitalisme qu'on prélève sur une population ouvrière qui en subit déjà largement les conséquences et assume la plus grande partie de la charge des chômeurs, car les chômeurs ne sont pas sur la planète Mars, mais dans les familles d'ouvriers ou d'employés. Quand ils sont seuls, alors leur situation devient rapidement invivable.
Quant aux dons et autres "gestes charitables", leur inefficacité par rapport à l'immensité du problème et des. besoins parle d'elle-même. Cette histoire de "solidarité" par la "charité" nous ramène plusieurs années en arrière, dans les années 30 :
"La société était engagée à résoudre ses problèmes locaux par un accroissement de leur travail de charité Aussi tardivement qu'en 1931, le président Hoover était d'avis que le maintien d'un esprit de mutuelle assistance par le don volontaire est d'une importance infinie pour l'avenir de 1'Amérique Aucune action gouvernementale, aucune doctrine économique ni projet ne peut remplacer cette responsabilité imposée par Dieu, de l'homme individuel ou de la femme envers leurs prochains'. (Adress on unemployement relief, 18 octobre 193 1 ).
Cependant, moins d'une année plus tard, 'la responsabilité imposée par Dieu' fut reconnue impotente. Les fonds de 1'Etat et de 1'aide locale étaient épuisés. La radicalisation des travailleurs tout autant que des masses progressaient rapidement : marche de la faim, manifestations spontanées de toutes sortes, et même des pillages devenaient de plus en plus fréquents". (Living Marxism. N°4, août 1938).
De toutes ces démarches qui en appellent à la solidarité pour faire face à la question du chômage, il nous reste à- considérer celle prônée plus spécifiquement par les syndicats, le fameux "Partage du travail". Cela fait d'ailleurs un sacré bout de temps que les syndicats, en particulier, ceux d'obédience social-démocrate, tentent de polariser l'attention de la classe ouvrière sur "la lutte pour les 35h". Au fond de l'idéologie syndicale qui prône ce "partage du travail", c'est une certaine vision de la crise actuelle que l'on retrouve. Dans leur travail idéologique, ces syndicats défendent le point de vue selon lequel la crise actuelle qui enfante un chômage massif n'est qu'une crise conjoncturelle, période charnière qui aboutirait à une nouvelle expansion de l'économie mondiale où les nouvelles technologies seraient peines. C'est dans cette perspective "rose" qu'ils demandent à la classe ouvrière d'accepter ce bouleversement et la préparation d'un avenir mythique.
Ces mots d'ordre de "partage du travail" ne sont pas si nouveaux que ça : dans les années 30 déjà, les IWW ([1] [881]) mettaient en avant des orientations d'action semblables :
"Les syndicats de chômeurs de 1'IWW avaient pour opinion que les secours ne pouvaient pas résoudre la question du chômage, et c'est pourquoi, il était nécessaire de renvoyer les sans-travail au travail, en raccourcissant la journée de travail pour tous les travailleurs à 4 heures. Leur politique était de faire le 'piquet de grève des industries' pour impressionner les ouvriers au travail" (Idem).
Autant dire tout de suite que de telles actions n'ont jamais abouti, même de manière insignifiante aux résultats recherchés. Au contraire, pour opposer une partie de la classe ouvrière à une autre, on ne peut rêver mieux. Et de fait, derrière toutes ces mascarades de solidarité, c'est fondamentalement, le seul but recherché. Toute la bourgeoisie et les différentes boutiques qui, par leurs idéologies et leurs actions s'y rattachent veulent bien considérer le problème des chômeurs dans la mesure où ceux-ci veulent bien être considérés comme des indigents et des assistés. Elles veulent bien prendre en compte une "nécessaire solidarité" dans la mesure où c'est la classe ouvrière qui paye.
Tous ces mots d'ordre sont d'ailleurs peu mobilisateurs et ne suscitent que méfiance quand ce n'est pas carrément le dégoût, et on le comprend aisément. Mais cet échec à mobiliser aujourd'hui la masse des chômeurs qui sont pourtant dans une situation dramatique est d'une certaine manière leur victoire. Une victoire sans éclat et panache peut-être, mais une victoire tout de même. Dans la situation actuelle, il vaut mieux pour l'Etat et les syndicats remporter de petites victoires en travaillant à la démobilisation générale que de tenter de grandes victoires dans de grands rassemblements, car les risques et les enjeux sont immenses. Avec les chômeurs, ces risques sont décuplés, car en dehors des usines et des bureaux, ils sont difficilement encadrables dans les structures syndicales traditionnelles et, face à la pression des besoins, la mollesse et les revendications syndicales traditionnelles peu adaptées.
Il est arrivé une fois dans l'histoire, où la bourgeoisie a fait l'erreur de rassembler la masse des chômeurs en croyant créer une armée facilement manipulable contre le reste de la classe ouvrière. Elle s'en est vite mordue les doigts et n'est pas prête de recommencer la même erreur. C'était en 1848 où comme le rapporte K.Marx :
"A côté de la garde mobile, le gouvernement décida de rassembler encore autour de lui une armée d'ouvriers industriels. Des centaines de mille d'ouvriers, jetés sur le pavé de la' crise et de la révolution, furent enrôlés par le ministre Marie dans les prétendus ateliers nationaux. Sous ce nom pompeux, se dissimulait seulement 1'occupation des ouvriers à des travaux de terrassement fastidieux, monotones et improductifs, pour un salaire de 23 sous Des workhouses anglais en plein air, voilà ce qu'étaient ces ateliers nationaux et rien de plus Le gouvernement provisoire croyait avoir formé avec ces ateliers une seconde armée prolétarienne contre les ouvriers eux-mêmes. Pour cette fois, la bourgeoisie se trompa au sujet des ateliers nationaux, comme les ouvriers se trompaient au sujet de la garde mobile Elle avait créé une armée pour 1'émeute" ("Lutte de classe en France. Ed.Sociales, p.81).
C'est ainsi que tout rassemblement des chômeurs dans des manifestai ions ou dans des comités est une force qui les contient toutes. Rassemblés massivement, les chômeurs sont directement amenés à prendre conscience de l'immensité du problème qu'ils représentent et de l'inanité de tous les discours syndicaux. Non seulement, les chômeurs en se mobilisant, prennent conscience de leur force, mais aussi des liens qui les unissent à toute la classe ouvrière dont ils ne forment pas une entité séparée.
De ce point de vue, il ne saurait y avoir plusieurs luttes différentes de la classe ouvrière. Depuis des années d'ailleurs, l'ensemble de la lutte de classe est essentiellement dominée par la lutte contre les licenciements. Depuis des années, la question du chômage est ainsi particulièrement présente comme détermination du combat. La seule différence aujourd'hui, c'est que les chômeurs menacent de rompre leur isolement et de ne pas accepter leur sort; cela veut-il dire qu'ils doivent mener un combat séparé de celui de l'ensemble de la classe ouvrière ? Sûrement pas. Si l'on se fonde sur l'expérience des luttes passées, on peut justement constater que les causes des défaites résidaient justement dans l'isolement corporatiste, régional, catégoriel dont les syndicats se sont faits les champions. Aujourd'hui, alors que la lutte ouvrière montre tous les signes d'un élargissement de son front social avec l'apparition de la lutte des chômeurs, alors que cet élargissement peut et doit contribuer à briser toutes les séparations qui jusqu'ici se sont révélées si néfastes pour l'ensemble de la classe ouvrière, nous devons combattre de toutes nos forces les nouvelles séparations, voire oppositions. Celles-là même utilisées par les syndicats pour mener à la défaite des luttes contre les licenciements hier, et qu'ils essaient encore d'introduire dans la lutte générale contre le chômage.
Si les chômeurs dans leurs luttes ne pouvaient compter sur la solidarité active des ouvriers encore au travail, alors ils seraient incapables de faire plier la bourgeoisie et l'Etat sur quoi que ce soit. Il en serait de même si les chômeurs d'une manière ou d'une autre, n'apportaient pas leur solidarité aux ouvriers actifs en lutte.
Cette extension de la lutte de classe qui est encore en germe, non seulement contient la possibilité de créer au sein de la société un rapport de force qui soit favorable à la classe ouvrière pour la défense de ses intérêts immédiats, mais de plus, de cette extension et unification de la classe ouvrière, dépend la possibilité de dégager une perspective qui déchire enfin l'horizon bouché de la crise historique du capitalisme.
Prénat[1] [882] "Industrial Workers of the World", organisation syndicaliste révolutionnaire"au début de ce siècle.
Questions théoriques:
- L'économie [90]
- Décadence [2]
Les communistes et la question nationale 3ème partie
- 3539 reads
Le débat pendant la vague révolutionnaire et les leçons pour aujourd'hui
Dans de précédents articles, nous avons examiné les débats qui se sont menés parmi les communistes au sujet des rapports entre la révolution prolétarienne et la question nationale :
- à la veille de la décadence capitaliste sur la question de savoir si les révolutionnaires devaient défendre "le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" (voir la Revue Internationale No 34) ;
- durant la première guerre mondiale, dans la Gauche de Zimmerwald, sur les implications des nouvelles conditions de la décadence pour le vieux "programme minimum" de la social-démocratie et de la nature de classe des guerres nationales (voir Revue Internationale No 37).
Dans ce troisième et dernier article, nous voulons examiner le moment qui a constitué le test le plus crucial pour le mouvement révolutionnaire : les événements historiques qui se sont déroulés à partir de la prise du pouvoir par le prolétariat russe en 1917 jusqu'au second congrès de l'Internationale Communiste en 1920 ; depuis les premiers pas optimistes dans le sens de la destruction du capitalisme jusqu'aux premiers signes de défaite des luttes prolétariennes et à la dégénérescence du mouvement en Russie.
C'est durant ces années que les erreurs des Bolcheviks sur la question de l'autodétermination des peuples furent pour la première fois mises en pratique et qu'à la recherche d'alliés, la nouvelle Internationale Communiste (I.C.) s'est engagée dans un cours opportuniste de soutien aux luttes de libération nationale dans les colonies. Si l'I.C. était encore une force révolutionnaire à cette époque, elle avait déjà fait les premiers pas fatals vers sa capitulation à la contre-révolution bourgeoise. Ceci met en relief la nécessité de faire aujourd'hui la critique de cette expérience prolétarienne afin d'éviter que de telles erreurs ne se répètent -question que bien peu arrivent à comprendre dans le milieu révolutionnaire actuel (voir l'article sur le "Bureau International pour le Parti Révolutionnaire" -B.I.P.R.-, dans la Revue Internationale No 41).
L'erreur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la pratique
L'établissement de la dictature du prolétariat en Russie en 1917 a posé concrètement la question : quelle classe dirige ? Face à la menace d'une extension à l'échelle mondiale du pouvoir des soviets, la bourgeoisie, quelles que fussent ses aspirations nationales, était confrontée à la nécessité de lutter pour sa survie en tant que classe. Même dans les recoins les plus arriérés du vieil empire tsariste, la question que posait l'Histoire était non pas la lutte pour des "droits démocratiques" ou l'achèvement de la révolution bourgeoise mais la confrontation des classes. Les mouvements nationalistes étaient devenus le jouet des puissances impérialistes dans leur lutte contre la menace prolétarienne.
Au milieu de cette guerre de classe, les Bolcheviks furent vite forcés d'accepter que derrière la reconnaissance du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" se trouvait la contre-révolution : dès 1917, l'Ukraine n'avait usé de son indépendance que pour s'allier à l'impérialisme français et se retourner contre le prolétariat. Comme nous l'avons déjà vu, il y avait dans le parti bolchevik, face à cette politique, une forte opposition menée par Boukharine et Piatakov ainsi que Dzerjinski, Lunacharsky et d'autres. En 1917, Piatakov avait presque porté le débat dans le parti en mettant en avant le slogan : "A bas toutes les frontières". Sous l'influence de Lénine, on était arrivé à un compromis ; l'autodétermination pour la classe ouvrière dans chaque pays. Mais ceci laissait telles quelles toutes les contradictions de cette politique. |
Le groupe autour de Piatakov qui était majoritaire dans le parti en Ukraine, s'opposa à ce compromis et appela au contraire à la centralisation de toutes les forces prolétariennes dans l'Internationale Communiste comme seule voie pour maintenir l'unité de la classe ouvrière contre la fragmentation nationale. À l'époque, Lénine ridiculisa les arguments des Bolcheviks de gauche ; mais après avoir vu la dégénérescence ultérieure de la révolution russe, leur insistance apparaît doublement valable. Quand Lénine dénonçait leur position comme étant du "chauvinisme Grand Russe", il révélait une vision nationale du rôle des révolutionnaires, alors que ceux-ci se placent du point de vue des intérêts de la révolution mondiale.
C'est dans les parties les plus développées de l'empire tsariste que les résultats désastreux de la politique des Bolcheviks ont été les plus clairs, et c'est là-dessus que Rosa Luxemburg a concentré ses attaques contre la mise en pratique du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" (écrits qui furent publiés après sa mort). En Pologne comme en Finlande, il y avait une bourgeoisie nationaliste développée, effrayée de toute révolution prolétarienne. Les deux pays ne se virent concéder l'indépendance que pour trouver un appui à leur existence auprès des deux puissances impérialistes. C'est sous le mot d'ordre du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" que la bourgeoisie de ces pays massacra ouvriers et communistes, dissolut les soviets et permit qu'une partie de son territoire serve de tremplin aux armées de l'impérialisme et de la réaction des Blancs.
Rosa Luxemburg y a vu une amère confirmation de ses polémiques d'avant-guerre contre Lénine :
- "Les bolcheviks sont partiellement responsables de ce que la défaite militaire ait abouti à l'effondrement et à la ruine en Russie. Les bolcheviks eux-mêmes ont considérablement aggravé les difficultés objectives de la situation par le mot d'ordre dont ils ont fait le fer de lance de leur politique, le "droit des nations à l'autodétermination" ou, plus exactement, par ce qui se cache, en fait, derrière cette phraséologie : la ruine de la Russie en tant qu'Etat...Défenseurs de l'indépendance nationale, même jusqu'au "séparatisme", Lénine et ses amis pensaient manifestement faire ainsi de la Finlande, de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie, des pays de la Baltique, du Caucase, etc. autant de fidèles alliés de la révolution russe. Mais nous avons assisté au spectacle inverse : l'une après l'autre, ces "nations" ont utilisé la liberté qu'on venait de leur offrir pour s'allier en ennemies mortelles de la révolution russe à l'impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection en Russie même le drapeau de la contre-révolution". (R. Luxemburg "La révolution russe" - Petite collection Maspéro, Rosa Luxemburg, Oeuvres II pp.71 et 73).
La mise en pratique du "droit des nations à l'autodétermination" après 1917 a mis en lumière la contradiction entre les intentions originelles de Lénine -l'affaiblissement de l'impérialisme- et les résultats, qui ont été la constitution de remparts contre la révolution prolétarienne vers lesquels la bourgeoisie a canalisé les luttes de la classe ouvrière à travers des guerres nationales et des massacres. Par conséquent, le bilan de cette expérience est strictement négatif.
LE PREMIER CONGRES DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE
La troisième Internationale (I.C.), dans l'invitation à son premier congrès en 1919, proclamait l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence... "une époque de désintégration et d'effondrement de tout le système capitaliste mondial". L'I.C. mettait en avant une claire perspective internationale pour la classe ouvrière : le système capitaliste dans son ensemble n'était plus progressif et devait être détruit par l'action de masse des ouvriers organisés en conseils ouvriers ou en soviets. La révolution mondiale qui avait commencé avec la prise du pouvoir politique par les soviets en Russie, montrait concrètement que la destruction de l'État capitaliste était immédiatement à l'ordre du jour.
Dans la première année de son existence, l'I.C. n'a pas fait spécifiquement référence au soutien aux luttes de libération nationale ni au "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes". Au contraire, elle posait clairement la nécessité de la lutte de classe internationale. L'I.C. était née au sommet de la vague révolutionnaire qui avait forcé la guerre impérialiste à s'arrêter et la bourgeoisie en guerre à s'unir contre la menace prolétarienne. La lutte de classe au coeur du capitalisme -en Allemagne, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, et en Amérique- a donné une énorme impulsion à l'Internationale dans la clarification des besoins de la révolution mondiale qui semblait alors au bord de la victoire, et pour cette raison, les principaux textes du premier congrès représentent sous bien des angles le zénith de la clarté de l'Internationale.
Le Manifeste de l'Internationale (adressé aux) prolétaires du monde entier donne une perspective très large, historique, a la question nationale, puisqu'il commence par la reconnaissance que "l'État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l'expansion des forces productives". ("Manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale Communiste," 1919-1923 - Fac-similé François Maspéro- p. 31)
Dans cette perspective, deux questions sont traitées :
- les petites nations opprimées d'Europe qui ne possédaient qu'une indépendance illusoire et avaient compté, avant la guerre, sur les antagonismes continuels entre puissances impérialistes. Ces nations avaient leurs propres prétentions impérialistes et s'appuyaient maintenant sur les garanties de l'impérialisme allié qui derrière le mot d'ordre du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" les opprimait et exerçait sa coercition sur elles : "Seule la révolution prolétarienne peut garantir aux petits peuples une existence libre, car elle libérera les forces productives de tous les pays des tenailles serrées par les États nationaux..." (Ibid, p. 32)
- les colonies qui avaient également été entraînées dans la guerre (impérialiste) pour combattre aux côtés de l'impérialisme. Ceci avait posé de façon aiguë leur rôle de fournisseurs de chair à canon des grandes puissances et avait mené à une série d'insurrections et de fermentation révolutionnaire en Inde, à Madagascar, en Indochine, etc. A nouveau, le Manifeste soulignait que : "L'affranchissement des colonies n'est concevable que s'il s'accomplit en même temps que celui de la classe ouvrière des métropoles. Les ouvriers et les paysans, non seulement de l'Annam, d'Algérie ou du Bengale mais encore de Perse et d'Arménie ne pourront jouir d'une existence indépendante que le jour où les ouvriers d'Angleterre et de France, après avoir renversé Lloyd George et Clemenceau, prendront entre leurs mains le pouvoir gouvernemental... Esclaves des colonies d'Afrique et d'Asie l'heure de la dictature prolétarienne en Europe sonnera pour vous comme l'heure de votre délivrance." (Ibid, p.34)
Le message de l'I.C. est clair. La libération des masses à travers le monde ne pourra avoir lieu qu'avec la victoire de la révolution prolétarienne dont la clé est entre les mains des ouvriers des pays centraux du capitalisme, grâce aux luttes des concentrations ouvrières les plus fortes et les plus expérimentées. Le chemin pour les masses des pays sous-développés se trouve dans l'union "sous le drapeau des soviets ouvriers, de la lutte révolutionnaire pour le pouvoir et la dictature du prolétariat, sous le drapeau de la troisième Internationale..." (Ibid, p. 34).
Ces brefs points, basés sur la reconnaissance de la décadence du capitalisme, brillent encore aujourd'hui comme des phares de clarté. Mais ils ne présentent guère de stratégie cohérente à suivre par le prolétariat et son parti dans une période révolutionnaire. Il était encore nécessaire de clarifier la question vitale de la nature de classe des luttes de libération nationale ainsi que de définir l'attitude de la classe ouvrière vis-à-vis des masses opprimées et des couches non-exploiteuses des pays sous-développés que le prolétariat devait mettre de son côté dans la lutte contre la bourgeoisie mondiale.
Ces questions furent traitées par le second congrès de l'I.C. en 1920. Mais si ce congrès, avec une plus grande participation et un débat plus profond, fit des avancées dans la concrétisation des leçons de la révolution russe et la nécessité d'une organisation centralisée et disciplinée des révolutionnaires, y apparurent également les premiers signes d'une régression par rapport à la clarté du premier congrès -les prémisses des tendances à l'opportunisme et au centrisme dans la jeune Internationale Communiste. Tout effort pour faire un bilan des travaux du second congrès doit commencer avec ces faiblesses qui se sont révélées fatales quand la vague révolutionnaire a reflué.
L'opportunisme a pu prendre racine dans les conditions d'isolement et d'épuisement du bastion russe. Déjà au moment du 1er congrès, la révolution en Allemagne avait reçu un sérieux coup avec le meurtre de Liebknecht, Luxemburg et de plus de 20 000 ouvriers. Mais l'Europe était embrasée par les luttes révolutionnaires qui menaçaient encore de renverser la bourgeoisie. Au moment où les délégués se rassemblaient pour le second congrès, le rapport de forces avait déjà commencé à pencher substantiellement en faveur de la bourgeoisie et les bolcheviks en Russie étaient obligés de penser en termes d'un long siège se prolongeant plutôt qu'à une défaite rapide du capitalisme mondial. Aussi, alors qu'au premier congrès on mettait l'accent sur l'imminence de la révolution en Europe de l'ouest et sur les énergies spontanées de la classe ouvrière, le second congrès soulignait :
- le problème de l'organisation du mouvement des soviets à travers le monde,
- la nécessité de construire la défense du bastion russe.
Minés par les terribles exigences de la famine et de la guerre civile, les bolcheviks se mirent à faire des compromis avec la clarté d'origine de l'I.C. en faveur d'alliances avec des éléments douteux, ou même tout à fait bourgeois parmi les débris de la seconde Internationale en faillite, afin de construire des "partis de masse" en Europe qui apporteraient un maximum d'aide au bastion russe. La recherche d'un soutien possible au sein des mouvements de luttes de libération nationale dans les pays sous-développés doit être considérée dans la même optique.
La couverture de ce cours opportuniste était la guerre contre l'aile gauche de l'Internationale, annoncée par Lénine dans sa fameuse brochure "La maladie infantile du communisme : le gauchisme". En fait, dans son discours d'ouverture du second congrès, Lénine soulignait toujours que "l'opportunisme est notre principal ennemi...En comparaison avec cette tâche, la correction des erreurs de la tendance 'de gauche' du communisme sera facile" (second congrès).
Cependant, dans une situation de reflux de la lutte de classe, cette tactique ne pouvait que laisser la porte plus grande ouverte à l'opportunisme tout en affaiblissant ses adversaires les plus intransigeants, l'aile gauche. Comme Pannekoek l'écrivit plus tard à l'anarchiste Muhsam : "Nous considérons que le congrès est coupable de s'être montré non pas intolérant mais bien trop tolérant. Nous ne reprochons pas aux chefs de la 3e Internationale de nous exclure ; nous les critiquons de chercher à inclure autant d'opportunistes que possible. Dans notre critique, nous ne sommes pas préoccupés par nous-mêmes, mais par les tactiques du communisme ; nous ne critiquons pas le fait secondaire que nous-mêmes soyons exclus de la communauté des communistes, mais bien le fait essentiel que la 3e Internationale suit en Europe occidentale une tactique à la fois erronée et désastreuse pour le prolétariat". ( « Die Aktion », 19 mars 1921)
Ceci s'est avéré également correct en ce qui concerne la position de l'I.C. sur les luttes de libération nationale.
Le second congrès : "l'opportunisme est notre ennemi principal" (Lénine dans son discours introductif)
Les Thèses sur la question nationale et coloniale adoptées au second congrès révèlent avant tout une tentative peu aisée de concilier une position internationaliste de principe et de dénonciation de la bourgeoisie, avec un soutien direct à ce qui est appelé des mouvements "révolutionnaires nationaux" dans les pays arriérés et les colonies :
- "Conformément à son but essentiel -la lutte contre la démocratie bourgeoise, dont il s'agit de démasquer l'hypocrisie- le Parti communiste, interprète conscient du prolétariat en lutte contre le joug de la bourgeoisie, doit considérer comme formant la clef de voûte de la question nationale, non des principes abstraits et formels, mais :
1. - une notion claire des circonstances historiques et économiques ; 2. - la dissociation précise des intérêts des classes opprimées, des travailleurs, des exploités, par rapport à la conception générale des soi-disant intérêts nationaux, qui signifient en réalité ceux des classes dominantes ; 3. - la division tout aussi nette et précise des nations opprimées, dépendantes, protégées, -et oppressives et exploiteuses, jouissant de tous les droits, contrairement à l'hypocrisie bourgeoise et démocratique qui dissimule, avec soin, l'asservissement (propre à l'époque du capital financier de l'impérialisme) par la puissance financière et colonisatrice, de l'immense majorité des populations du globe à une minorité de riches pays capitalistes."(Ibid, p.57)
Cette thèse établit la primauté de la lutte contre la démocratie bourgeoise pour le Parti communiste, point réitéré dans bien d'autres textes de l'I.C. et c'était crucial pour une approche marxiste. Le second point d'importance est le rejet de l'"intérêt national" qui n'appartient qu'à la bourgeoisie. Comme le Manifeste Communiste l'avait proclamé avec la plus grande clarté 70 ans auparavant, les ouvriers n'ont pas de patrie à défendre. L'antagonisme fondamental dans la société capitaliste est la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat qui seul peut offrir une dynamique révolutionnaire de destruction du capitalisme et pour la construction du communisme, et toute tentative pour voiler cette opposition d'intérêts historiques, qu'elle soit consciente ou non, défend les intérêts de la classe dominante.
C'est dans ce sens que l'on doit comprendre le troisième point dans cette deuxième thèse qui est bien plus vague et en reste à une simple description de la situation de l'impérialisme mondial dans lequel la majorité des pays sous-développés était l'objet d'un impitoyable pillage par une minorité de pays hautement développés. Même dans les "nations opprimées", il n'y avait pas d'"intérêt national" à défendre pour le prolétariat. La lutte contre le patriotisme était un principe fondamental du mouvement prolétarien qui ne pouvait être mis en causé et, plus loin, les thèses insistent sur l'importance primordiale de la lutte de classe : "il résulte de ce qui précède que la pierre angulaire de la politique de l'Internationale Communiste dans les questions coloniale et nationale, doit être le rapprochement des prolétaires et des travailleurs de toutes les nations et de tous les pays pour la lutte commune contre les possédants et la bourgeoisie." (Ibid. p.57)
Cependant, il y avait une ambiguïté dans cette insistance sur la division entre nations oppressives et opprimées, une ambiguïté qui a été exploitée par la suite pour tenter de justifier une politique du prolétariat apportant son soutien direct aux luttes de libération nationale des pays sous-développés dans le but d'"affaiblir" l'impérialisme. Ainsi, tandis qu'il était nécessaire pour les partis communistes de "démontrer sans cesse que le gouvernement des soviets seul peut réaliser l'égalité des nationalités en unissant les prolétaires d'abord, l'ensemble des travailleurs ensuite, dans la lutte contre la bourgeoisie."
Sur la même lancée, il était établi qu'il était nécessaire d'assurer "un concours direct par l'intermédiaire du Parti communiste, à tous les mouvements révolutionnaires des pays dépendants ou lésés dans leurs droits." (Ibid, 9ème thèse, p. 58)
Il y a une ambiguïté introduite ici. Quelle est exactement la nature de classe de ces "mouvements révolutionnaires"? Ce n'est pas une référence au milieu politique du prolétariat embryonnaire des pays sous-développés. Le même malaise dans les termes traverse toutes les thèses qui parfois parlent de mouvements "révolutionnaires de libération", parfois de mouvements de "libération nationale". En plus, la forme concrète que devait prendre ce soutien direct, était laissée aux décisions de chaque Parti communiste là où ils existaient.
Il y a au moins la reconnaissance dans la même thèse des dangers potentiels d'un tel soutien car elle avertit que : "Il est nécessaire de combattre énergiquement les tentatives faites par des mouvements émancipateurs qui ne sont en réalité ni communistes, ni révolutionnaires pour arborer les couleurs communistes. L'Internationale Communiste ne doit soutenir les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, qu'à la condition que les éléments des futurs partis communistes soient groupés et instruits de leurs tâches particulières , c'est-à-dire, de leur mission de combattre le mouvement bourgeois et démocratique. L'I.C. doit entrer en relations temporaires et former aussi des alliances avec les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés sans toutefois jamais fusionner avec eux et en conservant toujours le caractère indépendant de mouvement prolétarien même dans sa forme embryonnaire." (Ibid, thèse 11, p.58)
Ici concrètement la question est de savoir si les luttes de libération nationale dans les colonies avaient encore un caractère progressif. Il n'y avait pas encore une clarté sans équivoque sur le fait que l'époque des révolutions démocratiques bourgeoises s'était définitivement close pour toute l'Afrique, l'Asie et l'Orient. Même les communistes qui en Europe occidentale s'étaient opposés durant la guerre au slogan de "auto-détermination", faisaient une exception pour les colonies. L'expérience du prolétariat n'avait pas encore clairement établi que même dans les coins les plus reculés du globe, la période d'ascendance du capital avait pris fin, et que même dans les colonies, la bourgeoisie ne pouvait plus survivre qu'en se tournant contre "son" prolétariat.
Mais la plus sérieuse faiblesse du second congrès fut de ne pas débattre ouvertement de la question, en particulier quand l’orientation de beaucoup de contributions de communistes des pays sous-développés tendait à rejeter tout soutien à la bourgeoisie, même dans les colonies.
Dans la Commission sur la question nationale et coloniale, il y eut un débat autour des "thèses supplémentaires" développées par le communiste des Indes, M.N. Roy qui, tout en partageant beaucoup de points de vue avec Lénine et la majorité de l'I.C, mettait en lumière la contradiction croissante entre les mouvements bourgeois nationalistes qui poursuivaient une politique d'indépendance tout en préservant l'ordre capitaliste, et les intérêts des petits paysans. Roy voyait comme la plus importante tâche de l'I.C. : "la formation de partis communistes qui organisent les ouvriers et les paysans et les conduisent à la révolution et à l'établissement de la République soviétiste.(...) Ainsi, les masses des pays arriérés, conduites par le prolétariat conscient des pays capitalistes développés, arriveront au communisme sans passer par les différents stades du développement capitaliste". (Thèses supplémentaires sur la question nationale et coloniale, thèses 7 et 9, p.60)
Ceci impliquait une lutte contre la domination des mouvements bourgeois nationalistes. Pour soutenir ses thèses, Roy soulignait l'industrialisation rapide de colonies comme l'Inde, l'Égypte, les Indes occidentales néerlandaises et la Chine et la croissance conséquente du prolétariat ; en Inde il y avait eu d'énormes vagues de grèves et le développement d'un mouvement parmi les masses exploitées en dehors du contrôle des nationalistes.
Le débat dans la commission portait sur le principe pour l'I.C. de soutenir des mouvements nationalistes bourgeois dans les pays arriérés. Il y eut une tentative vers la compréhension que la bourgeoisie impérialiste encourageait activement de tels mouvements pour ses propres buts réactionnaires, comme Lénine le reconnaît dans son discours d'introduction du congrès : "Une certaine compréhension mutuelle est apparue entre la bourgeoisie des pays exploiteurs et celle des colonies, de sorte que très souvent, peut-être même dans la plupart des cas, la bourgeoisie des pays opprimés tout en soutenant les mouvements nationaux, combat néanmoins tous les mouvements révolutionnaires et les classes révolutionnaires, en accord à un certain niveau avec la bourgeoisie impérialiste, c'est-à-dire avec elle." (Le second congrès -souligné par nous)
Mais la "solution" à la divergence dans la Commission avec laquelle Roy fut d'accord, fut d'adopter les deux types de thèses et de remplacer "bourgeois démocratique" par "national-révolutionnaire" : "La question à ce sujet, c'est qu'en tant que communistes nous ne soutiendrons les mouvements bourgeois de libération dans les pays coloniaux que s'ils sont réellement révolutionnaires et si leurs représentants ne s'opposent pas à entraîner et organiser la paysannerie de façon révolutionnaire. Si ce n'est pas le cas, alors les communistes ont le devoir de lutter contre la bourgeoisie réformiste" (Ibid. souligné par nous).
Étant donné le grand malaise dans l'I.C. pour apporter son soutien à des mouvements nationalistes, c'était une façon claire d'esquiver le problème ; c'est à dire du centrisme. Le changement des mots n'avait en réalité aucun contenu et ne faisait qu'obscurcir l'alternative historique posée par l'entrée du capitalisme dans son époque de décadence : soit la lutte de classe internationale contre l'intérêt national de la bourgeoisie, soit la subordination de la lutte de classe à la bourgeoisie et à ses mouvements nationalistes contre-révolutionnaires. L'acceptation de la possibilité d'un soutien aux luttes de libération 'nationale dans les pays sous-développés par la majorité centriste de l'I.C. a ouvert le chemin vers des formes d'opportunisme plus ouvertes.
Le congrès de Bakou et les conséquences de l'opportunisme
Cette tendance opportuniste se renforça après le 2nd congrès. Immédiatement après, un congrès des Peuples d'Orient se tenait à Bakou où les chefs de l'I.C. réaffirmèrent leur soutien aux mouvements bourgeois nationalistes et défendirent même un appel à une "guerre sainte" contre l'impérialisme britannique.
Les politiques défendues par le parti mondial du prolétariat étaient de plus en plus dictées par les besoins contingents de la défense de la République Soviétique plutôt que les intérêts de la révolution mondiale. Le second congrès avait établi cela comme axe central de l'I.C. Le congrès de Bakou suivit cet axe, s'adressant en particulier aux minorités nationales des pays voisins de la République Soviétique assiégée où l'impérialisme britannique menaçait de renforcer son influence et donc de servir de tremplin à une intervention armée contre le bastion russe.
Les beaux discours du congrès ainsi que les déclarations de solidarité entre le prolétariat européen et les paysans de l'Orient malgré beaucoup de choses correctes sur la nécessité des soviets et de la révolution, ne suffisaient pas à cacher le cours opportuniste vers un soutien sans discrimination aux mouvements nationalistes : "Nous faisons appel, camarades, aux sentiments guerriers qui animèrent les peuples d'Orient dans le passé, quand ces peuples, conduits par leurs grands conquérants, avancèrent sur l'Europe. Nous savons, camarades, que nos ennemis vont dire que nous appelons à la mémoire de Genghis Khan et à celle des grands califes conquérants de l'Islam. Mais nous sommes convaincus qu'hier (dans le congrès -NdlR) vous avez sorti couteaux et revolvers non dans un but de conquête, non pour transformer l'Europe en cimetière. Vous les avez brandis, avec les ouvriers du monde entier, dans le but de créer une civilisation nouvelle, celle de l'ouvrier libre." (Radek, cité dans Le Congrès des Peuples d'orient).
Le Manifeste adopté par le congrès concluait sur une injonction aux peuples de l'Est à se joindre "à la première réelle guerre sainte, sous la bannière rouge de l'Internationale Communiste" ; plus spécifiquement, une croisade contre "l'ennemi commun, l'impérialisme britannique."
Déjà à l'époque, il y eut des réactions à ces tentatives éhontées de réconcilier le nationalisme réactionnaire avec l'internationalisme prolétarien. Lénine lui-même mettait en garde contre le fait de "peindre le nationalisme en rouge". De façon significative, Roy critiqua le congrès avant qu'il se tînt et refusa d'assister à ce qu'il qualifiait de "cirque de Zinoviev", tandis que John Reed, le communiste de gauche américain, faisait également des objections amères à "cette démagogie et cette parade".
Cependant, de telles réponses ne s'adressaient pas aux racines du cours opportuniste qui était suivi, mais restaient au contraire sur un terrain centriste de conciliation avec des expressions plus ouvertes d'opportunisme, se cachant derrière les thèses du second congrès ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a couvert une multitude de manquements dans le mouvement révolutionnaire.
Déjà en 1920, ce cours opportuniste avait pour implication un soutien direct au mouvement nationaliste bourgeois de Pasha Kemal en Turquie bien qu'à cette époque Kemal ait apporté son soutien au pouvoir religieux du sultan. Il était loin de la politique de l'Internationale, comme le notait Zinoviev, mais "en même temps nous disons que nous sommes prêts à aider toute lutte révolutionnaire contre le gouvernement britannique" (Congrès des Peuples d'Orient).
L'année suivante, le leader de cette "lutte révolutionnaire" fit exécuter les chefs du parti communiste de Turquie. Malgré cela, les Bolcheviks et l'I.C. continuèrent à voir des "potentialités révolutionnaires" dans ce mouvement nationaliste jusqu'à ce que Kemal fasse alliance avec l'Entente en 1923, choisissant d'ignorer le massacre des ouvriers et des communistes afin de s'allier un pays stratégiquement important, aux frontières de la Russie.
Les politiques de l'I.C. en Perse et en Extrême-Orient eurent les mêmes résultats désastreux, montrant que Kemal n'était pas un "accident", mais simplement l'expression de la nouvelle époque de décadence du capitalisme dans laquelle le nationalisme et la révolution prolétarienne sont tout à fait irréconciliables.
Les résultats de tout cet opportunisme furent fatals pour le mouvement ouvrier. Avec la révolution mondiale qui s'enfonçait dans une défaite de plus en plus profonde et le prolétariat en Russie épuisé et décimé par la famine et la guerre civile, l'I.C. devint de plus en plus l'instrument de la politique extérieure des bolcheviks qui se trouvaient eux-mêmes dans le rôle d'administrateurs du capital russe. D'erreur très sérieuse dans le mouvement ouvrier, la politique de soutien aux luttes de libération nationale s'était transformée à la fin des années 20 en stratégie impérialiste d'une puissance capitaliste.
Un moment décisif dans le processus d'involution fut la politique de l'I.C. de soutien aux nationalistes violemment anti-ouvriers du Kuomingtang en Chine qui mena, en 1927, à la trahison et au massacre de l'insurrection des ouvriers de Shanghai. De tels actes de trahison ouverte démontrèrent que la fraction stalinienne qui avait entre-temps acquis une domination presque complète de l'I.C. et de ses partis, n'était plus un courant opportuniste dans le mouvement ouvrier mais une expression directe de la contre-révolution capitaliste.
Mais c'est néanmoins un fait que les racines de cette politique résident dans des erreurs et des faiblesses au sein du mouvement ouvrier et que c'est le devoir des communistes d'exposer ces racines aujourd'hui afin de mieux s'armer contre le processus de dégénérescence, parce que :"Le stalinisme ne tombe pas du ciel et ne surgit pas du néant. Et s'il est absurde de jeter l'enfant avec l'eau sale de la baignoire, de condamner l'Internationale Communiste parce qu'en son sein a pu se développer et triompher le stalinisme (...) il n'est pas moins absurde de prétendre que l'eau de la baignoire a toujours été absolument pure et parfaitement limpide, de présenter l'histoire de 1' 'Internationale Communiste' divisée en deux périodes, dont l'une, la première, serait du cristal pur, révolutionnaire, sans la moindre tâche, sans défaillance aucune et brusquement - interrompue par l'explosion de la contre-révolution. Ces imageries d'un paradis bienheureux et d'un horrible enfer sans aucun lien entre eux, n'a rien à voir avec un mouvement réel, telle l'histoire du mouvement communiste où la continuité se fait au travers de profondes ruptures et où les futures ruptures ont leurs germes dans le processus de la continuité." ("Introduction aux textes de la Gauche mexicaine, sur la question nationale" -Revue Internationale N°20, p.24, 25).
Le second congrès a mis en lumière les dangers pour le mouvement ouvrier de l'opportunisme et du centrisme dans ses propres rangs; et si l'opportunisme ne réussit finalement à triompher que dans des conditions de profond reflux de la lutte de classe internationale et d'isolement du bastion russe, c'est d'abord dans toutes les vacillations et les hésitations du mouvement révolutionnaire qu'il a pris racine, mettant à profit tous les efforts pleins de "bonnes intentions", pour aplanir les différences avec des mots bien tournés plutôt que l'honnêteté dans la confrontation de sérieuses divergences.
Ce sont ces caractéristiques typiques du centrisme qui animent clairement le communiste de gauche hollandais Sneevliet (Maring) dans le second congrès où apparemment, c'est lui qui a résolu le problème des divergences entre les thèses de Lénine et celles de Roy en proposant, en tant que secrétaire de la commission sur la question nationale et coloniale que le congrès adopte les deux. En fait Sneevliet était d'accord avec Lénine sur la nécessité de faire des alliances temporaires avec des mouvements nationalistes bourgeois. Dans la pratique, c'est ce point de vue qui a dominé la politique de l'I.C. et non le rejet préconisé par Roy, de telles alliances.
Sneevliet fut désigné par le Comité Exécutif de l'I.C. pour aller en Chine en 1921 comme représentant de l'Extrême-Orient. Il y fut convaincu que le Kuoming-tang nationaliste chinois avait un "potentiel révolutionnaire" et écrivit dans l'organe officiel de l'I.C. : "Si nous, communistes, qui tentons d'établir des liens avec les ouvriers du Nord de la Chine, voulons réussir, nous devons prendre soin de maintenir des rapports fraternels avec les nationalistes. Les thèses du second congrès doivent être appliquées à la Chine par l'offre de notre soutien actif aux éléments nationalistes du sud (c'est-à-dire le Kuominqtanq). Notre tâche est de maintenir les éléments nationalistes révolutionnaires à nos côtés et d'entraîner tout le mouvement à gauche." (Kommunistische Internationale, 13 septembre 1922)
Cinq ans après, ces mêmes "éléments révolutionnaires" décapitaient ouvriers et communistes dans les rues de Shangaï dans une orgie de massacres.
Il est important de souligner que Sneevliet n'était qu'une expression individuelle du danger de centrisme et d'opportunisme auquel le mouvement révolutionnaire était confronté. Son point de vue est partagé par la majorité de l'I.C.
Il était partagé également, dans une mesure plus ou moins grande, même par les communistes de gauche qui ne réussirent pas à défendre clairement leurs positions. Ceux qui, comme Boukharine et Radek, s'étaient opposés au slogan du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" semblaient maintenant accepter les vues de la majorité, tandis que la gauche italienne autour de Bordiga et de la Fraction Communiste Abstentionniste, bien qu'opposée à la tactique opportuniste du "parlementarisme révolutionnaire", soutenait pleinement les thèses de Lénine. La gauche allemande, basant sa position sur celle de Rosa Luxemburg, était dans la meilleure position dans l'I.C. parmi toutes les fractions, pour faire une intervention de principe déterminée contre le soutien aux luttes de libération nationale, mais les délégués du K.A.P.D., dont Rühle, ne participèrent pas au débat, et c'était dû, en partie du moins, à leurs préjugés conseillistes. Les acquis théoriques des Gauches d'Europe occidentale issus des débats dans la Gauche de Zimmerwald pendant la guerre, ne furent pas concrétisés dans le second congrès. C'est seulement avec la défaite de la vague révolutionnaire à la fin des années 20 que les quelques fractions de gauche ayant survécu, en particulier la Gauche italienne autour de la revue Bilan, furent capables de conclure que le prolétariat ne pouvait apporter aucun soutien aux mouvements nationalistes, même dans les colonies. Pour Bilan le massacre de Chine 1927 prouvait que "Les thèses de Lénine au second congrès doivent être complétées en changeant radicalement leur contenu... le prolétariat indigène ne peut devenir le protagoniste d'une lutte anti-impérialiste qu'en se rattachant au prolétariat international " (Bilan N°16, février 1935). Ce sont la Gauche italienne et, plus tard, les Gauches du Mexique et de France qui furent finalement capables de faire une synthèse supérieure des travaux de Rosa Luxemburg sur l'impérialisme et de l'expérience de la vague révolutionnaire de 1917-23.
Les leçons pour le présent
Ces erreurs de l'I.C. ne peuvent absolument pas servir d'excuse pour les révolutionnaires d'aujourd'hui. Il y a longtemps que les staliniens sont passés dans le camp de la contre-révolution, y emportant l'I.C. avec eux. Pour les trotskystes la "possibilité" de soutien aux luttes nationalistes dans les colonies se transforma en soutien inconditionnel, et sur ce chemin ils finirent par participer à la seconde guerre impérialiste mondiale.
Dans le camp prolétarien, les bordiguistes de la Gauche italienne dégénérescente ont inventé la théorie des aires géographiques selon laquelle, pour la vaste majorité de la population mondiale dans les pays sous-développés, la "révolution démocratique-bourgeoise anti-impérialiste" était encore « à l'ordre du jour». Les bordiguistes, en figeant chaque point et chaque virgule des thèses du second congrès, ont pris la relève de l'opportunisme et du centrisme de l'I.C. La preuve des dangers contenus dans les tentatives d'appliquer des politiques impossibles dans la décadence du capitalisme, c'est la désintégration à laquelle arriva le Parti communiste international (Programma comunista)[1] en 1981 après avoir été complètement ronge par l'opportunisme vis-à-vis des divers mouvements nationalistes (voir Revue Internationale No 32) ce qui nous amène finalement aux "bordiguistes embarrassés" du Parti communiste internationaliste (Battaglia Comunista)[2], maintenant partiellement regroupes avec la Communist Workers Organisation[3] -voir l'article sur le B.I.P.R.[4], Revue Internationale N°40 et 41). En tant que groupe du milieu politique, Battaglia défend une position contre les luttes de libération nationale dans la décadence, mais il montre une singulière difficulté à rompre définitivement avec l'opportunisme et le centrisme de l'I.C. sur cette question et d'autres questions vitales. Par exemple, dans son texte préparatoire à la deuxième conférence des groupes de la Gauche communiste en 1978, B.C. n'a pas réussi à faire une quelconque critique des positions de la 2e Internationale, ou de la pratique de l'I.C, préférant par contre défendre sa position en citant Lénine en 1916 dans sa polémique contre Rosa Luxemburg ! La vision de B.C. d'un futur parti "transformant des mouvements de libération nationale en révolution prolétarienne" réintroduit le danger de l'opportunisme par la fenêtre et l'a déjà amené, avec la C.W.O., à un flirt avec le groupe nationaliste iranien, l'U.C.M. (maintenant "Parti Communiste d'Iran" -un groupe maoïste). Ces rapports ont été justifiés par la nécessité d'"aider de nouveaux militants à s'orienter", venant d'un pays "qui n'a aucune tradition, ni histoire communiste, un pays sous-développé" (Document présenté par B.C. à une réunion publique à Naples en juillet 1983).
Cette attitude paternaliste n'est pas seulement une excuse pour la pire forme d'opportunisme, c'est une insulte au mouvement communiste dans les pays sous-développés, un mouvement qui, malgré les timides excuses de Battaglia, a une histoire riche et fière d'opposition de principe aux luttes nationalistes bourgeoises. C'est une insulte au militant du Parti communiste perse qui, au second congrès de l'I.C., avertissait que : "Si l'on doit tenter de procéder conformément aux thèses dans des pays qui ont déjà dix années d'expérience ou plus, ou dans ceux où le mouvement a déjà eu le pouvoir, cela voudrait dire jeter les masses dans les bras de la contre-révolution. La tâche est de créer et de maintenir un mouvement purement bourgeois-démocratique." (Sultan Zadeh, cité dans Le second congrès de l'I.C.)
C'est une insulte à la position du communiste indien Roy (qui était en réalité délégué du Parti Communiste mexicain). C'est une insulte à ceux du jeune Parti communiste chinois comme Chang Kuo Tao qui s'est opposé à la politique officielle de l'I.C. d'entrisme dans le Kuomingtang nationaliste.
Gorter parla une fois du programme communiste qui devait être "dur comme l'acier, clair comme la glace". Avec les prises de position opaques et malléables à l'infini de Battaglia Comunista, nous revenons sur le terrain du second congrès de l'I.C. cinquante ans après : le terrain de l'opportunisme et du centrisme avec une touche de chauvinisme paternaliste en plus. C'est un terrain que les révolutionnaires doivent combattre et éviter constamment aujourd'hui. Telle est la leçon la plus durable des débats passés des communistes sur la question nationale.
S. RAY
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Approfondir:
- La question nationale [446]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [447]
Jan Appel, un révolutionnaire n'est plus
- 2956 reads
Le 4 mai 1985, la dernière grande figure de l'Internationale Communiste, JAN APPEL, s'est éteinte à l'âge de 95 ans Le prolétariat n'oubliera jamais cette vie, une vie de lutte pour la libération de l'humanité
La vague révolutionnaire du début de ce siècle a échoué Des milliers de révolutionnaires marxistes furent tués en Russie et en Allemagne, certains même se suicidèrent Mais, malgré cette longue nuit de contre-révolution, Jan Appel resta fidèle aux marxisme, il resta fidèle à la classe ouvrière, convaincu que la révolution prolétarienne devait venir
Jan Appel fut formé et trempé dans le mouvement révolutionnaire d'Allemagne et de Hollande au début de ce siècle. Il combattit côte à côte avec Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Lénine, Trotsky, Gorter, Pannekoek. Il combattit dans la révolution en Allemagne, en 1919. Il fut de ceux qui ne trahirent jamais la cause du prolétariat. Il fut un représentant digne de cette masse anonyme des générations mortes du prolétariat. Leur lutte historique a toujours renoncé à la glorification des personnes ou à la recherche de titres de gloire. Tout comme Marx, Engels, Jan Appel n'avait pas de comptes à rendre à la presse à sensation capitaliste
Mais il était aussi plus que cette masse anonyme de militants révolutionnaires courageux qui fut produite par la vague révolutionnaire du mouvement ouvrier du début de notre siècle. Il a laissé des traces qui permettent aux révolutionnaires d'aujourd'hui de reprendre le flambeau Jan Appel était capable de reconnaître ceux qui, tout aussi anonymes et pour le moment encore réduits à une petite minorité, continueront le combat communiste. Avec fierté, nous avions ainsi accueilli Jan Appel au Congrès de fondation du Courant Communiste International en 1976 à Paris. Les sigles utilisés dans cet article sont expliqués p.18.
Né en 1890 dans le Mecklenburg en Allemagne, Jan Appel a commencé très jeune à travailler dans les chantiers navals de Hambourg. Dès 1908, il est un membre actif du SPD. Dans les années tourmentées de la guerre, il participe aux discussions sur les questions nouvelles qui se posent à la classe ouvrière : l'attitude face à la guerre impérialiste et face à la révolution russe. C'est ce qui le conduisit, fin 1917, début 1918, à se joindre aux radicaux de gauche de Hambourg qui prirent une position claire contre la guerre pour la révolution. Il donna ainsi suite à l'appel de juillet 1917 des IKD de Hambourg demandant à tous les ouvriers révolutionnaires d'oeuvrer pour la constitution d'un ISPD en opposition à la politique réformiste-opportuniste de la majorité du SPD. Poussé par les combats ouvriers de fin 1918, il adhérera aussi au Spartakusbund de Rosa Luxemburg et prendra, après l'unification dans le KPD(S) une position responsable dans le groupe du district de Hambourg.
1918 fut surtout l'année des grandes grèves à Hambourg et dans toute l'Allemagne après novembre, dans lesquelles Appel se trouva au premier plan. Les ouvriers des chantiers navals furent en effet longtemps les combattants de pointe qui, dès le début, adoptèrent une attitude révolutionnaire, et poussés par les IKD et le KPD(S), furent le fer de lance dans les combats contre les orientations du SPD réactionnaire, de l'USPD centriste et des syndicats réformistes. Ce fut en leur sein que les hommes de confiance révolutionnaires, et après les AAU, virent le jour. Citons Appel lui-même : "En janvier de l'année 1918, les travailleurs de l'armement et des chantiers navals (sous contrôle militaire) en arrivèrent partout à se révolter contre la camisole de force de la guerre, contre la faim, le dénuement, la misère. Et ceci par la grève générale. Au début, la classe ouvrière, les prolétaires sous 1'uniforme, ne comprirent pas ces travailleurs (...) La nouvelle de ce mouvement, de ce combat de la classe ouvrière, pénétra jusque dans le dernier recoin. Et lorsque le rapport de forces eut assez mûri, lorsqu'il n'y eut plus rien à sauver de l'économie militaire et du soi-disant Empire allemand, alors, la classe ouvrière et les soldats firent ce que leur avaient appris les pionniers de janvier 1918" (Hempel, pseudonyme de Jan Appel, au 3ème Congrès de l'Internationale Communiste, juillet 1921). Et sur les grèves de novembre à Hambourg, Appel raconta : "Quand, en novembre 1918, les marins se révoltèrent et les ouvriers des chantiers à Kiel arrêtèrent le travail, nous apprîmes au chantier militaire de Vulkan, par des ouvriers de Kiel, ce qui s'était passé. Il s'en suivit alors une assemblée secrète sur le chantier, 1'usine étant sous occupation militaire. Le travail s'arrêta, mais les ouvriers restèrent ensemble, dans l'entreprise. Une délégation de 17 volontaires fut envoyée à la centrale des syndicats, pour exiger la déclaration d'une grève générale. Nous avons exigé une assemblée. Mais il s'en suivit alors une attitude opposée au mouvement de la part des dirigeants connus du SPD et des syndicats. Pendant des heures se déroulèrent des discussions acerbes. Pendant ce temps, sur le chantier Bloom und Vos, où travaillaient 17 000 ouvriers, une révolte spontanée éclata. Alors, tous les ouvriers quittèrent les usines, au chantier Vulkan également (où travaillait Appel), et se dirigèrent vers la maison des syndicats. C'est à ce moment que les dirigeants disparurent. La révolution avait commencé." (Appel, 1966, discussion avec H.M.Bock).
Ce furent alors surtout les hommes de confiance révolutionnaires élus à ce moment-là qui organisèrent les ouvriers dans des conseils d'entreprise, indépendamment des syndicats. Jan Appel fut élu pour son rôle actif et prépondérant dans les événements, président des hommes de confiance révolutionnaires. Ce fut également lui qui, avec Ernst Thâlmann, fut désigné comme homme de confiance révolutionnaire de l'USPD pendant une assemblée de masse après l'assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, pour organiser la nuit suivante une marche sur la caserne de Barenfeld, afin d'armer les ouvriers. Le manque de centralisation des Conseils, surtout avec Berlin, l'effritement et surtout la faiblesse du KPD(S) qui venait de se former, ne permirent pas au mouvement de se développer, et deux semaines plus tard, le mouvement se tassa. Ce fut alors la période où toute l'attention fut orientée vers le renforcement de l'organisation.
Pour les ouvriers en lutte, les syndicats étaient des organes morts. Début 1919, les syndicats locaux, de Hambourg entre autres, furent dissous, les contributions et les caisses réparties parmi les chômeurs. En août, la Conférence du district du nord du KPD (S), avec Hambourg comme fer de lance, obligea ses membres à quitter les syndicats. Selon Appel : "A ce moment là, nous arrivâmes à la conclusion que les syndicats n'étaient pas utilisables pour la lutte révolutionnaire, et cela amena dans une assemblée des hommes de confiance révolutionnaires à la propagande pour la constitution d'organisations d'entreprise révolutionnaires, comme base pour les Conseils. A partir de Hambourg, cette propagande pour la formation d'organisations d'entreprise se répandit et cela amena aux 'Allgemeine Arbeiter Unionen' (aau)." (Ibid.). Le 15 août, les hommes de confiance révolutionnaires se réunirent à Essen avec l'approbation de la centrale du KPD(S) pour fonder les AAU. Dans le journal KAZ apparurent à cette époque différents articles expliquant le fondement de cette décision et pourquoi les syndicats n'avaient plus de raison d'être pour la classe ouvrière dans la période de décadence, et donc révolutionnaire, du système capitaliste.
Jan Appel, comme président des hommes de confiance révolutionnaires, et organisateur actif, fut alors aussi élu comme président du KPD(S) de Hambourg. Dans les mois qui suivirent, les tensions et conflits entre la centrale de Paul Levi et surtout la section du nord du KPD(S) se multiplièrent autour de la question des syndicats, des AAU et du parti de masse. Lorsque eut lieu le 2ème Congrès du KPD en octobre 1919 à Heidelberg, où les questions de l'utilisation du parlementarisme et des syndicats furent discutées et votées, Appel, comme président et délégué du district de Hambourg, prit clairement position contre les thèses opportunistes qui allaient à 1'encontre du développement révolutionnaire. L'opposition, pourtant majoritaire, fut exclue du parti. Au Congrès même, 25 participants furent immédiatement exclus. Le groupe de Hambourg dans sa quasi-totalité se déclara en accord avec l'opposition, suivi par d'autres sections. Après différentes tentatives de l'opposition au sein du KPD(S), finalement, en février 1920, toutes les sections en accord avec l'opposition furent exclues. Mais ce n'est qu'en mars que toute tentative pour redresser le KPD (S) de l'intérieur cessa. Mars 1920 fut en effet la période du putsch de Kapp, pendant laquelle la centrale du KPD(S) lança un appel à la grève générale, tout en préconisant une "opposition loyale", négociant pour éviter toute révolte armée révolutionnaire. Aux yeux de l'opposition, cette attitude trancha et fut le signe clair de l'abandon de toute politique révolutionnaire.
Lorsqu'en avril 1920 le groupe de Berlin quitta le KPD, les bases furent jetées pour la construction du KAPD, et 40000 membres, parmi eux Jan Appel, quittèrent le KPD.
Dans les combats insurrectionnels de la Ruhr de mars 1920, de nouveau Jan Appel se trouva au premier plan, dans les unions, dans les assemblées, dans les luttes. Sur la base de sa participation active dans les combats depuis 1918 et de ses talents organisationnels, les participants au Congrès de fondation du KAPD désignèrent Appel et Franz Jung pour les représenter à Moscou auprès de l'Internationale Communiste. Ils devaient discuter et négocier sur l'adhésion à la 3ème Internationale et sur l'attitude traîtresse de la centrale du KPD pendant l'insurrection de la Ruhr. Pour parvenir à Moscou, ils durent détourner un navire. Une fois sur place, ils eurent des discussions avec Zinoviev, président de l'Internationale Communiste, et avec Lénine. Sur la base du manuscrit de Lénine "Le gauchisme, maladie infantile du communisme", ils discutèrent longuement, réfutant entre autres les fausses accusations de syndicalisme (c'est-à-dire le rejet du rôle du parti) et de nationalisme. Ainsi, Appel, dans ses articles, "Informations de Moscou" et "Où veut en venir Ruhle", dans la KAZ, défendit la position que Laufehberg et Wolffheim devaient être exclus "parce qu'on doit avoir plus de confiance dans les communistes russes que dans les nationalistes allemands qui ont quitté le terrain de la lutte de classe". Appel déclara aussi qu'il avait "jugé que Ruhle aussi ne se trouvait plus sur le terrain du programme du Parti ; si cette vision s'avère être fausse, alors 1'exclusion de Ruhle ne se pose pas. Mais les délégués avaient le droit et le devoir à Moscou de défendre le programme du Parti."
Il fallut encore plusieurs voyages à Moscou pour que le KAPD fût admis comme organisation sympathisante de la 3ème Internationale et pût ainsi participer au 3ème Congrès en 1921.
Appel travailla entre temps, sous le faux nom de Jan Arndt, un peu partout en Allemagne, et fut actif là où le KAPD ou l'AAUD l'envoyèrent. Ainsi, il devint responsable de l'hebdomadaire "Der Klassenkampf" de l'AAU dans la Ruhr où il resta jusqu'en novembre 1923.
Au 3ème Congrès de l'Internationale Communiste, en 1921, de nouveau Appel, avec Meyer, Schwab et Reichenbach, furent les délégués pour mener les négociations ultimes au nom du KAPD, contre l'opportunisme grandissant au sein de l'IC. Ils tentèrent vainement, avec des délégués de Bulgarie, Hongrie, Luxembourg, du Mexique, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de Belgique et des Etats-Unis, de former une opposition de gauche. Fermement, en ignorant les sarcasmes des délégués bolcheviks ou du KPD, Jan Appel, sous le pseudonyme de Hempel, souligna à la fin du 3ème Congrès quelques questions fondamentales pour la révolution mondiale d'aujourd'hui.. Souvenons-nous de ses paroles : ".Il manque aux camarades russes une compréhension des choses telles qu'elles se passent en Europe occidentale. Les camarades russes comptent avec une population telle que celle qu'ils ont en Russie. Les russes ont vécu une longue domination tsariste, ils sont durs et solides, tandis que chez nous le prolétariat est pénétré par le parlementarisme et en est complètement infesté. En Europe, il s'agit de faire quelque chose d'autre. Il s'agit de barrer la route à 1'opportunisme et 1'opportunisme chez nous, c'est 1'utilisation des institutions bourgeoises dans le domaine économique. Les camarades russes ne sont pas non plus des surhommes, et ils ont besoin d'un contrepoids, et ce contrepoids ce doit être une troisième internationale liquidant toute tactique de compromis, parlementarisme et vieux syndicats. "
Appel fut arrêté en novembre 1923, à cause du détournement du navire avec lequel la délégation s'était rendue à Moscou en 1920. En prison, il prépara une étude sur le mouvement ouvrier et en particulier sur la période de transition vers le communisme, à la lumière des leçons des événements de Russie.
Il fut libéré fin 1925, mais l'Allemagne était devenue dangereuse pour lui et il obtint un travail dans un chantier naval en Hollande. Ainsi, à partir d'avril 1926, commença sa période d'activité politique en Hollande. Il prit contact immédiatement avec Canne Meyer, qu'il ne connaissait pas personnellement, afin de pouvoir s'intégrer dans la situation aux Pays-Bas. A partir de ce contact, des ex-membres du CPH et/ou ex-KAPH se regroupèrent lentement, et à partir de 1927 se fonda le GIC qui publiera une revue, PIC, ainsi qu'une édition en allemand. Ils suivirent de près l'évolution du KAPD en Allemagne et s'orientèrent plus vers les thèses du KAP Berlin, en opposition au groupe autour de Gorter. Pendant 4 ans, le GIC étudia et discuta l'étude qu'Appel avait faite en prison, et le livre "Les fondements de la production et de la distribution communistes" fut publié en 1930 avec les AAU de Berlin, livre qui fut discuté et critiqué par des révolutionnaires dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui.
Appel fit encore plusieurs contributions importantes pendant les années difficiles de la contre-révolution, jusqu'à la seconde guerre mondiale, contre les positions des PC dégénérés et devenus bourgeois. Le GIC travailla en contact avec d'autres petites organisations révolutionnaires dans différents pays (comme la Ligue des Communistes Internationalistes en Belgique, le groupe autour de Bilan, "Union Communiste" en France, le groupe autour de P.Mattick aux Etats-Unis, etc.), et fut un des courants les plus importants de cette période à maintenir en vie l'internationalisme. A partir de 1933, Appel dut se tenir en retrait, vu que l'Etat hollandais en ami de l'Allemagne hitlérienne l'avait expulsé. Jusqu'en 1948, Appel vécut dans la clandestinité sous le nom de Jan Vos.
Pendant et après la seconde guerre mondiale cependant, Appel et d'autres membres du GIC se regroupèrent avec le "Spartacusbond", issu du "Marx-Lenin-Luxemburg Front", seule organisation internationaliste en Hollande jusqu'en 1942. Les membres du GIC qui s'attendaient, tout comme d'autres organisations révolutionnaires de cette période, à des mouvements de classe importants après la guerre, jugèrent important de se regrouper, même s'il existait encore des divergences entre eux, pour préparer une organisation révolutionnaire plus importante, plus forte, afin de jouer un rôle plus prépondérant dans les mouvements. Mais les mouvements ne se développèrent pas, et de nombreuses discussions eurent lieu dans le groupe sur le rôle et les taches de l'organisation politique. Appel resta dans le "Spartacusbond" et défendit des positions contre les positions conseillistes qui se renforçaient au sein du groupe. Les membres du GIC quittèrent presque tous le groupe en 1947 pour se perdre très vite dans le néant. En témoigne une lettre de Pannekoek, devenu lui aussi conseilliste, de septembre 1947 : "...Et maintenant que le mouvement de masse fort n'est pas venu, ni l'afflux de jeunes ouvriers (on avait compté là-dessus, que ça devait se produire après la guerre, et c'était sûrement le motif fondamental du GIC pour se regrouper avec le "Spartacusbond" dans la dernière année de guerre), c'est en fait logique pour le GIC de reprendre son ancien rôle, de ne pas empêcher le "Spartacusbond" de reprendre son ancien rôle du RSP. Selon mes informations, on discute pour le moment dans le GIC sur quelles formes de propagande choisir. Il est dommage que Jan (Appel) soit resté avec les gens du "Spartacus bond". Déjà dans le passé, j'avais remarqué comment son esprit et ses conceptions sont déterminés par ses expériences dans le grand mouvement allemand qui était le point culminant de sa vie; c'est là qu'il avait formé sa compréhension des techniques de 1'organisation des conseils. Mais il était trop un homme d'action pour se contenter de simple propagande. Mais vouloir être homme d'action dans une période où le mouvement de masse n'existe pas encore mène facilement à des formulations de formes d'actions impures et mystificatrices pour 1'avenir. Peut-être c'est quand même positif que dans le "Spartacusbond" ils gardent -un élément fort."
Par accident, Appel fut redécouvert par la police hollandaise en 1948. Après de multiples difficultés, on lui permit de rester aux Pays-Bas mais en lui interdisant toute activité politique. Appel dut ainsi quitter formellement le "Spartacusbond" et la vie politique organisée.
Après 1948, Appel resta néanmoins en contact avec ses vieux camarades, tant aux Pays-Bas qu'ailleurs, entre autres avec "Internationalisme" (prédécesseur du CCI) dans la fin des années 40 et dans les années 50. C'est pourquoi Jan Appel fut à nouveau présent lorsqu'à la fin des années 60 fut fondé "Révolution Internationale", future section en France du CCI, résultat des luttes massives du prolétariat en 1968. Puis, avec de nombreuses visites de camarades et sympathisants du CCI, nous vîmes Jan Appel contribuer à la formation de la nouvelle génération de révolutionnaires, participer à la constitution formelle du CCI en 1976, une dernière fois, passant ainsi le flambeau et les enseignements d'une génération révolutionnaire à celle d'aujourd'hui.
Jusqu'à la fin, Jan Appel fut convaincu que "seule la lutte de classe est importante". Nous poursuivons son combat.
Pour le CCI, A.Bai
Bibliographie dans la Revue Internationale :
"Le danger 'conseilliste' " (40);
"Le Communisten-bond Spartacus et le courant conseilliste"(39, 38);
"La faillite du conseillisme", "Les conceptions de l'organisation dans la gauche germano-hollandaise" (37);
"Critique de 'Lénine philosophe' de Pannekoek" (30,28,27,25);
"Réponse au 'communisme de conseil', Danemark" (25);
"La gauche hollandaise" (21,16,17);
"Rupture avec Spartacusbond"(9);
"Les épigones du conseillisme à 1'oeuvre : Spartacusbond, Daad en Gedachte" (2).
LISTE DES SIGLES UTILISES DANS L'ARTICLE :
GIC : Groupe des Communistes Internationaux.
KAZ : Journal Communiste Ouvrier.
USPD : Parti Social-démocrate Indépendant d'Allemagne.
RSP: Parti Socialiste Révolutionnaire, scission du CPH (1925-35), d'où sort le RSAP (Sneevliet), qui se transforme en "Marx-Lenin-Luxemburg Front"(MLL Front) en 1940.
KPD(S) : Parti Communiste d'Allemagne (Spartacus).
KAPD : Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne.
CPH : Parti Communiste de Hollande.
KAPH : Parti Communiste Ouvrier de Hollande (de Gorter).
PIC : Matériel de presse des Communistes Internationaux.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Correspondance internationale : en Inde, l'émergence d'un nouveau regroupement communiste
- 3106 reads
PRESENTATION
L'effort de prise de conscience du prolétariat s'exprime nécessairement par l'émergence constante de groupes, de minorités qui s'organisent pour participer au développement de cet effort dans l'ensemble de la classe. Plus la lutte de classe se développe, plus la prise de conscience mûrit dans les entrailles de la société, plus nombreux sont les éléments et groupes qui surgissent. L'apparition d'un nouveau groupement en Inde, dans le cadre des principes fondamentaux de la lutte du prolétariat à notre époque, constitue une expression de cette tendance permanente du prolétariat à la prise de conscience de son être révolutionnaire et de la présente maturation de la conscience de la classe.
Ce groupe s'est baptisé "Communist Internationalist" ([1] [883]) et vient de publier le premier numéro d'un bulletin qui :se donne pour tâche de participer à "la clarification et au regroupement des éléments et individus à la recherche d'une clarté révolutionnaire". Nous publions ci-dessous les principes de base à travers lesquels ils se définissent pour le moment.
Le fait que ce groupe surgisse en Inde constitue une démonstration éclatante du caractère unitaire du prolétariat comme classe mondiale, qui défend les mêmes intérêts et mène le même combat, quelle que soit la diversité des conditions dans lesquelles il. se trouve. Même si le prolétariat des pays sous-développés vit dans des conditions d'isolement national et international telles qu'il peut difficilement ouvrir la dynamique de la révolution mondiale ([2] [884]), il n'en est pas moins une partie totalement intégrante de la classe ouvrière mondiale. C'est l'être historique et mondial de la classe qui produit des minorités révolutionnaires. C'est pourquoi, les minorités révolutionnaires du prolétariat ne sont pas immédiatement dépendantes de l'expérience du prolétariat là où elles se trouvent, et peuvent surgir dans des pays sous-développés. Le CCI lui-même en est une expression : sa plus ancienne section est née au Venezuela.
Comme le lecteur pourra s'en rendre compte, les positions du CCI ont été un facteur crucial dans la clarification du groupe en Inde. Elles lui ont notamment permis de se rattacher à l'expérience historique de la classe, celle des Internationales et des Gauches communistes. Sans un rattachement et une compréhension critique de l'expérience historique de sa classe, aucun groupement révolutionnaire ne saurait s'enraciner.
LA RUPTURE AVEC LE GAUCHISME
Les positions du CCI ont servi de pôle de clarification pour les éléments de ce groupe qui, depuis 1982, avaient engagé un processus plus ou moins confus de rupture avec un groupe maoïste ([3] [885]). Elles les ont aides à mener à bien ce processus et à accomplir pleinement cette rupture qui est la condition sine qua non d'une évolution positive vers des positions communistes. Beaucoup d'analyses du CCI les ont aidés, mais nous voudrions souligner ce qui a constitué la pierre de touche de cette réelle rupture : la question nationale.
Dans les pays sous-développés, la mystification la plus importante de la bourgeoisie, celle qui trouve un écho dans la situation de misère de la population et du prolétariat, est le nationalisme, sous toutes ses formes, contre "l'impérialisme". C'est derrière ce slogan que les bourgeoisies nationales des pays sous-développés, spoliées par les plus grandes puissances, tentent de faire l'unité des mécontentements. Si nous regardons la Pologne où se sont déroulés à plusieurs reprises de formidables combats du prolétariat, nous devons nous rappeler la force du nationalisme anti-russe. Dans les pays d'Amérique Latine, "l'impérialisme yankee" a été dans les années 70 le grand thème de dévoiement de la part des gauchistes, défenseurs des "luttes de libération nationale". En Inde, l'idée de "nation opprimée" avec toutes les divisions nationales qui traversent cet Etat constitué tardivement, pèse très fortement. Le mythe de la "nation indienne", "indépendante" des grandes puissances impérialistes, est le fer de lance des mystifications de la bourgeoisie, masquant ainsi les caractéristiques de notre époque, à savoir l'impossibilité de tout développement et indépendance nationaux, et le réel ennemi du prolétariat : la bourgeoisie mondiale et nationale.
La "question nationale" n'est pas nouvelle : elle a posé beaucoup de problèmes et fait commettre bien des erreurs au mouvement ouvrier ([4] [886]). La compréhension que le terrain prolétarien contient la rupture avec toute forme de nationalisme par le groupe "Communist Internationalist" est l'un des critères majeurs qui nous permet de saluer aujourd'hui son émergence comme expression du prolétariat, comme groupement communiste.
Malheureusement, des groupes du milieu révolutionnaire, Battaglia Comunista (BC) et Communist Workers Organisation (CWO), n'ont pas la clarté des nouvelles énergies qui se dégagent aujourd'hui de la lutte de classe. D'Inde, ils rapportent dans les pages de leur presse, les nouvelles d'un groupe, le Revolutionary Proletarian Party (RPP), dont les camarades de "Communist Internationalist" nous disent :
"Nous pensons que leurs efforts (du RPP) pour rompre avec le gauchisme ne se sont pas bloqués ; en fait, ils n'ont jamais commencé d'efforts dans ce sens (...) ; sur la question nationale, ils n'ont même pas essayé de rompre avec le nationalisme fanatique de leur organisation-mère Le moindre internationalisme pour eux est aberrant Développant leur attaque hystérique contre les positions du CCI, dans leur publication en hindi, ils mettent en avant les idées de "socialisme (bien sûr comme 'première étape') 'en un seul pays', de 'nationalisme prolétarien', et d'autres positions tout à fait gauchistes ( .) L'enthousiasme de la CWO et ses relations avec le RPP et 1 'UCM ne font que montrer la confusion de la CWO " (Lettre du 1/4/85).
Sur cette question, BC et la CWO justifient leurs concessions aux "mouvements nationaux" par les spécificités... "nationales" des pays sous-développés ([5] [887]), et ne voient pas que, ce faisant, ils font le jeu d'une des mystifications les plus pernicieuses dans les pays sous-développés, le nationalisme. Et en fin de compte ils en sont eux-mêmes le jouet. Mais BC et la CWO ne veulent pas nous croire. Le CCI, disent-ils, est indifférentiste, voudrait un prolétariat pur, il est hors du réel...
Voila la force du nouveau groupe "Communist Interna-tionalist". Il est un argument concret, éminemment réel, contre les justifications de BC-CWO à leur opportunisme envers le gauchisme des RPP et autre UCM. L'arrivée de nouvelles forces aux positions communistes est un renforcement de tout le milieu prolétarien, pas seulement en forces numériques, mais aussi en argumentation concrète, pratique.
LES PERSPECTIVES
Comme nous l'avons dit plus haut, la clarté politique pour des éléments qui se sont détachés du gauchisme
et ont traversé tout un processus d'évolution à partir de celui-ci, passe par une claire rupture avec leur passé, et notamment la compréhension du caractère bourgeois du gauchisme. Dans les pays capitalistes avancés, c'est surtout la question du parlementarisme et, de plus en plus, du syndicalisme, qui sont la principale mystification que l'on doit démasquer dans le gauchisme. Dans les pays sous-développés, c'est avant tout le nationalisme.
Le groupe "Communist Internationalist" a 'accompli cette rupture, et adopté les positions fondamentales du prolétariat dans la période de décadence. Les perspectives de discussion pour la clarification des positions communistes qu'ils se donnent dans leur déclaration, le but de regroupement des éléments révolutionnaires qui surgissent et l'orientation vers l'intervention dans la lutte de classe qu'ils affirment et qu'ils ont déjà réalisée en publiant deux tracts lors d'événements en Inde (l'assassinat d'Indira Gandhi, puis les élections), sont des traits caractéristiques d'une expression authentiquement prolétarienne. Ces camarades ont encore du chemin à parcourir, comme ils le disent eux-mêmes, pour développer une pleine cohérence. Mais leur émergence constitue une nouvelle contribution à la lutte historique du prolétariat, un pas vers la formation de son parti mondial dans les perspectives d'affrontements de classe à venir. Pour notre part, nous contribuerons de toutes nos forces, comme c'est notre orientation depuis le début de notre existence, à la clarification et au regroupement des forces révolutionnaires qui se dégagent. Salut au groupe "Communist Internationalist".
CCI
Ce que nous sommes
Après des décennies d'une longue contre-révolution, la reprise mondiale du prolétariat a commencé dans les années 60 avec la réapparition de la crise ouverte du capitalisme décadent. Depuis, d'un côté le capital s'est enfoncé dans l'abîme de la crise s'approfondissant ; de l'autre, les luttes de la classe ouvrière ont été de plus en plus fières et conscientes.
Dans une perspective qui s'ouvre vers la révolution prolétarienne mondiale, des expressions politiques de la classe, ses minorités révolutionnaires, ont surgi et surgissent encore. Et si ces groupes sont le produit des efforts de prise de conscience de la classe, ceci a été vrai à un niveau encore plus rudimentaire en ce qui concerne nos propres efforts.
Bien qu'il y ait ici (en Inde) une longue tradition de luttes héroïques de la classe, ce sont les traits de la reprise mondiale de la classe qui ont commencé à arracher le masque du stalinisme et à faire succomber le mythe d'un socialisme russe et chinois. C'est sous la pression de ces luttes et sous l'influence directe et puissante de leur impact que certains éléments ici dont nous-mêmes, avons tenté de nous dégager du gauchisme, du stalinisme et du maoïsme (Naxalbari) et de faire de premiers pas vers des positions communistes. Contrairement à l'Europe où les nouveaux éléments et groupes révolutionnaires qui surgissaient, avaient à leur disposition le trésor que constituent les analyses de la gauche communiste, et pouvaient s'appuyer dessus, nos efforts initiaux ont été le résultat de purs instincts prolétariens.
Mais un simple instinct de classe ne suffit pas. Pour développer ces premiers efforts, il était essentiel qu'ils soient fermement basés sur le terrain solide de la longue expérience historique de la classe et de sa synthèse -le marxisme. Les analyses du CCI. ont été d'une grande aide pour nous dans cette direction.
Ces efforts nous ont convaincus qu'une position communiste ne peut que partir d'un ferme rejet de courants capitalistes tels que le stalinisme, le trotskysme et le maoïsme, et en se reliant au riche héritage des première, deuxième et troisième Internationales.
Mais ceci n'était pas encore suffisant. Nous vivons dans une époque, celle de la décadence du capitalisme, qui n'a commencé que récemment, en 1917-18. Toutes ses implications pour la tactique prolétarienne n'étaient pas clairement comprises alors. Mais aujourd'hui, après soixante-dix ans d'expérience, on ne peut passer à côté de cela sans abandonner les positions de classe.
En 1914 le système capitaliste est entré dans sa phase de décadence à cause de la saturation du marché mondial. La tendance au capitalisme d'Etat s'est développée dans tous les pays pour maintenir en vie le capitalisme décadent. L'Etat a commencé à se développer sous une forme monstrueuse, absorbant et intégrant toutes les sphères de la vie en son sein. Au cours de ce processus, le monstrueux Etat capitaliste a intégré toutes les anciennes organisations réformistes de la classe en son sein et les a transformées en ses propres appendices. Toutes les vieilles tactiques concernant les syndicats, les parlements, les fronts et les libérations nationales ont perdu leur ancien caractère prolétarien.
Les positions des fractions de gauche de la 3e Internationale ont représenté de premiers efforts pour rejeter les vieilles tactiques à la lumière du changement des conditions, et pour en adopter de nouvelles à la place. Ensuite, avec la dégénérescence de la révolution russe et du Comintern, les fractions de gauche ont non seulement lutté contre la contre-révolution stalinienne et, plus tard, ses supporters trotskystes, mais ont approfondi leur compréhension du caractère contre-révolutionnaire des syndicats, de l'activité parlementaire, du frontisme, des luttes de libération nationale et de toutes les sortes de nationalisme, à travers une profonde analyse de la décadence du capitalisme en fonction de laquelle elles ont développé leur tactique.
Nous pensons que l'expérience des dernières décennies a démontré maintes et maintes fois que ces positions étaient correctes. C'est notre ferme conviction que garder en vue ces positions, les comprendre et les assimiler, est essentiel pour toute intervention fructueuse dans les luttes de la classe.
C'est dans ce but que nous avons orienté nos efforts tous ces derniers temps. Nous avons essayé de comprendre l'expérience de la classe entre la première grande vague révolutionnaire et la reprise dans les années 60 et d'en assimiler les leçons. Nous avons aussi trouvé pour cet effort une aide valable avec le CCI.
Mais ceci n'est pas un effort valable une fois pour toutes. C'est un processus long et continu. Ce bulletin a pour but de permettre à ce processus de se poursuivre et de le pousser plus loin à une échelle supérieure et plus large. Nous aimerions donc avoir un débat sur la longue expérience historique de la classe avec les éléments qui surgissent et voudront que des leçons soient tracées à partir de l'expérience des luttes actuelles de la classe. Nous nous engageons à ouvrir les pages de ce bulletin à des éléments et groupes qui adoptent les positions communistes et sont intéressés à mener un débat honnête.
Mais ce travail de compréhension de l'expérience de la classe et d'apprentissage de ses leçons n'est pas notre but en soi. Comme révolutionnaires, notre but est d'enrichir notre compréhension des positions communistes afin de baser la défense de ces positions sur un terrain ferme et nos interventions dans la classe sur ces positions. En fait, le plus important pour^ nous, c'est cette intervention, la rendre fructueuse et,à travers elle, se réapproprier toutes les leçons de l'expérience passée de la classe. Ainsi, en les assimilant, la classe pourra réaliser toutes les possibilités latentes existant dans ses luttes présentes et à venir.
Tout cela nécessite un effort systématique et organisé. Etant donné le rôle décisif des révolutionnaires dans les luttes de la classe, il est essentiel que les débats du bulletin soient dirigés pour aider les éléments et individus à la recherche d'une clarté révolutionnaire et pour développer un pôle de regroupement. Le bulletin devra garder constamment en vue ce but extrêmement important.
Nous avons mentionné l'importante contribution du CCI dans notre développement vers des positions communistes. Même si nos positions sont le résultat de nos efforts pour comprendre et assimiler les analyses du CCI, nous pensons qu'il est nécessaire de clarifier la forme de nos relations actuelles avec le CCI.
BIEN QU'IL SYMPATHISE AVEC LE CCI, LE BULLETIN N'EST, EN AUCUN CAS, UNE PUBLICATION DU CCI, NI PARTIE DE SON CADRE ORGANI-SATIONNEL.
C'EST LE BULLETIN SEUL QUI PORTE LA RESPONSABILITE POLITIQUE DES IDEES EXPRIMEES DANS SES PAGES.
Communist Internationalist
[1] [888] Adresse : Post Box n°25 - N.I.T FARIDABAD 121001 - HARYANA STATE - INDE
[2] [889] Voir l'article "Le prolétariat d'Europe occidentale.", Revue Internationale n°3 1.
[3] [890] Nous publierons ultérieurement un article sur 1'évolution et les leçons de 1'expérience de ces camarades
[4] [891] Voir dans ce n° "Les communistes et la question nationale, III" ainsi que les Revues Internationales n°34 et 36.
[5] [892] Voir "La formation du BIPR : le bluff d'un regroupement", Revues Internationales n°40 et 4 7
Géographique:
- Inde [893]
Courants politiques:
Débat interne : les glissements centristes vers le conseillisme
- 2920 reads
Dans le précédent numéro de la Revue Internationale est paru un article de discussion signé JA et intitulé "Le CCI et la politique du moindre mal", exprimant les positions d'un certain nombre de camarades qui se sont récemment constitués en "tendance". Faute de temps (1'article nous étant parvenu quelques jours seulement avant la publication de la Revue), nous n'avions pas apporté de réponse à cet article lors de sa parution : nous nous proposons donc de le faire dans le présent numéro. Cependant, cette réponse ne sera pas exhaustive dans la mesure où le texte de la camarade JA aborde une multitude de questions diverses qu'on ne saurait traiter de façon sérieuse dans un seul article. Le fait que nous n'apportions pas de réponse à la totalité des arguments et questions contenus dans le texte ne signifie donc nullement que nous désirions esquiver ces questions (sur lesquelles nous serons amenés à revenir), mais tout simplement que nous préférons permettre au lecteur de se faire une idée claire et précise des positions de 1'organisation, plutôt que semer la confusion en mélangeant tous les sujets comme le fait malheureusement la camarade JA dans son article.
Le texte de JA a en effet pour caractéristique d'apporter bien plus de confusion que de clarté sur la véritable teneur des questions en débat : le lecteur non informé de ce débat risque de s'y perdre complètement. En fait ce texte ne fait qu’exprimer de façon particulièrement significative (on pourrait dire presque caricaturale) la confusion dans laquelle se débattent eux-mêmes à l1heure actuelle les camarades qui ont décidé de constituer une "tendance". C'est pour cela, qu'avant même de pouvoir répondre directement à l'article de la camarade JA, il est nécessaire -et de notre responsabilité- que nous présentions au lecteur un certain nombre d'éléments sur la façon dont le débat est apparu et s'est développé dans notre organisation, ne serait-ce que pour rectifier et éclaircir ce que dit là-dessus cet article.
L'ORIGINE DU DEBAT
Les difficultés du CCI en 1981
Comme pour l'ensemble des organisations communistes, les années 80, "années de vérité" ([1] [894]), ont été un test pour le CCI. L'aggravation considérable de la crise du capitalisme durant ces années, l'intensification des tensions entre blocs impérialistes, l'ampleur croissante des enjeux et de la portée des luttes ouvrières, ont mis à l'épreuve la capacité des groupes révolutionnaires de se hisser à la hauteur de leurs responsabilités. Cette épreuve s'est traduite, au sein du milieu prolétarien, par des convulsions importantes allant jusqu'à la désagrégation de certaines organisations comme "Programme Communiste" (accompagnée par une évolution de ses débris vers le gauchisme), la disparition complète d'autres groupes comme "Pour une Intervention Communiste", la fuite en avant dans des pratiques parfaitement opportunistes (flirt du tandem "Battaglia Comunista"-"Communist Workers Organisation" avec des groupes nationalistes kurdes-iraniens, participation des "Nuclei Leninisti Internazionalisti" à toutes sortes de"collectifs"avec les gauchistes et au référendum en Italie) ([2] [895]). Pour sa part, le CCI n'a pas été épargné puisque :
"Depuis son 4ème Congrès (1981), le CCI a connu la crise la plus grave de son existence. Une crise qui a secoué profondément 1'organisation, lui a fait frôler 1'éclatement, a provoqué directement ou indirectement le départ d'une quarantaine de ses membres, a réduit de moitié les effectifs de sa deuxième section territoriale. Une crise qui s'est traduite par tout un aveuglement, une désorientation comme le CCI n'en avait pas connus depuis sa création. Une crise qui a nécessité, pour être dépassée, la mobilisation de moyens exceptionnels : la tenue d'une Conférence Internationale extraordinaire, la discussion et 1 'adoption de textes d'orientation de base sur la fonction et le fonctionnement de 1'organisation révolutionnaire, 1'adoption de nouveaux statuts." (Revue Internationale n°35, Présentation du 5ème Congrès du CCI).
Un redressement effectif, mais incomplet : les déviations conseillistes
Avec la Conférence extraordinaire de janvier 82, le 5ème Congrès du CCI (juillet 83) devait représenter un moment important du ressaisissement de notre organisation après les difficultés rencontrées en 1981. Cependant, malgré l'adoption de rapports et résolutions (voir Revue Internationale n°35) tout à fait corrects et qui ont conservé leur validité, ce congrès devait révéler, par ses débats, l'existence au sein de l'organisation d'un certain nombre de faiblesses sur trois questions essentielles :
- l'évolution des conflits impérialistes dans la période actuelle ;
- les perspectives du développement de la lutte de classe ;
- le processus de prise de conscience du prolétariat.
Sur le premier point, on pouvait constater une certaine tendance à la sous-estimation de l'ampleur de ces conflits, à considérer que, puisque le cours historique est à l'heure actuelle aux affrontements de classe généralisés (et non à la guerre mondiale comme dans les années 30) ([3] [896]), nous allions assister à une atténuation progressive des tensions entre blocs impérialistes.
Sur le deuxième point, il s'était développé dans les débats du Congrès la thèse suivant laquelle le recul des luttes ouvrières constaté par le CCI dès 1981 serait de "longue durée" et qu'il faudrait un "pas qualitatif" dans la conscience et les luttes du prolétariat pour qu'on puisse assister à une nouvelle vague de combats de classe. Quelques mois après le Congrès, cette thèse -qui pourtant ne figurait ni dans le rapport, ni dans la résolution sur la situation internationale- devait révéler son caractère pernicieux et dangereux en empêchant de nombreux camarades et plusieurs sections du CCI de reconnaître l'importance des luttes dans le secteur public en Belgique et aux Pays-Bas de l'automne 83 comme les premières manifestations d'une reprise générale des combats ouvriers.
Sur le troisième point, il avait été exposé tant au Congrès que dans les textes internes et sans que cela provoque de réfutation sensible de la part de l'organisation, une analyse nettement conseilliste du processus de prise de conscience du prolétariat dont on peut se faire une idée par les extraits qui suivent :
"...la formule 'maturation souterraine de la conscience est à rejeter. D'abord parce que le seul et unique creuset de la conscience de classe c'est sa lutte massive et ouverte. D'autre part, les moments de recul dans la lutte marquent une régression de la conscience. La formule maturation souterraine de la conscience exprime une confusion entre deux processus qui, même s'ils sont étroitement liés, sont différents : le développement des conditions objectives et la prise de conscience.
Placés au centre du processus historique capitaliste, la classe ouvrière et surtout ses fractions centrales peuvent comprendre et traduire dans le fait de la prise de conscience la maturation des conditions objectives, mais cela elles ne peuvent le faire seulement que dans la lutte, c'est-à-dire dans l'affrontement avec le capitalisme (...).
La conscience de classe n'avance pas comme dans un cours scolaire... Phénomène global, il implique nécessairement une vision d'emblée globale et d'ensemble et pour cela son seul creuset c'est la lutte massive et ouvrière (...).
Cette formule ("maturation souterraine de la conscience") sous-estime un phénomène qui se produit dans les moments de recul : la régression qui s'opère dans la classe, une régression de la conscience. Et cela il ne faut pas avoir peur de le reconnaître parce que de la même façon que la lutte ouvrière se déroule en dents de scie, la conscience ne se développe pas de manière linéaire mais au contraire fait des avancées et des reculs. (...)Ce sont deux facteurs qui déterminent le niveau et le développement de la prise de conscience: la maturation de la crise historique du capitalisme et le rapport de forces entre les classes. Ces deux facteurs posés à 1 'échelle mondiale déterminent dans chaque période de la lutte de classe la clarté sur ses buts historiques, les confusions, les illusions,les concessions mêmes à 1'ennemi (...) cela se fait en donnant une réponse aux problèmes posés dans les luttes précédentes par les nouvelles luttes."
Les camarades qui s'identifiaient avec cette analyse pensaient être en accord avec les conceptions classiques du marxisme (et donc du CCI) sur le problème de la conscience de classe. En particulier, ils ne rejetaient nullement de façon explicite la nécessité d'une organisation des révolutionnaires dans le développement de celle-ci. Mais en fait, ils avaient été conduits à faire leur une vision conseilliste :
- en faisant de la conscience un élément uniquement déterminé et jamais déterminant de la lutte de classe ;
- en considérant que "le seul et unique creuset de la conscience de classe, c'est la lutte massive et ouverte", ce qui ne laissait aucune place aux organisations révolutionnaires ;
- en niant toute possibilité pour celles-ci de poursuivre un travail de développement et d'approfondissement de la conscience de classe dans les moments de recul de la lutte,
La seule différence majeure entre cette vision et le conseillisme, c'est que ce dernier va jusqu'au bout de sa démarche en rejetant explicitement la nécessité des organisations communistes, alors que nos camarades n'allaient pas jusque là.
La résolution de janvier 1984
Face aux différentes faiblesses qui s'étaient manifestées au sein du CCI, son organe central devait adopter en janvier 1984 une résolution en trois volets (conflits impérialistes, perspectives des luttes de classe, développement de la conscience) dont nous reproduisons ici le dernier (points 7 et 8).
7. Ce sont donc 1'aggravation de la crise et les attaques économiques contre la classe ouvrière qui constituent le moteur essentiel du développement des luttes et de la conscience de la classe. C'est notamment pour cela qu'à l'heure actuelle, et pour un bon moment encore, c'est la riposte aux agressions contre le niveau de vie des ouvriers, et non aux menaces de guerre, qui sera le facteur de leur mobilisation, même si les luttes économiques constituent en fait un obstacle à ces menaces. Cependant il ne faut pas donner à cette constatation matérialiste élémentaire, au rejet de la vision idéaliste critiquée plus haut, une interprétation restrictive et unilatérale étrangère au marxisme. Il faut se garder en particulier de la thèse qui ne voit la maturation de la conscience de classe que comme résultat ou reflet de la maturation des conditions objectives', qui considère que les luttes provoquées par cette 'maturation des conditions objectives' sont le 'seul creuset' où se forge la conscience, laquelle 'régresserait' à chaque recul des luttes. A une telle vision, il est nécessaire d'opposer les points suivants :
a) Le marxisme est une démarche matérialiste et dialectique : la pratique de la classe est praxis, c'est-à-dire qu'elle intègre comme facteur actif la conscience de la classe. La conscience n'est pas seulement déterminée par les conditions objectives et par la lutte, elle est également déterminante dans la lutte. Ce n'est pas un simple résultat statique de la lutte mais elle a sa propre dynamique et devient à son tour 'force matérielle ' (Marx).
b) Même si elles font partie d'une même unité et agissent l'une sur l'autre, il est faux d'identifier la conscience de classe avec la conscience de la classe ou dans la classe, c'est-à-dire son étendue à un moment donné. Autant cette dernière relève d'un grand nombre de facteurs, aussi bien généraux-historiques que contingents-immédiats -notamment le développement des luttes- autant la première est connaissance de soi, non seulement dans1'existence immédiate de la classe, dans son présent, mais également dans son devenir. La condition de la prise de conscience est donnée par 1 'existence historique de la classe capable d'appréhender son avenir, et non pas les luttes contingentes-immédiates. Celles-ci, 1'expérience, apportent de nouveaux éléments à son enrichissement, notamment dans les moments d'intense activité du prolétariat. Mais elles ne sont pas les seules : la conscience surgissant avec 1'existence a également sa propre dynamique : la réflexion, la recherche théorique, qui sont autant d'éléments nécessaires à son développement.
c) Les périodes de recul de la lutte ne déterminent pas une régression ni même un arrêt dans le développement de la conscience de classe : 1'ensemble de 1 'expérience historique, depuis 1'approfondissement de la théorie après la défaite de la révolution de 1848 jusqu'au travail des gauches en pleine contre-révolution atteste du contraire. Là encore, il est nécessaire de distinguer ce qui relève d'une continuité dans le mouvement historique du prolétariat : 1 élaboration progressive de ses positions politiques et de son programme, de ce qui est lié aux facteurs circonstanciels : 1'éten due de leur assimilation et de leur impact dans 1 'ensemble de la classe.
d) Ce n'est pas uniquement dans et au cours des luttes futures que se donnée la réponse aux questions et problèmes posés dans les luttes passées. En effet, non seulement les organisations révolutionnaires contribuent largement dans les après- luttes, et avant que ne surgissent des luttes nouvelles, à tirer les leçons des expériences vécues par la classe et à les propager en son sein, mais il se fait dans la tête de 1'ensemble des ouvriers tout un travail de réflexion qui va se manifester dans ses luttes nouvelles. Il existe une mémoire collective de la classe, et cette mémoire contribue également au développement de la prise de conscience et à son extension dans la classe, comme on a pu le constater une nouvelle fois en Pologne où les luttes de 80 révélaient 1'assimilation de l'expérience de celles de 70 et 76. Sur ce plan, il importe de souligner la différence existant entre une période de recul historique du prolétariat -le triomphe de la contre-révolution- où les leçons de ses expériences sont momentanément perdues pour sa très grande majorité, des périodes comme aujourd'hui, où ce sont les mêmes générations ouvrières qui participent aux vagues successives de combats contre le capitalisme et qui intègrent progressivement dans leur conscience les enseignements de ces différentes vagues.
Les luttes massives et ouvertes sont effectivement un riche creuset du développement de la conscience et surtout de la rapidité de son extension dans la classe. Cependant, elles ne sont pas le seul. L'organisation des révolutionnaires constitue un autre creuset de la prise de conscience et de son développement, un outil indispensable à la classe pour sa lutte immédiate et historique.
Pour cet ensemble de raisons, il existe, entre les moments de lutte ouverte, une 'maturation souterraine' de la conscience (la 'vieille taupe' chère à Marx), laquelle peut s'exprimer tant par l'approfondissement et la clarification des positions politiques des révolutionnaires que par une réflexion et une décantation dans 1'ensemble de la classe, un dégagement des mystifications bourgeoises.
8. En fin de compte, toute conception qui fait découler la conscience uniquement des conditions objectives et des luttes que celles-ci provoquent est incapable de rendre compte de 1'existence d'un cours historique. Si, depuis 1968, le CCI a mis en évidence que le cours historique présent est différent de celui des années 30, que 1'aggravation de la crise économique ne débouche pas vers la guerre impérialiste mondiale mais vers des affrontements de classe généralisés, c'est justement parce qu'il a été en mesure de comprendre que la classe ouvrière d'aujourd'hui n'est plus, et de loin, aussi perméable aux mystifications bourgeoises -notamment le mythe de 1'URSS et 1'antifascisme- qui avaient permis de dévoyer son mécontentement, d'épuiser sa combativité et de 1'embrigader sous les drapeaux bourgeois.
Avant même que ne s'engage la reprise historique des luttes à la fin des années 60, la conscience du prolétariat était donc déjà la clé de toute la perspective de la vie de la société en cette fin de siècle."
LE DEVELOPPEMENT DU DEBAT ET LA CONSTITUTION D'UNE "TENDANCE"
Les "réserves" sur le point 7 de la résolution et leur caractérisation par le CCI
Lorsque cette résolution fut adoptée, les camarades du CCI qui avaient auparavant développé la thèse de la "non-maturation souterraine" avec toutes ses implications conseillistes s'étaient rendu compte de leur erreur. Aussi se prononcèrent-ils fermement en faveur de cette résolution et notamment son point 7 qui avait comme fonction spécifique de rejeter les analyses qu'ils avaient élaborées auparavant. Par contre, on vit surgir de la part d'autres camarades des désaccords sur ce point 7 qui les conduisirent soit à le rejeter en bloc, soit à le voter "avec réserves" en rejetant certaines de ses formulations. On voyait donc apparaître dans l'organisation une démarche qui, sans soutenir ouvertement les thèses conseillistes, que la résolution condamnait, consistait à servir de bouclier, de parapluie à ces thèses en se refusant à une telle condamnation ou en atténuant la portée de celle-ci. Face à cette démarche, l'organe central du CCI était amené à adopter en mars 84 une résolution rappelant les caractéristiques :
"- de 1'opportunisme en tant que manifestation de la pénétration de 1'idéologie bourgeoise dans les organisations prolétariennes et qui s'exprime notamment par :
. un rejet ou une occultation des principes révolutionnaires et du cadre général des analyses marxistes ;
. un manque de fermeté dans la défense de ces principes ;
- du centrisme en tant que forme particulière de l'opportunisme caractérisée par :
. une phobie à 1'égard des positions franches, tranchantes, intransigeantes, allant jusqu'au bout de leurs implications ;
. 1'adoption systématique de positions médianes entre les positions antagoniques ;
. un goût de la conciliation entre ces positions;
. la recherche d'un rôle d'arbitre entre celles-ci ;
. la recherche de l'unité de 1'organisation à tout prix y compris celui de la confusion, des concessions sur les principes, du manque de rigueur, de cohérence et de continuité dans les analyses. "
Ensuite, la résolution "souligne le fait que, au même titre que toutes les autres organisations révolutionnaires de 1 'histoire du mouvement ouvrier, le CCI doit se défendre de façon permanente contre la pression constante et le danger d'infiltration en son sein de 1'idéologie bourgeoise." Elle considère que, "comme pour toutes les autres organisations, la tendance au centrisme constitue une des faiblesses importantes du CCI et parmi les plus dangereuses". Elle "estime que cette faiblesse s'est manifestée en de multiples occasions dans notre organisation et notamment (...) :
- lors du développement d'une démarche conseilliste au nom du rejet de la notion de 'maturation souterraine de la conscience par une réticence très nette à rejeter vigoureusement cette démarche;
- (en janvier 84) par une difficulté à se prononcer clairement, par des hésitations et des 'réserves' non ou peu explicitées (...), à l'égard de la résolution sur la situation internationale."
Puis la résolution "met fermement en garde 1'ensemble du CCI contre le danger de centrisme". Elle "appelle toute 1'organisation à prendre pleinement conscience de ce danger afin de le combattre avec détermination chaque fois qu'il se manifestera."
Enfin, la résolution estime "qu'une des menaces importantes à 1'heure actuelle est constituée par les dérapages vers le conseillisme -dérapages dont l'analyse rejetant la 'maturation souterraine' constitue une illustration- et qui, dans la période qui vient de luttes massives du prolétariat dans les pays centraux du capitalisme, constituera pour 1 'ensemble de la classe et ses minorités révolutionnaires, un réel danger, plus important, quant à son influence néfaste, que le danger d'entraînement vers des conceptions substitutionnistes." Et la résolution conclut "qu'il existe à 1 'heure actuelle au sein du CCI, une tendance au centrisme - c'est-à-dire à la conciliation et au manque de fermeté - à 1'égard du conseillisme."
La tendance au centrisme à l'égard du conseillisme
Cette tendance au "centrisme à l'égard du conseillisme" devait s'illustrer dans les "explications de votes" qui avaient été demandées aux camarades ayant voté "avec réserves" le point 7 de la résolution ou l'ayant rejeté. Si certains camarades reconnaissaient leurs propres doutes et manque de clarté, d'autres attribuaient à la résolution elle-même ce manque de clarté en l'accusant:
- "de frôler de trop près des conceptions qui voient dans la lutte révolutionnaire deux consciences" (comme la conscience socialiste et la conscience trade-unioniste telles qu'elles sont distinguées par Kautsky et Lénine) ;
- d'utiliser des formulations "qui laissent la porte ouverte à des interprétations de type 'Kautsky-léninistes' du processus de prise de conscience de la classe ouvrière" OU ayant "une résonance toute hégélienne" ou encore ne disant "rien d'autre que ce que disent, par exemple, les bordiguistes" de "flirter avec des conceptions léninistes", de "constituer une régression" par rapport au "dépassement du léninisme" opéré antérieurement par le CCI ;
-de "s'enfermer dans une démarche qui ferait croire que la conscience de classe est une donnée achevée" qui "est dans les mains d'une minorité et que la contribution de la classe ouvrière dans son ensemble historiquement ne serait que de l'accepter, 1'assimiler."
Une des caractéristiques des "réserves" était donc d'attribuer à la résolution des idées qui ne s'y trouvaient pas et qu'elle rejetait même explicitement (comme on peut s'en rendre compte en la relisant). On y voyait en particulier des conceptions "bordiguistes" ou "léninistes", ce qui est l'accusation classique des conseillistes à l'égard des positions du CCI (tout comme les groupes "léninistes" ou "bordiguistes" considèrent ces positions comme "conseillistes"). Les concessions au conseillisme étaient encore plus flagrantes lorsque telle "réserve" tendait à renvoyer dos à dos les analyses conseillistes apparues auparavant et leur critique par le point 7 de la résolution, en considérant que si les premières "pour démontrer une idée fausse étaient amenées à citer une idée juste", la seconde "pour rappeler des idées justes est maladroitement conduite à combattre ce qui était correct" dans ces analyses. Ces concessions s'exprimaient également dans telle autre "réserve" qui considérait que ces analyses "viennent plus d'une exagération abusive dans le débat sur la maturation souterraine... que d'un conseillisme sournois et délibéré". C'était là de belles illustrations de la "démarche centriste à l'égard du conseillisme" telle qu'elle avait été identifiée par le CCI, puisque ces réserves : se posaient en arbitre entre les positions qui s'affrontaient ; venaient au secours de la position conseilliste en se refusant de l'appeler par son nom ; créaient des rideaux de fumée (par exemple, l'introduction des épithètes "sournois" et "délibéré" qui n'étaient jamais apparues dans le débat) afin de faire obstacle à la clarté du débat.
Cette démarche, nous la retrouvons dans le texte de la camarade JA (Revue n°41, p.32) lorsqu'il essaie de présenter "les origines du débat" :
"Bien que la maturation souterraine soit rejetée à la fois explicitement par "Battaglia-CWO" par exemple (...), ce rejet étant parfaitement conséquent avec la théorie 'léniniste ' de la conscience 'trade-unioniste' de la classe, et à la fois par des théorisations du conseillisme dégénéré (...), l'organisation a décidé que le rejet de la maturation était en lui-même uniquement le fruit du conseillisme latent en nos rangs".
Il suffit de relire les extraits cités plus haut des analyses apparues dans le CCI rejetant la notion de "maturation souterraine de la conscience" pour se rendre compte que la démarche employée pour opérer un tel rejet est bien de nature conseilliste (même si d'autres que les conseillistes, et avec d'autres arguments, rejettent également cette notion). Encore faut-il, pour être en mesure de faire ce constat, ne pas être soi-même victime d'une vision conseilliste. Les camarades qui ont critiqué le point 7 se sont focalisés sur cette question de la "maturation souterraine" sans voir qu'elle s'appuyait sur une démarche conseilliste, parce qu'ils sont en fin de compte d'accord avec une telle dé marche même s'ils ne vont pas jusqu'au bout de toutes ses implications (autre caractéristique du centrisme) .C'est pour cela d'ailleurs que le point 7 de la résolution ne traite de la "maturation souterraine "que dans son 6ème et dernier paragraphe après avoir réfuté l'ensemble des maillons du raisonnement qui conduit au rejet de cette notion. Pour le CCI, comme pour le marxisme en général, il importe d'attaquer les conceptions qu'il combat à. la racine sans se contenter de faire un sort à telle ou telle brindille. C'est la différence entre une critique de fond propre au marxisme et une critique superficielle affectionnée par toutes les visions étrangères au marxisme, notamment le conseillisme .
L'escamotage des problèmes par les camarades "réservistes"
Cette incapacité des camarades "réservistes" à réfuter véritablement les conceptions conseillistes qui s'étaient introduites dans l'organisation, s'est illustrée dans le fait qu'ils n'ont jamais proposé une autre formulation du point 7 malqré les demandes répétées du CCI, et bien qu'ils se soient engagés à le faire en avril 84. Il n'y a là rien de bien mystérieux : lorsqu'on est soi-même d'une vision conseillisante, on est bien mal armé pour condamner le conseillisme. C'est d'ailleurs ce qu'ont compris certains de ces camarades: ayant échoué dans leur effort de reformuler ce point, ils ont pris conscience de leurs erreurs conseillistes et ont finalement apporté à ce point un soutien sans réserve comme l'avaient fait dès janvier 84 les camarades qui avaient élaboré l'analyse conseilliste de la "non-maturation souterraine". Les autres camarades, par contre, ont préféré escamoter le problème : pour tenter de masquer leur incapacité à condamner clairement le conseillisme, ils ont commencé à soulever toute une série d'autres questions étrangères au débat initial. C'est ainsi, qu'entre autres objections (nous ferons grâce au lecteur d'une liste exhaustive), il a été soulevé :
1°. que "rien n'autorise à décider unilatéralement, sans preuves, que le CCI se trouve dans ce débat en présence d'une tendance conseilliste ou de conciliation vis-à-vis du conseillisme", qu'on avait à faire avec "une campagne donquichottesque contre des moulins à vent conseillistes et centristes" ;
2°. que la résolution de mars 84 donne une "définition psychologisante et comportementale du centrisme", "une définition purement subjective du centrisme en termes de comportement et non plus en termes politiques" ;
3°. qu'on ne peut pas de toute façon parler de centrisme dans le CCI, puisque le centrisme, comme l'opportunisme en général, sont des phénomènes spécifiques de la période ascendante du capitalisme, idée qu'on retrouve dans le texte de JA.
4°. que, de ce fait, on ne pouvait en aucune façon considérer que l'USPD, donné dans le débat comme exemple de parti centriste, appartenait à la classe ouvrière ; que c'était dès l'origine "l'expression de la radicalisation de 1'appareil politique de la bourgeoisie, une première expression du phénomène du gauchisme, cette barrière extrême de 1'Etat capitaliste contre la montée révolutionnaire" (article de JA).
Nous n'entrerons pas dans cet article dans une réfutation de ces objections, irais il importe à leur sujet de préciser quelques points.
1°. On comprend tout à fait que les camarades qui sont eux-mêmes prisonniers d'une démarche centriste envers le conseillisme considèrent que le combat engagé par le CCI contre cette démarche n'est pas autre chose qu'une "campagne donquichottesque contre des moulins à vent conseillistes et centristes" : tout le monde connaît l'histoire du cavalier qui ne retrouve pas le cheval sur lequel il est assis. Cependant, la myopie et la distraction -de même que l'ignorance (comme disait Marx contre Weitling)- ne sont pas des arguments.
2°. Leur tentative d'opposer dans la définition du centrisme les "termes politiques" aux "termes de comportement" démontre qu'ils n'ont pas compris une des bases du marxisme : dans le combat de classe, le comportement est une question éminemment politique. Les hésitations, les vacillations, l'indécision, l'esprit de conciliation, le manque de fermeté dont peut faire preuve dans ce combat la classe ouvrière ou son organisation révolutionnaire, ne sont nullement réductibles à de la "psychologie", mais sont des données politiques qui témoignent de capitulations ou de faiblesses face à la pression de l'idéologie bourgeoise et face à l'ampleur, sans précédent dans l'histoire, des taches qui attendent le prolétariat. Les marxistes ont toujours posé le problème en ces termes. C'est ainsi que Rosa Luxemburg, dans sa polémique contre l'opportunisme, pouvait écrire : "Le petit jeu politique de 1'équilibre qui se traduit par les formules : 'd'une part, d'autre part', 'oui, mais', cher à la bourgeoisie d'aujourd'hui, tout cela trouve son reflet fidèle dans le mode de pensée de Bernstein, et le mode de pensée de Bernstein est le symptôme le plus sensible et le plus sûr de son idéologie bourgeoise". (Réforme ou Révolution).
De même lorsqu'elle se proposait d'expliquer la capitulation honteuse de la social-démocratie le 4 août 1914, elle invoquait, à côté des "causes objectives", "la faiblesse de notre volonté de lutte, de notre courage, de notre conviction" (La crise de la Social-Démocratie).
C'est pour cela également que Bordiga définissait le parti révolutionnaire comme "un programme et une volonté d'action" et que la plateforme du CCI caractérise les révolutionnaires comme "les éléments les plus déterminés et combatifs dans les luttes de la classe" (point 17b.).
3°. L'idée que l'opportunisme et le centrisme sont des menaces constantes pour les organisations révolutionnaires, et non spécifiques de la période ascendante du capitalisme, n'est nullement une "nouvelle orientation" du CCI comme l'écrit la camarade JA dans son article. C'était au contraire un acquis de l'organisation qu'on retrouve non seulement dans de nombreux articles de notre presse, mais également dans des prises de position officielles du CCI telles que la Résolution adoptée par le CCI à son 2ème Congrès sur "les groupes politiques prolétariens" où l'on peut lire : "toute erreur ou précipitation en ce domaine (les critères définissant la nature de classe d'une organisation)... porte en germe des déviations de caractère soit opportuniste, soit sectaire qui seraient des menaces pour la vie même du courant" de même que "(les fractions communistes qui peuvent apparaître comme réaction à un processus de dégénérescence des organisations prolétariennes) se basent non sur une rupture, mais sur une continuité du programme révolutionnaire précisément menacé par le cours opportuniste de 1'organisation". (Revue Internationale n°ll).
Ces notions étaient également des acquis pour la camarade JA elle-même lorsqu'elle écrivait dans la Revue Internationale n°36 (à propos de la démarche de "Battaglia Comunista") : "Au début des années 20, la majorité centriste de l'Internationale Communiste, les Bolcheviks en tête, préfère éliminer la Gauche pour s'allier à la Droite (Indépendants en Allemagne, etc...). Si 1'histoire se répète en farce, 1'opportunisme reste, lui, toujours le même". (Réponse aux réponses). On ne saurait être plus clair. Il faut donc constater qu'en plus d'être myopes et un peu distraits les camarades de la minorité ont aussi la mémoire courte…. et pas mal de culot.
4°. Toute l'insistance des camarades de la minorité sur la question de la nature de classe de l'USPD (insistance qu'on retrouve dans l'article de JA alors que ce n'est pas son sujet) n'est en fait qu'une diversion. Même si on considérait que l'USPD était une organisation bourgeoise (comme cela a été écrit à tort il y a dix ans dans la Revue Internationale, ce que la camarade JA se plaît à rappeler) cela ne remettrait nullement en cause l'idée que l'opportunisme et le centrisme sont aujourd'hui encore des dangers pour les organisations prolétariennes, sont "toujours les mêmes" comme le disait si bien JA il y a un an et demi.
L'hétérogénéité des critiques aux orientations du CCI
Outre les remarques qui précèdent, il faut signaler que les différentes objections soulevées contre les orientations du CCI ne provenaient pas des mêmes camarades, lesquels pendant près d'une année ont défendu dans l'organisation des positions divergentes.
C'est ainsi que, parmi les camarades de la minorité, certains ont voté contre le point 7 de la résolution de janvier 84, d'autres ont voté pour avec réserves et d'autres pour sans réserves tout en rejetant explicitement les arguments des "réservistes". De même, la thèse de l'inexistence des phénomènes de l'opportunisme et du centrisme dans la période de décadence du capitalisme n'a été défendue pendant longtemps que par certains camarades minoritaires (en fait, ceux qui, par ailleurs, étaient d'accord avec le point 7), alors que les autres considéraient que l'opportunisme et le centrisme :
- soit n'ont jamais été des maladies des organisations prolétariennes mais des expressions directes de la bourgeoisie (à l'image des bordiguistes qui qualifient "d'opportunistes" des organisations bourgeoises comme les PS et les PC) ;
- soit ils peuvent exister (et se sont déjà manifestés) dans le CCI, mais pas à l'égard du conseillisme.
Encore faut-il préciser que ces différentes positions n'étaient pas forcément défendues par des camarades différents, certains les défendant successivement même simultanément (!). Enfin, la position sur le danger de conseillisme telle qu'elle est exprimée dans le texte de JA n'était pas non plus celle de la totalité des camarades minoritaires pendant très longtemps.
Une "tendance" sans bases cohérentes
Jusqu'à la fin de l'année 84, cette hétérogénéité entre les positions des différents camarades minoritaires s'est exprimée dans le débat et était d'ailleurs reconnue par ces camarades eux-mêmes. Aussi, la constitution d'une "tendance" au début 85 par ces mêmes camarades fut-elle une surprise pour le CCI. Aujourd'hui, ces camarades affirment partager une même analyse sur les trois questions principales ayant provoqué des désaccords depuis janvier 84 :
- le point 7 de la résolution;
- le danger de conseillisme;
- la menace de l'opportunisme et du centrisme dans les organisations prolétariennes,
Ce que la camarade JA exprime en ces termes :
" C'est au moment des "réserves" sur cette formulation du point 7 que s'est introduite dans l'organisation la nouvelle orientation du "conseillisme, le plus grand danger", du "centrisme par rapport au conseillisme" et du centrisme appliqué à 1'histoire du mouvement ouvrier dans la période de décadence. La minorité actuelle qui se constitue en tendance se situe contre 1'ensemble de cette nouvelle orientation, considérant qu'elle pose le danger d'une régression dans notre armement théorique".
Pour sa part, le CCI considère qu'il ne s'agit pas là d'une véritable tendance présentant une orientation alternative positive à celle de l'organisation, mais d'un rassemblement de camarades dont le véritable ciment n'est ni la cohérence de leurs positions, ni une profonde conviction de ces positions, mais une démarche contre les orientations du CCI dans son combat contre le conseillisme comme cela transparaît d'ailleurs dans le passage du texte de J.A qui précède.
Cependant, si le CCI estime que la constitution de la "tendance" n'est pas autre chose que la poursuite de la politique d'escamotage dans laquelle se sont laissé entraîner depuis un an les camarades en désaccord, il ne leur accorde pas moins les droits d'une tendance - qui sont reconnus par nos principes d'organisation tels qu'ils sont énoncés, par exemple, dans le "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires" (Revue Internationale N° 33). Les camarades minoritaires pensent qu'ils sont une tendance ; le CCI pense le contraire mais préfère convaincre ces camarades de leur erreur plutôt que de les empêcher de fonctionner comme une tendance. Par contre, il est de la responsabilité du CCI de dire claire-, ment, comme il est fait dans cet article, ce qu'il pense de la démarche de ces camarades de même que de l'article de J.A qui constitue une illustration de cette démarche.
L'ARTICLE DE LA CAMARADE J.A : UNE ILLUSTRATION DE LA DEMARCHE DES CAMARADES MINORITAIRES
Nous avons vu que les glissements centristes vers le conseillisme des camarades en désaccord s'étaient traduits tout au long du débat par une tendance de la part de ces camarades à escamoter les véritables problèmes en discussion. C'est encore cette démarche qu'emploie le texte de la camarade J.A lorsqu'il se propose de répondre à l'article de la Revue Internationale N° 40 et à l'analyse du CCI sur le "danger du conseillisme". Nous ne pouvons citer ici tous les exemples de cette démarche : cela risquerait d'être fastidieux. Nous nous contenterons d'en signaler un certain nombre parmi les plus significatifs.
La prétendue "politique du moindre mal" du CCI
Le titre, ainsi que divers passages de l'article de J.A suggèrent ou même affirment nettement que l'analyse du CCI relèverait d'une "politique du moindre mal" :
" Toute la problématique de choisir entre "sous" et "sur"-estimer la parti, toute la politique du moindre mal que le CCI a toujours rejetée au niveau théorique, il l'introduit aujourd'hui au niveau pratique sous couvert de vouloir donner une perspective "concrète" à la classe : il faut dire au prolétariat que le danger conseilliste est plus grand que celui du substitutionisme, sinon le prolétariat n'aurait pas une 'perspective'!". (Revue Internationale N° 41, page 29).
Nous sommes obligés de dire que soit la camarade J.A ne sait pas de quoi elle parle, soit elle falsifie de façon délibérée et proprement inadmissible nos positions.
La "politique du moindre mal" consiste, comme son nom l'indique, à choisir un mal contre un autre. Elle s'est particulièrement illustrée dans les années 30, de la part du trotskysme notamment, par un choix entre deux maux capitalistes, la démocratie bourgeoise et le fascisme, au bénéfice de cette première. Elle conduisait à appeler les ouvriers à privilégier la lutte contre le fascisme au détriment des autres aspects de la lutte contre l'Etat capitaliste. Elle emboutissait à soutenir (quand ce n'était pas à y participer directement) l'embrigadement des ouvriers dans un camp de la guerre impérialiste. En politique les mots ont le sens que leur a conféré l'histoire : l'essence de la "politique du moindre mal" telle qu'elle s'est illustrée dans l'histoire, c'est la soumission des intérêts du prolétariat aux intérêts d'un secteur capitaliste et donc à l'ensemble du capitalisme. Utiliser cette notion à propos des positions du CCI, c'est suggérer que le CCI est engagé sur le même chemin que celui qui a conduit, par exemple, le trotskysme dans le camp bourgeois. Nous osons espérer que c'est plus par ignorance que de propos délibéré que la camarade J.A s'est laissée aller à substituer à l'argument polémique la simple insulte gratuite, bien qu'on puisse penser le contraire lorsqu'elle écrit que "quand une organisation introduit le raisonnement du moindre mal, elle ne dit jamais explicitement qu'il faut tordre les principes. C'est plutôt une logique d'engrenage". Mais même si c'est par ignorance, celle-ci n'est pas plus "un argument"aujourd'hui que du temps de Marx.
Pour ce qui est de la façon dont le CCI pose le problème, il est clair qu'en aucune façon il n'appelle à choisir entre le mal conseilliste et le mal substitutionniste : l'un et l'autre constituent, s'ils ne sont pas dépassés par le prolétariat, des dangers mortels pour la révolution.
La question qui est posée par le CCI n'est donc pas : "lequel est préférable à l'autre ?", mais bien "lequel exercera le plus d'influence dans la période à venir ?" de façon à ce que l'organisation et l'ensemble de la classe soient les mieux armés possible face aux embûches qui vont se présenter. Lorsqu'on se promène, on peut par exemple être mordu par un serpent venimeux ou écrasé par une voiture. Les deux dangers sont mortels et doivent être évités avec une égale méfiance. Cependant, tout être sensé cheminant dans un sentier de forêt portera son attention sur le premier danger sans que cela veuille dire qu'il "préfère" être écrasé par une voiture. Cette image, déjà employée dans le débat interne a du paraître trop"simpliste" à la camarade JA. Elle préfère attribuer au CCI des positions qui ne sont pas les siennes : c'est évidemment plus facile pour les combattre mais cela ne fait pas avancer d'un pouce le débat, sinon en mettant en évidence l'indigence des arguments des camarades de la "tendance" et leur propension à escamoter les vraies questions.
"Le plus grand danger, c'est la bourgeoisie".
"La divergence ne porte pas sur le danger du conseillisme mais... sur la nouvelle théorie unilatérale du conseillisme le plus grand danger parce qu'elle s'accompagne d'un rabaissement du substitutionnisme au niveau du "moins grand danger"; parce qu'elle détourne 1'attention du véritable danger essentiel pour le prolétariat que représente 1'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière (les partis de gauche, les gauchistes, le syndicalisme de base et tout le mécanisme de la récupération capitaliste à l'époque du capitalisme d'Etat) pour se focaliser sur de prétendues tares conseillistes du "prolétariat des pays avancés" (Idem, p.28) "Cette théorie détourne 1'attention du véritable danger essentiel pour la classe ouvrière -1'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière- et ne fait qu'émousser dans la confusion notre critique du substitutionnisme présenté comme le 'moindre mal'".
Comme on peut le voir, la question du "moindre mal" n'est pas la seule à faire l'objet d'une falsification des positions du CCI. La camarade JA fait également dire au CCI que le conseillisme serait le plus grand danger menaçant la classe ouvrière. Elle fait ainsi la preuve soit de sa mauvaise foi, soit de son incompréhension de la différence entre un superlatif et un comparatif ce qui est pourtant du programme de l'école primaire. Dire que le conseillisme est dans la période actuelle et à venir un plus grand danger pour la classe ouvrière que le substitutionnisme est toute autre chose que dire que le conseillisme est le plus grand danger, dans l'absolu. D'ailleurs, avec le même manque élémentaire de rigueur, JA nous fait "rabaisser le substitutionnisme au niveau du 'moins grand danger'". Vaut-il la peine d'expliquer à la camarade JA que si, dans un groupe on constate que "Pierre est le plus grand" ou que "Pierre est plus grand que Paul", cela ne veut pas dire nécessairement que Paul soit le plus petit, à moins que le groupe soit réduit à ces deux éléments ce qui, dans la question débattue voudrait dire que le CCI ne voit pour la classe ouvrière que deux dangers : celui de conseillisme et celui de substitutionnisme. La camarade JA ne va pas jusqu'à affirmer une telle absurdité mais c'est pourtant l'accusation implicite qui est contenue dans sa lourde insistance sur le "véritable danger essentiel pour le prolétariat: 1'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière". Franchement, si c'était pour nous apprendre que le plus grand danger qui menace le prolétariat vient de la classe ennemie et de son Etat, ce n'était pas la peine que la camarade JA se donne la peine d'écrire son article : nous le savions déjà. Et là encore le débat n'a pas beaucoup avancé sinon en faisant apparaître qu'en plus de la falsification des positions du CCI, il existe un autre moyen d'escamoter les vrais problèmes : enfoncer des portes ouvertes.
La caricature comme moyen de ne pas débattre sur le fond
Pour escamoter les vraies questions, il n'est pas toujours nécessaire d'enfoncer des portes ouvertes ou de falsifier les positions qu'on prétend combattre, on peut également se contenter de les caricaturer. La camarade JA ne s'en prive pas. Ainsi, l'article de la Revue n°40 sur "le danger du conseillisme" décrit dans sa partie sur "conditions d'apparition et caractéristiques du conseillisme", comment le conseillisme a gangrené la gauche allemande en la faisant glisser vers le rejet du centralisme, le localisme, un néo-syndicalisme révolutionnaire, l'usinisme, l'ouvriérisme, l'individualisme. Il montre que si ce ne sont pas des caractéristiques spécifiques du conseillisme, celui-ci est amené à tomber dans ce genre de pièges à travers tout un processus, un enchaînement logique, qui part de la négation ou de la sous-estimation du rôle du parti révolutionnaire. De même, il essaye de mettre en évidence comment dans la période qui suit 1968, le poids du conseillisme a conduit beaucoup de groupes à sombrer dans le modernisme, 1'immédiatisme et l'activisme, notamment comme expression de la pression de l'idéologie de la petite bourgeoisie révoltée.
Lorsque la camarade JA se propose de nous dire ce qu'elle a compris de cette argumentation, elle nous démontre soit qu'elle ne l'a pas compris, soit qu'elle ne s'est pas donné la peine de la comprendre. Qu'on en juge :
"En quoi consisteraient ces 'réflexes conseillistes' de la montée de la lutte de classe, comment on les reconnaît ? Selon 1'article, ils sont l'ouvriérisme, le localisme, le suivisme, le modernisme, l'apolitisme des ouvriers, la petite-bourgeoisie, 1'immédiatisme, l'activisme et l'indécision. En somme, tous les maux de la terre le conseillisme serait à lui tout seul le mal permanent du mouvement ouvrier !
Puisque toutes les faiblesses subjectives de la classe ouvrière deviennent, par ce jeu de définitions, 'des réflexes conseillistes', le remède est... le parti. En d'autres termes, le CCI, le milieu politique prolétarien et la classe ouvrière toute entière se protégeront contre 1'immédiatisme, la petite bourgeoisie, 1'hésitation, etc... En reconnaissant dès à présent le danger n°l de 'sous-estimer', 'minimiser' le parti".
Il suffira au lecteur de relire l'article de la Revue n°40 pour constater que ce qui y est décrit comme un processus dont on met en évidence le lien de causalité qui enchaîne les différentes étapes n'a rien à voir avec la photographie chaotique présentée par la camarade JA. Cette façon de caricaturer les positions du CCI est peut-être efficace pour convaincre celui qui est déjà convaincu ou celui pour qui une pensée rigoureuse est un carcan intolérable. Elle n'est pas par contre très efficace pour clarifier le véritable débat.
Pour conclure cette partie, on peut préciser à l'intention de la camarade JA et de l'ensemble des camarades de la "tendance" que la brochure du CCI "Organisations communistes et conscience de classe", dont ces camarades ne cessent de se réclamer, mérite les mêmes reproches que fait l'article de JA à l'article sur "le danger du conseillisme", notamment lorsqu'elle affirme (p.54) :
"Il est logique que cette conception immédiatiste de la conscience de classe conduise les conseillistes à verser dans 1'ouvriérisme et le localisme…."
"Mais poussée à ses ultimes conséquences, 1'apologie que les conseillistes font de la lutte strictement économique du prolétariat aboutit à 1 'autodissolution pure et simple de toute organisation révolutionnaire".
Les non réponses de la camarade JA
Les différentes techniques d'escamotage du débat qu'on vient de voir (et qui sont beaucoup plus amplement utilisées dans l'article de JA que ce que nous en signalons ici) sont complétées par la technique la plus simple qui soit : on ignore purement et simplement les arguments les plus importants de l'analyse qu'on prétend combattre. C'est ainsi que les arguments suivants du texte sur "le danger du conseillisme" ne trouvent pas le début d'une réponse dans l'article de JA :
- le poids du substitutionnisme par le passé était lié à l'héritage de la conception social-démocrate du parti comme "éducateur" et "représentant ou état-major de la classe" ;
- ces conceptions ont pu prendre pied dans une période de croissance du prolétariat et donc d'immaturité de celui-ci (ce qui est particulièrement net dans les pays plus arriérés avec un prolétariat jeune et faible) ;
- ces conceptions auront beaucoup moins de poids sur le prolétariat après l'expérience de la contre-révolution stalinienne et toute la réflexion théorique de la gauche communiste sur celle-ci et sur le rôle du parti dans la révolution ;
- le fait que la prochaine vague révolutionnaire partira nécessairement des pays avancés, avec le prolétariat le plus ancien et le plus expérimenté affaiblira d'autant le poids du substitutionnisme dans l'ensemble de la classe ouvrière : en ce sens, l'expérience de la révolution en Allemagne entre 1918 et 1923 -avec le poids non du substitutionnisme mais du conseillisme sur les éléments les plus avancés de la classe- est beaucoup plus significatif pour la révolution à venir que l'expérience de la révolution en Russie où le substitutionnisme joua le rôle négatif que l'on sait
- ce poids du conseillisme sera d'autant plus renforcé dans cette révolution qu'elle se fera contre les partis staliniens et socio-démocrates dont la méfiance qu'ils inspirent aux ouvriers se répercutera, et se répercute déjà sous forme d'une méfiance à l'égard de toute organisation politique ;
- y compris celle des révolutionnaires prétendant lutter pour la défense des intérêts prolétariens ;
- la contre-révolution de près d'un demi-siècle subie par la classe ouvrière et la rupture organique qu'elle a provoquée dans ses organisations communistes non seulement conduit un grand nombre d'ouvriers parmi les plus combatifs à ne pas comprendre la nécessité de s'engager dans ces organisations mais est responsable chez les militants de celles-ci d'une énorme difficulté à comprendre toute l'importance de leur rôle, le caractère absolument indispensable du parti révolutionnaire et des organisations qui le préparent, l'énorme responsabilité qui pèse sur leurs épaules, toutes, manifestations de déviations conseillistes.
Le fait que la camarade JA escamote la réponse à cette argumentation (dont seule la trame est ici reproduite) qui est justement centrale dans la défense de l'analyse du CCI est significatif de l'incapacité de la "tendance" à opposer des arguments serieux à cette analyse. Le plus ironique de l'affaire est certainement le fait qu'un des rares arguments sérieux contenus dans le texte de JA, probablement le plus important dans la défense de la position de la "tendance" reste pratiquement inexploité, comme si la camarade JA préférait attaquer une forteresse au lance pierre alors qu'elle dispose quand même d'un canon (même s'il est de calibre insuffisant).
Un argument sérieux
On a l'impression que c'est presque par mégarde que la phrase suivante se trouve dans le texte de JA :
"En réduisant le substitutionnisme, expression idéologique de la division du travail dans les sociétés de classes, à une quantité négligeable, la nouvelle théorie arrive à une minimisation du danger de 1'Etat capitaliste, son appareil politique et le mécanisme de son fonctionnement idéologique".
Laissons de côté la façon cavalière (affectionnée par JA) dont est évoquée la "quantité négligeable" que serait pour le CCI le substitutionnisme. Ce n'est évidemment pas une position du CCI. Le fait est que le substitutionnisme est incontestablement une "expression idéologique de la division du travail dans les sociétés de classe". En ce sens, on peut être amené à en conclure que puisque des millénaires de société de classe imprègnent toute la société y compris la classe révolutionnaire, celle-ci aura les plus grandes difficultés à se débarrasser du poids idéologique lié à la division hiérarchique du travail qui a prévalu depuis ces millénaires et notamment sous la forme du substitutionnisme. En fait, cela a été particulièrement valable dans le passé où le substitutionnisme qui s'exprimait notamment dans les sectes babouvistes ou blanquistes résultait directement de l'influence du schéma de la révolution bourgeoise où c'est nécessairement un parti qui prend le pouvoir (par exemple, les jacobins) pour le compte de l'ensemble de sa classe. Ce modèle de la révolution bourgeoise a continué d'exercer une influence très forte dans la classe ouvrière -qui tendait à y voir le seul modèle possible de la révolution- tant qu'elle ne s'est pas engagée elle-même dans des combats massifs contre le capitalisme et dans des tentatives révolutionnaires. Mais l'accumulation de ces expériences positives et négatives (comme la dégénérescence de la révolution d'une part et d'autre part l'éloignement dans le temps des révolutions bourgeoises en Russie) ont permis au prolétariat de se dégager progressivement de ce poids du passé. Cela veut-il dire que le substitutionnisme ne peut plus menacer la classe ouvrière ou ses organisations politiques ? Il est évident que non et le CCI, comme on peut le constater dans l'article de la Revue n°40, a toujours été clair là-dessus. La question posée est plutôt : suivant quelles modalités, avec quel impact ce poids continuera-t-il à peser ? En ce sens, dans "Le 18 Brumaire", Marx nous donne une clé lorsqu'il montre que si les révolutions bourgeoises s'habillaient nécessairement des oripeaux du passé, "ce poids des générations mortes qui pèse sur le cerveau des vivants" tendra à s'amenuiser avec la révolution prolétarienne "qui tire sa poésie de 1'avenir". La révolution prolétarienne ne pourra avoir lieu que sur la base d'une rupture radicale avec des siècles de domination de l'exploitation capitaliste, des millénaires de division de la société en classes et en ayant en vue la société communiste ("la poésie de l'avenir") ce qui comporte en particulier la nécessaire rupture avec le substitutionnisme. Par contre un élément pèsera très longtemps sur le prolétariat, comme il a déjà pesé considérablement dans le passé, un élément qui, s'il est exploité et activé en permanence par l'idéologie bourgeoise résulte d'une caractéristique propre de la classe ouvrière qu'elle ne partage avec aucune des autres classes révolutionnaires du passé. C'est le fait que le prolétariat est la seule classe de l'histoire qui soit à la fois, classe révolutionnaire et classe exploitée. Cet élément a pesé sous forme d'une difficulté très grande pour la classe -et pour sa minorité révolutionnaire- à faire la relation entre ces deux aspects de son être, une relation qui ne soit ni une identité ni non plus une séparation. Ce qu'exprime en bonne partie le conseillisme par son rejet du rôle des organisations communistes, c'est une difficulté à concevoir le prolétariat comme classe au devenir révolutionnaire -dont l'existence de ces organisations est justement une des manifestations. C'est pour cela que le conseillisme en arrive à rejoindre l'anarcho-syndicalisme chez qui les organes de lutte du prolétariat comme classe exploitée- les syndicats- devaient être les organes de gestion de la future société. C'est pour cela que le conseillisme sombre inéluctablement dans l'économisme ou l'usinisme qui expriment cette incapacité de concevoir la lutte du prolétariat comme autre chose qu'une lutte tristement limitée aux lieux de travail où les ouvriers sont exploités et qui tournent le dos à une vision générale, sociale, mondiale, politique du processus révolutionnaire.
Ainsi, lorsqu'on essaie d'examiner les difficultés auxquelles sera confrontée la classe ouvrière dans son chemin vers la révolution, il importe de prendre en compte 1'ensemble et non seulement certains des éléments historiques qui déterminent et détermineront ces difficultés. Sinon, la perspective que l'on dégage est faussée et de bien piètre utilité pour les combats qui attendent le prolétariat. Encore, faut-il évidemment estimer qu'une telle perspective présente une utilité pour ces combats et ne pas tomber dans la vision de C.W.O (Battaglia Comunista) pour qui l'analyse du cours historique (vers la guerre mondiale ou vers des affrontements de classe généralisés) n'est d'aucun intérêt. C'est ce que semble contester la camarade JA lorsqu'elle ironise : "il faut dire au prolétariat que le danger conseilliste est plus grand que celui du substitutionnisme, sinon le prolétariat n'aurait pas une perspective". Ce qu'elle propose en somme, c'est : pas de perspective !
LE FOND DE LA DEMARCHE DE J.A. : LES GLISSEMENTS CONSEILLISTES
En réalité, de façon contradictoire (puisque vers la fin de son texte elle semble dire que ni le substitutionnisme ni le conseillisme ne seront un danger suite à la faillite après 1968 des courants se réclamant de la gauche italienne et de la gauche allemande) ce qui ressort au fond de l'argumentation de JA, c'est que le substitutionnisme est un bien plus grand danger que le conseillisme.
C'est pour cela qu'elle s'applique longuement dans son texte à identifier substitutionnisme et gauchisme, substitutionnisme et contre-révolution alors que l'article de la Revue n°40 montrait justement que le substitutionnisme est une "erreur mortelle" certes, mais concerne le rapport entre la classe et ses propres organisations et non celle de la bourgeoisie.
C'est pour cela qu'elle écrit : "on escamote de plus en plus le fait que donner un rôle bourgeois au Parti ne défend pas mieux son rôle indispensable que de rejeter toute notion de parti : les deux conceptions, aussi bien 1'une que 1'autre, nient la fonction réelle du parti". Alors qu'en réalité, le débat sur le rôle du parti se situait depuis le siècle dernier au sein du marxisme qui a toujours défendu la nécessité d'un parti révolutionnaire alors que le rejet de tout parti est extérieur au marxisme et trouve ses premiers défenseurs chez les anarchistes. Pour être en mesure de dire que le rôle du parti n'est pas de prendre le pouvoir, il faut d'abord reconnaître qu'il a un rôle.
En fin de compte, ce qu'aspire à démontrer la thèse de la "tendance" défendue par JA dans son article, même si elle ne le dit pas ouvertement, c'est qu'il n'existe aucune menace de conseillisme notamment dans les organisations révolutionnaires, et plus particulièrement dans le CCI. Comme cela, les camarades de la "tendance" peuvent être tranquilles : ils ne peuvent en aucune façon être victimes de glissements vers le conseillisme et le CCI ne fait que combattre des "moulins à vent".
Pour la "tendance", il n'y a pas de réel danger de conseillisme. Pour le CCI, ce danger est une menace réelle. La preuve : la démarche de la "tendance".
F.M.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 43 - 4e trimestre 1985
- 2530 reads
Campagnes idéologiques : les armes de la bourgeoisie face a la lutte de classe
- 2358 reads
Après nous avoir conviés, pendant plusieurs semaines, à un battage sur la famine en Ethiopie avec ses milliers de morts, c'est sur les événements d'Afrique du Sud que les médias ont braqué leurs phares : manifestations des populations noire et métis réprimées dans le sang, images du quadrillage de quartiers entiers par l'armée, déportation dans les "bantoustans" de noirs 'jetés à coups de crosse dans des camions, séparation des familles, images d'ouvriers noirs parqués dans des ghettos, reprenant le travail le fusil dans le dos et sous les coups de fouet. Quotidiennement, télévision, radio, presse des pays occidentaux ont multiplié images et commentaires sur les conditions de misère et de répression sous le régime de l'"Apartheid". Et dans cette gigantesque campagne "contre l'Apartheid", toutes les fractions de la bourgeoisie occidentale, de la gauche à la droite, du pape aux organisations nationalistes sud-africaines, de Mitterrand à Reagan, sont unies en un choeur unanime pour dénoncer les "violations des droits de l'homme", et s'indigner" du caractère raciste, inhumain et inacceptable du régime sud-africain.
En réalité, la situation de misère et de répression de la population pauvre ne constitue pas une spécificité de l'Afrique du sud. Dans les pays de la périphérie, où la crise économique frappe de façon plus sauvage encore qu'en son centre, où de vastes parties de la population n'ont jamais été intégrées à la production, la barbarie du capitalisme mondial s'exprime de façon extrême, tant sur le plan économique -épidémies, sous-alimentation, famines font de plus en plus de ravages-, que sur le plan idéologique où la bourgeoisie utilise moins de subtiles mystifications mais affiche ouvertement le peu de cas qu'elle fait des êtres humains : ghettos, ségrégation, répression. La situation en Afrique du sud n'est qu'une caricature de ce qu'est l'exploitation capitaliste partout dans le monde, de ce qu'est la véritable nature de la domination capitaliste sur les classes exploitées.
La bourgeoisie occidentale veut faire croire qu'elle a "découvert" un nouvel enfer. Mais les Reagan et les Mitterrand qui jouent les indignés aujourd'hui, travaillent la main dans la main avec le gouvernement de Pretoria, et la forme raciste de domination et d'exploitation de la classe ouvrière et de la population ne les a guère gênés dans leurs bonnes relations économiques et militaires. Ce pays est un partenaire de choix : il est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matières premières. Depuis longtemps lui a échu le rôle de gendarme du bloc occidental en Afrique australe, ce dont témoigne tout dernièrement le raid que l'armée a effectué en Angola, visant à réintégrer ce pays dans le bloc de l'ouest comme ce fut le case pour le Mozambique.
L'aggravation de la crise provoque, comme partout ailleurs, des grèves et des manifestations de plus en plus fréquentes qui sont facteur d'instabilité. La seule répression ne suffit pas à endiguer les révoltes croissantes, et l'une des armes essentielles de la bourgeoisie pour tenter d'endiguer une telle situation, est d'appuyer la répression par des forces d'encadrement suffisamment efficaces. C'est le cas en Amérique Latine, où les Etats-Unis favorisent la "démocratisation", c'est-à-dire la reconnaissance plus ou moins officielle d'"oppositions" religieuse, syndicale, etc. qui se chargent de contenir la révolte contre l'ordre capitaliste pour la dévoyer dans des impasses. Un tel processus est engagé depuis longtemps en Afrique du sud, et la bourgeoisie y renforce comme ailleurs le partage du travail entre "oppositions" et gouvernement face au mécontentement social. Pour ce faire, pour discuter avec Botha et ses "opposants" des nécessités de la situation, point n'est besoin d'une campagne internationale dans tous les pays d'Europe occidentale. Alors pourquoi tout ce battage sinon que la touchante unanimité "anti-Apartheid" orchestrée par les médias poursuit un autre objectif.
LA CAMPAGNE "CONTRE L'APARTHEID" UNE DIVERSION CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
La bourgeoisie nous a depuis longtemps habitués à des campagnes désignant des "enfers" et des boucs émissaires pour mieux faire accepter la situation dans laquelle on se trouve. Elle se délecte, derrière des propos soi-disant "humanistes1', à présenter des scènes d'horreur : des "boat people" du Vietnam à la famine en Ethiopie ; des massacres du Cambodge aux ghettos de l'Apartheid ; des cadavres qui s'amoncèlent au Liban à ceux du dernier tremblement de terre de Mexico, etc. ce sont des monceaux de misère, de ruine et de mort qui entrent tous les jours dans les foyers sur les écrans de télévision, sur les ondes de radio, dans les pages des journaux.
Si, de tout temps, la bourgeoisie a cherché à cacher la réalité de son système d'exploitation et de ses intérêts derrière des discours idéologiques, aujourd'hui, les thèmes sont les mêmes, mille fois ressassés. Aucune campagne ne dure très longtemps. Un thème vient en chasser un autre. Qui se souvient de la campagne sur la guerre des Malouines ? Qui parle de l'Ethiopie trois mois plus tard ? Un jour, c'est le régime de Pinochet au Chili, le lendemain, c'est le Nicaragua ; un jour les accidents d'avion, l'autre le virus du Sida ; un jour les "attentats" et l'"anti-terrorisme", l'Etat fort, le lendemain les "hooligans" ; etc. C'est un battage permanent qui vise un but précis : tenter d'empêcher de cerner les vrais problèmes, tenter d'abrutir, de déboussoler la classe ouvrière, la seule classe sociale capable de mettre fin à la barbarie du capitalisme.
Les vrais problèmes du capitalisme, ce ne sont pas les massacres : plus les campagnes "humanistes" sont intenses, plus les cadavres s'amoncèlent ; les vrais problèmes, ce ne sont pas les "dictatures", ce ne sont pas les "injustices", car le capitalisme est la cause fondamentale de la misère et des massacres, des dictatures et des injustices. Les vrais problèmes pour la bourgeoisie, sur lesquels les médias ne font pas de campagnes, mais qui sont tus dans un silence à la mesure des craintes de la classe dominante, ce sont les luttes du prolétariat, son ennemi mortel. La bourgeoisie matraque des campagnes sur n'importe quelle question, mais c'est par contre un immense consensus international pour le black-out des informations sur les luttes ouvrières : rien ou très peu sur la vague massive de grèves qui a embrasé le "paisible" Danemark au printemps 83 ; rien sur les mouvements qui ont agité toute l'Espagne ou sur les grèves qui se sont multipliées en Scandinavie pendant la première moitié de la même année, pour ne citer que ces exemples ([1] [900]). Et si nous apprenons force détail sur certains aspects de la situation en Afrique du sud, d'autres, sur les réelles forces en présence dans ce pays, les classes sociales, sont passés sous silence : pas un mot sur la grève de 20 000 mineurs blancs au printemps 85 sur des revendications de salaires.
Faire oublier a misère dans les pays avancés
A travers ses campagnes, la bourgeoisie veut faire oublier la dégradation générale des conditions d'existence du prolétariat des pays centraux, pour tenter de l'immobiliser et de détourner la prise de conscience naissante que c'est le capitalisme mondial qui est le seul responsable de la misère qui s'abat sur les classes exploitées de tous les pays. Ce n'est pas seulement dans le Tiers-monde qu'on meurt de faim, mais aussi dans les pays industrialisés où misère, chômage, soupes populaires s'accélèrent comme jamais depuis la 2ème guerre mondiale.
Dans les discours, les émeutes et la répression en Afrique du Sud sont présentées comme le seul fait du racisme de l'Apartheid. Mais c'est aussi par le racisme que la bourgeoisie "explique" les émeutes de Birmingham, dans la très "démocratique" Angleterre, cachant par là les véritables causes des révoltes : la crise et le chômage. C'est face aux prolétaires des pays "riches", qui sont les plus aptes à prendre conscience que les problèmes se posent en termes de classe, que la bourgeoisie cherche à faire passer une propagande de fausse division raciale pour brouiller le chemin de l'unité de la classe ouvrière.
En Afrique du sud, la lutte de classe des mineurs est présentée comme un combat "pour l'égalité des races" pour dévoyer la lutte sur le terrain bourgeois des revendications démocratiques et nationalistes, tout comme la lutte des ouvriers de Pologne en 80-81 a été présentée comme une lutte "nationale", "religieuse", "anti-totalitaire".
Alors que les Etats "démocratiques" dévoilent chaque jour un peu plus leur vrai visage dictatorial (des milliers de mineurs sont allés en prison durant la grève en Grande-Bretagne, et des centaines y sont encore), la campagne sur l'Apatheid vient à point pour désigner à l'autre bout du monde une situation qui est "pire", pour masquer aux yeux des prolétaires que ce que la bourgeoisie leur prépare, ce sont les licenciements massifs et la répression.
Redorer le blason terni du syndicalisme
Si le premier volet de la propagande de la bourgeoisie vise à briser l'unité internationale d'un combat de classe contre la misère capitaliste, le second volet vise a identifier lutte ouvrière et syndicalisme : lamentations de syndicalistes sud-africains sur le "non-respect" des droits syndicaux et comment les ouvriers (noirs) sont traités sans aucune dignité en l'absence d'une reconnaissance plus large du syndicat, etc. Nous connaissons déjà cette chanson. La campagne sur "Solidarnosc" en Pologne a eu le même thème depuis les grèves de 80-81. Ceci vise à mener les ouvriers à la défaite, en immobilisant le prolétariat international dans les filets "syndicalistes" et "démocratiques". Au moment où de plus en plus les ouvriers contestent les "actions" syndicales, où une désyndicalisation générale manifeste la prise de conscience croissante que le syndicalisme est une impasse, la campagne sur l'Afrique du sud vient leur rappeler leur "chance" d'avoir "leurs" syndicats. Au moment où la classe ouvrière des pays centraux d'Europe devient chaque jour pus consciente du mensonge de la démocratie bourgeoise, des fausses divisions de races, de nationalités, de corporations, les événements d'Afrique du sud sont utilisés pour tenter de la maintenir passive face à l'austérité draconienne qui s'abat sur elle, dans le cadre des institutions capitalistes, ses partis et ses syndicats.
LES CAMPAGNES SUR LA LUTTE DE CLASSE EN EUROPE
En Europe occidentale, le prolétariat est le plus nombreux et le plus concentré. Depuis des décennies, il a fait l'expérience de la démocratie bourgeoise et du syndicalisme. Aussi, c'est lui qui peut le mieux répondre aux faux problèmes mis en avant par la bourgeoisie : les mystifications raciales, démocratiques et syndicales car il est confronté concrètement à la réalité qui se cache derrière : l'enfer capitaliste se trouve aussi dans les pays "libres" et "riches", et toutes les belles paroles cachent au fond la même répression avec les mêmes fusils que ceux de la police de l'Apartheid. Le prolétariat fourbit ses armes contre le capitalisme au coeur même de celui-ci, et la bourgeoisie se prépare à la confrontation. En même temps qu'elle cherche à l'étourdir par ses campagnes incessantes, qu'elle tente de l'immobiliser par un subtil partage du travail entre ses différentes fractions, qu'elle augmente dans tous les pays les budgets de police (témoin très clair de ses intentions), elle cherche à mettre en avant un autre thème : la classe ouvrière ne lutte pas, la classe ouvrière est "en crise". Les mystifications se basent toujours sur certaines réalités. Il est vrai qu'en France et en Italie par exemple, les statistiques de grèves pour les deux dernières années sont les plus basses depuis longtemps. Il est vrai que dans la situation de crise d'aujourd'hui on ne fait plus grève aussi facilement qu'il y a dix ans. La bourgeoisie joue sur cela pour démoraliser le prolétariat, lui dire qu'il ne lutte pas, lui faire perdre confiance en lui-même, tenter de le faire sortir de la scène sociale. Mais ce qui se cache derrière cette apparence, c'est d'abord le fait qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire une telle simultanéité internationale des luttes, touchant même des pays comme la Suède, l'Allemagne, le Danemark, pourtant réputés pour leur "paix sociale", des secteurs comme les fonctionnaires en Hollande qui n'avaient pas fait grève depuis des décennies. Ce qui se cache derrière cette apparente "faiblesse" des luttes ouvrières, en particulier dans des pays traditionnellement combatifs, c'est qu'après de nombreux combats dévoyés dans des impasses, la classe ouvrière se méfie et hésite à suivre les mots d'ordre d'actions syndicales. Et la bourgeoisie cherche à se servir de cette réalité -la méfiance des ouvriers vis à vis des syndicats et la désyndicalisation qui s'en suit- : faire passer la "crise du syndicalisme" pour une crise du mouvement ouvrier. C'est pourquoi en Grande-Bretagne, c'est au spectacle "désolant" du Congrès du TUC que les médias nous ont conviés avec tous les détails des "divisions" syndicales étalées, le syndicalisme "en crise", dans le "plus vieux pays démocratique du monde". Après que le syndicat des mineurs, le NUM, ait mené la grève à la défaite, la bourgeoisie nous présente la "défaite du NUM" alors que c'est là sa victoire contre les ouvriers. En France la CGT s'est radicalisée dans l'"opposition" pour prévenir la .mobilisation ouvrière tout en fanant grand tapage sur les "journées d'action", les "actions-commandos", pour se montrer "combative" face à des ouvriers "passifs". En Allemagne, la DGB annonce de grandes journées d'action pour septembre 85 pour limiter ensuite ses appels à quelques démonstrations isolées.
Les syndicats ne cherchent pas à mobiliser. Ils craignent que tout rassemblement ne les déborde comme cela s'est produit à Hambourg le 1er mai 85, où les chômeurs se sont affrontés à la police, à Lille dans le nord de la France en juillet, où les ouvriers ont fait de même. Les syndicats cherchent à montrer une image de la lutte contestée, minoritaire, divisée, impopulaire, tout en développant un discours de plus en plus "radical". Il s'agit pour la bourgeoisie de faire passer l'idée que la classe ouvrière n'a plus de réalité afin de saboter toute confiance de celle-ci en elle-même.
Dans les années 60 s'était développé le même genre d'idéologie sur la "crise" du prolétariat et son "intégration" au capitalisme. La reprise des luttes de la classe ouvrière en 1968, au tout début de la crise ouverte dans laquelle la société s'enfonce de plus en plus profondément, était venue jeter à bas ce mensonge. Marx disait que si l'histoire se répète deux fois, la première c'est en tragédie et la deuxième en farce. Le "remake" de cette idéologie au milieu des années 80 que tente d'utiliser la bourgeoisie, relève du deuxième genre.
Cependant, dans le milieu politique du prolétariat, nombre sont ceux qui expriment les mêmes doutes sur les capacités de la classe ouvrière à développer ses luttes et à dégager des perspectives. Pris dans le piège de l'apparence des phénomènes et des mystifications matraquées par toutes les forces de la bourgeoisie, ils ne voient ni l'usure de ces mystifications, ni les potentialités que la situation recèle. Ils ne voient "dans la misère que la misère", et c'est bien cela le but poursuivi par la bourgeoisie. Ce faisant, ils sont les victimes des campagnes de la bourgeoisie pour tenter de faire perdre toute confiance en elle-même à la classe ouvrière, et ils en deviennent finalement les acteurs. C'est ce que souhaite la bourgeoisie : faire croire au prolétariat qu'il est impuissant, qu'il n'est pas capable de se constituer en force unie contre la décadence du système capitaliste condamné.
PERSPECTIVES : L'EXTENSION ET L'AUTO-ORGANISATION DES LUTTES DE LA CLASSE OUVRIERE
La lutte de classe se développe ; la tension et le mécontentement s'accumulent dans la société. Si la reprise des luttes ouvrières est lente et difficile, c'est que le prolétariat se confronte, en Europe de l'Ouest, à la bourgeoisie la plus expérimentée du monde, consciente que le prolétariat est au coeur de la situation et qui déploie tout son savoir-faire pour tenter de le mystifier et de l'encadrer, pour le maintenir démobilisé.
Face à la reprise des luttes, la bourgeoisie a été contrainte de déployer tout un arsenal idéologique comme les campagnes de propagande visant à faire peur et à déboussoler, comme le partage du travail entre la droite et la gauche, avec la gauche dans l'"opposition", la réadaptation de syndicats aux expressions multiformes de la lutte de classe. La création d'un "syndicat de chômeurs" en France, la radicalisation de fractions de syndicats en Grande-Bretagne, le développement d'un syndicalisme "de base" ou "de combat" dans la plupart des pays, la création d'une "fédération internationale des mineurs", entre autres, sont les moyens de contrôle dont la bourgeoisie se dote pour parer la montée des luttes ouvrières et essayer d'anticiper sur les problèmes que vont de plus en plus lui poser cette montée.
Les leçons accumulées par le prolétariat sur les conséquences inéluctables de la crise économique et les perspectives de son accélération dans des pays considérés jusqu'ici comme des havres de paix sociale et des modèles de capitalisme (pays Scandinaves, Allemagne), les leçons sur le travail de dévoiement syndical que la classe ouvrière de ces pays commence à tirer, les leçons acquises par la classe ouvrière en France sur la véritable nature de la gauche telle qu'elle l'a révélée par sa présence au gouvernement, les expériences faites par les ouvriers en Espagne et en Italie sur les multiples formes du syndicalisme de base, toutes ces expériences, par leur accumulation vont devenir un facteur important de l'accélération des luttes.
Dans toutes les luttes s'est posé le problème de leur extension à d'autres secteurs, le problème de la nécessité de lutter massivement. Les luttes contre le chômage et les luttes de chômeurs ont soulevé la question de l'unité du prolétariat par delà toutes les divisions. Chaque fois, les syndicats ont été, par leurs manoeuvres multiples, facteur du dévoiement des luttes pour les mener dans des impasses. Et c'est dans l'accumulation des expériences du sabotage syndical que va de plus en plus clairement se poser pour la classe la question de l'auto organisation.
Si aujourd'hui on constate dans certains pays une "accalmie" des luttes ouvrières, "accalmie" qui est bruyamment exploitée par l'ensemble de la bourgeoisie pour démoraliser les ouvriers, cela ne signifie nullement que la classe ouvrière ait été mise au pas. Il s'agit en fait du calme qui précède la tempête, où le prolétariat rassemble ses forces pour de nouveaux assauts où il sera amené à répondre de façon de plus en plus claire aux problèmes posés dans les luttes passées : l'extension, l'auto organisation, l'unification des luttes, leur généralisation internationale. Et c'est aussi dans ses luttes que le prolétariat va développer la prise de conscience de la nature révolutionnaire de son combat.
Dans cette situation, les organisations révolutionnaires doivent contribuer activement à accélérer la prise de conscience de la classe de la nécessité, des buts et des moyens de la lutte : en dénonçant les pièges tendus par la bourgeoisie, en aidant la classe à les déjouer, en la poussant à prendre en main elle-même son combat, à affirmer son unité, A PRENDRE CONSCIENCE DE SA FORCE COMME SEULE CLASSE CAPABLE DE DONNER UN AVENIR A L'HUMANITE.
C.N.
[1] [901] Sur la reprise des luttes ouvrières depuis l’automne 83, voir Revue Internationale n°37 et 42.
Géographique:
- Afrique [902]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Où en est la crise économique? : Le bloc de l'est de plain-pied dans la crise capitaliste
- 3701 reads
Plus que tous les chiffres et les savantes analyses, la lutte des ouvriers en Pologne face aux augmentations des produits de consommation que l'Etat a voulu imposer en 1980, est venue démontrer non seulement que les pays de l'Est n'avaient rien de socialiste, que l'exploitation sauvage de la classe ouvrière y est la règle, mais de plus que face à l'approfondissement de la crise économique en Europe de l'est, ce sont, comme partout ailleurs, les mêmes vieilles solutions bourgeoises qui sont employées, c'est-à-dire d'abord une attaque draconienne contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Les années 80 sont les années de vérité, et même si les mythes ont la vie dure, l'illusion du socialisme régnant à l'est s'effondre sous les coups de boutoir d'une crise qui fait des ravages, qui va en s'accélérant à l'est comme à l'ouest. La crise mondiale du capitalisme, par son existence même dans ces pays, trahit la nature réelle du système d'exploitation qui existe en URSS et dans les pays sous sa domination impérialiste.
LA FAIBLESSE DU BLOC RUSSE FACE A SON RIVAL OCCIDENTAL
Nous sommes aujourd'hui bien loin des rodomontades de Kroutchev qui, à la fin des années 50, dans une crise d'optimisme démesuré - au service de la propagande russe - croyait pouvoir annoncer que l'URSS allait rattraper bientôt les USA sur le plan économique, prouvant par là la supériorité du prétendu "socialisme" sur son rival "capitaliste" occidental. C'est le contraire qui s'est produit, c'est le Japon qui a rejoint l'URSS au rang de 2ème puissance économique de la planète. C'est le bloc de l'est qui s'est affaibli relativement à ses concurrents : les pays du CAEM (URSS, Pologne, RDA, Bulgarie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie) ne représentent aujourd'hui que 15,7% de la production mondiale, alors que les USA à eux seuls font 27,2 % et que l'ensemble des pays de l'OCDE atteignent le chiffre écrasant de 65,1 % (chiffres de 1982).
Les chiffres montrent à l'évidence que ce n'est pas sur le plan économique que le bloc de l'est peut rivaliser avec l'ouest, la supériorité de ce dernier est sur ce plan écrasante. L'URSS ne peut maintenir sa place et celle de son bloc sur la scène mondiale qu'au travers de sa puissance militaire et pour cela il doit sacrifier sur l'autel de sa politique d'armement, sa compétitivité économique et celle de son bloc. Ainsi, alors que le budget du Pentagone représente 7 % du PNB des USA, pour l'URSS, les estimations varient de 10 à 20 % du PNB consacrés à l'effort militaire.
Dans ces conditions, alors que l'armée rouge prend sa ponction sur l'ensemble de l'économie du bloc, que les meilleurs produits, les meilleurs cerveaux sont utilisés dans la production d'armement, le reste de l'économie perd toute compétitivité vis-à-vis de la concurrence sur le marché mondial. Dans ces conditions, ce ne sont pas seulement les anciens traits de sous-développement qui perdurent de manière chronique, mais en plus l'ensemble du bloc qui sombre dans ce sous-développement, étouffé par le poids des secteurs improductifs, notamment militaire.
L'ACCELERATION DE LA CRISE DANS LES ANNEES 80
Les taux de croissance de l'économie des pays de l'est des années 70 sont aujourd'hui révolus. Ainsi, si l'URSS a pu maintenir une croissance relative au début des années 80, c'est grâce à sa position de leader du bloc, et à sa capacité de répercuter les effets de la crise sur ses alliés plus faibles; cependant cette croissance reste malgré tout en régression nette par rapport aux taux auxquels l'URSS avait pu nous habituer par le passé.
Taux de croissance de l’URSS :
1981 82 83 84
3,5 3,5 3 2,6
Quant aux autres pays du bloc, c'est à une véritable récession à laquelle nous avons assisté en ce début des années 80. Ainsi, la Pologne : si en 83, la croissance a été de 4,5 %, c'est après 3 ans de chute :
Croissance du PNB de la Pologne :
1980 81 82 83
-6 -12 -5,5 4,5
(Bulletin annuel pour l’Europe de l’Est)
Bien sûr le développement de la grève de masse en Pologne en 1980-81 a été un facteur important de cette chute de la production, mais ce n'est certainement pas le cas de la Tchécoslovaquie ni de la Hongrie qui ont connu une quasi stagnation.
Taux de croissance PNB
1981 82 83
Tchécoslovaquie -0,4 0 1,5
Hongrie 2,5 2,8 0,8
(F.M.I.)
Cette récession du bloc de l'est a exactement les mêmes causes que celle qui a frappé en même temps au début des années 80 le bloc occidental ; elle fait partie d'un même mouvement de récession mondial.
La chiite des exportations de produits manufacturés à l'extérieur du bloc a atteint de plein fouet les économies est-européennes. Alors que les échanges avec l'ouest représentent 57 % des exportations de la Roumanie, 35 % de celles de la Pologne, 50 % de celles de la Hongrie, la situation de saturation du marché mondial, et la concurrence exacerbée qui en découle, ont anéanti les espoirs des économies de l'est de rentabiliser les lourds investissements consentis dans les années 70. Le vieillissement de l'appareil productif, la mauvaise qualité des marchandises produites, le retard technologique qui s'aggrave, réduisent à néant tout espoir de redresser la situation, et la part des produits manufacturés tend à se réduire dans les exportations vers l'ouest, aux dépens des matières premières. Ainsi, en Pologne, les exportations industrielles ont baissé en 1981, 82 et 83, alors que les exportations charbonnières progressaient. Aujourd'hui, la structure des exportations de la Pologne vis-à-vis du monde occidental revient à ce qu'elle fût dans les années 50, c'est-à-dire que ce sont 30 ans de développement qui sont anéantis.
Cette chute de la croissance du bloc de l'est a été encore accentuée par l'austérité imposée par l'URSS qui contrôle les vannes d'approvisionnement énergétique et les livraisons en matières premières nécessaires à l'industrie des pays d'Europe de l'est. Plus qu'une grande puissance industrielle, l'URSS est avant tout une grande puissance minière, cela est explicite dans ses échanges avec l'ouest, représentés pour plus de 80 % d'exportations par des matières premières. Cela traduit le sous-développement relatif de l'URSS, même par rapport à d'autres pays de son bloc. Ainsi, en Tchécoslovaquie l'industrie manufacturière constitue 62 % du PNB contre 23 % seulement pour l'URSS. Pour maintenir le niveau de ses échanges avec l'ouest et récupérer ainsi les devises nécessaires à l'achat des produits technologiques qui lui font tant défaut, l'URSS a du augmenter ses ventes de pétrole dont le cours déclinait. Cela n'a pu se faire qu'aux dépens des livraisons à ses alliés. Ainsi, en 1982, la réduction des livraisons de pétrole à la RDA et à la Tchécoslovaquie de plus de 10 % a provoqué de sérieux problèmes à l'industrie, tandis qu'en 1985 le retard de livraison de pétrole et de charbon à la Bulgarie s'est traduit par une grave pénurie d'électricité devant la vague de froid du début de l'année.
L'EXEMPLE DE L'AGRICULTURE : SYMBOLE DE LA FAIBLESSE ECONOMIQUE DE L'URSS
En 1983, l'URSS a accumulé le plus fort déficit agricole mondial de tous les temps, plus de 16 milliards de dollars. Pourtant, l'URSS est la première puissance agricole du monde : 1er producteur de blé, d'avoine, de froment, de seigle, d'orge, de betterave, de tournesol, de coton et de lait, rien de moins, et pourtant l'agriculture est le talon d'Achille du bloc de l'est qui le met sous la menace de la famine. Sur ce plan, sa dépendance vis-à-vis de l'ouest s'accentue. La faillite du secteur agricole en URSS est tout à fait significative des maux dont souffre l'économie russe en général. Quand on apprend que la production de chars de combat est répercutée dans la comptabilité russe sous la catégorie de production de matériel agricole, on peut mesurer le gigantesque détournement qui se fait au profit de l'armée et aux dépens de la modernisation du secteur agricole.
Les rendements extrêmement bas traduisent l'archaïsme de l'agriculture des pays de l'est : en URSS, le rendement céréalier est de 1464 Kg à l'hectare, contre 4765 pour la France. En Roumanie, une vache laitière produit 1753 litres de lait par an, contre près du double en France, 3613 litres par an. Mais cette faible productivité voit ses conséquences considérablement aggravées par le manque d'équipement et par la lourdeur de l'appareil bureaucratique qui entrave le fonctionnement de l'économie. Ainsi, les récoltes de céréales pourrissent souvent sur pied faute de machines pour les moissonner, et quand elles sont moissonnées, il y a pénurie de silos pour les conserver. Et même quand cela est réalisé, d'autres obstacles apparaissent encore : les moyens de transport sont insuffisants, la paralysie bureaucratique pèse de tout son poids si bien qu'une part importante de la production de blé est gaspillée, souvent dans l'alimentation animale pour laquelle elle n'est pas le plus adaptée alors que le rationnement alimentaire sévit dans les villes. L'agriculture russe est un exemple du gigantesque gaspillage des forces productives qui sévit dans toute l'économie russe et montre clairement comment le développement de l'économie de guerre se fait aux dépens de l'ensemble de l'économie. Il y a de plus en plus de canons et de moins en moins de beurre. Mais ce gigantesque gaspillage pousse le capitalisme russe, comme son homologue occidental de manière encore plus nette dans des contradictions insurmontables.
UNE ATTAQUE REDOUBLEE CONTRE LES CONDITIONS DE VIE DU PROLETARIAT
La crise comme en occident s'est traduite au sein du bloc de l'est par la mise en place de programmes d'austérité draconiens, par une attaque sans précédent depuis les années 50 contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
La suppression des subventions de l'Etat qui avaient permis jusqu'à la fin des années 70 de masquer l'inflation, s'est traduite par des hausses en cascades. En Pologne, les hausses de plus de 100 % sur les produits alimentaires ont provoqué l'explosion de luttes de classe qui a marqué pour les pays de l'est l'entrée dans les années 80, tout en montrant la réalité de l'inflation dans les pays de l'est. En Pologne, cette inflation a été de :
1980 1981 1982 1983 1984
10 % 21 % 100 % 25 % 10 %
Elle a été de 16,9 % en 1982 pour la Roumanie, tandis qu'en Hongrie les augmentations des produits alimentaires ont atteint 20 %, celles du charbon, du gaz et de l'essence 25 %, celles des transports de 50 à 100 %. Des économistes occidentaux estiment que chaque tranche de 10 % d'inflation par an équivaut à une baisse de 3 % du pouvoir d'achat. On peut apprécier dans cette mesure l'attaque qu'a subie le prolétariat d'Europe de l'est qui sur ce plan devient comparable à celle qu'ont subie les prolétaires d'Amérique Latine.
Le ralentissement actuel de l'inflation dans les pays de l'est ne signifie pour autant certainement pas un ralentissement de l'attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière, au contraire. L'extension de la durée de travail hebdomadaire à 6 jours en Pologne et en Roumanie, le développement, au nom de la lutte pour la productivité, de campagnes contre "l'absentéisme", "l'alcoolisme", le "hooliganisme", par Andropov et Gorbatchev sont venus justifier une répression et un contrôle accrus sur les lieux de travail. L'augmentation des cadences dans les mines en Pologne s'est traduite par un doublement des accidents du travail en 1982.
En URSS, la "patrie" des travailleurs, de 1965 à 1982, la durée moyenne de vie est passée pour les femmes de 74,1 ans à 73,5, et pour les hommes de 66,2 à 61,9 selon une étude de l'Office Mondial de la Santé (Genève); l'URSS quant à elle ne publie plus depuis longtemps ce genre de statistiques.
QUELLES PERSPECTIVES ?
La plongée de l'économie mondiale dans une nouvelle phase de récession qui s'annonce avec le ralentissement de la reprise américaine n'augure rien de bon pour l'économie des pays de l'est qui auront de plus en plus de mal à exporter.
De plus, la chute constante des investissements depuis le début des années 80, alors que 84 % des chantiers planifiés à la fin des années 70 restent inachevés en URSS, montre que l'avenir est sombre. Le bloc de l'est doit parer au plus pressé pour éviter la banqueroute : 27 % des investissements prévus dans son plan par l'URSS sont consacrés à l'agriculture déficitaire, tandis qu'en Pologne, les investissements consacrés aux machines et aux biens d'équipement sont passés de 46 à 30 %. La crise se traduit par un mouvement de désindustrialisation, de sous-développement, d'appauvrissement du bloc de l'est, qui ira encore en s'accélérant dans le futur.
Les années qui viennent vont voir d'autre part une difficulté de plus en plus grande de l'URSS à équilibrer sa balance commerciale, dans la mesure où le pétrole, qui constitue sa principale exportation, va se tarir dans sa partie européenne, sans que le relais des gisements sibériens puisse être assuré faute des capitaux nécessaires et de la technologie indispensable. Ce qui est en perspective, c'est une réduction des échanges avec l'ouest et un repli du bloc de l'est sur lui-même dans une fuite en avant dans l'économie de guerre.
Quant aux ouvriers, Gorbatchev annonce la couleur de ce qui les attend lorsqu'il déclare : "les traditions du mouvement stakhanoviste ne sont pas révolues (...) mais correspondent aux exigences de notre temps". Comme Staline, Gorbatchev remplace le capital qui lui manque pour investir et moderniser l'industrie, par le "capital humain", en n'ayant d'autre recours pour élever la productivité que d'intensifier et d'augmenter l'exploitation sous ses formes les plus brutales. Les bras des ouvriers remplacent les machines absentes. Mais une telle politique et l'aggravation du niveau de vie qu'elle implique est grosse de révolte et de luttes du prolétariat dans le chemin tracé par les ouvriers de Pologne en 1980.
Dans les pays de l'est, comme dans le reste du monde l'alternative est posée : socialisme ou barbarie.
JJ. 23/9/85
Géographique:
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Heritage de la Gauche Communiste:
Révolution de 1905 : enseignements fondamentaux pour le prolétariat
- 3016 reads
Il y a 80 ans, le prolétariat engageait en Russie le premier mouvement révolutionnaire de ce siècle, la répétition générale de la révolution victorieuse de 1917 et la vague révolutionnaire mondiale qui l'a suivie jusqu'en 1923.
Ce mouvement qui éclate spontanément en janvier 1905, au départ d'un événement tout à fait fortuit, secondaire -le renvoi de deux ouvriers de l'usine de Poutilov - va se transformer au cours de l'année en un gigantesque soulèvement général du prolétariat où les grèves économiques et politiques vont fusionner, se développer à travers des avancées et des reculs, se coordonner à tous les secteurs de la production, se généraliser dans tout l'empire russe et finir par culminer en décembre avec l'insurrection de Moscou.
Mais ce qui fait la spécificité de 1905 ce n'est pas le caractère massif du mouvement, bien que la grève de masse ait été utilisée à cette occasion pour la première fois avec une telle ampleur ([1] [903]) Cette arme redoutable, le prolétariat l'avait déjà utilisée dans les années précédant 1905, notamment en Russie (1896) de même qu'en Belgique (1902). Ce qui fait de 1905 une expérience jusqu'alors inédite dans 1'histoire, c'est essentiellement le surgissement spontané -dans la lutte et pour la lutte- des conseils ouvriers, organes regroupant 1'ensemble de la classe avec des délégués élus, responsables devant celle-ci et révocables à tout moment.
Le surgissement des premiers conseils ouvriers dès 1905 marque 1'ouverture d'une période où la question qui va être posée historiquement pour la classe ouvrière est celle de la révolution prolétarienne.
Plus d'un demi-siècle de décadence du système capitaliste n'a fait que confirmer la validité toujours présente de cet enseignement fondamental pour le mouvement ouvrier : les conseils ouvriers s'imposent comme instruments du renversement de l'Etat bourgeois et pour la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Ils sont, comme le disait Lénine, "la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" En ce sens, il importe que les révolutionnaires soient capables de tirer toutes les leçons de cette première expérience révolutionnaire du prolétariat s'ils veulent être à même de remplir, dès à présent et dans les affrontements de classe à venir, la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir
Lorsqu'à éclaté la révolution de 1905, une des questions essentielles qui s'est posée aux révolutionnaires, comme à l'ensemble de la classe, était celle-ci : quelle est la signification de cette brusque irruption du prolétariat russe sur la scène de l'histoire ? Cette révolution était-elle une réponse aux conditions spécifiques de la Russie tsariste dans un pays où le développement de la grande industrie n'avait pas encore complètement balayé les derniers vestiges de la féodalité ? Ou bien était-elle le produit d'une étape nouvelle dans le développement des contradictions du capitalisme, étape qui prévalait sur l'ensemble de la planète ?
Face à cette question, Rosa Luxemburg est alors la première à percevoir la signification générale de ce mouvement lorsqu'elle affirme que la révolution de 1905 "arrive à un point historique qui a déjà passé le sommet, qui est de l'autre côté du point culminant de la société capitaliste."("Grève de masse, parti et syndicats" ([2] [904]). Ainsi, dès 1906, Rosa Luxemburg comprend que le soulèvement prolétarien de 1905 avait signé la fin de l'apogée du capitalisme comme système mondial et que s'ouvrait désormais une ère où le prolétariat devait assumer dans la pratique son être historique en tant que classe révolutionnaire. En entrant dans sa phase de décadence, le capitalisme devait révéler ainsi les premiers symptômes d'une crise chronique et sans issue : son incapacité à améliorer de façon durable les conditions d'existence du prolétariat, son enfoncement inexorable dans la barbarie avec notamment le développement de guerres impérialistes.
Ce n'est donc pas en réponse aux "spécificités", à l'arriération de la Russie tsariste qu'éclate la révolution de 1905, mais bien en réponse aux convulsions de la fin de la période ascendante du capitalisme qui, dans ce pays, prend en particulier la forme de la guerre russo-japonaise et de ses terribles conséquences pour le prolétariat.
Cependant, bien que R. Luxemburg ait été la première à saisir la signification historique de 1905 comme "forme universelle de la lutte de classe prolétarienne résultant de 1'étape actuelle du développement capitaliste et de ses rapports de production" ("Grève de masse."), sa compréhension de la période reste encore incomplète puisque, à l'instar des fractions de gauche de la IIe internationale, elle ne comprend pas clairement la nature de cette révolution. En effet, elle voit dans les événements de 1905 en Russie une révolution "démocratique bourgeoise" dont le prolétariat est le principal protagoniste, ne saisissant pas toutes les implications dictées par la fin de l'apogée du capitalisme: l'impossibilité pour le prolétariat de réaliser des tâches bourgeoises dans la mesure où ce qui est à l'ordre du jour ce n'est plus la révolution bourgeoise mais la révolution prolétarienne. Cette confusion dans l'ensemble du mouvement ouvrier du début du siècle trouve ses racines essentiellement dans le fait que 1905 surgit à un tournant, à une période charnière où, en vivant ses dernières années de prospérité, l'économie capitaliste manifestait déjà des signes d'essoufflement sans que pour autant ses contradictions insurmontables n'aient encore éclaté au grand jour dans les centres vitaux du capitalisme mondial. Et ce n'est que dans les années précédant la première guerre mondiale, lorsque, avec le développement à outrance du militarisme, la bourgeoisie des principales puissances européennes va accélérer ses préparatifs guerriers, que les gauches de la IIe Internationale comprendront réellement le changement de période posant l'alternative : révolution prolétarienne ou enfoncement de l'humanité dans la barbarie.
Néanmoins, bien que les révolutionnaires n'aient saisi immédiatement ni le changement de période, ni la nature de 1905, ce qui les distingue des tendances réformistes et opportunistes (tels que les Mencheviks, par exemple) au sein du mouvement ouvrier de l'époque, c'est essentiellement leur compréhension du rôle du prolétariat, de son action autonome en tant que classe historique et non comme force d'appoint au service des intérêts bourgeois. Et parmi ceux-là, il revient aux Bolcheviks d'avoir su appréhender dès 1905 (R. Luxemburg ne le verra qu'en 1918) le rôle spécifique des soviets comme instruments du pouvoir révolutionnaire. Ce n'est donc nullement par hasard que ces mêmes bolcheviks seront en 1917 à l'avant-garde de la révolution, non seulement en Russie, mais à l'échelle mondiale.
NATURE ET ROLE DES SOVIETS
Ce qui distingue le mouvement de 1905 de celui des années précédentes où les explosions ouvrières massives en Russie avaient constitué les prémisses de 1905, c'est la capacité du prolétariat à s'organiser en classe autonome avec le surgissement spontané dans la lutte et pour la lutte des premiers conseils ouvriers, résultant directement d'une période révolutionnaire.
En effet, la forme d'organisation dont se dote le prolétariat pour assumer sa lutte dans une telle période ne se construit pas à l'avance, suivant le schéma de l'organisation que se donnait la classe au siècle dernier : le syndicat.
Dans la phase ascendante du capitalisme, l'organisation préalable de la classe en syndicats était une condition indispensable pour mener des luttes de résistance économique qui se développaient sur une longue période.
Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, l'impossibilité pour la classe d'obtenir des améliorations durables de ses conditions d'existence a fait de l'organisation permanente en syndicats un moyen de lutte désormais caduc et que le capital va progressivement intégrer à l'Etat dans les premières années du siècle. De ce fait, la lutte du prolétariat posant historiquement la question de la destruction du capitalisme va tendre à dépasser le cadre strictement économique pour se transformer en une lutte sociale, politique, s'affrontant de plus en plus directement à l'Etat. Cette forme de lutte spécifique de la décadence capitaliste ne peut se planifier à l'avance. Dans la période où la révolution prolétarienne est historiquement à l'ordre du jour, les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser à tous les secteurs de la production. Ainsi, le caractère spontané du surgissement des conseils ouvriers résulte directement du caractère explosif et non programmé de la lutte révolutionnaire.
De même, conformément aux objectifs de la lutte prolétarienne au siècle dernier, le syndicat ne pouvait que regrouper les ouvriers à une échelle locale et par branches d'industrie ayant -outre des revendications générales, par exemple : la journée de 8 heures, des revendications spécifiques. Par contre, lorsque la lutte du prolétariat pose la question du bouleversement de l'ordre capitaliste exigeant la participation massive de l'ensemble de la classe, lorsqu'elle tend à se développer non plus sur un plan vertical (métiers, branches d'industrie) mais sur un plan horizontal (géographique) en unifiant tous ses aspects -économiques et politiques, localisés et généralisés-, la forme d'organisation qu'elle engendre ne peut avoir pour fonction que d'unifier le prolétariat par delà les secteurs professionnels.
C'est ce qu'a illustré de façon grandiose l'expérience de 1905 en Russie lorsqu'en octobre, à l'issue de l'extension de la grève des typographes aux chemins de fer et aux télégraphes, les ouvriers, réunis en assemblée générale, prennent, à Petersbourg, l'initiative de fonder le premier soviet qui va regrouper les représentants de toutes les usines et constituer ainsi le centre névralgique de la lutte et de la révolution. C'est ce qu'exprime Trotsky (président du soviet de Petersbourg) lorsqu'il écrit " Qu'est-ce que le soviet? Le conseil des députés ouvriers fut formé pour répondre à un besoin pratique suscité par les conjonctures d'alors : il fallait avoir une organisation jouissant d'une autorité indiscutable libre d toute tradition,qui grouperait du premier coup les multitudes disséminées et dépourvues de liaison ; cette organisation (...) devait être capable d'initiative et se contrôler elle-même d'une manière automatique : 1'essentiel, enfin, c'était de pouvoir la faire surgir dans les vingt-quatre heures (...) pour avoir de l'autorité sur les masses, le lendemain même de sa formation, elle devait être instituée sur la base d'une très large représentation. Quel principe devait-on adopter? La réponse venait toute seule. Comme le seul lien qui existât entre les masses prolétaires, dépourvues d'organisation, était le processus de la production, il ne restait qu'à attribuer le droit de représentation aux entreprises et aux usines " (Trotsky, "1905")
C'est cette même différence dans le contenu et la forme de la lutte entre la période ascendante et la période de décadence qui détermine la distinction entre le mode de fonctionnement des conseils ouvriers et celui des syndicats. La structure permanente de l'organisation de la classe en syndicat se reflétait par la mise en place de moyens permanents (caisses de grèves, fonctionnaires syndicaux...) en vue de l'action revendicative quotidienne et de la préparation des luttes. Par contre, avec le surgissement des conseils ouvriers, la lutte révolutionnaire du prolétariat met un terme à ce type de fonctionnement statique pour donner naissance, au coeur de la lutte elle-même, à une nouvelle forme d'organisation dont le caractère éminemment dynamique -à l'image du bouillonnement que représente la révolution- se manifeste par la révocabilité de ses délégués élus et responsables devant l'ensemble de la classe. Parce que ce mode de fonctionnement traduit et renforce la mobilisation permanente de toute la classe, les conseils ouvriers sont le terrain privilégié où s'exprime la véritable démocratie ouvrière, de même qu'ils sont le lieu où se reflète le niveau réel de conscience dans la classe. Cela se manifeste notamment dans le fait que les forces politiques qui dominent dans les conseils ouvriers à certains moments de leur évolution sont celles qui ont le plus d'influence au sein de la classe. De plus, les conseils ouvriers sont le lieu où le processus de prise de conscience dans la classe se développe de façon constante et accélérée. C'est cette dynamique d'accélération, résultant de la radicalisation des masses qui va devenir un facteur décisif dans la lutte. Ainsi, alors qu'à l'issue de la révolution de février 17, les soviets avaient accordé leur confiance au gouvernement provisoire démocrate-constitutionnel, leur adhésion à une orientation révolutionnaire après les événements de l'été (journées insurrectionnelles de juillet, offensive de Kornilov), était le résultat d'une maturation, d'une extension de la conscience dans la classe, condition indispensable à la prise du pouvoir en octobre 1917.
Il apparaît ainsi que les conseils ouvriers sont l'expression même de la vie de la classe dans la période révolutionnaire. De ce fait, l'expérience de 1903 apporte une réponse définitive à une question que le mouvement ouvrier depuis ses origines n'avait pu trancher : quelle forme doit revêtir la dictature du prolétariat ? Bien que l'expérience de la Commune de Paris ait mis en évidence l'impossibilité pour le prolétariat d'utiliser l'appareil d'Etat légué par le capitalisme - et donc la nécessité de le détruire -, elle n'a cependant pas apporté de réponse positive à une telle question. Et près d'un demi-siècle plus tard, cette question ne sera pas encore nettement tranchée pour une grande majorité de révolutionnaires, dont Rosa Luxemburg elle-même lorsqu'en 1918, dans sa brochure sur "La révolution russe", elle reprochera aux bolcheviks d'avoir dissous la Constituante, instrument qu'elle pensait être celui du pouvoir prolétarien. Il revient ainsi aux bolcheviks d'avoir été les premiers à tirer de la façon la plus claire les principaux enseignements de 1903 :
"Ce serait la plus grande absurdité d'accepter que la plus grande révolution dans 1'histoire de 1'humanité, la première fois que le pouvoir passe des mains de la minorité des exploiteurs aux mains de la majorité des exploités, puisse s'accomplir dans le cadre de la vieille démocratie parlementaire et bourgeoise sans les plus grands bouleversements, sans la création de formes nouvelles de démocratie, d'institutions nouvelles et de conditions nouvelles de son application.
(...) La dictature du prolétariat doit entraîner non seulement le changement des formes et institutions démocratiques en général, mais encore une extension sans précédent de la démocratie réelle pour la classe ouvrière assujettie par le capitalisme. Et à la vérité, la forme de la dictature du prolétariat déjà élaborée en fait, c'est-à-dire le pouvoir des soviets en Russie, le système des Conseils ouvriers en Allemagne (...) signifient et réalisent précisément pour les classes laborieuses, c'est-à-dire pour l'énorme majorité de la population, une possibilité effective de jouir des droits et libertés démocratiques, comme il n'en a jamais existé, même approximativement, dans les meilleures républiques démocratiques bourgeoises." (Lénine, "Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat", 1er Congrès de l'Internationale Communiste, mars 1919).
LE ROLE DES REVOLUTIONNAIRES DANS LES CONSEILS OUVRIERS
Dans la mesure où c'est l'ensemble du prolétariat qui doit entreprendre la transformation révolutionnaire de la société pour abolir toute division de la société en classes, sa dictature ne peut que revêtir une forme radicalement opposée .à celle de la bourgeoisie. Ainsi, contre la vision du courant bordiguiste suivant laquelle la forme d'organisation de la classe importe peu pourvu qu'elle permette au parti de prendre le pouvoir, il faut affirmer que sans l'existence des conseils ouvriers, il ne saurait y avoir de révolution prolétarienne. Pour les bordiguistes, le prolétariat ne peut exister comme classe qu'à travers le parti. Ce faisant, eux qui se réclament des conceptions de Lénine sur le rôle du parti révolutionnaire, ne font en réalité que donner une vision complètement caricaturale de ces conceptions. Au lieu de se réapproprier les apports essentiels de Lénine et des bolcheviks à la théorie révolutionnaire, ils ne font que reprendre leurs erreurs en les poussant jusqu'à leurs implications les plus extrêmes et les plus absurdes. Il en est ainsi de l'idée défendue par Lénine et exprimée dans les Thèses du 2ème Congrès de l'IC (mais qui est aussi celle de la majorité des révolutionnaires à cette époque) suivant laquelle le parti révolutionnaire a pour fonction de prendre le pouvoir au nom de la classe. Cette idée, l'histoire nous a enseigné qu'il fallait la rejeter. Du fait que c'est l'ensemble de la classe, organisée en conseils ouvriers, qui est le sujet de la révolution, toute délégation de son pouvoir à un parti, même révolutionnaire, ne peut que conduire à la défaite. C'est ce qu'a illustré de façon tragique la dégénérescence interne de la révolution russe à partir de 1918 dès lors que les soviets se sont vidés de leur pouvoir au profit du parti-Etat. Une telle vision du parti se substituant à la classe est héritée, en fait, du schéma des révolutions bourgeoises où l'exercice du pouvoir par une fraction de la classe dominante ne faisait qu'exprimer la dictature d'une classe minoritaire, exploiteuse, sur la majorité de la société.
Cette conception erronée défendue par le courant bordiguiste suivant laquelle le parti, seul détenteur de la conscience, serait une sorte d'"Etat-major" de la classe, a été souvent justifiée au nom de l'absence d'homogénéité de la conscience dans la classe. Ce type d'arguments ne fait que traduire une incompréhension du phénomène de développement de la conscience de classe en tant que processus historique inhérent à la lutte -même du prolétariat - classe exploitée sous le joug permanent de l'idéologie bourgeoise -vers son émancipation. C'est précisément le surgissement spontané des conseils ouvriers issu de la pratique révolutionnaire du prolétariat qui exprime cette maturation générale de la conscience dans la classe. En ce sens, cette arme dont se dote la classe pour le renversement de l'Etat bourgeois est l'instrument par lequel les masses ouvrières tendent à se dégager, au coeur de la lutte, de l'emprise des idées bourgeoises et à se hisser à une compréhension claire de la perspective révolutionnaire.
Est-ce à dire que les organisations révolutionnaires n'ont pas un rôle à jouer dans les conseils ouvriers, comme le prétend le courant conseilliste pour lequel tout parti ne peut que "violer" la classe ([3] [905]) ? Sous prétexte de défendre l'autonomie du prolétariat, l'aversion que les conseillistes éprouvent envers toute forme organisée des révolutionnaires n'est, en fait, que le corollaire de la vision bordiguiste : hanté par le spectre de la dégénérescence de la révolution russe le courant conseilliste s'avère incapable d'attribuer au parti une autre fonction que celle de prendre le pouvoir au nom et à la place de la classe. Ce que révèle en réalité, cette prétendue défense de l'autonomie du prolétariat, c'est la vision d'un rapport de force, de domination du parti sur la classe.
Ainsi, la vision conseilliste - tout comme celle des bordiguistes - non seulement est étrangère au marxisme pour lequel "les communistes n'ont pas d'intérêts qui les séparent du prolétariat dans son ensemble" (Manifeste Communiste), mais de plus elle ne peut que désarmer le prolétariat dans son affrontement avec les forces de la contre-révolution.
En effet, si les conseils ouvriers sont l'instrument indispensable à la prise du pouvoir prolétarien, leur existence seule n'offre cependant aucune garantie de victoire. Dans la mesure où la bourgeoisie défendra bec et ongles sa domination de classe, elle tentera par tous les moyens de s'infiltrer au sein des conseils ouvriers pour les pousser au suicide. C'est ce qu'a illustré la défaite sanglante du prolétariat en Allemagne 18 lorsqu'en décembre la remise du pouvoir des conseils ouvriers entre les mains d'un parti bourgeois - la Social-démocratie - a signé leur arrêt de mort.
Par ailleurs, la pression de l'idéologie dominante peut se manifester par l'existence au sein des conseils ouvriers non seulement de partis bourgeois mais également par celle de courants ouvriers opportunistes dont le manque de clarté, les hésitations, la tendance à la conciliation avec l'ennemi de classe, constituent une menace permanente pour la révolution. Ce tut notamment le cas des soviets en Russie 17 lorsqu'au lendemain de la révolution de février, le Comité Exécutif des soviets, dominé par des formations opportunistes (mencheviks et socialistes-révolutionnaires) avait délégué son pouvoir au gouvernement Kerenski. Cependant, si le prolétariat en Russie a pu prendre le pouvoir, c'est essentiellement grâce au ressaisissement des soviets après l'été 17 - et c'est là toute la différence avec l'Allemagne 18 - lorsque la majorité des conseils ouvriers est gagnée aux positions des bolcheviks, c'est-à-dire à celles du courant révolutionnaire le plus clair et le plus déterminé.
Ainsi, si dans toute lutte du prolétariat la fonction des révolutionnaires consiste à intervenir au sein de la classe pour défendre ses intérêts généraux, son but final et les moyens qui y mènent, à accélérer le processus d'homogénéisation de la conscience dans la classe, cela est encore plus vrai dans une période où c'est le sort de la révolution qui est en jeu. Même si dans une période révolutionnaire le prolétariat organisé en conseils ouvriers est "capable de faire des miracles" comme le disait Lénine, il faut encore que les partis révolutionnaires "sachent à ce moment-là formuler ses tâches avec le plus d'ampleur et de hardiesse ; il faut que leurs mots d'ordre devancent toujours 1'initiative révolutionnaire des masses, leur servant de phare (...), leur indiquant le chemin le plus court et le plus direct vers une victoire complète, absolue, décisive." (Lénine,"Deux tactiques de la social-démocratie", 1903)
Dans une telle période, le parti a pour tâche, entre autres, de lutter au sein des soviets pour la défense de l'autonomie du prolétariat, non pas au sens que lui accordent les conseillistes - l'autonomie par rapport aux organisations révolutionnaires - mais pour son indépendance par rapport aux autres classes de la société, et en tout premier lieu, à la bourgeoisie. Une des tâches essentielles du parti dans les conseils ouvriers consiste donc à démasquer aux yeux du prolétariat tout parti bourgeois qui tentera de s'infiltrer au sein des conseils pour les vider de leur substance révolutionnaire.
De même que le rôle des minorités révolutionnaires dans les conseils ouvriers traduit encore l'existence de différents niveaux de conscience et de pénétration de l'idéologie bourgeoise, cette hétérogénéité au sein de la classe se manifeste également par l'existence de plusieurs courants et partis. Contrairement à la vision bordiguiste suivant laquelle le processus d'homogénéisation de la conscience dans la classe ne se développe qu'à travers l'existence d'un parti unique, ce n'est pas par des mesures coercitives, d'exclusion de toute autre formation politique prolétarienne que l'avant-garde de la classe peut accélérer un tel processus. Au contraire, l'organisation unitaire de la classe, conformément à sa nature même, ne peut être que le théâtre d'un inévitable affrontement politique entre les positions véhiculées par les diverses tendances existant au sein du prolétariat. Ce n'est en effet que par la confrontation pratique des différents points de vue que la classe pourra se frayer un chemin vers la plus grande clarté, vers une "intelligence nette des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. " (Manifeste Communiste).
Cela ne signifie pas que l'avant-garde la plus déterminée, la plus clairvoyante du prolétariat doive pour autant passer des compromis, trouver des positions intermédiaires avec les courants politiques les plus hésitants. Son rôle consiste à défendre avec la plus grande intransigeance son orientation propre, à impulser le processus de clarification, à amener les masses momentanément soumises aux idées centristes vers des positions révolutionnaires, en les poussant à se démarquer de toutes les déviations réactionnaires dont elles peuvent être victimes.
Ainsi la vision conseilliste qui veut interdire aux révolutionnaires de s'organiser et intervenir dans la vie des conseils constitue une capitulation devant l'infiltration en leur sein de l'idéologie bourgeoise, une désertion face à l'opportunisme et à l'ennemi de classe qui, eux, mènent le combat de façon organisée. A moins que les conseillistes ne préconisent l'interdiction de force par les conseils de toute autre forme d'organisation en dehors d'eux-mêmes. Dans ce cas, non seulement ils ne feraient que rejoindre, d'une certaine façon, la vision coercitive des bordiguistes sur les rapports qui s'établissent au sein de la classe, mais de plus ils exhorteraient les conseils à adopter une politique digne des formes les plus totalitaires de l'Etat capitaliste (ce qui serait le comble de la part de ces défenseurs "acharnés" de la "démocratie ouvrière" !).
Telles sont les déviations que dès 1905 les révolutionnaires ont été capables de combattre au sein des conseils ouvriers afin de se hisser à la hauteur des tâches pour lesquelles la classe les a fait surgir :
"Il me semble que le camarade Radine a tort lorsqu'il pose cette question : 'le soviet des députés ouvriers ou le parti ?' Je pense qu'on ne saurait poser ainsi la question ; qu'il faut aboutir absolument à cette solution : et le soviet des députés ouvriers et le parti (...). Pour diriger la lutte politique le soviet comme le parti sont tous deux absolument nécessaires à l'heure actuelle. (...) Il me semble que le soviet aurait tort de se joindre sans réserve à un parti quelconque. Le soviet (...) est né de la grève générale, à l'occasion de la grève générale. Qui a conduit et fait aboutir la grève ? Tout le prolétariat au sein duquel il existe aussi, heureusement en minorité, de non social-démocrates. Faut-il que ce combat soit livré par les seuls social-démocrates ou uniquement sous le drapeau de la social-démocratie ? Il me semble que non (...). Le soviet des députés ouvriers doit tendre à s'incorporer les députés de tous les ouvriers (...) Quant à nous, social-démocrates , nous tâcherons de lutter en commun avec les camarades prolétaires, sans distinction d'opinion, pour développer une propagande inlassable, opiniâtre de la conception seule conséquente, seule réellement prolétarienne du marxisme. (...) Il ne peut, certes, être question de fusion entre social-démocrates et socialistes-révolutionnaires, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. (...) Les ouvriers qui partagent le point de vue des SR et qui combattent dans les rangs du prolétariat, nous en sommes profondément convaincus, font preuve d'inconséquence, car tout en accomplissant une oeuvre véritablement prolétarienne, ils conservent des conceptions non prolétariennes. (. . . ) Nous tenons comme par le passé les conceptions des SR pour des conceptions non socialistes. Mais dans le combat (...) nous aurons vite fait d'avoir raison de leur inconséquence puisque 1 'histoire elle-même milite en faveur de nos conceptions, de même que la réalité le fait à chaque pas. S'ils n'ont pas appris le social-démocratisme dans nos écrits, c'est notre révolution qui le leur apprendra." (Lénine, "Nos tâches et le Soviet des Députés Ouvriers", novembre 1905).
Pour les révolutionnaires, comme pour l'ensemble de la classe, l'histoire n'est pas une chose morte. Elle est un instrument indispensable pour les combats présents et à venir, à condition qu'ils soient capables d'en tirer tous les enseignements.
Tout comme la Commune de Paris, la révolution de 1905 s'est terminée sur une défaite. Mais cette défaite préparait déjà le terrain pour la victoire d'octobre 1917, de même que par la suite, la défaite de la première vague révolutionnaire des années 17-23 n'était qu'une étape dans le long et douloureux processus qui doit conduire le prolétariat jusqu'à la victoire finale. C'est cette continuité dans la lutte historique du prolétariat qu'affirmait ainsi Lénine lors de la révolution de février 17 :
"Si le prolétariat russe n'avait pas pendant 3 ans de 1905 à 1907, livré de grandes batailles de classe et déployé son énergie révolutionnaire, la 2ème révolution [celle de février 17] n'aurait pu être aussi rapide, en ce sens que son étape initiale n'eût pas été achevée en quelques jours. La 1ère révolution [1905] a profondément ameubli le terrain, déraciné des préjugés séculaires, éveillé à la vie politique et à la lutte politique des millions d'ouvriers et de paysans, révélé les unes aux autres et au monde entier toutes les classes (et les principaux partis) de la société russe quant à leur nature réelle, quant aux rapports réels de leurs intérêts, de leurs forces, de leurs moyens d'action, de leurs buts immédiats et lointains."(Lénine, "Lettres de loin", mars 1917).
La révolution de 1905, puis celle de 1917, devaient donc apporter des enseignements considérables à la classe ouvrière. Elles lui ont permis en particulier de comprendre quels étaient ses organes de combat pour la prise du pouvoir politique, de même qu'elles ont permis d'affirmer le caractère indispensable des minorités révolutionnaires dans la révolution. Cependant, ces premières expériences révolutionnaires du prolétariat ne lui ont pas permis de trancher définitivement la question du rapport entre le parti et les conseils ouvriers. De ce fait, les divergences existant dans le camp des révolutionnaires de l'époque (et notamment au sein des fractions de gauche qui se sont dégagées de la 3ème Internationale) ont constitué un facteur de dispersion de leurs forces dès lors que la 1ère vague révolutionnaire a commencé à décliner, et plus encore dans les années de contre-révolution. Plus d'un demi-siècle d'expérience du prolétariat et de réflexion des courants révolutionnaires qui ont survécu à celle-ci a permis de trancher de façon beaucoup plus claire cette question. Du fait de cette plus grande clarté, les conditions politiques pour un regroupement des révolutionnaires en vue de la formation du futur parti - regroupement rendu indispensable par la reprise historique de la lutte de classe à la fin des années 60 - sont beaucoup plus favorables que par le passé. C'est de la capacité des révolutionnaires à tirer complètement les enseignements de l'expérience passée sur les rapports entre le parti et la classe que dépend leur capacité à préparer dès aujourd'hui les conditions de la victoire future du prolétariat.
Avril
[1] [906] Sur les caractéristiques de la grève de masse, voir Revue Internationale N° 27 : "Notes sur la grève de masse".
[2] [907] En fait, c'est bien avant 1905 que Rosa Luxemburg entrevoit que le capitalisme entre dans un tour nant de son évolution lorsqu 'elle écrit, en 1898, dans sa brochure "Réforme sociale ou Révolution" : "La législation de protection ouvrière (...) sert autant l'intérêt immédiat de classe des capitalistes que ceux de la société en général. Mais cette harmonie cesse à un certain stade du développement capitaliste. Quand ce développement a atteint un certain niveau, les intérêts de classe de la bourgeoisie et ceux du progrès économique commencent à se séparer, même à 1'intérieur du système de l'économie capitaliste. Nous estimons que cette phase a déjà commencé ; en témoignent deux phénomènes importants de la vie sociale actuelle :la politique douanière d'une part, et le militarisme de 1 'autre."
[3] [908] C'est une ironie de constater que c'est précisément chez Lénine et les bolcheviks qu'un courant aussi "anti-léniniste" que le conseillisme a compris toute l'importance des conseils ouvriers et qu'il a emprunté le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux conseils".
Géographique:
Heritage de la Gauche Communiste:
Réponse à la CWO : sur la maturation souterraine de la conscience de classe
- 2627 reads
"Les idées révolutionnaires ne sont la propriété d'aucune organisation, et les problèmes de chaque composante du camp prolétarien sont 1'affaire de tous. Tout en réservant notre droit de critique, nous devons saluer sans réserve tout mouvement, dans les autres organisations, qui nous paraît exprimer une dynamique positive. Les questions soulevées par le congrès de World Révolution sont trop importantes pour rester les affaires privées d'une quelconque organisation, elles sont, et doivent devenir visiblement le problème de tout le milieu prolétarien." (WORKERS'VOICE N° 20).
Ainsi écrivait la Communist Workers'Organisation (CWO) dans son article sur le 6ème congrès de la section en Grande-Bretagne du CCI., un congrès animé par le débat sur la conscience de classe, le conseillisme et le centrisme, et que le CCI a mené pendant près de deux ans. On ne peut être que d'accord avec le jugement ci-dessus, et nous incitons les autres organisations révolutionnaires à suivre l'exemple de la CWO : jusqu'à maintenant la CWO est le seul groupe à avoir commenté sérieusement le débat dans le CCI.
Depuis l'article de WORKERS'VOICE (WV) N° 20 (janvier-février 1985) nous n'avons rien entendu de plus de la part de la CWO sur cette question bien que, à en juger sur des remarques faites dans la presse, elle ne semble pas s'être fait une opinion, soit que le CCI montre réellement une "dynamique positive", soit qu'il essaie simplement de "brouiller les pistes" (cf. WV N° 22 : "La conscience de classe et le rôle du parti"). Mais dans la mesure où nous restons persuadés de l'importance cruciale des questions soulevées dans ce débat, nous souhaitons revenir sur quelques-uns des thèmes principaux de façon plus étendue qu'il n'a été possible dans notre réponse initiale à la CWO (dans WORLD REVOLUTION N° 81 : "La menace conseilliste : la CWO manque la cible").
Dans l'article de WR n°81, nous saluions cette intervention dans le débat, ainsi que sa volonté de marquer son accord avec nous sur certaines questions centrales, "dans la mesure où, dans le passé, en particulier lors des Conférences Internationales de la Gauche Communiste- la CWO a taxé le CCI d'opportunisme quand il défendait l'idée que les groupes révolutionnaires devaient déclare ce qu'ils avaient en commun aussi bien que ce qui les divisait." En même temps, l'article signalait un certain nombre de distorsions et incompréhensions dans la présentation du débat par la CWO ; par exemple:
- l'article dans WV N° 20 faisait apparaître que ce débat était limité à la section du CCI en Grande-Bretagne, alors que, comme toute discussion importante dans le CCI, il avait d'abord et essentiellement un caractère international
- la CWO donne l'impression que ce débat n'est venu à la surface qu'au congrès de W.R. (novembre 1984), mais en fait ses origines remontent au moins au 3ème congrès du CCI en juillet 1983 (sur l'histoire de ce débat voir "Les glissements centristes vers le conseillisme", dans la REVUE INTERNATIONALE N° 42).
- la CWO suggère que le CCI a soudain adopte de "nouvelles" positions sur des questions telles que la conscience de classe et l'opportunisme ; en réalité ce débat nous a permis d'approfondir et de clarifier des positions qui ont toujours été centrales dans la politique du CCI. L'idée selon laquelle le CCI abandonne une ancienne cohérence est une idée que la CWO, à partir d'un point de départ différent, partage avec la "tendance" qui s'est constituée dans le CCI en opposition aux principales orientations dégagées dans ce débat. L'article de la REVUE INTERNATIONALE N°42 répond à cette accusation de' la tendance, en particulier sur la question de l'opportunisme. De même, l'article de WR N° 81 répond à l'insinuation de la CWO selon laquelle, jusqu'ici, le CCI a conçu l'organisation des révolutionnaires comme produit des luttes immédiates de la classe. Contre cette fausse représentation, citons un texte de base sur le parti, adopté en 1979 :
". ..si le parti communiste est un produit de la classe, il faut aussi comprendre... qu'il n'est pas le produit de la classe dans son aspect immédiat, telle qu'elle apparaît en tant que simple objet de 1'exploitation capitaliste, ou un produit simplement de la lutte défensive au jour le jour contre cette exploitation ; il est le produit de la classe dans sa totalité historique L'incapacité à voir, le prolétariat comme une réalité historique et pas seulement contingente, est à la base de toutes les déviations, qu'elles soient de nature économiste, spontanéiste (1'organisation révolutionnaire comme produit passif de la lutte quotidienne) ou de nature élitiste substitutio-niste (1'organisation révolutionnaire vue comme "extérieure à" ou "au-dessus de" la classe)" ("Parti, classe et révolution", W.R. N° 23).
Tout en corrigeant les fausses représentations de la CWO, ce passage nous mène au coeur des critiques que le CCI fait à la fois au conseillisme et au substitutionnisme, à l'égard duquel la CWO a une position centriste, puisqu'elle ne l'embrasse pas franchement. Les récents débats dans le CCI sont nés de divergences sur la question de la "maturation souterraine de la conscience" ; et c'est précisément leur commun "échec à voir le prolétariat comme une réalité historique et pas seulement contingente" qui conduit à la fois le conseillisme et le substitutionnisme à rejeter cette formulation.
CONVERGENCES ET DIVERGENCES
Avant d'en venir à la défense de la notion de "maturation souterraine", il serait utile de s'arrêter sur un point que nous avons en commun avec la CWO sur la question de la conscience de classe : le rejet du conseillisme. Dans son long article "Class consciousness in the marxist perspective" dans REVOLUTIONARY PERSPECTIVES (RP) N° 21, la CWO fait une critique parfaitement correcte de l'idéologie conseilliste qui tend à réduire la conscience de classe (et donc, les organisations révolutionnaires qui l'expriment le plus clairement) à un produit automatique et mécanique des luttes immédiates de la classe. Elle dégage que les Thèses sur Feuerbach de Marx (qui contiennent certaines des plus riches et plus denses affirmations de Marx sur le problème de la conscience) ont pour origine première le rejet de cette vision "automatique" qui prive la conscience de son aspect actif, dynamique, et qui est caractéristique du matérialisme vulgaire de la bourgeoisie. Ce fut précisément l'apparition de cette déviation au sein du CCI ainsi que de conciliations centristes à son égard, qui nous ont obligés à intensifier le combat contre l'idéologie conseilliste, réaffirmant, dans la résolution de janvier 1984 : "La condition de la prise de conscience est donnée par 1'existence historique de la classe capable d'appréhender son avenir, et non pas les luttes contingentes immédiates. Celles-ci, 1'expérience, apportent de nouveaux éléments à son enrichissement, notamment dans les moments d'intense activité du prolétariat. Mais elles ne sont pas les seules : la conscience surgissant avec 1'existence a également sa propre dynamique : la réflexion, la recherche théorique, qui sont autant d'éléments nécessaires à son développement." Et en conséquence :
"Même si elles font partie d'une même unité et agissent l'une sur l'autre, il est faux d'identifier la conscience de_ classe avec la conscience de la ou dans la classe, c'est-à-dire son étendue à un moment donné."(cf. REVUE INTERNATIONALE N° 42 "Les glissements centristes vers le conseillisme" p. 26).
Maintenant, dans WV N° 20, la CWO affirme explicitement qu'elle admet cette distinction entre la conscience de classe dans sa dimension historique, profonde, et l'étendue immédiate de la conscience dans la classe. Mais le CCI a été amené à souligner cette distinction afin de défendre l'idée de la maturation souterraine de la conscience contre la vision conseilliste qui ne peut pas concevoir la conscience de classe existant en dehors de luttes ouvertes. Et c'est là que nos convergences avec la CWO prennent fin, parce que, dans le même article, la CWO rejette la "maturation souterraine" comme une "panacée conseilliste", vision déjà exposée dans RP N° 21.
Ironiquement, la position de la CWO sur cette question est le reflet renversé de la position de notre tendance. Parce que, tandis que la CWO "accepte" la distinction entre profondeur et étendue mais "rejette" la notion de maturation souterraine, notre tendance accepte la notion de maturation souterraine mais "rejette" la distinction entre profondeur et étendue -c'est-à-dire l'argument théorique sur lequel notre organisation appuie la défense de la maturation souterraine de la conscience ! Pour notre tendance, cette distinction est un peu trop "léniniste", mais pour la CWO elle ne l'est pas assez, dans la mesure où, comme elle le dit dans WV N° 20,"nous aurions souhaité une affirmation plus explicite que c'est une différence plus de qualité que de quantité". La tendance voit dans profondeur et extension -qui sont deux dimensions d'une seule conscience de classe- deux sortes de conscience, comme dans la thèse de "Kautsky-Lénine" dans "Que Faire ?". La CWO qui défend réellement cette thèse, regrette de ne pas la retrouver vraiment dans la définition du CCI...
Nous reviendrons là-dessus brièvement. Mais avant d'examiner les contradictions de la CWO, nous voudrions qu'il soit clair que la notion de maturation souterraine, comme beaucoup d'autres formules marxistes (par exemple la baisse du taux de profit...) peut être utilisée et détournée à la mode conseilliste. Dans le CCI, la position "anti-maturation souterraine" est née d'une fausse réponse à une autre fausse position : l'idée, défendue au 3e congrès du CCI, selon laquelle le reflux d'après Pologne 80 durerait un long moment et ne pourrait, en fait, prendre fin que par un "saut qualitatif" préparé presque exclusivement par un processus de maturation souterraine, c'est-à-dire, en dehors de la lutte ouverte. Cette thèse a été balayée par deux souffles puissants : l'un était la résurgence de luttes en septembre 1983, l'autre est né du CCI lui-même. Ainsi, le point 6 de la résolution de janvier 84 sur la situation internationale, déjà citée, attaque cette thèse:
"Erroné était également 1'argument appuyant cette thèse et qui posait comme nécessaire le franchissement d'un "pas qualitatif" dans la lutte (notamment la remise en cause des syndicats) pour que soit mis fin au recul de l'après Pologne. Une telle conception implique que la conscience de classe mûrisse entièrement en dehors des luttes, et que celles-ci ne soient plus que des concrétisations de la clarification opérée préalablement. Poussée à bout, elle rejoint le modernisme, qui attend de la lutte de classe des ruptures avec le passé, la naissance d'une conscience révolutionnaire en opposition avec la fausse conscience "revendicative". Ce qu'elle oublie et occulte, c'est que le déploiement de la conscience de la classe n'est pas un processus purement intellectuel se déroulant dans la tête de chaque ouvrier, mais un processus pratique qui s 'exprime avant tout dans la lutte et qui se nourrit de celle-ci."
Cette vision quasi-moderniste, partage avec le conseillisme une profonde sous-estimation du rôle de l'organisation des révolutionnaires ; parce que si "la conscience mûrit complètement en dehors de la lutte" l'intervention des révolutionnaires dans les luttes quotidiennes de la classe est particulièrement peu utile. Et, bien que les expressions les plus patentes de cette vision aient été abandonnées, le CCI devait confronter dans ses propres rangs, des versions édulcorées de celle-ci. Par exemple, une certaine tendance à présenter l'hostilité passive des ouvriers à l'égard des syndicats, leur réticence à participer aux "actions" -enterrement des syndicats, comme des choses positives en elles-mêmes, alors qu'une telle passivité peut être facilement utilisée pour atomiser encore plus les ouvriers, s'ils ne traduisent pas leur méfiance à l'égard des syndicats en activité collective de classe.
Mais rien de tout cela n'est un argument contre la notion de maturation souterraine, pas plus que les marxistes rejettent la théorie de la baisse du taux de profit simplement parce que les conseillâtes (parmi d'autres) l'appliquent de façon rudimentaire et mécanique. Ainsi, les points 7 et 8 de la résolution de janvier 1984, revenant aux racines de la théorie marxiste sur la conscience, démontrent pourquoi la notion de maturation souterraine est un aspect intégral et irremplaçable de cette théorie (ces points sont cités intégralement dans l'article déjà cité de la REVUE INERNATIONALE N° 42).
LA MATURATION SOUTERRAINE DANS LA PERSPECTIVE MARXISTE
La CWO se considère comme très "marxiste" en rejetant la notion de maturation souterraine. Mais à quelle version du marxisme se réfère-t-elle ? Certainement pas au marxisme de Marx qui n'était pas sourd au creusement souterrain de la "vieille taupe". Certainement pas au marxisme de Rosa Luxemburg dont la perspicacité inestimable à propos des luttes ouvrières de la décadence est rejetée par la CWO comme étant la source ultime du non-sens conseilliste à propos de la maturation souterraine. Dans R.P. N° 21, la CWO décrit Luxemburg comme une "jungienne politique", attribuant à la classe "un inconscient historique collectif où se déroule une lente fermentation vers la compréhension de classe". S'il faut aller par là, Trotsky aussi était un "jungien", un conseilliste, un non-marxiste, quand il écrivait : "Dans une révolution, nous regardons en premier lieu 1'interférence des masses dans le destin de la société. Nous cherchons à découvrir derrière les événements des changements dans la conscience collective. Cela ne peut paraître mystérieux qu'à celui qui considère 1'insurrection des masses comme "spontanée" c'est-à-dire, comme la révolte d'un troupeau utilisée artificiellement par des leaders. En réalité, la simple privation ne suffit pas pour provoquer une insurrection; si cela était, les masses seraient toujours en révolte. Les causes immédiates des événements d'une révolution sont des changements dans l'état d'esprit de classes en conflit.Les changements dans la conscience collective ont naturellement un caractère à moitié invisible. Ce n'est que lorsqu'ils ont atteint un certain degré d'intensité que le nouvel état d'esprit et les nouvelles idées percent la surface sous la forme d'activités de masses." (Histoire de la révolution russe).
Donc, de quelle autorité marxiste la CWO se revendique-t-elle contre la maturation souterraine? Du Lénine de "Que faire ?" adapté à un usage moderne. D'après la CWO, dans RP N° 21, tout ce que la classe peut atteindre à travers ses luttes est une chose appelée "instinct de classe" ou "identité de classe" (Lénine l'appelait "conscience trade-unioniste"), "qui reste une forme de conscience bourgeoise". La conscience de classe elle-même se développe "en dehors de l'existence de l'ensemble du prolétariat", à travers ceux qui possèdent le capital intellectuel nécessaire : l'intelligentsia petite-bourgeoise. Et si, dans les luttes ouvertes elle ne peut atteindre que ce stade d'identité de classe, les choses sont encore pires quand les luttes cessent : "En dehors des périodes de luttes ouvertes la conscience du prolétariat reflue, et la classe est atomisée. Et ce parce que, pour la classe, la conscience est collective, et elle ne fait l'expérience de cette collectivité que dans la lutte. Quand elle est atomisée et individualisée dans la défaite, sa conscience retourne à celle de l'individualisme petit-bourgeois, le réservoir se tarit. "
Dans cette vision, la lutte de classe du prolétariat est un processus purement cyclique, et seule l'intervention divine du parti peut apporter la lumière à cet effort aveugle, animal, qui sans cela resterait condamné à l'éternel retour à la vie instinctive.
A propos du Lénine de "Que Faire", nous avons déjà dit à plusieurs reprises que dans ce livre Lénine a essentiellement raison dans la critique des "conseillistes" de l'époque, les économistes, qui voulaient réduire la conscience de classe d'un phénomène actif, historique et politique, à un banal reflet de la lutte quotidienne au niveau de l'atelier. Mais cet accord fondamental avec Lénine ne nous empêche pas de dégager que, en combattant le matérialisme vulgaire des économistes, Lénine a "trop tordu la barre" et est tombé dans la déviation idéaliste qui sépare la conscience de l'être (de même que, dans son "Matérialisme et Empiriocriticisme", en combattant l'idéalisme de Bogdanov et Cie, il tombait dans le matérialisme vulgaire qui présente la conscience comme un pur reflet de l'être).
Nous ne pouvons pas nous attarder ici à argumenter contre les thèses de Lénine et la version que la CWO s'en fait (nous l'avons déjà fait en longueur ailleurs : dans la brochure Organisations communistes et conscience de classe, et les articles sur, la vision de la CWO de la conscience de classe, dans WR N° 69 et 70). Mais nous ferons les remarques suivantes :
- La théorie de Lénine d'une "conscience venue de l'extérieur" était une aberration qui n'a jamais été intégrée dans le programme d'aucun parti révolutionnaire de l'époque, et qui a été rejetée, par la suite, par Lénine lui-même. La CWO, dans RP N° 21, nie cela. Mais elle devrait d'abord appeler Trotsky à la barre des témoins, parce qu'il a écrit :"L'auteur (de "Que Faire ?") lui-même, reconnut ultérieurement la nature tendancieuse et donc erronée de cette théorie qu'il avait utilisée comme une arme parmi d'autres dans la lutte contre 1'"économisme" et dans sa déférence envers la nature élémentaire du mouvement ouvrier." ("Staline").
Ou bien, si la parole de Trotsky n'est pas assez bonne pour elle, la CWO peut réexaminer Lénine lui-même qui, à l'époque de la révolution de 1903, fut amené à polémiquer contre ces bolcheviks dont l'adhésion rigide à la lettre de "Que Faire ?" les avait conduits à ne pas intervenir concrètement dans le mouvement des Soviets, et qui écrivait :"A chaque étape les ouvriers se trouvent confrontés à leur ennemi principal la class capitaliste. Dans le combat contre cet ennemi, 1'ouvrier devient socialiste, en vient à réaliser la nécessité d'une complète restructuration de toute la société, 1'abolition totale de toute pauvreté et de toute oppression." ("Les leçons de a révolution" -Oeuvres complètes, vol. 16).
- La thèse de Lénine (empruntée à Kautsky) va à l'encontre de toutes les affirmations les plus cruciales de Marx sur la conscience Contre les "Thèses sur Feuerbach" où Marx attaque le matérialisme contemplatif de la bourgeoisie qui considère le mouvement de la réalité comme un objet extérieur seulement et non "subjectivement", c'est-à-dire, elle ne voit pas la conscience et la pratique consciente comme partie intégrante et élément actif au sein du mouvement. La pénétration de ce point de vue dans les rangs du prolétariat donne naissance à l'erreur substitutionniste (dans les "Thèses" Marx désigne Owen comme une expression de cela) qui implique la "division de la société en deux parties dont l'une est supérieure à la société" et oublie que "l'éducateur lui-même a besoin d'être éduqué". Surtout, la thèse de Lénine va à rencontre de la position défendue dans "L'idéologie allemande", d'après laquelle c'est l'être social qui détermine la conscience et donc, elle va également à rencontre d'une des affirmations les plus explicites sur la conscience de classe de ce même ouvrage : "La conception de 1'histoire que nous venons de développer nous donne encore finalement les résultats suivants : dans le développement des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants et ne sont plus des forces productives, mais des forces destructrices (le machinisme et 1'argent ), et, fait lié au précédent, il naît une classe qui supporte toutes les charges de la société sans jouir de ses avantages, qui est expulsée de la société et se trouve, de force, dans 1'opposition la plus ouverte avec toutes les autres classes, une classe que forme la majorité des membres de la société et d'où surgit la conscience de la nécessité d'une révolution radicale, conscience qui est la conscience communiste et peut se former aussi, bien entendu, dans les autres classes quand on voit la situation de cette classe. " ("L'idéologie allemande", souligné par nous).
Notons que Marx renverse complètement la façon dont Lénine pose le problème : la conscience communiste "émane" du prolétariat et à cause de cela des éléments d'autres classes peuvent atteindre la conscience communiste, quoique, comme le dit le Manifeste Communiste, en rejoignant le prolétariat, en rompant avec l'héritage idéologique de leur classe. Nulle part ici nous ne trouvons trace d'une conscience communiste "émanant" des intellectuels pour être ensuite "injectée" dans le prolétariat.
Nul doute que la CWO ait ravivé cette aberration avec la louable intention de continuer le combat de Lénine contre le spontanéisme. Mais, dans la pratique, les "importateurs" de conscience finissent souvent sur le même terrain que les spontanéistes. Dans WR nous avons longuement écrit (spécialement dans les Nos 71 et 75) sur le fait que l'intervention de la CWO dans la grève des mineurs montrait la même tendance à capituler devant la conscience immédiate des ouvriers que celle du groupe conseilliste Wildcat. Cette conjonction n'est pas un hasard mais a des racines théoriques profondes comme le démontre justement la question de la maturation souterraine de la conscience. Ainsi, pour reprendre les termes de Trotsky, autant les conseillistes que les substitutionnistes tendent à voir "l'insurrection des masses comme 'spontanée', c'est-à-dire comme la révolte d'un troupeau utilisée artificiellement par des leaders", la seule différence étant que les conseillistes veulent que les ouvriers soient un troupeau sans chef alors que les substitutionnistes se voient comme les gardiens du troupeau. Aucun ne réussit à faire le lien entre les explosions de masses et les préliminaires "changements dans l'état d'esprit des classes en conflit". Parce que ces changements ont un "caractère à demi caché", les empiristes de ces deux ailes du camp prolétarien, paralysés par l'apparence immédiate de la classe, ne parviennent pas à les voir du tout. Ainsi, quand la CWO écrivait "en dehors des périodes de lutte ouverte, la conscience du prolétariat reflue", elle coïncidait dans le temps et dans le con tenu avec l'émergence dans le CCI d'une vision conseilliste qui insistait, non moins fermement, sur le fait que"les moments de recul dans la lutte marquent une régression de la conscience (...). Le seul et unique creuset de la conscience de classe, c'est sa lutte massive et ouverte". (Revue Internationale n°42, p.23).
POURQUOI UNE "MATURATION SOUTERRAINE" ?
"En tant que marxistes, le point de départ de toute discussion sur la conscience de classe est la prise de position sans ambiguïté de Marx dans 1'"Idéologie allemande", selon laquelle 'les idées de la- classe dominante sont dans toutes les époques les idées dominantes'. . . "
Ainsi parlait la CWO dans "Class conscioussness and councilist confusions" dans R.P. N° 17. Excusez-nous, camarades, mais vous marchez encore sur la tête. En tant que marxistes, le point de départ de toute discussion sur la conscience de classe est la prise de position sans ambiguïté de Marx, dans l'"Idéologie allemande", selon laquelle "1'existence d'idées révolutionnaires dans une période particulière présuppose l'existence d'une classe révolutionnaire "
La CWO ne voit qu'un aspect du prolétariat : son aspect de classe exploitée. Mais le marxisme se distingue par son insistance sur le fait que le prolétariat I est la première classe exploitée dans l'histoire, qui est en même temps classe révolutionnaire ; qu'il porte en lui la conscience de l'avenir de l'espèce humaine ; qu'il est l'incarnation du communisme.
Pour la CWO c'est de l'hégélianisme, de l'hérésie, du charabia mystique. Quoi ? Le futur serait déjà en action dans le présent ? "On se frotte les yeux ; serions-nous en train de rêver ?" bredouillent les gardiens de la Raison outragée dans R.P. N° 21. Pour nous, la nature du prolétariat comme classe communiste ne fait aucun doute. Pas plus qu'elle ne faisait de doute pour Marx dans "L'idéologie allemande" quand il définissait le communisme comme n'étant rien d'autre que l'activité du prolétariat et donc comme "le mouvement réel qui abolit 1'état actuel "
Non, pour nous la question est plutôt : comment le prolétariat, cette classe exploitée et dominée, prend-il conscience de sa nature révolutionnaire, de son destin historique, étant donné qu'il vit effectivement dans un monde où les idées dominantes sont celles de la classe dominante ? Et en cernant cette question nous voyons comment le mouvement du prolétariat vers la connaissance de lui-même passe nécessairement, inévitablement, par des phases de maturation souterraine.
DE L'INCONSCIENCE A LA CONSCIENCE
Dans R.P. N° 21, la CWO cite, comme une évidence du "suivisme" de Rosa Luxemburg, sa prise de position dans "Marxisme contre dictature" :"L'inconscient précède le conscient et la logique du processus historique objectif précède la logique subjective de ses protagonistes':Et la CWO pointe alors son doigt moqueur sur la pauvre Rosa :"Mais pour le parti il ne peut en être ainsi. Il doit être en avance sur la logique des événements.".
Mais la CWO est "inconsciente" de ce que Rosa vise là. Le passage ci-dessus est simplement une réaffirmation du postulat marxiste de base selon lequel l'être détermine la conscience et donc, une réaffirmation du fait que, dans la préhistoire de notre espèce, quand l'homme est dominé par des forces naturelles et sociales, qu'il ne peut contrôler, l'activité consciente tend à être subordonnée à des motivations et des processus inconscients. Mais cette réalité n'invalide pas ce postulat marxiste tout aussi fondamental selon lequel, ce qui distingue l'espèce humaine (et pas seulement le parti communiste) du reste du règne animal, c'est précisément sa capacité à prévoir, à être consciemment en avance sur ses actions concrètes. Et, une des conséquences de cet apparent paradoxe est que, jusqu'ici, toute pensée, y compris le travail mental le plus rigoureusement scientifique, a été amené à passer par des phases de maturation inconsciente et semi-consciente, de creuser le sous-sol avant de s'élever au soleil brillant de l'avenir.
Nous ne pouvons pas continuer là-dessus ici. Mais il suffit de dire que dans le prolétariat, ce paradoxe est poussé à son extrême limite : d'un côté, c'est la plus opprimée, la plus dominée et la plus aliénée de toutes les classes exploitées, portant sur ses épaules le fardeau et les souffrances de toute l'humanité ; de l'autre, c'est la "classe de la conscience", la classe dont la mission historique est de libérer la conscience humaine de la subordination à l'inconscience, et donc de réaliser vraiment la capacité humaine à prévoir et modeler sa propre destinée. Plus encore que pour toutes les classes historiques précédentes, le mouvement par lequel cette classe, la plus asservie de toutes, devient l'avant-garde de la conscience de l'humanité, ce mouvement doit, en très grande partie, être un mouvement souterrain, "à demi-caché".
LE CHEMIN DE LA CONSCIENCE PROLETARIENNE
Comme classe exploitée, le prolétariat n'a pas de base économique pour garantir un progrès automatique de sa lutte. En conséquence, comme Marx le disait dans "Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte", les révolutions prolétariennes "se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, (...) reculent constamment à nouveau devant 1'immensité infinie de leurs propres buts". Mais, contrairement à la vision de la CWO, l'inévitable mouvement de la lutte de classe avec ses hauts et des bas, ses avancées et ses reculs, n'est pas un cercle vicieux : au niveau historique le plus fondamental, c'est le mouvement à travers lequel la classe prolétarienne mûrit et avance vers sa propre conscience. Et contre la représentation de la CWO et des conseillistes, d'une classe sombrant dans une atomisation totale quand la lutte ouverte prend fin, nous ne pouvons que répéter ce qui est dit dans la résolution de janvier 84 : "La condition de la prise de conscience est donnée par 1'existence historique de la classe capable d'appréhender son avenir, et non par les luttes contingentes immédiates. " En d'autres termes, l'être historique de la classe ne se dissout pas quand la lutte immédiate s'éteint. Même en dehors des périodes de lutte ouverte, la classe reste une force vivante, collective ; aussi, a conscience peut continuer et continue de fait à se développer dans de telles périodes. Il est vrai, néanmoins, que le rapport de forces contingent entre les classes influence la façon dont ce développement s'opère. De façon générale, nous pouvons donc dire que : - dans une période de défaite et de contre-révolution, la conscience de classe est sérieusement réduite en étendue, dans la mesure où la majorité de la classe est piégée par les mystifications de la bourgeoisie, mais cette conscience peut malgré tout connaître de profondes avancées en profondeur, comme en témoigne la rédaction du "Capital" après la défaite de 1848, et plus particulièrement le travail de "Bilan" dans les jours sombres des années 30 ;
- dans les périodes de montée générale de la lutte de classe, comme aujourd'hui, le processus de maturation souterraine tend à mêler les deux dimensions -profondeur et étendue. En d'autres termes, toute la classe est impliquée dans un mouvement d'avancée de la conscience, même si cela s'exprime encore à des degrés très divers :
- au niveau de conscience le plus bas, ainsi que dans les plus larges couches de la classe, cela prend la forme d'une contradiction croissante entre l'être historique, les besoins réels de la classe, et l'adhésion superficielle des ouvriers aux idées bourgeoises. Ce heurt peut rester longtemps en grande partie non-reconnu, enfoui ou réprimé, ou bien il peut commencer à émerger sous la forme de désillusion et de désengagement vis-à-vis des thèmes principaux de l'idéologie bourgeoise ;
- dans un secteur plus restreint de la classe, parmi les ouvriers qui restent fondamentalement sur le terrain prolétarien, cela prend la forme d'une réflexion sur les luttes passées; de discussions plus ou moins formelles sur les luttes à venir, l'émergence de noyaux combatifs dans les usines et parmi les chômeurs. Récemment, la manifestation la plus spectaculaire de cet aspect du phénomène de maturation souterraine a été donnée par les grèves de masse en Pologne en 1980, dans lesquelles les méthodes de lutte utilisées par les ouvriers ont montré qu'il y avait eu une réelle assimilation de nombreuses leçons des luttes de 1956, 70 et 76 (pour une analyse plus complète de la façon dont les événements de Pologne démontrent l'existence d'une mémoire collective de classe, voir l'article sur la Pologne et le rôle des révolutionnaires dans la Revue Internationale N° 24) ; dans une fraction de la classe, qui est encore plus limitée en taille, mais destinée à croître avec l'avancée de la lutte, cela prend la forme d'une défense explicite du programme communiste, et donc de regroupement en avant-garde marxiste organisée. L'émergence d'organisations communistes, loin d'être lune réfutation de la notion de maturation souterraine, est à la fois un produit et un facteur actif de celle-ci. Elles sont "produit" en ce sens que, contrairement à la théorie idéaliste défendue par la CWO, la minorité communiste ne vient pas du ciel mais de la terre ; elle est le fruit de la maturation historique du prolétariat, du devenir historique de la classe, qui est nécessairement "cachée" pour les méthodes de perception immédiatistes, empiriques, instillées par l'idéologie bourgeoise. Un facteur actif parce que -spécialement dans la période de décadence où le prolétariat est privé de ses organisations de masse permanentes et que l'Etat bourgeois utilise tous les moyens dont il dispose pour enfouir aussi profondément qu'il le peut ces mouvements de la conscience de classe, les fractions communistes sont en grande partie réduites à des minorités si ténues qu'elles tendent à faire un travail "souterrain" dont l'influence sur la lutte prend la forme d'un processus de contagion moléculaire et non visible. A un moment où la troisième vague de luttes depuis 1968 n'est encore qu'à ses débuts, la capacité des révolutionnaires d'avoir un impact réel sur la lutte (impact qui s'exprimera plus complètement dans l'intervention du parti) commence aujourd'hui seulement à être évident. Mais cela ne signifie pas que tout le travail des révolutionnaires ces quinze dernières années a disparu dans le vide. Au contraire : les graines qu'ils ont semées commencent maintenant à germer.
La reconnaissance par les révolutionnaires du fait qu'ils sont un produit de la maturation souterraine de la conscience n'implique aucunement une attitude passive vis-à-vis de leurs tâches, une sous-estimation de leur rôle indispensable. Au contraire : reconnaître que seuls les communistes, dans le cours "normal" de la société capitaliste, sont explicitement conscients du processus sous-jacent se déroulant dans la classe, ne peut qu'augmenter l'urgence d'appliquer toute l'organisation et la détermination nécessaires à la tâche de transformer cette minorité en majorité. Comme nous l'avons déjà souligné, il n'y a pas de lien automatique entre l'être historique de la classe et la conscience de cet être. Si la transformation de la minorité en majorité n'a pas lieu, si la conscience de la classe ne devient pas conscience de classe dans le sens le plus fort du terme, le prolétariat sera incapable de remplir sa mission historique et toute l'humanité en subira les conséquences.
D'autre part, le rejet de la notion de maturation souterraine conduit, dans la pratique, à l'incapacité d'être "en avance sur la logique des événements", de donner à la classe ouvrière une perspective à ses luttes. Comme le dit la résolution de 84 dans sa conclusion : "toute conception qui fait découler la conscience uniquement des conditions objectives et des luttes que celles-ci provoquent est incapable de rendre compte de 1'existence d'un cours historique."
Incapable de voir la maturation réelle du prolétariat, de mesurer la force sociale qu'il représente même quand il ne lutte pas ouvertement, la CWO s'est révélée incapable de comprendre pourquoi la classe est aujourd'hui une barrière à la marche de la bourgeoisie vers la guerre : elle tend ainsi à tomber dans le pessimisme ou le déboussolement complet quand elle doit se prononcer sur la direction générale que prend la société. Incapable de comprendre l'existence d'un cours aux affrontements de classe, elle a aussi été incapable de refléter l'évolution progressive du réveil prolétarien depuis 1968, comme le démontrent le fait qu'elle n'ait pas su prévoir la reprise des luttes de 1983, sa reconnaissance tardive du fait qu'elle existe quand même et ses hésitations persistantes sur où va le cours (à un moment elle a même exprimé la crainte qu'une défaite de la grève des mineurs de Grande-Bretagne ne mette fin à la reprise des luttes dans toute l'Europe). Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent une règle générale : si on ne voit pas le mouvement réel de la classe en premier lieu, on est incapable d'indiquer vers où il va aller dans le futur et donc incapable d'être un élément actif dans la construction de ce futur. Et on sera incapable de saisir le mouvement si l'on ne parvient pas à gratter la couche superficielle de la "réalité" qui, d'après la philosophie empiriste de la bourgeoisie, est "tout ce qui existe".
MU
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Discussion : opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations
- 3026 reads
Dans les numéros 40, 41 et 42 de la Revue Internationale nous avons publié des articles portant sur un débat qui s'est mené dans le CCI depuis plus de deux ans. Dans le premier de ces articles, "Le danger du conseillisme" (n°40), nous expliquions toute l'importance que revêt la publication vers l'extérieur des discussions politiques qui se déroulent au sein des organisations révolutionnaires dans la mesure où celles-ci ne sont pas des cénacles où l'on "discute pour discuter", mais débattent de questions qui intéressent l'ensemble de la classe ouvrière, puisque leur raison d'être est de participer activement au processus de prise de conscience de celle-ci en vue de ses tâches révolutionnaires. Dans cet article, ainsi que dans celui publié dans le n°42, "Les glissements centristes vers le conseillisme", nous donnions des éléments sur la façon dont s'est déroulé le débat (y compris en citant de longs extraits des textes du débat interne). Nous n'y reviendrons pas sinon pour rappeler que les principales questions qui opposent la minorité (constituée en "tendance" depuis janvier 1985) aux orientations du CCI sont :
- le point 7 de la résolution adoptée en janvier 84 par l'organe central du CCI (reproduit dans l'article du n°42) portant sur la conscience de classe ;
- l'appréciation du danger que représente le conseillisme pour la classe et ses organisations révolutionnaires aujourd'hui et dans le futur ;
- l'analyse des phénomènes de l'opportunisme et du centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations.
Les trois premiers articles traitaient principalement de la question du danger du conseillisme :
- celui de la Revue n°40 exposant les positions de l'organisation,
- celui de la Revue n°41 ("Le CCI et la politique du moindre mal") exposant les positions de la minorité,
- celui de la Revue n°42 répondant, au nom du CCI, à l'article précédent.
Dans le présent numéro est traitée la question de l'opportunisme et du centrisme sous forme d'un article représentant les positions de la "tendance" ("Le concept de 'centrisme' : le chemin de l'abandon des positions de classe") et d'un article de réponse défendant les positions du CCI.
Le concept du "centrisme": le chemin de l'abandon des positions de classe
Cet article se donne comme tâche de présenter les positions de la "Tendance" qui s'est constituée dans le CCI en janvier 1985, sur la question du centrisme. Face à l'utilisation du terme "centrisme" par la majorité du CCI pour caractériser le processus de pénétration de l'idéologie bourgeoise dans les organisations révolutionnaires du prolétariat, nous voulons dans cet article:
- donner une définition claire, marxiste, du centrisme comme courant ou tendance politique qui existait autrefois au sein du mouvement ouvrier;
- montrer que le centrisme ne peut pas exister dans la période de décadence du capitalisme;
- souligner le très grave danger que constitue à notre époque l'utilisation du concept de centrisme pour une organisation révolutionnaire.
La "définition" du centrisme donnée par la majorité du CCI se limite à l'énumération de toute une série d'attitudes et de comportements (la conciliation, l'hésitation, la vacillation, le fait "de ne pas aller jusqu'au bout"). Si ces attitudes et comportements sont indiscutablement politiques de nature, caractéristiques des tendances centristes qui existaient autrefois dans l'histoire (cf. Rosa Luxemburg sur le caractère "visqueux" de Kautsky), ils sont nettement insuffisants comme définition d'un courant politique. Le centrisme a toujours eu un programme politique précis et une base matérielle spécifique. Les révolutionnaires marxistes (Luxemburg, Pannekoek, Bordiga, Lénine) qui combattaient le danger centriste responsable de la corruption et la dégénérescence de la IIe Internationale, ont toujours cherché la base réelle de la conciliation et la vacillation du centrisme dans ses positions politiques et dans la base matérielle de cette maladie du mouvement ouvrier avant 1914.
S'il y avait plusieurs variétés de centrisme dans la IIe Internationale : le menchevisme en Russie, les maximalistes en Italie, l'austro-marxisme dans l'empire des Habsbourg, l'exemple classique du centrisme est le kautskysme en Allemagne. Un bref examen des positions politiques du centre kautskyste montrera que la lutte entre les marxistes révolutionnaires et les centristes ne peut pas se réduire à un conflit entre "les durs" et "les mous". C'est une lutte entre deux programmes politiques complètement différents.
La base théorique et méthodologique du kautskysme est un matérialisme mécaniste, un déterminisme économique vulgaire menant à un fatalisme par rapport au processus historique. Prenant son point de départ non pas dans Marx, mais dans ce qu'il croyait être la révolution darwinienne de la science, Kautsky fait un amalgame entre la société et la nature et construit une théorie basée sur des lois universelles de la nature qui se réaliseraient de façon inéluctable à travers l'histoire.
Pour Kautsky, la conscience -devenue un simple épiphénomène- doit être apportée "de l'extérieur" par les intellectuels, le prolétariat étant une armée "disciplinée" par son état-major : la direction du parti. Kautsky rejette sans équivoque toute idée que l'action des masses constitue un creuset pour le développement de la conscience de classe, tout comme il insiste sur le fait que les seules formes d'organisation prolétarienne sont le parti de masse social-démocrate et les syndicats, chacun dirigé par un appareil bureaucratique professionnel.
Le but de la lutte prolétarienne est, selon Kautsky : "...la conquête du pouvoir étatique à travers la conquête d'une majorité au parlement et l'élévation du parlement à un poste de commandement dans l'État, certainement pas la destruction du pouvoir étatique". ("Die neue Taktik", 1911-12). Prendre l'appareil étatique existant mais pas le détruire, faire une transition pacifique au socialisme à travers le suffrage universel, utiliser le parlement comme instrument de la transformation sociale -voilà le programme politique du centrisme kautskyste. En opposition à une politique de lutte jusqu'au bout qui veut des batailles décisives avec l'ennemi de classe, Kautsky, dans sa polémique avec Rosa Luxemburg, à propos de la grève de masse, préconise une stratégie d'usure basée sur "le droit de vote, le droit d'assemblée, la liberté de la presse, la liberté d'association" accordés au prolétariat occidental ("Was nun?", 1909-10). Dans le cadre de cette stratégie d'usure, Kautsky donne un rôle extrêmement limité et subordonné à l'action des masses : le but des actions de masse "ne peut pas être de détruire le pouvoir d'État mais seulement d'obliger le gouvernement à céder sur une position particulière, ou de remplacer un gouvernement hostile au prolétariat par un gouvernement favorable à lui". (Die neue Taktik). De plus, selon Kautsky, le socialisme lui-même nécessite "des spécialistes entraînés" pour diriger l'appareil étatique : "le gouvernement pour le peuple et par le peuple dans le sens où des affaires publiques seraient gérées non pas par des fonctionnaires mais par les masses populaires travaillant sans salaires dans leur temps libre est une utopie, une utopie réactionnaire et anti-démocratique"("Die Agrarfrage" - 1899).
Un examen du menchevisme ou de l'austro-marxisme révélerait la même chose, c'est-à-dire, que le centrisme -comme toute tendance politique dans le mouvement ouvrier- doit être défini en premier lieu par ses positions politiques et son programme. Ici il est important de souligner la distinction marxiste fondamentale entre l'apparence et l'essence dans la réalité objective, la première étant aussi "réelle" que la seconde[1]. L'apparence du centrisme est, en effet, l'hésitation, la vacillation, etc. Mais l'essence du centrisme -politiquement- est son attachement constant et sans faille au légalisme, au gradualisme, au parlementarisme et à la "démocratie" dans la lutte pour le socialisme. Il n'a jamais oscillé d'un centimètre dans cette orientation.
La base matérielle du centrisme dans les sociétés capitalistes avancées d'Europe était la machine électorale des partis de masse social-démocrates (et surtout ses fonctionnaires salariés, ses bureaucrates professionnels et ses représentants parlementaires) ainsi que l'appareil syndical grandissant. C'est dans ces couches, qui ont sapé l'élan révolutionnaire des partis ouvriers, et pas dans une soi-disant "aristocratie ouvrière" créée, comme croyait Lénine, dans les masses prolétariennes par les miettes des superprofits capitalistes, que nous trouvons la base matérielle du centrisme. Mais, que l'on cherche du côté de la machine électorale social-démocrate et l'appareil syndical ou du côté d'une aristocratie ouvrière fictive, il est évident que les marxistes révolutionnaires ont toujours cherché à comprendre la réalité du centrisme par rapport à une base matérielle spécifique. De plus, il est essentiel de se rappeler que ces couches et ces institutions du mouvement ouvrier donnant au centrisme une base sociale -la machine électorale et l'appareil syndical- étaient justement en train d'être happées dans l'engrenage de l'appareil de l'État capitaliste, bien que cette intégration n'atteigne son point culminant que dans la première guerre mondiale.
Toute définition qui ignore que le centrisme implique toujours des positions politiques spécifiques et qu'il a toujours eu une base matérielle déterminée, toute définition qui se limite à des attitudes et des comportements (comme la définition de la majorité actuelle du CCI) est totalement incapable de comprendre un phénomène aussi complexe et historiquement spécifique que le centrisme et ne peut pas prétendre se réclamer de la méthode marxiste.
C'est maintenant la spécificité historique du centrisme que nous voulons aborder. Avant de savoir si le centrisme comme tendance au sein du mouvement ouvrier peut encore exister à l'époque de la décadence du capitalisme, il faut d'abord comprendre comment les frontières politiques du mouvement ouvrier ont été façonnées et transformées au cours de l'histoire. Ce qui constitue les frontières politiques à une époque donnée est déterminé par la nature de la période du développement du capitalisme, par les tâches objectives face au prolétariat et par l'organisation du capital et son État. Depuis le début du mouvement prolétarien, il y a un processus de décantation historique qui a progressivement rétréci et délimité les paramètres du terrain politique de la classe ouvrière.
À l'époque de la 1e Internationale, le développement du capitalisme, même au cœur de l'Europe, est encore caractérisé par l'introduction de la production industrielle à grande échelle et la formation d'un véritable prolétariat à partir de l'artisanat déclinant et la paysannerie dépossédée. Parmi les tâches historiques objectives face au jeune mouvement prolétarien à cette époque se trouvent le triomphe de la révolution démocratique anti-féodale et l'aboutissement du processus d'unification nationale dans les pays tels que l'Italie et l'Allemagne. Par conséquent, les frontières du mouvement ouvrier pouvaient regrouper les bakouninistes et les proudhoniens caractérisés par des programmes politiques ancrés dans le passé petit-bourgeois artisanal et paysan ; les blanquistes avec leur base dans l'intelligentsia jacobine et même les mazziniens avec leur programme de nationalisme et républicanisme radical ainsi que les marxistes, l'expression spécifique du prolétariat comme la classe ayant "des chaînes radicales".
À l'époque de la IIe Internationale, le développement du capitalisme obligea le prolétariat à se constituer en parti politique distinct, en opposition à tous les courants bourgeois et petits-bourgeois. La tâche de la classe ouvrière était aussi bien la préparation organisationnelle et idéologique de la révolution socialiste que la lutte pour des réformes durables dans le cadre du capitalisme ascendant ; c'est l'époque où le prolétariat avait un programme "minimum" et "maximum". La fin de la période des révolutions nationales, antiféodales, et la fin de l'enfance du prolétariat industriel comme classe avaient considérablement rétréci la délimitation du mouvement ouvrier. Mais la tension constante entre le programme maximum et minimum, entre la lutte pour le socialisme et celle pour les réformes, signifiait que des tendances aussi différentes que le marxisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, le centrisme et le "révisionnisme" pouvaient exister sur le terrain politique de la classe ouvrière.
À l'époque de la décadence du capitalisme, à l'ère du capitalisme d'État, avec l'intégration des partis politiques de masse et des syndicats dans les rouages de l'État totalitaire du capital, une époque ouverte par la première guerre mondiale, la révolution prolétarienne internationale devient le seule tâche objective de la classe ouvrière. La fin de toute distinction entre programme maximum et minimum, l'impossibilité des réformes à l'époque de la crise permanente, signifient que le terrain politique de la classe ouvrière et le marxisme révolutionnaire deviennent identiques. Les différentes tendances centristes avec leur programme politique du parlementarisme et du légalisme, avec leur stratégie d'usure, avec leur base matérielle dans les partis de masse parlementaires et les syndicats social-démocrates sont passées irrémédiablement dans le camp du capitalisme. Il faut être absolument clair sur les implications du changement fondamental dans la nature de la période, dans les tâches face à la classe ouvrière et dans l'organisation du capital : l'espace politique autrefois occupé par le centrisme est aujourd'hui définitivement occupé par l'État capitaliste et son appareil politique de gauche.
Les camarades de la majorité du CCI diront que si les positions politiques classiques du centrisme sont aujourd'hui celles de l'ennemi capitaliste (ce que personne ne nie dans le CCI), il existerait d'autres positions politiques qui caractérisent le centrisme à l'époque de la décadence. Outre le fait que cette façon de poser le problème ignore le fondement et la spécificité historique du centrisme, la vraie question reste toujours posée : qu'on nous dise quelles sont précisément ces positions "centristes" new-look ? Est ce qu'il y a une position "centriste" sur les syndicats ou sur l'électoralisme, par exemple ? Est-ce que la défense du syndicalisme de base ou du "parlementarisme révolutionnaire" devient maintenant "centriste" et non pas -comme nous avons toujours dit- contre-révolutionnaire ? Aucun camarade de la majorité ne s'est donné la peine de définir cette fausse version moderne du centrisme en positions politiques précises. Ces camarades se contentent de répéter que le centrisme est "conciliation", "vacillation", etc. Une telle "définition" est non seulement politiquement imprécise par rapport aux classes[2], mais, comme nous allons voir plus loin, ce n'est qu'avec Trotsky et l'Opposition de Gauche déjà dégénérescente des années 30 qu'un marxiste osera mettre en avant une définition du centrisme basée sur des attitudes et des comportements.
Nous allons voir comment le concept du centrisme a été utilisé par des révolutionnaires dans la période de décadence du capitalisme, comment cette notion à toujours fini par effacer les frontières de classe et comment elle devient un symptôme majeur de corruption idéologique et politique de la part des marxistes qui l'ont employée.
Dans la 3e Internationale pendant la formation des partis communistes nationaux en Europe occidentale et centrale (1919- 1922) et avec Trotsky et l'Opposition de Gauche avant son passage définitif dans le camp ennemi pendant la deuxième guerre mondiale, nous voyons deux tentatives de reporter le concept du centrisme employé par Luxemburg, Lénine et d'autres dans la période avant 1914 ("centrisme" pour désigner des tendances politiques corrompues mais encore sur le terrain de classe du prolétariat) à l'époque de la décadence, l'époque des guerres et révolutions ouverte par la première guerre mondiale.
Le processus de la formation des partis communistes en Europe occidentale et centrale après 1919 n'a pas du tout suivi le chemin des Bolcheviks en Russie, c'est-à-dire, le chemin d'une lutte théorique et politique intransigeante menée par une fraction marxiste révolutionnaire pour arriver à une clarté programmatique. Cet avis se trouve déjà dans les pages de "Bilan", clairement mis en avant par les camarades de la fraction italienne de la Gauche Communiste des années 30. La stratégie et la tactique de l'I.C. sont, au contraire, animées par l'idée de la nécessité de la formation immédiate des partis de masse, étant donné l'imminence de la révolution mondiale. Cela amène l'I.C. à une politique de compromissions avec des tendances corrompues et mêmes ouvertement contre-révolutionnaires intégrées dans les PC de l'Europe occidentale et centrale. L'influence de ces tendances aurait dû être contrecarrée par une situation prérévolutionnaire poussant la majorité du prolétariat à gauche. De plus, à l'avis de l'I.C, le danger de telles compromissions se trouvait minimisé par le fait que les nouveaux PC seraient soumis à la direction du parti bolchevik en Russie, idéologiquement plus avancé et plus clair du point de vue programmatique. En réalité, ni la situation prérévolutionnaire tant espérée, ni la direction du parti bolchevik ne pouvaient contrecarrer les conséquences désastreuses de la politique de l'I.C, les concessions et les compromissions avec des tendances qui ont participé à la guerre impérialiste. En fait, la politique non principielle de l'I.C dans la formation des PC en Europe devient en elle-même un facteur supplémentaire menant à la défaite du prolétariat. Si le parti bolchevik n'avait pas de théorie adéquate ni sur le rapport parti/classe, ni sur le développement de la conscience de classe, c'était le prix à payer pour des années de sclérose de la théorie et la méthode marxiste au sein de la Ile Internationale, mais cela s'explique aussi par le fait que beaucoup d'aspects de ces questions décisives ne pouvaient trouver un début de réponse que dans le creuset de la pratique révolutionnaire du prolétariat. Mais la politique de la 3ème Internationale en Europe occidentale menait à l'abandon de la clarté révolutionnaire et des principes déjà acquis par les Bolcheviks au cours de leur longue lutte théorique et politique au sein de la social-démocratie russe, dans le combat pour l'internationalisme prolétarien pendant la guerre impérialiste et dans la révolution en Russie. Le cas le plus criant de cet abandon des principes révolutionnaires par l'I.C est la formation du PC tchèque, basée sur des éléments ouvertement contre-révolutionnaires. Le PC tchèque se forme uniquement autour de la tendance Smeral qui soutenait fidèlement pendant toute la guerre impérialiste la monarchie Habsbourg !
Dans le parti socialiste français (la S.F.I.O.), outre une petite tendance internationaliste de gauche, le "comité pour la IIIe Internationale" qui voulait une adhésion sans conditions à l'I.C[3], deux tendances politiques s'affrontaient en 1920 à la veille du congrès de Tours où l'adhésion à l'I.C. allait être à l'ordre du jour. En premier lieu, le "comité de résistance socialiste à l'adhésion à la IIIe Internationale", la droite, autour de Léon Blum, Renaudel et Albert Thomas. Ensuite, le "comité pour la reconstruction de l'Internationale", les "reconstructeurs" ou le centre, autour de Longuet, Faure, Cachin et Frossard. Cette tendance "centriste" voulait adhérer à l'I.C. mais avec des conditions très strictes pour pouvoir sauvegarder l'autonomie, le programme et les traditions du "socialisme" français. L'avis que donne A. Bordiga sur ces deux tendances dans son livre "Storia délia Sinistra Comunista" est particulièrement juste : "Sur les questions de fond, en tous les cas, les deux ailes ne se distinguent que par de simples nuances. Elles sont, en réalité, les deux faces d'une même médaille."
Les Longuetistes ont participé à l'union sacrée jusqu'à ce que le mécontentement grandissant des masses et la nécessité pour le capitalisme de l'encadrer et le dérailler les ont amenés à demander une paix "sans vainqueurs ni vaincus". Pour comprendre toute la complicité des Longuetistes dans la boucherie impérialiste, il suffit de citer le discours de Longuet du 2 août 1914 préparant le terrain pour l'union sacrée : "Mais si demain la France est envahie, comment les socialistes ne seraient-ils pas les premiers à défendre la France de la révolution et de la démocratie, la France de 1'Encyclopédie, de 1789, de juin 1848 (...)". Quand l'I.C, contre l'avis de Zinoviev, refusait l'adhésion du chauvin notoire Longuet, Cachin et Frossard se sont séparés de leur ancien chef, créant ainsi la base d'une majorité à Tours qui allait adhérer -avec conditions- à l'I.C. Mais ils continuaient à défendre et à justifier leur soutien à la guerre impérialiste. Ainsi Cachin insistait sur le fait que "La responsabilité de la guerre n'était pas seulement celle de notre bourgeoisie mais celle de1'impérialisme allemand ; donc notre politique de défense nationale trouve en ce qui concerne le passé, sa pleine justification". Les implications de cette déclaration pour l'avenir se voient dans l'insistance sur le fait qu'il faut distinguer" la défense nationale honnête" de la défense nationale soi-disant fausse de la bourgeoisie.
La scission dans la S.F.I.O. à Tours et la formation du P.C.F. ont suivi les directives de l'I.C. et signifiaient que le PCF dans sa vaste majorité ainsi qu'à sa direction, serait composé de la fraction contre-révolutionnaire longuetiste et que les 21 conditions -insuffisantes en elles-mêmes- seraient interprétées de façon à inclure des éléments ouvertement chauvins. Comment était-il possible de constituer le PCF avec une majorité dirigée par Cachin-Frossard, une majorité essentiellement longuetiste ?[4] Cette capitulation, ce couteau plongé dans le cœur du prolétariat, cette graine de pourriture qui allait donner le Front Populaire et l'Union Sacrée, était dissimulé et rendu possible par ... le concept du centrisme ! En baptisant les longuetistes "centristes", cette tendance était lavée de ses péchés mortels, enlevée du terrain politique du capitalisme où sa pratique l'avait mise, pour être replacée sur le terrain politique du prolétariat (quoique un peu tachée idéologiquement).
En Allemagne, où le K.P.D. (Parti communiste allemand) avait déjà exclu ses tendances de gauche (contre l'esprit et la lettre de ses propres statuts), ces mêmes tendances de gauche qui ont pris une position de classe sans équivoque contre la guerre impérialiste et qui avaient la vision la plus claire sur la nature de la nouvelle période, l'I.C. donne l'ordre au KPD de fusionner avec l'U.S.P.D. pour créer une base de masse. L'USPD, avec Bernstein, Hilferding et Kautsky à sa tête, avec son manifeste de fondation écrit par le renégat Kautsky en personne, est né de l'exclusion du groupe parlementaire de l'opposition, l'Arbeitsgemeinschaft, du SPD en 1917. La position de l'Arbeitsgemeinschaft face à la guerre impérialiste[5] (et qui est devenue la position de l'USPD) était de demander une paix sans annexions -une position quasi-identique à celle d'un partisan aussi féroce du nationalisme allemand que Max Weber et d'autres porte-parole du capital financier allemand confronté au danger -principalement social- d'une longue guerre que l'Allemagne ne pouvait gagner. Dans la tourmente de la révolution allemande de novembre 1918, l'USPD participe au gouvernement de coalition, mis sur pied pour arrêter la montée révolutionnaire, aux côtés des social-démocrates "purs et durs", le SPD de Noske et Scheidemann. Quand, face au massacre de noël, la radicalisation des masses menace de dépasser l'USPD laissant les représentants du capital allemand sans influence sur les masses, l'USPD se met "dans l'opposition". De cette opposition, l'USPD travaille pour intégrer les conseils ouvriers -où elle a des majorités- dans la constitution de Weimar, c'est-à-dire, dans l'édifice institutionnel par lequel le capitalisme allemand cherchait à reconstituer son pouvoir. Au moment du 2ème congrès de l'I.C., quand la fusion du KPD et de l'USPD est l'objet d'un débat acharné, Winjkoop pour le PC hollandais déclare :"Mon parti est de l'avis qu'il ne faut absolument pas négocier avec l'USPD, avec un parti qui aujourd'hui même siège au présidium du Reichstag, avec un parti du gouvernement."
Pour comprendre jusqu'au bout la nature contre-révolutionnaire de l'USPD, il faut aller au-delà des déclarations publiques -pleines d'éloges du légalisme, du parlementarisme et de la "démocratie"- pour se pencher sur ce que ses dirigeants ont dit, plus librement, en privé. À cet égard, la lettre de Kautsky du 7 août 1916 à l'austro-marxiste Victor Adler expliquant les vraies raisons de la formation de l'Arbeitsgemeinschaft, l'embryon de l'USPD, est un document de la plus grande importance : "Le danger du groupe Spartakus est grand. Son radicalisme correspond aux besoins immédiats des grandes masses indisciplinées. Liebknecht est aujourd'hui l'homme le plus populaire dans les tranchées. Si on n'avait pas formé l'Arbeitsgemeinschaft, Berlin serait aux mains des "spartakistes" et en dehors du parti. Mais si on avait constitué le groupe parlementaire de gauche quand je voulais, il y a un an, le groupe Spartacus n'aurait acquis aucun poids." Est-il vraiment nécessaire, après cette mise au point de Kautsky, de dire explicitement que la fonction -objective et même consciente- de l'Arbeitsgemeinschaft et son successeur, l'USPD, était d'empêcher la radicalisation des masses et de préserver l'ordre capitaliste.
Pour que la décision de l'I.C. de fusionner le KPD et l'USPD soit prise et acceptée -une erreur monumentale avec des conséquences désastreuses pour la révolution en Allemagne-, il fallait d'abord commencer par désigner l'USPD un parti "centriste" (poussé à gauche par les événements...) transformant mais uniquement en paroles sa nature de classe capitaliste en nature prolétarienne.
Ce qui nous intéresse ici ce n'est pas de revenir sur tout le raisonnement qui amène l'I.C. à tourner le dos aux principes révolutionnaires dans la formation des PC européens, mais d'insister sur le fait que le concept du centrisme a. fourni la couverture idéologique pour envelopper une politique de compromission avec des éléments contre-révolutionnaires.
En concomitance et en lien avec la politique désastreuse de l'IC dans la formation du PCF, du VKPD, etc., se produisait le début du retour à la méthode et la philosophie du matérialisme mécaniste de la 2ème Internationale, ce qui donnera la base au "DIAMAT", la vision stalinienne (capitaliste) du monde, institutionnalisée dans le "Komintern" des années 30. L'abandon des principes prolétariens révolutionnaires va toujours de pair avec l'incohérence méthodologique et théorique.
Dans le cas de Trotsky et l'Opposition de Gauche, c'est par l'alliance avec la social-démocratie (le front unique, le front populaire, l'anti-fascisme) et la défense de l'"État ouvrier" en Russie que ce courant trahit définitivement le prolétariat pour passer dans le camp du capitalisme pendant la deuxième guerre mondiale. Ses positions sont indissolublement liées à l'utilisation du concept du centrisme par Trotsky pour caractériser la dynamique de la social-démocratie et pour analyser la nature du stalinisme. En effet, la théorie des "groupes centristes cristallisant à partir de la social-démocratie" l'incapacité de tracer la frontière de classe qui pour Trotsky est complètement obscurcie par cette notion du centrisme, fournit la base du "tournant français" en 1934 où Trotsky donne l'ordre aux sections de l'Opposition de Gauche internationale de faire de l'entrisme dans les partis social-démocrates contre-révolutionnaires.
La différence du centrisme en termes d'attitudes et de comportement, le portrait d'un centriste (incohérent, vacillant, conciliant, etc.) sur lequel la majorité du CCI fonde sa conception du centrisme aujourd'hui, voit le jour pour la première fois dans le mouvement ouvrier pendant les années 30 dans les rangs de l'Opposition trotskyste, qui abandonnait déjà à l'époque position de classe sur position de classe dans sa chute vers le camp de la contre-révolution. Dans "Le Centrisme et la IVe Internationale" paru dans "The Militant" du 17 mars 1934 ou tout semblant de définition du centrisme en termes de positions politiques est abandonné, Trotsky peint le portrait verbal d'un centriste qui se retrouve presque mot pour mot dans les textes de la majorité du CCI aujourd'hui[6].
Au crépuscule du capitalisme ascendant, le centrisme, en tant que tendance politique au sein de la IIe Internationale a mené à la corruption et la dégénérescence conduisant à la trahison de 1914. Dans le capitalisme décadent, c'est le concept du centrisme -encore utilisé par des révolutionnaires incapables de se débarrasser du poids mort du passé -qui à chaque fois ouvre la porte aux compromissions et à la soumission à l'idéologie du capitalisme au sein du mouvement ouvrier.
La majorité du CCI dit souvent que les révolutionnaires ne doivent pas rejeter un outil politique -en l'occurrence le concept du centrisme- simplement parce qu'il a été mal utilisé. À cela, nous voulons répondre. Premièrement, les camarades de la majorité utilisent le concept de centrisme aujourd'hui pour rejeter les mêmes erreurs commises par l'I.C. dans les années 20. Ainsi la majorité considère que l'USPD, malgré ses lettres de créance social-démocrates impeccables et malgré son rôle dans la défaite de la révolution en Allemagne, était encore sur le terrain prolétarien, un parti "centriste". Dans les pages de Révolution Internationale, les chauvins Cachin et Frossard deviennent des "centristes" ' et "opportunistes" dans un article donnant la version CCI de la constitution du PCF. Deuxièmement, il faut souligner le fait qu'il n'y a aucun exemple où l'utilisation du concept du centrisme par des révolutionnaires dans la période de décadence n'est pas en elle-même devenue l'instrument des compromissions et la conciliation avec l'idéologie de l'ennemi de classe capitaliste, d'un effacement des frontières de classe et enfin d'un recul des positions de classe. Troisièmement, le concept du centrisme dans les mains des révolutionnaires de l'époque actuelle est fondamentalement lié à une incompréhension profonde de la nature de notre époque historique, une incapacité à comprendre la vraie signification et les implications profondes de la tendance universelle vers le capitalisme d'État.
Jusqu'à présent, nous parlons des révolutionnaires qui ont employé le terme centrisme pour caractériser un phénomène qui se trouve, selon eux, toujours sur le terrain politique de la classe ouvrière. C'est précisément ainsi que la majorité actuelle du CCI utilise ce terme. Mais d'autres révolutionnaires avec plus de clarté programmatique que l'I.C. des années 20 ou Trotsky des années 30, ont utilisé le "centrisme" pour caractériser des tendances politiques qui sont actives dans les rangs de la classe ouvrière, mais qui sont en réalité contre-révolutionnaires, de l'autre côté de la frontière de classe. Par exemple, Goldenberg, un délégué français au 2ème congrès de l'I.C, parlant au nom de la gauche internationaliste, a dit : "Les thèses proposées par le camarade Zinoviev donnent toute une série de conditions permettant aux partis socialistes, les soi-disant "centristes", de rentrer dans l'I.C. Je ne peux pas être d'accord avec cette procédure. Ces dirigeants du PSF utilisent une phraséologie révolutionnaire pour tromper les masses. Le parti socialiste français est un parti pourri de petits-bourgeois réformistes. Son adhésion à l'I.C. aurait comme conséquence d'installer cette pourriture au sein de l'I.C. Je veux simplement déclarer que des gens qui malgré leur verbiage révolutionnaire, se sont montrés des contre-révolutionnaires décidés, ne peuvent pas se transformer en communistes en quelques semaines".
Goldenberg, la fraction abstentionniste de Bordiga du PSI et les autres représentants de la gauche au 2ème congrès, comprennent d'un côté la nature contre-révolutionnaire de Cachin, Frossard, Daumig, Dittman, etc., de ceux qui demandaient l'intégration dans l'I.C. au nom des tendances qu'ils dirigeaient pour mieux encadrer et détourner le prolétariat. Mais de l'autre côté, la gauche continue à employer la terminologie de "réformistes", "centristes", etc. pour caractériser les éléments qui se sont mis au service du capitalisme. Si la gauche dans l'I.C. est claire sur la nature contre-révolutionnaire du "centrisme", le fait qu'elle persiste à utiliser ce terme montre une confusion et une incohérence réelle face au phénomène nouveau du capitalisme d'État que la guerre impérialiste et la crise permanente ont produit. C'était une confusion sur le fait que ces tendances "centristes" ont non seulement définitivement trahi le prolétariat sans retour possible, mais qu'elles sont devenues en fait une partie intégrante de l'appareil étatique du capitalisme sans aucune différence de classe avec les partis bourgeois traditionnels bien qu'elles assument une fonction capitaliste particulière auprès de la classe ouvrière. Dans ce sens, la Gauche était très sérieusement handicapée dans sa lutte contre la dégénérescence de l'I.C.
La coexistence des termes "centriste", "social-patriote" et "contre-révolutionnaire" pour caractériser des éléments comme Cachin et Frossard, l'utilisation du concept du centrisme par lequel elle cherchait à comprendre le stalinisme, ont désarmé la fraction italienne de la Gauche Communiste dans les années 30 quand elle analysait la dégénérescence de l'I.C. et la contre-révolution stalinienne triomphante. Bien que la fraction italienne, contrairement à Trotsky, soit claire sur la nature contre-révolutionnaire du stalinisme et son alignement sur le terrain du capitalisme mondial, son analyse du stalinisme en termes de "centrisme"[7] était une source de confusion constante. Une conséquence de cette confusion était sa politique incohérente par rapport au PC italien ; la fraction ne s'est coupée formellement du PC italien totalement stalinisé qu'en 1933. Le fait que des camarades des fractions italienne et belge de la Gauche Communistes aient pu parler de la Russie en tant qu'"État ouvrier" jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, et malgré leur position que la Russie s'est alignée sur le terrain impérialiste du capitalisme mondial, témoigne de l'incohérence politique qui découle de l'utilisation du concept du centrisme dans la phase du capitalisme d'État.
Après la deuxième guerre mondiale, le PCI bordiguiste a également employé le concept du centrisme pour désigner les traîtres socialistes qui radicalisent leur langage pour mieux encadrer la classe ouvrière dans les intérêts du capital et pour caractériser les partis staliniens clairement reconnus comme contre-révolutionnaires par ailleurs[8]. Par exemple, en parlant de la tendance longuetiste de la SFIO qui allait constituer la majorité du PCF, les bordiguistes affirment avec raison que "la contre-révolution n'a pas eu besoin de briser le parti (le PCF) mais s'est au contraire appuyée sur lui". Mais, plus loin, par rapport à Cachin/Frossard : "Pour empêcher le prolétariat de se constituer en parti révolutionnaire, comme la situation objective 1'y poussait irrésistiblement, pour dévier son énergie vers les élections ou vers des mots d'ordre syndicaux compatibles avec le capitalisme (...) le 'centrisme' a dû adopter 'un langage plus radical'" Programme Communiste n°55, p.82 et 91). Ici, les bordiguistes comprennent le rôle joué objectivement par ces tendances contre-révolutionnaires mais retombent dans la confusion en les caractérisant comme "centristes".
Dans le cas de la Fraction italienne et encore plus gravement dans le cas des bordiguistes aujourd'hui (plus grave à cause des quarante années de plus pendant lesquelles ils ont continué à se cramponner à cette notion de centrisme et, en plus de leur ossification et stérilité politiques) l'utilisation du concept du centrisme est le prix payé pour l'incapacité de comprendre la réalité du capitalisme d'État et donc d'une des caractéristiques fondamentales de l'époque actuelle.
Il est incroyable que le concept de centrisme utilisé par la majorité du CCI aujourd'hui (un phénomène qu'elle considère encore sur le terrain prolétarien) soit en deçà des confusions de la gauche de l'IC, de la fraction italienne et, par rapport à l'histoire des débuts de l'I.C. et les combats dans lesquels Bordiga a participé, même en deçà des bordiguistes ! Le recours au concept de centrisme de la part du CCI est extrêmement dangereux pour l'organisation, dans la mesure où il met en question des acquis de la Gauche Communiste et tourne le dos à des leçons fondamentales du combat de la gauche au sein de l'I.C. Ce n'est pas que ces acquis suffisent actuellement pour arriver à la clarté programmatique nécessaire pour la classe ouvrière aujourd'hui et pour la formation du parti mondial de demain. Mais en abandonnant ces leçons et en tombant en deçà de la clarté théorique du passé, même la possibilité d'aller en avant dans le développement du programme communiste (ce qui dans la situation présente est absolument nécessaire) se trouve sérieusement compromise.
C'est pour ces raisons que la tendance qui s'est constituée au sein du CCI en janvier 1983, sur la base d'une "Déclaration", rejette le concept de centrisme et met en garde le CCI contre les graves dangers que sa politique actuelle représente pour la théorie et la pratique de l'organisation.
Pour la tendance : Mc Intosh
Le rejet de la notion de "centrisme: la porte ouverte à l'abandon des positions de classe
L'article de "Mac Intosh pour la tendance" publié dans ce numéro de la Revue Internationale présente un grand avantage par rapport au précèdent article de la minorité, "Le CCI et la politique du moindre mal" par JA, publié dans le n°41 : il traite d'une question précise et s'y tient jusqu'à la fin alors que l'autre, à côté du danger conseilliste, parle un peu de tout, ...et notamment de la question du centrisme. Cependant, si l'éclectisme qui tendait à embrouiller le lecteur était un défaut de l'article de JA (un défaut du point de vue de la clarté du débat, mais peut-être est-ce une qualité du point de vue de la démarche confusionniste de la "tendance"), on peut considérer que l'unité thématique de l'article de Mac Intosh, tout en permettant de mieux s'y retrouver sur les positions de la tendance, n'est pas uniquement un facteur de clarté. L'article de Mac Intosh est bien construit, se base sur un plan simple et logique et présente une apparence de rigueur et de souci d'étayer les arguments sur des exemples historiques précis, toutes caractéristiques qui en font à ce jour le document le plus solide de la tendance et qui peuvent impressionner si on le lit de façon superficielle. Cependant, l'article de Mac Intosh n'échappe pas au défaut que nous avons déjà signalé dans la Revue n°42 à propos de l'article de JA (et qui est une des caractéristiques majeures de la démarche de la tendance) : l'escamotage des véritables questions en débat, des véritables problèmes qui se posent au prolétariat. La différence entre les deux articles tient surtout au degré de maîtrise de cette technique d'escamotage.
Ainsi, alors que JA a besoin de faire beaucoup de bruit, de parler un peu à tort et à travers, de produire plusieurs écrans de fumée pour accomplir ses tours de passe-passe, c'est avec beaucoup plus de sobriété que Mac Intosh réalise les siens. Cette sobriété même est un élément de l'efficacité de sa technique. En ne traitant dans son article que du problème du centrisme en général et dans l'histoire du mouvement ouvrier sans se référer à aucun moment à la façon dont la question s'est posée dans le CCI, il évite de porter à la connaissance du lecteur le fait que cette découverte (dont il est l'auteur) de la non-existence du centrisme dans la période de décadence, était la bienvenue pour les camarades "réservistes" (qui s'étaient abstenus ou avaient émis des "réserves" lors du vote de la résolution de janvier 84). La thèse de Mac Intosh, à laquelle ils se sont ralliés lors de la constitution de la tendance, leur permettait de retrouver des forces contre l'analyse du CCI sur les glissements centristes envers le conseillisme dont ils étaient victimes et qu'ils s'étaient épuisés à combattre en essayant vainement de montrer (tour à tour ou simultanément) que "le centrisme c'est la bourgeoisie", "il existe un danger de centrisme dans les organisations révolutionnaires mais pas dans le CCI", "le danger centriste existe dans le CCI mais pas à l'égard du conseillisme". Les camarades "réservistes" faisaient ainsi la preuve qu'au moins ils connaissaient l'adage "qui peut le plus peut le moins". De même, dans son article, Mac Intosh se montre connaisseur du bon sens populaire qui veut qu'"on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu".
En résumé, si on peut se permettre une image, on pourrait illustrer ainsi la différence entre les techniques employées par JA et Mac Intosh dans leurs articles respectifs :
- le prestidigitateur maladroit JA, après de multiples et brouillonnes gesticulations annonce : "plus de lapin 'danger de conseillisme'!"', alors que la moitié de la salle peut encore lui voir la queue et le bout des oreilles ;
- le prestidigitateur habile Mac Intosh, pour sa part, dit simplement : "abracadabra, plus de pigeon 'centrisme'!", et il faut faire preuve de perspicacité pour savoir qu'il l'a dissimulé dans les basques de son frac.
Pour notre part, c'est en nous appuyant sur le marxisme et les leçons de l'expérience historique que nous essaierons de mettre en évidence les "trucs" qui permettent à Mac Intosh et à la tendance de dissimuler leurs différents tours de passe-passe[9] . Mais en premier lieu il importe de rappeler comment le marxisme révolutionnaire a toujours caractérisé le centrisme.
La définition du centrisme
Le camarade Mac Intosh nous dit : "la 'définition' du centrisme donnée par la majorité du CCI se limite à l'énumération de toute une série d'attitudes et de comportements (la conciliation, l'hésitation, la vacillation, le fait de 'ne pas aller jusqu'au bout d'une position'). Si ces attitudes et comportements sont indiscutablement de nature politique, caractéristiques des tendances centristes qui existaient autrefois dans l'histoire (cf. R. Luxemburg sur le caractère 'visqueux' de Kautsky), ils sont nettement insuffisants comme définition d'un courant politique."
Pour que le lecteur puisse se faire une idée plus précise sur la validité du reproche adressé par Me Intosh aux positions du CCI, nous allons donner un certain nombre d'extraits de textes de discussion interne exprimant ces positions.
L'opportunisme ne se caractérise pas seulement par ce qu'il dit, mais encore, et peut-être encore davantage par ce qu'il ne dit pas, par ce qu'il dira demain, par ce qu'il tait aujourd'hui pour pouvoir mieux le dire demain quand les circonstances lui paraîtront plus favorables, plus propices. L'opportunité qu'il scrute lui dicte souvent de garder le silence aujourd'hui. Et s'il agit ainsi, ce n'est pas tellement par volonté consciente, par esprit machiavélique, mais parce qu'un tel comportement est inscrit dans sa nature, mieux, il constitue le fond même de sa nature.
L'opportunisme, disait Lénine, est difficilement saisissable par ce qu'il dit, mais on le voit clairement par ce qu'il fait. C'est pourquoi il n'aime pas décliner son identité. Rien ne lui est plus désagréable que d'entendre être appelé par son nom. Il déteste se montrer à visage nu, en pleine lumière. La pénombre lui sied à merveille. Les positions franches, tranchantes, intransigeantes, qui vont au bout de leur raisonnement, lui donnent le vertige. Trop 'bien élevé', il supporte très mal la polémique. Trop 'gentleman' il n'aime que le langage châtié et voudrait que, s'inspirant du modèle du Parlement anglais, les protagonistes des positions radicalement antagoniques commencent, en s'affrontant à leurs adversaires, par les appeler 'honorable sir', ou 'mon honorable collègue'. Avec leur goût de l''exquis', du tact et de la mesure, de la politesse et du 'fair-play', ceux qui penchent vers l'opportunisme perdent complètement de vue que l'arène tragique et vivante de la lutte de classe et de la lutte des révolutionnaires ne ressemble en rien à cette vieille bâtisse poussiéreuse et morte qu'est 'l'honorable chambre des députés'.
Le centrisme est un des nombreux aspects par lequel se manifeste l'opportunisme, une de ses facettes, (appellations). Il exprime ce trait caractéristique de l'opportunisme de se situer toujours au centre, c'est-à-dire entre les forces et les positions antagoniques qui s'opposent et s'affrontent, entre les forces sociales franchement réactionnaires et les forces radicales qui combattent l'ordre de chose existant pour changer les fondements de la société présente.
C'est dans la mesure où il abhorre tout changement tout bouleversement radical, que le 'centrisme' est amené à se trouver forcément et ouvertement du côté de la réaction, c'est-à-dire du côté du capital, quand la lutte de classe atteint le point d'un affrontement décisif et qui ne laisse plus de place à aucune tergiversation comme c'est le cas au moment du saut révolutionnaire du prolétariat…
Le centrisme en quelque sorte est un 'pacifisme' à sa manière. Il a horreur de tout extrémisme. Les révolutionnaires conséquents au sein du prolétariat lui paraissent, par définition, toujours trop 'extrémistes'. Il leur fait la morale, les conjure contre tout ce qui paraît excessif et toute intransigeance lui paraît être une agressivité inutile.
Le centrisme n'est pas une méthode, c'est l'absence de méthode. Il n'aime guère l'idée d'un cadre... Ce qu'il préfère et où il se sent pleinement à l'aise, c'est le rond, là où on peut tourner et tourner sans fin, dire et se contredire à volonté, aller de droite à gauche et de gauche à droite sans jamais être gêné par les coins, où on peut évoluer avec d'autant plus de légèreté qu'on n'a pas à porter le poids ni à subir la contrainte de la mémoire, de la continuité, des acquis et de la cohérence, toutes choses qui entravent sa 'liberté'.
La maladie congénitale du centrisme est son goût, sincère ou non, de la réconciliation. Rien ne le dérange plus que le combat franc des idées. L'affrontement des positions lui paraît toujours comme trop exagéré. Toute discussion lui paraît de la polémique inutile. On comprend et on respecte le souci des uns et des autres pour ne froisser personne, car la priorité, des priorités, la raison première c'est sauver l'unité et garder l'ordre. Pour cela il est toujours prêt à vendre le droit d'aînesse pour un plat de lentilles.
Les révolutionnaires, à l'instar de la classe, aspirent également à la plus grande unité et à l'action la mieux ordonnée, mais jamais au prix de la confusion, de concessions sur les principes, d'obscurcissement du programme et des positions, du relâchement de la fermeté dans leur défense. Le programme révolutionnaire du prolétariat est à leurs yeux non négociable. C'est pourquoi, ils apparaissent, pour le centrisme, comme des trouble-fête, des extrémistes, des gens impossibles, incorrigibles et éternels trouble-ordre... "Y a-t-il une tendance centriste dans l'organisation ? Une tendance formellement organisée, non. Mais on ne peut nier qu'il y a chez nous des tendances au glissement vers le centrisme qui se manifestent chaque fois qu'apparaissent des situations de crise ou des divergences sur des questions de fond... Le centrisme, au fond, est une faiblesse chronique, toujours présente d'une façon patente ou latente dans le mouvement ouvrier, se manifestant différemment selon les circonstances. Ce qui le caractérise le plus, c'est de se situer non pas seulement au milieu, entre les extrémités, mais de vouloir les concilier en une unité dont il serait le centre conciliateur, en prenant un peu de l'un et un peu de l'autre. (...)
Aujourd'hui, ce centrisme se situe parmi nous entre la démarche du conseillisme et celle du CCI. Ce qui nous intéresse en tant que groupe politique, c'est d'étudier le phénomène politique de l'existence et de l'apparition des tendances vers le centrisme, la raison et le fondement de ce phénomène. Aussi, la tendance ou glissement vers le centrisme doit être étudié indépendamment des personnalités qui la composent à un moment donné." (...) (Extraits d'un texte du 17/2/84).
"Le centrisme est une démarche erronée mais il ne se situe pas hors du prolétariat, mais au sein du mouvement ouvrier et exprime, la plupart du temps, l'influence d'une démarche politique venant de la petite-bourgeoisie. Autrement on ne comprend pas comment les révolutionnaires ont pu cohabiter tout au long de l'histoire avec des tendances centristes dans les mêmes partis et internationales du prolétariat...
Le centrisme ne se présente pas avec un programme nettement défini ; ce qui le caractérise, c'est justement le flou, le vague, et c'est pour cela qu'il est d'autant plus dangereux, comme une maladie pernicieuse, menaçant toujours, de l'intérieur, l'être révolutionnaire du prolétariat." (Extraits d'un texte de mai 84).
"Mais quelles sont les sources de l'opportunisme et du centrisme dans la classe ouvrière ? Pour les marxistes révolutionnaires, elles se ramènent essentiellement à deux :
1) La pénétration dans le prolétariat de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise dominante dans la société et qui enveloppe le prolétariat (en tenant compte de plus du processus de prolétarisation qui s'opère dans la société faisant tomber sans cesse dans le prolétariat des couches provenant de la petite-bourgeoisie, de la paysannerie et même de la bourgeoisie, et qui emmènent avec elles des idées petites-bourgeoises). (...)" (Extraits d'un texte du 24/11/84).
Nous aurions pu donner encore beaucoup d'autres extraits illustrant l'effort de réflexion mené par le CCI sur la question du centrisme, mais nous n'en avons pas ici la place. Toutefois, ces citations, même incomplètes, permettent de faire justice de l'accusation affirmant que : "La 'définition' du centrisme donnée par la majorité du CCI se limite à l'énumération de toute une série d'attitudes et de comportements".
Cette suite de citations a également pour mérite de mettre en évidence un des tours de passe-passe majeurs opérés par Mac Intosh : l'identification entre "centrisme" et "opportunisme". En effet, son texte réussit le rare exploit de ne pas parler une seule fois du phénomène de l'opportunisme alors que la définition du centrisme s'appuie nécessairement sur celle de l'opportunisme dont il constitue une variété, une manifestation, situées et oscillant entre l'opportunisme ouvert et franc et les positions révolutionnaires.
La ficelle de Mac Intosh est à la fois très grosse et assez subtile. Il sait pertinemment que nous avons à de nombreuses reprises employé dans nos colonnes (y compris dans des résolutions de Congrès comme cela est rappelé dans la Revue n°42, p.29) le terme d'opportunisme appliqué à la période de décadence du capitalisme. En ce sens, affirmer aujourd'hui de but en blanc que la notion d'opportunisme n'est plus valable dans cette période conduirait à se demander pourquoi c'est justement maintenant que Mac Intosh découvre que ce qu'il avait voté (avec tous les membres de la "tendance") en 1978 (au 2ème Congrès du CCI) est faux. Dans la mesure où la notion de centrisme -qui pourtant est inséparable de celle d'opportunisme- a été bien moins utilisée jusqu'à présent par le CCI (et n'a pas fait l'objet d'un vote de congrès) on donne moins l'impression de se déjuger en affirmant aujourd'hui qu'elle n'est pas valable dans la période actuelle.
En escamotant la notion d'opportunisme pour ne plus parler que du centrisme, les camarades de la "tendance" essayent d'escamoter le fait que ce sont eux qui ont fait volte-face sur cette question et non le CCI comme ils se plaisent à le répéter.
Le CCI serait-il "centriste" par rapport au trotskysme?
Ce n'est évidemment pas de cette façon que la "tendance" pose le problème puisque, pour elle, il ne peut exister de centrisme dans la période de décadence. Par contre, par la plume de Mac Intosh, elle accuse le CCI de compromissions avec le trotskysme, de "tomber dans des positions trotskytes", ce qu'elle appuie par l'argument suivant :
- "La définition du centrisme en termes d'attitudes et de comportement, le portrait d'un centriste (incohérent vacillant, conciliant, etc.) sur lequel la majorité du CCI fonde sa conception du centrisme aujourd'hui, voit le jour pour la première fois dans le mouvement ouvrier pendant les années 30, dans les rangs de l'opposition trotskyste qui abandonnait déjà à l'époque position de classe sur position de classe dans sa chute vers le camp de la contre-révolution. Dans 'le centrisme et la 4ème Internationale' paru dans The Militant du 17 mars 1934 où tout semblant de définition du centrisme en termes de positions politiques est abandonné, Trotsky peint le portrait verbal d'un centriste qui se retrouve presque mot pour mot dans les textes de la majorité du CCI aujourd'hui".
Ici, Mac Intosh opère une de ses voltes faces dont il a le secret. Après avoir au début du texte admis la "nature politique" des questions de comportement, leur validité (bien qu'il les estime "insuffisantes") pour participer à la caractérisation d'un courant politique, voilà qu'il charge ce type de caractérisation de tous les maux de la création.
Mais là n'est pas la faute la plus grave de ce passage. Le plus grave, c'est qu'il falsifie complètement la réalité. Les formulations de l'article de Trotsky[10] frappent en effet par leur ressemblance avec celles du texte du 17/2/84 cité plus haut (alors que le camarade qui a rédigé ce texte n'avait jamais lu cet article particulier de Trotsky). Par contre, c'est un mensonge (délibéré ou par ignorance ?) que d'affirmer que ce type de caractérisation du centrisme a été inventé par Trotsky en 1934.
Voyons ce qu'écrivait ce même Trotsky dès 1903 à propos de l'opportunisme (à une époque où le terme centrisme n'était pas encore employé dans le mouvement ouvrier) :
- "On prendra peut-être pour un paradoxe l'affirmation qui consisterait à dire que ce qui caractérise l'opportunisme, c'est qu'il ne sait pas attendre. Et c'est pourtant cela. Dans les périodes [de calme plat], l'opportunisme, dévoré d'impatience, cherche autour de lui de 'nouvelles' voies, de 'nouveaux' moyens d'action. Il s'épuise en plaintes sur l'insuffisance et l'incertitude de ses propres forces et il recherche des 'alliés'... Il court à droite et à gauche et tâche de les retenir par le pan de leur habit à tous les carrefours. Il s'adresse à ses "fidèles" et les exhorte à montrer la plus grande prévenance à l'égard de tout allié possible. 'Du tact, encore du tact et toujours du tact !' Il souffre d'une certaine maladie qui est la manie de la prudence à l'égard du libéralisme, la rage du tact, et dans sa fureur, il donne des soufflets et porte des blessures aux gens de son propre parti". (Trotsky, Nos différends, Ed.de Minuit.p.376).
"Impatience", "prévenance", "rage du tact", "manie de la prudence" : pourquoi diable Trotsky ne s'est-il pas cassé la main le jour où il a écrit cet article, pourquoi n'a-t-il pas eu la bonne idée d'attendre 30 ans pour le publier ? Cela aurait bien arrangé les affaires de l'argumentation de la "tendance".
Quant à Lénine, lui qui, dans ses écrits, a probablement employé le terme centrisme plus que tous les autres grands révolutionnaires de son temps, pourquoi n'a-t-il pas consulté l'avis de Mac Intosh avant d'écrire :
"Les gens de la nouvelle Iskra (les mencheviks) trahissent-ils la cause du prolétariat ? Non, mais ils en sont des défenseurs inconséquents, irrésolus, opportunistes (et sur le terrain des principes d'organisation et de tactique qui éclairent cette cause)". (Oeuvres, T8, p.221).
"Trois tendances se sont dessinées dans tous les pays, au sein du mouvement socialiste et international, depuis plus de deux ans que dure la guerre... Ces trois tendances sont les suivantes :
- Les social-chauvins, socialistes en paroles, chauvins en fait (...) Ce sont nos adversaires de classe. Ils sont passés à la bourgeoisie (...)
- La deuxième tendance et celle dite du "centre", qui hésite entre les social-chauvins et les véritables internationalistes (...) Le 'centre', c'est le règne de la phrase petite-bourgeoise bourrée de bonnes intentions, de l'internationalisme en paroles, de l'opportunisme pusillanime et de la complaisance pour les social-chauvins en fait. Le fond de la question, c'est que le 'centre' n'est pas convaincu de la nécessité d'une révolution contre son propre gouvernement, ne poursuit pas une lutte révolutionnaire intransigeante, invente pour s'y soustraire les faux fuyants les plus plats, bien qu'à résonance archi-'marxistes' (...)
Le principal leader et représentant du 'centre' est Karl Kautsky, qui jouissait dans la 2ème Internationale (1889-1914) de la plus haute autorité et qui offre depuis août 1914 l'exemple d'un reniement complet du marxisme, d'une veulerie inouïe, d'hésitations et de trahisons lamentables. - La troisième tendance est celle des véritables internationalistes qui représente le mieux 'la gauche de Zimmerwald'." (Les tâches du prolétariat dans notre révolution, Oeuvres T.24.p.68-69).
On pourrait encore citer de multiples autres extraits de textes de Lénine sur le centrisme où reviennent les termes "inconséquent", "irrésolu", "opportunisme camouflé, hésitant, hypocrite, doucereux", "flottement", "indécision" et qui prouvent à quel point est fausse l'affirmation de Mac Intosh.
En prétendant que "ce n'est qu'avec Trotsky et l'Opposition de Gauche déjà dégénérescente des années 30 qu'un marxiste osera mettre en avant une définition du centrisme basée sur des attitudes et des comportements", Mac Intosh ne prouve nullement la non validité des analyses du CCI. Il ne prouve qu'une chose : qu'il ne connaît pas l'histoire du mouvement ouvrier. L'assurance avec laquelle il se réfère à celle-ci, les faits précis qu'il évoque, les citations qu'il donne, n'ont pas d'autre fonction que de masquer les libertés qu'il prend avec l'histoire réelle pour lui opposer celle qui existe dans son imagination.
La "véritable" définition du centrisme selon Mac Intosh
Le camarade Mac Intosh se propose, au nom de la "tendance" de "donner une définition claire, marxiste, du centrisme comme courant ou tendance politique qui existait autrefois au sein du mouvement ouvrier". Pour ce faire il en appelle à la méthode marxiste et il écrit avec raison que "... il est important de souligner la distinction marxiste fondamentale entre l'apparence et l'essence dans la réalité objective, ... la tâche de la méthode marxiste [étant] de pénétrer au-delà des apparences d'un phénomène pour saisir son essence."
Le problème de Mac Intosh c'est que son adhésion à la méthode marxiste n'est que formelle et qu'il est incapable de la mettre en application (tout au moins sur la question du centrisme). On pourrait dire que Mac Intosh ne voit que "l'apparence" de la méthode marxiste sans être capable de "saisir son essence". C'est ainsi qu'il affirme que "les révolutionnaires marxistes ... ont toujours cherché la base réelle de la conciliation et la vacillation du centrisme dans ses positions politiques..."
Le problème c'est qu'une des caractéristiques essentielles du centrisme c'est justement (comme nous l'avons vu plus haut) de ne pas avoir de position politique précise, définie, qui lui appartienne en propre. Voyons donc quel serait ce "programme politique précis" que "le centrisme a toujours eu" aux dires de Mac Intosh. Pour le définir, l'illusionniste Mac Intosh commence par utiliser quelques-uns des trucs qu'il affectionne :
- il identifie le centrisme au kautskysme dont ce dernier est indiscutablement un des représentants les plus typiques mais qu'il est loin de recouvrir entièrement (cette identification est faite de façon habile : après avoir "examiné" le kautskysme en tant qu' "exemple classique du centrisme" il affirme sans preuve que l'examen des autres courants centristes "révélerait la même chose") ;
- il identifie le kautskysme comme courant à ce qu'a pu écrire Kautsky, même quand ce n'était pas au titre de ce courant ;
- il fait de Kautsky un centriste de naissance qui n'aurait jamais modifié d'un quart de pas sa position dans l'éventail politique de la social-démocratie, alors que, s'il a terminé sa carrière politique dans la "vieille maison" social-démocrate passée à l'ennemi de classe il l'a commencée comme représentant de l'aile gauche radicale de celle-ci et qu'il a été pendant de longues années le plus proche camarade de combat (et l'ami personnel) de Rosa Luxemburg dans sa lutte contre l'opportunisme.
Après avoir d'emblée faussé de cette façon les choses, Mac Intosh est prêt à nous entraîner dans la quête du Graal "positions spécifiques du centrisme". "La base théorique et méthodologique du kautskysme est le matérialisme mécaniste, un déterminisme vulgaire menant à un fatalisme par rapport au processus historique".
Il doit être clair que c'est le dernier de nos soucis que de prendre la défense de Kautsky ni comme courant ni comme personne. Ce qui nous intéresse est de voir la façon d'argumenter de Mac Intosh et de la "tendance". Pour le moment, ce qu'il nous sert ce n'est pas un argument démontré mais une simple affirmation. Chose curieuse, comment comprendre que personne dans la 2ème Internationale ne se soit aperçu de ce qu'affirme Mac Intosh ? Il y avait pourtant quelques marxistes dans cette Internationale et même des théoriciens renommés et de gauche tels que A. Labriola, Plekhanov, Parvus, Lénine, Luxemburg, Pannekoek (pour ne citer que ceux-là). Étaient-ils tous aveuglés à ce point par la personnalité de Kautsky pour oublier la différence qui existe entre le marxisme et le "matérialisme mécaniste... un déterminisme économique vulgaire... un fatalisme...", etc. ? Rappelons encore que cette même critique, de glissement vers un matérialisme mécaniste, a été portée, avec raison, contre Lénine par Pannekoek (voir "Lénine philosophe"[11]). Quand donc le matérialisme mécaniste, etc., est-il devenu le programme du centrisme en général et de Kautsky en particulier ? Quand Kautsky combat le révisionnisme de Bernstein ou quand il défend aux côtés de Rosa la grève de masse en 19051907, ou bien en 1914, ou en 1919 ??? Quand, en 1910, Rosa engage sa fameuse et violente polémique contre Kautsky, à propos de la grève de masse, ce n'est pas un "programme précis" basé sur le "matérialisme mécaniste" qu'elle dénonce, mais le fait que Kautsky reprend les arguments des révisionnistes, le fait que par ses tergiversations se réclamant d'un marxisme "radical", Kautsky ne fait que couvrir la politique opportuniste et électoraliste de la direction de la social-démocratie (rappelons en passant qu'à part Parvus et Pannekoek, tous les grands noms de la gauche radicale désapprouvaient la critique de Rosa à cette époque).
Continuant sur sa lancée à la recherche du "programme précis" du centrisme, Mac Intosh découvre que "Pour Kautsky, la conscience doit être apportée aux ouvriers ‘de l'extérieur’ par les intellectuels". Voilà encore une banalité "redécouverte" par lui en guise de démonstration de l'existence d'un "programme précis" du centrisme. La fausseté de cette dénonciation, écrite par Kautsky en même temps qu'il combattait le révisionnisme, n'a rien à voir avec un "programme précis" et d'ailleurs n'a jamais été inscrite dans aucun programme socialiste. Et si cette idée a été reprise par Lénine dans "Que faire ?", elle n'a jamais figuré dans le programme des bolcheviks, et a été publiquement répudiée par Lénine lui-même dès 1907. Si une telle idée a pu être énoncée dans la littérature du mouvement marxiste cela ne prouve pas l'existence d'un "programme précis" du centrisme mais montre à quel point le mouvement révolutionnaire n'est pas imperméable à toutes sortes d'aberrations provenant de l'idéologie bourgeoise.
Il en est de même quand Mac Intosh, dans sa recherche obstinée d'articles du "programme centriste précis", écrit : "... il [Kautsky] insiste sur le fait que les seules formes d'organisations prolétariennes sont le parti de masse social-démocrates et les syndicats". Cela n'est en rien propre à Kautsky mais est l'opinion courante de toute la social-démocratie d'avant la première guerre mondiale y compris Pannekoek et Rosa. C'est un fait facile à vérifier que, en dehors de Lénine et de Trotsky, bien peu dans la gauche marxiste, avaient compris la signification de l'apparition des soviets dans la révolution de 1905 en Russie. C'est ainsi que Rosa Luxemburg ignore totalement les soviets dans son livre sur cette révolution dont le titre (et cela n'est pas le moins significatif) est justement "Grèves de masse, Partis et Syndicats". Enfin, quand Mac Intosh découvre le passage de Kautsky "… La conquête du pouvoir étatique à travers la conquête d'une majorité au parlement..." il s'écrit triomphalement : "Voilà le programme politique du centrisme kautskyste". Eurêka ! Mais pourquoi oublier de dire que c'est là un "emprunt" (en partie à Engels) que Kautsky fait au programme du révisionnisme de Bernstein ?
Mac Intosh a donc découvert, "au-delà des apparences", "l'essence politique du centrisme" : c'est son attachement constant et sans faille au légalisme, au gradualisme, au parlementarisme et à la 'démocratie' dans la lutte pour le socialisme. Il n'a jamais oscillé d'un centimètre dans cette orientation". Malheureusement pour lui, Mac Intosh ne se rend pas compte que ce qu'il vient de définir dans son "essence", ce n'est pas le centrisme ni même l'opportunisme, mais le réformisme. On en vient à se demander pourquoi les révolutionnaires ont éprouvé le besoin d'utiliser des termes distincts si, en fin de compte, le réformisme, le centrisme et l'opportunisme sont une seule et même chose. En réalité, notre expert en "méthode marxiste" est soudainement victime d'un trou de mémoire. Il vient d'oublier la distinction que Marx et le marxisme établissent entre "unité" et "identité". Dans l'histoire du mouvement ouvrier d'avant la première guerre mondiale, l'opportunisme (beaucoup plus que le centrisme d'ailleurs) a fréquemment pris la forme du réformisme (c'est particulièrement le cas chez Bernstein). Il y avait alors unité entre les deux. Mais cela ne signifie nullement que le réformisme recouvrait tout l'opportunisme (ou le centrisme), qu'il y avait identité entre eux. Sinon on ne comprendrait pas pourquoi Lénine a tant guerroyé à partir de 1903 contre l'opportunisme des mencheviks alors que bolcheviks et mencheviks venaient d'adopter (contre les éléments réformistes de la social-démocratie russe) le même programme[12] au 2ème congrès du POSDR et qu'ils avaient par conséquent les mêmes positions sur le "légalisme", le "gradualisme", le "parlementarisme" et la démocratie. Faut-il rappeler à Mac Intosh que la séparation entre bolcheviks et mencheviks s'est faite autour du point 1 des statuts du parti et que l'opportunisme des mencheviks (comme Martov et Trotsky), contre lequel Lénine engage le combat, concerne les questions d'organisation (ce n'est qu'en 1905, à propos de la place que le prolétariat doit occuper dans la révolution, que le clivage entre bolcheviks et mencheviks s'étend à d'autres questions).
On peut également demander à Mac Intosh et à la "tendance", s'ils pensent sérieusement que c'est parce que Trotsky était un "légaliste", un "gradualiste", un "crétin parlementaire", un "démocrate", que Lénine le range parmi les "centristes" dans les premières années de la guerre mondiale.
En réalité, ce que nous prouve une nouvelle fois Mac Intosh c'est que derrière l'"apparence" de rigueur et de connaissance de l'histoire qu'il affiche, réside l'"essence" de la démarche de la "tendance" : l'absence de rigueur, une ignorance affligeante de l'histoire réelle du mouvement ouvrier. C'est ce qu'illustre également la recherche par Mac Intosh des "bases matérielles et sociales" du centrisme.
Les bases matérielles et sociales du centrisme
Après la recherche de l'introuvable Graal des "positions politiques précises" du centrisme, le chevalier Mc Intosh nous entraîne dans la recherche défenses bases sociales et matérielles". Là, nous pouvons tout de suite le rassurer : elles existent. Elles résident (tant pour le centrisme que pour l'opportunisme dont il constitue une des expressions) dans la place particulière qu'occupe le prolétariat dans l'histoire en tant que classe exploitée et classe révolutionnaire (et c'est, la première -et dernière- fois qu'il en est ainsi). En tant que classe exploitée, privée de toute emprise sur les moyens de production (qui constituent justement la base matérielle de la société), le prolétariat doit subir en permanence la pression de l'idéologie de la classe qui les possède et contrôle, la bourgeoisie, de même d'ailleurs que les appendices de cette idéologie émanant des couches sociales petites bourgeoises. Cette pression se traduit par des infiltrations constantes de ces idéologies avec les différentes formes et démarches de pensée qu'elles comportent au sein de la classe et de ses organisations. Cette pénétration est notamment facilitée par la prolétarisation constante d'éléments de la petite bourgeoisie qui emportent au sein de la classe les idées et préjugés de leurs couches d'origine.
Ce premier élément explique déjà la difficulté avec laquelle la classe développe la prise de conscience de ses propres intérêts tant immédiats qu'historiques, les entraves qu'elle rencontre en permanence face à cet effort. Mais il n'est pas le seul. Il faut également prendre en considération que sa lutte comme classe exploitée, la défense de ses intérêts matériels quotidiens n'est pas identique à sa lutte comme classe révolutionnaire. L'une et l'autre sont liées, de même que si le prolétariat est la classe révolutionnaire c'est justement parce qu'il est la classe exploitée spécifique du système capitaliste. C'est en grande partie à travers ses luttes comme classe exploitée que le prolétariat prend conscience de la nécessité de mener le combat révolutionnaire, de même que ces luttes ne prennent leur véritable ampleur, n'expriment toutes leurs potentialités si elles ne sont pas fécondées par la perspective de la lutte révolutionnaire. Mais, encore une fois, cette unité (que ne voyait pas Proudhon, lui qui rejetait l'arme de la grève, et qu'aujourd'hui ne comprennent pas les "modernistes") n'est pas identité. La lutte révolutionnaire ne découle pas automatiquement des luttes pour la préservation des conditions d'existence, la conscience communiste ne surgit pas mécaniquement de chacun des combats menés par le prolétariat face aux attaques capitalistes. De même, la compréhension du but communiste ne détermine pas nécessairement et immédiatement la compréhension du chemin qui y conduit, des moyens pour l'atteindre.
C'est dans cette difficulté pour une classe exploitée de parvenir à la conscience des buts et des moyens de la tâche historique de loin la plus considérable qu'une classe sociale ait eu à accomplir, dans le "scepticisme", les "hésitations", les "craintes" qu'éprouve le prolétariat "devant l'immensité infinie de [son] propre but" si bien mis en évidence par Marx dans "Le 18 Brumaire", dans le problème que pose à la classe et aux révolutionnaires la prise en charge de l'unité dialectique entre ses luttes immédiates et ses luttes ultimes, c'est dans cet ensemble de difficultés, expression de l'immaturité du prolétariat, que l'opportunisme et le centrisme font en permanence leur nid.
Voilà où résident les bases "matérielles", "sociales" et on pourrait ajouter historiques de l'opportunisme et du centrisme. Rosa Luxemburg ne dit pas autre chose dans son texte le plus important contre l'opportunisme :
"La doctrine marxiste est non seulement capable de le réfuter théoriquement mais encore elle est seule en mesure d'expliquer ce phénomène historique qu'est l'opportunisme à 1'intérieur de 1'évolution du parti. La progression historique du prolétariat jusqu'à la victoire n'est effectivement pas une chose si simple. L'originalité de ce mouvement réside en ceci : pour la première fois dans 1'histoire, les masses populaires décident de réaliser elles-mêmes leur volonté en s'opposant à toutes les classes dominantes ; par ailleurs, la réalisation de cette volonté, elles la situent au-delà de la société actuelle, dans un dépassement de cette société. L'éducation de cette volonté ne peut se faire que dans la lutte permanente contre 1'ordre établi et à 1'intérieur de cet ordre. Rassembler la grande masse populaire autour d'objectifs situés au-delà de l'ordre établi ; allier la lutte quotidienne avec le projet grandiose d'une réforme du monde, tel est le problème posé au mouvement socialiste" ("Réforme ou Révolution ?").
Tout cela Mc Intosh le savait pour l'avoir appris dans le CCI et la lecture des classiques du marxisme. Mais apparemment, il est devenu amnésique : désormais, pour lui, la société bourgeoise et son idéologie, les conditions qui sont données historiquement au prolétariat pour l'accomplissement de sa révolution, tout cela n'est plus "matériel" et devient "l'esprit" voguant dans le tohubohu de l'univers dont nous parle la Bible.
De même que Karl Grün était un "socialiste vrai" (raillé par le manifeste Communiste), Mac Intosh est un "matérialiste vrai". Aux prétendus "idéalisme" et "subjectivisme" dont serait victime le CCI (suivant les termes souvent employés par la "tendance dans le débat interne") il oppose la "vraie" base matérielle du centrisme : "[c'était] dans les sociétés capitalistes avancées d'Europe la machine électorale des partis de masse social-démocrates (et surtout ses fonctionnaires salariés, ses bureaucrates professionnels et ses représentants parlementaires) ainsi que l'appareil syndical grandissant".
Mac Intosh fait bien de préciser que cela concerne les "sociétés capitalistes avancées d'Europe" parce qu'on aurait eu bien du mal à trouver dans un pays comme la Russie tsariste, où pourtant l'opportunisme a fleuri de la même façon qu'ailleurs, des "machines électorales" et des "appareils syndicaux". Quelle était alors la "base matérielle du centrisme" dans ce pays : les permanents ? Est-il nécessaire de rappeler à Mac Intosh qu'il y avait au moins autant de permanents et de "révolutionnaires professionnels" dans le parti bolchevik que chez les mencheviks ou les socialistes révolutionnaires ? Par quel miracle l'opportunisme qui a englouti ces deux dernières organisations a-t-il épargné les bolcheviks ? Voilà ce que ne nous explique pas la thèse de Mac Intosh.
Mais ce n'est pas là sa plus grande faiblesse. En réalité, cette thèse n'est qu'un avatar d'une approche qui, si elle est nouvelle dans le CCI, était déjà bien connue auparavant. Cette approche qui explique la dégénérescence des organisations prolétariennes par l'existence d'un "appareil", de "chefs" et de "dirigeants" est le bien commun des anarchistes d'autrefois, des libertaires et du conseillisme dégénéré d'aujourd'hui. Elle tend à rejoindre la vision de "Socialisme ou Barbarie" des années 30, qui "théorisait" la division de la société entre "dirigeants" et "dirigés" en lieu et place de la division en classes. Œuvres, tome 24, p. 69).
C'est vrai que la bureaucratie des appareils, de même que les fractions parlementaires, ont fréquemment servi d'appui à des directions opportunistes et centristes, députés au Parlement et les "permanents" des organisations prolétariennes ont souvent constitué un "terrain" de choix pour la pénétration du virus opportuniste. Mais expliquer l'opportunisme et le centrisme à partir de cette bureaucratie n'est pas autre chose qu'une stupidité simpliste relevant d'un déterminisme des plus vulgaires. C'est avec raison que Mac Intosh rejette la conception de Lénine basant l'opportunisme sur l'"aristocratie ouvrière". Mais au lieu de voir que cette conception avait le tort de fonder les divisions politiques au sein de la classe ouvrière sur des différences économiques (à l'image de la bourgeoisie où les divisions politiques reposent sur les différences entre groupes d'intérêt économiques) alors que l'intérêt "économique" est fondamentalement le même pour toute la classe, Mac Intosh régresse bien plus loin encore que Lénine. C'est des "appareils" et des "permanents" que proviendrait un problème qui affecte l'ensemble de la classe ouvrière. C'est de la même eau que la thèse trotskyste suivant laquelle "si les syndicats ne défendent pas les intérêts des ouvriers c'est à cause des mauvais dirigeants" sans jamais se demander pourquoi ils ont toujours eu, depuis plus de 70 ans, de tels dirigeants.
En réalité, si Lénine était allé chercher sa thèse de l'aristocratie ouvrière comme base de l'opportunisme dans une analyse erronée, non marxiste et réductionniste d'Engels, ce n'est même pas dans le "matérialisme mécaniste" et le "déterminisme économique vulgaire" dont il accuse Kautsky, que Mac Intosh est allé chercher la sienne, c'est dans la sociologie universitaire qui ne connaît pas les classes sociales mais seulement une multitude de catégories "socio-professionnelles".
Voilà ce qui s'appelle "pénétrer au-delà des apparences d'un phénomène pour saisir son essence" !
Et quand Mac Intosh veut couvrir ses prouesses de l'autorité des marxistes révolutionnaires en écrivant :
- "..que l'on cherche du côté de la machine électorale social-démocrates et 1'appareil syndical ou du côté d'une aristocratie ouvrière fictive, il est évident que les marxistes révolutionnaires ont toujours cherché à comprendre la réalité du centrisme par rapport à une base matérielle spécifique" il démontre soit a mauvaise foi, soit son ignorance. Par exemple, à aucun moment dans son étude de base sur l'opportunisme ("Réforme ou Révolution") R. Luxemburg ne lui attribue un tel type de "base matérielle spécifique". Mais peut-être Mac Intosh veut-il parler exclusivement du centrisme (et non de l'opportunisme qu'il n'évoque jamais). Alors là, il a encore moins de chance : "Les social-chauvins sont nos adversaires de classe, des bourgeois au sein du mouvement ouvrier. Ils y représentent une couche, des groupes, des milieux ouvriers objectivement achetés par la bourgeoisie (meilleurs salaire, postes honorifiques, etc.) [...]
Historiquement et économiquement parlant, ils [les hommes du "centre"] ne représentent pas une couche sociale distincte. Ils représentent simplement la transition entre une phase révolue du mouvement ouvrier, celle de 1871-1914, qui a beaucoup donné, surtout dans l'art, nécessaire au prolétariat, de l'organisation lente, soutenue, systématique, à une grande et très grande échelle, -et une phase nouvelle, devenue objectivement nécessaire depuis la première guerre impérialiste mondiale, qui a inauguré l'ère de la révolution sociale". (Lénine, Œuvres tome 24, p.69)
De même que la thèse sur l'aristocratie ouvrière, on peut contester la limitation du phénomène du centrisme à une expression de la transition entre les deux phases du mouvement ouvrier et de la vie du capitalisme telle qu'elle apparaît dans cette citation. Mais celle-ci a le mérite d'infliger un cuisant démenti à l'affirmation péremptoire de Mac Intosh sur les "marxistes révolutionnaires [qui] ont toujours" etc.
Mac Intosh a voulu jongler avec des morceaux d'histoire, avec opportunisme et centrisme, mais le tout lui retombe sur la tête et il se retrouve avec un œil au beurre noir.
Pas de centrisme dans la période de décadence?
Décidément, Mac Intosh et la "tendance" n'ont pas de chance avec l'histoire. Ils se proposent de démontrer que le "centrisme ne peut pas exister dans la période de décadence du capitalisme et ils ne se rendent pas compte que, le terme "centrisme" n'a été employé comme tel et de façon systématique qu'après le début de la première guerre mondiale, c'est-à-dire, après l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence. Certes, le phénomène du centrisme s'était déjà manifesté auparavant à de nombreuses reprises dans le mouvement ouvrier où il avait, par exemple, été qualifié de "marais". Mais ce n'est qu'avec le début de la décadence que ce phénomène, non seulement ne disparaît pas, mais au contraire, prend toute son ampleur et c'est pour cela que c'est à ce moment-là que les révolutionnaire l'identifient de façon claire, qu'ils en analysent l'ensemble des caractéristiques et en dégagent les spécificités. C'est bien pour cette raison aussi qu'ils lui donnent un nom spécifique.
C'est vrai qu'il arrive aux révolutionnaires d'être en retard sur la réalité, que "la conscience peut être en retard sur l'existence". Mais de là à croire que Lénine, qui ne commence à utiliser le terme centrisme qu'en 1914, était à ce point un retardataire, qu'il écrit des dizaines et des dizaines de pages sur un phénomène qui a cessé d'exister, ce n'est pas seulement faire injure à ce grand révolutionnaire, c'est se moquer du monde. C'est en particulier faire fi du fait que durant toute cette période de la guerre mondiale, Lénine et les bolcheviks étaient, comme on peut le voir par exemple à Zimmerwald, à l'extrême avant-garde du mouvement ouvrier. Que dire alors du retard de R. Luxemburg, de Trotsky (que Lénine considérait tous les deux comme centristes à cette époque) et autres grands noms du marxisme ? Que penser de ces courants communistes de gauche issus de la IIIe Internationale qui continuent à utiliser pendant des décennies les termes d'opportunisme et de centrisme ? De quel aveuglement n'ont-ils pas fait preuve ? Quel retard de leur conscience sur l'existence ! Heureusement que Mac Intosh et la "tendance" sont arrivés pour rattraper ce retard, pour découvrir, soixante-dix ans après, que tous ces révolutionnaires marxistes s'étaient trompés sur toute la ligne ! Et cela justement au moment où le CCI identifie dans ses rangs des glissements centristes vers le conseillisme dont les camarades de la "tendance" (mais pas les seuls) sont plus particulièrement les victimes.
Nous n'examinerons pas dans le cadre de cet article déjà très long, la façon dont s'est manifesté le phénomène du centrisme dans la classe ouvrière durant la période de décadence. Nous y reviendrons dans un autre article. Mais nous relèverons seulement le fait que l'article de Mac Intosh est construit comme un syllogisme :
- 1ère prémisse : le centrisme se caractérise par des positions politiques précises qui sont celles du réformisme;
- 2ème prémisse : or, le réformisme, ne peut plus exister dans la classe ouvrière dans la période de décadence comme le CCI l'a toujours dit :
- conclusion : donc le centrisme n'existe plus, "l'espace politique autrefois occupé par le centrisme est aujourd'hui définitivement occupé par l'État capitaliste et son appareil politique de gauche".
Voilà qui semble imparable. On peut même ajouter que Mac Intosh n'avait même pas besoin de faire intervenir sa thèse idiote sur les "bases matérielles" du centrisme. L'ennui, avec la logique aristotélicienne, c'est que lorsqu'une prémisse est fausse, en l'occurrence la première, comme nous l'avons démontré, la conclusion n'a plus aucune valeur. Il ne reste plus au camarade Mac Intosh et à la "tendance" qu'à recommencer leur démonstration (et à s'informer un peu plus sur l'histoire réelle du mouvement ouvrier). Quant à leur mise au défi : "qu'on nous dise quelles sont précisément ces positions 'centristes' newlook ?" Nous leur répondrons qu'il existe effectivement une position "centriste" sur les syndicats (et même plusieurs), celle par exemple qui consiste à les identifier comme des organes de l'État capitaliste et à préconiser un travail en leur sein, de même qu'il existe une position centriste sur l'électoralisme : celle de Battaglia Comunista énoncée dans sa plateforme : "Conformément à sa tradition de classe, le parti décidera chaque fois du problème de sa participation suivant 1'intérêt politique de la lutte révolutionnaire" (Cf. Revue Internationale N°41, p.17).
Mac Intosh et la "tendance" iront-ils, eux qui sont si "logiques", jusqu'à prétendre que Battaglia Comunista est un groupe bourgeois, que, hors le CCI, il n'existe dans le monde aucune autre organisation révolutionnaire, aucun autre courant sur un terrain de classe ? À quand l'affirmation, .propre aux bordiguistes, que dans la révolution il ne peut y avoir qu'un parti unique et monolithique ? Sans s'en rendre compte, les camarades de la "tendance" sont en train de remettre complètement en cause la résolution adoptée (y compris par eux) lors du 2ème congrès du CCI sur "les groupes politiques prolétariens" (Revue Internationale N°11) qui montrait clairement l'absurdité de telles thèses.
La porte ouverte à l'abandon des positions de classe
C'est en montrant tous les dangers que représentait le centrisme pour la classe ouvrière que Lénine a mené durant la première guerre mondiale, le combat pour un internationalisme conséquent, qu'il a, avec les bolcheviks, préparé la victoire d'octobre 17. C'est en mettant en avant le danger d'opportunisme que les gauches communistes ont engagé la lutte contre l'orientation centriste de l'Internationale Communiste qui refusait de voir ou minimisait ce danger :
- "Il est absurde, stérile et extrêmement dangereux de prétendre que le parti et l'Internationale sont mystérieusement assurés contre toute rechute dans l'opportunisme ou toute tendance à y retourner"! (Bordiga, "Projet de Thèses de la Gauche au Congrès de Lyon", 1926).
- "Camarade, du fait de la création de la IIIe Internationale, 1'opportunisme n'a pas été tué ; pas même chez nous. C'est ce que nous constatons déjà dans tous les partis communistes dans tous les pays. En effet, il y aurait là un miracle et une contradiction à toutes les lois de l'évolution, si ce dont est morte la Ile Internationale ne lui survivait pas dans la IIIe." (Gorter, "Réponse à Lénine", sur la "Maladie Infantile...")
Pour la "tendance" qui accomplit l'exploit remarquable de réussir là où ces gauches avaient échoué : éliminer le centrisme et l'opportunisme du sein de l’IC), c'est par contre l'utilisation de la notion de centrisme qui a "toujours fini par effacer les frontières de classe" et "devient un symptôme majeur de corruption idéologique et politique de la part de marxistes qui l'ont employée".
Il ne sert à rien, comme le fait Mac Intosh, de décrire à longueur de pages les erreurs fatales de l'IC dans la constitution des partis communistes. Le CCI a toujours défendu, et continue de défendre, la position de la gauche communiste d'Italie, considérant que les mailles du filet de protection (les 21 conditions) dont s'est entourée l'IC contre l'entrée des courants opportunistes et centristes étaient trop larges. Par contre, c'est une falsification pure et simple de l'histoire que d'affirmer que l'IC a baptisé du nom de "centriste" les longuettistes et l'USPD afin de pouvoir les intégrer en son sein, alors que c'est de cette façon que Lénine a caractérisé ces courants depuis le début de la guerre. D'ailleurs Mac Intosh, dans cette partie de son article, fait une nouvelle preuve de son ignorance en affirmant que Longuet et Frossard avaient été, au même titre que Cachin, des "social-chauvins" lors de la guerre, nous lui conseillons de lire ce que disait Lénine là-dessus (notamment dans sa "Lettre ouverte à Boris Souvarine" Œuvres, tome 23, p. 215216)[13]
En fait, la "tendance" adopte une démarche de pure superstition : de même que certains paysans attardés n'osent pas prononcer le nom des calamités qui les menacent de peur de les provoquer, elle voit le danger pour les organisations révolutionnaires non là où il est vraiment -le centrisme- mais dans l'utilisation du terme qui permet justement d'identifier ce danger pour pouvoir le combattre.
Faut-il faire remarquer à ces camarades que c'est en bonne partie pour avoir nié ou n'avoir pas suffisamment compris le danger de l'opportunisme (si justement souligné par la gauche) que la direction de l'IC (Lénine et Trotsky en tête) a ouvert les portes à l'opportunisme qui allait engloutir cette organisation. Pour escamoter leurs propres glissements centristes vers le conseillisme, ces camarades adoptent à leur tour cette politique de l'autruche : "il n'y a pas de danger centriste", "le danger c'est l'utilisation de cette notion qui conduit à la complaisance envers le reniement des positions de classe". C'est tout le contraire qui est vrai. Si nous mettons en évidence le danger permanent du centrisme dans la classe et ses organisations ce n'est nullement pour lui tresser des couronnes, c'est au contraire pour pouvoir le combattre énergiquement, chaque fois qu'il se présente et, avec lui, tout l'abandon des positions de classe qu'il implique. C'est au contraire en niant ce danger qu'on désarme l'organisation et qu'on entrouvre la porte à ces reniements.
Faut-il également faire remarquer à ces camarades que le centrisme n'a pas épargné les plus grands révolutionnaires comme Marx (lorsqu'en 1872, après la Commune, il préconise pour certains pays la conquête du pouvoir par le parlement), Engels (lorsqu'en 1894 il tombe dans le "crétinisme parlementaire" qu'il avait si vigoureusement combattu auparavant), Lénine (lorsqu'à la tête de l'IC il combat plus énergiquement la gauche intransigeante que la droite opportuniste), Trotsky (lorsqu'il se fait le porte-parole du "centre" à Zimmerwald). Mais ce qui fait la force des grands révolutionnaires c'est justement leur capacité à redresser leurs erreurs y compris centristes. Et ce n'est qu'en étant capables d'identifier le danger qui les menace qu'ils y parviennent. C'est ce que nous souhaitons aux camarades de la "tendance" de comprendre avant qu'ils ne soient broyés par les engrenages de la démarche centriste qu'ils ont adoptée et dont le texte de Mac Intosh, avec ses libertés par rapport à l'histoire et à une pensée rigoureuse, avec ses faux-fuyants et ses tours de passe de prestidigitateur, constitue une illustration.
F.M.
[1] La tâche de la méthode marxiste est de pénétrer au-delà des apparences d'un phénomène pour saisir son essence.
[2] Une telle définition est floue et imprécise en termes de classe parce qu'elle n'est pas spécifique au prolétariat et pour la majorité du CCI le centrisme ne peut exister qu'au sein du prolétariat. Par contre, la conciliation, la vacillation, etc. sont aussi caractéristiques de la bourgeoisie à certaines époques où les tâches de la révolution bourgeoise démocratique n'ont pas encore été accomplies : Marx l'a souligné par rapport à la bourgeoisie allemande en 1848 et Lénine à propos de la bourgeoisie russe en 1905
[3] Une tendance elle-même divisée entre marxistes, anarcho-syndicalistes et libertaires.
[4] À Tours, Cachin et Frossard ont fait appel à leur ancien chef pour qu'il reste avec eux dans le nouveau parti.
[5] Ses futurs membres justifiaient leur vote aux crédits de guerre pendant deux ans par le fait que le Kultur allemand était menacé par les hordes slaves
[6] C'est dans ce sens que la tendance actuelle dans le CCI dit que la majorité de l'organisation tombe dans des positions trotskystes. Ceci ne veut pas dire que d'un seul coup l'organisation a adopté toutes les positions de Trotsky sur la défense de l'URSS, les questions syndicale et nationale, l'électoralisme, etc.
[7] Souvent les termes "centriste" et "contre-révolutionnaire" se trouvent dans la même phrase pour caractériser le stalinisme dans les pages de Bilan.
[8] Le PCI continue aujourd'hui à utiliser cette terminologie grotesque par rapport au stalinisme.
[9] Nous n'affirmons pas que c'est de façon délibérée et consciente que les camarades de la "tendance" exécutent ces tours de passe-passe et escamotent les vraies questions. Mais qu'ils soient sincères ou de mauvaise foi, qu'ils soient ou non eux-mêmes trompés par leurs propres contorsions intellectuelles importe peu. Ce qui importe c'est qu'ils trompent et mystifient leurs lecteurs et partant, la classe ouvrière. C'est à ce titre que nous dénonçons leurs contorsions.
[10] Que nous ne pouvons reproduire ici faute de place mais que nous encourageons nos lecteurs à lire
[11] Il est intéressant de noter que dans ce livre -et comme il a été relevé dans les colonnes de notre revue par la réponse faite par "Internationalisme" à ce livre (Revue Internationale n° 25 à 30) Pannekoek prend lui-même de curieuses libertés avec le marxisme en faisant des conceptions philosophiques de Lénine un indice majeur de la nature bourgeoise capitaliste d'État du parti bolchevik et de la révolution russe d'Octobre 17. Est-il étonnant que des camarades qui aujourd'hui glissent vers le conseillisme reprennent le même type d'arguments que le principal théoricien de ce courant ?
[12] Un programme qui sera commun aux deux fractions jusqu'à la révolution de 1917.
[13] Nous reviendrons également dans un autre article sur le problème de la nature de classe de l'USPD et de la formation des partis communistes.
Vie du CCI:
- Débat [910]
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Opportunisme & centrisme [911]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [368]
Revue Int. 1986 - 44 à 47
- 3437 reads
Revue Internationale no 44 - 1e trimestre 1986
- 2585 reads
Les luttes ouvrières seul frein a la guerre
- 2302 reads
LE DEVELOPPEMENT LENT ET PROFOND DE LA LUTTE DE CLASSE
Des pays développés aux pays sous-développés, le capitalisme en crise impose l'austérité à tous les ouvriers, dans tous les secteurs. En Europe, le taux de chômage atteint 11%.Même dans les pays où "l'Etat-providence" était une tradition bien établie, comme la Hollande, la Suède, la Grande-Bretagne, les budgets sociaux et les dépenses de santé sont dramatiquement réduites. Partout le prolétariat est attaqué. Et partout, il est obligé de se défendre, de se défendre le plus massivement possible, de plus en plus violemment, de plus en, plus contre les gouvernements, la police et le sabotage des luttes par les syndicats et les partis de gauche sans responsabilité gouvernementale.
Simultanéité des luttes et tendances à l'extension
Face aux attaques de la bourgeoisie qui touchent toute la classe ouvrière, celle-ci réagit dans tous les secteurs : le privé comme le public, les secteurs traditionnels comme l'industrie de pointe, le secteur directement productif comme celui des services, et dans tous les pays. La simultanéité des luttes, notamment au coeur de la plus grande concentration prolétarienne du monde, en Europe, se poursuit. Cette simultanéité, la bourgeoisie veut à tout prix la cacher pour tenter d'empêcher les ouvriers :
- de prendre conscience qu'ils ne sont pas isolés, que, confrontés aux mêmes problèmes, à l'autre bout du pays, de l'autre côté de la frontière, leurs frères de classe luttent aussi ;
- de prendre confiance en leurs propres forces ;
- d'unifier leurs luttes.
La simultanéité des luttes pose concrètement la possibilité d'étendre les luttes. La tendance à l'extension s'est manifestée à plusieurs reprises avec dynamisme, au sein d'un même secteur, mais également dans quelques conflits de grande ampleur où plusieurs secteurs ont lutté : Brésil, Grèce. Les luttes aujourd'hui sont d'autant plus significatives de la combativité actuelle de la classe que faire grève dans les conditions difficiles de la crise, de la menace du chômage, de la répression renforcée de l'Etat, et face à la stratégie de démobilisation et de division des syndicats, est un choix autrement important que dans les périodes de lutte antérieures. Même si, quantitativement, le nombre de jours de grève est moins important qu'au début des années 70, ce sont cependant, rien qu'au cours de ces derniers mois, des millions d'ouvriers qui ont été impliqués dans des mouvements de lutte.
La nécessité d'une lutte massive
Parallèlement à un strict contrôle de l'information sur la situation sociale, se mène une campagne permanente sur le thème "lutter ne sert à rien". Les images de défaites ouvrières sont étalées jusqu'à l'écoeurement : fins moroses des grèves, impuissance face à la répression, divisions entre ouvriers, etc. Le but d'une telle propagande est de freiner l'expression ouverte du mécontentement, de profiter de la désillusion grandissante à l'égard des syndicats pour la transformer en passivité, pour induire un sentiment d'échec, de démoralisation, d'atomisation individuelle.
De même que la prétendue "passivité" de la classe ouvrière est un mensonge, la prétendue "inefficacité" de la lutte en est un autre. Le niveau actuel de la lutte de classe n'empêche pas les attaques croissantes contre les conditions de vie de la classe ouvrière, mais il limite la marge de manoeuvre de la classe dominante dans son offensive et freine cette attaque. Cela ne se traduit pas en soi dans les résultats de chaque conflit, mais c'est au niveau de l'ensemble de la classe ouvrière que l'attaque est freinée. Même s'il n'y a pas d'acquis durable pour chaque conflit, chaque expression du mécontentement et de la résistance des ouvriers participe d'une résistance d'ensemble de la classe ouvrière qui a un effet. Plus la classe ouvrière résiste aux attaques de la bourgeoisie, plus elle restreint la marge de manoeuvre de celle-ci et rend la planification des attaques difficile. La campagne actuelle de dénigrement des luttes ouvrières, par son ampleur, montre l'inquiétude de la classe dominante. Abandonner le terrain de la lutte signifierait pour la classe ouvrière laisser les mains libres à la bourgeoisie pour attaquer encore plus fortement sur le plan économique, pour entretenir l'impuissance et l'isolement.
La nécessité de l'auto organisation contre et en dehors des syndicats
Plus que les résultats sur le plan économique qui ne peuvent être que temporaires et extrêmement limités, les résultats de ses luttes pour la classe ouvrière se trouvent sur le plan de la confiance en elle-même et de sa prise de conscience. La première victoire, c'est la lutte elle-même, la volonté de relever la tête face aux attaques, aux humiliations, à la répression de la bourgeoisie. Tout ce qui manifeste une volonté de lutter du prolétariat par ses propres moyens, par les grèves, les rassemblements, les manifestations, est un encouragement pour toute la classe ouvrière. La multiplication de conflits bouscule le mur du silence, brise le sentiment d'isolement, développe la conscience de sa force par le prolétariat, et renforce l'idée que pour faire face à la bourgeoisie, il faut lutter massivement, être nombreux, que pour cela, il faut étendre la lutte, que non seulement c'est nécessaire, mais que c'est possible.
En luttant, les ouvriers obligent la bourgeoisie à se dévoiler, à dévoiler ses armes et notamment les plus pernicieuses : les partis de gauche et les syndicats, parce qu'ils prétendent défendre les intérêts ouvriers.
En Suède, en France, en Grèce, en Espagne, les Partis Socialistes au gouvernement imposent les mêmes mesures d'austérité que les gouvernements de droite en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, que les Partis Communistes dans les pays de l'Est, où comme le PC en France de 1981 à 1984. Partout les ouvriers au travail et les ouvriers au chômage font face aux mêmes attaques, et partout les partis de gauche et les syndicats, même lorsqu'ils ne sont pas les promoteurs directs de l'austérité au gouvernement, quand ils sont dans "l'opposition", sont le fer de lance du sabotage des luttes ouvrières. Parce qu'ils se réclament de la classe ouvrière, parce qu'en son nom ils agissent en son sein, les syndicats ont été et sont au coeur de l'action ouvrière, la "cinquième colonne" de la bourgeoisie.
Dans les grèves de Renault en France, dans les mines du Limbourg en Belgique, la division entre syndicats a été savamment utilisée pour diviser les ouvriers, pour casser l'action ouvrière et faire reprendre le travail. Le dernier Congrès des syndicats britanniques (TUC) a été clair : organiser et coordonner la division entre les différents syndicats corporatistes (en particulier les mines avec le NUM qui a brisé la grève de 1984, et la métallurgie), afin de lutter encore plus efficacement contre la tendance à la solidarité et à l'unité parmi les ouvriers.
Face aux syndicats qui mettent toute leur énergie à limiter le conflit entre les classes dans les limites de l'usine, de la corporation, du secteur, la méfiance se développe dans la classe ouvrière : c'est ce que montre la tendance à des mouvements spontanés qui démarrent hors des consignes syndicales, des grèves "sauvages" : en France dans les chemins de fer, en Belgique dans les chemins de fer et dans les postes, en Suède dans quasiment toutes les grèves, plus de 200 en deux ans, et fin 85 dans les grèves du personnel de garde des enfants et du nettoyage de l'usine sidérurgique de Borlange.
Dans tous les conflits qui démarrent hors de consignes syndicales, le dispositif d'alerte de la bourgeoisie est rapidement mis en place : campagnes des médias, répression et intimidation policière, jeu des partis politiques pour permettre aux syndicats de reprendre le contrôle des opérations, pour mener la mobilisation ouvrière à la défaite.
La radicalisation des syndicats, notamment sous la forme d'un syndicalisme de "base" ou "de combat", qui redore le blason syndical en tentant de faire croire à la possibilité d'un "vrai" et d'un "bon" syndicalisme, joue un rôle très pernicieux.
En Grande-Bretagne en octobre 85, dans le chantier naval de Tyneside, les délégués d'ateliers (shop-stewards), soutenus par les gauchistes, ont détourné la grève spontanée au départ sur la "démocratie syndicale". En Belgique, dans les mines du Limbourg, les gauchistes ont détourné la solidarité et l'extension sur l'idée qu'il faut d'abord que toutes les mines soient en grève pour ensuite contacter les autres secteurs ; ils ont joint le geste à la parole en s'opposant manu militari à l'intervention du CCI dans la grève.
Le prolétariat fait face aux mystifications les plus sophistiquées de la classe dominante et particulièrement les syndicats qui sont son arme la plus adaptée. Face à cela, la méfiance ne suffit pas ; il faut que la classe ouvrière se donne les moyens de contrôler sa lutte, de la prendre elle-même en charge pour pouvoir briser l'isolement, et par l'extension établir un véritable rapport de forces en sa faveur face à la bourgeoisie.
C'est cette conscience de 'a nécessité de l'auto organisation pour parvenir à une réelle extension de la lutte qui est en train de mûrir dans les entrailles du prolétariat et à laquelle les organisations révolutionnaires doivent contribuer activement.
Dans ces conditions, comment lutter ? Là encore, la lutte des ouvriers a déjà donné des débuts de réponse ces derniers mois :
- imposer dans chaque usine ou heure de travail le principe de l'assemblée générale souveraine, avec comme seul représentant un comité de délégués élus et révocables devant l'assemblée à tout moment ;
- imposer que la coordination entre les différents lieux et assemblées en lutte soit exclusivement aux mains de comités de délégués responsables ;
- rejeter la délégation des décisions et des actions aux syndicats.
Le développement de la lutte de classe n'en est qu'au début d'une vague internationale ; il est lent et se heurte à la question cruciale du rôle du syndicalisme. L'approfondissement de la crise économique va pousser de plus en plus la classe ouvrière à exprimer son potentiel de combativité. De la capacité du prolétariat à lutter sur son terrain, à prendre confiance en lui, à ne pas céder aux campagnes de propagande que la bourgeoisie assène à dose massive, à déjouer l'obstacle du syndicalisme, dépend le succès de sa lutte d'émancipation de la barbarie du capital.
Si l'approfondissement de la crise pousse la classe ouvrière à combattre, il pousse aussi la bourgeoisie a sa "solution" : la guerre généralisée, ce dont a témoigne fin 1985 la rencontre entre Reagan et Gorbatchev.
REAGAN-GORBATCHEV :LA COURSE AUX ARMEMENTS LE MENSONGE D'UN CAPITALISME "PACIFIQUE"
Cette rencontre a été l'occasion d'un intense martelage idéologique des deux côtés du "rideau de fer", pour prétendre montrer qu'aussi bien l'URSS que les USA sont des puissances impérialistes "responsables", qui veulent "la paix", et que le Sommet de Genève a été un pas en avant "vers la paix".
Après l'invasion de l'Afghanistan en 1980 les deux "grands" en étaient venus aux diatribes menaçantes de la "guerre froide" : Reagan, dans des discours menaçants, a dénoncé "l'Empire du mal" que constitue le bloc russe adverse, tandis que Gorbatchev, sitôt arrivé au pouvoir a affirmé que "jamais la tension n'avait été aussi forte depuis les années 30". Et après ces campagnes bellicistes et agressives qui se sont succédées, marquant le retour de la peur de la guerre au coeur du monde capitaliste, justifiant la course accélérée aux armements les plus perfectionnés dans la capacité a semer la mort ei la destruction, les paroles de "paix" des leaders des deux blocs assis autour d'une tasse de café, images véhiculées par les médias du monde entier, peuvent rencontrer un écho favorable parmi des populations inquiètes de voir plantée au dessus de leurs têtes l'épée de Damoclès de l'holocauste nucléaire.
Beaucoup d'événements historiques depuis des décennies l'ont démontré : quand la bourgeoisie développe des prêches pacifistes, c'est pour mieux préparer la guerre. Les exemples ne manquent pas : les accords de Munich qui en 1938 précèdent l'éclatement de la 2ème guerre mondiale ; le pacte germano-soviétique de 1939, rompu deux ans plus tard par l'invasion de l'Ukraine par les forces de l'armée allemande ; les accords de Yalta, en 1945, qui ont été suivis par 40 ans de rivalités et de guerres permanentes entre les deux blocs, à la périphérie du capitalisme ; et, plus proches de nous, les accords d'Helsinki en 1975, sur les "droits de l'homme" dont on a pu voir l'inanité, et le sommet Carter-Brejnev qui a précédé de six mois seulement l'entrée des troupes russes en Afghanistan. Qu'est-ce qui a déterminé la propagande de "paix" autour de la rencontre Reagan-Gorbatchev ? Côté russe, c'est essentiellement le changement de l'équipe au pouvoir qui a été déterminant. Paralysée par une crise de succession, la bourgeoisie russe, sur le plan de la politique étrangère, a été marquée par la passivité et un repli frileux. L'arrivée de l'équipe Gorbatchev a montré un plus grand dynamisme de la politique russe vis-à-vis de l'Occident, afin d'essayer de briser l'isolement que lui impose l'étau occidental. Côté américain la propagande ne pouvait rester indifférente, face aux multiples "propositions de désarmement" de Gorbatchev, au risque de paraître comme le fauteur de guerre. Les discours bellicistes de Reagan dénonçant "l'Empire du mal" ont été le support idéologique de l'offensive militariste occidentale, caractérisée par la mise en place d'un gigantesque programme d'armements (dont l'orientation avait été décidée par Carter), qui a englouti des sommes de plus en plus fabuleuses (Budget US : 230 milliards de Dollars en 1985, 300 prévus en 1986), et par l'intervention de plus en plus fréquente des troupes occidentales à l'étranger. Ce processus est maintenant mis sur rails. C'est un autre volet de la propagande qui commence à être mis en place, basé sur des paroles de "paix". en effet, pour mobiliser les ouvriers dans un effort de guerre, pour obtenir leur adhésion à la défense militaire du capital national, il ne faut pas que les ouvriers considèrent de la faute de leur propre gouvernement une poussée vers la guerre. Il faut faire apparaître que l'agresseur, c'est "l'autre". Toutes les belles paroles de Reagan et Gorbatchev aujourd'hui n'ont pas d'autre but que d'apparaître comme "pacifiques" pour endormir la méfiance de "leurs" ouvriers, faire apparaître le bloc adverse comme l'agresseur.
Dans le capitalisme, la paix est un mensonge. Ce n'est pas la responsabilité des chefs d'Etat qui permet la paix, c'est le non embrigadement du prolétariat dans la guerre. Pour faire la guerre, il ne faut pas seulement à la classe dominante des armes ; la guerre se fait avec des hommes ; il lui faut des hommes pour produire ses engins de mort, pour combattre. Le seul frein réel à la guerre, ce n'est pas "l'équilibre de la terreur" que chaque bloc essaie de bousculer par une course aux armements sans répit (dernièrement le programme spatial US de "guerre des étoiles"), le seul frein à la guerre, c'est la capacité ou prolétariat à résister aux programmes d'austérité imposés pour les besoins de l'économie de guerre, de la production d'armements.
La lutte des ouvriers en Pologne en 1980-81 qui, durant de longs mois, a perturbé l'ensemble du dispositif militaire soviétique, a montre., comment sans adhésion de la population, de la classe ouvrière, à la défense du capital national, il ne pouvait y avoir embrigadement dans la guerre. L'obstacle que la bourgeoisie rencontre dans son cheminement vers la guerre, c'est la volonté du prolétariat de ne pas accepter de sacrifier ses conditions de vie. Même si le niveau actuel de la lutte de classe n'empêche pas l'accentuation des tensions impérialistes, il ne permet pas pour autant à la bourgeoisie d'avoir les mains libres pour imposer sa "solution" à la crise : la destruction de l'humanité.
La classe ouvrière doit étendre, généraliser, unifier les combats qu'elle a entrepris et qui sont encore contenus par la gauche et les syndicats, vers une confrontation politique ouverte avec la bourgeoisie.
LES LUTTES OUVRIERES DANS LE MONDE : QUELQUES EXEMPLES
Brésil : grèves face au programme d'austérité ; plus de 400 depuis l'instauration de la "nouvelle démocratie" ; octobre 85, les transports sont paralysés par une grève générale ; novembre, 500 000 ouvriers de Sao-Paulo en grève pour les salaires.
Grèce : après la victoire électorale du Parti Socialiste face au gel des salaires pour deux ans, le 6 novembre 100 000 travailleurs des secteurs public et privé sont en grève ; le 14 novembre, 1,5 millions d'ouvriers sont présents à une "journée d'action" appelée par l'aile gauche du syndicat grec ; ambiance générale d'instabilité sociale, affrontements et émeutes à partir des universités d'Athènes.
Japon : novembre 85, grève des chemins de fer face aux menaces de licenciements.
Suède : face à l'austérité imposée par la Social-Democratie nouvellement réélue, grèves dans les abattoirs, les dépôts ferroviaires de tout le pays, avec assemblées générales ; cette tendance à l'auto organisation et à l'extension culmine dans un mouvement de grève du personnel de garde des enfants ; le 23 novembre, des manifestations ont lieu en 150 points du pays, rassemblant plusieurs milliers de personnes et dirigées ouvertement contre l'Etat et les syndicats.
Hollande : des débrayages ont eu lieu dans plusieurs usines de Philips, contre les tentatives de baisser les salaires ; à Amsterdam, grève en octobre 85 des conducteurs de tramways et des pompiers ; au port de Rotterdam, le 23 octobre, débrayages sans les syndicats ; les dockers protestaient contre l'accord entre syndicats et patronat sur les cadences et la baisse des salaires.
France : en septembre 85, grèves dans les chantiers navals et poursuite de la grève malgré l'avis syndical a Dunkerque ; le 30 septembre, deux jours après une "journée d'action" des syndicats très peu suivie, grève des chemins de fer hors des consignes syndicales, étendue en 48 heures à tout le réseau ; en octobre, grèves à Renault ; en novembre grève à l'agence de presse AFP et à la Banque de France ; 22 novembre, la quasi-totalité des mineurs de Lorraine sont en grève contre les licenciements.
Belgique : dans les chemins de fer, 11000 emplois ont été supprimés ces trois dernières années ; en octobre 85 la bourgeoisie a voulu faire payer des impôts nouveaux sur les primes de nuit avec effet rétroactif depuis 1982 ; devant la force et la vitesse du déclenchement de la grève à tout le réseau ferré, les mesures ont été reportées ; les syndicats ont présenté cela comme une victoire, pour empêcher les ouvriers de profiter du rapport de forces pour obtenir le retrait complet des mesures et surtout pour étendre la lutte aux autres secteurs, comme en septembre 83. Dans ce contexte, dans le Limbourg, contre la menace de 4000 licenciements, 3500 ouvriers sont partis en grève ; au bout d'une semaine, 18000 mineurs les avaient rejoint. Il a fallu l'apport des gauchistes syndicalistes de base organisant des actions bidon pour épuiser les ouvriers les plus déterminés, empêcher la solidarité vers les autres secteurs.
Etats-Unis : dans la sidérurgie, trois mois de grève à l'automne 85 ont paralysée Wheeling Pittsburgh ; dans l'automobile, Chrysler, grève de dix jours sur les salaires ; sur le chantier de la centrale nucléaire de Seabrooke, près de Boston, 2500 ouvriers de toutes les professions font grève ensemble malgré les barrières interprofessionnelles syndicales ; dans le plus grand centre de conserverie alimentaire du pays, en Californie, Watsonville, la combativité ouvrière s'est manifestée dans des assemblées générales et par un refus de l'accord syndical.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
6eme Congres du CCI
- 2542 reads
Début novembre, s'est tenu le 6ème congrès du Courant Communiste International. Le congrès est l'instance suprême d'une organisation communiste. C'est au congrès que l'ensemble de l'organisation fait un bilan de ses activités durant toute la période écoulée depuis le précédent congrès, qu'elle se prononce sur la«validité des orientations définies par ce dernier tant au plan de l'analyse de la situation internationale qu'au plan des perspectives d'activité qui en découlent pour l'organisation elle-même. Ce bilan permet que soient tracées à leur tour des perspectives sur ces deux plans pour la période allant jusqu'au prochain congrès. Il est clair que ce n'est pas seulement à l'occasion du congrès que l'organisation se préoccupe et discute de l'évolution de la situation internationale et de ses propres activités. C'est de façon permanente qu'elle réalise ce travail afin d'être à chaque riment en mesure d'assumer le mieux possible ses responsabilités au sein du combat de classe. Mais ce qui distingue les travaux du congrès des autres réunions régulières qui se tiennent au sein de l'organisation c'est qu'à cette occasion c'est toute l'organisation qui se prononce collectivement et de façon directement unitaire sur les orientations générales et essentielles constituant le cadre au sein duquel vont se développer et s'articuler toutes ses activités. En d'autres termes, ce qui distingue les congrès c'est qu'ils doivent se confronter aux enjeux primordiaux de toute la vie de l'organisation.
Quels étaient les enjeux de ce 6ème congrès du CCI ?
LES ENJEUX DU CONGRES
L'organisation révolutionnaire n'existe pas par elle-même ni pour elle-même. Sécrétion de la classe révolutionnaire, elle ne peut exister que comme facteur actif dans le développement de la lutte et de la conscience de celle-ci. En ce sens, les enjeux de ce congrès pour le CCI étaient directement tributaires des enjeux de 1'évolution présente de la lutte de classe. Or ces derniers enjeux sont considérables. Face à un système capitaliste qui s'enfonce de plus en plus et de façon irréversible dans sa crise mortelle, crise dont l'unique aboutissement sur le terrain de ce système ne peut être qu'une troisième guerre mondiale qui détruirait l'humanité, la lutte du prolétariat, sa capacité de mobilisation sur son propre terrain de classe, constitue le seul obstacle en mesure de s'opposer à un tel aboutissement comme nous l'avons souvent mis en évidence et comme nous le rappelons dans l'éditorial de ce numéro de la Revue. Si aujourd'hui la crise du capitalisme n'a pas débouché sur un holocauste généralisé, c'est dû fondamentalement à la reprise historique des combats de classe depuis la fin des années 60, une reprise, qui, malgré des moments de repli et de déboussolement provisoires de la classe, ne s'est jamais démentie. Ainsi, alors que le 5ème congrès du CCI eut notamment pour tâche de comprendre et d'analyser le recul de la classe au niveau mondial qui avait permis et suivi sa défaite de 1981 en Pologne, le 6ème congrès s'est tenu par contre deux ans après le début d'une nouvelle vague de luttes qui a touché la plupart des pays industrialisés et notamment tous ceux d'Europe occidentale. Cette vague de luttes (la 3ème depuis 1968) se situe à un moment crucial de la vie de la société.
Elle se situe au milieu d'une décennie dont notre organisation a démontré en de multiples reprises la gravité des enjeux, une décennie où la "réalité du monde actuel se révélera dans toute sa nudité", où "se décidera pour une bonne part l'avenir de l'humanité" (Revue Internationale n° 20, "Années 80, les années de vérité"). C'est dire toute l'importance de la question centrale à laquelle était confronté notre 6ème congrès : comment armer notre organisation face à la 3ème grande vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui prend place au milieu d'une décennie aussi décisive, comment faire pour que le CCI soit non un simple observateur, même avisé, ou même un "supporter" enthousiaste des combats menés par la classe, mais, comme c'est sa responsabilité, un acteur du drame historique qui se joue, partie prenante de ces combats ?
S'ils étaient en premier lieu déterminés par la situation mondiale et particulièrement par l'évolution de la lutte de classe, les enjeux du 6ème congrès du CCI résultaient également de la situation particulière dans laquelle s'est trouvée notre organisation durant ces dernières années. En effet, si elle est un produit historique du mouvement de la classe révolutionnaire vers sa prise de conscience, l'organisation communiste n'en est pas un produit mécanique ou immédiat. La classe se donne des organisations communistes pour répondre à un besoin : participer activement à l'élaboration, l'approfondissement et la diffusion dans l'ensemble de la classe de la théorie et des positions révolutionnaires, mettre en avant de façon claire les buts ultimes de son mouvement et les moyens pour y parvenir, mener un combat permanent et acharné contre toutes les facettes de l'idéologie dominante qui pèse de façon constante sur l'ensemble de la classe et tend à paralyser son combat. C'est là un mandat que la classe confie aux organisations révolutionnaires mais dont il n'est pas donné a priori qu'elles pourront s'acquitter au mieux, à chaque moment de leur existence. Au même titre que la classe dont elles constituent une partie, celles-ci, ainsi que leurs militants, sont soumises à la pression permanente de l'idéologie de la classe dominante, et si elles sont mieux armées que le reste du prolétariat pour y résister, la menace n'en existe pas moins pour elles d'un affaiblissement de leur résistance et, en fin de compte, de l'incapacité d'accomplir les tâches pour lesquelles elles ont surgi. C'est ainsi que la gravité des enjeux des années 80 constituait pour l'ensemble des organisations du milieu révolutionnaire un défi considérable que ce milieu a éprouvé les plus grandes difficultés à relever. Les "années de vérité" pour l'ensemble de la société l'étaient également pour les organisations révolutionnaires et les convulsions qui ont marqué la situation mondiale dès le début de cette décennie tant au plan des conflits impérialistes (comme l'Afghanistan) qu'au plan des luttes de classe (comme en Pologne) , se sont répercutées par des convulsions importantes au sein du milieu révolutionnaire qui s'était développé avec la reprise historique de la classe dès la fin des années 60. Cette crise du milieu révolutionnaire que nous avons signalée et analysée à plusieurs reprises dans cette Revue ([1] [912]) n'a pas épargné le CCI lui-même comme nous l'avons mis en évidence. La conférence extraordinaire du CCI de janvier 82 devait représenter un moment important du ressaisissement de notre organisation et son 5ème congrès (juillet 83) pouvait, avec raison, tirer un"bilan positif de la façon dont le CCI fait face à cette crise" (Présentation du 5ème congrès dans la Revue n°35). Mais, comme nous l'avons constaté par la suite (cf. notamment l'article de la Revue n°42, "Les glissements centristes vers le conseillisme"), si ce redressement était "effectif", il était encore "incomplet". C'est ce que constate dans sa partie bilan la résolution d'activités adoptée au 6ème congrès :
"1. Le 5ème congrès du CCI, en juillet 83, a réaffirmé à juste titre la validité du cadre général de redressement organisationnel et politique assumé par la conférence extraordinaire de 1982 en riposte à la crise qui avait secoué le CCI au début des années 80, comme 1 'ensemble du milieu révolutionnaire, face aux enjeux des années de vérité.
Cependant le 5ème congrès, en laissant subsister des flous sur la compréhension de la situation internationale, en particulier sur les perspectives immédiates de la lutte de classe (sur un long recul du prolétariat, 1 'attente d'un saut qualitatif) n'a pas donné, dans la résolution d'activités, d'orientation, d'intervention dans le surgissement pourtant prévisible de luttes ouvrières face à 1 'accentuation des attaques de la bourgeoisie.
La consigne ‘faire moins mais mieux’ ([2] [913]) au lieu d'être clairement posée et comprise comme la consolidation et la préparation de 1'organisation en vue d'explosions inévitables de la lutte de classe dans les deux années suivant le congrès, a été conçue et perçue comme reconduisant le même 'repli dans l'ordre' de la conférence extraordinaire de 1982. Le CCI restait ainsi en partie tourné vers la période de déboussolement du prolétariat alors que la prise en compte des caractéristiques générales de la lutte de classe en période de décadence et 1'analyse des conditions présentes déterminaient la reconnaissance de la sortie de ce déboussolement et de la reprise des luttes ouvrières, ce qui s'est confirmé trois mois à peine après le congrès par 1 'irruption des grèves en Belgique en septembre 1983.
2. Au cours des deux années écoulées, le CCI s'est donc affronté au rattrapage de ces faiblesses, et notamment celles du mandat qu'il s'était donné au 5ème congrès, réajustant 1'orientation de celui-ci pour hisser son activité à la hauteur des exigences posées aux révolutionnaires par le mouvement d'accélération de 1'histoire sur tous les plans qui conditionnent 1'évolution de la société vers des affrontements de classe décisifs' ([3] [914]) et, en particulier pour assurer une intervention conséquente dans la reprise générale des combats de classe.
Face aux retards et aux positions erronées dans la compréhension des événements après le congrès le CCI (...) a commencé à réajuster ses orientations, soulignant le rythme plus rapide de 1'évolution de la situation internationale, dégageant 1'idée de 1'accélération de 1'histoire en donnant la signification des événements face aux retards dans les analyses et en rejetant les conceptions erronées tendant à amoindrir a responsabilité de 1'organisation."
Le 6ème Congrès du CCI, se devait donc, en vue d'élever l'organisation à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes dans le moment présent, de consolider tous les acquis auxquels nous étions parvenus dans les années précédentes sur les différents plans évoqués dans la résolution d'activités. Il se devait en particulier de tourner résolument le dos aux hésitations, aux tergiversations, aux tendances conservatrices qui s'étaient manifestées face à l'effort développé par l'organisation en vue de parvenir à ces acquis et qui avaient trouvé dans la minorité constituée en tendance en janvier 85 leur expression la plus accentuée pour ne pas dire la plus caricaturale. Il se devait, en ce sens, de se prononcer clairement non seulement sur les perspectives de la situation internationale, de la lutte de classe et de l'intervention que celle-ci requiert de notre part, mais également sur les questions essentielles qui avaient été longuement débattues dans l'organisation tout au long de cet effort, débat que nous avions rendu public dans les colonnes de notre Revue Internationale (cf. Revue n°40, 41, 42 et 43) et qui portait principalement sur :
- la reconnaissance de glissements centristes vers le conseillisme au sein du CCI ;
- l'importance du danger de conseillisme pour la classe et ses organisations révolutionnaires dans la période présente et à venir ;
- la menace que fait peser sur ces dernières, aujourd'hui autant ou plus que par le passé, l'opportunisme et notamment sa variante centriste.
Voilà quels étaient les enjeux et les exigences du 6ème congrès du CCI. Dans quelle mesure a-t-il su y répondre ?
LES DISCUSSIONS ET LES TEXTES DU 6ème CONGRES
L'analyse de la situation internationale
Les lecteurs de notre Revue ont pu constater que c'est de façon permanente que le CCI examine la situation internationale. Aussi ne revenait-il pas au 6ème congrès la tâche de traiter tous les aspects de celle-ci mais de se concentrer sur les aspects les plus importants, les plus récents et déterminant le plus directement les tâches de notre organisation. Il se devait en particulier de souligner les enjeux majeurs de la période et notamment face à toute une série de campagnes idéologiques de la bourgeoisie tendant à "montrer" :
- que l'économie capitaliste se porte mieux, qu'elle est en "convalescence" ;
- que grâce à la sagesse des dirigeants des grandes puissances, les tensions entre celles-ci se sont atténuées ;
- que la classe ouvrière lutte de moins en moins, qu'elle a "compris" la nécessité de se montrer "raisonnable" pour favoriser la sortie de la crise.
La résolution adoptée par le congrès, et que nous publions à la suite, réfute - au même titre que les rapports présentés à ce congrès et sur lesquels elle est basée- ces différents mensonges. Reconnaître les principaux enjeux de la période présente cela consiste en particulier à mettre en évidence :
- l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste et la barbarie dans laquelle elle plonge toute la société (points 2 à 5) ;
- l'aggravation inéluctable des tensions impérialistes et le caractère mensonger de tous les discours de paix (points 6 à 8) ;
- que "la clé de toute la situation historique est entre les mains de la classe ouvrière" (point 9) ; que "la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de très grande envergure" et qu'"il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants face aux potentialités de la période présente et, en particulier, qu'ils ne sous-estiment pas ces potentialités" (point 15).
La mise en évidence des enjeux de la lutte de classe s'appuie donc, en premier lieu, sur la capacité à réfuter tous les mensonges sur la "passivité" de la classe ouvrière (les points 9, 10 et surtout 11 y sont consacrés), mais également sur une analyse des caractéristiques présentes du développement de cette lutte (notamment aux points 10 et 13) et des multiples pièges tendus par la bourgeoisie et en particulier ses syndicats pour la paralyser (points 12 et 13). Elle repose enfin sur une analyse claire du phénomène du chômage comme un aiguillon majeur du combat de classe :
L'examen du développement de la lutte de classe devait occuper la plus grande part des discussions sur la situation internationale (la moitié de la résolution y est consacrée). C'était la traduction de toute l'importance que le CCI accorde à cette question en vue d'intervenir du mieux possible, avec ses forces encore bien faibles, dans cette lutte afin que s'en dégagent toutes les potentialités qu'elle recèle.
L'intervention du CCI
La nécessité de l'intervention des révolutionnaires imprègne la résolution sur la situation internationale qui se termine sur ce point :
"C'est notamment à travers cette intervention, si elle est capable de mettre en avant des propositions de marche correspondant aux besoins de la classe, que les révolutionnaires feront la preuve concrète auprès des ouvriers de la nécessité d'une organisation révolutionnaire jetant ainsi les bases du futur parti de la révolution communiste. " (point 15) .
Mais elle est surtout au centre de la résolution d'activités adoptée au congrès :
"L'intervention dans la lutte de classe basée sur des revendications de classe doit être la priorité du CCI. Cette présence politique de 1'organisation par 1'intervention, sur le terrain de classe, sur la défense des intérêts immédiats des ouvriers face aux attaques du capital, par les moyens de lutte propres à la classe ouvrière (grèves, manifestations, réunions, assemblées, groupes ouvriers, comités de chômeurs) est non seulement possible, mais elle est nécessaire et a une influence parmi les ouvriers, que ce soit formellement les syndicats qui appellent ou non, que les ouvriers y soient présents en masse ou en petit nombre. C'est la condition pour que l'organisation remplisse en pratique la tâche pour laquelle elle existe dans la classe ouvrière, pour qu'elle soit capable de dénoncer les caricatures de lutte des syndicats et leur stratégie de démobilisation que sont les opérations médiatiques, les ‘actions-commando' , les délégations et pétitions syndicales, les 'revendications' corporatistes et nationalistes, pour qu'elle soit capable de mettre en avant des propositions concrètes de marche pour pousser à la réflexion, l'unité, l'action collective de la classe, à chaque moment et dans chaque lieu de la défense des intérêts ouvriers.
Cette maîtrise [du cadre organisationnel en vue de 1'intervention] suppose la conviction que ces deux années à venir vont voir surgir des explosions de la lutte de classe, que nous n'avons pas les réponses toutes faites aux problèmes nouveaux qui vont surgir mais que la fermeté sur ce que nous avons acquis est la condition pour être à la hauteur de la situation. L'organisation doit être prête à tout instant à un embrasement possible de la lutte de classe, ce qui implique de participer à chaque moment qui annonce, prépare et rapproche des mouvements de grande ampleur dont elle a besoin pour remplir sa mission historique."
C'est donc de façon particulièrement déterminée que le congrès a confirmé et renforcé l'engagement de l'organisation vers une intervention de plus en plus active au sein des luttes ouvrières, une intervention qui soit à la hauteur de 1'importance de celles-ci. Il a confirmé cette orientation par l'adoption d'une résolution spéciale sur la presse du CCI qui précise notamment que :
"La presse demeure le principal instrument d'intervention de1'organisation et elle se situe donc au centre de notre effort pour développer les moyens de participation active au combat de classe. Même si 1'intervention par tracts et les prises de parole deviennent partie intégrante du travail régulier de 1 'organisation, cela ne diminue en rien 1'importance de la presse, au contraire. Celle-ci incarne la continuité de notre intervention et constitue l’outil indispensable qui permet de replacer chaque intervention dans un cadre plus large, donnant les dimensions historiques et mondiales de chaque combat."
Enfin, à l'image du 5ème congrès qui avait adopté une "Adresse aux groupes politiques prolétariens" (Revue n°35), le 6ème congrès s'est à nouveau penché sur cette question en considérant notamment "que 1 'orientation actuelle vers 1'accélération et le renforcement de 1'intervention du CCI dans la lutte de classe est également valable et doit être appliquée rigoureusement dans notre intervention envers le milieu." La résolution adoptée affirme notamment que :
Le CCI [...] doit se préoccuper d'utiliser pleinement la dynamique positive de la situation actuelle de lutte afin de pousser le milieu de l'avant et d'insister sur une intervention claire et déterminée des organisations révolutionnaires dans ces luttes.(...)
Afin de faire le meilleur usage de ces potentialités qui sont à leur tour simplement une concrétisation du fait que la période de lutte pour la formation du parti est ouverte, il est nécessaire de mobiliser les forces de tout le CCI afin d'oeuvrer au mieux à la défense du milieu politique, ce qui passe par (...) une attitude déterminée pour participer au regroupement des révolutionnaires, à leur unité."
Si 1'importance et les modalités de l’intervention du CCI dans les luttes ouvrières ont mobilisé beaucoup d'attention et d'effort au 6ème congrès, la capacité politique de l'organisation conditionnant cette intervention a également été une préoccupation centrale. C'est ainsi que le danger que représente le conseillisme pour l'ensemble de la classe et pour ses organisations politiques a été clairement mis en avant tant dans la résolution sur la situation internationale (point 15) que dans la résolution sur les activités qui précise que :
"Ce danger qui remet en question la capacité de l'organisation 'être un facteur actif dans les luttes quotidiennes de la classe, ne peut être combattu que si 1 'organisation développe et renforce de manière constante sa clarté politique et sa volonté militante".
Mais cette préoccupation d'armer politiquement l'organisation ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné lieu à la discussion d'une résolution particulière "sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" et d'une contre-résolution présentée par une minorité du CCI "sur le centrisme et les organisations politiques du prolétariat", toutes deux publiées dans cette Revue.
L'opportunisme et le centrisme
La reconnaissance de la permanence du phénomène historique de l'opportunisme dans la période ae décadence du capitalisme fait partie intégrante du patrimoine politique de la gauche communiste qui s'est dressée contre la dénégénérescence de 1'Internationale Communiste, justement au nom de la lutte contre l'opportunisme et le centrisme.
Le CCI a éprouvé à ses débuts quelques difficultés à se réapproprier cet acquis. Mais dès son 2ème congrès (1977) c'était chose faite pour l'ensemble de l'organisation avec la "Résolution sur les groupes politiques prolétariens" (Revue Internationale n°11). La remise en cause de cet acquis par certains camarades de la minorité qui allait se constituer en "tendance" participait donc d'une régression contre laquelle le CCI a engagé le combat à travers une longue discussion que notre Revue a répercutée, notamment dans ses numéros 42 et 43. La richesse de ces débats, l'approfondissement des acquis qu'ils ont permis et qui renforcent notre organisation contre les menaces permanentes de l'opportunisme et du centrisme, ont trouvé leur conclusion logique au congrès par l'adoption de la "Résolution sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" et le rejet de la contre-résolution. Pour l'essentiel, cette dernière reprend les arguments figurant dans l'article "Le concept du 'centrisme' : le chemin de l'abandon des positions de classe" publié dans la Revue n°43 et auxquels le CCI a déjà apporté une réponse dans ce même numéro ("Le rejet de la notion de centrisme : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe"). C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de revenir ici sur la critique de ces arguments sinon pour souligner que les conceptions mises en avant par cette contre-résolution conduisent à la fois à un sectarisme total ("en dehors des organisations défendant sur tous les points un marxisme intransigeant il n'y a que la bourgeoisie") et à la fois, même si elle s'en défend, à amoindrir la vigilance de l'organisation contre la principale des formes de pénétration de l'idéologie bourgeoise.
L'adoption par le congrès de la résolution s'est accompagnée de l'adoption d'une courte résolution indiquant la nécessité pour le CCI de rectifier sa plate-forme. En effet, le degré de clarté qui s'était fait dans les débats et que la résolution résume, avait fait apparaître la nécessité d'une telle rectification en particulier sur la question des conditions de passage des partis ouvriers (PS et PC) dans le camp bourgeois. Cette rectification était d'ailleurs prévue à l'ordre du jour et des amendements avaient été préparés depuis plusieurs mois. Mais si les débats du congrès ont fait la preuve d'une grande clarté autour de la résolution elle-même, ils ont fait apparaître une maturité encore incomplète sur les formulations qu'il convenait d'insérer dans la plate-forme. Partant de ce constat, et conscient du fait que sur la question primordiale de l'opportunisme et du centrisme -laquelle a des implications immédiates sur la vie de l'organisation- celle-ci s'était solidement armée avec la résolution, le congrès a décidé de reporter au prochain congrès la rectification de la plate-forme.
Par contre, le congrès a adopté plusieurs amendements aux statuts permettant, dans le même esprit qui est le leur et qui s'exprime dans le "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires" (Revue n°33), de préciser certains points et de fermer en particulier la porte à toute idée que l'organisation pourrait fonctionner sur la base de groupes de travail comme c'était le cas dans la gauche hollandaise. Cette précision était devenue nécessaire dans la mesure où, entraînés par leurs glissements conseillistes, les camarades minoritaires s'étaient acheminés, sans le reconnaître, vers une telle conception.
Le déboussolement de ces camarades sur les questions organisationnelles devait d'ailleurs se traduire lors du congrès par leur départ de celui-ci et de l'organisation.
LA DESERTION DE LA "TENDANCE"
Dans l'article de la Revue n°43 en réponse à l'article de la "tendance", nous mettions ces camarades en garde contre le danger d'être "broyés par les engrenages de la démarche centriste qu'ils ont adoptée". Leur attitude lors du congrès a montré que la mise en garde n'était pas vaine. En effet, face aux affirmations de certains membres de cette "tendance" sur leur prochain départ de l'organisation, le congrès a d'emblée demandé aux camarades qui en faisaient partie ce qu'il en était de leur engagement militant dans l'organisation. En effet, il est parfaitement concevable qu'une minorité (ou une majorité) d'une organisation se présente à un congrès en annonçant la nécessité d'une scission et demande que soit immédiatement mise aux voix la question qui la motive : c'est ainsi qu'a agi la majorité de la SFIO au congrès de Tours en 1920 et la minorité du PSI au congrès de Livourne en 1921 sur la question de l'adhésion à l'Internationale Communiste. Mais telle n'a pas été l'attitude de la "tendance" qui, afin de ne pas mettre en évidence les désaccords existant en son sein entre ceux qui voulaient se retirer et ceux qui voulaient rester des militants du CCI, a préféré escamoter la question qui lui était posée. Voici comment, dans une résolution adoptée à l'unanimité des délégués présents, le congrès a pris position sur l'attitude de la "tendance" :
"Considérant que :
- la tendance s'est présentée au 6ème congrès en posant un ultimatum inacceptable selon lequel elle pourrait mettre en question son appartenance à 1’organisation au cas où celle-ci adopterait les orientations présentées par 1'organe central sortant ; la tendance a refusé de répondre à la demande du congrès qu 'elle se prononce clairement sur son engagement militant dans 1'organisation à la suite du congrès, le congrès a demandé à la tendance de se retirer afin de réfléchir, préparer et fournir une réponse à la séance suivante.
Au lieu de cela, la tendance et deux camarades de 1'organisation, tout en faisant parvenir une déclaration au présidium du congrès prétendant être exclus du congrès et affirmant continuer à faire partie de 1'organisation, ont quitté définitivement le congrès sans même 1'en avertir.
Malgré 1'adoption par le congrès d'une résolution exigeant leur retour, malgré que cette résolution leur ait été communiquée par téléphone, la tendance et les deux camarades ont refusé de revenir s'expliquer au congrès, se contentant d'une déclaration mensongère présentant leur attitude comme une 'exclusion de la tendance des travaux du congrès'.
Face à cela, le congrès considère que 1'attitude de la tendance et des deux camarades
- premièrement traduit un mépris du congrès et de son caractère de moment d'action militante de 1'organisation ;
- deuxièmement, constitue une véritable désertion des responsabilités qui sont celles de tout militant de l'organisation."
Après le congrès, le CCI a reçu des camarades de la "tendance" une déclaration où est renouvelée l'affirmation mensongère suivant laquelle elle aurait été exclue du congrès. Aux termes de la déclaration, cette prétendue "exclusion" marque de "façon irrévocable la dégénérescence de la vie interne du CCI" et en conséquence la "tendance" décide de se "constituer en fraction à 1'extérieur du cadre organisationnel du CCI" afin notamment de "représenter la continuité programmatique et organique avec le pôle de regroupement que fut le CCI, avec sa plateforme et ses statuts qu'il a cessé de défendre".
Ainsi, le milieu politique prolétarien déjà lourdement marqué par le sectarisme et la dispersion vient-il de "s'enrichir" d'un nouveau groupe basé sur la même plateforme que celle du CCI. La trajectoire lamentable de cette "tendance" qui réalise une "première historique" en se constituant en "fraction" (qui veut dire "partie de") après son départ de l'organisation d'origine, qui a besoin des mensonges les plus grossiers pour justifier ses contorsions, traduit bien le danger que représente la constitution d'une "tendance" sur des bases inconsistantes comme nous le signalions dans la Revue n°42 :
"... le CCI considère qu'il ne s'agit pas là d'une véritable tendance présentant une orientation alternative positive à celle de 1'organisation, mais d'un rassemblement de camarades dont le véritable ciment n'est ni la cohérence de leurs positions, ni une profonde conviction de ces positions, mais une démarche contre les orientations du CCI dans son combat contre le conseillisme."
Le réel dévouement, le sincère engagement militant d'un certain nombre de camarades de la "tendance" n'y a rien pu : dès lors qu'ils se sont laissés happer par la dynamique aberrante de celle-ci, ils ont fini par s'aligner sur les éléments qui étaient fatigués de militer et qui cherchaient le moindre prétexte, même le plus fallacieux, pour se désengager tout en "sauvant la face".
Tout au long de l'existence des organisations communistes, celles-ci ont perdu de leurs militants. A certains moments de l'histoire, comme au cours de la terrible contre-révolution des années 30 à 50, cette perte constituait un phénomène tragique qui a pu venir à bout des organisations elles-mêmes. Aujourd'hui, la situation est toute autre et le départ des camarades de la "tendance" ne saurait compromettre la capacité du CCI à faire face à ses responsabilités tout comme il n'a pas empêché le 6ème congrès d'assumer les taches qu'il s'était données.
EN CONCLUSION. . .
Après plusieurs jours de débats intenses, où se sont exprimées les délégations de toutes les sections territoriales qui composent le CCI, où ont été examinés, discutés et mis aux voix différents rapports, résolutions et de nombreux amendements, il nous faut donc considérer que le 6ème congrès du CCI a globalement atteint les objectifs qu'il s'était fixés, qu'il a valablement armé l'organisation face aux enjeux de la période présente. Les années qui viennent jugeront de la validité d'une telle appréciation, elles montreront en particulier si l'analyse dont s'est doté le CCI sur la situation internationale et notamment sur l'évolution de la lutte dardasse est bien conforme à la réalité, ce que contestent la plupart des autres groupes révolutionnaires. Mais dès à présent, les résolutions que nous publions dans ce numéro de la Revue Internationale font la preuve que le CCI s'est engagé dans une direction bien précise, laissant le moins possible la porte ouverte à toute ambiguïté (comme c'est le cas malheureusement de la part de beaucoup de ces groupes) , une direction qui, sur la base de l'analyse des énormes potentialités de combat qui mûrissent et se développent dans la classe, exprime la ferme volonté d'être à la hauteur de ces combats, d'en être partie prenante et de contribuer activement à leur orientation vers l'issue révolutionnaire.
F.M.
Conscience et organisation:
Résolution : la situation internationale
- 2491 reads
1) A la veille des années 80, le CCI a désigné celles-ci comme les "années de vérité", celles où les enjeux majeurs de toute la vie de la société allaient clairement se révéler dans leur formidable ampleur. A la moitié de cette décennie, l'évolution de la situation internationale a pleinement confirmé cette analyse :
- par une nouvelle aggravation des convulsions de l'économie mondiale qui se manifeste dès le début des années 80 par la récession la plus importante depuis celle des années 30 ;
- par une intensification des tensions entre blocs impérialistes qui se révèle notamment durant ces mêmes années, tant par un bond considérable des dépenses militaires que par le développement d'assourdissantes campagnes bellicistes dont s'est fait le chantre Reagan, chef de file du bloc le plus puissant ;
- par la reprise, dans le seconde moitié de 1983, des combats de classe après leur repli momentané de 1981 à 1983 à la veille et à la suite de la répression des ouvriers de Pologne, reprise qui se caractérise en particulier par une simultanéité des combats sans exemple par le passé, notamment dans les centres vitaux du capitalisme et de la classe ouvrière en Europe occidentale.
Mais, au moment même où se confirme toute la gravité des enjeux de la période présente, où se dévoilent toutes les potentialités qu'elle contient, la bourgeoisie lance toute une série de campagnes idéologiques visant à :
- accréditer le mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les "succès" de l'économie américaine en 1983 et 84 (taux de croissance élevés, baisse de l'inflation, recul du chômage) seraient l'incarnation ;
- faire croire à une atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la "main tendue" aux négociations avec l'URSS qui trouvent leur pendant avec l'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev ;
- ancrer dans la tête des ouvriers l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale.
En réalité, ce ne sont là que des rideaux de fumée destinés à masquer aux yeux des ouvriers toute l'importance des enjeux présents au moment même où se développe en profondeur une nouvelle vague de combats de classe. Ce que révèle en fait l'examen de la réalité mondiale d'aujourd'hui, c'est une confirmation éclatante des tendances fondamentales de la période historique présente qui s'étaient révélées dès le début de la décennie.
LA CRISE ECONOMIQUE
2) Le mythe d'une amélioration de la situation de l'économie mondiale éclate comme une bulle de savon dès qu'on constate la terrible réalité qui est celle des pays de la périphérie du capitalisme. L'endettement gigantesque (900 milliards de dollars) des pays appelés par une sinistre ironie "en voie de développement" (PVD), l'échec flagrant des potions -pourtant très amères- préparées "pour leur bien" par les "experts du FMI" (baisse de 30 % en deux ans du pouvoir d'achat au Mexique, de 20 % en six mois en Argentine, etc.). La faillite complète des derniers parmi ces pays dont on avait vanté la croissance miraculeuse (Hong-Kong, Singapour...), les taux d'inflation invraisemblables qu'ils connaissent (400 % au Brésil, le "pays modèle" des années 70, 10 000 % en Bolivie...), la terrible misère qui accable toutes les populations du tiers-monde, qui, avec la malnutrition, les famines, les épidémies qu'elle provoque, est responsable chaque jour de la mort de 40 000 personnes, qui transforme la vie quotidienne de plusieurs milliards d'êtres humains en un enfer permanent, toute cette effroyable réalité -que la bourgeoisie des pays avancés n'hésite pas à exhiber dès qu'il s'agit de présenter comme "enviables" la situation économique ainsi que le sort des ouvriers de ces pays- ne révèle en fait qu'une chose : l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie mondiale, l'incapacité définitive du mode de production capitaliste à surmonter ses contradictions mortelles dont les pays de la périphérie sont les premiers à payer les conséquences.
De même, l'incapacité permanente des pays dits "socialistes" à réaliser des plans pourtant de moins en moins ambitieux, la pénurie totale et permanente de biens de consommation qui s'y installe, le recul de la production en Tchécoslovaquie et en Pologne (dans ce dernier pays on en est aujourd'hui au niveau de 1974), les 150 % d'inflation en deux ans en Pologne comme la baisse de l'espérance de vie en URSS (66 ans en 1964, 62 ans en 1984), toutes ces caractéristiques, non seulement démasquent clairement le mensonge de leur nature "socialiste" mais font un sort définitif aux "théories" ayant eu cours même au sein du milieu révolutionnaire sur la capacité du capitalisme d'Etat à surmonter les contradictions du capitalisme classique, à se libérer des contraintes de la loi de la valeur. Elles révèlent que si ces pays ne sont pas moins capitalistes que les autres, c'est un capitalisme peu développé et peu compétitif qui y règne, un capitalisme qui, par bien des aspects, s'apparente à celui des pays du tiers-monde (comme la prédominance des matières premières dans ses exportations) et qui, à ce titre, est particulièrement fragile face aux coups de boutoir de la crise.
3) Le mythe de la convalescence du capitalisme se heurte également aux dures réalités qui sont celles des plus vieux pays bourgeois : ceux d'Europe occidentale où est localisée la plus forte concentration industrielle du monde. Dans cette zone, les quelques améliorations constatées ces dernières années pour certains pays en termes de taux d'inflation et de croissance du PNB ne sauraient masquer les réalités suivantes : - malgré son recul, résultant des attaques répétées contre les conditions de vie des ouvriers, le niveau présent de l'inflation (7,2 %) pour l'ensemble de ces pays représente encore plus du double de celui de 1967 (3,3 %) ;
- le niveau de la production industrielle n'était pas plus élevé en 1984 qu'en 1981 ;
- ce sont des pans entiers et considérables de l'appareil industriel qui sont éliminés (dans la sidérurgie, les chantiers navals, les mines, l'automobile, etc.) au nom d'un "assainissement" qui ressemble aux amputations répétées pratiquées sur un corps atteint de gangrène ;
- le fléau du chômage n'a cessé de se développer jusqu'à frapper 25 millions d'ouvriers, soit plus de 11% de la population active (entre 1981 et 84 le nombre des chômeurs a augmenté autant que durant les 20 années précédentes) ; la réalité quotidienne de ces pays, c'est l'extension à des échelles inconnues depuis des décennies des soupes populaires et de la paupérisation absolue.
Relatives à un des centres vitaux du capitalisme mondial, ces données prouvent à quel point les bavardages sur la "reprise", l'"assainissement" ne sont que purs rideaux de fumée.
4) De même, apparaissent comme totalement mensongers les discours sur la "santé" de l'économie américaine dès que sont dévoilées les recettes véritables de ces "reagonomics* sensées avoir fait des miracles. En effet, ce qui réside derrière l'augmentation "éblouissante" de 6,8 % de son PNB en 1984 (seule augmentation sensible de tous les pays importants en dehors du Japon, que sa grande compétitivité a préservé jusqu'à présent des atteintes les plus fortes de la crise), derrière le recul du chômage et derrière la baisse du taux d'inflation, ce sont respectivement :
- une relance de la production par des déficits considérables du budget fédéral (au total 379 milliards de dollars pour les années 83 et 84), ce qui est en totale contradiction avec les principes affichés par Reagan lors de son arrivée à la tête de l'Etat ;
- la poursuite de l'élimination de vastes pans du secteur industriel (et qui commence à affecter même les secteurs de haute technologie censés créer des quantités mirifiques de nouveaux emplois), la création d nouveaux emplois qui ont fait baisser le chômage revenant au secteur des services, ce qui n'a pu que détériorer la compétitivité d'ensemble de l'économie américaine ;
- la baisse des prix des importations du fait de l'augmentation considérable du taux de change du dollar lequel reposait sur les énormes emprunts faits par l'Etat fédéral pour combler ses déficits.
Comme le mettait en évidence la résolution du 5ème congrès du CCI pour expliquer la récession de 1980-1982 : "Les politiques 'monétaristes' orchestrées par Reagan et suivies par la totalité des dirigeants des pays avancés rendent compte de cette faillite des politiques néo-keynésiennes en laissant émerger la cause profonde de la crise du capitalisme, la surproduction généralisée et ses conséquences inéluctables : la chute de la production, 1'élimination du capital excédentaire, la mise au chômage de millions d'ouvriers, la dégradation massive du niveau de vie de 1 'ensemble du prolétariat." (REVUE INTERNATIONALE N° 35 - 4e trimestre 1983)
La "reprise" de l'économie américaine a été permise par l'abandon momentané de cette politique laquelle avait pour but d'empêcher que "le montant astronomique des dettes sur lequel repose aujourd'hui l'économie mondiale [n'aboutisse] à la mort du malade par un emballement apocalyptique de la spirale inflationniste et l'explosion du système financier international" (ibid).
Ainsi, les limites qu'on voit, dès aujourd'hui, de la "reprise" aux USA sont contenues dans la même réalité qui avait obligé dès 1980 le gouvernement de ce pays à opérer un coup de frein brutal plongeant le monde entier dans la brutale récession de 1980-82 : face à l'engorgement inévitable et croissant des marchés solvables, il ne peut exister pour le capital d'autre perspective que la réduction de la production, des profits, de la force de travail qu'il exploite, des salaires versés à celle-ci. De ce fait, il ne peut exister d'autre "relance" que celle de la fuite en avant de l'endettement, c'est-à-dire l'accumulation à une échelle inconnue par le passé et toujours plus vaste des contradictions qui font de l'économie mondiale un véritable baril de poudre.
5) En réalité, depuis l'entrée de celle-ci dans sa phase de crise ouverte au milieu des années 60, elle n'a eu d'autre alternative que d'osciller de plus en plus brutalement entre la récession (traduction directe des causes de la crise : la saturation des marchés) et l'inflation (qui ne fait que révéler l'abus du crédit et de la planche à billets par lesquels les Etats et les capitalistes ont tenté de contourner cette saturation; Chacune des "reprises" qu'a connues l'économie mondiale à la suite des récessions de 1971, de 1974-75 et de 1980-82 s'est basée sur une nouvelle flambée de l'endettement. C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70 -endettement alimenté par les prêts des banques occidentales en mal de "recyclage" des "pétrodollars"- qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.
Après 1982, c'est donc l'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur (qui en fera bientôt le premier débiteur du monde) qu'intérieur (plus de 6 000 milliards de dollars en 1984, soit l'équivalent de la production totale de la RFA pendant 10 ans), qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.
En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion de son système financier (dont on mesure dès à présent toute la vulnérabilité avec la succession ininterrompue de faillites bancaires), que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin.
La seule perspective qui s’offre au monde, y compris aux pays les plus industrialisés incluant pour la première fois de façon explicite les 2e et 3e puissances industrielles du "bloc de l'Ouest, le Japon et l'Allemagne", est donc :
- un nouveau recul du commerce mondial doublé d'une intensification de la guerre commerciale notamment entre les USA et ses grands "partenaires" tels le Japon et l'Europe de l'ouest ;
- une nouvelle plongée de la production se traduisant par une terrible aggravation du chômage; l'intensification des attaques contre les conditions de vie des ouvriers en forme de baisse des salaires, de réduction des prestations sociales ainsi que d'une aggravation sans précédent des rythmes et des conditions de travail.
Ce que recouvrent les discours sur la "reprise" et sur l"'assainissement" de l'économie c'est une nouvelle progression de la paupérisation absolue qui va atteindre dans les grandes métropoles du capital des niveaux qui, depuis plus de trois décennies, étaient réservés aux pays arriérés. Ainsi les "années de vérité" viennent confirmer un des enseignements importants du marxisme que toutes sortes d'"experts" prétendaient "faux" ou "dépassé " : ce système ne conduit pas seulement à la paupérisation relative de la classe exploitée, c'est bien une paupérisation absolue que subit maintenant de façon grandissante celle-ci, notamment avec le développement du chômage à une échelle massive.
La vérité que ces années révèlent de façon sinistrement éclatante, c'est toute la barbarie dans laquelle le capitalisme décadent enfonce l'ensemble de la société.
LES CONFLITS IMPERIALISTES
6) Cette barbarie du capitalisme décadent se révèle également en filigrane derrière les discours de paix qui occupent en ce moment le devant de la scène. Aussi bien le changement de ton de Reagan laissant de côté ses péroraisons sur "l'empire du mal" au bénéfice d'une main tendue au chef de file du bloc adverse que l'offensive diplomatique "bon enfant" de Gorbatchev, de même que la prochaine rencontre entre ces deux personnages, tout cela ne saurait masquer la poursuite des préparatifs guerriers des deux blocs ni le développement entre eux des tensions impérialistes.
En fait, le seul examen des efforts considérables faits par chacun des deux blocs en faveur des armements démontre la vanité des discours sur la "détente". Ainsi, durant la seule année 1984, les Etats industriels ont dépensé pour 1 000 milliards de dollars d'armements, soit plus que toute la dette cumulée des pays du tiers-monde. Les pays du bloc occidental sont en train de rejoindre ceux du bloc de l'Est dans la soumission complète de l'appareil productif au service de l'effort d'armement :
- dès à présent, ce sont deux tiers des laboratoires de recherche américains qui travaillent directement pour l'armée ;
- dans tous les secteurs de pointe (aéronautique, électronique, télécommunications, robotique, matériels et logiciels informatiques, etc.) les efforts de recherche et d'innovation sont directement déterminés par les besoins militaires lesquels canalisent les meilleures compétences scientifiques et techniques. C'est bien cela qu'illustre de façon éclatante le projet américain de "guerre des étoiles" et son pendant ouest-européen "Eurêka".
A l'échelle mondiale, alors que l'humanité s'enfonce dans une pauvreté et une misère de plus en plus intenables, que se développent les famines et les catastrophes "naturelles" aux effets meurtriers parfaitement évitables, ce sont plus de 10 % de la production qui sont non seulement stérilisés pour les armements mais qui participent indirectement ou directement par les destructions que ces derniers provoquent, à l'aggravation et à la multiplication de toutes ces calamités (comme par exemple en Ethiopie et au Mozambique où les terribles famines qui y sévissent résultent bien moins des conditions climatiques que de la guerre qui dévaste en permanence leur territoire).
La croissance des armements des deux blocs n'est pas seule à révéler la dimension et l'intensité présentes des tensions impérialistes. Cette intensité est à la mesure des enjeux considérables qui sont en cause dans toute la chaîne des conflits locaux qui déchirent la planète. Cette dimension est donnée par l'ampleur et les objectifs de l'offensive présente du bloc US.
7) Cette offensive a pour objectif de parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Cette offensive a pour priorité une expulsion définitive de l'URSS du Moyen-Orient, une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce importante de son dispositif stratégique. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise en fin de compte à étrangler complètement l'URSS, à lui retirer son statut de puissance mondiale.
La phase présente de cette offensive qui débute au lendemain de l'invasion de l'Afghanistan par les armées de l'URSS (qui constitue une avancée importante de celle-ci en direction des "mers chaudes") a d'ores et déjà atteint des objectifs importants :
- la prise de contrôle complète du Proche-Orient où la Syrie, précédemment liée au bloc russe et grande perdante avec l'OLP de l'invasion du Liban par Israël en 1982, est devenue une des pièces du dispositif américain se partageant avec Israël le rôle de "gendarme" de cette région et où la résistance des fractions bourgeoises récalcitrantes (OLP) est progressivement brisée ;
- l'alignement de l'Inde suite à l'assassinat d'Indira Gandhi en 1984 ;
- l'épuisement progressif de l'Iran (qui est la condition de son retour complet dans le giron américain) suite à la terrible guerre menée avec l'Irak qui bénéficie du soutien du bloc US par la France interposée ;
- une plus grande intégration de la Chine dans sa stratégie envers l'URSS et l'Indochine.
Une des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire, notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux (France, Grande-Bretagne, Italie) sur le terrain des affrontements (comme ce fut en particulier le cas au Liban pour "convaincre" la Syrie de la "nécessité" de s'aligner sur le bloc US et au Tchad, afin de mettre un terme aux velléités d'indépendance de la Libye), ce qui correspond au fait que la carte économique employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire ne suffit plus :
- du fait des ambitions présentes du bloc US;
- du fait de l'aggravation de la crise mondiale elle-même qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays du tiers-monde sur lesquels s'appuyait auparavant ce bloc.
L'offensive présente du bloc US n'est pas en contradiction avec le fait que, dans la période de décadence du capitalisme, ce soit le bloc le moins bien loti dans le partage du monde qui, en dernier ressort, entraîne l'ensemble de la société dans la guerre généralisée (puissances "centrales" en 1914, de l'"Axe" en 1939). Certes, la situation présente se différencie de celle qui a précédé la seconde guerre mondiale par le fait que c'est maintenant le bloc le mieux loti qui est à l'offensive :
- parce qu'il dispose d'une énorme supériorité militaire et notamment d'une très grande avance technologique ;
- dans la mesure où, en se prolongeant beaucoup plus longtemps que lors des années 30, sans qu'elle puisse déboucher sur un conflit généralisé, la crise prolonge et provoque un déploiement beaucoup plus vaste des préparatifs à un tel conflit, préparatifs pour lesquels, évidemment, le bloc économiquement le plus puissant est le mieux armé.
Cependant, pour l'URSS, les enjeux sont considérables; c'est, pour ce pays, une question de vie ou de mort qui est au bout de l'offensive du bloc US comme l'a démontré son acharnement à conserver jusqu'au dernier moment, avec la Syrie, une position au Moyen-Orient. Et si, finalement, cette offensive atteint ses objectifs ultimes (ce qui suppose qu'elle ne soit pas entravée par la lutte de classe), il ne restera à l'URSS pas d'autre alternative que de jouer la carte désespérée d'une percée vers les métropoles européennes -enjeu réel de tout conflit inter impérialiste-, en d'autres termes de faire appel aux terribles moyens de la guerre généralisée.
8) L'aggravation présente des tensions impérialistes, la menace qu'elles font peser sur la vie même de l'humanité sont la traduction directe de l'impasse dans laquelle se trouve l'économie capitaliste, de la faillite historique totale du système.
Dans les "années de vérité" se révèle donc dans une hideuse clarté, le fait qu'avec l'aggravation des convulsions de l'infrastructure économique de la société la guerre économique débouche nécessairement sur la guerre des armes, que les moyens économiques cèdent le pas aux moyens militaires. Si, autrefois, la force militaire venait appuyer et garantir les positions économiques acquises ou à acquérir, aujourd'hui l'économie sert de plus en plus d'auxiliaire aux besoins de la stratégie militaire. Toute l'activité économique a pour base le soutien à la force militaire. L'économie mondiale s'enfonce dans le gouffre béant de la production d'armements. Le militarisme qui, contrairement à l'affirmation de Rosa Luxemburg, n'a jamais constitué un véritable champ d'accumulation, est devenu par contre le terrain où se réalise l'effondrement de la production capitaliste et du capitalisme, dans son ensemble, comme système historique.
Il ne s'agit là nullement d'un abandon du marxisme lequel considère qu'en dernière instance c'est la base économique qui détermine toute la vie de la société. En effet, l'entrée du capitalisme dans la période de décadence est déterminée par des causes économiques et l'histoire de la décadence suit l'enfoncement de plus en plus complet de l'économie capitaliste dans l'impasse. De même, il est clair que c'est l'aggravation actuelle de la crise qui provoque une accentuation de la pression vers la guerre généralisée, pression qui est une donnée permanente de la vie de la société depuis le début de la décadence.
Mais ce qu'il importe de souligner c'est que, dans la décadence du capitalisme, la guerre -même si elle est déterminée par la situation économique- a perdu toute rationalité économique, contrairement au siècle dernier où elle était, malgré le coût et les massacres qu'elle occasionnait, un moyen de la marche en avant du développement des forces productives du capitalisme, ce qui en quelque sorte la "rentabilisait" pour l'ensemble de ce système.
Ce qui s'est révélé déjà dans les deux premières guerres mondiales : le caractère uniquement destructeur de la guerre dans la période de décadence, le fait que même les pays vainqueurs (à l'exception des USA dont le territoire se situait hors du champ de bataille) sortaient considérablement affaiblis du conflit, trouve aujourd'hui son plein épanouissement avec le fait patent qu'une troisième guerre mondiale n'apporterait aucun avantage économique ni au capitalisme dans son ensemble ni même à une quelconque de ses fractions nationales. Et si ce fait évident n'empêche cependant pas la bourgeoisie de la préparer, cela traduit bien cette réalité que dans la période de décadence le processus qui conduit à la guerre est un mécanisme qui échappe complètement au contrôle de la bourgeoisie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le plein développement d'une tendance qui existe depuis le début du siècle et non un phénomène "nouveau". Cependant, en atteignant son point extrême, cette tendance introduit une donnée nouvelle : la menace d'une destruction totale de l'humanité que seule la lutte du prolétariat peut empêcher. Jamais dans l'histoire n'aura été posée avec autant de terrible clarté l'alternative "socialisme ou barbarie". Jamais le prolétariat n'aura eu une si formidable responsabilité que celle qui est la sienne dans la période présente.
LA LUTTE DE CLASSE
9) La clé de toute la situation historique est entre les mains de la classe ouvrière. C'est justement ce que la bourgeoisie essaie de lui cacher en s'employant à la convaincre qu'elle est impuissante, que ses grands combats contre le capitalisme appartiennent à un passé définitivement révolu. C'est ce que ne voient pas non plus beaucoup de groupes révolutionnaires qui sont incapables de comprendre la nature du cours historique actuel et qui aujourd'hui se lamentent sur la "faiblesse des luttes ouvrières", montrant par là qu'ils sont eux-mêmes victimes des campagnes de la bourgeoisie.
En effet, le constat de l'aggravation des tensions impérialistes, de même que celui d'un certain nombre de défaites comme celles de 1981 en Pologne ne saurait conduire à la conclusion que la bourgeoisie a les mains libres pour donner sa seule réponse propre à la crise de son système : la guerre impérialiste généralisée. L'analyse du cours historique telle que l'a développée le CCI prend en effet en compte les éléments suivants :
a) par définition, un cours historique est donné pour toute une période historique. Il n'est pas conditionné par des événements conjoncturels ou de faible portée. Seuls des événements majeurs dans la vie de la société sont en mesure de le remettre en cause : la longue dégénérescence opportuniste de la 2ème Internationale, le complet déboussolement du prolétariat qu'elle traduisait et qu'elle a aggravé, étaient la condition de l'ouverture du cours vers la 1ère guerre mondiale ; trois années de guerre impérialiste généralisée, provoquant des massacres et des souffrances d'une ampleur inconnue auparavant, furent le prix à payer pour un nouveau renversement du cours en faveur du prolétariat ;. la longue série de défaites du prolétariat depuis l'Allemagne en 1919 jusqu'à la Chine en 1927, défaites aggravées par la dégénérescence de la révolution en Russie et de l'Internationale communiste ainsi que par le rétablissement momentané de l'économie capitaliste entre 1923 et 1929, furent nécessaires à la bourgeoisie pour se libérer de l'entrave prolétarienne à sa propre logique ; l'apparition de nouvelles générations ouvrières n'ayant connu ni la défaite, ni la guerre mondiale, l'épuisement tant du mythe de l'URSS -patrie du socialisme"- que de la mystification anti-fasciste, l'entrée du capitalisme dans une nouvelle crise ouverte de son économie, ont été les conditions nécessaires au rétablissement d'un cours aux affrontements de classe.
b) Le cours historique actuel ne saurait être remis en causes par des défaites partielles ou frappant, même durement, le prolétariat dans des pays secondaires ou périphériques comme la Pologne en 1981. Seule une succession de défaites à la suite de combats décisifs menés par le prolétariat dans les pays centraux, et notamment ceux d'Europe occidentale, serait en mesure d'ouvrir les portes à un cours vers la guerre.
c) L'existence d'un cours aux affrontements de classe n'implique nullement la disparition ni des antagonismes impérialistes ni des conflits entre blocs ni de l'aggravation de ces conflits ni des préparatifs militaires en vue d'une troisième guerre mondiale. En particulier, dans la période présente, seules des luttes d'une ampleur exceptionnelle, comme celles de Pologne en 80, peuvent avoir un impact immédiat sur les tensions entre l'Est et l'Ouest. A l'intérieur du cadre qui lui est tracé par le cours historique, la bourgeoisie continue à disposer d'une certaine marge de manoeuvre. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est donc pas la capacité de telle ou telle poussée des luttes à faire reculer les productions d'armements ou de faire taire tel ou tel conflit entre les blocs, c'est le fait que les réserves de combativité que ces luttes expriment interdisent que ces conflits impérialistes ne se développent jusqu'à leur aboutissement extrême : la conflagration mondiale.
d) L'existence d'un cours historique aux affrontements de classe ne signifie nullement que le prolétariat développe ses luttes de façon continue, que les combats de classe atteignent mois après mois ou année après année une ampleur et une profondeur toujours croissantes. Une telle vision serait totalement en désaccord avec toute l'expérience historique du prolétariat, elle serait en contradiction avec ce que Marx signalait déjà dans son texte sur "le 18 Brumaire" et que Rosa Luxemburg, avec beaucoup d'autres grands révolutionnaires, a analysé par la suite : le mouvement d'avancées et de reculs de la lutte de la classe dans sa progression vers les affrontements décisifs contre le capitalisme. Elle contredirait également le fait qu'avec la période de décadence, loin de disparaître, un tel phénomène ne fait que s'amplifier, ce qui conduit à l'existence au sein d'un cours aux affrontements de classe (lui-même traduction à une grande échelle de ce phénomène) d'une succession . de vagues de luttes, d'assauts répétés contre la forteresse capitaliste, entrecoupés par des moments de défaite partielle, de désarroi, de démoralisation.
10) La thèse de la "passivité" de la classe ouvrière, que la propagande bourgeoise a réussi à faire avaler à certains révolutionnaires, si elle pouvait avoir une apparence de réalité à certains moments du passé comme lors de la défaite du prolétariat en Pologne en 1981, est aujourd'hui totalement contredite par les faits. Elle est en particulier démentie par le formidable développement des luttes ouvrières à partir de la deuxième moitié de 1983 dont le CCI, dès janvier 1984, a analysé les conditions de surgissement et les caractéristiques : "La vague présente de lutte s'annonce d'ores et déjà comme devant dépasser en ampleur et en importance les deux vagues qui l'ont précédée depuis la reprise historique de la fin des années 60 : celle de 1968-74, et celle de 1978-80 [...] Elle tire sa source de 1'épuisement de ce qui avait permis le recul de 1'après-Pologne :
- reste des illusions propres aux années 70 qui ont été définitivement balayées par la très forte récession de 1980-82 ;
- désarroi momentané provoqué tant par le passage de la gauche dans l'opposition que par la défaite en Pologne.
Elle démarre :
- à partir d'une longue période d'austérité et de montée du chômage, d'une intensification des attaques économiques contre la classe ouvrière dans les pays centraux ;
- à la suite de plusieurs années d'utilisation de la carte de la gauche dans 1'opposition et de l'ensemble des mystifications qui y sont associées.
Pour ces raisons, elle va se poursuivre par des engagements de plus en plus puissants et déterminés du prolétariat des métropoles contre le capitalisme dont le point culminant se situera de ce fait à un niveau supérieur a celui de chacune des vagues précédentes.
Les caractéristiques de la vague présente, telles qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :
- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de 1'extension géographique des luttes ;
- tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats ;
- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes ;
- développement progressif au sein de 1 'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes ;
- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de 1'aptitude à leur auto organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications". (Revue Internationale N° 37, pp. 4-5).
11) Aujourd'hui, cette analyse reste tout à fait valable. Elle a été confirmée par l'étendue et la simultanéité sans précédent de cette 3ème vague de luttes. Cette simultanéité a été la plus marquée en Europe occidentale, épicentre de la révolution prolétarienne. Elle s'accompagne de luttes massives qui se sont développées dans le tiers-monde. En conséquence, cette analyse n'est pas contradictoire avec le constat du faible nombre de jours de grève dans un certain nombre de pays (telles la France et l'Italie) au cours de l'année écoulée, constat sur lequel s'appuient les médias bourgeois pour asséner de façon répétée l'idée d'une "passivité" de la classe ouvrière, d'une acceptation résignée de son sort. En particulier, rien n'autorise à dire que la 3ème vague de luttes serait d'ores et déjà épuisée, que nous serions entrés dans une situation semblable à celle de l'après-Pologne. En effet :
- on ne peut juger de façon immédiate, sur la base de faits qui ne couvrent qu'une courte durée dans un pays donné, de la situation d'ensemble à l'échelle internationale d'autant plus que la vague actuelle se distingue, comme nous l'avons mis en évidence, par le rythme lent de son développement : lorsque des révolutionnaires emploient une telle méthode à courte vue, comme c'est le cas aujourd'hui pour certains d'entre eux, ils ne l'empruntent pas au marxisme mais à l'idéologie bourgeoise et ne font que refléter passivement les hésitations qui traversent la classe dans son ensemble ;
- le surgissement de mouvements de grande ampleur, tels que les grèves de septembre 1983 en Belgique, les luttes des mineurs et des dockers en Grande-Bretagne, ou la grève générale au Danemark au printemps 1983, s'ils expriment une tendance de la 3ème vague de luttes, n'en sont pas pour autant une donnée permanente. Dans les expressions de combativité ouvrière -même plus limitées- qui continuent de se manifester à l'échelle internationale et où la classe ouvrière fait l'expérience concrète des obstacles à l'extension de sa lutte, mûrissent les conditions de nouveaux affrontements d'ensemble ;
- le prolétariat s'est engagé depuis deux ans dans un combat de longue haleine. Un tel combat passe également inévitablement par des moments de répit, de maturation, de réflexion. Mais, contrairement à la situation de l'après-Pologne où un court mais réel recul s'est ouvert sur une défaite internationale de la classe et a pris la forme d'une chape de plomb de deux années pesant sur l'ensemble des pays centraux d'Europe occidentale, les actuels moments de répit (reflétés par la diminution du nombre de jours de grève dans tel ou tel pays) que peut s'accorder aujourd'hui la classe restent limités dans le temps comme dans l'espace, et bien que la bourgeoisie fasse tout pour transformer cet effort de réflexion qui s'opère dans la classe en expectative et en passivité, la situation reste caractérisée par une accumulation de mécontentement et de combativité potentielle prête à exploser d'un moment à l'autre, comme l'ont montré les récents événements en France (Dunkerque, SNCF, etc.) ;
- le fait que dans des pays où la classe ouvrière est traditionnellement combative, comme la France et surtout l'Italie, les grèves se soient situées ces derniers temps à un niveau numérique particulièrement bas ne saurait enlever toute la signification qu'apporte à l'ensemble du mouvement de la classe la très forte combativité qui s'est manifestée au même moment dans les pays habitués à la "paix sociale" comme notamment les pays Scandinaves;
- en tout état de cause, les statistiques sur les jours de grève, si elles sont un élément que les révolutionnaires doivent savoir étudier et prendre en considération, ne sauraient traduire à elles seules le degré exact de mécontentement, de combativité et de conscience qui existe au sein de la classe ; en particulier il existe aujourd'hui un indice beaucoup plus significatif de l'état d'esprit qui règne dans le prolétariat et de ses potentialités de combat : c'est la méfiance de plus en plus massive qui se développe partout à l'égard des syndicats et qui se traduit notamment par un chute accélérée de leurs effectifs.
12) Si le phénomène présent de désyndicalisation revêt une telle importance, c'est du fait du rôle spécifique que joue à l'heure actuelle le syndicalisme en tant que fer de lance de la carte bourgeoise de la gauche dans l'opposition. En effet, si les partis politiques de gauche sont tout naturellement désignés pour détenir le rôle moteur dans la stratégie de la gauche au pouvoir ou candidate au pouvoir (comme au milieu des années 70), la stratégie de la gauche dans l'opposition qui se caractérise par un langage et une pratique sensés traduire de façon directe les préoccupations et les revendications ouvrières, s'appuie principalement sur les institutions bourgeoises les plus proches de la vie quotidienne des ouvriers et présentes sur les lieux de travail : les syndicats.
Face aux deux nécessités vitales de la lutte ouvrière: l'extension et l'auto organisation, c'est en effet aux syndicats qu'il revient :
- de désorienter les ouvriers, de développer chez eux un sentiment d'impuissance par de multiples divisions entre centrales différentes ou entre "base" et "sommet" ;
- d'enfermer et d'isoler les luttes sur le terrain corporatiste, sectoriel et localiste ;
- de promouvoir, face au danger d'extension réelle, de fausses extensions tendant à noyer les secteurs les plus combatifs -comme ce fut le cas en Belgique en septembre 1983- ou bien tendant à faire de l'extension l'affaire d'une branche industrielle (grève des mineurs en Grande-Bretagne) ou même des différentes usines d'une même entreprise (Renault en France, en octobre 1985) ;
- de prévenir tout surgissement spontané de luttes, toute tendance à l'auto organisation en prenant les devants par des appels à "l'action" démobilisateurs et en s'installant à la tête des mouvements dès leur surgissement.
Cette tactique de la bourgeoisie visant à occuper le terrain, et qui constitue la composante essentielle de sa stratégie de gauche dans l'opposition, a été large ment employée en 1985. Elle constitue à l'heure actuelle une véritable offensive politique de la bourgeoisie contre le prolétariat.
Ce dernier ne peut éviter cette bataille politique qui lui est imposée. Il ne peut, ni ne doit, laisser les partis de gauche et les syndicats manoeuvrer librement sur le terrain de la défense de ses conditions de vie, mais s'opposer et s'affronter résolument et systématiquement sur ce terrain à leurs manoeuvres.
C'est au premier rang de ce combat politique que le prolétariat doit assumer que les révolutionnaires doivent s'imposer sur le terrain, par la mise en avant des nécessités d'extension et d'auto organisation et par la dénonciation des manoeuvres et obstacles des syndicats.
C'est par les confrontations répétées du prolétariat à toutes ces manoeuvres, notamment dans les métropoles du capitalisme d'Europe occidentale où ses secteurs les plus concentrés, anciens et développés politiquement font face à la bourgeoisie la plus expérimentée, celle qui est en mesure d'élaborer les pièges les plus sophistiqués, ce n'est qu'à travers ces confrontations dès à présent engagées qu'il forge ses armes, qu'il se rend et se rendra de plus en plus capable de développer l'arme de la grève de masse, d'étendre et de généraliser ses combats à l'échelle internationale et d'engager les affrontements décisifs contre le capitalisme, ceux de la période révolutionnaire.
13) C'est pour cet ensemble de raisons que le développement actuel de la méfiance à l'égard des syndicats constitue une donnée essentielle du rapport de forces entre les classes et donc de toute la situation historique. Cependant, cette méfiance elle-même est en partie responsable, de façon immédiate", de la réduction du nombre de luttes dans différents pays et plus particulièrement là où justement le discrédit des syndicats est le plus fort (comme en France, suite à l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir en 1981). Lorsque pendant des décennies les ouvriers ont eu l'illusion qu'ils ne pouvaient mener des combats que dans le cadre des syndicats et avec l'appui de ceux-ci, la perte de confiance en ces organes s'accompagne de façon momentanée d'une perte de confiance en leur propre force et les conduit à opposer la passivité à tous les soi-disant "appels à la lutte" qui en émanent. C'est justement là-dessus que tendent de plus en plus à jouer les syndicats : incapables d'enrôler plus longtemps les ouvriers derrière leurs banderoles et leurs slogans, ils utilisent habilement la passivité et le scepticisme que rencontrent leurs appels pour tenter de transformer cette passivité en démoralisation, pour participer à leur façon, tout en s'en défendant évidemment, aux campagnes sur la "disparition des luttes de classe" qui visent à saper la confiance en soi du prolétariat. En ce sens, la passivité qu'observent encore à l'égard des "actions" appelées par les syndicats (grèves et manifestations) beaucoup d'ouvriers parmi les plus combatifs, si elle est parfaitement explicable et traduit la nécessaire perte d'illusions à l'égard du syndicalisme, ne doit pas être considérée en elle-même comme un élément positif puisqu'elle correspond exactement à ce qu'attend la bourgeoisie de ces ouvriers en cette circonstance. Le seul moyen pour eux de déjouer ce type de pièges consiste -et les révolutionnaires doivent les encourager dans ce sens- non pas à se détourner de ce type d'actions mais au contraire de mettre à profit toutes les occasions de rassemblement des ouvriers sur des questions touchant à la défense de leurs intérêts de classe et même si elles proviennent de manoeuvres syndicales, pour y participer activement et le plus massivement possible afin de transformer ces rassemblements en des lieux où s'expriment l'unité de la classe au-delà des divisions sectorielles, sa combativité et sa détermination comme ce fut le cas par exemple le 1er mai 1983 à Hambourg. De même qu'il n'existe aucun principe pour les révolutionnaires de refuser d'appeler à des mouvements "lancés" par les syndicats, l'appel à la présence dans ce type de mouvements ne saurait être une recette applicable en toutes circonstances, mais doit être évalué en fonction des potentialités immédiates de transformation de ces actions, sachant que les conditions de ces transformations seront de plus en plus souvent réunies.
Du fait de l'énorme mécontentement qui se développe dans la classe et qui ne pourra que s'accroître avec le nouveau déferlement des attaques capitalistes qui accompagneront nécessairement la récession qui s'annonce, du fait du potentiel considérable de combativité qui s'accumule en profondeur et dont on a pu deviner la force encore dernièrement avec la grève des chemins de fer en France, du fait que l'extension des luttes est ressentie comme un besoin impérieux par des masses croissantes d'ouvriers, toute manifestation de réelle combativité ouvrière, toute tentative décidée d'extension des luttes est et sera de plus en plus grosse de surgissements de classe de très grande ampleur. Et c'est principalement dans le combat pour l'extension, face aux obstacles que les syndicats opposent et opposeront à de tels mouvements que s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto organisation de leur combat.
14) La question de l'extension des luttes, du dépassement des barrières sectorielles et professionnelles, est donc au centre de toute la perspective des combats de la classe dans la période présente. Et c'est par la généralisation à tous les secteurs ouvriers de l'attaque capitaliste que se développent les conditions d'une réponse à cette question. Or l'accroissement présent dans des proportions inconnues depuis un demi-siècle du nombre des chômeurs, et qui est le résultat le plus marquant de cette attaque généralisée, constitue un facteur puissant de maturation de ces conditions dans la mesure où :
- c'est toute la classe ouvrière, et non seulement les ouvriers chômeurs, qui est touchée par le chômage, notamment par la baisse du niveau de vie que représente pour nombre de familles ouvrières le fait de compter en leur sein un ou plusieurs chômeurs ;
- le chômage fait disparaître les barrières catégorielles du fait même de l'éjection des ouvriers des lieux de production, qui a également comme conséquence un moindre encadrement par l'appareil syndical ;
- par la paupérisation absolue qu'il représente, le chômage indique le futur qui attend l'ensemble de la classe ouvrière et, partant, la perspective de ses combats futurs vers le renversement du capitalisme.
En fait, au même titre que le développement vertigineux du militarisme, mais de façon beaucoup plus directement compréhensible pour les ouvriers, l'accroissement irrémédiable du chômage est l'indice irréfutable de l'aberration que constitue aujourd'hui le capitalisme lequel plonge des masses croissantes d'ouvriers dans la misère totale non pas parce qu'il produit trop peu mais parce qu'il produit trop. Plus généralement, l'éjection hors du travail salarié de masses toujours croissantes d'ouvriers signe la faillite totale d'un mode de production dont le rôle historique était justement d'étendre le salariat.
Pour l'ensemble de ces raisons, le chômage constituera de plus en plus un facteur essentiel de prise de conscience pour l'ensemble de la classe des véritables enjeux des combats qu'elle mène, du fait qu'il lui échoit la tâche historique d'abolir un système qui conduit la société à de telles aberrations.
En ce sens, le chômage va jouer, plus lentement mais de manière infiniment plus profonde et positive, le rôle de la guerre dans l'émergence de la révolution en Russie et en Allemagne en 1917-18.
De même, les ouvriers au chômage tendront de plus en plus à se retrouver aux avant-postes des combats de classe jouant ainsi un rôle comparable à celui des soldats dans la révolution russe de 1917.
Contrairement donc à ce que prétendent la bourgeoisie et certains révolutionnaires particulièrement myopes, et même s'il peut dans un premier temps créer un certain désarroi dans la classe, le chômage n'est nullement un facteur d'atténuation des luttes ouvrières. Il deviendra au contraire un élément essentiel de leur développement jusqu'à la période révolutionnaire.
15) C'est l'affrontement révolutionnaire avec le capitalisme qui constitue la perspective ultime des luttes que mène dès aujourd'hui la classe ouvrière. Par ailleurs, la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de grande envergure.
La faillite totale du capitalisme que révèlent les années de vérité, de même qu'elle conduit à une accélération de l'histoire sur le plan des conflits impérialistes, provoque également une telle accélération sur le plan du développement de la lutte de classe, ce qui se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précédent. Et cette accumulation d'expériences de lutte du prolétariat, comme la proximité de plus en plus grande entre chacune d'elles, constitue un élément essentiel de prise de conscience par l'ensemble de la classe des véritables enjeux de son combat. C'est pour cela qu'il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants face aux potentialités de la période présente et en particulier qu'ils ne sous-estiment pas ces potentialités.
Cependant, cela ne veut nullement dire que nous soyons déjà entres dans la phase des combats qui conduisent directement à la période révolutionnaire. Celle-ci se trouve encore loin devant nous. Il en est ainsi à cause du rythme lent avec lequel se réalise l'effondrement irréversible du capitalisme et du fait de la formidable capacité de résistance politique de la bourgeoisie qu'affronte aujourd'hui le prolétariat là où se décide la situation historique mondiale, les grandes métropoles du capitalisme, et plus particulièrement celles d'Europe de l'Ouest.
Mais ce ne sont pas là les seuls éléments. Pour comprendre toutes les données de la période présente et à venir, il faut également prendre en considération les caractéristiques du prolétariat qui aujourd'hui mène le combat :
- il est composé de générations ouvrières qui n'ont pas subi la défaite, comme celles qui sont arrivées à maturité dans les années 30 et au cours de la 2ème guerre mondiale; de ce fait, en l'absence de défaite décisive que la bourgeoisie n'a pas réussi à leur infliger jusqu'à présent, elles conservent intactes leurs réserves de combativité ;
- ces générations bénéficient d'une usure irréversible des grands thèmes de mystification (la patrie, la civilisation, la démocratie, l'anti-fascisme, la défense de l'URSS) qui avaient permis par le passé l'embrigadement du prolétariat dans la guerre impérialiste.
Ce sont ces deux caractéristiques essentielles qui expliquent que le cours historique actuel soit aux affrontements de classe et non à la guerre impérialiste. Cependant, ce qui fait la force du prolétariat actuel fait aussi sa faiblesse : du fait même que seules des générations qui n'avaient pas connu la défaite étaient aptes à retrouver le chemin des combats de classe, il existe entre ces générations et celles qui ont mené les derniers combats décisifs, dans les années 20, un fossé énorme que le prolétariat d'aujourd'hui paie au prix fort :
- d'une ignorance considérable de son propre passé et de ses enseignements ;
- du retard dans la formation du parti révolutionnaire.
Ces caractéristiques expliquent en particulier le caractère éminemment heurté du cours actuel des luttes ouvrières. Elles permettent de comprendre les moments de manque de confiance en soi d'un prolétariat qui n'a pas conscience de la force qu'il peut constituer face à la bourgeoisie. Elles montrent également la longueur du chemin qui attend le prolétariat, lequel ne pourra faire la révolution que s'il a consciemment intégré les expériences du passé et s'est donné son parti de classe.
Avec le surgissement historique du prolétariat à la fin des années 1960 a été mise à l'ordre du jour la formation de celui-ci mais sans que cela puisse se réaliser du fait :
- du "creux d'un demi-siècle qui nous sépare des anciens partis révolutionnaires ;
- de la disparition ou de l'atrophie plus ou moins marquée des fractions de gauche qui s'en étaient dégagées ;
- de la méfiance de beaucoup d'ouvriers à l'égard de toute organisation politique (qu'elle soit bourgeoise ou prolétarienne) qui est une expression du danger de conseillisme, tel qu'il a été identifié par le CCI, une traduction d'une faiblesse historique du prolétariat face à la nécessaire politisation de son combat.
Il appartient aux groupes révolutionnaires qui existent aujourd'hui de préparer activement les conditions de cette formation, non pas en s'autoproclamant le Parti, ou en ne présentant d'autre perspective aux masses ouvrières que de se rallier à leur drapeau comme aiment à le faire les bordiguistes, mais en développant un travail systématique de regroupement des forces révolutionnaires et d'intervention dans la classe. C'est notamment à travers cette intervention, si elle est capable de mettre en avant des propositions de marche correspondant aux besoins de la classe, que les révolutionnaires feront la preuve concrète auprès des ouvriers de la nécessité d'une organisation révolutionnaire jetant ainsi les bases du futur parti de la révolution communiste.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Conscience et organisation:
Résolution : l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence
- 3111 reads
1. Il existe une différence fondamentale entre l'évolution des partis de la bourgeoisie et l'évolution des partis de la classe ouvrière.
Les premiers, du fait qu'ils sont les organes politiques d'une classe dominante, ont la possibilité d'agir dans la classe ouvrière et certains d'entre eux le font effectivement car ceci fait partie d'une division du travail au sein des forces politiques de la bourgeoisie dont une partie a la tâche particulière de mystifier le prolétariat, de mieux le contrôler en le faisant de l'intérieur, et de le détourner de sa lutte de classe. À cette fin, la bourgeoisie utilise de préférence d'anciennes organisations de la classe ouvrières passées dans le camp de la bourgeoisie.
Par contre, la situation inverse d'une organisation prolétarienne agissant dans le camp de la bourgeoisie ne peut jamais exister. Il en est ainsi du prolétariat, comme de toute classe opprimée, parce que la place que lui fait occuper dans l'histoire le fait d'être une classe exploitée ne peut jamais faire de lui une classe exploiteuse.
Cette réalité peut donc être résumée dans l'affirmation lapidaire suivante :
- il peut, il doit exister et il existe toujours des organisations politiques bourgeoises agissant dans le prolétariat ;
- il ne peut jamais exister, par contre, comme le démontre toute l'expérience historique, des partis politiques prolétariens agissant dans le camp de la bourgeoisie.
2. Ceci n'est pas seulement vrai pour ce qui concerne des partis politiques structurés. C'est également vrai pour ce qui concerne des courants politiques divergents pouvant naître éventuellement au sein de ces partis. Si des membres des partis politiques existants peuvent passer d'un camp dans l'autre et cela dans les deux sens (du prolétariat à la bourgeoisie et de la bourgeoisie au prolétariat) , cela ne peut être qu'un fait individuel. Par contre, le passage collectif d'un organisme politique déjà structuré ou en formation dans les partis existants ne peut obligatoirement se produire que dans un sens unique : des partis du prolétariat à la bourgeoisie et jamais dans le sens contraire : des partis bourgeois au prolétariat. C'est-à-dire qu'en aucun cas un ensemble d'éléments en provenance d'une organisation bourgeoise ne peut évoluer vers des positions de classe sans une rupture consciente avec toute idée de continuité avec son éventuelle activité collective précédente dans le camp contre-révolutionnaire. Autrement dit, s'il peut se former et se développer des tendances, dans les organisations du prolétariat, évoluant vers des positions politiques de la bourgeoisie et véhiculant cette idéologie au sein de la classe ouvrière, ceci est absolument exclu concernant les organisations de la bourgeoisie.
3. L'explication du constat qui précède réside dans le fait essentiel que la classe économiquement dominante dans la société est également dominante sur les plans politique et idéologique. Ce fait explique également :
- l'influence qu'exerce l'idéologie de la bourgeoisie sur 1'immense majorité de la classe ouvrière, idéologie dont celle-ci ne peut se dégager que très partiellement jusqu'au moment de la révolution ;
- les vicissitudes et les difficultés du procès de prise de conscience par l'ensemble de la classe de ses intérêts et surtout de son être historique, lesquelles déterminent un mouvement constant de victoires partielles et de défaites dans ses luttes, se traduisant par des avancées et des reculs dans l'extension de sa prise de conscience ;
- le fait obligatoire et inéluctable que ce soit seulement une petite minorité de la classe qui puisse parvenir à se dégager suffisamment (mais non totalement) de la chape de plomb de l'idéologie bourgeoise dominante pour entreprendre un travail théorique systématique et cohérent ainsi que d'élaboration des fondements politiques fécondant ainsi le processus de prise de conscience et le développement de la lutte immédiate et historique de la classe ;
- la fonction indispensable et irremplaçable dont la classe charge les minorités qu'elle secrète, fonction qui ne peut être accomplie par des individus ou de petits cénacles intellectuels, mais uniquement par des éléments qui se hissent à la compréhension des tâches pour lesquelles la classe, dans le développement de sa lutte, les a produits: ce n'est qu'en se structurant, en donnant naissance à une organisation politique centralisée et militante au sein des luttes ouvrières, que cette minorité, produit de la classe, peut assumer sa fonction d'être un facteur actif, un creuset dans lequel et avec lequel la classe forge les armes indispensables de sa victoire finale ;
- la raison pour laquelle des courants opportunistes et centristes peuvent se manifester au sein de la classe exploitée et révolutionnaire ainsi que dans les organisations de cette classe, et uniquement dans cette classe et ses organisations. En ce sens, parler d'opportunisme et de centrisme (par rapport au prolétariat) dans la bourgeoisie n'a aucun sens car jamais une classe dominante ne renonce, de par sa propre volonté, à ses privilèges en faveur de la classe qu'elle exploite (ce qui fait d'elle justement une classe dominante).
4. Deux sources sont à la base de l'apparition des tendances opportunistes et centristes dans la classe ouvrière : la pression et l'influence de l'idéologie de la bourgeoisie et le difficile procès de la maturation et de la prise de conscience par le prolétariat. Ce qui se traduit notamment par la caractéristique majeure de l'opportunisme qui consiste à isoler, séparer le but final du mouvement prolétarien des moyens qui y conduisent pour finalement les opposer, alors que toute remise en cause des moyens amène à la négation du but final, de même que toute remise en cause de ce but tend à ôter leur signification prolétarienne aux moyens mis en œuvre. Dans la mesure même où il s'agit là de données permanentes dans l'affrontement historique entre prolétariat et bourgeoisie, il apparaît donc que l'opportunisme et le centrisme sont bien des dangers qui menacent la classe de façon permanente, tant dans la période de décadence que dans la période ascendante. Cependant, de la même façon que ces deux sources sont liées entre elles, elles sont également en liaison quant à la façon dont elles affectent le mouvement de la classe, avec l'évolution générale du capitalisme et le développement de ses contradictions internes. De ce fait, les phénomènes historiques de l'opportunisme et du centrisme s'expriment de façon différente, avec des caractères de gravité plus ou moins grands suivant les moments de cette évolution et de ce développement.
5. Si l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence posant directement la question de la nécessité de la révolution est une condition favorable facilitant le procès de maturation de la conscience dans la classe ouvrière, cette maturation n'est pas pour autant une donnée automatique, mécanique, fatale.
La période de décadence du capitalisme voit d'une part la bourgeoisie concentrer à outrance son pouvoir de répression ainsi que s'employer à perfectionner au maximum les moyens de pénétration de son idéologie dans la classe et, d'autre part, s'accroître de façon considérable l'importance et l'urgence de la prise de conscience par la classe dans la mesure où l'enjeu historique de "socialisme ou barbarie se pose de façon immédiate et dans toute sa gravité : l'histoire ne laisse pas au prolétariat un temps illimité. La période de la décadence se posant en termes de guerre impérialiste ou révolution prolétarienne, de socialisme ou barbarie, non seulement ne fait pas disparaître l'opportunisme et le centrisme mais rend donc plus âpre, plus acharnée, la lutte des courants révolutionnaires contre ces tendances, en proportion directe de l'enjeu même de la situation.
6. Comme l'histoire l'a démontré, le courant opportuniste ouvert, du fait qu'il se situe sur des positions extrêmes et tranchées, aboutit, dans les moments décisifs, à effectuer un passage définitif et sans retour dans le camp de la bourgeoisie. Quant au courant qui se définit corme se situant entre la gauche révolutionnaire et la droite opportuniste -courant le plus hétérogène, en constante mouvance entre les deux et recherche de leur réconciliation au non d'une unité organisationnelle impossible- il évolue pour sa part selon les circonstances et les vicissitudes de la lutte du prolétariat.
Au moment de la trahison ouverte du courant opportuniste, en même temps que s'effectue une reprise et une montée de la lutte de la classe, le centrisme peut constituer au début une position passagère des masses ouvrières vers les positions révolutionnaires. Le centrisme, en tant que courant structuré, organisé sous forme de parti, est appelé, dans ces circonstances favorables, à exploser et à passer dans sa majorité, ou pour une grande partie, dans l'organisation de la gauche révolutionnaire nouvellement constituée, comme cela s'est produit pour le Parti Socialiste français, le Parti Socialiste d'Italie et l'USPD en Allemagne dans les années 1920-21, après la première guerre mondiale et la révolution victorieuse en Russie.
Par contre, dans les circonstances d'une série de grandes défaites du prolétariat ouvrant un cours vers la guerre, le centrisme est immanquablement destiné à être happé dans l'engrenage de la bourgeoisie et à passer dans son camp tout comme le courant opportuniste ouvert.
Avec toute la fermeté qui doit être la sienne, il est important pour le parti révolutionnaire de savoir comprendre les deux sens opposés de l'évolution possible du centrisme dans des circonstances différentes pour pouvoir prendre une attitude politique adéquate à son égard. Ne pas reconnaître cette réalité mène à la même aberration que la proclamation de l'impossibilité de l'existence de l'opportunisme et du centrisme au sein de la classe ouvrière dans la période de décadence du capitalisme.
7. Concernant cette dernière "théorie", toute l'histoire de la IIIème Internationale et des partis communistes est là pour en attester l'inanité, pour démontrer qu'elle n'est pas autre chose qu'une énormité. Non seulement l'opportunisme et le centrisme ont pu apparaître au sein même de l'organisation révolutionnaire mais, se renforçant avec les défaites et le recul du prolétariat, le centrisme est également parvenu à dominer ces partis et, après une lutte sans merci qui a duré de longues années pour battre les oppositions et fractions de la gauche communiste, à expulser celles-ci de tous les partis communistes : ayant vidé ces derniers de toute substance de classe il a fait de chacun d'eux des organes de leurs bourgeoisies nationales respectives.
La "théorie" de l'impossibilité d'existence de courants opportunistes et centristes au sein du prolétariat dans la période de décadence du capitalisme suppose en réalité l'existence d'un prolétariat et de partis révolutionnaires purs, absolument et à jamais immunisés et imperméabilisés contre toute pénétration de l'influence de l'idéologie bourgeoise en leur sein. Une telle "théorie" est non seulement une aberration mais repose sur une vision idéaliste abstraite de la classe et de ses organisations. Elle relève de la "méthode Coué" (se consoler en se répétant que tout va bien) et tourne résolument le dos au marxisme. Loin de renforcer le courant révolutionnaire, elle l'affaiblit en lui voilant ce danger réel qui le menace, en détournant son attention et sa vigilance indispensable contre ce danger.
Le CCI doit combattre de toute son énergie de telles "théories" en général, et dans son sein en particulier, car elles ne font que permettre au centrisme de se camoufler derrière une phraséologie radicale qui, sous couvert de "pureté programmatique", tend à isoler les organisations révolutionnaires du mouvement réel de la lutte de leur classe.
----------------------------
Résolution (rejetée)
LE CENTRISME ET LES ORGANISATIONS POLITIQUES DU PROLETARIAT
1. Il n'y a pas de débat académique possible sur la question du centrisme. Le centrisme est né et s'est développé comme concept dans le mouvement ouvrier face à la nécessité de délimiter les forces politiques en présence dans la lutte de classe, en particulier en vue de la constitution des partis de classe à l'époque actuelle des guerres et des révolutions. Ce n'est pas un hasard si cette question se repose aujourd'hui au CCI dans une période où s'annoncent des affrontements de classe décisifs et, avec eux, la perspective d'un nouveau parti de classe : de la réponse à cette question dépendra la nature du parti de demain, et dépend dès aujourd'hui l'attitude des groupes révolutionnaires dans la préparation de cette perspective. L'expérience pratique de la faillite tragique de la IIIIème Internationale, puis de la débâcle de la prétendue "IVème Internationale" trotskyste, par leur politique de compromission avec des fractions de la bourgeoisie sous le couvert du concept de centrisme, d'une part, le cadre théorique de la nature de la classe ouvrière, de la décadence du capitalisme et du capitalisme d'État comme mode d'existence du capitalisme à l'époque actuelle, d'autre part, fournissent tous les matériaux nécessaires au prolétariat pour passer au crible de la critique le concept de centrisme et ses implications .
2. De par sa condition de classe exploitée dans le capitalisme en même temps que de classe révolutionnaire portant en elle la destruction du capitalisme, le prolétariat est constamment soumis à deux tendances contradictoires :
- son mouvement propre vers la conscience de sa situation et de son devenir historique ;
- la pression de l'idéologie bourgeoise dominante, qui tend à détruire sa conscience.
Ces deux tendances inconciliables déterminent le caractère heurté de la lutte de classe qui voit se succéder avancées ou tentatives révolutionnaires et reculs ou contre-révolution, de même que le surgissement de minorités d'avant-garde organisées en groupes, fractions ou partis, appelés à catalyser le mouvement de la classe vers sa conscience.
Le prolétariat ne peut avoir qu'une seule conscience : une conscience révolutionnaire, mais, parce qu’il naît de la société bourgeoise et ne peut s'en libérer complètement que lorsqu'il disparaît en tant que classe, sa conscience est un processus en développement, jamais achevé dans le capitalisme, qui s'affronte en permanence à l'idéologie bourgeoise imprégnant l'ensemble de la société.
Cette situation détermine la dynamique des organisations politiques du prolétariat : soit elles assument leur fonction de développement de la conscience de classe contre l'idéologie bourgeoise et se situent pratiquement dans le camp prolétarien, soit elles succombent à 1’idéologie bourgeoise et s'intègrent pratiquement dans le camp bourgeois.
3. La délimitation des camps parmi les organisations politiques est elle-même un processus historique en développement, déterminé par les conditions objectives du développement du capitalisme et du prolétariat en son sein. Depuis le début du mouvement ouvrier s'est opéré un processus de décantation qui a progressivement rétréci et délimité les paramètres du terrain politique du prolétariat.
À l'époque de la 1ère Internationale, le développement du capitalisme est encore caractérisé, même au cœur de l'Europe, par l'introduction de la production industrielle à grande échelle et la formation du prolétariat industriel à partir de l'artisanat en déclin et de la paysannerie dépossédée. A ce stade de développement du prolétariat et de sa conscience, les frontières du mouvement ouvrier pouvaient inclure des courants aussi disparates que l'anarchisme bakouniniste et proudhonien, ancré dans le passé petit-bourgeois et paysan, le blanquisme ancré dans l'intelligentsia jacobine, le mazzinisme avec son programme de républicanisme radical, et le marxisme, expression développée du prolétariat révolutionnaire.
À l'époque de la IIème Internationale, la fin de la période des révolutions nationales et de l'enfance du prolétariat industriel ont considérablement rétréci les frontières du mouvement ouvrier, en obligeant le prolétariat à se constituer en parti politique distinct, en opposition à tous les courants bourgeois et petit-bourgeois. Mais la nécessité de lutter pour des réformes à l'intérieur d'un capitalisme ascendant, la coexistence des programmes "minimum" et "maximum" dans cette période permettaient à des courants comme l'anarcho-syndicalisme, le centrisme et l'opportunisme d'exister dans le camp politique prolétarien à côté du marxisme révolutionnaire.
À l'époque actuelle de la décadence du capitalisme, à l'ère du capitalisme d'État, de l'intégration des partis de masse et des syndicats dans les rouages de l'État totalitaire du capital, de l'impossibilité des réformes dans une situation de crise permanente et de la nécessité objective de la révolution communiste - époque ouverte par la première guerre mondiale, le camp politique prolétarien est définitivement 1imité au marxisme révolutionnaire. Les différentes tendances opportunistes et centristes, avec leur programme de parlementarisme, de légalisme avec leur stratégie d'usure, avec leur base dans les partis de masse et les syndicats, sont irrémédiablement passées dans le camp du capitalisme. Il en va de même de toute organisation qui abandonne d'une quelconque autre façon le terrain de la révolution mondiale, comme ce sera le cas de la IIIème Internationale lors de l'adoption du "socialisme en un seul pays" et du trotskysme lors de son soutien "critique" à la 2ème guerre mondiale.
4. La question que doit se poser le marxisme face au phénomène historique de l'opportunisme et du centrisme n'est pas de savoir si les organisations du prolétariat sont menacées ou non de pénétration de l'idéologie bourgeoise, mais de comprendre dans quelles conditions particulières celle-ci a pu aboutir à l'existence de courants distincts du marxisme révolutionnaire et de la bourgeoisie. De par sa nature même la classe ouvrière et ses organisations - les plus claires soient-elles - sont toujours pénétrées par l'idéologie bourgeoise. Cette pénétration prend les formes les plus variées, et c'est gravement la sous-estimer que de n'en rechercher qu'une seule forme générique. L'issue du combat entre conscience de classe et idéologie bourgeoise dans une organisation consiste soit en le développement de la première contre la seconde, soit en la destruction de la première par la seconde. Dans l'époque de décadence du capitalisme où les antagonismes de classe s'expriment de façon claire et tranchée, ceci signifie soit le développement du programme révolutionnaire, soit la capitulation face à la bourgeoisie.
La possibilité d'une "troisième voie" à l'époque ascendante du capitalisme, c'est-à-dire l'existence de courants et de positions ni vraiment bourgeois ni vraiment révolutionnaires à l'intérieur même du mouvement ouvrier résulte de la marge laissée alors par le capitalisme en expansion à une lutte permanente du prolétariat pour des améliorations de ses conditions de vie à l'intérieur du système sans mettre immédiatement celui-ci en péril. L'opportunisme - la politique visant la recherche de succès immédiats au détriment des principes, c'est-à-dire des conditions du succès final et le centrisme - variante de l'opportunisme cherchant à concilier ce dernier avec une référence au marxisme - se développèrent comme formes politiques de la maladie réformiste qui gangrena le mouvement ouvrier à cette époque. Leur base objective résidait non dans une différenciation fondamentale d'intérêts économiques au sein du prolétariat, comme le présentait la théorie de 1'"aristocratie ouvrière" de Lénine, mais dans les appareils permanents des syndicats et partis de masse, qui tendaient à s'institutionnaliser dans le cadre du système, à s'intégrer à l'Etat capitaliste et à s'éloigner de la lutte de classe. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, ces organisations basculèrent définitivement dans le camp du capital et, avec elles, les courants réformistes, opportunistes ou centristes.
Désormais, l'alternative immédiate qui est posée à la classe ouvrière est révolution ou contre-révolution, socialisme ou barbarie. Réformisme, opportunisme et centrisme ont cessé d'être une réalité objective à l'intérieur du mouvement ouvrier, car leur base matérielle - l'obtention de réformes et de succès immédiats, sans lutte pour la révolution, et les organisations de masse correspondantes - n'existe plus. Toute politique visant des succès immédiats en s'éloignant de la révolution, est devenue, du point de vue du prolétariat, une illusion et non une réalité objective ; elle représente une capitulation directe face à la bourgeoisie, une politique contre-révolutionnaire. Tous les exemples historiques de telles politiques à l'époque de décadence, comme celle d' "aller aux masses" de l'Internationale Communiste, montrent que, loin d'aboutir à des succès immédiats, elles aboutissent à des échecs complets, à la trahison des organisations et à la perte de la révolution dans le cas de l'I.C. Ceci ne veut pas dire que toute organisation prolétarienne qui dégénère passe immédiatement en tant que telle à la bourgeoisie ; en dehors des moments cruciaux de guerre et de révolution, la capitulation face à la bourgeoisie peut être partielle et progressive, comme le montre l'histoire du bordiguisme. Mais ceci ne change pas la caractéristique générale du processus, la contradiction permanente entre révolution et contre-révolution, la dénaturation de la première en la seconde sans passer par des courants et des idéologies de type intermédiaire comme l'étaient l'opportunisme et le centrisme.
5. La thèse, développée par Trotsky dans les années 30 et reprise aujourd'hui dans le CCI, selon laquelle l'opportunisme et le centrisme représentent par essence la pénétration de l'idéologie bourgeoise au sein des organisations du prolétariat, définie simplement en termes de "comportements politiques" (manque de fermeté sur les principes, hésitation, conciliation entre positions antagoniques), s'écarte radicalement de la méthode matérialiste historique du marxisme :
- du matérialisme, parce qu'elle met la réalité la tête en bas en considérant les courants politiques comme produits des comportements, au lieu de considérer les comportements comme produits de courants politiques, définis par leur rapport à la lutte de classe ;
- de l'histoire, parce qu'elle remplace toute l'évolution générale du prolétariat et de ses organisations par des catégories figées de comportements particuliers, incapables d'expliquer cette évolution historique.
Ses conséquences sont désastreuses sur une série d'aspects essentiels du programme révolutionnaire:
1) En situant l'origine des faiblesses des organisations prolétariennes dans le comportement d'hésitation, elle y oppose un autre comportement : la volonté, et base ainsi sa perspective sur le volontarisme, déviation typique du trotskysme des années 30.
2) En étant appliquée à l'époque de décadence du capitalisme, elle mène à la réhabilitation, dans le camp du prolétariat, du courant "centriste" et par là de la social-démocratie après sa participation à la première guerre mondiale et à l'écrasement de la révolution d'après-guerre, du stalinisme après l'adoption du "socialisme en un seul pays" et du trotskysme après sa participation à la deuxième guerre mondiale ; en d'autres termes à l'abandon du critère objectif de l'internationalisme, de la participation à la guerre ou à la révolution, pour délimiter le camp prolétarien du camp bourgeois ; à la reconnaissance de positions nationalistes - telles que le "socialisme en un seul pays" du stalinisme et le "soutien critique" à la guerre impérialiste du trotskysme - en tant qu'expressions du prolétariat.
3) De ce fait, elle altère en outre toutes les leçons tirées de la vague révolutionnaire et justifie, quoique de façon critique, la politique d'ouverture de la IIIème Internationale aux éléments et partis contre-révolutionnaires de la social-démocratie et comporte ainsi un grave danger pour la révolution et le parti de demain.
4) En fin de compte, elle implique une remise en cause de la nature révolutionnaire du prolétariat et de sa conscience, car si le centrisme désigne toute cohabitation de positions contradictoires, alors le prolétariat et ses organisations sont toujours et par nature centristes, puisque le prolétariat traîne nécessairement en lui les marques de la société dans laquelle il existe, de l'idéologie bourgeoise, tout en affirmant son projet révolutionnaire.
6. La vérité d'une théorie réside dans la pratique. C'est l'application du concept de centrisme par la IIIème Internationale dans la formation des partis communistes en Europe et par l'Opposition de gauche trotskyste dans la formation de la prétendue "IVème Internationale" qui apporte la démonstration historique définitive de sa faillite à l'époque de la décadence du capitalisme. C'est par manque de clarté sur la nature désormais bourgeoise du "centrisme" que l'IC fut amenée à une politique de compromissions avec des tendances et partis social-démocrates contre-révolutionnaires en leur ouvrant les portes de 1'Internationale, comme ce fut le cas en Allemagne où le KPD dut fusionner avec l'USPD, ou en France où le PCF fut formé à partir de la SFIO qui avait participé à l'Union sacrée pendant la guerre impérialiste. C'est de même sa conception du centrisme qui entraîna Trotsky dans une politique volontariste de construction d'une nouvelle internationale et d'entrisme dans la social-démocratie contre-révolutionnaire. Dans les deux cas, ces politiques précipitèrent la mort de l'IC et du trotskysme de façon spectaculaire.
Le fait que les gauches communistes aient continué à utiliser les termes de "centrisme" et d'"opportunisme" n'est en rien une preuve de l'adéquation de ceux-ci, mais une expression de la difficulté des gauches à tirer immédiatement les leçons théoriques de l'expérience vécue. Ces gauches étaient tout au moins claires sur l'essentiel, à savoir la fonction contre-révolutionnaire assumée par les courants qualifiés de "centristes", mais leur analyse en était affaiblie par le recours à des concepts applicables à la dégénérescence de la IIème Internationale. En témoignent les positions intenables de "Bilan" sur la dualité entre "nature" (prolétarienne) et "fonction" (contre-révolutionnaire) du stalinisme après 1927 et sur la qualification de l'URSS comme "Etat prolétarien" jusque dans la deuxième guerre mondiale.
7. La nature de classe d'une organisation est donnée par la fonction historique qu'elle remplit dans la lutte de classe, car une organisation ne surgit pas comme reflet passif d'une classe mais comme organe actif de celle-ci. Tout critère basé uniquement sur la présence d'ouvriers (comme pour le trotskysme) ou de révolutionnaires (comme pour le CCI aujourd'hui) dans une organisation pour délimiter sa nature de classe s'inspire du subjectivisme idéaliste et non du matérialisme historique. Le passage d'une organisation du prolétariat dans le camp bourgeois est par essence un phénomène objectif, indépendant de la conscience qu'en ont les révolutionnaires sur le moment, puisqu'il signifie que l'organisation fait face au prolétariat comme partie des conditions objectives, adverses, de la société capitaliste, et qu'elle échappe ainsi à l'action subjective du prolétariat. Le maintien d'ouvriers, et même parfois temporairement de fractions révolutionnaires en son sein n'est nullement contradictoire avec ce fait, puisque la fonction qu'elle remplit alors pour la bourgeoisie est précisément l'encadrement du prolétariat.
Il existe des critères historiques décisifs qui tranchent le passage d'une organisation dans le camp du capitalisme: l'abandon de l'internationalisme, la participation à la guerre et à la contre-révolution. Ce passage s'est effectué pour la social-démocratie et les syndicats lors de la première guerre mondiale, pour l'IC lors de l'adoption du "socialisme en un seul pays", pour le courant trotskyste lors de la deuxième guerre mondiale. Une fois ce passage accompli, l'organisation est définitivement morte pour le prolétariat, car désormais s'applique à elle le principe que Marx a dégagé face à l'Etat capitaliste, dont elle est partie prenante : celui-ci ne peut être conquis, il doit être détruit.
La mort d'une Internationale signifie simultanément la trahison de la majorité ou de l'ensemble des partis qui la composent, par l'abandon de l'internationalisme et l'adoption d'une politique nationaliste. Mais parce que les partis s'intègrent chacun dans un Etat capitaliste national, il peut exister des exceptions déterminées par des conditions nationales spécifiques, comme ce fut le cas dans la IIème Internationale. Ces exceptions qui ne se reproduisirent pas lors de la faillite de la IIIème Internationale avec l'adoption unanime du nationalisme stalinien par les PC, n'infirment en rien la règle générale, ni la nécessité pour ces partis de rompre totalement avec la politique de leurs ex-partis "frères". En outre, au sein de ces derniers subsistent parfois pendant quelque temps des courants ou fractions révolutionnaires qui n'ont pas réussi à comprendre immédiatement le changement de la situation et qui sont amenés par la suite à rompre avec le parti passé à la contre-révolution : ce fut le cas des spartakistes dans le SPD puis l'USPD en Allemagne. Ce processus n'est en rien assimilable à une impossible naissance d'une organisation prolétarienne à partir d'une organisation bourgeoise : ces fractions rompent organisationnellement avec le parti passé à la bourgeoisie mais représentent la continuité programmatique avec l'ancien parti dans lequel elles sont nées. Il traduit le phénomène général du retard de la conscience sur la réalité objective, qui se manifeste même lorsque les fractions ont quitté le parti : ainsi, alors que toutes les fractions de gauche avaient été exclues de l'IC dès 1927, la fraction italienne continua à analyser l'IC et les PC comme prolétariens jusqu'en 1933 et 1935 respectivement, et une minorité importante en son sein défendit encore le maintien de la référence au PC après l'analyse de sa mort en 1935.
La méthode subjectiviste prenant la subsistance de révolutionnaires dans une organisation comme critère de sa nature de classe désarme complètement les révolutionnaires dans la formation du parti. Car les révolutionnaires se battent jusqu'au bout pour garder un parti au prolétariat, et si ce parti est gardé au prolétariat par leur simple présence en son sein, cela signifie qu'il n' y a pour eux aucune raison de rompre avec une organisation tant qu'ils n'en sont pas exclus. Ce raisonnement circulaire revient à laisser l'initiative à l'ennemi. D'une part, il favorise la condamnation précipitée d'un parti en cas d'exclusion hâtive, mais d'autre part, il paralyse les révolutionnaires dans le cas opposé où un parti passé à la bourgeoisie est prêt à garder des révolutionnaires en son sein comme caution de son apparence "ouvrière", comme cela se passa avec l'USPD et une série de partis social-démocrates dans les mouvements révolutionnaires du début du siècle. En supprimant le critère objectif de la nature de classe des partis, il supprime ainsi la nécessité objective de la formation du parti révolutionnaire. Et la boucle est bouclée : la théorie du centrisme engendre le "centrisme" qu'elle prétend décrire et combattre, et par là s'engendre elle-même dans un cercle vicieux qui ne peut que l'amener à conclure à la nature centriste de la classe ouvrière et de sa conscience.
8. Lorsqu'elle est amenée à ses conclusions, la théorie du centrisme comme maladie permanente du mouvement ouvrier apparaît pour ce qu'elle est : une capitulation face à l'idéologie bourgeoise qu'elle prétend combattre, un refus de tirer les leçons de l'expérience historique, une altération du programme révolutionnaire.
Rejeter cette théorie, poursuivre l'analyse marxiste des leçons du passé et des conditions de la lutte de classe à l'époque présente sur base du travail des gauches communistes et reconnaître l'impossibilité du centrisme à cette époque, c'est tout le contraire d'un désarmement de l'organisation révolutionnaire face à l'idéologie bourgeoise, c'est son armement indispensable pour combattre celle-ci sous toutes ses formes et pour préparer la formation d'un réel parti révolutionnaire.
CCI
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Opportunisme & centrisme [911]
Zimmerwald (1915-1917) : de la guerre à la révolution
- 6255 reads
DEBUT DU REVEIL DU PROLETARIAT CONTRE LA 1ère GUERRE MONDIALE QUELQUES LEÇONS POUR LE REGROUPEMENT DES REVOLUTIONNAIRES
Qui se souvient aujourd'hui de Zimmerwald, petit village suisse, où en septembre 1915 se réunit la première conférence socialiste internationale depuis le début de la première guerre mondiale ? Ce nom pourtant rendit confiance aux millions d'ouvriers jetés dans les horreurs de la guerre impérialiste. Embrigadée dans la guerre par les partis ouvriers, qu'elle avait créés au cours de décennies d'évolution pacifique du capitalisme, littéralement trahie, obligée de s'entretuer pour les intérêts des puissances impérialistes, la classe ouvrière internationale était plongée dans la crise la plus profonde, sous l'effet du traumatisme le plus violent qu'elle ait eu à subir.
Zimmerwald a été la première réponse d'ampleur internationale du prolétariat au carnage des champs de bataille, à l'immonde tuerie à laquelle le capital l'obligeait de participer. Il a symbolisé la protestation de tous les exploités contre la barbarie guerrière. Il a préparé la réponse révolutionnaire du prolétariat à la guerre en Russie et en Allemagne. Zimmerwald a relevé le drapeau de l'internationalisme traîné dans la boue de l'Union sacrée. Il a constitué la première étape du regroupement des révolutionnaires pour la IIIe Internationale. C'est pourquoi Zimmerwald est notre héritage. Il est encore très riche de leçons pour le prolétariat, leçons qui doivent être réappropriées pour préparer la révolution de demain.
LES PREMIERES REACTIONS
La première guerre mondiale provoqua la crise la plus profonde du mouvement ouvrier. Cette crise coupe les partis socialistes en deux : une partie passe directement à la bourgeoisie en adhérant à l'Union sacrée ; une autre refuse de marcher dans la guerre impérialiste. La guerre pose la question de l'éclatement de ces partis et d'une scission. La formation de nouveaux partis révolutionnaires et d'une nouvelle Internationale, excluant les fractions passées à l'ennemi, est posée dès l'éclatement de la guerre.
Le 4 août 1914, le vote des crédits de guerre par les partis socialistes allemand et français, partis déterminants dans la lutte contre la guerre, était l'acte de décès de la IIe Internationale. Les directions de ces partis, et d'autres comme les partis belge et anglais, portaient la responsabilité directe de l'embrigadement des prolétaires derrière la bannière du capital national. Au nom de la "défense de la patrie en danger" et de "l'Union sacrée contre l'ennemi", elles entraînaient des millions d'ouvriers dans la première grande boucherie mondiale. Les résolutions contre la guerre des précédents congrès de l'Internationale, à Stuttgart et Bâle, étaient foulées aux pieds, le drapeau de l'Internationale souillé du sang des ouvriers envoyés au front. Dans la bouche des social-patriotes, le mot d'ordre "prolétaires de tous les pays, unissez-vous !" devenait "prolétaires de tous les pays, entre-égorgez-vous !".
Jamais l'infamie de la trahison ne se révéla avec autant d'impudence. Vandervelde, président de l'Internationale, devenait du jour au lendemain ministre du gouvernement belge. Jules Guesde, en France, chef du parti socialiste, devenait ministre. La direction du Parti socialiste britannique (BSP) allait jusqu'à organiser pour le compte du gouvernement la campagne de recrutement militaire.
La trahison des dirigeants de ces partis ne découlait pas d'une trahison de l'Internationale. Celle-ci avait fait faillite par sa dislocation en partis nationaux autonomes soutenant leur bourgeoisie respective au lieu d'appliquer les décisions des congrès contre la guerre. En cessant d'être un instrument aux mains de tout le prolétariat international, elle n'était plus qu'un cadavre. Sa faillite était l'aboutissement de tout un processus où le réformisme et l'opportunisme avaient fini par triompher dans les plus grands partis. La trahison des dirigeants était l'aboutissement ultime d'une longue évolution que n'avaient pu empêcher les tendances de gauche de l'Internationale. Néanmoins, la trahison du 4 août n'était pas celle de tous les partis ni même de la totalité de certains -comme la social-démocratie allemande- puisqu'elle se heurte dès le départ à l'intransigeance de la Gauche.
C'est la résistance -d'abord limitée- de quelques partis mais aussi au sein des grands partis dont les directions étaient devenues social-patriotes, contre l'Union sacrée, qui posa dans les faits la question de la scission. Quelques partis furent capables courageusement d'aller contre le courant de furie nationaliste, se séparant nettement du courant chauvin. Le petit parti socialiste serbe -dès le début de la guerre votait contre les crédits militaires, rejetant toute idée d'une guerre "nationale défensive" pour les petites nations. Comme l'affirmait l'un des dirigeants: "Pour nous. le fait décisif fut que la guerre entre la Serbie et l'Autriche n'était qu'une petite partie d'un tout, rien d'autre que le prologue de la guerre européenne universelle; et cette dernière nous en étions profondément convaincus- ne pouvait avoir nul autre caractère qu'un caractère impérialiste nettement prononcé. " ([1] [919])
Tout aussi magnifique fut l'attitude du SDKPIL de Rosa Luxemburg qui appela -dès le déclenchement de la guerre- à la grève, rejetant toute idée de guerre nationale ou de "libération nationale".
Mais le cas le plus connu d'intransigeance internationaliste est celui du parti bolchevik dont les députés à la Douma- avec les députés mencheviks, votent contre les crédits de guerre et sont bientôt envoyés en Sibérie. Dès le début de la guerre, ils prennent de fait l'opposition la plus résolue à la guerre, car elle est l'une des seules à proclamer -en pleine démoralisation de toutes les fractions révolutionnaires- la nécessité de "la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" comme "seul slogan prolétarien juste" ([2] [920]). C'est la seule opposition qui des le départ montre la perspective de la révolution et pour cela celle d'un regroupement de tous les internationalistes dans une nouvelle Internationale : "La IIe Internationale est morte vaincue par l'opportunisme. A bas l'opportunisme et vive la IIIe Internationale débarrassée non seulement des transfuges, mais aussi de l'opportunisme. A la IIIe Internationale d'organiser les forces du prolétariat pour l'assaut révolutionnaire des gouvernements capitalistes, pour la guerre civile contre la bourgeoisie de tous les pays, pour le pouvoir politique, pour la victoire du socialisme." (Lénine, 1er novembre 1914)
Mais aucun parti, même le parti bolchevik, ne put échapper à la crise profonde du mouvement ouvrier créée par le choc de la guerre. A Paris, une minorité de la section bolchevik s'engageait dans l'armée française.
Moins connues que les bolcheviks, d'autres organisations révolutionnaires ont tenté -au prix d'une crise plus ou moins grande- d'aller contre le courant et réussi à maintenir une attitude internationaliste. En Allemagne :
- le groupe "Die Internationale", constitué de fait en août 1914 autour de Luxemburg et Liebknecht
- les "Lichtstrahlen" -ou socialistes internationaux- de Borchardt constitués dès 1913 ;
- la Gauche de Brème (Bremerlinke) de Johann Knief, influencée par Pannekoek et les bolcheviks.
L'existence de ces trois groupes montre que la résistance à la trahison a été dès le départ très forte en Allemagne au sein même du parti social-démocrate. En dehors de l'Allemagne et de la Russie, de la Pologne et de la Serbie, on doit mentionner pour leur importance future :
- le groupe de Trotsky, qui se concentra d'abord autour de la revue de Martov -"Golos"- puis eut sa revue propre "Nache slovo" dans l'immigration russe en France, influençant dans un sens révolutionnaire une partie du syndicalisme révolutionnaire français (Monatte et Rosmer), et la social-démocratie roumaine de Racovski ;
- le Parti tribuniste de Gorter et Pannekoek en Hollande, qui dès le départ adhère aux thèses des bolcheviks et mène une vigoureuse campagne contre la guerre et pour une nouvelle Internationale.
A côté des social-chauvins et des révolutionnaires intransigeants se développait un troisième courant issu de la crise de tout le mouvement socialiste. Ce courant qu'on peut qualifier de centriste ([3] [921]) se manifestait par toute une attitude d'oscillation et d'hésitations : tantôt radical en paroles, tantôt opportuniste, gardant l'illusion d'une unité du parti les amenant à chercher à renouer avec les traîtres social-chauvins. Les mencheviks, le groupe de Martov à Paris, seront parcourus par ces hésitations, oscillant entre une attitude d'appel à la révolution et une position pacifiste. Typique est la politique du Parti socialiste italien, qui cherche dès septembre 1914 à renouer les liens internationaux brisés par la guerre et vote en mai 1913 contre les crédits de guerre. Il se proclame pourtant "neutre" dans la guerre avec son slogan "ni adhérer ni saboter". En Allemagne, les meilleurs éléments révolutionnaires, comme Liebknecht, marquent encore leur rupture avec l'Union sacrée ("Burgfriede") avec des mots d'ordre pacifistes: "pour une paix rapide et qui n'humilie personne, une paix sans conquêtes". ([4] [922])
C'est progressivement et dans la douleur que se développait le mouvement révolutionnaire, lui-même parcouru d'hésitations. Il se trouvait confronté avec un Centre -le "marais"- qui se situait encore dans le camp prolétarien. C'est avec les groupes issus de ce centre, et par la confrontation avec lui, que pouvait être initiée une lutte contre la guerre. Le regroupement international des révolutionnaires ayant rompu avec le social-patriotisme, en vue de la formation d'une nouvelle Internationale, passait par une confrontation avec les hésitants et les centristes.
Tel fut le sens profond des conférences de Zimmerwald et Kienthal : d'abord relever le drapeau de l'Internationale, par le rejet de la guerre impérialiste, et préparer les conditions subjectives, par la scission inévitable dans les partis socialistes, de la révolution, qui seule pourrait mettre fin à la guerre.
LA CONFERENCE SOCIALISTE INTERNATIONALE DE ZIMMERWALD
Au milieu du fracas de la guerre impérialiste, entraînant dans la mort des millions d'ouvriers, face à la misère effroyable régnant dans une classe ouvrière surexploitée et peu à peu réduite à la famine, la Conférence de Zimmerwald sera le cri de ralliement des exploités victimes de la barbarie capitaliste. En devenant le phare de l'internationalisme, par delà les frontières, par delà les fronts militaires, Zimmerwald va symboliser le réveil du prolétariat international, jusqu'alors traumatisé par le choc de la guerre ; il va stimuler la conscience du prolétariat qui une fois dissipées les vapeurs délétères du chauvinisme, passera progressivement d'une volonté de retourner à la paix à la prise de conscience de ses buts révolutionnaires. En dépit de toutes les confusions régnant en son sein, le Mouvement de Zimmerwald va être l'étape décisive sur le chemin menant à la révolution russe et à la fondation de la Ille Internationale.
A l'origine, l'idée d'une reprise des relations internationales entre partis de la IIe Internationale, qui refusent la guerre, naît dans des partis de pays "neutres". Dès le 27 septembre 1914 se déroulait à Lugano (Suisse), une conférence des partis socialistes suisse et italien, qui se proposait de "combattre par tous les moyens l'extension ultérieure de la guerre à d'autres pays". Une autre conférence de partis "neutres" se tenait les 17 et 18 janvier 1913 à Copenhague, avec des délégués des partis Scandinaves et de la social-démocratie hollandaise (la même qui avait exclu les révolutionnaires tribunistes en 1909). Les deux conférences, qui n'eurent aucun écho dans le mouvement ouvrier, se proposaient de réaffirmer "les principes de l'Internationale", d'une Internationale qui était définitivement morte. Mais alors que les Scandinaves et les Hollandais, dominés par le réformisme, faisaient appel au Bureau socialiste international pour tenir une conférence de la "paix" entre partis ayant adhéré au social-chauvinisme, les partis italien et suisse s'engageaient timidement vers une rupture. Ainsi, en janvier 1913, le parti socialiste suisse décidait de ne plus verser de cotisations à la feue IIe Internationale. Rupture très timide, puisqu'en mai de la même année la conférence des deux partis suisse et italien, tenue à Zurich, demandait dans une résolution" d'oublier les faiblesses (!) et les fautes ( !!) des partis frères des autres pays" ([5] [923]). Et que dire des mots d'ordre de "désarmement général" en plein carnage militaire et &"aucune annexion violente" (sic) en pleine guerre de brigandage!
En fait, c'est la renaissance de la lutte de classe dans les pays en guerre et le réveil des minorités hostiles à la guerre dans les partis social-chauvins qui vont impulser le mouvement de Zimmerwald. En Grande-Bretagne, en février 1915, dans la vallée de la Clyde, débutaient les premières grandes grèves de la guerre. Au même moment, en Allemagne, éclataient les premières émeutes alimentaires, émeutes de femmes ouvrières protestant contre le rationnement. Les oppositions à la guerre se font plus déterminées. Le 20 mars 1915, Otto Rühle -futur théoricien du "conseillisme" et député au Reichstag- qui jusqu'alors avait voté les crédits .de guerre "par discipline", vote contre avec Liebknecht, tandis que trente députés social-démocrates s'abstiennent en quittant la salle du parlement. Plus significatif était le développement des forces révolutionnaires. A côté des "socialistes internationaux", publiant "Lichtstrahlen" ("Rayons de lumière") et proches des bolcheviks et des "Radicaux" de Brème, le groupe de Rosa Luxemburg diffusait des centaines de milliers de tracts contre la guerre et publiait la revue "Die Internationale". C'est une telle activité révolutionnaire qui pouvait réellement poser les bases d'un regroupement international. En France même, où le chauvinisme était particulièrement puissant, les réactions contre la guerre se faisaient jour. Il est significatif que ces réactions, à la différence de l'Allemagne, turent d'abord le fait des syndicalistes-révolutionnaires, autour de Monatte, influencé par Trotsky et son groupe ("Nache Slovo"). Dans les fédérations de l'Isère, du Rhône, chez les métallos et les instituteurs, une majorité se dégageait contre l'Union sacrée. Dans le parti socialiste lui-même, des fractions significatives -comme la Fédération de la Haute-Vienne ([6] [924])-suivaient la même voie. Telles étaient les prémisses de Zimmerwald. Une scission de fait s'effectuait progressivement sur la question de la guerre, et en conséquence sur. le soutien aux luttes de classe qui inévitablement deviendraient les prémisses de la révolution. La question de la rupture avec le social-chauvinisme était posée. Les deux conférences internationales qui se tinrent à Berne au printemps 1915 la posèrent. La première, celle des femmes socialistes, les 25-27 mars, négativement, bien qu'elle déclarât "la guerre à la guerre" : la conférence refusait en effet de condamner les social-patriotes et d'envisager la nécessité d'une nouvelle Internationale. C'est pourquoi les délégués bolcheviks refusèrent de cautionner toute attitude ambiguë et quittèrent la conférence. La deuxième conférence, celle de la Jeunesse socialiste internationale, positivement : elle décida de fonder un Bureau international de la Jeunesse autonome et de publier une revue "Jugend Internationale", de combat contre la Ile Internationale. Dans un manifeste sans ambiguïté, les délégués affirmèrent leur soutien à "toutes les actions révolutionnaires et les luttes de classe".
- "Il (valait) cent fois mieux mourir dans les prisons comme victimes de la lutte révolutionnaire que de tomber sur le champ de bâtai lie en lutte contre nos camarades d'autres pays, pour la soif de profit de nos ennemis." ([7] [925])
C'est à l'initiative du comité directeur du Parti italien et de socialistes suisses, comme Grimm et Platten, que fut convoquée pour septembre 1915 la première conférence socialiste internationale. Bravant la police, les calomnies des social-chauvins et l'hystérie nationaliste, trente-huit délégués venant de douze pays se retrouvèrent dans un petit village à côté de Berne. Le lieu de la conférence avait été tenu secret pour échapper aux espions des différentes puissances impérialistes. Il est significatif que les délégations les plus nombreuses étaient celles des immigrés de Russie, bolcheviks, mencheviks et socialistes-révolutionnaires, et de l'Allemagne, les deux pays clefs de la révolution mondiale.
Cette conférence revêtit une importance historique décisive pour l'évolution de la lutte de classe et la formation d'une gauche communiste internationale.
En effet, de la conférence sortit une "Déclaration commune des socialistes et des syndicalistes franco-allemands", signée par les syndicalistes français Merrheim et Bourderon et les députés allemands Ledebour et Hoffmann. En appelant à "la cessation de cette tuerie" et en affirmant que "cette guerre n'est pas notre guerre", la déclaration eut un effet formidable tant en Allemagne qu'en France. Elle dépassait les intentions des signataires, qui étaient loin d'être des révolutionnaires mais des éléments timorés du centre, Ledebour, malgré les appels très fermes de Lénine, refusait de voter contre les crédits de guerre, préférant "s'abstenir". Parce qu'elle émanait de socialistes de pays belligérants, la déclaration apparut vite comme une incitation à la fraternisation des soldats des deux camps.
Enfin, le Manifeste, rédigé par Trotsky et Grimm, adressé aux prolétaires d'Europe, parce qu'adopté à l'unanimité par les socialistes de douze pays, allait avoir un impact considérable sur les ouvriers et les soldats. Traduit et diffusé dans plusieurs langues, le plus souvent sous forme de tracts et de brochures clandestins, le Manifeste apparut comme une vivante protestation des internationalistes contre la barbarie : "L'Europe est devenue un gigantesque abattoir d'hommes. Toute la civilisation, produit du travail de plusieurs générations, s'est effondrée. La barbarie la plus sauvage triomphe aujourd'hui sur tout ce qui était l'orgueil de l'humanité." Il dénonçait les représentants des partis qui "se sont mis au service de leur gouvernement et ont tenté, par leur presse et leurs émissaires, de gagner à la politique de leurs gouvernants les pays neutres", et le Bureau socialiste international qui a complètement failli à sa tâche". "Par-dessus les frontières, par-dessus les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées, prolétaires de tous les pays, unissez-vous '"([8] [926])
Devant la gravité de la situation, les ambiguïtés contenues dans le Manifeste passèrent au second rang dans l'esprit des ouvriers qui y virent la première manifestation d'internationalisme. Le Manifeste était en fait le fruit d'un compromis entre les différentes tendances de Zimmerwald, qui voulait apparaître comme un mouvement uni face aux puissances impérialistes. Les bolcheviks critiquèrent avec intransigeance révolutionnaire le ton pacifiste -"entraîner la classe ouvrière dans la lutte pour la paix"- et l'absence de perspectives de révolution. Le "Manifeste ne contient aucune caractéristique claire des moyens de combattre la guerre." ([9] [927]) Les délégués qui allaient former la Gauche de Zimmerwald proposèrent une résolution qui seule se plaçait sur le terrain du marxisme en appelant à "la lutte la plus intransigeante contre le social-impérialisme comme première condition pour la mobilisation révolutionnaire du prolétariat et pour la reconstruction de l'Internationale" ([10] [928])
Il est significatif, cependant, que la Gauche, sans abandonner ses critiques, vota le Manifeste. Lénine justifiait ainsi de façon très juste l'attitude de la Gauche '."Notre comité central devait-il signer ce manifeste inconséquent et timoré ? Nous pensons que oui... Nous n'avons rien dissimulé de notre opinion, de nos mots d'ordre, de notre tactique.. Que ce manifeste constitue un pas en avant (souligné par Lénine, NDR) vers la lutte réelle avec l'opportunisme, vers la rupture et la scission, c'est un fait acquis. Il serait d'un sectaire de se refuser à faire ce pas en avant avec la minorité des Allemands, des Français, des Suédois, des Norvégiens, des Suisses, alors que nous conservons notre pleine liberté de mouvement et la possibilité entière de critiquer les inconséquences présentes en travaillant pour de plus grands résultats." (10)
La Gauche qui regroupait sept à huit délégués, une infime minorité, était consciente de ce pas en avant. La bourgeoisie internationale ne se trompa pas en effet sur le sens de Zimmerwald. Ou bien elle utilisa les calomnies les plus infâmes pour présenter les révolutionnaires comme des "agents de l'ennemi", aidée en cela par les social-chauvins, ou bien, tant que ce fut possible, elle censura tout article faisant part des résultats de la Conférence. Avec raison, la bourgeoisie des deux camps prenait peur. L'établissement d'une Commission socialiste internationale, qui allait par la suite recueillir des adhésions de plus en plus nombreuses au Mouvement de Zimmerwald, était un pas en avant, de rupture avec la seconde Internationale, même si les initiateurs déclaraient ne vouloir "se substituer au secrétariat international" et la "dissoudre aussitôt que ce dernier pourra remplir à nouveau sa mission". En France, la création par les lecteurs de "La Vie Ouvrière" et de la "Nache Slovo" en novembre 1913 d'un comité pour la reprise des relations internationales, est une conséquence directe, positive, de la Conférence.
LE DEVELOPPEMENT DE LA GAUCHE ZIMMERWALDIENNE
La conférence fut un révélateur important de l'état des forces en présence :
- une droite représentée par les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires, les syndicalistes et les députés allemands, les Italiens et les Suisses, et prête à toutes les concessions avec le social-chauvinisme. Elle exprimait un centrisme de droite qui révéla, sur la question de la révolution et non plus de la "paix", dans les années à venir, son caractère contre-révolutionnaire en 1917 et 1919; -un centre, orienté vers la gauche, poussé à la conciliation par indécision et manque de fermeté sur les principes. Trotsky, les délégués du groupe "Die Inter- nationale", ceux des partis balkaniques et polonais traduisaient les hésitations de ce centre ;
- la Gauche de Zimmerwald, regroupée autour des bolcheviks, des Scandinaves, de Radek, de Winter (représentant d'un groupe en Lettonie lié aux bolcheviks), affirmait avec clarté et sans hésitation la nécessité de la lutte pour la révolution, consciente de plus en plus que la révolution et non la lutte contre la guerre serait la ligne de partage. "Guerre civile et non pas union sacrée, voilà notre devise. Il est du devoir des partis socialistes et des minorités oppositionnelles au sein des partis devenus social-patriotes d'appeler les masses ouvrières à la lutte révolutionnaire contre les gouvernements impérialistes pour la conquête du pouvoir politique, en vue de l' organisation socialiste de la société. "([11] [929])
La lutte sans concession de la Gauche pour opérer un clivage dans les rangs centristes est très significative. Elle montre que la lutte des révolutionnaires amène inévitablement à une décantation ; que les forces ne sont pas figées : sous la pression de la lutte de classe et des avant-gardes marxistes, une crise se produit qui entraîne une partie des hésitants sur la voie révolutionnaire. Le combat politique, comme volonté, est une force historique consciente qui opère la sélection la plus impitoyable. A l'heure des choix historiques, il est impossible de rester longtemps dans le marais.
Pour la gauche, il s'agissait, tout en adhérant au Mouvement de Zimmerwald, de garder l'autonomie d'action et de se compter dans un organisme, qui tout en participant à la Commission socialiste internationale, symbolisa le drapeau de la future Internationale : le "Bureau permanent de la gauche zimmer-waldienne" composé de Lénine, Zinoviev et Radek, fut chargé de mener son propre travail à l'échelle internationale.
L'attitude de la Gauche de Zimmerwald est pleine d'enseignements pour les révolutionnaires d'aujourd'hui. Pour la Gauche, tout en dénonçant impitoyablement les oscillations centristes, il ne s'agissait pas de proclamer artificiellement la nouvelle Internationale, mais de la préparer. La préparer) cela passait par la rupture nette avec le social-patriotisme, et donc par l'établissement de critères aux conférences excluant ce courant passé à la bourgeoisie.
En deuxième lieu, cela supposait une condamnation absolue de toute forme de pacifisme, professé par les centristes qui ne recherchaient rien de moins que la conciliation avec le social-chauvinisme et le retour à la IIe Internationale d'avant 14. Le chemin de la révolution ne pouvait passer que sur le corps du pacifisme. Comme l'affirmait Gorter dès octobre 1914 dans sa brochure "L'impérialisme, la guerre mondiale et la social-démocratie" :"Le mouvement pacifiste est la tentative que sont en train de faire la bourgeoisie, les réformistes et les radicaux, à L'heure où le prolétariat se trouve confronté au choix entre impérialisme et socialisme, pour le pousser vers l'impérialisme. Le mouvement pacifiste c'est la tentative de l'impérialisme de la bourgeoisie contre le socialisme du prolétariat." Ainsi la seule alternative n'était pas guerre ou paix mais guerre ou révolution. Seule la révolution pourrait mettre fin à la guerre, comme le montra 1917 en Russie et 1918 en Allemagne.
En troisième lieu, sur le plan pratique, il s'agissait de constituer des partis marxistes indépendants du centrisme, sur des bases réellement révolutionnaires. Comme l'affirmait le groupe "Arbeiterpohtik" (Gauche de Brème) -soutenu par les bolcheviks- "la scission (à l'échelle nationale et internationale) [est] non seulement inévitable mais une pré condition l'une réelle reconstruction de l'Internationale, l'une nouvelle croissance du mouvement ouvrier prolétarien" ("Unité ou scission du Parti ?",Arbeiterpolitik, n° 4-8 et 10, 1916).
Cette lutte de la Gauche zimmerwaldienne ne fut pas sans porter ses fruits. Sur la lancée d'une forte reprise de la lutte de classe internationale, la conférence de Kienthal (en mars 1916) s'orienta nettement plus à gauche. Déjà la circulaire d'invitation de la Commission socialiste internationale (C.S.I.) affirmait en février 1916 une nette rupture avec la IIe Internationale : "Toute tentative de ressusciter l'Internationale par une amnistie réciproque des chefs socialistes compromis, persistant dans leur attitude de solidarité avec les gouvernements et les classes capitalistes, ne peut être en réalité que dirigée contre le socialisme et aura pour effet de briser le réveil révolutionnaire de la classe ouvrière."([12] [930])
Enfin, la résolution de la même CSI à Kienthal en avril 1916 marquait une nette rupture avec la phraséologie pacifiste ; il s'agissait maintenant "d'attiser l'esprit de mécontentement et de protestation des masses ; de les éclairer dans le sens du socialisme révolutionnaire, afin que les étincelles et les tisons de révolte se confondent en une puissante flamme de protestation active des masses et que le prolétariat international -conformément à sa mission historique- accélère l'accomplissement de sa tâche et amène la chute du capitalisme qui seule peut libérer les peuples." ([13] [931])
Certes il y avait -malgré la croissance de la gauche qui avait plus de délégués qu'à Zimmerwald- encore une grande aile droite dans le mouvement zimmerwaldien. Mais il s'agissait d'un grand pas en avant vers la nouvelle Internationale. Comme le soulignait Zinoviev, au lendemain de Kienthal, "la deuxième conférence de Zimmerwald constitue indiscutablement un progrès, c'est un pas en avant. L'influence de la Gauche s'est trouvée beaucoup plus forte que dans le premier Zimmerwald. Les préjugés contre la Gauche se sont affaiblis à présent, il y a plus de chances qu'il n'y en eut après Zimmerwald pour que l'affaire tourne ainsi à l 'avantage des révolutionnaires, du socialisme. " ("Contre le Courant", tome 2, Maspéro, 1970). "Pas d'illusions/'; concluait néanmoins Zinoviev.
VERS LA IIIe INTERNATIONALE
"Plus d'illusions!", "L'ennemi principal se trouve dans notre propre pays" (Liebknecht) ; ces mots d'ordre trouvaient un écho pratique par le développement de la lutte de classe en 1917 dans les plus grands pays impérialistes : en Allemagne, avec des grèves gigantesques dans le Reich ; en Italie, à Turin où les ouvriers s'affrontaient les armes à la main à l'armée ; et surtout en Russie, où éclatait la révolution, prodrome de la révolution mondiale. C'est la question de la révolution qui, d'autre part, entraînait la scission dans les partis. Au printemps 1917 se formait en Allemagne le parti des Indépendants (USPD), au sein duquel l'Union spartakiste constituait une fraction ([14] [932]) ; en Italie se formait la fraction de Bordiga ; en Russie la révolution poussait les "centristes" de Zimmerwald -menchéviks officiels et socialistes-révolutionnaires de droite (à l'exception du groupe de Martov et des S.R. de gauche) dans le camp de la contre-révolution. En France, où triomphait pourtant l'idéologie nationaliste la plus crue, la minorité -composée elle-même d'une majorité de partisans de Longuet ("longuettistes"), centriste, et d'une petite minorité révolutionnaire- était sur le point de devenir la majorité face à la direction social-patriote en 1918.
La rupture avec les éléments centristes se posait avec netteté, comme condition de la naissance de la IIIe Internationale. Si cette rupture était valable théoriquement, sa réalisation a nécessité plusieurs années et passait par un nécessaire éclatement de ce courant. Que ce processus devrait durer plus longtemps que prévu, aucun révolutionnaire, dans le feu de la Révolution russe, ne pouvait l'envisager, face aux tâches de l'heure. C'est pourquoi les bolcheviks, et Lénine surtout, les Linksradikalen de Brème et les partisans de Gorter, étaient portés à accélérer la liquidation du Mouvement de Zimmerwald.
- "La tare principale de l'Internationale, la cause de sa faillite (car elle a déjà fait faillite moralement et politiquement ) réside dans ses flottements, dans son indécision sur la question essentielle qui détermine pratiquement toutes les autres, celle de la rupture avec le social-chauvinisme et la vieille Internationale social-chauvine. . . Il faut rompre sans délai avec cette Internationale. Il ne faut rester à Zimmerwald qu'à des fins d‘ information. " (Lénine, "Les objectifs du prolétariat dans notre révolution", 10 avril 1917)
La position de Lénine s'expliquait en fait par l'orientation des centristes mencheviks et socialistes-révolutionnaires vers le camp capitaliste. D'autre part, la majorité centriste de Zimmerwald était prête à céder aux sirènes des sociaux-patriotes de différents pays qui projetaient une conférence à Stockholm au printemps 1917, dans le but d'entraîner la Russie révolutionnaire dans la guerre. En réalité, une conférence se déroula bien à Stockholm, les 5-7 septembre 1917, mais ce fut la troisième (et dernière) conférence de Zimmerwald. Les bolcheviks, mencheviks internationalistes -les mencheviks se retirèrent avant la fin-, les indépendants et spartakistes avaient envoyé leurs délégués. Contrairement aux craintes des bolcheviks, la Gauche était en majorité dans la conférence. Celle-ci publia un manifeste appelant à une grève internationale contre la guerre et soutenant la révolution russe. Il concluait de façon frappante par ces mots : "Ou la révolution tuera la guerre ou la guerre tuera la révolution." ([15] [933])
La présence des bolcheviks à cette ultime conférence était un désaveu de fait de la position de Lénine en avril 1917 de quitter -selon ses mots "l'organisation pourrie de Zimmerwald" pour fonder la IIIe Internationale. La thèse de Lénine fut rejetée à la fin de 1917 par le comité central du parti bolchevik, à l'instigation de Zinoviev. Il fallait constater que malheureusement la thèse de Lénine de fonder rapidement de nouveaux partis et l'Internationale, tout à fait juste comme perspective, était encore prématurée, en l'absence d'une révolution en Allemagne, et de la formation de réels partis communistes indépendants, ayant rompu dans la plus grande clarté avec le centrisme impénitent, après avoir fait éclater le courant centriste. Il fallut encore attendre, compte tenu de la lente maturation de la conscience révolutionnaire du prolétariat, un an et demi, un an et demi de batailles révolutionnaires, pour que fût fondée l'Internationale communiste (mars 1919). Zimmerwald n'avait plus de raison d'être et fut dissoute officiellement par le congrès. La nécessaire décantation,passant par la scission, s'était en partie réalisée: une partie des Zimmerwaldiens adhérait à l’IC; le reste -une partie des indépendants et des centristes- s'unissait aux sociaux-patriotes "utilisant la bannière de Zimmerwald au profit de la réaction".La déclaration des participants de gauche (Zinoviev, Lénine, Trotsky, Platten et Racovski) pouvait conclure : "Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal eurent leur importance à une époque où il était nécessaire d'unir tous les éléments prolétariens décidés, sous une forme ou une autre, à protester contre la boucherie impérialiste. Mais il pénétra dans les groupements de Zimmerwald, à côté d'éléments nettement communistes, des éléments "centristes" pacifistes et hésitants. Le courant communiste s'est renforcé dans toute une série de pays et la lutte contre les éléments du centre qui empêchent le développement de la révolution socialiste est devenue maintenant une des tâches les plus urgentes du prolétariat révolutionnaire. Le groupement de Zimmerwald a fait son temps. Tout ce qui était véritablement révolutionnaire dans le groupement de Zimmerwald passe et adhère à l'Internationale communiste. " ([16] [934])
Ainsi, malgré ses faiblesses, le Mouvement de Zimmerwald a eu une importance décisive dans l'histoire du mouvement révolutionnaire. Symbole de l'internationalisme, bannière du prolétariat dans sa lutte contre la guerre et pour la révolution, il a été le pont indispensable entre la Ile et la IIIe Internationales. Il a posé, sans pouvoir la résoudre, la question du regroupement des forces révolutionnaires dispersées par la guerre.
Aujourd’hui à 70 années de distance, les leçons de restent toujours fondamentales pour le révolutionnaire. Elles le sont dans la les révolutionnaires comprennent la différence historique entre aujourd'hui et 1915 :
a) Alors que la guerre impérialiste est une donnée permanente du capitalisme décadent, sous forme généralisée ou localisée, les leçons de Zimmerwald restent bien vivantes aujourd'hui.
Dans les guerres locales, qui en permanence touchent les pays du tiers-monde -par exemple la guerre actuelle Irak-Iran, les révolutionnaires de ces contrées comme ceux du monde entier ont le devoir de lutter énergiquement contre la guerre impérialiste. Pour cela, comme leurs prédécesseurs du mouvement de Zimmerwald, ils doivent appeler à la fraternisation des soldats des deux camps et oeuvrer, dans la classe ouvrière, à la transformation de la guerre impérialiste en guerre de classe. Leur activité est indissociable de la lutte de classe du prolétariat des grands pays impérialistes pour la révolution mondiale.
b) Comme à Zimmerwald, le regroupement des minorités révolutionnaires se pose aujourd'hui de façon brûlante. Mais il se pose dans des conditions qui sont heureusement différentes : le cours actuel n'est pas un cours vers la guerre généralisée ; le cours de lutte de classe dans les grands pays industrialisés conduit à des affrontements de classe décisifs, dont l'enjeu est la marche vers la révolution et le renversement du capitalisme. Face aux enjeux actuels la responsabilité historique des groupes révolutionnaires est posée. Leur responsabilité est engagée dans la formation du parti mondial de demain, dont l'absence aujourd'hui se fait cruellement sentir. Le regroupement des révolutionnaires ne peut être une agglomération de tendances éparses. Il est un processus organique, sur la base des acquis de la Gauche communiste, dont l'aboutissement nécessaire est la formation du parti. La reconnaissance de la nécessité du parti est la pré condition d'un véritable regroupement. Cette reconnaissance n'a rien de platonique, à la manière de diverses sectes "bordiguistes", mais se base avant tout sur un réel engagement militant dans la lutte de classe actuelle.
c) Sur la base de la reconnaissance de la nécessité du parti et d'un engagement militant, les conférences internationales des groupes et organisations se revendiquant de la Gauche communiste sont des étapes décisives du regroupement des révolutionnaires. L'échec des premières tentatives de conférences (1977-80) ([17] [935]) n'invalide pas la nécessité de tels lieux de confrontation. Cet échec est relatif : il est le produit de l'immaturité politique, du sectarisme et de l'irresponsabilité d'une partie du milieu révolutionnaire qui paie encore le poids de la longue période de contre-révolution. Les conférences passées ont été et resteront un moment important dans l'histoire du mouvement 'révolutionnaire actuel. Elles ont constitué un premier pas, bien que limité, vers le regroupement. Demain, de nouvelles conférences des groupes se revendiquant de la Gauche se tiendront : elles devront se revendiquer des conférences passées de 1977-80, mais aussi de façon plus générale des conférences ou congrès qui ont déterminé l'existence du mouvement révolutionnaire. Sans être de "nouveaux Zimmerwald" ([18] [936]), les conférences internationales futures devront travailler dans un esprit "zimmerwaldien", celui de la Gauche : toute conférence n'est pas un peu de bavardage mais engage, implique de façon militante, par les prises de positions, manifestes, résolutions, les groupes présents.
d) Toute l'histoire du mouvement prolétarien montre une profonde hétérogénéité. Il est nécessairement divisé, compte tenu de son immaturité mais aussi de la pression de l'idéologie dominante, en différentes tendances.
Moins que tout autre, le courant du centre ("centrisme") n'est un courant politique homogène. D'où ses constantes oscillations entre les positions communistes et un opportunisme plus ou moins grand. Les groupes actuels qui subissent ces oscillations, voire se trouvent dans un marais anarchisant ou contamines par des positions gauchistes, ne sont pas des groupés bourgeois. Ces groupes, pour être plus ou moins éloignés chacun -selon leur histoire- du pôle révolutionnaire le plus cohérent, n'appartiennent pas au camp du capital. En dépit de leurs hésitations, confusions, opportunisme, ils ne sont pas fatalement perdus pour la révolution. La fermeté théorique et politique des groupes révolutionnaires d'avant-garde -et particulièrement le CCI aujourd'hui- est absolument cruciale pour le développement de tout le milieu prolétarien. Il n'y a pas d'évolution fatale, de déterminisme absolu. Comme Zimmerwald l'a montré, des groupes révolutionnaires qui subissent les oscillations centristes (ceux de Trotsky et de Rosa Luxemburg, par exemple) peuvent par la suite pleinement s'engager dans un regroupement révolutionnaire, sous la pression de l'avant-garde la plus claire et intransigeante. Au fur et a mesure que l'histoire s'accélère s'approchant des dénouements décisifs, les éléments ou groupes qui barbotent dans le marais, sont obligés de choisir leur camp, au prix d'un éclatement, voire de leur - passage dans le camp ennemi. A cet égard, l'histoire des mencheviks et des indépendants en 1917 et 1919 est riche d'enseignements.
Pour le mouvement révolutionnaire actuel, Zimmerwald n'est pas une simple date anniversaire. Il est aujourd'hui comme hier le drapeau des internationalistes. Mais dans des conditions différentes de 1915, les militants communistes sont aujourd'hui engagés dans la lutte de classe montante, sans laquelle ne peuvent se poser les conditions du triomphe de la révolution. Le regroupement des révolutionnaires se fera dans la seule perspective possible de transformer la crise mondiale en une lutte pour la révolution mondiale. Celle-ci est la condition préalable pour empêcher la possibilité d'une troisième guerre mondiale, dont le résultat ne peut être que la destruction de l'humanité, et donc de la perspective du communisme.
Ch.
[1] [937] Cité par Rosmer : "Le mouvement ouvrier pendant la guerre"
[2] [938] Cf. "Contre le Courant", col. Maspéro (1970)
[3] [939] Sur la question du centrisme, se reporter aux articles de la Revue Internationale n° 42
[4] [940] Cf. Liebknecht : "Militarisme, guerre et révolution", Maspéro (1970)
[5] [941] Cf. Humbert-Droz:"L'origine de l'Internationale communiste (de Zimmerwald à Moscou)", col. La Baconnière ( 1968)
[6] [942] Cf. Rosmer : "Le' mouvement ouvrier pendant la guerre" (1936)
[7] [943] Cf. Humbert-Droz, op. cit.
[8] [944] Cité par Rosmer et Humbert-Droz
[9] [945] Cf. Humbert-Droz
[10] [946] Cf. Humbert-Droz
[11] [947] Lénine, Zinoviev, "Contre le Courant",
[12] [948] Cités par Humbert-Droz
[13] [949] Cités par Humbert-Droz
[14] [950] Plus tard, Franz Mehring, l'un des principaux dirigeants spartakistes, devait reconnaître, avec d'autres militants, que l'adhésion à l'USPD avait été une erreur : "Nous nous sommes trompés sur un seul point : c'est d'avoir en effet rallié l'organisation du Parti des Indépendants après sa fondation -tout en conservant bien sûr l 'autonomie de nos positions- dans l'espoir de le faire progresser. Nous avons dû renoncer à cette espérance." (Lettre ouverte aux bolcheviks du 3 juin 1918, citée dans "Dokumente und Materialien Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung", tome II, Berlin, 1958).
[15] [951] Cités par Humbert-Droz
[16] [952] Cf. "Premier congrès de l'Internationale communiste", E.D.I. (1974)
[17] [953] Les procès-verbaux et les textes à ces conférences ont été publiés par le "Comité technique" et sont disponibles (CCI-RI, PCI-Battaglia, CWO)
[18] [954] En 1976, Battaglia comunista voulait appeler à un Zimmerwald bis...contre l'eurocommunisme des PC voués à la "social démocratisation" . ; une façon de transformer un symbole révolutionnaire en farce !
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [207]
Conscience et organisation:
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [956]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
Heritage de la Gauche Communiste:
Milieu politique : salut a "Comunismo" n° 1
- 3110 reads
Nous avons déjà présenté dans cette revue le COLLECTIF COMMUNISTE ALPTRAUM du Mexique (REVUE INTERNATIONALE N° 40). Nous y avions publié les thèses par lesquelles les camarades du C.C.A. se situaient et se présentaient au milieu révolutionnaire et au prolétariat international. Les thèses ne constituaient pas la plateforme d'un groupe politique prolétarien. Le C.C.A. n'est pas encore un groupe politique constitué, mais un "collectif" en évolution et en pleine clarification politique. Les positions qui étaient présentées dans ces thèses s'inscrivaient sans doute possible dans le camp révolutionnaire.
En particulier, les camarades rejetaient tout nationalisme et tout mouvement de lutte de libération nationale.
Salut à COMUNISMO ! C'est avec joie et enthousiasme que nous voulons présenter ici le premier numéro de la revue semestrielle du Collectif Communiste Alptraum du Mexique : Comunismo.
Comunismo paraît au moment où l'histoire connaît une terrible accélération de par l'accentuation de la crise économique et par l'existence d'une troisième vague internationale de lutte d'un prolétariat international qui n'accepte pas la misère et la barbarie croissantes du capitalisme.
La publication de Comunismo et l'existence d'articles sur la situation de la lutte de classe tant au Mexique qu'au niveau international sont la preuve d'un souci militant d'intervention dans la lutte de classe. C'est la preuve de la compréhension croissante des camara-du CCA du rôle actif des révolutionnaires dans le développement de la lutte de classe et de la perspective de la révolution prolétarienne. Comunismo N° l et le surgissement d'un petit milieu révolutionnaire au Mexique est aussi la preuve que l'heure n'est pas à la dispersion et à la disparition des énergies révolutionnaires comme dans les années de contre-révolution , mais bien au contraire au surgissement et au regroupement de nouvelles forces partout dans le monde, dans le cadre d'un cours historique au développement de la lutte de classes et aux affrontements de classes, face à l'alternative historique que nous impose le capitalisme : socialisme ou barbarie.
L'apparition d'une nouvelle voix prolétarienne en Amérique Latine est un pas important pour le prolétariat international. Historiquement, économiquement, politiquement et géographiquement, le Mexique tient une place centrale sur le continent américain ; et le prolétariat y est appelé à jouer un grand et difficile rôle dans la généralisation et l'unification du combat de classe entre le prolétariat des U.S.A. et celui d'Amérique Latine.
La volonté politique d'intervention des camarades du C.C.A.dans la lutte de classe s'accompagne d'un effort de réappropriation historique et de débat avec le milieu révolutionnaire international :
- c'est tout à l'honneur des camarades de reprendre le nom de la publication des années 30 du Groupe des Travailleurs Marxistes du Mexique dont nous avons déjà publié des textes dans cette revue (Nos 10, 19 et 20). Rappelons que le G.T.M. était en contact avec la Fraction Italienne et la Gauche Communiste Internationale. Comunismo N°1 contient un texte de 1940 dénonçant la guerre impérialiste et l'antifascisme ;
- les camarades du C.C.A. publient une série de textes de discussion avec le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) et nous promettent leur réponse a notre critique de leurs thèses dans le prochain numéro.
QUELQUES CRITIQUES
C'est donc un bilan positif que nous tirons de l'évolution et des discussions qu'ont menées les camarades du C.C.A. depuis plus de quatre ans avec le milieu révolutionnaire international. Alors, le lecteur sera peut-être surpris de nous voir maintenant adresser des critiques aux camarades après tant d'éloges. Mais l'activité révolutionnaire est ainsi faite qu'elle exige la discussion, la contradiction et la critique pour pouvoir se développer. Dans la mesure où nos critiques sont situées à leur place, c'est-à-dire dans le cadre d'une évolution et d'une dynamique positive tant de la part des camarades que de la situation historique actuelle, elles peuvent être à leur tour un facteur dynamique et actif dans la discussion et la clarification politiques.
Groupe en évolution, le C.C.A. n'a pas encore des positions politiques clairement définies et arrêtées. Il n'est donc nullement étonnant de trouver des positions contradictoires entre les différents articles, voire dans les articles mêmes. Nous voulons en relever deux ici. Deux qui renvoient à des questions de première importance. Nous n'allons pas développer notre position. Nous voulons juste avertir les camarades des contradictions et des dangers qui, à notre avis, peuvent les guetter s'ils n'y prennent garde.
1) Les camarades restent des plus vagues et des plus flous sur l'entrée en décadence du capitalisme. Ils considèrent "que le système se trouve en décadence" et que nous "pouvons situer le début de la décadence globale du système capitaliste à partir de 1858". Affirmation pour le moins originale que nous avons rapidement critiquée sur le plan "économique" dans la Revue Internationale" n°40.
Nous voulons souligner ici les contradictions dans lesquelles les camarades risquent de s'enfermer. Leur affirmation sur "1858" reste abstraite et sans aucune référence historique. Mais dès qu'ils sont amenés à fonder les positions politiques de classe qu'ils défendent, dès qu'ils sont obligés de défendre dans les discussions leur position juste sur le cours historique et le développement de la lutte de classe (voir la réponse au BIPR dans Comunismo) ils ne se réfèrent plus à 1858, mais à la rupture historique que constitue 1914 et la première guerre mondiale qui marque le passage du capitalisme dans sa phase de décadence "par sa situation irréproductible et unique dans l'histoire..." selon les propres termes du C.C.A.
Et ne croyez pas que cette question ne concerne que des historiens pointilleux sur les dates, ni qu'elle constitue une question théorique en soi sans implications pratiques pour les révolutionnaires. La reconnaissance et la compréhension de la fin de la période historiquement progressiste du capitalisme et son entrée en déclin sont à la base de la formation de la IIIème Internationale sur les ruines de la IIème Internationale morte en 1914. Elles fondent la cohérence de l'ensemble des positions de classe que les camarades partagent avec le CCI. Et en particulier la dénonciation des syndicats comme organes de l'Etat capitaliste au 20ème siècle et des mouvements de libération nationale comme moment des antagonismes inter-impénalistes aujourd'hui.
2) Deuxième point que nous voulons soulever. Les contradictions des camarades dans leur effort de clarification sur la question des organisations et du parti politiques du prolétariat. Les camarades pensent que "la question de l'organisation des révolutionnaires et la constitution du parti politique du prolétariat sont des aspects centraux de toute réflexion théorique-politique qui essaie de se situer dans une perspective communiste". Nous sommes d'accord.
Mais du coup les camarades - pour le moins dans ce numéro de Comunismo- ont tendance à reprendre tels quels les thèses et les textes de l'Internationale Communiste et de Bordiga sans esprit critique et sans référence aux différents apports des fractions de gauche sur cette question. Camarades du C.C.A., vous risquez de tomber dans les erreurs du bordiguisme :
- en affirmant à tort l'invariabilité du programme communiste (cf. Revue Internationale n°32). Nous nous contenterons de réaffirmer l'unité et la continuité historiques du programme communiste. Ce qui ne change pas, ce qui est invariable c'est le but : la destruction du capitalisme et l'avènement du communisme. Les moyens et les implications immédiats, eux, varient, changent et sont enrichis par l'expérience même de la lutte de classe, du prolétariat. Pour ne donner que deux exemples de ces enrichissements : l'impossibilité pour le prolétariat de s'emparer de l'Etat bourgeois pour l'utiliser à ses fins révolutionnaires et la nécessité de le détruire pour imposer sa dictature de classe est la leçon principale que tirèrent Marx et Engels de la Commune de Paris contrairement à ce qu'ils avaient exprimé auparavant ; l'impossibilité d'utilisation par le prolétariat du syndicat dans la période de décadence contrairement au 19ème siècle.
C'est Bordiga et ses "héritiers" qui ont développé dans les années 40 et 50, contre les idées que le marxisme était dépassé, l'idée poussée jusqu'à l'absurde de l'invariance du programme communiste depuis 1848, depuis la première édition du Manifeste Communiste. Au contraire, c'est justement une des forces de la fraction italienne de la Gauche Communiste - avec laquelle était en rapport et en accord le GTM du Mexique dont se revendiquent les camarades du C.C.A. -d'avoir su passer au crible de la critique la vague révolutionnaire des années 1917-23 et les positions de la IIIème Internationale ;
- en reprenant telle quelle la citation de Bordiga (I1 Soviet, 21 septembre 1919) :"Tant qu'existe le pouvoir bourgeois, l'organe de la révolution est le parti ; après la liquidation du pouvoir bourgeois, c'est le réseau des conseils ouvriers". Là, Bordiga commet une erreur en confondant les organisations politiques du prolétariat dont le rôle sera sans aucun doute plus important après la prise du pouvoir par le prolétariat, d'avec les organisations unitaires de la classe que sont les conseils ouvriers existant sur la base des assemblées regroupant tous les ouvriers ; et ces "soviets (les conseils) sont les organes de préparation des masses à l'insurrection et, après la victoire, les organes du pouvoir." (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe). Camarades du C.C.A., cette vision de Bordiga et du bordiguisme d'une "invariance du programme" et d'un parti pouvant se substituer à la classe ouvrière mène aujourd'hui soit à la sclérose, soit au néant, soit à la contre-révolution comme l'a illustré l'évolution récente du courant "bordiguiste".
LE REGOUPEMENT DES REVOLUTIONNAIRES.
La publication de Comunismo et le développement d'un petit milieu révolutionnaire autour du C.C.A., aussi faible soit-il, confirme la possibilité d'apparition et de regroupement d'éléments révolutionnaires dans le monde entier, y compris dans les pays du "Tiers-Monde". Mais ' pour cela, les éléments révolutionnaires doivent rompre clairement, nettement et sans hésitation avec le "tiers-mondisme", avec tout type de nationalisme et le gauchisme. C'est à ce prix qu'ils pourront développer une réelle clarification politique et une réelle activité révolutionnaire. C'est ce qui constitue la force de Comunismo.
Les organisations politiques du prolétariat déjà existantes (principalement situées en Europe) doivent être très fermes sur cette indispensable rupture avec tout nationalisme si elles veulent assumer la tâche de pôle de référence et de regroupement au niveau international, si elles veulent participer et aider au surgissement d'éléments et de groupes révolutionnaires. C'est une des tâches essentielles que le CCI s'est toujours donnée et qu'il essaie de remplir avec ses faibles forces : "concentrer les faibles forces révolutionnaires dispersées dans le monde est aujourd'hui, dans cette période de crise générale, grosse de convulsions et de tourmente sociales, une des tâches les plus urgentes et les plus ardues qu'affrontent les révolutionnaires" (Revue Internationale n°1, avril 1975).
C'est dans ce sens que le CCI aidera autant qu'il le peut les camarades du C.C.A. dans leur effort militant d'intervention dans la lutte de classe et dans leur volonté de débat dans le milieu révolutionnaire. L'accomplissement de ces tâches par Comunismo permettra le développement d'un milieu révolutionnaire au Mexique et surtout, à terme, - et là est le plus împortant- une réelle présence politique du prolétariat. Pour cela Comunismo est l'instrument indispensable dont avait besoin le prolétariat au Mexique. Longue vie à Comunismo !
CCI
Géographique:
- Mexique [36]
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 45 - 2e trimestre 1986
- 2458 reads
La lutte ouvrière en 1985 : bilan et perspectives
- 2538 reads
Une année de combats particulièrement difficiles, qui se sont heurtes a une bourgeoisie de plus en plus adroite, mais aussi de plus en plus apeurée. La perspective de ces combats : l'unification a travers un long processus d'expériences et d'affrontements.
Comme toujours au début de l'année, les médias de la classe dominante ont tiré le "bilan social" de l'année précédente. A les entendre et les lire, ils sont tous d'accord sur un point : l'année 1985 a été marquée par un recu1 généralisé de la lutte ouvrière.
A longueur de pages, ils publient des statistiques montrant la diminution du nombre de grèves et de "journées perdues pour fait de grève". Puis ils expliquent : en ces temps de crise, les ouvriers ont enfin compris que leurs intérêts ne sont pas contradictoires avec ceux des entreprises qui les emploient. Alors, pour mieux défendre leur emploi, ils s'abstiennent de faire grève.
En quelque sorte, la crise économique, loin d'exacerber les antagonismes entre les classes, les aurait au contraire estompé. La crise démontrerait la véracité de la vieille chanson qu'entonnent les exploiteurs aux exploités lorsque leurs affaires vont mal : "nous sommes tous dans le même bateau". Même la plupart des groupes du milieu politique prolétarien se rangent à l'analyse d'un recul de la lutte de classe.
Il n'y a -pour ainsi dire- que le CCI qui développe une vision contraire, reconnaissant une reprise internationale de la lutte 'ouvrière depuis la fin 1983. Une reprise (la troisième après les vagues de 1968-74 et 1978-80) qui touche toutes les parties du monde ; évidente dans les pays sous-développés, elle apparaît clairement dans les pays développés -en particulier en Europe occidentale- à condition de regarder la réalité de la lutte de classe en sachant la resituer dans sa dynamique historique et internationale.
Le paradoxe de cette situation, c'est que la bourgeoisie, ses gouvernements et l'ensemble de son appareil politique (partis et syndicats), malgré leur propagande, ne se trompent pas, et n'ont de cesse de développer et d'employer un arsenal d'instruments économique, politique et idéologique, pour conjurer, affronter, la combativité prolétarienne. La bourgeoisie montre dans la pratique sa peur de la menace ouvrière, alors que des groupes révolutionnaires se lamentent pitoyablement sur le fait que le mouvement de leur classe ne soit pas plus rapide, plus spectaculaire, ou plus immédiatement révolutionnaire.
Nous nous attacherons dans cet article :
1°) à démontrer que la réalité de la lutte de classe en 1985 dément radicalement cette idée de la soumission passive du prolétariat mondial aux nécessités du capital en crise ;
2°) à dégager les perspectives qui en découlent pour le combat prolétarien mondial.
COMMENT ENVISAGER LES FAITS
Avant de tracer un rapide tableau chronologique des luttes ouvrières dans le monde au cours de l'année1985, il est indispensable de faire quelques remarques :
Il est vrai que, de façon générale, dans les pays d'Europe occidentale les statistiques officielles du nombre de grèves et de journées de travail perdues pour fait de grève est resté bas en 1985, en comparaison des niveaux atteints à la fin des années 60 ou pendant les années 70. Mais un tel constat ne suffit pas pour déterminer le sens de la dynamique de la lutte ouvrière... encore moins pour conclure à un ralliement des ouvriers' aux nécessités de la logique économique capitaliste.
Premièrement, les statistiques de grèves (pour autant qu'elles ne soient pas trop faussées par la volonté des gouvernements toujours soucieux de démontrer leur capacité à maintenir "la paix sociale") sont généralement gonflées par de longues grèves sectorielles, isolées (telle la grève des mineurs britanniques). Or, une des caractéristiques majeures de l'évolution de la lutte ouvrière au cours des dernières années, particulièrement confirmée en 1985, c'est la tendance à abandonner cette forme d'action -spécialité des syndicats- dont l'inefficacité apparaît de plus en plus clairement aux yeux des travailleurs européens.
Comme nous le verrons, le type de lutte courte et explosive, surgissant généralement hors de toute consigne syndicale et cherchant rapidement à s'étendre, telles la grève d'octobre en. Belgique ou celle du métro parisien en décembre 1985, beaucoup plus caractéristiques et significatives de la période à venir, ne comptent que pour très peu (ou pas du tout) dans les statistiques off4cielles de grèves.
De ce point de vue, la faiblesse des statistiques du nombre de jours de grève ne traduit pas mécaniquement un recul de la lutte ouvrière mais exprime une certaine maturation de sa conscience.
Deuxièmement, faire grève en 1985 n'a pas la même signification que faire grève en 1970. La menace de chômage qui pèse sur chaque travailleur comme une épée de Damoclès d'une part, l'action concertée de l'ensemble des forces de la bourgeoisie -avec les syndicats aux premiers rangs- pour empêcher toute mobilisation de classe d'autre part, font qu'au milieu des années 80 il est beaucoup plus difficile pour les travailleurs de se lancer à la lutte que pendant les années 70 ou à la fin des années 60. Ce serait faire abstraction de toute la gravité de l'évolution historique des quinze dernières années que de vouloir comparer quantitativement et mettre sur le même plan une "journée de grève" d'aujourd’hui avec une de la décennie précédente. En ce sens on peut dire qu'une grève du milieu des années 80 est plus significative qu'une grève des années 70 ou 60.
Troisièmement : aucune statistique de grèves ne peut rendre compte de cet autre aspect crucial de l'action ouvrière que constitue à notre époque la lutte des chômeurs. Même si celle-ci reste encore pour le moment à ses premiers balbutiements, les débuts d'organisation de comités de chômeurs en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, représentent un élément important -et ignoré par ces statistiques- de l'actuelle combativité ouvrière.
1985 : LA CLASSE OUVRIERE MONDIALE REFUSE DE SE PLIER PASSIVEMENT A LA LOGIQUE DU CAPITAL EN CRISE.
L'idée d'après laquelle la crise pousserait les ouvriers à épouser la logique de la rentabilité capitaliste est peut-être un rêve chimérique de la classe dominante. Mais la réalité mondiale dément quotidiennement ces mensonges propagandistes.
En tenant compte des remarques que nous venons de formuler sur la signification des luttes ouvrières actuelles dans les pays les plus développés, un rapide aperçu des principales luttes ouvrières qui ont marqué mois par mois, aux quatre coins de la planète, l'année 1985, suffit à ridiculiser ces assertions.
La liste qui suit ne prétend évidemment pas rassembler toutes les luttes importantes de l'année. La bourgeoisie a mené consciemment une politique de "black-out" systématique sur les informations concernant les luttes ouvrières. Ceci est déjà vrai au niveau de chaque pays, mais l'est encore plus au niveau international. C'est ainsi, par exemple, que nous, ne pourrons pour ainsi dire pas citer de luttes dans les pays dits "communistes", même si nous savons que la classe ouvrière s'y bat tout comme en occident.
Si le mois de janvier fut marqué par le déclin de la grève des mineurs britanniques, dès le mois de février au moment même où celle-ci se concluait, une nouvelle vague de luttes ouvrières commençait en Espagne et allait durer jusqu'en mars touchant entre autres les chantiers navals, l'automobile (en particulier Ford-Valencia), les postes de Barcelone (grève spontanée et qui resta longtemps sous le seul contrôle de l'assemblée des grévistes) et les journaliers agricoles de la région du Levant.
Le mois d'avril commença par l'explosion des luttes ouvrières dans ce "paradis du socialisme Scandinave" qu'est le Danemark avec une grève générale qui mobilise plus d'un demi million de travailleurs. Au cours du même mois, en Amérique latine, dans le pays du "miracle brésilien", en pleine "transition démocratique", 400 000 ouvriers partent en grève et paralysent la très moderne banlieue industrielle de Sao Paolo, la principale concentration industrielle du subcontinent américain (malgré les appels des nouveaux syndicats, les ouvriers refusent d'arrêter leur lutte à l'occasion de la mort spectaculaire du nouveau président "démocratique").
Le mois de mai voit l'éclatement des premières luttes importantes des mineurs d'Afrique du Sud. Le mois de juin commença marqué par la grève de 14 000 employés des hôtels de New York qui vit les travailleurs organiser par eux-mêmes l'extension de la lutte par l'envoi de piquets massifs. Le mythe des USA comme pays réduit à la paix sociale musclée de Reagan était encore une fois démenti et le sera encore à plusieurs reprises au cours de 1985. Toujours au mois de juin et toujours en réponse à des mesures d'austérité prises par le gouvernement local, en Colombie les grèves se multiplient et, le 20, les syndicats sont contraints d'organiser une grève générale. Le mois de juillet commence par le début, aux USA, de la grève des métallurgistes de Wheeling Pittsburg : le secteur de l'acier est violemment frappé aux USA. Leur lutte -dans une des principales zones industrielles de la première puissance mondiale- durera jusqu'à fin octobre.
En Grande-Bretagne, où depuis la fin de la grève des m meurs, les grèves n'ont jamais cessé, éclate hors de coûte consigne syndicale une importante grève clans les chemins de fer : elle s'étend rapidement et l'on verra dans le Pays de Galles des piquets de grève de cheminots briser les barrières corporatistes pour aider Les piquets d'une aciérie en grève. En France les principaux chantiers navals du pays partent en grève et par deux occasions, à Lille et à Dunkerque, les ouvriers débordent l'encadrement syndical et affrontent la police pendant plusieurs heures. En Israël, toujours en juillet, à l'annonce par le gouvernement du "socialiste" Pérès d'une série de mesures d'austérité (hausse de certains prix de 100 %, baisse des salaires de 12 à 40 %, licenciement de 10 000 fonctionnaires), les réactions ouvrières ne se font pas attendre : le syndicat (lié au parti au gouvernement) doit organiser une grève générale de 24 heures (suivie par 90 % de la population active). Mais au moment de la reprise du travail, des secteurs entiers tentent de continuer la lutte. Les bonzes syndicaux parlent de "risques réels de débordement". Au mois d'août, en Yougoslavie "socialiste", un train 4e mesures d'austérité déclenche une vague de grèves qui touche diverses régions du pays : des grèves particulièrement importantes mobilisent les mineurs et les travailleurs des ports.
Au mois de septembre c'est en Bolivie, un des pays les plus pauvres du monde mais où il existe une vieille tradition de luttes ouvrières -en particulier dans les mines- que l'annonce de mesures économiques particulièrement draconiennes (multiplication par 4 du prix du pain, par 10 du prix de la nourriture, par 20 du gaz domestique, en même temps qu'un gel des salaires des fonctionnaires pendant quatre mois 0 déclenche une réaction générale des travailleurs. Le principal syndicat, la C.O.B., appelle à une grève de 48 heures, largement suivie. Le mouvement est violemment réprimé. Du coup, les ouvriers prolongent la grève générale pendant encore 16 jours. En France, fin septembre, éclate, hors de toute consigne syndicale, dans les chemins de fer, la grève la plus importante dans ce secteur depuis la fin des années 60. Elle s'étend rapidement contraignant le gouvernement à suspendre -du moins pour l'immédiat- l'application des mesures de contrôle qui avaient déclenché le mouvement.
Au mois d'octobre, en Belgique, éclatent des grèves dans les postes, les chemins de fer, le métro de Bruxelles et les mines du Limbourg, qui suivent le même déroulement : démarrage hors des consignes syndicales et extension rapide dans leur propre secteur, "recul" momentané du gouvernement par crainte d'extension des mouvements. Au même moment, la Hollande connaît une vague de grèves analogues qui touche principalement les pompiers, les conducteurs de camions et différents secteurs du port de Rotterdam. Le 6 novembre, au moment même où les mineurs du Limbourg reprenaient le travail, en Grèce, 100 000 travailleurs du secteur public et privé faisaient grève contre les mesures d'austérité du gouvernement socialiste. Au cours du même mois une vague de grèves secouait à nouveau le Brésil (600 000 grévistes). En Argentine, où le nouveau gouvernement "démocratique" a imposé en 1985 des baisses de revenus allant jusqu'à 45 %, commence toute une période d'agitation et de luttes ouvrières qui se prolonge jusqu'en janvier 1986. Toujours en novembre, la Suède -encore un "paradis socialiste"- connaît, elle, la plus importante période de luttes ouvrières depuis la fin des années 60 : ouvriers des abattoirs dans le nord, mécaniciens de locomotives dans tout le pays, nettoyeuses industrielles de Borlange et surtout la grève des nourrices ("mères de jour") qui ont organisé par elles-mêmes, contre l'Etat et les syndicats, leur lutte dans tout le pays, culminant le 23 novembre par des manifestations Simultanées dans 150 villes différentes. Dans une manifestation, les travailleuses scandaient "le soutien des syndicats est notre mort !".
Au Japon, pays réputé pour l'absence de luttes ouvrières, une grève éclate contre la menace de licenciements massifs dans les chemins de fer. Le mois de décembre -pour terminer ce bref tour d'horizon de l'année 85- est, lui, marqué par une nouvelle reprise des grèves en Espagne : hôpitaux et services de santé à Barcelone ; les mines des Asturies (contre une recrudescence sans précédents des accidents de travail) ; la région de Vigo (Galice) et surtout la région de Bilbao, sont touchées par des grèves dans divers secteurs, à nouveau les chantiers navals mais aussi les chômeurs embauchés par la municipalité. En France, les conducteurs du métro de Pans, à la suite de mesures prises à rencontre de l'un d'eux, partent spontanément en grève et paralysent en quelques heures la capitale. Au Liban, déchiré par les guerres entre fractions de la bourgeoisie locale et les antagonismes internationaux, une hausse des prix de 100 % provoque une grève générale et des appels des travailleurs du secteur musulman au secteur chrétien disant : "la famine ne connaît pas de couleurs politiques et touche tout le monde sauf la minorité dominante".
C'est volontairement que nous avons présenté cet aperçu des principaux moments de la lutte ouvrière mondiale "en vrac", suivant uniquement leur succession chronologique.
Quelles que soient les différences qui existent entre les combats prolétariens dans les pays de la périphérie et ceux des pays centraux, ceux-ci ne sont que des moments d'une même lutte, une même réponse à une même attaque du capital mondial en crise. Il était nécessaire, dans un premier temps, de montrer clairement l'aspect mondial de la résistance ouvrière pour démentir cette absurdité suivant laquelle la crise économique aurait atténué la lutte de classe. Il était en outre nécessaire de mettre en évidence cette unité pour mieux dégager, à partir des différences entre les luttes ouvrières, la dynamique globale de celles-ci.
DIFFERENCES DE LA LUTTE OUVRIERE DANS LES PAYS CENTRAUX INDUSTRIALISES ET DANS CEUX DE LA PERIPHERIE
Un regard global aux luttes ouvrières dans le monde actuellement met en évidence le fait que dans les pays sous-développés celles-ci tendent à prendre rapidement une forme unifiée -même si c'est encore derrière les centrales syndicales- alors que dans les pays industrialisés les luttes, au cours de 1985, ont eu tendance à être moins massives à la fin de l'année qu'au début : après des mouvements comme ceux des mineurs britanniques ou la grève générale au Danemark, on assiste à une multiplicité de luttes plus courtes, plus explosives, plus simultanées mais aussi plus isolées les unes des autres.
Cela tient essentiellement à la différence des effets de la crise suivant le degré de développement économique du pays et aux stratégies que la classe dominante est amenée à réaliser en fonction des conditions socio-politiques auxquelles elle est confrontée.
Dans les pays sous-développés dont l'économie est en banqueroute totale, les mesures dites "d'austérité" qu'est contraint de prendre le capital contre les travailleurs revêtent inévitablement un caractère beaucoup plus violent, direct et massif. Le capital n'y possède aucune marge de manoeuvre économique. Des mesures comme les hausses vertigineuses des prix des biens de consommation, les réductions des salaires réels de l'ordre de 30, 40 %, les licenciements immédiats et massifs comme on les a vus au cours de 1985 dans des pays comme la Bolivie, l'Argentine ou le Brésil, sont des attaques qui touchent simultanément et immédiatement l'ensemble des travailleurs.
Cela crée les bases objectives pour des mouvements d'ampleur pouvant rapidement unifier des millions de travailleurs.
Pour faire face à de tels mouvements, les bourgeoisies locales n'ont généralement eu d'autre recours que la plus sauvage et impitoyable répression. Répression qui est rendue possible par la faiblesse numérique et historique du prolétariat local et par le fait que la classe dominante peut recruter ses forces de répression dans une masse gigantesque de sans-travail marginalisés depuis des générations.
Mais de telles méthodes s'avèrent de moins en moins, suffisantes et créent le risque d'une déstabilisation totale de la société (comme on l'a vu en Bolivie, la répression n'a fait cette fois qu'exacerber la lutte ouvrière). C'est pourquoi l'on assiste à des simulacres de "démocratisation" des régimes des pays sous-développés souvent sous la pression des puissances impérialistes (voir les pressions des USA et ses alliés européens en ce sens en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Haïti, Philippines), dans le seul but de créer des appareils syndicaux et politiques capables de contrôler les luttes ouvrières (autrement plus dangereuses que les émeutes de la faim devenues chroniques dans certains de ces pays) et les conduire dans les impasses nationalistes.
Ces nouveaux appareils d'encadrement jouissent en outre de la force que leur octroie le manque d'expérience de la "démocratie" bourgeoise des travailleurs de ces pays et les illusions que ceux-ci entretiennent -du moins au début- à leur égard après avoir subi des années de dictature militaire ou civile.
Wans les pays développés -et plus particulièrement en Europe occidentale- la situation est tout autre. Sur le plan économique, la bourgeoisie dispose encore d'une marge de manoeuvre qui -même si elle ne cesse de se réduire chaque jour sous l'effet de la crise de son système- lui permet de mieux étaler, planifier ses attaques de façon à éviter la prise de mesures trop directement globales, frappant immédiatement et violemment un grand nombre de travailleurs à la fois. Les attaques qu'elle porte sont de plus en plus puissantes et massives mais elle s'applique à en disperser les retombées de sorte qu'elles apparaissent à chaque secteur de la classe ouvrière comme une attaque particulière, spécifique. Si l'on compare l'année 1984 avec l'année 1985 à ce niveau, on constatera qu'il s'agit d'une politique consciente de la bourgeoisie.
Les fameuses politiques de "privatisation" du secteur public de l'économie et de développement d'un soi-disant libéralisme économique au niveau de la vie des entreprises s'inscrivent parfaitement dans cette stratégie ([1] [957]). Les licenciements "pour raison de restructuration industrielle" apparaissent ainsi comme une affaire particulière d’embaucher dans les nouvelles entreprises privées qui "sauvent" les vieilles grandes entreprises en faillite. Le nombre de licenciements est le même- mais ceux-ci apparaissent éparpillés en autant d'entreprises, de "cas particuliers".
Sur ce plan, la bourgeoisie mondiale semble avoir tiré les leçons de la grande peur qu'elle eut avec la Pologne en 1980 : dans les pays de la périphérie elle comprend que lorsque la répression brutale et massive ne suffit plus, il est indispensable de créer des "Solidarnosc" locaux capables de saboter les mouvements sociaux de l'intérieur ; dans les pays les plus industrialisés elle sait que des attaques économiques trop grossièrement menées (comme celle qui, en août 80, déclencha l'explosion des villes ouvrières de la Baltique) lui font courir des risques trop importants pour le maintien de l'ordre social.
L'EUROPE OCCIDENTALE : LIEU DES AFFRONTEMENTS LES PLUS DETERMINANTS
Comme nous lavons à maintes reprises démontré en particulier au moment de tirer des leçons de la Pologne 80- c'est en Europe occidentale, la plus ancienne et la plus importante concentration industrielle du monde, que se jouent les affrontements les plus décisifs pour la lutte ouvrière mondiale ([2] [958]). C'est là que se trouve le prolétariat le plus concentré et le plus expérimenté. Mais c'est aussi là que règne la bourgeoisie la plus rompue à la lutte de classes. Cette politique de dispersion des luttes ouvrières par une apparence de dispersion de l'attaque économique n'est en réalité qu'un volet, un aspect de l'arsenal complexe et systématiquement développé par la bourgeoisie dans cette partie du monde pour affronter les luttes ouvrières.
Au cours de l'année 1985 on a pu voir la bourgeoisie européenne recourir à l'ensemble de ces moyens et les développer de façon de plus en plus concertée.
C'est ainsi qu'elle a eu recours simultanément
1°) au partage du travail entre ses différentes forces politiques et' syndicales ;
2°) aux campagnes idéologiques ;
3°) à la répression.
Le partage du travail entre, d'une part des gouvernements qui -de droite ou de gauche- ont systématiquement appliqué des politiques de "rigueur", c'est-à-dire de renforcement de l'exploitation et, d'autre part des forces de "gauche" (partis et syndicats) qui, chargés d'assurer l'encadrement des rangs ouvriers, ont radicalisé leur langage pour mieux canaliser les réactions prolétariennes dans des impasses ou, plus simplement, saboter toute mobilisation importante sur un terrain de classe.
Au cours de l'année 1985 ce mouvement de "radicalisation" des forces de gauche de l'appareil politique du capital s'est manifesté d'abord par le développement et le recours de plus en plus fréquent au "syndicalisme de base", c'est-à-dire à des tendances syndicalistes (généralement animées par des gauchistes) qui critiquent les directions et les appareils des grandes centrales mais pour mieux défendre le terrain syndical. Particulièrement actives en Belgique (mines du Limbourg), elles ont joué un rôle important dans les grèves en Grande-Bretagne (appui aux shop stewards), en Espagne, aux Etats-Unis, en Suède... Les grandes centrales elles-mêmes ont radicalisé leur langage. Cela a été notoire pour la CGT en France qui cherche à faire oublier la participation de son parti tuteur, le PCF, au gouvernement pendant trois ans ; pour L.O. en Suède, syndicat lié au parti socialiste au gouvernement et qui s'est vu de plus en plus débordé au cours des luttes en fin d'année ; pour l'UGT en Espagne qui, appuyant trop ouvertement le PSOE au pouvoir, passait de plus en plus pour un syndicat jaune.
Mais ce radicalisme de langage n'a servi qu'à mieux masquer un travail systématique de démobilisation.
Contrairement à ce qu'ils faisaient au cours des années 60 ou 70, lorsqu'ils pouvaient se permettre d'organiser de grandes manifestations de rue pour mieux redorer leur blason de "défenseurs des travailleurs", les syndicats européens ne prennent plus de tels risques aujourd'hui. Ils savent que la méfiance croissante des travailleurs à leur égard (qui se concrétise par une désertion massive des syndicats) n'a d'égal que la colère sourde qui gronde dans les rangs des exploités. Ils savent que toute manifestation importante de travailleurs sur un terrain de défense claire de leurs revendications de classe ([3] [959]) risque à tout moment d'échapper à leur contrôle. C'est pourquoi on assiste dans la plupart des pays européens à une stratégie syndicale qui consiste soit à convoquer des manifestations en ne donnant l'heure et le lieu de rassemblement qu'à la dernière minute et de la façon la plus discrète possible, de façon à n'y voir que les éléments les plus proches des appareils syndicaux, soit à convoquer de nombreux rassemblements mais dans des lieux différents d'une même ville en prenant soin d'éviter que les cortèges ne puissent se rencontrer (en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, les syndicats sont devenus maîtres à ce jeu de dispersion de la combativité prolétarienne).
Les campagnes idéologiques - Sur ce terrain encore, l'action de la bourgeoisie a été particulièrement fertile. Les ouvriers européens ont été matraqués quotidiennement par des campagnes sur :
- l'inutilité de la lutte en temps de crise -surtout après la défaite de la grève des mineurs britanniques;
- le bonheur de vivre dans des pays "démocratiques" surtout au moment des luttes en Afrique du Sud ;
- le terrorisme, cherchant à assimiler toute lutte contre l'Etat à du terrorisme en Belgique cette campagne a pris des proportions gigantesques et a abouti, entre autres, à la décision de mettre des forces armées d'élite à la porte de certaines usines...afin de mieux les défendre contre le terrorisme!; la défense des régions, du secteur, voire de l'entre prise, cherchant à faire croire aux travailleurs en lutte que la défense de leurs conditions d'existence devrait se confondre avec celle des instruments de leur exploitation ("défense du charbon national" (Limbourg, Ecosse, Asturies) défense de la région (Pays Basque en Espagne, la Lorraine en France, la Wallonie en Belgique, etc, etc.).
La répression - A côté des moyens économiques, politiques, idéologiques, la bourgeoisie européenne n'a cessé de développer aussi les instruments de la répression policière. L'année 1985 a été marquée à ce niveau en particulier par les exemples de la Belgique, dont nous avons fait déjà mention, et surtout celui de la Grande-Bretagne où, à la suite de la grève des mineurs et les émeutes de Birmingham et Brixton, la bourgeoisie a procédé à un renforcement sans précédents dans l'histoire de ce pays des forces et des moyens de répression des luttes sociales.
PERSPECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE
Mais si la bourgeoisie mondiale -et en particulier celle d'Europe occidentale- a été conduite au cours de 1985 à développer de telle sorte tous les moyens de la défense de son système, c'est parce qu'elle a peur. Et elle a raison d'avoir peur.
La troisième vague internationale de luttes ouvrières n'en est qu'à ses débuts et la lenteur de son développement exprime la profondeur du bouleversement qu'elle prépare.
La tendance en Europe occidentale -dont dépend l'avenir de la lutte ouvrière mondiale- à l'abandon par les ouvriers des formes de lutte consistant en des grèves longues, isolées dans des forteresses symboliques, traduit -même si cela prend encore une forme trop dispersée- une assimilation d'années d'expériences et de défaites dont la grève des mineurs britanniques a été un des derniers exemples spectaculaires. En ce sens, l'année 1985 a marqué en Europe une avancée.
Quant à cette dispersion, les bases sur lesquelles .repose l'actuelle stratégie d'éparpillement des luttes ouvrières en Europe occidentale, sont appelées à s'user de plus en plus rapidement sous l'effet de l'aggravation de la crise économique et de l'expérience cumulée de l'affrontement de la combativité ouvrière avec les carcans syndicaux.
La faible marge de manoeuvre économique dont dispose encore la bourgeoisie des pays industrialisés ne peut aller qu'en s'amenuisant au fur et à mesure que s'exacerbent les contradictions internes de son système et que s'épuisent ses palliatifs à la crise, tous fondés sur le recul des échéances par une fuite en avant dans le crédit. Sur ce plan-là, ce sont les pays sous-développés qui montrent l'avenir aux régions plus industrialisées.
Quant â la capacité de sabotage des luttes ouvrières que possèdent encore syndicats et autres forces "de gauche" du capital, la confrontation permanente, le heurt répété et omniprésent entre la poussée des forces prolétariennes et les barrières idéologiques et pratiques de ces institutions, conduit lentement, mais Irréversiblement, vers la création des conditions de l'épanouissement d'une véritable autonomie de la lutte ouvrière. L'abandon des casernes syndicales par un nombre toujours croissant d'ouvriers à travers toute l'Europe la multiplication- des luttes qui démarrent et cherchent à s'étendre en dehors des consignes syndicales en sont un témoignage in équivoque. La conscience de sa force, les moyens de développer celle-ci face aux attaques du capital, la classe ouvrière ne peut les obtenir que par le combat lui-même un combat qui l'affronte non seulement aux gouvernements et aux patrons, mais aussi aux syndicats et aux forces politiques de la gauche du capital.
La perspective de la lutte de classe c'est la poursuite de la lutte. Et la poursuite de la lutte est et sera de plus en plus le combat contre la dispersion, pour l'unification.
Au bout de l'actuel processus de développement d'une effervescence omniprésente internationalement, il y a l'internationalisation des luttes ouvrières.
R.V.
UNE MEME LUTTE DANS DES MOMENTS HISTORIQUES DIFFERENTS
Grèves d'hier et d'aujourd'hui
Voilà près de deux siècles que la classe ouvrière fait des grèves pour résister et combattre l'exploitation Capitaliste qu'elle subit plus directement que toute autre classe exploitée. Cependant toutes les grèves n'ont évidemment pas la même signification suivant la période historique dans laquelle elles se situent. Les grèves ouvrières de notre époque traduisent, comme celles du début du XIX° siècle, le même antagonisme et la même guerre entre la classe exploitée porteuse du communisme et la classe exploiteuse qui profite, défend et assure la reproduction de l'ordre social établi. Mais les luttes ouvrières actuelles n'affrontent pas, comme au XIX° siècle, un capitalisme en pleine jeunesse, conquérant le monde et faisant faire à l'humanité des progrès sans précédents dans tous les domaines. Les grèves des "années 80" combattent la réalité d'un système sénile, décadent, qui après avoir plongé par deux fois l'humanité dans les horreurs des deux guerres mondiales, après avoir connu à partir des années 50 vingt ans de prospérité relative en reconstruisant ce qu'il avait détruit auparavant et en développant un armement capable de détruire plusieurs fois la planète, se débat depuis la fin des années 60 dans une crise économique sans précédent.
Les luttes ouvrières actuelles, parce qu'elles constituent la seule résistance effective, réelle, à la barbarie totalitaire du capitalisme décadent, représentent la seule source de lumière pour une humanité en proie à "l'effroi sans fin" ".
Mais la blessure mortelle que porte le capitalisme, dont les lois sont devenues historiquement obsolètes, ne rend pas pour autant celui-ci plus conciliant envers ses esclaves. Au contraire. La classe ouvrière affronte aujourd'hui une bourgeoisie cyniquement expérimentée, adroite, capable d'agir de concert au niveau national et international (Pologne 80), pour faire face aux luttes ouvrières.
Parce que les enjeux historiques sont plus graves, parce que les difficultés rencontrées sont plus grandes, toute manifestation de résistance ouvrière prend aujourd'hui une signification d'autant plus importante. Ceux qui actuellement, au nom d'un "radicalisme" de parole, regardent grève après grève, lutte après lutte, avec un "mépris transcendental" parce qu'ils ne les trouvent pas encore assez "révolutionnaires", ne font qu'exprimer l'impatience de celui qui ignore tout de la révolution et de la complexité du processus qui la %' prépare. On ne peut rien comprendre aux luttes ouvrières présentes si on "oublie" cette nécessité élémentaire de les replacer dans leur contexte, dans leur dynamique historique.
R.V.
[1] [960] Sur le plan économique, le poids de l'Etat n'a jamais été aussi grand qu'actuellement...et il ne cesse de se développer. Il suffit de voir l'augmentation incessante de la part du revenu national qui, sous une forme ou sous une autre, passe par les mains de l'Etat, pour s'en convaincre La seule utilité qu'a sur le plan strictement économique cette politique dite "libérale", c'est d'accélérer les concentrations de capitaux par l'élimination plus rapide de secteurs et entreprises non rentables au profit des grands capitaux.
[2] [961] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest, au coeur de la lutte de classe" (Revue Internationale n° 31).
[3] [962] Evidemment, les forces de gauche sont toujours prêtes à mobiliser les travailleurs mais sur des terrains inter-classistes ou ambigus : voir la campagne anti-OTAN en Espagne actuellement ou celle pour les "droits démocratiques" de grève en R.F.A.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise économique ?
- 2469 reads
BAISSE DU PRIX DU PETROLE, BAISSE DU DOLLAR, LA RECESSION A L'HORIZON
Le texte qui suit est composé d'extraits de la partie sur la crise économique du rapport sur la situation internationale du 6ème congrès du CCI. Ce rapport a été rédigé à la mi-85; les éléments chiffrés les plus récents qu'il contient datent 'donc de cette période; cependant les analyses et orientations qu'il défend ont été amplement confirmées depuis.
Ces derniers mois, le marché mondial a été soumis à d'importantes secousses :
- la chute du dollar s'est accélérée et un an après avoir battu des records historiques (10,61 Frs le 28.2. 85), le roi dollar se retrouve à son niveau d'octobre 1977 (6,79 Frs et 2,20 DM le 28.2.86).
- depuis le début de l'année 86 les cours du pétrole ont fait le grand plongeon, le prix du baril passant de 28 $ à 14 $, soit une diminution de moitié du prix de l'or noir ;
- tous les cours des matières premières ont dans l'ensemble chuté et depuis l'automne la bourse des métaux de Londres est secouée par l'effondrement des cours de l'étain dont la cotation est interrompue depuis le 24.10.85, sans avoir repris depuis;
- la spéculation boursière est acharnée et partout les cours boursiers ont fortement progresse : à New York, à Londres, Paris, Tokyo etc., mais cette situation est fragile et en janvier la bourse de New York a connu une sérieuse alerte avec la plus forte chute de l'indice Dow Jones depuis la chute historique du jeudi noir de 1929.
Cette liste qui pourrait être encore allongée illustre les ravages de plus en plus importants de la crise de surproduction généralisée sur l'économie mondiale, l'accélération de la crise et l'instabilité croissante du marche mondial.
Pourtant, la classe dominante ne cesse de proclamer que "tout va bien !" : les politiciens de tous bords promettent toujours l'amélioration pour demain et les technocrates prétendent en se voulant rassurants; maîtriser la situation. Les travailleurs peuvent dormir tranquilles : malgré les records de chômage battus en Europe, malgré la misère qui recouvre le monde, il ne faut pas s'inquiéter car nos gouvernants contrôlent la situation !
Pourtant en fait l'inquiétude monte avec la déstabilisation grandissante de l'économie mondiale et les discours lénifiants de la bourgeoisie sont une litanie dont elle-même voudrait bien parvenir à se convaincre. La baisse du dollar est posée comme une mesure d"'assainissement" du marché mondial tandis que la chute des cours du pétrole est présentée comme une "aubaine" : la réalité est cependant bien inquiétante Car ce qui se profile au-delà c'est l'horizon de la récession. C'est cette perspective dont nul aujourd'hui n'est capable au sein de la classe dominante d'en mesurer les conséquences qui fait monter une angoisse Sourde au sein de la bourgeoisie.
La baisse du dollar à la suite de la première réunion du groupe des cinq (USA, Japon, RFA, Grande-Bretagne, et France) pourrait faire croire à une parfaite maîtrise des échanges monétaires de la part des grandes puissances. Pourtant, cette baisse traduit une nécessite impérieuse pour l'économie américaine, celle de retrouver sa compétitivité sur le marché mondial. Elle traduit l'échec et la fin de la politique de reprise menée par le gouvernement Reagan. La maîtrise dont fait preuve la bourgeoisie ne parvient qu'à limiter provisoirement les dégâts, si elle freine la dégradation de l'économie mondiale, elle ne parvient cependant pas à l'empêcher et celle-ci inéluctablement se poursuit.
Les conséquences de la baisse du dollar sont catastrophiques pour l'Europe et le Japon qui voient leur compétitivité grevée d'autant et se profiler ainsi le spectre de la récession. Face à une telle situation la 2ème réunion du groupe des cinq avait pour but de poser l'éventualité d'une baisse concertée des taux d'intérêts afin de relancer les marchés intérieurs et la production. Cette réunion a été présentée comme un échec devant les risques que constitueraient pour le dollar une baisse trop forte et trop rapide des taux américains :
- crise de confiance des spéculateurs du monde entier;
- relance accélérée de l'inflation.
Cependant ce n'est certainement pas un hasard si c'est au lendemain de cette réunion que s'est brutalement accélérée la chute des cours du pétrole. Cette chute n'est pas déterminée en soi par la bourgeoisie, elle est d'abord l'expression de la crise de surproduction; cependant elle tombe à point pour donner un ballon d'oxygène provisoire aux économies les plus développées. Non seulement, elle permet de faire baisser l'inflation, mais surtout elle permet de faire diminuer de moitié le coût de la première importation des principaux pays développés, et de faire de substantielles économies notamment en Europe et au Japon. Voilà les fonds pour financer une mini relance!
Conjoncturellement, la bourgeoisie du bloc occidental avait intérêt à faire accélérer la chute des cours du pétrole ; cependant, cette "politique" traduit la marge die manoeuvre de plus en plus restreinte de la bourgeoisie qui, sur le plan économique, en est réduite à des expédients pour gagner quelques mois de répit. En effet, à terme, la chute des cours du pétrole signifie un nouveau rétrécissement significatif du marché mondial, qui va se traduire par une nouvelle baisse des échanges, et donc une baisse des exportations des pays^ industrialisés, et donc de leur production : c'est la récession.
Quelles que soient les arguties de la propagande capitaliste et la capacité de la bourgeoisie de manoeuvrer au mieux de ses intérêts, la crise est là, de plus en plus aiguë, et les prétendus succès économiques ne font en fait que traduire l'incapacité de plus en plus, grande de la classe dominante à y faire face. Irrésistiblement, la récession se profile à l'horizon, et les soubresauts présents du marché mondial annoncent les tempêtes futures qui vont le secouer.
23 février 86.
Situation internationale : extraits du rapport au 6eme congres du CCI (août 1985)
UNE CRISE DE SURPRODUCTION GENERALISEE
L'ACCELERATION DE LA TENDANCE A LA PAUPERISATION ABSOLUE
Aujourd'hui en 1985, 40 000 êtres humains meurent de faim chaque jour et la FAO nous prédit qu'avant l'an 2000 ce seront 200 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui périront faute de nourriture. Selon la FAO toujours, 1/3 de la population du tiers-monde ne dispose pas du minimum reconnu nécessaire pour subsister physiquement, 835 millions d'habitants de la planète disposent de moins de 75 $ par an.
Le ministre de la santé du Brésil, pays naguère présenté comme un exemple de développement, avoue que près de la moitié (55 millions de personnes) de la population est malade : tuberculose, lèpre, malaria, schisostomiose et autres maladies parasitaires ; 18 millions souffrent de troubles mentaux. Dans les sept Etats du Nordeste brésilien, plus de la moitié des enfants meurt avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Des millions d'autres sont aveugles (carence en protéines), sous-alimentés, infirmes. Le gouvernement brésilien évalue à 15 millions le nombre d'enfants mineurs abandonnés. Le miracle brésilien est bien oublié.
Les 450 millions d'habitants d'Afrique ont l'espérance de vie la plus courte du monde : 42 ans en moyenne. L'Afrique a le plus fort taux de mortalité infantile : 137 décès au cours de la première année de vie pour 1000 naissances. Du Maroc à l'Ethiopie, la famine fait rage tout au long du Sahel : en 1984, 300 000 morts de faim en Ethiopie, 100 000 au Mozambique. Au BenglaDesh, depuis 1982, 800 000 personnes ont perdu la vue par suite de manque de protéines. Pour plus des 2/3 des hommes de notre planète, chaque jour et chaque nuit sont un interminable calvaire.
Les années 80, qui ont vu s'aggraver sans cesse la misère dans le monde jusqu'à un point jusqu'alors inconnu de l'humanité dans toute son histoire, qui n'avait jusqu'à présent jamais vécu une telle extension de la famine sur la planète, ont définitivement mis fin à l'illusion d'un quelconque développement des pays sous-développés.
L'écart entre les pays développés et les pays en constant sous-développement ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui 30% de la population du monde vit dans les pays industrialisés d'Europe (URSS comprise), d'Amérique du Nord, du Japon et d' Australie, représentant 82 % de la production mondiale et 91 % de toutes les exportations.
Ce n'est certainement pas un des moindres paradoxes que de voir la bourgeoisie utiliser la misère dont son système d'exploitation est responsable pour faire croire aux prolétaires des pays industrialisés qui produisent l'essentiel des richesses de la planète qu'ils sont des privilégiés qui, finalement, auraient; bien tort de se plaindre. Les incessantes campagnes médiatiques sur la famine, plus que de soulager la misère des affamés - plan sur lequel elles ont depuis longtemps montré leur inefficacité - ont pour but de culpabiliser cette fraction déterminante du prolétariat mondial qui se trouve au coeur des métropoles industrielles, de lui faire accepter sans réagir sa propre misère qui va en s'aggravant.
La première moitié des années 80 a été marquée par une dégradation brutale des conditions de vie dans les pays développés. A cet égard, l'évolution du chômage est particulièrement significative : ainsi, pour les pays européens de l'OCDE, il était de 2,9% en 1968, de 6,2% en 1979 et de 11,1% début 85, atteignant 21,6% pour l'Espagne et 13,3% pour le plus vieux pays industriel du monde, la Grande-Bretagne. Et encore, ces chiffres officiels (OCDE) sont-ils profondément sous-estimés, en deçà de la réalité. 25 millions d'ouvriers sont au chômage en Europe de l'Ouest et voient leurs conditions de vie, ainsi que celles de leur famille, se dégrader avec la baisse des indemnisations de l'Etat.
Mais le chômage n'est qu'un indice encore insuffisant de la pauvreté qui se développe dans les pays industrialisés. Ainsi, en France, si le chômage atteint 2,5 millions de personnes, ce sont 5 à 6 millions de personnes qui survivent avec moins de 50 francs par jour.
Aux Etats-Unis, pays le plus riche du monde, la faim gagne du terrain. Si, en 1978, il y avait 24 millions d'américains en dessous du seuil de pauvreté, ils sont aujourd'hui 35 millions.
Quant à l'URSS, ce ne sont certainement pas les chiffres du chômage qui peuvent donner un indice de la dégradation des conditions de vie de la population. Citons seulement un chiffre qui donne une idée de la misère croissante : l'espérance de vie est passée de 66 ans en 1964 à 62 ans en 1984.
"Nouveaux pauvres", "quart-monde", les termes ont fleuri pour décrire cette misère que l'on croyait réservée aux pays sous-développés. La tendance à la paupérisation absolue s'affirme aujourd'hui comme une sinistre réalité partout dans le monde, non seulement dans les mouroirs des bidonvilles et des campagnes du "tiers-monde", mais aussi au coeur des métropoles industrielles du capitalisme "développé". La catastrophe économique est mondiale et les dernières illusions sur les 'îlots de prospérité" que paraissaient constituer les pays industrialisés en contraste avec le sous-développement du reste du monde, disparaissent avec la généralisation de la misère de la périphérie vers le centre du capitalisme.
Plus que l'accroissement dramatique de la misère à la périphérie du capitalisme c'est l'enfoncement dans la pauvreté du prolétariat des pays industriels sous les coups de boutoir des programmes d'austérité de la bourgeoisie qui est significatif de l'approfondissement quantitatif et qualitatif de la crise au début des années 80. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie s'est rétrécie avec le travail de sape de la crise ; reporter les sévices essentiels de la crise sur les pays les plus faibles n'est plus suffisant pour éviter une attaque frontale contre les conditions de vie de la fraction décisive de la classe ouvrière mondiale qui vit dans les pays développés, qui produit les 4/5 des richesses mondiales, qui a le plus d'expérience historique, qui est la plus concentrée. Si la bourgeoisie s'attaque ainsi aujourd'hui aux plus forts bastions de son ennemi historique, la classe ouvrière, c'est qu'elle ne peut faire autrement.
Au milieu des années 80, la faillite de l'économie capitaliste n'est plus évidente seulement dans la misère du sous-développement, mais elle l'est quotidiennement par la classe ouvrière partout : dans les files d'attente du chômage, dans les fins de mois impossibles à boucler, dans l'accentuation de l'exploitation au travail, dans les soucis et les tracas de tous les jours, dans l'angoisse des lendemains, voilà, par-delà tous les chiffres, le bilan vécu par la classe ouvrière de la crise du capitalisme ; c'est le bilan de la faillite d'un système qui n'a plus rien à offrir.
Face à cette vérité qui s'impose avec de plus eh plus de force, la classe dominante n'a que des mensonges à offrir. Depuis le début de la crise ouverte de son économie à la fin des années 60, la bourgeoisie ne cesse de proclamer qu'elle possède des remèdes à la crise, que les lendemains chanteront, et pourtant la situation tout au long de ces années n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, Reagan et là bourgeoisie américaine nous resservent la même propagande éculée sous forme de "Reaganomics" à la sauce d'une nouvelle révolution technologique et, pour preuve de leurs affirmations, on nous présente la reprise de l'économie américaine. Qu'en est-il exactement de cette fameuse reprise dont on nous rebat tant les oreilles ? Où en est l'économie mondiale ?
LA FIN DE LA REPRISE AMERICAINE
Avec l'année 1985 déjà se marque le ralentissement de 1'économie américaine qui commence à montrer des signes d'essoufflement. Le colossal déficit budgétaire est de moins en moins suffisant pour maintenir l'activité de l'économie américaine : de 6,8% en 1984, le taux de croissance est retombé à un petit 1,6% pour les six premiers mois de 1985. L'industrie américaine souffre du cours élevé du dollar qui grève ses exportations et sa compétitivité face à ses rivales japonaises et européennes qui lui taillent des croupières sur le marché mondial et même à l'intérieur du marché américain. De mai 1984 à mai 1985, les exportations américaines ont chuté de 3,1%.
Reflétant le ralentissement de la croissance, le revenu net des 543 principales entreprises US a chuté de 11% au premier trimestre 1985 et de 14% au second. Les trois grands constructeurs automobiles américains ont enregistré une baisse de leurs profits de 25,4% tandis que la chute du secteur de la haute technologie, avec une baisse de 15% des bénéfices d'IBM et des pertes sèches pour Wang Laboratories, Apple et Texas Instruments (3,9 millions de dollars pour ce dernier au 2ème trimestre 85), fait voler en éclats le mythe d'une prétendue révolution technologique qui donnerait un nouveau souffle au capital.
Alors que toute une série de secteurs importants de l'économie américaine ne sont pas sortis du marasme depuis la fin des années 70, comme le secteur pétrolier, celui de la sidérurgie et surtout celui de l'agriculture (alors que la dette des fermiers américains est aujourd'hui supérieure à celle du Mexique et du Brésil réunis), ce sont aujourd'hui de nouveaux secteurs cruciaux qui viennent rejoindre ces derniers dans la crise, corme le bâtiment, l'électronique, l'informatique et l'automobile. Face à une telle situation, il faudrait, pour maintenir un minimum de santé économique au sein des pays les plus industrialisés, que l'Etat américain laisse se creuser des déficits commerciaux et budgétaires toujours plus énormes. Même la première puissance économique du monde ne peut se permettre cela, qui signifierait à terme un endettement qui trouve ses limites dans les disponibilités financières du marché mondial.
Malgré tous les discours de la bourgeoisie qui, chaque jour, prétend terrasser le monstre de la crise, la reprise de l'économie américaine a été l'arbre qui cache la forêt de la récession mondiale. L'économie planétaire n'est pas sortie de la récession amorcée à l'aube des années 80. Ainsi, si en 1984 le commerce mondial voyait la valeur des importations et des exportations croître respectivement de 6,5 et 6,1 %, c'est à la suite de trois années consécutives de régression. La relance n'a pas été suffisante pour retrouver le niveau de 1980. Par rapport à cette année-là, les pays industrialisés ont vu leurs exportations et importations régresser respectivement de 2 et 4,5 %. Ce recul est encore plus important pour les pays du tiers-monde qui, dans la même période, ont vu leurs exportations diminuer de 13,7 % et leurs importations de 12,5 %.
UNE CRISE DE SURPRODUCTION GENERALISEE
Les stocks de minerais qui s'accumulent, les mines qui ferment, les produits agricoles qui croupissent dans les silos et les frigos, tandis que l'arrachage des cultures se pratique à grande échelle, les usines qui ferment et les ouvriers qui se retrouvent massivement au chômage, tout cela exprime une chose: la crise de surproduction généralisée.
Prenons un seul exemple : le pétrole, tout un symbole malgré la paralysie de la production de l'Iran et de l'Irak en guerre et qui ont été, durant les années 70, de gros exportateurs, la surproduction fait rage. La fameuse pénurie qui, paraît-il, menaçait l'économie mondiale en 1974, est définitivement oubliée. L'OPEP est au bord de l'éclatement. Les stocks s'accumulent sur terre et sur mer, les supertankers rouillent dans les fjords de Norvège ou bien sont mis à la casse. Les chantiers navals n'ont plus de commandes, les compagnies pétrolières ont des problèmes de trésorerie et les banquiers qui ont fait des prêts commencent à se ronger les ongles. L'or noir ne parvient pas à sortir le Nigeria, le Mexique, le Venezuela ou l'Indonésie du sous-développement et de la misère tandis que même des pays "riches" comme l'Arabie Saoudite annoncent une balance commerciale déficitaire. La surproduction pétrolière affecte toute l'économie mondiale et rentre en résonance avec la surproduction dans les autres secteurs.
La crise de surproduction généralisée montre les contradictions du monde capitaliste de manière criante. Les fermiers américains entraînent les banquiers qui leur ont prêté de 1'argent dans leur faillite, alors que les céréales pourrissent dans les silos faute de débouchés solvables, tandis que la famine fait ses ravages dans le monde. Mais ce contraste insupportable a aujourd'hui fait irruption dans les pays "riches" où les chômeurs et autres "nouveaux pauvres" ne sont séparés que par une mince vitrine de ces "richesses" qui ne parviennent plus à se vendre et s'entassent jusqu'à devenir périmées.
Le cycle infernal de la surproduction se développe. Face à des marches saturés, la concurrence s'exacerbe, les coûts de production doivent baisser, donc les salaires, donc le nombre d'employés, ce qui réduit d'autant le marché Solvable et relance la concurrence...Chaque pays essaie ainsi de diminuer ses importations et d'augmenter ses exportations et le marché se rétrécit inexorablement.
LA PERSPECTIVE D'UNE NOUVELLE PLONGEE DANS LA RECESSION.
Au bout d'à peine deux ans, la fameuse reprise victorieuse de l'économie américaine, si chère à Reagan, montre des signes d'épuisement. Cela illustre clairement la tendance de l'économie mondiale à des mouvements de reprise de plus en plus courts et aux effets de plus en plus faibles, tandis que les périodes de récession se font de plus en plus longues et profondes. Cela montre l'accélération de la crise et la dégradation de plus en plus large que ses effets occasionnent à l'économie mondiale.
Avec le ralentissement de l'économie américaine, ce qui se profile à l'horizon, c'est la perspective d'une plongée encore plus profonde dans la récession. Nul économiste de la bourgeoisie n'ose prévoir les conséquences d'une récession durable de l'économie mondiale. La récession de 1981-82 a été la plus forte depuis 1929 et celle qui s'annonce, parce qu'elle traduit 1'impuissance et l'usure des recettes mises en place depuis par l'administration Reagan, ne peut qu'être plus profonde et plus durable encore pour les pays développés, car les pays sous-développés, eux, ne sont pas sortis du mouvement de récession amorcé à l'aube des années 80.
La plongée dans la récession implique :
- une nouvelle chute des échanges mondiaux consécutive au rétrécissement des marchés solvables, alors que pourtant, en 1984, le niveau de 1980 n'a pas été encore retrouvé ;
- une chute de la production qui va toucher le coeur des pays industrialisés encore plus fortement qu'en 1981-82, tandis que la production des pays sous-développés n'a cessé de chuter depuis 1981 ;
- de nombreuses faillites d'entreprises, de nouvelles fermetures d'usines, des millions d'ouvriers licenciés qui iront rejoindre les cohortes de chômeurs qui, en dehors des USA, n'ont cessé de se développer dans tous les pays malgré la "reprise" ;
- et, au bout du compte, une fragilisation du système financier international qui risque de culminer dans des tempêtes monétaires, tandis que l'inflation fera un retour remarqué.
On comprend que devant de telles perspectives, la bourgeoisie veuille freiner des quatre fers cet enfoncement dans la crise, car derrière l'effondrement du capital ce qui se profile c'est le développement de l'instabilité sur tous les plans : économique, politique, militaire et surtout social. Sa marge de manoeuvre se restreint au fur et à mesure que la crise s'approfondit et après avoir vu la faillite de toutes leurs théories, l'efficacité des mesures qu'ils ont préconisées s'user irrémédiablement, les savants économistes de la classe dominante guettent avec inquiétude le futur, ce qu'ils appellent eux-mêmes les "zones inexplorées de l'économie", avouant par là leur propre ignorance et impuissance.
La bourgeoisie n'a plus de politique économique à proposer, de plus en plus ce sont des mesures au jour le jour qui s'imposent. La bourgeoisie navigue à vue pour tenter de retarder la catastrophe et de sauver les meubles. Le fait que sa marge de manoeuvre se restreigne ne signifie pourtant pas que celle-ci n'existe plus et à un certain point de vue, le rétrécissement même de sa marge de manoeuvre pousse la classe dominante à développer son intelligence manoeuvrière. Cependant, toutes les mesures prises, si elles retardent les échéances, les reportent dans le futur, permettent un ralentissement des effets dévastateurs de la crise, contribuent à rendre ces échéances plus catastrophiques, à accumuler les contradictions propres du capitalisme, créant une tension chaque jour plus proche du point de rupture.
Le système financier international est un bon exemple de cette situation et des contradictions dans lesquelles se débattent les théoriciens et les gestionnaires du capital. Si la politique de crédit facile et de dollar pas cher menée dans les années 70 a permis, en absorbant une part du surplus produit, de reculer les échéances tout en assurant la suprématie du dollar, elle se traduit aujourd'hui par une montagne de dettes dans le monde entier, que de plus en plus d'Etats, d'entreprises, de particuliers, avec le développement de la récession depuis le début des années 80, sont aujourd'hui incapables de rembourser. Le vent de panique qui a soufflé sur les différentes places financières du monde durant l'hiver 1981-82 devant l'incapacité des pays du tiers-monde à rembourser leurs dettes de 800 milliards de dollars, n'a pu être calmé que par l'intervention des grands organismes de prêt internationaux, tels que la Banque Mondiale et le FMI qui ont imposé aux pays les plus endettés des programmes d'austérité draconiens comme condition à l'obtention de nouveaux crédits qui, s'ils ne permettaient pas le remboursement de la dette globale, en maintenant le paiement des intérêts, ont permis aux banques de souffler en attendant les résultats concrets des plans d'austérité mis en place précipitamment. .
Cependant, si la crise a été évitée, la fragilité du système monétaire international n'en a pas moins continué réellement à se développer. La faillite de la Continental Illinois en 1983, qui a fait les prêts les moins faibles, a obligé l'Etat américain à intervenir rapidement pour mobiliser les 8 milliards de dollars destinés à combler le trou et éviter une .réaction en chaîne dans le système bancaire américain qui aurait pu mener, là encore, à une crise majeure. Malgré la reprise américaine, ces dernières années ont connu un nombre de faillites record de banques américaines, et ce sont ainsi une centaine de faillites qui sont encore prévues en 1985 avec le ralentissement de l'économie américaine.
Mais si l'endettement des pays du tiers-monde est important, il n'est rien comparé aux 6000 milliards de dette accumulés par l'Etat, les entreprises et les particuliers aux USA. On peut comprendre que Volker, président de la banque fédérale puisse dire que "l'endettement est un revolver pointé sur l'économie américaine".
La crise du secteur agricole américain, qui a vu sa compétitivité sur le marché mondial anéantie par la hausse du dollar, s'est directement traduite par des faillites en série des caisses d'épargne agricoles où, pour la première fois depuis 1929, les queues d'épargnants paniques se sont allongées devant les banques fermées. L'intervention fédérale a permis d'éviter une panique plus grande, mais aujourd'hui c'est l'organisme fédéral de prêts aux agriculteurs, la Farmer Bank, qui est au bord de la faillite avec un trou de plus de 10 milliards de dollars que l'Etat va devoir conibler. Le simple ralentissement de 1'économie américaine au premier semestre 85 s'est traduit pour la deuxième banque américaine, la Bankamerica, par des pertes énormes au second trimestre 85 : 338 milliards de dollars. A ce rythme l'Etat fédéral risque d'avoir de plus en plus de difficulté à combler les trous béants qui s'ouvrent dans les comptes des banques américaines, et cette situation porte en germe la banqueroute de tout le système financier international, avec au coeur de cette banqueroute le dollar. La spéculation qui a porté le dollar vers des sommets risque de se retourner contre lui, accentuant encore le mouvement de yoyo qui, en six mois, de mars à août 85, a vu le dollar passer de 10,60 F à 8,50 F et qui a déjà mis bien à mal l'équilibre du système bancaire international.
L'IRRESISTIBLE RETOUR DE L'INFLATION
On comprend, dans ces conditions, l'inquiétude qui s'empare des capitalistes avec le ralentissement de l'économie américaine et la récession mondiale aggravée qui se profile à l'horizon et qui signifie pour les banques - avec des millions d'ouvriers mis au chômage, des milliers d'entreprises en faillite et de nouveaux Etats en cessation de paiements, qui ne pourront payer leurs dettes - une aggravation dramatique de leur situation. Les contradictions du capital sur le plan financier vont devenir explosives et risquent de se traduire par des crises de panique des capitalistes spéculateurs sur le marché financier mondial - surtout parce que le système bancaire international est indissolublement lié au système monétaire international, centré sur le dollar - par des tempêtes monétaires qui manifesteront le retour en force de l'inflation.
Celle-ci, même si elle a diminué, n'a certainement pas disparu;et si l'on considère que l'inflation des années 70 a été réduite essentiellement grâce à la chute des cours des matières premières qui, à part le pétrole, ont vu leur indice passer de 100 en 1980 à 72 en 1985-c'est-à-dire une chute de 28%-et grâce à une baisse des coûts de production consécutive à l'attaque contre les salaires et aux licenciements, son maintien même à un niveau plus faible dans la première moitié des années 80 montre a contrario le poids accru des pressions inflationnistes liées à la dette énorme et au poids des secteurs improductifs (notamment l'armée et la police) et des secteurs déficitaires, mais stratégiques que chaque Etat doit financer. Donc, même sur le plan de l'inflation, dans la réalité,la situation est loin de s'être améliorée et les pressions inflationnistes sont bien plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été dans les années 70, c'est-à-dire qu'un retour de l'inflation signifie bien plus rapidement que par le passé une tendance vers l'hyper inflation.
Si les années 70 ont montré la capacité de la bourgeoisie de reporter les effets de la crise à la périphérie du capitalisme, les années 80 montrent qu'aujourd'hui cela n'est plus suffisant pour permettre aux économies les plus développées d'échapper au marasme et à la récession. De plus en plus, les contradictions du capitalisme tendent à se manifester à un niveau central, à se polariser autour du roi dollar et de l'économie américaine qui en est la garante et dont de plus en plus l'ensemble de l'économie mondiale est dépendante. C'est pourquoi aujourd'hui les yeux des capitalistes du monde entier sont fixés au jour le jour sur les résultats obtenus par l'économie américaine ; de sa santé dépend la stabilité économique et monétaire du monde entier.
C'est pourquoi, avec les premiers signes annonciateurs du ralentissement de son économie, Washington a sonné le branle-bas pour résorber le déficit budgétaire, alléger l'endettement de l'Etat, et résorber le déficit commercial en restaurant la compétitivité de l'économie américaine. Mais une telle politique ne peut se faire qu'au détriment des exportations des industries européennes et japonaise qui ont profité de la relance américaine et du déficit commercial du plus grand marché du monde, relançant ainsi la guerre commerciale entre les pays les plus développés ; cependant, les USA, par leur puissance économique et militaire et parce qu'ils contrôlent le dollar, ont les moyens de détourner à leur profit les règles du marché pour imposer leurs diktats avec en plus le chantage protectionniste.
La baisse de 20% du dollar ces derniers mois a pour but premier de restaurer la compétitivité de l'économie américaine qui avait été sérieusement entamée (de 40% depuis 1980) par les hausses précédentes, afin de restaurer sa balance commerciale. Cependant, une telle mesure ne peut avoir que deux résultats :
- d'une part, plonger l'Europe et le Japon dans la récession en leur fermant le marché américain et en concurrençant leurs exportations dans le monde entier ;
- d'autre part, un retour de l'inflation dans la mesure où cette baisse du dollar est en fait une dévaluation, ce qui va surenchérir le cours des produits importés vendus sur le marché américain. La tentation est extrêmement forte pour les capitalistes américains de laisser chuter le dollar et se développer l'inflation, car c'est encore le meilleur moyen de rembourser leurs dettes en monnaie de singe après avoir engrangé des capitaux en provenance du monde entier.
Maintenir à flot l'économie américaine est une nécessité vitale pour éviter une catastrophe économique planétaire. Cependant, cela ne peut se faire qu'au détriment des principaux alliés des USA au sein de leur bloc.
Pourtant, dans la mesure où l'Europe et le Japon sont des pièces indispensables du puzzle impérialiste du bloc occidental et devant l'instabilité sociale qui ne peut que se développer en Europe - première concentration prolétarienne de la planète dont la classe ouvrière depuis l'automne 83 est au coeur de la reprise internationale de la lutte de classe qui continue à se développer - la bourgeoisie ne peut qu'être extrêmement prudente et essayer de ralentir au maximum les effets de la récession pour parvenir à contrôler la situation. C'est pour cela que Reagan parle d'un atterrissage "en douceur" de l'économie américaine et invite les capitalistes européens et japonais en même temps qu'il leur demande des concessions économiques (ouverture de leurs marchés, limitation de leurs exportations aux USA, internationalisation du yen afin d'épauler le dollar et d'affaiblir la compétitivité de 1'industrie japonaise en réévaluant sa monnaie) à faire la même politique que celle menée ces dernières années par les USA, c'est-à-dire une politique de déficit budgétaire et d'endettement afin de combler les effets néfastes de la chute de leurs exportations sur leur activité économique. Mais l'Europe et le Japon ne sont pas les USA et une telle politique ne peut se faire sans développer rapidement l'inflation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Washington prône l'inverse de la politique imposée cinq ans auparavant.
Cependant, même si la bourgeoisie parvient à ralentir le mouvement, ce freinage est de moins en moins efficace et les années 80 sont d'abord marquées par une accélération de la crise et des à-coups de plus en plus graves de l’économie mondiale. Si les années 80, dans leur première moitié, ont été marquées par l'enfoncement dans la stagnation et la récession avec une baisse de l'inflation, la deuxième moitié de la décennie va être marquée à la fois par une nouvelle plongée dans la récession qui va toucher de plein fouet les économies les plus développées et un retour en force de l'inflation que la bourgeoisie croyait avoir jugulée, dans une situation d'instabilité économique et monétaire grandissante qui va culminer dans des crises aiguées caractérisant l'accélération des effets dévastateurs de la crise.
J.J.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Milieu politique : le développement d'un milieu révolutionnaire en Inde
- 2902 reads
Après la crise qui a traversé le milieu révolutionnaire au début des années 80 ([1] [963]), l'avant-garde politique du prolétariat montre à nouveau des signes d'une force nouvelle. L'une de ses expressions les plus évidentes est l'apparition d'un certain nombre de groupes évoluant vers une cohérence communiste. Quelques exemples :
- en Belgique, l'apparition de RAIA ([2] [964]) dans un processus de rupture avec l'anarchisme ; en Autriche, l'apparition d'un cercle de camarades qui ont rompu avec Kommunistische Politik à cause de son académisme et qui évolue vers des positions révolutionnaires plus conséquentes ;
- en Argentine, le développement de groupes comme Emancipacion Obrera et Militancia Clasista Revolucionaria, qui semblent proches du Groupe Communiste Internationaliste (GCI), mais ont également eu des contacts avec d'autres groupes ([3] [965]) ;
- au Mexique, le développement du Colectivo Comunista Alptraum et la publication du premier numéro de sa revue Comunismo ([4] [966]).
Un des développements les plus importants est peut être celui qui est en train d'avoir lieu en Inde. Le but de cet article est de présenter, à grands traits, les origines et la trajectoire du milieu là-bas, en se basant sur ses publications, la correspondance et sur un récent voyage d'une délégation du CCI en Inde.
LE SURGISSEMENT DE REVOLUTIONNAIRES A LA PERIPHERIE DU CAPITALISME
Avant de parler des groupes spécifiques du milieu indien, il est nécessaire de faire quelques remarques sur le fait que la majorité de ces nouveaux groupes est apparue dans des pays périphériques du capitalisme. Dans le prochain numéro de la Revue Internationale, nous critiquerons la position du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) qui défend que dans ces régions où les institutions démocratiques et Syndicales ont moins d'emprise sur la vie sociale, les conditions pour un développement "massif" des organisations communistes sont "meilleures". Le GCI exprime le même genre de préférence "exotique" quand il dénonce sans cesse ce qu'il appelle le "soi-disant milieu révolutionnaire" qui ignorerait l'apparition de révolutionnaires à la périphérie (une contre-vérité flagrante comme on le verra par le contenu même de cet article).
Le surgissement de groupes révolutionnaires en Inde et en Amérique Latine est certainement l'expression de la portée internationale de la présente reprise de la lutte de classe et confirme - à rencontre de toutes les théories gauchistes sur la nécessité de révolutions!"démocratiques" dans les pays "dominés"- l'unité des tâches communistes auxquelles doit s'affronter le prolétariat. Mais cela ne prouve pas que la conscience communiste soit plus profonde ou plus étendue dans la périphérie que dans les métropoles et que, en conséquence (bien que ceci ne soit pas toujours clairement conclu) la révolution y soit plus à portée de main.
Pour commencer, nous devons nous rappeler que le point de vue du BIPR ou d'autres est déformé par l'incapacité à distinguer entre l'apparition d'authentiques groupes révolutionnaires et la "radicalisation" des groupes gauchistes, comme sa malheureuse alliance avec le Parti Communiste d'Iran et Revolutionary Proletanan Platform (RPP) d'Inde l'a montré. Deuxièmement, cette version revue et corrigée de la théorie du "maillon le plus faible" de Lénine, se base sur un empirisme très étroit qui se fixe sur les faits immédiats et n'arrive pas à situer l'émergence de ces groupes dans le contexte historique de la reprise générale de la lutte de classe qui a commencé en 1968, et qui constitue l'arrière-plan des différentes vagues de luttes caractérisant cette période. Une fois qu'on a saisi ce contexte, il apparaît clairement que ces groupes surgissent dix à vingt ans plus tard que ceux des métropoles -la plupart de ceux-ci étant sortis de la première vague de combats de classe en 1968-74. Et, troisièmement, s'il y a un important aspect de spontanéité dans l'apparition d'éléments à la recherche de positions de classe, nous ne devrions pas avoir à dire à des groupes comme le BIPR que cette spontanéité est insuffisante, qu'il y aurait peu de chances pour que ces groupes trouvent une cohérence communiste solide s'il n'y avait pas l'intervention des groupes d'Europe occidentale qui ont un rapport plus direct avec les traditions de la Gauche communiste. Il apparaîtra clairement à travers cet article que, plus les groupes en Inde se sont ouverts au milieu politique international, plus ils ont été capables de développer pleinement une pratique communiste.
Il est extrêmement dangereux de sous-estimer les difficultés et problèmes auxquels sont confrontés les révolutionnaires dans les pays sous-développés:
- problèmes "physiques" posés par l'isolement géographique par rapport au principal coeur du mouvement prolétarien; les barrières linguistiques (y compris l'analphabétisme) ; la pauvreté matérielle ; des choses que les révolutionnaires à l'ouest considèrent comme acquises aujourd'hui en tant qu'outils de leur intervention - machines à écrire, téléphone, ronéos, voitures, etc.- sont bien moins accessibles aux groupes dans des pays comme l'Inde ;
- profonds problèmes politiques créés précisément par la domination ouverte de l'impérialisme et l'absence de normes "démocratiques" qui rend la classe ouvrière de ces pays plus vulnérable en dernière analyse à la mythologie de la "libération nationale", de la "démocratisation", etc. Ceci rend à son tour encore plus difficile le combat des révolutionnaires de ces pays contre ces illusions, à la fois dans la classe et dans leurs propres rangs ;
- absence d'une tradition historique de la Gauche communiste dans la plupart de ces pays ; prédominance de déformations gauchistes, en particulier le stalinisme maoïsme, qui est capable de se parer de couleurs très "radicales" dans ces régions. Oublier toutes ces difficultés n'aidera pas l'évolution des camarades qui commencent un travail révolutionnaire malgré ces problèmes et contre eux. Il ne faut pas non plus sous-estimer le poids mort des idéologies plus traditionnelles dans ces pays : en Inde, par exemple, il est extrêmement difficile que des femmes participent au mouvement révolutionnaire.
EN INDE : LE DIFFICILE PROCESSUS DE RUPTURE AVEC LE GAUCHISME COMMUNIST INTERNATIONALIST
"Une organisation révolutionnaire est toujours indispensable, même dans une période de très grande défaite de la classe. Bien sûr, le rôle et l'impact changeants d'une organisation révolutionnaire dans une période de défaite de la classe ou de développement de la lutte de classe., ne peuvent être compris qu'avec les concepts de fraction et de parti. Aujourd'hui dans une période de crise mondiale accélérée et d'effondrement du capital et de révoltes de classe croissantes, tendant vers la confrontation avec l'Etat et s'ouvrant vers la révolution, le rôle des révolutionnaires devient de plus en plus important et décisif. Il est d'appeler au regroupement international des révolutionnaires et à la formation du parti révolutionnaire." (Lettre du Cercle de Faridabad au CCI, 11 janvier 1985).
La plupart des éléments qui constituent le milieu prolétarien en Inde, viennent .d'une rupture plus ou moins claire avec le gauchisme radical, facilitée par l'intervention directe des groupes du milieu international, en particulier le CCI et le BIPR. Mais comme le CCI l'a toujours souligné, l'avenir d'un groupe qui surgit de cette façon dépend en grande partie de la clarté de cette rupture, du degré de conscience atteint par les éléments impliqués en ce qui concerne leur provenance et combien ils ont à avancer. Le groupe en Inde qui a fait la rupture la plus complète avec le gauchisme est celui qui, par ses positions et son attitude politique, est le plus proche du CCI : Communist Internationalist (CI).
Comme nous l'avons écrit dans la Revue Internationale n° 42, un certain nombre de camarades de CI étaient auparavant impliqués dans la politique gauchiste radicale, et, plus récemment, dans Faridabad Workers News, journal militant et syndicaliste dans un important centre industriel près de Delhi.
En Inde, comme dans beaucoup de pays sous-développés, les syndicats se conduisent habituellement d'une façon si ouvertement anti-ouvrière (corruption, tabassage des ouvriers combatifs, etc.) que les ouvriers leur sont souvent profondément hostiles, tout comme vis-à-vis des partis de gauche auxquels ils sont liés (PC d'Inde, PCM d'Inde, etc.). Une anecdote pour l'illustrer : voyageant en train de Delhi au Bengale occidental, les camarades du CCI et de CI, sont entrés en discussion avec des cheminots qui les avaient invités dans leur wagon de travail ; après quelques minutes de conversation générale, et sans que le CCI et CI n'aient poussé dans ce sens, ces ouvriers (qui avaient participé à la grande grève des chemins de fer en 1974) ont commencé à dire que tous les partis de gauche étaient bourgeois, tous les syndicats des voleurs, et que seule la révolution pourrait changer les choses pour les ouvriers. De telles attitudes, qui sont assez répandues en Inde aujourd'hui, ne veulent pas dire que la révolution est imminente, car les ouvriers ont de grandes difficultés à voir comment transformer leurs désillusions en une lutte active contre le capital. Mais elles indiquent l'étendue de" l'antipathie ouvrière envers les syndicats et les partis de gauche. Ceci explique toute l'importance en Inde des formes très radicales de gauchisme qui sont tout à fait capables de dénoncer les syndicats et la gauche comme agents de la bourgeoisie -afin d'enfermer les ouvriers dans une variété plus extrême de la même chose. A Faridabad même, il y a eu toute une série de luttes durant lesquelles, après la mise à nu de la réelle fonction d'un appareil parti/syndicat un autre, au langage plus à gauche, est intervenu pour combler la brèche. Le cercle de Faridabad a fait de nombreux tournants avant d'arriver au moment où le Faridabad Workers Group était sur le point de former un syndicat ultra-radical dans certaines usines; Mais la lecture des publications du CCI sur la question syndicale lui a permis de se sortir de ce cercle vicieux. Et puisque cela s'est doublé d'un processus de clarification sur la question nationale, qui est une question de vie ou de mort pour un groupe prolétarien qui surgit à la périphérie, les camarades ont su s'orienter sur le difficile chemin de la rupture avec leur passé gauchiste.
A partir de l'effondrement du Faridabad Workers Group, un cercle de discussion a été formé qui s'est rapidement trouvé d'accord avec ce qu'il comprenait des positions et des analyses du CCI. Les camarades ont reconnu que la discussion n'était pas suffisante ni assez homogène avec le CCI pour envisager la possibilité d'une intégration rapide dans le courant ; mais la nécessité d'intervenir dans la lutte de classe, de défendre les positions révolutionnaires, a poussé les camarades à se former en un groupe qui, tout en étant encore engagé dans la clarification des positions et analyses fondamentales, puisse intervenir en publiant une revue, des tracts, etc. Ainsi naquit Communist Internationalist.
Dans les discussions avec CI, nous avons exprimé notre soutien à la décision d'évoluer du cercle de discussion au groupe politique, tout en soulignant que la priorité pour les camarades est l'approfondissement théorique et l'homogénéisation, ce qui veut dire que l'ensemble du groupe doit prendre connaissance, non seulement des positions du CCI, mais de l'histoire du mouvement ouvrier et des positions des autres groupes du milieu révolutionnaire. Mais dans la période actuelle, les révolutionnaires ne peuvent rester silencieux même quand leur compréhension des positions de classe n'en est qu'au stade initial. CI continuera donc à intervenir avec des tracts, une présence dans les importants moments de la lutte de classe ; il maintiendra la publication de Communist Internationalist en hindi et afin de rendre son travail plus accessible à la fois envers le milieu en Inde (où l'anglais est une langue plus répandue que l'hindi) et surtout le milieu international, il publiera un supplément en anglais à CI.
La perspective pour CI est l'intégration dans le milieu révolutionnaire. CI et le CCI sont pleinement conscients des problèmes qu'un tel processus contient.
Pour qu'ait lieu un regroupement solide et qu'il dure, c'est tout un travail organisationnel et politique qu'il faut réaliser. Il faut affronter les incompréhensions et les divergences existantes. Il n'y a rien de prédestiner ou d'automatique dans un tel processus. Mais nous sommes confiants que la convergence croissante de CI avec les positions du CCI, et en particulier concernant la nature du gauchisme, le milieu politique prolétarien et les dangers qui le guettent, fournit une base ferme et sure pour que le groupe achève sa rupture d'avec le passé gauchiste, et assume les énormes responsabilités qu'il porte en Inde et internationalement.
Comme c'est souvent le cas, le pas qu'a fait le cercle de Faridabad en formant CI, ne l'a pas été sans prix : la scission d'un camarade qui avait joué un rôle déterminant dans la rupture' initiale avec le gauchisme et qui, du coup, a formé de son côté un petit cercle. Les raisons de cette scission ont été pendant longtemps obscurcies par des questions "personnelles", mais à partir de ses interventions dans la situation qui avaient pour but d'apaiser les tensions d'une scission injustifiée ou, au moins, de faire ressortir les divergences réelles, le CCI considère maintenant que la question essentielle était la suivante : CI, avec toutes ses faiblesses et son immaturité, a compris qu'il ne pouvait rien faire sans un cadre collectif pour homogénéiser le groupe, et qu'il devait commencer au minimum à assumer des tâches d'intervention politique dans la classe. Les conceptions du camarade scissionniste, par contre, exprimaient une plus grande difficulté à rompre avec des attitudes gauchistes. Son argument selon lequel CI n'était pas un groupe politique parce qu'il n'y avait pas d'homogénéité suffisante en son sein, se basait en réalité, d'un côté sur un élitisme gauchiste classique qui juge individuellement les camarades comme étant fixés pour toujours à un niveau plus ou moins grand de compréhension, et ne voit pas comment la conscience peut avancer à travers un processus de discussion collective ; et, de l'autre, comme c'est souvent Je cas avec des camarades en réaction à un passé dans l'activisme gauchiste, sur une approche académique qui ne saisit pas les rapports entre l'approfondissement théorique et l'intervention pratique. Ceci s'est exprimé, par exemple, par une tendance à se fixer sur la théorie de la décadence de Rosa Luxemburg, sans en voir les implications militantes pour les révolutionnaires aujourd'hui.
L'académisme apparaît de nos jours comme un aspect du poids de l'idéologie conseilliste, de la sous-estimation de la nécessité d'une organisation de combat politique dans la classe. Si CI avait suivi les orientation du camarade scissionniste, il aurait indéfiniment | repoussé son travail d'intervention. Nous regrettons cette évolution car ces camarades auraient pu faire une importante contribution au travail de CI. Mais nous pensons que ces camarades vont devoir passer par un processus d'échecs amers avant de pouvoir comprendre l'erreur qu'ils font.
Ce n'est pas par hasard que la question du travail Collectif a été si centrale dans cette scission. Nous considérons que CI, par son évolution vers une conception conséquente de l'organisation, l'intervention et le milieu politique, va jouer un rôle clé au sein de ce milieu, grâce à la défense non seulement des positions communistes, mais aussi par son approche globale du processus de discussion et de clarification. Ceci s'est exprimé après plusieurs jours de discussion avec la délégation du CCI, par l'un des camarades de CI qui pendant des années a été impliqué dans des groupes maoïstes. Pour lui, l'une des preuves les plus évidentes qu'il n'y a pas de terrain commun quel qu'il soit entre le gauchisme et la politique révolutionnaire était justement le contraste total entre les "discussions" bidon qui ont lieu dans un groupe gauchiste, basées sur la vieille division bourgeoise du travail entre ceux qui pensent et ceux qui font, et l'effort de clarification réellement collectif, où tous les camarades doivent prendre position et développer leurs capacités politiques et organisationnelles dans le contexte de responsabilités centralisées et clairement définies. La défense de cette vision de l'organisation contre le point de vue hiérarchique hérité du gauchisme ainsi que les névroses anti-organisationnelles du conseillisme, sera une tâche primordiale des groupes révolutionnaires en Inde.
LAL PATAKA
Le CCI est peut-être le pôle international de référence le plus clair pour les révolutionnaires, mais il n'est pas le seul. Depuis l'effondrement du PCI (Programme Communiste), le BIPR dont les positions tendent à être à mi-chemin entre le CCI et le bordiguisme a développé une présence internationale, d'une façon cependant très marquée par l'opportunisme ([5] [967]).
En Inde, à peu près en même temps que se formait CI, une scission avait lieu dans le groupe gauchiste radical Revolutionary Proletanan Platform (RPP) qui avait été critiqué à la fois par les positions du CCI et du BIPR. Le camarade responsable de la publication du journal bengali du RPP, Lal Pataka (Drapeau Rouge), était expulsé de l'organisation après avoir appelé le RPP à se restructurer conformément aux positions fondamentales du BIPR.
Avant de décrire les discussions entre le CCI et Lal Pataka, nous voulons rappeler notre position sur le RPP.
Quand nous avons reçu pour la première fois les publications en anglais du RPP, nous n'étions pas entièrement clairs sur le fait de savoir si c'était une tentative de rompre avec le gauchisme, ou bien un autre groupe stalinien radical comme le PC d'Iran. Ces incertitudes ont persisté dans l'article sur le milieu en Inde dans World Révolution n°77 qui, tout en étant plus clair sur la nature bourgeoise du RPP, fait encore certaines concessions à la notion de "mouvement d'éloignement du gauchisme" de la part de ce groupe. Mais en s'appuyant sur nos propres discussions internes sur l'opportunisme et le centrisme([6] [968]) et en ayant une meilleure connaissance de l'histoire et des positions du RPP (en grande partie due au travail des camarades de CI), nous avons pu juger plus clairement ce groupe. Comme le dit la résolution du 6ème Congrès du CCI sur l'opportunisme : ".le passage collectif d'un organisme politique déjà structuré ou en formation dans les partis existant ne peut obligatoirement se produire que dans un sens unique : des partis du prolétariat à la bourgeoisie et jamais dans le sens contraire : des partis bourgeois au prolétariat." (Revue Internationale n° M, p. 17)
En effet, un bref survol de la préhistoire du RPP montre clairement que ce groupe a toujours été un "organisme politique déjà structuré" de la bourgeoisie. Au début de la 2ème guerre mondiale s'est formé le Parti Socialiste Révolutionnaire (RSP) d'Inde, en rupture avec le Parti Communiste d'Inde, mais pas du tout sur une base prolétarienne : au contraire, la politique du RSP était de se battre pour la "libération nationale" de l'Inde en s'alliant avec les ennemis de la Grande-Bretagne, l'impérialisme allemand et japonais. L'intégration ouverte du RSP dans des gouvernements de gauche de l'Inde "indépendante" a mené à une scission en 1969, faisant naître le RSPI (ML) qui se caractérisait par certaines positions apparemment radicales (dénonciation de la Chine, de la Russie, des PC, et même des syndicats comme capitalistes), mais qui n'a jamais critiqué les origines nationalistes du RSP. Le RPP s'est formé au début des années 80 à partir d'une scission dans le RSPI (ML), non pour défendre des positions de classe, mais en réaction aux "déviations ultra-gauchistes" du RSPI (ML) (pour citer le RPP lui-même dans Proletanan Emancipation, décembre 85). Le RPP se définit en particulier depuis le début comme un loyal défenseur des syndicats en tant qu'organisations de base des ouvriers et ne s'est jamais éloigné de là : de façon significative, la question syndicale était au coeur de la scission avec Lal Pataka. Le RPP n'a pas mis en question non plus le passé nationaliste du groupe ni le dogme du "droit des nations à disposer d'elles-mêmes". Toute la trajectoire du RPP et de ses ancêtres exprime donc des moments de la radicalisation du gauchisme, mais jamais une rupture qualitative avec son point de départ bourgeois.
La rencontre du RPP avec des groupes du camp prolétarien ne l'a pas dévié de sa trajectoire. Si le BIPR, répétant les erreurs déjà faites avec les gauchistes iraniens, a persisté, en se rapportant au RPP comme s'il était un groupe prolétarien confus, le RPP lui-même est, d'une certaine façon, plus conscient du fait qu'il n'a rien à voir avec le mouvement communiste. Malgré les protestations du BIPR comme quoi le RPP ne doit pas le confondre avec le CCI, le RPP a maintenant dénoncé publiquement les deux organisations comme "anarchistes petites-bourgeoises" et s'est identifié au niveau international avec le PC d'Iran et les "ex"-maoistes américains de l'organisation Pour un Parti Ouvrier Marxiste-Léniniste. De plus, le tableau décrit dans la Revue Communiste n°3 du BIPR de la désintégration du RPP sous l'impact des positions du Bureau, semble complètement fausse. C'est vrai que Lai Pataka (qui, de façon significative, existait avant de rejoindre le RPP et a toujours eu une certaine autonomie) est parti pour défendre des positions prolétariennes, mais ce départ n'a pas eu pour résultat l'effondrement du RPP qui, dans la mesure de ce que nous croyons savoir, a encore plusieurs centaines de membres et une certaine implantation dans l'appareil syndical (une autre petite scission qui a eu lieu en même temps que celle de Lal Pataka s'est faite sur une base entièrement gauchiste, puisque ces éléments veulent défendre la position du PC d'Iran sur la "révolution démocratique" et s'opposent ouvertement aux positions de la Gauche communiste, comme on l'a découvert en les rencontrant).
Dans nos discussions avec Lal Pataka, il est devenu clair qu'il était déjà au delà de la position du BIPR et de sa propre position précédemment exprimée dans le dernier texte de Lal Pataka au sein du RPP (publié dans la Revue Communiste n°3) où il appelait le RPP à adopter la plate-forme du BIPR. Nous avons souligné l'ambiguïté de ce texte et du fait que ce n'est pas Lal Pataka qui a quitté lui-même formellement le RPP, mais qu'il a été "suspendu" sur la base de différentes accusations organisationnelles inventées de toutes pièces. Nous avons insisté sur la nécessité d'une prise de position claire dans le prochain numéro du journal, dénonçant le RPP comme gauchiste (comme il le caractérise maintenant) et expliquant la rupture avec lui. Nous avons argumenté que le nom du journal devait changer afin de montrer cette totale rupture de continuité.
L'une des conséquences positives des discussions avec Lal Pataka s'exprime dans une lettre écrite au CCI :
"Nous préparons une déclaration sur les positions actuelles de Lal Pataka au Bengale qui définira clairement notre rupture totale avec le gauchisme ; nous n'avons pas d'hésitation sur le fait que ce qui reste du RPP est un groupe capitaliste de gauche. ..Bien qu'il soit un groupe éclectique en transition politique, le RPP a eu au moins un aspect positif dans son attitude quand il a déclaré faire un projet de plate-forme qui... pouvait être changé de façon adéquate et amélioré à travers des discussions et 1'analyse des conditions matérielles objectives qui prévalent en Inde et à 1'échelle mondiale...Cependant en réalité, la majorité du Comité central du RPP a refusé de confronter les implications politiques et organisationnelle de l'accomplissement d'une rupture avec la contre-révolution... Aussi ce qui reste du RPP n'est qu'une fraction de la gauche capitaliste dont 1'inévitable résultat est 1'éclatement de l'organisation elle-même. Lal Pataka reste dans sa préhistoire, 1'histoire du capitalisme de gauche". (28 décembre 1985).
Dans notre réponse à Lal Pataka, nous avons salué l'intention de publier une prise de position définissant le RPP comme un "groupe capitaliste de gauche". D'un autre côté, comme nous le soulignons dans notre réponse, les formulations de Lal Pataka contiennent un certain nombre de confusions '."Quand vous dites: 'Bien qu'il soit un groupe éclectique en transition politique, le RPP a eu au moins un aspect positif dans son attitude', etc. Vous évitez la question de la nature bourgeoise de ce groupe dès le début. Le RPP n'a pas commencé son existence comme une rupture, même confuse, même éclectique du gauchisme. En tant que groupe gauchiste bien structuré avec une certaine implantation dans l'appareil syndical, il ne pouvait, par définition, être 'en évolution' vers autre chose que vers une forme de gauchisme plus radical". "En parlant de 'ce qui reste du RPP',vous donnez 1'impression que ce n'est que maintenant que le RPP peut être clairement défini comme gauchiste. En fait, après votre départ, ce n'est pas 'ce qui reste du RPP', mais le RPP."(4 février 1986).
Néanmoins, cette discussion a été fructueuse parce qu'elle pose une question vitale à tout le mouvement révolutionnaire : la nécessité d'une méthode cohérente pour appréhender les rapports et les distinctions entre organisations bourgeoises et prolétariennes. Les discussions entre Lal Pataka, CI et le CCI ont eu lieu dans une atmosphère fraternelle. Nous avons été capables de parler de façon constructive sur la Conférence proposée des éléments révolutionnaires qui surgissent, dans la préparation de laquelle Lal Pataka a joué un rôle galvaniseur. Nous pensons que ces discussions indiquent la possibilité de surmonter le sectarisme, de confronter les divergences dans un contexte de solidarité fondamentale de classe. Pas un instant, nous n'atténuons notre critique de l'opportunisme et du confusionnisme quand ils apparaissent dans le camp prolétarien ; mais nous ne devons pas non plus oublier l'unité d'intérêts sous-jacente entre les différents composants du mouvement révolutionnaire, parce qu'à la racine cette unité exprime l'indivisibilité des intérêts du prolétariat comme un tout.
MA3DOOR MUKTI
Au travers de Lal Pataka, nous sommes entrés en contact avec un autre groupe : Majdoor Mukti (Emancipation ouvrière), qui est apparu récemment de manière plutôt "spontanée", rompant avec le milieu gauchiste, essentiellement sur la question du parti et de la conscience de classe. Dans un environnement politique dominé par la version gauchiste du point de vue "léniniste" sur l'organisation, il est vraiment significatif qu'un groupe apparaisse avec, dans ses déclarations de principes, des positions telles que : "Contre les tentatives de remplacer le rôle de la classe ouvrière dans sa propre émancipation par différentes sortes de soi-disant agents libérateurs, les communistes doivent défendre de manière claire que l'émancipation de la classe ouvrière ou la construction du socialisme sont impossibles sans l'activité consciente des masses prolétariennes ." Ou encore :
"Contre l’usurpation et la monopolisation du pouvoir politique par de soi-disant partis communistes et désignant ce pouvoir comme pouvoir prolétarien, les communistes doivent carrément déclarer que le pouvoir du parti ne peut jamais être synonyme du pouvoir ouvrier. .".
En fait, parmi les sept principes de base élaborés dans la déclaration, au moins cinq sont des critiques des conceptions substutionnistes. Bien que cela exprime une saine préoccupation du besoin d'auto-organisation ouvrière, c'est encore un déséquilibre qui démontre -dans un pays sans tradition conseilliste- l'immense pression du conseillisme aujourd'hui sur le mouvement prolétarien. De plus, les fixations conseillâtes ne représentent pas un barrage contre le gauchisme, au contraire. A partir, de la déclaration du groupe et de nos discussions avec eux, il est clair que le groupe ne voit pas les frontières de classe entre le gauchisme et le mouvement prolétarien, une difficulté renforcée par ses confusions entre le substitutionnisme (une erreur au sein du camp prolétarien) et la nature anti-prolétarienne de la gauche capitaliste ; bien qu'il insiste sur le fait que "le socialisme n'a pas encore été réalisé dans une partie du monde quelle qu'elle soit" , il hésite à définir la Russie, la Chine, etc. comme des Etats capitalistes ; et en n'ayant pas une claire conception de la décadence, il reste extrêmement flou sur la nature des syndicats, du réformisme, etc.
Pour toutes ces raisons et d'autres encore, il est évident que la rupture du groupe avec le gauchisme est loin d'être complète. Mais nous' pourrions difficilement attendre plus d'un groupe qui initialement est apparu sans référence directe aux forces communistes existantes. Ce qui nous permet d'espérer que ce groupe rejette ses influences gauchistes et conseillâtes, c'est sa confiance dans les capacités révolutionnaires de la classe ouvrière ; son rejet du nationalisme et son insistance sur les tâches internationales du prolétariat, sa défense du besoin d'organisation "communiste et d'un parti communiste, pour intervenir activement dans toutes les luttes de la classe ; et ce qui n'est pas le moindre, son attitude ouverte, sa volonté de discuter avec et d'apprendre des groupes révolutionnaires.
CONFERENCES DES REVOLUTIONNAIRES
L'émergence de ces groupes en Inde exprime un réel développement dans l'avant-garde du prolétariat. Il est absolument essentiel que les relations entre les différents composants du milieu soient établies sur une base organisée et sérieuse pour permettre la nécessaire confrontation des idées, pour permettre la coopération et la solidarité pratiques. Aussi, nous soutenons de tout coeur la proposition de Lal Pataka d'organiser une conférence pour ces éléments qui apparaissent.
Cependant dans l'incapacité d'assister à cette première rencontre, le CCI tient à marquer sa présence politique en envoyant une déclaration à la conférence :
- soulignant l'importance de la conférence en la situant dans la période actuelle. d'accélération de la crise et de la lutte de classe ;
- soutenant le choix du thème central : "les fondements et les implications de la décadence capitaliste", car une compréhension de la décadence est indispensable à l'élaboration des frontières de classe qui séparent le prolétariat de la bourgeoisie. En même temps, nous avons souligné la nécessité d'éviter les débats académiques et d'appliquer le concept de décadence aux développements présents de la réalité et aux tâches qui en résultent pour les révolutionnaires (en conjonction avec CI, le CCI a soumis à la conférence trois de ses textes déjà publiés sur la théorie des crises, la lutte prolétarienne dans la décadence et la situation internationale présente) ;
- appelant la conférence à adopter des critères pour une future participation suffisamment "large" pour la garder ouverte aux éléments prolétariens qui émergent mais suffisamment "étroite" pour exclure les gauchistes radicaux ;
- insistant sur le besoin pour la conférence de ne pas rester muette mais de prendre position au travers de résolutions communes, pour définir clairement les points d'accord et de désaccord ;
- défendant le besoin pour la conférence de s'ouvrir au milieu révolutionnaire international, particulièrement en publiant ses résultats en anglais ;
- en pointant le lien entre cette conférence et la nécessité d'un cadre international pour le débat entre révolutionnaires. Comme la déclaration le pose : "Bien que les Conférences de 1976-80 aient échoué sous le poids du sectarisme dominant dans le mi lieu, nous pensons que la résurgence de la lutte de classe et l'apparition de nouveaux groupes révolutionnaires dans de nombreux pays (Inde, Autriche, Mexique, Argentine, etc.) vient encore confirmer la nécessité d'un cadre international de discussion et d'activité au sein du milieu prolétarien. Même si un nouveau cycle de conférences internationales n'est pas encore une possibilité immédiate, la réunion en Inde, en brisant la fragmentation et le sectarisme, peut jouer son rôle dans le développement de nouvelles et fructueuses conférences à l'échelle internationale dans le futur".
Le développement du mouvement révolutionnaire en Inde peut donc être un facteur de vitalité dans l'ensemble du milieu international. C'est une confirmation de la promesse profondément contenue dans la période actuelle, un encouragement aux révolutionnaires partout, une claire indication du besoin pour les organisations révolutionnaires' des pays centraux d'assumer leurs responsabilités internationales. Pour sa part, le CCI n'a pas de doute sur le fait qu'il doit faire tout son possible pour soutenir et stimuler le travail de nos camarades de la "section en Inde" du mouvement prolétarien mondial.
MU.
[1] [969] Voir la Revue Internationale n° 32.
[2] [970] RAIA : BP 1724 1000 BRUXELLES 1
[3] [971] Lire "Le Communiste" n° 23.
[4] [972] Voir la Revue Internationale n° 44.
[5] [973] Voir Revue. Internationale n° 43, p. 17 : "Discussion : opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations", et n° 44 : "Résolution adoptée sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" (p. 16) et résolution rejetée sur "Le centrisme et les organisations politiques du prolétariat" (p. 18).
[6] [974] Voir Revue. Internationale n° 43, p. 17 : "Discussion : opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations", et n° 44 : "Résolution adoptée sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" (p. 16) et résolution rejetée sur "Le centrisme et les organisations politiques du prolétariat" (p.18).
Géographique:
- Inde [893]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
La gauche hollandaise (1900-1914) : naissance d'un courant révolutionnaire en Europe (1900 - 1909)
- 3719 reads
Cet article est la première partie d'un chapitre portant sur le courant tribuniste hollandais jusqu'à la première guerre mondiale Le chapitre en question fait partie d'une étude critique d'ensemble du courant de la Gauche communiste germano-hollandaise.
La gauche hollandaise est fort mal connue. Traitée d'anarchiste par les défenseurs intéressés du capitalisme d'Etat russe ou chinois, ou d' "illuministe" et d'"idéaliste" par les bordiguistes plus "léninistes" que le roi, elle a été fort mal servie par ses zélateurs conseillistes. Ceux-ci ont vite "oublié" qu'elle avait mené le combat au sein de la 2ème puis de la 3ème Internationales ; qu'elle était un courant marxiste et non une secte anarchiste ; qu'elle était pour l'organisation et non anti organisation ; qu'elle faisait partie d'un courant international et qu'elle se refusait d'être une secte locale ouvriériste ou une espèce de club de propagande et d'études
Certes, la Gauche hollandaise, pour des raisons historiques, est restée moins connue que la Gauche italienne. Elle n'a pas connu -comme la Fraction italienne des années 30- l'émigration qui lui aurait permis de rayonner dans plusieurs pays Liée chair et sang à la Gauche allemande dans les années 20 et 30, elle s'est étiolée dans le cadre étriqué de la petite Hollande La majorité de ses contributions, écrites bien souvent en hollandais, n'ont pas connu une audience aussi grande que celles des gauches italienne et allemande. Seuls les textes de Pannekoek écrit en allemand et traduits en français et anglais, espagnol et italien peuvent donner un idée de l'apport théorique de cette fraction de la Gauche communiste internationale.
Cette première partie se propose de montrer les difficultés de surgissement du courant marxiste dans un pays qui restait dominé encore par le capital commercial, un capital parasitaire reposant sur l'exploitation de ses colonies. La croissance du prolétariat a été un processus long qui s'est surtout réalisée après la 2ème guerre mondiale et la décolonisation Pendant très longtemps, le prolétariat reste marqué par un environnement artisanal et un isolement dans une population encore agricole. D'où la force des idées et du courant anarchiste pendant très longtemps. Ce retard historique fait cependant contraste avec le développement très affirmé d'un vigoureux courant marxiste représenté par la Gauche, et qui se signale –à 1' image des bolcheviks dans la Russie paysanne- au sein de l'Internationale par une nette avance théorique, au point d'influencer directement le KAPD en Allemagne, lequel considérera toujours Pannekoek et Gorter comme ses théoriciens La Gauche hollandaise, malgré sa faiblesse –après la scission de 1909- sur le plan numérique, a un poids international énorme sur le plan théorique (question de l'Etat, conscience de classe, grève de masses). Au premier plan, avec Luxemburg et les bolcheviks, dans la lutte contre le révisionnisme, elle sera l'une des .pierres essentielles dans la formation delà future Gauche communiste internationale
Faire un bilan des apports et des faiblesses de la Gauche hollandaise, c'est contribuer au développement de la conscience de classe prolétarienne, qui est inséparablement liée à la mémoire critique de tout son passé révolutionnaire.
RETARD DU CAPITALISME HOLLANDAIS
Le poids politique de la Hollande dans le mouvement ouvrier international avant et après la première guerre mondiale apparaît démesuré eu égard au sous-développement industriel du pays et à la domination écrasante de l'agriculture. Pays classique de la révolution bourgeoise au XVIIe siècle, le royaume des Pays-Bas avait connu son plein essor sous la forme de capital commercial soutiré de ses colonies. L'âge d'or de la Compagnie des Indes orientales (Ost-Indische Kompagnie), qui exploitait l'Indonésie coïncidait avec la mainmise de l'Etat (1800) sur son fructueux commerce, tandis que le roi obtenait le monopole commercial d'Etat pour l'exploitation de cette colonie.
Grugée par le roi des profits des colonies, qui ne s'investissaient pas dans le secteur industriel mais de façon spéculative, la bourgeoisie hollandaise -malgré sa longue histoire- jouait encore jusqu'à la fin du XIXe siècle un rôle secondaire, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. C'est ce qui explique son "radicalisme" verbal pendant cette période où elle végétait à l'ombre de l'Etat et l'enthousiasme chez certains pour le marxisme, enthousiasme qui disparut vite dès les premiers affrontements de classe au début du siècle. Comme en Russie, où la bourgeoisie libérale était encore faible, les Pays-Bas produisirent une variété locale de Struve, libéraux déguisés en marxistes "légaux". Mais à la différence de la Russie, les Struve hollandais finirent par l'emporter dans le Parti ouvrier social-démocrate. ([1] [975])
Le déclin de la bourgeoisie marchande dès la fin du XVIIe siècle, son incapacité à développer un capital industriel, la recherche de placements spéculatifs dans la terre, tous ces facteurs expliquent l'arriération économique des Pays-Bas au milieu du XIXe siècle. Ainsi, en 1849, 90 % du produit national hollandais provient de l'agriculture. Si 75 % de la population vit dans les villes, la majorité végète dans un état de chômage permanent et ne vit que des aumônes des possédants et des Eglises. En 1840, à Haarlem, ville de 20 000 habitants, 8 000 "pauvres" sont recensés, chiffre bien en deçà de la réalité. La dégénérescence physique de ce sous-prolétariat était telle que, pour la construction des premières lignes de chemin de fer, les capitalistes hollandais durent faire appel à la main-d'oeuvre anglaise. Dans son étude "Kapitaal en Arbeid in Nederland" ([2] [976]) la théoricienne socialiste Roland Holst notait que : "Depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, notre pays était entré en décadence, puis dans un état de stagnation et de développement défectueux, anormalement lent. En l'espace de plusieurs générations, notre prolétariat dégénéra physiquement et spirituellement." Et Engels, dans le même sens, analysait les Pays-Bas du XIXe siècle comme "un pays dont la bourgeoisie se nourrit de sa grandeur passée et dont le prolétariat s'est tari" ([3] [977])
Ces caractéristiques historiques expliquent la lenteur du développement du mouvement ouvrier et révolutionnaire aux Pays-Bas. Le mouvement ouvrier fut au départ un mouvement d'artisans et d'ouvriers de petites entreprises artisanales, où les cigariers et les ouvriers diamantaires -qui formaient un prolétariat juif à Amsterdam- jouaient un rôle de premier plan. La classe ouvrière proprement "néerlandaise" -c'est-à-dire d'origine rurale- était encore au milieu du XIXe siècle extrêmement réduite. Le prolétariat était soit d'origine juive soit allemand. Cette particularité explique la réceptivité très grande au marxisme. Mais le caractère tardif du développement industriel, laissant subsister les traits archaïques du travail artisanal, simultanément, fit de la Hollande pendant plusieurs décennies une terre d'élection pour l'anarchisme.
Jusqu'en 1848, les mouvements sociaux restèrent très limités prenant la forme d'explosions de révolte qui en tant que telles ne pouvaient se donner des buts conscients. Les manifestations de chômeurs d'Amsterdam et la marche de la faim de La Haye, en 1847, n'étaient pas encore des expressions claires d'une conscience de classe ouvrière, en l'absence d'un prolétariat développé et concentré. Pendant la Révolution de 1848, les manifestations et les pillages de magasins à Amsterdam avaient été le fait d'un véritable lumpenprolétariat dont les actions désespérées étaient étrangères à un prolétariat devenu conscient, et donc organisé.
Les premières formes d'organisation du prolétariat en Hollande traduisent immédiatement la nature internationale du mouvement ouvrier naissant. En 1847, se crée un Club communiste d'ouvriers allemands qui déploie ses activités dans le prolétariat néerlandophone ([4] [978]). Un an plus tard, la Ligue des communistes, qui avait plusieurs sections aux Pays-Bas, pouvait introduire illégalement des exemplaires, tout juste sortis de l'imprimerie, de la première édition du "Manifeste communiste". Mais ces premiers pas du mouvement marxiste restèrent pendant plus de vingt années sans lendemain, en l'absence d'un véritable développement industriel qui ne se manifesta qu'à partir des années 70. La section de l'A.I.T. resta sous l'influence des idées anarchistes et syndicalistes, lorsque se forma en 1871 la Ligue ouvrière des Pays-Bas. En effet, en 1872, au congrès de La Haye, les délégués hollandais se rallièrent aux thèses de Bakounine.
C'est l'industrialisation naissante, favorisée par l'afflux de capitaux allemands, à la suite de la victoire de la Prusse sur la France, qui permet finalement la naissance du mouvement socialiste hollandais. En 1878 est fondée à Amsterdam l'Association social-démocrate (Sociaal-Democratische Vereeniging) qui va bientôt entraîner localement (La Haye, Rotterdam, Haarlem) le surgissement de groupes se fixant comme tâche la direction de la lutte de classe. Le regroupement de ces associations ouvrières prend le nom d'Union social-démocrate (Sociaal Democratische Verbond). Le terme d'union montre déjà toute l'ambiguïté d'une organisation qui va osciller entre le marxisme et l'anarchisme anti-centraliste. LA "SOCIAAL DEMOCRATISCHE BOND"
La personnalité qui va marquer à ses débuts le mouvement ouvrier hollandais est Domela Nieuwenhuis, un ancien pasteur converti au socialisme. A l'époque, Nieuwenhuis n'était pas encore anarchiste et menait de grandes campagnes pour le suffrage universel. L'activité de son mouvement consistait à diriger les grèves économiques et à favoriser l'édification de syndicats. La fondation en 1879 de la revue "Recht voor aile" -organe du Sociaal-democratische Bond (SDB) amena une grande agitation dans les groupes d'ouvriers. Son activité était multiple : diffusion de tracts dans les usines et les casernes, tâches d'éducation du prolétariat par des cours sur le marxisme ; manifestations et meetings contre l'armée, les Eglises, la monarchie, l'alcoolisme et la justice de classe.
Bientôt la répression allait s'abattre sur le mouvement ouvrier naissant. Nieuwenhuis fut arrêté et condamné à une année de prison. Pour la première fois de son histoire, la police commença à s'armer, aidée par l'intervention de l'armée "en cas de conflit". La police avait le droit d'être présente dans les réunions publiques, de les dissoudre et d'arrêter les orateurs socialistes.
Se considérant comme un disciple de Marx et d'Engels, Nieuwenhuis maintint pendant, longtemps des contacts épistolaires avec les théoriciens du socialisme scientifique. Ceux-ci, bien que suivant avec sympathie le développement du mouvement socialiste en Hollande, étaient très réservés sur les conceptions immédiatement "révolutionnanstes" de Domela Nieuwenhuis. Marx mettait en garde contre tout doctrinarisme qui chercherait à dresser des plans- sur "un programme d'action pour le premier jour après la révolution" ([5] [979]). Le bouleversement de la société ne pouvait être un "rêve de la fin du monde prochaine".
Au contraire, "la notion scientifique de la décomposition inévitable et constante du régime social existant, les masses de plus en plus exaspérées par des gouvernements qui incarnent les spectres du passé, et d'autre part le développement positif des moyens de production, tout cela nous garantit qu'au moment où la véritable révolution prolétarienne éclatera, modus operandi (toutes les conditions de son progrès immédiat (rien moins qu'idylliques, évidemment) auront été créées". ([6] [980])
Dans les années 80, Nieuwenhuis et le SDB ne rêvaient nullement d'un "Grand Soir", à la façon des anarchistes de l'époque qui faisaient abstraction de la maturation des conditions de la révolution. Comme les socialistes de son temps, Nieuwenhuis était convaincu de la justesse de la tactique parlementaire, comme tribune pour le mouvement ouvrier naissant. Très populaire parmi les ouvriers, mais aussi chez les petits paysans du Nord des Pays-Bas, il fut élu député en 1889. Pendant deux années, il proposa des réformes : sécurité sociale, indépendance des colonies, suppression du salaire en nature pour les ouvriers, réformes qui constituaient le "programme minimum" de la social-démocratie.
Mais bientôt, Domela Nieuwenhuis ne tarda pas à rejeter le parlementarisme, et devint le seul dirigeant social-démocrate antiparlementaire au sein de ia Ile Internationale nouvellement créée. Ce rejet du parlementarisme le rapprochait insensiblement des positions anarchistes. Cette évolution s'explique par l'essor de la lutte de classe au cours des années 90 aussi bien en Hollande que dans d'autres pays, et qui se traduit par une croissance numérique du mouvement ouvrier organisé. Sous la pression d'une- crise cyclique, qui se traduit par un développement du chômage, des troubles éclatent. Aux Pays-Bas, les ouvriers s'affrontent à la police, laquelle soutient des bandes de la pègre qui donnent l'assaut aux locaux du SDB. Dans ce climat, qui entretenait l'espoir d'une proche "lutte finale", Nieuwenhuis et les militants du SDB se mirent à douter de la tactique parlementaire.
FAUSSES REPONSES A L'OPPORTUNISME
Cette remise en cause du parlementarisme n'était pas le simple fait du parti hollandais. Les années 90 voient se développer aussi bien l'opposition anarcho-syndicaliste qu'une opposition dans la social-démocratie internationale qui nient toute activité de type parlementaire. La domination de la fraction parlementaire sur le parti, comme dans la social-démocratie allemande, les tendances opportunistes qu'elle véhicule, autant de facteurs qui expliquent la révolte d'une partie des nouveaux adhérents contre la direction du parti. Ceux qui se nommeront les "Jeunes" (Jungen) en Allemagne, et dont l'exemple se propagera dans d'autres pays comme la Suède et le Danemark, vont être à la pointe d'une contestation souvent ambiguë, en dénonçant les tendances réformistes gangrenant la direction parlementaire ([7] [981]), souvent de façon juste, mais en cédant progressivement à des tendances anarchisantes anti-organisation ([8] [982]). En fait, il s'agissait de savoir si la période était une période révolutionnaire, ou au contraire une période de croissance du capitalisme impliquant une activité immédiate dans les syndicats et dans les parlements.
Sur cette question, Nieuwenhuis et les "Jeunes" en Allemagne, ainsi que les anarchistes, cristallisaient une impatience petite-bourgeoise, d'autant plus vive qu'elle se nourrissait d'une opposition saine aux tendances réformistes.
En Hollande même, le débat sur la tactique à employer par le mouvement ouvrier allait être faussé par le fait que l'opposition à Nieuwenhuis était conduite dans le SDB autant par des réformistes avérés, comme Troelstra, que par des marxistes, comme Van der Goes, qui restaient fermement révolutionnaires. Le SDB ayant majoritairement décidé -par une résolution- en 1892, de ne pas participer aux élections, il se forma autour des futurs chefs révisionnistes de la social-démocratie (Troelstra, Van Kool, Vliegen) et des jeunes intellectuels qui venaient d'adhérer au parti une opposition parlementanste. Uniquement pour participer aux élections, qu'une récente loi avait modifiées dans Je sens de l'abolition du système censitaire, et sans chercher à convaincre la majorité, la minorité scissionna. Ainsi, dans la pire confusion et avec des arrière-pensées électoralistes, naissait en 1894 la social-démocratie hollandaise, le SDAP. Cette scission était non seulement confuse mais prématurée. La majorité du SDB devait en effet progressivement se rallier à 'la tactique de participation aux élections : ce qu'elle fit dans les faits, en présentant en 1897 des candidats. Cette nouvelle orientation rendait caduque l'existence séparée du SDB, dont les 200 adhérents décidaient en 1899 la fusion de leur parti avec celui de Troelstra. Cette fusion eut pour conséquence la sortie de Nieuwenhuis et de Cornelissen. Ce dernier, avec Nieuwenhuis, représentait la tendance anarchiste du SDB. A son instigation avait été créé le NAS, d'orientation plus syndicaliste révolutionnaire qu'anarchiste, en 1893. Ce petit syndicat radical jouera par la suite un grand rôle dans le mouvement ouvrier : non seulement il représentera une attitude militante dans la lutte de classe, à la différence du syndicat social-démocrate NVV créé par le SDAP et qui jouera un rôle de saboteur des grèves (cf. infra), mais il constituera progressivement l'organisation syndicale des Tribunistes puis celle du parti communiste ([9] [983]).
L'évolution de Nieuwenhuis vers les positions anarchistes n'enlève rien au fait qu'il demeure une grande figure du mouvement ouvrier international. Devenu anarchiste, il ne trahira pas la classe ouvrière, à la différence des chefs anarchistes comme Kropotkine qui trempèrent dans la guerre impérialiste ; il sera l'un des rares anarchistes à demeurer internationa-tionaliste ([10] [984]). Il n'en demeure pas moins nécessaire de voir toutes les limites de l'apport de Nieuwenhuis, puisque ce dernier est devenu pour beaucoup le symbole de l'impossibilité de demeurer dans une Ile Internationale, qui aurait été "bourgeoise" dès le début ([11] [985]). Il est important donc d'évaluer la portée de la critique faite par Nieuwenhuis à la social-démccratie allemande. Celle-ci est valable dans la mesure où elle rejoint celle faite par Engels à la même époque, puis par la suite par la Gauche. Dans son livre "Le socialisme en danger", publié en 1897, au moment de sa sortie du SDB, il dénonce avec justesse un certain nombre de tares de la direction de la social-démocratie, qui allaient se cristalliser en la théorie révisionniste de Bernstein : la pénétration des éléments petits-bourgeois dans le parti, mettant en danger la nature prolétarienne du parti, et se manifestant par des concessions idéologiques à leur égard, notamment lors des élections ; la théorie du socialisme d'Etat qui conçoit la révolution comme une simple prise en main réformiste de l'Etat par le mouvement ouvrier : "...les social- démocrates sont de simples réformateurs qui veulent transformer la société actuelle selon le socialisme d'Etat" ([12] [986])
Mais la portée des critiques de Nieuwenhuis reste limitée. Il représente une tendance anarchiste religieuse, tolstoienne, très présente dans le mouvement ouvrier hollandais, qui subsistera jusqu'à la première guerre mondiale où elle représentera le courant pacifiste. En niant la nécessité d'une violence de classe -nécessaire pour la prise du pouvoir par le prolétariat- et d'une dictature du prolétariat sur la bourgeoisie, Nieuwenhuis rompait définitivement avec le marxisme qu'il avait contribué à introduire en Hollande et évoluait vers le pacifisme tolstoien : "..les anarchistes communistes demandent l'abolition de l'autorité politique, c'est-à-dire de l'Etat, car ils nient le droit d'une seule classe ou d'un seul individu à dominer une autre classe ou un autre individu. Tolstoï l'a dit d'une manière si parfaite qu'on ne peut rien ajouter à ses paroles." ([13] [987])
Ceux qui se réclament -comme les anarchistes et leurs successeurs actuels- de Nieuwenhuis pour proclamer la IIe Internationale "bourgeoise dès l'origine" nient un certain nombre d'évidences : la IIe Internationale a été le lieu où s'est développé éduqué et trempé le prolétariat développé des grandes concentrations industrielles, quittant ses caractéristiques artisanales, celles qu'il avait encore au temps de la 1ère Internationale et qui expliquent le poids de l'anarchisme. C'est à travers cette Internationale, qui n'avait pas encore failli, que s'est développé numériquement, mais aussi qualitativement le prolétariat socialiste en Europe et hors d'Europe ;
- c'est au sein de l’internationale que s'est développée la résistance au révisionnisme, à l'opportunisme. C'est en son sein que s'est enrichi le marxisme par les contributions de Luxemburg, Pannekoek. D'un corps bourgeois n'aurait pu sortir aucun corps prolétarien;
- c'est le fédéralisme, et non le centralisme qui ont fini par miner l'Internationale, au point de la transformer en une simple addition de sections nationales. C'est sur cette base que s'est développé le pouvoir exorbitant des cliques parlementaires qui ont fini par dominer les partis de toute leur autorité. En effet, dès le départ, il était affirmé en 1889 dans une résolution que "dans aucun cas et sous aucune pression" il n'était question de"porter atteinte à l'autonomie des groupements nationaux, ceux-ci étant seuls les meilleurs juges de la tactique à employer dans leur propre pays". ([14] [988])
De fait, la Gauche -dans les pays où elle surgit- luttera toujours pour un strict centralisme et pour le respect de la discipline de l'Internationale dans les partis nationaux, contre la volonté des chefs de ces partis organisés en fraction parlementaire autonome par rapport à l'organisation. Comme les bolcheviks, puis plus tard Bordiga, la Gauche hollandaise -ainsi d'ailleurs que les Gauches allemande et polonaise- mène ce combat pour le respect des principes d'une Internationale centralisée.
LES DEBUTS DE LA GAUCHE HOLLANDAISE
Que la social-démocratie hollandaise ne fût pas "bourgeoise" dès le commencement, la preuve en est donnée par l'adhésion au parti après 1897 d'une pléiade de marxistes dont les contributions au mouvement révolutionnaire international allaient être considérables.
Cette Gauche marxiste présente la particularité d'avoir été composée d'artistes et de scientifiques qui ont compté dans l'histoire de la Hollande. Gorter, le plus connu, est certainement le plus grand poète des Pays-Bas. Né en 1864 d'un père pasteur et écrivain, après avoir écrit une thèse sur Eschyle, il se fit connaître comme le poète de "Mai" -son poème le plus célèbre (1889). Après une crise spirituelle qui le mena vers une forme de panthéisme - s'inspirant de l'Ethique de Spinoza qu'il traduisit du latin en hollandais- Gorter se mit à étudier Marx, pour finir par adhérer en 1897 au SDAP. Très dynamique et remarquable orateur, Gorter a été surtout un bon vulgarisateur du marxisme qu'il a exposé dans un style très vivant, facilement compréhensible par la grande majorité des ouvriers ([15] [989]).
Moins pratiquement, et plus théoriquement, Pannekoek s'inscrivit dans le mouvement de la gauche marxiste internationale, et fut le moins "hollandais" de tous. Astronome réputé, il adhéra au mouvement socialiste en 1899. Né en 1873, fils d'un directeur d'entreprise, il sut se dégager de son milieu bourgeois pour se consacrer sans réserve à la cause prolétarienne. D'esprit rigoureux, par sa formation scientifique et philosophique, Pannekoek a été l'un des principaux théoriciens de la Gauche ; dans bien des domaines et débats théoriques -comme celui mené sur la signification de la grève de masses (cf. infra)- il s'est trouvé l'égal de Luxemburg, par la profondeur de sa réflexion, et a influencé Lénine dans son livre "L'Etat et la Révolution". L'un des premiers, parmi les marxistes, Pannekoek a mené le combat contre le révisionnisme naissant. Par son étude sur "La philosophie de Kant et le marxisme", publiée en 1901, il attaquait la vision néo-kantienne des révisionnistes qui faisaient du socialisme scientifique non une arme de combat mais une simple éthique bourgeoise. Cependant, plus- théoricien qu'homme d'organisation, son influence s'exerça essentiellement dans le domaine des idées, sans qu'il soit capable d'être une force active dans le combat organisationnel contre la majorité opportuniste du SDAP ([16] [990]).
Moins connus, d'autres intellectuels de la Gauche ont pesé d'un poids énorme et ont contribué souvent par leurs confusions à ternir l'image de cette Gauche. La poétesse Roland-Holst, bien qu'ayant contribué avec force à la théorie marxiste et à l'histoire du mouvement ouvrier ([17] [991]), symbolise à la fois une certaine religiosité mal digérée dans le socialisme naissant et les hésitations "centristes" au moment des grandes décisions à prendre sur le plan organisationnel. En dehors d'elle, des militants comme Wijnkoop et Van Ravesteyn se sont imposés par la suite comme les véritables organisateurs du mouvement tribuniste. Oscillant entre un radicalisme verbal et une pratique qui devait se révéler à la longue comme opportuniste, ils allaient contribuer à affaiblir le rayonnement de la Gauche hollandaise, qui apparut plus comme une somme de théoriciens brillants que comme un véritable corps.
Le drame de la Gauche hollandaise à sa naissance a été que des théoriciens marxistes reconnus internationalement, d’une grande force de conviction révolutionnaire, comme Gorter et Pannekoek, se soient peu impliqués dans la vie organisationnelle de leur parti. En cela, ils diffèrent de Lénine, Luxemburg, qui étaient aussi bien des théoriciens que des hommes de parti. Gorter, au sein du mouvement, était constamment déchiré entre son activité de poète -à laquelle par périodes il se consacrait totalement- et son activité militante de propagandiste et d'orateur du parti. D'où son activité hachée, et même épisodique au point de disparaître parfois des congrès du parti ([18] [992]). Pannekoek, pris à la fois par ses recherches d'astronome et son activité de théoricien marxiste, ne se sentait nullement un homme d'organisation ([19] [993]). Il ne se donna vraiment à plein au mouvement socialiste qu'à partir de 1909 jusqu'en 1914, en Allemagne, où il donnait des cours, comme professeur rémunéré, à l'école du parti de la social-démocratie allemande. Il se trouva donc absent de la Hollande au moment le plus crucial, quand se précipitait le processus de la scission au sein du SDAP. Dans cette période de développement du mouvement ouvrier, le poids des personnalités, des individus brillants, restait énorme. Il était d'autant plus négatif que les chefs des partis étaient des révisionnistes avérés qui écrasaient de toute leur personnalité la vie du parti. Tel était Troelstra, un avocat qui était poète frison à ses heures perdues. Il était un pur produit du parlementarisme. Constamment élu non par des secteurs ouvriers, mais par les paysans arriérés de la Frise, il avait tendance à se placer du point de vue des intérêts de la petite-bourgeoisie. Proche de Bernstein, il se définissait comme un révisionniste, voire un "libéral" bourgeois au point de déclarer en 1912 que "la social-démocratie tient aujourd'hui le rôle que le Parti libéral a tenu vers 1848" ([20] [994]). Mais il avait suffisamment d'habileté pour se montrer, lors des congrès de l'Internationale proche du Centre de Kautsky, pour pouvoir avoir les coudées franches dans son territoire national en toute autonomie. Soucieux de garder son poste de parlementaire et de chef du SDAP, il était prêt à n'importe quelle manoeuvre pour éliminer toute critique dirigée contre son activité opportuniste, voire exclure les opposants. Toute critique ne pouvait être, du point de vue de Troelstra et d'autres révisionnistes comme Vliegen et Van Kol, que de l'anarchisme ou de pures critiques "personnelles". Le poids des chefs dans ce parti récent, et issu d'une scission ambiguë, allait être un obstacle considérable auquel dut faire front l'ensemble de la Gauche.
La lutte de la Gauche allait se mener dès l'adhésion d'éléments nouveaux et jeunes, comme Gorter, Pannekoek, Roland-Holst, Wijnkoop et Van Ravesteyn Groupés autour de la revue "Nieuwe Tijd" (Temps nouveau), qui voulait rivaliser avec la revue théorique de Kautsky, "N'eue Zeit", ils commencèrent à mener un combat pour la défense des principes du marxisme foulés au pied par une pratique réformiste croissante. Leur combat allait être d'autant plus intransigeant que des militants comme Gorter et Pannekoek avaient des relations d'amitié avec Kautsky et crurent trouver son soutien dans la lutte contre le révisionnisme au sein de la Deuxième Internationale.
Chardin
[1] [995] Peter Struvé était l'un de ces bourgeois libéraux russes qui à 'la fin» du 19e siècle s'étaient pris de "passion" pour le marxisme, en lequel il ne voulaient voir qu'une théorie du passage pacifique du féodalisme au capitalisme industriel. Leur marxisme "légal", car toléré et même encouragé par la censure tsariste était un apologie du capitalisme. Struve devint bientôt l'un des chefs du parti libéral Cadet et se trouva au premier rang de la contre-révolution bourgeoise en 19 17.
[2] [996] Ce livre a été publié en 1932.Citation extraite de M.C.Wiessing :"Die Hollandische Schule des Marxismus" (L'école hollandaise du marxisme), VSA Verlag, Hambourg, 1980.
[3] [997] Marx-Engels Werke (MEW), volume 23, p.335-336
[4] [998] Cf, livre de Wiessing, déjà cité.
[5] [999] Lettre de Nieuwenhuis à Marx du 28 mars 1882, citée par Wiessing, p. 19.
[6] [1000] Lettre h Nieuwenhuis du 22 février 1881 (MFM, volume 35, p.159).
[7] [1001] Des exemples concrets de l'opportunisme des dirigeants parlementaires Liebknecht et Bebel sont donnés -citations à l'appui- par Nieuwenhuis dans "Le socialisme en danger" (1894, reprint Payot 1975)
[8] [1002] On trouvera les critiques d'Engels aux "Jeunes" dans le recueil de textes de Marx-Engels sur "La social-démocratie allemande" (10/18, Paris 1975).
[9] [1003] Cf. R. de Jong :"Le mouvement libertaire aux Pays-Bas"("Le mouvement social" n°83, avril-juin 73)
[10] [1004] Pendant la guerre, Nieuwenhuis distribuait les brochures de Gorter.
[11] [1005] Les conseillistes de "Daad en Gedachte" (Action et Pensée), en Hollande, affirment dans leur numéro de février 1984 que "en réalité, la social-démocratie n'est pas devenue un parti de réformes bourgeois ; elle l'était dès le commencement..." Un groupe comme le G.CI. (Groupe communiste internationaliste), de tendance bordiguiste, ne fait que reprendre les thèses anarchistes et conseillistes en affirmant exactement la même chose : ".ce sont ces tendances bourgeoises dénoncées par Marx qui domineront entièrement la social-démocratie et ce dès la naissance de la seconde Internationale". Citant abondamment le préfacier du livre de Nieuwenhuis, republié par Payot, Bériou -l'un des "théoriciens" du modernisme qui font du prolétariat une "classe pour le capital"- le G.C.I. rejoint la constellation politique des modernistes et conseillistes. Voir à ce sujet son article "Théories de la décadence, décadence de la théorie", in "Le Communiste", n° 23, novembre 1985.
[12] [1006] Toutes ces citations sont extraites du livre de Nieuwenhuis, republié par Payot en 1975.
[13] [1007] Toutes ces citations sont extraites du livre de Nieuwenhuis, republié par Payot en 1975.
[14] [1008] Cf. le livre de C Haupt : "La Deuxième Internationale, étude critique des sources. Essai biblio graphique", Mouton, Paris-La Haye, 1964. Beaucoup d'éléments sur l'absence de centralisation.
[15] [1009] li. n. ve Liagre Bohl : "Herman Gorter", SUN, Nijmegen, 1973. Biographie de Gorter, la seule existante et en langue hollandaise.20
[16] [1010] Sur Pannekoek, il existe une introduction par un ancien communiste des conseils, B.A. Sijes, qui a publié les "Mémoires" écrites par le théoricien des conseils ouvriers en 1944 : "Herinnerigen", Van Gennep, Amsterdam, 1982. En langue française, est disponible une importante notice biographique sur Pannekoek dans 1'ouvrage de Serge Bricianer, "Pannekoek et les conseils ouvriers" (EDI, Paris 1969), recueil et commentaires des textes du grand militant communiste hollandais.
[17] [1011] Les contributions de Roland-Holst sur la "grève de masses" attendent toujours d'être republiées et traduites dans des langues autres que le hollandais. Cf. "De revolutionaire masssa-aktie. Een Studie", Rotterdam, 1918
[18] [1012] En 1903, Gorter publiait ses "Versen", d'inspiration individuelle. Par la suite, il chercha à écrire des poèmes d'inspiration "socialiste", qui étaient loin d'avoir la force et la valeur poétiques de son inspiration première. "Een klein heldendicht" (1906) -"Une petite épopée"- chante l'évolution u'un jeune prolétaire vers la conviction du socialisme. "Pan" (1912), composé après la scission de 1909, est un poème moins idéologique et plus inspiré par une vision poétique de l'émancipation de l'homme et de la femme aimée. Sans que son inspiration se soit vraiment tarie, Gorter était écartelé entre son activité de propagandiste et sa création poétique où il oscillait entre le lyrisme personnel et l'épopée socialiste didactique.
[19] [1013] Pannekoek écrivait à Kautsky qu'il préférait en général "n'apporter que des éclaircissements théoriques". Il ajoutait : "Vous savez que... je ne me laisse entraîner dans les luttes pratiques que contraint et forcé." (Cité par Sijes, op. cit., p. 15). On est très loin de l'attitude d'autres dirigeants du courant de gauche international, qui -comme Lénine et Luxemburg-, n'hésitaient pas, en menant de front leurs travaux théoriques, à se plonger et se laisser entraîner dans les luttes quotidiennes
[20] [1014] Cité par Sam de Wolff -un social-démocrate d'origine juive qui finit par devenir sioniste- : "Voor het land van Belofte. Een terugblik op mijn leven" (Avant la terre promise. Un coup d'oeil en arrière sur ma vie), SUN, Nijmegen, 1978
Géographique:
- Hollande [558]
Conscience et organisation:
La "fraction externe du CCI" (polémique)
- 2885 reads
QUESTION D'ORGANISATION : UNE CARICATURE DE SECTE IRRESPONSABLE
Le milieu politique prolétarien, déjà fortement marqué par le poids du sectarisme, comme le CCI l'a souvent mis en évidence et déploré, vient de "s'enrichir" d'une nouvelle secte. Il vient en effet de paraître le n° 1 d'une nouvelle publication intitulée Perspective Internationaliste, organe de la "Fraction Externe du CCI" qui "revendique la continuité du cadre programmatique élaboré par le CCI". Ce groupe est composé des camarades appartenant à la "tendance" qui s'était formée dans notre organisation et qui l'a quittée lors- de son 6ème Congrès ([1] [1015]) pour "défendre la plate-forme du CCI". Nous avons déjà rencontré et mis en évidence beaucoup de formes de sectarisme parmi les révolutionnaires d'aujourd'hui, mais la création d'un CCI-bis ayant les mêmes positions programmatiques que le CCI constitue un sommet en ce domaine, un sommet jamais atteint jusqu'à présent. De même, ce qui peut être considéré comme un sommet, c'est la quantité de calomnies que P.I. déverse su le CCI ; il n'y a guère que le Communist Bulletin (formé également d'ex-membres du CCI) qui soit allé aussi loin dans ce domaine. Dès sa création, ce nouveau groupe se place donc sur un terrain que seul des voyous politique (qui s'étaient distingués en volant du matériel et des fonds du CCI avaient par le passé exploité avec autant de ferveur. Même si les membres de la "Fraction" ne se sont nullement rendus responsables de tels actes, on peut dire que son sectarisme et sa prédilection pour 1'insulte gratuite augurent mal de l'évolution future de ce groupe et de sa capacité d'être une contribution à l'effort de prise de conscience du prolétariat En effet, les petits jeux de la FECCI ne traduisent qu'une chose : une irresponsabilité totale face aux tâches qui incombent aujourd'hui aux révolutionnaires, une désertion du combat militant.
Calomniez, calomniez,...il en restera toujours quelque chose.
Dans le principal article de" P.I. consacré au CCI, on peut lire que "ce texte ne visera ni à régler des comptes, ni à tomber dans une basse polémique. On peut se demander ce que ce texte aurait été si tel avait été le cas. En effet, dans cet article, on peut lire, entre autres compliments, qu'au cours de ces deux dernières années, le CCI aurait fait preuve d'un mépris intolérable pour les principes révolutionnaires, traînés dans la boue de volte-face tactiques", qu'il aurait développé "une vision tout à fait stalinienne de l'organisation", qu'il se serait "enfoncé dans la pourriture" et que, "pour faire avaler la couleuvre de ses revirements à 180°", il aurait employé comme moyen de "semer la peur, terroriser et paralyser, l'ensemble des militants par des insinuations malsaines". En même temps, le CCI aurait, contre les camarades minoritaires qui ont constitué la FECCI, "mis en marche une machine infernale visant à broyer toute résistance" et dont la liste des exactions est impressionnante : "pratiques organisationnelles sordides", "chasse aux sorcières", "attaques personnelles de toutes sortes", "calomnies", "suspicion", "procédés inqualifiables", "multiples pressions et manoeuvres", "chantage". Ce n'est là qu'un petit échantillon de ce qu'on peut trouver dans cet article mais on peut se demander qui se livre à des"incantations hystériques", le CCI comme l'écrit la FECCI ou la FECCI elle-même ?
On pourrait écarter d'un revers de main ces calomnies ; mais elles sont d'une telle ampleur et en telle quantité qu'on peut craindre qu'elles ne finissent par impressionner les lecteurs mal informés de la réalité du CCI, que du fait qu'elles émanent d'une organisation prétendant défendre la plateforme du CCI, ce qui devrait être un gage de sérieux-elles n'insinuent l'idée "qu'il n'y a pas de fumée sans feu". Aussi, même si nous ne répondons pas à toutes les accusations de la FECCI (ce qui occuperait la totalité de ce numéro de la Revue), nous sommes contraints de récuser quelques uns des mensonges qu'on peut trouver dans les pages de P.I. ridicules jusqu'à des accusations d'une malveillance odieuse.
C'est ainsi que l'article sur le "déclin du CCI" commence par un "petit mensonge". La première phrase affirme que "la plupart des camarades qui ont constitué la Fraction externe du CCI ont été à la base de la constitution de cette organisation en "1975". C'est faux : des dix camarades qui ont quitté le CCI pour constituer la FECCI, trois seulement était dans l'organisation à la fondation du CCI en janvier 75.
L'article de PI fourmille de ce genre de "petits mensonges" ridicules. Il reprend par exemple un vieux dada de la "tendance" suivant lequel l'analyse présente du CCI sur l'opportunisme et le centrisme constituerait un revirement de ses positions classiques. Nous avons montré dans la Revue n° 42, citations à l'appui, que c'est en réalité l'analyse de la tendance qui constitue une révision des positions du CCI et de la gauche communiste. Nous ne lui chercherons pas ici querelle pour cette révision. Mais il faut constater que le procédé qui consiste à refuser d'assumer une démarche en l'attribuant aux autres est bien symptomatique de ce qu’a été le comportement de la "tendance" et que reprend aujourd'hui la FECCI : obscurcir par des contorsions et par la mauvaise foi les véritables questions posées.
Cette même propension à reprocher à autrui (en l'occurrence le CCI) ce qui lui revient de droit, nous la retrouvons lorsque P.I. accuse le CCI de "manque d'esprit fraternel". C'est de nouveau le monde à l'envers, nous n'allons pas ennuyer le lecteur en énumérant les multiples exemples où ce sont des camarades de la "tendance" qui se sont illustrés par un tel "manque d'esprit fraternel". Il suffit de lire dans P.I. la collection d'insultes odieuses, animée par la hargne et un esprit de revanche, qui s'intitule "Le déclin du CCI" pour se rendre compte de quel côté se situe le "manque d'esprit fraternel".
"PERSPECTIVE INTERNATIONLISTE"
Ils sont en nombre incalculable et prennent plusieurs formes en partant de petites contre vérités
Nous pourrions poursuivre la réfutation de ces petits mensonges mais ce serait fastidieux. Il est préférable de mettre en évidence les mensonges énormes qu’emploie la FECCI pour justifier sa thèse de la dégénérescence du CCI.
Le premier d'entre eux dépasse toute mesure : les camarades de la "tendance" auraient été exclus du CCI. Mal à l'aise pour soutenir une telle affirmation, la FECCI prend le soin de préciser dans certaines phrases qu'il s'agissait d'une exclusion "de fait". Il faut le réaffirmer nettement : c'est totalement faux. Ces camarades n'ont pas été exclus, ni formellement ni "de fait". Dans le précédent n° de la Revue nous expliquons, les circonstances du départ de ces camarades. En particulier nous y donnions connaissance d'une résolution adoptée à l'unanimité par le 6ème congrès montrant clairement que le départ de ces camarades était de leurs seules responsabilité et volonté. Sans y revenir dans le détail, rappelons ici :
- que le congrès a demandé aux camarades de la "tendance" quelles étaient leurs intentions pour après celui-ci, en particulier s'ils comptaient rester des militants du CCI, dans la mesure où certains d'entre eux avaient affirmé à plusieurs reprises qu'ils comptaient se retirer après le congrès ;
- que les camarades de la tendance ont constamment refusé de répondre à cette question dans la mesure où, en fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux là-dessus ;
- que face à ce refus de répondre, le congrès a demandé à ces camarades de se retirer de la séance pour qu^ils puissent réfléchir, discuter et revenir à la séance suivante avec une réponse claire ;
- que les camarades ont pris prétexte de cette demande pour se retirer du congrès en prétendant qu'on les avait exclus de celui-ci, ce qui est parfaitement faux ;
- que le congrès a adopté une résolution transmise par téléphone à ces camarades exigeant leur retour au congrès ;
- que ces camarades ont opposé une fin de non recevoir à cette demande en la qualifiant de "tentative de justification ignoble de l'exclusion de la tendance" ;
- que le congrès a adopté une résolution condamnant cette attitude qui "traduit un mépris du congrès et de son caractère de moment d'action militante de l'organisation" et "constitue une véritable désertion des responsabilités qui sont celles de tout militant de l'organisation".
Cette résolution prévoyait des sanctions contre ces camarades mais nullement leur exclusion.
Prétendre après cela que la "tendance" a été exclue du CCI, ou mené du congrès, est un mensonge aussi odieux que ridicule car le procès-verbal du congrès prouve exactement le contraire. D'ailleurs ces camarades savaient pertinemment en partant qu'ils n'avaient pas été exclus de l'organisation puisque dans la déclaration remise au moment de leur départ ils affirmaient qu'ils restaient "comme tendance et comme camarades minoritaires au sein du CCI".
Un autre mensonge énorme et tout aussi odieux qu'on peut lire dans P.I., c'est l'affirmation que le CCI aurait "étouffé" les débats, y compris par l'utilisation do mesures disciplinaires, et aurait censuré – l’expression publique des positions de la "tendance". Encore une fois, c'est le monde à l'envers ! En janvier 84, il a fallu insister auprès des camarades qui avaient émis des "réserves" pour qu'ils fassent parvenir à l'ensemble de l'organisation leurs explications de votes. Un an plus tard, c'est l'organe central qui demande que "les éventuelles contributions doivent être conçues en vue de l'ouverture du débat vers l'extérieur".
Franchement, affirmer que le CCI, ou son organe central, a "étouffé" le débat, qu'il a évolué vers le monolithisme comme le prétend la FECCI, c'est se moquer du monde. Les bulletins internes de l'organisation ont publié sur plus d'un an environ 120 textes portant sur la discussion soit environ 700 pages. Tous les textes des camarades minoritaires sans exception ont été publiés. |En fait de "monolithisme", c'est de façon permanente que l'organisation a insisté sur l'exigence de clarté, sur la nécessité que s'expriment de la façon la plus précise possible les différentes positions existant en son sein.
Il en est de même en ce qui concerne la publication vers l'extérieur des débats internes. C'est une calomnie grossière et stupide que de prétendre que le CCI "n'en a pratiquement rien laissé filtrer depuis deux ans et qu'il a établi autour un "mur du silence" (page 14). Tout lecteur a pu se rendre compte que les cinq derniers numéros de notre Revue ont donné une large place au débat (au total une quarantaine de pages avec trois textes de la "tendance" et trois textes défendant les positions du CCI). Toute aussi calomnieuse est l'affirmation suivant laquelle le CCI "a systématiquement censuré les textes dans lesquels nous essayions de dégager les enjeux réels du débat actuel" (p.25). En fait de censure systématique, les textes non publiés sont au nombre total de deux. L'un était destiné à la presse territoriale de Grande-Bretagne mais par le nombre même des questions traitées, il trouvait plus sa place dans la Revue Internationale, ce qui a été proposé à la "tendance" et refusé par elle. L'autre était la "Déclaration sur la formation d'une tendance" publiée dans P.I. (page 25). A son propos, l'organe central du CCI a adopté une résolution qui "relève dans la 'Déclaration' sur un certain nombre d'affirmations ou d'insinuations diffamatoires pour l'organisation" (suit la liste des passages concernés), qui "estime que, pour la dignité même du débat public, et donc de la crédibilité de l'organisation, de telles formulations ne peuvent paraître telles quelles dans le prochain numéro de la Revue" et "demande donc aux camarades signataires de la 'Déclaration', soit de les enlever du texte qui sera publié, soit de les argumenter, afin que ce débat public puisse se dérouler dans la clarté et s'éviter l'emploi des insultes gratuites". Cela est interprété par la FECCI : "le CCI s'arrogerait le droit de dicter à la minorité ce qu'elle pouvait (et ne pouvait pas) écrire et penser" (p.25).
Voilà comment on écrit l'histoire !
Si la "tendance" avait vraiment été intéressée à faire connaître la totalité de ses critiques, il lui suffisait de se donner la peine d'argumenter quelque peu les points qui, dans son texte, apparaissaient comme de simples insultes gratuites. Mais tel n'était pas son souci. Elle s'est drapée dans sa dignité offensée et a "catégoriquement refusé d'entrer dans ce jeu de compromissions" (P.I. p. 25), comme si expliciter un désaccord ou une critique était une "compromission".
C'est d'ailleurs là une constante dans la démarche de la "tendance" : elle a tout fait pour convaincre le reste du CCI de son manque de sérieux ...à elle, et a pleinement réussi.
LE "GLORIEUX COMBAT" DE LA TENDANCE
Lorsqu'une minorité apparaît dans une organisation pour essayer de la convaincre qu'elle fait fausse route, son comportement est au moins aussi important pour atteindre ce but que la validité de ses arguments politiques. P.I. dépeint comme un exemple de sérieux son action en vue de "redresser le CCI menacé de dégénérescence" : "les minoritaires avaient toujours mené leur lutte ouvertement de façon militante et responsable sans aucune atteinte au fonctionnement général de l'organisation, dans le but de convaincre le CCI de ses erreurs" (p. 22).
C'est une triste blague !
Dans les précédents numéros de la Revue nous avons mis en évidence l'inconsistance des arguments politiques de la "tendance". Le comportement de ses camarades tant dans le débat que dans la vie organisationnel le du CCI en a été le pendant fidèle. Comment peuvent-ils affirmer, par exemple, qu'ils n'ont porté "aucune atteinte au fonctionnement général de l'organisation" alors :
- qu'un membre de l'organe central a tenté d'annoncer à l'ensemble de l'organisation sa démission de celui-ci sans même le prévenir ;
- que plusieurs membres du même organe central ont communiqué à une section locale un document signé en tant que membres de cet organe et critiquant celui-ci sans le porter d'abord à sa connaissance ;
- qu'à plusieurs reprises se sont tenues des réunions dites "informelles" sans que l'organisation en ait été informée à l'avance »;
- que des membres de l'organe central ont manqué une réunion de celui-ci afin de pouvoir tenir une réunion de la "tendance".
Il ne manque pas d'autres exemples de l'absence de sérieux des camarades minoritaires dans le débat. Eux-mêmes en étaient d'ailleurs conscients lorsque, fin 84, ils faisaient (dans un texte justifiant la tenue régulière de réunions séparées) un "constat de carence dans (leur) contribution au débat en cours dans le CCI" : on est bien loin des affirmations satisfaites qu'on peut lire dans P.I. sur "l'inlassable impulsion des débats" par la minorité contre le "verrouillage" de l'organisation.
Nous ne citerons ici que deux exemples de cet "admirable" sérieux de la minorité :
- en juin 84, quatre camarades minoritaires, membres de l'organe central, votent à cinq minutes d'intervalle de façon totalement contradictoire sur la question du centrisme : dans un premier vote ils placent le centrisme dans la bourgeoisie, et dans un second vote ils en font un phénomène
au sein de la classe ouvrière;
- depuis le début du débat, les camarades minoritaires n'ont cessé d'affirmer la nécessité de "s'atteler enfin à la tâche difficile de développer à un niveau supérieur la théorie marxiste sur la conscience de classe et le rôle du parti sur les fondements déjà établis par le CCI". Et depuis deux ans, nous n'avons rien vu venir de la part de ces camarades. Rien ! Aucun texte ! Cela en dit long sur le sérieux avec lequel ils ont mené le débat.
UNE CARICATURE DE SECTE IRRESPONSABLE
Une question se pose : comment se fait-il que des membres de longue date de l'organisation, à l'expérience et aux capacités politiques souvent indiscutables, membres pour la moitié d'entre eux de l'organe central du CCI, aient pu se laisser aller à une telle régression qui les a conduits à des comportements de plus en plus irresponsables, jusqu'à scissionner de l'organisation et à déchaîner une telle quantité de mensonges odieux et ridicules contre celle-ci ? Toutes proportions gardées, nous assistons aujourd'hui à un phénomène très similaire à celui qui s'est développé au cours et à la suite du 2ème congrès du Parti Ouvrier Social Démocrate de Russie en 1903 et qui conduisit à la scission entre bolcheviks et mencheviks. A la tête des mencheviks il y avait également des militants de vieille date et d'une capacité politique reconnue, qui, pendant des années, avaient apporté beaucoup à la cause de la révolution socialiste, notamment à la rédaction de l'ancienne "Iskra" (1900-1903).
Et ce sont ces éléments (notamment Martov, rejoint par la suite par Plekhanov) qui allaient impulser un courant opportuniste dans le POSDR, courant qui s'achemina progressivement vers la trahison de classe.
Pour caractériser le phénomène du menchevisme à ses débuts et analyser ses causes, laissons la parole à Lénine, le chef de file de l'aile marxiste révolutionnaire dans le POSDR :
"…la nuance politique qui a joué un rôle immense au congrès et qui se distingue justement par sa veulerie,sa mesquinerie, par 1'absence d'une ligne propre,(...), par des oscillations perpétuel les entre les deux parties nettement déterminées, par la peur d'exposer ouvertement son credo, en un mot par son ' embourbement ' (dans le "marais"). (Il en est maintenant dans notre parti qui, à entendre ce mot, sont saisis d'horreur et crient à une polémique dénuée d'esprit de camaraderie... JI n'est guère de parti politique qui, connaissant la lutte intérieure,se soit passé de ce terme dont on se sert toujours pour désigner les éléments instables, qui oscillent^entre les combattants. Et les Allemands, qui savent faire tenir la lutte intérieure dans un cadre parfaitement convenable, ne se forma lisent pas au sujet du mot 'versumpft' (marais), et ne se sentent pas saisis d'horreur, ne font pas preuve d'une officielle et ridicule pruderie.)
Oeuvres, Tome 7, page 230.
"Mais le plus dangereux n 'est pas que Martov soit tombé dans le marais; c'est qu'y étant tombé fortuitement, loin de chercher à en sortir, il s'y soit enfoncé toujours davantage."
Oeuvres, Tome 7, page 78.
Nous avons là, à plus de 80 ans de distance, une caractérisation de la démarche dans laquelle se sont engagés les camarades de la minorité. Sur la base de réelles faiblesses conseillistes un certain nombre de camarades sont tombés fortuitement dans une démarche centriste à l'égard du conseillisme. Une partie d'entre eux s'est ressaisie mais il est arrivé aux autres ce qui était arrivé à Martov : refusant d'admettre qu'ils aient pu être victimes du centrisme (à entendre ce mot ils furent "saisis d'horreur et ont crié à la polémique dénuée d'esprit de camaraderie") ils s'y sont enfoncés toujours davantage. C'est ce que nous signalions déjà dans notre article de réponse à la "tendance" de la Revue n°43 ("Le rejet de la notion de centrisme : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe"). Ces camarades ont mal supporté qu'on puisse les critiquer, ils ont interprété un texte et une résolution se donnant pour but de mettre en garde contre le danger de centrisme dans l'organisation, et qui illustrait ce danger, entre autres, par leur attitude conciliante face au conseillisme, comme une insulte personnelle. Ce n'est nullement là une explication "subjectiviste" de leur démarche. Lénine explique en des termes similaires celle des Menchéviks :
"Lorsque je considère la conduite des amis de Martov après le congrès, leur refus de collaborer (…), leur refus de travailler pour le Comité Central.. je puis dire seulement que c'est là seulement une tentative insensée, indigne de membres du Parti...Et pourquoi? Uniquement parce qu'on est mécontent de la composition des organismes centraux car, objectivement, c'est uniquement cette question qui nous a séparés, les appréciations subjectives (comme offense, insulte, expulsion, mise à 1'écart, flétrissure, etc.) n'étant que le fruit d'un amour propre blessé et d'une imagination malade."
Oeuvres, Tome 7, page 28
Il faut d'ailleurs ajouter que même l'attitude de certains camarades minoritaires face aux organes centraux s'est apparentée à celle des mencheviks puisqu'ils ont à plusieurs reprises boycotté ceux-ci (en refusant de participer à leurs réunions ou d'assumer les responsabilités qu'on. voulait leur confier) et qu'ils ont fait une affaire d'Etat de ce que P.I. appelle (p.22) "la mise à l'écart de membres minoritaires de certaines fonctions qu'ils remplissaient, sous prétexte que leurs 'divergences' les mettaient dans l'incapacité de les remplir".
Pour quelles raisons ces camarades ont-ils été conduits à adopter cette démarche ? Là aussi, l'exemple des mencheviks est significatif :
"Sous le nom de 'minorité ' se sont groupés dans le Parti, des éléments hétérogènes qu'unit le désir conscient ou non, de maintenir les rapports de cercle, les formes d'organisation antérieures au Parti.
Certains militants éminents des anciens cercles les plus influents, n'ayant pas 1'habitude des restrictions en matière d'organisation, que l'on doit s ' imposer en raison de la discipline du Parti, sont enclins à confondre machinalement les intérêts généraux du Parti et, leurs intérêts de cercle qui, effectivement, dans la période des cercles, pouvaient coïncider."
Oeuvres, Tome 7, page 474.
Il est de nouveau frappant de constater, lorsqu'on examine la démarche des camarades qui allaient former la "tendance", puis la FECCI, sa similitude avec ce que décrit Lénine.
Fondamentalement, la "tendance" a été formée par des camarades qui se connaissaient depuis très longtemps (avant même la formation du CCI pour la plupart) et qui ont établi entre eux une solidarité l'artificielle basée essentiellement sur leurs vieux liens d'amitié et non sur une homogénéité politique. Nous avons déjà signalé dans notre Revue le manque d'homogénéité de la "tendance" composée de camarades qui, au départ, avaient des positions totalement divergentes tant sur la question de la conscience de classe que sur celles du danger de conseillisme, de la définition du centrisme et de l'importance de notre intervention à l'heure actuelle. Cette hétérogénéité s'est encore manifestée au 6ème congrès du CCI entre ceux qui voulaient quitter l'organisation et ceux qui voulaient y rester. Elle se révèle de nouveau dans P.I. si on compare le ton hystérique de l'article "Le déclin du CCI" et celui, incomparablement plus fraternel, intitulé "Critique de l'intervention du CCI". La seule chose qui cimentait la "tendance", outre et en conséquence de cet esprit de cercle "légué" par le passé des camarades, c'est la difficulté commune à supporter la discipline de l'organisation qui les f a conduits à de multiples manquements organisationnels.
Mais la similitude entre les mencheviks de 1903 et les camarades de la "tendance" ne s'arrête pas là :
"Le gros de 1 'opposition a été formé principalement par les éléments intellectuels de notre Parti. Comparés aux prolétaires, les intellectuels sont toujours plus individualistes, ne fût-ce qu'en raison de leurs conditions essentielles d'existence et de travail, qui les empêchent de se grouper largement spontanément, d'acquérir directement cette éducation qu'assure un travail en commun organisé.
Aussi est-il plus difficile aux éléments intellectuels de s 'adapter à la discipline de la vie du Parti, et ceux d'entre eux qui ne peuvent y parvenir, lèvent naturellement 1'étendard de la révolte contre les restrictions indispensables qu'exigent 1'organisation, et ils érigent leur anarchisme spontané en principe de lutte, qualifiant à tort cet anarchisme... de revendication en faveur de la 'tolérance', etc."
Oeuvres, Tome 7, page 474-475
Là encore, la ressemblance est frappante : si nous avions voulu faire enrager les camarades de la "tendance", nous aurions appelée celle-ci "la tendance de professeurs, des universitaires et des cadres supérieurs". Il est clair également que la susceptibilité et la vanité sont en général beaucoup plus fortes chez ces "individualités", habituées dans leur vie quotidienne à rencontrer une écoute respectueuse de la part de leurs interlocuteurs, que chez les ouvriers.
Nous pourrions poursuivre la mise en évidence de bien d'autres ressemblances entre la "tendance-fraction" et le courant menchevik de 1903. Nous nous bornerons à en signaler deux autres :
- le sectarisme,
- l'absence de sens des responsabilités face aux exigences de la lutte de classe.
1°) Le sectarisme
En de fréquentes occasions, Lénine a dénoncé le sectarisme des mencheviks qui portaient l'entière responsabilité de la scission alors que pour sa part, il estimait que :
"Les divergences de principe entre 'Vperiod' (le journal bolchevik) et la nouvelle 'Iskra' (menchévique)sont essentiellement celles qui existaient entre l'ancienne 'Iskra' et le 'Robotchéïé Diélo' (les'économistes '). Ces divergences, nous les considérons comme importantes, mais nous ne les considérons pas comme constituant en elles-mêmes un obstacle au travail commun au sein d'un seul parti..,v
Oeuvres, Tome 8, page 127
Le CCI estime également que les divergences politiques qui l'opposaient à la "tendance" notamment sur la conscience de classe et sur le danger de centrisme sont importantes. Si les positions de la "tendance" avaient gagné l'ensemble de l'organisation, cela aurait constitué une menace pour elle. Mais nous avons toujours affirmé que ces divergences sont parfaitement compatibles au sein d'une même organisation et ne devaient pas compromettre un travail commun. Telle n'est pas la conception de la "fraction" qui, à l'image des mencheviks, veut de plus nous faire porter la responsabilité de la séparation organisationnelle. Lorsque le milieu politique prolétarien sérieux prendra connaissance des questions de fond qui, selon la "fraction", interdisent un travail commun, il ne pourra que se demander quelle mouche a piqué ces camarades. De même, que pourront penser les ouvriers qui auront entre leurs mains deux tracts ou deux journaux qui, sur les questions essentielles auxquelles ils se confrontent : la nature de la crise, l'attaque de la bourgeoisie, le rôle de la gauche et des syndicats, la nécessité d'étendre, d'unifier et d'auto organiser leurs luttes, les perspectives de celles-ci, diront la même chose ? Ils ne pourront qu'en conclure que les révolutionnaires (ou certains d'entre eux) sont des gens bien peu sérieux.
Le sectarisme est le corollaire de "l'esprit de, cercle", de l'individualisme, de l'idée que "bougnat est maître chez soi". Tout cela, les camarades de la "tendance" l'avaient appris au sein du CCI au cours des multiples combats que nous avions menés contre le sectarisme qui pèse sur le milieu politique prolétarien actuel.
C'est en particulier pour tenter de masquer leur sectarisme fondamental, parce qu'ils savent bien, eux qui se réclament du "vieux CCI", que les divergences de fond qui les séparent du CCI n'ont jamais motivé pour nous une rupture organisationnelle, qu'ils ont inventé toutes les fables abracadabrantes, tous les mensonges odieux et imbéciles dont ils couvrent aujourd'hui notre organisation.
La "fraction" accuse le CCI de "monolithisme". Rien n'est plus absurde. En réalité, c'est la "fraction" qui est "monolithique", comme toutes les sectes : à partir du moment où on estime que n'importe quelle divergence surgissant dans une organisation ne peut aboutir qu'à la scission, c'est qu'on (refuse l'existence de telles divergences au sein de cette organisation : c'est le propre du monolithisme. D'ailleurs ce monolithisme se manifeste déjà dans P.I. : aucun des articles n'est signé comme s'il ne pouvait exister la moindre nuance en son sein (alors que nous savons que c'est tout le contraire qui est vrai).
2°) L'absence du sens des responsabilités face aux exigences de la lutte de classe.
Les mencheviks avaient entrepris tout leur travail scissionniste à la veille de la première révolution en Russie, le PQSDR se trouvait on ne peut plus mal armé pour l'affronter. Lénine n'a cessé de dénoncer le tort que portaient les agissements irresponsables des mencheviks à l'impact des idées révolutionnaires et à la confiance que les ouvriers pouvaient accorder au Parti. C'est également à ce moment crucial pour la lutte de classe que les camarades de la "tendance" choisissent de disperser les forces révolutionnaires. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent dans P.I. sur "l'importance déterminante de l'intervention des révolutionnaires à l'heure actuelle", leurs actes démentent leurs paroles. Ce qu'ils prouvent en réalité c'est que leurs intérêts de cercle et de secte priment sur les intérêts généraux de la classe ouvrière. Face aux exigences que la période actuelle impose aux révolutionnaires, ils font preuve d'une irresponsabilité bien plus grande encore que celle que le CCI a depuis longtemps dénoncée chez les autres groupes.
LES PERSPECTIVES DE LA "FRACTION"
Marx constate dans "Le 18 brumaire" que si l'histoire se répète, c'est la première fois sous forme de tragédie et la seconde fois sous forme de farce. Les événements de 1903 dans le POSDR étaient une tragédie dans le mouvement ouvrier. Les aventures de la "tendance" ressemblent beaucoup plus à une farce, ne serait-ce que par le fait de l'extrême faiblesse numérique de cette formation. On retrouve tant de ressemblances entre la démarche de la "tendance" et celle des mencheviks qu'on ne peut s'empêcher de faire le constat qu'il s'agit là d'un danger permanent au sein du mouvement ouvrier. Mais en même temps il y a bien peu de chances pour que la "fraction" joue un jour un rôle comparable à celui des mencheviks : se transformer en dernier rempart de la bourgeoisie au cours de la révolution, s'allier avec les armées blanches. Il est très probable qu'au moment de la révolution, la "fraction" aura disparu, que ses militants se seront depuis longtemps dispersés dans la démoralisation ou que, comprenant leurs erreurs, certains d'entre eux, auront repris une activité révolutionnaire responsable (comme ce fut le cas de Trotski qui, en 1903, s'était trouvé avec les mencheviks). Mais en attendant, la "fraction" joue un rôle essentiellement néfaste face à la classe.
D'une part, par son sectarisme, elle tend à renforcer la méfiance très forte qui existe aujourd'hui au sein de la classe ouvrière, y compris parmi les ouvriers les plus combatifs, à l'égard des organisations révolutionnaires.
D'autre part, en prétendant défendre la plateforme du CCI, elle porte un tort important aux idées de cette plateforme. Une défense sectaire et irresponsable des principes révolutionnaires clairs et cohérents est bien pire encore qu'une défense conséquente de positions révolutionnaires moins élaborées ou moins cohérentes. Elle ne fait que détourner de cette clarté et de cette cohérence les éléments en recherche qui sont dégoûtés par le comportement irresponsable de ceux qui prétendent s'en faire les porte-parole. D'ailleurs, l'expérience montre, qu'à terme, cette défense irresponsable se répercute nécessairement sur les principes eux-mêmes comme ce fut le cas des mencheviks qui ont progressivement tourné le dos au programme qu'ils avaient adopté en 1903 avant leur scission d'avec les bolcheviks.
Enfin, la comparaison que la FECCI établit entre elle et la fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie ne peut que discréditer les énormes apports de cet organisme dans le mouvement ouvrier. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, "Bilan, "Prometeo", "Communisme" sont un exemple de fermeté sur les principes révolutionnaires face aux reniements successifs des autres organisations prolétariennes emportées par la chape de la contre-révolution. Ils sont ainsi un exemple de sérieux, de sens des responsabilités au niveau le plus élevé. C'est sur ces mêmes bases, et en suivant son exemple, que le CCI a en permanence essayé de développer son activité militante. La "fraction" avait lutté jusqu'au bout au sein du Parti communiste dégénérescent pour tenter de le redresser. Elle ne l'avait pas quitté mais en avait été exclue comme la grande majorité des fractions révolutionnaires de 1'histoire. Elle a, en particulier, élaboré un apport inestimable sur la question de la lutte et du rôle d'une fraction communiste. Ce sont justement ces enseignements fondamentaux que la FECCI jette par la fenêtre en quittant le CCI et en usurpant le terme de "fraction", en créant cette nouveauté historique de "fraction (ce qui veut dire "partie de quelque chose") externe" sans jamais avoir développé un travail de fraction interne ou même de véritable tendance. Nous avons souvent écrit dans notre Revue que la caricature de Parti que constituait le PCI-Programme ridiculisait l'idée même de parti. La caricature de fraction que représente la FECCI ridiculise l'idée même de fraction.
Du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, la FECCI n'a aucune raison d'exister. Bien au contraire. A propos du "Communist Bulletin Group" qui avait quitté le CCI en 81 en gardant une partie de ses fonds, nous écrivions :
"Que représente le CBG face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus." (Revue n°36).
Pour la FECCI, le vol n'y est pas, mais le sectarisme et l'irresponsabilité font bon poids. Comme à l'égard du CBG, nous pouvons conclure à propos de la FECCI : "voilà un autre groupe dont l'existence est parasitaire" (Ibid.).
La meilleure chose que nous puissions souhaiter pour la classe ouvrière, de mené d'ailleurs que pour les camarades qui la composent, c'est la disparition la plus rapide possible de la FECCI.
F.M.
[1] [1016] La Revue Internationale n°44, dans l'article consacré au 6ème Congrès du CCI, rend compte du départ de ces camarades et de leur constitution en "Fraction". Le lecteur pourra s'y reporter, ainsi qu'aux articles publiés dans les Revues n°40 à 43 reflétant l'évolution du débat au sein du CCI.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 46 - 3e trimestre 1986
- 2584 reads
Grèves massives en Norvège, en Finlande, en Belgique : de la dispersion, vers l'unification
- 3538 reads
Les luttes ouvrières qui, ce printemps 1986, en Scandinavie et surtout en Belgique, ont pris un caractère massif, au point de quasiment paralyser l'activité de ces pays, annoncent l'ouverture d'une nouvelle période de la lutte de classe. Une période où se conjugueront de plus en plus, d'une part la contrainte pour la bourgeoisie de se livrer à des attaques de plus en plus frontales et massives, et d'autre part, au niveau de la conscience ouvrière, les concrétisations des leçons apprises au cours des combats, nombreux mais dispersés, qui ont caractérisé, surtout en Europe occidentale, la période précédente.
Plus s'avance la décomposition d'une société décadente, et plus la vérité, la réalité sociale quotidienne, devient contradictoire avec l'idéologie dominante. L'idéologie qui défend et justifie l'existence d'un ordre social et économique qui pourrit sur pied, provoquant les plus grandes famines de l'histoire de l'humanité, la menace d'auto-destruction de l'espèce, la barbarie et le manque d'avenir partout, avec l'étreinte du plus insidieux totalitarisme politique, une telle idéologie ne peut plus que reposer sur le mensonge, car la vérité est sa négation.
Les luttes ouvrières sont les porteuses de cette vérité simple qui dit que le mode de production -capitaliste' doit et peut être détruit si l'humanité veut survivre et poursuivre son développement.
C'est pourquoi, avec une minutie scientifiquement planifiée, la bourgeoisie internationale organise le silence sur les luttes ouvrières, en particulier sur le plan international.
Combien de prolétaires dans le monde savent-ils que dans la mythique Scandinavie, cette "patrie" du "socialisme à l'occidentale", la classe ouvrière connaît une attaque économique sans précédent, et que, en réponse, les prolétaires du Danemark (printemps 85), de Suède (hiver 85-86), puis ceux de Finlande et de Norvège (printemps 86) viennent de déployer leurs combats les plus importants depuis le 2ème guerre mondiale ? Combien de travailleurs savent que la Belgique connaît aux mois d'avril et mai 86 le développement d'une effervescence des luttes ouvrières qui a, à plusieurs reprises, pratiquement bloqué la vie économique du pays ? Que dans ce petit pays au coeur de l'Europe la plus industrialisée, au milieu de la plus grande concentration ouvrière du monde, les travailleurs ont multiplié les grèves spontanées, éclatant hors des consignes syndicales, pour répondre à l'accélération et aux menaces de nouvelles attaques économiques du gouvernement ; qu'ils ont commencé à chercher l'unification des luttes en agissant collectivement, sans attendre les syndicats, en envoyant des délégations massives - tels les 300 mineurs du Limbourg venus aux assemblées de travailleurs des services publics à Bruxelles - pour proposer l'unification des combats.
Les journaux, les médias n'en disent mot en dehors des pays concernés ; ils déversent à la place, à grands flots, les nauséabondes campagnes idéologiques orchestrées internationalement sur "l'anti-terrorisme", sur le besoin de "renforcement de l'ordre" (appelé pour la circonstance "sécurité") ou sur l'impuissance des pauvres êtres humains devant la "fatalité de la crise économique". Sur la lutte ouvrière internationale, c'est le silence ([1] [1017]) organisé. Tout au plus quelque entrefilet ici et là, surtout pour annoncer la fin de telle ou telle grève. La bourgeoisie a peur de la réalité, et ses fanfaronnades de matamore reaganien traduisent plus une sourde et croissante inquiétude que la sérénité d'une classe sûre de son pouvoir et de son avenir. Et pour cause.
DES LUTTES QUI MONTRENT LE CHEMIN
La caractéristique majeure des luttes de ce printemps 1986, c'est leur caractère massif : en Norvège, il y a eu jusqu'à 120 000 travailleurs touchés par les grèves, y compris les lock-outés (10 % de la population active) ; en Finlande, ce sont 250 000 grévistes qui, ensemble, ont affronté l'Etat ; en Belgique, c'est aussi par centaines de milliers qu'il faut compter le nombre de travailleurs qui, au moment où nous écrivons, ont déjà pris part aux luttes contre l'accélération de l'attaque économique du capital.
Il ne s'agit plus ici d'une série de luttes isolées, éparpillées, enfermées dans des usines en faillite. Ce sont des mobilisations massives qui parviennent à paralyser en grande partie l'économie. Des plateformes pétrolières de la Mer du Nord en Norvège, aux mines du Limbourg, des postes finlandaises aux transports ferroviaires et urbains en Belgique, le prolétariat vient de déployer en quelques semaines, dans des pays hautement industrialisés, une puissance et une force qui annoncent que les politiques bourgeoises de dispersion des luttes commencent à atteindre les limites de leur efficacité. La situation en Belgique est plus particulièrement significative pour dégager les caractéristiques de la période qui s'ouvre. D'une part parce qu'il s'agit d'un des pays industrialisés qui a été depuis longtemps parmi les plus frappés par la crise, d'autre part du fait de ses caractéristiques historiques. Le capitalisme belge, situé entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, est un des plus anciens du monde. Le prolétariat y est un des plus expérimentés et possède une longue tradition de luttes contre une bourgeoisie qui dispose d'un vieil et très expérimenté arsenal d'encadrement politique et syndical des ouvriers. Aussi les luttes ouvrières actuelles y possèdent une puissance d'exemple particulièrement importante -plus que celles de Norvège ou Finlande- quant aux moyens de la lutte de classe. Et cela d'autant plus que c'est en Belgique, a l'automne de" 1983, que les grèves massives des travailleurs du secteur public ont marqué la fin du recul qui suivit la défaite en Pologne et le début d'une nouvelle reprise de luttes ouvrières au niveau international.
Mais que ce soit par les conditions objectives économiques qui ont fait surgir ces luttes (obligation pour la bourgeoisie de porter des attaques de plus en plus massives et frontales), ou que ce soit par les conditions subjectives qui les ont caractérisées surtout en Belgique (maturation de la conscience ouvrière, tendance à l'unification), elles traduisent le début d'une nouvelle accélération de la lutte de classes : l'ouverture d'une nouvelle phase du combat historique du prolétariat mondial pour son émancipation.
I - LES CONDITIONS OBJECTIVES : LA BOURGEOISIE PEUT DE MOINS EN MOINS DISPERSER SON ATTAQUE ECONOMIQUE
Dans le numéro précédent de la Revue Internationale, nous avons montré comment, au cours de l'année 1985 la bourgeoisie des pays industrialisés du bloc occidental avait mené une politique consciente de dispersion de son attaque économique (licenciements planifies dans le temps, attaques secteur par secteur, etc.) afin d'empêcher des réactions frontales, unifiées, de la part des travailleurs.
Nous insistions sur le fait que la bourgeoisie tirait les leçons d'expériences telles celle de la Pologne en 1980 ou des combats qui ont marqué l'ouverture de ce que nous appelons "la troisième vague internationale de luttes" depuis 1968 (après celles de 1968-74 et de 1978-80), à savoir les grèves du secteur public en Belgique et Hollande à l'automne 1983. Mais nous soulignions aussi que cette politique menée en étroite coopération par gouvernements, partis politiques et syndicats, reposait en grande partie sur la marge de manoeuvre économique qu'a donnée à l'Europe la mini-reprise américaine.
Or, cette "marge se réduit aujourd'hui de façon accélérée sous la pression du ralentissement de l'économie américaine, et sous la pression de l'affaiblissement de la compétitivité des produits d'exportation européens face aux produits nord-américains (voir la page 6 : "Où en est la crise économique ?") La "nouvelle politique" américaine dont la forte baisse du dollar n'est que l'aspect le plus spectaculaire, n'est pas un cadeau pour l'Europe, mais une déclaration de guerre commerciale à l'échelle de la planète. Quelles que soient les économies que peuvent faire les pays européens sur la "facture pétrolière" dans l'immédiat, ils sont plus que jamais contraints de baisser leurs dépenses et leurs coûts de production, ce qui veut dire en premier lieu s'attaquer plus violemment aux revenus des exploités.
Qui plus est, cette attaque implique -surtout en Europe- des réductions drastiques de dépenses "sociales" de l'Etat (en Europe occidentale, surtout dans les pays du Nord, les dépenses des administrations publiques équivalent à plus de la moitié du produit national !) Cela veut dire prendre des mesures qui touchent immédiatement et simultanément l'ensemble des prolétaires :
- les chômeurs car leur seule source de revenus, quand ils en ont, ce sont les allocations gouvernementales ;
- l'ensemble des salariés car c'est la part du salaire dite "sociale" qui se trouve attaquée (sécurité sociale, allocations familiales, éducation, etc.)
- les employés de l'Etat parce que ce sont des milliers d'emplois qui sont supprimés.
C'est cette réalité qui est la toile de fond des agressions économiques globales qui ont provoqué les luttes en Scandinavie et en Belgique. Les faiblesses économiques spécifiques de ces pays n'en font pas des "cas exceptionnels" ; ces faiblesses expliquent seulement pourquoi les gouvernements y ont été parmi les premiers en Europe à porter de telles attaques ([2] [1018]). L'impossibilité de continuer à organiser la dispersion des attaques économiques, le recours à des attaques de plus en plus frontales et massives contre la classe ouvrière, tel est l'avenir pour l'ensemble des gouvernements européens.
II - LES CONDITIONS SUBJECTIVES : LA MATURATION DE LA CONSCIENCE DE CLASSE
De même que les politiques gouvernementales qui ont déclenché les luttes de ce printemps sont une indication de l'avenir pour tous les gouvernements capitalistes, de même les pas en avant réalisés par le prolétariat dans ces luttes, en particulier en Belgique, montrent le chemin au reste du prolétariat mondial.
La volonté de se battre
L'ensemble de ces luttes confirme la tendance au développement d'une simultanéité internationale des combats de classe.
La Suède, la Grande-Bretagne, l'Espagne, pour ne parler que de l'Europe, connaissent au même moment un développement des luttes ouvrières. Et l'on a pu voir des travailleurs des plateformes pétrolières britanniques se joindre à la grève de leurs collègues norvégiens ([3] [1019]). C'est internationalement qu'existe un ras-le-bol profond, non résigné, une combativité qui dément quotidiennement les propagandes officielles d'après lesquelles les ouvriers auraient enfin - avec la crise -compris que leurs intérêts sont les mêmes que ceux de "leur" capital national.
Dans la pratique, ces luttes sont la négation vivante des lots économiques basées sur le profit marchand du capital, où l'on répond au développement de la misère par plus de misère (baisse des salaires, des allocations ; chômage, etc.) et par la destruction des moyens de combattre la misère (fermetures d'usines, destruction de stocks d'invendus, production d'armement et frais militaires, etc.), toujours aux dépens des exploités.
Cette volonté de se battre montre que pour les ouvriers, il est de plus en plus clair que la question de leurs moyens de subsistance est posée en termes simples : ou la vie du capital ou la leur. Il n'y a pas de conciliation possible entre les intérêts du capital décadent et ceux des exploités. C'est d'abord en cela que les luttes de ce printemps annoncent l'avenir en montrant le chemin.
Les moyens de se battre
Ne pas attendre les consignes syndicales pour faire démarrer les luttes
Une des principales armes dont dispose l'Etat à travers son appareil syndical contre les luttes ouvrières, c'est le pouvoir de décider du moment du combat. La force de la classe ouvrière repose en premier lieu sur son unité, sa capacité à frapper ensemble. Les syndicats, en décidant de faire partir des luttes de façon dispersée, échelonnée dans le temps, évitant la simultanéité source d'unité, en empêchant que le combat n'éclate au moment où la colère est la plus généralisée ont un grand pouvoir de division et d'affaiblissement du mouvement. Pouvoir dont ils hésitent rarement à se servir.
En Belgique les syndicats n'ont cessé de tenter de le faire. C'est ainsi que, parmi tant d'autres exemples, ils ont appelé les travailleurs des services publics à faire grève le 6 mai ; les enseignants le 7 mai ; les ouvriers des chantiers navals trois jours après, etc. Systématiquement, minutieusement, ils tentent d'organiser...la dispersion du mouvement. La réponse des ouvriers a été -comme c'est de plus en plus le cas dans tous les pays- les grèves "spontanées", c'est-à-dire en dehors des consignes syndicales.
C'est ainsi que la grève des 16 000 mineurs du Limbourg, qui marque le début de toute la période de grèves qui allait suivre, éclata à la mi-avril, spontanément, contre l'avis des syndicats qui considéraient toute grève "prématurée". Il en est de même de la plupart des mouvements qui depuis lors, dans les chemins de fer, les postes, les télécommunications, l'enseignement, les transports urbains, les ministères, les hôpitaux, les chantiers navals, certaines parties du secteur privé, etc., ont démarré ou se sont arrêtées pour redémarrer peu de temps après, spontanément, en dehors - parfois contre- les consignes syndicales.
A partir du mois de mai, les syndicats ont organisé, sous la pression ouvrière, des journées de "grève générale" (le 6, le 16 puis le 21 mai) en vue de reprendre un contrôle plus efficace sur les événements. Mais ces journées pour importante qu'ait été la mobilisation qu'elles ont connue, restent comme des moments particuliers au milieu d'une effervescence générale qui cherche souvent de façon maladroite et heurtée à gagner la maîtrise d'elle-même. La bourgeoisie belge ne se trompe pas sur les risques que de telles formes de l'action ouvrière impliquent pour son pouvoir. Et, par la bouche d'un responsable syndical de la FGTB (J.C. Wardermeeren) elle déclarait le 23 mai au journal "Le Soir" "Le gouvernement pourra imposer sa volonté par la force jusqu'au moment où le ras-le-bol provoquera des explosions qui ne seront plus contrôlées par le mouvement syndical. Et qui seront de plus en plus difficiles à rattraper par la concertation. Voyez toute la différence entre des négociations précises, menées sur un cahier de revendications, et celles qui suivent des actions spontanées. Et calculez les risques." (Souligné par nous) Les syndicats connaissent mieux que quiconque "les risques" de laisser la force de vie prolétarienne échapper au carcan syndicaliste professionnel de l'encadrement et du sabotage, ils sont maîtres dans l'art de "prendre le train en marche". Face aux explosions spontanées, ils savent parfaitement "radicaliser" autant que nécessaire leur langage, pour reprendre le plus rapidement possible la direction et l'organisation du mouvement. Ils sont puissamment aidés en cela par le "syndicalisme de base" dont les critiques aux centrales constituent un dernier filet pour retenir les prolétaires dans la logique syndicaliste.
Le prolétariat en Belgique n'est pas encore parvenu à se débarrasser suffisamment de toutes les entraves syndicalistes (nous y reviendrons plus loin). Mais la "dynamique des actions qu'il a entreprises s'oriente clairement dans le bon sens.
La nécessité et la possibilité de développer la capacité à engager le combat sans attendre le feu vert des centrales syndicales, tel est un premier enseignement sur les moyens de se battre que confirment les luttes en Belgique. Nous disons "confirme" parce que la tendance à la multiplication des grèves spontanées n'a cessé de se confirmer, depuis 3 ans, depuis le début de la troisième vague.
Rechercher l'extension et l'unité
Mais probablement les enseignements principaux qui, resteront des luttes de ce printemps en Belgique, se situent au niveau des moyens de construire pratiquement l'unité des prolétaires. Les luttes en Belgique montrent clairement :
1°) que cette unité ne peut se faire qu'à travers la lutte. Le capital divise les ouvriers, son appareil politique et syndical organise la dispersion des forces ouvrières. L'unité, les prolétaires ne peuvent la bâtir qu'en combattant ce qui les divise, en combattant le capital et ceux qui le représentent;
2°) que cette unité ne tombe pas du ciel, ni des syndicats qui en sont les principaux saboteurs. Elle doit être bâtie pratiquement, volontairement, consciemment La recherche de cette unité doit constituer un objectif permanent. L'envoi de délégations massives pour rechercher la solidarité active, celle de l'extension et l'unification des luttes brisant les divisions catégorielles, linguistiques ou professionnelles, comme l'ont fait les mineurs du Limbourg qui ont, des le début de la lutte envoyé des délégations massives, d'une à plusieurs centaines de grévistes vers d'autres secteurs de la classe : la grande usine de Ford-Genk (10 000 ouvriers), vers les travailleurs des Postes, vers les cheminots de la SNCB, vers les lycéens en tant que futurs chômeurs pour les appeler à la grève ; comme l'ont fait les ouvriers des chantiers navals de Boel , près d'Anvers , qui ont envoyé des délégations vers les mineurs en se joignant à la lutte. Après l'explosion de la lutte elle-même, c'est le premier pas pratique pour répondre à la nécessité de la constitution des prolétaires en classe, en force unie capable d'agir sur le cours de la société ;
3°) que "la rue", les manifestations, les meetings, jouent un rôle essentiel dans la constitution de l'unité de classe. Il ne suffit pas que les luttes démarrent ; il ne suffit pas que par le moyen de délégations massives, les secteurs en lutte se rencontrent, il faut aussi que l'ensemble des forces au combat se reconnaissent dans l'action commune, qu'elles puissent se compter, mesurer et sentir l'ampleur de leur puissance. En Belgique, dans la rue, les chômeurs ont rencontré leur classe ; dans la rue, les mineurs et les enseignants, les sidérurgistes et les conducteurs de transports publics ont cherché à agir comme ce qu'ils sont, comme une seule classe. Dans la rue se rencontrent les énergies qui naissent dans les combats de mille lieux de travail. Si la dynamique de fond du mouvement est suffisante, si elle parvient à neutraliser les forces de division et de dispersion des appareils syndicaux et politiques de la bourgeoisie, ces énergies reviennent sur les lieux de travail, décuplées. ([4] [1020])
A travers la recherche de l'unité, les luttes de Belgique tirent les leçons des défaites passées, de celle des mineurs britanniques en 84-85, comme de toutes celles, petites ou grandes, mortes dans l'isolement. Il existe une mémoire collective dans les classes qui ont une mission historique. Il y a un progrès de la conscience collective, une maturation, tantôt explicite tantôt souterraine, qui fait le lien entre les principaux moments d'action collective de la classe. "Ne pas se faire avoir comme en 83 !" Par cette phrase, si souvent entendue dans les discussions entre grévistes en Belgique (référence à l'isolement des grèves du service public en septembre 83), était posé explicitement le problème de la recherche de l'extension et de l'unité comme une priorité qu'il fallait assumer consciemment si on voulait aller plus loin que par le passé.
C'est ainsi que progresse l'expérience, la conscience collective de la classe révolutionnaire. Les réponses pratiques apportées par les prolétaires de Belgique concernent les problèmes de toute la classe ouvrière mondiale ; leurs luttes actuelles auront des conséquences aussi en dehors de Belgique. Car ici encore, elles montrent l'avenir.
Rechercher l'auto-organisation : la lutte pour la maîtrise de sa propre force.
En déclenchant des grèves, en unifiant les luttes, en prenant la rue ensemble, le prolétariat crée une force gigantesque, redoutable. Mais à quoi peut-elle lui servir s'il n'en a pas la maîtrise ? Sans un minimum de maîtrise sur elle-même, sur le cours des événements, cette force ne tarde pas à s'effriter, d'abord et avant tout sous l'impact du torpillage systématique et démoralisateur des manoeuvres syndicales. Si les prolétaires en Belgique ont pu déployer une telle force, ce n'est pas grâce aux syndicats mais malgré ou contre eux. Ce n'est pas la une interprétation exagérée des faits. Le principal responsable des forces d'encadrement politique et syndical en Belgique le leader du Parti Socialiste (qui contrôle le plus grand syndicat du pays, la FGTB) le reconnaît le 30 mai clairement, dans un interview au journal "Le Soir" ""le mouvement part des gens et non des appareils syndicaux. Chez nous, les gens veulent la peau de Martens. Ceux qui croient que les organisations syndicales ont prémédité des plans ou ceux qui croient que les partis contrôlent les actions commettent une erreur monumentale. En beaucoup d'en droits, les travailleurs ne suivent pas les mots d'ordre syndicaux. Ils ne veulent pas reprendre le travail." C'est clair.
Cependant, s'il est vrai qu'"en beaucoup d'endroits les travailleurs (en lutte) ne suivent pas les mots d'ordre syndicaux", il n'en a pas découlé pour autant, du moins jusqu'au moment où nous écrivons, la création par les ouvriers d'une forme d'organisation centralisée regroupant des délégués de comités de grève élus par les assemblées, capable de donner des orientations pour l'ensemble des forces en lutte, capable de permettre au mouvement de devenir effectivement maître de sa force.
Les travailleurs en Belgique ne sont pas encore parvenus à ce stade de la lutte. Mais ils ont avancé dans ce sens. Ils ont développé leur capacité à déjouer les manoeuvres démobilisatrices des syndicats : par la capacité à démarrer les luttes sans attendre les consignes syndicales, ils ont su limiter les dégâts que provoque l'effort permanent des syndicats pour disperser les luttes dans le temps ; en prenant en main eux-mêmes l'organisation de l'extension par des délégations sans se reposer, sur les structures syndicales, ils limitent l'effet de l'action des syndicats pour disperser les luttes dans l'espace. En faisant des assemblées de vrais centres de décision de la lutte, ils déjouent les manoeuvres des syndicats pour ramener les ouvriers au travail ([5] [1021]).
Et c'est là encore une source de riches enseignements pour les luttes à venir du prolétariat mondial.
L'AFFRONTEMENT AVEC L'ETAT, C'EST AUSSI L'AFFRONTEMENT AVEC LES SYNDICATS.
Les travailleurs belges affrontent une bourgeoisie qui s'est longuement préparée à cette attaque, qui se présente en rangs de bataille, avec ses forces de gauche, les forces "ouvrières" de la bourgeoisie, non pas au gouvernement (où l'obligation de prendre de violentes mesures anti-ouvrières les dévoilerait dangereusement) mais dans l'opposition, au milieu des ouvriers en lutte, pour mieux saboter de l'intérieur. Les "socialistes" n'ont aucune intention pour le moment d'abandonner leurs responsabilités étatiques de policiers dans les rangs ouvriers. Cela se voit clairement dans leur pratique dans la rue :
"L'imposant cortège a défilé dans le calme et "là sérénité" écrit un article du "Soir" racontant, le 23 mai, une manifestation de 10 000 personnes à Charleroi (les syndicats s'attendaient à 5000 personnes seulement). "Parmi les manifestants proches des milieux socialistes, on s'inquiétait pourtant de voir la 'tiédeur' des discours ou l'absence des chefs de 1'état-major du PS. Beaucoup voyaient là le signe d'un 'renoncement au pouvoir'."
La bourgeoisie a besoin d'une gauche dans l'opposition et continuera de s'en donner les moyens. La politique de dispersion des luttes -telle que nous l'analysions dans le numéro précédent de cette revue- repose d'une part sur l'action concertée de l'Etat et du patronat privé qui dispersent les attaques, d'autre part sur l'action de division des forces politiques et syndicales de la gauche du capital. L'impossibilité croissante dans laquelle se trouvent Etat et patronat de continuer à disperser l'attaque économique conduit à ce que ce soit de plus en plus essentiellement sur l'action des syndicats et partis de gauche que reposera l'action de la bourgeoisie pour empêcher l'unification et le renforcement de la résistance prolétarienne.
Les ouvriers belges ont trouvé devant eux, tout au long de leur lutte, dans leurs propres rangs, le syndicalisme, avec ses trois volets : le "modéré" syndicat chrétien), le "combatif" (socialistes), celui "de base" (les maoïstes -en particulier dans les mines du Limbourg).
En cela aussi les luttes en Belgique annoncent l'avenir.
Les ouvriers de Belgique comme ceux du monde entier ont encore un long processus de combat à mener pour se débarrasser véritablement des entraves syndicalistes et avoir une entière maîtrise de leur force. Mais cette maîtrise sera le résultat des combats actuels.
Le mouvement de classe en Belgique est un mouvement politique, non parce qu'il nierait ses objectifs économiques mais parce qu'il assume les aspects politiques de ce combat : ce n'est pas contre le propriétaire d'une petite entreprise de province que combattent les travailleurs ; c'est contre l'Etat et à traders lui, contre toute la classe dominante. C'est la politique économique de la classe exploiteuse que combat le prolétariat. Le mouvement est politique parce qu'il affronte l'Etat sous toutes ses formes : le gouvernement, la police dans les nombreux affrontements de rue et enfin les syndicats.
"La lutte économique est l'élément qui conduit perpétuellement d'un noeud politique à l'autre, la lutte politique est la fécondation périodique pour la lutte économique. Cause et effet permutent à tous instants de place, et ainsi l'élément économique et l'élément politique, dans la période de grèves en masse, bien loin de se distinguer nettement ou même de s'exclure comme le veut le pédantisme schématique, ne constituent, au contraire, que deux faces entremêlées de la lutte de classe prolétarienne" (Rosa Luxemburg "Grève de masses, parti et syndicats", chap. 4)
C'est là un trait des luttes prolétariennes particulièrement renforcé dans le capitalisme décadent où la classe ouvrière doit affronter un capitalisme étatisé à l'extrême.
L'Etat belge a entrepris une attaque particulièrement forte sur la classe ouvrière pendant ces dernières années. Il a imposé des sacrifices économiques tout en organisant un gigantesque renforcement de la répression sous prétexte d"'anti-terrorisme". La bourgeoisie a suivi de près le déroulement de cette attaque : certains journaux parlaient même de "test belge" ; comment réagirait la classe ouvrière ? Celle-ci vient de leur répondre et, ce faisant, elle a indiqué la voie au reste de ses frères de classe.
Au moment où nous terminons cet article la vague de luttes en Belgique semble encore loin d'être épuisée. Mais dès à présent, et quel que soit le développement ultérieur des événements, on peut affirmer que les combats de classe qui secouent ce pays depuis plusieurs semaines sont les plus importants en Europe depuis la Pologne 80.
Leur signification est cruciale. Ils confirment, après les luttes ouvrières qui viennent d'ébranler la Norvège et la Finlande, qu'en Europe occidentale et dans le monde, la lutte de classe entre dans une nouvelle phase.
R.V., le 30 mai 86.
[1] [1022] Revue Internationale n°46, 2ème trim.86, "La lutte ouvrière en 1985 : bilan et perspectives".
[2] [1023] Le capital norvégien, qui tire une grande part de ses profits de l'exportation du pétrole, a violemment subi les conséquences de la surproduction et de la chute des cours mondiaux de l'or noir (chute de 70 % de ses revenus pétroliers). La bourgeoisie n'a pas tardé à répercuter ces pertes à travers une attaque sans précédent sur la classe ouvrière. Quant à l'économie belge (certainement une des plus sensibles à la conjoncture économique internationale puisqu'elle importe de l'étranger 70 % de ce qu'elle consomme et exporte 70 % de ce qu'elle produit !), c'est une des plus frappées par la crise mondiale, et cela depuis le début des années 80 : les secteurs industriels qui avaient fait la force de la Belgique (sidérurgie, textile, charbon) sont parmi les plus frappés par la surproduction mondiale ; le taux de chômage (14 %) est un des plus élevés d'Europe ; le déficit des Administrations publiques atteint en 1985 10 % du PNB, taux qui n'est dépassé en Europe que par l'Italie (13,4%), l'Irlande(12,3 %) et la Grèce (11,6 %). Le capital belge est aussi un des plus endettés internationalement, puisque sa dette équivaut à 100 % du PNB annuel ! Le gouvernement Martens s'est fait voter par 1'Assemblée des "Pouvoirs spéciaux" pour décréter un nouveau plan d'austérité draconien, afin de mieux rentabiliser l'exploitation de la force de travail : licenciements massifs, en particulier dans la Fonction publique, les mines, les chantiers navals ; réduction drastique de toutes les allocations sociales, en particulier suppression de 1'allocation chômage pour les moins de 21 ans, etc.
[3] [1024] La bourgeoisie suédoise, certainement consciente du danger de contagion, a appliqué au niveau national un black-out quasi total sur les informations concernant les grèves en Norvège et en Finlande, pays limitrophes. Lorsque le besoin s'en fait ressentir, les très "modernes" gouvernements démocratiques européens savent se comporter comme n'importe quel Duvalier.
Se donner les moyens d'informer internationalement le reste du prolétariat mondial est un objectif que les prochains mouvements de masses devront se fixer dès les premiers moments.
[4] [1025] Les syndicats savent ce qu'ils font lorsqu'ils organisent dans chaque manifestation -avec une minutie et des moyens matériels dignes d'une meilleure cause- un quadrillage serré séparant les manifestants par paquets (par usine, ville, région, secteur, organisation syndicale, tout et n'importe quoi qui permette de diviser en catégories).
[5] [1026] C'est l'assemblée de cheminots de Charleroi qui le soir du 22 mai fut capable de dire non aux appels du syndicat chrétien à l'arrêt de la grève ; non à la proposition de la FGTB d'organiser un vote car, d'après elle le "lâchage" du compère syndical était un terrible affaiblissement pour le mouvement. Quelques jours après, à La Louviere, près de Charleroi, un local du syndicat chrétien subit les dégâts de la colère d'une manifestation ouvrière qui passait par là. Ce ne fut pas le seul cas d'affrontement brutal entre ouvriers et forces syndicales en Belgique.
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise économique ? : L’Europe en première ligne.
- 7979 reads
La bourgeoisie n'a pas de solution à la crise de son système et ses remèdes ne sont que des palliatifs provisoires qui répercutent les effets de la crise à un niveau toujours plus grave et plus dramatique. La fin de la "reprise" américaine implique une nouvelle plongée dans la récession de l'économie mondiale. Et l'Europe, moins bien placée que les Etats-Unis et le Japon, va se retrouver en première ligne.
Cette nouvelle aggravation de la crise, conjuguée avec le développement de la vague de lutte de classe commencée en 1983, qui manifeste la combativité intacte du prolétariat, est un facteur déterminant de l'évolution future de la situation internationale, et va tendre à se traduire par une perte des illusions au coeur même des métropoles industrielles, et notamment en Europe, où se trouve la plus forte concentration du prolétariat mondial.
Avec la perspective d'une nouvelle plongée accélérée dans la récession, c'est une rupture qui est en train de s'opérer dans la situation mondiale, où même les pays les plus développés n'arrivent plus à se préserver des effets les plus graves de la crise, et la tragédie du tiers-monde montre sur quel chemin économique ils sont engagés.
Depuis le début des années 80, et sous l'impulsion de Reagan qui donne le ton, la classe dominante ne cesse de proclamer par tous ses médias que la situation de l'économie mondiale s'assainit, que tout va bien, et que les sacrifices imposés sont nécessaires pour sortir définitivement de la crise. L'économie est devenue une star des médias. Un brouhaha permanent de chiffres divers annoncés pêle-mêle jusqu'à saturation, des émissions didactiques programmées régulièrement, des déclarations contradictoires de "responsables" politiques et économiques commentées à satiété, des reportages sur le bon exemple de l'entreprise "modèle" et "performante à l'exportation", etc., tout cela sert à masquer l'essentiel : la crise ne cesse de s'aggraver et la bourgeoisie est impuissante à la juguler. Le capitalisme, en .tant que système économique, est en train de faire faillite, et il entraîne l'humanité dans son effondrement. Les déclarations optimistes actuelles des dirigeants capitalistes sur la durée de la "reprise" de l'économie américaine, sur le déploiement de ses effets bénéfiques à l'Europe, sur les effets positifs de la chute du cours du dollar et du pétrole, tout cela n'est que pur mensonge.
LE MYTHE DE LA REPRISE
Avec une chute de la croissance aux USA à 3 %, après avoir atteint 6,8 % l'année précédente, 1983 marque la fin de la "reprise américaine". Mais sur le plan mondial, cette "reprise" n'a pu que compenser, essentiellement par la création d'un imposant déficit commercial, la chute des marchés du tiers-monde durement secoués par la baisse des matières premières. La courbe des échanges mondiaux est restée désespérément stagnante depuis le début des années, 80, montrant par là que l'économie mondiale n'est en fait pas sortie de la récession depuis la fin des années 70.
L'EUROPE ET LE JAPON SOUS LES COUPS DE LA CRISE
Même les USA qui sont la première puissance économique mondiale n'ont plus les moyens, par les déficits budgétaires et commerciaux qu'ils ont accumulés, de soutenir l'activité de l'économie mondiale. La chute des cours du dollar de 35 % par rapport aux monnaies de ses principaux concurrents européens et japonais va redonner une compétitivité recouvrée aux produits américains qui s'étaient retrouvés pénalisés par le cours élevé du dollar, ce qui avait permis aux Européens et aux Japonais de développer leurs exportations. Cette situation signifie à terme une fermeture du marché américain aux exportations européennes et japonaises, fermeture accentuée par les mesures protectionnistes.
De la même manière, la chute des cours du pétrole (principale matière première dans le commerce mondial) de moitié, en quelques mois, si dans un premier temps, conjuguée à la chute du dollar, elle permit aux pays industriels importateurs de réaliser de substantielles économies, dans un second temps, cela signifie une réduction du marché à l'exportation que constituent les pays producteurs, et notamment de l'OPEP et du COMECON dont c'est la principale exportation.
Cela signifie que 1/5ème des exportations européennes et près de la moitié des exportations japonaises vont être directement touchées par la réduction des marchés consécutive à la chute du dollar et du prix du pétrole.
Ce qui commence c'est un nouveau pas en avant dans la récession ; la chute inéluctable des exportations ne peut se traduire que par un ralentissement de la production et donc des fermetures d'usines, des faillites, des licenciements.
UNE CONCURRENCE EXACERBEE
Dans ces conditions, la concurrence va être acharnée pour préserver "sa" part de marché, et les pays les moins bien lotis vont subir de plein fouet les effets de la crise, et notamment en Europe. Parce qu'ils sont la puissance dominante, les Etats-Unis sont évidemment les plus à même de défendre les intérêts de leur capital national face à leurs rivaux. En imposant la baisse du dollar, en recourant à des mesures protectionnistes pour protéger leur marché intérieur, et en recourant à toute la panoplie de moyens à leur disposition pour placer leurs exportations (subventions, pressions économiques et militaires, etc.), les USA affichent leur ambition : rétablir leur balance commerciale, et cela ne peut se faire qu'aux dépens de leurs rivaux européens et japonais.
La guerre commerciale bat d'ores et déjà son plein, et dans cet exercice difficile, c'est le Japon qui s'est particulièrement illustré ces dernières années tandis que l'Europe est restée en arrière. Dans la perspective d'une concurrence renforcée, c'est l'Europe qui est la plus fragile, c'est elle qui déjà a le moins profité des effets de la "reprise" de 1983, son indice de production est resté quasiment stagnant depuis la fin de 1979.
UNE ATTAOUE RENFORCEE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
La bourgeoisie, tout au moins dans ses cliques dirigeantes, n'est certainement pas dupe de ses bonnes paroles optimistes. Chaque fraction nationale de la classe dominante met en place de manière accélérée de nouveaux programmes d'austérité afin de faire baisser les coûts de la main-d'oeuvre pour rester concurrentiels face à une accélération prévisible du rétrécissement des marchés d'exportation. C'est toujours au nom de la défense de la compétitivité de l'économie nationale que les sacrifices sont exigés de la part de la classe ouvrière. Comme la même chose se passe dans tous les pays, les mêmes sacrifices sont exigés et partout le pouvoir d'achat baisse, si bien que la baisse du niveau de vie de la classe ouvrière, loin d'être une solution à la crise, signifie en fait une nouvelle réduction du marché. C'est la contradiction même que l'économie capitaliste ne peut surmonter. C'est la surproduction qui entraîne la récession.
Le chômage qui atteint déjà des proportions dramatiques ne peut que croître encore plus, comme il n'a cessé de le faire depuis le début des années 80 en Europe. Le chiffre de 10,8 % de la population active au chômage dans la CEE en 1983 va être largement dépassé dans la période qui vient.
Développement du chômage, gel des salaires, augmentation des prélèvements sociaux, depuis quelques mois, les attaques s'accentuent en Europe contre la classe ouvrière, toujours justifiées au nom de la santé de l'économie mondiale. Les résultats ne seront pas différents des programmes d'austérité précédents; ils seront pires pour la classe ouvrière et sans effet sur la crise qui continue de s'approfondir.
Jusqu'à présent, la classe dominante a su utiliser au mieux la stagnation économique pour essayer de répartir son attaque contre le prolétariat, et ainsi permettre la dispersion des luttes, empêcher leur unification. Une nouvelle chute des échanges mondiaux, et donc de la production, va réduire drastiquement la marge de manoeuvre de la bourgeoisie qui va être obligée d'attaquer frontalement la classe ouvrière. L'évolution même de la crise économique détermine les formes que prend l'attaque de la bourgeoisie et donc la dynamique de la lutte de classe.
L'évidence du fait que le capitalisme n'a plus rien à offrir va déchirer l'écran de la propagande capitaliste. Dans la période qui vient, partout dans le monde, le prolétariat va être durement attaqué, poussé à exprimer ses réserves de combativité. Mais c'est en Europe, première et plus ancienne concentration prolétarienne de la planète, que la situation est particulièrement significative. De la capacité du prolétariat le plus ancien et expérimenté du monde à tirer les leçons de la faillite économique du capital, à résister à l'attaque redoublée de la classe dominante, à traduire la perte de confiance dan? L’économie capitaliste en une prise de conscience de la nécessité ce détruire ce système économique et politique dépend l'avenir. La fin des années 80, marquée par l'accélération dramatique de la crise, sera décisive.
28/5/86.
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Polémique avec le BIPR : TACHES DES REVOLUTIONNAIRES DANS LES PAYS DE LA PERIPHERIE
- 3869 reads
Battaglia Comunista a publié dans le n° 9 de sa revue théorique Prometeo un "Projet de thèses sur la tactique communiste dans les pays périphériques", qui devrait bientôt paraître dans les versions anglaise et française de la Revue communiste, organe du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR), dans le but de les faire adopter par celui-ci ([1] [1027]).
Le CCI ne peut que saluer avec plaisir cette tentative de se donner une ligne d'intervention bien défi nie dans un secteur d'une telle importance, un secteur où l'absence de ligne claire avait conduit Battaglia Comunista (BC) à côtoyer inconsidérément des groupes bourgeois tels que l'UCM iranienne ([2] [1028]) ou le RPP indien.
Le projet traite de trois types de problèmes : en premier lieu la réaffirmation des positions générales de BC sur ces pays, positions qui coïncident en général avec les nôtres (fin de la phase de développement du capitalisme, nature contre-révolutionnaire des soi-disant luttes de libération nationale, etc.). En second lieu, une définition de l'approche à avoir envers les groupes qui dans ces pays se déclarent intéressés par une cohérence de classe, Nous nous sommes déjà maintes fois exprimés ([3] [1029]) sur l'opportunisme de fond de cette approche et nous ne manquerons pas d'y revenir de manière plus systématique. En troisième lieu -et c'est là l'objet spécifique de ces thèses : quelle tactique doivent appliquer les communistes dans les pays de la périphérie du capitalisme. Notre critique porte donc sur ce point spécifique, non pas tant pour mettre en évidence telle ou telle erreur particulière, mais pour mettre en lumière la tentation opportuniste d'obtenir des succès immédiats qui parcourt et empoisonne les thèses.
En effet, beaucoup de groupes, BC y compris, se sont convertis au travail envers la périphérie du capitalisme après la faillite, au début des années 80, des Conférences internationales de la Gauche communiste ([4] [1030]). Considérant que c'était "perdre son temps" que de poursuivre les "éternelles discussions" au sein de la Gauche communiste, ils ont trouvé plus gratifiant et excitant de cultiver en paix leur "propre" petit jardin de contacts avec des groupes qui se vantaient d'avoir des centaines, voire des milliers d'adhérents. A cette époque on a assisté, plutôt qu'à une diffusion des idées communistes dans les pays périphériques, à une pénétration au sein du milieu révolutionnaire des métropoles, des idées de groupes bourgeois de la périphérie, tels l'UCM-KOMALA ([5] [1031]).
Mais la classe ouvrière est mondiale, de même que la reprise de ses luttes et cette reprise à la longue fait sentir ses effets même dans les lieux où le prolétariat est dispersé et peu nombreux. Il ne nous vient plus des pays périphériques seulement des versions améliorées des sirènes nationalistes et tiers-mondistes, mais aussi la jeune voix de petits groupes qui, à travers mille difficultés, s'approchent d'une cohérence de classe. Et cette voix est une voix critique, qui demande avant tout aux organisations communistes des métropoles de la clarté, de la clarté sur leurs propres positions et sur les divergences effectives qui les séparent des autres groupes.
Le débat entre groupes révolutionnaires, interrompu depuis des années en Europe, revient aujourd'hui avec force à l'ordre du jour, justement par l'intermédiaire de ces camarades de la périphérie, au nom desquels on avait précipitamment déclaré mort et enterré le débat entre les groupes de la Gauche communiste ( [6] [1032]).
Les communistes internationalistes des métropoles, loin de se satisfaire de l'avantage que 1'histoire et l'expérience des prolétariats dont ils sont l'expression leur octroient par rapport aux camarades de la périphérie, devraient réfléchir sur le retard qu'ils ont accumulé dans la construction d'un pôle commun de clarification qui serve de point de référence pour les camarades de tous les pays. C'est celui-là le but (tant pis s'iln'est pas réalisable tout de suite) que nous nous assignons à nous-mêmes, aux camarades du BIPR et à tout le milieu politique prolétarien.
LA NECESSAIRE UNITE ENTRE "PROGRAMME" ET "TACTIQUE"
« Les "objectifs" partiels, contingents, justement tactiques, ne peuvent en aucun cas être assimilés à des objectifs programmatiques du Parti Communiste. Cela revient à dire qu'ils ne peuvent et ne doivent en aucun cas faire partie du programme communiste.
Pour clarifier la thèse avec un exemple, on peut faire référence à la question des organisations de base du prolétariat. Fait partie du programme communiste la centralisation nationale et internationale des conseils prolétariens, sur la base des unités productives et territoriales (...) Par contre, ne fait pas partie du programme communiste -mais bien de la tactique communiste- la libération du prolétariat des prisons syndicales dans la lutte contre le capitalisme à travers son organisation autonome dans les assemblées générales d'usine, coordonnées et centralisées à travers des délégués élus et révocables." (Préambule) La raison d'une telle séparation serait que si le mouvement prolétarien atteint cet objectif ["tactique"] indépendamment d'une stratégie globale d'attaque au pouvoir bourgeois, il est rapidement récupéré [par la» bourgeoisie]» (Ibid)
C'est vrai que toute victoire ouvrière partielle peut être récupérée par la bourgeoisie, mais cela, quel que soit son objectif, même celui que le projet signale comme l'essence du programme : "la dictature du prolétariat et la construction du socialisme". En effet si "la dictature du prolétariat" reste isolée dans un seul pays elle peut être et l'est même obligatoirement récupérée par le capitalisme, comme l'expérience de la révolution russe nous l'a démontré. Mais l'objection de fond que nous opposons aux arguments de BC est que, de tout temps, nous communistes "ne nous présentons pas au monde en doctrinaires avec un nouveau principe : voici la vérité, mets-toi à genoux! Nous ne lui disons pas : renonce à tes luttes car ce sont des sottises) Nous ne faisons que montrer au monde pourquoi il lutte en réalité. " (Marx). Se limiter à écrire dans le programme la nécessité de la centralisation des conseils ouvriers cela revient à présenter aux ouvriers une sorte d'idéal qu'il serait beau d'atteindre mais qui n'aurait rien à voir avec les luttes dans lesquelles il est déjà engagé. Le rôle des communistes est plutôt celui indiqué par Marx : montrer que l'objectif final de la centralisation mondiale des conseils ouvriers n'est autre que le point final du processus qui prend déjà forme dans les tentatives encore sporadiques aujourd'hui d'auto organisation des grèves au niveau de simples usines ou dans les tentatives d'extension des luttes d'un secteur à un autre. Le fait que l'écrasante majorité des ouvriers ne soit pas encore consciente de l'enjeu réel de ses luttes ne fait que confirmer la nécessité pour les communistes de mettre en avant, face au prolétariat, avec un maximum de clarté "pourquoi il lutte en réalité, car "la conscience est quelque chose qu'il devra faire sienne, qu'il le veuille ou non". (Marx)
Le programme ne contient donc pas seulement "où nous voulons arriver" mais aussi "pourquoi c'est possible et comment c'est possible d'y parvenir". Exclure du programme cette composante essentielle et la reléguer dans les limbes d'une "tactique communiste" plus élastique "fait partie des paradoxes historiques de certaines forces politiques" comme Battaglia Comunista, qui affirme avec justesse que la distinction entre "programme maximum"et "programme minimum" est dépassée, souligne la nécessité d'éliminer les ambiguïtés laissées sur cette question par l'Internationale Communiste et puis oublie justement le plus important. C'est là que se trouve toute l'ambiguïté : BC rejette la vieille distinction périmée mais la réintroduit ensuite, nouvelle version, sous la forme d'une insistance croissante sur la distinction entre le programme, bastion des principes, et la tactique, plus libre de "manoeuvrer" pour le triomphe final des principes.
Les différentes Gauches Communistes se sont élevées contre cette insistance, en particulier la Gauche italienne qui a réaffirmé, par la bouche de Bordiga, que la tactique ne peut être autre chose que l'application concrète de la stratégie, c'est-à-dire du programme. En effet, le but de la direction de l'I.C, en soulignant cette distinction, était double : d'une part Se donner une certaine marge de manoeuvre dans le domaine tactique, d'autre part s'assurer que les vire- voltes tactiques momentanées ne contaminent pas l'essentiel et donc la pureté du programme. Naturellement, cette distinction entre tactique et programme existait seulement, dans la tête des chefs de l'Internationale : l'opportunisme, introduit par la porte de service de la tactique, s'est infiltré de plus en plus dans le programme et a fini par ouvrir grand les portes à la contre-révolution stalinienne. Il semblerait que les camarades de BC se font eux aussi des illusions en croyant qu'il suffit de déclarer que les tactiques particulières pour les pays périphériques n'ont pas leur place dans le programme, pour ménager la chèvre et le chou. Ils veulent croire que les "petites" concessions tactiques, nécessaires pour accrocher plus solidement des groupes et des éléments des pays périphériques, n'ont aucune influence sur le programme ; ainsi, le programme restant pur, il sera facile de corriger les éventuelles déviations au niveau tactique. L'Internationale Communiste aussi pensait que c'était facile...et on a vu comment elle a fini. Si BC -et le BIPR- ne renversent pas rapidement la vapeur, ils risquent sérieusement de prendre un chemin sans retour.
LES ILLUSIONS SUR LES "DROITS DEMOCRATIQUES"
Voyons maintenant où mène l'application concrète de ces subtiles distinctions entre programme et tactique. "La domination du capital dans les pays périphériques se maintient au moyen de l'exercice de la répression violente et de la négation des libertés les plus élémentaires (de parole, de presse, d'organisation [...] Les marxistes savent distinguer [...] entre des mouvements sociaux pour les libertés et la démocratie, et les forces politiques libérales-démocratiques qui se servent de ces mouvements pour la conservation du capitalisme. [...] Ce n'est pas une politique communiste que. [...] de condamner, en même temps que la direction politique, 1'ensemble du mouvement matériel et social et ses mêmes revendications [...] de même qu'il n'est pas communiste d'ignorer dans les pays métropolitains les revendications immédiates, économiques du prolétariat, sous prétexte qu'en soi elles ne nient pas le mode de production capitaliste. " (Thèse n° 11).
Les énormes différences qui existent dans les conditions sociales et politiques des pays périphériques par rapport à celles des métropoles sont tellement évidentes que personne ne peut les nier. Le problème est : qu'est-ce que "la liberté et la démocratie" viennent faire ici ? Qu'est-ce que cela signifie d'affirmer que "C'est la domination du capitalisme -libéral et démocratique dans ses métropoles- qui nie la liberté et la démocratie dans les aires périphériques"? Ce que le capitalisme nie, ou plutôt, ce qu'il n'est pas capable de garantir, c'est un minimum de développement dans un sens capitaliste de ces aires, qui permette au" moins d'assurer la survivance physique de leurs populations. Le capitalisme n'est "démocratique", nulle part et encore moins dans les métropoles. Ce qu'il arrive encore à garantir dans les métropoles -mais de moins en moins- c'est un niveau de vie suffisant pour alimenter des illusions démocratiques au sein de la classe ouvrière. Par contre, si on veut parler du fait que dans les métropoles il existe une plus grande liberté d'organisation, de presse, etc. que dans la périphérie, il ne faut pas oublier la part que joue dans cet état de fait l'existence d'un rapport de forces plus favorable au prolétariat de par sa force et sa concentration. Lancer le mot d'ordre "droits démocratiques" là où le prolétariat n'a pas la force de les imposer et où le capitalisme n'a pas la force de les donner, cela revient à agiter devant les masses non pas une misérable carotte, mais l'illusion d'une misérable carotte.
La distinction entre les mouvements sociaux pour la démocratie et leurs directions est alors encore plus opportuniste. Comme l'admettent les thèses mêmes, les "désirs de liberté et de démocratie qui s'élèvent de toutes les couches de la population" (thèse 11) sont partagées par la bourgeoisie aussi. Le tableau n'est donc pas celui d'un vague "mouvement social" parasité par une direction bourgeoise qui en substance, lui serait étrangère. Au contraire, le mouvement contre l'Apartheid en Afrique du Sud (pour reprendre l'exemple cité par les thèses) est un mouvement interclassée dans lequel les ouvriers noirs sont obligés de marcher aux côtés des bourgeois noirs, sous la direction de bourgeois noirs et sur des mots d'ordre qui défendent les intérêts des bourgeois noirs en particulier, et du capitalisme en général. Le fait que ces revendications "surgissent naturellement dans le processus de la vie sociale de ces pays" est, en termes marxistes, une banalité dénuée de sens : la revendication pour des "réformes de structures" surgit aussi "naturellement" en Italie et dans d'autres pays industrialisés, et ce n'est pas pour cela que les communistes renoncent à la combattre et la dénoncer de toutes leurs forces. Dans la tentative de rendre plus acceptable l'appui "critique" à ces mouvements, les thèses s'efforcent de souligner leur caractère "réel", "naturel", "matériel" et ainsi de suite. Un peu comme les philosophes bourgeois du 18e siècle qui pensaient que "tout ce qui est réel est rationnel" (c'est-à-dire bourgeois), BC semble penser que tout ce qui est matériel est prolétarien ou, au moins, pas anti prolétarien. Nous regrettons de devoir refroidir ces enthousiasmes faciles, mais des phénomènes comme le nationalisme, le syndicalisme, le racisme (ou l'anti-racisme) sont des forces réelles, qui exercent leur poids matériel dans un sens bien précis et qui surgissent tout naturellement en défense de l'existence du capitalisme. Le parallèle avec les revendications "immédiates" ouvrières, qui est supposé attribuer le brevet de marxisme à l'appui de ces mouvements, montre seulement combien BC est obligée d'embrouiller les cartes pour tenter de retomber sur ses pieds. Une chose est la revendication immédiate ouvrière (plus de salaires, moins d'heures de travail) qui, même si elle est limitée, va dans le sens de la défense des intérêts de classe et doit donc être soutenue par les communistes, tout autre chose est la revendication pour des "élections libres" ou pour plus de pouvoir pour sa propre bourgeoisie "opprimée" qui, tant dans l'immédiat qu'en perspective, ne sert qu'à dévoyer les luttes ouvrières dans une voie sans issue. Dans le premier cas les communistes sont au premier rang dans la lutte, dans le second cas, ils sont toujours au premier rang mais pour mettre en garde les travailleurs contre les pièges que lui tend la bourgeoisie.
C'est là le point central : Battaglia Comunista a la conscience tranquille en rejetant "l'inscription au programme communiste d'objectifs politiques démocratiques qui ajournerait le contenu réel du programme communiste" elle utilise en même temps ces objectifs "dans la définition de lignes tactiques, de mots d'ordre pour la lutte immédiate [...] en lien étroit avec des revendications, lignes tactiques et slogans agitatrices de la lutte économique, de manière à rendre matériellement praticable la pénétration du programme proprement communiste au sein des masses prolétariennes et .déshéritées." L'ennui est que les objectifs politiques démocratiques, c'est-à-dire bourgeois, ne font pas qu'"ajourner" le programme communiste ; ils le nient et le détruisent de fond en comble. Soutenir que la pratique de ces objectifs favorise justement "la pénétration du programme communiste au sein des masses", cela revient à soutenir que pour apprendre à quelqu'un à nager, il faut d'abord commencer par lui attacher les mains avant de le jeter à l'eau.
En proclamant que ces objectifs démocratiques doivent aller de pair avec les revendications économiques, les camarades de BC tournent volontairement le dos à la réalité : l'expérience des mouvements prolétariens de la périphérie du capitalisme montre que c'est exactement le contraire qui arrive, c'est-à-dire que la soumission aux bavardages démocratiques entraîne comme premier résultat le renoncement aux revendications économiques prolétariennes. Pour rester encore sur l'exemple de l'Afrique du Sud : au printemps 85, les mineurs noirs ont décidé de faire grève pour de fortes augmentations de salaires ; les syndicats et les partis noirs ont décidé qu'il fallait "élargir" les revendications à des objectifs politiques tels que l'abolition de l'Apartheid. Puis les revendications économiques ont été éliminées "pour ne pas trop demander à la fois", tandis que la grève était repoussée de semaine en semaine pour permettre aux patrons de se préparer. Résultat : la grève, désormais vidée de toute force prolétarienne, a échoué le jour même où elle a commencé, avec un lavage de cerveau des ouvriers en conséquence : "la lutte ne paie pas, seules des élections libres peuvent changer réellement les choses".
Le plus inquiétant c'est qu'avec cette insistance sur le fait que la poursuite d'objectifs démocratiques peut servir à entraîner les masses sur des positions communistes, on se rapproche dangereusement de la thèse réactionnaire bien connue des trotskystes, pour qui le prolétariat n'est pas mûr pour les positions de classe et doit y être porté à petits pas, à travers des objectifs intermédiaires, codifiés dans un beau manuel appelé "Programme de Transition". Certes, BC ne partage pas ces assertions contre-révolutionnaires et les combats au sein du prolétariat occidental, mais elle n'est pas aussi ferme sur l'exclusion de la possibilité d'une tactique semblable sur certains aspects, pour le prolétariat des pays périphériques. Une telle ambiguïté n'ouvre même pas une petite fenêtre aux positions communistes dans la périphérie, par contre elle risque d'ouvrir grand les portes à l'infiltration opportuniste partout.
LES CONDITIONS DE LA LUTTE ET DU PROGRAMME COMMUNISTE DANS LES PAYS PERIPHERIQUES
"...Le fait que le mode de production capitaliste dans les pays périphériques s'est imposé en bouleversant les anciens équilibres et que sa conservation se fonde et se traduit par une misère croissante pour des masses de plus en plus nombreuses de prolétaires et de déshérités, 1'oppression politique et la répression qui sont donc nécessaires pour que les masses subissent ces rapports, tout cela détermine dans les pays périphériques un potentiel de radicalisation des consciences plus élevé que dans les formations sociales des métropoles." [...]
"Ceci, à la différence des pays métropolitains, rend possible l'existence et l'action d'organisations communistes de masse" (Thèse 5)
"La possibilité d'organisations de masse dirigées par les communistes [...] ne doit pas se traduire par une massification des partis communistes eux-mêmes."
"C'est au fond le même problème qui se présente dans les pays avancés et auquel notre courant répond par ses thèses sur les 'groupes d'usine' communistes gui regroupent autour des cadres du parti les avant-gardes ouvrières orientées par lui et sous son influence directe. La particularité des pays périphériques réside dans le fait que cette condition existe non seulement dans les usines et dans la très restreinte (pour le moment) aire d'action de la minorité révolutionnaire, en période de paix sociale, mais bien à plus large échelle sur le territoire, dans les villes et les campagnes. Dans ces pays, pour les raisons qu'on a vues, l'organisation de forts groupes communistes territoriaux devient donc possible." (Thèse 6).
Comme on peut voir, BC avance deux thèses étroitement liées sur la "particularité" des pays périphériques.
La première thèse est que la faiblesse de l'implantation capitaliste dans ces pays en met à nu les contradictions, facilitant "la circulation du programme au sein des masses".
La deuxième thèse est que cette plus grande disponibilité envers la propagande révolutionnaire rend dès aujourd'hui possible dans ces pays la construction d'organisations de masse sous l'influence directe du parti.
Deux thèses, deux erreurs. D'abord, la thèse selon laquelle, les pays périphériques, de par les contradictions particulièrement aiguës qu'ils vivent, offrent de meilleures conditions pour l'activité révolutionnaire, n'est pas une idée nouvelle de BC ; elle dérive d'une idée défendue par Lénine connue comme la théorie "du maillon faible du capitalisme", dont à voulu généraliser la validité après la victoire de la révolution dans ce pays périphérique qu'était la Russie tsariste. Le CCI a soumis à une critique approfondie cette théorie, critique qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici en entier ([7] [1033]). Il suffira simplement de rappeler que le système mondial de domination bourgeoise n'est pas composé d'autant, de maillons indépendants pouvant être pris séparément ; quand un des maillons les plus faibles est en difficulté (par exemple la Pologne en 1980) c'est toute la bourgeoisie mondiale qui intervient pour soutenir cette bourgeoisie nationale contre le prolétariat. Dans ces pays le processus d'une révolte prolétarienne, confronté à "sa propre" bourgeoisie seulement, aurait certainement de grandes possibilités d'extension et de radicalisation ; mais face au front uni que la bourgeoisie mondiale oppose de fait, ses possibilités sont très rapidement réduites. En conséquence, la circulation du programme communiste dans ces pays n'est pas du tout plus facile, malgré le haut niveau de radicalité et de violence souvent atteint par les luttes. Quiconque a eu des contacts avec des camarades de ces pays peut en témoigner, et peuvent en témoigner surtout les camarades mêmes qui travaillent dans ces pays. La réalité quotidienne à laquelle on a affaire dans un pays comme l'Iran par exemple, c'est l'énorme influence du radicalisme islamique sur les masses semi-prolétaires et déshéritées. La réalité à laquelle on se heurte chaque jour en Inde c'est la subsistance, au sein du prolétariat lui-même, du sectarisme tribal qui existe entre les milliers de communautés ethniques présentes dans le pays, la réalité de la séparation des individus en fonction du système des castes. Parler de la facilité avec laquelle circule le programme communiste dans des pays où une journée de salaire ouvrier ne suffit pas à payer un seul numéro d'un journal révolutionnaire, des pays où les ouvriers ne peuvent pas lire le soir après dix heures d'usine parce que le courant électrique n'est fourni que pendant quelques heures par jour, c'est faire de l'humanisme bon marché ou, plus simplement, n'y avoir jamais mis les pieds.
La réalité est exactement le contraire : de très petits noyaux de camarades commencent à travailler dans les pays de la périphérie du capitalisme et doivent conquérir la rue centimètre par centimètre, luttant à coups de griffes et à coups de dents contre des difficultés inouïes. Pour ne pas plier sous les difficultés ambiantes, ces camarades ont besoin de tout l'appui et de toute la force des organisations communistes des métropoles, et non de paroles sur la facilité de leur travail.
La conclusion pratique que BC fait découler de la soi-disant facilité pour la propagande communiste est la possibilité de construire des organisations de masse dirigées par les communistes. Il faut voir là un cas typique de pénétration de l'idéologie bourgeoise à travers les interstices laissés par une faiblesse persistante dans les positions révolutionnaires. En l'occurrence, il s'agit de la rencontre des mensonges éhontés des nationalistes du PC d'Iran quant à l'existence d'"organisations communistes de masse" sur les montagnes du Kurdistan et dans tout l'Iran, et de la volonté désespérée de BC de croire ces mensonges qui semblent redonner du souffle à sa vieille fixation Sur les "groupes communistes d'usine". Cela fait des années que le CCI polémique avec BC sur sa prétention de construire sur les lieux de travail des groupes d'usine, regroupant aussi bien des militants du parti que des prolétaires influencés politiquement par lui.
LA CHIMERE DE B.C. : LES "GROUPES COMMUNISTES D'USINE"
Pour répondre à nos critiques et mises en garde sur le danger de glissements opportunistes, les camarades de BC ont toujours insisté sur le fait que les "groupes communistes d'usine" ne s'écartent pas de la ligne du parti et donc leur existence n'est en fait pas basée sur une dilution du programme.
Or, la question est justement celle-là. Tant que les groupes d'usine sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire de simples copies du parti avec quelques rares sympathisants en plus et un peu de cohérence programmatique en moins, il ne peut effectivement pas surgir de gros problème, au moins dans l'immédiat, car seulement ce qui a une existence réelle peut réellement entraîner des avantages ou des problèmes. La question se pose différemment dans l'hypothèse d'un élargissement de ces groupes, hypothèse qui, en fait, n'est pas irréaliste : à mesure que la crise s'approfondit, un nombre croissant de prolétaires sera poussé à chercher une alternative aux faux partis ouvriers et à tous les organismes soi-disant "intermédiaires" (groupes ouvriers, groupes d'usine, etc.) et nous verrons affluer un grand nombre de ces éléments. Le jour où ils existeront vraiment, les groupes d'usine seront constitués d'un certain nombre de prolétaires dégoûtés par les faux partis ouvriers, mais encore en partie liés à eux du point de vue idéologique, plus quelques rares militants ayant effectivement une cohérence programmatique. Cette perspective semble être la "Terre promise" pour les militants de BC : enfin la cohérence programmatique du parti pourra influencer un plus grand nombre d'ouvriers ! Cela elle le comprend très bien. Par contre, ce qui n'arrive pas à lui rentrer dans la tête est que dans la nature tous les échanges se font dans les deux sens. Cela veut dire que si les groupes d'usine offrent un terrain organisationnel commun à la cohérence programmatique et aux illusions qui pèsent encore sur les prolétaires, alors ce ne sont pas seulement les 1’illusions qui cèdent le pas devant les positions révolutionnaires, mais aussi les positions révolutionnaires qui doivent faire quelques petites concessions aux illusions des prolétaires afin de maintenir un terrain commun d'entente.
Si on ajoute à la pression normale ambiante de l'idéologie dominante la pression interne des tendances activistes, localistes, ouvriéristes de dizaines d'ouvriers à peine éveillés à la nécessité de "faire quelque chose", où iraient finir ces groupes d'usine ? Le point de rencontre entre cohérence et confusion tendrait nécessairement à se faire plus près de la confusion, contaminant les militants révolutionnaires mêmes présents dans les groupes.
La réponse de BC à ces mises en garde peut facilement se réduire de l'insistance du projet de thèses sur le fait que "dans les organismes de parti se trouvent concentrées les meilleures qualités, les meilleurs cadres du prolétariat révolutionnaire et les mieux préparés." (Thèse 6)
En somme, la garantie de non déviation des groupes d'usine ou des groupes territoriaux résiderait dans l'existence d'un parti homogène et sélectionné, qui en assurerait la direction correcte. En fait BC se fait encore une fois des illusions sur la possibilité de ménager la chèvre et le chou en s'imaginant des séparations à cloisons étanches entre le parti et les ouvriers qui, dans la réalité, n'existent pas.
Nous avons déjà vu comment, au niveau des positions politiques, plus on laisse du champ libre aux "mots d'ordre agitatoires" et de la marge de manoeuvre à la "tactique communiste", plus on se fait des illusions sur la possibilité de sauver son âme en proclamant que tout cela "ne doit en aucun cas faire partie du programme communiste" (Préambule). Il en va de même au niveau organisationnel : plus on ouvre les portes de soi-disant organismes "communistes" à des masses de prolétaires convaincus seulement à moitié, plus on croit sauver son âme en proclamant qu'au parti, le vrai, n'entrent que les éléments "aptes". Que signifie cette corrélation ?
En premier lieu que ces fameux organismes territoriaux de masse ne sont pas autre chose que la concrétisation organisationnelle de la division opportuniste entre tactique et programme (dans les groupes on pratique la tactique, le parti, lui, s'occupe de maintenir le programme).
En second lieu, cela signifie que, étant donné qu'une tactique opportuniste finit toujours par souiller le programme dont elle est censée s'inspirer, ainsi chaque oscillation de la masse d'éléments semi-conscients encadrés par les groupes a forcément des répercussions sur l'organisation révolutionnaire qui est responsable de ces groupes du point de vue politique et organisationnel.
En fin de comptes, toute cette argumentation sur la tactique et les organisations "de masse" ne conduit pas à la "pénétration du programme proprement communiste au sein des masses prolétariennes et déshérités"? Thèse 11), mais plus banalement, à la pénétration de l'influence idéologique bourgeoise au sein des rares et précieuses organisations communistes.
LIMITES D'UN AMENDEMENT : UNE REACTION SALUTAIRE MAIS NETTEMENT INSUFFISANTE
C'est un vieil acquis de la Gauche Communiste que de savoir que toute tentative d'adapter les thèses communistes aux conditions particulières des divers pays (arriération, etc.) comporte les plus grands risques de déviation opportuniste. L'accentuation des connotations opportunistes que l'on remarque à chaque pas du projet était donc amplement prévisible, de même qu'on pouvait prévoir une réaction au sein du BIPR contre cette accentuation. À la dernière réunion du Bureau, un "amendement de forme" (!) a été approuvé, remplaçant "organisations communistes de masse" par "organisations de masse dirigées par les communistes".Donc,"aucune concession, pas même formelle, aux organisations politiques communistes de masse, mais une étude sérieuse des différentes possibilités offertes au travail des communistes dans les pays périphériques." (Battaglia Comunista n°l, 1986). En fait, pour les camarades de BC "l'argumentation ultérieure ne laissait aucune place au doute" Changer un terme est plus que suffisant pour tout clarifier. C'est peut-être vrai. Mais commençons par faire remarquer que ces groupes sont destinés à se voir attacher un adjectif de trop : pendant trente ans, BC les a définis comme des "groupes syndicalistes d'usine" et ce n'est qu'après les premières polémiques avec nous qu'elle les a rebaptisés "Groupes internationalistes d'usine". Nous avions alors commenté : "S'il suffisait d'éliminer le terme 'syndical' pour éliminer les ambiguïtés sur le syndicat, tout serait réglé." (Revue Internationale n° 39 p.16 : Polémique avec la CWO). Ceci dit, ici il ne s'agissait pas seulement d'un adjectif en trop : dans les thèses on ne se limite pas à appeler communistes ces groupes territoriaux. On prend aussi la peine de préciser qu'ils sont "communistes parce qu'ils sont dirigés par et en fonction des lignes communistes, parce qu'ils sont animés et guidés par les cadres et les organismes du parti". (Thèse 6). Si on prenait au sérieux ces affirmations, on jetterait à l'eau, en une seule phrase, toute la tradition politique-organisationnelle de la Gauche italienne, faisant passer pour une organisation communiste un organisme de masse composé de non-communistes et obligatoirement soumis aux oscillations des prolétaires qui le composent.
La logique liquidatrice du parti qui se trouve derrière ces organisations ne peut être extirpée par une simple élimination d'adjectifs. En écrivant ces formulations particulièrement opportunistes, les rédacteurs du projet des thèses n'ont fait que développer logiquement et jusqu'au bout ce que les camarades de BC ont toujours dit : que les groupes d'usine sont des organismes communistes, des organismes de parti, même s'ils encadrent des ouvriers qui n'adhèrent pas au parti. L'hypothèse actuelle d'une entrée en masse de non-communistes, de non-militants du parti au sein de ces organismes de parti, ne fait que rendre plus évidente et macroscopique une contradiction qui existait déjà. Si BC veut comme d'habitude ménager la chèvre et le chou, il faut précisément admettre qu'un organisme puisse être communiste même si l'écrasante majorité de ses militants ne l'est pas (il suffit que la direction le soit), et alors on ne comprend pas la nécessité de l'amendement approuvé, ou alors il faut admettre qu’il ne s'agit pas d'organismes de parti mais d'organismes semi-politiques, intermédiaires entre classe et parti, ce que BC a toujours nie. Et même si elle l'admettait, ce né serait pas un grand pas en avant : elle abandonnerait en fait une de ses confusions particulières, seulement pour s'enfoncer dans la confusion générale répandue dans le milieu prolétarien au sujet des "organismes intermédiaires" et autres "courroies de transmission".
Dans les deux cas toute la tentative de développer une proposition spécifique politique-organisationnelle pour les camarades des pays périphériques craque sur ses propres bases constitutives. Les camarades du BIPR doivent y réfléchir très sérieusement.
BEYLE
[1] [1034] Le BIPR s'est constitué à l'initiative de Battaglia Comunista et de la Communist Workers'Organisation (CWO)
[2] [1035] Voir Revue Internationale n°36 : "A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e congrès du CCI - Réponse aux réponses"
[3] [1036] Voir par exemple la 2ème partie de l'article "Bluff d'un regroupement" dans la Revue Internationale n° 41.
[4] [1037] Voir les brochures contenant les procès-verbaux de ces Conférences.
[5] [1038] Voir Revue Internationale n°36 : "A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e congrès du CCI - Réponse aux réponses"
[6] [1039] Voir Revue Internationale n°36 : "A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e congrès du CCI - Réponse aux réponses"
[7] [1040] Voir dans les Revues Internationales n°31 (4ème d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe", trim.82) et 37 (2ème trim.84) : "Le prolétariat "A propos de la critique de la théorie du 'maillon faible')
Courants politiques:
- TCI / BIPR [821]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : Emancipacion Obrera, Militancia Clasista Revolucionaria (Argentine, Uruguay)
- 2704 reads
Présentation
Nous venons de recevoir d'Argentine une "Proposition Internationale" qui s'adresse aux éléments et aux groupes révolutionnaires. Elle appelle à la discussion et au regroupement des forces révolutionnaires aujourd'hui faibles et dispersées de par le monde. Cette proposition que nous présentons ici avec notre réponse est clairement et sans équivoque possible prolétarienne : elle dénonce la démocratie bourgeoise, tout type de frontisme "anti-fasciste" et le nationalisme ; elle défend et affirme la nécessité de l'internationalisme prolétarien face à la guerre impérialiste.
Nous saluons l'esprit et la démarche dont les camarades font preuve dans leur document : nécessité de la discussion ouverte, de la "polémique", de la confrontation des différentes positions politiques, de la lutte politique fraternelle en vue de constituer un pôle de référence politique international. Un pôle de référence qui soit capable de regrouper et d'aider au surgissement d'éléments et de groupes révolutionnaires. Comment ne pourrions-nous pas appuyer 1'esprit et la préoccupation des camarades, nous qui affirmions, lors de la constitution du CCI, dans le premier numéro de notre Revue Internationale d'avril 1975, nos propres ambitions:"Concentrer les faibles forces révolutionnaires dispersées de par le monde est aujourd'hui, dans cette période de crise générale, grosse de convulsions et de tourmentes sociales, une des tâches les plus urgentes et les plus ardues qu'affrontent les révolutionnaires. Cette tâche ne peut être entreprise qu'en se plaçant d'emblée et dès le départ sur le plan international. Ce souci est au centre des préoccupations de notre Courant. C'est à ce souci que répond également notre Revue, et en la lançant nous entendions en faire un instrument, un pôle pour le regroupement international des révolutionnaires". Même si les résultats ont été modestes jusqu'à présent, notre ambition est toujours là et c'est dans ce sens que nous publions cette "Proposition Internationale" signée par deux groupes : "Emancipacion Obrera" et "Militancia Clasista Révolueionaria" ([1] [1041]).
Ce dernier groupe ne nous est pas connu. Par contre, nous savons qu'"Emancipacion Obrera" est un groupe qui a surgi après la guerre des Malouines. Il ne se rattache à aucune organisation déjà existante. Ce groupe s'est constitué petit à petit au cours des terribles années 70 en Argentine. Il a dû affronter la répression de 1'Etat bourgeois sous toutes ses formes :
-.1'officielle : la démocratique, la péroniste, la syndicale, et bien sûr la policière et la militaire;
- 1'officieuse, para-étatique : d'une part, celle des tristement célèbres commandos d'extrême droite A.A.A et, d'autre part, celle du trotskisme ([2] [1042]) quand nos camarades dénonçaient l'appui et la participation de ceux-ci à la guerre des Malouines et défendaient une politique de "défaitisme révolutionnaire".
C'est en 1978 que la répression a atteint son sommet lors de la coupe du monde de football en Argentine. C'est en 1978 que Ces camarades ont décidé "de commencer à réaliser un travail de lutte idéologique, de sortir une publication clandestine"."C'est cette activité qui, quand le gouvernement militaire a envahi les îles Malouines, a permis de sortir des tracts dans la rue s'opposant à la guerre dès le deuxième jour de celle-ci. C'est à partir de là que de vieilles et de nouvelles connaissances se sont regroupées dans la lutte contre le nationalisme et la guerre inter-bourgeoise. Durant ces deux mois, des petits groupes ont surgi réalisant une activité internationaliste" ("Emancipacion Obrera").Après la guerre, ces groupes se sont réunis et "ont décidé de poursuivre le processus de lutte politique et ont discuté de 1'avenir : produit de la discussion, est sorti un document sur les élections futures et ce document fut signé : "Emancipacion Obrera".
Nous allons peut-être manquer de pudeur, mais c'est avec émotion et joie que nous saluons ces camarades et présentons ici leur "Proposition Internationale". Dans un pays où le prolétariat avait subi une répression féroce, l'apparition d'une voix prolétarienne est une promesse de plus, après le Mexique, après l'Inde, pour l'issue victorieuse des gigantesques affrontements de classe qui se préparent.
C'est aussi la promesse de plus de travail et de responsabilité pour les groupes déjà constitués du milieu révolutionnaire international. Pour sa part, le CCI essaiera de remplir du mieux possible la tâche qu'il s'est assignée.
"Proposition internationale" aux partisans de la révolution prolétarienne mondiale
Les 22 et 23 février 1986, un groupe de. Militants que, (spécialement d'Argentine et d'Uruguay) se sont réunis en Uruguay pour discuter de la situation mondiale actuelle et des tâches du prolétariat
Entre eux, il y eut un accord général sur le fait que face aux attaques que la bourgeoisie porte mondialement contre le prolétariat et face à la situation actuelle de faiblesse, de dispersion et d'isolement des petites forces classistes et révolutionnaire il était nécessaire de travailler de manière associée pour renverser la situation en combattant le sectarisme et le nationalisme implicites dans certaines conceptions du travail international. Et comme tentative pour modifier cette situation, les camarades présents donnent à connaître les idées et la proposition suivantes.
QUELQUES CONSIDERATIONS ET FONDEMENTS PREALABLES.
Il peut paraître étrange que, ici, d'un seul coup, quelques groupes et militants peu nombreux, sûrement inconnus en général, lancent un appel, une proposition à tous ceux qui, en diverses parties du monde, avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de clarté, brandissent bien haut le drapeau de l'internationalisme prolétarien, de la révolution prolétarienne mondiale.
Mais ce n'est pas "d'ici" ni "d'un seul coup" que surgit une fois encore le cri angoissé de minorités révolutionnaires qui cherchent à rompre le cordon tendu par le capital, qui assistent impuissantes aux coups terrifiants que la bourgeoisie porte sur le prolétariat et sur elles-mêmes, qui, tant dans les périodes de montée de la lutte de classe que dans les moments de la contre-révolution la plus violente, découvrent l'une et l'autre ce que signifient l'isolement, la faiblesse de leurs petites forces ; faiblesse non seulement numérique, mais fondamentalement politique car il est impossible localement ou nationalement de résoudre les problèmes que le moment actuel impose aux révolutionnaires.
Nous sommes convaincus qu'en différents lieux, ont surgi des groupes, des militants qui, ne s'identifiant pas à la gauche traditionnelle (stalinienne, trotskyste et ses variantes.), aux politiques visant à aider la bourgeoisie à résoudre ses problèmes, avec la position de changer la forme étatique de la domination bourgeoise ou de l'appuyer dans ses guerres, ont essayé d'élaborer une politique distincte revendiquant l'autonomie de la classe ouvrière face à la bourgeoisie et la lutte pour détruire sa domination et son Etat sans admettre des phases ou des étapes préliminaires (démocratiques).
Et nous savons ce que c'est que d'aller à contre-courant, sans aucune aide sur laquelle compter, sans possibilité immédiate de réappropriation des expériences historiques du prolétariat révolutionnaire, sans textes théorico-politiques fondamentaux et dans une ambiance de répression et de danger.
Si, pour quelques uns, certaines définitions ou positions sont aussi évidentes que l'alphabet, au point qu'il ne leur paraît pas nécessaire d'en parler ou d'écrire dessus, pour d'autres, arriver à écrire la lettre "A" a signifié tout un processus de luttes, de ruptures, de peurs et d'incertitudes.
Ici, dans les écoles, on enseigne une phrase d'un homme illustre du siècle passé : "on ne peut tuer les idées". Cependant, nous avons appris qu'on tue ceux qui ont certaines idées (ou positions), et que la classe dominante peut entraver pour une longue période la réappropriation, la connaissance, le lien et le développement des expériences ; idées et positions que vit et construit le prolétariat révolutionnaire dans différentes aires du monde.
C'est ainsi que, paradoxalement, il a fallu une répression monstrueuse (avec l'exil qui s'en est suivi) et une guerre (les Malouines) pour savoir ici, qu'existaient dans le monde divers courants et groupes radicalisés ; pour connaître -et encore très peu- les expériences d'Allemagne et d'ailleurs après la première guerre ; pour connaître d'autres positions dans la guerre civile espagnole qui ne soient ni franquistes ni républicaines. Et qu'il y a une autre histoire plus proche (que nous ne connaissons pratiquement pas).
A partir de là, nous avons eu la confirmation qu'actuellement il existe des groupes qui ne s'inscrivent pas dans les courants politiques traditionnels, beaucoup que nous ne connaissons pas encore et d'autres dont nous ne savons ni quand ni comment ils ont rompu avec le capital et ses fractions, mais qui expriment à divers degrés des moments différents de rupture avec la politique du capital.
Mais si aujourd'hui nous savons que cela existe, ceci ne signifie nullement que la situation actuelle d'isolement et de faiblesse ait changé. Au contraire, nous n'arrivons même pas encore à savoir ce qui se passe, non dans un pays lointain ou limitrophe, mais dans une ville proche ou un quartier voisin. Et il ne faut pas comprendre cela comme une curiosité ou une question journalistique : en Argentine, par exemple, il y a continuellement des jours où plusieurs millions d'ouvriers sont en conflit... sans qu'il existe une quelconque coordination entre eux, parfois même sans qu'on sache qu'il y a une lutte ; ce qui arrive de tous côtés. Et s'il en est ainsi des mouvements relativement massifs, c'est encore pire pour ce qui concerne les contacts et la connaissance des avant-gardes qui surgissent au cours de ces luttes ou sous leur influence.
Et nous sommes convaincus que dans les pays dans lesquels nous vivons, comme dans d'autres parties du monde, des groupes d'ouvriers ou de militants surgissent qui essaient de rompre avec les politiques de conciliation, de subordination à la bourgeoisie, mais qui, en l'absence de référence internationale, avec la forte présence de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier, finissent par succomber absorbés par quelque fraction du capital ou simplement désagrégés, disparus.
Peu nombreux sont ceux qui réussissent à surmonter les premiers coups, et ceux qui le font ont devant eux une perspective incertaine ou la solitude politique, le devoir de passer des étapes et de rebrousser chemin, de se retrouver dans des impasses, partir presque à zéro sur de nombreux sujets, se transformer en une réalité quotidienne épuisante qui mine les petites forces déjà tant frappées politiquement et économiquement. N'y a-t-il pas d'autre alternative que celle-ci ? Est-ce que la gestation d'une politique internationaliste révolutionnaire, ou tout au moins une ébaucha de celle-ci, se fera ainsi, étape par étape, groupe par groupe, ville par ville, nation par nation, génération par génération ? Chacun doit-il repasser par les mêmes étapes, affronter les mêmes problèmes, recevoir les mêmes coups, déchiffrer les mêmes lettres, élaborer les noues mots, pour qu'après un temps et un chemin assez longs, une fois forts et constitués en "Parti", se réunir avec d'autres "égaux" ou, en leur absence, "s'étendre à d'autres nations ?
Nous ne croyons pas que ce soit la seule option ; nous ne croyons même pas qu'on puisse en tirer quelque chose de positif.
Au contraire, nous pensons que la seule alternative vers laquelle nous allons est internationale. Tout comme c'est une mystification de parler de Société Communiste tant qu'il existe un seul pays capitaliste dans le monde, c'en est une aussi de parler d'internationalisme en ne concevant celui-là que comme la solidarité avec les luttes ouvrières dans le monde ou en l'assimilant à quelques phrases pompeuses de temps en temps contre la guerre, le militarisme ou l'impérialisme.
L'internationalisme prolétarien a pour nous une autre signification et implique de faire un effort pour dépasser la solidarité générique car les dimensions internationales de la révolution prolétarienne exigent d'entrelacer et d'unifier les efforts pour délimiter une stratégie unique au niveau mondial et son corollaire politique dans les tâches auxquelles nous nous confrontons dans les > différentes aires et pays.
Naturellement, on ne résoudra pas ce problème par volontarisme ni du jour au lendemain ; il ne sera pas le fruit d'un travail long et prolongé d'"éducation" ou "scientifique" comme le concevait la 2ème Internationale (et pas seulement elle), un travail d' "accumulation de forces" ("en gagnant des militants un à un", en "élaborant LA théorie" et en "structurant LA direction qui devra être reconnue à son heure) pour un affrontement repoussé à un futur toujours plus lointain, alors que la résistance et la lutte du prolétariat contre le capital sont quotidiennes (pour ces courants politiques ces luttes quotidiennes doivent être contrôlées, cachées, isolées, afin de pouvoir s'en servir, comme ils l'ont toujours fait, pour soutenir une fraction de la bourgeoisie contre une autre supposée pire).
Si le parti de la classe ouvrière n'est pas un de ces groupes politiques qui se donne un tel nom dans un ou plusieurs pays ; si ne pas être d'accord avec "le parti pour la classe ouvrière" et revendiquer "la classe ouvrière organisée en classe, c'est-à-dire en parti" n'est pas un simple jeu de mots ; si nous rejetons les idées social-démocrates (staliniennes, trotskystes etc...) du parti comme étant l'appareil (intellectuels, ouvriers etc...) porteur de la Vérité et qui se constitue volontairement et au sein d'une nation , qui attend d'être reconnu par les masses incultes, et de l'Internationale comme étant une fédération de partis (ou d'un parti qui s'étend à d'autres nations), tout ceci implique de rompre avec ces conceptions et ces pratiques totalement opposées à l'internationalisme prolétarien et qui ne sont qu'une manière de manifester et de défendre le nationalisme.
Parmi celles-ci, la plus évidente est celle qui conçoit le développement de son propre groupe (ou de ses propres groupes) comme une question locale ou nationale, avec pour objectif d'obtenir une force déterminée afin de se dédier plus tard à prendre contact avec d'autres groupes dans d'autres pays, groupes qu'il faut absorber ou démasquer généralement par des discussions et des déclaration.
Les contacts internationaux sont considérés comme une question de"propriété privée"où règne la pratique de la bilatéralité, celle qui inclut chaque "X" année des périodes de rencontres pour se réunir dans des "Nations Unies" de "révolutionnaires". La pratique des partis de la 2ème Internationale en est un bon exemple.
Nous pensons que ce chemin ne peut conduire qu'à de nouvelles frustrations et de nouvelles mystifications ; c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de lutter contre tous les intérêts, les conceptions et les sectarismes que produisent et reproduisent les divisions créées par la bourgeoisie dans la défense de ses marchés internes, de ses Etats, de "ses" prolétaires, c'est-à-dire de la plus-value qu'elle leur extrait.
Personne ne pense à faire un travail commun, ni même un tract, avec ceux qui se situent dans le camp ennemi. Et avec l'ennemi de classe, il ne peut y avoir de conciliation ou d'entrisme. Mais il n'existe pas que des ennemis. Et on ne peut nier qu'entre les groupes et les personnes qui n'en sont pas, il y a très souvent des intolérances, des visions statiques et du sectarisme. Il y a une pratique des différences, une dispute de la "clientèle" commune, un nationalisme ou "une défense de sa propre chapelle" vêtue d'intransigeance.
Nous ne pouvions éluder ce problème dans une proposition internationale. Il est évident que personne ne pense à travailler dans une perspective commune avec un groupe se réclamant de la 4ème Inter- I nationale ou avec un groupe maoïste tiers mondistes. Mais si le caractère d'ennemi de classe est évident dans certains cas, dans d'autre il est plus subtil et rend difficile l'élaboration d'une ligne de démarcation, et ceci d'autant plus lorsque nous cherchons un point qui implique un pas en avant dans la situation actuelle de faiblesse, d'isolement et de dispersion
Nous pensons qu'il est impossible d'élaborer un ensemble de points "programmatiques" qui soient à l'abri des opportunistes sauf s'il est défini de telle sorte que seul le groupe lui-même puisse être en accord, et encore.
Cri ne peut prétendre non plus que, dans chaque pays du monde, des groupes ou des militants isolés aient mûrit de la même manière que dans d'autres zones et qu'ils aient telles ou telles définitions qui, si diffusées qu'elles soient en certains lieux, sont le produit d'une histoire non partagée et de laquelle, comme nous l'avons déjà signalé, rien ou peu n'est connu dans d'autres aires.
En contrepartie, la grève de presque un an des mineurs anglais, qui n'a suscité aucune tentative sérieuse de coordonner une réponse commune de l'ensemble des différents groupes et militants éparpillés dans le monde, n'indique pas seulement une faiblesse et une limitation : elle indique le sectarisme, des conceptions sur la lutte de classe et le Parti identiques à celles de la social-démocratie. Et face à la guerre entre l'Irak et l'Iran ? Et face à l'Afrique du Sud ? Et la Bolivie et tant d'autres lieux où le prolétariat se bat ou reçoit les coups les plus durs ? Quelle réponse, même minime, a-t-on essayé d'intégrer au niveau international ?
Comment faire pour résoudre cela ? Comment définir des critères pour nous reconnaître afin d'éviter que, dès le départ, la proposition pour commencer à dépasser la situation actuelle ne soit pas mort-née ? (parce qu'elle serait si ambiguë qu'elle serait une "auberge espagnole" ou qu'elle serait si stricte que seuls entreraient ceux qui réalisent déjà un travail ensemble ?) Pour nous, ce critère pour nous reconnaître c'est la pratique. Et c'est de celle-ci que la seconde partie de la proposition va traiter. Même si ni cette pratique, ni rien d'autre ne peut éluder le fondement, l'unique "garantie" : la lutte.
SUR QUELQUES PREVENTIONS
Nous ne savons pas si ce qui précède suffit pour présenter cette proposition et la fonder ou si elle requiert un plus grand développement. Cependant, nous pensons qu'il faut préciser quelques préventions.
Beaucoup demanderont sûrement : avec qui, jusqu' où et comment va-t-on se regrouper dans la perspective internationaliste prolétarienne ? Comment la déterminer ? Qui doit le faire ? Il est évident que
PROPOSITION INTERNATIONALE
Avec l'objectif de :
- contribuer à modifier la situation actuelle de faiblesse de petites forces révolutionnaires et classistes éparpillées de par le monde pour augmenter les possibilités d'action dans la lutte de classe ;
- de consolider et d'élargir ce qui est aujourd'hui des convergences sporadiques, dans la perspective d'organiser et de centraliser une tendance internationaliste prolétarienne qui, avec ses limites et des erreurs, existe aujourd'hui, nous proposons de promouvoir :
1) une réponse coordonnée face à certaines attaques du capital (exemple : dans la question des mineurs anglais, des travailleurs en Afrique du Sud, en Iran-Irak etc...) : tracts et campagnes communes, informations politiques, moments de relations effectives et d'orientations face aux questions concrètes et graves qui touchent le prolétariat mondial ;
2) une information internationale :
a- des luttes ouvrières, en faisant de la propagande en fonction des possibilités, sur les plus importantes qui se déroulent dans chaque région (ou pays) pour les répercuter ailleurs et pour renforcer la réalité de 1'internationalisme prolétarien et la fraternité prolétarienne ;
b- des différents groupes politiques, non seulement des participants à la proposition mais aussi des ennemis, car c'est un élément nécessaire pour la lutte politique contre eux ;
c- de l'expérience historique, des textes et des documents produits dans la longue lutte du prolétariat contre le capital et toute exploitation ;
3) la polémique théorico-politique en vue de prises de positions communes et comme contribution au développement d'une politique révolutionnaire.
Pour ceux qui non seulement partagent cet ensemble de points mais qui se retrouvent effectivement en accord avec une pratique qui mette en avant tous les points de cette proposition -en particulier le point (action commune)-, il est vital d'organiser la discussion. Et pour ceux-là uniquement nous proposons deux choses :
4) l'organisation internationale de la correspondance, ce qui implique la création d'un réseau fluide d'échange et de communication qui doit être une des bases matérielles pour le point 7 ;
5) une revue internationale qui ne doit pas être conçue comme un ensemble de positions politiques des différents groupes réunies sous une couverture "collective". Au contraire, elle doit être un instrument pour consolider l'activité réalisée en commun, pour fonder et propager les positions partagées et, bien sûr, pour développer la discussion publique nécessaire sur les questions vitales qui touchent aux tâches du moment, aux activités proposées et sur des thèmes "ouverts" considérés d'un commun accord comme étant nécessaire à inclure ;
6) dans la mesure où les accords le permettent, stimuler la participation d'autres groupes dans la presse et vice versa ainsi que la diffusion de textes des groupes intervenants ;
7) tendre à créer une discussion interne commune ; c’est-à-dire ne pas se limiter à la polémique "officielle et publique" de groupe à groupe, mais aussi à la discussion des communistes face aux problèmes "ouverts".
Toutes les activités et toutes les décisions que
- prendront les groupes intervenants seront prises d'un commun accord, c'est-à-dire à l'unanimité.
A QUI FAISONS-NOUS CETTE PROPOSITION ?_
1- A ceux qui, dans le monde, réalisent une lutte contre les attaques du capital, contre toutes les guerres impérialistes ou inter bourgeoisies, contre tous les Etats bourgeois (quelles que soient leur forme ou couleur) avec pour objectif la dictature de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, son système social et contre toute forme d'exploitation ;
2- A ceux qui n'appuient aucun secteur bourgeois contre un autre, mais qui luttent contre tous, qui ne défendent pas des fronts interclassistes ni n'y adhèrent ou participent ;
3- à ceux qui assument dans la pratique que "les ouvriers n'ont pas de patrie" ; phrase consacrée qui ne dit pas seulement que les ouvriers ne peuvent pas défendre ce qu'ils n'ont pas, mais qu'on "peut" et qu'on "doit" intervenir dans les luttes et les tâches qui se posent dans les différents pays du monde, en dépit du fait que, du point de vue bourgeois, cette intervention puisse être considérée comme une intromission et contre le "droit des nations à l'auto-détermination". Droit qui est revendiqué et défendu à chaque fois que le prolétariat révolutionnaire ou ses avant-gardes renforcent les liens internationaux face à leur ennemi de classe, droit qui est foulé aux pieds à chaque fois qu'il s'agit de réprimer et de massacrer les mouvements révolutionnaires ;
4- Et justement pour cela, à ceux qui luttent contre les politiques de "défense de l'économie nationale" de relance économique, de "sacrifices pour résoudre la crise", à ceux qui n'avalisent pas les politiques d'expansion de leur propre bourgeoisie même quand celle-ci subit des attaques économiques, politiques ou militaires ; à ceux qui luttent toujours contre toute la bourgeoisie, tant la locale comme celle étrangère.
5- A ceux qui combattent les forces et les idéologies qui prétendent enchaîner les prolétaires à l'économie et la politique d'un Etat national, et les désarmer sous prétexte de "réalisme" et de "moindre mal";
6- A ceux qui ne se donnent pas comme but de "récupérer" ou "reconquérir" les syndicats mais, au contraire, les caractérisent comme des instruments et des institutions de la bourgeoisie et son Etat -raison pour laquelle ils ne peuvent aucunement représenter les intérêts immédiats et encore moins historiques du prolétariat, ni être perméables aux intérêts révolutionnaires de la classe.
7- A ceux qui sont d'accord qu'une des tâches sur ce terrain est de mener jusqu'au bout la bataille contre la ligne politique de collaboration de classes soutenue par les syndicats et de contribuer à rendre irréversible la rupture entre la classe les syndicats.
8- A ceux qui dans la mesure de leurs possibilités contribuent à renforcer toutes les tentatives d'unification du prolétariat pour s'affronter, même partiellement, au capital, toutes les tentatives d'extension, de généralisation et d'approfondissement des luttes de résistance contre le capital.
9- A ceux qui défendent la lutte contre toutes les variantes de la répression capitaliste, tant celle exercée par les forces militaires officielles (étatiques) de l'ordre, comme celle de collègues civils de droite et de gauche du capital. A ceux qui dans la mesure de leurs possibilités, collaborent avec les groupes qui subissent des coups de la répression.
10-A ces avant-gardes qui, dans la lutte contre la bourgeoisie et son Etat,combattent implacablement ceux qui se limitent à critiquer une des formes qu' assume la dictature de la bourgeoisie (la plus violente, militaire en fait) et défendent la démocratie ou luttent pour son développement.
11-Dans ce sens, dans l'optique bourgeoise fascisme-antifascisme, à ceux qui dénoncent le caractère de classe bourgeois des fronts antifascistes et de la démocratie, et posent la nécessité de lutter pour la destruction de l'Etat bourgeois, peu importe sous quelle forme il se présente, avec l'objectif d'abolir le système de travail salarié et d'éliminer mondialement la société de classes et toute forme d'exploitation.
12-A ceux pour qui l'internationalisme prolétarien implique, en premier lieu, la lutte contre sa propre bourgeoisie, le défaitisme révolutionnaire en cas de guerre qui ne soit pas la guerre de classe du prolétariat contre la bourgeoisie et pour la révolution prolétarienne mondiale.
13- A ceux qui, au-delà des différentes théorisations sur le parti, sont d'accord sur le fait qu'il sera international dès sa naissance, ou ne sera pas.
14- Enfin, à ceux qui, en accord avec leur force et leur situation, définissent leurs tâches dans la lutte contre la bourgeoisie orientées vers deux aspects fondamentaux :
a) impulser le développement de l'autonomie de classe du prolétariat ;
b) contribuer à la construction et au développement de la politique internationaliste prolétarienne et de son parti mondial.
C'est-à-dire que, si en fonction des situations particulières,les moyens, les tâches et les priorités peuvent revêtir des formes différentes, toutes doivent être en relation avec une seule perspective : la constitution de la classe ouvrière en force mondiale pour détruire le système capitaliste.
ECLAIRCISSEMENTS FINAUX
Nous croyons que les formulations antérieures peuvent et doivent être améliorées, corrigées, complétées. Nous n'allons pas défendre au pied de la lettre cette proposition, mais son sens général.
Dans les premières discussions que nous avons eues sur la situation actuelle et sur comment commencer à la changer, il y a eu des camarades qui ont manifesté un certain pessimisme sur la réception qu'elle recevrait et les possibilités de sa réalisation.
Nous croyons que, face aux coups terribles que la bourgeoisie porte contre le prolétariat dans sa recherche, parfois désespérée, de résoudre ses problèmes, que, face aux possibilités (et aux réalités) de la guerre inter bourgeoisies, que face aux massacres de travailleurs, d'enfants et de vieux, qui se répètent dans diverses parties du monde, et que face à la montagne toujours croissante des tâches qui s'imposent aux révolutionnaires à l'heure actuelle, la politique de secte, les mesquineries, les "laisser pour plus tard", et la défense implicite ou explicite de l'actuel "statu quo" ne conviennent pas.
La reconnaissance de la situation actuelle doit se traduire dans une initiative politique capable de récupérer le terrain perdu et de dépasser les graves faiblesses. Pour cela, l'engagement commun doit être la lutte pour un changement radical dans les relations internationales entre révolutionnaires, c'est-à-dire passer du simple échange de positions (parfois même pas) à la prise de positions - communes face à 1'attaque de la bourgeoisie contre le prolétariat, aux coordinations indispensables orientant la réflexion et le débat sur des questions qui consolident une perspective commune.
Parmi les "objections" qui peuvent exister par rapport à la viabilité de cette proposition, il y a celle de comment la concrétiser ?
Ici, se trouvent cinq points pour, si on est d'accord avec tous, étudier comment organiser leur réalisation. Nous ne prétendons pas ici donner une réponse à chacune des questions et à chaque problème, mais manifester un engagement de lutte pour sa concrétisation.
Il est évident que, compter sur une exécution et une rapidité pour certaines choses, implique des rencontres physiques. Nous ne croyons pas que ce soit absolument nécessaire, c'est à dire qu'actuellement il nous parait difficile d'y arriver, au moins pour ceux d'entre nous qui vivons dans cette région du monde.
A l'heure actuelle, nous ne voyons pas comment réaliser une réunion vraiment internationale : voyager à l'étranger est pour nous (économiquement) interdit. Un voyage de plus de 8 000 kms équivaut à plus de quinze salaires mensuels (plus de vingt, si nous prenons le minimum défini par le gouvernement).
C'est pour cela que nous estimons que, dans un premier temps, les rapports, les discussions, au moins entre les non-européens et ceux-ci, se feront par correspondance. Cela nous retardera, rendra encore plus difficile la tâche, mais elle n'est pas impossible, loin de là (une lettre d'Europe par exemple, si il n'y a pas de grève, met de 15 à 20 jours).
Les conditions de sécurité (celui qui a confiance dans la légalité n'est pas seulement un crétin ingénu, mais un danger pour les révolutionnaires) posent aussi des obstacles, mais ils peuvent et doivent être résolus.
La langue aussi présente des inconvénients. De notre côté, et jusqu'à maintenant, la seule dans laquelle nous pouvons écrire est l'espagnol. Certains peuvent lire avec difficultés l'italien, le portugais et l'anglais. Avec de l'imagination, quelqu'un pourra comprendre un peu de français, mais rien à faire avec l'allemand. Les autres langues "n'existent pas". En tenant compte de cela, ce qui viendra en castillan n'aura pas la même diffusion, ni la même rapidité que les autres langues dans l'ordre établi.
Pour terminer, l'initiative présentée est exposée dans sa partie fondamentale. Ceux qui se montrent intéressés ou sont d'accord avec, recevront une partie dite "plus organisatrice", c'est-à-dire comment nous voyons, nous, pouvoir la réaliser et la concrétiser.
A tous ceux qui nous écriront, nous garantissons qu'ils recevront une copie de toutes les réponses reçues. L'organisation postérieure de la correspondance, des discussions, etc. se fera avec ceux qui sont d'accord et dépendra de la manière avec laquelle ils s'entendront entre eux.
A ceux qui sont d'accord avec l'esprit de la proposition, nous leur demandons sa diffusion et le détail des groupes (si possible avec leur adresse) à qui ils ont fait parvenir cette convocation.
Uruguay, février 1986.
Note du CCI. : Nous ne publions pas une "note d'éclaircissement" en post-scriptum par manque de place. Cette note a été rédigée après la réunion en mars 1986.Les camarades précisent leur proposition quant à l'aspect "technique" et la répartition des articles. Ils proposent une division en trois parties de la revue "une commune à tous les groupes intervenants élaborées d'un commun accord entre tous qui expliquerait et/ou fonderait les positions partagées. Une seconde partie, où le SUJET serait choisi d'un commun accord et les positions seraient individuelles. Et une troisième partie où le sujet serait choisi librement par chaque participant,où il pourrait impulser la discussion de thèmes qu'il considère importants et qui -selon lui- ne sont pas pris ou considérés correctement par les autres. Ou un sujet"nouveau" ou une argumentation particulière.
Nous considérons comme fondamentale 1'inclusion des TROIS PARTIES dans cette proposition internationale. (Emancipacion Obrera et Militancia Clasista Revolucionaria)
REPONSE DU CCI
Chers camarades
Nous venons juste de prendre connaissance de votre brochure d'appel : "Proposition Internationale à tous les partisans de la révolution prolétarienne mondiale".
Après une première lecture et discussion, nous tenons, avant toute chose, à saluer l'esprit qui anime votre "Proposition" à laquelle nous ne pouvons qu'adhérer avec détermination.
Nous ne pouvons que souscrire au constat que vous faites non seulement de l'extrême faiblesse dans laquelle se trouve le mouvement révolutionnaire aujourd'hui -son extrême faiblesse numérique, politique, et plus encore, organisationnelle- mais surtout de l'immense dispersion et isolement des faibles groupes qui s'en réclament. Comme vous, nous pensons qu'une des premières tâches -voire même la première tâche aujourd'hui- de chaque groupe se situant vraiment sur le terrain révolutionnaire du prolétariat consiste à oeuvrer de toutes ses forces pour mettre fin à cet état déplorable, à réagir vigoureusement contre la dispersion et l'isolement, contre l'esprit sectaire de chapelle, pour le développement de liaisons, de contacts, de discussions, de regroupements et d'actions communes entre les groupes, à l'échelle nationale et internationale. Ceux qui, parmi ces groupes, ne ressentent pas cette nécessité -et ceux-là existent malheureusement- montrent leur incompréhension de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et, de ce fait, leur tendance à se scléroser.
Qu'un groupe en Argentine découvre à son tour cette nécessité urgente -ce qui est tout à son honneur- n'est pas pour nous surprendre : 1°) parce que le fait qu'il ait ressenti cette nécessité prouve la vitalité révolutionnaire qui est la sienne et 2°) parce que nous avons retrouvé cette même préoccupation dans d'autres groupes qui ont surgi récemment tel le groupe Alptraum au Mexique ou encore celui des "Communistes Internationalistes" en Inde.
A quoi est due la constatation de cette nécessité précisément aujourd'hui ? Pour le comprendre il ne suffit pas de dire que ce n'est pas "d'un coup" que surgit, une fois encore, le cri anxieux des minorités révolutionnaires qui cherchent à rompre le cordon sanitaire tendu par le capital ; il ne suffit , pas de dire que tant dans les périodes de montée de la lutte de classe que dans les moments de la contre-révolution la plus violente ces minorités "découvrent^ l'une après l'autre, ce que signifient l'isolement, la faiblesse de leurs petites forces, une faiblesse non seulement numérique, sinon fondamentalement politique...". S'il est vrai que c'est de tout temps que les révolutionnaires s'efforcent de rompre le "cordon sanitaire" de la bourgeoisie visant à les disperser et à les isoler de leur classe, on ne peut mettre sur le même plan "les périodes de montée de la lutte de classe" et "les moments de la contre-révolution la plus violente".
Sans tomber dans le fatalisme, l'expérience historique de la lutte de classe nous enseigne qu'une période de recul et de défaites profondes du prolétariat entraîne inévitablement une dispersion des forces révolutionnaires et la tendance à leur isolement. La tâche qui s'impose alors aux groupes révolutionnaires est celle de chercher à limiter autant que possible l'avalanche de l'ennemi de classe afin d'empêcher que celle-ci ne les emporte vers le néant. Dans une certaine mesure, l'isolement, dans une telle situation, est non seulement inévitable mais nécessaire pour leur permettre de mieux résister à la violence momentanée du courant et au risque d'y être emporté. Ce fut le cas, par exemple, de l'attitude politique de Marx et Engels dissolvant la Ligue Communiste au lendemain des violentes défaites subies par le prolétariat durant la tourmente sociale de 1848-51, dissolvant la 1ère Internationale après l'écrasement sanglant de la Commune de Paris, de même que celle de Lénine et Luxembourg au moment de la faillite de la 2ème Internationale lors du déclenchement de la première guerre mondiale. On peut citer également en exemple la constitution et l'activité de la Fraction de gauche italienne après la banqueroute de la 3ème Internationale sous la direction stalinienne.
Toute autre se présente l'activité des groupes révolutionnaires dans une période de montée de la lutte de classe. Si, dans une période de recul, les groupes révolutionnaires nagent à contre-courant, et donc forcément sur les bords et par petits paquets, dans une période de montée, il est de leur devoir d'être dans le courant et le plus massivement, le plus internationalement organisés possible. Les groupes révolutionnaires qui ne le comprennent pas, qui n'agissent pas dans ce sens, soit parce qu'ils ne comprennent pas la situation, la période dans laquelle se trouve la lutte de classe et les perspectives de sa dynamique, soit parce que, ayant difficilement survécu à la période de recul et de dispersion, ils se sont plus ou moins sclérosés, se trouvent alors incapables d'assumer la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir.
Le sectarisme que vous dénoncez à juste titre avec tant de force n'est, au fond, rien d'autre que la survivance de la tendance à se replier sur soi-même correspondant à une période de recul. Hisser cette tendance à la hauteur d'une théorie et d'une pratique, à un esprit de chapelle, surtout dans une période de montée, est le signe d'un processus de sclérose extrêmement dangereux et finalement mortel pour tout groupe révolutionnaire.
Seules une analyse et une compréhension justes de la période ouverte à la fin des années 60 avec l'éclatement de la crise mondiale du capitalisme décadent et le resurgissement de la lutte de classe d'une nouvelle génération du prolétariat n'ayant pas connu la défaite et gardant ainsi toutes ses potentialités et combativité permet de comprendre la nécessité impérieuse qui se pose aujourd'hui aux groupes révolutionnaires existant dans le monde et surgissant dans divers pays : celle de s'engager consciemment dans la voie de la recherche des contacts, de l'information, de la discussion, de la clarification, de la confrontation des positions politiques, de prises de position et d'actions communes entre les groupes s'engageant résolument dans un processus de décantation et de regroupement. Cette voie est la seule qui mène à la perspective de l'organisation du futur parti mondial du prolétariat. Cette compréhension de la période et de ses exigences est aussi la condition majeure pour combattre efficacement le sectarisme et ses manifestations qui sévissent aujourd'hui encore dans le milieu révolutionnaire.
Nous nous sommes attardés longuement sur cette question, non pour critiquer mais pour appuyer votre "Proposition" en lui apportant une argumentation que nous pensons susceptible de renforcer encore son fondement. La lutte contre la dispersion et l'isolement, la lutte contre le sectarisme ont toujours été et restent une préoccupation majeure du CCI depuis sa constitution. Retrouver cette préoccupation aujourd'hui venant d'un groupe aussi isolé que le vôtre ne peut que nous réjouir et renforcer notre conviction de sa validité. C'est pourquoi nous nous proposons de traduire et de publier sans tarder votre texte dans le prochain numéro de notre Revue Internationale en français et en en anglais (et probablement ultérieurement dans les Revues Internationales en langues espagnole et italienne lors de leur parution). Nous sommes convaincus que vous ne verrez aucun inconvénient à cette publication (bien entendu, nous ne donnerons pas, pour des raisons de sécurité, votre adresse sans une autorisation explicite de votre part).
Cette préoccupation de la nécessité de rompre avec la dispersion et l'isolement des groupes révolutionnaires, de même que la conviction de sa validité, ont été à la base de tentatives telles que les trois conférences internationales des groupes révolutionnaires impulsées par nous et Battaglia Comunista durant les années 1977 à 1980. Ces conférences, qui auraient pu devenir un lieu de rencontre et un pôle de référence et de regroupement pour de nouveaux groupes surgissant dans différents pays, ont échoué en se heurtant justement au sectarisme de groupes comme Battaglia Comunista pour qui ces conférences devaient rester muettes, être un lieu uniquement de confrontation de groupes à la recherche de recrutement et de "pêche à la ligne". Sur notre insistance, les comptes rendus de ces Conférences ont été publiés en français, anglais et italien. Nous nous ferons un devoir de vous les communiquer au plus vite.
Le besoin urgent de rompre avec 1'éparpillement et l'isolement n'est certes pas une tâche facile de même qu'il ne peut se réaliser du jour au lendemain. Pour autant, cela ne constitue pas une raison pour abdiquer mais, au contraire, cette difficulté même devrait stimuler les efforts de chaque groupe révolutionnaire digne de ce nom de s'y engager résolument.
Nous ne pouvons, dans le cadre de cette lettre, nous livrer à un examen détaillé de chaque paragraphe et encore moins de chaque formulation. Comme' vous le dites vous-mêmes, ce texte ne prétend ni être complet ni définitif .Nous aurons largement le temps de discuter de telle ou telle formulation, de tel ou tel argument. Pour le moment, ce qui importe c'est le principe, la démarche-même qui sous-tend votre "Proposition". C'est là-dessus que porte notre accord. Toutefois, il faut retenir deux questions fondamentales que soulève cette "Proposition" :
1°) A qui s'adresse une telle "Proposition" ?
Pour répondre à cette question, il est évident que nous recherchons la participation la plus large possible des groupes authentiquement révolutionnaires,, même si des divergences sur des points particuliers mais secondaires existent entre ces groupes. Cependant, il ne s'agit pas de réunir n'importe qui, ce qui donnerait l'image d'un panier de crabes et constituerait une démarche négative, une entrave et non un renforcement du mouvement révolutionnaire. Il n'existe pas, surtout au stade actuel du mouvement -avec la dispersion et les différents degrés de maturité des groupes existants- de critères discriminatoires et sélectifs pouvant garantir, d'emblée, de façon absolue, une telle sélection. Mais il existe -et on doit pouvoir les formuler- un minimum de critères permettant d'établir un cadre général dans lequel les groupes qui s'y inscrivent puissent adhérer tout en maintenant des positions qui leur sont propres mais qui restent néanmoins compatibles avec ce cadre. Il nous faut rejeter tant le monolithisme que le rassemblement de forces fondamentalement hétérogènes sur la base de positions politiques vagues et incohérentes.
Dans votre chapitre;"A qui faisons-nous cette proposition ?vous essayez de donner une réponse en énumérant longuement (peut-être trop longuement) certaines positions devant servir de critères. Quelles que puissent être les améliorations toujours possibles dans leurs formulations, ces positions erronées sont, dans leur fond politique, absolument juste, à notre avis.
Cependant, le manque de prise de position claire et explicite sur des questions très importantes peut inquiéter. Nous en citerons quelques-unes :
- le rejet de toute participation aux campagnes électorales dans la période actuelle du capitalisme décadent ;
- la nécessité de se concevoir et de se situer dans la continuité de l'histoire du mouvement ouvrier, de ses acquis théoriques et politiques (non pas une continuité passive et de simple répétition, mais une continuité dynamique et de dépassement étroitement liée aux expériences et à l'évolution des exacerbations de toutes les contradictions du système capitaliste mettant désormais à l'ordre du jour la nécessité objective de sa destruction). Ceci implique la reconnaissance du marxisme comme la théorie révolutionnaire du prolétariat, le fait de se revendiquer des apports successifs des 1ère, 2ème et 3ème Internationales et des gauches communistes qui en sont issues ;
- la reconnaissance, sans ambiguïté, de la nature prolétarienne du parti bolchevik (avant sa banque route et son passage définitif dans le camp de la contre-révolution) et de la révolution d'octobre. ?
Il est surprenant de ne trouver, dans votre tex- i te, aucune référence à ces questions, pas plus qu'à la reconnaissance des Conseils Ouvriers, "forme enfin trouvée" de l'organisation unitaire de la classe en vue de la réalisation concrète de la révolution prolétarienne. Nous nous étonnons également de ne trouver aucune mention sur la question du terrorisme, des guérillas (urbaines ou non), et sur le rejet catégorique de ce type d'actions (armes propres aux couches désespérées de la petite-bourgeoisie, du nationalisme, et qui sont efficacement entretenues et manipulées par tous les Etats), non pas au nom du pacifisme qui n'est que ' l'autre face de la même médaille, mais au nom de son inefficacité et de sa prétention, , au mieux, à réveiller et, au pire, à se substituer à la seule violence de classe adéquate : celle de la lutte ouverte, massive et généralisée des grandes masses de la classe ouvrière. Votre silence est d'autant plus étonnant que vous vivez et luttez dans un continent et un pays qui ont tristement connu ce type d'actions aventuristes, les tupamaros et autres guérillas guévaristes.
2°) La deuxième question se rapporte à vos propositions concrètes de réalisation de ce grand projet, notamment à la publication d'une revue commune aux groupes adhérents et au mode de fonctionnement d'une telle coordination. Commençons par ce dernier point. Vous proposez l'unanimité comme règle de toute activité et décision. Une telle règle ne nous semble par forcément la plus appropriée. Elle comporte le risque soit de l'exigence d'un accord constant -et donc, du monolithisme-, soit de la paralysie de l'ensemble des groupes participants à chaque fois que l'un d'entre eux se trouve en désaccord. Le point 5 de votre "Proposition" porte sur l'éventualité d'une publication commune. Il est inutile d'ouvrir une discussion sur la structure d'une telle publication (division en 3 parties, etc...) puisque le projet-même d'une telle publication immédiate nous semble, en tout état de cause, largement prématuré. Une publication commune à de nombreux groupes présuppose deux conditions :
a) une connaissance plus approfondie de la trajectoire politique des différents groupes et de leurs positions actuelles, un constat de l'intégration effective de ces positions dans le cadre des critères élaborés de même que leur tendance à converger à plus ou moins long terme ;
b) et sur cette base, une avancée sérieuse de l'expérience d'une activité commune permettant à ces groupes de s'engager davantage sur le plan organisationnel avant de pouvoir affronter vraiment les difficultés inhérentes à une publication (questions politiques et techniques de la nomination d'une rédaction responsable, question de langues dans lesquelles doit être publiée une telle revue et, enfin, questions d'administration et de ressources financières).
Aucune de ces deux conditions n'étant actuellement remplie, ce point de la "Proposition" nous semble, de ce fait, irréalisable pour le moment et, en conséquence, il serait erroné de vouloir en faire un point central. Il serait plus judicieux et davantage à notre portée de nous contenter, pour le moment, de la tâche réalisable consistant à assurer la circulation de textes de discussion entre les groupes adhérents sur des thèmes importants et, autant que possible, convenus en commun.
Reste la proposition de 1'information réciproque, de l'échange de publications, de favoriser réciproquement la diffusion de la presse des différents groupes adhérents, la possibilité de publication d'articles dans la presse des autres groupes et, enfin, l'éventualité de prises de position communes sur des événements importants et, donc, l'éventualité d'une intervention publique commune. Cette partie de votre proposition générale peut être réalisée dans une échéance relativement brève, toujours dans le souci de rompre l'isolement, de resserrer les contacts entre les groupes révolutionnaires existants et surgissants, de développer les discussions et de favoriser un processus de décantation et de regroupement des révolutionnaires.
En un mot, mieux vaut partir avec prudence et arriver au but que de partir au galop, de s'essouffler et de s'arrêter à mi-chemin.
Avec nos salutations communistes.
[1] [1043] Nous ne publions pas l'adresse de ces groupes; pour tout contact, les lecteurs peuvent écrire à la boîte postale de R.I. qui transmettra.
[2] [1044] "Emancipacion Obrera" a du subir la répression et la violence du MAS, groupe trotskyste qui a appelé à participer à la guerre des Malouines, appuyant les généraux
Géographique:
- Argentine [335]
- Amérique Centrale et du Sud [138]
Courants politiques:
La Gauche hollandaise (1900-1914) : naissance d'un courant révolutionnaire en Europe (1903-1907) 2ème partie
- 3215 reads
Nous publions, dans ce numéro de la Revue Internationale, la suite de l'étude sur 1'histoire de la Gauche hollandaise. Cette partie de l'étude embrasse la période qui va de 1903 à 1907. L'histoire de la Gauche hollandaise est très mal connue du public et, à ce titre, l'étude que nous publions apporte une documentation qui ne pourrait qu'être fort appréciée par nos lecteurs.
L'histoire de la Gauche hollandaise comporte nécessairement beaucoup de particularités. Néanmoins, pour bien la comprendre, il est nécessaire de ne jamais perdre de vue qu'elle est partie intégrante d'un mouvement général, celui de la classe ouvrière internationale, de même qu'il est nécessaire de la situer dans le contexte de la période, c'est-à-dire à un moment précis de 1 'histoire du mouvement ouvrier,
A la lecture de cette étude, il se dégage deux enseignements capitaux :
1) l'extrême difficulté de la classe ouvrière à s'organiser comme classe distincte et à former ses propres organisations ;
2) la fragilité de ces organisations traversées par des crises qui les secouent périodiquement.
Le premier point se rattache à la nature-même de la classe ouvrière, nature qui la distingue de toutes les autres classes qui, à certains moments de 1'histoire humaine, furent appelées à jouer un rôle révolutionnaire en vue de la transformation de la société. Toutes les autres classes fondaient leur pouvoir politique sur la base d'un pouvoir économique préalablement conquis. Rien de tel pour le prolétariat qui n'a pas d'autre pouvoir économique que celui d'être complètement dépossédé et d'être contraint de vendre sa force de travail, de subir 1'exploitation au profit d'autrui. Classe révolutionnaire et exploitée à la fois, la classe ouvrière ne peut fonder ses organisations que sur la base d'une prise de conscience de ses intérêts immédiats et historiques sous l'aiguillon de l'oppression qu'elle subit par la classe exploiteuse.
Le deuxième point se rattache au fait que ses organisations, reflétant l'évolution du rapport de forces entre les classes dans leur lutte, sont constamment soumises à la pression de 1'idéologie régnant dans la société, idéologie qui est toujours celle de la classe dominante,
La raison de l'apparition de tendances révolutionnaires de gauche dans les organisations de la classe ouvrière trouve sa source dans la réaction à cette pénétration inévitable de 1'idéologie bourgeoise dans la classe. Chercher une organisation à jamais garantie contre cette pénétration, chercher une organisation révolutionnaire pure est aussi utopique que de chercher une humanité absolument invulnérable aux attaques microbiennes environnantes: C'est faire la politique de l'autruche cachant sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger qui la guette. Les révolutionnaires n'ont que faire des illusions sur les organisations parfaites et infaillibles". Ils savent que ce n'est que la lutte -et une lutte incessante, intransigeante contre les influences bourgeoises environnantes- qui constitue la seule garantie pour les organisations sécrétées par la classe de rester un instrument dans la voie de la révolution.
Le chapitre que nous publions est un témoignage de cette lutte farouche menée par le courant révolutionnaire international du prolétariat à un moment de l'histoire et dans un pays donnés.
LA LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME
Comme bien souvent dans l'histoire du mouvement ouvrier, la lutte pour la défense des principes révolutionnaires s'est d'abord placée sur un terrain pratique. La lutte contre l'opportunisme au sein du Parti hollandais s'est centrée sur deux questions qui en apparence semblent aujourd'hui, avec le recul historique, anodines : la question paysanne et la question scolaire.
L'importance de la question paysanne était évidente dans un pays comme la Hollande, où le retard indus triel maintenu par l'existence d'un capital commercial spéculatif investi dans les colonies s'accompagnait d'un archaïsme des structures sociales à la campagne. Bien qu'en début de mutation, l'agriculture -en dehors de l'élevage- restait arriérée, avec une masse encore considérable de petits paysans tout aussi arriérés, particulièrement en Frise, le "fief" de Troelstra. A côté de ces paysans, on trouvait une masse d'ouvriers agricoles qui ne possédaient nulle terre et vendaient leur force de travail à des paysans, propriétaires ou fermiers. Pour s'attirer les voix des paysans auxquels le SDAP devait en grande partie ses députés, il fut proposé en 1901 de modifier le programme du Parti. Au lieu de l'abolition de l'ordre existant par la socialisation du sol et donc la suppression de la propriété privée, le nouveau programme proposait une régulation du "contrat de fermage".Ce qui était le pire du point de vue du programme socialiste se trouvait dans le point consacré aux ouvriers agricoles. Au lieu de rattacher leur lutte à celle des ouvriers des villes et de souligner leurs intérêts communs avec le reste du prolétariat, le programme proposait ni plus ni moins que leur transformation en paysans propriétaires :
"La disposition du sol et du matériel agricole contre un certain prix aux ouvriers* agricoles, pour leur assurer une existence autonome."
Cependant, sous la pression de la Gauche qui s'appuyait sur Kautsky, alors à gauche sur la question agraire, quatre ans plus tard, en 1905, au congrès de La Haye, les deux points furent rayés du programme agraire du partie était le premier conflit et la première victoire du marxisme. Mais aussi son unique victoire."
En effet la lutte contre le réformisme ne faisait que commencer et connut une étape nouvelle lors des débats au Parlement hollandais sur les subventions à accorder aux écoles religieuses. Le combat du marxisme contre une telle manoeuvre de la bourgeoisie conservatrice n'avait rien de commun avec l'anticléricalisme des radicaux et des socialistes français à la même époque, qui constituait surtout une diversion. Le soutien aux confessions religieuses s'expliquait essentiellement, aux Pays-Bas, par la montée de la lutte de classe, laquelle entraînait une réaction idéologique de la bourgeoisie conservatrice au pouvoir ([1] [1045]). "De façon classique dans le mouvement ouvrier de l'époque, la Gauche constatait que : "lorsque surgit la lutte de classe du prolétariat, les libéraux comme partout, considèrent toujours plus la religion comme un rempart nécessaire au capitalisme, et ils abandonnent peu à peu leur résistance aux écoles religieuses."
Quelle ne fut pas la surprise des marxistes, groupés autour de la revue "Nieuwe Tijd", de voir le révisionnisme s'afficher publiquement au Parlement, en appelant à voter pour les subventions aux écoles religieuses. Pire, le Congrès de Groningue de la social-démocratie (1902) abandonnait nettement tout combat marxiste contre l'emprise religieuse sur les consciences. Dans un pays où le poids religieux pour des raisons historiques était très fort sous la triple forme du calvinisme, du catholicisme et du judaïsme, il s'agissait d'une véritable capitulation "Le Congrès constate qu'une plus grande partie de la classe laborieuse aux Pays-Bas exige pour ses enfants un enseignement religieux, et considère comme non souhaitable de s'opposer à elle, parce que la social-démocratie n'a pas à briser -pour des oppositions théologiques- l'unité économique de la classe travailleuse face aux capitalistes croyants et incroyants. "
L'argumentation utilisée, l'unité des ouvriers croyants et incroyants, sous-tendait l'acceptation de l'ordre existant, idéologique et économique. Ainsi, «avec cette résolution, le Parti [faisait] le premier pas sur le chemin du réformisme ; elle [signifiait] la rupture avec le programme révolutionnaire, dont la revendication, séparation de l'Eglise et de l'Etat, a certainement un tout autre sens que l'argent de l'Etat pour les écoles religieuses. " Il est intéressant de noter que la Gauche hollandaise ne se proposait nullement d'encenser l'école "laïque" dont elle dénonçait la prétendue "neutralité.". Elle se situait au-delà d'un faux choix, du point de vue marxiste, entre école "religieuse" et école "laïque". Son but était de se placer résolument sur le terrain de la lutte de classe ; cela signifiait un rejet de toute collaboration, sous quelque prétexte que ce soit, avec une fraction de la bourgeoisie. Les craintes des marxistes devant l'orientation révisionniste du Parti allaient se montrer fondées dans le feu de la lutte ouvrière.
LA GREVE DES TRANSPORTS DE 1903
Cette grève est le mouvement social le plus important qui ait agité avant la première guerre mondiale la classe ouvrière des Pays-Bas. Elle devait laisser de profondes traces dans le prolétariat qui se sentit trahi par la social-démocratie, et dont la partie la plus militante s'orienta encore plus vers le syndicalisme révolutionnaire. A partir de 1903, le processus de la scission entre le marxisme et le révisionnisme était engagé sans possibilité de retour en arrière. A ce titre, la grève de 1903 marque le vrai début du mouvement "tribuniste", comme mouvement révolutionnaire. ,
La grève des transports est d'abord une protestation contre des conditions d'exploitation qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Les ouvriers des chemins de fer subissaient des conditions de travail dignes de la période d'accumulation primitive du capital au début du 19e siècle ([2] [1046]). Travaillant 361 jours par an ils ne disposaient vers 1900 que de k jours de congé. D'autre part, le corporatisme particulièrement fort réduisait les possibilités d'une lutte unitaire, par une division en catégories professionnelles. Ainsi, les mécaniciens, les conducteurs de locomotives, les ouvriers de l'entretien des voies avaient leur syndicat propre. Chaque syndicat pouvait déclencher des grèves sans que les autres s'unissent à la lutte. Les syndicats de métier en protégeant soigneusement leur exclusivisme se dressaient comme un obstacle à l'unité massive des ouvriers par-delà leurs différences de qualification ([3] [1047]).
Contre de telles conditions, le 31 janvier 1901 surgissait de la base des cheminots, et non des syndicats corporatistes, une grève spontanée. Celle-ci se présente comme une grève de masse : non seulement elle touche toutes les catégories du personnel des transports, mais elle s'étend à tout le pays. Elle est aussi une grève de masses en partant non de revendications spécifiques, mais par solidarité avec les ouvriers du port d'Amsterdam, en grève. Refusant de servir de briseurs de grève, en continuant le travail, les ouvriers des transports empêchaient les tentatives des patrons de faire transiter leurs marchandises par les chemins de fer. Ce mouvement de solidarité, caractéristique des grèves de masse, faisait alors boule de neige : les boulangers et les métallos du matériel de transport donnaient leur appui. Mais l'originalité du mouvement -qui ne réussit pas à s'étendre aux autres couches du prolétariat néerlandais- se trouvait incontestablement dans la création d'un Comité de grève élu, surgi de la base et non dé signé par le syndicat des transports et le SDAP, même si leurs membres y participaient.
Par toutes ces caractéristiques, la grève de masse cessait d'être une simple grève catégorielle, purement économique ; elle devenait peu à peu une grève poli tique par une confrontation directe avec l'Etat. En effet, le 6 février, le gouvernement hollandais, par décret du ministre de la guerre, décidait la mobilisation des soldats ; il suscitait d'autre par un organisme, dans lequel étaient actifs les syndicats catholiques et protestants, rassemblant les briseurs de grève. Cette offensive de la bourgeoisie culminait enfin le 25 février par le dépôt d'un projet de loi contre la grève : les grévistes étaient menacés d'emprisonnement et le gouvernement décidait de mettre sur pied une compagnie de transport militaire pour briser la grève.
Mais plus que par les menaces et les mesures gouvernementales, la grève allait être sapée de l'intérieur, par le SDAP de Troelstra. Le 20 février, au cours d'un meeting représentant 60 000» grévistes, et non ouvert -à la différence du comité de grève- Troelsra proposait la création d'un "Comité de défense" composé de différentes organisations politiques et syndicales. Ce Comité était composé de Vliegen, un révisionniste du SDAP, du chef syndicaliste des transports Oudegeest, du NAS et de partisans anarchistes de Nieuwenhuis, ce dernier ayant refusé de participer à un tel organisme. L'orientation allait se révéler néfaste à la conduite de la grève projetée contre les mesures gouvernementales. Vliegen déclara que la grève ne pouvait être proclamée, en l'absence d'une promulgation des décrets du gouvernement Kuyper.
Dans les faits, l'attitude du "Comité de défense" autoproclamé par différentes organisations -et particulièrement celle du SDAP- allait vite se montrer négative. Non seulement l'opposition entre libertaires, partisans de Nieuwenhuis, et social-démocrates, paralysait le "Comité", mais le poids écrasant de Troelstra, qui n'en était pas membre bien que l'ayant suscité en faisait un organisme étranger à la lutte. Troelstra, prétextant la lutte contre "l'aventurisme anarchiste", se prononçait contre la grève politique ; il prétendait que celle-ci -si elle était décidée par les ouvriers des transports en réaction aux "lois scélérates"- ne ferait que renforcer la dureté des lois anti-grève à la Chambre des députés. Ces propos étaient tenus par le quotidien social-démocrate sans en référer ni au Comité de défense ni aux instances du Parti. De façon tangible, cet acte d'indiscipline était la preuve que la direction révisionniste estimait n'avoir aucun compte à rendre devant les ouvriers et les militants du Parti. Elle s'était rendue autonome pour mieux se placer sur le terrain de la conciliation avec la bourgeoisie. La Gauche, par la plume de Pannekoek, critiqua vivement cet acte, qui était le début d'une longue suite d'actes de trahison de la lutte:"Votre attitude molle et hésitante ne peut que servir la classe possédante et le gouvernement." écrivait-il à l'adresse de Troelstra.
C'est lors de la deuxième grève des transports, en avril, que la trahison devint ouverte. Le gouvernement avait fait voter les lois anti-grève interdisant la cessation du travail dans les transports publics. Au lieu d'avoir une attitude énergique, les chefs du Comité de tendance social-démocrate -comme Ouedegeest- se prononcent contre la grève générale de tous les ouvriers aux Pays-Bas. Pourtant, au même moment, se déroulaient des grèves qui donnaient un contexte social plus favorable à la lutte de classe qu'en janvier-février : à Amsterdam, se déroulaient la grève des bateliers, des forgerons, des cantonniers et terrassiers, des métallos ; et les travailleurs communaux s'étaient mis en grève par solidarité.
Néanmoins, sous la pression de la base, la grève générale fut proclamée. Sa faiblesse initiale fut que les réunions des ouvriers des chemins de fer étaient secrètes et non ouvertes par conséquent aux autres catégories de travailleurs. Malgré l'occupation des gares et des voies ferrées par la troupe, ce qui aurait dû développer la généralisation de la grève, celle-ci ne fut pas générale. Elle fut malgré tout spontanée dans son mouvement d'extension : à Utrecht, Amsterdam, les métallos et les maçons se joignirent au mouvement de solidarité. Ni la menace de cinq ans d'emprisonnement pour les "agitateurs" et de deux ans pour les grévistes,, peines prévues par les "lois scélérates", ni la présence de l'armée ne suffisaient à arrêter l'ardeur des ouvriers en grève, qui avaient connu dès janvier "la joie de lutter"
L'ardeur des ouvriers, leur élan furent arrêtés par les décisions prises par les dirigeants social-démocrates du "comité de défense" qui prétendait diriger la lutte. Le 9 avril, Vliegen fait décider la cessation du mouvement de grève. Devant l'incrédulité et la colère des ouvriers des transports, le "Comité" devient introuvable. Lors d'une réunion de masses, ceux-ci empêchent Vliegen de parler aux cris de : "Il nous a trahis !". Même la Gauche est privée de parole : ne faisant aucune distinction entre les révisionnistes et les marxistes, les ouvriers couvrent le discours de Roland-Holst par le cri : "Grève !". Ainsi, l'attitude des chefs révisionnistes allait entraîner pour longtemps un rejet de la social-démocratie, même marxiste, au profit de l'anarcho-syndicalisme, de la part de la classe ouvrière hollandaise.
La grève des transports de 1903 n'a pas de racines purement "hollandaises" ; elle marque un tournant dans la lutte de classe en Europe. C'est en tant que grève de masses spontané qu'elle surgit, devenant une force consciente capable de faire reculer sur le plan politique la bourgeoisie et donnant aux ouvriers un incontestable sentiment de victoire. Mais c'est en tant que grève générale, lancée par les syndicats et les partis, qu'elle échoue.
Elle s'inscrit dans toute une période historique marquée par la combinaison des grèves politiques et des grèves économiques, période qui culmine avec le mouvement révolutionnaire de 1905 en Russie. En effet, comme le souligne Rosa Luxemburg,
"Ce n'est que dans une situation révolutionnaire, avec le développement de l'action politique du prolétariat, que 1'importance et l'ampleur de la grève de masse apparaissent dans 'leur pleine dimension." Plus qu'aucun autre -sauf Pannekoek (cf. infra)- Luxemburg a su montrer dans sa polémique contre les révisionnistes l'homogénéité de la lutte, c'est-à-dire l'identité du phénomène dans sa simultanéité, dans toute l'Europe, Hollande incluse, et jusque sur le continent américain, au début du siècle: "En 1900, c'est la grève de masse des mineurs de Pennsylvanie qui selon les camarades américains, a fait davantage pour la diffusion des idées socialistes que dix ans d'agitation ; en 1900 encore, c'est la grève de masse des mineurs en Autriche, en 1902 celle des mineurs en France, en 1902 encore celle qui paralyse tout l'appareil de production à Barcelone, en solidarité avec les métallurgistes en lutte, en 1902 toujours, la grève de masse démonstrative en Suède pour le suffrage universel égalitaire, la même année en Belgique encore pour le suffrage universel égalitaire également ; la grève de masse des ouvriers agricoles dans l'ensemble de la Galicie orientale (plus de 200 000 participants) en défense du. droit de coalition, en janvier et avril 1903, deux grèves de masse des employés de chemins de fer en Hollande, en 1904 grève de masse des employés de chemins de fer en Hongrie, en 1904 grève démonstrative en Italie, pour protester contre les massacres , en Sardaigne, en janvier 1905, grève de masse des mineurs dans le bassin de la Ruhr, en octobre 1905 grève démonstrative à Prague et dans la région pragoise (100 000 travailleurs) pour le suffrage universel au Parlement de Bohême, grève de masse démonstrative à Lemberg pour le suffrage universel égalitaire au Parlement régional de Galicie, en novembre 1905 grève de masse démonstrative dans toute 1 'Autriche pour le suffrage universel égalitaire au Conseil d'Empire, en 1905 encore grève de masse des ouvriers agricoles en Italie, en 1905 toujours grève de masse des employés des chemins de fer en Italie..."
La grève de masse, en préparant la confrontation politique avec l'Etat, mettait à l'ordre du jour la question de la révolution, non seulement elle manifestait "l'énergie révolutionnaire" et "l'instinct prolétarien" des masses ouvrières -comme le soulignait Gorter après la grève de 1903- mais elle signifiait un profond changement de situation au début du siècle : "Nous avons toutes les raisons de penser que nous sommes entrés maintenant dans une période de combats dont l'enjeu est les institutions et le pouvoir d'Etat ; des combats qui peuvent au fil de vicissitudes diverses, durer des décennies, dont les formes et la durée ne sont pour le moment pas encore prévisibles, mais qui, très vraisemblablement, introduiront à brève échéance des changements fondamentaux dans les rapports de force en faveur du prolétariat, si ce n'est l'instauration de son pouvoir en Europe occidentale."
Ces remarques de Kautsky dans son livre "Le Chemin du pouvoir", la Gauche hollandaise allait les faire siennes contre Kautsky et ses partisans aux Pays-Bas tels Troelstra et Vliegen. La grève de 1903 posait en effet l'alternative "réforme ou révolution" et débouchait dans le SDAP inévitablement sur une confrontation avec les réformistes qui trahissaient non seulement l'esprit révolutionnaire du Parti, mais la lutte immédiate.
L'OPPOSITION DANS LE PARTI (1903-1907)
L'opposition dans le parti allait être d'autant plus vive que les conséquences de l'échec de la grève, sabotée par la direction Troelstra-Vliegen, étaient catastrophiques pour le mouvement ouvrier. Le total des ouvriers licenciés pour fait de grève était d'environ k 000. Le nombre des adhérents du NAS, qui avait pourtant pris une position militante dans la lutte et s'était opposé à Vliegen, tombait de 8 000 en 1903 à 6 000 en 1904. Le SDAP de Troelstra, traînant dorénavant une réputation de trahison, Derdart un nombre considérable d'adhérents : il comptait à la fin de 1903, 5 600 membres contre 6 500 à la fin de l'année 1902.Par contre, signe du reflux voire même de la démoralisation après l'échec de la grève, les syndicats religieux des transports, en particulier catholiques, connurent un rapide essor numérique. Politiquement, le mouvement syndical le plus combatif, le NAS, qui aurait pu devenir l'organisation économique du SDAP, se raccrochait aux positions anarchistes de Nieuwenhuis. Il continua sa chute numérique jusqu'au moment où apparut le mouvement tnbuniste qui 1' influença progressivement (cf. infra)... . Par contre, en 1905, les syndicats socialistes liés au SDAP créaient leur propre centrale syndicale : le NVV (Confédération des syndicats professionnels des Pays-Bas). Celui-ci, fortement influencé par le syndicat réformiste des ouvriers diamantaires de H. Polak, devenait la principale confédération syndicale des Pays-Bas. Dès le départ, le NVV se refusait à contribuer à l'extension de la lutte dans le bâtiment : les années suivantes il allait avoir la même attitude de retrait et de non-solidarité avec les ouvriers grévistes»
Face au développement du réformisme dans le Parti et à son affaiblissement comme parti ouvrier, l'attitude des marxistes fut d'abord modérée. Non seulement ils hésitaient à former une fraction résolue pour conquérir la direction du parti, mais leurs attaques contre Troelstra restaient encore extrêmement prudentes, bien que Troelstra ait par son action trahi la grève, ils hésitaient encore à parler de trahison. Lorsque au cours du 9ème congrès du SDAP, à la fin de 1903, fut discuté le bilan de la grève des transports, Gorter parla en termes très mesurés. Tout en affirmant qu'il était "un adversaire de la direction de Troelstra, non seulement dans cette grève, mais aussi dans les grandes affaires" il hésitait à parler de trahison de la direction :
"De trahison il n'est naturellement pas question, mais bien de la faiblesse de la conception de Troelstra et de ses oscillations permanentes."
Le congrès d'Enschede de 1903 n'eut pas l'effet souhaité par les marxistes du groupe "Nieuwe Tijd". Bien que Troelstra dût abandonner -au profit de Takla rédaction en chef de "Het Volk" ("Le Peuple"), Gorter fut contraint de lui serrer la main au nom de la "solidarité" et de "l'unité" dans le parti, contre "l'ennemi commun" extérieur. Il réussit à faire accroire que Gorter et ses partisans l'attaquaient non politiquement, mais personnellement ; se plaignant qu'on voulait le priver de ses responsabilités de chef, il posa la question de confiance. Au lieu d'apparaître comme l'un des principaux responsables de l'orientation opportuniste du parti, il se présenta comme victime, et comme telle il obtint la "confiance" de l'ensemble du Parti. De cette façon, la direction révisionniste évitait que la discussion s'engage sur les questions vitales de principes et de tactique dans la lutte de classe. Bien que complètement isolée, la minorité marxiste ne capitula pas et s'engagea avec résolution dans le combat. De 1905 à 1907, le courant marxiste se trouva confronté à une contre-offensive rigoureuse des révisionnistes.
a) les conséquences du congrès d'Utrecht de 905
En effet, la fraction parlementaire, qui dirigeait de fait le parti, alla toujours plus loin dans la collaboration avec la bourgeoisie. En 1905, lors des élections pour les Etats provinciaux, la question était posée par les révisionnnistes de soutenir les libéraux contre le gouvernement Kuyper, qui avait brisé la grève des ouvriers des transports. La Gauche, comme celle des autres partis ouvriers d'Europe, ne refusait pas -lors des ballottages électoraux- de soutenir les candidats libéraux qui se prononçaient pour le suffrage universel contre le suffrage censitaire. Dans ce sens, elle fit adopter une résolution, lors du congrès de La Haye en 1905 :
"(le parti) déclare vouloir soutenir lors des ballottages uniquement les candidats qui se prononcent pour l'urgence du suffrage universel, "
Pour les marxistes, il ne s'agissait pas de faire de ce soutien, purement tactique et temporaire, un principe. En aucun cas, comme le souhaitait Troelstra, il ne pouvait être question d'apporter les suffrages ouvriers aux "libéraux de tout aca bit, fussent-ils anticléricaux. D'un point de vue de classe, le combat n'avait pas à être mené contre un parti capitaliste déterminé mais contre le capitalisme comme totalité de façon à empêcher toute con fusion avec les éléments petits-bourgeois et petits- paysans. Il s'agissait d'éclairer les ouvriers sur leur identité :
"Il s'agissait que le parti à chaque occasion mette devant les yeux des ouvriers que leurs ennemis siégeant au Parlement aussi bien au côté gauche qu'au côté droit."
Or, au lieu de respecter la résolution du congrès, la direction du parti, la fraction parlementaire et le quotidien socialiste "Het Volk" laissèrent les électeurs socialistes libres de voter pourquoi leur semblerait bon parmi tous les candidats libéraux en ballottage. Bien que fermes sur des positions qui étaient classiques dans le mouvement ouvrier, les marxistes se trouvèrent isolés de la masse ouvrière. Troelstra joua à fond là-dessus.
Il y eut cependant des réactions dans le parti. Le parti, malgré les événements de 1903, était loin d'avoir succombé au révisionnisme ; il était encore capable de réactions prolétariennes face à la politique de la fraction parlementaire de Troelstra. Le congrès de La Haye de 1905, sans doute aussi la pression des événements révolutionnaires qui agitaient la Russie, nomma un nouveau comité directeur du parti, composé cette fois d'une majorité de marxistes, dont Gorter. Il s'en suivit une opposition entre le nouveau comité et la fraction parlementaire de Troelstra. Celui-ci voulait soutenir le nouveau gouvernement libéral "pour le pousser sur la voie des réformes". Pour le comité directeur, s'appuyant sur le groupe "Nieuwe Tiid", il n'en était pas question. Il s'agissait avant tout de développer l'agitation contre les limitations du droit de grève, quel que fût le gouvernement, libéral ou clérical. Une fois de plus, Troelstra viola la discipline du parti par une prise de position qui condamnait l'agitation ouvrière. Le 9 mars 1906 ouvertement, face aux parlementaires bourgeois, il renia l'action menée par les ouvriers et soutenue par le parti ; et cela malgré son appartenance au comité directeur.
Ce conflit posait une question vitale dans le mouvement ouvrier : est-ce la fraction parlementaire ou le comité directeur, élu par le parti, qui détermine la politique de l'organisation ? Il s'agissait de savoir si le parti était au service d'un groupe incontrôlé de parlementaires menant une politique de collaboration avec la bourgeoisie, ou si ce groupe était étroitement soumis dans son action aux décisions prises par les congrès. Ce conflit d'influence et de décision n'était pas propre aux Pays-Bas. En Allemagne, par exemple, Rosa Luxemburg eut à se battre ([4] [1048]) contre la direction parlementaire. Le problème de la réelle direction du parti était celui du maintien de sa nature révolutionnaire. En Russie, après 1905, lorsque les bolcheviks eurent des députés à la Douma d'empire, leur fraction parlementaire se trouva étroitement placée sous le contrôle du comité central ; et ce n'est nullement un hasard si cette fraction fut l'une des rares qui en août 1914 vota contre les crédits de guerre.
Cette opposition entre Troelstra et le comité directeur allait poser la vraie question sous-jacente : réforme ou révolution. Dans une brochure qu'il fit paraître avant le congrès d'Utrecht -où il attaquait la nouvelle direction du parti -Troelstra, selon son habitude, prétendit qu'on l'attaquait personnellement, que la nouvelle centrale marxiste était "doctrinaire" et "dogmatique". Se présentant comme une victime "innocente" de la persécution du groupe de Gorter, il ne pouvait cependant dissimuler le fond de sa pensée : faire du SDAP non un parti internationaliste, mais un parti national. Le parti devait passer par des compromis avec la petite et la grande bourgeoisie non seulement il devait tenir compte des préjugés petit-bourgeois existant dans la classe ouvrière -"le caractère religieux et en partie petit-bourgeois du prolétariat" mais il devait "utiliser les oppositions des groupes bourgeois entre eux". Pour faire accepter cette orientation réformiste, Troelstra n'hésitait pas à afficher une démagogie anti-intellectuels: les marxistes étaient des "ultra-infantiles" voulant transformer le parti en un "club de propagande ". Au rêve marxiste, il fallait opposer la "solide" réalité du Parlement :
"Le parti flottera-t-il au-dessus des travailleurs réels, en s'enracinant dans un prolétariat de rêve ou bien, comme il l'a fait dès le début de son existence et de son action, au Parlement et dans les conseils municipaux, pénétrera-t-il toujours plus profondément dans la vie réelle de notre peuple ?"
Ainsi pour Troelstra, la seule existence possible du prolétariat -qu'il confond d'ailleurs de façon volontaire avec les autres couches "populaires"- jaillissait non plus de la lutte de classe mais du parlement.
Pour parvenir à ses fins -faire du parti, un parti purement parlementaire et national hollandais- Troelstra proposait ni plus ni moins que l'élimination de la direction marxiste, la réorganisation du parti en donnant' pleins pouvoirs à la fraction parlementaire, qui jusqu'alors statutairement n'avait que deux représentants dans le comité directeur. A l'exécutif du comité du parti, élu par les militants, devait se substituer "l'exécutif" de la fraction au parlement ; celle-ci -selon lui- "représente le parti, il est vrai non officiellement, mais de fait, au Parlement, de même dans la politique pratique". Il s'agissait en fait d'établir une véritable dictature de la fraction révisionniste ; elle ne souhaitait rien de moins que diriger tous les organes du parti pour empêcher toute liberté de critique à sa gauche de la tête des marxistes, en vue d'abord de les terroriser et ensuite, si possible, "les faire capituler devant le révisionnisme. Troelstra, après le congrès, pouvait ouvertement menacer Gorter : "si Gorter venait à parler encore une fois de "rapprochement avec la démocratie bourgeoise", la pointe de cette assertion serait extraite par la résolution".
Ce triomphe du diktat révisionniste laissait à présent la voie libre pour une révision du programme marxiste du parti. Une commission de révision du programme fut formée au mépris des règles de fonctionnement du parti : le comité du parti qui avait décidé de nommer la commission le faisait sans mandat du congrès, seule instance suprême à même de décider une révision du programme. La commission, sous l'influence des révisionnistes, ne proposait rien moins que modifier les conditions d'adhésion marxistes au parti : si le parti se basait sur le système de Marx, aucune acceptation de ses soubassements philosophiques matérialistes n'était nécessaire pour adhérer. La porte était ainsi ouverte à des éléments religieux, et même bourgeois, non marxistes.
Le congrès de Haarlem, en 1907, ne fit que confirmer le triomphe du révisionnisme. Les quelques marxistes entrés dans la commission ne firent que servir de caution, ne pouvant guère faire entendre leur voix. Il en sortit une déclaration du congrès situant le parti au centre, entre le marxisme et le révisionnisme : "Le programme ne peut être ni marxiste-orthodoxe ni révisionniste ni un compromis des deux orientations" ... Quant au marxisme représenté par Gorter, Pannekoek, Roland-Holst, il ne pouvait être qu'une "opinion privée".
La défaite du marxisme à ce congrès était telle que ni Pannekoek, ni Van der Goes ; ne purent diffuser leurs propres brochures contre la direction du parti. Une résolution du congrès, adoptée à l'unanimité, ne fit que durcir celle du congrès d'Utrecht : l'exercice du droit de critique était suspendu au respect de "l'unité du partie La démocratie dans le parti était ouvertement foulée au pied avec l'accord de la grande majorité de ses membres qui souhaitaient que cessent ce qu'elle considérait comme de "simples querelles personnelles".
Toute une habile campagne menée par Troelstra, Vliegen et Schaper auprès des militants leur permit de se présenter comme les victimes d'une chasse aux sorcières non contre le révisionnisme mais contre leur propre personne. Ils firent si bien qu'une résolution adoptée au congrès d'Utrecht se proposait de limiter la liberté de discussion et de critique dans le parti : "(considérant) que l'unité du parti est nécessairement menacée, le congrès déplore cet abus de la liberté de critique, qui dans notre parti est au-dessus de tout doute, "et impose à tous les camarades de maintenir la critique à l'intérieur de telles limites, que ces camarades entre eux respectent la dignité et l'union du parti."
b) le nouveau cours révisionniste (1906-1907)
Il ne faisait aucun doute que cette résolution était une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus
Pour les marxistes, très minoritaires, le choix était entre la capitulation et le combat : ils choisirent le combat pour sauver l'ancienne orientation marxiste du parti. Pour cela, ils fondèrent leur propre revue : "De Tribune" ("La Tribune"), qui allait donner son nom aux marxistes.
Chardin
[1] [1049] En France, par contre, la bourgeoisie -pour lutter contre le développement du mouvement ouvrier et socialiste- joua à fond, en ce qui concerne sa fraction radical-socialiste, la carte anticléricale. Elle espérait aussi, compte tenu de la "popularité de l'anticléricalisme en milieu ouvrier entraîner le socialisme sur un terrain qui n'était pas le sien.
[2] [1050] Il n'était pas rare que les ouvriers travaillent six jours par semaine plus de 14 heures par jour. Sur les conditions inhumaines des ouvriers des transports et le développement du mouvement ouvrier hollandais à cette époque, voir : "De spoorwegstakingen van 1903 -Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland" ("Les grèves des chemins de fer de 1903 ; un miroir du mouvement ouvrier aux Pays-Bas"), étude de A.J.C. Ruter Leiden, 1935.Réédition, sans date (années 70), par SUN reprints, Nijmegen.
[3] [1051] Ces syndicats de métier, héritage de la période artisanale du mouvement ouvrier, furent remplacés progressivement par les syndicats d'industrie. Ceux-ci regroupaient tous les ouvriers par branche, quel que fut le métier exercé dans celle-ci. Le développement de la grève de masse au début du siècle allait montrer cependant que -lors de la lutte ouverte contre le capital- l'organisation en branches d'industries était dépassé par l'organisation massive des ouvriers de toutes les branches. L'idée d'une"grande union" propagée par les IWW américains allait vite se révéler inadéquate, en ne voyant que la lutte économique par branche, alors que la grève de masse tendait à devenir politique par la confrontation de toute la classe, et non de certaines de ses parties, contre l'Etat.
[4] [1052] Rosa Luxemburg posait la véritable question sous-jacente : réforme ou révolution. Elle pouvait ainsi écrire : ". Ce qui compte avant tout, c'est l'organisation générale de notre agitation et de notre presse afin d'amener les masses laborieuses à compter de plus en plus sur leurs propres forces et sur leur action autonome et à ne plus considérer les luttes parlementaires comme 1'axe central de la vie politique." Du point de vue révolutionnaire, il était vital de "prévenir la classe ouvrière consciente contre cette illusion pernicieuse selon laquelle il est possible de ranimer artificiellement la démocratie et l'opposition bourgeoise au Parlement en modérant et en émoussant la lutte de classe social-démocrate." (Sachsische Arbeiterzeitung, 5-6 décembre 1904).
Géographique:
- Hollande [558]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 47 - 4e trimestre 1986
- 2532 reads
Les attaques frontales annoncent l'unification des luttes ouvrières
- 2433 reads
Les formidables combats de classe qui se sont déroulés en Belgique en avril-mai dernier -les plus importants depuis ceux de Pologne 80, depuis la fin des années 60 en Europe occidentale sont venus démontrer de façon éclatante toute la vanité des discours bourgeois sur le "réalisme de la classe ouvrière face à la crise", sa "compréhension de la nécessité de faire des sacrifices" et autres sornettes destinées à démoraliser les ouvriers, à les empêcher de voir la force qu'ils représentent face au capitalisme lorsqu'ils luttent et s'unissent. Ces combats ont mis en évidence que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour asséner aux ouvriers les coups de plus en plus brutaux que lui dicte 1'effondre ment croissant de son économie. Et cela non seulement en Belgique, mais dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui se trouvent d'ores et déjà -ou ne tarderont pas à se trouver- dans une situation similaire à celle de ce pays. Mais ce mouvement a démontré plus encore. De même que celui du secteur public en septembre 1983 dans cette même Belgique avait donné le signal d'un renouveau magistral des luttes ouvrières dans les principales métropoles capitalistes - après le recul général qui avait accompagné la défaite de 1981 du prolétariat en Pologne- les combats du printemps 86 font la preuve que la lutte du prolétariat mondial est entrée dans une nouvelle phase de son développement. Alors qu'en 1985 la bourgeoisie des pays centraux avait réussi à émietter les manifestations de combativité, qu'avec une politique de découpage dans le temps et dans l'espace de ses attaques, elle était parvenue à disperser les ripostes ouvrières, les luttes massives du prolétariat en Belgique ont mis en évidence les limites d'une telle politique. En effet, l'approche d'une nouvelle récession bien plus considérable encore que celle de 1982-83 (voir 1'article "L'impasse" dans ce numéro de la Revue) oblige la bourgeoisie à renoncer de plus en plus à des attaques dispersées et la contraint à des attaques massives et frontales. Face à celles-ci, les luttes ouvrières, à l'image de celles de Belgique, en avril-mai 86, prendront à leur tour de façon croissante un caractère massif et tendront à l'unification par delà les divisions catégorielles et régionales.
Voilà ce qui constitue l'axe de l'analyse développée déjà dans l'article "De la dispersion, vers l'unification" dans le précédent n° de notre Revue ainsi que de la résolution adoptée par notre organisation en juin 86 et que nous publions dans ce n°. Depuis que cette résolution a été adoptée, la situation est venue clairement confirmer cette analyse. Si la période des vacances a été peu propice au déploiement de grands mouvements de la classe ouvrière, par contre, elle a été l'occasion pour la bourgeoisie d'un grand nombre de pays de déchaîner des attaques anti-ouvrières d'une brutalité et d'une ampleur sans précédent. Qu'on en juge...
DES ATTAQUES SANS PRECEDENT
C'est dans un pays réputé pour son haut niveau de vie et de "protection" sociale -les Pays-Bas- qu'on été portées les attaques les plus spectaculaires durant cet été. Avec quelques mois de décalage par rapport à la Belgique voisine, la bourgeoisie a décidé des mesures tout à fait comparables à celles qui, dans ce dernier pays, étaient à l'origine des grands mouvements du printemps. Dès sa mise en place, le 14 juillet, le gouvernement de centre droit issu des élections du 21 mai, a annoncé la nécessité de réduire de façon drastique les dépenses budgétaires pour l'année 87 : ce sont au moins 12 milliards de florins qui devront être économisés (l'équivalent de 360 dollars par habitant !). Le gouvernement a annoncé que si l'année 87 serait "dure", cela irait mieux par la suite et que le niveau des revenus de 90 retrouverait celui de 86. On sait ce que valent ce genre de promesses. En attendant, les mesures prévues se passent de commentaires :
- suppression de 40 000 emplois dans les services publics de l'Etat (sur un total de 170 000) et plus de 100 000 parmi les fonctionnaires régionaux et municipaux ;
- instauration d'une "auto-contribution" pour les soins de santé (par exemple, la 1ère journée d'un séjour à l'hôpital ne sera pas remboursée) ;
- augmentation de 5% de la contribution à la sécurité sociale, ce qui correspond à une baisse de 2% des salaires ;
- réduction de 25% de la masse totale des subventions pour le logement social (ce qui affecte en priorité les chômeurs et les ouvriers les plus pauvres) ;
- réduction de 41 000 à 30 000 par an du nombre des logements construits par l'Etat (dans un pays qui souffre d'une crise du logement permanente) : cette mesure, avec la précédente, aboutira à la suppression de 30 000 emplois dans le bâtiment ;
- réduction massive des allocations chômage (alors qu'il était versé 85% du salaire pendant 6 mois, 70% pendant 18 mois et 60% par la suite, l'indemnité passera à 60% dès le début) ;
- mise au travail obligatoire pour un salaire de misère des chômeurs de moins de 25 ans (un bon moyen de faire baisser à bon compte les chiffres du chômage) ;
- dans le secteur privé, limitation à 1,3% des hausses de salaires alors que l'inflation était de 2,5% en 85 et qu'elle va encore s'accélérer ;
- dans ce même secteur, réduction à 37 heures et demi de la semaine de travail sans aucune compensation salariale.
Au total, ces mesures représentent une baisse des revenus de 10% pour la classe ouvrière et une augmentation de 15% du nombre des chômeurs. Ce sont tous les secteurs de la classe ouvrière (secteur privé, secteur public, chômeurs), toutes les composantes du revenu ouvrier (salaire nominal, salaire "social") qui, à l'image de la Belgique, sont brutalement attaqués.
Bien que sous une forme moins spectaculaire, ce type de mesures a déferlé ces derniers mois sur les ouvriers de nombreux autres pays :
- réduction des effectifs de la fonction publique en Espagne et en France (30 000 pour 87 dans ce pays) ;
- suppression massive d'emplois dans les entreprises publiques (50 000 dans l'INI en Espagne, 20 000 à la régie Renault et 9000 dans les chemins de fer en France) ;
- poursuite et intensification des fermetures d'usines et des licenciements dans les secteurs "faibles" tels que la sidérurgie (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, 3000 en France, fermeture des aciéries de USX dans 7 Etats aux USA), la construction navale (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, fermeture de 3 sites de la Normed en France, soit 6000 emplois), les charbonnages (8000 suppressions d'emplois dans la Ruhr en RFA, par exemple) ;
- blocage ou baisse des salaires (gel des traitements de la fonction publique et des pensions vieillesse en France, nombreuses baisses de salaires aux USA, etc.) ;
- accroissement des charges sociales (amputation de 0,7% des salaires pour les cotisations vieillesse et prélèvement de 0,4% sur tous les revenus en France, mesures similaires en Espagne, etc.) ;
- démantèlement de la "couverture sociale" (nouvelle réduction de la liste des médicaments remboursés et suppression du remboursement à 100% des dépenses de santé par les mutuelles en France, mesures du même type encore plus brutales dans la plupart des entreprises aux USA) ;
- réductions de l'indemnisation du chômage (par exemple, suppression des primes particulières pour la nourriture, les vêtements et le logement en Grande-Bretagne).
La liste pourrait s'allonger beaucoup plus sans pour cela rendre compte de façon complète de la terrible attaque subie à l'heure actuelle par la classe ouvrière dans tous les pays. Et ce n'est pas fini : si de telles attaques peuvent permettre à chaque bourgeoisie nationale de ne pas être étouffée par ses concurrentes dans la guerre commerciale que toutes se livrent, elles ne peuvent en aucune façon empêcher l'effondrement global de l'économie mondiale et elles seront nécessairement suivies de nouvelles attaques encore plus brutales, massives et frontales : le pire est encore devant nous.
LA LUTTE DE CLASSE
Annoncées pour la plupart durant la période des vacances, ces mesures anti-ouvrières n'ont pas encore provoqué de réponses significatives dans les grandes concentrations d'Europe occidentale. Mais il ne faut pas s'y tromper : le mécontentement est partout explosif et il l'est d'autant plus que la sournoiserie de ces attaques portées dans le dos des ouvriers au moment où ils ne pouvaient se défendre n'a fait qu'accroître leur colère. D'ailleurs, la bourgeoisie sait à quoi s'en tenir : partout, elle a confié à sa gauche et à ses syndicats le soin de miner le terrain. Dans tous les pays on assiste à un même phénomène : les syndicats adoptent un langage de plus en plus "radical", "extrémiste" même. En Suède, par exemple, la centrale LO, pourtant contrôlée par le parti social-démocrate actuellement au gouvernement, surprend par le ton de ses discours d'une "combativité" et d'une "intransigeance" jamais vues. En France, c'est la CGT, contrôlée par le PC,qui aujourd'hui tient un langage, organise des actions qu'elle aurait dénoncés comme "gauchistes" et "irresponsables" il y a peu de temps encore : elle claironne que "seule la lutte paie"; elle appelle "partout à des ripostes massives et unitaires" contre les "mauvais coups" du gouvernement ; elle dénonce avec vigueur la politique du précédent gouvernement (qu'elle a pourtant soutenu pendant 3 ans) ; elle ne craint pas d'organisé des actions illégales (comme le blocage des trains et des autoroutes) ou violentes (affrontements contre la police). Si partout les syndicats durcissent ainsi le ton c'est ([1] [1053]) pour une raison très simple : il faut qu'ils prennent les devants afin de ne pas être débordés par les mouvements qui se préparent et d'être capables de les saboter, de les diviser.
Mais si, en Europe occidentale, c'est essentiellement à travers les manoeuvres bourgeoises qu'on peut juger des potentialités de lutte, dans la première puissance mondiale -les USA- c'est la classe elle-même qui est venu faire la preuve de sa combativité et de sa prise de conscience du besoin d'unité. En effet, dans un pays où le battage sur les "succès" économiques du libéralisme reaganien, sur la "reprise" etc. a été assourdissant, il n'y a pas eu de vacances pour la lutte de classe :
- dans le secteur du téléphone, grève de 155 000 ouvriers à ATT en juin durant 26 jours, de 66 000 ouvriers d'autres compagnies en août ;
- dans la sidérurgie, grève à la LTV (2ème producteur US) en juillet, 22 000 ouvriers en grève à USX le 1er août (premier mouvement depuis 1959) ;
- plusieurs autres mouvements dans les transports aériens, dans les usines de papier (7 500 ouvriers), dans l'industrie alimentaire (usines Hormel dans le Minnesota, Watsonville en Californie) ;
- dans le secteur public, en juillet-août, grève de 32 000 employés communaux à Philadelphie et Détroit (deux très grandes métropoles industrielles de l'Est) notamment dans les secteurs des transports, de la santé et chez les éboueurs.
Dans ces deux dernières grèves, les actes de solidarité se multiplient parmi les ouvriers et déjouent en partie les manoeuvres de division organisées de concert par la direction et les syndicats (signature d'accords séparés pour chaque catégorie d'ouvriers). Et si à Philadelphie, les menaces de licenciements proférées par les tribunaux viennent finalement à bout, après 3 semaines de grève, de la combativité et de la solidarité, celles-ci sont suffisamment fortes dès le début à Détroit pour empêcher la bourgeoisie de recourir à de telles menaces et pour l'obliger à renoncer à un de ses objectifs majeurs : faire dépendre les augmentations de salaires pour les 3 prochaines années de la "santé financière" de la municipalité.
Dans un pays où la bourgeoisie s'est toujours distinguée par la brutalité et le cynisme de son attitude face à la classe ouvrière (qu'on se souvienne du licenciement de 12 000 aiguilleurs du ciel en août 81, par exemple) son recul face aux grévistes de Détroit constitue une nouvelle illustration de la résolution publiée plus bas :
"(Les luttes) "paient" et ... elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire... plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer et reporter les attaques qu'elle se propose de mener"..
Ce que démontrent en fin de compte les luttes ouvrières aux USA, de même que l'extrême tension existant en Europe occidentale, c'est que l'heure n'est pas aux lamentations sur "la passivité de la classe ouvrière", son "embrigadement derrière les syndicats", lamentations dans lesquelles se complaisent encore nombre de groupes révolutionnaires. Dans la période qui vient, le prolétariat va livrer des combats d'une importance considérable ce qui va placer de plus en plus les organisations révolutionnaires devant leurs responsabilités : soit elles seront partie prenante de ces combats afin de les impulser, ce qui suppose qu'elles soient conscientes de leur enjeu et du rôle qu'elles doivent y jouer, soit elles seront balayées impitoyablement par l'histoire.
FM. 7 septembre 86
[1] [1054] Cette affirmation ne saurait être contredite par le fait, qu'après un recul temporaire face aux grèves du printemps, le gouvernement belge a finalement décidé de maintenir 1'intégralité des coupes budgétaires projetées : ce qui est ici démontré c'est 1 'habileté de la bourgeoisie dont le gouvernement a annoncé les mesures peu de temps avant les, vacances9afin de pouvoir les confirmer durant cette période après la retombée de la mobilisation ouvrière, c'est la capacité que conservent les syndicats à saboter l'unité ouvrière, c'est la nécessité, par suite, pour les ouvriers, non seulement de les huer comme ce fut le cas en Belgique mais aussi de se confronter à eux, de ne pas leur laisser l'initiative, de pousser toujours plus avant la recherche de l'unification et, ce faisant, de prendre eux-mêmes en main leur lutte par leur auto-organisation.
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Résolution sur la situation internationale 1986
- 2599 reads
1) La résolution sur la situation internationale du 6ème Congrès du CCI (Revue Internationale n°44) en novembre 85, était placée sous le signe de la dénonciation de toute une série de mensonges mis en avant par la bourgeoisie pour tenter de masquer les enjeux véritables de cette situation :
- "mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les 'succès' de l'économie américaine en 1983 et 84, seraient l'incarnation','
- prétendue "atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la 'main tendue' aux négociations avec 1’URSS qui trouvent leur pendant avec 1'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev",
- battage sur "l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale."
Si, à l'époque, ces mensonges pouvaient s'appuyer sur un semblant de réalité, huit mois après, cette même réalité s'est chargée de démentir ouvertement toutes les campagnes précédentes, confirmant une nouvelle fois que les années 80 sont bien celles où la faillite historique du capitalisme, sa nature décadente et barbare sont appelées à se révéler dans toute leur nudité, où se précisent de plus en plus ouvertement les véritables enjeux de toute la période historique que nous vivons. De plus, la rapidité avec laquelle les événements sont venus battre en brèche les mensonges de 85 illustre une autre caractéristique fondamentale de ces années de vérité : l'accélération croissante de l'histoire.
Ainsi, la présente résolution ne se propose pas de redémontrer, après celle de novembre 85, toute la vanité des discours bourgeois. Elle prend appui sur cette dernière résolution, dont elle constitue le complément, pour mettre en évidence en quoi les huit mois écoulés ont confirmé ses orientations, pour souligner cette accélération de l'histoire, de même qu'elle se propose de signaler les premiers enseignements des expériences de la classe ouvrière au cours de cette dernière période.
L'ACCELERATION DE L'EFFONDREMENT ECONOMIQUE
2) La résolution du 6ème Congrès du CCI indiquait les limites de la "reprise" aux USA de même que de la capacité de ce pays de servir de "locomotive" pour les économies des autres pays de son bloc :
"C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70... qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.
Après 82, c'est... 1'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur... qu'intérieur...
qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.
En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion dé son système financier... que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin."
L'évolution de la situation ces derniers mois constitue une illustration concrète de ces limites :
- le déficit du budget fédéral des USA, qui avait permis la création d'une demande artificielle pour les entreprises de ce pays (380 milliards de $ pour 83 et 84), sera impérativement réduit (le Congrès US a adopté une loi (Gramm-Rudman) instaurant des coupes automatiques des budgets en cas de déficit),
- plus encore, la baisse du dollar de 30 % en quelques mois (baisse voulue et organisée par les autorités) signifie que les USA sont déterminés à réduire drastiquement leur déficit commercial devenu astronomique (et qui a placé ce pays dans le peloton de tête des pays les plus endettés du monde) et donc à repartir à la reconquête de leurs marchés tant intérieurs qu'extérieurs.
Ce dernier fait signifie donc une intensification de la guerre commerciale avec les concurrents (qui sont aussi les alliés) des USA (Japon et Europe occidentale), lesquels verront leurs propres marchés s'effondrer (sans que cela signifie d'ailleurs un regain de santé de l'économie US du fait du rétrécissement général du marché mondial). De même, cette baisse du dollar signifie que ces mêmes pays se voient rembourser leurs prêts 30 % moins cher que leur valeur initiale.
3) De même, cette baisse du dollar ne signifiera nul répit pour les pays du tiers-monde. Si, d'un côté, leur endettement de 1.000 milliards de dollars (la plupart du temps libellé en cette monnaie) sera partiellement réduit, les revenus de leurs exportations servant à son remboursement seront amputés d'autant (puisque exprimés également en dollars). De plus, leur situation ne pourra que s'aggraver avec la baisse souvent considérable des prix des matières premières qui, sous la pression de la surproduction généralisée, caractérise la période actuelle, dans la mesure où celles-ci constituent leur poste principal (sinon exclusif) d'exportation. Cette situation est particulièrement spectaculaire et dramatique en ce qui concerne la principale des matières premières, le pétrole (dont l'effondrement des prix démontre le caractère uniquement spéculatif, et nullement basé sur une quelconque "pénurie", des flambées de 1973 et 1979). Des pays comme le Mexique ou le Venezuela, déjà incapables de faire face à leurs dettes phénoménales lorsqu'ils vendaient leur baril à 30 dollars, sont plongés avec le baril à 15 dollars, dans une banqueroute totale. Ainsi s'amplifie encore cette barbarie sans nom, cet enfer permanent dans le tiers-monde, que la résolution de novembre 85 présentait comme un des indices les plus éloquents de l'effondrement de l'économie mondiale.
De même aussi, les pays du bloc russe, à commencer par l'URSS elle-même, dont les matières premières constituent (à l'image des pays sous-développés) la principale exportation, verront-ils encore s'aggraver une situation économique déjà déplorable et devront-ils renoncer encore plus à acheter en occident les équipements industriels modernes qui leur font tant défaut (ce qui viendra encore réduire les débouchés de leurs fournisseurs occidentaux).
4) Pour ce qui concerne l'Europe occidentale, dont la résolution de novembre 85 soulignait la gravité de la situation économique, la baisse des matières premières et notamment du pétrole, ne permet d'espérer aucune amélioration sensible. Contrairement aux déclarations satisfaites présentant ces baisses (cumulées avec celle du dollar) comme un "ballon d'oxygène" du fait de la réduction de l'inflation et des déficits commerciaux qu'elles sont censées provoquer, c'est une nouvelle aggravation de la situation qu'il faut en attendre à terme. D'une part des pays comme la Grande-Bretagne et la Norvège ou les Pays-Bas sont directement victimes de la baisse du pétrole (et du gaz naturel dont le prix est lié à celui du pétrole). D'autre part, et surtout, l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui exportent une part importante de leur production vers les pays du tiers-monde et notamment les pays producteurs de pétrole, verront de plus en plus se fermer le marché de ces pays en même temps que s'épuiseront leurs sources de devises. En fait d'"oxygène"c'est du gaz asphyxiant que contient ce "ballon" tant vanté de la baisse des matières premières et du pétrole. D'ailleurs, derrière cette euphorie de façade, la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale est consciente de l'extrême noirceur des perspectives économiques résultant du cumul de la fermeture croissante du marché des USA (du fait de la baisse du dollar et des mesures protectionnistes prises par ce pays), de 1'anémie du marché du COMECON et de l'épuisement des contrats mirifiques des pays de l'OPEP, alors que dès maintenant c'est plus de 11 % (en chiffres officiels, donc sous-estimés) de la force de travail qu'elle ne peut employer. C'est justement parce qu'elle ne se fait pas d'illusions que, dans tous les pays, cette bourgeoisie multiplie les mesures brutales d'austérité (comme celles du gouvernement Martens en Belgique) afin de préserver du mieux possible sa compétitivité déjà faible en prévision de la terrible guerre commerciale que va déchaîner la récession qui s'annonce.
Dans ces centres vitaux du capitalisme, où se trouvent les plus grandes et anciennes concentrations industrielles, et donc ouvrières, c'est donc une nouvelle et considérable détérioration de la situation économique - avec les terribles attaques antiouvrières qu'elle comporte - qui constitue la seule perspective, à court terme, détérioration qui ne pourra que se répercuter, en fin de compte, sur les pays (USA et Japon) jusqu'à présent les mieux lotis.
L'INTENSIFICATION DES CONFLITS IMPERIALISTES
5) Comme le CCI, avec tous les marxistes, l'a toujours souligné (et rappelé dans la résolution de novembre 85), 1'effondrement de 1'infrastructure économique de la société capitaliste ne peut déboucher que sur une fuite en avant vers un affrontement impérialiste généralisé. A peine 6 mois après le grand "show" au sommet de Genève, les embrassades des duettistes Reagan et Gorbatchev sont complètement oubliées (comme l'annonçait cette résolution). Avec autant de promptitude qu'il les avait abandonnées lors de sa campagne électorale, Reagan a repris ses diatribes contre "l'empire du mal" dénonçant avec une vigueur renouvelée les "violations des droits de l'homme" et les "intentions belliqueuses" de l'URSS de même que l'hypocrisie de ses propositions de réduction des armements, ce qui s'est notamment concrétisé tout récemment par la dénonciation, de la part de la Maison Blanche, des accords SALT II. Ainsi se confirme avec éclat l'offensive du bloc occidental en vue de "parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct" (Résolution du 6ème Congrès du CCI). En ce domaine est particulièrement significatif de l'accélération générale dé l'histoire imprimée par l'effondrement économique du capitalisme, le bombardement par l'aviation américaine des deux plus grandes villes de Libye ainsi que des principales bases militaires de ce pays. C'est une nouvelle illustration du fait qu'une "des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire" (Ibid.).
6) Si le raid américain d'avril 86 n'était pas directement dirigé contre l'URSS ou une de ses positions stratégiques, dans la mesure où la Libye n'a jamais été un membre du bloc de l'Est, c'est bien l'offensive d'ensemble contre ce bloc qui constitue l'arrière-plan de cette action d'éclat. En effet, celle-ci visait à :
- confirmer avec force et de façon spectaculaire que la Méditerranée est désormais un "mare nostrum" américain (à la veille des bombardements, l'URSS éloigne prudemment ses navires des côtes libyennes ce qui illustre bien qu'elle a renoncé à contester l'hégémonie totale des USA dans cette région du monde) ;
- envoyer un avertissement à tous les pays (et pas seulement à la Libye) qui, sans appartenir au bloc de l'Est, manifestent au gré des USA une trop grande indépendance à leur égard ou une soumission insuffisante.
En particulier, il était signifié à la Syrie qu'elle se devait d'exécuter avec plus d'efficacité le contrat passé avec elle en échange du départ des corps expéditionnaires occidentaux du Liban en 84 et consistant à faire, en compagnie d'Israël, "le gendarme" dans ce pays (notamment par la mise au pas des groupements pro-iraniens). Mais le principal destinataire du message porté par les Fil américains, c'est une nouvelle fois l'Iran dont la réinsertion dans le bloc US continue de constituer l'objectif majeur de l'étape présente de l'offensive occidentale. Et il semble bien que le message ait été reçu par ce pays : son récent rapprochement diplomatique avec la France (qui a fait "un geste" en "poussant" Massoud Radjavi hors de ses frontières tout en maintenant son plein soutien militaire à l'Irak) indique que le régime de Téhéran commence à comprendre "où se trouve son intérêt".
Cependant, la fonction du raid américain ne se limitait pas à des questions de stratégie impérialiste. Avec tout le battage médiatique qui l'a accompagné, notamment autour de la "dénonciation du terrorisme", cette opération se voulait également une contribution à toutes les campagnes idéologiques visant à détourner la classe ouvrière des luttes qui ne peuvent manquer de se déployer face à 1'intensification des attaques économiques qui se développent à l'heure actuelle. Car pour la bourgeoisie de tous les pays, plus important encore que le problème des antagonismes commerciaux entre nations, des affrontements impérialistes entre blocs, est le problème que lui pose l'énorme potentiel de combativité existant au sein du prolétariat, notamment celui des pays centraux du capitalisme, et qui constitue la clé de voûte de toute la situation mondiale présente, l'élément déterminant le cours historique actuel.
L'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DES COMBATS DE CLASSE
7) S'il est un domaine où l'accélération de l'histoire se manifeste de façon particulièrement nette, c'est bien celui du développement de la lutte de la classe ouvrière. Cela "se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs, alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précédent" (Ibid.). De même, au sein de chacune de ces vagues, les "moments inévitables de répit, de maturation, de réflexion" (ibid.) sont eux-mêmes d'une durée de plus en plus courte. Ainsi toute la campagne récente sur la "passivité" de la classe ouvrière, basée sur une baisse apparente de la combativité en 1985, a fait aujourd'hui long feu avec les formidables combats de classe qui viennent de se dérouler en avril et mai en Belgique."Ces combats qui viennent après des mouvements de très grande ampleur en Scandinavie et surtout en Norvège (et qui, compte tenu du faible niveau des luttes ouvrières dans cette région auparavant, sont significatifs de la profondeur de la vague actuelle des combats de classe), constituent une confirmation éclatante de ce qu'affirmait la résolution du 6ème Congrès du CCI :
"...les actuels moments de répit... que peut s'accorder aujourd'hui la classe restent limités dans le temps comme dans l'espace, et bien que la bourgeoisie fasse tout pour transformer cet effort de réflexion qui s'opère dans la classe en expectative et en passivité, la situation reste caractérisée par une accumulation de mécontentement et de combativité potentielle prête à exploser d'un moment à l'autre."
Mais ce que traduit principalement le mouvement des ouvriers en Belgique c'est l'étroitesse des limites de la politique bourgeoise qui avait permis en 1985, non une extinction des manifestations de combativité, mais une dispersion de ces manifestations en une série de luttes isolées, menées par un nombre bien plus limité d'ouvriers que dans la première phase (83-84) de la troisième vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui avait débuté par les combats massifs du secteur public en septembre 83 dans ce même pays.
8) Cette politique de dispersion des luttes, la bourgeoisie l'avait basée essentiellement sur une dispersion des attaques économiques elles-mêmes, sur une planification et un étalement dans le temps et l'espace de celles-ci. Cela lui était permis par la petite marge de manoeuvre que lui laissaient les retombées de la "reprise" américaine de 83-84, ce qui d'emblée posait les limites objectives de cette politique du fait même que, pour l'économie capitaliste, ce répit ne pouvait être que de courte durée. De plus, cette politique contenait toute une série d'autres limites :
- dans la mesure où, dans les pays les plus avancés, une part non négligeable du prix de la force de travail est versée sous forme de prestations sociales de toutes sortes (sécurité sociale, allocations familiales, etc.) toute réduction de cette part de salaire ne peut se faire que de façon globale, au détriment de toutes les ouvriers et non de ceux de tel ou tel secteur;
- du fait que, dans ces mêmes pays, une énorme proportion (souvent la majorité) des ouvriers dépendent d'un "patron" unique, l'Etat, soit parce qu'ils travaillent dans le secteur public, soit parce que sans emploi, ils ne survivent que de ses subsides, le champ d'application de cette politique se limite essentiellement à un secteur particulier de la classe, celui qui travaille dans le secteur privé (ce qui explique en grande partie tous les efforts de beaucoup de gouvernements en vue de "reprivatiser" le plus possible l'économie).
Ce qui vient de se passer en Belgique confirme que 1'ensemble dé ces limites commence à être atteint, que c'est de façon de plus en plus massive et surtout frontale que la bourgeoisie est obligée de porter ses attaques, que la tendance générale des luttes n'est plus au maintien dans la dispersion mais au dépassement de cette dispersion. C'est particulièrement clair lorsqu'on constate que les mesures qui ont provoqué cette formidable réponse de la classe :
- sont dictées à la bourgeoisie par l'absence presque totale de marge de manoeuvre économique, par l'urgence d'"assainir" et d'adapter l'économie du pays notamment face à la perspective de 1'intensification sans précédent de la guerre commerciale que va provoquer la récession qui vient, urgence qui ne lui permet plus d'étaler ou de reporter ses attaques,
- concernent tous les secteurs de la classe ouvrière (privé, public et chômeurs) et mettent en cause toutes les composantes du salaire (salaire nominal et salaire "social").
C'est encore plus clair lorsqu'on voit pratiquement tous les secteurs de la classe ouvrière participer massivement au mouvement, non seulement d'une simple façon simultanée, mais avec des tentatives de plus en plus déterminées de rechercher la solidarité et l'unification des luttes d'un secteur à l'autre.
9) De même que la grève du secteur public en Belgique en 83 annonçait l'entrée de la classe ouvrière mondiale, et tout particulièrement en Europe occidentale, dans la première phase de la troisième vague de luttes, celle qui fut marquée par des luttes massives et d'une très grande simultanéité .internationale, les récentes grèves dans ce même pays, annoncent 1'entrée de cette même classe ouvrière dans une troisième phase de cette vague, celle qui après la deuxième phase marquée par la dispersion des luttes, va manifester des tendances de plus en plus nettes vers 1'unification de celles-ci. Le fait que dans les deux cas ce soit la classe ouvrière du même pays qui se soit retrouvée aux avant-postes n'est pas sans signification. En effet, malgré la petite taille de ce pays, la situation de la Belgique constitue un résumé des caractéristiques fondamentales de l'ensemble des pays d'Europe occidentale :
- situation catastrophique d'une économie nationale développée, par ailleurs extrêmement dépendante du marché mondial (70% de la production de ce pays est exportée)
- taux très élevé du chômage
- très forte concentration industrielle sur une surface réduite
- ancienneté tant de la bourgeoisie que du prolétariat
- vieille et forte expérience pour ces deux classes de leurs affrontements communs.
De ce fait, les combats qui viennent de se dérouler dans ce pays ne sauraient être considérés comme un feu de paille, un événement non significatif à l'échelle européenne et mondiale. Au contraire, ils ne font qu'augurer de ce qui attend les autres pays d'Europe occidentale, et plus généralement les principaux pays avancés, dans la période qui vient. Et cela notamment du point de vue de leurs principales caractéristiques dont la plupart avaient déjà été identifiées dès le début de la troisième vague de luttes :
1."tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes;
2. tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leurs débuts, un certain débordement des syndicats;
3. développement progressif au sein de l'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité à s'opposer comme classe aux attaques capitalistes"(Ibid.);
4. recherche de la solidarité active et de l'unification par delà les usines, les catégories ou les régions, notamment sous forme de manifestations de rue et en particulier de délégations massives d'un centre ouvrier à l'autre, mouvement qui se fera en confrontation croissante avec tous les obstacles placés par le syndicalisme et au cours duquel "s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto-organisation de leur combat" (Ibid.)
10) Cette nécessité de l'auto-organisation et cette tendance à la recherche active de l'unification, au-delà de la simple extension des luttes, constituent le trait majeur de la 3ème phase de la 3ème vague de luttes. Ce trait (qui n'avait pas encore été identifié lors du 6ème Congrès du CCI) découlait de la politique bourgeoise d ' éparpillement des luttes basée sur 1'éparpillement des attaques économiques (mise en évidence, par contre, au début de l'année 86 dans l'éditorial de la Revue Internationale n°45).
Du fait même qu'il fait suite à une offensive bourgeoise tendant à briser l'élan de la 3ème vague de luttes, et qu'il s'inscrit en dépassement des difficultés engendrées par cette offensive, ce trait introduit dans cette 3ème vague de luttes une dimension générale de la plus haute importance, d'une portée comparable à cette autre caractéristique mise en évidence dès son début : "la simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes." (Revue Internationale n°37, 1er trimestre 84). Cependant malgré leur importance comparable, ces deux caractéristiques n'ont pas la même signification du point de vue du développement concret des luttes ouvrières, et partant, de 1'intervention des révolutionnaires en leur sein. La simultanéité internationale, malgré toute sa dimension historique en tant que préfiguration de la future généralisation, est bien plus, à l'heure actuelle, un état de fait découlant notamment de la simultanéité des attaques bourgeoises dans tous les pays que d'une démarche délibérée, prise en charge de façon consciente par les ouvriers de ces pays, et cela notamment du fait de la politique systématique de black-out menée par la bourgeoisie. Par contre la tendance à l'unification des luttes, tout en ayant une portée historique comparable, en tant que jalon vers la grève de masse, et partant vers la révolution, constitue également une donnée immédiate au sein des combats prolétariens actuels, une composante de ces combats que les ouvriers doivent nécessairement prendre en charge de façon consciente. En ce sens, si la simultanéité internationale des luttes pose les jalons, le cadre historique de leur généralisation mondiale future, le chemin concret qui y conduit, dans la mesure où cette généralisation ne pourra être qu'un acte conscient, passe nécessairement par le développement des tendances à 1'unification qui s'expriment dès maintenant. C'est pour cela qu'il revient aux révolutionnaires de souligner dans leur intervention toute 1'importance de cette marche vers l'unification. Et cela d'autant plus que c'est dans cette marche que la classe sera contraint de développer de façon croissante son auto organisation face aux confrontations répétées contre les obstacles syndicaux.
11) Une des composantes de ce mouvement vers l'auto organisation, et qui s'était déjà manifestée dans les luttes récentes, s'est exprimée de façon très claire lors des derniers combats en Belgique : la tendance au surgissement spontané des luttes, en dehors de toute consigne syndicale, tendance déjà mise en évidence dès le début de la 3ème vague. A propos de cette tendance, il importe de souligner les points suivants :
11-1. Elle participe d'une composante générale de la lutte de classe dans la période de décadence déjà identifiée depuis longtemps par les révolutionnaires : "Un tel type de luttes, propre à la période de décadence, ne peut se préparer d'avance sur le plan organisationnel. Les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser...ce sont là des caractéristiques qui préfigurent l'affrontement révolutionnaire."(Revue Internationale N°23, "Le prolétariat dans le capitalisme décadent").
11-2. Cependant les mouvements spontanés ne traduisent pas nécessairement un niveau de conscience plus élevé que les mouvements se développant à l'appel des syndicats :
- d'une part, de nombreuses luttes surgies spontanément ont été et sont encore reprises en main facilement par les syndicats,
- d'autre part, l'occupation systématique du terrain social par la gauche dans l'opposition conduit souvent les syndicats à prendre les devants de combats porteurs d'un fort potentiel de prise de conscience,
- enfin, dans certaines circonstances historiques, notamment celles où la gauche est au gouvernement, comme ce fut le cas fréquemment au cours des années 60-70, des grèves spontanées ou même sauvages, peuvent n'être que la simple traduction pratique de 1'opposition déclarée des syndicats à toute lutte sans pour cela exprimer un niveau élevé de la conscience dans la classe.
11-3. Toutefois, le fait que la tendance à la multiplication des luttes spontanées se développe alors que la bourgeoisie a placé ses forces de gauche dans l'opposition, que celles-ci radicalisent de façon très importante leur langage, confère aux luttes spontanées d'aujourd'hui une signification toute différente de celle des luttes évoquées plus haut. Ce fait révèle notamment un discrédit croissant des syndicats aux yeux des ouvriers, discrédit qui, résultant de manoeuvres où les syndicats se présentent en permanence comme "l'avant-garde" des combats, et même s'il ne débouche pas mécaniquement sur une prise de conscience de fond de la véritable nature du syndicalisme et de la nécessité de l'auto-organisation, crée les conditions de cette prise de conscience.
11-4. Une des causes importantes de cette tendance aux surgissements spontanés réside dans l'accumulation d'un énorme mécontentement qui explose bien souvent de façon inattendue. Mais là encore, une des raisons de cette accumulation de mécontentement est constituée par le fait que le discrédit qui pèse sur les syndicats les empêche aujourd'hui d'organiser des "actions" destinées à servir de soupape de sécurité à ce mécontentement.
Ainsi, en exprimant globalement une maturation de la combativité et de la conscience, notamment du point de vue de la compréhension croissante du rôle du syndicalisme et des nécessités de la lutte, le développement actuel des mouvements spontanés de la classe s'inscrit pleinement dans le long processus historique qui conduit aux affrontements révolutionnaires.
12) Ce discrédit des syndicats, dont l'accroissement est une condition, certes insuffisante, mais indispensable au développement de la conscience dans la classe, est appelé à s'amplifier de façon significative dans la phase actuelle de la lutte de classe. En effet, si la mise à contribution depuis de nombreuses années,du syndicalisme et de la gauche en général comme élément central de la politique bourgeoise de division de la classe, de sabotage, dévoiement et épuisement des luttes, permet d'expliquer le degré de méfiance d'ores et déjà atteint par les ouvriers à 1'égard des syndicats, si le début de la 3ème vague correspondait déjà à une certaine usure de la gauche dans l'opposition après que cette carte jouée à partir de 78-79 ait été grandement responsable de l'épuisement prématuré de la 2ème vague et du désarroi qui accompagne la défaite en Pologne de 1981, la période pendant laquelle la bourgeoisie a été capable de mener sa politique de dispersion des attaques a permis à celle-ci, dans la plupart des pays, de s'épargner un emploi trop voyant de ses forces de gauche et de ses syndicats. En effet, durant cette période, ce sont les secteurs de droite et le patronat privé qui se sont trouvés aux avant-postes dans la mise en oeuvre de la stratégie de division des luttes ouvrières dans la mesure où celle-ci se basait avant tout, non sur les manoeuvres de la gauche, mais sur la façon dont les attaques directes étaient elles-mêmes conduites, les syndicats ne faisant qu'accentuer le caractère dispersé des luttes découlant de la forme même des attaques 'auxquelles ces luttes ripostaient.
Mais dès lors que par l'épuisement de sa marge de manoeuvre économique, la bourgeoisie est contrainte de renoncer à la dispersion des attaques, qu'elle est obligée de les mener de façon frontale, elle ne dispose plus pour poursuivre sa politique de division des ouvriers (politique qu'elle maintiendra jusqu'à la révolution) que de la gauche et des syndicats, lesquels sont beaucoup plus ouvertement mis à contribution et sont amenés, de ce fait, à dévoiler bien plus leur véritable fonction. La multitude de manoeuvres entreprises par les syndicats lors des récentes luttes en Belgique (notamment le saucissonnage des journées d'action par secteur) en vue de casser en morceaux la riposte ouvrière aux mesures gouvernementales, la prise de conscience constatée chez les ouvriers du rôle de diviseurs joué par les syndicats, constituent une première concrétisation probante de cette tendance générale à l'accentuation du discrédit de la gauche et des syndicats qui est propre à la phase actuelle du développement des combats de classe.
13) La méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats est riche, comme on l'a vu, de potentialités de surgissements massifs de la lutte du prolétariat, du développement de l'auto-organisation et de la conscience de celui-ci. En particulier, la période qui vient verra se manifester de plus en plus nettement une tendance à la formation au sein de la classe de groupements plus ou moins formels d'ouvriers cherchant à se défaire des nasses paralysantes du syndicalisme, à réfléchir sur les perspectives plus générales de leur combat.
C'est bien pour ces raisons que la bourgeoisie mettra de plus en plus en avant l'arme du"Syndicalisme "de base" ou "de combat" - comme cela s'est illustré clairement dans les luttes en Belgique - destiné, avec son langage "radical", à ramener à l'intérieur du carcan syndical (des syndicats existants ou du syndicalisme) les ouvriers qui tentent de briser ce carcan. Dans cette situation, il importe de pouvoir distinguer ce qui témoigne de la vitalité de la classe (l'apparition de groupes ou comités d'ouvriers combatifs engagés dans une démarche de rupture avec la gauche ou le syndicalisme) de ce qui relève d'une politique bourgeoise destinée notamment à entraver cette démarche (le développement du syndicalisme de base), d'autant qu'au début d'un tel processus, les éléments de la classe qui se sont engagés dans cet effort de rupture peuvent adopter des positions apparemment en retrait par rapport à celles du syndicalisme de base et des gauchistes, spécialistes de la phrase "radicale". Il appartient par conséquent aux révolutionnaires de ne pas juger de façon statique les phénomènes de ces deux types qui apparaîtront au cours du développement des luttes, mais d'avoir en vue, sur la base d'un examen attentif, la dynamique de chaque phénomène particulier afin de pouvoir combattre avec la plus grande vigueur toute manoeuvre "radicale" de la bourgeoisie mais aussi de savoir encourager et impulser les efforts encore embryonnaires de la classe en direction d'une prise de conscience et non les stériliser en les confondant avec ces manoeuvres bourgeoises.
14) Un des autres enseignements des récents combats en Belgique, qui vient confirmer ce que les marxistes ont toujours affirmé contre les proudhoniens et les lassaliens, et plus récemment contre les modernistes, c'est que la classe ouvrière, non seulement peut et doit lutter pour la défense de ses intérêts immédiats en préparation de sa lutte comme classe révolutionnaire, mais peut aussi sur ce terrain faire reculer la bourgeoisie. Si la décadence du capitalisme interdit à cette dernière d'accorder de réelles réformes à la classe ouvrière, si la phase de crise aiguë - comme celle où nous sommes entrés - ne lui offre d'autre possibilité que d'attaquer les ouvriers de plus en plus brutalement, cela ne signifie nullement que la classe ouvrière n'ait d'autre choix qu'entre faire (ou préparer) immédiatement la révolution et subir passivement ces attaques sans espoir de les limiter. Même lorsque la situation d'un capital national apparaît comme désespérée, comme c'est le cas de la Belgique aujourd'hui, que les attaques impliquées par cette situation ne semblent pas pouvoir être différées ou atténuées, la bourgeoisie conserve encore une petite marge de manoeuvre lui permettant de renoncer momentanément - et même au prix de difficultés futures bien pires encore - à certaines de ses attaques si elle se confronte à un niveau significatif de résistance de la part du prolétariat. C'est ce qu'on a pu également constater en Belgique avec le "réexamen" des mesures touchant les mines du Limbourg et les chantiers navals, de même qu'avec le report du plan d'austérité du gouvernement Martens.
Il en est en fin de compte du degré d'urgence et de gravité des attaques capitalistes comme du de gré de saturation des marchés qui les dicte : de même que, si elle tend à devenir de plus en plus totale, cette saturation n'atteint jamais un point absolu, la marge de manoeuvre économique de chaque capital national, tout en s'approchant toujours plus de zéro, n'atteint jamais une telle limite. Il importe donc que les révolutionnaires, s'ils doivent mettre en évidence la perspective d'effondrement de plus en plus total du capitalisme et donc la nécessité de le remplacer par la société communiste, soient également capables, en vue d'impulser les luttes immédiates, de montrer que celles-ci "paient" et qu'elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire, que plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer, et reporter les attaques qu'elle se proposé de mener.
15) Une des autres confirmations qu'apportent les événements d'avril-mai 86 en Belgique, c'est l'importance croissante de la lutte des chômeurs, la capacité de ce secteur de la classe ouvrière de s'intégrer de plus en plus dans les combats généraux de la classe, même si ce phénomène n'a été constaté que sous une forme encore embryonnaire au cours de cette période. Avec cet autre phénomène constitué par l'apparition et le développement ces dernières années de nombreux comités de chômeurs dans les principaux pays d ' Europe occidentale, c'est bien une confirmation de l'analyse selon laquelle :
- le chômage deviendra "un élément essentiel du développement des luttes ouvrières jusque-là la période révolutionnaire...
- les ouvriers au chômage tendront de plus en plus à se retrouver aux avant-postes des combats de classe."(Résolution du 6ème Congrès du CCI).
Une autre confirmation apportée par la dernière période concerne l'organisation des chômeurs : ce qu'a montré une nouvelle fois 1'expérience de la Conférence de Gottingen en RFA (en 1985) de même que de plusieurs comités de chômeurs comme celui de Toulouse en France, c'est que, fondamentalement, l'organisation des chômeurs est à l'image de celle de l'ensemble de la classe : elle surgit et se centralise dans la lutte et pour les besoins de la lutte. Même si les comités de chômeurs peuvent exister de façon plus durable que les comités de grève, toute tentative pour maintenir en vie de tels organes, de les doter d'une structure centralisée en dehors de tels besoins, ne peut que les conduire à devenir tout autre chose que des organisations unitaires de lutte : au meilleur des cas, des groupes ouvriers de discussion, au pire de nouveaux syndicats.
16) Les luttes en Belgique apportent enfin une autre confirmation de ce que les révolutionnaires ont mis en évidence depuis le surgissement historique du prolétariat à la fin des années 60 et plus particulièrement avec 1'accélération considérable de l'histoire qui marque les années 80 : du fait que la crise laisse de moins en moins de répit à la bourgeoisie et que celle-ci est amenée à en laisser de moins en moins à la classe ouvrière,, cette dernière est conduite, au cours d'une même génération, à accumuler les expériences de lutte contre le capital et "cette accumulation d'expériences de lutte du prolétariat, comme la proximité de plus en plus grande entre chacune d'elles, constitue un élément essentiel de prise de conscience par l'ensemble de la classe (des conditions et des véritables enjeux de son combat."(Ibid.)
Ainsi, il est clair qu'en Belgique, les ouvriers ont été capables de donner une telle ampleur à leurs combats du printemps 86 parce qu'ils avaient tiré et conservé de nombreux enseignements des luttes menées trois ans auparavant. C'est là un phénomène qui tendra à se généraliser et s'intensifier dans tous les pays centraux du capitalisme, ce qui donne la mesure des potentialités de lutte considérables, d'une ampleur inconnue jusque-là présent, qui existent dans ces pays et que ne doivent pas sous-estimer les révolutionnaires. Et cela d'autant plus que, contrairement à ce qui s'était déroulé dans le passé où la récession de 74-75 avait frappé une classe ouvrière en recul momentané, où celle de 81-82 est intervenue alors que le prolétariat subissait encore le poids de la défaite de 81 en Pologne, la récession qui s'annonce va rencontrer et impulser des luttes ouvrières en plein essor.
Toutefois il serait faux et dangereux de s'imaginer que, d'ores et déjà, est ouvert un chemin rectiligne vers la période révolutionnaire, La classe ouvrière est encore loin d'une telle période. Pour y parvenir elle doit opérer en son sein toute une transformation qui fera de la classe exploitée qu'elle est au sein du capitalisme - et à travers ses luttes comme classe exploitée - la classe révolutionnaire capable de prendre en charge l'avenir de l'humanité. C'est dire toute la dimension et la difficulté du chemin qu'il lui reste à parcourir, notamment pour se défaire de toute la pression de 1’idéologie dominante qui pèse sur elle et tout particulièrement pour venir à bout, à travers des confrontations répétées et de plus en plus conscientes, des multiples mystifications et pièges que la bourgeoisie, sa gauche et ses syndicats, opposent et continueront d'opposer à ses luttes et à sa prise de conscience. Même condamnée historiquement, et telle un fauve blessé à mort, la bourgeoisie continuera à se défendre bec et ongles jusqu'au bout, et l'expérience montre à quel point elle est capable d'inventer en permanence de nouveaux pièges visant à défaire le prolétariat, ou au moins à ralentir sa progression.
C'est pourquoi il importe de souligner le caractère heurté du combat de la classe ouvrière, d'avoir en mémoire les enseignements déjà tirés par Rosa Luxemburg lors des combats de 1905 dans l'Empire russe, le fait notamment que la grève de masse, qui marque l'entrée dans une période révolutionnaire, est un "océan de phénomènes" aux apparences contradictoires, de multiples formes de lutte, d'avancées puis de reculs au cours desquels il semble que se soit éteint le feu de la lutte, mais qui ne font que préparer des combats encore plus vastes.
Malgré leurs limites et bien qu'elles fussent encore bien loin de la grève de masse (laquelle constitue une perspective à long terme dans les pays avancés) les récentes luttes en Belgique, avec leurs divers rebondissements, nous confirment la nécessité de prendre en compte cette démarche heurtée, de ne pas enterrer un mouvement dès ses premiers revers, de garder confiance dans toutes les potentialités qu'il peut receler et qui ne s'expriment pas immédiatement.
S'il appartient aux révolutionnaires de souligner aux yeux de leur classe toute l'importance et toutes les potentialités de ses luttes actuelles, il leur appartient aussi de lui montrer la longueur et la difficulté du chemin à parcourir et cela, non pour la démoraliser, mais au contraire pour lutter contre la démoralisation qui menace après chaque revers. C'est le propre des révolutionnaires que d'exprimer au plus haut point ces qualités de la classe porteuse du futur de l'humanité : la patience, la conscience de l'ampleur immense de la tâche à accomplir, une confiance sereine mais indestructible en l'avenir.
25/6/86
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Conscience et organisation:
Où en est la crise économique ? : l’impasse
- 2895 reads
LA CRISE S'APPROFONDIT LA GUERRE COMMERCIALE S'EXACERBE
LES ATTAQUES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE S'INTENSIFIENT
Devant une population de travailleurs sceptiques, fatigués de voir le chômage s'accroître inexorablement depuis 15 ans et d'entendre tout aussi régulièrement que "la fin des difficultés de l'économie est proche", les gouvernements ont crié, au début 86, sur tous les toits, que cette fois-ci on commençait à voir le bout du tunnel -à condition, évidemment, que les travailleurs acceptent encore quelques sacrifices. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole s'effondraient sur le marché mondial et que le cours du dollar baissaient. La presse parlait de "contre-choc pétrolier", de la "manne pétrolière" qui allait tout résoudre. Le cauchemar tendrait à sa fin.
Six mois plus tard les faits sont là : les capitaux des pays industrialisés ont bien réalisé des économies sur la facture, pétrolière évaluées à 60 milliards de dollars, mais le chômage non seulement ne diminue pas mais ne fait que s'accroître et les annonces de nouveaux licenciements dans tous les secteurs se multiplient dans tous les pays.
Quant aux plans d'austérité, tous les gouvernements ne font quel es renforcer.
L'économie américaine ne cesse de ralentir sa croissance pour connaître au 2ème trimestre 86 son taux de croissance le plus faible depuis "l'année noire" de 1982 (+1,1%).
Le Japon, dont la production dépend plus que jamais directement de ses exportations vis-à-vis des USA, connaît pour la première fois depuis 1975 des taux de croissance négatifs (-0,5% du PNB au premier trimestre) et le spectre d'une récession imminente. L'Europe subit, tout carme le Japon, les effets de l'essoufflement de l'économie US et les prévisions de croissance sont toutes successivement révisées à la baisse.
OU EST PASSEE LA "MANNE PETROLIERE" ?
La chute du prix du pétrole et du dollar s'est bien traduite depuis la fin 85 par d'importantes économies en particulier pour les capitaux des pays industrialisés importateurs de pétrole (on parle de 60 milliards de dollars, soit l'équivalent de la production annuelle totale d'un pays comme l'Autriche ou le Danemark). Mais qu'ont fait jusqu'à présent les capitalistes avec cet argent ? Dans les pays sous-développés importateurs de pétrole il n'aura servi qu'à tenter d'éponger un peu de l'énorme endettement extérieur. Dans les pays industrialisés, il n'a fait pour le moment qu'alimenter les spéculations de toutes sortes (métaux précieux, taux de change des monnaies...) et en particulier celle effrénée qui enflamme depuis un an les principales places boursières d'occident.
Confrontés à la tâche quasi impossible de réaliser de véritables investissements productifs (ouverture de nouvelles usines, embauche de nouvelle main d'oeuvre) les capitaux se réfugient dans des manoeuvres spéculatives. Les capitaux affluent, entre autre, aux bourses et les actions des entreprises montent à des vitesses foudroyantes sans que pour autant celles-ci se préparent significativement à investir ou produire plus. C'est ainsi qu'on assiste à ce phénomène aussi absurde que lourd de menaces d'effondrements financiers où l'en voit en un an, entre mai 85 et mai 86, le cours des actions littéralement exploser : +25% en Grande-Bretagne, +30% aux USA et au Japon, +38% en France, +45% en Allemagne, +206% en Italie ! Alors que les indices de la production industrielle stagnent ou reculent carrément : -0,8% en Grande-Bretagne, +0,6% aux USA, -1,7% au Japon (du jamais vu depuis 75), -1,8% en France, +1% en Allemagne, +1,2% en Italie.
La spéculation en de telles proportions est toujours un signe majeur de crise : elle traduit l'impuissance de la machine productive et le déclin du capital' réel au profit de ce que Marx appelait le capital fictif. Pour l'avenir, c'est l'accumulation d'une bombe financière car les profits ainsi contenus sont tout aussi fictifs.
Les économies provoquées par la chute du prix du pétrole ne se transforment pas en facteur de croissance dans les pays industrialisés importateurs car le problème de fond du capitalisme n'est pas un manque de ressources financières mais le manque de débouchés, de marchés solvables pour ses marchandises. Par contre, cette chute a des effets catastrophiques pour les pays exportateurs qui voient se réduire d'autant leur principale source de revenus. Au premier plan de ces victimes, l'URSS, et à travers elle, les pays de l'Est.
LA CHUTE DE PETROLE ET DU DOLLAR : DES MANIFESTATIONS D'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE LA CRISE ECONOMIQUE
Le pétrole n'est pas une matière première tout à fait comme les autres du fait de son importance militaire et économique et du fait que sa distribution et son traitement dans le monde dépendent pour l'essentiel des grandes "multinationales" pétrolières américaines... donc du Pentagone. Mais il n'en demeure pas moins une marchandise soumise à la pression des lois du marché. L'effondrement de son cours nominal n'est pas un phénomène isolé. Il s'intègre entièrement dans le phénomène global de l'actuelle baisse des cours des matières premières (entre 1983 et 85, le prix des matières premières agricoles exportées par les pays en voie de développement ont chuté de 13%, celui des minéraux, minerais et métaux de 8% ; indice CNUCED). C'est là encore un symptôme typique de crise économique, capitaliste. Il y a surproduction de matières premières non pas parce que leur production a particulièrement augmenté, au contraire, mais parce que les industries manufacturières qui les consomment, sont elles-mêmes de plus en plus confrontées à la surproduction. La baisse de leur prix est le signe d'une insuffisance croissante du marché mondial, de la surproduction généralisée de toutes les marchandises.
Quant à la chute du dollar elle a une signification immédiate qui traduit la situation catastrophique de la première puissance mondiale. Pour sortir de l'effondrement de la récession de 1982 le capital américain a dû recourir à une nouvelle fuite en avant dans l'endettement, en particulier par une foudroyante augmentation de son déficit public (cf. graphique). Entre 82 et 85 celui-ci a presque doublé, passant de 128 à 224 milliards de dollars (et on estime qu'il ne sera pas inférieur à 230 milliards en 86), ce qui équivaut à peu près à la production annuelle de l'Espagne et de la Belgique réunis, ou à l'endettement total du Mexique, Brésil et Venezuela réunis ! Quant à sa balance commerciale -la différence entre la valeur des exportations et des importations- son déficit est passé de 34 milliards de dollars en 82 à 124 en 85, soit une augmentation de 265% en 3 ans. De ce fait, on est arrivé à cette situation particulièrement significative de l'état de santé du capitalisme mondial que la première puissance économique est devenue l'Etat le plus endetté du monde.
La chute du cours du dollar est la manifestation de cet état de fait. Le capital américain est contraint de laisser tomber le cours de sa monnaie car d'une part il y trouve le principal moyen de réduire le montant de sa dette astronomique (libellée en dollars), d'autre part parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour améliorer la compétitivité de ses marchandises sur le marché mondial.
20 ANS APRES, LES PROBLEMES DES MARCHES POSES PAR LA FIN DE LA RECONSTRUCTION D'APRES-GUERRE REAPPARAISSENT AU GRAND JOUR AVEC UNE FORCE DECUPLEE
Mais au-delà de la signification immédiate de la baisse du dollar au niveau de l'économie américaine, on assiste à la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme mondial depuis la fin des années 60.
Pendant les années 50 et 60 (les "années dorées" disent aujourd'hui avec nostalgie les économistes bourgeois) l'économie mondiale a connu un développement basé essentiellement sur la dynamique de la reconstruction des puissances détruites pendant la 2è guerre mondiale. Les USA "exportaient massivement vers l'Europe et le Japon qui absorbaient tout aussi massivement les produits "made in USA" et le monde entier honorait le roi dollar comme de l'or. Cependant, dans la deuxième moitié des années 60, la reconstruction s'achève ([1] [1055]) : l'Europe et le Japon sont devenus des puissances qui, non seulement sont capables d'exporter plus qu'elles n'importent, mais qui en outre ne peuvent plus vivre sans exporter de plus en plus. Dès 1967 un puissant ralentissement de la croissance en Allemagne occidentale déclenche une première récession mondiale. Eh 15 ans celle-ci sera suivie de trois autres récessions chacune plus profonde et étendue que la précédente : 1970, 1975, 1982.
Le capitalisme occidental a jusqu'à présent surmonté ces récessions, en un premier temps -au début des années 70- en "trichant" sur ses propres lois, en abandonnant certains des aspects les plus contraignants de ses propres mécanismes, un peu comme un navire qui, commençant à faire eau de toutes parts, jette à l'eau une partie de son intérieur pour ralentir sa perte. Mais il y est parvenu partout en ayant recours de façon de plus en plus massive au crédit sous toutes ses formes, c'est-à-dire en repoussant à plus tard les échéances... et sans pour autant résoudre le problème de fond : son incapacité intrinsèque à créer lui-même de réels débouchés solvables suffisants pour absorber sa production.
Crédits massifs à certains pays sous-développés, aux, pays du bloc de l'Est, aux pays producteurs de pétrole, enfin crédits au gouvernement de la première puissance mondiale pour financer son armement.
C'est ainsi qu'on voit au cours des années 70 "le miracle brésilien", la modernisation industrielle de certains pays de l'Est (Pologne) avec des prêts occidentaux, le boom des pays pétroliers.
Mais au début des années 80 l'ensemble de ces crédits arrive à échéance : il ne suffit pas de construire des usines et de les faire tourner encore faut-il pouvoir vendre ce qu'elles produisent. Les pays qui ont acquis quelques nouvelles capacités industrielles, incapables de se faire une place dans un marché mondial sursaturé et dominé par les vieilles puissances, se déclarent les uns après les autres incapables de rembourser leurs dettes, et donc à posteriori incapables de continuer à acheter : on connaît la banqueroute du capital polonais en 1980.Celles des autres pays périphériques se succèdent les unes après les autres. Les importations des pays sous-développés non producteurs de pétrole qui croissaient encore en 1980 au rythme de 11% par an, chutent a -5% l’an en 1982. La croissance de celles des pays pétroliers de la périphérie passent de 21% en 1980 à 2% en 82 et -3% en 83.
La récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la 2de guerre mondiale fut la manifestation éclatante de la faillite de cette fuite en avant.
La "relance américaine" de 83-84, faite au prix des déficits que l'on cannait, empêchera que le système bancaire mondial, et donc le système économique lui-même, ne s'effondre totalement. Cependant, malgré les gigantesques moyens mis en oeuvre par le capital américain, la relance n'en sera pas une réellement : elle ne réussit pas à relancer l'économie des pays périphériques qui s'effondre, l'Europe elle-même ne parvenant qu'à stagner. Dès la mi-85 la "locomotive" donne tous les signes de l'essoufflement.
L'actuelle baisse du dollar, le développement vertigineux du protectionnisme américain, les mesures prises par le gouvernement US pour réduire son déficit public, sont la manifestation de la fin de cette quatrième tentative de "relance" d'un capitalisme mondial décadent qui, depuis près de 20 ans, s'enfonce dans des convulsions- toujours plus profondes et tragiques pour l'humanité, incapable de dépasser ses propres contradictions.
LES PERSPECTIVES
Contraction du marché mondial par la banqueroute des pays sous-développés - producteurs de pétrole ou non -, par celle de l'économie des pays de l'Est, par 1'incessibilité pour les grandes puissances de poursuivre la fuite en avant dans l'endettement, menaces d'effondrement bancaires et financiers, même les économistes bourgeois les plus optimistes ne se risquent plus à parler sérieusement de véritable relance.
L'avenir des différents capitaux du monde est celui de la plongée dans la récession et d'une exacerbation sans précédent d'une guerre commerciale sans quartiers pour les parts de marché entre les capitaux "survivants".
Plus le marché mondial se rétrécit et plus cette guerre devient et deviendra aiguë. Or l'arme principale dans cette concurrence pour les marchés, c'est la réduction des prix de vente et donc des coûts de production, celui de la force de travail en premier lieu.
Licenciements de la main d'oeuvre dans les secteurs considérés peu compétitifs, 'flexibilité" de la force de travail, généralisation du travail temporaire et précaire, réduction des salaires versés sous forme monétaire, réduction des salaires versés sous forme de prestations sociales - de la sécurité sociale aux allocations familiales en passant par les retraites, l'enseignement, la santé, etc.
De l'Australie à la Norvège, du Japon à la Belgique, de l'Argentine aux Etats-Unis, tous les gouvernements appliquent des plans dits "d'austérité" destinés à réduire les coûts de main d'oeuvre, à attaquer brutalement les conditions d'existence de la classe ouvrière, pour permettre au capital de survivre.
Plus que jamais la logique de l'exploitation capitaliste apparaît pour ce qu'elle est : la négation antagonique des intérêts les plus élémentaires des travailleurs.
La décomposition de ce système barbare et décadent se fait et se fera en réduisant les classes exploitées à une misère intenable. Mais, ce faisant, elle développe les conditions qui permettent au prolétariat mondial, à travers sa lutte de résistance, de réaliser enfin son unité internationale et de s'affronter à sa tâche historique : la destruction du capitalisme et la construction du communisme.
R.V.
[1] [1056] Voir notre brochure "La décadence du capitalisme" sur 1'analyse de l'évolution du capitalisme depuis la seconde guerre mondiale
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
1936 : la gauche mène le prolétariat à la boucherie impérialiste
- 4591 reads
Il y a 50 ans, en 1936, au printemps, explosait en
France une vague de grèves ouvrières spontanéescontre l'aggravation de
l'exploitation provoquée par la crise économique et le développement de l'économie
de guerre. En juillet, en Espagne, face soulèvement militaire de Franco,
l'ensemble de la classe ouvrière partait aussi en grève pour répondre à
l'attaque. Trotski crut voir le début d'une nouvelle vague
révolutionnaire internationale.
Cependant, en quelques mois, l'appareil politique de la gauche du capital, sachant se mettre à la tête de ces mouvements, parviendra à les saboter de l'intérieur, participera à leur répression et enfin, enfermant les ouvriers dans la fausse alternative fascisme/anti-fascisme, remplira le rôle de sergent-recruteur idéologique pour la préparation de ce qui allait être la 2ème boucherie inter-impérialiste mondiale.
Si nous consacrons, à l'occasion de cet anniversaire, deux articles sur ces événements, c'est parce qu'il est aujourd'hui indispensable :
- de dénoncer le mensonge colporté par "la gauche" du capital selon lequel celle-ci aurait été pendant ces événements 1'incarnation-des intérêts de la classe ouvrière, en montrant au contraire comment elle en fut le bourreau ;
- de rappeler les leçons tragiques de ces expériences, en particulier le piège fatal que constitue pour la classe ouvrière d'abandonner le terrain de la défense intransigeante de ses intérêts spécifiques, pour se soumettre aux nécessités d'un camp bourgeois contre un autre ;
- de mettre en évidence ce qui distingue les années 30 - marquées par la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution - de l'actuelle période historique Ou de nouvelles générations de prolétaires cherchent à se dégager des idéologies contre-révolutionnaires à travers une confrontation permanente et croissante contre le capital et cette même gauche ; une confrontation que le prolétariat ne pourra mener jusqu'à son terme, les révolution communiste, qu'en se réappropriant les leçons, si chèrement payées, de son expérience passée.
GUERRE D'ESPAGNE, répétition de la guerre mondiale
1986 marque le cinquantième anniversaire des événements de 1936 en Espagne. La bourgeoisie commémore cette date par des campagnes de falsification des faits, lançant le pernicieux message que les événements de 1936 auraient été une "révolution prolétarienne", alors qu'aujourd'hui, par contre, nous serions dans une situation de "recul et de défaites", de "crise de la classe ouvrière", de soumission toujours plus forte aux diktats du capitalisme.
Il est bien évident que cette leçon, que la bourgeoisie veut que nous tirions de ces événements passés, fait partie de toute sa tactique de dispersion, d'isolement, de division contre le développement des luttes ouvrières. Il s'agit de les noyer dans un soi-disant climat d'apathie et de démobilisation pour s'opposer à leur extension et leur unification.
Face à ces manoeuvres, notre position militante défend les potentialités immenses des luttes actuel les du prolétariat avec la même force qu'elle rejette le mensonge d'une "révolution sociale" en 1936. Nous nous réclamons du courage et de la lucidité de BILAN qui dénonçait, contre le courant, la tuerie impérialiste perpétrée en Espagne, et qui nous fournit la méthode qui nous permet d'affirmer aujourd'hui les potentialités de la lutte de classe dans les années 80 et d'assumer une intervention déterminée en son sein.
GUERRE IMPERIALISTE OU REVOLUTION PROLETARIENNE ?
Comment caractériser les événements qui se sont déroulés en Espagne à partir de 1931 et qui se sont accélérés à partir de 1936?
Notre méthode ne peut se fonder exclusivement sur la violence et la radicalité des heurts entre les classes qui secouèrent l'Espagne de l'époque, mais sur l'analyse du rapport de forces entre les classes à échelle capitaliste internationale et sur toute une époque historique
Cette analyse du cours historique nous permet de déterminer si les différents conflits et situations s'inscrivent dans un processus de défaites du prolétariat dans la perspective de la guerre impérialiste généralisée ou, par contre, dans un processus de montée de la lutte de classes s'orientant vers des affrontements de classe révolutionnaires.
Pour savoir dans quel cours s'inscrivent les événements de 1936, il faut répondre à une série de questions :
- quel était le rapport de forces mondial entre les classes ? Evoluait-il en faveur du prolétariat ou de la bourgeoisie ?
- quelle était l'orientation des organisations politiques du prolétariat ? Vers la dégénérescence opportuniste, la désagrégation et l'intégration dans le camp capitaliste ou, au contraire, vers la clarté et le développement de leur influence ? Plus concrètement : le prolétariat disposait-il d'un parti capable d'orienter ses combats vers la prise du pouvoir ?
- les conseils ouvriers se sont-ils développés et affirmés comme alternative du pouvoir ?
- les luttes prolétariennes ont-elles attaqué l'Etat capitaliste sous toutes ses formes et institutions ?
Face à ces questions notre méthode est celle de BILAN et des autres communistes de gauche (par exemple la minorité de la Ligue des Communistes Internationaux de Belgique à la tête de laquelle se trouvait Mitchell) : ils partent d'une analyse historique et mondiale du rapport de forces dans laquelle inscrivent les événements d'Espagne; ils constatent non seulement l'inexistence d'un parti de classe, mais la débandade et le passage dans le camp de la bourgeoisie de la grande majorité des organisations ouvrières; ils dénoncent la récupération rapide des organismes ouvriers embryonnaires du 19 juillet 1936 par l'Etat capitaliste et, surtout, ils élèvent leur voix contre le piège criminel d'une soi-disant "destruction" de l'Etat capitaliste républicain qui "disparaît" sous la couverture d'un "gouvernement ouvrier" détruisant le terrain de classe des ouvriers et les mène à la tuerie impérialiste de la guerre contre Franco.
Quel était le rapport de forces après les terribles défaites des années 20 ? De quelle manière la mort de l'Internationale communiste ainsi que la dégénérescence accélérée des partis communistes conditionnaient-elles la situation des ouvriers espagnols ? Que restait-il, en définitive, dans les années 30 ? Un cours vers l'affrontement entre les classes ?
Répondre à ces questions était vital pour déterminer s'il y avait ou non révolution en Espagne et, surtout, pour se prononcer sur la nature du violent conflit militaire établi entre les forces franquistes et les forces républicaines, pour voir leur rapport avec l'aggravation des conflits impérialistes qui frappent le monde à cette époque.
L'ABANDON DU TERRAIN DE CLASSE
Le 19 juillet 1936, les ouvriers déclarent la grève contre le soulèvement de Franco et vont massivement aux casernes pour désarmer cette tentative, sans demander la permission au Front Populaire ni au Gouvernement Républicain qui leur font autant de croche-pieds que possible. Unissant la lutte revendicative à la lutte politique, les ouvriers dans cette action arrêtent la main meurtrière de Franco. Mais une autre main meurtrière les paralyse en faisant semblant de leur serrer la main : c'est le Gouvernement Républicain, le Front Populaire, Companys, qui, avec l'aide de la CNT et du POUM, réussissent à faire que les ouvriers abandonnent le terrain de classe de la bataille sociale, économique et politique contre Franco et la République, et se déplacent sur le terrain capitaliste d'une bataille exclusivement militaire dans les tranchées et la guerre de positions, exclusivement contre Franco. Devant la riposte ouvrière du 19 juillet l'Etat républicain "disparaît", la bourgeoisie "n'existe plus", tous se cachent derrière le Front Populaire et les organismes "plus à gauche" tels que le Comité Central de Milices Antifascistes ou le Conseil Central de l'Economie. Au nom de ce "changement révolutionnaire" si facilement conquis, la bourgeoisie demande et obtient des ouvriers l'Union Sacrée autour du seul et unique objectif de battre Franco. Les sanglants massacres qui ont lieu par la suite en Aragon, à Oviedo, à Madrid, sont le résultat criminel de la manoeuvre idéologique de la bourgeoisie républicaine qui fait avorter les germes classistes du 19 juillet 1936.
Ayant quitté son terrain de classe, le prolétariat non seulement devra subir l’égorgement guerrier mais, en conséquence, il lui sera imposé toujours plus de sacrifices au nom de la production pour la guerre "de libération" : réduction des salaires, inflation, rationnements, journées de travail épuisantes... Désarmé politiquement et physiquement, le prolétariat de Barcelone se soulèvera de désespoir en mai 1937 et sera vilement massacré par ceux qui l'avaient bassement trompé : "Le 19 juillet 1936, les prolétaires de Barcelone, AVEC LEURS POINGS NUS, écrasèrent l'attaque de bataillons de Franco, ARMES JUSQU'AUX DENTS. Le 4 mai 1937, ces mêmes prolétaires, MUNIS D'ARMES, laissent sur le pavé bien plus de victimes qu'en juillet lorsqu'il doivent repousser Franco et c'est le gouvernement antifasciste -comprenant jusqu'aux anarchistes et dont le POUM est indirectement solidaire- qui déchaîne la racaille des forces répressives contre les ouvriers." (BILAN "Plomb, mitraille, prison : ainsi répond le front populaire aux ouvriers de Barcelone osant résister à l'attaque capitaliste") "Les fronts militaires : une nécessité imposée par les situations ? Non ! Une nécessité pour le capitalisme afin d'encercler et d'écraser les ouvriers ! Le 4 mai 1937 apporte la preuve éclatante qu'après le 19 juillet, le prolétariat avait à combattre Companys, Giral, tout autant que Franco. Les fronts militaires ne pouvaient que creuser la tombe des ouvriers parce qu'ils représentaient les fronts de la guerre du capitalisme contre le prolétariat. A cette guerre, les prolétaires espagnols -à 1 'exemple de leurs frères russes de 1917- ne pouvaient riposter qu'en développant le défaitisme révolutionnaire dans les deux camps de la bourgeoisie : le républicain comme le "fasciste", et en transformant la guerre capitaliste en guerre civile en vue de la 'destruction totale de l'Etat bourgeois. (BILAN, idem)
L'argument" selon lequel en Espagne 1936, il y a eu une "révolution" est d'une incroyable légèreté et implique une totale ignorance des conditions d'une réelle révolution prolétarienne.
Le contexte international était à la défaite et la désagrégation ouvrières :-"Si le critère internationaliste veut dire quelque chose, il faut affirmer que sous le signe d'une croissance de la contre-révolution au niveau mondial, 1'orientation politique de l'Espagne, entre 1931 et 1936, ne pouvait que poursuivre une direction parallèle et non le cours inverse, d'un développement révolutionnaire. La révolution ne peut atteindre son plein développement que comme produit d'une situation révolutionnaire à échelle internationale. Ce n'est que sur cette base que nous pouvons expliquer les défaites de la Commune de Paris et de la Commune russe de 1905, ainsi que la victoire du prolétariat russe en octobre 1917" (Mitchell : "La guerre en Espagne", janvier 1937).
Les organisations politiques prolétariennes souffraient, dans leur immense majorité, une terrible débandade : les PC s'intégraient définitivement à leurs capitaux nationaux respectifs, le trotskysme se perdait dramatiquement dans l'opportunisme, les rares organisations fidèles au prolétariat ("Bilan", etc.) souffraient d'un terrible isolement : "Notre isolement n'est pas fortuit : il est la conséouence d'une profonde victoire du capitalisme mondial qui est parvenu à gangrener jusqu'aux groupes de la gauche communiste dont le porte-parole a été jusqu'à ce jour Trotsky." (BILAN "L'isolement de notre fraction devant les événements d'Espagne"). "S'il restait le moindre doute sur le rôle fondamental du parti dans la révolution, l'expérience espagnole depuis juillet 1936 aurait suffi pour l'effacer définitivement. Même si on assimile l'attaque de Franco à l'aventure de Kornilov en août 1917(ce qui est faux historiquement et politiquement le contraste entre les deux évolutions est impressionnant L'une, en Espagne détermine la collaboration progressive entr les classes jusqu'à l'union sacrée de toutes les forces politiques ; l'autre, en Russie se dirige vers une élévation de la lutte de classes qui culmine dans 1'insurrection victorieuse, sous le contrôle vigilant du parti bolchevique, trempé, tout au long de quinze années de lutte, par la critique et la lutte armée".(Mitchell : "La guerre en Espagne", janvier 1937).
Il ne peut y avoir une débandade opportuniste vers la bourgeoisie de toutes les forces révolutionnaires en même temps que les masses ouvrières vont de victoire en victoire. C'est tout le contraire : la montée de la lutte de classes est le résultat, en même temps qu'elle l'impulse, d'un mouvement de clarification et de regroupement des révolutionnaires et le fait que ceux-ci se trouvent réduits à leur plus simple expression traduit, en même temps qu'il le renforce, un cours de défaites de la classe ouvrière.
LA SOUMISSION A L'ETAT BOURGEOIS
Malgré la propagande qui a été faite sur la "valeur révolutionnaire" des Comités d'Usine, les collectivités, etc. , il n'a pas existé non plus de conseils ouvriers en 1936 : "Immédiatement étouffés, les comités d'usine, les comités de contrôle des entreprises où l'expropriation ne fut pas réalisée (en considération du capital étranger ou pour d'autres considérations) se transformèrent en organes devant activer la production et, par là, furent déformés dans leur signification de classe. Il ne s'agissait pas d'organismes créés pendant une grève insurrectionnelle pour renverser l'Etat, mais d'organismes orientés vers 1'organisation de la guerre, condition essentielle pour permettre la survivance et le renforcement de cet Etat'.' (BILAN "La leçon des événements d'Espagne")
Pour entraîner les ouvriers dans la boucherie inter capitaliste, tous, de Companys au POUM, d'Azana à la CNT "cèdent le pouvoir" aux organismes ouvriers :
"En face d'un incendie de classe, le capitalisme ne peut même pas songer à recourir aux méthodes classiques de la légalité. Ce qui le menace, c'est 1'INDEPENDANCE de la lutte prolétarienne conditionnant l'autre étape révolutionnaire vers l'abolition de la domination bourgeoise. Le capitalisme doit donc renouer les fils de son contrôle sur les exploités. Ces fils, qui. étaient précédemment la magistrature, la police, les prisons, deviennent dans la situation extrême de Barcelone, les Comités des Milices, les industries socialisées, les syndicats ouvriers gérant les secteurs essentiels de l'économie, les patrouilles de vigilance, etc." (BILAN "Plomb, mitraille, prison : ainsi répond le front populaire aux ouvriers de Barcelone osant résister à l'attaque capitaliste")
En fin de comptes, le pire des mensonges a été le mirage criminel de la soi-disant "destruction" ou "disparition" de l'Etat républicain. Laissons la voix marxiste de BILAN et la minorité de la Ligue des Communistes dénoncer ce mensonge :
1) "En ce qui concerne 1'Espagne, on a souvent évoqué la révolution prolétarienne en marche, on a parlé de la dualité de pouvoirs, le pouvoir "effectif" des ouvriers, la gestion 'socialiste', la 'collectivisation' des usines et de la terre, mais à aucun moment n'ont été posés sur des bases marxistes le problème de l'Etat ni celui du parti." (Mitchell :"La guerre d'Espagne")
2) "Ce problème fondamental (il se réfère à la question de l'Etat) a été remplacé par celui de la destruction des 'bandes fascistes' et l'Etat bourgeois est resté debout en adoptant une apparence 'prolétarienne'. On a permis que ce qui domine soit l'équivoque criminelle sur sa destruction partielle et on a juxtaposé à l'existence d'un 'pouvoir ouvrier réel' le 'pouvoir de façade' de la bourgeoisie, qui se concrétisera en Catalogne dans deux organismes 'prolétariens' : le Comité Central des Milices Antifascistes et le Conseil d'Economie." (Mitchell, idem)
3) "Le Comité Central des milices représente l'arme inspirée par le capitalisme pour entraîner, par l'organisation des milices, les prolétaires en dehors des villes et de leurs localités, vers les fronts territoriaux où ils se feront massacrer impitoyablement. Il représente l'organe qui rétablit l'ordre en Catalogne, non avec les ouvriers, mais contre ceux-ci, qui seront dispersés sur les fronts. Certes l'armée régulière est pratiquement dissoute, mais elle est reconstituée graduellement avec les colonnes de miliciens dont 1'Etat-Major reste nettement bourgeois, avec les Sandino, les Villalba et consorts. Les colonnes sont volontaires et elles peuvent le rester jusqu'au moment où finiront la griserie et 1 'illusion de la révolution et réapparaîtra la réalité capitaliste. Alors on marchera à grands pas vers le rétablissement officiel de l'armée régulière et vers le service obligatoire." (BILAN "La leçon des événements d'Espagne")
4) "Les ressorts essentiels de l'Etat bourgeois sont restés intacts :
- l'armée a pris d'autres formes - en devenant des milices- mais elle a conservé son contenu bourgeois en défendant les intérêts capitalistes de la guerre antifasciste ;
-la police, formée par les gardes d'assaut et les gardes civils, n'a pas été dissoute mais s'est cachée pendant un temps dans les casernes pour reparaître au moment opportun ;
- la bureaucratie du pouvoir central a continué à fonctionner et a étendu ses ramifications à l'intérieur des milices et du Conseil de 1'Economie dont elle n'a pas du tout été un agent exécutif, mais au contraire à qui elle a inspiré des directives en accord avec les intérêts capitalistes." (Mitchell, idem)
5) "Les tribunaux ont été rétablis rapidement dans leur fonctionnement avec l'aide de 1'ancienne magistrature, plus la participation des organisations "antifascistes". Les Tribunaux populaires de Catalogne partent toujours de la collaboration entre les magistrats professionnels et des représentants de tous les partis. [...] Les banques et la Banque d'Espagne sont restées intactes et partout des mesures de précaution furent prises pour empêcher (même par la force des armes) la mainmise des masses." (BILAN, op. cit.)
ANNEES 30 - ANNEES 80
Nous avons déjà vu que, comme Marx l'a dit, l'idéologie bourgeoise nous présente la réalité cul par dessus tête : les années 30 seraient ainsi des années "révolutionnaires" tandis qu'aujourd'hui nous serions dans une époque "contre-révolutionnaire".
Si la bourgeoisie insiste tellement sur cette réalité renversée c'est précisément à cause de la profonde crainte qu'elle ressent devant les potentialités de la lutte ouvrière à notre époque et parce que, en même temps, elle regrette ces années 30 où elle a pu enrôler le prolétariat pour la boucherie impérialiste et lui présenter chacune de ses défaites comme de "grandes victoires".
A L'EPOQUE, en 1936, les mystifications sur l’anti-fascisme, la "défense de la démocratie", faire prendre parti entre fractions opposées du capital (fascisme/anti-fascisme, droite/gauche, Franco/République), polarisent de manière croissante le prolétariat mondial, augmentant sa démoralisation et son adhésion aux plans de guerre de la bourgeoisie, culminant dans la terrible boucherie de 1939-45.
AUJOURD'HUI les mystifications de l’anti-fascisme, la défense nationale, le soutien à la Russie "patrie du socialisme", convainquent de moins en moins les ouvriers qui montrent une hostilité et une méfiance croissantes devant de tels mensongers. Cela ne s'est certes pas traduit, pour le moment, en une compréhension massive de la nécessité d'opposer une alternative révolutionnaire à la débâcle du capitalisme, laissant prévaloir trop souvent encore une attitude de scepticisme et d'expectative. Mais cette attitude peut et doit se transformer, avec le développement des luttes ouvrières contre les attaques toujours plus brutales et massives du capital en crise, et avec l'intervention des révolutionnaires en leur sein.
A L'EPOQUE, les gouvernements de gauche, les Fronts Populaires, ont suscité une ample adhésion de la part de la classe ouvrière, au point que ce sont eux qui, dans beaucoup de pays (France, Suède, Espagne) ont assumé la tâche de convaincre les ouvriers d'accepter "pour le bien de la Patrie", tous les sacrifices imaginables.
AUJOURD'HUI, la classe ouvrière s'oppose, en défense de ses besoins en tant que classe, à tout gouvernement, fût-il de droite ou de gauche, au point d'"appliquer dans la pratique" la consigne que BILAN défendait sans succès dans les années 30 : "Ne pas faire le jeu de la gauche quand on lutte contre la droite et ne pas avantager la droite quand, on lutte contre la gauche". Une démonstration concluante en est que les gouvernements "socialistes" en France, en Grèce, en Espagne, en Suède, etc. ont eu affaire à des ripostes massives et acharnées des travailleurs qui ne se sont pas laissés tromper par le chantage selon lequel ils seraient en train de s'opposer à "leur" gouvernement.
A L'EPOQUE, les partis prolétariens, créés lors de la formation de la 3ème Internationale, les partis communistes, menaient à terme un processus tragique de dégénérescence opportuniste en s'intégrant définitivement au camp capitaliste et en utilisant leur passé ouvrier -qui était indiscutable- pour cautionner une politique de défense de l'Etat bourgeois. Quant aux fractions communistes qui s'en étaient dégagées et poursuivaient le travail de défense intransigeante des positions de classe, elles étaient de plus en plus réduites à l'isolement et se heurtaient à l'incompréhension croissante des ouvriers.
AUJOURD'HUI les organisations qui ont su rester fidèles à la continuité historique des positions communistes élargissent leur écho dans la classe, en même temps que surgissent, un peu partout, des noyaux, des groupes, des éléments, qui n'ont aucune illusion sur les forces de gauche du capital et recherchent véritablement une cohérence communiste. Tout cela, bien qu'à ses débuts et encore entravé par les doutes et les hésitations, constitue la base d'un processus de décantation politique qui conduit à la constitution du Parti Communiste Mondial, d'une nouvelle Internationale du prolétariat.
En d'autres termes, alors que les luttes ouvrières de 1936, en particulier en Espagne, s'inscrivaient dans le cours ouvert par la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23, et le triomphe de la contre-révolution en Allemagne, Italie, Europe centrale, Russie, les combats ouvriers de notre époque s'inscrivent dans un processus de reconstitution de l'unité du prolétariat mondial qui se dégage de l'emprise de l'idéologie de la classe dominante pour livrer de nouvelles batailles décisives contre le capital.
LES MANOEUVRES DE LA GAUCHE : UNE EXPERIENCE A NE PAS OUBLIER
La comparaison des deux époques nous conduit à une autre leçon fondamentale : la continuité qui existe dans le travail anti-ouvrier des partis de gauche et des syndicats, à l'époque et aujourd'hui. Leurs tactiques ne sont pas les mêmes car, comme nous venons de le voir, les différences dans le rapport de forces entre les classes et dans l'état de la conscience ouvrière sont évidentes, mais ce qui n'a pas changé est leur fonction anti-ouvrière en tant que bastion fondamental de l'Etat capitaliste contre les luttes ouvrières.
Malgré les conditions historiques différentes, un examen des virages, des manoeuvres des partis de gauche, des syndicats -particulièrement de la CNT- dans l'Espagne de 1936, peut nous offrir des leçons pour combattre leurs manoeuvres et pièges dans les luttes actuelles.
En 1931, le PSOE, qui avait déjà montré son intégration au capital espagnol avec sa collaboration ouverte avec la dictature de Primo de Rivera (Largo Caballero a été conseiller d'Etat du dictateur et l'UGT faisait office d'indicateur dans les usines) a fait alliance avec les républicains et, jusqu'en 1933, a participé à la féroce répression des luttes ouvrières et paysannes,
Mais, comme nous l'avons indiqué "La gauche n'accomplit pas [sa fonction capitaliste] uniquement et même pas généralement au pouvoir. La plupart du temps, elle 1'accomplit plutôt en étant dans 1'opposition parce qu'il est généralement plus facile de l'accomplir en étant dans l'opposition qu'au pouvoir. (...) Leur présence au gouvernement les rend plus vulnérables, leur usure au pouvoir plus grande et leur crédibilité se trouve plus rapide ment mise en- question. Dans une situation d'instabilité, cette tendance est encore accélérée. Or, la baisse de leur crédibilité les rend inaptes pour assurer leur fonction d'immobilisation de la classe ouvrière" (Revue Internationale n°18, p.25, 26 : "Dans l'opposition comme au gouvernement, la "gauche" contre la classe ouvrière").
Pour ces raisons, le PSOE qui, en janvier 1933, se tachait les mains de sang ouvrier à Casasviejas, quittait le gouvernement en mars et, suivi par l'UGT, "radicalisait" son langage au point que Largo Caballero, ancien conseiller d'Etat de Primo de Rivera et ministre du Travail de 1931 à 1933, devenait le "Lénine espagnol" !
Dans l'opposition, le PSOE promettait aux ouvriers la "révolution" et parlait partout d'"immenses dépôts d'armes prêts pour quand viendrait le moment opportun de réaliser l'insurrection". Avec cette "musique céleste", il s'opposait aux luttes revendicatives des ouvriers qui, soi-disant, "portaient préjudice aux plans d'insurrection" et tout ce qu'il visait était, de même que son compère en Autriche à la même époque, d'amener les ouvriers à un affrontement suicide avec l'Etat bourgeois pour les saigner cruellement.
En octobre 1934 les ouvriers des Asturies sont tombés dans ce piège. Leur héroïque insurrection dans les zones minières et dans la ceinture industrielle d'Oviedo et de Gijon s'est trouvée complètement isolée par le PSOE qui a empêché par tous les moyens que dans le reste de l'Espagne, particulièrement à Madrid, les ouvriers ne secondent le mouvement. Tout au plus a-t-il toléré des grèves "pacifiques", incapables d'étendre le front ouvert par les mineurs des Asturies.
Cette manoeuvre criminelle du PSOE et de l'UGT a permis au gouvernement républicain d'écraser la révolte ouvrière par une répression sauvage. A la tête des troupes du massacre se trouvait Franco, qualifié par les partis de l'époque de général "professionnel, loyal à la République".
Mais le massacre des Asturies a ouvert une répression féroce dans tout le pays : tout militant ouvrier remarqué était mis en prison sans que le "Lénine espagnol", Largo Caballero, ne bougeât le petit doigt.
Le doigt que le PSOE a bougé, en concordance avec une tactique générale mise en pratique dans d'autres pays européens, a été le fameux "Front Populaire". Ensemble avec le PSOE, l'UGT et les partis républicains (Azana et Cie) se sont ligués le PCE (illustrant par là son passage définitif dans la défense de l'Etat bourgeois), la CNT et le POUM, deux organismes qui avaient jusqu'alors été ouvriers, qui l'ont appuyé "de manière critique".
Le "Front Populaire" prétendait ouvertement remplacer la lutte ouvrière par la farce électorale, la lutte en tant que classe contre toutes les fractions du capital par la lutte sur le terrain de ce dernier contre sa fraction "fasciste" au bénéfice de son aile "antifasciste". A la lutte revendicative d'ouvriers et de paysans pauvres, il opposait un illusoire et ridicule "programme de réformes" qui ne serait jamais appliqué. A la seule perspective possible pour le prolétariat (sa révolution communiste) il opposait une fantasmagorique "révolution démocratique".
Il s'agissait là d'un crime de démobilisation des ouvriers, de dévoiement de leur combat sur le terrain de la bourgeoisie, c'était une manière concrète de les désarmer, de briser leur unité et leur conscience, de les livrer, pieds et poings liés, aux militaires qui, depuis le jour même du triomphe du Front Populaire (février 1936), préparaient tranquillement un bain de sang parmi les ouvriers avec l'assentiment tacite du gouvernement "populaire".
Quand enfin Franco s'est soulevé le 18 juillet, le Front Populaire, montrant son vrai visage, n'a pas seulement essayé de calmer les ouvriers et de les renvoyer chez eux, mais a refusé catégoriquement de répartir les armes. Dans une fameuse déclaration, le Front Populaire appelait au calme et lançait sa devise "LE GOUVERNEMENT COMMANDE, LE FRONT POPULAIRE OBEIT", ce qui revenait concrètement à demander aux ouvriers de rester passifs et obéissants afin de se laisser massacrer par les militaires. C'est ce qui est arrivé à Séville, où les ouvriers ont suivi les consignes de calme et d'attente "des ordres du gouvernement", données par le très "antifasciste" PCE, ce qui a permis au général Queipo del Llano de prendre facilement le contrôle et d'organiser un terrible bain de sang.
Ce ne fut, comme nous l'avons vu plus haut, que le soulèvement pour leur propre compte des ouvriers à Barcelone et dans d'autres centres industriels, sur leur propre terrain de classe, unissant la lutte revendicative à la lutte politique, qui a paralysé pour un moment le bourreau Franco.
Mais les forces de gauche du capital, les PSOE-PCE et compagnie, ont su réagir à temps et ont déployé une manoeuvre qui allait devenir décisive. Rapidement, en 24 heures, ils se sont mis à la tête du soulèvement ouvrier et ont essayé de l'acheminer -avec succès- vers l'affrontement exclusivement contre Franco -laissant ainsi le chemin libre à la République et au Front Populaire- et exclusivement sur un terrain militaire, hors du terrain social, revendicatif et politique, hors des grandes concentrations industrielles et urbaines.
En vingt-quatre heures le gouvernement de Martinez Barrio -formé pour négocier avec tes militaires rebelles et organiser avec eux le massacre des ouvriers- a été remplacé par le gouvernement de Giral, plus "intransigeant" et "antifasciste".
Mais l'essentiel a été de s'assurer l'appui inconditionnel de la CNT, qui regroupait le gros des ouvriers en Espagne et qui, rapidement, a déconvoqué la grève et a orienté les organismes ouvriers créés spontanément dans les usines et quartiers ouvriers -les Comités, les Milices, les Patrouilles de Contrôle- vers la collaboration "antifasciste" avec les autorités républicaines (les Companys, Azana, Front Populaire, etc.) et vers leur transformation en agences de recrutement d'ouvriers pour la boucherie sur le front.
Avec ce pas culminait la dégénérescence de la CNT qui s'intégrait définitivement à l'Etat capitaliste. La présence de ministres cénétistes au gouvernement catalan d'abord et au gouvernement central ensuite, présidé par l'inévitable Largo Caballero, ne faisait que sceller cette trajectoire. Tous les organismes dirigeants de la CNT déclarèrent une guerre féroce contre les rares courants qui, même dans une terrible confusion, luttaient pour défendre une position révolutionnaire. Ce fut le cas, par exemple, des groupes autour de la revue "Les Amis du Peuple". Ils se sont trouvés isolés, expulsés, envoyés aux positions les plus dangereuses du front, dénoncés indirectement à la police républicaine, etc., par toute la bande des Garcia Oliver, Montseny , Abad de Santillan, et Cie.
La manoeuvre du Front Populaire de la "guerre antifasciste, a été définitive et a conduit les ouvriers espagnols à une tuerie aux proportions monstrueuses : plus d'un million de morts. Mais la tuerie s'est pro longée par des souffrances incroyables à l'arrière pas seulement franquiste mais aussi républicaine. Là, au nom de la guerre "antifasciste", les quelques conquêtes ouvrières concédées pour calmer le soulèvement ouvrier du 19 juillet 1936, ont été immédiatement annulées, la CNT ayant été la première à le demander. Les salaires de misère, les journées épuisantes, les rationnements, la militarisation du travail, ont scellé une exploitation sauvage et totale des ouvriers.
Le PCE fut alors le principal parti de l'exploitation, du sacrifice pour la guerre et la répression anti-ouvrière.
Le parti stalinien avait comme mot d’ordre "Non aux grèves dans l'Espagne démocratique", et cela était plus qu'un mot d’ordre, c'était le drapeau pour empêcher, au moyen de la police -qu'il contrôlait en majorité- toute lutte, toute revendication dans les usines. C'est la succursale catalane du PCE, le PSUC, qui a organisé, en janvier 1937, une manifestation "populaire" contre les Comités d'Usine trop réticents aux impératifs de la militarisation.
Le PCE est devenu, dans l'Espagne républicaine, le parti de l'ordre. C'est comme ça qu'il a acquis l'estime de nombreux militaires, propriétaires agricoles et industriels, fonctionnaires de la police, et de nombreux et qualifiés "senontos" d'extrême-droite qui y ont adhéré ou l'ont appuyé. Avec cet aval, il a rapidement contrôlé les appareils répressifs de l'Etat républicain, vidant les prisons des fascistes et patrons et les remplissant d'ouvriers combatifs.
Le point culminant de ces bons et loyaux services rendus au capitalisme a été la tuerie de mai 1937. Les ouvriers de Barcelone, en ayant assez de tant de souffrances et d'exploitation, se sont soulevés devant la provocation de la police face aux travailleurs du téléphone. Le PCE a immédiatement organisé une répression féroce, déplaçant des troupes de Valence et du front d'Aragon. La CNT et le POUM, faisant des appels au "calme", à la "réconciliation entre frères", etc., ont collaboré en immobilisant les ouvriers. Franco a arrêté momentanément les hostilités pour faciliter aux bourreaux staliniens l'écrasement des ouvriers.
La guerre d'Espagne se prolongea jusqu'en 1939. Elle se conclut par la victoire de Franco et l'établissement du régime politique que l'on sait. L'effroyable répression qui s'en suivit sur les prolétaires qui a/aient participé à la guerre dans le camp républicain. acheva la saignée que la bourgeoisie venait d'effectuer sur un des secteurs les plus combatifs du prolétariat à cette époque. Les horreurs de la dictature obscurantiste firent en partie oublier celles de la "dictature-démocratique" de la République du début des années 30 et tout le travail de sabotage et répression des luttes ouvrières par les forces "de gauche" du capital (PCE, PSOE, CNT) pendant les années de la guerre civile. Cinquante ans après, les prolétaires espagnols subissent le pouvoir et l'exploitation capitaliste à nouveau sous la forme de la démocratie bourgeoise, franquistes et républicains réconciliés derrière une même armée et une même police pour préserver et gérer l'ordre social existant.
Cinquante ans après, alors que la résistance ouvrière contre les effets de la crise économique capitaliste fait de nouveau se reconstituer, aux quatre coins de la planète, l'armée des prolétaires de tous les pays, les avertissements de BILAN de 1936, les leçons de la tragédie espagnole, doivent être clairement assimilés : les prolétaires ne peuvent se défendre efficacement qu'en comptant uniquement sur leurs propres forces, imposant l'autonomie de leur classe. Tout abandon du terrain tracé par la défense intransigeante de leurs intérêts de classe au profit d'une quelconque alliance avec quelque fraction que ce soit de la classe dominante, se fait à leurs dépens et conduit aux pires défaites.
Adalen
LE "FRONT POPULAIRE" EN FRANCE, du dévoiement des grèves à l'union nationale (extraits de Bilan)
"Le Front Populaire s'est avéré être le processus réel de la dissolution de la conscience de classe des prolétaires, l'arme destinée à maintenir .dans toutes les circonstances de leur vie sociale et politique les ouvriers sur le terrain du maintien de la société bourgeoise." BILAN N° 31 - Mai-juin 1936
En ce début des années 30, 1 'anarchie de la production capitaliste est totale. La crise mondiale jette sur le pavé des millions de prolétaires. Seule 1'économie de guerre, pas seulement la production massive d'armement mais aussi toute 1'infrastructure nécessaire à cette production, se développe puissamment. Autour d'elle 1'industrie s'organise ; elle impose les nouvelles organisations du travail dont le "taylorisme" sera un des plus beaux rejetons.
Sur le front social, malgré la puissante contre-révolution "venue de l'intérieur" en Russie, malgré l'écrasement du prolétariat le plus puissant du monde, la classe ouvrière d'Allemagne, le monde vacille, semble encore hésiter à la croisée des chemins entre une nouvelle guerre mondiale ou un nouveau souffle révolutionnaire, seul capable d'endiguer la terrible perspective et d'ouvrir les portes d'un nouvel avenir. L'écrasement du mouvement ouvrier en Italie, les fronts populaires ([1] [1057]) de France et d'Espagne, les idéologies d'union nationale, alimenté par la plus colossale duperie et escroquerie idéologique de ce siècle -1'"antifascisme"- auront finalement raison de ces dernières hésitations. En 1939 le monde basculera dans la boucherie, il est minuit dans le siècle. L'avenir n'a plus d'avenir, il est tout entier absorbé et détruit dans le présent de la haine, du meurtre et de la destruction massive.
Le mérite de ce grand service rendu au capitalisme d'avoir vaincu les dernières poches de résistance ouvrières en emprisonnant le prolétariat dans une idéologie nationaliste, démocratique, en lui faisant abandonner le terrain de la lutte contre les conséquences de la crise historique du capitalisme, revient à ceux qui aujourd'hui fêtent ce sinistre anniversaire : la gauche capitaliste et ses garde-chiourme syndicaux.
Fêter 1'anniversaire du Front Populaire, c'est fêter l'anniversaire de la guerre, de la victoire finale sur le prolétariat international de 1'idéologie nationaliste et de la collaboration de classes qui allait amener trois ans après les ouvriers de toutes les nations dans le colossal fratricide de la seconde guerre mondiale.
L'histoire du Front Populaire a été élevée au rang de mythe et la vérité, tant de ce qui l'a amené, de son contenu réel et surtout de ses conséquences, est bien loin de ce qu'en disent ceux qui se revendiquent de ce passé glorieux et qui 1'évoquent aujourd'hui avec nostalgie.
Pour faire parler la vérité sur ces années noires où la conscience de la classe ouvrière sabordée par ceux qui s'en réclamaient sombra dans la pire des servitudes, le nationalisme, nous avons choisi de laisser la parole à ceux qui, contemporains de cette bien triste époque, peut-être la plus triste de toute l'histoire du mouvement ouvrier, surent, à l'écart des grandes hystéries idéologiques, maintenir haut le drapeau de 1'émancipation ouvrière, à commencer par l'internationalisme. Nous laisserons donc la parole à la revue BILAN sur le contenu, le déroulement et 1'attitude de la gauche officielle dans les luttes ouvrières ainsi que sur les "acquis' ouvriers" du front populaire.
De tous les mythes sur l'histoire du Front Populaire, les acquis ouvriers, et parmi ceux-ci les "congés payés", sont de loin les plus répandus.
LES ACQUIS DU FRONT POPULAIRE : UNE LARGE FUMISTERIE
La lecture des longues citations de BILAN nous apprendra, si l'on ne le sait déjà, que la période du Front Populaire ne fut en rien idyllique en ce qui concerne la condition ouvrière, les longues et dures grèves qui ponctuent toute son histoire en sont déjà le meilleure indication. Quant aux congés payés, pour ne prendre qu'un exemple, il nous faut tout d'abord dire que les luttes qui les obtinrent furent toujours le fait spontané des ouvriers en butte à la militarisation du travail :
"Ce n'est pas par hasard que ces grandes grèves se déclenchent dans l'industrie métallurgique en débutant par les usines d'avions. C'est qu'il s'agit de secteurs qui travaillent aujourd'hui à plein rendement, du fait même de la politique de réarmement suivie dans tous les pays. Ce fait ressenti par les ouvriers fait qu'ils ont dû déclencher leurs mouvements pour diminuer le rythme abrutissant de la chaîne : améliorer leurs salaires : obtenir un contrat collectif de travail et la reconnaissance des syndicats par le patronat ; des vacances payées, sur la base d'une intensification du travail en métallurgie qui se fait en l'onction de la guerre. C'est donc là un paradoxe douloureux dont les ouvriers ne sont pas responsables mais qui revient aux forces du capitalisme qui ont réduit les travailleurs à cette situation." (BILAN n° 31, mai-juin 1936, p. 1013)
Si face à la tension de la force de travail dans le cadre du renforcement de 1'économie de guerre et aux nouvelles organisations du travail que celles-ci induisaient, les ouvriers furent acculés à la lutte pour, entre autres, obtenir une pause annuelle, dans les mains des syndicats cette victoire pour laquelle ceux-ci n'avaient d'ailleurs aucun mérite, devint un but final, une institution qui devait permettre 1'intégration de la classe ouvrière à 1'économie de guerre dans le cadre de la militarisation du travail.
A LA VEILLE DU FRONT POPULAIRE : LE POISON NATIONALISTE
Les articles de BILAN donnent de la période qui s'étend de juillet 1934 jusqu'au printemps 1937 un autre éclairage que le conte de fées traditionnellement raconté par la gauche. Sur quelles bases s'est constitué le Front Populaire ?
SOUS LE SIGNE DU 14 JUILLET
C'est' sous le signe d'imposantes manifestations de masses que le prolétariat français se dissout au sein du régime capitaliste. Malgré les milliers et les milliers d'ouvriers défilant dans les rues de Paris, on peut affirmer que pas plus en France qu'en Allemagne ne subsiste une classe prolétarienne luttant pour ses objectifs historiques propres. A ce sujet, le 14 juillet marque un moment décisif dans le processus de désagrégation du prolétariat et dans la reconstitution de l'unité sacro-sainte de la Nation capitaliste. Ce fut vraiment une fête nationale, une réconciliation officielle des classes antagonistes des exploiteurs et des exploités ; ce fut le triomphe du républicanisme intégral que la bourgeoisie, loin d'entraver par des services d'ordre vexatoires, laissa se dérouler en apothéose. Les ouvriers ont donc toléré le drapeau tricolore de leur impérialisme, chanté la "Marseillaise" et même applaudi les Daladier, Cot et autres ministres capitalistes qui avec Blum, Cachin, ont solennellement juré "de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde" ou, en d'autres termes, du plomb, des casernes et la guerre impérialiste pour tous.
Il n'y a pas à dire, les événements vont vite. Depuis la déclaration de Staline, la situation s'est rapidement clarifiée. Les ouvriers ont désormais une patrie à défendre, ils ont reconquis leur place dans la Nation et, désormais, ils admettent que toutes les proclamations révolutionnaires concernant l'incompatibilité entre l'Internationale et la "Marseillaise", la révolution communiste et la Nation capitaliste, ne sont que des phrases que la révolution d'Octobre a lancées vainement, puisque Staline en a montré l'insuffisance [...].
Le 14 juillet vint donc une apothéose finale du dévouement prolétarien à la république démocratique. C'est l'exemple des militants communistes et socialistes qui détermina les ouvriers -hésitant à juste titre- d'entonner la Marseillaise. Quel spectacle inoubliable, écrira le "Populaire" ; quel triomphe, ajoutera l'"Humanité". Et les uns comme les autres feront intervenir le "vieil ouvrier" classique qui, "en pleurant", exprimera sa joie de voir l'hymne de ses exploiteurs, des bourreaux de juin, des assassins des communards, des civilisateurs du Maroc et de la guerre de 1914, redevenir prolétarien. Duclos, dans son discours, dira qu'en saluant le drapeau tricolore, les ouvriers saluent le passé "révolutionnaire" de la France, mais que leur drapeau rouge représente le futur. Mais ce passé se continue dans le présent, c'est-à-dire dans l'exploitation féroce des ouvriers, dans les guerres de rapine du capitalisme jetant au massacre des générations entières de prolétaires. En 1848 également, la bourgeoisie essaya de ressusciter le passé, les traditions de 93, les principes de Liberté, Egalité, Fraternité, pour voiler les contrastes présents des classes : la tuerie de juin fut la conséquence des illusions prolétariennes.[...]
Et après cette imposante manifestation de défaite de la classe appelée à renverser la société bourgeoise, à instaurer une société communiste, l'on se demande si, vraiment, une menace fasciste pourrait se poser en France. Jusqu'ici, il semble bien que les Croix de Feu aient plus été un moyen de chantage, un épouvantail pour accélérer la désagrégation des masses prolétariennes au travers du front commun qu'un danger réel. Mais on érigea l'antifascisme en loi suprême justifiant les pires capitulations, les compromissions les plus basses pour arriver par là à concentrer les ouvriers loin de leurs revendications immédiates, loin de leurs organisations de résistance, sur un front d'antifascisme comportant même Herriot. Ce n'est pas un hasard si les arrêtés-lois vinrent immédiatement après le 14 juillet et s'ils trouvèrent le prolétariat dans un état d'incapacité manifeste bien que des milliers d'ouvriers aient défilé en clamant "les Soviets" quelques jours auparavant. [...] (BILAN, juillet-août 1933)
FACE AUX LUTTES REVENDICATIVES
La préparation du Front Populaire annonçait donc déjà son futur déroulement, en particulier face aux luttes revendicatives des ouvriers. Comment s'est déroulée la fameuse année 1936 sur le front social ?
LA RECONCILIATION DES FRANÇAIS ET L'UNITE SYNDICALE
Un souffle d'air frais a traversé la France le 6 décembre dernier ; le parlement a vécu une "journée historique" lorsque Blum, Thorez, Ybarnegaray ont scellé la "réconciliation des Français". Désormais, plus de luttes meurtrières ne doivent ensanglanter la France républicaine et démocratique. T out le monde va fraternellement désarmer. Le fascisme est vaincu. Le Front Populaire a sauvé les institutions républicaines. Si ces événements n'entraînaient à leur suite des millions d'ouvriers français, s'ils ne contenaient tellement de faits répugnants, l'on serait tenté de rire aux éclats devant les bouffonneries qu'ils contiennent. Personne ne menaçait la République bourgeoise et tous la voulaient menacée. La droite accusait la gauche et vice-versa. Le Front Populaire proclamait son civisme républicain alors que La Roque et ses Croix de Feu répétaient la même litanie. Les formations Croix de Feu -certes plus puissantes et infiniment mieux armées que les ouvriers- ne menaçaient pas plus la République que les formations de combat ou d'auto-défense du Front Populaire, puisque les uns et les autres se mettaient à son service pour renforcer la domination capitaliste qui est d'autant plus républicaine qu'elle y trouve largement son compte.
Au point de vue de la situation immédiate, les dupes de la journée historique du 6 décembre .sont incontestablement les ouvriers. Déjà, après leur résistance de Brest et de Toulon, ils furent qualifiés de "provocateurs" par les chiens déchaînés du Front Populaire. Après la "réconciliation", le prolétaire qui tentera de résister par la violence à la violence capitaliste sera assommé, injurié et remis par les adeptes du front populaire entre les mains des agents de police. Contre les spartakistes, disait Rosa Luxemburg, les social-patriotes mobilisèrent ciel et terre, déchaînèrent le fer et le feu : Spartakus devait être massacré ! En France, le Front populaire, fidèle à la tradition des traîtres, ne manquera de provoquer au meurtre contre ceux qui ne se plieront pas devant le "désarmement des Français " et qui, comme à Brest et à Toulon, déclencheront des grèves revendicatives, des batailles de classe contre le capitalisme et en dehors de l'emprise des piliers du Front Populaire. (BILAN n°26, décembre-janvier 1936)
Cette attitude en ce début de l'année 1936 n'est que le prélude au fantastique travail de sape de la gauche et des syndicats lors du mouvement du printemps.
Les conditions qui accompagnent le triomphe du Front Populaire sont donc celles qui voient l'anéantissement de la conscience de classe des ouvriers. Le triomphe du gouvernement du Front Populaire consacre la disparition de toute résistance prolétarienne au régime bourgeois, du moins de toute résistance organisée du prolétariat. Des centristes ([2] [1058]) aux socialistes, tous s'efforcent de bien faire ressortir que le gouvernement Blum ne sera pas un gouvernement révolutionnaire, qu'il ne touchera pas à la propriété bourgeoise, qu'il ne faut pas que les possédants prennent trop au sérieux la formule centriste : faire payer les riches. Le programme du Front Populaire porte comme premier point l'amnistie et non la révolution ; l'épuration des administrations ; la dissolution des Ligues et puis des mesures économiques de grands travaux que l'on exécutera, comme en Belgique M. de Man en exécute pour résorber le chômage. Les centristes seront satisfaits des dernières décisions du parti radical, déclarant participer au gouvernement Blum et exigeant l'unité de vote de ses élus au gouvernement. Deux bonnes décisions dira l'"Humanité" qui s'empressera de crier que le Front Populaire représente enfin la revanche des Communards sur Versailles. Toute la presse bourgeoise louera la modération des socialistes et des centristes et l'on ne prendra pas trop au sérieux les accusations de l'extrême droite criant que le PC prépare l'avènement des Soviets avec ses comités de Front Populaire. Mais dans cette atmosphère idyllique une seule note discordante : les menaces de conflits de salaires de prolétaires lassés des promesses "d'humanisation" des décrets-lois. A grande peine la CGT avait liquidé la menace d'une grève générale des mineurs du Pas-de-Calais, menace qui pouvait tomber comme un pavé dans une mare entre les deux tours électoraux. Après la victoire du Front Populaire des mouvements se déterminent progressivement jusqu'à embrasser ces derniers temps l'ensemble de la région parisienne. Un journaliste belge a fait remarquer très justement que les mouvements en France se sont déclenchés un peu sur le type des grèves de mai 1936 en Belgique : en dehors et contre les syndicats, en somme comme des mouvements "sauvages". [...]
A partir du 14 mai, le mouvement atteint la région parisienne. C'est à Courbevoie, où les ouvriers font la grève dans l'usine et arrachent 0,25 F d'augmentation et un contrat collectif de six mois. C'est à Villacoublay où les ouvriers obtiennent des vacances payées, puis à Issy-les-Moulineaux, à Neuilly, à Gennevilliers. Partout les mouvements se déclenchent en dehors de toute intervention des syndicats, spontanément, et acquièrent tous le même caractère : des grèves au sein de l'usine.
Le jeudi 28 mai, c'est enfin la grève chez Renault, où 32.000 ouvriers se mettent en branle. Le vendredi et samedi les entreprises métallurgiques de la Seine entrent dans le mouvement. [...] Dans l'"Humanité" et dans le "Populaire" on fit un particulier effort pour bien prouver que le Front Populaire n'était pour rien dans ces mouvements et surtout dans leurs formes. Il fallait à tout prix tranquilliser la bourgeoisie qui, comme le prouve l'article de Gallus dans l'"Intransigeant", n'était pas le moins du monde effrayée. Le capitalisme comprenait parfaitement qu'il ne pouvait être question d'une véritable occupation des usines, mais d'une lutte ouvrière prenant pour champ de combat l'intérieur de l'usine où l'intrusion des partis du Front Populaire, de la CGT est moins à craindre. En Belgique aussi les grèves des mineurs en mai 1935 eurent ce caractère et l'exprimèrent clairement en refusant de recevoir dans la mine des délégués officiels des syndicats socialistes du POB ou du PC.
De pareils mouvements sont symptomatiques et gros de dangers pour le capitalisme et ses agents. Les ouvriers sentent que leurs organisations de classe sont dissoutes dans le Front Populaire et que leur terrain d'action spécifique devient leur lieu de travail où ils sont unis par les chaînes de leur exploitation. Dans de pareilles circonstances une fausse manoeuvre du capitalisme peut déterminer des heurts, des chocs qui peuvent ouvrir les yeux aux travailleurs et les éloigner du Front Populaire. Mais Sarraut comprit encore une fois la situation. Il laissa faire. Pas de gardes mobiles, pas de brutale expulsion des travailleurs des usines. Des marchandages, et puis laisser faire socialistes et centristes.
Le 30 mai, Cachin tente de lier ces mouvements de classe en opposition au Front Populaire à ce dernier. Il écrit : "Le drapeau tricolore fraternise sur l'usine avec le drapeau rouge. Les ouvriers sont unanimes à soutenir les revendications générales : Croix de Feu, Russes blancs, étrangers, socialistes communistes, tous sont fraternellement unis pour la défense du pain et le respect de la loi". Mais le "Populaire" du même jour n'est pas complètement d'accord avec cette appréciation, car après avoir chanté victoire au sujet de la rentrée chez Renault, il écrit : "C'est fini. C'est la victoire. Seuls dans l'Ile Seguin, quelques exaltés -il y a des sincères, mais aussi des provocateurs Croix de Feu- semblent en douter". Il est probable que la "victoire chez Renault n'ait pas été approuvée par de nombreux ouvriers qui n'ont pas voulu faire preuve de 'cet esprit conciliant' dont Frachon parle dans l'"Humanité" et qui les détermina très souvent à reprendre le travail 'avec une partie seulement de ce qu'ils réclament'". Ceux-là seront les "provocateurs", les "Croix de Feu".
Ces messieurs du Front Populaire ont bien mis en évidence non seulement pour la bourgeoisie, mais aussi pour les ouvriers eux-mêmes, qu'il ne s'agissait pas d'événements révolutionnaires. Cela "une occupation révolutionnaire, écrit le "Populaire", allons donc ! Partout : joie, ordre, discipline". Et l'on montre des photos d'ouvriers dansant dans les cours des usines ; on parle de parties de plaisir : "les ouvriers se baignent, ou jouent à la belote ou flirtent." (BILAN n° 31, mai-juin 1936)
DU SABOTAGE A LA REPRESSION DIRECTE ET IMPITOYABLE
Ainsi, avant, pendant son règne, le Front Populaire ne fut jamais le front ouvrier contre le capitalisme mais le front de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. C'est en tant que tel qu'il signa son oeuvre contre-révolutionnaire avec le sang des ouvriers parisiens. C'est ce que nous montre la répression du printemps37.
LA FRANCE "LIBRE, FORTE ET HEUREUSE" ASSASSINE LES PROLETAIRES
Les sifflements des balles ont arraché le masque du Front Populaire. Les cadavres ouvriers ont expliqué la "pause" du gouvernement Blum. Dans les rues de Clichy, le programme du Front Populaire s'est manifesté au travers des fusils des gardes mobiles et rien ne pouvait mieux l'illustrer.
Ah ! Les défenseurs de l'ordre républicain, les bourreaux de la démocratie bourgeoise peuvent pousser leurs cris d'allégresse. L'émeute est matée et le vieux cri traditionnel : "l'ordre règne, dans Varsovie" peut retentir à nouveau car les cosaques de Max Dormoy veillent.
Mais le sang ouvrier n'a pas rougi impunément les pavés de Paris, ce Pans où l'on s'apprêtait à commémorer les Communards de 1871. Désormais l'Union Sacrée acquiert une signification de sang et les ouvriers pourront retirer de cette tragique expérience un précieux enseignement de classe. Ils sauront notamment que l'on ne peut "réconcilier les Français" par la capitulation volontaire du mouvement ouvrier. La garde mobile sera présente pour l'imposer avec ses fusillades. Ils sauront aussi que la démocratie bourgeoise, "la France libre, forte et heureuse" et le fameux mot d'ordre du "Front Populaire", "le Pain, la Paix, la Liberté" signifie : le surarbitre pour les revendications ouvrières, l'emprunt de la défense nationale et les fusils des gardes mobiles, pour les manifestations prolétariennes dépassant le cadre tracé par les socialo-centnstes. [...]
Voilà dix mois que les ouvriers sont aux prises avec le Front Populaire et la chanson commence à s'user. Pourquoi Blum ne réprime-t-il pas ce danger fasciste que l'on dit si imminent ? Pourquoi reprend-on aux ouvriers tout ce qu'ils avaient cru gagner avec leurs mouvements de grèves ? Pourquoi les traite-t-on de "provocateurs" lorsqu'ils passent à l'attaque malgré l'arbitrage ? Blum fait la "pause" uniquement pour les ouvriers qui doivent continuer à faire des sacrifices.
Tout cela a créé un état d'irritation parmi les ouvriers qui se manifeste particulièrement dans la région parisienne où les bonzes réformistes-centristes sont acculés dans les assemblées syndicales. Déjà, devant cet état de tension, ils avaient décidé d'organiser deux manifestations aux environs de Paris : l'une pour les chômeurs et l'autre pour les ouvriers. Enfin, en métallurgie l'on se trouvait devant des demandes d'ouvriers, de grève générale, afin de protester contre les décisions du surarbitre
C'est dans cette situation tendue que les socialo-centristes ont donné le dernier carré de l'antifascisme pour maintenir les ouvriers dans le chemin de l'Union Sacrée, consentie "volontairement" par les travailleurs. La contre-manifestation de Clichy devait être imposante : on allait montrer à de La Roque que "la Nation française" vit et lutte pour la démocratie bourgeoise dont Messieurs Daladier-Herriot sont d'authentiques représentants. La bourgeoisie aussi se préparait, car connaissant la situation parmi les ouvriers, elle se méfiait un peu des chefs socialo-centnstes pouvant être débordés par leurs troupes. Les gardes mobiles furent armés sérieusement comme s'ils partaient en guerre. Parmi les dirigeants des forces répressives existait la conviction que "la pause" de Blum était aussi la pause des mouvements ouvriers. La directive était donc de réprimer férocement ces derniers et l'ambiance nécessaire fut certainement créée parmi les gardes mobiles. Il n'y avait pas, et il ne pouvait y avoir de contradiction entre les chefs "fascistes" de la police et le gouvernement du Front Populaire. Celui-ci parlait de la "pause" en expliquait la nécessité aux ouvriers alors que les premiers ne faisaient que l'appliquer avec la mentalité bornée du policier qui applique brutalement ses instructions sans s'occuper des conséquences. [...]
Deux forces se sont heurtées à Clichy : le prolétariat et la bourgeoisie. Les travailleurs concentrés en masse pour des buts antifascistes ont trouvé dans leur nombre imposant la force d'exalter leur colère et d'exprimer la tension imprimée dans leurs chairs de prolétaires éternellement dupés : la bourgeoisie est passée à la répression là où le Front Populaire ne pouvait plus maintenir les ouvriers sur le front des intérêts capitalistes. [...]
Rien n'a pu dénaturer la bataille de Clichy, comme rien n'a pu dénaturer les massacres de la Tunisie et ceux qui se déroulent ces derniers temps en Algérie, en Indochine. C'est le Front Populaire, qui en voulant rester au pouvoir pendant "la pause" doit passer au massacre des prolétaires de la métropole et des colonies où l'accumulation des reculs imposés aux ouvriers par Blum, pousse à des batailles de plus en plus violentes. Le programme démagogique du Front Populaire arrive au bout de son rouleau et le nouveau programme passe par le massacre des ouvriers. Et que l'on ne cherche pas les "provocations" ailleurs que dans la situation qui est faite aux ouvriers. La vérité se dégage ici avec une clarté qui se passe de commentaires : les ouvriers en exigeant la grève la faisaient contre l'Etat capitaliste qui les avait mitraillés et où se trouvait le Front Populaire. Les socialo-centnstes conscients de cette^ situation (qui pourrait déterminer la bourgeoisie à employer un autre matériel que celui de Blum pour maintenir sa domination) essayait d'en faire une vulgaire manifestation antifasciste. C'est pourquoi il fallait en limiter strictement la durée (jusqu'à midi) ; bien marquer qu'il ne s'agissait pas de réaliser des ordres du jour demandant la grève générale pour défendre les revendications ouvrières (communiqué de la CGT et de l'Union des Syndicats parisiens).
Et enfin, il s'agissait non de lutter contre le gouvernement du Front Populaire mais de le consolider. (BILAN n° 40, avril-mai 1937)
Prénat
GLOSSAIRE :
Front Populaire : coalition électorale, puis ensuite gouvernementale (1936-37), de la gauche capitaliste, regroupant Parti Socialiste (SFIO), Parti Radical (ou "Radicaux"), Parti Communiste Français.
Croix de Feu : organisation d'"Anciens combattants", d'extrême-droite. Fondée en 1927, elle sera dissoute en 1936.
QUELQUES-UNS DES HOMMES POLITIQUES :
Duclos, Cachin : dirigeants du PCF.
Thorez : Secrétaire général du PCF.
Daladier : dirigeant du Parti Radical.
Blum : dirigeant du Parti Socialiste SFIO, mènera la coalition gouvernementale du Front Populaire.
Herriot : Président de la Chambre des députés de 1936 à 1940, dirigeant du Parti Radical Socialiste.
La Roque : dirigeant des Croix de Feu.
JOURNAUX :
L'Intransigeant : journal de droite, classique.
L'Humanité : organe quotidien du PCF.
Le Populaire : journal du Parti socialiste.
[1] [1059] Un bref glossaire donnant les principaux partis et mouvements, hommes politiques, journaux, est disponible en fin d'article.
[2] [1060] La Gauche communiste et Bilan considéraient comme « centristes » les staliniens et les partis communistes affiliés à l'Internationale. Sur « centrisme et opportunisme » voir la Revue Internationale n°44.
Géographique:
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [108]
Approfondir:
- Espagne 1936 [1062]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique avec le P.C.Int.-Battaglia Comunista : La période de transition
- 2835 reads
Le débat sur la période de transition a toujours été l'objet de polémiques acharnées entre groupes révolutionnaires. Avec le développement de la lutte de classe, les révolutionnaires sont obligés de porter leur attention sur des questions plus immédiates des luttes ouvrières, en particulier les questions de l'intervention et de l'organisation. Mais en jouant son rôle de force de propositions concrètes dans les luttes ouvrières, l'organisation révolutionnaire, parce qu'elle s'appuie sur ce qui est "général", ce qui concerne tous les ouvriers, l'ensemble de la classe, ne peut pas se permettre de négliger le problème des buts historiques de la lutte : la destruction révolutionnaire de l'Etat capitaliste, la dictature du prolétariat, la transformation communiste de la vie sociale.
En consacrant cet article aux positions du Parti Communiste Internationaliste-Battaglia Comunista (PCInt.) sur la période de transition, telles qu'elles ont été exprimées dans le document de son 5ème Congrès (Prometeo n°7), notre but est d'aider à la réanimation de cette importante discussion au sein du mouvement révolutionnaire.
Pour notre part, nous n'avons aucun doute sur le fait que le PCInt. partage avec nous une base commune importante d'acquis historiques du marxisme, en particulier :
- contre les théories idéalistes typiques de l'historiographie bourgeoise, il localise les origines de l'Etat dans l'évolution historique réelle et matérielle de la société de classes ;
- contre l'utopie anarchiste, il affirme la nécessité de la dictature du prolétariat et d'un Etat pendant la période de transition, qui sera encore marquée par des divisions de classes ;
- contre le réformisme, qui est maintenant une idéologie contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, il affirme les leçons de La Commune de Paris sur la nécessité de détruire l'Etat bourgeois et de le remplacer par un Etat d'un nouveau type, un semi-Etat destiné à disparaître avec le dépassement des antagonismes de classe ;
- en accord avec L'Etat et la Révolution de Lénine, il affirme que le semi-Etat doit être basé sur la forme Soviet découverte par la classe ouvrière en 1905 et 1917 ;
- et enfin, dans la ligne de la contribution de la Fraction italienne de la Gauche communiste dans les années 30, il tire un certain nombre de leçons critiques de l'expérience russe :
.les causes du déclin de la révolution russe et la transformation de l'Etat des Soviets et du parti bolchevik en machine capitaliste contre-révolutionnaire, réside d'abord et surtout dans l'échec de la révolution à s'étendre au niveau international;
.au sein du cadre objectif de l'isolement de la révolution et des conditions d'arriération et de famine auxquelles s'est confrontée la révolution russe, certaines erreurs du parti bolchevik ont agi comme "accélérateur" du processus de dégénérescence ;
.la première de ces erreurs résidait dans une identification entre le parti et la dictature du prolétariat, aboutissant à la confusion entre parti et Etat, à la faille grandissante entre le parti et la classe, et l'incapacité croissante du parti à jouer son rôle réel d'avant-garde politique ; il y a aussi un écho - même si, comme nous le verrons plus loin, il est faible et inconsistant - de la position développée par la Fraction et plus élaborée par la Gauche Communiste de France(GCF) ([1] [1063]) et le CCI selon laquelle non seulement le parti ne doit pas être identifié à l'Etat, mais aussi que l'Etat transitoire et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques.
L ' importance de ces points communs ne doit pas être sous-estimée parce que ceux-ci constituent des frontières de classe sur le problème de l'Etat, le "point de départ" essentiel pour une compréhension marxiste de la question, l'exception ici étant la question de la non-identification de l'Etat avec la dictature du prolétariat qui, comme nous 1'avons toujours défendu est une "question ouverte" qui ne peut pas être définitivement tranchée avant la prochaine expérience révolutionnaire majeure.
Ayant brièvement défini ce que nous considérons être des zones d'accord, nous pouvons maintenant développer nos critiques aux inconséquences et insuffisances du PCInt. qui diminuent sa capacité à défendre et développer la position marxiste sur ces questions.
Une assimilation incomplète du travail de la GAUCHE ITALIENNE
Le PCInt. proclame que :
"Les positions politiques mentionnées ici, représentent le bagage théorique et la tradition de lutte de la Gauche Italienne, dont la présence historique a été assurée par la fondation du Parti Communiste d'Italie, et les acquis successifs de la Fraction et du PCInt. constitué au cours de la seconde guerre mondiale."
Comme nous l'avons dit, le texte reflète indubitablement le travail de la Fraction. Mais si le PCInt ne balaie pas purement et simplement ce travail comme le font les bordiguistes. On ne peut pas dire non plus qu'il a pleinement assimilé ce travail et surtout la méthode qui a permis à la Fraction d'entamer une critique fondamentale des positions de 1'Internationale Communiste (IC). Dans un certain nombre de cas, le PCInt. revient à l'orthodoxie "léniniste" que la Fraction avait osé mettre en doute. Ceci est particulièrement clair sur la question des relations entre le prolétariat et 1'Etat transitoire.
D'après le PCInt., le CCI régresse du marxisme à l'opportunisme quand il défend l'idée qu'une leçon cruciale de la révolution russe est que l'Etat transitoire, émanant d'un ordre social qui est encore divisé en classes, aura un caractère conservateur plutôt que dynamique, codifiant et administrant, au mieux, la poussée vers le communisme venant de la classe révolutionnaire, et au pire, s'y opposant et devenant le foyer de la contre-révolution renaissante ; et que, en conséquence, le prolétariat ne doit pas identifier son autorité de classe avec la machine d'Etat, mais doit subordonner rigoureusement celle-ci au contrôle de ses propres organes de classe.
Le PCInt. veut être très "orthodoxe" sur cette question et revient donc à la position de Marx selon laquelle dans la période de transition, "l'Etat ne peut être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat." (Marx s'attaquait ici aux déviations réformistes sur l'Etat). Pour le PCInt. -'l'Etat est un 'Etat ouvrier', et même un 'Etat socialiste (dans le sens où il permet la réalisation du socialisme)"; c'est la même chose que les Soviets : "L'erreur est de voir les Soviets (qui auront tout le pouvoir) comme étant différents de l'Etat ; mais l'Etat prolétarien n'est rien d'autre que la synthèse centralisée du réseau des Soviets."
En fait, le PCInt. ne peut rester très "orthodoxe" sur cette question qu'en ignorant certaines des questions fondamentales posées par la Fraction et les continuateurs de sa méthode. Le texte a, en fait, quelques lueurs des développements de la Fraction à ce propos, en ce sens que certains passages impliquent que l'Etat et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques. Par exemple, le texte commence en disant :
"Parler de la période de transition, c'est parler de l'Etat ouvrier et de ses caractéristiques politiques et économiques, et des relations qui doivent s'établir entre celui-ci et la forme spécifique de la dictature du prolétariat : les Soviets"
Mais cette perspicacité est alors contredite par l'insistance du PCInt. à se définir contre les positions du CCI. Et ce faisant, il se définit inévitablement contre le travail de la Fraction. Les pages de Bilan contiennent beaucoup d'études profondes sur la question de l'Etat. Ses origines historiques, les différentes formes de l'Etat dans la société capitaliste, etc., sont analysées dans ... la série d'articles "Parti-Internationale-Etat". Les questions politiques et économiques posées par la période de transition sont examinées surtout dans la série d'articles de Mitchell "Problèmes de la Période de Transition" (que le CCI se propose de republier).A la lumière de l'expérience russe, où les Soviets ont été transformés en un monstrueux appareil bourgeois, Mitchell revient à certaines mises en garde de Marx et Engels à propos de l'Etat transitoire qui est un "mal nécessaire", un "fléau" que le prolétariat est contraint d'utiliser, et Mitchell conclut que les bolcheviks avaient fait une erreur fondamentale en identifiant la dictature du prolétariat avec l'Etat transitoire :
"Bien que Marx, Engels et surtout Lénine eussent maintes fois souligné la nécessité d'opposer à l'Etat son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la Révolution russe, loin d'assurer le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les stérilisa en les incorporant à l'appareil étatique et ainsi dévora sa propre substance. Même dans la pensée de Lénine, la notion de "Dictature de l'Etat" devint prédominante : c'est ainsi qu'à la fin de 1918, dans sa polémique avec Kautsky ("La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky") il ne parvient pas à dissocier les deux notions opposées : Etat et Dictature du Prolétariat." (Bilan n°31, p.1038) Ou encore,
"La sauvegarde de la Révolution russe et son maintien sur les rails de la Révolution mondiale n'étaient donc pas conditionnés par l'absence de l'ivraie bureaucratique - excroissance accompagnant inévitablement la période transitoire - mais par la présence vigilante d'organismes prolétariens où pût s'exercer l'activité éducatrice du Parti conservant au travers de l'Internationale la vision de ses tâches internationalistes. Ce problème capital, les Bolcheviks ne purent le résoudre par suite d'une série de circonstances historiques et par ce qu'ils ne disposaient pas encore du capital expérimental et théorique indispensable. L'écrasante pression des événements contingents leur fit perdre de vue l'importance que pouvait représenter la conservation des Soviets et Syndicats en tant qu'organisations se juxtaposant à l'Etat et le contrôlant, mais ne s'y incorporant pas."(Id.p.1040).
Le lien entre cette position et celle du CCI est clair. Les organes de classe du prolétariat ne doivent pas être confondus avec l'Etat. Aussi, le PCInt. devrait se référer à BILAN sur cette question.
Bien sûr, la position du CCI n'est pas simplement une répétition de celle de BILAN. En assimilant le travail de la GCF il a rendu plus clairs un certain nombre de points :
- Sur la question du parti : BILAN a vu la nécessité de distinguer le prolétariat et son parti d'avec l'Etat, mais tendait à identifier le parti avec la dictature du prolétariat. Pour le CCI, le parti n'est pas un instrument pour exercer le pou voir politique. C'est là la tâche des "conseils ouvriers" et des autres organes unitaires de la classe ouvrière. La fonction du parti est de mener un combat politique au sein des conseils et de la classe dans son ensemble contre toutes les vacillations et l'influence bourgeoise, et pour la réalisation du programme communiste ;
- sur la question syndicale : le prolétariat dans la période de transition aura encore besoin de défendre ses intérêts immédiats contre les exigences de l'Etat, mais il n'y aura plus de syndicats, hérités des organisations par métier du siècle dernier dans la lutte pour des réformes et qui ont prouvé être antithétiques aux besoins de la lutte de classe' et sont passés dans le camp capitaliste à l'époque de la révolution sociale. Il y aura les conseils ouvriers et les comités d'usines, de quartier, milices, etc., qui en émanent (cf. infra).
- sur la question de l'Etat lui-même : la GCF et le CCI faisant des recherches plus approfondies sur les origines de l'Etat dans l'histoire et dans la période de transition ([2] [1064]) ont rejeté la formulation "Etat prolétarien" qui apparaît encore dans le travail de BILAN.
Dans le passage de son document traitant des origines historiques de l'Etat, le PCInt. résume correctement les écrits d'Engels sur le sujet en disant que :
1) l'Etat est le produit de la société divisée en classes ;
2) l'Etat est l'instrument de domination de la classe économiquement dominante.
" Pourtant, il n'en tire pas toutes les conclusions appropriées, en particulier le fait que l'Etat n'émerge pas comme une simple création, ex-nihilo, de la classe dominante, mais il émerge "spontanément" des contradictions internes d'un ordre social divisé en classes. L'Etat est d'abord et avant tout un instrument de préservation de l'ordre social. Cette compréhension permet d'expliquer comment, dans le phénomène du "capitalisme d'Etat", l'Etat peut se "substituer" à la classe dominante traditionnelle, l'exemple le plus poussé étant l'Etat russe où cette classe dominante "traditionnelle"avait été renversée par le prolétariat. Cette compréhension du fait que l'Etat émerge d'une situation sociale divisée en classes permet de voir que l'Etat transitoire n'émane pas du prolétariat mais des exigences de la société transitoire elle-même. La destruction de l'Etat bourgeois représente une rupture dans une continuité millénaire, qui nous conduit, à un niveau supérieur, à la situation qui existait avant l'émergence des premières formes étatiques. L'Etat transitoire découle des "désordres" hérités de la destruction de l'Etat bourgeois. Mais, contrairement à tous les Etats antérieurs, cet Etat ne deviendra pas "automatiquement" l'expression organique, la prolongation d'une classe économiquement dominante, exploiteuse, parce qu'une telle classe n'existera plus. Le prolétariat devra mener une lutte politique constante pour s'assurer que l'Etat reste sous son contrôle ; aucun développement automatique des lois économiques n'assurera cela. Au contraire, la période de transition sera la champ de bataille entre la volonté humaine consciente et les automatismes économiques de toutes sortes, et ainsi entre le prolétariat communiste et l'Etat qui tendra à refléter la pression continue des lois économiques dans une société encore marquée par la pénurie et la division en classes.
Pour être plus précis, l'émergence de l'Etat dans la société transitoire signifie que celui-ci sera basé sur des organismes -les soviets territoriaux- qui regroupent l'ensemble de la population non-exploiteuse. Bien qu'ils contiennent des prolétaires, ces organes ne sont pas prolétariens en eux-mêmes et le prolétariat doit toujours maintenir une stricte indépendance politique, à travers ses organes de classe spécifiques, les conseils ouvriers, qui exerceront un contrôle rigoureux sur les soviets territoriaux et sur tous les organes administratifs ou répressifs qui émergeront de leur centralisation.
Il est frappant de voir que le texte du PCInt. évacue presque entièrement le problème de l'organisation des couches non-prolétariennes, non exploiteuses dans l'Etat transitoire, en particulier au vu de la "sensibilité" autoproclamée du PCInt vis-à-vis des problèmes que rencontrent ces couches à la périphérie du capitalisme, où elles dépassent largement en nombre la classe ouvrière et posent donc un problème central pour la révolution. En conséquence, quand le PCInt. est obligé d'aborder ce problème, il tombe dans deux erreurs symétriques :
- l'erreur "ouvriériste" (qui a été, dans le passé, particulièrement nette dans la Communist Workers'Organisation (CWO) consistant à nier que ces couches auront un rôle particulier quelconque dans l'Etat transitoire. Ainsi ils écrivent : "Les soviets seront élus exclusivement par les ouvriers, privant de tout droit électoral ceux qui profitent du travail salarié ou qui, d'une façon ou d'une autre, exploitent économiquement le travail du prolétariat."
L'exclusion des exploiteurs de toute participation aux soviets est une chose, et nous sommes d'accord avec cela. Mais ce passage ne nous dit rien de ce qu'il faut faire de toutes les vastes masses humaines -paysans, artisans, éléments marginalisés, etc.- qui n'appartiennent ni à la classe ouvrière ni à la bourgeoisie. Essayer d'exclure ces masses du système des soviets aurait été impensable aux Bolcheviks en 1917, et il devrait en être de même pour les communistes aujourd'hui. Pour entraîner ces couches derrière et dans la révolution ouvrière et non contre elle, pour élever leur conscience des buts et des méthodes de la transformation communiste, pour pousser en avant leur intégration dans le prolétariat, ces couches doivent être intégrées dans le système des soviets, à travers un réseau de Soviets élus sur la base d'assemblées de quartiers ou de village (au contraire des conseils ouvriers, qui seront élus sur les lieux de travail) ;
- l'erreur inter-classiste, qui consiste à faire , fusionner, ou à submerger les organes de classe du prolétariat dans des organes regroupant toute la population non-exploiteuse : le PCInt. parle ainsi de l'Etat transitoire comme "l'Etat de tous les exploités,. dirigés politiquement par une classe ouvrière organisée sur une base internationale."De nouveau, la formulation n'est pas totalement incorrecte ; la confusion provient de ce qui n'est pas dit. Qui sont "tous les exploités" ? La classe ouvrière seule, ou bien, comme le passage semble l'impliquer dans la phrase "dirigés politiquement par une classe ouvrière", les autres couches non-exploiteuses aussi ? Et si l'Etat doit être celui de toutes les couches non-exploiteuses, comment sera-t-il "dirigé politiquement" par la classe ouvrière si la classe ouvrière n'est pas organisée de façon indépendante ?
Ces deux erreurs se renforcent réciproquement, dans la mesure où elles viennent de la même source : une incapacité à analyser les conditions sociales réelles donnant naissance à l'Etat dans la période de transition.
LA QUESTION SYNDICALE
Sur la question syndicale, il est normal d'attendre des groupes révolutionnaires d'aujourd'hui une plus grande clarté que la Gauche italienne, dans la mesure où la faiblesse des luttes de classe autonomes dans les années 30 ne donnait pas à celle-ci tous les éléments pour résoudre cette question. Comme nous l'avons dit, à la fois Bilan, et à ses débuts la GCF considéraient que la nécessaire défense des intérêts immédiats du prolétariat contre les exigences de l'Etat transitoire, serait assurée par les syndicats. Ce qui est étrange, en tout cas, c'est de lire que le PCInt. - qui dit que les syndicats ne sont plus des organes prolétariens, et devront être détruits pendant la révolution - défend l'idée, dans son document sur la période de transition, écrit en 1983, selon laquelle :
"Les Soviets sont réellement des organes révolutionnaires et politiques. Ils ne doivent donc pas être confondus avec les syndicats qui, après la révolution, auront encore la fonction de défense des intérêts immédiats du prolétariat et d'organisation des luttes contre la bourgeoisie pendant le difficile processus 'd'expropriation des expropriateurs’. Ils ne doivent pas non plus être confondus avec les Conseils d’usine qui auront la tâche d'assurer le contrôle ouvrier sur la production."
Nous avons souvent dit que le PCInt. et la CWO gardent certaines confusions à propos des syndicats, vus comme organisations "intermédiaires" ou même "ouvrières" à notre époque, et cela le confirme tout à fait. Ils semblent incapables de comprendre pourquoi la forme syndicale ne correspond plus aux besoins de la lutte de classe de notre époque, époque de la décadence capitaliste et de la révolution prolétarienne. Les caractéristiques essentielles de la lutte de classe à cette époque - son caractère massif, la nécessité de rompre toutes les barrières sectorielles - ne changeront pas après la prise du pouvoir par les ouvriers. Nous avons déjà dit que nous reconnaissons la nécessité continué pour les ouvriers de pouvoir défendre leurs intérêts immédiats et spécifiques contre les exigences de l'Etat transitoire, mais pour cela il faut des organes qui regroupent les prolétaires sans tenir compte des branches ou secteurs : les comités d'usine et les Conseils ouvriers eux-mêmes. Dans la vision des choses du PCInt., où les Conseils ouvriers "sont" l'Etat, on nous présente le scénario bizarre dans lequel les ouvriers utilisent les syndicats pour se défendre... contre les Conseils ouvriers !
EN CONCLUSION
Cet article ne prétend en aucune façon être une étude exhaustive sur la question de la période de transition, ni même de la vision du PCInt. sur la question. Son but était plutôt de donner une nouvelle impulsion à la discussion sur là période de transition, de définir certains points de base, et de critiquer quelques une des confusions, contradictions ou concessions à l'idéologie bourgeoise contenues dans les positions d'une autre organisation révolutionnaire. Les positions du PCInt.,bien que se situant sur une base marxiste, montrent,sur certaines questions cruciales - les relations entre classe et Etat, Parti et Etat, la question syndicale - une difficulté à avancer à partir de cette base vers des conclusions plus cohérentes. Il reste à mi-chemin entre les positions les plus avancées de la Gauche communiste et les thèses dépassées de l'Internationale Communiste sous Lénine. Mais comme même la bourgeoisie révolutionnaire l'avait compris, on ne peut pas faire une révolution à moitié. Toutes les confusions et contradictions à propos du processus révolutionnaire seront mises à nu par la révolution elle-même. Et c'est précisément pour cela que le débat sur la période de transition ne peut pas être ignoré aujourd'hui : quand nous serons lancés dans l'océan de la révolution communiste, nous devrons être équipés de la boussole la plus précise possible que nous permet l'évolution présente de la théorie marxiste.
M.U.
Courants politiques:
- Bordiguisme [126]
- Battaglia Comunista [449]
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise (1900-1914) : Le mouvement "Tribuniste" 3eme partie
- 4189 reads
Cet article est la dernière partie de l'étude sur l'histoire de la Gauche hollandaise entre 1900 et 1914. Après avoir traité des difficultés du surgissement du courant marxiste dans les conditions de la Hollande du début du siècle et des débuts de ce qui allait devenir la "Gauche hollandaise" (Revue Internationale n°45), puis de la fragilité des organisations politiques du prolétariat confrontées à la pression permanente de l'idéologie bourgeoise en leurs rangs (Revue Internationale n°46), l'étude traite dans cette partie de la naissance du mouvement "tribuniste" jusqu'à l'exclusion de ce courant de la social-démocratie (SDAP) par l'aile opportuniste.
C'est en octobre 1907 que les radicaux marxistes commencèrent à publier leur propre "hebdomadaire social-démocrate". A la tête de "De Tribune" on trouvait les futurs chefs de l'organisation tribuniste : Wijnkoop, Ceton et van Ravesteyn, qui disposaient du soutien inconditionnel du 3ème rayon d'Amsterdam, le plus révolutionnaire du parti. Pannekoek et Gorter y contribuèrent régulièrement, donnant des textes théoriques et polémiques parmi les plus importants. Tous étaient animés par l'espérance d'une future révolution ; la période était plus favorable que jamais historiquement avec le début d'une crise économique, qu'ils n'analysaient pas encore comme la crise générale du capitalisme.
L'orientation était déjà antiparlementaire; il s'agissait de rattacher la lutte des ouvriers à la lutte internationale en les libérant des illusions parlementaire et nationale. Le but était en effet "1° démasquer la signification réelle des manoeuvres trompeuses de la démocratie bourgeoise en matière de droit de vote et de transformations sociales, et 2° donner une'' idée aux ouvriers de la signification des relations internationales et de la lutte de classe à l'étranger." Il est remarquable de constater que cette ligne politique se rapproche considérablement de celle du futur courant de Bordiga, par la proclamation de la lutte politique et théorique contre la démocratie bourgeoise et l'affirmation de l'internationalisme. Il est certain que les "Tribunistes" ne pouvaient guère avoir une activité organisée, en dehors des sections comme celle d'Amsterdam où ils étaient majoritaires. Chassés par les révisionnistes des organes centraux, ils concevaient leur lutte essentiellement sous l'aspect théorique.
Mais le combat politique - avec la publication de "De Tribune" qui était sans concessions dans sa lutte contre le révisionnisme - allait vite se durcir et poser rapidement la question de la scission dans le parti. Une chasse aux "sorcières" marxistes était enclenchée. A Rotterdam, les chefs révisionnistes firent destituer la rédaction marxiste de l'organe local ; et cela juste après le Congrès d'Arnhem (1908) qui avait rejeté la proposition de Troelstra d'interdire "De Tribune". Par la suite, c'est le même processus d'interdiction des autres organes locaux d'inspiration marxiste qui se généralise.
La crise du parti était ouverte ; elle allait se précipiter avec les interventions publiques de Troeistra contre les positions marxistes en plein parlement, face aux partis politiques bourgeois.
a) La question de la période et de la crise
L'affrontement avec les "tribunistes" allait se produire à l'automne 1908. à l'occasion d'une prise de position de Troelstra au parlement. Celui-ci niait publiquement la nécessité pour les ouvriers d'appréhender le devenir du capitalisme de façon théorique, dans le cadre du marxisme ; il soutenait qu'il n'y avait "pas de besoin de théorie logique abstraite" dans la lutte de classe. Finalement - sans la nécessité d'une révolution, et donc de façon pacifique et "automatique" - "le capitalisme conduit de lui-même au socialisme" (Id.). Autant dire que le socialisme n'était plus déterminé par l'existence des conditions objectives de la crise et la maturation de la conscience du prolétariat ; il devenait une simple croyance religieuse. A ces affirmations, "De Tribune" réagit très violemment et de façon mordante contre la personne de Troelstra, symbole du révisionnisme dans le parti :
"Un politicien pratique de la social-démocratie doit aussi comprendre la théorie ; il doit la connaître et pouvoir la défendre. C'est peut-être pour un 'bourgeois' une lourde tâche, mais la classe ouvrière ne s'accorde pas moins avec son chef. Ce savoir, cette science socialiste est certes souvent plus facile à atteindre que pour un homme qui est issu de la bourgeoisie. L'ouvrier peut savoir immédiatement à partir de sa propre vie ce que le socialiste issu de la bourgeoisie doit auparavant apprendre de la théorie ; par exemple, ce qui pour Troelstra n'est pas encore certain : que le fossé économique entre les deux classes devient toujours plus profond... Si la possibilité existe que le fossé entre les classes ne devienne pas plus profond, alors notre socialisme sombre dans une croyance ; la certitude devient une attente. Avec la croyance et l'espoir les ouvriers sont suffisamment floués. Pour cela ils n'ont pas besoin de socialisme. L'Eglise aussi leur apporte la croyance que cela ira mieux dans l'au-delà et les braves libéraux et démocrates espèrent que cela ira mieux bientôt." Mais le plus important dans la dénonciation du révisionnisme par les Tribunistes était l'affirmation théorique du cours historique du capitalisme vers une crise mondiale.' En cela, la Gauche hollandaise - sauf Pannekoek plus tard (cf.infra) - rejoignait la position de Rosa Luxemburg qu'elle devait exposer en 1913 : "La prétendue 'prophétie' de Marx est aussi pleinement réalisée dans le sens que les périodes de développement capitaliste moderne deviennent toujours plus courtes, que. en général les 'crises' comme force transitoire d'une production forte à une production faible doivent toujours encore persister et que avec le développement du capitalisme elles s'élargissent, deviennent plus longues, les maux limités localement devenant toujours plus des calamités mondiales."
Ces attaques portées contre les théories révisionnistes de Troelstra furent considérées par une majorité du SDAP comme de simples attaques personnelles. Fait extrêmement grave dans l'histoire du mouvement ouvrier, en contradiction avec la liberté de critique dans un parti ouvrier, les révisionnistes interdirent le colportage de "De Tribune" lors d'une réunion publique où parlait Troelstra. C'était le début du processus -d'exclusion des positions marxistes, processus qui allait brutalement s'accélérer à la veille de l'année 1909.
b) Gorter contre Troelstra sur la "morale" prolétarienne
"De Tribune" avait sorti en feuilleton au cours de l'année 1908 l'une des contributions majeures de Gorter à la vulgarisation du marxisme : "Le matérialisme historique expliqué aux ouvriers". Prenant à titre d'exemple la grève de 1903, Gorter montrait que la lutte de classe faisait surgir une authentique morale de classe qui entrait en contradiction avec la morale "générale" commune défendue par les tenants de l'ordre existant. La conception matérialiste, défendue par Gorter, qui sapait les fondements de toute morale religieuse, fut violemment attaquée au Parlement par le député chrétien Savornin Lohman les 19 et 20 novembre. Celui-ci, en défendant l'unité de la nation, accusa la social-démocratie de vouloir susciter la guerre entre les classes et d'intoxiquer ainsi la classe ouvrière avec le marxisme.
Au heu de faire bloc avec Gorter face aux attaques d'un représentant de la conception bourgeoise,Troelstra se lança dans une diatribe contre Gorter,qu'il présenta comme non représentatif du parti et une simple caricature du marxisme. Pour lui, la morale n'était pas déterminée par les rapports sociaux ; elle était valable 'pour les prolétaires comme pour les bourgeois. Il s'appuyait pour cela sur les concepts ambigus qu'avait utilisés Marx dans les statuts de l'AIT, ceux de droits, de devoirs et de justice. - Mais Troelstra, en confondant à dessein les valeurs communes à l'espèce humaine et la morale officielle qu'il présentait comme universelle transformait la morale de la lutte ouvrière - guidée par des intérêts communs et une action tendue vers la victoire - en une monstruosité. Le matérialisme de Gorter serait un pur appel au meurtre et aboutirait à une vision de barbarie. Selon lui, Gorter, par exemple, serait contre le fait qu'"un ouvrier sauve un fils de capitaliste en train de se noyer". La démagogie de Troelstra dans l'argumentation était dans ce cas identique à celle de Lohman, à laquelle il se ralliait.
Gorter répliqua fougueusement, selon son habitude, aussi bien à Lohman qu'à Troelstra, par une brochure vite écrite et publiée pour les nécessités du combat. Après une période d'isolement politique, il se lançait totalement dans la lutte de parti. Il concentra la pointe acérée de la critique sur la personne de Troelstra qui "en réalité, au plus profond de ses paroles, a choisi le camp de la bourgeoisie". Il montrait d'autre part que Troelstra trahissait la pensée profonde de Marx en utilisant les termes ambigus des Statuts de l'AIT. La correspondance de Marx et Engels, publiée quelques années plus tard, devait permettre à Gorter de justifier triomphalement son argumentation. En effet, dans une lettre du 4 novembre 1864, Marx expliquait qu'il avait du faire quelques concessions face aux proudhoniens: "j'ai été obligé d'accueillir dans le préambule des Statut deux phrases contenant les mots 'devoir' (duty) et 'droit' (right) de même que les mots vérité, morale et justice' (truth, morality and justice), mais je les ai placés de telle sorte qu'ils ne causent pas de dommage."
D'autre part, Gorter répliquait vigoureusement à l'accusation que la morale du prolétariat visait à s'attaquer aux individus capitalistes, au mépris de tout sentiment d'humanité. La morale du prolétariat est essentiellement une morale de combat qui vise à la défense de ses intérêts contre la classe bourgeoise, comme catégorie économique, et non comme somme d'individus. Elle est une morale qui vise à s'abolir dans la société sans classes, laissant la place à une véritable morale, celle de l'humanité tout entière émancipée de la société de classes.
Suite à cette polémique, la scission devint inévitable. Elle était souhaitée par Troelstra, qui tenait à éliminer du parti toute tendance critique marxiste. Dans une lettre à Vliegen du 3 décembre, il avouait :
"Le schisme est là; la seule ressource ne peut être qu'une scission."
LA SCISSION DU CONGRES DE DEVENTER (13-14 février 1909)
Pour éliminer les Tribunistes et leur revue, les chefs révisionnistes proposèrent un référendum pour examiner la question de la suppression de la revue "De Tribune" lors d'un congrès extraordinaire. Le comité du parti était hésitant et même contre de telles mesures extraordinaires. Troelstra passa par dessus le comité et par référendum obtint des 2/3 du parti la convocation du congrès. Il se manifestait ainsi que la très grande majorité du SDAP était gangrenée par le révisionnisme; elle était même à la base plus révisionniste que le "sommet", que ses organes directeurs.
D'autre part, les- éléments marxistes issus du "Nieuwe Tijd" et collaborateurs de "De Tribune" capitulèrent devant Troelstra. Au cours d'une conférence tenue le 31janvier, sans même que soient invités les principaux rédacteurs tribunistes, Roland-Holst et Wibaut se déclarèrent prêts à quitter la rédaction de la revue pour diriger un futur supplément hebdomadaire ("Het Weekblad") de "Het Volk" le quotidien du SDAP débarrassé de toute critique marxiste contre le révisionnisme. Au lieu de se solidariser avec leurs camarades de combat, ils firent un serment d'allégeance à Troelstra en se déclarant pour "un travail commun de loyale camaraderie de parti". Ceux-ci se proclamèrent; "marxistes de paix", essayant de se réfugier dans une attitude centriste de conciliation entre la droite et la gauche marxiste. Dans le mouvement marxiste en Hollande, Roland-Holst conserva constamment cette attitude (cf. infra).
Les Tribunistes ne manquèrent pas de reprocher à Roland-Holst sa capitulation : son attitude ne faisait que rendre plus certaine la scission souhaitée par les révisionnistes.
Il est vrai que, de leur côté, la minorité marxiste j était loin d'être homogène pour mener jusqu'au bout le combat à l'intérieur du SDAP. Wijnkoop, Van Raveysten et Ceton, qui constituaient la véritable tête organisatrice de la minorité, s'étaient déjà résolus à la scission avant le congrès, pour maintenir en vie "De Tribune". Par contre, Gorter - qui n'était pas formellement dans la rédaction - restait beaucoup plus réservé. Il se méfiait de la fougue de cette triade et ne voulait en aucun cas précipiter la scission. Il souhaitait que Wijnkoop se modère et que les Tribunistes restent dans le parti, au prix même de l'acceptation j de la suppression de "De Tribune" en cas d'échec au congrès de Deventer :
"J'ai 'continuellement dit contre la rédaction de 'Tribune' : nous devons tout faire pour attirer les autres vers nous, mais si cela échoue après que nous nous soyons battus jusqu'au bout et que tous nos efforts aient échoué, alors nous devons céder." (Lettre à Kautsky, 16 février 1909)
De fait, lors du congrès extraordinaire de Deventer, les Tribunistes se battirent pendant deux jours avec acharnement et dans des conditions extrêmement difficiles. Souvent interrompus par Troelstra qui usait systématiquement d'une démagogie anti-"intellectuels" ironisant sur les "professeurs de "De Tribune" -, affrontant le plus souvent les rires d'incompréhension de la majorité du congrès, ils restèrent offensifs. Ils se battirent pour maintenir l'essence révolutionnaire du parti, "le sel du parti", selon la formule lancée par Gorter. Sans la liberté de critique marxiste contre l'opportunisme, liberté exercée dans les grands partis comme le parti allemand -, on supprimait la possibilité "d'éveiller la conscience révolutionnaire". Plus qu'aucun autre, Gorter sut exprimer lors du congrès la conviction révolutionnaire des Tribunistes ; une période décisive de guerre menaçante ,et de révolution future en Allemagne s'ouvrait, qui entraînerait la Hollande dans la tourmente :
"Internationalement, la période est très importante. Une guerre internationale menace. Alors le prolétariat allemand entrera en insurrection.
Alors la Hollande doit choisir sa couleur ; alors le parti doit se réjouir qu'il y ait eu des hommes qui mettaient au premier plan le côté révolutionnaire de notre lutte."
Conscient finalement du naufrage du SDAP, Gorter concluait à la fin du congrès par un vibrant appel au regroupement des révolutionnaires autour de "Tribune": "Venez vous joindre à nous autour de 'Tribune' ; ne laissez pas le navire couler !". Cet appel n'était cependant pas une invitation à la scission et à l'édification du nouveau parti. Gorter était encore convaincu de la nécessité de rester dans le parti, faute de quoi les Tribunistes perdraient toute possibilité de se développer : "Notre force dans le parti peut grandir; notre force en dehors du parti ne pourra jamais croître."
Mais ce combat pour rester à l'intérieur du parti échoua. Le processus de scission était irréversible avec les décisions prises majoritairement par le congrès.
Le congrès décida de façon écrasante - par 209 mandats contre 88 et 13 blancs la suppression de "De Tribune", remplacé par un hebdomadaire dirigé principalement par Roland-Holst. Mais, surtout, il excluait du parti les trois rédacteurs de "Tribune" : Wijnkoop Van Raveysten et Ceton. Dans l'esprit des révisionnistes, il s'agissait de décapiter la "tête" organisative, de séparer les "chefs" de la masse des sympathisants tribunistes dans le parti.
Cette manoeuvre échoua. Après le choc de l'exclusion des porte-parole du tribunisme, dans les sections les militants se ressaisirent et se solidarisèrent avec les trois rédacteurs. Rapidement, ce qui était jusque là une tendance informelle se transforma en groupe organisé. Aussitôt après le congrès - preuve que les Tribunistes avaient envisagé cette possibilité avant la scission - une commission permanente d'organisation fut formée pour regrouper la tendance "tribuniste". Des membres du groupe "Nieuwe Tijd", dont Gorter, finirent par rejoindre la commission. Gorter, après six semaines d'hésitations et de doute sur son attitude unitaire, finit par se résoudre à s'engager à fond dans un travail avec les Tribunistes exclus. Gorter mettait en garde, cependant, contre la fondation d'un second parti qui serait purement volontariste.
C'est en fait la publication le 13 mars par le SDAP du référendum dans le parti, pour approuver les décisions de Deventer, qui poussa les exclus à former un second parti. Par 3712 voix contre 1340, le SDAP avalisait l'exclusion du parti de toute la rédaction de "Tribune".
Or, entre-temps, avant que l'annonce d'exclusion définitive fut connue, Gorter et Winjkoop se rendirent à Bruxelles le 10 mars. Trois membres du Bureau socialiste international - Huysmans, Vandervelde et Anseele tous connus pour leur appartenance à la droite - dont le siège était dans la capitale belge, les attendaient pour résoudre la "question hollandaise". Contrairement à leurs craintes, Gorter et Wijnkoop trouvèrent une grande compréhension dans le BSI, lequel s'indigna de l'exclusion décidée à Deventer, et tenta d'obtenir la réintégration des exclus comme la libre expression du marxisme dans le SDAP. Pour jouer les médiateurs, Huysmans, le secrétaire en titre du BSI, se rendit en Hollande pour obtenir des instances du SDAP les décisions suivantes :
- l'annulation de la décision d'exclusion de Deventer ;
- l'acceptation d'un des rédacteurs exclus dans le nouvel hebdomadaire dirigé par Roland-Holst ;
- la reconnaissance du droit d'expression pour la minorité marxiste.
Sur tous ces points, les instances dirigeantes du SDAP semblèrent ébranlées par les avis de Huysmans suggérés le 15 mars. Mais, la veille, le 14 mars, s'était tenu à Amsterdam le congrès de fondation du parti tribuniste qui prit le nom de SDP (Parti social-démocrate). Sa fondation avait donc été décidée par ses membres sans même attendre les résultats des négociations du BSI avec le SDAP. Ce dernier, pourtant au courant des discussions menées depuis le 10 mars, avait fait avaliser l'exclusion le 13 mars.
C'est donc dans une situation d'extrême confusion que naquit le SDP. Il s'agissait d'un petit parti de 419 membres divisé en 9 sections. Son programme était celui de l'ancien parti d'avant 1906, avant les modifications révisionnistes.
Wijnkoop était nommé par le congrès président du parti, en raison de ses capacités d'organisateur.Gorter devenait membre de la direction du SDP. Mais son poids organisationnel était trop faible pour contrecarrer la politique personnelle, voire ambitieuse de Wijnkoop, prêt à sacrifier toute possibilité d'unité sur l'autel de "son" groupe. Une telle politique n'était pas sans arranger la majorité révisionniste du SDAP qui souhaitait la scission définitive d'avec le courant marxiste.
Pour toutes ces raisons, les tentatives faites par le BSI pour mettre fin à la scission échouèrent. Un congrès extraordinaire convoqué d'urgence pour le 21 mars, une semaine après celui de fondation, rejeta majoritairement les propositions faites par Huysmans de retourner dans le SDAP. Gorter était, avec quelques-uns qui appartenaient à la vieille garde du SDAP pour. Il jugeait particulièrement irresponsable l'attitude de Wijnkoop dont il dénonçait en privé "l'opiniâtreté sans limites". Il était à ce point démoralisé qu'il songea même un moment à quitter le SPD. Le rejet par le BSI et le SDAP des conditions de réintégration des militants tribunistes le décida cependant à s'engager complètement dans l'activité du nouveau parti.
En effet, le congrès du 21 mars, en dépit de l'attitude peu claire de Wijnkoop, avait laissé la porte ouverte à une réintégration dans l'ancien parti. Une résolution du congrès montrait le souhait de la majorité de maintenir aux Pays-Bas un seul parti ; pour cela le congrès posait des conditions qui permettraient aux Tribunistes de continuer leur travail de critique et d'activité marxistes dans le SDAP, si elles étaient acceptées :
"(le congrès) souhaite qu'en Hollande il y ait un seul parti social-démocrate et charge le comité du Parti, dans l'intérêt de l'unité, de lui donner pleins pouvoirs pour dissoudre le SDP, dès que :
- le SDAP, par référendum, lève 1'exclusion des trois rédacteurs;
- le SDAP reconnaît dans une résolution clairement formulée la liberté de tous ses membres ou de tout groupe de membres, ouvertement, sous toute forme, écrite et orale, de proclamer les principes consignés dans le programme et d'exercer leur critique"
Le rejet de ces conditions qui apparurent comme un ultimatum, par le BSI et le SDAP, créait une situation nouvelle dans l'Internationale : il y avait dans un pays comme les Pays-Bas deux partis socialistes se réclamant tous deux de la 2ème Internationale. Cette situation était - dans la 2ème Internationale - exceptionnelle. Même en Russie, après la scission entre les bolcheviks et les mencheviks, les deux fractions restaient adhérentes du même parti : le POSDR (Parti ouvrier social-démocrate russe). Mais aux Pays-Bas, il s'était révélé à travers la scission l'impossibilité politique - et aussi la non-volonté autant de la majorité révisionniste que de la minorité tribuniste - de demeurer membres du même parti.
Il était cependant très clair pour les militants marxistes du SDP que leur parti était un parti de l'Internationale. La scission était une scission locale et non une scission d'avec la 2ème Internationale.
Il était évident pour eux que la 2ème Internationale restait un corps vivant pour le prolétariat international et qu'elle n'avait nullement encore fait faillite. La faillite du SDAP de Troelstra n'était nullement celle de l'Internationale. Pour le SDP, le "modèle" de parti .restait encore, comme pour les bolcheviks, la social-démocratie allemande, avec laquelle il avait des liens étroits. Gorter, comme membre de la direction du SDP, restait en correspondance régulière avec Kautsky, du moins jusqu'en 1911, date de la rupture de la Gauche avec le Centre kautskyste. Pannekoek, qui s’était installé en Allemagne depuis 1906 et était depuis la scission membre du SDP, était membre de la section de Brème du SPD, après avoir enseigné dans l'école du Parti.
Pour devenir section de l'Internationale, le SDP entre prit promptement des démarches auprès du Bureau socialiste international. Gorter et Wijnkoop furent mandatés pour exposer au BSI les motifs de la scission en s'appuyant sur les rapports spécialement rédigés à l'adresse de l'Internationale. La demande d'acceptation du nouveau parti comme section à part entière fut en fait l'objet d'un conflit entre une gauche représentée par Singer (SPD) et Vaillant et une droite, dont l'autrichien Adler était le porte-parole. C'est à une faible majorité que l'acceptation du SDP dans l'Internationale fut rejetée : fa résolution Adler recueillait 16 voix, contre l'acceptation ; celle de Singer 11 voix, pour. Ainsi, le 7 novembre 1909, par ce vote, le SDP était de fait exclu du mouvement ouvrier international, par une majorité du BSI qui prenait fait et cause pour le révisionnisme.
Le SDP trouva néanmoins un appui inconditionnel dans la gauche bolchevique. Lénine -qui avait pris contact avec Gorter avant le BSI condamna avec indignation la décision du Bureau socialiste international de Bruxelles. Pour lui, il ne faisait aucun doute que les révisionnistes étaient responsables de la scission :
"[Le BSI] adopta une position formaliste et, prenant nettement parti pour les opportunistes, rendit les marxistes responsables de la scission."-
Il approuvait sans réserves les tribunistes qui n'avaient pas accepté la suspension de "De Tribune". Comme eux, il condamnait le centrisme de Roland-Holst "qui fit malheureusement preuve d'un désolant esprit de conciliation"
Ainsi débutait entre le SDP et les bolcheviks une communauté d'action qui allait devenir de plus en plus étroite. En partie grâce à la Gauche russe, le SDP finit par être accepté en 1910 comme section, de plein droit de l'Internationale. Disposant d'un mandat contre 7 au SDAP, il put participer aux travaux des congrès internationaux, à Copenhague en 1910 et à Bâle en 1912.
Ainsi, malgré les manoeuvres des révisionnistes, le SDP s'intégrait pleinement dans le mouvement ouvrier international. Son combat allait se mener conjointement avec la Gauche internationale, particulièrement avec la Gauche allemande, pour la défense des principes révolutionnaires.
JUSQU’A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Jusqu'à la première guerre mondiale, pendant laquelle il allait connaître une audience croissante dans le prolétariat, le SDP connut une "traversée du désert". Il resta un petit parti, sans grande influence dans le prolétariat néerlandais : quelques centaines de militants contre plusieurs milliers au SDAP de Troelstra. Sa croissance numérique fut très lente et limitée, en dépit de son esprit militant : au moment de la scission, le SDP comptait 408 militants ; en 1914,' 525. Le nombre d'abonnés à "De Tribune" fut limité et fluctuant : 900 lors du congrès de Deventer ; 1400 en mai 1909 et 1266 en 1914. A cause de sa faible audience le SDP ne fut jamais un parti parlementaire le devint à la fin de la guerre ; sa participation aux élections fut toujours une débâcle. Lors des élections de juin 1909, il obtint 1,5 % des voix par district. Même Gorter, qui était réputé être le meilleur orateur du parti, le seul capable de susciter l'enthousiasme des ouvriers connut un échec retentissant : poussé à être candidat aux élections de 1913 à Amsterdam et dans la ville industrielle d'Enschede, il obtint 196 voix pour le SDP contre 5325 pour le SDAP, dans cette dernière ville. Mais, même s'il participait aux élections, le terrain du- SDP n'était pas les élections, terrain où s'était enlisé le SDAP.
Réduit à une petite cohorte, le SDP -par suite de mauvaises conditions dans lesquelles s'était accomplie la scission de Deventer- ne peut rallier l'organisation des jeunesses, qui traditionnellement se tenait à la pointe de la lutte contre le capitalisme et la guerre, de façon active et radicale. L'organisation de jeunesse, "De Zaaier" ("Le Semeur"), qui avait été créée en 1901, voulut rester autonome : ses sections étaient libres de se rattacher à l'un ou à l'autre des deux partis. Lorsque, en 1911, le SDAP créa sa propre organisation de jeunesse, essentiellement pour contrer l'activité antimilitariste du "Zaaier", celui-ci éclata. Les quelques militants restants (100 environ) refusèrent néanmoins de suivre le SDP, malgré l'orientation commune.
Le risque était grand, malgré la solidité théorique du parti, que le SDP s'enfonce dans le sectarisme. Les attaches du parti avec le prolétariat d'industrie étaient distendues depuis la scission. Moins de la moitié des militants travaillait dans les usines ou les ateliers ; une grosse partie était composée d'employés et d'instituteurs. Le sommet du parti -jusqu'en 1911 du moins était composé d'intellectuels, solides théoriciens, mais -sauf Gorter- souvent sectaires et doctrinaires. Cette direction d'enseignants était portée à transformer le parti en secte.
La lutte contre le sectarisme au sein du SDP se posa dès le départ. En mai 1909, Mannoury -un des chefs du parti et futur dirigeant stalinien- déclara que le SDP était le seul et unique parti socialiste, le SDAP étant devenu un parti bourgeois. Gorter, d'abord minoritaire, se battit avec acharnement contre cette conception, lui qui avait mené la bataille contre Troelstra avec le plus d'acharnement ; il montra que -bien que le révisionnisme " menât au camp bourgeois- le SDAP était avant tout un parti opportuniste au sein du camp prolétarien. Cette position avait des implications directes au niveau des activités d'agitation et de propagande dans la classe. Il était en effet possible de se battre avec le SDAP, chaque fois que celui-ci défendait encore un point de vue de classe, sans la moindre concession théorique.
"Secte ou parti", telle était la question que Gorter posa très clairement devant l'ensemble du parti en novembre 1910. Il s'agissait de savoir si le SDP s'associerait à une pétition lancée par le SDAP pour le suffrage universel. Le SDP, comme tous les partis socialistes de l'époque, se battait pour le suffrage universel. La question centrale était donc l'analyse de classe du SDAP, mais aussi la lutte contre l'inaction sectaire lors des luttes politiques. Au départ, seule une petite minorité, menée par Gorter, soutint l'idée de la pétition et de l'agitation sur le suffrage universel. Il fallut tout le poids de Gorter pour qu'enfin une faible majorité se dessinât en faveur d'une activité commune avec le SDAP. Gorter montra le danger d'une tactique de non-participation, qui risquait de pousser le parti à un isolement total. Face au SDAP, qui n'était certes "pas un vrai parti", mais "un rassemblement, une masse attroupée pour une troupe de démagogues", la tactique devait être celle du "frelon" aiguillonnant dans le bon sens. Cette attitude fut finalement. Celle du parti jusqu'à la guerre, moment où le SDAP franchit le Rubicon en votant les crédits de guerre.
L'évolution du SDAP confirmait en effet la validité du combat mené dès le début par les tnbunistes contre le révisionnisme. Celui-ci, progressivement, était happé par l'idéologie et l'appareil d'Etat bourgeois. En 1913, le SDAP se prononça pour la mobilisation militaire en cas de guerre, et Troelstra proclamait ouvertement l'adhésion du révisionnisme au nationalisme et au militarisme :"Nous devons accomplir notre devoir", écrivait-il dans le quotidien du SDAP.
Fort de ses succès électoraux en 1913, le SDAP qui avait obtenu 18 sièges, se déclarait prêt à prendre des portefeuilles ministériels dans le nouveau gouvernement libéral. La participation à un gouvernement bourgeois aurait signifié l'abandon total du reste de principes prolétariens du parti de Troelstra ; celui-ci devenait ainsi un parti bourgeois intégré dans l'appa reil d'Etat. Il y eut cependant un faible et dernier sursaut prolétarien dans ce parti : lors de son congrès tenu à Zwolle, contre l'avis de Troelstra, une faible majorité se dégagea (375 voix contre 320) finalement contre la participation ministérielle Il est vrai que l'agitation faite par le SDP sous la forme d'une lettre ouverte écrite par Gorter et adressée au con grès qui n'en eut même pas connaissance- contre la participation ne fut pas étrangère à ce dernier sur saut.
L'activité du SDP ne se limita pas à critiquer le SDAP. Elle se déploya essentiellement dans la lutte de classe, dans les luttes économiques et dans l'action contre la guerre :
- La reprise de la lutte de classe internationale au début des années 1910 favorisa l'activité du parti qui y puisa enthousiasme et confiance. Ses militants participèrent avec ceux du NAS aux luttes des maçons d'Amsterdam en 1909 et 1910, qui se défiaient du SDAP, jugé "parti d'Etat". En 1910, le parti formait avec le NAS un "comité d'agitation contre la vie chère". Ainsi débutait une longue activité commune avec les syndicalistes-révolutionnaires, qui ne fut pas sans développer l'influence du SDP avant et pendant la guerre, au sein du prolétariat néerlandais. Cette activité commune eut pour conséquence de réduire progressivement le poids des éléments anarchistes au sein du petit syndicat et de développer une réceptivité aux positions marxistes révolutionnaires,
La lutte politique contre la guerre menaçante fut une constante du SDP. Celui-ci participa très activement au congrès de Bâle en 1912, congrès centré sur la menace de guerre. Le SDP, comme d'autres partis, proposa un amendement pour la grève de protestation en cas d'éclatement d'un conflit mondial. Cet amendement, qui fut rejeté, prenait soin de se démarquer de l'idée de "grève générale" lancée par les anarchistes. Malheureusement, suite' à l'interdiction des débats dans le congrès, le discours qu'avait préparé Gorter et orienté contre le pacifisme, ne put être lu. La voix révolutionnaire du SDP ne put retentir dans l'Internationale, couverte par les discours de tribun du pacifiste Jaurès.
A la veille de la guerre, le SDP -après une crise d'isolement sectaire- avait incontestablement développé une activité dans le prolétariat néerlandais qui ne fut pas sans porter ses fruits. L'évolution du SDAP vers le- "ministérialisme" -c'est-à-dire la participation au gouvernement bourgeois-, son acceptation de la "défense nationale" avaient incontestablement confirmé les analyses du courant marxiste. Celui-ci, compte tenu des conditions très défavorables de la scission de Deventer, restait néanmoins faible .numériquement : le courant révolutionnaire était recouvert par le courant révisionniste, en pleine expansion numérique et électorale.
Dans un si petit parti, l'orientation politique restait en partie déterminée par le poids des personnalités. La clarté théorique d'un Gorter et son soutien actif étaient décisifs^ face aux ambitions organisationnelles et au manque de principes d'un Wijnkoop et d'un Revesteyn. Cette opposition était lourde d'une nouvelle scission.
Cependant, l'audience du courant marxiste hollandais et sa force dépassaient le cadre étroit de la petite Hollande. C'est dans l'Internationale et avec la Gauche allemande que le marxisme hollandais contribua de façon décisive à la naissance de la Gauche communiste. Cette contribution fut moins organisationnelle que théorique, et déterminée par l'activité de Pannekoek en Allemagne. C'était à la fois une force et une faiblesse du "tnbunisme" hollandais.
Chardin
Géographique:
- Hollande [558]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Int. 1987 - 48 à 51
- 3709 reads
Revue Internationale no 48 - 1e trimestre 1987
- 2897 reads
Situation internationale : face à l'enfoncement dans la barbarie, la nécessite et la possibilité de la révolution
- 2544 reads
La misère se généralise, le chômage s'intensifie, la barbarie s'approfondit, la révolution communiste est une nécessite absolue
Depuis plus de quinze ans, la bourgeoisie de tous les pays tient régulièrement des discours lénifiants sur la proximité et la possibilité de sortir de la crise économique. Chaque jour qui passe dément formellement ces pronostics mensongers. A l'encontre des discours bourgeois, la situation présente est à la plongée dans la récession de l'économie mondiale, à une contraction violente du marché, à l'exacerbation sans précédent d'une guerre commerciale acharnée. Le niveau actuel de la crise économique capitaliste laisse clairement apparaître les causes profondes de celle-ci : la surproduction généralisée. Inexorablement cela se traduit par le développement de la misère la plus profonde, une misère sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Epidémies, malnutrition, famines, sont le lot quotidien de milliards d'être humains. C'est ce véritable enfer que vivent, dans les pays à capitalisme moins développé, des populations entières : 40 000 personnes y trouvent chaque jour la mort. Cette réalité barbare tend également à envahir progressivement les pays les plus industrialisés. Nations où des pans entiers, considérables, de l'appareil de production sont démantelés et disparaissent, laissant ainsi la rue des millions d'ouvriers. Ce sont actuellement plus de 32 millions d'entre eux qui se retrouvent dans cette situation, avec des allocations qui ne cessent de se réduire dramatiquement. La bourgeoisie de chaque pays y est contrainte d'attaquer toujours plus massivement et frontalement les populations et particulièrement la classe ouvrière par la réduction des salaires réels, des allocations sociales, des retraites, des dépenses de santé, etc. Mais la généralisation de l'austérité, de la misère n'est qu'une des expressions de la barbarie croissante du capitalisme en voie de putréfaction. Tout aussi parlants sont les derniers événements de Tchernobyl, la fuite de gaz radioactif à la centrale de Minkley-Point (Grande-Bretagne), les 200 000 blessés de Bhopal en Inde suite à 1’explosion d'une usine de gaz toxique. Aussi sophistiquée soit-elle, la production capitaliste devient une arme de destruction dans les mains d'une bourgeoisie acculée, par une guerre économique exacerbée, à tirer un maximum de profit au détriment croissant de toute règle sérieuse de sécurité, en exploitant au maximum des sources d'énergie que personne ne sait réellement contrôler.
Depuis toujours, et tout particulièrement depuis le début de ce siècle, le capitalisme a vécu les armes à la main : deux guerres mondiales sont là pour le rappeler si nécessaire. Mais jamais auparavant nous n'avions connu un tel degré d'armement généralisé de la planète, une telle constance et permanence dans l'utilisation systématique des forces armées, dans la fermentation incessante de conflits locaux. L'enlisement dans la guerre au Liban, entre l'Iran et l'Irak, en Ethiopie, au Mozambique, en Angola, n'est que la partie visible de cet énorme iceberg véritable gangrène qui ronge cette société pourrissante. Dans le cadre historique du capitalisme décadent, il n'existe aucune limite à l'enfoncement dans la barbarie. L'utilisation d'un terrorisme aveugle visant- des populations entières, comme le bombardement aérien de Tripoli par les USA, en plein centre urbain, ou encore comme les derniers attentats d'octobre à Paris, devient un mode courant de règlement de comptes entre les différentes cliques impérialistes, défendant chacune ses propres intérêts sordides, son capital national, son bloc impérialiste de tutelle.
Toute cette misère, cette boue et ce sang révèlent la décomposition avancée du capitalisme. Tout cela marque l'enfoncement continu de ce système barbare dans l'abîme de la décadence. Poussé par ses propres contradictions, incapable de surmonter sa crise économique de surproduction, le capitalisme fait peser sur la tête de toute l'Humanité un danger bien pire encore : une nouvelle guerre impérialiste généralisée.
De tout cela découle la nécessité de le détruire de fond en comble. La révolution communiste s'impose comme un besoin vital à l'humanité afin de balayer définitivement toute cette pourriture et de créer un monde sans exploitation, sans misère et sans guerre. Ainsi s'achèvera la « préhistoire de l'humanité ».
Un scepticisme largement partage
Dans l'ensemble du milieu politique prolétarien, il n'existe aucune sorte de difficulté pour reconnaître et dénoncer la barbarie généralisée du capitalisme. Même les groupes de la mouvance « moderniste » n'y font pas exception. C'est même en général leur terrain de prédilection. Tous mettent en avant la nécessité historique de la révolution communiste, certains groupes modernistes ont même pris des noms fort évocateurs sur ce plan : « Le Communisme », « Les Fossoyeurs du vieux monde », etc. Par contre, c'est une tout autre affaire lorsqu'il s'agit de savoir si le communisme a réellement une chance de voir le jour. Quelle est la force dans la société capable de réaliser la révolution communiste ? Quelles sont les conditions nécessaires à son éclosion ? Quel est le chemin à parcourir ? Dès ce moment-là, les difficultés commencent, le scepticisme gagne.
Pour ce qui concerne le « marais moderniste », en dehors dudit milieu, aussi informel que possible, c'est le doute permanent qui fait force de loi. On se réunit en colloques pour discuter d'activités alternatives (on se demande lesquelles !), on se proclame « les Amis du doute » ou encore « Ecologie et lutte de classes ». On se propose de discuter de la réalisation du communisme « par la lutte écologique », « féministe » et autres fadaises. On fait en ce domaine pire encore que par le passé, l'«Internationale situationniste » est bel et bien enterrée. On doute de tout, mais surtout de la seule force capable de renverser le capitalisme : la classe ouvrière. En s'enlisant ainsi dans des mouvements interclassistes, on signifie que l’on se trouve en dehors du marxisme, en dehors de la lutte de classes. Marx affirmait dans la « Contribution à la critique du Droit de Hegel », oeuvre dite « de jeunesse » de Marx et plat préféré des modernistes :
«La possibilité d'une révolution radicale existe dans le fait de la formation d'une classe dans la société civile, qui ne soit pas une classe de la société civile, d'un groupe social qui soit la dissolution de tous les groupes. Une sphère qui possède un caractère d'universalité, par l'universalité de ses souffrances et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on lui a fait subir non une injustice particulière mais l'injustice en soi, qui ne puisse plus se targuer d'un titre historique, mais seulement d'un titre humain. Qui ne soit pas en contradiction exclusive avec les conséquences, mais en contradiction systématique avec les conditions préalables du régime politique allemand. D'une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper sans émanciper toutes les autres sphères de la société, qui soit en un mot la perte totale de l'homme et ne puisse donc se reconquérir elle-même sans une reconquête totale de l'homme. Cette dissolution de la société réalisée dans une classe particulière, c'est le prolétariat ». C'est le prolétariat à l'exclusion de tout autre, faudrait-il sans doute préciser ici.
Il n'y a donc rien d'étonnant qu'en rejetant ainsi la seule force capable de renverser la société capitaliste, on en arrive à n'être que des sceptiques permanents, incapables de voir l'activité de la classe ouvrière et donc totalement inaptes à comprendre le développement du processus de la lutte de classes. A n'envisager en fin de compte le présent, comme le fait « La Banquise », que sous la forme d'une glaciation, d'une époque de congélation de la révolution. Les classes petites-bourgeoises, qui sont hétérogènes par excellence, ont, comme nous l'avons dit, la caractéristique de méconnaître le sujet historique révolutionnaire de la société moderne : le prolétariat.
Ecrasées dans leur vie quotidienne et matérielle par les effets de la crise économique, tout en étant incapables de mettre en avant une perspective propre, elles sont par conséquent particulièrement réceptives à toutes les mystifications bourgeoises : poussés à la révolte par les conditions de vie que leur fait le capital, un certain nombre d'individus qui les composent s'engluent dans le marais moderniste. Mais étant donné que ce qui les marques fondamentalement c'est l'individualisme, la démoralisation et l'impatience, d'autres ne peuvent éviter de tomber dans le piège du terrorisme. C'est seulement comme cela que peut être expliquée l'existence de groupes terroristes tels qu'« Action directe », la « Bande à Baader » ou encore les « Brigades rouges » en Italie...
Utilisant le terrorisme pour tenter d'« ébranler » le capitalisme et de « réveiller le prolétariat » vu comme une masse amorphe et apathique, ils ne font alors rien d'autre que la preuve de leur propre impuissance. Contrairement à ce que peuvent penser ces quelques individus mystifiés, ces actions purement spectaculaires ne poussent en rien la classe ouvrière à lutter. Par contre elles favorisent grandement le travail permanent qu'effectue la bourgeoisie contre le prolétariat. Celle-ci a beau jeu, après chaque attentat terroriste et au nom de la sécurité des citoyens de développer et déployer tout son arsenal de répression : armée et police. Cela lui permet de préparer d'autant plus efficacement la répression directe de la classe ouvrière et de ses organisations révolutionnaires. C'est même pour ces raisons que tous ces groupes se retrouvent infiltrés et manipulés par les services compétents de l'Etat bourgeois.
Si le scepticisme et le manque de confiance à l'égard du prolétariat — et même les aventures désespérées du terrorisme — s'expliquent pour ces éléments et courants de la petite-bourgeoise, beaucoup plus surprenant par contre est le fait qu'un tel scepticisme puisse exister également, avec autant de force, au sein du milieu politique prolétarien. Cette réalité s'exprime de façon différente suivant les groupes qui le composent, mais il s'agit d'une faiblesse constante qui sévit dans l'ensemble de ce milieu.
Pour le FOR ([1] [1067]), la question est en apparence fort simple : le prolétariat est révolutionnaire ou il n'est pas et c'est le mépris qui domine à l'égard des ouvriers. Dans « Alarme » n° 33, il est écrit sur la lutte des chantiers navals en France : « Qu'est-ce que cela signifie, une nouvelle fois, si ce n'est que les syndicats prennent la classe ouvrière pour un tas d'abrutis ? Et le pire, malgré quelques débordements sans contenu, c'est que ça marche comme en témoigne le remue-ménage syndical sur les chantiers ».
Dans le n° 30 de sa revue, niant totalement le lien existant entre la crise économique et la lutte de classe, le FOR déclare: « Notre principale base économique pour estimer la situation politique mondiale, ce ne sont ni les difficultés du capitalisme, ni le chômage, ni les perspectives d'une reconversion industrielle et encore moins la prétendue crise de surproduction ». Tout ceci ne serait que pur économisme et donc « de fait une manière de se plier à la logique et à la contamination cérébrale que veut nous imposer le capitalisme. » Rien de moins ! La lutte contre le chômage est ainsi assimilée à une « contamination cérébrale ». Sur sa lancée, le FOR peut ensuite écrire : « Le seul problème réel aujourd'hui est l'énorme décalage entre ce qui est possible objectivement et la misérable condition subjective. » Etre plus méprisant à l'égard du prolétariat relèverait du tour de force. Contrairement à ce que pense le FOR, la lutte contre le chômage dans la période actuelle est un des principaux facteurs d'unification des luttes ouvrières. Les luttes économiques de la classe ouvrière ne peuvent être ainsi rejetées, sous peine de tomber dans l'impuissance la plus complète.
A propos des grèves dans le Caucase en 1902, Rosa Luxembourg écrit ceci : « La crise engendra un chômage énorme alimentant le mécontentement dans les masses des prolétaires. Aussi le gouvernement entreprit-il, pour apaiser la classe ouvrière, de ramener progressivement la 'main d'oeuvre inutile' dans son pays d'origine. Cette mesure qui devait toucher environ quatre cents ouvriers du pétrole provoqua précisément à Batoum une protestation massive. Il y eut des manifestations, des arrestations, une répression sanglante et finalement un procès politique au cours duquel la lutte pour des revendications partielles et purement économiques prit le caractère d'un événement politique et révolutionnaire. » (Grève de masses, parti et syndicats).
En fin de compte, lorsqu'on ne comprend pas les conditions générales nécessaires au développement de la lutte ouvrière, on ne peut que tomber dans le doute sur le présent et la fuite dans un avenir hypothétique. La révolution communiste devient une chimère.
" Ce scepticisme profond, nous le retrouvons au sein du BIPR ([2] [1068]) dans la « Revue Communiste » n° 4 (article « Crise du capitalisme et perspectives du BIPR »), il est écrit: « Partout où ils sont les révolutionnaires doivent développer la conscience politique révolutionnaire dans la classe ouvrière et construire une organisation révolutionnaire. Une telle tâche ne peut attendre l’explosion généralisée des luttes ouvrières et elle demeure y compris au cas où la guerre viendrait à éclater, car il est vital que le prolétariat s'organise contre sa propre bourgeoisie en cas de guerre comme en temps de paix. » Cela revient à dire que tout est possible dans la situation historique actuelle : le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale comme la révolution communiste. Mais quelle signification aurait pour toute l'humanité l'éclatement d'un nouveau conflit impérialiste généralisé ?
Le marxisme a toujours rejeté la vision consistant à comprendre les guerres dans l'histoire comme le simple résultat d'une nature humaine par trop belliqueuse, permettant ainsi de tracer un trait d'égalité entre toutes les guerres.
Sans remonter bien loin dans l'histoire, il faut souligner que les guerres du 19e siècle au sein de la société capitaliste elle-même étaient bien différentes dans leurs causes, dans leurs déroulement et implications, que les deux guerres impérialistes généralisées du 20e siècle. Le sens profond des guerres du 19e siècle résidait dans la nécessité pour le capitalisme ascendant de s'ouvrir de nouveaux marchés, de les unifier sur une échelle plus grande. Ce processus s'accompagne de la constitution de nouveaux Etats capitalistes concurrents. Les guerres avaient alors immédiatement une rationalité économique. Mais ce processus d'expansion du capitalisme n'est pas sans limites. Celles-ci s'imposeront dans la réalité par la constitution du marché mondial. Dès lors, l'impérialisme, la lutte à mort entre les différents Etats capitalistes pour étendre leur zone d'influence va régner en maître. La guerre et le militarisme vont être soumis aux exigences de cette nouvelle réalité. Le capitalisme décadent, de par ses propres contradictions internes, se voit alors poussé inexorablement dans la guerre généralisée.
Rosa Luxembourg en 1919 dans le « Discours sur le Programme » au congrès de constitution du PC d'Allemagne, affirmait : « Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l’humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie ou salut par le socialisme. Il est impossible que la guerre mondiale procure aux classes dirigeantes une nouvelle issue, car il n'en existe plus sur le terrain de la domination de classe du capitalisme(...) Le socialisme est devenu une nécessité non seulement parce que le prolétariat ne veut plus vivre dans les conditions matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce que, si le prolétariat ne remplit pas son devoir de classe en réalisant le socialisme, l'abîme nous attend tous,autant que nous sommes. » Paroles particulièrement prophétiques si l'on envisage le déclenchement d'une troisième guerre mondiale.
S'il est vrai que les deux guerres mondiales furent suivies de périodes (de durée très courte) de reconstruction permettant au capitalisme de relancer momentanément son économie, cela ne signifie nullement que ces deux conflits impérialistes généralisés aient constitué des « solutions » à la crise capitaliste délibérément mises en place par la bourgeoisie. En réalité l'un et l'autre résultèrent d'un engrenage incontrôlable entraînant sans rémission l'ensemble de la bourgeoisie vers le gouffre. Si c'est l'effondrement économique qui pousse le capitalisme vers la guerre mondiale, celle-ci constitue l'expression la plus développée, absurde et barbare de la crise historique de ce système. Et la bourgeoisie ne peut pas plus arrêter définitivement le processus qui pousse l'économie mondiale dans une crise généralisée que l'engrenage la conduisant vers une guerre impérialiste totale, tout comme elle ne peut contrôler l'utilisation des moyens de destruction mis à sa disposition.
Déjà durant la deuxième guerre mondiale, la bourgeoisie s'est servie de tous les moyens existant à l'époque. Le résultat en a été le bombardement de Londres par les V1 (ancêtres des missiles) de l'armée allemande ou les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima. Si dans la période actuelle la bourgeoisie est inexorablement poussée vers une troisième guerre mondiale, il ne faut pas se faire d'illusions : cela voudra dire très certainement la quasi destruction de l'humanité dans son ensemble, ce qui met particulièrement en évidence l'absurdité de la thèse sur la rationalité économique pour la bourgeoisie des guerres impérialistes généralisées en période de décadence !
L'utilisation massive de tous les moyens de destruction est alors inévitable : bombes thermonucléaires, bombes à neutrons, etc. La bourgeoisie dispose aujourd'hui de l'arsenal nécessaire et amplement suffisant pour éliminer toute vie de la surface de la planète, en renvoyant alors vraiment cette dernière à l'époque de la glaciation, comme le pense sinistrement « la Banquise ». Le fait d'envisager la possibilité de « la transformation de la 3e guerre mondiale en guerre civile », comme le fait le BIPR dès aujourd'hui, revient à dire dans cette hypothèse que la révolution communiste tient du miracle, que la réalisation du socialisme relève de l'utopie.
Le prolétariat seul frein a la guerre impérialiste : le cours historique aux affrontements de classe généralises
Lorsqu'on se rend compte du scepticisme général qui règne actuellement dans le milieu politique prolétarien — ainsi que dans le marais moderniste — indépendamment des différentes façons dont il s'exprime et de la nature des groupes qui l'affichent, ce qui surprend en premier lieu, c'est qu'aucun des groupes concernés ne s'aperçoive de la contradiction apparente existant actuellement entre le niveau atteint par la crise économique, le développement gigantesque de l'armement, la constitution de deux blocs impérialistes mondiaux et le fait que malgré tout la 3e guerre impérialiste généralisée ne se déclenche pas. On ne peut aller au-delà de cette contradiction apparente qu'en prenant en compte que le déclenchement de la guerre mondiale n'est possible que si la bourgeoisie peut absolument compter non seulement sur la neutralité du prolétariat, mais encore sur son adhésion, sur son embrigadement derrière les idéaux bellicistes et nationalistes de la classe dominante. C'est tout un processus de dégénérescence et de trahisons des partis ouvriers sociaux-démocrates qui a permis la mobilisation du prolétariat en 1914-18.
Pourtant, dès 1917, des mouvements de masse vont surgir contre la guerre. La révolution prolétarienne d'Octobre en Russie, les mouvements révolutionnaires en Allemagne et Autriche-Hongrie en 18-19 vont venir rappeler à la bourgeoisie que l'on ne déclenche pas une guerre mondiale simplement « en s'assurant la neutralité du prolétariat ». C'est pour cela qu'avant la deuxième guerre mondiale, ce sont dix années qui seront nécessaires à la bourgeoisie pour achever l'écrasement physique et le désarmement idéologique de la classe ouvrière, dix années de travail acharné des partis staliniens encore tout auréolés de leur appartenance récente au mouvement ouvrier, dix années de massacres sanglants perpétrés par la soldatesque à la solde de la bourgeoisie. Le résultat a été l'embrigadement de la classe ouvrière sous la bannière de l'anti-fascisme ou dans les rangs du fascisme. La guerre mondiale ne peut éclater sans l'écrasement préalable de toute résistance ouvrière, idéologique et physique.
Dans la période historique actuelle, toute organisation qui n'a pas une vision au jour le jour, qui ne pose pas d'ultimatum aussi absurde à la classe ouvrière, qui ne se pare pas d'un scepticisme grandiloquent, devrait percevoir que la situation est radicalement différente. En effet, depuis l'irruption d'un nouveau cycle de crise ouverte du capitalisme à la fin des années 60, le prolétariat, développe sa lutte et sa conscience préparant ainsi la réalisation de sa propre perspective historique : la révolution communiste, qui sans être inéluctable, devient une réelle possibilité et la seule chance de survie de l'humanité.
C'est donc, dès la fin des années 60 que le prolétariat mondial reprend à une échelle historique le chemin de sa lutte. En premier lieu, pendant toute la période qui va de 1968 à 1974 — avec Mai 68 en France, le Mai rampant en Italie, les affrontements en Pologne en 1970 — le prolétariat marquait alors la fin de plusieurs dizaines d'années de contre-révolution particulièrement noires et sanglantes ayant conduit à la liquidation physique de toute une partie d'une génération de prolétaires. Le fait que cette première vague de luttes se soit déroulée à partir d'une situation économique encore peu dégradée, laissait beaucoup de place pour les illusions au sein de la classe ouvrière, des illusions du type « Programme commun » en France, « Compromis historique » en Italie. La croyance en la possibilité de se sortir de la crise capitaliste, vue comme passagère, comme crise de restructuration, était profondément enracinée dans la classe. L'expérience pratique dans la lutte de l'affrontement aux syndicats restait en très grande partie à faire pour les jeunes générations de prolétaires impliquées dans ces luttes. Les illusions sur la capacité des syndicats de mener le combat de classe avaient une très forte emprise sur le prolétariat.
Mais déjà, malgré toutes ces limites, les quelques minorités révolutionnaires de l'époque se devaient de relever le changement profond dans la situation historique qui était en train de s'opérer.
Après quatre années d'accalmie relative, les années 1978-80 verront à nouveau un développement significatif de la lutte ouvrière qui culminera dans la grève de masse en 1980 en Pologne. Cette deuxième vague de lutte qui se développera à partir d'attaques déjà beaucoup plus fortes de la condition de vie ouvrière démontre l'évolution survenue dans le prolétariat. La combativité y sera plus forte et plus répandue que lors de la première vague de luttes, les illusions sur la possibilité de sortir rapidement de la crise capitaliste moins grandes et moins fortes. Les mystifications bourgeoises du type « Programme commun » ou « Compromis historique », tout en gardant une forte emprise sur la classe ouvrière, ne seront plus suffisantes pour empêcher le développement des luttes de résistance du prolétariat.
C'est pour faire face à cette situation de renforcement du combat de classe que la bourgeoisie sera alors contrainte de réorganiser l'ensemble de son appareil politique et d'enclencher un processus de renvoi de ses forces de gauche dans l'opposition.
Débutant par les luttes en Belgique en 1983, l'actuelle 3° vague de luttes marque un pas en avant important dans le développement de la combativité et de la conscience ouvrières. Elle prend sa source face à des attaques économiques massives et à la suite de plusieurs années de sabotage des luttes mené par la gauche et les syndicats dans l'opposition. Elle se traduit au coeur du capitalisme mondial, dans les pays les plus industrialisés et à haute concentration ouvrière, par l'existence de mouvements de grande ampleur impliquant des centaines de milliers d'ouvriers simultanément (Danemark en 1985, Belgique en 1986, Suède en 1986). Dans tous ces mouvements se sont développées des tendances concrètes à l'unification des luttes par-delà les secteurs, privé, public, chômeurs, etc. : par l'envoi de délégations ouvrières vers différents secteurs, par des manifestations centrales autour de mots d ordre communs, etc. Une grande partie de ces luttes ont débuté de façon spontanée en dehors de toute consigne syndicale, marquant ainsi concrètement dans la lutte l'usure croissante des forces d'encadrement bourgeoises. La vague de luttes actuelle marque toute l'évolution survenue dans le prolétariat depuis la fin des années 60 et notamment le dégagement progressif de l'emprise de l'idéologie bourgeoise et de l'Etat sur la classe ouvrière. Il est caractéristique que les appels de la bourgeoisie à accepter des sacrifices immédiats en vue d'une hypothétique amélioration future rencontrent un écho toujours plus restreint dans les rangs ouvriers. Les campagnes idéologiques sur les luttes de libération nationale (Nicaragua, Angola, etc.), le « pacifisme », l'« anti-totalitarisme » font de moins en moins recette dans la classe ouvrière et n'amoindrissent en rien sa volonté de lutte.
La vague présente de luttes de classe montre la détermination croissante du prolétariat à refuser toujours plus consciemment les conditions de vie qui lui sont faites par le capitalisme décadent ; elle prépare ainsi dès aujourd'hui la future généralisation des luttes dans la grève de masse. Face à la menace du prolétariat, dans l'incapacité de répondre aux exploités par une réelle amélioration de leurs conditions de vie, mais au contraire, contrainte d'exiger l'exploitation toujours plus féroce, la bourgeoise développe à outrance ses appareils de répression (armée, police, etc.), radicalise davantage ses appareils d'encadrement de la lutte ouvrière. Cet état de choses exprime l'affaiblissement historique de la bourgeoisie amenée s à faire face à des mouvements de lutte qui gagnent en ampleur. Il indique que sa priorité absolue est de tenter de battre idéologiquement et d'écraser dans le sang le prolétariat. Si la lutte est suffisamment forte, si elle continue à se développer, alors l'aboutissement de la logique du capitalisme en crise généralisée : la guerre impérialiste mondiale, n'est pas possible.
Aujourd'hui, le cours est vers la montée des luttes : la généralisation de la crise capitaliste reste la principale alliée du prolétariat r Dans le passé, jamais les conditions ne lui ont été aussi favorables. La division de la classe ouvrière dans la vague révolutionnaire commencée en 1917, entre ouvriers des pays vainqueurs et ouvriers des pays vaincus de la première guerre mondiale, n'existe plus. Dans la situation historique présente, le milieu politique prolétarien doit avoir résolument confiance dans les réelles possibilités présentes de la classe ouvrière.
LE SCEPTICISME, UNE ATTITUDE QUI DETOURNE LES ORGANISATIONS REVOLUTIONNAIRES DE LEURS TACHES ACTUELLES
Il est une évidence : le développement de la lutte de classe n'est pas un processus linéaire. Il est fait d'avancées et de reculs, de moments d'accélération et de défaites partielles : « Elles (les grèves de masse) prirent les dimensions d’un mouvement de grande ampleur, elles ne se terminaient pas par une retraite ordonnée, mais elles se transformaient, tantôt en luttes économiques, tantôt en combats de rue, et tantôt s'effondraient d'elles-mêmes. » (Rosa Luxembourg, Grève de masse, partis et syndicats).
Il n'y aurait pas de pire chose que se laisser ballotter au gré des événements, perdre confiance à chaque pause de la lutte de classe car on se rend alors incapable de saisir la dynamique générale du mouvement.
Le chemin qui reste à parcourir est encore long et difficile : sur ce plan, le plus dur est encore devant pour la classe ouvrière. La vague de luttes présente va continuer de se heurter à une bourgeoisie parfaitement organisée et unifiée face au prolétariat. Elle devra s'affronter à des syndicats de plus en plus actifs au sein des luttes ouvrières, à un syndicalisme de base toujours plus « radical » et virulent.
C'est parce que les révolutionnaires connaissent cette réalité, mais aussi parce que jamais les possibilités n'ont été aussi fortes et favorables au mouvement ouvrier, qu'ils doivent éviter à tout prix de tomber dans le scepticisme. Celui-ci ne peut que les détourner des tâches à l'ordre du jour.
C'est dès aujourd'hui dans sa lutte présente que la classe ouvrière a besoin d'une intervention adaptée et décidée des révolutionnaires. Quiconque manque actuellement de confiance dans la classe ouvrière démontre ainsi sa profonde sous-estimation du développement de la lutte de classe. Avec une telle vision on est conduit, comme le font les modernistes, à chercher en dehors du marxisme, en dehors de la lutte de classe, sur le terrain interclassiste des consolations à moindre prix. Dans le meilleur des cas, comme peut le faire une organisation révolutionnaire telle que le FOR, on développe un antisyndicalisme abstrait en dehors de l'activité réelle de la classe.
Etre à l'écoute permanente des mouvements actuels de la lutte de classe, répondre aux besoins du combat par des propositions adaptées à la situation, assumer dans les faits le rôle d'avant-garde de la classe, voilà le devoir présent des révolutionnaires.
C'est la seule façon de vérifier dans la pratique la validité des positions communistes : « Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat /'avantage d'une intelligence claire des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. » (Manifeste Communiste, Marx et Engels).
pa
Questions théoriques:
- Décadence [2]
- Le cours historique [3]
Où en est la crise économique ? : Récession, chômage, inflation : la grande plongée de la fin des années 80
- 7037 reads
La « reprise » de l'économie américaine, amorcée en 1983 et qui a culminé en 1984, est définitivement terminée. Les cris de victoire de l’administration Reagan qui prétendait avoir terrassé la crise, scandés au rythme de la baisse de l'inflation et galvanisés par la croissance record de l'économie américaine en 1984 (6,6%) se sont tus. Le bel optimisme du gouvernement américain, après les doutes de 1985, a sombré, au vu des mauvais résultats de 1986 qui ont amené tous les principaux pays industrialisés à réviser en baisse leurs prévisions de croissance.
A priori, le taux de croissance de l'économie américaine ne sera pas pire en 1986 qu'il ne l'a été en 1985 : après avoir plafonné à 2,2 % en 1985, les premières estimations pour 1986 ont été de 4 %, puis revues à 3 % ; finalement, il devrait se situer plus près des 2 %. Cependant, le taux de croissance de 1986 est resté faible, malgré un déficit budgétaire record qui a servi à faire tourner la production, essentiellement grâce aux commandes d'armement, et surtout malgré une baisse du dollar de plus de 40 % par rapport au yen et au mark allemand qui aurait dû doper les exportations, et donc la production. Cette dernière espérance ne s'est pas réalisée malgré toutes les mesures prises, et c'est avec une inquiétude croissante que les dirigeants politiques et les responsables économiques du monde entier voient l'économie américaine s'engager sur le chemin de la récession, entraînant derrière elle l'ensemble de l'économie mondiale.
Les remèdes de la bourgeoisie face à la crise économique mondiale n'en sont pas, et ne font que répercuter les contradictions de l'économie capitaliste à un niveau toujours plus élevé. Les fameuses « Reaganomics », dont la seule nouveauté était le nom, n'échappent pas à la règle. Cela est vrai tant sur le plan de la croissance du chômage que de l'inflation, plans sur lesquels la bourgeoisie prétendait encore, il y a peu, avoir vaincu la crise.
UN NOUVEAU PAS DANS LA RECESSION
La croissance américaine s'est faite à crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4600 milliards en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé. Et pour quels résultats ! Cette politique n'a pas permis une relance mondiale ; elle a tout au plus permis de bons scores pour les pôles les plus développés (USA, Japon, Allemagne), tandis que pour le reste des pays industrialisés de l'OCDE, l'économie est plutôt restée stagnante, et que pour les pays capitalistes les moins développés, cette politique d'endettement s'est traduite par une fuite des capitaux, un recul dramatique des investissements, et une plongée depuis le début des années 80 dans une récession tragique dont ils ne sont pas sortis. La locomotive américaine n'a pas été suffisante pour entraîner une réelle reprise mondiale ; tout cet endettement n'a permis que de gagner du temps. Et cette politique menée par les USA à coups de déficits budgétaires et commerciaux n'est plus possible aujourd'hui. La dette du gouvernement américain depuis le début de la décennie a crû à un rythme de 16,6 % par an en moyenne ; les seuls remboursements des intérêts pour l'année 1986 s'élèvent à 20 milliards de dollars. Il devient urgent pour les USA de réduire leur déficit budgétaire (210 milliards de dollars en 1986) et commercial (170 milliards de dollars en 1986). Ils doivent rétablir leur balance commerciale et ne peuvent le faire qu'aux dépens de tous leurs concurrents commerciaux (notamment l'Europe et le Japon) qui avaient vu leur croissance stimulée par les exportations vers les USA. Le marché américain, principal marché capitaliste de la planète, est en train de se fermer comme débouché pour les autres pays. La chute de 40 % du dollar vis-à-vis du mark et du yen a constitué le premier pas de cette politique, mais comme celle-ci s'est révélée insuffisante, des mesures encore plus drastiques sont à prévoir de la part de la première puissance mondiale : nouvelle baisse du dollar, protectionnisme renforcé, etc. Les conséquences prévisibles et qui commencent à faire sentir leurs effets sont dramatiques : concurrence exacerbée, déstabilisation du marché mondial et, surtout, nouvelle accélération de la plongée dans la récession dont nul économiste n'ose aujourd'hui prévoir les terribles effets à venir.
VERS UN ACCROISSEMENT DRAMATIQUE DU CHOMAGE
La diminution du chômage aux USA — qui est passé de 9,5 % de la population active en 1983 à 7,1 % en 1985 — a constitué un des axes de la propagande reaganienne pour justifier sa politique économique. Mais ce « succès » est une fausse victoire, car pour l'ensemble des pays européens de l'OCDE, dans le même temps, le chômage a continué sa croissance : 10 % en 1983 et 11 % en 1985. Le chômage n'a pas été vaincu ; au contraire, il s'est développé en dépit de toutes les rodomontades de la propagande bourgeoise. Même là où les résultats ont été les meilleurs, en Amérique du Nord, ceux-ci sont à relativiser, car les chiffres fournis par la bourgeoisie sur cette question sont une tricherie permanente, du fait qu'ils sont soumis aux besoins de la propagande sur ce sujet particulièrement brûlant.
Par rapport aux résultats des USA, il faut d'abord noter que même avec la baisse du chômage, les chiffres restent supérieurs à tous ceux enregistrés avant 1981.
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
USA 6,9 6,0 5,8 7,0 7,5 9,5 9,5 7,4 7,1
Europe 5,7 6,0 6,2 6,8 8,4 9,5 10,0 10,8 11,0
De plus, si la politique de Reagan a permis de créer des centaines de milliers d'emplois, c est essentiellement dans le secteur des services où l'emploi est moins stable, et surtout moins bien payé (d'environ 25 %) que dans l'industrie où 1 million d'emplois ont été perdus.
Avec la chute de la croissance et la concurrence renforcée qui en découle, une nouvelle vague de licenciements massifs est en cours, et il est tout à fait significatif de voir aujourd'hui une firme comme General Motors annoncer la fermeture de 11 usines et plusieurs dizaines milliers de licenciements. Le mythe de la diminution possible du chômage a vécu, alors qu'il y a déjà 32 millions de sans emploi (officiellement) dans les pays de l'OCDE, que les taux de chômage sont déjà en 1985 de 13,2 % en Belgique, 13 % en Grande-Bretagne, 13 % en Hollande, 21,4 % en Espagne ; ce sont des taux comparables à ceux qui ont suivi la grande crise de 1929 qui se profilent à l'horizon.
A aucun moment, la « reprise » américaine n'a permis au chômage de revenir à son niveau des années 70, et maintenant que celle-ci est terminée, c'est une perspective dramatique qui se profile pour la fin des années 80.
LE RETOUR DE L'INFLATION GALOPANTE
S'il est un plan sur lequel la classe dominante croyait bien avoir gagné la partie, c'est bien celui de l'inflation passée pour les pays de l'OCDE de 12,9 % en 1980 à 2,4 %, pour les 12 mois qui ont précédé août 86. Cependant, l'inflation n'a pas disparu, loin de là. Pour l'ensemble du monde, selon le FMI, elle a continué à croître : 12,6 % en 1983, 13,8 % en 1984, 14,2 % en 1985. En fait, seuls les pays les plus industrialisés ont bénéficié de la baisse de l'inflation, tandis que celle-ci continuait ses ravages dans le reste du monde, et tous les plans d'austérité draconiens mis en place au Mexique, en Argentine et au Brésil ne sont pas parvenus à la juguler. L'inflation est présente aux frontières des centres les plus industrialisés, prête à déferler de nouveau : au Mexique, aux portes des USA, 66 % en 1986 ; en Yougoslavie, aux frontières de l'Europe industrielle, 100 % prévus en 1986!
La politique anti-inflationniste menée par les USA et le reste des pays industrialisés n'a pu se faire que par :
— une attaque sévère contre le niveau de vie de la classe ouvrière, afin de diminuer les coûts de production : licenciements massifs, attaques en règle contre les salaires, diminution de la protection sociale, cadences accélérées, etc.,
— et surtout une chute dramatique du cours des matières premières, imposée et orchestrée par les puissances économiques dominantes qui ont mis à profit la situation de surproduction généralisée, ce qui a eu pour résultat de plonger les pays les plus pauvres, essentiellement producteurs de matières de base, dans une misère encore plus effroyable.
Cette politique a eu pour conséquence d'engendrer un rétrécissement du marché mondial et un^ concurrence exacerbée. Elle est fondamentalement à l'origine de la récession comme expression de la surproduction généralisée. Cependant, dans le même temps, la politique d'endettement des USA en vue de maintenir l'activité dans les plus importantes concentrations du monde capitaliste, a été, elle, une politique fondamentalement inflationniste qui tirait des traites sur l'avenir et dont les effets étaient seulement reportés. En procédant ainsi, la classe dominante n'a fait que gagner du temps, et le spectre de l'inflation, chassé par la porte de la baisse des coûts de production et du coût des matières premières, ne peut que faire un retour en force par la fenêtre de l'endettement.
Ainsi, ce n'est pas par hasard si, au même moment, les principaux pays industrialisés sont amenés à réviser en baisse les prévisions de croissance, présentant ainsi la perspective d'une nouvelle accélération de la plongée dans la récession, et à réviser en hausse les indices d'inflation. Toutes les mesures prises pour freiner la récession qui s'impose inéluctablement, ne peuvent que contribuer à une relance de l'inflation dans une situation où l'accumulation d'un endettement gigantesque a créé les conditions d'un développement rapide de celle-ci. Le double infléchissement : croissance en chute, inflation en hausse de l'année 1986, est caractéristique de la dégradation profonde de l'économie mondiale ces dernières années.
LE JAPON ET L'ALLEMAGNE DANS LA TOURMENTE DE LA CRISE
Finalement, les résultats de la « reprise » américaine sont bien faibles :
— l'économie mondiale n'est pas sortie de la récession amorcée à l'aube des années 80 ; celle-ci a tout au plus été freinée essentiellement dans les pays les plus industrialisés;
— le chômage a continué de se développer, et là où il a pu diminuer d'une année sur l'autre, il n'est cependant jamais revenu au niveau d'avant le début de cette décennie;
— l'inflation n'a pas disparu, et les conditions de son redéveloppement se sont renforcées.
Ce piètre résultat a cependant été obtenu au prix fort d'un endettement gigantesque, nous l'avons vu pour les USA, mais aussi pour l'ensemble du monde : la dette des pays au capitalisme sous-développé est passée, de 1980 à aujourd'hui, de 800 à plus de 1000 milliards de dollars, au prix d'une paupérisation dramatique de la population, avec pour conséquence des famines comme jamais l'humanité n'en avait connues dans son histoire, au prix d'un déséquilibre renforcé entre les pays capitalistes les plus pauvres et les pays les plus riches, au prix d'une instabilité croissante du marché mondial qui a vu sa principale monnaie, le dollar, jouer au yoyo, doublant son cours en trois ans, pour reperdre la moitié de sa valeur en un an. Tout cela signifie une fragilisation très importante de l'économie capitaliste mondiale.
Mais aujourd'hui, même cette politique aux conséquences catastrophiques n'est plus possible pour maintenir l'activité des centres industriels; l'économie américaine, locomotive de l'économie mondiale, a entamé son irrésistible plongée dans la récession.
A la lumière de la catastrophe prévisible à venir, c'est avec une inquiétude croissante que les dirigeants du monde entier sont à la recherche désespérée de nouvelles solutions qui permettraient de prolonger l’« atterrissage en douceur » de l'économie mondiale. L'administration Reagan prétend avoir trouvé la réponse avec ses demandes répétées au Japon et à l'Allemagne de contribuer à la « relance » de l'économie mondiale. Mais cette « solution », pas plus que les précédentes, n'en est une. Ce que n'a pas réussi à faire l'économie américaine, relancer l'économie mondiale, les économies japonaise et allemande en ont encore moins les moyens.
A eux deux, le Japon et la RFA ne représentent que la moitié du PNB des USA (en 1985 : 612 milliards de dollars pour la RFA, 1233 pour le Japon, contre 3865 pour les USA) ; tout au plus peuvent-ils, par une politique de relance interne, contribuer à freiner la plongée dans la récession. Mais à quel prix ? Les fameux pays du miracle économique japonais et allemand ne sont plus que des miraculés en sursis. L'Allemagne et le Japon sont ceux qui ont le mieux profité de la reprise américaine ; la fermeture du marché américain frappe aujourd'hui leur économie de plein fouet.
L'exemple du Japon est particulièrement significatif. Initialement estimée à 4 % en 1986 (après avoir été de 5,1 % en 1984 et de 4,8 % en 1985), la croissance ne cesse tout au long de l'année 1986, d'être revue en baisse. Officiellement, elle devrait être finalement de 2,8 %, mais au vu des résultats, elle pourrait n'atteindre que 2,3 %. Durant le premier semestre 1986, la production industrielle a baissé de 0,2 % par rapport à la même période de 1985 ; les résultats de l'automne risquent d'être encore plus alarmants. La récession est déjà une réalité tangible au Japon, la 2e puissance économique du monde.
En conséquence, on assiste à une flambée du chômage, le chiffre de 6 % annoncé par les journaux japonais est certainement plus réaliste que les 3 % officiels (qui ne considèrent pas comme chômeur tout ouvrier qui a travaillé ne serait-ce qu'une heure dans le mois). Tous les grands groupes industriels annoncent des licenciements. D'ici à 1988, les cinq grands groupes sidérurgiques annoncent 22 500 suppressions d'emploi. A la fin de 1986, 6 000 emplois auront été supprimés dans la construction navale. Le gouvernement, de son côté, a décidé de licencier dans les chemins de fer, et surtout dans les mines de charbon : 8 mines sur 11 vont être fermées, entraînant 14 000 suppressions d'emploi. Le mythe du Japon qui ne connaît pas le chômage a définitivement sombré.
Et pourtant, ces résultats négatifs se sont produits malgré la politique de relance interne du gouvernement japonais qui a fait baisser son taux d'escompte tout au long de l'année 1986 jusqu'à 3 % aujourd'hui. Un record ! Mais cela n'est pas suffisant pour compenser la baisse des exportations vers les USA.
Les chiffres record des excédents de la balance commerciale japonaise ne doivent pas semer l'illusion. Ils sont essentiellement dus à la chute des importations, liée à la chute des cours des matières premières et notamment du pétrole. Mais cette situation est tout à fait provisoire. Ce n'est qu'à grand peine que le Japon a maintenu ses exportations en rognant sur ses marges bénéficiaires face à un dollar en baisse qui a diminué d'autant la compétitivité de ses exportations. Ce qui a pour la première fois conduit les grandes entreprises japonaises exportatrices à enregistrer des pertes.
L'économie allemande ne sauve guère mieux les apparences, la situation n'est pas florissante. Le chômage persistant se maintient à 8,5 % de la population active, la croissance industrielle a stagné à 1,6 % d'août 1985 à août 1986 et les mauvais résultats de l'automne ont amené les autorités germaniques à réviser à la baisse toutes leurs prévisions de croissance (pour 1987, on ne s'attend plus qu'à une croissance de 2 %, ce qui est peut-être encore optimiste). La croissance de la masse monétaire, pourtant de 7,9 % d'août 85 à août 86, ne parvient pas à stimuler la croissance. Malgré les résultats exceptionnels obtenus sur le plan de l'inflation, et qui sont dus essentiellement à la revalorisation du mark. Cette croissance de la masse monétaire annonce l'inflation à brève échéance.
Le Japon et la RFA ont commencé une politique de croissance interne, mais celle-ci se révèle déjà insuffisante pour leur économie nationale. Alors, quant à relancer l'économie mondiale, il n'en est pas question. Les recettes reaganiennes appliquées à ces pays ne peuvent qu'avoir des résultats encore plus aléatoires que pour les USA. Le Japon et l'Allemagne sombrent eux aussi de plus en plus nettement dans l'abîme de la récession mondiale.
DE PLAIN-PIED DANS LA CATASTROPHE ECONOMIQUE
Les perspectives sont donc on ne peut plus sombres pour l'économie mondiale. Toutes les « solutions » mises en avant et appliquées par la bourgeoisie se révèlent impuissantes à juguler la crise qui poursuit son long travail de dégradation de l'économie capitaliste. La classe dominante est en train de brûler ses dernières cartouches pour freiner autant que possible la plongée dans la récession. Les dernières années ont montré que la relance mondiale était devenue impossible, la crise a mis en échec toutes les mesures apprises par les économistes de la bourgeoisie depuis la crise de 1929, et même la relance par l'économie de guerre vient d'échouer avec la fin de la « reprise » américaine. La surproduction est générale, y compris pour l'industrie d'armements, où l'on voit une entreprise comme Dassault en France être aujourd'hui obligée de licencier.
La seule question qui se pose maintenant, ce n'est pas de savoir si la perspective est catastrophique, elle l'est, mais à quelle vitesse l'économie mondiale s'enfonce dans cette catastrophe. Plus la bourgeoisie va vouloir freiner les effets de la récession, plus l'inflation se développe. Plus la bourgeoisie veut freiner le développement de l'inflation, plus la récession s'accélère, et finalement les deux tendent à se développer ensemble.
Avec l'effondrement de l'économie mondiale, ce sont les dernières illusions sur le capitalisme qui vont être sapées à la base. La misère et la barbarie qui se développent plus que jamais imposent la nécessité de la perspective communiste. La crise balaie le terrain pour que cette perspective puisse s'imposer comme la seule issue. La crise, malgré les misères qu'elle impose, en détruisant les bases d'existence et de mystification de la classe dominante est la meilleure alliée du prolétariat.
JJ. 26/11/86
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (1)
- 4811 reads
A travers la polémique avec un groupe, le GCI[1] [1071] qui se dit marxiste mais rejette violemment l'idée de la décadence», voici une réaffirmation des fondements de l'analyse de la décadence du capitalisme et de sa brûlante actualité au milieu des années 80, lorsque le prolétariat mondial relève la tête et se prépare à livrer des combats décisifs pour son émancipation.
Pourquoi l'humanité en est-elle à se poser la question de savoir si elle n'est pas en train de s'autodétruire dans une barbarie croissante, alors qu'elle a atteint un degré de développement des forces productives qui lui permettrait de s'engager dans la voie de la réalisation d'un monde sans pénurie matérielle, une société unifiée capable de modeler sa vie suivant ses besoins, sa conscience, ses désirs, pour la première fois de son histoire ?
Le prolétariat, la classe ouvrière mondiale, constitue-t-elle la force révolutionnaire capable de sortir l'humanité de l'impasse dans laquelle le capitalisme l'a enfermée, et pourquoi les formes de lutte du prolétariat à notre époque ne peuvent-elles plus être celles de la fin du siècle dernier (syndicalisme, parlementarisme, lutte pour des réformes, etc.) ? Il est impossible de prétendre se repérer dans la situation historique actuelle, encore moins de jouer un rôle d'avant-garde, d'orientation pour les luttes ouvrières, sans avoir une vision globale, cohérente, permettant de répondre à ces questions aussi élémentaires que cruciales.
Le marxisme -le matérialisme historique- est la seule conception du monde qui permette de le faire. Sa réponse claire et simple peut être résumée en peu de mots : pas plus que les autres modes de production qui l'ont précédé (communisme primitif, despotisme oriental, esclavagisme, féodalisme), le capitalisme n'est un système éternel.
L'apparition puis la domination mondiale du capitalisme furent le produit de toute une évolution de l'humanité et du développement de ses forces productives : au moulin à bras correspondait l'esclavagisme, au moulin à eau le féodalisme, au moulin à vapeur le capitalisme, écrivait Marx. Mais au-delà d'un certain degré de développement, les rapports de production capitalistes se sont transformés à leur tour en obstacle au développement des forces productives. Dès lors, l'humanité vit prisonnière d'un ensemble de rapports sociaux devenus inadaptés, obsolètes, qui la condamnent à une «barbarie» croissante dans tous les domaines de la vie sociale. La succession de crises, guerres mondiales, reconstructions, crises, depuis quatre-vingts ans n'en est que la plus claire manifestation. C'est la décadence du capitalisme. La seule issue est dès lors la destruction de fond en comble de ces rapports sociaux par une révolution dont seul le prolétariat peut assumer la direction, car il est la seule classe véritablement antagoniste au capital ; une révolution qui peut aboutir à une société communiste parce que le capitalisme, pour la première fois dans l'histoire, a permis la création des moyens matériels d'entreprendre une telle réalisation.
Tant que le capitalisme remplissait une fonction historiquement progressiste de développement des forces productives, les luttes prolétariennes ne pouvaient aboutir à une révolution mondiale triomphante mais pouvaient, à travers le syndicalisme et le parlementarisme, obtenir de véritables réformes et améliorations durables des conditions d'existence de la classe exploitée. A partir du moment où le système capitaliste entre en décadence, la révolution communiste mondiale devient une nécessité et une possibilité à l'ordre du jour, ce qui bouleverse entièrement les formes de combat du prolétariat, même sur le plan immédiat revendicatif (grève de masses).
Depuis l'Internationale communiste, constituée sous la poussée de la vague révolutionnaire internationale qui mit fin à la première guerre mondiale, cette analyse de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence est devenue patrimoine commun des courants communistes qui ont su, grâce à cette « boussole historique», se maintenir sur un terrain de classe intransigeant et cohérent. Le CCI n'a fait que reprendre et développer ce patrimoine tel qu'il fut transmis et enrichi par le travail des courants des gauches communistes allemande, italienne ("Bilan"), dans les années 30, puis du groupe de la gauche communiste de France ("Internationalisme") dans les années 40[2] [1072]
Aujourd'hui, alors que sous la pression d'une crise économique sans précédent qui, depuis plus de quinze ans, accélère les manifestations de la décadence et exacerbe les antagonismes de classes, le prolétariat mondial a repris le chemin de la lutte, lentement, se heurtant à mille difficultés et aux mille armes de la classe dominante, mais avec une simultanéité internationale inconnue auparavant, il est crucial que les organisations révolutionnaires sachent être à la hauteur de leur fonction.
En vue des combats décisifs qui se préparent, plus que jamais il est indispensable que le prolétariat se réapproprie sa propre conception du monde, telle qu'elle s'est élaborée à travers près de deux siècles de luttes ouvrières et d'élaboration théorique de ses organisations politiques.
Plus que jamais, il est indispensable que le prolétariat comprenne que l'actuelle accélération de la barbarie, l'exacerbation ininterrompue de son exploitation ne sont pas des fatalités "naturelles", mais les conséquences des lois économiques et sociales capitalistes qui continuent à régir le monde alors qu'elles sont devenues historiquement dépassées depuis le début du siècle.
Plus que jamais, il est indispensable que la classe ouvrière comprenne que les formes de lutte qu'elle avait apprises au siècle dernier (luttes pour les réformes, appui à la constitution de grands Etats nationaux - pôles d'accumulation du capitalisme en développement), si elles avaient un sens lorsque la bourgeoisie était encore en plein développement historique et pouvait accepter l'existence du prolétariat organisé au sein de la société, ces mêmes formes ne peuvent le conduire, à l'heure du capitalisme décadent, qu'à des impasses et à l'inefficacité.
Plus que jamais il est crucial que le prolétariat comprenne que la révolution communiste - dont il est le porteur - n'est pas un rêve chimérique, une utopie, mais une nécessité et une possibilité qui trouve ses fondements scientifiques dans la compréhension de la décadence même du mode de production dominant, décadence qui s'accélère sous ses yeux.
“Il n'y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire”, disait Lénine. Cette idée est d'autant plus à réaffirmer aujourd'hui que la classe dominante ne se défend plus idéologiquement par l'élaboration de théories nouvelles ayant un minimum de consistance, mais par une sorte de “nihilisme” de la conscience, le rejet de toute théorie comme “fanatisme idéologique”. S'appuyant sur la méfiance justifiée de la classe exploitée à l'égard des théories “de gauche” qui, de la social-démocratie au stalinisme, ont été utilisées pendant des décennies comme instruments de la contrerévolution, incapable de trouver dans la réalité sociale en décomposition un quelconque avenir à offrir, la classe dominante n'a rien d'autre à proposer que “la politique de l'autruche” : ne pas réfléchir, se résigner, le fatalisme.
Lorsque la bourgeoisie était une classe historiquement révolutionnaire elle a donné des Hegel qui ont ouvert des portes essentielles pour la compréhension de l'évolution de l'humanité ; lorsqu'elle stabilise son pouvoir dans la seconde moitié du 19e siècle, elle revient en arrière à travers les conceptions positivistes d'un Auguste Conte. Aujourd'hui, elle ne produit même plus de philosophes pouvant revendiquer une compréhension de l'histoire. L'idéologie dominante, c'est le néant, le vide, la négation de la conscience.
Mais autant cette négation de la conscience est la manifestation d'une décadence qui devient à son tour instrument de défense de la classe dominante, autant pour la classe révolutionnaire la conscience de son être historique est un instrument vital pour sa lutte.
LES «ANTI-DECADENTISTES»
Ce qui nous préoccupe ici, c'est que cette tendance au nihilisme de la conscience se manifeste aussi dans des groupes politiques prolétariens ...paradoxalement à prétentions théoriques.
C'est ainsi que l'on a pu voir, fin 1985, un groupe comme le GCI publier un article dans le n° 23 de son organe “Le Communiste” qui, par son contenu, illustre parfaitement la deuxième partie de son titre : “Théories de la décadence : décadence de la théorie”. Ce texte, écrit dans un langage prétentieux, à “sonorité marxiste”, citant à tort et à travers Marx et Engels, prétend détruire ce qu'il appelle les “théories décadentistes”, dont il situe les défenseurs à côté de : “Tous les chacals réactionnaires hurlant à la 'décadence de l'Occident' depuis les témoins de Jéhovah, jusqu'aux «nouveaux philosophes», en passant par les néo-nazis européo-centristes, jusqu'aux adorateurs de Moon !” Rien que ça!
Ce texte réussit le chef-d'oeuvre de concentrer en quinze pages les principales incompréhensions de base que l'on peut trouver dans l'histoire du mouvement ouvrier en ce qui concerne l'évolution historique du capitalisme et les bases objectives pour l'avènement d'une société communiste. Le résultat est une bouillie aussi pédante qu'informe, qui mélange les théories tant combattues par Marx des socialistes utopiques, celles des anarchistes ...et, pour les temps modernes, la théorie bordiguiste des années 50 sur l'“invariance” du marxisme et sur le développement continu du capitalisme depuis 1848 !
Nous nous attacherons ici à mettre en lumière les principales aberrations de ce document, pas tant pour le GCI en lui-même dont l'involution vers l'incohérence est d'un intérêt fort restreint, mais parce que sa défense de certaines positions politiques de classe, son langage radical et ses prétentions théoriques, peuvent faire illusion chez des éléments nouveaux à la recherche d'une cohérence - entre autres, parmi ceux qui viennent de l'anarchisme[3] [1073]
Cela permettra de rappeler quelques éléments de base de l'analyse marxiste de l'évolution des sociétés et donc de ce qu'on entend par décadence du capitalisme.
Y-A-T-IL UNE EVOLUTION HISTORIQUE ?
Y-A-T-IL UNE PHASE ASCENDANTE DU CAPITALISME?
Le GCI n'est pas modeste. A la manière de Dühring qui prétendait bouleverser la Science, le GCI bouleverse le Marxisme. Il se veut marxiste, mais à condition de rejeter dans le camp des «chacals réactionnaires» tous ceux qui depuis la 2e Internationale ont enrichi le marxisme en analysant les causes et l'évolution de la décadence du capitalisme... et comme on le verra, en ignorant ou altérant totalement l'oeuvre de Marx lui-même.
La grande découverte du GCI, celle qui réduit au rang d'«adorateurs de Moon» les Bolcheviks, les Spartakistes, la gauche allemande du KAPD, la gauche italienne de «Bilan» - qui ont tous élaboré et partagé l'analyse de la décadence du capitalisme -, sa grande vérité, consiste en ceci : il n'y a pas de décadence du capitalisme parce qu'il n'y a jamais eu de phase ascendante «progressiste» du capitalisme. Il n'y a pas de barbarie de la décadence parce que le capitalisme a toujours été barbare.
Il suffisait d'y penser !... Si ce n'était que les courants socialistes pré-marxistes et leurs héritiers anarchistes, qui n'ont jamais compris à quoi bon cela pouvait servir de passer du temps à réfléchir sur les lois de l'évolution historique - puisqu'il suffit d'être révolté et que le communisme a toujours été à l'ordre du jour de l'histoire - n'ont jamais dit autre chose ...contre le marxisme.
Mais regardons de plus près les principaux arguments du GCI: «Presque tous les groupes se prévalant aujourd'hui de défendre la perspective communiste se réclament d'une vision décadentiste non seulement du mode de production capitaliste mais de l'ensemble de la succession de sociétés de classes (cycle de la valeur) et cela grâce à de multiples 'théories' allant de la 'saturation des marchés' à 'l'impérialisme : stade supérieur du capitalisme', du 'troisième âge du capitalisme' à la 'domination réelle', de 'l'arrêt du développement des forces productives' à '1a baisse tendancielle du taux de profit'... Ce qui nous intéresse dans un premier temps est le contenu commun à toutes ces théories : la vision moralisatrice et civilisatrice qu'elles induisent.» (“Théories de la décadence : décadence de la théorie”, “Le Communiste” n° 23, p. 7, novembre 1985)
En quoi constater que les rapports de production capitalistes sont devenus à un moment donné une entrave au- développement des forces productives, traduirait-il une conception «moralisatrice et civilisatrice» ? Parce que cela implique qu'il y aurait eu un temps où tel n'était pas le cas et où ces rapports auraient constitué un progrès, un pas en avant dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase ascendante du capitalisme. Or, dit le GCI, ce “progrès” n'était qu'un renforcement de l'exploitation :
“(...) il s'agit de voir en quoi la marche forcée du progrès et de la civilisation a signifié chaque fois plus d'exploitation, 1a production de surtravail (et pour le capitalisme uniquement la transformation de ce surtravail en survaleur) en fait 1a réelle affirmation de la barbarie par la domination de plus en plus totalitaire de la valeur...” (op. cit. p. 8, le GCI emploie ici le terme de “barbarie” sans savoir de quoi il s'agit ; nous y reviendrons plus loin). Que le capitalisme ait toujours été depuis sa naissance un système d'exploitation -le plus achevé, le plus impitoyable- n'est ni faux ni nouveau, mais, à moins de partager la vision idéaliste –“morale” au sens propre du terme- suivant laquelle n'est progrès dans l'histoire que ce qui avance de façon immédiate dans le sens de la “justice sociale”, cela n'explique pas encore pourquoi affirmer que l'instauration de ce mode d'exploitation représenta un progrès historique, constitue une preuve de “vision moralisatrice et civilisatrice”. Le GCI nous explique alors que : “La bourgeoisie présenta (...) tous les modes de production qui l'ont précédée comme 'barbares' et 'sauvages' et, à mesure de 'l'évolution' historique, progressivement 'civilisés'. Le mode de production capitaliste étant bien entendu l'incarnation de l'aboutissement final de la Civilisation et du Progrès. La vision évolutionniste correspond donc bien à l'être social capitaliste et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle fut appliquée à toutes les sciences (c'est-à-dire à toutes les interprétations partielles de la réalité du point de vue bourgeois) : science de la nature (Darwin), démographie (Malthus), histoire logique, philosophie (Hege1)...” (Ibid.p.8).
Le GCI a placé au début de son texte, en grosses lettres, en encadré, ce titre “ambitieux” : “Première contribution : la méthodologie”. Le morceau que nous venons de citer est un échantillon de ce qu'il a à nous offrir dans ce domaine.
“La bourgeoisie, constate le GCI, présente le mode de production capitaliste comme étant l'aboutissement final de la civilisation et du “progrès”. “Donc, conclut-il la vision évolutionniste correspond à l'être social capitaliste”.
C'est en-deçà du plus stupide syllogisme ! Avec une telle “méthodologie”, pourquoi ne pas penser que les théories “fixistes” (“rien de nouveau sous le soleil”) correspondent à l'“être social du prolétariat” ? La bourgeoisie disait que le monde bouge et que l'histoire évolue. Le GCI en déduit que puisque c'est la bourgeoisie qui l'a dit, ce doit être certainement faux ; donc, le monde n'évolue pas. Si aberrant que cela paraisse, c'est à cela qu'aboutit “la méthode” du GCI, comme on le verra plus loin à propos de son adhésion à la vision de «l'invariance».
Le marxisme rejette évidemment l'idée que le capitalisme représente l'aboutissement de l'évolution humaine. Mais il ne rejette pas pour autant l'idée que l'histoire humaine a suivi une évolution qui peut être rationnellement expliquée et dont il s'agit de trouver les lois. Marx et Engels en leur temps reconnurent les mérites scientifiques de Darwin et se sont toujours réclamés du noyau rationnel de la dialectique hégélienne (Malthus, que le GCI ramène ici, n'a rien à faire dans cette histoire). Ils ont su voir dans ces efforts pour définir une évolution, une vision dynamique de l'histoire, la manifestation du combat que devait livrer la bourgeoisie pour asseoir son pouvoir contre la réaction féodale, avec ses avancées et ses limites. Voici comment Engels parle de Darwin dans l'“Anti-Dühring” : “Il faut citer ici Darwin, qui a porté le coup 1e plus puissant à la conception méthaphysique de la nature en démontrant que toute la nature organique actuelle, les plantes, les animaux et, par conséquent, l'homme aussi, est le produit d'un processus d'évolution qui s'est poursuivi pendant des millions d'années” (chap. I).
De Hegel, il dit ceci: “De ce point de vue, l'histoire de l'humanité n'apparaissait plus comme un enchevêtrement chaotique de violences absurdes, toutes également condamnables devant le tribunal de la raison philosophique arrivé à maturité et qu'il est préférable d'oublier aussi rapidement que possible, mais comme le processus évolutif de l'humanité lui-même” (chap. I).
Ce que le marxisme rejette de la vision de Hegel c'est son caractère encore idéaliste (l'histoire ne serait que la réalisation de l'Idée de l'histoire) et bourgeois (l'Etat capitaliste serait l'incarnation de la raison achevée) et, évidemment pas l'idée qu'il existe une évolution historique qui traverse des étapes nécessaires. Au contraire, il revient à Marx le mérite d'avoir découvert ce qui constituait le fil conducteur de l'évolution des sociétés humaines et d'avoir fondé sur cela la nécessité et la possibilité du communisme :
“Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. (...) Réduits à leurs grandes lignes, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne apparaissent comme des époques progressives de la formation économique de 1a société. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagonique du procès social de production (...) Avec ce système social, c'est donc la préhistoire de la société humaine qui se clôt.” (Avant-propos à la Critique de l'Economie politique).
LE COMMUNISME A-T-IL TOUJOURS ÉTÉ A L'ORDRE DU JOUR DANS L'HISTOIRE ?
Dans son délire “anti-décadentiste” le GCI considère que ceux qui défendent aujourd'hui l'analyse de la décadence du capitalisme ne parlent de déclin du capitalisme à notre époque que pour mieux être “pro-capitalistes”... il y a un siècle (!) : “Les décadentistes sont donc pro-esclavagistes jusqu'à telle date, pro-féodaux jusqu'à telle autre... pro-capitalistes jusqu'en 1914 ! Ils sont donc chaque fois, du fait de leur culte du progrès, opposés à la guerre de classe que mènent les exploités opposés aux mouvements communistes qui ont le malheur de se déclencher dans la «mauvaise phase” (GCI, op. cit., p. 19)
Avec de grands airs de radicalisme, le GCI ne fait que reprendre la vision idéaliste d'après laquelle le communisme a été à l'ordre du jour à n'importe quel moment de l'histoire.
Nous n'entrerons pas ici dans la question des spécificités du combat prolétarien au cours de la phase ascendante du capitalisme, mais pourquoi le “Manifeste communiste” dit-il : “Au début (...) les prolétaires ne combattent pas encore leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, les résidus de la monarchie absolue, les propriétaires fonciers, les bourgeois non-industriels, les petits-bourgeois” (Manifeste communiste, “Bourgeois et prolétaires”) ? Pourquoi et comment les luttes ouvrières de la phase suivante se donnent-elles pour objectif la conquête de réformes et l'“union de plus en plus étendue des travailleurs” ? Pourquoi le syndicalisme, les partis de masse, la social-démocratie de la fin du XIXe siècle furent-ils des instruments prolétariens...? Toutes ces formes de lutte que le GCI est incapable de comprendre et rejette un siècle après comme bourgeoises, nous les aborderons dans un prochain article consacré spécifiquement à la question de la nature prolétarienne de la social-démocratie.
Pour le moment, ce qui nous importe ici et ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est la conception marxiste de l'histoire et des conditions de la révolution communiste.
Marx, les marxistes, ne se sont jamais cantonnés à dire simplement : le capitalisme est un système d'exploitation qu'il faut détruire et qui n'aurait jamais dû exister, le communisme étant possible à tout moment. C'est sur cette question que le marxisme constitue une rupture avec le socialisme “utopique” ou “sentimental” ; c'est sur cette question que se fera la rupture entre anarchisme et marxisme. Tel fut l'objet du débat entre Marx et Weitling en 1846, qui devait aboutir à la constitution de la première organisation politique marxiste: la Ligue des Communistes. Pour Weitling : “Ou bien l'humanité est, nécessairement, toujours mûre pour 1a révolution, ou bien elle ne le sera jamais” (cité par Nicolaïevski, La Vie de Karl Marx, chap. X).
C'est encore ce même problème qui est la base des divergences entre Marx-Engels et la tendance de Willich et Schapper au sein de la Ligue des Communistes en 1850, et qui fera dire à Marx : “A la conception critique, la minorité substitue une conception dogmatique, à la conception matérialiste, elle substitue une conception idéaliste. Au lieu des conditions réelles, elle considère la simple volonté comme le moteur de la révolution.” (Procès-verbal de la séance du Comité central du 15 septembre 1850, cité par Nicolaïevski, op.cit., chap XV).
C'est la conception du matérialisme historique, du socialisme scientifique que rejette le GCI. Voici comment Engels dans l'“Anti-Dühring” abordait un aspect fondamental des conditions du communisme : “La scission de la société en une classe exploiteuse et une classe exploitée, en une classe dominante et une classe opprimée était une conséquence nécessaire du faible développement de la production dans le passé. Tant que le travail total de la société ne fournit qu'un rendement excédant à peine ce qui est nécessaire pour assurer strictement l'existence de tous, tant que le travail réclame donc tout ou presque tout le temps de la grande majorité des membres de la société, celle-ci se divise nécessairement en classes. (...) Mais si, d'après cela, la division en classes a une certaine légitimité historique, elle ne l'a pourtant que pour un temps donné, pour des conditions sociales données. Elle se fondait sur l'insuffisance de la production ; elle sera balayée par 1e plein déploiement des forces productives modernes” (partie III, chap. II).
C'est en ce sens que Marx parla des “merveilles” accomplies par la bourgeoisie et de “la grande influence civilisatrice du capital”. “C'est elle (1a bourgeoisie) qui a montré ce que l'activité humaine est capable de réaliser. Elle a accompli des merveilles qui sont autre chose que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques ; les expéditions qu'elle a menées à bien sont très différentes des invasions et des croisades.” (Marx/Engels : Le Manifeste communiste, “Bourgeois et Prolétaires”).
“C'est ici, écrit ailleurs Marx, la grande influence civilisatrice du capital : il hausse la société à un niveau en regard duquel tous les stades antérieurs font figure d'évolutions locales de l'humanité et d'idolâtrie de la nature. La nature devient enfin un pur objet pour l'homme, une simple affaire d'utilité ; elle n'est plus tenue pour une puissance -en soi” (Grundrisse, Chap. II : Le capital; marché mondial et système de besoins - 1857-58).
Si le GCI était conséquent, s'il avait un quelconque souci de cohérence théorique, il ne devrait pas hésiter à rejeter aux poubelles de la bourgeoisie -après les gauches communistes, après Trotsky, Lénine, Luxembourg et toute la 2e Internationale- les vieux Marx et Engels, en tant que farouches défenseurs de ce qu'il appelle des conceptions “évolutionnistes” et “civilisatrices”.
Peut-être qu'alors le groupe RAIA, ayant pour sa part achevé son approfondissement de “la question Marx-Bakounine”, pourra lui faire comprendre que ce qu'il défend n'est rien d'autre que la vieille et insipide rengaine utopiste et anarchiste, maquillée -pour on ne sait quelle raison- d'un verbiage marxiste.
LA DÉCADENCE DU CAPITALISME : “UNE ÈRE DE RÉVOLUTION SOCIALE”
A partir de quel moment la révolution communiste devient-elle une possibilité historique ? Marx répond : “A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de 1a société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale.” (Avant-propos à la Critique de l'Economie politique, 1859).
Le marxisme ne définit pas un jour, une heure, à partir de laquelle la révolution communiste est objectivement à l'ordre du jour. Il détermine les conditions générales -au niveau de ce qui constitue le squelette de la vie sociale, l'économie- qui caractérisent une “ère”, une période historique dans laquelle le capitalisme se heurte d'une façon qualitativement différente à ses propres contradictions, et se transforme en frein au développement des forces productives.
Les principales manifestations de cette nouvelle situation historique se situent au niveau économique (crises économiques, ralentissement de la croissance des forces productives). Mais aussi au niveau de l'ensemble des aspects de la vie sociale qui, en dernière instance, sont influencés par la vie économique de la société. Marx parle des “formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit (entre rapports de production et forces productives, ndlr) et le poussent jusqu'au bout.” (Avant-propos...).
Marx et Engels crurent à plusieurs reprises au cours de la deuxième moitié du 19e siècle que le capitalisme était parvenu à ce point, en particulier à l'occasion des différentes crises économiques cycliques qui secouèrent le système à cette époque. Ils surent reconnaître à chaque occasion qu'il n'en était rien.
Ainsi, en 1850, après que la crise économique et sociale de 1848 fut dépassée, Marx écrivait :
“Avec cette prospérité générale, au sein de laquelle les forces productives de la société bourgeoise se développent avec toute l'exubérance que permettent les conditions bourgeoises, il ne peut être question d'une véritable révolution. Une telle révolution n'est possible que dans une période où deux facteurs se trouvent en opposition : les forces productives modernes et les formes bourgeoises de production (...) Une nouvelle révolution n'est possible qu'à la suite d'une nouvelle crise. Mais celle-là est aussi certaine que celle-ci.” (Les luttes de classes en France, 1850).
En réalité jusqu'au début du 20e siècle, les crises du capitalisme furent encore des crises de croissance rapidement surmontées par le système. C'est seulement avec la Ire guerre mondiale que se sont manifestés de façon éclatante et in-équivoque les symptômes de l'arrivée du capitalisme à un point où le développement de ses contradictions internes avait atteint un degré qualitativement différent.
Les marxistes révolutionnaires, la gauche de la 2e Internationale, ceux-là même qui venaient de combattre pendant des années les courants révisionnistes (Bernstein) qui avaient théorisé l'idée que le capitalisme ne connaîtrait plus de crises et que l'on pourrait aller au socialisme par une évolution graduelle et pacifique, reconnurent sans hésitations la création de cette nouvelle situation historique : l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin.
L'éclatement de la révolution russe, puis la vague révolutionnaire internationale qui la suivit, confirmaient avec éclat la perspective marxiste.
C'est de cette analyse que nous nous réclamons aujourd'hui ; une analyse que 70 ans marqués par deux guerres mondiales, deux phases de reconstruction et deux périodes de crise économique mondiale : 1929-1939 et 1967-1987, sont venus confirmer par un développement sans précédent de la barbarie sur l'ensemble de la planète.
UNE CRITIQUE DÉNUÉE DE SENS
Pour rejeter cette analyse, le GCI commence par attribuer aux “décadentistes” une idée absurde qu'il invente de toutes pièces et qu'il se plait par la suite à critiquer longuement. Avant de passer à leur argument de “l'invariance”, réglons donc rapidement cette manoeuvre pitoyable.
Le GCI prétend que l'analyse de la décadence affirmerait que pendant la phase ascendante du capitalisme, celui-ci ne connaît aucune contradiction, ces contradictions n'apparaissant que pendant la phase de décadence. Ainsi répond-il:
“Il n'y a donc pas deux phases : l'une où la contradiction de classe (autrement dit la contradiction entre force productive sociale et rapport de production) n'existerait pas : phase progressive où le 'nouveau' mode de production développerait sans antagonismes ses bienfaits civilisateurs..., et une phase où, après le développement 'progressiste de ses bienfaits', il deviendrait obsolescent et commencerait à décliner, induisant donc seulement à ce moment, l'émergence d'un antagonisme de classe.”
Voici ce que nous écrivions sur cette question dans notre brochure : La décadence du capitalisme :
“Marx et Engels ont eu la géniale perspicacité de dégager dans les crises de croissance du capitalisme l'essence de toutes ses crises et d'annoncer ainsi à l'histoire future les fondements de ses convulsions les plus profondes. S'ils ont pu le faire, c'est parce que, dès sa naissance, une forme sociale porte en germe toutes les contradictions qui l'amèneront à sa mort. Mais tant que ces contradictions ne sont pas développées au point d'entraver de façon permanente sa croissance, elles constituent le moteur même de cette croissance.” (La décadence du capitalisme, p.68).
Le GCI ne sait pas de quoi il parle.
“L'INVARIANCE”
Ayant rejeté avec l'analyse de la décadence du capitalisme tous les courants marxistes conséquents depuis plus d'un demi-siècle, mais craignant certainement de se reconnaître comme anarchiste, le GCI est allé chercher dans les théories de Bordiga des années 50 une “caution” marxiste à ses délires libertaires : c'est la théorie de “l'invariance du programme communiste depuis 1848”.
Le paradoxe n'est qu'apparent. L'anarchisme qui ignore tout de l'évolution historique en général peut s'accommoder de la vision bordiguiste, qui, sous prétexte d'“invariance”, ignore les changements fondamentaux qui ont marqué l'évolution du capitalisme depuis ses origines.
Cependant, pour aberrante que soit la théorie de Bordiga, elle a au moins le mérite d'une certaine cohérence avec les positions politiques qu'elle soutient : le bordiguisme considère que les formes de lutte du 19° siècle, telles que le syndicalisme ou l'appui à la constitution de nouveaux Etats, demeurent valables à notre époque. Par contre, pour le GCI, qui rejette ces formes de lutte, cela devient une source d'incohérence. Il est alors contraint de rejeter dans le camp de la bourgeoisie la social-démocratie du 19e siècle, et de s'inventer un Marx anti-syndicaliste, antiparlementariste, anti-social-démocrate, un peu comme le stalinisme réinventait l'histoire de la révolution russe en fonction des besoins de sa politique immédiate.
Mais regardons de plus près la critique de la théorie de la décadence et l'analyse de l'évolution du capitalisme de Bordiga, derrière laquelle le GCI prétend dissimuler son involution anarchisante. Bordiga, que le GCI cite dans l'article mentionné, dit en effet :
“La théorie de la courbe descendante compare 1e développement historique à une sinusoïde : tout régime, 1e régime bourgeois par exemple, débute par une phase de montée, atteint un maximum, commence à décliner ensuite jusqu'à un minimum, après un autre régime entreprend son ascension. Cette vision est celle du réformisme gradualiste : pas de secousse, pas de saut, pas de bond. La vision marxiste peut se représenter (dans un but de clarté et de concision) en autant de branches de courbes toutes ascendantes jusqu'à leur sommet (en géométrie : point singulier ou cuspides) auxquelles succède une violente chute brusque, presque verticale, et au fond, un nouveau régime social surgit ; on a une autre branche historique d'ascension (...) L'affirmation courante que le capitalisme est dans sa branche descendante et ne peut remonter contient deux erreurs : l'une fataliste, l'autre gradualiste.” (Réunion de Rome, 1951). Ailleurs Bordiga écrit encore : “Pour Marx, 1e capitalisme croît sans arrêt au-dela de toute limite…” (Dialogue avec les morts).
Avant de répondre aux accusations fantaisistes de «gradualisme» et de “fatalisme”, confrontons, ne fût-ce que rapidement, la vision de Bordiga avec la réalité.
Tout d'abord une remarque importante : Bordiga parle de “courbe” ascendante ou descendante d'un régime. Précisons que ce dont il est question pour les marxistes lorsqu'ils parlent de «phase ascendante» ou «décadente» n'est pas une série statistique mesurant la production en soi. Si l'on veut envisager l'évolution de la production comme un élément pour déterminer si un mode de production connaît ou non sa phase de décadence -c'est-à-dire savoir si les rapports de production sont devenus un frein ou non au développement des forces productives- il faut d'abord savoir de quelle production on parle : la production d'armes ou d'autres biens et services improductifs n'est pas un signe de développement des forces productives, mais au contraire un signe de leur destruction ; ensuite, ce n'est pas le niveau de production en soi qui est significatif, mais son rythme de développement, et cela non pas en absolu, mais évidemment eu égard aux possibilités matérielles acquises par la société.
Ce point étant précisé, lorsque Bordiga affirme que “1a ‘vision marxiste’ (dont il prétend être 'l'invariable' défenseur) peut se représenter en autant de branches de courbes toutes ascendantes jusqu'à leur sommet auxquelles succède une violente chute brusque”, il dit deux contre-vérités.
C'est une contre-vérité d'affirmer que telle est la vision marxiste. Marx s'est exprimé très clairement sur la fin du féodalisme et la naissance du capitalisme, et cela dans un texte suffisamment connu, Le Manifeste Communiste :
“Les moyens de production et d'échange, sur la base desquels s'est édifiée la bourgeoisie, furent créés à l'intérieur de la société féodale. A un certain degré du développement de ses moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, l'organisation féodale de l'agriculture ou de la manufacture, en un mot le régime féodal de 1a propriété, cessèrent de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entravaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il fallait les briser. Et on les brisa.” (‘Bourgeois et prolétaires’, souligné par nous).
Il s'agit ici pourtant d'une situation fort différente de celle qui se produit pour la fin du capitalisme, puisque le communisme ne peut pas commencer à s'édifier au sein de l'ancienne société. Mais dans le cas du féodalisme comme dans celui du capitalisme, la mise à l'ordre du jour du bouleversement des rapports sociaux existants est provoquée par la nature de frein, de chaîne de ceux-ci, par le fait que ceux-ci entravent au lieu de faire progresser le développement économique.
C'est tout autant une contre-vérité d'affirmer que l'histoire s'est déroulée suivant le schéma d'une série de branches toujours ascendantes. En particulier pour le cas qui nous intéresse le plus, le capitalisme.
Il faut être aveugle ou ébloui par la propagande en trompe-l'oeil, immédiatiste de la bourgeoisie décadente pour ne pas voir la différence entre le capitalisme depuis la première guerre mondiale et le capitalisme du 19e siècle, pour affirmer que les rapports de production, capitalistes ne sont pas plus une entrave au développement des forces productives au 20e qu'au 19e siècle.
Les crises économiques, les guerres, le poids des frais improductifs, existent aussi bien au 19e qu'au 20e siècle, mais la différence entre les deux époques est quantitativement si importante qu'elle en devient qualitative.
(Le GCI, qui emploie si souvent à tort et à travers le mot “dialectique” dans son texte, a dû au moins entendre parler de la transformation du quantitatif en qualitatif).
L'effet de frein au développement des forces productives exercé par les destructions et le gaspillage de forces matérielles et humaines des deux guerres mondiales est qualitativement différent de celui qu'ont pu exercer par exemple la guerre de Crimée (1853-56) ou la guerre franco-prussienne (1870-71). Pour ce qui est des crises économiques, celles de 1929-39 et de 1967-87 sont à peine comparables aux crises cycliques de la deuxième moitié du 19e siècle, et cela aussi bien sur le plan de leur intensité, que sur celui de leur étendue internationale ou de leur durée (Voir à ce propos l'article La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent, Revue Internationale n° 23, 4e trimestre 1980, où cette question est spécifiquement traitée). Quant au poids des frais improductifs, son effet stérilisateur sur la production est lui aussi qualitativement différent de tout ce qui pouvait exister au 19e siècle :
- production permanente d'armement, recherche scientifique orientée vers le militaire, entretien d'armées (pour 1985, les chiffres officiels des gouvernements reconnaissent plus de 1,5 millions de dollars dépensés en frais militaires par minute dans le monde !) ;
- les services improductifs (banques, assurances, la plupart des administrations étatiques, publicité, etc.).
Le GCI cite quelques chiffres sur la croissance de la production au 19e et au 20e siècle qui prétendent démontrer l'inverse. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails (Voir la brochure La décadence du capitalisme). Mais quelques remarques s'imposent.
Les chiffres du GCI comparent la croissance de la production de 1950 à 1972 à celle de 1870 à 1914. C'est une mystification assez grossière. Il suffit de comparer ce qui peut être comparé pour que l'argument s'effondre. Si au lieu de considérer les dates cidessus qui excluent de la phase de décadence la période de 1914 à 1949 (deux guerres mondiales et la crise des années 30 !), on compare la période 1840-1914 avec celle de 1914-1983, la différence s'annule... Mais qui plus est, la production du 19e siècle est essentiellement celle de moyens de production et de biens de consommation, alors que celle du 20e siècle inclut une part toujours croissante de moyens de destruction ou improductifs (aujourd'hui, on compte une puissance destructrice cumulée équivalente à 4 tonnes de dynamite par être humain, et par ailleurs, dans la comptabilité nationale, un fonctionnaire d'Etat est considéré «produire» l'équivalent de son salaire). Enfin et surtout, la comparaison entre la production réalisée et ce qu'elle pourrait être eu égard au degré de développement atteint par les techniques de production est totalement ignorée.
Mais outre les contre-vérités contenues dans l'affirmation “pour Marx, le capitalisme croît sans arrêt au delà de toute limite”, la vision de Bordiga tourne le dos aux fondements matérialistes, marxistes de la possibilité de la révolution.
Si “le capitalisme croît sans arrêt au delà de toute limite”, pourquoi des centaines de millions d'hommes décideraient un jour de risquer leur vie dans une guerre civile pour remplacer ce système par un autre? Comme le dit Engels :
“Tant qu'un mode de production se trouve sur la branche ascendante de son évolution, ü est acclamé même de ceux qui sont désavantagés par le mode de répartition correspondant.” (Engels, Anti-Dühring, partie II, “Objet et méthode”).
GRADUALISME ET FATALISME ?
Le gradualisme est la théorie qui prétend que les bouleversements sociaux ne peuvent et ne doivent être faits que lentement par une succession de petits changements : “pas de secousse, pas de saut, pas de bond”, comme dit Bordiga. L'analyse de la décadence dit que celle-ci se traduit par l'ouverture d'une “ère de guerres et de révolutions” (Manifeste de l'Internationale communiste). A moins d'assimiler les guerres et les révolutions à des évolutions en douceur, Bordiga et le GCI ne font que se payer de mots.
Quant à l'accusation de fatalisme, elle n'est pas plus sérieuse que la précédente[4] [1074]
Le marxisme ne dit pas que la révolution est inévitable. Il ne nie pas la volonté comme facteur de l'histoire, mais il démontre qu'elle ne suffit pas, qu'elle se réalise dans un cadre matériel produit d'une évolution, d'une dynamique historique dont elle doit tenir compte pour être efficace. L'importance donnée par le marxisme à la compréhension des «conditions réelles», des «conditions objectives» n'est pas la négation de la conscience et de la volonté, mais au contraire la seule affirmation conséquente de celles-ci. L'importance attribuée à la propagande et à l'agitation communistes en est une preuve évidente.
Il n'y a pas d'évolution inévitable de la conscience dans la classe. La révolution communiste est la première révolution de l'histoire où la conscience joue véritablement un rôle déterminant, et elle n'est pas plus inévitable que cette conscience.
Par contre l'évolution économique suit des lois objectives qui, tant que l'humanité vit dans la pénurie matérielle, s'imposent aux hommes indépendamment de leur volonté.
Dans le combat que livra la gauche de la 2e Internationale contre les théories révisionnistes, la question de l'effondrement inévitable de l'économie capitaliste était au centre du débat, comme le montre l'importance donnée à cette question par Rosa Luxemburg dans Réforme ou révolution, cet ouvrage salué par toute la gauche aussi bien en Allemagne qu'en Russie (Lénine en particulier).
L'orthodoxie “marxiste” religieuse de Bordiga ignore Marx et Engels qui écrivaient sans crainte :
“L'universalité vers quoi tend sans cesse 1e capital rencontre des limites immanentes à sa nature, lesquelles, à un certain degré de son développement, 1e font apparaître comme le plus grand obstacle à cette tendance, et le poussent à son auto-destruction.” (Marx, Grundrisse, “Le capital : marché mondial et système des besoins”), et encore :
“Le mode de production capitaliste (...) par son évolution propre, tend vers le point où il se rend lui même impossible.” (Engels, Anti-Dühring, partie II, “Objet et méthode”).
Ce qu'affirme le marxisme, ce n'est pas que le triomphe de la révolution communiste est inévitable, mais que, si le prolétariat n'est pas à la hauteur de sa mission historique, l'avenir n'est pas à un capitalisme qui “croît sans arrêt au delà de toute limite” comme le prétend Bordiga, mais au contraire à la barbarie, la vraie. Celle qui ne cesse de se développer depuis 1914. Celle dont Verdun, Hiroshima, le Biafra, la guerre Irak-Iran, les dernières vingt années d'augmentation ininterrompue du chômage dans les pays industrialisés, la menace d'une guerre nucléaire qui mettrait fin à l'espèce humaine, ne sont que des images parmi tant d'autres.
Socialisme ou barbarie, comprendre que telle est l'alternative pour l'humanité, c'est cela comprendre la décadence du capitalisme.
RV.
[1] [1075] Groupe Communiste Internationaliste: BP 54, BXL 31, 1060 Bruxelles
[2] [1076] Pour une histoire de l'élaboration théorique de l'analyse de la décadence du capitalisme, voir l'introduction à la brochure du CCI La décadence du capitalisme.
[3] [1077] C'est ainsi qu'on a pu voir un petit groupe en Belgique, en rupture avec l'anarchisme et qui en est encore à “approfondir la question Marx-Bakounine” comme ils disent, juger du haut de son ignorance et de sa lecture admirative du GCI, la théorie de la décadence du capitalisme en ces termes : “La théorie de la décadence du capitalisme! Mais que diable est-ce donc que cette théorie ?
En quelques mots on pourrait qualifier celle-ci de la plus merveilleuse, la plus fantastique histoire jamais écrite depuis l'Ancien Testament !
D'après les prophètes du CCI, la ligne de vie du capitalisme serait divisée en DEUX tronçons distincts. A. la date fatidique du 8 août 1914 (sic!) (pour l'heure exacte, prière de s'adresser au bureau de renseignements !), le système capitaliste 'aurait' cessé d'être dans sa 'phase ascendante' pour entrer dorénavant dans de terribles convulsions mortelles que le CCI baptise du nom de 'phase décadente du capitalisme'! Décidemment, nous nageons en pleine psychopapouille !” (RAIA n° 3, BP 1724, 1000 Bruxelles).
[4] [1078] Le GCI n'en est pas à une contradiction près, qui, reprenant une formulation de Bordiga, affirme qu'il faut y “considérer le communisme comme un fait advenu” !
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Correspondance internationale (Norvège, Danemark)
- 4839 reads
LE DEVELOPPEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE ET LA NECESSITE DE L'ORGANISATION ET DE L'INTERVENTION DES REVOLUTIONNAIRES
Critique du « conseillisme »
Nous publions ci-dessous
des extraits de deux lettres qui émanent du courant politique « conseilliste », l’une d'un élément
venant du KPL, cercle politique en Norvège aujourd'hui dissout, l'autre d'un
membre du GIK du Danemark. Ces textes traitent essentiellement de deux
questions particulièrement importantes pour les révolutionnaires dans la
période actuelle: le rôle et les taches de l'organisation révolutionnaire,
l'intervention dans les luttes ouvrières. Le premier texte fait un bilan de
l'échec du KPL à maintenir une activité révolutionnaire organisée. Il a été adressé
« aux anciens membres du KPL et aussi aux autres camarades en Scandinavie », et
à ce titre a été envoyé à la section du CCI en Suède, IR, L'auteur se propose
de « reprendre une activité politique organisée », de « prendre contact et
prendre part à la discussion et à l'activité qui malgré tout existe », Nous
répondons sur la nécessité de clarifier et débattre de la question de la
fonction et du fonctionnement d'une organisation révolutionnaire qui est la
question-clé abordée par ce bilan et posée par la proposition qui est faite. Le
texte du GIK est une critique de l'intervention du CCI dans les luttes
ouvrières actuelles.
SUR L'ORGANISATION
Lettre de Norvège (ex-KPL)
Camarades,
Ca commence à faire un moment que le KPL s'est complètement dissout. On trouve un petit réconfort au malheur des autres, mais pendant ces dernières années ce n'est pas seulement le KPL qui a disparu. Dans le monde entier, une série de groupes révolutionnaires soit ont disparu complètement, soit ont été fortement réduits.
Si nous regardons dans le « milieu Scandinave », les groupes avec lesquels, pendant plusieurs années, nous avons été plus ou moins en contact, c'est le même développement. Le GIK semble engagé dans un processus similaire à celui qu'a connu le KPL. La section du CCI, IR, et Arbetarpress existent encore, mais ils se sont réduits par rapport à avant.
Nous, qui avons été parmi ces groupes, avons pris des voies différentes. Mais elles ont une chose en commun : elles mènent à l'abandon de l'activité révolutionnaire organisée. Nous nous sommes dans une large mesure éloignés de toute activité politique ; et ce qui existe est au mieux individuel et limité.
Nous avons vu un processus de déclin qui ne peut donner aucun résultat positif. Nous voyons des camarades abandonner l'activité révolutionnaire, et nous voyons des camarades abandonner les positions révolutionnaires.
Le capitalisme poursuit continuellement sa crise que nous ne pouvons concevoir que d'une seule façon, comme crise mortelle du capitalisme. Nous savons que cette crise ne peut qu'avoir une solution violente, ou la révolution prolétarienne mondiale, ou une destruction du capital, une nouvelle guerre mondiale.
La classe ouvrière mène une lutte qui est grosse de possibilités pour le développement d'une révolution mondiale. Cette lutte a un long chemin devant elle, mais il n'y a aucun signe évident qu'elle ne pourrait pas se développer. Dernièrement au Danemark, au printemps 1985, nous avons vu comment la lutte de classe peut se développer ; presque sans signe avant-coureur, elle a surgi dans des formes similaires à la grève de masse.
Qu'ont fait alors les communistes ? Rien. Ou même pire, ils ont cessé d'être communistes. Dans une période où les idées révolutionnaires et l'activité révolutionnaire peuvent commencer à devenir autre chose qu'un hobby pour de petits cercles, beaucoup de communistes cessent leur activité.
Je pense qu'il est grand temps d'essayer de faire quelque chose dans le processus dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous l'avons laissé se développer faussement assez longtemps.
Pourquoi sommes-nous arrivés dans l'impasse où nous nous trouvons maintenant ? Il serait trop facile et immédiatiste de se contenter de voir le développement du KPL comme le résultat de l'évolution individuelle de personnes. Nous sommes passés par une évolution où nous étions nettement moins intéressés par ce que nous faisions, dans un environnement qui ne nous fournissait pas d'impulsion particulière dans une autre direction. Le niveau de la lutte de classe était bas ; et l'intérêt politique et l'activité au sein de la « gauche en général » ont fortement régressé. Il y a un faible intérêt pour la politique en général, et pour la politique révolutionnaire en particulier. Je crois que c'est important car c'est la lutte ouvrière locale qui, malgré tout, nous influence tous, d'abord et avant tout.
Mais de telles explications ne peuvent être suffisantes pour comprendre ce qui est arrivé. Nous avons vu le même processus ailleurs et dans d'autres groupes. Il doit y avoir des raisons plus générales.
Au mieux, le KPL a été capable de produire des choses comme Extremisten n° 2, les bulletins en anglais, la brochure sur la Pologne. Qui plus est, de les avoir faits et distribués nous a donné des résultats notables. Nous avions fait des progrès politiques avec de nouveaux membres et contacts. Extremisten n° 2 a donné, relativement, de grands succès au KPL, à la fois dans le recrutement et l'influence de nos positions politiques. Les bulletins en anglais nous ont donné un certain écho international.
En même temps, ceci montre aussi partiellement nos faiblesses. Nous n'avons pas été capables de nous maintenir en vie et de développer les progrès que nous avions faits. Nous avions une organisation misérable, ou plus exactement nous n'avions pas d'organisation. Ceci nous a fortement gênés et a empêché que le KPL comme groupe fonctionne vraiment bien. Nous n'avons probablement jamais été capables de maintenir une activité continue et responsable, ni interne ni externe. Au sein du groupe, cela a pu subsister pendant un moment ; à l'extérieur, c'était une catastrophe. L'activité était occasionnelle et mauvaise.
Nous avions eu des difficultés à définir quelle sorte de groupe devait être le KPL. Le KPL devait-il être une organisation avec une base politique et une structure fermes ? ou le KPL devait-il être un groupe plus souplement coordonné à la fois politiquement et organisationnellement ? Nous avons essayé d'être les deux, mais ce fut de plus en plus la seconde position qui a dominé. Nous avions en partie défini des critères d'appartenance, mais nous ne les avons pas beaucoup pris en compte. Nous n'avions pas décidé quelles tâches le KPL devait avoir. Nous n'avions pas de structure organisationnelle.
C'est une des choses aujourd'hui que les communistes doivent apprendre : comment être organisés et comment les organisations doivent fonctionner. Pour être capables de répondre à ces questions, on doit être clairs sur quelle sorte d'organisation on essaye de créer. Le KPL n'a jamais donné de réponse claire à cette question, nous l'avions à peine posée.
Nous n'avons jamais été particulièrement « militants ». La question de l'activité politique, nous ne l'avons jamais vue comme une question de « nécessité ». Nous ne nous sommes pas, jusqu'à présent, sentis obligés de faire quelque chose de nos positions politiques. C'était plus une question de savoir si nous voulions ou si nous ne voulions pas faire quelque chose de nos positions politiques. Dans la période que nous laissons maintenant derrière nous, une période de faible niveau de la lutte de classe, il était possible de vivre ainsi. Quand la lutte de classe s'aiguise, ce n'est plus possible. Dans les périodes de lutte de classe ouverte, les révolutionnaires ne peuvent plus choisir, ils doivent alors agir en fonction de leurs positions politiques. Alors la question n'est plus s'ils feront quelque chose, mais ce qu'ils feront. Nous entrons dans une telle période maintenant, une période où l'activité révolutionnaire sera nécessaire. S'il n'y a rien, nous serons comme ouvriers, comme participants individuels dans un processus social, face à une lutte qui nous forcera à prendre position et à y participer. Comme communistes, nous ne serons pas capables de contribuer beaucoup à la lutte de classe sur une base individuelle. Les contributions des communistes à la lutte de classe sont d'abord les analyses, les perspectives et les expériences historiques. La lutte des ouvriers combatifs et les revendications ne sont pas notre contribution la plus importante.
Le fait que nous sommes à un tournant est, je crois, une partie de la racine de la crise que les révolutionnaires ont traversée et traversent encore. Ca commence à devenir sérieux, nos positions commencent à avoir des conséquences. Nous risquons quelque chose quand nous agissons en conséquence. Notre vie quotidienne et nos positions politiques ne peuvent plus être séparées de la même façon qu'auparavant.
Ce qui est exigé des révolutionnaires est aussi quelque chose d'autre que ce dont nous étions préoccupés antérieurement. Nous devons prendre part à la lutte que la classe ouvrière est en train de mener, et nous devons être capables de mettre en avant notre vision du chemin à parcourir. Pas seulement le développement général, mais la critique concrète de la lutte qui est menée et des pas qui sont faits.
Nous, qui sommes révolutionnaires aujourd'hui, avons une mauvaise connaissance et une mauvaise expérience de la réalité de la lutte de classe. La période de paix sociale dans laquelle nous avons vécu ne nous a donné que peu de possibilités d'apprendre de nos propres expériences.
Il serait tentant d'essayer de se retirer de la lutte de classe. Se maintenir hors de l'activité risque de nous exposer. Et naturellement on pourrait se mettre en sécurité du mieux possible ; mais ceci ne veut pas dire qu'on devrait abandonner la conviction et l'activité révolutionnaires, capituler. Je pense que c'est une illusion de croire qu'on pourrait se retirer dans une existence « sûre ». Tôt ou tard, cette « sécurité » n'existe plus. La seule voie pour que l'existence soit « sûre » est la révolution prolétarienne mondiale. C'est seulement si la révolution prolétarienne a réussi que l'individu peut compter sur une existence « sûre et en sécurité ».
La situation d'aujourd'hui est déprimante. Pas seulement pour nous qui étions dans le KPL, mais aussi pour d'autres révolutionnaires. La tendance à la dissolution continue, même si nous voyons quelques signes de nouvelles organisations.
La plate-forme du KPL disait, en 1981 : « Nous ne croyons pas que nous allons jouer le rôle décisif dans la lutte pour le socialisme. Nous allons participer où nous sommes, comme courant révolutionnaire dans la classe ouvrière. Quelles expressions politiques la lutte de classe va prendre dans les années qui viennent, nous le verrons. Peut-être serons-nous présents dans celle-ci comme groupe, peut-être rejoindrons-nous d'autres groupes ou serons-nous avec d'autres groupes. Le plus important n'est pas seulement l'organisation avec un grand 0, mais que la discussion dans la classe ouvrière existe et se développe, malgré les partis et les syndicats qui voudraient maintenir le monopole de leurs positions. Au cours des dernières années, nous avons vu à nouveau la croissance de groupes et tendances communistes dans une série de pays dans le monde. Nous nous considérons comme une partie de cette tendance internationale. Nous voyons comme notre tâche de mettre en avant que toute autre solution que la révolution prolétarienne est seulement expression du rapport de forces permanent entre le prolétariat et la bourgeoisie. »
Sur cette base, je souhaite reprendre une sorte d'activité politique. C'est pour nous, révolutionnaires, partiellement un acte de volonté. Nous avons vu quelques-unes des conditions fondamentales : on peut naturellement choisir de les « oublier », si on peut le supporter. Pour nous qui ne pouvons pas le supporter, nous devons choisir de faire quelque chose avec notre clarté et nos positions politiques.
Dans la situation d'aujourd'hui, il n'y a pas de grands pas à faire pour améliorer la situation. Et c'est d'abord avec de petits pas que nous devons commencer. Les camarades qui veulent continuer une activité révolutionnaire doivent se regrouper : à présent, c'est le seul progrès qui peut être fait.
Cette lettre est d'abord écrite aux anciens membres du KPL, et aussi aux autres camarades en Scandinavie. Ceci ne signifie pas qu'il y a un souhait de nous limiter à cette région géographique. C'est hors de Scandinavie que la plupart des révolutionnaires existent. Cependant, nous qui vivons ici en Scandinavie, nous devons commencer par un endroit, là où nous sommes nous-mêmes.
Le fait que nous soyons inactifs est cependant le résultat de ce que la plupart des camarades ne sont plus intéressés par l'activité révolutionnaire. Nous devons voir qui est intéressé à prendre part à une activité organisée, et commencer avec ce point de départ.
Les bases politiques n'ont pas changé. Je reste encore sur les vieilles positions politiques du KPL. Ceci ne signifie pas que toutes les positions politiques sont décidées une fois pour toutes ; mais jusqu'à présent, il n'y a aucune base pour réviser les positions fondamentales.
Lorsqu'on passe à la pratique, c'est autre chose. Il serait sans signification de poursuivre à partir de là où nous nous sommes arrêtés. Il ne s agit pas d'une nouvelle édition du vieux groupe, mais de quelque chose qui permette de tirer les leçons de ce que nous avons fait avant.
Ce n'est pas une tentative de former une nouvelle organisation politique. C'est un souhait de trouver une base pour l'activité révolutionnaire organisée. La situation d'aujourd'hui n'est pas tenable, et nous devons faire quelque chose.
Il n'y a pas une organisation communiste aujourd'hui. C'est pourquoi les camarades ont tort s'ils croient que leur propre organisation est la seule avec une politique et une pratique correctes.
Ont également tort ceux qui croient que parce qu'on ne peut pas créer une organisation « parfaite », on devrait laisser faire et plutôt rejoindre un groupe existant.
Tous les camarades devront réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Ceux qui arrivent à la conclusion qu'ils désirent continuer à prendre part à une activité révolutionnaire doivent faire eux-mêmes les pas pour sortir des « eaux stagnantes » où ils sont. Ceux d'entre nous qui souhaitent continuer une activité que nous avons cessée pendant trop longtemps, peuvent reprendre cette activité. En premier, ceci signifie reprendre contact et prendre part à la discussion et à l'activité qui malgré tout existent.
Salutations fraternelles. WP, février 1986.
Réponse du CCI
Cet appel adressé « aux anciens membres du KPL et aux autres camarades en Scandinavie » est une initiative très positive. Elle manifeste une volonté de réagir et de ne pas céder à la démoralisation, à la dispersion des énergies militantes, qui conduisent nombre de groupes politiques prolétariens à végéter, à se disloquer jusqu'à l'abandon de toute activité révolutionnaire, comme le décrit très clairement la lettre à propos de la dissolution du KPL en Norvège.
Actuellement les luttes ouvrières se développent dans le monde entier, en particulier en Europe occidentale, et dans les pays « nordiques » également, la classe ouvrière est engagée dans cette vague de résistance aux mêmes attaques toujours plus fortes des plans d'austérité de la bourgeoisie dans tous les pays. Tour à tour et simultanément, en Scandinavie, figurant au nombre des luttes les plus importantes de la vague mondiale, des mouvements se sont développés, comme la grève générale au Danemark au printemps 85, les mouvements de grève en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède, contre le démantèlement de l'« Etat social » particulièrement développé dans ces pays, la multiplication de grèves et débrayages hors des consignes syndicales, surtout en Suède depuis deux ans, et tout dernièrement encore, le mouvement autour des grèves dans le secteur public dans ce pays en octobre 86.
Dans cette situation, il est vital que les minorités révolutionnaires sachent reconnaître la combativité de ces mouvements, la prise de conscience qu'ils manifestent de la nécessité de lutter, de ne pas rester passifs, de ne pas se laisser enfermer par les manoeuvres des syndicats. Or les groupes du milieu politique prolétarien se caractérisent pour la plupart aujourd'hui par un scepticisme sur la réalité du développement de la lutte de classe sinon par une négation complète de celui-ci, ce qui contribue à renforcer le déboussolement et la dispersion des énergies révolutionnaires. Au contraire, la lettre pose clairement les enjeux de la période actuelle et leurs implications pour les révolutionnaires :
— la crise actuelle est une «r crise mortelle du capitalisme »,
— la seule alternative historique est « ou la révolution prolétarienne mondiale, ou une destruction du capital, une nouvelle guerre mondiale » ;
— la lutte présente de la classe ouvrière est « grosse de possibilités pour le développement d'une révolution sociale », ayant « un long chemin devant elle », mais avec « aucun signe évident qu'elle ne pourrait pas se développer »;
— les révolutionnaires doivent « prendre part à la lutte que la classe ouvrière est en train de mener », être « capables de mettre en avant notre vision du chemin à parcourir. Pas seulement le développement général, mais la critique concrète de la lutte qui est menée et des pas qui sont faits ».
Nous soutenons pleinement ces positions qui sont à la base de cet appel à rouvrir des discussions et des contacts, et à un regroupement de ceux qui veulent « sortir des 'eaux stagnantes' où ils sont ».
En plus de ces points nous soutenons également l'affirmation de la nécessité de l'organisation des révolutionnaires et ne pouvons qu'appuyer le souhait de « reprendre une activité organisée ».
C'est dans cet esprit que nous ferons les remarques qui suivent sur la question centrale soulevée dans la lettre, celle de la conception de l'organisation des révolutionnaires et de l'engagement militant, sur laquelle il nous semble nécessaire de poursuivre et approfondir la discussion, en plus du suivi de la situation et de l'intervention dans la lutte de classe.
Il est vrai, comme le mentionne le texte, que tous les groupes ont connu et connaissent des difficultés. Le début des années 80 en particulier a été marqué par une « crise » du milieu politique prolétarien que le CCI a amplement analysée ([1] [1080]). Pour cette raison, il est juste de relier le processus de dissolution du KPL à cette crise d'ensemble. Cependant, si la crise a touché tous les groupes, elle ne les a pas tous amenés à « l'abandon de l'activité révolutionnaire », et de plus de nouveaux groupes surgissent ([2] [1081]), produits de la poussée de la lutte de classe, de la lente clarification qui est en train de s'opérer sur les enjeux de la période, la nature capitaliste de la gauche du capital, les perspectives des combats ouvriers.
L'évolution des groupes n'est pas seulement liée à des facteurs objectifs tels que le fait que nous vivons une période totalement nouvelle dans toute l'histoire du capitalisme, l'accélération brutale de sa crise catastrophique avec l'entrée dans les années 80, ou le poids des cinquante années de la contre-révolution qui a dominé jusqu'à la fin des années 60 et qui pèse sur l'expérience des générations ouvrières actuelles.
La capacité ou l'incapacité à faire face aux difficultés, à tirer des leçons de l'expérience, qui font qu'un groupe politique maintienne les positions révolutionnaires et son activité ou qu'il les abandonne pour aller vers le gauchisme ou le néant, relèvent aussi de la conception qu'il défend de la fonction et du fonctionnement d'une organisation révolutionnaire du prolétariat.
La lettre illustre particulièrement clairement cela en décrivant comment la dissolution du KPL a été directement liée au flou régnant en son sein sur la question de l'organisation : le groupe a été incapable de « maintenir une activité continue et responsable » (« nous n'avions pas d'organisation », « l'activité était occasionnelle et mauvaise », etc.), le dilettantisme dominait une activité conçue comme « hobby » et « non comme une nécessité ». De même la lettre montre comment le groupe n'avait jamais tranché entre deux conceptions diamétralement opposées, celle d'« une organisation avec une base politique et une structure ferme » ou celle d'« un groupe plus souplement coordonné ».
Le texte se prononce sans ambiguïté dans sa condamnation de la deuxième position et affirme l'impossibilité de maintenir le flou, et particulièrement combien, « quand la lutte de classe s'aiguise, ce n'est plus possible ». Il rejette le repli dans l'individualisme en quête d'une « sécurité » tout à fait illusoire. Il reconnaît que les positions des révolutionnaires « peuvent avoir des conséquences». Ainsi, implicitement, il rejette les conceptions conseillistes d'une organisation de type fédéraliste ou de groupes « souplement coordonnés », qui n'ont pas fondamentalement un rôle actif à jouer dans la lutte de classe.
Mais pour tirer véritablement les leçons de l'expérience, trouver les moyens politiques de « reprendre une activité organisée », c'est explicitement qu'il est nécessaire de relier le bilan du KPL à sa conception ou plutôt son absence de conception de l'organisation, influencée par le « conseillisme » sinon
Le KPL a surgi de la mouvance conseilliste influencée par Mattick, formée de quelques groupes et cercles qui avaient tenu des « Conférences » à la fin des années 70 ([3] [1082]). Si ces conférences destinées à regrouper les révolutionnaires « en Scandinavie », et auxquelles le CCI a participé en partie, ont échoué dans l'académisme d'études économiques qui n'ont jamais abouti, ce n'est pas en soi à cause des théories économiques de Mattick ou de Grossmann que défendaient la plupart des participants ([4] [1083]). C'est essentiellement en raison des conceptions conseillistes des tâches des révolutionnaires qui prévalaient.
Pour l'anecdote, on peut rappeler que les propositions du CCI de ne pas se cantonner à ces seules questions économiques furent rejetées. Et ce n'est pas en fait pour ses positions « luxemburgistes » sur les questions économiques que le CCI était ressenti comme indésirable c'est fondamentalement pour sa conception de l'organisation et des tâches des révolutionnaires jugée par trop « léniniste » (ceci alors que par ailleurs le CCI était exclu des Conférences Internationales de la Gauche Communiste parce que jugé... « conseilliste » par la CWO et Battaglia Comunista).
Si nous faisons ce bref rappel, ce n'est pas pour revenir sur la « petite histoire » des débats de l'époque, mais parce que dans la mesure où l'appel de Norvège nous a été adressé, nous pensons qu'il est nécessaire de reprendre clairement ces questions là où elles ont été laissées. Il n'est pas suffisant, comme la proposition finale le fait, de simplement réaffirmer la validité des bases politiques d'origine du KPL (« les bases politiques n'ont pas changé »), alors que le bilan est tout à fait lucide sur le fiasco du groupe quant à la question de l'organisation, que la lettre se termine par « le souhait de trouver une base pour l'activité révolutionnaire », affirmant qu'«r il ne s'agit pas d'une nouvelle édition du vieux groupe ».
Pour que la proposition ne reste pas lettre morte, et soit une réelle impulsion à « trouver les bases d'une activité organisée », ce que le camarade appelle de ses voeux, si le bilan entrepris de l'expérience du KPL est poursuivi, cela doit se faire en discutant des conceptions théoriques erronées qui l'ont influencé, en comprenant les origines et l'évolution de telles conceptions dans le mouvement ouvrier, au sein des gauches qui se sont dégagées de la 3e Internationale.
Sans développer dans cette courte réponse, on peut schématiquement rappeler cette évolution : au départ des critiques souvent justes de la dégénérescence du parti bolchevik, essentiellement de la part de la gauche germano-hollandaise ; ces critiques, au fil des années de contre-révolution, emporteront « l'enfant avec l'eau du bain » ; elles finiront par mener le courant politique du « communisme de conseils » au rejet du parti bolchevik, de la révolution russe, de la nécessité d'organisations politiques centralisées, dotées d'« une base politique et d'une structure ferme » ; enfin, elles aboutiront au rejet de toute organisation politique quelle qu'elle soit, jusqu'à l'abandon du marxisme et du militantisme pour beaucoup de groupes et éléments révolutionnaires.
Ces conceptions qui amènent à ranger au placard des accessoires inutiles les organisations politiques du prolétariat, ce sont celles qui se trouvaient à la base de la constitution de nombre de groupes du type KPL qui ont aujourd'hui disparu. Elles sont l'explication première de cet « abandon de l'activité organisée ».
«Reprendre un travail organisé» passe par des débats sur l'analyse de la situation actuelle et de ses perspectives et sur l'intervention des révolutionnaires, et nécessite une réelle clarification de la question de l'organisation.
SUR L'INTERVENTION DANS LES LUTTES OUVRIERES ACTUELLES
La conception de l'organisation, c'est aussi celle des tâches concrètes des révolutionnaires dans les luttes, en particulier dans la période actuelle, avec le développement international d'une vague de mobilisation ouvrière, dans toute l'Europe. Et l’année 1986 a encore confirmé cette reprise de la lutte de classe, avec les grèves massives du printemps en Belgique, puis les grèves de l'automne autour du secteur public en Suède, qui ont montré une plus grande tendance à V unité et une plus forte contestation des syndicats dans la classe ouvrière.
Quelle doit être l'intervention au sein de tels mouvements ? La lettre de Norvège aborde aussi cette question à plusieurs reprises, à un niveau général, et appelle justement à « prendre part à la lutte que la classe ouvrière est en train de mener ». Cependant, tout comme sur la question de l'organisation en général, la vision « conseilliste » de l'intervention n'est pas explicitement remise en cause, alors qu'elle est aussi à la base de cette absence d'intervention communiste que déplore le texte, de la part des groupes qui partagent cette conception de l'organisation et de ses tâches dans la lutte de classe.
En Scandinavie, un des exemples en est le cercle GIK du Danemark, à qui l'appel de Norvège a aussi été adressé. Ce groupe, s'il maintient quelques contacts et correspondances épisodiques dans le milieu politique prolétarien, en particulier avec le CCI, n'a en fait publié depuis sa constitution il y a quatre ans, qu'un seul numéro de sa publication Mod Strommen (« Contre le courant ») ; il n'est intervenu à aucun moment dans les mouvements de grève du printemps 1985 au Danemark, malgré l'aide que certains des éléments du groupe ont fournie à l'intervention du CCI au moment des événements ; il n'a pas pris position publiquement sur ce mouvement le plus important de la classe ouvrière dans ce pays depuis dix ans au moins, sinon plus. Par contre, le GIK nous a adressé en 1985 une critique de l'intervention du CCI, contre une « orientation très activiste » et « le ton et la tendance à l'exagération empirique des luttes ouvrières » dans la presse du CCI, affirmant que « ce n'est pas seulement notre impression, mais aussi celle du KPL en Norvège et d'autres groupes ». Voici quelques extraits de cette lettre à laquelle nous avons répondu largement dans Internationell Révolution, la publication du CCI en Suède, et sur laquelle nous faisons ici quelques remarques au sujet de la vision « conseilliste » de l’intervention qui sous-tend la critique qui nous est adressée.
Extraits de lettre du Danemark (GIK)
(...) Nous sommes principiellement tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de chose comme une « pure lutte de classe », qu'on doit attendre un long et douloureux processus avant que les travailleurs ne se libèrent des vieilles illusions et traditions, et que par conséquent, il est nécessaire pour les révolutionnaires communistes d'être présents dans la vie courante de l'ouvrier, entre autres les assemblées convoquées par les syndicats pour y faire de la propagande (...)
Le CCI a pris ces dernières années une orientation très activiste (...) Vous divisez plutôt l'activité des révolutionnaires en trois domaines : travail théorique, propagande et agitation. Cette addition d'agitation, avec des « perspectives pratiques pour chaque phase de la lutte », les « prochains pas pour la lutte de classe », constitue, à notre avis, un phénomène concomitant du tournant activiste du CCI.
Je ne veux pas rejeter ici catégoriquement et par principe l'adjonction de l'agitation. Lorsqu'on fait de la propagande, il est nécessaire, cela va de soi, d'être en état d'indiquer aussi des pas tout à fait concrets. Et c'est un point particulièrement difficile. Mais on doit précisément s'attacher aux principes généraux et expliquer franchement par une propagande et une agitation inséparablement liées qu'il appartient à la classe ouvrière elle-même de se décider à lutter, et dans cette lutte de se déterminer à des pas concrets. Ce n'est pas la tâche des communistes de penser pour la classe ouvrière et de lui proposer toute espèce de direction, conduite, etc. Ce n'est pas la tâche des communistes de formuler pour les luttes quotidiennes les mots d'ordre concrets. Cela surgit de soi-même chez les ouvriers qui entrent en lutte. Notre tâche consiste plutôt à critiquer les mots d'ordre concrets, à critiquer les pas concrets en éclaircissant les expériences récentes, à renvoyer à des luttes et défaites analogues, à analyser et estimer les conditions de la lutte et à propager le « programme maximum », c'est-à-dire le but final et les développements nécessaires, généraux, de la lutte de classe y conduisant. A supposer que cela réussisse et que les ouvriers peut-être, pour un moment, écoutent les communistes au milieu de la lutte ou en dehors (c'est-à-dire qu'ils ne nous ignorent pas simplement, ou ne nous contraignent pas au silence comme « provocateurs indésirables »), ils nous demanderont peut-être : oui, peut-être, mais que faire ? Que veulent proposer ici les communistes ? A cette question, on ne peut pas répondre autrement, dans une situation tout à fait concrète, que par des généralités : prenez la lutte dans vos propres mains ! Ne remettez pas la direction et le déroulement de la lutte dans les mains des syndicats, des partis politiques et autres « pros » qui d'ordinaire pensent et agissent à votre place ! Choisissez votre propre comité directement par vous-mêmes et contrôlez constamment ses décisions ! Allez directement vers les autres ouvriers pour les entraîner dans la lutte et former directement avec eux leur propre coordination !
Ou bien la situation concrète peut voir le surgissement de luttes, alors on peut seulement dire qu on doit exhorter les ouvriers à plus se préoccuper de leurs propres affaires, qu'ils doivent se préparer à mieux diriger les prochaines luttes, qu'ils doivent lire, discuter la presse révolutionnaire, qu'ils ne doivent pas se laisser enfermer par les barrières syndicales, les portes d'usines ou les frontières locales, etc. Mais quels seront dans un sens tout à fait concret précisément les « prochains pas », on ne peut le dire. On doit précisément s'en remettre aux ouvriers eux-mêmes. Ils le savent le mieux (...).
Ceci conduit à la question de l'agitation. Précisément en raison de notre estimation de votre presse, nous craignons beaucoup que votre récente orientation vers des interventions pratiques dans les luttes ouvrières soit portée par le même sensationnalisme empirique. S'il en est ainsi, nous ne pouvons rien y voir d'autre qu'un mauvais activisme.
Et je veux expliciter cela sur la base de l'expérience des combats de 1921 en Allemagne centrale. Cela ne signifie pas naturellement que je considère cette situation valable pour opérer une comparaison avec notre situation actuelle. Surtout pas. Mais pour la question de l'agitation, de la presse et de l'intervention des révolutionnaires, c'est un bon enseignement. Ce n'est pas seulement le VKPD, mais aussi le KAPD et l'AAU qui étaient dans cette situation très activistes ; les exagérations dans leurs organes de presse constituaient, dans cette situation très tendue, une très dangereuse agitation pour l'insurrection qui reposait sur une information fausse. La presse du KAPD et de l'AAU donnait l'impression mensongère que dans presque toutes les grandes villes et centres industriels d'Allemagne était arrivé le premier signe de l'insurrection armée. C'était un mensonge. Et dans une situation aussi critique, c'était une tentative très dangereuse des organisations révolutionnaires de pousser les ouvriers à la confrontation armée avec l'Etat. La clarification de cette question d'une agitation dangereuse par la surestimation et l'interprétation erronée, de même que celle de la question de la lutte armée et de la lutte de classe prolétarienne, nous la devons à Otto Ruhle, Franz Pfemfert et à l'AAU-E en 1921. On peut beaucoup reprocher à ces gens, mais on doit en tirer un grand profit critique. Le KAPD et l'AAU ont commis ici de très graves erreurs dont nous avons tous à apprendre.
Cette question fut aussi abordée dans la première moitié des années 30 par le GIK (Hollande) de façon semblable à Ruhle et Pfemfert en 1921. Parmi les différentes tendances du mouvement communiste de gauche germano-hollandais, le GIK se prononça contre l'agitation excitatoire qui partout cherchait à entraîner les ouvriers dans la lutte. Comme le GIK le soulignait, ce n'était pas la tâche des minorités révolutionnaires d'appeler le plus souvent possible et à chaque instant les ouvriers à la lutte directe, mais plus de contribuer à long terme à la clarification et à la conscience de classe de l'ouvrier. Et cela ne se fait pas par un activisme impatient et une agitation à sensation, mais au contraire par des analyses froides et une claire propagande (...).
Avec toute notre camaraderie, salutations.
Un membre du GIK. Octobre 1985.
Quelques remarques en réponse au GIK
En premier lieu, le GIK, à la différence de la lettre de Norvège, ne voit dans la lutte de classe actuelle « rien d'autre qu'un essor purement quantitatif des luttes. Par leur contenu et leur qualité, la plupart des luttes sont encore profondément rattachées à la vieille tradition économiste et réformiste.(...) les masses restent encore profondément prisonnières des schémas syndicaux et des illusions réformistes. (...). » Et lorsque le GIK nous met en garde, au fond le débat n'est pas si la presse du CCI fait du « gonflement sensationnaliste qui s'exprime par des mots d'ordre et la routine d'analyse simplistes », mais quelle appréciation nous avons des luttes actuelles. L'analyse de la combativité et de la prise de conscience dans la classe ouvrière des enjeux de la période, des caractéristiques des luttes dans cette période nouvelle dans l'histoire du mouvement ouvrier, du rôle de division des syndicats et de la gauche, etc., n'a rien de « simpliste » et le CCI ne se fonde pas sur le dénombrement empirique des luttes pour défendre cette analyse comme en témoignent nombre d'études, rapports et articles publiés sur cette question. Nous n'y reviendrons pas dans le cadre de ces remarques ; le GIK ne fait que reprendre l'idée qui domine dans la quasi-totalité des groupes politiques prolétariens aujourd'hui qu'il ne se passe rien ou peu de chose sur le front des luttes ouvrières, idée à laquelle nous avons déjà répondu à plusieurs reprises et à laquelle nous répondons encore dans le premier article de ce numéro.
En second lieu, il existe un profond désaccord de la part du GIK avec certaines des positions de base du CCI. Parmi elles, le GIK ne pense pas que la crise économique soit irréversible, mais qu'il existe toujours pour le capitalisme des possibilités de « restructuration » ; le GIK ne conçoit pas que la gauche de l'appareil politique et syndical de la bourgeoisie soit une composante à part entière de l'Etat capitaliste, tout comme la droite, etc. De ce fait, c'est toute la base pour comprendre la période historique actuelle qui diverge d'avec celle du CCI. Et avec sa vision, le GIK ne peut effectivement voir dans la presse du CCI que du « sensationnalisme » sur les grèves ouvrières actuelles puisque lui ne voit qu'une classe ouvrière « prisonnière des schémas syndicaux et des illusions réformistes ». Il faut savoir voir au-delà de l'apparence des événements, du black-out et de la propagande de la bourgeoisie sur les luttes ouvrières, tout comme Marx a pu reconnaître dans la Commune de Paris la première tentative de dictature du prolétariat, alors que tout concourait à n'y faire voir qu'une guerre patriotique.
Pour ces raisons, il est « logique » que le GIK voie de l'« activisme » dans l'agitation que le CCI s'efforce d'entreprendre dans les luttes concrètes des ouvriers, en cohérence avec sa propagande sur l'analyse et les perspectives de la période. L'« activisme » étant en effet l'agitation alors que le cours de la période n'est pas au développement de la lutte de classe, le GIK nous met donc en garde contre l'« activisme », avec l'exemple historique de la gauche germano-hollandaise dans les années 20 à l'appui. Mais précisément, pour le CCI, ce que montre un tel exemple n'est pas le « danger » que constitue en soi l’« agitation excitatoire » des organisations révolutionnaires, mais bien le danger pour les communistes de se tromper sur l'analyse de la période.
Mais la critique du GIK ne relève pas seulement des divergences de méthode et d'analyse, mais aussi de la conception des tâches des communistes. Il est tout à fait vrai que « ce n'est pas la tâche des révolutionnaires de penser pour la classe ouvrière », mais il est tout à fait faux de dire : « on ne peut pas répondre autrement dans une situation tout à fait concrète que par des généralités ». Les organisations révolutionnaires font partie intégrante de la classe ouvrière et de ses combats ; elles ne sont pas seulement la voix de la lutte historique du prolétariat défendant le but communiste et le « critique » de la lutte immédiate, et le GIK l'affirme par ailleurs : « il est nécessaire, cela va de soi, d'être en état d'indiquer aussi des pas tout à fait concrets ». La seule chose, c'est que cela ne va pas de soi. C'est une tâche difficile qui doit être prise en charge consciemment par les organisations révolutionnaires pour appliquer les « généralités » dans chaque situation concrète, pas seulement pour indiquer les perspectives lointaines, mais aussi les objectifs et les moyens immédiats de la lutte, dans les grèves, les assemblées, les manifestations, les piquets. Cela, la conception « conseilliste » de l'organisation le rejette ou, pour le moins, le minimise complètement. C'est ce qui est aussi à la base de l'incapacité des éléments et groupes de ce courant politique à s'organiser et à être actifs dans le combat prolétarien.
MG.
[1] [1084] Revue Internationale n° 32, 1er trimestre 1983.
[2] [1085] Revue Internationale n° 42 et 45 sur l'Inde, n° 44 sur le Mexique, n° 46 sur l'Argentine et l'Uruguay par l’anarchisme, et qui explique la manière dont le KPL, qui était d'ailleurs plus un « collectif » qu'un groupe, s'est disloqué.
[3] [1086] P. Mattick était un membre du KAPD dans les années 20 ; il fut un des chefs de file du « communisme de conseils » dans les années 30 avec la publication International Council Correspondance aux Etats-Unis. Dans les années 70, professeur au Danemark, il eut une forte influence sur l'orientation des groupes politiques en Scandinavie.
Sur les conférences en Scandinavie, voir la Revue Internationale n° 12, 1er trimestre 1978 ; sur les « conseillistes » au Danemark, voir le n° 25, 2e trimestre 1981.
[4] [1087] Ce ne sont pas les explications théoriques de la crise du capitalisme, sur lesquelles peuvent exister des divergences au sein même des groupes politiques, qui constituent des critères de délimitation des discussions dans le camp révolutionnaire.
Géographique:
- Europe [274]
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 : du tribunisme au communisme (1914-1916)
- 2960 reads
DU TRIBUNISME AU COMMUNISME (1914-1916)
Nous publions la suite de l'histoire de la Gauche hollandaise dont plusieurs chapitres sont parus dans de précédents numéros de la Revue Internationale. La période traitée dans cette nouvelle série d'articles va de 1914 au début des années 20 : le déclenchement de la 1° guerre mondiale, la révolution russe et la vague révolutionnaire en Europe occidentale. Cette 1° partie concerne l'attitude du courant « tribuniste » pendant la première guerre mondiale.
Bien que les Pays-Bas aient préservé pendant la première guerre mondiale leur neutralité et se soient épargné les destructions matérielles et les terribles saignées en hommes, la guerre a été une hantise constante de la population. L'invasion de la Belgique portait les combats aux frontières mêmes de la Hollande. La prolongation du conflit mondial semblait rendre inévitable l'engagement de la bourgeoisie hollandaise dans le camp de l'Allemagne ou dans celui des Alliés. Le mouvement socialiste, comme dans les autres pays, devait donc se déterminer clairement sur le soutien ou la lutte contre son propre gouvernement.
En fait, bien souvent, les gouvernements de pays comme la Suisse, la Suède, le Danemark et la Norvège avaient une « neutralité » de façade : leur orientation était discrètement pro-allemande. Mais cette orientation se manifestait avec d'autant plus de discrétion qu'ils en tiraient des avantages commerciaux dans les deux camps. A cela s'ajoutait, facteur décisif, la profonde division des bourgeoisies de ces pays en deux fractions souvent de poids égal : l'une pro-Entente, l'autre pro-allemande (Triplice).
La bourgeoisie néerlandaise décréta très tôt la mobilisation en prévision de son engagement militaire. Ce fut surtout pour elle un moyen de tester à la fois l'adhésion des ouvriers à une éventuelle guerre et de mesurer l'intégration de la social-démocratie à l'Etat national.
La social-démocratie officielle, comme la plupart des partis des pays belligérants, adhéra au nationalisme. Le SDAP franchissait le Rubicon en reniant l'internationalisme encore affiché dans son programme. Dès le début de la guerre, Troelstra s'affirmait « principiellement au côté du gouvernement ». Le 3 août 1914, avant même la social-démocratie allemande, le SDAP votait les crédits de guerre. Il affirmait nettement sa volonté d'« Union sacrée » avec la bourgeoisie néerlandaise : « l'idée nationale domine les différends nationaux », affirmait Troelstra au Parlement.
Cependant, tout en s'engageant au côté du gouvernement dans l'Union sacrée, le SDAP mena une politique internationale qui le fit apparaître, apparemment, « neutre ». Le SDAP ne se prononça pas ouvertement pour le camp allemand, bien que la majorité du parti, et Troelstra en particulier, inclinât vers la Triplice. Il est vrai qu'une minorité significative, autour de Vliegen et Van der Goes, était ouvertement pro-Entente....
La tactique du SDAP consistait à faire ressurgir la 2e Internationale, une Internationale disloquée en partis nationaux, une Internationale qui s'était volatilisée en août 1914 avec le vote des crédits de guerre par ses principaux partis adhérents. Troelstra fit en sorte que le Bureau socialiste international, auquel refusaient d'adhérer les socialistes français, fût transporté à La Haye, pour passer sous le contrôle du SDAP et... de la social-démocratie allemande. Quant à convoquer une conférence des partis des pays neutres, comme le proposaient dans un premier temps les socialistes suisses et italiens, le parti de Troelstra ne voulait pas en entendre parler.
Néanmoins, cette pseudo-neutralité du SDAP en politique internationale lui permit d'éviter le choc de multiples scissions. L'attitude du prolétariat néerlandais resta pendant toute la durée du conflit mondial résolument anti-guerre. Celle-ci, même si elle se tenait aux frontières des Pays-Bas, se traduisait par une chute dramatique du niveau de vie de la classe ouvrière de ce pays : l'étouffement économique du pays se concrétisait rapidement par une augmentation considérable du chômage. A la fin de 1914, il y avait plus de 40000 chômeurs à Amsterdam. Rapidement, les produits de première nécessité étaient rationnés. Pour la majorité des ouvriers, la guerre mondiale était une réalité qui se traduisait par plus de misère, plus de chômage. Le risque d'extension du carnage aux Pays-Bas était aussi bien présent et permanent : en décrétant en août 1914 la mobilisation, le gouvernement plaçait sous les drapeaux des milliers d'ouvriers et laissait planer en permanence l'engagement militaire de l'armée dans le conflit mondial. Pour cela, une propagande constante était menée pour l'Union sacrée et l'arrêt des grèves ouvrières.
Menacé des horreurs des champs de bataille, soumis à une misère grandissante, le prolétariat hollandais se montrait très combatif. Des grèves éclataient, comme celle de 10000 diamantaires à Amsterdam. Dès 1915, et pendant toute la durée de la guerre, des manifestations contre la vie chère se déroulaient dans la rue. Les meetings dirigés contre la guerre et ses effets trouvaient des auditeurs de plus en plus attentifs et combatifs.
Il faut noter d'ailleurs que, dès le départ, les idées antimilitaristes et internationalistes rencontrèrent un très vif écho dans le prolétariat. Sous l'influence de Nieuwenhuis, un fort antimilitarisme organisé s'était développé aux Pays-Bas depuis le début du siècle. L'Association internationale antimilitariste (IAMV) avait été fondée en 1904 à Amsterdam. Sa section néerlandaise, qui publiait la revue « De Wapens neder » (A bas les armes !), était la plus active de cette association. Sous l'autorité de Nieuwenhuis, qui restait un révolutionnaire, elle ne prit jamais une coloration pacifiste. Restant libertaire, elle était liée aussi bien au SDP qu'au mouvement libertaire de Nieuwenhuis. Pour un petit pays de la taille des Pays-Bas, le tirage de la revue devint considérable pendant la guerre : plus de 950000 exemplaires. De façon générale, à côté du mouvement antimilitariste, le courant syndicaliste révolutionnaire connut un nouvel essor et le NAS passa de 10000 à 30000 adhérents pendant la période de la guerre.
Le SDP, de son côté, ne resta pas passif. Dès le 1° août 1914, « De Tribune » proclamait « la guerre à la guerre ». Un manifeste publié en décembre 1914 pour la démobilisation de l'armée hollandaise montrait la volonté du parti de mener une propagande vigoureuse contre la guerre.
Cependant, la politique du SDP était loin d'être claire et montrait même un éloignement des positions marxistes intransigeantes. Le SDP avait choisi en août 1914 de participer avec d'autres organisations — NAS, IAMV — à la formation d'un cartel d'organisations, dénommé « Unions ouvrières agissantes » (SAV). Ce cartel, dans lequel se fondait le SDP, apparaissait finalement moins comme une organisation de lutte révolutionnaire contre la guerre que comme une nébuleuse antimilitariste à connotation inévitablement pacifiste, faute de se prononcer clairement pour la révolution.
D'autre part, au sein du SDP, une partie de la direction véhiculait des conceptions étrangères à l'intransigeance première du tribunisme. C'est ainsi que Van Ravesteyn, entre autres, se prononçait pour « l'armement populaire » en cas d'invasion des Pays-Bas. Cette position était déjà ancienne dans la 2° Internationale ; elle essayait de concilier l'inconciliable : le patriotisme, que l'armement « populaire » transformerait en « patriotisme ouvrier » et l'internationalisme. Même les révolutionnaires les plus intransigeants, comme Rosa Luxemburg, n'échappèrent pas pendant la guerre à cette conception, héritée de l'époque des révolutions bourgeoises, qui menait directement au soutien d'un camp impérialiste. Mais chez Rosa Luxemburg, une ambiguïté passagère était vite surmontée par un rejet de toute guerre nationale à l'époque de l'impérialisme. Rejet sans ambiguïté aucune.
En fait, derrière la conception de Van Revestayn, il y avait l'idée d'une défense nationale des petits pays menacés par les « grands » pays. Cette conception menait inévitablement à la défense du camp impérialiste soutenant les petits pays en question. C'est cette idée implicite d'une « guerre juste » que les socialistes serbes avaient rejetée avec force en août 1914, en refusant de voter les crédits de guerre et en se prononçant pour l'internationalisme et la révolution internationale.
Il fallut une bataille acharnée de Gorter pour que la conception d'une défense nationale des petits pays plongés dans le conflit généralisé soit explicitement condamnée. Une résolution écrite par Gorter, dite « Résolution de Bussum », fut proposée et adoptée lors du congrès du parti de juin 1915. Elle marquait le rejet de la position de Van Revesteyn.
Lors du même congrès, Gorter fit adopter dans la même résolution le rejet du pacifisme, qui sans être explicite dans le SDP s'infiltrait derrière un langage radical, mais en fait anarchisant. Gorter s'en prenait particulièrement à la section de Groningue qui par principe, comme les anarchistes, déclarait « combattre et rejeter toute organisation militaire et toute dépense militaire. »
Une telle position, en fait, par son purisme abstrait, ne faisait qu'évacuer la question de la révolution prolétarienne. Celle-ci, finalement, dans cette vision, ne pourrait être que pacifique, sans que se pose la question concrète de l'armement des ouvriers avant la prise du pouvoir, donc celle de l'organisation militaire des ouvriers. De plus, une telle position niait la réalité, après la prise du pouvoir, d'une orientation de la production, en cas de guerre civile, en vue de la fabrication d'armes pour défendre le nouveau pouvoir révolutionnaire face à la contre-révolution.
Finalement, l'acceptation de la position de la section de Groningue par le parti aurait signifié un glissement du SDP vers le pacifisme, danger d'autant plus grand que celui-ci était inséré dans un cartel d'organisations anarchistes à orientation plus pacifiste que révolutionnaire. Pour cette raison, Gorter, par sa résolution acceptée par 432 voix contre 26, faisait condamner sans ambiguïté l'idéologie pacifiste, fût-elle antimilitariste, comme menant à l'abandon de la lutte révolutionnaire pour le pouvoir armé du prolétariat : « Si un jour les ouvriers ont le pouvoir en main, ils doivent le défendre les armes à la main. »
Ces flottements politiques au sein du SDP faisaient contraste avec les positions théoriques sur la guerre mondiale qui s'inscrivaient pleinement dans l'orientation de la gauche révolutionnaire en Russie et en Allemagne. Mais celles-ci étaient plus le produit de l'activité de Gorter que du parti comme un tout. Comme Pannekoek, Gorter avait finalement plus d'écho réel dans le mouvement révolutionnaire international que dans son parti même.
Avec Lénine et Rosa Luxemburg, Gorter fut au début de la guerre le théoricien marxiste qui exprima de la façon la plus cohérente les raisons de la mort de l'Internationale et la nature des guerres à l'ère de l'impérialisme, pour en tirer les implications pratiques pour la lutte révolutionnaire future.
C'est en décembre 1914 que Gorter fit publier par les éditions du SDP sa principale contribution théorique et politique à la lutte contre la guerre, « L'impérialisme, la guerre mondiale et la social-démocratie ». Cette brochure, qui connut plusieurs éditions rapprochées en hollandais, fut immédiatement traduite en allemand pour mener le combat politique contre la social-démocratie au niveau international.
Gorter abordait les questions les plus brûlantes posées par la guerre mondiale et la faillite de l'Internationale :
LA NATURE DE LA GUERRE
Comme les révolutionnaires de l'époque, Gorter situe le conflit mondial dans le cadre de l'évolution du capitalisme. Cette évolution est celle de la mondialisation du capital, à la recherche de nouveaux débouchés. L'analyse de Gorter sur le plan économique reste néammoins très sommaire et constitue plus une description des étapes du développement capitaliste en direction des colonies et semi-colonies qu'une véritable explication théorique du phénomène impérialiste. Par certains côtés, Gorter est plus proche de Lénine que de Rosa Luxemburg. C'est sur le plan politique que l'analyse de Gorter est proche de celle de Rosa Luxemburg, en affirmant fortement que tout Etat est impérialiste et qu'il ne peut y avoir de lutte de libération nationale, comme le soutenait encore Lénine pendant la première guerre mondiale : « sont tous les Etats qui font une politique impérialiste et veulent étendre leur territoire. » (Op. cit.)
En conséquence, le combat du prolétariat ne peut être dirigé seulement contre « sa » propre bourgeoisie. A la différence de Liebknecht, qui proclamait que « l'ennemi principal est dans son propre pays », Gorter proclame qu'il n'y a pas d'ennemis n° 1 et n° 2, mais au contraire qu'il s'agit de combattre tous les impé-rialismes, puisque le combat ne se situe plus sur un terrain national, mais sur un terrain mondial :
« L'impérialisme national menace le prolétariat autant que l'impérialisme des autres nations. Par conséquent, pour le prolétariat dans son ensemble il est nécessaire de combattre de la même façon, c'est-à-dire avec une égale énergie, tous les impérialismes, le sien comme l'impérialisme étranger. » (Ibid.)
LE DECLIN DU SYSTEME CAPITALISTE
Gorter ne voit pas la décadence du système capitaliste en théoricien, en s'appuyant sur une étude historique et économique. Il la saisit dans ses effets à la fois sociaux et culturels. La guerre mondiale signifie une menace directe pour la vie même du prolétariat mondial ; la mondialisation du capitalisme est l'aboutissement d'une évolution historique qui conduit à un combat mortel entre prolétariat et capital mondial: « Les temps ont changé ! Le capitalisme s'est tellement développé qu'il peut continuer son développement ultérieur seulement en massacrant le prolétariat de tous les pays. Un capitalisme mondial est né qui se tourne contre le prolétariat mondial... L'impérialisme mondial menace la classe ouvrière du monde entier. » (Ibid.)
On ne sera pas étonné que le grand poète que fut Gorter soit particulièrement sensible à la crise des valeurs artistiques, signe indubitable du déclin de la civilisation capitaliste. Son jugement est sans doute expéditif, car il fait abstraction des nouvelles formes d art qui surgiront au lendemain de la guerre, fortement inspirées par la vague révolutionnaire (expressionnisme, surréalisme...). Mais Gorter montre surtout l'incapacité de créer de nouveau un grand art à l'image d'un système en expansion, comme ce fut le cas au 19e siècle :
« Le grand art est aujourd'hui mort. La grande poésie dans tous les pays est morte ; sont morts l'impressionnisme, le naturalisme, le grand réalisme bourgeois... Morte la grande architecture. Ce qui subsiste encore d'architecture est sans coeur, sans amour. La musique est l'ombre de ce qu'elle était. La grande peinture est morte. La philosophie est morte ; l'ascension même du prolétariat l'a tuée. » (Ibid.)
Cette vision de la décadence du système capitaliste, sous toutes ses formes, n'est pas propre à Gorter ; elle sera la base même des courants de la gauche communiste après la guerre, en particulier de la gauche allemande, influencée aussi bien par Rosa Luxemburg que par Gorter et Pannekoek.
LA FAILLITE DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE
La guerre a été rendue possible par la trahison des partis qui ont « renié les idées socialistes ». Comme Pannekoek, Gorter montre que le processus d'effondrement de la 2° Internationale a été préparé par des reniements successifs de la lutte contre la guerre et de la lutte immédiate. C'est le facteur subjectif qui a finalement permis à la bourgeoisie mondiale d'avoir les mains libres en 1914 pour se lancer dans la guerre. Nulle mieux que la bourgeoisie, classe qui vit dans sa propre putréfaction comme classe condamnée par l'histoire, ne pouvait saisir avec autant d'intelligence, l'intelligence d'une classe toute orientée vers sa propre survie, la putréfaction de son adversaire, au sein même du prolétariat. Gorter donne l'exemple au congrès de Bâle (1912) :
« La bourgeoisie qui, suite à sa propre putréfaction, a un odorat très fin pour la décomposition morale, sentit immédiatement la marche de ce congrès de l'Internationale. Elle sentit que d'un tel congrès il n'y avait rien à craindre. Elle mit la cathédrale de Bâle à notre disposition...; » (Ibid.)
Ainsi, pour la gauche hollandaise, qui avait d'ailleurs été interdite de parole lors de ce congrès, Bâle n'était que l'ultime aboutissement d'un long déclin. Août 1914 est annoncé par Bâle, qui ne fut qu'une messe contre la guerre.
Cependant, Gorter n'analyse pas la trahison de la 2° Internationale comme simplement la trahison des chefs. Il va plus profondément en analysant les facteurs organisationnels, tactiques qui ont conduit à cette banqueroute. Toutes les causes envisagées mènent à une interrogation brûlante : quel est le réel état de conscience du prolétariat, son degré de maturité révolutionnaire ?
Il est significatif que Gorter hésite dans les explications de la faillite de la 2e Internationale. Il insiste fortement sur le fait que les révisionnistes et les centristes kautskystes sont « coresponsables du nationalisme et du chauvinisme des masses ». D'un autre côté, il préfigure sa théorie, exposée en 1920 dans sa « Réponse à Lénine », sur l'opposition entre « masses » et « chefs ». C'est le phénomène bureaucratique qui aurait privé la masse prolétarienne de sa capacité d'action révolutionnaire :
«Le centre de gravité se déplaça... de la masse aux chefs. Il se forma une bureaucratie ouvrière. La bureaucratie cependant est par nature conservatrice. » (Ibid.)
Mais Gorter, qui est profondément marxiste, ne se contente pas d'une simple analyse sociologique ; la question de l'organisation des partis comme émanation de l'Internationale est la question décisive. Comme plus tard, pour la gauche italienne, c'est l'Internationale qui précède les partis et non les partis nationaux l'Internationale. La faillite de la 2° Internationale s'explique avant tout par son caractère fédéraliste :
«La seconde Internationale alla réellement à la débâcle, parce qu'elle n'était pas internationale. Elle était un conglomérat d'organisations nationales et non un organisme international. » (Ibid.)
Toutes ces causes expliquent finalement le recul de la conscience du prolétariat, dans la guerre. Le prolétariat s'est trouvé « très affaibli » et « spirituellement démoralisé ». Mais pour Gorter, comme pour les révolutionnaires de l'époque, il ne s'agissait que d'un recul et non d'une défaite définitive. De la guerre devait nécessairement surgir la révolution.
L'AVENIR
Les conditions même d'évolution du capitalisme donnent les conditions objectives pour l'unification du prolétariat mondial. La révolution est posée à l'échelle mondiale :
« ...pour la première fois dans l'histoire mondiale, tout le prolétariat international est aujourd'hui uni grâce à l'impérialisme, en temps de paix comme en temps de guerre, comme un tout, dans une lutte qui ne peut être menée sans un commun accord du prolétariat international, face à la bourgeoisie internationale. »
Cependant, Gorter souligne avec force que la révolution est un long processus, « s'étendant sur des décennies et des décennies ». Les « facteurs spirituels » sont décisifs. En particulier, la lutte passe par un changement radical de tactique : lutte non par le moyen du syndicat ou du parlement, mais par la grève de masse. Sans être développé, ce point annonçait toute la conception communiste de gauche pleinement développée en 1919 et 1920.
Tout aussi décisive était la lutte politique du prolétariat. Celui-ci devait combattre aussi bien le révisionnisme que le centrisme. Mais plus encore, pour s'engager dans la voie révolutionnaire, le prolétariat devait rejeter la lutte pour la paix, telle qu'elle était développée par les courants pacifistes. L'ennemi le plus dangereux restait le pacifisme :
« ...autant comme hypocrisie et auto tromperie que comme moyen de mieux asservir et exploiter, le mouvement pacifiste est le revers de la médaille de l'impérialisme (...) Le mouvement pacifiste, c'est la tentative de l'impérialisme de la bourgeoisie contre le socialisme du prolétariat. » (Ibid.)
Enfin, sans Internationale, créée par le prolétariat, il ne pouvait y avoir de véritable mouvement révolutionnaire. De la guerre devait naître une « nouvelle internationale », à la fois nécessaire et possible.
La brochure de Gorter, qui fut saluée comme un modèle par Lénine, posait donc de façon concrète l'attitude du SDP dans la reprise des liens internationaux en vue de poser les bases de la nouvelle Internationale.
LE SDP ET ZIMMERWALD
Il est significatif que la position de Gorter d'oeuvrer énergiquement au regroupement international des socialistes opposés à la guerre et partisans de la fondation d'une nouvelle internationale restât isolée dans le parti. De toutes ses forces, Gorter — appuyé par Pannekoek — souhaitait la participation du SDP aux débats et à la conférence de Zimmerwald en 1915.
En cette année 1915, l'opposition à la guerre commençait à se faire plus vigoureuse. Dans le SPD allemand, l'opposition de Rosa Luxemburg et celle d'éléments à Berlin et Brème s'enhardissait et posait les bases d'une réorganisation des forces révolutionnaires. Dans tous les pays belligérants, et dans les pays neutres, naissait une opposition au social-patriotisme qui dans les faits posait la question de la réorganisation des révolutionnaires dans les anciens partis et même en dehors, au prix de la scission.
Précisément, aux Pays-Bas, au sein même du SDAP, des éléments opposés à la politique nationaliste de leur parti, officialisée par un congrès de janvier 1915, s'étaient constitués en « club révolutionnaire-socialiste » à Amsterdam. Ils décidèrent de constituer une fédération de clubs qui prit le nom de « Revolutionaire Socialistisch Verbond » (RSV), afin de développer une opposition contre la guerre et le nationalisme en dehors du SDAP. Mais à la tête du RSV se trouvaient des éléments qui n'appartenaient pas au SDAP de Troelstra. Roland-Holst, sans parti depuis qu'elle avait quitté le SDAP en 1912, était le porte-parole reconnu du RSV. Celui-ci, composé essentiellement d'intellectuels, avait peu d'influence dans la classe ouvrière. Numériquement très réduit — une centaine de membres au départ — il ressemblait plus à un cartel qu'à une véritable organisation. La confusion organisationnelle de ses adhérents était grande : beaucoup étaient encore dans le SDAP et appartenaient donc à deux organisations. Cela dura encore quelques mois, jusqu'au moment où ils furent expulsés ou quittèrent définitivement le SDAP. Non moins floue était l'attitude des membres du SDP, qui bien que membres d'une organisation révolutionnaire, adhéraient au RSV. Il fallut toute la fermeté du congrès d'Utrecht du SDP (20 juin 1915) pour que soit interdite formellement la double appartenance organisationnelle. Ceux qui avaient adhéré au RSV le 2 mai durent donc le quitter.
Politiquement, le RSV — à l'image de Roland-Holst — pouvait être considéré comme un groupe du centre, entre le SDAP et le SDP. D'un côté, il se prononçait pour « l'action de masse nationale et internationale », pour la reprise des mouvements de lutte de classe ; d'un autre côté, il refusait de condamner explicitement l'attitude du SDAP dans la guerre, au nom de l'unité qui devait se concrétiser par la « concentration de tous les travailleurs révolutionnaires » . Cette position hésitante n'empêcha pas néanmoins une collaboration de plus en plus active entre le RSV et le SDP.
Pourtant, le SDP, plus clair politiquement et théoriquement, allait dans le concret se retrouver derrière le RSV, lorsque en 1915, la reprise des relations internationales entre groupes révolutionnaires en vue d'une conférence s'effectua.
Lénine dès le début de la guerre prit contact avec les Hollandais. Il s'adressa tout naturellement au SDP afin « d'arriver à un contact plus étroit » entre Russes et Hollandais. Il ne pensait certainement pas à s'associer à Roland-Holst, en laquelle il voyait — depuis son attitude face aux tribunistes en 1909 — une version de Trotsky, voire de Kautsky, transplantée aux Pays-Bas ».
Mais le SDP resta divisé pour mener clairement une activité de collaboration étroite avec les révolutionnaires russes et allemands. Une petite minorité de la direction du parti, autour de Gorter, était fermement décidée à mener un travail international contre le social-chauvinisme et le centre kautskyste. Dans ce sens, Gorter proposa le 8 avril 1915 à Lénine de publier une revue marxiste, sous la direction de Pannekoek, qui se substituerait à la « Neue Zeit » de Kautsky. A cette proposition, Lénine s'associa. Dans les faits, l'effort de regroupement mené au sein du SDP avec d'autres groupes révolutionnaires, en Suisse, avant Zimmerwald, fut l'oeuvre de Gorter et de Luteraan, membre de la direction du parti. Luteraan fut délégué à la conférence internationale des jeunes socialistes à Berne, en avril 1915, non comme représentant officiel du SDP, mais comme membre du groupe de jeunes socialistes « De Zaaier », indépendant du parti. C'est là que Luteraan prit contact avec Lénine.
On doit noter qu'au contraire la position des chefs historiques du tribunisme, Wijnkoop, Ravesteyn et Ceton fut plus qu'ambiguë. Lénine souhaitait associer étroitement les Hollandais à la préparation de la conférence de Zimmerwald. Dans une lettre à Wijnkoop, écrite au cours de l'été, Lénine déclarait avec force : « Mais vous et nous nous sommes des partis indépendants ; nous devons faire quelque chose : formuler le programme de la révolution, démasquer et dénoncer les mots d'ordre stupides et hypocrites de paix. » Et un télégramme fut envoyé peu avant Zimmerwald à Wijnkoop : « Venez aussitôt ! ».
Mais le SDP n'envoya aucun délégué à la conférence de Zimmerwald, qui se déroula du 5 au 8 septembre 1915. Wijnkoop et ses amis firent circuler l'information dans le parti — non confirmée — que l'organisateur de la conférence, le Suisse Robert Grimm, député, aurait donné au début de la guerre son vote pour l'approbation des crédits de mobilisation. « De Tribune », l'organe du parti ne donna pas à ses lecteurs communication des résolutions de la conférence. Au lieu de voir dans Zimmerwald «un pas en avant dans la rupture idéologique et pratique avec l'opportunisme et le social-chauvinisme», les chefs du SDP — à l'exception de Gorter, Pannekoek et Luteraan — n'y trouvèrent que pur opportunisme. Pire, ils passèrent à côté de l'importance historique de l'événement, comme première réaction organisée à la guerre et première étape d'un regroupement de révolutionnaires internationalistes ; ils ne virent qu'une « farce historique » dans ce qui devint par la suite le symbole de la lutte contre la guerre, une « sottise » dans le geste de fraternisation par delà les tranchées de socialistes allemands et français :
« Nous devons manifestement remercier Dieu (sic)...qu'il nous ait préservé de la sottise de la conférence de Zimmerwald, ou en termes plus précis, de la nécessité de nous occuper de l'opposition sur les lieux (...) Nous savions déjà à l'avance ce qu'il en adviendrait: rien que de l'opportunisme et aucune lutte de principe ! »
Cette attitude de Wijnkoop, mélange de sectarisme et d'irresponsabilité, ne fut pas sans conséquence pour l'image même de la gauche hollandaise. Elle laissa la place libre au courant de Roland-Holst, à Zimmerwald, qui représenta — par défection du SDP — le mouvement révolutionnaire aux Pays-Bas. Le RSV se situait dans le courant « centriste« de Zimmerwald, qui envisageait comme seule possible la lutte pour la paix, et refusait de s'associer à la gauche zimmerwaldienne, qui posait comme bases la lutte révolutionnaire et la nécessité d'une 3e Internationale. Internationalement, dans le mouvement de la gauche zimmerwaldienne, auquel s'associait le SDP politiquement, le « tribunisme » apparaissait comme un courant sectaire.
Dans le cas de Wijnkoop, Ravesteyn et Ceton, le sectarisme ne faisait que camoufler une politique opportuniste qui se révéla pleinement à partir de 1916-17. Le « sectarisme », dont l'Internationale communiste les accusa en 1920, n'était pas chez Gorter, Pannekoek et leurs partisans, qui oeuvraient de façon décidée pour un regroupement international des révolutionnaires.
QUELQUES LEÇONS
Les leçons que le mouvement révolutionnaire peut tirer de cette période de crise dans le mouvement ouvrier ne sont pas différentes ou spécifiques en comparaison des autres pays. Ce sont des leçons générales :
1) Le vote des crédits de guerre par le SDAP de Troelstra le 3 août 1914 signifie que l'ensemble de l'appareil s'est rangé du côté de la bourgeoisie hollandaise. Cependant, comme dans les autres partis, la crise provoquée dans ce parti se traduira par deux scissions, à gauche. Celles-ci seront numériquement très limitées : 200 militants pour chacune, pour un parti comptant 10000 adhérents. Le SDAP, à la différence du SPD allemand, n'était plus capable de sécréter en son sein de très fortes minorités, voire une majorité, hostile à la guerre, et se rangeant sur des positions prolétariennes. La question de la reconquête du parti ne pouvait plus se poser. C'est autour du SDP « tribuniste » que s'opère le processus de regroupement pendant la guerre. L'existence même du SDP depuis 1909 a en quelque sorte vidé le SDAP de l'essentiel de ses minorités révolutionnaires.
2) L'antimilitarisme et la « lutte pour la paix » en période de guerre sont une source énorme de confusion. Ils rejettent au second plan la lutte de classe et la lutte pour la révolution, seule capable de mettre fin à la guerre. Ces mots d'ordre, qu'on retrouve dans le SDP, traduisent la pénétration — dans le meilleur des cas — de toute l'idéologie petite-bourgeoise véhiculée en priorité par les courants anarchiste, syndicaliste-révolutionnaire et « centriste ». L'alliance conduite par le SDP avec ces courants, pendant la guerre, n'a fait que favoriser la pénétration de l'opportunisme dans le parti révolutionnaire qu'était le SDP.
3) Une scission « étroite » et précoce d'avec l'ancien parti, tombé dans l'opportunisme, n'est pas une garantie en soi contre le retour de l'opportunisme dans le nouveau parti révolutionnaire. La scission à gauche n'est pas un remède miracle. Toute organisation, fut-elle une minorité la plus sélectionnée, la plus armée théoriquement et la plus décidée, n'est pas épargnée par la pénétration constante de l'idéologie bourgeoise et/ou petite-bourgeoise. L'histoire du SDP pendant la guerre le montre amplement. Nécessairement se créent en réaction des minorités qui tendent à devenir fraction dans le parti. Telle fut l'opposition qui se développe autour de Gorter — à partir de 1916 — contre le danger opportuniste représenté par la clique Wijnkoop-Ravesteyn, succédané « radical » de celle de Troelstra.
4) Dans un parti révolutionnaire, l'opportunisme ne se manifeste pas toujours au grand jour. Très souvent, il se cache sous le masque du radicalisme verbal et de la « pureté des principes ». La direction Wijnkoop-Ravesteyn-Ceton en est l'illustration lorsqu'elle refuse de participer à la conférence de Zimmerwald sous prétexte que celle-ci serait dominée par les courants opportunistes. Le sectarisme ici n'est bien souvent que le revers de la médaille de l'opportunisme. Il s'accompagne bien souvent d'un grand esprit de « largesse » avec des courants confus, anarchisants et même carrément opportunistes. L'évolution de la direction du SDP, qui entraîne dans sa suite une grande partie de l'organisation, est typique. En cédant aux sirènes du parlementarisme, en s'alliant avec des courants étrangers au mouvement ouvrier — comme les Chrétiens-sociaux —, en ayant une attitude pro-Entente à la fin de la guerre, en se situant au début de la révolution russe aux côtés de Kerensky, cette direction empruntait le chemin de Troelstra avec un vernis «révolutionnaire» en plus. Les événements cruciaux — guerre et révolution — dissolvent immanquablement un tel vernis.
5) Dans la lutte contre l'opportunisme, l'action des minorités révolutionnaires est décisive. Il n'y a pas de fatalisme. Le fait que la réaction de Gorter, Pannekoek ait été dispersée, et au départ une simple opposition, a beaucoup pesé sur l'évolution ultérieure du SPD, lorsqu'il se transforma en parti communiste en novembre 1918.
Ch.
Géographique:
- Hollande [558]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 49 - 2e trimestre 1987
- 2891 reads
Leçons des grèves ouvrières en Europe de l'ouest
- 2526 reads
Entrer en lutte massivement, prendre en mains les luttes
Débutée en automne 1983, la troisième vague de luttes depuis la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 1960, confirme aujourd'hui son ampleur et sa profondeur. Si durant 1985 on avait pu constater un certain affaiblissement de cette vague de luttes résultant principalement du fait que la bourgeoisie avait mis en œuvre une stratégie d'éparpillement des attaques en vue de morceler les ripostes ouvrières, l'année 1986, notamment avec la Belgique au printemps, a vu le retour de combats massifs répondant au caractère de plus en plus frontal des attaques anti-ouvrières imposées par la poursuite et l'aggravation de l'effondrement économique du capitalisme.
Ce nouveau souffle de la lutte de classe s'est amplement confirmé durant les mois qui viennent de s'écouler : tour à tour la Suède, le France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, c'est-à-dire des pays parmi les plus avancés et centraux, mais aussi la Grèce, ont été le théâtre de luttes importantes et souvent d'un niveau inconnu depuis des années, voire des décennies. Ces différents combats de classe sont riches d'enseignements qu'il importe que les révolutionnaires soient en mesure de tirer afin d'être un facteur actif dans leur développement
UNE AMBIANCE GENERALE DE COMBATIVITE OUVRIERE
Depuis l'extrême nord de l’Europe occidentale jusqu'à son extrême sud, depuis la Suède « prospère » jusqu'à la Grèce « pauvre » et relativement sous-développée, le prolétariat a engagé le combat de façon déterminée et souvent massive.
En Suède s'est déroulé à partir du début octobre 1986 le troisième mouvement de grèves important en un an et demi, affectant particulièrement les fonctionnaires (près de 30 000 employés de l'Etat et des municipalités), mais s'accompagnant aussi d'une série de grèves sauvages dans d'autres secteurs.
En Grèce, ce sont des mouvements généralisés de grève, impliquant plus de deux millions d'ouvriers qui ont, fin janvier 1987 et surtout courant février, paralysé tout le pays. Industrie, télécommunications, postes, électricité, banques, transports routiers, aériens et maritimes, enseignement et hôpitaux : ce pays n'avait pas connu depuis des décennies un mouvement social d'une telle ampleur.
Cette relative simultanéité des luttes ouvrières dans deux pays aussi éloignés et apparemment aussi différents, met en évidence; l'unité du prolétariat mondial, et notamment celui qui vit et travaille en Europe occidentale, confronté à une morne crise insoluble du capitalisme. Que le niveau de vie des ouvriers dans les pays scandinaves soit de très loin supérieur à celui (les ouvriers en Grèce, que la part de la classe ouvrière dans l'ensemble de la population soit très différente entre ces deux pays n'y change; rien : partout les ouvriers subissent des attaques de plus en plus violentes de la part de la bourgeoisie et de son Etat, partout ils sont contraints d’entrer dans la lutte.
Les attaques extrêmement dures contre lesquelles a réagi la classe ouvrière en Grèce (les plus brutales depuis la chute du régime des colonels en 1974) ne sont pas simplement à l'image de la situation économique catastrophique de ce pays. Elles sont le reflet d'une détérioration considérable de l'économie mondiale depuis près d'une année, qui affecte également ces modèles de « prospérité » que sont les pays Scandinaves, et notamment le plus important d'entre eux, la Suède. Là aussi, les ouvriers subissent des attaques d'une ampleur sans précédent. En 10 ans, les salaires réels ont baissé de 12 %. Ces derniers mois se sont multipliées dans de nombreux secteurs les annonces de licenciements massifs, et pour 1987, le ministre des finances a parlé de 23 000 suppressions d'emplois dans le secteur public (dans un pays comptant moins de 9 millions d'habitants). Comme partout, le mythe de « l'Etat social », particulièrement fort en Suède, s'effondre totalement. Et si dans ce pays, comme dans la plupart des pays les plus avancés (à l'exception de la Belgique au printemps 1986), les luttes n'ont pas encore connu le caractère généralisé qu'elles ont connu en Grèce, c'est principalement parce que sa force industrielle lui a permis jusqu'à présent de s'épargner le niveau de convulsions économiques qui affecte les pays les plus faibles. Mais ce n'est que partie remise. Alors qu au siècle dernier, au moment de la phase ascendante du système capitaliste, c'était le pays le plus développé, la Grande-Bretagne, qui indiquait l'avenir des autres nations, dans la décadence capitaliste, c'est le délabrement total de l'économie des pays les plus faibles qui donne l'image de ce qui attend les pays les plus développés. Et avec l'effondrement économique croissant de ces derniers, avec le déchaînement des attaques anti ouvrières qui en découle, c'est bien le développement de luttes de plus en plus massives et généralisées qui constitue la perspective.
Cette perspective, elle est déjà en germe dans les manifestations de combativité ouvrière qui, au début de 1987, ont pris place dans plusieurs pays centraux d'Europe occidentale.
Ainsi aux Pays-Bas, les ouvriers ont commencé à riposter à un plan d'austérité d'une brutalité sans précédent (voir Revue Internationale n° 47). Et c'est un des secteurs « phares » de la classe ouvrière de ce pays, les dockers de Rotterdam (le plus grand port du monde) qui se trouve directement impliqué. Significatif est le fait que le secteur des containers, qui s'était trouvé en dehors des grèves de 1979 et de 1984, soit cette fois-ci parti en grève sauvage. Par ailleurs, contrairement à la grande grève des dockers de 1979, le mouvement de janvier-février 1987 ne se déroule pas de façon isolée. Des manifestations de solidarité se sont fait jour dans le port d'Amsterdam, et par ailleurs, des grèves ont éclaté simultanément dans diverses entreprises du pays (dans un chantier naval de Rotterdam, à Amsterdam, à Arnhem).
Un autre pays, parmi ceux du cœur de l'Europe occidentale, vient de confirmer les caractéristiques du moment présent de la lutte de classe. Il s'agit d'un des plus significatifs de tous, celui qui concentre les traits les plus marquants de la situation de l'ensemble de cette zone : la Grande-Bretagne.
En effet, ce pays a connu fin janvier et début février, avec la grève de British Telecom, un mouvement d'une grande ampleur affectant jusqu'à 140 000 travailleurs, qui a su associer aussi bien les employés du secteur administratif que les ouvriers du secteur technique, marquant un pas important dans le dépassement du corporatisme du métier traditionnellement très fort au sein de la classe ouvrière en Grande-Bretagne et qui, en particulier, s'est déclenché et développé de façon spontanée en solidarité à l'égard d'ouvriers sanctionnés pour refus d'effectuer des heures supplémentaires. Alors que la grande grève des mineurs de 1984-85 et la grève des ouvriers de l'imprimerie en 1986 étaient restées entièrement, du début jusqu'à la fin, encadrées par les syndicats, le débordement de ces derniers qui s'est exprimé dans ce mouvement récent, le fait qu'ils aient été contraints de courir en permanence après la lutte afin de ne pas se démasquer ouvertement, la reprise du mouvement après que le 11 février, le syndicat ait réussi par ses manœuvres à faire voter la fin de la grève, tous ces traits témoignent d'un processus profond de maturation de la conscience dans la classe ouvrière. De même, cette explosion massive de combativité est le signe que les ouvriers de Grande-Bretagne se sont remis de la relative démoralisation qui avait accompagné la défaite de la grève des mineurs et celle des ouvriers de l'imprimerie. Le fait que cette reprise d'une combativité massive concerne un pays où se trouve la classe ouvrière la plus ancienne du monde, où la bourgeoisie est la plus expérimentée et habile, est un nouveau témoignage de la force du nouveau souffle de la lutte de classe internationale depuis le début 1986.
Mais l'événement le plus significatif de cette situation, après les luttes de Belgique du printemps 1986, est certainement la grève qui a paralysé pendant près d'un mois les transports ferroviaires en France.
Les enseignements de la grève des chemins de fer en France
Alors que depuis l'automne 1983 s'étaient produits des surgissements massifs de la lutte de classe dans pratiquement tous les pays d'Europe occidentale, la classe ouvrière semblait relativement à la traîne en France. Certes les ouvriers de ce pays n'étaient pas restés étrangers au mouvement, et les luttes dans l'automobile fin 1983 et courant 1984, dans la sidérurgie et la construction navale au printemps 1984 constituaient, en compagnie d'autres mouvements de moindre importance, un témoignage du caractère général de la reprise des luttes dans les pays les plus avancés. Cependant on était loin de l'ampleur des mouvements qui avaient affecté des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou le Danemark.
Pour certains groupes révolutionnaires, le fait qu'un des secteurs nationaux de la classe ouvrière dont les luttes passées — et en particulier mai 1968 — avaient témoigné de la capacité à mener des combats massifs, n'ait amené à partir de 1983 que des luttes de portée limitée, était un argument pour conclure à une apathie durable des ouvriers dans ce pays et pour sous-estimer l'importance des combats qui se menaient dans le reste de l'Europe. En réalité, ce type d'analyse est à l'opposé de la démarche qui doit être celle des révolutionnaires marxistes dans l'examen des situations historiques. Loin de regarder celles-ci par le petit bout de la lorgnette, les marxistes se sont toujours distingués par leur capacité à déceler derrière des apparences trompeuses les véritables enjeux des situations auxquelles ils étaient confrontés. Le faible niveau des grèves en France n'était nullement le signe de l'absence ni d'un profond mécontentement, ni d'un important potentiel de combativité. D'ailleurs des indices de ce mécontentement et de cette combativité avaient été donnés par les grèves spontanées et de courte durée qui avaient paralysé durant deux jours le trafic ferroviaire national fin septembre 1985 et pendant une journée les transports parisiens deux mois plus tard.
En réalité, il convenait d'analyser cette relative faiblesse de la lutte ouvrière comme le résultat de deux facteurs assez spécifiques de la situation en France.
Le premier de ces facteurs était la relative timidité des attaques anti-ouvrières portées par le gouvernement de gauche PS-PC. Ce gouvernement, s'il s'était montré un fidèle gestionnaire du capital national en accentuant sous le nom de la « rigueur » une réelle politique d'austérité, se trouvait entravé par la présence de tous les partis de gauche à la tête de l'Etat dégarnissant le terrain social : un niveau d'attaques plus élevé risquait fort d'aboutir à une situation complètement incontrôlable par la totalité des syndicats, lesquels soutenaient ce même gouvernement.
Le second de ces facteurs était la stratégie d'immobilisation menée à partir de 1984 et suite au départ du PC du gouvernement par ces mêmes syndicats, et particulièrement la CGT (proche du Parti Communiste), consistant à utiliser contre les luttes le discrédit qui s'était développé à leur égard parmi les ouvriers : leurs appels répétés et radicaux à « l'action » avaient pour résultat justement de détourner de l'action les ouvriers les plus conscients de leur rôle de saboteurs.
Mais derrière la relative passivité ouvrière résultant de cette situation s'accumulait un énorme mécontentement et mûrissait la capacité à transformer en positif le discrédit des syndicats, pour (et non plus contre) le combat de classe.
C'est justement ce qu'a démontré la grève à la SNCF (Chemins de Fer français) à partir de la deuxième moitié de décembre 86.
La grève est partie le 18 décembre dans le dépôt de conducteurs de la gare du Nord de Paris, de façon spontanée, sans préavis auprès de la direction (obligatoire dans le secteur public en France), ni consigne des syndicats, lesquels attendaient l'ouverture de négociations avec la direction prévues le 6 janvier 1987. Ce premier groupe de grévistes bloquait immédiatement le trafic dans le réseau Nord et appelait les autres conducteurs à rejoindre la lutte. En 48 heures, ce sont tous les dépôts (quatre-vingt treize) qui sont touchés et on compte 98 % de grévistes parmi les conducteurs. C'est le mouvement le plus important dans ce secteur depuis mai 1968. Ce mouvement déborde sur d'autres catégories de travailleurs de la SNCF. Bien qu'avec une participation moindre, les « sédentaires » de pratiquement toutes les gares, de tous les ateliers, sont entrés en lutte.
Pendant plusieurs jours, les syndicats sont complètement débordés et prennent position contre la lutte sous prétexte de ne pas gêner les départs en vacances de la période de fin d'année. Même la CGT, qui est le plus « radical » d'entre eux, s'oppose au démarrage du mouvement, allant dans certains dépôts jusqu'à organiser des « piquets de travail » pour casser la grève. Cette attitude des syndicats, l'énorme méfiance qui s'était développée à leur égard depuis des années et particulièrement au cours de l'année écoulée où ils ont écœuré les ouvriers de la SNCF par quatorze « journées d'action » stériles, tout cela permet d'expliquer que d'emblée une des préoccupations majeures de tous les grévistes a été de prendre eux-mêmes en main leur lutte afin d'empêcher les syndicats de la saboter. Partout se tiennent chaque jour des assemblées générales souveraines qui se veulent le seul lieu de prise de décision sur la façon de conduire la lutte. Partout des comités de grève sont élus par les assemblées et sont responsables devant elles. C'est la première fois qu'en France on assiste à un tel niveau d'auto-organisation des luttes. Les grévistes ressentent le besoin d'unifier cette auto-organisation à l'échelle de tout le pays, ce qui aboutit à la création de deux « coordinations » nationales. La première, celle dite de « Paris-Nord » (lieu de ses réunions) regroupe les délégués de près de la moitié des dépôts de conducteurs. La seconde, dite « d'Ivry » (dépôt de la banlieue sud de Paris) est ouverte à toutes les catégories d'ouvriers de la SNCF mais est en même temps moins représentative et beaucoup de ses participants ne sont pas mandatés par les assemblées. Et c'est là que le mouvement exprime ses limites. La coordination de Paris-Nord décide de se limiter aux seuls conducteurs et celle d'Ivry, si elle est plus ouverte, décide à son tour d'interdire l'entrée de ses réunions aux ouvriers d'autres secteurs.
Dans cet enfermement de la lutte, il faut voir évidemment le résultat du travail des instruments les plus radicaux de l'Etat bourgeois : le syndicalisme « de base » et les groupes gauchistes. En effet, ces derniers, tout en faisant dans leur presse de grandes déclarations en faveur de l'extension de la lutte, sont les premiers, sur le terrain, à combattre une telle extension. Ce n'est pas un hasard si la coordination de Paris-Nord, qui se referme aux seuls conducteurs, a pour porte-parole un militant de la « Ligue Communiste Révolutionnaire » (trotskyste) ; si la coordination d'Ivry a pour figure de proue un militant d'un autre groupe trotskyste, « Lutte Ouvrière ». En réalité, si ces groupes bourgeois sont en fin de compte capables de dévoyer le mouvement dans l'impasse de l'isolement c'est qu'il existait encore au sein de la classe ouvrière un fort poids du corporatisme que les gauchistes ont flatté par des propos radicaux du style : « si nous élargissons le mouvement à d'autres secteurs, nos propres revendications spécifiques seront comme d'habitude noyées dans les autres et d'autre part, nous allons perdre le contrôle du mouvement au bénéfice des syndicats qui eux ont une structure à l'échelle de tout le pays ».
L'isolement dans lequel se sont enfermés au bout d'une semaine les travailleurs de la SNCF s'est révélé extrêmement nocif pour la suite du mouvement. Il était d'autant plus grave qu'il existait tout au cours de la fin décembre d'importants mouvements de grève dans les transports parisiens et dans les ports. Ces mouvements avaient été lancés par les syndicats mais témoignaient d'une très forte combativité et méfiance par rapport à ceux-ci. Alors que l'envoi de délégations massives des assemblées de cheminots vers les autres assemblées et secteurs ouvriers, que l'ouverture de leurs propres assemblées à ces autres secteurs auraient pu constituer autant d'exemples de comment lutter pour l'ensemble de la classe ouvrière, de comment s'organiser en dehors des syndicats, l'isolement des cheminots dont l'attitude des deux coordinations était le témoignage, a déterminé la stagnation puis le déclin de leur mouvement après le 25 décembre. Celui-ci avait cessé d'être un facteur dynamique positif dans l'ensemble de la situation en France. Par contre, son épuisement a été l'occasion pour la bourgeoisie de développer une contre-offensive visant à saboter dans les autres secteurs la combativité ouvrière. Le partage des tâches a été systématiquement organisé. En particulier syndicats et gouverneraient ont fait pendant des semaines de la question de la grille des salaires (la Direction voulait remplacer une grille d'avancement à l'ancienneté par une grille d'avancement « au mérite ») le sujet central de leur battage, alors que la question centrale qui concerne tout le secteur public en France est celle d'une baisse continue du pouvoir d'achat qui va encore s'amplifier en 1987. Après avoir affiché son intransigeance sur la « grille », le gouvernement décide le 31 décembre de la « suspendre », ce qui évidemment est salué comme une « victoire » par les syndicats. Comme les cheminots décident après cette date de poursuivre la grève, on voit alors la CGT, sûre désormais de l'échec du mouvement, adopter (suivie par la CFDT d'obédience PS) un langage « jusqu'au-boutiste » qui va se maintenir jusqu'à la fin de la grève à la mi-janvier. Ce même syndicat lance au début janvier une série de grèves dans le secteur public notamment aux Postes et Télécommunications et surtout dans un de ses bastions, l'Electricité et le Gaz (EDF-GDF). C'est au nom de l'extension de la grève des cheminots à tout le secteur public que la CGT lance ses appels. Le fait qu'elle reprenne à ce moment-là un slogan qui en général est celui des révolutionnaires ne signifie évidemment pas que ce syndicat aurait décidé d'un seul coup de défendre les intérêts ouvriers. Ce qu'il cherche par ses appels ce n'est pas l'extension du combat mais l'extension de sa défaite. Plus important sera le nombre des ouvriers engagés dans la lutte dans un moment défavorable et plus cuisante et étendue sera la démoralisation qui en résultera : tel est le calcul de la bourgeoisie. Et c'est en partie ce qu'elle a obtenu dans des secteurs comme EDF-GDF.
Ainsi, malgré son complet débordement au début du mouvement, la bourgeoisie, avec l'ensemble de ses forces se partageant le travail : droite, gauche et gauchistes (lesquels en particulier ont réussi à convaincre les ouvriers les plus méfiants de s'en remettre aux syndicats pour négocier avec le gouvernement) a réussi encore une fois à reprendre les choses en main. Cependant, cette grève a laissé une marque très importante dans la conscience de toute la classe ouvrière en France. Ainsi, dans chaque petit mouvement qui a pu se dérouler par la suite (instituteurs, hôpitaux, etc.), la nécessité d'assemblées générales souveraines s est exprimée et sont apparues des «coordinations» fomentées en général par les gauchistes pour qu'ils puissent en garder le contrôle. Par ailleurs, on assiste à l'heure actuelle à un profond mouvement de réflexion au sein de la classe dont une des manifestations est l'apparition encore timide de comités de lutte ([1] [1088]) se donnant pour objectif d'impulser la réflexion parmi les ouvriers dans la perspective des prochains combats.
Le mouvement qui vient de se produire en France, malgré son échec et ses faiblesses, est extrêmement significatif du moment présent des luttes à l'échelle européenne. L'auto-organisation dont il s'est doté avant que gauchistes et syndicats ne viennent la vider de son contenu, l'extrême méfiance qui s'est exprimée à l'égard de ces derniers montrent l'avenir de la lutte de classe à l'échelle internationale. Ces caractéristiques sont particulièrement accentuées en France du fait de la présence au gouvernement pendant trois ans de tous les partis de gauche. En ce sens, les luttes qui viennent de se dérouler en France constituent une confirmation a contrario de la nécessité pour la bourgeoisie de tous les pays, depuis la fin des années 1970, de placer ses forces de gauche dans l'opposition afin d'occuper le terrain social. Elles sont aussi une confirmation du fait que la venue de la gauche au pouvoir en mai 1981 ne résultait nullement d'une stratégie de la bourgeoisie, mais bien d'un accident lié à l'archaïsme de son appareil politique. Cependant, même dans les pays qui ont pu s'éviter ce genre d'accident (c'est-à-dire la grande majorité), l'usure d'un appareil syndical de plus en plus mis à contribution dans le sabotage des luttes ouvrières débouchera de plus en plus vers l'apparition de tels mouvements spontanés et développant leur auto-organisation.
L’intervention des révolutionnaires
Il est clair qu'un mouvement d'une telle importance requiert de la part des organisations révolutionnaires une intervention active afin d'apporter une contribution réelle au développement de la lutte et à la prise de conscience de l'ensemble de la classe.
C'est dès les premiers jours du mouvement qu'une telle intervention active s'avérait nécessaire pour appeler tous les autres secteurs de la classe ouvrière à rejoindre le mouvement. C'est pour cela que notre section en France a publié le 22 décembre un court tract en ce sens largement diffusé et intitulé : « Pour faire reculer l'attaque du gouvernement, élargissons le mouvement, entrons tous ensemble dans la lutte ».
Ensuite, lorsque après le 25 décembre le mouvement a atteint son apogée et a commencé à piétiner, il s'agissait de souligner aux yeux de tous les ouvriers l'impérieuse nécessité de ne pas laisser isolée la grève des cheminots sous peine d'aboutir à une défaite pour l'ensemble de la classe ouvrière. Il fallait en même temps insister particulièrement pour que se développe dans la classe une réflexion approfondie à partir des événements qu'elle vivait depuis une dizaine de jours. C'était la signification du deuxième tract publié le 28 décembre par la section en France du CCI et intitulé « Appel à tous les ouvriers pour élargir et unifier les lunes ».
Enfin, lorsque la lutte s'est achevée, il convenait que les révolutionnaires participent encore activement au processus de réflexion et de décantation qui s'opérait dans la classe en vue de mieux être armée pour les combats futurs. C'était le but du troisième tract publié le 12 janvier par notre organisation, intitulé « Leçons du premier combat ».
Il est clair que l'intervention des révolutionnaires ne peut se limiter à la diffusion de tracts : la vente de la presse sur les lieux de travail, dans les manifestations, les prises de parole dans les assemblées et meetings, les réunions publiques, constituent aussi des moyens importants de cette intervention au cours d'une telle période, moyens que le CCI a tenté d'utiliser le mieux possible malgré ses faibles forces.
Cependant, ce n'est pas une seule organisation du milieu révolutionnaire mais toutes ses organisations qui étaient confrontées à cette nécessité d'une intervention active. Et malheureusement, pour la majorité de celles-ci, cette intervention s'est trouvée une nouvelle fois bien en deçà de ces nécessités lorsqu'elle n'a pas été carrément inexistante.
De cette carence de l'ensemble du milieu politique prolétarien il est nécessaire de tirer plusieurs enseignements.
En premier lieu, une organisation révolutionnaire ne peut être un facteur actif dans le développement des luttes que si elle s'est dotée d'une analyse claire du moment historique dans lequel elles se situent. Lorsqu'on continue de penser que le cours historique est encore à la guerre, que le prolétariat n'est pas encore sorti de la contre-révolution (alors que c'est tout le contraire qui est vrai depuis la fin des années 1960), il n'est pas étonnant qu'on sous-estime complètement l'importance des mouvements présents, qu'on en soit absent ou qu'on y intervienne après la bataille.
En second lieu, il importe que les révolutionnaires soient capables à chaque moment de situer la signification réelle des différents événements auxquels ils sont confrontés : attribuer au mouvement des étudiants de décembre 1986 en France, une valeur « d'exemple » pour les luttes ouvrières de ce pays c'est non seulement confondre 1986 avec 1968, c'est aussi ne pas comprendre la nature profonde, inter-classiste de ce type de mouvement, c'est enfin apporter sa petite contribution aux discours des gauchistes et de toute la bourgeoisie sur le même thème.
En troisième lieu, il est nécessaire que les révolutionnaires soient à chaque moment en mesure de juger de façon précise des situations afin d'y intervenir suivant les formes les plus appropriées. Cette nécessité d'une analyse au jour le jour de l'évolution des situations est évidemment difficile pour les révolutionnaires. Elle ne découle pas mécaniquement de la validité de leurs principes programmatiques ni de la justesse de leur compréhension de la période historique. En particulier, cette capacité résulte aussi, pour une bonne part, de l'expérience concrète acquise par les révolutionnaires dans la lutte.
Pour pouvoir réunir l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire que les organisations communistes se conçoivent comme partie prenante des combats actuels de la classe ouvrière. Et c'est sûrement ce qui manque le plus dans le milieu politique prolétarien à l'heure actuelle.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons ce constat ; le CCI n'est pas intéressé à dénigrer les autres organisations afin de pouvoir souligner ses propres mérites. Nos critiques, sur lesquelles nous reviendrons plus précisément, nous les concevons -comme un appel à tous les révolutionnaires à prendre à bras le corps la responsabilité que la classe leur à confiée et dont l'importance croît de jour en jour en même temps que se développe le mouvement de celle-ci.
Perspectives du développement des luttes
Dans un contexte européen et même mondial (voir l'article dans ce numéro sur les luttes aux USA) le développement des luttes ouvrières, les combats qui se sont déroulés en France à la fin 1986, constituent, après ceux de Belgique au printemps de la même année, un pas important de ce développement. En particulier bien qu'elles aient beaucoup de caractéristiques communes, ces deux luttes ont mis particulièrement en évidence, chacune pour sa part, une des deux nécessités majeures du combat de classe à l'heure actuelle.
Les luttes de Belgique ont souligné la nécessité et la possibilité de mouvements massifs et généralisés dans les pays capitalistes avancés. Les luttes en France sont venues confirmer la nécessité et la possibilité d'une prise en main par les ouvriers de leurs combats, de l'auto-organisation de ceux-ci en dehors des syndicats, contre eux et leurs manœuvres de sabotage.
Ce sont ces deux aspects inséparables du combat ouvrier qui seront de plus en plus présents dans le mouvement de luttes qui a déjà débuté.
FM. 1/3/87
[1] [1089] Voir dans Révolution Internationale n°8153 et 154 deux textes publiés par des comités de ce type.
Géographique:
- Europe [274]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Rapport (Internationalism) : Crise et lutte de classe aux USA (extraits)
- 2741 reads
L'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase de récession n'épargne pas les USA, chef de file du bloc de l'Ouest et principale puissance économique mondiale. Les difficultés s'accroissent inexorablement pour le capital américain. Et les changements qui s'opèrent à la tête de l'exécutif, à travers le montage médiatique autour de «l'Irangate», visant à préparer la relève de Reagan en maintenant le Parti républicain au gouvernement et le Parti démocrate dans l'opposition, témoignent des préoccupations de la bourgeoisie américaine sur la nécessaire application d'une austérité brutale aux USA. Et cette austérité, comme dans le monde entier, comme en Europe occidentale, le prolétariat américain n'est pas prêt à l'accepter sans réagir. Même si du fait de ses caractéristiques historiques, le prolétariat aux USA n'a pas encore développé ses luttes au niveau atteint depuis quelques années en Europe de l'Ouest, il a montré une combativité dans toute une série de grèves ouvrières dans différents secteurs qui s'inscrit dans la vague actuelle de lutte de classe internationale.
Nous publions ci-dessous l'extrait sur la «Lutte de classe » du rapport sur la situation aux USA adopté par la section du CCI aux USA en décembre 1986, traitant de la politique de la bourgeoisie et des luttes ouvrières (pour obtenir le texte complet en anglais, s'adresser à «Internationalism»), Les événements des quelques mois écoulés depuis ce rapport n'ont fait que confirmer la perspective qui y est tracée d'un renforcement des attaques de la bourgeoisie et des réactions ouvrières à ces attaques.
La lutte de classe
La classe ouvrière aux USA participe à part entière à la troisième vague de luttes de classe qui a commencé en septembre 1983. Chaque phase de la vague actuelle a eu un écho très rapide dans les luttes des ouvriers américains. Le retard des ouvriers américains est en profondeur, pas dans le temps. Les luttes n'ont pas atteint la même ampleur qu'en Europe de T Ouest, mais ont montré les mêmes tendances et caractéristiques, prouvant une fois de plus que la lutte de classe est internationale. Les différences de degré qui se manifestent aux USA sont le reflet de la force du capitalisme américain et de sa position de chef du bloc de l'Ouest.
La troisième vague a eu trois phases distinctes :
— Première phase : elle commence en septembre 1983 en Belgique avec la grève du secteur public, et montre une tendance à l'extension — les ouvriers allant chercher d'autres secteurs lorsqu'ils voient la nécessité d'éviter l'isolement — et aussi un haut degré dans la simultanéité des luttes dans différentes industries et différents pays. Cette phase s'est rapidement exprimée aux USA par la grève à Greyhound, dans laquelle les ouvriers se battaient contre des baisses de salaires. Quand la direction a essayé de suivre l'exemple de l'administration Reagan face aux aiguilleurs du ciel, et a voulu employer des jaunes pour remplacer les ouvriers, des ouvriers combatifs d'autres secteurs sont accourus pour montrer leur solidarité dans les manifestations. Ces manifestations, appelées par le conseil syndical central, ville par ville, ont offert souvent la possibilité de rompre le contrôle syndical et ont montré que les ouvriers avaient tiré des leçons de l'expérience des contrôleurs aériens. Des manifestations de masse, des défilés dans les rues, d'abord appelés par les syndicats sous la pression des ouvriers, devinrent bientôt chose courante. Alors que les mois précédents avaient vu les pionniers de la nouvelle vague s'affronter violemment à la police lors des grèves à Iowa Beef, Phels Dodge en Arizona, ATT Continental, et avant Chrysler (en 1983), la grève de Greyhound a marqué un pas qualitatif : pour la première fois des ouvriers, hors d'un conflit spécifique sur un contrat, ont participé directement à la lutte. Cette recherche de la solidarité active n'a pas pris la forme de rejoindre la grève sur leurs propres revendications, comme cela a été le cas dans la grève du secteur public en Belgique en septembre 1983. Mais la grève de Greyhound a clairement exprimé le même processus, et les premiers jalons ont été posés pour briser l'isolement du corporatisme entretenu par les syndicats. Les ouvriers qui n'étaient pas employés à Greyhound se battaient à côté des grévistes, bloquant les autobus, risquant d'être arrêtés par la police, et un ouvrier de la construction est mort en essayant de bloquer un bus à Boston. Cette première phase a continué à faire écho aux événements en Europe, lorsque plusieurs milliers d'ouvriers à Toledo on rejoint les grévistes pour attaquer un atelier de jaunes en mai 1984, et se sont lancés dans une bataille rangée avec la police qui dura toute la nuit. Les confrontations violentes à Phels Dodge, la grève de la LILCO contre les baisses de salaires en dépit de la faillite proche de la compagnie, la grève des hôpitaux à New York et la grève de General Motors, grève sauvage non officielle qui s'est étendue à treize usines dans le pays, et la grève des employés de l'hôtel New York City dans laquelle les grévistes ont pris les rues, marchant d'hôtel en hôtel dans la ville, bloquant le trafic et trouvant un certain écho chez les employés des centres de distribution; tels furent quelques-uns des épisodes marquants de cette première phase de la troisième vague de lutte de classe, qui ont démontré la résistance grandissante aux baisses de salaires et autres concessions, et la tendance à la solidarité.
— La seconde phase a commencé à la fin 1985 - et fut caractérisée par une série de luttes dispersées, la bourgeoisie essayant de contrecarrer la tendance à l'extension et à la solidarité active dans la classe ouvrière en recourant à une stratégie d'attaques dispersées, attaquant les ouvriers d'une compagnie, d'une usine, d'un secteur à la fois. Les syndicats n'attendirent plus la pression ouvrière pour organiser des manifestations de solidarité et des marches, mais agirent préventivement en annonçant leurs plans d action, court-circuitant toute action spontanée. Bien sûr, les syndicats sabotèrent consciemment ces manifestations. Pour combattre le danger, explosif de la tendance à l'extension, les syndicats mirent de plus en plus en avant la fausse stratégie des « batailles d'usure » — la grève de longue durée. La restriction des piquets de masse, des marches de solidarité et autres armes de la classe ouvrière devinrent l'arme de routine utilisée par le syndicat, la direction et le gouvernement pour dévoyer les luttes ouvrières. Là où la situation était si explosive que les tactiques des syndicats traditionnels ne suffisaient plus à contrôler et à défaire les ouvriers, la bourgeoisie commença à s'appuyer de plus en plus sur les syndicalistes de base.
La stratégie d'attaques dispersées et le relais assuré par les syndicalistes de base menèrent à la dispersion de luttes combatives, dans lesquelles les ouvriers affirmèrent une résistance croissante aux attaques, et même une tendance à rompre le contrôle syndical, mais qui sont restées isolées. Les luttes centrales de cette période furent : la grève de Wheeling-Pittsburgh, où les ouvriers partirent en grève contre le plan de restructuration prévu à la suite de la faillite de l'entreprise; la grève d'Hormel, où la bourgeoisie s'appuya sur les syndicalistes de base qui se mirent à la tête de la tendance à l'extension, en prirent le contrôle, et l'amenèrent à la défaite ; la grève de Watsonville Cannery, où les premiers pas de l'auto organisation furent réalisés par une assemblée générale massive qui élit un comité de grève, qui se fit cependant récupérer par les syndicalistes de base qui orientèrent les ouvriers sur une «réforme syndicale » ; la grève des imprimeurs du Chicago Tribune, qui, bien qu'empêtrée dans une « grève d'usure », explosa dans une énorme manifestation de solidarité de classe en janvier 1986 où 17 000 ouvriers débrayèrent quelques heures pour aller à une manifestation appelée par les syndicats, se battirent avec la police, et essayèrent de bloquer le passage des jaunes ; la grève du personnel naviguant de la TWA, dans laquelle les grévistes refusaient les baisses de salaires drastiques et eurent dès le départ le soutien massif des mécaniciens et du personnel au sol, qui refusèrent de traverser les piquets de grève. Mais le gouvernement réussit à briser cette solidarité, isola et mena à la défaite le personnel naviguant.
— La troisième phase commence au printemps 1986. Comme le CCI l'avait prévu, à cause de l'approfondissement de la crise et de la chute dans une nouvelle récession globale, la bourgeoisie de tous les pays a de moins en moins de marge de manœuvre, de moins en moins de possibilité de reporter ses attaques contre la classe ouvrière. Elle déclenche une attaque frontale contre toute la classe ouvrière : un assaut d'austérité général. Internationalement, la troisième phase apparaît en Scandinavie où les ouvriers se battent contre les programmes d'austérité du gouvernement au début du printemps, et atteint son point le plus haut en Belgique au printemps, où la combativité des ouvriers est renforcée par un effort conscient de recherche de l'unité dans la lutte. Aux USA, les premiers signes d'un changement de situation sont apparus à peu près en même temps : au printemps, une grève sauvage de General Electric s'étendit à quatre usines du Massachusetts, et une grève des cheminots du Maine Railroad s'étendit rapidement dans la Nouvelle-Angleterre, les autres cheminots manifestant une solidarité active. Mais ce fut la grève des employés municipaux de Philadelphie et Détroit en juillet qui annonça le plus clairement la troisième phase aux USA, à peine deux mois après les événements de Belgique.
A Philadelphie, les ouvriers utilisèrent des piquets de masses pour fermer l'Hôtel de Ville, refusant de laisser les syndicats utiliser des divisions juridiques pour diviser l'unité de la lutte, ne laissant pas les ordres syndicaux dissoudre les piquets pour faire dérailler le mouvement, et n'obéirent pas à l'injonction de reprendre le travail. Mais les syndicats parvinrent à utiliser la menace de la Ville de licencier tous les ouvriers, et à briser la grève, parce que les ouvriers n'avaient pas encore compris que la seule façon de déjouer de telles tactiques est d'étendre encore plus la lutte, d'entraîner plus d'ouvriers d'autres secteurs dans la bataille.
A Détroit, les efforts conscients de recherche d'unité ont atteint un niveau encore plus haut : les employés dits « cols bleus » comme ceux du sanitaire et du transport, qui n'étaient pas directement impliqués dans le conflit immédiat sur le contrat de salaires, ont maintenu une unité combative, résistant à tous les efforts des syndicats et de la direction pour les diviser. Même si les « cols bleus » n'ont jamais vraiment rejoint la grève sur leurs propres revendications, leur solidarité combative a donné à la grève sa réelle force, et a permis aux ouvriers de repousser l'attaque pour le moment, montrant clairement que la lutte paie. La même tendance s'est manifestée dans la grève des hôtels à Atlantic City où les ouvriers ont affirmé que la manifestation de rue était une arme puissante de la lutte de classe, défilant dans les rues, bloquant les transports de touristes et les bus qui transportaient les jaunes, et s'affrontant à la police pendant près de deux jours, avant qu'un nouveau contrat ne leur soit proposé.
Les mêmes tendances vers la recherche rapide et consciente de l'unité, ignorant les ordres syndicaux, prenant les rues, évitant les « guerres d'usure » se sont manifestées dans la grève des cliniques d'une chaîne privée en Californie, qui voulait baisser le salaire d'entrée de 30 %. Les piquets de masse forcèrent cinq autres syndicats représentants d'autres employés à rejoindre la grève.
En identifiant les nouvelles tendances déterminantes qui ont surgi dans cette troisième phase de la lutte, nous ne voulons pas déduire que toute lutte a nécessairement les mêmes forces et le même développement. Il est clair que la bourgeoisie américaine, avec sa grande force économique, a encore la capacité de disperser ses attaques, à un plus ou moins grand degré, et le fera tant que ce sera possible. Comme le montre l'exemple de la grève à USX (sidérurgie), elle a la capacité d'orchestrer l'isolement des luttes et recourt à l'idéologie de la grève d'usure. Néanmoins, nous devons insister sur le fait que la tendance générale favorise un développement des luttes dans lesquelles les ouvriers cherchent consciemment à unifier leurs luttes et à construire une solidarité active.
Vu les spécificités de l'économie américaine, avec son large secteur privé, et la façon plus indirecte dont les plans d'austérité du gouvernement sont imposés au secteur privé, c'est dans le secteur public que les conditions sont le plus favorables à un mouvement unifié à court terme. Toutefois, comme le montre l'avalanche de nouveaux licenciements, la résistance des ouvriers du secteur privé ne suivra pas de loin.
Avec les contrats pour 1987 qui touchent près de 600 000 ouvriers du secteur public et 400 000 du secteur automobile, les potentialités pour des luttes importantes sont posées. La croissance rapide du chômage pose la condition pour que les chômeurs jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte de classe, comme nous l'avons vu dans certains pays d'Europe. La fermeture d'un nombre croissant d'usines, suivant des années de concessions syndicales, qui étaient censées garantir le futur, et les licenciements dans des compagnies qui réalisent d'énormes profits, attisera la résistance combative des ouvriers. La pression grandissante du gouvernement et des compagnies pour attaquer les ouvriers amènera une plus grande simultanéité des luttes, et créera des circonstances de plus en plus favorables pour la tendance à l'unification des luttes contre des attaques unifiées.
La participation de la classe ouvrière américaine à la troisième phase démontre clairement que le même processus de maturation de la conscience de classe a eu lieu ici et en Europe. Les ouvriers aux USA comprennent de plus en plus le sérieux de ce qui est engagé dans les luttes. Bien que le nombre de grèves en 1986 ait incroyablement augmenté par rapport à 1985 (qui détenait le record du nombre de grèves le plus bas depuis la seconde guerre mondiale), il n'a pas encore rattrapé celui de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Mais, plus important que le nombre de grèves, est la qualité des grèves, qui se traduit dans le sérieux des enjeux des grèves et dans les efforts de la classe ouvrière pour tirer les leçons des grèves passées.
La bourgeoisie utilise ses médias pour démoraliser les ouvriers quant aux perspectives de lutte, insistant sur la défaite des contrôleurs aériens en 1981, sur la grève d'Hormel, sur celle du personnel naviguant de la TWA — tous ceux là ayant perdu leur travail. Mais les ouvriers n'ont pas été détournés de la lutte par ces défaites. Au contraire, ils commencent à tirer les leçons de ces défaites, et cherchent l'unité dans la lutte, qui est leur principale arme. Il devient de plus en plus évident que la meilleure façon de se battre ce n’est pas les longues grèves d'usure, mais les conflits courts, qui s'étendent rapidement. A Hormel, à Watsonville, à la TWA, à USX, les syndicats ont imposé leur stratégie de grève d'usure, et ont mené les ouvriers à la défaite. Mais à Philadelphie, Détroit, Atlantic City et dans les cliniques de Californie, les ouvriers ont très rapidement cherché à étendre leurs luttes.(...)
Internationalism Décembre 1986
Géographique:
- Etats-Unis [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise économique ? : Le capitalisme russe s'enfonce dans la crise mondiale
- 3820 reads
Avec Mikhaïl Gorbatchev, la propagande soviétique s'offre une cure de jouvence médiatique. Devant les caméras du monde entier, le nouveau chef de l’Etat russe pérore : « ...des transformations révolutionnaires sont en cours dans notre pays », et les nouveaux princes du Kremlin de disserter sur la « révolution », la « démocratie », la « paix », le « désarmement », etc. Mais dans tout cela, rien de bien nouveau, ce sont les thèmes classiques de la propagande soviétique depuis des décennies. Ce qui est nouveau, c'est après la paralysie de l'administration brejnevienne, le dynamisme de la nouvelle équipe à mettre en œuvre ses thèmes de propagande, de mystification, sa capacité à jouer des ressources de l'arsenal médiatique, à libérer quelques «dissidents» par-ci, à faire de mirifiques propositions de « désarmement » par-là, à arrêter quelques bureaucrates « corrompus » par ailleurs. La bourgeoisie russe est en train de prendre exemple sur ses consœurs occidentales et apprend à maîtriser l'art des campagnes idéologiques de déboussolement destinées à cacher aux yeux du prolétariat la réalité de la dégradation générale de l'économie, l'attaque drastique contre les conditions de vie des ouvriers et l’accentuation des tensions impérialistes.
La dégradation économique de l'URSS
Les données économiques de manière générale sont toujours sujettes à caution, car ce sont d'abord des données fournies par la classe dominante, donc en partie assujetties aux besoins de sa propagande, mais en URSS cette tendance est certainement encore plus forte que pour les autres grandes puissances, quand ce n'est pas que simplement ces données sont classées secret d'Etat. Dans ces conditions, il est bien difficile de se faire une idée exacte de la situation réelle de l'économie russe. Cependant, quelques éléments montrent clairement sa situation de faiblesse sur la scène mondiale et la dégradation qui va en s'accélérant dans le cadre de la crise économique mondiale du capitalisme.
Le statut de 2e puissance économique mondiale de l'URSS est à relativiser. Alors qu'en 1984, les USA caracolent en tête avec un PNB de 3627 milliards de dollars, l'URSS, en 2e position, est talonnée par le Japon : respectivement 1400 et 1307 milliards de dollars.
Cependant, l'estimation du PNB russe, pour être un élément de comparaison valable, doit être relativisée par:
— le fait que le rouble qui sert de base aux calculs en URSS est profondément surévalué par rapport à la monnaie internationale de référence qui est le dollar ;
— une grande part (de 10 à 20 %) de la production manufacturière russe est déficiente et invendable (même sur le marché interne), mais est tout de même comptabilisée, et l'ensemble de la production est de qualité médiocre.
En tenant compte de ces éléments, il est probable que la valeur réelle de la production globale du Japon a dépassé celle de l'URSS et de toute façon, même sur le plan des chiffres officiels, le Japon, sur le strict plan de la production manufacturière, précède l'URSS pour laquelle celle-ci ne représente que 25 % du PNB.
Ce rattrapage de l'URSS par le Japon montre à l'évidence que l'URSS, malgré les taux de croissance records annoncés depuis des années, a vu sa situation se dégrader sur la scène économique mondiale.
Un bon indice du degré de développement est le PNB par habitant. Avec 5500 dollars en 1984, le PNB de l'URSS par habitant se situait à la 49e place mondiale, après Hong-Kong et Singapour. L'URSS présente de graves caractéristiques de sous-développement. Cela est particulièrement net si on considère simplement la situation du commerce extérieur, même si celui-ci ne représente que 6 % du PNB (contre 18 % pour la France par exemple).
Les échanges de l'URSS avec l'OCDE sont caractéristiques de ceux d'un pays sous-développé. L'URSS est essentiellement un exportateur de matières premières : 80 % du total de ses exportations vers l'OCDE en 1985.
Le capital russe est incapable de maintenir sa compétitivité. Ainsi, si les exportations de produits « dérivés de la technologie » représentaient 27 % des exportations russes vers l'OCDE en 1973, ils n'en représentaient plus que 9 % en 1982. C'est de moins en moins sa puissance industrielle et de plus en plus la richesse de son sous-sol qui permet à l'URSS de maintenir une balance commerciale positive et d'acheter à l'occident la technologie qui lui fait défaut. Mais cette situation rend l'URSS particulièrement sensible aux fluctuations du marché mondial.
Sur le plan de ses échanges avec l'occident, l'année 1986 a été une année noire pour l'URSS. La chute des cours des matières premières, et notamment du pétrole, est venue porter un coup très rude aux exportations soviétiques : au cours du 1er semestre 1986, les exportations ont baissé en valeur de 21 %, tandis que pour maintenir le solde de sa balance commerciale, l'URSS a dû réduire ses importations de 17,5 %, et procéder à d'importantes ventes d'or, écornant ainsi ses réserves.
L'URSS, comme tout pays capitaliste, subit de plein fouet la crise de l'économie mondiale. Depuis le début des années 1970, la croissance n'a cessé de chuter. Elle est ainsi passée d'un taux moyen annuel de 5,1 % en 1971-75, à 3,7 % en 1976-80, pour finir à 3,1 % en 1985. Sur 1981-85, ce taux de 3,2 % a été le plus bas de l'après-guerre (ces taux officiels sont surévalués, mais ils donnent une idée de l'évolution générale vers la récession).
Comme on vient de le voir, nous sommes bien loin des rodomontades d'un Khrouchtchev qui prétendait il y a 25 ans rattraper les USA sur le plan économique. Pourtant aujourd'hui, Gorbatchev nous ressort le même type de balivernes. Mais derrière le sourire de l'homme médiatique, s'impose la même poigne de fer qui, dans la logique de la gestion capitaliste, impose au prolétariat toujours plus d'austérité. Le discours et la pratique des dirigeants russes n'a pas changé. Devant la dégradation de son appareil économique, devant la pénurie de capital typique du sous-développement, le « capital humain » comme disait Staline, doit remplacer les machines que l'URSS n'a pas la technique pour construire, ni l'argent pour acheter à l'occident. Alors que le prolétariat russe subit déjà des conditions de misère terribles, derrière tous les beaux discours actuels, c'est encore plus de peine, plus de sueur, plus de sang, plus de larmes qui lui sont imposés.
Une attaque redoublée contre le niveau de vie de la classe ouvrière
La lutte sur le front de la productivité, inclut les méthodes policières mises en place durant l'intermède Andropov, et derrière les campagnes contre l'alcoolisme, ces mesures sont même intensifiées par les nouveaux dirigeants : surveillance renforcée dans les usines, interdiction d'aller faire les courses durant les heures de travail (ce qui était une coutume étant donné les longues heures d'attente pour avoir une chance de disposer des rares produits disponibles dans les magasins d'Etat), vérifications dans la rue et dans les usines de la présence sur les lieux de travail, sanctions accrues contre les récalcitrants à la discipline du travail, etc.
Le but de l'équipe Gorbatchev est d'accroître la production et la compétitivité en renforçant la compétition économique entre les ouvriers. La part des primes de toutes sortes dans les salaires est accrue par les nouvelles réformes : les nouveaux critères de qualité, s'ils peuvent signifier un accroissement du salaire dans les usines les plus modernes, là où ils sont possibles à réaliser (ainsi par exemple une usine-pilote de turbines en Sibérie a fait grimper le salaire mensuel de 320 à 450 roubles) ; par contre, là où l'appareil productif est délabré (ce qui constitue l'essentiel des cas), l'impossibilité de répondre à ces critères va signifier une chute brutale des primes, et donc des salaires. De plus, comme ces primes sont attribuées collectivement, il est nécessaire que l'ensemble des ouvriers participe de l'effort de production. Cela signifie une pression renforcée sur l'ensemble des travailleurs, et vise à renforcer aussi les divisions et oppositions entre ouvriers. Ces nouvelles mesures vont accroître les disparités des salaires et accentuer le fonctionnement à deux vitesses de l'économie russe : d'un côté les secteurs pilotes nécessaires au développement technologique de l'industrie d'armement où les salaires sont plus élevés, de l'autre côté le reste de l'économie où les salaires vont diminuer.
De plus, dans la mesure où les primes, qui représentent 40 % du salaire, sont indexées aux résultats obtenus vis-à-vis des objectifs du plan, la perspective très ambitieuse d'une croissance de 4 % imposée par Gorbatchev, signifie en fait, devant le peu de chances de la réaliser, une baisse des salaires.
Si l'inflation ' n'a jamais officiellement existé en URSS, pour autant c'est un secret de polichinelle que celle-ci a fait comme à l'ouest ses ravages durant les années 1970. Cela s'est notamment manifesté sur le marché kolkhozien et sur le marché noir omniprésents face à la pénurie de produits dans les magasins d'Etat. Cependant, si l'inflation a marqué le pas ces dernières années, les nouvelles mesures prises signifient à terme une relance de celle-ci :
— dans les magasins d'Etat les prix vont tendre à s'aligner sur ceux des marchés parallèles au travers de la diminution des subventions de l'Etat aux produits de base, l'approvisionnement va être « facilité » pour des produits soi-disant de meilleure qualité, mais surtout d'un prix beaucoup plus élevé ;
— la plus grande liberté pour les paysans de cultiver et de vendre leurs propres produits va permettre d'alimenter le marché kolkhozien, mais à des prix prohibitifs (ainsi cet été, un kilo de tomates valait une journée de salaire ouvrier) ;
—-la tendance actuelle à la légalisation de l'économie souterraine, reconnaissance du travail artisanal, mise en place de nouvelles structures semi-privées de production et de distribution, va tendre à aligner les prix officiels sur ceux du marché noir.
Ces mesures sont une attaque directe contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Quelles perspectives ?
Il est tout à fait significatif qu'au même moment où Gorbatchev lance ses appels à la lutte pour la production, pour la compétitivité, ce sont les mêmes discours qui sont prononcés à l'ouest, où Reagan lance une « bataille pour la compétitivité », qu'au même moment où la direction soviétique met en place un vaste plan de réformes économiques, la « refonte », pour donner plus d'autonomie concurrentielle aux entreprises d'Etat ; à l'ouest, la mode est au « libéralisme », à la « privatisation », pour éliminer les « canards boiteux » de la production. La crise est mondiale, et dans la situation de concurrence exacerbée qui en découle, la lutte pour une plus grande compétitivité passe par la mise en place de programmes d'austérité renforcés. Là est le véritable sens de tous les beaux discours qui sont assénés au prolétariat à l'est comme à l'ouest.
Les discours productivistes, pacifistes et démocratiques, de Gorbatchev ne sont que du bluff :
— les mirifiques taux de croissance annoncés pour le futur plan quinquennal de la fin des années 1980 ne seront jamais atteints. L'économie mondiale est en train, lentement mais sûrement, de s'enfoncer dans la récession, et l'URSS, puissance économique secondaire, à l'appareil productif périmé, est bien incapable, même en soumettant l'ensemble de son bloc à un pillage en règle, de redresser la situation. L'URSS, à l'instar des autres pays, s'enfonce inexorablement dans la crise, et ceci, vu la faiblesse économique de ce pays, va prendre des formes brutales :
— Dans ces conditions, étant donné l'incapacité de l'URSS d'asseoir sa puissance sur le plan économique, plus que jamais c'est dans la fuite en avant dans l'économie de guerre, dans le sacrifice de l'économie sur l'autel de la production d'armements, que l'URSS peut parvenir à maintenir sa place de puissance impérialiste dominante. Tous les beaux discours de Gorbatchev sur le désarmement ne sont qu'un leurre, lié à la réorientation de sa stratégie imposée par sa difficulté à faire face à 1 offensive impérialiste du bloc de l'ouest de ces dernières années, et qui vise a resserrer son dispositif militaire sur les frontières de son bloc et à entreprendre un vaste plan de modernisation de son armement technologiquement en retard.
— Après la défaite du prolétariat en Pologne en 1981, et le reflux des luttes qui s'en est suivi, de nouveaux échos de la lutte de classe nous parviennent d'Europe de l'est, qui témoignent que le potentiel de combativité de la classe ouvrière est toujours là, et que face à l'attaque en règle contre ses conditions de vie, celle-ci réagit. Dans le bloc de l'est aussi la perspective est au développement de la lutte de classe.
En URSS, les émeutes de Kazakhstan témoignent d'un mécontentement croissant. Mais plus significatives encore ont été les émeutes, réprimées elles aussi dans le sang, des travailleurs originaires des Etats baltes, réquisitionnés pour circonscrire la catastrophe de Tchernobyl, et les échos de grèves qui ont eu lieu dans la gigantesque usine Kamaz où l'on fabrique des camions (ville de Breschnev, République Tatare) contre les « contrôles de qualité » imposés par Gorbatchev.
Les beaux discours démocratiques de Gorbatchev ont d'abord pour but de faire accepter par une classe ouvrière récalcitrante une austérité accrue, et d'adapter l'appareil d'Etat russe pour faire face à la lutte ouvrière. L'utilisation des mystifications démocratiques par Gorbatchev n'a pas un sens différend de l'utilisation de la « démocratisation » des régimes gouvernementaux en Argentine ou au Brésil : désarmer et encadrer la classe ouvrière pour mieux l'affronter. Le pire danger pour le prolétariat serait de prendre ces belles paroles pour argent comptant. L'expérience kroutchevienne, qui elle aussi, derrière la campagne de « déstalinisation », avait été marquée par une attaque massive contre les conditions de vie des ouvriers, et avait vu en 1961-62-63 se développer une importante vague de lutte de classe, vague qui avait notamment culminé dans la grève des mineurs du Donbass que les troupes du KGB avaient réprimée violemment, n'est pas si éloignée, comme celle plus récente de la Pologne, pour montrer aux ouvriers russes le mensonge des discours démocratiques.
Avec le développement de la crise, Gorbatchev, bien moins encore que Kroutchev il y a 30 ans, n'a les moyens de sa politique.
J.J. 27/2/87
Géographique:
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (2)
- 3547 reads
COMPRENDRE LES CONSÉQUENCES POLITIQUES DE LA DÉCADENCE DU CAPITALISME
-
Le syndicalisme, le parlementarisme, les partis de masse, la lutte pour des réformes sociales, l'appui aux luttes pour la formation de nouveaux Etats... ce ne sont plus là des formes de lutte valables pour la classe ouvrière. La réalité de la crise ouverte qui secoue le capitalisme, l'expérience des luttes sociales que cette crise a engendrées, rendent cela de plus en plus clair pour des centaines de millions de travailleurs dans le monde entier.
-
Mais pourquoi ces formes de lutte qui ont été si importantes au siècle dernier pour le mouvement ouvrier ont-elles pu être transformées en ce qu'elles sont aujourd'hui ?
-
Il ne suffit pas d'être contre. Pour avoir une intervention solide dans la lutte de classe, capable de combattre le déboussolement que distille l'idéologie bourgeoise, encore faut-il savoir pourquoi on est contre.
Aujourd'hui, soit par ignorance, soit par facilité, certains groupes qui sont parvenus à la conclusion de la nature bourgeoise du syndicalisme, parlementarisme, etc., tentent de répondre à ces questions en ayant recours à des conceptions anarchistes ou utopistes, formulées en langage marxiste pour faire « plus sérieux ». Parmi eux, le Groupe Communiste Internationaliste (GCI)[1] [1090].
Pour le GCI, le capitalisme n'a pas changé depuis ses origines. Les formes de lutte du prolétariat non plus. Quant au programme formulé par les organisations révolutionnaires, pourquoi aurait-il changé ? C'est la théorie de l'Invariance.
Pour ces chantres de la « révolte éternelle », la lutte de type syndical, parlementaire, la lutte pour des réformes ont toujours été, depuis leur apparition, ce qu'elles sont aujourd'hui, des moyens d'intégrer le prolétariat dans le capitalisme.
L'analyse de l'existence de deux phases dans l'histoire du capitalisme auxquelles correspondent des formes de lutte différentes ne serait qu'une invention des années 30 pour mieux « trahir le programme historique », programme qui lui se résumerait à une vérité quasi-éternelle : « révolution violente et mondiale ».
Voici comment ils formulent tout cela :
-
« Cette théorisation de l'ouverture d'une nouvelle phase capitaliste : celle de son déclin, permit ainsi à posteriori de maintenir une cohérence formelle entre les "acquis du mouvement ouvrier du siècle précédent" (il s'agit bien entendu ici des "acquis" bourgeois de la social-démocratie : le syndicalisme, le parlementarisme, le nationalisme, le pacifisme, la "lutte pour des réformes", la lutte pour la conquête de l'Etat, le rejet de l'action révolutionnaire...) et, du fait du "changement de période" (argumentation classique pour justifier toutes les révisions-trahisons du programme historique), l'apparition de "nouvelles tactiques" propres à cette "nouvelle phase"; cela allant de la défense de la "patrie socialiste" pour les staliniens au "programme de transition" de Trotsky, au rejet de la forme syndicale au profit de celle des conseils "ultra-gauches" » (cf. Pannekoek : Les Conseils Ouvriers). Tous entérinent ainsi, de façon a-critique l'histoire passée et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait "dans la phase ascendante du capitalisme...".
-
(...) « Et, les communistes d'être encore une fois des “iguanodons[2] [1091] de l'histoire”, ceux pour qui rien n'a fondamentalement changé, ceux pour qui les “vieilles méthodes” de lutte directe, classe contre classe, la révolution violente et mondiale, l'internationalisme, la dictature du prolétariat... restent toujours -hier, aujourd'hui, demain- valables ». “Le Communiste” n° 23, p. 17-18.
Le GCI précise :
-
« L'origine même des théories décadentistes (théories du "changement de période" et de "l'ouverture d'une nouvelle phase capitaliste" : celle de son "déclin"...) se retrouve bizarrement" dans les années 30, théorisées tant par les staliniens (Varga) que par les trotskystes (Trotsky lui-même) que par certains sociaux démocrates (Hilferding, Sternberg...) et universitaires (Grossmann). C'est donc à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 que certains produits de la victoire de la contre-révolution commencèrent à théoriser une longue période de "stagnation" et de "déclin" ».
Difficile de dire autant d'absurdités en si peu de lignes. Laissons de côté les amalgames auxquels recourt fréquemment le GCI, qui n'apportent rien au débat sinon de démontrer la superficialité de son propre raisonnement. Mettre dans un même sac la gauche communiste internationaliste (Pannekoek) et le stalinisme (Varga) parce qu'ils ont parlé de décadence du capitalisme est aussi stupide que d'identifier révolution et contre-révolution parce que les deux traitent de lutte des classes.
LES ORIGINES DE LA THÉORIE DE LA DÉCADENCE
Commençons par ce qui est un vulgaire mensonge, ou dans le meilleur des cas, l'expression de la plus crasse ignorance de l'histoire du mouvement ouvrier : d'après le GCI, c'est dans les années 30, “a postériori”, qu'aurait été “bizarrement” inventée l'analyse de la décadence du capitalisme. Quiconque connaît un tant soit peu de l'histoire du mouvement ouvrier, et en particulier du combat contre le réformisme que mena la gauche révolutionnaire au sein de la social-démocratie et de la seconde Internationale, sait qu'il n'en est rien.
Dans l'article “Comprendre la décadence du capitalisme” nous avons longuement montré comment l'idée de l'existence de deux phases, l'une “ascendante” où les rapports capitalistes stimulent le développement économique et global de la société, l'autre “décadente” où ces rapports se transforment en « entrave » à ce développement, ouvrant une “ère de révolution”, nous avons indiqué comment cette vision est au coeur de la conception matérialiste de l'histoire, telle qu'elle fut définie par Marx et Engels, dès le Manifeste Communiste de 1847. Nous avons montré le combat que durent mener les fondateurs du socialisme scientifique contre tous les courants utopistes, anarchistes qui ignoraient volontairement une telle distinction de phases historiques et ne voyaient dans la révolution communiste qu'un idéal éternel à réaliser à tout moment et non un bouleversement que seul pouvait rendre possible et historiquement nécessaire l'évolution même des forces productives et leur contradiction avec les rapports sociaux de production capitalistes.
Mais Marx et Engels durent surtout combattre ceux qui ne voyaient pas que le capitalisme était encore dans sa phase ascendante. Dès la fin du siècle, la gauche de la seconde Internationale -en particulier à travers Rosa Luxembourg- dut combattre la tendance inverse, celle des réformistes qui consistait à nier que le capitalisme approchait sa phase de décadence. C'est ainsi qu'en 1898, Rosa Luxembourg écrivait dans Réforme ou Révolution :
-
« Une fois que 1e développement de l'industrie aura atteint son apogée et que sur le marché mondial, commencera pour le capital la phase descendante, la lutte syndicale deviendra doublement difficile : premièrement parce que les conjonctures objectives du marché s'aggraveront pour la force du travail, la demande de force de travail augmentant plus lentement et l'offre plus rapidement que ce n'est maintenant le cas ; deuxièmement, parce que le capital lui-même, pour se, dédommager des pertes subies sur le marché mondial, s'efforcera d'autant plus énergiquement de réduire la part du produit revenant aux ouvriers (...). L'Angleterre nous offre déjà le tableau du début du deuxième stade du mouvement syndical. Ce dernier se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des conquêtes déjà réalisées, et même celle-ci devient de plus en plus difficile » (souligné par nous), Réforme ou Révolution (1ère partie, point 3).
Ce n'est pas “a posteriori” -comme le prétend le GCI-, ce n'est pas après que la première boucherie impérialiste mondiale eut apporté la preuve irréfutable que le capitalisme était définitivement entré dans sa phase décadente, que ces lignes furent écrites. C'est quinze ans auparavant. Et Rosa Luxembourg commence à voir nettement les conséquences politiques -ici au niveau de la possibilité du syndicalisme- qu'entraîne pour le mouvement ouvrier un tel changement de “phase”.
Le GCI affirme que c'est « à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 que certains produits de la victoire de la contre-révolution commencent à théoriser une longue période de stagnation et de déclin ».
Le GCI ignore-t-il que, au cœur même de cette vague révolutionnaire, se fonde la troisième Internationale sur la base de l'analyse de l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase :
« Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat » (Plate-forme de l'Internationale Communiste). Et c'est au sein de cette Internationale que la gauche communiste mènera à son tour le combat contre les tendances majoritaires qui ne voient pas toutes les conséquences politiques pour les formes de lutte du prolétariat de cette nouvelle période historique.
Voici, par exemple, comment s'exprimait le KAPD, la gauche communiste allemande en 1921, au troisième congrès de l'IC :
-
« Pousser le prolétariat à prendre part aux élections dans la période de décadence du capitalisme revient à nourrir en son sein l'illusion que la crise peut être surmontée par des moyens parlementaires ».
Enfin dans les années 30, ce ne sont pas seulement les « produits de la victoire de la contre-révolution » mais les avant-gardes prolétariennes qui s'efforcent de tirer les enseignements de la vague révolutionnaire passée et qui « théorisent une longue période de stagnation et de déclin ». Ainsi la revue Bilan, qui regroupait des éléments de la gauche communiste d'Italie, Belgique et France, écrivait:
-
« La société capitaliste, vu le caractère aigu des contradictions inhérentes à son mode de production, ne peut plus remplir sa mission historique : développer les forces productives et la productivité du travail humain de façon continue et progressive. Le choc entre les forces productives et leur appropriation privée, autrefois sporadique, est devenu permanent, le capitalisme est entré dans sa crise générale de décomposition » (Mitchell, Bilan n° 11, septembre 1934)[3] [1092].
Le GCI ignore ou falsifie l'histoire du mouvement révolutionnaire. Dans les deux cas ses affirmations sur « l'origine même des théories décadentistes » suffisent à démontrer la vacuité de son argumentation et le peu de sérieux de sa démarche.
L'INVARIANCE DU PROGRAMME OU LE “MARXISME DES DINOSAURES”
Venons en à l'argument du GCI selon lequel parler de changement pour les moyens de lutte du prolétariat serait « trahir le programme historique ».
Le programme d'un mouvement politique est constitué par la définition de l'ensemble des moyens et des buts que se propose ce mouvement. Le programme communiste contient en ce sens des éléments qui sont effectivement permanents depuis le Manifeste Communiste dont la rédaction correspond aux révolutions de 1848 qui virent la première apparition sur la scène de l'histoire du prolétariat comme force politique distincte. Il en est ainsi par exemple de la définition du but général : la révolution communiste mondiale ; ou du moyen fondamental pour atteindre ce but: la lutte de classe et la dictature du prolétariat.
Mais le programme communiste n'est pas que cela. Il contient aussi les buts immédiats et les moyens concrets, les formes d'organisation, les formes de la lutte nécessaires pour atteindre le but final.
Ces éléments concrets sont directement déterminés par la situation historique concrète dans laquelle se déroule la lutte du prolétariat.
-
« Si notre programme formule une bonne fois l'évolution historique de 1a société du capitalisme en socialisme, il doit manifestement aussi formuler, dans leurs traits fondamentaux, toutes les phases transitoires de ce développement, et par conséquent, pouvoir indiquer, à chaque moment, au prolétariat, le comportement correspondant, dans le sens du rapprochement vers le socialisme » dit Rosa Luxemburg dans Réforme ou révolution (2e partie, point sur la conquête du pouvoir politique).
Pour le GCI, le programme communiste ignore tout cela, et se cantonne à un seul cri de guerre : « I1 faut faire la révolution mondiale toujours et partout ». Réduit à cela, le programme pourrait être considéré invariant, mais il ne serait plus alors un programme, mais une déclaration d'intentions.
Quant à son application pratique, si ce « programme » pouvait en avoir une, elle se résumerait à envoyer des prolétaires à l'affrontement final quelles que soient les conditions historiques, les rapports de force. Autant dire c'est la voie au massacre.
Marx avait déjà combattu ce genre de tendances au sein de la Ligue des Communistes :
-
« Tandis que nous disons aux ouvriers : vous avez à traverser quinze, vingt, cinquante ans de guerres civiles et de guerres internationales, non seulement pour transformer les conditions, mais pour vous transformer vous-mêmes, et pour vous rendre aptes au pouvoir politique, vous leur dites au contraire : il faut que nous parvenions tout de suite au pouvoir, ou bien nous pouvons aller nous coucher. » (Marx, contre la tendance de Willich et Schapper au sein de la Ligue des Communistes, procès-verbal de la séance du comité central de septembre 1850, cité par B.Nicolaïevski in « La vie de Karl Marx », chap. XV.).
Un programme qui ne s'attache pas à définir les spécificités de chaque situation historique et des comportements prolétariens qui correspondent, un tel programme ne sert à rien.
Par ailleurs, le Programme communiste trouve une source permanente d'enrichissement dans la pratique de la classe. Des questions aussi cruciales que 1 impossibilité pour le prolétariat de conquérir 1’appareil d'Etat bourgeois à son profit ou les formes de lutte et d'organisation du prolétariat pour la révolution ont entraîné des modifications dans le programme communiste à la suite d'expériences comme celles de la Commune de Paris de 1871 et de la révolution russe de 1905.
Refuser de modifier le programme, de l'enrichir en permanence, en fonction de l'évolution des conditions objectives et de l'expérience pratique de la classe, ce n'est pas « rester fidèle » au programme, mais le détruire en le transformant en des tables de la loi. Les communistes ne sont pas des dinosaures et leur programme n'est pas un fossile.
Savoir modifier, enrichir le programme communiste comme ont toujours su le faire les révolutionnaires les plus conséquents pour qu'il soit capable de répondre à chaque situation historique générale, pour qu'il intègre les résultats de la praxis révolutionnaire, ce n'est pas « trahir le programme », mais c'est la seule attitude conséquente qui fasse de celui ci un véritable outil pour la classe[4] [1093].
LE POINT DE VUE IDÉALISTE DE L'ANARCHISME ET LA MÉTHODE MARXISTE
Pour le GCI, le pire crime des “décadentistes” consiste à « théoriser une cohérence formelle avec 'les acquis du mouvement ouvrier du siècle précédent'». Et le GCI de préciser: « Il s'agit bien entendu ici des 'acquis' bourgeois de la social-démocratie ». Le danger fondamental de la théorie de la décadence serait « d'entériner de façon a-critique l'histoire passée et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait 'dans la phase ascendante du capitalisme'».
Pour le GCI, « La fonction historique de 1a Socialdémocratie a été directement, non pas d'organiser la lutte pour la destruction du système (ce qui est le point de vue invariant des communistes), mais d'organiser les masses d'ouvriers atomisés par la contre-révolution afin de les éduquer pour les faire participer au mieux au système d'esclavage salarié ». (Le Communiste n° 23, p. 18).
Nous reviendrons dans un prochain article de façon spécifique sur la nature de classe de la Socialdémocratie-2e Internationale de la période de l'entredeux siècles. Mais pour pouvoir en parler, il faut auparavant répondre au simplisme absurde du GCI selon lequel « rien n'a fondamentalement changé » pour la lutte ouvrière depuis ses origines.
Le GCI reproche à la Social-démocratie en effet de ne pas avoir organisé la lutte « pour la destruction du système (ce qui est le programme invariant des communistes) », mais le combat syndical, parlementaire, pour des réformes qui n'a jamais pu être autre chose qu'un moyen pour faire participer les prolétaires au système.
Mais rejeter le syndicalisme ou le parlementarisme uniquement parce qu'il s'agit là de formes de lutte qui ne se traduisent pas immédiatement par la « destruction du système », c'est les rejeter pour des raisons purement idéalistes, fondées sur le vent des idéaux éternels et non sur la réalité concrète des conditions objectives de la lutte de classe. Cela revient à ne voir la classe ouvrière que comme classe révolutionnaire, oubliant qu'au contraire de toutes les classes révolutionnaires du passé, elle est aussi une classe exploitée.
La lutte revendicative et la lutte révolutionnaire sont deux moments d'un même combat de la classe ouvrière contre le capital ; la lutte pour la destruction du capitalisme n'est autre que la lutte revendicative contre les attaques du capital portée à ses dernières conséquences. Ces deux moments de lutte n'en sont pas pour autant identiques. Et l'on a une vision totalement creuse de la lutte prolétarienne si l'on en ignore ce double caractère.
Ceux qui -tels les réformistes- ne voient dans la classe ouvrière que son caractère de classe exploitée et sa lutte comme seulement revendicative, ont une vision statique, a-historique bornée. Mais ceux qui ne voient la classe ouvrière que comme classe révolutionnaire ignorant sa nature d'exploitée et partant la nature revendicative de toute lutte ouvrière, parlent d'un fantôme.
Lorsque les révolutionnaires marxistes ont rejeté la forme de lutte syndicale ou parlementaire par le passé, ce ne fut jamais au nom du radicalisme creux et a-classiste propre aux anarchistes, et qui faisait écrire à Bakounine en 1869 dans le “Catéchisme révolutionnaire” que l'organisation doit consacrer « toutes ses forces et tous ses moyens à aggraver et à étendre les souffrances et les misères qui doivent finalement pousser le peuple à un soulèvement général ».
L'anarchisme se situe du point de vue d'un idéal de « révolte » abstrait. Pour les luttes revendicatives de la classe ouvrière, il n'éprouve qu'un « mépris transcendantal » comme le dénonce Marx à propos de Proudhon dans Misère de 1a philosophie. Le marxisme se situe du point de vue d'une classe et de ses intérêts, aussi bien historiques qu'immédiats. Lorsque les révolutionnaires marxistes parviennent à la conclusion que le syndicalisme, le parlementarisme, les luttes pour des réformes ne sont plus valables, ce n'est pas parce qu'ils abandonnent la lutte revendicative, mais parce qu'ils savent que celle-ci ne peut plus aboutir, ne peut plus être efficace en se servant des anciennes formes.
Telle est la démarche générale de Rosa Luxemburg lorsqu'elle envisage qu'avec l'entrée du capital dans “la phase descendante”, la lutte syndicale deviendra “doublement difficile”, lorsqu'elle constate à la fin du 19e siècle, que le mouvement syndical, dans le pays le plus avancé de l'époque, l'Angleterre, « se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des conquêtes déjà réalisées, et même celle-ci devient de plus en plus difficile ».
Telle est la démarche du KAPD quand il rejette la participation aux élections non pas parce que « le vote c'est sale », mais parce que les moyens parlementaires ne servent plus pour faire face aux effets de la crise du capitalisme, c'est-à-dire pour faire face à la misère pour le prolétariat.
Tant que le développement du capitalisme a pu s'accompagner de façon durable d'une véritable amélioration des conditions d'existence de la classe ouvrière, tant que l'Etat n'était pas devenu une puissance totalitaire sur la vie sociale, la lutte revendicative devait et pouvait prendre les formes syndicales, parlementaires. Les conditions objectives où le capitalisme connaît son apogée historique créent une sorte de terrain économique et politique où les intérêts immédiats de la classe ouvrière peuvent coïncider avec les nécessités du développement d'un capital en pleine expansion mondiale, et y trouver un réel profit.
C'est l'illusion de croire qu'une telle situation pourrait se poursuivre indéfiniment qui fut la base du développement du réformisme -cette idéologie bourgeoise selon laquelle la révolution communiste est impossible et seul peut être réalisée une réforme progressiste du capitalisme au profit de la classe ouvrière- au sein du mouvement ouvrier.
Pour les marxistes, le rejet de la lutte pour des réformes dans le capitalisme a toujours reposé -en dernière instance- sur l'impossibilité de celles-ci. Rosa Luxembourg formulait cela dès 1898 en ces termes :
-
« La protection ouvrière, par exemple, est autant dans l'intérêt immédiat des capitalistes en tant que classe, que de la société en général. Mais cette harmonie ne dure que jusqu'à un certain moment du développement capitaliste. Quand ce développement a atteint un certain niveau, les intérêts de la bourgeoisie en tant que classe, et ceux du progrès économique, même dans le sens capitaliste, commencent à se séparer » (Réforme ou Révolution, 1re partie, point 4).
Ce qui change pour la lutte ouvrière au niveau des conditions objectives avec l'entrée du capitalisme dans sa phase décadente c'est l'impossibilité d'obtenir de véritables améliorations durables. Mais cela ne se produit pas isolément. La décadence du capitalisme est aussi synonyme de capitalisme d'Etat, d'hypertrophie de l'appareil d'Etat, et cela bouleverse entièrement les conditions d'existence du prolétariat.
Nous ne pouvons ici développer tous les aspects du bouleversement qu'implique pour la vie sociale en général, et pour la lutte de classe en particulier, l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase historique. Nous renvoyons le lecteur à l'article « La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent » (Revue Internationale, n° 23).
Ce qui nous importe de souligner ici, c'est le fait que pour les marxistes, les formes de lutte du prolétariat dépendent des conditions objectives dans lesquelles celle-ci se déroule et non sur des principes abstraits de révolte éternelle.
C'est seulement en se fondant sur l'analyse objective du rapport de forces entre les classes envisagé dans sa dynamique historique que l'on peut fonder la validité ou non d'une stratégie, d'une forme de combat. En dehors de cette base matérialiste, toute prise de position sur les moyens de la lutte prolétarienne repose sur du sable mouvant ; c'est la porte ouverte au déboussolement dès que les formes superficielles de la « révolte éternelle » -la violence, l'anti-légalité- font leur apparition.
Le GCI en est une manifestation criante. Quand on ne comprend pas pourquoi certaines formes de lutte étaient valables dans le capitalisme ascendant, on ne peut pas comprendre pourquoi elles ne le sont plus dans le capitalisme décadent. A force de ne baser ses critères politiques que sur des “anti-tout-ce-qui ressemble-à-la-social-démocratie”, à force de croire que “l'anti-démocratie” peut être un critère en soi, suffisant, le GCI se retrouve à affirmer en novembre 1986 qu'une organisation comme celle des guérilleros nationaliste staliniens du Pérou, “Sentier Lumineux”, parce qu'elle est armée et a refusé de participer à des élections « apparaît de plus en plus » comme l'unique structure capable de donner une cohérence au nombre toujours croissant d'actions directes du prolétariat, « dans les villes et les campagnes, alors que tous les autres groupes de gauche s'unissent objectivement contre tous les intérêts ouvriers au nom de la condamnation du terrorisme en général et de la défense de la démocratie » (souligné par nous, Le Communiste n° 25, p. 48-49).
Le GCI constate que « tous les documents que 'SL' a rédigés sont basés sur le plus strict stalinomaoïsme », et que celui-ci considère qu'au Pérou la lutte est « dans l'époque actuelle anti-impérialiste et anti-féodale ». Mais cela n'empêche pas le GCI de conclure : « Nous n'avons pas d'éléments pour considérer 'SL' (ou le PCP comme il s'auto-définit) comme une organisation bourgeoise au service de la contre-révolution » (idem).
Ce qui manque au GCI pour apprécier la nature de classe d'une organisation politique, ou toute autre réalité de la lutte de classe, ce ne sont pas des “éléments d'information”, mais la méthode marxiste, la conception matérialiste de l'histoire -dont la notion de phases historiques d'un système (ascendante et décadente) est un élément indispensable.
RV.
[1] [1094] Cet article fait suite à celui paru dans le numéro précédent de la Revue Internationale: « Comprendre la décadence du capitalisme ».
[2] [1095] Iguanodon : “reptile dinosaurien fossile, qui vivait à l'époque crétacée”.
[3] [1096] Le GCI reconnaît dans une petite note de l'article cité qu'effectivement Luxemburg, Lénine, Boukharine ont partagé des «théories décadentistes ». Mais il prétend qu'il ne s'agissait pas pour eux de « définir une phase de plus de 70 années ». C’est encore une falsification: pour la gauche de la 2e Internationale, fondatrice de la 3e, le stade dans lequel était entré le capitalisme n'était pas une phase parmi d'autres à laquelle pourraient succéder de nouvelles phases ascendantes. Pour eux tous, la nouvelle période était « une phase ultime », un « stade suprême » du capitalisme, audelà duquel il n'y aurait plus d'autre issue pour la société que la barbarie ou le socialisme.
[4] [1097] Contre toute attitude religieuse à l'égard de ce qui est l'instrument vivant d'une classe vivante, nous nous revendiquons de l'attitude de Marx et Engels déclarant après la Commune de Paris qu'une partie du Manifeste Communiste était devenue périmée ; de celle de Lénine en 1917 dans Les thèses d'avril affirment la nécessité de re-rédiger une partie du programme du Parti.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Correspondance internationale (Argentine) a propos du regroupement des révolutionnaires
- 3027 reads
L'an dernier, deux groupes en Argentine et en Uruguay ont lancé une «Proposition internationale aux partisans de la révolution mondiale » que nous avons publiée dans le n° 46 de cette Revue.
La
question de la nécessité du regroupement des forces révolutionnaires, dans la
perspective du développement de la lutte de classe, est vitale aujourd'hui. Il
est nécessaire que les groupes confrontent et clarifient leurs positions
politiques et leurs orientations respectives dans la période actuelle, pour
pouvoir envisager un rapprochement et des tâches communes, ce que la situation
présente du milieu politique prolétarien ne permet pas encore. C'est dans ce
sens que nous avions répondu à la « Proposition
». Emancipacion Obrera a commencé à publier dans une brochure les réponses
reçues à sa « Proposition » et
répondu en particulier par un texte aux questions soulevées par le CCI. Nous
publions ci-dessous de larges extraits de ce texte, ainsi qu'à nouveau une
réponse de notre part sur les principales questions posées sur les conditions
et critères d'un regroupement des forces révolutionnaires dans la période
historique actuelle.
Emancipacion obrera au CCI
Argentine, le 20 septembre 1987
Compagnes et Compagnons du CCI,
Avant
tout nous voulons vous remercier du geste que vous avez eu en traduisant notre
proposition en anglais et en français ainsi qu'en la publiant dans vos Revue Internationale de France et
d'Angleterre, et d'y avoir dédié un article dans votre publication en Espagne, Action Proletaria. Ce n'est pas
n'importe qui qui ferait cela et nous n'avons pas de doutes sur le fait que
grâce à votre contribution, nos préoccupations ont eu une divulgation bien
plus grande que celle que nous aurions pu avoir par nos seules forces.
Répondre
à quelques questions et clarifier des positions
(...) Quand nous avons élaboré cette proposition nous avons essayé de trouver les points de discrimination (lignes de séparation, NDT) les plus importants, tout en tenant compte du fait que tout le monde n'a pas suivi les mêmes étapes ni donné des définitions dans le même ordre d'idées. Nous voulions en même temps qu'ils soient un obstacle contre les opportunistes, les réformistes, et contre la gauche (du capital) en général tout en fournissant une base minimum permettant d'établir des rapports, et non un obstacle apportant plus de sectarisme ou de confusion, ou encore, des définitions avec lesquelles nous seuls aurions pu être d'accord.
Par exemple, il y a un sujet que nous considérons fondamental et que la plupart des organisations considèrent comme secondaire ou subsidiaire : la condition de la femme, les rapports d'exploitation et d'oppression qui existent dans le travail domestique, la manipulation permanente du corps et de la vie de la femme pour qu'elle garantisse la production et la reproduction de la force de travail en fonction des besoins et des intérêts généraux et particuliers de la classe dominante. Pour nous, l'élimination de l'exploitation dont souffre la classe ouvrière (hommes et femmes) et celle dont souffre la majorité des femmes à travers le système du travail domestique (perturbant aussi les rôles familiaux et sexuels) sont partie intégrante d'une lutte unique pour la révolution sociale. Et dans la Proposition il n'apparaît pratiquement rien là-dessus parce que nous pensions qu'étant donné que cette question a, en général, été traitée très peu et très mal, elle ne pouvait être un point de départ mais le résultat d'un processus. Nous avons adopté le même critère pour d'autres sujets et il ne nous a pas semblé juste d'établir des priorités sans tenir compte du fait que les points discriminants sont un point de départ. Dans ce sens ils doivent être larges et stricts : larges pour que puissent participer des groupes ou des personnes dont les définitions, de par leurs limitations historiques, ne recouvrent pas la vaste gamme des autres groupes, mais s'inscrivent dans la même tendance ; stricts, pour exclure ceux qui expriment une politique antagonique à celle que nous revendiquons, même si leur langage contient des relents marxistes.
Sur la démocratie
C'est ainsi que nous n'avons pas mis tout ce que nous défendons et nous considérons certaines questions comme contenues implicitement dans les points discriminants ; par exemple, la question de la démocratie. Nous n'avons aucune objection à l'expliciter davantage et il va de soi que nous ne sommes pas d'accord pour faire du parlementarisme, pas plus que nous ne considérons qu'à travers la démocratie ou la participation à ses institutions on puisse apporter quelque chose de révolutionnaire.
Et ces conclusions nous ne les tirons pas d'un principe a priori mais en analysant les situations concrètes, étant donné que nous sommes d'accord avec Marx sur le fait que « des événements historiques sensiblement analogues, mais qui se déroulent dans des milieux différents, conduisent à des résultats totalement différents » ([1] [1098]).
Nous n'aboutissons pas à cette conclusion sur la base de la catégorie « capitalisme décadent » car cela pourrait donner lieu à deux types d'erreurs : justifier pour la fin du siècle dernier ou les débuts de celui-ci la participation aux élections pour des postes exécutifs — c'est-à-dire, appuyer le crétinisme parlementaire que Lénine a critiqué si justement — ou définir la tactique sur la base de principes idéaux valables en tout temps et en tout lieu, méconnaissant le fait que la vérité est concrète, et la tactique doit partir des situations réelles, non pour les justifier ou les affirmer, mais pour les modifier.
Il ne nous semble pas que le refus de participer à une campagne électorale soit un critère discriminant ([2] [1099]), même si nous ne l'avons jamais fait et n'avons pas l'intention de le faire vu que nous considérons que, dans l'état actuel des choses, c'est complètement réactionnaire et cela ne sert à rien de révolutionnaire. Nous insistons : nous sommes d'accord sur le fait qu'à travers la démocratie ou la participation à ses institutions on ne fait que renforcer les options bourgeoises et nous n'avons pas d'objection à rendre cette idée plus explicite.
Il y a cependant d'autres points sur lesquels il peut y avoir des différences de deux types : l'une, disons « tactique » et l'autre « stratégique ». Voyons la première.
Pourquoi nous nous referons peu au passe ,
Nous ne pensons pas que pour pouvoir participer à la Proposition chaque groupe doive avoir analysé et défini des prises de position sur toute l'histoire du mouvement ouvrier et les différentes organisations et partis qui ont existé. Non pas que nous considérions que ce n'est pas important, mais parce que nous savons que tous les groupes ou personnes n'ont pas ou n'auront pas une longue histoire antérieure ou des possibilités de produire tant de définitions — justes — par eux-mêmes et dans un laps de temps limité.
Prenons un exemple : vous nous demandez, entre autres, une reconnaissance et une revendication des Gauches communistes issues de la Troisième Internationale. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord les connaître et cela n'est pas possible sans des documents les concernant et la possibilité de les étudier. (...)
Revendiquer la continuité avec la social-democratie ?
Mais nous faisons une autre objection, plus « stratégique » : bien que nous n'ayons pas, en tant qu'organisation, de documents et d'analyses stricts sur le sujet, nous ne nous revendiquons pas, par exemple, d'une continuité du Parti Social-démocrate allemand, ni de l'Internationale à laquelle il appartenait (la soi-disant deuxième). Le fait que des secteurs de la bourgeoisie (ou de la petite-bourgeoisie), à quelque moment de leur histoire, aient été révolutionnaires, n'implique pas que nous nous considérions comme leurs continuateurs, et nous aurions du mal à nous considérer comme des continuateurs d'organisations qui n'ont jamais revendiqué dans la pratique la destruction de l'Etat bourgeois et son remplacement par la dictature socialiste du prolétariat, mais, par contre, ont bien dédié leurs efforts à renforcer et élargir la démocratie bourgeoise. On peut ajouter qu'il y a des camarades d'EO qui disent que Lénine s est trompé quand il a traité Kautsky de renégat et qu'il a parlé de la faillite de la IIe Internationale ; pour eux, Kautsky a toujours été cohérent et celui qui renie, qui rompt (et à la bonne heure !) c'est Lénine. Quelles interventions et orientations révolutionnaires ont été produites par la IIe Internationale ? Quelle activité révolutionnaire prolétarienne concrète a-t-elle impulsé ? Ces camarades de notre organisation n'hésiteraient pas à affirmer qu'ils n'auraient pas appartenu à la IIe Internationale et que la IIe Internationale n'« entrerait » pas dans cette Proposition. (...)
Prenons
un autre exemple : parmi les différents groupes, il y en a qui se réclament de
la IIIe Internationale jusqu'en 1928, d'autres des quatre premiers congrès ;
nous, nous n'allons même pas au-delà du deuxième et sûrement que parmi ceux qui
connaissent les Gauches hollandaise, allemande et italienne, il doit exister
différentes interprétations et évaluations. Faut-il incorporer toutes ces
questions parmi les points de discrimination ? Nous ne le pensons pas, au moins
pas en ce moment, mais nous considérons par contre qu'il est nécessaire de
stimuler organiquement ces études et débats pour apprendre à les connaître et
tirer des conclusions de ces expériences. Le fait de se définir et de
s'homogénéiser autour de ces questions reflétera un moment supérieur au moment
présent et doit avoir comme point de départ la prise effective de positions de
classe aujourd'hui face à des situations qui ne requièrent pas seulement des
caractérisations générales mais des indications et des actions politiques
concrètes. (...)
Guerilla tiers-mondiste et terrorisme petit-bourgeois
Vous vous étonnez également de ne rien trouver sur la question du terrorisme, ni un « rejet catégorique de ce genre d'action »(...) C'est peut-être parce que nous vivons depuis de nombreuses années cette expérience et que nous avons souffert dans notre propre chair ce qu'étaient ces groupes, que nous avons une approche quelque peu différente de cette affaire. Le combat fondamental contre eux ne se mène pas en nous en prenant à la méthode mais à la politique qui guide ce fusil et qui préconise la formation d'armées parallèles, de poser des bombes, de séquestrer des patrons pour obtenir une augmentation de salaire, etc.
Quand nous disons dans notre Proposition, au point 2 « à ceux qui n'appuient aucun secteur bourgeois contre un autre, mais qui luttent contre tous... » ou, au point 4 : « à ceux qui luttent contre les politiques de défense de l’économie nationale, de relance économique...», ou au point 11 : «Dans ce sens, dans l’optique bourgeoise fascisme-antifascisme, à ceux qui dénoncent le caractère de classe bourgeois des fronts antifascistes et de la démocratie... », notre condamnation de ces groupes guérilleristes est implicite, en tant que secteurs de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, qui luttent violemment pour prendre l'Etat bourgeois et se répartir la part de plus-value arrachée à la classe ouvrière. Nous n'entrons même pas dans les considérations de savoir s'ils prétendent atteindre leurs objectifs au moyen des élections ou de l'insurrection, en formant des armées de votants ou des groupes armés, en essayant de conquérir un syndicat ou d'assassiner un de leurs dirigeants.
La lutte pour le communisme est une lutte contre la bourgeoisie dans son ensemble : ce n'est pas juste de choisir un «moindre mal» ou de recommander telle ou telle forme de lutte à l'ennemi de classe. Nous ne rejetons pas l'action de guérilla seulement par « son inefficacité » et sa prétention à « réveiller » — dans le meilleur des cas — ou à se substituer — dans le pire des cas — à la seule violence adéquate, la violence de classe, comme vous semblez le dire dans votre lettre.
Notre combat contre des groupes comme les Montoneros, Tupamaros, ERP, etc. ne découle pas de divergences méthodologiques mais du contenu de classe de la politique qu ils impulsent, qui correspond à celle d'un secteur du capital. Leur pacifisme, bien qu'ils empoignent les armes, s'exprime dans leur politique de collaboration de classes : libération nationale, tiers-mondisme, anti-impérialisme, nationalisations, etc. Centrer la polémique sur une question de méthode empêche de voir clairement le contenu bourgeois et les conséquences politiques, leur caractère contre-révolutionnaire, ce qui n'empêche pas que nous mettions également en question leur messianisme, leur substitutionnisme, leur violence petite-bourgeoise, leurs « méthodes ».
(...) Et dans ce sens nous prenions l'exemple de la torture : pour nous il n'existe pas une torture bourgeoise et une autre révolutionnaire. De même que l'Etat bourgeois ne peut être utilisé à des fins révolutionnaires — et le problème n'est pas « qui le dirige » ; c'est par essence — il y a des questions comme celle-ci qui, par elles-mêmes, renferment un contenu opposé aux rapports sociaux auxquels nous aspirons, raison pour laquelle nous ne la revendiquerons jamais et la condamnerons toujours, quels que soient les justificatifs qu'elle se donne.
Bref, nous ne mentionnons pas les groupes terroristes parce qu'ils sont par eux-mêmes exclus par la majorité des points discriminants, mais nous n'avons pas d'objection à les condamner plus explicitement.
Les conseils ouvriers
C'est vrai qu'il n'y a aucune référence aux conseils ouvriers. Dans ce sens vous avez raison. Nous parlons de la nécessité de détruire l'Etat bourgeois mais nous ne développons pas par quoi on va le « remplacer ». On revendique une dictature du prolétariat générique et rien de plus. Il faudrait élaborer ce point. Dans ce point il faudrait aussi dire clairement que la forme ne garantit pas un contenu et aussi que, sans certaines formes — comme celle dont nous parlons — il ne peut y avoir un réel pouvoir prolétarien avec un contenu révolutionnaire.
Caractérisation de la période actuelle
Nous ne sommes pas si convaincus, par contre, sur la caractérisation que vous faites selon laquelle il y a une génération du prolétariat « qui n'a pas connu de défaite et conserve toute sa potentialité et combativité ». Il est vrai qu'après la grande contre-révolution qui a donné lieu à la 2e guerre mondiale — et la période qui la précédait — avec le massacre de millions de travailleuses et travailleurs, la décennie des années 1960 marque une remontée de la lutte de classes, de la lutte prolétarienne. Dans cette zone du monde nous l'avons bien connue, particulièrement dans les périodes 1967-73, mais cette remontée de la lutte ouvrière, ce ressurgissement de secteurs classistes, révolutionnaires, a été écrasé ou contrôlé, avec plus ou moins de violence, par diverses méthodes. Et ce fut une défaite douloureuse, les minorités les plus radicales et sur des positions de classe ont été démantelées politiquement ou massacrées et la classe ouvrière en général frappée durement. Il reste encore des arrière-goûts de ces coups.
Et nous ne pensons pas que cela ne touche que cette aire en particulier : nous avons fraîche dans notre mémoire la question de la Pologne, la grève des mineurs anglais et d'autres cas. Cest-à-dire, la décennie des années 1960 marque un changement qualitatif: la fin d'une longue période contre-révolutionnaire ; mais de là à affirmer que la génération actuelle ne connaît pas de défaites c est un peu fort : n'a-t-elle pas eu à lutter et été défaite, dans la plupart des cas, ne fût-ce que de manière circonstancielle ? La période 1973-81 est assez noire, au moins dans plusieurs zones de la planète, et nous ne pouvons pas ignorer cela dans nos analyses.([3] [1100])
Nous devons signaler que dans cette décennie des années 1980 on assiste à un ressurgissement de la lutte de classes, quoique avec des hauts et des bas. (…)
Nous ne sommes pas aujourd'hui au plus bas de la force et de la lutte de la classe prolétarienne mais, de par un ensemble de facteurs que nous n'analyserons pas ici, il commence à y avoir des luttes et des mouvements qui secouent la classe et la tirent de son repli et de son retrait... et à nous aussi. Mais l'ennemi, malgré ses problèmes économiques, conserve en grande partie sa force politique et l'initiative, c'est pourquoi il ne sera pas rare de trouver des agents à lui, au sein du mouvement ouvrier, préconisant « la lutte » alors qu'en réalité cette « lutte » est la subordination aux projets de secteurs de la classe dominante. C'est pourquoi, bien que nous comprenions ce que vous avez voulu dire quand vous affirmez « c'est un devoir de se mettre dans le courant» au lieu de nager contre le courant comme dans d'autres périodes, nous préférons dire qu'aujourd'hui plus que jamais il faut nager contre le courant bourgeois et petit-bourgeois, particulièrement celui de gauche qui justifie le réformisme et sa politique de subordination à la bourgeoisie par l'affirmation que « le mouvement est tout », défendant dans les faits la démocratie, les syndicats, les fronts, la nation.
Oui, nous devons rentrer pleinement dans le courant internationaliste prolétarien, en combattant tant ceux qui recherchent une pureté utopique que ceux qui, au nom d'un soi-disant réalisme, laissent pour un futur lointain ou pour une autre étape les principes et les objectifs révolutionnaires internationalistes prolétariens (ou ceux qui s'assoient pour étudier et discuter dans l'attente d'une future — et lointaine — vague révolutionnaire au lieu de participer effectivement à la lutte concrète et de résistance et contre le capital que la classe ouvrière livre de manière intermittente). (...)
Quelques conclusions
(...) Pour nous, votre réponse a été un stimulant, et pas seulement la lettre mais l'attitude que vous avez eue de faire circuler nos idées. Et par rapport à la lettre, nous considérons les critiques très importantes — de même que celles de l'OCI/Italie —, non que nous soyons d'accord avec chacune d'elles mais parce qu'elles démontrent une attitude très revendicable de responsabilité, d'essayer d'être un apport — avec votre politique, bien sur — au développement du mouvement révolutionnaire.
Salutations chaleureuses Emancipaciôn Obrera
Réponse
à Emancipaciôn Obrera
Chers camarades,
Avant tout nous voulons que vous compreniez que si nous avons traduit et publié votre « Proposition-appel » dans notre presse internationale et lui avons donné le maximum de diffusion, autant que nos forces limitées nous le permettaient, ce n'était pas par « sentimentalisme révolutionnaire », ni parce que nous sommes des partisans « inconditionnels » du regroupement « à tout prix ». Ce qui détermine notre position dans ce domaine, ce sont des convictions fermes basées sur une analyse approfondie de la période présente.
Quelles perspectives pour le regroupement des révolutionnaires dans la période historique actuelle.
Toute l'histoire de la lutte du prolétariat nous enseigne que la formation et le regroupement des révolutionnaires, donnant lieu à une organisation internationale révolutionnaire, sont étroitement liés au cours suivi par la lutte de la classe. Les périodes de hautes luttes et les périodes de grandes défaites du prolétariat ont inévitablement une répercussion directe sur les organisations révolutionnaires de la classe, sur leur développement ou leur dispersion, et sur leur existence même.
Sans vouloir ici entrer dans de grands développements à ce sujet, il suffit de rappeler le déroulement de l'histoire de la Ligue des Communistes de 1848, des lre, 2e et 3e Internationales pour s'en convaincre. Nous disons que cette relation est évidente et inévitable parce que, pour nous, l'apparition et l'activité des organisations révolutionnaires ne sont pas un produit de la « volonté » de gens intelligents en marge des classes, mais sont le produit des classes elles-mêmes. Une organisation révolutionnaire (dans la société capitaliste) ne peut être que le produit de la classe historiquement révolutionnaire : le prolétariat. Et la vie de cette organisation ne peut donc pas être fondamentalement différente de la vie et l'état de la classe.
L'échec de la première vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale nous enseigne, entre autres, que la gravité et les conséquences de la défaite sont en rapport avec le projet révolutionnaire mis en pratique par la classe. L’échec de la première vague révolutionnaire s'est soldé par un massacre sanglant de grandes masses de prolétaires, dans de nombreux pays, par la ruine de la révolution victorieuse d'octobre 1917, par la dégénérescence rapide de la 3e Internationale, et par la trahison des PC staliniens passés, dans tous les pays, dans le camp de la bourgeoisie ; par une 2e guerre mondiale, par 50 ans de réaction engloutissant deux générations du prolétariat. Une telle situation ne pouvait que disperser les forces révolutionnaires, affaiblissant de plus en plus leurs activités, les réduisant à des îlots de résistance qu'étaient les Fractions de la Gauche Communiste. Et ces groupes ne pouvaient résister à l'avalanche écrasante de la contre-révolution qu'en se maintenant fermement sur les principes programmatiques, comprenant la profondeur réactionnaire de la période, l'impossibilité d'avoir un impact réel sur les masses, et limitant essentiellement leur activité à un travail de réexamen critique, de bilan de l'expérience que la classe venait de vivre, afin de tirer les enseignements politiques indispensables pour assumer leur tâche lors d'une nouvelle reprise de la lutte du prolétariat.
Toute orientation contraire, qui voulait coûte que coûte se lancer, dans une telle situation, à la reconstruction immédiate d'une organisation de masses, à une nouvelle Internationale (la 4e), relevait à la fois d'une incompréhension de la situation, et d'une démarche volontariste nécessairement impuissante, ou pire encore, comme ce fut le cas du courant trotskyste, menait à brader les principes révolutionnaires, et à s'enfoncer de plus en plus dans une évolution opportuniste.
Un autre exemple de l'incompréhension d'une période est celui de la proclamation d'un parti, comme ce fut le cas des bordiguistes, à la fin de la 2e guerre, en pleine réaction. Ces actions « d'impatience révolutionnaire », sont des aventures qui se font toujours au prix d'une politique immédiatiste et opportuniste.
Guerre ou révolution, la crise actuelle.
Nous avons insisté un peu longuement sur ce point, pour mieux faire ressortir ce qui distingue la période antérieure, de celle qui s'est ouverte à la fin de la décennie des années 1960, qui marque la fin de la reconstruction d'après la deuxième guerre mondiale, l'annonce d'une nouvelle crise ouverte du capitalisme mondial avec tout ce que cela impliquait du point de vue de la lutte de classe. Contrairement à la crise des années 1930 qui trouve un prolétariat épuisé par de grandes défaites historiques de sa lutte révolutionnaire, démoralisé par la dégénérescence de la révolution d'octobre et la trahison des PC passés à la bourgeoisie, par la victoire du fascisme en Allemagne, et le massacre du prolétariat espagnol sur l'autel de la défense de la république, qui ouvraient un cours inexorable vers une nouvelle guerre mondiale, la crise qui s'annonce à la fin des années 1960 trouve, elle, une nouvelle génération du prolétariat qui n'avait connu ni de batailles décisives, ni de défaites sanglantes, gardant donc toutes les potentialités et les capacités d'une reprise de la lutte.
Tout en aiguisant les tensions inter-impérialistes, cette crise ouvre avant tout un cours de luttes de la classe ouvrière, et c'est le sort de cette lutte de classe qui conditionne l'issue de l'alternative historique : barbarie ou socialisme, ou une 3e guerre mondiale (et ses conséquences catastrophiques) ou la révolution prolétarienne.
C'est
cette analyse de la période actuelle de reprise et de développement de la lutte
de la classe ouvrière qui détermine la nécessité et la possibilité d'une
renaissance et le renforcement d'une organisation révolutionnaire apte à
assumer pleinement sa fonction dans la classe et sa lutte.
Le cours à des affrontements de classe
Cinquante années de contre-révolution et de réaction ont rompu la continuité organique du mouvement révolutionnaire, ont anéanti les organisations de la Gauche communiste russe, allemande, hollandaise, et sclérosé en grande partie celle d'Italie, et développé un esprit de secte, de chapelle. Mais le ressurgissement du mouvement du prolétariat en lutte ne peut pas ne pas sécréter en son sein de nouvelles organisations révolutionnaires. Ces nouvelles organisations qui ont leurs racines communes dans la situation nouvelle, actuelle, de la lutte des classes, n'ont pas pour autant une même trajectoire et un même développement politique ; elles souffrent souvent d'un manque de formation théorique-politique rigoureux, d'une connaissance sérieuse de l'histoire du mouvement révolutionnaire, de ses expériences et acquis, se débattent souvent dans la confusion, avec le risque, dans leur isolement, de se perdre dans des impasses et de disparaître.
Seule la prise de conscience de la nécessité de rompre l'isolement, de développer des contacts avec d'autres groupes, de la nécessité de l'échange des idées, de la presse, de l'information, de la stimulation de la discussion internationale inter-groupes, des accords éventuels pour des interventions communes, peut permettre un processus de décantation indispensable, et ouvrir la voie vers un regroupement international des forces révolutionnaires, basé sur des principes solides, marxistes, et des positions politiques rigoureuses de classe.
C'est sur ces analyses et ces convictions que repose notre ferme volonté de propulser et soutenir toute proposition qui va dans le sens de resserrer les contacts entre les groupes, de créer un pôle, un lieu de réflexion, de clarification, de décantation et de regroupement des forces révolutionnaires aujourd'hui encore dispersées.
C'est parce que nous sommes convaincus que cette tâche est à l'ordre du jour aujourd'hui, pour la reconstitution du mouvement révolutionnaire, qui ne peut être faite que sur le plan international, que nous ne nous lassons pas de poursuivre notre effort dans ce sens, depuis bien avant la constitution formelle du CCI, et c'est la raison pour laquelle nous avons salué votre Appel.
Par expérience, nous savons que ce n'est pas une tâche facile. Mieux que vous, nous connaissons les différents groupes qui constituent ce que nous appelons le milieu politique prolétarien ; ce milieu que beaucoup de groupes ignorent ou veulent ignorer, se considérant chacun dans son sectarisme, comme le seul et unique groupe révolutionnaire de par le monde. On ne peut certes ignorer qu'il existe des divergences réelles qui ne peuvent être résolues que par la discussion, la clarification approfondie et la décantation politique inévitable et salutaire. Mais on doit savoir distinguer ces divergences réelles de ce qui relève de malentendus, d'incompréhensions, et surtout d'un étroit état d'esprit mégalomane.
Il n'existe pas de recettes contre ces dernières manifestations. Il faut reconnaître leur existence comme autant d'entraves, et leur opposer une ferme volonté de poursuivre inlassablement l'effort pour rompre l'isolement, pour développer les contacts, les discussions sérieuses de clarification et, les événements aidant, parvenir à un rapprochement des groupes, en vue d'une activité révolutionnaire fructueuse.
Pour résumer notre pensée sur ce point, nous pouvons dire : tant que, d’une part, une compréhension de la période actuelle ne se fondera pas sur une analyse juste d'une période de reprise internationale de la lutte du prolétariat, de ses causes et potentialités, et d'autre part persistera l'esprit de secte, le souci prioritaire de conservation de SA chapelle, héritage caricatural d'une période passée, votre proposition d'une revue publique internationale commune à tous les groupes, quel que soit le souci JUSTE qui la sous-tend, ne peut rester qu'un vœu pieux, une illusion sur le plan politique, sans parler déjà des difficultés quasiment insurmontables dans les conditions actuelles sur le plan pratique. En tout état de cause, avec la meilleure volonté du monde, votre proposition d'une telle revue reste pour le moins largement prématurée dans la réalité du moment présent.
Seul
un événement révolutionnaire d'une portée historique extraordinaire pourrait
précipiter la réalisation d'un tel projet. Est-ce à dire que pour le moment il
n'y a rien à faire ? Absolument pas ! Mais il serait erroné et même négatif de
chercher des raccourcis, et de penser qu'on peut contourner les difficultés en
commençant par un regroupement d'actions politiques ou la publication dune
revue commune. Ces raccourcis, loin de mener vers un rapprochement, sur une
base politique claire et solide, risquent au contraire de mener vers la
confusion et l'escamotage des problèmes politiques, terre fertile de tous les
opportunismes.
Les critères minimaux ouvrant la voie d'un rapprochement
Pour éviter tout malentendu concernant les critères devant servir de base de sélection des groupes pouvant positivement participer à des discussions de clarification dans un processus de rapprochement entre les groupes révolutionnaires existants, nous partageons pleinement votre souci que de tels critères doivent être à la fois « larges et stricts : larges pour que puissent participer des groupes ou des personnes dont les définitions, de par leurs limitations historiques, ne recouvrent pas la vaste gamme des autres groupes, mais s'inscrivent dans la même tendance ; stricts pour exclure ceux qui expriment une politique antagonique à celle que nous revendiquons, même si leur langage contient des relents marxistes ». Nous sommes même d'avis, qu'appliquant ce même type de critères, nous devons également tenir compte s'il s'agit de groupes anciens, dans lesquels les positions erronées ou historiquement dépassées sont incrustées au point de les scléroser ; ou de groupes nouveaux qui surgissent, et dont les erreurs relèvent d'une immaturité momentanée, et peuvent être largement surmontées et corrigées au cours d'un processus de clarification.
Cependant, nous divergeons en partie avec vous, sur la question de savoir quels sont « les points de discrimination les plus importants, tout en tenant compte du fait que tout le monde n'a pas suivi les mêmes étapes, ni donné des définitions dans le même ordre d'idées. Nous voulions en même temps qu'ils soient un obstacle contre les opportunistes, les réformistes et contre la gauche en général... (du capital) ». La question est de savoir quels sont ces « points de discrimination les plus importants ».
Tout d'abord, nous ne saurions admettre l'absence de critère politique, et ne retenir pour seul et unique critère l'affirmation qui se trouve dans votre « Proposition Internationale» (Revue Internationale n°46, p. 15) : «Pour nous, ce critère pour nous reconnaître, c'est la pratique ». Qu'est-ce donc que cette « pratique » se suffisant à elle-même, et bonne pour toute discrimination ? Formulé ainsi, c'est en contradiction, ou du moins ça entretient une ambiguïté avec tout le souci exprimé dans le reste de votre « Proposition » et dans les 14 points pour définir à qui celle-ci est adressée.
Une « pratique », séparée de tout fondement politique, de toute orientation, de tout cadre de principes n'est qu'une pratique suspendue en l'air, un immédiatisme borné, mais ne saurait jamais être une activité vraiment révolutionnaire. Toute séparation entre théorie et pratique optant, soit pour la théorie sans pratique, soit pour la pratique sans théorie, détruit l'unité des luttes immédiates et du but historique. Cette fameuse «pratique» en soi ressemble étrangement à une réédition de la non moins fameuse devise révisionniste bernsteinienne de la fin du siècle dernier : « Le mouvement est tout, le but n'est rien».
Cette « pratique pour la pratique », quoi qu'on en dise, est aussi une politique : une politique de cacher, d'escamoter, d'esquiver les vrais problèmes de la lutte de classe concrète, tels qu'ils se présentent dans la réalité aux ouvriers. Incapable de répondre à ces problèmes, cette pratique cache à peine l'indigence de pensée de ses protagonistes, préférant le coup de poing ou le coup de gueule d'une phraséologie révolutionnaire, aussi grandiloquente que creuse, pour s'épargner l'effort, un tant soit peu, de la réflexion et de l'activité cohérente.
Une politique-pratique révolutionnaire découle à la fois du but qu'on se propose d'atteindre, et de l'analyse des conditions concrètes, de la situation réelle, vivante, du rapport de forces donné entre les classes. La « pratique » politique, par contre, tourne complètement le dos à la réflexion, à toute cohérence qui lui apparaît comme un carcan pesant et inutile, dont il faut se débarrasser au plus vite, pour mieux pouvoir, non pas agir mais s'agiter. Cette politique (de la pratique se suffisant à elle-même) a une tradition dans le mouvement ouvrier : elle va de Weitling à Willitch, de Bakounine à Netchaev, et à toutes les variantes de l'anarchisme d'hier et d'aujourd'hui.
Ajouter le mot « commune » à la pratique, et parler de la « pratique commune » pour en faire le seul point de discrimination et pour « se reconnaître » n'arrange pas davantage les choses. Quelle est la pratique commune des groupes qui se disent révolutionnaires ? Elle consiste, avant tout, dans le fait de publier une presse, de sortir des tracts, de les diffuser le plus largement possible. Cette pratique effectivement commune ne permet nullement de distinguer les révolutionnaires des autres organisations politiques au service de l'ennemi de classe. Le problème n'est donc pas la pratique, mais son contenu politique, et seul ce contenu effectivement politique peut nous permettre de juger le terrain de classe sur lequel se situent les différentes organisations. C'est pourquoi ce n'est pas la pratique en soi qui peut servir de critère de discrimination et de regroupement, mais fondamentalement les positions politiques qui la fondent.
C'est pourquoi, nous voudrions rappeler les critères politiques qui ont servi de base aux trois Conférences Internationales des groupes de la Gauche Communiste dans les années 1977 à 80, critères qui pour une première délimitation immédiate demeurent nécessaires. L'invitation s'adressait à tous les groupes qui :
« 1°) Se réclament et défendent les principes fondamentaux qui ont présidé à la Révolution prolétarienne d'octobre 1917 et à la constitution de la 3e Internationale de 1919 et qui, à partir de ces principes, entendent soumettre à la critique constructive les positions politiques et la pratique élaborée et énoncée par l'Internationale Communiste à la lumière de l'expérience.
2°) Rejettent sans la moindre réserve toute prétendue existence dans le monde de pays à régime socialiste ou de gouvernement ouvrier, même avec le qualificatif de "dégénéré". Rejettent toute distinction de classe à établir entre les pays du bloc de l’est ou de la Chine avec les pays du bloc de l’ouest et dénoncent comme contre-révolutionnaire tout appel à la défense de ces pays.
3°) Dénoncent les PS et les PC et leurs acolytes comme des partis du capital
4°) Rejettent catégoriquement l’idéologie de l'anti-fascisme, établissant une frontière de classe entre le fascisme et la démocratie, en appelant les ouvriers à défendre ou à soutenir la démocratie contre le fascisme.
5°) Proclament la nécessité pour les communistes d’œuvrer pour la reconstruction du Parti, arme indispensable pour la victoire de la Révolution prolétarienne.
Un simple énoncé de ces critères fait comprendre à tout ouvrier qu'il ne s'agit pas d'un ramassis de toutes les "bonnes volontés", mais de groupes authentiquement communistes, se démarquant nettement de toute la faune gauchiste : maoïstes, trotskystes, modernistes, et autres conseillistes bêlants "anti-parti".
Ces critères, certes insuffisants pour établir une plate-forme politique pour un regroupement, sont par contre parfaitement suffisants pour savoir avec qui on discute et dans quel cadre, afin que la discussion soit réellement fructueuse et constitue un point positif. »
(Revue Internationale n° 16, 1er trimestre 1979)
Cependant, certains aspects contenus dans ces critères, en particulier dans les points 1 et 5, peuvent et doivent être explicités.
La discrimination fondée sur la séparation historique entre le marxisme et les théories de l'anarchisme (cette expression des couches artisanales en voie de prolétarisation) et du populisme reste d'autant plus importante aujourd'hui avec le réveil de courants tendant à préconiser la conciliation possible avec ces deux courants antagonistes.
Il en est de même pour ce qui concerne ce que nous appelons les modernistes, qui prétendent remettre en cause le marxisme et remettre en question le prolétariat comme l'unique classe révolutionnaire dans la société et le seul sujet de son dépassement.
Il en est aussi de même des académistes-marxologues qui acceptent volontiers de discourir sur la validité de la théorie marxiste, mais oublient et passent sous silence le côté actif du marxisme qui est avant tout la théorie et la pratique de la lutte de classe du prolétariat.
Il en est encore de même de la discrimination avec le conseillisme qui rejette la nécessité d'une organisation politique du prolétariat (le parti) et lui nie toute fonction politique et militante dans la lutte pour la révolution, ou bien les théories bordiguistes qui substituent à la dictature du prolétariat la dictature du parti.
La compréhension et la reconnaissance de la phase de décadence du système capitaliste aujourd'hui, qui explique l'impossibilité de réformes durables et donc du réformisme, qui définit catégoriquement les partis socialistes et « communistes » comme non ouvriers et simple aile gauche du capital, qui rejette de façon tranchante le parlementarisme, le syndicalisme, et les mouvements de libération nationale comme définitivement dépassés, ne servant désormais qu'à mystifier le prolétariat en le détournant sur un terrain de classe de la bourgeoisie.
Nous voulons citer en exemple vos propres expériences qui confirment l'importance de ces critères :
1) Durant la guerre des Malouines, vous vous trouvez être le seul groupe en Argentine à dénoncer la guerre et les appels à la collaboration du prolétariat sous prétexte de la lutte anti-impérialiste. A lui seul cet événement a pu faire un démarquage de principes entre vous et tous les autres groupes qui se sont laissés prendre dans le piège de la lutte soi-disant anti-impérialiste. Nous reviendrons plus loin sur la soi-disant existence des pays impérialistes et non impérialistes. Mais ce que nous voulons mettre en relief dès maintenant, c'est que la question de la soi-disant lutte anti-impérialiste est passée du plan théorique au plan pratique comme critère important de position de classe.
2) Concernant vos discussions avec l'OCI d'Italie, vous écrivez que si l'OCI persiste à défendre ses positions concernant la « libération nationale », vous vous verrez dans l'obligation de constater l'impossibilité et l'inutilité de poursuivre les discussions avec ce groupe. Vous confirmez ainsi que la position sur la libération nationale est devenue un critère de discrimination entre les groupes qui se disent révolutionnaires.
3) Concernant la question du terrorisme révolutionnaire et votre discussion avec le GCI qui « revendique le terrorisme révolutionnaire », votre rejet de cette position anarchiste est nette et catégorique comme le fut et reste la notre. Cette question constituait une des raisons de la rupture du GCI avec le CCI, il y a huit ans. Pour ne pas avoir compris ce qui distingue la violence révolutionnaire de la classe du terrorisme petit-bourgeois, le GCI nous lançait alors le reproche de défendre rien de moins que le pacifisme bourgeois. Aujourd'hui le GCI semble être revenu sur cette position. Nous voudrions espérer que ce retour n'est pas simplement un fait conjoncturel, sans en être pourtant absolument sûrs. Toujours est-il que cette question du terrorisme «révolutionnaire » ne peut pas ne pas être un critère discriminatoire.
Il
va de soi que nous partageons absolument vos remarques sur la torture comme
méthode absolument étrangère au prolétariat et à combattre par les
révolutionnaires. Le prolétariat ne peut pas utiliser ce type de méthode parce
que si la torture correspond à une classe oppressive par nature, elle est dans
son essence antagonique à une classe, le prolétariat, qui représente, pour la
première fois dans l'histoire, la libération de toutes les oppressions et
barbaries.
La continuité historique du mouvement révolutionnaire
Nous comprenons très bien que, partant de la constatation juste que vous faites qu'un bon nombre de groupes authentiquement prolétariens et révolutionnaires qui ont surgi et surgiront encore connaissent mal l'histoire du mouvement révolutionnaire du prolétariat, vous vouliez éviter de faire, des leçons de cette histoire, des critères de discrimination risquant de laisser ces groupes hors du processus de contact et de regroupement qu'il importe aujourd'hui de propulser.
Nous ne sommes pas assez stupides ni sectaires pour l'exiger comme préalable absolu. Ce sur quoi nous voulions insister de toute notre conviction, c est que sans cette connaissance et cette assimilation, aucun regroupement véritable, solide, n'est possible. C'est pourquoi nous mettons tant d'insistance sur la discussion et la clarification, sur l'évolution du mouvement et de ses différents courants, sur leurs positions énoncées, sur leur expérience afin de pouvoir partir de ses acquis indispensables pour avancer aujourd'hui dans notre activité révolutionnaire.
Nous avons déjà rappelé les plus de 50 ans de rupture de la continuité organique qui s'est produite après la défaite de la 1re vague révolutionnaire, et les lourdes conséquences pour le mouvement révolutionnaire. Mais il ne suffit pas de se contenter de le constater, il importe de s'efforcer de rétablir la continuité politique et historique du mouvement. Bien des groupes font cette constatation et font même de cela une vertu. Il leur semble plus avantageux de rester dans l'ignorance et même d'effacer purement et simplement le passé, et de considérer que l'histoire de la lutte de classe commence avec eux. Il importe au plus haut point de combattre cette absurde présomption et apprendre à ces groupes, dans leur volonté d'effacer le passé, se considérant être sortis du néant, qu'ils sont condamnés à n'être que le néant.
De même que la classe ouvrière continue à rester la même classe ouvrière, c'est-à-dire à la fois classe exploitée et historiquement révolutionnaire, quelles que soient les vicissitudes de l'évolution du capitalisme, de même les organismes politiques qu'elle engendre constituent, au travers des hauts et des bas de la lutte de la classe, un mouvement politique historique continu. La notion même du prolétariat comme une classe internationale unie fonde et détermine la réalité de la continuité de son mouvement politique.
Seuls les gens bornés peuvent interpréter la notion de continuité comme identique à immobilité, à une idée statique. La continuité n'a rien à faire avec les idées telles « qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil» ou bien que chaque jour et avec chaque génération commence une histoire totalement nouvelle qui n'a rien à voir avec le passé ni avec le devenir. La continuité, au contraire, est fondamentalement dynamique, mouvement, développement, dépassement, critique et nouveaux acquis. Rien d'étonnant à ce que les groupes politiques ouvriers qui ne comprennent pas ou rejettent la notion de continuité n'ont eux mêmes aucune continuité et traversent le mouvement ouvrier comme phénomènes éphémères et disparaissent sans laisser de trace de leur passage.
C'est le cas de bien des groupes qui se sont agités dans les décennies 1960 et 1970. Il suffit de mentionner les groupes tels que : ICO (ouvriériste anarchiste), les Situationnistes (intellectuels-volontaristes), le GLAT (marxiste-ouvriériste), Pouvoir ouvrier (trots-kysto-conseilliste), le PIC (activiste-conseilliste), l'OCL (libertaire) en France ; Potere Operaio (ouvriériste), Lotta Continua (activiste), Autonomia Operaia (ouvriériste-moderniste) en Italie, Spartacus (conseilliste) en Hollande, et tant d'autres groupes pseudo-marxistes, semi-libertaires, semi-modernistes un peu partout en Europe et aux Amériques. Tous ces groupes, dont l'existence constituait un énorme gaspillage de forces ouvrières, avaient tous cette caractéristique commune de rejeter l'histoire du mouvement ouvrier et plus particulièrement l'idée d'une continuité politique du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
Quoi d'étonnant que tous ces éléments et groupes devaient plus ou moins se retrouver et se reconnaître dans la sentence, le verdict sans appel prononcé par l'éminent sociologue universitaire en titre, M.Rubel, lors du débat organisé pour le centenaire de la mort de Marx. Selon Rubel, Marx (et le marxisme) ne sont qu'une utopie du 19e siècle, car Marx annonçait que « le prolétariat sera tout et partout, or aujourd'hui le prolétariat n'est rien et nulle part», prenant ainsi leur propre faillite pour la faillite du prolétariat et de sa théorie : le marxisme révolutionnaire.
Derrière le rejet de la continuité, se cache une négation de toute l'histoire du mouvement ouvrier, ou pour mieux dire, la négation que la classe ouvrière ait eu et peut avoir une histoire. Derrière une phraséologie ultra-radicale en apparence et en fait creuse des modernistes, se cache en réalité la mise en question du prolétariat comme classe révolutionnaire et qui est, pour les marxistes, la seule classe révolutionnaire dans la société capitaliste.
Il est de bon ton aujourd'hui, pour chaque moderniste au nez très délicat de se détourner avec dégoût, à la seule évocation de la 2e Internationale. Avec 80 ans de retard, ces « révolutionnaires » de la phrase, découvrent la faillite de la 2e Internationale sous le poids de l'opportunisme et ne voient que cela. Ils ignorent et veulent ignorer tout le positif que constituait cette Internationale, à un moment donné et précis dans l'histoire du mouvement ouvrier. En le rejetant en bloc, ces farceurs « révolutionnaires » jettent l'enfant avec l'eau sale de la baignoire. Ils ferment les yeux et se bouchent les oreilles pour ne pas entendre et ne pas voir que cette organisation a servi, à un moment de l'histoire du mouvement ouvrier, de pôle de rassemblement des forces ouvrières, une pépinière d'éducation, de formation et de propagation de la prise de conscience des grandes masses du prolétariat. Ils ignorent ou semblent ignorer que c'est en son sein et nulle par ailleurs, que se développait et agissait la gauche marxiste, de Lénine à Luxemburg, de Liebknecht à Bordiga, qui combattait, non en phrases creuses mais théoriquement et pratiquement, la pénétration de l'idéologie bourgeoise et contre la dégénérescence opportuniste. Mais de qui donc ces « révolutionnaires » en peau de lapin d'aujourd'hui, de qui donc ont-ils appris la faillite de la 2e Internationale, sinon de cette gauche marxiste qui a reconstitué, après la faillite de la précédente, et en continuation et dépassement de cette dernière, la nouvelle Internationale : l'Internationale Communiste. Il ne s'agit pas de faire l'apologie et de se réclamer de toute l'œuvre positive et négative, pêle-mêle, de la 2e Internationale, mais de situer celle-ci dans l'histoire, et dans l'histoire du mouvement ouvrier. Nos grands-pères ont peut-être mal fini leur vie, tombant dans l'alcoolisme dévastateur, ils n'en reste pas moins que ce sont eux qui ont donné la vie à la génération de laquelle nous sommes la progéniture. Une nouvelle génération révolutionnaire ne vient pas par la voie de la génération spontanée, mais se hisse, en continuation, sur les épaules des générations révolutionnaires antérieures du prolétariat.
Vos
remarques critiques et objections formulées sur ce point nous paraissent,
franchement, trop évasives et peu satisfaisantes.
Sur le parlementarisme
Pour commencer, nous prenons acte de votre affirmation que sur la question de la participation électorale « nous ne l'avons jamais fait et nous n'avons pas l'intention de le faire». Mais cette affirmation claire est immédiatement rendue ambiguë, dans la mesure où vous confondez participation et dénonciation quand vous écrivez : «si à quelque moment se pose la question d'un boycott actif dans une élection, cela revient dans les faits à participer à une campagne.. » C'est peut-être la faute d une traduction défaillante, mais si nous continuons ainsi, nous n'arriverons pas à nous comprendre. Boycotter, même accompagné de l'adjectif «actif» ne peut, en toute logique, vouloir dire participer, de même que boycotter les syndicats et les dénoncer ne veut pas dire participer. Participer veut dire prendre part positivement à quelque chose, c'est par exemple appeler les ouvriers à voter, en présentant ou non des candidats. Il faut donc distinguer clairement ces deux choses : participation ou abstention. Pour ne pas embrouiller encore plus la question, il vaudrait mieux laisser de côté le crétinisme parlementaire qui s'est développé dans le giron de l'opportunisme dans la 2e Internationale.
Au 19e siècle, Marx et la majorité de la 1ere Internationale défendirent contre les anarchistes et Bakounine la validité politique de la participation aux élections et au Parlement, non pour briguer « des charges exécutives » comme vous semblez le dire, mais dans la mesure où, à l'époque, la lutte pour des réformes politiques et sociales au sein de la société capitaliste comme le suffrage universel, le droit d'association, de réunion, de la presse ouvrière, ou encore la limitation officielle de la journée de travail, etc. avaient un intérêt et un sens évident dans la défense des intérêts de la classe ouvrière. Vous semblez mettre en question ce point, rejoignant ainsi, avec un siècle de retard, la position anarchiste, et en oubliant complètement ce que vous dites par ailleurs, sur la nécessité de prendre en compte « les situations concrètes ».
Cette justification de la participation au parlement fut abandonnée par Lénine et les marxistes à la fondation de l'Internationale communiste qui retenait uniquement l'argument de la possibilité de l'utilisation des campagnes électorales et de la tribune des parlements en vue de l'agitation révolutionnaire, ce qu'ils nommaient le parlementarisme révolutionnaire.
Vous ne semblez pas attacher grande importance à ce changement fondamental, ni chercher les raisons profondes pour lesquelles il a été accompli par des révolutionnaires qui n'entendaient pas faire en cela une quelconque « concession » rétrospective à l'idéologie anarchiste, mais en marxistes, se référaient au changement historique de la situation, aux conditions objectives nouvelles intervenues dans la réalité concrète.
Ce qui est en discussion aujourd'hui dans nos débats, c'est de se prononcer sur la validité ou non de ce que Lénine appelait le parlementarisme révolutionnaire. Cette position, qui a été celle de Lénine dans la 3e Internationale a-t-elle jamais été valable dans la période présente ? Et pourquoi n'est-elle pas valable ? Comme vous ne répondez pas clairement, ni à la première, ni à la seconde question, vous vous contentez d'écrire après maintes tergiversations que cela ne peut être un « critère discriminatoire », laissant ainsi la porte ouverte à tout venant. Même en retenant votre affirmation qu'« il va de soi que nous ne sommes pas d'accord pour faire du parlementarisme», vous l'accompagnez par « nous ne le tirons pas d’un principe a priori », ni « de la catégorie (?) capitalisme décadent », « mais en analysant les situations concrètes ». De quelles situations concrètes s'agit-il ? De situations locales, ou «des aires géographiques » chères aux bordiguistes, ou encore de « situations conjoncturelles », autre argument bordiguiste, ou bien de changement d'une situation historique, de période historique ? Et ce manque de clarté s amplifie encore quand vous vous référez hors contexte à Marx sur le fait que «des événements historiques sensiblement analogues mais qui se déroulent dans des milieux différents (souligné par nous) conduisent à des résultats totalement différents ». Qu'est-ce à dire sinon que vous considérez que le même problème: le parlementarisme, se pose, encore aujourd'hui, dans des milieux différents, selon le pays ou aire géographique, et donc ne peut conduire qu'à des résultats totalement différents, à savoir ; à tel endroit (situation concrète !) le parlementarisme serait toujours praticable, et à tel autre endroit il ne serait plus valable ou que cela dépendrait du moment.
Cette généralité de « situations concrètes » peut servir à n'importe quoi sauf à répondre à la question : pourquoi le parlementarisme, dans le sens révolutionnaire de Lénine, a cessé d'être valable précisément à partir de la 1re guerre mondiale dans tous les pays du monde.
Serait-il trop vous demander de préciser clairement, pour nous et pour le milieu prolétarien en général, votre position là-dessus ? Ceci est d'autant plus nécessaire que la question du parlementarisme révolutionnaire est très étroitement liée à celle du syndicalisme et de la libération nationale.
Il faut se garder de la méthode phénoménologique et ne pas traiter ces questions d'une façon séparée, chacune à part, en soi. Ces questions ne sont que différents aspects d'une même problématique ayant ses racines dans une même réalité « concrète ». A des questionnements qui s'inscrivent dans une même globalité, la réponse ne peut être que globale.
On ne peut que regretter la façon un peu légère avec laquelle vous touchez, comme cela en passant, le problème du capitalisme décadent. Sans vouloir nous étendre ici sur ce problème, nous nous contenterons d'attirer votre attention sur l'article paru dans la Revue Internationale n° 48 qui répond plus à fond aux diverses objections sur cette question, et à la suite de cet article dans ce numéro.
Vous semblez, par ailleurs, accorder une importance particulière à la question de la condition des femmes aujourd'hui. Nous regrettons de ne pas bien vous comprendre et de ne pas pouvoir vous suivre. Les marxistes n'ont jamais ignoré le problème de l'oppression que subissent les femmes dans toute société où existe la division des classes et donc l'exploitation et l'oppression dans tous les domaines et à tous les niveaux. Mais la solution de ce problème relève de la solution générale : mettre fin au capitalisme, dernière société de la division en classes, libérer toute l'humanité de ce fléau qu'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et rétablir, réaliser la communauté humaine. Mais il faut affirmer que le porteur de cette libération totale ne peut être que le prolétariat, parce que LUI SEUL représente l'humanité universelle. Il faut surtout se garder de faire de la question des conditions de la femme un problème séparé, un problème de féminisme supra-classiste, tel qu'il s'est développé dans les décennies 1960-70, avec la campagne et le mouvement dit de «libération de la femme ». Tous ces mouvements de « libération » de la femme, de le jeunesse, des minorités nationales, des homosexuels, etc. tendent à être toujours supra ou inter-classistes, et ont pour vocation de détourner l'attention du problème fondamental, celui de la lutte de classe du prolétariat.
Pour finir, nous voulons clarifier une fois pour toute la question ainsi nommée de tiers-mondisme ([4] [1101]) afin de lever tout malentendu à ce sujet. Nous partageons pleinement avec vous que ce terme, autant que celui de « pays sous-développés » sont impropres, ambigus, et se prêtent à toutes sortes de distorsions et de confusions. Nous les employons faute d'un vocable plus approprié à la réalité, et probablement aussi du fait que c'est la terminologie courante dans toute l'Europe, et dans toute la presse du monde. C'est là une explication, mais non une justification.
Qu'il soit clair que pour nous, le capitalisme est depuis longtemps parvenu à créer un marché mondial dans lequel il a intégré tous les pays dans les rapports de production capitalistes. L'impérialisme, pour Rosa Luxemburg, est précisément ce stade atteint de l'intégration de l'ensemble des pays dans le système économique capitaliste, d'où la saturation du marché mondial, la surproduction, la crise permanente et insurmontable du système dans laquelle tous les pays se débattent pour vendre leurs marchandises aux dépens de leurs concurrents. Ainsi le concept d'impérialisme ne se réduit pas au simple fait de la domination d'un pays par un autre, comme le prétendent les trotskystes et autres maoïstes, divisant le monde en pays impérialistes (dominants) et pays non impérialistes (dominés). Il est bien plus que cela. Il est un stade atteint par le capitalisme, et de ce fait, tous les pays, quelle que soit leur puissance, sont marqués du sceau de l'impérialisme.
Il serait pour autant erroné de ne pas reconnaître le décalage existant dans le développement et la puissance des différents capitaux nationaux. L'inégalité du développement est une loi inhérente au capitalisme. Non seulement l'inégalité a pour cause des raisons historiques, mais encore parce que le capitalisme, comme système, ne permet pas un développement vers une égalisation totale de la puissance économique des différents pays. Cela ne sera possible que dans le socialisme. C'est le cas surtout des pays qui se sont intégrés plus tardivement dans le système capitaliste de production. Cette inégalité se répercute forcément et joue un rôle énorme dans le rapport de forces entre les classes dans les pays différents. De cette loi de l'inégalité du développement, Lénine a tiré la théorie du maillon le plus faible, selon laquelle la tension révolutionnaire va produire la rupture de la chaîne dans les pays de moindre puissance du capitalisme. A cette théorie, nous opposons la vision classique de Marx et de Engels, pour qui la révolution communiste est plus certaine de se produire et de se propager, partant des pays les plus avancés, les plus industrialisés, là où les forces productives se heurtent le plus violemment au mode de production, là où le prolétariat est le plus nombreux, le plus concentré, le plus expérimenté, constituant une plus grande force pour vaincre le capitalisme. C'est dans ces pays qu'ils situaient l'épicentre du tremblement et de l'effondrement du capitalisme.
C'est dans ce sens que nous employons parfois, à défaut de termes plus appropriés, 1’image métaphorique et les termes de centre et de périphérie constituant un tout.
Toutefois nous sommes d'accord avec vous qu'il serait souhaitable de trouver des termes plus appropriés. En attendant, il serait peut-être judicieux de les mettre entre guillemets afin d'éviter toute interprétation abusive et déformatrice de notre pensée.
Dans l'espoir que cette lettre, un peu longue, contribuera à dissiper les malentendus et permettra de clarifier les vrais problèmes en discussion, recevez, chers camarades, nos salutations communistes et nos meilleurs vœux pour une nouvelle année de luttes pour la révolution.
CCI
08/01/1987
[1] [1102] Marx, 1877, dans «Correspondance».
[2] [1103] C'en est un que de se présenter pour des postes exécutifs ou pour défendre qu'à travers la démocratie l'on puisse obtenir des changements révolutionnaires. La phrase «participer à une campagne électorale » est très ambiguë, car, par exemple, si à un moment se pose la question d'un boycottage actif dans une élection, cela revient dans les faits à participer à une campagne et nous ne pensons pas que l'on puisse exclure cette possibilité pour toujours et partout : les questions tactiques ne se déterminent pas par des principes généraux, mais, en se basant sur eux et en analysant les situations concrètes, on détermine quels sont les meilleurs cours pour l'action révolutionnaire.
[3] [1104] Un des vieux écrits que vous nous avez envoyés récemment le confirme : vous parlez de la grave défaite qu'a été la Pologne non seulement pour la classe ouvrière polonaise mais pour la classe ouvrière mondiale.
[4] [1105] Nous faisons ici référence à un autre des textes publiés dans votre brochure, critiquant la notion de « pays périphériques ».
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 « 2° partie»
- 3428 reads
Face a la révolution russe
Le chapitre précédent de l’histoire de la Gauche hollandaise, paru dans
le n° 48 de la Revue Internationale, traitait du passage du SDAP
dirigé par Troelstra, dans le camp de la bourgeoisie, par le vote des crédits
de guerre en 1914, des scissions dans ce parti, du regroupement des minorités
révolutionnaires, essentiellement le courant « tribuniste », autour du SDP créé
depuis 1909. Mais la direction du SDP adopta face à la Conférence de Zimmerwald
contre la guerre en 1915, une attitude sectaire et fermée. Le chapitre publié
dans ce numéro montre comment cette attitude amenait à abandonner
l'internationalisme pour une position pro Entente dans la guerre, et quelles
furent l'attitude et les positions révolutionnaires, autour de Gorter, face à
la révolution russe et contre les concessions opportunistes du SDP. Le fait que
la réaction de Gorter, Pannekoek, ait été dispersée, et au départ une simple
opposition, a beaucoup pesé sur l'évolution ultérieure du SDP, lorsqu'il se
transforma en parti communiste en novembre 1918.
Le développement du SDP entre la révolution et l'opportunisme (1916-1917)
En dépit de la politique de la direction du SPD hollandais, l'écho de Zimmerwald fut, comme dans les pays belligérants, très grand dans la classe ouvrière des Pays-Bas. Une grosse propagande avait été faite dans les grandes villes par Roland-Holst. L'écho rencontré chez les ouvriers était tel que même le SDAP, sous la pression d'oppositionnels, publia le Manifeste de Zimmerwald, dans son quotidien « Het Volk».
Finalement, sous la pression des ouvriers et du RSV — auquel il ne voulait pas donner un label exclusif d'activité révolutionnaire — le SDP se rattacha, en 1916, et à contrecœur ([1] [1106]), à la Commission socialiste internationale créée à Zimmerwald. C'était une adhésion tardive au mouvement de Zimmerwald. Finalement, plusieurs raisons avaient entraîné un changement d'attitude de la part du SDP, et un rapprochement avec le RSV.
En premier lieu, le RSV de Roland-Holst s'était rapproché considérablement des « tribunistes ». Il avait même donné des gages tangibles de son glissement vers la gauche : les membres du RSV, qui étaient encore au sein du SDAP, le quittèrent en janvier 1916 ; devant l'attitude de ce parti, qui avait condamné explicitement le mouvement de Zimmerwald, lors de son Congrès, la petite minorité hostile à la 2e Internationale se tournait désormais vers le SDP. Aussitôt, Roland-Holst fit savoir que la fusion avec le parti « tribuniste » était à l'ordre du jour. Après ce départ, le SDAP ne connut guère plus de scission, à l'exception de celle qui se produisit sur sa gauche en février 1917.
En deuxième lieu, et malgré les atermoiements de sa direction, le SDP rencontrait une sympathie croissante en milieu ouvrier. Il avait considérablement développé sa propagande : contre la guerre, le service militaire de 3 ans, contre le chômage et le rationnement. Il était particulièrement actif chez les chômeurs et au sein des comités que ceux-ci faisaient surgir. Politiquement, le parti disposait d'instruments théoriques qui le faisaient apparaître comme le seul parti marxiste conséquent en Hollande. Le mensuel théorique « De Nieuwe Tijd » (« Les temps modernes ») qui appartenait ni au SDAP ni au SDP et comprenait des «théoriciens marxistes» appartenant aux deux partis depuis la scission de 1909, passait entièrement dans les mains du courant marxiste révolutionnaire. Le départ de Wibaut et Van der Goes de la rédaction mettait fin à la présence du courant opportuniste et révisionniste au sein du seul organe théorique en hollandais.
Il est notable que Roland-Holst fut associée à Gorter et Pannekoek pour assurer la rédaction de la revue, qui devenait un organe de combat «pour le socialisme, pour la libération de l'humanité du capitalisme».
En troisième lieu, à travers la personne de Pannekoek, le SDP s'impliquait de plus en plus dans l'effort de rassemblement des forces révolutionnaires qui se prononçaient nettement contre la guerre pour la révolution. A partir de 1915, Pannekoek collabore régulièrement avec les courants internationalistes allemands ; le groupe « Lichstrahlen » de Borchardt (Berlin), puis le groupe de Brème « Arbeiterpolitik », qui publie sa revue en 1916, après être sorti du SPD. Sans ; cesse en contact avec les internationalistes allemands, Pannekoek est désigné tout naturellement pour prendre en charge — avec la collaboration de Roland-Holst — l'édition de la revue « Vorbote » en janvier 1916. Cette revue, éditée en Suisse, était l'organe de la Gauche zimmerwaldienne ([2] [1107]), hostile au centrisme du courant pacifiste de Zimmerwald. Elle se plaçait résolument sur le terrain de la « future 3e Internationale ».
Tout cela manifestait une évolution positive du SDP et du groupe de Roland-Holst. Après une période de flottement, le parti « tribuniste » prenait ses responsabilités au niveau international. Roland-Holst, après avoir marché avec le centre du mouvement zimmerwaldien, avec Trotsky particulièrement, avait évolué à gauche.
L'existence de deux groupes révolutionnaires séparés en Hollande n'avait plus de raison d'être. L'heure était au regroupement. Le 19 février 1916, la direction du SDP émit le souhait d'une fusion avec le RSV. Enfin, le 26 mars, l'assemblée générale de ce dernier se prononça pour le regroupement. Seules les sections de La Haye et de Rotterdam manifestèrent une grande confusion, en voulant n'accepter la fusion que si pouvaient s'intégrer des éléments syndicalistes. Ces hésitations montraient que, comme pour le SDP, la délimitation du courant marxiste d'avec le courant syndicaliste-révolutionnaire était loin d'être nette.
Néanmoins, la fusion se réalisa. Le SDP, qui gagnait 200 militants, devenait un parti de 700 membres. Cette croissance, après une longue période de stagnation numérique, permettait au parti de disposer d'un quotidien : « De Tribune » paraissait dorénavant tous les jours. Le développement du SDP devenait même qualitatif. Pour la première fois de son histoire, le 21 juin, le SDP était capable de conduire avec succès une manifestation ouvrière à Amsterdam contre la faim et la guerre. La « secte » devenait véritablement un parti ouvrier par sa capacité d'influencer activement l'action de larges masses prolétariennes.
Il est certain que le développement du courant marxiste en Hollande, en cette année 1916, était le fruit de tout un réveil du prolétariat international après un an et demi d'hécatombes sur les champs de bataille. L'année 1916 est l'année tournant, celle qui préfigure le bouleversement révolutionnaire de 1917 en Russie. La reprise de la lutte de classe, après des mois de torpeur et de stupeur, brise l'Union Sacrée. En Allemagne, commencent les premières grèves politiques contre la guerre, après l'arrestation de Karl Liebknecht.
Les Pays-Bas, bien que « neutres », connaissent la même reprise des luttes ouvrières. Le début de la vague de grèves et de manifestations contre les effets de la guerre au niveau international est une réalité de la « petite Hollande ». Pendant les mois de mai et de juin se déroulèrent à Amsterdam des manifestations spontanées de femmes contre le rationnement. Des comités de femmes ouvrières avaient été constitués à Amsterdam et dans d'autres villes. Une agitation permanente régnait qui se manifestait par des assemblées et des manifestations auxquelles participaient ouvriers et ouvrières. Ces mouvements se prolongèrent par des grèves dans tout le pays au mois de juillet. Ces phénomènes de mécontentement profond étaient incontestablement prérévolutionnaires. Jamais la situation n'avait été aussi favorable pour le courant révolutionnaire aux Pays-Bas.
Pourtant, la direction du SDP allait progressivement révéler une attitude ambiguë et même opportuniste. Non pas sur le terrain de la lutte revendicative, où le parti était très actif, mais sur celui de la lutte politique.
Tout d'abord, le SDP continuait infatigablement sa politique de front avec des organisations de type syndicaliste et anarchiste. L'ancien cartel d'organisations, le SAV s'était sabordé le 25 février ([3] [1108]). Ce fut pour être remplacé, en avril 1916, par un comité socialiste-révolutionnaire contre la guerre et ses conséquences, en abrégé RSC. Le SDP, avec Wijnkoop et Louis de Visser — tous deux futurs chefs du PC des Pays-Bas stalinisé — était de fait à la tête du nouveau cartel d'organisations. Celui-ci, bien que très actif dans la lutte contre la guerre et la misère, apparaissait en fait comme un état-major des luttes, se substituant à leur spontanéité. Il n'était ni un conseil ouvrier, en l'absence de révolution, ni un comité central de grève, qui par nature est temporaire et lié à l'étendue de la lutte. Il était un organisme politique hybride, qui loin d'apporter la clarté sur les objectifs de la lutte de classe, apparaissait comme très confus, comme compromis entre différents courants politiques au sein du mouvement ouvrier.
On trouvait au sein du RSC les groupements anarchistes qui avaient déjà travaillé avec le SDP. Le plus révolutionnaire de tous était incontestablement le groupe de Nieuwenhuis.
Ce groupe — « Action social-anarchiste » (SAC) — était incontestablement, bien que de façon confuse, révolutionnaire, en raison surtout de la personnalité intransigeante de Nieuwenhuis. Cela n'était certainement pas le cas des autres groupements. On trouvait pêle-mêle : le « Bond van Christen-Socialisten », fédération des chrétiens socialistes (BCS), dont la couleur politique était pacifiste-chrétienne et parlementariste ; le « Vrije Menschen Verbond » (VMV), « Ligue des hommes libres » se réclamant de Tolstoï. Lorsque le groupement de Nieuwenhuis et aussi l'IAMV quittèrent fin 1916 le cartel, il ne restait plus que ces groupes, bientôt rejoints en février 1917 par le petit parti socialiste (SP), scission de 200 personnes du SDAP. C'était avant tout un groupe syndicaliste et parlementariste.
Ce conglomérat d'organisations pacifistes, la plupart étrangères au marxisme révolutionnaire, eut comme conséquence directe d'entraîner la direction du SDP toujours plus sur le terrain de l'opportunisme pratique. En s'alliant avec les « chrétiens socialistes » et avec le SP, le SDP allait tomber rapidement dans l'aventurisme parlementaire et une politique sans principe qu'il avait naguère dénoncée chez Troelstra. En effet, en 1917, et comme dérivatif à une situation sociale de plus en plus tendue dans le pays, la bourgeoisie néerlandaise avait instauré le suffrage universel. Le SDP forma un cartel électoral avec les deux organisations. Il put obtenir ainsi un net succès, par rapport à l'avant-guerre : 17 000 voix contre 1340 en 1913. Ce résultat, certes, traduisait une désaffection croissante de nombreux ouvriers pour le SDAP. Il était néanmoins, le début d'une politique qui devint rapidement, un an plus tard, parlementariste. Cette politique développa alors progressivement une nette réaction anti-parlementaire dans le parti, à l'origine de l'anti-parlementarisme de la gauche communiste hollandaise.
Mais l'opposition au sein du parti ne se cristallisa pas d'emblée sur l'anti-parlementarisme. Elle se forma dès 1916, pour culminer en 1917, contre la politique étrangère de la direction Wijnkoop. Sous la conduite de Barend Luteraan, membre de cette direction, et de Sieuwertsz van Reesema surgit dans les sections d'Amsterdam et de La Haye une puissante opposition à cette politique.
En effet, de plus en plus ouvertement, Wijnkoop, à la suite de Ravesteyn, mais aussi de la majorité du SDP — ce qui était plus grave — adoptaient une orientation favorable à l'Entente ; cela s'était déjà exprimé, mais de façon indirecte, dès septembre 1914, sous la plume de Ravesteyn. Celui-ci affirmait que la défaite de l'Allemagne serait la condition la plus favorable pour l'éclatement de la révolution dans ce pays. Il n'était certes pas nouveau dans le camp marxiste d'envisager — et cela se répéta lors de la deuxième guerre mondiale ([4] [1109]) — quels seraient les différents épicentres du séisme révolutionnaire à venir. Pannekoek répliqua dans « De Tribune », pour mettre fin à cette question purement théorique : même si l'Allemagne est plus développée économiquement que l'Angleterre, il est indifférent pour des marxistes d'envisager lequel des deux camps impérialistes doit remporter la victoire finale ; l'oppression violente par un camp et la tromperie démocratique, plus rusée, sont toutes deux défavorables au mouvement ouvrier. C'est exactement la même réponse que firent les gauches communistes italienne et hollandaise pendant la deuxième guerre mondiale à des courants comme l'anarchisme et le trotskysme.
La discussion en resta là. Ravesteyn, à l'évidence, développait des positions pro Entente. Il resta néanmoins isolé dans le parti ; Wijnkoop lui-même, président du SDP, avait encore la même position que Pannekoek et Gorter. Au cours de l'année 1916, tout commença à changer. Wijnkoop, brusquement, se rangea du côté de Ravesteyn, en mettant au premier plan la lutte contre le militarisme allemand, sous prétexte — ce qui était faux — que la bourgeoisie néerlandaise dans son ensemble se rangeait derrière l'Allemagne. Au cours de l'année 1917, il utilisa cette fois les mêmes arguments que ceux des « social-chauvins » des pays de l'Entente. Dans un article approuvé par la rédaction de « De Tribune », ce qui montrait que le danger de gangrène opportuniste était réel dans le SDP, Wijnkoop dépeignit l'Allemagne comme le rempart « féodal » de la réaction en Europe, contrainte aux pillages et à l'assassinat des peuples vaincus ; par contre, la France, héritière de la Grande Révolution, et l'Angleterre développée seraient incapables de tels actes (sic !). Une telle position était un net abandon des principes internationalistes du SDP ; elle laissait présager que si la neutralité des Pays-Bas était violée par l'Allemagne, la direction du SDP n'appellerait pas à la lutte contre les deux camps impérialistes mais au soutien de l'Entente.
Cette position, qui marquait un tournant dans l'histoire du parti, souleva de violentes protestations à l'intérieur de celui-ci. Une opposition, menée par Barend Luteraan et Van Reesema, engagea la lutte contre le comité de rédaction, qui avait laissé s'exprimer dans « De Tribune » des conceptions totalement étrangères à l'essence révolutionnaire du parti. La chose avait été d'autant plus aisée que Gorter, malade et déprimé ([5] [1110]), s'était retiré en 1916 de la rédaction, et se trouvait momentanément dans l'impossibilité de participer aux activités du parti.
Pour désamorcer l'opposition, la direction de Wijnkoop employa une arme qu'elle allait utiliser de plus en plus, par la suite, pour déconsidérer ses adversaires de gauche : la calomnie. Elle prétendit que les opposants, Gorter et Pannekoek inclus, étaient en fait des partisans de l'Allemagne, Ravesteyn ne fut pas le dernier à créer ce bruit.
L'opposition reprenait en fait l'analyse de Gorter, exposée en 1914 dans sa brochure sur 1 impérialisme, et qui avait été officiellement acceptée par le SDP comme base pour sa propagande. Clairement, elle montrait la nécessité de combattre tous les impérialismes, tous les camps en présence :
«Il ne s'agit pas de combattre spécialement l'impérialisme allemand. Tous les impérialismes sont également dommageables pour le prolétariat » ([6] [1111]).
Malheureusement pour elle, et signe inquiétant pour l'évolution de l'ensemble du parti, l'opposition se trouva isolée. Elle se trouvait d'ailleurs sans appui. Gorter hésitait encore à mener le combat avec elle. Pannekoek et Roland-Holst étaient plus plongés dans l'activité internationale que dans celle du SDP. C'était un signe de faiblesse organisationnelle qu'on retrouva comme constante chez ces dirigeants marxistes de stature internationale, et qui ne fut pas sans conséquence en 1917 et 1918.
La situation en 1917, et particulièrement la révolution russe et ses répercussions aux Pays-Bas, accentuèrent encore les clivages politiques au sein du SDP.
Le SDP en 1917 face a la révolution
La Révolution russe de 1917 ne fut pas une surprise pour des révolutionnaires comme Gorter, qui étaient convaincus que de la guerre naîtrait la révolution. Dans une lettre à Wijnkoop de mars 1916, Gorter montrait une confiance inébranlable dans l'action révolutionnaire du prolétariat international : «Je m'attends à de très grands mouvements après la guerre»
Les événements révolutionnaires tant attendus venaient pourtant en pleine guerre. L'écho de la révolution russe fut énorme aux Pays-Bas. Il montrait à l'évidence que la révolution prolétarienne était aussi à l'ordre du jour en Europe occidentale ; qu'il s'agissait non d'un phénomène « russe » mais d'une vague internationale de luttes révolutionnaires. De ce point de vue, l'année 1917 est décisive dans l'évolution du SDP confronté aux premiers signes de la révolution internationale, par l'action de masse, qu'il avait appelée de ses vœux dès le début de la guerre.
Premiers signes prérévolutionnaires aux Pays-Bas
L'année 1917 ouvrit une nouvelle période d'agitation contre la guerre, la faim, le chômage. En février, au moment où éclatait la révolution en Russie, les ouvriers d'Amsterdam manifestaient violemment contre l'absence de produits alimentaires et la politique de la municipalité de la ville.
Les manifestations prirent rapidement une tournure politique ; non seulement elles étaient dirigées contre le gouvernement, mais aussi contre la social-démocratie. Celle-ci, en effet, avait plusieurs élus — échevins — dans la municipalité d Amsterdam. Wibaut, l'un des dirigeants du SDAP, était même président de la commission d'approvisionnement de la ville depuis décembre 1916. En tant que tel, il était tenu responsable par les ouvriers de la pénurie alimentaire.
Mais Wibaut, et avec lui Vliegen — autre sommité du SDAP, élu à la mairie — fit appel le 10 février à l'armée, pour « rétablir Tordre », à la suite de pillages de boulangeries. C'était le premier pas concret de l'engagement du SDAP aux côtés de la bourgeoisie pour réprimer toute réaction ouvrière. Cette solidarité du SDAP avec l'ordre établi se manifesta encore plus en juillet, au cours d'une semaine qui est restée gravée dans l'histoire sous le nom de « semaine sanglante ». A la suite de manifestations de femmes contre la pénurie et de pillages de magasins, la municipalité, avec l'appui de tous les échevins social-démocrates, fit interdire toute démonstration. La réaction du prolétariat fut immédiate : une grève de 24 heures — à l'appel du RSC — fut suivie par plus de 20 000 ouvriers d'Amsterdam, grève de masse qui s'étendit comme une traînée de poudre dans la plupart des grandes villes des Pays-Bas. Mais à Amsterdam, comme dans d'autres villes, la troupe et la police tirèrent sur les ouvriers. Cette fois, pour la première fois depuis le début de la guerre, des ouvriers tombèrent sous les balles des forces de la bourgeoisie.
A Amsterdam, Vliegen et surtout Wibaut ([7] [1112]) portaient une, lourde responsabilité dans la répression sanglante. Wibaut n'hésita pas à opposer les chômeurs et les manifestants, dans lesquels il ne voulait voir qu'une « jeunesse débauchée », au « mouvement ouvrier moderne», organisé dans les syndicats et le SDAP. Il justifiait même, dans un article de « Het Volk », la répression qui, selon lui, aurait été « limitée » et appelait à « d'autres moyens pour assurer l'ordre ». Un tel langage, non désavoué par la direction du SDAP, était le langage de la classe dirigeante. Ainsi, même si le SDAP, officiellement, hésitait à couvrir totalement Wibaut ([8] [1113]), la social-démocratie hollandaise initiait une politique qui fut pleinement développée en Allemagne, en 1919, par Noske et Scheidemann. Le parti de Troelstra, à une petite échelle, ouvrait la voie de la collaboration avec la bourgeoisie face au mouvement révolutionnaire.
La « Semaine Sanglante » rendit plus nette la démarcation entre le SDP révolutionnaire et le SDAP, devenu traître à la classe ouvrière ; le SDP pouvait ainsi appeler les ouvriers à « s'écarter pleinement des traîtres à la classe ouvrière, des judas modernes, des valets du capital, de la direction du SDAP et du NW»
(De Tribune, 23-74917).
De tels événements aux Pays-Bas s'inscrivaient incontestablement dans le sillage de la révolution russe. Celle-ci non seulement entraînait manifestations et grèves dans le prolétariat, mais encourageait l'agitation dans l'armée. Ainsi, et bien que le phénomène fut limité, à partir d'octobre 17 se formèrent des conseils de soldats dans quelques localités, tandis que tout un mouvement se développait contre la discipline militaire.
Le SDP avait incontestablement profité de la situation. En participant pleinement aux grèves et aux manifestations, en subissant la répression — plusieurs de ses militants étaient en prison —, le SDP apparaissait comme un véritable parti révolutionnaire, non un parti de la « phrase » sectaire, mais comme une organisation militante active.
Cette activité tranchait nettement avec l'ambiguïté du SDP en politique extérieure, vis-à-vis de l'Entente et surtout face à là révolution russe. Comme si le développement du parti le poussait, par souci d'une « popularité » fraîchement acquise en milieu ouvrier, à faire des concessions opportunistes pour renforcer une influence qu'il avait témoignée sur le terrain électoral en 1917.
La direction du SDP et la révolution russe
Le parti que Lénine avait considéré avec le parti bolchevik au début de la guerre, comme le plus révolutionnaire et le plus apte à œuvrer à la constitution de la Nouvelle Internationale va se trouver singulièrement éloigné en 1917 du bolchevisme. Du moins la majorité du parti dont la direction était totalement dominée par le trio Wijnkoop-Ravesteyn-Ceton. La minorité, après le départ de Gorter et l'élimination de Luteraan de la direction du SDP, se trouvait isolée. C'est elle du moins, qui mena, avec l'autorité morale de Gorter et Pannekoek, la lutte la plus résolue pour soutenir le bolchevisme et défendre le caractère prolétarien de la révolution russe. Cette attitude est d'ailleurs commune à toutes les gauches qui se formaient soit comme opposition, soit comme fraction dans les différents partis socialistes.
La méfiance qui se fit jour dans la majorité à l'égard des bolcheviks découle directement de ses positions pro Entente en politique internationale. Elle se manifesta en premier lieu lorsque les bolcheviks traversèrent l'Allemagne pour regagner la Russie. Ce voyage fut désapprouvé par « De Tribune », qui y vit une compromission avec l'Allemagne. En fait, cette méfiance dissimulait mal un soutien à la politique de Kerenski, qui en juillet 1917 menait une offensive similaire contre l'Allemagne. Pour justifier cette politique, van Ravesteyn — dans «De Tribune» —n'hésitait pas à comparer la Russie de Kerenski à la France révolutionnaire de 1792. Idéologiquement, la position de Ravesteyn, et aussi de Wijnkoop, était identique à celle des mencheviks : il s'agissait de réaliser la révolution bourgeoise et de l'exporter militairement pour écraser l'Empire allemand, « féodal et réactionnaire ».
Ce soutien implicite au gouvernement Kérenski entraîna de violentes réactions de l'opposition. Celle-ci, par la plume de Pannekoek et de Gorter, se situa résolument au côté des bolcheviks, en dénonçant à la fois la démocratie bourgeoise russe et la conception d'une révolution bourgeoise comparable à 1793 en France. Pour Pannekoek, il ne s’agissait pas d'une révolution « bourgeoise » en marche, mais d'une politique contre-révolutionnaire et impérialiste. Son point de vue était identique à celui des bolcheviks en 1917 :
« Toute guerre (..) menée avec la bourgeoisie contre un autre Etat est un affaiblissement de la lutte de classe, et par conséquent une trahison, un forfait contre la cause du prolétariat» ([9] [1114])
Les errements de la direction du SDP s'arrêtèrent là. Lorsque la prise du pouvoir par les conseils fut connue en novembre, celle-ci fut saluée avec enthousiasme par « De Tribune ».
Mais la minorité autour de Gorter, Pannekoek et Luteraan, émettait des doutes justifiés sur le soudain enthousiasme révolutionnaire de la direction. En refusant, une fois de plus, de participer à la troisième (et dernière) conférence du mouvement de Zimmer-wald ([10] [1115]), à Stockholm, en septembre, celle-ci montrait un refus de s'engager résolument sur la voie de la troisième internationale. Le radicalisme verbal utilisé une fois de plus pour condamner « l'opportunisme » avait du mal à camoufler la politique étroitement nationale de la direction Wijnkoop. Son internationalisme était purement verbal et le plus souvent déterminé par l'air ambiant.
Il n'est pas surprenant que, lors des débats qui se firent jour autour de Brest-Litovsk, sur la question de la paix ou de la guerre révolutionnaire, la direction se fit le champion d'une guerre révolutionnaire à tout prix. En Russie, • Boukharine, Trotsky, en étaient devenus les partisans pour accélérer, croyaient-ils, l'expansion de la révolution prolétarienne en Europe. Chez eux, nulle ambiguïté : la « guerre révolutionnaire» n'était pas une guerre contre l'Allemagne, insérée dans les plans de l'Entente ; il s'agissait de briser l'encerclement de la Russie révolutionnaire pour étendre la révolution non seulement à l'Allemagne, mais à toute l'Europe, pays de l'Entente inclus.
Contrairement à toute attente, Gorter — pour des raisons identiques à celles des communistes de gauche russes — se rangea du côté de la direction du SDP pour soutenir la position de Trotsky et Boukharine. Gorter attaqua vivement Pannekoek, qui soutenait entièrement la position de Lénine sur la paix rapide avec l'Allemagne.
Pannekoek partait du point de vue, évident, que la « Russie ne peut plus combattre ». En aucun cas, la révolution ne pouvait s'exporter par la force militaire ; son côté fort résidait dans l'éclatement de luttes de classe dans d'autres pays : « la force des armes est le côté faible du prolétariat»
Gorter se trompa de cible. Il laissa pendant plusieurs mois toute critique à la direction du SDP de côté. Il crut voir exprimée dans la prise de position de Pannekoek une version du pacifisme qu'il avait combattu en 1915, une négation de l'armement du prolétariat. Selon lui, une guerre révolutionnaire devait être conduite contre l'Empire allemand, car dorénavant : « la force des armes est le côté fort du prolétariat »
Cependant, Gorter commença à changer sa position. Il se trouvait en Suisse depuis l'été 1917, officiellement pour des raisons de santé. Il voulait en fait s'éloigner du parti hollandais et travailler en collaboration avec les révolutionnaires russes et suisses. Au contact de Platten et de Berzin — tous deux « zimmerwaldiens » et collaborateurs de Lénine — il entra en relation avec les révolutionnaires russes. Une correspondance étroite commença avec Lénine. Il se convainquit de la justesse des positions de Lénine sur la paix avec l'Allemagne. Et c'est lui qui se chargea de traduire en hollandais les thèses « sur la paix malheureuse ».
Gorter se trouvait libre pour combattre avec Pannekoek la direction du SDP, et soutenir sans réserve le caractère révolutionnaire de la Russie, et l'internationalisme bolchevik.
La révolution russe et la révolution mondiale
Contrairement à une légende tenace, la gauche hollandaise dans le SDP défendit pendant trois ans le caractère prolétarien de la révolution russe. Celle-ci était la première étape de la révolution mondiale. Avec acharnement, Gorter et la minorité du parti dénoncèrent l'idée menchevik — exprimée par Ravesteyn — d'une révolution bourgeoise en Russie. Une telle position ne pouvait que renforcer la position favorable à l'Entente et perpétuer la guerre impérialiste, au nom d'une « guerre révolutionnaire ». Lorsque, avec la dégénérescence de la révolution russe et la soumission de la troisième internationale aux intérêts d'Etat russes, la gauche commença à défendre l'idée dune révolution « double » en Russie : en partie bourgeoise, en partie prolétarienne, c'était dans une optique différente du menchevisme. Pour elle une révolution bourgeoise, ne pouvait être que le capitalisme d'Etat et la contre-révolution. Elle ne naissait pas au début mais à la fin de la vague révolutionnaire.
En 1917 et 1918, Gorter et la minorité sont les plus chauds partisans du bolchevisme. Ils sont les véritables introducteurs et propagateurs des conceptions de Lénine. C'est Gorter qui, de son propre chef, se charge de traduire, au cours de l'année 1918, « L'Etat et la Révolution ». De façon naïve, il se fait le propagateur d'un véritable culte de la personne de Lénine, dans sa brochure — parue en 1918 — sur la « Révolution mondiale » ; le futur pourfendeur des « chefs » reconnaît en Lénine le chef de la révolution : « il est le chef de la révolution russe, il doit devenir le chef de la révolution mondiale » ([11] [1116])
La brochure de Gorter — qui n'était pas un travail officiel du SDP — est l'une de ses contributions » théoriques et politiques les plus importantes. Elle présente l'avantage de tirer un certain nombre de leçons de la révolution russe, du point de vue de son organisation. Comme Lénine, Gorter proclame que les conseils ouvriers sont la forme enfin trouvée du pouvoir révolutionnaire, forme valable non pour la Russie, mais pour l'ensemble des pays du monde :
« Dans cette organisation de conseils ouvriers, la classe ouvrière du monde a trouvé son organisation, sa centralisation, sa forme et son être » (idem, p. 59)
La conception localiste et fédéraliste des conseils ouvriers, qui fut développée par la suite par le courant unioniste autour de Ruhle, est totalement absente dans la gauche hollandaise ; pas plus que n'est présente 1’idée d'une fédération d'Etats prolétariens, reposant sur des conseils ouvriers nationaux, idée développée plus dans l'I.C. de Zinoviev. La forme du pouvoir mondial du prolétariat sera « dans un avenir proche le conseil ouvrier central du monde » (idem, p. 76)
La révolution prolétarienne ne peut trouver son véritable essor que dans les principaux pays industrialisés, et non dans un seul pays. Elle doit être un phénomène simultané : « (Le socialisme) doit naître simultanément dans plusieurs, dans de nombreux, dans tous les pays et au moins dans les pays principaux» (idem, p. 64) On trouve ici chez Gorter l'idée maintes fois répétée par la suite que l'Europe occidentale est l'épicentre de la véritable révolution ouvrière, compte tenu du poids numérique et historique du prolétariat par rapport à la paysannerie : « La révolution véritable et complètement prolétarienne doit être faite par l'Europe occidentale elle-même» (idem, p.45) La révolution sera bien plus longue et difficile qu'en Russie, face à une bourgeoisie beaucoup mieux armée ; d'autre part, « le prolétariat d'Europe occidentale est seul comme classe révolutionnaire » (idem, p. 67). Nulle impatience « infantile » donc sur le cours révolutionnaire, reproche qui sera fait par la suite à la gauche communiste de la troisième Internationale.
Il est remarquable que la seule critique, indirecte, faite aux bolcheviks dans la brochure « La Révolution mondiale » soit dirigée contre le mot d'ordre du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Celui-ci, selon Gorter, qui reste bien en deçà des positions de Pannekoek et Rosa Luxemburg qui refusent le cadre de la « nation », « ne peut être garanti que par le socialisme ; il ne peut être introduit qu'avec le socialisme, ou qu'après son établissement» ([12] [1117]). Il est vrai que Gorter — qui est pour l'indépendance des Indes néerlandaises et soutient donc le mot d'ordre du SDP — fait une distinction explicite entre l'Occident, où seule la révolution est à 1’ordre du jour, et l'Orient, où l'indépendance des colonies doit être revendiquée :
«En traitant de ce droit, il faut bien distinguer entre Europe occidentale et orientale, entre les Etats asiatiques et les colonies » (idem)
Lénine pouvait à juste titre souligner l'inconséquence de la position de Gorter, qui apparaissait moins comme une divergence de principe que comme une question tactique à examiner suivant les zones géo-historiques ([13] [1118]).
Cette brochure eut en tout cas un écho considérable tant aux Pays-Bas que dans maints pays, où sa traduction fut immédiate.
Ch.
[1] [1119] Le SDP ne participa ni à la conférence de Kienthal ni à celle de Stockholm. Finalement, il ne participa à aucune des conférences tenues de 1915 à 1917.
[2] [1120] Elle n'eut que deux numéros. Radek en Suisse en avait la direction effective.
[3] [1121] Les courants syndicalistes, représentés par les fédérations d'employés et de marins avaient peur en fait de 1 emprise croissante du SDP au sein du SAV.
[4] [1122] La gauche communiste italienne était convaincue que la révolution surgirait en Allemagne en 1945.
[5] [1123] Gorter avait perdu sa femme, ce qui l'avait rendu dépressif. D'autre part, sa maladie l'affaiblissait ; il était depuis 1913 dans l'impossibilité de parler dans les meetings ouvriers. Il est certain aussi que son retour à la poésie — il publie son grand poème «Pan» en 1917 — l'a presque complètement absorbé.
[6] [1124] Article de Van Reesema, in « De Tribune », 21 mai 1917.
[7] [1125] F.M. Wibaut (1859-1936) ; adhéra en 1897 au SDAP. Il devint membre du conseil municipal d'Amsterdam de 1907 à 1931, échevin de 1914 à 1931. Vliegen (1862-1947) était l'un des fondateurs du SDAP en 1894.
[8] [1126] Plus tard, Troelstra — dans ses Mémoires parus de 1927 à 1931 — appuya cyniquement la politique de répression menée par Wibaut comme une politique de parti : il la trouvait même trop douce ! : « Wibaut écrivit quelques semaines plus tard dans "Het Volk" un article où il qualifiait cette violence d'inévitable, mais il faisait fortement ressortir le fait déplorable qu'une municipalité démocratique doive ainsi intervenir contre la population. Il exprima dans son article urgemment le souhait que les professionnels de la police dussent imaginer une méthode non violente pour prévenir des pillages. A mon avis, on ne peut se laisser diriger par une telle sensiblerie dans l'argumentation, qu'il fit peser si lourd dans celle-ci. Si nous social-démocrates avons conquis une importante position de force, c'est dans l'intérêt de la classe ouvrière toute entière, et par conséquent cette position de force doit être défendue par tous les moyens, violents si nécessaire» (« Gedenkschriften» t. IV,p. 72-73, Amsterdam, 1931)
[9] [1127] « De Nieuwe Tijd», 1917, p. 444-445.
[10] [1128] Malgré l'opposition de Lénine, qui voulait fonder immédiatement la troisième Internationale, en avril 17, les bolcheviks déléguèrent leurs représentants à la conférence de Stockholm. Celle-ci ne doit pas être confondue avec celle des partis de la seconde Internationale, qui devait se dérouler dans la même ville au même moment. Elle ne put se tenir, les socialistes patriotes français refusant de siéger avec les social-patriotes allemands.
[11] [1129] Cf. traduction française : « La révolution mondiale», Ed. socialistes, Bruxelles 1918, p. 58. Gorter idolâtre l'individu Lénine, qu'il ne voit plus comme l'expression d'un parti : « La force de son esprit et de son âme est égale à celle de Marx. Si Marx le surpasse en connaissances théoriques, en force dialectique, il surpasse Marx par ses actions... Et nous l'aimons comme nous aimons Marx. Comme chez Marx, son esprit, son âme nous inspirent immédiatement de l'amour»
[12] [1130] Idem, p. 24, Gorter ajoute : «Il se peut que cette indépendance soit pire que la soumission pour les nations, pour le prolétariat.»
[13] [1131] « Gorter est contre l'autodétermination de SON pays, mais POUR celle des Indes néerlandaises, opprimées par sa nation!» (Lénine, « Bilan d'une discussion sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes », 1916).
Géographique:
- Hollande [558]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [207]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 50 - 3e trimestre 1987
- 2928 reads
Lutte de classe internationale : le besoin de l'unification et la confrontation au syndicalisme de base
- 2633 reads
La faillite de plus en plus évidente du capitalisme mondial, qui s'engage aujourd'hui dans une nouvelle récession, commence sérieusement à alarmer même les plus optimistes analystes des «perspectives» de l'économie dans tous les pays. En même temps, le mécontentement, la colère, la combativité ne cessent de monter dans la classe ouvrière contre des attaques de plus en plus généralisées des conditions de vie :
— le chômage de moins en moins indemnisé, de longue durée, sans perspective de retrouver des emplois ; au contraire, de plus en plus de licenciements, au nom de la «restructuration», «reconversion», «privatisation»;
— le démantèlement de toutes les réglementations de l'aide sociale de l'Etat, dans les domaines de la santé, des retraites, du logement, de l'éducation ;
— la baisse des revenus par suppression de primes, augmentation du temps de travail, limitations et blocages des salaires ;
— la déréglementation des conditions de travail : réintroduction du travail pendant les jours de congé, du travail de nuit des femmes, «flexibilisation» des horaires.
— l'augmentation des sanctions sur les lieux de travail, le renforcement des contrôles policiers, notamment dans «l'immigration», au nom de la lutte «pour la sécurité», contre le «terrorisme» ou même «l'alcoolisme», etc.
Sur le plan de l'économie et des conséquences pour la vie des classes sociales exploitées et déshéritées de la société, ce sont les pays au capitalisme moins développé qui montrent l'avenir pour les pays industrialisés. Aujourd'hui, les caractéristiques de la faillite historique du capitalisme se manifestent très violemment dans ces pays (voir article sur le Mexique dans ce numéro). Cependant, ces caractéristiques ne sont pas réservées au «sous-développement» et le capitalisme des centres industriels les plus importants montre des symptômes de plus en plus flagrants de cette faillite au cœur même de son système : aggravation du chômage au Japon, endettement des Etats-Unis supérieur à celui du Brésil, plans de licenciements massifs en Allemagne de l'Ouest, pour ne donner que quelques indices les plus significatifs.
Face à cette tendance à unifier dans la crise du capitalisme les conditions d'exploitation et de misère pour les travailleurs de tous les pays, la classe ouvrière a répondu internationalement. Toute une série de luttes ouvrières se sont développées depuis 1983 et renforcées depuis 1986, parcourant tous les pays et tous les secteurs. La vague actuelle de luttes constitue une simultanéité de riposte ouvrière aux attaques capitalistes inconnue jusque là dans l'histoire. Dans les pays parmi les plus industrialisés d'Europe occidentale — Belgique, France, Angleterre, Espagne, Suède, Italie —, également aux Etats-Unis, dans les pays de capitalisme moins développé — en particulier en Amérique Latine —, en Europe de l'Est où se manifestent des signes récents d'une reprise de la combativité ouvrière, en Yougoslavie où déferle depuis plusieurs mois une vague de grèves ; partout dans le monde, dans tous les secteurs de l'économie, la classe ouvrière a entamé et va poursuivre le combat contre les attaques des conditions d'existence. La tendance à des mouvements touchant de plus en plus d'ouvriers, dans tous les secteurs, actifs et chômeurs, la tendance au surgissement de mouvements spontanés, au développement de la confiance en soi au sein du prolétariat, à la recherche de la solidarité active, sont présentes, à des degrés divers suivant les moments et les pays, dans les luttes ouvrières actuelles. Elles manifestent une recherche de l'unification dans la classe ouvrière, unification qui constitue le besoin central des luttes dans la période présente.
C'est à enrayer cette tendance à l'unification que s'emploie la bourgeoisie, surtout sur le terrain de la lutte classe par l'intervention des syndicats et du syndicalisme de base qui déploient toutes les tactiques possibles division et de détournement des objectifs et des moyens de lutte :
— contre l'extension des luttes: l'isolement corporatiste, régional;
— contre l'auto organisation : la fausse extension par les syndicats ;
— contre les manifestations unitaires, l'utilisation des divisions syndicales et corporatistes, le trucage des convocations et du calendrier, etc.
Le tout est enveloppé d'un verbiage d'autant plus radical que la méfiance envers les syndicats se transforme de plus en plus en hostilité ouverte parmi les ouvriers et que la combativité est stimulée lorsqu'il y a mobilisation en nombre des travailleurs, dans des assemblées, dans des manifestations.,
«Les luttes de Belgique (printemps 1986) ont souligné la nécessité et la possibilité de mouvements massifs et généralisés dans les pays capitalistes avancés. Les luttes en France (hiver 1986-87) sont venues confirmer la nécessité et la possibilité d'une prise en mains par les ouvriers de leurs combats, de l'auto organisation de ceux- ci en dehors des syndicats, contre eux et leurs manœuvres de sabotage.
Ce sont ces deux aspects inséparables du combat ouvrier qui seront de plus en plus présents dans le mouvement de luttes qui a déjà débuté». (Revue Internationale n° 49, 2e trimestre 1987)
Après la grève des chemins de fer en France et la grève des télécommunications en Grande-Bretagne au début de l’année, les luttes ouvrières en Espagne et en Yougoslavie depuis plusieurs mois, et en ce moment même en Italie, confirment à leur tour les caractéristiques générales de la vague de luttes actuelles. La simultanéité des ripostes et les tendances à prendre en main la lutte face à la stratégie de la gauche, de l’extrème-gauche et des syndicats, confirment le développement d'un potentiel d'unification.
Espagne : divisions syndicales contre unité ouvrière
En Espagne, surtout depuis le mois de février, pas un jour ne se passe sans grèves, assemblées, manifestations : des mines à l'aviation, du secteur de la santé à celui de la sidérurgie, des chantiers navals aux transports, de l'enseignement à la construction. Le très sérieux journal Le Monde constate ainsi : «Nombre de travailleurs semblent désormais persuadés, à tort ou à raison, que descendre dans la rue constitue la seule manière de se faire entendre» (8/5/87). C'est évidemment «à raison» que la classe ouvrière ressent le besoin de descendre dans la rue pour tenter de rechercher la solidarité et l'unité face à la bourgeoisie. Ceci est vrai pour toute la classe ouvrière dans tous les pays. En Espagne, c'est une tradition, héritée en particulier de la période franquiste quand la police interdisait aux ouvriers en grève de rester dans les usines, que de manifester d'usine en usine et de rechercher immédiatement la solidarité. C'est ce qui avait déjà caractérisé les luttes massives de 1975-76 dans ce pays.
Dès le début du mouvement de cette année, des premières tentatives d'unification ont surgi dans certains secteurs de la classe ouvrière : les ouvriers agricoles de la région de Castellon ont multiplié les manifestations entraînant d'autres travailleurs et des chômeurs avec eux ; à Bilbao, les ouvriers de deux usines ont imposé contre l'avis des syndicats une manifestation commune, tout comme l'ont fait aux Canaries les travailleurs du port de Tenerife avec les ouvriers du tabac et les camionneurs. Cependant, malgré ces signes d'une poussée à la solidarité active, en février mars les syndicats parviennent à contenir l'extension et en particulier à isoler le mouvement de 20000 mineurs dans les Asturies au nord du pays : il n'y a dans ce mouvement pratiquement aucune assemblée générale qui se tient ni aucune manifestation organisée. Début avril, il semble que les syndicats vont parvenir à arrêter le mouvement grâce à ce déploiement sans précédent des tactiques de division de tous bords. Commissions Ouvrières, syndicat du PCE, UGT, syndicat du PSOE, CNT, syndicat anarchiste, et toute une kyrielle de syndicats de métier, de branche, y compris des syndicats de base comme la «Coordinadora des dockers des ports» (CEP), s'emploient à diviser par revendications, par secteurs, par régions, etc., à disperser par des arrêts de travail tournants, notamment dans les transports.
En fait, si les manœuvres syndicales parviennent à contenir le potentiel d'unification important qui existe, elles ne parviennent à étouffer la combativité à un endroit que pour la voir immédiatement ressurgir ailleurs. Beaucoup d'arrêts de travail, de courtes grèves, d'initiatives de manifestations, ont lieu hors de toute consigne syndicale et il règne dans de nombreux secteurs une ambiance de conflit larvé. La bourgeoisie, qui ne parvient pas à empêcher les travailleurs d'investir la rue, fait tout pour éviter que ceux-ci ne se rejoignent dans les manifestations et mettent en œuvre une solidarité active entre différents secteurs ; ceci par le jeu des divisions syndicales complété par l'intervention systématique des forces de police là où ces divisions ne suffisent pas. Ainsi, à certains endroits, toutes les énergies sont mobilisées dans les affrontements quasi quotidiens : dans le port de Puerto Real à Cadix, les ouvriers et beaucoup d'éléments de la population qui se joignent à eux, affrontent la police depuis plusieurs semaines ; dans les mines d'El Bierzo, près de Léon dans le nord, alors que le mécontentement se manifeste depuis -le début de l'année, depuis début mai, tous les jours il y a des bagarres avec la police auxquelles est mêlée toute la population. La mort d'un travailleur à Reinosa, zone sidérurgique près de Santander, dans des affrontements particulièrement violents, a une fois de plus tragiquement confirmé le véritable rôle de chien de garde du capitalisme qu'est, au même titre que la «droite», la «gauche» du capital, en l'occurrence le PSOE, parti «socialiste» au gouvernement.
L'engagement dans les affrontements avec la police dans les petites villes industrielles relativement isolées telles que Reinosa et Ponferrada dans le nord du pays, Puerto real dans le sud, montre la profondeur du mécontentement ouvrier, de la combativité et des tendances à s'unifier toutes catégories confondues contre le sort qui est fait aux conditions de vie des travailleurs, et contre l'envoi de la force publique. Cependant, ces affrontements systématiques constituent souvent un piège pour les travailleurs. Toutes les énergies sont mobilisées sur les seuls combats de rue, rituellement orchestrés par la police et par ceux qui, dans les rangs ouvriers, réduisent la question des objectifs et des moyens de la lutte à ces seuls affrontements. Syndicats et organismes de base «radicaux» se partagent le travail pour cette orchestration ; c'est ainsi que depuis plusieurs semaines, à Puerto Real, les combats sont «programmés» le mardi au port et le jeudi en ville ! Ce n'est pas pour rien que les médias en Europe commencent seulement à parler maintenant des événements en Espagne, et seulement sur des bagarres avec la police, alors que les luttes ouvrières se développent depuis plusieurs mois. Dans ces combats isolés contre les forces de l'ordre, les ouvriers ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent qu'épuiser leurs forces au détriment d'une recherche de l'extension, de la solidarité, hors de la région, car seules des luttes massives et unies peuvent faire face à l'appareil d'Etat, à sa police et à ses agents en milieu ouvrier.
Les tendances à l'unité des luttes simultanées, dans des luttes massives et par la prise en charge de celles-ci par les travailleurs eux-mêmes, ne trouvent pas encore leur plein épanouissement dans l'unification de la classe ouvrière. Cependant, les conditions qui ont fait surgir ces tendances — attaques massives et frontales contre la classe ouvrière, maturation de la conscience de classe sur la nécessité de lutter ensemble — sont loin d'être épuisées, ni en Espagne, ni dans aucun autre pays.
Italie : le syndicalisme de base contre la prise en mains des luttes
Les tendances à la prise en mains des luttes par les ouvriers se sont manifestées à plusieurs reprises. C'est en particulier en France, dans la grève des cheminots du début de l'année, que la nécessité et la possibilité de l'auto organisation de la lutte ouvrière ont ressurgi au grand jour. Cette expérience a eu un profond écho dans toute la classe ouvrière internationalement.
Aujourd'hui en Italie, c'est à nouveau ce besoin de la prise en mains des luttes, hors du cadre syndical traditionnel, qui est au premier plan du mouvement qui se développe dans le pays dans de nombreux secteurs : chemins de fer, transports aériens, hôpitaux, et surtout dans l'enseignement. Dans ce dernier secteur, le rejet de la convention acceptée par les syndicats a conduit à une auto organisation en comités de base, d'abord dans 120 écoles de Rome, puis à' l'échelon national. En l'espace de quelques mois, le mouvement est devenu majoritaire par rapport aux syndicats et a organisé trois assemblées nationales à Rome, Florence et Naples de délégués élus par des coordinations provinciales. A l'intérieur du mouvement se sont affrontées essentiellement la tendance à stabiliser les comités en un nouveau syndicat (Unione Comitati di Base, Cobas, majoritaire à Rome) et la tendance «assembléiste», majoritaire aux assemblées nationales, manifestant clairement un profond rejet du syndicalisme qui existe dans toute la classe ouvrière. Pour le moment, ceci s'exprime plus par un rejet généralisé de toute notion de délégué — ce qui laisse le champ plus libre au syndicalisme de base — que par une claire conscience de l'impossibilité de bâtir de nouveaux syndicats. Mais le fait que le syndicalisme, pour garder le contrôle de la mobilisation, soit contraint d'accepter les « comités de base », est significatif du lent dégagement des travailleurs de l'idéologie syndicaliste, et du besoin de prise en charge et d'unité des luttes qu'ils ressentent.
Toujours en Italie, dans les chemins de fer, le mouvement est parti d'une assemblée «autoconvoquée» à Naples qui a donné naissance à une coordination régionale, puis des organes semblables se sont constitués dans d'autres régions, pour former une coordination nationale dans une assemblée à Florence. Le besoin de l'unité s'est exprimé dans le fait que lors d'une manifestation nationale des cheminots à Rome, un tract-appel à lutter ensemble a été distribué par la minorité non syndicale du mouvement des comités de base de l'enseignement. Dans les coordinations des cheminots, dès le début, le poids des gauchistes a été très fort. Democrazia Proletaria (DP, gauche radicale du type PSU en France, mais plus important), a tout de suite essayé de canaliser le mouvement en focalisant l'attention sur le double plan «hors/dans» les syndicats, ramenant les syndicats comme préoccupation du mouvement, et poussant ainsi au second plan la question de l'unité.
La profondeur du processus d'accumulation de multiples expériences ponctuelles et de réflexion dans la classe depuis plusieurs années s'exprime de plus en plus ouvertement : par de courtes grèves «sauvages», comme celle de 4000 travailleurs de la municipalité de Palerme en Sicile ; par des regroupements pour discuter ce qu'il faut faire, comme la tenue d'une assemblée de 120 travailleurs de différentes catégories de la Fonction Publique, en mars à Milan, sur comment s'organiser face à la trahison des syndicats. Face à ce bouillonnement se développe un travail préventif de sape de la part des différentes fractions syndicalistes de base et extrême-gauche du capital. Pour la première fois en Italie, les trotskystes ont joué un rôle, dans l'enseignement. Les libertaires sont sortis de leur torpeur pour réchauffer le cadavre de l'anarcho-syndicalisme. DP fait tout un travail pour transformer les comités de base, organismes prolétariens au départ, en syndicats de base, pour contrôler la manifestation de 40000 travailleurs de l'enseignement à Rome fin mai, en polarisant l'attention sur la reconnaissance des Cobas pour «négocier» avec le gouvernement, au détriment de la jonction avec les autres secteurs qui tendent à se mobiliser.
Cependant, si la bourgeoisie, en battant le rappel de toutes les forces politiques susceptibles d'encadrer la classe ouvrière «à la base», garde le contrôle de la situation d'ensemble, la situation présente en Italie est une illustration de l'affaiblissement historique de la gauche de l'appareil politique de la bourgeoisie face à la classe ouvrière. Le Corriere della Serra, journal tout aussi «sérieux» que Le Monde, constate dans un article intitulé «Malaise incontrôlé»: «La crise des syndicats n'est pas épisodique, mais structurelle (...) ». De son point de vue bourgeois qui ne voit la classe ouvrière que dans les syndicats, il considère de ce fait «caducs les intérêts de classe» ! Mais il affirme aussitôt : «ceci ne signifie pas que les syndicats parviennent à contrôler les manifestations spontanées et centrifuges de franges (rebelles ? sauvages ? égoïstes ?) qui n'entendent pas renoncer à la défense de leurs propres intérêts» ! Et c'est bien pourquoi la bourgeoisie essaie de contrôler les mouvements :
— par le jeu de la radicalisation de la gauche, incapable désormais de se contenter du syndicalisme traditionnel complètement discrédité au yeux des ouvriers les plus combatifs de plus en plus nombreux,
— par les tentatives de jeter le discrédit sur les franges les plus combatives de la classe ouvrière, présentées comme « égoïstes ». Tout ceci ne peut néanmoins cacher la réalité de la montée de la mobilisation, ainsi décrite concassement : «les enseignants bloquent les vacances des hospitaliers qui ne soignent pas les cheminots qui ne transportent pas les employés de banque. Etc. » ! (id.).
Alors que l'Italie avait connu relativement moins que dans d'autres pays des manifestations ouvertes de la vague internationale actuelle de la lutte de classe, les luttes de ce printemps 1987 montrent que la période d'émiettement et de dispersion des luttes a aussi tiré à sa fin dans ce pays. Les attaques renforcées contre la classe ouvrière, la méfiance et le ras-le-bol accumulés vis-à-vis des syndicats, une plus grande confiance en soi des travailleurs sur la possibilité d'agir par eux-mêmes, amènent la classe ouvrière à des actions plus massives et plus décidées.
Le développement de la perspective de l'unification
Les caractéristiques générales des luttes ouvrières actuelles ne se manifestent pas seulement dans les pays industrialisés d'Europe de l'Ouest. Dans les pays de capitalisme moins développé, comme au Mexique (voir le communiqué dans ce numéro), mais aussi dans les pays de l'Est (voir également dans ce numéro), la classe ouvrière montre une combativité montante qui confirme la dimension internationale de la lutte.
En Yougoslavie également : depuis février 1987, une vague de grèves contre de nouvelles mesures gouvernementales sur les salaires (qui ont déjà baissé de 40 % en six ans), a déferlé dans le pays. La mesure consistant à faire rembourser par les travailleurs des augmentations versées depuis plusieurs mois a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ! De 20000 travailleurs à Zagreb au départ, dans l'industrie, les hôpitaux, l'enseignement, les grèves se sont ensuite étendues à la province puis à tout le pays, et à d'autres secteurs tels que les ports, les chantiers, la sidérurgie, et le secteur agricole dans la région de Belgrade. Ce mouvement que la bourgeoisie yougoslave ne parvient pas à juguler depuis trois mois, revêt des caractéristiques d'extension, de combativité et d'initiatives prises directement par les ouvriers. Et cela d'autant plus fortement que les syndicats apparaissent ouvertement comme partie de l'appareil d'Etat, comme dans tous les pays de l'Est. De là une dynamique marquée par une ébullition dans toute la classe, des mouvements décidés hors de toute consigne syndicale, des décisions collectives d'ouvriers de quitter publiquement le syndicat officiel — qui dénonce les grévistes comme «antisocialistes» —, des assemblées nombreuses où se discute et se décide l'action. Et face à cette situation les syndicats demandent une autonomie vis-à-vis du gouvernement afin de tenter de reprendre une emprise sur la classe ouvrière.
Dans tous ces événements, c'est la question de l'unification des luttes, de l'unité d'action et de la prise en mains des luttes qui se précise aussi bien en Espagne qu'en Italie, qu'en Yougoslavie. Dans les autres pays d'Europe de l'Ouest également, la classe ouvrière est loin d'être restée passive. En Belgique, les mineurs du Limbourg, qui avaient démarré le mouvement du printemps 1986 marquant le début de la nouvelle accélération dans la vague actuelle de lutte de classe, sont à nouveau repartis en lutte, dans un contexte de regain de combativité marqué par des grèves courtes dans plusieurs secteurs, après l'accalmie relative qui avait suivi le mouvement de l'an dernier. En Hollande, après que les dockers de Rotterdam aient été enfermés dans une «grève surprise» syndicale début mars, les travailleurs de la municipalité d'Amsterdam entamèrent une grève qui s'est étendue en deux jours à toute la capitale. Les syndicats avaient préparé le même scénario que pour le port de Rotterdam, mais les travailleurs ont démarré rapidement et simultanément la grève avec la menace de l'étendre aux postiers et aux chemins de fer, et ont refusé les «actions surprises» des syndicats. Cependant, sans trouver une alternative aux syndicats et avec le retrait rapide par la bourgeoisie de ses plans, les ouvriers ont alors repris le travail. Néanmoins, ce bref mouvement a marqué un changement dans le «climat social» dans le pays et approfondi la perspective du développement de luttes contre les mesures de plus en plus draconiennes que prend la bourgeoisie. En Allemagne également, face aux plans de licenciements de dizaines de milliers de travailleurs, en particulier dans la Ruhr, quelques manifestations dont une conjointe entre ouvriers de l'industrie et travailleurs municipaux, ont déjà montré que même dans ce pays où la mobilisation ouvrière est en retard par rapport à d'autres pays, des luttes ne vont pas manquer de se développer avec la plongée dans la récession de l'économie mondiale qui n'épargnera pas l'Allemagne et ses conséquences pour la classe ouvrière.
Comités de lutte : une tendance générale au regroupement des ouvriers combatifs
Particulièrement significative de la maturation qui s'opère aujourd'hui dans la classe ouvrière est l'apparition encore embryonnaire de comités de lutte, regroupant des ouvriers combatifs autour des problèmes posés par la nécessité de lutter, de préparer la lutte, ceci hors des structures syndicales traditionnelles.
Dès le printemps 1986 en Belgique, un comité s'était constitué dans les mines du Limbourg, prenant l'initiative d'envoyer des délégations pour impulser l'extension (à l'usine Ford de Gand, aux meetings de Bruxelles) ; à Charleroi également, des cheminots s'étaient regroupés pour envoyer des délégations dans d'autres gares et dans d'autres secteurs de la région comme les transports urbains ; à Bruxelles, une coordination d'enseignants (Malibran) s'était également formée, regroupant des non-syndiqués et des syndiqués avec comme perspective de «combattre la division dans les luttes». Ces comités, surgis avec la lutte du printemps 1986, ont finalement disparu avec le recul du mouvement, après avoir été progressivement vidés de leur vie ouvrière et repris en main par les syndicalistes de base.
De tels regroupements n'apparaissent pas seulement comme fruit d'une lutte ouverte. Dans une lutte ouverte ils tendent à grouper un plus grand nombre de participants, à d'autres moments ils regroupent de plus petites minorités d'ouvriers. En Italie, il existe par exemple à Naples depuis plusieurs mois un comité d'éboueurs et un comité d'hospitaliers. Ce dernier, composé d'une petite minorité de travailleurs, se réunit régulièrement et est intervenu par tracts, affiches, prises de parole dans les assemblées convoquées par les syndicats, pour l'extension, contre les propositions syndicales. Il a rencontré un écho important dans le secteur (depuis, les syndicats ne convoquent plus d'assemblées dans l'hôpital !) et même au-delà parmi des cheminots. En France aussi des comités ont surgi. Au début de l'année, les syndicats ont tout fait pour essayer d'entraîner toute la classe ouvrière dans la défaite des cheminots, en organisant une extension bidon sous la houlette de la CGT — qui n'avait cessé de condamner la grève pendant la montée de celle-ci. Face à ce sabotage, des ouvriers du gaz électricité, puis des postes, ont constitué des comités pour tirer les leçons de la lutte des cheminots, établir des contacts entre les différents lieux de travail, se préparer pour les prochaines luttes.
Même si ces premières expériences de comités de lutte en sont à leur début, même si ces comités ne parviennent pas encore à se maintenir longtemps et fluctuent fortement en fonction des événements, ceci ne veut pas dire que ce ne sont que des phénomènes éphémères liés à une situation particulière. Au contraire, ils vont tendre à se multiplier parce qu'ils correspondent à un besoin profond dans la classe ouvrière. Dans le processus vers l'unification des luttes, c'est une nécessité que les travailleurs combatifs, convaincus du besoin de l'unité dans la lutte, se regroupent :
— pour, au sein des luttes, défendre la nécessité de l'extension et de l'unification des combats,
— pour y montrer la nécessité des assemblées générales souveraines et des comités de grève et coordinations élus et révocables par les assemblées,
— pour mener en leur sein, y compris en dehors des moments de lutte ouverte, la discussion et la réflexion la plus large, dans le sens de tirer les leçons des luttes précédentes et préparer les luttes à venir,
— pour être des lieux de regroupements, ouverts à tous les ouvriers désirant y participer, quels que soient leur secteur et leur éventuelle appartenance individuelle à un syndicat.
De tels regroupements n'ont donc pas pour vocation de constituer des groupes politiques, définis par une plateforme de principes, et ils ne sont donc pas non plus des organes unitaires englobant l'ensemble des travailleurs (assemblées générales d'actifs et de chômeurs, comités élus et révocables devant les assemblées) ; ils regroupent des minorités d'ouvriers et ne sont pas des délégations des organes unitaires.
En 1985, avec une relative dispersion des luttes, la méfiance grandissante envers les syndicats avait entraîné beaucoup de travailleurs à rester dans l'expectative, écœurés des manœuvres syndicales, et passifs vis-à-vis de l'action. L'accélération de la lutte de classe en 1986 a été marquée non seulement par les tendances à des luttes plus massives et à la prise en charge de celles-ci par les travailleurs, mais également par des tentatives plus nombreuses de la part de minorités combatives dans la classe, de se regrouper pour agir dans la situation. Les premières expériences de comités de lutte correspondent à cette dynamique : une plus grande détermination et confiance en soi, qui va se développer de plus en plus dans la classe ouvrière, et amener des regroupements de travailleurs sur le terrain de la lutte, hors du cadre syndical. Et ce n'est pas seulement une possibilité, mais une nécessité impérieuse pour développer la capacité de la classe ouvrière à trouver son unité, contre les manœuvres qui visent à enrayer le processus d'unification du prolétariat,
Cela, la bourgeoisie l'a bien compris. Le principal danger qui guette les comités de lutte est celui du syndicalisme. Les syndicalistes et gauchistes se font aujourd'hui les promoteurs de «comités de lutte». En y introduisant critères d'appartenance, plate-forme, voire cartes d'adhésion, ils ne font que tenter de recréer une variante de syndicalisme. En les maintenant dans le cadre corporatiste et les autoproclamant «représentatifs», alors qu'ils ne sont que l'émanation de ceux qui y participent et non d'assemblées de l'ensemble des ouvriers, ils les ramènent également sur le terrain du syndicalisme. Par exemple, dans le Limbourg en Belgique, les maoïstes réussirent à dénaturer la réalité du comité de lutte des mineurs en le proclamant «comité de grève» et le transformant ainsi en obstacle à la tenue d'assemblées générales de tous les travailleurs. En France des militants de la CNT (anarcho-syndicaliste) et des éléments venant de l'ex-PCI-Programme Communiste (aujourd'hui disparu en France), ont tenté une opération de récupération des comités des postiers et du gaz électricité. Ils proposèrent une plate-forme d'adhésion «pour un renouveau du syndicalisme de classe», reproduisant de façon «radicale» les mêmes objectifs et moyens que n'importe quel syndicat. Et contre le principe défendu par le CCI de la nécessaire ouverture à tout ouvrier désirant participer, un élément de la CNT opposa même le «danger de voir dans ces comités trop d'ouvriers "incontrôlés"» !.
Malgré les difficultés qu'il y a à constituer et faire vivre de tels groupes ouvriers, malgré le danger constant qu'ils soient tués dans l'œuf par le syndicalisme de base, les comités de lutte seront partie intégrante du processus de constitution du prolétariat en classe unie, autonome, indépendante de toutes les autres classes de la société. Tout comme l'extension et l'auto organisation de la lutte, le soutien et l'impulsion de tels comités doivent être défendus par les groupes révolutionnaires : leur développement est une condition de l'unification des luttes ouvrières.
MG. 31/5/87
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Où en est la crise économique ? : Crise et lutte de classe dans les pays de l'est
- 3081 reads
Récession, inflation, endettement, misère accrue pour la classe ouvrière : comme à l’Ouest, la crise se développe en force au sein du bloc de l’Est les vieilles rengaines staliniennes et trotskystes sur la nature «socialiste» des pays ou de certains pays du bloc russe, sur L’absence de crise, succombent sous l’évidence des faits. Non seulement la crise à l’Est, étant donné le relatif sous-développement de l’économie, prend une forme particulièrement brutale, mais le développement de la lutte de classe montre clairement la nature anti-ouvrière, bourgeoise, de ces régimes. La crise économique et sociale qu'ils subissent montrent qu'ils sont partie intégrante du capitalisme mondial
Dans le précédent numéro de la Revue Internationale du CCI (n° 49), la rubrique régulière sur la crise économique a été consacrée à la crise en URSS ; dans ce numéro nous continuons notre état des lieux du bloc de l’Est en traitant des autres pays d'Europe intégrés au COMECON. ([1] [1132])
La faiblesse économique du bloc de l'Est
Les six pays européens du bloc de l'Est : RDA, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie constituent après l'URSS les pays les plus puissants économiquement de ce bloc. Cela permet de constater sa faiblesse profonde vis-à-vis de son rival occidental : le PNB global des 6 pays d'Europe de l'Est, égal en 1984 à 507 milliards de dollars, est à peine supérieur à celui de la France la même année : 496 milliards de dollars, et bien inférieur à celui de la RFA : 616 milliards de dollars ?
|
|
PNB 1984 |
PNB/habitant |
|
|
(milliards de dollars) |
(dollars) |
|
RDA |
145 |
8680 |
|
POLOGNE |
160 |
4370 |
|
TCHECOSLOVAQUIE |
100 |
6485 |
|
HONGRIE |
20 |
1902 |
|
BULGARIE |
43 |
4790 |
|
ROUMANIE |
39 |
1750 |
|
URSS |
500 |
5500 |
L'ensemble des pays du COMECON (avec le Vietnam et Cuba) totalise un PNB de 2020 milliards de dollars, ce qui est bien peu en comparaison de l'alliance économique rivale regroupée au sein de l'OCDE qui avec ses 8193,4 milliards de dollars, totalise quatre fois plus. A eux seuls, les pays de la CEE en 1984 représentaient un PNB de 2364 milliards de dollars, encore bien supérieur à celui du COMECON dans son ensemble.
Et encore faut-il relativiser les chiffres en provenance d'Europe de l'Est car ceux-ci selon certaines études ([2] [1133]), sont pour les besoins de la propagande et à cause d'un mode de comptabilité bien différent, surestimés de 25 à 30%, à l'exception toutefois de la Hongrie qui appartient au FMI et qui, pour pouvoir accéder aux crédits pour pays pauvres, diminue volontairement de 50 % ses estimations !
Ce n'est donc certainement pas sur le plan économique que le bloc de l'Est peut faire le poids face à son concurrent occidental. La seule issue pour l'URSS, afin de maintenir l'indépendance et l'unité de son bloc impérialiste, est de soumettre de manière draconienne le potentiel économique de celui-ci aux besoins de son économie de guerre. La production d'armements, nécessaire au renforcement de son potentiel militaire, est le seul plan sur lequel il peut concurrencer et s'opposer à la puissance du bloc adverse. Cette réalité détermine profondément la situation économique des pays d'Europe de l'Est depuis qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, l'avancée de l'armée rouge et les accords de Yalta ont scellé leur soumission aux besoins de l'impérialisme russe.
Les pays d'Europe de l'Est ont payé très cher dans leur développement leur intégration au bloc russe. La réalité est bien différente de celle que voudraient faire croire les taux de croissance ronflants que nous servent les économistes staliniens depuis des décennies.
Le démantèlement des usines les plus compétitives pour en envoyer les machines en URSS au lendemain de la guerre, la réorientation à 180 degrés vers l'Est de toutes les voies de communication et des circuits d'échange traditionnels , la «collectivisation» forcée, le pillage systématique et l'imposition d'une division internationale de la production au sein du bloc pour les besoins de l'économie de guerre russe ont pesé très lourdement sur la croissance réelle de l'économie des pays d'Europe de l'Est. Sur ce plan, la Tchécoslovaquie est un cas tout à fait exemplaire : en 1963 le niveau de la production agricole était encore inférieur à celui de 1938, mais c'est surtout sur le plan industriel que cette dégradation est la plus nette, pour le pays qui avant la seconde guerre mondiale était connu pour la qualité de ses produits. Ainsi, en 1980, un Institut tchèque a réalisé une étude sur 196 produits portant le label «1re qualité» et destinés à l'exportation ; 113 étaient invendables à l'ouest car ils ne correspondaient pas aux critères de qualité requis. Les dirigeants russes eux-mêmes ont élevé une protestation officielle à propos de la mauvaise qualité des produits que l'URSS importe de Tchécoslovaquie.
|
|
Consommation énergétique (*) |
Consommation d'énergie par unité de PNB |
|
RDA |
86 |
0,61 |
|
POLOGNE |
114 |
0,71 |
|
TCHECOSLOVAQUIE |
69 |
0,69 |
|
HONGRIE |
28 |
1,35 |
|
BULGARIE |
37 |
0,90 |
|
ROUMANIE |
70 |
1,57 |
(*) millions de tonnes équivalent pétrole
La croissance industrielle des pays d'Europe de l'Est s'est faite sur la base d'une perte de qualité des produits, d'un retard technologique croissant qui se caractérise par le fait que l'essentiel des marchandises produites est considéré comme périmé selon les standards du commerce international et donc invendable sur le marché mondial en dehors du COMECON. Ce retard technologique pris par la production dans les pays d'Europe de l'Est ne se manifeste pas seulement par l'obsolescence de l'appareil productif (machines-outils périmées, recours abondant à la main-d'œuvre pour pallier le retard pris dans l'automatisation) et de ce qui est produit, mais aussi dans le gaspillage énergétique nécessaire à cette production.
Si l'on considère l'énergie nécessaire à la production d'une unité de PNB, le pays le plus compétitif d'Europe de l'Est arrive péniblement au niveau du Portugal (0,60), derrière la Grèce (0,54) et loin derrière la RFA (0,38) ou la France (0,36). Et encore faut-il considérer ces chiffres à la lumière de ce que nous avons dit auparavant sur l'estimation du PNB, c'est-à-dire les majorer de 25 à 30%. Cela traduit parfaitement le retard industriel inacceptable accumulé par les pays de l'Est durant les décennies de «croissance» de l'après-guerre par rapport à leurs concurrents ouest européens. Le développement des pays de l'Est depuis la deuxième guerre mondiale s'est fait dans une situation de crise permanente.
Convulsions de la crise du capital et réactions ouvrières
La crise, depuis la fin des années 60, a pris à l'Est des formes moins «dynamiques» et spectaculaires qu'à l'Ouest qui constitue l'épicentre de la surproduction généralisée. Dans les années 70, la crise a été marquée en Europe de l'Est par un ralentissement général de la croissance, et pour les pays les plus faibles (Pologne, Roumanie), par un endettement croissant en vue de tenter de moderniser une économie encore largement marquée par un important secteur agricole arriéré. L'accélération de la crise dans les années 80 va avoir de graves conséquences pour l'ensemble des pays d'Europe de l'Est : la chute des échanges Est-ouest, l'épuisement des sources de crédit, la chute des cours des matières premières, l'effondrement du marché du «Tiers-monde», et la concurrence exacerbée sur le marché mondial, l'intensification de la course aux armements menacent d'étrangler l'économie du COMECON.
Les attaques de la bourgeoisie contre les conditions de vie de la classe ouvrière déjà très difficiles se font chaque jour plus aiguës. Le mécontentement croît et l'écho des luttes ouvrières commence à percer le mur du silence qu'impose la bourgeoisie stalinienne.
Roumanie
Après avoir été en cessation de paiement en 1981, la Roumanie a vécu au rythme du remboursement accéléré de la dette passée de 9,9 milliards de dollars en 1981 à 6,5 fin 1985. Pour aboutir à ce résultat, un rationnement brutal et une intensification violente de l'exploitation ont été imposés à la population.
En deux ans (1984-85), la consommation d'électricité des familles a été diminuée de moitié pour aboutir à ce résultat : limitation du chauffage à 12° dans les maisons et les bureaux, interdiction d'utiliser des ampoules de plus de 15 watts, programmes de télévision ramenés à deux heures par jour. La liste des rassures bureaucratiques imposées par la terreur policière n'a pas de fin : interdiction de circulation des voitures privées à Bucarest pour économiser l'essence, rationnement drastique des produits alimentaires pour diminuer les importations et stimuler les exportations ; fin 86, face à la crise du logement, Ceausescu a demandé aux vieux retraités de Bucarest de déménager à la campagne ; devant la résistance de la population, il a annoncé durant l'été que «certaines catégories» de retraités se verraient refuser leur traitement médical s'ils ne déménageaient pas.
Symptômes soigneusement cachés par la bourgeoisie, la mortalité augmente et la famine gagne. En décembre 85, des paysans affamés du Banat ont tenté de s'emparer des silos à blé, témoignant du mécontentement profond de la population.
Les ouvriers sont soumis à une exploitation forcenée : suppression du salaire garanti en septembre 1983, obligation décrétée en juin 85, pour ceux qui n'auraient pas fait don d'une journée de travail, de dédommager l'Etat en espèces. Les «accidents» du travail se sont multipliés dans les mines et le grand chantier de la canalisation de la Volga a coûté des centaines de vies ouvrières.
Le mécontentement de la classe ouvrière s'est concrétisé dans les grèves qui ont duré plusieurs mois dans les mines de charbon et dans l'industrie pétrochimique en 1983-84. La répression a été brutale et sanglante, la militarisation du travail a été imposée dans ces secteurs ; cette mesure a été étendue en octobre 85 aux ouvriers des centrales qui produisent l'électricité. Des grèves éparses ont éclaté en novembre 1986 dans plusieurs villes de Transylvanie, contre le nouveau système de salaire. Au début de Tannée 1987, des tracts circulaient à Bucarest appelant à la grève générale pour renverser Ceausescu.
Pologne
L'économie polonaise s'enfonce dans l'abîme. Le revenu national a baissé de 30 % entre 1978 et 1982 ; il reste encore officiellement inférieur de 10 % à celui de 1979. Les taux de croissance positifs annoncés depuis 1983 sont à relativiser : par exemple, en 1983, le taux de croissance officiel annoncé est de 5,9 % mais il est estimé à seulement -0,7 % par l'OCDE. L'économie polonaise est en pleine récession.
La chute des cours du charbon (dont la Pologne est le 3e exportateur mondial) de - 25 % en 1986 et l'empoisonnement de la récolte par les retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl ont de graves conséquences sur les exportations qui ont déjà chuté vis à vis de l'Occident de 3,8 % en 1985. Malgré des dévaluations successives du zloty, la monnaie nationale (plus de 30 % de dévaluation en 1984-85), pour renforcer la compétitivité des exportations, et une diminution drastique des importations, l'excédent commercial dégagé n'est même pas suffisant pour payer le service de la dette et celle-ci s'accroît allègrement : elle est passée de 29,5 milliards de dollars en 1985 à 33,4 en 1986 et vole vers les 35 en 1987.
L'inflation fait rage et les augmentations des prix se succèdent en cascade : en mars 86, les biens alimentaires essentiels sont devenus 8 % plus chers, le prix des autobus et des transports a grimpé de -66 % ; le 7 avril 86, le gaz et l'électricité ont augmenté de -80 % ; en août, c'est au tour de la viande : S %. Entre 1982 et 1986, le prix du pain a explosé de 3 à 28 zlotys.
Dans le même mouvement, les salaires ont été attaqués avec la réforme sur la «nouvelle autonomie des entreprises». Le travail le week-end, annulé par les accords d'août 80, a été rétabli dans les secteurs «vitaux» tels les mines. Avec l'intensification de l’exploitation, les normes de sécurité ne sont plus respectées et les accidents du travail se sont multipliés.
Face au mécontentement qui gronde, le gouvernement Jaruzelski a fait siennes les orientations de Gorbatchev : après la répression, les amnisties se sont succédées et la bourgeoisie essaie de présenter un visage plus libéral, Solidarnosc est toléré ; mais tout cela, c'est pour mieux faire accepter les attaques contre la classe ouvrière.
Bulgarie
La Bulgarie elle aussi est touchée par la récession. Si les estimations officielles de la croissance du PNB se situent à 4 % en 1982 et à 3 % en 1983, l'OCDE quant à elle les estime plus justement, respectivement pour ces deux années là, à : - 0,7 % et -0,2 %. En 1985, la production agricole a reculé de - 10 % et celle d'électricité de - 7 %, au lieu des 4,1 % prévus. La croissance a officiellement été revue à la baisse : 1,8 % finalement, le taux le plus bas depuis la guerre. Les hausses de prix s'accélèrent : en septembre 85, l'électricité a été augmentée de 41 % pour les ménages, l'essence de 35 %...
Pour économiser l'électricité, les coupures de courant se sont multipliées et le rationnement a été imposé : consommation électrique ramenée à 350 KWh par mois et par ménage là où un chauffage collectif existe, à 1100 KWh là où il n'existe pas, toujours dans le même but ; la fermeture des magasins a été avancée de deux heures, l'éclairage limité à des ampoules de 60 W dans les salons et de 45 W dans les autres pièces. En cas de désobéissance, c'est la coupure d'électricité.
Le mécontentement gronde et la bourgeoisie essaie de le dévier sur la question des minorités nationales en réprimant sauvagement la minorité turque pour en faire un bouc émissaire et renforcer le nationalisme. L'écho encore à confirmer de grèves durant l'hiver 86-87 est venu percer le black-out.
Hongrie
Vitrine libérale de l'Europe de l'Est, la Hongrie elle aussi s'enfonce de manière accélérée dans la crise. La croissance officiellement de -0,3 % en 83, de 2,8 % en 1984 a rechuté à 0,6 % en 1985 et il semble bien qu'elle soit inférieure à 1 % en 1986.
En 1986, les exportations vers l'Ouest ont stagné et l'année 1987 s'annonce mal ; alors que la Hongrie est essentiellement un exportateur agricole, les retombées de Tchernobyl ont rendu sa récolte invendable à l'Ouest tandis que l'entrée de l'Espagne dans le Marché Commun vient de lui rétrécir son principal marché occidental : la CEE.
Le taux d'inflation officiel est de 7 %. Les augmentations de prix tombent en cascade ; en 1985 les transports ont augmenté de 100 % ; les tarifs des postes de 85 % et la tendance s'est accélérée en 1986, rognant constamment le niveau de vie des ouvriers et des retraités.
L'attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière se fait de plus en plus vive ; en décembre 86, le conseil des ministres appelle à un gel des salaires de base, de nouveaux critères de qualité et de rendement qui diminuent les primes sont imposés. Les ouvriers ne peuvent maintenir leur niveau de vie qu'en cumulant des emplois et en doublant leur temps de travail.
Le modèle hongrois au niveau de consommation relativement haut a été une exception en Europe de l'Est qui atteint aujourd'hui ses limites, une chimère basée sur un endettement par tête vis à vis de l'Ouest plus élevé que celui de Pologne. Les attaques contre la classe ouvrière ne peuvent aller qu'en s'intensifiant, ce qui va exacerber le mécontentement croissant de la population. Les grèves de mineurs, dans la région de Tababanya, sont significatives de la tendance de la classe ouvrière en Hongrie à reprendre le chemin du combat de classe.
Tchécoslovaquie et RDA
La Tchécoslovaquie et la RDA sont les pays de l'Europe de l'Est les plus développés industriellement et qui ont le mieux résisté aux effets dévastateurs de la crise. Cependant, les signes de la crise qui les secoue, se font de plus en plus nets : la croissance stagne et la récession s'annonce. Pour la RDA la croissance officielle de 2,5 % en 1982 et de 4,4 % en 1983 est revue à la baisse par l'OCDE : respectivement 0,2 % et 0,8 %. le taux officiel de 4,8 % en 1985 est profondément surévalué. De même, en Tchécoslovaquie, les taux officiels de 0 % en 1982 et de 1,5 % en 1983, ce dernier taux revu à la baisse à 0,1 % par l'OCDE, montrent qu'en fait ce pays plus faible que la RDA a entamé la récession.
Si ces deux pays ont jusqu'à présent relativement bien défendu leurs exportations sur le marché mondial, l'avenir est cependant sombre étant donnée la perspective de rétrécissement du marché ouest-européen lui aussi touché par la crise et qui reste le principal domaine d'exportation en Occident pour ces deux pays. La Tchécoslovaquie dont la production de produits manufacturés est de plus en plus périmée et inexportable, n'a pu rétablir sa balance commerciale qu'en vendant de plus en plus de produits semi-finis à moins faible valeur ajoutée.
L'endettement, croissant de la RDA vis à vis de l'Occident : 13 milliards de dollars en 1985, et de la Tchécoslovaquie vis à vis de l'URSS : 15 milliards de couronnes, pèse lourdement sur ces deux pays et le redressement des comptes implique à terme une attaque renforcée contre les conditions de vie des travailleurs.
Le niveau de vie en RDA et en Tchécoslovaquie est le plus élevé d'Europe de l'Est ; le PNB par habitant était respectivement de 8680 dollars et de 6485 dollars en 1984, soit des niveaux comparables à ceux de l'Autriche (8685) ou de l'Italie (6190). Cette situation « privilégiée » sur le plan du bien-être matériel en Europe de l'Est, conjuguée avec un quadrillage militaire et policier, a permis jusqu'à présent de maintenir un relatif calme social.
Cependant, ce constat reste à relativiser :
— sur le plan du niveau de vie, pour comparer réellement avec l'Ouest, il faut diminuer les chiffres du PNB de 25 à 30 %. De plus, le PNB calcule la production et non la consommation, et ne tient pas compte de la cherté et de la mauvaise qualité des produits de consommation, ni du cadre militarisé d'une tristesse qu'aucun indice ne saurait mesurer. 150 allemands de l'Est passent clandestinement à l'Ouest chaque jour, 50 000 par an pour fuir le pays qui a le « meilleur » niveau de vie de toute l'Europe de l'Est.
— la perspective est à la dégradation économique, non seulement pour la Tchécoslovaquie, mais aussi pour la RDA qui a jusqu'à présent le mieux résisté. Les attaques contre la classe ouvrière vont en s'accroissant. Le dernier congrès du parti en RDA a annoncé 1 million de licenciements. Cela ne va pas créer du chômage étant donnée la pénurie chronique de main-d'œuvre et la réembauche obligatoire, mais cela permet d'imposer aux ouvriers des emplois moins bien rémunérés. Là encore, le cumul des emplois, le travail parallèle, est le seul moyen pour les ouvriers de maintenir leur niveau de vie. Le mécontentement croît et même s'il s'exprime encore de manière mystifiée, par les campagnes « d'opposition » démocratique et religieuse, il est significatif des futures luttes de classe à venir.
Comme le reste du capitalisme mondial, l'Europe de l'Est s'enfonce inexorablement dans la crise. Comme à l'Ouest, les attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière se font de plus en plus drastiques ramenant le niveau de vie de la classe ouvrière vers celui des années noires de l'après-guerre et de la guerre.
Le mécontentement partout s'accroît, et peu à peu s'impose à l'Est l'écho de la lutte de classe. Avec retard et difficulté, le prolétariat d’Europe de l'Est tend à s'intégrer dans la reprise internationale de la lutte de classe. C'est pour faire face à cette perspective que la bourgeoisie russe, sous l'impulsion de Gorbatchev, essaie d'imposer une fausse libéralisation afin d'utiliser au mieux les mystifications démocratiques, religieuses et nationalistes en vue de briser l'élan naissant de la lutte de classe. Cependant, l'expérience encore récente de la répression en Pologne est là pour montrer aux ouvriers le mensonge du cours nouveau de la propagande stalinienne à la sauce Gorbatchev. En Pologne, le difficile processus de tirer les leçons est en train de se faire ; cela prend souvent la forme de l'affirmation des luttes défensives sur le terrain de classe contre les «aventures politiques» de Solidarnosc et sa collaboration avec Jaruzelski. Aujourd'hui, Walesa est ouvertement contesté et critiqué. Si la classe ouvrière en Pologne a subi une défaite, pour autant son potentiel de combativité est encore très fort et les expériences répétées de 1970-76-80 sont un gage de la capacité du prolétariat polonais à développer ses luttes dans le futur.
La perspective du développement des luttes en Europe de l'Est, faisant écho à celles qui se mènent à l'Ouest, va poser de plus en plus la question de l'internationalisme prolétarien et de la solidarité ouvrière par-delà la division du monde en deux blocs militaires antagonistes, notamment avec le développement de ces luttes dans les pays plus développés, la Tchécoslovaquie et surtout la RDA, en contact direct avec les grandes concentrations industrielles d'Europe de l'Ouest.
JJ. 29/05/87
[1] [1134] Nous ne traitons pas dans ces articles des racines historiques du capitalisme russe et de son histoire qui déterminent les caractéristiques présentes qui sont celles du bloc russe avec ses spécificités ; pour cela, nous renvoyons nos lecteurs à d'autres textes publiés précédemment par le CCI, parmi d'autres la brochure «La décadence du capitalisme», l'article «La crise dans les pays de l'Est» (Revue Internationale n° 23).
[2] [1135] «The Soviet Union and Eastern Europe in the World Economy», P. Marer
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : le développement de la vie politique et des luttes ouvrières au Mexique
- 2705 reads
Le capitalisme est un tout. La crise chronique du capitalisme touche tous les pays du monde. Partout les gouvernements aux abois ont recours à la même politique, aux mêmes mesures : attaque forcenée et frontale contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Partout la classe ouvrière riposte en s'engageant dans la lutte pour la défense de ses intérêts vitaux et partout la lutte prend de plus en plus un caractère massif. Et partout aussi les ouvriers se trouvent face à un ennemi qui a raffiné sa stratégie : le gouvernement attaque de front, pendant que la «gauche», les syndicats et les gauchistes se chargent de saboter les luttes de l'intérieur, briser et diviser l'unité ouvrière et s'emploient, avec un langage «radical», à dévoyer les luttes dans des impasses, assurant leurs défaites.
A l’encontre des divagations de tous les pessimistes et les déçus pour ce qui concerne la classe ouvrière et sa combativité, de ceux qui la cherchent sur la «Banquise» où ils se trouvent eux-mêmes (les modernistes) ou encore ceux qui, comme le GCI, passent leur temps à se plaindre de la classe ouvrière qu'ils voient toujours «passive et amorphe», les nouvelles qui nous arrivent du Mexique viennent leur porter un démenti et confirmer pleinement nos analyses sur le développement de la 3e vague de luttes qui atteint aussi bien les pays de l'Amérique Latine que ceux d'Europe.
Nous publions ci-dessous des extraits d'un communiqué adressé à tous les ouvriers et à tous les groupes révolutionnaires du monde par le «Collectif Communiste Alptraum» (CCA) sur les dernières luttes au Mexique. Ce groupe est peu connu en Europe. Aussi estimons-nous nécessaire de donner à nos lecteurs quelques informations à son sujet. Le CCA s'est constitué au début des années 1980 comme un groupe marxiste d'étude et de discussions. Sa trajectoire a été une évolution lente et hésitante à devenir pleinement un groupe d'intervention politique. Cette évolution lente n'est pas seulement due à des «hésitations» devant les difficultés venant de l'ambiance politique pourrie qui règne au Mexique mais est, d'une certaine manière, le témoignage du sérieux, du sens des responsabilités de ces camarades cherchant à s'assurer un fondement théorique politique solide avant de se lancer dans une activité publique. Dans ce sens, c'est une leçon salutaire pour tant de petits groupes qui se laissent enivrer imprudemment par le seul goût de l'«action pratique», courant toujours le risque d'une vie éphémère et se perdant souvent dans la superficialité et la confusion.
Depuis 1986, le CCA — avec lequel nous sommes en étroite relation (voir Revue Internationale n° 40 et 44) — devenu un groupe politique à part entière, publie régulièrement la revue Comunismo avec un contenu aussi intéressant que sérieux. Nous sommes certains que les lecteurs liront avec un grand intérêt ce communiqué sur la situation au Mexique et la lutte ouvrière qui s'y développe. Intégrant la situation au Mexique dans le contexte international, l'analyse que fait le CCA emprunte la même démarche et tire les mêmes conclusions que nous.
Nous saluons le CCA, non seulement pour le contenu juste de ce communiqué mais également pour le souci qui les a guidés en l'adressant pour information aux révolutionnaires et aux ouvriers de tous les pays.
Simultanément au communiqué du CCA nous recevons du Mexique le premier numéro de la revue Revolucion mundial publiée par le Grupo Proletario Internacionalista (GPI). Le GPI a été constitué définitivement en décembre 1986 par un certain nombre d'éléments qui ont parcouru un «pénible et long processus de décantation politique». C'est un groupe d'éléments solidement formés politiquement et foncièrement militants. La place nous manque dans ce numéro pour donner une plus ample information sur ce nouveau groupe et sur ses positions, nous ne manquerons pas dans notre prochain numéro de reproduire de larges extraits de leurs travaux théoriques et prises de positions politiques. Pour le moment nous nous contenterons de donner l'extrait suivant de la présentation de leur revue :
«C'est dans cette situation de "croisée des chemins" historique et sous l'influence politique de la propagande communiste qu'est né le Grupo Proletario Internacionalista. C'est aussi dans ce cadre que voit le jour "Revolucion Mundial". Cette publication est le produit d'un pénible et long processus de décantation politique d'une période dédiée fondamentalement à la discussion, à la clarification, d'effort de rupture avec tout type de pratiques et influences bourgeoises ».
Nous ne pouvons qu'exprimer notre grande satisfaction de voir les rangs révolutionnaires se renforcer avec la venue au jour de ce nouveau groupe communiste. Avec la venue de ce groupe s'ouvre une perspective, après les nécessaires discussions et confrontations des positions, d'un processus de regroupement des forces révolutionnaires au Mexique dont l'importance et l'impact dépasseront largement les frontières de ce pays. Nous en sommes convaincus et ferons tout notre possible pour aider ce processus à se conclure positivement.
Nos chaleureuses salutations communistes au Grupo Proletario Internacionalista.
Le CCI
A TOUTES LES ORGANISATIONS REVOLUTIONNAIRES DANS LE MONDE AU PROLETARIAT INTERNATIONAL
COMUNISMO (MEXICO)
(...) La misère croissante du prolétariat est devenue palpable avec la réduction et la liquidation des «programmes sociaux» de l'Etat, principalement dans les aires centrales du capitalisme ; avec la croissance accélérée de l'armée de réserve industrielle surtout en Europe, avec l'augmentation du taux d'exploitation dans toutes les aires capitalistes qui, dans le cas des pays de la périphérie, se combinent avec de très hauts taux d'inflation et rendent encore plus pénible l'existence du prolétariat.
(...) Le prolétariat mexicain n'a pas fait exception; La fraction mexicaine de la bourgeoisie mondiale a appliqué les mesures nécessaires pour maintenir les intérêts du capital mondial dans son ensemble.
(...) Au cours des trois dernières années, l'Etat a fermé des entreprises dans les secteurs de la sidérurgie, des transports et communications, des docks, des automotrices, des engrais, du sucre, ainsi que du secteur de l'administration centrale. Les subventions d'Etat à l'alimentation de base ont été suspendues et les dépenses pour l'éducation et la santé ont été fortement diminuées.
Une des mesures prises par l'Etat et appliquée de manière générale a été celle de maintenir les augmentations de salaire de tous les travailleurs en dessous du niveau de l'inflation et faire que les salaires accordés dans les contrats collectifs de travail soient toujours plus près du minimum légal. Pour donner une idée générale de la situation du prolétariat au Mexique, nous indiquerons quelques chiffres des statistiques bourgeoises :
— 6 millions de chômeurs, soit 19 % de la population active ;
— 4 millions de «sous-emplois» ;
— le salaire minimum légal est passé de 120 dollars par mois en 1985 à 87 dollars par mois en 1986 ;
— plus de 50 % des salariés recevaient en 1986 le salaire minimum légal.
(...) Pour 1987, étant donné le processus d'accélération de la dévaluation et l'accélération de la croissance du taux d'inflation (115% annuel), la détérioration des salaires est encore plus grande, tandis que le nombre de chômeurs n'arrête pas d'augmenter.
La baisse importante des conditions de vie du prolétariat au Mexique dans les trois dernières années a atteint un point extrême au début de 1987. Ainsi par exemple, la situation salariale des ouvriers du secteur de l'électricité est l'illustration de ce qui arrive dans le secteur public. Après avoir perçu en 1982 des salaires qui allaient jusqu'à 11,5 fois le salaire minimum légal, en 1987 ils ne recevaient plus que 4 fois ce minimum légal.
L'inquiétude parmi les travailleurs du secteur public se faisait déjà sentir l'an dernier. La grande majorité des syndicats a réalisé les révisions du contrat collectif et fixé les salaires professionnels entre janvier et avril. La pression croissante des travailleurs pour demander des salaires plus élevés laissait prévoir aux syndicats du secteur public qu'il y aurait des mobilisations qui risquaient d'échapper à leur contrôle. En février, l'Etat a fait savoir aux travailleurs, à travers les syndicats, qu'«il n'y avait pas de fonds» pour couvrir la demande d'augmentation salariale d'«urgence» que les syndicats avaient fixée à 23 % (au Mexique le taux annuel de l'inflation dépasse les 110%).
En dépit des coups durs portés au prolétariat à DINA, RENAULT et FUNDIDORA de Monterrey (FUMOSA) en 1986, et immédiatement après que se soit terminée la grève des étudiants à Mexico — conflit typique des classes moyennes et avec lequel la bourgeoisie et la petite-bourgeoise ont tenté de donner au prolétariat une «leçon» sur les «bontés» de la démocratie bourgeoise — au milieu de la crise économique la plus aiguë de tous les temps, les électriciens (36000 au total) entamèrent le 28 février une grève dans la zone centrale du pays qui englobe le District Fédéral (Mexico) et les quatre départements qui l'entourent. Cela signifiait toucher un nerf central de l'appareil productif, étant donné que c'est la zone industrielle et concentration ouvrière la plus importante du pays.
(...) La grève n'a duré que cinq jours, et les ouvriers ont été ramenés au travail sans rien obtenir. Mais dans ce bref laps de temps s'est exprimée plus nettement une série de tendances qui sont apparues dans les mobilisations actuelles du prolétariat, en Europe principalement, et dont certaines existaient déjà en germe dans la lutte à FUMOSA. Dans la grève de l'électricité s'est manifestée la tendance ouvrière à lutter massivement, avec de fortes possibilités d'extension à d'autres secteurs du prolétariat, comme cela s'est vu récemment en Belgique, en France et en Espagne. Un autre aspect significatif de cette grève a été sa durée réduite dans le temps, à la différence de celle de FUMOSA qui avait duré près de deux mois. Les particularités de la grève sont les suivantes :
1. A la différence de ce qui est arrivé à DINA, RENAULT et FUMOSA l'année dernière, où les conflits ont duré plus longtemps, la grève des électriciens a pris immédiatement un caractère politique. Deux heures avant l'éclatement de la grève, l'Etat, par ordre présidentiel, a réquisitionné les installations de la Compagnie d'Electricité «pour sauvegarder l'intérêt national». Certaines installations de production d'énergie électrique ont été occupées et gardées par les forces de l'ordre. L'armée était prête à intervenir à tout moment. Devant le caractère clairement politique acquis par la grève, le syndicat, avec l'aide de la gauche du capital, n'a fait que marteler dans la tête des ouvriers que le mouvement «était une affaire nationale de défense du droit, de la légalité, de la Constitution», de la «souveraineté nationale», etc.
(...) En insistant en permanence sur le fait « qu'on ne peut déclarer la grève illégale que si on prouve qu'il y a eu des actes de violence de la part des travailleurs », le syndicat a empêché la mise en place de la plupart des piquets de grève ainsi que l'appel à se joindre à la grève aux travailleurs non syndiqués et des autres agences (transformés par décret en « jaunes ») qui ont été amenés à travailler à leur place.
2. (...) Le syndicat a montré une grande capacité de flexibilité pour s'adapter aux conditions que lui a imposées le mouvement des ouvriers afin de le récupérer, le canaliser et le soumettre.
Les syndicats qui sont plus étroitement et plus ouvertement liés à l'appareil de l'Etat ont plus de possibilité de perdre leur crédibilité aux yeux des ouvriers avec des actes aussi brutaux que celui qu'ils ont commis à FUMOSA (14000 licenciements directs et 40000 indirects) ; c'est à cause de cela que doivent entrer en jeu les tendances de gauche du capital et les gauchistes, afin de maintenir l'ordre et ramener la mobilisation sur les rails de la «paix sociale».
Dans ce cas, et contrairement à ce qui était arrivé à FUMOSA où les ouvriers étaient assujettis à un syndicat , clairement identifié par eux comme faisant partie de la structure étatique, le syndicat mexicain des électriciens (SME) est un syndicat « démocratique » qui en plus fait , le pont entre le syndicalisme officiel et le syndicalisme de base («de classe») animé par la gauche du capital et les gauchistes. Pour cela même, depuis la première minute de la grève, le syndicat n'a pas cessé de marteler aux ouvriers l'idée que « l'organisation syndicale était en péril», raison pour laquelle il était nécessaire de se plier aux décisions du Comité Central du syndicat. Cela a permis au SME de se mouvoir de droite à gauche et vice versa, radicalisant son langage en même temps qu'il manipulait des consignes dans un sens purement idéologique nationaliste.
Les ouvriers se sont laissés littéralement mener par ce que décidait le SME : dans leur grande majorité ils ont quitté les lieux de travail et se sont concentrés autour de l'immeuble du syndicat... immobilisés tout le temps pour «éviter la violence»... et ont laissé le syndicat chercher la «solidarité»... des autres syndicats. Le SME a fait exactement la même chose que les syndicats des automotrices et des mineurs à DINA, RENAULT et FUMOSA enfermant les ouvriers dans le pire corporatisme, les isolant du reste des ouvriers et maintenant le conflit dans les strictes limites locales. De plus le SME, comme un des principaux impulseurs de la «table de concertation syndicale» — véritable concile où se réunit toute la gamme des syndicats «démocratiques» et syndicalistes de base pour fabriquer des caricatures de «journées de solidarité», s'est chargé de remplir les pages de la presse bourgeoise avec une véritable «solidarité»... de papier, pendant que le reste des syndicats maintenait tranquilles -«leurs» ouvriers.
La gauche du capital, à travers ses partis et groupes politiques et syndicalistes s'est chargée de son côté de bombarder les électriciens avec l'idée qu'il fallait défendre ce «bastion de la démocratie» qu'est le SME et surtout qu'il était nécessaire d'engager la mobilisation dans les voies de la «souveraineté nationale» et «contre le paiement de la dette extérieure», etc.
4. (...) La seule marche qu'ont pu réaliser les électriciens avec la participation de centaines de milliers de personnes à Mexico a réussi à concentrer de grands contingents d'électriciens provenant des quatre départements de la zone centrale. A cette marche se sont joints beaucoup de travailleurs du secteur public (métro, banque du commerce extérieur, téléphone, tramways, agences de change, universités, etc. et de l'industrie (confection), ainsi que de petits noyaux d'ouvriers d'entreprises moyennes (brasserie Moctezuma, aciérie Ecatepec). A la marche se sont joints aussi des groupes d'habitants des quartiers marginaux et des lycéens.
Face à la visible possibilité d'extension massive de la grève à d'autres secteurs, le Tribunal du Travail a déclaré, deux jours après la marche, que la grève était «inexistante», appelant les ouvriers à reprendre immédiatement le travail sous la menace de licenciements massifs. Le syndicat a obligé les ouvriers à reprendre le travail, leur disant : «Nous sommes respectueux de la loi». Quand le syndicat en a informé l'assemblée de travailleurs qui était restée dans le local syndical, les grévistes ont manifesté leur mécontentement. Il y a eu des cris de «traîtres» contre les dirigeants syndicaux. Mais toute cette colère s'est diluée dans la frustration puis dans la résignation. Seule une minorité d'ouvriers a été capable de réagir contre le syndicat. (...)
5. Pendant que l'Etat frappait les électriciens, les autres syndicats sabotaient toute tentative de mobilisation dans les autres secteurs. En trois occasions, ils ont empêché qu'éclatent des grèves dans des secteurs clés, comme le téléphone, l'aéronavale et les tramways de la ville. Ils ont aussi démoralisé les ouvriers des universités, du cinéma et les enseignants du primaire. Secteur après secteur, les syndicats ont manipulé et se sont imposés aux travailleurs afin qu'ils acceptent la décision de l'Etat de n'accorder aucune augmentation du salaire général d'urgence. Après avoir arrêté la grève des électriciens, il était visible que les ouvriers du téléphone allaient se mettre en grève. Le syndicat a tenté de contenir jusqu'au bout l'éclatement de la grève, la «remettant» sans cesse à plus tard. Mais dans les assemblées syndicales, la détermination des ouvriers à s'engager dans la grève était ferme. L'Etat a appliqué alors la même tactique qu'il avait employée avec les électriciens : deux heures avant l'éclatement de la grève, il a réquisitionné l'entreprise et le syndicat a tout de suite fait entrer les ouvriers au travail. (...) Finalement, on a pu observer que les syndicats, dans leurs diverses variantes, sont un véritable obstacle pour la lutte revendicative du prolétariat. Loin d'exprimer les intérêts du mouvement revendicatif des ouvriers, ils incarnent les intérêts bourgeois nationaux et de l'Etat. L'Etat bourgeois a imposé sa politique salariale avec l'aide des syndicats, brisant la résistance des ouvriers et retenant les tendances vers la massivité, l'extension et la simultanéité.
6. Le mouvement de résistance aux mesures salariales du capital qu'ont réussi à mener les électriciens, malgré toutes ses limitations comme le corporatisme, la confiance dans les syndicats et le manque de confiance dans ses propres forces, l'isolement et le grand poids de l'idéologie bourgeoise nationaliste qui pesait sur eux, a été très important, car il a montré aux ouvriers que la lutte pour les revendications économiques se transforme inévitablement en un mouvement politique, étant donné qu'inexorablement l'Etat bourgeois la confronte. Il a montré aussi qu'il existe une tendance vers la grève de masse où les possibilités de l'extension du mouvement vers d'autres secteurs sont chaque fois plus évidentes. (...) C'est dans ces mouvements qu'apparaît la nécessité de forger l'instrument politique du prolétariat qui lui donne les éléments de son identité comme classe, c'est-à-dire le Parti Communiste International qui incarne dans chaque moment de sa lutte la perspective du programme communiste. (...)
Comunismo Mexico, avril 1987
Géographique:
- Mexique [36]
Heritage de la Gauche Communiste:
Comprendre la décadence du capitalisme (3) : la nature de la Social-Démocratie
- 3485 reads
La continuité des organisations politiques du prolétariat : la nature de la Social-Démocratie
Comprendre la décadence du capitalisme c'est aussi
comprendre les spécificités des formes de la lutte prolétarienne à notre époque
et donc les différences avec celles d'autres phases historiques. A travers la
compréhension de ces différences se dégage la continuité qui traverse les
organisations politiques du prolétariat.
Ceux
qui, tel le Groupe Communiste Internationaliste (GCI), ignorent la décadence du
capitalisme, rejettent «logiquement y dans le camp de la bourgeoisie la 2e
Internationale (1889-1914) et les partis qui l'ont constituée. Ce faisant ils
ignorent cette continuité réelle qui constitue un élément fondamental de la
conscience de classe.
En défendant cette continuité il ne s'agit pas pour nous de glorifier pour aujourd'hui les partis qui ont constitué la 2e Internationale. Encore moins de considérer comme valable pour notre époque, leur pratique. 11 ne s'agit surtout pas de revendiquer l'héritage de la fraction réformiste qui glissait vers le K social-chauvinisme y et est passée, avec l'éclatement de la guerre, définitiuem?nt dans le camp de la bourgeoisie. Ce dont il s'agit c'est de comprendre que la 2e Internationale et les partis qui l'ont constituée ont été des expressions authentiques du prolétariat durant un moment de l'histoire du mouvement ouvrier.
Un de ses mérites, et non le moindre, consistait à achever la décantation qui avait commencé dans les dernières années de la 1ère Internationale en éliminant l'anarchisme, cette expression idéologique du processus de décomposition de la petite bourgeoisie et de sa prolétarisation, fort mal acceptée par certaines couches de l'artisanat.
La 2e Internationale se situe d'emblée sur les bases du marxisme qu'elle inscrit dans son programme.
11 y a deux façons de juger la 2e Internationale et les partis social-démocrates : l'une avec la méthode marxiste, c'est à dire critique, la situant dans son contexte historique. L'autre c'est celle de l'anarchisme, qui sans méthode cohérente et de façon a-historique se contente simplement de nier ou d'effacer son existence dans le mouvement ouvrier. Et pour cause !
La première est celle qu'ont toujours empruntée les
gauches communistes, et que reprend le CCI. La deuxième est celle des
irresponsables qui, sous une phraséologie « révolutionnaire » aussi creuse
qu'incohérente, cachent mal leur nature et leur démarche semi-anarchiste. Le
GCI appartient à cette dernière.
Un nihilisme apocalyptique
« Avant moi le chaos ». Pour celui qui croit qu'il n'y a pas d'avenir, « no future », l'histoire passée semble inutile, absurde, contradictoire. Tant d'efforts, tant de civilisations, tant de savoir pour n'en arriver qu'à la perspective d'une humanité affamée, malade, et menacée d'être détruite par le feu nucléaire. « Après moi le déluge » ... « Avant moi le chaos ».
Ce genre d'idéologie « punk » suintée par le capitalisme dans cette époque de décadence avancée, pénètre à des degrés divers l'ensemble de la société. Même des éléments révolutionnaires, supposés être convaincus - par définition - de l'existence, sinon de l'imminence d'un avenir révolutionnaire pour la société, subissent parfois, lorsqu'ils sont peu armés politiquement, la pression de ce « nihilisme apocalyptique », où plus rien dans le passé n'a de sens. L'idée même d'une « évolution » historique leur semble saugrenue. Et l'histoire du mouvement ouvrier, l'effort d'un siècle et demi de générations de révolutionnaires organisés, pour accélérer, stimuler, féconder la lutte de leur classe, tout cela est considéré comme peu de chose, voire même comme des éléments de conservation, d'« autorégulation » de l'ordre social existant. C'est une mode qui revient parfois, véhiculée surtout par des éléments en provenance de l'anarchisme ou allant vers celui-ci.
Depuis quelques années, le GCI, Groupe Communiste Internationaliste, joue de plus en plus ce rôle. Le GCI est une scission du CCI (1978), mais les éléments qui l'ont constitué provenaient en partie, avant d'être au CCI, de l'anarchisme. Après un flirt passager avec le bordiguisme, au lendemain de la rupture, le GCI a évolué par la suite vers les amours d'enfance de certains de ses animateurs, l'anarchisme, avec ses élucubrations désespérées a-historiques sur la révolte éternelle ; mais il ne s'agit pas d'un anarchisme déclaré, ouvert, capable d'affirmer par exemple nettement que Bakounine ou Proudhon avaient raison sur le fond contre les marxistes de l'époque ; c'est un anarchisme honteux, qui n'ose pas dire son nom et qui défend ses thèses à coups de citations de Marx et de Bordiga. Le GCI a inventé l'« anarcho-bordiguisme punk ».
Comme un adolescent en mal d'affirmation de son identité et de rupture parentale, le GCI considère qu'avant lui et sa théorie, c'était le néant ou presque. Lénine ? « (Sa) théorie de l'impérialisme - nous dit le GCI - n'est qu'une tentative de justifier sous une autre couleur (antiimpérialiste !) le nationalisme, la guerre, le réformisme... la disparition du prolétariat comme sujet de l'histoire » ([1] [1136]). Rosa Luxemburg ? Les Spartakistes allemands? « des sociaux-démocrates de gauche ». Et la social-démocratie elle-même, celle du 19e siècle et du début du 20e siècle, à la fondation de laquelle participèrent Marx et Engels, dans laquelle se formèrent non seulement les bolcheviks et les spartakistes, mais aussi ceux qui allaient constituer la gauche communiste de la 3e Internationale (gauches italienne, allemande, hollandaise, etc.) ? Pour le GCI, la Social-démocratie (ainsi que la 2e Internationale qu'elle a créée) était « de nature essentiellement bourgeoise ». Tous ceux qui, au sein de la 2e Internationale puis de la 3e, ont défendu, contre les réformistes qui la niaient, l'inéluctabilité puis la réalité de la décadence du capitalisme ? « Anti-impérialiste ou luxemburgiste, la théorie de !a décadence n'est qu'une science bourgeoise visant à justifier idéologiquement la faiblesse du prolétariat dans sa lutte pour un monde sans valeur ».
Avant le GCI, il semblerait - au nombre de citations utilisées - qu'il n'y ait eu en fait de révolutionnaire que Marx et peut-être Bordiga... quoiqu'on soit en droit de se demander ce que pouvaient avoir de révolutionnaire - dans la conception du GCI - un fondateur d'organisations « de nature essentiellement bourgeoise » comme Marx, et un élément comme Bordiga qui ne rompt avec la Socialdémocratie italienne qu'en 1921 !
En fait, pour le GCI, c'est la problématique même de
savoir quelles ont été les organisations prolétariennes du passé et quels ont
été leurs apports successifs au mouvement communiste qui est un non-sens. Pour
le GCI, se réclamer d'une continuité politique historique des organisations du
prolétariat, comme l'ont toujours fait les organisations communistes, comme nous
le faisons, c'est tomber dans l'esprit de « famille ». Ce n'est là qu'une des
facettes de sa vision chaotique de l'histoire, une des perles de la bouillie
théorique qui est supposée servir au GCI de cadre pour son intervention. Dans
les deux articles précédents ([2] [1137]),
consacrés à l'analyse de la décadence du capitalisme et à la critique qu'en
fait le GCI, nous avons montré d'une part la vacuité anarchiste qui se cache
derrière le verbiage marxisant du GCI avec son rejet de l'analyse de la
décadence du capitalisme et de l'idée même d'évolution historique, d'autre part
des aberrations politiques, des positions nettement bourgeoises - appui aux
guérilleros staliniens du Sentier Lumineux au Pérou, par exemple - auxquelles
conduit cette méthode, ou plutôt cette absence totale de méthode. II s'agit
donc dans cet article de combattre l'autre volet de cette conception
a-historique : le rejet de la nécessité pour toute organisation révolutionnaire
de comprendre et de se situer dans le cadre de la continuité historique des
organisations communistes du passé.
L'importance de la continuité historique dans le mouvement communiste
Dans toutes nos publications, nous écrivons : « Le CCI se réclame des apports successifs de la Ligue des Communistes, des le, 2e et 3e Internationales, des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière, en particulier des gauches allemande, hollandaise et italienne ». Voila qui donne la nausée au GCI.
« Les communistes - écrit le GCI - n'ont pas de problème de "paternité", l'attachement à la "famille" révolutionnaire est une manière de nier l'impersonnalité du programme. Le fil historique sur lequel circule le courant communiste n'est pas plus une question de "personne" que d'organisation formelle, c'est une question de pratique, cette pratique étant portée tantôt par tel individu, tantôt par telle organisation. Laissons donc les décadentistes séniles caqueter sur leurs arbres généalogiques, à la recherche de leurs papas. Occupons-nous de la révolution ! »
Obsédé par des problèmes de « révolte contre le père », le GCI ne parle de « fil historique » que pour en faire une abstraction éthérée, vide de chair et de réalité, planant au dessus des « personnes » et des «organisations formelles ». Se réapproprier l'expérience historique du prolétariat et donc les leçons tirées par ses organisations politiques, le GCI appelle cela « rechercher son papa ». « Occupons-nous plutôt de la révolution », oppose-t-il, mais ces mots sont des formules creuses et inconséquentes quand on ignore l'effort et la continuité de l'effort des organisations qui depuis plus d'un siècle et demi... « s'occupent de la révolution ».
Ce n'est pas à partir du passé de l'histoire qu'on s'intéresse au présent, c'est à partir des besoins présents et à venir de la révolution que l'on s'intéresse au passé. Mais sans cette compréhension de l'histoire, on est inévitablement désarmé vis-à-vis de l'avenir.
La lutte pour la révolution communiste n'a pas commencé avec le GCI. Cette lutte a déjà une longue histoire. Et si celle-ci est jalonnée surtout de défaites du prolétariat, elle a fourni à ceux qui aujourd'hui veulent véritablement contribuer au combat révolutionnaire des leçons, des acquis qui sont de précieux et indispensables instruments de combat. Or ce sont justement les organisations politiques du prolétariat qui tout au long de cette histoire se sont efforcées de dégager et de formuler ces leçons. C'est du charlatanisme de révolté à la petite semaine que d'appeler à « s'occuper de la révolution » sans s'occuper des organisations politiques prolétariennes du passé et de la continuité de leur effort. Le prolétariat est une classe historique, c'est-à-dire porteuse d'un avenir à l'échelle de l'histoire. C'est une classe qui, contrairement aux autres classes opprimées qui se décomposent avec l'évolution du capitalisme, se renforce, se développe, se concentre tout en acquérant au travers des générations, à travers des milliers de combats de résistance quotidienne et quelques grandes tentatives révolutionnaires, une conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut et de ce qu'elle veut. L'activité des organisations révolutionnaires, leurs débats, leurs regroupements comme leurs scissions, font partie intégrante de ce combat historique, ininterrompu depuis Babeuf jusqu'à son triomphe définitif.
Ne pas comprendre la continuité qui lie politiquement
celles-ci au travers de l'histoire, c'est ne voir dans le prolétariat qu'une
classe sans histoire ni conscience... tout au plus révoltée. C'est la vision
qu'a la bourgeoisie de la classe ouvrière. Pas celle des communistes ! Le GCI
voit un problème psychologique de « paternité » et d'« attachement à la famille
» là où il s'agit en fait du minimum de conscience qui puisse être exigé d'une
organisation qui prétend s'élever au rôle d'avant-garde du prolétariat.
De quelle continuité nous réclamons-nous ?
Le GCI affirme que se réclamer d'une continuité avec les organisations communistes du passé c'est « nier l'impersonnalité du programme ». Il est évident que le programme communiste n'est ni l'oeuvre ni la propriété d'une personne, d'un génie. Le marxisme porte le nom de Marx en reconnaissance du fait que ce fut lui qui jeta les fondements d'une conception prolétarienne véritablement cohérente du monde. Mais cette conception n'a cessé de s'élaborer à travers la lutte de la classe et ses organisations depuis ses premières formulations. Marx luimême se revendiquait de l'oeuvre des Egaux de Babeuf, des socialistes utopistes, des chartistes anglais,etc. et considérait ses idées comme un produit du développement de la lutte réelle du prolétariat.
Mais pour « impersonnel » qu'il soit, le Programme communiste n'en est pas moins l'oeuvre d'êtres humains en chair et en os, de militants regroupés dans des organisations politiques, et il n'en existe pas moins une continuité dans l'oeuvre de ces organisations. La vraie question n'est pas de savoir s'il existe ou non une continuité, mais de savoir quelle est cette continuité.
Montrant qu'il ne comprend même pas ce qu'il prétend critiquer, le GCI laisse entendre que se revendiquer d'une continuité des organisations politiques prolétariennes reviendrait à se réclamer de ce que tout le monde a pu dire, à n'importe quel moment, dans le mouvement ouvrier.
Un des principaux reproches que fait le GCI à ceux qui défendent l'idée de l'existence d'une décadence du capitalisme, c'est qu'ils « entérinent ainsi, de façon acritique, l'histoire passée, et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait "dans la phase ascendante du capitalisme" ». Dans l'esprit borné du GCI, assumer une continuité historique ne peut signifier qu'« entériner de façon a-critique ». Dans la réalité, pour ce qui est des organisations du passé, l'histoire s'est chargée elle-même d'exercer une critique impitoyable en tranchant dans les faits la question.
Ce ne sont pas des tendances quelconques qui ont pu assumer la continuité entre l'ancienne organisation et la nouvelle. Entre les trois principales organisations politiques internationales du prolétariat, c'est la gauche qui a toujours assumé cette continuité.
Ce fut elle qui assura la continuité entre la 1e et la 2e Internationales à travers le courant marxiste, en opposition aux courants proudhonien, bakouniniste, blanquiste, et autres corporativistes. Entre la 2e et la 3e Internationales c'est encore la gauche, celle qui mena le combat tout d'abord contre les tendances réformistes, ensuite contre les «social -patriotes », qui assura la continuité pendant la lere guerre mondiale en formant l'Internationale communiste. De la 3e Internationale, c'est encore la gauche, la « gauche communiste », et en particulier les gauches italienne et allemande, qui ont repris et développé les acquis révolutionnaires foulés au pied par la contre révolution social-démocrate et stalinienne. Cela s'explique par la difficulté de l'existence des organisations politiques du prolétariat. L'existence même d'une authentique organisation politique prolétarienne constitue un combat permanent contre la pression de la classe dominante, pression qui est d'ordre matériel : manque de moyens financiers, répression policière, mais aussi et surtout d'ordre idéologique. L'idéologie dominante tend toujours à être celle de la classe économiquement dominante. Les communistes sont des hommes et leurs organisations ne sont pas miraculeusement imperméables à la pénétration de l'idéologie qui imprègne toute la vie sociale. Les organisations politiques du prolétariat meurent souvent vaincues, en trahissant, en passant dans le camp de l'ennemi. Seules les fractions de l'organisation qui ont eu la force de ne pas laisser tomber leurs armes devant la pression de la classe dominante - la gauche - ont pu assumer la continuité de ce que ces organisations contenaient de prolétarien.
En ce sens, se réclamer de la continuité qui traverse les organisations politiques prolétariennes c'est se réclamer de l'action des différentes fractions de gauche qui seules ont eu la capacité d'assurer cette continuité. Se revendiquer « des apports successifs de la Ligue des Communistes, des le, 2e et 3e Internationales », ce n'est pas « entériner de façon a-critique » les Willich et Schapper de la Ligue des Communistes, ni les anarchistes de la l" Internationale, ni les réformistes de la 2e, ni les bolcheviks dégénérescents de la 3e. Au contraire, c'est se revendiquer du combat politique mené par les gauches généralement minoritaires contre ces tendances. Mais ce combat n'était pas mené n'importe où. Il se déroulait au sein des organisations qui regroupaient les éléments les plus avancés de la classe ouvrière. Des organisations prolétariennes qui avec toutes leurs faiblesses ont toujours été un défi vivant à l'ordre établi. Elles n'étaient pas l'incarnation d'une vérité invariable éternelle et définie une fois pour toutes -- comme le prétend la théorie de l'Invariance du Programme communiste, empruntée par le GCI aux bordiguistes. Elles ont été « l'avant-garde » concrète du prolétariat comme classe révolutionnaire à un moment donné de l'histoire et à un degré donné du développement de la conscience de classe.
A travers les débats entre la tendance Willich
et celle de Marx au sein de la
Ligue des Communistes, à travers la confrontation entre les
anarchistes et les marxistes au sein de la le Internationale, entre les
réformistes et la gauche internationaliste au sein de la 2e, entre les
bolcheviks dégénérescents et les gauches communistes au sein de la 3e, c'est
l'effort permanent de la classe ouvrière pour se donner les armes politiques de
son combat qui se concrétise. Se revendiquer de la continuité politique des
organisations politiques du prolétariat, c'est se situer en continuité des
tendances qui ont su assumer cette continuité, mais aussi de l'effort en
lui-même que représentent ces organisations.
La nature de classe de la social-démocratie de la fin du 19e siècle, début du 20e.
Pour le GCI, ce qui interdit le plus de parler de continuité des organisations politiques prolétariennes c'est que l'on puisse considérer les partis social-démocrates du 19e siècle et la 2e Internationale comme des organisations ouvrières. Pour lui, la social-démocratie est de nature « essentiellement bourgeoise ».
Comme on l'a vu dans les articles précédents, le GCI reprend la vision anarchiste d'après laquelle la révolution communiste a toujours été à l'ordre du jour depuis les débuts du capitalisme : il n'y a pas différentes périodes du capitalisme. Le programme du prolétariat se réduit à un mot d'ordre éternel : la révolution communiste mondiale tout de suite. Le syndicalisme, le parlementarisme, la lutte pour des réformes, rien de cela n'a jamais été ouvrier. En conséquence, les partis social-démocrates puis la 2e Internationale, qui ont fait de ces formes de lutte l'axe essentiel de leur activité ne pouvaient être que des instruments de la bourgeoisie. La 2e Internationale d'Engels serait la même chose que les ententes entre Mitterrand et Felipe Gonzales. Pour les avoir abordées longuement dans deux articles précédents, nous ne reviendrons pas ici sur des questions telles que l'existence de deux phases historiques fondamentales dans la vie du capitalisme et sur la place centrale de l'analyse de la décadence du capitalisme dans la cohérence marxiste (Revue Internationale n° 48) ; nous ne redévelopperons pas non plus la question des différences qui découlent du changement de période pour la pratique et les formes de lutte du mouvement ouvrier (Revue Internationale n° 49).
Nous situant ici du point de vue de la question de la continuité historique des organisations révolutionnaires, nous voulons mettre en relief ce qui, au delà de ses faiblesses, dues aux formes de lutte de l'époque, et de sa dégénérescence, était prolétarien dans la Socialdémocratie et quels sont les apports dont les révolutionnaires marxistes se sont revendiqués par la suite.
***Quels sont les critères pour juger de la nature de classe d'une organisation. On peut en définir trois importants :
- le programme., c'est-à-dire la définition de l'ensemble des buts et des moyens de son action ;
- la pratique de l'organisation au sein de la lutte de classe ;
- enfin, son origine et sa dynamique historique.
Cependant, ces critères n'ont évidemment de sens que si l'on sait tout d'abord resituer l'organisation en question dans les conditions historiques de son existence. Et cela non seulement parce qu'il est indispensable de tenir compte des conditions historiques objectives pour définir ce que sont et peuvent être les objectifs immédiats et les formes de la lutte prolétarienne. Il est aussi indispensable d'avoir à l'esprit quel était le degré de conscience atteint historiquement par la classe prolétarienne à un moment donné pour juger du degré de conscience d'une organisation spécifique.
Il y a un développement historique de la conscience. Il ne suffit pas de comprendre que le prolétariat existe comme classe autonome politiquement au moins depuis le milieu du 19e siècle. Encore faut-il comprendre que pendant tout ce temps il n'est pas resté une momie, un dinosaure empaillé. Sa conscience de classe, son programme historique ont évolué, s'enrichissant de l'expérience, évoluant avec les conditions historiques murissantes. Pour juger du degré de conscience exprimé par le programme d'une organisation prolétarienne du 19e siècle, il serait absurde d'en exiger la compréhension de ce que seules des décennies d'expérience et l'évolution de la situation pouvaient permettre de comprendre plus tard.
Rappelons donc brièvement quelques éléments sur les
conditions historiques dans lesquelles se forment et vivent les partis
social-démocrates dans le dernier quart du 19e siècle et jusqu'à la période de
la le guerre mondiale, moment où meurt la 2e Internationale et où éclatent les
partis, les uns après les autres, sous le poids de la trahison de leurs
directions opportunistes.
Les conditions de la lutte du prolétariat à l'époque de la social-démocratie
Dans la conception figée et statique du GCI selon laquelle le capitalisme serait « invariable » depuis ses débuts, la fin du 19e siècle apparaît comme identique à l'époque actuelle. Aussi son jugement sur la socialdémocratie de cette époque se résume à une identification de celle-ci avec les partis social-démocrates ou staliniens de notre temps. En réalité, ce genre de projections infantiles selon lequel ce que l'on connaît est la seule chose qui n'ait jamais pu exister n'est autre chose qu'une plate négation de l'analyse historique. Les générations actuelles connaissent un monde qui depuis plus de trois quarts de siècle a vécu au rythme des plus grandes manifestations de barbarie de l'histoire de l'humanité : les guerres mondiales. Quand ce n'est pas la guerre mondiale ouverte, c'est la crise économique qui s'abat sur la société, seules faisant exception deux périodes de « prospérité » fondées sur la « reconstruction » au lendemain des le et 2e guerres mondiales. A cela doit s'ajouter depuis la fin de la 2e guerre, l'existence de guerre locales en permanence dans les zones les moins développées et une orientation de l'économie, au niveau mondial , essentiellement vers des objectifs militaires et destructifs.
L'appareil chargé du maintien de cet ordre décadent n'a cessé de développer son emprise sur la société et la tendance au capitalisme d'Etat, sous toutes ses formes, se concrétise dans tous les pays de façon toujours plus puissante et omniprésente dans tous les secteurs de la vie sociale, au premier rang desquels se trouvent évidemment les rapports entre les classes. Dans tous les pays, l'appareil d'Etat s'est doté de toute une panoplie d'instruments pour contrôler, encadrer, atomiser la classe ouvrière. Les syndicats, les partis de masse sont devenus des rouages de la machine étatique. Le prolétariat ne peut plus affirmer son existence comme classe que sporadiquement. En dehors des moments d'effervescence sociale il est, en tant que corps collectif, atomisé, comme chassé de la société civile.
Tout autre est le capitalisme du dernier quart du 19e siècle. Sur le plan économique, la bourgeoisie connaît la plus longue et puissante période de prospérité de son histoire. Après les crises cycliques de croissance qui, presque tous les 10 ans, avaient frappé le système de 1825 à 1873, le capitalisme connaît jusqu'en 1900, près de 30 ans de prospérité quasi ininterrompue. Sur le plan militaire, c'est aussi une période exceptionnelle : le capitalisme ne connaît aucune guerre importante. Dans ces années de prospérité relativement pacifiques, difficilement concevables pour des gens de notre époque, la lutte du prolétariat se déroule dans un cadre politique qui, s'il demeure - évidemment - celui de l'exploitation et l'oppression capitalistes, n'en possède pas moins des caractéristiques très différentes de celles du 20e siècle.
Les rapports entre prolétaires et capitalistes sont des rapports directs, et d'autant plus éparpillés que la plupart des usines sont encore de taille réduite. L'Etat n'intervient dans ces rapports qu'au niveau des conflits ouverts qui risquent de « troubler l'ordre public ». Les négociations salariales, l'établissement des conditions de travail sont pour l'écrasante majorité des cas une affaire qui dépend des rapports de forces locaux entre les patrons (souvent d'entreprises de type familial) et des ouvriers dont la grande majorité vient directement de l'artisanat et de l'agriculture. L'Etat est à l'écart de ces négociations.
Le capital conquiert le marché mondial et étend sa forme d'organisation sociale aux quatre coins de la planète. La bourgeoisie fait exploser le développement des forces productives. Elle est chaque jour plus riche et trouve même un profit dans l'amélioration des conditions d'existence des prolétaires. Les luttes ouvrières sont fréquemment couronnées de succès. Les grèves longues, dures, même isolées, parviennent à faire céder des patrons qui - outre le fait qu'ils peuvent payer - affrontent souvent les ouvriers en ordre dispersé. Les ouvriers apprennent à s'unifier et à s'organiser de façon permanente (les patrons aussi d'ailleurs). Leurs luttes imposent à la bourgeoisie le droit d'existence d'organisations ouvrières : syndicats, partis politiques, coopératives. Le prolétariat s'affirme comme force sociale dans la société, même en dehors des moments de lutte ouverte. Il y a toute une vie ouvrière au sein de la société : il y a les syndicats (qui sont des « écoles de communisme »), mais il y a aussi des clubs ouvriers où on parle de politique, il y des « universités ouvrières » où l'on apprend aussi bien le marxisme qu'à lire et écrire, (Rosa Luxembourg et Pannekoek furent enseignants dans la social démocratie allemande), il y a des chansons ouvrières, des fêtes ouvrières où l'on chante, danse et parle du communisme.
Le prolétariat impose le suffrage universel et obtient
d'être représenté par ses organisations politiques dans le parlement bourgeois
- les parlements sont encore des lieux où le théâtre mystificateur n'a pas tout
dévoré ; le pouvoir réel n'est pas encore totalement dans le seul exécutif au
gouvernement ; les différentes fractions des classes dominantes s'y affrontent
réellement et le prolétariat parvient parfois à utiliser les divergences entre
partis bourgeois pour imposer ses intérêts. Les conditions d'existence de la
classe ouvrière en Europe connaissent des améliorations réelles : réduction du
temps de travail de 14 ou de 12 à 10 heures ; interdiction du travail des
enfants et des travaux pénibles pour les femmes ; élévation générale du niveau
de vie, élévation du niveau culturel. L'inflation est un phénomène inconnu. Les
prix des biens de consommation baissent au fur et à mesure que les nouvelles
techniques de production sont introduites dans la production. Le
chômage est réduit à celui minimum d'une armée de réserve où le capital en
expansion peut puiser la nouvelle force de travail dont il a en permanence
besoin. Un jeune chômeur peut aujourd'hui avoir du mal à imaginer ce que cela
pouvait être, mais cela devrait être une évidence pour toute organisation qui
se réclame du marxisme.
La social-démocratie ne s'identifie pas avec le réformisme
Les partis ouvriers social-démocrates et « leurs » syndicats étaient le produit et l'instrument des combats de cette époque. Contrairement à ce que peut laisser entendre le GCI, ce n'est pas la social-démocratie qui a « inventé » la lutte syndicale et politique parlementaire au début des années 1870. Dès les premières affirmations du prolétariat comme classe, dans la première moitié du 19e siècle, la lutte pour l'existence de syndicats ou le suffrage universel (Chartistes en Angleterre en particulier) se développait dans la classe ouvrière. La social-démocratie n'a fait que développer, organiser un mouvement réel qui existait bien avant elle et se développait indépendamment d'elle. Pour le prolétariat la question était - comme aujourd'hui - toujours la même : comment combattre la situation d'exploitation qui lui est faite. Or la lutte syndicale et politique parlementaire étaient alors des moyens de résistance véritablement efficaces. Les rejeter au nom de « la Révolution » c'était ignorer, rejeter le mouvement réeel et le seul cheminement possible à l'époque vers la révolution. La classe ouvrière devait s'en servir pour limiter l'exploitation mais aussi pour prendre conscience de soi, de son existence comme force autonome, unie.
- « La grande importance de la lutte syndicale et de la lutte politique réside en ce qu'elles socialisent la connaissance, la conscience du prolétariat, l'organisent en tant que classe », écrit Rosa Luxemburg dans « Réforme ou Révolution » (I,5).
C'était le «programme minimum ». Mais celui-ci s'accompagnait d'un «programme maximum », réalisable par une classe devenue capable de mener son combat contre l'exploitation jusqu'au bout : la révolution. Rosa Luxemburg formulait le lien entre ces deux programmes :
- « Selon la conception courante du Parti, le prolétariat parvient, par l'expérience de la lutte syndicale et politique, à la conviction de l'impossibilité de transformer de fond en comble sa situation au moyen de cette lutte et de l'inéluctabilité d'une conquête du pouvoir. »
Tel était le programme de la social-démocratie.
Le réformisme se définit, par contre par son refus de l'idée de la nécessité de la révolution. Il considère que seule la lutte pour des réformes au sein du système peut avoir un sens. Or la social-démocratie se constitue en opposition directe aussi bien aux anarchistes - qui croient la révolution à l'ordre du jour à toute heure - qu'aux possibilistes et a leur réformisme considérant le capitalisme comme éternel. Voici par exemple comment le Parti ouvrier français présentait son programme électoral en 1880 :
- « .... Considérant,
- Que cette appropriation collective ne peut sortir que de l'action révolutionnaire de la classe productive - ou prolétariat - organisé en parti politique distinct ;
- Qu'une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel, transformé ainsi d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation ;
- Les travailleurs socialistes français, en donnant pour but à leurs efforts dans l'ordre économique le retour à la collectivité de tous les moyens de production, ont décidé, comme moyens d'organisation et de lutte, d'entrer dans les élections avec le programme minimum suivant... » ([3] [1138]).
Quelque fut le poids de l'opportunisme vis à vis du
réformisme au sein des partis social-démocrates, leur programme rejettait
explicitement le réformisme. Les partis social-démocrates avaient comme
programme maximum la révolution ; la lutte syndicale et électorale était
essentiellement le moyen pratique, adapté aux possibilités et nécessités de
l'époque, pour préparer la réalisation de ce but.
Les acquis de la 2e Internationale
L'adoption du marxisme
Le GCI ne reconnait évidemment aucun apport pour le mouvement ouvrier de toutes ces organisations de nature « essentiellement bourgeoise ». « Entre social-démocratie et communisme, dit-il, il y a la même frontière de classe qu'entre bourgeoisie et prolétariat ».
Le rejet de la social-démocratie et de la 2e Internationale du 19e siècle n'est pas nouveau. II a toujours été le fait des anarchistes. Ce qui est relativement nouveau ([4] [1139]) c'est de prétendre faire ce rejet en se réclamant de Marx et Engels... (par souci d'autorité parentale peut-être).
Le problème c'est que l'adoption des conceptions marxistes et le rejet explicite des conceptions anarchistes par des organisations de masses constitue sans aucun doute le principal acquis de la 2e Internationale par rapport à la première.
La 2e Internationale, fondée en 1864, regroupait, surtout à ses débuts, toutes sortes de tendances politiques en son sein : mazzimistes, proudhoniens, bakouninistes, blanquistes, les trade-unionistes anglais, etc. Les marxistes n'y étaient qu'une infime minorité (le poids de la personnalité de Marx au sein du Conseil général de celle qui s'appelait Association ou Internationale des Travailleurs, ne doit pas faire illusion). Pendant la Commune de Paris il y avait un seul marxiste, Frankel, et il était hongrois.
La 2e Internationale par contre se fonde, avec Engels, dès le départ, sur la base des conceptions marxistes. Le congrès d'Erfurt en 1891 le reconnaît explicitement.
En Allemagne, dès 1869, le Parti Ouvrier SocialDémocrate fondé à Eisenach par Wilhelm Liebknecht et August Bebel, proches de Marx, après avoir scissionné de l'organisation de Lassalle (l'Association générale des ouvriers allemands) se fonde sur le marxisme. Lorsqu'en 1875 se réalisera la réunification, les marxistes sont majoritaires, même si le programme qui est adopté est tellement rempli de concessions aux conceptions lassalliennes que Marx écrira dans une lettre d'accompagnement de sa célèbre critique du Programme de Gotha :
- « ... après le congrès de coalition, nous publierons, Engels et moi, une brève déclaration où nous dirons que nous sommes fort éloignés dudit programme de principes, et que nous nous en louons les mains ». Mais il ajoute : « Un seul pas du mouvement réel est plus important qu'une douzaine de programmes ».
Quinze ans plus tard, sa confiance dans le mouvement réel se confirmait par l'adoption des conceptions marxistes par l'ensemble de la 2e Internationale dès ses premiers moments.
C'était là un apport fondamental au renforcement du mouvement ouvrier.
Le GCI rappelle le rejet par Marx et Engels du terme de « social-démocrate » qui en réalité reflétait des faiblesses lassalliennes du parti allemand : dans « tous ces écrits je ne me qualifie jamais de social-démocrate, mais de comrnuniste. Pour Marx comme pour moi il est donc absolument impossible d'employer une expression aussi élastique pour désigner notre conception propre ». (Engels dans la brochure « Internationales aus dem Volkstaat », 1871-1875).
Mais le GCI « oublie » de rappeler que les marxistes n'en déduisent pas pour autant qu'il fallait rompre avec le parti mais s'en faire une raison en menant le combat sur le fond. Ainsi Engels précisait-il : « Il en va autrement aujourd'hui, et ce mot peut passer à la rigueur, bien qu'il ne corresponde pas davantage aujourd'hui à un parti dont le programme économique n'est pas seulement socialiste en général, mais directement communiste, c'est à dire à un parti dont le but final est la suppression de tout Etat et, par conséquent, de la démocratie. »
L'adoption des conceptions de base du marxisme par
l'Internationale ne fut pas un cadeau de la Providence mais un
acquis conquis par le combat des éléments les plus avancés.
La distinction entre organisations unitaires et organisations
politiques du prolétariat
Un autre apport important de la 2e Internationale par rapport à la première fut la distinction entre deux formes distinctes d'organisation. D'une part, les organisations unitaires regroupant les prolétaires sur la base de leur appartenance de classe (syndicats, et plus tard les soviets ou conseils ouvriers) ; d'autre part, les organisations politiques regroupant des militants sur la base d'une plateforme politique précise.
La 1e Internationale, surtout à ses débuts, regroupait aussi bien des individus que des coopératives, des associations de solidarité, des syndicats ou des clubs politiques. Ce qui en faisait un organe qui ne parvint jamais à remplir véritablement ni des tâches d'orientation politique claires, ni des tâches d'unification des prolétaires.
C'est donc tout naturellement que les anarchistes qui rejettent aussi bien le marxisme que la nécessité des organisations politiques, combattent la 2e Internationale dès sa naissance. D'ailleurs, beaucoup de courants anarchistes continuent de se réclamer aujourd'hui de l'AIT.
Ici encore le GCI n'innove pas et demeure
invariablement ... anarchiste.
Le pourquoi et le comment du combat des révolutionnaires dans les partis de la 2e Internationale
Est-ce-à dire que la social-démocratie et la 2e Internationale furent des incarnations parfaites de ce que doit être l'organisation politique d'avant-garde du prolétariat ? Il est évident que non.
Le congrès de Gotha se tient quatre ans après l'écrasement de la Commune ; la 2e Internationale se fonde après près de vingt ans de prospérité capitaliste ininterrompue dans l'élan d'une poussée de grèves provoquée non par l'aggravation de l'exploitation due à une crise économique, mais par la prospérité elle-même qui situe le prolétariat en relative position de force. La séparation des crises cycliques du capitalisme, le progrès de la condition ouvrière par la lutte syndicale et parlementaire, créaient inévitablement des illusions parmi les ouvriers, même dans leur avant-garde.
Dans la vision marxiste, la révolution ne peut être provoquée que par une crise économique violente du capitalisme. L'éventualité d'une telle crise semblait s'éloigner au fur et à mesure que se prolongeait la prospérité. Les succès mêmes de la lutte pour des réformes crédibilisaient l'idée des réformistes de l'inutilité et de l'impossibilité de la révolution. Le fait même que les résultats de la lutte pour des réformes dépendent essentiellement du rapport de forces existant au niveau de chaque Etatnation et non du rapport de forces international - comme c'est le cas pour la lutte révolutionnaire - enfermait de plus en plus l'organisation du combat dans le cadre national, les tâches, les conceptions internationalistes étant souvent réléguées à un second plan ou repoussées aux calendes grecques.
En 1898, sept ans après le congrès d'Erfurt, Bernstein formule dans l'Internationale la remise en question de la théorie marxiste des crises et l'inévitabilité de l'effondrement économique du capitalisme (celle-là même que rejette le GCI) : seule la lutte pour des réformes est viable, « Le but n'est rien, le mouvement est tout ».
Les groupes parlementaires du parti sont souvent facilement englués dans les filets de la logique du jeu démocratique bourgeois et les responsables syndicaux tendent à devenir trop « compréhensifs » à l'égard des impératifs de l'économie capitaliste nationale. L'ampleur du combat que menèrent Marx et Engels contre les tendances conciliatrices avec le réformisme au sein de la social-démocratie naissante, le combat des Luxemburg, Pannekoek, Gorter, Lénine, Trotsky, dans la socialdémocratie dégénérescente sont une preuve de l'importance du poids de cette forme de l'idéologie bourgeoise au sein des organisations prolétariennes... Mais le poids du réformisme dans la 2e Internationale ne fait pas plus de celle-ci un organe bourgeois que celui du réformisme proudhonien ne fit de l'AIT un instrument du capital.
Les organisations politiques du prolétariat n'ont jamais été un bloc monolithique de conceptions identiques. Qui plus est, les éléments les plus avancés s'y sont retrouvés souvent en minorité - comme nous l'avons illustré précédemment. Mais ces minorités qui vont de Marx et Engels aux gauches communistes des années 30 savaient que la vie des organisations politiques du prolétariat dépendait d'un combat non seulement contre l'ennemi dans la rue et les lieux de travail, mais aussi d'un combat permanent contre les influences bourgeoises - toujours présentes - au sein même de ces organisations.
Pour le GCI ce genre de combats était un non-sens, une aide à la contre-révolution.
- « La présence de révolutionnaires marxistes (Pannekoek, Gorter, Lénine...), écrit le GCI, au sein de la 2e Internationale ne signifiait pas que cette dernière défendait les intérêts du prolétariat (tant "immédiats" qu'historiques) mais permettait de cautionner - par manque de rupture - toute la pratique contre-révolutionnaire de la social-démocratie. »
Remarquons en passant que voici Pannekoek, Gorter et Lénine, cette gauche d'une organisation séparée du communisme « ou une frontière de classe » élevés par le GCI soudain au rang de « révolutionnaires marxistes ». Merci pour eux. Mais ce faisant, le GCI nous laisse entendre que des organisations « de nature essentiellement bourgeoise » peuvent avoir une gauche constituée d'authentiques « révolutionnaires marxistes » ... et cela pendant des décennies ! C'est probablement la même « dialectique » qui conduit le GCI à considérer que l'aile gauche du stalinisme latino-américain (les maoïstes du « Sentier Lumineux » au Pérou) peuvent être dans ce pays « l'unique structure capable de donner une cohérence au nombre toujours croissant d'actions directes du prolétariat ».
N'en déplaise à nos dialecticiens punk, le stalinisme maoiste péruvien n'est pas plus « une structure capable de donner une cohérence » aux actions du prolétariat » que les « révolutionnaires marxistes » de la 2e Internationale ne furent des « cautions d'une pratique contre-révolutionnaire ».
Le prolétariat se prépare aujourd'hui à livrer des combats décisifs contre le système capitaliste qui ne parvient plus à se relever de la crise ouverte qui le frappe depuis maintenant près de vingt ans, depuis la fin de la reconstruction à la fin des années 60.
Marx et Engels, Rosa et Lénine, Pannekoek et Gorter n'étaient pas des imbéciles incohérents qui pensaient pouvoir lutter pour la révolution en militant et animant des organisations bourgeoises. C'étaient des révolutionnaires qui, contrairement aux anarchistes - ... et au GCI - avaient une compréhension des conditions concrètes de la lutte ouvrière suivant les époques historiques du système
On peut critiquer le retard avec lequel un Lénine prit conscience de la gravité de la maladie opportuniste qui rongeait la 2e Internationale ; on peut critiquer l'incapacité de Rosa Luxemburg à mener un véritable travail organisationnel de fraction au sein de la social-démocratie dès le début du siècle, mais on ne peut rejeter la nature du combat qu'ils menèrent.
On doit par contre saluer la lucidité de Rosa Luxemburg qui, dès la fin du siècle dernier, fit la critique impitoyable du courant révisionniste qui s'affirmait au sein de la 2e Internationale tout comme la capacité des bolchéviks à s'organiser en fraction indépendante, avec ses propres moyens d'intervention au sein du Parti Ouvrier socialdémocrate de Russie. C'est pour cela qu'ils purent être l'avant-garde du prolétariat dans la vague révolutionnaires de la fin de la première guerre mondiale.
Le GCI croit-il que c'est par hasard que ceux qu'il appelle parfois les « marxistes révolutionnaires » provenaient de la social-démocratie et non de l'anarchisme ou autre courant ? Il est impossible de répondre à cette question élémentaire sans comprendre l'importance de la continuité des organisations politiques du prolétariat. Et ceci ne peut être compris sans comprendre l'analyse de la décadence du capitalisme.
Toute l'histoire de la 2e Internationale ne peut
apparaître que comme un chaos dénué de sens si l'on n'a pas à l'esprit que son
existence se situe dans la période charnière entre la période historique
d'ascendance du capitalisme et celle de sa décadence.
Conclusion
Il part vers ces combats, relativement dégagé des mystifications que la contre-révolution stalinienne a fait peser sur lui pendant près de quarante ans ; ayant perdu dans les pays à vieille tradition de démocratie bourgeoise, ses illusions sur la lutte syndicale ou parlementaire, dans les pays moins développés les illusions sur le nationalisme anti-impérialiste.
Cependant, en se dégageant de ces mystifications, les prolétaires ne sont pas encore parvenus à se réapproprier toutes les leçons des luttes ouvrières du passé.
La tâche des communistes n'est pas d'organiser la classe ouvrière - comme le faisait la social-démocratie au 19e siècle. L'apport des communistes à la lutte ouvrière est essentiellement au niveau de la pratique consciente, de la praxis de la lutte. Et à ce niveau ce n'est pas tant par les réponses qu'ils contribuent, mais par la façon d'envisager, de poser les problèmes. C'est une conception du monde et une attitude pratique qui mettent toujours en avant les dimensions mondiale et historique de chaque question à laquelle est confrontée la lutte.
Ceux qui, tel le GCI, ignorent la dimension historique de la lutte ouvrière, en niant les différentes phases de la réalité du capitalisme, en niant la continuité réelle des organisations politiques du prolétariat, désarment la classe ouvrière au moment où elle a le plus besoin de se réapproprier sa propre conception du monde.
Il ne suffit pas d'être « pour la violence », « contre la démocratie bourgeoise » pour pouvoir se repérer et tracer à chaque moment des perspectives dans la lutte de classe. Loin de là. Entretenir des illusions à cet égard est dangereux et criminel.
RV.
[1] [1140]
Voir « Comprendre la décadence
du capitalisme», Revue Internationale
n° 48, 1e trimestre 1987, ainsi que « Comprendre les conséquences politiques de
la décadence du capitalisme », Revue
Internationale n° 49, 2e trimestre 1987.
[2] [1141] Sauf indication contraire, toutes les
citations du GCI sont tirées des articles «Théories de la décadence, décadence
de la théorie » parus dans les n° 23 et 25 de Le Communiste, novembre 1985 et novembre 1986.
[3] [1142]
Rédigé par Marx, K. Marx,
Oeuvres, La Pleiade,
T. 1.
[4] [1143]
En réalité c'est la vieille
rengaine des modernistes ou anarchistes « honteux », surtout depuis 1968.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Polémique : réponse à « Battaglia Comunista » sur le cours historique
- 3133 reads
Depuis 1968, les groupes révolutionnaires qui ont été amenés à former le CCI défendent le fait que la vague de luttes ouvrières qui a débuté cette année-là en France a marqué une nouvelle période dans le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat : la fin de la longue période de contre-révolution consécutive au reflux de la vague révolutionnaire de 1917-23 ; l'ouverture d'un cours vers des confrontations de classe généralisées. Alors que l'accélération de l'écroulement de l'économie capitaliste ne pouvait que pousser la bourgeoisie vers une nouvelle guerre mondiale, cette même désintégration économique provoquait une forte résistance de la part d'une nouvelle génération d'ouvriers qui n'a pas connu la défaite. En conséquence, le capitalisme ne peut pas aller à la guerre sans, d'abord, écraser le prolétariat ; d'un autre côté, la combativité et la conscience croissantes du prolétariat conduisent inévitablement vers des combats de classe titanesques dont l'issue déterminera si la crise du capitalisme débouchera sur la guerre ou sur la révolution.
Il n'y a pas beaucoup de groupes du milieu politique prolétarien qui partagent cette vision du cours historique, et c'est le cas en particulier du courant le plus important en dehors du CCI, le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR). Après une longue période pendant laquelle le BIPR montrait peu ou pas d'intérêt à discuter avec le CCI, on ne peut que saluer sa récente contribution sur cette question parue dans « Battaglia Comunista » (BC), publication de l'organisation du BIPR en Italie : le Parti Communiste Internationaliste (article « Le CCI et le cours historique : une méthode erronée », BC n° 83, mars 87, publié en anglais dans la « Communist Review » n° 5). Cela, non seulement parce que le texte contient des passages qui indiquent que BC s'éveille à certaines réalités de la situation mondiale actuelle, en particulier la fin de la contre-révolution et les « signes » — au moins cela — d'une reprise des luttes de classe. Mais aussi parce que, même là où le texte défend des positions fondamentalement erronées, il pose les questions essentielles : le problème de la méthode marxiste dans la compréhension de la dynamique de la réalité ; les conditions qui permettent le déchaînement d'une nouvelle guerre mondiale ; le niveau réel de la lutte de classe aujourd'hui, et l'approche de cette question qu'a faite notre ancêtre commun, la Fraction Italienne de la Gauche Communiste dans les années 1930 et 1940.
La méthode marxiste : indiquer la direction ou agnosticisme ?
Dans la Revue Internationale n° 36 nous avons publié une autre polémique avec BC sur la question du cours historique (« Le cours historique : les années 80 ne sont pas les années 30 »). Un texte émanant du 5e Congrès de BC avait affirmé qu'il n'était pas possible de dire si les tourmentes sociales provoquées par la crise éclateraient avant, pendant ou après une guerre impérialiste mondiale. Dans notre réponse, ainsi que dans un texte de base sur le cours historique émanant de notre 3e Congrès en 1979 (voir Revue Internationale n° 18), nous disions que c'est une tâche cruciale et fondamentale des révolutionnaires que d'indiquer la direction générale dans laquelle évoluent les événements sociaux. C'est dommage que le texte de BC ne réponde pas vraiment à ces arguments. En fait, il ne fait pas grand chose d'autre que citer de nouveau le passage que nous avons longuement critiqué dans la Revue Internationale n° 36 ! Mais dans une autre partie de l'article, BC essaie au moins d'expliquer pourquoi il lui semble nécessaire de maintenir une attitude agnostique, considérant qu'il est impossible de se déterminer au sujet du cours historique ; et, plutôt que de répéter simplement tous les arguments qui sont contenus dans nos deux précédents articles, on va répondre à cette nouvelle « explication ».
Voici comment BC pose le problème :
« En ce qui concerne le problème que le CCI nous pose, de devenir des prophètes exacts du futur, la difficulté est que la subjectivité ne suit pas mécaniquement les mouvements objectifs. Bien qu'on puisse suivre de manière précise les tendances et les probables contre-tendances dans les structures du monde économique, ainsi que leurs rapports réciproques, il n'en va pas de même pour ce qui concerne le monde subjectif, ni pour la bourgeoisie ni pour le prolétariat. Personne ne peut croire que la maturation de la conscience, même de la plus élémentaire conscience de classe, puisse être déterminée de manière rigide à partir de données observables et mises dans un rapport rationnel. »
Il est parfaitement exact que les facteurs subjectifs ne sont pas déterminés mécaniquement par les facteurs objectifs et que, en conséquence, il n'est pas possible de faire des prédictions exactes sur les lieu et place des luttes prolétariennes à venir. Mais cela ne veut pas dire qu'historiquement le marxisme se soit confiné à prédire seulement les tendances de l'économie capitaliste. Au contraire : dans le Manifeste Communiste, Marx et Engels ont défini les communistes comme ceux qui « ont l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien ». Et durant toute leur vie ils ont essayé de mettre en pratique cette proposition théorique, alignant étroitement leur activité organisationnelle sur les perspectives qu'ils traçaient pour la lutte des classes (soulignant la nécessité de réflexion théorique après les défaites des révolutions de 1848, pour la formation des 1ére et 2e Internationales dans des périodes de reprise des luttes, etc. ). Ils se sont parfois trompés et ont dû réviser leurs prédictions, mais ils n'ont jamais abandonné l'effort qui a fait d'eux les éléments qui ont vu le plus loin dans le mouvement prolétarien. De même, les positions révolutionnaires intransigeantes adoptées par Lénine en 1914 et en 1917 se basaient sur une confiance inébranlable dans le fait que les horreurs « objectives » de la guerre impérialiste faisaient mûrir en profondeur la conscience de classe du prolétariat. Et quand la Fraction italienne dans les années 30 a insisté si fortement sur la nécessité de fonder toute son activité sur une analyse adéquate du cours historique, elle ne faisait que suivre la même tradition. Et ce qui s'applique à la dimension historique plus large s'applique aussi à la lutte immédiate ; afin de pouvoir intervenir concrètement dans un mouvement de grève, les communistes doivent développer leur capacité d'évaluer et réévaluer la dynamique et la direction des luttes. Le fait d'avoir affaire à des facteurs « subjectifs » n'a jamais empêché les marxistes d'accomplir ce travail essentiel.
Les conditions de la guerre généralisée aujourd'hui
Le CCI a toujours soutenu que, pour pouvoir envoyer le prolétariat à une nouvelle guerre, le capitalisme a besoin d'une situation caractérisée par « l'adhésion croissante des ouvriers aux valeurs capitalistes (et à leurs représentants politiques et syndicaux) et une combativité qui soit tend à disparaître, soit apparaît au sein d'une perspective totalement contrôlée par la bourgeoisie » (Revue Internationale n° 36, « Cours historique : les années 80 ne sont pas les années 30 »).
Peut-être parce qu'il ne veut pas continuer à insister (comme il la fait dans le passé) sur le fait que le prolétariat est encore aujourd'hui écrasé par le talon de fer de la contre-révolution, BC fournit une nouvelle réponse :
«...la forme de guerre, ses moyens techniques, son rythme, ses caractéristiques par rapport à l'ensemble de la population, ont beaucoup changé depuis 1939. Plus précisément, la guerre aujourd'hui nécessite moins de consensus ou de passivité de la part de la classe ouvrière que les guerres d'hier. Qu'il soit clair que nous ne sommes pas en train de théoriser la séparation complète du "militaire" et du "civil" qui, particulièrement au niveau de la production, sont de plus en plus interconnectés. Plutôt, nous voulons mettre en relation la rapidité et le haut contenu technique de la guerre, avec son cadre économique, politique et social. Cette relation est telle que l'engagement dans des actions de guerre est possible sans l'accord du prolétariat. Chaque bourgeoisie est capable de compter sur sa victoire pour rétablir un consensus ainsi que sur les autres choses qu'amène la victoire : occupation de territoires, etc. Et il est évident que chaque bourgeoisie entre en guerre en pensant à la victoire. »
En lisant ce passage, il est difficile de comprendre de quelle guerre parle BC. Les conditions mentionnées ci-dessus pourraient s'appliquer à des aventures impérialistes très limitées telles que les divers raids et expéditions que l'Occident a faits au Proche-Orient — quoique même ces actions doivent s'accompagner de campagnes idéologiques intenses pour embobiner le prolétariat sur ce qui est en train de se passer. Mais nous ne parlons pas d'actions limitées ou locales mais de guerre mondiale, une troisième guerre mondiale dans un siècle où les guerres ont été chaque fois plus globales — embrassant la planète entière — et totales, exigeant la coopération active et la mobilisation de toute la population. BC suggérer ait-il sérieusement que la 3e guerre mondiale pourrait se faire avec des armées professionnelles, sur un champ de bataille « distant », et que l'« interconnexion » des secteurs civils et militaires qui s'ensuivrait n'imposerait pas des sacrifices monstrueux à toute la population travailleuse ? Avec une vision si moyenâgeuse de la guerre mondiale, il n'est pas surprenant que BC puisse encore avoir des espoirs sur une révolution prolétarienne victorieuse pendant et même après le prochain conflit mondial ! Ou alors, par « moyens techniques » et « rythme », BC veut dire que la 3e guerre commencera d'emblée par le bouton qu'on appuie et qui déclenche la guerre atomique. Mais, si c'est le cas, cela n'a aucun sens de parler de victoire de la bourgeoisie ou du prolétariat, vu que le monde serait réduit à des décombres.
En fait, il est pratiquement certain que l'escalade d'une troisième guerre mondiale aboutirait à l'holocauste nucléaire, ce qui est une raison suffisante pour ne pas parler à la légère de la révolution prolétarienne émergeant pendant ou après la prochaine guerre. Mais nous sommes d'accord sur le fait que « chaque bourgeoisie va à la guerre en pensant à la victoire ». C'est pourquoi la bourgeoisie ne veut pas plonger tout de suite dans la guerre nucléaire, c’est pourquoi elle dépense des milliards à chercher des moyens de gagner la guerre sans tout annihiler au passage. La classe dominante sait aussi que les enjeux essentiels de la prochaine guerre seraient les cœurs industriels de l'Europe. Et elle est certainement assez intelligente pour reconnaître que pour que l'Occident puisse occuper l'Europe de l'Est ou pour que la Russie s'empare des richesses de l'Europe de l'Ouest, il faudrait l'engagement et la mobilisation totale des masses prolétariennes, soit dans les fronts militaires soit dans les lieux de production, et cela particulièrement en Europe.
Mais pour que cela soit possible, la bourgeoisie doit s'assurer au préalable non seulement de la « passivité » de la classe ouvrière, mais de son adhésion active aux idéologies de guerre de ses exploiteurs. Et c'est précisément de cela que la bourgeoisie ne peut pas s'assurer aujourd'hui.
Le resurgissement historique du prolétariat
En 1982 le texte du congrès de BC disait que « si le prolétariat aujourd'hui, confronté à la gravité de la crise et subissant les coups répétés des attaques bourgeoises, ne s'est pas encore montré capable de riposter, cela signifie simplement que le long travail de la contre-révolution mondiale est encore actif dans les consciences ouvrières » ; que le prolétariat aujourd'hui « est fatigué et déçu, bien que pas définitivement battu ».
Le texte de BC le plus récent sur le sujet dénote un progrès certain sur ce point. Pour la première fois, il constate sans équivoque que « la période contre-révolutionnaire qui a suivi la défaite de la révolution d'octobre a pris fin » et qu'« il ne manque pas de signes d'une reprise de la lutte de classe et on ne manque pas de les signaler ». Et en fait on a déjà signalé que les pages de Battaglia ont montré un suivi conséquent des mouvements de classe massifs en Belgique, France, Yougoslavie, Espagne, etc.
Cependant, l'attitude sous-jacente du BIPR demeure une attitude de profonde sous-estimation de la profondeur réelle de la lutte de classe aujourd'hui et c'est cela pardessus tout qui le rend incapable de voir à quel point le prolétariat représente un obstacle aux plans de guerre de la bourgeoisie ([1] [1144]).
Battaglia a peut-être remarqué quelques « signes » de riposte de la classe ouvrière dans les années 86-87. Mais ces « signes » sont en réalité le point le plus avancé d'une succession de vagues internationales qui remontent à mai 68 en France. Mais quand la première de ces vagues s'est manifestée, que ce fût en France en 1968 ou lors de l'« automne chaud » en Italie (1969), Battaglia n'y a pas attaché d'importance, les qualifiant d'éruptions bruyantes des couches petites-bourgeoises étudiantes ; elle a ridiculisé les arguments des prédécesseurs du CCI sur l'ouverture d'une nouvelle période et puis est retournée se coucher. Lors de son 5e congrès, en 1982, elle projetait encore sa propre fatigue sur le prolétariat, malgré le fait qu'il y avait déjà eu une seconde vague de luttes entre 78 et 81, qui a culminé dans les grèves de masses en Pologne. Et, après un court reflux après 1981, une nouvelle vague a débuté en Belgique, en septembre 83 ; mais ce n'est qu'en 86, trois ans après le début de cette vague, que BC a commencé à voir les « signes » d'une reprise des luttes de classe ! Ce n'est donc pas surprenant que BC ait du mal à voir où va le mouvement de la classe, vu l'ignorance qu'il a d'où il vient. Typique de cet aveuglement, même par rapport au passé, est cet extrait de son dernier article selon lequel : « après 74 et 79 la crise a poussé la bourgeoisie à asséner des attaques beaucoup plus sérieuses sur la classe ouvrière, mais la combativité ouvrière qui a été tellement saluée, n'a pas augmenté». La vague de luttes de 78 à 81 se trouve donc effacée de l'histoire...
N'interprétant les luttes actuelles que comme un premier et timide début de reprise des luttes plutôt que de les situer dans une dynamique historique en évolution depuis presque vingt ans, BC est par conséquent incapable de mesurer la réelle maturation de la conscience de classe qui a été à la fois un produit et un facteur actif de ces luttes.
Ainsi, quand le CCI dit que les idéologies que le capitalisme utilisait afin de mobiliser la classe pour la guerre dans les années 30 — fascisme/anti-fascisme, défense de la Russie « socialiste », etc. — sont maintenant usées, discréditées aux yeux des ouvriers, Battaglia affirme que la bourgeoisie peut toujours trouver des alternatives au stalinisme ou aux campagnes sur fascisme/antifascisme des années 30. Mais, assez curieusement, il ne nous dit pas lesquelles. Si, par exemple, quand il parle de trouver d'« autres obstacles » au stalinisme il veut dire des obstacles à la gauche du stalinisme, cela apporte de l'eau à notre moulin : parce que quand la bourgeoisie est obligée de mettre son extrême gauche en première ligne pour faire face à la menace prolétarienne, cela ne fait que traduire un processus réel de radicalisation qui s'opère dans la classe.
La vérité est que le désengagement croissant du prolétariat des principales idéologies et institutions de la société bourgeoise est un problème réel pour la classe dominante, en particulier quand elle affecte les principaux organismes chargés de discipliner les ouvriers : les syndicats. Et, à ce niveau, BC semble particulièrement aveugle à ce qui se passe dans la classe ouvrière :
«Le CCI devrait indiquer ici les termes dans lesquels se présente le cours qu'ils ont adopté : une renaissance de la combativité, la faillite des vieux mythes, la tendance à se débarrasser des entraves syndicales... Comme il n'existe pas de réelles pièces à conviction (de cela)... il lui est nécessaire de tricher avec la réalité, l'exagérer, la distordre, l'inventer. »
Ainsi, la tendance croissante à la désyndicalisation (dont la presse bourgeoise se lamente dans beaucoup de pays), le nombre croissant de grèves qui éclatent spontanément, ignorant ou débordant les directives syndicales (comme en Belgique en 83 et 86, au Danemark en 85, la grève de British Telecom début 86, les cheminots en France, les mineurs et métallurgistes en Espagne, et beaucoup d'autres mouvements), les ouvriers qui de plus en plus souvent huent les discours syndicaux, ignorent les pseudo actions syndicales ou les transforment en vraies actions de classe, l'apparition de formes d'auto organisation ouvrière indépendantes et unitaires (comme à Rotterdam en 1979, en Pologne en 1980, en France fin 86-début 87 avec la grève des cheminots, ou la grève des enseignants en France et en Italie...), le surgissement de noyaux d'ouvriers combatifs en dehors des structures syndicales (Italie, Belgique, France, Grande-Bretagne...) toutes ces « pièces à conviction » sur « la tendance à se débarrasser des entraves syndicales» que la presse du CCI suit et commente depuis des années, tout cela ne serait que « pure invention » de notre part, ou au mieux, une « distorsion » de la réalité.
Est-ce que la lutte de classe affecte la bourgeoisie ?
Si l'idée d'une marée montante de résistance prolétarienne n'est qu'une pure invention du CCI, alors il devrait s'ensuivre que la bourgeoisie n'a pas à prendre la classe ouvrière en considération lorsqu'elle élabore ses stratégies économiques ou politiques. Et BC n'hésite pas à tirer cette conclusion :
«Il n'existe pas une seule politique dans l’économie politique des pays métropolitains (à l'exception peut-être de la Pologne et la Roumanie) qui ait été modifiée par la bourgeoisie par suite de luttes du prolétariat ou de fractions de celui-ci. »
Si ce que Battaglia veut dire est que la bourgeoisie n'élabore pas ses attaques économiques (ou ses campagnes de propagande, ses stratégies électorales, etc.) en anticipant sûr les réactions qu'elles vont provoquer chez les ouvriers alors il prend la bourgeoisie pour une imbécile — erreur que les marxistes peuvent difficilement se permettre. En même temps, BC laisse entendre que les bourgeoisies polonaise et roumaine seraient les plus rusées du monde ! En fait, ce n'est pas un hasard si ces deux exemples sont cités. La forme stalinienne de capitalisme d'Etat met souvent plus en relief des tendances qui sont moins évidentes parce que plus banales dans les variantes occidentales du capitalisme d'Etat. On peut toutefois se demander quelles modifications de la politique de la bourgeoisie BC discerne en Roumanie jusqu'à présent. Quant aux modifications de la politique de la bourgeoisie en Pologne pour mieux attaquer la classe ouvrière, qu'on a vues à l'œuvre face à la lutte de classe en 1980 : fausse libéralisation, utilisation du syndicalisme « rénové » à la sauce Solidarnosc, étalement des attaques dans le temps, etc., ce sont celles employées couramment depuis des décennies en Occident. Ce sont les mêmes que Gorbatchev veut généraliser à l'ensemble de son bloc pour mieux confronter la lutte de classe renaissante. Même les fractions les plus rigides et brutales de la bourgeoisie sont aujourd'hui amenées à modifier et adapter leur politique pour mieux confronter la lutte de classe en plein développement.
Par ailleurs, dire que le prolétariat, malgré toutes les luttes massives de ces dernières années, n'a aucunement réussi à faire reculer les mesures d'austérité de la classe dominante, c'est dénier toute signification aux luttes défensives de la classe. Logiquement cela impliquerait que seule la lutte immédiate pour la révolution peut défendre les intérêts ouvriers. Mais, bien qu'en termes globaux il soit vrai que la révolution est la seule ultime défense du prolétariat, il est aussi vrai que les luttes actuelles de la classe sur le terrain des revendications économiques ont à la fois retenu la bourgeoisie de faire des attaques encore plus sauvages, et, dans bon nombre de circonstances, obligé la bourgeoisie à remettre des attaques qu'elle essayait d'imposer. L'exemple de la Belgique en 86 est particulièrement significatif à ce sujet, parce que c'est la menace réelle d'unification des luttes qui a obligé la bourgeoisie à reculer temporairement.
Mais la signification la plus profonde de la capacité prolétarienne à faire reculer les attaques économiques de la classe dominante c'est qu'elle représente aussi la résistance du prolétariat à la poussée du capitalisme vers la guerre. Parce que si la bourgeoisie ne peut pas obliger les ouvriers à se résigner à faire des sacrifices toujours plus lourds au nom de l'économie nationale, elle ne pourra pas plus mettre en place la militarisation du travail que requiert une guerre impérialiste.
Pour Battaglia, cependant, le prolétariat n'est pas encore à la hauteur. Les preuves que nous donnons d'un désengagement croissant de l'idéologie bourgeoise, d'une combativité et d'une conscience en développement, tout cela en fait, «présenté par le CCI comme une "preuve', est extrêmement faible et insuffisant pour caractériser un cours historique. »
Le fait est que pour Battaglia, la seule chose qui pourrait avoir un effet quelconque sur la poussée à la guerre est la révolution elle-même. Notre texte de 1979 répondait déjà à cet argument : « Certains groupes, tel "Battaglia Comunista", estiment que la riposte prolétarienne à la crise est insuffisante pour constituer un obstacle au cours vers la guerre impérialiste. Ils estiment que les luttes devraient être "de nature révolutionnaire" pour qu'elles puissent contrecarrer réellement ce cours et basent leur argumentation sur le fait qu'en 1917-18, c'est la révolution seule qui a mis fin à la guerre impérialiste. En fait, ils commettent une erreur en essayant de transposer un schéma en soi juste sur une situation qui n'y rentre pas. Effectivement, un surgissement du prolétariat dans et contre la guerre prend d'emblée la forme d'une révolution :
— parce que la société est alors plongée dans la forme la plus extrême de sa crise, celle qui impose aux prolétaires les sacrifices les plus terribles,
— parce que les prolétaires en uniforme sont déjà armés,
— parce que les mesures d'exception (loi martiale, etc.) qui sévissent alors rendent tout affrontement de classe plus violent et frontal,
— parce que la lutte contre la guerre prend immédiatement une forme politique d'affrontement avec l'Etat qui mène la guerre sans passer par l'étape de luttes économiques qui, elles, sont beaucoup moins frontales.
Mais toute autre est la situation quand la guerre ne s'est pas encore déclarée.
Dans ces circonstances, toute tendance, même limitée à la montée des luttes sur un terrain de classe suffit à enrayer l'engrenage dans la mesure où :
— elle traduit un manque d'adhésion des ouvriers aux mystifications capitalistes,
— l'imposition aux travailleurs de sacrifices bien plus grands que ceux qui ont provoqué les premières réactions risque de déclencher de leur part une réplique en proportion. » (« Revue Internationale » n° 18, « Le Cours historique », p. 23.)
Ce à quoi nous ne pouvons qu'ajouter qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, on se dirige vers une confrontation de classes généralisée provoquée non par une guerre mais par une crise économique qui s'étend dans le temps. Le mouvement de luttes qui pose les fondations pour cette confrontation est par conséquent lui-même très long et paraît même très peu spectaculaire en comparaison aux événements de 1917-18. Néanmoins, rester fixé sur les images de la première vague révolutionnaire et mésestimer les luttes actuelles, c'est bien la dernière chose à faire pour se préparer aux explosions sociales massives qui vont venir.
La Fraction Italienne et le cours de l'histoire
La manière dont le CCI pose la question du cours historique se base en grande partie sur la méthode de la Fraction Italienne de la Gauche communiste, dont l'activité politique, dans les années 30 était fondée sur la reconnaissance du fait que la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 et l'assaut de la crise de 1929 avaient ouvert un cours vers la guerre impérialiste.
Bien que le Parti Communiste Internationaliste revendique aussi une continuité organique avec la Fraction, il n'a pas réellement assimilé beaucoup de ses contributions les plus vitales, et cela est particulièrement vrai par rapport à la question du cours historique. Ainsi, alors que ce que nous voyons dans la clarté avec laquelle la Fraction traite ce problème c'est que cela lui a permis d'apporter une réponse internationaliste aux événements d'Espagne 1936-39 — contrairement à tous les autres courants prolétariens, du trotskysme à Union Communiste et la minorité de la Fraction elle-même, qui ont succombé à des degrés divers à l'idéologie de l'antifascisme — Battaglia est seulement avide de trouver l'« erreur méthodologique » de la Fraction :
«La Fraction (spécialement son CE. et en particulier Vercesi) dans les années 30, ont évalué la perspective comme étant vers la guerre de manière absolue. Avaient-ils raison ? Certes, les faits leur ont donné intégralement raison. Mais même alors le fait de faire du cours quelque chose d'absolu a conduit la Fraction à faire des erreurs politiques...
L'erreur politique était la liquidation de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne avant la défaite réelle du prolétariat, avec le consécutif durcissement des divergences entre la minorité et la majorité sur une base où aucune des deux n'était à son avantage. Les "internationalistes" se sont laissés absorber par les milices du POUM dont ils ont vite été déçus et sont retournés à la Fraction. La majorité est restée à regarder et pontifier : "II n'y a rien à faire..." »
Revenant au CCI aujourd'hui, Battaglia poursuit :
« Aujourd'hui l'erreur du CCI est fondamentalement la même, même si l'objet est inversé. On fait un absolu du cours vers les affrontements avant la guerre ; toute l'attention est tournée vers cette ingénieuse et irresponsable sous-évaluation de ce qui est devant les yeux de tout le monde en ce qui concerne la course de la bourgeoisie à la guerre. »
Ce passage est rempli d'erreurs. Pour commencer, BC semble mélanger les notions de cours et celle de tendances produites par la crise. Quand il nous accuse de « faire un absolu » du cours vers les affrontements de classe il semble penser que nous voulons nier la tendance à la guerre. Mais ce que nous voulons dire par cours aux affrontements de classe est que la tendance à la guerre — permanente en décadence et aggravée par la crise — est entravée par la contre tendance aux soulèvements prolétariens. Par ailleurs, ce cours n'est ni absolu ni éternel : il peut être remis en question par une série de défaites de la classe ouvrière. En fait, simplement parce que la bourgeoisie est la classe dominante de la société, un cours vers les affrontements de classe est plus fragile et réversible qu'un cours à la guerre.
Deuxièmement, BC déforme complètement l'histoire de la Fraction ; nous ne développerons pas ici en détail l'histoire complexe des groupes de la Gauche communiste ([2] [1145]). Il faut cependant préciser rapidement quelques points.
Ce n'est pas vrai que la position de la majorité était qu'« il n'y avait rien à faire ». Alors qu'elle s'opposait à toute idée d'engagement dans les milices antifascistes, la majorité a envoyé une délégation de camarades en Espagne pour étudier la possibilité de créer un noyau communiste sur place, malgré le danger évident que représentaient les troupes de choc staliniennes : ces camarades ont manqué de peu se faire assassiner à Barcelone. En même temps, en dehors de l'Espagne, les Fractions italienne et belge (et aussi mexicaine : « Groupe ouvrier marxiste ») ont émis un certain nombre d'appels dénonçant le massacre en Espagne et insistant sur le fait que la meilleure solidarité avec les ouvriers espagnols était que les prolétaires des autres pays se mettent en lutte pour leurs propres revendications.
C'est vrai que, devant la 2e guerre mondiale, une tendance s'est cristallisée autour de Vercesi, qui niait « l'existence du prolétariat pendant la guerre » et rejetait toute possibilité d'activité révolutionnaire. C'est aussi vrai que les Fractions de gauche en général ont plongé dans le désarroi et l'inactivité peu avant l'éclatement de la guerre. Mais la source de ces erreurs réside précisément dans l'abandon de leur précédente clarté sur le cours historique. La théorie, formulée surtout par Vercesi, d'une « économie de guerre » qui aurait surmonté les crises de surproduction et par conséquent toutes autres guerres, preuve d'une solidarité inter-impérialiste pour écraser le danger prolétarien, a abouti à la disparition de la revue « Bilan » et la publication d'« Octobre » qui se voulait une anticipation d'une nouvelle reprise révolutionnaire. Les Fractions s'en sont trouvées complètement désarmées à la veille de la guerre : loin de « fixer toute leur attention sur la guerre » comme le dit BC, « Octobre » a interprété l'occupation de la Tchécoslovaquie et les accords de Munich comme des tentatives désespérées de prévenir la révolution ! Il faut dire qu'une minorité significative de l'organisation s'est opposée à cette révision radicale des analyses précédentes de la Fraction. Quelques-uns des porte-parole les plus clairs de cette minorité ont été réduits à silence dans les camps de mort nazis. Mais en France on a continué à défendre cette position même pendant la guerre ; et ce n'est pas par hasard que les mêmes camarades qui ont insisté sur la nécessité de poursuivre l'activité communiste pendant la guerre ont aussi été capables de résister à la fièvre activiste qu'ont provoquée les mouvements prolétariens en Italie en 1943, quand la majorité des camarades de la Gauche Italienne y ont vu un nouveau 1917 décident que le moment de former le parti était venu. Le Parti Communiste Internationaliste est l'héritier direct de cette erreur de méthode ([3] [1146]).
Dans ce contexte, cela vaut aussi la peine de signaler que les éléments de la minorité « internationaliste » ne sont pas retournés à la Fraction comme le dit BC. Ils sont revenus à Union Communiste, qui était à mi-chemin entre la gauche communiste et le trotskysme. Et après 1943 ils sont retournés... au Parti Communiste Internationaliste. Ils se sentaient sans doute plus à l'aise dans une organisation dont les ambiguïtés concernant les formations de partisans en Italie étaient sensiblement les mêmes que leurs propres ambiguïtés envers les milices antifascistes en Espagne... ([4] [1147]). De même Vercesi, d'abord opposé à la formation prématurée du parti, finit par le rejoindre dans l'activisme et la confusion après avoir participé à un « comité anti-fasciste » à Bruxelles !
Le danger qui guette Battaglia
Comme nous venons de le voir, les origines mêmes de Battaglia reposent sur une analyse erronée du cours historique. La formation précipitée du PCI pendant la 2e guerre mondiale a abouti à un abandon de la clarté qu'avait atteinte Bilan sur beaucoup de points, en particulier sur les questions de « fraction », « parti » ou « cours historique ». Ces erreurs ont atteint leur forme la plus caricaturale dans le courant « bordiguiste » qui a scissionné du courant de Battaglia en 1952 ; mais c'est très difficile pour ce dernier de dépasser les ambiguïtés qui lui restent sans remettre en question ses propres origines.
Dans son récent article BC affirme que les erreurs de méthode du CCI, ses déformations de la réalité, ont entraîné des scissions et en amèneront d'autres. Mais le fait est que les pronostics du CCI se sont avérés fondamentalement justes depuis 1968. Nous avons été les premiers à réaffirmer la réapparition de la crise historique à la fin des années 60. Nos prédictions sur le développement de la lutte de classes se sont confirmées avec les différentes vagues qui ont eu lieu depuis lors. Et, malgré tous les sarcasmes et les incompréhensions du milieu politique, il devient de plus en plus évident que la « gauche dans l'opposition » est bien la stratégie politique essentielle de la bourgeoisie dans la période actuelle. Ceci n'est pas pour dire que nous n'avons pas fait des erreurs ou subi des scissions. Mais avec un cadre d'analyses qui est fondamentalement valable, dans une période pleine de possibilités pour le travail révolutionnaire, les erreurs peuvent se corriger et les scissions peuvent aboutir à un renforcement de l'organisation.
Le danger qui guette Battaglia est d'un ordre différent. Il est tellement attaché à sa fausse analyse du cours historique, tellement lié à un certain nombre de conceptions politiques dépassées, qu'il risque de voir éclater l'« homogénéité » dont il fait montre aujourd'hui en une série d'explosions provoquées par la pression constante de la lutte de classe, la contradiction croissante entre ses analyses et la réalité de la lutte des classes.
Que cela plaise à Battaglia ou pas, nous allons vers des confrontations de classe immenses. Les courants qui n'y seront pas préparés risquent de se faire emporter par le souffle de l'explosion.
MU
[1] [1148] On parle ici à un niveau général. A certains moments — et en totale contradiction avec l'article auquel nous répondons ici — Battaglia va même jusqu'à appuyer la thèse selon laquelle le capitalisme doit d'abord réduire à silence le prolétariat avant de pouvoir l'envoyer à la guerre. Ainsi, dans le même numéro de Battaglia où est paru cet article, on peut lire un article « Réaffirmons quelques vérités sur la lutte de classes » qui dit : « réaffirmons pour la nième fois aux ouvriers que ne pas lutter contre les sacrifices qu'impose la bourgeoisie revient à laisser la bourgeoisie consolider la paix sociale requise comme prélude à une troisième guerre impérialiste. » (Souligné par nous).
[2] [1149] Voir notre brochure « La Gauche communiste d'Italie ».
[3] [1150] On trouvera une documentation plus fournie sur la réponse de la Fraction à la guerre en Espagne et la 2e guerre mondiale dans notre brochure « La Gauche Communiste d'Italie ».
[4] [1151] Sur les ambiguïtés du PCI sur la question des partisans, voir la Revue Internationale n° 8 : « Les ambiguïtés sur "les partisans" dans la constitution du PCI en Italie 1943 ».
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
- Battaglia Comunista [449]
Approfondir:
Questions théoriques:
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 (3° partie)
- 3061 reads
L'ANNEE 1918 : ENTRE LA REVOLUTION ET L'OPPORTUNISME, LA NAISSANCE DU PARTI COMMUNISTE HOLLANDAIS
L'année 1918 est une année décisive pour le mouvement révolutionnaire hollandais. La minorité du SDP, constituée de différentes fractions, devient une opposition structurée contre l'opportunisme de la direction Wijnkoop-Van Ravesteyn. Cette opposition se développe numériquement au rythme de la croissance du SDP, qui se proclame en novembre Parti communiste, au moment où la révolution frappe aux portes des Pays-Bas.
L'offensive de la minorité dans le SDP: entre la fraction et l'opposition
Au printemps 1918, le SDP connaît une crise sans précédent en son sein. La minorité est directement menacée d'écrasement par la direction autoritaire de Wijnkoop. Celui-ci fait suspendre — phénomène inouï dans l'histoire du SDP — la section de La Haye, Tune des plus combatives dans l'opposition à Wijnkoop. Cette suspension venait après plusieurs exclusions individuelles de militants de l'opposition. Ces mesures, en contradiction avec la démocratie ouvrière, faisaient apparaître la direction comme de dignes émules de Troelstra.
L'opposition ne tarda pas à se regrouper, lors d'une réunion commune tenue le 26 mai 1918. Elle était composée de groupes qui jusqu'ici avaient réagi de façon dispersée à l'opportunisme dans la SDP:
— l'Union de propagande Gauche de Zimmerwald, d'Amsterdam, dirigée par Van Reesema, qui œuvrait pour le rattachement du parti à la gauche bolchevik ;
— le groupe de Luteraan, à Amsterdam, en relation étroite avec Gorter ;
— le groupe de Rotterdam ;
— la section de La Haye.
L'opposition représentait un tiers des militants du parti. Elle se dota d'un organe bimensuel, «De Internationale», dès juin. Une commission de rédaction était mise en place. La commission de presse, qui se réunissait tous les trois mois, et était composée des représentants des 4 groupes ([1] [1152]) formait dans les faits un organe exécutif. Cette opposition était bien près de former une fraction à l'intérieur du SDP, avec son journal et sa commission. Il lui manquait, cependant, une plate-forme clairement établie, faute d'homogénéité. Elle souffrait aussi cruellement de l'absence de Gorter, qui de Suisse ne contribuait aux débats que sous forme d'articles, dont la parution était d'ailleurs soumise à la mauvaise volonté de la rédaction de « De Tribune », entièrement contrôlée par Wijnkoop et Van Ravesteyn. ([2] [1153])
La cause de ce regroupement des oppositions était l'hostilité croissante à la politique du parti, de plus en plus tournée vers les élections. Celles-ci, qui s'étaient déroulées, le 3 juillet, avaient été un véritable succès pour le SDP. Pour la première fois, il siégeait au Parlement : Wijnkoop et Ravesteyn devenaient députés, cela avait été rendu possible par une alliance avec le petit parti socialiste (S. P.), sorti du SDAP en 1917. Celui-ci dirigé par un chef du NAS — Kolthek ([3] [1154]) — était ouvertement pro Entente. Avec les chrétiens sociaux, autre composante de ce «front uni» électoral, il obtenait un siège à l'Assemblée.
L'opposition, par suite de cette alliance, qu'elle dénonçait comme une «union monstrueuse» avec les éléments syndicalistes pro Entente, souligna que le succès électoral était un succès démagogique. Les voix glanées chez les militants syndicalistes du NAS l'avaient été par une campagne qui apparaissait comme un soutien à la politique des USA. Alors que les Etats-Unis retenaient dans ses ports la flotte de commerce hollandaise, pour l'utiliser dans la guerre contre l'Allemagne, en échange de denrées alimentaires pour les Pays-Bas, Wijnkoop affirmait que tous les moyens étaient bons pour obtenir des USA ces denrées. Une telle politique fut vivement dénoncée par Gorter et la section de Bussum, mais beaucoup plus tard, en novembre. Avec Gorter, l'opposition voyait de plus en plus en Wijnkoop un nouveau Troelstra, dont l'amour pour la révolution russe était «purement platonique» et la politique purement parlementaire ([4] [1155]).
L'approche de la fin de la guerre, avec les événements révolutionnaires qui l'accompagnèrent, plaça au second plan la lutte de l'opposition contre la politique pro Entente de Wijnkoop. De plus en plus elle souligna ([5] [1156]) le danger d'une politique parlementaire. Elle combattit avec force le syndicalisme révolutionnaire, celui du NAS, qui s'était mis à travailler avec le syndicat réformiste NVV, soumis au parti Troelstra. En germe, se trouve la politique antiparlementaire et antisyndicale de la future Gauche Communiste hollandaise. Cette politique signifiait une rupture avec l'ancien «tribunisme».
La révolution avortée de novembre 1918
C'est un parti en pleine croissance numérique, mais menacé d'éclatement, qui subit l'épreuve du feu des événements révolutionnaires de novembre.
Ce sont les événements en Allemagne, où le gouvernement est tombé fin octobre, qui créent une véritable atmosphère révolutionnaire aux Pays-Bas. De véritables mutineries éclatent dans les camps militaires les 25 et 26 octobre 1918. Elles succèdent à une agitation ouvrière permanente contre la faim, durant les mois de septembre et octobre, à Amsterdam et Rotterdam.
Il est symptomatique de voir la social-démocratie officielle de Troelstra se radicaliser. Au grand étonnement des autres chefs du SDAP, le dirigeant du parti tient des discours enflammés pour la révolution, pour la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Il proclame, à la stupéfaction de la bourgeoisie hollandaise, qu'il était son adversaire irréductible :
«Ne sentez-vous pas peu à peu avec les événements que vous êtes assis sur un volcan...L'époque du système gouvernemental bourgeois est révolu. A présent, la classe ouvrière, la nouvelle force montante, doit vous prier de lui laisser la place et une place qu'il revient de lui remettre. Nous ne sommes pas vos amis, nous sommes vos adversaires, nous sommes, pour ainsi dire (sic), vos ennemis les plus résolus »
Troelstra, un «révolutionnaire» de la dernière heure ? Il tenait en fait un double langage. Dans le secret d'une réunion des instances du SDAP, tenue le 2 novembre — soit trois jours avant cette déclaration enflammée à la chambre des députés — Troelstra avouait crûment que sa tactique était de devancer l'action des révolutionnaires, encouragés par la révolution en Allemagne :
«Dans ces circonstances les contrastes s'accentueront dans la classe ouvrière et une partie croissante de celle-ci se placera sous la direction d'éléments irresponsables.»
Jugeant la révolution inévitable et pour neutraliser un éventuel « spartakisme » hollandais, Troelstra proposait d'adopter la même tactique que la social-démocratie allemande dans les conseils ouvriers ; en prendre la direction pour mieux les détruire :
«Nous n'appelons pas maintenant la révolution, mais la révolution nous appelle ... Ce qui s'est passé dans les pays qui font l'épreuve d'une révolution me fait dire : nous devons dès qu'elle arrive jusque là en prendre la direction.»
La tactique adoptée fut d'appeler à la formation de conseils ouvriers et de soldats, le 10 novembre, si l'exemple allemand devait gagner la Hollande. «Wijnkoop ne doit pas être le premier», affirmait Oudegeest, un des chefs du SDAP.
Mais le SDP fut le premier à appeler à la formation de conseils de soldats et à la grève, dès le 10 novembre. Il se prononçait pour l'armement des ouvriers et la formation d'un gouvernement populaire sur la base des conseils. Il exigeait aussi une « démobilisation immédiate » des appelés, mot d'ordre ambigu, puisque sa conséquence était le désarmement des soldats.
C'est ce mot d'ordre que reprit le SDAP, dans cette intention. A cela, il ajoutait le programme de la social-démocratie allemande, pour désamorcer les revendications révolutionnaires : socialisation de l'industrie, assurance chômage complète et travail de huit heures.
Mais les événements montrèrent que la situation aux Pays-bas était loin d'être encore révolutionnaire. Il y eut bien le 13 novembre un début de fraternisation entre ouvriers et soldats d'Amsterdam ; mais le lendemain, la manifestation se heurta aux hussards qui tirèrent sur la foule, laissant plusieurs morts sur le pavé. L'appel à la grève lancé par le SDP pour le lendemain, en protestation contre la répression, resta sans écho chez les ouvriers d'Amsterdam. La révolution était bien écrasée avant d'avoir pu pleinement se développer. L'appel à former des conseils ne rencontra qu'un succès limité ; seuls quelques groupes de soldats, dans des lieux isolés de la capitale — à Alkmaar et en Frise — se constituèrent en conseils. Constitution sans lendemain.
Si la situation n'était pas mûre pour une révolution, on doit constater que l'action du SDAP a été décisive pour empêcher tout mouvement de grève en novembre. Plus de 20 ans après, Vliegen, dirigeant du SDAP, l'avouait sans ambages :
«Les révolutionnaires n'ont pas accusé en vain le SDAP d'avoir en 18 étranglé le mouvement de grève, car la social-démocratie l'a alors consciemment freiné.»
Mais, à côté de la politique du SDAP pour empêcher la révolution, celle pratiquée par les syndicalistes du NAS et par le RSC — auquel adhérait le SDP — ne fut pas sans provoquer un désarroi dans les masses ouvrières. En effet, au cours des événements de novembre, le NAS entreprit de se rapprocher du SDAP et du NVV afin d'établir un éventuel programme d'action commune. Cette politique de « front uni » avant la lettre, vivement critiquée dans les assemblées du RSC, donnait l'impression que le RSC, auquel adhérait le NAS, et le SDAP se situaient sur le même terrain. La politique de sabotage du mouvement de grève n'était pas mise à nu. D'autre part, la direction du SDP n'émit aucune critique véritable du syndicalisme révolutionnaire ; elle estima, lors du congrès de Leiden tenu les 16 et 17 septembre, que «le NAS avait agi correctement » pendant la semaine révolutionnaire du 11 au 16 septembre.
La fondation du Parti communiste en Hollande (CPN)
La transformation du SDP en Parti communiste faisait de celui-ci le deuxième parti du monde, après le parti russe, à avoir abandonné l'étiquette «social-démocrate». Il se formait avant même le parti communiste allemand.
Petit parti, le CPN était en pleine croissance : plus de 1000 membres au moment du congrès ; chiffre qui doubla en l'espace d'un an.
Cette transformation ne mit pas fin à la politique autoritaire et manoeuvrière de Wijnkoop. Trois semaines avant le congrès, lui et Ceton, par un avis paru dans «De Tribune», s'étaient autoproclamés respectivement président et secrétaire du parti. Tous deux, en anticipant les résultats du congrès, donnaient un curieux exemple de démocratie. ([6] [1157])
Cependant, le nouveau parti demeurait le seul pôle révolutionnaire aux Pays-Bas. Ce fait explique que le résultat du congrès de fondation fut la désagrégation de l'opposition. «De Internationale», organe de l'opposition, cessait de paraître en janvier 19. La démission des 26 membres de la section de La Haye en décembre 1918 qui refusaient de devenir membres du CPN apparaissait irresponsable. Sa transformation en groupe de « Communistes internationaux » pour se rattacher aux spartakistes et aux bolcheviks, sur une base antiparlementaire et de solidarité avec la révolution russe, fut sans lendemain. Ses membres, pour la plupart, ne tardèrent pas à regagner le parti. Le groupe Gauche de Zimmerwald, au sein du parti, ne tarda pas à se dissoudre lui aussi. Seule restait l'opposition « gortérienne » d'Amsterdam autour de Barend Luteraan. C'est ce groupe qui maintint la continuité avec l'ancienne opposition, en faisant paraître son propre organe, dès l'été 1919 : «De Roode Vaan» (« Le drapeau rouge »).
Contrairement à une légende qui en a fait un fondateur du parti communiste, Gorter était absent du congrès. Il s'était de plus en plus détaché du mouvement hollandais pour se consacrer entièrement au mouvement communiste international. Fin décembre, il était à Berlin, où il eut un entretien avec Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. De là, il rentrait aux Pays-Bas. Il refusait, malgré la demande pressante de Luteraan, de prendre la tête de l'opposition dans le CPN. La direction d'une opposition était pour lui «aussi bonne qu'impossible», en raison de son état de santé dégradé.
Il ne s'agissait pas de sa part d'un refus de toute activité politique. Quelques mois plus tard, il se retirait de toute activité au sein du CPN, pour se consacrer entièrement au mouvement communiste en Allemagne. Il devenait de fait un militant et le théoricien de l'opposition qui allait former le KAPD en avril 1920. Son activité se déployait totalement au sein de l'Internationale communiste, dans l'opposition.
Pannekoek, à la différence de Gorter, ne devint pas membre du KAPD. Il resta dans l'opposition au sein du CPN jusqu'en 1921, pour en démissionner. Ses contributions furent essentiellement théoriques plus qu'organisationnelles. Il s'agissait pour lui de déployer ses activités théoriques au sein du mouvement communiste mondial, principalement en Allemagne.
Ainsi, les têtes théoriques du «tribunisme» se détachaient du CPN. Elles constituaient l'Ecole hollandaise du marxisme, dont le destin était lié désormais théoriquement et organiquement à celui du KAPD en Allemagne. Désormais, la gauche communiste aux Pays-Bas était liée, jusqu'au début des années 30, à la gauche communiste allemande. Celle-ci, étroitement dépendante de l'Ecole hollandaise du marxisme, constituait le centre du communisme de gauche international, sur le terrain pratique de la révolution et sur le plan organisationnel. Quant au CPN, en dehors de l'opposition qui finit par s'en détacher, son histoire devient celle d'une section de plus en plus « orthodoxe » de l'Internationale communiste.
CH. (Fin du chapitre)
[1] [1158] De Internationale, n° 1, 15 juin 1918, «Ons Orgaan», p. 1. Les lignes directrices du regroupement étaient : le rattachement politique à la Gauche zimmerwaldienne ; le combat contre l'Etat impérialiste néerlandais ; la lutte la plus aiguë contre toute les tendances réformistes et impérialistes parmi les syndiqués organisés dans le NAS et le NW (syndicat du SDAP).
[2] [1159] Depuis août 1917, Wijnkoop et Van Ravesteyn étaient les seuls rédacteurs du quotidien.
[3] [1160] Kolthek, qui fut élu député, était collaborateur d'un journal bourgeois « De Telegraaph », qui avait l'orientation la plus vigoureusement pro Entente. Avec son parti, le SP, et le BVSC, le SDP obtenait plus de 50 000 voix, dont 14 000 pour Wijnkoop à Amsterdam — soit la moitié de celles du SDAP. Les trois députés élus formèrent une «fraction parlementaire révolutionnaire» à la chambre.
[4] [1161] Gorter rédigea un article assimilant Wijnkoop à Troelstra, publié sous le titre « Troelstra-Wijnkoop », le 18 septembre 1918 dans De Tribune. De Tribune, du 26 octobre 1918 soulignait : «l'amour du comité directeur pour la révolution russe est purement platonique. En réalité toutes les puissances de son amour sont dirigées vers l'extension de la popularité et de la croissance du parti avec l'aide des secours du parlement.»
[5] [1162] L'opposition ne rejetait pas encore le parlementarisme ; elle souhaitait une discussion sérieuse dans le mouvement ouvrier pour déterminer la tactique future : « ...d'importants problèmes dans cette phase du mouvement ouvrier ne pouvaient s'éclaircir...Au sujet du parlementarisme, la rédaction soutient le point de vue que chacun doit pouvoir son avis là dessus dans "De Internationale". Cette question pourtant ne doit pas être encore épuisée... La même chose vaut pour la participation ou la non-participation aux élections. » (De Internationale, n° 9, 12 octobre 1918, « Landelijke conferentie van "de Internationale"».
[6] [1163] De Tribune, 26 octobre 1918. Cité par WIESSING ; op. cit., p. 86. La nomination anticipée sous forme d'avis était annoncée de la façon suivante : « Attention ! étant donné que Wijnkoop est le seul candidat pour le poste de président du parti, il est par cela même déclaré élu à ce poste. Etant donné que l'unique candidat pour le poste de secrétaire du parti est Ceton, il est en conséquence déclaré élu. Les candidats pour le poste de vice-président sont: A. Lisser et B. Luteraan. »
Géographique:
- Hollande [558]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
La gauche hollandaise en 1919-1920 (1° partie) : la troisième internationale
- 3359 reads
En janvier 1919, était envoyée à différents partis communistes, qui venaient à peine de se constituer, et à des fractions ou oppositions révolutionnaires dans les anciens partis, une lettre d'invitation au congrès de la « nouvelle Internationale révolutionnaire ». A l'origine, il ne s'agissait pas de convoquer un congrès, mais une simple « conférence socialiste internationale », pour préparer la fondation de la 3e Internationale. Elle devait se tenir avant le premier février, soit à Berlin, soit en Hollande, clandestinement. L'écrasement de l'insurrection de janvier à Berlin modifia le plan originel : la conférence dut se tenir à Moscou, du 2 au 6 mars 1919.
Le parti communiste hollandais reçut la convocation. Il avait déjà décidé lors de son congrès de novembre 1918 d'envoyer un délégué lorsque serait connue la convocation au congrès de la troisième Internationale. Pourtant, l'attitude de la direction du CPN fut exactement la même que celle qu'elle avait adoptée pour les trois conférences du mouvement de Zimmerwald. Bien qu'ayant reçu tous les moyens pour faire le voyage vers Moscou, Wijnkoop ne « réussit » pas à se mettre en route. Il s'agissait en fait de sa part d'un refus. Pour expliquer ce refus, toujours camouflé derrière une phrase sectaire, il fit paraître les articles du journaliste bourgeois Ransome qui prétendait que le congrès de la troisième Internationale n'aurait été qu'une « pure opération slave ».
Finalement, le parti communiste des Pays-Bas fut représenté indirectement, et uniquement avec voix consultative, au premier congrès de la nouvelle internationale. Son représentant, Rutgers, ne venait pas directement des Pays-Bas : il avait quitté le pays en 1914 pour les Etats-Unis, où il était devenu membre de la Ligue américaine de propagande socialiste ([1] [1164]). Parvenu à Moscou, via le Japon, il ne représentait en fait que ce groupe américain, sans mandat. C'est par son intermédiaire qu'aux USA, la gauche Hollandaise était connue. L'un des chefs du communisme de gauche américain, Fraina ([2] [1165]), son ami, était très influencé par Gorter et Pannekoek.
Le parti communiste hollandais finissait par adhérer à la troisième Internationale, en avril 1919. Rutgers fut associé aux travaux du comité exécutif.
Les courants de gauche dans l'Internationale en 1919
La gauche dans la troisième Internationale s'est développée au cours de Tannée 1919 sous l'influence de la révolution allemande. Celle-ci représentait pour tous les courants de gauche l'avenir du mouvement prolétarien dans l'Europe occidentale industrialisée. Malgré la défaite de janvier 1919 à Berlin, où le prolétariat avait été écrasé par la social-démocratie de Noske et Scheidemann, jamais la révolution mondiale n'avait semblé aussi proche. La république des conseils avait été instaurée aussi bien en Hongrie qu'en Bavière. La situation demeurait révolutionnaire en Autriche. De grandes grèves de masses secouaient la Grande-Bretagne et s'ébauchaient en Italie. Le continent américain lui-même était secoué par la vague révolutionnaire de Seattle jusqu'à Buenos-Aires ([3] [1166]). Le prolétariat des pays les plus développés se mettait en branle. La question de la tactique à adopter dans les pays centraux du capitalisme, où la révolution serait plus purement prolétarienne qu'en Russie, devait nécessairement être examinée à la lueur d'une prise du pouvoir, que les révolutionnaires pensaient devoir se produire dans un futur très proche.
La vague révolutionnaire, c'est-à-dire l'expérience même des ouvriers confrontés à l'Etat, se traduisait par un changement de tactique avec la fin de l'ère pacifique de croissance du capitalisme. Tous les courants révolutionnaires reconnaissaient la validité des thèses du Premier Congrès de la Troisième Internationale :
« 1) La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et ce sera celle de l'effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n'est pas abattu.
2) La tâche du prolétariat consiste maintenant à s'emparer du pouvoir d'Etat. La prise du pouvoir d'Etat signifie la destruction de l'appareil d'Etat de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil du pouvoir prolétarien. » ([4] [1167])
Dans la nouvelle période, c'est la praxis même des ouvriers qui remettait en cause les vieilles tactiques parlementaire et syndicale. Le parlement, le prolétariat russe l'avait dissous après la prise du pouvoir, et en Allemagne une masse significative d'ouvriers s'était prononcée en décembre 1918 pour le boycottage des élections. En Russie comme en Allemagne, la forme conseils était apparue comme la seule forme de lutte révolutionnaire en lieu et place de la structure syndicale. Mais la lutte de classe en Allemagne avait révélé l'antagonisme entre prolétariat et syndicats. Lorsque les syndicats eurent participé à la répression sanglante de janvier 19 et que surgirent des organismes politiques de lutte — les Unions (AAU) — le mot d'ordre fut non la reconquête des vieux syndicats, mais leur destruction ([5] [1168]).
En donnant comme base fondamentale de PIC aussi bien le programme du PC allemand que celui du parti bolchevik, l'Internationale acceptait de fait les courants de gauche antiparlementaires et antisyndicaux. Le congrès du Spartakus Bund n'avait-il pas rejeté la participation aux élections ? Même si Rosa Luxembourg en cela n'était pas d'accord avec la majorité, elle défendait une ligne antisyndicale : «(...) (les syndicats) ne sont plus des organisations ouvrières, mais les protecteurs les plus solides de l'Etat et de la société bourgeoise. Par conséquent, il va de soi que la lutte pour la socialisation ne peut pas être menée en avant sans entraîner celle pour la liquidation des syndicats. Nous sommes tous d'accord sur ce point. » ([6] [1169])
A ses débuts, l'Internationale communiste acceptait dans ses rangs des éléments syndicalistes révolutionnaires, comme les IWW, qui rejetaient aussi bien le parlementarisme que l'activité dans les anciens syndicats. Mais ces éléments rejetaient par principe l'activité politique et donc la nécessité d'un parti politique du prolétariat. Ce n'était pas le cas des éléments de la gauche communiste qui d'ailleurs étaient le plus souvent hostiles au courant syndicaliste révolutionnaire qu'ils ne souhaitaient pas voir accepter dans l'Internationale, organisme non syndical, mais politique ([7] [1170]).
C'est au cours de l'année 1919 qu'apparaît véritablement le courant communiste de gauche sur une base politique et non syndicaliste, dans les pays développés. La question électorale est dans certains pays la question clef pour la gauche. En mars 1918, le parti communiste polonais — issu lui-même du SDKPIL de Rosa Luxembourg et Jogiches — boycotte les élections. En Italie, est publié le 22 décembre 1918 «Il Soviet» de Naples, sous la direction d'Amadeo Bordiga. A la différence de Gramsci, et de son courant syndicaliste, qui défend la participation aux élections, le courant de Bordiga prône l'abstentionnisme communiste en vue d'éliminer les réformistes du parti socialiste italien, pour constituer un « parti purement communiste ». Formellement, la Fraction communiste abstentionniste du PSI est constituée en octobre 1919. En Grande-Bretagne, la Worker's Socialist Fédération de Sylvia Pankhurst se prononce contre le parlementarisme «révolutionnaire» afin d'éviter tout «gaspillage d'énergie» ([8] [1171]). En Belgique le groupe «De Internationale» des Flandres et le groupe de War van Overstraeten ([9] [1172]) sont contre l'électoralisme. Il en est de même dans les pays plus « périphériques ». Au Congrès du parti communiste bulgare, en mai 1919, une forte minorité s'était prononcée pour la condamnation de l'action parlementaire ([10] [1173])
Les Hollandais, par contre, en dépit d'une légende tenace étaient loin d'être aussi radicaux sur la question parlementaire. Si la majorité autour de Wijnkoop était électoraliste... la minorité était hésitante. Gorter lui-même était pour l'activité révolutionnaire au Parlement ([11] [1174]).
Pannekoek, par contre, défendait une position antiparlementaire. Comme tous les communistes de gauche il soulignait le changement de période historique et la nécessité de rompre avec le principe démocratique ancré dans les masses ouvrières d'Europe occidentale. Pour le développement de la conscience de classe, il était nécessaire de rompre avec la « démocratie parlementaire » ([12] [1175]).
L'Internationale communiste en 1919 ne considérait pas que le rejet de la participation aux parlements bourgeois était un motif d'exclusion de la gauche. Lénine, dans une réponse à Sylvia Pankhurst ([13] [1176]) était d'avis que « la question du parlementarisme est actuellement un point particulier, secondaire... Etre indissociablement lié à la masse ouvrière, savoir y faire une propagande constante, participer à chaque grève, faire écho à chaque revendication des masses, voilà ce qui est primordial pour un parti communiste... Les ouvriers révolutionnaires dont les attaques ont pour cible le parlementarisme ont parfaitement raison dans la mesure où elles expriment la négation de principe du parlementarisme bourgeois et de la démocratie bourgeoise. » ([14] [1177])
Sur cette question, pourtant, la circulaire du comité exécutif de TIC du 1er septembre 1919, marque un tournant. Si les actions parlementaires et les campagnes électorales sont encore définies comme des «moyens auxiliaires», la conquête du parlement apparaît comme une conquête de l'Etat. L'I.C. revient à la conception social-démocrate du Parlement comme centre de la lutte révolutionnaire: « (les militants)... vont au parlement pour s'emparer de cette machine (souligné par nous) et pour aider les masses, derrière les murs du Parlement, à le faire sauter.»
Beaucoup plus grave, comme point de rupture entre la gauche et l'IC était la question syndicale. Dans une période où les conseils ouvriers n'étaient pas encore apparus, fallait-il militer dans les syndicats, devenus contre-révolutionnaires, ou au contraire les détruire en instaurant de véritables organismes de lutte révolutionnaire ? La gauche était divisée. La fraction de Bordiga penchait pour la constitution de « vrais » syndicats rouges : le parti communiste d'Amérique de Fraina était partisan de travailler avec les syndicalistes révolutionnaires des IWW, rejetant tout « entrisme » dans les syndicats réformistes. La minorité du CPN, avec Gorter et Pannekoek, était hostile de plus en plus à une activité dans le NAS, estimant la rupture inéluctable avec le courant anarcho-syndicaliste.
L'exclusion de la gauche allemande, pour antiparlementarisme et antisyndicalisme, va cristalliser l'opposition de gauche internationale. La minorité hollandaise se trouve de fait, théoriquement, à la tête du «Linkskommunismus» allemand et international.
(A suivre)
Ch.
[1] [1178] La Ligue américaine de propagande socialiste naquit en 1916 au sein du Parti socialiste, dans le Massachussetts, contre l'orientation électoraliste de la direction du parti. Elle publia «The Internationalist» qui combattit la majorité orientée vers le pacifisme en 1917. En 1919, elle prit la dénomination d'«Aile gauche du parti socialiste », et publia à Boston — sous la direction de Fraina l'hebdomadaire «Revolutionary Age». Dans ses Thèses, elle se prononçait en 19 pour la sortie de la deuxième Internationale et le rattachement à la troisième Internationale : pour l'élimination des revendications réformistes contenues dans la plate-forme du P. S.
[2] [1179] Louis Fraina (1894-1953) : né en Italie du Sud, avait émigré aux USA avec ses parents à l'âge de deux ans. A 15 ans, il devenait membre du SLP deléoniste qu il quitta en 1914. Il devint membre du PS américain et actif, avec J. Reed, dans son aile gauche, qui décida la scission lors d'une conférence en juin 19. De cette scission naquit le Communist Labor Party of America de Fraina le plus avancé théoriquement — en septembre 1919. Après la conférence d'Amsterdam de février 1920, il participa au second congrès de l'I. C., après avoir été lavé du soupçon d'être un « agent provocateur». Il prit alors avec Katayama et un certain Jésus Ramirez la direction du «Bureau panaméricain du Komintern» à Mexico, en 1920-21, sous le pseudonyme de Luis Corey. En 1922, il cessait de militer et se faisait connaître comme journaliste sous ce pseudonyme. Devenu professeur d'université en économie, il se fit par la suite essentiellement valoir pour ses ouvrages d'économie.
[3] [1180] Les IWW furent à la tête de la grève de Seattle qui se généralisa à Vancouver et Winnipeg, au Canada. La même année 19, éclatèrent des grèves très dures chez les métallos de Pennsylvanie. Ces grèves furent combattues par les syndicats et durement réprimées par la police patronale et le gouvernement fédéral. En Argentine, la «Semaine sanglante» de Buenos-Aires se solda par des dizaines de morts chez les ouvriers. A l'extrême sud du continent, les ouvriers agricoles de Patagonie furent sauvagement réprimés.
[4] [1181] « Lettre d'invitation du Congrès » dans « La révolution allemande » de Broué, p. 40.
[5] [1182] La première union (AAU) qui ne soit pas anarcho-syndicaliste > — comme dans la Ruhr — naquit à l'automne 1919 à Bremen. Son organe Kampfruf (Flugzeitung fur die revolutionàre Betrieb-sorganisation) affirmait clairement qu'elle ne voulait pas «devenir un nouveau syndicat » Se prononçant « pour la conquête du pouvoir politique», l'AAU de Bremen dénonçait les syndicalistes comme « des adversaires de la dictature politique du prolétariat ». (In « Kampfruf», n° 1, 15 octobre 1919, « Was ist die AAU ? »).
[6] [1183] Cité par Prudhommeaux, « Spartacus et la Commune de Berlin 1918-19 », « Spartacus », p. 55)
[7] [1184] Bordiga était le plus ferme partisan de cette séparation entre Internationale politique et Internationale d'organisations économiques. Jusqu'en 1920, l'I.C. acceptait dans ses rangs aussi bien des organisations communistes que des syndicats nationaux, régionaux de métier et d'industrie. Cela dura jusqu'à l'instauration de l'Internationale syndicale rouge (Profintern). Le KAPD voulait instaurer, à côté de l'Internationale communiste, une internationale des organisations d'entreprise sur des bases politiques : antiparlementarisme, destruction des svndicats contre-révolutionnaires, conseils ouvriers, destruction de 1 Etat capitaliste.
[8] [1185] S. Pankhurst, « Pensée et action communistes dans la troisième Internationale » publié dans « Il Soviet » de Bordiga le 20 septembre 1919.
[9] [1186] War van overstaeten (1891-1981), peintre ; d'abord anarchiste, il devint pendant la guerre le rédacteur en chef du journal des Jeunes Gardes Socialistes : « Le socialisme », zimmerwaldien. Il est à l'origine du groupe communiste de Bruxelles, fondé en 1919, qui devait publier le 1er mars 1920 « L'ouvrier communiste » (« De Kommunistische Arbeider » en Flandre). Il défendit au seond congrès de l'IC les thèses antiparlementaires de Bordiga. Il fut l'un des principaux artisans de la fondation du PC belge en novembre 1920, auquel adhéra la Fédération flamande en décembre (« De Internationale »). Au troisième congrès de l'IC, il se trouvait très proche du KAPD. Sous la pression de l'IC, il dut admettre le groupe « centriste » : « Les amis de l'exploité » de Jacquemotte et Massart, en septembre 1921, lors du congrès d'unification. Contrairement à Bordiga, il continua toujours à défendre les positions antiparlementaires. Hostile aux partis de «masse» et à la «bolchevisation», il fit partie en 1927 du groupe unifié de l'opposition. Il fut exclu avec l'opposition en 1929 et devint proche de la Ligue des communistes internationalistes de Hennaut, fondée en 1931, après la séparation d'avec l'aile trotskyste. En Espagne de 1931 à 1935, en contact avec des groupes de la gauche communiste, il se retira par la suite de tout engagement politique.
[10] [1187] Une forte opposition s'était constituée dans le PC bulgare autour d'Ivan Gantchev, journaliste et traducteur de Goethe. C'est lui qui se chargea de traduire en bulgare un certain nombre d'ouvrages de Gorter. En Hongrie, les positions antiparlementaires furent connues grâce au groupe de communistes hongrois exilés à Vienne, après la fin de la « Commune hongroise ». Au sein de ce groupe, Lukacs était antiparlementaire, tandis que Bêla Kun préconisait une tactique curieuse : participation aux élections pour les dénoncer ; aucun envoi de députés au parlement. En Suède, la fédération de la jeunesse social-démocrate (Social-démokratiska ungdomsfôrbundet) de C. J. Bjôrklund, qui avait adhéré à l'IC en mai 1919, était résolument antiparlementaire ; en contact avec le KAPD en 1920, elle dénonçait l'opportunisme de Hôglund au Parlement, ce dernier étant présenté par Lénine comme le «Liebknecht» suédois. L'antiparlementarisme s'étendit jusqu'à l'Amérique latine : au sein du Partido socialista internacional d'Argentine — futur parti communiste d'Argentine, créé en décembre 1920 — se forma en 1919 une forte minorité, se réclamant de Bordiga, préconisant le boycott des élections.
[11] [1188] Quelques semaines avant de rédiger sa « Réponse à Lénine », Gorter écrivait le 1ermai 1920 à Lénine ces mots : «Je ne suis pas un adversaire du parlementarisme. Je vous écris cela seulement pour vous montrer — à vous et au comité central — combien il est dangereux de trop parler en faveur des communistes opportunistes. » (cité par Wiessing « Die Hollàndische Schule des Marxismus », p. 91)
[12] [1189] A. Pannekoek, « De strijd over de kommunistische taktiek in Duistland », in « De Nieuwe Tijd », 1919, p. 695.
[13] [1190] Sylvia Pankhurst (1882-1960) avait milité dans le mouvement des « suffragettes » fondé par sa mère Emma. Elle avait fondé en 1914 l'East London Fédération of Suffragettes qui publiait « The Womens Dreadnaught ». Sous l'effet de la guerre, son mouvement rompit avec le féminisme. Il se transforma en 1917 en Workers Socialist Fédération, dont l'organe était « The Workers Dreadnaught » (« Le cuirassé ouvrier »). Elle se prononce pour les bolcheviks. En 1919, elle est présente au congrès de Bologne du PSI. Elle devient correspondante rémunérée de « l'Internationale Communiste », organe de l'IC. Elle participe activement, de retour en Italie, à la conférence de Frankfurt puis à la conférence d'Amsterdam. Refusant toute tactique parlementaire et toute entrisme dans le Labor Party, elle contribue en juin 1920 à la fondation du Communist Party (British Section of the Third International). Elle défendra la même année, avec le shop steward Gallacher, les positions antiparlementaires et antisyndicales au second congrès de l'IC. Son parti est obligé de fusionner, en janvier 1921 à Leeds, avec le CP of Great Britain (CPGB) qui défend l'orthodoxie de l'IC. « The Workers Dreadnaught » reste l'organe indépendant de sa tendance dans le PC « unifié ». Jetée en prison par le gouvernement britannique, elle sera libérée pour être exclue du CPGB, avec ses partisans, en septembre 1921. En février 1922, elle fondera avec les exclus le Communist Workers Party, section de la KAI de Gorter, qui subsistera jusqu'en juin 1924. Sylvia Pankhurst, à partir de cette date, cesse d'être une communiste de gauche et une militante prolétarienne. Elle revient à ses premières amours féministes et se prend de passion pour l'espéranto. Elle devient même en 1928 l'apôtre d'une croisade « antiraciste ». Elle forme en 1932 un Womens International Matteoti Committee, mouvement féministe antifasciste. Elle soutient le Negus, lors de la guerre de 1935 entre l'Italie et l'Ethiopie. Elle part en Ethiopie pour devenir finalement catholique. Amie du Negus, elle meurt à Addis-Abeba en 1960, où elle est enterrée.
[14] [1191] la lettre de Pankhurst et la réponse de Lénine (août 1919) se trouvent dans « Die Kommunistische Internationale », n° 4-5, p. 91-98 (« der Sozialismus in England »).
Géographique:
- Hollande [558]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 51 - 4e trimestre 1987
- 3069 reads
Situation internationale : conflits impérialistes et lutte de classe
- 2645 reads
Simultanément la situation mondiale nous livre d'un côté les événements guerriers du Moyen-Orient, et d'un autre, les luttes ouvrières en Afrique du Sud et en Corée du Sud. Ces deux aspects antagoniques de la situation mondiale, sur fond général d'un approfondissement de la crise du capitalisme, illustrant ce que nous entendons par accélération de l’histoire. Ils montrent que le cours historique, le rapport de forces entre deux perspectives: guerre ou révolution, est l'axe autour duquel s'articule l'histoire présente et à venir. Et si jusqu'à présent la lutte de classe a réussi à prévenir l'humanité d'un engagement sur le chemin sans retour de la guerre, l'accélération de l'histoire souligne la nécessité vitale d'une prise de conscience pour la classe ouvrière des enjeux de la situation mondiale et de sa mission historique pour pousser ses combats plus loin.
Guerre dans le Golfe persique
«Guerre des ambassades» en Europe, événements sanglants de la Mecque pour les pays arabes, scandale de «l'Irangate» aux USA, résolution de l'ONU pour tous. C'est de main de maître que le bloc impérialiste occidental, sous la haute impulsion et direction des USA, a préparé et couvert le plus vaste déploiement militaire depuis la seconde guerre mondiale. L'événement était de taille, il devait être précautionneusement préparé, surtout en direction de ce que l'on appelle «l'opinion publique». Il le fut. Au cœur de cette préparation minutieuse, le scandale de «l'Irangate» et la publicité tapageuse qu'il reçut dont les événements actuels nous révèlent la véritable signification : justifier le tournant majeur de la politique des USA par.rapport à l'Iran.
Comme le scandale du «Watergate» en 1973-74, qui entraîna la démission du président Nixon, correspondait à un changement de politique internationale (retrait des USA du Viêt-Nam, rapprochement avec la Chine), l'Irangate aujourd'hui correspond à un changement dans l'orientation de politique internationale. Que ressort-il de ce «scandale» sinon que la négociation avec les «terroristes», iraniens est impossible, que seule la force, le langage des armes, est capable de leur faire entendre raison ?
Pour ceux qui pensent encore que cette intervention militaire dans le Golfe Persique où sont engagés 40 navires de guerre américains des plus sophistiqués dont deux porte-avions, sans compter les forces aéronavales, la moitié de la marine française dont un porte-avion, les navires les plus perfectionnés de la marine anglaise et plusieurs dizaines de milliers d'hommes, pour une grande part du contingent, n'est somme toute pas si importante et qui, cédant aux roucoulades sur la «volonté de paix», s'endorment en se disant que finalement il ne s'agit là que d'une «aventure lointaine», sans conséquences et implications importantes pour l'Europe, nous rappellerons simplement que la première guerre mondiale qui allait saigner en particulier cette même Europe a commencé par ces mêmes guerres «lointaines», les deux guerres des Balkans, dans une région du monde très proche du Moyen-Orient, jouant un rôle stratégique analogue : hier l'affrontement entre grandes puissances pour l'accès aux «mers chaudes», aujourd'hui haut-lieu de l'affrontement est-ouest depuis qu'il a été déclaré tel symboliquement à Yalta en 1945.
De tous points de vue la classe ouvrière est concernée par l'engagement militaire. Comment en serait-il autrement quand, du seul point de vue économique et social les deux tiers de l'humanité souffrent de la faim, quand le chômage étend son ombre de misère sur une grande partie de la classe ouvrière des pays industrialisés, alors que les frais de l'intervention militaire actuelle dans le Golfe Persique s'élèvent officiellement pour les USA au chiffre astronomique d'un million de dollars par jour pour les* simples frais de convoi. Quant à la France qui est présente sur deux fronts, en Afrique et au Moyen-Orient, aucun chiffre n'est fourni et pour cause.
«Fanatisme et terrorisme» contre «paix et civilisation»
La politique des USA n'est ni «chaotique»,ni «incohérente», ni «au coup par coup» comme l'affirment beaucoup de commentateurs. Malgré ses détours et ses contours pas toujours immédiatement compréhensibles, la stratégie américaine au Moyen-Orient, stratégie d'offensive et d'étranglement du bloc russe, se règle sur une logique de fer.
Si pendant huit années les Etats du monde entier ont pu se satisfaire de la simple poursuite de la guerre entre l'Iran et l'Irak, aujourd'hui la situation a qualitativement changé. Après avoir «réglé» la situation au Liban et parfait l'isolement de l'Iran au Moyen-Orient, les USA ont décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec la question iranienne. Il s'agit aujourd'hui pour les USA de reconstituer la forteresse militaire que fut il y a presque une dizaine d'années l'Iran. Il n'y a pas d'autre pays qui par sa position géographique, l'étendue de son territoire, sa densité démographique, puisse de ce point de vue remplacer l'Iran dans cette région.
En face de ces réalités indéniables que dit-on pour justifier l'intervention dans le Golfe Persique ? Que le fanatisme de la population iranienne, subjuguée par des religieux déments, serait la cause de l'instabilité dans le Golfe Persique et de bien d'autres maux. Toute l'entreprise actuelle des pays occidentaux et du chef d'orchestre américain n'aurait pour but que de contenir, «par la force si nécessaire», cette poussée d'irrédentisme religieux, de ramener la paix entre l'Iran et l'Irak et bien sûr d'assurer l'intérêt des pays occidentaux par la libre circulation des convois pétroliers dans le Golfe Persique.
Ainsi les chancelleries du monde occidental et des pays arabes désignent d'un même geste le fanatisme religieux en Iran comme un dangereux fauteur de trouble, faisant peser une lourde menace sur la paix du Golfe.
Tout d'abord nous ne pensons pas que la population en Iran, qui, comme celle de l’Irak, vient de subir sept années d'une guerre particulièrement meurtrière, quelque chose comme un million de morts, soit d'un grand enthousiasme pour mener la «guerre sainte» contre toutes les puissances du «monde arabe» et plus encore, contre toutes les puissances du monde occidental.
Toutes les guerres sont atroces. Celle-ci particulièrement. A la puissance de feu des armes modernes est venue s'ajouter la guerre chimique. Rien, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, n'a été refusé à la barbarie qui sur les champs de bataille comme dans les agglomérations urbaines a fait une boucherie. •
Comment oublier que durant ces sept années, faute d'un nombre suffisant de combattants que la guerre fauchait par milliers, ce sont des gamins qui dès 10 ans étaient envoyés de force sur le front. Et comment mesurer, quand la guerre ne vous arrache pas votre vie, ou celle de vos enfants, ou encore ne vous laisse infirme, les sacrifices qu'il faut consentir pour payer huit années de guerre ? Dans ces conditions, on ne peut guère se tromper en affirmant qu'il y a dans la population iranienne et dans la population irakienne un large sentiment anti-guerre. On ne subit pas huit ans de guerre sans être guéris de tout fanatisme. Malgré le peu d'information, et pour cause, que la bourgeoisie laisse filtrer sur ces questions nous pouvons savoir qu'aussi bien en Iran qu'en Irak existe une réelle opposition à la guerre :
«L'hostilité de la population au conflit est en relation étroite avec les privations, notamment chez les pauvres (...). L'agitation habituellement provoquée par la situation économique (...) a fait place pour la première fois en 1985 à de véritables manifestations contre la guerre. » ([1] [1192]).
Il est déjà hallucinant d'entendre aujourd'hui ce formidable concert de déclarations pacifistes accompagner le déploiement dans le Golfe d'une gigantesque armada de guerre. Mais la duperie est encore plus éclatante quand on considère que cette guerre à laquelle on prétend vouloir mettre un terme, a été commencée, entretenue et nourrie pendant huit ans par ceux qui aujourd'hui crient le plus fort à la «paix». Ce n'est un secret pour personne que la guerre entre l'Iran et l'Irak avait pour objectif essentiel la destruction du pouvoir religieux de Téhéran, le prix en vies humaines comptait peu ou plutôt pas du tout.
Tous les pays qui furent à l'origine de ce conflit, sous l'impulsion des USA, Koweït et Arabie Saoudite en particulier, pensaient que le choc de la guerre dans un pays plongé dans un chaos indescriptible après la chute du Shah d'Iran conduirait rapidement à l'effondrement du pouvoir religieux de Téhéran. Cette perspective ne s'est pas vérifiée, au contraire. Cette guerre, qui était prévue courte, est toujours, et comment, d'actualité aujourd'hui. La fraction derrière Khomeiny loin de s'effondrer dans la guerre, s'en est nourrie et a renforcé son emprise sur la société iranienne par les moyens d'une répression impitoyable. Qu'aucune autre fraction dirigeante plus «adaptée», moins anachronique que le pouvoir des mollahs n'ait pu s'imposer à Téhéran montre la profondeur de la décomposition sociale atteinte dès l'époque du Shah.
Quoi qu'il en soit, l'objectif de renversement des dirigeants de Téhéran ayant momentanément échoué, l'Iran et l'Irak ne pouvaient que s'enliser dans la guerre. Guerre entretenue par toutes les puissances internationales qui, pendant huit ans, ont fourni armes et matériel militaire moderne de toutes sortes aux belligérants. Armement sans lequel la poursuite du conflit aurait été impossible.
Ne pouvant espérer régler rapidement la question iranienne, en particulier tant que la question de la Syrie et du Liban n'était pas «stabilisée», tant que l'isolement de l'Iran n'était pas total, le monde occidental, les pays arabes, Israël s'accomodaient fort bien de la guerre.
Ainsi pendant des années tout le beau monde impérialiste y a trouvé son compte, à commencer par les marchands d'armes de tous bords. En tête de ceux-ci, la France qui a vendu à l'Irak des armements modernes pour un montant de 7 milliards de dollars. L'Etat d'Israël, dont on ne peut mettre en doute les liens qui l'unissent aux USA, a durant toute la guerre été lui-même le principal pourvoyeur d'armes de l'Iran :
«Bien que Téhéran nie tout lien de cette nature, l'Iran a reçu des livraisons israéliennes dès le début de la guerre (...) à l'époque, le montant de ces transactions a pu être évalué à prés de 100 millions de dollars. (...) Pour la seule année 1983, les livraisons d'armes à l'Iran ont atteint 100 millions de dollars.».
Sur d'autres plans, au-delà du commerce des armes qui alimentait le carnage au profit d'un grand nombre de nations, Chine et URSS y compris, cette guerre faisait autour d'elle un large consensus. Les nations arabes qui ne pouvaient voir sans satisfaction, en plus de «l'occupation» que cette guerre fournissait à leur voisin iranien turbulent, deux des principaux producteurs de pétrole du Golfe baisser drastiquement leur production en pleine période de surproduction et de chute des cours. Israël, qui, tant que l'Iran restait un ventre mou de la défense des intérêts occidentaux au Moyen-Orient, pouvait, lui, prétendre occuper ce rôle exclusivement et en tirer tous les avantages. Jusqu'à l'URSS, qui, bien que n'ayant aucune possibilité et aucun espoir d'implanter une quelconque influence en Iran, préférait de loin voir celui-ci en guerre plutôt que comme place forte des USA aux frontières de l'Afghanistan occupé militairement par ses troupes.
Tant que les USA ne pouvaient régler son sort à la clique d'illuminés de Téhéran, ils permettaient et encourageaient la poursuite de la guerre, contrôlant et dosant savamment les livraisons d'armes à Bagdad comme à Téhéran. Il s'agissait de ne permettre, ni de victoires décisives à l'Iran, ce qui aurait renforcé le pouvoir en place, ni non plus, par une défaite cuisante, de pousser à un effondrement et un démantèlement total de ce dernier qui aurait compromis toute possibilité de reconstruction sur place d'une forteresse militaire du bloc occidental.
Dans cette optique, la continuation de la guerre et des tensions dans le Golfe offrait de plus aux USA l'avantage non négligeable d'une dépendance accrue des pays arabes vis-à-vis d'eux :
«Ils (les Etats du Golfe) se sont ainsi condamnés à soutenir financièrement Bagdad et à renforcer leurs propres systèmes de défense civile et militaire contre Téhéran. Leur dépendance implicite vis-à-vis de la garantie américaine, comme le poids politique de cette alliance de fait, s'est accrue brutalement.».
Voilà les réalités de la danse macabre de l'impérialisme dans le Golfe Persique. Et encore n'en avons-nous évoqué que les lignes directrices.
De façon générale cette escalade n'est pas une suite désordonnée d'actions et d'efforts, sans but cohérent et aux conséquences somme toute limitées géographiquement au Moyen-Orient. La situation actuelle dans le Golfe Persique est la continuation d'une stratégie d'ensemble qui, même si elle ne met pas en prise directe l'impérialisme russe et l'impérialisme américain -et heureusement, participe de la logique mondiale de cet affrontement.
Quand les USA seront parvenus a «régler» la question iranienne, c'est-à-dire à faire de nouveau de l'Iran un bastion de leurs positions militaires avancées au Moyen-Orient, ce «règlement» ne marquera en fin de compte qu'un cran de plus dans l'engrenage militariste planétaire. Après avoir établi la paix des tombes, ce n'est guère par la puissance économique, déjà très à mal au sein des métropoles, que le bloc de l'Ouest pourra maintenir son «ordre» dans une région du monde aussi instable, où la décomposition économique s'est particulièrement installée. Obligatoirement, l'ordre militaire s'y installera de façon permanente aux frontières mêmes de la Russie, marquant ainsi un degré supérieur dans les tensions impérialistes mondiales.
Le développement des tensions militaires et les enjeux historiques
Détachons un moment notre attention du Moyen-Orient. Les flammes de la lutte de classe brûlent en Afrique du Sud. En Corée du Sud, un mouvement massif de la classe ouvrière, par sa pugnacité, son intransigeance et son courage, brise en mille morceaux la vitrine tant exposée d'un prolétariat d'esclaves dociles en Asie. Et ce ne sont là que les expressions actuelles d'un puissant flot mondial d'insoumission aux lois du capitalisme en crise.
Toute la situation mondiale est contenue dans cette contradiction, dans l'opposition de deux perspectives issues toutes deux de la décadence du capitalisme, la guerre ou la révolution.
Jusqu'aujourd'hui, il revient à la classe ouvrière internationale, d'avoir, par ses luttes, repoussé la perspective bourgeoise de la guerre mondiale. En refusant de se sacrifier pour la survie de l'économie bourgeoise, il lui revient d'avoir repoussé d'autant la perspective d'un sacrifice suprême sur l'autel de l'impérialisme. Il est tout à son honneur d'avoir dans sa lutte, par sa résistance à l'exploitation, forgé un esprit auquel sont étrangères les molles et serviles conception et mentalité fatalistes.
Mais comme nous le montre la situation mondiale dans sa totalité, l'histoire s'accélère et en s'accélérant devient de plus en plus exigeante. Elle exige du prolétariat qu'il prenne conscience de ce qu'il a déjà fait et, en en prenant pleinement conscience, qu'il le pousse jusqu'au bout. D'internationale de fait, la lutte ouvrière peut et doit devenir internationaliste.
L'histoire sait parfois être ingrate, mais jamais elle n'exige l'impossible. Avec une nécessité historique se développent toujours les conditions de sa réalisation. Par le développement de la crise économique, véritable fléau social, et de la barbarie que celle-ci induit, par le développement international de la lutte prolétarienne même, la classe ouvrière est aujourd'hui contrainte de pousser son combat à un niveau supérieur. L'expérience accumulée de ses assauts répétés contre la forteresse capitaliste lui en donne la force et les moyens.
Le prolétariat, pour prendre conscience de sa mission historique, ne peut attendre d'être submergé dans la barbarie, dans ce cas il serait trop tard. Sur le terrain même de l'économie, la lutte entre le travail et le capital est déjà un barrage à l'orientation vers la troisième guerre mondiale, et aujourd'hui les luttes ouvrières peuvent et doivent ouvrir la perspective propre au prolétariat. Détruire les frontières, l'exploitation et l'économie de profit sont les seules voies pour balayer définitivement la menace du désastre que le capitalisme fait peser sur l'humanité.
Prénat 6/9/87.
Géographique:
- Moyen Orient [10]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
Luttes ouvrières en Corée du sud et en Afrique du sud la mobilisation du prolétariat mondial se développe
- 2796 reads
Contrairement à l'insistance de la propagande de la classe dominante, les récentes luttes ouvrières en Corée du Sud et en Afrique du Sud ne sont pas de nature essentiellement différente de celles menées par les ouvriers des autres pays et en particulier dans les pays les plus industrialisés. Malgré leurs spécificités - dictature militaire en Corée, régime de l'« apartheid » en Afrique du Sud- il s'agit de moments d'un seul et même combat, celui mené par la classe ouvrière mondiale contre l'exploitation capitaliste.
La Corée du Sud, ce pays dont les «experts économiques» ont tant vanté les performances exceptionnelles, qu'ils ont donné en modèle aux pays moins développés, vient de connaître, au cours de cet été, sa plus grande secousse sociale depuis la guerre. Les dix millions de prolétaires sur le dos desquels le capital national, mais aussi le capital japonais et américain, ont fait «le miracle coréen» en leur imposant des conditions de travail parmi les pires du monde, ont donné une gifle magistrale au mythe des «ouvriers asiatiques, passifs, résignés, travailleurs, exploités jusqu'à la mort et... contents de l'être». Par un mouvement de grèves sans précédent qui, partant des principales concentrations ouvrières -les mines de charbon, les chantiers navals, l'industrie automobile- s'est étendu comme une traînée de poudre à tous les secteurs de la classe ouvrière, les travailleurs coréens ont démontré que dans la zone d'influence du capital japonais, comme dans le reste du monde, la classe ouvrière apprend à se constituer en force, la seule capable d'affronter le capitalisme décadent en crise et d'ouvrir une perspective. A terme, c'est la mobilisation du prolétariat japonais qu'annoncent ces combats.
L'Afrique du Sud vient aussi de connaître la plus grande mobilisation ouvrière de son histoire. Plus d'un quart de million de mineurs ont fait grève pendant trois semaines. En même temps 10 000 travailleurs des postes partaient en grève; 60 000 ouvriers dans le secteur de la métallurgie poursuivaient des mouvements de grève commencés depuis juillet et 15 000 travailleurs du secteur de la pétrochimie menacent de faire de même.
Nous ne pouvons ici traiter de tous les aspects de ces combats. Nous renvoyons le lecteur aux différents organes de notre presse territoriale qui le font.
Ce qui nous importe ici c'est de dénoncer l'idéologie qui cherche à enfermer ces luttes dans un cadre qui les émascule de leur contenu de classe, qui cache ce qui les unit au combat de tout le reste de la classe ouvrière mondiale.
La bourgeoisie a toujours recours au même stratagème : mettre l'accent sur ce qui diffère dans les conditions spécifiques des travailleurs en lutte dans une entreprise, un secteur ou un pays afin d'isoler, d'étouffer ce combat, tout en le dévoyant sur de faux terrains. L'exemple de la Pologne 1980, où la lutte des ouvriers contre leur exploitation avait été présentée dans le monde entier comme une lutte pour le droit d'aller à la messe, et localement fut enfermée dans le combat pour le droit d'existence du syndicat Solidarnosc, reste un des plus spectaculaires.
La barbarie capitaliste connaît en Corée du Sud la forme d'une dictature militaire particulièrement violente ; en Afrique du Sud celle du racisme de l'«apartheid». La bourgeoisie américaine s'y emploie actuellement à se débarrasser des aspects les plus anachroniques de ces régimes afin, non pas de soulager les conditions d'existence de la classe ouvrière -ce dont elle n'a que faire- mais au contraire d'y créer des institutions capables d'encadrer et de contrôler la lutte de classe qui s'y développe, comme dans tous les pays, sous les effets de la crise économique mondiale.
Les grèves ouvrières en Corée du Sud n'ont pas éclaté avec l'objectif d'instaurer un régime bourgeois «démocratique à l'occidentale», pas plus que celles de travailleurs sud-africains pour l'établissement d'un capitalisme moins cruel envers les prolétaires noirs. Ces luttes se sont manifestées dès le départ comme des réactions directes contre l'exploitation capitaliste, pour des augmentations de salaires, pour des améliorations des conditions de travail et d'existence en général.
S'il en avait été autrement, elles n'auraient pas pris la forme de grèves pour des revendications de classe, mais seraient restées dans le cadre suicidaire, interclassiste des pétitions et manifestations des fractions dites «démocratiques» des partis bourgeois d'«opposition».
Cela ne veut pas dire qu'elles ne s'attaquent pas aux formes dictatoriales et racistes de l'exploitation capitaliste. Au contraire, elles sont les seules luttes qui peuvent imposer des limites à la barbarie de la classe dominante locale.
Toutes les fractions de la bourgeoisie, démocrates et libéraux en tête, s'en disent choquées et réclament aux prolétaires de ces pays de faire attention à ne pas situer leurs intérêts «égoïstes» de classe au-dessus des intérêts de «la nation».
Kim Young Sam, un des principaux leaders de l'opposition démocratique coréenne ne cesse de demander aux ouvriers de «faire preuve de modération dans leur exigences pour ne pas mettre à mal les succès de l'économie Sud-coréenne ». En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le leader du NUM, le nouveau syndicat «démocratique» qui vient de saboter et de vendre la grève des mineurs, expliquait ses appels à la reprise du travail par la nécessité de respecter la légalité de la nation.
Leurs appels, leurs manœuvres ne sont en réalité que des moyens pour désarmer la classe exploitée, pour détruire ses luttes en les dévoyant sur le terrain de leurs exploiteurs.
Non, les luttes des prolétaires de Corée et d'Afrique du Sud ne sont pas des exemples de coopération entre exploités et exploiteurs pour une utopique «humanisation» de la barbarie capitaliste. Elles sont des moments du combat mondial de la classe ouvrière contre le capital et sa barbarie mondiale.
Et cela parce que :
1) les causes qui les provoquent sont les mêmes : la crise économique du capitalisme mondial se traduit à la périphérie comme ailleurs par un renforcement de l'exploitation capitaliste ; s'il y a une différence c'est uniquement parce qu'en général dans ces pays l'aggravation de la crise se fait sentir de façon encore plus violente ;
2) les "formes" mêmes que prennent ces luttes -leur tendance à s'étendre aux différents secteurs de la classe ouvrière, par delà les barrières de profession, de secteur ou de race- sont les mêmes qui se sont manifestées dans toutes les luttes ouvrières importantes de ces dernières années en Europe occidentale ;
3) enfin, parce que comme les luttes des autres prolétaires dans le monde entier, elles doivent se battre sur deux fronts : celui des ennemis déclarés, les gouvernements et leur appareils armés, militaires et policiers ; mais aussi celui des ennemis déguisés en «amis», les syndicats et les partis dits d'«opposition» qui travaillent de l’«intérieur» au sabotage de la lutte.
Le pire danger pour les prolétaires de ces pays c'est de tomber prisonniers de la confusion créée par toute la propagande «démocratique», d'autant plus dangereuse qu'elle s'adresse à un prolétariat qui ne connaît pas encore, ou ne fait que commencer à connaître le rôle de policiers de ces institutions «démocratiques» au sein des rangs prolétariens.
C'est dire toute la responsabilité des prolétaires des pays à longue tradition «démocratique», eux qui savent de plus en plus à quoi s'en tenir, qui désertent par millions ces institutions -partis et surtout syndicats- et qui apprennent de plus en plus à se battre non seulement en dehors d'elles, mais aussi contre elles comme l'ont démontré dans les dernières années les travailleurs de pays comme la Belgique, la France, et plus récemment l'Italie.
5/9/87 RV
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Le septième congres du CCI
- 2331 reads
Début juillet 1987 s'est tenu le septième congrès du Courant Communiste International. Ce congrès se situait à un moment crucial de la vie de la classe ouvrière mondiale marqué à la fois par une nouvelle aggravation de la crise du capitalisme et des tensions impérialistes qu'elle détermine et par un nouvel essor des luttes ouvrières à l’échelle internationale dont une des conséquences est le surgissement de toute une série de nouveaux groupes plus ou moins formels se situant sur des positions de classe révolutionnaires. C'est l'ensemble de ces questions et la façon dont le CCI y a fait et devra y faire face qui constituaient l'ordre du jour du congrès. Celui-ci devait également se prononcer sur une rectification de la plate-forme de l'organisation dont la nécessité avait été déjà constatée lors du précédent congrès (voir Revue Internationale n° 44). Nous publions dans ce numéro les principales résolutions correspondant aux différents points à l'ordre du jour du congrès. Ces résolutions parlent par elles-mêmes et expriment de façon condensée la position du CCI face aux principaux problèmes qui se posent à la classe et à ses minorités révolutionnaires. Le présent texte de présentation ne se propose pas de répéter ce que disent les textes publiés à la suite, mais essentiellement d'insister sur les enjeux essentiels qui se sont trouvés au centre des préoccupations de ce congrès et qui confèrent à ces différents textes leur unité.
Dans la conclusion de la présentation du 6e congrès en novembre 1985 (Revue Internationale n° 44), nous écrivions : « ...il nous faut donc considérer que le 6e congrès du CCI a globalement atteint les objectifs qu'il s'était fixés, qu'il a valablement armé l'organisation face aux enjeux de la période présente. Les années qui viennent jugeront de la validité d'une telle appréciation, elles montreront en particulier si l'analyse dont s'est doté le CCI sur la situation internationale et notamment sur l'évolution de la lutte de classe est bien conforme à la réalité, ce que contestent la plupart des autres groupes révolutionnaires. Mais dès à présent,les résolutions que nous publions dans ce numéro font la preuve que le CCI s'est engagé dans une direction bien précise, laissant le moins possible la porte ouverte à toute ambiguïté (comme c'est le cas malheureusement de la part de beaucoup de ces groupes), une direction qui, sur la base de l'analyse des énormes potentialités de combat qui mûrissent et se développent dans la classe, exprime la ferme volonté d'être à la hauteur de ces combats, d'en être partie prenante et de contribuer activement à leur orientation vers l'issue révolutionnaire.»
Les vingt mois qui se sont écoulés entre le 6e et le 7e congrès du CCI ont amplement confirmé le bien-fondé de cette position. En effet, cette période a vu se poursuivre et s'amplifier la vague de luttes ouvrières (la troisième depuis la reprise historique des combats de classe à la fin des années 1960) dont les luttes massives du secteur public de septembre 83 en Belgique avaient marqué le début. Au moment du 6e congrès, en novembre 1985, cette vague de luttes connaissait un certain affaiblissement après les mouvements massifs de fin 1983 et de 1984. Mais cela n'avait pas conduit le CCI, contrairement à beaucoup d'autres groupes du milieu révolutionnaire, à en conclure qu'elle était déjà épuisée. Bien au contraire, la résolution sur la situation internationale adoptée à ce congrès (Revue Internationale n° 44) insistait sur le fait que : «la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de grande envergure»(point 15).
De façon plus générale, cette résolution soulignait que :
«La faillite totale du capitalisme que révèlent les années de vérité, de même qu'elle conduit à une accélération de l'histoire sur le plan des conflits impérialistes, provoque également une telle accélération sur le plan du développement de la lutte de classe, ce qui se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précèdent » (point 15)
C'est pour cela que, contrairement à ce qui s'était en partie passé en 1983 lors du surgissement de la troisième vague de luttes, l'ensemble du CCI n'a été nullement surpris lorsque les formidables combats du printemps 1986 en Belgique ont signé l'entrée de cette vague de luttes dans une nouvelle phase d'affrontements massifs et déterminés qui ne s'est pas démentie depuis comme le relève la résolution adoptée au 7e congrès (point 6).
Ainsi, alors que le 6e congrès marquait une discontinuité avec le précédent, le 7e congrès s'est inscrit en parfaite continuité du 6e.
En effet, une des tâches essentielles du 5e congrès, tenu en juillet 1983, avait consisté à tirer toutes les leçons de la défaite subie par la classe ouvrière mondiale en 1981 et marqué en particulier par le coup de force contre le prolétariat en Pologne en décembre de cette année. S'il avait armé l'organisation de perspectives générales justes, il ne l'avait par contre pas préparée à l'imminence de la reprise des combats ouvriers qui allait intervenir quelques mois après. Et si le CCI a su immédiatement reconnaître l'importance de ces combats, il lui a fallu tout un effort d'adaptation face aux responsabilités nouvelles qu'ils impliquaient pour les révolutionnaires, effort qui a été contrarié par toute une série d'incompréhensions et de résistances dont la manifestation la plus évidente a été l'apparition d'une soi-disant «tendance» qui allait quitter l'organisation justement lors du 6e congrès pour constituer la Fraction externe du Courant Communiste International (FECCI).
Le 6e congrès venait justement ponctuer tout ce processus de réarmement de l'organisation notamment en affirmant clairement la nécessité pour les révolutionnaires d'intervenir activement et systématiquement dans les combats en cours, de se concevoir comme «partie prenante» de ceux-ci.
Le 7e congrès a confirmé intégralement cette orientation. Ses résolutions ici publiées et ses débats ont insisté sur la validité des travaux et perspectives du 6e congrès. Il ne s'agissait donc pas au 7e congrès de tracer de nouvelles perspectives mais de vérifier comment celles du 6e avaient été mises en pratique et, à la lumière de l'expérience, de les préciser pour la période qui vient. C'est ainsi que tous les points à l'ordre du jour partaient de préoccupations déjà affirmées lors du 6e congrès :
- sur la situation internationale ;
- sur notre intervention dans la classe ouvrière ;
- sur notre responsabilité à l'égard du milieu politique ;
- sur la nécessité de renforcer la capacité théorique et programmatique de l'organisation face à ses responsabilités croissantes.
Sur la situation internationale
Outre la lutte de classe dont le développement actuel a donné le ton à l'ensemble des débats, le congrès s'est penché, comme le révèle la résolution, sur la nouvelle aggravation de la crise du capitalisme. Il a mis en évidence la faillite aujourd'hui patente des «Reaganomics» sensées ouvrir une nouvelle ère de prospérité et qui débouche maintenant sur une nouvelle récession mondiale aux effets encore plus dévastateurs que les précédents notamment du point de vue de la brutalité des attaques anti-ouvrières. Le congrès a également souligné que l'enfoncement dans la crise ne pouvait, malgré les discours de paix spectaculaires, que déboucher sur nouvelle aggravation des tensions impérialistes dont l'élément central est l'offensive américaine visant à parachever l'encerclement de l'URSS et qui passe aujourd'hui par une remise au pas de l'Iran. Sur ce plan, l'actualité s'est chargée immédiatement de confirmer notre analyse avec l'envoi d'une formidable armada occidentale dans le golfe Persique et l'aggravation des tensions dans cette région du monde.
Cependant, le point le plus discuté de la situation internationale a été évidemment le développement de la lutte de classe et plus particulièrement :
- les multiples moyens mis en avant par la bourgeoisie pour entraver ce développement, et dont le syndicalisme de base constitue le fer de lance ;
- les différentes manifestations du processus de développement de la conscience dans la classe, en particulier le surgissement de groupes d'ouvriers combatifs, les comités de lutte.
Sur notre intervention
Notre responsabilité face à ce développement des combats de classe a évidemment fait l'objet de débats très animés. Ces débats étaient en particulier alimentés par l'expérience acquise par nos dix sections territoriales dans leurs pays respectifs. Il s'agissait que cette expérience contribue pleinement à l'armement de toute l'organisation face aux tâches qui l'attendent dans la période qui vient. La préoccupation et la tonalité des débats s'expriment notamment dans cet extrait de la résolution d'activités adoptée par le congrès.
«Ces perspectives vont constituer pour le CCI une nouvelle épreuve, la lutte de classe exigeant plus d'unité, de capacité de mobilisation et d'engagement à tous les niveaux, pour faire face aux responsabilités dans l'intervention, pour être un facteur actif dans la tendance à l'unification et la confrontation avec la bourgeoisie sur le terrain des luttes, et assurer ainsi l'apprentissage des implications concrètes de la fonction de l'organisation dans la classe
(...).»
«L'intervention dans les luttes immédiates est un axe des activités pour la période qui vient (...). »
«Dans cette perspective, il est nécessaire de renforcer notre capacité à faire des propositions concrètes de marche, à faire que ces propositions ''passent". Pour cela, en plus de l'intervention de l'organisation par la presse, les tracts et les prises de parole, il est nécessaire lorsque les conditions le permettent :
- de faire des propositions de motions, déclarations, résolutions écrites, autant que possible préparées et discutées dans le cadre de l'organisation pour faire que les assemblées se prononcent ;
- d'intervenir non seulement dans les manifestations, les assemblées, les comités de chômeurs, les réunions politiques, mais également dans les tentatives de regroupement d'ouvriers combatifs, dans les comités de lutte, en dehors des syndicats, qui peuvent surgir et vont surgir, en les impulsant, en participant à leur formation.»
Nous ne pouvons ici répercuter l'ensemble des questions qui ont été abordées dans ce point de l'ordre du jour. Des positions très minoritaires se sont exprimées, principalement sur notre intervention à l'égard des comités de lutte, qui traduisent encore une certaine difficulté à prendre en compte les aspects de ce qu'implique l'axe central de notre orientation à l'égard de l'intervention dans la classe : être «partie prenante des combats ouvriers» afin de contribuer à leur plein épanouissement vers des affrontements de plus en plus massifs, déterminés, unis et conscients contre un capitalisme toujours plus barbare.
Sur notre responsabilité à l'égard du milieu politique révolutionnaire
Comme le signalait une résolution adoptée lors du 6e congrès :
«L'orientation actuelle vers l'accélération et le renforcement de l'intervention du CCI dans la lutte de classe est également valable et doit être appliquée rigoureusement dans notre intervention envers le milieu. »
«Le CCI (...) doit se préoccuper d'utiliser pleinement la dynamique positive de la situation actuelle de lutte afin de pousser le milieu de l'avant et d'insister sur une intervention claire et déterminée des organisations révolutionnaires dans ces luttes (...). »
«Afin de faire le meilleur usage de ces potentialités qui sont à leur tour simplement une concrétisation du fait que la période de lutte pour la formation du parti est ouverte, il est nécessaire de mobiliser les forces de tout le CCI afin d'oeuvrer au mieux à la défense du milieu politique, ce qui passe par (...) une attitude déterminée pour participer au regroupement des révolutionnaires, à leur unité.»
Cette préoccupation s'est de nouveau, et encore plus illustrée lors du 7e congrès. C'est ce qu'exprime l'adoption d'une nouvelle résolution que nous publions ici, accompagnée d'une présentation spécifique et qui souligne tout l'intérêt et toute la préoccupation de notre organisation envers le surgissement de plusieurs nouveaux groupes révolutionnaires. Ce surgissement met en évidence la nécessité d'un nouvel effort de tenue de conférences internationales des groupes de la gauche communiste dont un premier cycle avait été interrompu par le sectarisme d'une partie du milieu politique. Comme le relève la résolution, les conditions pour de telles conférences ne sont pas aujourd'hui réunies, mais le congrès a été pleinement conscient de l'importance de l'effort que doit faire notre organisation pour impulser la création de ces conditions et, plus généralement, pour contribuer résolument au renforcement du milieu révolutionnaire dans son ensemble.
Le renforcement de la capacité théorique et programmatique
Le renforcement du milieu révolutionnaire et de notre capacité à impulser son développement passe par le renforcement de notre propre organisation sur les plans théorique et programmatique. C'est pour cela que tous les congrès du CCI ont eu dans leur ordre du jour une question d'une portée plus générale que l'examen de la situation internationale et la définition de notre intervention en son sein. Le 6e congrès avait en particulier adopté une résolution sur la question de «l'opportunisme et du centrisme dans la période de décadence» (Revue Internationale n° 44) faisant suite à près de deux ans de débats sur cette question. Le présent congrès, en continuité du précédent et en application de sa décision, avait mis à son ordre du jour la rectification de la plate-forme de l'organisation.
Nous publions ici deux documents sur cette question :
- le texte d'orientation de septembre 1986 ouvrant la discussion dans notre organisation,
- la résolution de rectification de la plate-forme contenant la nouvelle version du point 14 de celle-ci qui est touché par cette rectification.
Là aussi les textes parlent par eux-mêmes mais il importe de souligner particulièrement deux idées fondamentales qui y sont exprimées :
- «une telle rectification ne constitue nullement une remise en cause ni des fondements de la plate-forme, ni des acquis de la gauche communiste, ni des acquis du CCI, mais constitue au contraire un affermissement de ces fondements, une meilleure traduction de ces acquis et notamment une mise en adéquation du document programmatique central de l'organisation avec les textes déjà adoptés lors de congrès précédents (Résolution sur les groupes politiques prolétariens du 2e congrès, Rapport sur le cours historique du 3e congrès et Résolution sur le centrisme et l'opportunisme du 6e congrès, «Résolution de rectification»).
- « ...la discussion théorique en vue de la rectification de la plate-forme (...) n'est nullement un débat académique. Il n'est pas académique parce que tout débat sur des questions programmatiques se trouve au cœur de ce qui fonde l'existence de l'organisation, mais, de plus, parce qu'il fait partie de sa capacité à accomplir ses tâches non seulement futures mais aussi immédiates à l'heure où le développement de la lutte de classe confère à notre organisation des responsabilités croissantes » («Texte d'orientation»).
Conclusion
Ainsi, du début à la fin, le 7e congrès du CCI a été traversé par la volonté de hisser l'organisation à la hauteur des responsabilités que la situation internationale, et particulièrement le développement de la lutte de classe, impose aux minorités révolutionnaires. Nous sommes conscients des faiblesses qui sont les nôtres, comme elles sont celles de l'ensemble du milieu révolutionnaire prolétarien. Nous savons en particulier quel tribut celui-ci continue de payer à la rupture organique que près d'un demi-siècle de contre-révolution a provoqué dans les courants révolutionnaires. Mais le constat de ces faiblesses, l'ampleur de la tâche à accomplir, ne sont pas faits pour nous décourager. Ils constituent au contraire, comme pour tous les communistes, pour tous ceux qui misent sur l'avenir révolutionnaire du prolétariat et luttent à cette fin, un stimulant de notre volonté de poursuivre et de renforcer toujours plus notre combat et notre engagement.
FM. Courant Communiste International
RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
1. La résolution sur la situation internationale du 6e Congrès du CCI (Revue Internationale n° 44) avait comme axe la dénonciation de toute une série de mensonges mis en avant par la bourgeoisie pour tenter de masquer la réalité de cette situation :
- «mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les "succès" de l'économie américaine en 1983 et 1984... seraient l'incarnation» ;
- prétendue «atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la "main tendue" aux négociations avec l'URSS qui trouvent leur pendant avec l'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev» ;
- battage sur «l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale».
Huit mois plus tard, la résolution du CCI de juin 1986 (Revue Internationale n° 47) constatait, « suite :
- à la baisse de 30% du dollar US et aux premiers signes d'une nouvelle récession mondiale,
- à un nouveau durcissement des diatribes de Reagan contre "l'empire du mal" et aux bombardements US sur la Libye,
- au formidable mouvement de luttes massives qui s'était développé en Belgique en avril et mai 1986»,
que la «réalité s'est chargée de démentir ouvertement toutes les campagnes précédentes» et que «la rapidité avec laquelle les événements sont venus battre en brèche les mensonges de 1985 illustre une autre caractéristique générale de ces années de vérité : l'accélération croissante de l'histoire. »
Un an après cette dernière résolution, le 7e Congrès du CCI confirme toute la validité des analyses sur la situation internationale développées par l'organisation au cours et à la suite de son 6e congrès. En ce sens, la présente résolution se conçoit essentiellement comme une prolongation, un enrichissement des deux précédentes. Elle ne se donne pas pour but de re-développer leurs analyses, mais de les illustrer et de les compléter par les événements intervenus depuis un an, de tirer les enseignements de ces événements, et principalement au plan des luttes de la classe ouvrière, afin d'armer le mieux possible les révolutionnaires pour leur intervention au sein de ces dernières.
L'évolution de la crise du capitalisme
2. Après les déclarations euphoriques de 1984 et 1985, le temps des lamentations est revenu pour les «experts» bourgeois de l'économie. Il ne se passe pas un mois sans qu'ils ne soient obligés de revoir «à la baisse» les prévisions qu'ils avaient faites auparavant, à l'heure où ils s'étaient eux-mêmes grisés des discours optimistes qu'ils tenaient aux exploités pour leur faire accepter des sacrifices censés permettre enfin un redressement de l'économie. Au centre de cette euphorie, les péroraisons de l'administration Reagan sur le «libéralisme»
et le «désengagement de l'Etat» comme remède miracle à la crise ne faisaient en réalité que cacher le rôle décisif de l'Etat US dans la «reprise» américaine et mondiale des années 1983-85 sous forme de déficits budgétaires et commerciaux colossaux.
Alors que l'endettement des pays de la périphérie du capitalisme dits du «tiers-monde» avait alimenté la «reprise» des années 1976-79, celui de la première puissance mondiale a joué un rôle similaire après la récession de 1981-82. Mais de même que le premier, en se heurtant à la menace d'un effondrement brutal du système financier international, a épuisé ses effets dès 1980, le second, en faisant des USA l'Etat le plus endetté du monde, loin devant le Brésil, ne peut plus aujourd'hui faire office de «locomotive» de l'économie mondiale, ce qui débouche sur une nouvelle récession dont l'ampleur et la profondeur seront bien plus considérables encore que celles de la précédente. Tous les artifices destinés à contourner la maladie mortelle du capitalisme, la surproduction généralisée, ne peuvent en fin de compte que repousser pour un temps limité les échéances tout en aggravant encore cette maladie, en accumulant à un niveau supérieur les contradictions explosives qui minent le système (qui s'expriment notamment aujourd'hui par une reprise importante de l'inflation et les poussées de fièvre spéculative et en réduisant toujours plus la capacité de la bourgeoisie à limiter l'ampleur et les effets de la récession). Et le fait que ces contradictions aboutissent aujourd'hui à l'énorme endettement extérieur du pays le plus puissant du monde, que celui-ci se retrouve dans une situation qui jusqu'à présent caractérisait essentiellement les pays sous-développés, est significatif du niveau présent de ces contradictions et souligne l'urgence pour ce pays de mesures destinées à redresser son commerce extérieur et sa balance des paiements. C'est le sens du déploiement actuel par les USA de tout un arsenal protectionniste, comme la taxation à 100% d'un certain nombre de marchandises japonaises qui, à côté de la baisse considérable du taux de change du dollar caractérise une intensification sans précédent depuis près d'un demi-siècle de la guerre commerciale à l'échelle mondiale que les organismes, tel le GATT, chargés de favoriser les échanges commerciaux ne peuvent empêcher mais seulement permettre qu'elle n'aboutisse, comme au cours des années 1930, à un étranglement brutal du marché mondial.
3. Ainsi, la perspective qui se présente à l'économie capitaliste n'est pas seulement celle d'une nouvelle récession encore plus catastrophique que celle de 1980-82 du fait de l'épuisement de tous les palliatifs utilisés jusqu'à présent, mais aussi celle d'un déchaînement de la concurrence entre capitaux du fait de cette récession et également de la nécessité pour la première puissance économique de rétablir coûte que coûte sa balance commerciale. Et ce sont tous les pays du monde qui feront les frais de cette situation.
Les pays de la périphérie capitaliste dits «sous-développés» seront un nouvelle fois les plus brutalement atteints par la récession qui arrive et par ses conséquences. En particulier, la baisse du prix des matières premières qui constituent dans la plupart des cas l'essentiel des exportations de ces pays, ne pourra aboutir qu'à la poursuite et à l'aggravation de leurs difficultés face à un endettement phénoménal. Non seulement ces pays ne pourront pas réduire leur endettement mais les nouveaux déficits prévisibles de leur commerce extérieur ne pourront aboutir qu'à une augmentation de cet endettement. Pour ces pays, la perspective consiste donc en un resserrement de l'étau de leurs créanciers avec en tête le FMI, soucieux de maintenir le plus longtemps possible le mythe qu'ils rembourseront leurs dettes afin de ne pas provoquer une explosion de faillites parmi les banques prêteuses et un effondrement de tout le système financier international. De plan «d'austérité» en nouveau plan «d'austérité», la barbarie qui règne dans ces pays est appelée à atteindre de nouveaux sommets dans la misère absolue, la famine, les épidémies meurtrières. Si d'ores et déjà ce sont 40. 000 individus qui y meurent pour ces raisons chaque jour, ce chiffre ne peut encore que s'aggraver. Avec la nouvelle plongée de l'économie mondiale, l'enfer permanent que vivent des milliards d'êtres humains ne pourra que s'étendre et prendre des formes plus terrifiantes encore.
Pour leur part, les pays du bloc de l'Est sont appelés à connaître une nouvelle dégradation de leur situation économique. Si plusieurs de ces pays ont pu annoncer pour 1986 des chiffres en augmentation quant à leur taux de croissance, il est nécessaire de prendre en compte les faits que, plus encore qu'en Occident, ces chiffres sont falsifiés et aussi qu'une bonne part de la production annoncée concerne des biens absolument inutilisables à cause de leur qualité défectueuse. En fin de compte, la gravité de la crise qui affecte ces pays, transparaît dans leurs propres déclarations alarmistes lors de la réunion du COMECON en novembre 1986 signalant leur incapacité à atteindre les objectifs de leurs plans quinquennaux. Elle se manifeste aussi dans le nouvel accroissement de la dette extérieure de la Pologne (33,4 milliards de dollars pour 1986 contre 29,5 en 1985), comme dans la stagnation de la production industrielle de la Hongrie pourtant considérée jusqu'ici comme un «modèle» de bonne gestion. Elles se révèlent enfin, pour ce qui concerne la première puissance du bloc, l'URSS :
- par une chute de près d'un tiers des exportations vers les pays occidentaux en 1986, ce qui l'a condamnée à réduire ses propres importations de 17% (ce qui affecte particulièrement sa capacité de moderniser son appareil productif) ;
- par les campagnes de l'équipe Gorbatchev en vue d'intensifier l'effort de productivité avec à la clé des baisses de salaire pour les ouvriers des secteurs peu productifs.
Pour la classe ouvrière des pays dits « socialistes », l'heure est donc à de nouvelles attaques contre ses conditions d'existence déjà particulièrement pénibles : baisse des salaires réels (notamment sous forme d'une inflation baptisée «vérité des prix»), nouvelle dégradation des conditions de travail, de logement, de santé. Et si la grande fragilité des régimes d'Europe de l'Est leur interdit les licenciements massifs et la mise au chômage d'énormes proportions de la force de travail (comme c'est le cas dans les autres régions du monde), les transferts considérables d'ouvriers (un million pour la seule RDA d'ici à 1990) dans des secteurs dits «moins productifs» -donc moins payés- sous couvert de «restructuration technologique», constituent un de moyens par lesquels ils viseront le même objectif qui est atteint par le chômage : une réduction massive du capital variable.
Concernant le Japon, l'évolution de sa situation économique constitue très certainement un des indices les plus significatifs de la gravité présente de la crise mondiale. Alors que ce pays s'était distingué jusqu'à présent par des taux de croissance bien au-dessus de ceux de ses concurrents et qu'il avait réussi à limiter le fléau du chômage, il se retrouve aujourd'hui avec une quasi-stagnation de sa production et une brutale flambée du nombre de chômeurs. Même les «modèles» ne résistent plus au flot croissant de la crise.
L'Europe Occidentale, enfin, se retrouve de nouveau, et bien plus encore que lors des précédentes récessions, aux avant-postes pour ce qui concerne les effets de la nouvelle récession et de la guerre commerciale qui s'avancent. La fermeture du marché des pays « sous-développés » aux abois, celle des pays du bloc de l'Est et surtout la fermeture du marché américain résultent de la forte poussée du protectionnisme des USA et de la baisse du dollar (qui ne peut que stimuler l'agressivité des exportations américaines sur le marché européen), tous ces éléments augurent d'une aggravation considérable des difficultés économiques sur le vieux continent. Ces difficultés seront d'autant plus brutales que l'Europe occidentale va devenir la cible de choix des exportations japonaises privées du marché américain. Alors que ce continent voit déjà pratiquement stagner sa production industrielle (la croissance du PNB étant due essentiellement au secteur tertiaire), que de façon continue sont mis à la casse des pans considérables de son appareil productif non seulement dans les secteurs traditionnels (mines, sidérurgie, chimie, etc.), mais aussi dans les secteurs «de pointe» (électronique, télécommunications, etc.), c'est une nouvelle saignée bien plus brutale encore que les précédentes qui s'y profile. Et cette chute de la production va entraîner une nouvelle poussée du chômage vers des niveaux de plus en plus intolérables alors qu'en chiffres réels, il frappe déjà près de 30 millions d'ouvriers, soit de 10 à 30% de la population active, suivant les pays, c'est-à-dire de 15 à 45% de la classe ouvrière. Chiffre auquel il faut ajouter la masse de plus en plus considérable des chômeurs partiels et des travailleurs précaires. Alors qu'au-delà des statistiques officielles, c'est une baisse de près de 10% de son niveau de vie que la classe ouvrière a subi en 1986, c'est donc une attaque d'une violence inouïe, sans précédent depuis la dernière guerre mondiale qui l'attend. Si l'inflation durant les années 1970 et le chômage dans la première partie des années 1980 furent successivement les axes centraux des attaques capitalistes, dans la période qui s'est ouverte, ce sont tous les aspects de la vie des ouvriers qui, sous l'égide directe et ouverte de l'Etat, sont brutalement attaqués de façon simultanée : emploi, conditions de travail, salaires nominaux, santé, allocations pour les enfants et les personnes âgées, logement, etc. , entraînant de façon massive la paupérisation absolue de la classe ouvrière, une paupérisation absolue dont les « experts » détracteurs du marxisme avaient annoncé des décennies durant l'extinction définitive. Ainsi reviennent déferler au centre historique du capitalisme, dans les concentrations industrielles et ouvrières les plus anciennes et importantes du monde, ces formes extrêmes de la barbarie que la bourgeoisie croyait avoir rejetées une fois pour toutes vers la périphérie après la 2e guerre mondiale.
L'évolution des conflits impérialistes
4. La barbarie qui aujourd'hui revient frapper le cœur du capitalisme, aussi cruelle qu'elle soit, n'est qu'une pâle image de celle vers où ce système entraîne l'humanité s'il est laissé à sa propre logique ; sur le terrain capitaliste, il n'existe qu'un seul aboutissement à la crise économique mondiale : un 3e holocauste impérialiste qui détruirait toute civilisation et probablement l'humanité elle-même.
Cette perspective s'est profilée de façon ouverte à l'entrée des années 1980 lorsque les augmentations astronomiques des dépenses militaires, et particulièrement celles des USA, se sont accompagnées d'une radicalisation des diatribes entre les gouvernements des deux blocs et une détérioration sensible des rapports diplomatiques. Mais si aujourd'hui ce sont des discours de paix qui dominent la vie diplomatique, si fleurissent des initiatives et des discussions en faveur des réductions d'armement, cela ne signifie nullement qu'il se serait produit un réel changement dans l'ensemble de la situation, que nous irions vers une atténuation des tensions impérialistes et une disparition définitive de la menace d'une 3e guerre mondiale.
En réalité, les discours pacifistes, les grandes manœuvres diplomatiques, les Conférences internationales de toutes sortes ont toujours fait partie des préparatifs bourgeois en vue de la guerre impérialiste (cf. les accords de Munich en 1938 par exemple). Ils interviennent en général en alternance avec des discours bellicistes et ont une fonction complémentaire. Alors que ces derniers ont pour objet de faire accepter à la population, et en particulier à la classe ouvrière, les sacrifices économiques commandés par l'explosion des armements, de la préparer à la mobilisation générale, les premiers ont pour objet de permettre à chaque Etat d'apparaître comme «celui qui veut la paix», qui n'est pour rien dans l'aggravation des tensions, afin de pouvoir justifier par la suite la «nécessité» de la guerre contre «l'autre qui en porte toute la responsabilité». C'est bien à une telle alternance entre discours bellicistes et discours pacifistes que nous avons assisté ces dernières années notamment de la part de l'administration Reagan dont le «jusqu'au-boutisme» des premières années de son mandat, destiné à justifier les énormes accroissements des dépenses militaires ainsi que diverses interventions à l'extérieur (Liban, Grenade, etc.), a fait place à «l'ouverture» face aux initiatives soviétiques dès lors qu'était acquise et affermie la nouvelle orientation d'accroissement des préparatifs militaires et qu'il convenait de faire preuve de «bonne volonté». Mais derrière le battage diplomatique actuel et les perspectives d'une réduction des «euromissiles», il n'existe aujourd'hui aucune remise en cause réelle des menaces que le capitalisme fait peser sur l'humanité : même si les négociations actuelles aboutissaient -ce qui est extrêmement improbable- à une réduction importante ou même totale des «euromissiles», cela ne remettrait nullement en cause la capacité des armements actuels à détruire 10 fois la planète. D'ailleurs, c'est en partie aussi le surarmement des deux grandes puissances qui permet d'expliquer leurs discussions actuelles : plutôt que d'épuiser encore plus une économie déjà violemment frappée par la crise (ce qui est particulièrement le cas de l'URSS dont ce n'est pas par hasard qu'elle soit à l'origine des présentes initiatives), par une concurrence du nombre de missiles et des mégatonnes, elles préfèrent soulager quelque peu cette économie et consacrer plus de moyens aux systèmes d'armes les plus sophistiqués.
5. Ainsi, au plan des conflits impérialistes, la situation internationale n'a connu sur le fond aucune modification sensible ces derniers temps où se sont maintenus ou même avivés les multiples foyers d'affrontement entre les grands blocs sous couvert notamment de «libérations nationales» (comme en Angola, en Ethiopie, au Cambodge, en Afghanistan, etc.). En particulier, cette situation reste dominée par l'offensive du bloc occidental destinée à établir un «cordon sanitaire» autour de l'URSS, à parachever l'encerclement de cette puissance et dont l'étape actuelle consiste dans la réinsertion de l'Iran dans le dispositif stratégique du bloc.
Cette offensive a été rendue difficile non pas tant par la résistance que peut lui opposer l'URSS mais principalement par l'instabilité interne d'un grand nombre de régimes des régions concernées par cette offensive, instabilité qui ne fait que s'aggraver avec les coups de boutoir de la crise et la décomposition sociale qui en résulte et qui est un terrain de choix pour toutes sortes de surenchères entre cliques bourgeoises notamment à l'égard des blocs impérialistes. Ces pays bien souvent expriment de façon caricaturale que l'appartenance à un bloc ne signifie nullement qu'une bourgeoisie renonce pour autant à la défense de ses propres intérêts nationaux ni à ses propres ambitions impérialistes particulières. Une telle appartenance a au contraire comme objectif d'assurer la meilleure défense possible de ces intérêts et ambitions dans un monde où la crise tend à exacerber les rivalités économiques et militaires entre tous les pays et où il est impossible à un pays donné de s'affronter à tous les autres. Dans toute une série de pays «sous-développés» de la périphérie plongés dans une situation économique catastrophique et aux ambitions impérialistes perpétuellement frustrées, l'indiscipline et le chantage à l'égard du bloc de tutelle constituent un des moyens pour essayer de se vendre le plus cher possible.
Cependant de telles gesticulations ne sauraient remettre en cause le facteur prépondérant que constitue, dans la situation mondiale, la division en deux grands blocs impérialistes, ni non plus le fait que dans leurs affrontements permanents, c'est le bloc de l'Ouest qui dispose des meilleurs atouts. C'est bien ce que viennent de confirmer les derniers événements au Proche et Moyen-Orient :
- avec son intervention à Beyrouth Ouest de début 1987, la Syrie a fait la preuve qu'elle était désormais prête à jouer pleinement au Liban son rôle de gendarme au profit des intérêts du bloc US : cette intervention fait comme principales victimes les partis de « gauche » (PCL et PSL de W. Joumblatt) et surtout les «hezbollahs» pro-iraniens, preuve que la Syrie a renoncé à son alliance avec l'Iran pour participer à l'offensive occidentale visant à récupérer ce pays ;
- les déboires de la Libye au Tchad, résultant de l'important soutien militaire de la France et des Etats-Unis à ce dernier pays démontrent les limites des velléités d'indépendance des pays qui sont tentés de faire passer leurs intérêts impérialistes locaux devant les intérêts globaux du bloc auquel ils sont rattachés ; plus qu'à la Libye c'est à l'Iran qu'est destiné un tel avertissement ;
- le scandale de «l'Irangate», au-delà des manœuvres de politique interne américaine destinées à préparer en faveur des Républicains la succession de Reagan, fait apparaître la nécessité pour l'Iran, malgré toutes ses campagnes contre les pays du bloc occidental, de composer avec celui-ci afin de faire face au poids grandissant de la guerre contre l'Irak encouragée au départ par ce même bloc.
Ainsi, ces derniers mois ont apporté à celui-ci, après plusieurs années de relatif piétinement, de réels succès dans son offensive. Mais les progrès de celle-ci et l'établissement, vers lequel elle s'achemine, d'un contrôle ferme et sans partage du bloc occidental sur les Proche et Moyen-Orient, n'annoncent aucune perspective réelle de paix dans cette région et encore moins à l'échelle mondiale :
- dans cette région, l'accumulation de problèmes légués par l'histoire du capitalisme -notamment celle de la colonisation (divisions communautaires au Liban, Kurdes et surtout question palestinienne)- et qui ne pourront pas être réglés au sein de ce système (même par une nouvelle «conférence de Genève» si elle arrive à se tenir), ne pourra aboutir dans un contexte général d'aggravation de la crise et des tensions impérialistes qu'à de nouvelles convulsions meurtrières ;
- même s'il établissait dans cette partie spécifique du monde une «pax americana» durable, elle ne pourrait empêcher que la poursuite de l'offensive du bloc US ne fasse surgir d'autres foyers de conflits jusqu'à aboutir à l'embrasement généralisé d'une 3e guerre mondiale au cas où l'URSS serait repoussée dans ses derniers retranchements.
Cet aboutissement monstrueux, ce point culminant de toute la barbarie du capitalisme décadent, supposerait évidemment que la classe ouvrière, par son embrigadement derrière les drapeaux nationaux laisse les mains libres aux grandes puissances pour s'engager dans l'engrenage qui y conduit, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle du fait même du développement des luttes ouvrières.
L'évolution de la lutte de classe
6. Ainsi la lutte du prolétariat, si elle porte dans son devenir, avec le renversement du capitalisme, l'élimination de tous les aspects de la barbarie de ce système, constitue déjà le facteur historiquement décisif de la période actuelle, empêchant le déchaînement de la forme extrême de cette barbarie : le cours historique n'est pas à la guerre impérialiste généralisée, mais aux affrontements de classe généralisés et ce qui caractérise les mois écoulés, c'est que la lutte de classe est revenue de façon de plus en plus insistante au centre de la situation mondiale immédiate.
En moins d'un an, en effet, outre des mouvements importants dans une multitude de pays dans le monde entier, allant des USA (sidérurgie, employés municipaux de Philadelphie et Détroit durant l'été 1986) à la Yougoslavie (vague de grèves sans précédent au printemps 1987), en passant par le Brésil (plus d'un million et demi d'ouvriers de nombreux secteurs en grève en octobre 1986 et nouvelle vague de luttes massives en avril mai 1987), l'Afrique du Sud (grèves dans les mines et les chemins de fer), le Mexique (manifestations massives de plusieurs secteurs en appui aux électriciens en grève), la Suède (des dizaines de milliers de grévistes à l'automne 1986) et la Grèce (près de 2 millions d'ouvriers en grève en janvier 1987) ; on a pu assister à quatre mouvements majeurs très significatifs affectant le cœur du prolétariat mondial : l'Europe occidentale. Il s'agit :
- des grèves massives en Belgique au printemps 1986;
- du très important mouvement des travailleurs des chemins de fer en France en décembre 1986 ;
- de la grève des 140. 000 travailleurs de British Telecom en Grande-Bretagne fin janvier 1987 ;
- de la vague de luttes affectant de nombreux secteurs en Espagne au printemps 1987.
L'ensemble de ces mouvements confirme donc que la 3e vague de luttes ouvrières depuis la reprise historique de la fin des années 1960 et qui avait débuté à l'automne 1983 avec les luttes massives du secteur public en Belgique, a une toute autre durée, ampleur et profondeur que la 2e (1978-80), et que le piétinement qu'elle avait connu en 1985, suite à la politique bourgeoise d'éparpil-lement des attaques en vue d'éparpiller les ripostes ouvrières, ne remettait pas en cause sa dynamique d'ensemble.
Les mouvements démontrent également que c'est au cours de cette 3e phase dans le développement de cette vague de luttes (après les mouvements massifs de 1983-84 et l'éparpillement de 1985) que s'expriment pleinement ses principales caractéristiques telles qu'elles avaient été dégagées par le CCI dès janvier 1984 («Résolution sur la situation internationale», Revue Internationale n° 37, 2e trimestre 1984) et confirmée lors de son 6e congrès de même que dans la résolution de juin 1986 :
1. tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes ;
2. tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant en particulier à leurs débuts, un certain débordement des syndicats ;
3. développement progressif au sein de l'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité à s'opposer comme classe aux attaques capitalistes ;
4. recherche de la solidarité active et de l'unification par-delà les usines, les catégories ou les régions, notamment sous forme de manifestations de rue et en particulier de délégations massives d'un centre ouvrier à l'autre, mouvement qui se fera en confrontation croissante avec tous les obstacles placés par le syndicalisme et au cours duquel s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto organisation de leur combat. »
7. En effet, les luttes qui se sont développées depuis un an, et notamment celles de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d'Espagne, revêtent toutes, à des degrés divers, une ou plusieurs de ces caractéristiques.
C'est ainsi que la tendance à des mouvements de grande ampleur s'est exprimée de façon très nette en Belgique, où c'est près d'un million d'ouvriers qui ont été impliqués dans les luttes (dans un pays qui ne compte que 9 millions d'habitants), de même qu'en Espagne où les luttes se sont déployées sur plusieurs mois dans de multiples secteurs. Mais, dans une moindre mesure, elle s'est exprimée également en Grande-Bretagne avec plus de 130. 000 grévistes de British Telecom, ainsi qu'en France où, malgré un nombre plus limité de grévistes (40.000 à 50.000), la lutte dans les chemins de fer a eu un énorme impact dans toute la classe ouvrière et la vie politique du pays.
Pour sa part, la tendance au surgissement de mouvements spontanés s'est manifestée de manière très claire dans ces deux derniers pays. Et si, dans le cas de la France, la spontanéité du mouvement des cheminots -qui a rencontré au départ l'hostilité de tous les syndicats résultait pour une part du discrédit qui s'était accumulé à l'égard de ces organismes durant les 5 années de gouvernement de gauche qu'ils soutenaient (ce qui constitue une confirmation a contrario de la nécessité pour la bourgeoisie dans la période présente de placer ses forces de gauche dans l'opposition), le cas de la Grande-Bretagne (où la bourgeoisie la plus expérimentée du monde avait mis la gauche dans l'opposition dès la fin des années 1970) illustre le fait que cette tendance est bien un phénomène général qui se développera de plus en plus dans les autres pays.
C'est également dans ces deux pays que le développement de la confiance en soi du prolétariat s'est manifesté de la façon la plus significative. Pour ce qui est de la France, le déploiement de la grève des cheminots confirme la sortie d'une période où la bourgeoisie avec l'aide des syndicats avait mis en œuvre, avec un certain succès, une politique d'immobilisation de la classe, où le discrédit des syndicats était retourné contre les ouvriers pour les convaincre qu'ils ne pouvaient rien faire contre les attaques capitalistes. Le phénomène est encore plus net en Grande-Bretagne où la grève de British Telecom signifie la fin d'une période de démoralisation et de sentiment d'impuissance qui avait suivi la défaite de la longue grève des mineurs de 1984-85 et celle des ouvriers de l'imprimerie en 1986.
Ces différentes caractéristiques des luttes récentes sont appelées à se renforcer dans la période qui vient avec le développement de la résistance ouvrière face à l'intensification et la généralisation des attaques d'une bourgeoisie dont la marge de manoeuvre économique se réduit toujours plus. Cette période sera marquée par :
- une tendance à une mobilisation beaucoup plus massive et simultanée des ouvriers,
- une plus grande fréquence de ces situations de mobilisation de la classe, les moments de répit tendant à être d'une durée de plus en plus courte,
- un renforcement de l'expérience et surtout de la maturation de la prise de conscience dans les rangs ouvriers où la simple méfiance face aux forces bourgeoises d'encadrement cédera de plus en plus la place à une attitude active de débordement de celles-ci, de prise en main directe des luttes posant de façon croissante la question de leur unification.
8. La tendance vers l'unification des luttes est justement celle qui a éprouvé jusqu'à présent le plus de difficultés à s'exprimer de façon positive et claire. Si les bases en ont été posées de façon nette lors des luttes en Belgique au printemps 1986 (avec en particulier la volonté permanente des mineurs d'étendre le combat dans d'autres secteurs), c'est surtout son besoin qui s'est exprimé alors que des centaines de milliers d'ouvriers luttaient simultanément, bien plus que sa réalité. Ce besoin s'est également fait sentir fortement lors des luttes de l'hiver et du printemps 1987 en Espagne, alors que de multiples mouvements affectant de nombreux secteurs dans tout le pays se sont déroulés en ordre dispersé, ce qui a permis la reprise en main de la situation par la bourgeoisie et la dissipation de leur énorme potentialité. Dans le cas de la France, l'isolement corporatiste qui a caractérisé la grève dés cheminots et constitué sa principale faiblesse a d'autant plus mis en évidence le besoin de l'unification que se déroulaient en même temps d'autres mouvements dans les transports urbains à Paris et parmi les marins, et qu'il existait dans tout le secteur public un réel potentiel de combativité qui aurait pu se cristalliser si les cheminots avaient appelé leurs frères de classe à les rejoindre.
Cette difficulté à concrétiser le besoin de l'unification, alors que les autres caractéristiques des combats actuels se sont exprimées déjà de façon beaucoup plus marquée, s'explique aisément par le fait que l'unification constitue justement l'élément central des luttes de la période présente, celui qui, d'une certaine façon, contient tous les autres, qui en constitue la synthèse.
Par ailleurs, les mouvements récents ont montré que l'effort vers l'unification se heurtait à la différence existant entre la situation des ouvriers du secteur privé et ceux du secteur public. Le fait que ces grèves aient touché essentiellement le secteur public illustre cette différence. En effet, dans le secteur privé, l'arme de la grève se révèle d'un emploi beaucoup plus difficile à cause du poids du chômage et de la menace de licenciement. C'est pour cela que les manifestations de rue tendront à devenir, comme la résolution de juin 1986 le mettait en évidence, un des moyens privilégiés du processus d'unification du combat entre tous les secteurs de la classe ouvrière : ouvriers du secteur public, du secteur privé, ouvriers au chômage. Et cela a pu être vérifié négativement dans la lutte des ouvriers des chemins de fer en France, par exemple où un des facteurs indiscutables du maintien de leur isolement favorisant les manœuvres syndicales et les conduisant à la défaite a résidé dans le fait qu'ils n'aient pas pris l'initiative de telles manifestations de rue dès qu'ils se sont mis spontanément en grève et dotés de l'auto organisation de leur combat.
9. Le fait que l'unification du combat de classe face aux attaques de plus en plus frontales du capital -et qui constitue à l'heure actuelle l'axe central du développement de l'affrontement contre celui-ci- contienne tous les autres aspects de la lutte ouvrière -la prise en main des luttes, leur auto organisation, leur extension d'un secteur à l'autre, les manifestations de rue- détermine les caractéristiques de la stratégie employée par la bourgeoisie, sa gauche et en particulier ses syndicats contre ce combat. Dans la période présente où c'est dans l'opposition qu'agissent les forces bourgeoises de gauche, celles-ci n'ont et n'auront pas pour tactique, dans l'accomplissement de leur fonction anti-ouvrière, de s'opposer ouvertement à la combativité qui surgit partout, ni même en général de s'opposer à tel ou tel aspect de la lutte, mais essentiellement de dissocier, d'opposer les différents aspects complémentaires du chemin vers l'unification. C'est ainsi que dans les grèves du printemps 1987 en Espagne, la tactique syndicale a consisté essentiellement à prendre les devants face à un mécontentement et une combativité généralisés, afin d'empêcher les surgissements spontanés de la lutte et sa prise en charge par les ouvriers, et de pouvoir la découper en rondelles à travers des « actions » dispersées dans le temps et l'espace, des manifestations séparées alors que le sens même d'une manifestation est de permettre aux ouvriers de tous les secteurs de se retrouver ensemble. De même, lors de la grève des cheminots en France, la tactique syndicale, une fois qu'il était devenu impossible de faire obstacle au mouvement, a consisté non pas à s'opposer ouvertement à son auto organisation, mais d'abord à en faire un problème «spécifique» des cheminots et même des conducteurs de train, puis de jouer la carte du «jusqu'au-boutisme» quand la preuve a été faite que la lutte était battue, tout en lançant à ce moment-là des appels à «l'extension» visant non pas à l'extension du combat, mais à l'extension de la défaite.
Une des caractéristiques de la période présente et à venir de développement de la combativité et de la conscience de la classe ouvrière consiste dans l'utilisation croissante par le syndicalisme, à côté des grandes centrales officielles, de ses variantes «de base» et «de combat», notamment lorsque les premières sont débordées par les ouvriers. La fonction essentielle du syndicalisme de base, derrière lequel on trouve en général les différentes variétés de groupes gauchistes, consiste à ramener dans les filets du syndicalisme, et en fin de compte des syndicats «officiels», les secteurs ouvriers qui tendent à rompre avec celui-ci. C'est bien ce qui a pu être constaté dans la grève des chemins de fer en France, où les deux «coordinations» constituées en dehors des syndicats, celle des «roulants» et celle «inter catégories», ont décidé, sous l'influence des deux groupes trotskystes qui s'étaient placés à leur tête, de confier aux centrales syndicales officielles le soin de mener les négociations avec la direction («l'audace» la plus «radicale» consistant à demander qu'on lui réserve une petite place sur un strapontin). Mais le mode d'activité du syndicalisme de base ne se limite pas à cela. Il consiste également à promouvoir des actions «dures» (que les centrales peuvent dans certains cas reprendre également à leur compte) telles que des blocages de routes, de voies de chemin de fer, des séquestrations, des affrontements avec la police qui, si elles peuvent faire partie dans certaines circonstances des moyens de lutte de la classe ouvrière, sont ici utilisées pour isoler les éléments les plus combatifs du reste de la classe, ce qui met en évidence une réelle convergence entre syndicalisme de base et répression étatique, un partage des tâches de fait. De même, outre qu'il peut prôner directement un syndicalisme plus « radical » face aux centrales officielles en appelant à la formation de syndicats «révolutionnaires» ou «rouges», le syndicalisme de base peut également agir à travers la mise en place de structures de nature syndicale qui ne disent pas leur nom ou en poussant à la transformation de réels organes de la lutte en de telles structures. C'est ainsi qu'il est amené, comme on l'a vu en Allemagne avec les comités de chômeurs et en France avec les « coordinations », à auto proclamer une fausse centralisation de la lutte, avant que les ouvriers concernés ne soient prêts à pouvoir la réaliser par eux-mêmes, avec comme résultat d'entraver le réel processus d'auto organisation.
Face à cette multitude de facettes de l'action des forces bourgeoises au sein de la classe ouvrière, il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants à ne pas leur apporter un concours involontaire en fétichisant ou en employant à contretemps des mots d'ordre justes en général mais qui, dans certaines circonstances particulières, peuvent aller dans le sens des gauchistes et des syndicats cherchant à créer des abcès de fixation ou des diversions. En toutes circonstances, ils se doivent de mettre en avant ce qui contribue réellement au développement de la force essentielle du combat : son unification et la prise de conscience.
10. Cette même vigilance des révolutionnaires doit s'appliquer à l'égard d'un phénomène qui. ne s'est manifesté que de façon embryonnaire jusqu'à présent, mais qui tendra à prendre une importance croissante avec le développement de la lutte elle-même : le surgissement de regroupements des éléments parmi les plus combatifs de la classe, les comités de lutte. Il importe que les révolutionnaires sachent bien faire la différence entre d'une part des manifestations du syndicalisme de base, des tentatives bourgeoises pour ramener dans les nasses du syndicalisme les ouvriers qui tentent de rompre avec lui, et d'autre part de réelles expressions de la vie de la classe, aussi confuses soient-elles. Afin de pouvoir impulser efficacement la création et le développement des comités de lutte, combattre les dangers tendant à les dénaturer et en faire des proies pour les gauchistes et le syndicalisme de base, les révolutionnaires doivent en particulier comprendre leur nature, fonction et caractéristiques réelles :
- ils n'ont pas de plate-forme, ni de conditions d'admission, ni de cotisations régulières, ils sont ouverts à tous les ouvriers ;
- ils ne constituent pas les embryons des futurs comités de grève (dans le cas d'élection de certains de leurs membres dans ces derniers, une claire distinction devrait s'établir entre leur appartenance à un comité et le mandat émanant d'une assemblée générale) ;
- ils ont pour tâche première, à travers la discussion, la réflexion, la propagande, de préparer les combats à venir, leur auto organisation et leur unification ;
- ils se distinguent en ce sens des cercles de discussion (même si de tels cercles peuvent également exister aujourd'hui) tels qu'ils étaient apparus dans les années 1970 et qui constituent une étape vers la formation d'organisations politiques ;
- ils ne sauraient être des «annexes» ou «courroies de transmission» de groupes politiques existants, même si ces derniers interviennent en leur sein ;
- ils ne doivent pas être mis sur le même plan que les comités de chômeurs qui eux ont une vocation d'organisation unitaire de la classe au même titre que les assemblées générales (même si dans certaines circonstances où ils regroupent un nombre réduit d'ouvriers les comités de chômeurs peuvent s'apparenter à des comités de lutte).
11. Si c'est essentiellement dans les grandes concentrations industrielles des pays centraux du capitalisme, et en premier lieu ceux d'Europe occidentale, que se dérouleront dans la période qui vient les combats prolétariens les plus importants et les plus riches d'enseignements pour l'ensemble de la classe ouvrière mondiale, il importe que les révolutionnaires soient vigilants aux manifestations de la combativité ouvrière dans les autres aires de la planète, notamment dans les pays de l'Est et dans les centres les plus industrialisés des pays de la périphérie. Dans ces zones du capitalisme, la perspective pour les luttes est étroitement liée au développement des combats dans les pays avancés du bloc occidental qui sont les seuls à pouvoir réellement démystifier les illusions d'un syndicalisme «libre» et «démocratique» fortement présentes à l'Est et les illusions du type «syndicalisme révolutionnaire» ainsi que le nationalisme «anti-impérialiste» très implantés dans les pays de la périphérie. Cependant, les combats de classe qui se mènent dans les pays dits «socialistes» et ceux des pays dits «sous-développés» apportent et seront appelés à apporter encore plus une contribution appréciable au développement de la prise de conscience des ouvriers des pays centraux du capitalisme. C'est aux premiers, en particulier, qu'on doit principalement l'usure et l'épuisement en cours de la mystification sur l'existence de «pays socialistes». Mais plus généralement, la simultanéité qu'on constate, au cours de cette 3e vague de luttes ouvrières, dans le développement de celles-ci, à l'Ouest, à l'Est et dans les centres névralgiques de la périphérie, constituent déjà un facteur important et significatif dans l'évolution du rapport de forces entre classes en faveur du prolétariat. C'est la seule voie qui pourra préparer et annoncer une généralisation des luttes au niveau mondial, qui posera la question de leur future unification à l'échelle mondiale.
C'est pour cela qu'il importe de comprendre les campagnes «rénovatrices» de Gorbatchev en URSS et dans les autres pays de l'Europe de l'Est. Elles traduisent la crainte de la bourgeoisie que les mesures d'austérité de plus en plus sévères rendues nécessaires par l'intensification de la crise ne provoquent d'importantes réactions de la classe ouvrière. Dans ces pays, où la marge de manœuvre économique et politique de la classe dominante est beaucoup plus restreinte qu'en Occident, les promesses «démocratiques» et la «radicalisation» des syndicats officiels sont un moyen par lequel les autorités essaient de prévenir un débordement trop massif, immédiat et explosif comme ce fut le cas en Pologne en 1980.
De même, pour ce qui concerne les pays dits du «tiers-monde», il convient de réaffirmer que, dans la période à venir, c'est de plus en plus autour de la classe ouvrière que se forgera la résistance de toutes les couches non exploiteuses contre l'attaque brutale de leurs conditions d'existence déjà intenables. Seule en effet, la classe ouvrière, aussi minoritaire qu'elle soit dans ces pays, peut donner une perspective à toutes ces luttes et révoltes. C'est pour cela que dans cette partie du monde également, l'intervention des révolutionnaires est indispensable, notamment dans la dénonciation des campagnes bourgeoises «anti-impérialistes» et en faveur de «l'indépendance nationale», de la «démocratisation» et d'un «syndicalisme de base révolutionnaire».
12. L'accélération de l'histoire qui se produit aujourd'hui, et notamment sur le plan de la lutte de classe, confère d'énormes responsabilités aux organisations révolutionnaires que la classe a fait surgir en son sein. En particulier celles-ci sont appelées à acquérir une influence croissante non pas encore au niveau de l'évolution globale du combat prolétarien, mais sur des moments significatifs de celui-ci. Pour se porter à la hauteur de ces responsabilités, il est indispensable que ces organisations :
- se dotent des positions programmatiques tirant à fond les enseignements de toute l'expérience historique de la classe ouvrière, notamment sur la question syndicale ;
- soient en mesure de développer les analyses les plus claires et précises possibles de la période actuelle : le cours historique aux affrontements de classe, les caractéristiques de la 3e vague de luttes ouvrières depuis le resurgissement historique de la fin des années 1960 ;
- soient capables de concrétiser à tout instant ces analyses par un suivi pas à pas de chacun des mouvements importants de la classe afin de mettre en avant les perspectives et les mots d'ordre appropriés aux différentes situations qu'il traverse ;
- sachent tirer de chacune de leurs interventions dans ces mouvements le maximum d'enseignements afin de pouvoir reconstituer progressivement le potentiel d'expérience que la terrible contre-révolution dont nous sommes sortis a fait perdre aux révolutionnaires.
Pour faire face à ces nécessités, et notamment aux deux dernières, il est indispensable, que les organisations révolutionnaires se conçoivent comme partie prenante des combats qui se mènent dès aujourd'hui. Cela suppose de leur part et de celle de leurs militants une implication résolue, énergique et directe au sein de ces combats. Cela suppose aussi, comme condition indispensable à une telle implication, qu'elles conçoivent leur rôle et leur activité non au jour le jour, mais dans une perspective à long terme, de façon en particulier à ne pas se laisser ballotter, et finalement emporter par les soubresauts de la lutte de classe.
Comme le CCI l'affirmait dans sa résolution de juin 1986:
«C'est le propre des révolutionnaires que d'exprimer au plus haut point ces qualités de la classe porteuse du futur de l'humanité : la patience, la conscience de l'ampleur immense de la tâche à accomplir, une confiance sereine mais indestructible en l'avenir».
Conscience et organisation:
Rectification de la plate-forme du CCI
- 2780 reads
Introduction: quelle démarche pour modifier la plate-forme ?
Le programme d'une organisation révolutionnaire n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le bordiguisme sclérosé, une doctrine figée et invariante. Ce programme est vivant. Certes, ce qu'il exprime avant tout c'est le devenir révolutionnaire de la classe ouvrière lequel est tracé à celle-ci par l'histoire depuis près de deux siècles avec son développement en même temps que celui des rapports de production capitalistes. Mais le programme ne saurait se résumer à la mise en avant de la nécessité et de la possibilité pour la classe d'abolir le capitalisme et d'instaurer, le communisme. Il bénéficie en permanence de l'expérience accumulée par la classe ouvrière et de la clarification qui s'opère en son sein et, en premier lieu, dans ses organisations politiques dont c'est la responsabilité même :
- d'éclaircir et de préciser sans relâche les positions politiques de classe ;
- de rectifier ces positions lorsque l'expérience, la discussion ou la réflexion a démontré leur non validité.
C'est pour cela que les organisations révolutionnaires ont souvent été amenées à rectifier ou modifier leur programme. Les exemples historiques ne manquent pas. On peut citer notamment :
- la préface de l'édition allemande de 1872 du Manifeste Communiste où Marx et Engels signalent la caducité de certains passages de ce document et la nécessité en particulier de prendre en compte l'expérience de la Commune de Paris sur la question de l'Etat ;
- l'adoption par la Social-démocratie allemande à son congrès d'Erfurt en 1891 d'un nouveau programme en remplacement de celui de Gotha adopté en 1875 ;
- la modification du programme du POSDR de 1903 par les bolcheviks au cours même de la révolution de 1917;
- la modification des positions de l'Internationale Communiste par Bilan.
Cependant, lorsqu'une modification s'impose, il faut agir à la fois avec audace et avec prudence comme nous l'a en particulier enseigné Bilan. S'il ne faut pas craindre de remettre en cause ce qui pouvait apparaître comme des dogmes intangibles, « ne supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme », comme le dit Bilan (ce que n'ont pas su faire les résidus de la Gauche italienne comme Programma et Battaglia Comunista), il faut se garder encore plus de «jeter l'enfant avec l'eau du bain», de «faire table rase» de l'expérience passée du mouvement ouvrier. Lorsque s'impose une modification du programme :
- il ne s'agit pas d'une «révision» ou d'une «rupture» (à l'image de la démarche des conseillistes ou des modernistes) ;
- il s'agit de s'appuyer fermement sur les acquis pour aller plus loin, il s'agit d'un dépassement au sens marxiste du terme.
C'est bien cette démarche qui a été mise en œuvre par le CCI depuis ses origines : «Les bases sur lesquelles s'est appuyé, dès avant sa constitution formelle, notre Courant dans son travail de regroupement ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours par le passé constitué les piliers de ce type de travail. On peut les résumer ainsi :
- la nécessité de rattacher l'activité révolutionnaire aux acquis passés de la classe, à l'expérience des organisations communistes qui ont précédé (...);
- la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes non comme un dogme mort mais comme un programme vivant, en constant enrichissement et approfondissement (...)» («10 ans du CCI, quelques enseignements» ; Revue Internationale n° 40).
C'est aussi la démarche qu'il s'agit d'adopter pour la rectification de la plate-forme du CCI. En particulier, il importe en premier lieu pour cette rectification de se baser sur les acquis de la Gauche communiste concernant les points qui sont aujourd'hui soulevés.
Pourquoi des erreurs ont-elles été commises par le CCI ?
Les questions qui sont ici concernées - la dégénérescence et le passage à la bourgeoisie d'organisations révolutionnaires ; les conditions d'apparition et de développement de nouvelles organisations - ne sont pas nouvelles. Elles sont en fait tranchées depuis longtemps dans le mouvement ouvrier, en grande partie grâce au travail théorique réalisé par Bilan, sur la question de la Fraction, sur les circonstances d'apparition de celle-ci au sein du parti frappé de dégénérescence opportuniste, sur son rôle en vue de la reconquête de celui-ci tant que cela est possible et, lorsque cette tâche devient sans objet par le passage définitif du parti au service de la bourgeoisie nationale, sur sa fonction de préparation du surgissement du nouveau parti de classe lorsque les circonstances historiques le permettront ; travail théorique qui était lui-même une systématisation de l'expérience de la Gauche au sein de la 2e et 3e Internationale. Et si le CCI a commis des erreurs, c'est essentiellement dû à la rupture organique provoquée dans le courant révolutionnaire par la plus longue et profonde contre-révolution de l'histoire et qui a nécessité à ses origines tout un travail de réappropriation des acquis du passé. C'était un travail considérable et si, lors de sa constitution formelle en 1975, notre courant en avait déjà accompli l'essentiel, l'expérience a démontré qu'il n'était pas encore achevé. En particulier notre organisation n'avait pas toujours correctement digéré ces acquis et elle n'a pas échappé à des erreurs de jeunesse assez classiques.
Ainsi, lorsqu'on parvient à un certain degré de clarté et à une certaine cohérence sur certaines questions (comme ce fut le cas au début des années 1970), il peut en découler un sentiment d'euphorie conduisant à considérer que toutes les organisations qui ne partagent pas les mêmes positions, qui véhiculent encore des positions bourgeoises, sont en réalité dans le camp de la bourgeoisie.
C'est typiquement une maladie de la jeunesse : les jugements catégoriques et définitifs qu'on porte sur ceux qui ne partagent pas ses positions sont le pendant du manque d'assurance qu'on a soi-même sur ces positions.
C'est bien cette immaturité qui se révélait dans le texte de la plate-forme adopté lors du premier congrès du CCI et qui, par certaines de ses formulations, rejetait dans la bourgeoisie tous les autres groupes politiques. Pour dépasser cette immaturité, il a fallu que le 2e congrès adopte la résolution sur «Les groupes politiques prolétariens» qui jetait les bases claires sur cette question. C'est sur ces bases que s'est appuyée la modification de la plate-forme du CCI lors du 3? congrès ; mais cette modification, si elle permet à la plate-forme de donner un cadre correct à l'égard des organisations existant aujourd'hui, est encore insuffisante du point de vue même de la clarté auquel nous étions parvenus au 2e congrès. En effet, il subsiste encore une contradiction entre, d'un côté, la plate-forme qui par exemple place en 1914 le passage à la bourgeoisie des partis socialistes tout en considérant à juste titre comme révolutionnaire et à l'avant-garde du mouvement ouvrier les partis communistes sortis de ces partis bien après cette date, et, de l'autre côté, la résolution du 2e congrès qui affirme que : « (les groupes politiques issus de scissions dans des organisations passées définitivement à la .bourgeoisie, scissions basées sur une ^rupture avec certains points de leur programme), se distinguent fondamentalement des fractions communistes qui peuvent apparaître comme réaction à un processus de dégénérescence des organisations prolétariennes. En effet, celles-ci se basent non sur une rupture mais sur une continuité du programme révolutionnaire précisément menacé par le cours opportuniste de l'organisation, même si par la suite elles lui apportent les rectifications et enrichissements imposés par l'expérience. De ce fait, alors que les fractions apparaissent avec un programme révolutionnaire cohérent et élaboré, les courants qui rompent avec la contre-révolution se présentent avec des positions essentiellement négatives opposées, généralement de façon partielle, à celles de leur organisation d'origine, ce qui ne suffit pas à constituer un programme communiste solide. Leur rupture avec une cohérence contre-révolutionnaire ne peut suffire à leur conférer une cohérence révolutionnaire (...) ».
Outre cette immaturité globale, il existe une autre cause plus circonstancielle (mais elle aussi résultant de notre immaturité et de celle du milieu révolutionnaire) • aux erreurs du CCI sur ces questions et plus particulièrement sur le moment précis du passage à la bourgeoisie des PS et des PC. A l'époque où ces erreurs ont été commises, nous sortions d'une longue polémique avec des groupes (tel Revolutionary Perspectives) qui plaçaient en 1921 le passage à la bourgeoisie des PC et la mort de l'IC ou qui estimaient que les partis social-démocrate n'avaient jamais appartenu à la classe ouvrière. Polarisés par la lutte contre des positions ouvertement intenables, nous n'avions pas suffisamment consacré d'efforts à développer pour notre part une analyse tout à fait correcte puisque notre première préoccupation avait été de démontrer pourquoi la Social-démocratie avait été prolétarienne et pourquoi en 1921 les PC étaient des partis ouvriers.
Quelle ampleur pour les modifications de la plate-forme ?
Faut-il considérer que les modifications, dont une première proposition avait été faite au 6e congrès, constituent une remise en cause de nos acquis, une révision du marxisme comme le prétendait la «tendance» (devenue depuis lors la FECCI) ? En d'autres termes, sommes-nous en train de nous écarter de la méthode de Bilan pour rejoindre celle des modernistes ? La réponse est clairement non !
En réalité, ce qu'il s'agit fondamentalement et simplement de réaliser c'est une mise en cohérence (suite à des débats importants qui se sont déjà menés dans l'organisation et que nous pouvons conclure) de l'ensemble de nos positions, telles qu'elles s'expriment dans la plateforme, avec toute une série de textes d'orientation d'ores et déjà adoptés par l'organisation.
La plupart de ces textes sont antérieurs au 6e congres du CCI (et ont été adoptés par les camarades qui ont quitté le CCI à ce congrès). Il s'agit notamment de :
- la résolution du 2e congrès sur «Les groupes politiques prolétariens» ;
- le rapport sur «Le cours historique» adopté par le 3e congrès.
Dans ce deuxième texte sont reprises et qualifiées de «lumineuses» les lignes suivantes provenant du rapport sur la situation internationale à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France :
«On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerres impérialistes.
La première s'achève avec l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917 et consiste dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, de la défaite de la gauche exclue de l’IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme au travers de la théorie et de la pratique du «socialisme dans un seul pays»
La deuxième étape est celle de l'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique du capitalisme ou socialisme : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l’lC et la faillite de l'Opposition de gauche de Trotsky (...)
La troisième étape fut celle du dévotement total du mouvement ouvrier des pays "démocratiques". Sous le masque de défense des libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a en réalité cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de la bourgeoisie nationale, de sa patrie capitaliste. L'antifascisme était la plate-forme, l'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres au prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale. Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif (...) ».
La relecture de ces lignes nous montre en particulier trois choses :
- les modifications à apporter à la plate-forme ne constituent pas, sur cette question, une remise en cause des positions des groupes dont nous revendiquons la continuité politique, mais bien une réappropriation de ces positions ;
- l'ensemble du CCI a adopté à son 3e congrès un texte important, longuement discuté, sans prendre pleinement en compte toutes les implications de ce texte, ce qui traduit une faiblesse déjà constatée à plusieurs reprises par ailleurs ;
- plus précisément, le CCI (ou une partie de ses militants) a apporté à des acquis de la Gauche communiste une adhésion formelle mais relativement superficielle (ce qui s'était également manifesté à d'autres reprises).
Il faut donc constater, contre nombre d'affirmations malveillantes, que dès avant le 6e congrès (en fait dès 1979) le CCI s'était doté des moyens théoriques lui permettant de corriger sa plate-forme dans le sens où nous nous proposons de le faire. Cependant, le 6e congrès, avec sa résolution sur l'opportunisme et le centrisme qui ramassait presque deux ans de débats particulièrement animés et approfondis, nous dote aujourd'hui des moyens non seulement de donner à notre plate-forme les formulations les plus correctes possibles mais aussi de comprendre pleinement les implications de ces formulations.
Quelles modifications de la plate-forme ?
Comme on a vu plus haut, avant même que l'organisation se penche de façon précise sur les formulations des amendements à apporter à la plate-forme, il importe qu'elle ait une vue claire des questions qui sont concernées par ces amendements. Il importe en premier lieu qu'elle sache se réapproprie les acquis du passé, dégager toutes les implications découlant de ces acquis , de même que des documents qu'elle a déjà adoptés et notamment la résolution du 6e congrès sur le centrisme et l'opportunisme.
Les textes du passé qui explicitent ces acquis sont nombreux. Un des plus significatifs est certainement une résolution adoptée en août 1933 par la Commission exécutive de la Fraction de gauche du PCI publiée dans le N° 1 de Bilan sous le titre «Vers l'Internationale deux et trois quarts... ?» republiée dans le « Bulletin d'Etude et de Discussion » de RI N° 6 et dont on peut extraire les passages suivants :
«(...) La capacité d'action du parti ne précède pas, mais suit la compréhension des situations. Cette compréhension ne dépend pas d'individus qui se réclament du prolétariat, mais du parti lui-même. Celui-ci, parce qu'il est un élément des situations et de leur enchevêtrement, peut être mobilisé et gagné par l'ennemi de classe, et dès lors, il appartiendra au courant marxiste de saisir le cours de l'évolution historique.
Le prolétariat a essuyé en 1927 une défaite terrible en ne parvenant pas à empêcher le succès contre-révolutionnaire du centrisme au sein des PC. S'il avait gagné sa bataille, au sein des partis, il aurait assuré la continuité du parti pour la réalisation de sa mission, car il aurait résolu, dans une direction révolutionnaire, les nouveaux problèmes issus de l'exercice du pouvoir prolétarien en URSS.
Lorsque le parti a perdu sa capacité de guider le prolétariat vers la révolution -et cela arrive par le triomphe de l'opportunisme-, les réactions de classe produites par les antagonismes sociaux n'évoluent plus vers la direction qui permet au parti d'accomplir sa mission. Les réactions sont appelées à chercher les nouvelles bases où se forment désormais les organes de l'entendement et de la vie de la classe ouvrière : la Fraction. L'intelligence des événements ne s'accompagne plus avec l'action directe sur ces derniers, ainsi qu'il arrivait précédemment au sein du parti et la fraction ne peut reconstituer cette unité qu'en délivrant le parti de l'opportunisme. (...)
Au point de vue fondamental, le problème est vu sous deux formes diamétralement opposées : notre fraction conçoit sa transformation en parti, envisage chaque moment de son activité comme un moment de la reconstruction du parti de classe du prolétariat et considère que, seule la fraction à l'intérieur ou en dehors de l'organisation officielle du parti, représente l'organisme pouvant conduire le prolétariat à la victoire. Le camarade Trotsky conçoit, par contre, que la constitution d'un nouveau parti ne dépendra pas directement de la fraction ou de son travail, mais du travail de «l'opposition»en jonction avec d'autres formations politiques et même avec des courants appartenant à des partis de la classe ennemie.
La transformation de la fraction en parti est conditionnée par deux éléments intimement liés :
1. L'élaboration, par la fraction de nouvelles positions politiques permettant d'asseoir la lutte du prolétariat pour la révolution, dans sa nouvelle phase plus avancée. (...)
2. Par l'ébranlement du système des rapports de classe tel qu'il s'est constitué lors de la victoire de l'opportunisme au sein du parti de la classe ouvrière. Cet ébranlement résiderait dans l'éclosion de mouvements révolutionnaires permettant à la fraction de reprendre la direction des luttes vers l'insurrection.
Ces deux données sont dialectiquement liées et nous verrons et comprendrons les nouvelles situations -qui sont en devenir- dans la mesure où se vérifie le passage vers l'ennemi de l'opportunisme qui dirige le parti communiste. Ou bien, dans la perspective opposée, dans la mesure où progresse le travail de la fraction de gauche pour la victoire révolutionnaire. (...)
La notion de l'Internationale est supérieure à celle du parti, non seulement dans l'ordre organisatoire et politique, mais aussi dans l'ordre chronologique. En effet, le parti est un organisme qui se relie directement avec un processus de lutte de classe et qui affirme comme objectif celui de sa lutte contre l'Etat capitaliste. L'Internationale, au contraire, se fonde uniquement sur des notions politiques et n'a pas en face d'elle un Etat capitaliste mondial, mais des Etats qui reproduisent, sur l'échelle internationale, les antagonismes qui opposent, dans le domaine économique, les capitalistes ou les groupes de ceux-ci.
La mort de l'Internationale Communiste dérive de l'extinction de sa fonction (...).
Le parti ne cesse pas d'exister, même après la mort de l'Internationale. Le parti ne meurt pas, il trahit. Le parti, se rattachant directement au processus de la lutte de classe, est appelé à continuer son action même lorsque l'Internationale est morte.
Dans le passé, nous avons défendu la notion fondamentale de la "fraction" contre la position dite "d'opposition". Par fraction nous entendions l'organisme qui construit les cadres devant assurer la continuité de la lutte révolutionnaire, et qui est appelée à devenir le protagoniste de la victoire prolétarienne. Contre nous, la notion dite "d'opposition" a triomphé au sein de l'Opposition Internationale de Gauche. Cette dernière affirmait qu'il ne fallait pas proclamer la nécessité de la formation des cadres : la clé des événements se trouvant entre les mains du centrisme et non entre les mains de la fraction.
Il est préconisé aujourd'hui un travail commun avec les gauches socialistes en vue de la formation de la nouvelle Internationale. (...)
A notre avis, la guerre et la révolution russe ont opéré, dans l'histoire, une rupture définitive. Avant 1914, les partis socialistes pouvaient se trouver au sein de la classe ouvrière ; par après, leur place s'est trouvée être du côté opposé : au sein du capitalisme. Cette transformation de la position de classe de la Social-démocratie comporte, par conséquent, une opposition fondamentale entre les gauches socialistes qui préparèrent les partis communistes et les gauches socialistes d'après-guerre nécessaires à la Social-démocratie pour tromper les masses et pour lui permettre de continuer à remplir ainsi sa fonction dans l'intérêt de l'ennemi. Les gauches socialistes se situent aujourd'hui en deçà de la révolution russe et ne peuvent jamais cohabiter avec les fractions de gauche des partis communistes afin de déterminer le programme devant traduire -pour les révolutions futures- les leçons découlant d'une grandiose expérience de gouvernement prolétarien et de la terrible expérience survenue avec la victoire du centrisme.
(...) Le travail des fractions de gauche pour la formation des nouveaux partis et de la nouvelle Internationale ne peut résulter d'un accouplement d'espèces historiques fondamentalement opposées : les partis ne peuvent résulter que du travail des fractions de gauche et seulement d'elles.».
Concernant les implications de la résolution du 6e congrès sur le centrisme et l'opportunisme et sur les questions concernant directement la rectification de la plate-forme on peut également signaler plus particulièrement les passages suivants :
« 1. Il existe une différence fondamentale entre l'évolution des partis de la bourgeoisie et l'évolution des partis de la classe ouvrière.
Les premiers, du fait qu'ils sont des organes politiques d'une classe dominante, ont la possibilité d'agir dans la classe ouvrière et certains d'entre eux le font effectivement car ceci fait partie d'une division du travail au sein des forces politiques de la bourgeoisie dont une partie a la tâche particulière de mystifier le prolétariat, de mieux le contrôler en le faisant de l'intérieur, et de le détourner de sa lutte de classe. A cette fin, la bourgeoisie utilise de préférence d'anciennes organisations de la classe ouvrière passées dans le camp de la bourgeoisie.
Par contre, la situation inverse d'une organisation prolétarienne agissant dans le camp de la bourgeoisie ne peut jamais exister. Il en est ainsi du prolétariat, comme de toute classe opprimée, parce que la place que lui fait occuper dans l'histoire le fait d'être une classe exploitée ne peut jamais faire de lui une classe exploiteuse.
Cette réalité peut donc être résumée dans l'affirmation lapidaire suivante :
- il peut, il doit exister et il existe toujours des organisations politiques bourgeoises agissant dans le prolétariat.
- il ne peut jamais exister, par contre, comme le démontre toute l'expérience historique, des partis politiques prolétariens agissant dans le camp de la bourgeoisie.
2. Ceci n'est pas seulement vrai pour ce qui concerne des partis politiques structurés. C'est également vrai pour ce qui concerne des courants politiques divergents pouvant naître éventuellement au sein de ces partis. Si des membres des partis politiques existants peuvent passer d'un camp dans l'autre et cela dans les deux sens (du prolétariat à la bourgeoisie et de la bourgeoisie au prolétariat), cela ne peut être qu'un fait individuel. Par contre, le passage collectif d'un organisme politique déjà structuré ou en formation dans les partis existants ne peut obligatoirement se produire que dans un sens unique : des partis du prolétariat à la bourgeoisie et jamais dans le sens contraire : des partis bourgeois au prolétariat. C'est-à-dire qu'en aucun cas un ensemble d'éléments en provenance d'une organisation bourgeoise ne peut évoluer vers des positions de classe sans une rupture consciente avec toute idée de continuité avec son éventuelle activité collective précédente dans le camp contre-révolutionnaire. Autrement dit, s'il peut se former et se développer des tendances dans les organisations du prolétariat, évoluant vers des positions politiques de la bourgeoisie et véhiculant cette idéologie au sein de la classe ouvrière, ceci est absolument exclu concernant les organisations de la bourgeoisie.
(...)
6. Comme l'histoire l'a démontré, le courant opportuniste ouvert, du fait qu'il se situe sur des positions extrêmes et tranchées, aboutit, dans les moments décisifs, à effectuer un passage définitif et sans retour dans le camp de la bourgeoisie. Quant au courant qui se définit comme se situant entre la gauche révolutionnaire et la droite opportuniste -courant le plus hétérogène, en constante mouvance entre les deux et recherche de leur réconciliation au nom d'une unité organisationnelle impossible- il évolue pour sa part selon les circonstances et les vicissitudes de la lutte du prolétariat.
Au moment de la trahison ouverte du courant opportuniste, en même temps que s'effectue une reprise et une montée de la lutte de la classe, le centrisme peut constituer -au début- une position passagère des masses ouvrières vers les positions révolutionnaires. Le centrisme, en tant que courant structuré, organisé sous forme de parti, est appelé, dans ces circonstances favorables, à exploser et passer dans sa majorité, ou pour une grande partie, dans l'organisation de la gauche révolutionnaire nouvellement constituée, comme cela s'est produit pour le Parti Socialiste français, le Parti Socialiste d'Italie et l'USPD en Allemagne dans les années 1920-21, après la première guerre mondiale et la révolution victorieuse en Russie.
Par contre, dans les circonstances d'une série de grandes défaites du prolétariat ouvrant un cours vers la guerre, le centrisme est immanquablement destiné à être happé par l'engrenage de la bourgeoisie et à passer dans son camp tout comme le courant opportuniste ouvert.
Avec toute la fermeté qui doit être la sienne, il est important pour le parti révolutionnaire de savoir comprendre les deux sens opposés de l'évolution possible du centrisme dans des circonstances différentes pour pouvoir prendre une attitude politique adéquate à son égard. Ne pas reconnaître cette réalité mène à la même aberration que la proclamation de l'impossibilité de l'existence de l'opportunisme et du centrisme au sein de la classe ouvrière dans la période de décadence du capitalisme.»
Pour résumer, on peut dégager trois questions essentielles affectant directement les modifications et ajouts à introduire dans la plate-forme.
La première question concernée est la différence existant (et dont la plate-forme ne rend pas compte dans sa forme actuelle) entre la mort d'une internationale et le passage de ses différents partis dans le camp bourgeois :
- la mort d'une internationale est la traduction d'une crise dans le mouvement ouvrier, c'est un événement se déroulant à l'échelle de celui-ci, l'échelle mondiale, et non de tel ou tel pays et qui intervient quand l'internationale perd sa substance, sa raison d'être même (paralysie de la 2e face à la 1ère guerre mondiale en août 1914, adoption de la thèse du « socialisme dans un seul pays » par l'IC en 1928) ;
- le passage à la bourgeoisie des partis composant une internationale qui s'est disloquée ne découle pas mécaniquement ni immédiatement de cette dislocation. D'une part, certains partis de l'Internationale peuvent maintenir après sa mort des positions clairement internationalistes et révolutionnaires. D'autre part, cette intégration à la bourgeoisie d'anciens partis ouvriers ne relève pas seulement d'un phénomène mondial (crise dans le mouvement ouvrier) mais également de circonstances au plan national (puisque cette intégration se fait au sein de chaque capital national dans la mesure où la bourgeoisie ne connaît pas une unité mondiale).
La deuxième question est le caractère heurté d'un tel passage. La mort de l'Internationale ne signifie ni la mort pour le prolétariat de ses partis ni non plus un processus linéaire et irréversible vers cette mort. Ce qui est ouvert, c'est un affrontement acharné au sein de ces partis entre les forces qui essayent de garder l'organisation à la classe et celles qui la poussent à s'intégrer dans l'Etat capitaliste. De plus, cette intégration nécessite l'élimination de toute possibilité de réaction contraire au sein des partis. (C'est ainsi que le soutien de la social-démocratie allemande -dirigée par la droite- à l'effort de guerre de la bourgeoisie nationale a provoqué en son sein, au cours de la guerre, une opposition croissante qui était en passe de devenir majoritaire, donc de renverser la domination de la droite et, par suite, d'empêcher celle-ci d'amener définitivement l'ensemble du parti dans le camp bourgeois qu'elle avait pour sa part rejoint dès 1914. Et c'est pour arrêter un tel processus que la droite décide en 1917, avant qu'elle ne soit elle-même éliminée, d'exclure du parti non seulement la gauche spartakiste mais aussi le centre de Kautsky). C'est pour cela que le critère majeur permettant d'établir qu'une organisation est complètement morte pour le prolétariat, c'est son incapacité définitive à faire surgir en son sein des fractions ou tendances prolétariennes. Or ce n'est en général qu'après coup qu'on peut juger d'une telle situation. C'est pour cela que les révolutionnaires responsables ont toujours été de la plus grande prudence dans ce domaine même si, dans le feu des événements, ils ont pu être conduits à formuler des jugements hâtifs (ainsi Rosa décrétant en 1914 -avec l'approbation de Lénine- que la Social-démocratie est un «cadavre» ce qui a été contredit par la suite par toute l'attitude de ces deux révolutionnaires).
La troisième question concernée (et qui découle de la deuxième) est la question de la fraction, question qui est traitée en termes généraux dans le point 17 de la plate-forme (l'organisation des révolutionnaires dans les différents moments de la lutte de classe), et qu'il s'agit également d'envisager du point de vue de l'attitude que doivent avoir les révolutionnaires face à un processus de dégénérescence pouvant affecter une organisation prolétarienne : non pas abandon précipité du navire en perdition afin de se « sauver soi-même », mais lutte acharnée en vue de le sauver comme un tout, et si l'entreprise s'avère* impossible, d'en sauver le maximum d'occupants. Telle a toujours été la démarche des fractions de gauche responsables.
Plus généralement, une défense intransigeante des principes communistes ne signifie nullement qu'il faille considérer comme définitivement perdus pour la classe les courants centristes. Dans la mesure même où ce qui caractérise ces courants c'est l'instabilité et le manque de cohésion, il est nécessaire de lutter pour les gagner (ou tout au moins la plus grande partie possible) à ces principes communistes tant qu'il existe une telle possibilité, ce qui est particulièrement le cas lorsque la dynamique de ces courants n'est pas des positions de classe vers les positions bourgeoises mais de rupture avec celles-ci vers des positions de classe.
A un niveau plus général encore, et même s'il n'est pas nécessaire que la plate-forme évoque explicitement cette question, il importe qu'il soit clair qu'il est vain d'attendre des partis du prolétariat une parfaite «pureté», une totale compréhension de tous leurs membres de l'intégralité de la pensée marxiste. Une telle vision (qui aujourd'hui est défendue par la FECCI) implique notamment qu'on se refuse à prendre en considération le fait que la pression de l'idéologie bourgeoise qui s'exerce sur l'ensemble de la classe n'épargne pas ses organisations politiques malgré tous les garde-fous qu'elles peuvent établir contre cette menace.
Les enjeux pour aujourd'hui
Ce n'est qu'en apparence que les modifications à apporter à la plate-forme relèvent de problèmes de l'histoire passée du mouvement ouvrier. Ce qui est en jeu ce n'est pas une simple question de date (c'est pour cela que, contrairement à ce qu'affirmaient les camarades qui allaient former la FECCI, il y a place dans l'organisation pour des camarades qui ont des désaccords sur la date précise de passage à la bourgeoisie de tel ou tel parti ouvrier). Ce qui importe c'est que l'organisation comme un tout se renforce le plus possible et renforce sa capacité d'action dans la classe :
- par une meilleure assimilation des acquis de la Gauche communiste ;
- par une meilleure assimilation de la méthode marxiste en général notamment en rejetant les visions simplistes, «blanc ou noir», les démarches mécanistes et non dialectiques ;
- par une meilleure compréhension du rôle des courants révolutionnaires les plus conséquents face aux formations politiques ou tendances qui, sans se situer dans le camp bourgeois, ne défendent pas des positions communistes conséquentes et cohérentes.
Ce dernier point a deux implications :
- la démarche qui doit guider la lutte des tendances et fractions de gauche au sein des .organisations prolétariennes en dégénérescence, qui, si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui pour ce qui concerne le CCI (contrairement aux affirmations de l'ex-« tendance ») doit lui permettre de s'armer face à une telle éventualité pour le futur (éventualité contre laquelle il n'existe pas de vaccin définitif) et doit permettre à ses militants de s'éviter le lamentable parcours de la «tendance» ;
- de façon bien plus immédiate, l'attitude que doit adopter le CCI à l'égard des différents groupes du milieu prolétarien, tant les anciennes organisations que les courants que le développement international de la lutte de classe fait et fera surgir.
Sur cette deuxième question, il importe en particulier que soit établi dans les discussions le lien qui unit le texte sur le milieu politique adopté en juin 86 et l'ensemble des questions et textes rattachés à la rectification de la plateforme.
Ainsi, la discussion théorique en vue de la rectification de la plate-forme n'est nullement un débat académique. Il n'est pas académique parce que tout débat sur des questions programmatiques se trouve au cœur de ce qui. fonde l'existence de l'organisation, mais de plus parce qu'il fait partie de sa capacité à accomplir ses tâches non seulement futures mais aussi immédiates à l'heure où le développement de la lutte de classe confère à notre organisation des responsabilités croissantes.
CCI, septembre 1986.
Résolution de rectification de la plate-forme
1) Le 7e congrès du CCI confirme le constat fait depuis plusieurs années par une majorité de l'organisation de l'existence dans le point 14 de la plate-forme de celle-ci d'un certain nombre de formulations schématiques conduisant à une interprétation erronée du processus de passage des partis ouvriers, PS et PC, dans le camp bourgeois.
En effet, ce que conduisent à considérer les formulations existant jusqu'à présent dans la plate-forme c'est que le vote des crédits de guerre par les fractions parlementaires de la plupart des principaux partis de la 2e Internationale en août 1914 et l'adoption par le 6e congrès de l'Internationale communiste en 1928 de la «théorie» du «socialisme dans un seul pays», sont l'indice de la trahison définitive de l'ensemble des partis constituant ces deux internationales. Il s'agit là d'une analyse erronée.
Outre une simple erreur de dates, et plus important que celle-ci, une telle interprétation de ces événements historiques contient implicitement le rejet d'un certain nombre d'acquis fondamentaux du mouvement ouvrier et notamment de la Gauche communiste d'Italie, acquis que le CCI avait déjà fait siens depuis longtemps.
En premier lieu, cette interprétation tend à éliminer la distinction essentielle établie par le CCI entre le mode de vie d'une Internationale et celui des partis qui la constituent. Elle tourne le dos au fait que l'issue d'un processus de dégénérescence opportuniste au sein d'une internationale se trouve -même si elle se maintient d'une façon formelle- dans la mort de celle-ci, la fin de sa raison d'exister (comme ce fut effectivement le cas en 1914 et en 1928), alors qu'après cette disparition, la vie des partis la composant se poursuit dans un processus plus ou moins long de crise menant soit à leur trahison, c'est-à-dire à leur intégration dans l'appareil politique de chaque capital national (laquelle s'accompagne de l'élimination des courants de gauche continuant à défendre les positions révolutionnaires), soit à un rétablissement du parti par l'exclusion de la droite bourgeoise.
En deuxième lieu, et plus important encore, cette interprétation entre en contradiction (à moins de considérer avec les conseillistes que les partis communistes étaient bourgeois dès leur naissance) avec une position essentielle de la Gauche Communiste d'Italie -notamment contre la position trotskyste- affirmant qu'il ne peut surgir au sein d'un organisme de la bourgeoisie aucune tendance ou fraction prolétarienne, position qui a été clairement acquise par le CCI dès son deuxième congrès avec la résolution sur les groupes politiques prolétariens et qui a été explicitée dans la résolution de son 6e congrès sur l'opportunisme et le centrisme.
Enfin, une telle interprétation remet en cause la validité -proclamée par le CCI depuis ses origines- du combat mené par les fractions de gauche (Bolcheviks, Spartakistes, Gauche du Parti communiste d'Italie, etc.) dans les partis socialistes après 1914 et dans ou en dehors des partis communistes avant et après 1928 en vue de reconquérir ces partis à des positions révolutionnaires. C'est seulement à partir de la reconnaissance de la validité et de l'importance primordiale de cette lutte héroïque, qu'il est nécessaire et possible de rendre compte des hésitations et faiblesses qui ont pu se manifester dans cette lutte afin d'être en mesure de dépasser ce type de faiblesses.
2) Conscient :
- de la nécessité, déjà signalée par une résolution du 6e congrès du CCI, de rectifier les formulations incorrectes contenues dans le point 14 de la plate-forme ;
- du fait qu'une telle rectification ne constitue nullement une remise en cause ni des fondements de la plate-forme, ni des acquis de la Gauche communiste, ni des acquis du CCI, mais constitue au contraire un affermissement de ces fondements, une meilleure traduction de ces acquis et notamment une mise en adéquation du document programmatique central de l'organisation avec les textes déjà adoptés lors de congrès précédents (Résolution sur les groupes politiques prolétariens du 2e congrès, Rapport sur le cours historique du 3e congrès et Résolution sur le centrisme et l'opportunisme du 6e congrès) ;
- du fait que la nouvelle formulation n'enlève rien à la valeur charnière du 4 août 1914, date qui signe effectivement la crise historique ouverte de la Social-démocratie et l'intégration sans retour de son aile droite dans le camp bourgeois, mais au contraire explicite mieux que l'ancienne le clivage et la lutte à mort qui se produisent entre gauche prolétarienne et droite bourgeoise ;
Le 7e congrès du CCI adopte pour le point 14 de la plate-forme la formulation suivante :
L'ensemble des partis ou organisations qui aujourd'hui défendent, même «conditionnellement» ou de façon «critique», certains Etats ou certaines fractions de la bourgeoisie contre d'autres, que ce soit au nom du «socialisme», de la «démocratie», de «l'anti-fascisme», de «l'indépendance nationale», du «front unique» ou du «moindre mal», qui fondent leur politique sur le jeu bourgeois des élections, dans l'activité anti-ouvrière du syndicalisme ou dans les mystifications autogestionnaires sont des organes de l'appareil politique du capital. Il en est ainsi, en particulier, des partis «socialistes» et «communistes».
Ces partis, en effet, après avoir constitué à un certain moment les véritables avant-gardes du prolétariat mondial, ont connu par la suite tout un processus de dégénérescence qui les a conduits dans le camp du capital. Si les internationales auxquelles ils appartenaient (2e Internationale pour les partis socialistes, 3e Internationale pour les partis communistes) sont mortes comme telles malgré la survivance formelle de leur structure dans un moment de défaite historique de la classe ouvrière, ils ont quant à eux survécu pour devenir progressivement, chacun pour sa part, des rouages (souvent majeurs) de l'appareil de l'Etat bourgeois de leurs pays respectifs.
Il en est ainsi des partis socialistes lorsque, dans un processus de gangrène par le réformisme et l'opportunisme, la plupart des principaux d'entre eux ont été conduits, lors de la première guerre mondiale (qui marque la mort de la 2e Internationale) à s'engager, sous la conduite de leur droite, «social chauvine», désormais passée à la bourgeoisie, dans la politique de défense nationale, puis à s'opposer ouvertement à la vague révolutionnaire d'après guerre jusqu'à jouer le rôle de bourreaux du prolétariat comme en Allemagne en 1919. L'intégration finale de chacun de ces partis dans leurs Etats nationaux respectifs a pris place à différents moments dans la période qui a suivi l'éclatement de la 1ère guerre mondiale mais ce processus a été définitivement clos au début des années 1920, quand les derniers courants prolétariens ont été éliminés ou sont sortis de leurs rangs et ont rejoint l'Internationale communiste.
De même, les partis communistes sont à leur tour passés dans le camp du capitalisme après un processus similaire de dégénérescence opportuniste. Ce processus, engagé dès le début des années 1920, s'est poursuivi après la mort de l'Internationale communiste (marquée par l'adoption en 1928 de la théorie du «socialisme en un seul pays») jusqu'à aboutir, malgré la lutte acharnée de leurs fractions de gauche et après l'élimination de celles-ci, à une complète intégration dans l'Etat capitaliste au début des années 1930 avec leur participation aux efforts d'armement de leurs bourgeoisies respectives et leur entrée dans les «fronts populaires». Leur participation active à la «Résistance» durant la seconde guerre mondiale et à la «reconstruction nationale» après celle-ci les a confirmés comme de fidèles serviteurs du capital national et comme la plus pure incarnation de la contre-révolution.
L'ensemble des courants soi-disant «révolutionnaires» tels que le maoïsme -qui est une simple variante de partis définitivement passés à la bourgeoisie-, le trotskysme -qui après avoir constitué une réaction prolétarienne contre la trahison des PC a été happé dans un processus similaire de dégénérescence- ou l'anarchisme traditionnel -qui se situe aujourd'hui dans le cadre d'une même démarche politique en défendant un certain nombre des positions des partis socialistes et des partis communistes (comme par exemple les alliances «anti-fascistes»)- appartiennent au même camp qu'eux : celui du capital. Le fait qu'ils aient moins d'influence ou qu'ils utilisent un langage plus radical n'enlève rien au fond bourgeois de leur programme et de leur nature, mais en fait d'utiles rabatteurs ou suppléants de ces partis.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Résolution sur le milieu politique prolétarien
- 3389 reads
Introduction
Le milieu politique prolétarien, avec ses forces et ses faiblesses, est le produit de la classe ouvrière. Dans sa dynamique et dans ses caractéristiques, il tend à exprimer le mouvement de développement de la prise de conscience par le prolétariat de sa nature de classe révolutionnaire et de sa capacité à réaliser la perspective communiste. Cependant, le milieu politique n’est pas un simple reflet de la classe. Elle le sécrète pour qu’il joue un rôle actif dans sons processus de prise de conscience, dans sa lutte. Le dynamisme propre du milieu politique est donc aussi déterminé par la conscience qu’il a de lui-même et par le rôle que jouent en son sein ces fractions les plus claires.
C’est pour cela, que la question du milieu politique, de son état actuel, de ses perspectives de développement et du rôle du CCI au sein de ce processus, a été mise à l’ordre du jour du 7e congrès du CCI.
Le souci du renforcement politique organisé, le travail pour son regroupement, son un axe permanent de l’activité des révolutionnaires et de leur intervention. Le CCI en tant que principal pôle de référence et donc de regroupement au sein du milieu révolutionnaire international porte une responsabilité particulière dans le processus qui mène à la formation du parti prolétarien sans lequel il n’y a pas de révolution communiste possible. Cette responsabilité, le CCI entend pleinement l’assumer ; tel est le sens de la résolution sur le milieu politique que nous publions ci-après et que le 7e congrès du CCI a fait sienne.
Le développement actuel du milieu politique prolétarien caractérisé par le surgissement de nouveaux groupes témoigne de l'écho grandissant des positions révolutionnaires au sein de la classe ouvrière mondiale. Produits par la reprise internationale de la lutte de classe, ces nouveaux groupes politiques posent avec encore plus d'acuité la responsabilité des organisations plus anciennes qui ont survécu à la décantation politique de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le développement actuel du milieu prolétarien ne pourra se traduire dans un renforcement politique et organisationnel de la présence politique révolutionnaire que si les groupes plus anciens sont à même de se dégager du poids du sectarisme pour s'avancer sur le chemin indispensable de la clarification politique nécessaire à tout processus de regroupement.
Sur le milieu politique actuel pèsent encore de tout leur poids, la faillite de la 3e internationale et les décennies de contre-révolution qui ont suivi, durant lesquelles les révolutionnaires ont été réduits à une infime minorité. Malgré le développement réel du milieu politique depuis la reprise historique du prolétariat à la fin des années 60, au-delà des vicissitudes inhérentes à tout processus vivant, celui-ci reste marqué par une grande faiblesse. Celle-ci n'exprime pas seulement le poids de la rupture organique avec les fractions communistes du passé, mais est aussi l'expression d'une difficulté propre au milieu actuel à assumer avec détermination le nécessaire travail de réappropriation critique des acquis politiques du mouvement ouvrier. Cette réappropriation, insuffisante de la continuité politique se manifeste notamment sur le plan organisationnel par la dispersion du milieu, par son éclatement en de multiples organisations, par son incompréhension de la nécessité d’œuvrer avec détermination et clarté au processus de regroupement du milieu révolutionnaire. Ce n'est certainement pas un hasard si c’est la question de l'organisation -et donc celle du regroupement-, qui cristallise le plus clairement la faiblesse du milieu politique, car c'est elle qui concrétise, dans l'activité, l'ensemble des autres positions révolutionnaires. Elle pose la nécessité de la réappropriation des acquis du passe, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, et c'est sur ce plan de l'expérience pratique que pèse le plus lourdement le poids de la rupture de la continuité organisationnelle. La dispersion du milieu et le sectarisme (à l'opposé des conceptions des organisations communistes du passé) qui l'accompagne, sont un facteur de confusion terrible pour les nouveaux éléments qui surgissent à la recherche d'une cohérence révolutionnaire. Le milieu politique actuel est un véritable labyrinthe qui rend d'autant plus difficile pour les nouveaux groupes le laborieux travail de réappropriation d'une continuité politique nécessaire à leur survie.
Le milieu politique est un tout. La défense de son identité face aux forces de la contre-révolution, comme le rejet de toute pratique étrangère au prolétariat en son sein, sont un aspect essentiel de la vie de toute organisation révolutionnaire. Cependant, ce n'est pas un tout homogène, loin de là, étant donnée la dispersion qui pèse et entrave son renforcement. Toutes les organisations qui l'animent, n'expriment pas la même dynamique vis à vis du nécessaire processus de clarification politique et de regroupement organisationnel qui doit absolument s'opérer pour permettre la formation du parti communiste de demain.
Pour rendre efficace l'intervention des révolutionnaires et œuvrer clairement au processus de clarification et de regroupement, il est important de distinguer :
-
les nouveaux groupes qui surgissent et qui, malgré les confusions inhérentes à leur jeunesse et leur manque de continuité historique d'avec les organisations révolutionnaires du passé, expriment la volonté positive de clarification et d'intégration au sein du milieu révolutionnaire prolétarien, manifestent la réalité du développement de l'écho des révolutionnaires au sein de la classe ;
-
les organisations qui constituent, par leur origine, les pôles historiques et politiques du milieu prolétarien et qui portent en premier lieu la responsabilité d'œuvrer de manière décidée à renforcer la maturité politique des nouveaux groupes qui surgissent et à engager dans la clarté le processus de regroupement indispensable ; ainsi, en dehors du CCI, le BIPR, et notamment Battaglia Comunista ;
-
les organisations qui expriment de manière plus aiguë le poids du sectarisme et qui fondent leur existence sur un repli de secte ou sur des scissions prématurées marquant par là une incompréhension majeure par rapport à la question de l'organisation et du regroupement des révolutionnaires. En se distinguant artificiellement des principaux pôles de cohérence du milieu politique, ces groupes ne peuvent que cristalliser un déboussolement politique qui, que ce soit au travers de l'académisme ou de l'activisme, ouvre les portes à des abandons des positions de classe et constitue en fait une entrave au processus de clarification nécessaire pour le regroupement. Ainsi, la FECCI est une claire expression de ce parasitisme politique qui, tout en se réclamant de la plate-forme du CCI, théorise de manière incohérente son existence séparée.
L'histoire n'attend pas, l'accélération du processus historique impose ses propres besoins : le surgissement de nouveaux groupes, le développement de l'écho des idées révolutionnaires avec le développement de la lutte de classe posent, à terme, la nécessité de nouvelles conférences des groupes de la Gauche communiste afin de lutter contre l'émiettement du milieu révolutionnaire et d'accélérer le processus de clarification et de décantation politiques préalable à tout regroupement. Les organisations incapables de s'intégrer de manière positive dans ce processus absolument nécessaire sont condamnés par l'histoire ; l'itinéraire du PCI bordiguiste qui naguère, refusait obstinément tout contact avec d'autres organisations du milieu prolétarien, qui a refusé de participer aux Conférences des groupes de la Gauche communiste à la fin des années 1970 et, finalement, a payé de son existence son repli sectaire (car celui-ci l'a empêché de s'engager sur la voie du redressement politique), le démontre amplement.
Loin de toute illusion immédiatiste qui pourrait faire croire à une possibilité de regroupement immédiat, le CCI, conscient de ses responsabilités, est décidé à agir de manière déterminée pour préparer la perspective de la tenue de nouvelles Conférences, dans un cadre de rigueur et de clarté politique.
Même si les conditions nécessaires à la tenue de nouvelles Conférences ne sont pas encore réunies, il est extrêmement important que l'ensemble des organisations constitutives du milieu politique prolétarien prenne une claire conscience de l'absolue nécessité d’œuvrer dans le sens de rendre possible dans le futur la concrétisation de cette perspective. Pour cela, il faut que contre tout sectarisme mais avec la rigueur et la fermeté politiques nécessaires à toute clarification , les organisations révolutionnaires et, en premier lieu, celles qui constituent les principaux pôles historiques, développent leurs relations, présentent dans leur presse des polémiques claires qui permettent de souligner les points d'accord et de divergence, aient le souci permanent d'utiliser toutes les opportunités et, notamment, les réunions publiques, pour confronter clairement leurs points de vue.
De la capacité du milieu prolétarien d'assumer cette responsabilité, d'avancer vers la tenue de nouvelles Conférences, de poser la perspective du regroupement, dépend l'avenir de la lutte de classe. L'issue du futur se forge dès aujourd'hui.
JJ
Résolution sur le milieu politique
1- L'évolution du milieu politique prolétarien au cours des deux dernières années a été marquée en particulier par :
-
une sortie de celui-ci, notamment sous la poussée de la 3e vague de luttes depuis la reprise historique de la fin des années 1960, de la crise dans laquelle il avait été plongé au début des années 1980 ;
-
le surgissement, sous cette même poussée, de nouveaux groupes, surtout dans les pays de la périphérie du capitalisme ;
-
la dégénérescence de certains des groupes déjà existants : comme celle du GCI vers l'anarchisme et celle de 1’OCI (Organizzazione Comunista Internazionalista) vers le trotskysme.
2 - Cette évolution a encore plus mis en relief la responsabilité croissante des organisations qui ont su se maintenir sur un terrain marxiste conséquent et qui disposent d'une réelle expérience et présence internationale.
En ce sens, l'effort du CCI vis-à-vis de l'éclaircissement, la décantation, le renforcement et, finalement, le regroupement de ce milieu, ne peut aller qu'en se développant.
3 - Dans cet effort, la méthode du CCI reste fondamentalement la même que par le passé : mettre en avant la priorité de la clarté et de la rigueur politiques contre toutes les aventures de rapprochement entre groupes par des raccourcis activistes qui ne peuvent qu'ouvrir la porte à la superficialité et à l'opportunisme.
4 - Dans le cadre de cette évolution et de cet effort, une nouvelle série de conférences des groupes de la Gauche communiste est une perspective à préparer. L'écho rencontré par l'initiative du groupe Emancipacion Obrera (écho auquel a contribué le CCI en la faisant connaître en sept langues et dans dix pays et au-delà) traduit, malgré l'inconsistance de beaucoup de réponses reçues, l'existence d'un plus grand souci dans le milieu pour combattre l'actuelle situation de dispersion.
Cependant, bien que le besoin de telles conférences se fasse ressentir de façon de plus en plus urgente, les conditions pour l'appel à leur tenue ne sont pas aujourd'hui encore suffisamment mûres :
-
d'une part, parce que beaucoup d'« anciens groupes » ont encore une attitude de repli sectaire (l'enthousiasme pour le contact avec un nouveau groupe à l'autre bout du monde ne doit pas cacher que cela s'accompagne souvent d'un refus -parfois théorisé- de même participer aux réunions publiques tenues dans leur propre pays par d'autres organisations révolutionnaires) ;
-
d'autre part, parce que les « nouveaux » groupes, du fait même de leur jeunesse, ne sont pas en mesure de porter jusqu'au bout avec succès la responsabilité politique d'un tel travail.
5 - Pour l'immédiat, l'intervention du CCI dans le milieu politique prolétarien doit suivre deux axes fondamentaux :
-
vis-à-vis des nouveaux groupes l'organisation doit poursuivre son travail de suivi et de discussion poussant à la décantation par l'éclaircissement politique ; mettant en avant la nécessité pour ceux-ci de s'intégrer dans le milieu international et à se rattacher à la continuité politique de la Gauche communiste sans pour autant négliger les tâches de renforcement de leur propre définition politique et intervention dans la classe ;
-
vis-à-vis des « anciens » groupes, outre la dénonciation de la dégénérescence de certains et de la nature parasitaire1 d'autres, la priorité doit être donnée à un resserrement des rapports avec l'autre pôle de référence historique du milieu : le courant du BIPR (poursuite et amélioration de la qualité du débat public et international, présence à leurs réunions publiques, propositions de réunions publiques communes, contacts directs aussi fréquents que possible).
FF
1 C'est-à-dire en maintenant une existence artificielle de façon séparée, avec une plate-forme politique quasiment identique à celle d'autres groupes, le CCI en particulier.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Débat : syndicats bourgeois, organes ouvriers et intervention des révolutionnaires (réponse à Battaglia Comunista]
- 3832 reads
Après de nombreuses années de silence, Battaglia Comunista ([1] [1195]) a repris dans sa presse la polémique avec les positions du CCI. A la vérité, ça n'a pas été une reprise facile. D'abord BC a commencé par discuter et répondre à des groupes qui, à la périphérie du capitalisme (Mexique, Inde), partageaient ou connaissaient les positions du CCI, puis a entrepris de publier ces réponses dans sa presse ; enfin, en prenant appui sur la réponse faite à un groupe de nos sympathisants espagnols, BC a finalement entamé une polémique directe avec le CCI.
Comme nous avons déjà répondu ([2] [1196]) sur la question du cours historique et de l'évaluation de la phase actuelle des luttes, dans cet article nous traiterons des «positions abstraites du CCI sur les syndicats et le parlementarisme» (BC, février 1987), en nous concentrant sur la question des syndicats et de l'intervention des révolutionnaires dans les luttes ouvrières. Fidèles à notre méthode, nous essaierons de ne pas nous attacher à telle ou telle phrase qu'on peut trouver dans un article donné, mais d'aller à la racine des divergences, en prenant en compte l'ensemble des textes de BC sur cette question.
L'article de BC part du présupposé que tant qu'il ne s'agit que du «problème théorique général (nature et fonction des syndicats)», il ne faut pas de grands efforts pour donner une réponse de classe. «Tout autre est le problème politique qu'on peut poser ainsi : étant donné cette nature et cette fonction des syndicats, comment peut-on réaliser leur ''dépassement révolutionnaire" ? ». A cette question, selon BC, le CCI ne saurait répondre «du fait de son incapacité organique... à faire de la politique».
Dans notre réponse, nous cherchons avant tout à mettre en évidence que, même au niveau «théorique général», BC devrait éclaircir certains points. Ensuite, nous examinerons les propositions spécifiques que BC avance en ce qui concerne l'organisation des révolutionnaires au sein des luttes : «les groupes internationalistes d'usine». Enfin, nous analyserons en quoi les faiblesses de l'intervention de BC sont liées, en grande partie, à la difficulté de reconnaître la réalité de la lutte de classe, et en particulier les tentatives encore confuses et embryonnaires dans lesquelles la classe elle-même commence à se poser les problèmes de son organisation unitaire de demain.
Ces questions étaient justement au centre des débats du premier cycle de Conférences Internationales de la Gauche Communiste, interrompu par la volonté de BC et de la CWO en 1980. C'est à travers la reprise de ce débat, sur des bases plus larges et plus claires, que l'ensemble du milieu politique prolétarien international pourra contribuer de la meilleure façon à donner des réponses aux problèmes qui se posent à la classe dans la préparation des affrontements décisifs avec le capitalisme.
LES SYNDICATS, ORGANES DE L'ETAT BOURGEOIS
Quels sont pour BC les points de repère fermes sur lesquels se fonder pour comprendre les syndicats aujourd'hui ? Essentiellement trois : 1) «le syndicat n'est pas et n'a jamais été un organe de lutte révolutionnaire pour l'émancipation du prolétariat », 2) «en tant qu'organe de négociation économique, il est amené à s'opposer aux poussées révolutionnaires pour l'abolition du capitalisme » 3) «la révolution passera sur le cadavre des syndicats».
Ces points de repère fermes nous paraissent cependant chancelants, surtout parce qu'ils ne touchent pas à l'essentiel du problème posé par les camarades espagnols. Ces camarades veulent savoir pourquoi BC tient encore aujourd'hui pour possible de travailler dans des organes contre-révolutionnaires comme les syndicats. S'entendre répondre que les syndicats ne sont pas révolutionnaires, cela leur fera certainement plaisir, mais cela ne fait pas avancer la question d'un pouce.
Il ne fait aucun doute que déjà au 19e siècle les syndicats n'étaient pas des organes révolutionnaires et que leur fonction même de négociation a toujours influencé leurs dirigeants dans un sens conformiste et non révolutionnaire. Mais il est tout aussi vrai qu'au 19e siècle les marxistes se sont battus avec toute leur énergie pour renforcer ces syndicats -ce que BC considère comme valable. Comment est-il possible alors que sur cette base identique, les camarades de BC puissent arriver à la conclusion diamétralement opposée, que la révolution devra «passer sur le cadavre des syndicats».
Il est clair que de cette façon, on n'arrive nulle part et qu'il faut encore remettre de l'ordre dans les idées avant d'aller de l'avant. Les axes essentiels de la position communiste sur les syndicats sont à notre avis les suivants : 1) les syndicats ont été l'organisation prolétarienne unitaire typique de la phase ascendante du capitalisme, quand, la révolution prolétarienne mondiale n'étant pas à l'ordre du jour, la classe ouvrière luttait essentiellement pour défendre ses conditions de vie et son unité à l'intérieur du capitalisme ; 2) avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, marquée par la 1ère guerre mondiale, le prolétariat ne peut plus conquérir de réforme réelle à son profit ; en conséquence, tous les instruments qu'il s'était donné dans ce but (syndicats, partis parlementaires, etc. ) devenaient inutilisables pour lui ; 3) la tendance dominante du capitalisme décadent est la tendance au capitalisme d'Etat, dont une des caractéristiques est l'intégration dans l'Etat, avec une fonction anti-ouvrière, de tous les organes devenus désormais inutiles pour les ouvriers. Les syndicats sont donc devenus les organes de l'Etat bourgeois chargés du contrôle des ouvriers et c'est en tant que tels qu'ils seront détruits par la révolution.
Comme on le voit l'essentiel est que les syndicats étaient hier des organes de la classe ouvrière, aujourd'hui sont des organes de la classe antagonique ; l'essentiel n'est pas ce qui est resté tel quel, mais ce qui a changé.
Etant donné que la réponse aux camarades espagnols ne parle justement pas de cela, cherchons dans le document que BC a dédié aux syndicats en octobre 1986. Ici effectivement on dit que quelque chose a changé. Mais quoi ? Et quand ?
Selon BC, ce qui a changé c'est qu'à l'époque de Marx, les augmentations de salaires réduisaient effectivement les profits des patrons et que donc la lutte syndicale, bien que limitée, était de toute façon antagonique au capital. Avec le développement de sa forme monopoliste, le capital serait devenu au contraire capable de contrôler de façon monopoliste le marché, et donc de répercuter sur les prix les augmentations de salaires ; en conséquence, «l'irréconciliabilité des intérêts immédiats diminuant, ou mieux s'atténuant, toute une idéologie interclassiste a pu se développer et avoir une résonance au sein même de la classe ouvrière, et avant tout dans le syndicat (...), le syndicat institution constitue l'aboutissement inévitable de ce processus » ([3] [1197]).
En une phrase, BC réussit à faire marcher le monde la tête en bas : la décadence du capitalisme ne signifie plus que le capitalisme est devenu historiquement incapable d'accorder des réformes à la classe ouvrière, mais que «le syndicat s'est trouvé face à un patronat qui parfois même le précédait en concédant des augmentations de salaire, rendues possibles justement, par le quota élevé de surprofit que la grande entreprise réalise grâce à sa capacité d'agir sur le processus de formation des prix».
BC prend ici les effets pour les causes : le fait que la bourgeoisie soit contrainte de réglementer toutes les étapes du cycle économique (quota de production, de marché, équilibre monétaire, etc. ) ne démontre pas que le capital monopoliste fait ce qu'il veut, mais démontre au contraire qu'il est obligé de marcher sur la pointe des pieds dans un terrain miné, parce qu'il suffirait de laisser le capitalisme décadent «au libre jeu» de ses lois pendant quelques mois pour le voir s'écrouler dans le chaos. Les syndicats, organes destinés à négocier des améliorations au sein du capitalisme, s'intègrent dans l'Etat, parce qu'obtenir des améliorations durables est devenu impossible, non parce que c'est devenu trop facile.
Par ailleurs, si véritablement la facilité de distribution de miettes de surprofits était la cause de l'intégration à l'Etat, alors la crise, qui, comme le dit BC, a «réduit de façon drastique la possibilité (...) de distribuer les miettes des surprofits», aurait par là même éliminé la raison de l'intégration des syndicats et ouvert la voie à la reconversion des «glorieux syndicats rouges» comme l'attendent classiquement les différents groupes bordiguistes.
C'est le contraire qui est arrivé, et BC est la première à reconnaître qu'avec la crise le syndicat «a progressivement accentué son appartenance à l'appareil d'Etat».
Il n'y a qu'une manière de sortir de ce réseau de contradictions : reconnaître que l'intégration des syndicats dans l'Etat bourgeois n'a rien à voir avec les surprofits, mais est fondée sur deux nécessités historiques complémentaires :
1) la décadence du capitalisme rend impossible la lutte pour des améliorations durables, 2) la décadence du capitalisme rend indispensable un renforcement croissant de cet instrument de cohésion qu'est l'Etat, renforcement qui se réalise en particulier par l'intégration des différentes structures d'origine ouvrière comme les syndicats, et leur transformation en organes destinés à contrôler la classe ouvrière.
A quelle époque les syndicats se sont-ils intégrés à l'Etat bourgeois ?
En dehors de cette cohérence, BC est obligée de se débattre dans des contradictions de plus en plus inextricables, surtout quand elle cherche à répondre à la question : quand est-ce que les syndicats sont passés à la bourgeoisie ?
Ici il ne devrait pas y avoir de doute possible : dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine décrit le passage à la forme monopoliste du capital comme quelque chose déjà réalisé, et ceci en 1916. Donc l'intégration des syndicats qui, selon BC, dépend de ce passage, se situe autour de la 1re guerre mondiale. Comme le confirmait la voix autorisée du gouvernement impérial allemand pendant la 1re guerre mondiale : «sans les dirigeants syndicaux, et à plus forte raison contre eux, on ne peut arriver à rien ; leur influence se base sur les actions qu'ils ont menées avec succès pendant des décennies pour améliorer les conditions des ouvriers... on ne peut imaginer comment nous ferions pour rester à flot s'il n'en était pas ainsi» ([4] [1198]).
Cette intégration définitive ne fait que conclure un processus engagé de nombreuses années auparavant, et ce n'est pas par hasard si, à l'inadéquation progressive de la forme syndicale pour les besoins de la lutte ouvrière, correspond déjà en 1905, le surgissement de nouveaux organes de masse : les conseils ouvriers de la révolution russo-polonaise qui seront ensuite les protagonistes de la vague révolutionnaire qui déferle à partir de l'octobre rouge.
Face à ces données de fait, c'est avec une grande surprise qu'on lit dans la brochure que le syndicat d'aujourd'hui est le même «que celui d'il y a 30 ou 40 ans» (c'est-à-dire 1947-1957) et encore que le «passage définitif, au moins en Italie, s'est produit pendant et après la 2e guerre mondiale». En bref, le passage est transféré vers la fin des années 1940, faisant un bond de plus de 30 ans ! A quoi devons-nous ce véritable séisme historique ? Probablement au fait que dans la discussion qui s'est développée au début des années 1920, la Gauche italienne s'était alignée sur les bolcheviks en faveur de la reconquête des syndicats (Thèses de Rome, 1922), contre la Gauche hollandaise et allemande qui soutenait que l'intégration des syndicats à l'Etat était désormais irréversible ; ce qui est incompréhensible, c'est qu'encore aujourd'hui on cherche à réécrire l'histoire pour nier ce qui est une évidence, à savoir que sur cette question, l'intuition des Allemands et Hollandais a été plus rapide et plus profonde que celle des Russes et des Italiens. ([5] [1199])
Cela n'a rien à voir avec ce que fut la méthode que nous a transmis la Gauche italienne ; déjà dans les années 1930, les Fractions de celle-ci à l'étranger, loin de se retrancher dans la défense à outrance des formulations des Thèses de Rome, travaillaient avec ténacité à «souligner les étapes de l'incorporation progressive des syndicats dans l'appareil d'Etat» ([6] [1200]). Tandis que quelques-uns insistaient sur le fait que seule une nouvelle situation révolutionnaire aurait permis de clarifier définitivement la question, d'autres la considéraient comme déjà résolue et se battaient pour l'abandon de l'activité au sein des syndicats : «Il ne s'agit pas aujourd'hui de voir si oui ou non il est possible pour des marxistes de développer à l'intérieur des syndicats une activité saine ; il s'agit de comprendre que ces organes sont désormais passés de façon définitive dans le camp ennemi, et qu'il est impossible de les transformer».
En réalité, l'unique raison pour situer le tournant décisif à la fin des années 1940 réside dans le fait que... c'est seulement au début des années 1950, à l'occasion de la scission avec les bordiguistes de Programma Comunista que BC se décide à renoncer définitivement à tout projet de reconquête des syndicats.
Pour tenter de masquer ce fait, la brochure de BC rappelle que déjà dans les Thèses sur la question syndicale présentées au Congrès de Turin du Parti Communiste Internationaliste en décembre 1945 «il y avait toutes les prémisses de notre position ultérieure et d'aujourd'hui». C'est vrai, les Thèses, présentées par Luciano Stefanini, étaient nettement anti-syndicales et, de ce point de vue, assez voisines des positions de la Gauche communiste de France dont nous nous réclamons : et c'est justement pour cela qu'elles ont été refusées par une grande majorité du Congrès qui se donnait comme objectif la «conquête des organes dirigeants du syndicat» ! Si les camarades de BC considèrent utile de citer des épisodes de l'histoire de leur parti, qu'ils cherchent au moins à les citer entièrement.
Comment s'est modifiée la conception de Battaglia Comunista de ses «groupes internationalistes d'usine» ?
Parvenus à ce point, une fois «donnée cette nature et cette fonction des syndicats», nous pouvons enfin considérer quel type d'intervention organisée doit être développée. La lettre aux camarades mexicains et espagnols n'en parle pas directement (pourquoi ?), mais on sait que pour BC l'intervention organisée des révolutionnaires se fait à travers les «groupes d'usine». Voyons donc quelles sont «la nature et la fonction» de ces groupes, et comment cette conception a évolué avec le temps.
1922 : les Thèses de Rome du PC d'Italie attribuent aux Groupes communistes d'usine composés de militants du Parti la tâche de reconquérir et de prendre la direction politique des syndicats, vus comme courroies de transmission entre classe et parti.
1952 : la perspective de reconquérir les syndicats étant abandonnée, pour maintenir le groupe en vie, on leur fait porter «deux casquettes, celle d'organisme intermédiaire entre le parti et la classe, et celle d'organisme politique» (3). Bref, étant donné que la courroie de transmission syndicat n'existe plus, ce sont les groupes eux-mêmes qui doivent assumer la fonction de courroie de transmission, remplaçant en quelque sorte l'organisation unitaire de la classe. Ce n'est pas par hasard qu'au lieu de les définir comme communistes, comme en 1922, on les appelle Groupes syndicaux d'usine, coordonnés dans une Fraction Syndicale, sur la base d'une Plate-forme Syndicale spécifique.
1977-80 : en réaction à la discussion qui se développe à ce sujet dans les Conférences internationales de la Gauche Communiste, BC se limite à modifier leur nom qui devient Groupe internationaliste d'usine, sans changer tout le reste.
1982 : le 5e Congrès de BC laisse tomber toute l'armature de Fraction Syndicale, Plate-forme Syndicale, etc. , mais continue à assigner aux groupes la fonction de «seule réelle courroie de transmission entre le parti et la classe» ([7] [1201]).
1986 : la nouvelle brochure sur les syndicats de BC déclare clairement que, si le groupe garde sa fonction d'organisme de parti, «nous ne pouvons cependant plus le considérer comme un organe intermédiaire», «situé à mi-chemin entre le parti et la classe ». Des termes comme «organisme intermédiaire» et «courroie de transmission» sont liquidés car considérés «usés et vieills».
Le plus incroyable, c'est que les camarades de BC ne paraissent pas se rendre compte de l'importance de ces derniers changements. Pour comprendre et surtout pour en faire comprendre l'importance à tous les nouveaux camarades qui aujourd'hui sont présents sur la scène internationale, il est nécessaire de revenir au cycle des Conférences internationales qui a eu lieu entre 1977 et 1980.
L'argument qui était au centre des débats du moment était sans conteste quelle doit être l'intervention des révolutionnaires. Le débat a fini par se polariser entre BC et CWO d'une part, qui défendaient les groupes d'usine, en soutenant que «leur fonction est d'agir comme ''courroie de transmission" ou "intermédiaires" entre le parti et la classe» ([8] [1202]), et le CCI d'autre part qui défendait au contraire que les communistes, au lieu de s'illusionner sur le fait de pouvoir créer eux-mêmes les organes dans lesquels s'organisent les secteurs combatifs de la classe, doivent intervenir politiquement dans les organismes que la classe elle-même tend à créer dans son mouvement (aujourd'hui : assemblées, comités, coordinations ; demain : les Conseils ouvriers). BC résume elle-même le débat de la 3e Conférence : «le développement de la discussion a permis de mettre en évidence deux positions opposées : 1) le parti a un rôle secondaire dans la lutte de classe, en niant sa raison d'être dans l'organisation de la lutte elle-même ; 2) sans le parti comme organe dirigeant et organisateur, le prolétariat ne peut accomplir sa tâche historique» ([9] [1203]) (souligné par nous). Comme on le voit, pour BC, les organes du parti doivent non seulement être une direction politique, mais être aussi les organisateurs de la classe ; celui qui refuse ce rôle nie «la raison d'être du Parti». Sur cette base, BC et CWO ont saboté les Conférences, en proclamant qu'il était impossible de continuer à discuter avec les «spontanéistes» du CCI, qui affirmaient que seul est juste le terme «d'orientation politique », de « direction politique» ([10] [1204]) et qui proposaient une formulation selon laquelle le parti est «l'organe indispensable d'orientation politique, pouvoir qui est pris par l'ensemble de la classe organisée en Conseils» ([11] [1205]). BC, qui a déclaré à la Conférence que la formulation était «inacceptable, parce que la Conférence devait éliminer le spontanéisme» ([12] [1206]) (c'est-à-dire le CCI), déclare aujourd'hui tranquillement que «l'unité dialectique de la classe et du parti se réalise à travers la direction politique du Parti (stratégie-tactique de la Révolution) dans les organes de masse du Prolétariat (force vive et sujet de la Révolution)» ([13] [1207]). Le sujet de la révolution est donc l'ensemble de la classe, organisée dans ses organes de masse (les conseils), et c'est au sein de ces organes que doit s'exercer le rôle de direction politique du parti.
Les camarades de BC seraient bien aimables de nous expliquer pourquoi ces formulations seraient complètement «opposées» à celles «inacceptables» du CCI ? Pendant une dizaine d'années, quand on demandait comment font les groupes pour être en même temps des organes du parti et des intermédiaires entre la classe et le parti, on nous répondait «vous ne comprenez rien à la dialectique». Et aujourd'hui BC, comme si de rien n'était, nous annonce que d'avoir situé les groupes «à mi-chemin entre la classe et le parti» a été clairement «équivoque» et «ambigu» ([14] [1208]).
Sur ce point, deux choses doivent être claires. La première, c'est que nous savons bien que, malgré ce changement, les positions de BC restent encore très éloignées des nôtres ; la seconde, c'est que, malgré cela, nous saluons avec enthousiasme le pas en avant qu'a fait Battaglia. Mais une troisième chose doit cependant être claire : quel que soit le pas en avant, pour petit ou grand qu'il soit, il ne peut servir à quelque chose que s'il est fait de manière cohérente. Abandonner une position qui a servi de base à une décision aussi grave que celle d'interrompre les conférences internationales, sans se poser le moins du monde le problème de réfléchir sur la validité ou non de cette décision, à notre avis, n'est ni sérieux ni cohérent.
Les communistes peuvent-ils travailler dans des organes d'Etat comme les syndicats ?
La réponse de BC aux camarades espagnols sur les problèmes d'intervention peut être résumée ainsi :
1) les camarades du CCI, du fait qu'ils restent dans l'abstrait schématique et l'extrémisme verbal, se limitent à faire «les révolutionnaires du bavardage et du beau geste, qui mettent leur conscience en paix, en parlant "sagement" pour eux, faute de toute possibilité de se faire entendre, et, encore moins, de voir leurs ''indications" se concrétiser dans une praxis organisationnelle et de lutte de classe» ;
2) en réalité, ce qui est décisif, ce n'est pas tant où on intervient, mais comment on intervient. En ce sens «le problème d'être en dehors ou à l'intérieur du syndicat est un faux problème, ou mieux, un problème lié aux possibilités concrètes et aux opportunités que présente la situation contingente» ;
3) la confirmation de la validité de la position de BC réside dans le fait que «le CCI depuis quelque temps développe pour sa part une activité intense d'intervention et a corrigé, en les ramollissant, certaines de ses rigidités de type idéaliste».
Essayons de remettre les choses à leur place. Le CCI est si peu «abstrait» dans son anti-syndicalisme de principe, que non seulement il intervient dans toutes les manifestations et assemblées syndicales dans lesquelles il y a une réelle présence ouvrière, mais admet aussi explicitement que ses militants puissent s'inscrire à un syndicat quand c'est rendu légalement obligatoire pour pouvoir travailler dans tel ou tel secteur (pratique de «closed-shop» en usage dans beaucoup de pays anglophones). Mais cette obligation, analogue à celle de payer les impôts, n'a rien à voir avec le choix de s'inscrire au syndicat pour y avoir une activité antisyndicale. Notons, au passage, que déjà dans les années 30, les camarades de la Gauche Italienne excluaient -à la différence des Trotskystes- tout travail à l'intérieur des syndicats fascistes, en Italie et en Allemagne. Puisqu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait que ces syndicats-là étaient des organes d'Etat, il était automatiquement exclu de discuter, puisqu'on tenait pour établi qu'aucune activité communiste n'était possible à l'intérieur d'un organe de l'Etat, les camarades de Battaglia affirment au contraire que les syndicats sont intégrés à l'Etat et qu'il est tout de même possible de travailler dedans : ils sont libres de l'affirmer, mais pas de se réclamer de la Gauche communiste pour soutenir cette affirmation.
Deux hypothèses d'intervention dans la lutte de classe
Face à cette affirmation amusante selon laquelle le CCI aurait changé de position en se jetant dans «une activité intense d'intervention» dans les luttes, il faut retourner encore une fois aux discussions des Conférences Internationales.
Le débat ne se situait pas entre ceux qui étaient en faveur et ceux qui étaient contre la nécessité d'intervenir. Le débat affrontait d'une part le CCI qui soutenait que les révolutionnaires doivent intervenir dans les luttes et dans les tentatives d'auto organisation qui à ce moment- là se développaient (en 1978 : hospitaliers en Italie, en 1979 : les sidérurgistes en Angleterre et en Lorraine, les dockers à Rotterdam, etc. ) et d'autre part Battaglia et la CWO, qui soutenaient que les révolutionnaires devaient se dédier à la construction de groupes d'usine, qui auraient organisé les secteurs combatifs du prolétariat et rendu possible de vrais mouvements de classe. Le CCI proposa une résolution. Celle-ci prenait comme point de départ la reconnaissance du fait que «la reprise historique des luttes ouvrières s'accompagne du développement, au sein de la classe, de groupes, de cercles, de noyaux de prolétaires, qui, bien que n'ayant pas une forme achevée et bien qu'étant menacés par toutes sortes de dangers, d'activisme, d'ouvriérisme, de néo-syndicalisme, sont une manifestation réelle de la vie de la classe» ([15] [1209]). Cette résolution soulignait en conséquence la nécessité d'intervenir au sein de ces organismes pour combattre ces dangers et contribuer ainsi au processus de prise de conscience et d'organisation de la classe.
Cette résolution fut rejetée par BC et CWO qui, aveuglés par les faiblesses de ces tentatives, en arrivaient à mettre en discussion leur nature de classe, en les voyant essentiellement comme des «manœuvres de tel ou tel groupe politique». Même dans les thèses du Ve Congrès de 1982 on insiste encore sur cette caractérisation et quand on admet la possibilité lointaine qu'il puisse surgir de véritables «cercles ouvriers», on ne leur donne comme seule possibilité que celle de se transformer en groupe d'usine, courroie de transmission entre Battaglia et la classe.
Aujourd'hui, la brochure sur les syndicats de BC insiste sur le fait que les organismes que se donnera la spontanéité ouvrière (assemblées, coordinations d'assemblées, conseils...) devront trouver «sur les lieux de travail des points de référence bien caractérisés politiquement et capables de représenter la direction politique de ces organes de masse». Lorsque, en 1977-80, nous insistions sur le fait que le rôle des communistes était de se battre pour donner une orientation de classe au sein des organisations que la spontanéité ouvrière fera de plus en plus surgir, nous étions taxés de «spontanéistes» avec lesquels il était impossible de discuter sérieusement. Aujourd'hui, de quoi faut-il taxer Battaglia ?
Les deux hypothèses à l'épreuve de la réalité
Mais avoir abandonné l'idée qu'il incombe aux communistes de créer les organismes appelés à encadrer les secteurs combatifs du prolétariat, ne résout pas tous les problèmes et n'élimine pas toutes les différences entre nous et BC En premier lieu, BC reconnaît aujourd'hui la réalité du processus d'apparition, ça et là, d'organismes autonomes de masse (assemblées, comités de grève...) mais ne se prononce pas sur la tendance à l'apparition d'organismes minoritaires, regroupant de petits noyaux d'ouvriers combatifs, qui se donnent comme objectif de faire aller de l'avant les luttes et d'en tirer ensuite les leçons. Toujours dans les thèses de 82, ces organismes minoritaires sont pratiquement identifiés à des «émanations des organisations politiques de la classe». Aujourd'hui, est-ce que BC reconnaît, oui ou non, que la tendance à former de tels noyaux est une «manifestation réelle de la vie de la classe»?
En second lieu, il ne suffit pas de comprendre qu'il faut assurer une direction politique dans ces organes de masse, encore faut-il être capable de le faire.
Et de ce point de vue, le bilan de Battaglia est tout autre que positif. Si nous examinons les deux épisodes dans lesquels nous avons vu récemment apparaître des organismes prolétariens de masse en dehors des syndicats : la lutte des cheminots en France et la lutte des travailleurs de l'Ecole en Italie, nous voyons que ni la section française du BIPR liée à Battaglia, ni Battaglia même, ne sont intervenus dans ces mouvements. Tout ce qu'ils ont réussi à faire a été d'attendre la fin des luttes pour écrire un texte dans lequel... ils dénonçaient les limites de la lutte ! C'est particulièrement déconcertant dans le cas de Battaglia, qui, dans le secteur de l'enseignement, a un groupe organisé de militants, avec une vieille tradition d'intervention, qui aurait pu et dû jouer un rôle d'aiguillon et de direction politique dans le mouvement. Mais pour diriger un mouvement, il faut au moins intervenir dedans, et ne pas se limiter à dire «sagement» ses opinions. Battaglia préfère, au contraire, nous expliquer que le mouvement des cheminots de 87 a été plus corporatiste que celui des sidérurgistes en 79 et que cela démontre qu'il n'est pas vrai que la classe apprend de ses propres expériences, contrairement à ce que dit le CCI. Des affirmations de ce genre ne font que montrer que BC n'a rien à faire ni du mouvement des cheminots ni du mouvement des sidérurgistes. En 79, la lutte des sidérurgistes français, avec toute sa radicalité et sa combativité, est restée sous le contrôle de l’«Intersyndicale» de Longwy, c'est-à-dire d'un organe de base des syndicats. En 86-87, les cheminots ont déclenché et étendu leur mouvement à l'échelle nationale en dehors et contre les syndicats : ils ont formé des comités de grève, émanation de leurs assemblées, et commencé à créer des coordinations régionales et nationales. Ce qui est un pas en avant non négligeable. Quant aux travailleurs de l'école en Italie, ils se sont organisés au niveau national en dehors et contre les syndicats.
Bien sûr il y avait le corporatisme et surtout les syndicats de base, mais il y avait aussi la maturation de la classe ouvrière, son ouverture par rapport à l'intervention des révolutionnaires qui s'est manifestée par le fait que non seulement le CCI a pu intervenir au sein du mouvement, comme en 78, mais que ses militants ont trouvé un écho plus important et, dans le cas des assemblées nationales des travailleurs des écoles en Italie, ont été délégués dans les coordinations nationales ([16] [1210]).
Certes, nous avons fait des erreurs pendant ces années, et certaines nous les avons même payées assez cher. Mais au moins, nous les avons faites en apprenant quelque chose, au cœur même des luttes ouvrières. Est-ce que les fameux groupes d'usine, avec tous leurs virages, permettent à Battaglia de tirer un bilan semblable ?
La reprise de la lutte de classe remet à l’ordre du jour les discussions inachevées
Après avoir saboté les Conférences Internationales, Battaglia Comunista a omis pendant des années de répondre dans sa presse à nos articles de polémique. Quand on en demandait la raison aux camarades, ils nous répondaient que leur journal était lu dans les usines et que les ouvriers ne sont pas intéressés à lire des pages et des pages de polémiques avec le CCI, ce qui revient à dire que le débat entre révolutionnaires n'est que du vent et que les ouvriers «concrets» n'en ont rien à faire.
Aujourd'hui cependant, BC dédie régulièrement des pages et des pages à la polémique avec le CCI, avec l’OCI et même avec un groupe extraparlementaire bourgeois comme Lotta Comunista. Que s'est-il passé ? Les lecteurs ouvriers de BC auraient-ils décidé de se «refaire une culture» ? Ou n'est ce pas plutôt qu'apparaît la vérification de ce que nous répondions quand BC a décidé d'interrompre les Conférences : «il y a une chose qui doit être claire : les questions que vous refusez de discuter aujourd'hui, seront demain à l'ordre du jour dans les luttes » ([17] [1211]). C'est effectivement la reprise de la lutte de classe internationale qui pousse aujourd'hui à reprendre le débat et à l'élargir jusqu'au Mexique, à l'Inde, à l'Argentine, alors qu'il s'était engagé seulement en Europe.
Pour reprendre les termes de la Lettre ouverte que nous envoyions alors à Battaglia : «Si la Conférence est morte de votre fait, l'idée des Conférences, elle, n'est pas morte. Au contraire, la reprise de la lutte du prolétariat continuera à pousser les révolutionnaires à sortir de leur isolement et à discuter publiquement et de façon organisée les questions auxquelles se confronte la classe» ([18] [1212]).
C'est cela l'objectif que tous les révolutionnaires, compris Battaglia, doivent consciemment se fixer.
Beyle
[1] [1213] Parti communiste internationaliste, (Battaglia Comunista, du nom du journal qu'il publie) ; C. P. 1753, 20101 Milan, Italie.
[2] [1214] Voir « Le cours historique », Revue internationale n° 18, 1979.
[3] [1215] «Les syndicats dans le 3e cycle d'accumulation du Capital». On peut se procurer cette brochure auprès de BC. Les différentes citations se trouvent pp. 9, 8, 11, 13, 3, 10, 15 et 16.
[4] [1216] Cité dans « La Sinistra Tedesca » de Barrot, Ed. La Salamandra.
[5] [1217] Le fait que cette intuition, par sa précocité même, se soit exprimée avec des formulations encore incomplètes et immatures, qui n'immunisaient pas encore complètement contre des rechutes sous la forme radicale de syndicalisme « révolutionnaire » n'enlève rien au mérite qui revient aux Gauches allemande et hollandaise pour avoir posé les premières le problème de la destruction des syndicats.
[6] [1218] Ce travail est exposé de façon détaillée dans le livre «La Gauche Communiste Italienne -1912-1952 », éditions CCI, en particulier dans le chapitre VII.
[7] [1219] Les thèses sur le syndicat du Ve Congrès de BC sont reproduites en annexe de la brochure de 86.
[8] [1220] Bulletin n° 2 des Textes préparatoires pour la 3e Conférence des groupes de la Gauche Communiste, p. 17.
[9] [1221] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[10] [1222] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[11] [1223] Les thèses sur le syndicat du Ve Congrès de BC sont reproduites en annexe de la brochure de 86.
[12] [1224] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[13] [1225] «Les syndicats dans le 3e cycle d'accumulation du Capital». On peut se procurer cette brochure auprès de BC. Les différentes citations se trouvent pp. 9, 8, 11, 13, 3, 10, 15 et 16.
[14] [1226] «Les syndicats dans le 3e cycle d'accumulation du Capital». On peut se procurer cette brochure auprès de BC. Les différentes citations se trouvent pp. 9, 8, 11, 13, 3, 10, 15 et 16.
[15] [1227] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[16] [1228] Un article de critique détaillée sur l'absence de BC dans le mouvement des travailleurs de l'école sera publié dans le numéro 31 de l'organe du CCI en Italie : Rivoluzione internazionale.
[17] [1229] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[18] [1230] « Lettre du CCI au PCInt (BC) à la suite de la 3e conférence » publiée en annexe au procès verbal de la conférence.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [449]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Il y a 70 ans la révolution russe : LA PLUS IMPORTANTE EXPERIENCE DU PROLETARIAT MONDIAL
- 3329 reads
- Les dix jours qui ébranlèrent le monde, c'était il y a 70 ans. Les médias du monde entier « célèbrent » l'anniversaire. Une fois de plus ils vont reparler de la Révolution russe. A leur façon. Celle de l'idéologie dominante, avec ses mensonges et déformations, avec sa rengaine défraîchie : « la révolution communiste ne peut conduire qu'au Goulag ou au suicide ».
- En défense de la véritable nature de ce qui reste la plus grande expérience révolutionnaire du prolétariat mondial, le CCI vient de faire paraître une brochure consacrée à la Révolution russe.
En voici la présentation.
« Le trait le plus incontestable de la Révolution, c'est l'intervention directe des masses dans les événements historiques. D'ordinaire l’Etat, monarchique ou démocratique, domine la nation ; l'histoire est faite par des spécialistes de métier : monarques, ministres, bureaucrates, parlementaires, journalistes. Mais aux tournants décisifs, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de l'arène politique, renversent leurs représentants traditionnels, et, en intervenant ainsi, créent une position de départ pour un nouveau régime. Qu'il en soit bien ou mal, aux moralistes d'en juger. Quant à nous, nous prenons les faits tels qu'ils se présentent dans leur développement objectif. L'histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d'une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propres destinées. » (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe, Préface).
Le terme même de révolution fait souvent peur. « L'idéologie dominante -disait Marx- est toujours l'idéologie de la classe dominante». Et ce que les classes dominantes, les classes exploiteuses craignent le plus, au fond de leur être, c'est que les masses qu'elles exploitent s'avisent un jour de mettre en question l'ordre des choses existant en faisant une « irruption violente dans le domaine où se règlent leurs propres destinées ».
La Révolution russe de 1917 ce fut d'abord et avant tout cela : une grandiose action des masses exploitées pour tenter de détruire l'ordre qui les réduit à l'état de bêtes de somme de la machine économique et de chair à canon pour les guerres entre puissances capitalistes. Une action où des millions de prolétaires, entraînant derrière eux toutes les autres couches exploitées de la société, sont parvenus à briser leur atomisation, à s'unifier consciemment, à se donner les moyens d'agir collectivement comme une seule force. Une action pour devenir maîtres de leurs propres destinées, pour commencer la construction d'une autre société, une société sans exploitation, sans guerres, sans classes, sans nations, sans misère : une société communiste.
La Révolution russe mourut étouffée, isolée, du fait de la défaite des tentatives révolutionnaires dans le reste de l'Europe, en particulier en Allemagne. La bureaucratie stalinienne en fut l'hypocrite et impitoyable bourreau.
Mais cela ne change rien à la grandeur de l'intrépide « assaut du ciel » que fut la Révolution russe. Octobre 1917 ce ne fut pas une tentative révolutionnaire parmi d'autres. La Révolution russe constitue, et reste jusqu'à présent -et de loin- la plus importante expérience révolutionnaire de la classe ouvrière mondiale.
Par sa durée, par le nombre de travailleurs qui y ont participé, par le degré de conscience de ceux-ci, par le fait qu’elle représentait le point le plus avancé d'un mouvement international de luttes ouvrières, par l'ampleur et la profondeur des bouleversements qu'elle tenta de mettre en place, la Révolution russe constitue la plus transcendante des expériences révolutionnaires de la classe ouvrière. Et en tant que telle elle est la plus riche source d'enseignements pour les luttes révolutionnaires ouvrières à venir.
Mais pour pouvoir tirer des enseignements d'une expérience historique, il faut au départ savoir de quel type d'expérience il s'agit. La Révolution russe a t’elle été une révolution ouvrière ? Ou bien a t’elle été un coup d'Etat, fomenté par un parti bourgeois particulièrement habile dans la manipulation des masses ? Le stalinisme a t’il été le produit normal, « naturel » de cette révolution ou bien en a t’il été le bourreau ? Suivant la réponse que l'on donne à ces questions élémentaires, les enseignements que l'on tirera seront évidemment radicalement opposés.
Or la bourgeoisie ne s'est pas contentée d'écraser militairement ou d'étouffer les révolutions prolétariennes du passé. Elle en a aussi systématiquement déformé le souvenir en en donnant des versions déformées, dénaturées : de même qu'elle a entièrement adultéré l'histoire de la Commune de Paris de 1871 - cette première grande tentative prolétarienne de destruction de l'Etat bourgeois - en la présentant dans ses manuels d'histoire comme un mouvement nationaliste, patriotique anti-prussien, de même elle a totalement défiguré le souvenir de la Révolution russe.
Les idéologies staliniennes «reconnaissent» une nature prolétarienne (ils préfèrent en général parler de «populaire»), à la révolution d'Octobre. Mais la version totalement défigurée qu'ils en donnent n'a d'autre objectif que de faire oublier l'effroyable répression à laquelle le stalinisme s'est livré contre les ouvriers et les bolcheviks qui en avaient été les protagonistes ; de tenter de justifier ce qui restera comme un des plus grands mensonges de l'histoire : l'assimilation du capitalisme d'Etat, cette forme décadente et militarisée de l'exploitation capitaliste, comme synonyme de « communisme ».
Les trotskystes parlent aussi d'« Octobre ouvrier », mais pour eux encore les régimes de type stalinien ont quelque chose de prolétarien qu'il s'agit de défendre au nom de la marche vers le « communisme ».
Les autres formes de l'idéologie bourgeoise, non staliniennes ou assimilées, dénaturent la Révolution russe de façon non moins répugnante. Certaines se contentent de parler de mouvement nationaliste en vue de moderniser le capitalisme russe qui ne parvenait pas, au début de ce siècle, à se débarrasser de ses oripeaux féodaux : en somme une révolution bourgeoise comme celle de 1789 en France, mais avec plus d'un siècle de retard et aboutissant à une dictature de type fasciste. D'autres parlent de « révolution ouvrière » pour Octobre 1917 et s'accordent avec les staliniens pour considérer l'URSS comme un pays « communiste », mais ce n'est que pour mieux décrire les horreurs du stalinisme en en déduisant : « c'est à cela, et seulement à cela que peuvent conduire des mouvements révolutionnaires à notre époque ». Et d'entonner le credo de toutes les classes dominantes : « les révoltes des exploités ne peuvent conduire qu'au suicide ou à des régimes encore pires que ceux qu'elles prétendent combattre ».
Bref, les idéologues bourgeois ont complété l’œuvre des massacreurs de la Révolution russe en s'attachant à détruire le souvenir même de ce qui a été la plus grande tentative révolutionnaire prolétarienne jusqu'à présent.
Malheureusement dans le camp révolutionnaire, parmi les courants politiques prolétariens dont la tâche devrait être de tirer les leçons des expériences du passé pour les transformer en armes pour les combats à venir, l'on retrouve aussi des théories aberrantes sur la nature de la Révolution russe, même si évidemment leur objectif politique est différent. Ainsi les « conseillistes », au sein du courant de la Gauche allemande, en sont arrivés à considérer Octobre et les bolcheviks comme bourgeois. Ainsi, au sein de la Gauche italienne, les « bordiguistes» ont développé la théorie de la « double nature » (bourgeoise et prolétarienne) de la Révolution russe.
Ces théories ont été les produits de la défaite de la vague révolutionnaire des années 1920, de la confusion créée dans les esprits par le fait que la Révolution russe ne mourut pas comme la Commune de Paris, rapidement et ouvertement écrasée par la réaction bourgeoise, mais dégénéra suivant un processus long, douloureux et complexe, subissant le pouvoir d'une bureaucratie qui se prétendait la continuatrice d'Octobre 1917.
Mais si on peut comprendre l'origine de ces aberrations, elles n'en demeurent pas moins un obstacle majeur pour la rappropriation par la classe révolutionnaire des enseignements de sa principale expérience historique. Et elles doivent être combattues comme telles. Tel est l'objectif de cette brochure qui est composée de deux articles parus dans la Revue Internationale du CCI (no 12 et 13, fin 1977 - début 1978) et consacrés l'un à la critique des théories « conseillistes » et l'autre à celle des théories « bordiguistes ».
Il faudra longtemps au prolétariat mondial pour parvenir à se débarrasser de toute la boue idéologique avec laquelle la bourgeoisie a recouvert la plus grande expérience révolutionnaire. Probablement, il ne parviendra à se réapproprier toute la richesse des leçons de cette expérience qu'au cours de la lutte révolutionnaire elle-même, lorsqu'il sera confronté aux mêmes questions pratiques.
C'est lorsqu'ils seront confrontés à la nécessité immédiate de s'organiser comme force unifiée, capable d'abattre l'Etat bourgeois et de proposer une nouvelle forme d'organisation sociale, que les prolétaires réapprendront le véritable sens du mot russe « soviet ». C'est lorsqu'ils se trouveront devant la tâche d'organiser collectivement une insurrection armée qu'ils ressentiront massivement le besoin de posséder les leçons d'Octobre 1917. C'est lorsqu'ils seront confrontés à des questions telles que savoir qui exerce le pouvoir, ou bien quels rapports doit-il y avoir entre le prolétariat en armes et l'institution étatique qui surgira au lendemain des premières insurrections victorieuses, ou bien encore comment réagir face à des divergences entre secteurs importants du prolétariat, qu'ils comprendront les véritables erreurs commises par les bolcheviks (en particulier dans la tragédie de Kronstadt).
Malgré son échec, qui fut en réalité celui de la vague révolutionnaire internationale dont elle n'était que le point le plus avancé - échec qui confirmait que la révolution prolétarienne n'a pas plus de patrie que les prolétaires eux-mêmes - la Révolution russe a posé dans la pratique des problèmes pratiques cruciaux auxquels les mouvements révolutionnaires de l'avenir se trouveront inévitablement confrontés. En ce sens, qu'ils en aient conscience aujourd'hui ou non, les prolétaires des luttes de demain devront s'en réapproprier les enseignements.
Mais pour cela ils devront commencer par reconnaître cette expérience comme leur expérience. Pour affirmer la continuité du mouvement révolutionnaire prolétarien ils devront inévitablement réaliser, sur ce terrain aussi, « la négation de la négation », le rejet des théories qui nient le caractère prolétarien de leur plus grande expérience passée.
Quant aux organisations révolutionnaires, pour elles, c'est dès à présent que la reconnaissance d'Octobre est cruciale : leur capacité à féconder les luttes prolétariennes immédiates dépend en effet tout d'abord de la compréhension de la dynamique historique qui depuis plus de deux siècles a conduit aux luttes présentes. Or cette compréhension serait impossible sans une claire reconnaissance de la véritable nature de la Révolution d'octobre.
C'est à la recherche de cette clarté indispensable que veut contribuer cette brochure.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [207]
Approfondir:
- Russie 1917 [1231]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1988 - 52 à 55
- 3666 reads
Revue Internationale no 52 - 1e trimestre 1988
- 2557 reads
Editorial : la crise économique, la guerre et la révolution
- 4665 reads
Effondrement boursier, nouvelle aggravation de la crise économique; mobilisation des armées des principaux pays industrialisés occidentaux dans la guerre du Golfe Persique. L'histoire s'accélère. Les forces contradictoires qui minent les rapports sociaux capitalistes s'exacerbent. Le système enfonce de plus en plus rapidement la société mondiale dans la barbarie de la misère et de la guerre.
Mais la crise économique n'est pas que cela. La crise dans laquelle se débat l'économie mondiale depuis près de 20 ans a aussi développé les contradictions entre les classes; elle crée les conditions pour l'unification de la seule force capable d'imposer une issue: la classe ouvrière mondiale.
La crise boursière annonce un enfoncement de l'économie dans la récession, c'est-à-dire dans le chômage, les bas salaires, la surexploitation, la misère, la répression, l'insécurité, et enfin les tensions guerrières. Tout le monde le sait ou le sent plus ou moins confusément. Mais, toute la pression de la classe dominante, avec la répression, avec les médias et la propagande idéologique omniprésente, s'emploie à entretenir le sentiment d'impuissance face à l'ordre régnant.
Pourtant, pour la classe exploitée l'heure n'est ni aux lamentations, ni à la résignation, ni aux politiques "de l'autruche" préconisées par la classe dominante. Plus que jamais son combat contre le capitalisme est à l'ordre du jour. Plus que jamais s'impose à elle la nécessité d'unifier ses combats épars de résistance immédiate, pour les porter jusqu'au bout, jusqu'au combat non plus contre les conséquences de l'exploitation, mais contre l'exploitation elle-même. La crise économique mondiale, développe les conditions d'un tel processus. Et c'est surtout cela que la classe ouvrière doit avoir à l'esprit devant les appels à la résignation de tous les défenseurs de "l'économie nationale".
LA CRISE ECONOMIQUE AFFAIBLIT LE POUVOIR DE LA BOURGEOISIE MONDIALE
La crise économique se traduit inévitablement par des attaques féroces contre les conditions d'existence des prolétaires. Mais cela ne traduit pas pour autant un renforcement de la bourgeoisie mondiale. Devant la crise de son système, la classe dominante ne connaît d'autre mode de vie que celui de la guerre de tous contre tous. La concurrence exacerbée sur le plan commercial et sur le plan militaire. Ceux qui gagnent dans ces combats ne créent plus de nouvelles richesses, ils ne s'enrichissent que des cadavres de leurs concurrents vaincus. La bourgeoisie ne parvient plus à assurer la seule fonction sociale qui lui permet de fonder son pouvoir autrement que sur la violence: la fonction d'organisateur de la production sociale des moyens de subsistance. La bourgeoisie ne peut plus produire: elle ne survit qu'en détruisant. Détruisant économiquement: chômage massif, fermetures d'entreprises, destruction de récoltes et de "surplus invendables"; détruisant militairement: production d'armement, guerres. De ce fait son pouvoir repose de plus en plus uniquement sur la répression et le mensonge idéologique. Et l'histoire montre que pour une classe dominante c'est une situation de faiblesse. "On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus", disait Talleyrand à l'époque où la bourgeoisie avait encore un rôle révolutionnaire et était sûre de son "utilité sociale".
Ce que doivent voir les prolétaires dans l'actuelle aggravation de la crise économique, c'est qu'en même temps que celle-ci érode les fondements du pouvoir de la bourgeoisie, elle développe des conditions objectives pour l'unification de la classe ouvrière mondiale, pour un développement de sa conscience de classe révolutionnaire et de ses combats contre le capitalisme.
LA CRISE CREE DES CONDITIONS POUR L'UNIFICATION PROLETARIENNE
La crise tend à unifier le prolétariat international parce que la crise unifie les conditions d'existence des exploités, parce que l'attaque tend à être de plus en plus simultanée sur tous les secteurs de la classe ouvrière, dans tous les pays. Ce ne sont plus surtout les pays les moins développés qui connaissent cette austérité. L'Allemagne occidentale, le Japon, tout comme les petits "miracles" d'Extrême-Orient (Singapour, Hong-Kong, Corée du Sud, Taiwan) ou l'Amérique Latine (Brésil, Mexique, Argentine, Venezuela), tout comme les pays pétroliers, tous ces pays qui, à un moment ou à un autre, apparaissaient dans les dernières années comme des zones épargnées par la crise, connaissent le développement du chômage et de la misère à l'égal des autres pays frappés plus tôt.
Lorsque le développement de la crise est relativement lent, la bourgeoisie parvient à disperser son attaque, géographiquement et dans le temps, cherchant consciemment à éviter des réactions brusques et surtout unifiées. Le fameux "Plan Davignon" réalisé par les gouvernements de la Communauté européenne, pour licencier des centaines de milliers de travailleurs dans la sidérurgie, sur tout le continent, en prenant soin de disperser les attaques au cours des années et en passant d'un pays à l'autre, est une illustration de ce genre de tactique. L'aggravation de la crise économique interdit de plus en plus ce genre de planification de la dispersion de l'attaque. Poussée par ses propres impératifs de concurrence et de rentabilité capitaliste, la bourgeoisie est contrainte de frapper de plus en plus simultanément et rapidement (donc violemment) toute la classe travailleuse. Les attaques massives de la bourgeoisie créent les bases pour les réponses massives du prolétariat. La bourgeoisie polonaise a appris à ses dépens, en 1970 comme en 1980, ce que coûtent au maintien de son ordre des mesures violentes telles que le doublement des prix de la viande et du lait du jour au lendemain. Les politiques de "privatisation", de "dérégulation", tout comme la "perestroïka" de Gorbatchev ou le "libéralisme" de Teng Shiao Ping ont aussi comme objectif d'éviter de telles secousses. Malheureusement. pour ces bourgeois attardés, il est trop tard et la crise économique mondiale est trop profonde pour réussir à masquer la massivité des attaques.
Le pire piège pour la classe ouvrière serait de "ne voir dans la misère que la misère" et ne pas saisir les moyens de son unification que lui offre l'effondrement du système économique. La classe ouvrière ne peut s'unifier que dans et pour le combat contre ce qui la divise: le capitalisme. C'est ce que confirme tous les jours la lutte ouvrière aux quatre coins de la planète. Le fait qu'en un peu plus d'un an la classe ouvrière ait développé des luttes massives comme en Belgique en 1986 ou en Corée du Sud pendant l'été 1987, qu'elle livre des combats importants simultanément en Yougoslavie et en Roumanie, en Italie et au Bangladesh, le montre sans ambiguïtés.
LA CRISE MET A NU LE VERITABLE ENJEU DES LUTTES OUVRIERES
La crise économique capitaliste fait éclater au grand jour cette vérité simple mais fondamentale que ce qui conduit à la situation d'impasse dans laquelle s'enfonce la société, ce ne sont pas des problèmes techniques ou de manque de moyens matériels, mais d'organisation sociale de la production. La bourgeoisie répond à la crise de son système en détruisant et en menaçant d'aller vers une nouvelle destruction mondiale, comme elle le fit à la suite de la crise des années 30. Les besoins économiques non satisfaits se développent à une vitesse vertigineuse en même temps que la société dispose des techniques les plus puissantes qui permettraient à l'humanité de vivre comme des "maîtres sans esclaves", avec comme seul objectif pour -l'activité productrice: satisfaire sans limites les besoins humains.
Plus la crise s'approfondit et plus ce contraste, entre ce qui est matériellement possible et ce qui existe dans la réalité capitaliste, apparaît clairement, montrant au prolétariat la justesse et l'ampleur historique de ses luttes si elles sont menées jusqu'à leurs ultimes conséquences.
LE TRIOMPHE DU MARXISME
La réalité de la dynamique capitaliste vérifie de façon éclatante l'analyse marxiste de l'inéluctabilité de la crise capitaliste et du fait que cette crise crée les conditions matérielles, objectives, nécessaires -même si non suffisantes- pour l'unification et l'action révolutionnaires de la classe ouvrière.
Cependant, les classes dominantes ne croient jamais à la possibilité de leur propre disparition... sauf peut-être dans un chaos sans retour. Elles ne voient de la réalité que ce que leurs lunettes de classe leur permettent de voir. La bourgeoisie mondiale ne comprend pas plus les raisons profondes de la crise violente qui secoue son système qu'elle ne voit dans les grèves ouvrières la possibilité d'une société communiste. Elle craint les luttes ouvrières qui se généralisent, par dessus tout, parce qu'elle craint de perdre le contrôle de la situation et donc ses privilèges, non parce qu'elle entreverrait une société sans misère ni exploitation.
Que la bourgeoisie ne voit pas comment la crise du capitalisme peut conduire à la transformation des luttes revendicatives ouvrières en luttes offensives révolutionnaires est en fait "normal". Ce qui est plus surprenant ce sont les objections aux fondements du marxisme de la part de courants se réclamant de la révolution communiste, voire de Marx.
Trois arguments, basés sur une observation -superficielle- de l'histoire sont souvent cités contre les analyses marxistes:
1. Au cours des années 80 la crise a été plus profonde et a plus frappé la classe ouvrière que pendant les années 70. Cependant il y eu moins de grèves.
2. La grande crise économique de 1929 n'a pas conduit à des luttes révolutionnaires mais à l'embrigadement des prolétaires derrière leurs bourgeoisies nationales pour s'entre-tuer dans une boucherie mondiale qui laissa 50 millions de morts.
3. Les luttes ouvrières du passé qui sont arrivées à remettre en question de façon révolutionnaire le pouvoir de la bourgeoisie, ne se sont pas produites pendant des périodes de crise économique "pure" mais pendant ou à la suite de guerres entre nations.
Nous avons souvent répondu à ce type d'arguments dans notre presse et plus particulièrement dans cette revue ([1] [1232]). Cependant, à l'heure où les échéances historiques s'approchent de façon accélérée sous la pression de la crise économique, il nous semble important de rappeler quelques éléments importants pour la perspective actuelle des luttes ouvrières.
Et pourtant...
"IL Y A MOINS DE GREVES DANS LES ANNEES 80"
Il est vrai que de façon générale il y a eu moins de grèves, moins de journées "perdues pour fait de grève" ; comme disent les statistiques, au cours des dernières années que pendant la vague de luttes de la fin des années 60 ou au cours des années 70. Il est aussi vrai que la crise économique, si on en mesure les effets à l'ampleur du chômage par exemple, est plus profonde et plus étendue au cours des années 80. Mais en déduire qu'il v a là la preuve que la crise économique ne crée pas des conditions pour l'unification du prolétariat c'est tout ignorer de ce qu'est le processus d'unification de la classe ouvrière mondiale.
Ce processus ne se mesure pas mécaniquement au nombre de journées de grève dans tel ou tel pays. Le processus d'unification des luttes ouvrières se mesure tout autant à des critères tels que la conscience qui soutient la lutte ou l'ampleur internationale des combats.
Les grèves des années 80 sont moins nombreuses que celles de la décennie précédente mais elles sont beaucoup plus significatives. Partir en grève aujourd'hui, affrontant la menace du chômage, cette répression insidieuse qui est comme un fusil derrière le dos de chaque travailleur, cela implique beaucoup plus de volonté et de décision de combat que de participer à dix journées d'action syndicale bidon comme il y en eut tant pendant les années 70. Et pourtant cela comptabilisera bien moins d'heures de grève.
La conscience qui traverse les luttes ouvrières actuelles est beaucoup plus profonde que celle de ce qu'on a souvent appelé les années d'illusion: illusions sur les "libérations nationales", sur "la gauche au pouvoir" ou sur l'autogestion des entreprises en faillite, par exemple. Aujourd'hui, dans les principaux centres industriels d'Europe, ainsi que dans les pays où les formes "démocratiques" de la dictature bourgeoise ont duré suffisamment, le prolétariat a énormément perdu de ses illusions sur les institutions syndicales, sur les partis dits "ouvriers" mais appartenant à l'appareil de la classe dominante (PC, Socialistes, Démocrates, etc.), sur le rôle des élections, sur la possibilité de sortir de la crise économique en acceptant de faire des sacrifices pour l'entreprise ou la nation, etc. La quasi-totalité des mouvements importants de la classe ouvrière démarrent en dehors des syndicats, et les affrontements entre ouvriers et leurs prétendues organisations représentatives sont de plus en plus fréquents. Après les luttes de Belgique au printemps 1986 qui ont montré comment étendre un mouvement de lutte malgré les syndicats, après les grèves des cheminots pendant l'hiver 86-87 en France qui ont tenté de former des coordinations centralisées en dehors des syndicats, les luttes des travailleurs en Italie au cours de 1987 démontrent, dès le début, avec le mouvement des travailleurs de l'école puis d'autres secteurs, en particulier des transports, une farouche volonté de conduire le combat en dehors du contrôle syndical et en se donnant ses propres formes d'organisation basées sur les assemblées de base.
Il y a moins de grèves dans les années 80, mais elles traduisent une bien plus grande maturité en profondeur. Une maturité qui a été acquise et s'acquiert non malgré, la crise économique, mais sous sa pression directe.
Et pourtant...
"LA CRISE DE 1929 N'A PAS ABOUTI A L'UNIFICATION DE CLASSE OUVRIERE MAIS AU CONTRAIRE A SA NEGATION LA PLUS VIOLENTE: LA GUERRE IMPERIALISTE".
Le marxisme n'a jamais conçu la réalité sociale comme une mécanique simpliste et inconsciente. Sans conscience de classe, aucune crise capitaliste ne peut provoquer par elle même une unification effective des combats prolétariens. C'est pour cela que, comme nous l'avons dit, la crise économique est une condition nécessaire, mais non suffisante. L'expérience historique des années 30 ne démontre pas que la crise économique ne contribue pas au processus d'unification prolétarien, mais qu'à elle seule, la crise ne suffit pas.
En 1929, lorsque éclate le krach de Wall Street, le prolétariat européen est encore sous les coups de la répression de la vague révolutionnaire internationale qui secoua l'Europe à la fin de la première guerre mondiale. La révolution russe, cet événement qui avait suscité tant d'espoirs, cette lutte qui avait été le phare de tous les combats ouvriers mourait étouffée après la défaite sanglante de la révolution en Allemagne entre 1919 et 1923.
Dans ces conditions, subissant la défaite, le prolétariat n'avait pas les moyens de répondre au nouveau défi que lui jetait le capitalisme en crise.
Il faut ajouter à cette différence au niveau de la conscience de la classe, une autre de taille au niveau du déroulement de la crise elle-même: dans les années 30 les politiques de réarmement et de grands travaux qui préparaient à la guerre ont permis de résorber puissamment le chômage et de limiter les effets de la crise (voir l'article qui suit sur la crise actuelle et sa différence avec celle de 1929: "Crise: quand il faut payer le solde").
L'actuelle génération de prolétaires n'a pas connu de défaites de cette ampleur dans ses principales concentrations. 50 ans de décadence du capitalisme sont passés par là, avec leur lot de barbarie mais aussi avec leur somme d'expériences lentement digérées, avec leur pouvoir de destruction des illusions.
Le capitalisme en crise trouve aujourd'hui devant lui un prolétariat dont la conscience se débarrasse des pires mythes qui l'enchaînaient il y a 50 ans.
Et pourtant...
"TOUTES LES LUTTES REVOLUTIONNAIRES IMPORTANTES DU PROLETARIAT DANS LE PASSE ONT ETE LE PRODUIT DE GUERRES ET NON DE CRISES ECONOMIQUES PURES"
Il est vrai que les plus grandes luttes ouvrières jusqu'à présent ont été provoquées par des situations de guerre: la Commune de Paris de 1871, liée à la guerre franco prussienne, la révolution de 1905 en Russie, liée à la guerre russo-japonaise, la vague révolutionnaire internationale de 1917-1923 liée à la première guerre mondiale.
Mais il n'en découle nullement que la guerre crée les conditions optimales pour la révolution prolétarienne. Encore moins que la crise économique "pure" -car la guerre impérialiste n'est qu'une manifestation de la crise économique- ne favorise pas l'unification de la classe ouvrière.
Les guerres, par les souffrances extrêmes qu'elles imposent aux classes exploitées en très peu de temps, tendent à créer des situations révolutionnaires. Mais ceci ne se produit que dans les pays ayant été défaits (la France en 1871 défaite par la Prusse, la Russie en 1905 défaite par le Japon, fa Russie en 1917 défaite par l'Allemagne, l'Allemagne en 1918 défaite par les Alliés). Dans les pays victorieux la guerre ne provoque pas les mêmes conséquences.
La crise économique a un effet beaucoup plus lent sur les conditions de vie de la classe ouvrière. Mais cet effet est aussi plus profond et plus étendu géographiquement. Dans la crise économique mondiale du capital, il n'y a pas de pays "neutre", ni de vainqueur. C'est toute la machine capitaliste qui est vaincue par ses propres lois devenues contradictoires. La misère ne connaît plus de frontières.
En outre, les mouvements de lutte déclenchés par le combat contre la guerre trouvent un point d'arrêt, sinon un puissant ralentissement, si la bourgeoisie est contrainte à la paix. Par contre la crise économique, sans aboutissement révolutionnaire, ne peut avoir d'autre issue que la guerre. La guerre joue ici un rôle dans la prise de conscience, mais comme menace.
Le constat du rôle de la guerre dans les révolutions passées n'infirme donc en rien le rôle unificateur que peut avoir la crise économique aujourd'hui sur la lutte ouvrière. Au contraire.
L'unification de la classe ouvrière mondiale sera un effort conscient de celle-ci ou ne sera pas. Mais cette conscience ne peut se développer et vaincre que dans les conditions objectives que crée la crise économique du mode de production capitaliste.
Ce que montre l'évolution des luttes des années 80, ce que montre l'expérience des années 30, ce que montre le rôle joué par la guerre dans les révolutions prolétariennes passées, ce n'est pas que la crise empêche l'unification des luttes prolétariennes mais que jamais dans l'histoire les conditions objectives pour la révolution prolétarienne n'ont été aussi mûres.
Au prolétariat mondial de relever le défi qu'une fois encore lui jette l'histoire.
RV. 21/11/87
[1] [1233] Voir entre autre les articles : « Le prolétariat dans le capitalisme décadent » (n°23, 3° trim. 1980), « les années 80 ne sont pas les années 30 » (n° 36, 1er trim. 1984), « Sur le cours historique » (n° 50, 3e trim. 1987).
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
Où en est la crise économique ? : Krach : quand il faut payer le solde
- 7056 reads
Quelques semaines après le fameux "jeudi noir" en octobre 1929, Hoover, le président des USA, déclarait: "La prospérité nous attend au prochain coin de rue". Nous connaissons la suite, les années 30 de si sinistre mémoire, la crise jamais surmontée, finalement la guerre mondiale.
Trente huit ans après, les mêmes propos sur la santé de l'économie mondiale ne rassurent plus personne. Si la volonté de rassurer reste la préoccupation obsessionnelle des pouvoirs établis, la perspective d'une nouvelle et très grave avancée de la récession mondiale est une chose tenue pour certaine, même pour les plus optimistes. Le jour même où les USA annonçaient pour "rassurer les marchés", qu'ils étaient prêts a réduire de quelques milliards de dollars leur déficit budgétaire, une étude de la très célèbre et puissante banque américaine "la Morgan" avançait l'analyse suivant laquelle la récession à venir "sera trois à quatre fois plus destructrice que la récession de 1981-1982". 1981-82 c'était déjà la flambée du chômage dans les pays développés, le fond de la misère pour les autres. Quand on connaît cette morsure qu'a infligée dans la chair de l'humanité la récession de 81-82, une telle perspective laisse rêveur.
Qu'ici l'on ne se trompe pas; la crise boursière d'octobre 87 ne représente que l'écume des vagues, elle n'est que le signe annonciateur, précurseur d'un raz de marée d'une puissance inouïe, aux conséquences encore difficilement mesurables.
UNE SITUATION BIEN PLUS GRAVE QUE DANS LES ANNEES 30
Il est normal que les récentes secousses du système financier international viennent rappeler le krach boursier de 1929 et, par analogie, la crise des années 30. Mais au-delà des apparences immédiates les situations historiques sont radicalement différentes et, contrairement à ce qui en est généralement dit, la comparaison entre les deux époques fait ressortir du strict point de vue économique les impasses et la gravité de la situation actuelle.
Comme à la fin des années 20, la crise boursière a été précédée par une orgie et une ivresse spéculatives où l'argent et le profit semblaient s'auto engendrer dans une spirale infinie. Miracle de l’argent dégageant des profits sans emprunter le classique circuit de la production. Spéculation sans précédent attirant tous les capitaux et toute l'épargne sociale dont les appétits de profit ne pouvaient être assouvis par le marché traditionnel et l'industrie.
Comme en 29 cette bulle spéculative va crever dès les premiers signes de récession et, comme en 29 encore, le coup d'envoi de la crise boursière est donné par un mouvement de retrait des capitaux européens. Retrait marqué en 1929 par le relèvement des taux d'escompte de la Banque d'Angleterre, en octobre 1987 par le relèvement des taux d'intérêt en RFA.
La similitude entre ces deux situations s'arrête là.
Il est vrai que le krach de 1929 ne tombe pas du ciel, il a lentement mûri tout au long d'une période où les industries traditionnelles comme les chemins de fer, les mines, le charbon, le textile souffrent d'une surcapacité chronique et où le pouvoir d'achat des ouvriers et des paysans, de 1920 à 1929, n'a cessé de baisser. Mais à part ces secteurs, les années précédant le krach sont des années de très grande prospérité dans des secteurs nouveaux et de plus en plus puissants comme l'automobile, la TSF', l'acier, l'électricité, le gaz et le pétrole.
De fait, le krach boursier de 1929 ouvre la période de crise économique, il la précède. Aujourd'hui il la suit et dans une situation où tous les secteurs sont touchés depuis des années.
La spéculation financière à l'origine du krach ne s'était vraiment développée que depuis 1928. Du seul point de vue de la spéculation, la fuite du capital hors des sphères de la production précédant la crise boursière d'octobre 1987 n'est pas un phénomène récent. La spéculation est depuis de longues années une activité chronique du capital et en tant que telle elle traduit toutes les difficultés du capital à se valoriser dans le processus de production. Bien qu'elle soit allée crescendo pour aboutir aux délires de l'année 1986, là spéculation se généralise depuis plus d'une décennie: spéculation par anticipation sur le prix des matières premières comme le pétrole dans les années 70, spéculation sur les monnaies comme le dollar dans le début des années 80, spéculation au travers de rachats d'entreprises depuis deux ans... Qu'après avoir fui massivement la sphère de la production industrielle, le capital se voit traqué et piégé dans les temples de la bourse où, fiévreusement réfugié dans la spéculation financière, il s'était retranché ces dernières années ne montre qu'une chose: la crise boursière est l'enfant de la crise économique et non le contraire.
Les rapports actuels entre les flux financiers et ceux des marchandises en sont un des principaux indicateurs:
"Les mouvements financiers sont devenus sans commune mesure avec ceux des marchandises: le rapport est de 50 à 1, puisque pour 5 milliards de dollars d'échanges commerciaux quotidiens, les flux monétaires à travers les frontières sont supérieurs à 200 milliards de dollars. " (Dossiers et documents, le Monde novembre 87)
La crise actuelle n'est pas seulement plus grave qu'en 1929 par la masse des contradictions accumulées mais aussi conjointement par le fait que toutes les recettes employées pour y faire face, ou tout au moins pour les contourner, sont aujourd'hui épuisées et usées jusqu'à la corde.
Si contrairement à 1929 la crise précède, et de loin, la tempête boursière, il en est de même des politiques économiques pour faire face à cette crise historique de surproduction. New-deal, politique de grands travaux, relance par la consommation et l'inflation, bref, tout ce que l'on recoupe sous le terme de Keynésianisme en fait l'intervention croissante de l'Etat dans l'économie, le développement du capitalisme d'Etat- ne sont plus devant nous mais derrière nous.
Les manipulations financières ont toujours été l'outil essentiel de ces politiques de fuite en avant: aujourd'hui, à force d'avoir abusé du crédit, de l'inflation, des déficits, de la spéculation, l'édifice du système financier international est incapable d'en supporter plus, il est un véritable château de cartes dont l'édifice totalement vermoulu menace chaque jour davantage de s'effondrer et dont l'équilibre relève du miracle.
Ce tableau ne serait pas complet si l'on n'y intégrait pas les questions des déficits budgétaires et la politique d'armement qui leur est liée.
Dans les années 30 la situation encore saine de la trésorerie des Etats, alimentée par des années de prospérité du capital, allait permettre l'illusion d'une relance de la production par une immense production d'armements. Aujourd'hui, cette production gigantesque d'armements qui aspire tout ce que la société a créé de plus productif de manière ininterrompue depuis la seconde guerre mondiale, est une des causes majeures du déficit budgétaire des États nationaux, des USA et de l'URSS particulièrement, et s'inscrit donc dans la situation historique actuelle comme un accélérateur important de la crise économique mondiale (voir l'article "Guerre, militarisme..." dans ce numéro). Toute la bourgeoisie mondiale, en particulier en Europe, montre du doigt les USA et accuse leur déficit budgétaire. Pourtant, le déficit budgétaire des USA a pour cause profonde une politique de surarmement, comme en URSS d'ailleurs, que personne ne conteste mais que les bourgeoisies mondiales rechignent à payer. Pour ces raisons incontournables du point de vue capitaliste, les récriminations des bourgeoisies européennes sont condamnées à rester des gesticulations. Pour l'essentiel, elles feront comme d'habitude, elles s'aligneront.
De quelque côté qu'elle se tourne, l'économie capitaliste mondiale, de Washington à Moscou, de Pékin à Paris, de Tokyo à Londres, est coincée.
LA PERSPECTIVE D'UNE ACCELERATION MAJEURE DE LA RECESSION MONDIALE
L'histoire économique de ces vingt dernières années n'est pas autre chose que l'histoire de cette course mondiale de l'économie capitaliste mondiale vers l'impasse actuelle. Dans cette période qui s'étend de la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons distinguer plusieurs phases:
"Avec l’arrêt définitif de tous les mécanismes delà reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en Occident a commencé de vivre suivant des oscillations déplus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté déplus en plus violemment à deux écueils: d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et déplus en plus inflationnistes.
On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante:
- en 1967y ralentissement de la croissance;
- en 1968, relance;
- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967;
- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flotte ment des principales parités monétaires; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe";
- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis dix-huit ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973); -fin 1973 afin 1975, nouvelle récession; la troisième, mais aussi la plus longue et la plus profonde; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3%par an;
-1976-1979, troisième relance; mais cette fois ci, malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés de pays industrialisés, malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu 'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en oeuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement, mais systématiquement. (...) Comme on le voit, que ce soit le remède 'déficit budgétaire' ou que ce soit le remède 'déficit extérieur' des USA, tous les deux ont été administrés en doses massives à l’économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats obtenus ne prouve qu'une chose: leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80." (Revue Internationale N° 20,1980).
Ecrits au début des années 80, ces pronostics ont été plus qu'amplement vérifiés.
Aujourd'hui, après avoir vu les capitaux du monde entier fuir la sphère de la production industrielle, laissant sur le carreau des millions de personnes, financer l'effort d'armement du bloc occidental en finançant le déficit budgétaire américain, nourrir la spéculation boursière, on aboutit à la situation actuelle où les déficits sont tellement colossaux, les rouages financiers et les structures monétaires tellement fragilisés, à la limite de la rupture, une surproduction totale dans tous les secteurs - qu'il s'agisse de l'agriculture, des matières premières, de l'industrie - qu'une nouvelle récession majeure doublée d'une nouvelle période d'inflation est inévitable.
Dans les pays de l'Est, la "libéralisation" ne fait pas illusion. A l'évidence elle couvre idéologiquement une diminution extrêmement grave des charges d'entretien de la force de travail, salaires, logements, santé, transports... Les émeutes en Roumanie sont là pour témoigner de l'insupportable paupérisation. De plus en plus, les conditions ouvrières intolérables des périodes de guerre se répandent sous la seule pression de la crise: rationnement, militarisation....
En Occident devant quel choix se retrouve la bourgeoisie, plus spécifiquement le chef d'orchestre américain ?
- soit maintenir le dollar par une politique de taux d'intérêt élevés. Et ces taux doivent être d'autant plus forts que le dollar est faible, pour soutenir le dollar et attirer les capitaux de toutes les places financières nécessaires au financement de là dette. Orientation qui implique immédiatement une tempête récessioniste aux USA et par contrecoup au niveau mondial;
- soit laisser "filer" le dollar avec une politique de taux d'intérêt bas pour soutenir l’exportation et la production. Ce qui ne peut que provoquer une vague inflationniste très forte. D'autant plus forte que les marchés, les banques sont littéralement assoiffés de devises, d'argent frais et particulièrement l'Etat avec sa dette colossale.
Bien que l'incertitude règne, et on peut-être sûr que cette incertitude sur l'orientation à prendre est essentiellement due à l'immensité et l'insolvabilité du problème plus qu'à une attitude tactique, à l'heure actuelle il semble bien que ce soit la dernière solution qui a été retenue: baisse des taux d'intérêt et du dollar. Donc dans l'immédiat politique inflationniste. Ici les commentateurs évoquent la période électorale aux USA qui dans cette situation ne veulent pas entendre parler de récession. Dans une certaine mesure, celle-ci joue. Mais dans le fond il faut souligner qu'aucun choix n'est donné par l'état de l'économie mondiale, la marge de manoeuvre est extrêmement réduite.
Ainsi si les USA optent dans l'immédiat pour une politique inflationniste en laissant filer le dollar par des taux d'intérêt bas, l'autre alternative d'une puissante récession n'en est pas moins terriblement pressante. Comment et jusqu'où les USA peuvent-ils laisser filer le dollar en le laissant s'approcher de sa valeur réelle ?
On a déjà vu ces deux dernières années qu'une dévaluation de 50% de la monnaie américaine n'a pas permis de rétablir la balance commerciale US. A considérer la compétitivité de l'économie américaine, les déficits accumulés (données qui fondent la valeur d'une monnaie), le dollar en termes réels ne vaut plus grand-chose et les USA ne peuvent se permettre de le laisser s'approcher de la valeur 0. Ils ne peuvent prendre le risque de provoquer avec une telle politique un effondrement du système bancaire américain déjà extrêmement fragilisé.
Donc l'inflation et la récession sont les perspectives immédiates, conjuguées et incontournables.
Le souffle de la crise financière de ce mois d'octobre 87 a brutalement balayé le bluff colossal que représentait la "reprise américaine", le "retour salvateur aux sources de la loi du marché". La situation laisse constater à qui veut le voir le délabrement total dans lequel se trouve l'économie mondiale. Ce qui est vrai pour la santé de l'économie mondiale, l'est aussi en ce qui concerne la condition ouvrière. Et plus spécifiquement en ce qui concerne le chômage qui résume à lui seul l'état général de la condition ouvrière.
A côté du bluff sur la "reprise américaine", nous avons assisté ces dernières années après l'explosion sans précédent du chômage -jusqu'à 12% en moyenne de la population active des pays industriels- à un maquillage de l'état général de ce qu'il est convenu d'appeler le "marché du travail".
Aux USA, tout d'abord, où la pseudo reprise s'accompagnait d'une pseudo baisse du taux de chômage (sans jamais revenir, même officiellement, aux taux d'avant 1980). Ce que cachaient les chiffres absolus n'était en fait qu'une paupérisation sans précédent de la condition ouvrière et de pans entiers des couches moyennes. Dans ces données absolues, la création d'emplois semblait suivre le rythme de leur disparition; mais là où il y avait auparavant dans l'industrie un emploi qualifié, assuré et à peu près "correctement" rémunéré, se substituait un emploi sans qualification dans "les services", instable, une rémunération correspondant à la moitié de ce qu'elle était auparavant.
Tel est le miracle américain.
En Europe, on a eu droit à d'inimaginables contorsions et manipulations de chiffre pour camoufler un tant soit peu "la honte" du chômage. Mieux encore on a pu voir la bourgeoisie "joindre l'utile à l'agréable" en créant des emplois dits "d'utilité publique" (dans beaucoup de pays d'Europe) pour la jeunesse, rémunérés quatre fois moins que le montant du salaire minimum garanti.
Avec le développement de la crise actuelle, comme le bluff de la santé de l'économie mondiale retrouvée, le bluff sur la condition des classes laborieuses va crever lamentablement et laisser apparaître au grand jour la vérité sur la misère de ce monde. Et cette misère va encore faire un bond en avant sans précédent. Telle est la vérité, la vérité à laquelle plus personne ne peut se soustraire, que l'on devra soit accepter avec ses conséquences économiques et militaires, soit combattre avec acharnement. Rappelons-nous ce qu'a signifié la récession de 81-82 pour imaginer les conséquences d'une nouvelle récession sur les plaies encore vives de la vague récessioniste précédente.
Si les années 70 ont été des années d'illusions et les années 80 les années de vérité couverte par un immense bluff, les années à venir seront les années d'une vérité qu'on ne peut plus fuir.
UNE IMMENSE CRISE DE SURPRODUCTION
Une grande majorité de personnes interrogées, avouerait ne rien entendre à l'évolution pourtant bien concrète de la crise économique mondiale. Il est vrai, rien n'est fait dans ce sens, et pour cause. Mais dans le fond, les déterminations essentielles de cette crise mondiale qui dure et s'approfondit depuis des années sont bien plus simples à saisir que ce qui en est dit le laisse supposer. Le développement même de la crise joue lui aussi un rôle de clarification.
La cause immédiate de l'effondrement de la bourse de New York et par sympathie de toutes les autres places boursières, c'est la chute du dollar. A la racine de la chute du dollar, il y a les déficits budgétaires et commerciaux américains. A la racine de ces déficits, la surproduction mondiale. Que cet effondrement ait tant fait de vagues est essentiellement dû au gonflement de la bourse par la spéculation. Cette fièvre spéculative a principalement pour cause la fuite des capitaux de la sphère de la production, cette fuite a elle-même pour cause la surproduction mondiale. De quelque côté que l'on prenne le problème on aboutit à cette détermination essentielle: la surproduction mondiale. Et finalement la crise boursière d'octobre 87, par rapport à toute l’ampleur du problème auquel se trouve confrontée l'humanité, n'est que du pipi de chat.
C'est parce que la société produit "trop" qu'elle engendre la misère. Qu'exprime cette crise de surproduction qui à d'autres époques aurait paru absurde ? sinon que les rapports de production actuels dits "modernes" appartiennent en fait à la préhistoire de l'humanité. Rapports de production anachroniques dominés par la production en fonction du marché et en vue du profit; caractérisés par la séparation des producteurs d'avec les forces productives, c'est-à-dire par l'exploitation du travail, et sa division entre travail intellectuel et travail manuel; rapports de production qui conditionnent la division du monde en nations, division où s'exprime et se concentre tout le déchirement de l'humanité comme le montrent les guerres.
Dans cette crise de surproduction où s'affrontent les nations, à l'Est où à l'Ouest, que nous demandent les classes dominantes, sinon d'être les soldats de la guerre économique avant d'être les soldats de la guerre totale, finale, définitive?
Du point de vue capitaliste la crise de surproduction c'est la guerre de tous contre tous, la guerre sous toutes ses formes, d'abord économique, ensuite par les armes; de notre point de vue, celui de l'avenir, la crise impose l'unification de l'humanité, la destruction des frontières. Soit nous serons capables de mettre sur pied un grand projet mondial qui abolira toutes les séparations, soit nous emprunterons misérablement le chemin de la fin du monde.
Prénat. 30/11/87
Questions théoriques:
- L'économie [90]
Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme
- 4383 reads
La formidable armada déployée par le bloc occidental dans le Golfe persique (voir l'éditorial de la Revue Internationale n° 51) est venue rappeler avec brutalité la nature profonde du système capitaliste, un système qui depuis son entrée en décadence au début du siècle a conduit à une militarisation croissante de toute la société, a stérilisé ou détruit des proportions considérables du travail humain, a transformé la planète en une véritable poudrière. A l'heure où de grands discours sont prononcés par les principaux gouvernements du monde sur la limitation des armements, ou même le désarmement, les faits du Moyen-Orient viennent donc apporter un démenti cinglant aux illusions sur une "atténuation" des tensions militaires et illustrent en particulier de façon éclatante une des composantes majeures des enjeux impérialistes actuels: l'offensive du bloc américain en vue de poursuivre son encerclement du bloc russe et qui passe en premier lieu par la remise au pas de l'Iran. Ces événements, par la remarquable coopération des forces navales des principaux pays occidentaux qu'ils mettent en évidence, soulignent également que les rivalités économiques qui s'aiguisent entre ces mêmes pays n'entravent nullement leur solidarité en tant que membres d'un même bloc impérialiste alors qu'en même temps, le climat belliciste qui imprègne toute la planète ne se traduit pas seulement par des tensions guerrières entre les grands blocs mais se répercute également par des affrontements entre certains pays liés à un même bloc, comme c'est le cas dans le conflit entre l'Iran et l'Irak et, derrière ce dernier, les principaux pays occidentaux.
C'est de cet ensemble de questions, essentielles pour la classe ouvrière, son combat et sa prise de conscience, que se propose de traiter le présent article.
LA GUERRE ET LE MILITARISME DANS LA DECADENCE DU CAPITALISME
Le mouvement ouvrier face a la guerre
Depuis ses origines le mouvement ouvrier a porté une attention soutenue à l'égard des différentes guerres que se livraient entre elles les nations capitalistes. Pour ne citer qu'un exemple on peut rappeler les prises de position de la première organisation internationale de la classe ouvrière, l’A.I.T. à l'égard de la guerre de Sécession aux Etats-Unis en 1864 ([1] [1234]) et de la guerre franco-allemande de 1870 ([2] [1235]). Cependant l'attitude de la classe ouvrière à l'égard des guerres bourgeoises a évolué dans l'histoire, allant du soutien de certaines d'entre elles à un refus catégorique de toute participation. Ainsi, au siècle dernier, les révolutionnaires pouvaient appeler les ouvriers à apporter leur appui à telle ou telle nation belligérante (pour le Nord contre le Sud dans la guerre de Sécession, pour l'Allemagne contre la France du Second Empire au début de leur affrontement en 1870), alors que la position de base de tous les révolutionnaires au cours de la première guerre mondiale était justement le rejet et la dénonciation de tout appui à l'un ou l'autre des camps en présence.
Cette modification de la position de la classe ouvrière à l'égard des guerres, qui fut justement en 1914 le point de clivage crucial dans les partis socialistes (et particulièrement dans la Social-démocratie allemande) entre ceux qui rejetaient toute participation à la guerre, les internationalistes, et ceux qui se réclamaient des positions anciennes du mouvement ouvrier pour mieux soutenir leur bourgeoisie nationale ([3] [1236]), cette modification correspondait en réalité à la modification de la nature même des guerres liée pour sa part à la transformation fondamentale subie par le capitalisme entre sa période ascendante et sa période de décadence ([4] [1237]).
Cette transformation du capitalisme et de la nature de la guerre qui en découle, a été reconnue par les révolutionnaires depuis le début du siècle et notamment lors de la première guerre mondiale. C'est sur cette analyse, en particulier, que se base l'Internationale Communiste pour affirmer l'actualité de la révolution prolétarienne. Depuis ses origines, le CCI s'est réclamé de cette analyse et en particulier des positions de la Gauche Communiste de France qui, déjà en 1945, se prononçait de façon très claire sur la nature et les caractéristiques de la guerre dans la période de décadence du capitalisme:
"A l’époque du capitalisme ascendant, les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, de renforcement et d'élargissement du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d’une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.
A l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.
Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre, négatif par définition, destructeur et entrave au développement de la société, en opposition à la paix qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans un cours objectif, économiquement déterminé.
La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même, le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu’engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.
Il n’existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et déca dente de la société capitaliste et, partant, une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix) dans les deux phases respectives.
Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de biens de consommation, dans la seconde phase, la production est essentiellement axée su la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre (période décadente).
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de la plus-value, mais cela signifie que la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent."
(Rapport à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France, repris dans le rapport sur le Cours Historique adopté au 3e congrès du CCI, Revue Internationale n° 18, 3e trim. 1979).
LA CONFIRMATION DE L'ANALYSE DE LA GAUCHE COMMUNISTE
Ces lignes furent écrites en juillet 1945, alors que la guerre mondiale se terminait à peine en Europe et qu'elle se poursuivait encore en Extrême-Orient. Et tout ce qui s'est passé depuis cette date n'a fait que confirmer amplement l'analyse qu'elles expriment, bien au delà même de ce qu'on avait pu connaître auparavant. En effet, alors qu'au lendemain de la le guerre mondiale on avait pu assister, jusqu'au début des années 30, à une certaine atténuation des antagonismes inter impérialistes, de même qu'à une réduction significative des armements dans la monde, rien de tout cela ne s'est produit au lendemain de la 2e guerre mondiale. Les quelques 150 guerres qui, depuis que la "paix" a été rétablie, se sont déroulées dans le monde ([5] [1238]), avec leurs dizaines de millions de tués, ont bien fait la preuve qu'"il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix", et que "la guerre, prenant un caractère de permanence, est devenue le mode de vie du capitalisme décadent". Et ce qui caractérise toutes ces guerres, comme les deux guerres mondiales, c'est qu'à aucun moment, contrairement à celles du siècle dernier, elles n'ont permis un quelconque progrès dans le développement des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des destructions massives laissant complètement exsangues les pays où elles se sont déroulées (sans compter les horribles massacres qu'elles ont provoqués). Parmi une multitude d'exemples de guerres survenues depuis 1945, on peut prendre celle au Vietnam qui devait permettre, aux dires de ceux qui, dans les années 60 et 70, manifestaient avec les drapeaux du FNL, de construire un pays neuf et moderne, où les habitants seraient délivrés des calamités qui les avaient accablés avec l'ancien régime de Saigon. Depuis la réunification de ce pays en 1975, non seulement les populations vietnamiennes n'ont pas connu la paix (les anciennes "armées de libération" s'étant converties en armées d'occupation du Cambodge), mais leur situation économique n'a cessé de se dégrader à tel point que, lors de son dernier congrès, le parti dirigeant s'est vu obligé de dresser un constat de faillite de l'économie.
LES DESTRUCTIONS DES DEUX GUERRES MONDIALES ET LEURS CONSEQUENCES
Pour aussi catastrophiques qu'elles soient, les destructions provoquées par les différentes guerres qui se sont déroulées depuis 1945, et qui ont surtout affecté des pays faiblement développés, sont évidemment bien en deçà de celles de la première, et surtout de la seconde guerre mondiale qui, elles, avaient concerné les pays les plus développés du monde, notamment ceux d'Europe occidentale. Ces deux guerres, par les différences qu'elles comportent avec celles du siècle dernier «par exemple celle de 1870 entre la France et l'Allemagne sont bien à l'image des transformations subies par le capitalisme depuis cette époque. Ainsi, la guerre de 1870, en permettant la réunification de l'Allemagne, fut pour ce pays une des conditions majeures de son formidable développement de la fin du 19e siècle, alors même que, pour le pays vaincu, la France, elle n'eut pas de réelle conséquence négative malgré les 5 milliards de francs or versés à l'Allemagne pour obtenir le départ de ses troupes: c'est au cours des trois dernières décennies du 19e siècle que la France connaît son développement industriel le plus important (illustré notamment par les expositions universelles de Paris en 1878,1889 et 1900).
En revanche, les deux grandes guerres de ce siècle qui, au départ, ont mis aux prises les deux mêmes antagonistes, ont eu pour principale conséquence non pas un nouveau bond en avant dans le développement des forces productives, mais en premier lieu une dévastation sans précédent de celles-ci et notamment de la principale d'entre elles, la classe ouvrière.
Ce phénomène est déjà flagrant lors de la le guerre mondiale. Dans la mesure même où ce sont les principales puissances capitalistes qui s'y affrontent, la plus grande partie des soldats qui sont fauchés sur le front sont des ouvriers en uniforme. La saignée que la guerre représente pour la classe ouvrière est en proportion non seulement de l'acharnement des combats et de "l'efficacité" des nouvelles armes utilisées au cours de cette guerre (blindés, gaz de combat, etc.), mais aussi du niveau de mobilisation auquel elle donne lieu. Contrairement aux guerres du passé qui n'avaient jeté dans les combats qu'une proportion relativement faible de la population masculine, c'est la quasi-totalité de celle-ci dans la force de l'âge qui est affectée par la mobilisation générale ([6] [1239]), plus d'un tiers qui est tuée ou blessée gravement dans les combats.
D'un autre côté, bien que la le guerre mondiale se soit déroulée du côté occidental sur une faible étendue territoriale et qu'elle ait par conséquent grandement épargné les principales régions industrielles, elle s'est traduite par une chute de près de 30% de la production européenne. C'était principalement la conséquence de la ponction énorme que représentait pour l'économie tant l'envoi sur le front de l'essentiel de la classe ouvrière que l'utilisation de plus de 50% du potentiel industriel dans la fabrication d'armements, ce qui se traduisait notamment par une chute vertigineuse des investissements productifs aboutissant au vieillissement, à l'usure extrême et au non remplacement des installations industrielles.
Expression de l'enfoncement du système capitalisme dans sa décadence, les destructions de la seconde guerre mondiale se situent à une échelle bien plus vaste encore que celles de la première. Si certains pays comme la France ont un nombre plus faible de tués que lors de la le guerre du fait qu'ils ont été rapidement vaincus dès le début des hostilités, le nombre total des morts est environ quatre fois plus élevé (de l'ordre de 50 millions). Les pertes d'un pays comme l'Allemagne, la nation la plus développée d'Europe, où vit le prolétariat le plus nombreux et le plus concentré, s'élèvent à plus de 7 millions, soit trois fois plus qu'entre 1914 et 1918, parmi lesquels figurent 3 millions de civils. Car dans sa barbarie croissante, le capitalisme ne se contente plus de dévorer les prolétaires en uniforme, c'est toute la population ouvrière qui, désormais, non seulement est mobilisée dans l'effort de guerre (comme ce fut déjà le cas lors du 1er conflit mondial) mais qui paye directement le prix du sang. Dans certains pays, la proportion de civils tués excède de très loin le nombre de soldats tués au front: par exemple sur les 6 millions de disparus que compte la Pologne (22% de la population), 600000 seulement (si on peut dire) sont morts dans les combats. En Allemagne, ce sont par exemple 135000 êtres humains (plus qu'à Hiroshima) qui sont tués pendant les 14 heures (en 3 vagues successives) que dure le bombardement de Dresde le 13 février 1945. Presque tous évidemment sont des civils, et la grande majorité des ouvriers. Les quartiers d'habitation ouvriers ont d'ailleurs la faveur des bombardements alliés car cela permet à la fois d'affaiblir le potentiel de production du pays à moindre frais que par l'attaque des installations industrielles souvent enterrées et bien protégées par la DCA (bien que ces installations ne soient pas épargnées évidemment) et, à la fois, de détruire la seule force susceptible de se révolter contre le capitalisme à la fin de la guerre comme elle le fit entre 1918 et 1923 dans ce même pays.
Sur le plan matériel, les dégâts sont évidemment considérables. Par exemple, si la France a eu un nombre "limité" de tués (600000 dont 400000 civils) son économie est ruinée du irait notamment des bombardements alliés. La production industrielle a baissé de près de moitié. De nombreux quartiers urbains ne sont plus que ruines; 1 million d'immeubles ont subi des dégâts. Tous les ports ont été systématiquement bombardés ou sabotés et sont obstrués par des bateaux coulés. Sur 83000 kilomètres de voies ferrées, 37000 sont avariés ainsi que 1900 viaducs et 4000 ponts routiers. Le parc ferroviaire, locomotives et wagons, est réduit au quart de celui de 1938.
L'Allemagne se retrouve aussi, évidemment, aux premiers rangs des destructions matérielles: 750 ponts fluviaux sont détruits sur 948, ainsi que 2400 ponts de chemin de fer et 3400 kilomètres de voies ferrées (pour le seul secteur occupé par les alliés occidentaux); sur 16 millions de logements, près de 2,5 millions sont inhabitables et 4 millions endommagés); un quart seulement de la ville de Berlin est épargné et Hambourg a subi à elle seule plus de dégâts que toute la Grande-Bretagne. En fait, c'est toute la vie économique du pays qui se trouve désarticulée provoquant une situation de détresse matérielle comme la population n'en a jamais connue:
"... en 1945, la désorganisation est générale, et dramatique. La reprise est rendue difficile par le manque de matières premières, l'exode des populations, la raréfaction de la main d'oeuvre qualifiée, l'arrêt de la circulation, l'effondrement de l'administration... Le mark étant devenu sans valeur, on commerce par troc la cigarette américaine sert de monnaie; la sous-alimentation est générale; la poste ne fonctionne plus; les familles vivent dans l'ignorance du sort de leurs proches, victimes de l'exode ou prisonniers de guerre; le chômage général ne permet pas de trouver de quoi vivre; l'hiver 1945-46 sera particulièrement dur, le charbon et l'électricité faisant souvent défaut... 39 millions de tonnes de houille seulement ont été extraites en 1945 et 3 millions de tonnes d'acier seront fabriqués en 1946; la Ruhr travaille à 12% de sa capacité."
(H.Michel, "La Seconde guerre mondiale", PUF, chapitre sur "L'effondrement de l'Allemagne").
Ce tableau —bien incomplet encore— des dévastations provoquées par les deux guerres mondiales, et notamment par la dernière, illustre donc d'une façon particulièrement crue les changements fondamentaux intervenus dans la nature de la guerre entre le 19e siècle et le 20e siècle. Alors qu'au siècle dernier les destructions et le coût des guerres n'étaient pas autre chose que des "faux frais de l'expansion capitaliste -faux frais qui, en général, étaient amplement rentabilisés depuis le début de notre siècle, elles sont des saignées considérables qui ruinent les belligérants, aussi bien les "vainqueurs" que les "vaincus" ([7] [1240]). Le fait que les rapports de production capitaliste aient cessé e constituer la condition du développement des forces productives, qu'ils se soient au contraire convertis en de lourdes entraves à ce développement, s'exprime d'une façon on ne peut plus nette dans le niveau des ravages que subissent les économies des pays gui se sont trouvés au coeur du développement historique de ces rapports de production: les pays d'Europe occidentale. Pour ces pays notamment, chacune des deux guerres se traduit par un recul important de leur poids relatif à l'échelle mondiale tant au plan économique et financier u'au plan militaire au bénéfice des Etats-Unis dont ils deviennent de façon croissante une dépendance. En fin de compte, l'ironie de l'histoire a voulu que les deux pays qui se sont le mieux relevés économiquement à la suite de la seconde guerre mondiale malgré les destructions considérables qu'ils ont subies, sont justement les deux grands vaincus de cette guerre: l'Allemagne D’ailleurs amputée de ses provinces orientales) et le Japon. A ce phénomène paradoxal il existe une explication qui, loin de démentir notre analyse, la confirme au contraire amplement.
En premier lieu, le relèvement de ces pays n'a pu avoir lieu que par le soutien économique et financier massif apporté par les Etats-Unis à travers notamment le plan Marshall, soutien qui fut un des moyens essentiels par lesquels cette puissance s'est assurée une fidélité sans faille de ces pays. Par leurs propres forces, ces pays auraient été dans l'incapacité complète d'obtenir les "succès" économiques que l'on connaît. Mais ces succès s'expliquent aussi et surtout, notamment pour le Japon, par le rait que, durant toute une période, l'effort militaire de ces pays -en tant que pays vaincus- a été volontairement limité par les "vainqueurs" à un niveau bien moindre que celui de leur propre effort. C'est ainsi que la part du PNB du Japon consacré au budget des armées n'a jamais, depuis la guerre, dépassé le seuil de 1%, ce qui est très en deçà de la part qu'y consacrent les autres principaux pays.
LE CANCER DU MILITARISME RONGE L'ECONOMIE CAPITALISTE
Nous retrouvons donc là une des caractéristiques majeures du capitalisme dans sa période de décadence telle qu'elle a déjà été analysée par les révolutionnaires dans le passé: le fardeau énorme que représentent pour son économie les dépenses militaires, non seulement dans les périodes de guerre mais aussi dans les périodes de "paix". Contrairement à ce que pouvait écrire Rosa Luxemburg dans "L'accumulation du Capital" (et c'est la seule critique importante qu'on peut faire à ce livre), le militarisme ne représente nullement un champ d'accumulation pour le capitalisme. Bien au contraire: alors que les biens de production ou les biens de consommation peuvent s'incorporer dans le cycle productif suivant en tant que capital constant ou capital variable, les armements constituent un pur gaspillage du point de vue même du capital puisque leur seule vocation est de partir en fumée (y compris au sens propre) quand ils ne sont pas responsables de destructions massives. Ce fait s'est illustré de façon "positive" pour un pays comme le Japon qui a pu consacrer l'essentiel de sa production, notamment dans les secteurs de haute technologie, à développer les bases de son appareil productif, ce qui explique (outre les bas salaires payés à ses ouvriers) les performances de ses marchandises sur le marché mondial. Cette réalité s'est également illustrée de façon éclatante, mais de façon négative cette fois, dans le cas d'un pays comme l'URSS dont l'arriération présente et l'acuité des difficultés économiques résultent pour une large part de l'énorme ponction que représente la production d'armements: lorsque les machines les plus modernes, les ouvriers et les ingénieurs les plus qualifiés sont presque tous mobilisés dans la production de tanks, d'avions ou de missiles, il reste bien peu de moyens pour fabriquer par exemple des pièces détachées pour les innombrables tracteurs immobilisés, ou construire des wagons permettant d'acheminer des récoltes qui sont condamnées à pourrir sur place alors que les queues devant les magasins s'allongent dans les villes. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, l'URSS tente de desserrer cet étau que représentent pour son économie les dépenses militaires en prenant l'initiative d'un certain nombre de négociations avec les USA en vue de la réduction des armements.
Enfin, la première puissance mondiale n'échappe pas, elle non plus, aux conséquences catastrophiques des dépenses d'armement pour son économie: son énorme déficit budgétaire qui n'a cessé de progresser depuis le début des années 80 (et qui après avoir permis la "reprise" tant vantée de 1983, apparaît clairement aujourd'hui comme un des responsables de l'aggravation de la crise) accompagne avec un parallélisme remarquable l'accroissement considérable des budgets de défense depuis cette même date. L'accaparement par le secteur militaire du fleuron des forces productives (potentiel industriel et scientifique) n'est pas propre à l'URSS: la situation est identique aux USA (la différence étant que le niveau de technologie mis en oeuvre dans la fabrication des tanks en URSS est en deçà de celui qui est utilisé dans la fabrication des tracteurs aux USA et que les ordinateurs "grand public" américains sont copiés par PURSS pour ses besoins militaires). Dans ce dernier pays, par exemple, 60 % des efforts publics de recherche sont officiellement consacrés aux armements (95 % en réalité) ; le centre de recherche atomique de Los Alamos (celui qui a fabriqué la première bombe A) est systématiquement le bénéficiaire du premier exemplaire de chacun des ordinateurs les plus puissants du monde (Cray I, puis Cray II, Cray III) lors de leur apparition; l'organisme CODASYL gui a défini dans les années 60 le langage de programmation informatique COBOL (un des plus utilisés dans le monde) était dominé par les représentants de l'armée américaine; le nouveau langage ADA, qui est appelé à devenir un des "standards ' de l'informatique mondiale, a été directement commandité par le Pentagone... La liste pourrait encore s'allonger des exemples démontrant la mainmise totale du militaire sur les secteurs de pointe de l'économie, mettant en évidence la stérilisation considérable de forces productives, et particulièrement les plus performantes, que représentent les armements, tant aux Etats-Unis que dans les autres pays.([8] [1241])
En effet, ces données concernant la première puissance mondiale ne sont qu'une illustration d'un des phénomènes majeurs delà vie du capitalisme dans sa phase de décadence: même en période de "paix" ce système est rongé par le cancer du militarisme. Au niveau mondial, d'après les estimations de PONU, ce sont 50 millions de personnes qui sont concernées dans leur emploi par le secteur de la défense et parmi elles 500000 scientifiques. Pour Tannée 1985 ce sont quelque 820 milliards de dollars qui ont été dépensés dans le monde en vue de la guerre (soit presque l'équivalent de toute la dette du tiers-monde).
Et cette folie ne fait que s'amplifier d'année en année: depuis le début du siècle les dépenses militaires (à prix constants) ont été multipliées par 35.
LES ARMES ET LES CONSEQUENCES D'UNE 3ème GUERRE MONDIALE: ILLUSTRATION DE LA BARBARIE DU CAPITALISME DECADENT
Cette progression permanente des armements se concrétise notamment par le fait qu'à l'heure actuelle, l'Europe -qui constitue le théâtre central d'une éventuelle 3e guerre mondiale - recèle un potentiel de destruction incomparablement plus élevé qu'au moment de l'éclatement de la seconde guerre mondiale: 215 divisions (contre 140), 11500 avions et 5200 hélicoptères (contre 8700 avions), 41600 chars de combat (contre 6000) auxquels il faut ajouter 86000 véhicules blindés de toutes sortes. A ces chiffres il faut ajouter, sans compter les forces navales, 31000 pièces d'artillerie, 32000 pièces anti-char et tous les missiles de toutes sortes, "conventionnels" et nucléaires. Les armes nucléaires elles-mêmes ne disparaîtront nullement avec la concrétisation (si elle a lieu) du récent accord entre URSS et USA sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire. A côté de toutes les bombes transportées par des avions et des missiles à courte portée, l'Europe continuera d'être menacée par les quelque 20000 ogives "stratégiques" transportées par des sous-marins et des missiles intercontinentaux ainsi que par les dizaines de milliers d'obus et de mines nucléaires. Si une guerre devait donc éclater en Europe, sans même qu'elle prenne la forme nucléaire, elle provoquerait sur ce continent des ravages terrifiants (notamment du fait de l'utilisation des gaz de combat et des nouveaux explosifs dits "quasi-nucléaires" d'une puissance sans commune mesure avec celle des explosifs classiques, mais aussi par l'anéantissement de toute l'activité économique qui aujourd'hui dépend de façon vitale des transports et de la distribution d'électricité, lesquels seraient paralysés: les populations épargnées par les bombardements et les gaz mourraient de faim!). L'Allemagne, en particulier, qui constituerait le principal théâtre des combats, serait pratiquement rayée de la carte. Mais une telle guerre ne se contenterait pas de mettre en oeuvre les seuls armements conventionnels. Dès lors qu'un des deux camps verrait se dégrader sa situation, il serait amené à utiliser d'abord son arsenal nucléaire "tactique" (artillerie à obus nucléaires et missiles de courte portée munis de charges à "faible" puissance) pour en arriver, suite aux ripostes équivalentes de l'adversaire, à l'emploi de son arsenal "stratégique" composé d'une dizaine de milliers de charges à "forte" puissance: ce serait purement et simplement la destruction de l'humanité ([9] [1242]).
Un tel scénario, pour dément qu'il paraisse, est de loin le plus probable si la guerre éclatait en Europe: c'est celui, par exemple, qu'a retenu l'OTAN pour le cas où ses forces seraient débordées par celles du Pacte de Varsovie dans des affrontements conventionnels dans cette région du monde (concept stratégique dit de "riposte graduée"). Car il ne faut pas se bercer d'illusions sur une possibilité de "contrôle" par les deux blocs d'une telle escalade: les deux guerres mondiales, et notamment la dernière -qui fut conclue par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki— nous ont déjà montré que la totale absurdité que représente pour la société, depuis le début du siècle, le mode de production capitaliste, ne s'exprime pas seulement par le poids de plus en plus écrasant du militarisme sur l'économie, ni par le fait que la guerre ait perdu toute rationalité économique réelle, elle se manifeste également par l'incapacité pour la classe dominante de contrôler l'engrenage qui conduit à la guerre totale. Mais si cette tendance n'est pas nouvelle, son plein développement, qui accompagne l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence, introduit une donnée nouvelle: la menace d'une destruction totale de l'humanité que seule la lutte du prolétariat peut empêcher.
La deuxième partie de cet article s'attachera à mettre en évidence les caractéristiques présentes des affrontements inter impérialistes et notamment la place et la signification que prend au sein de ces derniers le déploiement de l'armada occidentale dans le Golfe Persique.
RM. 30/11/87
[1] [1243] Voir l'adresse envoyée le 29 novembre 1864 par le conseil central de PA.I.T. (Association Internationale des Travailleurs, le Internationale), à Abraham Lincoln à l'occasion de sa réélection et l'Adresse au président Andrew Johnson du 13 mai 1865.
[2] [1244] Voir les deux adresses du Conseil Général sur la guerre franco-allemande des 23 juillet et 9 septembre 1870.
[3] [1245] C'est ainsi que la presse officielle social-démocrate allemande saluait en 1914 la guerre contre la Russie: "La social-démocratie allemande a depuis longtemps accusé le tsarisme d'être le rempart sanglant de la réaction européenne, depuis l'époque où Marx et Engels poursuivaient tous les faits et gestes de ce régime barbare de leurs analyses pénétrantes... Puisse maintenant venir l'occasion d'en finir avec cette société effroyable sous les drapeaux de guerre allemands." (Frankfurter Volksstimme du 31 juillet, cité par Rosa Luxemburg dans "La Crise de la Social-Démocratie").
Ce à quoi Rosa Luxemburg répondait: "Le groupe social-démocrate avait prêté à la guerre le caractère d'une défense de la nation et de la civilisation allemandes; la presse social-démocrate, elle, la proclama libératrice des peuples étrangers. Hindenburg devenait l'exécuteur testamentaire de Marx et Engels." (Ibid)
De même, Lénine pouvait écrire en 1915: "Les sociaux-démocrates russes (Plekhanov en tête) invoquent la tactique de Marx dans la guerre de 1870; les social chauvins allemands (genre Lensch, David et Cie) invoquent les déclarations d'Engels en 1891 sur la nécessité pour les socialistes allemands de défendre la patrie en cas de guerre contre la Russie et la France réunies...Toutes ces références déforment d'une façon révoltante les conceptions de Marx et d'Engels par complaisance pour la bourgeoisie et les opportunistes... Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx: 'Les ouvriers n'ont pas de patrie', paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois." (Lénine, le socialisme et la guerre, Oeuvres T. 21, p. 319-20).
[4] [1246] C'est pour cela que les
courants politiques, tel le bordiguisme ou le GCI, qui, aujourd'hui encore sont
incapables de comprendre le caractère décadent du mode de production
capitaliste, sont bien en peine pour expliquer pourquoi, de points de vue aussi
prolétariens l'un que l'autre, Marx pouvait soutenir l'Allemagne contre la France au début de la
guerre de 70 (tant que Napoléon III n'était pas renversé et avant que la Prusse n'envahisse le
France) et Lénine dénoncer toute participation à la première guerre mondiale.
[5] [1247] La liste de toutes ces guerres suffirait à remplir une page complète de cette Revue. On peut seulement citer, à titre d'illustration, quelques unes parmi les plus meurtrières : les guerres d’Indochine et d’Afrique du Nord entre 1945 et 1962, ont aboutit au départ de la France de ces régions, les cinq guerres dans lesquelles a été impliqué l’Etat d’Israël contre les pays arabes (1948, 1957, 1966, 1973 et 1982); les guerres du Vietnam et du Cambodge entre 1963 et 1975 (dans ce dernier pays après l’intervention du Vietnam fin 78, la guerre se poursuit encore), guerre, brève mais très meurtrière, entre la Chine et le Vietnam au début 1979 ; la guerre en Afghanistan qui dure depuis 8 ans, et celle entre l’Iran et l’Irak, vieille de 7 ans. On pourrait encore citer de multiples conflits dans lesquels l’inde a été mêlée après son indépendance sous la conduite du « non-violent Gandhi (guerres contre le Pakistan au Cachemire, au Bangladesh) et tout dernièrement, guerre contre les Tamouls au Sri lanka. A ce tableau il est également nécessaire d'ajouter les dizaines de guerres qui ont ravagé et continuent de ravager l'Afrique noire et l'Afrique du Nord-Est: Angola, Mozambique, Ouganda, Congo, Ethiopie, Somalie, etc., et évidemment Tchad.
[6] [1248] Par exemple, les guerres napoléoniennes, qui furent les plus importantes du 19e siècle, n'ont jamais occupé du côté français plus de 500000 nommes pour une population totale de 30 millions de personnes, alors qu'au cours de la le guerre mondiale, ce sont plus de 5 millions de soldats qui ont été mobilisés pour une population française de 39,2 millions.
[7] [1249] Aussi bien lors de la première guerre mondiale que lors de la seconde, le seul pays qu'on peut considérer comme Vainqueur" est les Etats-Unis dont le niveau de la production au lendemain des conflits est nettement au-dessus du niveau existant à la veille de ceux-ci. Mais ce pays, pour important qu'ait été son rôle dans ces guerres, et notamment lors de la seconde, a bénéficié d'un privilège qui était refusé aux pays qui se trouvaient à l'origine du conflit: son territoire se trouvait à des milliers de kilomètres des zones de combat, ce qui lui a permis de s'éviter tant les pertes civiles que la destruction du potentiel industriel et agricole. L'autre "vainqueur" de la seconde guerre, l'URSS, qui accède à la suite de celle-ci au rang de puissance mondiale, notamment en établissant sa domination sur l'Europe centrale et une partie de l'Extrême-Orient, a payé sa "victoire'" au prix fort de 20 millions de morts et de destructions matérielles considérables qui ont contribué grandement à maintenir son économie à un niveau de développement loin derrière celui de l'Europe occidentale et même derrière celui de la plupart de ses "satellites".
[8] [1250] La thèse des "retombées technologiques positives pour l'économie et le secteur civil de la recherche militaire est une vaste fumisterie oui est immédiatement démentie quand on compare la compétitivité technologique civile du Japon et de la RFA (qui consacrent 0,01% et 0,10% PNB à la recherche militaire) a celle de la France et de la Grande-Bretagne (0,46% et 0,63%).
[9] [1251] Des études sur les conséquences d'un conflit nucléaire généralisé mettent en évidence que les 3 milliards (sur 5) d'êtres humains qui seraient épargnés le premier jour ne pourraient pas survivre aux calamités qui surviendraient les jours suivants: retombées radioactives, rayons ultraviolets mortels suite à la disparition de la couche d'ozone de l'atmosphère, glaciation du fait du nuage de poussières plongeant la terre entière dans une nuit de plusieurs années. La seule forme de vie qui subsisterait aurait la forme de bactéries, au mieux d'insectes.
Questions théoriques:
- Guerre [279]
- Impérialisme [11]
Débat International : crise et décadence du capitalisme (Critique au CCA, Mexique)
- 2898 reads
Grupo Proletario Internacionalista, Mexique
Présentation
Dans la Revue Internationale n° 50 nous avions rapidement présenté le Grupo Proletario Internacionalista du Mexique à l'occasion de la sortie du premier numéro de leur revue: Revolucion Mundial. Aujourd'hui, au moment où vient de sortir le deuxième numéro, nous publions ici un texte de critique du GPI aux "thèses du Collectif Communiste Alptraum" (CCA), lui aussi du Mexique ([1] [1252]), publiées dans notre Revue Internationale n° 40 en janvier 1985.
Laissons le GPI lui-même se présenter à nos lecteurs:
"Nous nous sommes constitués il y a seulement quelques mois comme groupe politique avec le nom de GPI et unis autour des principes ([2] [1253]) présentés dans le premier numéro de notre publication Revolucion Mundial. Dans la période immédiatement antérieure, nous étions fondamentalement un 'groupe de discussion', un regroupement en grande partie informel du point de vue organisatif (sans nom, sans normes de fonctionnement organique, etc.) et, dans un effort de discussion et de clarification politique, politiquement centré et orienté en son sein principalement vers la précision des frontières de classe' ou des principes à défendre.
Cette rapide esquisse de la formation du GPI serait incomplète si nous ne mentionnons pas un fait important: l'influence de la propagande du milieu communiste international et, en particulier de l'activité d'intervention que réalise le CCI depuis plusieurs années au Mexique.
Ainsi donc, en résumé, le GPI est un nouveau groupe, qui se constitue, en général, en rupture avec l'idéologie bourgeoise et nationaliste, plus particulièrement gauchiste, aux effets si néfastes en Amérique Latine. Le GPI ne revendique aucune continuité, ni organisationnelle, ni politique, avec aucun groupe ayant existé dans le pays -sauf l'exception représentée par le 'Groupe des Travailleurs Marxistes’ ([3] [1254]), existant à la fin des années 30 dans le pays, qui fit partie des fractions de 'Gauche Communiste' et dont le GPI se revendique. La formation du GPI s'inscrit dans le processus de resurgissement de minorités communistes dans le monde, particulièrement à partir du resurgissement historique de la lutte de classe ouvrière mondiale depuis 1968."
L'existence de deux groupes communistes le CCA et le GPI- partageant grosso modo les mêmes positions politiques peut surprendre. Et effectivement, si cette situation devait se prolonger, elle deviendrait # l'expression d'une faiblesse des forces révolutionnaires au Mexique. Pour l'instant, elle n'est que le fruit des circonstances, d'éléments révolutionnaires surgissant, d'un milieu tout juste naissant. En liens étroits avec le milieu révolutionnaire international, l'établissement de rapports politiques entre les deux groupes, de discussions, de débats, est la condition sine qua non pour l'indispensable clarification politique de tous les éléments révolutionnaires du pays. Elle est la condition première pour le regroupement des deux groupes, et des éléments isolés, pour la création d'une présence politique du prolétariat unique et unie au Mexique.
Ne serait-ce que pour cette raison, nous devrions saluer l'existence du texte du GPI que nous publions ici: Crise et décadence du capitalisme (critique du CCA). Cette critique s'inscrit tout à fait dans l'esprit fraternel dont nous venons de souligner la nécessité: c'est un texte engageant le débat avec le CCA en vue de clarifier la question de l'explication des crises économiques du capitalisme et de la période actuelle de décadence de ce dernier.
Ensuite, le choix de la crise et de la décadence du capitalisme comme débat et discussion pour des nouveaux camarades qui viennent juste d'adopter des positions de classe est le signe de leur volonté d'établir sérieusement les fondements mêmes des positions révolutionnaires. Voici ce que nous écrivions sur ce débat de la décadence lors de notre salut à Comunismo n° 1, la publication du CCA:
"Et ne croyez pas que cette question ne concerne que des historiens pointilleux sur les dates, ni qu'elle constitue une question théorique en soi sans implications pratiques pour les révolutionnaires. La reconnaissance et la compréhension de la fin de la période historiquement progressiste du capitalisme et son entrée en déclin sont à la base de la formation de la 3e Internationale sur les ruines de la 2e Internationale morte en 1914. Elles fondent la cohérence de l'ensemble des positions de classe que les camarades partagent avec le CCI. Et en particulier la dénonciation des syndicats comme organes de l'Etat capitaliste au 20e siècle et des mouvements de libération nationale comme moment des antagonismes inter impérialistes aujourd'hui. " (Revue Internationale n ° 44).
Enfin, nous saluons ce texte par son sérieux, sa qualité, et surtout la critique et la prise de position juste que les camarades prennent vis à vis des Thèses du CCA. Nous avions déjà rapidement critiqué les prises de position du CCA ([4] [1255]) sur son explication des crises du capitalisme par la seule loi de "la baisse tendancielle du taux de profit", et surtout l'incapacité du Collectif Alptraum à situer clairement l'entrée en décadence du capitalisme avec le 20e siècle marquée en particulier par l'éclatement du premier holocauste mondial en 1914. Malgré quelques erreurs que nous soulignons en note dans le cours du texte, les camarades du GPI défendent l’explication marxiste des crises et la réalité de la décadence du capitalisme depuis le début de ce siècle.
Le texte du GPI s'inscrit dans l'effort que nous avons accompli dernièrement dans les numéros 47, 48 et 49 de cette revue par la publication d'une série d'articles polémiques avec le GCI justement sur la question de la décadence. Et nous prévoyons de continuer cet effort dans notre prochain numéro. Que des groupes comme le CCA et le GPI —qui tous deux reconnaissent l'existence de la décadence du capitalisme-- participent à ce débat est signe que malgré les difficultés de tous ordres qu'affrontent les faibles forces révolutionnaires de par le monde, l'heure est au surgissement, au développement, à la clarification politique et au regroupement de ces forces. Par leur sérieux, par leur effort de réappropriation des leçons et des débats du passé, par leur soucis de clarification, par leur volonté de discussion, le CCA et le GPI interpellent l'ensemble des courants politiques prolétariens actuels, et ridiculisent les "théories anti-décadentistes" du GCI, les "découvertes" savantes de la FECCI sur le capitalisme d'Etat et autres élucubrations modernistes qui tournent le dos au marxisme.
CCI 25/10/87
CRISE ET DECADENCE DU CAPITALISME (Critique au CCA.)
L'objet de cet article est, au travers de la critique au Colectivo Comunista Alptraum, d'essayer de contribuer à la clarification des positions de notre groupe sur la crise et la décadence du capitalisme.
Nous avons choisi d'exposer notre point de vue sous la forme d'une polémique car les tentatives de le faire sous forme de thèses produisaient de pures généralités, des conclusions sans arguments, qui en ce moment n'aideraient pas à la discussion interne.
Nous sommes partis de la critique de vos positions car nous pensions commencer en même temps une discussion directe avec le CCA. Bien que sachant que cette dernière n'a pu se développer, la délimitation reste nécessaire car le Colectivo est un groupe en relation avec le milieu international.
Nous aborderons les questions suivantes:
1- les caractéristiques de la crise actuelle.
2- les causes de la crise.
3- les limites du marché.
4- les particularités de l'époque de la décadence du capitalisme.
Nous faisons la critique à partir de vos thèses et de parties de vos autres écrits où est développé le point traité. Nous utilisons votre revue "Comunismo" n°l et 2.
- "elle a une dimension mondiale", à cause de l'extension mondiale du capitalisme et de sa domination sur toutes les branches de la production. Une telle crise décrit une spirale qui part des pays développés vers le reste du système capitaliste mondial;
- "elle doit être conque comme une crise classique de suraccumulation " dans laquelle se vérifie le cycle prospérité-crise-stagnation.
La première particularité est de la plus grande importance pour comprendre le cours de la situation mondiale. Le capitalisme s'est étendu à toute la planète et, pour cela même, la crise, inhérente au capitalisme lui-même, est devenue elle aussi mondiale. L'interpénétration de l'économie de tous les pays, la création du marché mondial, empêche quiconque d'échapper au coup de fouet de la crise. De là, nous devons relever qu'il n'existe pas de solution nationale à la crise. Aussitôt^ qu'un pays ou une région donne des indices de reprise, il se retrouve de nouveau happé dans le tourbillon de cette crise mondiale. L'issue ne peut qu'être à l'échelle planétaire et, comme nous le verrons plus loin, seuls deux chemins y mènent: la guerre ou la révolution.
Mais alors le second point, le caractère cyclique de la crise, est un contresens; il nie la validité du premier à moins de penser qu'à partir de la moitié des années 60 le capitalisme ait connu une véritable phase de prospérité. L'idée que cette crise est "mondiale", et à la fois vérification du cycle prospérité-crise-stagnation conduit le Colectivo à réaliser des jongleries quand il s'agit d'analyser la situation concrète.
Parfois, il semble qu'effectivement il parle de crise mondiale qui se serait développée et approfondie à partir de la fin des années 60. Il mentionne "la crise qui s'est aggravée dans les dernières décennies", que les "prolégomènes de la crise actuelle se trouvent au milieu des années 60" et que depuis ces années le PIB décroît et que le chômage augmente. Mais en même temps il dit que "les crises cycliques de surproduction dans leur périodicité... tendent à être chaque fois plus profondes, surtout à partir de 1968." Le Colectivo résout ce contresens par l'introduction de deux concepts: la "récession" et la "reprise relative", nous apprenons que, selon le CCA.:
"En 1973-74, le renchérissement du pétrole a touché les aires centrales du capitalisme car il a accentué la chute de leur taux de profit. 1974-75 fut une phase de récession où les aires de la périphérie, fondamentalement pétrolières, se retrouvèrent moins affectées puisque, par la hausse du pétrole et le transfert de capital, on augmenta le capital et elles purent soutenir un rythme accéléré d'accumulation dans la phase suivante de relative reprise. 1980-83 est une autre phase de récession mais où s'est déroulé le contraire: le pétrole a baissé et cela a contrecarré la chute du taux de profit des aires centrales alors que les pays des aires périphériques restaient submergés par la dépression; situation aggravée par le transfert de plus-value du capital financier mondial. Ce transfert a contribué, dans la période de reprise relative, à renforcer l’aire centrale. Malgré cela, à la fin 85 les aires centrales recommencent à présenter des symptômes de récession par les mesures de réorganisations prises; et en outre, cette récession a touché aussi les pays pétroliers. (n°2, Editorial).
LES CARACTERISTIQUES DE LA CRISE
Dans ses thèses, le CCA. relève deux particularités de la crise actuelle:
De quoi s'agit-il, donc? Si depuis 1968, il y a eu plusieurs crises cycliques, nous devons supposer que pour le Colectivo ce qu'il appelle "récession" seraient précisément de telles crises et que les phases de "reprise relative" équivaudraient à la prospérité. Nous aurions eu crise en 74-75, en 80-83 et depuis 85, et prospérité " en 76-79, 84-85 et nous nous dirigerions vers une de plus. Dans un tel cas, on ne voit pas pourquoi utiliser ces termes, pris de l'arsenal de l'idéologie bourgeoise dont la signification est ambiguë.
Mais le Colectivo sait bien qu'en réalité la situation n'est pas comme cela. Si il parle de "reprise relative", c'est parce qu'il sait que l'économie mondiale n'a connu aucune "reprise absolue" depuis 68. Si il parle de "récession", c'est parce qu'il doit différencier les "transferts de capital" de la véritable crise générale mondiale.
Si on devait mener le raisonnement du Colectivo à ses conséquences ultimes où le "transfert de capital" dans les phases de "récession" ouvre la porte à la "reprise", nous arriverions: premièrement à ce que la crise soit seulement régionale (puisque dans la "récession" des aires sont "plus affectées que d'autres), et deuxièmement à ce que la crise ait une solution nationale. Ainsi, dans la phase de récession 74-75, les pays pétroliers gagnèrent une grande masse de capital ce qui leur permit de "soutenir un rythme accéléré d'accumulation dans la phase de relative reprise", bien sûr que le Colectivo ne partage pas le rêve des fractions bourgeoises: la possibilité de sortir de la crise au détriment des autres. Mais une telle idée découle de l'identification de la "récession" avec la "crise cyclique".
Nous devons donc reconnaître:
- que depuis le milieu des années 60, le capitalisme mondial n'a pas connu de phase de prospérité sinon que, compulsivement, chaque fois il s'enfonce encore plus dans la stagnation et la paralysie; et que la "reprise relative" de quelques régions n'est seulement que momentanée et au prix de la chute générale;
- que le caractère mondial des rapports de production capitalistes et, donc, de la crise, rend impossible une réelle issue nationale à cette dernière.
En d'autres termes, que depuis le milieu des années 60 a commencé une crise chronique du capitalisme comme système mondial, qui tend à s'approfondir et à se généraliser de manière inévitable. Qu'il n'existe plus le cycle crise-stagnation-prospérité.
Il est certain qu'en théorie ce cycle indique la vie du capitalisme: la crise se présente comme solution momentanée aux contradictions du capitalisme lui-même, comme destruction de forces productives qui ouvre la porte à une nouvelle phase de prospérité. Une crise "chronique" ou "permanente" ne pourrait pas exister théoriquement car elle signifierait la destruction totale de forces productives, la chute définitive du capitalisme. C'est probablement pour cela que le Colectivo soutient l'idée du "cycle classique".
Paradoxalement, par la forme dans laquelle elle s'est étendue et approfondie durant toutes ces années, comparée à la crise périodique du siècle passé, la crise actuelle se présente précisément comme une crise permanente. Plus encore. A partir du 20e siècle, nous voyons que les crises conduisent à des guerres de destruction e forces productives; que le capital, dans son esprit de conservation, tend réellement à la chute définitive, entraînant à sa suite l'humanité. Que ce cycle industriel "classique" s'est renversé en cycle barbare de crise-guerre-reconstruction. ([5] [1256])
Ce dont il s'agit c'est d'expliquer les faits, et en dernière instance, d'"adapter la théorie à la réalité et, non comme le prétend parfois le Collectif, la réalité à la théorie. C'est pour cela que nous devons aller aux causes de la crise.
LES CAUSES DE LA CRISE
Le développement du capitalisme est déterminé par ses contradictions; celles-ci le mènent à la crise. La crise est l'expression ouverte de toutes les contradictions du capitalisme et en même temps leur solution momentanée. En dernière instance, la cause de la crise est la contradiction fondamentale du capitalisme. C'est pour cela que trouver la cause de la crise c'est définir les contradictions du capitalisme et spécialement la contradiction fondamentale.
De la manière la plus générale et la plus résumée, ces contradictions peuvent être exprimées ainsi: pour pouvoir vivre les hommes ont besoin de se lier pour produire, de contracter des rapports de production déterminés qui sont indépendants de leur volonté et qui correspondent à un degré déterminé de développement de leurs instruments de production et de leur forme d'organisation du travail, du développement des forces productives. A certains moments, les forces productives tendent à déborder les rapports de production. De cadre adéquat les rapports de production se convertissent en une entrave pour le développement ultérieur des forces productives. Ils ont besoin d'être transformés et ils le sont. S'ouvre une époque de révolution sociale où les vieux rapports de production doivent être détruits et à leur place s'instaurent d'autres, nouveaux, en accord avec les conditions matérielles de la production. Dans le capitalisme, la contradiction entre le développement des forces productives et les rapports capitalistes de production donne lieu à la crise.
La paralysie des usines et la masse de produits qui ne trouvent pas de sortie, tout comme l'armée de sans-emploi, indiquent que les forces productives sont excessives pour les rapports de production basés sur l'accumulation de capital, sur l'obtention de profits. Chaque crise met en question l'existence du capitalisme.
Mais en même temps, chaque crise se présente comme solution momentanée des contradictions. D'un côté par la destruction d'une partie des forces productives; de l'autre, par une extension du cadre des rapports de production ce qui ne fait rien d'autre que préparer de nouvelles crises chaque fois plus larges et plus profondes.
Dans ce sens, le Collectif souligne:
"La crise que nous vivons est le résultat du choc entre le développement énorme atteint par les forces productives, c'est à dire par la richesse existante, et les rapports capitalistes de production qui imposent l'appropriation privée de celle-ci". Dans les crises s'exprime
"le caractère historiquement limité de ses rapports de production qui ne peuvent contenir, en leur sein, le développement progressif des forces productives sociales. Les moments de crise sont ceux dans lesquels le capitalisme doit nécessairement détruire une masse croissante de forces productives, mettant en évidence, de cette manière sa nature décadente" (thèses du C.CA.; Revue Internationale 40).
Cependant, une explication si générale des contradictions ne nous explique pas ses causes déterminantes. Elle ne nous dit toujours rien de la contradiction fondamentale et elle n'est pas non plus une explication des caractéristiques de la crise actuelle.
Le Collectif n'élargit son point de vue dans les thèses que lorsqu'il touche à la question de la décadence. Mais avant de discuter la relation entre crise et décadence, nous devons arriver aux causes de la crise et pour cela, pour le moment, nous traiterons de manière séparée ce qu'il dit sur ce point. Le Colectivo fait découler la crise de la loi de la tendance décroissante du taux de profit:
"Aussi bien le développement que le déclin du système reposent sur deux déterminations essentielles, à savoir, une qui se manifeste par la baisse tendancielle du taux de profit"... (Revue Internationale 40).
Ensuite, il tente de résumer cette loi dans les points suivants:
- l’objectif du système est la "formation ininterrompue et croissante du capital";
- ce qui implique l'expansion du capital, l'augmentation de la productivité du travail et un développement accéléré des forces productives;
- ce qui précède se traduit par la croissance de la composition organique du capital: le volume du capital constant (moyens de production) croit plus par rapport au capital variable (force de travail) qui est celui qui produit la plus-value;
- ceci mène à la chute du taux de profit.
"C'est à ce moment qu 'apparaît la crise capitaliste"... "quand la composition organique croissante ne correspond pas une augmentation équivalente de valeur"... "la suraccumulation par rapport à la capacité d'exploiter le travail conduit le système capitaliste à la crise. "
Suivons la polémique du Collectif avec le C.C.I., là où il élargit son exposition (Comunismo 2, p.34; organe du CCA.). La critique du CCI. réside en ce que ce dernier considère insuffisante la loi du taux décroissant de profit comme explication des causes de la crise car pour le CCI. "la contradiction fondamentale du capitalisme se trouve dans son incapacité à créer indéfiniment les marchés pour son expansion. "
Le Collectif lui réplique qu'il "ne rejette pas le problème de la réalisation" mais que c'est une erreur "de situer la contradiction fondamentale dans la sphère de l'échange" (Comunismo 2).
Et le Collectif ajoute:
"quand nous nous référions au niveau des déterminations essentielles (dans les thèses), nous nous référions simplement au niveau où se génère et se produit la plus-value qui, suivant Marx, est la source de la richesse capitaliste"... "La contradiction fondamentale du mode de production et d'échange capitaliste se situe au pôle dominant de cette totalité, c'est-à-dire, dans le cadre de la production. Bien qu'aussi dans sa singularité, elle puisse être déterminée par l'échange, la distribution et la consommation. " La contradiction de la production est entre "le processus de valorisation du capital et le procès de travail." (Comunismo 2, p.35)
Le C.C.A. situe la contradiction fondamentale dans la production car c'est là que se génère la plus-value, car c'est le "pôle dominant" par rapport à l'échange. Cependant, nous "rappelant de Marx nous aussi, nous devons dire que si la plus-value se génère seulement dans la production, analogiquement, elle se réalise dans l'échange.
"Si, au travers du procès de production, le capital se reproduit comme valeur et valeur nouvelle, en même temps il se trouve comme non-valeur, comme quelque chose qui ne se valorise pas tant qu 'elle ne rentre pas dans l'échange... " (Marx, Grundisse, trad.par nous de l'espagnol).
"Les conditions de l'exploitation directe et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles divergent non seulement quant au temps et au lieu, mais aussi conceptuellement. Les unes sont limitées par la force productive de la société, alors que les autres le sont seulement par la proportionnalité entre les différentes branches de la production et par la capacité de consommation delà société. Mais cette capacité n'est pas déterminée par la force absolue de production ni par la capacité absolue de consommation, mais par la capacité de consommation sur la base des relations antagoniques de distribution qui réduit la consommation de la grande masse de la société à un minimum seulement modifiable dans des limites plus ou moins étroites..." (Marx, Le Capital, traduit par nous).
En d'autres termes: il existe une contradiction déterminante entre les conditions dans lesquelles se produit la plus-value et les conditions dans lesquelles celle-ci se réalise, c'est-à-dire entre la production et le marché. Quelle est donc la contradiction fondamentale? Entre travail-valorisation ou bien entre production-marché?
Nous considérons qu'il ne s'agit pas en réalité de deux contradictions différentes mais de la même dans ses différents aspects: la première indique le contenu comme catégorie abstraite; la seconde est la forme concrète dans laquelle elle se manifeste.
La contradiction interne travail-valorisation se dédouble vers l'extérieur comme production-échange. (De manière analogue, la contradiction interne de la marchandise entre valeur d'usage-valeur s'exprime dans la forme concrète de marchandise-argent).
De manière abstraite, la création de valeur et de plus-value se présente comme une barrière pour la création de la valeur d'usage. De manière concrète, le marché se présente comme limite réelle et déterminée pour la production.
La loi de l'accumulation croissante de capital qui s'accompagne d'un taux de profit décroissant n'existe pas indépendamment des problèmes du marché. Que le taux de profit diminue par l'augmentation du capital constant par rapport au variable, car une plus grande somme de capital total investi s'approprie en proportion une somme moindre de plus-value, va seulement se montrer de manière tangible sur le marché quand le capitaliste ne trouve pas d'acheteur pour ses marchandises aux prix de production établis.
Il n'existe pas non plus deux types de crise: de suraccumulation de capital et de surproduction de marchandises. C'est une seule crise dans ses deux déterminations. Par son contenu, c'est l'incapacité d'utiliser tout le capital existant étant donné un taux de profit déterminé, et de là, la dévalorisation de capital. Par sa forme, c'est le manque de sortie pour les marchandises, les entrepôts surchargés de stocks, et de là, la paralysie et la destruction des moyens de production et de consommation. La crise a son origine dans la contradiction travail-valorisation et elle se réalise comme contradiction entre la production et le marché.
Ceux qui expliquent la crise par la seule loi de la baisse tendancielle du taux de profit, pourront dire qu'ils arrivent au "fond" de la question, à l'origine de la plus-value. Mais une telle explication est insuffisante quand il s'agit de revenir sur le terrain de la réalité concrète. Si on fait abstraction du marché, c'est-à-dire si on le laisse de côté, les limites du capitalisme apparaîtront aussi comme une pure abstraction, comme quelque chose de lointain, comme une limite inaccessible, simplement théorique qui serait l'impossibilité absolue d'accroissement de la plus-value devant toute augmentation de capital comme le pose le Colectivo.
D'autre part, ceux qui fixent leur attention sur les problèmes de la réalisation du marché réussissent à mieux saisir le cours de la situation réelle dans ses multiples aspects et les vraies limites de la production; bien que s'il manque la base de l'origine de la plus-value, toute crise se présente à eux comme une limite absolument insurmontable.
Le C.C.A. penche pour le "pôle dominant". Il tend à expliquer la crise par la seule loi de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est pour cela qu'il ne trouve pas les limites réelles auxquelles se heurte actuellement le capitalisme. L'évident caractère mondial de la crise n'a aucune signification spéciale pour le Colectivo: c'est seulement une autre de plus dans le "cycle classique". Ses tendances (à la guerre par exemple) sont les mêmes que dans toutes les autres. Pour le Colectivo, il n'y a rien de nouveau. Seulement la confirmation de la théorie.
Il est donc nécessaire non seulement de constater les traits communs à toute crise mais aussi d'étudier leurs particularités, les formes de chaque crise. C'est seulement ainsi nous comprendrons le véritable cours de la situation. En passant des "origines de la plus-value" aux limites qu'offre le marché.
LES LIMITES DU MARCHE
Expliquons maintenant comment l'accumulation de capital avec sa chute du taux de profit se manifeste dans l'impossibilité pour les capitalistes de vendre la totalité de leurs marchandises aux prix de production déterminés, c'est-à-dire dans la limite du marché.
On a déjà mentionné que l'objectif des capitalistes est l'obtention de profit, la croissance de capital; lesquels ne peuvent s'obtenir que par une extraction croissante de plus-value. Pour cela, les capitalistes ne doivent pas consommer toute la plus-value qu'ils obtiennent en articles de luxe; mais ils doivent continuellement réinvestir la majeure partie comme capital, en augmentant l'échelle de la production. L'accumulation de capital est le réinvestissement de plus-value pour qu'elle fonctionne comme capital.
L'accumulation de capital se traduit dans la croissance de la production. Ou, plus exactement, le développement des forces productives dans ce système adopte le caractère d'accumulation de capital. Mais la croissance de la production et de l'accumulation de capital n'est pas harmonieuse mais elle contient une contradiction, qui se reflète dans la chute du taux de profit, due au changement dans la composition organique du capital.
La composition organique du capital résume les deux aspects de la production capitaliste: - premièrement, la composition technique du capital, le rapport qui existe entre moyens de production et ouvriers utilisés. Le développement des forces productives signifie qu'un nombre déterminé d'ouvriers est capable d'employer des moyens de production chaque fois plus puissants qui permettent de créer une plus grande quantité de produits (valeurs d'usage) en moins de temps; deuxièmement, la composition de valeur du capital: la proportion qui existe entre la valeur qui se transfère simplement dans la marchandise (capital constant employé en moyens de production) et la valeur qui retourne se reproduire et permet la création de la plus- value (le capital variable investi en force de travail).
Le développement des forces productives dans son caractère d'accumulation de capital se traduit dans une croissance proportionnellement plus grande du capital constant par rapport au capital variable. Bien sûr le capital variable augmente, et donc, augmente aussi la quantité de plus-value appropriée; mais cette augmentation a lieu au prix d'une augmentation proportionnellement plus grande de capital constant, ce qui occasionne la réduction du taux de profit qui est la proportion entre la plus-value obtenue et le capital total investi (constant plus variable). A mesure qu'augmente l'accumulation de capital, l'obtention de plus-value est proportionnellement moindre, ce qui contredit l'objectif des capitalistes. A un moment donné, on a une suraccumulation, trop de capital par rapport aux nécessités d'exploitation du travail, et survient la paralysie de la production.
La chute du taux de profit rendrait impossible l'existence du capitalisme s'il n'existait pas en même temps des causes qui la contrecarre comme: la prolongation de la journée de travail, l'intensification des rythmes de travail et la réduction des salaires qui permettent d'extraire plus de plus-value sans faire un plus grand investissement; la diminution des coûts des moyens de production, la surpopulation et le commerce extérieur qui permettent de créer de nouvelles branches de production avec une faible composition organique de capital. Du fait de toutes ces causes, la chute du taux de profit se présente seulement comme une tendance qui, malgré tout, finit par s'imposer dans la crise.
La loi de la tendance à la baisse du taux de profit exprime de cette manière la contradiction entre les Forces productives et les rapports de production. La production se développe en laissant de côté la création de plus-value. C'est pour cela, qu'à un moment donné, la création de plus-value s'oppose à ce que continuent d'avancer les forces productives. Mais cette contradiction de la production est interne, invisible. Elle doit se manifester de manière concrète comme limite de l'échange, comme limite pour la réalisation de la plus-value. Cette limite est double, elle a deux aspects:
- Premièrement, comme disproportion entre les différentes industries.
Le capital global de la société est divisé entre les mains de la multitude de capitalistes privés qui sont en concurrence et luttent entre eux à la recherche du plus grand profit. Dans cet effort, chacun introduit de nouvelles méthodes de production, de meilleures machines, et enfin, impulse le développement des forces productives pour gagner le marché en introduisant plus de marchandises et moins chères.
Ce qui précède entraîne à la fois que la production sociale est divisée en une multitude d'industries individuelles, mais qui forment une chaîne, la division sociale du travail, où la production des unes entre comme matière première ou comme moyen de production dans la production des autres, jusqu'à arriver au produit de consommation personnel.
Cependant, la croissance de chaque industrie n'est pas proportionnelle aux demandes des autres mais est déterminée par l’intérêt privé. Elle s'oriente là où elle obtient le plus de profit. Les changements dans la composition organique du capital, c'est-à-dire la croissance plus grande du capital constant par rapport au variable, signifient ici, une croissance disproportionnée du secteur qui produit des moyens de production par rapport à celui qui produit des moyens de vie. De l'industrie lourde par rapport à l'industrie légère et de l'industrie en général par rapport à l'agriculture. Tout ce qui précède se traduit par une surproduction de marchandises, dans un excès de produits qui sont demandés par les autres capitalistes.
Si dans certains moments déterminés, un capitaliste, du fait de la croissance disproportionnée de son industrie, n'arrive pas à vendre toutes ses marchandises au prix équivalent à la réalisation de la plus-value, la production de son usine se verra freinée provoquant une réaction en chaîne. En amont ses fournisseurs ne pourront pas vendre non plus leurs produits, en aval ses clients ne pourront pas acheter le produit dont ils ont besoin; tout cela fermera aussi leur production et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il suffit que la surproduction se manifeste dans quelques industries-clé pour que la crise éclate et se généralise. Ici la crise apparaît comme le produit de l'anarchie de la production, en opposition à la division sociale du travail.
De là l'illusion des théories bourgeoises (ainsi que celles d'Hilferding et de Boukharine) sur la possibilité d'éviter de nouvelles crises au moyen d'un mécanisme régulateur de la production comme le monopole privé ou, mieux encore, le capitalisme d'Etat, lesquels « élimineraient la concurrence et les disproportions. De telles théories oublient tout simplement que derrière la disproportion se trouve la son0 de profit et que les monopoles et le capitalisme d'Etat cherchent aussi le profit maximum et qu'ils ne peuvent que reproduire 'anarchie de la production. C'est non seulement dans la concurrence entre les monopoles, mais au sein de ceux-ci que nous en trouvons la preuve la plus palpable. Comme par exemple, la guerre des prix à l'intérieur de l'OPEP provoquée par la croissance disproportionnée de chaque membre; ou encore le capitalisme étatique des pays comme l'URSS où la concurrence et l'anarchie sont reproduites entre les entreprises du même Etat par dessus la fameuse "planification".
De ce qui précède, on retient que le surgissement des monopoles modernes et des pays où domine le capitalisme d'Etat ne signifie pas un pas en avant, de "transition" du capitalisme au socialisme, ni n'entraîne une "socialisation croissante" de la production. La seule chose que cela indique, c'est que les conditions matérielles pour la société communiste sont déjà données depuis longtemps ([6] [1257]) et que le capital engendre ces avortons de production sociale" comme tentative désespérée mais inutile pour ne pas s'enfoncer dans ses propres contradictions.
- La seconde limite à laquelle se confronte la réalisation de la plus-value, c'est la capacité de consommation des masses travailleuses. Bien sûr, il ne s'agit pas de la capacité absolue de consommation, la satisfaction totale de leurs nécessités vitales, mais de la capacité de consommation déterminée par les rapports antagoniques de distribution, de la capacité de paiement.
Dans ce cas, la croissance plus grande de capital constant par rapport au variable se révèle comme croissance plus grande des marchandises par rapport au salaire.
L'ouvrier reproduit la valeur équivalente de son salaire (capital variable) et en plus remet, sans rien recevoir en échange, une autre somme de valeur au capitaliste (la plus-value). Si le capitaliste, peut exploiter plus de force de travail avec le même capital variable, il obtiendra une plus grande plus-value. De là, la tendance du capital à augmenter les heures de travail, à le rendre plus intense et à réduire le salaire. Ceci a comme conséquence l'existence d'une armée industrielle de réserve qui fait pression sur les ouvriers actifs pour travailler pour un salaire moindre. Ce qui se traduit par un pouvoir d'achat chaque fois plus restreint de la classe ouvrière. Le capital cherche à augmenter la création de plus-value. Il l'obtient, mais d'un autre côté en réduisant les possibilités de réaliser cette même plus-value ([7] [1258]).
Il faut noter que nous parlons en terme de valeur. Mais il peut aussi arriver qu'augmente la consommation de valeur d'usage et que diminue, malgré tout, la réalisation de la plus-value. En fait, si les méthodes de production des biens de consommation s'améliorent, cela signifie qu'on peut en produire une plus grande quantité dans un temps moindre, c'est-à-dire avec moins de valeur: les capitalistes réduisent de cette manière la valeur de la force de travail, le capital variable investi, car alors on peut acheter autant sinon plus de choses; et ainsi pour un temps de travail égal, ils s'approprient plus de plus-value. Mais cela se heurte à nouveau aux possibilités de réaliser cette plus-value. D'autre part, et c'est ce qui arrive actuellement, les capitalistes essayent de diminuer de manière absolue le salaire, lequel tend à être réduit à une valeur inférieure à la valeur de la force de travail, entraînant la dénutrition, des maladies et même la mort de faim parmi la population travailleuse.
La crise apparaît ici de nouveau comme une surproduction de marchandises, "paradoxalement", avec une masse d'affamés et de chômeurs. Entrent en scène de nouveau les idéologues de la bourgeoisie et tout spécialement ceux de gauche pour dire que la crise pourrait être évitée si on augmentait la capacité de consommation des travailleurs, si on augmentait les salaires. Mais toute augmentation des salaires se change en une diminution de la plus-value ce qui contredit les buts mêmes du capital. En réalité, les promesses "d'augmentation des salaires" que fait la gauche du capital dans les périodes d'élections ne sont que des vils mensonges pour s'attirer les votes ouvriers. C'est ce que montre la crise actuelle où aucun gouvernement, qu'il soit de "droite" ou de "gauche" n'a fait autre chose que de réduire les salaires.
"Vu que la finalité du capital n 'est pas la satisfaction des nécessités mais la production de profit... une scission doit se produire constamment entre les dimensions réduites de la consommation sur les bases capitalistes et une production qui tend constamment à dépasser cette barrière qui lui est immanente... "... périodiquement sont produits trop de moyens de travail et de subsistance pour qu’ils puissent agir en qualité de moyens d'exploitation des ouvriers à un taux de profit déterminé. Sont produites trop de marchandises pour pouvoir réaliser la valeur et la plus-value contenues ou enfermées en elles dans les conditions de distribution et de consommation données par la production capitaliste et la reconvertir en nouveau capital, c'est-à-dire, pour mener à terme ce processus en évitant les explosions qui surviennent constamment..." "La raison ultime de toutes les crises réelles continue toujours à être la pauvreté et la restriction de la consommation des massés en contraste avec la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives comme si seule la capacité absolue de consommation de la société constituait sa limite. " (Marx, Le Capital, Tome III).
"Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives; de Vautre en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit-il? A préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir." (Le Manifeste Communiste).
En effet, avec la dévalorisation du capital, au travers de la paralysie et la faillite d'usines et la destruction même de moyens de production et de consommation, qui ont lieu dans la crise, les capitalistes cherchent une solution à la surproduction par la recherche de nouveaux marchés. De là la tendance à créer le marché mondial.
Chaque capital national cherchera, dans un premier temps, à imposer ses rapports d'échange aux producteurs indépendants et aux nations où dominent encore des rapports de production précapitalistes. Mais ces marchés sont encore limités car dans la production précapitaliste s'échange seulement l'excédent par rapport à la satisfaction des nécessités individuelles. Le capital a besoin donc de créer son propre marché, "de forger un monde à son image et à sa ressemblance".
Donc, la bourgeoisie en s'alliant ou luttant' contre les seigneurs de la terre et les roitelets, réalise le dépouillement des petits producteurs. La richesse est concentrée dans peu de mains et susceptible d'être orientée vers la production de marchandises nécessaire pour les capitalistes; en même temps, elle crée une armée de prolétaires qui n'ont plus maintenant comme remède que de vendre leur force de travail pour pouvoir acheter toutes les choses dont ils ont besoin pour vivre. De cette manière, les capitalistes peuvent exporter leurs marchandises et réaliser leur plus-value et en acquérir d'autres. En outre les industries créées dans les nations plus arriérées fonctionnent avec un taux de profit plus élevé car la composition organique du capital est moindre: machines plus vieilles, matières premières, force de travail presque gratuite, journées de travail plus longues. Mais ceci ne mène pas à autre chose qu'à la reproduction à une échelle plus grande des mêmes contradictions du système capitaliste.
Les nations capitalistes les plus vieilles, à la recherche de débouchés pour leurs produits, les obtiennent en créant dans les nations plus arriérées de nouveaux concurrents établissant les bases pour de nouvelles crises plus étendues et plus profondes.
Ainsi, au début du siècle, nous assistons à la "fin du partage du monde entre les puissances", à la fin de l'expansion capitaliste pour le monde habité. Depuis lors, cette solution à la crise se trouve supprimée. Seule reste la destruction de forces productives, laquelle doit atteindre une telle ampleur qu'elle appelle le moyen de la guerre.
Les guerres inter bourgeoises actuelles ont pour objectif fondamental non la conquête ou le pillage de territoires ou de nations mais la pure destruction de forces productives, d'usines, de cultures, de ports, d'hôpitaux et de zones industrielles et de villes entières ([8] [1259]). Maintenant c'est seulement ainsi que le capitalisme peut ouvrir une nouvelle période de "prospérité" tant que dure la reconstruction; jusqu'à ce que le capital recommence à rencontrer ses limites inhérentes et plonge la société dans une nouvelle crise mondiale. Le cycle industriel où la crise menait à une nouvelle phase d'essor et d'expansion, s'est transformé ainsi dans le cycle crise-guerre-reconstruction.
La fin de son oeuvre créatrice, le marché mondial, et le début des guerres pour détruire des forces productives marquent la fin de la mission historique progressiste du capitalisme et l'entrée dans sa phase de décadence. Depuis lors, son existence n'est pas seulement un obstacle pour le progrès social mais avec sa barbarie croissante, elle met en danger l'existence même de la société humaine. Pour les révolutionnaires du début du siècle, les changements ayant eu lieu dans le capitalisme représentaient sa "désagrégation" et son "effondrement définitif'. Avec ces changements, l'ère de la révolution communiste mondiale avait commencé.
Le Colectivo Comunista Alptraum considère aussi que nous vivons l'époque de la décadence du capitalisme. Continuons donc la critique de ses positions que nous avions laissée dans le chapitre II pour essayer de définir avec plus de clarté les caractéristiques de cette époque.
LA DECADENCE DU CAPITALISME
"Nous considérons -dit le Collectif dans sa thèse 6~ que le capitalisme se trouve en décadence"... "La décadence du système implique l'exacerbation et l'approfondissement de toutes ses contradictions"... "La loi qui nous explique le développement du système est la base pour comprendre sa nature décadente... tant le développement que le déclin du système reposent sur deux déterminations essentielles, à savoir, une qui se manifeste par la baisse tendancielle du taux de profit et l'autre qui constitue son contenu et s'exprime dans la subordination formelle et réelle du travail au capital. " (Revue Internationale 40).
Ainsi la décadence, tout comme l'ascendance, a une forme dans laquelle elle s'exprime, et un contenu.
La forme c'est la loi de la baisse du taux de profit. Nous avons déjà vu que de cette loi surgit la crise. Il y a donc un rapport entre la crise et la décadence. Selon le Collectif:
"Les moments de crise sont ceux dans lesquels le capitalisme doit détruire une masse croissante de forces productives mettant en évidence de cette manière sa nature décadente. " (thèse 1, Rint 40).
Mais la baisse du taux de profit et la crise ont existé tout au long du capitalisme. Dire que dans celles-ci s'exprime sa nature décadente pourrait faire penser que la décadence est présente depuis qu'ont surgi les crises (et le cycle "classique" de celles-ci commence en 1825) ou que le capitalisme vit des cycles d'ascendance et de décadence; bref, que la décadence ne signifie rien de différent du capitalisme en général. Evidemment ce n'est pas la pensée du CCA. S'il insiste sur la "nature décadente", ce n'est pas parce qu'il considère la décadence comme l'état éternel du capitalisme, mais simplement parce que le germe de la décadence se trouvait déjà dans ses origines. Bien. Mais alors, à part reconnaître que la décadence est une phase "naturelle" dans la vie du capitalisme, nous n'avons pas avancé d'un poil dans sa caractérisation. En quoi cette phase de décadence se distingue-t-elle de la précédente, de 1 ascendance? Peut-être trouvons-nous la solution dans le "contenu" de la décadence, dans la domination formelle et réelle du travail.
La domination formelle, c'est la période où le capitalisme exploite le travail salarié sous la forme où il se trouvait dans les modes de production antérieurs. L'ouvrier réalise le même procès de travail qu'il faisait quand il était artisan, mais il lui imprime déjà un caractère coopératif et, fondamentalement, les instruments et le produit même ne lui appartiennent déjà plus à lui mais au capitaliste sous les ordres duquel il travaille. La révolution industrielle a établi les bases pour la domination réelle, pour la transformation du processus même de travail, pour le surgissement du travail sous sa forme spécifiquement capitaliste avec son haut degré de coopération, de division et de simplicité. C'est le surgissement du prolétariat moderne dépouillé non seulement de ses moyens de production mais aussi de sa puissance spirituelle. Historiquement, le passage de la domination formelle du travail à la domination réelle n'est que le passage de la manufacture à la grande industrie. L'expansion postérieure du capital se présente comme une reproduction de ces phases de manière rapide et violente: premièrement le capital s'approprie la production sous sa forme précapitaliste telle qu'il la rencontre, et immédiatement il lui imprime son caractère capitaliste. Si l'époque de la décadence correspondait au passage de la domination formelle à la domination réelle du processus de travail, nous devrions la situer à la fin du 18e siècle et au début du 19e. Encore une fois, nous nous trouvons en face de la tendance à diluer l'époque déterminée de la décadence dans le développement général du capitalisme.
A un moment, il semble que le Collectif situe la décadence au début du siècle. Après avoir mentionné la nature décadente du capitalisme, il poursuit (thèse 1):
"Le capitalisme dans cette logique impose alors la destruction violente et périodique d'une masse croissante de forces productives"... "De cette tendance interne surgit la nécessité des guerres pour prolonger son existence comme un tout. Historiquement, on a vu qu'après chaque guerre apparaît une période de reconstruction."
Mais les guerres de ce type furent une réalité seule ment au début du siècle présent et nous supposons que c'est à elles que se réfère le Collectif et non à un autre type de guerre du siècle passé. Y compris dans sa réponse au BIPR, le CCA ajoute:
"Si nous observons comment le système capitaliste est devenu de plus en plus barbare depuis la première guerre mondiale jusqu 'à nos jours, il est possible de comprendre pourquoi plus le capitalisme se développe, plus il plonge dans la barbarie (ou décadence)..." (Comunismo n°l, p.22).
Donc la décadence se verrait située au début du 20e siècle ce qui coïnciderait avec la position que nous avons adoptée. Cependant, dans une note au paragraphe antérieur, le Collectif "clarifie":
"En étant strict en termes historique, nous pourrions dire que cette progressive 'barbarisation' du système capitaliste commence au milieu du 19e siècle, date ou moment où la bourgeoisie perd son rôle progressif dans l'histoire de l'Europe et où le prolétariat apparaît au niveau historique de la lutte des classes comme son pôle antagonique", "...nous pouvons situer le début de la décadence globale du système capitaliste à partir de 1858. Celle-ci se situe précisément dans le cours de son expansion progressive aliénée à l'échelle planétaire..."
Enfin le Collectif place la décadence à partir de la maturation du capitalisme en Allemagne et des révolutions de 1848, au milieu du siècle passé, ce qui amène toute tentative de caractériser cette époque à rester dans des généralités sur le capitalisme. Ainsi il n'y aura pas de différences substantielles entre le capitalisme actuel et celui du siècle passé car tout existait déjà: la crise cyclique, le marché mondial, la tendance à la guerre, la possibilité de la révolution. C'est à cela que mène la prétention de tout expliquer à partir du "pôle dominant" de la production, en laissant de côté les changements ayant eu lieu dans la sphère de l'échange.
Mais ceci est une erreur. Le Collectif ne se rend pas compte que déjà conceptuellement c'est un contresens de placer l'époque de la décadence, de déclin du capitalisme "précisément dans le cours de sa progressive expansion" et qu'ajouter l'adjectif "aliéné" ne résout rien.
Dans cette même note, le Collectif cite deux fois Marx pour argumenter sa position. La première est une fausse et lamentable interprétation. Marx dit que l'économie bourgeoise est en décadence. Il se réfère évidemment à la science économique bourgeoise, mais le CCA, loin de clarifier cela, laisse implicite que Marx se réfère au' mode de production. Cependant, il vaut la peine de reproduire la seconde citation:
"Nous ne pouvons nier que la société bourgeoise a expérimenté pour la seconde fois son 16e siècle, un 16e siècle qui, je l'espère, mettra à mort la société bourgeoise, de la même manière que le premier lui a donné le jour. La mission particulière de la société bourgeoise, c'est l'établissement d'un marché mondial. Comme le monde est rond, cela semble être achevé avec la colonisation de la Californie et de l'Australie et avec l'ouverture de la Chine et du Japon. Ce qui est difficile pour nous est ceci: sur le continent, la révolution est imminente et assumera immédiatement un caractère socialiste. Ne sera-t-elle pas destinée à être défaite dans ce petit coin en tenant compte que sur un territoire beaucoup plus grand le mouvement de la société est toujours en ascension ?" (Marx, prologo a la 2a edicion del Capital)
On peut difficilement conclure du passage antérieur qu'à l'époque de Marx, le capitalisme comme système mondial se trouvait déjà dans sa phase de décadence alors qu'un territoire beaucoup plus grand se trouvait en "ascension".
Marx comprenait que la révolution n'était pas possible à n'importe quel moment mais qu'elle requérait certaines conditions matérielles et sociales. Pour lui:
"Une formation sociale m disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s’y substituent avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société" (Préface à la Contribution à la critique de l'économie politique, Editions Sociales, p.5. 1972).
Bien. Que tire-t-on du passage cité par le Collectif? Marx considérait-il déjà "mûres" les conditions pour la révolution? Pour l'Europe, oui. Pour le reste du monde, non.
La préoccupation des révolutionnaires à cette époque était les perspectives d'une révolution en Europe alors que dans le reste du monde la lutte du prolétariat était improbable ou inexistante. Peut-être le communisme aurait-il pu s'étendre aux nations arriérées; en Russie, par exemple, on pourrait de passer de la communauté patriarcale au communisme moderne. Mais aussi peut-être, la révolution européenne pourrait être écrasée par le poids du mouvement toujours ascendant de la société dans le reste du monde.
Marx, comme les révolutionnaires et la classe ouvrière en général, était limité par les conditions historiques. La révolution européenne se présentait comme la fin de la société bourgeoise car à cette époque la société bourgeoise se limitait pratiquement à l'Europe. Personne ne pouvait deviner à ce moment-là si la révolution dans cette "petite région" suffirait pour instaurer le communisme dans un monde encore arriéré.
Aujourd'hui, nous pouvons déjà dire crue ce n'était pas possible. Qu'à cette époque le capitalisme avait des réserves, que ses tendances au développement ascendant étaient plus puissantes que les tendances à son déclin et que les forces de la révolution; que l'ouverture de l'Orient ouvrait un champ d'expansion immense, que les limites du marché mondial étaient encore loin de s'exprimer ouvertement. En somme, que l'exacerbation des contradictions du capitalisme n'était pas arrivée au degré où s'ouvrirait réellement l'époque de sa décadence et de la révolution mondiale.
Marx posait les bases générales pour une théorie de la décadence mais ne pouvait pas la développer; seuls pouvaient le faire les révolutionnaires des débuts du 20e siècle; quand la décadence est devenue une réalité. Celle-ci est annoncée par la dépression chronique de la fin du 19e siècle, les guerres inter bourgeoises du début de ce siècle et la révolution russe de 1905, et déjà elle s'exprime avec une clarté aveuglante dans la transformation de la crise de 1913 en guerre impérialiste généralisée de 1914-18 et dans l'explosion révolutionnaire du prolétariat international en 1917-
La conception de la décadence du capitalisme définit l'époque à laquelle le capitalisme a accompli déjà définitivement sa "mission historique", et les contradictions ne se manifestent plus seulement en un quelconque "haut degré de développement" mais: le développement du capitalisme est tel qu'il se transforme en barbarie, car l'exploitation du travail salarié n'a déjà plus sa contrepartie dans l'oeuvre civilisatrice progressive des nations "barbares". Maintenant, la civilisation se présente comme généralisation de la barbarie. L'accumulation de capital n'a plus sa contrepartie dans le pur développement des forces productives, mais maintenant les forces productives se voient freinées et, en plus, leur développement tend à se transformer en puissances destructrices. Et la contrepartie à la crise périodique ne se manifeste plus dans des phases d'expansion et de prospérité mais dans la "solution" de la guerre généralisée.
La décadence du capitalisme ouvre l'époque de la révolution communiste mondiale, non seulement parce que, par la création du marché mondial, elle a déjà crée les conditions matérielles pour la nouvelle société, mais aussi parce que la désagrégation du capitalisme, l'avancée de la barbarie, a sa contrepartie dans l'avancée des forces de la révolution.
La crise, comme destruction de forces productives, ne signifie pas seulement destruction de moyens de production, mais surtout, destruction de forces productives humaines. Elle signifie plus de chômage, plus d'exploitation, d'accidents, de misère, et de morts même. L'antagonisme entre le capital et le travail salarié s'exprime de la manière la plus brutale et la plus ouverte. Ce sont les conditions pour la maturation de la conscience et du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
"Une révolution est seulement possible comme conséquence d'une crise... mais celle-ci est aussi certaine que celle-là."
La crise actuelle avec son caractère mondial et sa longue durée ne tend pas seulement à une nouvelle guerre mondiale. Mais aussi, elle ouvre la perspective pour un assaut définitif du prolétariat de la forteresse ennemie. Elle crée comme jamais les conditions pour la révolution mondiale du prolétariat.
Ces conditions doivent être l'objet de toute notre attention.
GPI, août 1986.
[1] [1260] Cf. la présentation du CCA dans la Revue Internationale 50.
[2] [1261] La place nous manque pour les reproduire ici. Le GPI partage avec le CCI l'essentiel des positions politiques qui sont publiées au dos même de toutes les publications territoriales ainsi que de cette Revue Internationale.
[3] [1262] Cf. Revue Internationale n° 10,19 et 20.
[4] [1263] Revue Internationale 40.
[5] [1264] Une remarque qui nous semble nécessaire ici: les cycles économiques dans la période actuelle de décadence ne s'arrêtent pas à la "reconstruction". Contrairement à la période ascendante dont les cycles se présentent dans la formule Production-Crise-Production élargie, les cycles actuels se caractérisent dans la formule Crise-Guerre-Reconstruction-Crise plus profonde. (NDLR)
[6] [1265] Nous pensons que les camarades commettent ici une erreur. Il est faux de dire que « les conditions matérielles pour la société communiste sont déjà données ». En fait, les conditions matérielles rendent de plus en plus impossible la continuation du système capitaliste de production, d’où la décadence et la crise permanente. Ainsi sont indiquées la nécessité et la possibilité de s'engager vers l'unique n'est que dans la période de transition que les conditions matérielles seront achevées permettant l'instauration du communisme: "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins". (NDLR)
[7] [1266] Il est faux de dire que la baisse des salaires réduit la réalisation de la plus-value. Par définition, le salaire ne rachète jamais la plus-value. La baisse des salaires est toujours une augmentation de la production de plus-value aussi bien absolue que relative. (NDLR)
[8] [1267] La destruction généralisée des forces productives n'est pas un "but" recherché par le capital mais une conséquence "aveugle" de ses contradictions. Cette idée de la guerre comme "recherche" de destruction est fausse. A la rigueur, peut-elle être valable pour un pays ou un bloc capitaliste pour détruire l'appareil industriel de pays rivaux ou s'en emparer. Une telle vision escamote une donnée déterminante: l'exacerbation de l'antagonisme inter impérialiste comme cause directe des guerres généralisées de notre période. (NDLR)
Géographique:
- Mexique [36]
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Polémique : où va le F.O.R. ? ("Ferment Ouvrier Révolutionnaire")
- 4336 reads
Le Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR) est aujourd'hui une composante du milieu prolétarien révolutionnaire. Il est l’un des rares groupes qui défendent les positions communistes (contre les syndicats, le parlementarisme, les luttes de libération nationale, le frontisme, le capitalisme d'Etat, etc.) et interviennent dans la lutte de classe. Par ce fait, il n'est pas indifférent de faire un bilan politique de ce groupe dont les positions sont mal connues au sein du milieu prolétarien.
A travers un de ses militants les plus connus, G. Munis, le FOR est issu de l’ancien groupe trotskyste espagnol qui se constitua dans les années 30. L'évolution de Munis et de ses partisans vers des positions révolutionnaires ne se fit pas sans mal. Munis -suivant les consignes de Trotsky- fut partisan de l’entrée des "bolcheviks léninistes" dans les Jeunesses Socialistes/ mais par contre refusa la fusion avec le POUM, parti "socialiste de gauche" qui devait jouer un rôle essentiel dans la défaite des ouvriers espagnols en 1936-37. En 1936, Munis et ses amis allaient, temporairement, servir dans les milices socialistes sur le front de Madrid. Un itinéraire qui était loin d'être révolutionnaire et s'écartait notablement des positions intransigeantes de la Gauche communiste à l’époque (Gauche italienne, et même Gauche hollandaise). C'est seulement en 1937, lors des événements de Mai -où le prolétariat de Barcelone se fit massacrer par le gouvernement de Front Populaire— que le groupe de Munis commença à abandonner sa fausse trajectoire ([1] [1268]) en se plaçant résolument du côté des insurgés, en dénonçant les staliniens ainsi que le POUM et la CNT-FAI. L'attitude révolutionnaire courageuse de Munis lui valut d'être emprisonné en 1938. En 1939, il réussit à s'évader, échappant à l'assassinat de la part des staliniens, pour gagner finalement le Mexique.
L'immense mérite de Munis et de ses amis au Mexique — dont le poète surréaliste Benjamin Péret— fut de dénoncer la politique de "défense de l'URSS" et l'intégration dans la guerre impérialiste de la "4e Internationale" trotskyste. Cela amena Munis à faire une rupture en 1948 avec l'organisation trotskyste, pour sa trahison de l'internationalisme, en même temps que d'anciens trotskystes espagnols. Mais, caractéristique du groupe de Munis —qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le FOR— celui-ci estimant que la révolution était une simple question de volonté, fit décider le départ du groupe pour une action clandestine en Espagne franquiste. Pris par la police, Munis subit un dur emprisonnement.
Il n'est pas indifférent que le rapprochement du groupe de Munis des positions de la gauche communiste, dans le début des années 50, fût favorisé par les discussions entamées avec les groupes issus de la gauche communiste italienne. Les discussions avec "Internationalisme" puis avec le groupe de Damen ([2] [1269]) ne furent pas étrangères au fait que l'Union ouvrière internationaliste (nom du groupe de Munis) pût quelque peu se "décrotter" de toute une idéologie trotskyste, pour trouver une vraie trajectoire révolutionnaire.
Au cours des années 60, le groupe de Munis et de Benjamin Péret (mort en 1959) s'est maintenu courageusement, en une période de pleine contre-révolution, sur des positions révolutionnaires prolétariennes. C'est au cours de cette période difficile, où les éléments révolutionnaires étaient extrêmement peu nombreux et dispersés, que l'ancêtre du FOR actuel publia ses textes politiques de référence: "Les syndicats contre la révolution" et "Pour un second manifeste communiste" ([3] [1270]). Ces textes, après la longue nuit de contre-révolution qui s'étendit sur le monde jusqu'à la reprise internationale des luttes prolétariennes qu'a marquée Mai 68 en France, ont joué un rôle non négligeable vis-à-vis de jeunes éléments qui, avec difficulté, se réappropriaient les positions de la Gauche communiste et cherchaient à combattre les théories nauséabondes du maoïsme et du trotskysme. Le FOR, qui publie aujourd'hui en France "Alarme" et en Espagne "Alarma" ([4] [1271]), est la continuation organisationnelle de l'ancien groupe de Munis et défend en conséquence les positions politiques exprimées dans les anciens textes. Malheureusement, le FOR se réclame aussi de textes des années 40, où le groupe de Munis montre à l'évidence qu'il ne s'était guère débarrassé de sa gangue trotskyste, et qu'il continue à diffuser ([5] [1272]), comme s'il y avait une continuité entre les anciens groupes trotskystes espagnol et mexicain de cette époque et le FOR d'aujourd'hui.
Il est donc nécessaire de voir dans quelle mesure le FOR actuel se situe clairement sur le terrain de la Gauche communiste et s'il lève les ambiguïtés de ses origines.
L'HERITAGE DU TROTSKYSME
On doit malheureusement constater que le FOR et Munis n'ont pas proclamé sans réticence la rupture avec le courant et l'idéologie trotskystes. Si d'un côté, il est affirmé que depuis la 2e Guerre mondiale le trotskysme est passé à la contre-révolution, de l'autre côté il subsiste une très forte nostalgie de ce courant, au temps où, dans les années 30, il conservait encore un caractère prolétarien.
C'est avec étonnement qu'on peut lire les assertions suivantes, dans la littérature du FOR:
"C'est l’opposition de gauche (trotskyste) qui formula le mieux l'opposition au stalinisme" (Munis, "Parti Etat, stalinisme, révolution", Cahiers Spartacus, 1975)
"L'oeuvre de Trotsky et du mouvement originel de la 4e Internationale a constitué un apport considérable pour la compréhension du Thermidor russe." ("Pour un second manifeste communiste", Losfeld Paris, 1965, p. 57)
Ou encore, tout récemment:
"Le trotskisme étant le seul courant internationaliste en activité dans des dizaines de pays et plusieurs continents, il incarnait la continuité du mouvement révolutionnaire depuis la Première Internationale et préfigurait la liaison pertinente avec le futur. " (Munis, "Analisis de un vacio", Barcelona, 1983, p. 3)
A lire ce panégyrique du trotskysme et de Trotsky des années 30, on croirait qu'il n'a jamais existé de Gauche communiste. En proclamant que seul le courant trotskyste a été "internationaliste" dans les années 30, on aboutit à une falsification grossière et éhontée de l'histoire. Munis et ses amis passent sous silence l'existence d'une Gauche communiste (en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Russie) oui, bien avant que le courant trotskyste n'existe, mena le combat contre la dégénérescence de la Révolution russe, pour l'internationalisme.
Ce travail d'escamotage du VERITABLE mouvement révolutionnaire des années 20 et 30 (KAPD, GIC, "Bilan" et la fraction italienne) ne peut avoir qu'un but: absoudre à tout prix la politique opportuniste originelle du trotskysme et de Trotsky et donner un brevet révolutionnaire à l'activité des trotskystes espagnols dont Munis faisait partie. Munis et le FOR ont-ils "oublié" que la politique de défense de l'URSS des trotskystes devait les amener directement à participer à la seconde boucherie impérialiste? Ont-ils oublié la politique antifasciste de ce mouvement, qui l'amena à proposer le "front unique" avec ces bouchers du prolétariat que furent et sont toujours les partis staliniens et social-démocrate ? Munis a-t-il "oublié" la politique d'entrisme dans le Parti socialiste espagnol qu'il soutint dans les années 30? De tels silences sur ces faits expriment dans le FOR des ambiguïtés graves qu'il est loin d'avoir surmontées.
De tels "oublis" ne sont pas innocents. Ils manifestent un attachement sentimental à l'ancien courant trotskyste, qui conduit directement à des falsifications et à des mensonges. Lorsque le FOR proclame allègrement que "Trotsky n'a jamais défendu même critiquement le Front populaire ni en Espagne ni ailleurs" (cf. "L'arme de la critique", organe du FOR, n°l, mai 1985), il s'agit d'un mensonge manifeste ([6] [1273]). A moins que le FOR ignore complètement l'histoire réelle du mouvement trotskyste... Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Nous donnons sans commentaires, à l'intention de Munis et de ses amis, quelques citations "édifiantes" de Trotsky, extraites du recueil de Broué "La révolution espagnole (1930-1940)":
"Renoncer à soutenir les armées républicaines, seuls peuvent le faire les poltrons et les traîtres, agents du fascisme" (p.355); "Tout trotskyste en Espagne doit être un bon soldat au côté de la Gauche" (p.378); "Partout et toujours, là où les ouvriers révolutionnaires ne sont pas dans l'immédiat assez forts pour renverser le régime bourgeois, ils défendent, contre le fascisme, même la démocratie pourrissante, mais surtout ils défendent leurs propres positions à l'intérieur de la démocratie bourgeoise" (p. 431); "Dans la guerre civile espagnole, la question est démocratie ou fascisme" (p. 432).
En fait, on doit constater que cet attachement de Munis et de ses amis à l'ancien mouvement trotskyste des années 30 n'est pas seulement "sentimental". Il existe bel et bien des restes importants d'idéologie trotskyste aujourd'hui dans le FOR. Sans en dresser une liste exhaustive, on peut en relever quelques-uns parmi * les plus significatifs:
a) L'incompréhension du capitalisme d'Etat en Russie qui amène le FOR à parler, comme les trotskystes, de l'existence non d’une classe bourgeoise mais d'une bureaucratie:
". ..Il n'y (en Russie) existe pas une classe propriétaire, pas plus nouvelle que vieille. Les tentatives pour définir la bureaucratie comme une sorte de bourgeoisie sont aussi inconsistantes que taxer de bourgeoise la révolution de 1917... Ce n'est pas à l'heure où la concentration de son développement capitaliste atteint des proportions mondiales et élimine par sa propre dynamique la fonction des capitaux privés agissant chaotiquement qu'une bourgeoisie toute fraîche va se constituer. Le processus caractéristique de la civilisation capitaliste ne peut se répéter nulle part, même si l'on en imagine des formes modifiées. " (Munis, "Parti-Etat", idem p. 58)
Le FOR considère donc, comme les trotskystes, que le capitalisme se définit par sa forme juridique d'appropriation. La suppression de l'appropriation privée implique la disparition de la classe bourgeoise. Il n'entre pas dans l'esprit du FOR que la "bureaucratie" dans les pays de l'Est (et en Chine, etc.) est la forme que prend la bourgeoisie décadente en s'appropriant les moyens de production (Pour cette question, nous renvoyons à nos textes de base).
b) La mise en plan d'un nouveau "Programme de transition" à l'exemple de Trotsky en 1938, marque chez le FOR une incompréhension de la période historique, celle de la décadence du capitalisme. En effet, le FOR a cru bon -dans "Pour un second manifeste communiste"- de mettre en avant toutes sortes de revendications transitoires, en l'absence de mouvements révolutionnaires du prolétariat. Cela va de la semaine de 30 heures, de la suppression du travail aux pièces et du chronométrage; dans les usines, à la "revendication du travail pour tous, chômeurs et jeunes", sur le terrain économique. Sur le plan politique, le FOR exige de la bourgeoisie le "droit"(!) et la "liberté" démocratiques: "liberté de parole, de presse et de réunion; le droit d'élire pour les ouvriers, leurs délégués permanents d'atelier, d'usine, profession", "sans aucune formalité judiciaire ou syndicale" ("Second Manifeste", p. 65-71).
Cela se situe dans la "logique" trotskyste, selon laquelle il suffirait de poser des revendications bien choisies pour arriver graduellement à la révolution. Pour les trotskystes, le tout est de savoir être pédagogue avec les ouvriers, qui ne comprendraient rien à leurs revendications, et de brandir les carottes les plus appétissantes dans le but de pousser les ouvriers dans leur "parti"... Est-ce cela que veut Munis, avec son programme de transition "bis"?...
Aujourd'hui, ce n'est pas aux groupes révolutionnaires qu'il revient de dresser un catalogue de revendications e l'avenir; les ouvriers sont assez grands pour trouver eux-mêmes, dans la lutte, spontanément, des revendications précises.
Aujourd'hui telle ou telle revendication précise, comme le "droit au travail" pour les chômeurs, peut être reprise par des mouvements bourgeois et utilisée contre le prolétariat (camps de travail, chantiers collectifs des années 30, etc.).
Aujourd'hui, c'est seulement à travers la lutte massive que le prolétariat peut faire face aux attaques de la bourgeoisie, et c'est dans la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie que les ouvriers pourront réellement satisfaire leurs revendications. Le capitalisme décadent n'est plus en état de concéder des réformes durables au prolétariat.
De façon très caractéristique, le FOR met sur le même plan ses mots d'ordre réformistes de "droits et libertés" démocratiques pour les ouvriers et des mots d'ordre qui ne peuvent surgir que dans une période pleinement révolutionnaire. On trouve ainsi pêle-mêle les mots d'ordre de:
- "expropriation du capital industriel, financier et agricole";
- "gestion ouvrière de la production et de la distribution des produits";
- "destruction de tous les instruments de guerre, atomiques aussi bien que classiques, dissolution des armées, des polices, reconversion des industries de guerre en production de consommation";
- "armement individuel des exploités sous le capitalisme, territorialement organisé, selon le schéma des comités démocratiques de gestion et de distribution";
- "suppression du travail salarié en commençant par élever le niveau de vie des couches sociales les plus pauvres pour atteindre finalement la libre distribution des produits selon les besoins de chacun";
- "suppression des frontières et constitution d'un seul gouvernement et d'une seule économie au fur et à mesure de la victoire du prolétariat dans divers pays. "
Et le FOR d'ajouter à tout ce catalogue le commentaire suivant:
"C’est seulement sur les ailes de la subjectivité (sic) - révolutionnaire que l'homme franchira la distance du règne de la nécessité au règne de la liberté" (idem, p. 71).
En d'autres termes, le FOR prend ses désirs pour des réalités et considère la révolution comme une simple question de volonté subjective, et non de conditions objectives (la maturation révolutionnaire du prolétariat dans la crise historique du capitalisme plongé dans la crise économique).
Tous ces mots d'ordre montrent des confusions énormes. Le FOR semble avoir abandonné toute boussole marxiste. Aucune distinction n'est faite entre une période prérévolutionnaire, où domine politiquement le capital, une période révolutionnaire, où s'établit un double pouvoir, et la période de transition (après la prise du pouvoir par le prolétariat) qui seule peut mettre à l'ordre du jour (et non immédiatement!) la "suppression du travail salarié" et la "suppression des frontières".
A l'évidence, ces "mots d'ordre" du FOR montrent non seulement des restes mal digérés du programme de transition trotskyste, mais de fortes tendances anarchistes. Les mots d'ordre de "gestion ouvrière" font partie du bagage anarchiste, conseilliste ou "gramscien" mais certainement pas du programme marxiste. Quant à "l'armement individuel" (et pourquoi pas collectif?) du prolétariat et à l'exaltation de la "subjectivité" (individuelle, sans doute) ils s'inscrivent dans le confusionnisme anarchiste.
Finalement, la "théorie" du FOR apparaît comme un mélange de confusions héritées du trotskysme et de l’anarchisme. Les positions du FOR sur l'Espagne en 1936-37 le montrent de façon éclatante.
LA "REVOLUTION ESPAGNOLE" DANS L'EVANGILE DU FOR
Nous avons déjà eu l'occasion dans la presse du CCI ([7] [1274]) de critiquer les conceptions de Munis et ses amis sur les événements d'Espagne de 1936-37. Il est nécessaire d'y revenir, car l’interprétation du FOR conduit aux pires aberrations politiques, inévitablement fatales pour un groupe se situant sur le terrain de la révolution prolétarienne.
Pour le groupe de Munis, les événements d'Espagne sont le moment le plus élevé de la vague révolutionnaire qui débuta en 1917. Mieux, ce qu'il appelle la "révolution espagnole" serait plus révolutionnaire que la révolution russe:
"Plus nous regardons rétrospectivement les années qui vont jusqu'en 1917, plus la révolution espagnole acquiert de l'importance. Elle fut plus profonde que la révolution russe.... " (Munis, "Jalons de défaite, promesse de victoire", Mexico, 1948; postface "Réaffirmation", 1972).
Bien plus, et rien moins que cela, les événements de Mai 37, où le prolétariat espagnol se fit écraser par les staliniens avec la complicité des "camarades ministres" anarchistes, est "le degré de conscience suprême de la lutte du prolétariat mondial" (Munis, "Parti-Etat; stalinisme-révolution", Spartacus, 1975, p. 66)
Munis ne fait que reprendre l'analyse trotskyste sur les événements en Espagne, et jusqu'aux conceptions anti-fascistes. Pour lui, les événements d'Espagne n'ont pas été une contre-révolution permettant à la bourgeoisie d'écraser le prolétariat, mais la révolution la plus importante de l'histoire. De telles assertions sont justifiées de la façon suivante:
- en juillet 36, l'Etat aurait quasiment disparu; des "comités-gouvernement" auraient surgi à la place de l'Etat ([8] [1275]);
- les collectivités de 36 en Espagne auraient instauré un véritable communisme local! (et pourquoi pas le communisme dans un seul village?);
- la situation internationale était objectivement révolutionnaire, avec la France "au bord de la guerre ci-" vile" et "la renaissance de l'offensive ouvrière en Angleterre" ("Jalons", p.380).
Il est inutile d'insister sur la fausseté des paroles d'évangile contenues dans "Jalons". Elles sont caractéristiques d'une secte qui "s'élevant sur les ailes de la subjectivité", prend ses fantasmes pour la réalité, au point de devenir mystificateur et de s'auto mystifier. L'invention de "comités-gouvernement" par Munis, qui n'ont nullement existé -seules ont surgi les Milices qui étaient un cartel de partis de gauches et de syndicats— montre une tendance à l’automystification, et surtout au bluff, dont les trotskystes ont toujours été friands.
Mais le plus grave, chez Munis, est le fait qu'il reprend à son compte l'analyse des trotskystes et anarchistes de l'époque, pour finalement mieux les absoudre. En saluant l'action des trotskystes espagnols comme "révolutionnaire", Munis les absout de leur appel à "assurer la victoire militaire" de la République contre le fascisme (idem p. 305). Et que dire de l'enthousiasme manifesté pour les tristement célèbres "Brigades Internationales—avec Marty, le boucher des ouvriers d'Albacete- en lesquelles Munis voit un exemple magnifique où des milliers d'hommes offrirent "leur sang pour la révolution espagnole" (p. 395). Quant au sang ouvrier versé par les bouchers staliniens composant ces brigades, un pudique silence est gardé.
En continuant à répéter les mêmes erreurs que les trotskystes espagnols en 36, le FOR aboutit à une totale incompréhension qui est inévitablement fatale à tout groupe prolétarien:
- d'abord, l'incompréhension des conditions de la disparition de l'Etat capitaliste et de l'ouverture d'une véritable période de transition du capitalisme au communisme. En affirmant que le 19 juillet 36, "l'Etat capitaliste cessa d'exister" ("Jalons", p.280), non seulement Munis travestit la réalité historique mais considère que la disparition de l'Etat s'accomplit sur-le-champ, en quelques heures, dans un seul pays. Une telle vision est identique à celle de l'anarchisme.
- Munis et ses amis considèrent que la révolution prolétarienne peut s'accomplir sans l'existence et de conseils ouvriers et d'un parti révolutionnaire. Ainsi, sans organisation unitaire et sans organisation politique, la révolution se déroulerait spontanément. Malgré sa reconnaissance de la nécessité d'un parti révolutionnaire pour catalyser le processus de fa révolution, le FOR introduit par la bande les conceptions conseillistes.
Finalement, le FOR manifeste une totale incompréhension des conditions de la révolution prolétarienne aujourd'hui.
L'AVENIR D'UNE SECTE
Le FOR se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Toute sa raison d'être a été l'affirmation que la révolution était une question de volonté et de subjectivité. Pour cela, il n'a cessé d'affirmer que les conditions objectives (crise générale du capitalisme, décadence économique) importaient peu. De façon idéaliste, le FOR n'a cessé de prétendre qu'il n'y avait pas un déclin économique mais une décadence "morale" du capitalisme. Pire, il n'a voulu voir depuis les années 70 dans la crise économique du capitalisme qu'une "simple ruse de guerre de la bourgeoisie" comme l'affirmait Munis lui-même, au début de la 2ème conférence internationale des groupes de la gauche communiste ([9] [1276]).
A l'heure où les deux "lundis noirs" du krach boursier d'octobre 1987 (19 et 26 octobre) sont la confirmation éclatante de la faillite économique du système capitaliste mondial, le FOR va-t-il continuer tranquillement à affirmer qu'il n'y a pas de crise? A l'heure où se confirme avec éclat l'effondrement du capitalisme, le FOR va-t-il répéter -comme en 1975- que "le capitalisme résout toujours ses propres contradictions -les crises de surproduction" (cf. RI n°14, mars 75, "Réponse à Alarma")?
Si le FOR continuait à se placer au delà de la réalité sur les "nuages" roses de sa "subjectivité", il apparaîtrait comme une secte condamnée par la réalité objective elle-même. Or, par définition, une secte qui est repliée sur elle-même, pour défendre ses propres "dadas" —comme la "révolution espagnole" et l'absence de crise économique- et nie la réalité, est condamnée soit à disparaître totalement, soit à éclater en multiples morceaux dans la pire confusion.
Le FOR se trouve à la confluence de trois courants: le trotskysme, le conseillisme et l'anarchisme.
Du trotskysme, le FOR conserve non seulement des résidus (Espagne 36, "revendications transitoires", volontarisme) mais aussi une singulière attraction pour ses éléments "critiques" en rupture. Si le FQR est clair aujourd'hui que "rien de révolutionnaire ne peut prendre sa source dans aucune tendance dite trotskyste" (Munis, "Analisis de un vacio", 1983), il garde l'illusion que des scissions du trotskysme "pourraient contribuer à bâtir une organisation du prolétariat mondial" (idem). C'est cette même illusion qu'il avait entretenue en 1975, lorsque s'était constitué le groupe Union Ouvrière, issu de "Lutte Ouvrière" en France. Le FOR n'avait pas hésité à voir dans cette scission sans lendemain le "fait organique le plus positif arrivé en France pour le moins depuis la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui" ("Alarma" n°28,1975, "Salut à Union Ouvrière").
Le FOR doit dire clairement maintenant, alors que les responsabilités des révolutionnaires sont autrement plus écrasantes aujourd'hui qu'il y a dix ans, si oui ou non il se considère comme une composante de la gauche communiste, oeuvrant à son regroupement, ou au contraire comme une composante du milieu marécageux dans lequel barbotent les différents groupuscules "critiques" issus du trotskysme. Le FOR doit se prononcer sans ambiguïtés sur les conditions de formation du parti révolutionnaire. Il doit dire clairement si celui-ci se constituera autour des groupes issus de la gauche communiste, qui se réclament de l'apport des gauches des années 20 et 30 (KAPD, "Bilan", Gauche hollandaise), ou autour des groupes issus du trotskysme. Une réponse claire à cette question déterminera la participation du FOR à des conférences de la Gauche communiste, participation qu'il a déclinée en 1978, de façon sectaire.
En deuxième lieu, il apparaît que le FOR a ouvert toutes grandes les portes vers le "conseillisme". En considérant comme secondaire et même inexistante la crise économique du capitalisme, en affirmant que la conscience du prolétariat ne peut surgir que de la lutte elle-même ([10] [1277]), le FOR sous-estime non seulement les facteurs objectifs de la révolution mais le facteur subjectif, celui de l'existence d'une organisation révolutionnaire, qui est le point le plus haut, le plus élaboré de la conscience de classe.
En troisième lieu, le FOR montre des attaches et une attraction très dangereuses vers les conceptions anarchistes. Si le FOR a rejeté la vision trotskyste des "révolutions politiques c'est pour mieux proclamer que la révolution sera d'abord et avant tout "économique et non politique:
"Cette vision politique de la révolution partagée par l’extrême gauche et la plupart de ce qui est appelé l’ultra-gauche est une vision bourgeoise de la prise du pouvoir." ("L'arme de la critique", n°l, mai 1985). Cette conception était exactement la même que celle du GIC conseilliste hollandais (voir brochure à paraître sur la gauche communiste germano hollandaise), qui se rapprochait ainsi de l’anarchisme. En croyant et en faisant croire qu'une révolution fera disparaître immédiatement la loi de la valeur et réalisera rapidement les tâches économiques du communisme, le FOR tombe dans l'illusion anarchiste selon laquelle le communisme est une simple question économique, pour mieux évacuer la question du pouvoir politique du prolétariat (dictature es conseils à l'échelle mondiale, ouvrant réellement la période de transformation économique de la société).
Le FOR est à la croisée des chemins. Ou bien il restera une secte sans avenir amenée à mourir de sa belle mort, ou bien il se décomposera en morceaux attirés vers les courants trotskyste, anarchiste et conseilliste, ou bien il s'orientera résolument vers la Gauche Communiste. En tant que secte hybride, mariant la carpe et le lapin, dédaignant la réalité présente, le FOR n'est pas un groupe viable. Nous ne pouvons que souhaiter et contribuer de toutes nos forces à ce que le FOR s'oriente vers une réelle confrontation avec le milieu révolutionnaire. Pour cela, il devra faire une autocritique de son attitude négative en 1978, lors de la seconde conférence des groupes de la Gauche Communiste.
Le milieu révolutionnaire prolétarien a tout à gagner à ce que des éléments révolutionnaires, comme ceux du FOR, ne se perdent pas et s'unissent aux forces révolutionnaires existantes, celles de la Gauche communiste. L'accélération brutale de l'histoire met le FOR devant ses responsabilités historiques. Il y va de son existence, et surtout de celle des jeunes énergies révolutionnaires qui le composent.
Ch.
[1] [1278] Les militants du FOR qui ironisent sur la "fausse trajectoire" de Révolution Internationale -titre de leur brochure diffusée à la seconde conférence des groupes de la gauche communiste- feraient mieux d'analyser la fausse trajectoire des trotskystes espagnols avant 1940 (cf. pour cela les textes cités par Munis lui-même dans son livre "Jalons d'une défaite, promesses de victoire" et le livre de Broué: "La Révolution» espagnole", éditions de Minuit, 1975).
[2] [1279] Il s'agit du Parti communiste internationaliste de Damen, issu de la scission en 1952 d'avec la fraction de Bordiga, regroupé autour de la publication "Battaglia Comunista".
[3] [1280] "Pour un second manifeste communiste", bilingue français et espagnol, Eric Losfeld, Paris, 1965; "Les syndicats contre la révolution" de B.Péret et de G. Munis, Eric Losfeld, Paris, 1968. Publier les textes de Péret des années 50 (qui se trouvent dans ce dernier recueil), dans le "Libertaire", organe de la Fédération anarchiste, était plus qu'ambigu. C'était donner un brevet révolutionnaire aux éléments anarcho-syndicalistes qui ont trempé dans la guerre antifasciste en 36-37, et continuent à être les chantres de la CNT, syndicat anarchiste.
[4] [1281] Alarme, BP 329,75624 Paris cedex 13 (France); Alarma Apartado 5355 Barcelona (Espagne).
[5] [1282] Ainsi les textes de critique de la 4e Internationale publiés au Mexique entre 1946 et 1949.
[6] [1283] cf. la Revue Internationale n° 25,1981, "Critique de Munis et du FOR"; brochure du CCI en espagnol sur l'Espagne 36-37 (1987) et l'article "Critica de Jalones de derrota, promesas de Victoria'".
[7] [1284] cf. la Revue Internationale n° 25,1981, "Critique de Munis et du FOR"; brochure du CCI en espagnol sur l'Espagne 36-37 (1987) et l'article "Critica de Jalones de derrota, promesas de Victoria'".
[8] [1285] Ce n'est pas par hasard si le trotskyste Broué reprend à son compte l’affirmation de Munis, selon laquelle auraient existé des "comités-gouvernement" assimilables aux conseils ouvriers, pour mieux prouver l'existence d'une "révolution espagnole", cf. Broué, "La révolution espagnole. 1931-39", Flammarion, 1973, p. 71.
[9] [1286] 2e Conférence des groupes de la Gauche communiste, novembre 1978. Le FOR, décidant de "rester en marge de la Conférence", la quitta finalement dès le début, ne voulant pas reconnaître l'existence d'une crise du capitalisme.
[10] [1287] "...l'école du prolétariat ne sera jamais la réflexion théorique ni l'expérience accumulée et bien interprétée mais le résultat de ses propres réalisations EN PLEINE LUTTE. L'existence précède la conscience; le fait révolutionnaire sa propre conscience pour l'écrasante majorité des protagonistes..."
"En somme, la motivation MATERIELLE de la liquidation du capitalisme est donnée par la déclinante (?) contradiction existant entre le capitalisme et la liberté du genre humain" ("Alarme" n°13, juillet septembre 1981, "Organisation et conscience révolutionnaires".
Géographique:
- Espagne [107]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
La Gauche hollandaise en 1919-1920 (2e partie) la troisième internationale
- 3485 reads
LA QUESTION ALLEMANDE
C'est par une manoeuvre que la direction du KPD fit expulser du parti la majorité de gauche en septembre 1919. Cette majorité, depuis le congrès de décembre 1918, avait pour mot d'ordre "Sortez des syndicats!" (Heraus aus den Gewerkschaften). Les militants communistes, surtout à Bremen et Hamburg, attaquaient les bureaux du syndicat social-démocrate de Legien, prenaient les caisses et en distribuaient le contenu aux ouvriers chômeurs. Lorsque se formèrent les premières unions (Unionen), la centrale de Levi et Brandler avait d'abord appuyé: elle lança le mot d'ordre de formation d'Unionen dans les chemins de fer et chez les ouvriers agricoles. Les organisations d'usine (Betriebsorganisationen) composées d'ouvriers et de délégués révolutionnaires se centralisaient pour former les Unionen. Celles-ci, avec le déclin de la révolution, apparaissaient comme des organes de lutte politique, héritage des conseils d'usine. Elles se généralisèrent au cours de l'année 19 dans les principaux secteurs de la classe ouvrière: mineurs, chantiers navals, marins, métallurgie.
A partir de l'été 1919, la position de la centrale de Levi et Brandler changea du tout au tout, non sans arrière-pensées politiques. Il s'agissait pour elle de se rapprocher des Indépendants de l'USPD, qui contrôlaient l'opposition dans les syndicats officiels. Elle se mit à attaquer la gauche comme "tendance syndicaliste". Mais, dans les faits, cette tendance était représentée par une minorité: celle du Wasserkannte (Bremen et Hamburg) autour de Laufenberg et Wolffheim, qui rêvaient d'une IWW allemande, et celle de Saxe autour de Ruhle. Ces deux tendances sous-estimaient l'existence d'un parti politique du prolétariat, qu'elles tendaient à réduire à un cercle de propagande pour les Unions. Tel n'était pas le cas de la grande majorité qui allait former le KAPD en avril 1920: elle était fortement hostile à l’anarcho-syndicalisme et au syndicalisme révolutionnaire antipolitiques. Elle ne concevait les Unionen que comme des organismes de lutte appliquant les directives du parti. Elle n'était donc pas "syndicaliste" mais anti-svndicaliste. ([1] [1288])
En août 1919, Levi, lors de la conférence nationale de Francfort, se prononça aussi bien pour un travail dans les syndicats que pour un travail au Parlement. Lors du congrès d'octobre, dit congrès d'Heidelberg, Levi présenta -sans que cela ait pu être discuté dans les sections du parti avant le congrès— une résolution d'exclusion des éléments refusant tout travail dans les syndicats et au parlement. Au mépris de toute démocratie ouvrière, dans le parti, chaque district disposait d'une voix quelle que soit sa taille et le droit de vote -en violation de la décision de la conférence de Francfort- était accordé à la centrale, d'accord pour l'exclusion de la gauche. Celle-ci, bien que majoritaire dans le KPD, fut expulsée. Il est notable que l'opposition en dehors du parti refusa de suivre Laufenberg, WoLffheim et Riïlhe qui voulaient former immédiatement un nouveau parti. Cette attitude de se battre jusqu'au bout pour la reconquête du parti est une constante de la Gauche communiste de l'époque, qui en cela est très proche de la Fraction de Bordiga.
La Gauche hollandaise se solidarisa avec la Gauche allemande. Pannekoek attaqua particulièrement Radek, qui avait soutenu théoriquement Levi ([2] [1289]) dans son combat contre la Gauche allemande. Il dénonça le rapprochement du KPD avec les Indépendants, comme glissement vers l'opportunisme ([3] [1290]). Cette politique traduisait une approche petite-bourgeoise, "blanquiste", de la conception du parti. En défendant la théorie non marxiste qu'une "petite minorité révolutionnaire pourrait conquérir le pouvoir politique et le — garder en main", Radek ne faisait que justifier la dictature de la centrale de Levi jusqu'à l'intérieur du parti. Sa position était étrangère en fait au bolchevisme. Celui-ci en octobre 1917 ne voulait pas une dictature de parti mais celle des conseils:
"Le véritable exemple russe, on le trouve dans les jours précédant novembre 1917. Là le parti communiste n'avait jamais déclaré ou cru qu'il devait prendre le pouvoir et que sa dictature soit la dictature des masses travailleuses. Il déclara toujours: les soviets, les représentants des masses devaient s'emparer du pouvoir; lui-même établit le programme, combattit pour, et lorsque finalement la majorité des soviets reconnut la justesse de ce programme elle prit le pouvoir en main...". ([4] [1291])
Le Pannekoek de 1919 n'est pas encore le Pannekoek "conseilliste" des années 30 et 40. Il reconnaît - comme la Gauche communiste depuis les années 1920 – le rôle irremplaçable du parti. Contrairement à ce que le courant "bordiguiste" lui reprochera plus tard, Pannekoek et la Gauche hollandaise n'ont rien à voir avec les positions à la Ruhle antiparti et démocratistes, avec son culte de la démocratie spontanée et le suivisme des masses:
"Nous ne sommes pas des fanatiques de la démocratie, nous n'avons aucun respect superstitieux des décisions. majoritaires et ne nous adonnons pas à la croyance que tout ce que ferait la majorité serait bon et devrait se produire"
Ce que souligne en fait la Gauche hollandaise c'est la plus grande difficulté d'une révolution en Europe occidentale, dont le cours est "plus lent et plus difficile". Les recettes de Radek pour accélérer les événements au prix d'une dictature de la minorité dans le parti sont la voie de la défaite.
Dans les pays où domine la "vieille culture bourgeoise" avec un esprit d'individualisme et de respect devant l'éthique bourgeoise, la tactique blanquiste est impossible. Non seulement elle nie le rôle des masses, comme sujet révolutionnaire, mais elle sous-estime la force de l'ennemi et le nécessaire travail de propagande, comme préparation de la révolution.
C'est le développement de la conscience de classe, comme procès difficile, qui peut permettre le triomphe de la révolution. Dans cette direction, et pour la première fois de façon explicite, Pannekoek rejette la tactique syndicale. Il appuie pleinement la Gauche allemande qui préconise la formation d'organisations d'usine ([5] [1292]) .Beaucoup moins claire restait Ta position des hollandais sur la question du parlementarisme révolutionnaire. Pannekoek avait fait paraître en effet une série d'articles dans Der Kommunist organe de l'opposition de Bremen, qui dans la plupart des questions avait une attitude d'oscillations centristes entre la droite et la gauche. Tout en montrant l'impossibilité d'utiliser le parlementarisme comme "méthode de la révolution prolétarienne" ([6] [1293]) à "l'ère impérialiste et révolutionnaire", Pannekoek semblait envisager l'utilisation de la tribune parlementaire dans les pays moins développés; selon lui, cette utilisation dépendrait de "la force, du stade de développement du capitalisme dans chaque pays". Cette théorie des "cas particuliers" aboutissait à la négation implicite de l'antiparlementarisme comme principe nouveau du mouvement révolutionnaire à l'ère de l'impérialisme décadent -"période de crise et de chaos"- et valable mondialement, quel que soit le pays. Il ne s'agissait plus alors que d'une question de tactique à déterminer en fonction des forces productives d'un pays donné. Cette idée n'était qu'implicite, mais sera largement reprise par la suite par le courant "bordiguiste" dégénérescent. ([7] [1294])
La conception théorique de la Gauche hollandaise se développait lentement; elle s'enrichissait par la confrontation polémique et avec l'expérience de la révolution allemande. Elle apprit en réalité autant de la Gauche allemande que celle-ci de la Gauche hollandaise. Il y avait une interpénétration des différentes gauches, italienne incluse, au niveau international. La cristallisation, de façon presque achevée, des positions de la gauche communiste, comme corps de doctrine, a été largement favorisée par la création du Bureau d'Amsterdam de l'Internationale communiste. Cette création est le point le plus haut de l'audience internationale de la Gauche hollandaise dans le mouvement révolutionnaire mondial.
LE BUREAU D'AMSTERDAM (1919-1920)
L'isolement, au cours de l'année 1919, du centre de la 3e Internationale établi dans un pays plongé dans la guerre civile et entouré du cordon sanitaire des armées alliées, avait conduit le comité exécutif à décider l'installation de bureaux de l'Internationale en Europe occidentale. Ceux-ci avaient autant des tâches de propagande que d'organisation des différents partis dépendant des bureaux respectifs. L'exécutif de PIC avait donc créé des bureaux en Scandinavie, dans les Balkans, dans le sud de la Russie et en Europe centrale à Vienne; simultanément était mis en place le "bureau latino-américain" de Mexico, à l'instigation de Borodine. Tous ces organismes, mal coordonnés, traduisaient encore une grande confusion dans la centralisation du travail international. Mais il était encore clair pour l'IC que dans un futur proche le centre de l'Internationale devrait être transporté, en Europe occidentale, avec le développement de la révolution. Les bureaux en question en étaient l'ébauche.
Mais à l'automne 1919, PIC mit en place simultanément un secrétariat provisoire pour l'Europe occidentale, siégeant en Allemagne, et un bureau provisoire, siégeant en Hollande et en contact permanent avec celui-là. Ces deux organismes reflétaient bien l'état des tendances dans PIC Le secrétariat était sous la coupe de la droite, celle de Levi et Clara Zetkin, qui penchait vers les Indépendants; celui d'Amsterdam regroupait les communistes de gauche hostiles au cours vers la droite du KPD.
L'IC accordait une place particulière aux Hollandais pour mener au sein du bureau d'Amsterdam la propagande et l'établissement de liens entre partis communistes d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Les Hollandais devaient diriger ce travail. Par une décision du 28 septembre 1919, l'Exécutif de PIC nommait Gorter, Pannekoek, Roland-Holst -tous à la gauche du CPN, Rutgers, Van Ravesteyn et Wijnkoop -ces deux derniers représentant la droite. Rutgers arriva début novembre pour mettre en place le "sous bureau" et organiser une conférence communiste internationale. Malgré les divergences avec les Hollandais, la confiance des bolcheviks était grande, particulièrement à l'égard de Pannekoek. Celui-ci était invité expressément à aller en Russie pour aider au travail théorique et servir d'expert. Pannekoek refusa pour rester indépendant matériellement du gouvernement russe.
Dès le départ, par une série de manoeuvres, Wijnkoop fit en sorte que Pannekoek et surtout Gorter -qu'il faisait calomnieusement passer pour psychopathe- ([8] [1295]) soient éliminés de la direction au Bureau. Ne restèrent plus, au mépris de la décision de PIC, que Rutgers, Roland-Holst et Wijnkoop. Il est vrai que Wijnkoop, durant la brève existence dû bureau, se donna une apparence de radicalité, semblant se situer à "gauche" de PIC. Il prit position contre le rapprochement du KPD avec l’USPD, contre l’entrée du PC anglais dans le Labour Party. Malgré ce radicalisme, il fit en sorte que sur des questions, comme la question parlementaire – lui-même étant député- se manifestât une position médiane. Dans les faits, il refusait de prendre position explicitement pour la Gauche communiste: en Allemagne, la lutte entre l'opposition allemande et la droite de Levi étaient définies par lui comme "une lutte entre bonzes de parti des deux directions". Mais l'apparent radicalisme de Wijnkoop dura peu, juste le temps d'exiger au 2e congrès de TIC l'exclusion des Indépendants et de Cachin et Frossard ([9] [1296]). La seule exclusion qu'il obtint fut finalement celle de la gauche dans le CPN en 1921 (cf. infra).
En vue de la conférence internationale, qui devait se tenir en février 1920, des Thèses avaient été rédigées, à l’écriture desquelles participèrent Pannekoek et Roland-Holst ([10] [1297]). Elles étaient précédées d'un appel à l'unité des communistes qui devaient se fondre en un seul parti, conformément aux décisions de l'Exécutif de l'IC.
Mais ces Thèses s'éloignaient peu ou prou de la ligne de l'IC. Les Thèses sur le parlementarisme -probablement rédigées par Rutgers- étaient un compromis entre les positions de la gauche communiste et celles de l'Internationale. Elles affirment que "le parlementarisme ne peut jamais être une organe du prolétariat victorieux", ce qui est l'une des leçons de la Révolution d'octobre. La théorie du parlementarisme révolutionnaire est défendue avec force:
"(...) l'action parlementaire comprenant les formes les plus énergiques de la protestation contre les brutalités impérialistes, et ceci en combinaison avec l'action de l'extérieur, se révélera un moyen effectif d'éveiller les masses et de susciter leur résistance. "
Il est vrai que cette assertion était accompagnée de restrictions: d'un côté, on affirmait que les parlements "dégénèrent de plus en plus en parades de foires où des escrocs abusent des masses", ce qui démontrait la vacuité du parlementarisme "révolutionnaire", de l'autre on soutient que l’électoralisme est une simple question à déterminer localement et non mondialement:
"... la question de savoir quand et comment le parlementarisme devra être utilisé dans la lutte des classes doit être réglée par la classe ouvrière de chaque pays." ([11] [1298])
Ces thèses n'étaient qu'un projet; elles furent modifiées et réécrites par Pannekoek, probablement. Le rejet du parlementarisme révolutionnaire apparaissait plus explicite, mais conditionnel, lié au surgissement des conseils ouvriers:
"(...) lorsque le parlement devient le centre et l'organe de la contre-révolution et que, d'autre part, la classe ouvrière construit les instruments de son pouvoir sous forme des soviets, il peut même s'avérer indispensable de répudier toute participation, quelle qu 'elle soit, à l'action parlementaire. "
Sur la question syndicale, les thèses étaient aussi une position de compromis. Il était préconisé que les ouvriers révolutionnaires forment une "opposition révolutionnaire à l'intérieur des syndicats", ce qui était la position de l'IC qui rêvait de "révolutionner" les syndicats contre-révolutionnaires, sous prétexte que de larges masses s'y trouvaient rassemblées. D'un autre côté le Bureau d'Amsterdam envisageait la possibilité de former des "organisations nouvelles". Celles-ci devaient être des syndicats d'industrie, et non des syndicats corporatistes basés sur le métier. Ces syndicats, d'inspiration révolutionnaire, seraient calqués sur les IWW et les shop stewards anglais. Là où, en fin de compte, le Bureau se démarquait expressément de l'IC, c'était sur le rôle des syndicats après la prise du pouvoir par le prolétariat: à la différence des Russes, qui ne voyaient plus dans les conseils -comme Trotsky ([12] [1299])- qu'un "informe parlement ouvrier", les Hollandais rejetaient vigoureusement l'idée que les syndicats pourraient "construire la nouvelle société prolétarienne". Ce rôle incombe aux soviets, organismes politiques unitaires du prolétariat.
L'influence de la révolution allemande, mais aussi celle de Pankhurst et Fraina, amena le Bureau à prendre des positions beaucoup plus tranchées, mieux étayées théoriquement et plus proches de celles de l'Opposition allemande. Le Bureau pouvait devenir le centre de regroupement de toute la gauche communiste internationale, opposée aux orientations de l'IC dans les questions syndicale et parlementaire. C'est ce que montrèrent les travaux de la conférence communiste internationale tenue du 3 au 8 février 1920, à Amsterdam.
La conférence est très représentative des forces du communisme de gauche dans les pays développés. De cette tendance étaient présents Fraina des USA, Sylvia Pankhurst de Grande-Bretagne, Van Overstraeten de Belgique, Gorter, Pannekoek et Roland-Holst de Hollande, Cari Stucke ([13] [1300]) de la gauche de Bremen. Les autres délégués se situaient soit au centre, comme Wijnkoop, Rutgers et Mannoury, soit carrément à droite, comme les membres du BSP, parti socialiste de "gauche", Willis et Hodgson. Etaient présents aussi un Indonésien et Maring-Sneevliet, délégué d'Indonésie ([14] [1301]). Sans doute prévenus trop tard, arrivèrent après la fin de la conférence les délégués du KPD de Levi - Zetkin, Frôlich, Posener et Mûnzenberg -, le Suisse Herzog, anti-parlementaire, et le secrétaire du bureau latino-américain, F.K. Puerto ([15] [1302]). Le délégué de Finlande et celui d'Espagne arrivèrent eux aussi trop tard...
Cette conférence s'apparentait à un congrès international par sa durée, l'ampleur de ses travaux et l'importante participation de délégués de différents pays de trois continents. Elle était plus représentative que les précédentes conférences d'Imola et de Francfort oui l'avaient annoncée ([16] [1303]). Il faut noter que les Hollandais étaient pourtant loin d'être à la hauteur pour le travail clandestin. Toute la conférence se trouvait sous la surveillance de la police néerlandaise et d'espions, qui notèrent tout ce qui se décidait et disait ([17] [1304]). Clara Zetkin fut arrêtée à son arrivée à Amsterdam et ne fut libérée que par l'intervention du social-démocrate de droite Wibaut, qui s'était rendu tristement célèbre en 17 dans la répression des ouvriers. Hommage rendu à la peu "extrémiste" direction du KPD?
Qualifiée de "conférence-croupion" par Clara Zetkin, la conférence internationale a représenté le communisme de gauche dans deux questions essentielles: le rejet du syndicalisme et le refus de tout entrisme dans les organisations liées à la 2e Internationale, tel le Labour Party.
Les thèses de Fraina sur le syndicalisme, votées à l'unanimité, vont plus loin que les thèses provisoires mentionnées plus haut. Elles excluent tout travail dans les "syndicats de métier", qui sont "intégrés définitivement dans le capitalisme", et rattachés politiquement au travaillisme, dont la "forme d'expression gouvernementale est le capitalisme d'Etat". Elles préconisent le syndicalisme révolutionnaire d'industrie après la prise du pouvoir, en les assimilant aux conseils d'usine, les thèses sont un rejet implicite de l’apolitisme des IWW. En préconisant l'unionisme industriel, la Gauche communiste du Bureau est bien plus proche, en apparence, du KAPD. Mais en apparence seulement, car plus tard le KAPD comme la minorité du CPN rejetteront la forme syndicale, fût-elle d'industrie et d'orientation révolutionnaire.
Mais dans le Bureau, la confusion demeurait entre parti politique et syndicat révolutionnaire. Malgré l'opposition très forte de Fraina et Pankhurst, la conférence acceptait la représentation des organisations économiques du type shop stewards dans le Bureau. Cette décision était d'ailleurs celle de l'IC jusqu'au 2e congrès...
La décision la plus importante de la conférence concerne la Grande-Bretagne. Dans ce pays existaient un très fort Labour Party, lié à la 2e Internationale, et des partis socialistes de gauche --BSP, ILP ([18] [1305]), comparables à l'USPD en Allemagne. Lénine, et avec lui TIC voulaient que les groupes communistes adhérent au Labour Party pour gagner "les masses". Cela était en contradiction avec le mot d'ordre de scission des révolutionnaires d'avec la 2e Internationale, considérée comme morte, et dont les partis encore adhérant étaient considérés non comme l'aile droite du mouvement ouvrier mais comme l'aile gauche de la bourgeoisie, et là où la "gauche" prédominait comme courant "centriste". Au début de 1920, la politique de l'IC change en préconisant la formation de partis de masses: soit par la fusion des groupes communistes avec les courants centristes majoritaires, tels les Indépendants en Allemagne, soit par l'entrisme des petits groupes communistes dans un parti de la 2e Internationale, dans le "cas particulier" de la Grande-Bretagne. Mais une politique des "cas particuliers" aboutit toujours à une politique opportuniste.
La résolution adoptée par la conférence était celle de Fraina. Elle remplaçait celle de Wijnkoop, trop vague, qui éludait les questions de l'unité des communistes et de la scission. Fraina mit en avant la nécessité de se séparer non seulement des sociaux patriotes mais aussi des "opportunistes", c'est-à-dire du courant naviguant entre la 2e et la 3e Internationale. Position identique à celle de Bordiga ([19] [1306]). Il est symptomatique que la résolution pour la scission en vue de former le parti communiste et contre la "prétendue possibilité que le nouveau parti communiste anglais puisse être lié au parti travailliste" -selon les termes de Pankhurst - fut rejetée par les délégués du BSP et un délégué hollandais (C. Van Leuven). Telle quel la résolution apparaissait comme une décision valable aussi bien contre le Labour Party que contre l'USPD.
De fait, le Bureau d'Amsterdam devenait le centre de l'opposition de gauche dans la 3e Internationale, avec pouvoir exécutif, puisqu'il exigeait que le Secrétariat de Berlin, aux mains de la droite, se cantonne dans les affaires d'Europe orientales. Le sous bureau américain ([20] [1307]) pour lequel le PC d'Amérique de Fraina était mandaté, pouvait devenir un centre de propagande de la gauche sur tout le continent américain. Devant ce danger, et au moment même où le Bureau saluait la formation du KAPD en Allemagne, l'IC décida de le dissoudre -par simple message radio de Moscou- le 4 mai 1920. Désormais le centre de l'opposition se déplaçait vers l'Allemagne, mettant fin à toute velléité d'opposition de la part de la direction de Wijnkoop et de la majorité du CPN.
CH. (à suivre)
[1] [1308] Le KAPD était très hostile à l'anarcho-syndicalisme, représenté par la FAUD, née en 1919, qui eut en mars 1920 une position pacifiste lors du putsch de Kapp, alors que la gauche communiste participait aux combats armés dans la Ruhr. Le KPD, de son côté, ne dédaignait pas le syndicalisme révolutionnaire de la FAU de Gelsenkirchen, qui en 1920-21 passa sous son contrôle.
[2] [1309] Radek tentera néanmoins de s'opposer de sa prison à la volonté de scission de Levi. Une fois celle-ci consommée, Lénine, mis au courant, se prononça clairement pour l'unité du parti, voyant dans l'Opposition un signe de jeunesse et d'inexpérience.
[3] [1310] A. Pannekoek, sous le pseudonyme de K. Horner: "Die Gewerkschaften", in Der Kommunist, 28 janvier 1920 et aussi cf. "Der Weg nach rechts", in Der Kommunist, 24.1.1920.
[4] [1311] Cette citation et la suivante sont extraites de l'article de Karl Horner: "Der neue Blanquismus", in Der Kommunist, 1920, n° 27.
[5] [1312] . Horncr, in Der Kommunist, n° 22, 1920.
[6] [1313] K. Horner: "Taktische und organisatorische Streitfragen", in Der Kommunist, 13 déc. 1919.
[7] [1314] Avant son éclatement en 1982, le courant "bordiguiste" envisageait de participer éventuellement aux élections dans certaines "aires géographiques" du "tiers-monde", où la "révolution bourgeoise" serait encore à l’ordre du jour.
[8] [1315] C’est ce que déclara Wijnkoop au congrès de Groningue du CPN en juin 1919. Gorter rompit toute relation personnelle avec lui.
[9] [1316] Sur les autres questions -parlementarisme, syndicalisme— Wijnkoop resta silencieux. A son retour en Hollande, il se chargea de faire appliquer la ligne de TIC dans le CPN.
[10] [1317] Il est difficile de savoir si Rutgers ou Pannekoek, ou les deux ensemble, ont rédigé ces Thèses sur le parlementarisme.
[11] [1318] Les Thèses du bureau d'Amsterdam furent publiées comme propositions dans l'organe de TIC en janvier 1920: "Vorschlâge aus Holland", in Die Kommunistische Internationale, n° 4-5. Traduction dans Broue, op. cit., p. 364.
[12] [1319] Trotsky, Terrorisme et communisme, éd. Prométhée, 1980, p. 119: "... la dictature des soviets n'a été possible que grâce à la dictature du parti: grâce à la clarté de sa vision théorique, grâce à sa forte organisation révolutionnaire, le parti a assuré aux soviets la possibilité de se transformer d'informes parlements ouvriers qu'ils étaient en un appareil de domination du travail."
[13] [1320] Cari Stucke était un des dirigeants de la tendance brêmoise. D'abord antiparlementaire, au moment de la conférence d'Amsterdam, il défendit quelques mois plus tard la participation aux élections en avril 1920.
[14] [1321] Sneevliet ne souffla mot pendant la conférence. Il était accompagné du sino-indonésien Tjun Sju Kwa, correspondant du CPN en Indonésie, présenté comme un "camarade chinois" (sic).
[15] [1322] il s'agit sans doute du pseudonyme du Russe Borodine, chargé du secrétariat du Bureau latino-américain, et plus tard agent du Kominterm en Chine, où il joua un rôle non négligeable dans la défaite du prolétariat chinois, avec la politique d'adhésion du PC chinois dans le Kuomintang.
[16] [1323] La conférence d'Imola du 10 octobre 1919 était une rencontre internationale de quelques délégués d'Europe occidentale avec la direction du PSI, à titre d'information. Sauf Pankhurst, les délégués étaient loin d'être à gauche. La conférence de Francfort de décembre 19 n'avait qu'un caractère informel. Le secrétariat qui en sortit comprenait Radek, Levi, Thalheimer, Bronski, Munzenberg et Fuchs, qui représentaient la tendance de droite de l'IC.
[17] [1324] Le courrier de Fraina, Nosovitsky, qui participait à la conférence, était un policier. La police néerlandaise enregistra tous les débats d'une pièce voisine de la salle de conférence; et elle communiqua à la presse bourgeoise le contenu de ceux-ci. Plusieurs délégués furent arrêtés par la police.
[18] [1325] BSP: Parti Socialiste Britannique, crée en 1911; il est la principale force constituante du CPGB (PC de Grande-Bretagne) en juillet 1920. ILP: Indépendant Labour Party, crée dans les années 1890 à partir de la société fabienne; non marxiste, il dénonça la guerre en 1914.
[19] [1326] En Italie, la tendance "centriste" était représentée par le courant dit "maximaliste" de Serrati.
[20] [1327] Le Sous Bureau devint après le 2e congrès de l'IC le Bureau panaméricain du Kominterm. Installé à Mexico, il était composé du japonais Katamaya, de Fraina et d'un nord-américain utilisant différents pseudonymes à consonance espagnole.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 53 - 2e trimestre 1988
- 2609 reads
Editorial : luttes ouvrières en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, émeutes et répression en Palestine
- 2702 reads
SEUL LE PROLETARIAT PEUT METTRE FIN A LA BARBARIE
Les médias, les journaux télévisés, la presse sont pleins de nouvelles. Depuis un an, petit à petit on apprend tout, et même beaucoup plus, sur le passé nazi du président autrichien K.Naldheim, sur l'insulte de "couille" que Chirac aurait adressée à Thatcher , pour ne citer que deux des innombrables "nouvelles d'importance" qui font couler tant d'encre.
Par contre, il faut être un lecteur assidu, et sacrement fouineur, de plusieurs journaux par jour pour découvrir les rares nouvelles ayant trait aux Misères quotidiennes et aux luttes de millions d'hommes. Parfois dans un entrefilet, on apprend la fin d'une grève... dont personne n'avait parlé à son début. Ou bien à l'occasion d'un article sur le PS portugais, on apprend que le pays est secoué par une vague de mécontentement social (février 88). Et quand la nouvelle d'une lutte ou d'une révolte ouvrière ne peut être censurée à cause de son ampleur, de ses répercussions et de son écho dans la société, alors c'est le mensonge et la désinformation la plus complète. Quand ce ne sont pas les insultes sur les ouvriers en lutte.
LA BOURGEOISIE CONTRE LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE LA SITUATION
La bourgeoisie fait le maximum pour occulter la réalité des luttes ouvrières. Aujourd'hui la faillite économique du capitalisme ne peut plus être cachée. La bourgeoisie internationale se prépare à accentuer encore plus dramatiquement ses attaques contre les conditions d'existence de l'humanité entière, et en premier lieu du prolétariat mondial. La censure des médias sur les luttes vise à limiter, si elle ne peut l'empêcher, le développement de la confiance en soi, dans sa force, dans son combat, du prolétariat.
Mais il n'y a pas que les luttes ouvrières que la bourgeoisie essaye de masquer. Alors qu'une véritable armada des principaux pays du bloc occidental se trouve sur le pied de guerre dans le golfe Persique face au bloc russe, avec pour prétexte de mettre au pas l'Iran de Khomeiny, c'est plutôt la discrétion qui règne dans les médias. Sauf campagne de propagande précise. Et pourtant il ne se passe pas de jour sans opérations militaires. Sans parler évidemment de la poursuite de la guerre Iran-Irak. Les grandes puissances se livrent en ce moment à un renforcement considérable de l'armement qu'elles essaient de masquer derrière les campagnes sur le "désarmement" est-ouest (sommet Reagan-Gorbatchev, sommet de l'OTAN). Partout, il s'agit de limiter autant que faire se peut la prise de conscience que le capitalisme c'est la guerre. S'il n'est pas détruit de fond en comble, il n'a rien d'autre à offrir à l'humanité qu'une 3ème guerre mondiale.
LA DECOMPOSITION DU CAPITALISME
L'avenir que nous prépare le capitalisme se manifeste dans toute son horreur au Moyen-Orient: la guerre Iran-Irak; non contents d'avoir déjà envoyé plus d'un million d'hommes à la mort sur le front, les Etats se livrent à la "guerre des villes" : la population civile massacrée à coups de missiles lancés à l'aveuglette, en plein coeur des villes. Pour "faire pression sur l'ennemi". Le Liban, dont on connaît l'horreur devenue endémique. Et maintenant les "territoires occupés" par Israël.
Nous dénonçons ici la répression sauvage que l'Etat bourgeois israélien exerce contre les populations en révolte des territoires occupés. En révolte contre la misère, le chômage massif, les famines, et contre la répression systématique et sauvage qu'elles subissent en permanence. Presque une centaine de morts. Tués par balles. Des blessés par milliers. Blessés par les sévices imposés: tortures, "passages à tabac", bastonnades. Et tout particulièrement des fractures des bras et des phalanges des mains à coup de pierre, de casque, infligés à froid et systématiquement par les soldats. Certains resteront infirmes à vie. Bref la terreur. La terreur capitaliste, banale et courante, telle qu'elle existe quotidiennement dans le monde. Rien qui soit exceptionnel à vrai dire.
Mais il ne suffit pas de dénoncer la répression. Il faut aussi dénoncer, et sans équivoque, toutes les forces qui agissent pour dévoyer cette colère, cette révolte, dans l'impasse du nationalisme. L'OLP certes. Mais aussi et surtout l'ensemble du bloc occidental, USA en tête évidemment, qui pousse l'OLP, qui pousse à son implantation dans les territoires occupés -jusque là relativement faible-, qui pousse, sinon à la constitution d'un Etat palestinien, du moins au contrôle de la population par l'OLP. Et qu'Israël, malgré sa bonne volonté, n'arrive plus à garantir. Il n'y a rien à attendre de l'OLP sinon l'exercice de la même terreur étatique que celle d'Israël. L'OLP a déjà largement fait ses preuves dans la répression et le maintien de l'ordre capitaliste dans les camps palestiniens du Liban.
Disons-le clairement. Que ce soit avec Israël ou avec un Etat palestinien, les populations des territoires occupés et en exil dans les camps palestiniens du Liban ou d'ailleurs vont souffrir encore plus de la misère, de la répression et de la guerre permanente qui existent et se développent en particulier dans cette région du monde. Tout comme pour l'ensemble des populations voisines. La seule façon de limiter les effets de cette barbarie croissante réside dans la capacité de la classe ouvrière de ces pays à entraîner les populations dans le refus de la logique guerrière et de la misère. Et c'est possible: les manifestations de rue au Liban contre les hausses de prix; la réalité du mécontentement ouvrier en Israël déjà exprimé par des grèves et des manifestations.
En troisième lieu, nous voulons aussi dénoncer le choeur des pleureuses, des démocrates de gauche, et autres humanistes, qui recommandent de "tout leur coeur" un traitement humain dans la répression. Une répression qui serait "humaine". Non violente sans doute. Et pourquoi pas rêver de guerre sans morts et sans souffrance. Guerre humaine quoi. Ces gens ne sont pas aussi idiots que cela. En fait, ce sont des hypocrites qui participent de toutes leurs larmes à la campagne médiatique et idéologique du bloc occidental visant à rendre la population otage de la fausse alternative: ou Israël ou l'OLP.
La publicité des médias faite autour des exactions de l'armée israélienne est le fait conscient du bloc US: il utilise la violence de la répression tout comme les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chat Ila à Beyrouth en septembre 1982. Massacres accomplis sous les yeux complices des soldats israéliens. Massacres qui avaient servi à justifier aux yeux des populations occidentales l'envoi au Liban des armées US, britannique, française et italienne en 1982.
La situation dans les territoires occupés signifie que l'Etat d'Israël, à son tour, est en train de se "libaniser". C'est toute la région, tout le Moyen-Orient qui se "libanaise". C'est toute la société qui se décompose et pourrit. Cette décomposition est le produit du déclin, de la putréfaction du capitalisme. Il pourrit sur pied. Partout dans le monde.
SEUL LE PROLETARIAT PEUT EN FINIR AVEC LA BARBARIE DU CAPITALISME
Faillite économique, misère croissante et la guerre. Voilà dans toute son horreur ce que le capitalisme nous offre. Et cela alors qu'il existe potentiellement dans le monde un développement des forces productives suffisant amplement à mettre fin à la misère de la planète. C'est la réalité de ces contradictions qui forge la prise de conscience de la classe ouvrière
- du futur que nous prépare la bourgeoisie si on ne lui enlève pas le pouvoir;
- qu'elle seule, classe ouvrière, est en mesure d'enlever le pouvoir à la bourgeoisie parce que c'est elle qui produit tout, que c'est grâce à elle que tout fonctionne. Et qu'une classe dominante qui n'est plus obéie n'est plus une classe dominante.
La prise de conscience révolutionnaire qui passe obligatoirement par l'unification des prolétaires. Unification qui ne peut se faire que dans la lutte commune, sur des intérêts communs, contre un ennemi commun.
LE PROLETARIAT CONTINUE A LUTTER
A l'heure où nous écrivons, et malgré la censure de fait établie par l'ensemble de la presse internationale, le mouvement de lutte en Grande-Bretagne continue: grèves dans l'automobile, mécontentement constant et luttes parmi les infirmières et dans les services publics, dans l'enseignement. Malgré cela, au vu des informations fournies par les camarades de notre section en Grande-Bretagne, nous pouvons dire aujourd'hui que le mouvement semble marquer une pause.
Les premiers jours de février, les infirmières, 15 000 mineurs, 7 000 marins, 32 000 ouvriers de Ford et ceux de General Motors (Vauxhall), de Renault Truck industries (RVI), les enseignants, se mobilisent malgré l'opposition et les sabotages syndicaux ([1] [1328]) . D'abord débordés, les syndicats vont vite obtenir une première victoire: en réussissant à retarder le déclenchement de la grève à Ford pour après la grève nationale des infirmières du 3 février. Malgré la simultanéité des luttes, malgré diverses manifestations de solidarité avec les mineurs et les infirmières, malgré l'éclatement d'une grève sauvage dès le 4, aux usines Ford de Londres,, les syndicats vont reprendre le contrôle de la situation en évitant toute tentative d'extension et d'unification à partir de Ford, véritable coeur du mouvement. L'isolement des ouvriers de Ford réussi, leur retour au travail obtenu au prix d'une promesse d'augmentation salariale de 14% sur 2 ans, la possibilité d'une première unification des différentes luttes ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui les syndicats, pour le moment maîtres de la situation, préparent toute une série de journées d'action par secteur en vue d'épuiser la forte combativité dans des actions cloisonnées et sans perspective.
LES OUVRIERS BRITANNIQUES NE SONT PAS SEULS
Malgré la propagande bourgeoise selon laquelle les ouvriers sont passifs, résignés et sans combativité, ce mouvement de lutte en Grande-Bretagne vient confirmer l'existence d'une vague internationale de luttes. Ce mouvement succède à celui des ouvriers en Belgique au printemps 86, à la grève dans les chemins de fer français de l'hiver dernier, aux luttes ouvrières du printemps 87 en Espagne, à celles, massives, en Italie au cours de l'année 87 et au mouvement de colère et de lutte en Allemagne à la fin de cette même année. Sans parler des myriades de petits conflits qui ne font pas parler d'eux mais n'en représentent pas moins une immense acquisition d'expérience pour le prolétariat sur ce qu'est le capitalisme. Et ces luttes au coeur de la vieille Europe ne sont pas isolées: luttes en Yougoslavie, en URSS, en Roumanie, en Pologne pour les pays de l'Est; en Corée, à Taiwan, au Japon; en Suède, au Portugal, en Grèce; en Amérique Latine... Tout cela depuis le début 87. Même dans les pays où la bourgeoisie réussissait encore à empêcher l'éclatement de luttes ouvrières malgré le mécontentement, l'accélération brutale de la crise rompt l'équilibre fragile qui existait tant bien que mal.
Ce sont tous les continents qui sont touchés par le développement des luttes ouvrières. Outre la simultanéité dans le temps, ces mouvements manifestent les mêmes grandes caractéristiques: ils sont massifs; ils touchent plusieurs secteurs à la fois parmi les plus concentrés et les plus nombreux, et en particulier la fonction publique; ils posent tous la nécessité de briser le corporatisme et de réaliser l'unification entre les différents secteurs en lutte; ils manifestent une méfiance chaque fois plus grande à l'égard des syndicats en les débordant tout au moins au début; et en tentant de leur disputer le contrôle et l'organisation des luttes.
LES LUTTES ACTUELLES NE SUFFISENT PAS: IL FAUT ALLER PLUS LOIN
La situation actuelle est marquée par une accélération terrible de l'histoire sur tous les plans: économique par la chute dans la crise; guerrier par l'accentuation des antagonismes impérialistes; social par l'existence des luttes ouvrières de défense face aux attaques économiques. Cette accélération sur tous les plans signifie pour le prolétariat l'annonce d'attaques encore plus dramatiques sur ses conditions d'existence. Ces attaques vont nécessiter de sa part un effort important pour pouvoir développer à un niveau plus haut ses luttes. Il devra de plus en plus assumer l'aspect politique de ses luttes économiques:
"Dans les combats à venir de la classe ouvrière, une compréhension claire de leur enjeu véritable, du fait qu'ils ne constituent pas une simple résistance au coup par coup contre les agressions croissantes du capital nais qu'ils sont les préparatifs indispensables en vue de la seule issue pour l’humanité: la révolution communiste, une telle compréhension de l'enjeu sera la condition tant de leur efficacité immédiate que de leur aptitude à servir réellement de préparatifs pour les affrontements à venir.
Par contre, toute lutte qui se cantonne sur le terrain strictement économique, défensif contre l'austérité sera plus facilement défaite, tant au niveau immédiat que comme partie d'une lutte beaucoup plus vaste, fin effet, elle sera privée du ressort de cette arme, aujourd'hui si importante pour les travailleurs qu'est la généralisation et qui s'appuie sur la conscience du caractère social et non pas professionnel du combat de la classe. De même, par manque de perspectives, les défaites immédiates seront surtout un facteur de démoralisation au lieu d'agir comme éléments d'une expérience et d'une prise de conscience." (Revue Internationale n°21, 2è trimestre 1980)
Se limiter à combattre les conséquences économiques de la crise du capitalisme sans lutter contre la cause elle-même, c'est, à terme, rendre inefficaces les luttes même au plan économique. Lutter contre la cause des malheurs qui assaillent l'humanité, c'est non seulement lutter contre le mode de production capitaliste, mais aussi le détruire de fond en comble et en finir avec la misère et les guerres. Et cela seul le prolétariat peut le réaliser. Pour aller plus loin, la classe ouvrière doit tirer les leçons de ses luttes passées. Les travailleurs britanniques viennent de nous montrer qu'ils s'étaient remis de la défaite cuisante subie lors de la grève des mineurs. En particulier en en tirant la principale leçon: les luttes isolées, même si elles sont longues, sont vouées à l'échec.
EN ITALIE: L'OBSTACLE DU SYNDICALISME DE BASE
Déjà durant le "mai rampant" italien en 1969, les ouvriers s'étaient affrontés durement aux syndicats. La forte méfiance à leur égard est sans doute une des principales caractéristiques du prolétariat dans ce pays. En 1984, les ouvriers en lutte contre la remise en cause de l'échelle mobile des salaires avaient refusé d'obéir aux syndicats officiels. Et le mouvement était parti derrière les "conseils d'usines" qui en fait étaient de véritables organes syndicalistes de base. Son apogée, et en même temps son enterrement, fut la participation d'un million d'ouvriers à la manifestation de Rome en avril 84.
L'échec de cette lutte a nécessité trois ans de "digestion", de réflexion, de mûrissement de la conscience ouvrière. Le mouvement de 87 qui démarre dans les écoles au printemps rejette les syndicats officiels. Il s'organise en assemblées et en comités de délégués -les COBAS- pour s'étendre dans tout le pays. Quarante mille personnes manifesteront à Rome au mois de mai à l'appel des seuls COBAS. Mais il ne réussira pas à s'étendre à d'autres secteurs malgré la mobilisation existante. Après les vacances de l'été le mouvement dans l'école s'essouffle, et les autres mobilisations ouvrières -surtout dans les transports- restent isolées et dispersées sans réussir à prendre véritablement le relais de l'école. Et cela en particulier à cause de la mainmise de plus en plus forte du syndicalisme de base sur les COBAS qui se sont développés un peu dans tous les secteurs en lutte.
Quand la mobilisation retombe, quand le mouvement recule, ces comités de délégués deviennent une proie facile pour le syndicalisme. Celui-ci fait dévier l'indispensable recherche de la solidarité et de l'extension entre les différents secteurs en lutte vers de faux problèmes, en vérité des pièges, pour étouffer la combativité ouvrière:
- d'abord dans la question de l'institutionnalisation ou de la légalisation des COBAS en vue d'en faire de nouvelles formes syndicales qui ne veulent pas dire leur nom et ayant la confiance des ouvriers;
- dans le cadre du corporatisme (spécialement dans les chemins de fer parmi les conducteurs);
- dans la centralisation trop précipitée, hâtive des comités dans des assemblées au plan régional et surtout national où les syndicalistes de base gauchistes peuvent utiliser toute leur science de la manoeuvre bureaucratique et... syndicale.
Au nom de l'extension, les syndicalistes de base, qui y sont dans les faits opposés, n'hésitent pas à provoquer un contre-feu qui s'avère bien souvent efficace en provoquant, soit trop tôt, soit artificiellement, la "centralisation" des premières et immatures tentatives de prise en main de leur lutte par les ouvriers, pour mieux les étouffer dans les assemblées de base. Un peu comme les bourgeons se développant trop tôt et détruits par les dernières gelées de l'hiver. C'est le mouvement et la vitalité des luttes, l'existence des assemblées ouvrières, la recherche de l'extension, le processus vers l'unification par la prise en main des luttes par les ouvriers eux-mêmes, qui peuvent mener à la centralisation indispensable et effective des combats ouvriers.
LE GEANT PROLETARIEN ALLEMAND SE REVEILLE ET ANNONCE L'UNIFICATION DES LUTTES
Le mouvement de décembre 87 autour de l'opposition aux 5 000 licenciements à une usine Krupp à Duisburg a été la lutte la plus importante en Allemagne depuis les années 20. Le prolétariat allemand est appelé à jouer un rôle central dans le processus révolutionnaire de par sa concentration, sa puissance, son expérience historique particulièrement riche, ses liens avec le prolétariat de RDA et des pays de l'Est. Les luttes de décembre portent un coup au mythe de la prospérité allemande, de la discipline et de la docilité des ouvriers de ce pays. Nous sommes au début de luttes massives en RFA.
L'importance de cette lutte fut qu'elle provoqua la participation d'ouvriers de différentes villes et de différents secteurs dans un mouvement classiste de solidarité. Non dans la grève, mais dans les manifestations de rue, dans les meetings de masse et dans les délégations de masse. Alors que dans la grève des cheminots français (SNCF), la question centrale était encore l'extension d'un secteur isolé au reste de la classe, en Allemagne la question de l'unification autour des ouvriers de Krupp fut posée dès le début.
Nais surtout l'importance de cette lutte réside en ce qu'elle annonce. Malgré son manque d'expérience, d'affrontements aux syndicats et à leurs manoeuvres, aux partis de gauche et au gauchisme du syndicalisme de base, dès son entrée sur la scène sociale, le prolétariat allemand indique clairement la caractéristique principale et la perspective des mouvements à venir: ce sont les secteurs centraux, le coeur du prolétariat européen, qui vont être touchés par les attaques. Les principales concentrations ouvrières: la Ruhr, le Benelux, les régions de Londres et de Paris, et le nord de l'Italie. Ce sont ces fractions centrales qui vont entrer en lutte et ouvrir, "offrir" à l'ensemble de la classe ouvrière, la perspective concrète de l'unification des combats ouvriers dans chaque pays. Et la perspective de la généralisation internationale de la lutte ouvrière.
Les mouvements en Italie et en Allemagne synthétisent et cristallisent les principales nécessités de TOUTES les luttes actuelles dans le monde au-delà des particularités politiques locales et nationales:
- ne pas rester isolés dans le corporatisme;
- étendre les luttes;
- les organiser en assemblées générales en ne laissant pas le syndicalisme -officiel ou "masqué", "radical", de base- les étouffer par ses sabotages et ses manoeuvres;
- assumer le caractère général et politique des luttes: toute la classe ouvrière est attaquée, unifier les luttes en une seule lutte contre les différents Etats.
IL FAUT SE PREPARER AUX COMBATS A VENIR
Les luttes qui vont se produire ne sont pas gagnées d'avance. Automatiquement. Il faut que la classe ouvrière les prépare et s'y prépare. C'est ce qu'elle a fait et continue de faire par ses luttes mêmes. Par sa propre pratique. En développant son expérience. En en tirant les leçons. En prenant confiance dans sa propre force. C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui renforce sa prise de conscience de manière massive et collective. Dans les luttes ou bien en dehors de celles-ci de manière "invisible", souterraine telle la taupe comme disait K. Marx.
Dans cette tâche, un rôle particulier est dévolu aux minorités d'ouvriers -organisées ou non- les plus combatives et les plus conscientes. Celles-ci doivent se préparer aux combats à venir si elles veulent remplir le rôle pour lequel le prolétariat les a produites. Parmi celles-ci, les groupes révolutionnaires sont irremplaçables et se doivent d'être à la hauteur de la situation. Etre à la hauteur de la situation signifie en premier lieu reconnaître celle-ci. Reconnaître la vague internationale de luttes actuelles et sa signification. Cette reconnaissance doit servir aux groupes communistes pour assurer une présence, une intervention politique sur le terrain, dans les luttes. Une intervention qui soit juste et efficace immédiatement et à plus long terme. Pour cela, il faut que les révolutionnaires ne tombent pas dans les pièges tendus par le syndicalisme de base. Et surtout n'en restent pas prisonniers. Prisonniers en particulier, comme nous l'avons vu ces dernières années:
- de la "fétichisation" de 1'auto-organisation au travers des coordinations et autres "assemblées nationales" centralisatrices mises en place par les syndicalistes gauchistes;
- du corporatisme et du localisme même au travers du radicalisme violent et du jusqu'au-boutisme véhiculés par les PC et les gauchistes.
Enfin, les révolutionnaires doivent pousser et participer aux regroupements ouvriers. En particulier, favoriser toutes les formations de comités de lutte. Car les ouvriers les plus combatifs ne doivent pas attendre l'éclatement de mouvements pour tisser des contacts entre eux, pour discuter, réfléchir ensemble, se préparer aux luttes afin d'en faire la propagande, l'agitation. Et par la suite, malgré les magouilles, les obstacles, voire l'opposition violente des syndicalistes, intervenir et prendre la parole dans les grèves, les assemblées, les manifestations de rue pour défendre les besoins des luttes et entraîner l'ensemble des ouvriers.
Il en va de la défense immédiate des conditions d'existence de la classe ouvrière. Il en va de l'avenir de l'humanité gravement menacée par l'absurdité aveugle et suicidaire du capitalisme. Seul le prolétariat international peut aujourd'hui limiter le développement de la misère. Et surtout, seul le prolétariat peut en finir à jamais avec la barbarie capitaliste.
R.L. 7/3/88.
[1] [1329] Pour le suivi plus précis de ce mouvement, nous renvoyons nos lecteurs à nos différentes publications territoriales.
Géographique:
- Europe [274]
- Moyen Orient [10]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
20 ANS depuis MAI 1968 : le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne
- 5094 reads
Les commentateurs "officiels" de l'histoire et les nostalgiques déçus des années de gloire du "mouvement étudiant" fêtent l'anniversaire des 20 ans de Mai 1968 en étant d'accord sur un point: les "rêves révolutionnaires de 68" n'étaient que des rêves. La réalité des 20 années qui nous séparent de l'explosion sociale de Mai 68 n'aurait fait que confirmer le caractère utopique de l'idée de la révolution communiste. Les conditions d'une telle révolution loin d'avoir mûri, se seraient au contraire éloignées. Il suffit pourtant de ne pas chausser les lunettes opaques de 1'idéologie de la classe dominante pour percevoir que la dynamique profonde qui traverse ces deux décennies traduit un mûrissement, sans précédent dans l'histoire, des conditions d'une révolution communiste mondiale.
Il est impossible de traiter ici en détail ces 20 années de lutte de classe particulièrement riches en enseignements. Mous nous attacherons uniquement à répondre à deux questions : quelle fut la signification de Mai 68? Les conditions d'une révolution communiste mondiale se sont-elles développées depuis lors?
LA RUPTURE DE MAI 1968
Mène s'ils se sont déroulés en France, les événements du printemps 68 étaient par leurs racines comme par leurs conséquences d'une dimension internationale. C'est dans le monde entier que les relations entre les classes commençaient à connaître un changement profond. Ces événements ne faisaient que concrétiser de façon éclatante un processus qui se déroulait à l'échelle de la planète et c'est comme tel qu'ils doivent être envisagés.
La grève de nasses de 1968 en France, comme la quasi-totalité des grèves ouvrières importantes de ce siècle, fut au départ totalement spontanée: ce ne sont pas les syndicats qui ont déclenché le mouvement, au contraire. Ceux-ci tentèrent au début, en vain, d'arrêter par tous les moyens la mobilisation naissante.
Sur le plan immédiat, cette mobilisation trouva au départ un amplificateur gigantesque, dans la volonté de répondre la brutale répression à laquelle se livrait l'Etat contre des manifestations d'étudiants. Contre cette répression, le 13 mai, Paris connaissait une des plus grandes manifestions de son histoire. Puis, en quelques jours par centaines de milliers, dans toutes les villes de France, tous les secteurs de la classe ouvrière sont entrés en lutte. Tout aussi rapidement le mouvement de grève se faisait l'expression du profond mécontentement qui mûrissait dans l'ensemble de la classe travailleuse. 10 millions de travailleurs paralysaient l'essentiel de l'appareil productif du capital français.
L'arrogance coutumière de la classe dominante laissait la place à la surprise et au désarroi devant le déploiement de force de ce prolétariat qu'elle croyait définitivement soumis et vaincu. Après avoir subi la défaite sanglante des insurrections ouvrières qui ont marqué la fin de la 1ère guerre mondiale, après avoir subi le triomphe de la contre-révolution stalinienne en Russie, après avoir subi dans les années 30 les effets d'une dépression économique sans avoir les moyens de répondre, après avoir subi une deuxième guerre mondiale dont les horreurs et la barbarie étaient à peine prévisibles, après avoir subi 20 ans de reconstruction économique avec la robotisation et l'atomisation la plus effroyable de la vie sociale, après avoir vécu près de 40 ans sous le contrôle quasi militaire des partis politiques staliniens, fascistes ou démocratiques , après avoir entendu pendant des années qu'elle s'embourgeoisait, bref après des décennies d'écrasement, de soumission et de désorientation, en mai 1968 la classe ouvrière revenait par la grande porte sur la scène de l'histoire. Si l'agitation estudiantine qui se développait en France, depuis le début du printemps avait déjà bouleversé l'ambiance sociale du pays: affrontements répétés avec les forces de l'Etat sur des barricades où il n'y avait pas que des étudiants; s'il y avait déjà eu des premières grèves qui pouvaient annoncer un prochain orage (Sud-Aviation, Renault-Cléon), l'entrée massive en lutte de la classe ouvrière bouleversa tout. La classe exploitée relevait la tête et cela entraînait une secousse dans l'ordre social jusque dans ses fondements les plus profonds. Des "comités d'action", d'usine ou de quartier, des "comités de lutte", des "groupes ouvriers" se formaient partout rassemblant les éléments les plus combatifs qui cherchaient à comprendre et à se regrouper pour agir indépendamment des structures syndicales. Les véritables idées communistes y retrouvaient un droit de citer.
Cependant la classe ouvrière, qui fut certainement la première surprise par l'ampleur de sa propre force, n'en était pas, dans son ensemble, à se poser la question de jouer le tout pour le tout dans une tentative révolutionnaire. Loin de là. Elle en était à ses premiers nouveaux pas, sans expérience et encore pleine d'illusions.
La bourgeoisie, passé l'effet de surprise ne resta pas les bras croisés. Déployant une coopération sans faille entre tous ses secteurs politiques, de la droite à l'extrême gauche et des forces de répression policière aux structures syndicales, elle parvint à reprendre le contrôle de la situation. Il y eut les concessions économiques accordées à grand renfort d'appels à la reprise du travail après la "victoire des accords de Grenelle". Il y eut l'annonce d'élections dans le but a peine voilé de dévoyer les luttes du terrain de la rue vers celui des urnes. Mais il y eut surtout l'habituelle combinaison de la répression policière et du sabotage des luttes de l'intérieur par les syndicats et les forces de la gauche du capital. Dés le départ les syndicats orientèrent les travailleurs vers l'occupation des usines, nais une occupation qui devait s'avérer rapidement un moyen d'emprisonner les travailleurs et de les isoler les uns des autres, sous prétexte de "protéger l'outil de travail contre les étudiants provocateurs". Tout au long du mouvement, les syndicats se sont appliqués à entretenir cet éparpillaient et enfermement des forces. Les heurts directs sont fréquents entre ouvriers et responsables syndicaux, pourtant prêts à tout faire pour ne pas perdre toute crédibilité. Après la signature des dits "accords de Grenelle", le responsable du principal syndicat, Georges Séguy (secrétaire général de la CGT et membre du bureau politique du PCF), venu à Renault-Billancourt pour faire voter leur acceptation et la reprise du travail, se voit désavoué par l'assemblée générale. Il faudra toute la capacité manoeuvrière des syndicats pour parvenir enfin à faire reprendre le travail. Deux exemples concrets résument bien ce que fut le travail final de "rétablissement de l'ordre": le premier, les syndicats appelant à la reprise du travail dans les différents dépôts des chemins de fer et des transports de la capitale en affirmant mensongèrement que d'autres dépôts l'avaient déjà fait; le second, à Sochaux, dans la plus grande usine d'automobiles de France, relativement isolée à l'est du pays, au moment des très violents affrontements provoqués par les charges de police pour faire évacuer l'usine -DEUX OUVRIERS SONT TUES PAR LA POLICE- la CGT sabote matériellement l'organisation de la résistance dans l'usine, toujours pour "ne pas céder à la provocation".
Beaucoup d'ouvriers rentrèrent la rage au ventre. Beaucoup de cartes Syndicales furent déchirées. La presse "bien pensante" parlait élogieuse du sens des responsabi1ités des syndicats. La bourgeoisie parvint à rétablir l'ordre, son ordre.
Mais les événements de 1968 avaient bouleversé irréversiblement la situation historique. 10 millions d'ouvriers, au coeur de la zone la plus industrialisée du monde, avaient fermé avec fracas une porte de l'histoire: celle de près de 40 ans d'écrasement idéologique du prolétariat, de 40 ans de contre-révolution triomphante. Une nouvelle période historique commençait.
Mai 68 pose la question de la perspective révolutionnaire
Aujourd'hui la bourgeoisie ne parle plus de 68 avec la haine qu'elle inculquait à ses forces de police au moment des barricades ou de Sochaux. A travers ses médias elle prend même parfois un ton d'attendrissement pour parler des UTOPIES des jeunes de ce temps là. Mai 68 c'était un beau rêve, mais irréalisable. Car, sous-entendu, le capitalisme est éternel.
Il est vrai qu'en Mai 68 la question de la révolution devint à nouveau pour des millions de personnes un objet de débats et de réflexion. Il est vrai que pour une partie des étudiants "la révolution" était à l'ordre du jour, immédiatement. On voulait TOUT, TOUT DE SUITE! Et il est vrai aussi que c'était là une utopie.
Mais l'utopie n'était pas dans l'idée générale de la nécessité et la possibilité de la révolution -comme le dit la bourgeoisie- mais dans l'illusion de croire que celle-ci était, il y a 20 ans, immédiatement réalisable.
Tout d'abord une remarque. Pour la partie des étudiants qui se réclamait de "la révolution" (une petite minorité, contrairement à ce que certaines légendes laissent penser) le mot de révolution ne voulait souvent pas dire grand chose. Avant 1968 en France, comme dans la plupart des pays, il y avait déjà une agitation estudiantine. Beaucoup de jeunes étudiants s'intéressaient aux luttes de libération nationale des pays moins développés (car pensaient-ils, il n'y avait rien à attendre du prolétariat trop embourgeoisé des pays industrialisés); Che Guevara était la nouvelle idole; ils croyaient souvent au "socialisme" ou à "la nature ouvrière" des régimes des pays de l'Est... avec des préférences suivant les courants pour la Chine, Cuba, l'Albanie...; et quand l'idée de révolution n'était pas identifiée avec celle d'un capitalisme d'Etat à la stalinienne elle se perdait dans un flou artistique qui allait des élucubrations autogestionnaires aux utopies dépassées des socialistes pré-marxistes; les stupidités d'un Marcuse sur la disparition de la classe ouvrière et sur la nature révolutionnaire de couches comme les étudiants trouvaient un franc succès. Il n'en demeure pas moins que, indépendamment des confusions universitaires, la réalité posait la question de la perspective révolutionnaire. Le retour de la force du prolétariat sur la scène sociale, le fait que celui-ci démontrait dans la pratique sa capacité à se saisir de l'ensemble de l'appareil productif social, le fait que la chape de plomb du pouvoir des classes dominantes perdait soudain son apparence éternelle, immuable, inévitable, tout cela faisait que -même si ce n'était pas en termes de réalisation immédiate- la question de la révolution revenait hanter les esprits.
"A mieux considérer les choses, on verra toujours que la tache surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées, où sont en train de se créer".
Marx, Avant-propos à la Critique de l'économie politique.
Un nouveau développement des conditions de la révolution était "en train de se créer" en 1968. Ce même prolétariat qui avait été capable de se lancer à plusieurs reprises dans l'histoire à l'assaut révolutionnaire contre la société d'exploitation, était de retour et il se préparait encore une fois à recommencer. Mais on n'était qu'au début d'un processus.
* Quelles sont les conditions d'une situation révolutionnaire?
Lénine définissait les conditions d'une telle situation en disant en substance qu'il fallait "que ceux d'en haut ne puissent plus gouverner comme auparavant" et que "ceux d'en bas ne veuillent plus vivre comme auparavant". En effet, une révolution sociale implique un bouleversement de fond en comble des rapports sociaux existants pour tenter d'en établir de nouveaux. Cela exige la volonté révolutionnaire des lasses lais aussi un affaiblissement "objectif des conditions de pouvoir de la classe dominante. Or le pouvoir de cette classe ne repose pas uniquement sur les armes et la répression. (Contrairement à ce que prétend l'anarchisme). Ce pouvoir trouve ses fondements, en dernière instance, dans la capacité de la classe dominante à assurer le fonctionnement d'un mode de production permettant la subsistance matérielle de la société. Aussi n'y a-t-il pas de véritable affaiblissement de l'ordre établi sans crise économique, que cette crise prenne la forme "pure" ou celle "déguisée" d'une guerre. Cette crise économique est aussi une condition nécessaire, même si non suffisante, pour le développement de la volonté révolutionnaire de la classe ouvrière. C'est cette crise qui par l'aggravation des conditions d'existence qu'elle entraîne, pousse la classe exploitée à réagir et à s'unifier au niveau mondial.
A ces conditions "objectives", c'est-à-dire indépendantes de l'action de la classe révolutionnaire, doivent s'ajouter évidemment celles qui mesurent l'extension et la profondeur de la conscience et la volonté révolutionnaires dans cette classe: dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante, assimilation de sa propre expérience historique, confiance en soi, réappropriation de son programme historique.
En 1968 ces conditions commençaient à se former, mais, ce développement était encore loin d'être parvenu à son terme.
Sur le plan économique, le capitalisme sortait à peine de la période de relative prospérité de la reconstruction. La récession de 67, si elle traduisait la fin de quelque chose et l'ouverture d'une nouvelle période de crise économique, restait encore fort modérée. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie commençait de nouveau à se rétrécir de façon accélérée, mais elle avait encore les moyens de faire face aux secousses de la machine économique, même si c'était au prix de manipulations économiques des Etats qui ne faisaient que préparer de nouvelles et plus grandes difficultés pour l'avenir. Pour la classe ouvrière mondiale cette situation se traduisait encore par des illusions quant à la possibilité d'une nouvelle prospérité. Le caractère mondial de la crise économique, qui aujourd'hui semble si évident, ne l'était pas à l'époque. On croyait encore souvent que les difficultés économiques étaient d'ordre national et qu'une meilleure gestion des affaires publiques suffirait à rétablir la situation. Dans les pays les moins développés c'était les illusions sur les dites" luttes de libération nationale".
Le chômage recommençait à se développer, d'où une certaine inquiétude, mais son niveau restait encore proche de celui du "plein-emploi" (un terme employé à l'époque et tombé depuis quasiment en désuétude). De façon générale, le niveau de vie s'il se dégradait déjà, était encore loin de connaître les chutes violentes qu'il connaîtrait dans les deux décennies suivantes. (Voir l'article consacré à 20 ans de crise économique).
Cette immaturité générale se concrétisait aussi au niveau de l'autonomie du prolétariat à l'égard des forces syndicales du capital. Mai 68, comme toutes les luttes de notre époque, s'est caractérisé par l'intensification de l'opposition ouverte entre ouvriers et organisations syndicales. En Mai 68 comme en 69 en Italie, la lutte ouvrière devait se heurter souvent violemment à celles-ci. Mais ici encore ce n'était que le début d'un processus. Malgré la méfiance croissante, les illusions sur la nature des syndicats qu'on considérait "malgré tout ouvrière", restait importante.
Mais ce qui manquait le plus à la génération de prolétaires de 1968 c'était l'expérience des combats. Pour gigantesque qu'ait été le déploiement de forces de Mai 68, la classe ouvrière dans son ensemble était loin de comprendre ce qu'elle était en train de faire et encore moins de le maîtriser. De façon générale son expérience immédiate se résumait encore trop souvent aux ballades syndicales, aux enterrements des Premier Mai, aux grèves longues et isolées.
Mai 68 était très loin de constituer une véritable situation révolutionnaire. L'ensemble de la classe ouvrière le savait ou le sentait. Et toute l'impatience de la petite-bourgeoisie intellectuelle en révolte qui voulait "Tout, tout de suite" n'y pouvait rien. ([1] [1330])
CE QUE LE PROLETARIAT A APPRIS EN 20 ANS
20 années de décomposition capitaliste
Cependant, les conditions d'une situation révolutionnaire au niveau mondial n'ont cessé de se développer et de s'approfondir pendant les dernières 20 années. Ceux qui le nient aujourd'hui sont souvent les mêmes qui croyaient la révolution immédiatement réalisable en 1968. Et ce n'est pas par hasard, car dans les deux cas le lien entre crise économique et lutte de classe est ignoré ou nié. L'évolution objective de la société capitaliste au cours de ces 20 dernières années peut se résumer en un bilan aussi catastrophique que menaçant. La misère la plus effroyable que l'humanité ait jamais connue s'est étendue comme tâche d'huile dans les zones les moins développées de la planète nais aussi de plus en plus dans les pays centraux; la destruction de tout avenir pour un nombre toujours croissant de chômeurs et une intensification impitoyable des conditions d'exploitation pour ceux qui travaillent encore; développement permanent de l'économie de guerre et exacerbation des rivalités commerciales et militaires entre nations: l'évolution de la vie économique et politique du capitalisme au cours des 20 dernières années a mis en évidence, encore une fois que la seule "issue" à la quelle conduit ce système social décadent est celle d'une nouvelle guerre mondiale.. De la guerre du Viêt-nam à la guerre Irak-Iran, en passant par la destruction du Liban et la guerre d'Afghanistan, le capitalisme menace toujours plus de transformer la planète en un bain de sang. (Voir dans ce numéro et le précédent l'article consacré à l'évolution des conflits impérialistes). L'évolution du capitalisme ruine elle même les bases sur lesquelles repose le pouvoir de la classe dominante.
Ces années ont détruit beaucoup d'illusions dans la conscience des ouvriers et développé quelques convictions importantes:
- caractère irréversible et mondial de la crise économique capitaliste;
- impossibilité de toute issue "nationale" et l'impasse que constituent "les guerres de libération nationale".
- impossibilité de réformer un système social qui est de plus en décomposé dans ses fondements mêmes.
- nature capitaliste des pays dits "communistes".
Mais ce n'est pas tant le développement de la NECESSITE de la révolution et de la conscience qu'en acquiert le prolétariat qu'il est difficile de percevoir. C'est plutôt le développement de la POSSIBILITE de celle-ci, à travers l'accumulation d'expériences au cours de 20 années de combats ouvriers, qui n'apparaît pas toujours au regard superficiel.
20 années de luttes
La lutte de classe pendant ces années ne s'est pas développée de manière linéaire. Son développement s'est fait au contraire de façon heurtée, complexe, connaissant des avancées et des reculs, à travers des vagues successives entrecoupées de périodes d'accalmie et de contre-offensive de la bourgeoisie. Si l'on regarde globalement ces 20 années de luttes sur le plan mondial -le seul plan qui soit valable pour comprendre la dynamique de la lutte prolétarienne- on peut distinguer trois vagues majeures de montée des luttes ouvrières. La première vague ouverte par mai 68 s'étend jusqu'en 1974. Pendant près de 5 ans dans la quasi-totalité des pays, industrialisés ou moins développés, de l'Est ou de l'Ouest, les luttes ouvrières connaissent un nouveau développement. Dès 1969 en Italie ("l'Automne chaud") une puissante vague de grèves, au cours de laquelle les heurts entre ouvriers et syndicats se sont multipliés, confirmait que 1968 avait bien été l'ouverture d'une nouvelle dynamique internationale de la lutte ouvrière; la même année en Argentine (Cordoba, Rosario), la classe ouvrière se lançait dans des combats massifs. En 1970 en Pologne la lutte ouvrière atteint de nouveaux sommets: affrontements généralisés dans la rue avec la milice; la classe ouvrière contraint le gouvernement à reculer. Pour les ouvriers des pays de l'Est c'est la confirmation qu'on peut se battre contre le totalitarisme étatique ; pour les ouvriers du monde entier, le mythe de la nature ouvrière des pays de l’Est subit un nouveau choc. Puis, dans un contexte international de combativité, des luttes particulièrement significatives se développent en Espagne (Barcelone en 1971), en Belgique et Grande-Bretagne (1972). Cependant dès 1973 la mobilisation ouvrière va se ralentir sur le plan international. Malgré les luttes importantes que développe la classe ouvrière au Portugal et en Espagne à l'occasion de la démocratisation des régimes politiques (1974-1977), malgré une nouvelle vague de grèves en Pologne en 1976, au niveau global -en particulier en Europe occidentale- la mobilisation ouvrière se réduit fortement.
Mais en 1978, une nouvelle vague de luttes ouvrières explose au niveau international. Plus courte dans le temps que la précédente, on y voit de 1978 à 1980, un nouveau déploiement des forces prolétariennes qui frappe par sa simultanéité internationale. Les grèves massives du secteur pétrolier en Iran en 1978, celles des métallurgistes allemands et brésiliens de 1978 à 1980; la lutte des mineurs aux USA en 1979 puis des transports de New-York en 1980; les violentes luttes des sidérurgistes français en 79 ou celles des dockers de Rotterdam la mène année; "l'hiver de mécontentement", 1979-80 en Grande-Bretagne qui aboutit à la grande grève des sidérurgistes et à la chute du gouvernement travailliste; les grèves de Togliattigrad en URSS en 1980 comme celles de Corée du Sud au même moment... Tous ces combats confirment que l'accalmie sociale du milieu des années 70 n'avait été que provisoire. Puis, en août 1980, en Pologne éclatait la plus importante lutte ouvrière depuis les années 20. Tirant les leçons des expériences de 1970 et 76, la classe ouvrière déploie un degré de combativité, d'organisation et de maîtrise de sa force, extraordinaires. Hais sa dynamique va échouer sur deux écueils meurtriers: les illusions des travailleurs des pays de l'Est sur la "démocratie occidentale" en particulier sur le syndicalisme; et deuxièmement le cadre national. Solidarnosc, le nouveau syndicat "démocratique", formé sous l'oeil attentif des forces "démocratiques" des pays occidentaux, imbibé et propagateur zélé de la plus insidieuse idéologie nationaliste, sut distiller et cultiver systématiquement ce poison. Dans les faits, l'échec de la grève de masse en Pologne qui aboutit au coup de force de Jaruzelski en décembre 1981, a posé ouvertement la question de la responsabilité du prolétariat des pays les plus centraux et disposant de la plus grande expérience historique: non seulement au niveau de l'internationalisation de la lutte ouvrière, mais aussi au niveau de sa contribution pour le dépassement des illusions sur les "démocraties occidentales" qui pèsent encore sur le prolétariat des pays de l'est.
Après la période de reflux qui au niveau international accompagne la lutte ouvrière à la fin du mouvement en Pologne, une troisième vague de combats commence à la fin 1983 avec la grève du secteur public en Belgique. En Allemagne occidentale, à Hambourg c'est l'occupation des chantiers navals. En 1984 l'Italie connaît une puissante vague de grèves contre l'élimination de l'échelle mobile qui aboutit à une manifestation de près d'un million de travailleurs à Rome. En Grande-Bretagne c'est la grande grève des mineurs qui dura un an et qui, malgré le caractère exemplaire de son courage et de sa combativité, mit en évidence, plus que tout autre, l'inefficacité à notre époque des grèves longues et isolées. Cette même année des luttes importantes se déroulent en Inde, aux USA, en Tunisie et au Maroc. En 1985 c'est la grève massive au Danemark; plusieurs vagues de grèves sauvages secouent cet autre "paradis socialiste" qu'est la Suède; les premières grandes grèves au Japon (chemins de fer), les grèves de la banlieue de Sao Paolo au Brésil en pleine transition "démocratique"; l'Argentine, la Bolivie, l'Afrique du Sud, la Grèce, la Yougoslavie connaissent aussi des luttes importantes. L'année 1986 est marquée par la grève massive du printemps en Belgique qui paralyse le pays en s'étendant par elle-même malgré les syndicats. Fin 1986, début 87 les travailleurs des chemins de fer en France développent une lutte caractérisée par les tentatives des ouvriers de s'organiser indépendamment des syndicats. Au printemps 87, 1’Espagne connaît une série de grèves qui s'opposent directement aux plans du gouvernement socialiste. Puis ce sont les luttes des mineurs d'Afrique du Sud, celles des travailleurs de l'électricité au Mexique et une grande vague de grèves en Corée du Sud. L'année restera marquée par les luttes des travailleurs de l'école en Italie qui parviennent à organiser leur combat en dehors et contre les syndicats. Enfin, la récente mobilisation des travailleurs de la Ruhr en Allemagne et la reprise des grèves en Grande-Bretagne en 1988 (voir l'éditorial de ce numéro) confirment que cette troisième vague internationale de luttes ouvrières, qui dure depuis maintenant plus de 4 ans est loin d'être terminée et ouvre des perspectives d'autant plus importantes que le capital mondial connaît une nouvelle aggravation de sa crise économique.
Ce que le prolétariat a appris de ses luttes
La simple comparaison des caractéristiques des luttes d'il y a 20 ans avec celles d'aujourd'hui permet de percevoir rapidement l'ampleur de l'évolution qui s'est lentement réalisée dans la classe ouvrière. Sa propre expérience, ajoutée à l'évolution catastrophique du système capitaliste, lui a permis d'acquérir une vision beaucoup plus lucide de la réalité de son combat. Cela s'est traduit par ;
- une perte des illusions sur les forces politiques de la gauche du capital et en premier lieu sur les syndicats à l'égard desquels les illusions ont laissé la place à la méfiance et de plus en plus à l'hostilité ouverte;
- l'abandon de plus en plus marqué de formes de mobilisation inefficaces, impasses dans lesquelles les syndicats ont tant de fois fourvoyé la combativité ouvrière:
- journées d'action, manifestations-ballades-enterrements,
- les grèves longues et isolées...
Mais l'expérience de ces 20 années de lutte n'a pas dégagé pour la classe ouvrière que des enseignements "en négatif" (ce qu'il ne faut pas faire). Elle s'est aussi traduite par des enseignements sur comment faire:
- la recherche de l'extension de la lutte (Belgique 1986 en particulier),
- la recherche de la prise en main des combats, en s'organisant par assemblées et comités de grève élus et révocables; (France fin 86, Italie 1987 principalement).
De façon générale, les ouvriers ont moins recours à la forme de lutte de la grève: quand le combat s'engage il tend à être massif et "la rue", l'action politique, prend de plus en plus d'importance. C'est la réponse à des attaques qui sont de plus en plus massives et font éclater de plus en plus crûment l'incompatibilité totale entre les intérêts ouvriers et ceux de l'ordre social existant.
Au cours de ces 20 années, lentement, de façon toujours heurtée, le prolétariat mondial a développé sa conscience en perdant ces illusions et gagnant en expérience et détermination.
Ce que la bourgeoisie a appris
La bourgeoisie mondiale a aussi beaucoup appris de ces années. Le problème du maintien de l'ordre social est devenu une priorité. Elle a développé tous les moyens de répression: tous les gouvernements du monde ont, dans les 20 dernières années, créé ou renforcé leurs polices "anti-émeutes", inventé de nouvelles armes pour "guerres civiles", développé leurs polices politiques... Nombre d'entre eux ont utilisé le désespoir de petits bourgeois déçus et se suicidant dans le terrorisme pour renforcer un climat de répression. Dans les usines, le chantage au chômage est systématiquement utilisé comme moyen de répression.
Mais ce qu'a le plus appris la bourgeoisie c'est à utiliser les forces politiques et syndicales qui travaillent au sein de la classe ouvrière : syndicats, partis "de gauche", organisations "gauchistes". Elle a ainsi "démocratisé" les régimes de nombreux pays, (Portugal, Espagne, Amérique Latine, Philippines, Corée du Sud...) non pas pour alléger le poids de sa dictature mais pour créer des organes syndicaux et politiques capables de compléter le travail que l'armée et la police ne pouvaient plus faire seules. Dans les pays à plus vieille tradition "démocratique", face à l'usure des syndicats officiels et des partis de gauche, elle a recours au "syndicalisme de base" ou à ses forces "extra-parlementaires" pour ramener les luttes sur le terrain syndical et "démocratique".
Nous sommes loin de 1'"effet de surprise" créé par les luttes ouvrières de la fin des années 60. Mais ce "réarmement" de la bourgeoisie ne traduit en fait que la nécessité de recourir à des moyens de plus en plus extrêmes pour faire face à une situation qui devient de plus en plus difficile à contrôler. Derrière ce "renforcement" se dessine l'effondrement des hases réelles de son pouvoir.
VERS DES AFFRONTEMENTS DIFFICILES ET DECISIFS
Pour l'impatiente petite bourgeoisie des années 60 tout cela est trop long, trop difficile et ne peut conduire à rien. Tout lui semble un recul par rapport aux années 60.
Pour les marxistes l'évolution de ces années n'a fait que confirmer la vision, que Marx formulait déjà au XIXe siècle, de ce qu'est la lutte de la seule classe de l'histoire qui soit à la fois EXPLOITEE ET REVOLUTIONNAIRE.
Contrairement au combat révolutionnaire de la bourgeoisie contre la féodalité, où chaque victoire se traduisait par un développement de son pouvoir politique réel sur la société aux dépens de celui de la noblesse, le combat révolutionnaire du prolétariat ne connait pas d'acquis progressifs et cumulatifs au niveau du pouvoir. Tant que le prolétariat n'est pas parvenu à la victoire politique finale, la Révolution, il reste classe exploitée, dépossédée, réprimée. C'est pourquoi ses luttes apparaissent comme un éternel recommencement.
"Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour mieux lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit crée la situation gui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient: 'Hic Rhodus, hic salta"'.([2] [1331]) Marx, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte.
On parle peut être moins facilement de révolution en 1988 qu'en 1968. Mais lorsqu' aujourd'hui le mot est crie dans une manifestation qui dénonce la nature bourgeoise des syndicats à Rome ou dans une manifestation de chômeurs à Bilbao il a un sens autrement plus concret et profond que dans les assemblées enfiévrées et pleines de fausses illusions de 1968.
1968 avait affirmé le retour de l'objectif révolutionnaire. Pendant 20 années les conditions de sa réalisation n'ont cessé de mûrir. L'enfoncement du capitalisme dans sa propre impasse, la situation de plus en plus insupportable que cela crée pour l'ensemble des classes exploitées, l'expérience cumulée par la combativité ouvrière, tout cela conduit à cette situation dont parlait Marx, gui rend "tout retour en arrière impossible".
RV.
[1] [1332] Pour une histoire et analyse révolutionnaires des événements de Mai 68 voir Pierre Hempel, "Mai 68 et la question de la révolution".
[2] [1333] Référence à une légende grecque: un vantard qui parcourait les villes de la Méditerranée en affirmant qu'il était capable de sauter par-dessus la statue du colosse de Rhodes, se trouva un jour dans cette ville. Il lui fut alors crié: "Voici Rhodes, c'est ici que tu dois sauter!".
Géographique:
- France [1061]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1334]
Approfondir:
- Mai 1968 [1335]
Heritage de la Gauche Communiste:
Vingt ans depuis mai 1968 : le capitalisme dans le tourbillon de la crise
- 3055 reads
"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson (...) voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" gui avait succédé à la seconde guerre mondiale." ("Internacionalismo", Venezuela, janvier 1968)
Il y a vingt ans nous devions convaincre de l'existence de cette crise, aujourd'hui nous en sommes à l'expliquer et à en montrer les implications historiques.
"C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production Mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE et le PUB croit de 3,51. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent bien négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la "prospérité" d'après-guerre (...). La deuxième récession dont le fond est touché en 1970 est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 61 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique." (cf. notre brochure "La décadence du capitalisme", p. 4)
Il aura fallu vingt ans, une génération, pour que ce qui n'était que les premières manifestations d'une crise ouverte après la période de reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale apparaisse ouvertement comme l'expression d'une crise générale et insurmontable d'un mode de production aiguillonné par la course au profit, la soif jamais assouvie de marchés et fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Que ce soit dans les pays dits "communistes", dans les pays de l'Est ou encore en Chine, dans les pays dits "développés" ou ceux hier désignés par l'appellation "en développement", d'un point de vue mondial et historique, le bilan de ces vingt années de crise est catastrophique et la perspective s'annonce encore plus catastrophique.
Catastrophique en absolu déjà. Par la misère qui sur toute la planète est devenue le lot quotidien de l'immense majorité de la population mondiale. Situation où l'avenir n'est pas indiqué par un développement des pays peu ou pas industrialisés rejoignant les pays développés, mais au contraire par un développement des caractéristiques du sous-développement au coeur même des métropoles industrielles, ce que les sociologues appellent le "quart monde".
Catastrophique relativement encore quand on considère l'immense gâchis comparé aux possibilités réelles en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de toutes les richesses matérielles produites par le travail; toutes choses qui pourraient être le puissant levier d'une émancipation de l'humanité mais qui dans le carcan de la crise mondiale sont systématiquement orientées et transformées en forces de destructions.
L'évidence de cette crise d'une profondeur et d'une gravité extrême s'impose d'autant plus fortement que toutes les politiques économiques pour y faire face ont depuis vingt ans été, sans exception aucune, des échecs cuisants et que les perspectives de sortir de l'ornière où, à l'Est comme à l'Ouest, l'économie mondiale s'enfonce chaque jour plus, apparaissent aujourd'hui comme totalement illusoires.
De fait les questions que soulève cette crise sont des questions de fond qui touchent le coeur même de l'organisation sociale, de sa structure, des rapports qui s'y nouent et conditionnent l'avenir de la société mondiale.
A la veille d'une nouvelle et puissante récession mondiale inéluctable, cette rétrospective de vingt années de crise ne peut que prendre en compte le rappel des illusions et des mythes qui pendant des années, à tel ou tel moment, furent distillés par les voies officielles du pouvoir ou de la contestation de gauche.
CE QUI A ETE DIT A PROPOS DE LA CRISE
Ces vingt dernières années, au rythme d'une crise jamais surmontée, progressant par à-coups, sont en même temps l'histoire de l'effondrement des illusions qui ont marqué son parcours. Durant toutes ces années tout ou presque tout a été invoqué pour conjurer le démon.
LA "CRISE DU PETROLE" ET LA CRISE DE SURPRODUCTION
Dans la première moitié des années 70, la "crise du pétrole", "la crise énergétique", et la "pénurie" de matières premières en général furent rendues responsables de la récession de 74 et de la crise financière jamais surmontée.
A en croire les experts et les dirigeants mondiaux de tous bords la "pénurie" des sources énergétiques "qui provoquait une augmentation de leur prix" était responsable des soubresauts économiques. L'économie mondiale était en quelque sorte victime d'un problème "naturel", indépendant et extérieur à sa nature profonde.
Pourtant quelques années après, dès 78-79, alors que les soubresauts de l'économie mondiale furent devenus convulsions, nous étions amenés à constater non pas une pénurie des sources énergétiques accompagnée d'une augmentation de leurs prix, mais une surproduction générale de celles-ci et en particulier du pétrole, et conséquemment une chute de leur cours.
L'aspect flagrant de la nature de cette crise s'exprime caricaturalement dans les secteurs de la production des matières premières et en particulier dans l'agriculture: une crise manifeste de surproduction qui engendre la pénurie. C'est ainsi qu'alors que toutes les nations se livrent la guerre agricole la plus acharnée qui ait jamais existé nous sommes amenés à constater un développement ahurissant des famines et de la sous-nutrition dans le monde. C'est ainsi que:
"La production agricole mondiale est suffisante pour assurer à chaque individu plus de 3.000 calories par jour, soit 500 de plus que ce qu'il est nécessaire à la bonne santé d'un adulte moyen et, de 1969 à 1983, la croissance de la production agricole (40 %) a été plus rapide que celle de la production mondiale (35%)."
("L'insécurité alimentaire dans le monde", octobre 87, p. 4)
Ce qui n'empêche que, comme nous l'apprend an dernier rapport de la Banque mondiale, l'insécurité alimentaire concerne 700 millions de personnes et qu'il ne s'agit en aucune façon d'une question de capacité productive puisque:
"La faim persiste même dans les pays qui ont atteint l'autarcie alimentaire. Dans ces pays les famines touchent simplement ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour accéder au marché." (Banque mondiale: "Rapport sur la pauvreté et la faim" -1987)
D'autre part, les bourgeoisies occidentales se sont à l'époque beaucoup plaintes de cette augmentation des coûts dans l'approvisionnement en matières premières et sources énergétiques qui les "étranglait". Par contre, il n'est jamais fait référence au sort de ces masses de dollars qui à l'époque passèrent dans les mains des pays producteurs de matières premières. En fait, ces dollars se retrouvèrent vite dans les poches de ceux qui les avaient déboursés, car ils développaient la capacité d'importation des pays producteurs de matières premières. Mieux encore, ce qui fut acheté en majorité par les pays producteurs de matières premières dans les années 70, ce ne fut pas des moyens de consommation, ou des moyens de production, mais des armes.
"Entre 1977 et 1985, le tiers monde a acheté pour 286 milliards de dollars d'armement, ce qui équivaut à 30% de la dette que les pays du Sud avaient accumulée durant la même période (...). Le Proche-Orient a absorbé près de la moitié des exportations (...). Le marché a connu, entre 1910 et 1911, une expansion moyenne de 13%."
("Le Monde diplomatique", mars 88: "le grand bazar aux canons dans le tiers monde", p. 9)
Ravagé par la guerre et la crise, l'état de barbarie avancé dans lequel se trouve aujourd'hui le Moyen-Orient est une illustration parfaite des rapports étroits qu'entretiennent crise et guerre, et l'histoire de ces dernières années nous montre ici clairement comment la crise de surproduction se transforme en destruction pure et simple.
Il y a dans tout mensonge une part de vérité, dans toute illusion ou mythe une part de réalité; sinon aucun d'entre eux ne saurait trouver d'écho dans le cerveau des vivants. Il en est ainsi des "explications" de la crise qui ont jalonné ces vingt dernières années.
Tout d'abord, "la crise du pétrole" pouvait présenter une apparence de réalité. En effet l'augmentation brutale des coûts dans l'approvisionnement en sources énergétiques dont le relatif bon marché jusqu'alors avait conditionné la période de reconstruction représenta à partir de 1974 un coup dur pour les économies européennes. Contrairement aux prix de l'investissement en matériel dont les coûts se répercutent sur une longue période, l'amortissement, le prix des matières premières lui se répercute immédiatement dans le prix total des marchandises produites. De ce fait, les conséquences de l'augmentation des ressources énergétiques et des matières premières furent immédiates: affaiblissement face à la concurrence internationale et baisse des taux de profit.
Contrairement à ce qui en a été dit, ces augmentations n'avaient pas pour cause une pénurie naturelle des matières premières, les seules "pénuries" qui sévirent à cette époque ne furent que des "pénuries" organisées pour spéculer sur une anticipation à la hausse.
La brutale augmentation des coûts des ressources énergétiques et des matières premières en général avait par contre pour raison véritable la baisse brutale du dollar depuis 1971. Dans la mesure où tous les achats étaient libellés en dollars, les pays producteurs en augmentant le prix du pétrole ne faisaient que répercuter la baisse de la valeur du dollar.
Nous touchons ici du doigt le fond de la question. La chute du dollar, résultat direct de la décision des autorités américaines prise en 1973 de laisser flotter le dollar en vue de rendre l'économie américaine plus compétitive, venait consacrer l'effondrement des accords de Brettons Wood signés en juillet 1944.
"Ces accords étaient destinés i reconstruire, une fois la paix rétablie, le système monétaire international, disloqué depuis le début des années 30...Il s'agissait précisément d'éviter au monde le retour à l'expérience désastreuse des dévaluations "compétitives" et des "changes flottants" qu'il avait connue entre les deux guerres" ("Bilan économique et social 87" - Le Monde - page 41)
De fait, la baisse "compétitive" du dollar signifiait un retour aux conditions économiques de crise d'avant guerre.
L'économie mondiale dans une nouvelle période de crise économique aiguë se retrouvait face aux mêmes problèmes qui avaient précipité la seconde guerre mondiale, mais cette fois, multipliés par cent.
Prélude à cette situation, en 1967: l'apparition du déficit commercial américain.
En lui-même, ce déficit, mineur comparé au gouffre actuel (voir courbe du déficit USA), marquait la fin de la période de reconstruction. Il signifiait que les économies européennes et asiatiques désormais reconstruites ne constituaient plus un marché et que de plus elles s'inséraient dans la concurrence mondiale face à un marché réduit d'autant. Depuis tout ce qui a été fait en matière d'économie politique n'a eu pour raison d'être que la volonté de compenser l'effondrement des possibilités économiques que représentait la période de reconstruction.
La période qui s'étend de 1967 à 1981 n'est pas autre chose du point de vue économique que l'histoire de l'emploi massif et redoublé des recettes keynésiennes de soutien artificiel de l'économie. Rappelons rapidement en quoi consistent ces recettes keynésiennes:
"Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'Etat. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'Etat se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier." (Voir notre brochure "La décadence du capitalisme", P. 15)
Durant cette période:
"Les USA sont devenus la locomotive de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de leur bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendu. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de référence et de réserve mondiale- pouvaient mettre en oeuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement leur monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer". (Revue Internationale n° 26, p.4)
Nous pouvons ici citer encore en exemple pour cette période d'illusion, la RFA:
"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître des autres pays (...) L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant de 1,7 fois la croissance du produit national. A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les services publics. Ainsi la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18i du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 251 en 1975, puis à 351 en 81. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de 1'entre-deux-guerres.
Les Allemands qui n'ont pas la mémoire courte voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la république de Weimar/" (cité dans la Revue Internationale n° 31 en 1982, p.22)
C'est la crise du dollar et la menace d'une faillite financière générale qui en 79 vont donner le signal d'un changement de politique économique mondiale sous le couvert de l'idéologie libérale de la "déréglementation" qui aboutira en 82 à la plus forte récession économique qu'ait connue le monde depuis les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale.
LA "REVOLUTION LIBERALE"
Toutes les explications tant exploitées des causes "naturelles" de la crise mondiale dans les années 70 n'expliquaient rien du tout. On les oublia vite et on n'en entendit plus parler. La crise mondiale elle, inexorablement se développait, gagnait en profondeur et étendue, touchant au coeur même des métropoles industrielles. Il fallait l'expliquer; au moins trouver une caution idéologique aux "thérapies" douloureuses que l'on commença dès 1979 à administrer aux populations laborieuses. Le chômage allait passer brutalement du simple au double, les salaires étaient bloqués, dans les entreprises, les usines, les bureaux, la mentalité garde-chiourme était à l'honneur. Partout l'on demandait aux ouvriers et employés de se transformer en soldats de "l'Entreprise", de la "Nation" pour une guerre économique où ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Et où en effet ils perdirent beaucoup.
Quel soulagement quand les causes de la maladie pernicieuse qui rongeait d'un mal secret l'économie mondiale furent mises à jour et le mystère enfin révélé.
La "société" souffrait de trop de "dirigisme". Mollement, elle se mourait dans ses "habitudes d'assistanat", qui accompagnèrent ce qui à l'occasion fut appelé "les trente glorieuses", c'est-à-dire toute la période après-guerre des reconstructions (1945-75) (sic). Ce "trop d'Etat" avait fini par briser les ressorts productifs, par casser "la soif d'entreprendre" et créer de lourds déficits dans les caisses des Etats, déficits qui grevaient d'autant le potentiel productif.
Au fond des choses, si "fond" dans de telles conceptions simplistes il y a, cet "interventionnisme" de l'Etat empêchait les "lois naturelles" de l'économie mondiale de jouer et d'assurer leur rôle "d'autorégulation". D'un seul coup les économistes avaient mis le doigt sur les causes de la crise et leur joie était d'autant plus profonde que ces révélations indiquaient du même coup les solutions et remèdes à y apporter. L'euphorie fut d'autant plus grande, le soulagement d'autant plus intense que ces remèdes qui furent administrés à haute dose aux populations laborieuses du monde entier durant la première moitié des années 80 avaient un goût qui n'était pas pour déplaire à la bourgeoisie mondiale: licencier, réduire les salaires, casser les assurances sociales de toutes sortes, montrer du doigt et mettre au pilori le "fonctionnaire" et autres employés d'Etat, enfin étrangler et laisser crever de tiers monde.
Mais tout comme la prétendue pénurie des matières premières et des sources énergétiques qui se révéla être en fait surproduction, ce "moins d'Etat" apparut rapidement comme un plus d'Etat. Ne serait-ce que par son intervention dans tous les aspects de la vie sociale, à commencer par la répression de toutes les manifestations de révolte que cette politique provoqua. Ou encore pour orienter une part croissante de l'effort productif, technologique et scientifique vers la production d'armement et l'investissement productif vers la bourse.
Pourtant en 84-85, le mythe d'une reprise économique aux USA a fait grand bruit. Les recettes reaganiennes semblaient avoir un impact salutaire sur la santé économique. Tous les indices cités, inflation, production, emploi reprenaient de la santé. Dans le monde entier, les financiers, les industriels, les hommes d'Etat, étaient éblouis par cette "révolution" et tout le monde dorénavant voulait faire du "libéralisme", y compris en ... URSS et en Chine. L'aventure échoua comme on le sait dans le spectaculaire effondrement boursier d'octobre 87, la menace d'une récession majeure et un renouveau de l'inflation.
Les déficits budgétaires et commerciaux loin de se dégonfler avaient atteint en quelques années des sommets vertigineux, en particulier sur le sol où cette idéologie avait trouvé à la fois un tremplin et un terrain de prédilection: les USA. C'est le bilan que nous tirions dès 1986:
"La croissance américaine s'est faite a crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8.000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4.600 milliards de dollars en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé." (Revue Internationale n°48)
La production industrielle, elle, au lieu de prendre un nouvel essor ne fut jamais aussi poussive ou finit par franchement reculer aux USA encore. Cette "soif d'entreprendre", de "créer" qui libérée de ses contraintes, devait se trouver des ailes et prendre un nouvel essor, après avoir fui de façon massive la sphère industrielle, ne trouva d'autre refuge que la spéculation financière et boursière, seule activité fiévreuse du capital ces dernières années et qui a connu la fin lamentable que l'on sait.
Cela vaut pour toutes les grandes puissances industrielles et particulièrement pour la plus puissante, les USA. On a cité la baisse du chômage comme un des principaux acquis de cette "révolution libérale" aux USA, alors qu'un million d'emplois était définitivement perdu dans les secteurs industriels, que plus de 30 millions de personnes se trouvaient dorénavant dans des conditions d'existence en dessous du "seuil de pauvreté", et que les seuls emplois créés étaient des emplois à temps partiel dans le secteur des services :
"Alors que, dans les années 70, un emploi supplémentaire sur cinq était rémunéré moins de 7.000 dollars par an, cela a été le cas pour 6 emplois nouveaux sur dix i partir de 1979. (...) Entre 1979 et 1984, le nombre de travailleurs qui touchaient un salaire égal ou supérieur au salaire moyen a diminué de 1,8 million... Le nombre de travailleurs qui gagnaient moins a augmenté de 9,9 millions". ("Le Monde", "Dossiers et Documents, bilan économique et social", 1987).
Quant aux nations dites du "tiers monde" qui auraient dû trouver un stimulant dans la libération des "lois naturelles" du marché et de la concurrence, elles ont dans les dernières années touchées le fond du gouffre. Loin d'être "libérées" de la tutelle hégémonique des grandes puissances industrielles, elles ne furent jamais aussi dépendantes, écrasées par le poids d'une dette et de ses intérêts qui doublaient en même temps que la valeur monétaire du dollar alors que les exportations de matières premières, leur principale source de revenus, que l'appareil productif mondial n'absorbait plus, s'effondraient. Le Mexique, pour ne citer que cet exemple, en novembre 87 dévaluait le peso de 50%.
Comme dans la question de la crise du pétrole, il y a dans la "critique libérale" du "trop d'Etat" une part de vérité. Ce qu'il y a de juste ne concerne pas l'analyse, loin s'en faut, encore moins les solutions, mais un certain constat: de soutien essentiel à une activité économique dont les forces internes poussaient à l'éclatement, l'intervention de l'Etat dans tous les domaines de la vie économique et sociale a précipité la crise de surproduction qu'il avait pour tâche de contenir.
Au début des années 80, nous analysions ce changement de situation en soulignant ses caractéristiques essentielles qui ne concernaient pas uniquement un développement quantitatif de la crise économique, mais aussi un développement qualitatif des conditions historiques de son développement. Au sein de ces caractéristiques nous distinguions comme aspect essentiel que contrairement aux années de crise d'avant-guerre où les mesures keynésiennes de "New deal" furent prises après le plus fort de la crise, ce style de mesures pour le soutien artificiel de l'économie n'est pas devant mais irrémédiablement derrière nous alors que le plus fort de la crise lui, est devant nous.
Le déroulement des faits ou plutôt méfaits économiques depuis le début des années 80 est largement venu conforter ce constat. Plus encore, la concentration accélérée des activités des différents Etats sur les domaines militaires, production d'armements, stratégie mondiale, intervention et présence militaires accentuées alors que la disparition des "aspects sociaux" de cette intervention ne servait plus de masque et ne pouvait plus faire illusion, est venu souligner la gravité de la situation historique actuelle.
LA "REVOLUTION" TECHNOLOGIQUE »
Notre bref, trop bref, rappel de ce qui a tenu lieu d'analyse de la crise durant ces vingt dernières années ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas ici la fameuse "troisième révolution industrielle". A cheval entre deux époques, entre deux phases historiques de développement, les "soubresauts" économiques n'étaient finalement pas autre chose que la crise obligée et nécessaire du passage d'une époque à une autre. Que n'a t’on pas dit et imposé au nom de cette fameuse "révolution technologique", à commencer par les licenciements. Le premier intérêt de cette "analyse" historique était tout entier contenu dans l'idée que la crise du capitalisme que personne ne pouvait plus nier, ce qui était ennuyeux en soi, n'était somme toute qu'une crise de croissance. Au-delà de cette mauvaise passe l'avenir était radieux. A condition, bien sûr, de se soumettre aux impératifs douloureux, mais nécessaires de l'accouchement présent. Dans la continuité, cette analyse "révolutionnaire" offrait l'avantage de présenter comme "rétrograde", voire "réactionnaire", toute révolte contre les mesures qui allaient contre cette "révolution" (licenciements, restructuration, etc.) Malheureusement pour les idéologues qui furent les défenseurs de ces thèses, il advint de l'explication de la crise par la "troisième révolution industrielle" dont aujourd'hui plus personne ne parle, la même mésaventure que pour la "crise du pétrole" ou encore la "révolution libérale" entre lesquelles elle se situa: elle s'effondra face à la réalité des faits qui décidément sont têtus.
Au-delà des involutions industrielles et sociales qui ont marqué cette époque alors que toutes les "révolutions industrielles" ont toujours suscité et accompagné des bonds en avant de la production, il est ici nécessaire de souligner que toutes les avancées techniques, scientifiques et technologiques des deux dernières décennies ont eu pour aiguillon et application le domaine militaire de la production d'armement, les retombées civiles, elles, restant extrêmement limitées.
"Le monde consacre à des fins militaires une somme de ressources supérieures i ce qu'était la production mondiale de 1900 (...). De plus, le domaine militaire absorbe les deux tiers de la défense mondiale en matière de recherche et de développement." ("Armement et désarmement à l'âge nucléaire", "La documentation française" n° 4456, p. 13)
POUR EN FINIR AVEC LES MYTHES ET ILLUSIONS SUR LA CRISE
Toute la difficulté à comprendre la crise économique tient à sa nature. C'est en effet la première fois dans son histoire que l'humanité est amenée à subir une crise de surproduction générale. Alors que toutes les crises des modes de production qui nous ont précédés, esclavagisme, féodalisme, s'exprimaient dans de larges crises de sous-production, il en va tout autrement pour le capitalisme, ce qu'exprime K. Marx dans le "Manifeste Communiste:
"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mis encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie éclate qui, à toute époque, eût semblé absurde: l'épidémie de la surproduction."
Et encore K. Marx n'a de son vivant assisté qu'à des crises de surproduction limitées dans le temps et dans l'espace. Limitées à des secteurs particuliers et précédées par de longues et larges périodes d'expansion du capitalisme à travers le monde.
Non seulement cette caractéristique de crise de surproduction la rend de prime abord incompréhensible par l'absurdité qu'elle représente, mais de plus, le fait que la crise économique soit une crise de surproduction a permis pendant des années toutes les manipulations pour en repousser les échéances. Face à une crise de sous-production, il n'y a pas d'alternative: quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. La crise de surproduction, surproduction qui est une surproduction relative, non en fonction des besoins humains mais de la capacité d'absorption du marché mondial, elle, peut être repoussée, masquée par toute une série de manipulations financières, commerciales et l'histoire économique récente n'est pas autre chose que l'histoire de ces manipulations. Mais ces manipulations dans lesquelles sont passés maîtres les Etats modernes ne font qu'alimenter la surproduction et finalement exacerber la crise. Fatalement il arrive un moment où elle doit être résorbée parce que sous son poids c'est toute la structure sociale qui menace d'effondrement.
Notre époque n'est pas autre chose qu'une telle situation d'échéance et de solde. Et au-delà de ces vingt dernières années, la crise actuelle n'est que le prolongement et l'aboutissement de toute une période historique qui commence dès le début de notre siècle avec la première guerre mondiale. Période où:
"Entre 1914 et 1980, on compte 10 années de guerre généralisée (sans compter les guerres locales permanentes), 39 années de dépression (1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-87), soit au total 49 années de guerre et de crise, contre seulement 24 années de reconstruction (1922-29 et 1950-67). Et le cycle de la crise n’est pas encore terminé !..."(Revue Internationale, n°48)
Résorbée, la surproduction mondiale ne peut l'être de mille manières. Soit elle est résorbée par une immense destruction, c'est le cas des guerres, soit par une transformation radicale des rapports sociaux et mondiaux de production où les buts, les moyens, les conditions de l'activité productrice seront enfin libérés des carcans du marché, du profit, de l'exploitation et de la division du travail entre travail manuel et travail intellectuel.
Y a t-il plus grande ineptie face à la crise économique mondiale et à son stade avancé que les injonctions de toutes les bourgeoisies nationales à vouloir transformer la population laborieuse en soldats de l'économie, à vouloir les faire s'affronter dans une guerre économique où ce sont des générations entières qui sont sacrifiées et qui en fin de compte -la triste expérience de deux guerres mondiales nous le prouve- ne peut qu'aboutir à la guerre tout court.
Prénat
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1334]
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Vingt ans depuis mai1968 : évolution du milieu prolétarien (1° partie) (1968-1977)
- 3396 reads
Mai 1968: 10 millions de travailleurs en grève en France sont l'annonce du retour significatif du prolétariat sur la scène de l'histoire et ouvrent une vague de luttes qui va prendre une dimension internationale et qui jusqu'au milieu des années 1970 va manifester ses effets dans presque tous les pays de la planète.
Jamais depuis des décennies, depuis l'échec de la vague révolutionnaire commencée en 1917 et gui s'épuise à la fin des années 1920, la lutte de classe n'avait déployé une telle force, pris une telle ampleur. Après quarante longues années de contre-révolution où le triomphe de la bourgeoisie s'était exprimé par une domination idéologique sans précédent dans l'histoire, où la théorisation de l'intégration du prolétariat, de son embourgeoisement, de sa disparition comme classe révolutionnaire animait la réflexion d'intellectuels en mal de nouveautés, où le socialisme était identifié aux sombres dictatures staliniennes et à leurs caricatures "tiers-mondistes", où les jungles d'Amérique du sud et d'Indochine étaient présentées corne le centre de la révolution mondiale, le réveil du prolétariat vient remettre les pendules de l'humanité a l'heure. Un verrou vient de sauter, celui de la contre-révolution: une nouvelle période historique s'ouvre.
La lutte ouvrière renaissante va polariser le mécontentement qui s'accumule depuis des années bien au-delà du prolétariat dans de nombreuses couches de la société. La guerre du Vietnam qui s'éternise et s'intensifie, les premières attaques de la crise gui marque son retour au milieu des année 1960 après la période d'euphorie de la reconstruction d'après-guerre vont provoquer un profond malaise au sein d'une jeunesse élevée dans l'illusion d'un capitalisme triomphant, sans crise, et les promesses d'un avenir radieux. La révolte des étudiants sur tous les campus du monde va servir à la propagande bourgeoise pour masquer la reprise de la lutte de classe, mais aussi elle va répercuter l'écho déformé du regain de réflexion politique qui se développe au sein du prolétariat, ce qui se concrétise dans un intérêt renouvelé pour la classe ouvrière, son histoire et ses théories et donc pour le marxisme. Révolution devient un mot à la mode.
Brutalement, comme étonnée de sa propre force, une nouvelle génération de prolétaires s'affirme sur la scène historique et mondiale. Comme produit de cette dynamique, dans une ébullition juvénile mais aussi dans une grande confusion; sans expérience, sans liens avec les traditions révolutionnaires du passé, sans réelle connaissance de l'histoire de sa classe, fortement influencé par la contestation petite-bourgeoise, un nouveau milieu politique du prolétariat se forme. Une nouvelle génération de révolutionnaires est en train de naître dans l'enthousiasme et... l'inexpérience.
Bien sûr, lorsque nous traitons du milieu prolétarien, n'y sont pas incluses les organisations qui prétendent représenter le prolétariat et le défendre, nais qui ne sont en fait que les expressions destinées à le mystifier, à saboter ses luttes, de la "gauche" de l'appareil politique de contrôle de l'Etat capitaliste sur la classe ouvrière, quelles que soient les illusions qui existent dans la classe ouvrière à leur sujet. Ce sont non seulement les PC et PS depuis longtemps intégrés à tous les rouages de l'appareil d'Etat, nais aussi leurs émules maoïstes, qui ne sont qu'une excroissance tardive du stalinisme, les trotskystes dont l'abandon des principes de classe dans la IIème guerre impérialiste mondiale, dont la trahison par le soutien d'un camp impérialiste contre un autre, les a définitivement mis en dehors du camp prolétarien. Même si en 1968 et après, ces groupes dits "gauchistes" ont une influence déterminante et occupent le devant de la scène, leur histoire passée les situe radicalement en dehors du prolétariat et de son milieu politique. C'est d'ailleurs contre l'attitude politique de ces groupes de la "gauche" bourgeoise que se forme dans un premier temps la mouvance dont va surgir le renouveau du milieu prolétarien, et cela même si dans la confusion et le remue-ménage de l'époque, les idées gauchistes pèsent lourdement sur la naissance de ce nouveau milieu prolétarien.
Depuis les événements de mai 68, vingt ans se sont écoulés, 20 ans durant lesquels la crise économique a exercé ses ravages sur le marché mondial, a labouré le champ social, balayé les illusions de la reconstruction. 20 ans durant lesquels la lutte de classe a connu des flux et des reflux. 20 ans durant lesquels le milieu prolétarien a du retrouver ses racines et poursuivre la clarification nécessaire à l'efficacité de son intervention.
Durant ces 20 années, quelle a été l'évolution du milieu politique? Quel bilan tirer aujourd’hui? Quels fruits prolétariens a donnés la génération de 1968? Quelles perspectives tracer pour féconder le futur ?
LE MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN AVANT 1968
Les groupes politiques qui avant le chambardement de la fin des années 60 ont pu résister à l'étouffement de la contre-révolution et maintenir contre vents et marées leur existence sur des positions révolutionnaires ne sont qu'une poignée, regroupant chacun une poignée d'individus. Ces groupes se définissent en fonction de leur filiation politique. Deux grands courants se distinguent essentiellement qui trouvent leur origine dans les fractions qui se sont opposées dans les années 20 à la dégénérescence politique de la Illème Internationale:
- la tradition des gauches dites "hollandaise" et "allemande" ([1] [1336]) qui s est maintenue au travers de groupes politiques tel le "Spartacusbond" ([2] [1337]) en Hollande ou de cercles plus ou moins formels comme celui regroupé autour de Paul Mattick aux USA, ICO en France ou Daad en Gedachte en Hollande apparus au début des années 60, sont le produit dégénéré de cette tradition du "communisme de conseils" incarnée principalement par le GIK dans les années 30, Ce courant, dans la continuité politique des théorisations d'Otto Riihle dans les années 20, puis d'Anton Pannekoek et de Canne Meier dans les années 30, se caractérise par une incompréhension profonde de l'échec de la révolution russe et de la dégénérescence de l'Internationale communiste, ce qui 1’amène à nier le caractère prolétarien de celles-ci et dans la foulée à rejeter la nécessité de l'organisation politique du prolétariat;
- la tradition de la gauche dite "italienne" exprimée dans sa continuité organisationnelle par le PCI ([3] [1338]), fondé en 1945 autour d'Onorato Damen et d'Amadeo Bordiga, et qui publie Battaglia Comunista. * Les scissions dont la principale va se faire autour de Bordiga en 1952 qui va publier Programa Comunista ([4] [1339]) vont donner lieu à de multiples avatars du PCI parmi lesquels on peut entre autre citer "Il Partito Comunista". Cependant, ces organisations, si elles ont pu maintenir une continuité organisationnelle avec les fractions communistes du passé ne se revendiquent paradoxalement pas du groupe qui dans les années 30 a représenté le plus haut niveau de clarté politique de cette tradition dont elles sont issues, et de ce point de vue, en rejetant ainsi les apports politiques de Bilan, expriment une continuité politique affaiblie. Cela va se traduire dans une rigidité dogmatique qui nie les nécessaires clarifications imposées par 60 ans de décadence du capitalisme, ainsi Bordiga et le PCI (Programa Comunista) vont caricaturalement se réclamer de l'invariance du Marxisme depuis...1848. Pour ces organisations, la critique insuffisante des positions erronées de la Illème Internationale va se traduire dans des positions politiques on ne peut plus floues et même souvent fausses sur des points aussi centraux que la question nationale ou la question syndicale. La juste volonté de défendre la nécessité du parti va pour ces groupes malheureusement s'exprimer dans une forme caricaturale, notamment chez Bordiga, où le parti est présenté et conçu de manière formelle comme la réponse à toutes les difficultés du prolétariat, comme la panacée universelle à laquelle les prolétaires doivent se soumettre. De ces groupes, seul le PCI (Programa Comunista) a une existence internationale, notamment en France et en Italie, alors que les autres n'existent qu'en Italie.
Dans cette tradition de la gauche "italienne" il faut inclure Internacionalismo au Venezuela, fondé en 1964 sous l'impulsion d'anciens membres de Bilan (1928-1939) ([5] [1340]) et d'Internationalisme (1945-1953) ([6] [1341]) qui, s'il n'exprime pas une réelle continuité organisationnelle, est par contre la plus claire expression de la continuité politique avec les acquis de Bilan et ensuite d'Internationalisme qui en a poursuivi le travail d'élaboration théorique. Cependant, si Internacionalismo se réclame explicitement des apports de Bilan et de la gauche "italienne", il a su aussi s'enrichir de manière critique, comme l'ont fait avant lui Bilan et Internationalisme, des apports des autres fractions de la gauche internationale du début du siècle et cela se concrétise dans la clarté de ses positions sur la question de la décadence du capitalisme, sur la question nationale, sur la question syndicale, comme sur celle du rôle du parti. Ce n'est certainement pas un hasard si Internacionalismo est le seul groupe à prévoir le retour historique de la lutte de classe.
Ce tableau du milieu politique avant 1968 ne serait pas complet s'il n'incluait également les groupes qui se sont formés au lendemain de la IIème guerre mondiale en réaction à la trahison de la IVème Internationale trotskyste et qui sont issus de ce courant. Il faut notamment citer le FOR ([7] [1342]) qui se forme autour de Benjamin Perret et _G. Munis, et Socialisme ou Barbarie autour de Cardan-Chaulieu. Ces groupes issus d une tradition politique, le trotskisme, affaiblie par sa participation à la dégénérescence de la Illème Internationale et son abandon des principes de classe dans son soutien à la 2ème boucherie impérialiste mondiale, ont une originalité liée a leur filiation: leur incompréhension de la dégénérescence de la révolution en Russie et des fondements économiques du capitalisme d'Etat dans la période de décadence du capitalisme qui les mène à théoriser la fin des crises économiques du capitalisme et ainsi à se couper des bases d'une compréhension matérialiste, marxiste de l'évolution de la société. Socialisme ou Barbarie va explicitement renier le prolétariat et le marxisme pour développer «ne théorie fumeuse où la contradiction fondamentale de la société n'était plus celle entre capital et travail, entre bourgeoisie et prolétariat, mais dans le rapport idéologique entre dirigeants et dirigés! Niant la nature révolutionnaire du prolétariat, Socialisme ou Barbarie perd sa raison d'être comme organisation politique et disparaît au début des années 60. Pourtant l'influence pernicieuse de ses théories va lourdement peser non seulement sur les milieux intellectuels, nais aussi sur le milieu politique, notamment ICO, et sur sa marge l'Internationale situationniste. Le FOR quant à lui ne va jamais sombrer dans de telles extrémités, mais son refus de reconnaître la réalité de la crise économique affaiblit l'ensemble de ses positions politiques en les privant d'une cohérence indispensable.
LA FRAGILITE DU MILIEU QUI RENAIT APRES 1968
Les événements de la lutte de classe et notamment les grèves de mai 68 en France, le mai rampant italien en 1969, les émeutes de Pologne en 1970, par leur écho international, vont impulser une réflexion dans le prolétariat et même dans toute la société, et redonner ainsi une audience à la théorie révolutionnaire du marxisme. Portés par cette vague internationale de lutte de classe, une multitude de petits groupes, cercles ou comités vont naître dans la plus grande confusion mais à la recherche d'une cohérence révolutionnaire. De cette mouvance informelle va surgir le renouveau du milieu politique.
La confrontation concrète avec les manoeuvres de sabotage de la lutte de classe menées par ceux-là mêmes qui se prétendent les défenseurs les plus ardents des intérêts de la classe ouvrière, va être un facteur décisif de la prise de conscience brutale de la nature anti-ouvrière des syndicats et des partis de "gauche". La remise en cause de la nature prolétarienne des organisations syndicales, des partis socialistes naguère issus de la défunte Ilème Internationale, des partis communistes staliniens et de leurs émules "gauchistes" dans leurs différentes variantes maoïstes et trotskystes, est le produit immédiat de la lutte de classe qui sert de révélateur. Cependant l'intuition de positions politiques de base du prolétariat ne peut dissimuler la profonde fragilité politique de cette nouvelle génération qui renoue avec les positions révolutionnaires sans une réelle connaissance de l'histoire passée de sa classe, sans lien avec les organisations antérieures du prolétariat, sans expérience militante d'aucune sorte et sous l'influence pesante des illusions petite bourgeoises véhiculées par le mouvement des étudiants. Le poids de décennies de contre-révolution pèse extrêmement lourdement. "Cours camarade, le vieux monde est derrière toi!" clament les révoltés de 68. Mais si le rejet du "vieux monde" permet d'approcher certaines positions de classe telles que la nature capitaliste des syndicats, des partis dits de "gauche", des soi-disant "patries du socialisme", dans la foulée il tend allègrement à faire rejeter des acquis indispensables du prolétariat. Et en premier lieu celui de la nature révolutionnaire du prolétariat, mais aussi le marxisme, les organisations passées du prolétariat, la nécessité de l'organisation politique, etc. Immédiatement, les idées qui vont trouver le plus d'écho parmi une mouvance marquée du sceau de l'immaturité et de l'inexpérience propre à la jeunesse sont celles de courants "radicaux" telle l'Internationale Situationniste qui réactualise au goût du jour les théories de Socialisme ou Barbarie, et se fait l'expression la plus radicale du mouvement des étudiants. Diluant la lutte ouvrière dans la révolte des couches petites-bourgeoises, l'identifiant avec un réformisme radical de la vie quotidienne, tentant un savant amalgame entre Bakounine et Marx, l'Internationale Situationniste esquive le terrain marxiste pour réactualiser avec un siècle de retard les illusions utopistes.
Ainsi va le "modernisme" ([8] [1343]) qui, tout dévoué à sa recherche de la nouveauté et au rejet de l'ancien, ne fait que redécouvrir des théories historiquement périmées. Mais alors que le courant "moderniste" est fondamentalement étranger à la classe ouvrière, le courant conseilliste ([9] [1344]) lui, s'inscrit historiquement dans le milieu politique prolétarien. ICO en France est particulièrement représentatif de cette tendance, se réclamant des apports des gauches "allemande" et "hollandaise", il théorise, dans la continuité des errements de la gauche "hollandaise" dans les années 30, le rejet de la nécessité pour le prolétariat de se doter d'organisations politiques. Cette position va connaître un grand succès alors que, après des décennies de contre-révolution victorieuse, de trahison des organisations prolétariennes gui succombent sous la pression bourgeoise et s'intègrent à l'Etat capitaliste, et de manoeuvre anti-ouvrière des organisations qui prétendent pourtant parler en son nom, le sentiment de méfiance du prolétariat vis-à-vis des organisations quelles qu'elles soient est exacerbé. Cette tendance tend à culminer dans une peur de l'organisation en soi. Le mot même effraie.
Dans un premier temps ICO va polariser le milieu politique renaissant en France et même internationalement avec l'écho planétaire des événements de mai 68, et contribuer à la divulgation et à la réappropriation de l'expérience prolétarienne des révolutionnaires du passé (notamment du KAPD en Allemagne), bien que de manière partielle et déformée. Aux conférences qu'organise ICO participent de nombreux groupes; ainsi en France: les Cahiers du communisme de conseil de Marseille, le Groupe conseilliste de Clermont-Ferrand, Révolution Internationale de Toulouse, le GLAT, la Vieille Taupe, Noir et rouge, Archinoir; à la conférence de Bruxelles en 1969 vont participer des groupes belges et italiens ainsi que des "personnalités" telles que Daniel Cohn-Bendit et Paul Mattick. Mais cette dynamique de polarisation du milieu politique se fait plus sous la pression de la lutte de classe que grâce à la cohérence politique d'ICO ; avec la retombée de la lutte ouvrière en France au tout début des années 70, les conceptions anti-parti, anti-organisation d'ICO vont peser de plus en plus lourdement sur un milieu politique immature. Alors qu'au début ICO attire aux positions prolétariennes des groupes et éléments en rupture d'anarchisme et d'académisme intellectuel, avec le reflux des grèves c'est l'inverse qui se produit: c'est ICO qui est gagné par la gangrène anarchiste et "moderniste". Finalement ICO disparaîtra en 1971.
Cet itinéraire d'ICO est tout a fait exemplaire de la dynamique du conseillisme dans le milieu politique international, même si dans d'autres pays que la France ce phénomène a pu être décalé dans le temps. Les théorisations conseillistes en rejetant la nécessité de l'organisation, en niant la nature prolétarienne de la révolution russe, du Parti bolchevik et de la IIIème Internationale constituent un pôle de déboussolement et de décomposition au sein du milieu prolétarien en formation en le coupant de racines historiques essentielles et en le privant des moyens organisationnels et politiques de s'inscrire dans la durée. Le conseillisme est un pôle de dilution des énergies révolutionnaires de la classe.
Tous les groupes prolétariens qui surgissent dans l'enthousiasme de la jeunesse à la fin des années 60 sont peu ou prou marqués par l'influence pernicieuse du "modernisme" et du conseillisme: que de discours n'a-t-on entendu sur la fin des crises avec le capitalisme d'Etat, sur les méchants bolcheviks et la destinée inéluctable pour tout parti de trahir le prolétariat, sur l'aliénation suprême que constitue le militantisme révolutionnaire. Discours à la mode et qui vont disparaître avec elle! La décantation inévitable qui vient avec le reflux de la lutte de classe, en même temps qu'elle balaye les illusions, imposant ainsi une nécessaire clarification, va se traduire par la disparition des groupes politiquement les plus faibles. Dans la première moitié des années 70 c'est l'hécatombe: exit l'IS qui n'aura "brillé" qu'un fugace printemps, exit ICO morte sur le champ dérisoire de la critique de la vie quotidienne, exit Pouvoir Ouvrier, Noir et rouge et la Vielle Taupe en France, exit Lotta continua et Potere Operaio en Italie mal dégrossis du gauchisme maoïste, et la liste est évidemment loin d'être exhaustive. L'histoire est là, avec la lutte de classe qui reflue et la crise qui se développe, qui impose inéluctablement ses évidences et apporte sa sanction.
Les divers PCI issus de la gauche "italienne" incapables de comprendre que le réveil de la lutte de classe la fin des années 60 signifie le glas de la période de contre-révolution, sous-estimant complètement l'importance des grèves qui se déroulent sous leurs yeux vont être incapables de remplir la fonction pour laquelle ils existent: intervenir dans la classe et dans le processus de formation de son milieu politique. Ceux qui se prétendent la seule continuité organique et politique avec les organisations révolutionnaires du début du siècle, qui auraient dû renforcer le milieu politique renaissant en accélérant le nécessaire processus de réappropriation des acquis prolétariens du passé, ceux qui se prétendent le Parti de classe, ceux-là sont quasiment absents jusqu'au milieu des années 70. Ils dorment en croyant que continue la longue nuit de la contre-révolution et en serrant frileusement les "tables de la loi" du programme communiste. Le PCI (Programme Communiste), seule organisation à avoir une réelle existence internationale, traite avec un souverain mépris ces éléments à la recherche balbutiante d'une cohérence révolutionnaire et le PCI (Battaglia Comunista), plus enclin à la discussion politique, reste timidement replié sur l'Italie.
Même si les positions de ces groupes sur la question du parti, qui les distinguaient fondamentalement du conseillisme, ne pouvaient dans un premier temps polariser de la même manière le milieu politique renaissant, leur relative absence n'a pu que renforcer le poids destructeur du conseillisme sur les jeunes énergies révolutionnaires immatures.
Finalement, seule l'expression qui pouvait paraître superficiellement la plus "faible" des courants qui se rattachent à la gauche "italienne", parce qu'isolée au Venezuela, mais qui ne l'était certainement pas sur le plan politique qui nous intéresse, va parvenir à donner des fruits. A l'initiative de membres d'Internacionalismo immigrés en France va être formé le groupe Révolution Internationale à Toulouse, en plein bouillonnement de mai 68. Ce petit groupe, perdu dans la multitude de ceux qui surgissent à cette époque va être à même -parce qu'en son sein participent d'anciens militants de la gauche "italienne", de Bilan et d'Internationalisme, qui lui apportent une expérience politique irremplaçable- de jouer un rôle positif face à la tendance à la décomposition qui est à l'oeuvre dans ce nouveau milieu politique sous l'emprise dangereuse du conseillisme. Cela va notamment se concrétiser dans la dynamique de regroupement que va savoir incarner Révolution Internationale.
LA DYNAMIQUE DU REGROUPEMENT ET LE POIDS DU SECTARISME
Du sein même du nouveau milieu politique dominé par la confusion va apparaître une tendance qui va s'opposer au processus de décomposition qui se manifeste comme expression du poids des idées conseillistes. La volonté de clarification politique, le souci de réappropriation des acquis politiques du marxisme va se concrétiser dans une défense de la nécessité de l'organisation politique pour le prolétariat et une critique des erreurs conseillistes. Dès sa fondation RI va se consacrer à cette tâche: défendant des principes révolutionnaires sur la question de l'organisation, mais aussi proposant un cadre cohérent de compréhension des positions de classe et de l'évolution du capitalisme au XXème siècle au travers de la théorie de la décadence du capitalisme reprise de Rosa Luxemburg et de Bilan et des élaborations sur le capitalisme d'Etat héritées d'Internationalisme. Cela lui permet une plus grande clarté sur des questions comme celles du caractère prolétarien de la révolution russe, du parti bolchevik, de la IIIème Internationale qui sont celles qui sont posées au sein du milieu d'après 68. De plus, la cohérence plus solide des fondements politiques de RI va s'exprimer dans sa compréhension des événements de mai 68: tout en défendant l'importance et la signification historique des luttes ouvrières qui se développent internationalement RI s'oppose fermement aux surestimations délirantes de ceux qui au sein du courant conseillisto-moderniste voyaient la révolution communiste pour l'immédiat et préparaient ainsi leur démoralisation future. RI, même si dans un premier temps son audience est restreinte et noyée dans le conseillisme dominant, représente un pôle de clarté dans le milieu politique de l'époque. En France, la participation de RI aux réunions organisées par ICO va lui permettre de confronter la confusion conseilliste et de polariser l'évolution d'autres groupes. Le processus de clarification qui prend place alors permettra de développer une dynamique de regroupement qui aboutira en 1972 à la fusion du Groupe conseilliste de Clermont-Ferrand et des Cahiers du communisme de conseil au sein de RI.
La dynamique du regroupement et la formation du CCI ([10] [1345])
Sur le plan international la dynamique est la même. Dans la retombée de la lutte de classe les débats s'accélèrent au sein du milieu politique prolétarien dans lesquels RI et Internacionalismo vont jouer un rôle de clarification déterminant. La lutte contre les conceptions conseillistes s'intensifie, poussant de nombreux groupes à rompre avec leurs premières amours libertaro-conseillistes. Internationalism aux USA se forme en contact étroit avec Internacionalismo, les discussions de clarification avec RI sont directement à l'origine de la formation de World Révolution et vont avoir beaucoup d'influence sur des groupes comme Worker's Voice et Revolutionary Perspective en Grande-Bretagne, c'est directement sous l'égide de RI que trois groupes fusionnent pour former Internationalisme en Belgique, de même en Espagne et en Italie c'est autour de la cohérence de RI que se forment Accion Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
L'appel d'Internationalism (USA) à la constitution d'un réseau international de contacts entre les groupes prolétariens existants va permettre l'accélération de la clarification théorique et de la décantation politique. Dans cette dynamique sera tenue une conférence internationale en 1974 qui prépare et annonce la fondation du CCI en 1975 qui regroupe alors Internacionalismo (Venezuela), Révolution Internationale (France), Internationalism (USA), Nord Révolution (GB), Internationalisme (Belgique), Accion proletaria (Espagne), Rivoluzione Internazionale (Italie) sur la base d'une plate-forme commune. Existant ainsi dans sept pays, loin des conceptions anarcho-conseillistes qui cachent mal le poids du localisme le CCI appuiera son existence sur un fonctionnement centralisé à l'échelle internationale, à l'image de la classe ouvrière qui est une et n'a pas d'intérêt particulier suivant les pays où elle se trouve.
La décomposition du gauchisme et le développement du PCI (Programme Communiste)
La vague de lutte de classe qui a débuté de manière explosive en 1968 commence à marquer le pas dès le début des années 70, la classe dominante surprise dans un premier temps réorganise son appareil de mystification politique pour lieux confronter la classe ouvrière. Cet infléchissement de la situation qui provoque la débandade du milieu conseilliste marqué par l'immédiatisme et la déroute des conceptions qui le caractérisaient va aussi provoquer une certaine décomposition des groupes "gauchistes" trotskystes et maoïstes secoués par de nombreuses scissions dont certaines vont tendre à se rapprocher des positions révolutionnaires. Cependant ces groupes marqués par leur lourde hérédité vont être incapables de réellement s'intégrer au milieu prolétarien. Ainsi les deux scissions de Lutte ouvrière en France: Union ouvrière et Combat communiste dont la première,au début influencée par le FOR/fait une traversée météoritique du milieu prolétarien pour disparaître dans le "modernisme" alors que la seconde se révélera congénitalement incapable de rompre avec le trotskisme "radical".
La dynamique de sortie du sein des groupes de 1'extrême-gauche de nombreux éléments plus démoralisés que clarifiés va s'intensifier avec l'entrée de la lutte de classe dans une phase de recul au milieu des années 70. C'est sur cette base que va se développer le PCI (Programme communiste). Après être passé à côté de la lutte de classe à la fin des années 60 sans rien voir, le PCI bordiguiste commence à sortir de sa torpeur au début des années 70, mais ce sera pour traiter avec un souverain mépris le milieu prolétarien qui s'est constitué et développer un recrutement opportuniste vis-à-vis d'éléments au "gauchisme" mal dégrossi. Sur la base de positions erronées sur des questions cruciales telles que la question nationale ou la question syndicale, la dérive opportuniste du PCI va s'intensifier et s'accélérer tout au long des années 70. Il va ainsi successivement soutenir la lutte de libération nationale en Angola, la terreur des Khmers rouges au Cambodge et la "révolution" palestinienne. Et le PCI bordiguiste va enfler à la mesure de la gangrène "gauchiste" qui le gagne.
A la fin des années 70 le PCI (Programme Communiste) sera l'organisation la plus importante au sein du milieu politique prolétarien existant. Hais si le PCI est le pôle dominant du milieu politique durant cette période ce n'est pas seulement à son importance numérique et sa réelle existence internationale qu'il le doit. Le recul de la lutte de classe sème le doute sur la capacité révolutionnaire du prolétariat et un nouvel attrait pour les conceptions substitutionnistes du parti se développe en réaction aussi à l'évidente déroute des conceptions anti-organisationnelles du conseillisme. Le bordiguisme qui théorise le parti comme le remède souverain contre toutes les difficultés de la classe fondamentalement trade-unioniste qu'il doit diriger et organiser comme un état-major militaire dirige son armée, connaît un regain d'intérêt dont le PCI va bénéficier. Hais au-delà du PCI (Programme communiste) c'est l'ensemble du milieu politique qui va être polarisé par le nécessaire débat sur le rôle et les tâches du parti communiste.
Le poids du sectarisme
Cependant si le PCI (Programme communiste) est la principale organisation du milieu prolétarien dans la deuxième moitié des années 70, il n'est pas pour autant le produit d'une dynamique de clarification et de regroupement. Bien au contraire, son développement s'est opéré sur la base d'un opportunisme grandissant et d'un sectarisme constamment théorisé. Le PCI qui se considère comme la seule organisation prolétarienne existante refuse toute discussion avec d'autres groupes. Le développement du PCI bordiguiste n'est pas l'expression de la force de la classe mais celle de son affaiblissement momentané déterminé par le recul des grèves. Malheureusement le sectarisme n'est pas l'apanage du seul PCI de Bordiga même s'il en fait la théorisation la plus caricaturale, il pèse sur l'ensemble du milieu prolétarien comme expression de son immaturité. Cela se concrétise notamment dans:
- la tendance de certains groupes à se croire seuls au monde et à nier la réalité de l'existence d'un milieu politique prolétarien; à l'image du PCI de nombreuses sectes se réclamant du bordiguisme vont développer cette attitude;
- une tendance à être plus soucieux de se distinguer sur des points secondaires afin de justifier sa propre existence séparée que de se confronter au milieu politique pour pousser à la clarification. Cette attitude va en général de pair avec une profonde sous-estimation de l'importance du milieu prolétarien et des débats qui l'animent; ainsi, Revolutionary Perspective qui refuse la dynamique de regroupement avec World Révolution en Grande-Bretagne en 1973 en arguant d'une divergence "fondamentale": selon ce groupe, après 1921 le parti bolchevik n'était plus prolétarien. Cette "fixation" de RP sur cette question n'étant qu'un prétexte, ce qui va se traduire quelques années plus tard par l'abandon de cette position sans en tirer les conséquences sur l'échec antérieur du regroupement en GB;
- une tendance aux scissions immatures et prématurées comme celle du PIC qui se sépare de RI en 1973 sur une base activiste et immédiatiste mâtinée de conseillisme. Cependant, toute les scissions ne sont pas infondées; ainsi celle du CCI ([11] [1346]) en 1977 à partir du CCI est justifiée dans la mesure où les camarades qui vont former le CCI rompent avec la cohérence du CCI sur des positions fondamentales telles que le rôle du parti et la nature de la violence de classe, rejoignant les conceptions bordiguistes. Cependant cette scission exprime quand même le poids du sectarisme en reprenant les conceptions sectaires du PCI sur bien des points;
- paradoxalement la tendance au sectarisme va aussi se manifester dans des tentatives de regroupement qui vont singer la dynamique qui fut celle du CCI. Ainsi le PIC va se faire l'initiateur de conférences qui essaieront dans la plus grande confusion de regrouper des groupes plus marqués par l'anarchisme que par les positions révolutionnaires. La fusion de Worker's Voice et de Revolutionnary Perspective en Grande-Bretagne au sein du CWO ([12] [1347]), si elle marque une volonté positive vers le regroupement, est aussi malheureusement marquée par l'attitude sectaire que cette organisation déploie vis-à-vis du CCI, alors que les positions de base sont très proches.
Ce poids du sectarisme sur le milieu politique est l'expression de la rupture occasionnée par 50 ans de contre-révolution, et l'oubli de l'expérience des révolutionnaires du passé sur la question du regroupement et de la formation du parti communiste, situation encore accentuée à la fin des années 70 par le recul de la lutte de classe. Cependant parce que le milieu politique n'est pas un reflet mécanique de la lutte de classe mais l'expression d'une volonté consciente de celle-ci de lutter contre les faiblesses qui la marquent, la volonté des différents groupes du milieu politique de s'engager résolument dans la dynamique de clarification, avec en perspective le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, est l'expression concrète de leur clarté politique sur leur immense responsabilité dans la période historique présente.
Dans ces conditions l'appel de Battaglia Comunista à la tenue de conférences des groupes de la Gauche communiste, après une longue période de très grande discrétion de ce groupe sur la scène internationale, marque une évolution positive pour l'ensemble du milieu qui, avec le recul momentané de la lutte ouvrière, subit fortement le poids du sectarisme et de la dispersion.
Dans la deuxième partie de cet article nous verrons comment s'est située l'évolution du milieu politique à la fin des années 70 et durant les années 80, évolution marquée par la tenue des conférences et leur échec final, la crise que cette situation ouvre au sein du milieu et la brutale décantation qui en résulte et qui se traduit notamment par l'éclatement du PCI, et comment ce milieu va réagir face au développement d'une nouvelle vague de lutte de classe à partir de 1983 et aux responsabilités que cela implique pour les révolutionnaires.
JJ. 7/3/88
[1] [1348] Remarque préliminaire: Il est évident que dans le cadre de ces notes il n'est pas possible de retracer l'itinéraire et les positions de tous les groupes mentionnés dans cet article et dont beaucoup ont d'ailleurs rejoint les poubelles de l'histoire. Nous nous bornerons donc à faire référence aux groupes de la tradition de la gauche communiste et à ceux toujours existants.
[2] [1349] "Spartakusbond": voir Revue Internationale n*38 et 39. Sur la •gauche hollandaise", voir Revue Internationale n*30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52.
[3] [1350] "Partito Comunista Internazionalista", fondé en 1945, qui publie Battaglia Comunista et Prometeo: voir, entre autres, Revue Internationale n*36, 40 et 41. Adresse: Prometeo, Caselia Postale 1753, 20100 Milano, Italie.
[4] [1351] "Parti Communiste International", scission en 1952 du précédent, qui publie en France Le Prolétaire et Programme Communiste. Voir Revue Internationale n'32, 33, 34, 38.
[5] [1352] Bilan, publication de la "gauche italienne", formée en 1928, publié de 1333 à 1938. Voir la brochure du CCI La Gauche Communiste d'Italie. Voir Revue Internationale n°47
[6] [1353] Internationalisme, publication de la Gauche Communiste de France, 1945-1952. Voir les rééditions d'articles dans la Revue Internationale. Voir La Gauche communiste d’ltalie,
[7] [1354] "Ferment Ouvrier Révolutionnaire", qui publie Alarme, BP329,
Ï5624 PARIS Cedex 13. Voir Revue Internationale nf52.
[8] [1355] Sur le "modernisme", voir Revue Internationale n'34.
[9] [1356] Sur le "conseillisme", voir Revue Internationale n#37, 40, 41.
[10] [1357] Voir la Revue Internationale n°40: "10 ans de CCI". Voir les différentes publications territoriales du CCI au dos de cette revue.
[11] [1358] GC1, BP 54, BXL 31 Bruxelles, Belgique. Voir Revue Internationale n°48, 49, 50, sur la décadence du capitalisme.
[12] [1359] CWO, PO Box 145, Head Post Office, Glasgow, Grande-Bretagne. Voir Revue Internationale n°39, 40, 41.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1334]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Décadence du capitalisme guerre, militarisme et blocs impérialistes (2eme partie)
- 3448 reads
Dans la première partie de cet article nous mettions en évidence le caractère parfaitement irrationnel de la guerre dans la période de décadence du capitalisme. Alors qu'au siècle dernier, malgré les destructions et les Massacres qu'elles occasionnaient, les guerres constituaient un moyen de la marche en avant du mode de production capitaliste favorisant la conquête du marché mondial et stimulant le développement des forces productives de l'ensemble de la société, les guerres du 20ème siècle ne sont plus que l'expression extrême de toute la barbarie dans laquelle la décadence capitaliste plonge cette même société. Cette partie de l'article soulignait en particulier que les guerres mondiales, mais aussi les multiples guerres "locales", de même que toutes les dépenses militaires englouties dans leur préparation et leur entretien, ne sauraient nullement être considérées comme des "faux frais" du développement de l'économie capitaliste mais s'inscrivent de façon uniquement négative dans le bilan d'ensemble de celle-ci: résultat majeur des contradictions insolubles qui minent cette économie, elles constituent un facteur puissant d'aggravation et d'accélération de son effondrement. En fin de compte, la parfaite absurdité de la guerre aujourd'hui s'illustre de façon éclatante avec le fait qu'une nouvelle guerre généralisée, qui est la seule perspective que le capitalisme soit en mesure pour sa part de proposer malgré toutes les campagnes pacifistes actuelles, signifierait tout simplement la destruction de l'humanité.
Une autre illustration du caractère complètement irrationnel et absurde de la guerre dans la période de décadence du capitalisme, comme manifestation de l'absurdité même que représente pour l'ensemble de la société la survivance de ce système, est constituée par le fait que le bloc qui, en dernier ressort, déclenche la guerre mondiale est justement celui qui en sort "vaincu" (si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a un "vainqueur"). C'est ainsi qu'en août 1914 c'est directement l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui déclarent la guerre aux pays de l'Entente. De même en septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne qui déclenche les hostilités en Europe alors que c'est le bombardement de la flotte américaine à Pearl Harbor en décembre 1941 par le Japon qui se trouve à l'origine immédiate de l'entrée en guerre des Etats-Unis.
LA DEMARCHE "SUICIDAIRE" DU CAPITALISME DECADENT
Cette démarche "suicidaire" des pays qui allaient en fin de compte être les principaux perdants de la conflagration mondiale ne peut évidemment pas s'expliquer par la "folie" de leurs dirigeants. En réalité, cette apparente "folie" dans la conduite des affaires de ces pays, n'est pas autre chose que la traduction de la "folie" générale du système capitaliste aujourd'hui; cette démarche "suicidaire", c'est avant tout celle du capitalisme dans son ensemble depuis qu'il est entré dans sa période de décadence, et qui ne fait que s'aggraver à mesure qu'il s'enfonce dans cette décadence. Plus précisément, la conduite "irrationnelle" des futurs "perdants" des guerres mondiales ne fait qu'exprimer deux réalités:
- le caractère inéluctable, lorsque fait dé faut l'obstacle de la lutte prolétarienne, de la guerre généralisée comme aboutissement de l'exacerbation des contradictions économiques du mode de production capitaliste;
- le fait que la grande puissance qui "pousse" le plus vers l'affrontement général soit la moins bien lotie dans le partage du butin impérialiste et qui trouve le plus grand intérêt dans la remise en cause de ce partage.
Le premier point fait partie du patrimoine "classique" du marxisme depuis le début du siècle. Il est un des fondements de toute la perspective de notre organisation pour la période actuelle et il a été amplement développé dans d'autres articles de notre presse. Ce qu'il importe de souligner plus particulièrement ici, c'est l'absence d'un réel contrôle de ce phénomène de la part de la classe dominante. De même que tous les efforts, toutes les politiques de la bourgeoisie en vue de surmonter la crise de l'économie capitaliste ne peuvent empêcher celle-ci de s'aggraver de façon inexorable, toutes les gesticulations des gouvernements, même lorsqu'elles visent "sincèrement" à préserver la paix, ne peuvent enrayer l'engrenage qui conduit le monde vers la boucherie impérialiste généralisée, le deuxième phénomène découlant d'ailleurs du premier.
En effet, devant l'impasse totale où se trouve le capitalisme et la faillite de tous les "remèdes" économiques, aussi brutaux qu'ils soient, la seule voie qui reste ouverte à la bourgeoisie pour tenter de desserrer l'étau de cette impasse est celle d'une fuite en avant avec d'autres moyens - eux aussi de plus en plus illusoires d'ailleurs - qui ne peuvent être que militaires. Depuis plusieurs siècles déjà, la force des armes est un des instruments essentiels de la défense des intérêts du capitalisme: c'est par les guerres coloniales en particulier que ce système s'est ouvert le marché mondial, que chaque puissance bourgeoise s'est constitué son "pré carré" lui permettant d'écouler ses marchandises et de se fournir en matières premières. Ce qu'exprimait l'explosion du militarisme et des armements dès la fin du siècle dernier, c'est l'achèvement de ce partage du marché mondial entre les grandes (et même les petites) puissances bourgeoises. Désormais, pour chacune d'entre elles, un accroissement (et partant la préservation) de sa part du marché passait nécessairement par un affrontement avec les autres puissances, et les moyens militaires qui suffisaient pour mettre au pas des populations indigènes munies de flèches et de lances devaient être plus que décuplés pour faire face à ceux des autres nations industrielles. Depuis cette époque, et même si la colonisation a fait place à d'autres formes de domination impérialiste, ce phénomène n'a fait que s'amplifier jusqu'à acquérir des proportions monstrueuses transformant complètement ses rapports avec l'ensemble de la société.
En effet, dans la décadence capitaliste, il en est de la guerre et du militarisme comme des autres instruments de la société bourgeoise et notamment de son Etat. A l'origine, ce dernier apparaît en tant que simple instrument de la société civile (de la société bourgeoise dans le cas de l'Etat bourgeois) pour assurer un certain "ordre" en son sein et empêcher que les antagonismes qui la divisent ne l'amènent à sa dislocation. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, avec l'amplification des convulsions du système, se développe le phénomène du capitalisme d'Etat où ce dernier acquiert un poids sans cesse croissant jusqu'à absorber l'ensemble de la société civile, à devenir le principal, sinon le seul, patron. Même si l'Etat continue d'être un organe du capitalisme, et non l'inverse, en tant que représentant suprême de ce système, que garant de sa préservation, il tend à échapper au contrôle immédiat des différents secteurs de la classe bourgeoise dans la plupart de ses fonctions, pour imposer à celle-ci ses propres nécessités globales et sa propre logique totalitaire. Il en est de même du militarisme qui constitue une composante essentielle de l'Etat et dont le développement est justement un des facteurs majeurs de l'intensification du phénomène du capitalisme d'Etat. A l'origine simple moyen de la politique économique de la bourgeoisie, il acquiert avec l'Etat, et au sein de l'Etat, un certain niveau d'autonomie et tend de plus en plus, avec l'amplification de son rôle dans la société bourgeoise, à s'imposer à celle-ci et à l'Etat.
Cette tendance à la colonisation de l'appareil étatique par la sphère militaire s'illustre en particulier par l'importance du budget des armées dans le budget total des Etats (c'est en général le budget le plus élevé), mais pas uniquement. En fait, c'est l'ensemble de la conduite des affaires de l'Etat qui subit de façon massive l'emprise du militarisme. Dans les pays les plus faibles, cette emprise prend souvent la forme extrême de dictatures militaires, mais elle n'est pas moins effective dans les pays où c'est le personnel spécialisé des politiciens qui dirige l'Etat, de même que l'emprise du capitalisme d'Etat n'est pas moins forte là où, contrairement aux pays prétendus socialistes, il n'y a pas identification complète entre l'appareil politique et l'appareil économique du capital. D'ailleurs, même dans les pays les plus développés, les exemples ne manquent pas, depuis la première guerre mondiale, de la participation de militaires aux instances suprêmes de l'Etat: rôle éminent du Général Groener, premier quartier-maître général, comme inspirateur de la politique du chancelier social-démocrate Ebert dans la répression de la Révolution allemande en 1918-19, élection du Maréchal Hindenburg à la présidence de la République en 1925 et 1932 (c'est lui qui fera appel à Hitler dans la fonction de chancelier en 1933), nomination à la tête de l'Etat français du maréchal Péta in en 1940 et du général De Gaulle en 1944 puis en 1958, élection du général Eisenhower comme président des Etats-Unis en 1952 et 1956, etc. De plus, alors que, dans le cadre de la "Démocratie", le personnel et les partis politiques sont amenés à changer au sommet de l'Etat, 1'état-major et la hiérarchie militaire bénéficient d'une remarquable stabilité, ce qui ne peut que renforcer leur pouvoir réel.
Du fait de cette domination du militarisme dans la vie politique, à mesure que les "solutions" à la crise préconisées et mises en oeuvre par les appareils économiques et politiques de la société bourgeoises font la preuve de leur impuissance, les "solutions" spécifiques dont les appareils militaires sont les promoteurs tendent à s'imposer de façon croissante. C'est en ce sens, par exemple, qu'on peut comprendre l'accession au pouvoir du parti nazi en 1933: ce parti représentait avec le plus de détermination l'option militaire face à la catastrophe économique qui sévissait de façon particulièrement aiguë en Allemagne. Ainsi, à mesure que s'enfonce le capitalisme dans sa crise, s'impose à lui de façon croissante, irréversible et incontrôlable, la logique du militarisme, même si celui-ci n'est pas plus capable que les autres politiques de proposer (comme on l'a vu dans la première partie de cet article) la moindre solution aux contradictions économiques du système. Et cette logique du militarisme, dans un contexte mondial où tous les pays sont dominés par elle, où le pays qui ne prépare pas la guerre, qui n'emploie pas les moyens militaires lorsqu'ils "s'imposent", devient la "victime" des autres pays, ne peut conduire qu'à la guerre généralisée même si celle-ci ne saurait apporter à tous les belligérants que massacres et ruines, et même la destruction totale.
Cette pression inéluctable vers l'affrontement généralisé s'exerce d'autant plus fort sur les grandes puissances que celles-ci sont moins bien pourvues dans le partage du butin impérialiste alors que les mieux loties ont beaucoup plus intérêt à préserver le statu quo. C'est pour cela que lors de la première guerre mondiale, les deux puissances qui poussent le plus vers la guerre sont la Russie et surtout l'Allemagne et que le bloc qui engage le conflit est celui dominé par cette dernière laquelle se trouve avec un empire colonial de moindre envergure que ceux de la Belgique et du Portugal alors qu'elle est devenue la première puissance économique d'Europe. Cette situation est encore plus nette lors de la deuxième guerre mondiale où la situation de l'Allemagne s'est encore aggravée du fait des conditions du traité de Versailles de 1919 qui l'a dépouillée de ses rares possessions coloniales de même que d'une partie de "son" territoire national. De même, le Japon détruit la flotte américaine du Pacifique en 1941 dans l'espoir d'élargir dans cet océan un empire colonial qu'il estime insuffisant, compte tenu de sa nouvelle puissance économique, avec la seule Mandchourie acquise en 1937 au détriment de la Chine. Ainsi, les brigands impérialistes qui précipitent la guerre du fait de l'étroitesse de leur "espace vital" sont finalement les moins bien lotis pour la gagner:
- parce qu'ils disposent de moindres assises territoriales et économiques que leurs adversaires;
- parce que leur offensive, dans un monde entièrement partagé entre les grandes puissances bourgeoises, ne peut que souder entre elles celles qui sont déjà "installées" (comme c'est par exemple le cas de la France et de la Grande-Bretagne dont les rivalités en Afrique de la fin du 19ème siècle sont finalement surmontées face à la menace commune que représente l'Allemagne).
Par bien des côtés, l'URSS et son bloc se trouvent aujourd'hui dans une situation similaire à celle de l'Allemagne et de ses alliés en 1914 et 1939. En particulier, la cause première de la situation dont pâtissent l'une et l'autre de ces deux puissances est leur accession tardive au développement industriel et au marché mondial qui les a contraintes de se contenter des miettes laissées par les puissances industrielles plus anciennes (comme la France et la Grande-Bretagne notamment) lors de leur partage du gâteau impérialiste. Cependant, il faut noter une différence importante entre l'URSS d'aujourd'hui et l'Allemagne du passé. Si, comme l'Allemagne en 1914 et 1939, l'URSS est aujourd'hui la 2ème puissance économique du monde (bien qu'en termes de PNB elle soit passée derrière le Japon) elle se distingue de ce pays par le fait qu'elle ne dispose nullement d'une économie et d'une industrie à 1'avant-garde du développement. Bien au contraire: elle accuse dans ce domaine un retard considérable et insurmontable. C'est là on des phénomènes majeurs de la décadence capitaliste: l'impossibilité pour les capitaux nationaux nouveaux venus de se hisser au niveau de développement des puissances "installées". L'essor industriel de l'Allemagne prend place au moment (fin du 19ème siècle) où le capitalisme connaît sa plus grande prospérité ce qui permet de faire de l'économie de ce pays la plus moderne du monde au moment où le capitalisme entre en décadence. L'essor industriel de la Russie actuelle, après les terribles destructions de la première guerre mondiale et de la guerre civile qui a suivi la révolution, prend place au contraire en pleine période de décadence (la fin des années 20 et les années 30): de ce fait, ce pays n'est jamais parvenu à sortir réellement de son sous-développement et compte parmi les plus arriérés du bloc qu'il domine ([1] [1360]).
Ainsi, à la moindre extension de son empire s'ajoute, pour l'URSS, une faiblesse économique et financière énorme par rapport à son rival occidental. Ce décalage économique est encore plus évident au niveau de l'ensemble des deux blocs: ainsi parmi les 8 premières puissances mondiales (en termes de PNB), 7 (l'URSS se trouvant en 2ème position) font partie de l'OTAN ou sont, comme le Japon, des alliés sûrs des Etats Unis. En revanche, les alliés de l'URSS au sein du pacte de Varsovie se situent respectivement aux 11ème, 13ème, 19ème, 32ème, 40ème et 55ème positions. Cette faiblesse se répercute sur toute une série de domaines dans la période actuelle.
Une des conséquences primordiales de la supériorité économique du bloc occidental, et notamment des Etats-Unis, consiste dans la variété des moyens dont il dispose pour asseoir et maintenir sa domination impérialiste. Ainsi, les Etats Unis peuvent établir leur domination aussi bien sur des pays gouvernés par des régimes "démocratiques", que sur des pays aux mains de l'armée, de partis uniques, et même de partis de type stalinien. L'URSS, par contre, n'arrive à contrôler que des régimes directement à son image (et encore!) ou des régimes militaires dépendant directement du soutien des troupes du bloc.
De même, le bloc occidental peut faire, à côté de la carte militaire, un large usage de la carte économique dans le contrôle de ses dépendances (aides bilatérales, intervention d'organismes comme le FMI, la Banque mondiale, etc.). Ce n'est pas le cas de l'URSS qui n'a pas, et n'a jamais eu, les moyens de jouer une telle carte. C'est uniquement à la force militaire que cette puissance doit la cohésion de son bloc.
Ainsi, la faiblesse économique d'ensemble du bloc russe explique sa situation stratégique nettement défavorable à l'échelle mondiale: le registre limité de ses moyens ne lui a jamais permis de se dégager vraiment de l'encerclement que fait peser sur lui le bloc américain. Elle explique également que même sur le terrain strictement militaire - qui est le seul qui lui reste - il n'ait pas de possibilité de s'affronter victorieusement à son rival.
En effet, alors que l'Allemagne du début du siècle ou des années 30 avait pu, grâce à son potentiel industriel moderne, prendre momentanément, avant les affrontements décisifs, une certaine avance militaire sur les pays dont elle contestait l'hégémonie, l'URSS et son bloc, du fait de leur arriération économique et technologique, ont toujours été en retard sur le bloc américain du point de vue des armements. De plus, ce retard est aggravé par le fait que, depuis la seconde guerre mondiale -comme manifestation de l'accentuation constante des grandes tendances de la décadence capitaliste- le monde entier n'a pas bénéficié d'un seul instant de répit dans le domaine des conflits locaux et des préparatifs militaires contrairement à ce qui avait prévalu à la suite de la première guerre mondiale.
Depuis la seconde guerre mondiale, l'URSS n'a pu donc que courir derrière -bien loin- la puissance militaire du bloc de l'Ouest sans jamais parvenir à l'égaler ([2] [1361]). Les énormes efforts qu'elle a consacrés à ses armements, notamment dans les années 60-70, s'ils lui ont permis d'atteindre une certaine parité dans quelques domaines (notamment la puissance de feu nucléaire) ont eu comme résultat une aggravation encore plus dramatique de son retard industriel et de sa fragilité face aux convulsions de la crise économique mondiale. En revanche, ils ne lui ont pas permis de préserver les positions (à l'exception de l'Indochine) que les guerres de décolonisation (menées contre des pays du bloc de l'Ouest) lui avaient permis de conquérir en Asie (Chine) ou en Afrique (Egypte notamment).
Au tournant des années 70 et 80, se produit une modification importante du contexte général dans lequel se sont déployés les conflits impérialistes depuis la fin de la guerre froide. A la base de cette modification se situe la mise en évidence de plus en plus nette de l'impasse totale de l'économie capitaliste dont la récession de 81-83 constitue une illustration particulièrement claire. Cette impasse économique ne peut qu'accentuer de façon très importante la fuite en avant de tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale dans une marche vers la guerre (voir en particulier l'article "Années 80, les années de vérité", in Revue Internationale n° 20, 1er trimestre 1980).
L'OFFENSIVE DU BLOC AMERICAIN
Dans ce contexte on assiste à une modification qualitative de l'évolution des conflits impérialistes. Sa caractéristique majeure consiste dans une offensive générale du bloc américain contre le bloc russe. Une offensive dont Carter, avec le lancement de sa campagne sur les "droits de l'homme" et les décisions essentielles sur le plan des armements (système de fusées nucléaires NX, construction des euromissiles, constitution de la force d'intervention rapide), avait jeté les bases et qui s'est déployée avec le mandat de Reagan notamment avec des augmentations considérables des budgets militaires, l'envoi des corps expéditionnaires US au Liban en 82, à la Grenade en 84, la décision de développer le dispositif de la "Guerre des étoiles" et, plus récemment, les bombardements de la Libye par l'US Air Force et le déploiement de l'US Navy dans le golfe persique.
Cette offensive vise à parachever l'encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle passe par une expulsion définitive de l'URSS du Moyen-Orient, d'ores et déjà réalisée avec l'insertion de la Syrie au milieu des années 80, dans les plans impérialistes occidentaux, par une lise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce importante de son dispositif. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise en fin de compte à étrangler complètement l'URSS, à lui retirer son statut de puissance mondiale.
Une des caractéristiques majeures de cette offensive, c'est l'emploi de plus en plus massif par le bloc US de sa puissance militaire notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux du bloc (France, Angleterre et Italie notamment) sur le terrain des affrontements, comme on a pu le voir en 1982 au Liban, dans le golfe persique en 1987. Cette caractéristique correspond au fait que la carte économique employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire ne suffit plus:
- du fait des ambitions présentes du bloc US;
- du fait de l'aggravation de la crise mondiale elle-même -qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays du Tiers-monde sur lesquels s'appuyait auparavant le bloc US.
Sur ce point, les événements d'Iran ont été un révélateur. L'effondrement du régime du Shah et la paralysie que cela a occasionné pour le dispositif américain dans cette région ont permis à l'URSS de marquer des points en Afghanistan en installant ses troupes à quelques centaines de kilomètres des "mers chaudes" de l'océan Indien. Ils ont convaincu la bourgeoisie américaine de mettre sur pied sa force d'intervention rapide (et lui ont permis de faire "avaler" facilement cette décision à la population traumatisée par l'exploitation de l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran en 1980) et de réorienter sa stratégie impérialiste.
Ainsi, la situation présente se différencie de celle qui a précédé la 2ème guerre mondiale par le fait que c'est maintenant»le bloc le mieux loti qui est à l'offensive:
- du fait que ce bloc dispose d'une énorme supériorité militaire et notamment d'une très grande avance technologique;
- du fait qu'en se prolongeant beaucoup plus longtemps que lors des années 30, sans qu'elle puisse déboucher sur un conflit généralisé, la crise prolonge et provoque un déploiement beaucoup plus vaste des préparatifs à un tel conflit, préparatifs pour lesquels, évidemment, le bloc économiquement le plus puissant est le mieux armé.
Cependant, cela ne veut pas dire que soit remis en cause le fait que ce soit le bloc le plus défavorisé qui déclenche en fin de compte le conflit généralisé. Pour l'URSS, les enjeux sont considérables. Pour ce pays, c'est une question de vie ou de mort qui est au bout de l'offensive actuelle du bloc US. Finalement, si le bloc américain peut poursuivre jusqu'au bout son offensive actuelle (ce qui suppose qu'il ne soit pas entravé par la lutte de classe) il ne restera à l'URSS pas d'autre alternative que de faire appel aux terribles moyens de la guerre généralisée:
- parce que, en règle générale, un bloc ne capitule jamais avant d'avoir usé de tous les moyens militaires dont il dispose (sauf s'il y est contraint par la lutte de classe);
- parce qu'une capitulation de l'URSS signifierait l'effondrement du régime et la dépossession complète de l'actuelle bourgeoisie du fait qu'elle est complètement intégrée à l'Etat (contrairement à la bourgeoisie allemande qui pouvait s*accommoder d'une victoire des Alliés et d'un changement de régime politique).
Si, en fin de compte, le schéma qui a prévalu en 1914 et en 1939 reste donc aujourd'hui valable sur l'essentiel (c'est le bloc le plus défavorisé dans le partage impérialiste qui fait le pas décisif), il faut s'attendre dans la période qui vient à une avancée progressive du bloc US qui va continuer à marquer des points (contrairement aux années 30 où c'est l'Allemagne qui a marqué des points: Anschluss en 37, Munich en 38, Tchécoslovaquie en 39...).
Face à cette avancée, il faut s'attendre à une résistance pied à pied, acharnée de la part du bloc russe partout ou il peut opposer une telle résistance, ce qui va se traduire par une poursuite et une intensification des confrontations militaires dans lesquelles le bloc US va s'engager de plus en plus directement. En ce sens, la carte diplomatique, si elle continuera à être jouée, tendra de plus en plus à être le résultat d'un rapport de forces obtenu au préalable sur le terrain militaire.
C'est bien d'ailleurs ce qui en est advenu encore récemment avec la signature, le 8 décembre 87, de l'accord de Washington entre Reagan et Gorbatchev sur les missiles "de portée intermédiaire (entre 500 et 5500 km) et des négociations qui se poursuivent à l'heure actuelle à propos d'un éventuel retrait des troupes russes de l'Afghanistan.
Dans ce dernier cas, si un tel retrait se produit, il résultera de l'impasse dans laquelle s'est lise c l'URSS dans ce pays depuis notamment que les Etats-Unis fournissent abondamment la guérilla en armements ultramodernes comme les missiles sol-air "Stinger" qui provoquent des dégâts considérables parmi les avions et les hélicoptères russes.
Pour ce qui concerne les accords de Washington sur l'élimination des "euromissiles", il faut relever qu'ils sont aussi un résultat de la pression militaire exercée par les Etats-Unis et leur bloc sur le bloc adverse, notamment l'installation des fusées "Pershing II" et des "missiles de croisière" dans différents pays d'Europe occidentale (Grande-Bretagne, RFA, Pays-Bas, Belgique et Italie) à partir de novembre 83. Le fait que cet accord résulte principalement d'une initiative russe et que le nombre de missiles et de têtes nucléaires supprimés par l'URSS soit bien plus élevé que du côté américain (857 missiles et 1667 têtes contre 429 missiles et autant de têtes) illustre que c'est bien l'URSS qui se trouve en position de faiblesse (notamment du fait que ses fusées SS20 sont bien moins précises que les Pershing II, qui peuvent frapper à moins de 40 mètres du but des cibles distantes de 1800 km, sans parler des "missiles de croisière" qui, après 3000 km de vol, sont encore bien plus précis).
Pour le chef de file du bloc de l'Ouest, l'opération est d'autant plus intéressante que le retrait de ses propres "euromissiles" n'implique ni le retrait, ni -. l'arrêt du déploiement de ceux de ses alliés: en ; fait, derrière l'accord de Washington, il y a la volonté des Etats-Unis de reporter vers les pays européens une partie du fardeau militaire. Cette plus grande implication de ces pays dans l'effort de défense de leur bloc s'est d'ailleurs illustrée durant l'été 87 de façon on ne peut plus significative par leur participation, souvent massive, à l'Armada occidentale déployée dans le golfe persique. Elle s'est confirmée clairement fin 87 avec la décision franco-britannique de construire en commun un missile nucléaire air-sol de plus de 500 km de portée de même qu'avec les manoeuvres militaires conjointes franco-allemandes préfigurant une plus grande intégration des armées des deux pays concernés et, à terme, de l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. Elle s'est confirmée une nouvelle fois au dernier "sommet" de l'OTAN, début mars 88, où les membres de cette alliance, c'est-à-dire principalement les pays d'Europe occidentale, se sont engagés à moderniser régulièrement leurs armements (en fait à accroître encore leurs dépenses militaires).
Ainsi, les accords de Washington ne signifient nullement une remise en cause des caractéristiques générales des antagonismes inter impérialistes qui dominent le monde à l'heure actuelle. En particulier, la suppression des "euromissiles" ne constitue qu'une petite égratignure dans la phénoménale capacité de destruction dont disposent les grandes puissances. Malgré l'effroyable potentiel de destruction que représentent les 2100 bombes atomiques appelées à être éliminées (chacune plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima en août 1945), cela ne constitue qu'une petite partie des quelques 40000 bombes qui restent prêtes à être expédiées par des missiles de toutes sortes installés à terre ou à bord d'avions, de sous-marins et de navires; sans compter tous les obus nucléaires (probablement des dizaines de milliers) que 6800 canons peuvent tirer.
LA CLASSE OUVRIERE DOIT COMBATTRE LES ILLUSIONS PACIFISTES
Si les accords de Washington n'impliquent aucune réduction sensible du formidable potentiel de destruction entre les mains des grandes puissances, ils ne signifient pas non plus l'ouverture d'une quelconque perspective de désarmement et de liquidation de la menace d'une guerre mondiale. Le "réchauffement" présent des relations entre les deux "grands", les amabilités échangées entre Reagan et Gorbatchev qui tranchent avec les échanges d'insultes d'il y a quelques années, n'indiquent nullement que la "raison" soit en train de l'emporter dans les relations internationales au détriment de la "folie" que représente l'affrontement entre puissances.
"En réalité, les discours pacifistes, les grandes manoeuvres diplomatiques, les conférences internationales de toutes sortes ont toujours fait partie des préparatifs bourgeois en vue de la guerre impérialiste (corne l’ont démontré par exemple les accords de Munich en 1938, un an avant le déchaînement de la seconde guerre mondiale). Ils interviennent en général en alternance avec les discours bellicistes et ont une fonction complémentaire. Alors que ces derniers ont pour objet de faire accepter à la population, et en particulier à la classe ouvrière, les sacrifices économiques commandés par l'explosion des armements, de la préparer à la mobilisation générale, les premiers ont pour objet de permettre à chaque Etat d'apparaître comme 'celui qui veut la paix', qui n'est pour rien dans l'aggravation des tensions, afin de pouvoir justifier par la suite la 'nécessité' de la guerre contre 'l'autre qui en porte toute la responsabilité". (Résolution sur la situation internationale du 7èrae congrès du CCI, Revue Internationale n°51, p.10) On pourrait même préciser que l'exemple de la conférence de Munich, qui avait été présentée comme un "grand pas vers la paix en Europe" après toute une période de développement des tensions diplomatiques et de déploiement des discours bellicistes, nous a enseigné que les phases "pacifistes" de la propagande bourgeoise ne signifient nullement que le danger de guerre soit moins imminent qu'au moment des phases "bellicistes". C'est tout le contraire qui est vrai: en réalité la fonction spécifique de chacun des deux types de campagnes conduit à justement utiliser les discours pacifistes à la veille même du déchaînement des conflits, afin de mieux pouvoir surprendre la classe ouvrière et paralyser toute résistance de sa part, alors que les discours pacifistes correspondaient à la phase antérieure de développement des armements.
Même si le déchaînement d'une troisième guerre mondiale n'est pas actuellement à l'ordre du jour du fait que le prolétariat d'aujourd'hui n'a pas été défait mais se trouve au contraire dans une période historique de développement de ses luttes, "c'est bien à une telle alternance entre discours bellicistes et discours pacifistes que nous avons assisté ces dernières années de la part de l'administration Reagan dont le 'jusqu'auboutisme' des premières années de son Mandat, destiné à justifier les énormes accroissements des dépenses militaires ainsi que diverses interventions à l'extérieur (envoi des corps expéditionnaires américains au Liban et à la Grenade en 82-83, etc.), a fait place à 1"ouverture' face aux initiatives soviétiques dès lors qu'était acquise et raffermie la nouvelle orientation d'accroissement des préparatifs militaires et qu'il convenait de faire preuve de 'bonne volonté'". (Ibid)
Le fait que le principal "destinataire" de ces différentes campagnes soit le prolétariat mondial est notamment illustré par le moment où chacune d'entre elles s'est développée. En effet, le point culminant de la campagne belliciste prend place au début des années 80 alors que la classe ouvrière a subi une importante défaite concrétisée et aggravée par la répression des ouvriers de Pologne en décembre 81. Ce qui momentanément domine au sein de la classe ouvrière c'est un sentiment d'impuissance et une forte désorientation. Dans ce contexte, les campagnes bellicistes promues par les gouvernements, les discours de guerre quotidiens, s'ils développent parmi les ouvriers une inquiétude justifiée face aux perspectives terribles que le système propose à toute l'humanité, ont finalement pour principal résultat d'accroître encore leur sentiment d'impuissance, leur désarroi, et d'en faire des "proies" plus faciles pour les grandes manifestations pacifistes de diversion organisées par les forces de gauche dans l'opposition. Pour sa part, la campagne pacifiste promue par les gouvernements occidentaux derrière le "chef d'orchestre" Reagan prend son essor en 84 juste après que toute une série de luttes massives en Europe aient fait la preuve que la classe ouvrière était sortie de son désarroi momentané et quelle reprenait confiance en elle-même. Dans ces conditions, l'inquiétude résultant des discours guerriers est beaucoup moins en mesure de développer un sentiment d'impuissance parmi les ouvriers. En revanche, elle risque d'accélérer parmi eux la prise de conscience du fait que leurs luttes présentes contre les attaques économiques du capitalisme constituent le seul obstacle véritable à un déchaînement de la guerre mondiale, qu'elles sont des préparatifs vers le renversement de ce système barbare. C'est justement à conjurer ce "risque" que les campagnes pacifistes visent aujourd'hui. Ne pouvant plus faire accepter avec fatalisme aux ouvriers la perspective d'un nouvel accroissement des conflits impérialistes et les effroyables implications contenues dans une telle perspective, il s'agit maintenant pour la bourgeoisie de tenter de les endormir, de leur faire croire que la "sagesse" des dirigeants du monde est en mesure de mettre un terne définitif à la menace d'une troisième guerre mondiale.
Ainsi, l'idée essentielle qu'avec des arguments différents ces deux types de campagnes se proposent d'ancrer dans la tête des ouvriers, c'est que les questions fondamentales de la vie de la société, et en particulier la question de la guerre, se jouent en dehors de toute possibilité pour le prolétariat d'y apporter sa propre réponse en tant que classe. C'est justement l'idée opposée que les révolutionnaires doivent défendre de façon permanente en intervenant dans la classe ouvrière: toutes les "conférences", tous les "accords" entre brigands impérialistes, toute la "sagesse" des hommes d'Etat n'y feront rien: seule la classe ouvrière peut empêcher que la crise actuelle du capitalisme ne débouche sur une troisième guerre mondiale et donc sur la destruction de l'humanité, seule la classe ouvrière, en renversant le capitalisme, peut libérer la société du fléau des guerres.
Aujourd'hui, alors que la bourgeoisie occidentale fait tout son possible pour masquer la véritable gravité de l'envoi de sa formidable armada dans le golfe persique -qui porte en elle la perspective d'une intensification considérable des tensions entre les grandes puissances-, alors qu'elle présente les décisions du dernier sommet de l'OTAN comme un appel à la poursuite du désarmement et à l'atténuation de ces tensions alors qu'en fait c'est un renforcement des armements et une aggravation de celles-ci qu'elles contiennent, alors que Gorbatchev se fait partout et ostensiblement le "grand champion de la paix", il appartient aux révolutionnaires de rappeler et souligner, comme se le proposait cet article, les dimensions et le caractère inéluctable, au sein du capitalisme, de la barbarie dans laquelle ce système a plongé et plongera de plus en plus la société. Il leur appartient en même temps de renforcer leur dénonciation de toutes les illusions pacifistes en poursuivant le combat engagé par leurs aînés depuis le début de ce siècle:
"Les formules du pacifisme: désarmement universel sous le régime capitaliste, tribunaux d'arbitrage, etc., apparaissent non seulement comme une utopie réactionnaire mais encore comme une véritable duperie des travailleurs, tendant à désarmer le prolétariat et à le distraire de sa tâche qui est le désarmement des exploiteurs." (Lénine, Programme du Parti Bolchevik, mars 1919)
F.M.
[1] [1362] Notre revue, à plusieurs reprises (voir en particulier le "Rapport sur la situation internationale" du 3ème Congrès du CCI dans le n°18 et "A propos de la critique de la théorie du "maillon faible" dans le n°37), a mis suffisamment en évidence l'arriération considérable dont n'arrive pas à se défaire l'URSS pour qu'il soit nécessaire d'y revenir ici.
[2] [1363] C'est d'ailleurs un des éléments qui expliquent que les conflits de la "guerre froide" de la fin des années 40 et du début des années 50 n'aient pu dégénérer en conflagration mondiale: les échecs de l'URSS dans ses tentatives à Berlin (blocus de Berlin-Ouest entre avril 48 et mai 49 déjoué par un pont aérien ais en place par les Occidentaux) et en Corée (invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 50 qui doit faire face à l'envoi des troupes américaines et aboutit en juillet 53 à un armistice par lequel la Corée du Nord perd une partie de son territoire) lui ont démontré, dès cette époque, qu'elle n'avait pas les moyens de ses objectifs. Les autres tentatives ultérieures de l'URSS pour améliorer ses positions se sont pour la plupart soldées aussi par des échecs. Il en fut ainsi, par exemple, en 1961, de sa tentative d'installer à Cuba des fusées nucléaires menaçant directement le sol américain et qu'elle a dû abandonner face au blocus naval des Etats-Unis. C'est pour cela que tous les discours sur la prétendue "supériorité* Militaire du Pacte de Varsovie sur l'OTAN, notamment en Europe, ne sont que pure propagande. En 82, la bataille aérienne de la Bekaa au Liban est concluante: quatre-vingt deux avions à zéro en faveur d'Israël, équipé de matériel américain, contre la Syrie équipée de Matériel russe. En Europe, l'OTAN n'a pas besoin d'avoir autant de tanks ou d'avions que le Pacte de Varsovie pour disposer d'une supériorité écrasante.
Questions théoriques:
- Internationalisme [1364]
- Guerre [279]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : adresse au milieu prolétarien et à la classe ouvrière (GPI, Mexique)
- 2683 reads
Présentation
Nous publions ci-dessous le communiqué du Grupo Proletario Internacionalista du Mexique sur l'agression dont il a été victime de la part d'éléments issus de la décomposition du gauchisme. Nous partageons entièrement les positions qui y sont développées et affirmons notre totale solidarité avec le GPI. Alors que de plus en plus se développent les luttes ouvrières sur un terrain de classe, contre les attaques des conditions de vie, contre les blocages et baisses des salaires, contre les licenciements, et ceci dans tous les pays y indus les pays moins développés, alors que de plus en plus ces luttes remettent en question ouvertement l'encadrement syndical, alors que commence à se développer un milieu politique prolétarien résolument internationaliste, qui défend la nécessité des luttes massives de la classe ouvrière et dénonce comme pratiques bourgeoises toutes les formes de syndicalisme, de nationalisme et de terrorisme, le "gauchisme" issu des "guérillas" et de la "libération nationale" qui ont dominé la vie politique en Amérique Latine depuis la fin des années 60, montre son vrai visage. Mon seulement cette idéologie "radicale" de la petite bourgeoisie prônant le terrorisme n'a jamais remis en question en quoi que ce soit la domination étatique de la bourgeoisie, mais l'impuissance d'hier de ses actes terroristes contre l'Etat se convertit aujourd'hui directement en un instrument indispensable de cet Etat contre les véritables groupes communistes, contre les intérêts immédiats et généraux du prolétariat. Ainsi, à peine quelques mois se sont-ils écoulés depuis la sortie de "Révolution mundial", publication du GPI, et en particulier du n°2 dénonçant le caractère bourgeois de cette idéologie gauchiste et l'impasse que constituent pour le prolétariat les guérillas et le terrorisme radical, que la riposte s'est organisée, usant des méthodes de la violence bourgeoise et de la terreur d'Etat contre les éléments prolétariens: torture, vol, intimidation, etc.
Les groupes politiques prolétariens et avec eux toute la GPI, et ceci sans aucune réserve.
Communiqué du Grupo Proletario Internacionalista ( Mexique ) .
Au milieu communiste international,
A la classe ouvrière mondiale,
Le mardi 9 février 1988, la terreur étatique à laquelle le capital soumet la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires dans le monde entier s'est manifestée, cette fois, dans l'action de gangsters et de répression que le GPI a vécu des mains d'une des bandes des résidus du gauchisme terroriste du pays.
L'activité contre-révolutionnaire des groupes terroristes et de guérilla a une histoire néfaste dans cette région du monde (tout comme en Amérique Latine et ailleurs):
- comme une des expressions de l'action désespérée et sans perspective de la petite bourgeoisie urbaine et rurale, elle a dominé la scène sociale du pays de la moitié des années 60 jusqu'aux premières années 70, en diffusant dans la classe ouvrière, avec des nuances diverses, l'idéologie réactionnaire du capital;
- comme instrument indirect ou direct du capital quand les premiers signes du réveil du prolétariat se sont manifestés dans cette région -autour de 1973- elle propagea dans les luttes ouvrières l'impasse de l'idéologie contre-révolutionnaire de la terreur facilitant le travail de répression de l'Etat;
- aujourd'hui, alors qu'il ne reste que des résidus caricaturaux et de simples bandes de voleurs de la majorité des groupes terroristes ou de guérilla; maintenant, alors que depuis quelques années la classe ouvrière dans le pays est en train de s'incorporer à la lutte contre le capital que réalisent ses frères de classe dans le monde entier; maintenant, quand une vraie présence politique révolutionnaire dans la région est en train de se former au milieu de grandes difficultés; maintenant, de nouveau commence à s'agiter le fantôme de la "guérilla" et de la "terreur" fournissant là une utilisation beaucoup plus directe de la part de l'Etat de ces groupes en décomposition contre la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires.
Un de ces groupes a attaqué plusieurs militants du GPI, en les torturant et en volant au groupe du matériel d'impression, des documents politiques, de la propagande du milieu communiste et les papiers officiels de camarades. Cette bande a répondu ainsi à la dénonciation politique du rôle contre-révolutionnaire du terrorisme et de la guérilla que le GPI a faite dans sa publication Revolucion Mundial; c'est ainsi que dans le futur ces bandes continueront à agir en collaboration directe ou indirecte avec le travail de répression du capital.
Face à l'action de cette bande et aux actions qui, en rapport avec elle, viendront dans le futur, et qui en accord avec la réalité de la lutte de classe constituent une attaque contre le prolétariat, contre ses forces révolutionnaires naissantes dans le pays et contre l'ensemble du milieu communiste international, et qui s'inscrivent en plein dans la logique de l'activité terroriste étatique, le GPI manifeste:
1- La réitération de sa dénonciation du rôle contre-révolutionnaire du terrorisme et de la guérilla et son avertissement à la classe ouvrière contre l'activité de ces individus et leurs tentatives de l'amener dans l'impasse de la violence minoritaire (individuelle ou de groupe).
2- Sa dénonciation de l'usage que ces individus ou l'Etat peuvent faire des documents politiques du GPI et de l'ensemble du milieu communiste international pour accroître le climat de répression étatique contre la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires.
3- Le GPI n'a rien à voir avec les prédicateurs apeurés du pacifisme "démocratique" ni avec la petite bourgeoisie désespérée (ou des éléments déclassés) qui font du culte de la violence minoritaire terroriste le centre de leur existence; le GPI base son activité révolutionnaire dans la conviction que l'unique force capable de s'opposer à la violence réactionnaire de l'Etat capitaliste est la classe ouvrière dans l'exercice de sa lutte et de sa propre violence révolutionnaire.
Grupo Proletario Internacionalista. Mexico, 15 février 1988.
Géographique:
- Mexique [36]
Courants politiques:
Revue Internationale no 54 - 3e trimestre 1988
- 2744 reads
Editorial : Reagan-Gorbatchev, Afghanistan, mensonges du "désarmement" et de la "paix"
- 3215 reads
"Réduction des armements" et marche à la guerre
Une propagande quotidienne est faite en cette année 88 sur la "réduction des armements" et les "pourparlers de paix" entre USA et URSS avec les rencontres Reagan-Gorbatchev, le tout sur fond de "droits de l'homme" et de "perestroïka". Le "désarmement" est une fois encore à la mode, mais en réalité, comme chaque fois, la "réduction des armements" est un énorme mensonge. C'est une façade de propagande qui couvre dans les faits la marche forcée du capitalisme vers une recherche permanente pour perfectionner les moyens militaires. La part consacrée à l'armement dans les budgets nationaux de tous les pays n'a jamais été aussi élevée, et elle ne va en aucune manière diminuer. Comme nous l'avons largement développé dans les numéros précédents de cette Revue ([1] [1365]), le capitalisme, dans sa période de déclin depuis la Ire guerre mondiale, survit dans une économie de guerre permanente et "même en période de 'paix' ce système est rongé par le cancer du militarisme". La course aux armements est de plus en plus démesurée et n'a de dénouement possible, dans le cadre des lois capitalistes, que la guerre généralisée, ce qui signifie, avec les moyens de notre époque, la destruction de la planète et de l'humanité.
La modernisation de l'armement
La propagande actuelle ne doit tromper personne. Le retrait de certains missiles en Europe sert pour les USA, à faire prendre en charge les dépenses militaires beaucoup plus directement par leurs alliés, le retrait étant tout à fait négligeable quant à la puissance de feu du bloc de l'ouest globalement. Pour l'URSS, cela lui permet de supprimer du matériel complètement dépassé face à la sophistication des armements occidentaux actuels. Les accords "START", de "limitation" des armements", comme le sont toujours ce genre de conférences de représentants des grandes puissances, sont une nouvelle concertation sur le renouvellement du matériel et ne constituent en rien une véritable réduction de celui-ci. Comme les accords "SALT 2" de l'été 79 avaient amené l'installation des fameux missiles de moyenne portée, avec pour justification à l'époque celle du "désarmement" d'ogives intercontinentales devenues obsolètes, les accords actuels font passer comme "réduction des armements" ce qui est en réalité l'abandon de matériel hors d'usage, tandis qu'on fait le point dans les "coulisses" sur les nouveaux systèmes militaires pour assurer leur modernisation.
Il est vrai aussi que, pour chaque Etat national, les dépenses d'armement ne font qu'aggraver la crise et ne permettent en rien de résoudre celle-ci. Mais ce ne sont pas des raisons d'économies qui expliquent la campagne sur la "réduction des armements". Le capitalisme n'a pas la possibilité de réduire l'armement. Lorsque les USA, dans leur volonté de diminuer leur gigantesque déficit, envisagent de diminuer leurs dépenses militaires, ce n'est pas pour les réduire globalement dans le bloc de l'ouest, mais pour accroître la part payée par leurs alliés européens et japonais pour la "défense du monde libre". Il en est de même pour l'URSS, de plus en plus étranglée par la crise économique, quand elle s'efforce de "rationaliser" ses dépenses militaires. La course aux armements est inhérente à l'impérialisme tel qu'il s'est développé dans la période de décadence, impérialisme de toutes les nations, de la plus petite à la plus grande "et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire" comme le disait déjà Rosa Luxemburg.
Si actuellement les discours parlent de "fin de guerre froide" et autres formules du genre, cela doit être compris non dans le sens que la "paix" serait maintenant à l'ordre du jour, mais bien plutôt comme un avertissement que c'est une "guerre chaude" à laquelle le capitalisme est de plus en plus poussé mondialement. D'ailleurs, malgré la volonté de promouvoir la justification des menées guerrières par un langage pacifiste, l'administration Reagan, plus à l'aise dans le bellicisme, comme en général toute la droite de l'appareil politique de la bourgeoisie, n'a pas manqué d'émailler les déclarations de l'acteur pantin de la Maison Blanche de "soyons vigilants", "restons forts" et de saluer particulièrement Tchatcher parce que "sans jamais sacrifier son brevet d'anti-communisme, elle a été aussi la première à suggérer que l'on discute affaires avec Gorbatchev"; les "affaires" en question n'étant pas autre chose que la facette diplomatique de la pression militaire qui s'exerce sur le terrain.
L'intensification du conflit EST-OUEST
Les discours pacifistes d'aujourd'hui recouvrent la même réalité que les discours bellicistes du début des années 1980, quand Reagan pérorait sur "l'empire du mal" à propos de l'URSS. Lorsque aujourd’hui la diplomatie américaine rencontre à Moscou la diplomatie soviétique, la discussion porte sur les "règles" de la confrontation croissante à l'échelle mondiale sous le leadership de Moscou et de Washington, en aucun cas sur la fin de cette confrontation.
Seul le discours a changé. La réalité est toujours celle de la marche à la guerre du capitalisme mondial, marche qui se caractérise aujourd'hui par une offensive occidentale tous azimuts contre les positions stratégiques de l'URSS et par la recherche de moyens pour résister et riposter à cette offensive, là où c'est possible, de la part du bloc impérialiste russe.
Aujourd'hui règne une grande discrétion sur les incessants combats au Moyen-Orient et surtout sur la présence massive de la flotte des grandes puissances dans la région. Il semble évident que les médias aux ordres ont consigne de faire le moins de bruit possible sur ce qui se trame dans le Golfe Persique, sur les navires de guerre les plus perfectionnés, sur l'armement embarqué, qui sont à pied d'oeuvre depuis l'été 1987. Depuis ces vingt dernières années, la présence militaire directe de pays comme les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, et même la soi-disant "désarmée" RFA, n'a jamais été aussi forte hors de leurs frontières, sur ce que les "stratèges" appellent le "théâtre des opérations". Peut-on vraiment croire que toute cette armada n'est là que pour "régler pacifiquement la circulation des bateaux"? Bien évidemment, non. Cette présence fait partie de la stratégie militaire occidentale et celle-ci n'est pas dictée par les quelques vedettes iraniennes et les remorqueurs qui les ravitaillent, mais par la rivalité historique entre Est et Ouest. L'offensive occidentale vise l'URSS et elle vient de marquer des points avec le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.
L'URSS est obligée de céder sous la pression militaire directe de la "résistance" afghane équipée de missiles Stingers américains qui ont permis à celle-ci de renforcer considérablement sa puissance de feu, sous la pression "indirecte" de la flotte occidentale dans le Golfe, et doit abandonner en partie l'occupation d'un des seuls pays hors de son "glacis" est européen. Et, à la différence des USA qui gagnèrent l'alliance avec la Chine lors de leur retrait du Vietnam en 1975, l'URSS aujourd'hui ne peut compter sur aucun marchandage. Les USA ne céderont rien; c'est d'ailleurs là le contenu réel du "parler affaires" de Reagan avec Gorbatchev au cours des dernières rencontres. Le bloc de l'ouest est déterminé à maintenir sa pression, ce que confirme également le projet de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge.
Mais que l'URSS recule ne signifie pas le retour de la "paix", au contraire. Tout comme les accords de "paix israélo-arabe" de Camp David il y a plus de dix ans entre Egypte et Israël, sous la bénédiction de Carter et Brejnev, se sont soldés en fait par un élargissement des conflits, des massacres de populations et de la décomposition sociale de la situation au Moyen-Orient, le retrait actuel des troupes russes n'ouvre pas une perspective de "paix" et de "stabilité", mais bien plutôt un renforcement des tensions, et en particulier une probable "libanisation" de l'Afghanistan comme c'est la tendance dans tous les pays de cette région.
La "perestroïka" de Gorbatchev, tout comme elle n'est qu'un vernis "démocratique" à l'intérieur pour tenter de faire passer en réalité des mesures anti-ouvrières redoublées, n'est également qu'un vernis "pacifiste" d'une politique extérieure d'occupation militaire de plus en plus impopulaire, mais qui va cependant se poursuivre et se renforcer, même si c'est sous la forme plus "discrète" du soutien politique et militaire à des fractions, clans et cliques des bourgeoisies nationales qui ne trouvent pas leur compte dans le camp de la "pax americana", notamment les Partis Communistes locaux et leurs appendices gauchistes.
Le conflit entre les grandes puissances se poursuivra en jouant en permanence sur les différentes fractions gouvernementales ou d'opposition dans des "conflits locaux" extrêmement sanglants, avec la participation militaire de plus en plus importante des principaux protagonistes, jusqu'à les mettre face à face directement, si ceux-ci ont les mains libres à l'intérieur pour faire régner l'ordre social et entraîner l'adhésion à leurs desseins impérialistes. Mais ceci est encore loin d'être le cas aujourd'hui.
Le "pacifisme" : un mensonge dirigé contre la classe ouvrière
C'est fondamentalement parce que la bourgeoisie est aux prises avec un prolétariat qui ne se plie pas docilement aux attaques de l'austérité, un prolétariat qui ne manifeste aucune adhésion profonde aux manoeuvres diplomatico-militaires qu'entraîne l'accélération des tensions inter impérialistes, que la propagande actuelle, d'une part fait le silence sur les grèves et les manifestations ouvrières, et d'autre part a converti son discours, hier "belliciste", en campagne "pacifiste" et de "désarmement".
Au début des années 1980, le prolétariat était sous le coup du reflux de plusieurs luttes importantes qui s'étaient développées internationalement, de 1978 à la défaite des ouvriers en Pologne en 1981. La propagande de la bourgeoisie pouvait au début des années 80 s'appuyer sur le sentiment diffus de déboussolement qu'avait engendré une telle situation, et elle ne s'est pas privée d'essayer d'entretenir un sentiment de fatalité, d'impuissance, d'immobilisation et d'intimidation, en particulier par un battage guerrier: guerre des Malouines, invasion US de l'île de La Grenade, diatribes de Reagan contre "l'Empire du mal", "Guerre des étoiles", etc., le tout accompagnant des actions militaires impliquant de plus en plus les grandes puissances sur les lieux des opérations jusqu'à l'installation de troupes occidentales au Liban en 1983.
Depuis 1983-84 grèves et manifestations ouvrières se sont multipliées contre les différents plans d'austérité dans les pays industrialisés et également dans les pays moins développés, marquant la fin de la courte période précédente de reflux et de passivité. Et si beaucoup de groupes révolutionnaires prolétariens sont malheureusement incapables de voir, au-delà de l'image quotidienne que distille la propagande de la bourgeoisie et de ses médias, la réalité du développement actuel de la lutte de classe ([2] [1366]), la bourgeoisie, elle, a ressenti le danger. Au travers des différents moyens politiques et syndicaux dont elle dispose, il est évident que la bourgeoisie sait que le problème essentiel est la "situation sociale", partout, et particulièrement en Europe de l'ouest où se concentrent tous les enjeux de la situation mondiale. Et de plus en plus nombreux sont les bourgeois "éclairés" qui tirent la sonnette d'alarme sur le danger de la désyndicalisation de la classe ouvrière et le risque de mouvements "imprévisibles" et "incontrôlés". C'est à cause de ce danger que s'impose à la bourgeoisie de mettre en avant la fausse alternative de "guerre ou paix", l'idée que l'avenir dépend de la "sagesse" des dirigeants de ce monde, alors qu'il dépend de la prise en mains et de l'unification des combats de la classe ouvrière internationale pour son émancipation. C'est à cause de ce danger que tout est fait pour cacher et minimiser les mobilisations de travailleurs et de chômeurs, pour entretenir l'idée de faiblesse, d'impuissance ou même de "dislocation" de la classe ouvrière.
Si la bourgeoisie est une classe divisée en nations regroupées autour de blocs impérialistes, prêts à aiguiser leurs rivalités, jusqu'à en découdre avec tous les moyens dont ils disposent jusqu'à la guerre impérialiste généralisée, elle est par contre une classe unie lorsqu'il s'agit d'attaquer la classe ouvrière, de l'encadrer et de contenir ses luttes, de la maintenir au rang de classe exploitée soumise aux impératifs de chaque capital national. C'est seulement face à la classe ouvrière que la bourgeoisie trouve une unité, et le choeur unanime actuel sur la "paix" et le "désarmement" n'est qu'une mascarade destinée essentiellement à anesthésier la menace prolétarienne que la bourgeoisie rencontre de plus en plus.
Car, malgré leurs limites et de nombreux échecs, les luttes qui se déroulent depuis plusieurs années dans tous les pays, touchant tous les secteurs, de l'Espagne à la Grande-Bretagne, de la France à l'Italie, y compris dans un pays comme la RFA jusqu'à présent moins touché par les effets dévastateurs de la crise ([3] [1367]), sont non seulement le signe que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement les attaques sur le terrain économique, mais aussi que les tentatives précédentes d'intimidation par les campagnes idéologiques "bellicistes", ou le battage sur la "reprise économique", ont fait long feu et n'ont pas eu l'impact escompté. Egalement symptomatique de la maturation de la conscience qui s'opère dans la classe ouvrière est le fait, qu'après l'Italie et l'Espagne l'an dernier, on a vu pendant les campagnes électorales, traditionnellement périodes de "trêve sociale", pour la première fois en France se déclencher de nombreuses grèves particulièrement combatives.
C'est ce développement de la lutte de classe qui pousse la bourgeoisie à travestir de "pacifisme" la propagande actuelle aussi bien en URSS et dans les pays de l'Est , que dans les pays de l'ouest.
MG. 6/7/88
Questions théoriques:
- Décadence [2]
- Impérialisme [11]
Pologne : les grèves sabotées par le syndicat "Solidarnosc"
- 3596 reads
Une nouvelle démonstration éclatante du rôle de sabotage de la lutte par le syndicalisme vient d'être donné par les dernières grèves en Pologne au printemps. Solidarnosc, présenté par tous comme l’émanation du formidable mouvement des ouvriers polonais de 1980, vient de confirmer ouvertement, sept ans plus tard, la vraie raison de son existence : ramener les ouvriers dans le giron des institutions nationales capitalistes de la Pologne.
Face à un mouvement qui surgit spontanément pour réclamer des augmentations de salaires, contre une accumulation sans précédent de mesures prises par le gouvernement, Solidarnosc va déployer toute une panoplie de manoeuvres, digne des plus vieilles manigances du syndicalisme des pays occidentaux. L'élève a bien appris de ses maîtres : les multiples rencontres de Walesa et ses acolytes avec nombre de syndicats, en France et en Italie notamment, ont porté leur fruits.
En 1980, en quelques jours, la classe ouvrière par ses propres moyens était parvenue à s'organiser à l'échelle de tout le pays, sur la base des assemblées générales dans les usines, étendant et unifiant le mouvement, le centralisant dans les comités interentreprises de délégués des assemblées (les MKS), obligeant le pouvoir à venir discuter et négocier publiquement face à tous les ouvriers dans les usines. Il faudra plus d'un an d'efforts conjugués du gouvernement et de Solidarnosc fraîchement constitué comme pare-feu à la grève de masse pour faire rentrer dans le rang les ouvriers. Cette année, le syndicat "libre et indépendant", soigneusement "toléré" depuis lors par le gouvernement et qui, derrière les mascarades de répression de ses dirigeants, dispose d'un nombre non négligeable de moyens de contact et de propagande dans le pays, a pu cette fois-ci dès le début jouer son rôle de pompier social au service du capital national polonais.
Au début du mouvement, fin avril, lorsque les travailleurs des transports de Bygdoszcz, puis les ouvriers des aciéries de Nowa Huta près de Cracovie, suivis par ceux des autres aciéries Stalowa Wola, partent en grève, ils soulèvent les espoirs de toute la classe ouvrière, qui subit des attaques considérables sur les salaires et les conditions de travail. Dans une situation où règne un rationnement draconien des biens de consommation de première nécessité, où de plus viennent d'être annoncées des hausses de 40% des denrées de première nécessité et de 100% pour l'électricité et le gaz, tous les yeux sont braqués vers ces grèves qui mettent en avant des revendications générales pour tous les travailleurs, des aciéries, des hôpitaux, et d'autres secteurs. A ce moment-là, les dirigeants de Solidarnosc, Walesa et Kuron en tête, désapprouvent les grèves "qui sont des actes de désespoir compréhensibles mais qui ne peuvent que rendre les choses plus difficiles" (sic!), pour conseiller aux ouvriers de réclamer des "réformes politiques" et des "syndicats libres", jusqu'à un soutien ouvert à la "perestroïka" de Gorbatchev.
Le gouvernement se partage la tâche avec Solidarnosc, cédant rapidement aux revendications à Bygdoszcz et Stalowa Wola – car ces usines sont "compétitives"! -, emprisonnant pendant quelques heures des personnalités du syndicat, afin de crédibiliser pleinement leur rôle d'"opposants", ceci vis-à-vis en particulier des jeunes ouvriers auprès desquels passent très mal les appels de Solidarnosc à la modération. Enfin, face à la solidarité croissante qui se manifeste, solidarité caractéristique des luttes en Pologne depuis les combats de 1970, 1976 et surtout 1980, le syndicat va tout faire pour parvenir à chevaucher le mouvement. Il appuie l'entrée en grève aux chantiers navals de Gdansk, haut lieu du mouvement de 1980, et à l'usine de tracteurs d'Ursus près de Varsovie, focalisant l'élan de solidarité sur ces deux concentrations ouvrières où il est fortement implanté, au détriment bien sûr d'un véritable élargissement du mouvement. La manoeuvre est habile. Même si une réelle solidarité se manifeste parmi les ouvriers de ces usines, celles-ci sont des lieux où Solidarnosc a suffisamment de poids pour manoeuvrer. En particulier à Gdansk, il proclame un "comité de grève", nommé par lui et non par l'assemblée des ouvriers, manoeuvre typique du syndicalisme "démocratique" occidental. Il fait de même à Nowa Huta où il met en place son propre "comité de grève" alors que la lutte est déjà entamée depuis plusieurs jours sous le contrôle des ouvriers. Ensuite, alors que tout le début du mouvement est marqué par des revendications unificatrices (indexation des salaires sur l'inflation, amélioration du service de la santé, etc.), ces dernières disparaissent comme par enchantement lorsque Solidarnosc se retrouve "à l'avant" du mouvement, pour céder la place à la revendication "démocratique" de la "reconnaissance du syndicat". Enfin, ayant réussi à prendre le contrôle de la situation, Solidarnosc peut alors se permettre de lancer au gouvernement des "menaces" de "grève générale", "au cas où Jaruzelski enverrait les zomos (miliciens) à Nowa Huta", ce que ce dernier ne fera pas, bien sûr, Solidarnosc ayant rassuré le gouvernement en reprenant les choses en mains.
Malgré l'expérience considérable de la lutte, que les ouvriers polonais se sont forgée surtout depuis vingt ans au travers des trois précédentes vagues de grève, la classe ouvrière vient de se heurter au barrage syndical, à la manière dont celui-ci manoeuvre, à partir de P"opposition", dans les pays les plus industrialisés. Et ceci d'autant plus fortement que dans les régimes des pays de l'Est, les illusions sur le syndicalisme "libre et indépendant" sont très fortes, et qu'en Pologne Solidarnosc apparaît encore comme un résultat de la lutte de 1980.
La réponse aux obstacles auxquels viennent de se heurter les ouvriers en Pologne se trouve d'abord dans l'approfondissement des luttes actuelles dans les pays occidentaux. C'est dans ces pays que la bourgeoisie est la plus forte, c'est dans ces pays que se trouve la "clé" de sa domination sur le prolétariat international. Et surtout, pour le développement de l'expérience et de la conscience dans la classe, c'est dans ces pays que la classe ouvrière est la plus développée et confrontée aux obstacles à la lutte les plus sophistiqués, en particulier l'obstacle du syndicalisme et de ses variantes "à la base" ou "de combat".
Malgré le repli auxquels ils sont contraints dans l'immédiat, les ouvriers en Pologne viennent à nouveau de donner au prolétariat mondial un exemple de détermination, de combativité, de solidarité active, en reprenant le combat sept ans après la cuisante défaite de 1981. La réponse à cet exemple, la véritable solidarité avec les ouvriers en Pologne, c'est le renforcement des luttes dans les pays de l'Ouest et le développement de leur unification.
MG
Géographique:
- Pologne [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Où en est la crise économique ? : La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire
- 4192 reads
Six mois après l'effondrement boursier d'octobre 87, les "experts économiques" révisent à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'année 1988. Au même moment les craintes d'un nouvel effondrement boursier mondial ne cessent de croître.
En réalité les gouvernements des principales puissances économiques avaient soigné les convulsions d'octobre 87 avec les remèdes les plus dangereux. Les récents indicateurs de la croissance économique aux Etats-Unis, moins pires que ceux attendus, produits de cette médication, ne peuvent cacher que les problèmes économiques de fond du capitalisme décadent loin d'avoir été résolus, n'ont fait que s'aggraver. Une fois déplus les remèdes des gouvernements face aux difficultés immédiates s'avèrent de véritables poisons dont les effets, pour lents qu'ils soient n'en sont pas moins mortels.
"Que se passe-t-il ici ? D'après toutes les estimations, l'expansion économique qui dure maintenant depuis cinq ans et demi devrait être en train de partir en fumée. Déjà assez longue, si on la compare à celles du passé, cette expansion semblait avoir subi un coup dévastateur lorsque la bourse s'est effondrée en octobre dernier. Mais, défiant toutes les prévisions, l'économie tourne encore et cela avec suffisamment de pression pour inspirer des craintes de surchauffe. Oubliez la récession, disent certains économistes, commencez à vous faire du souci pour l'inflation. " TIME, mai 1988.
A entendre certains commentateurs économiques, ou des ministres de l’économie, tel Lawson de Grande Bretagne, le danger d'une nouvelle récession économique serait écarté. Ce serait le retour du monstre de l'inflation qui serait aujourd'hui à craindre.
La réalité est que tout indique que l'inflation - ou plutôt l'accélération de l'inflation, car l'inflation, même si elle s'est décélérée dans les dernières années n'a jamais disparue -fait un retour certain dans l'économie mondiale. Mais, par contre, rien ne permet d'affirmer que les risques de récession soient écartés. Au contraire.
Pour se rendre à l'évidence il faut regarder de plus près la réalité et les fondements financiers de cette fameuse période "d'expansion économique" qui dure depuis cinq ans et demi.
Le bilan réel de cinq ans de "non effondrement" et de dévastation
Depuis la récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la guerre, le capitalisme a connu effectivement une croissance de la production. La croissance du produit intérieur brut de l'ensemble constitué par les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, l'OCDE ([1] [1371]), entre 1983 et 1987 est restée positive (+ 3 % par an en moyenne). C'est à dire que la masse de valeur produite - telle qu'elle peut être mesurée par les comptabilités nationales ([2] [1372]) - n'a pas diminué. Cependant ce chiffre en lui même ne dit pas grand-chose. Derrière cette moyenne se cache une autre réalité.
Une croissance faible et localisée
La croissance de cette période est restée EN-DESSOUS DES TAUX atteints pendant les périodes d'"expansion" des années 70 : 5,5 % entre 1972 et 1973, 4 entre 76 et 79. (taux annuels moyens).
Depuis 1984, cette croissance n'a cessé de se RALENTIR systématiquement, passant de 4,9 % en 1984 à 2,8 en 1987. Elle s'est manifestée surtout aux Etats-Unis et au Japon ; en Europe elle est restée à des niveaux misérables, proches d'une simple STAGNATION. Dans la plupart des pays faiblement industrialisés, sauf quelques exceptions, elle s'est traduite par un EFFONDREMENT.
La désertification industrielle
La stagnation ou la faible croissance de la production s'est faite en ne maintenant en vie que les centres de production les plus rentables et DETRUISANT tous ceux qui suivant les lois d'un marché qui se réduit comme peau de chagrin, ne parvenaient pas à produire suffisamment bon marché pour faire partie des privilégiés qui peuvent encore écouler leurs marchandises. L'Europe, par exemple, produit aujourd'hui sensiblement le même nombre de voitures qu'il y a dix ans en 1978. Mais le capital n'en a pas moins fermé des dizaines d'usines et supprimé des centaines de milliers de postes de travail dans l'industrie automobile. Hauts fourneaux en parfait état de fonctionnement qu'on fait sauter à la dynamite aux Etats-Unis, complexes industriels entiers laissés à l'abandon et au travail de la rouille : on a parlé de désertification industrielle. La communauté Européenne décide de geler des millions d'hectares de terre cultivable. Se déplaçant des bords vers le centre, ce fléau touche de plus en plus le coeur même des principales puissances industrielles.
Le chômage
Pendant ces cinq années de "croissance", LE CHOMAGE dans le monde n'a cessé de se développer. Cela n'a été que la suite de ce qui constitue un phénomène jamais vu auparavant dans l'histoire du capitalisme : 20 années d'augmentation sans discontinuité du chômage. Seuls, parmi les grandes puissances, les Etats-Unis - et pour, la seule année 1987, la Grande-Bretagne- affichent des chiffres de diminution du chômage. Pour l'ensemble de l'Europe le manque d'emplois a au contraire battu des records historiques, même si sa croissance s'est "officiellement" ralentie. Dans la plupart des autres pays du monde, le désemploi atteint des proportions sans précédents.
Et encore s'agit-il de mesures officielles qui sous-estiment délibérément l'ampleur du désastre. Ainsi les comptabilités gouvernementales considèrent que celui qui travaille un jour par semaine, ou celui qui suit un stage de formation pour chômeurs, ou les jeunes à qui on donne un semblant d'emploi pendant quelques mois pour une misère qui ne permet pas de vivre, ou l'adulte mis en préretraite, tous ces sans emploi, ne sont pas des "chômeurs". Il y a d'autre part la généralisation de la précarité de tout emploi : le développement du travail à temps partiel, du travail suivant les besoins immédiats du capital : 12 heures par jour pendant une période, 2 heures pendant une autre - avec la diminution correspondante du salaire, la menace de licenciement toujours.
La production d'armements
A toutes ces formes de destruction de capital, (pour le capital, le développement du chômage au-delà du minimum d'une "armée de réserve" est une destruction de capital, tout comme la destruction d'usines ou la stérilisation des terres), qui marquent profondément ces cinq années d'"expansion économique", U faut ajouter le développement de la production de moyens de destruction, l'ARMEMENT, en particulier aux Etats-Unis. Le capital américain, qui a, par son déficit public, joué le rôle de principal marché pour la croissance au niveau mondial y a consacré des sommes gigantesques.
"Depuis 1982, les dépenses de l'Etat fédéral ont augmenté de 24 % en valeur réelle (4 % Van), Cette expansion est entièrement imputable aux crédits de la défense nationale, en hausse de 37 %, les autres dépenses étant abaissées de 7 %. Un effort considérable a été accompli pour l’acquisition de matériel, presque un doublement en cinq ans : + 78 %".([3] [1373])
Tel est le bilan, en termes réels, de ces cinq années dites d'"expansion économique". Malgré des taux de croissance de la production faibles, mais qui restent encore positifs, la misère économique n'a jamais cessé de croître, même dans les pays les plus industrialisés. La base de production même du capital ne s'est pas élargie mais rétrécie. La recomposition du capital mondial se fait au travers du plus puissant mouvement de concentration des capitaux qu'ait connu l'histoire, dans une guerre de requins dévorant les cadavres des faillites, à travers les "OPA" les plus importantes de tous les temps, le sang des uns aiguisant la voracité des autres.
Les résultats dans le domaine réel de la production de ces cinq dernières années, loin de traduire une nouvelle force du système capable d'écarter la perspective d'une nouvelle récession mondiale, concrétise, au contraire l'impuissance chronique du système à rétablir une véritable croissance, une croissance capable ne serait-ce que de résorber le chômage.
Le bilan sur le plan financier
Les résultats au niveau du financement ne font que confirmer l’inéluctabilité d'une telle récession : une récession qui tout comme celles de 1974-1975 et de 1980-1982 s'accompagnera de l'aggravation de cette autre maladie du capitalisme décadent : l'inflation.
"Les assassinats sur la grande route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières".Balzac.
Financer une production c'est fournir l'argent pour la réaliser. Dans le capitalisme cet argent le capitaliste le trouve par la vente de ce qu'il produit, ou par un crédit, ce qui n'est qu'une avance sur cette vente.
A qui les capitalistes du monde entier ont-ils vendu ce petit surplus qu'ils ont réussi à dégager tant bien que mal pendant ces années ? Essentiellement aux Etats-Unis. Comme en 1972-1973, comme en 1976-1977, en 1983 les Etats-Unis ont joué à nouveau au niveau mondial le rôle de marché locomotive pour sortir de la récession de 1980-1982 : en 1983 le volume des importations américaines fait un bond de près de 10 % ; en 1984 ce bond est de 24 % ! (record historique). Le capital américain achète de tout à tout le monde. En 1982 la part des importations américaines dans le commerce mondial est de 15 %, en 1986 cette part est de 24 % ! C'est-à-dire qu'un quart de tout ce qui est exporté dans le monde est acheté par les Etats-Unis !
En cinq ans le déficit commercial américain passe de 30 milliards de dollars à 160. Ce déficit s'élargit vis à vis de toutes les zones du monde : 40 milliards de déficit en plus avec le Japon, 36 milliards avec les autres pays d'Asie, 32 avec l'Europe, 8 milliards avec l'Amérique Latine.
Avec quel argent le capital américain a-t-il payé ? D'une part avec des dollars surévalués. De 1982 à 1985 la valeur du dollar ne cesse d'augmenter contre celle de toutes les autres monnaies. Cela revenait à payer ce qu'il importait à des prix d'autant plus réduits.
D'autre part, et surtout, en s'endettant à tous les niveaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une véritable explosion du crédit. De fin 1983 au milieu de 1987 le total des dettes s'est accru de 3000 milliards de dollars - trois fois l'augmentation du produit national pendant la même période. Les Etats-Unis sont devenus l'Etat le plus endetté du monde vis-à-vis de l'extérieur. En 1983 la part de l'économie américaine financée par l'extérieur était de 5 %. En 1987 elle frôle les 20 %. Le seul poids des intérêts à verser est devenu monstrueux.
Les Etats-Unis peuvent-ils rembourser ces dettes ? Ils doivent commencer par tenter de réduire l'augmentation vertigineuse de celles-ci. Et pour cela ils n'ont pas d'autre choix que de réduire leur déficit commercial, augmenter les exportations, diminuer les importations. C'est ce qu'ils s'attachent à faire, entre autres en laissant se dévaluer le dollar de façon à rendre plus difficiles les importations et plus compétitives les exportations "made in USA". Cela s'est déjà traduit en 1987 par une diminution de la croissance du volume des importations à 7 % et par une augmentation de celui des exportations de près de 13 %. Une telle évolution est encore loin de fournir au capital américain de quoi rembourser ses dettes. Mais par contre elle fait déjà l'effet d'une douche d'eau glaciale sur tous ceux qui voient leurs exportations diminuer d'autant. Le marché locomotive américain se rétrécit en même temps que les marchandises américaines se font de plus en plus agressives et efficaces sur le marché mondial. Ce qui avait constitué le stimulant de l'économie mondiale disparaît sans qu'aucune autre fraction du capital mondial ne puisse jouer un rôle de locomotive équivalent.
La dévaluation du dollar constitue par elle même un autre moyen de réduire l'endettement. Ce que le capital américain avait acheté avec un dollar surévalué, il le rembourse aujourd'hui avec une monnaie dévaluée. C'est autant de moins à rembourser, mais c'est aussi autant ne pas vers l'inflation et autant de perte sèche pour des créditeurs tels que l'Allemagne ou le Japon... supposés assurer la relève de la relance.
Il reste enfin un troisième moyen au capital américain pour rembourser ses dettes : contracter de nouveaux emprunts, de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes...tout comme les pays les moins industrialisés. C'est ce qu'il continue de faire, et c'est ce qui l'a contraint en 1987 à recommencer à augmenter ses taux d'intérêts en vue d'attirer les capitaux nécessaires au financement de son déficit. Le résultat de cette hausse, ainsi que de la dévaluation du dollar (qui dévalue d'autant les actions en dollars) ne fut autre que l'effondrement boursier d'octobre. L'écart entre les bénéfices tirés de la bourse et les coûts des emprunts nécessaires pour y participer était devenu trop grand.
Mais dans tous les cas de figure - augmentation des exportations américaines et diminution des importations, dévaluation du dollar et inflation généralisée, fuite en avant dans l'endettement - le problème posé par le financement de la dette accumulée par l'économie mondiale et celle de la première puissance économique en particulier, n'ouvrent d'autre perspective que celle d'une nouvelle récession inflationniste.
L'effondrement boursier
Le véritable miracle que saluent certains économistes aujourd'hui, tels ceux dont parle Time cité au début de cet article, c'est que la croissance ne se soit pas écroulé comme en 1929 au lendemain du "crash" d'octobre 1987.
La plupart des économistes avaient prédit un fort ralentissement de la croissance économique au lendemain de l'effondrement boursier d'octobre 1987. Les gouvernements avaient révisé à la baisse leurs déjà peu reluisantes prévisions de croissance.
C'était oublier, premièrement, qu'il ne s'agissait pas d'une situation comme celle de 1929. L'effondrement boursier de 1929 se situait au début d'une crise économique ouverte. Celui d'octobre 1987 explose après 20 ans de lent enfoncement du capitalisme dans la crise : il n'est pas l'ouverture de la crise mais une convulsion au niveau financier qui sanctionne le délabrement économique qui l'a précédé.
Deuxièmement, c'était oublier que le capital qui est comptabilisé à la bourse, est, pour une grande part du capital purement spéculatif, du papier, ce que Marx appelait déjà le capital fictif : pour une part donc, surtout lors d'un premier effondrement, la destruction de celui-ci n'est pas une destruction d'usines, mais de papier. Le secteur économique qui a été le plus touché est le secteur bancaire, plus directement lié à la spéculation.
Troisièmement c'était oublier que, contrairement à 1929, et contrairement aux légendes dites "libérales" sur une soi-disant réduction actuelle du rôle de l'Etat dans l'économie, le capitalisme d'Etat a atteint un développement aussi vertigineux que systématique et généralisé dans le capitalisme décadent. Tous les gouvernements du monde, derrière le premier d'entre eux, celui des Etats-Unis, ont immédiatement réagi pour parer au danger d'une dégénérescence sous forme d'effondrement économique immédiat et non contrôlé.
Mais les remèdes qu'ils ont apportés ne résolvent pas les problèmes de fond du système, au contraire ils les aggravent.
Ces remèdes ont consisté essentiellement dans une baisse forcée des taux d'intérêt et une plus grande facilité pour se procurer des crédits, surtout aux Etats-Unis. En d'autres termes, aux problèmes posés par l'excessif endettement, le capital n'a répondu que par un accroissement de l'endettement.
Cela a permis les "surprenants résultats de la croissance américaine" à la fin 1987 et début 1988. Mais cela n'a résolu en rien le problème de fond. Dès le mois de mai les pressions vers une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, qui doivent financer un nouvel emprunt d'Etat de 26 milliards de dollars, se font sentir puissamment. Or, comme le notait The Economist :
"Même si l'économie a surmonté le crash, le poids intérieur de sa dette Va laissée en un bien piètre état pour supporter des taux d'intérêt plus élevés. Et le Texas est prêt à déclencher une crise bancaire de plusieurs milliards de dollars." The Economist, 7 mai 1988.
Fondée sur l'endettement massif, sur une véritable explosion du crédit sans espoir de remboursement, l'actuelle évolution économique ne peut aboutir, une fois de plus, qu'à la conjugaison de ces deux maladies du capitalisme décadent : l'inflation ET la récession - comme ce fut déjà le cas pendant les récessions de 1970-71, 1974-75 et 1980-82 (dans les années 70 on avait déjà inventé un terme :"la stagflation"). Cette fois-ci il faudra ajouter les effondrements financiers.
Les experts économiques de la bourgeoisie ne se font d'ailleurs pas trop d'illusions. S'ils ont révisé à la hausse les taux de croissance pour 1988 c'est de façon fort modeste, et leurs prévisions pour l'année 1989 demeurent sombres.
Lorsque le capital est confronté à sa crise, on reproche souvent aux marxistes et à leurs "sombres perspectives" pour le capitalisme, d'être comme une horloge arrêtée qui a raison deux fois par jour. Pour les marxistes, et pour eux seulement, le capitalisme est, sur le plan économique, historiquement condamné, comme tous les systèmes économiques qui l'ont précédé dans l'histoire. Ils ont, il est vrai, parfois commis des erreurs dans leurs prévisions quant à l'imminence d'un nouvel effondrement économique. Ils ont parfois sous-estimé l'efficacité des mesures de capitalisme d'Etat, des "tricheries" du système avec ses propres lois (voir dans ce numéro l'article Comprendre la décadence du capitalisme) qui permettent au système de pallier à ses contradictions et de retarder les échéances. Mais aujourd'hui, lorsque les "économistes" comprennent aussi peu les causes profondes de la crise économique que les raisons qui empêchent une "véritable reprise", la théorie marxiste est la seule qui permet de comprendre pourquoi le "non effondrement" des cinq dernières années n'est que l'annonce d'une prochaine récession aussi profonde qu'inévitable.
RV
[1] [1374] Tous les pays d'Europe Occidentale, plus les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande.
[2] [1375] D'après ces
comptabilités, par exemple, un agent de police ou un fonctionnaire de l'armée
est censé créer une valeur équivalente à celle de son salaire.
[3] [1376] Banque française du commerce extérieur, Actualités, décembre 1987.
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
L’évolution du milieu politique depuis 1968 (2eme partie)
- 3481 reads
La première partie de cet article est parue dans le numéro 53 de Revue Internationale.
Au milieu des années 70, le milieu politique prolétarien est écartelé entre deux pôles qui sont de manière caricaturale le produit de quarante ans de théorisation non pas de ce qui constituait la force des fractions de gauche italienne ([1] [1377]) et germano hollandaise ([2] [1378]), mais au contraire de leurs faiblesses et cela notamment par rapport à une question cruciale pour un milieu prolétarien qui renaît après des décennies d'effacement sur la scène de l'histoire, sans grande expérience historique : celle de l'organisation. D'un coté, il y a le courant conseilliste qui tend à nier la nécessité de l'organisation et, de l'autre, le courant bordiguiste qui s'exprime notamment au travers du PCI (Programme communiste) et qui fait du parti le remède mécanique à toutes les difficultés de la classe ouvrière. Le premier courant va connaître son heure de gloire dans la foulée des événements de 1968 et des années qui suivent, mais il va rencontrer de grands déboires avec le recul de la lutte de classe qui marque le milieu des années 70, tandis que le second, après être resté on ne peut plus discret durant la période de développement de la lutte de classe, connaît un regain d'écho avec le reflux des luttes ouvrières, notamment auprès d'éléments issus du gauchisme.
Dans la seconde moitié des années 70, le pôle conseilliste s'est effondré tandis que le PCI (Programme communiste) tient de manière arrogante le haut du pavé : il est LE PARTI et en dehors de lui, rien n'existe. Le milieu politique prolétarien est extrêmement dispersé, divisé. La question qui se pose avec le plus d'acuité -et qui est intimement liée à celle de l'organisation- est celle du développement des contacts entre les divers groupes existants sur la base d'une cohérence révolutionnaire, afin d'accélérer le processus de clarification indispensable pour le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires. Le CCI, dans la continuité de Révolution Internationale, a montré l'exemple en 1974-75, et le Manifeste qu'il publie en 1976 est un appel à l'ensemble du milieu prolétarien à oeuvrer dans ce sens :
"Avec ses moyens encore modestes, le CCI s'est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires à l’échelle mondiale autour d'un programme clair et cohérent. Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux. Il les appelle à se joindre à cet effort afin de constituer avant les combats décisifs, l'organisation internationale et unifiée de son avant-garde. Fraction la plus consciente de la classe, les communistes se doivent de lui montrer son chemin en faisant leur le mot d'ordre : REVOLUTIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !"
C'est dans ce contexte mouvant d'un milieu politique en pleine décantation et profondément marqué par la dispersion et le poids du sectarisme que se situe l'appel de Battaglia comunista ([3] [1379]) à la tenue d'une conférence internationale des groupes de la gauche communiste en 1976.
En 1972, Battaglia comunista avait refusé de s'associer à l'appel d'Internationalism (USA) proposant le développement d'une correspondance internationale dans la perspective d'une conférence internationale, appel qui avait ouvert la dynamique qui a mené à la formation du CCI en 1975. A l'époque BC répondait au lendemain de 1968 :
"- qu'on ne peut pas considérer qu'il existe un développement conséquent de la conscience de classe,
- que même la floraison de groupes n'exprime pas autre chose que le malaise et la révolte de la petite-bourgeoise,
- qu'il nous fallait admettre que le monde est encore sous le talon de l'impérialisme."
Qu'est-ce qui a donc déterminé ce revirement? Une question fondamentale pour BC : la "social démocratisation" des PC staliniens! BC prend ainsi le tournant "euro-communiste" des PC, tournant purement conjoncturel au milieu des années 70, comme on peut le vérifier clairement aujourd'hui avec le recul du temps, comme raison de son changement d'attitude vis-à-vis des autres organisations du milieu politique. C'est pour discuter de cette question "fondamentale" que le PCI (Battaglia comunista) propose la tenue d'une conférence. Par ailleurs, il n'y aura aucun critère politique de délimitation du milieu prolétarien dans la lettre d'appel de Battaglia comunista, et BC exclura de son invitation les autres organisations du milieu prolétarien en Italie telles que le PCI (Programma Comunista) où II Partito comunista. Malgré l'orientation vers la tenue de conférences, "bougnat veut rester maître chez soi" !
Cependant, malgré ce manque de clarté de l'appel, le CCI conformément aux orientations déjà concrétisées par le passé dans sa propre histoire et réaffirmées dans le Manifeste publié en janvier 1976, va répondre positivement et se faire conjointement avec BC le promoteur de cette conférence en proposant des critères politiques délimitant les organisations du milieu prolétarien de celles de la bourgeoisie, en appelant à ouvrir cet appel aux organisations "oubliées" par Battaglia comunista, en essayant d'inscrire cette conférence dans une dynamique de clarification politique au sein du milieu communiste, étape nécessaire vers le regroupement des révolutionnaires.
La dynamique des conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste
La première conférence ([4] [1380])
A l'appel de Battaglia comunista plusieurs groupes vont répondre pour donner leur accord de principe : le FOR (Fomento Obrero Revolucionario) de France et d'Espagne, Arbetarmakt de Suède, la CWO (Communist Workers' Organisation) de Grande-Bretagne ([5] [1381]), le PIC (Pour une intervention communiste) de France. Mais cet accord restera platonique et seul le CCI participera activement aux côtés de BC à la tenue de la première conférence, tandis que, sous divers prétextes plus ou moins valables, mais qui tous, de fait, traduisent une sous-estimation de l'importance des conférences, les autres groupes brilleront par leur absence.
Quant aux chantres du conseillisme et du bordiguisme : Spartakusbond (Hollande) et PCI (Programme communiste) ([6] [1382]) inintéressés par de telles conférences, ils se réfugient dans un splendide isolement sectaire.
Cependant, cette première conférence qui se tient en mai 1977, si elle ne réunit finalement que deux organisations : le CCI et BC - ce qui témoigne bien de la réalité du sectarisme ambiant - est malgré tout un grand pas en avant pour l'ensemble du milieu prolétarien.
Cette première conférence n'a pas été un débat fermé entre seulement deux organisations mais va, au contraire, permettre de démontrer à l'ensemble du milieu prolétarien qu'il est possible de briser la méfiance sectaire, qu'il est possible de créer un lieu de confrontation et de clarification des positions divergentes. L'importance des questions abordées le prouve amplement :
- analyse de la situation de la crise économique et de l'évolution de la lutte de classe ;
- fonction contre-révolutionnaire des partis dits "ouvriers" : PS, PC et leurs acolytes gauchistes ;
- fonction des syndicats ;
- les problèmes du parti ;
- tâches actuelles des révolutionnaires ;
- conclusions sur la portée de cette réunion.
Cependant, une faiblesse importante de la conférence et de celles qui l'ont suivie, sera son incapacité à prendre une position commune sur les débats qui l'ont animée ; ainsi le projet de déclaration commune proposé par le CCI et synthétisant les accords et divergences qui se sont manifestés, notamment par rapport à la question syndicale, sera rejeté par BC sans proposition alternative.
La publication en deux langues (italien et français) des textes de contribution à la conférence et des comptes-rendus des discussions qui s'y sont déroulées, va susciter un grand intérêt dans l'ensemble du milieu prolétarien et permettre d'élargir la dynamique ouverte avec la première conférence. Cela va se concrétiser avec la tenue, un an et demi plus tard, de la deuxième conférence fin 1979.
La deuxième conférence ([7] [1383])
Cette conférence a été mieux préparée, mieux organisée que la première, cela tant du point de vue politique qu'organisationnel. Ainsi l'invitation a été faite sur la base de critères politiques plus précis :
"- reconnaissance de la révolution d'octobre comme une révolution prolétarienne ;
•reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le premier et le deuxième congrès de l’Internationale Communiste ;
- rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion ;
- rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois ;
- orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat".
Ces critères - certes insuffisants pour établir une plateforme politique pour un regroupement et dont le dernier point demande certainement à être précisé- sont, par contre, amplement suffisants pour permettre de délimiter le milieu prolétarien et de donner un cadre de discussion fructueux.
A la deuxième conférence qui se tient en novembre 1978, ce sont cinq organisations prolétariennes qui vont participer aux débats : le PCI (Battaglia comunista) d'Italie, la CWO de Grande-Bretagne, le Nucleo Comunista Internaziona-lista (NCI) d'Italie, Fur Komunismen de Suède et le CCI qui, à l'époque, était présent par ses sections dans neuf pays, tandis que le groupe II Leninista fait parvenir des textes de contribution aux débats de la conférence sans pouvoir physiquement y participer, et que Arbetarmakt de Suède et POCRIA de France apportent un soutien purement platonique à la conférence. Quant au FOR, son cas est un peu particulier. Après avoir apporté sa pleine adhésion à la première conférence, fait parvenir des textes pour la préparation de la seconde et y être venu pour y participer, il va provoquer Un coup de théâtre à l'ouverture de celle-ci : sous prétexte de ne pas être d'accord avec l'ordre du jour qui comportait un point sur la crise économique dont le FOR nie de manière surréaliste l'existence, il va quitter spectaculairement la conférence ! Les épigones du conseillisme et du bordiguisme pur quant à eux persévèrent dans leur rejet des conférences : le Spartacusbond de Hollande finalement imité par le PIC de France parce qu'ils rejettent la nécessité du Parti, le PCI (Programme communiste) et le PCI (Il Partito Comunista) d'Italie parce qu'ils se considèrent chacun comme le seul parti existant et donc qu'en dehors d'eux, aucune organisation prolétarienne ne peut exister.
L'ordre du jour de la conférence témoigne de la volonté militante qui l'anime :
- l'évolution de la crise et les perspectives qu'elle ouvre pour la lutte de la classe ouvrière ;
- la position des communistes face aux mouvements dits de "libération nationale" ;
- les tâches des révolutionnaires dans la période présente.
La deuxième conférence internationale des groupes de la gauche communiste est un succès, non seulement parce qu'un plus grand nombre de groupes y participe, mais aussi parce qu'elle permet une meilleure délimitation des accords et des divergences politiques existants entre les différents groupes y participant. En permettant aux diverses organisations présentes de mieux se connaître, la conférence offre un cadre de discussion qui permet d'éviter les faux débats et de pousser à la clarification des divergences réelles. En ce sens, les conférences sont un pas en avant dans le sens de la perspective du regroupement des révolutionnaires qui, même si elle n'est pas immédiate, à court terme, est cependant à l'ordre du jour, étant donné la situation de dispersion du milieu prolétarien après des décennies de contre-révolution.
Cependant, les faiblesses politiques dont souffre le milieu prolétarien pèsent aussi sur les conférences elles-mêmes. Cela va notamment se traduire dans l'incapacité des conférences à ne pas rester muettes, c'est-à-dire dans l'incapacité des groupes y participant à prendre collectivement position sur les questions qui ont été discutées afin de mettre au clair le point où elles sont parvenues. Le CCI a proposé des résolutions dans ce sens mais, en dehors du NCI, s'est heurté au refus des autres organisations présentes et notamment du PCI (Battaglia comunista) et de la CWO ; cette attitude traduit le climat de méfiance qui perdure au sein du milieu communiste, même chez les plus ouverts à la confrontation, et qui entrave le nécessaire processus de clarification politique qui doit se développer.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les propositions du CCI de voter une résolution fustigeant le sectarisme des groupes refusant de participer aux conférences se soient heurtées au refus des autres groupes ; cela touchait évidemment un point sensible.
Ces faiblesses vont malheureusement trouver leur concrétisation au lendemain de la deuxième conférence dans les polémiques qui vont être lancées par Battaglia comunista et la CWO qui qualifient allègrement le CCI d'"opportuniste" et nient qu'il existe un problème de sectarisme, la dénonciation du sectarisme n'étant, selon eux, qu'un moyen de nier les divergences politiques existantes. Cette position de BC et de la CWO ne voit pas que la question du sectarisme est une question politique à part entière puisqu'elle traduit la perte de vue d'une question essentielle : celle du rôle de l'organisation dans un de ses aspects déterminants qui est la nécessité permanente du regroupement des révolutionnaires. En niant le danger du sectarisme, ces organisations sont bien mal armées pour y faire face en leur propre sein, et malheureusement, cela va se concrétiser avec la troisième conférence.
La troisième conférence ([8] [1384])
La IIIème conférence se tient au printemps 1980 à un moment où les luttes ouvrières de l'année précédente montrent que le reflux du milieu des années 70 est terminé, et où l'intervention des troupes "soviétiques" en Afghanistan montre l'actualité de la menace de la guerre mondiale, ce qui pose de manière aiguë la responsabilité des révolutionnaires.
De nouveaux groupes vont s'associer à la dynamique des conférences : I Nuclei Leninisti est le produit de la fusion du NCI et de II Leninista en Italie qui s'étaient déjà associés à la seconde conférence, le Groupe Communiste Internationaliste qui est le produit d'une scission bordiguisante du CCI en 1977, l'Eveil Internationaliste qui provient d'une rupture en France d'avec le maoïsme en pleine décomposition, le groupe américain Marxist Workers' Group qui s'associe à la conférence sans pouvoir y participer physiquement. Pourtant, malgré l'écho grandissant au sein du milieu révolutionnaire que rencontre la dynamique des conférences, la Illème conférence internationale des groupes de la gauche communiste va se solder par un échec.
La demande du CCI que la conférence adopte une résolution commune sur le danger de la guerre impérialiste à la lumière des événements d'Afghanistan, est rejetée par BC, la CWO et, à leur suite, par l'Eveil Internationaliste, car même si les différents groupes avaient une position commune sur cette question, il eût été selon eux "opportuniste" d'adopter une telle résolution, "parce qu'on a des divergences sur ce que sera le rôle du parti révolutionnaire de demain". Le contenu de ce brillant raisonnement "non-opportuniste" est le suivant : puisque les organisations révolutionnaires ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur toutes les questions, elles ne doivent pas parler de celles sur lesquelles elles sont d'accord depuis longtemps. Les spécificités de chaque groupe priment par principe sur ce qu'il y a de commun à tous. C'est cela le sectarisme. Le silence, l'absence de prise de position collective des groupes lors des trois conférences est la plus nette démonstration de l'impuissance à laquelle mène le sectarisme.
Deux débats étaient à l'ordre du jour de la IIIème conférence :
- où en est la crise du capitalisme et ses perspectives ?
- perspectives de développement de la lutte de classe et les tâches qui en découlent pour les révolutionnaires.
Le débat sur le deuxième point à l'ordre du jour va permettre que s'amorce le début d'une discussion sur le rôle du parti qui fut un des points discutés lors de la IIème Conférence. Cette question du rôle du parti est une des plus graves et des plus importantes à laquelle sont confrontés les groupes révolutionnaires actuels, en particulier eu égard à l'appréciation que Ton a sur les conceptions du parti bolchevik à la lumière de l'expérience historique qui s'est accumulée depuis et avec la Révolution russe.
Et pourtant le PCI (Battaglia comunista) et la CWO, par impatience... ou par peur, à moins que ce ne soit misérablement par tactique opportuniste, ce qui est malheureusement le plus probable, alors même que lors de la précédente conférence ils déclaraient sur cette question qu'elle "nécessitera de longues discussions", vont refuser de poursuivre ce débat sur le problème du parti et vont prendre prétexte de soi-disant conceptions "spontanéistes" du CCI pour déclarer la question close et faire de leur propre position un critère d'adhésion aux conférences, provoquant ainsi l'exclusion du CCI et finalement la dislocation des conférences. En brisant ainsi la dynamique qui avait permis de resserrer les liens entre différents groupes du milieu prolétarien et de pousser l'ensemble du milieu politique sur la voie de la clarification indispensable au nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, la CWO et BC portent une lourde responsabilité dans le renforcement des difficultés qui devaient se répercuter sur l'ensemble du milieu.
La CWO et BC rejoignaient ainsi dans l'irresponsabilité, celle du GCI qui n'était venu à la troisième conférence que pour mieux en dénoncer le principe et y pratiquer la "pèche à la ligne" la plus éhontée.
L'éclatement, trois mois après l'échec de la conférence: de la grève de masse en Pologne ne peut que mettre pleinement en relief l'irresponsabilité de ces groupes qui ne croient exister qu'en fonction de leur propre ego et qui oublient que c'est la classe ouvrière qui pour ses besoins les a produits. Ces défenseurs "intransigeants" du Parti oublient que la première tâche de ce parti, ce n'est pas le repli sectaire, mais au contraire la volonté de confrontation politique afin d'accélérer le processus de clarification au sein du milieu prolétarien et de renforcer sa capacité d'intervention au sein de la classe.
La pseudo quatrième conférence qui va se tenir en 1982 n'aura dans ces conditions plus rien à voir avec la dynamique qui a présidé à la tenue des trois conférences internationales des groupes de la gauche communiste. La CWO et BC vont trouver un troisième larron pour tenir la bougie qui éclairera leurs amours en la personne du SUCM d'Iran. Ce groupe nationaliste mal dégagé du stalinisme était certainement un interlocuteur plus valable pour Battaglia comunista et la CWO que le CCI. Etait-ce parce qu'il défendait une position "correcte" sur le rôle du parti contrairement au CCI? Le sectarisme a de ces vicissitudes ; il mène au plus plat opportunisme et finalement à l'abandon des principes !
Quel bilan pour les conférences?
Le premier acquis des conférences c'est d'abord qu'elles aient eu lieu.
Les conférences internationales des groupes de la gauche communiste ont été un moment particulièrement important de l'évolution du milieu politique prolétarien international qui s'était reconstitué au lendemain de 1968. Elles ont constitué un cadre de discussion entre les différents groupes qui ont directement participé de leur dynamique et ainsi permis une clarification positive sur les débats qui animent le milieu prolétarien, offrant ainsi un cadre de référence politique pour toutes les organisations ou éléments du milieu prolétarien en recherche d'une cohérence politique révolutionnaire. Les bulletins publiés en trois langues à la suite de chaque conférence et contenant les diverses contributions écrites et le compte-rendu de toutes les discussions sont restés une référence indispensable pour tous les éléments ou groupes qui depuis ont rejoint les positions révolutionnaires.
En ce sens, malgré l'échec final qu'ont connu les conférences, celles-ci ont constitué un moment fructueux de l'évolution du milieu politique prolétarien en permettant aux différents groupes de mieux se connaître, en offrant un cadre qui a permis une clarification et une décantation politique positive.
Le rôle positif des conférences et l'écho grandissant qu'elles ont rencontré, ne se manifeste pas seulement dans le nombre croissant des groupes qui y participent, mais elles montrent à l'ensemble des groupes du milieu prolétarien l'intérêt de telles rencontres. La conférence d'Oslo en septembre 1977 qui regroupe des groupes Scandinaves et à laquelle participe le CCI, même si elle se tient sur des bases encore trop floues, témoigne du besoin ressenti dans le milieu prolétarien international.
Mais avec le recul, c'est dans le vide qui est créé par leur disparition, et dans la crise du milieu politique qui va suivre l'échec de la IIIème conférence, que se mesure paradoxalement le plus clairement l'apport positif des conférences.
La crise du milieu politique prolétarien
Au même moment où se tiennent les conférences, le milieu politique de la fin des années 70 est marqué par un double phénomène : d'une part l'effondrement de la mouvance conseilliste, pôle de débat dominant du début de la décennie, et d'autre part le développement du PCI (Programme communiste) qui devient l'organisation la plus développée du milieu prolétarien.
La dégénérescence politique du PCI bordiguiste
Si le PCI (Programme communiste) est devenu l'organisation la plus développée du milieu politique, ce n'est pas seulement par son existence internationale dans plusieurs pays: Italie, France, Suisse, Espagne, etc., publiant en français, italien, anglais, espagnol, arabe, allemand, mais aussi par ses positions politiques qui, dans une période de reflux de la lutte de classe, connaissent un succès certain pas uniquement auprès d'éléments produits par la décomposition du gauchisme mais aussi au sein même du milieu prolétarien constitué. L'incapacité du « conseillisme » à résister à la lutte de classe et à son reflux traduit concrètement la faillite où mène le rejet de la nécessité du parti politique de la classe ouvrière et la sous-estimation profonde de la question de l'organisation que cette position implique. L'insistance du PCI sur la nécessité du parti est donc tout à fait juste, cependant sa conception "substitutionniste" absolument caricaturale pour laquelle le parti est tout et la classe n'est rien, forgée durant les plus profondes années de contre-révolution au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque la classe exsangue est mystifiée comme elle ne l'avait jamais été auparavant, est la théorisation de la faiblesse du prolétariat. Le Parti est présenté comme la panacée à toutes les difficultés de la lutte de classe. A un moment où la lutte reflue le développement de l'écho des positions du PCI sur la question du parti est le reflet des doutes sur la classe ouvrière ; ce doute sur les capacités révolutionnaires de la classe ouvrière va trouver sa concrétisation éclatante dans la dérive opportuniste du PCI (Programme communiste) qui va aller en s'accélérant tout au long de ces années. Alors que les travailleurs des pays développés sont censés toucher les dividendes de l'impérialisme, gages de leur passivité, c'est à la périphérie du capitalisme, dans les soi-disant "luttes de libération nationale" que le PCI voit se développer les potentialités révolutionnaires. Cette dérive nationaliste va ainsi amener Programme communiste à soutenir la terreur des Khmers rouges au Cambodge, les luttes nationalistes en Angola et la "révolution palestinienne" ainsi que pour faire bonne mesure l'OLP, tandis qu'en France par exemple l'intervention privilégiée du PCI dans les luttes des travailleurs "immigrés" va tendre à renforcer le fardeau pesant des illusions nationalistes. Les conceptions fausses du bordiguisme sur la question du parti, sur la question nationale mais aussi sur la question syndicale sont autant de portes largement ouvertes à la pénétration de l'idéologie dominante à laquelle le PCI est en train de succomber. Le développement du bordiguisme comme principal pôle politique au sein du milieu prolétarien est l'expression du recul de la lutte de classe, sa théorisation. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le PCI (Programme communiste) qui préfère ouvrir les portes au gauchisme bourgeois plutôt que de discuter au sein du milieu communiste révolutionnaire, paye cette attitude d'une dégénérescence politique accélérée qui se traduit par un abandon des principes mêmes qui avaient présidé à sa naissance.
Les débats au sein du milieu prolétarien au début des années 80
Cependant, si le PCI (Programme communiste) pousse ses positions politiques jusqu'à la caricature, les conceptions erronées qui les sous-tendent et qui sont issues de positions débattues au sein de la IIIème Internationale, sont présentes dans les conceptions générales d'autres groupes (sans atteindre cependant le même niveau d'aberration), et notamment ceux qui comme le PCI de Bordiga trouvent leur origine à des degrés divers dans le Parti Communiste Internationaliste constitué principalement en Italie au lendemain de la IIème guerre impérialiste mondiale : le PCI (Battaglia comunista) qui en est la continuité la plus claire sur ses principes révolutionnaires, Il Partito comunista d'Italie scission de Programme communiste en 1973 et le NCI par exemple.
Dans ces conditions, il n'est donc pas surprenant que les débats qui ont lieu au sein des conférences, tendent à se polariser autour des mêmes questions fondamentales : question du parti, question nationale, question syndicale car ce sont les questions de l'heure déterminées par la situation mondiale et l'histoire propre du milieu prolétarien. Dans les conférences, le NLI(NCI+I1 Leninista) est le groupe le plus proche des positions bordiguistes, Battaglia comunista faisant des concessions à ces conceptions sur les questions nationale et syndicale. Quant à la question du parti, on a vu qu'elle fut un prétexte au sabotage de la dynamique des conférences. La CWO de son côté a poursuivi durant les conférences une évolution qui, à partir d'une plate-forme très proche de celle du CCI, la mène à se rapprocher des conceptions du PCI (Battaglia comunista).
L'accélération de l'histoire au début des années 80 et la décantation au sein du milieu politique
Avec l'échec des conférences, c'est donc un milieu prolétarien encore profondément divisé qui va se trouver confronté à une très forte accélération de l'histoire au début des années 80 qui sera marquée par :
- le développement international de la vague de luttes ouvrières qui met fin au reflux qui avait succédé à la vague commencée en 1968 et qui culmine avec la grève de masse en Pologne, sa répression brutale et le fort reflux international de la lutte de classe qui suit ;
- l'exacerbation des tensions inter impérialistes entre les deux "grands" avec l'intervention russe en Afghanistan et l'intense propagande guerrière qui se déchaîne tandis que la course aux armements s'accélère ;
- la plongée dans la crise de l'économie mondiale, la récession américaine de 1982, la plus forte depuis celle des années 30 entraîne celle de l'ensemble de l'économie mondiale.
Si les leçons de l'histoire peuvent échapper à certains, par contre nul ne peut échapper à celles-ci. Inévitablement, une décantation politique doit se faire au sein du milieu prolétarien, l'expérience historique doit apporter sa sanction.
La vague de lutte de classe qui se lance à la fin des années 70 va poser concrètement la nécessité de l'intervention des révolutionnaires.
Les luttes des sidérurgistes de Lorraine et du nord de la France en 1979, la grève des sidérurgistes de G.B. en 1980 et finalement la grève de masse des ouvriers de Pologne en 1980 vont se heurter à la radicalisation de l'appareil syndical, au syndicalisme de base. Les luttes vont être dévoyées, défaites et la victoire de Solidarnosc signifie l'affaiblissement de la classe ouvrière qui va permettre la répression. L'avortement de la vague internationale de lutte de classe et le brutal reflux qui suit vont être une épreuve de vérité pour le milieu politique prolétarien.
Dans ces conditions; alors que l'échec des conférences ne permet plus au milieu prolétarien d'avoir un lieu où se poursuit la confrontation des positions politiques,l'inévitable décantation ne pourra permettre que la sélection politique se traduise par la polarisation des énergies révolutionnaires dans la dynamique de regroupement ; au contraire, au feu de l'accélération de l'histoire, la sélection politique va se faire par le vide, par une hémorragie des énergies militantes qui sont happées par la débâcle des organisations incapables de répondre aux besoins de la classe ouvrière. Le milieu politique prolétarien est entré dans une phase de crise ([9] [1385]).
La question de l'intervention : la sous-estimation du rôle des révolutionnaires et la sous-estimation de la lutte de classe
Confronté à la nécessité de l'intervention, le milieu prolétarien va réagir en ordre dispersé et montrer la profonde sous-estimation du rôle des révolutionnaires qui le mine. L'intervention du CCI au sein des luttes ouvrières, et notamment avec les événements de Longwy Denain en France va être la cible des critiques ([10] [1386]) de l'ensemble du milieu prolétarien, mais au moins, celle-ci a le mérite d'exister. En dehors du CCI, le milieu politique brille plutôt par son absence du terrain des luttes ouvrières : le PCI (Programme communiste) par exemple, la principale organisation, qui s'était caractérisé par son activisme dans la période précédente, ne voit pas la lutte de classe sous ses yeux ; hypnotisé par ses rêves tiers-mondistes il continue par ailleurs sa dérive syndicaliste.
La faiblesse de l'intervention du milieu politique traduit sa profonde sous-estimation de la lutte de classe, son manque d'expérience et son incompréhension de celle-ci. Cela se cristallise particulièrement autour de la question syndicale, non seulement par les concessions politiques vis-à-vis de celle-ci exprimées à des degrés divers par les groupes issus du PCI de 1945, mais aussi par une tendance à rejeter l'importance et la positivité des luttes qui se mènent, car celles-ci restent prisonnières du carcan des syndicats, du terrain "économique". Ainsi, paradoxalement, les tendances conseillistes et celles issues du PCI de 1945 se rejoignent pour rejeter l'importance des luttes ouvrières au nom de l'emprise syndicale qui persiste. Programme communiste, Battaglia comunista comme bien d'autres, par exemple le FOR, persistent à nier la réalité du développement de la lutte de classe depuis 1968 et à affirmer que la contre-révolution continue son règne. Dans ce contexte, la CWO va se singulariser par son appel à l'insurrection en Pologne, mais cette grave surestimation ponctuelle ne fait que traduire les mêmes incompréhensions qui dominent malheureusement le milieu politique en dehors du CCI.
L'explosion du PCI (Programme communiste)
La défaite en Pologne, le recul international de la lutte de classe qui avec la plongée dans la récession économique vont être autant de coups de boutoir de la réalité, vont faire des ravages au sein d'un milieu qui n'avait pas su pleinement être à la hauteur de ses responsabilités historiques. Les plus touchés par la crise du milieu politique vont d'abord être les groupes qui se sont signalés par leur refus de la dynamique des conférences. C'est dans l'indifférence que le Spartakusbond en Hollande et le PIC en France (ainsi que sa continuité avortée, le Groupe Volonté Communiste au nom si mal choisi) vont être emportés comme des fétus de paille par la tempête de l'accélération de l'histoire. Par contre, l'explosion du PCI (Programme communiste) en 1982 va bouleverser le paysage du milieu politique. Le parti bordiguiste monolithique, l'organisation la plus "importante" du milieu, paye le prix de longues années de sclérose et de dégénérescence politique dans l’isolement le plus sectaire qui en a accéléré le processus : il va éclater sous l'impulsion des éléments nationalistes d'El Oumami, et imploser avec l'hémorragie brutale de ses forces militantes qui, déboussolées et démoralisées se perdent dans la nature. De cette crise le PCI sort exsangue, le centre s'est effondré, les liens internationaux se sont perdus, ce qu'il reste des sections à la périphérie se retrouve isolé ; le PCI n'est plus qu'un pâle reflet de l'organisation pôle qu'il a été au sein du milieu. Cette débandade du PCI (Programme communiste) marque l'effondrement définitif du bordiguisme comme pôle politique dominant au sein du milieu prolétarien.
Les effets de la crise sur les autres groupes du milieu prolétarien
Cependant, si l'éclatement du PCI (Programme communiste) est la preuve la plus claire de la crise du milieu politique, celle-ci est bien plus large et touche aussi les groupes qui ont participé à des degrés divers à la dynamique des conférences.
Les groupes les plus faibles, ceux qui sont le produit des circonstances immédiates, sans tradition et identité politiques propres vont disparaître avec la fin des conférences ; Arbetarmakt en Suède, l'Eveil internationaliste en France, le Marxist Workers' Group aux USA, etc. D'autres groupes plus solides, car mieux enracinés dans une tradition politique mais qui lors des conférences avaient montré leur faiblesse, non seulement par leurs positions politiques mais aussi, comme le FOR et le GCI, par leur irresponsabilité sectaire, vont connaître avec la confrontation à l'accélération historique une dégénérescence politique grandissante :
- le NLI en Italie va suivre un chemin identique à celui déjà tracé par Programme communiste par des abandons répétés des principes sur les questions nationales et syndicales et un flirt de plus en plus poussé avec le gauchisme bourgeois ;
- le GCI quant à lui, ses positions confuses sur la question de la violence de classe inspirées du bordiguisme vont, moins paradoxalement qu'il n'y paraît à première vue, l'amener à se rapprocher de la mouvance anarchiste ;
- le FOR dans sa folle négation de la réalité de la crise économique va prendre des positions de plus en plus surréalistes où le radicalisme de la phrase remplace toute cohérence.
Le CCI, lui-même ne sera pas à l'abri des effets de cette crise du milieu prolétarien. L'implication du CCI dans l'intervention a soulevé d'importants et riches débats en son sein, mais en même temps le manque d'expérience organisationnelle qui pèse encore lourdement sur la génération présente de révolutionnaires va permettre à un élément à l'aventurisme douteux, Chenier, de cristalliser les tensions par des manoeuvres secrètes et finalement fomenter un vol contre le matériel de l'organisation. Les quelques éléments qui suivront Chenier dans son aventure publieront l'Ouvrier Internationaliste qui ne survivra pas à son premier numéro. Au même moment le Communist Bulletin Group qui se forme dans la même dynamique douteuse avec des éléments issus de la section du CCI en GB se met en dehors du milieu prolétarien par son soutien aux comportements gangstéristes d'un Chenier.
La formation opportuniste du BIPR
La formation en 1983 du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire ([11] [1387]) qui regroupe la CWO de Grande-
Bretagne et le PCI (Battaglia comunista) d'Italie dans ce contexte de crise du milieu prolétarien semble être une réaction positive. Cependant si ce regroupement constitue une clarification du paysage politique sur le plan organisationnel, il n'en va pas de même sur le plan politique. Ce regroupement se situe dans la dynamique de l'échec des conférences, et ce sont les deux groupes qui sont responsables de cet échec qui en sont les acteurs ; il est dans la droite ligne de l'opportunisme et de l'esprit sectaire qu'ont manifesté ces deux organisations lors de la IIIème Conférence et par la suite.
Pour être un apport politique, il est indispensable que la dynamique de regroupement se fasse dans la clarté politique. Or, ce n'est certainement pas la dynamique qui préside au "regroupement" qui permet la formation du BIPR. Les débats qui déterminent la CWO à prendre ses distances d'avec sa plateforme d'origine qui d'ailleurs était très proche de celle du CCI - ce qui n'a pas empêché la CWO de refuser en 1974 tout regroupement avec Word Révolution, future section du CCI en GB car selon elle après 1921, après Kronstadt il n'y a plus de vie prolétarienne au sein du parti Bolchevik et des PCs, prétexte sectaire bien vite oublié quelques années plus tard- resteront un mystère pour l'ensemble du milieu politique. Ce ne sera que deux ans après la soi-disant IVème Conférence que seront publiés les comptes-rendus de discussion qui en fait n'apportent pas de réelle clarté sur l'évolution politique des deux groupes. La plate-forme d'adhésion au BIPR comporte les mêmes confusions et ambiguïtés caractéristiques que celles manifestées lors des conférences par BC sur la question syndicale, sur la question nationale, sur la possibilité du parlementarisme révolutionnaire, et évidemment sur la question du parti et du cours historique.
Mais surtout, la formation du BIPR traduit une conception fausse du regroupement des révolutionnaires. Le BIPR est un cartel d'organisations existantes plus qu'une nouvelle organisation produit d'un regroupement où les forces fusionnent autour de la clarté d'une plate-forme commune, chaque organisation adhérente garde sa spécificité. En plus de la plate-forme du BIPR, chaque groupe garde la sienne propre sans expliquer les importantes différences qui peuvent exister, cela permet de mesurer la fausse homogénéité du BIPR et l'opportunisme qui a présidé à sa formation.
La formation du BIPR n'est donc pas le signe annonciateur de la fin de la crise du milieu qui continue ses ravages, ni d'une nouvelle dynamique de clarification au sein des forces révolutionnaires mais l'expression d'un reclassement des forces du milieu politique qui se fait dans la confusion opportuniste et dans l'isolement sectaire.
En 1983, avec la crise qui a sévi, la face du milieu prolétarien est transformée. Le PCI bordiguiste a quasiment disparu et le CCI est devenu l'organisation la plus importante du milieu communiste, son pôle politique dominant et dans la mesure où l'histoire a apporté sa sanction historique, un pôle de clarté confirmé dans les débats qui animent le milieu. Le CCI est une organisation centralisée à l'échelle internationale qui par ses sections est présente dans dix pays et publie en sept langues. Cependant, si le CCI est devenu le principal pôle de regroupement, il n'est pas pour autant seul au monde. Le BIPR malgré la confusion qui a déterminé ses origines, par rapport à la déliquescence politique des autres groupes qui forment alors le milieu prolétarien constitue l'autre pôle de référence et de relative clarté politique qui va polariser les débats.
Comme on le voit les groupes qui ont le mieux résisté à la crise du milieu prolétarien, sont ceux qui ont su le mieux participer à la dynamique des conférences internationales ; ce seul fait permet de mesurer l'apport positif de celles-ci et rétrospectivement donc d'apprécier l'erreur politique majeure qu'a constitué leur dislocation dont le PCI (Battaglia comunista) et la CWO portent la lourde responsabilité.
A la mi-1983, après la courte mais profonde phase de recul de la lutte de classe qui a suivi la défaite en Pologne, les premiers signes d'une reprise des luttes ouvrières commencent à se manifester. Nous avons vu comment, à la fin des années 70 et au début des années 80, la question de l'intervention des révolutionnaires a été une épreuve de vérité pour le milieu prolétarien, c'est la question que l'histoire pose de nouveau aux révolutionnaires ; nous verrons dans la troisième partie de cette article si les organisations du milieu politique sauront, après 1983, se hisser à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs.
JJ
[1] [1388] Voir brochure "LA GAUCHE COMMUNISTE D'ITALIE".
[2] [1389] Voir articles in Revue Internationale 11-16-17-21-25-28-36-37-38-45 et suivantes.
[3] [1390] Voir article "Rencontre internationale convoquée par le PCI-"Battaglia comunista"(mai 1977) in Revue Internationale 10.
Voir Bulletin de la 1ère conférence des groupes de la gauche communiste.
[4] [1391] Sur la CWO voir Revue Internationale 12-17-39.
[5] [1392] Sur le PCI-Battaglia comunista voir Revue Internationale 13-33-34-36.
[6] [1393] Sur le PCI-Programme communiste voir Revue Internationale 14-23-32-33.
[7] [1394] Voir articles sur la Ilème conférence in Revue Internationale 16 et 17, sur le cours historique voir article in Revue Internationale 18. Voir Bulletin ( 2 volumes) de la Ilème conférence des groupes de la Gauche communiste.
[8] [1395] Voir article sur la Ilème conférence in Revue Internationale 22. Voir Bulletin ( 3 volumes) de la Même conférence des groupes de la gauche communiste.
[9] [1396] Sur la crise du milieu révolutionnaire, voir article in Revue Internationale 28-32.
[10] [1397] Sur les débats sur l'intervention voir Revue Internationale 20-24.
[11] [1398] Sur la formation du BIPR voir article in Revue Internationale 40-41.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1334]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (4)
- 4659 reads
- Nous poursuivons ici la série d'articles entamée dans les n°48, 49 et 50 de la Revue Internationale qui s'attachait à défendre l'analyse de la décadence du capitalisme contre les critiques dont elle a été l'objet de la part de groupes du milieu révolutionnaire et plus particulièrement du GCI ([1] [1399]).
- Dans le présent article nous tenterons de développer, sous différents aspects, les bases de la décadence du mode de production capitaliste et de répondre aux arguments qui les récusent.
- Au tournant des années 60-70 le CCI a dû se battre pour convaincre le milieu politique de la fin des "Golden Sixties" et de l'entrée du capitalisme mondial dans une nouvelle période de crise. Les graves secousses monétaires internationales d'octobre 87 et la stagnation effective de l'économie réelle depuis 10 ans ne laissent plus aucun doute et achèvent de démontrer l'ineptie de la position d'un groupe comme le FOR ([2] [1400]) qui nie toujours la réalité de la crise économique. Mais il y a plus grave, alors qu'aujourd'hui le monde est au seuil de l'alternative Guerre ou Révolution, il se trouve encore des groupes révolutionnaires qui, reconnaissant pourtant la crise, se font le chantre de la vitalité du capitalisme.
Face à l'enjeu historique actuel (soit développement de l'actuel cours aux affrontements de classes vers une perspective révolutionnaire, soit défaite de la classe ouvrière et ouverture d'un cours vers la guerre) qui met en balance l'avenir de l'humanité, alors que la tâche des révolutionnaires est la démonstration de la faillite historique du mode de production capitaliste, de la nécessité et de l'actualité du socialisme, des groupes politiques se grattent le nombril sur les 'formidables taux de croissance de la reconstruction". Abandonnent la conception marxiste de la succession des modes de production en rejetant la notion de décadence et ils s'échinent à prouver que "... le capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite". Il n'est pas étonnant que sur de telles bases, en l'absence d'un cadre d'analyse cohérent de la période, ces groupes défendent une perspective défavorable pour la classe ouvrière et des préoccupations essentiellement académistes pour l'activité des minorités révolutionnaires.
La réflexion théorique et la discussion constituent, pour la FECCI ([3] [1401]) , la tâche prioritaire de l'heure (cf. Perspective Internationaliste. n°9 p38 et 32). Interloquée par l'urgent problème "d'une reconstruction de la longueur et de l'ampleur de celle qui a suivi la 2ème guerre mondiale", elle propose à tout le milieu de discuter des "graves questions" que cela pose (Perspective Internationaliste n°5 p30 et n°7 p20). Pour Communisme ou civilisation ([4] [1402]) nous vivons toujours dans la période de contre-révolution qui perdure depuis les années 20 ("Communisme ou civilisation" n°22, p2); "avec la fin de la seconde guerre mondiale le mode de production capitaliste est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent" (p6) et "...en l'absence de rupture qualitative et quantitative..." de la lutte de classe, ce groupe se propose de produire par fascicule... semestriel... une grande fresque encyclopédique sur la théorie des crises et l'histoire du mouvement ouvrier. Pour le GCI, depuis la vague de luttes de 68-74 "la paix sociale, la paix des Versaillais règne" (éditorial du n°25 et n°26 p5, 6 et 9). La préoccupation essentielle de ce dernier groupe est la liquidation des acquis du socialisme; dans sa publication (Le Communiste n°23 pll) il assimile la conception marxiste de la décadence des modes de production aux visions religieuses du monde telles celles de Moon, des témoins de Jéhovah, etc.... La scission du GCI A Contre Courant ([5] [1403]) reste sur le même terrain tant sur le plan historique "...nous rejetons dos à dos tant les schémas sclérosés de type décadentiste vulgaire (plaqués idéologiquenient sur une réalité qui les infirme chaque fois plus fort)...", que sur le plan actuel des rapports de force entre les classes "...ce qui matérialise pour nous essentiellement la dite crise boursière d'aujourd'hui est l'absence du prolétariat en tant que force révolutionnaire..." (A contre courant. n°1 p7).
La decadence du capitalisme
Pour voiler son involution anarchiste et l'abandon de toute référence au cadre marxiste d'analyse des sociétés, le GCI se couvre de l'autorité d'une conception erronée du "très marxiste" Bordiga ([6] [1404]): "La conception marxiste de la chute du capitalisme ne consiste pas du tout à affirmer qu'après une phase historique d'accumulation, celui-ci s'anémie et se vide de lui-même. Ca, c'est la thèse des révisionnistes pacifistes. Pour Marx, le capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite" (Le Communiste n°23 p10).
Si les décadences des modes de production antérieurs sont clairement identifiables (nous développerons ce point ultérieurement) soit parce qu'il y a recul absolu des forces productives -mode de production asiatique et antique- soit parce qu'il y a stagnation avec fluctuations séculaires -mode de production féodal- il n'en va pas de même pour le capitalisme. Mode de production éminemment dynamique, les bases de sa reproduction élargie ne lui permettent aucun répit, croître ou mourir tel est sa loi. Cependant tout comme dans les modes de production antérieurs, le capitalisme connait également une phase de décadence qui commence dans la seconde décennie de ce siècle et est caractérisée par le frein qu'exerce le rapport social fondamental de production (le salariat qui à terme se traduit par une insuffisance de marché solvables par rapport aux besoin de l'accumulation), devenu suranné, sur le développement des forces productives.
Ceci est violemment contredit par nos censeurs. Les affirmations péremptoires mises de côté, quels sont leurs argumcnts ?
1- Sur un plan théorique général l'on nous rétorque que l'analyse Luxembourgiste de la crise, sur laquelle nous nous appuyons, est incapable de féconder une explication cohérente de la "soit-disant" décadence du capitalisme: "Si nous suivons la logique luxembourgiste, c'est à dire la logique sur laquelle repose le raisonnement du CCI et la théorie de la décadence, on est amené à conclure que décadence doit rimer avec effondrement immédiat de la production capitaliste puisque toute Plus-Value destinée à l'accumulation ne peut être réalisée et, par suite, accumulée." (Communisme ou civilisation n°22 p5)
2- Sur un plan quantitatif général, il est affirmé que la dite période de décadence du capitalisme connaît, en réalité, une croissance bien plus rapide qu'en ascendance: "Pour l'ensemble du monde capitaliste, la croissance a été, au cours des vingt dernières années (1952-72 NDLR), au moins deux fois plus rapide qu'elle ne l'avait été de 1870 à 1914, c'est à dire pendant la période qui était généralement considérée comme celle du capitalisme ascendant. L'affirmation que le système capitaliste était entré depuis la première guerre mondiale dans sa phase de déclin est tout simplement devenue ridicule..." (P. Souyri cité dans Le Communiste n°23 pll), "Que plus de 70 ans après la date fatidique de 1914 le mode de production capitaliste accumule de la plus-value tandis que le taux et la masse de cette plus-value ont cru à un rythme supérieur à celui du 19ème siècle, siècle de la soi-disant phase ascendante du mode de production capitaliste ...".
3- Sur un plan circonstancié, en coeur avec tous les pourfendeurs du marxisme, les taux de croissance consécutifs à la seconde guerre mondiale (les plus élevés de toute l'histoire du capitalisme) sont brandis comme preuves décisives de l'inanité d'une décadence du mode de production capitaliste: "Car avec la fin de la seconde guerre mondiale, le mode de production capitaliste est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent depuis le passage à la phase de soumission réelle du travail au capital." (Communisme ou civilisation n°22 p6), "L'accumulation effrénée qui a suivi la 2ème guerre mondiale est venue balayer tous les sophismes à base de Luxembourgisme..." p41.
Sur le plan théorique
Nous n'allons pas revenir ici sur un sujet déjà largement traité et argumenté dans notre presse (Revue Internationale n°13,16,19,21,22,29,30). Bornons nous à relever le procédé foncièrement malhonnête de nos contradicteurs qui déforment sciemment nos propos afin de faire apparaître une absurdité qui n'existe que dans leur cerveau. Il consiste à prétendre que pour le CCI décadence = inexistence de marchés extra-capitalistes: "Si comme l'affirme par ailleurs le CCI les marchés extra capitalistes ont -du moins qualitativement- disparu, on ne voit pas ce que peut bien signifier cette exploitation des marchés anciens. Soit il s'agit de marchés capitalistes et alors leur rôle est nul pour l'accumulation soit il s'agit de marchés extra-capitalistes et on ne voit pas comment ce qui n'existe plus peut jouer un rôle quelconque."
Sur une telle base il n'est pas difficile à Communisme ou Civilisation de montrer l'impossibilité de toute accumulation élargie depuis 1914. Mais, pour Rosa Luxembourg et pour nous, la décadence du capitalisme se caractérise non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par une insuffisance de marchés extra-capitalistes par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteint par le capitalisme. C'est-à-dire que la masse de Plus-Value réalisée par les marchés extra-capitalistes est devenue insuffisante pour réaliser la part de Plus-Value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Une fraction du capital total ne trouve plus à s'écouler sur le marché mondial, signalant une surproduction qui, d'épisodique en période ascendante, deviendra un obstacle permanent auquel sera confronté le capitalisme en décadence. L'accumulation élargie s'en trouve donc ralentie mais n'en a pas disparu pour autant. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement et l'histoire de l'inefficacité de ces derniers est signalée, entre autres, par les deux guerres mondiales (cf.ci-dessous).
Sur le plan quantitatif general
Pour illustrer la réalité d'un frein des forces productives par les rapports sociaux de production capitalistes, c'est-à-dire la décadence du mode de production capitaliste, nous avons calculé le développement qu'aurait eu la production industrielle sans le frein constitué par ces rapports sociaux de production depuis 1913. Ensuite nous comparons cet indice de production industrielle hypothétique (2401) à l'indice de production industriel réel (1440) pendant la même période (1913-83).
Pour ce faire, nous appliquons le taux de croissance de la dernière phase de l'ascendance du capitalisme à l'ensemble de la phase de décadence (1913-83) et nous comparons la croissance réelle en 83 (=1440) à la croissance potentiellement possible (=2401 -application du taux de croissance de 4,65% à la même période-) c'est à dire sans l'obstacle de l'insuffisance des marchés. Nous constatons que la production industrielle en décadence atteint 60% de ce qui eut été possible, bref que le freinage des rapports sociaux capitaIistes de production sur la croissance des forces productives est dé l'ordre de 40%. Et, ceci est encore sous-estimé pour trois raisons:
a- Nous devrions extrapoler non pas linéairement au taux de 4,65% mais sur base d'un taux à progression exponentielle car telle est la tendance au cours des différentes phases de prospérité du capitalisme ascendant étant donné le processus de technicité croissant du capital (1786-1820: 2,48%, 1840-70: 3,28%, 1894-1913: 4,65%).
b- La croissance réelle en décadence est surestimée dans la mesure où cette dernière est droguée par une série d'artifices (point que nous développerons dans un prochain article) qu'il faudrait défalquer. Par exemple, la part de la production d'armement -secteur improductif- dans le produit intérieur mondial augmente fortement en décadence (1,77% en 1908, 2,5% en 1913, 8,3% en 1981 ([7] [1405])) et donc plus fortement encore dans la production industrielle mondiale car la part de cette dernière dans le produit intérieur mondial baisse au cours de la décadence.
c- La crise actuelle se poursuivant, la stagnation du taux de croissance après 1983 ne ferait qu'accroître davantage le décalage.
Si l'on additionne l'ensemble de ces phénomènes nous atteignons facilement un frein au développement des forces productives de l'ordre de 50% !
Pourquoi avoir choisi le taux de croissance de la période 1895-1913 et non le taux de l'ensemble de la phase ascendante?
a- Parce qu'il faut comparer des choses comparables. A ses débuts, le capitalisme est entravé par d'autres freins: la subsistance de rapports de production hérités de la féodalité. La production n'est pas encore pleinement capitaliste (forte subsistance du travail à domicile ([8] [1406]), etc...), alors qu'elle l'est en 1895-1913.
b- Parce que la période 1895-1913 fait suite à la poussée majeure de l'impérialisme (conquêtes coloniales) qui s'est déroulée dans la phase précédente (1873-95) ([9] [1407]). Nous avons donc là une période qui reflète au mieux les potentialités productives du capitalisme puisqu'il a à sa disposition un marché "sans limites". Ceci rejoint tout à fait notre objectif qui était de comparer un capitalisme sans frein et avec frein.
c- Parce qu'autrement l'on supprimerait la tendance exponentielle à l'accroissement des taux de croissance au cours du temps.
Ces éléments récusent définitivement toutes les affabulations sur "un capitalisme croissant deux fois plus rapidement en décadence qu'en ascendance". La "démonstration" de Souyri (cf. citation ci-dessus) sur laquelle s'appuie le GCI n'est qu'une grossière mystification car elle compare deux périodes incomparables :
a- Pour le GCI et Souyri, 1952-72 est la période censée représenter la décadence alors qu'elle exclut les deux guerres mondiales (14-18 et 39-45) et les deux crises (29-39 et 67-...) !
b- Elle compare une phase homogène de 22 ans de croissance droguée à une phase hétérogène de 44 ans de vie normale du capitalisme (cette dernière phase inclut une phase de ralentissement relatif du capitalisme 1870-94 (3,27%) qui se décloisonne par le colonialisme massif débouchant sur une phase de forte croissance 1894-1913 (4,65%).
c- Elle compare deux périodes dont les bases qui sous-tendent la croissance sont qualitativement différentes (cf. ci-dessous).
La décadence est loin d'être un "schéma sclérosé vulgaire plaqué idéologiquement sur une réalité qui l’infirme chaque fois plus" mais une réalité objective depuis le début de ce siècle qui se confirme d'avantage de jour en jour.
Sur le plan qualitatif
La décadence d'un mode de production ne saurait se mesurer à la seule aune des indices statistiques. C'est à un faisceau de manifestations quantitatives mais également qualitatives et superstructurelles qu'il faut se référer pour bien saisir le phénomène.
Nos censeurs feignent de les ignorer pour ne pas avoir à se prononcer, tout heureux d'avoir pu brandir un chiffre dont nous avons vu ce qu'il fallait en penser.
a/ Cycle de vie du capitalisme en ascendance et en décadence.
Le graphique n°1 est illustratif de la dynamique générale du capitalisme. En ascendance, la croissance est en progresston continue avec de faibles fluctuations. Elle est rythmée par des cycles de crise - prospérité - crise atténuée -prospérité accrue -etc... En décadence, outre un frein global sur la croissance (cf. ci-dessus), elle connait d'intenses fluctuations jamais vues auparavant. Deux guerres mondiales et un fort ralentissement ces quinze dernières années, voire une stagnation depuis moins de 10 ans. Le commerce mondial n'a lui-même jamais connu d'aussi fortes contractions (stagnation de 1913 à 48 et violent freinage ces dernières années) illustrant le problème permanent, en décadence, de l'insuffisance de marchés solvables.
Le Tableau n°l illustre le cycle qui rythme la vie du capitalisme en décadence: une spirale grandissante de crise - guerre - reconstruction - crise décuplée - guerre décuplée - reconstruction droguée.... Mais la décadence a une histoire et n'est pas un éternel recommencement du cycle. Nous vivons le début de la 3ème spirale et l'enjeu pour aujourd'hui c'est le vieux cri de guerre de Engels: "socialisme ou barbarie": "Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant (1914 NDLR) devait se poursuivre sans entrave jusque dans ses demières conséquences. C'est exactement ce que F. Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans (...). C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien - ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Celui-ci doit résolument jeter dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire: l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent" (Rosa Luxembuug in "La crise de la social-démocratie", p68, Ed. La Taupe).
TABLEAU 1
1er spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1913 1914-18 1918-24
1.5 ans de crise 4 ans et 20 millions de morts 10 ans
2ème spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1929-39 1939-45 1945-67
10 ans de crise 6 ans, 50 millions de mort 26 ans
et destructions massives
3ème spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1967-….
20ans de crise déjà guerre irrémédiable pour ……
L’humanité ou révolution
b/ Les guerres en ascendance et en décadence du capitalisme.
"Depuis l'ouverture de la phase impérialiste du capitalisme au début du siècle actuel, l'évolution oscille entre la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne. A l'époque de la croissance du capitalisme, les guerres frayaient la voie de l'expansion des forces productives par la destruction des rappons surannés de production. Dans la phase de décadence capitaliste, les guerres n'ont d'autre fonction que d'opérer la destruction de l'excédent des richesses..." Résolution sur la constitution du Bureau International des Fractions de la Gauche Communiste, OCTOBRE n°1 de février 1938, p4 et 5.
En période ascendante, les guerres se manifestent essentiellement en phase d'expansion du capitalisme comme produit de la dynamique d'un système en expansion:
1790-1815: Guerres de la révolution, guerres de l'empire (Napoléon).
1850-1873: Guerres de Crimée, de Sécession, du Mexique, d'unification nationale (Allemagne et Italie), Franco-Prussienne (1870).
1895-1913: Guerres Hispano-U.S., Russo-Japonaise, Balkaniques.
Au 19ème siècle, la guerre a, en général, la fonction d'assurer à chaque nation capitaliste une unité (guerre d'unification nationale) et/ou une extension territoriale (guerres coloniales) nécessaire à son développement. En ce sens, malgré les calamités qu'elle entraîne, la guerre est un moment de la nature progressive du capital; tant qu'elle permet un développement de celui-ci, ce sont des frais nécessaires à l'élargissement du marché et donc de la production. C'est pourquoi Marx parlait de guerres progressives pour certaines d'entre elles. Les guerres sont alors: a) limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes, b) elles sont de courte durée, c) elles provoquent peu de dégâts, d) elles sont le fait de corps spécialisés et mobilisent peu l'ensemble de l'économie et de la population, e) elles sont déclenchées dans un but rationnel de gain économique. Elles déterminent, tant pour les vaincus que pour les vainqueurs, un nouvel essor. La guerre franco-prussienne est typique de cc genre de guerre: elle constitue une étape décisive dans la formation de la nation allemande, c'est à dire la création des bases pour un formidable développement des forces productives et la constitution du secteur le plus important du prolétariat industriel d'Europe; en même temps, cette guerre dure moins d'un an, n'est pas très meurtrière et ne constitue pas, pour le pays vaincu, un réel handicap.
En période de décadence, par contre, les guerres se manifestent à l'issue des crises (cf. tableau 1) comme produit de la dynamique d'un système en contraction. Dans une période où il n'est plus question de formation d'unités nationales ou l'indépendance réelle, toute guerre prend un caractère inter-impérialiste. Les guerres sont par nature:
a) généralisées au monde entier car trouvant leurs racines dans la contraction permanente du marché mondial face aux nécessité de l'accumulation, b) elles sont de longue durée, c) elles provoquent d'énormes destructions, d) elles mobilisent l'ensemble de l'économie mondiale et de la population des pays belligérants, e) elles perdent, du point de vue du développement du capital global toute fonction économique progressistes, devenant purement irrationnelles. Elles ne relèvent plus du développement des forces productives mais de leur destruction. Elles ne sont plus des moments de l'expansion du mode de production mais des moments de convulsion d'un système décadent. Alors que par le passé un vainqueur émergeait et que l'issue de la guerre ne préjugeait pas du développement futur des protagonistes, dans les deux guerres mondiales ni les vainqueurs, ni les vaincus, n'en sortent renforcés mais affaiblis, au profit d'un troisième larron, les E.U.. Les vainqueurs n'ont pu faire payer leurs frais de guerre aux vaincus (comme la forte rançon en Marks OR payés à l'Allemagne par la France suite à la guerre franco-prussienne). Dans la période de décadence, le développement des uns se fait sur la ruine des autres. Autrefois, la force militaire venait appuyer et garantir les positions économiques acquises ou à acquérir; aujourd'hui, l'économie sert de plus en plus d'auxiliaire à la stratégie militaire.
A Contre Courant et Communisme ou Civilisation se refusent à reconnaître cette différence qualitative entre les guerres d'avant et d'après 1914 « A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...) Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...) Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux décadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (A Contre Courant n°l, p18). Communisme ou Civilisation, avec une pointe d'ironie, essaie de nous opposer Rosa Luxemburg pour qui "..le militarisme n'est pas caractéristique d'une phase particulière du mode de production capitaliste" (Communisme ou Civilisation n°22, p4). Ce groupe oublie que si effectivement pour Rosa Luxembourg "..le militarisme accompagne toutes les phases historiques de l'accumulation", pour elle également, la nature et la fonction des guerres et du militarisme changent avec l'entrée en décadence du système capitaliste "La force impérialiste d'expansion du capitalisme qui marque son apogée et constitue son dernier stade a pour tendance, sur le plan économique, la métamorphose de la planète en un monde où règne le mode de production capitaliste (...) La guerre mondiale est un tournant dans l'histoire du capitalisme (...) Aujourd'hui la guerre ne fonctionne plus comme une méthode dynamique susceptible de procurer au jeune capitalisme naissant les conditions de son épanouissement national (...) la guerre produit un phénomène que les guerres précédentes des temps modernes n'ont pas connu: la ruine économique de tous les pays qui y prennent part..." (Rosa Luxemburg in "La crise de la social-démocratie").
Si l'image de la décadence est celle d'un corps qui croît dans un habit devenu trop étroit, la guerre marque la nécessité pour ce corps de s'auto-phagocyter, de dévorer sa propre substance pour ne pas faire craquer l'habit, telle est la signification de ces destructions massives de forces productives. La vie en blocs rivaux, la guerre, sont devenues des données permanentes, le mode de vie même du capitalisme
LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME D'ETAT
Le développement de l'Etat dans tous les domaines, son emprise croissante sur l'ensemble de la vie sociale est une caractéristique inéquivoque d'une période de décadence. Chaque mode de production antérieur, asiatique, antique, féodal, a connu une telle hypertrophie de l'appareil d'Etat (nous y reviendrons ultérieurement). Il en va de même pour le capitalisme. Un mode de production qui, sur le plan économique, devient une entrave au développement des forces productives, se matérialisant par un disfonctionnement et des crises d'ampleur croissante. Qui, sur le plan social, est contesté par la nouvelle classe révolutionnaire porteuse des nouveaux rapports sociaux de production et par la classe exploitée ([10] [1408]) au travers d'une lutte de classe de plus en plus âpre. Qui, sur le plan politique, est constamment déchiré par les antagonismes internes à la classe dominante débouchant sur des guerres intestines de plus en plus meurtrières et destructrices. Qui, sur le plan idéologique, voit ses valeurs se décomposer, et réagit en blindant ses structures à l'aide d'une intervention massive de l'Etat.
Dans la décadence du capitalisme l'Etat supplante l'initiative privée qui survit de plus en plus mal au sein d'un marché sur-saturé. Au travers des anciennes organisations ouvrières (PS, PC et syndicats) et d'un ensemble de mécanismes sociaux rattachant la classe ouvrière à l’Etat (sécurité sociale, etc...) il encadre un prolétariat développé, devenu un danger permanent pour la bourgeoisie, et discipline les fractions particulières du capital derrière l'intérêt général du système. Une mesure, encore que très partielle, de ce processus nous est fournie par le développement de l'intervention de l'Etat dans la formation du P.N.B.. Nous reproduisons, ci-dessus les graphiques illustrant cet indicateur pour trois pays ([11] [1409]).
La rupture en 1914 est nette, la part de l'Etat dans l'économie est constante tout au long de la phase ascendante du capitalisme alors qu'elle croît au cours de sa décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50% du P.N.B. ! (47% en 1982 pour les 22 pays les plus industrialisés de l'OCDE).
La FECCI ne critique pas encore ouvertement la théorie de la décadence du capitalisme mais elle l'abandonne petit à petit, insidieusement, au fil de ses "contributions à la discussion" qui constituent autant de bornes qui jalonnent sa régression. Sa "contribution" sur le capitalisme d'Etat dans "Perspective Intemationnaliste" n°7 en est une illustration flagrante.
Pour la FECCI la décadence ne s'explique plus essentiellement par l'insuffisance mondiale de marchés extra-capitalistes mais par le mécanisme du passage de la domination formelle à la domination réelle du capital: "C'est ce passage qui pousse le MPC vers sa crise permanente, qui rend insolubles les contradictions du procès de production capitaliste (...) le lien inextricable entre ce passage et la décadence du capitalisme" (p25 et 28). Il en va de même pour le développement du capitalisme d'Etat: 'A cet égard, il est essentiel de reconnaître le rôle non moins décisif joué par le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital dans le développement du capitalisme d'Etat (...) L'origine du capitalisme d'Etat doit également être cherchée dans la transformation économique fondamentale interne au mode de production capitaliste amenée par le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital" (p24 et 20). Sur cette base la FECCI, qui n'en est plus à une régression près, critique notre thèse de la restriction du champ d'application de la loi de la valeur sous le capitalisme d'Etat au nom du développement du libre-échange après la seconde guerre mondiale: "Donc, loin de s'accompagner d'une restriction de l'application de la loi de la valeur, le capitalisme d'Etat en marque la plus grande extension" (p20). Dans un même élan la FECCI introduit l'idée que le but de la guerre est la destruction de capital (p25 et 26). Découvrant le 6ème chapitre inédit du Capital de Marx avec 20 ans de retard sur les modernistes, la FECCI y trouve l'inspiration nécessaire pour abandonner la cohérence des positions révolutionnaires.
a/ Ce "groupe" confond deux choses diamétralement opposées, d'une part, le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital, c'est à dire, le passage à un mode d'organisation plus productif de la production et un mode d'extraction plus efficace de la plus-value et, d'autre part, le capitalisme d'Etat qui est une réponse face aux difficultés du capitalisme à survivre, à réaliser l'entièreté de la plus-value produite. L'un est une réponse à "comment mieux développer le capital", l'autre est une réponse au blo cage de ce développement. L'un propose un nouveau mécanisme d'extraction de la plus-value, l'autre est une perversion de ce mécanisme afin de survivre dans le cadre d'une crise permanente.
b/ En plaçant le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital à la charnière du 20ème siècle, la FECCI se trompe ... d'un siècle. Le capitalisme d'Etat se développe avec la décadence du capitalisme, le passage à la domination réelle se réalise au cours de la phase ascendante. Marx montre que les rapports capitalistes de production s'emparent tout d'abord de la production telle qu'elle est héritée des modes de production précédents, c'est la période de soumission formelle qu'il situe au 17ème, début du 18ème, ce n'est qu'ultérieurement que le capital se soumet réellement les forces de production déterminant la révolution industrielle du 18ème et du début du 19ème siècle. Comme l'explique très bien le G.P.I. critiquant le C.CA. ([12] [1410]): "Si l'époque de la décadence correspondait au passage à la domination réelle du processus de travail, nous devrions la situer à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème. Encore une fois, nous nous trouvons en face de la tendance à diluer l'époque déterminée de la décadence dans le développement général du capitalisme" (Revue Internationale n°52 p19).
c/ Le capitalisme d'Etat est l'expression de la contradiction entre la socialisation mondiale de la production et la base nationale des rapports sociaux de production capitalistes. Il montre l'incapacité du capitalisme en décadence à dépasser le cadre de fEtat devenu trop étroit pour contenir le développement des forces productives. Toute la décadence du capitalisme est là pour nous le démontrer:
1- Les limites des organisations internationales (tant invoquées par la FECCI dans son argumentation). Nous assistons à un développement croissant des rivalités nationales que seul l'Etat peut prendre en charge et non 'à une coopération croissante entre Etats. Même si cela passe par , un minimum de coopération dans le cadre d'une politique obligée de blocs.
2- Dans ce cadre, chaque pays, en décadence, doit tricher avec la loi de la valeur s'il ne veut pas, soit être mangé par un pays plus puissant, soit voir son économie se désagréger sous le poids de ses contradictions insurmontables. La décadence correspond au plein développement des tricheries avec la loi de la valeur, à une restriction relative de son champ d'application. Quelques exemples: les pays dits "socialistes" (1/4 de la production manufacturière mondiale !) qui pour survivre ont du s'isoler du marché mondial et pratiquer sur leur propre marché une politique de prix en porte à faux avec la loi de la valeur, toute la production agricole européenne qui pour se vendre est artificiellement soutenue et vendue à un prix qui ne correspond pas à la logique de la loi de la valeur, il en va de même pour les prix de toute une série de produits des pays sous-développés, toutes les formes de protectionnisme déguisé qui touchent près des deux tiers du commerce mondiale selon le GATT (droits de douanes, quotas d'importation, subsides à l'exportation, réglementation à l'importation, etc...), les marchés 'protégés" (dotation d'une aide financière à la condition qu'elle serve à s'approvisionner en produits chez le pays donateur), marché des commandes publiques (monopole aux entreprises nationales), accords entre firmes nationales, cartels et monopoles sur les marchés et les prix, etc... Tous ces exemples illustrent ce processus de restriction relative du champ d'application de la loi de la valeur. Eblouie par la reconstruction, le GATT, la Banque Mondiale... et surtout par la propagande bourgeoise, la FECCI prend des vessies pour des lanternes.
d/ Enfin et surtout, la vision développée par la FECCI pour expliquer le développement du capitalisme d'Etat est celle d'un mécanisme strictement économique, une adaptation à un mode d'organisation de la production alors que le capitalisme d'Etat est une réaction d'un système qui craque de toute part et qui est obligé de blinder ses structures sur tous les plans tant social, politique, économique et militaire. Aspects que la FECCI se garde bien d'aborder.
S'il y a bien une chose sur laquelle Communisme ou Civilisation a raison c'est lorsqu'il parle de l'avenir de la FECCI en ces termes: "La FECCI a entrepris de penser, pour l'instant en se débattant dans les insurmontables contradictions de la théorie de la décadence, et elle ne fait que resserrer le noeud coulant qui l'étrangle. A toute cette agitation théorique il n'existe que deux issues: ou la FECCI rompra avec la théorie de la décadence, ou ce qui est pour l'instant plus probable, elle s'arrêtera de penser par elle même" (n°22 p24).
Toutes les décadences antérieures ont connu un arrêt de l'expansion géographique de leurs rapports sociaux de production et un frein dans l'intégration de forces de travail à ces derniers. Arrêt de l'expansion romaine, diminution de la population, expulsion croissante de travailleurs du processus de production, développement de nouveaux rapports de production à la périphérie de l'empire romain, tel est le tableau de la décadence de Rome. Arrêt des défrichements, stagnation de la population, émigration, fuite des paysans vers les villes, développement des rapports de production capitaliste, tel est le tableau de la décadence féodale.
Un processus analogue se développe au sein de la décadence du capitalisme (hormis pour le développement de nouveaux rapports de production qui ne pourront s'instaurer qu'après la prise du pouvoir au niveau mondial). En phase ascendante, l'existence de marchés vierges à conquérir, tant internes qu'externes, le faible capital nécessaire au démarrage industriel, la faiblesse de la pénétration du capital des pays dominants, permettaient à divers pays d'accrocher les wagons de leur économie au train de la révolution industrielle et d'acquérir une réelle indépendance politique.
TABLEAU 2
Evolution de l'écart entre le P.N.B./habitant des pays sousdéveloppés et développés de 1850 à 1980. Source: P. Bairoch et Banque, Mondiale.
Écart moyen
1850 1/5
1900 1/6
1930 1/7.5
1950 1/10
1970 1/14
1980 1/16
Depuis, la situation s'est quasi figée, les conditions économiques de la décadence n'offrent plus de possibilités réelles d'émergence et de développement de nouveaux pays, pire, l'écart relatif entre les premiers pays industrialisés et les autres se creuse.
Alors que l'écart est quasi constant au cours de la phase ascendante il saute de 1 à 6 à 1 à 16 en décadence. Bairoch, dans son livre "Le Tiers-monde dans l'impasse" (Ed. Idées/Gallimard, 1971) a publié un tableau illustrant l'arrêt de l'expansion géographique de la révolution industrielle et de la réduction relative de la population (!) touchée par celle-ci dans la décadence du capitalisme.
TABLEAU 3
Dates Nombre de pays: Pourcentage de la population mondiale:
1700 0 0
1760 1 1
1800 6 6
1860 11 14
1930 28 37
1960 28 32
1970 28 30
Alors qu'en phase ascendante la population intégrée au processus productif croissait plus rapidement que la population elle-même, aujourd'hui c'est au rejet d'une masse grandissante de travailleurs en dehors du système que nous assistons. Le capitalisme a achevé son rôle progressif notamment au travers de la fin du développement d'une des principales forces productives: la force de travail. Communisme ou Civilisation a beau nous bassiner des pages de sa prose avec des chiffres qui montrent l'augmentation plus importante dans la décadence de la part des salariés dans la population active pour la ... France ([13] [1411]) cela ne change rien à la réalité du phénomène au niveau mondial (seule échelle valable pour appréhender le phénomène). A ce niveau les chiffres de la population active avancés par Communisme ou Civilisation ne démontrent rien du tout... si ce n'est l'explosion démographique du Tiers-Monde ! En effet, la population active n'est en rien un indicateur d'intégration de la population aux rapports de production capitaliste, il mesure tout simplement un rapport démographique de classes d'âges des actifs (15 ou 20 ans à 60 ou 65 ans selon les définitions) sur la population totale ([14] [1412]). Si Communisme ou Civilisation se donnait la peine de raisonner, d'apprendre à lire des statistiques et à compter, il constaterait, ce qu'il entre-aperçoit au détour d'une phrase, l'ampleur du développement de cette "..masse croissante de sans réserves absolus qui n'ont d'autre ressources que de mourir de faim.." (p46).
Dans une prochaine contribution, nous développerons les bases qui ont rendu possible la reconstruction d'après guerre et ainsi répondre au 3ème type d'arguments qui nous sont rétorqués (taux de croissance « faramineux » consécutifs à la seconde guerre mondiale). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut du capitalisme dans sa phase de décadence est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc...) pour la réaliser viennent à épuisement ouvrant la porte à une crise sans précédent. Nous montrerons également que derrière le rejet de la notion de décadence, se cache en réalité le rejet de la conception marxiste de l'évolution de l'histoire qui fonde la nécessité du communisme.
C.McI
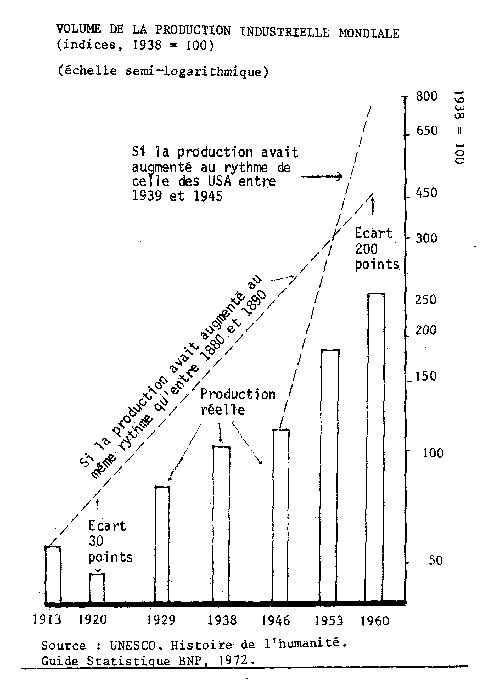
[1] [1413] GCI : Groupe Communiste Internationaliste en Belgique, qui publie la revue Le Communiste (LC). , Bp 54, Bxl 31, lOGO Bruxelles
[2] [1414] FOR: Ferment ouvrier Révolutionnaire. Cedex 13, France, qui publie la revue Alarme, BP 329, 75624 Paris
[3] [1415] F.E.C.C.L: Fraction Externe du CCI, B.P. 1181 / 1000 Brux. / Belgique, qui publie la revue Perspective Internationaliste (P.L).
[4] [1416] CoC: Communisme ou Civilisation, B.1'. 88 / 75722 Paris Cedex 15 / France, qui publie la revue du même nom.
[5] [1417] A.C.C.: A Contre Courant, B.P. 1666 / Centre monnaie / 1000 Bruxelles / Belgique, qui publie la revue du même nom.
[6] [1418] Fondateur et chef de file du P.C. d'Italie pendant ses premières années d'existence. Ensuite, après une éclipse politique, animateur du P.C. Internationaliste (1946) aujourd'hui disparu.
[7] [1419] Pourcentage calculé à l'aide de la série du P.N.B.M. (1750-1980) de Bairoch P. ("International Industrial levels from 1750 to 1980" in Journal of european economic history) et des statistiques du S.I.P.R.I. sur les dépenses militaires mondiales depuis 1908 jusqu'à nos jours.
[8] [1420] En G-B le sommet en effectif et en production du travail domestique et artisanal se situe autour de 1820. En France, autour de 1865-70. En Belgique, second pays à connaître la révolution industrielle après l'Angleterre, il y a en 1846, 406.000 travailleurs travaillant dans l'industrie mais encore 225.000 travailleurs à domicile (plus encore si l'on compte les travailleurs occasionnels). (Données tirées de Dockès P. et Rosier B. in "Rythmes économiques", Ed. Maspéro; et thèse de Doctorat, inédite, de Vandermotten C. sur l'industrialisation de la Belgique).
[9] [1421] "Le capital trouve à vendre ses marchandises à l'extérieur de sa propre sphère. Il produit pour les paysans lorsque la montée du capitalisme agraire ne les a pas pratiquement remplacé par des salariés agricoles, comme en Angleterre, il produit pour les fermiers, pour les propriétaires fonciers, pour les autres rentiers, pour les classes "moyennes" commerçantes et artisanales (...) Lorsque le salariat se développe -seulement dans les années 1850-1860- en France, mais beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne- sans qu'augmente suffisamment sa puissance consommatrice, lorsque la paysannerie se prolétarise et que l'importance de l'agriculture décline relativement (le cas de la GB), avec ses revenus et ses rentes foncières, une "solution" provisoire devra être et sera trouvée dans l'impérialisme et le colonialisme. Il y a là une explication possible de la précocité colonialiste britannique, mais à la fin du siècle, tous les pays capitalistes se conduiront de même. Rosa Luxemburg, comme d'ailleurs les capitalistes et les hommes politiques de ce temps (de Disraeli à Jules Ferry), comprend qu'il faut chercher là des débouchés pour les produits finis, ouvrir du même coup des perspectives de profits et donc développer sur cette base une demande interne de biens d'équipement (...) La grande dépression des années 1880 nous montre déjà les limites de la réalisation par la demande paysanne, d'où l'intensification des luttes impérialistes pour trouver à tout prix des acheteurs extérieurs. La grande dépression des années 1930, comme nous le verrons, est, de façon caractéristique, une crise de réalisation interne". (Rosier B., op. cité, p73 et 69).
[10] [1422] Dans le capitalisme le prolétariat cumule ces deux caractéristiques, c'cst à dire d'être à la fois la classe exploitée et la future classe révolutionnaire, ce qui n'était pas le cas pour tous les modes de production antérieur.
[11] [1423] Ces trois graphiques sont illustratifs d'une évolution qui est identique pour tous les pays. Pour d'autres graphiques et pour plus de renseignements, se référer au n°390, 1983/1, de la revue "Statistiques et Etudes financières":
"Matériaux pour une comparaison internationale des dépenses publiques en longues période".
[12] [1424] G.P.L: Grupo Proletario Intemacionalista du Mexique (écrire à notre boîte postale). Pour une présentation de ce nouveau groupe révolutionnaire lisez la Revue Internationale n°52.
[13] [1425] Ce pays constitue d'ailleurs une exceptiônpour iliustrer ce proreagus. Après 1871, avec les accords de Méline, la bovrgeoisie-dût s'appuyer-sur la fraction aisée de la paysannerie pour asseoir son pouvoir face à l'aristocratie.
La contre-partie à payer en fut le frein de la pénétration du capitalisme dans les campagnes. Ainsi, la France se retrouve en décadence avec une part importante de sa population active dans la petite agriculture (40% en 1930) contrairement aux autres pays (moins de 10% dès 1914 pour la GB). II n'est donc pas si étonnant de constater une telle croissance de la part des salariés dans la population active en décadence.
[14] [1426] De plus, la comparaison de CoC est dénuée de sens dans la mesure ou les actifs en 1750 sont en grande majorité sous d'autres rapports de production que capitalistes.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Polémique : La confusion des groupes communistes sur la période actuelle
- 2928 reads
LA SOUS-ESTIMATION DE LA LUTTE DE CLASSE
Dans sa lutte contre le capitalisme, en vue de son renversement et de l’édification de la société communiste, la classe ouvrière secrète des organisations politiques qui, non seulement expriment son devenir révolutionnaire, mais sont la condition indispensable de celui-ci. Si les buts généraux exprimés par ces organisations, leur programme, ne sont pas sujets à des fluctuations dans le temps, sinon à un constant enrichissement, les formes qu'elles prennent, leur impact, les moyens d'action et le mode d'intervention qu'elles se donnent dépendent, en revanche, des conditions historiques spécifiques dans lesquelles agit la classe, et tout particulièrement du rapport de forces existant entre elle et la classe ennemie. En d'autres termes, il ne suffit pas à une organisation communiste de défendre un programme révolutionnaire pour être un instrument efficace dans le développement de la lutte du prolétariat. Elle n'y parviendra réellement que si elle comprend les tâches qui lui incombent dans chacun des moments spécifiques de ce développement et si elle est capable, donc, d'analyser de façon correcte ces différents moments. Et c'est justement une question sur laquelle la plupart des organisations actuelles se situant sur un terrain de classe prolétarien éprouvent les plus grandes difficultés à s'orienter. En particulier des points aussi fondamentaux que le développement de la crise économique du capitalisme et les perspectives qui en découlent pour l'ensemble de la vie de la société : guerre impérialiste mondiale ou généralisation des combats de classe, constituent pour la plupart de ces organisations des sujets d'une énorme confusion alors que la plus grande clarté est plus que jamais indispensable pour contribuer au développement des combats présents de la classe ouvrière.
Ces derniers mois les confusions considérables qui pèsent sur le milieu politique prolétarien ont eu l'occasion de se manifester sous forme d'une sorte de tir groupé de plusieurs organisations contre les positions du CCI. Assurément, ce n'est pas de façon concertée que ces différentes organisations ont développé leurs attaques, mais cette simultanéité trouve en partie son origine dans une commune incapacité à apprécier la véritable importance des combats que mène à l'heure actuelle la classe ouvrière ([1] [1427]). Parmi ces attaques, certaines comme celles du Groupe Communiste Internationaliste dans le n°26 du Communiste ([2] [1428]), se situent sur un terrain d'une telle bassesse qu'elles ne sauraient donner lieu à une réponse dans le cadre de cet article de débat. De même, si on trouve dans le n°39 d'Alarme (publiée par le Ferment Ouvrier Révolutionnaire) et dans le n°10 de Perspective Internationaliste (publié par la "Fraction Externe du CCF), toute une série d'articles qui sont consacrés à notre organisation, et si les positions qui s'y expriment sont en partie tributaires d'une sous-estimation de l'importance des combats actuels de la classe ouvrière, nous n'y répondrons pas directement dans cet article car, sur cette question, nous avons affaire avec ces organisations à des caricatures (le FOR est probablement la seule organisation au monde qui reste encore incapable de reconnaître l'existence de la crise économique du capitalisme, ce qui est vraiment le comble quand on se veut "marxiste", et la FECCI, pour sa part, ne fait pas autre chose que nous présenter une caricature des positions du CCI). Plutôt que de nous attaquer à ces caricatures, il nous semble plus profitable, pour la clarté des questions que nous nous proposons d'aborder dans cet article, de nous intéresser à d'autres textes de polémique publiés récemment qui ont le mérite, outre qu'ils émanent d'organisations plus sérieuses que celles qu'on vient de citer, de présenter une orientation élaborée nettement différente de celle du CCI et représentant de façon claire la sous-estimation générale de la portée des combats actuels de la classe ouvrière. Ces articles nous les trouvons dans le n°4 de Comunismo, revue publiée par les camarades de l'ancien Colectivo Comunista Alptraum, et dans le n° ll (décembre 87) de Prometeo publié par le Par-tito Comunista Intemazionalista (Battaglia Comunista). Il s'agit, dans le premier cas, d'une lettre envoyée par la Communist Workers' Organisation (qui est associée au PCInt au sein du Bureau International Pour le Parti Révolutionnaire) au CCA à propos du communiqué de cette organisation "Sur les grèves récentes au Mexique" (avril 87) dont nous avons publié de larges extraits dans la Revue Internationale n°50. Dans le second cas, il s'agit d'un article intitulé "La crise du capital entre objectivité historique et subjectivité de classe" ("La crisi del capitale traoggettivita storica e sog-gettivita di classe") qui attaque, sans nommer à aucun moment le CCI, notre analyse du rapport de forces actuel entre bourgeoisie et prolétariat et particulièrement notre conception du cours historique.
Dans la mesure où la question du cours historique est la clé de voûte de toute compréhension de l'évolution présente de la lutte de classe, et bien que nous l'ayons déjà souvent abordée dans ces colonnes (en particulier dans la Revue Internationale n°50 où nous répondions déjà à un article de Battaglia Comunista n°3 de mars 87 intitulé "Le CCI et le cours historique, une méthode erronée"), nous devons y revenir ici pour mettre en évidence les absurdités auxquelles on est conduit lorsqu'on est incapable d'avoir une vision claire sur ce problème.
"Battaglia Comunista et le cours historique, une méthode inexistante
L'analyse du CCI sur la question du cours historique a été maintes fois exprimée dans l'ensemble de nos publications. On peut la résumer ainsi : dans la période de décadence du capitalisme qui débute avec le siècle, les crises ouvertes de ce mode de production, comme la crise des années 30 et la crise présente, n'offrent, du point de vue du capitalisme, d'autre perspective que la guerre impérialiste mondiale (1914-1918 et 1939-1945). La seule force qui puisse empêcher le capitalisme de déchaîner une telle "issue" est la classe ouvrière dont la bourgeoisie doit s'assurer de la soumission avant que de se lancer dans la guerre mondiale. Contrairement à la situation des années 30, la classe ouvrière d'aujourd'hui n'est pas défaite ni embrigadée derrière les idéaux bourgeois comme l'anti-fascisme, et c'est la combativité qu'elle a manifestée depuis une vingtaine d'années qui seule permet d'expliquer que la guerre mondiale n'ait pas encore été déclenchée.
Pour sa part, le PCInt partage une partie de cette analyse comme on peut le voir dans le passage qui suit :
"Le monde est constellé de telles tensions qui souvent dégénèrent en conflits ouverts (depuis sept ans fait rage la guerre entre l'Iran et l'Irak) et qui prennent les formes les plus variées (des coups d'Etat aux luttes de "libération nationale", etc.) : c'est là le signe des difficultés rencontrées par le capitalisme pour résoudre les questions internes au marché mondial
La crise pousse à une concurrence encore plus impitoyable. Dans les périodes "normales" les coups sont moins douloureux. Dans les périodes critiques les coups augmentent en fréquence et intensité et, de ce fait, très souvent, ils engendrent des ripostes. Pour survivre, le capitalisme ne peut qu'employer la force. Un coup aujourd'hui, un coup demain, on en arrive de cette façon à une situation véritablement explosive dans laquelle les conditions de la dégénérescence (élargissement et généralisation des conflits localisés) se trouvent désormais à l'ordre du jour. La phase qui conduira au déchaînement d'une nouvelle et terrifiante pierre impérialiste est ouverte.
POURQUOI LA GUERRE "MONDIALE" N'A-T-ELLE PAS ENCORE ECLATE ?
Tous les épisodes d'affrontements entre Etats, puissances et superpuissances nous indiquent qu'existe déjà la tendance qui nous conduira vers un troisième conflit mondial. Au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée. Au niveau subjectif, de façon évidente, il n'en est pas ainsi. Le processus par lequel se meuvent les forces de la subjectivité est asymétrique par rapport à celui avec lequel s'exprime la situation historique objective* S'il n'en était pas ainsi, la guerre aurait déjà éclaté depuis un certain temps et des épisodes comme celui du Golfe persique, parmi d'autres, auraient pu constituer des motifs valables pour le déchaînement du conflit. Mais en quoi se manifeste le décalage entre les aspects subjectifs et le processus qui implique tout le monde de la structure ?"
On pourrait s'attendre à ce que BC fasse ici intervenir le prolétariat comme élément "subjectif" surtout qu'on trouve ailleurs dans le texte l'affirmation suivante :
"Il est clair qu'aucune guerre ne pourra jamais être menée sans la disponibilité (au combat et dans la production de guerre) du prolétariat et de toutes les classes laborieuses. Il est évident que, sans un prolétariat consentant et embrigadé, aucune guerre ne serait possible. Il est évident, de même, qu'un prolétariat en pleine phase de reprise de la lutte de classe serait la démonstration du surgissement d'une contre tendance précise, celle de l'antithèse à la guerre, celle de la marche vers la révolution socialiste. "
Cependant, BC poursuit ainsi :
"Nous sommes en présence, malheureusement, d'un phénomène inverse. Nous avons une crise à un niveau de gravité extrêmement élevé. La tendance à la guerre avance d'un pas rapide mais le niveau de l'affrontement de classe, par contre, est absolument en dessous de celui imposé par la situation objective ; il est en dessous de ce qui serait nécessaire pour repousser les pesantes attaques lancées par le capitalisme contre le prolétariat international. " (page 34)
Dans la mesure où la lutte du prolétariat ne permet pas, aux yeux de BC, d'expliquer le fait que la guerre n'ait pas encore eu lieu voyons par conséquent qu'elles sont les causes subjectives de ce "retard" :
"L'attention doit se tourner principalement vers des facteurs qui transcendent les initiatives particulières pour être situés dans un processus plus vaste qui voit les équilibres internationaux non encore définis et tracées en fonction de ce que seront les coalitions guerrières proprement dites, coalitions qui sont appelées à constituer les fronts de la guerre... Mais tout le cadre des alliances est encore assez fluide et plein d'inconnues. Le développement de la crise ne manquera pas de tracer de profonds sillons à l'intérieur desquels se glisseront les intérêts de chacun, qui iront s'y réunir avec ceux des autres. En un processus inverse et parallèle, le heurt des intérêts opposés tracera une ligne de division entre Etats qui se retrouveront dans des camps opposés de chaque côté de la barricade...
"Un autre aspect à prendre en considération est la dissuasion que représente la question nucléaire. Une guerre se déroulant dans les conditions historiques de prolifération maximale des armes nucléaires devient problématique pour un quelconque, hypothétique front militaire. La théorie du "suicide collectif, vers laquelle imprudemment et sentencieusement s'étaient tournés les apocalyptiques de service, s'est révélée - et il ne pouvait en être autrement - absolument dépourvue de fondement. Le retard dans le déclenchement de la guerre trouve une de ses causes dans l'absence d'un désarmement nucléaire (même partiel) auquel semblent vouloir parvenir, dans un proche avenir, les plus hauts représentants des plus grandes puissances impérialistes.
La rencontre au sommet entre Reagan et Gorbatchev, claironnée comme une volonté tenace de paix, se présente en réalité comme un sommet destiné à faire tomber les dernières barrières qui empêchaient la guerre d'éclater. Et cela en faisant abstraction de ce que peuvent penser réellement et subjectivement Reagan et Gorbatchev. La guerre naît de causes objectives. Les facteurs subjectifs n'en sont que des effets induits qui peuvent être, suivant les cas, retardés ou accélérés mais jamais empêchés." (page 34)
Il semble que nous ayons dans ces passages la quintessence de la pensée de Battaglia puisque ces deux idées apparaissent en de multiples occasions dans la presse de cette organisation. Il importe donc de les examiner de façon attentive. Nous commencerons par la plus sérieuse (en essayant de la formuler d'une façon un peu plus simple que ne le fait BC chez qui la boursouflure du langage semble avoir pour fonction de masquer l'indigence et l'imprécision des analyses).
"Si la guerre mondiale n'a pas encore eu lieu c'est parce que les alliances militaires ne sont pas encore suffisamment constituées et stabilisées".
Preuve qu'il s'agit là d'un point important dans l'analyse du PCInt, cette idée est reprise une nouvelle fois, et de façon détaillée, dans un tout récent article de Battaglia Comunista (^'Accord USA-URSS, Un nouveau pacte Molotov-Ribben-trop ?" dans BC n°5) où cet accord est supposé chercher "à délimiter, dans cette phase, les aires et les intérêts plus directement en conflit entre les USA et l'URSS et à permettre aux deux de concentrer les ressources et les stratégies à différents niveaux .et préparer de nouveaux et plus stables équilibres et systèmes d'alliances, en vue d'un futur affrontement plus profond et généralisé," De même on peut lire plus loin que "...l'aggravation de la crise générale du mode de production capitaliste...ne pouvait pas ne pas provoquer l'approfondissement des motifs de conflits entre les partenaires atlantiques même, et en particulier entre ceux qu'on appelle les 7 grands". Enfin, toute cette "démonstration" aboutit à la conclusion que "Tout cela (l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché mondial) ne peut que favoriser ultérieurement la guerre commerciale de tous contre tous, basée sur le dumping les contingentements, le protectionnisme, les accords secrets sur le dos d'autres rivaux, etc., mais aussi la formation de nouvelles agrégations d'intérêts tendant à leur concrétisation en alliances politico-militaires dont les nouveaux axes préférentiels trouveront leur place ou bien à différents niveaux au sein du même système, qui va en se déstructurant malgré les déclarations contraires et les diverses proclamations de "fidélité" durable, ou bien dans la perspective de possibles changements de camp,"
Cette analyse n'est pas nouvelle. Par le passé nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises, notamment sous la forme développée par le groupe (aujourd'hui disparu) Pour une Intervention Communiste qui parlait de la tendance à "l'effritement" et à la recomposition des blocs en fonction des rivalités commerciales. De son côté, le PIC ne faisait que reprendre la thèse développée par le courant "bordiguiste" qui aboutissait à considérer que ces rivalités commerciales allaient provoquer une dislocation du bloc occidental et la formation d'une alliance entre les pays d'Europe de l'Ouest et l'URSS. Enoncée depuis plusieurs décennies, cette prévision attend encore sa réalisation. Précisons, pour compléter ce rappel, que le PIC attribuait, pour sa part, cette tendance vers la "dislocation des blocs" à... la force du développement de la lutte de classe (!) ce qui, évidemment, ne saurait être le cas de Battaglia.
A de nombreuses reprises dans notre presse, nous avons fait justice de la thèse suivant laquelle les blocs impérialistes se constituent directement sur la base des rivalités commerciales ([3] [1429]). Nous ne reviendrons pas ici sur les arguments que nous avons développés pour réfuter cette analyse. Nous nous contenterons de rappeler que cette question n'est pas nouvelle dans le mouvement ouvrier et qu'elle a fait en particulier l'objet d'un débat au sein de l'Internationale Communiste où Trotski fut conduit à combattre la thèse majoritaire suivant laquelle les deux têtes de bloc pour la seconde guerre mondiale devaient être les USA et la Grande Bretagne qui, à l'époque, constituaient les deux principales puissances commerciales concurrentes ([4] [1430]). L'histoire s'est chargée (avec quel sinistre éclat !) de valider la position de Trotski en confirmant que le lien - réel - existant entre exacerbation des rivalités commerciales et aggravation des antagonismes militaires n'est pas de nature mécanique. En ce sens, le système d'alliances existant à l'heure actuelle entre grandes puissances ne saurait être remis en cause par l'aggravation de la guerre commerciale entre tous les pays. Bien que les USA, le Japon et l'Europe occidentale constituent les principaux rivaux sur un marché mondial où la lutte pour les débouchés se fait chaque jour plus vive et impitoyable, cela ne saurait remettre en cause leur appartenance à la même alliance militaire.
Il faut donc être clair sur le fait que si la guerre mondiale n'a pas encore éclaté, cela n'a rien à voir avec une quelconque nécessité de modification ou de renforcement des alliances existant à l'heure actuelle. C'est vrai que les deux premières guerres mondiales ont été précédées de toute une série de conflits locaux et d'accords qui participaient de sa préparation et qui ont permis que se dégagent les alignements de l'affrontement généralisé (par exemple la constitution de la "Triple Entente" Grande-Bretagne-France-Russie au début du 20ème siècle et la création de l'"Axe" Allemagne-Italie au cours des années 30). Mais pour ce qui concerne la période historique actuelle, ces "préparatifs" se sont déroulés depuis des décennies déjà (en fait dès le lendemain de la seconde guerre mondiale avec l'ouverture de la "Guerre Froide") et il faut remonter à plus de vingt ans (rupture entre l'URSS et la Chine au début des années 60 et intégration de ce dernier pays dans le bloc occidental à la fin de cette décennie) pour constater un changement d'alliances important. En fait, à l'heure actuelle, les alliances impérialistes sont bien plus solidement constituées que celles existant à la veille des deux guerres mondiales où l'on a vu des pays majeurs entrer dans le conflit bien après qu'il se soit engagé (Italie en mai 1915, Etats-Unis en avril 1917, lors de la première, URSS en juin 1941, Etats-Unis en décembre 1941, lors de la seconde). De plus, chacun des deux blocs dispose depuis de très nombreuses années d'un commandement unique de l'essentiel de son dispositif militaire (OTAN dès avril 1949, Pacte de Varsovie en mai 1955), alors qu'un tel commandement unique n'a été créé (et uniquement par les puissances occidentales au niveau du front européen) que dans la seconde partie des deux guerres mondiales.
Ainsi, affirmer qu'aujourd'hui les préparatifs diplomatiques ou militaires pour une troisième guerre mondiale ne seraient pas encore achevés, c'est faire preuve d'une incroyable méconnaissance de l'histoire de ce siècle, ce qui est impardonnable pour une organisation révolutionnaire. Mais encore plus impardonnable est la thèse suivant laquelle :
"C'est l'existence des armements atomiques, du fait de la dissuasion qu'ils représentent, qui explique que la guerre mondiale n'ait pas encore eu lieu."
Est-il possible que des révolutionnaires sérieux puissent encore croire une telle fable ? La bourgeoisie l'a racontée un certain temps lorsqu'il s'agissait pour elle de déployer les arsenaux nucléaires. En particulier, la stratégie dite de "représailles massives", d'"équilibre de la terreur", était sensée agir comme moyen de dissuasion : dès lors qu'un pays aurait utilisé la bombe atomique, ou même qu'il aurait menacé les intérêts vitaux d'un autre, il s'exposerait à la destruction de ses principales concentrations urbaines et industrielles dans l’heure suivante. L'arme la plus meurtrière dont l'humanité se soit jamais dotée, aurait eu comme mérite d'empêcher désormais toute guerre mondiale. Qu'un tel mensonge ait pu avoir un certain impact sur des populations ayant des illusions sur la "raison" des gouvernements, et plus généralement dans la "rationalité" du système capitaliste, s'explique encore. Mais qu'aujourd'hui, alors que tous les derniers développements des armements nucléaires (bombes à neutrons, obus nucléaires, missiles à courte portée, missiles de "croisière" capables d'atteindre leur cible à quelques mètres près, programme de "la guerre des étoiles"), de même que l'élaboration de stratégies dites de "riposte graduée" (c'est la doctrine officielle de l'OTAN) font la preuve que les gouvernements et les états-majors envisagent sérieusement de mener une guerre atomique en vue de la "gagner", il se trouve encore des révolutionnaires qui se veulent "marxistes" pour croire et véhiculer de telles sornettes est proprement sidérant. Et pourtant, c'est malheureusement le cas avec nos camarades de "Battaglia" qui, sur ce point, défendent des absurdités dignes de celles du FOR lorsqu'il nie que le capitalisme soit aujourd'hui en crise. Car, la thèse qu'on trouve dans le n°11 de Prometeo n'est pas une erreur de plume, un raté d'un camarade un peu farfelu qui aurait échappé à la vigilance de l'organisation. Elle était déjà exposée avec encore plus de détail dans un article du n°4 de Battaglia Comunista (avril 86) intitulé 'Premières notes sur la guerre prochaine" où l'on peut lire :
"Un autre facteur à ne pas sous-évaluer, parmi ceux concourant à la dilatation des temps de préparation de la guerre ([5] [1431]), est le chantage nucléaire, dans la mesure où l'affrontement direct entre les blocs ne peut raisonnablement dépendre du hasard des moments de plus grande tension entre les deux superpuissances, sous peine du risque-certitude de l’extinction de la vie sur la terre. "Le jour après la signature de l'accord sur le non-emploi des armes nucléaires, la guerre sera déclarée" est une boutade désormais classique entre nous et qui a tout le goût de la vérité. "
Nos camarades de Battaglia peuvent trouver à cette boutade le goût qu'ils veulent ; pour notre part nous dirons que leurs remarques ont "tout le goût" d'une naïveté affligeante. En effet, quel est le scénario-fiction que nous proposent les articles d'avril 86 dans BC et de décembre 87 dans Prometeo ? En poursuivant le processus de "désarmement nucléaire" engagé par l'accord de Washington de décembre 87 ([6] [1432]), les deux super-puissances parviennent à une élimination totale des armements nucléaires ou bien à un accord de non-emploi de ces armements. Elles ont alors les mains libres pour déchaîner la guerre mondiale sans danger d"'extinction de la vie sur terre" dans la mesure où elles font confiance à leurs ennemis pour ne pas utiliser les armements prohibés ou pour n'en avoir pas conservé en secret. On peut se demander pourquoi les deux blocs, qui sont décidés à être "fair-play" en tout état de cause, n'ont pas poursuivi leur démarche de désarmement en éliminant ou en interdisant l'utilisation des armements conventionnels les plus meurtriers. Après tout, l'un et l'autre sont intéressés à limiter au maximum les destructions que pourraient provoquer ce type d'armements dont les ruines et les massacres de la seconde guerre mondiale ne nous donnent qu'une très faible idée. Et il n'y a pas de raison que les dirigeants du monde s'arrêtent en si bon chemin. Certes, ils n'ont pas renoncé à se faire la guerre puisque nous vivons toujours dans le capitalisme et que les antagonismes entre bourgeoisies rivales subsistent et s'attisent avec l'aggravation de la crise économique. Mais animés par le même souci initial que cette guerre soit la moins meurtrière possible, ces dirigeants en viennent progressivement à s'interdire tout emploi des armements modernes qui tous sont très meurtriers : interdiction des missiles, de l'aviation, des bombardements, de l'artillerie lourde, puis, sur la lancée, interdiction de l'artillerie légère, des mitrailleuses et, pourquoi pas, des armes à feu... On connaît la phrase célèbre : "Si la troisième guerre mondiale a lieu, la quatrième se déroulera avec des bâtons". La perspective qui se dégage de l'analyse de Battaglia est légèrement différente : c'est la troisième guerre mondiale qui se fera avec des bâtons. A moins qu'elle ne se déroule sous la forme d'un combat singulier, "à la loyale", entre les deux chefs d'Etat Major comme cela se pratiquait parfois au Moyen Age ou dans l'Antiquité. Si l'arme choisie était le jeu d'échecs, l'URSS aurait alors quelque chance de gagner la guerre.
Il va sans dire que les camarades de Battaglia ne racontent ni ne pensent de telles sornettes : ils ne sont pas fous. Mais ce conte de fées découle logiquement de l'idée qui se trouve au centre de leur "analyse" : la bourgeoisie est capable de se fixer des règles de "tempérence" dans l'utilisation de ses moyens de destruction, elle est disposée à respecter les traités qu'elle signe, et cela même quand elle est prise à la gorge, même quand ses intérêts vitaux sont menacés. Les deux guerres mondiales sont pourtant là pour montrer que tous les moyens dont dispose le capitalisme sont bons dans la guerre impérialiste, y compris - et surtout - les plus meurtriers ([7] [1433]), y compris les armes nucléaires (nos camarades ont-ils oublié Hiroshima et Nagasaki ?). Nous ne prétendons pas qu'une troisième guerre mondiale devrait commencer d'emblée avec l'utilisation des armes de l'Apocalypse. Mais nous devons être sûrs que la bourgeoisie qui se retrouverait acculée le dos au mur après l'utilisation es armes conventionnelles, finirait par les employer quels Sue soient les traités qu'elle aurait pu signer auparavant. De même, il n'existe aucune chance pour que les .(très minimes) réductions actuelles des armements nucléaires puissent aboutir un jour à leur élimination totale. Aucun des deux blocs, et particulièrement celui qui se trouve en état d'infériorité technologique dans le domaine des armements conventionnels, le bloc de l'Est, ne consentira jamais à se démunir complètement de l'arme qui constitue son dernier recours, même s'il sait pertinemment que l'utilisation de cette arme signifie son propre arrêt de mort. Et cela n'a rien à voir avec un quelconque "comportement suicidaire" des dirigeants du monde capitaliste. C'est le système comme un tout, dans la barbarie engendrée par sa décadence, qui mène l'humanité vers son autodestruction ([8] [1434]). En ce sens, l'article de Prometeo a tout à fait raison de souligner que le processus qui conduit à la guerre généralisée ne résulte pas "de ce que peuvent penser réellement et subjectivement Reagan et Gorbatchev" et que "la guerre naît de causes objectives". Le PCInt connaît les fondements du Marxisme. Le problème c'est qu'il lui arrive de les "oublier" et de se laisser piéger par les mystifications bourgeoises les plus éculées.
Ainsi on peut constater que pour tenter de défendre son analyse sur le cours historique actuel, le PCInt en est conduit non seulement à aligner contradiction après contradiction, mais aussi à "oublier" l'histoire du 20ème siècle et, plus grave encore, un certain nombre d'enseignements fondamentaux du marxisme au point de reprendre à son compte, avec la plus grande des naïvetés, un certain nombre des illusions répandues par la bourgeoisie pour peindre son système en rose.
La question qu'il faut donc se poser est donc : comment se fait-il qu'une organisation communiste, qui pourtant base ses positions sur le marxisme et qui connaît l'expérience du mouvement ouvrier soit victime de tels "trous de mémoire" et fasse preuve d'autant de naïveté vis à vis des mystifications capitalistes ? La réponse, nous la trouvons en partie dans l'article publié par BC n°5 de mars 87 et en Anglais dans la Communist Revue n°5 intitulé "Le CCI et le cours historique : une méthode erronée". Nous avons déjà répondu à cet article dans la Revue Internationale n°50. En particulier, nous avons rectifié un certain nombre d'erreurs sur l'histoire du mouvement ouvrier, et notamment sur l'histoire de la Fraction de Gauche du Parti Communiste dont pourtant se réclame en partie le PCInt. Il sera donc inutile d'y revenir longuement ici. Nous nous contenterons de mettre en évidence la complète incompréhension par le PCInt de la notion même de cours historique.
Cours historique ou cours fluctuant ?
Dans cet article, le PCInt écrit :
"Le procédé implicite du raisonnement du CCI est le suivant : pour toutes les années 30 le cours était vers le guerre impérialiste de façon univoque, comme le disait la Fraction en France. Cette période est terminée, révolue : maintenant le cours est de façon univoque vers la révolution (ou vers les affrontements qui la rendent possible).
C'est sur cette question nodale; ce point méthodologique, que nous divergeons de façon extrêmement profonde... La Fraction (particulièrement sa Commission Exécutive et, en son sein, Vercesi) évaluait dans les années 30 la perspective vers la guerre comme un absolu. Avait-elle raison ? Certes, l'ensemble des faits lui ont donné raison. Mais même alors, le fait de considérer le "cours' comme quelque chose d'absolu a conduit la Fraction à commettre des erreurs politiques...
L’erreur politique fut la liquidation de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne avant même que le prolétariat ait été réellement défait...
L'erreur de méthode qui la soutenait se situait dans l’"absolutisation" du cours, dans l'exclusion méthodologique de toute possibilité de surgissements prolétariens significatifs dans lesquels pouvaient intervenir les communistes de façon active en vue de la perspective, toujours ouverte dans la phase impérialiste, d'une rupture révolutionnaire. "
Effectivement, c'est là le coeur de la divergence entre le PCInt et le CCI bien que, comme il est normal, le PCInt n'ait pas tout à fait compris notre analyse ([9] [1435]). En particulier, nous n'établissons pas une complète symétrie entre un cours à la guerre et un cours aux affrontements de classe, de même que nous ne prétendons pas qu'un cours ne puisse s'inverser :
"...ce que nous voulons dire par cours aux affrontements de classe est que la tendance à la guerre -permanente en décadence et aggravée par la crise - est entravée par la contre-tendance aux soulèvements prolétariens. Par ailleurs, ce cours n'est ni absolu ni éternel: il peut être remis en question par une série de défaites de la classe ouvrière. En fait, simplement parce que la bourgeoisie est la classe dominante de la société, un cours vers les affrontements de classe est plus fragile et réversible qu'un coure à la guerre." (Revue Internationale n°50, "Réponse à Battaglia Comunista sur le cours historique'1)
"L'existence d'un cours vers la guerre, comme dans les années 30, signifie que le prolétariat a subi une défaite décisive qui l'empêche désormais de s'opposer à l'aboutissement bourgeois de la crise. L'existence d'un cours à "l'affrontement de classes" signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale ; auparavant elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de l'issue de cet affrontement, ni dans un sens ni dans un autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de "cours à la révolution"." (Revue Internationale n°35, "Résolution sur la situation internationale" du 5ème congrès du CCI, juillet 83)
Ceci étant rappelé, on peut donc voir facilement où se situe la divergence. Quand nous parlons d'un "cours historique" c'est pour qualifier une période... historique, une tendance globale et dominante de la vie de la société qui ne peut être remise en cause que par des événements majeurs de celle-ci (telle la guerre impérialiste, comme ce fut le cas au cours de la première mondiale avec le surgissement de la vague révolutionnaire de 1917, ou encore une série de défaites décisives, comme au cours des années 20). En revanche, pour Battaglia, qui emploie il est vrai plus souvent le terme "cours" que le terme "cours historique", il s'agit d'une perspective qui peut être remise en cause, dans un sens comme dans l'autre, à chaque instant puisqu'il n'est pas exclu qu'au sein même d'un cours à la guerre il puisse intervenir "une rupture révolutionnaire". C'est pour cela également, que ces camarades sont totalement incapables de comprendre les enjeux de la période historique présente et qu'ils attribuent le fait que la guerre généralisée n'ait pas encore eu lieu, bien que ses conditions objectives soient présentes depuis longtemps, à l'absence d'un désarmement nucléaire complet ou d'un traité de non-utilisation de l'arme atomique et autres stupidités retentissantes.
Là aussi la vision de Battaglia ressemble à une auberge espagnole : dans la notion de cours historique chacun apporte ce qu'il veut. On trouvera la révolution dans un cours vers la guerre comme la guerre mondiale dans un cours aux affrontements de classe. Ainsi chacun y trouve son compte : en 1981, le CWO qui partage la même vision du cours historique que BC, appelait les ouvriers de Pologne à la révolution alors que le prolétariat mondial était supposé n'être pas encore sorti de la contre révolution. Finalement c'est la notion de cours qui disparaît totalement ; voila où en arrive BC : éliminer toute notion d'une perspective historique.
En fait, la vision du PCInt (et du BIPR) porte un nom : l’immédiatisme. C'est le même immédiatisme qui se trouvait à l'origine de la proclamation du Parti au lendemain de la seconde guerre mondiale alors que le prolétariat était au plus profond de la contre révolution. C'est ce même immédiatisme qui explique qu'aujourd'hui les participants au BIPR fassent en permanence la fine bouche devant les combats que mène la classe dans la mesure où ces combats, et c'est normal, ne prennent pas encore une forme révolutionnaire et qu'ils continuent à se heurter aux multiples entraves des syndicats et de la gauche du capital.
La sous estimation des combats présents de la classe ouvrière
Notre appréciation des caractéristiques actuelles du combat prolétarien a été présentée de façon régulière dans la Revue Internationale (de même que dans l'ensemble de la presse territoriale du CCI). Nous n'y reviendrons pas ici. Par contre il est intéressant d'examiner, pour conclure cet article, comment le BIPR, à travers un document du CWO publié dans Comunismo n°4, concrétise l'analyse du cours historique qui est la sienne dans la critique de notre appréciation de ces luttes.
"... les événements en Europe montrent que la pression vers la lutte n'est pas directement liée à la gravité de la crise ni à la sévérité des attaques contre le prolétariat... Nous ne pensons pas que la fréquence et l'extension de ces formes de lutte indiquent -tout au moins jusqu'à aujourd'hui- une tendance vers leur développement progressif. Par exemple, après les luttes des mineurs britanniques, des cheminots en France, nous avons l'étrange situation dans laquelle les couches agitées sont celles... de la petite bourgeoisie I (docteurs, pilotes d'avion, magistrats, moyens et hauts fonctionnaires et maintenant, les enseignants)"
Il est déjà significatif que, pour le BIPR, les enseignants du primaire et du secondaire soient des "petits bourgeois" et que la lutte remarquable menée l'an dernier par ce secteur de la classe ne puisse rien représenter du point de vue prolétarien. On se demande pourquoi certains camarades de Battaglia, qui sont enseignants, ont tout de même jugé utile d'y intervenir (c'est vrai que les militants du CCI ont contribué de façon non négligeable à les réveiller en fustigeant leur passivité du départ).
S'adressant à Comunismo, le BIPR poursuit :
"Vous avez été probablement influencés par l'emphase mise par le CCI dans les luttes épisodiques des ouvriers en Europe
- emphase hors de toute proportion avec la réalité... à côté d'épisodes de lutte héroïque (en termes de durée et de sacrifices consentis par les travailleurs) comme ceux des mineurs britanniques, nous voyons, pour notre part, la passivité des autres secteurs de la classe en Angleterre et ailleurs en Europe."
Il ne nous paraît pas utile de rappeler ici tous les exemples donnés dans notre revue et dans notre presse territoriale qui contredisent cette affirmation. Nous y renvoyons le lecteur, de même que les camarades du BIPR, tout en sachant qu'ils n'y verront pas mieux pour cela : il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais poursuivons ces citations pour ce qui concernée les causes de cette triste situation et les conditions de son dépassement :
"Pour expliquer la relative passivité de la classe et son incapacité à répondre aux attaques du capital, les boucs émissaires (les syndicats, les partis) ne suffisent pas. Le pouvoir de persuasion des partis et des syndicats n'est pas la cause mais la manifestation du phénomène essentiel, qui est la domination réelle du capital sur la société... L'équilibre sur lequel repose la société bourgeoise existe encore. Il a été consolidé en Europe pendant près de 2 siècles et un mouvement de la classe puissant, matériel, est nécessaire pour le rompre...
Plus la domination capitaliste devient réelle, et plus elle s'exprime dans la superstructure, renforçant la domination réelle de telle façon que plus elle se cristallise, plus difficile et plus violent sera le processus qui la détruira."
Et voilà ! En jonglant un peu, pour "faire profond" sur le terme de "domination réelle du capital", que Marx utilisait dans un tout autre contexte (voir l'article sur la Décadence du capitalisme dans ce même n° de la Revue), on allonge de bonnes banalités quand ce ne sont pas des tautologies : "aujourd'hui le prolétariat est encore incapable de renverser le capitalisme parce que celui-ci exerce une domination réelle sur la société". Bravo le BIPR ! Voila une thèse qui fera date dans l'histoire du mouvement ouvrier et de la théorie marxiste. De même, l'histoire retiendra les phrases suivantes:
"L'intervention révolutionnaire du Parti est nécessaire pour vaincre toute influence bourgeoise, de quelque forme qu'elle soit, afin de rendre possible le passage des protestations et des revendications vers une attaque frontale contre l'Etat bourgeois...
La condition pour la victoire du programme révolutionnaire dans le prolétariat est la déroute de ce que nous avons défini comme les influences bourgeoises sur et dans la classe".
De nouveau, le BIPR nous propose des banalités agrémentées d'un raisonnement qui se mord la queue :
"Il n'existe pas un développement significatif des luttes parce qu 'il n 'existe pas le parti ; et le parti ne pourra exister sans que la classe ne se trouve dans un processus de développement des luttes". Comment peut-on rompre ce cercle vicieux ? Le BIPR ne nous le dit pas. C'est sans doute ce que ces camarades, qui sont très friands de formules "marxistes" tape à l'oeil, appellent la "dialectique"
En réalité, en sous estimant complètement la place qu'occupe le prolétariat dès à présent sur la scène de l'histoire, en empêchant le capitalisme de déchaîner une troisième guerre mondiale, la vision du BIPR sous estime de la même façon l'importance des combats actuels de la classe, tant par leur capacité de constituer un frein aux attaques bourgeoise que par l'expérience qu'elles représentent en vue des affrontements décisifs, révolutionnaires, contre l'Etat capitaliste. C'est pour cela que cette organisation, non seulement est conduite, comme on l'a vu plus haut, à tomber dans les pièges les plus grossiers de la propagande bourgeoise sur la "dissuasion nucléaire", mais qu'en plus elle néglige la responsabilité des révolutionnaires à l'heure actuelle-, tant du point de vue du travail de regroupement des forces communistes (voir article sur le Milieu politique dansée numéro de la revue) que du pointa vue du travail d'intervention dans les luttes. En particulier, le texte du BIPR est significatif à cet égard :
"Nous, les avant gardes révolutionnaires, nous pouvons seulement avoir une influence très limitée -presque inexistante -sur ce processus (de rupture de l’équilibre sur lequel repose le capitalisme), précisément parce que nous sommes en dehors de la dynamique matérielle de la société"
Si par "dynamique matérielle" le BIPR entend l'évolution de la crise, il est évident que les révolutionnaires n'ont aucun impact là dessus. Mais, il ne peut s'agir uniquement de cela puisque, par ailleurs, le BIPR estime que "l'affrontement de classe est absolument en dessous de celui imposé par la situation objective" : il faut donc supposer que d'après le BIPR, la crise est pour sa part suffisamment développée pour permettre la "rupture" qu'attend cette organisation. En fin de compte, derrière les jeux de mots sur la "domination réelle", etc., derrière le refrain perpétuel sur le "rôle indispensable du parti" (idée que nous revendiquons également d'ailleurs), le BIPR ne fait qu'abdiquer devant ses responsabilités. Ce n'est pas en clamant en permanence : "Il faut le Parti ! Il faut le Parti !) qu'on assume son rôle, dans la classe face aux besoins actuels du développement de sa lutte. Il existe un proverbe russe qui dit : "quand il n'y pas de vodka parlons de vodka". En fin de compte, beaucoup de groupes du milieu prolétarien font aujourd'hui la même chose. Seul le dépassement de cette attitude de scepticisme vis à vis des luttes de la classe, et notamment de leur impact sur le cours historique, leur permettra d'assumer réellement la responsabilité qui est celles des révolutionnaires, et contribuer efficacement à la préparation des conditions du parti mondial du prolétariat.
FM
[1] [1436] Une autre raison permettant d'expliquer cette convergence des attaques contre les positions du CCI réside probablement dans le fait que notre organisation, qui depuis la dislocation du Parti Communiste International (bordiguiste) constitue la formation la plus importante du milieu révolutionnaire international, est devenue de ce fait le point de référence pour tous les groupes et éléments de ce milieu. Ce fait n'est pas pour nous un motif de satisfaction particulière : nous sommes bien trop conscients et préoccupés par la faiblesse générale du milieu révolutionnaire vis à vis des responsabilités qui sont les siennes dans la classe pour nous réjouir de cette situation.
[2] [1437] Ce n° du Communiste contient un article dont le titre seul : "Une fois déplus... le CCI du côté des flics, contre les révolutionnaires" en dit long sur la teneur.
[3] [1438] On peut se reporter en particulier à la Résolution sur la situation internationale adoptée lors de notre 3ème congrès (Revue Internationale n°18) et à l'article "Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme" publié dans la Revue Internationale n°52 et n°53.
[4] [1439] Voir en particulier "Europe et Amérique".
[5] [1440] Il faut remarquer que dans un passage précédent du même article, on explique la "dilatation des temps de préparation de la guerre" par les transformations économiques subies par le capitalisme depuis la seconde guerre mondiale, ce qui est en contradiction flagrante avec la thèse énoncée dans Prometeo n°ll suivant laquelle "au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée". Quand on s'appuie sur une théorie fausse, il ne faut pas s'étonner de s'enfermer dans toutes sortes de contradictions lorsqu'on essaye de la faire cadrer avec la réalité.
[6] [1441] A propos de cet accord, l'article déjà cité de BC de mai 88 souligne avec pertinence qu'il n'affecte que 3,5% du potentiel de destruction des signataires, et qu'il a pour but de leur permettre de "concentrer les efforts (économiques, de recherche, etc.) à la restructuration et la modernisation des armements nucléaires et conventionnels respectifs^. Décidément, les analyses du PCInt ressemblent à une auberge espagnole : il n'y a pas de menu fixe, chaque article de la presse y apporte ses propres conceptions, mêmes si elles sont en contradiction avec celles des autres articles. Il faudrait que BC et Prometeo accompagnent chacun des articles qui y sont publiés d'une note précisant s'il exprime les positions de l'organisation ou une position particulière d'un camarade afin que le lecteur puisse s'y retrouver. La même suggestion restant valable lorsque c'est au sein d'un même article qu'on énonce des affirmations contradictoires.
[7] [1442] Les camarades de Battaglia estiment que la non utilisation des gaz de combat au cours de la seconde guerre mondiale illustre la capacité de la bourgeoisie à se donner un certain nombre de règles du jeu. Ce qu'illustre en fait leur affirmation c'est qu'ils prennent pour argent comptant les mensonges utilisés par la bourgeoisie lorsqu'elle veut démontrer qu'elle est capable de "raison" et d'"humanité" même dans les manifestations les plus extrêmes de la barbarie de son système. La seconde guerre mondiale n'a pas fait appel à ce type d'armes parce que la première avait montré qu'il était à double tranchant et pouvait se retourner contre ceux qui l'employaient. Depuis, l'Irak "barbare" dans la guerre du Golfe, et avant lui, les très "civilisés" Etats-Unis au Vietnam, ont fait la preuve qu'avec les moyens modernes on pouvait de nouveau les utiliser "efficacement".
[8] [1443] Sur cette question voir l'article "Guerre, militarisme et blocs impérialistes..."
[9] [1444] Il faut en finir avec le mensonge sur "la liquidation par la Fraction de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne". La Fraction est intervenue par sa presse de façon publique et dans le milieu prolétarien, pour dénoncer la politique de collaboration de classe sous prétexte de "sauver la République", pour apporter un soutien total à la révolte des ouvriers de Barcelone en juillet 36 et en mai 37, par son soutien à la lutte des ouvriers des Asturies en 34. Mais il y a intervention et intervention : intervenir pour combattre "l'alliance républicaine anti-fasciste" ou intervenir pour s'intégrer dans les milices pour le soutien de la République bourgeoise. "Battaglia" condamne la position de la majorité de la Fraction (la première) même si elle critique aussi celle de la minorité (l'embrigadement anti-fasciste). Qu'elle était finalement la bonne position d'après le PCInt, celle qui a conduit cette organisation à lancer en 45 un "Appel aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne" (en fait les PC, les PS et les anarchistes) pour un "front unique de tous les travailleurs" (voir à ce sujet notre Revue Internationale n°32)
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 55 - 4e trimestre 1988
- 2945 reads
Editorial : les "paix" de l'été 88
- 2406 reads
L'intensification des préparatifs guerriers
L’été 1988 serait selon toute la presse du monde capitaliste l'été de la paix dans le monde, ou du moins de tous les espoirs de paix. Ce serait la paix entre l'Iran et l'Irak, en Angola et au Cambodge et bientôt en Afghanistan. Ce serait aussi le début d'un processus de désarmement des missiles nucléaires entre les deux têtes de bloc - les USA et l'URSS -, processus garant de la volonté réelle de paix de la part des dirigeants des deux principales puissances capitalistes du monde. Bref la perspective de la paix l'emporterait sur celle, supposée opposée, d'une 3ème guerre mondiale.
LE CAPITALISME, C'EST LA GUERRE
Une des principales positions de toujours de la théorie du prolétariat, du marxisme, est que, dans le capitalisme, la paix et la guerre ne sont pas contradictoires, ni ne s'excluent. Mais qu'elles sont deux moments de la vie même de ce mode de production, que la paix n'est que la préparation de la guerre. Malgré "l'été 88", malgré les accords de "désarmement" entre Reagan et Gortbachev, malgré toute la propagande pacifiste actuelle, l'alternative historique qui s'offre à l'humanité n'est pas paix ou guerre, mais reste toujours socialisme ou 3ème guerre impérialiste mondiale, socialisme ou barbarie. Plus exactement aujourd'hui : socialisme ou continuation et développement encore plus dramatique de la barbarie capitaliste.
Nous nous trouvons donc en face de deux thèses: celle de la propagande bourgeoise et celle de la théorie révolutionnaire du prolétariat. L'une contribue à essayer de maintenir l'ordre social actuel en tentant de développer l'illusion que la paix est possible dans le capitalisme. Pour la seconde, pour le marxisme: "la guerre est un produit nécessaire du capitalisme" (Lénine, "Le congrès socialiste international de Stuttgart", 1907), et: "L'humanité (...) est menacée de destruction. Il n'est plus qu'une force capable de la sauver, et cette force c'est le prolétariat." ("Plate-forme de l'Internationale communiste", 1919).
LA CRISE ECONOMIQUE IRREVERSIBLE DU CAPITALISME POUSSE A LA GUERRE IMPERIALISTE
Depuis 1945, l'antagonisme impérialiste entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est n'a cessé de s'exprimer dans des guerres (Corée, Indochine, Moyen-Orient, etc.). Mais aujourd'hui, l'impasse économique et la chute dans la crise, ne font qu'exacerber ces antagonismes et poussent le capitalisme à la fuite en avant dans la guerre, à l'éclatement d'une 3ème guerre mondiale.
"A partir du moment où cette crise ne peut trouver d'issue temporaire dans une expansion du marché mondial, la guerre mondiale de notre siècle exprime et traduit ce phénomène d'autodestruction d'un système qui, par lui-même, ne peut dépasser ses contradictions historiques." ("La guerre dans le capitalisme", Revue Internationale n°41, 1985).
C'est dans l'impossibilité pour le capitalisme en déclin d'éviter et de surmonter la crise économique que se trouve la base même de la guerre impérialiste, expression la plus haute de cette crise et de la décadence de ce mode de production lui-même.
LES "PAIX" DE L'ETE 88 : UNE ETAPE DE L'OFFENSIVE OCCIDENTALE
C'est la paix partout, clament les journaux et les télévisions: en Angola, au Cambodge, en Afghanistan, et surtout entre l'Irak et l'Iran. Et cela après les accords de désarmement entre les USA et l'URSS ([1] [1445]). Selon les médias, la raison et la sagesse l'emporteraient. Gorbatchev et Reagan seraient touchés par la grâce pacifiste. Les dirigeants des principales puissances réussiraient à s'entendre pour dépasser l'antagonisme impérialiste qui menace le monde. Les bonnes volontés l'emporteraient donc sur les lois mêmes du capitalisme.
La preuve serait ainsi faite que le capitalisme n'est pas forcément la guerre comme le proclame le marxisme. Et pourtant nous continuons d'affirmer que c'est ce dernier qui a raison.
Essayons donc d'y voir de plus près. Ces différentes "paix" apparaissent toutes comme des "pax americana": l'armée russe quitte l'Afghanistan, les forces cubaines l'Angola, et les Vietnamiens le Cambodge. En fait, ces différents retraits russes sont le résultat du soutien économique et surtout, et de plus en plus, militaire des USA à la résistance afghane et à la guerre menée par l'Afrique du Sud et le mouvement de guérilla l'UNITA contre l'Angola. Tout comme c'est bien l'immense pression militaire et économique du bloc de l'Ouest qui a eu raison des ayatollahs iraniens dans le conflit avec l'Irak. Si raison il y a, c'est celle du plus fort, celle qui s'exprime sans ambiguïté par la présence de l'armada occidentale dans le golfe Persique et l'efficacité des missiles Stinger américains contre l'aviation russe en Afghanistan.
A la vérité, les différentes "paix" ne sont pas le produit de la raison, ni de la bonne volonté pacifiste, mais du rapport de forces actuel entre les deux blocs. Les "paix" de l'été 88 sont le produit de la guerre.
LES "PAIX" DE L'ETE PREPARENT LA GUERRE IMPERIALISTE
Produits de la guerre, les "paix" de l’été 88 préparent les guerres à venir vérifiant ainsi la thèse marxiste. Seule celle-ci permet de révéler la réalité cachée des conflits impérialistes et même bien souvent de prévoir leur issue. Voilà comment nous caractérisions en 1984 l'évolution des conflits impérialistes:
"Contrairement à la propagande assenée quotidiennement par tous les médias du bloc occidental, la caractéristique majeure de cette évolution consiste en une offensive du bloc américain contre le bloc russe. Celle-ci vise à parachever l’encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle a pour but d'expulser définitivement l'URSS du Moyen-Orient en réintégrant la Syrie au sein du bloc occidental. Elle passe par une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce majeure de son dispositif militaire. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise, en fin de compte, à étrangler complètement l'URSS; et à lui retirer son statut de puissance mondiale." (Revue Internationale n°36, 1er trimestre 1984, p.2).
Nous sommes en train de vivre l'aboutissement de la deuxième phase de cette offensive du bloc US contre l'URSS: la remise au pas de l'Iran alors qu'il y a déjà un certain temps que la Syrie manifeste sa réintégration dans le bloc occidental - première phase de cette offensive - en assumant le rôle du gendarme américain au Liban. Cette remise au pas de l'Iran va signifier le retour plus ou moins rapide de ce pays à la discipline du bloc de l'Ouest qui en avait fait le gendarme de l'Occident dans cette région du temps du Shah. Et pour cela, l'impérialisme US est tout disposé à laisser, le temps qu'il faudra, ses forces militaires dans le golfe Persique pour "aider" l'Iran à bien comprendre le rôle qui lui revient: exercer une pression directe sur la frontière sud de l'URSS.
Celle-ci, après son expulsion du Moyen-Orient, est maintenant pratiquement exclue de l'Afrique -sauf de l'Ethiopie mais pour combien de temps encore ?- avec les projets de retrait des forces cubaines de l'Angola et doit donc aussi retirer ses troupes d'Afghanistan. Cette offensive occidentale va se poursuivre en Indochine: nous le voyons déjà avec les projets de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge. Elle vise à retirer à l'URSS les dernières places fortes qu'elle détient encore en dehors de l'Europe.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
L'UNIQUE PERSPECTIVE DU CAPITALISME : UNE 3ème GUERRE MONDIALE
Le succès de l'offensive américaine contre l'URSS signifie pour cette dernière une situation croissante d'isolement et d'affaiblissement de plus en plus critique. Elle va se retrouver de plus en plus acculée sur son glacis est européen et dans les faits, étranglée.
Si ce processus d'affrontements impérialistes entre le bloc de l’Ouest et de l'Est allait jusqu'à son terme, l'URSS se retrouverait dans la situation de l'Allemagne lors des deux premières guerres mondiales: contrainte en dernière instance, sous peine de mourir étouffée, de déclencher une 3ème guerre mondiale. Et cela malgré une situation économique et militaire extrêmement défavorable par rapport au rival de l'Ouest. Et cela malgré toutes les conséquences dramatiques pour l'avenir même de l'humanité avec les armements actuels. Car ce processus d'affrontements menant à la guerre est inhérent au capitalisme et ne peut être stoppé que par la destruction même de ce mode de production.
AUJOURD'HUI LE CAPITALISME C'EST LA CHUTE DANS LA MISERE, LA GUERRE ET LA BARBARIE
Pour l'instant ce processus menant sans doute à la destruction de la plus grande partie de l'humanité, sinon à sa disparition complète, ne peut se développer jusqu'à son terme. Nous allons y revenir.
Mais, il n'en demeure pas moins que le capitalisme continu de survivre, et tel un fruit trop mûr, de pourrir sur pied. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'alternative historique n'est plus "socialisme ou barbarie", mais socialisme ou continuation et développement de la barbarie capitaliste. Quatre-vingts ans de décadence historique marquée par une misère jamais vue encore dans l'histoire de l'humanité -en particulier les 2/3 des êtres humains souffrant de la faim !-, des massacres sans fin au cours de guerres ininterrompues -dont deux guerres mondiales avec des millions de morts- ont fait la preuve de l’obsolescence du mode de production capitaliste qui, porteur de progrès historique dans le passé, s'est transformé en une entrave et en un risque mortel pour le développement et la survie même de l'humanité.
Et, pour ceux qui douteraient de la validité de la thèse marxiste sur l'existence de la décadence du capitalisme, rappelons brièvement la réalité macabre du conflit sciemment provoqué, déclenché et entretenu par les USA et leurs alliés occidentaux entre l'Iran et l'Irak. Selon la presse (22/8/88): 1 200 000 morts dont 900 000 du côté iranien parmi lesquels un grand nombre d'enfants, de vieillards et même de femmes. Le nombre des blessés et des invalides est deux fois plus élevé encore. Inutile ici de revenir sur l'utilisation massive des gaz. L'économie de ces pays se retrouve dévastée: les dépenses d'armements des deux pays s'élevant à plus de 200 milliards de dollars tout comme le total des destructions.
Et toute cette horreur sans aucun "bénéfice" historique, économique, ni même territorial pour les deux belligérants sinon une place de choix assurée dans les conflits à venir!
Car, malgré les différents cessez-le-feu, ce n'est pas la paix qui attend les pays directement concernés. Qu'ils soient destinés ou non à servir de place forte d'un impérialisme -tel l'Iran-, c'est la guerre, la misère et la décomposition sociale qui vont se développer. Leur futur immédiat, c'est l'instabilité comme au Liban. Pour les pays africains et le Moyen-Orient en particulier, ainsi que pour l'Afghanistan, le Cambodge, l'Iran, etc., les "paix" de 88 sont un pas de plus dans la décomposition sociale, dans la famine et la misère, et dans les guerres interminables des différentes fractions et bandes locales. Pour ces pays, ce n'est pas la paix, c'est la "libanisation" qui s'annonce, le développement encore plus dramatique de la putréfaction économique et sociale du capitalisme.
Cette "libanisation" s'exprime en particulier dans l'explosion de massacres entre ethnies -dernier en date au Burundi où il y aurait 25 000 morts dans les affrontements entre les "Hutus" et les "Tutsis"- et aussi dans "l'explosion des nationalités" tout autant accompagnée de massacres comme avec les Sikhs en Inde, les Kurdes en Iran et en Irak, et même en URSS, en Azerbaïdjan. Ces conflits sont une des expressions de la décomposition croissante du tissu social dans tous les pays.
Toute cette horreur est la réalité du capitalisme décadent. La guerre et la décomposition sont les seules perspectives que cette société en putréfaction puisse offrir à l'humanité.
LE PROLETARIAT EST LE SEUL FREIN A LA GUERRE IMPERIALISTE
Nous avons affirmé précédemment que le processus de développement des antagonismes impérialistes entre l'Ouest et l'Est ne réussissait pas pour l'instant à se développer jusqu'à son terme apocalyptique. Malgré la profondeur de la crise économique et son accélération, malgré la constitution depuis 1945 des deux grands blocs impérialistes, malgré une économie dirigée principalement vers la production d'armement et par conséquent leur abondance, la 3ème guerre mondiale n'a toujours pas éclaté.
Certes, le temps travaille pour les USA. Cette puissance a pu attendre durant 8 ans de guerre l'épuisement de l'Iran pour sa remise au pas. Elle a adopté la même attitude en Afghanistan par rapport à l'URSS. Le bloc de l'Ouest peut se permettre, car c'est lui qui a l'initiative, de laisser s'épuiser l'URSS dans la course aux armements. D'autant que le bloc de l'Est se trouve dans une situation intérieure difficile. Tout particulièrement sa puissance dominante: l'URSS elle-même se trouve confrontée à "l'explosion des nationalités" -encore dernièrement dans les pays baltes- qui, nous l'avons vu, est une des expressions de la décomposition.
D'un autre côté, l'URSS est sur la défensive et assume de plus en plus mal le poids de l'économie de guerre et les frais de ces diverses occupations militaires. Elle cherche désespérément de l'air face à l'étouffement qui la guette et un répit pour pouvoir faire face et se préparer.
Mais ce n'est pas là la raison du non-déclenchement aujourd'hui du conflit mondial entre les deux blocs. Toutes les conditions sont réunies. Sauf une: l'adhésion et la soumission des populations et en tout premier lieu des ouvriers qui produisent l'essentiel de la richesse sociale et toutes les armes, et qui constitueraient les principaux contingents lors d'une guerre généralisée. Les ouvriers ne sont pas prêts aujourd'hui au sacrifice de leur vie dans une guerre. A l'heure où nous écrivons, au delà des particularités polonaises et de leurs limites propres, les grèves ouvrières en Pologne ([2] [1446]) manifestent une fois de plus la combativité du prolétariat international et son refus d'accepter sans réaction les attaques économiques imposées par la crise et l'immense misère accompagnant inévitablement le développement de l'économie de guerre.
Cette combativité ouvrière s'est exprimée dans les luttes de ces dernières années pour la défense des conditions de vie et contre leur brutale et croissante détérioration, principalement en Europe Occidentale ([3] [1447]). Elle constitue le frein et l'obstacle au développement du processus capitaliste à la guerre et à son aboutissement logique dans un 3ème conflit impérialiste mondial.
Beaucoup d'ouvriers individuellement, nombre de militants révolutionnaires et presque tous les groupes politiques du prolétariat, victimes de la propagande bourgeoise, désespèrent des luttes de la classe ouvrière et même certains vont jusqu'à nier leur existence ([4] [1448]). Et face à la question pourquoi la guerre n'a-t-elle pas encore éclaté alors que toutes les conditions sur le plan objectif sont réunies, ces camarades désespèrent du marxisme et remettent alors en cause ses principes mêmes.
LE PACIFISME DESARME LA CLASSE OUVRIERE ET PREPARE LA GUERRE
La bourgeoisie, elle, ne doute pas de l'existence et du danger des luttes ouvrières. En lien avec la combativité ouvrière, elle sait aussi très bien que les populations civiles ne sont pas disposées aux sacrifices d'une guerre. C'est la raison d'être des campagnes de propagande pacifiste dirigées à l'Ouest comme à l'Est essentiellement contre les ouvriers.
Malgré toute sa puissance idéologique, l'Etat capitaliste US aurait aujourd'hui le plus grand mal à envoyer un corps expéditionnaire de 500 000 soldats du contingent sur un champ de bataille, comme à l'époque du Vietnam, sans susciter des réactions populaires, et sans doute ouvrières, très dangereuses. Et, même si ce n'est pas la première, une des raisons du retrait russe est aussi le mécontentement croissant parmi la population en URSS et même parmi la troupe comme on a pu s'en apercevoir lors des violents troubles qui ont eu lieu à l'occasion d'un rassemblement de plus de 8 000 parachutistes, anciens soldats d'Afghanistan, le 2 août dernier à Moscou (presse du 9/8/88).
Après les accords entre Reagan et Gorbatchev sur les euromissiles, et après les accords et les négociations concernant l'Afrique Australe, l'Iran et l'Irak, le Vietnam, la bourgeoisie internationale utilise le retrait de l'URSS de l'Afghanistan pour entretenir les illusions pacifistes au sein de la classe ouvrière. La "paix" imposée à l'Iran est aussi l'occasion de présenter la présence de l'immense flotte occidentale dans le golfe Persique comme une entreprise civilisatrice et pacificatrice en opposition au fanatisme islamiste des ayatollahs.
Ces campagnes pacifistes sont organisées aussi bien par les gouvernements, les médias, les partis de gauche et les syndicats. Elles ont pour but d'endormir la classe ouvrière en lui faisant croire que la paix est possible dans le capitalisme. Elles essayent ainsi d'empêcher la prise de conscience des dramatiques enjeux historiques actuels: révolution prolétarienne ou 3ème guerre mondiale.
"L'une des formes de mystification de la classe ouvrière est le pacifisme et la propagande abstraite de la paix. En régime capitaliste, et particulièrement à son stade impérialiste, les guerres sont inévitables." (Lénine, Résolution sur "Le pacifisme et la consigne de la paix" de la Conférence des sections du POSDR à l'étranger, mars 1915).
Et surtout, en faisant croire à l'opposition entre la guerre et la paix, le pacifisme au nom de la paix abstraite rejette dans ce mal absolu que serait la guerre, la lutte des classes, et plus particulièrement la lutte de la classe ouvrière et la perspective de la révolution prolétarienne. Le pacifisme veut mener la classe ouvrière à l'abandon de ses combats, à l'acceptation de l'exploitation, de la misère et des sacrifices croissants. Il veut rendre les ouvriers impuissants face au drame historique qui vient en les détournant du terrain de l'opposition aux attaques économiques croissantes du capital en crise.
Que la classe ouvrière ne cède pas aux sirènes du pacifisme et n'abandonne pas ses luttes pour gagner la paix. Elle n'y gagnerait que la défaite d'abord. Et ensuite la guerre généralisée.
Dans le capitalisme, la seule paix possible c'est celle des cimetières. Les "paix de l'été 88" préparent l'intensification de la guerre impérialiste. Et les campagnes pacifistes visent à masquer aux yeux des ouvriers cette monstrueuse réalité.
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l’humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante: chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme. Ainsi nous vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx et Engels ont formulée pour la première fois, comme base scientifique du socialisme, dans le grand document qu'est le Manifeste communiste: le socialisme est devenu une nécessité historique." (Rosa Luxemburg, "Discours sur le programme du Parti Communiste d'Allemagne", 1/1/1919).
RL. 26/8/88
[1] [1449] Sur le mensonge du désarmement et la réalité des accords sur les euro-missiles et du développement des armements, voir éditorial de notre Revue Internationale n°54.
[2] [1450] Voir l'article suivant sur les grèves en Pologne dans ce numéro.
[3] [1451] Sur la réalité et la signification des luttes ouvrières actuelles, voir les différents articles dans les numéros antérieurs de cette revue (éditorial du n° 53) et dans notre presse territoriale.
[4] [1452] Voir dans ce numéro l'article "Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR".
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Lutte de classe internationale : luttes ouvrières en Pologne
- 2641 reads
Une nouvelle fois le prolétariat de Pologne, face à une dégradation insupportable de ses conditions d'existence, a repris le chemin du combat de classe : ses luttes de la deuxième moitié du mois d'août 88, qui ont succédé à celles du printemps, sont les plus importantes depuis les combats de l'été 80. Une nouvelle fois la bourgeoisie a démontré son savoir-faire pour mener dans une impasse et défaire la combativité ouvrière, grâce à un remarquable partage des tâches entre gouvernement et forces d'"opposition" avec en tête "Solidamosc". Ces luttes sont un appel aux ouvriers de tous les pays, et particulièrement à ceux des pays les plus développés : par leur ampleur, leur détermination, leur combativité, mais aussi parce que seul le prolétariat des pays les plus avancés, et notamment celui d'Europe occidentale, est en mesure de montrer le chemin de la lutte contre les pièges et mystifications qui sont venus à bout des ouvriers de Pologne.
Pologne : 31 août 1980 - 31 août 1988 : à huit ans de distance, deux rencontres entre les autorités gouvernementales et des "représentants de la classe ouvrière" symbolisent l'évolution de la situation sociale et des rapports de force entre classes dans ce pays.
Du côté du gouvernement les acteurs ont changé, le ministre de l'intérieur de 88, Kiszczak, a remplacé le vice-Premier ministre de 80, Jagielski, mais le mandataire est toujours le même : le représentant suprême du capital national polonais. En face, par contre, c'est toujours le même Lech Walesa qui sert d'interlocuteur, mais en août 80 il est mandaté par l'organe que s'est donné la classe ouvrière au cours des grèves, le MKS (Comité de grève inter-entreprises), alors qu'aujourd'hui ce n'est pas la classe ouvrière en lutte qu'il représente mais lui aussi le capital national.
En août 80, la classe ouvrière, en un combat qui demeure à ce jour le plus important depuis la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 60, avait réellement réussi à faire reculer momentanément l'Etat bourgeois. Aujourd'hui, la formidable combativité qu'elle a manifestée depuis plusieurs mois, et tout particulièrement en ce mois d'août, a été dévoyée et bradée par de sordides manoeuvres entre ses ennemis notoires, le gouvernement et le parti au pouvoir (bien que ce dernier se dise toujours "Parti Ouvrier"), et l'organisation qui, malgré (ou plutôt grâce à) sa non existence légale, bénéficie encore de sa confiance : le syndicat "Solidarité".
Le 31 août 80, Lech Walesa n'était que le porte parole des ouvriers en lutte, lesquels pouvaient à chaque instant contrôler les négociations qu'il menait avec les représentants du gouvernement qui avaient été contraints de se rendre dans le bastion ouvrier du chantier naval "Lénine". Le 31 août 88, le même Lech Walesa a rencontré à huis clos, dans une villa gouvernementale des beaux quartiers de Varsovie, le ministre de l'intérieur, c'est-à-dire le spécialiste gouvernemental du "maintien de l'ordre" capitaliste, avec un seul objectif : rechercher le meilleur moyen de rétablir cet "ordre" remis en cause par les grèves ouvrières.
Le 31 août 80, Walesa appelle à la reprise parce que le pouvoir a donné satisfaction aux 21 revendications élaborées par les grévistes. Le 31 août 88, il met à profit la popularité dont il continue encore à jouir auprès des ouvriers pour leur demander qu'ils mettent fin à leur mouvement en échange de vagues promesses sur l'ordre du jour d'une "table ronde" où devrait être abordée la question du "pluralisme syndical", c'est-à-dire du pluralisme des organes destinés à encadrer la classe ouvrière et à saboter ses luttes. C'est d'ailleurs pour cela que, si le 1er septembre 80 l'ensemble des grévistes était retourné au travail avec le sentiment d'avoir gagné, cette fois-ci il a fallu à Walesa une bonne partie de la nuit pour convaincre le comité de grève inter-entreprises de Gdansk d'appeler à la reprise et toute une matinée pour obtenir des ouvriers du chantier "Lénine" qu'ils mettent fin à la grève, alors que dans d'autres villes la grève s'est poursuivie jusqu'à la venue du "pompier volant".
En bref, en août 80, la classe ouvrière avait remporté une victoire (provisoire certes, mais il ne peut en exister d'autre dans la période actuelle), en août 88 elle a subi une défaite.
Faut-il en conclure à un recul général de la classe ouvrière dans tous les pays ? Les derniers événements de Pologne sont-ils significatifs de l'évolution des rapports de force entre classes au niveau mondial ?
Rien n'est moins vrai. En réalité, les dernières luttes du prolétariat en Pologne constituent une confirmation éclatante de toute la perspective mise en avant par notre organisation depuis une vingtaine d'années : plus que jamais l'heure est au déploiement, à l'intensification du combat de classe dans la mesure même où ses conditions n'ont fait que se développer depuis son renouveau historique débuté il y a deux décennies.
L'AGGRAVATION INEXORABLE DE LA CRISE ECONOMIQUE ET L'INTENSIFICATION DES ATTAQUES CAPITALISTES
A l'origine des luttes ouvrières qui ont secoué la Pologne ces derniers mois se trouvent des attaques d'une brutalité incroyable contre le niveau de vie de la classe ouvrière. Ainsi, au début de l'année le gouvernement décide pour le premier de chacun des mois suivants, février, mars, avril, des trains de hausses massives sur les produits alimentaires, les transports, les services... Le taux d'inflation sur cette période se monte à 60%. Malgré les augmentations de salaires qui accompagnent ces hausses, la perte de revenus pour la population est de 20%. En un an, certains prix ont fait plusieurs fois la culbute : ainsi les loyers ont doublé, le prix du charbon a été multiplié par trois, celui des poires par quatre, celui des chaussures en toile pour enfants par cinq, et ce ne sont que des exemples parmi beaucoup d'autres. Par ailleurs, vue la pénurie (par exemple la viande, le lait pour enfants, le papier hygiénique), beaucoup de biens élémentaires doivent être achetés au marché noir ou bien dans les "Pewex" où il faut payer en devises fortes dont le taux délirant au marché noir (seul moyen pour un ouvrier de se les procurer) ramène le salaire moyen mensuel à 23 dollars. Dans ces conditions il n'est pas surprenant que les autorités elles mêmes reconnaissent que 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Cette misère est vécue de façon particulièrement dure par les jeunes ouvriers qui constituent les bataillons les plus déterminés des combats actuels. D'après Tygodnik Mazowsze, l'hebdomadaire clandestin de Solidarnosc pour Varsovie, les jeunes ouvriers forment "une génération sans perspectives" : "La vie qu'ils vivent est un cauchemar. Leurs chances de trouver un logement à eux sont pratiquement nulles. La plupart d'entre eux vivent dans de prétendus foyers fournis par l'entreprise. Ils sont parfois six entassés dans deux chambres. Un couple avec trois enfants vit dans une petite pièce et une cuisine de quatre mètres carrés où il n'y a que l'eau froide."
Cette dégradation incroyable des conditions de vie de la classe ouvrière, malgré (ou plutôt à cause de) toutes les "réformes économiques" successives mises en oeuvre par le régime depuis de nombreuses années, ne saurait évidemment pas être considérée comme une sorte d'"exception", de "particularité" réservée à la Pologne ou même aux pays dits "socialistes". Même si dans ce pays elle prend une forme extrême, caricaturale, du fait de l'acuité de la crise économique (la dette extérieure de la Pologne se monte à quelque 50 milliards de dollars dont 39 envers les pays occidentaux), on la retrouve dans tous les pays d'Europe de l'Est comme dans les pays les plus avancés. En URSS par exemple, les pénuries n'ont jamais été aussi catastrophiques malgré les hausses des prix qui étaient sensées les faire disparaître. La fameuse "perestroïka" (restructuration) de l'économie est totalement absente des réfrigérateurs, comme le constatent avec humour les habitants de la "patrie du socialisme" et la "glasnost" (transparence) est avant tout celle des rayons des magasins qui restent désespérément vides. Ce que viennent souligner en premier lieu les grèves en Pologne et la catastrophe économique qui les alimente, c'est la faillite de la politique de "perestroïka" chère à Gorbatchev. Et à cela il n'y a nul mystère : alors que l'économie des pays les plus avancés ne réussit à donner l'illusion d'une certaine stabilité qu'au prix d'une fuite en avant vers le gouffre d'un endettement astronomique, il revient aux économies les plus faibles, comme celles d'Europe de l'Est, et notamment en Pologne, d'être les premières à faire les frais de l'effondrement mondial du capitalisme. Et nulle "restructuration" n'y peut rien. Comme partout dans le monde, la "réforme économique" ne peut avoir comme unique conséquence que de nouvelles et encore plus brutales attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Ainsi, ce qu'illustre en premier lieu la situation actuelle en Pologne, c'est le caractère insurmontable de la crise du capitalisme. Le délabrement économique de ce pays, la misère qui en résulte pour la classe ouvrière, ne font qu'indiquer la direction vers laquelle s'acheminent aussi les pays les plus avancés, ceux qui, jusqu'ici, ont été les plus "épargnés" par la crise.
POUR LA CLASSE OUVRIERE UNE SEULE VOIE : LE DEVELOPPEMENT DE SES LUTTES
Le deuxième enseignement qu'il faut tirer de cette situation c'est que, face à l'effondrement irréversible de l'économie mondiale, face à des attaques capitalistes sans cesse croissantes, il ne reste d'autre voie pour la classe ouvrière de tous les pays que de reprendre et développer ses combats. Et les luttes des ouvriers de Pologne font la preuve, une nouvelle fois, que c'est bien sur cette voie que s'est engagé le prolétariat mondial.
A cet égard, les luttes récentes en Pologne sont particulièrement significatives. Dans ce pays les ouvriers ont subi, suite à leur lutte magnifique et leur première victoire de 1980, une défaite cuisante qui s'est en particulier concrétisée par l'instauration de l'état de guerre en décembre 81. Ils ont été emprisonnés par dizaines de milliers, leur résistance a été réduite par la force au prix de la vie de dizaines d'entre eux, ils ont dû subir les matraquages, les sévices, ils ont dû affronter pendant des années la terreur policière, la hantise permanente, au cas où ils voudraient résister aux attaques capitalistes, à perdre leur travail, leur logement ou même d'aller moisir en prison. Malgré cette pression énorme, malgré la démoralisation qui pesait sur beaucoup d'entre eux depuis 1981, ils ont repris le chemin de la lutte au printemps dernier, dès que sont tombées les attaques économiques. Point désarmés par l'échec de cette première tentative (où toute l'habileté de Walesa avait été nécessaire pour convaincre les jeunes ouvriers de Gdansk de reprendre le travail) ([1] [1453]), ils se sont replongés dans le combat de classe au cours de l'été, en un mouvement bien plus vaste que le précédent, ce qui illustre bien une des caractéristiques majeures de la période actuelle : l'accélération de l'histoire sous la pression de l'aggravation de la crise économique et qui se manifeste, sur le plan du combat de classe, par une tendance à des vagues de lutte de plus en plus rapprochées dans le temps.
Ce mouvement avait débuté le 16 août de façon spontanée dans le coeur ouvrier de la Pologne, les mines de Silésie. Il était particulièrement significatif puisqu'il affectait un des secteurs les plus anciens et expérimentés de la classe ouvrière et, par ailleurs, traditionnellement les plus "choyés" par le gouvernement (salaires et rations plus élevés,) du fait notamment de son importance économique (le charbon constitue la matière première et la source d'énergie la plus importante du pays et représente 1/4 des exportations), et qui n'en demandait pas moins de fortes augmentations de salaire (jusqu'à 100%, chiffre jamais vu jusqu'à présent dans des luttes ouvrières en Europe). Jour après jour le mouvement s'est étendu à de nouvelles mines et dans d'autres régions, notamment à Szczecin où le port et les transports ont été paralysés par la grève. Partout, la pression en faveur de la grève est très forte notamment de la part des jeunes ouvriers. A Gdansk, au chantier naval "Lénine", entreprise phare pour tous les ouvriers du pays, les jeunes ouvriers veulent en découdre à nouveau malgré leur échec du mois de mai. De nouveau Walesa joue les temporisateurs. Mais le lundi 22 août, il ne peut faire autre chose qu'appeler lui même à la grève qui paralyse aussitôt le chantier "Lénine". La grève se propage en quelques heures à Varsovie (aciérie Huta Warszawa, usine de tracteurs d'Ursus), Poznan, Stalowa Wola et d'autres entreprises de Gdansk. Il y a de 50 000 à 70 000 ouvriers en grève. Le mardi 23 août, la grève continue de s'étendre notamment à Gdansk, dans d'autres chantiers navals, et dans de nouvelles mines de Haute-Silésie. La classe ouvrière semble avoir renoué avec la dynamique de l'été 80. Mais en fait, le mouvement a atteint son apogée et il commence à refluer dès le lendemain car, cette fois-ci, la bourgeoisie est beaucoup mieux préparée que huit ans auparavant.
LA DEFAITE DU MOUVEMENT : GOUVERNEMENT ET OPPOSITION SE PARTAGENT LE TRAVAIL
Il est possible que le gouvernement ait été surpris par l'ampleur des luttes. Cependant, sa conduite tout au long de celles-ci a démontré qu'il avait beaucoup appris depuis l'été 80 et à aucun moment il n'a été débordé par la situation. En particulier il a pris soin, chaque fois qu'une nouvelle entreprise entrait en grève, de l'encercler par un cordon de "zomos" (unités spéciales anti-émeutes). Ainsi, à chaque fois, l'occupation du lieu de travail se refermait comme un piège sur les ouvriers en lutte les empêchant d'entrer en contact avec leurs frères de classe et, partant, d'unifier le mouvement, de le rassembler en un seul front de combat. La répression et l'intimidation n'en restent pas là. Le 22 août, jour où le mouvement s'étend le plus, le ministre de l'intérieur, le général Kiszczak, apparaît en uniforme à la télévision pour annoncer une série de mesures destinées à briser cette extension : établissement du couvre feu dans les trois régions les plus touchées par les grèves : Katowice, Szczecin et Gdansk; toute personne étrangère à une entreprise en grève sera évacuée et risque l'emprisonnement. Il accuse les grévistes d'être armés et il agite la menace d'une "effusion de sang". Au même moment, sa prestation est soutenue par celle de la télévision soviétique qui diffuse des images des entreprises en grève en traitant les grévistes d’"extrémistes qui exercent des pressions et des menaces sur leurs camarades par des grèves illégales". Les barres de fer que tiennent les ouvriers pour faire face à une éventuelle intervention policière sont présentées comme les instruments de ces "menaces". Ainsi, quand il s'agit de faire face à un mouvement de la classe ouvrière, Gorbatchev s'asseoit sur sa "glasnost" et retrouve la langue de bois classique de la terreur stalinienne : il ne faudrait pas que les ouvriers de Russie aient l'idée d'imiter leurs frères de classe de Pologne et ces derniers doivent savoir qu'ils n'ont rien à attendre de la "libéralisation" (d'ailleurs, ils ne se font guère d'illusions depuis le venue de Gorbatchev en Pologne, début juillet, lorsque ce dernier leur a dit qu'"Il doivent être fiers d'avoir un leader comme Jaruzelski" et qu'il a présenté ce dernier comme son "ami personnel".
Mais les menaces n'en restent pas au stade des paroles. Les actes viennent les "crédibiliser" : la Silésie est coupée du reste du pays par des barrages de la police et de l'armée; chaque jour les "zomos" interviennent dans de nouvelles entreprises pour déloger les ouvriers (notamment en Silésie où, au fond des puits, les mineurs manquent de nourriture, de médicaments et de couvertures); les arrestations se multiplient. Celles-ci frappent les grévistes mais aussi des membres de l'opposition et particulièrement des dirigeants de Solidarnosc, tel Frasyniuk, chef du syndicat de Wroclaw et membre de la direction nationale. Dans le premier cas il s'agit d'inciter les grévistes à reprendre le travail et de dissuader les autres ouvriers de les rejoindre dans la lutte. Mais les arrestations de syndicalistes ont une autre fonction : crédibiliser Solidarnosc afin que cette organisation puisse pleinement jouer son rôle de saboteur des luttes. Car, une nouvelle fois, la défaite ouvrière résulte avant tout de l'action du syndicalisme.
Les objectifs anti-ouvriers de Solidarnosc nous sont décrits sans pudeur dès le mois de mai par Kuron, un des principaux "experts" de Solidarnosc et fondateur de l'ex-KOR : "Seul un gouvernement qui aura la confiance sociale pourra stopper le cours des événements, et appeler à l’austérité dans le cadre de réformes. Le véritable enjeu de la bataille actuelle est la constitution d'un tel gouvernement." (Interview au journal français "Libération" du 5 mai 1988). On ne peut être plus clair, le but de Solidarnosc est le même que celui du gouvernement : faire accepter "l'austérité" aux ouvriers.
C'est pour cela que, dès le début du mouvement, le syndicat a développé son action de sabotage. Une des composantes essentielles de sa stratégie a été de détourner dans une impasse le mécontentement ouvrier. Alors que le mouvement débute pour des revendications salariales, Solidarnosc met tout son poids dans la balance pour que ne subsiste qu’'"une seule revendication : la légalisation du syndicat". Ainsi, lorsque Walesa appelle à la grève dans les ateliers du chantier "Lénine", le 22 août, c'est avec le slogan : "Fini les plaisanteries ! Maintenant nous voulons Solidarnosc !" Comme si la défense des conditions de vie les plus élémentaires, la résistance contre la misère, étaient de simples plaisanteries ! Pour sa part, le président du comité de grève du chantier "Lénine", réputé "radical", affirme également : "La seule revendication est le rétablissement de Solidarnosc".
C'est de façon très sélective que Solidarnosc lance ses appels à la grève. D'une part, en beaucoup d'endroits où la pression en faveur de la lutte est très forte, Solidarnosc se garde bien d'appeler à l'arrêt du travail, préférant décréter, afin de "défouler" la combativité ouvrière, l’"état de préparation à la grève"y ou bien menaçant d'appeler à celle-ci dans le cas où les autorités déchaîneraient une répression générale, ce qu'elles ont évité de faire, évidemment. D'autre part, l'appel direct à la grève aux chantiers navals "Lénine" de Gdansk, qui restent depuis l'été 80 un symbole pour toute la classe ouvrière en Pologne, participe également d'une manoeuvre. C'est une des entreprises où Solidarnosc est le mieux implanté, notamment du fait que c'est là où Walesa travaille; de ce fait, il sera plus facile qu'ailleurs de faire reprendre le travail et cette reprise fera figure à son tour de symbole : dans le reste du pays, les ouvriers auront le sentiment qu'il ne leur reste plus qu'à imiter leurs camarades de Gdansk. D'ailleurs, aux chantiers "Lénine", afin de faciliter cette reprise, Walesa a fait tout son possible pour présenter dès son début la grève comme une calamité, inévitable du fait de la mauvaise volonté du gouvernement qui n'a pas voulu entendre ses appels répétés à la négociation : "Je voulais éviter les grèves. Nous ne devrions pas être en grève, nous devrions travailler. Mais nous n'avions pas le choix... Nous attendons toujours des discussions sérieuses." (22 août). Et en fait, afin de mieux fatiguer les ouvriers, le gouvernement et Solidarnosc jouent au chat et à la souris pendant plus d'une semaine, l'un et l'autre faisant preuve d'"intransigeance" sur LA question du pluralisme syndical (polarisant ainsi les ouvriers sur une fausse question) jusqu'au moment où les deux parties "acceptent" de se rencontrer pour discuter "sans tabous" (sic)... de l'ordre du jour d'une hypothétique "table ronde" qui ne pourra se tenir, évidemment, que... lorsque le travail aura repris.
Ainsi, la totale complicité entre les autorités et Solidarnosc est évidente. Elle est encore plus évidente lorsque l'on sait qu'un des sports favoris des dirigeants de Solidarnosc est de franchir impunément les cordons policiers isolant les entreprises et les régions en lutte pour aller rejoindre les grévistes (tel Jan Litynski, fondateur du KOR et responsable de Solidarnosc pour Varsovie qui réussit à rejoindre le comité de grève des mines de Silésie pour en devenir le principal "expert", et Lech Walesa lui-même qui rentre dans le chantier "Lénine" en "faisant le mur"). Décidément, les flics polonais sont des incapables !
A ce partage des tâches participe, comme toujours en Pologne, l'Eglise qui se paie même le luxe de faire entendre deux sons de cloche : le son modéré tel celui de l'aumônier du chantier "Lénine" qui, la veille de la grève, prend position contre en affirmant qu'elle "mettrait le feu à la Pologne", et le son "radical" qui apporte son plein soutien aux grévistes et à leur revendication de "pluralisme syndical". Même les forces au pouvoir font étalage de leurs "désaccords" pour mieux désorienter les ouvriers. Ainsi, le 24 août, les syndicats officiels (OPZZ), dont le président est membre du Bureau politique du Parti, lancent une mise en garde au gouvernement pour qu'"il entende leur opinion" et "menacent" d'appeler à la grève générale. Jaruzelski a du avoir vraiment très peur !
Finalement, grâce à toutes ces manoeuvres, la bourgeoisie est arrivée à ses fins : faire reprendre le travail sans que les ouvriers n'aient RIEN obtenu. C'est une défaite ouvrière importante qui laissera des marques. C'est d'autant plus une défaite que Solidarnosc a réussi, comme organisation, à ne pas se démasquer dans le travail de sabotage en laissant le soin à Walesa, qui est toujours volontaire pour ce genre de besognes, d'apparaître comme celui qui a "vendu la grève". Sa popularité y laissera sans doute quelques plumes, mais "on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs". L'essentiel est que la majorité des ouvriers conserve ses illusions sur le syndicalisme "libre". En refusant de légaliser Solidarnosc (alors qu'en fait cette organisation a déjà "pignon sur rue" : nombreux hebdomadaires, collectes de cotisations, réunions régulières de ses membres et de ses dirigeants, tout cela est "toléré"), en continuant à "persécuter" ses dirigeants, le pouvoir apportera sa contribution à ces illusions.
EN POLOGNE COMME PARTOUT DANS LE MONDE, LA PERSPECTIVE EST PLUS QUE JAMAIS AUX AFFRONTEMENTS DE CLASSE
Août 80 - août 88 : la comparaison des résultats des grèves de ces deux périodes, semble donc indiquer un recul très sensible de la force de la classe ouvrière. Un examen superficiel de ces deux moments de lutte peut confirmer une telle vision : c'est vrai qu'il y a huit ans la classe ouvrière avait été capable de mener des combats beaucoup plus massifs, déterminés, c'est vrai en particulier, qu'en 80, elle avait réussi à se doter d'une organisation de sa lutte lui permettant de la contrôler de bout en bout jusqu'à la victoire. Mais on ne peut s'arrêter à ces simples éléments. En réalité, la faiblesse actuelle de la classe ouvrière en Pologne est fondamentalement l'expression du renforcement politique de la bourgeoisie dans ce pays, tout comme sa force d'août 80 lui venait en grande partie de la faiblesse de la classe dominante. Et ce renforcement de la bourgeoisie, plus qu'à une plus grande habileté des dirigeants du pays, elle le doit à l'existence d'une structure d'encadrement de la classe ouvrière absente en 80 : le syndicat Solidarnosc. Cela est très bien exprimé par Kuron : "Contrairement à juillet-août 1980, l'opposition dispose aujourd'hui de structures organisées capables de contrôler les événements".(Ibid.)
En fait la classe ouvrière de Pologne se trouve aujourd'hui confrontée au même type de pièges que les ouvriers des pays les plus avancés ont dû affronter depuis des décennies. C'est justement parce qu'elle n'avait pas encore fait cette expérience, qu'elle a pu se laisser piéger de cette façon par les manoeuvres du syndicalisme après sa lutte remarquable de l'été 80. En revanche, toute l'expérience accumulée par le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, notamment celui d'Europe occidentale, lui permet aujourd'hui de se dégager progressivement de l'emprise syndicale (comme on l'a vu lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86, ou en Italie dans le secteur de l'Ecole, en 87) et de prendre de plus en plus en main et unifier ses luttes comme l'avaient fait les ouvriers de Pologne en 80. Mais quand il y sera pleinement parvenu, la bourgeoisie ne pourra plus le faire revenir en arrière comme elle l'a fait pour le prolétariat de Pologne. Ce sont bien ces secteurs les plus avancés du prolétariat mondial qui pourront alors montrer le chemin à leurs autres frères de classe, et notamment ceux de Pologne et d'Europe de l'Est.
Les luttes de l'été 88 en Pologne ne démontrent nul recul de la classe ouvrière à l'échelle internationale. Au contraire, elles font la preuve des énormes réserves de combativité du prolétariat d'aujourd'hui que les défaites partielles ne réussissent pas à épuiser, mais qui, au contraire, ne font que s'accumuler avec l'intensification des attaques capitalistes. De même, la force des illusions syndicalistes, démocratiques, et même nationalistes pesant sur le prolétariat en Pologne met en relief les pas accomplis par celui des centres décisifs, des grandes concentrations ouvrières d'Europe occidentale, et donc du prolétariat mondial comme un tout; elle met donc en évidence son avancée vers des combats de plus en plus autonomes, puissants et conscients.
FM 4/9/1988
[1] [1454] Au sujet des grèves du printemps 88 en Pologne et de leur sabotage par "Solidarnosc", voir la Revue Internationale n°54.
Géographique:
- Pologne [111]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Grupo Proletario Internacionalista : crise et luttes ouvrières au Mexique
- 3036 reads
Nous publions ici un article du Grupo Proletario Internacionalista du Mexique. Nous avons déjà présenté ce groupe dans les numéros 50, 52 et 53 de notre revue. Cet article sur la situation au Mexique exprime la position du GPI. Cette prise de position est parue dans la publication du groupe Revolucion Mundial n°4 avant les élections présidentielles mexicaines de juillet dernier.
Par sa publication, outre l'expression de notre accord avec le contenu politique, nous voulons aussi porter à la connaissance du plus grand nombre la réalité du désastre économique que vit le capitalisme au Mexique ainsi que sur les 3/4 de la planète. Nous voulons aussi dénoncer les conditions d'existence dramatiques de milliards d'êtres humains aujourd'hui. Le texte de nos camarades du GPI montre que la barbarie capitaliste n'est pas une fatalité et que la classe ouvrière - même si elle ne peut avoir la même force locale que dans les grandes concentrations industrielles d'Amérique du Nord et d'Europe - lutte contre la misère et s'affirme comme la seule force sociale capable d'offrir une perspective autre que la barbarie à l'ensemble des couches populaires sans travail et miséreuses de ces pays. Oui, le prolétariat au Mexique, tout comme dans le reste de l'Amérique Latine, se bat et se trouve amené à développer les mêmes armes que ses frères de classe des autres continents contre les mêmes difficultés et les mêmes obstacles que sont en tout premier lieu les partis de gauche, les syndicats et la répression étatique.
La réalité de la combativité ouvrière au Mexique se trouve confirmée par le déroulement même des dernières élections présidentielles qui ont vu pour la première fois depuis plus de 60 ans le candidat du PRI - le parti au pouvoir - n'obtenir que 50% des votes dans la confusion la plus totale et de toute évidence grâce à la fraude. Cuauhtemoc Cardenas, son concurrent et lui-même issu du... PRI, était soutenu par une coalition de partis de gauche - dont le PC et les trotskystes. C'est sur les thèmes mystificateurs de la démocratie contre la corruption et la fraude électorale, et du nationalisme contre le remboursement de la dette mexicaine, contre la ''dictature du FMI" et l'impérialisme US que la bourgeoisie a tenté - et semble-t-il réussi - de constituer une force politique de gauche autour de Cardenas afin de dévoyer la colère et le désespoir croissants sur le terrain inoffensif et sans danger de la "démocratie". Et cette adaptation nouvelle des forces politiques de la bourgeoisie au Mexique s'accompagne du développement du "syndicalisme indépendant", indépendant du syndicat unique la CTM, version mexicaine du syndicalisme de base.
Bref, sous les conseils éclairés des USA, la bourgeoisie mexicaine met en place des forces politiques et syndicales de gauche dans l'opposition afin de dévoyer les inévitables luttes ouvrières à venir avec en particulier la mystification démocratique déjà employée dans la plupart des pays latino-américains tel le Chili aujourd'hui.
Dans l’abîme de la crise chronique
Durant ces dernières années, nous constatons une aggravation constante de la crise au Mexique. De fait, cette situation ne peut être comprise dans sa totalité qu'en prenant en compte le fait que le pays fait partie intégrante du système capitaliste mondial et que, de ce fait, il se trouve immergé dans la crise chronique mondiale qui s'étend et s'aggrave inexorablement depuis la fin des années 60, sous la forme de "récessions" (croissance industrielle et commerciale en voie de paralysie) toujours plus dures et profondes suivies de "reprises" toujours plus courtes et factices.
Ainsi, alors que la dernière "récession" de 1980-82 frappa littéralement le monde entier, la "reprise" qui s'en suivit de 1983 à 86 ne concerna que les grandes puissances, et la majorité des pays restèrent plongés dans la stagnation. Aujourd'hui, le monde entier reprend le chemin d'une nouvelle "récession" dont les effets seront certainement encore plus désastreux que ceux de la précédente.
Dans le cas du Mexique, nous assistons depuis 1982 à l'effondrement de l'industrie. Depuis cinq ans, le pourcentage de croissance du PIB reste en dessous de zéro... Tous les secteurs industriels sont stagnants ou en recul... ce qui entraîne une aggravation de la situation des travailleurs. En 1987, "la croissance industrielle continue à être totalement arrêtée" ([1] [1455]).
Nous n'allons mettre ici en évidence que trois signes extérieurs, visibles, de l'approfondissement de la crise en 1987 :
1) Le maigre accroissement du PIB (1,4 %) est loin de rééquilibrer la chute de l'année précédente (- 3,8 %). Ceci indique clairement que la production continue à stagner, à cause de l'absence de motifs pour investir due à la surproduction mondiale et à la chute des cours de toutes les matières premières dont le Mexique est producteur (pétrole, minéraux, produits agricoles).
2) Une inflation qui tourne annuellement autour de 159 %. Comme le marché interne reste épuisé, le gouvernement tente de le ranimer par une augmentation de ses dépenses. Il accélère pour cela la fabrication de billets de banque (papier-monnaie) avec lesquels il paye ses employés, vacataires, etc., ce qui permet à ces derniers de continuer à consommer, faire des crédits, etc.
Cependant, la fabrication incontrôlée de papier-monnaie a sur celui-ci les mêmes effets qu'aurait, par exemple, la production d'une marchandise quelconque à moindre coût : sa valeur baisserait. Et plus il y a du papier-monnaie sans valeur mis en circulation, plus il est déprécié par rapport à l'ensemble des marchandises, ce qui revient à dire que les marchandises coûtent plus cher.
S'il est vrai que toutes les marchandises coûtent plus cher, elles n'augmentent pas dans les mêmes proportions ; le prix de la force de travail (les salaires), en particulier, reste très en arrière par rapport au prix des autres marchandises, mécanisme si bien connu par tous les ouvriers et qui est utilisé par la classe capitaliste pour s'approprier de meilleurs bénéfices par le biais de la chute des salaires.
Le problème, pour le capital, réside dans le fait que chaque hausse des prix provoque une accélération de l'émission de billets... et ainsi de suite, provoquant une "spirale inflationniste " dans laquelle la quantité de monnaie va croissant au même rythme accéléré qu'elle se déprécie, jusqu'à parvenir à une situation où les prix augmentent si rapidement -au jour le jour et même d'heure en heure (la dite "superinflation")- que la monnaie perd toute utilité, puisqu'elle ne sert plus ni à mesurer la valeur des marchandises, ni aux échanges, ni à faire des économies, ni à rien.
Ainsi, le mécanisme utilisé dans un premier temps pour réanimer la circulation des marchandises se transforme en son contraire : un obstacle supplémentaire pour cette même circulation, ce qui approfondit la stagnation.
L'inflation est un exemple clair de la façon dont les mesures de politique économique appliquées actuellement par les Etats nationaux parviennent momentanément à contenir la crise, mais non à en finir avec elle. Et ces derniers mois, l'économie mexicaine courait tout droit vers l’hyperinflation" ([2] [1456]).
3) L'accroissement démesuré des valeurs boursières mexicaines en quelques mois et leur effondrement fin octobre 1987, en même temps que s’effondrait toutes les valeurs boursières du monde. La chute de la bourse au Mexique et la simultanéité avec la chute des autres bourses dans le monde n'est pas une simple coïncidence : elle a obéi aux mêmes causes profondes, elle a mis en évidence l'interpénétration totale de l'économie mondiale.
Les principales bourses du monde (New York, Europe et Japon) ne cessaient de croître ces deux dernières années, de façon totalement disproportionnée par rapport à la croissance industrielle. Les capitaux fuyaient les investissements productifs pour se placer dans des opérations financières spéculatives, signe que la "reprise" commencée en 1983 touchait à sa fin. Les principaux centres financiers étant en voie d'être saturés, les moins importants aussi voyaient affluer des capitaux. Ainsi, durant l'année 1987, beaucoup de capitaux "retournèrent" au Mexique, non pour être investis dans l'industrie, mais fondamentalement pour être placés sur le marché boursier, dans l'émission de valeurs papier (actions), s'appropriant l'argent d'autres investisseurs, qui achetaient des actions attirés par la promesse de juteux bénéfices (promesses qui allaient jusqu'à plafonner à 1000 %). Ainsi, par le pur jeu de l'offre et de la demande, jeu animé par la presse et le gouvernement, la bourse mexicaine gonfla en quelques mois de 600 % ... pour s'effondrer avec toutes les autres bourses du monde, quand il s'avéra que ni la production mondiale ni la production nationale n'avaient subi de croissance suffisante et que les bénéfices n'étaient pas réels; la bourse au Mexique alla jusqu'à perdre 80 % de la valeur qu'elle était parvenu à manipuler. Les seuls qui ont pu tirer des bénéfices sont ceux qui connaissent et manipulent l'information et qui ont pu en conséquence se défaire rapidement des actions et garder l'argent liquide, cependant que les autres se ruinaient. ([3] [1457])
Ainsi donc, dans les conditions présentes de surproduction et de saturation des marchés, la production industrielle est bloquée cependant que les capitaux s'orientent vers la recherche de bénéfices spéculatifs.
C'est dans cette situation que le gouvernement mexicain décide en décembre 1987 d'adopter un nouveau programme économique, baptisé "Pacte de solidarité économique".
L'Etat reconnaît l'échec des plans antérieurs pour contenir la crise (ce qui confirme que les déclarations officielles optimistes étaient mensongères), que la crise persiste et s'aggrave, et la nécessité d'opérer un autre recul de la façon la plus ordonnée possible, en "distribuant" (dans la mesure où l'Etat peut le faire) les pertes entre les différents secteurs capitalistes mais, fondamentalement, en augmentant encore plus l'exploitation de la classe ouvrière.
Pour lancer ce programme, l'Etat a développé une énorme campagne idéologique, en utilisant tous les moyens de diffusion existant, afin de convaincre les travailleurs qu'ils doivent l'accepter, que le "pacte" servirait de base pour trouver une solution aux "problèmes nationaux", qu'il doit exister une "solidarité" entre tous les "secteurs" sociaux, en d'autres termes, qu'ils doivent se sacrifier encore davantage pour sauver les bénéfices des capitalistes.
Par sa forme, le "pacte de solidarité" est un programme anti-inflationniste, semblable dans une certaine mesure à ceux qui sont appliqués dans d'autres pays comme l'Argentine, le Brésil ou Israël. En partant d'une hausse générale des prix des marchandises, subite et inattendue, jointe au blocage des salaires et à une diminution drastique des dépenses de l'Etat (5,8 %), il s'agit de tenter de contenir peu à peu l'inflation. Ce qui ne signifie rien d'autre qu'une nouvelle et terrible contraction du commerce interne, bien que "régulée" par l'Etat, et davantage de fermetures d'entreprises, en commençant par les entreprises étatisées (fermetures qui à leur tour se répercutent sur le terrain du privé).
De fait, durant ces cinq dernières années, il y a eu une constante liquidation des entreprises semi nationalisées, et elles ont été vendues à des prix d'enchères. Ce processus, nommé par le gouvernement "désincorporation", a atteint quelques 600 entreprises, dont certaines, importantes comme Fundidora Monterrey, ont entraîné dans la liquidation tout un ensemble de filiales et de fournisseurs. Le "pacte" ne fait qu'accélérer ce processus : rien que pendant les trois premiers mois du "pacte", le gouvernement a autorisé la disparition de quelques 40 entreprises (le cas le plus significatif étant celui de Aeroméxico qui employait plus de 10000 travailleurs) et la vente de 40 autres (parmi lesquelles se trouve la mine de cuivre Canaena, la plus importante du pays).
Tel est le sens de l'approfondissement de la crise : l'accélération du processus de destruction-dévalorisation du capital, par la destruction matérielle des moyens de production ou leur dévalorisation, et par la baisse des salaires
Avec le "pacte de solidarité", donc, les conditions de vie de la classe ouvrière ne font qu'empirer. L'épuisement physique au travail, le chômage et la misère s'approfondissent. L'exploitation capitaliste devient toujours plus insupportable.
LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LE PAYS
Comme dans le reste du monde, la situation du prolétariat au Mexique continue d'empirer. Les chiffres donnés par la bourgeoisie ne constituent qu'un reflet bien pâle de cette réalité.
L'effondrement de la base productive trouve son complément dans le chômage massif. On calcule ([4] [1458]) qu'au Mexique, plus de 4 millions de travailleurs ont été licenciés ces cinq dernières années, ce qui, joint à la population jeune qui cherche du travail sans en trouver, amène à 6 millions le nombre de chômeurs.. Un dramatique exemple est donné par le groupe DINA, qui employa jusqu'à 27 000 ouvriers, pour ne plus en employer que 10 000 en 1982 et à peine 5 000 en 87; le pacte va réduire davantage cette quantité, d'autant plus du fait de la décision de vendre sept filiales du groupe (opération qui sera accompagnée des mesures de "restructuration" adéquates, ce qui implique pour les ouvriers des licenciements supplémentaires).
Le lancement du "pacte de solidarité" a entraîné, de façon immédiate, 30 000 postes de travail en moins (17 000 dans les industries semi-étatisées et 13 000 dans le secteur central) ([5] [1459]), et les licenciements continuent.
Au chômage il faut ajouter la chute du salaire réel de la classe ouvrière. On peut se faire une idée de cette chute en regardant l'évolution de la "distribution des recettes", le pourcentage des salaires dans le PIB par rapport à la quantité du gouvernement et du patronat. En 1977, la part des salaires dans le PIB était de 40 % ; en 1986, elle était de 36 % et en 1987 elle est arrivée juste à 26 %.
Tous reconnaissent la chute libre du salaire minimum (officiellement, le pouvoir d'achat de ce SMIG n'aurait diminué que de 6 % en 1987). Il faudrait ajouter qu'il existe dans ce pays un nombre incalculable de salariés qui gagnent encore moins que ce salaire minimum ; exemple : les travailleurs de la municipalité de Tampico (ville-port de la côte atlantique de 230 000 habitants - ndlr) ont fait grève pour... exiger le salaire minimum ! Il y a, en plus, une tendance à ce que les salaires des travailleurs des plus hautes catégories (aussi bien des ouvriers gue d'autres sortes de travailleurs) aillent vers le bas : en 1976, par exemple, un professeur d'université arrivait à gagner l'équivalent de 4 SMIG et un travailleur de l'université 1 et demi ; aujourd'hui, celui-là ne perçoit que 2,8 fois le SMIG et celui-ci 1,2 fois ([6] [1460]).
D'autres exemples : les salaires dans les maquiladoras ([7] [1461]) de la frontière nord du pays sont tombés au point d'être les salaires d'usine de montage les plus bas du monde ; les retraités y touchent une pension de moins de la moitié du salaire minimum...
Les chercheurs sont obligés de reconnaître les conséquences de la réduction des salaires sur les conditions de vie des travailleurs. Ainsi, par exemple, "dans les années 81-85, les familles avec bas revenus (40 % de la population nationale) ont souffert une chute très sévère de leurs niveaux alimentaires de sorte qu'elles se trouvent au dessous des niveaux recommandés par la FAO" ([8] [1462]). On reconnaît aussi que 100 000 petits enfants meurent chaque année dans ce pays pour des raisons dues à la misère (dénutrition, parasitoses...).
Le "pacte" signifia un nouveau et brutal laminage des salaires et ceci sous deux aspects : d'un côté, les coupes dans les dépenses gouvernementales entraînent des coupes dans le salaire social : éducation, santé et autres services ; d'un autre coté, le mécanisme de base pour le contrôle de l'inflation repose, comme nous le disions plus haut, sur le ralentissement des hausses salariales par rapport à la montée des prix, autrement dit, sur la chute du pouvoir d'achat des salaires.
Au chômage massif et à la chute des salaires, il faudrait ajouter les conditions de travail que le capital impose : rupture complète des conventions collectives, partout, avec le remplacement des postes fixes par des temporaires (avec perte de toute sorte d'avantages, tels que les vacances etc.), augmentation des cadences de travail, des mesures que le "pacte" ne fait qu'accélérer. Un exemple récent est celui de Nissan, où les patrons voulaient en finir avec le temps de tolérance (10 minutes à l'entrée et 10 à la sortie du travail), ce qui reviendrait à produire 12 automobiles de plus par jour.
Enfin, conséquence directe de l'économie de capital (ce qui implique économie en mesures de sécurité) et de l'augmentation des cadences, il y a augmentation des "accidents" de travail, ce qui est même reconnu officiellement. Un cas récent est P"accident" survenu le 25 janvier dernier dans la mine Cuatro y Medio de Cohauila, où 49 travailleurs ont perdu la vie ; les autorités ont eu beau vouloir occulter les causes de l'effondrement qui enterra les mineurs , les faits sont là : l'effondrement a eu lieu à cause de l'explosion d'un transformateur électrique, qui fit exploser à son tour une haute concentration de grisou, ce qui mit en évidence aussi bien le manque d'entretien approprié dans les installations que le manque d'une équipe pour détecter et extraire le gaz. Les autres mineurs furent ensuite obligés de revenir au travail dans les mêmes conditions.
Voilà. Toute la situation au Mexique met en relief les mêmes traits du capitalisme mondial. Une crise chronique, qui n'est pour le prolétariat qu'encore plus d'exploitation, encore plus de misère, et, même, sa destruction physique. Une barbarie sociale croissante, une barbarie sans fin. Aucune "restructuration", aucun "programme" ne fera sortir le capitalisme d'une telle situation.
Pour la classe capitaliste mondiale (y incluse sa fraction mexicaine), la seule "solution" à la crise serait une nouvelle guerre mondiale en tant que moyen de destruction à une échelle mille fois plus grande des moyens de production, seule base qui, d'une façon hypothétique, pourrait donner passage à des nouvelles forces productives et à une nouvelle répartition du marché mondial entre les vainqueurs ([9] [1463]).
Mais la crise capitaliste actuelle, avec l'aggravation des conditions de vie et de travail qu'elle entraîne, fait bouger les têtes des millions de prolétaires. Elle réveille leur volonté de lutter contre l'exploitation capitaliste, volonté qui est restée écrasée sous le poids de plus de 50 années de contre-révolution triomphante, mais qui resurgit au niveau international, depuis la fin des années 60 avec des grèves massives.
Le prolétariat mexicain a lui aussi fait montre de ce réveil prolétarien.
LA LUTTE DE CLASSE AU MEXIQUE
A l'échelle mondiale, il n'y a qu'une seule classe ouvrière. Sa condition de classe productrice des richesses matérielles, et, à la fois, exploitée, l'unit face aux mêmes intérêts et objectifs historiques : l'abolition du travail salarié. La crise chronique qui traverse toute la planète rend encore plus évident le fait que les conditions de l'exploitation capitaliste sont fondamentalement les mêmes dans tous les pays du monde, qu'ils s'appellent "développés", "sous-développés" ou "socialistes", et rend encore plus évident le caractère unique, international de la classe ouvrière.
Dans ce sens, la lutte du prolétariat "au Mexique" est une petite partie d'une lutte unique et mondiale du prolétariat, même si, pour le moment, cette unité n'est déterminée qu'"objectivement", à cause de l'exacerbation de l'exploitation qui pousse les ouvriers de partout à résister, et qu'elle exige encore l'unité "subjective", c'est-à-dire, consciente et organisée par la classe ouvrière au niveau international, pour pouvoir mener à terme ses objectifs révolutionnaires.
Dans le numéro précédent de Revolucion Mundial, nous reconnaissions l'existence d'une réponse ouvrière dans ce pays face aux attaques économiques du capital, réponse qui, malgré sa faiblesse, ses limites et les obstacles que le capital met devant elle, s'inscrivait dans l'ensemble des luttes qui parcourt le monde depuis 1983.
Cette réponse a eu comme axe la grève des 36 000 électriciens du début 87, grève qui, malgré le fait d'être restée sous contrôle syndical, réussit à attirer dans une manifestation des centaines de milliers de travailleurs d'autres secteurs, au même moment où d'autres fractions de la classe ouvrière luttaient dans d'autres parties du monde.
Récemment, dans ces trois premiers mois de 1988, nous avons assisté au Mexique à un nouvel élan de la classe ouvrière, à des grèves en série qui, même si elles ont été relativement petites, même si elles n'ont pas eu l'amplitude des grèves qui ont récemment eu lieu dans d'autres pays, n'en expriment pas moins les mêmes tendances générales, les mêmes difficultés et elles affrontent les mêmes attaques de l'Etat.
Presque simultanément, à cause de la période de révision des contrats, des grèves ont éclaté dans tout le pays, aussi bien dans le "secteur public" que dans le "privé" : dans les usines d'automobiles Ford à Chihuahua, chez General Motors à Mexico, chez Volkswagen à Puebla et peu après chez Nissan dans le Morelos ; dans d'autres industries, telles que Quimica y Derivados et Celanese dans le Jalisco ; chez Central de Malta et les transports à Puebla ; Produc-tos Pesqueros à Oaxaca ; Aceitera B y G à San Luis Potosi ; les dockers du port de Veracruz ; chez les carrossiers CASA à Mexico. Une grève éclata aussi dans 25 compagnies d'assurances et dans 10 universités du pays. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture ont fait des arrêts de travail dans le Tamaulipas et le Sinaloa ; ceux du Métro de Mexico firent une marche de protestation. Et les travailleurs de la Sécurité Sociale ont réalisé des arrêts de travail et des mobilisations dans Mexico et aussi dans d'autres villes de province. Toutes ces grèves et ces mobilisations exprimaient la revendication centrale d'augmentation des salaires et de rejet des licenciements massifs que le capital avait planifiés.
Mais toutes ces grèves sont restées isolées les unes des autres, sous le contrôle d'airain des syndicats, aussi bien "officiels" (Congrès du Travail) qu'"indépendants" (Bureau de Concertation) ; à une exception près : le mouvement dans la Sécurité Sociale (IMSS) dont nous parlerons plus bas.
Le contrôle syndical s'est exprimé, par exemple, dans les accords qu'ils prenaient et qu'ils faisaient apparaître comme de la "solidarité ouvrière", mais qui n'avaient d'autre but que de soumettre les luttes : l'accord, par exemple, des cinq syndicats de l'industrie automobile, de décompter 1 000 pesos par semaine et par travailleur restant au travail pour "soutenir" ceux qui étaient en grève ; ils annulèrent ainsi toute possibilité de véritable solidarité (laquelle ne peut être que l'extension de la grève à d'autres usines de n'importe quel secteur), faisant croire à un "soutien" qui n'était en fait que passivité et isolement. Un autre exemple similaire est le nouveau genre que se donne le SUNTU (une espèce de fédération de syndicats de l'Université), dont le travail consiste principalement à maintenir dans un cadre de négociation séparée chaque université en grève.
Les syndicats sont toujours le premier obstacle que les ouvriers trouvent dans le développement de leurs luttes. Le syndicat est le principal moyen dont dispose le capital pour empêcher que les luttes dépassent le cadre de la protestation isolée et ne prennent le chemin de leur coordination et unification, laissant de côté les divisions par secteur ou régionales (ce gui est aujourd'hui possible du fait de la simultanéité même des luttes).
C'est là l'importance de la lutte des travailleurs de la Sécurité Sociale, eux dont les efforts pour se libérer du joug syndical ont été un exemple pour d'autres secteurs qui se posaient, à ce moment-là, la question d'entrer en lutte. Depuis déjà 1986, différentes catégories de l'IMSS ont réalisé des mobilisations dans différentes régions du pays ; maintenant ces catégories se sont mobilisées ensemble : les infirmières, les médecins, les travailleurs de l'intendance, etc.
La raison immédiate de cette nouvelle lutte fut le sabotage de la part de la direction et des syndicats de la révision de la convention collective, exigeant des travailleurs qu'ils se contentent de l’"augmentation" octroyée par le "pacte de solidarité".
Les travailleurs, en riposte, commencèrent à faire des arrêts de travail spontanés dans tous les services de la capitale mexicaine et dans d'autres villes de province, des arrêts de travail en dehors et contre le syndicat officiel ; les délégués syndicaux furent explicitement identifiés comme faisant partie des autorités du pouvoir. Le sommet de la lutte fut la manifestation combative du 29 janvier avec 50 000 travailleurs dans la rue et qui attira la solidarité des travailleurs d'autres services du secteur de la santé et des "colons" (habitants des quartiers marginaux). Les travailleurs firent aussi des efforts pour se doter d'un organisme représentatif, mais qui ne réussirent pas à se concrétiser.
La lutte fut durement attaquée par l'Etat. Les média ne faisaient que répéter que les autorités et les syndicats n'accepteraient aucune demande faite en dehors du "cadre juridique et syndical". Beaucoup de travailleurs reçurent des menaces de sanction dans leurs centres de travail ; plus d'une centaine furent mise à pied. La police aussi est venue réprimer ceux qui bloquaient les rues au moment des grèves. Mais la partie la plus importante de l'attaque contre les travailleurs fut prise en charge par la gauche du capital.
A chaque fois que les travailleurs essayent de sortir du contrôle des syndicats officiels, c'est la gauche du capital qui se met en branle pour mettre en avant une politique, tout aussi bourgeoise et néfaste pour les travailleurs, de "démocratisation" du syndicat ou de création d'un quelconque syndicat "indépendant". Cette fois-ci, cette gauche a agi sur deux versants : en essayant, d'un côté, de former un "front" qui appelait à "faire pression sur le syndicat pour que celui-ci remplisse son rôle"...comme s'il ne l'avait pas rempli, en réprimant ouvertement les travailleurs ! D'un autre côté, en minant le mouvement "de l'intérieur", en dévoyant les efforts d'auto organisation des travailleurs vers la création d'une coordination, laquelle, loin de mettre en avant les exigences de la lutte, se posa comme but celui de "gagner des postes dans le syndicat pour le démocratiser". En même temps, la gauche du capital essayait de renforcer les fortes tendances corporatistes dans ce secteur pour le tenir isolé du reste des travailleurs en grève. Et c'est ainsi que la lutte s'est épuisée sans avoir obtenu la moindre revendication.
Malgré tout, la lutte dans l'IMSS a encore une fois montré que non seulement le syndicat, en tant qu'organe du capital, peut très bien arriver à réprimer ouvertement les travailleurs, mais, et c'est le plus important, qu'il est possible de se mobiliser sans faire appel au syndicat. C'est donc un pas en avant, un exemple à suivre pour l'ensemble de la classe ouvrière, même s'il faut encore rompre avec les divisons sectorielles et régionales, rompre l'isolement des luttes.
En bref : les grèves que nous avons connues au Mexique, reflètent les mêmes tendances qu'à l'heure actuelle on a pu déceler dans des luttes ouvrières d'autres pays :
- d'abord, une tendance croissante à leur simultanéité : des séries de grèves qui éclatent un peu partout, dans différents secteurs, en même temps.
- tentatives de rompre le contrôle syndical, de s'auto- organiser dans les luttes les plus exemplaires.
- et, dans une moindre mesure, quelques manifestations de solidarité entre secteurs différents.
Les grèves affrontent l'attaque concentrée de l'Etat, dont le premier front est constitué par les syndicats. Les syndicats n'ont pas réussi à empêcher l'éclatement des grèves, mais, par contre, ils ont réussi à les maintenir isolées et dans le cadre des revendications "particulières" de chaque secteur.
Le contrôle syndical est en mesure de changer d'habit, là où les ouvriers sont décidés à s'en défaire, que ce soit en remplaçant un syndicat officiel par un autre "radical" ou "indépendant", que ce soit en présentant comme de l’ "auto organisation" ce qui n'est qu'une coquille sans le moindre contenu prolétarien et qui joue le même rôle que le syndicat : isolement et usure des luttes.
En même temps l'attaque se concrétise dans un renforcement continu des appareils répressifs, l'énorme déploiement policier contre les mobilisations, la répression directe dans certaines luttes.
A ce qui précède, il faut encore ajouter les campagnes pour maintenir la domination politique sur les travailleurs, par le jeu de la "démocratie", question qui est aujourd'hui au : Mexique, à plein rendement face au prochain changement de président. C'est ainsi que les partis d'opposition ont essayé de canaliser le mécontentement dû au "pacte de solidarité" vers les élections, en particulier avec des marches convoquées soi-disant contre le "pacte" et qui finissent en fait en demandant l'appui à tel ou tel candidat.
Enfin, l'Etat bourgeois veut apparaître aux yeux du prolétariat comme quelque chose d'inamovible et intouchable.
La dernière expression de la récente vague de grèves au Mexique a été la grève d'Aeroméxico. Plus de 10 000 travailleurs (fondamentalement ceux au sol) se sont soulevés contre le souhait de la compagnie de mettre hors service 13 avions, ce qui aurait entraîné un bon paquet de licenciements.
Etant assuré du fait que le syndicat tenait bien en main le contrôle de ces travailleurs, le gouvernement, contraire ment à ce qu'ils craignaient, n'a pas "réquisitionné" l'entreprise (ce qui aurait impliqué l'entrée de la police et des jaunes), tel qu'il le fait en général dans les entreprises para-étatiques, mais il laissa éclater la grève pour, peu de j jours après, sous prétexte des "pertes dues à la grève" déclarer la compagnie en faillite, jetant à la rue des milliers de travailleurs.
Il est évident qu'à cette occasion, l'Etat a voulu donner une "leçon", non seulement à ce secteur, mais à toute la classe ouvrière. Le message, diffusé à profusion par tous les média du capital, était on ne peut plus clair : "les travailleurs doivent se résigner...la grève ne sert à rien".
Mais, pour la classe ouvrière les leçons que ces luttes ont laissées sont bien différentes; et bien différentes sont les perspectives que nous devons en extraire.
PERSPECTIVES DE LA LUTTE OUVRIERE
Pour le moment, les grèves ont cessé dans ce pays. Mais il n'est pas nécessaire d'être sorcier pour deviner que face à l'approfondissement de la crise, les ouvriers continueront à être poussés à résister, et il ne se passera pas longtemps avant de revoir des nouvelles luttes. De fait, la tendance actuelle dans tous les pays du monde va vers la multiplication des grèves, même s'il s'agit de luttes à caractère défensif, des grèves de résistance face aux attaques économiques du capital.
Cependant, au fur et à mesure que les grèves s'étendent, en embrassant d'autres fractions de la classe ouvrière de par le monde entier, en montrant des tentatives de rupture avec les syndicats, d'auto organisation et de solidarité, les contre-attaques du capital sont aussi de plus en plus dures. Chaque nouvelle lutte devient de plus en plus difficile, elle exige une plus grande détermination, une plus grande énergie ouvrière, car elle affronte un ennemi de moins en moins disposé à ne céder à aucune revendication. Chaque fraction nationale du capital essayera d'écraser les luttes par tous les moyens à sa portée pour ne pas prendre le risque de perdre la moindre parcelle de terrain dans la concurrence sur les marchés.
Depuis longtemps déjà, les grèves de résistance isolées ne réussissent pas à arracher au capital la moindre solution aux revendications. Aujourd'hui, seule une lutte vraiment massive et combative, qui embrasse des centaines de milliers de travailleurs peut avoir l'espoir d'arrêter momentanément les attaques économiques du capital, mais même cela aussi devient de plus en plus difficile. Cela veut dire que le développement des luttes de résistance ne pourra culminer en aucune façon dans une amélioration réelle et durable pour les travailleurs, tant que le contexte de crise chronique subsiste.
Le développement des luttes, dans un sens progressif, ne peut être, par conséquent, en plus de l'extension, que l'approfondissement des objectifs, le passage des luttes isolées pour des revendications particulières à une lutte générale et organisée pour des objectifs de classe. Les efforts actuels pour la solidarité et l'auto organisation des ouvriers nous démontrent cette tendance.
Mais le fait que les luttes de résistance prennent cette voie n'est pas un produit automatique de la crise, mais cela exige un effort supplémentaire de la classe ouvrière : l'effort de récupération, d'assimilation et de transmission de l'expérience de ses luttes, historiques et récentes, de ces expériences qui lui montrent la nécessité de se hisser à partir des luttes qui ont seulement pour but de résister seulement face aux effets de l'exploitation capitaliste, jusqu'à la lutte qui a pour but d'en finir définitivement avec cette exploitation; et pour cela elle devra renverser la bourgeoisie et prendre le pouvoir politique, instaurer la dictature du prolétariat.
Cela exige, donc, que le prolétariat se hisse à la conscience de ses objectifs historiques révolutionnaires. C'est là un effort collectif, de l'ensemble de la classe, dans lequel l'organisation des révolutionnaires (et plus le Parti Mondial), en tant que partie la plus active et consciente de la classe, joue un rôle déterminant.
Le résultat du combat pour la conscience de classe sera décisif, en dernier ressort, dans l'issue des affrontements de classe à venir.
Ldo Mai 1988.
[1] [1464] Voir Revolucion Mundial n° 1 et 3. Le PIB (Produit Intérieur Brut) c'est un chiffre de l'économie bourgeoise qui, d'une certaine manière, exprime la croissance d'une année sur l'autre. Il faut cependant avoir à l'esprit que, étant donné les présupposés théoriques utilisés (division de l'économie en "secteurs" industriel, agraire et financier ; "valeur ajoutée" etc.) et la manipulation que les "scientifiques" font des résultats, ce genre de chiffres présente une réalité déformée en fonction des intérêts du capital.
[2] [1465] La tendance à "hyperinflation" était évidente pour quiconque sait que deux et deux font quatre :
INFLATION : Pourcentage de variation annuel
1983 1984 1985 1986 1987
% 80 60 64 106 160
[3] [1466] Dans la phase suivante du jeu, les gagnants récupèrent aussi, à des prix donnés, les papiers émis, en gardant finalement aussi bien l'argent que les actions. C'est pour cela que la bourse paraît se récupérer dans une certaine mesure par la suite et les licenciements massifs d'ouvriers (qui vont de pair avec l'augmentation des cadences pour ceux qui continuent à avoir un travail). Sur cette base, le capital tente de compenser la chute des profits, en s'appropriant davantage de plus-value par rapport au capital investi, ce qui, sur le plan du marché international, signifie présenter des produits moins chers, plus compétitifs.
[4] [1467] D'après les données du SIPRO (Servicios Informativos y Procesados A.C.), qui coïncident avec d'autres sources
[5] [1468] Rapport officiel sur le "pacte" du Secrétariat de la Présidence, mars 88.
[6] [1469] Du journal Uno mâs uno du 27-1-88
[7] [1470] Les "maquiladoras" sont pour la plupart, des industries de composants électroniques et automobiles à capital étranger, dont la production est dirigée vers le marché des Etats-Unis (c'est pour cela qu'elles sont installées de préférence sur la frontière nord). Le tableau suivant montre le salaire payé dans ces "maquiladoras" par rapport à d'autres installées dans d'autres pays :
Moyenne du salaire de base/heure (1986) : Corée du Sud : 3,65 $ ; Taïwan : 2,95 $ ; Singapour : 2,30 $ ; Hong-Kong : 2,05 $ ; Jamaïque : 1,25 $ ; Costa-Rica : 1,05 $ ; R. Dominicaine : 0,95 $ ; Mexique : 0,85 $. Source : El Financière, 10/08/87
[8] [1471] Le Monde Diplomatique, version espagnole, Décembre 87.
[9] [1472] La bourgeoisie mexicaine participa, par exemple, à la 2ème Guerre Mondiale, pas tant avec des soldats (ce fut purement symbolique), mais avec la fourniture des matières premières. Par la suite, elle tira profit de la période de reconstruction d'après-guerre, ce qui a permis l'industrialisation accélérée du pays
Géographique:
- Mexique [36]
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
- Luttes de classe [33]
Comprendre la décadence du capitalisme (5) : l'analyse marxiste du développement de l'histoire
- 15026 reads
Dans cette cinquième partie (cf. Revue Internationale n° 48, 49, 50 et 54) nous revennons sur la critique ou le rejet de la notion de décadence par une série de groupes du milieu politique prolétarien (Parti Communiste Intemationaliste (Programma, bordiguiste; PCI), Groupe Communiste Internationaliste (GCI), A Contre Courant (récente scission du GCI), Communisme ou Civilisation (CoC), en partie la Fraction Externe du CCI (FECCI) etc.). Ici encore nous montrerons en quoi ces critiques cachent en réalité un abandon de la conception marxiste de l'évolution de l'histoire qui fonde la nécessité du communisme, et, par là même, affaiblissent la nécessaire dimension historique dans la prise de conscience du prolétariat, ou, pour certains comme le GCI, aboutissent à présenter la révolution comme la vieille utopie anarchiste.
L'analyse marxiste du developpement de l'histoire
"Les visions décadentistes correspondent non pas au point de vue prolétarien mais à celui bourgeois de l'évolutionnisme" (Le Communiste - LC - n° 23). Le GCI ([1] [1473]) ne se limite pas à récuser l'idée même d'une décadence du mode de production capitaliste (cf. articles précédents), il généralise ce refus à toute l'histoire de l'humanité. Ce "groupe" s'écarte ainsi de l'analyse de Marx pour qui chaque mode de production connait une phase où les nouveaux rapports sociaux de production aiguillonnent le développement des forces productives et une phase où ces rapports constituent un frein à la croissance de celles-là: « A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore fontes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale" ("Avant-Propos à la critique de l'économie politique", Ed. La Pléiade).
Pour mieux pouvoir nier toute phase de décadence, le GCI nie son corollaire : l'existence même d'une phase ascendante ! Au nom de la défense des classes exploitées le GCI enfourche la vision morale des anarchistes qui, arguant du développement de l'exploitation tout au long de l'histoire, refuse de reconnaître le rôle progressiste du développement des forces productives. "Pour nous qui partons de la vision de tout l'arc historique du communisme primitif au comnuanisnte intégral, il s'agit au contraire de voir en quoi la marche forcée du progrès et de la civilisation a signifié chaque fois plus l'exploitation, la production de surtravail, en fait la réelle afflinnation de la barbarie par la domination de plus en plus totalitaire de la valeur." (LC n° 23). A l'instar de Proudhon, le GCI ne voit dans la misère que la misère sans voir son côté révolutionnaire. Concevoir, avec Marx, la succession des "modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne comme des époques progressives de la formalion économique de la société"("Avant-Propos"), montrer le rôle progressiste des classes exploiteuses du passé reviendrait à défendre ces dernières contre les classes exploitées... Ainsi, Marx deviendrait le pire des contre-révolutionnaires lui qui, tout au long des pages du Manifeste Communiste, souligne ce rôle de la bourgeoisie dans sa phase ascendante : "La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire (...). Elle a accompli des merveilles qui sont autre chose que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques (...) Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait dans le passé toutes les générations dans leur ensemble" ("Le Manifeste Communiste").
Bordiga et ses epigones
Se couvrir de l'autorité de Bordiga ([2] [1474]) pour masquer son involution anarchiste n'est d'aucun secours pour le GCI "La vision marxiste (du développement historique NDLR) peut se représenter en autant de branches, de courbes toutes ascendantes jusqu'à ses sommets auxquelles succède une violente chute brusque, presque verticale, et, au fond, un nouveau régime social surgit; on a une autre branche historique d'ascension." (Bordiga, Procès verbal de la réunion de Rome 1951, publié dans Invariance n° 4) car c'est une planche pourrie pour plusieurs raisons et nous allons le montrer dans ce point et au suivant.
Bordiga écrivit ce texte contre ceux qui, au sein du PCInt, défendaient encore les acquis de la Gauche Communiste Internationale. L'acte de naissance du courant bordiguiste (1951) correspond à la liquidation des restes des positions politiques de la Fraction Italienne de la G.C.I. de 1926 à 45 au sein du PCInt ([3] [1475]). Et pour cause, toutes les analyses et positions politiques de la Fraction s'articulaient autour de la compréhension que le capitalisme était entré dans sa phase de décadence depuis 1914: « Aujourd'hui dans la phase extrêrne de décadence capitaliste, il n'y a plus de territoire à conquérir pour le mode bourgeois de production, car celui-ci est arrivé au point ultime de sa situation et les pays arriérés ne peuvent être industrialisés que par le prolétariat luttant pour la société communiste (..) L'accumulation progressive de plus-value capitalisée porte ce contraste (entre le travail payé et le travail spolié) à son terme extrême lorsque les forces productives, débordant du cadre limité de la production bourgeoise, heurtent les limites historiques du champ d'écoulement et de réalisation des produits capitalistes." (Extraits du Manifeste et de la Résolution de constitution du Bureau International des Fractions de la Gauche Communiste Internationale, Octobre n° 1, février 1938) ([4] [1476]).
Quant aux autres références du GCI elles parlent d'elles mêmes : "La Gauche Internationaliste", un groupe moderniste issu de la décomposition du maoïsme et aujourd'hui disparu, et "Socialisme ou Barbarie" un groupe qui n'a pu véritablement rompre d'avec le trotskysme et qui, tout au long de son existence, a combattu les continuateurs de la Fraction Italienne : la Gauche Communiste de France ([5] [1477]).
Critique de la conception bordiguiste de l'evolution historique
Bordiga s'écarte sur trois plans de la conception marxiste. C'est ce que nous allons développer à l'aide d'exemples puisés dans la réalité historique elle-même. Cette dernière constitue un violent démenti à la vision développée par Bordiga, mais confirme par contre, pleinement, toutes les thèses de Marx.
La nécessité d'une période de transition
Aucune société dans le passé n'a disparu à la suite d'une "violente chute brusque". La courbe d'évolution de la population mondiale que nous reproduisons ci-dessous est une magistrale confirmation d'une part, de la succession des modes de production (primitif, asiatique, antique, féodal et capitaliste), d'autre part, du mouvement lent d'ascendance et de décadence de chaque mode de production et, enfin, de la longue transition entre eux. Nous sommes loin "des branches de courbes toutes ascendantes jusqu'à leur sommet auxquelles succède une violente chute brusque" de Bordiga ([6] [1478]).
GRAPHIQUE N°1
SOURCE : « Essai sur l'évolution du nombre des hommes », J.N. Biraben, Population, n° 1, 1979. Ce graphique est la plus cohérente et récente reconstitution de l'évolution de la population mondiale. Nous avons, nous même, subdivisé cette courbe pour y distinguer clairement les différentes phases de chaque mode de production. L'évolution démographique des sociétés passées était, du fait du faible développement de leurs forces productives, étroitement liée aux fluctuations de la production agricole qui constituait l'activité productrice essentielle de celles-ci. Le mouvement de la population est donc un bon indicateur des grandes tendances économiques, des fluctuations dans le développement des forces productives. Pour les sociétés qui précèdent le féodalisme nous constatons ce lien direct entre la production agricole et le mouvement de la population. Dans la décadence féodale, par contre, la courbe de population, après une chute, continue de croître. Ceci est le résultat de la montée du capitalisme (l6ème siècle), qui, par l'accroissement de la productivité du travail qu'il induit, rompt ce lien. En fait, si l'on isole la production strictement féodale, celle-ci stagne globalement du 14ème au 18ème siècle.
Les récentes reconstitutions d'histoire économique nous fournissent de précieuses indications qui confirment cette évolution globale :
FEODALISME. Après une transition qui dure 7 siècles (de 300 à l'an 1000), pendant laquelle la nouvelle classe féodale et les nouveaux rapports sociaux de production du servage prennent place, se développe la phase ascendante de l'an 1000 au 14ème siècle. "...Vers la fin du ler millénaire les forces de production ne différaient que fort peu de celles de l'Antiquité (..). Du l0ème au 13ème siècle c'est la révolution agricole qui nourrit le développement de toutes les branches de la société (...) un nouveau système agraire dont la capacité de production est doublée par rapport à celle de l'ancien (..). C'est pourquoi, en relation avec la croissance démographique, la production céréalière augmenta jusqu'au 14ème siècle (...)". A cette date, la féodalité entre en décadence jusqu'au 18ème siècle. "Inversement il y a arrêt de la croissance agricole et démographique à la fin du 13ème siècle (...). On conjecture donc que l'agriculture médiévale avait atteint dès la fin du 13ème siècle un niveau technique moyen équivalent à celui du début du 18ème siècle." (citations tirées de : Agnès Geshard, "La Société Médiévale", 1985, Ed. M.A. et Antonetti Guy, "L'économie féodale", Que sais-je?). Au sein de cette décadence commence la transition au capitalisme à partir du l6ème siècle
ANTIQUITE. Le cas de l'Antiquité est trop connu pour devoir s'y étendre; tout le monde a au moins une fois dans sa vie entendu parler de la décadence de Rome ! Les besoins croissants de l'empire, la pression démographique, la gestion d'un territoire de plus en plus grand imposait à Rome d'aller au-delà des limites permises par ses rapports de production. L'appropriation privée du sol et la faible productivité de l'esclavagisme obligeaient Rome à piller du blé pour se nourrir et à importer des esclaves pour travailler la terre. A un certain stade de son expansion, Rome n'est plus à même de s'alimenter : les conquêtes sont de plus en plus lointaines et difficiles à assurer et l'esclave se fait cher (son prix est multiplié par 10 entre l'an 50 et 150 après J.C.). Dépasser la faible productivité de l'esclavagisme nécessitait d'autres rapports de production plus productifs. Mais ceci passe nécessairement par une révolution sociale, par la perte de pouvoir de l'ancienne classe dominante liée à ces rapports de production. C'est pourquoi, s'additionnant aux blocages économiques, la classe au pouvoir bloque le développement des forces productives afin de préserver sa domination politique. En l'absence d'innovations technologiques (c'est-à-dire d'accroissement de la productivité du travail) l'agriculture subit la loi des rendements décroissants, la famine se développe, la natalité baisse, la population décroît, c'est la décadence romaine. Nous publions ci-dessous un graphique intéressant dans la mesure où il illustre clairement l'action de frein exercée par les rapports de production sur le développement des forces productives : nous y constatons l'antécédence du déclin des découvertes scientifiques sur la chute de la population.
GRAPHIQUE N°2
SOURCE : “The effects of population on nutrition and economic wellbeing", Julian L. Simon, in Hunger and History, Ed. Cambridge University Press.
Ce graphique montre, d'une part, l'évolution de la population (en millions d'habitants, 2ème échelle de gauche), d'autre part, le taux de croissance de cette dernière (en %, lère échelle de gauche) et, enfin, le nombre de découvertes scientifiques (échelle de droite).
SOCIETE DE TYPE ASIATIQUE. Un phénomène analogue se développe au sein des sociétés vivant sous la domination des rapports de production de type asiatique ([7] [1479]). Ces dernières disparaissent pour la plupart d'entre elles entre 1000 et 500 avant J.C. (cf. courbe de la population). La décadence de ces sociétés se manifeste par d'incessantes guerres entre sociétés royales cherchant par le pillage de richesses une solution aux blocages productifs internes, des révoltes paysannes incessantes, un développement, gigantesque des dépenses étatiques improductives. Les blocages politiques et rivalités intestines au sein de la caste dominante épuisent les ressources de la société dans des conflits sans fin et les limites d'expansion géographique des empires attestent que le maximum du développement, compatible avec les rapports de production, a été atteint.
SOCIETES PRIMITIVES. De même, les sociétés de classes n'ont pu naître que de la décadence des sociétés primitives, comme le disait Marx : "L'histoire de la décadence des sociétés primitives (...) est encore à faire. Jusqu'ici on n'a fourni que de maigres ébauches (..). Deuxièmement, les causes de leur décadence dérivent de données économiques qui les empêchaient de dépasser un certain degré de développement (...). En lisant les histoires de communautés primitives, écrites par des bourgeois, il faut être sur ses gardes." (Lettre à Vera Zassoulitch dans "L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat", Ed. Sociales). "Durant la période paléolithique qui a précédé le néolithique, la croissance de la population a été très lente (0,01 à 0,03 % par an), mais cela a quand même permis à la population mondiale d'atteindre quelque 9 à 15 millions de personnes (vers -8000). Chiffres certes très faibles, mais qui, dans le contexte d'une économie de chasse et de cueillette, a atteint un niveau qui ne permettait plus la poursuite de la croissance de la population SANS UNE MODIFICATION RADICALE DE L'ECONOMIE. (...) D'après les estimations de Hassan (1981), la capacité optimum de la population du monde dans le contexte d'une société basée sur la chasse et la cueillette serait de l'ordre de 8,6 millions de personnes." (P.Bairoch, "De Jéricho à Mexico", Gallimard-Arcades, 1985).
Condition de l'émergence d'une nouvelle classe révolutionnaire et de nouveaux rapports sociaux
Décréter l'inexistence d'une phase de décadence pour toute société comme le fait Bordiga, c'est rendre impossible tout passage à un nouveau mode de production. La nécessité de celui-ci est un douloureux enfantement qui ne peut émerger que face aux blocages de l'ancien mode de production. Pourquoi tout à coup les hommes s'ingénieraient-ils à produire autrement si le système dans lequel ils vivent est toujours ascendant et productif ? Pourquoi, sous quelles nécessités - restons matérialistes tout de même ! -, une partie de la société développerait de nouveaux rapports de production plus productifs si les anciens sont toujours pcrformants ? "... jamais des rapports de production ne se mettent en place avant que les conditions matérielles ne se soient écloses dans le sein même de la vieille société." (Marx, Avant-Propos).
Le pouvoir de la classe dominante et l'attachement de celle ci à ses privilèges sont de puissants facteurs de conservation d'une forme sociale. Or ce pouvoir est à son maximum au moment de l'apogée d'un mode de production et, seule une longue décadence est à même de l'éroder et de remettre en cause la légitimité de cette domination. L'épuisement historique du rôle d'une classe sociale n'apparaît pas du jour au lendemain dans la conscience sociale, et quand bien même apparaîtrait-elle, que cette dernière, à l'image d'un gentleman anglais, ne laisserait pas le libre passage à une nouvelle classe dominante. C'est par les armes et la répression qu'elle défendra son pouvoir jusqu'au bout. Il aura fallu des dizaines d'années de famines, d'épidémies, de guerres et d'anarchie avant que l'ancien mode de production soit abandonné: 7 siècles pour l'esclavagisme, 4 siècles pour le féodalisme ! Un ensemble de rapports sociaux ayant lié entre eux des hommes pendant des siècles n'est pas dépassé du jour au lendemain. Seuls de tels événements parviennent à venir à bout de siècles de coutumes, d'idées et de traditions. La conscience collective retarde toujours sur la réalité objective qu'elle vit.
Un nouveau mode de production ne peut s'instaurer que s'il existe une classe porteuse de nouveaux rapports sociaux de production plus productifs, or seule une décadence crée les conditions de son développement. De plus, et conjointement, le développement du mécontentement de la classe exploitée doit également mûrir pendant une longue période. Ce sont des dizaines d'années de famines et d'humiliation qui pousseront les exploités à se révolter aux côtés de la nouvelle classe dominante contre l'ancienne.
Le développement de nouveaux rapports sociaux de production plus productifs est un long processus, d'une part, parce que les hommes n'abandonnent pas un outil avant d'avoir fait la preuve de son inutilité et, d'autre part, parce qu'ils naissent en milieu hostile, subissant la gangue et la répression de l'ancien mode de production.
Les castes des sociétés du mode de production asiatique n'ont pu se développer que dans la déstructuration des rapports sociaux de production "égalitaires" du communisme primitif.
La classe des propriétaires fonciers esclavagistes naît dans la décadence du mode de production asiatique. Concrètement, à Rome, du combat entre la nouvelle force constituée par les propriétaires terriens qui s'approprient le sol de façon privée et la caste princière de la société royale étrusque qui vit encore à partir du tribut extorqué à un ensemble de collectivités villageoises produisant sous des rapports communautaires hérités des sociétés post-néolithiques.
La féodalité naît au sein de la décadence de Rome. C'est à la périphérie de l'empire que commencent à s'instaurer de nouveaux rapports sociaux de production : le servage. Les anciens maîtres romains affranchissent leurs esclaves, ces derniers peuvent alors cultiver un lopin de terre et posséder leurs moyens de production en contrepartie d'une fraction de leur récolte.
La bourgeoisie naît au sein de la décadence féodale, écoutons Marx : "...les moyens de production et d'échange qui servirent de base à la formation de la bourgeoisie furent créés dans la société féodale (nous sommes aux antipodes de la chute brusque, verticale, au fond de laquelle un nouveau régime social surgit de Bordiga, NDLR). "La société bourgeoise moderne est issue des ruines de la société féodale (...) Ils (le commerce mondial, les marchés coloniaux) hâtèrent le développement de l'élément révolutionnaire au sein d'une société féodale en décomposition. L'ancien mode de production, féodal ou corporatif, ne suffisait plus aux besoins qui augmentaient en même temps que les nouveaux marchés (...) A un certain stade du développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et commerçait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot, les rapports féodaux de propriété, cessèrent de correspondre aux forces productives en pleine croissance. Ils entravaient la production au lieu de la faire avancer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Ces chaînes, il fallait les briser: elles furent brisées." ("Le Manifeste Communiste"). "... L'ère capitaliste ne date que du 16ème siècle. Partout où elle éclôt, l'abolition du servage est depuis longtemps un fait accompli, et le régime des villes souveraines, cette gloire du Moyen Age, est déjà en pleine décadence. (...) L'histoire moderne du capital date de la création du commerce et du marché des deux mondes au 16ème siècle." (Marx, "Le Capital", Ed. La Pléiade). Le régime des villes souveraines, c'est la pleine ascendance du Moyen Age (llème - 14ème siècle). Le capitalisme naît au sein de la décadence féodale (14ème - 18ème siècle) au 16ème siècle au moment des grandes découvertes.
Il aura fallu deux siècles de décadence de Rome pour que s'ébauchent de nouveaux rapports sociaux de production (le colonat, forme primitive du servage) à la périphérie de l'empire et encore 4 à 6 siècles pour qu'ils se développent et se généralisent. Il faudra attendre 2 siècles de décadence féodale avant que n'apparaissent les rapports capitalistes de production et encore 3 siècles avant qu'ils ne se généralisent. Nous sommes donc très loin également de la pétition de principe du GCI, dénuée de tout fondement théorique et historique, qui pour nier toute phase ascendante postule que dès sa naissance le capitalisme est "directement et invariablement universel (...) Ainsi le capital pose lui-même tous ses présupposés, il est lui-même auto présupposition de sa domination mondiale, dès qu'il apparaît comme mode de production il pose en bloc et mondialement son caractère universel ..." (LC n° 23). Par ce biais, le GCI élimine d'un trait de plume l'existence des marchés extra-capitalistes. Comme il postule "l'existence pleine et entière du marché mondial comme présupposition de l'apparition du mode de production capitaliste (...) l'échange entre production capitaliste et production extra-capitaliste est un non-sens, ... ".
Ainsi sont gommées de l'histoire les dizaines d'années mises par la bourgeoisie pour se développer et se dégager des rapports trop étroits du féodalisme. Sont également gommées des dizaines de pages où Marx décrit ce difficile et long procès qu'est l'accumulation primitive du capital... "La grande industrie a fait naître le marché mondial (...) en retour, ce développement a entraîné l'essor de l'industrie (où est la présupposition du marché mondial chez Marx ? ) (...) Nous voyons donc que la bourgeoisie moderne est elle-même le produit d'un long processus de développement de toute une série de révolutions survenues dans les modes de production et d'échange." ("Le Manifeste").
Comment peut-on prendre au sérieux un "groupe" qui invente et réécrit l'histoire au gré de ses humeurs?
La prise de conscience de la nécessité politique de la destruction du capitalisme ne peut venir que de la crise historique de celui-ci et non d'une simple crise de croissance ou de restructuration. C'est face à l'enjeu actuel : socialisme ou barbarie, révolution communiste ou guerre impérialiste généralisée irrémédiable pour l'humanité, que le prolétariat pourra comprendre et mesurer toute l'immensité de sa tâche. Nier la décadence c'est amoindrir la nécessité du communisme et affaiblir la dimension historique dans la prise de conscience du prolétariat. Si le capitalisme se développe "...au moins deux fois plus rapidement que dans sa phase ascendante" comme le prétend le GCI ([8] [1480]), la révolution est encore moins possible aujourd'hui qu'hier; elle devient une lointaine utopie anarchiste. C'est ce que le GCI propose aujourd'hui à la classe ouvrière.
ANALYSE DE LA DECADENCE ET TROTSKYSME
Nos censeurs se plaisent à nous confondre avec le trotskysme. "Une telle conception (la décadence) pouvait à la limite s'expliquer dans l'entre-deux-guerres où effectivement la production capitaliste a stagné. C'est à cette époque qu'un Trotsky pouvait déclarer en tête du Programme de Transition que « les forces productives de l'humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus d’un accroissement de la richesse matérielle ». C'est à cette époque aussi que certains courants de gauche (la Gauche Communiste) fondent une analyse de la décadence du mode de production capitaliste sur des thèses luxemburgistes en considérant que la plus-value a cessé d'augmenter." (CoC n° 22), "Pour les décadentistes trotskystes, les forces productives ont cessé de croître, en l'occurrence à partir de 1914 pour le capitalisme (...) la conception de la décadence est étroitement liée à celle de la dégénérescence du caractère ouvrier de l'URSS chère tant aux staliniens qu'aux trotskystes" (LC n° 23).
De Marx à la troisième Internationale, la problématique de la décadence est devenue une question centrale au sein du courant marxiste. Avec la dégénérescence de la vague révolutionnaire de 1917-23 et de ses organisations politiques, débutait, pour le mouvement ouvrier, une longue nuit de plus de 50 ans, qui a fait dire à Victor Serge qu'il était "minuit dans le siècle". Depuis, les contributions sur cette question se concentrèrent dans les groupes de gauche issus du combat contre la dégénérescence de la troisième Internationale, y compris l'Opposition Internationale de Gauche animée par Trotsky jusqu'en 1939 ([9] [1481]). Ces groupes ont certes balbutié sur bien des questions. Nous ne sommes pas des bordiguistes qui considérons les textes anciens comme des tables de lois intouchables. Néanmoins ces groupes, malgré certaines erreurs, ont eu le mérite de développer la théorie révolutionnaire dans un cadre marxiste contrairement à nos critiques qui renient ce cadre à la simple vue des taux de croissance d'après 1945 ! Les premiers nous lèguent un cadre de compréhension fécond même entaché d'imprécisions, les autres nous mènent à l'impasse ou à l'anarchisme.
Mais faisant flèche de tout bois, le GCI et CoC nous attribuent à tort la conception développée par la "IVème Internationale" trotskyste. A y regarder de plus près, c'est CoC et le GCI qui sont de bien pâles copistes des positions de Mandel et Cie ! Certains trotskystes ont depuis belle lurette abandonné la sentence de Trotsky du "Programme de Transition" pour reprendre la vision de Lénine pour qui "Dans l'ensemble, le capitalisme se développe infiniment plus vite qu'auparavant". Pour Mandel "...ce n'est donc pas la baisse des forces productives, mais un parasitistne exacerbé et un gaspillage accru qui accompagnent la croissance et s'en emparent (...). La forme la plus néfaste du gaspillage inhérent au 3ème âge du capitalisme est dès lors la mauvaise utilisation des forces productives", le pourrissement du système se manifeste par "...les résultats pitoyables en comparaison des possibilités de la troisième révolution technologique et de l'automation (..). Mesuré en rapport à ces possibilités, le gaspillage de forces productives potentielles et réelles à crû de façon démesurée. En ce sens - mais uniquement sur la base d'une telle définition - la description donnée par Lénine de l'impérialisme comme phase de pourrissement généralisée du mode de production capitaliste' demeure justifiée". Pour Mandel, le capitalisme connaît trois phases, "...le capitalisme de libre concurrence de Waterloo à Sedan, l'époque de l'impérialisme classique et entre les 2 guerres mondiales et le 3ème âge du capitalisme aujourd'hui" et de nous spécifier que, "en valeur absolue, les forces productives ont augmenté plus vite à l'époque du 3ème âge du capitalisme qu'auparavant': Voilà CoC et le GCI en belle compagnie ! Plus loin Mandel réinterprète explicitement la définition que donne Marx de la décadence d'un mode de production exprimée dans "L'Avant-Propos" : "Ceci est d'autant plus évident que Marx ne se réfère pas ici à la chute du capitalisme, mais à la chute de toutes les sociétés de classes. II ne lui serait sûrement pas venu à l'idée de caractériser la période qui a précédé la victoire des révolutions bourgeoises dans l'histoire moderne (celle de la révolution des Pays-Bas du XVIème siècle, de la révolution anglaise du XVilème siècle, de la révolution américaine et de la grande révolution française du XVIIIème siècle) comme une phase où les forces productives auraient stagné ou même diminué" ("Le troisième âge du capitalisme", Ed. 10/18,1976).
GRAPHIQUE N°3
SOURCES: Rostow W. W., -ne world economy, history and prospect"., University of Texas Press, 1978.
Ce graphique nous montre l'évolution de la Production Industrielle Mondiale (P.LM.) depuis 1820 jusqu'en 1983 (traits continus avec des valeurs pour l'indice - sous les petits triangles - à certaines dates clefs). L'échelle des indices est logarithmique, ce qui permet d'apprécier le taux de croissance à la pente plus ou moins forte de la courbe. Le graphique est illustratif de la dynamique générale du capitalisme au cours de ses deux phases historiques. En ascendance, la croissance est en progression continue avec de faibles fluctuations. Elle est rythmée par des cycles de crise / prospérité / crise atténuée / prospérité accrue / etc. En décadence, outre un frein global sur la croissance (le phénomène de frein des rapports sociaux de production capitaliste sur la croissance des forces productives produit un différentiel entre la croissance potentiellement possible sans frein (droite en pointillé: indice 2401) et la croissance effective (indice: 1440), elle connaît d'intenses fluctuations jamais vues auparavant : deux guerres mondiales et un fort ralentissement ces quinze dernières années, voire une stagnation depuis moins de 10 ans. Si nous défalquons les frais improductifs de la production réelle le frein à la croissance des forces productives atteint et dépasse les 50% ! Le commerce mondial (suite de petites croix) n'a lui-même jamais connu d'aussi fortes contractions (st.ignation de 1913 à 1948, violent freinage ces dernières années : un taux de croissance nul s'exprime par une droite horizontale sur le graphe) illustrant le problème permanent, en décadence, de l'insuffisance de marchés solvables. La forte croissance du commerce mondial de 1948 à 1971 est artificiellement gonflée par la comptabilisation des échanges internes aux multinationales. ('_e biais statistique représente près du tiers (33%) du commerce mondial !
Qu'est-ce qui se dégage de ce fouillis inextricable ? Une négation pure et simple de la conception marxiste de l'évolution historique. Le déclin d'un mode production n'est plus le résultat d'une entrave des forces productives par les rapports de production, c'est-à-dire du décalage entre une croissance potentielle sans frein et la croissance effective mais, dit Mandel, est défini comme la différence entre ce qui est techniquement possible sous un mode de production socialiste (!) et la croissance actuelle, entre une économie d'automation et d'abondance et la croissance d'aujourd'hui "infiniment plus rapide qu'auparavant" mais ô! combien "gaspilleuse" et "mal utilisée". Définir le pourrissement du capitalisme en montrant la supériorité du socialisme ne démontre rien du tout et ne répond sûrement pas à la question pourquoi, quand et comment une société entre en déclin. Mais Mandel contourne la question en niant toute décadence à l'instar de nos censeurs. Ainsi il prétend que l'époque qui va du 16ème au 18ème siècle est une période non de décadence du mode de production féodale et de transition au capitalisme mais de pleine croissance, se permettant d'attribuer à Marx une conception contraire à tout ce qu'il a développé à ce sujet. Mandel additionne deux dynamiques opposées dans une période où s'enchevêtrent deux modes de production différents : le déclin du féodalisme du 14ème au 18ème siècle qui engendre guerres, famines, épidémies et crises agricoles et la transition au capitalisme (16ème au 18ème) qui dynamise la production (marchands, artisans...).
Le graphique ci-dessus illustre ce que nous avons développé jusqu'ici (pour un commentaire détaillé de ce graphique voir l'article précédent dans la Revue Internationale n° 54) et montre ce qu'il faut entendre par décadence pour le mode de production capitaliste : non une chute ou une stagnation, comme pour les modes de production antérieurs, mais un frein, une entrave au développement des forces productives par les rapports sociaux de production capitalistes. Ceci est illustré par le freinage général de la croissance en décadence et par la spirale infernale de crise / guerre / reconstruction / crise décuplée / guerre plus meurtrière / reconstruction droguée / etc. dans laquelle s'est enfoncé le capitalisme.
C.Mcl
[1] [1482] Pour les références concernant les groupes cités dans cet article voir l'article précédent dans le n° 54.
[2] [1483] Voir l'article du n° 54..
[3] [1484] Les éléments qui continueront à défendre, tant bien que mal, les positions de la Fraction scissionneront pour créer le Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Comunista) qui existe encore de nos jours. Lire notre brochure "Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : La Gauche Communiste d'Italie" .
[4] [1485] Pourquoi diable le GCI ose-t-il encore se réclamer de la Fraction italienne ? C'est eux plus que tout autre groupe qui ont développé l'analyse de la décadence. Pourquoi ne traitent-ils pas la Gauche Communiste Internationale d'adepte de Moon, de Témoins de Jéhovah, puisque la décadence constitue l'ossature de toutes leurs positions politiques puisqu'elle est inscrite dans tous leurs textes programmatiques ?
[5] [1486] Lire notre brochure "Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : La Gauche Communiste d'Italie".
[6] [1487] Cette courbe a été réalisée à partir d'une reconstitution de l'évolution de la population dans 12 régions du monde (Chine / Inde-PakistanBangladesh / Sud Ouest asiatique / Japon / Reste de l'Asie / Europe / URSS / Afrique du Nord / Reste de l'Afrique / Amérique du Nord / Amérique Centrale et du Sud / Océanie). Toutes, à de petits décalages près dans le temps, suivent la même évolution que le total mondial (un test statistique qui mesure la significativité des différences entre ces évolutions a été réalisé et confirme ce parallélisme dans l'évolution de la population de ces différentes régions). Nous n'avons pas la place ici pour développer toutes les implications qui en découlent, nous y reviendrons ultérieurement.
[7] [1488] Ces sociétés (4000 à 500 av. J.C. - sociétés mégalithiques, égyptiennes, etc.) sont l'aboutissement du processus de néolithisation, de division en classe de la société. Une caste dominante a pu s'ériger par l'accaparement des surplus dégagés de l'augmentation de la production. Celle-ci est encore le fait d'une multitude de collectivités villageoises produisant selon des rapports communautaires. L'esclavage existe pour les besoins de la caste dominante (serviteurs, grands travaux, etc.) mais pas encore dans la production agricole.
[8] [1489] La réfutation de cette assertion a été largement développée dans notre précédent article.
[9] [1490] 'L.e capitalisme, oui ou non, a-t-il fait son temps? Est-il en mesure Cie développer dans te monde les forces productives et de faire progresser l'humanité? Cette question est fondamentale. Elle a une importance décisive pour le prolétariat (...) S'il s'avérait que le capitalisme est encore capable de remplir une mission de progrès, de rendre les peuples plus riches, leur travail plus productif, cela signifierait que nous, parti communiste de 1't]MS'S, nous nous sommes hâtés de chanter son DE PROFUNDIS; en d'autres termes, que nous avons pris trop tôt le pouvoir pour essayer de réaliser le socialisme. Car, comme l'expliquait Marx, aucun régime social ne disparaît avant d'avoir épuisé toutes ses possibilités latentes. (...) Mais la guerre de 1914 n'a pas été un phénomène fortuit. Cela a été le soulèvement aveugle des forces de production contre !es formes capitalistes, y compris celles de l'F_tat national. Les forces de production créées par le capitalisme ne pouvaient plus tenir dans le cadre des formes sociales du capitalisme." fI'rotsky, Europe et Amérique, 1924, Ed. Anthropos) .
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR
- 4424 reads
Si on se limite à une vision superficielle de l'état du milieu politique international, on risque sûrement d’être immédiatement déprimé. Les groupes existants se scindent (à Contre-Courant du GCI, le Groupe Leninista Internazionalista de l OCI), dégénèrent (Daad en Gedachte capitule, cède au frontisme démocratique à travers la stratège du front anti-apartheid en Afrique du Sud ; la FECCI met de plus en plus en discussion les bases programmatiques du CCI dont elle est sortie), perdent la boussole (Communisme ou Civilisation se discrédite en proposant défaire sans aucun sérieux "des revues communistes" a qui veut bien l'écouter ; Comunismo, ex-Alptraum, prétend d'un jour à l'autre ne plus être d'accord avec le concept de décadence du capitalisme sur lequel il fondait ses positions), ou, plus simplement, disparaissent (auto-dissolution du groupe Wildcat ; disparition progressive par auto-dissolution dans le néant des nombreux fragments qui avaient survécu à l'explosion de Programma Comunista).
C'est effectivement sur la base de l'impression qui se dégage d'une telle observation que se répand dans le milieu une ambiance de dépression et de pessimisme qui donne l'occasion aux anciens de 68 de proclamer qu'est venu le temps des "bilans autocritiques"1. Et ces bilans vont presque tous dans le même sens : malgré la crise, malgré des luttes même importantes de la classe, l'influence et l'importance numérique des révolutionnaires ne se sont pas accrues, alors que la guerre désormais menace... donc tout est perdu ou presque.
Dans la première partie de cet article, nous chercherons à démontrer en quoi cette attitude de "reflux" :
-
ne correspond pas en réalité à l'état du milieu prolétarien ;
-
ne sert qu'à fournir une couverture idéologique à l'incapacité d'une bonne partie du milieu d'assumer ses responsabilités par rapport aux nécessités de la lutte de classe.
Dans ce contexte de confusion, la responsabilité qui pèse sur les épaules des deux pôles de regroupement, le CCI et le BIPR, est d'autant plus grande, et ils sont appelés à faire un rempart contre cette vague insidieuse de méfiance et de désertion. Dans la deuxième partie de l'article nous montrerons comment du fait de son incapacité congénitale à affronter et à résoudre ses contradictions internes, le BIPR a de plus en plus de difficultés à remplir la tâche de donner des orientations aux débats du milieu dans son ensemble.
Le défaitisme contre le militantisme révolutionnaire
Bien qu'on puisse retrouver des signes d'une attitude de méfiance par rapport à la possibilité pour les révolutionnaires de jouer un rôle dans la lutte de classe dans presque tous les groupes, leur expression la plus claire se manifeste évidemment dans les groupes qui font de la méfiance envers l'intervention des révolutionnaires leur unique raison d'exister. Le cas le plus exemplaire est sans aucun doute la Fraction externe du CCI (FECCI) dont les militants ont déserté de façon irresponsable le CCI, sous le prétexte que sa dégénérescence était telle qu'aucune lutte ne pouvait plus l'empêcher de jeter sa plate-forme d'origine aux orties. La fausseté de cette affirmation est évidente aujourd'hui : trois ans après, le CCI est plus que jamais renforcé sur sa plate-forme alors que c'est la FECCI qui lui découvre toujours de nouvelles "limites". En réalité, la divergence portait sur l'analyse de la dynamique de la lutte de classe et la tendance de ces camarades à privilégier arbitrairement le débat interne par rapport à l'intervention militante dans les luttes ouvrières. La FECCI l'a d'abord nié avec une vertueuse indignation pendant trois années de suite, puis, étant donné l'ambiance de pessimisme qui règne dans le milieu, elle a pris courage et a mis cartes sur table. Dans le n°9 de Perspective Internationaliste, on découvre "qu'à la base de la dégénérescence" du CCI, il y a la stagnation et la dégénérescence de tout le milieu et que, loin de se renforcer il est aujourd'hui beaucoup plus faible et beaucoup plus divisé par le sectarisme qu'il ne l'était dans les années 70. En conséquence il faut avoir le courage de reconnaître que "dans cette période, l'élaboration théorique (dont la clarté dans l'intervention fait partie intégrante) doit être une priorité bien supérieure par rapport au développement organisationnel. En conséquence la clarification théorique est aujourd'hui notre travail principal". (PI n°9)
Est enfin théorisé ce qui est déjà depuis 3 ans la pratique de non intervention dans la lutte de classe de la part de la FECCI. Naturellement, une telle régression, un tel abandon de l'engagement militant ne peuvent qu'être salués avec enthousiasme par cette fraction du milieu qui base justement son existence sur le refus de cette responsabilité militante dans les affrontements de la lutte ouvrière. Communisme ou Civilisation s'était déjà réjoui des pas qui menaient dans cette direction : "face au désert théorique du CCI, la prose de la FECCI peut être comparée à un oasis" (Communisme ou Civilisation n°22, mai 87).
Mais c'est une autre secte qui fait de la lutte contre le CCI sa raison d'exister, le Communist Bulletin Group (CBG), qui a manifesté le plus grand enthousiasme. Ce groupe (qui s'est mis en dehors du camp politique prolétarien avec son soutien aux actions de gangstérisme de l'aventurier Chenier contre le CCI) s'est empressé de se déclarer "entièrement d'accord" avec les conclusions de la FECCI, ou mieux, a de façon juste, souligné que la FECCI aujourd'hui se met au niveau de la lutte contre toute activité communiste militante et centralisée, niveau que le CBG a atteint triomphalement dès le début des années 80. Il saisit donc le moment favorable pour sa propagande défaitiste qui finalement "trouve un écho". Le n°13 de son bulletin a immédiatement mis à disposition de ceux qui ont des doutes ou des hésitations une théorisation "cohérente" du défaitisme qui se base sur les points suivants :
-
"Comme le souligne la FECCI, notre affirmation de base selon laquelle l'approfondissement de la crise économique trouverait sa contrepartie dans un approfondissement de la lutte de classe et un accroissement correspondant de la taille et de l'influence des fractions révolutionnaires, a été démentie par la réalité".
-
Le milieu s'est développé positivement de 68 à 75 ; "à ce point, le mouvement révolutionnaire avait atteint un plateau". Par la suite "il n'y a eu d'accroissement ni en nombre, ni en influence. (...) Sous beaucoup d'aspects, le milieu est beaucoup plus faible qu'il y a dix ans".
-
"Les divisions qui ont surgi dans les années 70 se sont aujourd'hui solidifiées en barrières dogmatiques d'une telle résistance qu'il est difficile de voir comment elles peuvent être surmontées. Il est certain qu'il ne semble pas correct du tout de croire qu'une plus grande combativité de la classe ouvrière pousserait les révolutionnaires à s'unir".
Les conclusions sont prévisibles : il faut arrêter les efforts de construction d'une organisation centralisée en vue de l'intervention dans la lutte de classe, il faut se dédier à un travail d'étude et de débat "ouvert", auquel participeraient, sur un plan d'égalité formelle, les organisations militantes, les individus et les cercles qui n'ont rien de mieux à faire. Ce débat académique "fraternel" ne manquera pas de poser les bases du futur parti du prolétariat.
De telles théorisations ne manqueront pas de "trouver un écho" de ci, de là. Le Collectif mexicain Alptraum (Comunismo) sera certainement d'accord, lui qui a finalement résolu ses longues hésitations par rapport à l'intervention dans la lutte de classe, en niant la nécessité de l'intervention et la réalité de la lutte de classe (toutes deux inventions du CCI...) et en se donnant comme seule tâche la publication d'une revue théorique (avec Communisme ou Civilisation comme par hasard) dans l'attente du parti tout puissant de demain.
Le comique de cette tendance à la retraite stratégique, c'est qu'en fait elle agglomère en un seul front aussi bien les partisans du Parti unique, de fer, monolithique (Communisme ou Civilisation, Comunismo) que les admirateurs d'un parti "ouvert", démocratique, dans lequel tout le monde est libre de dire et de faire ce qui lui plaît (FECCI, CBG). Les deux seules choses qui unissent ce front disparate sont :
-
l'espoir de vivre assez longtemps pour assister à cet "écroulement du CCI" qu'ils attendent tous et qui ne vient jamais ;
-
l'absolue conviction que dans les conditions actuelles de la lutte de classe, l'intervention des révolutionnaires ne joue aucun rôle réel.
Les deux choses sont naturellement liées entre elles : le CCI est aujourd'hui le principal pôle de regroupement du milieu prolétarien international et le défenseur le plus décidé du rôle des révolutionnaires dans la lutte de classe. Ceci signifie que toute tentative de remettre ce rôle en discussion est obligée de régler des comptes avec le CCI. Mais ça veut dire aussi que le CCI est prêt à régler les comptes à toute tentative qui va dans ce sens, en revenant sur les arguments un par un. C'est ce que nous avons fait et entendons continuer à faire.
Les avances difficiles du milieu politique prolétarien
On trouvera une réponse plus détaillée aux tentatives de falsification de la vie du mouvement révolutionnaire dans les vingt dernières années, dans la série d'articles "L'évolution du milieu politique prolétarien après 68" et nous renvoyons nos lecteurs à ces articles. Dans celui-ci, nous nous limiterons donc à répondre aux différentes affirmations de base contenues dans le de profundis sur le milieu théorisé par CBG et partagées par une bonne partie du milieu lui-même.
Commençons par l'observation centrale, selon laquelle le mouvement révolutionnaire croît numériquement et politiquement de 68 à 75, puis stagne de nouveau numériquement et régresse politiquement. Pour présenter les choses de cette manière, il est nécessaire de falsifier sans pudeur la dynamique réelle des événements. Il est absolument vrai que les années 68-75 ont vu tout un processus de décantation et de politisation autour du groupe français Révolution Internationale, qui conduira à un regroupement international dans le CCI, et à celui limité à l'Angleterre dans la CWO. Mais c'est vrai aussi que les années 72-75 ont vu l'explosion de la mode "moderniste", avec l'abandon qui s'ensuit du marxisme de la part d'un nombre énorme de militants qui, dans ces années-là, en étaient à peine à rompre avec les groupes extra-parlementaires en redécouvrant les positions de la Gauche communiste. Si CBG pense nous émouvoir en nous parlant des "beaux jours" où il semblait que tous se dirigeaient vers les positions de la Gauche communiste, alors il se trompe complètement d'adresse. Le fait que des milliers d'individus, qui la veille encore, ne juraient que par le Programme de transition de Trotsky ou le Bloc des quatre classes de Mao, se soient mis à l'improviste à citer à tort et à travers Pannekoek et Bordiga, n'était pas une force mais une faiblesse, et surtout, un très grave danger pour le mouvement révolutionnaire.
Si nous avons été capables de regrouper une petite partie de ces camarades dans une organisation politique homogène, c'est parce que tout cela nous l'avions compris et dit à l'époque et pas seulement aujourd'hui : "la réapparition internationale d'un courant communiste est laborieuse, tâtonnante, incertaine et en retard par rapport à la reprise de la lutte de classe. De plus, elle est encore trop souvent due à la conjoncture d'éléments relevant du hasard plus que d'une détermination historique. Mais en même temps, le long purgatoire traversé par les groupes existant actuellement et les crises que provoquera en leur sein le cours de plus en plus opportuniste, racoleur et lèche-bottes des courants radicaux issus de la contre-révolution (trotskysme principalement) débouchera et débouche déjà sur de brusques accès de mode pour nos idées. La faiblesse numérique ne sera plus alors le lourd boulet traîné par notre courant mais bien le danger de 'trop plein' et de dilution dans une masse d'éléments n'ayant pas encore pleinement compris nos positions et leurs implications."2
Nous avons été capables de constituer ce qui est aujourd'hui le principal pôle de regroupement justement parce qu'alors nous ne nous sommes pas fait prendre par "l'enthousiasme" par le fait que les positions de la Gauche communiste devenaient à la mode tout à coup, mais nous nous sommes rigoureusement différenciés de tous ceux qui refusaient des délimitations politiques sur des positions claires. Ce n'est pas par hasard que déjà à l'époque, en 1975, la constitution du CCI ait été saluée par un chœur unanime d'accusations de "monolithisme", "sectarisme", "fermeture à l'égard des autres groupes", "isolement paranoïaque", "conviction d'être les uniques dépositaires de la vérité", etc. de la part d'une foule de cercles et d'individus qui, un an plus tard, se sont heureusement dissous dans le néant.
Les années comprises entre 1975 et 1980, loin de montrer une nouvelle stagnation du milieu révolutionnaire, sont caractérisées par le fait qu'elles voient tous ces groupes (la majorité) évoluer, alors qu'ils avaient stagné pendant la phase de confrontation et de regroupement des années 68-75. Le milieu entier se subdivise en trois grandes tendances :
-
l'isolement dans la passivité et l'académisme (les restes du courant conseilliste historique) ;
-
l'isolement dans l'activisme dépourvu de principes (Programme Communiste qui pendant toutes les années 70 a été la principale organisation communiste) ;
-
la rupture de l'isolement à travers la confrontation et le débat politique (Conférences internationales des groupes de la Gauche communiste animées par Battaglia Comunista et le CCI).
Le premier bilan qu'on peut tirer est que les conférences ont été le premier élément dynamique capable de polariser TOUT le milieu ; en fait, même les groupes qui N'ONT PAS participé (Spartacusbond, Programma, etc.) se sont sentis obligés de motiver publiquement leur refus. Le second bilan est que, au-delà des résultats immédiats qui cependant existent (rapprochement de Battaglia Comunista de la CWO, fusion des NLI et d'Il Leninista, naissance d'une section du CCI en Suède), les conférences restent un acquis pour le futur.
"Les bulletins publiés en trois langues à la suite de chaque conférence et contenant les diverses contributions écrites et le compte-rendu de toutes les discussions sont restés une référence indispensable pour tous les éléments ou groupes qui depuis ont rejoint les positions révolutionnaires."3
De tout ceci, les idéologues du reflux se gardent bien de parler : le fait que les positions de la gauche communiste sont aujourd'hui présentes en Inde et défendues en Amérique latine n'est probablement pour eux qu'une "curiosité exotique". Mais passons à un autre point, au fait que l'influence de la minorité communiste n'aurait pas grandi parallèlement à la crise et à la lutte de classe. Naturellement, si par influence, on entend le nombre d'ouvriers directement organisés dans les organisations révolutionnaires, alors il est clair qu'elle a très peu grandi ! Mais dans la phase décadente du capitalisme, l'influence de la minorité révolutionnaire se manifeste d'une tout autre façon, elle se manifeste en tant que capacité de jouer un rôle de direction politique à l'intérieur des luttes significatives de la classe. C'est sur la base du renforcement de cette capacité à pousser les luttes en avant, à influencer politiquement les éléments ouvriers les plus actifs, les plus combatifs, que se développeront les conditions pour l'intégration toujours croissante de militants ouvriers dans les organisations révolutionnaires.
Si nous considérons les choses de ce point de vue, le point de vue marxiste, c'est une donnée de fait que dans les dernières années les organisations qui, comme le CCI, ont maintenu une pression constante au niveau de l'intervention dans la lutte de classe, ont été pour la PREMIERE FOIS capables d'influencer des secteurs minoritaires de la classe dans le cours de luttes de grande ampleur comme celle des cheminots français ou des enseignants italiens. Ceci n'était jamais arrivé et NE POUVAIT PAS arriver dans les années 70, parce que les conditions n'existaient pas encore4. Aujourd'hui, ÇA COMMENCE A ETRE POSSIBLE, grâce à la maturation de la crise, de la lutte de classe ET des organisations communistes qui ont été capables de faire face victorieusement à la sélection qui s'est opérée pendant ces années.
Venons en enfin à la troisième question douloureuse : le fait qu'aujourd'hui, le milieu serait plus divisé et sectaire que dans les années 70 et que la lutte de classe elle-même ne pourrait pas pousser les révolutionnaires à discuter entre eux.
Nous avons déjà vu que cette vision pessimiste ne tient pas compte du fait que la majorité du milieu révolutionnaire dans les années 1968-75 était restée rigoureusement étrangère à toute dynamique de contact et de discussion, alors qu'aujourd'hui, les deux principaux pôles de regroupement qui existent à l'échelle internationale -le CCI et le BIPR- sont tous les deux des défenseurs -même si c'est en termes différents- de la nécessité de ce débat.
Ce n'est pas par hasard si les nouveaux groupes qui sont en train d'apparaître, en particulier à la périphérie du capitalisme, tendent immédiatement à faire référence aux débats entre ces deux pôles. Aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui croient que le débat entre les révolutionnaires est une espèce de supermarché, qui, pour être riche et satisfaisant, devrait offrir le choix entre des milliers de produits divers, cette sélection n'est pas un "appauvrissement", mais un pas en avant. Cette polarisation permet aux nouveaux éléments qui surgissent de se situer clairement par rapport aux divergences politiques FONDAMENTALES qui existent parmi les grands courants essentiels du mouvement révolutionnaire, au lieu de se perdre dans les mille finasseries secondaires de telle ou telle secte. Que les sectes s'en attristent, c'est évident, qu'elles poussent de grands cris sur le "renforcement des divisions", c'est encore plus évident : ce qui leur fait pousser de hauts cris, ce n'est pas autre chose que l'accélération de l'histoire, c'est-à-dire de la crise et de la lutte de classe, qui pousse toujours plus à la décantation du camp révolutionnaire. C'est cette accélération qui a contraint les camarades de Wildcat à reconnaître qu'ils s'étaient engagés dans une impasse et à dissoudre un groupe qui n'était que source de confusion. C'est cette accélération qui a permis le processus relativement rapide par lequel tout un milieu de militants mexicains a réussi à rompre avec la contre-révolution, faisant surgir un nouveau groupe communiste, le Grupo Proletario Internacionalista. C'est l'obligation de prendre en compte cette accélération qui a fait surgir au sein du même pays un groupe communiste MILITANT qui a finalement poussé le groupe déjà existant, le collectif Alptraum à résoudre ses hésitations de six ans face à l'engagement militant, en se suicidant dans la régression académique. Même un choix négatif de ce type est préférable de toute façon à l'ambiguïté : à partir de maintenant, les éléments mexicains à la recherche d'une cohérence de classe, auront face à eux une alternative claire : ou l'engagement dans le militantisme révolutionnaire avec le GPI ou le hobby de la discussion sans implications dans Comunismo ex-Alptraum (si toutefois il survit).
La question de l'intervention militante dans la lutte de classe devient donc facteur de clarification et de sélection. Mais ce qui est le plus important, c'est que –contrairement aux sombres prophéties des oiseaux de mauvais augure– l'intervention commence à devenir un facteur d'INTERACTION entre les révolutionnaires. Le dégagement progressif d'une minorité nettement classiste, qui se manifestait ouvertement dans la lutte des travailleurs de l'école en Italie, a été aussi et surtout le résultat d'un travail ORGANISE et COMMUN de la part des militants internationalistes qui participaient à la lutte (militants du CCI, de Battaglia et du groupe bordiguiste II Partito Comunista). Il s'agit d'un petit exemple, mais c'est le PREMIER EXEMPLE d'une collaboration dans la lutte que l'approfondissement de la lutte de classe ne manquera pas de multiplier.
Les conséquences pour l'ensemble du milieu sont évidentes : les débats -souvent abstraits- du passé, vont tendre à s'approfondir grâce à la confrontation des positions dans la réalité de la lutte de classe. Très bon pour le débat, très mauvais pour les groupes parasites qui n'ont que peu ou rien à voir avec la lutte de classe.
Le BIPR et la lutte de classe : quelques contradictions de trop
Dans cette seconde partie de l'article, nous allons chercher à retracer les difficultés que le BIPR (le plus grand pôle de regroupement international après le CCI) rencontre pour établir une résistance adéquate à la vague de défaitisme qui déferle sur le milieu révolutionnaire.
La première difficulté vient du fait que le BIPR est lui-même victime d'une vision pessimiste du mouvement actuel de lutte de classe et qu'il se trouve donc dans une position difficile pour résister à la propagande défaitiste. Dans le numéro précédent de la Revue Internationale, nous avons abordé spécifiquement la question de la sous-estimation de la lutte de classe actuelle par le milieu et en particulier par le BIPR, alors que dans les numéros 50 et 51 de cette revue, nous avons traité des incompréhensions du BIPR sur le cours historique et la question "syndicale". Dans cet article, nous reviendrons spécifiquement sur un problème que nous avons cependant souligné plus d'une fois : les contradictions croissantes dans les prises de position du BIPR sur l'ensemble des questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour.
Pour une question de place, nous nous limiterons évidemment à une seul exemple qui paraît particulièrement significatif. Nous voulons parler de la question centrale, c'est-à-dire du niveau de la lutte de classe et la possibilité qui s'ensuit ou non pour les révolutionnaires de jouer un rôle en son sein. Dans la désormais fameuse lettre du BIPR au Collectif Alptraum de juin 87, amplement critiquée par nous dans l'article sur la sous-estimation de la lutte de classe dans le numéro précédent de la Revue Internationale, les luttes des travailleurs de l'école en Italie, organisées pendant des mois dans les COBAS, étaient mises sur le même pied que celles des professionnels de certains milieux (pilotes, magistrats, etc.) et donc abandonnées à elles-mêmes à peu près jusqu'à l'été. A l'automne 87 se tient l'assemblée annuelle de la CWO, qui fait une théorie sur le profond coma du prolétariat anglais, cauchemar de Thatcher, et dans ses perspectives, étant donné "la période de calme social", affirme que "nous avons plus besoin -et plus le temps- de nous réorienter vers le travail théorique" (Workers'Voice n°39, février-mars 1988).
En février 1988, l'assemblée annuelle de Battaglia Comunista affirme qu'« avec l'affaire des Cobas, débute une phase nouvelle et intéressante de la lutte de classe en Italie et que s'offre pour notre organisation la possibilité de susciter dans les mouvements un intérêt certainement plus grand que par le passé (...). Les camarades de CWO qui sont intervenus à la réunion ont fait référence aux développements récents de la lutte de classe en Grande-Bretagne (...) : les grèves, inexistantes jusqu'alors, et les grèves de solidarité entre travailleurs de secteurs différents.
Ces luttes aussi confirment le commencement d'une période marquée par l'accentuation des conflits de classe. » (d'après le rapport publié dans BC n°3 de mars 88)
Comme on le voit, aussi bien l'analyse ponctuelle de la situation en Italie qu'en Angleterre, que les conséquences qui en sont tirées sur le plan général ("le commencement d'une période marquée par l'accentuation des conflits entre classes") sont en totale contradiction (heureusement !) avec les analyses précédentes. Ce qui frappe, c'est que pourtant, on trouve encore dans le n°39 de Workers'Voice, A LA SUITE de la vague de luttes en Grande-Bretagne, publié tel quel, SANS UN MOT DE CRITIQUE, les perspectives de la réunion annuelle de la CWO qui sont fondées sur la "démoralisation et la passivité" du prolétariat anglais et mondial. Quelle est donc en février-mars 1988, la position des camarades de la CWO ? Celle, optimiste qui est publiée dans Battaglia, ou celle, pessimiste, qu'eux-mêmes publient dans Workers'Voice ?
La situation semble s'éclaircir dans le n°40 d'avril-mai 1988 où, dans l'introduction à un article sur mai 68 ("le premier réveil généralisé de la lutte de classe après les années de la reconstruction d'après-guerre") on affirme clairement : "les derniers mois ont vu en Angleterre, Allemagne et ailleurs une agitation qui est le signe avant-coureur d'une reprise des affrontements sociaux". Mais l'espoir d'avoir enfin compris quelque chose à la position de ces camarades est de courte durée. Quelques semaines après, la CWO expédie au Communist Bulletin Group une lettre sur les mêmes questions : "l'article (sur les 20 ans après 68) paraîtra dans Workers'Voice n°41, mais globalement, nous avons rejeté ce que nous ressentons comme notre dernier bagage du CCI, c'est-à-dire l'idée que mai 68 a ouvert une nouvelle période, la fin de la contre-révolution, et le commencement d'une nouvelle période révolutionnaire... Nous voyons définitivement la période comme une continuation de la domination capitaliste qui a régné, en étant seulement sporadiquement contestée, depuis la fin de la vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale. Cela a beaucoup de conséquences et je suis sûr que vous serez d'accord là-dessus... L'avant-garde va mal parce que ce n'est pas une période 'pré-révolutionnaire' mais une période de domination capitaliste (croissante)."5
Cette lettre n'est pas qu'un démenti total de ce qui est écrit dans le n°40 de Workers'Voice, qui était diffusé à ce moment-là, mais aussi une CAPITULATION SANS CONDITION devant la pression du défaitisme de la partie parasitaire du milieu et du CBG en particulier. Notons que la CWO s'est donnée la peine de préciser qu'elle ne s'opposait pas à la publication de cette lettre. C'est donc très préoccupés que nous avons ouvert le n°41 de Workers'Voice, où devait se trouver l'article mentionné dans la lettre. Mais, énième volte-face, l'article sur 1968 n'y est pas alors qu'au contraire, il y a un article sur le milieu révolutionnaire où on affirme que : "Cependant, les événements de mai 68 en France ont été les premières de beaucoup dégrèves ouvrières qui marquaient la fin du boum capitaliste d'après-guerre...ceci a donné naissance au camp politique prolétarien actuel (...). Dans les récentes années, il y a eu un développement des groupes communistes à la périphérie du capitalisme."
C'est exactement le contraire de ce qui est écrit dans la lettre qui était publiée au même moment dans le Bulletin.
Le minimum qu'on puisse dire, c'est que sur cette question essentielle, il y a dans le BIPR au moins trois positions différentes :
-
CWO n°l : hier, fin de la contre-révolution en 68 ; aujourd'hui, reprise de la lutte.
-
CWO n°2 : hier, aucun changement en 68 ; aujourd'hui, domination croissante du capital.
-
BC n°3 : hier, aucun changement en 68 ; aujourd'hui, "quelque chose se met à bouger, même si ce n'est pas encore suffisant" (Prometeo n°11, décembre 87).
Nous avons donc trois positions ou peut-être quatre, puisqu'à la réunion publique tenue par le CCI en juin 88 à Milan, un camarade de BC est intervenu pour soutenir que "nous sommes moins nombreux aujourd'hui qu'en 68".
Il est évident que "cela a beaucoup de conséquences". La première, c'est que le BIPR non seulement est tout à fait incapable de réagir de manière adéquate à la propagande défaitiste qui infiltre le milieu, mais qu'il tombe lui-même dans le piège du défaitisme, à la profonde satisfaction de tous les groupes parasites en lutte contre l'engagement militant dans les luttes.
La seconde constatation qu'on peut faire, c'est que le BIPR, qui rejette la nécessité de définir clairement le cours historique (à la guerre ou aux affrontements de classe) est nécessairement forcé de se faire secouer ad eternam dans les balançoires de l'IMMEDIATISME, en ce qui concerne son analyse des affrontements de classe.
Nous avons vu comment BC et la CWO, en l'absence de luttes en Italie et en Grande-Bretagne, avaient parlé de passivité de la classe, en considérant comme des "exceptions" sans importance les vagues de luttes en Allemagne, en Espagne, etc. (Perspectives pour la CWO, Workers Voice n°39). Avec le développement des luttes, d'abord en Italie, puis en Angleterre, BC d'abord, la CWO ensuite, ont commencé à parler de reprise des luttes. Avec le reflux de ces deux périodes de luttes, aussi bien dans BC que dans la CWO (surtout) sont ressorties les analyses pessimistes, les discours sur l'isolement des communistes, etc. Nous savons bien que BC dans le n°11 de sa revue Prometeo a tout juste nié que ses analyses dépendent d'influences localistes et/ou immédiatistes. Il nous semble cependant que les faits sont plus convaincants que les démentis de BC.
Le dernier problème qui naît du développement des contradictions dans lesquelles tourne en rond le BIPR concerne l'existence même du BIPR, c'est le fait même que sur une question aussi décisive que "qu'est ce qui se passe et que devons-nous faire ?", il y ait dans l'organisation au moins trois positions; cela en dit long sur leur désorientation. Mais ce qui est le plus grave, ce n'est pas qu'il existe des positions différentes, mais qu'elles s'expriment côte à côte, en s'ignorant et sans le moindre souci de débat pour chercher à résoudre les divergences.
La chose est d'autant plus grave qu'en 1980, BC et la CWO, pour justifier leur sabotage des Conférences internationales, affirmaient qu'il fallait en finir avec la méthode utilisée par le CCI "pour résoudre les divergences politiques -c'est-à-dire les minimiser- pour maintenir l'unité" (Revolutionary Perspectives n°18). Le BIPR, créé au contraire pour "favoriser l'harmonisation politique (des organisations qui lui sont affiliées) en vue de leur centralisation organisationnelle" (statuts du BIPR) se retrouve aujourd'hui, après cinq ans d'existence, avec ces résultats : la non-homogénéité n'a pas diminué entre BC et la CWO, en revanche cependant, elle a augmenté à l'intérieur de la CWO. Ce n'est pas nous qui nous en étonnerons vu qu'on notait déjà en 1985 : "ce qui est sûr, c'est que nous, nous ne pourrons jamais accuser BC et la CWO de 'minimiser' leurs divergences ; en réalité, ils les font purement et simplement disparaître"6.
Le résultat de cette méthode erronée, c'est une difficulté croissante pour le BIPR à remplir le rôle qui incombe à un pôle de regroupement international. Ce rôle ne consiste pas seulement à chercher à regrouper autour de soi les noyaux avec lesquels on a des points de contact, mais aussi à savoir faire un barrage aux tendances négatives qui menacent l'ensemble du milieu révolutionnaire. La lettre, déjà citée, au Collectif Alptraum, qui est une exhortation à ne pas SUR-évaluer la lutte de classe, envoyée à un groupe sur le point de couler à cause de sa SOUS-estimation de la lutte de classe, est un bon exemple de cette difficulté.
Mais le risque le plus grand réside dans la contamination des bases politiques du BIPR lui-même. Les virages périodiques de la CWO, la tendance manifeste à se retirer de l'intervention pour "faire de la théorie", ne mènent à aucun approfondissement théorique, mais seulement à une remise en discussion systématique de la clarté atteinte précédemment ("le moteur de l'histoire n'est plus la lutte de classe, mais la guerre" ; "le capitalisme d'Etat n'est plus la tendance dominante à notre époque" ; "nous sommes dans une phase de domination croissante du capital" ne sont que quelques exemples de ces résultats intéressants.)
Ce n'est pas en tournant le dos à l'engagement militant qu'on avancera en quoi que ce soit théoriquement. Il y a trois ans, en saluant l'apparition des thèses du collectif Alptraum, nous mettions déjà en garde : "Le CCA doit se situer plus activement, plus directement sur le terrain de l'intervention politique au sein du mouvement actuel du prolétariat (...). La théorie révolutionnaire ne peut vivre et se développer qu'en vue de cette intervention, surtout dans la période historique actuelle."7
Cette mise en garde, nous la réitérons aujourd'hui auprès des camarades de la CWO, du BIPR, de tous les groupes du milieu révolutionnaire. Les batailles décisives sont devant nous. Veillons à ce qu'elles ne nous trouvent pas la tête dans le sable.
Beyle
1 Pour le bilan des 20 ans depuis 68 tiré par le CCI, voir l'ensemble des articles publiés dans le numéro 53 de la Revue Internationale et la série d'articles sur le milieu dans les numéros 53 et 54 et à paraître dans le n°56.
2 Bulletin d'études de discussion de Révolution Internationale n°4, janvier 74.
3 "L'évolution du milieu révolutionnaire depuis 1968 (II)", Revue Internationale n°54, p.l9.
4 Programme Communiste a tenté de forcer la cadence dans les années 70, avec une bataille politique complètement inadéquate : la catastrophe était inévitable.
5 Lettre publiée dans le n°13 du bulletin du Communist Bulletin Group
6 "BIPR : un regroupement-bluff". Revue Internationale n°40
7 "Une nouvelle voix de classe à Mexico". Revue Internationale n°40.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
- TCI / BIPR [821]
- Battaglia Comunista [449]
- Communist Workers Organisation [647]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
1918-1919 : il y a 70 ans, a propos de la révolution en Allemagne (1ere partie)
- 3560 reads
INTRODUCTION
Il y a 70 ans, le prolétariat en Allemagne se lançait dans la plus importante expérience de son histoire. Il s'attelait à la tâche de porter plus loin la flamme de la révolution que le prolétariat russe avait allumée en 1917, pour l'étendre à l'Europe de l'ouest.
Partout en Allemagne des conseils d'ouvriers et de soldats surgirent dans les premiers jours de novembre 1918. L'exemple des ouvriers en Russie, qui était également repris par les ouvriers en Autriche et en Hongrie, et, dans une certaine mesure, en Italie, constituait un formidable stimulant.
Les révolutionnaires avaient mis tous leurs espoirs dans l'Allemagne parce que, plus que toute autre, la classe ouvrière dans ce pays, du fait de sa position-clé en Europe, pouvait venir en aide aux ouvriers isolés en Russie, en battant la classe capitaliste en Allemagne, ouvrant ainsi la voie de la révolution mondiale.
Le destin de la classe ouvrière internationale, et même celui de toute l'humanité, se trouvait entre les mains de la classe ouvrière en Allemagne. La capacité de celle-ci à pousser vers une révolution victorieuse, à conquérir le pouvoir et à le maintenir, devait être décisive pour le cours ultérieur des luttes en Russie, au centre de l'Europe, et même à l'échelle mondiale. Mais les obstacles à affronter étaient à la mesure de l'immense responsabilité qui reposait sur la classe ouvrière en Allemagne. Le prolétariat faisait face à une classe capitaliste fortement expérimentée et bien armée contre la classe ouvrière. Classe dominante d'un pays industrialisé, elle était capable d'opposer une résistance bien plus âpre que la bourgeoisie en Russie qui avait été chassée relativement rapidement sans bain de sang pour le prolétariat en octobre 1917.
Tous les révolutionnaires étaient conscients de cela. Ainsi Lénine écrivait le 23 juillet 1918: "Tour nous, il était plus facile de commencer la révolution, mais il est extrêmement difficile pour nous de la poursuivre et de l’accomplir. Et la révolution a des difficultés énormes pour aboutir dans un pays aussi industrialisé que l'Allemagne, dans un pays avec une bourgeoisie aussi bien organisée." (Discours à la Conférence de Moscou des délégués de comités d'usines).
En comprenant ce qui était en jeu, les révolutionnaires en Russie en particulier étaient prêts à venir en aide aux ouvriers en Allemagne. Bien avant le véritable surgissement des ouvriers, Lénine écrivait le 1er octobre 1918: "Pour les masses ouvrières allemandes nous sommes en train de préparer... une alliance fraternelle, une aide alimentaire et militaire. Nous allons tous mettre nos vies en jeu pour aider les ouvriers allemands, pour pousser en avant la révolution qui a commencé en Allemagne." (Lettre à Sverdlov, dans "Lénine: sur l'Allemagne et le mouvement des ouvriers allemands", Berlin-Est 1957).
Mais la bourgeoisie allemande a aussi reçut le soutien de la classe dominante d'autres pays, en particulier des "vainqueurs" de la 1ère guerre mondiale qui étaient effrayés par le spectre de l'extension de la révolution prolétarienne mondiale. Alors qu'auparavant les différentes bourgeoisies nationales s'étaient entre-déchirées pour la conquête de territoires sur les champs de bataille de la guerre impérialiste au prix de plus de 20 millions de morts et un nombre innombrable de blessés, elles étaient désormais prêtes à resserrer leurs rangs vis-à-vis d'une classe ouvrière combattant sur son terrain de classe. Une fois encore était confirmé que la classe dominante, divisée par nature, tend à s'unifier dans une situation révolutionnaire pour faire face à la classe ouvrière.
Le soulèvement de la classe ouvrière en Allemagne contre le régime capitaliste put être enrayé par la bourgeoisie. Plus de 20 000 ouvriers furent massacrés et plus encore furent blessés entre 1918 et le début des années 1920. La bourgeoisie en Allemagne parvint en 1919 à décapiter la direction du prolétariat, le KPD (Parti Communiste). Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht furent assassinés par les corps francs organisés du SPD (Parti Social-Démocrate) au cours du soulèvement de janvier 1919. Même si le KPD qui venait d'être fondé au feu des luttes de décembre 1918-jan-vier 1919 fut un des premiers à se prononcer contre les syndicats et le parlement, il était engagé dans les luttes avec des positions programmatiques insuffisamment élaborées, mal préparé organisationnellement, et divisé peu de temps après sa fondation. Politiquement affaibli, le prolétariat ne put faire la preuve de sa capacité dans le cours des luttes à surmonter ces faiblesses.
Les tentatives d'étendre la vague révolutionnaire au-delà des frontières russes échouèrent avec la défaite de la classe ouvrière en Allemagne. Ceci devait avoir des conséquences catastrophiques pour la classe ouvrière internationale. Avec la défaite des luttes en Allemagne, la bourgeoisie était capable d'entreprendre une offensive à l'échelle mondiale contre la classe ouvrière. Ceci plaça les ouvriers en Russie dans une situation d'isolement encore plus grand face aux attaques des armées blanches. L'écrasement des luttes révolutionnaires en Allemagne, et, du fait de celui-ci, l'isolement des ouvriers en Russie, accélérèrent ainsi la défaite de la révolution en Russie; l'échiné du prolétariat isolé pouvait être ainsi brisée.
LES LUTTES EN ALLEMAGNE ET EN RUSSIE : LA MEME FORCE LES DYNAMISAIT LA MEME PERSPECTIVE LES UNISSAIT
Les luttes en Allemagne furent stimulées par la même force que les luttes de la classe ouvrière en Russie.
Après la mobilisation de la classe ouvrière en Allemagne sur le champ de bataille pour les buts de la guerre impérialiste de la bourgeoisie allemande, à travers la trahison ouverte de la fraction parlementaire qui était à la tête du SPD en août 1914, et après que les syndicats aient maintenu un calme relatif dans les usines et dans la classe ouvrière dans son ensemble dans les premières années de la guerre, la classe ouvrière, surtout à partir de 1916, releva lentement la tête. La vague de grèves sauvages qui, à partir de l'hiver 1917, commença à secouer l'industrie d'armement à l'arrière, et la résistance contre une politique amenant la famine, mit le feu au mouvement particulièrement au cours de l'hiver 1917-18. Ces luttes ouvrières contre la guerre et ses misères, sous l'influence de la révolution russe, montrèrent clairement qu'en Allemagne aussi, la classe ouvrière, malgré un affaiblissement significatif à cause de la guerre, se remettait de la défaite et de l'ivresse chauviniste et guerrière. Au contraire elle était en train de se dresser contre la politique de guerre à l'extérieur et de paix sociale à l'intérieur (Burgfrieden). Cette vague de grèves brisa cette paix sociale sur laquelle s'étaient mis d'accord les syndicats et le capital au début de la guerre. Cet accord non seulement emporta irréversiblement les syndicats dans le camp de la bourgeoisie, mais constitua aussi un pilier de la domination du capital.
Le mouvement de novembre 1918 mit en avant les mêmes revendications que celles avancées un an auparavant par les ouvriers en Russie: du pain et la paix. Le mouvement contre la guerre partit non du front, mais des usines.
Son axe central unificateur était alors la lutte contre la faim, contre la continuation de la guerre. Il était nécessaire de mettre à bas la classe dominante pour satisfaire ces revendications.
C'est pourquoi les Spartakistes et Rosa Luxemburg résumèrent le but et les premières mesures qu'il y aurait à prendre dans les termes suivants: "Le but de la révolution (l'abolition de la domination du capital, la réalisation de l'ordre socialiste de la société) indique clairement sa marche, la tâche dicte sa méthode. Tout le pouvoir dans les mains des masses, dans les mains des conseils d'ouvriers et de soldats assurant le travail de la révolution face à ses lâches ennemis : telle est l'orientation pour toutes les mesures du gouvernement révolutionnaire :
- le développement futur et la réélection des conseils locaux d'ouvriers et de soldats pour que ce premier geste impulsif et chaotique de leur surgissement puisse être remplacé par le processus conscient d'auto-compréhension sur les buts, les tâches et la marche de la révolution;
- le rassemblement permanent de ces représentants des masses et la prise en main du pouvoir politique réel depuis le plus petit comité ('Vollzugsrat') à la plus large formation de conseils d'ouvriers et de soldats;
- la formation d'une garde rouge prolétarienne;
- l'appel immédiat à un congrès mondial d'ouvriers en Allemagne pour indiquer directement et clairement le caractère socialiste et international de la révolution. La révolution internationale, mondiale, du prolétariat est le seul point d'ancrage du futur de la révolution allemande" (Le début, 18 novembre 1918, Rosa Luxemburg, Oeuvres Choisies, Vol.4, édition est-allemande, p.398).
Partout les ouvriers étaient au centre des luttes. Les ouvriers se rassemblèrent en conseils d'ouvriers et de soldats dans presque toutes les grandes villes. Les syndicats, qui durant la guerre s'étaient eux-mêmes révélés être le meilleur rempart du capital, perdirent de l'influence pendant cette phase initiale. Comme Lénine l'avait dit, les conseils d'ouvriers et de soldats se révélaient être la forme enfin trouvée de l'organisation de la révolution ouvrière. Les ouvriers formaient des manifestations pour resserrer leurs rangs comme une seule classe, pour montrer leur véritable force dans la société. D'innombrables manifestations eurent lieu en novembre, décembre, dans la plupart des grandes villes allemandes. Elles étaient le point d'unification de la classe ouvrière par-delà toutes les limites d'usine et de région. C'est pourquoi les communistes y attachèrent autant d'importance dans leur agitation:
"En période de crise révolutionnaire, la rue appartient naturellement aux masses. Elles sont le seul refuge, la seule sécurité de la révolution... Leur présence même, les contacts entre elles, sont une menace et un avertissement contre tous les ennemis ouverts et cachés de la révolution." (Devoirs inaccomplis, Rosa Luxemburg, 8 janvier 1919, vol.4, p.524).
Tout comme en Russie, des résolutions étaient adoptées, des délégations mandatées, et des mesures prises contre les institutions étatiques. Les formes de lutte qui dans la décadence du capitalisme devaient devenir les armes typiques du prolétariat étaient en place : grèves sauvages, formation de conseils d'ouvriers et de soldats comme organes unitaires de la classe, manifestations de masse rassemblant tous les ouvriers quelle que soit leur profession, qu'ils aient ou non du travail, initiatives des ouvriers eux-mêmes.
Comme l'avaient proclamé en Russie les conseils ouvriers et les révolutionnaires à leur tête, la perspective du mouvement consistait en l'extension immédiate de la révolution aux autres pays pour la construction d'une société communiste:
"... Le moment des comptes avec la domination capitaliste est venu. Mais cette grande tâche ne peut pas être remplie par le seul prolétariat allemand. Ce dernier ne peut lutter et vaincre que s'il appelle à la solidarité des prolétaires du monde entier." ("Aux prolétaires de tous les pays", 25 novembre 1918, Spartakusbund).
Les ouvriers s'étaient entre massacrés comme chair à canon de chaque capital national dans la guerre impérialiste. La classe ouvrière en Europe était paralysée par le poison nationaliste. Surtout dans les pays "Vainqueurs" comme la France en particulier où la bourgeoisie sut utiliser la "victoire" pour entretenir le chauvinisme et le nationalisme parmi la classe ouvrière.
Les spartakistes, considérant cette faiblesse du prolétariat international, et convaincus qu'ils étaient de la nécessité de l'extension de la révolution, proclamaient ainsi:
"Souvenons-nous ! Vos capitalistes victorieux sont prêts à f supprimer dans le sang notre révolution qu'ils craignent tout autant que la vôtre. Vous n'êtes vous-mêmes pas devenus plus libres à travers la 'victoire', vous êtes seulement devenus plus esclaves. Si vos classes dominantes réussissent à étrangler la révolution prolétarienne en Allemagne et en Russie, elles se retourneront contre vous avec une férocité redoublée...Elisez des conseils d'ouvriers et de soldats partout pour prendre le pouvoir politique et établir la paix ensemble avec nous...". (Ibid.)
LA BATAILLE POUR LA PRISE DU POUVOIR PAR LES CONSEILS OUVRIERS
La classe ouvrière en Russie réussit à renverser le gouvernement bourgeois, après des mois de polarisation du pouvoir entre les soviets et le gouvernement provisoire, pour prendre le pouvoir elle-même à travers les soviets. Le gouvernement provisoire put être renversé sans bain de sang. Les conseils d'ouvriers et de soldats furent rapidement capables d'exercer un contrôle réel dans tout le pays. Ce fut seulement quelque temps APRES la prise du pouvoir victorieuse à travers les conseils de soldats et d'ouvriers, que la bourgeoisie put commencer une contre-offensive effective qui jeta le pays dans une guerre civile qui fit couler le sang des ouvriers et des paysans, avec le soutien des armées blanches, pour finalement pas à pas complètement les priver de leur pouvoir (Voir Revue internationale n°2).
Bien que le mouvement en Allemagne ait été mené par la classe ouvrière, qui mit en avant les mêmes perspectives en lien direct avec les luttes des ouvriers en Russie, les ouvriers en Allemagne ne réussirent pas à renverser la classe capitaliste. La bourgeoisie torpilla le pouvoir des conseils d'ouvriers et de soldats dès le début. Elle ne permit jamais la formation d'un nouveau centre de pouvoir des ouvriers. Elle provoqua des affrontements militaires prématurés pour la classe ouvrière, à un moment où celle-ci n'était pas encore mûre pour l'insurrection. Elle lança immédiatement des confrontations armées et infligea des coups dévastateurs aux ouvriers sur le terrain militaire, APRES avoir préparé politiquement ce terrain.
L'aspect le plus important fut le véritable désarmement politique, et la destruction politique des conseils d'ouvriers et de soldats de Berlin, qui survécurent seulement de nom (nom qui fut employé par le capital contre la révolution).
La mainmise des sociaux-démocrates sur les conseils, la transformation de ceux-ci en organes contrôlés par l'Etat bourgeois, la dénaturation des conseils ouvriers, ont eu pour effet de détruire de l'intérieur les conseils. De conseils-organes prolétariens pour l'organisation en classe du prolétariat et la destruction de l'Etat bourgeois, ils deviennent la caution de l'Etat social-démocrate avant que celui-ci les supprime définitivement par l'instauration de l'Assemblée nationale; fort de son contrôle sur les conseils, la social-démocratie peut organiser la provocation de janvier 1919 à Berlin pour décapiter le mouvement prolétarien et le parti spartakiste.
La montée du mouvement en novembre-décembre 1918 fut brisée dès les premiers mois de 1919.
Avec l'aide des corps francs, force militaire contre-révolutionnaire mise en place à la veille de la dissolution de l'armée régulière, à la fin de la guerre, avec l'aide du gouvernement social-démocrate SPD, la bourgeoisie parvint à massacrer les ouvriers de Berlin en janvier 19, de Brème en février, en mars en Allemagne centrale et dans la région de la Ruhr, en avril-mai à Munich, les uns après les autres, ville par ville, région par région, paquet par paquet, écrasant la colonne vertébrale du mouvement.
Bien que ceci n'ait pas mis fin à la combativité de la classe ouvrière, et que la classe ouvrière ait encore repris la lutte jusqu'en 1923 (du soulèvement contre le putsch du général Kapp en avril 1920, jusqu'au soulèvement en Allemagne centrale en mars 1921 et à Hambourg en octobre 1923), en fait le mouvement était défait dès les premiers mois de 1919.
LES ORIGINES DE LA DEFAITE AU COEUR DE LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE
Tout comme l'échec des révolutions ouvrières les plus importantes de 1848, 1871, 1905, la vague révolutionnaire de 1917-23 ne fut pas simplement le résultat des fautes, ou même de l'absence d'une avant-garde révolutionnaire; dans le même sens, la défaite de la classe ouvrière en Allemagne ne peut pas simplement être expliquée par la faible influence et le manque d'expérience du Parti Communiste (nouvellement créé). L'influence relativement faible du KPD reflétait à son tour une faiblesse profondément ancrée dans la classe ouvrière elle-même : la difficulté à comprendre le changement fondamental pour la perspective communiste que constituait l'ouverture d'une nouvelle période historique de décadence et de décomposition du mode de production capitaliste.
Il est vrai que le retard dans la formation de fractions révolutionnaires en Allemagne a été une cause déterminante du retard des révolutionnaires allemands à affronter la nouvelle situation. Le parti communiste s'est formé trop tard et trop rapidement sous la poussée de la révolution de novembre, sans une longue tradition de luttes et de combat contre la bourgeoisie et les fractions bourgeoises dans la social-démocratie, dont la politique contre-révolutionnaire s'était révélée pleinement en 1914.
LA GUERRE n'est pas la meilleure condition pour l'issue victorieuse de la révolution
Néanmoins, bien qu'à la fois la Commune de Paris et la grève de masse de 1905 aient surgi dans des moments de guerre, le mouvement marxiste s'attendait à ce que la révolution soit déclenchée non en réaction à la guerre, mais comme conséquence ultime de la résistance du prolétariat à la crise économique.
La chute rapide du capitalisme dans le bain de sang de la 1ère Guerre mondiale rendait incomparablement plus difficile pour la classe ouvrière le développement d'une pleine conscience de la gravité réelle et la signification de cette guerre. Après avoir subi le massacre bestial de la guerre, la classe ouvrière était surtout consciente des conséquences de la guerre, sans être déjà consciente des autres conséquences de la décadence du capitalisme.
Ce fait avait déjà amené Rosa Luxemburg à tirer la conclusion suivante: "En partant de la base du développement historique, on ne peut pas attendre d'une Allemagne qui a présenté la terrible image du 4 août 1914 et des quatre années qui ont suivi, de pouvoir soudainement faire le 9 novembre 1918 l’expérience d'une magnifique révolution de classe consciente de ses buts. Ce que nous avons vécu le 9 novembre 1918 était aux trois-quarts plus un effondrement de l'impérialisme existant que la victoire d'un nouveau principe. Le moment était simplement venu pour que l'impérialisme, comme un géant aux pieds d'argile, pourri de l'intérieur, n'ait qu'à s'effondrer. Ce qui s'ensuivit fut un mouvement plus ou moins chaotique, sans plan, très peu conscient, dans lequel l'unique lien et principe resté sauf était résumé dans le seul slogan: formation de conseils d'ouvriers et de soldats." (Congrès de fondation du KPD, 1918-19, Oeuvres Choisies, vol.4, p.497).
Bien que le capitalisme soit à cette époque entré dans une phase de décomposition, ceci n'amena pas automatiquement et mécaniquement la classe ouvrière à comprendre toutes les implications du changement de période. La classe ouvrière souffrait encore du poids du réformisme et n'était pas capable de tirer toutes les leçons de cette nouvelle époque aussi rapidement que l'évolution des événements eux-mêmes.
L'illusion d'un retour à la prospérité du 19ème siècle fut renforcée à partir du moment où la bourgeoisie accordait la paix.
LES LEÇONS DE LA REVOLUTION EN ALLEMAGNE
Les anciennes armes du prolétariat se retournent contre les ouvriers
En Allemagne où la classe ouvrière au siècle dernier avait développé le plus le pouvoir des syndicats et du parti de masse, le SPD, ceci pesait d'un poids particulier. Les anciens piliers du prolétariat servaient désormais directement de gardes-chiourmes contre la classe ouvrière:
- les SYNDICATS passèrent un accord avec les patrons en 1914 pour interdire les grèves; sans cela, l'énorme production d'armements et la paix du début sur le "front de la production" n'auraient pas été possibles; ils agirent désormais comme forteresse contre les conseils d'ouvriers et de soldats;
- la participation aux ELECTIONS PARLEMENTAIRES, l'espoir d'obtenir des concessions de la part de la bourgeoisie dans la phase de décadence et d'utiliser la tribune du Parlement pour gagner les ouvriers hésitants à la cause de la révolution, se révéla non seulement être une illusion, mais aussi un dangereux poison;
- le SPD, sous le contrôle de la direction de droite, avec plusieurs millions de membres du parti, n'était pas seulement devenu inutile comme parti de masse, mais une arme directe du capital soutenant la guerre, puis ensuite dans l'écrasement des luttes révolutionnaires.
L'aile droite du SPD passa dans le camp de la bourgeoisie en 1914, à travers son vote aux crédits de guerre. Ceci se fit contre l'âpre résistance d'une petite minorité qui gagna du terrain au cours de la guerre, mais qui, en 1917, fut expulsée par la direction du SPD, et dont la majorité de cette minorité constitua l'USPD (Parti Social-Démocrate Indépendant). Après avoir été une arme du prolétariat, le SPD devait devenir le bourreau du prolétariat en 1918-19. En Allemagne où résidaient les plus importantes concentrations du prolétariat en Europe et où les ouvriers avaient accumulé l'expérience organisationnelle la plus étendue, la classe ouvrière souffrait aussi le plus du poids du réformisme et de l'influence de l'opportunisme.
Avec le surgissement des luttes révolutionnaires en 1918, la classe ouvrière non seulement ne put faire face aux armes qu'elle avait elle-même forgées et utilisées au siècle dernier et qui étaient maintenant tombées dans les mains de ses bourreaux, mais elle avait aussi à combattre contre le poids des traditions du réformisme.
Mais la reconnaissance que ces anciennes armes (parlement, syndicats) sont devenues caduques ne tombe pas du ciel et doit être élaborée dans la pratique. Le prolétariat n'a pas d'autre chemin d'apprentissage qu'à travers sa propre expérience.
La transition du capitalisme de sa phase ascendante à sa phase de décadence était un facteur objectif. Mais la classe ouvrière elle-même n'avait fait que commencer à tirer les premières leçons du changement de situation. Même les organisations révolutionnaires, l'avant-garde du prolétariat, étaient loin d'avoir tiré les leçons de cette nouvelle période.
La gauche de la social-démocratie avait déjà commencé avant la guerre à se confronter à la reconnaissance de l'apparition d'une nouvelle période (cf. les positions de Luxemburg, Pannekoek, Radek, etc., sur la grève de masse, le parti, la question nationale, la lutte contre le réformisme et l'opportunisme). Mais l'avant-garde révolutionnaire ne prit elle-même position que dans le feu de la lutte sur beau coup de ces questions. Dans les premières années après 1914, il n'y avait pas encore d'assimilation profonde et étendue de toutes les implications du changement de période.
La leçon première de la révolution allemande - sur laquelle nous reviendrons dans un prochain article - est évidemment la question du rapport du prolétariat à l'Etat bourgeois, des conseils comme organes du pouvoir dont le rôle est non seulement d'organiser unitairement le prolétariat mais de détruire l'ensemble de l'Etat capitaliste. L'échec de l'Allemagne vérifie par la négative la justesse des Thèses d'Avril de Lénine en 1917. Les conseils ouvriers doivent prendre le pouvoir et détruire l'ensemble de l'appareil politique de la bourgeoisie, dont la social-démocratie en Allemagne était le principal défenseur idéologique, et même le corps armé par l'organisation des corps francs dès décembre 1918. Nous reviendrons sur ces principales leçons, décisives pour l'avenir de la future révolution mondiale.
Le capitalisme était entré dans sa période de décadence avec la 1ère guerre mondiale. La nécessité de sa transformation par une révolution prolétarienne mondiale se trouva ainsi à l'ordre du jour de l'histoire ainsi que le souligna 1l'Internationale communiste
"Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, et de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat". (Plate-forme de l’IC, 1919).
Les pré conditions objectives de la révolution prolétarienne étaient remplies. Mais, par elles-mêmes, elles ne suffisent pas. Bien que le capitalisme développe un cours irrésistible vers la destruction, il ne se détruira pas lui-même. Seule la classe ouvrière est capable de l'abolir. Mais pour ce faire, le fossoyeur de l'ancienne société, le prolétariat, doit avoir suffisamment développé ses armes (sa conscience et sa capacité organisationnelle) pour détruire véritablement le système capitaliste. La première vague révolutionnaire, dont la clé de la généralisation à l'échelle mondiale résidait dans les mains de la classe ouvrière en Allemagne, échoua finalement parce que le prolétariat, après quatre ans de boucherie dans les tranchées, ne réussit pas à se relever de la déroute politique d'août 14 avec la trahison des grands partis sociaux-démocrates appelant à l'union nationale et à la participation à la guerre impérialiste.
Bien que l'insurrection ait échoué et ait abouti à une défaite, elle reste néanmoins une partie de l'expérience internationale et historique de la classe ouvrière mondiale. L'insurrection victorieuse en Russie, tout autant que la défaite rapide des ouvriers en Allemagne, sont deux éléments- clés dans la vague révolutionnaire, deux parties d'un seul et même processus, deux expériences d'une seule et même tentative de la classe ouvrière de renverser le système capitaliste.
(à suivre) Dino. Eté 88.
Quelques dates :
1914
4 août : la fraction parlementaire du SPD vote à l'unanimité (moins Ruhle) les crédits de guerre ; l'opposition commence à se rassembler.
1915
Février : Liebknecht mobilisé, Rosa Luxemburg emprisonnée.
Mars : Liebknecht et Ruhle votent contre les crédits de guerre.
Mai : tract de Liebknecht "L'ennemi est dans notre pays".
Décembre : 18 députés "centristes" votent contre les crédits militaires.
1916
1er Mai : manifestations ouvrières pour la paix.
Juin : grèves et manifestations en faveur de Liebknecht
1er Septembre : première Lettre de Spartakus
1917
Février : début de la révolution en Russie.
Avril : grèves à Berlin, premiers conseils ouvriers à Berlin et Leipzig ; l'opposition contre la guerre, exclue par la droite du SPD, forme l'USPD.
Août : manifestations de marins.
Octobre : le prolétariat prend le pouvoir en Russie.
Décembre : négociations de paix russo-allemande de Brest-Litovsk.
1918
Janvier : vague de grèves en Autriche et en Hongrie; vague de grèves à Berlin de 400 000 ouvriers ; le Conseil ouvrier de Berlin est formé.
Printemps et été : série de grèves, en particulier dans l'armement.
Octobre:
le 3 : le SPD entre au le gouvernement,
le 30 : les marins de Kiel refusent de repartir au front.
Novembre :
le 4 : la répression contre les marins provoque une vague de solidarité ; des conseils d'ouvriers et de soldats sont formés dans une douzaine de villes;
le 8 : le premier Gouvernement républicain est formé en Bavière ;
le 9 : accord entre le SPD et le Commandement militaire suprême contre la révolution ; l'Empereur abdique; Ebert, dirigeant SPD, chancelier du Conseil des commissaires du peuple; 3 membres du SPD et 3 membres de l'USPD forment ce gouvernement bourgeois au nom de la révolution.
le 10 : formation du Conseil d'ouvriers et de soldats du grand Berlin; son pouvoir est contrebalancé par le Conseil des commissaires du peuple.
le 11 : armistice ; organisation de la Ligue Spartakus avec une centrale.
le 12 : capitalistes et syndicats mettent en place le code du travail (journée de 8 heures sans perte de salaire décrétée pour le 1er janvier 1919).
le 16 : le SPD organise les corps francs (troupes contre-révolutionnaires).
le 23 : le Conseil d'ouvriers et de soldats de Berlin délègue le pouvoir exécutif au Conseil des commissaires du peuple.
Décembre :
les 6 et 8 : affrontements militaires et grandes manifestations à Berlin.
du 16 au 21 se tient le congrès des Conseils d'ouvriers et de soldats de Berlin ; 250 000 ouvriers manifestent sous la direction des Spartakistes.
le 23 : affrontements militaires à Berlin.
le 25 : manifestation de masse à Berlin; le quotidien du SPD est occupé.
le 29 : l'USPD quitte le gouvernement, Noske Ministre de la guerre.
les 30,31 et le 1er janvier 1919 se tient le Congrès de fondation du KPD
1919
Janvier:
le 5 : grandes manifestations à Berlin.
du 6 au 12 : batailles de rue à Berlin, Stuttgart, Nurenberg, Brème, Dusseldorf ; les corps francs rétablissent l'ordre à Berlin.
le 10 : proclamation d'une République des Conseils à Brème.
le 15 : assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht à Berlin.
le 16 : le "Rote Fahne", journal quotidien du KPD, est déclaré illégal.
le 26 : élections de l'assemblée constituante.
Février :
du 2 au 4 : écrasement de la République de Brème par les corps francs
le 11 : vague de grèves dans la Ruhr, Ebert élu président.
du 18 au 22 : intervention militaire par les mêmes corps francs
le 24 : grève générale en Allemagne centrale, en Saxe.
Mars :
le 2 : congrès de fondation de l'Internationale communiste à Moscou.
du 3 au 8 : grève générale à Berlin et "semaine sanglante" : intervention des mêmes corps francs de retour de la Ruhr
7 Avril : proclamation de la République des conseils de Bavière.
1er Mai : prise de Munich et massacre par les corps francs.
28 Mai : fin de la grève dans la Ruhr.
Fin Juin : grève des cheminots.
Août : liquidation de la République des conseils de Hongrie.
Géographique:
- Allemagne [92]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [852]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Int. 1989 - 56 à 59
- 3867 reads
Revue Internationale no 56 - 1e trimestre 1989
- 2794 reads
Editorial : FRANCE : les "coordinations" à l'avant-garde du sabotage des luttes
- 2671 reads
Les mouvements sociaux qui agitent la France depuis plusieurs mois dans presque toutes les branches du secteur public constituent une illustration éclatante de la perspective mise en avant par le CCI depuis de nombreuses années : face aux attaques de plus en plus brutales et massives d'un capital plongé dans une crise insurmontable (voir dans ce n° l'article sur la situation économique), la classe ouvrière mondiale n'est pas résignée, bien au contraire. Le profond mécontentement qu'elle a accumulé se transforme maintenant en une énorme combativité qui contraint la bourgeoisie à déployer des manoeuvres de plus en plus vastes et subtiles pour ne pas être débordée. Ainsi en France, elle a mis en oeuvre un plan très élaboré qui faisait appel non seulement aux différentes formes de syndicalisme (syndicalisme "traditionnel" et syndicalisme "de base") mais encore et surtout à des organes qui se prétendent encore plus "à la base" (puisqu'ils sont sensés s'appuyer sur les assemblées générales de travailleurs en lutte), les "coordinations", dont l'utilisation dans le sabotage des luttes ne va pas s'arrêter de sitôt.
Jamais, depuis de nombreuses années, "rentrée sociale" en France n'avait été aussi explosive que celle de l'automne 88. Depuis le printemps, il était clair que d'importants affrontements de classe se préparaient. Les luttes qui s'étaient déroulées entre mars et mai 88 dans les entreprises "Chausson" (construction de camions) et SNECMA (moteurs d'avions) avaient fait la preuve que la période de relative passivité ouvrière qui avait suivi la défaite de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 et janvier 87 était bien terminée. Le fait que ces mouvements aient éclaté et se soient développés alors que se déroulaient les élections présidentielles et législatives (pas moins de 4 élections en deux mois) était particulièrement significatif dans un pays où traditionnellement ce type de période est synonyme de calme social. Et cette fois-ci, le Parti socialiste revenu au pouvoir ne pouvait espérer aucun "état de grâce" comme en 81. D'une part les ouvriers avaient déjà appris entre 81 et 86 que l'austérité "de gauche" ne vaut pas mieux que celle "de droite". D'autre part, dès son installation, le nouveau gouvernement avait clairement mis les points sur les i : il était hors de question de remettre en cause la politique économique appliquée par la droite durant les deux années précédentes. Et elle avait mis à profit les mois d'été pour aggraver cette politique.
C'est pour cela que la combativité ouvrière que le cirque électoral du printemps avait partiellement paralysée ne pouvait manquer d'exploser dès l'automne en des luttes massives, en particulier dans le secteur public où les salaires avaient baissé de près de 10% en quelques années. La situation était d'autant plus menaçante pour la bourgeoisie que depuis les années du gouvernement PS-PC (81-84), les syndicats avaient subi un discrédit considérable et n'étaient plus en mesure dans beaucoup de secteurs de contrôler à eux seuls les explosions de colère ouvrière. C'est pour cette raison qu'elle a mis en place un dispositif visant à émietter, à disperser les combats de classe, où évidemment les syndicats avaient leur place, mais dont le premier rôle serait tenu pendant toute la phase initiale par des organes "nouveaux", "non syndicaux", "vraiment démocratiques" : les "coordinations".
UNE NOUVELLE ARME DE LA BOURGEOISIE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE : LES "COORDINATIONS"
Le terme de "coordination" a été employé déjà en de multiples reprises ces dernières années dans différents pays d'Europe. Ainsi nous avons connu, au milieu des années 80 en Espagne, une "Coordinadora de Estibadores" (Coordination de dockers) ([1] [1491]) dont le langage radical et la très grande ouverture (notamment en permettant aux révolutionnaires d'intervenir dans ses assemblées) pouvait faire illusion, mais qui n'était pas autre chose qu'une structure permanente du syndicalisme de base. De même, nous avons vu se constituer en Italie, au cours de l'été 87, un "Coordinamento di Macchinisti" (Coordination des conducteurs de train), qui s'est révélé rapidement comme étant de même nature. Mais la terre d'élection des "coordinations" est incontestablement, à l'heure actuelle, la France où, depuis l'hiver 86-87, toutes les luttes ouvrières importantes ont vu se manifester des organes portant ce nom :
- "coordinations" des "agents de conduite" (dite de Paris-Nord) et "intercatégorielle" (dite de Paris Sud-Est) lors de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 ([2] [1492]);
- "coordination des instituteurs" lors de la grève de cette catégorie en février 87 ;
- "coordination Inter-SNECMA" lors de la grève dans cette entreprise au printemps 88 ([3] [1493]).
Parmi ces différentes "coordinations", certaines sont de simples syndicats, c'est-à-dire des structures permanentes prétendant représenter les travailleurs dans la défense de leurs intérêts économiques. Par contre, d'autres de ces organes n’on pas à priori la vocation de se maintenir de façon permanente? Ils surgissent, ou apparaissent au grand jour, au moment des mobilisations de la classe ouvrière dans un secteur et disparaissent avec elles. Il en a été ainsi, par exemple des coordinations qui avaient surgi lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86. Et c'est justement ce caractère "éphémère" qui, en donnant l'impression qu'ils sont des organes constitués par la classe spécifiquement pour et dans la lutte, qui les rend d'autant plus pernicieux.
En réalité, l'expérience nous a montré que de tels organes, quand ils n'étaient pas préparés de longs mois à l'avance par des forces politiques précises de la bourgeoisie, étaient "parachutés" par celles-ci sur un mouvement de luttes en vue de son sabotage. Déjà dans la grève des chemins de fer en France, nous avions pu constater comment la "coordination des agents de conduite", en fermant complètement ses assemblées à tous ceux qui n'étaient pas conducteurs, avait contribué de façon très importante à l'isolement du mouvement et à sa défaite. Or cette "coordination" s'était constituée sur la base de délégués élus par les assemblées générales des dépôts. Pourtant, elle avait été immédiatement contrôlée par des militants de la "Ligue Communiste" (section de la 4ème Internationale trotskiste) qui, évidemment, ont pris en charge le sabotage de la lutte comme c'est leur rôle. Mais avec les autres "coordinations" qui ont surgi par la suite, déjà avec la "coordination inter catégorielle des cheminots" (qui prétendait combattre l'isolement corporatiste), et plus encore avec la "coordination des instituteurs" qui est apparue quelques semaines après, on a constaté que ces organes étaient constitués de façon préventive avant que les assemblées générales n'aient commencé à envoyer des délégués. Et à l'origine de cette constitution on retrouvait toujours une force bourgeoise de gauche ou gauchiste preuve que la bourgeoisie avait compris le parti qu'elle pouvait tirer de ces organismes.
Mais l'illustration la plus claire de cette politique bourgeoise nous a été donnée par la constitution et les agissements de la "Coordination Infirmière" à qui la bourgeoisie a confié le rôle principal dans la première phase de sa manoeuvre : le déclenchement de la grève dans les hôpitaux en octobre 88. En fait cette "coordination" avait été constituée dès mars 88, dans les locaux du syndicat socialisant CFDT, par des militants de celui-ci. Ainsi, c'est directement le Parti socialiste, qui s'apprêtait à revenir au pouvoir, qui a porté sur les fonts baptismaux cette soi-disant organisation de lutte des travailleurs. Le déclenchement de la grève elle-même porte la marque de l'action du parti socialiste et donc du gouvernement. Il s'agissait pour la bourgeoisie (non pas ses forces d'appoint comme les gauchistes, mais directement ses forces dominantes, celles qui se trouvent au sommet de l'Etat) de lancer un mouvement de lutte dans un secteur particulièrement arriéré sur le plan politique afin de pouvoir "mouiller la poudre" du mécontentement qui s'accumulait depuis des années dans l'ensemble de la classe ouvrière. Il est clair que les infirmières qui allaient involontairement constituer l'infanterie de cette manoeuvre bourgeoise avaient elles aussi de réelles raisons d'exprimer leur mécontentement (des conditions de travail invraisemblables qui ne cessaient de s'aggraver et des salaires de misère). Mais l'ensemble des événements qui se sont déroulés sur plus d'un mois permet de mettre en évidence la réalité du plan bourgeois destiné à établir un contre-feu face à la montée du mécontentement ouvrier.
LES AGISSEMENTS DES "COORDINATIONS" DANS LA GREVE DES HOPITAUX EN FRANCE
En choisissant les infirmières pour développer sa manoeuvre, la bourgeoisie savait ce qu'elle faisait. C'est un secteur parmi les plus corporatistes qui soient, où le niveau de diplômes et de qualification requis a permis l'introduction de préjugés très forts et un certain mépris vis-à-vis d'autres personnels hospitaliers (aides soignantes, ouvriers de l'entretien, etc.) considérés comme "subalternes". De plus, en France, l'expérience de lutte est très faible dans ce secteur. L'ensemble de ces éléments donnait à la bourgeoisie la garantie qu'elle pourrait contrôler globalement le mouvement sans crainte de débordements significatifs, et en particulier que les infirmières ne pourraient en aucune façon constituer le fer de lance de l'extension des luttes.
Cette garantie était renforcée par la nature et la forme des revendications mises en avant par la "Coordination infirmière". Parmi celles-ci, la revendication d'un "statut" et de la "revalorisation de la profession" recouvrait en réalité la volonté de mettre en avant la "spécificité" et la "qualification particulière" des infirmières vis-à-vis des autres travailleurs de l'hôpital. De plus cette revendication contenait l'exigence répugnante de n'accepter dans les écoles d'infirmières que des élèves ayant leur baccalauréat. Enfin, dans la même démarche élitiste, la revendication d'une augmentation de 2 000 francs par mois (qui représentait de 20 à 30 %) était rattachée au niveau d'études des infirmières (baccalauréat < plus 3 ans), ce qui voulait dire que les autres travailleurs hospitaliers moins qualifiés, et encore moins payés, n'avaient aucune raison d'avoir les mêmes exigences et cela d'autant plus que, sans le prendre officiellement à son compte évidemment, la "Coordination" faisait et laissait dire qu'il ne fallait pas que les autres catégories revendiquent des augmentations de salaire car cela serait déduit des augmentations des infirmières.
Un autre indice de la manoeuvre est le fait que c'est dès le mois de juin que le noyau initial de la "Coordination infirmière" a planifié le début du mouvement pour le 29 septembre avec une journée de grève et une grande manifestation dans la capitale. Cela donnait le temps à la "Coordination" de bien se structurer et d'élargir son assise avant l'épreuve du feu. Ce renforcement de la capacité de contrôle des travailleurs par la "Coordination" s'est poursuivi dès la fin de la manifestation par une assemblée de plusieurs milliers de personnes où les membres de sa direction se sont présentés pour la première fois en public. Cette assemblée a constitué une première légitimation a posteriori de la "Coordination" où elle a "magouillé" du mieux possible pour empêcher que la grève ne démarre immédiatement, tant qu'elle n'aurait pas bien "les choses en main". Elle lui a permis également de bien affirmer sa "spécificité infirmière", notamment en "encourageant" les autres catégories qui avaient participé à la manifestation (preuve de l'énorme "ras-le-bol" existant), et qui se trouvaient dans la salle, à créer leurs "propres coordinations". Ainsi était mis en place le dispositif qui allait permettre un émiettement systématique de la lutte au sein des hôpitaux, de même que son isolement à l'intérieur de ce secteur. Les "coordinations" qui allaient se créer à partir du 29 septembre dans la foulée de la "Coordination infirmière" (pas moins de 9 dans le seul secteur de la santé) se sont chargées de compléter le travail de division de celle-ci parmi les hospitaliers, alors qu'il revenait à une "coordination des personnels de santé" (créée et contrôlée par le groupe trotskiste "Lutte ouvrière"), qui se voulait "ouverte" à toutes les catégories, d'encadrer les travailleurs qui rejetaient le corporatisme des autres "coordinations" et de paralyser toute tentative de leur part d'élargir le mouvement en dehors de l'hôpital.
Le fait que ce soit une "coordination" et non un syndicat qui ait lancé le mouvement (alors qu'elle avait été constituée par des syndicalistes), n'est évidemment pas le fait du hasard. En réalité, c'était le seul moyen permettant une mobilisation importante compte tenu du discrédit considérable que subissent en France les syndicats, notamment depuis le gouvernement de la "gauche unie" entre 1981 et 1984. Ainsi, les "coordinations" ont comme fonction d'assurer cette "mobilisation massive" qui est ressentie par tous les ouvriers comme une nécessité pour faire reculer la bourgeoisie et son gouvernement. Cette mobilisation massive, il y a un bon moment déjà que les syndicats ne l'obtiennent plus derrière leurs "appels à la lutte". En fait, dans de nombreux secteurs, il suffit souvent qu'une "action" soit appelée par tel ou tel syndicat, pour qu'un nombre important d'ouvriers considère que c'est une manoeuvre destinée à servir les intérêts de chapelle de ce syndicat et décide de s'en détourner. Cette méfiance, et le faible écho que rencontrent les appels syndicaux, ont d'ailleurs été souvent employés par la propagande bourgeoise pour faire entrer dans la tête des ouvriers l'idée d'une "passivité" de la classe ouvrière en vue de développer en son sein un sentiment d'impuissance et de démoralisation. Ainsi, seul un organisme ne portant pas l'étiquette syndicale était en mesure d'obtenir au sein de la corporation choisie par la bourgeoisie comme principal terrain de sa manoeuvre, une "unité", condition d'une participation massive derrière ses appels. Mais cette "unité" que la "Coordination infirmière" prétendait être seule à garantir contre les habituelles "chamailleries" entre les différents syndicats n'était que le revers de l'écoeurante division qu'elle a promue et renforcée parmi les travailleurs de l'hôpital. L'"anti-syndicalisme" qu'elle a affiché s'accompagnait de l'argument crapuleux suivant lequel les syndicats ne défendent pas les intérêts des travailleurs justement parce qu'ils sont organisés non par profession mais par secteur d'activité. Un des thèmes majeurs mis en avant par la "Coordination" pour justifier l'isolement corporatiste était que les revendications unitaires avaient pour résultat de "diluer" et "d'affaiblir" les revendications "propres" aux infirmières. Cet argument n'est pas nouveau. Il nous a notamment été servi lors de la grève des chemins de fer de décembre 86 par la "coordination des agents de conduite". On le retrouve également dans le discours corporatiste tenu par le "Coordinamento di Macchinisti" dans les chemins de fer italiens en 87. En fait, au nom de la "remise en cause" ou du "dépassement" des syndicats on en revient ici à une base d'organisation qui appartenait à la classe ouvrière au siècle dernier, lorsqu'elle a commencé par constituer des syndicats de métier, mais qui dans la période actuelle ne peut être moins bourgeoise que les syndicats eux-mêmes. Alors que la seule base sur laquelle peut aujourd'hui s'organiser la classe ouvrière est la base géographique, par-delà les distinctions entre entreprises et branches d'activité (distinctions que les syndicats ne cessent évidemment de cultiver dans leur travail de division et de sabotage des luttes), un organisme qui se constitue spécifiquement sur la base de la profession ne peut se situer que dans le camp bourgeois.
On voit ainsi le piège dans lequel les "coordinations" se proposent d'enfermer les ouvriers : ou bien ils "marchent" derrière les syndicats (et dans les pays où il existe le "pluralisme syndical" ils deviennent les otages des différents gangs qui entretiennent leurs divisions) ou bien ils se détournent des syndicats mais c'est pour se diviser d'une autre façon. En fin de compte les "coordinations" ne sont pas autre chose que le complément des syndicats, l'autre mâchoire de l'étau qui vise à emprisonner la classe ouvrière.
LE PARTAGE DU TRAVAIL ENTRE LES "COORDINATIONS" ET LES SYNDICATS
Cette complémentarité entre le travail des syndicats et celui des "coordinations" s'est révélée de façon claire dans les deux mouvements les plus importants qui se sont déroulés en France ces deux dernières années : dans les chemins de fer et dans les hôpitaux. Dans le premier cas, le rôle des "coordinations" s'est réduit essentiellement à "contrôler le terrain" en laissant le soin aux syndicats de mener les négociations avec le gouvernement. En cette circonstance elles ont d'ailleurs joué un rôle utile de rabatteurs pour le compte des syndicats en affirmant bien fort qu'elles ne leur contestaient nullement la responsabilité de "représenter" les travailleurs auprès des autorités (elles ont tout juste réclamé sans succès d'avoir un petit strapontin à la table de négociation). Dans le second cas, alors que les syndicats étaient bien plus contestés, la "Coordination infirmière" a été finalement gratifiée d'une place à part entière à cette même table. Après que le ministre de la santé ait au début refusé de la recevoir (à l'issue de la première manifestation du 29 septembre), c'est par la suite le premier ministre lui-même qui, le 14 octobre, après une manifestation rassemblant près de 100 000 personnes à Paris, lui a accordé cette faveur. C'était la moindre des récompenses que le gouvernement pouvait donner à ces gens qui lui rendaient de si fiers services. Mais le partage des tâches s'est également réalisé en cette circonstance : finalement, ce 14 octobre les syndicats (à l'exception du plus "radical", la CGT contrôlée par le PC) ont signé un accord avec le gouvernement alors que la "coordination" continuait à appeler à la lutte. Soucieuse d'apparaître jusqu'au bout comme un "véritable défenseur" des travailleurs, elle n'a jamais officiellement accepté les propositions du gouvernement. Le 23 octobre, elle a enterré le mouvement à sa façon en appelant à la "poursuite de la lutte sous d'autres formes" et en organisant de temps en temps des manifestations où l'assistance de moins en moins nombreuse ne pouvait que démobiliser les travailleurs. Cette démobilisation résultait également du fait que le gouvernement, s'il n'avait rien donné aux autres catégories d'hospitaliers et s'il avait refusé toute augmentation d'effectif du personnel infirmier (une des revendications importantes), avait accordé à celui-ci des augmentations de salaire non négligeables (de l'ordre de 10 %) sur des fonds (1,4 milliard de francs) qui d'ailleurs étaient déjà prévus à l'avance dans le Budget. Cette "demi-victoire" des seules infirmières (prévue et planifiée depuis longtemps par la bourgeoisie : on avait pu voir l'ancien ministre de la santé participer aux manifestations de la "Coordination" et même Mitterrand avait déclaré que les revendications des infirmières étaient "légitimes") présentait le double avantage d'aggraver encore la division entre les différentes catégories de travailleurs de l'hôpital et d'accréditer l'idée qu'en se battant sur un terrain corporatiste, notamment derrière une "coordination", on pouvait obtenir quelque chose.
Mais la manoeuvre bourgeoise visant à désorienter l'ensemble de la classe ouvrière ne s'arrêtait pas avec la reprise du travail dans les hôpitaux. La dernière phase de l'opération débordait largement le secteur de la santé et appartenait pleinement aux syndicats que le travail des coordinations avait remis en selle. Alors que pendant toute la montée du mouvement dans la santé, les syndicats et les groupes "gauchistes" avaient fait tout leur possible pour empêcher le démarrage de grèves dans d'autres secteurs (notamment dans les postes où la volonté de lutte était très forte), à partir du 14 octobre, ils ont commencé à appeler à la mobilisation et à la grève un peu partout. C'est ainsi que le 18 octobre la CGT a convoqué une "journée d'action inter catégorielle" et que le 20 octobre les autres syndicats, rejoints au dernier moment par la CGT, ont appelé à une journée d'action dans la fonction publique. Par la suite, les syndicats, et en première ligne la CGT, ont commencé à appeler systématiquement à la grève dans les différentes branches du secteur public, les unes après les autres : postes, électricité, chemins de fer, transports urbains des villes de province puis de la capitale, transports aériens, sécurité sociale... Il s'agit pour la bourgeoisie d'exploiter à fond la désorientation créée dans la classe ouvrière par le mouvement dans les hôpitaux au moment de son reflux, pour déployer sa manoeuvre dans tous les autres secteurs. On assiste à une "radicalisation" des syndicats - CGT en tête - qui font de la "surenchère" par rapport aux "coordinations" en appelant à "l'extension", qui organisent, là où ils conservent une influence suffisante, des grèves "jusqu'auboutistes" et minoritaires, faisant appel à des "actions de commando" (comme parmi les conducteurs des camions des postes qui ont bloqué les centres de tri) ce qui a pour effet de les isoler encore plus. A l'occasion, d'ailleurs, les syndicats n'hésitent pas à se coiffer ouvertement de la casquette des "coordinations" lorsque cela peut "aider" comme ce fut le cas aux postes où la CGT a créé la sienne.
Ainsi, le partage des tâches entre "coordinations" et syndicats couvre tout le champ social : aux premières il revenait de lancer et de contrôler à la base le mouvement "phare", le plus massif, celui de la santé ; aux seconds, après qu'ils aient négocié de façon "positive" avec le gouvernement dans cette branche, il revient maintenant la responsabilité de compléter le travail dans les autres catégories du secteur public. Et en fin de compte, l'ensemble de la manoeuvre a réussi puisque, aujourd'hui, la combativité ouvrière se retrouve dispersée en de multiples foyers de lutte isolés qui ne pourront que l'épuiser, ou paralysée chez les ouvriers qui refusent de se laisser entraîner dans les aventures de la CGT.
QUELLES LEÇONS POUR LA CLASSE OUVRIERE ?
Alors que, deux mois après le début du mouvement dans les hôpitaux, les grèves se poursuivent encore en France dans différents secteurs, ce qui met bien en évidence les énormes réserves de combativité qui s'étaient accumulées dans les rangs ouvriers, les révolutionnaires peuvent déjà en tirer un certain nombre d'enseignements pour l'ensemble de la classe.
En premier lieu, il importe de souligner la capacité de la bourgeoisie d'agir de façon préventive et en particulier de "susciter le déclenchement de mouvements sociaux de façon prématurée lorsqu'il n'existe pas encore dans l'ensemble du prolétariat une maturité suffisante permettant d'aboutir à une réelle mobilisation. Cette tactique a déjà été souvent employée dans le passé par la classe dominante, notamment dans des situations où les enjeux étaient encore bien plus cruciaux que ceux de la période actuelle. L'exemple le plus marquant nous est donné par ce qui s'est passé à Berlin en janvier 1919 où, à la suite d'une provocation délibérée du gouvernement social-démocrate, les ouvriers de cette ville s'étaient soulevés alors que ceux de la province n'étaient pas encore prêts à se lancer dans l'insurrection. Le massacre de prolétaires (ainsi que la mort des deux principaux dirigeants du Parti communiste d'Allemagne : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht) qui en a résulté a porté un coup fatal à la Révolution dans ce pays où, par la suite, la classe ouvrière a été défaite paquet par paquet.
Aujourd'hui et dans les années à venir, cette tactique visant à prendre les devants pour battre les ouvriers paquet par paquet sera systématiquement employée par la bourgeoisie alors que la généralisation des attaques économiques du capital commande une riposte de plus en plus globale et unie de la part de la classe ouvrière. L'exigence de l'unification des luttes qui est ressentie de façon croissante par les ouvriers est appelée à se heurter à une multitude de manoeuvres, impliquant un partage des tâches entre toutes les forces politiques de la bourgeoisie, et particulièrement la Gauche, les syndicats et les organisations gauchistes, visant à diviser la classe ouvrière et à émietter son combat. Ce que nous confirment les événements récents en France, c'est que parmi les armes les plus dangereuses mises en oeuvre par la bourgeoisie dans la conduite de cette politique, il faut ranger les "coordinations" dont l'utilisation se fera de plus en plus fréquente à mesure que se développera le discrédit des syndicats et la volonté des ouvriers de prendre en main leurs luttes.
Face aux manoeuvres de la bourgeoisie visant à chapeauter les luttes par ces fameuses "coordinations", il appartient à la classe ouvrière de comprendre que sa force véritable ne provient pas de ces prétendus organes de "centralisation" mais, en premier lieu, de ses assemblées générales à la base. La centralisation du combat de classe constitue un élément important de sa force, mais une centralisation précipitée, lorsqu'à la base n'existe pas un niveau suffisant de prise en main de la lutte par l'ensemble des travailleurs, lorsque ne«se manifestent pas des tendances significatives à l'extension, ne peut aboutir qu'au contrôle de l'ensemble du mouvement par des forces bourgeoises (en particulier les organisations gauchistes) et à son isolement, c'est-à-dire, deux éléments de sa défaite. L'expérience historique a démontré que plus on s'élève dans la pyramide des organes créés par la classe pour centraliser son combat, que plus on s'éloigne du niveau où l'ensemble des ouvriers peut s'impliquer directement dans celui-ci, et plus les forces de gauche de la bourgeoisie ont le jeu facile pour établir leur contrôle et développer leurs manoeuvres. Cette réalité on a pu la constater même dans des périodes révolutionnaires. C'est ainsi qu'en Russie, durant la plus grande partie de l'année 1917, le Comité exécutif des soviets a été contrôlé par les mencheviks et les socialistes révolutionnaires ce qui a conduit les bolcheviks pendant toute une période à insister pour que les soviets locaux ne se sentent pas liés par la politique menée par cet organe de centralisation. De même, en Allemagne, en novembre 1918, le Congrès des Conseils ouvriers ne trouve rien de mieux à faire qu'à remettre tout le pouvoir aux sociaux-démocrates passés à la bourgeoisie, prononçant ainsi l'arrêt de mort de ces mêmes conseils.
Cette réalité, la bourgeoisie l’a parfaitement comprise. C'est pour cela qu'elle va systématiquement susciter l'apparition d'organes de "centralisation" qu'elle pourra facilement contrôler en l'absence d'une expérience et d'une maturité suffisantes de la classe. Et pour mieux se garantir, elle va le plus souvent possible, notamment par l'entremise de ses forces gauchistes, fabriquer à l’avance de tels organes qui vont par la suite se faire "légitimer" par des simulacres d'assemblées générales empêchant de cette façon que celles-ci ne créent elles-mêmes de véritables organes de centralisation : comités de grève élus et révocables au niveau des entreprises, comités centraux de grève au niveau des villes, des régions, etc.
Les luttes récentes en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, ont fait la preuve que, quoi qu'en puissent dire les éléments conseillistes-ouvriéristes qui aujourd'hui se pâment devant les "coordinations", la classe ouvrière n'a pas encore atteint à l'heure actuelle la maturité suffisante lui permettant de constituer des organes de centralisation de ses luttes à l'échelle de tout un pays comme se proposent de le faire les "coordinations". Elle ne pourra pas prendre de raccourci et sera contrainte de déjouer pendant une longue période tous les pièges et obstacles que la bourgeoisie dispose devant elle. Elle devra en particulier poursuivre l'apprentissage de l'extension de ses luttes et d'une réelle prise en main de celles-ci à travers les assemblées générales souveraines sur les lieux de travail. Le chemin est encore long pour le prolétariat, mais il n'en existe pas d'autre.
FM. 22-11-88
Géographique:
- France [1061]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question syndicale [129]
Où en est la crise économique ? De la crise du crédit a la crise monétaire et a la récession ou le crédit n'est pas une solution
- 2644 reads
Un an après l'effondrement boursier d'octobre 1987 qui vit partir en fumée près de 2 000 milliards de dollars de capitaux spéculatifs (soit l'équivalent de près de 400 dollars par être humain), le capitalisme mondial semblerait en bonne santé : l'année 1988 s'annoncerait même, d'après les estimations actuelles, la meilleure depuis le début des années 80. Mais les années 1973 et 1978-79 qui ont précédé les grandes récessions de 1974-75 et 1980-82 furent aussi les plus brillantes en leur temps. La fuite dans le crédit n'est pas une solution éternelle. Ce qui s'annonce dans "l’euphorie" actuelle c'est une convulsion monétaire avec au bout une nouvelle récession mondiale.
D'ailleurs au lendemain même des élections américaines, le langage des propagandes officielles commence déjà à changer et le triomphalisme cède le pas aux appels à la prudence.
- "La fin du mandat Reagan est caractérisée par une expansion persistante depuis maintenant six ans, la plus longue de l’histoire américaine en temps de paix... En valeur absolue le déficit américain peut paraître important. Mais, comme le pays produit le quart du PNB mondial, le déficit américain est, en pourcentage, inférieur à la moyenne OCDE... La 'crise des déficits' américains est une astuce des relations publiques employée par l’establishment républicain traditionnel pour purger le parti d'hommes politiques populaires... Ce qu'il faut, c'est un système monétaire qui empêche les banques centrales de mettre en danger la prospérité économique." (P.C. Roberts, professeur au Centre d'études stratégiques, USA, un des théoriciens de la dite "économie de l'offre" ou "reaganomics")([1] [1497]).
En d'autres termes, ce que disent certains économistes, c'est que les gigantesques déficits et l'endettement massif du capital américain ne constituent pas des problèmes majeurs. Les inquiétudes que le développement vertigineux de ces phénomènes soulève, seraient sans fondement réel et traduiraient tout au plus des "astuces" liées à des guerres de clans parmi les politiciens américains. Derrière cette affirmation d'autruche se trouve en fait posée la question de savoir si la fuite en avant dans le crédit ne serait pas, finalement, un remède éternel, un moyen de permettre à l'économie capitaliste de poursuivre, à condition que les autorités monétaires aient une politique adaptée, un développement ininterrompu : "L'expansion persistante... la plus longue de l'histoire américaine en temps de paix" confirmerait une telle possibilité.
En réalité, les fameuses six années d"'expansion" de l'économie américaine qui ont provisoirement empêché l'effondrement total de l'économie mondiale ([2] [1498]) n'ont pas été le fruit d'une nouvelle découverte économique. Elles étaient une continuation de la vieille politique keynésienne de déficits étatiques et de la fuite en avant dans l'endettement. Et, contrairement à ce qu'affirme notre éminent professeur, l'ampleur de cet endettement - produit d'une véritable explosion du recours au crédit au cours des dernières années - loin d'être une question sans importance, pose DES A PRESENT des problèmes énormes aussi bien au capital américain qu'à l'économie mondiale et ouvre à brève échéance la perspective d'une nouvelle récession mondiale.
LES EFFETS DEVASTATEURS DE L'EXCES DE CREDIT
- "En 1987, l'Amérique importait près de deux fois plus qu'elle n'exportait. Elle dépensait 150 milliards de dollars de plus, dans les autres pays, qu'elle ne gagnait, et le gouvernement fédéral dépensait 150 milliards de dollars de plus sur le marché intérieur qu'il n'engrangeait de recettes fiscales. Les Etats-Unis comptant environ 75 millions de ménages, chacun d'entre eux a ainsi dépensé l'an dernier 2 000 dollars (12 500 F) de plus qu'il n'a gagné en moyenne et a emprunté le solde à l'étranger. " ([3] [1499])
Les statistiques sont cette science qui permet d'affirmer que lorsqu'un bourgeois possède cinq automobiles et que sou voisin chômeur n'en possède aucune, ce dernier en possède tout de même deux et demie. La moyenne de dépenses à crédit pour chaque ménage américain n'est qu'une moyenne, mais elle donne une image de l'ampleur du phénomène de recours au crédit qui a caractérisé le capitalisme américain au cours des dernières années.
Cette situation a, dès à présent, des conséquences particulièrement significatives de l'état d'empoisonnement de la machine capitaliste aussi bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde.
Aux Etats-Unis
L'année 1988, outre le record d'endettement global du capital américain, a vu trois autres records historiques particuliers être battus :
- le record de faillites bancaires : en octobre 1988 le nombre de ces faillites avait déjà pulvérisé le record de 1987;
- le record de paiement des autorités fédérales pour indemniser les clients de caisses d'épargnes en faillite;
- le record de la masse d'intérêts payés par le trésor américain sur sa dette : "D'un moment à l'autre, les comptables du gouvernement US enregistreront un moment remarquable dans les comptes fédéraux : les intérêts que le Trésor paie sur les 2 000 milliards de dollars de la dette nationale sont sur le point de dépasser le montant de l'énorme déficit du budget. Le gouvernement US paie quelques 150 milliards de dollars par an en intérêts, soit 14% du total de la dépense gouvernementale. De ces 150 milliards, de 10 à 15% vont aux investisseurs étrangers." (New York Times, 11 octobre 1988).
Cependant, l'effet immédiat le plus grave de cette course dans l'endettement est la hausse des taux d'intérêt qu'elle entraîne. Le Trésor américain a de plus en plus de mal a trouver de nouveaux prêteurs pour financer sa dette. Pour y parvenir il est contraint d'offrir des taux d'intérêts de plus en plus élevés. Le gouvernement avait été contraint de rabaisser ces taux en octobre 1987 pour freiner l'effondrement boursier, mais depuis lors, il a de nouveau été conduit à les remonter. Le taux des Bons du Trésor à trois mois est ainsi passé de 5,12 % fin octobre 87 à 7,20 en août 88.
Les conséquences immédiates sont déjà dévastatrices à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la dette elle-même : étant donné l'ampleur de l'endettement, on estime qu'un point de plus des taux d'intérêt se traduit par 4 milliards de dollars de plus à payer par an par le capital américain. Deuxièmement, et surtout, la hausse des taux d'intérêt entraîne un freinage inévitable de la machine économique, c'est-à-dire annonce une récession à plus ou moins brève échéance.
Dans le monde
Mais le capital des Etats-Unis n'est pas le seul endetté dans le monde, loin s'en faut, même s'il est devenu le premier débiteur de la planète. La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis entraîne celle des taux d'intérêt dans le monde entier. Pour les pays de la périphérie, depuis longtemps confrontés à l'incapacité de faire face à leurs dettes, en particulier ceux d'Afrique et d'Amérique latine, cela veut dire une augmentation immédiate des intérêts à débourser et donc de leur dette déjà faramineuse. Leur faillite chronique pousse déjà leurs taux d'inflation vers de nouveaux records. Pour le Brésil, par exemple, il est prévu une inflation de 820% pour l'année 1988. Sur le plan des investissements, ceux-ci connaissent déjà une chute vertigineuse et généralisée.
Pour les capitaux créanciers des Etats-Unis, ceux qui bénéficient théoriquement en premier des déficits US car ils y trouvent dans l'immédiat un débouché pour leurs exportations (Japon et Allemagne en particulier), ils se trouvent de plus en plus en possession de montagnes de "promesses de paiement" américaines, libellées en dollars, sous toutes sortes de formes : bons du Trésor, actions, obligations, etc. Cela fait beaucoup de richesse sur le papier, mais que devient cette masse de papier du moment que le capital américain ne parvient pas à payer ou si - on y reviendra plus loin - les USA dévaluent le dollar ?
La thèse des économistes qui prétendent que la fuite en avant dans le crédit, en particulier aux Etats-Unis, n'est pas une véritable menace pour le capital mondial, est un leurre que la réalité dément dès à présent par les effets dévastateurs qu'elle exerce, même sans tenir compte des perspectives qu'elle ouvre pour l'avenir.
LE CREDIT N'EST PAS UNE SOLUTION ETERNELLE
Le capitalisme a toujours eu recours au crédit pour assurer sa reproduction. Il constitue un élément fondamental de son fonctionnement en particulier au niveau de la circulation. Sa généralisation par le capital constitue un accélérateur de son processus d'accumulation et en tant que tel il est un instrument indispensable à son bon fonctionnement. Mais il ne joue ce rôle que dans la mesure où le capital fonctionne dans des conditions d'expansion réelles, c'est-à-dire, si au bout du retardement qu'il crée entre le moment de la vente et le moment du paiement, il existe un remboursement réel.
- "Le maximum que puisse faire le crédit dans ce domaine -qui concerne la seule circulation - c'est de sauvegarder la continuité du processus productif, A CONDITION qu'existent toutes les autres conditions de cette continuité, c'est-à-dire, qu'existe réellement le capital contre lequel il doit être échangé. " (Marx, Grundrisse).
Or, le problème pour le capitalisme actuellement, aussi bien aux USA qu'ailleurs, c'est que "le capital contre lequel (le crédit) doit être échangé", "les autres conditions de cette continuité du processus productif n'existent pas.
Contrairement à ce qui se produit dans des conditions de véritable expansion, le capital ne recourt pas aujourd'hui au crédit pour accélérer un processus productif sain, mais pour retarder les échéances d'un processus productif embourbé dans la surproduction et le manque de débouchés solvables. Depuis la fin des années 1950-60, depuis la fin du processus de reconstruction qui suivit la deuxième guerre mondiale, le capitalisme n'a survécu qu'en poussant les manipulations économiques de toutes sortes à des extrêmes insoupçonnables, mais il n'a pas pour autant résolu son impasse de fond. Au contraire il n'a fait, et ne fait, que l'aggraver.
LA POURSUITE DE LA FUITE EN AVANT
Aux Etats Unis. Au lendemain du "krach" d'octobre 1987 les USA n'ont eu d'autre solution que de poursuivre leur endettement. Certains économistes estiment que les Banques centrales des autres pays ont dû ainsi racheter pour près de 120 milliards de dollars.
Dans les pays moins développés. Certains économistes avaient parlé de faire des moratoires et d'annuler tout simplement la dette des pays les plus pauvres. Comme nous l'avions prévu dans le n° 54 de cette revue, cela s'est réduit essentiellement à des promesses verbales et à quelques miettes.
Il est vrai que l'annulation de l'obligation de rembourser les crédits éliminerait le problème. Mais cela reviendrait à faire du capitalisme un mode de production qui ne produit plus pour le profit... ce qui n'est plus du capitalisme. Non, la "solution" trouvée a été d'ouvrir de nouveaux crédits. On assiste ainsi à la fin de 1988 à une spectaculaire ouverture de nouveaux crédits à ces pays : de nouveaux rééchelonnements des dettes sont accordés et le Mexique s'est même vu accorder un prêt d'urgence, par les Etats-Unis : 3,5 milliards de dollars, le prêt le plus important accordé à un pays débiteur depuis 1982.
Dans les pays de l'Est L'URSS, après toute une période où elle s'est attachée à réduire son endettement, revient quémander des crédits aux puissances occidentales, Perestroïka aidant. Des consortiums bancaires en Italie, RFA, France et Grande Bretagne devraient permettre à Moscou d'obtenir environ 7 milliards de dollars de crédits. Il en est de même pour la Chine qui connaît une situation de plus en plus analogue à celle des pays d'Amérique latine (inflation galopante, demande de nouveaux crédits pour pallier l'incapacité de rembourser ceux contractés auparavant).
LES PERSPECTIVES
L'économie capitaliste ne va pas vers une crise du crédit. Elle est déjà entièrement plongée dans une telle crise. C'est sur le plan monétaire que celle-ci devrait désormais se manifester.
- "Le système monétaire est essentiellement catholique, le système de crédit essentiellement protestant... The Scotch hâte gold (l’Ecossais hait Vor). Sous la forme de papier, l’existence monétaire des marchandises est de nature purement sociale. C'est la FOI qui sauve : la foi en la valeur monétaire considérée comme l’esprit immanent des marchandises, la foi dans le mode de production et son ordre prédestiné, la foi dans les agents individuels de la production tenus pour de simples personnifications du capital qui croît de lui-même.. Pas plus que le protestantisme ne peut s'émanciper des fondements du catholicisme, le système du crédit ne peut s'émanciper des fondements du système monétaire." (Marx, Le Capital, III, "Circulation, crédit, change", XVIII, Ed. La Pléiade, t. II, 1265).
En ce sens, Roberts ressent quelque chose de juste quand il nie le problème d'un excès de crédit pour les Etats-Unis et ne voit que celui des limites monétaires imposées par les banques centrales.
Mais ce qu'il ne voit pas c'est que ce qui en découle n'est pas que les banques centrales devront créer plus de monnaie, mais qu'elles en ont déjà créé trop et que c'est dans le domaine de la monnaie, dans la perte de "la FOI" dans la monnaie (et en premier lieu celle dans laquelle se fait la quasi-totalité du commerce mondial, LE DOLLAR) que s'exprimera dans le prochain temps la crise de surproduction capitaliste (dont la crise du crédit n'est qu'une manifestation superficielle).
Le capital américain, pas plus que les autres capitaux, ne peut pas et ne pourra rembourser ses dettes. Mais il est le plus puissant des gangsters. Et il dispose des moyens de faire violemment "réduire" par la force sa dette - une fois de plus - par ses propres créanciers. Contrairement aux autres Etats du monde, les Etats-Unis sont les seuls à pouvoir payer leur dette avec leur propre monnaie (les autres doivent la payer en devises et en particulier en dollars). C'est pourquoi, tout comme en 1973 et en 1979, ils n'ont d'autre issue que la dévaluation du dollar.
Mais une telle perspective aujourd'hui est l'annonce directe d'un nouveau marasme monétaire mondial ouvrant la porte à une nouvelle récession qui sera autrement plus profonde que celles de 1974-75 et 1980-82.
La dévaluation du dollar constitue d'une part une "ruine" sur le plan financier pour les principaux capitaux créanciers des Etats-Unis, et en premier lieu du Japon et de l'Allemagne... qui n'y pourront rien et qui par là même ne pourront en aucun cas jouer le fameux rôle de "locomotive" pour remplacer celle, défaillante, des USA. Mais d'autre part, cela constitue une barrière douanière qui ferme l'accès du marché américain - celui qui a servi depuis six ans de "locomotive" - pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Comme nous l'écrivions dans le n° 54 de cette revue, seule l'attente des élections américaines retardait le déclenchement d'un tel processus. Quelle que soit sa vitesse, il apparaît désormais en marche.
Les six dernières années ont traduit une ambiance particulièrement troublante. La crise de l'économie mondiale, loin de se résorber ou de disparaître n'a cessé de se développer en profondeur : poursuite de la croissance du chômage dans presque tous les pays, développement de la misère dans des proportions inconnues jusqu'à présent dans les zones les plus pauvres de la planète, désertification industrielle au coeur même des centres vitaux du capitalisme, paupérisation des classes exploitées dans les pays les plus industrialisés; au niveau financier ça a été l'explosion de l'endettement et les plus grandes secousses boursières depuis un demi-siècle, le tout pataugeant dans une frénésie spéculative sans précédent dans l'histoire. Cependant, la machine capitaliste ne s'est pas réellement effondrée. Malgré des records historiques de faillites, malgré des craquements de plus en plus puissants et fréquents, la machine à profits a continué de tourner, concentrant de nouvelles fortunes gigantesques - produit du carnage auquel se livrent les capitaux entre eux - et affirmant une arrogance cynique sur les bienfaits des lois "du libéralisme mercantile". "Les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres", constatent souvent les journalistes économiques, mais la machine "tourne" et les résultats de 1988, du moins dans les statistiques, s'annoncent les meilleurs de la décennie.
Plus grand monde ne croit réellement à la possibilité d'une nouvelle période de "prospérité" économique, comme celle des années 1950-60. Mais la perspective d'un nouvel effondrement capitaliste comme celui de 1974-75 ou de 1980-82 semblerait s'éloigner grâce aux multiples manipulations des gouvernements sur la machine économique. Ni réelle reprise, ni véritable effondrement : l'incertitude pour l'éternité.
Il n'en est rien. Jamais le système capitaliste ne fut aussi malade. Jamais son corps ne fut aussi empoisonné par les doses massives de drogues et de médicaments auxquelles il a dû avoir recours pour assurer sa médiocre et effroyable survie des six dernières années. Sa prochaine convulsion, qui une fois encore, combinera récession et inflation, n'en sera que plus violente, plus profonde et plus étendue mondialement.
Les forces destructrices et autodestructrices du capital se déchaîneront, une fois de plus, avec une violence sans précédent; mais cela provoquera l'indispensable ébranlement qui contraindra le prolétariat mondial à porter ses luttes à des niveaux supérieurs et à tirer profit de toute l'expérience accumulée en particulier au cours des dernières années.
20-11-88, RV.
[1] [1500] Le Monde, 25 octobre 1988.
[2] [1501] Pour une analyse de la réalité de cette "expansion" et de ses effets sur l'économie mondiale, voir "La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire" dans la Revue Internationale n° 54, 3e trimestre 1988.
[3] [1502] Stephen Marris, Le Monde, 25 octobre 1988
Récent et en cours:
- Crise économique [6]
Rubrique:
Algérie : la bourgeoisie massacre
- 2857 reads
Fin septembre et début octobre, l'Algérie a connu une vague sociale sans précédent dans son histoire depuis "l'Indépendance" de 1962. Dans les grandes villes et les centres industriels, grèves ouvrières massives et émeutes de la faim d'une jeunesse sans travail se sont succédé. Avec une barbarie inouïe, l'Etat "socialiste" algérien et le parti unique FLN ont massacré des centaines de jeunes manifestants. Cet Etat et ce parti, salués il y a 20 ans par les trotskystes et les staliniens comme "socialistes", ont opposé aux revendications "du pain et de la semoule" le plomb et la mitraille de l'armée. Assassinats, tortures, arrestations massives, état de siège et militarisation du travail, voilà la réponse de la bourgeoisie algérienne aux revendications des exploités.
1. Les grèves et les émeutes s'expliquent par la rapide détérioration de l'économie algérienne. Celle-ci, déjà en proie à la crise permanente des pays sous-développés s'effondre littéralement. La chute des cours du pétrole et du gaz algériens, dont le pays vit quasi exclusivement, l'épuisement de ces ressources vers l'an 2000, tout cela explique l'austérité draconienne des années 80. Comme la Roumanie de Ceausescu, l'Algérie de Chadli s'est engagée à rembourser sa dette auprès des banques mondiales, tâche à laquelle elle a travaillé activement. L'abandon du soutien de l'Etat à tous les secteurs (santé, alimentation, logement) s'est traduit par une situation effroyable pour les couches laborieuses. Des queues dès 6h du matin pour obtenir pain et semoule ; la viande introuvable, l'eau coupée pendant plusieurs mois ; l'impossibilité de trouver un logement, des salaires de misère bloqués, le chômage généralisé pour la jeunesse (65% des 23 millions d'habitants ont moins de 25 ans), tel est le résultat de 25 années de "socialisme" algérien, engendré par la lutte de "libération nationale". Face aux exploités, la bourgeoisie algérienne - parasitaire - se maintient totalement au travers d'une féroce dictature militaire. Les bureaucrates du FLN et les officiers de l'armée, qui ont la haute main sur l'appareil économique, vivent de spéculations, stockant les denrées alimentaires importées pour les revendre au prix fort sur le marché noir. Cela illustre toute la faiblesse de cette bourgeoisie. Si elle s'appuie de plus en plus sur le mouvement intégriste musulman qu'elle a encouragé ces dernières années, ce mouvement, - en dehors de fractions de la petite bourgeoisie et du lumpenprolétariat - est sans influence réelle sur la population ouvrière.
2. Le véritable sens des événements sociaux d'octobre, en réaction à la misère dramatique, c'est le surgissement net du prolétariat d'Algérie sur la scène sociale. Plus que lors des émeutes de 1980, 1985 et 1986, l'importance du mouvement ouvrier est incontestable. Dès fin septembre 88, des grèves éclataient dans toute la zone industrielle de Rouiba-Reghaia, à 30 km d'Alger, dont l'avant-garde est constituée des 13 000 ouvriers de la société nationale des véhicules industriels (ex-Berliet). De là, la grève s'étendait à toute la région d'Alger : Air Algérie, et surtout les postiers des FIT (Postes et télécommunications). Malgré la répression des ouvriers de Rouiba - arrosés par la police à coups de canon à eau - le mouvement s'étendait jusque dans les grandes villes de l'Est et de l'Ouest. En Kabylie, les tentatives de militaires et de policiers de dresser "Kabyles" contre "Arabes" - "ne soutenez pas les Arabes qui ne vous ont pas soutenu en 1985", claironnaient les voitures de police - n'ont rencontré que mépris et haine. Enfin, de façon significative, face aux grèves sauvages, le syndicat étatique UGTA a dû prendre ses distances avec le gouvernement, pour mieux prendre le "train en marche", et tenter de contrôler un tant soit peu le mouvement.
C'est dans ce contexte et cette ambiance qu'ont éclaté à partir du 5 octobre émeutes, pillages, destructions de magasins et édifices publics accomplis par des milliers de jeunes chômeurs, dont des enfants, auxquels se sont mêlés parfois provocateurs de la police secrète et intégristes. Ces émeutes ont été montées en épingle par les médias algériens et occidentaux pour mieux dissimuler l'étendue et le sens de classe des grèves. D'autre part, la bourgeoisie algérienne en a profité pour faire un bain de sang préventif, qu'elle a par la suite utilisé pour souligner la nécessité de "réformes" "démocratiques" et éliminer des fractions de son appareil d'Etat trop liées à l'armée et au FLN et inadéquates devant la menace prolétarienne.
Les émeutes de cette population très jeune, sans espoir et sans travail, ne sont pas la continuité des grèves ouvrières. Elles s'en distinguent nettement par leur absence de perspectives et leur trop facile utilisation et manipulation par l'appareil d'Etat. Il est vrai que cette jeunesse semble avoir manifesté un timide début de politisation en refusant de suivre et les mots d'ordre de l'Opposition à l'étranger (Ben Bella et Ait Ahmed, ex-chefs de FLN, éliminés par Boumediene) et les intégristes islamiques, qui ne sont qu'une création du régime et des militaires. Ici et là ces jeunes ont arraché le drapeau national algérien, ont saccagé mairies et sièges du FLN, détruit à Alger le siège du Polisario sahraoui, mouvement nationaliste soutenu par l'impérialisme algérien, et symbole de la guerre larvée avec le Maroc. Mais un tel mouvement doit être soigneusement distingué de celui des ouvriers en grève. La jeunesse en tant que telle n'est pas une classe. Composée aussi bien de jeunes chômeurs, de jeunes sans-travail tombés dans le lumpenprolétariat (appelés là bas les "gardiens du mur" en raison de leur oisiveté quotidienne), son action - séparée de l'action prolétarienne - est sans issue.
En s'attaquant seulement aux symboles de l'Etat, en pillant et détruisant aveuglément, ces révoltes sont impuissantes ; elles ne sont que des feux de paille ne pouvant guère contribuer au développement de la conscience et de la lutte ouvrières. Elles ne se différencient guère des émeutes périodiques des bidonvilles en Amérique latine. Elles traduisent la décomposition accélérée d'un système qui engendre dans les couches de sans-travail des explosions sans perspective historique.
L'absence - semble-t-il - d'organisation de la grève a sans doute permis à ces révoltes de passer au premier plan. Ce fait explique l'étendue de la répression policière et militaire (environ 500 morts, souvent très jeunes). L'armée n'a pas été contaminée ; elle n'a même pas connu un début de décomposition. Les 70 000 jeunes de l'armée de terre, ceux du contingent, sur une armée qui en compte 120 000, n'ont pas bougé.
C'est pourquoi, une fois l'eau rétablie dans les grandes villes, et les magasins "miraculeusement" réapprovisionnés, le gouvernement Chadli pouvait mettre fin à l'état de siège le 12 octobre. La grève générale de 48 heures en Kabylie et les quelques affrontements avec les policiers ont été un combat d'arrière-garde. L'ordre bourgeois a été rétabli avec quelques promesses "démocratiques" de Chadli (référendum sur la Constitution) et les appels au calme des imams (14 octobre) qui en appellent à une "république islamique" avec les militaires. Il s'agit en fait d'une pause dans une situation qui reste toujours explosive et se traduira par des mouvements sociaux ayant plus d'ampleur, où la présence du prolétariat sera plus visible et plus déterminante. Cette défaite est une première manche dans les affrontements futurs, de plus en plus décisifs, entre prolétariat et bourgeoisie. Des grèves sauvages ont d'ailleurs éclaté début novembre à Alger (7 novembre).
3. Malgré l'apparent "retour au calme", ces événements sociaux ont une importance historique considérable. En tant que tels ils ne peuvent être assimilés ni à l'Iran en 1979, ni aux événements actuels en Yougoslavie et au Chili. En aucun cas, les ouvriers et les jeunes sans-travail n'ont suivi les intégristes musulmans. Contrairement à ce qu'affirment la presse, les intellectuels bourgeois, le PC français, qui soutiennent peu ou prou Chadli, les intégristes sont l'arme idéologique des militaires, avec lesquels ils travaillent main dans la main. La religion, à la différence de l'Iran, n'a presque aucun impact sur les jeunes chômeurs et encore moins sur les ouvriers.
Mais le PLUS GRAND DANGER ACTUEL consisterait pour le prolétariat à croire dans les promesses de "démocratisation" et de rétablissement des "libertés", surtout depuis le référendum fin octobre (90% de votants pour Chadli). Le prolétariat n'a rien à espérer mais tout à craindre de telles promesses. Le bavardage démocratique ne fait que préparer d'autres ignobles massacres par la classe bourgeoise qui n'a rien à offrir d'autre que misère, plomb et mitraille aux exploités. C'est une leçon générale pour tous les prolétaires du monde : ON VOUS PROMET LA "DEMOCRATIE"; VOUS AUREZ D'AUTRES MASSACRES SI VOUS NE METTEZ PAS FIN A L'ATROCE BARBARIE CAPITALISTE!
Les événements d'octobre en Algérie ont une importance historique pour 4 raisons :
- ils sont dans le prolongement des grèves et émeutes de la faim qui ont secoué le Maroc et la Tunisie limitrophes depuis le début des années 80. Ils traduisent une réelle menace d'extension à tout le Maghreb, où ils ont déjà rencontré un large écho. La solidarité immédiate des gouvernements marocain et tunisien avec Chadli - en dépit d'appétits impérialistes contradictoires - est à la mesure de la peur qui a envahi la classe bourgeoise de ces pays ;
- ils montrent surtout -face aux GREVES OUVRIERES - la solidarité des grandes puissances impérialistes (France, USA) contre le prolétariat et leur soutien aux bains de sang pour rétablir "l'ordre". Déjà équipée en armes par la France, la RFA, les USA - qui ont pris la place des russes -, l'Algérie va être encore plus l'objet de soins attentifs du bloc américain sous forme d'armements et d'équipements de guerre civile.
Une fois de plus, se vérifie la Sainte Alliance de l'ensemble du monde capitaliste contre le prolétariat d'un pays, lequel n'affronte pas seulement "sa" bourgeoisie, mais toutes les bourgeoisies.
- en raison de l'importance de la classe ouvrière d'origine maghrébine, et surtout algérienne (presque 1 million d'ouvriers) en France, de tels événements ont déjà un impact énorme dans ce pays. L'unité du prolétariat contre la bourgeoisie en Europe occidentale et dans la périphérie immédiate se trouve posée, les conditions sont aujourd'hui propices pour la formation de minorités révolutionnaires dans le prolétariat algérien : dans un premier temps, dans l'immigration en France et en Europe, dans un second temps en Algérie, où le prolétariat est le plus développé, et même en Tunisie et au Maroc.
- Enfin, pour le prolétariat en Algérie, la grève généralisée est une première expérience d'envergure de confrontation avec l'Etat. Les prochains mouvements auront moins l'aspect d'un feu de paille. Ils se démarqueront plus nettement des révoltes des jeunes sans-travail.
A la différence des couches peu conscientes, perméables à la décomposition, le prolétariat ne s'attaque pas à des symboles, mais à un système, le capitalisme. Le prolétariat ne détruit pas pour aussitôt sombrer dans la résignation ; lentement, mais sûrement, il est appelé à développer sa conscience de classe, sa tendance à l'organisation. C'est dans ces conditions que le prolétariat, en Algérie comme d'ailleurs dans les pays du tiers monde, pourra orienter la révolte des jeunes sans-travail pour la canaliser vers la destruction de l'anarchie et de la barbarie capitalistes.
Chardin, 15-11-88
«Il n'existe pas de preuve plus flagrante de 1'impossibilité d'une révolution bourgeoise de nos jours que le caractère politique des régimes de "libération nationale". Ceux-ci sont inévitablement organisés dans le but avoué d'empêcher et, si nécessaire, de briser par la force tout embryon de lutte autonome de la classe ouvrière. La plupart d'entre eux sont des Etats policiers à parti unique, qui proscrivent le droit de grève. Leurs prisons sont remplies de dissidents. Nombreux sont ceux qui se sont illustrés dans l'écrasement sanglant de la classe ouvrière ; nous avons déjà mentionné la précieuse contribution de Ho-Chi-Minh à l'écrasement de la Commune ouvrière de Saigon ; nous pourrions aussi rappeler comment Mao a envoyé l'armée de "libération du peuple" "restaurer l'ordre" après les grèves, les débuts d'insurrection et les aventures ultra-gauchistes qu'avait provoqués la soi-disant "révolution culturelle". Nous devrions aussi nous souvenir de la répression des grèves des mineurs par Allende ou de celle exercée par la très "progressiste" junte militaire de Peron. La liste est pratiquement inépuisable. »
Nation ou Classe, brochure du CCI.
Géographique:
- Afrique [902]
Comprendre la décadence du capitalisme (6) : Le mode de vie du capitalisme en décadence
- 3933 reads
- Dans les deux articles précédents nous avons montré que tout mode de production est rythmé par un cycle ascendant et décadent (Revue Internationale n° 55) et qu'aujourd'hui nous vivons au coeur de la décadence du capitalisme (Revue Internationale n° 54). L'objet de cette contribution-ci est de mieux cerner les éléments qui ont permis au capitalisme de survivre tout au long de sa décadence et plus particulièrement de dégager les bases explicatives des taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut momentané du capitalisme est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour la réaliser viennent à épuisement, ouvrant la porte à une crise sans précédent.
La contradiction fondamentale du capitalisme
"Ce qui est décisif dans le processus de production c'est la question suivante : quels sont les rapports entre ceux qui travaillent et leurs moyens de production." (Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, Ed. 10/18). Dans le capitalisme le rapport qui lie les moyens de production et les travailleurs est constitué par le salariat. C'est le rapport social de production de base qui à la fois imprime la dynamique du capitalisme, et contient ses contradictions insurmontables ([1] [1503]). Rapport DYNAMIQUE en ce sens que, pour vivre, le système doit constamment s'élargir, accumuler, étendre et pousser à bout l'exploitation salariale, aiguillonné par la baisse tendancielle du taux de profit (la péréquation de ce dernier découlant de la loi de la valeur et de la concurrence). Rapport CONTRADICTOIRE en ce sens que le mécanisme même de production de plus-value crée plus de valeur qu'il n'en distribue ; la plus-value étant la différence entre la valeur du produit du travail et le coût de la marchandise force de travail : le salaire. En généralisant le salariat, le capitalisme restreint ses propres débouchés, contraignant le système à constamment devoir trouver des acheteurs en dehors de sa sphère capital-travail :
"(...)Plus la production capitaliste se développe, et plus elle est obligée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate, mais dépend d'une extension constante du marché mondial (...). Ricardo ne voit pas que la marchandise doit être nécessairement transfonnée en argent. La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage (..). Dire enfin que les capitalistes n'ont en somme qu'à échanger et consommer les marchandises entre eux, c'est oublier tout le caractère de la production capitaliste et oublier qu'il s'agit de mettre le capital en valeur (...). La surproduction provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, que sa consommation n'augmente pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail (...). Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :
1) Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs, acheteurs d'une très grande portion de leur produit;
2) Que la majeure partie des producteurs, des ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent de leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent, qu'ils produisent la plus-value, le surproduit. Il leur faut constamment être surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs (...). La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital: produire à la mesure des forces productives, c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse de travail avec une masse donnée de capital, sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables (...)." (Marx, Le Capital, Ed.. Sociales, 1975, livre IV, t.II et livre III, t.I).
Marx a clairement montré, d'une part, l'inéluctabilité de la fuite en avant de la production capitaliste afin d'accroître la masse de plus-value pour compenser la baisse du taux de profit (dynamique), et d'autre part l'obstacle qui se dresse pour le capital : l'éclatement de la crise par le rétrécissement du marché nécessaire à l'écoulement de cette production (contradiction), bien avant que ne se manifeste l'insuffisance de la plus-value engendrée par la baisse tendancielle du taux de profit : "Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin de débouchés s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants et plus coûteux qu'il a créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre plus de marchandises, à conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandises (...). Les crises deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes déjà du fait que, au fur et a mesure que la masse de produits et, par conséquent, 1e besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit de plus en plus et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter, car chaque crise antérieure a soumis au commerce mondial un marché non conquis jusque là ou exploité de façon encore superficielle par le commerce" (Marx, Travail salarié et capital, Ed.. de Pékin, 1970).
Cette analyse fut systématisée et amplement développée par Rosa Luxemburg qui dégagea l'idée que, puisque la totalité de la plus-value du capital social global ne pouvait être réalisée, de par sa nature même, au sein de la sphère purement capitaliste, la croissance du capitalisme était dépendante de ses continuelles conquêtes de marchés pré-capitalistes ; l'épuisement relatif, c'est-à-dire eu égard aux besoins de l'accumulation, de ces marchés devra précipiter le système dans sa phase de décadence :
"Par ce processus, le capital prépare doublement son propre effondrement: d'une part, en s'étendant aux dépens des formes de production non capitalistes, il fait avancer le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation, deviendront impossibles. D'autre part, à mesure qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie économique et politique internationale à tel point qu'il provoquera contre sa domination la rebellion du prolétariat intemational bien avant que l'évolution économique ait abouti à sa dernière conséquence : la domination absolue et exclusive de la production capitaliste dans le monde. (...) L'impérialisme actuel (...) est la dernière étape du processus historique (du capitalisme) : la période de concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe." (L'accumulation du capital, Ed.. Maspéro, 1967).
Outre son analyse du lien indissoluble entre les rapports de production capitalistes et l'impérialisme, qui montre que le système ne peut vivre sans s'étendre, sans être impérialiste par essence, ce que Rosa Luxemburg apporte de fondamental ce sont les outils d'analyse pour comprendre pourquoi, comment et quand le système entre dans sa phase de décadence. A cette question Rosa y répondra dès les prodromes de la guerre 1914-18, estimant que le conflit inter impérialiste mondial ouvre l'époque où le capitalisme devient définitivement une entrave pour le développement des forces productives : "La nécessité du socialisme est pleinement justifiée dès le moment où l'autre, la domination de la classe bourgeoise, cesse d'être porteuse de progrès historique et constitue un frein et un danger pour l'évolution ultérieure de la société. Or, s'agissant de l'ordre capitaliste, c'est ce que précisément la guerre actuelle a révélé" (Rosa Luxemburg, in Rosa Luxemburg jountaliste-polémiste-révolutionnaire, Badia. Ed.. Sociales, 1975). Cette analyse, quelle qu'en soit l'explication "économique" était partagée par l'ensemble du mouvement révolutionnaire.
Si l'on saisit bien cette contradiction insoluble pour le capital, on détient la boussole pour comprendre le mode de vie du système au cours de sa décadence. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement que constitue le marché. Seule cette compréhension permet de relativiser les "performances" ponctuelles du capitalisme (taux de croissance après 1945). Nos critiques (cf. Revue Intemationale n° 54 et 55) sont éblouis par les chiffres de la croissance mais cela les aveugle sur la NATURE de cette croissance. Ils s'écartent ainsi de la méthode marxiste qui s'efforce de dégager l'essence véritable cachée derrière l'existence des choses. C'est ce que nous allons tenter de montrer ([2] [1504]).
Quand la réalisation de la plus-value prend le pas sur sa production
Globalement, en phase ascendante, la demande dépasse l'offre, le prix des marchandises est déterminé par les coûts de production les plus élevés qui sont ceux des secteurs et pays les moins développés. Ceci permet à ces derniers de réaliser des profits permettant une réelle accumulation et aux pays les plus développés d'encaisser des sur-profits. En décadence, c'est l'inverse, globalement l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les secteurs et les pays ayant les coûts les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est à perte ou de tricher avec la loi de la valeur pour survivre (cf. infra). Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas. Même les économistes bourgeois avec leur terminologie propre (prix de vente et de revient) constatent cette inversion : "Nous avons été frappés par l'inversion contemporaine de la relation entre prix de revient et prix de vente (...) à long terme le prix de revient conserve son rôle (...) Mais alors qu'hier, le principe était que le prix de vente pouvait TOUJOURS être fixé au-dessus du prix de revient, aujourd'hui il apparaît le plus souvent comme devant être soitmis au prix de marché. Dans ces conditions, lorsque l'essentiel n'est plus la production mais la vente, lorsque la concurrence se fait de plus en plus rude, les chefs d'entreprise partent du prix de vente pour remonter progressivement jusqu'au prix de revient (...) pour vendre, le chef d'entreprise a plutôt tendance aujourd'hui à considérer en premier le marché, donc à examiner d'abord le prix de vente. (...) Si bien que désormais, on assiste souvent au paradoxe que ce sont de moins en moins les prix de revient qui déterminent les prix de vente et de plus en plus l'inverse. Le problème est : ou bien renoncer à produire, ou bien produire au-dessous du prix de marché." (Fourastier J. et Bazil B., Pourquoi les prix baissent, Ed. Hachette - Pluriel).
Ce phénomène se marque spectaculairement dans la part démesurée que prennent les frais de distribution et de marketing dans le produit final. Ces fonctions sont assurées par le capital commercial qui participe au partage général de la plus-value. Ces frais sont donc inclus dans les coûts de production. En phase ascendante, tant que le capital commercial assurait l'augmentation de la masse de plus-value et du taux annuel de profit, par la réduction de la période de circulation des marchandises et le raccourcissement du cycle de rotation du capital circulant, il contribuait à la baisse généralisée des prix, caractéristique de cette période (cf. graphique 4). Ce rôle se modifie en phase de décadence. A mesure que les forces productives se heurtent aux limites trop étroites du marché, le rôle du capital commercial devient moins celui d'accroître la masse de plus-value que d'en assurer la réalisation. Ceci s'exprime dans la réalité concrète du capitalisme, d'une part par un accroissement du nombre de personnes employées dans la sphère de la distribution et de façon générale par une diminution relative du travail réellement productif et, d'autre part par l'accroissement des marges commerciales dans la plus-value finale. On estime que les frais de distribution atteignent aujourd'hui en moyenne entre 50 à 70 % du prix des marchandises dans les grands pays capitalistes. L'investissement dans les secteurs parasitaires du capitalisme commercial (campagne marketing, sponsoring, lobbing, etc.), secteurs qui vont au-delà de la fonction normale de distribution de la marchandise, prend de plus en plus le pas sur l'investissement réellement productif. Cela correspond purement et simplement à de la destruction de capital. productif. Ceci montre le caractère de plus en plus parasitaire du système.
Le crédit
"Le système de crédit accélère par conséquent le développement matériel des forces productives et la constitution d'un marché mondial; la tâche historique de la production capitaliste est justement de pousser jusqu'à un certain degré le développement de ces deux facteurs, base matérielle de la nouvelle forme de production. Le crédit accélère en même temps les explosions violentes de cette contradiction, les crises et, partant, les éléments qui dissolvent l'ancien mode de production." (Marx, Le Capital, Livre III).
En phase ascendante, le crédit a constitué un puissant moyen pour accélérer le développement du capitalisme par le raccourcissement du cycle de rotation du capital. L'avance sur la réalisation de la marchandise que constitue le crédit trouvait son dénouement grâce à la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés extra-capitalistes. En décadence ce dénouement est de moins en moins possible, le crédit se mue alors en un palliatif à l'incapacité de plus en plus grande du capital à réaliser la totalité de la plus-value produite. L'accumulation rendue momentanément possible par le crédit ne fait que développer un abcès insoluble qui débouche inévitablement dans la guerre inter-impérialiste généralisée.
Le crédit n'a jamais constitué une demande solvable en soi et encore moins en décadence comme voudrait nous le faire dire Communisme ou Civilisation (CoC) : "Parmi les raisons qui permettent au capital d'accumuler figure maintenant le crédit ; autant dire que la classe capitaliste est capable de réaliser la plus-value grâce à une demande solvable provenant de la classe capitaliste. Si, dans la brochure du CCI sur la Décadence du capitalisme, cet argument n'apparaît pas, il fait désormais partie de la panoplie de tout initié de la secte. On admet ici ce qui, jusque là, a été farouchement nié à savoir la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation." (CoC n°22) ([3] [1505]). Le crédit constitue une avance sur la réalisation de la plus-value et permet ainsi d'accélérer la clôture du cycle complet de la reproduction du capital. Ce cycle comprend, selon Marx - on l'oublie trop souvent -, la production ET la réalisation de la marchandise produite. Ce qui se modifie entre la phase ascendante et la phase décadente du capitalisme, ce sont les conditions dans lesquelles opère le crédit. La saturation mondiale des marchés permet de moins en moins, et de moins en moins vite, de récupérer le capital investi. C'est pourquoi le capital vit de plus en plus sur une montagne de dettes qui prend des proportions astronomiques. Le crédit permet ainsi de maintenir la fiction d'une accumulation élargie et de repousser l'échéance où le capital devra passer à la caisse. Chose qu'il est d'ailleurs incapable d'assurer, ce qui le pousse inexorablement à la guerre commerciale et à la guerre inter-impérialiste tout court. Les crises de surproduction en décadence n'ont de "solution" que dans la guerre (cf. Revue Internationale n° 54). Les chiffres du tableau n° 1 et le graphique n°1 illustrent ce phénomène.
Concrètement les chiffres du tableau n° 1 nous montrent que les Etats-Unis vivent sur 2,5 ans de crédits, l'Allemagne sur 1 an. Pour rembourser ces crédits, si tant est qu'ils le seront un jour, les travailleurs de ces pays devraient respectivement travailler 2,5 et 1 ans gratuitement. Ces chiffres illustrent également une croissance plus rapide des crédits que du P.N.B. indiquant que le développement économique se fait de plus en plus à crédit au cours du temps.
Ces deux exemples ne constituent nullement une exception mais sont illustratifs de l'endettement mondial du capitalisme. L'estimer constitue un exercice périlleux, surtout à cause du manque de statistiques fiables mais l'on peut supputer que ce dernier se monte à 1,5 à 2 fois le PNB mondial. Entre 1974 et 1984 le taux d'accroissement de cet endettement est d'environ 11 % tandis que celui du P.N.B. mondial oscille autour de 3,5 % !
Tableau 1. Évolution de l'endettement du capitalisme
|
|
Dette publique et privée |
(en % du PNB) |
Dette des ménages (en % du revenu disponible) |
|---|---|---|---|
|
|
RFA |
USA |
USA |
|
1946 |
|
|
19,6% |
|
1950 |
22% |
|
|
|
1955 |
39% |
166 % |
46,1 % |
|
1960 |
47% |
172% |
|
|
1965 |
67% |
181 % |
|
|
1969 |
|
200% |
61,8 |
|
1970 |
75 % |
|
|
|
1973 |
|
197% |
71,8% |
|
1974 |
|
199% |
93% |
|
1975 |
84% |
|
|
|
1979 |
100% |
|
|
|
1980 |
250% |
|
|
Sources : Economic Report of the President (0l/1970) / Survey of Current Business (07/1975) / Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6) / Statistical Abstract of United States (1973).
Graphique 1. Belgique, croissance comparée de l'endettement et de la production.
Source : Bulletin de l'IRES, 1982, n°80 (l'échelle de gauche est un indice d'évolution des deux indicateurs, qui, pour être comparés, ont été ramenés à l'indice 100 en 1970).
Le graphique n° 1 est illustratif de l'évolution de la croissance et de l'endettement dans la majorité des pays. L'accroissement des crédits est nettement supérieur à celui de la production industrielle manufacturière. Si précédemment la croissance s'effectuait de plus en plus à crédit (1958-74: production= 6,01 %, crédit=13,26 %), aujourd'hui, le simple maintien de la stagnation se réalise à crédit (1974-81 : production = 0,15 %, crédit = 14,08 %).
Depuis le début de la crise chaque reprise économique est supportée par une masse de crédits de plus en plus importante. La reprise de 75-79 a été stimulée par des crédits accordés aux pays du "tiers-monde" et aux pays dits "socialistes", celle de 83 a été entièrement supportée par un accroissement des crédits aux pouvoirs publics américains - essentiellement consacré aux dépenses militaires - et aux grands trusts d'Amérique du Nord, crédits servant aux fusions d'entreprises, donc non productifs. CoC ne comprend rien à ce processus et sous-estime complètement le crédit et son ampleur comme mode de survie du capitalisme dans sa phase de décadence.
Les marches extra-capitalistes
Nous avons vu précédemment (Revue Intentationale n° 54) que la décadence du capitalisme se caractérisait non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par leur insuffisance par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteints par le capitalisme. C'est-à-dire que les marchés extra-capitalistes sont devenus insuffisants pour réaliser l'entièreté de la plus-value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Néanmoins une partie encore non négligeable de cette plus-value, bien que décroissante, est encore réalisée par ces marchés extra-capitalistes. Le capitalisme dans sa phase de décadence, aiguillonné par une base d'accumulation de plus en plus restreinte, va tenter d'exploiter au mieux l'exutoire que constitue pour lui la subsistance de ces marchés et cela de trois façons :
Par une intégration accélérée et planifiée, surtout après 1945, des secteurs d'économie marchande subsistants dans les pays développés.
Graphique 2. Part de la population active agricole dans la population active totale.
Le graphique n° 2 montre que si, pour certains pays, l'intégration de l'économie marchande agricole au sein des rapports sociaux capitalistes de production est déjà réalisée dès 1914, pour d'autres (France, Japon, Espagne, etc.), elle s'effectue encore au cours de la décadence et de façon accélérée après 1945.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale l'augmentation de la productivité du travail dans l'agriculture était plus faible que dans celle de l'industrie, résultat d'un plus lent processus de développement de la division du travail dû, entre autres, à un poids encore important de la rente foncière qui détourne une part des capitaux nécessaires à la mécanisation. Après la seconde guerre mondiale la croissance de la productivité du travail est plus rapide dans l'agriculture que dans l'industrie. Ceci se matérialise par une politique conjugant tous les moyens pour ruiner les entreprises agricoles familiales de subsistance relevant de la petite production marchande, et les transformer en entreprises purement capitalistes. C'est le processus d'industrialisation de l'agriculture.
Aiguillonnée par la recherche impérative de nouveaux marchés, la période de décadence se caractérise par une meilleure exploitation des marchés extra-capitalistes subsistants.
D'une part, le développement des moyens techniques, des communications, et la baisse des coûts de transport facilitent la pénétration - tant intensive qu'extensive - et la destruction de l'économie marchande de la sphère extra-capitaliste.
D'autre part, le développement de la politique de "décolonisation" soulage les métropoles d'un fardeau coûteux, leur permet de rentabiliser au mieux leurs capitaux et d'accroître les ventes aux anciennes colonies (payées par la sur-exploitation des populations autochtones). Ventes dont une part non négligeable est constituée par l'armement, nécessité première et absolue de l'édification d'un pouvoir étatique local.
En phase ascendante le contexte dans lequel se développe le capitalisme permet une homogénéisation des conditions de la production (conditions techniques et sociales, degré de productivité moyenne du travail, etc.). La décadence, par contre, accroît les iriégalités de développement entre pays avancés et sous-développés (cf. Revue Intemationale n° 54 et 23).
Alors qu'en ascendance la part des profits retirés des colonies (ventes, prêts, investissements) est supérieure à la part des profits résultant de l'échange inégal ([4] [1506]), en décadence c'est l'inverse qui se produit. L'évolution sur longue période des termes de l'échange est un indicateur de cette tendance. La détérioration de ces derniers pour les pays dits du "tiers monde" est devenue extrêmement importante depuis la seconde décennie de ce siècle.
Le graphique n° 3 ci-dessous illustre l'évolution des termes de l'échange de 1810 à 1970 pour les pays du "tiers-monde", c'est-à-dire du rapport entre prix des produits bruts exportés et prix des produits industriels importés. L'échelle exprime un rapport de prix (x 100), ce qui signifie que lorsque cet indice est supérieur à 100, il est favorable aux pays du "tiersmonde", et inversement lorsqu'il est inférieur à 100. C'est au cours de la deuxième décennie de ce siècle que la courbe passe l'indice pivot de 100 et entame sa chute, seulement interrompue par la guerre de 1939-45 et la guerre de Corée (forte demande de produits de base dans un contexte de pénurie).
Graphique 3. Evolution des termes de l'échange 1810 à 1970
Sources : Emilio de Figueros, Economie appliquée, t. XXII, n°1 et 2, publié également dans Le Monde du 29/07/69.
Le capitalisme d'État
Nous avons vu précédemment (Revue Internationale n° 54) que le développement du capitalisme d'Etat est étroitement lié à la décadence du capitalisme ([5] [1507]). Le capitalisme d'Etat est une politique globale qui s'impose au système dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. Il concourt à atténuer les contradictions insurmontables du capitalisme : au niveau social par un meilleur contrôle d'une classe ouvrière suffisamment développée pour constituer un réel danger pour la bourgeoisie ; au niveau politique pour maîtriser les tensions croissantes entre fractions de la bourgeoisie ; et au niveau économique pour modérer les contradictions explosives qui s'accumulent. A ce dernier niveau, qui nous occupe ici, l'Etat intervient par le biais d'une série de mécanismes :
Les tricheries avec la loi de la valeur.
Nous avons vu qu'en décadence une partie de plus en plus importante de la production échappe à la détermination stricte de la loi de la valeur (Revue Internationale n° 54). La finalité de ce processus est le maintien en vie d'activités qui autrement n'auraient pas survécu à l'impitoyable verdict de la loi de la valeur. Le capitalisme parvient ainsi pour un temps, mais pour un temps seulement, à éviter les conséquences des fourches caudines du marché.
L'inflation permanente est un des moyens qui répond à cette finalité. L'inflation permanente est d'ailleurs un phénomène typique, propre à la décadence d'un mode de production ([6] [1508]).
Graphique 4. Evolution des prix de gros dans cinq pays développés de 1750 à 1950-70.
Alors qu'en ascendance la tendance globale des prix est stable ou le plus souvent décroissante, la période de décadence marque l'inversion de la tendance. 1914 inaugure la phase d'inflation permanente.
Graphique 5. Evolution des prix de détail en France de 1820 à 1982
Stables pendant un siècle, les prix en France explosent après la première guerre mondiale et surtout la seconde : ils sont multipliés par 1000 entre 1914 et 1982. Sources: INSEE pour la France.
Si une chute et une adaptation périodique des prix aux valeurs d'échange (prix de production) sont artificiellement interdites par un gonflement du crédit et de l'inflation, toute une série d'entreprises qui sont déjà tombées au-dessous de la moyenne de la productivité du travail de leur secteur peuvent alors échapper à une dévalorisation de leur capital et à la banqueroute. Mais ce phénomène ne peut qu'accroître à la longue le déséquilibre entre la capacité de production et la demande solvable. La crise est reportée mais en devient du coup plus ample. Historiquement, dans les pays développés, l'inflation est tout d'abord apparue avec les dépenses étatiques dues à l'armement et à la guerre. Ensuite, le développement du crédit et des dépenses improductives de tous ordres s'y ajoute et en devient la cause majeure.
Les politiques anti-cycliques : armée de l'expérience de la crise de 1929 - où le repli sur soi a considérablement aggravé la crise - la bourgeoisie s'est débarrassée des restes d'illusions libre-échangistes d'avant 1914. Les années 30, et plus encore après 1945 avec le keynésianisme, sont marquées par la mise en place de politiques capitalistes d'Etat concertées. Il serait illusoire de vouloir toutes les énumérer mais elles ont une seule et même finalité : maîtriser tant bien que mal les fluctuations économiques et artificiellement soutenir la demande.
L'intervention croissante de l'Etat dans l'économie. Ce point à déjà été largement traité dans des Revue Internationale antérieures, nous n'aborderons ici qu'un aspect encore relativement peu abordé à savoir, l'intervention de l'Etat dans le domaine social et ses implications économiques.
En phase ascendante, les hausses salariales, la baisse du temps de travail, les conquêtes au niveau des conditions de travail sont des "concessions arrachées de haute lutte au capital (...) la loi anglaise sur les dix heures de travail par jour, est en fait le résultat d'une guerre civile longue et opiniâtre entre la classe capitaliste et la classe ouvrière." (Marx, Le Capital). En décadence, les concessions faites par la bourgeoisie à la classe ouvrière, suite aux mouvements sociaux révolutionnaires des années 1917-23, sont, pour la première fois, des mesures prises pour calmer (journée des huit heures, suffrage universel, assurances sociales, etc.) et encadrer (conventions collectives, droits syndicaux, commissions ouvrières, etc.) un mouvement social qui ne s'assigne plus comme but l'obtention de réformes durables dans le cadre du système mais la conquête du pouvoir. Dernières mesures à être un sous-produit des luttes, elles marquent le fait qu'en décadence c'est l'Etat avec l'aide des syndicats qui organisent, encadrent et planifient les mesures sociales afin de prévenir et contenir le danger prolétarien. Ceci se marque par le gonflement des dépenses étatiques consacrées au domaine social (salaire indirect prélevé sur la masse salariale globale) :
Tableau 2. Dépenses de l'État dans le domaine social
En pourcentage du PNB
|
|
|
All |
Fr |
GB |
US |
|
ASCENDANCE |
1910 |
3.0% |
- |
3.7% |
- |
|
|
1912 |
- |
1.3% |
- |
- |
|
DÉCADENCE |
1920 |
20.4% |
2.2% |
6.3% |
- |
|
|
1922 |
- |
- |
- |
3.1% |
|
|
1950 |
27.4% |
8.3% |
16.0% |
7.4% |
|
|
1970 |
- |
- |
- |
13.7% |
|
|
1978 |
32.0% |
- |
26.5% |
- |
|
|
1980 |
- |
10.3% |
- |
- |
Sources : Ch. André & R. Delorme, op. cit. dans la Revue internationale n° 54.
En France, en plein calme social, l'Etat prend une série de mesures sociales : 1928-30 assurance maladie, 1930 enseignement gratuit, 1932 allocations familiales ; en Allemagne, assurance sociale élargie aux employés et ouvriers agricoles, aide aux chômeurs (1927). C'est au cours de la seconde guerre mondiale, c'est à dire au sommet de la défaite de la classe ouvrière qu'est conçu, discuté et planifié au sein des pays développés la mise en place du système actuel de sécurité sociale ([7] [1509]), en France en 1946, en Allemagne en 1954-57 (loi sur la cogestion en 1951), etc.
Le but premier de toutes ces mesures vise à un meilleur contrôle social et politique de la classe ouvrière, à accroître sa dépendance vis-à-vis de l'Etat et des syndicats (salaire indirect). Mais la conséquence secondaire de ces mesures sur le plan économique est l'atténuation des fluctuations de la demande dans le secteur II de la production (biens de consommations), là où apparaît en premier la surproduction.
L'instauration de revenus de remplacement, de programmation des hausses salariales ([8] [1510]) et le développement du crédit à la consommation participent du même mécanisme.
Armements, guerres, reconstruction
En période de décadence du capitalisme, les guerres et la production militaire n'ont plus aucune fonction de développement global du capital. Ils ne constituent ni des champs d'accumulation du capital ni des moments de centralisation politique de la bourgeoisie - cf. guerre Franco-Prussienne de 1871 pour l'Allemagne (voir Revue Internationale n° 51, 52, 53).
Les guerres sont la plus haute expression de la crise et de la décadence du capitalisme. "A Contre-courant" (ACC) se refuse à un tel constat. Pour ce "groupe" les guerres ont une fonctionnalité économique au travers du processus de dévalorisation du capital suite aux destructions, de même, elles accompagnent un capitalisme en développement toujours croissant dont elles expriment le degré grandissant des crises. Ainsi les guerres ne recèlent aucune différence qualitative entre l'ascendance et la décadence du capitalisme : "A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...). Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...). Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux déeadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (n° 1). ACC mobilise deux exemples à l'appui de sa thèse, la période des guerres Napoléoniennes (1795-1815) et le caractère encore local (sic!) de la première guerre MONDIALE par rapport à la seconde. Ces exemples sont totalement inopérants. Les guerres Napoléoniennes se situent à la charnière entre deux modes de production, ce sont les dernières guerres d'Ancien Régime (décadence féodale), elles ne peuvent être prises comme caractéristiques des guerres de type capitaliste. Si Napoléon, par ses mesures économiques, va favoriser le développement du capitalisme, il va, sur le plan politique, entamer une campagne guerrière dans le droit fil de la tradition d'Ancien Régime. La bourgeoisie ne s'y trompera d'ailleurs pas, après l'avoir soutenu dans un premier temps, elle le lâchera par la suite, trouvant ses campagnes trop coûteuses et supportant de plus en plus mal un blocus continental qui étouffe son développement. Quant au second exemple il faut un sacré culot ou une bonne dose d'ignorance historique pour le soutenir. La question n'est pas tant de comparer la première à la seconde guerre mondiale mais de les comparer aux guerres du siècle dernier, chose que ACC se garde bien de réaliser. Là, l'évidence ne peut échapper à personne.
Après la démence des guerres d'Ancien Régime, celles-ci se sont adaptées et circonscrites aux nécessités du capital conquérant le monde, telles que nous les avons longuement décrites dans la Revue Internationale n° 54, pour se muer à nouveau dans l'irrationalité la plus complète en décadence du système capitaliste. Avec l'approfondissement des contradictions du capital il est normal que la seconde guerre mondiale soit plus ample et destructrice que la première, mais dans leurs grandes caractéristiques elles sont identiques et s'opposent aux guerres du siècle dernier.
Quant à l'explication de la fonction économique de la guerre par la dévalorisation du capital (hausse du taux de profit - PV/CC+CV - par destruction de capital constant) elle ne tient pas debout. D’une part parce que l'on constate que les travailleurs (CV) sont également fauchés au cours de la guerre et d'autre part parce que la croissance de la composition organique du capital se poursuit pendant la guerre. S'il y a accroissement momentané du taux de profit dans l'immédiat après-guerre, c'est d'une part parce qu'il y a augmentation du taux de plus-value due à 1a défaite et la sur-exploitation de la classe ouvrière et d'autre part, grâce à l'accroissement de la plus-value relative engendrée par le développement de la productivité du travail.
A l'issue de la guerre le capitalisme se trouve toujours face au même problème de la nécessité d'écouler la totalité de sa production. Ce qui a changé c'est d'une part, la diminution momentanée de la masse de la plus-value destinée à être réinvestie qui doit être réalisée (les destructions de la guerre ont fait disparaître la surproduction d'avant guerre) et d'autre part, le désengorgement du marché par l'élimination de concurrents (les USA s'accaparent l'essentiel des marchés coloniaux des anciennes métropoles européennes).
Quant à la production d'armement, sa motivation première est également imprimée par la nécessité de survivre dans un environnement inter-impérialiste quel qu'en soit le coût. Ce n'est que subséquemment qu'elle joue un rôle économique. Bien que constituant une stérilisation de capital et se soldant par un bilan nul, au niveau du capital global, après un cycle de production, elle permet au capital de décaler ses contradictions dans le temps ET dans l'espace. Dans le temps parce que la production d'armements entretient momentanément la fiction de la poursuite de l'accumulation et dans l'espace parce qu'en instiguant en permanence des foyers de guerres localisées et en vendant une grande part de cette production dans le "tiersmonde", le capital opère un transfert de valeur de ces derniers pays vers les plus développés ([9] [1511]).
L'épuisement des palliatifs
Employés partiellement APRES la crise de 1929 sans pouvoir la résoudre (New Deal, Front Populaire, plan De Man, etc.) les moyens mis en oeuvre par le capitalisme pour reporter l'échéance de sa contradiction fondamentale, et décrit ci-dessus, ont déjà été amplement utilisés dès le début et tout au long de la période qui va de la guerre à la fin des années 60. Ils viennent tous aujourd'hui à épuisement. Ce à quoi nous assistons ces vingt dernières années c'est à la fin de l'efficacité de ces palliatifs.
La poursuite de la croissance militaire est une nécessité (car poussée par les besoins impérialistes toujours plus importants), mais elle ne constitue plus un palliatif temporaire. De par leur ampleur les coûts de cette production grèvent directement le capital productif. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à un ralentissement de sa croissance (sauf au USA, 2,3 % de croissance pour 1976-80 et 4,6 % pour 1980-86) et à une diminution de la part du "tiers-monde" dans les achats, encore que de plus en plus de dépenses militaires soient masquées, dans la "recherche" notamment. Quoi qu'il en soit, les dépenses militaires mondiales continuent d'augmenter chaque années (3,2 %, 1980-85) à un rythme supérieur à celui du PNB mondial (2,4 %).
L'emploi massif de crédits est arrivé à un point tel qu'il provoque de graves secousses monétaires (cf. octobre noir de 1987). Le capitalisme n'a plus d'autre choix que de naviguer entre le danger de la reprise de l'hyper-inflation (crédits inconsidérés) et de la récession (taux d'intérêts élevés pour contenir le crédit). Avec la généralisation du mode production capitaliste, la production se détache de plus en plus du marché, la réalisation de la valeur des marchandises et de la plusvalue se complique davantage. Le producteur ignore de plus en plus si ses marchandises trouveront un débouché réel, si elles rencontreront un "dernier consommateur". En permettant une expansion de la production sans rapport avec les capacités d'absorption du marché, le crédit retarde l'échéance des crises mais aggrave le déséquilibre et rend par conséquent la crise plus violente quand elle éclate.
Le capitalisme peut de moins en moins supporter des politiques inflationnistes pour artificiellement soutenir l'activité économique. Une telle politique suppose des taux d'intérêts élevés (car inflation déduite il ne reste plus grand chose de l'intérêt sur les sommes déposées). Mais des taux d'intérêts bancaire élevés impliquent un taux de profit élevé dans l'économie réelle (en règle général le taux d’intérêt doit être inférieur au taux de profit moyen). Or, c'est de moins en moins possible, les méventes, la crise de surproduction font chuter 1a rentabilité du capital investi et ne permettent plus de dégager un taux de profit suffisant pour payer les intérêts bancaires. Ce différentiel en tenaille s'est concrétisé en octobre 1987 par la panique boursière que l'on connaît.
Les marchés extra-capitalistes sont tous sur-exploités, pressurés à fond, et ils sont loin de constituer un exutoire possible.
Aujourd'hui c'est la rationalisation des faux frais qui est de mise, le développement des secteurs improductifs aggrave plus qu'il ne soulage du fait de leur sur-développement.
Ces palliatifs employés abondamment depuis 1948 n'étaient déjà pas fondés sur une base saine mais leur épuisement actuel engendre une impasse économique d'une gravité sans précédent. La seule politique possible aujourd'hui est l'attaque frontale de la classe ouvrière, attaque que tous les gouvernements de droite comme de gauche, à l'Est comme à l'Ouest appliquent avec zèle. Cependant cette austérité qui fait payer cher la crise à la classe ouvrière, au nom de la compétitivité de chaque capital national, ne porte pas en elle même une une "solution" à la crise globale au contraire, elle ne fait que réduire encore plus la demande solvable.
Conclusions
Si nous nous sommes penchés sur les éléments explicatifs de la survie du capitalisme en décadence ce n'est pas par souci académique comme nos censeurs mais dans un but militant. Ce qui nous importe c'est de mieux comprendre les conditions du développement de la lutte de classe en la renlaçant dans le seul cadre valable et cohérent : la décadence, en saisissant toutes les modalités introduites par le capitalisme d'Etat et en comprenant toute l'urgence et l'enjeu de la situation actuelle par la reconnaissance de l'épuisement de tous les palliatifs à la crise catastrophique du capitalisme (cf. Revue Internationale n° 23, 26, 27, 31).
Marx n'a pas attendu d'avoir achevé Le Capital pour s'engager et prendre position dans la lutte de classe. Rosa Luxemburg et Lénine n'ont pas attendu d'accorder leurs violons sur l'analyse économique de l'impérialisme avant de prendre position sur la nécessité de fonder une nouvelle internationale, de lutter contre la guerre par la révolution, etc. D'ailleurs derrière leurs différences (Lénine = baisse tendancielle du taux de profit et monopole, Rosa Luxemburg = la saturation des marchés) il y a un profond accord sur toutes les questions cruciales pour la lutte de classe et notamment la reconnaissance de la faillite historique du mode de production capitaliste qui met à l'ordre du jour la révolution socialiste :
"De tout ce qui a été dit plus haut de l'impérialisme, il ressort qu'on doit le caractériser comme un capitalisme de transition ou, plus exactement, comme un capitalisme AGONISANT. (...) le parasitisme et la putréfaction caractérisent le stade historique suprême du capitalisme c'est-à-dire l'impérialisme. (...) L'impérialisme est le prélude de la révolution sociale du prolétariat. Cela s'est confirmé, depuis 1917, à l'échelle mondiale."( Lénine, L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Oeuvres complètes, Ed.. de Moscou, t. 22). Si ces deux grands marxistes se sont tellement fait attaquer à propos de leur analyse économique c'est moins pour celle-ci que pour leur prise de positions politiques. De même, derrière l'attaque dont le CCI est l'objet sur les questions économiques se cache en réalité un refus de l'engagement militant, une conception conseilliste du rôle des révolutionnaires, une non reconnaissance du cours historique actuel aux affrontements de classes et une non conviction de la faillite historique du mode de production capitaliste.
C.Mcl
- "Les rapports juridiques, pas plus que les formes de l'Etat, ne peuvent s"expliquer ni par eux-même, ni par la prétendue évolution de l'esprit humain ; bien plutôt, ils prennent leurs racines dans les conditions matérielles de la que Hegel, à l'exemple des anglais et des français du XVIIIe siècle, comprend dans leur ensemble sous le nom de "société civile" ; et c'est dans l'économie politique qu'il convient de chercher l'anatomie de la société civile...
- "ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de productions existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de dévekloppement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociales." Marx, Avant-propos à la crtique de l'économie politique.
[1] [1512] C'est pourquoi Marx a toujours été très clair sur le fait que le dépassement du capitalisme et l'avènement du socialisme supposent l'abolition du salariat : "Sur leur bannière, il leur faut effacer cette devise conservatrice : 'Un salaire équitable pour une journée de travail équitable', et inscrire le mot d'ordre révolutionnaire: Abolition du salariat!' (... ) pour l'émancipation finale de la classe ouvrière, c'est-à-dire pour abolir enfin le salariat". (Marx, Salaire, prix et plus-value, Ed.. La Pléiade).
[2] [1513] Nous ne prétendons pas ici avancer une explication détaillée des mécanismes économiques et de l'histoire du capitalisme depuis 1914 mais simplement poser les éléments majeurs qui ont permis sa survie et nous centrer sur les moyens qu'il a déployés pour repousser l'échéance de sa contradiction fondamentale.
[3] [1514] Nous devons signaler ici qu'à part quelques questions "légitimes", bien qu'académiques, cette brochure-critique n'est qu'un ramassis de déformations motivé par la politique de "qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage".
[4] [1515] La loi de la valeur règle l'échange sur la base de l'équivalence des quantités de travail. Mais, compte tenu du cadre national des rapports sociaux capitalistes de production et des différences nationales croissantes des conditions de la production (productivité et intensité du travail, composition organique du capital, salaires, taux de plus-value, etc.) au cours de la décadence, la péréquation du taux de profit parvenant à la formation d'un prix de production opère essentiellement dans le cadre national. II existe donc des prix de production différents d'une même marchandise dans différents pays. Ceci implique qu'au travers du commerce mondial le produit d'une journée de travail d'une nation plus développée sera échangée contre le produit de plus d'une journée de travail d'une nation moins productive ou à salaires nettement inférieurs... Les pays exportateurs de produits finis peuvent vendre leurs marchandises au-dessus de leur prix de production mais tout en restant en dessous du prix de production du pays importateur. Ils réalisent ainsi un sur-profit par transfert de valeurs. Ex. : un quintal de blé US revient en 1974 à 4 h de salaire d'un manceuvre aux Etats-Unis mais à 16 h en France du fait de la plus grande productivité de l'agriculture outre Atlantique. Les entreprises agro-industrielles US peuvent vendre leur blé en France au-dessus de leur prix de production (4 h) tout en restant plus compétitives que le blé français (16 h) - ceci explique le redoutable protectionnisme du marché agricole de la CEE face aux produits US et les incessantes querelles sur cette question.
[5] [1516] Pour la FECCI cela n'est plus vrai. C'est le passage de la domination formelle à la domination réelle qui explique le développement du capitalisme d'Etat. Or, si cela était, nous devrions statistiquement constater une progression continue de la part de l'Etat dans l'économie puisque ce passage de domination se déroule sur toute une période et, de plus, cette progression devrait débuter au cours de la phase ascendante. Manifestement ce n'est pas du tout le cas. Les statistiques que nous avons publiées nous montrent une rupture nette en 1914. En phase ascendante la part de l'Etat dans l'économie est FAIBLE et CONSTANTE (elle oscille autour de 12 %) alors qu'elle croît au cours de la décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50 % du P.N.B. Ceci confirme notre thèse de l'indissoluble lien entre le développement du capitalisme d'Etat et la décadence et infirme catégoriquement celle de la FECCI.
[6] [1517] Au terme de cette suite d'articles, il faut être aveugle comme nos censeurs pour ne pas voir la rupture constituée par la première guerre mondiale dans le mode de vie du capitalisme. Toutes les séries statistiques sur le long terme publiées dans l'article montrent cette rupture : production industrielle mondiale, commerce mondial, prix, intervention de l'Etat, termes de l'échange et armements. Seule l'analyse de la décadence et son explication par la saturation mondiale des marchés permet de comprendre cette rupture.
[7] [1518] A la demande du gouvernement anglais, le député libéral Sir William Beveridge rédige un rapport, publié en 1942, qui servira de base pour édifier le système de sécurité sociale en GB mais inspirera également tous les systèmes de sécurité sociale des pays développés. Le principe est d'assurer à TOUS, en contre partie d'une cotisation prélevée sur le salaire, un revenu de remplacement en cas de "risque social" (maladie, accident, décès, vieillesse, chômage, maternité, etc.).
[8] [1519] C'est également au cours de la seconde guerre mondiale que la bourgeoisie au Pays-Bas planifie avec les syndicats la hausse progressive des salaires selon un coefficient qui est fonction de la hausse de la productivité tout en lui étant inférieur.
[9] [1520] CoC aime quand 2 et 2 font a, dès qu'on leur explique que quatre peut être obtenu en faisant 6 moins 2 c'est, pour eux, contradictoire. C'est pourquoi CoC revient "au CCI et d ses considérations contradictoires sur l'armement. Si d'un côté tes armements fournissent des débouchés d la production au point que par exempte la reprise économique après ta crise de 1929 serait due exclusivement d l'économie d'armement, d'un autre côté nous apprenons que l'armement n'est pas une solution aux crises et donc que tes dépenses d'armements sont pour le capital un gaspillage inouï pour !e développement des forces productives, une production d inscrire au passif du bilan définitif." (n' 22 p. 23)
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Vingt ans depuis 1968 : l'évolution du milieu politique depuis 1968 (3ème partie)
- 2627 reads
LES DEUX PREMIERES PARTIES DE CET ARTICLE SONT PARUES DANS LES NUMEROS 53 ET 54 DE LA REVUE INTERNATIONALE
Le milieu de l’année 1983 est marqué par la reprise de la lutte de classe. Sabotées par les manoeuvres du syndicalisme de base impulsé par la gauche et les gauchistes, déboussolées par le passage de la gauche dans l'opposition, les luttes de 78-80 en occident ont été dévoyées, et leur reflux ponctué par la répression brutale de décembre 1981 en Pologne, préparée par le travail de sape de Solidarnosc. Après trois ans de recul, la combativité retrouvée du prolétariat ne va cesser de s'affirmer sur l'ensemble de la planète : après les grèves massives des ouvriers de Belgique à l'automne 1983, ce sont successivement la Hollande, la R.FA., la Grande-Bretagne, les U.S A., la Suède, la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Corée, la Pologne, et la liste n'est pas exhaustive, qui sont marqués par des luttes significatives de la classe ouvrière.
Comment le milieu politique prolétarien et les organisations qui le constituent, vont-ils réagir ? Comment va être assumée la responsabilité essentielle des révolutionnaires, une nouvelle fois posée avec acuité par la lutte de classe en développement : celle de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires au sein des luttes de leur classe
Quelles vont être les conséquences de l'accélération de l'histoire sur tous les plans : économique, militaire et social, sur la vie du milieu politique prolétarien ? Le redéploiement de la lutte de classe porte en lui le développement potentiel du milieu révolutionnaire. Cette revitalisation de la lutte ouvrière va-t-elle permettre au milieu politique prolétarien de surmonter la crise qu'il a traversée dans la période précédente ? Va-t-elle lui permettre de dépasser les difficultés et les faiblesses qui le marquent depuis la reprise historique de la lutte de classe en 1968 ?
UN MILIEU POLITIQUE AVEUGLE FACE A LA LUTTE DE CLASSE
"Les formidables affrontements de classe qui se préparent seront également une épreuve de vérité pour les groupes communistes : ou bien, ils seront capables de prendre en charge ces responsabilités et ils pourront apporter une contribution réelle au développement des luttes, ou bien ils se maintiendront dans leur isolement actuel et ils seront balayés par le flot de l’histoire sans avoir pu mener à bien la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir. "
Adresse du CCI aux groupes politiques prolétariens (2° trimestre 1983).
Le CCI sera la seule organisation à reconnaître pleinement dans les mouvements de classe de l'année 1983 les signes d'une reprise internationale de la lutte de classe. Pour l'ensemble des autres groupes du milieu prolétarien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour ceux-ci, les luttes ouvrières qui se développent sous leurs yeux, à partir de 1983, n'ont rien de significatif ; elles restent encore sous l'emprise des appareils syndicaux, donc elles ne peuvent être l'expression d'une reprise prolétarienne !
En dehors du CCI., la plupart des organisations du milieu politique prolétarien qui ont survécu à la décantation et à la crise de la fin des années 70 et du début des années 80, théorise, comme un seul homme, que nous sommes toujours en période de contre-révolution. Les plus anciennes organisations du milieu révolutionnaire, chacune à sa manière, affirment donc que depuis la débâcle prolétarienne des années 30, il n'y a pas grand-chose de changé, notamment celles issues du P.C.I. de 1945, c'est-à-dire les différents groupes de la diaspora bordiguiste d'une part (P.C.I.-Programme communiste ou II Partito Comunista par exemple) et Battaglia Comunista (regroupée avec la C.W.O. de G.B. au sein du B.I.P.R.) d'autre part. Quant au F.O.R., lui qui au plus profond de la défaite ouvrière dans les années 30 voit la révolution triomphante en Espagne, aujourd’hui, il ne voit dans les luttes ouvrières que leur faiblesse !
Les micro-sectes parasitaires, incapables d'exprimer une cohérence propre, soit développent un académisme bordiguisant tout à fait stérile comme par exemple Communisme ou Civilisation en France, soit sombrent dans une dérive anarcho-conseilliste; les deux tendances n'étant d'ailleurs absolument pas contradictoires comme le montre un groupe tel que le G.C.I. Mais le point commun reste toujours une négation bornée de la réalité de la lutte de classe présente. Même les vestiges du milieu "moderniste" issues de 1968, participent à leur manière à cette négation généralisée de la combativité en développement du prolétariat dans les années 80. Ainsi on a pu voir surgir de manière éphémère mais significative en France une revue au titre évocateur : La Banquise.
La vision, généralisée en dehors du CCI., selon laquelle le cours historique est toujours à la contre-révolution, traduit à l'évidence une sous-estimation dramatique de la lutte de classe depuis 1968 et ne peut donc que se manifester négativement sur le plan essentiel pour les révolutionnaires qu'est celui de leur intervention au sein des luttes. Cette situation déjà évidente à la fin des années 60, lorsque les organisations alors constituées, telles le P.CI.(Programme communiste) et le P.CI.(Battaglia comunista) sont étrangement absentes, car elles ne voient pas la lutte de classe qui se déroule sous leurs yeux et nient l'importance significative des luttes ouvrières de mai 68 en France - grève la plus massive que le prolétariat ait jamais menée en France pourtant-, se confirme à la fin des années 70. L'intervention du CCI dans la vague de lutte qui se redéploie, va être la cible des critiques de l'ensemble du milieu prolétarien. Cette vision du cours historique prend un tour encore plus aigu avec la reprise des luttes depuis 1983.
LA QUESTION DE L'INTERVENTION AU COEUR DES DEBATS
Depuis le début du renouveau de la lutte de classe qui marque les années 80, l'intervention des organisations politiques révolutionnaires dans les luttes ouvrières, en dehors de, celle du CCI., va être quasiment inexistante. Les groupes politiquement les plus faibles vont aussi être, bien sûr, les plus absents de l'intervention directe dans les luttes. Après un activisme tous azimuts au début des années 80, le G.C.I., alors que la lutte de classe se développe, va s'enfoncer dans un académisme douillet, tandis que le F.O.R., pour justifier son inexistence sur le terrain de la lutte de classe, va se réfugier derrière la théorisation de son manque de moyens matériels ([1] [1521]) ! Tout à fait significatif est le fait que, malgré leurs rodomontades, ces groupes n'ont, durant cette période qui s'est ouverte depuis 1983, pas dû faire plus de tracts qu'une seule main ne compte de doigts, sans parler même de leur contenu.
Le B.I.P.R. quant à lui, exprime certainement une autre solidité politique que celle des groupes que nous venons de citer; pourtant, son intervention au sein des luttes n'est guère plus reluisante. Cela est d'autant plus grave que cette organisation constitue en dehors du CCI. le principal pôle de regroupement au sein du milieu politique prolétarien international. La volonté effective d'intervention de ce groupe lors de la longue grève des mineurs en Grande-Bretagne en 1984 ne va malheureusement pas se répéter dans les luttes qui vont suivre. Malgré une présence effective de membres du B.I.P.R. en France, celui-ci ne développera aucune intervention lors de la grève des cheminots en 1986 et, si Battaglia Comunista intervient dans la lutte des travailleurs de l'école en 1987 en Italie, ce sera avec de longues semaines de retard sous la sollicitation insistante de la section du CCI dans ce pays.
Cette faiblesse de l'intervention du B.I.P.R. trouve son origine dans ses conceptions politiques erronées qui ont déjà été au coeur des débats des conférences internationales des groupes de la Gauche communiste qui se sont déroulées en 1977, 1978 et 1980. Cela s'exprime essentiellement sur deux plans :
- une incompréhension de la période historique présente qui entraîne l'incompréhension des caractéristiques de la lutte de classe dans cette période et se traduit par une sous-estimation profonde de celle-ci. Ainsi, la C.W.O. peut écrire au groupe Alptraum du Mexique à propos des luttes en Europe : "Nous ne pensons pas que la fréquence et l'extension de ces formes de luttes indiquent -tout au moins jusqu'à aujourd’hui- une tendance vers leur développement progressif Par exemple, après les luttes des mineurs britanniques, des cheminots en France, nous avons l'étrange situation dans laquelle les couches agitées sont celles de la petite-bourgeoisie /", et de citer ensuite, entre autres, comme exemple de la petite-bourgeoisie, les enseignants !
- de graves confusions sur la question du parti qui se traduisent par une incompréhension du rôle des révolutionnaires. Toujours à Alptraum qui a publié cette lettre dans Comunismo n° 4, le B.I.P.R. peut ainsi écrire : "Il n'existe pas un développement significatif des luttes parce qu'il n'existe pas le parti; et le parti ne pourra exister sans que la classe ne se trouve dans un processus de développement des luttes". Comprenne qui pourra dans cette étrange dialectique, mais dans ces conditions, c'est toute la question du rôle décisif de l'intervention des révolutionnaires qui est escamotée en attendant le surgissement du 'deus ex-machina', du parti avec un grand P.
Durant toute cette période, le CCI. qui ne se proclame pas Parti comme le P.C.I.(Battaglia comunista), a, quant à lui, essayé de développer son intervention dans la mesure de ses forces, essayant de s'élever à la hauteur des responsabilités historiques qui sont celles des révolutionnaires vis-à-vis de leur classe. Pas une lutte significative, là où existent des sections du CCI. , dans laquelle les positions révolutionnaires n'aient été défendues, et où l'intervention du CCI n'ait tenté de pousser la dynamique ouvrière, de briser l'étau syndical, d'impulser l'extension, que ce soit par tracts, par des prises de paroles dans les assemblées ouvrières, par la diffusion de notre presse, etc. Il ne s'agit pas ici de tirer gloriole de ce fait ni de s'étaler démesurément, mais de poser simplement ce que doit être l'intervention des révolutionnaires lorsque le prolétariat développe ses luttes et que l'impact de leurs idées s'en trouve donc facilité.
Dans ces conditions, il n'est par conséquent pas surprenant que les débats et polémiques entre les différents groupes communistes sur la question de l'intervention proprement dite soient finalement restés plutôt maigres. Face à la vacuité de l'intervention des autres groupes, il n'a pu y avoir de réels débats sur le contenu d'une intervention qui n'existait pas. Il a fallu revenir aux principes de base sur le rôle des révolutionnaires que le CCI. a défendus avec vigueur. Quant à la critique des autres groupes vis-à-vis du CCI., elle s'est en général bornée à dire que le CCI surestimait la lutte de classe et sombrait dans l'activisme !
De fait, les questions de la reconnaissance du développement réel de la lutte de classe et du rôle des révolutionnaires dans la question de l'intervention vont constituer la ligne de démarcation au sein du milieu communiste qui polarisera, durant les années 80, tous les débats en son sein.
LES DEBATS AU SEIN DU CCI ET LA FORMATION DE LA F.E.CCI.
Les tendances délétères de la propagande bourgeoise qui a durant ces années imposé un black-out sur la réalité des grèves pour mieux en nier l'existence, n'ont pas seulement poussé l'ensemble des autres organisations prolétariennes à rester aveugles face aux luttes ouvrières, à les sous-estimer profondément, mais ont aussi pesé sur le CCI. De la lutte au sein du CCI contre ces tendances à la sous-estimation de la lutte de classe va naître un débat qui a pour fondement les questions de la conscience de classe et du rôle des révolutionnaires. Ce débat va ensuite se développer pour poser :
- la question du danger que constitue dans la période actuelle le conseillisme qui cristallise une tendance à nier la nécessité de l'organisation politique et donc à nier la nécessité d'une intervention organisée au sein de la classe;
- la question de l'opportunisme comme expression de l'infiltration de l'idéologie dominante au sein des organisations du prolétariat.
Ces débats vont être la source d'un renforcement politique et de clarifications essentielles au sein du CCI. Ils vont permettre un renforcement de la capacité d'intervention au sein des luttes par une meilleure compréhension du rôle actif des révolutionnaires dans le processus de développement de la conscience dans la classe, et une meilleure réappropriation de l'héritage des fractions révolutionnaires du passé qui va s'exprimer dans une vision plus adéquate du processus de dégénérescence et de trahison des organisations de la classe au début du siècle et dans les années 30.
Se trouvant réduits à une petite poignée, plus dilettante que militante, des camarades en désaccord vont saisir le premier prétexte venu pour se retirer, dès le début de ses travaux, du 6e Congrès du CCI., fin 1985, contents de se "libérer" du "carcan" de l'organisation, et vont se constituer en "Fraction Externe" du CCI., prétendant être les défenseurs "orthodoxes" de la plate-forme du CCI. Cette scission irresponsable traduit une incompréhension profonde de la question de l'organisation et donc une sous-estimation grave de sa nécessité. Plus que toutes les arguties théoriques et le tombereau de calomnies que la F.E.CCI a pu déverser sur le CCI pour justifier son existence de secte, ce qui détermine son surgissement, c'est une sous-estimation de la lutte de classe et du rôle essentiel des révolutionnaires dans leur intervention au sein de celle-ci. La F.E.CCI., si parfois elle reconnaît formellement la reprise des luttes prolétariennes depuis 1983, s'est engagée ainsi dans les mêmes ornières de passivité académique où patauge malheureusement déjà la majorité des organisations plus anciennes du milieu prolétarien, comme nous venons de le voir. Elle qui se proclame le défenseur orthodoxe de la plate-forme du CCI., va peu à peu, depuis 1985, se trouver une multitude de nouvelles divergences qui constituent autant d'abandons de la cohérence dont elle entendait pourtant se faire le "dernier" défenseur ! La F.E.CCI a ouvert la boîte de Pandore, et comme l'ont fait avant elle d'autres scissions du CCI. tels le P.I.C et le G.C.I., c'est à d'autres abandons bien plus graves, mettant en cause la plate-forme dont elle se réclame, qu'elle se prépare dans la dynamique où elle se trouve entraînée pour valider son existence séparée.
LE POIDS DE LA DECOMPOSITION SOCIALE ET LA DECANTATION AU SEIN DU MILIEU REVOLUTIONNAIRE
Cette nouvelle scission est-elle le signe d'une crise du CCI., l'indice d'un affaiblissement politique et organisationnel de l'organisation qui constitue aujourd’hui le principal pôle de regroupement et de clarté au sein du milieu prolétarien? Bien au contraire, ce que la F.E.CCI. exprime, c'est la résistance à la mise en adéquation des activités des révolutionnaires aux besoins de la lutte de classe à un moment où le prolétariat reprend de manière déterminée la voie de la lutte et où se pose de façon aiguë la nécessité de l'intervention, c'est-à-dire de ne pas rester au balcon à regarder la lutte ouvrière qui passe de manière "critique", mais d'être partie prenante de ces luttes, de défendre en leur sein les positions révolutionnaires à un moment où il peut se développer un réel écho à celles-ci. C'est parce que le CCI a su poursuivre la clarification théorique et politique, et le renforcement organisationnel indispensable pour jouer son rôle d'organisation de combat de la classe que les éléments les moins convaincus qui préfèrent les discussions académiques au feu de la lutte de classe l'ont quitté. Paradoxalement, même si tout départ de militants ne peut en aucun cas être quelque chose de souhaitable et si on ne peut que regretter la scission irresponsable qui a donné lieu à la formation de la F.E.CCI et n'a fait qu'apporter un peu plus de confusion dans le milieu qui n'en a nullement besoin, c'est à un renforcement politique et organisationnel du CCI qu'on assiste durant cette période et qui va se concrétiser par sa plus grande capacité à assurer une présence des idées révolutionnaires au sein de la lutte de classe en plein développement.
Cependant, si le surgissement de la F.E.CCI ne traduit pas une crise du CCI qui signifierait, dans la mesure où c'est la principale organisation du milieu, une crise de l'ensemble du milieu prolétarien, elle n'en traduit pas moins les difficultés qui pèsent de manière persistante sur les groupes révolutionnaires depuis le ressurgissement du prolétariat sur la scène de l'histoire en 1968.
Ces difficultés trouvent leur origine, comme nous l'avons vu, dans l'inadéquation théorique et politique fondamentale de la majorité des groupes qui ne voient pas la lutte de classe qui se déroule sous leurs yeux et sont par conséquent bien incapables de se revitaliser à son contact. Mais là n'est pas la seule explication. L'immaturité organisationnelle, produit de décennies de rupture organique d'avec les fractions révolutionnaires issues de l'Internationale communiste, qui marque le milieu prolétarien ressurgi au lendemain de 1968, se concrétise dans un sectarisme pesant, entrave le nécessaire processus de clarification et de regroupement au sein du milieu communiste, va être le biais par lequel s'infiltre l'idéologie dominante dans son aspect le plus pernicieux, celui de la décomposition.
Une des caractéristiques spécifiques de la période historique présente est que, alors que la fuite en avant de la bourgeoisie dans la guerre est freinée par la combativité prolétarienne et que par conséquent la voie à une nouvelle guerre impérialiste généralisée, n'est pas ouverte, le développement lent de la crise et de la lutte de classe n'a pas permis que surgisse encore clairement au sein de la société la perspective prolétarienne de la révolution communiste. Cette difficulté est inhérente au fait que c'est justement face à la crise que la classe ouvrière doit développer ses luttes et sa prise de conscience révolutionnaire. Cette situation de "blocage" se traduit dans le pourrissement sur pied, la décomposition générale de l'ensemble de la vie sociale et de l'idéologie dominante. Avec l'accélération de la crise au dé but des années 80, cette décomposition n'a cessé de s'accentuer. Elle touche particulièrement les couches petites-bourgeoises qui n'ont aucun avenir historique, mais elle tend aussi malheureusement à manifester ses effets pervers sur la vie du milieu prolétarien. C'est la forme que tend à prendre le processus de sélection de l'histoire, de décantation politique au sein du milieu dans la période présente.
Le poids de la décomposition environnante tend à se traduire de différentes manières au sein du milieu prolétarien, on peut notamment citer :
- La multiplication des micro-sectes. Le milieu communiste a connu ces dernières années de multiples petites scissions qui toutes traduisent la même faiblesse, aucune d'elles n'a représenté un quelconque apport à la dynamique de regroupement en se situant clairement par rapport aux pôles de débat déjà existants, mais au contraire, elles se sont enfermées dans leur spécificité pour constituer de nouveaux aspects de confusion dans un milieu prolétarien déjà trop dispersé et émietté. On peut ainsi citer, en dehors de la F.E.CC. dont nous avons déjà trop parlé, A Contre Courant qui quitte le CCI en 1988. S'il exprime une réaction positive face à la dégénérescence du G.C.I., il n' est pas pour autant dans sa critique capable d'aller au-delà d'un retour aux sources de ce groupe, origines qui portent déjà les germes de tous les déboires qu'il a connus ultérieurement. Il en est ainsi aussi de la scission récente du F.O.R. qui s'est réfugié derrière de fausses arguties organisationnelles sans être capable de publier une quelconque argumentation politique. De plus, on a vu ressurgir ou naître, en France par exemple, une multitude de petites sectes parasitaires comme Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., qui représentent quasiment autant de points de vue que les quelques individus qui les composent et qui, de flirts en divorces, n'en finissent pas d'alimenter la confusion au sein du milieu politique et face à la classe en fournissant de lamentables caricatures d'organisations prolétariennes. Tous ces groupuscules irresponsables constituent autant de repoussoirs pour des éléments sérieux qui tentent de se rapprocher d'une cohérence révolutionnaire.
- Une perte du cadre normal de débat au sein du milieu révolutionnaire. Ces dernières années ont été marquées par de graves dérapages polémiques au sein du milieu prolétarien dont le CCI. a été la cible essentielle. Que le CCI. soit au centre des débats cela est parfaitement normal dans la mesure où il constitue le principal pôle au sein du milieu révolutionnaire actuel, cependant, cela ne peut en aucun cas justifier les imbécillités dangereuses qui ont pu être écrites sur son compte. Ainsi la mauvaise foi et le dénigrement systématique de la F.E.CCI. qui trouve sa cohésion dans "l’anti-CCI", le F.O.R. qui traite le CCI. de "capitaliste" parce que celui-ci serait riche, et pire encore, le G.C.I. qui édite un article intitulé "Une fois de plus le CCI. du côté des flics contre les révolutionnaires" ! Ces dérapages, plus que l'imbécillité de ceux qui en sont les auteurs traduisent une grave perte de vue de ce qui constitue l'unité du milieu politique prolétarien face à toutes les forces de la contre-révolution et les principes qui doivent présider aux rapports existants en son sein afin de le protéger.
- L'érosion des forces militantes, face au poids dominant de l'idéologie capitaliste, notamment dans ses variantes petites-bourgeoises, la perte de vue de ce qu'est le militantisme révolutionnaire, la perte de conviction et le repli dans le confort "familial" sont un phénomène qui, de tout temps, a pesé sur les organisations révolutionnaires. Cependant dans la période actuelle, cette usure de la conviction militante par l'idéologie dominante s'en trouve accentuée de par la décomposition environnante. De plus, la confrontation aux difficultés de l'intervention dans la lutte de classe est un puissant facteur d'hésitation pour les convictions les moins ancrées, et souvent, tout autant que le retrait pur et simple du militantisme sans divergences réelles, la fuite en avant dans l'académisme stérile, loin du combat que mène la classe est l'expression d'une même peur des implications pratiques du combat révolutionnaire : confrontation avec les forces de la bourgeoisie, répression, etc.
Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'usure de l'idéologie dominante dans sa forme décomposée affecte en priorité les organisations politiquement et organisationnellement les plus faibles. Ces dernières années, leur dégénérescence s'est accélérée. L'exemple le plus clair en est le G.C.I. Sa fascination morbide pour la violence l'a mené dans une dérive de plus en plus forte vers le gauchisme et l'anarchisme qui s'est traduite par exemple dans un soutien aux actions du Sentier Lumineux du Pérou, organisation maoïste s'il en est ou encore, récemment, dans le soutien totalement irresponsable aux luttes en Birmanie embrigadées derrière la bannière démocratique et où les ouvriers sont allés au casse-pipe face à l'armée ! Le F.O.R. qui aujourd'hui encore, nie de manière psychotique la crise, s'enfonce dans les marécages modernistes et son outrance verbale cache de plus en plus mal sa vacuité théorique et pratique. Quant à la F.E.CCI., sa critique-critique systématique de la cohérence du CCI la pousse dans une incohérence toujours plus grande et dans sa presse semble s'exprimer autant de points de vue qu'il y a de militants !
De son côté, la diaspora bordiguiste ne s'est pas remise de l'effondrement du P.C.I. (Programme communiste) ([2] [1522]) et végète tristement en fournissant son obole au syndicalisme de base. Tous ces groupes, incapables de se situer dans la lutte de classe aujourd'hui parce que fondamentalement ils la nient ou la sous-estiment trop profondément, sont donc incapables de se régénérer à son contact et leur avenir risque d'avoir rapidement l'odeur nauséabonde des poubelles de l'histoire.
Les organisations qui sont l'expression de réels courants historiques au sein du milieu communiste parce qu'elles expriment une plus grande cohérence théorique et une plus grande expérience organisationnelle, sont mieux à même de résister au poids délétère de l'idéologie dominante. Ce n'est certainement pas par hasard si aujourdhui le CCI. et le B.I.P.R. sont les principaux pôles de regroupement au sein du milieu prolétarien. Cependant, cela n'est certainement pas une garantie d'immunisation contre les virus de l'idéologie dominante. Même les organisations les plus solides n'ont pas échappé aux effets pernicieux de la décomposition environnante. L'exemple du P.C.I. bordiguiste qui, à la fin des années 70, était la principale (au moins au niveau numérique) organisation du milieu et qui s'est définitivement effondré (2) au début des années 80, en est le plus parfait exemple. Ces dernières années, le départ du CCI. des éléments qui allaient former la F.E.CCI., ou plus récemment, le départ acerbe des éléments du Noyau nord d'Accion Proletaria, la section en Espagne du CCI., tout comme la participation d'un élément du B.I.P.R. en France à une pseudo-conférence réunissant à Paris la F.E.CCI., Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons et des individus isolés, validant ainsi ce bluff pour ensuite quitter le B.I.P.R. devant le désaveu rencontré, sont autant d'éléments qui montre que la vigilance et le combat contre les effets de la décomposition de l'idéologie sont une priorité.
Le CCI., pour sa part a su prendre clairement position sur ces questions : en diagnostiquant la crise du milieu prolétarien en 1982, en soulignant en 1984 le danger de l'infiltration de l'idéologie dominante qui trouve son expression politique au niveau historique dans l'opportunisme et le centrisme, en posant aujourd'hui dans l'analyse des spécificités de la période actuelle, notamment le poids de la décomposition de l'idéologie capitaliste environnante. Ce faisant, il s'est armé politiquement et renforcé organisa-tionnellement. Le B.I.P.R. quant à lui, préfère faire la politique de l'autruche, la crise du milieu au début des années 80, il l'a splendidement niée, déclarant péremptoirement que ce n'était que la crise des autres groupes. Il est vrai que Battaglia comunista et par la suite le B.I.P.R. n'ont pas connu de scission, mais cela en soi est-il significatif de la vitalité d'une organisation ? Durant les longues années qui ont précédé l'éclatement final du P.CI. (Programme communiste) en 1983, il n'avait pas connu de scissions significatives.... Le manque de débats internes, la sclérose politique ne se traduisent pas le plus souvent par des scissions politiques, mais par un déboussolement politique croissant qui se traduit par une hémorragie militante dans le désenchantement sans qu'il y ait clarification, ni pour ceux qui partent, ni pour ceux qui restent.
Pour le B.I.P.R., son repli de l'intervention dans la lutte de classe, sa théorisation de la contre-révolution persistante sont autant de facteurs inquiétants pour son avenir.
Devant ce bilan des difficultés que traverse le milieu politique, doit-on tirer la conclusion que le milieu communiste n'est pas sorti de sa crise du début de la décennie qui s'était pleinement exprimée dans la disparition du bordiguisme comme principal pôle de référence au sein du milieu prolétarien?
Avec la reprise de la lutte de classe, le développement du milieu prolétarien
La situation du milieu prolétarien est aujourd’hui bien différente de celle qui détermine la crise de 1982-83 ([3] [1523]) :
- L’échec des Conférences des groupes de la Gauche communiste, sept ans plus tard, même s'il pèse encore, est digéré;
- nous ne sommes plus dans une période de recul de la lutte de classe, au contraire, celle-ci a repris depuis cinq ans maintenant ;
- l'organisation la plus importante du milieu prolétarien n'est plus une organisation sclérosée et dégénérée comme l'était le P.C.I. bordiguiste.
En ce sens, le milieu politique n'est pas, malgré les faiblesses très graves qui continuent de le marquer et dont nous venons de tracer un rapide bilan, dans la même situation de crise que celle qui l'a marqué au début de la décennie. Au contraire, depuis 1983, le développement de la lutte de classe en même temps qu'il crée le terrain pour un écho renforcé des positions révolutionnaires tend à faire surgir de nouveaux éléments au sein du milieu prolétarien. Même si, à l'image de la lutte de classe dont il est le produit, ce surgissement d'un nouveau milieu révolutionnaire est un processus lent, il n'en est pas moins significatif de la période présente.
L'apparition d'un milieu politique prolétarien à la périphérie des principaux centres du capitalisme mondial comme au Mexique avec Alptraum qui publie Comunismo et le Grupo Proletario Internacionalista qui publie Revolucion Mundial, en Inde avec les groupes Communist Internationalist et Lai Pataka et le cercle Kamunist Kranti, en Argentine avec le groupe Emancipacion Obrera, est extrêmement important pour l'ensemble du milieu prolétarien, alors que durant des années, nul écho des positions révolutionnaires ne semblait surgir de ces pays marqués par le sous-développement capitaliste. Bien sûr, tous ces groupes n'expriment pas le même degré de clarté, et leur survie reste fragile étant donnés leur manque d'expérience politique, leur éloignement du centre politique du prolétariat que constitue l'Europe, les conditions matérielles extrêmement précaires dans lesquelles ils doivent se développer. Cependant, le simple constat de leur existence est la preuve de la maturation générale de la conscience de classe qui est en train de se développer au sein du prolétariat mondial.
Le surgissement de ces groupes révolutionnaires à la périphérie du capitalisme pose de manière cruciale la responsabilité des organisations révolutionnaires déjà existantes qui ont tenté de se réapproprrier l'expérience historique du prolétariat qui fait cruellement défaut aux nouveaux groupes surgissant sans connaissance réelle des fractions révolutionnaires du passé, sans même une connaissance des débats qui ont animé le milieu communiste depuis deux décennies, sans expérience organisationnelle. La situation de dispersion du milieu politique ancien marqué par le sectarisme est une entrave dramatique au nécessaire processus de clarification dans lequel ces nouveaux éléments qui surgissent au sein du milieu révolutionnaire doivent s'engager. Vu de loin, il est extrêmement difficile de s'y retrouver dans le dédale des multiples groupes existant en Europe et d'apprécier à leur juste mesure l'importance politique des différents groupes et des débats existants.
Les mêmes difficultés qui affectent le milieu politique ancien centré sur l'Europe pèsent d'un poids encore plus fort sur les nouveaux groupes qui surgissent à la périphérie, par exemple le sectarisme d'un groupe comme Alptraum au Mexique ou du cercle Kamunist Kranti en Inde sont malheureusement à signaler, mais il est extrêmement important de comprendre que la confusion politique que ces groupes et éléments peuvent manifester, est d'une nature différente de celle des groupes existants en Europe : si dans le premier cas elle exprime une immaturité de jeunesse renforcée par le poids de l'isolement, dans le second elle est l'expression d'une sclérose précoce ou d'une dégénérescence sénile.
L'influence des groupes anciens va être déterminante pour l'évolution des nouveaux groupes qui surgissent. Ceux-ci ne peuvent développer leur cohérence, se renforcer politiquement, survivre comme expression révolutionnaire qu'en brisant leur isolement, en s'intégrant aux débats existants au sein du milieu politique international, en se rattachant aux pôles historiques déjà existants. Les influences négatives d'un groupe tel que le G.C.I. qui nie l'existence d'un milieu politique prolétarien et véhicule des confusions extrêmement graves vont peser de tout leur poids sur l'évolution d'un groupe tel que Emancipacion Obrera en Argentine, renforçant de plus ses faiblesses intrinsèques. De même, l'académisme de petite secte de Communisme ou Civilisation avec qui Alptraum développe son activité, ne peut mener ce dernier qu'à la stérilité. Le B.I.P.R., dans l'ensemble, a développé une attitude plus correcte vis-à-vis des nouveaux groupes qui surgissaient ; cependant, celle-ci reste entachée par l'opportunisme des conceptions organisa-tionnlles qui ont présidé à la naissance du B.I.P.R. ([4] [1524]) : par exemple, l'intégration hâtive de Lai Pataka comme expression du B.I.P.R. en Inde. De plus, la sous-estimation grave de la lutte de classe que tous ces groupes anciens expriment, tend à entraver fortement l'évolution des nouveaux groupes qui surgissent, en les privant de la compréhension fondamentale de ce qui a déterminé leur naissance : le développement international actuel de la lutte ouvrière.
Le CCI. quant à lui, parce qu'il a fait dès son origine, au lendemain de 1968, le constat de la passivité et de la confusion politique des organisations qui existaient alors, notamment chez le P.CI.(Programme communiste) et le P.CI.(Battaglia comunista), prend particulièrement à coeur ses responsabilités vis-à-vis des nouveaux groupes qui surgissent au sein du milieu prolétarien De la même manière que l'intervention au sein de la lutte de classe, l'intervention vis-à-vis des groupes que la lutte de classe fait naître pour notre organisation est une priorité.
Dans la presse du CCI. ont été publiés, loin de tout esprit sectaire, des textes de Emancipacion Obrera, Alptraum, du G.P.I., de Communist Internationalist, et de tous les groupes dont il a été fait mention dans notre presse, les faisant souvent ainsi connaître à l'ensemble du milieu révolutionnaire, contribuant ainsi grandement à briser leur isolement. Pas un de ces groupes avec lequel une importante correspondance n'ait été échangée, pas un qui n'ait reçu notre visite, afin de permettre des discussions approfondies et contribuer ainsi à une meilleure connaissance réciproque et à la clarification nécessaire, non pas pour faire du recrutement et pousser à une intégration prématurée au sein du CCI., mais pour permettre leur réelle solidification politique, leur survie, étape indispensable pour qu'un regroupement que nous estimons toujours nécessaire puisse se faire dans la plus grande clarté.
Si l'apparition de nouveaux groupes dans des pays éloignés des centres traditionnels du prolétariat est un phénomène particulièrement important, tout à fait significatif du développement actuel de la lutte de classe et de ses effets sur la vie du milieu politique, notre insistance ne signifie en aucun cas qu'il n'y a point un développement corollaire là où le milieu politique est déjà présent, bien au contraire. Mais ce développement ne prend pas la même forme, parce que le milieu politique est déjà présent avec ses organisations. Le surgissement de nouveaux éléments tend à se traduire non pas par l'apparition de nouveaux groupes mais par l'apparition d'éléments qui se rapprochent des groupes déjà existants. Les nouveaux éléments qui surgissent, contrairement à la situation de 1968 et de ses lendemains, marquée par le poids du milieu étudiant qui déterminait des préoccupations théoriques générales, le font au contact direct de la lutte ouvrière, produits en son sein. De nouveau, sur ce plan, la question de l'intervention apparaît comme cruciale pour permettre à ces éléments de rejoindre le milieu prolétarien, d'en renforcer les capacités militantes. Le développement actuel des comités de lutte et des cercles de discussion est l'expression du développement de la conscience qui est en train de s'opérer dans la classe. Pour les groupes prolétariens aujourd'hui, sous-estimer la question de l'intervention revient à se couper de ce qui détermine leur vie, cela est particulièrement évident en ce qui concerne le développement des ressources militantes, l'arrivée d'un sang neuf. Les organisations qui ne voient pas cela aujourd'hui, se condamnent à la stagnation d'abord, à la sclérose et à la régression ensuite, à la démoralisation et à la crise plus tard.
Avec le renouveau de la lutte de classe, une nouvelle génération de révolutionnaires est en train de naître. Non seulement l'avenir, mais déjà le présent sont porteurs d'une nouvelle dynamique de développement du milieu prolétarien. Mais cette dynamique ne signifie pas simplement que le relatif isolement des révolutionnaires de leur classe est en train de se briser de façon immédiate, ni que tout va s'en trouver facilité, elle signifie d'abord une décantation accélérée au sein du milieu prolétarien. Rien n'est gagné d'avance, l'avenir des organisations prolétariennes, leur capacité à forger demain le parti communiste mondial indispensable à la révolution communiste dépend de leur capacité présente à assumer les responsabilités pour lesquelles la classe les a produites. Tels sont les enjeux des débats et de l'activité présents du milieu communiste. Les organisations incapables d'assumer dès aujourd'hui leurs responsabilités, d'être partie prenante du combat de classe, ne sont d'aucune utilité pour le prolétariat et pour cette raison, le processus historique apportera sa sanction.
J.J.
[1] [1525] Voir l'édifiant article intitulé "Hé ! Ceux du CCI." dans Alarme n° 37-38.
[2] [1526] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
[3] [1527] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
[4] [1528] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [1334]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
1918 - 1919: il y a 70 ans ; a propos de la révolution allemande, II
- 3236 reads
Dans le n° 55 de la Revue Internationale, nous avons abordé quelques-uns des traits généraux les plus marquants de l’échec du mouvement révolutionnaire en Allemagne de novembre 1918 à janvier 1919, et les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce mouvement. Nous revenons dans cet article sur la politique contre-révolutionnaire systématique que mena dans cette période le SPD passé dans le camp de la bourgeoisie.
Au début de novembre 1918, la classe ouvrière en Allemagne avait été capable de mettre fin à la première guerre mondiale par sa lutte de masse, par le soulèvement des soldats. Pour couper l'herbe sous les pieds du mouvement, pour éviter un aiguisement plus fort des contradictions de classe, la classe dominante avait été obligée de mettre fin à la guerre sous la pression de la classe ouvrière, et de faire abdiquer le Kaiser ; il lui fallait ensuite éviter que la flamme de la révolution prolétarienne, qui s'était allumée un an plus tôt par la révolution d'octobre 1917 en Russie, n'embrasât aussi l'Allemagne. Tous les révolutionnaires étaient conscients que la classe ouvrière en Allemagne était au centre de l'extension internationale des luttes révolutionnaires : "Pour la classe ouvrière allemande nous sommes en train de préparer... une alliance fraternelle, du pain et une aide militaire. Nous allons tous exposer nos vies, pour aider les ouvriers allemands à pousser en avant la révolution qui a commencé en Allemagne." (Lénine, 1er octobre 1918, "Lettre à Sverdlov").
Tous les révolutionnaires étaient d'accord sur le fait que la révolution devait aller plus loin : "La révolution a commencé. Nous ne nous devons pas nous réjouir de ce qui a été réalisé, nous ne devons pas avoir le sentiment d'un triomphe sur l’ennemi écrasé, mais nous devrions faire la plus forte autocritique, pousser courageusement notre énergie ensemble, pour continuer ce que nous avons commencé. Parce que ce que nous avons réalisé est peu, et l’ennemi n’a pas été défait. " (Rosa Luxemburg, "Le début", 18 novembre 1918).
S'il avait été plus facile pour la classe ouvrière en Russie de renverser la bourgeoisie, la classe ouvrière en Allemagne avait affaire à une classe dominante autrement plus forte et plus intelligente, qui n'était pas seulement mieux armée du fait de sa force économique et politique, mais qui avait tiré des leçons des événements de Russie, et qui jouissait du soutien des classes dominantes des autres pays. Mieux encore, ce qui fut son atout décisif c'est que la bourgeoisie disposait du soutien du parti social-démocrate passé de son côté : "Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, programme contre programme, épée contre bouclier. (...) Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante, mais sous le drapeau du 'parti social-démocrate'. Si la question cardinale de la révolution était ouvertement et honnêtement posée dans les termes de capitalisme ou socialisme, les grandes masses du prolétariat n'auraient eu aucun doute ou hésitation. (...) Mais l'histoire ne nous rend pas les choses aussi faciles et confortables. La domination de classe bourgeoise mène aujourd'hui sa dernière lutte historique mondiale sous un drapeau étranger, sous le drapeau de la révolution elle-même. C'est un parti socialiste, c'est-à-dire la création la plus originale du mouvement ouvrier et de la lutte de classe, qui est lui-même devenu l'instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. Le fond, la tendance, la politique, la psychologie, la méthode, tout cela est capitaliste de bout en bout. Seuls restent le drapeau, l'appareil et la phraséologie du socialisme." ("Une victoire à la Pyrrhus", Rosa Luxemburg, 21 décembre 1918, Oeuvres choisies, vol.4, p. 472). Comme déjà pendant la première guerre mondiale, le SPD devait être le plus loyal défenseur du capital pour écraser les luttes ouvrières.
ARRET DE LA GUERRE, GOUVERNEMENT SPD-USPD ET REPRESSION
Le 4 novembre 1918, l'appel du commandement militaire à la flotte, enjoignant d'appareiller pour une nouvelle bataille navale contre l'Angleterre - ordre que même certains généraux considéraient comme suicidaire - déclencha la mutinerie des marins de Kiel, sur la mer Baltique. Devant à la répression de la mutinerie, une vague de solidarité avec les marins se développa comme une traînée de poudre dans les premiers jours de novembre, à Kiel, puis dans les principales villes d'Allemagne. Tirant les leçons de l'expérience russe, le commandement militaire du général Groener, véritable détenteur du pouvoir en Allemagne, décida de mettre fin immédiatement à la guerre. L'armistice, réclamé aux Alliés dès le 7 novembre, fut signé le 11 novembre 1918. Avec ce cessez-le-feu la bourgeoisie éliminait un des facteurs les plus importants de radicalisation des conseils d'ouvriers et de soldats. La guerre avait arraché aux ouvriers leurs acquis, mais la plupart d'entre eux croyaient que, une fois la guerre terminée, il serait possible de revenir à la vieille méthode gradualiste et pacifique pour "faire avancer les choses". Beaucoup d'ouvriers se sont engagés dans le combat, avec la "paix" et la "république démocratique" comme principaux objectifs de la lutte. Une fois la "paix" et la "république" obtenues, au mois de novembre 1918, le combat de classe avait perdu l'aiguillon qui l'avait fait se généraliser, et cela se ressentira tout au long des luttes qui se poursuivront.
Le commandement militaire, levier central du pouvoir de la bourgeoisie, avait eu assez de perspicacité pour comprendre qu'il avait besoin d'un cheval de Troie pour arrêter le mouvement. Wilhelm Groener, chef suprême du commandement militaire, déclarera plus tard à propos de l'accord du 10 novembre 1918 avec Friedrich Ebert, dirigeant du SPD et chef du gouvernement :
"Nous avons formé une alliance pour combattre la révolution dans la lutte contre le bolchevisme. Le but de l'alliance que nous avons constituée le soir du 10 novembre était le combat sans merci contre la révolution, le rétablissement d'un pouvoir gouvernemental de l'ordre, le soutien de ce gouvernement par la force des armes et l'appel d'une assemblée nationale dès que possible. (...) A mon avis, il n'y avait aucun parti en Allemagne à ce moment avec assez d'influence dans le peuple, particulièrement parmi les masses, pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. Les partis de droite avaient complètement disparu et il était bien sûr hors de question de travailler avec les radicaux extrémistes. Il ne restait rien d'autre à faire pour le commandement militaire que de former une alliance avec les sociaux-démocrates majoritaires. "
Les cris de guerre les plus sournois du SPD contre les luttes révolutionnaires furent "unité des ouvriers", "pas de lutte fratricide", "unité du SPD et de l'USPD". Face à la dynamique vers une polarisation croissante entre les deux forces opposées, poussant à une situation révolutionnaire, le SPD s'efforça de masquer les contradictions entre les classes. D'un côté il ne cessa de cacher et déformer son propre rôle au service du capital pendant la guerre, de l'autre il s'appuya sur la confiance dont il jouissait encore parmi les ouvriers, résultant du rôle prolétarien qu'il avait joué avant la guerre pendant plus de trente ans. Il contracta une alliance avec l'USPD - composé d'une droite qui se distinguait à peine des sociaux-démocrates majoritaires, d'un centre hésitant, et d'une aile gauche, les Spartakistes -, dont le centrisme favorisa la manoeuvre du SPD. L'aile droite de l'USPD rejoignit en novembre le conseil des commissaires du peuple, qui était dirigé par le SPD, en d'autres termes le gouvernement bourgeois du moment.
Quelques jours après la création des conseils, ce gouvernement commença les premiers préparatifs d'une répression militaire systématique : organisations de Corps francs (troupes de mercenaires), rassemblant des unités de soldats républicains et des officiers fidèles au gouvernement, pour enrayer l'effondrement de l'armée et avoir de nouveaux chiens sanglants à sa solde.
Il était difficile pour les ouvriers de percer le rôle du SPD. Ancien parti ouvrier, puis protagoniste de la guerre et défenseur de l'Etat démocratique capitaliste, le SPD développait d'un côté un langage ouvrier "en défense de la révolution", et de l'autre il faisait, soutenu par l'aile droite de l'USPD, la chasse aux sorcières contre la "révolution bolchevik" et ceux qui la soutenaient, les Spartakistes.
Liebknecht, au nom des Spartakistes, écrivait dans le Rote Fahne du 19 novembre 1918 : "Ceux qui appellent le plus fort à l'unité (...) trouvent maintenant un écho surtout parmi les soldats. Ce n'est pas étonnant. Les soldats sont loin d'être tous prolétaires. Et la loi martiale, la censure, le bombardement de la propagande officielle n'ont pas manqué d'avoir un effet. La masse des soldats est révolutionnaire contre le militarisme, contre la guerre, et contre les représentants ouverts de l'impérialisme. Par rapport au socialisme, elle est encore indécise, hésitante, immature. Une grande partie des soldats prolétariens, comme les ouvriers, considèrent que la révolution a été accomplie, que nous devons seulement maintenant établir la paix et démobiliser. Ils veulent qu'on les laisse en paix après autant de souffrances. Mais ce n'est pas n'importe quelle unité qui nous rend forts. L'unité entre un loup et un agneau condamne l'agneau à être dévoré par le loup. L'unité entre le prolétariat et les classes dominantes sacrifie le prolétariat. L'unité avec les traîtres signifie la défaite. (...) La dénonciation de tous les faux amis de la classe ouvrière, est dans ce cas notre premier devoir (...) ".
Pour affaiblir les SPARTAKISTES, fer de lance du mouvement révolutionnaire, une campagne fut lancée contre eux: outre les calomnies systématiques qui présentaient Spartakus comme composé d'éléments corrompus, pillards, terroristes, les Spartakistes étaient interdits de parole. Le 6 décembre, les troupes gouvernementales occupèrent le journal de la Ligue Spartakus, le Rote Fahne (Drapeau rouge), le 9 puis le 13 décembre, le quartier général de la Ligue fut occupé par les soldats. Liebknecht fut dénoncé comme terroriste, responsable de l'anarchie et du chaos. Le SPD appela au meurtre de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht dès le début de décembre. Ayant tiré les leçons des luttes en Russie, la bourgeoisie allemande était déterminée à utiliser tous les moyens possibles contre les organisations révolutionnaires en Allemagne. Sans hésitation elle utilisa la répression contre elles dès le premier jour et ne cacha jamais ses intentions de tuer les dirigeants les plus importants.
CONCESSIONS REVENDICATIVES ET CHANTAGE AU RAVITAILLEMENT
Dès le 15 novembre, les syndicats et les capitalistes avaient conclu un accord pour limiter la radicalisation des ouvriers en faisant quelques concessions économiques. Ainsi fut accordée la journée de 8 heures sans réduction de salaire (en 1923 elle repassa à 10-12 heures). Surtout, des " conseils d'usine" (Betriebsrâte) furent instaurés systématiquement, dont l'objectif était de canaliser l'initiative des ouvriers dans les usines, et de les soumettre au contrôle de l’Etat. Ces conseils d'usine furent formés pour contrecarrer les conseils ouvriers. Les syndicats jouèrent un rôle primordial dans la mise en place de cet obstacle.
Enfin, le SPD lança la menace d'une intervention des Etats-Unis, qui bloquerait la fourniture de l'approvisionnement alimentaire au cas où les conseils ouvriers continueraient à "déstabiliser" la situation.
LA STRATEGIE DU SPD : DESARMER LES CONSEILS OUVRIERS
C'est surtout contre les conseils ouvriers que la bourgeoisie concentra son offensive. Elle essaya d'empêcher que le pouvoir des conseils ouvriers n'arrivât à saper, à paralyser l'appareil d'Etat.
- Dans certaines villes, le SPD prit l'initiative de transformer les conseils d'ouvriers et de soldats en "parlements populaires", moyen par lequel les ouvriers se trouvaient "dilués" dans "le peuple", ce qui leur ôtait toute possibilité de reprendre un rôle dirigeant vis-à-vis de l'ensemble de la classe travailleuse (c'est ce qui arriva à Cologne par exemple, sous la direction de K. Adenauer, qui sera plus tard chancelier).
- Les conseils ouvriers furent privés de toute possibilité concrète de mettre réellement en pratique les décisions qu'ils prenaient. Ainsi, le 23 novembre, le Conseil exécutif de Berlin (les conseils de Berlin avaient élu un Conseil exécutif, Vollzugsrai) n'opposa aucune résistance lorsque ses prérogatives lui furent retirées des mains, quand il renonça à exercer le pouvoir pour le laisser au .gouvernement bourgeois. Dès le 13 novembre, sous la pression du gouvernement bourgeois et des soldats qui le soutenaient, le Conseil exécutif avait renoncé à créer une garde rouge. Le Conseil exécutif se trouva ainsi confronté au gouvernement bourgeois sans avoir aucune arme à sa disposition, alors que dans le même temps, le gouvernement bourgeois s'occupait à rassembler des troupes en masse.
- Après que le SPD eût réussi à entraîner l'USPD au gouvernement, promulguant une frénésie d'"unité" entre les "différentes parties de la social-démocratie", il poursuivit son intoxication des conseils ouvriers. Dans le Conseil exécutif de Berlin comme dans les conseils des autres villes, le SPD insista sur l’égalité du nombre de délégués dans les conseils entre SPD et USPD. Avec cette tactique, il eut plus de mandats que le rapport de forces dans les usines ne lui en aurait alloués. Le pouvoir des conseils ouvriers comme organes essentiels de direction politique et organes de l'exercice du pouvoir fut ainsi encore plus déformé et vidé de tout contenu.
Cette offensive de la classe dominante se mena parallèlement à la tactique des provocations militaires. Ainsi, le 6 décembre les troupes fidèles au gouvernement occupèrent le Rote Fahne, arrêtèrent le Conseil exécutif de Berlin et provoquèrent un massacre parmi les ouvriers qui manifestaient (plus de 14 tués). Même si pendant cette phase, la vigilance et la combativité de la classe n'étaient pas encore brisées - le jour suivant les provocations, d'énormes masses d'ouvriers (150 000) prirent la rue -, et même si la bourgeoisie devait encore compter avec une résistance courageuse des ouvriers, le mouvement était très dispersé. L'étincelle de la révolte avait embrasé une ville après l'autre mais la dynamique de la classe ouvrière à la base, dans les usines, n'était pas très forte.
Dans une telle situation, l'impulsion au mouvement doit venir de plus en plus fortement de la base : des comités d'usine doivent se former, dans lesquels les ouvriers les plus combatifs se regroupent, des assemblées générales doivent se tenir, des décisions être prises, leur réalisation étant contrôlée, et les délégués doivent rendre compte aux assemblées générales qui les ont mandatés et si nécessaire être révoqués. Des initiatives doivent être prises. Bref, la classe doit mobiliser et rassembler toutes ses forces à la base par-delà les usines, les ouvriers doivent exercer un contrôle réel sur le mouvement. Mais en Allemagne le niveau de coordination englobant des villes et des régions n'avait pas été atteint ; au contraire l'aspect dominant était encore l'isolement entre les différentes villes, alors qu'une unification des ouvriers et de leurs conseils par delà les limites des villes est un pas essentiel dans le processus pour faire face aux capitalistes. Lorsque les conseils ouvriers surgissent et se confrontent au pouvoir de la bourgeoisie, une période de double pouvoir s'ouvre et ceci requiert que les ouvriers aussi centralisent leurs forces à une échelle nationale et même internationale. Cette centralisation ne peut ne peut qu'être le résultat d'un processus que les ouvriers contrôlent eux-mêmes. En arrière-plan de la dispersion du mouvement qui prévalait encore, l'isolement des différentes villes, le conseil des ouvriers et des soldats de Berlin, poussé par le SPD, convoqua un congrès national des conseils d'ouvriers et de soldats du 16 au 22 décembre. Ce congrès devait constituer une force centralisatrice avec une autorité centrale. En réalité, les conditions pour une telle centralisation n'étaient pas encore mûres, parce que la pression et la capacité de la classe à donner une impulsion dans ses propres rangs et à contrôler le mouvement n'étaient pas assez fortes. La dispersion était encore le trait dominant. Cette centralisation artificielle, PREMATUREE, à l'initiative du SPD, qui était plus ou moins "imposée" aux ouvriers au lieu d'être un produit de leur lutte, constitua un très grand obstacle pour la classe ouvrière.
Ce n'est pas surprenant si la composition des conseils ne correspondait pas à la situation politique dans les usines, si elle ne suivait pas les principes de responsabilité devant les assemblées générales et de révocabilité des délégués : la répartition des délégués correspondait plutôt aux pourcentages de votes pour les partis, sur la base du scrutin de 1910. Le SPD sut aussi comment utiliser l'idée courante à l'époque qu'un tel conseil devait travailler suivant les principes des parlements bourgeois. Ainsi, par une série de trucs parlementaires, de manoeuvres de fonctionnement, le SPD parvint à garder le congrès sous son contrôle. Après l'ouverture du congrès les délégués mirent en place immédiatement des fractions : sur 490 délégués, 298 étaient des membres du SPD, 101 de l'USPD, parmi lesquels 10 Spartakistes, 100 "divers".
Ce congrès était en fait une assemblée autoproclamée, qui parlait au nom des ouvriers, mais qui dès le début devait trahir les intérêts des ouvriers.
- Une délégation d'ouvriers russes, qui devait assister au congrès sur invitation du Conseil exécutif de Berlin, fut refoulée à la frontière sur ordre du gouvernement SPD '."L'Assemblée générale réunie le 16 décembre ne traite pas de délibérations internationales mais seulement d'affaires allemandes, dans lesquelles les étrangers ne peuvent bien sûr pas participer. (...) La délégation russe n'est rien d'autre que des représentants de la dictature bolchevik", telle fut la justification du Vorwarts, organe central du SPD (n° 340, 11 décembre 1918). C'est ainsi que la perspective d'unification des luttes à travers l'Allemagne et la Russie, ainsi que leur extension internationale, furent combattues par le SPD. Avec l'aide des manoeuvres tactiques du praesidium, le congrès rejeta la participation de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht : ils ne furent même pas admis comme observateurs sans droit de vote, sous prétexte qu'ils n'étaient pas des ouvriers des usines de Berlin.
Pour faire pression sur le congrès, la Ligue Spartakus organisa une manifestation de masse le 16 décembre 1918 à laquelle participèrent 250 000 ouvriers, parce que de très nombreuses délégations d'ouvriers et de soldats qui voulaient présenter leurs motions au congrès avaient été pour la plupart rejetées ou écartées.
Le congrès signa son arrêt de mort quand il décida d'appeler à la formation d'une assemblée constituante le plus tôt possible, assemblée qui devait détenir tout le pouvoir de la société. L'appât de la démocratie parlementaire bourgeoise tendu par la bourgeoisie entraîna la majorité des ouvriers dans le piège. L'arme du parlement bourgeois fut le poison utilisé contre l'initiative des ouvriers. Enfin le congrès mit en avant l'écran de fumée des "premières mesures de socialisation" qui devaient être prises, alors que la classe ouvrière n'avait même pas pris le pouvoir.
La question centrale, celle du désarmement de la contre-révolution, du renversement du gouvernement bourgeois fut ainsi repoussée à l’arrière-plan. "Prendre des mesures politico-sociales dans des usines particulières est une illusion tant que la bourgeoisie détient encore le pouvoir politique." (IKD, Der Kommunist).
Le congrès fut un succès total pour la bourgeoisie. Pour les Spartakistes il signifiait l'échec : "Le point de départ et la seule acquisition tangible de la révolution du 9 novembre, a été la formation des conseils d'ouvriers et de soldats. Le premier congrès de ces conseils a décidé de détruire cette seule acquisition, de voler au prolétariat ses positions de pouvoir, de démolir le travail du 9 novembre, d'emporter la révolution. (...) Puisque le congrès des conseils a condamné le véritable organe des conseils d'ouvriers et de soldats qui lui a donné son mandat, à n'être que l'ombre de lui-même, il a donc violé ses compétences, trahi le mandat que les conseils d'ouvriers et de soldats lui ont remis, il a détruit le sol sous les pieds de sa propre existence et autorité. (...) Les conseils d'ouvriers et de soldats déclareront nul et vide le travail contre-révolutionnaire de leurs délégués infâmes." ("Les esclaves d'Ebert", Rosa Luxemburg, 2 décembre 1918, ibid., vol. 4, p. 469). Dans quelques villes, Leipzig par exemple, les conseils locaux d'ouvriers et de soldats protestèrent contre les décisions du congrès. Mais la centralisation préventive des conseils les fit tomber rapidement dans les mains de la bourgeoisie. La seule voie pour combattre cette manoeuvre était d'accroître la pression de la "base", des usines, de la rue.
Encouragée et renforcée par les résultats de ce congrès, la bourgeoisie en vint alors à provoquer des confrontations militaires. Le 24 décembre, la Division de la marine du peuple, une troupe d'avant-garde, fut attaquée par les troupes gouvernementales. Plusieurs marins furent tués. Une fois encore un orage d'indignation éclata parmi les ouvriers. Le 25 décembre, un nombre important d'ouvriers prit la rue. En arrière-plan de ces actions contre-révolutionnaires ouvertes du SPD, l'USPD se retira du gouvernement le 29 décembre. Le 30 décembre et le 1er janvier la Ligue Spartakus et les IKD formèrent le parti communiste (KPD) dans le feu des luttes. A son congrès de fondation un premier bilan du mouvement fut tiré. Nous reprendrons le contenu des débats à ce congrès à une autre occasion. Le KPD, par la voix de Rosa Luxemburg, souligna : "Le passage de la révolution de soldats prédominante le 9 novembre 1918 à une révolution ouvrière spécifique, la transformation du superficiel, purement politique, dans le lent processus de règlement de comptes général économique entre le travail et le capital, réclame de la classe ouvrière révolutionnaire un niveau complètement différent de maturité politique, d'éducation, de ténacité de celui qui a suffi pour la première phase de début." ("Le 1er congrès", 3 janvier 1919, Die Rote Fahne).
LA BOURGEOISIE PROVOQUE UNE INSURRECTION PREMATUREE
Après avoir rassemblé un nombre suffisant de troupes loyalistes surtout à Berlin, après avoir mis en place un nouvel obstacle contre les conseils ouvriers avec le résultat du "congrès" de Berlin et avant que la phase de luttes économiques puisse prendre un plein essor, la bourgeoisie voulait marquer des points décisifs contre les ouvriers sur le plan militaire.
Le 4 janvier 1919, le superintendant de la police de Berlin, qui était membre de l'aile gauche de l'USPD, fut écarté par les troupes gouvernementales. Au début de novembre le quartier général de la police avait été occupé par les ouvriers et les soldats révolutionnaires, et jusqu'en janvier il n'était pas encore tombé aux mains du gouvernement bourgeois. Une fois de plus une vague de protestation éclata contre le gouvernement. A Berlin des centaines de milliers de gens prirent la rue le 5 janvier. Le Vorwarts, journal du SPD, fut occupé aussi bien que d'autres organes de presse de la bourgeoisie. Le 6 janvier, il y eut encore plus de manifestations de masse avec des centaines de milliers de participants.
Bien que la direction du KPD fît constamment de la propagande sur la nécessité de renverser le gouvernement bourgeois avec le SPD à sa tête, elle ne pensait pas que le moment était venu pour le faire ; en fait, elle mettait en garde contre une insurrection prématurée. Cependant, avec la présence écrasante des masses dans les rues, qui fit que beaucoup de révolutionnaires pensaient que les masses ouvrières étaient prêtes pour l'insurrection, un "comité révolutionnaire" fut fondé le soir du 5 janvier 1919, dont la tâche était de mener la lutte pour le renversement du gouvernement et de prendre temporairement en main les affaires gouvernementales, une fois le gouvernement bourgeois expulsé des bureaux. Liebknecht rejoignit ce "comité". En fait, la majorité du KPD considérait que le moment de l'insurrection n'était pas encore venu, et insistait sur l'immaturité des masses pour un tel pas en avant. Il est vrai que les gigantesques manifestations de masse à Berlin avaient exprimé un rejet énorme du gouvernement SPD, mais bien que le mécontentement s'accrut dans de nombreuses villes, la combativité et la détermination dans les autres villes étaient en retard. Berlin se trouva totalement isolé. Pire même : après que le congrès national des conseils en décembre et le conseil exécutif de Berlin eussent été désarmés, les conseils ouvriers à Berlin ne furent plus un lieu de centralisation, de prise de décisions et d'initiative des ouvriers. Ce "comité révolutionnaire" n'émanait pas de la force des conseils ouvriers, il n'avait même pas un mandat. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu une vue d'ensemble de l'état d'esprit des ouvriers et des soldats. Il ne prit à aucun moment la direction du mouvement à Berlin ou dans d'autres villes. En fait, il finit par n'avoir aucun pouvoir et manqua lui-même d'orientation. Ce fut une insurrection sans conseils.
Les appels du comité furent sans effet, ils n'étaient même pas pris au sérieux par les ouvriers. Les ouvriers étaient tombés dans le piège des provocations militaires. Le SPD n'hésita pas dans sa contre-offensive. Ses troupes envahirent les rues et entamèrent des combats de rue avec les ouvriers armés. Les jours qui suivirent, les ouvriers de Berlin durent subir un terrible bain de sang. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht furent assassinés par les troupes fidèles au SPD. Avec le bain de sang des ouvriers de Berlin, l'assassinat des principaux dirigeants du KPD, la tête du mouvement avait été brisée, l'arme féroce de la répression s'était abattue sur les ouvriers. Le 17 janvier, la Rote Fahne fut interdite. Le SPD intensifia sa campagne démagogique contre les Spartakistes et justifia l'ordre d'assassiner Rosa et Karl : "Luxemburg et Liebknecht eux-mêmes (...) sont maintenant victimes de leur propre tactique de terreur sanguinaire (...). Liebknecht et Luxemburg n'étaient plus des sociaux-démocrates depuis longtemps, parce que pour les sociaux-démocrates les lois de la démocratie sont sacrées, et qu'ils ont rompu avec ce principe. Parce qu'ils enfreignirent ces lois, nous devions les combattre et nous devons encore le faire (...) ainsi l'écrasement du courant Spartakiste signifie pour l’ensemble du peuple, en particulier pour la classe ouvrière, un acte de sauvegarde, quelque chose que nous étions obligés de faire pour le bien-être de notre peuple et pour l'histoire".
Alors que pendant les journées de juillet 1917 en Russie, les bolcheviks avaient réussi à empêcher une insurrection prématurée malgré la résistance des anarchistes, pour pouvoir jeter tout leur poids dans un soulèvement victorieux en octobre, le KPD ne parvint pas à le faire en janvier 1919. Et un des plus importants dirigeants, Karl Liebknecht, surestima la situation et se laissa emporter par la vague de mécontentement et de colère. La majorité du KPD vit la faiblesse et l'immaturité du mouvement ; elle ne put cependant éviter le massacre.
Comme un membre du gouvernement le déclara le 3 février 1919 : "Dès le début un succès des gens de Spartakus était impossible, parce que, grâce à notre préparation, nous les avons forcés à une insurrection immédiate.".
Avec le massacre du prolétariat à Berlin, le coeur du prolétariat avait été touché, et après le bain de sang des Corps francs à Berlin, ces derniers purent être déplacés vers d'autres centres de résistance prolétarienne dans d'autres régions d'Allemagne ; car au même moment dans quelques villes, qui étaient isolées les unes des autres, des républiques avaient été proclamées depuis le début de novembre 1918 (le 8 en Bavière, le 10 à Brunswig et à Dresde, le 10 à Brème), comme si la domination du capital pouvait être renversée à travers une série d'insurrections isolées et dispersées. Aussi les mêmes troupes contre-révolutionnaires marchèrent sur Brème en février. Après avoir fait subir un nouveau bain de sang, elles procédèrent de même dans la Ruhr en Allemagne centrale en mars, et en avril 100 000 contre-révolutionnaires marchèrent sur la Bavière pour écraser la "République de Bavière". Mais même avec ces massacres la combativité de la classe ne fut pas immédiatement brisée. Beaucoup de chômeurs manifestèrent dans les rues tout au long de l'année 1919, il y eut encore un grand nombre de grèves dans différents secteurs, luttes contre lesquelles la bourgeoisie n'hésita jamais à employer la troupe. Pendant le putsch du général Kapp en avril 1920 et pendant les soulèvements en Allemagne centrale (1921) et à Hambourg (1932), les ouvriers témoignèrent encore de leur combativité, jusqu'en 1923. Mais avec la défaite du soulèvement de janvier 1919 à Berlin, avec les massacres dans beaucoup d'endroits d'Allemagne au cours de l'hiver 1919, la phase ascendante avait été brisée, le mouvement privé de son coeur et sa direction avait été décapitée.
La bourgeoisie était parvenue à enrayer l'extension de la révolution prolétarienne en Allemagne, en empêchant la partie centrale du prolétariat de rejoindre la révolution. Après une autre série de massacres des mouvements en Autriche, en Hongrie, en Italie, les ouvriers en Russie restèrent isolés et furent alors exposés aux attaques de la contre-révolution. La défaite des ouvriers en Allemagne, ouvrit la voie à une défaite internationale de toute la classe ouvrière, et pava le chemin d'une longue période de contre-révolution.
QUELQUES LEÇONS DE LA REVOLUTION ALLEMANDE
C'est la guerre qui avait catapulté la classe ouvrière dans ce soulèvement international, mais en même temps il en résultait que :
- la fin de la guerre écartait la cause première de la mobilisation aux yeux de la plupart des ouvriers ;
- la guerre avait divisé profondément le prolétariat, en particulier à la fin de celle-ci entre pays "vaincus", où les ouvriers se sont lancés à l'assaut de la bourgeoisie nationale, et pays "vainqueurs" où le prolétariat subissait le poison nationaliste de la "victoire".
Pour toutes ces raisons, il doit être clair pour nous aujourd'hui combien les conditions de la guerre étaient vraiment défavorables à l'époque pour le premier assaut à la domination capitaliste. Seuls des simples d'esprit pourraient croire que l'éclatement d'une troisième guerre mondiale aujourd'hui fournirait un terrain plus fertile pour un nouvel assaut révolutionnaire.
Malgré les spécificités de la situation, les luttes en Allemagne nous ont laissé tout un héritage de leçons. La classe ouvrière aujourd'hui n'est plus divisée par la guerre, le développement lent de la crise a empêché un embrasement spectaculaire des luttes. Dans les innombrables confrontations d'aujourd'hui, la classe acquiert plus d'expérience et développe sa conscience (même si ce processus n'est pas toujours direct et souvent sinueux).
Cependant, ce processus de prise de conscience sur la nature de la crise, les perspectives du capitalisme, la nécessité de sa destruction, s'oppose exactement aux mêmes forces qui déjà en 1914, 17, 18, 19, étaient à l'oeuvre : la gauche du capital, les syndicats, les partis de gauche et leurs chiens de garde, les représentants de l'extrême gauche du capital. Ce sont eux qui, aux côtés d'un capitalisme d'Etat beaucoup plus développé et de son appareil de répression, empêchent la classe ouvrière de parvenir à poser la question de la prise du pouvoir plus rapidement.
Les partis de gauche et les gauchistes, comme les sociaux-démocrates qui à l'époque assumèrent le rôle de bourreau de la classe ouvrière, se posent encore aujourd'hui comme amis et défenseurs des ouvriers, et, les gauchistes comme les syndicalistes d'"opposition" auront aussi dans le futur la responsabilité d'écraser la classe ouvrière dans une situation révolutionnaire.
Ceux qui comme les trotskystes parlent aujourd'hui de la nécessité d'amener ces partis de gauche au pouvoir, pour mieux les dévoiler, ceux qui aujourd'hui clament que ces organisations, bien qu'elles aient trahi dans le passé, ne sont pas intégrées à l'Etat, et qu'on peut soit les reconquérir, soit faire pression sur elles pour "changer leur orientation", maintiennent les pires illusions sur ces gangsters. Les "gauchistes" ne jouent pas seulement un rôle de sabotage des luttes ouvrières. La bourgeoisie ne pourra pas se limiter à laisser la gauche dans l'opposition ; le moment venu, elle aura à amener ces gauchistes au gouvernement pour écraser les ouvriers.
Alors que, à l'époque, beaucoup de faiblesses de la classe ouvrière pouvaient s'expliquer du fait de l'entrée récente du capitalisme dans sa période de décadence, ce qui n'avait pas laissé le temps de clarifier beaucoup de choses, aujourd'hui aucun doute n'est permis après soixante-dix ans d'expérience concernant :
- la nature des syndicats,
- le poison du parlementarisme,
- la démocratie bourgeoise et le simulacre de libération nationale.
Les révolutionnaires les plus clairs montrèrent déjà à l'époque le rôle dangereux de ces formes de lutte propres aux années de prospérité historique du capitalisme. Toute confusion et illusion sur la possibilité de travailler dans les syndicats, dans l'utilisation des élections parlementaires, toute tergiversation sur le pouvoir des conseils ouvriers et le caractère mondial de la révolution prolétarienne, auront des conséquences fatales.
Bien que les Spartakistes, aux côtés des Radicaux de gauche de Brème, Hambourg et de Saxe aient fait un héroïque travail d'opposition pendant la guerre, il n'en demeure pas moins que la fondation tardive du Parti communiste a été une faiblesse décisive de la classe. Nous avons essayé de montrer le contexte historique plus large des causes de celle-ci. Néanmoins, l'histoire n'est pas condamnée au fatalisme. Les révolutionnaires ont un rôle conscient à jouer. Nous devons tirer toutes les leçons des événements en Allemagne et de la vague révolutionnaire en général. Aujourd'hui il revient aux révolutionnaires non de se lamenter sans cesse sur la nécessité du parti, mais de constituer les fondations réelles de la construction du parti. Il ne s'agit pas de s'autoproclamer "dirigeants", comme le font aujourd'hui une douzaine d'organisations, mais de continuer le combat pour la clarification des positions programmatiques, prendre le rôle d'avant-garde dans les luttes quotidiennes de la classe - ce qui requiert aujourd'hui pas moins qu'à l'époque une dénonciation vigoureuse du travail de la gauche du capital, et de montrer les perspectives larges et concrètes de la lutte de classe. La pré condition réelle pour remplir cette tâche est d'assimiler toutes les leçons de la vague révolutionnaire, en particulier les événements en Allemagne et en Russie. Nous reviendrons sur les leçons des événements d'Allemagne sur la question du parti dans un prochain article de cette revue.
Dino
"La classe des capitalistes impérialistes, dernier rejeton des classes exploiteuses, surenchérit en bestialité, en cynisme effronté, en ignominie sur tous ses prédécesseurs. Pour défendre son Saint des Saints: le profit et le monopole de l’exploitation, elle emploiera les dents et les ongles, elle utilisera au maximum chacune des méthodes froidement implacables qui ont fait leur apparition quotidienne dans l'histoire de la politique coloniale et dans la dernière guerre mondiale. Elle déchaînera le ciel et l'enfer contre la révolution prolétarienne. Elle mobilisera la paysannerie contre les villes, elle excitera les couches arriérées du prolétariat à frapper leur propre avant-garde ; elle fera de ses officiers des organisateurs de massacres, elle paralysera chaque mesure socialiste par les mille et un moyens de la résistance passive, (...) Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes qu'elle ne renoncera de bon gré à l'esclavagisme du salariat. "
"Toutes ces résistances devront être brisées pas à pas, avec un poing de fer, avec une énergie inébranlable. Il faut opposer à la violence de la contre-révolution la violence révolutionnaire du prolétariat tout entier. Aux guets-apens, aux pièges et aux traquenards de la bourgeoisie, l'implacable clarté du but, la vigilance et l'initiative permanentes des masses ouvrières."
(...)
"La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles que l'histoire ait jamais vue, et la révolution prolétarienne doit prendre, en vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit acquérir, pour le mettre à profit, l'art de combattre et de vaincre. "
"Que veut Spartakus ?", Programme de la Ligue Spartakus, 14 décembre 1918, rédigé par Rosa Luxemburg,
Géographique:
- Allemagne [92]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [852]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 57 - 2e trimestre 1989
- 2823 reads
La décomposition du capitalisme
- 3113 reads
L'impasse dans laquelle se trouve acculé le système capitaliste nous donne chaque jour plus l'image d'une société en train de courir à sa propre perte. Aux guerres et aux massacres qui, depuis la fin de l'holocauste de la seconde guerre mondiale, se perpétuent à la périphérie du capitalisme viennent aujourd'hui s'ajouter d'autres manifestations de la barbarie de ce système décadent dont l'agonie prolongée ne peut engendrer que destructions sur destructions. Les catastrophes "naturelles" ou accidentelles qui se sont multipliées ces derniers temps dans toutes les parties du monde, le développement du banditisme, du terrorisme, de l'usage et du trafic des drogues sont aujourd'hui autant de manifestations du phénomène de décomposition générale qui gangrène l'ensemble du corps de la société capitaliste.
Si l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence était la condition rendant possible le renversement de ce système par la révolution prolétarienne, la perpétuation de cette décadence n'est pas sans danger pour la classe ouvrière. Cette putréfaction du capitalisme, en se propageant à toutes les couches de la société, comporte un risque de contamination de la seule classe porteuse d'un avenir pour l'humanité. Face à la gravité des enjeux contenus dans cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, il revient aux révolutionnaires, non pas de consoler les ouvriers de leur misère et de leurs souffrances en leur masquant toute l'horreur de ce monde pourrissant, mais d'en souligner, au contraire, toute l'ampleur afin de les mettre en garde contre le danger de cette contamination qui les menace quotidiennement.
L'annonce de catastrophes provoquées par des phénomènes "naturels" ou par des accidents, tuant ou mutilant chaque jour une multitude de vies humaines, est aujourd'hui entrée dans le quotidien de l'actualité. Ces derniers mois, il ne s'est pas passé une semaine sans que les médias ne nous renvoient les images apocalyptiques de ces catastrophes frappant tantôt les pays sous-développés, tantôt les grandes métropoles industrielles du monde occidental. La banalisation de ces événements chaque jour plus meurtriers, leur accumulation partout dans le monde, n'engendrent pas seulement une insécurité croissante pour la classe ouvrière comme pour l'ensemble de la population. Elles sont de plus en plus ressenties comme une menace qui risque d'engloutir toute l'espèce humaine au même titre que la guerre nucléaire.
EN S'ENFONÇANT DANS LA DÉCADENCE LE CAPITALISME NE PEUT ENGENDRER QUE TOUJOURS PLUS DE DESTRUCTIONS
Pluies torrentielles au Bangladesh faisant plus de 30 millions de victimes en septembre 1988, sécheresse au Sahel qui, ces dernières années, a provoqué des famines comme jamais l'humanité n'en a connues ; cyclones au large des Caraïbes ou à l'ile de la Réunion, détruisant sur leur passage les habitations de la population locale ; tremblement de terre en Arménie où, en quelques minutes, ce sont des villes entières qui ont été rasées, ensevelissant sous leurs décombres des dizaines de milliers d'êtres humains... Toutes ces catastrophes à grande échelle qui ont ravagé ces derniers mois les pays sous-développés ne constituent pas un phénomène localisé aux États du "tiers-monde" ou du bloc de l'Est.
Elles tendent à se généraliser aux régions du monde les plus industrialisées comme en témoigne la succession effarante d'accidents d'avions ou de trains qui se sont soldés, ces derniers mois, par plusieurs centaines de victimes au cœur des grandes métropoles d'Europe occidentale.
Et ce n'est certainement pas, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie, à la fatalité, à une quelconque "loi des séries" ou aux "forces incontrôlables de la nature" qu'il faut distribuer toutes ces destructions, toutes ces pertes en vies humaines. Ces "explications" dont s'accommode fort bien la classe dominante n'ont d'autre objectif que celui de dégager la responsabilité de son système, d'en cacher toute la barbarie et la pourriture. Car le véritable responsable de toutes ces tragédies, de ces souffrances humaines indicibles, c'est bien le capitalisme lui-même et cette succession effarante de catastrophes "naturelles" ou "accidentelles" n'est que l'expression la plus spectaculaire d'une société moribonde, d'une société qui part en lambeaux.
Ces tragédies font éclater au grand jour la faillite totale d'un mode de production -le capitalisme- qui est entré depuis la première guerre mondiale dans sa période de décadence. Cette décadence signifie qu'après toute une période de prospérité où il a été capable de faire accomplir un bond gigantesque aux forces productives et aux richesses de la société en créant et unifiant le marché mondial, en étendant son mode de production à toute la planète, ce système a atteint depuis le début du siècle ses propres limites historiques. Ce déclin du capitalisme se traduit aujourd'hui par le fait qu'il ne peut désormais engendrer à l'échelle planétaire que toujours plus de destruction et de barbarie, de famines et de massacres.
C'est en particulier cette décadence qui explique que les pays du "tiers-monde" n'aient pu se développer : ils sont arrivés trop tard sur un marché mondial déjà constitué, déjà partagé, déjà saturé (cf. notre brochure La décadence du capitalisme). C'est elle qui condamne ces pays, malgré tous les discours hypocrites sur leur prétendu "développement", à être aujourd'hui les premières victimes de toute la barbarie du capitalisme moribond, les lieux privilégiés, si l'on peut dire, de l'horreur absolue.
En se prolongeant, l'agonie du capitalisme, fait apparaître aujourd'hui dans toute leur horreur les traits les plus saillants de cette décadence en même temps qu'éclatent au grand jour les contradictions internes, insolubles de ce système.
Certes, on ne peut reprocher au capitalisme d'être à l'origine d'un tremblement de terre, d'un cyclone ou de la sècheresse. En revanche, on peut mettre à son passif le fait que tous ces cataclysmes liés aux phénomènes naturels se transforment en immense catastrophe sociale, en gigantesque tragédie humaine.
Ainsi, le capitalisme dispose de forces technologiques telles qu'il est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, de produire des armes monstrueuses susceptibles de détruire des dizaines de fois la planète, mais en même temps il ne se donne pas les moyens -pour protéger les populations des pays exposés aux cataclysmes naturels- de construire des digues, de détourner des cours d'eau, d'édifier des maisons qui puissent résister aux tremblements de terre ou aux ouragans.
Pire encore, ce n'est pas seulement dans l'incapacité du capitalisme à prévenir ces catastrophes qu'éclatent dans toute leur nudité les contradictions du système, mais aussi dans son inaptitude à remédier aux effets dévastateurs de ces catastrophes. Ce que la bourgeoisie appelle aujourd'hui l'"aide internationale" aux populations sinistrées est un ignoble mensonge. Ce sont tous les États, tous les gouvernements de la classe dominante, qui sont directement responsables des souffrances et de la détresse de ces centaines de millions d'êtres humains qui tombent chaque jour comme des mouches, victimes de la dysenterie, du choléra ou de la faim.
Alors que des dizaines de millions d'enfants sont aujourd'hui menacés par la famine, dans les grands centres industriels du capitalisme, ce sont des milliers de tonnes de lait qu'on détruit chaque année pour éviter une chute brutale des cours sur le marché. Alors que dans les pays ravagés par la mousson ou les cyclones, la population en est réduite à se battre pour une ration de céréales, les gouvernements des pays de la CEE prévoient de geler 20 % des terres cultivables pour cause de... surproduction !
Mais cette barbarie effroyable qu'engendre le capitalisme décadent ne se traduit pas seulement par son impuissance à soulager les souffrances des populations victimes de ces cataclysmes. C'est la crise permanente, insoluble, de ce système qui est elle-même une immense catastrophe pour toute l'humanité, comme le révèle en particulier le phénomène de paupérisation croissante de millions d'êtres humains réduits à l'indigence, à la misère la plus totale. L'incapacité du capitalisme décadent à intégrer dans le processus de production d'immenses masses de sans-travail ne touche pas seulement les pays arriérés. C'est au cœur même des États les plus industrialisés que la misère atroce dans laquelle sont plongés des dizaines de millions de prolétaires révèle chaque jour plus toute la pourriture de ce système. Non seulement à travers le développement massif du chômage auquel aucune "politique économique" n'est en mesure de remédier, mais encore à travers la généralisation de la pauvreté qui touche de plus en plus les ouvriers au travail. Et c'est dans l'État le plus riche du monde que cette paupérisation croissante de la classe ouvrière des pays les plus développés est aujourd'hui particulièrement édifiante avec le phénomène de clochardisation de masses immenses d'ouvriers. Ainsi, aux USA, ce sont maintenant des millions de travailleurs, pour la plupart salariés à plein temps (représentant 15% de la population et vivant au-dessous du seuil de pauvreté), qui sont transformés en sans-abri et contraints de dormir sur les trottoirs, dans les cinémas pornographiques (les seuls qui restent ouverts la nuit) ou dans des voitures, faute de pouvoir se payer un logement.
Plus le capitalisme est asphyxié par sa crise de surproduction généralisée, moins il est capable d'assurer le minimum vital à ceux qu'il exploite, de venir à bout des famines qui, dans des pays comme l'Éthiopie ou le Soudan, prennent aujourd'hui la forme de véritables génocides. Plus il avance dans la maîtrise de la technique, moins il l'utilise au service de la sécurité des populations.
Face à cette effarante réalité, que peuvent valoir toutes les campagnes "humanitaires" d'"aide aux sinistrés et aux affamés" orchestrées par les grandes "démocraties" occidentales, tous les appels aux "élans de solidarité" lancés par des célébrités de tous bords ? Quelle est l'"efficacité" réelle de toutes les entreprises caritatives qui, dans les pays avancés, distribuent des repas aux plus pauvres et les hébergent pour quelques nuits ? Quelle signification accorder aux subsides misérables distribués par certains États à ceux qui n'ont plus rien ? Au mieux, toutes ces aides réunies ensemble ne représentent qu'une goutte d'eau dans un océan de misère et de famine. Lorsqu'elles sont adressées aux pays du "tiers-monde", elles ne font que repousser de quelques semaines les échéances tragiques pour les populations concernées. Quand elles sont mises en place dans les pays avancés, elles permettent tout juste d'éviter que ceux-ci ne ressemblent pas trop aux précédents. En réalité, ces "aides" et ces "campagnes de solidarité" ne sont pas autre chose que de sinistres mascarades, un racket sordide et cynique dont la seule "efficacité" véritable réside dans leur capacité à acheter des "bonnes consciences", à faire oublier l'absurdité et la barbarie du monde actuel.
Car, aux meilleurs sentiments et à l'humanisme bourgeois, il y a des limites. Malgré les larmes de crocodile des curés et autres âmes charitables de tout poil, malgré la "bonne volonté" affichée par les gouvernements, ces limites sont dictées par le fait que la bourgeoisie ne peut détourner les lois de son système, et cela d'autant moins qu'après trois quarts de siècle de décadence, ces lois lui échappent totalement comme en témoignent aujourd'hui les catastrophes accidentelles en série qui frappent la population des pays les plus industrialisés.
Ces derniers mois, la multiplication des accidents ferroviaires, notamment dans le réseau urbain des grandes villes des pays les plus avancés, comme la France et la Grande-Bretagne, ont démontré que l'insécurité ne menaçait pas seulement les populations des pays sous-développés, mais le monde entier et dans tous les moments de la vie. Et, contrairement aux mensonges crapuleux de la bourgeoisie, ce ne sont pas les défaillances de tel ou tel conducteur de train qui sont responsables des accidents ferroviaires comme celui de la gare de Lyon à Paris en juin 1988 ou celui de Clapham Junction au sud de Londres en décembre 1988 ; ce n'est pas à une mauvaise gestion de l'économie que l'on doit l'état de délabrement actuel des moyens de production, la vétusté des moyens de transports, qui, chaque jour, tuent ou mutilent des centaines de vies humaines dans les pays les plus industrialisés.
Ces accidents en cascade ne sont que les conséquences désastreuses des politiques de "rationalisation" de la production où tous les États, dans leur quête insatiable de profit, de compétitivité face à l'aggravation de la crise économique mondiale, cherchent à faire des petites économies, au mépris des vies humaines, en grignotant sur tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers et de l'ensemble de la population. "Rationalisation" totalement irrationnelle où, en fait de rentabilité, le capitalisme se livre aujourd'hui à une destruction de plus en plus massive de forces productives. Destruction de force de travail non seulement avec le développement du chômage mais aussi avec les pertes en vie humaines et les mutilations que provoquent ces catastrophes de même que tous les accidents de travail résultant de cette "rationalisation". Destruction de moyens technologiques avec les fermetures d'usines, mais aussi avec les dégâts matériels causés par tous ces "accidents".
De même, des phénomènes tels que la pollution croissante qui empoisonne les cours d'eau, l'atmosphère et la population des villes, les "accidents" d'usines chimiques comme ceux de Seveso en Italie et de Bhopal en Inde, qui fit plus de 2000 morts, les catastrophes nucléaires comme celles de Three Miles Island et de Tchernobyl, les "marées noires" qui, régulièrement, viennent détruire la flore et la faune des littoraux, compromettant pour des décennies ou plus les réserves alimentaires des océans (comme on vient encore de le voir dans l'Antarctique), la destruction par les aérosols de la couche d'ozone qui protège les êtres vivants des rayons ultra-violets, la disparition rapide des forêts amazoniennes, principal poumon de la planète..., tous ces méfaits attribués par les écologistes au "progrès technologique" ne sont pas autre chose que des manifestations de la logique irrationnelle, suicidaire, du capitalisme décadent, de son incapacité totale à maîtriser les forces productives qu'il a mises en œuvre et qui risquent de compromettre pour des siècles, ou même définitivement, l'équilibre de la planète nécessaire à la vie de l'espèce humaine.
Et cette logique suicidaire, cet engrenage du capitalisme décadent dans la destruction, prend des dimensions bien plus terrifiantes encore avec la production massive d'engins de mort toujours plus sophistiqués. Toute la technologie la plus avancée est aujourd'hui orientée vers la production d'armements dans la perspective de massacres infiniment plus meurtriers encore que ceux qui se déchaînent à l'heure actuelle - même en temps de "paix" - dans les pays périphériques. Pour ce monstre sanguinaire qu'est le capitalisme décadent, l 'horreur ne connaît pas de limite.
Mais toutes ces destructions qu'engendre ce système moribond ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles ne sont que les manifestations caricaturales d'un phénomène plus général qui affecte tous les rouages de la société capitaliste. Elles ne traduisent rien d'autre que la réalité d'un monde en pleine décomposition.
LA DÉCOMPOSITION IDÉOLOGIQUE DE LA SOCIETE CAPITALISTE
Cette décomposition ne se limite pas au seul fait que le capitalisme, malgré tout le développement de sa technologie, se retrouve de plus en plus soumis aux lois de la nature, qu'il est incapable de maîtriser les moyens qu'il a mis en œuvre pour son propre développement. Elle n'atteint pas seulement les fondements économiques du système. Elle se répercute aussi dans tous les aspects de la vie sociale à travers une décomposition idéologique des valeurs de la classe dominante qui, en continuant de s'effondrer, entraînent à présent avec elles un écroulement de toute valeur rendant possible la vie en société, notamment par une tendance à l'atomisation croissante des individus.
Cette décomposition des valeurs bourgeoises n'est pas un phénomène nouveau. Elle était déjà marquée dès la fin des années 1960 par l'apparition de phénomènes marginaux qui pouvaient encore colporter l'illusion d'une possibilité de constituer les îlots d'une autre société, fondés sur d'autres rapports sociaux, au sein même du capitalisme.
C'est cette décomposition des valeurs de la classe dominante qu'exprimait déjà l'apparition des idéologies de type "communautaire" -fruit de la révolte des couches petites bourgeoises frappées par l'aggravation de la crise capitaliste et particulièrement affectées par la décomposition sociale- telles qu'elles furent véhiculées par le mouvement hippie ou encore par toutes sortes de courants préconisant le "retour à la terre", à la "vie naturelle", etc. En fondant leur existence sur une prétendue "critique radicale", contestataire du travail salarié, de la marchandise, de l'argent, de la propriété privée, de la famille, de la "société de consommation", etc., toutes ces communautés se présentaient comme autant de "solutions alternatives", "révolutionnaires", à l'effondrement des valeurs bourgeoises et à l'atomisation des individus. Toutes trouvaient leur justification dans l'illusion qu'il suffisait de "changer les mentalités" en multipliant ces expériences communautaires pour construire un monde meilleur. Cependant, ces idéologies minoritaires édifiées sur du sable - puisqu'elles émanaient de couches sociales qui, contrairement au prolétariat, n'ont aucun avenir historique - ne se contentaient pas de véhiculer des illusions, comme le confirme aujourd'hui leur faillite totale. Leur projet mégalomaniaque n'était, en réalité, qu'une parodie grotesque du communisme primitif. Cette nostalgie du retour à un type de société archaïque et dépassé depuis des millénaires ne traduisait rien d'autre qu'une idéologie parfaitement réactionnaire dont l'essence religieuse s'est d'ailleurs révélée par le fait que tous ces thèmes "purificateurs" furent amplement repris presque à la lettre par les sectes mystiques telles que Moon, Krishna et autres "Enfants de Dieu" qui se sont développées par la suite sur les décombres de ces communautés.
Aujourd'hui, les communautés des années 1970 ont cédé la place soit à ces sectes religieuses - pour la plupart largement exploitées, voire manipulées par l'État capitaliste et les services secrets des grandes puissances -, soit à des phénomènes plus éphémères encore tels que les grands rassemblements au sein des concerts rock organisés par des institutions bourgeoises comme SOS Racisme en France ou Amnesty International et qui, au nom de grandes causes humanitaires -la faim dans le monde ou la lutte contre l'Apartheid-, ne peuvent offrir aux nouvelles générations qu'un ersatz de communauté et de solidarité humaines.
Mais cette décomposition idéologique de la société capitaliste se traduit surtout depuis quelques années par le développement, au cœur des grandes métropoles industrielles, d'idéologies de type nihiliste -telle l'idéologie "punk", par exemple -, expressions d'une société qui est de plus en plus aspirée vers le néant.
Aujourd'hui, l'impasse économique dans laquelle est acculé le système capitaliste engendre une misère et une barbarie telles que c'est l'image d'un monde sans avenir, un monde au bord du gouffre, qui tend à s'imposer à toute la société. C'est l'évidence de cette impasse depuis le début des années 80 qui est venue balayer toutes les "solutions alternatives" de la décennie précédente. À l'utopie du "peace and love" des communautés hippies s'est substitué le "no future" des bandes de "punks", "hooligans" ou "skin heads" semant la terreur au cœur des grandes villes. Ce n'est plus l'amour, le pacifisme, la non-violence béate des idéologies marginales de la période précédente, mais la haine, la violence, le désir de tout casser, qui animent maintenant cette frange de la jeunesse livrée à elle-même dans un monde sans espoir, un monde qui n'a rien d'autre à lui offrir que la perspective du chômage, de la misère et d'une barbarie croissante.
Toute la vie sociale est aujourd'hui asphyxiée par les relents nauséabonds de cette décomposition des valeurs dominantes. C'est le règne de la violence, de la "débrouille individuelle", du "chacun pour soi", qui gangrène toute la société, et particulièrement ses couches les plus défavorisées, avec son lot quotidien de désespoir et de destruction : chômeurs qui se suicident pour fuir la misère, enfants qu'on viole et qu'on tue, vieillards qu'on torture et assassine pour quelques centaines de francs... Partout, l'insécurité, la terreur permanente, la loi de la jungle, le terrorisme, qui se développent de plus en plus dans les grandes concentrations industrielles, sont aujourd’hui une manifestation criante de l'état avancé de décomposition de cette société.
Quant aux médias, ils sont le reflet et le propagateur de cette décomposition. A la télévision, au cinéma, la violence est omniprésente, le sang et l'horreur éclaboussent quotidiennement les écrans, y compris dans les films destinés aux enfants. De façon systématique, obsédante, l'ensemble des moyens de communication participe à une gigantesque entreprise d'abrutissement des populations, et particulièrement des ouvriers. Tous les moyens sont bons : depuis l'occupation généralisée des écrans par les spectacles sportifs, où s'affrontent des "héros" gonflés aux anabolisants, jusqu'aux appels à participer à toutes sortes de loteries et autres jeux de hasard grâce auxquels, en échange des dernières pièces de monnaie qu'on peut grappiller dans leurs poches, on vend, semaine après semaine, ou même jour après jour, l'espoir illusoire d'une vie meilleure à ceux que la misère prend à la gorge. En fait, c'est l'ensemble de la production culturelle qui, aujourd'hui, exprime la pourriture de la société. Non seulement le cinéma et la télévision, mais également la littérature, la musique, la peinture ou l'architecture, ne savent de plus en plus qu'exprimer et générer l'angoisse, le désespoir, l'éclatement de la pensée, le néant.
Une des manifestations les plus flagrantes de toute cette décomposition est à l'heure présente le développement de plus en plus massif de la drogue. Sa consommation prend aujourd'hui une signification nouvelle, exprimant non plus la fuite dans les chimères, comme c'était le cas dans les années 70, mais une fuite en avant effrénée dans la folie et le suicide. Ce n'est plus pour "planer" collectivement autour d'un "joint" de marijuana que toute cette partie de la jeunesse s'accroche aux drogues les plus dures, mais pour "s'éclater", "se défoncer".
Et c'est toute la société qui est maintenant affectée par ce cancer et non pas les seuls consommateurs. En particulier, ce sont les États eux-mêmes qui sont aujourd'hui gangrénés de l'intérieur par un tel phénomène. Non seulement ceux du "tiers-monde", comme la Bolivie, la Colombie, le Pérou, où l'exportation de la drogue est la principale activité leur permettant de maintenir leur économie à flot, mais également les USA, qui sont aujourd'hui un des premiers producteurs du monde de cannabis avec une exploitation représentant la troisième récolte nationale en valeur après le mais et le soja.
Là encore, le capitalisme se trouve confronté à une contradiction insurmontable. D'un côté, ce système ne peut tolérer l'usage massif de la drogue (dont la consommation annuelle aux USA représente environ 250 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la défense US), qui, en favorisant le développement de la criminalité, des maladies mentales ou des épidémies comme le SIDA, constitue une véritable calamité du point de vue strictement économique ; de l'autre, c'est le trafic de cette marchandise qui constitue aujourd'hui un des piliers de l'État, comme on le voit, non seulement dans les pays sous-développés tels le Paraguay ou le Surinam, mais également au sein de l'État "démocratique" le plus puissant du monde, les USA.
Ainsi, c'est en grande partie grâce aux exportations de cannabis que sont financés les services secrets américains, à tel point que Bush, qui se fait aujourd'hui le champion de la campagne anti-drogue aux USA, a lui-même directement trempé dans le trafic en tant que chef de la CIA. Et toute cette corruption liée au commerce de la drogue, ce pourrissement dont se nourrit aujourd'hui l'État capitaliste à travers les mœurs de gangsters de ses dirigeants, ne sont pas une spécificité des pays producteurs de drogue. Tous les États sont directement contaminés comme en témoigne encore tout récemment le scandale du blanchiment des "narco-dollars" dans lequel était impliqué le mari de l'ex-ministre de la Justice d'un pays aussi "propre" que la Suisse.
Ce n'est d'ailleurs pas uniquement autour de la drogue que se développe toujours plus la corruption de l'appareil politique de la bourgeoisie : la pourriture ne cesse de progresser dans tous les domaines. A l'heure actuelle, à tous les horizons de la planète, il ne se passe pas un mois sans qu'éclate un nouveau scandale éclaboussant les plus hauts dignitaires de l'État (et comme toujours, ces scandales ne révèlent qu'une infime partie de la réalité). Par exemple, en ce moment même, au Japon, nous en arrivons à une situation où ce sont pratiquement tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, qui sont mouillés dans une énorme affaire de corruption. La pourriture est telle que la bourgeoisie a les plus grandes peines du monde à trouver des hommes politiques "présentables" pour remplacer les ministres démissionnaires, et lorsqu'elle pense avoir enfin découvert un tel "oiseau rare", un "véritable incorruptible", c'est pour qu'on découvre au bout de quelques jours qu'il n'avait pas été parmi les derniers à se faire généreusement "arroser".
Et le Japon n'est pas, évidemment, le seul pays avancé où se produisent de tels événements. Dans un pays comme la France, c'est le Parti socialiste, dont les thèmes électoraux, pourtant, dénoncent traditionnellement "les puissances d'argent", qui se trouve en première ligne d'une affaire de "délit d'initié" (utilisation des informations secrètes obtenues dans l'entourage du pouvoir pour s'enrichir en quelques heures), et c'est un ami intime d'un président réputé pour ses dénonciations de l'"argent corrupteur" qui figure parmi ceux qui s'en sont mis plein les poches. D'ailleurs, la spéculation boursière, qui constitue le moyen de cet enrichissement, est elle-même significative, par l'ampleur phénoménale qu'elle est en train de prendre, de la pourriture de la société capitaliste où la bourgeoisie, tels les "flambeurs" de la roulette, draine la plus grande partie de ses capitaux, non pas vers les investissements productifs, mais vers les "coups de dés" destinés à rapporter gros, tout de suite. De plus en plus, les Bourses ressemblent aux salles de jeu de Las Vegas.
Si, jusqu'à présent, le capitalisme avait pu repousser à la périphérie (les pays sous-développés) les manifestations les plus extrêmes de sa propre décadence, cette pourriture lui revient aujourd'hui comme un boomerang, le touchant en son cœur même. Et cette décomposition qui gagne les grands centres industriels n'épargne désormais aucune classe sociale, aucune classe d'âge, même pas les enfants.
Jusque maintenant on connaissait la criminalité et la délinquance des enfants dans les pays du "tiers-monde" où le marasme économique chronique plonge depuis des décennies les populations dans une misère atroce et le chaos généralisé. Aujourd'hui, la prostitution des enfants sur les trottoirs de Manille ou les mœurs de gangsters des gamins de Bogota ne sont plus des fléaux lointains et exotiques. C'est au cœur même de la première puissance mondiale, dans l'État le plus développé des USA - la Californie - qu'apparaît maintenant ce phénomène, aux portes de la Silicon Valley, région où se trouve concentrée la technologie la plus avancée du monde. Aucune image ne peut résumer de façon plus édifiante les contradictions insolubles que porte en lui le capitalisme décadent. D'un côté, une accumulation gigantesque de richesses, de l'autre, une misère effroyable qui entraîne aujourd'hui des bandes d'enfants dans des mœurs suicidaires : fuite en avant de fillettes à peine pubère dans la prostitution quand ce n'est pas, en quête d'une raison de vivre, dans la maternité ; fuite en avant dans la consommation et le trafic de drogue, où ce sont des gosses de huit à dix ans qui sont happés dans la spirale infernale du banditisme, du meurtre organisé (dans la seule ville de Los Angeles, ce ne sont pas moins de 100 000 enfants - membres de gangs responsables de 387 meurtres en 1987 - qui se partagent le marché de détail de la drogue).
Mais ce n'est pas seulement aux USA que le capitalisme pourrissant sème chaque jour le désespoir et la mort au sein des jeunes générations. Dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, outre le développement pharamineux, ces dix dernières années, de la délinquance et de la toxicomanie chez les adolescents, le taux de suicides parmi les jeunes prend aujourd'hui des proportions désastreuses. Ainsi, la France, par exemple, est actuellement, avec la Belgique et la RFA, un des pays d'Europe occidentale qui connaît le taux de suicides le plus élevé chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans. Avec une moyenne officielle de 1000 suicides par an, représentant plus de 13 % du taux de mortalité dans cette tranche d'âge (alors qu'il est de 2,5 % pour l'ensemble de la population), les chiffres ont triplé entre 1960 et 1985. Sans compter les tentatives de suicide manquées qui, elles, sont dix fois plus nombreuses dans cette même tranche d'âge !
Toutes les manifestations de décomposition de cette société qui regarde aujourd'hui mourir ses enfants nous renvoient ainsi l'image hallucinante d'un monde qui court à sa propre perte. Le capitalisme est semblable à un organisme qui est arrivé au bout du rouleau et dont le maintien artificiel en vie ne peut se traduire que par un pourrissement de tous ses organes.
SEUL LE PROLÉTARIAT PEUT SORTIR LA SOCIETE DE CETTE IMPASSE
La décomposition générale de la société n'est pas un phénomène nouveau. Toutes les sociétés décadentes du passé ont connu un tel phénomène. Mais, comparées à celles des modes de production antérieurs, les manifestations de pourrissement de la société actuelle prennent les formes d'une barbarie jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. De plus, contrairement aux sociétés du passé, où plusieurs modes de production pouvaient exister simultanément dans différentes régions du monde, le capitalisme est devenu un système universel, un système qui a soumis le monde entier à ses propres lois. De ce fait, les différentes calamités pouvant toucher telle ou telle partie de la planète se répercutent inévitablement partout ailleurs, comme en témoigne, par exemple, l'extension à tous les continents de maladies telles que le SIDA. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, c'est toute la société humaine qui est menacée d'être engloutie par les manifestations de ce phénomène de décomposition. Par ailleurs, une telle barbarie est liée au fait qu'il n’existe aucune possibilité pour que surgissent, au sein du capitalisme, les fondements d'une nouvelle société. Alors que dans le passé, les rapports sociaux de même que les rapports de production d'une nouvelle société en gestation pouvaient éclore au sein même de l'ancienne société en train de s'effondrer (comme c'était le cas pour le capitalisme qui a pu se développer au sein de la société féodale en déclin), il n'en est plus de même aujourd'hui. La seule alternative possible ne peut être que l'édification, SUR LES RUINES DU SYSTÈME CAPITALISTE, d'une autre société - la société communiste - qui pourra apporter une pleine satisfaction des besoins humains grâce à un développement considérable, un épanouissement et une maîtrise des forces productives que les lois mêmes du capitalisme rendent impossibles. Et la première étape de cette régénération de la vie sociale ne peut être que le renversement du pouvoir de la bourgeoisie par la seule classe qui soit aujourd'hui en mesure d'offrir un avenir à l'humanité, le prolétariat mondial :
"C'est parce que dans le prolétariat développé l’abstraction de toute humanité, et même de toute APPARENCE d'humanité, est achevée en pratique ; c'est parce que les conditions d'existence du prolétariat résument toutes les conditions d'existence de la société actuelle parvenues au paroxysme de leur inhumanité ; c'est parce que, dans le prolétariat l'homme s'est perdu lui-même, mais a acquis en même temps la conscience théorique de cette perte et, qui plus est, se voit contraint directement, par la MISERE désormais inéluctable, impossible à farder, absolument impérieuse-expression pratique de la NECESSITE - à se révolter contre cette inhumanité : c'est pour toutes ces raisons que le prolétariat peut et doit se libérer lui-même. Toutefois, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions d'existence. Il ne peut abolir ses propres conditions d'existence sans abolir TOUTES les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle que sa propre situation résume." (K. Marx, La Sainte Famille.)
Ce que Marx écrivait déjà au siècle dernier, à l'époque où le capitalisme était un système florissant, est encore plus vrai aujourd'hui. Face à cette décomposition qui menace la survie même de l'homme, seul le prolétariat, de par la place qu'il occupe dans les rapports de production capitaliste, est en mesure de sortir l'humanité de sa préhistoire, de construire une véritable communauté humaine.
Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la forme ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle.
C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique.
Plus le capitalisme va s'enfoncer dans sa propre décadence, plus il va prolonger son agonie, moins la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme sera épargnée par tous les effets dévastateurs de la putréfaction de ce système.
Ce sont en particulier les nouvelles générations de prolétaires qui sont aujourd'hui directement menacées par ce danger de contamination qui gangrène toutes les couches de la société. Le désespoir menant au suicide, l'atomisation et la débrouille individuelle, la drogue, la délinquance et tout autre phénomène de marginalisation -tel que la clochardisation des jeunes chômeurs qui n'ont jamais été intégrés au processus de production- sont autant de fléaux qui risquent d'exercer une pression vers la dissolution et la décomposition du prolétariat et, partant, d'affaiblir ou même de remettre en cause sa capacité à réaliser sa tâche historique de renversement du capitalisme.
Toute cette décomposition, qui infeste de plus en plus les jeunes générations, peut ainsi porter un coup mortel à la seule force porteuse d'avenir pour l'humanité. De la même façon que le déchaînement de la guerre impérialiste au cœur du monde "civilisé" avait, comme le disait Rosa Luxemburg en 1915 dans La Brochure de Junius, anéanti, décimé, en quelques semaines "les troupes d'élite du prolétariat international, fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations", de même le capitalisme pourrissant peut faucher, dans les années à venir, la "fine fleur" du prolétariat, qui constitue notre seule force, notre seul espoir.
Face à la gravité des enjeux que pose cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, les révolutionnaires doivent alerter le prolétariat contre le risque d'anéantissement qui le menace aujourd'hui. Ils doivent, dans leur intervention, appeler la classe ouvrière à trouver dans toute cette pourriture qu'elle subit quotidiennement en plus des attaques économiques contre l'ensemble de ses conditions de vie une raison supplémentaire, une plus grande détermination pour développer ses combats et forger son unité de classe. De la même façon qu'elle doit comprendre que ses luttes contre la misère et l'exploitation portent en elles l'abolition de la barbarie guerrière, de même elle doit prendre conscience que le développement, l'unification de ses combats, sont seuls en mesure de sortir l'humanité de l'enfer capitaliste, de ce suicide collectif vers lequel la décomposition de ce vieux monde entraîne toute la société.
Les luttes actuelles du prolétariat mondial pour son unité et sa solidarité de classe, notamment dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, constituent l'unique lueur d'espoir au milieu de ce monde en pleine putréfaction. Elles seules sont en mesure de préfigurer un certain embryon de communauté humaine. C'est de la généralisation internationale de ces combats que pourront enfin éclore les germes d'un monde nouveau, que pourront surgir de nouvelles valeurs sociales. Et ces valeurs ne s'étendront à l'ensemble de l'humanité qu'avec l'édification par le prolétariat d'un monde débarrassé des crises, des guerres, de l'exploitation et des miasmes de toute cette décomposition. Le désespoir dans lequel se trouvent plongées de plus en plus toutes les couches non exploiteuses de la société ne pourra ainsi être surmonté que lorsque la classe ouvrière s'acheminera DE FAÇON CONSCIENTE dans cette perspective.
Et c'est au prolétariat le plus concentré, le plus expérimenté du monde -celui des pays d'Europe occidentale - que revient la responsabilité historique de se porter à l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale dans sa marche vers ce but. L'étincelle qui surgira de ses combats sera seule en mesure de déclencher l'incendie de la révolution prolétarienne.
Avril (22/2/1989)
Questions théoriques:
- Décomposition [1529]
Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme
- 10341 reads
A la fin des années 80, les médias multiplient les bilans économiques de la décennie. Ils se contentent, dans l'ensemble, de constater des faits, avec un regard plus ou moins optimiste ou pessimiste, suivant les cas, mais avec toujours la même myopie historique : au-delà du capitalisme, il ne peut y avoir que le néant. Les "experts" ne scrutent la réalité économique qu'à la recherche des moyens d'entretenir la vie du système existant, considéré comme un ensemble de lois naturelles, éternelles, indestructibles.
Pourtant, depuis la seconde guerre mondiale, les années 80 ont été les plus barbares du point de vue du développement de la misère dans le monde, les plus violentes contre la classe ouvrière, mais aussi été les plus autodestructrices pour le capital, dont les contradictions internes se sont exacerbées à l'extrême.
Si nous examinons cette réalité, ce n'est pas pour larmoyer sur la misère croissante ni pour chercher des remèdes pour la machine capitaliste en proie aux pires difficultés. Ce dont il s'agit, c'est de dénoncer, une fois encore le renforcement de l'exploitation et de la barbarie dans laquelle la survie des lois capitalistes plonge de plus en plus l'humanité; mais aussi, de mettre en évidence l'affaiblissement économique des fondements mêmes du système capitaliste, son enfermement dans ses propres contradictions. Bref, il s'agit de mesurer l'évolution économique des années 80 à l'aune de la maturation des conditions de la révolution communiste.
A travers les différents articles analysant la situation économique dans les numéros précédents de cette revue, nous avons déjà en grande partie tirée un bilan de cette décennie. (Voir en particulier Revue Internationale n° 54, 56.) Nous nous proposons ici surtout de fournir un ensemble de statistiques qui illustrent ce que nous avons déjà dit. Les statistiques économiques, même les plus déformées, contredisent violemment ceux qui saluent les années 80 comme celles d'un nouveau capitalisme, plus "agressif et plus "efficace", qui aurait retrouvé sa force et une capacité à améliorer les conditions matérielles d'existence de la société.
Nous utiliserons évidemment les statistiques officielles, seules disponibles, en sachant ce qu'elles valent. Contrairement à la période où Marx devait passer des journées dans les bibliothèques de Londres à la recherche de quelques maigres statistiques pour analyser l'évolution du système économique qu'il combattait, aujourd'hui, le capitalisme offre, du moins dans les pays les plus développés, un énorme ensemble de statistiques. Celles-ci sont le produit du développement de la tendance au capitalisme d'Etat, qui exige une gestion plus "globale" de l'économie et du fait qu'il s'agit de gérer une machine de plus en plus complexe et contradictoire. Mais il faut considérer en outre la volonté des gouvernements de fournir de prétendus justificatifs économiques aux politiques dites d'"austérité" qu'ils imposent aux classes exploitées. Quelles que soient les déformations, parfois énormes, de la réalité que ces statistiques contiennent (nous y reviendrons), elles tendent à mentir toujours dans le sens de la défense de l'ordre établi. Le fait qu'elles permettent de mettre en évidence les faillites et les faiblesses de ce système ne peut que renforcer, dans la plupart des cas leur pouvoir démonstratif.
Pour tirer un bilan économique de ces années, nous distinguerons deux aspects de la réalité qui, bien qu'étant étroitement liés et dépendants entre eux, n'en sont pas moins distincts : d'une part, l'évolution des conditions d'existence de l'ensemble de l'humanité et en particulier de celles de la classe ouvrière; d'autre part, la "santé" des mécanismes internes de la machine capitaliste, le développement de ses contradictions.
LE CAPITAL CONDUIT L'HUMANITE A L'AGONIE
Pour le capitalisme, assurer la subsistance des exploités ne constitue pas un objectif mais un "pis aller", un "frais de production". Comme les systèmes d'exploitation du passé (esclavagisme, féodalisme), le capitalisme est contraint de nourrir la classe exploitée pour pouvoir en extirper du surtravail. Mais, à la différence de l'esclave et du serf féodal, qui telles les bêtes de somme, étaient toujours nourris, quel que fut le travail à faire, le prolétaire du capitalisme n'a accès aux biens nécessaires à sa subsistance qu'à condition d'être embauché :
"...le prolétariat, la classe des travailleurs modernes, qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail, et qui ne trouvent de l'ouvrage qu'autant que leur travail accroît le capital. Ces travailleurs sont obligés de se vendre morceau par morceau, telle une marchandise; et, comme tout autre article de commerce, ils sont livrés à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché." (Marx, Le Manifeste communiste, "Bourgeois et prolétaires".)
C'est pourquoi tout ralentissement de la croissance capitaliste se traduit inévitablement par un développement de la misère et de la pauvreté. Dans le capitalisme, décadent, où l'essor des forces productives rencontre une entrave chronique, la misère matérielle connaît une extension et une ampleur sans précédent dans l'histoire. La réalité des pays sous-développés ([1] [1530]) en est une des manifestations les plus criantes. Dans ces pays vit, à côté d'une bourgeoisie locale étalant ses richesses et régnant souvent avec les formes les plus barbares d'oppression, une partie croissante de l'humanité dans des conditions de pauvreté absolue. Quel est le bilan des années 80 à l'égard de cette réalité ?
La Banque mondiale, cet organisme financier international chargé plus spécifiquement des pays qu'il appelle hypocritement "en voie de développement", tire un bilan catastrophique dans son dernier rapport de 1988 :
"La pauvreté s'aggrave : entre 1970 et 1980, le nombre de mal nourris est passé de 650 millions â 730 millions dans les pays en développement (Chine exclue). Et, depuis 1980, la situation a encore empiré : les taux de croissance économique se sont tassés, les salaires réels ont diminué et la croissance de remploi s'est ralentie dans la plupart de ces pays. Les fortes baisses des prix des produits de base ont réduit les revenus ruraux et les dépenses publiques affectées aux services sociaux ont diminué en valeur réelle.
On manque de données complètes sur la pauvreté, en particulier pour les années les plus récentes, mais des données fragmentaires provenant de divers pays confirment l'impression générale d'une dégradation des conditions sociales dans bien des pays. Les auteurs d'une étude récente ont constaté que le nombre de personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté a augmenté au moins jusqu en 1983-1984 au Brésil, au Chili, au Ghana, à la Jamaïque, au Pérou et aux Philippines, et que la tendance à l'amélioration des normes de santé, de nutrition et d'éducation des enfants s'était, dans bien des cas, nettement inversée. Selon d'autres sources, la ration calorique quotidienne par habitant aurait diminué entre 1965 et 1985 dans 21 des 35 pays en développement à faible revenu. Entre 1979 et 1983, l'espérance de vie a baissé dans neuf pays d'Afrique subsaharienne. En Zambie, le nombre des nourrissons et des enfants morts de malnutrition a doublé entre 1980 et 1984 et, au Sri Lanka, la consommation calorique des 10 % de la population les plus pauvres a diminué de 9 % entre 1979 et 1982. Au Costa Rica, la baisse des salaires réels en 1979-1982 a accru le nombre de pauvres de plus de deux tiers. Dans les pays en développement à faible revenu, le montant réel par habitant des dépenses publiques d'éducation et de santé a stagné entre 1975 et 1984. Dans six d'entre eux, le nombre de médecins, rapporté à la population, a diminué entre 1965 et 1981 et, dans douze pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne, les taux de scolarisation dans le primaire ont baissé. "
(Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1988.)
On ne pourrait accuser une des principales institutions bancaires internationales d'anti-capitalisme. Pourtant, son bilan est sévère. C'est que la réalité est trop criante. Et que, de toute façon, pour les "experts" de la Banque mondiale, un tel bilan n'est qu'un appel à plus de capitalisme, plus de développement capitaliste. En aucun cas, ils n'envisageraient même l'idée qu'il puisse s'agir d'une inadéquation définitive des lois économiques capitalistes elles-mêmes ; pour eux, celles-ci sont aussi "naturelles" que la loi de la pesanteur. Alors qu'ils assistent à une des périodes les plus critiques et aberrantes, du point de vue économique, de l'humanité, alors qu'ils mesurent, statistiques en main, l'écroulement barbare du mode de production qu'ils représentent, ils prétendent qu'il ne s'agit en réalité que de "divergences de politique macro-économique" entre les grandes puissances, de politiques budgétaires trop "laxistes" ou trop restrictives", ou enfin de la réduction par les gouvernements des pays les plus développés des "dépenses affectées à la lutte contre la pauvreté". Ils ne montrent l'aggravation de la misère que pour mieux affirmer qu'on peut la combattre, avec de "bonnes politiques" capitalistes, alors que c'est la survie même du système capitaliste qui engendre de plus en plus cette misère.
La paupérisation est générale et s'accélère depuis la fin des années 70. Les années 80 l'ont vu s'approfondir et s'étendre, plongeant les pays les moins développés dans la banqueroute pure et simple. La Banque mondiale fournit des chiffres parlants à cet égard :
Le concept même de PIB est trompeur puisqu'il comptabilise également toutes sortes d'activités économiques, la production de pain comme celle de canons, le travail des prolétaires comme celui de spéculateurs financiers ou de militaires supposés produire l'équivalent de leur revenu. Il ne s'en dégage pas moins clairement l'appauvrissement qui caractérise les années 80.
Le cas des "pays exportateurs de produits manufacturés" regroupe une minorité de pays dont le caractère exceptionnel ne fait que mettre plus en relief l'effondrement de l'ensemble. Il suffit de rappeler que cinq pays (Brésil, Mexique, Taiwan, Corée du Sud, Singapour) réalisent 75 % des exportations manufacturières de l'ensemble des pays sous-développés.
Sur l'ensemble des capitaux de ces pays pèse en outre un endettement massif. Celui-ci, après avoir permis à certains d'entre eux de connaître une certaine croissance illusoire au cours des années 70, pèse aujourd'hui sous la forme d'intérêts et de capitaux à rembourser. Ce poids ne s'est pas allégé au cours des années 80 mais s'est au contraire renforcé :
Un des facteurs principaux qui entretient le sous-développement de ces pays est le fait que la quasi-totalité d'entre eux tirent leur revenu extérieur essentiellement de l’exportation de produits de base, agricole ou minéral. Or le cours de ces produits s'effondre dès que la machine industrielle des pays les plus développés se ralentit. Cet effondrement des cours se trouve en outre renforcé par la hausse des prix des produits manufacturés par les pays les plus industriels. Le ralentissement général de la croissance mondiale au cours des années 80 n'a pas manqué d'agir fortement en ce sens :
Le poids de l'endettement, intérêts et capitaux à rembourser, l'effondrement des cours de leurs produits d'exportation, font retomber sur ces pays les effets de la crise des années 80 de façon particulièrement dévastatrice. La bourgeoisie s'y est vue contrainte de réduire de façon draconienne les importations traduisant cela par une chute des investissements et par une réduction massive de la consommation des classes exploitées et de l'ensemble de la population marginalisée :
Comme toujours, ce sont les classes exploitées et les "sans-travail" qui subissent le plus violemment les effets de la crise. Les bourgeoisies locales, qui ne sont qu'une partie de la bourgeoisie mondiale et reçoivent une grande partie de leurs revenus en dollars des capitaux qu'elles ont investis dans les pays centraux, en particulier au cours des années 80, exécutent la besogne avec la brutalité qui les caractérise.
Mais certains diront qu'il n'y a là rien de vraiment nouveau pour le capitalisme qui, depuis ses débuts, a réservé un sort particulièrement sévère pour les travailleurs de ses colonies, et que la situation des travailleurs des pays centraux est tout autre. Il n'en est rien.
LE CAPITAL SAIGNE A BLANC LE PROLETARIAT DANS LES PAYS LES PLUS INDUSTRIALISES
L'aggravation des conditions d'existence des travailleurs dans les pays moins industrialisés au cours des années 80 s'est accompagnée d'une attaque non moins violente dans les zones les plus développées, même si le niveau de départ y est beaucoup plus élevé et que la classe ouvrière y dispose d'une force qui lui permet de mieux résister. Dans un récent rapport la Commission européennes de Bruxelles estimait qu'il y avait dans la CEE, en 1985 (date des dernières estimations disponibles), 40 millions de personnes, 6 millions de plus que dix ans auparavant, considérées comme pauvres ("ayant un revenu inférieur à la moitié du revenu moyen de leurs pays").
Le chômage
Le chômage constitue sans aucun doute la plus puissante et la plus déterminante manifestation de cette attaque. Son développement au cours des années 80 a eu des conséquences sur tous les aspects de la vie de l'ensemble de la classe ouvrière : pour les chômeurs ayant la "chance" de percevoir une allocation, avec ou sans "stages de formation" et autres "travaux d'utilité publique", cela a été une chute rapide et continue du revenu; pour ceux qui n'ont pas eu cette chance (une proportion toujours plus grande), ça a été l'indigence, la misère complète; pour les travailleurs restés actifs, la généralisation du chômage s'est traduite par une baisse des salaires, par la généralisation de la précarité de toute situation de travail, par l'intensification de l'exploitation sous menace de licenciements, par le renforcement de la répression politique dans les lieux de travail; pour les jeunes de la classe ouvrière, ça a été la menace de désespoir dans l'atomisation; pour tous, c'est l'étau d'acier du capitalisme qui s'est serré de plusieurs crans.
Depuis le milieu des années 80, après l'explosion mondiale du chômage qui a accompagné la récession de 1979-82, les gouvernements de certains pays, tels les Etats-Unis ou l'Angleterre affirment, chiffres à l'appui, être parvenus à faire baisser le chômage. En réalité, ils sont surtout parvenus à modifier les statistiques et les définitions du "chômage".
Mais, même en prenant en compte les statistiques les plus officielles et les plus déformées, le bilan des années 80, mises à part quelques rares exceptions, fait ressortir une augmentation générale et nette du chômage dans les pays les plus industrialisés :
On imagine mal à quel point ces chiffres sous-estiment consciemment, déguisent délibérément la réalité. Au cours des années 80, il y a eu une série de révisions de la façon de comptabiliser le chômage : la raison invoquée a été celle de standardiser internationalement les mesures, la définition modèle étant celle du Bureau international du travail (BIT).
Les estimations, car il s'agit toujours d'"estimations", sont basées sur des sondages, et partiellement, et dans certains pays, sur les listes de chômeurs inscrits dans les bureaux de chômage. Dans les enquêtes, les chômeurs sont définis comme ceux qui ne sont pas des "personnes au travail". Et ce dernier ensemble est défini comme les "personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature; (...) on peut interpréter la notion de travail effectué au cours de la période de référence comme étant un travail d'une durée d'une heure (!) au moins."
C'est-à-dire qu'une personne ayant "travaillé", de quelque façon que ce soit, pendant une heure au cours de la semaine d'enquête n'est pas considérée comme "chômeur". C'est ainsi que le développement de la précarité de l'emploi, la multiplication des "petits travaux", des "stages", ne se traduit pas dans les statistiques par une augmentation mais par une diminution du chômage. Il faut encore signaler, parmi d'autres déformations de ces statistiques, que les travailleurs mis à la préretraite forcée ou les jeunes "en formation" ne sont pas non plus considérés comme chômeurs.
Malgré toutes ces tricheries grossières, les statistiques officielles comptent, pour la période 1979-1987 une augmentation de 1,5 million de chômeurs en Amérique du Nord, de 6 millions et demi en Europe occidentale, de 11 millions dans les 24 pays de l'OCDE.
Une autre mesure statistique, bien qu'aussi très sous-estimée, donne une image de la dégradation des conditions des prolétaires des pays industrialisés : la proposition de chômeurs de "longue durée". Celle-ci n'a fait qu'augmenter au cours des années 80 :
Les salaires réels
S'il est des chiffres que les gouvernements déforment, ce sont ceux qui mesurent les salaires en termes "réels", c'est-à-dire compte tenu de la perte de pouvoir d'achat de la monnaie par l'inflation. Et pour cause, c'est sur leur base que le gouvernement fixe le niveau des salaires. Il est connu que, dans tous les pays, les indices des prix à la consommation sont toujours sous-estimés ne fût-ce que parce que les biens de première nécessité, qui ont une part si importante pour les bas revenus, sont sous-représentés dans le calcul de ces indices. Quel ouvrier ne s'est pas indigné en regardant les chiffres de l'inflation annoncés à la télévision et leur décalage avec ce qu'il constate tous les jours dans les magasins ?
Une autre façon de déformer la réalité est le calcul des rémunérations par salarié. Pour ce faire, les statistiques disponibles sont celles de "la masse salariale", c'est-à-dire la somme de TOUS les salaires, y compris ceux des hauts fonctionnaires, cadres, dirigeants d'entreprise, etc., qui sont aussi considérés "salariés" même si l'essentiel de leur revenu est fait de plus-value extirpée aux prolétaires tout comme les revenus des capitalistes actionnaires.
De manière générale, les chiffres sur le niveau des salaires concernent le revenu par salarié ou par heure de travail, et non par ménage. De ce fait, la baisse de revenu provoquée par la perte d'emploi d'un des membres de la famille, ou par l'entretien de jeunes au chômage restés à la maison, n'apparaît pas. Elle est pourtant une donnée cruciale dans une époque où il faut deux salaires pour entretenir un foyer.
Malgré toutes ces réserves, le calcul de la rémunération réelle par salarié fait ressortir nettement le sens de la dégradation qui s'est réalisée pendant les années 80 :
Ces chiffres sont des moyennes annuelles et font apparaître des taux parfois encore positifs pour 1980-87. En réalité, au début des années 80, la variation des salaires réels par tête est dans beaucoup de cas négative. C'est en Suède, la "socialiste", que l'attaque contre les salaires est la plus importante : la chute du salaire réel par tête, par rapport à son niveau de 1976, était déjà de -6 % en 1980; elle atteint -14 % en 1986, et ce ne sont pas les légères augmentations de 1987 qui ont permis de rattraper cette dégradation.
Les données officielles sur le chômage, sur sa durée, sur le niveau des salaires réels, ne livrent qu'un aspect de la réalité de la dégradation de la condition de la classe ouvrière. Elles ne prennent pas en considération qu'une partie importante du revenu des ouvriers, en particulier en Europe occidentale, est fournie par le capital sous forme indirecte à travers les dites "dépenses sociales" : allocations chômage, retraites, services de santé, d'éducation, etc. La forte dégradation de ces prestations au cours des années 80 n'est un mystère pour personne. La multiplication des luttes contre les licenciements et contre la détérioration des conditions de travail qui en découle, de la part des travailleurs de l'école, de la santé ou des transports publics, au cours des années 80, en est une manifestation.
Il faut considérer en outre dans ce bilan des années 80, la dégradation des conditions générales d'existence provoquée par le développement de phénomènes telle la pollution (rendre nocifs à l'existence humaine l'air, les eaux, la terre, les villes, etc.) la désorganisation croissante de la production et donc de la vie sociale - sauf la répression - la décomposition qui se généralise. (Voir dans cette revue l'article "La décomposition de la société capitaliste".)
Dans les pays les plus industrialisés comme dans les pays sous-développés et dans les pays de l'Est, qui pour beaucoup entrent dans cette dernière catégorie (nous traiterons spécifiquement du bilan des années 80, dans les pays de l'Est, dans le prochain numéro de la Revue Internationale) pour la classe ouvrière, pour l'ensemble de la population qui ne fait pas partie des classes dominantes, le bilan des années 80 est totalement négatif.
Certains "experts" se chargent de consoler la population en expliquant, à longueur de temps sur les antennes, que cela aurait pu être bien pire si de tels sacrifices n'avaient pas été consentis; qu'il s'agit de secousses de "la restructuration après les deux chocs pétroliers des années 70". Mais que, demain, cela ira mieux à condition que chacun sache travailler encore plus dur et accepter plus de privations. "Rendre compétitif le capital national face à la concurrence étrangère", telle est la rengaine éternelle à laquelle aboutissent tous les "raisonnements" des "experts économistes" : "Sacrifiez-vous encore plus pour le système qui vous détruit !"
Ils appellent à la sauvegarde d'une forme d'organisation sociale qui, depuis plus de trois quarts de siècle, depuis la première guerre mondiale, a plongé l'humanité dans une des périodes les plus difficiles et autodestructrices de son histoire : deux guerres mondiales et le développement des instruments pour faire disparaître la planète en cas d'une troisième, les pires famines de l'histoire.
Ils appellent à la défense d'un système social qui, depuis 20 ans, s enfonce dans une crise toujours plus profonde et étendue, une crise dont les années 80 ont apporté la preuve définitive qu'elle était irréversible.
LE CAPITAL RUINE LES BASES DE SA PROPRE EXISTENCE
La perspective d'un dépassement du capitalisme, la perspective d'un bouleversement révolutionnaire de l'ordre établi mondialement, ne repose pas seulement sur le mécontentement et l'exaspération des classes exploitées; pour que ce mécontentement puisse s'unifier, se renforcer et aboutir à un processus révolutionnaire international - et c'est seulement à cette échelle qu'il peut véritablement exister-, il faut qu'éclate ouvertement l'incapacité définitive du système dominant de remplir sa fonction économique élémentaire. Il faut que la machine d'exploitation s'affaiblisse dans ses fondements, qu'elle se trouve de plus en plus bloquée par ses propres contradictions. Pour reprendre la fameuse formule de Lénine : "Il ne suffît pas que ceux d'en bas ne veuillent plus, encore faut-il que ceux d'en haut ne puissent plus." De ce point de vue, le bilan des années 80 est une confirmation du développement des conditions de la perspective révolutionnaire.
Les années 80 sont, en effet, clairement marquées par un nouveau ralentissement simultané de la croissance de la production et du commerce mondial :
Un des traits les plus significatifs de ce ralentissement est le fait qu'il a été plus marqué dans le commerce que dans la production. Pour le capitalisme, qui est le système marchand par excellence et qui ne peut vivre sans expansion, ce signe d'un rétrécissement de ses marchés est la manifestation de sa crise de "surproduction" et l'annonce de nouvelles régressions. La chute des importations des pays sous-développés y compris les "pétroliers", dont nous avons déjà parlé, a constitué à elle seule un puissant frein à la croissance de la production mondiale.
Le processus de "désertification industrielle", qui voit des régions industrielles être littéralement rasées par la crise pour ne laisser que des tas de ferrailles rouillées (Ecosse, nord de la France, etc.) n'a cessé d'accélérer au cours des années 80. Cette décennie a commencé dans la récession de 1979-1982, la plus profonde, longue et étendue depuis la seconde guerre mondiale. Elle a été suivie par la fameuse "plus longue période d'expansion du capitalisme", qui n'a été en moyenne qu'une sorte de récession rampante, déguisée par la croissance improductive et à crédit de la première puissance économique mondiale.
Mais surtout, comme nous l'avons développé dans les derniers numéros de la Revue Internationale ([2] [1531]), cette survie de l'économie s'est faite en développant deux maladies qui rongent les fondements de la machine à profits capitaliste:
1. la croissance du secteur improductif de l'économie (militarisme mais aussi tous les autres secteurs parasitaires) ([3] [1532]), au détriment du secteur productif.
2. l'explosion du crédit et de l'endettement mondial.
Le développement du secteur improductif
Les chiffres officiels concernant les dépenses militaires des gouvernements sont encore parmi le moins fiables et les plus sous-estimés. Aux raisons politiques évidentes s'ajoutent le prétexte du "secret militaire". Mais, encore une fois, malgré les déformations grossières, l'observation des données les plus officielles donne une idée de l'ampleur du développement des frais militaires, en particulier aux Etats-Unis :
En grande partie, la "reprise" d'après 1982 a servi à produire le réarmement des Etats-Unis.
Mais, parallèlement à la gangrène militariste, le capitalisme des années 80 a vu se développer celle d'un ensemble d'activités tout aussi parasitaires, tel le secteur financier : banques et assurances, une grande partie du secteur commercial : marketing, publicité, la bureaucratie étatique : police, etc. C'est là un phénomène typique de l'époque de décadence du capitalisme, mais il a connu une accélération importante dans la dernière décennie. Il a marqué tous les pays, industrialisés ou non. Il a pris des formes particulièrement spectaculaires aux Etats-Unis :
Pour certains "experts", il n'y a là rien de très grave. Peu importe au capitaliste que ses profits viennent de la spéculation boursière ou de la production de gaz chimiques, du moment qu'il obtient un profit. Mais, de même que la production d'engins de destruction doit être inscrite avec le signe négatif et que la valeur créée par les services financiers repose sur du vent, de même les profits qui en découlent s'avèrent être, tôt ou tard, au niveau du capital global, des profits fictifs. L'effondrement boursier d'octobre 1987, détruisant 2000 milliards de dollars en quelques jours, est là pour le montrer et annoncer l'avenir.
L'endettement
Le recours massif au crédit par une fuite en avant dans l'endettement est aussi une des caractéristiques majeures des années 80. Nous en avons longuement traité dans la Revue Internationale n° 56, mettant en avant son caractère de palliatif provisoire et de source de difficultés dont les effets auto-destructeurs sur le capital se font sentir dès à présent, tout en préparant de futures catastrophes pour le capital. Nous avons déjà illustré dans le tableau 2 l'ampleur du phénomène pour les pays sous-développés. Rappelons ici ce qu'a été son développement dans les pays industrialisés. Le tableau 9 montre le saut réalisé, pendant les années 80, par l'endettement des administrations publiques :
L'accroissement vertigineux des intérêts de cet endettement, dont personne ne sait comment il pourrait être effectivement remboursé; la multiplication des faillites du système bancaire aux Etats-Unis et la crise des caisses d'épargne, qui contraint le gouvernement Bush à emprunter de nouvelles sommes faramineuses pour rembourser les épargnants et tenter d'empêcher un vent de panique; la hausse irrésistible des taux d'intérêt aux Etats-Unis, et par suite dans le monde, annonciatrice d'une nouvelle récession; la confirmation de l'accélération de l'inflation dans tous les pays, tels sont les aboutissements des politiques "miraculeuses" ("libéralisme reaganien" et autres "perestroïka") au bout des années 80.
Le capital mondial n'est pas parvenu à surmonter les difficultés qu'il avait déjà subies si violemment dans les années 70. Il n'a pu survivre qu'en les aggravant.
Les années 80 ont, plus que toutes autres, mis en lumière la faillite des lois économiques capitalistes, le caractère décadent et barbare de ce mode de production. Le capitalisme est né "dans le sang et dans la boue" (Marx). Après une période de croissance et d'extension, il agonise comme une aberration anachronique, une puissance de mort et de destruction.
Sur le plan de la dégradation des conditions matérielles d'existence de l'humanité et en particulier du prolétariat, comme sur celui des contradictions internes du mode de production capitaliste, l'évolution économique des années 80 a été une nouvelle confirmation de la nécessité et de la possibilité de la perspective communiste. En ce sens, les années 80 sont des "années de vérité".
Les prolétaires ne doivent pas voir dans la décomposition du système capitaliste que la source de nouvelles souffrances. Dans les convulsions qui secouent les fondements même du dernier mode d'exploitation de l'histoire, se forgent les conditions de leur émancipation définitive. Telle est la responsabilité qu'ils doivent assumer.
"La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui donneront la mort; elle a en outre produit les hommes qui manieront ces armes - les travailleurs modernes, les prolétaires. " (Marx, Le Manifeste communiste.)
RV.
[1] [1533] Nous employons ce terme pour désigner la réalité de tous ces pays, généralement anciennes colonies, qui, arrivés trop tard sur le marché mondial, n'y ont été intégrés qu'en fonction des impératifs des principales puissances dominantes (monoculture, marginalisation des populations par la destruction sans avenir des modes de production pré-capitaliste, etc.). Le terme "pays en développement", tel qu'il est pudiquement employé par les organismes économiques internationaux, n'est qu'un hypocrite mensonge : leurs propres statistiques montrent comment l'écart entre pays développés et sous-développés s'est creusé dans les dernières décennies. Cet écart était évalué à 7 300 dollars de revenu par habitant en 1967, à 10 000 en 1980 et à 12 000 en 1987. Les camarades du groupe Emancipacion Obrera, en Argentine insistent souvent sur le fait que des pays comme l'Argentine ont un degré de développement économique bien plus avancé que des pays comme la Bolivie ou le Tchad. Ce qui est vrai, mais ne change rien à l'existence de traits communs et importants.
[2] [1534] Voir en particulier Revue Internationale n° 56.
[3] [1535] Pour une définition du concept d'"improductivité" d'un secteur économique, voir notre brochure La décadence du capitalisme.
Questions théoriques:
- Décadence [2]
- L'économie [90]
Emeutes de la faim et répression sanglante au Venezuela : la bourgeoisie massacre
- 3749 reads
Près de 1000 morts, d'après des sources hospitalières (300 d'après le gouvernement), 3 000 manifestants blessés grièvement, 10 000 arrestations, état de siège, suppression de toutes les "libertés", quartier ouvert à 10 000 hommes pour massacrer sans discrimination : le gouvernement "de gauche" de Carlos Andrés Pérez, le partisan d'un "socialisme humaniste qui accepte les normes du système capitaliste", vient de réprimer dans le sang et avec une brutalité inouïe,les émeutes de la faim qu'il a lui même provoquées par un train de mesures qui, du jour au lendemain, ont fait doubler le prix des transports collectif et tripler celui de certains biens de première nécessité. Telles sont les "normes du système capitaliste" en crise. Telle est la réalité qui se cache derrière les discours "humanistes" des fractions "de gauche" du capital qui n'ont rien à envier dans ce domaine à celles "de droite".
Les événements de la première semaine de mars au Venezuela, tout comme ceux d'Algérie en octobre dernier, sont une illustration du seul avenir qu'offre le capitalisme aux classes exploitées : le sang et la misère. Ils constituent un nouvel avertissement aux prolétaires qui garderaient encore quelque illusion sur ces partis dits "socialistes" ou "communistes" qui prétendent les représenter tout en "acceptant les normes du système capitaliste".
Au moment où nous mettons sons presse, nous ne disposons pas encore de toutes les informations sur ces événements. Mais dés à présent il est indispensable de dénoncer ce nouveau massacre commis par la bourgeoisie pour la défense de ses intérêts de classe et les mensonges avec lesquels elle tente de les recouvrir.
DES EMEUTES DE LA FAIM
La presse, en particulier celle de la gauche "socialiste", celle des amis européens du président C.A.Pérez, tente de nier qu'il s'est agi de révoltes contre la faim. Le Venezuela, un des grands pays pétroliers du monde, serait un "pays riche". Les récentes mesures du gouvernement n'auraient eu comme objectif que de faire comprendre à la population que la période de la "manne pétrolière" est terminée et qu'il s'agit -pour "le bien des familles" - de s'adapter aux nouvelles conditions de l'économie mondiale. En somme, les "pauvres" du Venezuela auraient pris de mauvaises habitudes de riches. D s'agissait de les faire revenir à la réalité. Le cynisme de la bourgeoisie est sans limites.
Même aux moments des plus fortes hausses des prix du pétrole, au milieu et à la fin des années 70, la richesse des "pétrodollars" est évidemment restée pour l'essentiel aux mains de la classe dominante locale. Celle-ci s'est même empressée de placer cet argent, ainsi que la plus grosse partie des prêts internationaux, à l'étranger, s'assurant ainsi des revenus plus sûrs et payés en dollars ([1] [1536]). Par contre, dés que les revenus de l'or noir ont commencé à baisser, en particulier à partir de 1986, et que le remboursement de la dette internationale se faisait trop lourd, elle a fait porter sur les classes les plus pauvres toute l'aggravation de sa situation économique. L'instrument principal de cette attaque a été l'inflation accompagnée d'une quasi stagnation des salaires. De 13 % en 1986 l'inflation est passée (officiellement) à 40 % en 1988, et l'on prévoit 100 % pour 1989, alors que les salaires (pour ceux qui en ont encore un, le taux "officiel" du chômage en 1988 étant de 25 %) restent loin derrière. La dégradation des conditions d'existence des travailleurs et des millions de "sans-travail" marginalisés dans les bidonvilles, a été foudroyante au cours des dernières années. Jamais le contraste entre l'opulence des riches et le dénuement croissant des pauvres n'a été aussi criant. La faim, pour cette partie de la population, n'est pas une menace pour l'avenir mais une réalité de plus en plus oppressante depuis des années.
C'est pourquoi les récentes mesures gouvernementales, qui impliquent jusqu'au triplement du prix du lait en poudre - base de l'alimentation des enfants - ne pouvaient être vécues que comme la plus brutale provocation. Les émeutes qui ont explosé à Caracas et sa banlieue (4 millions d'habitants) mais aussi dans les principales villes du pays, n'étaient pas une réaction à une soi-disant "baisse de standing", comme l'affirment les dandys de la gauche bien pensante, mais bien des émeutes de la faim : des réactions spontanées à l'aggravation d'une misère devenue insupportable. "Nous préférons nous faire tuer plutôt que continuer à mourir de faim" ont crié des manifestants à la soldatesque déchaînée.
La classe ouvrière peut imposer un rapport de force à la bourgeoisie par la grève et le combat politique de classe. Mais les masses des "sans-travail", les populations marginalisées des pays sous-développés ne peuvent, par elles-mêmes, répondre aux attaques du capital que par l'action désespérée des pillages et des émeutes sans issue. Le fait que leurs premières actions aient consisté à piller des épiceries (dont beaucoup pratiquent la pénurie pour faire monter les prix) et des supermarchés d'alimentation, dit clairement que c'est de la faim qu'il s'agit.
Les émeutes de début mars au Venezuela sont tout d'abord cela : la réponse des masses marginalisées aux attaques de plus en plus barbares du capitalisme mondial en crise. Elles font partie des secousses qui ébranlent de plus en plus fortement les fondements mêmes de la société capitaliste en décomposition.
LE VERITABLE VISAGE DE LA DEMOCRATIE BOURGEOISE
Mais la barbarie du capitalisme décadent ne s'arrête pas au niveau économique. La répression à laquelle s'est livrée la bourgeoisie au Venezuela est éloquente. A l'ampleur de la boucherie il faut ajouter sa sauvagerie : blessés achevés sur le trottoir, enfants assassinés devant les parents, chambre de torture installée dans une pension de famille désaffectée, etc.
Jamais la bourgeoisie vénézuélienne, qui a pourtant gouverné avec des régimes militaires pendant des décennies, ne s'était livrée à un tel carnage. En une semaine la réalité a fait voler en éclats le mythe tant vanté de "la démocratie, rempart contre la dictature militaire". La "démocratie" n'est que le masque anesthésiant de la pire brutalité bourgeoise. C'est ce qu'a clairement montré le travail, main dans la main, du gouvernement d'Accion Democratica, parti membre de l'Internationale socialiste, et des gorilles de l'année pour protéger leurs biens, leur argent, leurs lois, leur système.
Ceux qui aujourd'hui se lamentent sur les "dangers que ces événements font courir à la fragile démocratie vénézuélienne" sont les mêmes qui ont préparé la répression en faisant croire qu'en votant aux récentes élections, pour C.A.Pérez ou tout autre, "on serait protégés des militaires".
C'EST LA BOURGEOISIE MONDIALE QUI S'EST LIVREE A UN BAIN DE SANG AU VENEZUELA
Mais le président C.A.Pérez n'est pas seulement le représentant de la bourgeoisie locale. Sa réaction en défense des intérêts de sa classe est la même que celle de tout gouvernement bourgeois qui se sent menacé. Un aréopage de chefs d'Etats s'est chargé de le lui manifester cérémonieusement, quelques semaines avant le massacre, au cours de son intronisation comme nouveau président. Fidel Castro lui à même déclaré : "Il faut un leader à l'Amérique Latine, et ce sera toi.". Quelques mois auparavant il se réunissait à Paris, dans une conférence de l'Internationale socialiste. Les socialistes suédois, anglais, les Willy Brandt d'Allemagne, Mitterrand de France, Craxi d'Italie, Kreysky d'Autriche, Gonzales d'Espagne, Soares du Portugal, Papandreou de Grèce, etc. tous ces vibrants "démocrates socialistes", "humanistes" reconnaissent chaleureusement ouvertement comme l'un des leurs celui qui restera comme le boucher de Caracas.
Les "démocrates" du monde entier cherchent à présenter le gouvernement vénézuélien comme une "victime du FMI". Celui-ci serait une sorte de "monstre impitoyable", venu d'on ne sait où, pour contraindre les bourgeois des pays les plus endettés à exploiter et à engendrer toujours plus de misère et d'oppression, à être des bourgeois. Mais, en réclamant le remboursement de la dette, en réprimant ceux qui s'attaquent à l'ordre établi, le FMI et C.A.Pérez ne font qu'appliquer les "nonnes du système capitaliste", les normes de tous les bourgeois du monde. C'est leur "ordre" qui a été rétabli au Venezuela, celui qu'ils font régner dans tous les pays et pour le maintient duquel ils n'ont jamais hésité à employer les méthodes les plus barbares.».
Un "ordre" qui pourrit sur pied dans la barbarie et que seul le prolétariat mondial pourra détruire.
Pour la classe ouvrière, au Venezuela comme dans tous les pays et en particulier dans les plus industrialisés ces événements constituent, en ce sens, un nouveau rappel des responsabilités historiques qui sont les siennes.
[1] [1537] Le montant des investissements de la bourgeoisie à vénézuélienne à l'étranger (aux Etats-Unis en particulier) est supérieur au montant de la dette extérieure du pays : 30 milliards de dollars. C'est dire toute l'hypocrisie de la bourgeoisie locale qui prétend justifier par les "diktats du FMI", la misère qu'elle impose.
Géographique:
- Vénézuela [32]
1919 : fondation de l'Internationale Communiste
- 5326 reads
Parmi les nombreux anniversaires historiques à célébrer en cette année 1989, il en est un que les médias et les historiens passent sous silence, ou bien, quand ils l'évoquent -en général très rapidement-, c'est pour en dénaturer consciemment la signification. En mars 1919 s'est tenu le premier congrès de l'Internationale Communiste, le congrès de constitution de la 3e Internationale.
En fêtant l'anniversaire de la révolution française de 1789 -tout comme pour le bicentenaire des Etats-Unis-, les historiens grassement payés au service de la bourgeoisie insistent sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de démocratie, de nation, présentées comme les principes absolus et définitifs enfin trouvés pour l'accession au "bonheur" de l'humanité. Deux siècles d'exploitation, d'affrontement des classes, de misère et de guerres impérialistes ont dévoilé la réalité du capital masquée derrière ces belles paroles. Pour la bourgeoisie, l'objectif de ces célébrations est de faire oublier que "le capitalisme est né dans le sang et la boue" (K. Marx), qu'il est né de la lutte ^des classes, et surtout qu'il est une société transitoire appelée à disparaître comme tous les autres modes de production avant lui.
Pour la bourgeoisie de 1989, l'anniversaire de la constitution de l'Internationale communiste lui rappelle la réalité et l'actualité de la lutte des classes dans le capitalisme en crise d'aujourd'hui, de l'existence du prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire, et l'annonce de sa propre fin.
LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE EN 1919
La constitution de l'IC éveille aussi de très mauvais souvenirs pour l'ensemble de la classe capitaliste et ses serviteurs zélés. En particulier, l'angoisse qu'elle eut au sortir de la première guerre mondiale devant le flot montant, et qui paraissait alors à tous inéluctable, de la vague révolutionnaire internationale. 1917: révolution prolétarienne victorieuse en Russie en octobre, mutineries dans les tranchées ; 1918 : abdication de Guillaume II et signature précipitée de l'armistice devant les mutineries et la révolte des masses ouvrières en Allemagne ; mouvements ouvriers à partir de 1919 : insurrections ouvrières en Allemagne, instauration sur le modèle russe de républiques des conseils ouvriers en Bavière et en Hongrie, début de grèves de masse ouvrières en Italie et en Grande-Bretagne ; mutineries dans la flotte et les troupes françaises, ainsi que dans des unités militaires britanniques, re rusant d'intervenir contre la Russie soviétique...
C'est Lloyd George, le Premier ministre du gouvernement britannique de l'époque, qui exprime le mieux la frayeur de la bourgeoisie internationale devant le pouvoir des soviets ouvriers en Russie, devant la force du mouvement révolutionnaire, lorsqu'il déclarait, en janvier 1919, que Vil tentait actuellement d'envoyer un millier de soldats britanniques en occupation en Russie, les troupes se mutineraient", et que "si l'on entreprenait une opération militaire contre les bolcheviks, l'Angleterre deviendrait bolchevique et il se créerait un soviet à Londres.(...) L'Europe tout entière est gagnée par l'esprit révolutionnaire. Il y a chez les ouvriers un sentiment profond, non seulement de mécontentement, mais de colère et de révolte contre les conditions d'avant-guerre.L'ordre établi, sous ses aspects politique, social, économique, est remis en question par les masses de la population d'un bout à l'autre de l'Europe." (Cité par E.H. Carr, La révolution bolchevique, Editions de Minuit, 1974.)
La constitution de l'IC marque -nous le savons aujourd'hui- le point culminant de la vague révolutionnaire qui va pour le moins de 1917 à 1923 et qui parcourut le monde entier, traversant l'Europe de part en part, atteignant l'Asie (Chine) et le "nouveau" continent, Canada (Winnipeg) et USA (Seattle) jusqu'à l'Amérique latine. Cette vague révolutionnaire est la réponse du prolétariat international à la première guerre mondiale, à quatre années de guerre impérialiste entre les Etats capitalistes pour le partage du monde. L'attitude des partis et des militants de la social-démocratie, de la 2e Internationale engloutie en 1914 face à la guerre impérialiste mondiale, allait déterminer celle qu'ils allaient prendre face à la révolution et à l'Internationale communiste.
-
"La 3e Internationale Communiste s'est constituée à la fin du carnage impérialiste de 1914-1918, au cours duquel la bourgeoisie des différents pays a sacrifié 20 millions de vies.
Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voilà la première parole que l’Internationale communiste adresse à chaque travailleur, quelles que soient son origine et sa langue. Souviens-toi que, du fait de l'existence du régime capitaliste, une poignée d'impérialistes a eu, pendant quatre longues années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s'entre—égorger ! Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l'Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement! Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible, mais inévitable !" (Statuts de l'Internationale communiste, 2e Congrès, juillet 1920.)
LA CONTINUITE DE L'I.C. AVEC LA 2e INTERNATIONALE
La 2e Internationale et la question de la guerre impérialiste
Dans le Manifeste Communiste (1848), K. Marx énonce un Mes principes essentiels de la lutte du prolétariat contre le capitalisme : "Les ouvriers n'ont pas de patrie." Ce principe ne signifiait pas que les ouvriers devaient se désintéresser de la question nationale, mais au contraire qu'ils devaient définir leur prise de position et leur attitude sur cette question et celle des guerres nationales en fonction du développement même de leur propre lutte historique. La question des guerres et l'attitude du prolétariat a toujours été au centre des débats dans la le Internationale (1864-1873) tout comme dans la 2e Internationale (1889-1914). Dans la majeure partie du XIXe siècle, le prolétariat ne pouvait rester indifférent aux guerres d'émancipation nationale contre la réaction féodale et monarchique, en particulier contre le tsarisme.
C'est au sein de la 2e Internationale que les marxistes, particulièrement derrière Rosa Luxemburg et Lénine, surent reconnaître le changement de période dans la vie du capitalisme survenu à l'aube du XXe siècle. Le mode de production capitaliste se trouve alors à son apogée et règne maintenant sur l'ensemble de la planète. S'ouvre ensuite la période de "l'impérialisme, stade suprême du capitalisme", comme le dit Lénine. Dans cette période, la guerre européenne à venir sera une guerre impérialiste et mondiale, opposant les différentes nations capitalistes pour la dispute et le partage des colonies et du monde. C'est principalement rafle gauche de la 2e Internationale qui mena le combat pour armer l'Internationale et le prolétariat, dans la situation nouvelle, contre l'aile opportuniste qui abandonnait chaque jour un peu plus les principes de la lutte prolétarienne. Un des moments essentiels de cette bataille politique est le congrès international de Stuttgart en 1907, où Rosa Luxemburg, tirant les leçons de l'expérience de la grève de masse en Russie de 1905, lie la question de la guerre impérialiste à la question de la grève de masse et de la révolution prolétarienne :
-
"J'ai demandé la parole, dit Rosa Luxemburg, au nom des délégations russe et polonaise pour vous rappeler que nous devons tirer sur ce point (la grève de masse en Russie et la guerre, NDLR.) la leçon de la grande Révolution russe... La Révolution russe n’a pas surgi seulement comme un résultat de la guerre ; elle a aussi servi à mettre fin à la guerre. Sans elle, le tsarisme aurait sûrement continué la guerre..." (Cité par B.D. Wolfe, Lénine, Trotski, Staline, Calmann-Lévy, 1951.)
La Gauche fait adopter un amendement de la plus haute importance à la résolution du congrès, présenté par Rosa Luxemburg et Lénine :
-
"Si néanmoins une guerre éclate, les socialistes ont le devoir d oeuvrer pour qu'elle se termine le plus rapidement possible et d'utiliser par tous les moyens la crise économique et politique provoquée par la guerre pour réveiller le peuple et de hâter ainsi la chute de la domination capitaliste." (Cité dans "La résolution sur la position envers les courants socialistes et la conférence de Berne", Premier congrès de l'Internationale communiste, Pierre Broué, EDI, 1974.)
En 1912, le congrès de Bâle de la 2e Internationale réaffirme cette position face aux menaces de plus en plus fortes de guerre impérialiste en Europe :
-
"Que les gouvernements bourgeois n'oublient pas que la guerre franco-allemande donna naissance à l'insurrection révolutionnaire de la Commune et que la guerre russo-japonaise mit en mouvement les forces révolutionnaires de Russie. Aux yeux des prolétaires, il est criminel de s'entretuer au profit du gain capitaliste, de la rivalité dynastique et de la floraison des traités diplomatiques." (Ibid.)
La trahison et la mort de la 2e Internationale
Le 4 août 1914 éclate la première guerre mondiale. Gangrenée par l'opportunisme, emportée par la tempête chauvine et guerrière, la 2e Internationale éclate et se meurt dans la honte : les principaux partis qui la composent -et surtout les partis social-démocrates allemand, français et anglais aux mains de directions opportunistes- votent les crédits de guerre, appellent h la "défense de la patrie", à l'"union sacrée" avec la bourgeoisie contre "l'étranger", et sont même récompensés en France par des postes de ministre pour leur renoncement à la lutte de classe. Ils reçoivent l'appui "théorique" du "centre" (entre les ailes droite et gauche de l'Internationale) quand Kautsky, "le pape du marxisme", séparant la guerre et la lutte de classe, déclare cette dernière possible seulement en "temps de paix". Et bien sûr impossible en "temps de guerre".
-
"Pour les ouvriers conscients (...), le krach de la 2e Internationale, c'est l'abominable trahison, par la majorité des partis social-démocrates, de leurs convictions, des solennelles déclarations des congrès internationaux de Stuttgart et de Bâle, des résolutions de ces congrès, etc." (Lénine, "Le krach de la 2e Internationale", 1915, dans le recueil Contre le Courant, Maspéro, 1970.)
Seuls quelques partis résistent à la tempête : principalement le» partis italien, serbe, bulgare et russe. Ailleurs, des militants bien souvent isolés, essentiellement de la Gauche, tels RosaLuxemburg et les "Tribunistes" hollandais autour de Pannekoek et Gorter, vont rester fidèles à l'internationalisme prolétarien et à la lutte de classe, et essayer de se regrouper.
La mort de la 2e Internationale signifie une lourde défaite pour le prolétariat, qu'il paiera de son sang dans les tranchées. Nombre d'ouvriers révolutionnaires vont disparaître dans la boucherie. Pour les "social-démocrates révolutionnaires", c'est la perte de leur organisation internationale, qui est à reconstruire :
-
"La 2e Internationale est morte vaincue par l'opportunisme. A bas l'opportunisme, et vive la 3e Internationale débarrassée non seulement des transfuges (...) mais aussi de l'opportunisme !" (Lénine, "Situation et tâches de l'Internationale socialiste", 1er octobre 1914, Ibid.)
Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal : un pas vers la construction de l'Internationale communiste
En septembre 1915 se tient "la conférence socialiste internationale de Zimmerwald". Elle devait être suivie d'une seconde conférence en avril 1916 à Kienthal, toujours en Suisse. Malgré les conditions de guerre et de répression, des délégués de 11 pays y participent, d'Allemagne, d'Italie, de Russie, de France, etc.
Le Manifeste de Zimmerwald reconnaît la guerre comme une guerre impérialiste. La majorité de la conférence se refuse à dénoncer la droite opportuniste des partis social-démocrates passés dans le camp de l'"union sacrée" et à envisager la scission d'avec elle. Cette majorité centriste est pacifiste, et défend le mot d'ordre de la "paix".
Unie derrière les représentants de la fraction bolchevik, Lénine et Zinoviev, la "gauche zimmerwaldienne" défend la nécessité de la rupture et de la construction de la 3e Internationale. Contre le pacifisme, elle affirme que "la lutte pour la paix sans action révolutionnaire est une phrase creuse et mensongère" (Lénine) et elle oppose au centrisme le mot d'ordre de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Ce mot d'ordre, précisément, est indiqué par les résolutions de Stuttgart et de Bâle." (Lénine.) Bien que la Gauche se renforce d'une conférence à l'autre, elle ne réussit pas à convaincre les délégués et reste minoritaire. Pourtant, elle tire un bilan positif :
-
"La deuxième conférence de Zimmerwald (Kienthal) constitue indiscutablement un progrès, c'est un pas en avant. (...) Que faire donc demain? Demain, continuer à lutter pour notre solution, pour la social-démocratie révolutionnaire, pour la 3e Internationale ! Zimmerwald et Kienthal ont montré que notre voie était la bonne." (Zinoviev, 10 juin 1916, Ibid.)
La rencontre et le combat communs des gauches de différents pays durant les conférences a permis la constitution du "premier noyau de la 3e Internationale en formation", devait reconnaître Zinoviev en mars 1918.
La réalisation par le prolétariat des résolutions des congrès de Stuttgart et de Bâle
Nous l'avons vu précédemment, la révolution prolétarienne, en Russie de 1917, ouvre une période de vague révolutionnaire dans toute l'Europe. La menace prolétarienne décide la bourgeoisie internationale à mettre fin au carnage impérialiste. Le mot d'ordre de Lénine se réalise : le prolétariat russe puis international transforme la guerre impérialiste en guerre civile. Le prolétariat rend ainsi honneur à la Gauche de la 2e Internationale en appliquant la fameuse résolution de Stuttgart.
La guerre a rejeté définitivement la droite opportuniste des partis sociaux-démocrates dans le camp de la bourgeoisie. La vague révolutionnaire met au pied du mur les pacifistes du centre, et va mener à son tour une grande partie d'entre eux -surtout les dirigeants, comme Kautsky - à rejoindre l'ennemi de classe. Il n'existe plus d'Internationale. Les nouveaux partis qui se constituent en rupture avec la social-démocratie commencent à adopter l'appellation de "parti communiste", en même temps que la vague révolutionnaire nécessite et pousse à la constitution du parti mondial du prolétariat, la 3e Internationale.
La constitution de pic et la continuité politique et principielle avec la 2e Internationale
L'Internationale, qui prend le nom d'Internationale communiste, se forme donc en mars 1919 sur la base de la rupture organique avec la droite des partis de la défunte 2e Internationale. Pour autant, elle ne rejette pas les principes et les apports de celle-ci :
-
"Rejetant loin de nous toutes les demi-mesures, les mensonges et la paresse des partis socialistes officiels surannés, nous nous considérons, nous communistes, rassemblés dans la 3e Internationale, comme les continuateurs directs des efforts héroïques et du martyre de toute une longue série de générations révolutionnaires, depuis Babeuf jusqu'à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Si la 1e Internationale a prévu le développement de l'histoire et préparé ses voies, si la 2e a rassemblé et organisé des millions de prolétaires, la 3e Internationale, elle, est l'Internationale de l'action de masse ouverte, de la réalisation révolutionnaire, l'Internationale de l’action." ("Manifeste de l'IC", P. Broué, Ibid.)
Les courants, les fractions, les traditions et les positions défendues et approfondies par la Gauche, qui vont être à la base de l'IC, sont apparus et se sont développés au sein de la 2e Internationale :
-
"l'expérience est là pour nous prouver que c'est seulement un groupement sélectionné dans le milieu historique où s'est développé le prolétariat d'avant-guerre : la 2e Internationale, que la lutte prolétarienne contre la guerre impérialiste a pu être poussée à ses conséquences extrêmes car il est le seul ayant pu formuler un programme avancé de la révolution prolétarienne et, par là, le seul qui ait pu jeter les bases pour le nouveau mouvement prolétarien." ("Bilan" n° 34, Bulletin théorique de la fraction italienne de la Gauche communiste, août 1936.)
Au-delà d'individus tels Lénine, Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, au-delà même des groupes et fractions des partis social-démocrates tels les bolcheviks, les gauches allemande, hollandaise, italienne, etc., il existe une continuité politique et organique entre la Gauche de la 2e Internationale, la Gauche de Zimmerwald et la 3e Internationale. C'est sur l'initiative du Parti communiste (bolchevik) de Russie -ex-Parti ouvrier social-démocrate (bolchevik) de Russie adhérant à la 2e Internationale- et du Parti communiste d'Allemagne -ex-Ligue Spartacus- qu'est convoqué le premier congrès de la nouvelle Internationale. Les bolcheviks ont animé et entraîné la Gauche à Zimmerwald. Celle-ci, véritable lien organique et politique entre la 2e et la 3e Internationale comme "fraction de gauche" de la 2e, tire le bilan de son combat passé et indique la nécessité de l'heure :
-
"Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal eurent leur importance à une époque où il était nécessaire d'unir tous les éléments prolétariens décidés sous une forme ou une autre à protester contre la boucherie impérialiste. (...) Le groupement de Zimmerwald a fait son temps. Tout ce qui était véritablement révolutionnaire dans le groupement de Zimmerwald passe et adhère à l’Internationale communiste." ("Déclaration des participants à Zimmerwald", P. Broué, Ibid.)
Nous insistons particulièrement sur la continuité qui existe, entre les deux Internationales. En effet, nous l'avons vu, l'IC ne surgit pas du néant au niveau organique. Il en est de même au niveau de son programme et de ses principes politiques. Ne pas reconnaître le fil historique qui les relie serait tombé dans l'anarchisme, incapable de comprendre le déroulement de l'histoire, ou céder au spontanéisme le plus mécanique en voyant l'IC comme le produit du seul mouvement révolutionnaire des masses ouvrières.
Ne pas reconnaître la continuité, c'est l'impossibilité de comprendre en quoi l'IC rompt avec la 2e Internationale. Car, s'il y a continuité entre les deux -continuité de principe s'exprimant entre autre dans la résolution de Stuttgart-, il y a aussi une rupture. Rupture matérialisée dans le programme politique de l'IC, dans ses positions politiques et dans sa pratique organisationnelle et militante comme "parti communiste mondial". Rupture au travers des faits eux-mêmes, dans l'emploi des armes et la répression sanguinaire, par le gouvernement de Kerenski, auquel participent mencheviks et socialistes-révolutionnaires, membres de la 2e Internationale, contre le prolétariat et les bolcheviks en Russie, par le gouvernement social-démocrate de Noske-Scheidemann contre le prolétariat et le KPD en Allemagne.
Ne pas reconnaître cette "rupture dans la continuité", c'est rendre impossible aussi la compréhension de la dégénérescence de l'IC dans les années 20 et le combat qu'ont mené en son sein, et par la suite dans les années 30 en dehors, car exclues, les fractions de la Gauche Communiste "italienne", "allemande" et "hollandaise" pour ne citer que les plus importantes. C'est de ces fractions de gauche, de leur défense des principes communistes et de leur travail de bilan critique de l'IC et de la vague révolutionnaire de 1917-23, que les groupes communistes d'aujourd'hui et les positions qu'ils défendent sont le produit.
Ne pas reconnaître l'héritage de la 2e, l'héritage politique du prolétariat, rend incapable de comprendre les fondements des positions de l'IC, ni la validité actuelle de certaines d'entre elles parmi les plus importantes, ni les apports des fractions des années 30. C'est-à-dire être incapable de défendre de manière conséquente, assurée et déterminée les positions révolutionnaires aujourd'hui.
LA RUPTURE DE L'I.C. AVEC LA 2e INTERNATIONALE
Le programme politique de l’I.C.
Trotski rédige fin janvier 1919 la Lettre d'invitation au congrès de constitution de l'IC, qui détermine les principes politiques que veut se donner la nouvelle organisation. Elle est en fait le projet de "Plate-forme de l'Internationale communiste" et en fournit un bon résumé. Elle se base sur les programmes des deux principaux partis communistes :
-
"La reconnaissance des principes suivants établis sous forme de programme et élaborés à partir des programmes de la Ligue Spartacus en Allemagne et du Parti communiste (bolchevik) de Russie, doit, selon nous, servir de base à la nouvelle Internationale." ("Lettre d'invitation au 1er congrès", P. Broué, Ibid.)
La Ligue Spartacus n'existe plus alors, depuis la constitution du Parti communiste allemand le 29 décembre 1918. Ce dernier, le KPD, vient de perdre ses principaux dirigeants, Rosa | Luxemburg et Karl Liebknecht, assassinés par la social-démocratie lors de la répression terrible qu'a subie le prolétariat berlinois en janvier. C'est donc au moment où elle se constitue que l'IC connaît sa première défaite en même temps que le prolétariat international. A deux mois de sa constitution, elle vient de perdre deux de ses dirigeants au prestige, à ( la force et aux capacités théoriques et politiques comparables à ceux de Lénine et de Trotsky. C'est Rosa Luxemburg qui a le plus développé dans ses écrits et prises de position, à la fin du siècle dernier, le point qui va devenir la clé de voûte du programme politique de la 3e Internationale.
Le déclin historique irréversible du capitalisme
Pour Rosa Luxemburg, il est clair qu'avec la guerre de 1914, s'est ouverte la période de décadence du mode de production capitaliste. Cette position ne souffre plus de contestation après le carnage impérialiste :
-
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme." ("Discours sur le Programme" au congrès de fondation du KPD, dans Spartacus et la commune de Berlin, Editions Spartacus.)
Cette position est réaffirmée avec force par l'Internationale dans le premier point de la Lettre d'invitation au congrès :
-
"1° La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et sera celle de l’effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n’est pas abattu." Et
"Une nouvelle époque est née : l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat." ("Plate-forme de l'Internationale communiste", P.Broué, Ibid.)
Les implications politiques de l’époque de décadence du capitalisme
Pour tous ceux qui se situent sur le terrain de l'Internationale communiste, le déclin du capitalisme a des conséquences sur les conditions de vie et de lutte du prolétariat. Contrairement à la position du centre pacifiste, à Kautsky par exemple, la fin de la guerre ne signifie pas le retour à la vie et au programme d'avant-guerre. Là se situe un des points de rupture entre la 2e Internationale morte et la 3e :
- "Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. (...)"La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement." (La crise de la social-démocratie, dite Brochure de Junius, Rosa Luxemburg, 1915, Editions La Taupe.)
L'ouverture de la période de déclin de la société capitaliste, marquée par la guerre impérialiste, signifie de nouvelles conditions de vie et de lutte pour le prolétariat international. La grève de masse en Russie en 1905, le surgissement pour la première fois d'une nouvelle forme d'organisation unitaire des masses ouvrières, les soviets, la formation de conseils ouvriers, l'avaient annoncée. Rosa Luxemburg (Grève de masse, parti et syndicats, 1906) et Trotsky (1905) tirèrent les leçons essentielles de ces mouvements de masse. Avec R.Luxemburg, l'ensemble de la Gauche mena le débat sur la grève de masse et la bataille politique au sein de la 2e Internationale contre l'opportunisme des directions syndicales et des partis social-démocrates, contre leur vision d'une évolution pacifique et graduelle vers le socialisme. En rupture avec la pratique social-démocrate, l'IC affirme que :
- "La méthode fondamentale de la lutte est l’action de masse du prolétariat, y compris la lutte ouverte à main armée contre le pouvoir d'Etat du capital." ("Lettre d'invitation au congrès").
La révolution et la dictature du prolétariat
L'action des masses ouvrières mène à l'affrontement avec l'Etat bourgeois. L'apport le plus précieux de l'IC est sur l'attitude du prolétariat révolutionnaire face à l'Etat. Rompant avec le réformisme de la social-démocratie, reprenant la méthode marxiste et les leçons des expériences historiques : la Commune de Paris, 1905, et surtout l'insurrection d'Octobre 1917 puis la destruction de l'Etat capitaliste en Russie et l'exercice du pouvoir des conseils ouvriers, l’IC se prononce clairement et sans ambiguïté pour la destruction de l'Etat bourgeois et la dictature du prolétariat, la dictature des masses ouvrières organisées dans les conseils ouvriers.
Dans la Lettre d'invitation déjà citée, on lit :
- "2° La tâche du prolétariat consiste maintenant à s'emparer du pouvoir d'Etat. La prise du pouvoir signifie la destruction de l'appareil d'Etat de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil du pouvoir prolétarien.
- "3° Le nouvel appareil du pouvoir doit représenter la dictature de la classe ouvrière, et, dans certains endroits aussi celle des petits paysans et des ouvriers agricoles (...). Le pouvoir des conseils ouvriers ou des organisations ouvrières est sa forme concrète.
- "4° La dictature du prolétariat doit être le levier de l’expropriation immédiate du Capital, de l'abolition de la propriété privée des moyens de production et de sa transformation en propriété sociale."
Cette question est un point essentiel du congrès qui voit la présentation et l'adoption des "Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne" présentées par Lénine.
Les thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat
Les thèses commencent par dénoncer la fausse opposition entre la démocratie et la dictature "car, dans aucun pays capitaliste civilisé, il n'existe de 'démocratie en général', mais seulement une démocratie bourgeoise." La Commune de Paris a montré le caractère dictatorial de la démocratie bourgeoise. Défendre la démocratie "pure" dans le capitalisme, c'est défendre dans les faits la démocratie bourgeoise, la forme par excellence de la dictature du capital. Quelle liberté de réunion pour les ouvriers ? Quelle liberté de presse ? Lénine répond :
- "La 'liberté de presse' est également un des principaux mots d'ordre de la 'démocratie pure'. Néanmoins, les ouvriers savent (...) que cette liberté est un leurre, tant que les meilleures imprimeries et les plus gros stocks de papier sont accaparés par les capitalistes, et tant que le pouvoir du capital demeure sur la presse, ce pouvoir qui s'exprime dans le monde entier d'autant plus cyniquement que la démocratie et le régime républicain sont plus développés, par exemple comme en Amérique. Pour conquérir une véritable égalité et une véritable démocratie pour les travailleurs, pour les ouvriers et les paysans, on doit retirer aux capitalistes la possibilité d'embaucher des écrivains, d'acheter des maisons d'éditions et de corrompre la presse. A cet effet, il est nécessaire de secouer le joug du capital, de renverser les exploiteurs et de briser leur résistance." ("Thèses sur la démocratie et la dictature du prolétariat", P.Broué, Ibid.)
Revendiquer et défendre la démocratie pure, comme les kautskystes, est un crime contre le prolétariat après l'expérience de la guerre et de la révolution, continuent les thèses. C'est pour les intérêts des différents impérialismes, d'une minorité de capitalistes, que des millions d'hommes ont été massacrés dans les tranchées et que dans tous les pays, démocratiques ou non, s'est édifiée la "dictature militaire de la bourgeoisie". C'est la démocratie bourgeoise qui a assassiné Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg alors qu'ils étaient arrêtés et emprisonnés par le gouvernement social-démocrate.
- "Dans un tel état de fait, la dictature du prolétariat ne se légitime pas seulement en tant que moyen de renverser les exploiteurs et de briser leur résistance, mais aussi par le fait qu'elle est nécessaire à la masse des travailleurs comme unique moyen de défense contre la dictature de la bourgeoisie, qui a mené à la guerre et qui prépare de nouvelles guerres.(...)"La différence fondamentale entre la dictature du prolétariat et la dictature des autres classes (...) consiste en ce que (...) la dictature du prolétariat est la répression par la violence de la résistance des exploiteurs, c'est-à-dire de la minorité infime de la population des grands propriétaires fonciers et des capitalistes. (...)"
La forme de la dictature du prolétariat déjà élaborée en fait, c'est-à-dire le pouvoir des soviets en Russie, le système des conseils ouvriers en Allemagne, les Shop-stewards Committees et autres institutions soviétiques dans d'autres pays signifient et réalisent précisément pour les classes laborieuses, c'est-à-dire pour l'énorme majorité de la population, une possibilité effective de jouir des droits et libertés démocratiques, comme il n'en a jamais existé, même approximativement, dans les meilleures républiques démocratiques bourgeoises." (Ibid.)
Seule la dictature du prolétariat à l'échelle mondiale peut détruire le capitalisme, abolir les classes, et assurer le passage au communisme.
- "L'abolition du pouvoir d'Etat est l’objectif que se sont assigné tous les socialistes, Marx en tête. Tant que cet objectif n'est pas réalisé, la démocratie véritable, c'est-à-dire l’égalité et la liberté, est irréalisable. Seule la démocratie soviétique ou prolétarienne conduit pratiquement à ce résultat, car elle commence aussitôt à préparer le dépérissement complet de tout Etat, en associant les organisations des masses laborieuses à la gestion de l'Etat." (Ibid.)
La question de l'Etat est cruciale au moment où la vague révolutionnaire déferle en Europe et à l'heure où la bourgeoisie de tous les pays mène la guerre civile contre le prolétariat en Russie, quand l'antagonisme entre le travail et le capital, entre le prolétariat et la bourgeoisie atteint son degré le plus extrême et le plus dramatique. C'est concrètement que se pose aux révolutionnaires la nécessité de la défense de la dictature du prolétariat en Russie et de l'extension internationale de la révolution, du pouvoir des soviets à l'Europe. Pour ou contre l'Etat de la dictature du prolétariat en Russie et la vague révolutionnaire. "Pour" signifie l'adhésion à l'Internationale communiste, et la rupture politique et organique avec la social-démocratie. "Contre" veut dire la défense de l'Etat bourgeois et le choix définitif du camp de la contre-révolution. Et pour les courants centristes hésitants devant l'alternative, ce sera l'éclatement et la disparition. Les périodes révolutionnaires ne laissent pas de place à la politique timorée du "juste milieu".
AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONTINUER LE TRAVAIL DE L'I.C.
Le changement de période historique définitivement révélé avec la guerre de 1914-1918 détermine la rupture entre les positions politiques de la 2e et de la 3e Internationales. Nous venons de le voir sur la question de l'Etat. Le déclin du capitalisme et ses conséquences sur les conditions de vie et de lutte pour le prolétariat posaient toute une série de nouveaux problèmes : fallait-il toujours participer aux élections et se servir du parlementarisme ? Face aux conseils ouvriers, les syndicats qui ont participé à l’"union sacrée", étaient-ils encore des organisations ouvrières ? Quelle attitude adopter vis-à-vis des luttes de libération nationale dans l'époque des guerres impérialistes ?
L'IC ne sait pas répondre à ces nouvelles questions. Elle se constitue plus d'un an après octobre 1917 en Russie, deux mois après la première défaite du prolétariat à Berlin. Les années qui suivent, sont marquées par la défaite et le recul de la vague révolutionnaire internationale et, par conséquent, par l'isolement croissant du prolétariat en Russie. Cet isolement est la raison déterminante de la dégénérescence de l'Etat de la dictature du prolétariat. Ces événements vont rendre incapable l'IC de résister au développement de l'opportunisme. A son tour, elle en mourra.
Pour tirer un bilan de l'IC, il faut évidemment la reconnaître comme le Parti communiste international qu'elle fut. Pour ceux qui n'y voient qu'une organisation bourgeoise -du fait de sa dégénérescence ultérieure- il est impossible d'en tirer un bilan et des leçons. Le trotskisme lui, se revendique des "Quatre premiers congrès" sans critique. Il n'a jamais vu que, là où le premier rompait avec la 2e Internationale, les congrès suivants marquaient un recul : en opposition à la scission accomplie au 1er Congrès avec la social-démocratie, le 3e propose à cette dernière l'alliance dans le "Front unique". Après avoir reconnu son passage définitif dans le camp de la bourgeoisie, elle réhabilite la social-démocratie au 3e Congrès. Cette politique d'alliance avec les partis social-démocrates allait mener le trotskisme à l’'entrisme", c'est-à-dire à entrer dans ces partis dans les années 30 au mépris des principes mêmes du 1er Congrès. Cette politique d'alliance, de capitulation, aurait dit Lénine, devait précipiter encore plus le courant trotskyste dans la contre-révolution avec le soutien au gouvernement républicain bourgeois dans la guerre d'Espagne et ensuite la participation dans la 2e guerre impérialiste mondiale, trahissant ainsi Zimmerwald et l'Internationale.
C'est au sein de l’IC que, dès le début des années 20, s'est créée une nouvelle Gauche pour essayer de lutter contre la dégénérescence : en particulier les Gauches italienne, allemande et hollandaise. Ces fractions de Gauche, qui ont été exclues tout au long des années 1920, continuèrent leur combat politique pour assurer la continuité entre l'IC qui se mourait et le "parti de demain" en tirant un bilan de la vague révolutionnaire et de l'Internationale communiste. "Bilan" était précisément le nom de la revue de la Fraction italienne de la Gauche communiste dans les années 1930.
En continuité avec les principes de l'Internationale, ces groupes ont critiqué les faiblesses de sa rupture avec la 2e Internationale. Leur travail obscur au plus profond de la contre-révolution, leur défense des principes communistes dans les années 30 et au cours de la 2e guerre impérialiste mondiale, ont permis le surgissement et l'existence des groupes communistes d'aujourd'hui, qui, à défaut d'une continuité organique, assurent la continuité politique. Les positions défendues et élaborées par ces groupes répondent aux problèmes soulevés dans l'IC par la nouvelle période de décadence du capitalisme.
C'est donc sur la base du bilan critique accompli par les Fractions de la Gauche communiste que l'IC vit actuellement et vivra dans le Parti communiste mondial de demain.
Aujourd'hui, face à l'exploitation et à la misère croissantes, le prolétariat doit adopter la même position que la Gauche de Zimmerwald :
- Non à l'union sacrée avec sa bourgeoisie dans la guerre économique !
Non aux sacrifices pour sauver l'économie nationale !
Vive la lutte de classe !
Transformation de la guerre économique en guerre civile !
Face à la catastrophe économique, face à la décomposition de la société, face à la perspective d'une troisième guerre impérialiste mondiale, auxquelles nous mène le capitalisme, l'alternative historique reste la même qu'en 1919 : destruction du capitalisme et instauration de la dictature du prolétariat au niveau mondial, socialisme ou barbarie.
L'avenir appartient au communisme.
R.L.
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [1538]
Heritage de la Gauche Communiste:
Conscience de classe et parti - GPI, Mexique : débat avec le BIPR
- 3796 reads
Avertissement préliminaire :
Parmi les divers groupes politiques prolétariens avec lesquels le GPI a pu prendre contact et établir un échange de publications, le BIPR (et, au sein de celui-ci, plus particulièrement le Parti Communiste Internationaliste -PCInt) a été un des rares groupes à s'être donné la peine de faire une critique directe et élaborée de nos positions, telles qu'elles sont exprimées dans Revolucion Mondial. C’est une attitude du BIPR que nous saluons. Les questionnements dont nous ont fait part ces camarades sont d'ordres divers, mais ils tournent tous autour d'une préoccupation centrale : selon eux, le GPI « a adopté de manière immédiate et manquant de sens critique toutes les positions qui caractérisent particulièrement le CCI au sein du camp prolétarien ». Bien entendu, ils expliquent ceci par le contact "direct et exclusif avec le CCI" qui a été « à l'origine dit GPI, bien que -poursuivent les camarades - vu que nous sommes convaincus que le CCI (sans nier sont mérite d'être une organisation de militants sincères et fidèles à la classe prolétarienne) ne représente pas un pôle de regroupement valable pour la constitution du parti révolutionnaire international, nous croyons que les camarades du GPI doivent faire des pas ultérieurs vers un réel processus de clarification, de décantation et de sélection des positions utiles à la constitution d’un pôle révolutionnaire au Mexique (...) la discussion politique sérieuse et les faits qui en découleront pourront démontrer que nous avons raison" ([1] [1540])
Que le GPI s'est constitué sous l'influence du CCI, reprenant de manière immédiate ses positions (ou, si on veut le poser dans une autre perspective : que nous sommes un résultat du travail militant du CCI), c'est quelque chose que nous n'avons jamais omis de signaler. Nous avons déjà dit qu'actuellement, face aux faiblesses du milieu révolutionnaire international, face à l'absence d'un pôle unique de référence et de regroupement des forces révolutionnaires, les nouveaux militants surgissent sous l'influence déterminante de tel ou tel groupe, héritant autant ses mérites que ses déficiences, se trouvant d'emblée devant la nécessité de "prendre parti" face aux divergences existantes dans le milieu.
Mais il n'est pas juste de dire que le GPI a adopté ses positions avec peu de sens critique. Car nous avons reconnu dès le début l'existence d'un camp de groupes politiques prolétariens, ce qui veut dire que nous ne considérons pas le CCI comme le détenteur de "toute la vérité" et nous aurons l'occasion d'exposer nos divergences avec lui. Bien que, a dire vrai, la connaissance des positions des autres regroupements nous a laissé la certitude que le CCI, au moins, est parmi ceux qui maintiennent la plus grande cohérence théorique politique.
Nous insistons une fois encore sur le fait que le GPI considère que sa consolidation ne pourra se faire qu'en approfondissant les positions politiques auxquelles, il est parvenu, notamment en les confrontant sérieusement à celles que soutiennent les différents groupes du milieu communiste international. Que nous sommes ouverts à la discussion et à la collaboration avec d'autres groupes, jusqu'au point où le permet le maintien des principes prolétariens, car nous nous considérons comme une minuscule partie du processus vers la constitution du Parti Communiste Mondial.
C'est dans ce sens que nous publions ici notre prise de position sur la conception du BIPR de la conscience de classe et de la fonction du parti.
Nous pensons que les conditions pour le regroupement des révolutionnaires en un nouveau parti international sont encore loin d'être données ; probablement seul un événement très important de la lutte de classe permettra une polarisation claire et effective des forces révolutionnaires existantes. Nous n'avons pas encore idée de la forme concrète que prendra cette polarisation. Ce qui est certain c’est que la nécessité d'un parti communiste à échelle mondiale se pose au prolétariat de manière chaque fois plus urgente, et ses minorités révolutionnaires doivent aujourd'hui s'efforcer de déblayer le chemin qui conduit à sa constitution, en posant les bases pour que les différents groupes existants en viennent au regroupement avec la plus grande définition politique possible en commençant par la mise au clair des points d'accord et de désaccord qui existent sur la fonction du parti communiste dans la classe ouvrière.
De toute évidence le GPI ne fait ici que s' « immiscer » dans le débat fondamental qui a occupé les révolutionnaires depuis de nombreuses années et qui a connu récemment deux moments importants lors des conférences convoquées par le PCInt et ensuite avec les réponses à la "Proposition Internationale" fait en 1986 par Emancipacion Obrera). Et si nous entrons dans ce débat avec les camarades du PCInt c'est parce que tous les points qu'ils ont mis en discussion nous renvoient à la question de la conscience de classe et du parti. Nous sommes loin de prétendre apporter maintenant une solution de dernière instance à la question. Mais si nous arrivons au moins à poser clairement ce qui constitue à nos yeux les faiblesses du BIPR (et de ceux qui partagent ses positions), nous considérerons que nous avons atteint le but de cet article.
Nos critiques se réfèrent fondamentalement à l'article la conscience de classe dans la perspective marxiste (Revue Communiste n° 2), à la plate-forme du BIPR et à la correspondance que nous a envoyée le PCint directement.
1. DONNEES DU PROBLEME
Dans l'article "La conscience de classe dans la perspective marxiste", le BIPR expose sa conception sur le sujet, essayant a la fois de démontrer que dans la polémique qui tournait autour de Lénine et de Rosa Luxembourg au sujet de la formation de la conscience de classe et la fonction du parti, le premier avait raison et la deuxième se trompai( et avec elle, ses "héritiers" actuels).
II y a en effet, dans le milieu communiste international, une tendance à présenter les divergences actuelles sur le parti (et sur tous les sujets) comme une reproduction ou une continuation des anciens débats qui ont animé de tout temps les révolutionnaires. C'est là le résultat non d'un exercice académique, mais de l'effort réel des regroupements politiques prolétariens de ne pas perdre le fil historique des positions révolutionnaires.
II est évident cependant que le débat actuel ne peut pas être exactement le même qu'il y a presque un siècle. "Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts" depuis lors : le prolétariat a vécu non seulement la vague révolutionnaire la plus grandiose qu'on ait connue jusqu'à nos jours, mais aussi la plus longue période de contre-révolution. Pour les minorités révolutionnaires actuelles il y a une immense accumulation d'expériences qui pose les bases de la clarification d'une série de problèmes qui vont se poser au prolétariat dans sa lutte, mais en même temps elles éprouvent une plus grande difficulté à faire cette clarification, étant donné leur existence précaire. C'est ainsi que le débat actuel entre les révolutionnaires sur le rapport conscience de classe - parti reproduit apparemment les mêmes divergences qu'entre la tendance exprimée par Lénine et celle exprimée par Rosa Luxembourg, mais il cache une divergence beaucoup plus profonde, plus grave que celle qui séparait ces deux dirigeants du prolétariat.
En effet, au début du siècle la préoccupation des révolutionnaires portait sur le processus par lequel les masses prolétariennes arrivent à la conscience de classe, c'est-à-dire, à la compréhension de l'antagonisme irréconciliable entre bourgeoisie et prolétariat et la nécessité ainsi que la possibilité d'une révolution communiste ; si cette préoccupation subsiste encore, elle est doublée par une autre, plus générale et élémentaire, plus « primitive » pourrait-on dire : celle de savoir si, de manière générale, les masses prolétariennes arrivent ou non -d'une manière ou d'une autre- à la conscience de classe. Une partie du milieu révolutionnaire actuel, y compris le BIPR, considère que "le parti communiste est le seul ou le principal dépositaire de la conscience de classe", jusqu'à la destruction de l'Etat bourgeois et l'instauration de la dictature du prolétariat, et que ce n'est qu'à ce moment que les masses acquerront une conscience de classe. L'autre partie, dans laquelle s'inscrit le GPI, considère que la condition fondamentale préalable pour la destruction de l'Etat bourgeois et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est la prise de conscience de classe du prolétariat, de masses déterminantes de la classe (au moins la majorité des prolétaires des grandes villes). De là qu'il existe un véritable abîme dans la conception défendue sur la fonction du parti (et plus spécifiquement sur le rôle que doivent jouer actuellement les minorités révolutionnaires organisées). Au fond, le débat ne concerne pas le rôle plus ou moins décisif que joue le parti dans le processus de constitution du prolétariat en classe pour soi ; le problème majeur n'est pas de définir si le parti Il oriente" ou "dirige", mais une question plus générale : qu'entend-on par "classe pour soi" `?
Ainsi par exemple, nous pourrions peut-être nous mettre d'accord sur le fait que la fonction du parti est de "diriger" le prolétariat. Mais cet accord ne serait qu'apparent : car à partir du moment ou l'on considère "idéaliste" que les masses prolétariennes puissent développer une conscience révolutionnaire comme condition préalable à 1a prise du pouvoir, il est évident que par "direction" il faut entendre alors un rapport essentiellement identique à celui qui existe, par exemple, entre l'officier et les soldats dans l'armée moderne, ou entre le patron et les ouvriers clans l'usine, c'est-à-dire, un rapport dans lequel seul le dirigeant connaît les buts réels poursuivis, tandis que, pour la partie dirigée, ces buts demeurent dans l'obscurité, confus, voilés par des nuages idéologiques -et c'est pour cela même qu'elle se laisse diriger ; il s'agit alors d'une direction imposée (que ce soit de manière patriarcale ou de manière autoritaire), d'un rapport de dominant à dominés. Pour nous, au contraire, la direction du parti communiste n'est pas autre chose que la compréhension, la conviction profonde que développe l'ensemble de la classe ouvrière de la justesse des positions programmatiques et des mots d'ordre du parti, lesquels sont l'expression du mouvement même de la classe. Une conviction à laquelle parviennent les masses à travers les enseignements historiques qu'elles tirent de leurs luttes, auxquelles le parti participe en tant qu'avant-garde. Entre le parti et la masse prolétarienne il existe un rapport d'un type nouveau, propre 3 la classe ouvrière.
Ainsi, pour les uns, la constitution du prolétariat en classe signifie que le parti, seul dépositaire de la conscience prolétarienne-révolutionnaire, se met à la tête des masses, lesquelles, malgré toutes leurs expériences de lutte, demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise. Pour d'autres, au contraire, la constitution du prolétariat en classe signifie que les masses, grâce à leur expérience et à l'intervention du parti, développent une conscience prolétarienne révolutionnaire. Le BIPR soutient la première position. Nous la deuxième. Le GPI serait-il submergé dans l'idéalisme ?
II. COMMENT LE BIPR ESSAIE D'APPROFONDIR LENINE
Une des premières questions qui ressortent de l'article cité du BIPR, c'est la nouvelle formulation qu'il fait des thèses que Lénine a exprimées dans son ouvrage Que Faire ?. Mais les changements introduits par les camarades dans la terminologie employée par Lénine n'entraînent pas tant une "précision" de sa pensée qu'une distorsion de celle-ci, derrière laquelle se trouve un déplacement du débat de la question de "comment est-ce que les masses arrivent à la conscience de classe ?" A celle de savoir si, en général, il est possible qu'elles y arrivent. C'est pour cela que, bien que nous ne partagions pas la démarche de Lénine selon laquelle la conscience est apportée à la classe ouvrière de l'extérieur, avant d'essayer de "critiquer" Lénine, nous devrons le "défendre", essayer de restituer sa pensée, exprimer clairement quelles étaient sa préoccupation et ses intentions dans le combat contre le courant "économiste" (pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, disons clairement que quand nous nous référons à "Lénine" ou a n'importe quel autre révolutionnaire, nous ne recherchons pas si celui-ci "se trompait" ou s'il était "infaillible" en tant que personne. Nous le prenons comme représentant d'un courant politique à un moment donné ; et ce n'est que parce que tel ou tel courant s'exprime plus clairement dans tel ou tel ouvrage que nous pouvons le prendre comme "spécimen").
Bien. Lénine appelle conscience trade-unioniste (syndicaliste) la "conviction qu'il faut s'unir en syndicats, se battre contre !es patrons, réclamer du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers..." ([2] [1541]), et conscience social démocrate (nous dirions aujourd'hui communiste) la "conscience de l'opposition irréductible de leurs intérêts (celui des ouvriers) avec tout ordre politique et social existant" ([3] [1542]). D'après Lénine, la classe ouvrière, à partir de ses luttes spontanées, de résistance, n'est capable d'atteindre qu'une conscience tride-unioniste -de là que la conscience communiste doive lui être "apportée de l'extérieur" par le parti.
Le BIPR modifie la formulation de Lénine en posant que "l'expérience immédiate de la classe ouvrière la mène à prendre conscience de son identité de classe et de la nécessité de lutter collectivement (...)", que "les conditions d'existence du prolétariat, ses luttes et ses réflexions sur celles-ci , élèvent sa conscience au point qu'il peut se reconnaître comme une classe à part et se définir par la nécessité de lutter contre la bourgeoisie. Mais identité de classe ne veut pas dire conscience communiste." ([4] [1543]) Et un peu plus haut il signalait que 'pour que l'identité de classe se transforme en conscience communiste, l'organisation des prolétaires 'en classe, et donc en parti politique si nécessaire". Nous verrons tout de suite plus précisément ce que le BIPR entend quand il parle de "transformation". D'abord il faut signaler que les camarades appellent ici « conscience de identité de classe » ce que Lénine appelait « conscience trade-unioniste ».
Ceci dit, Lénine posait que si l'élément spontané est la forme embryonnaire du conscient. "puisque les masses ouvrières sont incapables d’élaborer elles-mêmes une idéologie indépendante dans le cours de leur mouvement, le problème se pose en ces seuls termes : il faut choisir entre idéologie bourgeoise ou idéologie socialiste. Il n'y a pas de milieu (…) le développement spontané du mouvement ouvrier aboutit justement à le subordonner à l'idéologie bourgeoise (...) c’est pourquoi notre tâche, celle de la social-démocratie, est de combattre la spontanéité de détourner le mouvement ouvrier de cette tendance spontanée du trade-unioniste à se réfugier sous l'aile de la bourgeoisie, pour l'attirer sous l'aile de la social-démocratie révolutionnaire (le parti prolétarien de l'époque).([5] [1544])
I1 y a lieu de demander alors : de quel côté le BIPR situe-t-il cette "conscience de l'identité de classe" qu'élaboreraient les ouvriers '? Et il répond : "les expériences acquises par la classe ouvrières dans son combat contre la bourgeoisie son politiquement revêtues par les analyses et les interprétations de la bourgeoisie elle-même . elles donnent seulement naissance un sentiment (?) d'identité de classe qui reste une forme de conscience bourgeoise" ([6] [1545]). Ainsi donc, en faisant tout un détour (en remplaçant "conscience" par "sentiment") le BIPR nous dit que la conscience d'identité de 1a classe ouvrière est... une forme de la conscience bourgeoise. Retenons ceci qui, d'emblée. n'est que l'introduction d'une énorme confusion de termes dans le marxisme. Mais nous ne faisons que commencer ; le BIPR (fort maintenant expliquer comment l'identité de classe, c'est-à-dire, cette forme de conscience bourgeoise "se transforme en conscience communiste" :
« une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, cette partie des idéologues bourgeois qui se sont élevés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique" (Manifeste du Parti Communiste). Sous une forme lapidaire, on trouve là la conception matérialiste de la conscience de classe. La lutte spontanée de la classe ouvrière peut élever sa conscience jusqu'au niveau de l'identité de classe, lui permettant de se rendre compte qu'elle n'est pas une fraction du 'peuple", mais une classe en soi (sic). C’est un préalable indispensable pour que puisse s'opérer le saut qualitatif vers la conscience de classe (l'apparition d’une classe pour soi,. mais celui-ci ne peut intervenir que si la "philosophie", que si la compréhension théorique du mouvement historique dans son ensemble se développe et s’empare de la classe. C'est-à-dire si la classe parvient à se convaincre de la nécessite d'un parti Porteur d'une interprétation scientifique globale. Une telle analyse globale est nécessairement élaborée au-dehors de la lutte de classe (bien qu'elle y puise en partie ses matériaux) et au dehors de l'existence quotidienne de l'ensemble du prolétariatt, même si des prolétaires isoles participent à son élaboration ([7] [1546]).
Un trouve dans ce paragraphe du BIPR une telle quantité de confusions qu'il nous est très difficile de choisir par où commencer. Essayons de reprendre le raisonnement. Le BIPR nous offre ici trois "niveaux" de conscience -appelons-les ainsi- :
- Premier niveau : conscience de l'identité de classe, laquelle n'est plus considérée maintenant comme identité de classe en opposition aux patrons, mais seulement comme "différenciation d'avec le 'peuple"'. Le BIPR rabaisse par là cet "embryon de conscience" produit des luttes dont parlait Lénine, au niveau de la "connaissance" vulgaire de n'importe quel ouvrier, ou encore de n'importe quel enfant, qui sait faire la distinction entre "ouvriers", "paysans", etc. Mais en même temps, le BIPR signale cette identité comme un préalable indispensable pour que puisse s'opérer le saut vers la conscience de classe. Cependant le BIPR nous disait il y a un instant que cette "identité de classe" n'était pas autre chose qu'une forme de la conscience bourgeoise. D'où il résulte que la conscience bourgeoise est un préalable indispensable pour... la conscience prolétarienne : en d'autres termes! la seule chose que nous disent les camarades c'est que, pour que le prolétariat parvienne à être une "classe pour soi" il a besoin, avant, d'être une "classe en soi", ou, pour que le prolétariat parvienne à la conscience de classe, c'est un préalable indispensable qu'il ne l'ait pas.
Deuxième niveau : la conscience de classe. Par un saut qualitatif le prolétariat devient classe pour soi. En quoi consiste ce saut ? En la conviction des masses de la nécessité d'un parti porteur, lui, de la conscience communiste. Mais cette conviction implique-t-elle que les masses prolétariennes rompent, en fin de comptes, avec l'idéologie bourgeoise? D'après le raisonnement du BIPR non. Les masses ne peuvent pas développer la conscience communiste avant la prise du pouvoir et, comme il n'y a pas de "milieu", alors le saut qualitatif en question, en réalité, n'en est pas un.
Le prolétariat, d'après le BIPR, se constitue en classe pour soi, mais les masses prolétariennes demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise. II y aurait lieu de demander alors : sur quelle base les masses sont-elles "convaincues" de la nécessité d'un parti communiste ? II n'en existe aucune, mis à part cette même idéologie bourgeoise. Autrement dit : comment est ce que les masses reconnaissent le parti "juste" ? Etann donné qu'elles demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise et que, donc, elles ne peuvent pas comprendre les positions révolutionnaires du parti, une telle "conviction" devient un pur hasard, quelque chose qui dépend non pas de la justesse des positions du parti, mais de l'habileté plus ou moins grande à manoeuvrer de celui-ci par rapport aux autres partis (bourgeois et petits-bourgeois) qui essaieront aussi de "convaincre" les masses. C'est à cela que le BIPR réduit la constitution du prolétariat en classe pour soi.
Troisième niveau : la conscience communiste, compréhension théorique du mouvement, interprétation scientifique globale dont le parti est porteur. D'où provient elle ? Avant nous comprenions, avec Marx, que "Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découvert par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classes existante. d'un mouvement historique qui s’opère sous nos yeux ." (Manifeste communiste). Mais maintenant le BIPR, "approfondissant" Lénine, a découvert que les thèses, théoriques des communistes se fondent sur les analyses élaborées au-dehors de la lutte de classe (bien qu'elles y puisent leurs matériaux) par tel ou tel idéologue bourgeois ou par tel ou tel prolétaire isolé qui s'élève au niveau d'idéologue. Très bien. Mais la lutte de classe est la forme d'existence réelle des classes, son processus, sa forme de mouvement ; les classes n'existent que dans la lutte. Affirmer, donc, comme le fait le BIPR, que la conscience communiste s'élabore en dehors de la lutte des classes revient à dire qu'elle s'élabore en dehors des classes, de manière indépendante, à la marge de celles-ci, et notamment à la marge du prolétariat. Et en effet, le raisonnement du BIPR tend à faire une différence entre ce qui serait la conscience de classe du prolétariat da conviction de la nécessité du parti), et ce qui serait la conscience communiste, faisant de cette dernière une sorte de... "philosophie" inaccessible aux profanes.
Certes, on peut trouver dans l'article du BIPR de magnifiques paragraphes qui contredisent ce qui précède, comme là où il est dit que "le parti doit étudier en profondeur la réalité sociale, les contradictions qui travaillent la société bourgeoise, sa courbe historique ; en même temps qu'il doit intervenir concrètement dans la lutte de classe. Il cherche ainsi à souder toutes les parcelles de conscience communiste provenant de la lutte de classe, à les fondre dans une vision globale et homogène et à rassembler tous ceux qui souscrivent à cette analyse en une seule et même force capable d'intervenir, capable d'intégrer l'expérience de la classe ouvrière dans un cadre communiste cohérent" ([8] [1547]). Ainsi formulée, la question de l'élaboration de la théorie communiste n'a rien à voir avec la conception selon laquelle elle serait l'oeuvre d'idéologues qui se situent en dehors de la lutte de classes. Mais ce n'est pas nous mais le BIPR qui doit choisir une de ces deux positions qui sont en contradiction.
En quoi consiste donc l'approfondissement de Lénine fait par le BIPR ?
D'après Lénine, les masses prolétariennes ne peuvent pas, par elles-mêmes, à partir de leurs luttes spontanées, s'élever à la conscience communiste. A cause de cela le parti doit leur insuffler cette conscience, la leur apporter, car il soutient que "la conscience socialiste des masses ouvrières est la seule base qui peut nous garantir le triomphe ". « Le parti doit avoir toujours la possibilité de révéler à la classe ouvrière l'antagonisme hostile entre ses intérêts et ceux de la bourgeoisie ». La conscience de classe atteinte par le parti « doit être diffusée parmi les masses ouvrières avec un zèle croissant ». Si on trouve des ouvriers dans l'élaboration de la théorie socialiste, "ils n'y participent que dans la mesure ou ils parviennent à acquérir les connaissances plus ou moins parfaites de leur époque et à les faire progresser. Or, pour que les ouvriers y parviennent plus souvent, il faut s'efforcer le plus possible d'élever le niveau de conscience des ouvriers en général." (Le BIPR a cité la première partie de cet extrait de Lénine, mais il a "oublié" de citer la seconde).
Que la tache du parti est de "tirer profit des étincelles de conscience politique que la lutte économique a fait pénétrer dans l'esprit des ouvriers pour élever ceux-ci au niveau de la conscience politique social-démocrate" (c'est-à-dire communiste). Que la "conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. La seule sphère dans laquelle on peut trouver ces connaissances et celle des rapports de toutes les classes entre elles". Que le militant communiste est partisan du "développement intégral de la conscience politique du prolétariat". Que "la sociale-démocrate (le parti) est toujours en première ligne ... proposant un matériel abondant pour le développement de la conscience politique et de l’activité politique du prolétariat". Enfin, que le parti doit s'occuper « d’une agitation politique multiforme, c'est-à-dire, d'un travail qui justement tend à rapprocher et à fusionner en un tout la force destructive spontanée de la foule et la force destructive consciente de l'organisation des révolutionnaires ».
A l'opposé de cela, le BIPR considère qu’ « admettre que l'ensemble ou même la majorité de la classe ouvrière, compte tenu de la domination du capital, peut acquérir une conscience communiste avant la prise du pouvoir et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est purement et simplement de l'idéalisme » ([9] [1548])
Les camarades devraient étendre leur critique au-delà de Rosa Luxembourg et de ses "héritiers". Au-delà de leur critique à Engels, dont ils qualifient de "crétinisme social-démocrate" son affirmation selon laquelle "Le temps des coups de main, des révolutions exécutées par de petites minorités conscientes à la tête des masses inconscientes et passé. Là où il s'agit d'une transformation complète de l'organisation de la société, il faut que les masses elles-mêmes y coopèrent, qu'elles aient déjà compris elles-mêmes de quoi il s'agit, pour quoi elles interviennent (avec leur corps et avec leur vie).(...). Mais pour que les masses comprennent ce qu'il y a à faire, un travail long, persévérant est nécessaire" ([10] [1549]) Des formules de ce type « impliquent -d'après le BIPR- une surestimation du degré de conscience communiste auquel pourrait s'élever le prolétariat grâce au parti » ([11] [1550])
Mais alors le BIPR devrait étendre sa critique, disions-nous, à Lénine lui-même,car apparemment lui aussi "surestimait" le degré de conscience communiste auquel pouvait s'élever le prolétariat, au point de considérer le travail du parti d'élever cette conscience comme sa tache de base et fondamentale, au point de considérer que la conscience communiste des masses est la seule garantie pour le triomphe de la révolution.
Tout le combat de Lénine exprimé dans le Que faire ? était dirigé contre "les économistes", contre ceux qui - objectivement- maintenaient les ouvriers au niveau du trade-unionisme, dans le spontanéisme qui conduit les ouvriers à rester sous la domination de l'idéologie bourgeoise. Et voici que le BIPR, pour soi-disant combattre le "spontanéisme", au lieu de chercher comment élever la conscience des masses, érige au contraire en théorie le maintien de ces masses sous la domination de l'idéologie bourgeoise.
Les camarades ne se sont pas aperçus qu'en essayant d'approfondir Lénine, ce qu'ils ont fait -sans le vouloir, bien entendu-, c'est se rapprocher de ces mêmes "économistes" que Lénine combattait. La thèse du BIPR selon laquelle les masses ne peuvent pas se débarrasser de la domination idéologique de la bourgeoisie avant la prise du pouvoir, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de se convaincre de la nécessité d'un parti porteur, lui, de la conscience communiste, ressemble trop à la thèse fondamentale de l"'économisme" : "que les ouvriers s'occupent de la lutte trade-unioniste et qu'ils laissent aux intellectuels marxistes la lutte politique".
Et ainsi, alors que pour Lénine la constitution du prolétariat en classe pour soi signifiait élever les masses à la conscience communiste, fonder ainsi en un tout le mouvement spontané et le socialisme scientifique, pour le BIPR par contre, la constitution du prolétariat en classe pour soi signifie le maintien des masses sous la domination de l'idéologie bourgeoise, la fusion en un tout de l'idéologie bourgeoise avec la conscience communiste. C'est à cela que se réduit sa "dialectique".
Dans le prochain numéro de Revolucion Mundial nous poursuivrons ce travail. Nous aborderons les fondements du marxisme sur la conscience du prolétariat et la fonction du parti.
Ldo. (Octobre 1988)
[1] [1551] Lettre du BIPR au GPI, 19 mars 1988.
[2] [1552] Que Faire ? , Lénine, Ed. Seuil.
[3] [1553] Ibid.
[4] [1554] "La conscience de classe dans la perspective marxiste",. Revue Communiste n° 2.
[5] [1555] Que Faire ?
[6] [1556] "La conscience de classe dans la perspective marxiste",. Revue Communiste
[7] [1557] idem
[8] [1558] idem
[9] [1559] idem
[10] [1560] Introduction d'Engcls aux luttes de Classe en France. cité dans le Même article de la Revue Communiste.
[11] [1561] idem
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 58 - 3e trimestre 1989
- 2855 reads
Communiqué : sur les événements en chine
- 2716 reads
Le 3 juin 1989 la bourgeoisie chinoise a lâché ses chiens enragés sur la population de Pékin. Plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, les habitants de Pékin ont payé très cher leur résistance aux chars de l'Armée "Populaire". En province aussi la répression a fait rage, peu à peu l'écho parvient de massacres à Shanghai, Nankin, etc. Bien au-delà des étudiants, constamment mis sur le devant de la scène médiatique, c'est toute la population prolétaire des villes qui subit la répression: après les mitraillages, les rafles, les appels à la délation, les arrestations massives et arbitraires, la terreur qui règne partout.
La bourgeoisie du monde entier met à profit l'indignation justement soulevée par cette répression barbare pour verser ses larmes de crocodile et renforcer ses campagnes de diversion démocratiques. Le vacarme médiatique sur la démocratie est intense, mais il ne doit pas nous aveugler, car il est un piège pour la classe ouvrière : aussi bien sur le plan international qu'en Chine même.
STALINISME, DEMOCRATIE ET REPRESSION
Toute la propagande occidentale utilise les événements pour accréditer l'idée que seules les dictatures staliniennes ou militaires ont le monopole de la répression, que la démocratie est pacifique, n'utilise pas de telles armes. Rien de plus faux. L'histoire a suffisamment montré que les démocraties occidentales ont peu à envier des pires dictatures de ce point de vue, le sanglant massacre des luttes ouvrières de Berlin 1919 reste un exemple historique. Depuis elles ont montré leur savoir faire meurtrier dans les répressions coloniales et dans l'envoi de conseillers-tortionnaires pour maintenir l'ordre de leurs intérêts impérialistes sur toute la planète.
Deng Xiaoping, aujourd'hui mis au banc de la bonne conscience démocratique internationale était, il y a encore quelques jours, pour l'ensemble de la bourgeoisie occidentale, le symbole de l'après maoïsme éclairé et des "réformateurs", l'homme de l'ouverture vers l'Occident, l'interlocuteur privilégié. Cela va-t-il changer ? Rien n'est moins sûr ! Une fois la chape de plomb remise en place, qui que ce soit qui sorte vainqueur, nos belles démocraties, aujourd'hui soulevées d'indignation, essuieront leurs larmes hypocrites pour tenter de se concilier les grâces des nouveaux dirigeants.
Il n'y a aucun antagonisme entre démocratie et répression, au contraire, elles sont les deux faces indissociables de la domination capitaliste. La terreur policière-militaire et le mensonge démocratique se complètent et se renforcent l'un, l'autre. Les "démocrates" d'aujourd'hui sont les bourreaux de demain, et les tortionnaires d'hier, comme par exemple Jaruzelski, jouent aujourd'hui aux "démocrates".
Alors que le battage démocratique résonne assourdissant sur toute la planète, de l'Est à l'Ouest, les massacres succèdent aux massacres, en Birmanie, en Algérie où, après avoir ordonné la fusillade contre les émeutiers, le président Chadli "démocratise". Au Venezuela, c'est l'ami de Mitterrand, le social-démocrate Carlos Andrès Perez qui lance la soldatesque contre les révoltés de la misère et de la faim. En Argentine, au Nigeria, en U.R.S.S. (Arménie, Géorgie, Ouzbékistan), etc., ce sont des milliers de morts que la survie du capital impose en quelques mois. La Chine vient ponctuer provisoirement une longue liste sinistre.
CHINE: LA GUERRE DES CLIQUES
La crise économique mondiale impose à toutes les fractions de la bourgeoisie une rationalisation-"modernisation" de leurs économies qui se concrétise :
- par l'élimination de secteurs anachroniques et déficitaires, les canards boiteux du capital, provoquant des tensions croissantes au sein de la classe dominante ;
- dans des programmes d'austérité de plus en plus draconiens qui polarisent un mécontentement grandissant au sein du prolétariat
En Chine, la mise en place depuis une dizaine d'année de réformes "libérales" de l'économie s'est traduite par une misère croissante de la classe ouvrière et des tensions de plus en plus fortes au sein du Parti qui regroupe la classe dominante. La mise en place des réformes économiques se trouve doublement entravée par le poids du sous-développement et par les spécificités de l'organisation du capitalisme d'Etat à la sauce stalinienne. Alors que plus de 800 millions de chinois sont des paysans qui vivent dans des conditions qui n'ont pas fondamentalement changé depuis des siècles, de larges fractions de l'appareil d'Etat, quasiment féodales, contrôlent des régions entières, des fractions de l'armée, de la police et voient d'un mauvais oeil des réformes qui risquent de remettre en cause les bases de leur domination. Les secteurs les plus dynamiques du capital chinois : l'industrie du sud (Shanghai, Canton, Wuhan), de plus en plus liée au commerce mondial, les banques qui traitent avec l'Occident, le complexe militaro-industriel qui cristallise les technologies de pointes, etc., ont toujours dû composer avec l'énorme force d'inertie des secteurs anachroniques du capital chinois. Durant des années Deng Xiaoping a personnifié l'équilibre fragile qui régnait à la tête du P.C. chinois et de l'armée. Alors que son grand âge lui rend de plus en plus difficile d'assumer ses fonctions et que les rivalités entre les cliques se sont aggravées, la fraction regroupée autour de Zhao Ziyang a lancée la guerre de succession. Gorbatchev a fait des émules, mais la Chine n'est pas l'U.R.S.S.
Dans la plus pure tradition maoïste, Zhao Ziyang a lancé une gigantesque campagne démocratique par étudiants interposés pour tenter de mobiliser le mécontentement de la population à son profit et s'imposer à l'ensemble du capital chinois. Représentant de la faction réformatrice, qui, pour mieux encadrer et : exploiter le prolétariat, rêve d'une Perestroïka à la chinoise, il n'a pas pu imposer son point de vue, et la réaction des fractions rivales de l'appareil d'Etat a été brutale. Deng Xiaoping, qui a été le père des réformes économiques, a réduit à néant : les illusions de son ex-protégé. Un secteur dominant de lai bourgeoisie chinoise pense qu'il y a plus à perdre de la tentative de mise en place de formes démocratiques d'encadrement : qu'à y gagner. Peut-être même considère-t-il, non sans raisons, que c'est là une tâche impossible et que le seul résultat ; serait une déstabilisation de la situation sociale en Chine. Cependant, même si elles représentent partiellement des intérêts divergents au sein du capital chinois, les cliques qui s'affrontent aujourd'hui n'utilisent les arguments idéologiques que comme paravent mystificateur : les organisateurs de la répression peuvent aussi bien essayer de se transformer demain en "démocrates" pour mieux abuser les ouvriers : Jaruzelski et Chadli ont montré l'exemple.
Ces événements dramatiques s'inscrivent dans le processus de déstabilisation de la situation mondiale sous les coups de boutoirs de la crise. Ils traduisent la barbarie croissante qu'impose la décomposition accélérée dans laquelle s'enfonce le capitalisme mondial. La Chine est entrée dans une période d'instabilité qui risque de perturber grandement les intérêts impérialistes des deux grands et d'ouvrir la porte à des tensions dangereuses pour la stabilité mondiale.
UN TERRAIN PIEGE POUR LE PROLETARIAT
Sur le terrain de la guerre de succession, engagée entre les différentes cliques de la bourgeoisie chinoise, le prolétariat n'est pas sur son terrain de classe. Il n'a rien à gagner dans cette bataille. Les prolétaires de Pékin qui ont essayé de résister héroïquement à la répression -plus par haine du régime en place que par la profondeur de leurs illusions sur des fractions démocratiques au sein du parti - ont payé chèrement leur combativité. Plus que par enthousiasme pour les manifestations pour la démocratie des apprentis-bureaucrates étudiants, les ouvriers ont manifesté leur prudence dans les grandes villes industrielles du sud de la Chine. L'appel à la grève générale des étudiants, (qui appellent aussi à l'appui de Zhao Ziyang face à la répression) n’a pas été suivi
Le prolétariat n'a pas à choisir entre la dictature militaire et la dictature démocratique. Ce faux choix est celui qui a servi à mobiliser le prolétariat pour ses pires défaites, lors de la guerre d'Espagne en 1936 et ensuite dans la IIième boucherie impérialiste mondiale. En Chine aujourd'hui, appeler le prolétariat à lutter, à faire grève alors que la répression se déchaîne, c'est le mener à l'abattoir pour un combat qui n'est pas le sien, ou il a tout à perdre.
Même si le prolétariat chinois a montré par des grèves ces dernières années, et dans sa résistance désespérée de ces derniers jours, sa combativité grandissante, il ne faut pourtant pas surestimer ses capacités immédiates. Il a peu d'expérience et n'a eu, à aucun moment ces dernières semaines, l'occasion de s'affirmer sur son véritable terrain de classe. Dans ces conditions, et alors que la répression bat son plein la perspective ne saurait être la possibilité d'une entrée immédiate des prolétaires sur leur propre terrain de classe.
Mais, les effets de la crise qui ébranle de plus en plus profondément l'économie capitaliste, particulièrement dans les pays les moins développés comme la Chine, ainsi que l'exacerbation de la haine des prolétaires à l'égard de la classe dominante, violemment renforcée par les derniers crimes de celle-ci, annoncent qu'il n'en sera pas ainsi longtemps.
Les événements qui viennent d'ébranler le pays le plus peuplé du monde, mettent, une fois encore, en évidence l'importance du combat mondial du prolétariat pour arrêter la barbarie sanguinaire du capital. Ils soulignent la responsabilité particulière des prolétaires des pays centraux, à vieille tradition de démocratie bourgeoise, qui seuls peuvent, par leurs combats, détruire les bases des illusions sur celle-ci.
9-6-1989
Géographique:
- Chine [1562]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [315]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Rubrique:
Editorial : les manoeuvres bourgeoises contre l'unification de la lutte de classe
- 2365 reads
"L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes." Il est des périodes où cette vérité générale, qui est un des fondements du marxisme, ne s'applique pas immédiatement. Ainsi les guerres mondiales ne peuvent s'expliquer par la confrontation entre prolétariat et bourgeoisie : au contraire leur déclenchement n'est rendu possible que par l'affaiblissement de cette confrontation. Mais s'il est une époque où ce jugement s'applique à la réalité immédiate c'est bien celle que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai au niveau du cours historique actuel : comme le CCI l'a démontré depuis longtemps, seules les luttes et la mobilisation de la classe ouvrière depuis que le capitalisme est entré en crise ouverte, à la fin des années 60, ont empêché ce système d'apporter sa propre réponse à son effondrement économique : la guerre impérialiste généralisée. C'est vrai pour ce qui concerne plus spécifiquement la décennie qui s'achève où le développement et l'âpreté des combats de classe depuis l'automne 1983 ont contraint la bourgeoisie à développer à grande échelle des campagnes idéologiques de tous ordres - notamment des campagnes pacifistes - destinées à masquer aux ouvriers les véritables enjeux de la situation présente. C'est encore plus vrai, enfin, à l'heure actuelle où l'intensification de ces campagnes, de même que le déploiement de multiples manoeuvres sur le terrain des luttes, sont un des plus sûrs indices du potentiel de développement de celles-ci.
Jamais, depuis la 2ème Guerre mondiale, la classe ouvrière de tous les pays n'avait subi des attaques d'une brutalité comparable à celles que le capitalisme déchaîne à l'heure actuelle. Dans les pays de la périphérie, comme au Mexique, en Algérie, au Venezuela, c'est souvent de moitié qu'a chuté le niveau de vie des ouvriers au cours des dernières années. Dans les pays centraux, la situation n'est pas fondamentalement différente. Derrière des chiffres frelatés "expliquant" que les "choses vont mieux", que "le chômage régresse" et autres mensonges grossiers, la bourgeoisie ne peut masquer aux ouvriers la dégradation constante de leurs conditions de vie, les baisses des salaires réels, le démantèlement des "prestations sociales", la multiplication des emplois précaires et des "petits boulots" payés une misère, la montée irrésistible de la paupérisation absolue.
Face à cette dégradation inexorable de ses conditions de vie, la classe ouvrière mondiale a mené depuis plus de 20 ans nombre de combats de grande envergure. Ceux de la fin des années 60 - début des années 70 (mai 68 en France, "automne chaud" italien de 69, soulèvement des ouvriers de Pologne en décembre 70, etc.), alors même que la crise ouverte du capitalisme commençait tout juste à affecter les conditions de vie de la classe ouvrière, ont fait la preuve irréfutable que le prolétariat s'était dégagé de la chape de plomb de la contre-révolution qui avait pesé sur lui depuis la fin des années 20. La perspective ouverte par l'intensification des contradictions du mode de production capitaliste n'était pas celle d'une nouvelle boucherie impérialiste, comme au cours des années 30, mais celle d'affrontements de classe généralisés. Pour sa part, la vague de combats ouvriers de la fin des années 70 - début des années 80 (Longwy-Denain en France, sidérurgie et bien d'autres secteurs en Grande-Bretagne, Pologne, etc.) confirmait que la vague précédente n'était pas un feu de paille mais avait ouvert toute une période historique où l'affrontement entre bourgeoisie et prolétariat ne ferait que s'aiguiser. La courte durée du recul des luttes succédant à la défaite subie par la classe ouvrière lors de ces combats (défaite ponctuée par le coup de force de décembre 81 en Pologne), témoignait à son tour de cette même réalité. Dès l'automne 83, avec les luttes massives du secteur public en Belgique, s'ouvrait en effet toute une série de combats dont l'ampleur et la simultanéité dans la plupart des pays avancés, et notamment européens, traduisait de façon significative l'approfondissement d’antagonisme de classe dans les pays centraux, décisifs pour sa perspective générale à l'échelle mondiale. Cette série de combats, notamment le conflit généralisé du secteur public du printemps 86 en Belgique, montrait clairement que le caractère de plus en plus frontal et massif des attaques capitalistes posait désormais comme nécessité aux luttes prolétariennes celle de leur unification, c'est-à-dire non seulement leur extension géographique par dessus les secteurs et les branches [professionnelles, mais aussi la prise en charge consciente par a classe ouvrière de cette extension. En même temps, les différentes luttes de cette période, et particulièrement celles qui se sont déroulées ces dernières années en France (chemins de fer en décembre 86, hôpitaux à l'automne 88) et en Italie (enseignement au printemps 87, chemins de fer durant l'été et l'automne 87) ont mis en relief le phénomène d'usure des syndicats, l'affaiblissement de leur capacité à se présenter comme les "organisateurs" des luttes ouvrières. Même si ce phénomène ne s'est manifesté de façon évidente que dans les pays où les syndicats se sont le plus déconsidérés par le passé, il correspond à une tendance historique générale et irréversible. Surtout qu'il se double d'un discrédit croissant dans les rangs ouvriers à l'égard des partis politiques de gauche, et plus généralement à l'égard de la Démocratie bourgeoise, discrédit que l'on peut constater notamment par une abstention croissante lors des farces électorales.
Dans ce contexte historique d'une combativité prolétarienne qui ne s'est pas démentie depuis 20 ans et d'affaiblissement des structures fondamentales d'encadrement de la classe ouvrière, l'aggravation continue des attaques capitalistes crée les conditions de nouveaux surgissements encore plus considérables de celle-ci, d'affrontements bien plus massifs et déterminés que ceux que nous avons connus par le passé. Voilà ce qui constitue le cadre véritable des enjeux de la situation mondiale. Voilà ce que la bourgeoisie essaie par tous les moyens de cacher aux ouvriers.
LE RENFORCEMENT DES CAMPAGNES IDEOLOGIQUES DE LA BOURGEOISIE
En regardant la télévision, écoutant la radio, lisant les journaux, nous "apprenons" que les faits majeurs et significatifs de la situation mondiale présente sont :
- le "réchauffement" des relations entre les principales "puissances", les Etats-Unis et l'URSS en premier lieu, mais aussi entre cette dernière et la Chine ;
- la "réelle volonté" de tous les gouvernements de construire un monde "pacifique", de régler par la négociation les conflits pouvant subsister dans différentes parties du monde et de limiter la course aux armements (notamment les plus "barbares" comme les armes atomiques et chimiques) ;
- le fait que le principal danger qui menace aujourd'hui l'humanité soit constitué par la destruction de la nature, notamment de la forêt amazonienne, par "l'effet de serre" qui va désertifier d'immenses étendues de la planète, par les "risques technologiques" à la Tchernobyl, etc. ; qu'il faut par conséquent se mobiliser derrière l'action des écologistes et des gouvernements qui maintenant reprennent à leur compte les préoccupations des premiers ;
- l'aspiration croissante des peuples vers la "Liberté" et la "Démocratie", aspiration dont Gorbatchev et ses "extrémistes", tel Boris Eltsine, figurent parmi les principaux interprètes en compagnie d'un Walesa portant en bandoulière son Prix Nobel, d'un Bush converti en grand pourfendeur de ses anciens amis "gorilles" et trafiquants de drogue à la Noriega, d'un Mitterrand exhibant aux quatre coins du monde son bicentenaire de la "Déclaration des Droits de l'Homme", des étudiants chinois, enfin, qui apportent une touche exotique et "populaire" à ce grand remue-ménage ;
- la préparation de l'Europe de 93, la mobilisation pour cet "événement historique incomparable" que constituera l'ouverture des frontières entre ses pays membres et dont les élections du 18 juin seront un jalon de premier ordre ;
- le danger que représente "l'intégrisme islamique", son grand maître Khomeiny avec ses appels Rushdicides et ses bataillons de terroristes.
Au milieu de ce tintamarre, la crise et la classe ouvrière sont étrangement discrètes. Quand on évoque la première, c'est pour proclamer qu'elle s'éloigne (les taux de croissance ne retrouvent-ils pas leur niveau des années 60?), pour nous faire vibrer pour le cours du dollar, nous "informer" que les grands de ce monde se préoccupent de la dette des pays sous-développés et "font quelque chose". Quant à la seconde, lorsque les médias s'y intéressent (en général ses luttes font l'objet du plus systématique des black-out), c'est surtout pour prononcer son oraison funèbre où afficher des bulletins de santé alarmistes à son sujet : elle est morte ou bien presque morte, en tout cas "elle est en crise puisque le syndicalisme est en crise".
L'intoxication n'est pas un phénomène nouveau dans la vie du capitalisme, ou même des sociétés de classe. Depuis ses origines la bourgeoisie a raconté des balivernes aux exploités afin de leur faire accepter leur sort, de les détourner du chemin de la lutte de classe. Mais ce qui distingue notre époque, c'est le niveau extrême du totalitarisme que l'Etat capitaliste a su mettre en place en vue de contrôler les esprits. Il n'assène pas une vérité unique et officielle, mais, pluralisme oblige, cinquante "vérités" concurrentes parmi lesquelles chacun est "libre de faire son choix", comme dans un hypermarché, et qui ne sont en réalité que cinquante variantes d'un même mensonge. Avant même les réponses, ce sont les questions elles-mêmes qui sont mensongères : pour ou contre le désarmement ? Pour ou contre l'élimination des missiles à courte portée ? Pour ou contre un Etat palestinien ? Pour ou contre le "libéralisme" ? Gorbatchev est-il sincère ? Reagan était-il sénile ? Voilà les questions "fondamentales" des "débats" télévisés ou des sondages, quand ce n'est pas "pour ou contre la chasse au renard" ou "pour ou contre le massacre des éléphants".
Si les mensonges et les campagnes médiatiques ont pour objet principal de recouvrir d'un rideau de fumée les vrais problèmes qui se posent à la classe ouvrière, leur intensification présente ne fait que traduire la conscience qu'a la bourgeoisie du danger croissant d'explosions de combativité prolétarienne, du processus de développement de la conscience qui traverse la classe. Ainsi, comme nous l'avons déjà mis en évidence dans cette Revue (par exemple dans "Guerre, militarisme et blocs impérialistes", Revue n°53, page 27), une des causes du remplacement des campagnes militaristes du début de la décennie (la croisade reaganienne contre 1'"Empire du Mal") par la campagne pacifiste actuelle à partir de 83-84, réside dans le fait que le thème sur le danger de guerre, s'il pouvait accentuer la démoralisation de la classe ouvrière dans un moment de défaite, risquait au contraire d'ouvrir les yeux des ouvriers sur les véritables enjeux de la période actuelle dès lors qu'ils avaient repris le chemin des combats ouverts. Sur le fond, il n'y a pas eu de réelle atténuation des conflits entre les grandes puissances impérialistes, au contraire : comme preuve suffisante on peut retenir le fait que les dépenses militaires ne cessent de s'accroître alors qu'elles représentent un fardeau de plus en plus lourd pour l'économie de tous les pays. Mais ce qui a changé, c'est le fait que la classe ouvrière est aujourd'hui en meilleure position pour comprendre que la seule force qui puisse empêcher une troisième guerre mondiale, c'est sa propre lutte. Dans ces conditions, il importait pour la bourgeoisie de "démontrer" que c'est la "sagesse" des gouvernements qui permet de parvenir à un monde plus pacifique, moins menacé par la guerre.
Dans ce même sens, les campagnes actuelles sur les dangers écologiques, la volonté affichée par les gouvernements de "lutter" contre ces dangers, ont pour but principal d'obscurcir la conscience du prolétariat. Ces dangers constituent une menace réelle pour l'humanité. Ils sont une manifestation de la décomposition générale, du pourrissement sur pied, qui affecte aujourd'hui la société capitaliste (voir l'article "La décomposition du capitalisme", Revue Internationale n°57). Mais les campagnes à leur sujet ne visent évidemment pas à promouvoir une telle analyse. Ce qu'il s'agit de "démontrer", et la bourgeoisie y est pour le moment parvenue dans une certaine mesure dans nombre de pays, c'est que la principale menace pesant sur l'humanité n'est pas la guerre mondiale. En proposant une "peur de substitution" aux inquiétudes qu'un monde à l'agonie engendre nécessairement dans la population, on renforce l'impact des campagnes pacifistes. En outre, bien plus que la guerre dont la classe ouvrière sait bien qu'elle est la principale victime, la menace écologique se présente comme beaucoup plus "démocratique" : l'air pollué de Los Angeles ne sélectionne pas les poumons des prolétaires, les nuages radioactifs de Tchernobyl ont frappé indistinctement les ouvriers, les paysans et les bourgeois de la région (en réalité, dans ce domaine également, les ouvriers sont beaucoup plus exposés que les bourgeois). De ce fait "l'écologie est l'affaire de tous" : là encore, il importe de masquer à la classe ouvrière l'existence de ses intérêts spécifiques. Il s'agit aussi de l'empêcher de comprendre que ce type de problèmes (comme ceux de l'insécurité croissante ou de la drogue) n'a pas de solution au sein de la société capitaliste dont la crise irrémédiable ne peut engendrer que toujours plus de barbarie. C'est ce but que visent principalement les gouvernements lorsqu'ils annoncent qu'ils vont "s'attaquer sérieusement" aux dangers qui menacent l'environnement. De plus, les dépenses supplémentaires que vont occasionner les mesures "écologiques" (hausse des impôts et des prix des biens de consommation telle la "voiture propre") auront bon dos pour justifier la baisse du niveau de vie des ouvriers. Il est évidemment plus facile de faire accepter des sacrifices au nom des "frais pour l'amélioration du cadre de vie" qu'au nom des dépenses d'armement (quitte à détourner discrètement les premiers au bénéfice des secondes).
Cette tentative de faire accepter aux ouvriers des sacrifices supplémentaires au nom des "grandes causes", nous la retrouvons d'ailleurs dans les campagnes sur la "construction de l'Europe". Déjà, lorsque les ouvriers de la sidérurgie se révoltaient contre les licenciements massifs, à la fin des années 70, chaque Etat national avait utilisé cet argument : "ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de ces réductions d'effectifs, la décision vient de Bruxelles". Aujourd'hui, on reprend la même rengaine : il faut que les ouvriers améliorent leur productivité, soient "raisonnables" dans leurs revendications pour permettre à l'économie nationale d'être compétitive dans "le Grand Marché européen de 93". En particulier, "l'harmonisation des fiscalités et des prestations sociales" sera l'occasion de "niveler par le bas" ces dernières, c'est-à-dire de porter une nouvelle attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Les campagnes démocratiques, enfin, ont pour objet de "faire comprendre" aux ouvriers des grandes métropoles occidentales la "chance" qu'ils ont de disposer des biens aussi précieux que sont "la Liberté" et "la Démocratie" même si, par ailleurs, leurs conditions de vie sont de plus en plus dures. Aux ouvriers des pays qui sont encore privés de "Démocratie", il importe de faire passer le même message : leur mécontentement tout à fait légitime face à la dégradation continuelle et catastrophique de leurs conditions de vie, face à la misère croissante qui les accable, doit se tourner vers le soutien d'une politique - la "démocratisation" - visant à surmonter les causes de ces calamités (voir dans ce numéro de la Revue l'article sur la "glasnost").
Une mention spéciale doit être accordée au battage médiatique considérable qui, en ce moment même, entoure les événements de Chine : "la force véritable capable de défier un gouvernement, ce n'est pas la classe ouvrière, mais les étudiants" (c'est une chanson que nous avions déjà entendue par le passé, notamment en mai 68 en France et, dans ce même pays, en décembre 86) : voilà le message qu'il faut faire passer car tout est bon pour tenter de convaincre la classe ouvrière qu'"elle n'est rien", ou au moins d'entraver en son sein la prise de conscience qu'elle est la seule classe porteuse d'un avenir, que ses luttes actuelles sont des préparatifs en vue de la seule perspective qui puisse sauver l'humanité, une condition du renversement de ce système qui engendre tous les jours une barbarie croissante.
Mais pour parvenir à cette fin, la bourgeoisie ne se contente pas de ses grandes campagnes médiatiques. Elle doit en même temps, et plus encore, s'attaquer à la combativité, à la confiance en soi et au développement de la conscience du prolétariat sur le terrain où ils se manifestent le plus directement, celui des luttes contre les attaques de plus en plus brutales que la bourgeoisie lui assène.
LES MANOEUVRES DE LA BOURGEOISIE CONTRE LES LUTTES OUVRIERES
Si l'unification de ses combats constitue à l'heure actuelle pour la classe ouvrière une nécessité vitale, il est clair que c'est sur ce terrain que la bourgeoisie doit déployer ses efforts majeurs. Et il en est bien ainsi dans le moment présent.
En effet, on a pu assister ces derniers mois au déploiement de toute une offensive bourgeoise consistant à prendre les devants de la combativité ouvrière, en provoquant des luttes de façon préventive, afin de briser dans l'oeuf l'élan vers une mobilisation massive et solidaire de l'ensemble de la classe. Et c'est en Grande-Bretagne, pays où domine la bourgeoisie la plus expérimentée et habile du monde, qu'une telle tactique a été mise en oeuvre dès l'été dernier avec la grève des postes du mois d'août. En déclenchant prématurément un mouvement dans un secteur aussi central que les postes, dans la période de l'année la moins propice à un élargissement du combat, la bourgeoisie s'est donnée ainsi toutes les garanties au maintien de l'isolement et à l'enfermement catégoriel. Le succès d'une telle manoeuvre a donné le feu vert à la bourgeoisie des autres pays d'Europe occidentale pour exploiter à fond cette stratégie comme on a pu le voir en France, dès le mois de septembre, avec le déclenchement artificiel et planifié plusieurs mois auparavant de la grève des infirmières. En cette circonstance également, il s'agissait pour la bourgeoisie de faire partir prématurément un secteur, de provoquer un affrontement sur un terrain miné avant que n'aient mûri suffisamment dans l'ensemble de la classe ouvrière les conditions d'un réel combat frontal (voir l'article "France : les "coordinations" à l'avant-garde du sabotage des luttes", Revue Internationale n°56). Dès le mois de décembre, c'est en Espagne que la bourgeoisie, forte des succès remportés en Grande-Bretagne et en France, va reprendre à son compte une telle stratégie comme on a pu le voir avec l'appel de tous les syndicats à la fameuse "grève générale" du 14 décembre où, cette fois, ce n'est pas un secteur particulier mais des millions d'ouvriers de tous les secteurs qui ont été embarqués dans une bataille prématurée, dans une fausse démonstration de "force". Voilà comment la bourgeoisie, dans tous les pays où elle a été confrontée ces deux dernières années à des luttes importantes, est parvenue à mouiller la poudre en prenant les devants pour étouffer tout nouveau surgissement de combats massifs.
Pour être en mesure de mener à bien une telle politique de sabotage des luttes ouvrières, l'Etat capitaliste est aujourd'hui contraint de renforcer l'ensemble de ses forces d'encadrement sur le terrain. Face au discrédit croissant des syndicats dans les rangs ouvriers, face aux tendances de la classe ouvrière à prendre elle-même en main la conduite de ses luttes, partout la bourgeoisie a tenté non seulement de remettre en selle ses syndicats officiels mais encore de mettre en place des structures "extra syndicales" pour occuper tout le terrain de la lutte, reprendre à son propre compte les besoins de la classe pour mieux les vider de leur contenu et les retourner contre elle.
C'est ainsi qu'en France, on assiste à une extrême "radicalisation" de la CGT (contrôlée par le PC), en même temps que des remaniements sont opérés au sein des autres syndicats afin de "gauchiser" leur image. En Espagne, c'est à cette même radicalisation que se sont trouvés confrontés les ouvriers, radicalisation qui a permis à tous les syndicats unis d'orchestrer la manoeuvre du 14 décembre. En particulier, on a vu l'UGT (syndicat lié au PSOE au gouvernement) se démarquer subitement du PSOE, en engageant la "bataille" aux côtés des Commissions ouvrières et du PC contre la politique d'austérité du gouvernement. C'est cette même radicalisation des syndicats officiels qui a entravé également le développement des luttes aux Pays-Bas ces derniers mois, où comme en Espagne, les syndicats non seulement ont tenté de redorer leur blason à travers leurs discours d'opposition au gouvernement, mais ont surtout tenté de reprendre à leur propre compte le besoin d'unité des ouvriers pour le dénaturer et le dévoyer. Si, en Espagne, c'est l'unité syndicale UGT-CCOO-CNT qui a été mise en avant dans la manoeuvre du 14 décembre, alors que tout était organisé pour éviter que les différents secteurs ouvriers ne se retrouvent dans les manifestations, aux Pays-Bas, c'est à travers un appel à une fausse "solidarité active" que les syndicats ont pu prendre les devants et dévoyer ce besoin essentiel de la classe. Et, à cet effet, ils avaient mis en place dès l'automne dernier un "comité de coordination" destiné soi-disant à "organiser la solidarité" avec les différents secteurs en lutte.
En Grande-Bretagne, enfin, la bourgeoisie n'est pas restée à la traîne dans la politique de "radicalisation" des syndicats. Dans la récente grève générale des transports de la région de Londres, la plus importante dans ce secteur depuis 1926, ce sont les syndicats "officiels" eux-mêmes qui ont pris la responsabilité d'appeler à une grève illégale.
Cependant, cette stratégie de "radicalisation" des syndicats se révèle de moins en moins capable, à elle seule, de barrer le chemin au développement des luttes. De façon de plus en plus fréquente, les syndicats officiels ou même "de base" sont relayés et épaulés par une autre structure d'encadrement, soi-disant "extra-syndicale" et animée essentiellement par les gauchistes : les coordinations auto-proclamées. Depuis le mouvement dans les hôpitaux en France, qui a mis en vedette la "coordination infirmière", celle-ci est devenue un modèle pour l'ensemble de la bourgeoisie européenne. Ainsi, ces derniers mois, ont surgi dans plusieurs pays des "succursales" de cette coordination infirmière, notamment en RFA où s'est constituée dès le mois de novembre une coordination du même type dans les hôpitaux de Cologne avant même le développement d'une mobilisation dans ce secteur. Aux Pays-Bas, c'est également chez les infirmières que les gauchistes ont mis en place une coordination et ont appelé à un meeting national à Utrecht en février, c'est-à-dire à une tentative de centralisation ne correspondant à aucune mobilisation réelle des travailleurs.
Et ce n'est pas un hasard si la manoeuvre déployée avec la grève des infirmières en France sert aujourd'hui de modèle, de référence pour la bourgeoisie des autres pays européens. C'est elle qui, grâce à la pseudo victoire qu'elle a obtenu (alors que les fonds destinés aux augmentations avaient été débloqués depuis longtemps par le gouvernement), a été le fer de lance de l'offensive bourgeoise actuelle visant à présenter les luttes corporatistes comme étant les seules pouvant mener les ouvriers à une victoire, à opposer les différents secteurs les uns aux autres, afin de saper toute velléité de développer une riposte unifiant l'ensemble des secteurs sur la base de revendications communes à tous. C'est ainsi que ces derniers mois, dans un grand nombre de pays, on a vu syndicats et gauchistes intensifier la politique utilisée déjà lors des grèves des chemins de fer de 86 en France et de 87 en Italie (en particulier à travers les "coordinations") pour inoculer systématiquement le poison corporatiste dans toutes les luttes, au moyen notamment de la mise en avant de revendications spécifiques à tel ou tel secteur, afin d'empêcher les autres secteurs de se reconnaître dans les luttes, voire de les opposer les uns aux autres.
Ainsi, en Espagne, la grande manoeuvre du 14 décembre ne visait pas seulement à prendre les devants de la mobilisation ouvrière pour mouiller la poudre. Elle ouvrait également la voie à toute une campagne syndicale sur le thème : "il faut tirer maintenant les leçons du grand succès du 14 décembre dans chaque secteur car chaque secteur a sa propre convention collective, ses propres revendications". De même, dans les secteurs où les syndicats sont particulièrement contestés, ce sont les gauchistes et les syndicalistes de base qui ont mis en avant des revendications spécifiques pour les roulants dans les chemins de fer, les mécaniciens des transports aériens, les mineurs de Tewel, les infirmières à Valence etc.
En RFA, c'est au moyen d'une vaste campagne médiatique autour de la revalorisation du métier d'infirmière que la bourgeoisie, en utilisant un secteur particulier s'est efforcée d'inoculer le poison du corporatisme au sein de la classe ouvrière. Et sur le terrain, ce sont les gauchistes de la coordination constituée à Cologne qui ont mis en avant la revendication d'une augmentation de salaire de 500 Marks pour les seules infirmières, comme ce fut le cas en France.
Aux Pays-Bas, alors que depuis le début de l'année la combativité ouvrière menaçait d'éclater ouvertement dans tous les secteurs contre les nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement, les syndicats et les gauchistes ont su exploiter leur image radicale pour enfermer, isoler les unes des autres toutes les luttes qui se sont développées depuis le début de l'année 89 dans de nombreux secteurs : aux usines Philips, dans le port de Rotterdam, chez les enseignants, les employés communaux d'Amsterdam, les sidérurgistes des aciéries de Hoogovens, les conducteurs de camions, les ouvriers du bâtiment, etc. La stratégie de dispersion des luttes déployée par les forces d'encadrement (grèves tournantes secteur après secteur, meetings régionaux, débrayages de 2 ou 3 heures, "journées d'action" appelées dans un seul secteur, etc.) s'est appuyée essentiellement sur la mise en avant de revendications catégorielles, de telle sorte que les autres secteurs de la classe ne puissent se reconnaître dans telle ou telle lutte (semaine de 36 heures pour les sidérurgistes, paiement des heures supplémentaires pour les camionneurs, défense de la qualité de l'enseignement pour les instituteurs etc.).
Voilà comment la bourgeoisie déploie à l'heure actuelle ses manoeuvres en Europe occidentale, c'est-à-dire là où est concentré le fer de lance du prolétariat mondial. Cette stratégie a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats. Mais le fait que la classe dominante soit de plus en plus obligée de s'appuyer sur ses forces "gauchistes" constitue un indicateur, au même titre que l'intensification de ses campagnes médiatiques, du processus profond de maturation des conditions pour de nouveaux surgissements massifs, de plus en plus déterminés et conscients de la lutte prolétarienne. En ce sens, les luttes extrêmement massives et combatives qu'ont menées ces derniers mois les ouvriers dans différents pays de la périphérie, tels la Corée du Sud, le Mexique, le Pérou et surtout le Brésil (où, pendant plusieurs semaines, une mobilisation de plus de 2 millions d'ouvriers a passablement débordé les syndicats), ne sont que les signes avant-coureurs d'une nouvelle série d'affrontements majeurs dans les pays centraux du capitalisme affirmant toujours plus que c'est bien la classe ouvrière qui détient entre ses mains la clé de toute la situation historique présente.
FM, 28-5-89
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Un mensonge dans la continuité du stalinisme : la perestroïka de Gorbatchev
- 5660 reads
Après les années d'immobilisme incarnées par le règne de la clique brejnévienne, l'U.R.S.S., sous la houlette de Gorbatchev est prise d'une frénésie de réformes politiques et économiques. Les campagnes médiatiques sur la réforme économique, sur la démocratisation font écho sur toute la planète ; les termes de Perestroïka et de Glasnost ont franchi le rideau de fer tandis que, personnifiée par Gorbatchev, une nouvelle image pacifiste de l'U.R.S.S. est offerte à la population mondiale.
Que se passe-t-il en U.R.S.S. ? Quelle est la signification de ces bouleversements qui remuent la deuxième puissance impérialiste mondiale ? Que peut en attendre le prolétariat ?
L'U.R.S.S. D'AVANT LA PERESTROÏKA
Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de resituer le contexte économique et historique du capital russe qui détermine directement les aspects spécifiques permettant de mieux comprendre la situation présente.
LA FAIBLESSE ECONOMIQUE DE L'U.R.S.S.
La situation présente en U.R.S.S. est le résultat de décennies de crise permanente du capital russe. L'économie russe est fondamentalement sous-développée. La puissance économique de l'U.R.S.S. se caractérise plus par sa taille que par sa qualité. Le P.N.B./habitant estimé à 5700 $ en 1988 ([1] [1563]) place l'U.R.S.S. au 53e rang mondial juste avant la Libye. Les exportations de l'U.R.S.S. sont caractéristiques des pays sous-développés : essentiellement des matières premières, gaz et pétrole dont elle est le premier producteur mondial.
La situation de sous-développement du capital russe est ancienne, il est arrivé trop tard sur le marché mondial. Entravé dans son développement par la féodalité tsariste au XIXème siècle, à peine s'impose-t-il politiquement, portant encore les marques profondes du féodalisme, que son Etat est anéanti et son économie bouleversée par la révolution prolétarienne de 1917. Ce n'est qu'avec la contre-révolution stalinienne qu'il s'imposera sur la scène internationale. Le capitalisme stalinien, surgi en pleine période de décadence capitaliste, en porte irrémédiablement les stigmates. Produit de la pire des contre-révolutions, il est une caricature du capitalisme d'Etat décadent. Si l'U.R.S.S. a pu s'imposer comme deuxième puissance mondiale, ce n'est certainement pas par la compétitivité et la productivité de son économie, mais par la force de ses armes idéologiques et militaires dans la seconde guerre impérialiste mondiale, et ensuite, dans les soi-disant luttes de libération nationale. Même si le capital russe s'est renforcé après la guerre par le pillage des pays d'Europe de l'Est (démantelant des usines pour les remonter en U.R.S.S.) et une tutelle de fer sur son bloc pour détourner les lois de l'échange à son profit, son retard sur le plan économique par rapport aux pays les plus développés ne fera que s'aggraver.
L'U.R.S.S. n'a pu accéder au rôle de deuxième puissance impérialiste mondiale et s'y maintenir qu'en transformant toute son économie en économie de guerre, en polarisant son appareil productif autour de la production d'armement. Des pans entiers de l'économie qui ne relevaient pas de la priorité militaire, ont été sacrifiés : agriculture, biens de consommation, santé, etc. Les richesses, produit de l'exploitation des travailleurs, sont faiblement réinvesties dans la production et surtout détruites dans la production d'armements.
Une telle ponction sur l'économie, bien supérieure à celles réalisées pour la production d'armements en occident, ne peut que peser de plus en plus lourdement sur l'économie russe et entraver gravement le développement de son capital, lui faisant perdre à jamais tout espoir de concurrencer ses rivaux sur le plan économique. Le capitalisme à l'est s'inscrit totalement dans la crise mondiale, sous des formes parfois différentes mais tout aussi significatives qu'à l'ouest. Irrésistiblement, décennies après décennies, le taux de croissance officiel, artificiellement entretenu par la production d'armements, baisse.
Une telle politique économique où tout est sacrifié sur l'autel de l'économie de guerre et de la stratégie impérialiste, ne peut que se traduire par des attaques permanentes contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
Cependant, à terme, une telle faiblesse économique ne peut que constituer une entrave à la capacité de développement de la puissance impérialiste de l’U.R.S.S.. C'est ce qu'illustre l'histoire du capital russe après la guerre. ([2] [1564])
LE RECUL DU BLOC RUSSE ET L'IMMOBILISME BREJNEVIEN
Avec les accords de Yalta qui entérinent le partage du monde et notamment de l'Europe, entre l'U.R.S.S. et les U.S.A., s'ouvre une nouvelle période marquée par l'antagonisme de ces deux puissances impérialistes mondiales dominantes, avides de s'approprier des lambeaux de l'empire colonial de l'Europe défaillante. Les soi-disant "luttes de libération nationales" vont être un des vecteurs de l'impérialisme des deux "grands". Tout comme les U.S.A., l'U.R.S.S. va mettre à profit la période de décolonisation pour sortir de son isolement continental. Usant et abusant de son discours idéologique mystificateur, par son soutien armé aux mouvements "anticoloniaux" et "nationalistes" elle va étendre sa zone d'influence : en Asie (Chine, Vietnam), au Moyen-Orient (Egypte, Syrie, Irak), et même en Amérique (Cuba). Partout dans le monde, les partis staliniens et les "guérillas" soutenus par l'U.R.S.S. témoignent de sa puissance mondiale. Mais, ce que l'U.R.S.S. est capable de gagner sur le plan militaire et idéologique, elle se révèle incapable de le consolider sur le plan économique. Avec les années 60, s'engage un irréversible processus de déclin, qui va s'accélérer avec le développement de la crise économique dans les années 70 : le gain de Indochine ne compense pas la perte catastrophique de la Chine ; la réaction occidentale impose un recul dans l'affaire des missiles à Cuba ; la défaite militaire de ses alliés au Proche-Orient, face à Israël, accélère sa perte d'influence dans la région ; en Amérique et en Afrique, les mouvements de "lutte de libération nationale" qu'elle soutient, sont défaits et la "victoire" en Angola qui met à profit la décolonisation tardive des possessions portugaises, n'est qu'une maigre consolation.
Ce recul traduit la situation de faiblesse relative dans laquelle se trouve le bloc russe vis-à-vis de son concurrent occidental.
L'U.R.S.S. pour consolider son bloc à la périphérie ne peut quasiment rien offrir sur le plan économique : ses aides financières sont pauvres et incapables de concurrencer les subsides de l'occident ; elle n'a pas de réels débouchés à offrir aux exportations de ses alliés, sa technologie est déficiente et ne permet pas à ses vassaux de concurrencer efficacement leurs rivaux sur le plan économique. Les pays sous sa domination vont s'appauvrir et s'affaiblir vis-à-vis de leurs concurrents du bloc occidental. Pour n'importe quel capital national, il est plus intéressant économiquement de se trouver inséré au sein du bloc le plus puissant dominé par les U.S.A.
Face à cette situation de faiblesse, les seuls atouts de l'U.R.S.S. sont la force des armes et le mensonge idéologique. Mais, la faiblesse économique du bloc russe ne peut, à la longue, que saper ces deux piliers de la puissance du capital russe. A cet égard, le règne de Brejnev va être exemplaire. Après les ambitions de Kroutchev (qui prévoyait le communisme et l'abondance pour 1980 !!!), la bourgeoisie russe doit revoir ses ambitions à la baisse. Après l'euphorie des années 50 : expansion impérialiste, succès technologiques (premier Spoutnik), les échecs répétés au début des années 60 : recul dans l'épisode des missiles de Cuba, brouille avec la Chine, le mécontentement de la classe ouvrière qui va culminer avec les émeutes sanglantes de Novotcheikass, l'hostilité de la Nomenklatura aux réformes économiques, vont précipiter la chute de Kroutchev qui sera "démissionné pour raison de santé" en 1964. Brejnev prend la succession.
Finie la politique de réforme ambitieuse. Les réformes économiques proposées par Lieberman pour dynamiser l'économie russe sont enterrées. Les campagnes idéologiques de "déstalinisation" inaugurées par le XXe Congrès et menées pour tenter de recrédibiliser l'Etat, sont stoppées net. L'incapacité de la bourgeoisie russe de mener ce programme de modernisation va se traduire par l'immobilisme. Le capitalisme russe s'enfonce encore plus dans le marasme économique. Plus que jamais le seul moyen pour l'U.R.S.S. de s'ouvrir de nouveaux marchés, non pour les faire fructifier mais pour les piller, c'est la force des armes. Des armes, c'est la seule chose que l'U.R.S.S. a à offrir à ses alliés. Des armes, la Russie de Brejnev va en produire à profusion. L'industrie de l'armement va continuer de s'hypertrophier aux dépens des autres secteurs de la production.
Sur le plan international, l'arrivée de Brejnev sanctionne le recul de l'impérialisme russe. Alors que la guerre au Vietnam s'intensifie et que les deux puissances s'y embourbent, les relations entre les deux grands sont paradoxalement marquées par les campagnes sur la "coexistence pacifique" et des accords de limitation des armements sont signés : en 1968, un traité de non-prolifération des armes nucléaires et en 1973, les célèbres accords S.A.L.T. Loin des discours "pacifistes" de l'après-Vietnam, la course aux armements se poursuit et impose des sacrifices toujours plus forts à l'économie. Mais l'économie est un tout. Les impasses faites dans certains secteurs se traduisent par un retard technologique croissant qui se répercute inévitablement sur l'efficacité des armes. La quantité d'armements va tendre à remplacer la qualité. Durant les années 70, l'influence du bloc de l'est va se réduire comme peau de chagrin. Même la victoire sur le terrain au Vietnam va se traduire par une déroute stratégique avec l'alliance de la Chine et des U.S.A. Les pays où l'Est maintient sa présence à la périphérie du capitalisme, sont soumis à une pression militaire, économique de la part du bloc occidental et sont un gouffre pour le capital russe sans que celui-ci puisse en tirer grand profit ni sur le plan économique, ni sur le plan stratégique.
L'effondrement du régime du Shah en Iran en créant un vide béant dans le dispositif militaire du bloc occidental qui enserre le bloc de l'Est, donne à l’U.R.S.S. l'opportunité de s'ouvrir une route vers son rêve stratégique d'un accès aux mers chaudes et aux richesses du Moyen-Orient. Après des années de litanies pacifistes, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, fin 1979, est une remise en cause dans les faits des accords de Yalta. Les années 80 s'ouvrent sous les auspices inquiétants d'un très brutal réchauffement des tensions inter impérialistes entre les deux grands. Le bloc occidental réagit par une offensive impérialiste de grande envergure. Le bloc de l'Est est soumis à un blocus technologique et économique. Les budgets d'armements occidentaux font un bond, de nouvelles armes toujours plus perfectionnées et efficaces sont fabriquées, de nouveaux programmes intégrant les dernières découvertes technologiques sont lancés, une politique militairement plus agressive est imposée partout où l'U.R.S.S. a encore une influence, l'arme de la "guérilla" est retournée contre le bloc russe en Angola, en Ethiopie, au Cambodge, en Afghanistan.
Le brutal accroissement des tensions impérialistes va mettre en relief les carences du dispositif militaire russe. Déjà, la guerre du Kippour en 1973 où, en quelques heures, l'aviation israélienne avait cloué au tapis, sans aucune perte, une centaine d'avions russes de l'armée syrienne, avait montré le retard technologique des armements russes, leur inefficacité. La fourniture par les U.S.A. de missiles Stinger aux "moudjahiddines" afghans va bouleverser le champ de bataille. L'armée rouge ne peut plus utiliser ses hélicoptères blindés comme auparavant et son aviation ne peut plus se permettre sans risque de bombarder les "résistants" à basse altitude ; quant à ses chars, ils sont des cibles fragiles face aux nouveaux missiles et roquettes anti-chars qui sont livrés par l'occident. Malgré un contingent de plus de 100 000 hommes, des milliers de chars, des centaines d'hélicoptères et d'avions, l'armée rouge est incapable de s'imposer sur le terrain. L'état-major "soviétique" doit constater l'inefficacité de ses armes, leur retard technologique. L'annonce par Reagan du programme dit de la "guerre des étoiles" qui rendrait caduques les missiles stratégiques nucléaires et donc, du même coup, l'essentiel de l'arsenal nucléaire russe, le constat du retard dramatique dans des domaines essentiels tels que l'électronique provoque parmi les stratèges du bloc russe la crainte d'une percée technologique occidentale qui surclasserait totalement leurs systèmes d'armes.
Au sein de la bourgeoisie russe, la fraction militaire responsable du complexe militaro-industriel et de l'armée devient la plus chaude partisane d'une réforme économique destinée à redresser la situation. Des armes en quantité, ce n'est pas suffisant si celles-ci ne sont pas de qualité. Pour moderniser les armes, il faut "moderniser" l'économie, c'est-à-dire exploiter plus et mieux les travailleurs pour renforcer la capacité technologique du secteur militaro-industriel.
La nécessaire réforme économique se heurte à la pesanteur bureaucratique de la classe dominante regroupée dans le Parti qui paralyse le fonctionnement de la production et justifie tous les gaspillages. Le capitalisme russe a la particularité de s'être imposé directement au travers de l'Etat, le secteur privé ayant été réduit à sa plus simple expression par la Révolution russe. Le marché intérieur ne joue pas le rôle de régulateur par la concurrence. Les gestionnaires et responsables de la production sont plus soucieux de leur place dans la Nomenklatura et des privilèges qui en découlent, que de la production. Le népotisme, la corruption et les combines règnent. Les membres du Parti, pour qui le poste de directeur d'usine ne correspond à aucune compétence particulière, mais à une situation où au travers de privilèges multiples, on peut s'en mettre plein les poches, sont peu soucieux de la production. Liés à un clan ou à un autre, parrainés en haut lieu, leur carrière ne dépend pas de leurs résultats économiques. L'anarchie bureaucratique qui règne dans la production est tout à fait profitable aux "apparatchiks". Une large fraction de la Nomenklatura y trouve tout à fait son compte et en fait sa base d'existence. Les fractions de la bourgeoisie qui ont soutenu l'immobilisme brejnévien, sont hostiles à tout changement qui remettrait en cause leurs privilèges, même si c'est pour le bien du capital national. Avec la mort de Léonid Brejnev, les rivalités de cliques vont s'exacerber et la guerre de succession va faire rage.
Mais le principal obstacle à la mise en place d'une réforme économique reste le prolétariat. En effet, la réforme économique implique une attaque renforcée contre les conditions de vie des travailleurs. Comme dans le reste du monde, dans le bloc de l'Est, les luttes ouvrières ont réapparu sur la scène de l'histoire. Les années de plomb de la contre- révolution stalinienne se sont éloignées, une nouvelle génération de prolétaires est née que la terreur et la répression ne parviennent plus à soumettre.
LA QUESTION SOCIALE DANS LE BLOC DE L'EST
Dans la tradition stalinienne, les conditions de vie de la population ont été sacrifiées aux besoins de l'économie de guerre. La pénurie règne, les magasins sont vides, le rationnement est imposé, les salaires sont maigres et le quadrillage policier impose le silence. Cette situation ne s'est pas beaucoup améliorée sous le régime de Kroutchev et Brejnev. Elle s'est même aggravée avec l'approfondissement de la crise économique mondiale à partir de la fin des années 60 qui fait aussi sentir ses effets à l'Est. Le mécontentement s'est développé au sein de la classe ouvrière, l'étau de la résignation face à la terreur policière a commencé à se desserrer pour une nouvelle génération de prolétaires qui n'a pas connu les pires années de la contre-révolution stalinienne. Le développement de la lutte de classe en Pologne est particulièrement significatif h cet égard ([3] [1565]). Les grèves et les émeutes des villes de la Baltique (Gdansk, Slettin, Sopot, Gdynia) durant l'hiver 1969-70 en Pologne, sauvagement réprimées dans un bain de sang, la vague de grèves de 1976 et finalement la grève de masse de 1980 qui se répand comme une traînée de poudre et embrase toute la Pologne, montrent la combativité retrouvée du prolétariat. Elles montrent aussi à la bourgeoisie que la répression ne suffît plus à maintenir le prolétariat sous le joug : malgré les répressions successives, après de bref reculs, la lutte de classe s'est redéployée à un niveau supérieur. La répression, si elle peut parvenir à intimider le prolétariat, constitue aussi un important facteur de prise de conscience pour une classe dont la combativité renaissante est aiguillonné par les attaques incessantes contre ses conditions de vie : le divorce entre l'Etat et la société civile est total, l'ennemi est clairement identifié. La fracture entre les exploités et la classe dominante étant tranchée, le prolétariat parvient plus facilement à reconnaître son unité de classe et imposer ses méthodes de luttes.
Pour la bourgeoisie, la répression est une arme à double tranchant. Mal employée, loin de démoraliser les ouvriers, elle risque de renforcer la mobilisation et la détermination du prolétariat. Au plus fort de la grève en Pologne, réprimer le mouvement portait le risque de cristalliser le mécontentement grandissant de la classe ouvrière dans tous les pays d'Europe de l'Est et d'ouvrir les portes à la généralisation de la grève au-delà des frontières de la Pologne. Face à la grève de masse en Pologne, la bourgeoisie a dû reculer pour se donner une marge de manoeuvre. Les accords de Gdansk d'août 1980, en même temps qu'ils marquent l'apogée de la lutte de classe, marquent aussi le début de la contre-offensive de la bourgeoisie. Celle-ci va se mener sous le masque de l'illusion démocratique et du nationalisme. Le prolétariat de Pologne qui avait montré sa combativité, son courage, sa détermination, son unité, ses réflexes de classe pour contrôler, organiser et orienter sa lutte, montre son immaturité, son inexpérience face aux mystifications plus sophistiquées de la bourgeoisie : la création de Solidarnosc, la montée en première ligne de l'Eglise donne une nouvelle crédibilité démocratique à l'Etat stalinien. Walesa va faire le pompier de la lutte de classe, demandant aux ouvriers en grève de reprendre le travail pour ne pas entraver le processus de "démocratisation" et la modernisation du capital polonais. La nouvelle "opposition" fait de la surenchère nationaliste avec le Parti communiste dirigeant. Le prolétariat polonais est déboussolé, démobilisé, divisé, isolé de ses frères de classe des autres pays. La bourgeoisie va en profiter pour réprimer une nouvelle fois à la fin de 1981. Solidarnosc est interdit, ce qui va renforcer sa crédibilité, mais son travail de sabotage de la lutte de classe va se poursuivre. La classe va continuer, malgré la répression, de manifester sa combativité tout au long des années 80, mais ses luttes sont détournées par Solidarnosc qui jouit d'une très grande popularité, et transformées en "lutte pour la démocratie", pour la reconnaissance "officielle" du nouveau syndicat.
Le prolétariat de Pologne est la fraction la plus avancée du prolétariat des pays de l'Est. Il montre dans ses forces et ses faiblesses des caractéristiques qui ne lui sont pas propres, mais que partagent d'autres fractions du prolétariat :
- une caractéristique générale au prolétariat mondial, celle d'un développement de la combativité, de la volonté de lutter. Dans les pays de l'Est comme ailleurs une nouvelle génération de prolétaires est arrivée sur la scène de l'histoire qui n'a pas subi le joug de la contre-révolution triomphante qui a marqué ce siècle, qui n'est pas vaincue, résignée, qui possède un potentiel de combativité intacte qui ne demande qu'à se déployer ;
- des caractéristiques plus particulières, qui se rencontrent à la fois dans les pays de 1’Est et dans les pays sous- développés :
- le manque d'expérience par rapport aux mystifications les plus sophistiquées de la bourgeoisie : l'illusion démocratique, le pluralisme électoral, le syndicalisme "libre" sont autant de pièges dont le prolétariat d'Europe de l'Est a très peu l'expérience; de plus sa propre expérience de la terreur stalinienne tend à renforcer ses illusions démocratiques, à idéaliser le modèle occidental ;
- le poids ancien des illusions nationalistes a été constamment renforcé par le centralisme néo colonial et brutal de Moscou qui, sur ce plan, a repris l'héritage du tsarisme. Attiser le nationalisme par la répression a été une constante du stalinisme qui, en divisant le prolétariat en multiples nationalités, renforçait son pouvoir central.
La faiblesse du prolétariat d'Europe de l'Est par rapport aux illusions démocratiques et nationalistes, est connue depuis longtemps par la bourgeoisie stalinienne. Elle a toujours su utiliser adroitement un savant dosage de répression et de libéralisation pour maintenir le prolétariat dans les chaînes de l'exploitation : Gomulka et Gierek qui dirigent le capital polonais respectivement de 1956 à 1970 et de 1970 à 1980, avant d'être ceux qui ordonnent la répression, auront été les artisans d'une "libéralisation" du régime. Le "printemps de Prague" montre comment certaines fractions du régime stalinien peuvent être d'ardents défenseurs de la "démocratie" pour mieux contrôler le mécontentement de la population. Depuis 1956, le K.G.B. a fait de la Hongrie son domaine réservé pour y expérimenter ses réformes politiques de "libéralisation". L'épisode Kroutchev et la "déstabilisation" montrent que le désir d'un encadrement "démocratique" du prolétariat, plus efficace que la seule terreur policière préoccupe la bourgeoisie du bloc russe.
La question sociale est déterminante dans la capacité du bloc de 1’Est à manoeuvrer sur le terrain impérialiste :
- sur le plan économique, la résistance grandissante des ouvriers entrave la course du capital à la productivité et sur tout rend dangereuse une réforme économique, indispensable au renforcement du potentiel militaire mais qui implique une exploitation renforcée du prolétariat. La modernisation de l'appareil productif porte avec elle le danger de luttes ouvrières, d'une crise sociale et d'une déstabilisation du bloc ;
- sur le plan politique, le mécontentement croissant du prolétariat entrave la capacité de manoeuvre de la bourgeoisie. La colère vis-à-vis de l'aventure afghane a crû avec le retour des morts et des blessés du champ de bataille, tandis que les aides aux alliés du tiers-monde devenaient de plus en plus impopulaires face à un niveau de vie qui allait en se dégradant. L'hostilité du prolétariat vis-à-vis des sacrifices imposés par les ambitions de l'impérialisme russe va grandissante ;
- sur le plan stratégique, les grèves de Pologne, en paralysant les chemins de fer, ont complètement perturbé l'approvisionnement du plus important dispositif militaire russe le long du rideau de fer, montrant concrètement pourquoi la paix sociale est absolument nécessaire à la guerre impérialiste.
LA CREDIBILITE DE L'ETAT
Au début des années 80, l'état de décrépitude sénile de Brejnev est à l'image du capital russe. Des mesures de réformes sont urgentes, et en premier lieu des réformes politiques afin de redonner une crédibilité à l'Etat russe aussi bien sur le plan intérieur qu'international.
Cependant, cette politique de démocratisation, la bourgeoisie stalinienne ne s'en est jamais vraiment donnée les moyens, si elle les a jamais eus. Pour la mettre en place, elle se heurte à des obstacles de taille :
.- jusqu'aux événements de Pologne 1980, la combativité du prolétariat avait pu être facilement contenue, surtout grâce à une répression brutale, ce qui ne poussait pas la Nomenklatura à envisager des réformes politiques en profondeur ;
- les intérêts de larges fractions de la bourgeoisie sont liés à la forme même de l'Etat et à son fonctionnement stalinien. La peur de perdre ses privilèges est un puissant facteur de résistance d'une fraction de l'appareil d'Etat hostile à toute idée de réforme ;
- le sous-développement du capital russe est une entrave très lourde à la crédibilisation des illusions démocratiques alors qu'en dehors de belles paroles, il n'a à offrir aucune amélioration des conditions de vie du prolétariat ;
- même si le prolétariat est fragile face aux mystifications démocratiques, pour autant sa méfiance absolue vis-à-vis de l'Etat rend difficile sa crédibilisation. Il est ainsi plus facile d'enraciner l'illusion démocratique en réprimant qu'en intégrant une opposition permanente dans le fonctionnement de l'Etat, ce qui risque de nuire à la crédibilité de celle- ci, qui est la clé de voûte de la légitimation de la "démocratie".
La crédibilité de son Etat est une question essentielle pour la bourgeoisie, aussi bien sur le plan intérieur, qu'international. A priori, c'est d'autant plus vrai pour une puissance impérialiste majeure telle que l'U.R.S.S. Pourtant, la bourgeoisie russe exprime dans son fonctionnement la faiblesse de son capital sous-développé et le poids de ses origines historiques par un immobilisme, une paralysie politique qui se traduisent dans une résistance profonde aux réformes politiques nécessaires à son capital. La bourgeoisie d'Etat russe a vécu sur les acquis de sa contre-révolution victorieuse :
- sur le plan interne, l'écrasement du prolétariat, l'anéantissement de la révolution par Staline a assuré à la bourgeoisie une longue paix sociale que la seule répression a permis globalement de maintenir. La crédibilité de l'Etat correspondait à la terreur qu'il était capable d'entretenir.
- sur le plan international, la puissance de ses armes et notamment le développement de son arsenal nucléaire sont en soi suffisants pour crédibiliser l'impérialisme russe. Cependant, l'U.R.S.S. durant des décennies a pu jouir de l'insigne privilège de se réclamer impunément de la révolution prolétarienne, dont il a été le pire bourreau, pour mener une politique internationale offensive en s'attirant la sympathie de prolétaires et d'exploités abusés par le mensonge stalinien. Le plus grand mensonge du siècle, celui de la nature prolétarienne de l'Etat russe a été le principal vecteur de la crédibilité de sa propagande internationale.
Ces acquis de la bourgeoisie russe se sont usés, avec l'accélération de l'histoire. Au début des années 80, la réalité des contradictions du capitalisme russe va devenir criante. La question de la crédibilité de l'Etat russe est cruciale ; d'elle dépend sa capacité à moderniser son économie, à maintenir sa puissance impérialiste. Sur le plan intérieur, la terreur policière ne suffit plus à faire taire le prolétariat. La dynamique de développement de la lutte de classe en Pologne montre en fait une tendance générale qui s'exprime dans l'ensemble des pays de l'Est, même si c'est à un niveau moindre. Sur le plan international, l'U.R.S.S. a peu à peu perdu sa crédibilité idéologique. La situation économique désastreuse de ses alliés à la périphérie du capital et, notamment, la catastrophe sociale du Vietnam après le départ des américains, se sont chargés de balayer grandement les illusions sur le "progressisme", le "socialisme" du bloc de l'Est. Les événements de Tchécoslovaquie en 1968 ont montré aux ouvriers du monde entier la brutalité répressive de l'U.R.S.S., semant le doute parmi des millions de prolétaires de par le monde jusque-là crédules. L'influence des partis communistes pro-russes, solidement implantés au sein du bloc adverse, va aller en se réduisant. Les luttes ouvrières en Pologne vont se charger de porter le coup de grâce sur le mensonge de la nature prolétarienne de l'Etat russe et de ses affidés.
La capacité de l'U.R.S.S. a maintenir la puissance de son impérialisme est liée à sa capacité à maintenir la crédibilité de son Etat. Avec l'accélération des années 80, avec l'enlisement de l'expédition afghane et l'explosion sociale en Pologne, des réformes radicales, une remise en cause déchirante pour la bourgeoisie se révèlent indispensables pour assurer la survie du capital russe comme puissance dominante.
LA PERESTROÏKA ET LA GLASNOST DES MENSONGES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
LA VICTOIRE DES PARTISANS DES REFORMES
La mort de Léonid Brejnev en 1982 va mettre fin à deux décennies d'immobilisme. L'heure des choix difficiles arrive pour la Nomenklatura russe ; la lutte pour la succession va faire rage et mettre aux prises les partisans des réformes à ceux qui s'y opposent. Dans un premier temps le nouveau secrétaire général Andropov, l'ancien chef du K.G.B., va annoncer de timides réformes et surtout commencer à purger l'appareil d'Etat de ses hiérarques brejnéviens, mais sa mort prématurée en 1984 permet le retour des brejnéviens. Tchernenko, le nouveau secrétaire général marque la victoire des tenants de l'attentisme, mais celle-ci sera de courte durée. Un an plus tard, il décédera à son tour. Les décès se multiplient parmi les gérontes qui diligent l'U.R.S.S., témoignant de l'âpreté de la lutte pour le pouvoir. Le nouveau secrétaire général, Mikaël Gorbatchev, qui arrive en 1985 à la tête de l'U.R.S.S., est alors peu connu, mais très rapidement, il va se signaler par son dynamisme politique. Le vent a tourné, la fraction "réformatrice" de la bourgeoisie russe a pris les rênes du pouvoir. L'heure est à la réforme économique et politique et une intense campagne idéologique est menée : Perestroïka (refonte), Glasnost (transparence) font écho dans le monde entier.
Paradoxalement, les secteurs de l'appareil politique les plus favorables à cette politique de réforme économique et démocratique ne sont pas les secteurs traditionnellement "libéraux", mais les secteurs centraux de l'Etat russe : l'état-major du complexe militaro-industriel, soucieux de la préservation de la compétitivité impérialiste de l'U.R.S.S , et la direction du K.G.B. qui est bien placée pour mesurer les risques de la croissance du mécontentement du prolétariat et qui a particulièrement suivi le déroulement de la situation en Pologne. L'intelligentsia russe est à l'image de ses consoeurs occidentales, toujours prompte à soutenir des causes perdues, à servir de faire-valoir aux fractions les plus mystificatrices de la bourgeoisie. Elle va servir de porte-flambeau à Gorbatchev. De la même manière, Kroutchev avait bénéficié de son soutien 30 ans auparavant. Sakharov, longtemps persécuté sous Brejnev, va se faire le défenseur déterminé de la Perestroïka.
Les secteurs les plus résistants à cette "nouvelle politique" sont ceux à tous les échelons du parti qui profitent du modèle stalinien de contrôle de l'Etat : les potentats locaux du Parti qui ont bâti leur pouvoir sur des années de magouilles politicardes et policières, et leur fortune sur les pots-de-vin, trafics et rackets de toute sorte ; les responsables économiques, directeurs d'usines plus soucieux de leur situation privilégiée pour spéculer sur le marché noir que de la qualité de la production, et toute une série de bureaucrates à tous les échelons de la machine politico-policière du parti plus soucieux de leurs privilèges particuliers que de l'intérêt de leur capital national. La bourgeoisie russe porte les stigmates du sous-développement de son capital. Le poids de ses anachronismes pèse très lourdement sur sa capacité d'adaptation.
De plus, une fraction centrale de la Nomenklatura russe qui a pu constater l'échec de l'expérience Kroutchevienne et qui s'est incarnée dans l'immobilisme brejnévien, est toujours en place. Pas seulement en U.R.S.S., mais dans tout le glacis Est-européen. Cette fraction doute de la capacité de l'Etat-capital russe à mener la politique ambitieuse que veulent les "réformateurs". C'est cette peur, non sans raisons, d'un échec des réformes, porteur du risque d'un chaos économique et social amplifié qui l'a poussée durant 20 ans dans une paralysie conservatrice. La mise en place des réformes prend donc d'abord la forme d'une guerre de cliques qui luttent pour le contrôle de la direction. L'empoignade au sein de la bourgeoisie russe, discrète mais violente, après la mort de Brejnev, va devenir spectaculaire avec l'arrivée de Gorbatchev qui va se servir des différentes purges pour alimenter la campagne de crédibilisation démocratique. C'est au pas de charge des purges staliniennes qu'est menée la Perestroïka. Mais au fait, quelle Perestroïka ?
L'ECHEC DE LA PERESTROÏKA ECONOMIQUE
A l'origine, Perestroïka signifiait : refonte de l'économie, tandis que la Glasnost, la transparence, était le volet politique, celui des réformes "démocratiques". Mais les mots magiques que les experts en publicité savent trouver pour alimenter les campagnes médiatiques de la bourgeoisie peuvent voir leur contenu évoluer suivant les besoins. Le mot Perestroïka a pris le sens de l'idée même de changement, s'est étendu à tous les domaines, a englobé la Glasnost heureusement pour lui, parce que plus de quatre ans après l'arrivée du nouveau Secrétaire général, la réforme économique, elle, est toujours au point mort.
Les réformes promulguées à coups de décrets et claironnées à coups de fanfares médiatiques sont sans grands effets sur l'économie réelle ; elles sont absorbées, digérées et détournées par l'appareil du parti et rendues inapplicables par le poids des carences et des dysfonctionnements de l'économie. Le grand barouf sur l'autonomie financière des entreprises, sur les nouvelles entreprises familiales privées ou les entreprises mixtes à participation de capitaux étrangers correspond plus à un battage médiatique qu'à une transformation économique réelle. Pour ne citer qu'un exemple, parce qu'il a été largement médiatisé, l'entrepreneur américain qui s'était lancé avec l'Etat russe dans la distribution de pizzas et dont on a pu voir les camions assiégés par les moscovites curieux sur les chaînes de T.V. du monde entier, a préféré renoncer à son entreprise : lorsque les camions tombaient en panne, il fallait des semaines pour les réparer ; les frigos pour entreposer la marchandise manquaient et étaient souvent défectueux ; la qualification de la main-d'oeuvre laissait à désirer; le vol, les bakchich bureaucratiques rendaient toute gestion impossible.
Cet exemple est à l'image de l'économie russe. La pénurie de capital est telle qu'elle rend toute réforme particulièrement aléatoire. Les ambitions affichées au départ par l'équipe Gorbatchev ont été rapidement revues à la baisse et, aujourd'hui, un des principaux conseillers économiques du Secrétaire général déclare qu'il faudra "une ou deux générations pour réaliser la Perestroïka". Au rythme actuel même compter en siècles ne serait pas suffisant. Depuis l'arrivée de la nouvelle clique dirigeante la situation des prolétaires, malgré toutes les affirmations de la propagande, loin de s'améliorer, s'est encore dégradée. La pénurie de biens de consommation s'est aggravée. Même à Moscou, la capitale jusque-là privilégiée dans son approvisionnement, des denrées aussi banales que le sucre et le sel sont rationnées. Les magasins de la Perestroïka sont vides ([4] [1566]).
LA PRIORITE DE LA GLASNOST
Pourtant, même si une véritable réforme de l'économie relève plus de la propagande que de possibilités réelles, il n'en demeure pas moins que la bourgeoisie russe doit mener à bien un certain nombre de mesures destinées à renforcer le potentiel militaire de son économie. Mais toutes les mesures envisagées sur ce plan :
- libération des prix par la suppression des subventions ;
- imposition de contrôles de qualité à toute l'économie suivant des critères issus de la production militaire ;
- autonomie financière des entreprises d'Etat et fermetures des usines non rentables ;
- développement d'un nouveau système de primes pour développer la productivité des travailleurs ;
- déplacement massif de main-d'oeuvre des secteurs où il y a sureffectifs vers ceux où on manque de bras ; etc., se heurtent à la résistance d'une fraction importante de l'appareil du Parti, et surtout, mises en place telles quelles, elles risquent de mettre le feu aux poudres du mécontentement social.
En effet, n'importe laquelle de ces mesures signifie une attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière. La Perestroïka est en fait un programme d'austérité. L'exemple polonais, en 1980, où une augmentation massive des prix avait déclenché la dynamique de la grève de masse qui s'est étendue à tout le pays, est toujours suffisamment présent pour inciter la bourgeoisie russe à la prudence et pour lui permettre d'en tirer les leçons. Avant d'entreprendre de telles attaques d'envergure, la bourgeoisie russe doit d'abord se donner les moyens de les faire le plus possible accepter et surtout doit doter son appareil d'Etat des armes d'encadrement et de mystification idéologique qui lui permettront de se confronter au mécontentement inéluctable du prolétariat. Ainsi, lorsque les planificateurs froids annoncent que d'ici à la fin du siècle, ce sont 16 millions de travailleurs qui devront être déplacés, cela signifie aussi des millions de travailleurs dans la rue, avec le danger que cela comporte au niveau social. La bourgeoisie stalinienne doit donc adapter son appareil d'encadrement du prolétariat, d’assouplir, le rendre plus crédible ; elle doit mettre en place des mystifications idéologiques de plus en plus intensives et sophistiquées pour masquer la réalité concrète de plus en plus désastreuse.
La Glasnost est le volet politique de la Perestroïka, le mensonge destiné à masquer la mise en place d'une austérité renforcée. Les réformes de l'appareil politique destinées à le crédibiliser et le renforcer sont une priorité, leur mise en place est la condition de la réussite de la Perestroïka. Cela est tellement vrai que le gouvernement russe a préféré reporter à plus tard les mesures de libération des prix et en 1988, a laissé filer les salaires - les augmentations ont été de 9,5 % - de manière à ne pas attiser le mécontentement et ne pas affaiblir l'impact immédiat des campagnes idéologiques sur la "démocratisation".
Le retour au premier plan de la question sociale en Europe de l'Est oblige la bourgeoisie russe a utiliser les mêmes armes que partout la bourgeoisie mondiale fourbit contre le prolétariat parce que partout celui-ci a redressé la tête, développé ses luttes. Les campagnes pour la démocratie se sont développées à l'échelle planétaire, et la Perestroïka démocratique en U.R.S.S. fait écho aux campagnes actives menées par les U.S.A., au sein de leur bloc, pour remplacer rapidement les "dictatures" usées par des "démocraties" flambant neuf. Ce n'est pas que dans tous ces pays la bourgeoisie craigne une révolution prolétarienne, loin de là, mais c'est le risque d'une explosion sociale déstabilisatrice des intérêts de l'impérialisme qui inquiète la classe dominante et la pousse à renforcer son front social par la panacée démocratique : pluralisme des partis, élections à répétition, opposition légale, syndicats crédibles et radicalisés, etc. A l'est comme à l'ouest, ce sont les mêmes politiques qui sont menées et pour les mêmes raisons.
LES CAMPAGNES DE "DEMOCRATISATION" EN U.R.S.S.
Les campagnes démocratiques ne sont pas une chose nouvelle en U.R.S.S. Kroutchev, en son temps, avait tenté une Perestroïka avant l'heure. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens employés : la bourgeoisie russe s'est mise à copier ses consoeurs occidentales. La campagne médiatique est intense, les manipulations politiques se font plus fréquentes pour tenter de redonner une nouvelle crédibilité démocratique à l'Etat. Ces campagnes vont de pair avec un renouvellement en profondeur des organes dirigeants du Parti. Le limogeage de la vieille garde stalinienne, en même temps qu'elle permet d'éliminer des fractions résistantes à la Perestroïka, sert à renforcer la crédibilité démocratique des changements actuellement en cours en mettant en avant des éléments plus jeunes favorables aux réformes. Les vieux bureaucrates, caciques du parti stalinien depuis des décennies, complètement pourris par des années de pouvoir et de concussion sont un épouvantail tout trouvé, par la haine qu'ils inspirent à la population, pour défouler la vindicte populaire et justifier les difficultés de la Perestroïka sur le plan économique. Avec les "conservateurs" constamment désignés dans la presse et comme dans un théâtre de guignol personnifiés par Ligatchev, membre du bureau politique, Gortatchev a trouvé le faire-valoir idéal qui lui assure le soutien d'une partie de la population, notamment les intellectuels qui craignent le retour des méthodes policières passées et de l'étouffement de l'illusion de liberté actuelle.
Le débat entre "réformateurs" et "conservateurs" va quotidiennement se développer dans tous les médias russes. Un savant partage du travail est organisé : la Pravda va défendre une orientation conservatrice tandis que les Izvestia prendront le parti des réformateurs ; des polémiques multiples sont publiées pour essayer de polariser 1’attention des travailleurs et les inviter à participer aux débats. Une nuée de publication semi-légale, défendant tout et n'importe quoi, va ajouter à la confusion générale. Des procès pour corruption contre les personnalités de la période Brejnev, notamment son propre gendre, servent à dédouaner et légitimer le nouveau régime.
Mais tout cela est encore peu, comparé à la gigantesque manipulation qui va être mise en place pour organiser la kermesse électorale du printemps 1989. Gorbatchev, qui tient les rênes du pouvoir, a trouvé en la personne de Ligatchev le repoussoir qui lui sert à rehausser sa propre image, mais il a aussi besoin 'une gauche crédible pour canaliser le mécontentement et chapeauter les multiples petites chapelles oppositionnelles, pour offrir l'image d'une vraie démocratie. En Pologne, où la démocratisation s'est faite à chaud, dans la confrontation directe à la lutte de classe, Solidamosc a d'emblée bénéficié d'une grande crédibilité auprès du prolétariat. Par ailleurs, l'Eglise, pourtant depuis longtemps intégrée à l'appareil d'Etat polonais, s'était toujours cantonnée dans une opposition discrète et avait conservé une popularité certaine dans la population. En U.R.S.S., la situation est bien différente. La "démocratisation" se fait à froid, à titre préventif ; et après des décennies de répression, la bourgeoisie russe n'a pas grand chose sur quoi s'appuyer pour conforter ses nouveaux habits démocratiques. Il va lui falloir créer une opposition de toutes pièces pour animer le spectacle électoral.
Un ponte du parti de Moscou, Boris Eltsine, membre du Bureau politique, va se faire le chantre de la Perestroïka à tout va, le critique intransigeant des insuffisances dans la course à la démocratie ; il va stigmatiser les résistances des conservateurs, se faire le défenseur des intérêts de la population. Après une algarade avec le chef de file des conservateurs, Ligatchev, durant une réunion en plénum du Comité central, il va être exclu de son poste de suppléant du Bureau politique, perdre son poste dans la hiérarchie du Parti. Une campagne de rumeurs sur le contenu radical de son intervention devant le Comité central se développe, tandis que durant des mois, il va jouer l'arlésienne. Au sein du Parti à Moscou, une campagne est menée en sa faveur par la "base". Finalement, Eltsine va réapparaître pour animer et crédibiliser la campagne électorale pour le renouvellement d'une partie du Soviet suprême. Toutes les mesures prises à son encontre, les médisances distillées sur son compte par la bureaucratie vont lui donner une crédibilité toute neuve. Dans un pays où durant des décennies tout le monde a appris une chose essentielle, c'est que l'Etat ment, ce qui donne une crédibilité à un individu, à son discours, c'est la répression, les tracasseries bureaucratiques auxquelles il est soumis. Dans les bagarres qui secouent la Nomenklatura, une foule d'apparatchiks ambitieux, qui sauront coller à l'air du temps, va se forger une image d'"opposition", de radicalisme, d'anti-corruption, de populisme à bon compte face à la hargne bureaucratique des gérontes qui ne veulent pas céder leur place. Les intellectuels, longtemps humiliés par Brejnev, vont constituer les troupes électorales de la nouvelle "opposition" apportant leur caution "libérale" et "démocratique" en la personne de Sakharov. La nouvelle "opposition" est créée. Les élections du printemps 1989 vont la légitimer.
Pour ces élections une innovation de taille va être apportée : des candidatures multiples issues du Parti et des structures de l'Etat sont encouragées, donnant une illusion de pluralisme. Rien ne va être négligé pour crédibiliser ces élections et, par conséquent, les nouveaux oppositionnels. Une campagne "à l'américaine" va pour la première fois être menée en U.R.S.S. L'"opposition" va se mobiliser devant les médias. Eltsine est passé sur toutes les chaînes de télévision : interviewé dans son modeste logement, avec sa femme et sa fille qui paraissaient tout effrayées de tant de nouveauté ; en train de jouer poussivement au tennis, short blanc et bandeau sur le front, pour le mettre en valeur ; on lui avait même trouvé un sparring-partner bureaucratique encore plus boursouflé, plus grotesque.
Eltsine fait un come-back retentissant, il est omniprésent, avec Gorbatchev évidemment, dans les médias. Un miracle bureaucratique et médiatique de plus. Dans le même temps des manifestations de soutien sont organisées dans les rues de Moscou avec son portrait en emblème. L'ambiance est chauffée par les démêlés de nos "réformateurs radicaux" pour faire accepter leurs candidatures aux oligarchies locales du Parti. Sakharov s'empoigne avec les bureaucrates de l'Académie des sciences. La popularité des nouvelles candidatures ne fait que croître.
Pourtant, tout cela n'est pas encore suffisant. La bourgeoisie russe va en rajouter en manipulations pour rameuter les prolétaires vers les urnes et crédibiliser les élections et l'idée de changement. Quelque temps avant le jour électoral fatidique, une manifestation nationaliste en Géorgie sera sévèrement réprimée. Plusieurs manifestants tués restent sur le carreau. Les conservateurs, la droite, sont accusés de vouloir saboter la Perestroïka. Des rumeurs inquiétantes d'attentat dans le métro à Moscou circulent. Gorbatchev serait en difficulté, les éléments conservateurs prépareraient un retour en force. Il faut voter pour préserver la direction actuelle ; la gauche, derrière Eltsine, se pose comme le meilleur obstacle à un retour du conservatisme, comme le meilleur garant de l'application des réformes. La population est appelée à donner son point de vue, à se prononcer, son destin en dépend. La victoire des "radicaux" de la Perestroïka va être totale. A Moscou, Eltsine va être triomphalement élu avec 89 % des voix, dans toute l'U.R.S.S., la nouvelle "gauche" fait des scores impressionnants. Des hiérarques du P.C. sont battus. De ces élections, l'Etat russe sort renforcé : l'illusion démocratique d'un changement électoral prend une apparence de vérité, une gauche à la crédibilité naissante se met à exister à la fois au sein et en dehors du Parti.
Fort de ce succès, contrairement aux fausses rumeurs qui avaient circulé avant les élections, Gorbatchev sort renforcé et mène une nouvelle purge. Une centaine de délégués au Soviet suprême démissionnent aimablement, tandis que la gauche va organiser des manifestations où cote à cote Eltsine et Sakharov mènent le bal pour soutenir les nouveaux députés réformateurs du Soviet. En mai 1989, 100 000 personnes manifestent derrière eux à Moscou et on remarquera dans l'assistance une délégation de la 4ème Internationale trotskiste. Quelle caution !
Par son habileté politique à mettre en place les éléments d'une nouvelle crédibilité de l'Etat russe, ce que montre Gorbatchev, ce n'est pas tant sa sincérité démocratique, mais sa capacité manoeuvrière typiquement stalinienne. Purges bureaucratiques, manipulations politiques et policières multiples, campagnes idéologiques mystificatrices, rumeurs organisées, répression savamment dosée, etc., cette panoplie du mensonge et de la terreur montre que, par-delà les apparences, Gorbatchev est le digne héritier du stalinisme qui adapte son savoir-faire aux besoins de la situation présente. Cette réalité va particulièrement s'exprimer sur le terrain des "nationalités".
LE NATIONALISME EN SOUTIEN DE LA PERESTROÏKA
Depuis 1988, les manifestations nationalistes en Arménie, en Azerbaïdjan, dans les pays baltes, en Géorgie, polarisent l'attention sur la situation en U.R.S.S.. La question des nationalités est un vieux problème en U.R.S.S. Héritée du passé colonial de la Russie des tzars, renforcée par la répression brutale des staliniens, elle traduit le poids du sous-développement du capital soviétique. Ces manifestations traduisent un mécontentement réel existant au sein de la population. Cependant, parce qu'elles se déroulent sur un terrain purement nationaliste, ces expressions de mécontentement ne peuvent dans cette logique que renforcer l'emprise de la classe dominante, même si elles ont été provoquées par les rivalités de cliques. Elles sont le terrain parfait pour les manipulations de l'Etat central russe, manipulations dont l'équipe gorbatchévienne dans la lignée d'une vieille tradition, montre qu'elle est maîtresse.
La bourgeoisie russe a toujours su exploiter au mieux le poids des illusions nationalistes, la grogne anti-russe, pour diviser ses prolétaires et dévoyer le mécontentement social dans le nationalisme qui est le terrain privilégié de la domination bourgeoise. Cela est vrai, non seulement en U.R.S.S. même, mais aussi dans tout le glacis européen sous sa coupe impérialiste. Les événements en Pologne sont là depuis 1980 pour montrer à l'évidence cette réalité : les illusions démocratiques et le nationalisme anti-russe ont été les principales armes de la bourgeoisie polonaise pour faire rentrer les ouvriers dans le rang. Le développement présent de la propagande nationaliste dans les pays de l'Est n est certainement pas un pur produit des illusions d'une population mécontente, même si celles-ci existent réellement, mais correspond à une politique voulue mise en place par l'administration Gorbatchev. La propagande nationaliste qui se déchaîne aujourd'hui, sous le masque de l'opposition, correspond à la nouvelle politique anti-ouvrière menée pour entraver le développement à venir des luttes prolétariennes face à la politique draconienne d'austérité qui est en train d'être mise en place.
Dans ces conditions, ce n'est donc certainement pas l'expression d'une perte de contrôle de l'Etat russe si en Arménie, la branche locale du P.C. soutient la revendication nationaliste du rattachement du Haut-Karabak, alors qu'en Azerbaïdjan, elle soutient exactement l'inverse, soufflant sur les braises nationalistes (à cet égard on peut se poser de réelles questions sur l'origine des pogroms anti-arméniens qui ont mis le feu aux poudres), tandis que dans les pays baltes, c'est le P.C. qui a directement organisé les manifestations nationalistes autour d'un débat constitutionnel n'ayant pour but que de valider les illusions démocratiques et nationalistes.
Tout ce remue-ménage, loin d'affaiblir Gorbatchev, lui a permis de développer son offensive politique. En laissant se développer des manifestations massives, il a renforcé son image libérale à peu de frais, et même le cataclysme qui a frappé l'Arménie lui a permis de faire un one-man-show médiatique sur sa politique d'ouverture. De même, cette situation qui met en lumière les carences de l'administration est un prétexte tout trouvé pour intensifier les purges en cours au sein du parti stalinien. Même la répression dans ce contexte hyper-médiatisé est présentée comme une preuve de fermeté rassurante vis-à-vis d'excès qui risquent de freiner les réformes.
La répression cynique et meurtrière d'une manifestation en Géorgie a été le prétexte d'une nouvelle campagne contre les "conservateurs" pour mobiliser les ouvriers sur le terrain électoral en dramatisant la situation. La clique dirigeante locale en a fait incidemment les frais en passant à la trappe d'un remaniement. Mais à qui le crime a-t-il réellement profité, sinon à Gorbatchev ?
Ce n'est pas seulement en U.R.S.S. que cette politique de propagande nationaliste anti-ouvrière est mise en place : nous avons déjà cité la Pologne, mais c'est aussi en Hongrie où se déchaîne la propagande anti-roumaine ; en Roumanie, c'est, évidemment, la propagande anti-hongroise ; en Bulgarie, c'est la propagande anti-turque. Chaque fois, le nationalisme des minorités nationales est attisé, au besoin par la simple répression, pour justifier des campagnes plus générales.
Les divers nationalismes qui se développent aujourd'hui dans les pays de l'Est, ne sont pas l'expression d'un affaiblissement de l'Etat central, mais au contraire le moyen de son renforcement. Les illusions nationalistes sont le digne complément des mystifications démocratiques.
LE SUCCES INTERNATIONAL DE LA PERESTROÏKA
Jamais une campagne idéologique de la bourgeoisie russe n'aura reçu un tel soutien de la part de l'Occident. Gorbatchev est devenu une nouvelle star médiatique mondiale ; il est venu concurrencer celui qu'on surnommait le "grand communicateur" : Reagan. La bourgeoisie russe a visiblement bien appris de ses consoeurs occidentales l'art de la manipulation médiatique.
La mise en avant dès son arrivée au pouvoir d'une volonté de concessions sur le plan impérialiste, la tenue d'un langage de "paix", les propositions de désarmement, largement médiatisées, sont autant de facteurs qui suggèrent une sympathie instinctive aux habitants de la planète traumatisés par les campagnes militaristes incessantes qui se sont succédé depuis 1980. Dans l'incapacité de se lancer dans une surenchère militaire à cause du manque d'adhésion de la population, face à l'offensive impérialiste occidentale des années 80, l'U.R.S.S. est obligée une nouvelle fois de reculer. L'intelligence de la bourgeoisie russe, et notamment de sa fraction animée par Gorbatchev, va être de savoir mettre à profit ce recul imposé pour rénover sa stratégie de politique intérieure et internationale.
Les nouveaux axes de la propagande soviétique - la paix et le désarmement au niveau international, la Perestroïka-Glasnost sur le plan intérieur - vont prendre à contre-pied les thèmes de la propagande occidentale basés sur la dénonciation de 1'"Empire du mal", du militarisme russe et de l'absence de démocratie dans les pays de l'Est. Cette situation va provoquer un chamboulement médiatique mondial. Le Bloc de 1 Ouest va être obligé de changer le fusil de ses campagnes médiatiques d'épaule. Face aux thèmes "pacifistes" de la diplomatie russe, les U.S.A. ne peuvent se permettre d'apparaître comme les seuls va-t-en-guerre, surtout face à un prolétariat qui après le recul qui marque le début des années 80, a repris de manière significative le chemin de la lutte au milieu des années 80. Les deux blocs impérialistes qui se partagent la terre vont alors se lancer à l'unisson dans une surenchère pacifiste et démocratique. Les campagnes mensongères sur la paix sont un moment de la lutte que se mènent les deux blocs sur le plan idéologique.
Cependant, si le bloc occidental a suivi Gorbatchev dans le changement de tonalité des campagnes idéologiques, s'il parait le soutenir dans sa volonté de réformes politiques, ce n'est certainement pas qu'il en croit un traître mot. Même si les concessions militaires de l'U.R.S.S. sont réelles et toujours bonnes à prendre, ce n'est pas bien nouveau. Brejnev avait fait de même et "la paix et le désarmement" sont des thèmes éculés de la propagande stalinienne depuis toujours. Et ce n'est certainement pas non plus, même si c'est un aspect réel, parce que le bloc occidental s'est trouvé piégé par la nouvelle propagande russe. Cela ne l'obligeait certainement pas à chanter les louanges de Gorbatchev comme il l'a fait, soutenant de toute la force de ses médias les initiatives "démocratiques" de la Perestroïka, les crédibilisant ainsi aux yeux du monde entier, les intégrant dans une gigantesque et assommante campagne médiatique sur la "Démocratie" menée à l'échelle planétaire.
Ce soutien de l'Occident au nouveau groupe dirigeant russe dont la politique étrangère offensive vise à donner une nouvelle crédibilité à l'impérialisme russe, et la politique intérieure à renforcer la force de l'Etat et de son économie de guerre, peut sembler paradoxal. Cependant, cette situation s'explique par les leçons qu'a tirées la bourgeoisie du bloc de F Ouest des événements d Iran et de Pologne. Elle ne tient pas à voir se développer des luttes sociales en Europe de l'Est qui pourraient avoir des effets internationaux contagieux et, en provoquant une déstabilisation de la classe dominante du bloc adverse, pourraient permettre l'accession au pouvoir de fractions de la bourgeoisie particulièrement stupides, autrement dangereuses pour la stabilité mondiale qu'un Khomeiny en Iran, étant donné le potentiel militaire russe.
Malgré sa plus grande puissance, le bloc occidental est fondamentalement confronté aux mêmes difficultés que le bloc russe. Le développement des mêmes thèmes de propagande traduit des besoins identiques : encadrer le prolétariat, entraver et dévoyer l'expression de son mécontentement, lui faire accepter des mesures d'austérité de plus en plus draconiennes, le ressouder à "son" Etat au nom de la Démocratie et ouvrir la voie vers la guerre ([5] [1567]).
LE PROLETARIAT AU COEUR DE LA SITUATION
A écouter les commentateurs avisés de l'a bourgeoisie internationale, la Perestroïka irait de succès en succès et Gorbatchev volerait de victoire en victoire. On a vu rapidement ce qu'il en était sur le plan économique : un fiasco jusqu'à présent. Où se situe donc la réussite de Gorbatchev? D'abord sur le plan politique dans sa capacité à s'imposer face aux secteurs réticents de la bourgeoisie russe ; les purges successives en témoignent. Le bilan de la mise en place des nouveaux habits démocratiques du stalinisme est plus mitigé. L'essentiel reste encore à faire pour développer une réelle crédibilité de l'Etat russe vis-à-vis de sa propre population. Bien sûr 1'"intelligentsia" applaudit les timides réformes démocratiques à tout rompre, et par son agitation incessante leur donne l'apparence de la vie, mais quelle est la réaction du prolétariat, de l'immense majorité de la population, face à ce tourbillon médiatique autour des "réformes" ?
La méfiance vis-à-vis d'un Etat qui incarne 60 ans de domination du stalinisme, de répression cynique, de mensonge permanent, de pourriture bureaucratique, est très forte au sein de la classe ouvrière. Même si les thèmes démocratiques mis en avant par la Perestroïka peuvent susciter un certain intérêt parmi les travailleurs, le fait que les réformes soient imposées par en haut, qu'elles viennent de la hiérarchie du P.C., ne peut que susciter la défiance. L'expérience de Kroutchev n'est pas si loin pour être oubliée; les belles paroles démocratiques d'alors s'étaient terminées par la répression des luttes ouvrières en 1962 et 1963. Face à la Perestroïka, le prolétariat continue à utiliser les mêmes armes que face à la tutelle policière de Brejnev: la résistance passive.
La politique de rigueur et de "transparence" de la nouvelle direction soviétique se heurte aux vieux réflexes de méfiance et de "démerde" profondément enracinés dans le prolétariat russe et donne souvent des résultats paradoxaux typiques de l'économie russe. Le rationnement tout à fait impopulaire de l'alcool a provoqué une razzia des stocks de sucre dans les magasins, pour alimenter les alambics clandestins, entraînant le rationnement du sucre. L'annonce par un bureaucrate, face aux rumeurs de pénurie sur le thé à Moscou, qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, provoque immédiatement une panique des consommateurs qui se ruent vers le magasin le plus proche, et le thé aussi devra être rationné. Ces faits qui font les délices des journalistes étrangers et la misère des travailleurs de l'U.R.S.S. traduisent la résistance et la méfiance par rapport à toutes les initiatives de l'Etat. Cette hypothèque, a Perestroïka ne l'a pas levée, elle n'en a pas les moyens ; les rayons des magasins sont toujours plus vides et c'est là qu'est la vérité pour le prolétariat. Dans la mesure où il n'a rien matériellement à offrir, le gouvernement ne peut réellement mystifier directement ; tout au plus peut-il essayer d'enraciner l'idée qu'il est moins répressif, plus ouvert au dialogue que ceux qui l'ont précédé, mais cela ne remplit pas les estomacs.
Le véritable danger mystificateur pour le prolétariat vient de ceux qui se posent comme étant les "opposants", qui critiquent ouvertement le gouvernement et dénoncent la pénurie, qui prétendent défendre les intérêt de la classe laborieuse. Cependant, la nouvelle "opposition" regroupée autour de Eltsine et Sakharov a encore des progrès à faire si elle veut gagner une réelle crédibilité mystificatrice au sein du prolétariat. L'ébullition actuelle autour de l’"opposition" est essentiellement animée par l'intelligentsia et des jeunes sans grande expérience. Fondamentalement les ouvriers sont restés plutôt indifférents face à ce remue-ménage. La personnalité des Eltsine et Sakharov, eux-mêmes dignes membres de la Nomenklatura, n'est pas faite pour les enthousiasmer. Cette relative indifférence de la classe ouvrière ne doit pourtant pas faire sous-estimer la fragilité de la classe ouvrière en Russie face aux mystifications plus sophistiquées que la bourgeoisie est en train de mettre en place. L'exemple polonais est là pour le démontrer.
L'offensive idéologique de l'Etat russe en est encore à ses débuts. Avec la mise en place d'une opposition c'est seulement une première pierre de son édifice "démocratique" que Gorbatchev a posée. L'utilisation d'un syndicalisme radical avec Solidarnosc en Pologne, l'instauration d'un pluralisme politique et syndical en Hongrie montrent que la bourgeoisie russe est prête à aller beaucoup plus loin pour renforcer la crédibilité de son Etat et dissoudre la méfiance ouvrière. La création d'un syndicat crédible est la condition indispensable d'un encadrement "démocratique" de la classe ouvrière. Nul doute que Gorbatchev va devoir s'atteler à cette rude tache s'il veut mener à bien son programme de renforcement du capitalisme russe. Comme les syndicats dans le monde de l'Ouest, Solidarnosc en Pologne a suffisamment montré sa capacité à étouffer les luttes ouvrières pour que la bourgeoisie russe veuille se doter d'un tel outil. Mais si un parti politique, une opposition peut tenter de se crédibiliser à froid, dans et par le sacro-saint "débat démocratique", il n'en est pas de même d'un syndicat qui, lui, doit tirer sa crédibilité de la lutte de classe, des grèves.
Le prolétariat russe, ces dernières années, n'a pas particulièrement manifesté sa combativité par des grèves, à ce qu'on en sait tout du moins. Cependant, la diminution croissante de son niveau de vie va s'accélérer avec la Perestroïka; conjuguée aux effets "désinhibiteurs" de la "libéralisation" qui a besoin d'un minimum de permissivité pour être un tant soi peu crédible, elle ne peut qu'encourager les ouvriers à lutter. Dans les pays du bloc de l'Est, comme dans ceux de l'Ouest la perspective est au développement de la lutte de classe. C'est dans ce contexte que la Perestroïka/Glasnost se montrera comme une amie redoutable contre le prolétariat: les ouvriers de l'Est devront se confronter à des mystifications particulièrement dangereuses: "oppositions radicales" se réclamant faussement de ses intérêts, syndicats "libres" qui saboteront ses luttes, tapage médiatique permanent, etc., dont il n'ont quasiment aucune expérience.
Cette expérience, c'est celle que le prolétariat polonais est en train de faire. Elle signifie un dur apprentissage et des défaites pour la classe ouvrière en Europe de l'Est ([6] [1568]). Cette situation, c|est celle que le prolétariat des pays développés d'Occident vit depuis (tes décennies, celle du mensonge du totalitarisme "démocratique" sur laquelle il a accumulé une expérience irremplaçable. Parce que partout la perspective est à un développement de la lutte de classe, partout la bourgeoisie essaie de mettre en place les mêmes armes, les plus efficaces, les plus mensongères, les plus dangereuses: celles de la "Démocratie", pure illusion qui cache le totalitarisme du capitalisme décadent. La campagne est mondiale. De fait, la situation du prolétariat mondial s'homogénéise: la répression policière se fait plus fréquente et plus forte dans les vieilles démocraties occidentales, tandis que dans tous les pays sous-développés du monde - U.R.S.S. comprise - l'heure est à la rénovation de la façade étatique d'un bon coup de peinture démocratique.
La question n'est pas de savoir si Gorbatchev, ou même la bourgeoisie mondiale, a les moyens de sa politique. La question est: comment le prolétariat va se confronter a l'arsenal de mystifications que la bourgeoisie est en train de mettre en place pour lui imposer l'austérité renforcée des réformes économiques ? La capacité du prolétariat d'Europe de l'Est à déjouer les pièges est indissolublement liée à la capacité du prolétariat d'Europe occidentale à développer ses luttes, à montrer sous l'éclairage cru de la confrontation de classe la réalité du mensonge démocratique, tout comme les prolétaires d'Europe de l'Est, par leurs luttes, ont montré à leurs frères de classe du monde entier la réalité du mensonge stalinien ([7] [1569]). Les illusions sur l'Occident, sur son modèle démocratique, pèsent lourdement sur la conscience des ouvriers d'Europe de l'Est. Seule la lutte de classe qui se développe au coeur de l'Europe occidentale industrialisée, au coeur du mensonge démocratique, peut déchirer le mirage, clarifier les consciences, renforcer ainsi, partout dans le monde, la capacité du prolétariat à déjouer les pièges, à briser les rideaux de fer du capital, et à poser les jalons de sa dynamique d'unification mondiale.
JJ. 29 mai 1989
[1] [1570] Source : Nations Unies
[2] [1571] Sur la crise dans les pays de l'Est lire les articles dans la Revue Internationale n° 12-14-23-43.
[3] [1572] Sur les luttes en Pologne voir Revue Internationale n° 24-25-26-27, et de manière plus générale sur la lutte de classe en Europe de l'Est voir Revue Internationale n° 27-28-29.
[4] [1573] Sur la situation économique en U.R.S.S. à l'heure de la Perestroïka un article sera publié dans un prochain numéro de la Revue Internationale qui développera plus largement sur cette question. Voir aussi Revue Internationale n' 49-50.
[5] [1574] Voir article "Les paix de l'été", Revue Internationale n° 55.
[6] [1575] Voir article "Pologne: l'obstacle syndical", Revue Internationale n° 54.
[7] [1576] Voir article "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe", Revue Internationale n° 31.
Après les années d'immobilisme incarnées par le règne
Géographique:
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [342]
Comprendre la décadence du capitalisme (7) : Le bouleversement des formes idéologiques
- 5716 reads
Le bouleversement des formes idéologiques
La "crise idéologique", "crise des valeurs" dont parlent les journalistes et sociologues depuis des décennies n'est pas, comme ils disent, "une douloureuse adaptation aux progrès technologiques capitalistes". Elle est au contraire la manifestation de l'arrêt de tout progrès historique réel du capitalisme. C'est la décomposition de l'idéologie dominante qui accompagne la décadence du système économique.L'ensemble des bouleversements subis par les formes idéologiques capitalistes depuis trois quarts de siècle constitue en réalité non pas un rajeunissement permanent du capitalisme mais une manifestation de sa sénilité, une manifestation de la nécessité et de la possibilité de la révolution communiste.
Dans les articles précédents de cette série[1] [1577] destinée à répondre à ces "marxistes" qui rejettent l'analyse de la décadence du capitalisme, nous nous sommes penchés surtout sur les aspects économiques de la question : "C'est dans l'économie politique qu'il convient de chercher l'anatomie de la société civile", disait Marx[2] [1578]. Nous avons rappelé la vision marxiste d'après laquelle ce sont des causes économiques qui font qu'à un moment donné de leur développement les systèmes sociaux (esclavagisme antique, féodalisme, capitalisme) entrent en décadence :
- "A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété nu sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale." Marx[3] [1579]
Nous avons montré comment depuis la période de la première guerre mondiale et de la vague révolutionnaire prolétarienne internationale qui y a mis fin, le mode de production capitaliste connaît un tel phénomène. Comment celui-ci s'est transformé en une entrave permanente au développement des forces productives des moyens de subsistance de l'humanité : les pires destructions guerrières de l'histoire, économie permanente d'armement, les plus grandes famines, épidémies, des zones de plus en plus étendues condamnées au sous-développement chronique. Nous avons mis en évidence l'enfermement du capitalisme dans ses propres contradictions et sa fuite en avant, explosive, dans le crédit et les dépenses improductives.
Au niveau de la vie sociale nous avons analysé certains des bouleversements fondamentaux que ces changements économiques ont entraîné dans : la différence qualitative entre les guerres du XXe siècle et celles du capitalisme ascendant; l'hypertrophie croissante de la machine étatique dans le capitalisme décadent par opposition au "libéralisme économique" du 20ème siècle ; la différence des formes de vie et de lutte du prolétariat au 20ème siècle et dans le capitalisme décadent.
Ce tableau reste cependant incomplet. Au niveau des "superstructures", des "formes idéologiques" qui reposent sur ces rapports de production en crise, il se produit des bouleversements qui sont tout aussi significatifs de cette décadence.
- "Le changement dans les fondements économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout." Marx[4] [1580]
Dans nos textes sur la décadence du capitalisme (en particulier dans la brochure qui y est consacrée) nous avons relevé certaines caractéristiques de ces bouleversements idéologiques. Nous y reviendrons ici en répondant à certaines aberrations formulées sur cette question par nos critiques.
L'aveuglement de l'invariance
Ceux qui rejettent l'analyse de la décadence, qui ne parviennent déjà pas à percevoir un quelconque changement dans le capitalisme depuis le 16ème siècle sur le plan concret de la production, ne sont pas moins myopes lorsqu'il s'agit de voir l'évolution du capitalisme au niveau des formes idéologiques. Qui plus est, pour certains d'entre eux, les anarcho-bordiguistes-punk du GCI en particulier[5] [1581], prétendre reconnaître des bouleversements a ce niveau là, ne peut relever que d'une vision "moralisatrice" de "curés". Voici ce qu'ils écrivent à ce propos :
- “(...) il ne reste plus aux décadentistes que la justification idéologique, que l'argumentation moralisatrice (...) d'une décadence super-structurelle reflétant (en parfaits matérialistes vulgaires qu'ils sont) la décadence des rapports de production. ‘L'idéologie se décompose, les anciennes valeurs morales s'écroulent, la création artistique stagne ou prend des formes contestataires, l'obscurantisme et le pessimisme philosophiques se développent’. La question à cinq francs est bien : qui est l'auteur de ce passage : Raymond Aron ? Le Pen ? ou Monseigneur Lefèbvre ? [6] [1582] (...) Eh bien non, il s'agit de la brochure du CCI : La décadence du capitalisme, page 34 ! Le même discours moralisateur correspond donc à la même vision évolutionniste et ce dans la bouche de tous les curés de gauche, de droite ou d’‘ultragauche’”.
- “Comme si l'idéologie dominante se décomposait, comme si les valeurs morales essentielles de la bourgeoisie s'écroulaient ! Dans la réalité l'on assiste plutôt à un mouvement de décomposition/recomposition chaque fois plus important : à la fois de vieilles formes de l'idéologie dominante se trouvent disqualifiées et donnent naissance à chaque fois à de nouvelles recompositions idéologiques dont le contenu, l'essence bourgeoise reste invariablement identique.”[7]
L'avantage avec le GCI c'est sa capacité de concentrer en peu de lignes un nombre particulièrement élevé d'absurdités, ce qui, dans une polémique, permet d'économiser du papier. Mais commençons par le début.
Bouleversements économiques et formes idéologiques
D'après le GCI ce serait du "matérialisme vulgaire" que d'établir un lien entre décadence des rapports de production et déclin des superstructures idéologiques. Le GCI a lu chez Marx la critique de la conception qui ne voit dans les idées qu'un reflet passif de la réalité matérielle. Marx lui oppose la vision dialectique qui perçoit l'interrelation permanente qui lie ces deux entités. Mais il faut être un "invariantiste" pour en déduire que les formes idéologiques ne subissent pas l'évolution des conditions matérielles.
Marx est très clair :
- "A toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes ; autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression en idées des conditions matérielles dominantes, ce sont ces conditions conçues comme idées, donc l'expression des rapports sociaux qui font justement d'une seule classe la classe dominante, donc les idées de sa suprématie." Marx[8] [1584]
Comment les "conditions matérielles dominantes" pourraient elles connaître les bouleversements d'une décadence sans qu'il en soit de même pour leurs "expressions en idée" ? Comment une société vivant une époque de véritable développement économique, où les rapports sociaux de production apparaissent comme une source d'amélioration des conditions générales d'existence, pourrait-elle s'accompagner de formes idéologiques identiques à celles d'une société où, ces mêmes rapports conduisent la société à la misère à l'autodestruction massive, à l'angoisse permanente et généralisée ?
En niant le lien qui existe entre les formes idéologiques d'une époque et la réalité économique qui la sous-tend, le GCI prétend combattre le "matérialisme vulgaire", mais ce n'est que pour défendre le point de vue de l'idéalisme qui croit à l'existence première des idées et à leur indépendance à l'égard du monde matériel de la production sociale.
L'idéologie dominante est-elle putrescible ?
Ce qui heurte le GCI c'est qu'on puisse parler de décomposition de l'idéologie dominante. Voir dans celle-ci une manifestation de la décadence historique du capitalisme serait développer une "argumentation moralisatrice". Pour s'y opposer il nous assène cette grande vérité : l'idéologie bourgeoise au 20ème siècle est tout comme au 18ème..., "invariablement" bourgeoise.
Conclusion ? Donc, elle ne se décompose pas. (?)
Cela fait partie de la "dialectique" de "l'invariance" qui nous enseigne que tant que le capitalisme existe il demeure "invariablement" capitaliste et que tant que le prolétariat subsiste il reste, tout aussi "invariablement" prolétarien.
Mais après avoir déduit de ces tautologies la non-putréfaction de l'idéologie dominante, le GCI s'efforce d'approfondir la question : "l'on assiste plutôt à un mouvement de décomposition/recomposition chaque fois plus important. De vieilles formes de l'idéologie dominante se trouvent disqualifiées et donnent naissance à chaque fois à de nouvelles recompositions idéologiques".
Voilà qui n'est plus si "invariant". Le GCI ne fournit évidemment aucune explication sur l'origine, les causes, le début de ce "mouvement chaque fois plus important". La seule chose dont il est certain c'est que -contrairement aux conceptions "décadentistes"- cela n'a rien à voir avec l'économie.
Mais revenons à la découverte d'un "mouvement" par le GCI : la décomposition/recomposition. D'après ce qui nous est expliqué, l’idéologie dominante connaît en permanence de "nouvelles recompositions idéologiques". Oui, "nouvelles". C'est la jeunesse éternelle ! Quelles sont-elles ? Le GCI nous répond sans attendre :
- "C'est ce que nous constatons dans la ré-émergence en force et au niveau mondial des idéologies (...) religieuses".
Ce qui, tout le monde le sait, est le dernier cri en matière de mystification idéologique. Autres nouveautés : "l'antifascisme... les mythes démocratiques... l'anti-terrorisme".
Qu'y a-t-il de nouveau dans ces vieilles rengaines usées par les classes dominantes depuis au moins un demi-siècle, si ce n'est des millénaires ? Si le GCI n'a pas d'autres exemples à donner c'est parce que fondamentalement il n'y a pas "nouvelles recompositions idéologiques" dans le capitalisme décadent. L'idéologie capitaliste ne peut pas plus se rajeunir que le système économique qui l'engendre. Ce à quoi nous assistons dans le capitalisme décadent, c'est au contraire à l'usure, plus ou moins lente ou rapide suivant les zones de la planète, des "éternelles" valeurs bourgeoises.
Sur quoi repose l'emprise de l'idéologie dominante ?
L'idéologie de la classe dominante se résume aux "idées de sa suprématie" comme classe. En d'autres termes, elle est la justification permanente du système social que gère cette classe. Le pouvoir de cette idéologie se mesure d'abord et avant tout non pas dans le monde abstrait des idées confrontées à des idées, mais dans l'acceptation de cette idéologie par les hommes eux-mêmes et en premier lieu par la classe exploitée.
Cette "acceptation" repose sur un rapport de force global. Elle s'exerce comme une pression constante sur chaque membre de la société, de la naissance aux cérémonies d'enterrement. La classe dominante dispose d'hommes spécifiquement chargés de ce travail : les services religieux ont par le passé assumé la plus lourde part de cette fonction ; dans le capitalisme décadent cela revient à des "scientifiques de la propagande" (nous y reviendrons). Marc parlait des "idéologues actifs et conceptistes dont le principal gagne-pain consiste à entretenir l'illusion que cette classe nourrit à son propre sujet"[9] [1585].
Mais cela ne suffit pas pour asseoir à long terme une domination idéologique. Encore faut-il que les idées de la classe dominante aient un minimum de correspondance avec la réalité existante. La plus importante de ces idées est toujours la même : les règles sociales existantes sont les meilleures possibles pour assurer le bien être matériel et spirituel des membres de la société. Toute autre forme d'organisation sociale ne peut conduire qu'à l'anarchie, la misère et la désolation.
C'est sur cette base que les classes exploiteuses justifient les sacrifices permanents qu'elles demandent et imposent aux classes exploitées. Mais qu'advient-il de cette idéologie lorsque le mode de production dominant ne parvient plus à assurer le minimum de bien-être et que la société s'enfonce dans l'anarchie, la misère et la désolation ? Lorsque les sacrifices les plus difficiles n'apportent plus aucune compensation aux exploités ?
Les idées dominantes se trouvent alors quotidiennement contredites par la réalité elle-même. Leur pouvoir de conviction s'amenuise dans le même mouvement. Suivant un processus toujours complexe, plus ou moins rapide, jamais linéaire, fait d'avancées et de reculs qui traduisent les vicissitudes de la crise économique et du rapport de forces entre les classes, les "valeurs morales" de la classe dominante s'écroulent sous les coups mille fois répétés de la réalité qui les dément.
Ce ne sont pas de nouvelles idées qui détruisent les anciennes, c'est la réalité qui les vide de leur pouvoir mystificateur.
- "La morale, la religion, la métaphysique et toute autre idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, ne conservent plus l'apparence d'autonomie. Elles n'ont pas d'histoire ; elles n'ont pas d'évolution ; ce sont les hommes qui, en développant la production matérielle et les relations matérielles, transforment en même temps leur propre réalité, leur manière de penser et leurs idées." Marx[10] [1586]
C'est l'expérience de deux guerres mondiales et des dizaines de guerres locales, la réalité de près de 100 millions de morts, pour rien, en trois quarts de siècle, qui ont porté les coups les plus dévastateurs, surtout dans le prolétariat des pays européens, contre l'idéologie patriotique. C'est le développement de la misère la plus effroyable, dans les pays de la périphérie capitaliste, et de plus en plus dans les principaux centres industriels, qui détruit les illusions sur les bienfaits des lois économiques capitalistes. C'est l'expérience de centaines de luttes "trahies", systématiquement sabotées par les syndicats qui ruine le pouvoir idéologique de ceux-ci et explique, dans les pays les plus avancés, la désaffection de plus en plus massive des syndicats par les ouvriers. C'est la réalité de l'identité de pratique des partis politiques "démocratiques", de droite ou de gauche, qui n'a cessé d'éroder le mythe de la démocratie bourgeoise et conduit dans les plus vieux pays "démocratiques" à des records historiques d'abstention aux élections. C’est l'incapacité croissante du capitalisme d'offrir une autre perspective que celle du chômage et de la guerre qui fait s'effondrer les anciennes valeurs morales qui chantent les louanges de la fraternité capital-travail.
Les "nouvelles recompositions idéologiques" dont parle le GCI, ne désignent que les efforts de la bourgeoisie pour tenter de redonner vigueur à ses vieilles valeurs morales, en les recouvrant d'une couche de maquillage plus ou moins sophistiqué. Cela peut tout au plus freiner le mouvement de décomposition idéologique -en particulier dans les pays les moins développés où l'expérience historique de la lute de classe est moindre[11] [1587]- en aucun cas l'inverser, ni même l'arrêter.
Les idées de la bourgeoisie, et leur emprise, ne sont pas plus indécomposables que ne le furent celles des seigneurs féodaux ou des maîtres d'esclaves en leur temps, n'en déplaise aux gardiens de l'orthodoxie "invariantiste".
Enfin, pour conclure sur la défense intransigeante par le GCI de la qualité indestructible des idées des bourgeois, quelques mots sur la référence aux hommes de droite. Le GCI, avec sa puissante capacité d'analyse, a remarqué que certains bourgeois "de droite", en France, constatent l'effritement des valeurs morales de leur classe. Le GCI en déduit de quoi faire un amalgame, un de plus, avec "les décadentistes". Pourquoi ne pas amalgamer ces derniers avec les pygmées, puisque, tout comme les "décadentistes", ils constatent que le soleil se lève tous les matins ? Il est normal que les fractions de droite affirment plus aisément la décomposition du système idéologique de leur classe : ce n'est là que le pendant complémentaire des politiciens de gauche, dont la tâche essentielle est de tenter d'entretenir en vie cette idéologie moribonde, en la présentant déguisée de verbiage "ouvrier" et "anticapitaliste". Ce n'est pas par hasard si la "popularité" de Le Pen et de son "Front National" est le résultat d'une opération politique et médiatique, soigneusement organisée par le Parti socialiste de Mitterrand.
Nous ne sommes plus à la fin du 19ème siècle, lorsque les crises économiques s'atténuaient de plus en plus, que les arts et les sciences se développaient de façon exceptionnelle, les prolétaires voyant leur conditions d'existence s'améliorer régulièrement sous la pression de leurs organisations économiques et politiques de masses. Nous sommes à l'époque d'Auschwitz, d'Hiroshima, du Biafra, et du chômage massif et croissant pendant 30 ans sur 75.
L'idéologie dominante n'a plus l'emprise qu'elle avait au début de ce siècle, lorsqu'elle pouvait se permettre de faire croire à des millions d'ouvriers que le socialisme pourrait être le produit d'une évolution pacifique et quasi naturelle du capitalisme. Dans la décadence du capitalisme, l'idéologie dominante doit de plus en plus être imposée par la violence des manipulations médiatiques, précisément parce qu'elle peut de moins en moins s'imposer autrement.
Le développement des moyens de manipulation idéologique
Le GCI fait une constatation banale mais vraie :
- "La bourgeoisie, même avec sa vision limitée (limitée du point de vue de son être de classe) a tiré énormément de leçons du passé et à renforcé, affiné en conséquence l’utilisation de ses armes idéologiques".
C’est un fait indéniable. Mais le GCI n'en comprend ni l’origine, ni la signification.
Le GCI confond renforcement de l'idéologie dominante et renforcement des instruments de sa diffusion. Il ne voit pas que le développement de ces derniers est le produit de la faiblesse de cette idéologie, de la difficulté pour la classe dominante à maintenir "spontanément" son pouvoir. Si la bourgeoisie a dû multiplier au centuple ses dépenses en propagande depuis la 1ère guerre mondiale, ce n'est pas par un subit désir pédagogique, mais parce que, pour maintenir son pouvoir, la classe dominante a dû imposer aux classes exploitées des sacrifices sans précédent, et faire face à la première vague révolutionnaire internationale.
Le début du développement vertigineux des instruments idéologiques de la bourgeoisie date précisément de la période d'ouverture de la décadence capitaliste. La première guerre mondiale est la première guerre "totale", la première qui se fait par une mobilisation de la totalité des forces productives de la société en vue du but guerrier. Il ne suffit plus d'embrigader idéologiquement les troupes au front, il faut en outre encadrer, et de la façon la plus stricte, l'ensemble des classes productives. C'est à ce travail que les "syndicats ouvriers' se transformeront définitivement en rouages de l'Etat capitaliste. Un travail d'autant plus rude que jamais guerre n'avait été aussi absurde et destructrice et que le prolétariat se lançait dans sa première tentative révolutionnaire internationale.
Au cours de la période de l'entre-deux guerres, la bourgeoisie, confrontée à la plus violente crise économique de son histoire et à la nécessité de préparer une nouvelle guerre, va systématiser et développer encore les instruments de la propagande politique, en particulier "l'art" de la manipulation des masses : Goebbels et Staline ont laissé à la bourgeoisie mondiale des traités pratiques qui demeurent aujourd'hui les références de base de tout "publiciste" ou "manipulateur" des médias. "Un mensonge répété mille fois devient une vérité" enseignait le principal responsable de la propagande hitlérienne.
Après la seconde guerre mondiale, la bourgeoisie va disposer d'un nouvel instrument redoutable : la télévision. L'idéologie dominante à domicile distillée quotidiennement pour chaque cerveau par les services des gouvernements et des marchands les plus puissants. Présenté comme un luxe, les Etats sauront en faire le plus puissant instrument de manipulation idéologique.
La bourgeoisie a bien "renforcé et affiné l'utilisation de ses armes idéologiques", mais, contrairement aux affirmations du GCI, premièrement, cela n'a pas empêché l'usure et la décomposition de l'idéologie dominante, deuxièmement ce phénomène est le produit direct de la décadence du capitalisme.
Ce développement du totalitarisme idéologique se retrouve aussi dans la décadence des sociétés passées, tel que l'esclavagisme antique et le féodalisme. Dans l'empire romain décadent, la divinisation de la charge d'empereur ainsi que l'imposition du christianisme comme religion d'Etat, dans le féodalisme du Moyen-Âge, la monarchie de droit divin et l'emploi systématique de l'inquisition en sont des manifestations parmi d'autres, Mais elles n'y traduisaient pas plus que dans le capitalisme un quelconque renforcement de l'idéologie, une plus grande adhésion de la population aux idées de la classe dominante. Au contraire.
La spécificité de la décadence capitaliste
Il faut noter ici, encore une fois, l'importance des différences entre la décadence du capitalisme et celles des sociétés qui l'ont précédée en Europe. Tout d'abord, la décadence capitaliste est un phénomène aux dimensions mondiales, qui touche simultanément, même si dans des conditions différentes, tous les pays. Celle des sociétés passées reste toujours un phénomène local.
Ensuite, le déclin de l'esclavagisme antique, tout comme celui de la féodalité, se fait en même temps que le surgissement, au sein de l'ancienne société et coexistant avec elle, du nouveau mode de production. C'est ainsi que les effets de la décadence romaine sont atténués par le développement simultané de formes économiques de type féodal. C'est ainsi que ceux de la féodalité décadente le sont par le développement du commerce et des rapports de production capitalistes à partir des grandes villes.
Par contre, le communisme ne peut pas coexister avec le capitalisme décadent, ni même commencer à s'instaurer, sans avoir auparavant réalisé une révolution politique - le prolétariat commence sa révolution sociale 1à où les précédentes révolutions la terminaient : la destruction du pouvoir politique de l'ancienne classe dominante.
Le communisme n'est pas l'oeuvre d'une classe exploiteuse qui pourrait, comme par le passé, partager le pouvoir avec l'ancienne classe dominante. Classe exploitée, le prolétariat ne peut s'émanciper qu'en détruisant de fond en comble le pouvoir de cette dernière. Il n'y a aucune possibilité que les prémices de nouveaux rapports, communistes, puissent venir alléger, limiter les effets de la décadence capitaliste.
C'est pourquoi la décadence capitaliste est beaucoup plus violente, destructrice, barbare que celle des sociétés passées.
A côté des moyens développés par la bourgeoisie pour assurer son oppression idéologique, ceux des plus délirants empereurs romains décadents, ou des plus cruels des inquisiteurs féodaux, apparaissent comme des jeux d'enfants. Mais ces moyens sont à la mesure du degré de pourriture interne atteint par l'idéologie du capitalisme décadent.
"Les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout."
Mais il n'y a pas que l'idée d'une décomposition de l'idéologie dominante ou de l'écroulement des valeurs morales qui choque le GCI. Pour les prêtres de l'invariance, parler de manifestations de la décadence au niveau des formes philosophiques, artistiques, etc. c'est encore du "moralisme".
Encore une fois on ne peut que se demander pourquoi le GCI tient-il tellement à continuer à se réclamer du marxisme. Comme on l'a vu, non seulement Marx en parle, mais il y voit un domaine particulièrement crucial: "les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout."
Pour le marxisme "les hommes" sont déterminés par les rapports entre les classes. Aussi la façon dont se manifeste la prise de conscience du conflit entre les rapports de production existants et la nécessité du développement des forces productives, est différente suivant qu'il s'agisse de telle ou telle classe.
Pour la classe dominante, la prise de conscience de ce conflit se traduit sur le plan politique et juridique par un blindage de son Etat, par un durcissement et une généralisation totalitaire du contrôle de l'Etat, des lois, sur toute la vie sociale. C'est le capitalisme d'Etat, le féodalisme de la monarchie absolue, c'est l'Empire de droit divin. Mais, simultanément, la vie sociale plonge de plus en plus dans l'illégalité, dans la corruption généralisée, dans le brigandage. Depuis les trafics de la première guerre mondiale qui ont fait et défait des fortunes colossales, le capitalisme mondial n'a cessé de développer toutes les formes de trafics : drogue, prostitution, armes jusqu'à en faire devenir une source de financement permanent (par exemple pour les services secrets des grandes puissances) et, dans le cas de certains pays, la première source de revenu. La corruption sans limites, le cynisme, le machiavélisme le plus sordide et sans scrupules sont devenus des qualités indispensables pour survivre au sein d'une classe dominante qui s'entre-déchire d'autant plus violemment que les sources de richesse se tarissent.
Pour les artistes, philosophes et certains religieux, qui font en général partie des classes moyennes, la perte d'avenir de leur maîtres, qu'ils ressentent probablement avec une plus grande sensibilité que leurs employeurs eux mêmes, ils ont tendance à l'assimiler à leur propre fin et à la fin du monde. Le blocage du développement matériel par les contradictions des lois sociales dominantes, ils l'expriment par le pire pessimisme.
Voici comment formulait ce sentiment, Albert Camus, prix Nobel de littérature 1957, au lendemain de la 2ème guerre mondiale, dans la décennie des guerres de Corée, d'Indochine, de Suez, d'Algérie, etc.: "L'unique donnée est pour moi l'absurde. Le problème est de savoir comment en sortir et si le suicide doit se déduire de cet absurde."
Une sorte de "nihilisme" se développe, refusant à la raison toute possibilité de comprendre et de maîtriser le cours des choses. Le mysticisme, en tant que négation de la raison se développe. Et ici encore c'est un phénomène qui marque les décadences passées. Ainsi dans la décadence féodale du 14ème siècle :
- "Le temps du marasme voit éclore le mysticisme sous toutes ses formes. Il est intellectuel avec les Traités de l'art de mourir et, surtout, l'Imitation de Jésus Christ. Il est émotionnel avec les grandes manifestations de la piété populaire exacerbée par la prédication d'éléments incontrôlés du clergé mendiant: les 'flagellants' parcourent les campagnes, se déchirant la poitrine à coups de lanière sur la place des villages, afin de frapper la sensibilité humaine et d'appeler les chrétiens à la pénitence. Ces manifestations donnent le jour à une imagerie d'un goût souvent douteux, comme ces fontaines de sang qui symbolisent le Rédempteur. Très rapidement le mouvement tourne à l'hystérie et la hiérarchie ecclésiastique doit intervenir contre les fauteurs de trouble, pour éviter que leur prédication n'accroisse encore le nombre de vagabonds. (...) L'art macabre se développe (...) un texte sacré l'emporte alors dans la faveur des esprits les plus lucides : l'Apocalypse "[12] [1588].
Alors que dans les sociétés passées le pessimisme dominant se trouvait contrebalancé, après un certain temps, par l'optimisme engendré du fait de l'émergence d'une nouvelle société, dans le capitalisme décadent, la chute semble sans fond.
La décadence capitaliste détruit les anciennes valeurs, mais la bourgeoisie sénile n'a rien d'autre à offrir sinon le vide, le nihilisme. "Dont think !", "Ne pensez pas !" Telle est la seule réponse que peut désormais offrir le capitalisme en décomposition à la question des plus désespérés : "No future !".
Une société qui bat des records historiques de suicide, parmi les jeunes en particulier, une société où l'Etat est contraint, dans une capitale comme Washington, d'instaurer le couvre-feu contre les jeunes, les enfants, afin de limiter l'explosion du banditisme, est une société bloquée, en décomposition. Elle n'avance plus. Elle recule. C'est cela "la barbarie". Et c'est cette barbarie qui s'exprime dans le désespoir, ou dans la révolte, qui traverse les formes artistiques, philosophiques, religieuses depuis des décennies.
Dans l'enfer que devient pour les hommes une société en proie à la décadence de son mode de production, seule l'action de la classe révolutionnaire est porteuse d'espoir. Dans le cas du capitalisme cela se vérifie plus qu'en toute autre occasion.
Toute société soumise à la pénurie matérielle, donc toutes les formes de sociétés ayant existé jusqu'à présent, est organisée de sorte que la première des priorités sont d'assurer la subsistance matérielle de la communauté. La division de la société en classes n'est pas une malédiction tombée du ciel, mais le fruit du développement de la division du travail en vue de subvenir à cette première nécessité. Les rapports entre les hommes depuis la façon de se répartir les richesses créées, jusqu'à la façon de vivre l'amour, toutes les relations humaines sont médiatisées par leur mode d'organisation économique.
Que la machine économique vienne à se bloquer et c'est le lien, la médiation, le ciment des relations entre les hommes qui s'effrite, se décompose. Que l'activité productive cesse d'être créatrice d'avenir et ce sont les activités humaines dans leur quasi-totalité qui semblent perdre leur sens historique.
Dans le capitalisme l'importance de l'économie dans la vie sociale atteint des degrés inégalés auparavant. Le salariat, le rapport entre le prolétaire et le capital est de tous les rapports d'exploitation de l'histoire, le plus dépouillé de toute relation non-marchande, le plus impitoyable. Même dans les pires conditions économiques, les maîtres d'esclaves ou les seigneurs féodaux nourrissaient leurs esclaves et serfs, comme leur bétail. Dans le capitalisme, le maître ne nourrit l'esclave que pour autant qu'il en a besoin pour ses affaires. Pas de profit, pas de travail, pas de rapport social. L'atomisation, la solitude, l'impuissance. Les effets du blocage de la machine économique sur la vie sociale sont, dans le cas de la décadence capitaliste beaucoup plus profonds que dans celle des sociétés passées. La désagrégation de la société que provoque la crise économique engendre des retours à des formes de rapports sociaux primitifs, barbares : la guerre, la délinquance comme moyen de subsistance, la violence omniprésente, la répression brutale[13] [1589].
Dans ce marasme, seul est porteur d'avenir le combat contre le capitalisme qui détruit toute perspective autre que celle de l'autodestruction généralisée. Seul est unificateur et créateur de véritables rapports humains, le combat contre le capitalisme qui les aliène et les atomise. Ce combat, c'est le prolétariat qui en est le principal protagoniste.
C'est pourquoi la conscience de classe prolétarienne, telle qu'elle s'affirme lorsque le prolétariat agit comme classe, telle qu'elle est développée par les minorités politiques révolutionnaires, est la seule qui peut "regarder le monde en face", la seule qui soit une véritable "prise de conscience" du conflit dans lequel se trouve bloquée la société.
Le prolétariat l'a montré pratiquement en portant ses luttes revendicatives à leurs dernières conséquences, dans la vague révolutionnaire internationale ouverte par la prise de pouvoir du prolétariat en Russie 1917. Il réaffirma alors clairement le projet dont sont porteurs les prolétaires du monde entier : le communisme.
L'activité organisée des minorités révolutionnaires, en mettant systématiquement en évidence les causes de cette décomposition, en dégageant la dynamique générale qui conduit à la révolution communiste, constitue un facteur décisif de cette prise de conscience.
C'est essentiellement dans et par le prolétariat que "les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout".
Décomposition de l'idéologie dominante : développement des conditions de la révolution
Pour la classe révolutionnaire, il ne sert à rien de se lamenter sur les misères de la décadence capitaliste. Elle doit au contraire voir dans la décomposition des formes idéologiques de la domination capitaliste, un facteur qui dégage les prolétaires de l'emprise idéologique du capital. Elle constitue un danger lorsque le prolétariat se laisse aller à la résignation et à la passivité. La lumpénisation des jeunes prolétaires chômeurs, l'autodestruction par la drogue ou la soumission au "chacun pour soi" préconisé par la bourgeoisie, sont des dangers d'affaiblissement réels pour la classe ouvrière. (Voir "La décomposition du capitalisme", Revue Internationale n° 57). Mais la classe révolutionnaire ne peut porter son combat jusqu'au bout sans perdre ses dernières illusions sur le système dominant. La décomposition de l'idéologie dominante fait partie du processus qui y conduit.
Par ailleurs cette décomposition a des effets sur les autres parties de la société. La domination idéologique de la bourgeoisie sur l'ensemble de la population non-exploiteuse, en dehors du prolétariat, s'en trouve aussi affaiblie. Cet affaiblissement n'est pas en lui même porteur d'avenir : la révolte de ces couches, sans l'action du prolétariat, ne conduit qu'à la multiplication des massacres. Mais, lorsque la classe révolutionnaire prend l'initiative du combat, cela lui permet de compter sur la neutralité, voire l'appui de ces couches.
Il ne peut y avoir de révolution prolétarienne triomphante si les corps armés de la classe dominante ne sont pas eux-mêmes décomposés. Si le prolétariat doit affronter une armée qui continue d'obéir inconditionnellement à la classe dominante, son combat est condamné d'avance. Trotsky en faisait une loi déjà au lendemain des luttes révolutionnaires en Russie en 1905. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, après des décennies de développement de l'armement par la bourgeoisie décadente. Le moment où les premiers soldats refusent de tirer sur des prolétaires en lutte, constitue toujours un moment décisif dans un processus révolutionnaire. Or seule la décomposition des valeurs idéologiques de l'ordre établi, jointe à l'action révolutionnaire du prolétariat, peut provoquer la désagrégation de ces corps armés. Pour cela encore, le prolétariat ne saurait "voir dans la misère que la misère".
***
Le CCI, pour qui la révolution est et a toujours été à l'ordre du jour, ne comprend pas plus les changements dans les formes idéologiques dominantes, qu'il ne voit se mouvoir quoi que ce soit dans son univers "invariant". Mais ce faisant, il s'interdit de comprendre le véritable mouvement qui conduit à la révolution.
La décomposition des formes idéologiques du capitalisme est une manifestation criante de la mise à l'ordre du jour de l'histoire de la révolution communiste mondiale. Elle fait partie du processus où mûrissent la conscience de la nécessité de la révolution et où se créent les conditions de sa possibilité.
RV
[1] [1590] Revue Internationale n° 48,49, 50, 54, 55, 56.
[2] [1591] Avant-propos de la critique de l'économie politique ; Ed. La Pléiade, T.1.
[3] [1592] Ibid
[4] [1593] Ibid
[5] [1594] Voir les articles Précédents de cette série.
[6] [1595] Célèbres personnages de la droite en France
[7] [1596] Le communiste n° 23.
[8] [1597] L'Idéologie allemande, "Feuerbach, conception matérialiste contre conception idéaliste" ; Ed. La Pléiade, T. 3.
[9] [1598] Ibid.
[10] [1599] Ibid.
[11] [1600] Les exemples concrets de "nouvelle recomposition idéologique" données par le GCI se réfèrent pour la plupart à des pays moins développés : "renaissance de l'Islam", "le retour de nombreux pays anciennes 'dictatures fascoïdes' au 'libre jeu des droits et libertés démocratiques', Grèce, Espagne, Portugal, Argentine. Brésil, Pérou, Bolivie ...". Ce faisant, "l'invariance" ignore la décomposition croissante de ces mêmes valeurs dans les pays de plus longue tradition et concentration prolétarienne, tout comme la rapidité avec laquelle elles s’usent dans leurs nouveaux lieux d’application. Mais il est difficile de voir l’accélération de l’histoire, lorsqu’on la croit « invariante ».
[12] [1601] J. Favier, De Marco Polo à Christophe Colomb.
[13] [1602] Le développement massif et dans tous les pays de corps armés spécialisés dans la répression des foules et des mouvements sociaux, est une caractéristique spécifique du capitalisme décadent
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [2]
A la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière
- 2971 reads
Le 4 février 1989, mourait Manuel Fernandez Grandizo, dit G. Munis. Le prolétariat vient de perdre un militant qui a consacré toute sa vie au combat de classe. Né au début du siècle, c'est très jeune que Munis a commencé sa vie de révolutionnaire comme militant du trotskisme, à une époque où ce courant se trouvait encore dans le camp du prolétariat et menait une lutte acharnée contre la dégénérescence stalinienne des partis de l'Internationale Communiste. Il est membre de l'Opposition, de gauche espagnole (OGE) qui se orée en février 1930 à Liège, en Belgique, autour de F. Garcia Lavid, dit "H. Lacroix". Il milite dans sa section de Madrid où il prend position pour la tendance "Lacroix" en mars 1932 contre le Centre dirigé par Andrés Nin. La discussion au sein de l'Opposition de gauche (OG) portait alors sur la nécessité ou non de créer "un deuxième parti communiste" ou bien de poursuivre l'Opposition aux PC avec pour but de les redresser. Cette dernière position qui était, dans les années 30, la position de Trotsky sera mise en minorité à la troisième Conférence de l'OGE, qui changera alors de nom pour devenir Izquierda Comunista espanola (ICE - Gauche communiste espagnole). Malgré son désaccord, Munis continuera à militer en son sein. La concrétisation de cette orientation de création d'un nouveau parti aboutit à la fondation, en septembre 1934, du POUM, parti centriste, catalaniste et sans principes regroupant l'ICE et le Bloc ouvrier et paysan (BOC) de J. Maurin. Munis s'oppose alors avec une poignée de camarades à la dissolution des révolutionnaires dans le POUM et fonde le Groupe B-L d'Espagne (Bolchevique-léniniste).En 1936 au milieu de la dispersion des révolutionnaires espagnols, il reforme le groupe B-L qui avait disparu, et surtout, il participe avec beaucoup de courage et de décision, aux côtés des "Amis de Durruti", à l'insurrection des ouvriers de Barcelone en Mai 1937 contre le gouvernement de Front populaire. Arrêté en 1938, il réussit à s'évader des prisons staliniennes en 1939.Le déclenchement de la 2ème guerre impérialiste mondiale conduit Munis à rompre avec le trotskisme sur la question de la défense d'un camp impérialiste contre un autre et à adopter une position internationaliste claire de défaitisme révolutionnaire contre la guerre impérialiste. Il dénonce la Russie comme pays capitaliste ce qui aboutit à la rupture de la section espagnole d'avec la IV° internationale à son 1er congrès d'après guerre en 1948 (c.f. "Explication y Uamaminento a los militantes, grupos y secciones de la IV° international", septembre 1949). Après cette rupture, son évolution politique en direction d'une plus grande clarté révolutionnaire se poursuivra, en particulier sur la question syndicale et la question parlementaire, à la suite notamment des discussions avec les militants de la Gauche Communiste de France. Cependant, le "Second Manifeste Communiste" qu'il publie en 1965 (après qu'il ait été emprisonné en 1952 pendant quelques années dans les geôles franquistes) témoigne de sa difficulté à rompre complètement avec la démarche trotskiste, bien que ce document se situe clairement sur un terrain de classe prolétarien. En 1967, il participe, en compagnie de camarades d'"Internacionalismo", à une prise de contact avec le milieu révolutionnaire en Italie. Aussi, à la fin des années 60, avec le resurgissement de la classe ouvrière sur la scène de l'histoire, il sera sur la brèche aux côtés des faibles forces révolutionnaires existantes, dont celles qui vont fonder "Révolution Internationale". Au début des années 70, il reste malheureusement à l'écart de l'effort de discussion et de regroupement qui allait notamment aboutir, en 1975, à la constitution du Courant Communiste International. En revanche, le Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR), l'organisation qu'il avait fondée autour des positions du "Second Manifeste", sera partie prenante de la première Conférence des Groupes de la Gauche Communiste qui s'est tenue en 1977 à Milan. Mais cette attitude sera remise en cause à la deuxième Conférence, où le FOR se retire dès l'ouverture, ce qui exprime une démarche d'isolement sectaire qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui dans cette organisation. Il est donc clair que nous avions des divergences très importantes avec le FOR, ce qui nous a conduit à polémiquer en de nombreuses reprises avec cette organisation dans notre presse (voir notamment l'article de la Revue Internationale n° 52). Cependant, malgré les erreurs sérieuses qu'il a pu commettre, Munis est resté jusqu'au bout un militant profondément fidèle au combat de la classe ouvrière. Il était un de ces très rares militants qui ont résisté à la pression de la plus terrible contre-révolution qu'ait subit le prolétariat dans son histoire, alors que beaucoup désertaient le combat militant ou même trahissaient, pour être présent aux côtés de la classe ouvrière lors de la reprise historique de ses combats à la fin des années 60.C'est à ce militant du combat révolutionnaire, à sa fidélité au camp prolétarien et à son engagement indéfectible que nous voulons rendre hommage. A ses camarades du FOR, nous adressons notre salut fraternel.
RI
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Contribution pour une histoire du mouvement révolutionnaire : histoire de la gauche germano-hollandaise
- 2826 reads
L'histoire de la gauche communiste internationale depuis le début du siècle, telle que nous avons commencé à la relater dans les brochures sur La Gauche communiste d'Italie, n'est pas seulement un travail d'historien. Ce n'est que d'un point de vue militant, du point de vue de l'engagement dans le combat de la classe ouvrière pour son émancipation que peut être abordée l'histoire du mouvement ouvrier, histoire dont la connaissance, pour la classe ouvrière, n'est pas affaire de savoir, mais d'abord et avant tout une arme de son combat pour les luttes du moment et à venir, par les leçons du passé qu’elle enseigne.
C'est de ce point de vue militant que nous publierons, comme contribution pour une histoire du mouvement révolutionnaire, une brochure sur La gauche communiste germano-hollandaise, qui paraîtra dans le courant de cette année. C'est ce point de vue de comment nous avons abordé cette histoire qui est présenté ci-dessous dans l'introduction à cette brochure.
INTRODUCTION A L'HISTOIRE DE LA GAUCHE GERMANO-HOLLANDAISE
Franz Mehring, auteur réputé d'une biographie de Marx et d'une histoire de la social-démocratie allemande, compagnon d'armes de Rosa Luxemburg, soulignait en 1896 -dans la Neue Zeit - toute l'importance que revêt pour le mouvement ouvrier la réappropriation de son propre passé :
"C'est un avantage qu'a le prolétariat, par rapport à tous les autres partis, de pouvoir puiser sans cesse de nouvelles forces dans l'histoire de son propre passé pour mener la lutte du présent et atteindre le nouveau monde du futur. "
L'existence d'une véritable "mémoire ouvrière" traduit un effort constant du mouvement ouvrier, dans sa dimension révolutionnaire, pour se réapproprier son propre passé. Cette réappropriation est indissociablement liée à l'auto développement de la conscience de classe, qui se manifeste pleinement dans les luttes massives du prolétariat. Et Mehring notait dans le même article que "comprendre c'est dépasser" (auflieben), dans le sens de conserver et d'assimiler les éléments d'un passé qui portent en germe le futur d'une classe historique, d une classe qui est la seule classe historique en étant porteuse du "nouveau monde du futur". Ainsi, on ne peut guère comprendre l'émergence de la Révolution russe d'octobre 1917 sans les expériences de la Commune de Paris et de 1905 en Russie.
Considérant que l'histoire du mouvement ouvrier ne peut se réduire à une suite d'images d'Epinal, faisant revivre de façon colorée un passé révolu, et encore moins à des études académiques où "le passé du mouvement ainsi miniaturisé en des études minutieuses, pédantes, privées de toute perspective générale, isolées de leur contexte, n'est susceptible de susciter qu'un intérêt fort limité" (G. Haupt, L'Historien et le mouvement social), nous avons fait le choix dans notre travail d'aborder l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire germano-hollandais en tant que praxis. Nous faisons nôtre cette définition donnée par G. Haupt. Considérée comme l'expression d'un "matérialisme militant" (Plékhanov), cette praxis se définit comme un "laboratoire d'expériences, d'échecs et de succès, champ d'élaboration théorique et stratégique, où rigueur et examen critique s’imposent pour fixer la réalité historique et par là même découvrir ses ressorts cachés, pour inventer donc innover à partir d'un moment historique perçu comme expérience." (Haupt, Ibid.)
Pour le mouvement ouvrier révolutionnaire, l'histoire de son propre passé n'est pas "neutre". Elle implique une constante remise en question et donc assimilation critique de son expérience passée. Le bouleversement révolutionnaire dans la praxis du prolétariat est sous-tendu finalement par un bouleversement en profondeur de la conscience de classe. Seul l'examen critique du passé, sans dogmes ni tabous, peut redonner au mouvement ouvrier révolutionnaire cette dimension historique caractéristique d'une classe ayant une finalité, sa libération et celle de l'humanité. Rosa Luxemburg définissait ainsi la méthode d'investigation par le mouvement ouvrier de son propre passé :
"Il n'existe pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer (au prolétariat) les voies sur lesquelles il doit s'engager. Il n'a pas d'autre maître que l’expérience historique. Le chemin de croix de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait tirer l'enseignement de ses propres erreurs" (R. Luxemburg, La crise de la social-démocratie ; cité par G. Haupt, L'historien et le mouvement social, Maspéro, 1980.)
Alors que l'histoire du mouvement ouvrier, comme praxis, se traduit par une discontinuité théorique et pratique, au contact de l'expérience historique nouvelle, elle se présente aussi comme une tradition jouant un rôle mobilisateur de la conscience ouvrière et alimentant la mémoire collective. Si souvent elle joue un rôle conservateur dans l'histoire du prolétariat, elle exprime encore plus ce qui demeure de stable dans les acquis théoriques et organisationnels du mouvement ouvrier. Ainsi, la discontinuité et la continuité sont les deux dimensions indissociables de cette histoire politique et sociale de ce mouvement.
Les courants communistes de gauche, issus de la 3e Internationale, comme la Gauche italienne "bordiguiste", d'un côté, et la Gauche communiste hollandaise de Gorter et Pannekoek, de l'autre, n'ont pas échappé à la tentation de se situer unilatéralement dans la continuité ou la discontinuité du mouvement ouvrier. Le courant "bordiguiste" a choisi résolument d'affirmer une "invariance" du marxisme et du mouvement ouvrier depuis 1848, une "invariance" de la théorie communiste depuis Lénine. Le courant "conseilliste" des années 1930, aux Pays-Bas, par contre, a fait le choix de nier toute continuité dans le mouvement ouvrier et révolutionnaire. Sa théorie du Nouveau Mouvement ouvrier rejetait dans le néant "l'ancien" mouvement ouvrier, dont l'expérience était jugée négative pour l'avenir. Entre ces deux attitudes extrêmes, se situaient le KAPD de Berlin et surtout "Bilan", la revue de la Fraction italienne en exil en France et en Belgique dans les années 1930. Les deux courants, allemand et italien, tout en innovant théoriquement et en marquant la discontinuité entre le nouveau mouvement révolutionnaire des années 1920 et 1930 et celui qui précéda, dans la social-démocratie, la guerre de 1914-1918, s'orientaient dans la continuité avec le mouvement marxiste originel. Toutes ces hésitations montrent la difficulté à saisir le courant de la gauche communiste dans sa continuité et sa discontinuité, c'est-à-dire la conservation et le dépassement de leur héritage actuel.
Les difficultés d'une histoire du mouvement révolutionnaire communiste de gauche et communiste de conseils ne tiennent pas seulement au dépassement critique de leur propre histoire. Elles sont surtout le produit d'une histoire, tragique, qui depuis presque soixante années s'est traduite par une disparition des traditions révolutionnaires du mouvement ouvrier, qui avaient culminé avec la Révolution russe et la Révolution en Allemagne. Une sorte d'amnésie collective a semblé s'installer dans la classe ouvrière, sous l'effet de défaites successives et répétées trouvant leur culmination dans la deuxième guerre mondiale, qui a détruit des générations qui maintenaient vivantes les expériences vécues d'une lutte révolutionnaire et le fruit de décennies d'éducation socialiste. Mais c'est surtout le stalinisme, la contre-révolution la plus profonde qu'ait connue le mouvement ouvrier, avec la dégénérescence de la Révolution russe, qui a réussi le mieux à gommer cette mémoire collective, indissociable d'une conscience de classe. L'histoire du mouvement ouvrier, et surtout celle du courant révolutionnaire de gauche dans la 3e Internationale, est devenue une gigantesque entreprise de falsifications idéologiques au service du capitalisme d'Etat russe, puis des Etats qui se bâtirent sur le même modèle après 1945. Cette histoire devenait la glorification cynique du Parti unique au pouvoir et de son appareil étatique et policier. Sous couvert d' 'internationalisme", l'histoire officielle, "révisée", au fur et à mesure des règlements de comptes et des "tournants" successifs, devenait un discours étatique et nationaliste, de justification de toute guerre impérialiste et de la terreur, de justification des instincts les plus bas et les plus morbides cultivés sur le sol putréfié de la contre-révolution et de la guerre.
Il vaut la peine, à ce propos, de citer l'historien Georges Haupt, disparu en 1980, qui s'est fait connaître par la probité de ses travaux sur la 2e et la 3e Internationales :
"A l'aide de falsifications inouïes, foulant aux pieds et méprisant les réalités historiques les plus élémentaires, le stalinisme a méthodiquement gommé, mutilé, remodelé le champ du passé pour le remplacer par sa propre représentation, ses mythes, son autoglorification. L'histoire du mouvement ouvrier international se fige elle aussi en une collection d'images mortes, truquées, vidées de toute substance, remplacées par des copies maquillées où le passé se reconnaît à peine. La fonction que le stalinisme assigne à ce qu'il considère et déclare être l'histoire, et dont la validité sera imposée au mépris de toute vraisemblance, exprime une peur profonde de la réalité historique qu'il s'efforce de masquer, tronquer, déformer systématiquement pour en faire le terrain du conformisme et de la docilité. A l'aide d'un passé imaginaire, fétichisé, privé des éléments rappelant la réalité, le pouvoir cherche non seulement à obstruer la vision du réel mais à tétaniser la faculté de perception elle-même. D'où la nécessité permanente d'anesthésier, de pervertir la mémoire collective, dont le contrôle devient total du moment que le passé se voit traiter en secret d'Etat et l'accès aux documents est interdit."
Enfin, vint la période de mai 1968, le surgissement d'un mouvement social d'une telle ampleur, qui parcourut le monde de la France à la Grande-Bretagne, de la Belgique à la Suède, de l'Italie à l'Argentine, de la Pologne à l'Allemagne. Nul doute que la période d'éclosions ouvrières dans la période 1968-1974 a favorisé la recherche historique sur le mouvement révolutionnaire. Nombre de livres parurent sur l'histoire des mouvements révolutionnaires du XXe siècle, en Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne. Le fil rouge d'une continuité historique, entre le passé lointain des années 1920 et la période de mai 1968, apparut évidente à ceux qui ne se laissaient pas abuser par le côté spectaculaire de la révolte étudiante. Bien rares furent cependant ceux qui virent l'existence d'un mouvement ouvrier renaissant de ses cendres, dont l'effet fut le réveil d'une mémoire historique collective, anesthésiée, endormie pendant près de quarante années. Pourtant, dans un enthousiasme confus, les références historiques révolutionnaires sortaient spontanément et dans une joyeuse profusion de la bouche des ouvriers qui parcouraient les rues de Paris et fréquentaient les Comités d'action, antisyndicaux. Et ces références, ce n'étaient pas les étudiants "gauchistes", historiens et sociologues qui les leur soufflaient dans l'oreille. La mémoire collective ouvrière évoquait - souvent de façon confuse, et dans la confusion des événements - toute l'histoire du mouvement ouvrier, ses principales étapes : 1848, la Commune de Paris, 1905, 1917, mais aussi 1936, qui en était l'antithèse avec la constitution du Front populaire. C'est à peine si était évoquée l'expérience décisive de la Révolution allemande (1918-1923). L'idée des conseils ouvriers, préférée à celle de soviets moins purement prolétariens avec leur masse de soldats et paysans, apparaissait de plus en plus dans les discussions de la rue et dans les comités d'action nés de la vague de grève généralisée.
Le resurgissement du prolétariat sur la scène historique, d'une classe qui était déclarée par certains sociologues "intégrée" et "embourgeoisée", a largement créé les conditions favorables à une recherche sur l'histoire des mouvements révolutionnaires des années 1920 et 1930. Des études, trop rares, ont été consacrées aux gauches de la 2e et 3e Internationales. Les noms de Gorter et Pannekoek, les sigles KAPD et GIC, à côté de ceux de Bordiga et Damen, sont devenus plus familiers aux éléments se déclarant "ultra-gauche" ou "communistes internationalistes". La chape de plomb du stalinisme était soulevée, mais d'autres formes, plus insidieuses, de troncature et de déformation de l'histoire du mouvement révolutionnaire sont apparues, avec le déclin du stalinisme. Une historiographie de type social-démocrate, trotskyste, ou purement universitaire - suivant l'air du temps - est apparue, dont les effets sont tout aussi pervers que ceux du stalinisme. L'historiographie social-démocrate, comme la stalinienne, a essayé d'anesthésier et de gommer tout le côté révolutionnaire du mouvement communiste de gauche, pour le réduire à une "chose morte" du passé. Souvent, les critiques de la Gauche communiste à la social-démocratie ont soigneusement été gommées, de façon à en rendre l'histoire tout à fait inoffensive. L'historiographie gauchiste, et trotskyste en particulier, a pratiqué de son côté le mensonge par omission, en évitant soigneusement de trop parler des courants révolutionnaires à gauche du trotskisme. Beaucoup d'entre eux, quand il fallait inévitablement en parler, la mentionnaient au passage en lui collant l'étiquette - se voulant infamante - d'ultra-gauche, de "sectaire", et renvoyaient à la critique de "l'infantilisme de gauche" par Lénine. Une méthode longtemps pratiquée d'ailleurs par l'historiographie stalinienne. L'histoire devenait celle de leur propre auto-justification, un instrument de légitimation. Citons de nouveau ce que dit l'historien George Haupt, qui était loin d'être révolutionnaire, à propos de l'historiographie de cette "nouvelle gauche" :
"Il v a une décennie à peine, la ‘nouvelle gauche’ anti réformiste et antistalinienne, censeur sévère de l'histoire universitaire quelle rejette comme bourgeoise, affichait une attitude 'traditionnelle' envers l'histoire, retombant dans les mêmes ornières que les staliniens et les social-démocrates en coulant le passé dans le même type de moules. Ainsi les idéologues de l'opposition extraparlementaire (qui ne l'est plus depuis bien longtemps, NDR) dans les années soixante en Allemagne, eux aussi se sont employés à rechercher leur légitimité dans le passé. Ils ont traité l'histoire comme un gros gâteau dont chacun pouvait retrancher un morceau selon son goût ou son appétit'. Erigée en source de légitimité et utilisée comme instrument de légitimation, l'histoire ouvrière reste une sorte de dépôt d’accessoires, de déguisements, où chaque fraction, chaque groupuscule trouve sa référence justificatrice, utilisable pour les besoins du moment. " (Ibid.)
Des courants révolutionnaires, comme le "bordiguisme" ou le "conseillisme", parce qu'ils n'ont pu échapper au danger du sectarisme, ont fait eux aussi de l'histoire du mouvement révolutionnaire une source de légitimation de leurs conceptions. Au prix d'une déformation de l'histoire réelle, ils ont opéré un soigneux découpage, écartant toutes les composantes du mouvement révolutionnaire qui n'allaient pas dans leur sens. L'histoire de la Gauche communiste n'était plus celle de l'unité et de l'hétérogénéité de ses composantes, une histoire complexe à écrire dans toute sa globalité et sa dimension internationale, pour mieux en montrer l'unité, mais devenait celle de courants antagonistes et rivaux. Les "bordiguistes" ignoraient superbement l'histoire des Gauches communistes hollandaise et allemande. Quand ils en pariaient, c'était toujours avec un superbe mépris, et comme les trotskystes, ils renvoyaient à la critique "définitive" de Lénine de l'infantilisme de gauche. Ils gommaient soigneusement qu'en 1920 Bordiga, tout comme Gorter et Pannekoek, avait été condamné par Lénine comme "infantile", pour le même rejet du parlementarisme et de l'entrée du PC britannique dans le Labour Party. L'historiographie "conseilliste" a une attitude similaire. Glorifiant l'histoire du KAPD et des Unions -qu'elle réduisait le plus souvent à ses courants "antiautoritaires" et anarchisants, comme celui de Ruhle -, et surtout celle du GIC, elle ignorait non moins superbement l'existence du courant de Bordiga, celle de la Fraction italienne autour de "Bilan" dans les années 1930. Ce courant était rejeté dans le même sac que le "léninisme". Elle gommait aussi, avec un zèle non moins grand que celui des bordiguistes, les différences énormes entre la Gauche hollandaise de 1907 à 1927, revendiquant une organisation politique, et le conseillisme des années 1930. L'itinéraire de Pannekoek d'avant 1921 comme après 1927 devenait pour le "conseillisme" parfaitement droit. Le communiste de gauche Pannekoek d'avant 1921 était "révisé" à la lumière de son évolution conseilliste.
Outre le sectarisme de ces historiographies bordiguiste et conseilliste, qui se veulent "révolutionnaires" - alors que seule la vérité est révolutionnaire-, on doit souligner l'optique étroitement nationale de ces courants. En réduisant l'histoire du courant révolutionnaire à une composante nationale, choisie en fonction de leur "terroir" d'origine, ces courants ont manifesté une étroitesse nationale bornée et un fort "esprit de clocher". Le résultat a été que la dimension internationale de la Gauche communiste a été gommée. Le sectarisme de ces courants est inséparable de leur propre localisme, qui laisse transparaître la soumission inconsciente à des caractéristiques nationales, aujourd'hui révolues pour un véritable mouvement révolutionnaire international.
Vingt ans après mai 1968, le plus grand danger qui menace les tentatives d'écrire une histoire du mouvement révolutionnaire est moins la déformation ou la "désinformation" que la pression idéologique énorme, qui s'est fait ressentir ces dernières années. Cette pression va dans le sens d'une diminution notable des études et des recherches, dans le cadre universitaire, sur l'histoire du mouvement ouvrier. Pour s'en rendre compte, il suffit de citer les conclusions de la revue Le Mouvement social (n° 142, janvier-mars 1988), revue française connue pour ses recherches sur l'histoire du mouvement ouvrier. Un historien note une baisse sensible, dans cette revue, des articles consacrés au mouvement ouvrier et aux partis et organisations politiques s'en réclamant. Il constate une "baisse tendancielle de l'histoire politique 'pure' 60 % des articles au début, 10-15 % aujourd'hui. Depuis 1981, avec sans doute l'érosion de l'"illusion lyrique" sur la gauche au pouvoir, on assiste à une baisse sensible des études dur le communisme en général. Ce "décrochage" a été brutal depuis 1985-1986. Signe plus inquiétant d^me pression idéologique -celle de la bourgeoisie, devant l'incertitude croissante qui ébranle ses soubassements économiques, avec la crise mondiale- l'auteur note qu'une "prépondérance ouvrière (dans cette revue) est lentement grignotée par la montée de la bourgeoisie". Et il conclut par une hausse des études consacrées à l'histoire de la bourgeoisie et des couches non ouvrières. L'histoire du mouvement ouvrier cède de plus en plus la place à celle de la bourgeoisie et de l'histoire économique tout court.
Ainsi, après toute une période où furent écrites des études sur le mouvement ouvrier et révolutionnaire, dont les limites dans le monde universitaire étaient les semi vérités et les demi mensonges répétés, le gommage de l'histoire du mouvement dans sa dimension révolutionnaire, on assiste à une période de réaction. Même 'neutre', accommodée au goût du jour, même anesthésiante, l'histoire du mouvement ouvrier, surtout quand elle est révolutionnaire, apparaît "dangereuse" pour l'idéologie dominante. C'est que l'histoire politique et idéologique du mouvement révolutionnaire est explosive. Etant une praxis, elle est lourde de leçons révolutionnaires pour le futur. Elle remet en cause toutes les idéologies de la gauche officielle. Leçon critique du passé, elle est lourde d'une critique du présent. Elle est "une arme de la critique", laquelle -comme l'affirmait Marx- peut se changer en "critique des armes". On peut citer à ce propos le même G. Haupt : "...l'histoire est un terrain explosif, dans la mesure où la réalité des faits ou les expériences d'un passé souvent escamoté sont susceptibles de remettre en question toute prétention à la représentation unique de la classe ouvrière. Car l'histoire du monde ouvrier touche le fondement idéologique sur lequel s'appuient tous les partis à vocation d'avant-garde pour maintenir leurs visées hégémoniques." (p. 38, idem).
Cette histoire de la Gauche Communiste germano-hollandaise va à contre-courant de l'historiographie actuelle. Elle ne vise pas une pure histoire sociale de ce courant. Elle veut être une histoire politique, redonnant vie et actualité à tous les débats politiques théoriques qui s'y développèrent. Elle veut replacer dans son cadre international cette Gauche, sans lequel son existence devient incompréhensible. Elle se veut surtout une histoire critique, pour en montrer, sans a priori ni anathème, les lignes de force et de faiblesse. Elle n'est ni une apologie ni un rejet du courant communiste germano-hollandais. Elle veut montrer les racines du courant conseilliste, pour mieux en souligner les faiblesses intrinsèques et expliquer les raisons de sa disparition. Elle veut montrer aussi que l'idéologie du conseillisme traduit un éloignement des conceptions du marxisme révolutionnaire, exprimées dans les années 20 et 30 par le courant bordiguiste et le KAPD. Et en tant que telle cette idéologie, proche de l'anarchisme, peut être particulièrement pernicieuse pour le mouvement révolutionnaire futur, par son rejet de l'organisation révolutionnaire et de la Révolution russe, finalement par son rejet de toute l'expérience acquise par le mouvement ouvrier et révolutionnaire du passé. C'est une idéologie qui désarme la classe révolutionnaire et ses organisations.
Bien qu'écrite dans un cadre universitaire, cette histoire est donc une arme de combat. Pour reprendre l'expression de Mehring, elle est une histoire-praxis, une histoire "pour mener la lutte du présent et atteindre le nouveau monde du futur".
Cette histoire n'est donc pas "impartiale". Elle est un travail engagé. Car la vérité historique, quand il s'agit de l'histoire du mouvement révolutionnaire, exige un engagement révolutionnaire. La vérité des faits, leur interprétation dans un sens prolétarien, ne peut être que révolutionnaire.
Dans cet ouvrage, nous avons fait nôtres les réflexions de Trotski -dans sa Préface à son "Histoire de la Révolution russe"- sur l'objectivité du travail d'une histoire révolutionnaire :
"Le lecteur n'est pas, bien entendu, obligé de partager les vues politiques de l’auteur, que ce dernier n'a aucun motif de dissimuler. Mais le lecteur est en droit d'exiger qu'un ouvrage d'histoire constitue non pas l'apologie d'une position politique, mais une représentation intimement fondée du processus réel de la révolution. Un ouvrage d'histoire ne répond pleinement à sa destination que si les événements se développent, de page en page, dans tout le naturel de leur nécessité...
"Le lecteur sérieux et doué de sens critique n'a pas besoin d'une impartialité fallacieuse qui lui tendrait la coupe de l'esprit conciliateur, saturée d'une bonne dose de poison, d'un dépôt de haine réactionnaire, mais il lui faut la bonne foi scientifique qui, pour exprimer ses sympathies, ses antipathies, franches et non masquées, cherche à s'appuyer sur une honnête étude des faits, sur la démonstration des rapports réels entre les faits, sur la manifestation de ce qu'il y a de rationnel dans le déroulement des faits. Là seulement est possible l'objectivité historique, et elle est alors tout à fait suffisante, car elle est vérifiée et certifiée autrement que par les bonnes intentions de l'historien -dont celui-ci donne d'ailleurs la garantie- mais par la révélation de la loi intime du processus historique."
Le lecteur pourra juger, par l'abondance des matériaux utilisés, que nous avons visé cette bonne foi scientifique, sans cacher nullement nos sympathies et antipathies.
Ch.
Géographique:
- Hollande [558]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [852]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Revue Internationale no 59 - 4e trimestre 1989
- 2712 reads
Editorial : Chine, Pologne, Moyen-Orient, grèves en URSS et aux Etats-Unis
- 2705 reads
CONVULSIONS CAPITALISTES ET LUTTES OUVRIERES
En quelques mois, le monde a été le théâtre de toute une série d'événements particulièrement significatifs des enjeux réels de la période historique actuelle : les événements de Chine au printemps, les grèves ouvrières en URSS durant l'été, la situation au Moyen Orient, marquée par des faits d'apparence "pacifique" comme la nouvelle orientation de la politique de l'Iran, mais aussi par des événements sanglants et menaçants comme la destruction systématique de Beyrouth et les gesticulations belliqueuses de la flotte française au large du Liban. Enfin, le dernier événement qui ait fait la "une" des journaux, la constitution en Pologne, pour la première fois dans un pays à régime stalinien, d'un gouvernement dirigé par une formation politique qui n'est ni le parti "communiste", ni même une de ses marionnettes (comme le "parti paysan" où autres), rend compte de la situation inédite dans laquelle se trouvent ces pays.
Pour les commentateurs bourgeois, ces différents événements trouvent en général une explication spécifique, sans lien aucun avec celle des autres. Et quand ils s'emploient à dégager ce qui les relie entre eux, à établir un cadre général dans lequel ils s'insèrent, c'est pour les mettre au service des campagnes démocratiques qui se déchaînent à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'on peut lire et entendre que :
- "les convulsions qui ont secoué la Chine sont liées au problème de la succession du vieillard autocrate Deng Xiaoping" ;
- "les grèves des ouvriers en URSS s'expliquent par les difficultés économiques spécifiques auxquelles ils se confrontent" ;
- "le nouveau cours de la politique iranienne est la conséquence de la disparition du fou paranoïaque Khomeiny" ;
- "les affrontements sanglants du Liban et l'expédition militaire française ont pour cause les appétits excessifs de Assad, le "Bismarck" du Moyen Orient" ;
- "on ne peut comprendre la situation actuelle en Pologne qu'en partant des spécificités de ce pays"...
"Mais tous ces événements ont un point commun : ils participent de la lutte universelle entre la "Démocratie" et le totalitarisme", entre les défenseurs des "Droits de l'Homme" et ceux qui les bafouent."
Face à la vision du monde des bourgeois qui ne dépasse pas le bout de leur nez et surtout face aux mensonges qu'ils répètent à satiété en espérant que les prolétaires en feront leur vérité, c'est le rôle des révolutionnaires de mettre en avant les véritables enjeux que les événements récents traduisent, de dégager le cadre réel dans lequel ils se situent.
A la racine de la situation internationale actuelle se trouve l'effondrement irréversible des bases matérielles de l'ensemble de la société, la crise mondiale insurmontable de l'économie capitaliste. La bourgeoisie a eu beau saluer ces deux dernières années comme celles de la "reprise" et même de la "sortie de la crise", elle a bien pu s'extasier sur les taux de croissance "d'un niveau inconnu depuis les années 60", elle ne peut rien contre des faits qui restent toujours aussi têtus : les "performances" récentes de l'économie mondiale (en fait de l'économie des pays les plus avancés) ont été payées par une nouvelle fuite en avant dans l'endettement généralisé qui augure de futures convulsions encore plus dramatiques et brutales que les précédentes ([1] [1603]). Et, déjà, le retour d'une inflation galopante dans la plupart des pays et notamment dans la Grande Bretagne de Madame Thatcher, modèle de "vertu économique" commence à semer l'inquiétude... Toutes les déclarations euphoriques de la bourgeoisie n'auront pas plus d'effet que les incantations des hommes préhistoriques pour faire pleuvoir : le capitalisme est dans une impasse. Depuis qu'il est entré dans sa période de décadence au début du siècle, la seule perspective qu'il sache offrir à l'humanité, dans une telle situation de crise ouverte, est celle d'une fuite en avant dans la guerre dont l'aboutissement est la guerre impérialiste généralisée.
LIBAN ET IRAN : LA GUERRE HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN...
C'est bien ce que viennent confirmer les derniers événements du Liban. Ce pays, qui autrefois était appelé la "Suisse du Moyen Orient", n'a pas connu de répit depuis plus de 15 ans. Sa capitale, qui a bénéficié de la sollicitude de nombreux "libérateurs" et "protecteurs" (Syriens, Israéliens, Américains, Français, Anglais, Italiens...) est en passe d'être rayée de la carte. Véritable Carthage des temps modernes, elle fait l'objet aujourd'hui d'une destruction systématique, méticuleuse, qui, au moyen de centaines de milliers d'obus par semaine, la transforme en un champ de ruines et condamne ses habitants rescapés à vivre comme des rats. Contrairement au passé, ce ne sont plus à l'heure actuelle les deux grandes puissances qui 's'y affrontent : l'URSS qui, pendant un temps, s'était trouvée derrière la Syrie, a dû ravaler ses ambitions face au déploiement de force du bloc occidental de 1982. Cependant, dans le monde actuel, les antagonismes entre les deux blocs impérialistes, s'ils déterminent, en dernière instance, la physionomie générale des affrontements guerriers, ne sont pas les seuls à occuper le terrain militaire. Avec l'aggravation catastrophique de la crise capitaliste, les revendications particulières des petites puissances tendent à s'exacerber, surtout lorsqu'elles constatent qu'elles sont les victimes d'un marché de dupes, comme c'est le cas de la Syrie aujourd'hui. Après 83, ce pays avait échangé, avec le bloc américain, son retrait de l'alliance avec l'URSS contre une partie du Liban. Il s'était même converti en "gendarme" de sa zone d'occupation contre l'OLP et les groupuscules pro-iraniens. Mais en 88, estimant qu'il n'avait plus à craindre le retour dans la région d'un bloc russe de plus en plus pris à la gorge, le bloc américain a décidé qu'il n'avait plus besoin de respecter les clauses du marché. En téléguidant l'offensive du général chrétien Aoun, il a entrepris de faire revenir la Syrie à l'intérieur de ses frontières, ou au moins de réduire ses prétentions, afin de confier le contrôle du Liban à des alliés plus fiables, les milices chrétiennes et Israël, tout en mettant au pas les milices musulmanes. Le résultat en est ce massacre dont les populations civiles des deux côtés sont les premières victimes. Et dans cette affaire, on assiste une nouvelle fois à un judicieux partage des tâches entre les différents pays du bloc occidental : les Etats-Unis feignant de ne pas prendre parti entre les deux camps belligérants afin de ramasser la mise quand la situation sera mûre, alors que la France s'implique directement sur le terrain en envoyant un porte-avions et 6 autres navires de guerre dont personne n'arrive à croire, même en faisant beaucoup d'efforts, qu'ils sont investis d'une "mission humanitaire , comme le raconte Mitterrand. Au Liban, comme partout ailleurs, les croisades sur les "droits de l'homme" et la "liberté" ne sont que le cache-sexe des calculs impérialistes les plus sordides.
Le Liban constitue à l'heure actuelle un concentré de la barbarie dont est capable le capitalisme moribond. Il fait la preuve que toutes les paroles de paix qui ont été prononcées depuis un an ne sont que... des paroles. Même si un certain nombre de conflits ont été mis en sourdine ces derniers temps, il n'existe pour le monde aucune perspective de paix réelle. Bien au contraire.
C'est de cette façon que nous devons comprendre l'évolution récente de la situation en Iran. La nouvelle orientation du gouvernement de ce pays, qui désormais est prêt à coopérer avec le "Grand Satan" américain, n'a pas pour cause fondamentale la disparition de Khomeiny. Elle résulte essentiellement de la formidable pression que ce même "Grand Satan" a exercée pendant des années, en compagnie de la totalité de ses alliés les plus proches, pour remettre au pas ce pays après qu'il ait tenté de se soustraire au contrôle du bloc américain. Il y a deux ans à peine, celui-ci, en envoyant dans le Golfe persique la plus formidable armada qu'on ai vue depuis la seconde guerre mondiale, tout en intensifiant son soutien à l'Irak en guerre avec l'Iran depuis 8 ans, avait clairement signifié à ce dernier que "les choses avaient assez duré". Le résultat ne s'était pas fait attendre bien longtemps : l'an dernier, l'Iran acceptait de signer un armistice avec l'Irak et d'entamer des négociations de paix avec ce pays. C'était un premier succès de l'offensive du bloc occidental, mais jugé encore insuffisant par ce dernier. Il fallait en plus que la direction du pays passe aux mains de forces politiques capables de comprendre où se trouvait son "véritable intérêt" et de museler les cliques religieuses fanatiques et complètement archaïques qui l'avaient conduit dans cette situation. Les déclarations "Rushdicides" de l'hiver dernier traduisaient une dernière tentative de ces cliques, regroupées autour de Khomeiny, pour reprendre le contrôle d'une situation qui tendait à leur échapper, mais la mort du descendant du Prophète a sonné le glas de leurs ambitions. En fait, celui-ci constituait, par l'autorité qu'il conservait encore, le dernier verrou bloquant l'évolution de la situation, comme le cas s'était déjà présenté en Espagne, au début des années 70, où la survie de Franco était le dernier obstacle à un processus de "démocratisation" ardemment souhaité par la bourgeoisie nationale et par celle du bloc américain. La rapidité avec laquelle évolue aujourd'hui la situation politique en Iran, où le nouveau président Rafsandjani s'est entouré d'un gouvernement de "techniciens" excluant tous les anciens "politiques" (à part lui), fait la preuve que la situation était "mûre" depuis longtemps, que les forces sérieuses de la bourgeoisie nationale étaient pressées d'en finir avec un régime dont le bilan se solde par la ruine totale de l'économie. Cette bourgeoisie risque vite de déchanter : au milieu de la catastrophe actuelle de l'économie mondiale, il n'y a aucune place pour le "rétablissement" d'un pays sous-développé, et de plus détruit et saigné par huit ans de guerre. En revanche, pour les grandes puissances du bloc occidental, le bilan est nettement plus positif : ce bloc a réussi à faire un nouveau pas dans le développement de sa stratégie d'encerclement de l'URSS, un pas qui vient s'ajouter à celui qu'il avait accompli en obtenant le retrait d'Afghanistan des troupes de ce pays. Cependant, la "Pax Americana" qui est en passe de se rétablir, au prix d'incroyables massacres, dans cette partie du monde n'augure nullement une "pacification" définitive. En refermant de plus en plus son étau sur l'URSS, le bloc occidental ne fait que reporter à un niveau supérieur les antagonismes insurmontables entre les deux blocs impérialistes.
Par ailleurs, les différents conflits du Moyen-Orient ont mis en relief une des caractéristiques générales de la période actuelle : la décomposition avancée, le véritable pourrissement sur pieds qui affecte aujourd'hui la société bourgeoise du fait de la perpétuation et de l'aggravation continuelle de la crise depuis plus de vingt ans. Plus encore que l'Iran, le Liban témoigne de ce phénomène, avec la loi de ses bandes armées rivales, avec l'éternisation d'une guerre qui n'a jamais été déclarée, avec les attentats terroristes quotidiens et avec ses "preneurs d'otages". Les guerres entre factions de la bourgeoisie n'ont jamais été des jeux de fillettes, mais cette classe s'était par le passé donné des règles pour "organiser" ses déchirements et ses massacres. Aujourd'hui, preuve de cette décomposition de l'ensemble de la société, même ces règles sont quotidiennement bafouées.
Mais la barbarie et la décomposition sociales actuelles ne se limitent pas aux guerres et aux moyens qu'elles emploient aujourd'hui. C'est dans ce cadre qu'il faut également comprendre les événements du printemps en Chine et ceux de l'été en Pologne.
CHINE ET POLOGNE : LES CONVULSIONS DES REGIMES STALINIENS
Ces deux séries d'événements, en apparence diamétralement opposés, révèlent une même situation de crise profonde, un même phénomène de décomposition qui affecte les régimes dits "communistes".
En Chine, la terreur qui s'est abattue sur le pays parle d'elle-même. Les massacres de juin, les arrestations en masse, les exécutions en série, la délation et l'intimidation quotidiennes rendent compte, non pas d'une quelconque force du régime, mais de son extrême fragilité, des convulsions qui menacent de le disloquer. De cette faiblesse nous avions eu une illustration flagrante lors de la venue de Gorbatchev à Pékin, le 15 mai, lorsque les manifestations étudiantes avaient, fait incroyable, contraint les autorités à chambouler complètement le programme de la visite de l'inventeur de la "Perestroïka". En fait, les déchirements au sein de l'appareil du parti, entre la clique des "conservateurs" et celle des "réformateurs" qui a utilisé les étudiants comme masse de manoeuvre, ne relevaient pas uniquement de la lutte pour la succession de Deng Xiaoping. Ils révélaient aussi, et fondamentalement, le niveau de la crise politique qui secoue cet appareil.
Les convulsions de ce type ne sont pas nouvelles dans ce pays. Par exemple, la prétendue "Révolution culturelle" avait correspondu à une période de troubles et d'affrontements sanglants. Cependant, durant une dizaine d'années, après l'élimination de la "bande des quatre" et sous la direction de Deng Xiaoping, la situation a donné l'impression de s'être quelque peu stabilisée. En particulier, l'ouverture vers l'Occident et la "libéralisation" de l'économie chinoise avaient permis une petite modernisation de certains secteurs créant l’illusion d'un développement enfin "pacifique" de la Chine. Les convulsions qui ont secoué ce pays au printemps dernier sont venues mettre un terme à ces illusions. Derrière la façade de la "stabilité", les conflits s'étaient en réalité aiguisés au sein du parti entre les "conservateurs" qui estimaient qu'il y avait déjà trop de "libéralisation" et les réformateurs" qui considéraient qu'il fallait poursuivre le mouvement sur le plan économique et même l'élargir, éventuellement, au plan politique. Les deux derniers secrétaires généraux du parti, Hu Yaobang et Zhao Zyiang, étaient partisans de cette deuxième ligne. Le premier a été chassé de son poste en 86 après le lâchage de Deng Xiaoping, qui pourtant l'avait sacré. Le second, qui était le principal instigateur des manifestations étudiantes du printemps, sur lesquelles il comptait pour imposer sa ligne et sa clique, a connu le même sort après la terrible répression de juin. C'en était fini du mythe de la "démocratisation de la Chine" sous l'égide du nouveau "timonier" Deng. Ce fut d'ailleurs l'occasion, pour certains "spécialistes", de rappeler qu'en réalité, toute la carrière de cet individu s'était faite comme organisateur de la répression et en utilisant la plus grande brutalité contre ses adversaires. Ce qu'il est nécessaire de préciser, c'est que tous les dirigeants chinois ont fait ce type de carrière. La force brute, la terreur, la répression, les massacres, constituent la méthode de gouvernement presque exclusive d'un régime qui, sans de tels moyens, s'effondrerait au milieu de ses contradictions. Et lorsque, de temps en temps, un ancien boucher, un tortionnaire recyclé, embouche les trompettes de la "Démocratie", en faisant baver la petite bourgeoisie intellectuelle du pays et les bonnes âmes médiatiques du monde entier, ses fanfaronnades sont vite ravalées : soit il est assez intelligent (comme Deng Xiaoping) pour changer à temps de registre, soit il passe à la trappe.
En Chine, avec les événements du printemps et leur sinistre épilogue, c'est de façon évidente que s'est exprimée une nouvelle fois la situation de crise aiguë qui affecte le régime de ce pays. Mais ce type de situation n'est pas réservé à la Chine. Il ne résulte pas seulement de son arriération économique considérable. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Pologne démontre de façon claire que c'est l'ensemble des régimes de type stalinien qui subit aujourd'hui les rigueurs d'une telle crise.
Dans ce pays, la constitution d'un gouvernement dirigé par Solidarnosc, c'est-à-dire par une formation qui n'est ni le parti stalinien, ni même directement contrôlée par celui-ci (et qui se trouvait, il y a peu de temps encore, dans la clandestinité), ne constitue pas seulement une première historique pour les pays du glacis soviétique. Cet événement est également significatif du niveau de la crise économique et politique qui frappe ces pays. En effet, il ne s'agit pas là d'une décision prévue et pré-paiée délibérément par la bourgeoisie afin de renforcer son appareil politique, mais le résultat de l'affaiblissement de celui-ci qui ne peut que contribuer à l'affaiblir encore. En fait, ces événements traduisent de la part de la bourgeoisie une perte de contrôle de la situation politique. Ils appartiennent à un processus de dérapage dont les étapes et les résultats n'ont été voulus par aucun des partenaires de la "table ronde" du début 89. En particulier, ni l'ensemble de la bourgeoisie, ni aucune de ses forces en particulier, n'a pu maîtriser le jeu électoral et "semi-démocratique" élaboré au cours de ces négociations. Déjà, au lendemain des élections de juin, il est apparu clairement que leur résultat, la défaite cuisante du parti stalinien et le "triomphe" de Solidarnosc, embarrassait autant le second que le premier. Aujourd'hui, la situation qui s'est instaurée rend bien compte de la gravité réelle de la crise et présage clairement des futures convulsions.
En effet, nous avons à l'heure actuelle en Pologne un gouvernement dirigé par un membre de Solidarnosc, dont les postes clés (surtout pour un régime dont le contrôle sur la société repose essentiellement sur la force) de l'Intérieur et de la Défense sont entre les mains de deux membres du POUP (en fait les précédents titulaires), c'est-à-dire le parti qui, il y a encore quelques mois, maintenait Solidarnosc dans l'illégalité et qui avait fait emprisonner ses dirigeants il y a quelques années. Même si tout ce beau monde témoigne d'une même et indéfectible solidarité anti-ouvrière (sur ce point on peut lui faire confiance), la "cohabitation" entre les représentants de ces deux formations dont les programmes politiques et économiques sont antinomiques, risque d'être tout sauf harmonieuse. Concrètement, les mesures économiques décidées par une équipe qui ne jure que par le "libéralisme" et "l'économie de marché" ont toutes les chances de rencontrer une résistance décidée de la part d'un parti dont le programme et la raison d'être même ne peuvent s'accommoder d'une telle perspective. Et cette résistance, ce n'est pas seulement au sein du gouvernement qu'elle va se manifester. Elle proviendra principalement de tout l'appareil du parti, de ces centaines de milliers de fonctionnaires de la "Nomenklatura" dont le pouvoir, les privilèges et les prébendes sont liés à la "gestion" (si toutefois ce terme a encore un sens quand on voit la désorganisation actuelle) administrative de 1’économie. En Pologne, comme dans la plupart des autres pays de l'Est, on a pu déjà constater, en de multiples circonstances, la difficulté d application de ce type de réformes, alors qu'elles étaient plus timides que celles prévues par les "experts" de Solidarnosc et qu'elles étaient décidées par la direction du parti. Aujourd'hui si on voit très bien que la gestion d'un gouvernement inspiré par ces experts signifie pour les ouvriers une nouvelle aggravation de leurs conditions d'existence, on ne voit vraiment pas, en revanche, comment elle pourrait parvenir à un autre résultat qu'une désorganisation encore plus grande de l'économie.
Mais les difficultés de ce nouveau gouvernement ne s'arrêtent pas là. Celui-ci sera confronté en permanence au gouvernement "bis", constitué autour de Jaruzelski et composé pour l'essentiel de membres du POUP. En réalité, c'est à ce dernier qu'obéira l'ensemble de l'appareil administratif et économique existant qui, lui aussi, se confond avec le POUP. Ainsi, dès sa constitution, le gouvernement Mazowiecki, salué comme une "victoire de la Démocratie" par les campagnes médiatiques occidentales, n'a d'autre perspective que le développement d'un chaos économique et politique encore plus grand que celui qui règne à l'heure actuelle.
La création en 1980 du syndicat indépendant Solidarnosc, destinée à canaliser, dévoyer et défaire la formidable combativité ouvrière qui s'était exprimée durant l'été avait, en même temps, engendré déjà une situation de crise politique qui ne s'était résolue qu'avec le coup de force et la répression de décembre 81. La mise hors-la-loi du syndicat, une fois qu'il eût achevé son travail de sabotage, montrait que les régimes de type stalinien ne peuvent supporter sans dommages l'existence en leur sein d'un "corps étranger", d'une formation qui ne soit pas directement sous leur contrôle. La constitution aujourd'hui d'un gouvernement dirigé par ce même syndicat (le fait, unique dans l'histoire, que ce soit un syndicat qui se trouve à la tête d'un gouvernement en dit long, par lui-même, sur le degré d'aberration de la situation qui s'est créée en Pologne) ne peut donc qu'entraîner, à une échelle encore plus vaste, ce type de contradictions et de convulsions. En ce sens, la "solution" de décembre 81, l'emploi de la force, une répression féroce, n'est nullement à exclure. Le ministre de l'intérieur de l'état de guerre, Kiszczak, est d'ailleurs toujours à son poste...
Les convulsions qui secouent à l'heure actuelle la Pologne, même si elles prennent dans ce pays une forme caricaturale, ne doivent pas être considérées comme spécifiques à ce pays. En fait, c'est l'ensemble des pays à régime stalinien qui se trouve dans une impasse. La crise mondiale du capitalisme se répercute avec une brutalité toute particulière sur leur économie qui est, non seulement arriérée, mais aussi incapable de s'adapter d'une quelconque façon à l'exacerbation de la concurrence entre les capitaux. La tentative d'introduire dans cette économie des normes "classiques" de gestion capitaliste, afin d'améliorer sa compétitivité, ne réussit qu'à provoquer une pagaille plus grande encore, comme le démontre en URSS, l'échec, complet et cuisant de la "Perestroïka". Cette pagaille se développe également sur le plan politique, lorsque sont introduits des essais de "démocratisation" destinés à défouler et canaliser quelque peu l'énorme mécontentement qui existe depuis des décennies dans la population et qui va croissant. La situation en Pologne l'illustre bien, mais celle qui se développe en URSS en constitue une autre manifestation : par exemple, l'explosion actuelle des nationalismes, que le relâchement de l'emprise du pouvoir central a favorisé, constitue une menace grandissante pour ce pays. De même, c'est la cohésion de l'ensemble du bloc de l'Est qui est aujourd'hui affectée : les déclarations hystériques des partis "frères" d'Allemagne de l'Est et de Tchécoslovaquie contre les "assassins du marxisme" et les "révisionnistes' qui sévissent en Pologne et en Hongrie ne sont pas du cinéma ; elles rendent compte des clivages qui sont en train de se développer entre ces différents pays.
La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est donc nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents.
Ainsi la plupart des événements qui se sont déroulés cet été nous renvoient l'image d'un monde qui, de toutes parts, s'enfonce dans la barbarie : affrontements militaires, massacres, répressions, convulsions économiques et politiques. Cependant, dans le même moment, s'est exprimé de façon extrêmement significative la seule force qui puisse offrir un autre avenir à la société : le prolétariat. Et c'est justement en URSS qu'il s'est manifesté de façon massive.
URSS : LA CLASSE OUVRIERE AFFIRME SA LUTTE
Les luttes prolétariennes qui, à partir de la mi-juillet et durant plusieurs semaines, ont paralysé la plupart des mines du Kouzbass, du Donbass et du grand nord sibérien, mobilisant plus de 500 000 ouvriers, revêtent une importance historique considérable. De très loin, elles constituent le mouvement le plus massif du prolétariat en URSS depuis la période révolutionnaire de 1917. Mais surtout, dans la mesure même où elles ont été menées par le prolétariat qui avait subit le plus durement et profondément la terrible contre-révolution, longue de quatre décennies, qui s'était déchaînée à l'échelle mondiale à la fin des années 20, elles sont une confirmation lumineuse du cours historique actuel : la perspective ouverte par la crise aiguë du capitalisme n'est pas celle d'une nouvelle guerre mondiale mais celle des affrontements de classe.
Ces luttes n'ont pas eu l'ampleur de celles de Pologne en 1980, m même de beaucoup de celles qui se sont développées dans les pays centraux du capitalisme depuis 1968. Cependant, pour- un pays comme 1’URSS, où pendant plus d'un demi-siècle, face à des conditions de vie intenables, les ouvriers ne pouvaient, à de rares exceptions près, que se taire, la rage au ventre, elles ouvrent une nouvelle perspective pour le prolétariat de ce pays. Elles font la preuve que même dans la métropole du "socialisme réel", face à la répression mais aussi face à tous les poisons du nationalisme et des campagnes démocratiques, les ouvriers peuvent s'exprimer sur leur terrain de classe.
Elles ont aussi fait la preuve, comme ce fut déjà le cas en Pologne en 80, de ce dont est capable le prolétariat lorsque, ne sont pas présentes les forces classiques d'encadrement de ses luttes, les syndicats. L'extension rapide du mouvement d'un centre minier à l'autre avec l'envoi de délégations massives, la prise en charge collective du combat par les assemblées générales, l'organisation de meetings et de manifestations de masse dans la rue, dépassant la séparation en entreprises, l'élection de comités de grève par les assemblées et responsables devant elles, voilà les formes élémentaires de lutte que se donne spontanément la classe dès lors que le terrain n'est pas occupé, ou qu'il l'est faiblement, par les professionnels du sabotage.
Face à l'ampleur et à la dynamique du mouvement, et pour éviter son extension à d'autres secteurs, les autorités n'ont eu d'autre remède que d'accepter, sur le moment, les revendications mises en avant par les ouvriers. Il est clair cependant que la plupart de ces revendications ne seront jamais réellement satisfaites : la catastrophe économique dans laquelle s'enfonce l'URSS ne le permet absolument pas. Les seules revendications qui risquent de ne pas être remises en cause sont justement celles qui révèlent les limites du mouvement : "l'autonomie" des entreprises permettant à celles-ci de fixer le prix du charbon et de vendre sur le marché intérieur et mondial ce qui n'aura pas été prélevé par l'Etat. De la même façon que, en 1980, la constitution d'un syndicat "libre" en Pologne était un piège qui s'est rapidement refermé sur la classe ouvrière, cet "acquis", la fixation des prix du charbon par les entreprises, va très vite se transformer en un moyen de renforcer l'exploitation des mineurs et de provoquer des divisions entre eux et les autres secteurs du prolétariat qui devront payer plus cher le charbon cour se chauffer. Ainsi, les combats considérables des ouvriers des mines en URSS constituent aussi, au même titre que ceux de Pologne en 80, une illustration de la faiblesse politique du prolétariat des pays de l'Est Dans cette partie du monde, malgré tout le courage et toute la combativité qu'elle est amenée à manifester face à des attaques d'une ampleur sans précédent, la classe ouvrière est encore extrêmement vulnérable face aux mystifications bourgeoises syndicalistes, démocratiques, nationalistes et même religieuses (si on prend le cas de la Pologne). Enfermés pendant des décennies dans le silence par la terreur policière, les ouvriers de ces pays manquent cruellement d'expérience face à ces mystifications et ces pièges. De ce fait, les convulsions politiques qui régulièrement secouent ces pays, et qui les secoueront de plus en plus, sont la plupart du temps retournées contre leurs luttes, comme on a pu le voir en Pologne où l'interdiction de Solidarnosc entre 81 et 89 a servi à lui redorer un blason terni par ses nombreuses interventions comme "pompier social". C'est ainsi également que les revendications "politiques" des mineurs en URSS (démission des cadres locaux du parti, nouvelle constitution, etc.), ont pu être utilisées par la politique actuelle de Gorbatchev.
C'est pour ces raisons que les luttes qui se sont déroulées cet été en URSS constituent un appel à l'ensemble du prolétariat mondial, et particulièrement à celui des métropoles du capitalisme, là où sont concentrés ses bataillons les plus puissants et expérimentés. Ces luttes témoignent de la profondeur, de la force et de l'importance des combats actuels de la classe. En même temps, elles mettent en évidence toute la responsabilité du prolétariat de ces métropoles : seul son affrontement contre les pièges les plus sophistiqués que peut semer sur son chemin la bourgeoisie la plus forte et expérimentée du monde, seule la dénonciation par et dans la lutte de ces pièges permettra aux ouvriers des pays de l'Est de combattre victorieusement ces mêmes pièges. Les combats ouvriers qui se sont déroulés cet été aux Etats-Unis, dans la première puissance mondiale, au même moment que ceux qui secouaient la deuxième puissance, combats qui ont mobilisé plus de cent mille ouvriers dans les hôpitaux, les télécommunications et l'électricité, font la preuve que ce prolétariat des pays centraux poursuit son chemin sur cette voie. De même, la très forte combativité ouvrière qui s'est exprimée pendant plusieurs mois en Grande-Bretagne, notamment dans les transports et dans les docks, en se heurtant au sabotage syndical mis en place par la bourgeoisie la plus forte du monde sur le plan politique, constitue une autre étape de ce chemin.
FM, 7/9/89.
[1] [1604] Sur la question de la crise économique voir la résolution sur la situation internationale du 8ème congrès du CCI ainsi que sa présentation.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
Le 8eme congres international du CCI : les enjeux du congres
- 2415 reads
Le Courant Communiste International vient de tenir son 8ème congrès. Outre la présence de délégations des dix sections du CCI, des délégués du Grupo Proletario Internacionalista (GPI) du Mexique et de Communist Intemationalist (CI) d'Inde ont participé aux travaux du congrès. A travers leur participation active et enthousiaste, c'est de la périphérie du capitalisme, là où la lutte du prolétariat est la plus difficile, là où les conditions d'une activité militante communiste sont les plus défavorables, qu'est venu un souffle nouveau d'énergie et de confiance qui a animé toutes nos discussions et donné le ton au congrès. La délégation du GPI était mandatée pour poser l'adhésion des militants du groupe à notre organisation, adhésion que le congrès a discuté et accepté dès son ouverture. Nous y reviendrons plus loin. Ce congrès s'est tenu au moment où l'histoire s'accélère considérablement.
Le capitalisme conduit l'humanité à la catastrophe. Les conditions d'existence de l'immense majorité des êtres humains sont chaque jour plus dramatiques, les émeutes et les révoltes de la faim se multiplient, l'espérance de vie diminue pour des milliards d'hommes, les catastrophes de tout ordre causent des milliers de victimes, et les guerres des millions.
La situation de la classe ouvrière dans le monde, y compris dans les pays riches et développés de l'hémisphère nord, se dégrade constamment elle aussi, le chômage croît, les salaires baissent, les conditions de travail et de vie empirent. La classe ouvrière ne reste pas passive face à cela et, en essayant de résister pas à pas aux attaques économiques qui lui sont portées, elle développe ses luttes, son expérience et sa conscience. La dynamique de développement des luttes ouvrières s'est trouvée confirmée encore dernièrement par les grèves massives qui ont eu lieu cet été en Grande-Bretagne et en URSS. A 1’Ouest comme à l'Est, le prolétariat international lutte contre le capital.
Les enjeux sont clairs : le capitalisme nous mène à la chute encore plus brutale dans la catastrophe économique et dans la 3ème guerre mondiale. Seule la résistance du prolétariat, le développement de ses luttes, empêchent aujourd'hui, et peuvent empêcher demain, le déchaînement de l'holocauste généralisé et dégager pour l'humanité la perspective révolutionnaire du communisme.
Nous n'allons pas entrer ici dans les débats que nous avons menés au congrès sur la situation internationale. Nous renvoyons le lecteur à la résolution adoptée par le congrès et à sa présentation publiées dans ce numéro de la Revue Internationale. Disons simplement que le congrès devait confirmer la validité de nos orientations précédentes et leur accélération sur les trois volets de la situation internationale : crise économique, conflits inter-impérialistes, et lutte des classes. Il a permis de réaffirmer la validité et l'actualité de l'existence d'un cours historique vers des affrontements de classes : les dernières années n'ont pas vu la remise en cause de cette perspective ; le prolétariat, malgré ses faiblesses et ses difficultés, n'a pas subi de défaite majeure provoquant le renversement de ce cours historique et le cours à la guerre mondiale reste barrée pour le capitalisme. Plus précisément, le congrès devait confirmer la réalité et la continuation de la vague de luttes ouvrières qui se développe depuis 1983 au niveau international face aux mensonges et à la propagande de la bourgeoisie, face aux doutes, aux hésitations, au manque de confiance, et au scepticisme régnant actuellement parmi les groupes du milieu politique prolétarien.
Le GPI et CI se sont constitués autour, et sur nos analyses générales de la période actuelle, et en particulier, sur la reconnaissance du cours historique vers des affrontements de classes. Les interventions du délégué d'Inde et des nouveaux militants du CCI au Mexique se sont donc intégrées tout à fait dans la réaffirmation et la manifestation par l'ensemble du congrès de notre confiance dans la lutte du prolétariat, dans ses luttes actuelles. Là résidait un des enjeux du congrès. La résolution adoptée répond clairement à cet enjeu. Comme on peut le voir à sa lecture, le congrès a su aller plus loin encore dans la clarification des différentes caractéristiques de la période présente, et il a décidé d'ouvrir une discussion sur le phénomène de la décomposition sociale.
LA DEFENSE ET LE RENFORCEMENT DE L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE.
C'est dans le cadre de cette compréhension générale des enjeux historiques actuels que les organisations révolutionnaires qui sont à la fois le produit et aussi partie prenante des combats menés par le prolétariat mondial, doivent se mobiliser, se préparer et participer à la lutte historique de leur classe. Le rôle qui leur échoit est essentiel : sur la base de la compréhension la plus claire possible de la situation actuelle et de ses perspectives, il leur revient d'assumer dès aujourd'hui le combat politique d'avant-garde dans les luttes ouvrières.
Pour cela, les perspectives d'activités pour notre organisation que le congrès a dégagées, forment un tout avec l'analyse et la compréhension de la période historique actuelle. Après avoir tiré un bilan positif du travail militant accompli depuis le 7ème congrès, la résolution adoptée sur les activités réaffirme notre orientation précédente :
"Les activités du CCI pour les deux ans qui viennent doivent se mener en continuité avec les tâches entreprises depuis la reprise des combats de classe en 1983, tracées lors des deux précédents congrès de 1985 et 1987, suivant les priorités de l'intervention dans les luttes ouvrières, de la participation à leur orientation, et un engagement militant plus important, à long terme, face aux perspectives :
- de nouvelles intégrations issues de la vague actuelle de la lutte de classe, en premier lieu la constitution d'une nouvelle section territoriale, un des principaux enjeux à court terme pour le CCI ;
- d'un rôle déplus en plus important de l'organisation dans le processus des luttes ouvrières vers leur unification (...).
Les expériences les plus récentes de l'organisation ont permis en particulier de mettre en évidence plusieurs leçons qui doivent être pleinement intégrées dans les perspectives d'activités:
- la nécessité de mener le combat pour la tenue des assemblées générales ouvertes, qui se donnent dès le début l'objectif de l'élargissement de la lutte, de son extension géographique ;
- la nécessité de revendications unitaires, contre les surenchères démagogiques et les particularismes corporatistes ;
- la nécessité de ne pas être naïfs face à l'action de la bourgeoisie sur le terrain, pour pouvoir faire échec aux manoeuvres de confiscation de la lutte par les syndicats et les coordinations telles qu'elles se développent aujourd'hui ;
- la nécessité d'être au premier rang de l'intervention dans la constitution et l'action des comités de lutte (...)".
Dans la période actuelle, l'intervention dans les luttes ouvrières détermine tous les plans de l'activité d'une organisation révolutionnaire. Pour pouvoir mener à bien les tâches d'intervention, les révolutionnaires doivent pouvoir se doter d'organisations politiques centralisées solides. De tout temps, la question de 1’organisation politique et sa défense a été une question politique centrale. Les organisations communistes subissent la pression de l'idéologie bourgeoise, et aussi celle de la petite-bourgeoisie qui se manifeste par l'individualisme, le localisme, l'immédiatisme, etc., contre l'activité des organisations communistes. Cette pression devient encore plus forte sur les groupes communistes d'aujourd'hui par les effets de la décomposition sociale qui touche la société capitaliste. Comme le souligne la résolution sur les activités adoptée :
"La décomposition de la société bourgeoise, son pourrissement sur pied en l'absence d'une perspective d'issue immédiate exerce sa pression sur le prolétariat et ses organisations politiques (...)."
Cette pression accrue sur les groupes communistes rend la question de la défense de l'organisation révolutionnaire encore plus cruciale. C'est là le second volet de notre discussion au congrès sur les activités. La résolution réaffirme que, face à ce danger, "la force principale du CCI réside dans son caractère international, uni et centralisé". Dans ce sens, le congrès a engagé l'ensemble de l'organisation, des sections et des camarades à renforcer le tissu organisationnel, le travail collectif, à développer la centralisation internationale, à développer la rigueur dans le fonctionnement et l'implication militante. Il s'agit là de contrecarrer les effets particuliers d'aujourd'hui de la décomposition sur les groupes politiques révolutionnaires tels que le localisme, l'individualisme, voir les pratiques manoeuvrières et destructrices.
LA CONSTITUTION DE "REVOLUCION MUNDIAL" COMME NOUVELLE SECTION DU CCI.
Confiance dans la lutte du prolétariat, confiance dans le rôle et l'intervention des révolutionnaires, confiance dans le CCI : tels étaient les enjeux du congrès, avons-nous dit. La présence d'une délégation de CI, la demande d'intégration des camarades du Mexique, leurs interventions durant les débats, étaient l'illustration de leur propre confiance sur ces trois plans, situant les camarades dans la dynamique même du congrès. Au delà des textes, documents et résolutions adoptés, la manifestation la plus concrète de cette confiance par le congrès, fut l'adoption de la résolution d'intégration des camarades du GPI dans le CCI et la constitution d'une nouvelle section au Mexique. En voici les principaux extraits :
1- Produit du développement de la lutte de classe, le Grupo Proletario Internacionalista est un groupe communiste qui s'est constitué -avec la participation active du CCI- sur la base des positions politiques principielles du CCI et de ses orientations générales, en particulier celle de l'intervention dans la lutte des classes. (...)
2- Le 1er congrès du GPI a vu la ratification par tous ses militants (...) des positions politiques de classe développées par le groupe. En étroite relation avec le CCI, il a ouvert un processus de réappropriation et de clarification politiques, et dégagé les lignes principales pour l'établissement d'une présence politique conséquente du groupe au Mexique.
3- Un an plus tard, le 2ème congrès du GPI - ainsi que le CCI
- a tiré un bilan positif de ce processus de clarification politique. Le groupe a su en effet :
- prendre connaissance, se confronter et prendre position sur les différents courants et groupes du milieu politique prolétarien ;
- défendre les positions programmatiques, théoriques et politiques du CCI ;
- développer les mêmes orientations d intervention dans les luttes ouvrières et le milieu politique prolétarien que le CCI ;
- assumer une présence politique tant au niveau local qu'international ;
- avoir une vie politique interne vivante, intense et fructueuse.
4- C'est avec succès que le 2ème congrès du GPI a affronté et dépassé les faiblesses conseillistes du groupe qui s'étaient exprimées dans le processus de clarification politique :
- au plan théorique, par l'adoption unanime d'une position correcte sur la question de la conscience de classe et du parti ;
- au plan politique, par la demande unanime d'ouverture d'un processus d'intégration dans le CCI de ses militants que le (CCI) a accueillie favorablement.
5- Sept mois plus tard, le Sème congrès du CCI tire un bilan positif de ce processus d'intégration. C'est à l'unanimité que les camarades du GPI se sont prononcés en accord avec la Plate-forme du CCI et ses statuts après des débats approfondis. Par ailleurs, le GPI a maintenu les tâches d'une véritable section du CCI depuis l'ouverture de ce processus par une correspondance régulière et fréquente, des prises de position dans les débats du CCI, l'intervention dans la lutte de classes, la publication régulière de Revolucion Mundial
6- Le 8ème congrès du CCI (...), conscient des difficultés d'intégration pour l'organisation d'un ensemble de militants dans un pays relativement isolé, estime donc que le processus de rapprochement et d'intégration des camarades du GPI avec le CCI touche à son terme. En conséquence, le congrès se prononce pour l'intégration des militants du GPI dans l'organisation et leur constitution en section du CCI au Mexique."
Après la décision du congrès, la délégation, comme le précisait son mandat fixé par le GPI, a déclaré dissout ce dernier. A partir de ce moment, bien évidemment, les délégués sont intervenus dans le congrès comme délégués de la nouvelle section au Mexique, Revolucion Mundial, comme membres à part entière du CCI. Par le haut niveau de clarté politique qui s'est exprimé dans la préparation au congrès et dans la participation énergique et importante de sa délégation, la constitution de la section manifeste un renforcement considérable du CCI au niveau politique et au niveau de sa présence consolidée sur le continent américain.
UN RENFORCEMENT DU MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN.
Cette dynamique de clarification politique, vers l'engagement militant, de regroupement, en particulier avec le CCI, n'est pas le seul fait des camarades de RM. A l'issue du congrès, le délégué de CI, groupe avec lequel nous sommes en étroit contact depuis plusieurs années, a posé sa candidature à notre organisation, candidature que nous avons acceptée. Cette intégration et la publication de Communist Internationalist comme organe du CQ en Inde signifie la perspective d'une présence politique, d'une douzième section de notre organisation, dans un pays et sur un continent, l'Asie, où les forces révolutionnaires sont pratiquement inexistantes, et où le prolétariat, malgré une grande combativité comme en Inde justement, est peu concentré et a peu d'expérience historique et politique. A vrai dire, ce processus de rapprochement et d'intégration au CCI n'est pas propre aux pays de la périphérie. Nous constatons, et nous y participons aussi, un renouveau des contacts et une dynamique vers l'engagement militant en Europe même, là où le CCI, et les principaux groupes et courants communistes, sont déjà présents.
Soyons clairs : même si ces intégrations et cette dynamique au renforcement militant nous enthousiasment, il ne s'agit pas pour nous de faire ici du triomphalisme. Nous sommes bien trop conscients des enjeux historiques, des difficultés du prolétariat et des faiblesses des forces révolutionnaires.
Pour le CCI qui, depuis sa fondation, a toujours revendiqué et travaillé afin d'assumer les tâches d'un véritable pôle international de référence et de regroupement politiques, ces nouvelles adhésions sont un succès. Elles sont la confirmation de la justesse de ses positions politiques, valables aussi bien dans les pays développés que de la périphérie, sur tous les continents, et de l'orientation de son intervention en direction du milieu politique prolétarien. Mais aussi, et nous en sommes extrêmement conscients, elles nous posent des responsabilités accrues : d'une part, réussir complètement ces intégrations et, d'autre part, une plus grande responsabilité militante encore face au prolétariat mondial.
Le surgissement d'éléments et de groupes politiques dans les pays de la périphérie (Inde, Amérique Latine), l'apparition d'une nouvelle génération de militants, sont le produit de la période historique, le produit des luttes ouvrières d'aujourd'hui. C est d'ailleurs, nous l'avons vu, essentiellement sur la reconnaissance plus ou moins claire du cours historique vers des affrontements de classes, de la réalité de la vague de luttes actuelles que ces éléments et groupes se constituent.
La question du cours historique est la question centrale qui "sépare" les groupes du milieu politique prolétarien. Au delà des différences programmatiques existantes, c'est elle qui détermine aujourd'hui la dynamique dans laquelle se situent les différents courants et groupes : soit vers l'intervention dans les luttes, dans le milieu révolutionnaire, vers la discussion et la confrontation politiques, et, à son terme, le regroupement ; soit le scepticisme devant les luttes, le refus et la peur de l'intervention, le repli sectaire, la dispersion, le découragement et la sclérose.
La reconnaissance du développement des luttes ouvrières, et la volonté d'intervention des révolutionnaires en leur sein, est à la base de la capacité des groupes révolutionnaires à faire face aux responsabilités qui sont les leurs : dans les luttes ouvrières elles-mêmes bien sûr ; mais aussi face aux éléments et groupes qui surgissent de par le monde; face à la nécessité de développer des organisations centralisées et militantes pouvant jouer un rôle de référence et de regroupement.
Le renforcement du CCI représente, à notre avis, un renforcement de tout le milieu politique prolétarien. Ce sont les premiers regroupements, réels et significatifs, depuis une décennie, en fait depuis la constitution de la section du CCI en Suède. Ils marquent un coup d'arrêt à la multiplication des scissions, à la dispersion et à la perte de forces militantes. Pour tous les groupes politiques prolétariens, pour tous les éléments révolutionnaires qui surgissent, ce doit être un élément de confiance dans la situation actuelle et d'appel au sérieux et à la responsabilité militante.
L'HISTOIRE ACCELERE SUR TOUS LES PLANS.
Par la réaffirmation de sa confiance dans les luttes ouvrières actuelles, sa conviction dans leur développement au cours de la période qui vient, par la réaffirmation de l'orientation vers l'intervention dans ces luttes, par le renforcement encore du cadre centralisé et international du CCI en vue de sa défense, par l'intégration de nouveaux camarades et la constitution d'une nouvelle section "Revolucion Mundial" et la publication de Communist Intemationalist, nous pouvons d'ores et déjà tirer un bilan positif du 8ème congrès du CCI, véritable congrès "mondial avec la participation de camarades d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
L'histoire s'accélère.
C'est dans ce cadre historique que le congrès a réussi à se situer. Le 8ème congrès du CCI aura été à la fois un produit de cette accélération de l'histoire, et n'en doutons pas, un moment et un facteur de celle-ci.
"Dans les épreuves de l'histoire, les tâches du prolétariat moderne sont aussi gigantesques que ses erreurs. Il n'existe pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer les voies sur lesquelles il doit s'engager. Il n'a d'autre maître que l'expérience historique. Le chemin de croix de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait tirer enseignement de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l'autocritique, une autocritique impitoyable, cruelle, allant jusqu'au bout des choses, c'est l'air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre."
Rosa Luxemburg. La crise de la social-démocratie.
"Ce n'est qu'en période révolutionnaire, où les fondements sociaux et quand les murailles de la société de classes se lézardent et se disjoignent continuellement, que toute action politique de classe entamée par le prolétariat peut, en quelques heures, arracher à leur immobilité des couches de la classe ouvrière, jusque là inertes."
Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicats, 1906.
Conscience et organisation:
8ème Congrès du CCI : la situation internationale
- 2950 reads
PRESENTATION DE LA RESOLUTION
Nous publions dans ce numéro la résolution sur la situation internationale adoptée par le 8ème Congrès du CCI. Cette résolution se base sur un rapport très détaillé dont la longueur ne nous permet pas de le publier dans ce numéro de la Revue. Cependant, compte tenu du caractère synthétique de cette résolution, nous avons estimé utile de la faire précéder par des extraits, non du rapport lui-même, mais de la présentation qui en a été faite au Congrès-même, extraits que nous avons accompagnés d'un certain nombre de données prélevées dans le rapport.
Habituellement, le rapport pour un congrès tend compte de l'évolution de la situation depuis le congrès précédent. En particulier, il examine dans quelle mesure les perspectives qui avaient été dégagées deux ans auparavant se sont vérifiées. Pour sa part, le présent rapport ne se contente pas de prendre en compte les deux dernières années. Il se propose de faire un bilan pour l'ensemble des années 80, celles que nous avons appelées "les années de vérité".
Pourquoi un tel choix ?
Parce qu'au début de la décennie, nous avions annoncé que celle-ci allait représenter tout un tournant dans l'évolution de la situation internationale. Un tournant entre :
- une période où la bourgeoisie avait encore tenté de masquer à la classe ouvrière -et à elle-même- la gravité des convulsions de son système ;
- et une période où ces convulsions allaient atteindre un tel niveau, qu'elle ne pourrait plus cacher comme auparavant l'impasse où se trouve le capitalisme, une période où cette impasse s'afficherait toujours plus aux yeux de l'ensemble de la société.
Cette différence entre ces deux périodes devait évidemment se répercuter sur tous les aspects de la situation mondiale. Elle devait en particulier souligner le niveau des enjeux présents des combats de la classe ouvrière.
Pour le présent Congrès, qui est le dernier congrès des années 80, il était donc important de vérifier la validité de cette orientation générale que nous avions adoptée il y a dix ans. Il importait notamment de mettre en évidence qu'à aucun moment cette orientation n'avait été démentie, en particulier face aux doutes et fluctuations qui peuvent exister dans l'ensemble du milieu politique prolétarien et qui tendent à sous-estimer les enjeux de la période présente, et particulièrement l'importance des combats de la classe ouvrière.
Quels sont les points qu'il convient de souligner particulièrement pour ce Congrès ?
SUR LA CRISE ECONOMIQUE
Il est indispensable que le congrès parvienne à une pleine clarté sur ce sujet. En particulier, avant même de dégager les perspectives catastrophiques de l'évolution du capitalisme dans les années qui viennent, il importe de mettre en évidence toute la gravité de la crise telle qu'elle s'est déjà manifestée jusqu'à présent.
Pourquoi est-il nécessaire de faire un tel bilan ?
1°) Pour une première raison évidente : notre capacité à dégager les perspectives futures du capitalisme dépend étroitement de la validité du cadre d'analyse que nous nous sommes donné pour analyser la situation passée.
2e) Parce que, et c'est également une évidence, de l'évaluation correcte de la gravité actuelle de la crise dépend, pour une large part, notre capacité à nous prononcer sur les réels enjeux et potentialités des luttes présentes de la classe ouvrière, notamment face aux sous-estimations qui existent dans le milieu politique.
3°) Parce qu'il a pu exister, dans l'organisation, des tendances à sous-estimer la gravité réelle de l'effondrement de l'économie capitaliste en se basant de façon unilatérale sur l'évolution des indicateurs fournis habituellement par la bourgeoisie tels que le "Produit National Brut" ou le volume du marché mondial.
Une telle erreur peut être très dangereuse. Elle pourrait nous conduire à nous enfermer dans une vision similaire à celle de Vercesi ([1] [1605]), à la fin des années 30, qui prétendait que le capitalisme avait désormais surmonté sa crise. Cette vision se basait sur l'accroissement des chiffres bruts de la production sans se préoccuper DE QUOI était faite cette production (en réalité, principalement des armements) ni se demander QUI allait la payer.
C'est justement pour cette raison que le rapport, de même que la résolution, base son appréciation de l'aggravation considérable de la crise capitaliste tout au long des années 80, non pas tant sur ces chiffres (qui eux semblent indiquer une "croissance", en particulier ces dernières années) mais sur toute une série d'autres éléments qui, pris ensemble, sont beaucoup plus significatifs. Il s'agit des éléments suivants :
- l'accroissement vertigineux de l'endettement des pays sous-développés, mais aussi de la première puissance mondiale de même que des administrations publiques de tous les pays ;
- la progression continue des dépenses d'armement, mais également de l'ensemble des secteurs improductifs tels que, par exemple, le secteur bancaire, et cela au détriment des secteurs productifs (production de biens de consommation et de moyens de production) ;
- l'accélération du processus de désertification industrielle qui fait disparaître des pans entiers de l'appareil productif et jette dans le chômage des millions d'ouvriers ;
- l'énorme aggravation du chômage tout au long des années 80 et, plus généralement, le développement considérable de la lunpénisation absolue au sein de la classe ouvrière des pays es plus avancés ;
Sur ce point, il vaut la peine de faire un commentaire pour dénoncer les campagnes actuelles de la bourgeoisie sur l'idée que la situation serait en train de s'améliorer aux Etats-Unis. Les chiffres que donne le rapport soulignent le réel appauvrissement de la classe ouvrière dans ce pays. Mais il faut attirer l'attention du Congrès sur le rapport adopté par la section des USA lors de sa dernière conférence (voir Supplément au n°64 d’Internationalism). Ce dernier rapport met clairement en évidence que les chiffres bourgeois sur le prétendu recul du chômage au niveau de celui des années 70 essaient en réalité de masquer une aggravation tragique de la situation : en fait le taux réel du chômage est environ trois fois supérieur au taux officiel.
- enfin une des manifestations fondamentales de l'aggravation des convulsions de l'économie capitaliste est constituée par une nouvelle aggravation des calamités qui frappent les pays sous-développés, la malnutrition, les famines qui font toujours plus de victimes, des calamités qui ont transformé ces pays en un véritable enfer pour des milliards d'êtres humains.
En quoi faut-il considérer ces différents phénomènes comme des manifestations très significatives de l'effondrement de l'économie capitaliste ?
Pour ce qui concerne l'endettement généralisé, nous avons là une expression claire des causes profondes de la crise capitaliste : la saturation générale des marchés. Faute de réels débouchés solvables, à travers lesquels pourrait se réaliser la plus-value produite, la production est écoulée en grande partie sur des marchés fictifs.
On peut prendre trois exemples :
1°) Pendant les années 70, on a assisté à une augmentation sensible des importations des pays sous-développés. Les marchandises achetées provenaient principalement des pays avancés, ce quia permis de relancer momentanément la production dans ces pays. Mais comment étaient payés ces achats ? Par des emprunts contractés par les pays sous-développés acheteurs auprès de leurs fournisseurs (voir tableau 1). Si les pays acheteurs payaient réellement leurs dettes, alors on pourrait considérer que ces marchandises ont été réellement vendues, que la valeur qu'elles contenaient a été effectivement réalisée. Mais nous savons tous que ces dettes ne seront jamais remboursées ([2] [1606]). Cela signifie que, globalement, ces produits ont été vendus non pas contre un paiement réel, mais contre des promesses de paiement, des promesses qui ne seront jamais tenues. Nous disons globalement, parce que, pour leur part, les capitalistes qui ont effectué ces ventes peuvent avoir été payés. Mais cela ne change pas le fond du problème. Ce que ces capitalistes ont encaissé avait été avancé par des banques ou des Etats qui, eux, ne seront jamais remboursés. C'est bien là que réside la signification profonde de toutes les négociations actuelles (désignées par le terme de "plan Brady") visant à réduire de façon significative l'endettement d'un certain nombre de pays sous-développés, à commencer par le Mexique (pour éviter que ces pays ne se déclarent ouvertement en faillite et cessent tout remboursement). Ce "moratoire" sur une partie des dettes veut dire qu'il est officiellement prévu, dès à présent, que les banques ou les pays prêteurs ne récupéreront pas la totalité de leur mise.
2°) Un autre exemple est celui de l'explosion de la dette extérieure des Etats-Unis. En 1985, pour la première fois depuis 1914, ce pays est devenu débiteur vis à vis du reste du monde. C'était un événement considérable, d'une importance au moins équivalente au premier déficit commercial de ce pays depuis la première guerre mondiale en 1968 et, en 1971, à la première dévaluation du dollar depuis 1934. Le fait que la première puissance économique de la planète, après avoir été pendant des décennies le financier du monde, se retrouve dans un situation digne d'un quelconque pays sous-développé ou d'une puissance de second ordre, comme par exemple la France, en dit long sur l'état de dégradation de l'ensemble de l'économie mondiale et traduit un degré supplémentaire dans l'effondrement de celle-ci.
Fin 1987, la dette extérieure nette (total des dettes moins total des créances) des Etats-Unis se montait déjà à 368 milliards de dollars (soit 8,1% du PNB). Le champion du monde de la dette extérieure n'était donc plus le Brésil : l'Oncle Sam faisait déjà trois fois mieux. Et la situation n'est pas près de s'arranger dans la mesure où le principal responsable de cet endettement, le déficit de la balance commerciale se maintient à des niveaux considérables. D'ailleurs, même si ce déficit se résorbait miraculeusement, la dette extérieure américaine ne cesserait de s'accroître dans la mesure où, comme un quelconque pays d'Amérique latine, les Etats-Unis devraient continuer à emprunter pour être en mesure de verser les intérêts et rembourser le principal de leur dette. De plus, le solde du revenu des investissements américains à l'étranger et des investissements étrangers aux Etats Unis, qui était encore positif de 20,4 milliards de dollars en 1987, ce qui limitait les conséquences financières du déficit de la balance commerciale, est devenu négatif en 1988 et poursuivra son effondrement dans les années suivantes (voir le tableau 2).
Sur la base de ces projections, la dette extérieure des Etats-Unis est donc destinée à s'accroître de façon très importante dans l'avenir : elle devrait atteindre 1000 milliards de dollars en 1992 et 1400 milliards de dollars en 1997. Ainsi, au même titre que la dette des pays sous-développés, la dette américaine n'a pas la moindre perspective de remboursement.
3°) Le dernier exemple est celui des déficits budgétaires, de l'accumulation des dettes de tous les Etats à un niveau astronomique (voir les tableaux 3 et 4). Nous avons déjà mis en évidence, lors des précédents congrès, que ce sont en grande partie ces déficits, et particulièrement le déficit fédéral des Etals-Unis, qui ont permis une relance timide de la production à partir de 83. C'est de nouveau le même problème. Ces dettes, elles non plus, ne seront jamais remboursées, sinon contre de nouvelles dettes encore plus astronomiques (le tableau 3 met ainsi en évidence que le simple intérêt de ces dettes dépasse déjà largement les 10% des dépenses de l'Etat dans la plupart des pays avancés : ce poste est en passe de devenir le premier dans les budgets nationaux). Et la production achetée par ces déficits, principalement des armements d'ailleurs, ne sera, elle non plus, jamais réellement payée.
En fin de compte, pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est donc pas une production de valeur, c'est-à-dire la seule chose qui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital global s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites. Pris comme un tout, le capitalisme ne s est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri.
Et le capitalisme s'est appauvri d'autant plus qu'on a vu s'accroître à des niveaux ahurissants la production d'armements, de même d'ailleurs que l'ensemble des dépenses improductives (voir tableau 5).
Les armes ne doivent pas être comptabilisées avec un signe "plus" dans le bilan général de la production mondiale, mais au contraire avec un signe "moins". Car contrairement à ce que Rosa Luxemburg avait pu écrire en 1912, dans "L'accumulation du capital", et à ce qu'affirmait Vercesi à la fin des années 30, le militarisme n'est nullement un champ d'accumulation pour le capital. Les armes peuvent enrichir les marchands de canons mais nullement le capitalisme comme un tout puisqu’elles ne peuvent pas s'incorporer dans un nouveau cycle de production. Au mieux, quand elles ne servent pas, elles constituent une stérilisation de capital. Et quand elles servent, elles aboutissent à une destruction de capital.
Ainsi, pour se faire une idée véritable de l'évolution de l'économie mondiale, pour rendre compte de la valeur réellement produite, il faudrait retrancher des chiffres officiels sensés représenter la production (indicateurs du PNB par exemple) les chiffres de l'endettement de la période considérée, de même que les chiffres correspondant aux dépenses d'armement et à l'ensemble des dépenses improductives. Pour ce qui concerne les Etats-Unis, par exemple, sur la période 1980-87, le seul accroissement de l'endettement de l'Etat est plus élevé que la croissance du PNB : 2,7% du PNB pour l'accroissement de l'endettement contre 2,4% de croissance du PNB en moyenne annuelle. Ainsi, pour la décennie qui s'achève, la seule prise en compte des déficits budgétaires nous indique déjà une régression de la première économie mondiale. Régression qui est bien plus importante dans la réalité, du fait :
l°) des autres endettements (extérieur, entreprises, particuliers, administrations locales, etc.) ;
2°) des énormes dépenses improductives.
En fin de compte, même si nous ne disposons pas des chiffres exacts permettant de calculer au niveau mondial le réel déclin de la production capitaliste, on peut conclure du simple exemple précédent, la réalité de cet appauvrissement global de la société que nous évoquions.
Un appauvrissement considérable au cours des années 80.
C'est uniquement dans ce cadre - et non pas en faisant de la stagnation ou du recul du PNB la manifestation par excellence de la crise capitaliste - que Ton peut comprendre la signification réelle des "taux de croissance exceptionnels" dont s'est félicitée la bourgeoisie ces deux dernières années. En réalité, si l'on retranchait de ces formidables "taux de croissance" affichés par la bourgeoisie tout ce qui est stérilisation de capital et endettement nous aurions une croissance nettement négative. Face à un marché mondial de plus en plus saturé, une progression des chiffres de la production ne peut correspondre qu'à une nouvelle progression des dettes. Une progression encore plus considérable que les précédentes. ,
C'est donc en constatant la réalité d'un réel appauvrissement de l'ensemble de la société capitaliste, une destruction réelle de capital tout au long des années 80, que l'on peut comprendre les autres phénomènes qui sont analysés dans le rapport.
Ainsi la désertification industrielle constitue une illustration flagrante de cette destruction de capital. Le tableau 6 nous donne une idée chiffrée de ce phénomène qui, de façon concrète, se traduit par le dynamitage ou la mise à la casse d'usines à peine construites, par les paysages de désolation, de terrains vagues sordides et de ruines, dans lesquels se sont transformées certaines zones industrielles, et surtout par les licenciements massifs d'ouvriers. Par exemple, ce tableau nous indique qu'aux Etats-Unis, entre 1980 et 1986, les effectifs ont diminué de 1,35 millions dans l'industrie alors qu'ils augmentaient de 3,71 millions dans le secteur du commerce-hôtels-restaurants et de 3,99 millions dans le secteur finances-assurances-affaires. La prétendue "diminution du chômage", dont la bourgeoisie de ce pays fait aujourd'hui ses choux gras, n'a nullement permis une amélioration des capacités productives réelles de l'économie américaine : en quoi la "reconversion" d'un ouvrier qualifié de la métallurgie en vendeur de "hot dogs" est-elle positive pour l'économie capitaliste, sans parler du travailleur lui-même ?
De même, la progression du chômage réel, la paupérisation absolue de la classe ouvrière et la plongée des pays sous-développés dans le dénuement le plus total (dont l'article de la Revue Internationale n°57, "Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme", nous donne un tableau impressionnant) sont les manifestations de cet appauvrissement global du capitalisme, de l'impasse historique de ce système ([3] [1607]), un appauvrissement que la classe dominante fait payer aux exploités et aux masses misérables.
C'est pour cela que la prétendue "croissance" dont se vante la bourgeoisie depuis 83 a été accompagnée d'attaques sans précédent contre la classe ouvrière. Ces attaques ne sont évidemment pas l'expression d'une "méchanceté" délibérée de la bourgeoisie, mais bien la manifestation de l'effondrement considérable qu'a connu l'économie capitaliste au cours de ces années. Un effondrement dont les tricheries bourgeoises avec les lois du capitalisme, le renforcement des politiques de capitalisme d'Etat à l'échelle des blocs, la fuite en avant dans l'endettement, ont permis qu'il n'apparaisse de façon trop évidente sous la forme d'une récession ouverte.
Une remarque sur cette question de la "récession". Dans un souci de plus grande clarté, la résolution désigne par "récession ouverte" le phénomène de stagnation ou de recul des indicateurs capitalistes eux-mêmes qui mettent ouvertement en évidence la réalité de ce que la bourgeoisie essaye de cacher, et de se cacher : l'effondrement de la production de valeurs. Cet effondrement, pour sa part, et comme l'établit le rapport, se poursuit même dans les moments qualifiés de "reprise" par la bourgeoisie. C'est ce dernier phénomène que la résolution désigne par le terme de "récession".
En conclusion de cette partie sur la crise économique, il faut souligner une nouvelle fois très clairement l'aggravation considérable de la crise du capitalisme, et des attaques contre la classe ouvrière, tout au long des années 80, confirmant sans aucune ambiguïté la validité de la perspective que nous avions tracée il y a dix ans. De même, il faut souligner que cette situation ne pourra que s'aggraver à une échelle encore bien plus considérable dans la période qui vient, du fait de l'impasse totale dans laquelle se trouve le capitalisme aujourd'hui.
SUR LES CONFLITS IMPERIALISTES
Sur cette question, qui n'a pas soulevé de débats importants, la présentation sera très brève et va se résumer à la réaffirmation lapidaire de quelques idées de base :
1°) C'est uniquement en s'appuyant fermement sur le cadre du marxisme que l'on peut comprendre l'évolution réelle des conflits impérialistes : au delà de toutes les campagnes idéologiques, l'aggravation de la crise du capitalisme ne peut conduire qu'à une intensification des antagonismes réels entre les blocs impérialistes.
2°) Manifestation de cette intensification, l'offensive du bloc US, par les succès qu'elle a remportés, permet d'expliquer l'évolution récente de la diplomatie de l'URSS et le désengagement de cette puissance d'un certain nombre de positions qu'elle ne pouvait plus tenir.
3°) Cette évolution diplomatique ne signifie donc nullement que s'ouvre une période d'atténuation des antagonismes entre grandes puissances, bien au contraire, ni que soient éteints, à l'heure actuelle, les conflits qui ont ravagé de nombreux points de la planète ces dernières années. En de nombreux endroits la guerre et les massacres se poursuivent et peuvent s'intensifier d'un jour à l'autre, semant toujours plus de cadavres et de calamités.
4°) Dans les campagnes pacifistes actuelles, un des éléments déterminants est la nécessité pour l'ensemble de la bourgeoisie de masquer à la classe ouvrière les véritables enjeux de la période présente à un moment où se développent ses luttes.
L'EVOLUTION DE LA LUTTE DE CLASSE
Ce que se propose de faire essentiellement la présentation, c'est d'expliciter le bilan global de la lutte de classe au cours des années 80.
Pour donner les grandes lignes d'un tel bilan, pour rendre compte du chemin parcouru, il est nécessaire de voir brièvement où en était le prolétariat au début de la décennie.
Le début des années 80 est marqué par le contraste entre, d'une part, l'affaiblissement de la lutte du prolétariat des grandes concentrations ouvrières des pays avancés du bloc de l'Ouest, en particulier d'Europe occidentale, faisant suite aux grands combats de la seconde vague de luttes en 1978-79 et, d'autre part, les formidables affrontements de Pologne de l'été 80, qui constituent le point culminant de cette vague. Cet affaiblissement de la lutte des bataillons décisifs du prolétariat mondial est dû en grande partie à la politique de la gauche dans l'opposition mise en place par la bourgeoisie dès le début de cette deuxième vague de luttes. Cette nouvelle carte bourgeoise a surpris la classe ouvrière et a, en quelque sorte, brisé son élan. C est pour cela que les combats de Pologne se déroulent dans un contexte général défavorable, dans une situation d'isolement international. C'est une situation qui évidemment facilite d'autant leur dévoiement sur les terrains du syndicalisme, des mystifications démocratiques et nationalistes ; qui facilite par conséquent la brutale répression de décembre 81. En retour, la défaite cruelle subie par le prolétariat en Pologne ne peut qu'aggraver pour un temps la démoralisation, la démobilisation et le désarroi du prolétariat des autres pays. Elle permet en particulier de redorer de façon très sensible le blason du syndicalisme à l'Est et à l'Ouest. C'est pour cela que nous avons parlé de défaite et de recul de la classe ouvrière," non seulement sur le plan de sa combativité, mais aussi sur le plan idéologique.
Cependant, ce recul est de courte durée. Dès l'automne 83, se développe une 3ème vague de luttes, une vague particulièrement puissante qui met en évidence la combativité intacte du prolétariat, et qui se distingue par le caractère massif et simultané des luttes.
Face à cette vague de luttes ouvrières, la bourgeoisie déploie en beaucoup d'endroits une stratégie de dispersion des attaques destinée à émietter les luttes, stratégie accompagnée d'une politique d'immobilisation menée par les syndicats là où ils sont les plus déconsidérés. Mais dès le printemps 86, les combats généralisés du secteur public, en Belgique, de même que la grève des chemins de fer de décembre en France, mettent en évidence les limites d'une telle stratégie du fait même de l'aggravation considérable de la situation économique qui contraint la bourgeoisie à mener des attaques de plus en plus frontales. La question essentielle que posent désormais, et pour toute une période historique, ces expériences de la classe et le caractère même des attaques capitalistes, est celle de l'unification des luttes. C'est-à-dire une forme de mobilisation qui ne se contente pas de la simple extension mais où la classe prendra en main directement celle-ci à travers ses assemblées générales en vue de constituer un front uni face à la bourgeoisie. ([4] [1608])
Face à ces nécessités et potentialités de la lutte, il est évident que la bourgeoisie ne reste pas inactive. Elle déploie d'une manière encore plus systématique qu'auparavant les armes classiques de la gauche dans l'opposition :
- la radicalisation des syndicats classiques,
- la mise en avant du syndicalisme de base,
- la politique consistant pour ces organes à prendre les devants afin de mouiller la poudre.
Mais de plus, elle utilise, notamment là où le syndicalisme est le plus déconsidéré, des armes nouvelles telles les coordinations, qui complètent où précèdent le travail du syndicalisme. Enfin, elle utilise en de nombreux pays le poison du corporatisme visant notamment à enfermer les ouvriers dans un faux choix entre "l'élargissement avec les syndicats" et le repliement "auto-organisé" sur le métier.
Cet ensemble de manoeuvres a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats. Cela ne veut pas dire que soit remise en cause la dynamique des luttes ouvrières dans la mesure même où la radicalisation des manoeuvres bourgeoises est, au même titre que toutes les campagnes médiatiques actuelles, pacifistes et autres, un signe du développement des potentialités vers de nouveaux combats de bien plus grande envergure et beaucoup plus conscients.
En ce sens, le bilan global qu'il faut tirer des années 80 est celui, non pas d'une quelconque stagnation de la lutte de classe, mais bien d'une avancée décisive. Cette avancée, elle s'exprime notamment dans le contraste existant entre le début des années 80, qui voit un renforcement momentané du syndicalisme, et la fin de cette période où, comme le disent les camarades de WR, "la bourgeoisie manoeuvre pour imposer des structures "anti-syndicales" dans les luttes de la classe ouvrière".
Le rapport, par ailleurs, explicite le cadre historique dans lequel se développe aujourd'hui la lutte du prolétariat, cadre qui explique le rythme lent de ce développement, de même que les difficultés sur lesquelles s'appuie systématiquement la bourgeoisie pour développer ses manoeuvres. Plusieurs des éléments qui sont avancés avaient déjà été évoqués par le passé (rythme lent -qui aujourd'hui, évidemment, tend à s'accélérer- de la crise elle-même, poids de la rupture organique et inexpérience des nouvelles générations ouvrières). Mais le rapport fait un point particulier sur la question de la décomposition de la société capitaliste, lequel a suscité de nombreux débats dans l'organisation.
L'évocation de cette question était indispensable à plusieurs titres :
1°) D'une part, ce n'est que récemment que cette question a été clairement mise en évidence et explicitée par le CCI (bien que nous l'ayons déjà identifiée lors des attentats terroristes de Paris à l'automne 86).
2°) Il importait d'examiner dans quelle mesure un phénomène qui affecte les organisations révolutionnaires (et qui est particulièrement souligné dans le rapport d'activités) pèse également sur la classe dont ces organisations constituent l'avant garde.
La présentation ne reviendra pas sur ce qui est dit dans le rapport. Nous nous bornerons à mettre en avant les points suivants :
1°) Depuis déjà longtemps, le CCI a mis en évidence le fait que les conditions objectives dans lesquelles se développent aujourd'hui les luttes ouvrières (l'enfoncement du capitalisme dans sa crise économique qui touche simultanément tous les pays) sont bien plus favorables au succès de la révolution que celles qui se trouvaient à l'origine de la première vague révolutionnaire (la 1ère guerre impérialiste).
2°) De même, nous avons montré en quoi les conditions subjectives étaient également plus favorables dans la mesure où il n'existe pas aujourd'hui de grands partis ouvriers, comme les partis socialiste, dont la trahison au cours même de la période décisive pourrait, à l'image du passé, désarçonner le prolétariat.
3°) En même temps, nous avons également mis en évidence les difficultés spécifiques et les entraves que rencontre la vague historique actuelle des combats de classe : le poids de la rupture organique, la méfiance vis à vis du politique, le poids du conseillisme (voir en particulier la résolution sur la situation internationale adoptée par le 6ème congrès du CCI).
Il importait donc de mettre en évidence, en simple cohérence avec ce que nous disons sur les difficultés que rencontre l'organisation, que le phénomène de décomposition pèse à l'heure actuelle et pour toute une période d'un poids considérable, qu'il constitue un danger très important auquel la classe doit s'affronter pour s'en protéger et se donner les moyens de le retourner contre le capitalisme.
En prenant conscience de la gravité de cette réalité, il ne s'agit évidemment pas de dire que tous les aspects de la décomposition constituent un obstacle à la prise de conscience du prolétariat. Les éléments objectifs qui mettent clairement en évidence la barbarie totale dans laquelle s'enfonce la société constituent un facteur de dégoût pour ce système et contribuent donc à la prise de conscience du prolétariat. De même, dans la décomposition idéologique, des éléments comme la corruption de la classe bourgeoise ou l'effondrement des piliers classiques de sa domination son également des facteurs de prise de conscience de la faillite du capitalisme. En revanche, tous les éléments de la pourriture idéologique qui pèsent sur l'organisation révolutionnaire pèsent également d'un poids encore plus fort sur l'ensemble de la classe, rendant plus difficile le développement de la conscience et des combats du prolétariat.
De même ce constat ne doit être nullement une source de démoralisation ou de scepticisme.
l°) Tout au long des années 80, c'est malgré ce poids négatif de la décomposition, systématiquement exploité par la bourgeoisie, que le prolétariat a été en mesure de développer ses luttes face aux conséquences de l'aggravation de la crise, laquelle s'est confirmée une nouvelle fois comme la "meilleure alliée de la classe ouvrière" (comme nous l'avons souvent dit).
2°) Le poids de la décomposition constitue un défi qui doit être relevé par la classe ouvrière. C'est aussi dans sa lutte contre cette influence, notamment en renforçant, dans l'action collective, son unité et sa solidarité de classe, que le prolétariat forgera ses armes en vue du renversement du capitalisme.
3°) Dans ce combat contre le poids de la décomposition, les révolutionnaires ont un rôle fondamental à jouer. De la même façon que le constat de ce poids dans nos propres rangs n'est pas fait pour nous démoraliser, mais au contraire pour nous mobiliser, pour renforcer notre vigilance et notre détermination, le constat de cette difficulté que rencontre la classe ouvrière est un facteur de plus grande détermination, conviction et vigilance dans notre intervention au sein de la classe.
Pour conclure cette présentation, nous dirons donc que la discussion sur la situation internationale doit faire ressortir dans nos rangs, non seulement la plus grande clarté, mais aussi :
- la plus grande confiance dans la validité des analyses sur lesquelles s'est formé et développé le CCI, et tout particulièrement la confiance dans le développement du combat de classe vers des affrontements de plus en plus profonds et généralisés, vers une période révolutionnaire ;
- la plus grande détermination à nous montrer à la hauteur des responsabilités que le prolétariat nous a confiées.
RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
1) L'accélération de l'histoire tout au long des années 1980 a mis en relief les contradictions insurmontables du capitalisme. Les années 1980 sont des années de vérité. Vérité de l'approfondissement de la crise économique. Vérité de l'aggravation des tensions impérialistes. Vérité du développement de la lutte de classe.
Face à cette clarification de l'histoire la classe dominante n'a plus que des mensonges à offrir : "croissance", "paix" et "calme social".
LA CRISE ECONOMIQUE
2) Le niveau de vie de la classe ouvrière a subi, durant cette décennie, sa plus forte attaque depuis la guerre :
- développement massif du chômage et de l'emploi précaire ;
- attaques contre les salaires et diminution du pouvoir d'achat;
- amputation du salaire social ;
Tandis que le prolétariat des pays industriels subissait une paupérisation croissante, la majorité de la population mondiale s'est retrouvée à la merci de la famine et du rationnement.
3) La bourgeoisie, contre l'évidence subie dans leur chair par les exploités du monde entier, chante la "croissance" retrouvée de son économie. Cette "croissance" est un mythe.
Cette soi-disant "croissance" de la production a été financée par un recours effréné au crédit et à coups de déficits commerciaux et budgétaires gigantesques des USA, de manière purement artificielle. Ces crédits ne seront jamais remboursés.
Cet endettement a, pour l'essentiel, financé la production d'armement, c'est-à-dire que c'est du capital détruit. Alors que des pans entiers de 1 industrie ont été démantelés, les secteurs à forte croissance sont ceux, donc, de l'armement et de manière générale les secteurs improductif (services : publicité, banques, etc.), ou de pur gaspillage (marché de la drogue).
La classe dominante n'a pu maintenir son illusion d'activité économique que par une destruction de capital. La fausse "croissance" des capitalistes est une vraie récession.
4) Pour parvenir à ce "résultat", les gouvernements ont dû avoir recours aux mesures capitalistes d'Etat à un niveau jamais atteint jusqu'à présent : endettement record, économie de guerre, falsification des données économiques, manipulations monétaires.
Le rôle de l'Etat, contrairement à l'illusion selon laquelle les privatisations représentent un démantèlement du capitalisme d'Etat, s'est renforcé.
Imposée par les USA, la "coopération" internationale s'est développée entre les puissances occidentales participant du renforcement du bloc impérialiste.
5) De son coté, la "perestroïka" constitue la reconnaissance au sein du bloc de l'Est de la faillite de l'économie. Les méthodes capitalistes d'Etat à la russe : l'emprise totale de l'Etat sur l'économie et l'omniprésence de l'économie de guerre, ont eu pour seul résultat une anarchie bureaucratique croissante de la production et un gaspillage gigantesque de richesses. L'URSS et son bloc se sont enfoncés dans le sous-développement économique. La nouvelle politique économique de Gorbatchev n'y changera rien.
A l'Est comme à l'Ouest, la crise capitaliste s'accélère tandis que les attaques contre la classe ouvrière vont en s'intensifiant.
6) Aucune mesure de capitalisme d'Etat ne peut permettre une réelle relance de l'économie, ni même toutes utilisées en semble. Elles sont une gigantesque tricherie par rapport aux lois économiques. Elles ne sont pas un remède, mais un facteur aggravant de la maladie. Leur utilisation massive est le symptôme le plus évident de celle-ci.
En conséquence, le marché mondial a été fragilisé : fluctuation croissante des monnaies, spéculation effrénée, crise boursière, etc., sans que l'économie capitaliste sorte de la récession dans laquelle elle a plongé au début des années 1980.
Le poids de la dette s'est terriblement accru. A la fin des années 1980, les USA, la première puissance mondiale, sont devenus le pays le plus endetté du monde. L'inflation n'a jamais disparu : elle a continué de galoper aux portes des pays industrialisés, et sous la pression inflationniste de l'endettement, elle connaît aujourd'hui une accélération irréversible au coeur du capitalisme développé.
7) Avec la fin des années 1980, les politiques capitalistes d'Etat montrent leur impuissance. Malgré toutes les mesures prises, la courbe de croissance officielle descend irrésistible ment et annonce la récession ouverte à venir et l'indice des prix remonte lentement. L'inflation artificiellement masquée est prête à faire un retour en force au coeur du monde industriel.
Durant cette décennie, la classe dominante a fait une politique de fuite en avant. Cette politique, même employée de plus en plus massivement, montre ses limites. Elle sera de moins en moins efficace immédiatement et les traites sur l'avenir qui ont été tirées, devront être payées. Les années à venir seront des années de plongée encore accélérée dans la crise économique, où l'inflation va se conjuguer toujours plus avec la récession. Malgré le renforcement international du contrôle des Etats, la fragilité du marché mondial va s'accroître et les convulsions vont s'accentuer sur les marchés (financiers, monétaires, boursiers, matières premières) tandis que les faillites vont se développer dans les banques, l'industrie et le commerce.
Les attaques contre le niveau et les conditions de vie du prolétariat et de l'humanité ne pourront donc que s'accentuer à un degré dramatique.
LES TENSIONS INTER-IMPERIALISTES
8) Les années 1980 se sont ouvertes sous les auspices de la chute du régime du Shah en Iran, ayant eu pour conséquence le démantèlement du dispositif militaire occidental au sud de l'URSS, et l'invasion de l'Afghanistan par les troupes de l'Armée rouge.
Cette situation a déterminé le bloc américain, aiguillonné par la crise économique, a lancer une offensive impérialiste de grande envergure visant à consolider son bloc, mettre au pas les petits impérialismes récalcitrants (Iran, Libye, Syrie), à expulser l'influence russe de la périphérie du capitalisme et à l'étouffer dans les limites étroites de son glacis en imposant un quasi-blocus.
Cette offensive vise en dernière instance à retirer à l'URSS son statut de puissance mondiale.
9) Face à cette pression, incapable de soutenir les enchères de la course aux armements et de moderniser ses armes périmées au niveau requis par ces enchères de la course aux armements, incapable d'obtenir une quelconque adhésion de son prolétariat à son effort de guerre comme l'ont montré les événements de Pologne et l'impopularité croissante de l'aventure afghane, l'URSS a dû reculer.
La bourgeoisie russe a su mettre à profit ce recul pour lancer, sous la houlette de Gorbatchev, une offensive diplomatique et idéologique de grande envergure sur le thème de la paix et du désarmement.
Les USA, face au mécontentement croissant du prolétariat au sein de leur bloc ne pouvaient apparaître comme la seule puissance belliciste et ont entonné à leur tour la rengaine de la paix.
10) Commencées sous les diatribes guerrières de la bourgeoisie, les années 1980 se terminent sous le martèlement des campagnes idéologiques sur la paix.
La paix dans le capitalisme en crise est un mensonge. Les paroles de paix de la bourgeoisie servent à camoufler les antagonismes inter-impérialistes et les préparatifs guerriers qui vont en s'intensifiant, à cacher à la classe ouvrière les véritables enjeux historiques, guerre ou révolution, pour empêcher les ouvriers de prendre conscience du lien entre l'austérité et les préparatifs guerriers et endormir la classe dans un faux sentiment de sécurité.
Les traités sur le désarmement n'ont aucune valeur. Les armes mises au rencard ne constituent qu'une infime partie de l'arsenal de mort de chaque bloc et sont, pour l'essentiel, périmées. Et, la tricherie et le secret étant la règle, rien n est réellement vérifiable.
L'offensive occidentale se poursuit tandis que l'URSS essaie de mettre à profit la situation pour rattraper son retard technologique et moderniser son armement et pour se recréer une virginité politique mystificatrice.
La guerre continue en Afghanistan, la flotte occidentale est toujours massée dans le golfe, les armes parlent toujours au Liban, etc. Les budgets de l'armée continuent de grossir, alimentés si besoin est de manière discrète. De nouvelles armes toujours plus destructrices sont mises en chantier pour les 20 ans à venir. Non seulement rien n'a fondamentalement changé malgré tous les discours somnifères, mais encore la spirale guerrière est allée en s'accélérant.
A l'Ouest, les propositions américaines de réductions des troupes en Europe ne sont que l'expression de la pression du chef de bloc sur les puissances européennes pour qu'elles contribuent plus à l'effort de guerre global. Ce processus est déjà en cours avec la formation d'armées "communes", la proposition d'un avion de chasse européen, le renouveau des missiles Lance, le projet Euclide, etc. Derrière la fameuse Europe 1992, il y a une Europe armée jusqu'aux dents pour faire face à l'autre bloc.
Le recul présent du bloc russe est porteur des surenchères militaires de demain. La perspective est au développement des tensions impérialistes, au renforcement de la militarisation de la société et à une décomposition à la "libanaise" particulièrement dans les pays les plus touchés par les conflits inter impérialistes et les pays les moins industrialisés, comme aujourd'hui l'Afghanistan. Ce processus peut connaître, à long terme, de tels développements en Europe si le développement international de la lutte de classe n'est pas suffisant pour y faire obstacle.
11) Alors que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour imposer sa "solution" : la guerre impérialiste généralisée, et que a lutte de classe n'est pas encore suffisamment développée pour permettre la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, le capitalisme est entraîné dans une dynamique de décomposition, de pourrissement sur pied qui se manifeste sur tous les plans de son existence :
- dégradation des relations internationales entre Etats manifestée par le développement du terrorisme ;
- catastrophes technologiques et soi-disant naturelles à répétition ;
- destruction de la sphère écologique ;
- famines, épidémies, expressions de la paupérisation absolue qui se généralise ;
- explosion des "nationalités" ;
- vie de la société marquée par le développement de la criminalité, de la délinquance, des suicides, de la folie, de l'atomisation individuelle ;
- décomposition idéologique marquée entre autre par le développement du mysticisme, du nihilisme, de l'idéologie du "chacun-pour-soi", etc..
LA LUTTE DE CLASSE
12) La grève de masse en Pologne a éclairé les années 1980 et posé les enjeux de la lutte de classe pour la période. Le dévoiement de la stratégie bourgeoise de la gauche dans l'opposition en Europe occidentale, le sabotage syndical et la répression par l'armée des ouvriers en Pologne ont déterminé un recul bref mais difficile pour la classe ouvrière au début de la décennie.
La bourgeoisie occidentale a profité de cette situation pour lancer des attaques économiques redoublées (développement brutal du chômage), tout en accentuant sa répression et en menant des campagnes médiatiques sur la guerre destinées à accentuer le recul en démoralisant et terrorisant, et à habituer les ouvriers à l'idée de la guerre.
Cependant, les années 1980 ont, avant tout, été des années de développement de la lutte de classe. A partir de 1983, le prolétariat, sous la pression des mesures d austérité qui tombent en cascade, retrouve internationalement le chemin de la lutte. Face aux attaques massives la combativité du prolétariat se manifeste avec ampleur dans des grèves massives sur tous les continents, et surtout en Europe occidentale, au coeur du capitalisme, là où se trouvent concentrés les bataillons les plus expérimentés de la classe ouvrière mondiale. Ainsi des luttes ouvrières ont éclaté d'un continent à l'autre : Afrique du sud, Corée, Brésil, Mexique, etc...et, en Europe : Belgique 1983, mineurs de Grande-Bretagne 1984, Danemark 1985, Belgique 1986, cheminots en France 1986, Espagne 1987, RFA 1987, enseignants en Italie 1987, hospitaliers en France en 1988, etc.
Cette vérité de la lutte de classe n'est pas celle de la bourgeoisie. De toutes ses forces elle tente de la cacher. La chute statistique des journées de grève par rapport aux années 1970 qui a alimenté les campagnes idéologiques de démoralisation de la classe ouvrière ne rend pas compte du développement qualitatif de la lutte. Depuis 1983, les grèves courtes et massives sont de plus en plus nombreuses, et malgré le black-out sur l'information auquel elles sont soumises la réalité du développement de la combativité ouvrière s'impose peu à peu à tous.
13) La vague de lutte de classe qui se développe depuis 1983 pose la perspective de l'unification des luttes. Dans ce processus, elle se caractérise par :
- des luttes massives et souvent spontanées, liées à un mécontentement général qui touche tous les secteurs,
- une tendance à la simultanéité croissante des luttes,
- une tendance à l'extension comme seule manière d'imposer un rapport de force à la classe dominante soudée derrière son Etat,
- la croissante prise en main des luttes par les ouvriers pour réaliser cette extension contre le sabotage syndical,
- le surgissement des comités de lutte.
Cette vague de lutte traduit non seulement le mécontentement grandissant de la classe ouvrière, sa combativité intacte, sa volonté de lutter mais aussi le développement et l'approfondissement de sa conscience. Ce processus de maturation se concrétise sur tous les aspects de la situation à laquelle se confronte le prolétariat : guerre, décomposition sociale, impasse du capitalisme, etc., mais il se concrétise plus particulièrement sur deux points essentiels, puisqu'ils déterminent le rapport du prolétariat à l'Etat :
- la méfiance par rapport aux syndicats va en se développant, ce qui se traduit internationalement par des confrontations répétées avec les forces d'encadrement et par la tendance à la désyndicalisation ;
- le rejet des partis politiques de la bourgeoisie s'intensifie, comme le concrétisent par exemple les luttes continues pendant les campagnes électorales et l'abstention grandissante aux élections.
14) Loin de la minimisation des médias étatiques, les convulsions sociales sont une préoccupation centrale et permanente de la classe dominante, à l'ouest comme à l'est. Première ment, parce qu'elles interfèrent avec toutes les autres questions à un niveau immédiat, deuxièmement la lutte ouvrière porte en germe la remise en cause radicale de l'état de choses existant.
De même que la préoccupation de la classe dominante s'exprime dans les pays centraux par un développement sans précédent de la stratégie de la gauche dans l'opposition, elle se manifeste aussi :
- dans la volonté des dirigeants américains du bloc occidental de remplacer les "dictatures" caricaturales dans les pays sous leur contrôle par des "démocraties" plus adaptées à faire face à l'instabilité sociale en incluant une "gauche" capable de saboter les luttes ouvrières de l'intérieur (les leçons de l'Iran ont été tirées) ;
- dans celle de l'équipe Gorbatchev qui fait de même dans son bloc au nom de la " glastnost" (là ce sont les leçons de la Pologne).
15) Face au mécontentement de la classe ouvrière, la bourgeoisie n'a rien à offrir sinon toujours plus d'austérité et de répression. Face à la vérité des luttes ouvrières, la bourgeoisie n'a que le mensonge pour pouvoir manoeuvrer.
La crise rend la bourgeoisie intelligente. Face à la perte de crédibilité de son appareil politico-syndical d'encadrement de la classe ouvrière, elle a du utiliser celui-ci de manière plus subtile :
* d'abord, en faisant manoeuvrer sa "gauche" en étroite connivence avec l'ensemble des moyens de l'appareil d'Etat : "droite" repoussoir pour renforcer la crédibilité de la "gauche", médias aux ordres, forces de répression, etc. La politique de gauche dans l'opposition s'est renforcée dans tous les pays, malgré les vicissitudes électorales ;
* ensuite, en adaptant ses organes d'encadrement pour entraver et saboter les luttes ouvrières de l'intérieur :
- radicalisation des syndicats classiques,
- utilisation accrue des groupes gauchistes,
- développement du syndicalisme de base,
- développement de structures en dehors du syndicat, qui prétendent représenter la lutte : coordinations.
16) Cette capacité de manoeuvre de la bourgeoisie est parvenue jusqu'à présent à entraver le processus d'extension et d'unification dont est porteuse la vague présente de lutte de classe. Face à la dynamique vers des luttes massives et d'extension des mouvements, la classe dominante encourage tous les facteurs de division et d'isolement : corporatisme, régionalisme, nationalisme. Face à cette même dynamique la bourgeoisie est prête à lancer des actions préventives afin de pousser la classe ouvrière à lutter dans des conditions défavorables. Dans chaque lutte les ouvriers sont obligés de se confronter à la coalition de l'ensemble des forces de la bourgeoisie.
Cependant, malgré les difficultés qu'elle rencontre, la dynamique de lutte de la classe ouvrière n'est pas brisée. Au contraire, elle se développe. La classe ouvrière a un potentiel de combativité, non seulement intact, mais qui va en se renforçant. Sous l'aiguillon douloureux des mesures d'austérité qui ne peuvent aller qu'en s'intensifiant la classe ouvrière est poussée à la lutte et à la confrontation avec les forces de la bourgeoisie. La perspective est à un développement de la lutte de classe. C'est pourquoi les armes de la bourgeoisie, parce que celles-ci vont être utilisées de plus en plus fréquemment sont destinées à se dévoiler.
17) L'apprentissage que fait le prolétariat de la capacité manoeuvrière de la bourgeoisie est un facteur nécessaire de sa prise de conscience, de son renforcement face à l'ennemi qu'il confronte.
La dynamique de la situation le pousse à imposer sa force par l'extension réelle de ses luttes, c'est-à-dire l'extension géographique contre la division organisée par la bourgeoisie, contre l'enfermement sectoriel, corporatiste ou régionaliste, contre les propositions de fausse extension des syndicalistes et des gauchistes.
Pour mener à bien cet élargissement nécessaire de son combat, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même et, avant tout, sur ses assemblées générales. Celles-ci doivent être ouvertes à tous les ouvriers et assumer souverainement, par elles-mêmes, la conduite de la lutte, c'est-à-dire en priorité son extension géographique. De ce fait, les assemblées générales souveraines doivent rejeter tout ce qui tend à les étouffer (leur fermeture aux autres ouvriers) et à les déposséder de la lutte (les organes de centralisation prématurée que la bourgeoisie, aujourd'hui, ne se prive pas de susciter et de manipuler, ou pire ceux qu'elle parachute de l'extérieur : coordinations, comités de grève syndicaux, etc.). De cette dynamique dépend l'unification future des luttes.
Le manque d'expérience politique de la génération prolétarienne actuelle, dû à près d'un demi-siècle de contre-révolution, pèse lourdement. Elle est encore renforcée par :
- la méfiance et le rejet de tout ce qui est politique, expression de décennies d'écœurement des manoeuvres politicardes bourgeoises des partis prétendument ouvriers ;
- le poids de la décomposition idéologique environnante sur laquelle s'appuient et s'appuieront de plus en plus les manoeuvres bourgeoises visant à renforcer l'atomisation, le "chacun pour soi", et à saper la confiance croissante de la classe ouvrière en sa propre force et en l'avenir que porte son combat.
De la capacité de la classe ouvrière dans la période présente de renforcer, dans l'action collective, son unité et sa solidarité de classe, de tirer les leçons de ses luttes, de développer son expérience politique dépend sa capacité à surmonter ses faiblesses et à confronter demain l'Etat du capital pour le mettre à bas et ouvrir les portes de l'avenir.
Dans le processus vers l'unification, dans le combat politique pour l'extension contre les manoeuvres syndicales, les révolutionnaires ont un rôle d'avant-garde, déterminant et indispensable à remplir. Ils sont partie intégrante de sa lutte. De leur intervention dépend la capacité de la classe à traduire sa combativité sur le plan du mûrissement de sa conscience. De leur intervention dépend l'issue future.
18) Le prolétariat est au coeur de la situation internationale. Si les années 1980 sont des années de vérité, cette vérité c'est d'abord celle de la classe ouvrière. Vérité d'un système capitaliste qui entraîne l'humanité à sa perte, par la décomposition barbare déjà à l'oeuvre maintenant, et dont la guerre apocalyptique que la bourgeoisie prépare avec toujours plus de folie est l'aboutissement extrême.
Les années 1980 ont posé les enjeux et ses responsabilités au prolétariat : socialisme ou barbarie, guerre ou révolution ! De sa capacité à y répondre dans les années à venir, par la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, par et dans sa lutte, dépend l'avenir de l'humanité.
[1] [1609] Vercesi était le principal animateur de la Fraction de gauche du Parti communiste d'Italie. Sa contribution politique et théorique dans celle-ci, et dans l'ensemble du mouvement ouvrier, est considérable. Mais à la fin des années 30, il a développé une théorie aberrante sur l'économie de guerre comme solution à la crise qui a désarmé et désarticulé la Fraction face à la seconde guerre mondiale.
[2] [1610] D'ailleurs, les "experts" bourgeois eux-mêmes le disent clairement : "Pratiquement plus personne ne pense aujourd'hui que la dette puisse être remboursée, mais les pays occidentaux insistent pour élaborer un mécanisme qui permettrait de dissimuler ce fait et d'éviter des termes aussi durs que cessation de paiement et banqueroute." (W.Pfaff, "International Herald Tribune" du 30-1-89). Ce que l'auteur oublie de préciser, ce sont les causes profondes d'une telle "pudeur". En réalité, pour la bourgeoisie des grandes puissances occidentales, proclamer officiellement la faillite complète de ses débiteurs, c'est reconnaître la faillite de son système financier et, au delà, de l'ensemble de l'économie capitaliste. En fin de compte, la classe dominante ressemble un peu à ces personnages de dessins animés qui continuent de courir alors qu'ils se trouvent déjà au dessus d'un précipice et qui n'y tombent qu'au moment où ils en prennent conscience.
[3] [1611] Les famines et la paupérisation absolue de la classe ouvrière, telles que nous les avons vécues ces dernières années, ne sont pas des phénomènes nouveaux dans l'histoire du capitalisme. Mais au delà de l'ampleur qu'elles prennent aujourd'hui (et qui n'est comparable qu'aux situations vécues lors des guerres mondiales), il importe de distinguer ce qui relevait de l'introduction du mode de production capitaliste dans la société (qui s'est faite effectivement "dans la boue et le sang", suivant les termes de Marx, en s'appuyant sur la création d'une armée de miséreux et de mendiants, sur les "workhouses", le travail de nuit des enfants, l'extraction de la plus value absolue...) de ce qui relève de l'agonie de ce mode de production. De même que le chômage ne représente plus aujourd'hui une "armée industrielle de réserve", mais traduit l'incapacité du système capitaliste de poursuivre ce qui constituait une de ses tâches historiques - développer le salariat, le retour des famines et de la paupérisation absolue (après une période où elle avait été remplacée par la paupérisation relative) signe la faillite historique totale de ce système.
[4] [1612] Cette analyse est développée dans les rapports et résolutions des précédents congrès publiés dans la Revue Internationale n°35, 44 et 51.
PRE
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [239]
Questions théoriques:
- Guerre [279]
- Le cours historique [3]
- L'économie [90]
Il y a 50 ans : les véritables causes de la 2eme guerre mondiale
- 24500 reads
Le texte que nous publions ci-dessous est une partie du Rapport sur la situation internationale présenté et débattu à la Conférence de la Gauche communiste de France (GCF) qui s'est tenue en juillet 1945 à Paris. Aujourd'hui, quand la bourgeoisie mondiale commémore avec enthousiasme les hauts faits de la victoire de la "démocratie" contre le fascisme hitlérien qui, selon elle, était la seule raison de la 2ème guerre mondiale de 1939-45, il est nécessaire de rappeler à la classe ouvrière, non seulement la vraie nature impérialiste de cette boucherie sanglante qui a fait 50 millions de victimes et a laissé en ruines fumantes tant de pays d'Europe et d'Asie, mais aussi ce qui s'annonçait être la "paix" capitaliste qui allait suivre.
Tel était l'objectif que cette petite minorité de révolutionnaires qu'était la GCF s'était donnée dans cette conférence, en démontrant, contre tous les laquais de la bourgeoisie allant des PS-PC jusqu'aux groupes trotskystes, que, dans le capitalisme dans sa période impérialiste, la "paix" n'est qu'un intervalle entre les guerres, quelle que soit l'étiquette sous laquelle ces guerres se camouflent.
De 1945 à aujourd'hui, les innombrables conflits armés localisés, qui ont déjà fait au moins autant de victimes que la guerre mondiale de 1939-45, la crise économique mondiale qui dure depuis vingt ans, la course effarante aux armements, ont amplement confirmé ces analyses, et plus que jamais reste valable la perspective : lutte de classe du prolétariat débouchant sur la révolution communiste comme seule alternative à la course vers une 3ème guerre mondiale qui mettrait en question la survie même de l'humanité.
RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
GAUCHE COMMUNISTE DE FRANCE (juillet 1945, extraits)
I. GUERRE ET PAIX
Guerre et paix sont deux moments d'une même société : la société capitaliste. Elles ne se présentent pas comme des oppositions historiques s'excluant Tune l'autre. Au contraire, guerre et paix en régime capitaliste représentent des moments complémentaires indispensables l'un à l'autre, des phases successives d'un même régime économique, des aspects particuliers et complémentaires d'un phénomène unique.
A l'époque du capitalisme ascendant les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, d'élargissement et de l'expansion du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d'une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.
A l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.
Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre négatif par définition, destructeur et entrave du développement de la société, en opposition à la paix, qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans uni cours objectif, économiquement déterminé.
La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement, qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.
Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix), dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de consommation, dans la seconde phase la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique - période ascendante -, l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre -période de décadence.
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de plus-value, mais cela signifie que la guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme décadent.
Dans la mesure où l'alternative guerre paix n'est pas simplement destinée à tromper le prolétariat, à endormir sa vigilance et à lui faire quitter son terrain de classe, cette alternative n'exprime que le fond apparent, contingent, momentané, servant au regroupement des différentes constellations en vue de la guerre. Dans un monde où les zones d'influences, les marchés d'écoulement des produits, les sources de matières premières et les pays de l'exploitation forcenée de la main d'oeuvre sont définitivement partagés entre les grandes puissances impérialistes, les besoins vitaux des jeunes impéria-lismes les moins favorisés se heurtent violemment aux intérêts des vieux impérialismes les plus favorisés et s'expriment dans une politique belliqueuse et agressive pour obtenir par la force un nouveau partage du monde. Le bloc impérialiste de la "Paix" ne signifie nullement une politique basée sur un concept moral plus humain, mais simplement la volonté des impérialismes repus et favorisés, de défendre par la force leurs privilèges acquis dans les brigandages antérieurs. La "paix" pour eux ne signifie nullement une économie se développant pacifiquement, qui ne peut exister en régime capitaliste, mais la préparation méthodique à l'inévitable compétition armée et l'écrasement impitoyable au moment propice des impérialismes concurrents et antagoniques.
La profonde aversion des masses travailleuses pour la guerre est d'autant plus exploitée qu'elle offre un magnifique terrain de mobilisation pour la guerre contre l'impérialisme adverse... fauteur de guerres.
Entre les deux guerres, la démagogie de la "paix" a servi aux impérialismes anglo-américano-russe de camouflage à leur préparation à la guerre, qu'ils savaient inévitable et à leur préparation idéologique des masses.
La mobilisation pour la paix est du charlatanisme conscient de tous les laquais du capitalisme et dans le meilleur des cas un songe creux, une phrase vide et impuissante, des petits bourgeois se lamentant. Elle désarme le prolétariat en faisant miroiter devant lui l'illusion dangereuse entre toutes d'un capitalisme pacifique.
La lutte contre la guerre ne peut être efficace et avoir un sens qu'en liaison indissoluble avec la lutte de classe du prolétariat, avec la lutte révolutionnaire pour la destruction du régime capitaliste.
A l'alternative mensongère de guerre-paix le prolétariat oppose la seule alternative que pose l'histoire : GUERRE
IMPERIALISTE ou REVOLUTION PROLETARIENNE.
II. LA GUERRE IMPERIALISTE
Le bureau international de la Gauche communiste a commis, l'erreur à la veille de la guerre, de ne voir en celle-ci avant tout qu'une expression directe de la lutte de classe, une guerre de la bourgeoisie contre le prolétariat. Il prétendait nier complètement ou partiellement l'existence des antagonismes inter impérialistes s'exacerbant et déterminant la conflagration mondiale. Partant d'une vérité indéniable de l'inexistence de nouveaux débouchés à conquérir, qui de ce fait rend la guerre inopérante en tant que moyen de résoudre la crise de surproduction, le bureau international aboutissait à la conclusion simpliste et erronée d'après laquelle la guerre impérialiste ne serait plus le produit du capitalisme divisé en Etats antagoniques luttant chacun pour l'hégémonie mondiale. Le capitalisme sera présenté comme un tout unifié et solidaire et ne recourant à la guerre impérialiste que dans le but de massacrer le prolétariat et d'entraver la montée de la révolution.
L'erreur fondamentale dans l'analyse de la nature de la guerre impérialiste se doublait d'une deuxième erreur dans l'appréciation des rapports de forces des classes en présence au moment du déclenchement de la guerre impérialiste.
L'ère des guerres et des révolutions ne signifie pas qu'au développement du cours de la révolution réponde un développement du cours de la guerre. Ces deux cours ayant leur source dans une même situation historique de crise permanente du régime capitaliste, sont toutefois d'essences différentes n'ayant pas des rapports de réciprocité directe. Si le dé roulement de la guerre devient un facteur direct précipitant les convulsions révolutionnaires, il n'en est pas de même en ce qui concerne le cours de la révolution qui n'est jamais un facteur de la guerre impérialiste.
La guerre impérialiste ne se développe pas en réponse au flux de la révolution, mais c'est exactement le contraire qui est vrai, c'est le reflux de la révolution qui suit la défaite de la lutte révolutionnaire, c'est l'évincement momentané de la menace de la révolution qui permet à la société capitaliste d'évoluer vers le déclenchement de la guerre engendrée par les contradictions et les déchirements internes du système capitaliste.
La fausse analyse de la guerre impérialiste devait amener fatalement à présenter le moment du déclenchement de la guerre comme la réponse au flux de la révolution, à confondre et à intervertir les deux moments, à donner une appréciation erronée des rapports de forces existants entre les classes.
L'absence de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés où puisse se réaliser la plus-value incluse dans les produits au cours du procès de la production, ouvre la crise permanente du système capitaliste. La réduction du marché extérieur a pour conséquence une restriction du marché intérieur. La crise | économique va en s’amplifiant.
A l'époque impérialiste l'élimination achevée des producteurs isolés et groupes de petits et moyens producteurs par la victoire et le monopole des grandes concentrations du capital, les syndicats et les trusts, trouve son corollaire sur le plan international par l'élimination et la complète subordination des petits Etats à quelques grandes puissances impérialistes dominant le monde. Mais de même que l'élimination des petits producteurs capitalistes ne fait pas disparaître la concurrence qui, de petites luttes éparpillées en surface qu'elle était» se creuse en profondeur et se manifeste en des luttes géantes dans la mesure même de la concentration du capital, de même l'élimination des petits Etats et leur vassalisation par les 4 ou 5 Etats impérialistes monstres, ne signifie pas atténuation des antagonismes inter impérialistes.
Au contraire ces antagonismes ne font que se concentrer et ce qu'ils perdent en surface, en nombre, ils le gagnent en intensité et dont les chocs et les explosions ébranlent jusqu'aux fondements de la société capitaliste.
Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du i marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre Etats. La lutte économique exaspérée entre Etats ne peut finalement se résoudre que par la j force militaire. La guerre devient le seul moyen non pas de solution à la crise internationale, mais le seul moyen par le quel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des Etats impérialistes rivaux.
Les solutions momentanées des impérialismes isolés, par des |victoires militaires et économiques, ont pour conséquence non seulement l'aggravation des situations des pays impérialistes adverses, mais encore une aggravation de la crise mondiale et la destruction des masses de valeurs accumulées par des dizaines et des centaines d'années de travail social. La société capitaliste à l'époque impérialiste ressemble à un bâtiment dont les matériaux nécessaires pour la construction des étages supérieurs sont extraits de la bâtisse des étages inférieurs et des fondations. Plus frénétique est la construction en hauteur, plus fragile est rendue la base soutenant tout l'édifice. Plus est imposante en apparence, la puissance au sommet, plus l'édifice est, en réalité, branlant et chancelant. Le capitalisme, forcé qu'il est de creuser sous ses propres fondations, travaille avec rage à l'effondrement de l'économie mondiale, précipitant la société humaine vers la catastrophe et l'abîme.
"Une formation sociale ne périt pas avant que soient développées toutes les forces productives auxquelles elle ouvre un champ libre" disait Marx, mais cela ne signifie pas qu'ayant épuisé cette mission, la formation sociale disparaît, s'évanouit d'elle-même. Pour cela, il faut qu'une nouvelle formation sociale correspondant à l'état des forces productives et à même de leur ouvrir des champs nouveaux pour leur développement, renne la direction de la société. En cela elle se heurte à 'ancienne formation sociale, qu'elle ne peut remplacer qu'en la vainquant par la lutte et la violence révolutionnaires. Et si, se survivant, l'ancienne formation, restée maîtresse des destinées de la société, continue à agir et à guider la société non plus vers l'ouverture des champs libres au développement des forces productives, mais d'après sa nouvelle nature désormais réactionnaire, elle oeuvre vers leur destruction.
Chaque jour de survivance du capitalisme se solde pour la société par une nouvelle destruction. Chaque acte du capitalisme décadent est un moment de cette destruction.
Prise dans ce sens historique, la guerre à l'époque impérialiste, présente l'expression la plus haute en même temps que la plus adéquate du capitalisme décadent, de sa crise permanente et de son mode de vie économique : la destruction.
Aucun mystère n'enveloppe la nature de la guerre impérialiste. Historiquement, elle est la matérialisation de la phase décadente et de destruction de la société capitaliste se manifestant par la croissance des contradictions et l'exaspération des antagonismes inter-impérialistes qui servent de base concrète et de cause immédiate au déchaînement de la guerre.
La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine, elle est le fruit d'une nécessité de l'Etat capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir, aux dépens des autres Etats impérialistes.
Plus les marchés de réalisation de la plus-value se rétrécissent, plus la lutte entre impérialistes devient acerbe, plus l'antagonisme inter-impérialiste s'exacerbe, et plus l'Etat est amené à renforcer son appareil offensif et défensif. La crise permanente pose l'inéluctabilité, l'inévitabilité du règlement des différends impérialistes par la lutte armée. La guerre et la menace de guerre sont les aspects latents ou manifestes d'une situation de guerre permanente dans la société. La guerre moderne est essentiellement une guerre de matériel. En vue de la guerre une mobilisation monstrueuse de toutes les ressources techniques et économiques des pays est nécessaire. La production de guerre devient aussi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société.
Mais la masse des produits représente-t-elle un accroissement de la richesse sociale ? A cette question, il faut répondre catégoriquement par la négative, la production de guerre, toutes les valeurs qu'elle matérialise, est destinée à sortir de la production, à ne pas se retrouver dans la reprise du procès de la production et à être détruite. Après chaque cycle de production, la société n'enregistre pas un accroissement de son patrimoine social, mais un rétrécissement, un appauvrissement dans la totalité.
Qui paie la production de guerre ? Autrement dit, qui réalise la production de guerre ?
En premier lieu, la production de guerre est réalisée aux dépens des masses travailleuses dont l'Etat par diverses opérations financières : impôts, emprunts, conversions, inflation et autres mesures, draine des valeurs avec lesquelles il constitue un pouvoir d'achat supplémentaire et nouveau. Mais toute cette masse ne peut réaliser qu'une partie de la production de guerre. La plus grande partie reste non réalisée et attendant sa réalisation au travers de la guerre, c'est-à-dire au travers du brigandage exercé sur l'impérialisme vaincu. Ainsi s'opère en quelque sorte une réalisation forcée.
L'impérialisme vainqueur présente la note de sa production de guerre, sous l'appellation de "réparations" et se taille la livre de chair sur l'impérialisme vaincu à qui il impose sa loi. Mais la valeur contenue dans la production de guerre de l'impérialisme vaincu, comme d autres petits Etats capitalistes, est complètement et irrémédiablement perdue. Au total, si on fait le bilan de l'ensemble de l'opération pour l'économie mondiale prise comme un tout, le bilan sera catastrophique, quoique certains secteurs et certains impérialismes isolément se trouvent enrichis.
L'échange des marchandises au travers duquel la plus-value parvenait à se réaliser, ne fonctionne que partiellement avec la disparition du marché extra-capitaliste et tend à être supplanté par "l'échange" forcé, de brigandage sur les pays vaincus et plus faibles, par les capitalistes les plus forts, au travers des guerres impérialistes. En cela réside un aspect nouveau de la guerre impérialiste.
III. LA TRANSFORMATION DE LA GUERRE IMPERIALISTE EN GUERRE CIVILE
Comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'arrêt de la lutte de classes, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, en vidant ces luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l'éclatement de la guerre impérialiste.
Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.
Ainsi la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 eh Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masses, gloire et fierté de la 2ème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et pourri par l'opportunisme régnant en maître, devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.
La réalité ne se traduit pas dans la photographie chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates. On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à l'ordre chronologique de l'histoire, et présenter la guerre de 1914 comme la cause de l'effondrement de la 2ème Internationale, quand en réalité l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste
se faisaient d'autant plus extérieurement, qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, l'embourgeoisement des partis de la 2ème Internationale, la substitution à leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de leur bourgeoisie nationale.
Ce processus interne de la destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans l'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionnée.
L'éclatement de la 2ème guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.
On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerres impérialistes.
La première s'achève avec l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917 et consignée dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la Gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme au travers de la théorie et la pratique du "socialisme en un seul pays".
La deuxième étape est celle de l'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique du capitalisme-socialisme : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de gauche de Trotski qui, incapable de regrouper les énergies révolutionnaires, s'engage par la coalition et la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la 4ème Internationale.
La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays démocratiques. Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a en réalité cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de leur bourgeoisie nationale, de leur patrie capitaliste. L'anti-fascisme était la plate-forme, l'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres du prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.
Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses par l'idéologie "anti-fasciste", l'adhésion des masses à la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936, de la guerre "antifasciste" espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'Etat en Russie se manifestant entre autre par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN ; son intégration dans un bloc impérialiste et l'instauration de l'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des communistes de gauche surgis par la crise de TIC et qui, au travers de l'idéologie "anti-fasciste" à la "défense de l'Etat ouvrier" en Russie, sont happés dans l'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré un pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. L'avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduit quantitativement à de petits îlots négligeables.
L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte, qu'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat, pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale.
La guerre impérialiste ne résout aucune des contradictions du régime qui la engendrée. Mais cette manifestation pouvant s'épanouir grâce à l'effacement "momentané" du prolétariat luttant pour le socialisme, provoque le plus grand déséquilibre de la société, et accule l'humanité à l'abîme. Conditionnée par l'effacement de la lutte de classe, la guerre devient au cours de son déroulement un facteur puissant de réveil de la conscience de classe et de la combativité révolutionnaire des masses. Ainsi se manifeste le cours dialectique et contradictoire de l'histoire.
Les ruines accumulées, les destructions multipliées, les cadavres s'entassant par millions, la misère et la famine se développant et s'amplifiant chaque jour, tout pose devant le prolétariat et les couches travailleuses le dilemme aigu et direct de mourir ou de se révolter. Les mensonges patriotiques et la fumée chauvine se dissipent et font apparaître devant les masses l'atrocité et l'inutilité de la boucherie impérialiste. La guerre devient un puissant moteur accélérant la reprise de la lutte de classe et transformant rapidement celle-ci en guerre civile de classe.
Au cours de la troisième année de la guerre, commencent à se manifester les premiers symptômes d'un processus de désintégration du prolétariat de la guerre. Processus encore profondément souterrain, difficilement décelable et encore moins mesurable. Contrairement aux russophiles et anglophiles, les amis platoniques de la révolution, et en premier lieu les trotskystes, qui cachaient leur chauvinisme sous l'argument que la démocratie offrait plus de possibilité à l'éclosion d'un mouvement révolutionnaire du prolétariat et voyaient dans la victoire des impérialismes démocratiques, la condition de la révolution, nous placions, nous, le centre de la fermentation révolutionnaire dans les pays de l'Europe et plus précisément en Italie et en Allemagne, où le prolétariat a subi moins la destruction de sa conscience que la destruction physique, et n'a adhéré à la guerre que sous la pression de la violence.
A la faveur de la guerre, la puissance du gendarme allemand s'épuisait. Les auspices économiques extrêmement fragiles de ces impérialistes qui n'ont pas pu supporter dans le passé les convulsions sociales, devaient être ébranlées aux premières difficultés, aux premiers revers militaires. Ces "révolutionnaires de demain" mais aujourd'hui chauvins nous citaient triomphalement les grèves de masse en Amérique et en Angleterre (tout en les condamnant et les déplorant parce qu'elles affaiblissaient la puissance des démocraties) comme preuve des avantages qu'offre la démocratie pour la lutte du prolétariat. En dehors du fait que le prolétariat ne peut déterminer la forme du régime qui convient le mieux, à un moment donné du capitalisme, et du fait que placer le prolétariat sur le terrain du choix : démocratie-fascisme, c'est lui faire abandonner son terrain propre de lutte contre le capitalisme, les exemples des grèves citées, des masses en Amérique ou en Angleterre, ne prouvaient nullement une plus grande maturation de la combativité des masses ouvrières dans ces pays, mais plutôt la plus grande solidité du capitalisme dans ces pays pouvant supporter des luttes partielles du prolétariat.
Loin de nier l'importance de ces grèves, et les soutenant intégralement comme manifestations de classe pour des objectifs immédiats, nous ne nous leurrons pas sur leur portée encore limitée et contingente.
Notre attention fut avant tout concentrée sur l'endroit où s'accomplissait un processus de décomposition des forces vitales du capitalisme et de fermentation révolutionnaire de la plus haute portée où la moindre manifestation extérieure prenait une acuité et posait l'imminence de l'explosion révolutionnaire. Déceler ces symptômes, suivre attentivement cette évolution, s'y préparer et participer à leur explosion, telle devait être et a été notre tâche dans cette période.
Une partie de la fraction italienne de la Gauche communiste nous taxant d'impatience, se refusait à voir dans les mesures draconiennes prises par le gouvernement allemand dans l'hiver 1942-43, tant à l'intérieur que sur les fronts, autre chose que la suite ordinaire de la politique fasciste et niait que ces mesures reflétaient un processus moléculaire interne. Et c'est parce qu'ils les niaient qu'ils se sont trouvés surpris et dépassés par les événements de juillet 1943, au cours desquels le prolétariat italien rompait le cours de la guerre et ouvrait celui de la guerre civile.
Enrichi par l'expérience de la première guerre, incomparablement mieux préparé à l'éventualité de la menace révolutionnaire, le capitalisme international a réagi solidairement avec une extrême habileté et prudence contre un prolétariat décapité de son avant-garde. A partir de 1943, la guerre se transforme en guerre civile. En l'affirmant nous n'entendons pas dire que les antagonismes inter-impérialistes ont disparu, ou qu'ils ont cessé d'agir dans la poursuite de la guerre. Ces antagonismes subsistaient et ne faisaient que s'amplifier, mais dans une mesure moindre et acquérant un caractère secondaire, en comparaison de la gravité présentant pour le monde capitaliste la menace d'une explosion révolutionnaire.
La menace révolutionnaire sera le centre des soucis et des préoccupations du capitalisme dans les deux blocs : c'est elle qui déterminera en premier lieu le cours des opérations militaires, leur stratégie et le sens de leur déroulement. Ainsi d'un accord tacite entre les deux blocs impérialistes antagonistes et afin de circonvenir et d'étouffer les premiers brasiers de la révolution, l'Italie, chaînon le plus faible et le plus vulnérable sera coupée en deux tronçons. Chaque bloc impérialiste sera chargé par des moyens propres, la violence et la démagogie, d'assurer l'ordre dans un des deux tronçons.
Cet état de cernement et de division de l'Italie dont la partie industrielle et le centre vital le plus important, le Nord, confié à l'Allemagne, et voué à la répression féroce du fascisme, sera maintenu en dépit de toute considération militaire, jusqu'après l'effondrement du gouvernement en Allemagne.
Le débarquement allié, le mouvement contournant des armées russes permettant la destruction systématique des centres industriels et de concentration prolétarienne, obéiront au même objectif central de cernement et de destruction préventives, face à une menace éventuelle d'explosion révolutionnaire. L'Allemagne même sera le théâtre d'une destruction et d'un massacre encore inégalés dans l'histoire.
A l'effondrement total de l'armée allemande, à la désertion massive, aux soulèvements des soldats, des marins et des ouvriers, répondront des mesures de représailles d'une sauvagerie féroce, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, la mobilisation des dernières réserves d'hommes jetés sur les champs de bataille et voués consciemment et inexorablement à l'extermination.
A rencontre de la première guerre impérialiste, où le prolétariat une fois engagé dans le cours de la révolution garde l'initiative et impose au capitalisme mondial l'arrêt de la guerre, dans cette guerre-ci dès le premier signal de la révolution en Italie, en juillet 1943, c'est le capitalisme qui se saisira de l'initiative et poursuivra implacablement une guerre civile contre le prolétariat, empêchera par la force toute concentration des forces prolétariennes, n'arrêtera pas la guerre même 3uand après l'effondrement et la disparition du gouvernement 'Hitler, l'Allemagne demandera avec insistance l'armistice, afin de s'assurer par un carnage monstre et un massacre préventif impitoyable, contre toute velléité de menace de révolution du prolétariat allemand.
Quand on sait que les terribles bombardements auxquels les alliés ont soumis l'Allemagne et qui ont eu pour effet la destruction de centaines de milliers de maisons d'habitation et le massacre de millions d'hommes, ont cependant laissé intacts comme nous annonce la presse alliée, 80% des usines, on saisit toute la signification de classe de ces bombardements "démocratiques".
Le chiffre total des morts de la guerre en Europe s'élève à 40 millions d'hommes dont les deux tiers à partir de 1943, à lui seul ce chiffre donne le bilan de la guerre impérialiste en général et de la guerre civile du capitalisme contre le prolétariat en particulier.
Aux sceptiques qui n'ont pas vu la guerre civile ni du côté du prolétariat, ni du côté du capitalisme, parce qu'elle ne s'est pas reproduite d'après les schémas connus et classiques nous laissons entre autre ces chiffres à leur méditation de sages.
Le trait original et caractéristique de cette guerre qui la distingue de 1914-1918, c'est la transformation brusque en guerre contre le prolétariat tout en poursuivant ses buts impérialistes. C'est la poursuite du massacre méthodique du prolétariat et ne s'arrêtant qu'après s'être assuré momentanément et partiellement il est vrai, contre le foyer de la révolution socialiste.
Comment cela fut-il possible, comment expliquer cette victoire momentanée mais incontestable du capitalisme contre le prolétariat ? (...) Comment se présentait la situation en Allemagne ?
L'acharnement avec lequel les alliés poursuivaient une guerre d'extermination, le plan de déportation massive du prolétariat allemand, plus particulièrement émis par le gouvernement russe, la méthodique et systématique destruction des villes, laissait peser la menace d'une extermination et d'une dispersion telle du prolétariat allemand, qu'avant qu'il ait pu esquisser le moindre geste de classe, il soit mis hors de combat pour des années.
Ce danger a existé effectivement, mais le capitalisme n'a pu réussir à appliquer que partiellement son plan. La révolte des ouvriers et des soldats, qui, dans certaines villes, se sont rendus maîtres des fascistes, a forcé les alliés à précipiter leur marche et à finir cette guerre d'extermination avant le plan prévu. Par ces révoltes de classe, le prolétariat allemand a réussi un double avantage : brouiller le plan du capitalisme, en le forçant à précipiter la fin de la guerre, et esquisser ses premières actions révolutionnaires de classe. Le capitalisme international a su mater momentanément le prolétariat allemand, et empêcher qu'il prenne la tête de la révolution mondiale, mais il n'a pas réussi à l'éliminer définitivement.
GCF, juillet 1945.
L'ETINCELLE N° l. Janvier 1945 Organe de la Fraction Française de la Gauche Communiste
MANIFESTE
La guerre continue.
La "libération" avait pu faire espérer aux ouvriers la fin du massacre et la reconstruction de l'économie, au moins en France.
Le capitalisme a répondu à cet espoir par le chômage, la famine, la mobilisation. La situation qui accablait le prolétariat sous l'occupation allemande s'est aggravée ; pourtant il n'y a plus d'occupation allemande.
La Résistance et le Parti communiste avaient promis la démocratie et de profondes réformes sociales ! Le gouvernement maintient la censure et renforce sa gendarmerie. Il s'est livré à une caricature de socialisation en nationalisant quelques usines, avec indemnités aux capitalistes ! L'exploitation du prolétariat reste et aucune réforme ne peut le faire disparaître. Pourtant la Résistance et le parti communiste sont aujourd'hui tout à fait d'accord avec le gouvernement : c'est qu'Us se sont toujours moqués de la démocratie et du prolétariat.
Ils n'avaient qu'un seul but : la guerre.
Ils l'ont, et c'est maintenant l'Union sacrée.
Guerre pour la revanche, pour le relèvement de la France, guerre contre l'hitlérisme, clame la bourgeoisie.
Mais la bourgeoisie a peur ! Elle a peur des mouvements prolétariens en Allemagne et en France, elle a peur de l'après-guerre
Il lui faut museler le prolétariat français ; elle accroît sa police, qu'elle enverra demain contre lui.
Il lui faut se servir de lui pour écraser la révolution allemande ; elle mobilise son armée.
La bourgeoisie internationale l'aide. Elle l'aide à reconstruire son économie de guerre pour maintenir sa propre domination de classe.
L'URSS l'aide, la première, et fait avec elle un pacte de lutte contre les prolétaires français et allemands.
Tous les partis, les socialistes, les "communistes" l'aident :
"Sus à la cinquième colonne, aux collaborateurs ! sus à l'hitlérisme î sus au maquis brun !"
Mais tout ce bruit ne sert qu'à cacher l'origine réelle de la misère actuelle : le capitalisme, dont le fascisme n'est que le fils.
A cacher la trahison aux enseignements de la révolution russe, qui s'est faite en pleine guerre et contre la guerre.
A justifier la collaboration avec la bourgeoisie au gouvernement.
A jeter à nouveau le prolétariat dans la guerre impérialiste.
A lui faire prendre demain les mouvements prolétariens en Allemagne pour une résistance fanatisée de l'hitlérisme !
Camarades ouvriers !
Plus que jamais la lutte tenace des révolutionnaires pendant la première guerre impérialiste, de Lénine, Rosa Luxemburg et Liebknecht doit être la notre !
Plus que jamais le premier ennemi à abattre est notre propre bourgeoisie !
Plus que jamais, face à la guerre impérialiste, se fait sentir la nécessité de la guerre civile 1
La classe ouvrière n'a plus de parti de classe -le parti "communiste" a trahi, trahit aujourd’hui, trahira demain.
L'URSS est devenue un impérialisme. Elle s'appuie sur les forces les plus réactionnaires pour empêcher la révolution prolétarienne. Elle sera le pire gendarme des mouvements ouvriers de demain : elle commence dès aujourd'hui à déporter en masses les prolétaires allemands pour briser toute leur force de classe.
Seule la fraction de gauche, sortie de ce "cadavre pourrissant" qu'est devenue la 2ème, la 3ème Internationale, représente aujourd'hui le prolétariat révolutionnaire.
Seule la gauche communiste s'est refusée à participer au dévoiement de la classe ouvrière par l'antifascisme et l'a, dès le début, mise en garde contre ce nouveau guet-apens.
Seule elle a dénoncé l'URSS comme le pilier de la contre-révolution depuis la défaite du prolétariat mondial en 1933 !
Seule elle restait, au déclenchement de la guerre, contre toute Union sacrée et proclamait la lutte de classe comme la seule lutte du prolétariat, dans tous les pays, y compris l'URSS.
Enfin, seule elle entend préparer les voies du futur parti de classe, rejetant toutes compromissions et front unique, et suivant dans une situation mûrie par l'histoire le dur chemin suivi par Lénine et la fraction bolchevique avant la première guerre impérialiste.
Ouvriers ! La guerre ce n'est pas seulement le fascisme ! C'est la démocratie et le "socialisme dans un seul pays" : l'URSS, c'est tout le régime capitaliste qui, en périssant, veut faire périr la société !
Le capitalisme ne peut pas vous donner la paix ; même sorti de la guerre, il ne peut plus rien vous donner.
Contre la guerre capitaliste, il faut répondre par la solution de classe : la guerre civile !
C'est de la guerre civile, jusqu'à la prise du pouvoir par le prolétariat, et seulement d'elle que peut surgir une société nouvelle, une économie de consommation et non plus de destruction !
Contre le patriotisme et l'effort de guerre ! Pour la solidarité prolétarienne internationale. Pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile.
La Gauche communiste (Fraction française)
M.Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français, déclarait en 1945 : "Les communistes ne formulent pas présentement des exigences socialiste ou communiste. Ils disent franchement qu'une seule chose préoccupe le peuple : gagner la guerre au plus vite pour hâter l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne, pour assurer le plus vite possible le triomphe de la démocratie, pour préparer la renaissance de la France démocratique et indépendante. Ce relèvement de la France est la tâche de la nation toute entière, la France de demain sera ce que ses enfants l'auront faite.
Pour contribuer à ce relèvement, le Parti communiste est un parti de gouvernement ! Mais il faut encore une armée puissante avec des officiers de valeur, y compris ceux qui ont pu se laisser abuser un certain temps par Pétain. Il faut remettre en marche les usines, en premier lieu les usines de guerre, faire plus que le nécessaire pour fournir les soldats en .armes."
Les Statuts de l'Internationale Communiste déclaraient en 1919 : "Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voila la première parole que l'Internationale Communiste adresse à chaque travailleur, quelles que soient son origine et la langue qu'il parle. Souviens-toi que du fait de l’existence du régime capitaliste, une poignée d'impérialistes a eu pendant 4 années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s entr'égorger l Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l'Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement. Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible mais inévitable !"
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [1613]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Questions théoriques:
- Décadence [2]
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (1° partie)
- 4718 reads
Première partie : la Gauche italienne, 1922-1937
Nous publions ici la première partie d'un article consacré à la clarification de la définition du rapport Fraction-Parti telle qu'elle s'est progressivement affirmée dans l'histoire du mouvement révolutionnaire. Cette première partie traitera du travail de la Fraction de Gauche du Parti Communiste italien dans les années 1930, en insistant particulièrement sur les années décisives, de 1935 à 1937, années dominées par la guerre d'Espagne, pour répondre aux critiques exprimées à plusieurs reprises par les camarades de Battaglia Comunista à l'égard de "la Fraction", c'est-à-dire du groupe qui se constitue à la fin des années 1920 comme "fraction" du Parti Communiste d'Italie en lutte contre la dégénérescence stalinienne de celui-ci.
Comme nous avons déjà répondu plusieurs fois à ces critiques sur divers points particuliers ([1] [1614]), ce qui nous intéresse aujourd'hui est de développer les éléments généraux du rapport historique entre "fraction" et parti. L'importance de ce travail pourrait paraître secondaire, à un moment où les communistes ne se considèrent plus depuis un demi-siècle comme des fractions des vieux partis passés à la contre-révolution. Mais, comme nous le verrons au cours de cet article, la Fraction est une donnée politique qui va au delà de la pure donnée statistique (partie du Parti), elle exprime substantiellement la continuité dans l'élaboration politique qui va du programme du vieux parti au programme du nouveau parti, conservé et enrichi parce qu'il condense les nouvelles expériences historiques du prolétariat. C'est la signification profonde de cette méthode de travail, de ce fil rouge que nous voulons faire ressortir pour les nouvelles générations, pour les groupes de camarades qui, dans le monde entier, sont à la recherche d'une cohérence de classe. Face à tous les imbéciles qui s'amusent à faire "table rase" de l'histoire du mouvement ouvrier antérieur à eux, le CCI réaffirme que ce n'est que sur la base de cette continuité du travail politique que pourra surgir le Parti communiste mondial, arme indispensable dans les batailles qui nous attendent.
LES CRITIQUES DE "BATTAGLIA COMUNISTA" ENVERS LA FRACTION ITALIENNE A L'EXTERIEUR
Tout d'abord, tentons d'exposer systématiquement, et sans les déformer, les positions de Battaglia sur lesquelles nous entendons polémiquer. Dans l'article "Fraction-Parti dans l'expérience de la Gauche italienne", est développée la thèse selon laquelle la Fraction, fondée à Pantin, dans la banlieue parisienne, en 1928 par les militants en exil, aurait rejeté hypothèse trotskyste de fondation immédiate de nouveaux partis, parce que les vieux partis de l'Internationale communiste n'étaient pas encore officiellement passés de l'opportunisme à la contre-révolution. "Ce qui revenait à dire que (...) si les partis communistes, malgré l'infection de l’opportunisme, n'étaient pas encore passés, avec armes et bagages, au service de l'ennemi de classe, on ne pouvait pas mettre à l'ordre du jour la construction de nouveaux partis. " Ceci est absolument vrai, même si, comme on le verra, ce n'était qu'une des conditions nécessaires à la transformation de la Fraction en Parti. A part cela, il peut être utile de rappeler que les camarades qui ont fondé la fraction en 1928, avaient déjà dû, en 1927, se séparer d'une minorité activiste qui considérait déjà les PC comme contre-révolutionnaires ("Hors de l'Internationale de Moscou !", disait-elle) et qui, rapidement, en ayant l'illusion que la crise de 1929 était un prélude immédiat à la révolution, adoptait la position de la Gauche allemande, qui elle même avait, en 1924 donné naissance à une éphémère "nouvelle" "Internationale communiste ouvrière".
Poursuivant sa reconstitution, Battaglia rappelle que la Fraction "...a surtout un rôle d'analyse, d'éducation, de préparation des cadres, qu'elle développe la plus grande clarté sur la phase dans laquelle elle agit pour se constituer en parti, au moment même où la confrontation entre les classes balaie l'opportunisme." (Rapport pour le Congrès de 1935). "Jusque là - poursuit BC -, les termes de la question semblaient être suffisamment clairs. Le problème Fraction-Parti a été 'programmatiquement' résolu du fait que la première dépendait du processus de dégénérescence qui était en cours dans ce dernier, (...) et non grâce à une élaboration théorique abstraite qui aurait élevé ce type particulier d'organisation des révolutionnaires à une forme politique invariante, valable pour toutes les périodes historiques de stagnation de la lutte de classe (...). L'idée que l'on ne peut envisager la possibilité de transformation de la fraction en parti que dans des situations 'objectivement favorables', c'est-à-dire en présence d'une reprise de la lutte de classe, reposait sur l'éventualité calculée que ce n'est que dans une telle situation ou dans les orages qui V accompagnent que se serait vérifiée dans les faits la trahison définitive des partis communistes. "
La trahison des PC a été publiquement déclarée en 1935, avec l'appui de Staline et du PCF (imité par tous les autres) aux mesures de réarmement militaire décidées par le gouvernement bourgeois de France "pour défendre la démocratie. Face à ce passage officiel du côté de l'ennemi de classe, la Fraction lançait le manifeste "En dehors des Partis communistes, devenus instruments de la contre-révolution" et se réunissait en congrès pour donner une réponse en tant qu'organisation à ces événements. L'article de Battaglia affirme que :
"Suivant le schéma développé au cours des années précédentes, la Fraction aurait dû accomplir sa tâche en fonction de cet événement et passer à la construction du nouveau parti.
Mais pour la mise en pratique, même si la perspective restait celle-là, il s'exprima au sein de la Fraction quelques tendances qui s'efforçaient de renvoyer le problème plutôt que de le résoudre dans ses aspects pratiques.
Dans le rapport de Jacobs sur lequel aurait dû se développer le débat, la trahison du centrisme et le mot d'ordre lancé par la Fraction de sortir des partis communistes (n'impliquait pas) 'sa transformation en parti, ni ne représentait la solution prolétarienne à la trahison du centrisme, solution qui ne sera ^ donnée que par les événements de demain et auxquels la fraction se prépare aujourd'hui.'(...)
Pour le rapporteur la réponse au problème de la crise du mouvement ouvrier ne pouvait pas consister en l'effort de souder les rangs dispersés des révolutionnaires pour redonner au prolétariat son organe politique indispensable, le parti (...), mais bien de lancer le mot d'ordre 'sortir des PC sans aucune autre indication, puisque 'il n'existe pas de solution immédiate au problème que pose cette trahison.' (...)
S'il était vrai que les dommages provoqués par le centrisme avaient fini par immobiliser la classe, politiquement désarmée, dans les mains du capitalisme (...), il était tout aussi vrai que la seule possibilité d'organiser une quelconque opposition à la tentative de l'impérialisme de résoudre ses propres contradictions par la guerre, passait par la reconstruction de nouveaux partis (...) de façon à ce que l'alternative guerre ou révolution ne soit pas seulement un slogan dont on se gargarise.
Les thèses de Jacobs créèrent au sein du congrès de la Fraction une forte opposition qui (...) divergeait sur l'analyse attentiste du rapporteur. Pour Gatto (...), il était urgent de clarifier le rapport Fraction-Parti, pas sur la base de petites formes mécaniques, mais bien sur la base des tâches précises qu'imposait la nouvelle situation :
'nous sommes d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas passer immédiatement à la fondation du parti, mais par ailleurs, il peut se présenter des situations qui nous imposent la nécessité de passer à sa constitution. La dramatisation du rapporteur peut conduire à une espèce de fatalisme.' Ce souci n'était pas vain puisque la Fraction devait rester dans l’attente jusqu'à son acte de dissolution en 1945."
Battaglia affirme ensuite que la Fraction est restée paralysée par celte divergence, en notant que "le courant partidiste , demeuré toutefois dans l'immobilisme le plus absurde, restait cohérent avec les positions exprimées au congrès, alors que dans le courant ' attentiste', et tout particulièrement chez son élément le plus prestigieux, Vercesi, les hésitations et les changements de route ne manquèrent pas. "
Les conclusions politique de Battaglia sur ce point sont inévitables : "soutenir que le parti ne peut surgir qu'en relation avec une situation révolutionnaire où la question du pouvoir est à l'ordre du jour, alors que dans les phases contre-révolutionnaires le parti 'doit' disparaître ou laisser la place aux fractions" signifie "priver la classe dans les périodes les plus dures et délicates d'un minimum de référence politique" avec "pour seul résultat de se faire dépasser par les événements. "
Comme on le voit, nous n'avons pas lésiné sur la place pour retracer de la façon la plus fidèle possible la position de Battaglia, de manière à la faire connaître aux camarades qui ne lisent pas l'italien. Pour résumer, Battaglia affirme que :
a) depuis sa fondation jusqu'au congrès de 1935, la Fraction ne faisait que défendre en réalité sa transformation en Parti de la reprise de la lutte de classe,
b) la minorité même qui défendait en 35 la formation du Parti, est restée politiquement cohérente, mais dans l'immobilisme pratique le plus complet les années suivantes (c'est-à-dire dans les années des occupations d'usines en France et de la Guerre d'Espagne) ;
c) les fractions (considérées comme des "organismes pas très bien définis", "des succédanés") ne sont pas en mesure d'offrir un minimum de référence politique au prolétariat dans les périodes contre-révolutionnaires. Ce sont là trois déformations de l'histoire du mouvement ouvrier. Voyons pourquoi.
LES CONDITIONS POUR LA TRANSFORMATION DE LA FRACTION EN PARTI
Battaglia soutient que le lien entre la transformation en parti et la reprise de la lutte de classe est une nouveauté introduite en 1935 dont on ne trouve pas trace si on remonte à la naissance de la Fraction en 1928. Mais si on veut remonter dans le temps, pourquoi s'arrêter en 1928 ? Il vaut mieux aller jusqu'en 1922, aux Thèses de Rome légendaires (approuvées par le 2ème congrès du PC d'Italie), qui constituent par définition le texte de base de la Gauche italienne :
"Le retour, sous l'influence de nouvelles situations et d'incitations à l'action exercées par les événements sur la masse ouvrière, à l’organisation d'un véritable Parti de classe, s'effectue sous la forme d'une séparation d'une partie du Parti qui, à travers les débats sur le programme, la critique des expériences défavorables à la lutte, et la formation au sein du Parti d'une école et d'une organisation avec sa hiérarchie (fraction), rétablit cette continuité dans la vie d'une organisation unitaire fondée sur la possession d'une conscience et d'une discipline d'où surgit le nouveau Parti."
Comme on le voit, les textes de base mêmes de la Gauche sont très clairs sur le fait que la transformation de la fraction en parti n'est possible que "sous l'influence de nouvelles situations et d'incitations à l'action exercées par les événements sur la masse ouvrière."
Mais venons-en à la Fraction et à son texte de base sur la question, "Vers l'Internationale 2 et 3/4 ?", publié en 1933 et que Battaglia considère comme "bien plus dialectique" que la position de 1935 :
"La transformation de la fraction en Parti est conditionnée par deux éléments intimement liés :
1. L'élaboration, par la fraction, de nouvelles positions politiques capables de donner un cadre solide aux luttes du Prolétariat pour la Révolution dans sa nouvelle phase plus avancée. (...)
2. Le renversement des rapports de classe du système actuel (...) avec l'éclatement de mouvements révolutionnaires qui pourront permettre à la Fraction de reprendre la direction des luttes en vue de l’insurrection." (Bilan n°l)
Comme on le voit, la position est restée identique à celle de 1922 et ne varie pas si on prend en considération les textes de base qui ont suivi. Nous lisons dans le "Rapport sur la situation en Italie" d'août 1935 :
"Notre fraction pourra se transformer en parti dans la mesure où elle exprimera correctement l'évolution du prolétariat qui sera à nouveau jeté sur la scène révolutionnaire et démolira le rapport de force actuel entre les classes. Tout en ayant toujours, sur la base des organisations syndicales, la seule position pouvant permettre la lutte des masses, notre fraction doit s'acquitter du rôle qui lui revient : formation des cadres en Italie aussi bien que dans l’émigration. Les moments de sa transformation en parti seront les moments mêmes de l’ébranlement du capitalisme."
Sur ce point, prenons directement en considération la phrase que Battaglia elle-même rapporte sur le Rapport pour le Congrès de 1935, en jugeant que "les termes de la question semblaient assez clairs." Dans cette phrase, on affirme textuellement que la transformation de la fraction en Parti est possible "dans les moments où la confrontation entre les classes balaie l'opportunisme"? C’est-à-dire, dans un moment de reprise du mouvement de classe." Effectivement, les termes de la question semblaient déjà clairs dans cette phrase. Par ailleurs, pour lever tous les doutes, il faut lire quelques lignes plus loin :
"La classe se retrouve donc dans le parti au moment où les conditions historiques déséquilibrent les rapports des classes et ï affirmation de V existence du parti est alors l’affirmation de la capacité d'action de la classe."
Plus clair que cela, on meurt ! Comme le disait souvent Bordiga, il suffit de savoir lire. Le problème, c'est que quand on veut réécrire l'histoire avec les lunettes déformantes d'une thèse préétablie, on est obligé de lire le contraire de ce qui est écrit.
Mais le plus stupéfiant, c'est que pour retomber sur leurs pieds, les camarades de Battaglia sont obligés de devenir incapables de lire ce qu'eux-mêmes ont écrit à propos du congrès de la Fraction en 1935 :
"Il convient ici de rappeler que la Gauche italienne abandonne le titre de ‘Fraction de gauche du PCI' pour celui de 'Fraction italienne de la Gauche Communiste Internationale' à un Congrès de 1935. Cela lui fut imposé du fait que contrairement à ses prévisions, la trahison ouverte des PC opportunistes au prolétariat n'attendit pas l'éclatement de la seconde guerre. (...) Le changement de titre marquait à la fois une prise de position par rapport à ce 'tournant' des PC officiels, et le fait que les conditions objectives ne permettaient toujours pas de passer à la formation de nouveaux partis. "
Comme à notre habitude, nous ne nous sommes pas appuyés sur telle ou telle phrase dite incidemment par tel ou tel membre de Battaglia, mais nous avons cité la Préface politique par laquelle le PCInt (Battaglia), en mai 1946, présentait aux militants des autres pays sa Plate-forme Programmatique, tout récemment adoptée à la Conférence de Turin. Ce même document de base, destiné à expliquer la filiation historique existante entre le PC d'Italie de Livourne 1921, la fraction à l'étranger et le PCInt de 1943, exprimait clairement qu'un des points clés de démarcation avec le trotskysme concernait : "...les conditions objectives requises pour que le mouvement communiste se reconstitue en partis influençant effectivement les masses, conditions dont Trotski ou bien ne tenait pas compte, ou dont une analyse erronée des perspectives lui faisait admettre l'existence dans la situation en cours. D'une part elle établissait (s’appuyant sur l'expérience de la fraction bolchevique) que le cours déformation du parti était essentiellement un cours où, la lutte de classe se livrant dans des conditions révolutionnaires, les prolétaires étaient amenés à se regrouper autour d'un programme marxiste restauré contre l'opportunisme et défendu jusque là par une minorité."
Comme on le voit, le PCInt lui-même dans ses textes officiels de 1946, ne s'écartait pas d'une virgule de la position sur cette question de la Fraction, dont, par ailleurs, il revendiquait officiellement les positions politiques. Celle qui, au contraire, s'en écarte si rapidement qu'elle en devient insaisissable, c'est bien Battaglia qui, dans la même discussion, réussit à aligner au moins quatre positions différentes. La concomitance entre reprise de la lutte de classe et reconstruction du Parti est en fait qualifiée par BC de :
a) somme toute "hypothétisable", de 1927 à 1935 ;
b) "fataliste" et "dans ses grandes lignes, mécaniciste", s'il s'agit de la Fraction entre 1935 et 1945 ;
c) tout à fait correcte, c'est ce qui ressort des textes, s'il s'agit du PCInt en 1946 ;
d) redevient "une conception anti-dialectique et liquidatrice" dans la nouvelle Plate-forme approuvée par Battaglia en 1952, dont on parlera plus en détail dans un second article. Mais laissons de côté les zigzags intéressés de Battaglia, et retournons au congrès de 1935.
LE DEBAT DE 1935 : FATALISME OU VOLONTARISME
De ce qui est écrit plus haut, on peut voir que ce n'est pas la majorité du congrès qui a introduit de nouvelles positions, mais la minorité qui a remis en question celles de toujours, en reprenant les formulations des adversaires politiques de la Fraction. Ainsi, Gatto accuse de "fatalisme' un rapport qui cependant répondait aux accusations de fatalisme qui étaient lancées à la Fraction par ceux-là qui, trotskystes en tête, refusaient le travail de fraction pour l'illusion de "mobiliser les masses". Piero affirme que "notre orientation doit changer, nous devons rendre notre presse plus accessible aux ouvriers", en faisant concurrence aux pseudo "ouvriers de l'opposition", spécialistes pour "accrocher les masses" moyennant l'adulation systématique de leurs illusions. Tullio tire des conclusions logiques en apparence : "si nous disons que quand il n'y a pas de parti de classe, il manque la direction, nous voulons dire que celle-ci est indispensable même dans les périodes de dépression", publiant cependant que Bilan avait déjà répondu à Trotsky :
"De la formule, la Révolution est impossible sans Parti communiste, on tire la conclusion simpliste qu'il faut déjà dès maintenant construire le nouveau Parti. C'est comme si des prémisses : sans insurrection, on ne peut plus défendre les revendications élémentaires des travailleurs, on déduisait lé nécessité de déchaîner immédiatement l'insurrection." (Bilan n°l.)
En réalité, ce qui ne tient pas, c'est la tentative de Battaglia de présenter le débat comme une confrontation entre ceux qui veulent le Parti déjà bien trempé au moment des affrontements révolutionnaires et ceux qui veulent l'improviser au dernier moment. La majorité du Congrès, à qui était posée l'alternative ridicule : "mais est-il nécessaire d'attendre que lies événements révolutionnaires se présentent pour passer à la fondation du nouveau parti, ou, inversement, ne serait-il pas mieux que les événements se manifestent avec la présence du parti " avait déjà répondu une fois pour toutes : "Si, pour nous, ce problème se limitait à un simple problème de volonté, nous serions tous d'accord et il n'y aurait personne qui s'efforcerait de discuter."
Le problème qui était posé au Congrès n'était pas un problème de volonté, mais de volontarisme, comme les années suivantes 1'ont démontré.
LE DEBAT DE 1935-37 : VERS LA GUERRE IMPERIALISTE OU VERS LA REPRISE DE CLASSE
En présentant le débat de 1935 comme une confrontation entre ceux qui voulaient le parti indépendamment des conditions objectives et ceux qui se "réfugiaient" dans l'attente de telles conditions, Battaglia oublie ce que la Préface de 1946 avait mis au clair, c'est que : "les constructeurs de Parti" ne se limitent pas à sous-estimer ou à ignorer les conditions objectives, mais ils sont aussi, nécessairement poussés "à admettre l'existence de telles conditions, sur la base d'une fausse analyse des perspectives." Et c'est justement cela le centre de la discussion en 1935, qui semble échapper complètement à Battaglia. La minorité activiste ne se borne pas à affirmer son "désaccord sur la constitution du parti seulement en période de reprise prolétarienne", mais est nécessairement contrainte de développer une fausse analyse des perspectives qui lui permette d'affirmer que s'il n'y a pas encore de véritable reprise prolétarienne, il y a cependant les premiers mouvements annonciateurs dont il faut prendre la direction, et ainsi de suite. Au congrès, cette remise en discussion des analyses de la Fraction sur le cours à la guerre impérialiste n'a pas été développée ouvertement par la minorité qui, probablement, ne se rendait pas encore bien compte de là où sa manie de fonder des partis devait nécessairement la conduire. Cette ambiguïté explique qu'à côté des activistes déclarés, provenant en grande partie du défunt "Réveil communiste", se trouvaient des camarades comme Tullio et Gatto Mammone, qui se sépareront de la minorité dès que le véritable objet de la discussion deviendra clair. Mais si la minorité ne révèle pas encore l'étendue de ses divergences (approuvant le rapport de Jacobs à l'unanimité), les éléments les plus lucides de la majorité en voient déjà toute l'ampleur :
"Il est facile d'apercevoir cette tendance, quand on examine la position soutenue par des camarades envers de récents conflits de classe, où ceux-ci défendirent que la fraction pouvait assurer également, dans la phase actuelle de décomposition du prolétariat, une fonction de direction dans ce mouvements, faisant par là abstraction du véritable rapport entre les forces" (Eieri)
"Ainsi, comme la discussion Va prouvé, on pourrait croire que nous puissions intervenir dans les événements actuels de désespoir (Brest-Toulon) pour en diriger le cours (...) Croire que la fraction puisse diriger des mouvements de désespoir prolétarien, c'est compromettre son intervention dans les événements de demain." (Jacobs)
Les mois suivant le Congrès voient une polarisation grandissante des deux tendances. Ainsi, Bianco, dans son article "Un peu de clarté, s'il vous plaît" (Bilan n° 28, janvier 1936), dénonce-t-il le fait que des membres de la minorité déclarent désormais ouvertement qu'ils rejettent le rapport de Jacobs qu'ils venaient à peine d'approuver, et attaque en particulier : "le camarade Tito qui est prolixe en gros mots comme 'changer de ligne' ; ne pas se borner à être présents 'mais prendre la tête, la direction du mouvement de renaissance communiste' : d'abandonner, en vue de former un organisme international, tout 'apriorisme obstructionniste' et 'nos scrupules de principe'. "
Les regroupements définitifs se font désormais jour (même si Vercesi dans le même numéro de Bilan tente de minimiser la portée des divergences). Déjà dans le numéro précédent du journal en langue italienne, Prometeo,Gatto avait pris ses distances avec la minorité, réaffirmant que "la Fraction s'exprimera comme parti dans le feu des événements" et pas avant que le prolétariat ne déchaîne "sa bataille émancipatrice."
Mais pour comprendre l'ampleur des errements que la minorité se préparait à faire, il faut prendre un peu de recul et considérer le rapport de force entre les classes dans ces années décisives et l'analyse qu'en faisaient les différentes forces de gauche. La Gauche italienne caractérisait la période comme contre-révolutionnaire se basant sur la dure réalité des faits : 1932, éradication politique des réactions au stalinisme, avec l'exclusion hors de l'Opposition de Gauche, de la Gauche italienne et des autres forces qui ne s'accommodaient pas des zigzags de Trotski ; 1933, écrasement du prolétariat allemand ; 1934, écrasement du prolétariat espagnol des Asturies ; 1935, écrasement du prolétariat autrichien, embrigadement du prolétariat français derrière le drapeau tricolore de la bourgeoisie. Face à cette course folle vers un massacre mondial, Trotski fermait les yeux pour maintenir le moral des troupes. Pour lui, jusqu'en 1933, le PC allemand pourri était toujours "la clé de la Révolution mondiale" ; et, si en 1933, le PC allemand s'écroulait face au nazisme, alors, ça voulait dire que la voie était dégagée pour fonder un nouveau parti, aussi bien qu'une nouvelle internationale, et si les militants contrôlés par le stalinisme n'y étaient pas, alors c'était l'aile gauche de la social-démocratie qui "évoluait vers le communisme", et ainsi de suite... Le manoeuvriérisme opportuniste de Trotski suscita donc des scissions à gauche de groupes de militants qui se refusaient à le suivre sur cette voie (Ligue des Communistes Internationalistes en Belgique, Union Communiste en France, Revolutionary Workers League en Amérique, etc.). Jusqu'en 1936 de tels groupes paraissaient se situer à mi-chemin entre la rigueur de la Gauche italienne et les acrobaties de Trotski. L'épreuve de 1936 prouvera que leur solidarité avec le trotskysme était beaucoup plus solide que leurs divergences. 1936 représente, dans les faits, le dernier sursaut désespéré de classe du prolétariat européen : entre mai et juillet, se succédèrent les occupations d'usines en France, la vague de lutte en Belgique, la réponse de classe du prolétariat de Barcelone au coup de Franco, à la suite de laquelle les ouvriers resteront pendant une semaine entière maîtres de la Catalogne. Mais c'est le dernier soubresaut. En l'espace de quelques semaines, le capitalisme réussit non seulement à circonscrire ces réactions, mais même à les dénaturer complète ment, en les transformant en des moments d'Union Sacrée pour la défense de la démocratie. Trotski ignore cette récupération, lui qui proclame que "la Révolution est commencée en France" et qui pousse le prolétariat espagnol à s'enrôler comme chair à canon dans les milices antifascistes pour défendre la république. Toutes les dissidences de gauche, de la LCI à l'UC, de RWL à une bonne partie des communistes de conseils s'y laissent prendre, au nom de "la lutte armée contre le fascisme", La minorité même de la Fraction italienne adhère dans les faits aux analyses de Trotski, proclamant qu'en Espagne, la situation reste "objectivement révolutionnaire" et que dans les zones contrôlées par les milices on pratique la collectivisation "sous le nez des gouvernements de Madrid et de Barcelone" (Bilan n°36, Documents de la minorité). L'Etat bourgeois survit et renforce son contrôle sur les ouvriers ? Il ne s'agit que d'une "façade", d'une "enveloppe vide, un simulacre, un prisonnier de la situation " parce que le prolétariat espagnol, en soutenant la République bourgeoise, ne soutient pas l'Etat, mais la destruction prolétarienne de l'Etat. En cohérence avec cette analyse, beaucoup de ses membres se rendirent en Espagne pour s'enrôler dans les milices antifasciste gouvernementales. Pour Battaglia, ces sauts périlleux à 360° veulent dire rester "cohérents avec eux-mêmes dans le plus complet immobilisme." Etrange conception de la cohérence de l'immobilisme
En réalité, la minorité a abandonné le cadre d'analyse de la Fraction, pour reprendre intégralement les acrobaties dialectiques de Trotski, contre lesquelles la Fraction avait déjà écrit, à l'occasion du massacre des mineurs dans les Asturies par la République démocratique en 1934 :
"Le terrible massacre de ces derniers jours en Espagne devrait mettre fin aux jeux d' équilibristes selon lesquels la République est certainement 'une conquête ouvrière' à défendre,mais à 'certaines conditions' et surtout dans 'la mesure où' elle n'est pas ce qu'elle est, ou à la condition qu'elle 'de vienne' ce qu'elle ne peut devenir, ou enfin, si, loin d'avoir la signification et les objectifs qu'elle a effectivement, elle s'apprête à devenir l'organe de la domination de la classe travailleuse. " (Bilan n° 12, octobre 1934.)
LA LIGNE DE PARTAGE HISTORIQUE DES ANNEES 1935-37
Seule la majorité de la Fraction italienne (et une minorité des communistes de conseils) restait sur la position défaitiste de Lénine face à la guerre impérialiste d'Espagne. Mais ce n'est que la Fraction qui tire toutes les leçons de ce tournant historique, en niant qu'il existerait encore des situations d'arriération où on pourrait lutter transitoirement pour la démocratie, ou pour la libération nationale, et en caractérisant comme bourgeoise et comme instrument de la guerre impérialiste toute forme de milice partisane antifasciste. Il s'agit de la position politique indispensable pour rester internationaliste dans le massacre impérialiste qui se prépare et, par conséquent, avoir les cartes en main pour contribuer à la renaissance du futur Parti communiste mondial. Les positions de la Fraction depuis 1935 (guerre sino-japonaise, guerre italo-abyssinienne) jusqu'en 1937 (guerre d'Espagne) constituent donc la ligne de partage historique qui signe la transformation de la Gauche italienne en Gauche communiste internationaliste et sélectionne les forces révolutionnaires à partir de ce moment-là.
Et quand nous parlons de sélection, nous parlons de sélection sur le terrain et pas dans les petits schémas théoriques dans la tête de quelques-uns. A la faillite en Belgique de la Ligue des Communistes répond l'apparition d'une minorité qui se constitue en Fraction belge de la Gauche communiste. A la faillite d'Union communiste en France répond la sortie de quelques militants qui adhèrent à la Fraction italienne et qui seront à l'origine, en pleine guerre impérialiste, de la Fraction française de la Gauche communiste. A la faillite en Amérique de la Revolutionary Workers League et de la Liga Comunista mexicaine correspond la rupture d'un groupe de militants mexicains et immigrés oui se constituent en Groupe des travailleurs marxistes sur les positions de la Gauche Communiste Internationale. Aujourd'hui encore, seuls ceux qui se situent en continuité absolue avec ces positions de principe, sans distinguo ou recherche d'une "troisième voie", ont aujourd'hui les bonnes cartes pour contribuer à la renaissance du Parti de classe.
Le CCI, comme on le sait, revendique intégralement cette délimitation programmatique. Mais quelle est la position de Battaglia ?
"Les événements de la Révolution espagnole ont mis en évidence les points forts comme les points faibles de notre propre tendance : la majorité de Bilan apparaît comme attachée à une formule, théoriquement impeccable qui a cependant le défaut de rester une abstraction simpliste ; la minorité apparaît, de son côté, dominée par le souci d'emprunter, de toute façon, le chemin d'un participationnisme qui n'a pas toujours été assez prudent pour éviter les pièges du jacobinisme bourgeois, même quand on est sur les barricades.
Puisqu'il existait la possibilité objective, nos camarades de Bilan auraient dû poser le problème, le même que devait poser plus tard notre parti face au mouvement de partisans, en appelant les ouvriers qui s'y battaient à ne pas tomber dans le piège de la stratégie de la guerre impérialiste"
Cette position que nous citons d'un numéro spécial de Prometeo consacré à la Fraction en 1958, n'est pas accidentelle, mais a été réaffirmée plusieurs fois, même récemment ([2] [1615]) Comme on le voit, Battaglia se détermine pour une troisième voie, éloignée autant des abstractions de la majorité que de la participation de la minorité. Mais s'agit-il vraiment d'une troisième voie ou d'une reprise pure et simple des positions de la minorité ?
LA GUERRE D'ESPAGNE :
"PARUCIPATIONNISME"
OU "DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE" ?
Quelle est l'accusation portée à la majorité ? D'être restée inerte face aux événements, de s'être contentée d'avoir raison en théorie, sans cependant se donner la peine d'intervenir pour défendre une orientation correcte parmi les ouvriers espagnols. Cette accusation reprend mot à mot celle exprimée à ce moment-là par la minorité, les trotskystes, les anarchistes, les Poumistes, etc. : "dire aux ouvriers espagnols ce danger vous menace et ne pas intervenir nous mêmes pour combattre ce danger, c'est une manifestation d'insensibilité et de dilettantisme." (Bilan n°35, Textes de la minorité). Une fois établi que les accusations sont identiques, il faut encore dire qu'il s'agit de mensonges éhontés. La majorité s'est immédiatement mise à combattre aux côtés du prolétariat espagnol sur le front de classe, et pas dans les tranchées. Si on veut faire la différence avec la minorité, c'est que cette dernière a abandonné l'Espagne à la fin de 1936, tandis que la majorité y continuait son activité politique, jusqu'en mai 1937, quand son dernier représentant, Tulho, retourne en France, pour annoncer à la Fraction et aux ouvriers du monde entier que la République antifasciste en était venue à massacrer directement les prolétaires en grève à Barcelone.
Certes la présence de la majorité était plus discrète que celle des minoritaires qui avaient à leur disposition pour leurs communiqués la presse du Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM) de gouvernement, et qui devenaient généraux de brigade sur le front d'Aragon, comme leur porte-parole Condiari. Mitchell, Tullio, Candali, qui représentaient la majorité, agissaient au contraire dans la plus stricte clandestinité, avec le risque constant d'une arrestation par les escouades staliniennes -qui les recherchaient, d'être dénoncés par le POUM ou des anarchistes qui les considéraient plus ou moins comme des espions fascistes. Dans ces terribles conditions, ces camarades continuèrent à combattre pour soustraire au moins Quelques militants à la spirale de la guerre impérialiste, affrontant non seulement les risques mais aussi l'hostilité et le mépris des militants avec qui ils discutaient. Même les éléments les plus lucides, comme l'anarchiste Bemeri (ensuite assassiné par les staliniens) étaient déboussolés par l'idéologie au point de se faire les promoteurs de l'extension du régime d'économie de guerre - et de la militarisation de la classe qui en découlait - à toutes les usines plus ou moins grandes, et étaient totalement incapables de comprendre où se trouvait la frontière de classe, jusqu'à écrire que "les trotskystes, les bordiguistes, les staliniens, ne sont divisés que sur quelques conceptions tactiques". (Guerre de classe, octobre 1936). Malgré le fait que toutes les portes se soient claquées devant eux, les camarades de la majorité continuaient à frapper à r toutes les portes : c'est ainsi qu'en sortant d'une énième discussion infructueuse au local du POUM, ils trouvèrent les "killers" staliniens qui les attendaient et qui par pur hasard ne réussirent pas à les éliminer.
Notons au passage que la minorité qui en 1935 criait que le Parti devait être prêt à l'avance par rapport aux affrontements de classe théorise alors qu'en Espagne, c'est la révolution et qu'elle va vaincre, sans même une once de parti de classe. Au contraire, la majorité considère le parti comme le centre de son analyse et déclare qu'il ne peut y avoir de révolution en cours, étant donné qu'il ne s'est formé aucun parti et qu'il n'y a même pas la moindre tendance à l'apparition de petits noyaux qui iraient dans ce sens, malgré l'intense propagande faite par la fraction dans ce but. Ce n'était pas dans la majorité que se trouvaient ceux qui sous-estimaient l'importance du Parti... et de la Fraction. Face au naufrage de la minorité, qui à la fin eut l'illusion de trouver le parti de classe au sein du POUM, parti de gouvernement, on peut mesurer toute la justesse des mises en garde de la majorité au congrès de 1935, sur le danger d'en arriver "à dénaturer les principes mêmes de la Fraction."
Pour Battaglia, la minorité s'est rendue coupable d'un "participationnisme pas toujours (!) Assez prudent pour éviter les pièges bourgeois." Que veut dire une formulation aussi vague ? La différence entre la majorité et la minorité réside justement en ceci, que la première est intervenue pour convaincre au moins une avant-garde réduite de déserter la guerre impérialiste, alors que la seconde est intervenue pour y participer, à travers l'enrôlement volontaire dans les milices gouvernementales. Certes, Battaglia posséderait un atout extraordinaire dans sa manche si elle connaissait un moyen de participer à la guerre impérialiste qui soit tellement "prudent" que cela ne fasse pas le jeu de la bourgeoisie... Qu'est-ce que ça veut dire que la majorité aurait dû se comporter comme l’a fait ensuite le PCInt "face au mouvement des partisans" ? Cela signifie peut-être qu'elle aurait dû lancer l'appel au "front unique" aux partis staliniens, socialistes, anarchistes et poumistes, comme le PCInt l'a fait en 1944, en proposant le front unique aux Comités d'Agitation des PCI, PSI, PRI et anarcho-syndicalistes ? Battaglia pense probablement que "puisque les conditions objectives existaient", de telles propositions "concrètes" auraient permis à la Fraction de faire sortir de son chapeau de magicien le parti qui manquait tant. Espérons que Battaglia n'ait pas d'autres atouts dans sa manche, d'autres expédients miraculeux capables de transformer une situation objective contre-révolutionnaire en son exact contraire, chose certainement possible, "mais à certaines conditions" et surtout "dans la mesure où elle n’est pas ce qu'elle est", ou à la condition qu'elle "devienne ce qu'elle ne peut devenir" (Bilan n°12.)
Le problème est autre, c'est que Battaglia s'éloigne de la Fraction, dont elle se réclame pourtant, au moins sur deux points essentiels, les conditions pour la fondation de nouveaux partis et l'attitude à avoir, en période globalement contre-révolutionnaire, dans la confrontation avec des formations à façade prolétarienne, comme les milices antifascistes. Dans le prochain article, qui traitera de la période de 1937 à 1952, nous venons comment ces incompréhensions se manifestent ponctuellement dans la fondation du PCInt en 943 et dans 'ambiguïté de son attitude envers les partisans.
En nous penchant sur cette période tragique pour le mouvement ouvrier, nous démontrerons en outre combien est fausse l'affirmation de Battaglia qui dénie à un organe comme la Fraction toute capacité d'offrir à la "classe un minimum d'orientation politique dans les périodes les plus dures et délicates."([3] [1616])
Beyle
[1] [1617] Sur la Guerre d'Espagne, voir les articles dans la Revue Internationale n*50 et 54. Sur la Fraction italienne et ses positions politiques, voir les divers articles et documents publiés dans la Revue Internationale, et notre livre "La gauche communiste d'Italie. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire" paru en français et italien (et prochainement en espagnol) ainsi que son "Complément" traitant des "Rapports entre la fraction de gauche du P.C. d'Italie et l'opposition de gauche internationale, 1929-1933".
[2] [1618] Dans l'article "Le CCI et le cours historique", BC n*3, 1987, Battaglia force la dose : "la Fraction (...) évaluait dans les années 30 la perspective de la guerre comme un absolu", ce qui l'aurait conduite "à commettre des erreurs politiques", comme "la liquidation de toute possibilité d'intervention révolutionnaire en Espagne avant même que le prolétariat n'ait été défait."
[3] [1619] Ces attaques à la Fraction, du nom de laquelle Battaglia se revendique, sont d'autant plus significatives qu'elles se produisent à un moment où différents groupes bordiguistes commencent à redécouvrir la Fraction après le silence entretenu par Bordiga (voir les articles parus dans "Il Comunista" de Milan, et la republication par "Il Partito Comunista" de Florence, du manifeste de la Fraction sur la Guerre d'Espagne). Battaglia et les bordiguistes en seraient-ils à s'échanger leurs rôles ?
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [449]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [382]