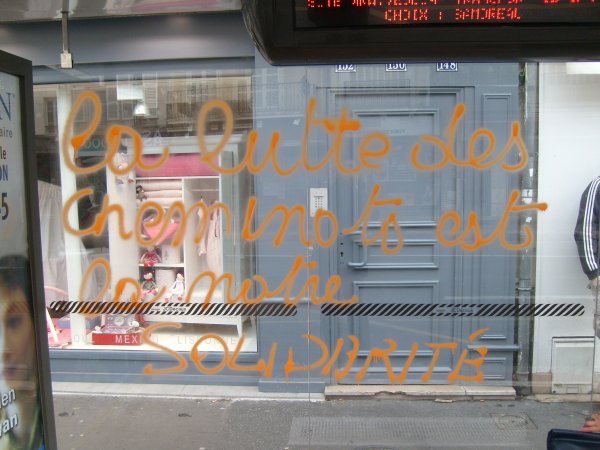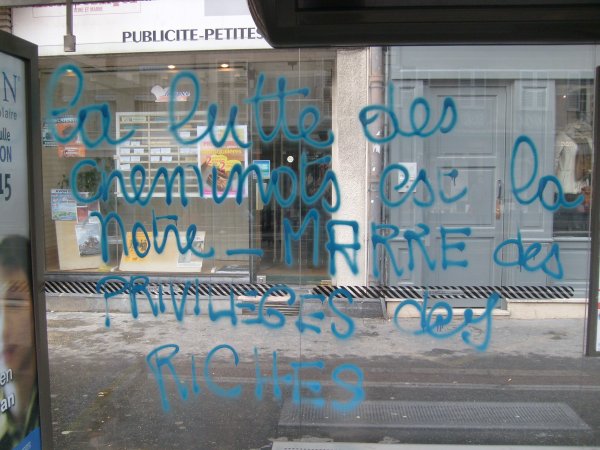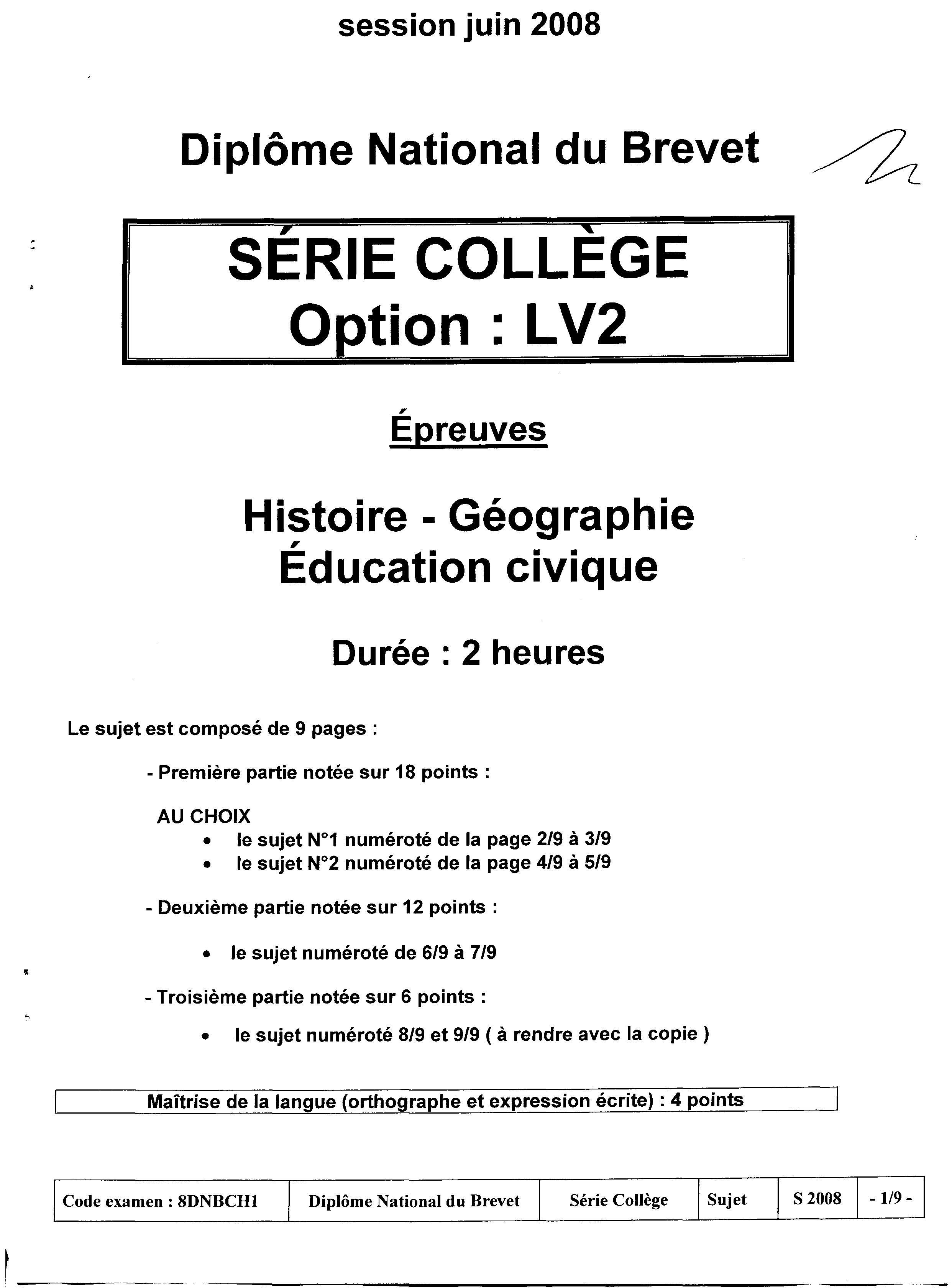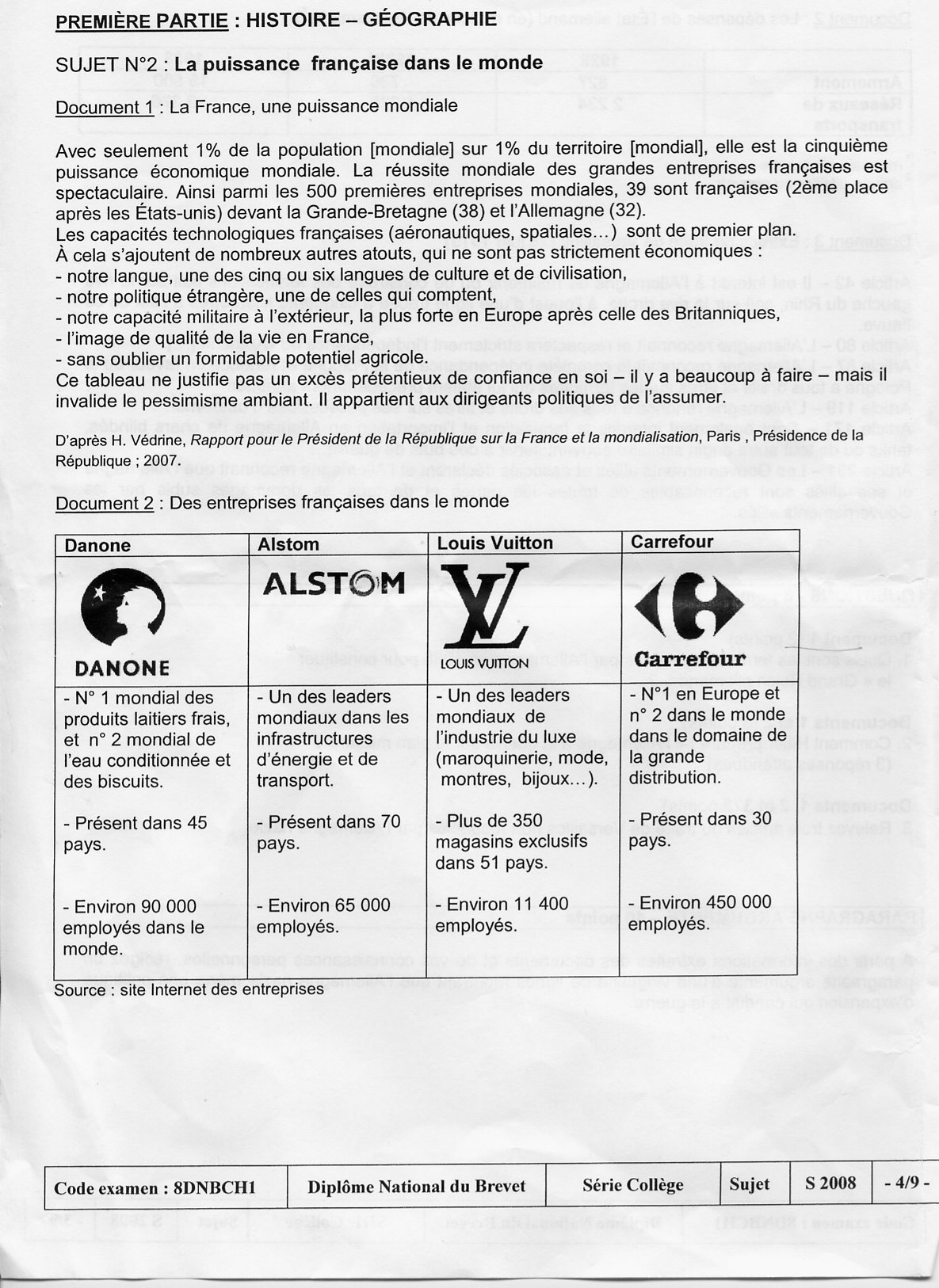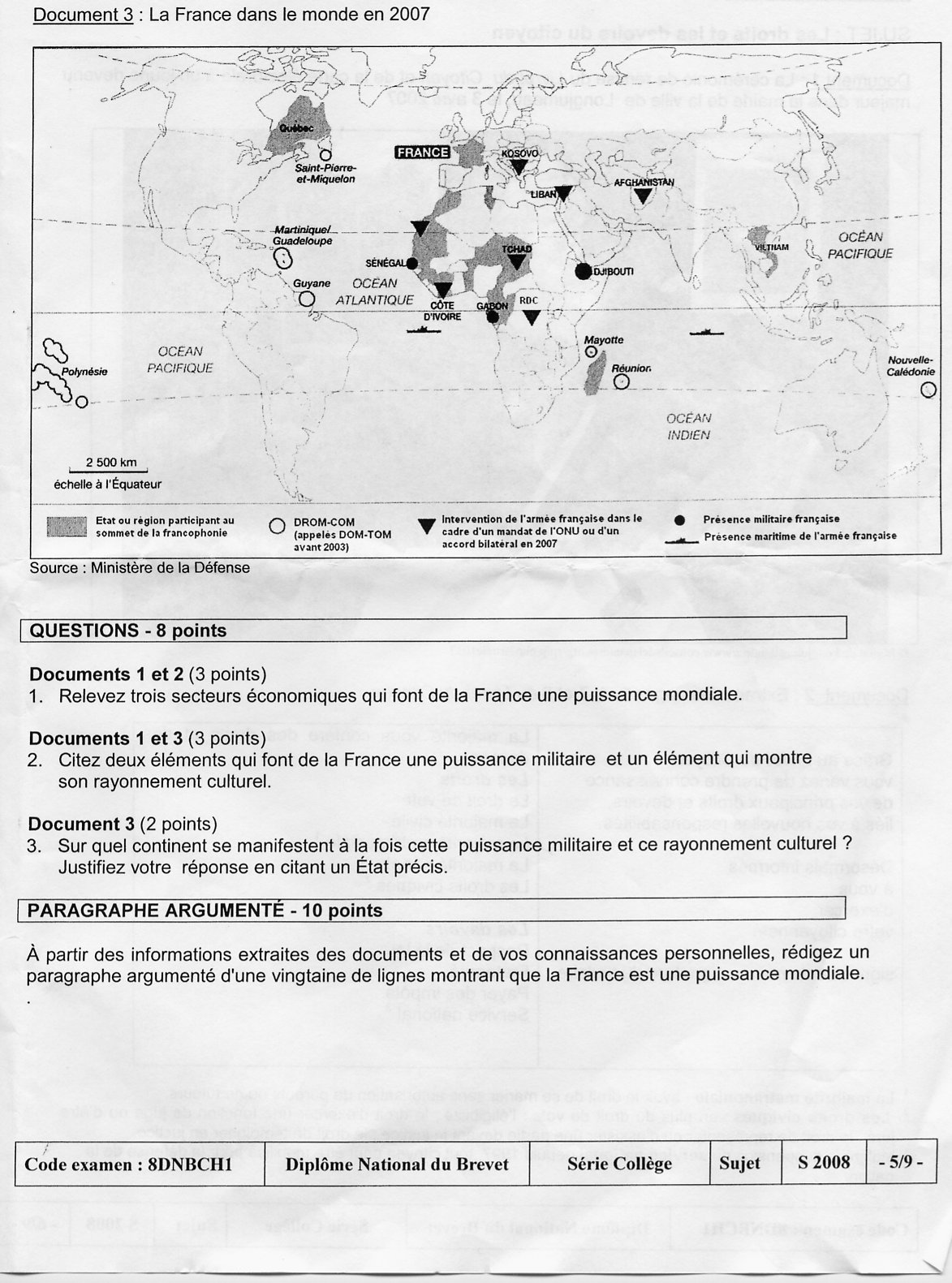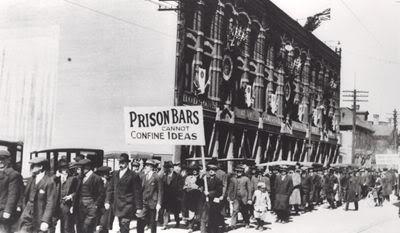ICConline - années 2000
- 2174 lectures
Structure du Site:
- ICConline [1]
ICConline - 2002
- 5529 lectures
Communiqué à nos lecteurs - Une attaque parasitaire visant à discréditer le CCI
- 2901 lectures
De tout temps les organisations révolutionnaires ont eu à se défendre contre des tentatives visant à les discréditer (voir notre article "le combat des organisations révolutionnaires contre la provocation et la calomnie" paru dans Révolution Internationale n°321 ou voir ici [2]) et le CCI, tout au long de son existence, n'a pas été épargné.
Aujourd'hui, à nouveau, il est la cible d'une attaque destructrice de la part d'un petit nombre de ses militants "mécontents", pratiquant depuis plusieurs mois en notre sein une véritable politique de la terre brûlée. A leur actif, un texte portant des attaques très violentes contre notre organisation, intitulé "On dit qu'ils ont la rage !" et que certains de nos abonnés ont reçu par le courrier. Ce texte a également été diffusé lors de la réunion publique du CCI à Paris du 16 mars, en même temps qu'un autre texte intitulé "de nouvelles exclusions du CCI". Nous tenons à effectuer cette première prise de position destinée à rétablir la réalité des faits face à un ensemble de mensonges et de calomnies. Nous reviendrons ultérieurement sur une analyse plus en profondeur concernant la signification de cette démarche consistant à couvrir de boue une organisation révolutionnaire.
Ces deux textes s'élèvent
contre des décisions et attitudes politiques du CCI qu'ils condamnent
:
- L'exclusion de Jonas, "militant fondateur du CCI, [qui] a comme seul tort d'avoir été l'un des premiers et l'un des plus déterminés à combattre, sans hésitation ni compromission, ce que nous étions, ces dernières années (et pas seulement en France) à analyser comme une dérive inquiétante au sein du CCI tant au niveau de son fonctionnement interne qu'au niveau de ses orientations politiques générales".
- Les "persécutions" dont serait aujourd'hui victime une "fraction"
au sein du CCI et qui est à l'origine des deux textes en question : "Ce
n'est pas actuellement un ex-militant isolé qui est traité comme
un malpropre et qui est exclu du CCI ; c'est l'exclusion d'une fraction qui
est à l'œuvre. Reste au CCI à trouver le justificatif "crédible"
pour rendre publique l'exclusion des autres membres de cette fraction, les uns
derrière les autres".
Toujours selon les auteurs de ces deux textes, cette situation serait le produit
d'une grave crise au sein de notre organisation ainsi caractérisée
: "Le CCI est aujourd'hui devant une contradiction flagrante entre l'image
qu'il veut se donner d'une organisation saine, ouverte, fraternelle, soucieuse
de la discussion et … sa réalité actuelle marquée
par le refus de toute expression divergente à l'intérieur, agrémentée
d'un régime de pression constante, de rumeurs, de calomnies à
l'égard de ses propres militants". En fait une situation de dégénérescence
comme le suggère par ailleurs l'un des deux textes : "L'accusation
'd'indignité politique' de la part du CCI nous fait autant d'effet que
celles portées par l'IC dégénérescente contre Bordiga,
Trotsky et tous les militants bolchéviks pour justifier leur exclusion".
Nous sommes donc en présence d'un groupe de militants, se proclamant
"fraction interne du CCI", qui prend la défense ouverte d'un
ancien militant du CCI, Jonas, dont nous avons rendu compte de l'exclusion à
travers un "Communiqué à nos lecteurs" publié
dans notre n° 321 de Révolution Internationale (et ou voir ici [3]).
L'exclusion de Jonas : celle d'un individu ayant le comportement d'un agent provocateur
Parmi les raisons que nous donnons pour cette exclusion il y a le motif suivant
: "Un des aspects les plus intolérables et répugnants de
son comportement est la véritable campagne qu'il a promue et menée
contre un membre de l'organisation (…) l'accusant dans les couloirs et
même devant des personnes extérieures au CCI de manipuler son entourage
et les organes centraux pour le compte de la police" (Communiqué
à nos lecteurs ). Les membres de la prétendue "fraction"
ne peuvent démentir ce fait patent au sein du CCI et, pas plus que Jonas
d'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. En réalité, "le fait
que Jonas ait refusé de rencontrer le CCI pour s'expliquer sur ses comportements
constitue en soi un aveu du fait qu'il est conscient d'être devenu un
ennemi juré de notre organisation malgré ses déclarations
théâtrales à ses 'camarades' qu'il présente en réalité
(à l'exception de ceux qu'il a réussi à entraîner
dans son sillage) soit comme des 'flics', soit comme des 'Torquemada', soit
comme de pauvres crétins 'manipulés'" (Ibid). En prononçant
la sanction d'exclusion de Jonas, nous n'avons fait que nous inscrire dans la
tradition de défense des organisations révolutionnaires au sein
du mouvement ouvrier. En effet, "depuis le début du mouvement ouvrier,
ses organisations politiques ont toujours fait la preuve de la plus grande sévérité
(consistant bien souvent dans l'exclusion) contre les auteurs, même de
bonne foi, d'accusations calomnieuses contre leurs militants …" .
Nous ayant récemment fait part de leur désaccord avec la décision
d'exclusion de Jonas, qu'ils considéraient comme étant inique,
ces militants de la "fraction" ont "exigé" du CCI
qu'il leur accorde une place dans les colonnes de sa presse pour qu'ils puissent
y exprimer leur point de vue.
On conçoit très bien que des faits retenus à charge contre
un militant puissent être contestés par lui-même ou par d'autres
(ce qui, rappelons-le, n'a pas été le cas concernant Jonas) mais
le cadre pour l'expression et la discussion de tels désaccords n'est
pas la presse. En effet, il existe pour cela des moyens spécifiques dont
se dotent les organisations de la classe ouvrière permettant que des
questions délicates puissent être discutées par des commissions
mandatées à cet effet. Il existe aussi, comme dernier recours,
la possibilité pour un militant qui estime avoir été injustement
déshonoré de faire appel à un jury d'honneur des groupes
de la Gauche communiste. Cette possibilité, nous l'avons évidemment
proposée à Jonas.
Par contre, nous avons accepté que les membres de la fraction expriment
dans nos colonnes un point de vue contradictoire concernant la sanction en précisant
: "Pour que cela soit productif, la défense d'un tel point de vue
devrait se référer de façon critique à notre article
'le combat des organisations révolutionnaires contre la provocation et
la calomnie' et en particulier il devrait montrer en quoi les précurseurs
du mouvement ouvrier se trompaient ou en quoi le changement des conditions historiques
fait que leur pratique en matière de défense de l'organisation
n'est plus valable aujourd'hui". A notre proposition la "fraction"
a répondu par l'envoi à nos abonnés, dans le dos du CCI,
de l'un de ces deux textes dénigrant notre organisation (des abonnés
nous en ont informé dés réception) et nous avons découvert
l'autre à l'occasion de sa diffusion lors de notre réunion publique
à Paris.
En réalité, le refus de Jonas de se défendre selon les
règles et les moyens en vigueur dans le mouvement ouvrier correspond
au fait que, ce qui l'intéresse avant tout, c'est que la bande d'amis
qui lui sont restés fidèles, regroupés en "fraction",
prenne sa défense en couvrant de boue le CCI. Ce à quoi "les
amis de Jonas" s'emploient effectivement.
La "fraction" : un corps parasite au sein du CCI
Et c'est bien une entreprise de destruction du CCI et de son milieu de contacts
à laquelle les amis de Jonas commencent à se livrer, à
l'extérieur de notre organisation, après l'avoir fait pendant
des mois l'intérieur de celle-ci. Pourquoi ce comportement ?
Ce n'est pas la première fois que le CCI est affecté par des problèmes
organisationnels. Il en a déjà largement rendu compte dans les
colonnes de sa presse notamment en ce qui concerne une tendance à la
personnalisation des questions politiques, en particulier en tant que conséquence
de la prédominance de critères affinitaires, de loyautés
individuelles au détriment de l'esprit de parti, lequel suppose le plein
développement de l'engagement et de la responsabilité individuelles
des militants au service du corps collectif que représente l'organisation.
De même, nous avons déjà mis en évidence des similitudes,
toutes proportions gardées, entre des problèmes nous ayant affecté
et des épisodes intervenus au 2e Congrès du POSDR (Parti Ouvrier
Social Démocrate de Russie) en 1903. Face à l'attitude des mencheviks,
aux attaques qui le prennent pour cible et à la subjectivité qui
a envahi Martov et ses amis, Lénine répond : "Sous le nom
de 'minorité' se sont groupés dans le Parti des éléments
hétérogènes qu'unit le désir conscient ou non, de
maintenir les rapports de cercle, les formes d'organisation antérieures
au parti". Ces éléments "lèvent naturellement
l'étendard de la révolte contre les restrictions indispensables
qu'exige l'organisation, et ils érigent leur anarchisme spontané
en principe de lutte, qualifiant à tort cet anarchisme... de revendication
en faveur de la 'tolérance', etc". Et encore : "Lorsque je considère
la conduite des amis de Martov après le congrès (...) je puis
dire seulement que c'est là une tentative insensée, indigne des
membres du parti, de déchirer le parti... Et pourquoi ? Uniquement parce
qu'on est mécontent de la composition des organismes centraux, car objectivement,
c'est uniquement cette question qui nous a séparés, les appréciations
subjectives (comme offense, insulte, expulsion, mise à l'écart,
flétrissure, etc.) n'étant que le fruit d'un amour-propre blessé
et d'une imagination malade" (Lénine, Relation du 2e congrès
du POSDR, Œuvres, Tome 7).
L'expérience historique des organisations révolutionnaires démontre
que les questions touchant à leur fonctionnement sont des questions politiques
à part entière méritant la plus grande attention, la plus
grande profondeur. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons dans notre
presse sur l'analyse des faiblesses qui ont permis que se répètent,
en notre sein, de telles difficultés. Pour l'instant nous décidons
de nous centrer sur les manifestations de ces difficultés.
C'est la remise en cause par le 14e Congrès du CCI de certaines orientations
qu'avaient défendues des camarades, dans et hors de l'ancien organe central,
qui a cristallisé leur mécontentement. A la différence
du 2e congrès du parti russe, ce n'est pas la composition des organes
centraux qui s'est trouvée en cause puisque ceux parmi ces camarades
qui en étaient membres ont été renommés par notre
congrès, lequel misait justement sur leur expérience et la confiance
que, jusqu'ici, ils avaient méritée de la part de l'organisation.
Ainsi, le 14e Congrès du CCI sait diagnostiquer, comme l'exprime la résolution
d'activité qu'il a adoptée, l'existence de dangers menaçant
le tissu organisationnel et le fonctionnement de notre organisation, en particulier
à travers la persistance de l'esprit de cercle, de clan, idée
à laquelle ces camarades étaient farouchement hostiles. Contre
leur positionnement antérieur, il met également en évidence
le danger d'euphorie en notre sein conduisant notamment à sous-estimer
de telles difficultés. Par ailleurs, la nomination par le congrès
d'une commission d'information destinée à faire la clarté
sur des dysfonctionnements ayant affecté les commissions permanentes
des organes centralisateurs fut vécue par ces camarades comme une véritable
menace et, très tôt, ils se mirent en devoir de saboter son travail.
Tout comme le parti bolchevik, avant sa dégénérescence
stalinienne, le CCI n'a pas une conception monolithique de l'organisation. L'existence
et l'expression de désaccords en son sein ne constituent pas pour lui
un problème en soi. L'existence de divergences est admise par nos statuts
et reconnue comme faisant partie du nécessaire processus de clarification
des questions politiques. Mais, ce qui a posé problème, c'est
que, sous le prétexte de ces désaccords, un certain nombre de
militants de la section en France ont mené depuis lors une politique
de violation permanente de nos règles organisationnelles. Sur la base
d'une réaction "d'amour propre blessé", ils se sont
lancés à corps perdu dans des attitudes anarchisantes de violation
des décisions du Congrès, de dénigrement et de calomnies,
de mauvaise foi, de mensonges. Après plusieurs manquements organisationnels,
dont certains d'une extrême gravité, qui ont nécessité
des réactions fermes de l'organisation, ces camarades ont secrètement
tenu des réunions pendant le mois d'août 2001, réunions
qui ont engendré un groupement baptisé "Collectif de réflexion".
Le procès verbal d'une des réunions de cette tendance secrète
est parvenu à l'organisation, contre la volonté de ses participants.
Il a permis que soit clairement mis en évidence, au sein de l'organisation,
le fait que ces camarades, en toute conscience de la gravité de leurs
actes, étaient en train de fomenter un complot contre l'organisation,
faisant ainsi la preuve d'une déloyauté totale envers le CCI,
laquelle s'est exprimée en particulier à travers :
- l'établissement d'une stratégie pour tromper l'organisation et faire passer sa propre politique;
- une démarche putschiste/gauchiste posant les problèmes politiques confrontés en terme de "récupération des moyens de fonctionnement" ;
- l'établissement de liens conférant "une solidarité
de fer" entre les participants et contre les organes centraux, tournant
ainsi clairement le dos à la discipline librement consentie au sein d'une
organisation politique prolétarienne.
Par ailleurs, il s'est avéré depuis lors que certains membres du "collectif" établissaient, dés cette époque, une correspondance secrète avec certains militants appartenant à d'autres sections du CCI.
Suite à de longues
discussions, notamment sur la signification de la démarche exprimée
par les notes des réunions secrètes, des participants au "collectif"
ou le soutenant, décident de le dissoudre et de rejoindre le débat
dans le cadre même de l'organisation. Ils reconnaissent en particulier
qu'une véritable volonté de clarification ne peut craindre le
débat ouvert dans lequel chaque camarade doit pleinement s'impliquer
afin de renforcer le corps collectif du CCI. Ils reconnaissent que ce n'est
qu'au terme d'un tel débat qu'il sera possible de voir s'il existe deux
orientations politiques irréconciliables et alors, si c'est le cas, constituer
une tendance ou une fraction qui ait un contenu réel et responsable.
De plus, les camarades s'engagent alors à mener une réflexion
de fond sur les raisons les ayant conduits à se comporter comme des ennemis
de l'organisation.
Malheureusement, un mois après, une partie des camarades de l'ex-"Collectif",
tournant le dos à leurs propres prises de position, ont constitué
un regroupement qu'ils ont baptisé "Fraction interne du CCI"
et ils ont commencé à se lancer dans un viol systématique
et répété des statuts de notre organisation. Pour n'en
citer que quelques exemples : utilisation des adresses individuelles des camarades
; refus de payer la totalité de leurs cotisations ; refus d'assister
aux réunions d'organes centraux, auxquels ils appartiennent ou sont invités,
sous le prétexte que le CCI doit "d'abord discuter du 'statut' de
la 'Fraction' " ; menace de publier à l'extérieur des documents
internes de la vie de l'organe central ; refus de remettre à l'organisation
un document ayant circulé parmi certains militants et étayant
paraît-il, sur la base d'accusations particulièrement graves contre
certains militants, leurs divergences ; refus de rencontrer des délégations
de l'organisation sous le prétexte que cette dernière décidait
de garder les notes (procès-verbaux), consultables à tout moment,
de toute réunion ou rencontre de ce type . A la liste de ces infractions,
il faut en ajouter une supplémentaire mise en lumière dernièrement
par l'envoi des textes à nos abonnés : le vol du fichier des adresses
des abonnés de Révolution Internationale par le membre de l'organe
central à qui en avait été confiée la responsabilité,
avant même que soit déclarée l'existence du "collectif
de réflexion".
Face à de tels comportements destructeurs, et non aux divergences et
désaccords politiques existants, l'organisation n'avait d'autre possibilité,
pour assurer sa défense et sa survie, que de prendre les sanctions prévues
par les statuts. Sans le respect des règles organisationnelles, librement
consenties par chacun, consignées en particulier dans nos statuts, il
n'y a pas d'organisation.
Là non plus, ce phénomène
d'une organisation dans l'organisation, agissant en son sein comme un corps
parasite et destructeur n'est pas nouveau. Il a existé dans la première
internationale sous la forme de l'Alliance pour la démocratie socialiste
de Bakounine à propos de laquelle Engels avait lancé l'avertissement
suivant :
"Il est grand temps, une fois pour toutes, de mettre fin aux luttes internes
quotidiennement provoquées dans notre Association par la présence
de ce corps parasite.
Ces querelles ne servent qu'à gaspiller l'énergie qui devrait
être utilisée à combattre le régime de la bourgeoisie.
En paralysant l'activité de l'Internationale contre les ennemis de la
classe ouvrière, l'Alliance sert admirablement la bourgeoisie et les
gouvernements." ("Le conseil général à tous les
membres de l'Internationale").
Le mépris de la lettre et de l'esprit des statuts du CCI
A chaque fois que des groupes
de militants ont décidé de quitter notre organisation, en lui
faisant le plus de tort possible, ils n'ont pas manqué d'accuser celle-ci
de dégénérescence "stalinienne" et de se présenter
comme les véritables continuateurs du CCI. Les militants regroupés
derrière la bannière de la "fraction interne du CCI"
ne font pas aujourd'hui exception. Leurs déclarations affirmant vouloir
mener un combat politique à l'intérieur du CCI ne sont que le
paravent honorable à une guerre permanente qu'ils mènent en son
sein pour porter atteinte à sa vie interne et à son activité.
En définitive, ce sont les agissements mêmes de ces camarades qui
ont permis une conviction croissante, au sein de notre organisation, que leur
volonté clamée à qui veut bien l'entendre de mener un véritable
travail de fraction n'est qu'un bluff. Le problème c'est que, pendant
tout un temps, ils risquent de semer le trouble à l'extérieur
de notre organisation, à présent qu'ils ont décidé
de déverser leurs insanités sur la place publique. Face aux doutes
qu'ils pourraient faire surgir, nous rappelons que le CCI, pendant toute son
existence, n'a que très rarement exclu des militants, cela ne se produisant
que face à des comportements extrêmement graves mettant en danger
l'organisation. Il n'a jamais exclu le moindre militant pour des raisons de
divergences politiques. Et aujourd'hui, tout autant qu'au début de son
existence, il accorde la plus grande importance à l'expression et à
la confrontation des divergences dans la clarté, sur la base de textes
et contributions, toutes les discussions faisant l'objet de rapports à
tous les niveaux de l'organisations destinés à synthétiser
l'avancée des débats. Mais, pour nous comme pour Rosa Luxembourg,
le principe de la liberté de critique dans l'organisation est assorti
d'une clause particulière non négociable : "l'indépendance
de la pensée est pour nous de la plus haute importance. Or, elle ne sera
possible que si, abstraction faite de toute calomnie, de tout mensonge, de toute
injure, nous accueillons avec gratitude et sans distinction de tendance, les
opinions des gens qui peuvent se tromper, mais qui n'ont en vue que le salut
de notre parti" (Liberté de critique et de la science). Une telle
restriction s'applique à fortiori en cas d'entreprise de destruction
de l'organisation .
Quant à l'affirmation selon laquelle le CCI violerait ses propres statuts
en refusant de reconnaître la "fraction", c'est un montage grossier.
En fait, le "collectif" et la "fraction" à sa suite
se sont formés non pas sur la base de la mise en avant d'une orientation
positive alternative à une position prise par l'organisation mais comme
rassemblement de "mécontents" qui mettent dans un pot commun
leurs divergences et essaient, par la suite, de leur donner une certaine cohérence.
En ce sens, la constitution prématurée et hors de tout principe
de la "fraction" ne correspond en rien à ce qu'exprime historiquement
la création d'une fraction dans le mouvement ouvrier : "Contrairement
à la tendance qui ne s'applique qu'à des divergences sur l'orientation
face à des questions circonstancielles, la fraction s'applique à
des divergences programmatiques qui ne peuvent trouver d'aboutissement que dans
l'exclusion de la position bourgeoise ou par le départ de la fraction
communiste" (Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation
des révolutionnaires, point 10, Revue Internationale n° 33). Cette
analyse, l'organisation ne pouvait la mettre dans sa poche à cause des
trépignements de la "fraction" pour être reconnue officiellement
comme telle. De même elle ne remet en rien en question le droit à
l'existence au sein du CCI de formes organisées comme les tendances ou
les fractions. Tout au contraire, c'est justement parce que, comme le disent
ses statuts, "l'organisation n'a pas à juger quand une telle forme
organisée doit se constituer et se dissoudre" que les membres de
la "fraction" peuvent se réunir comme ils le souhaitent et
présenter collectivement, face à l'organisation, les positions
qu'ils souhaitent. De même que, comme pour tout autre camarade de l'organisation,
les colonnes de la presse leur sont ouvertes pour rendre compte de positions
minoritaires élaborées. C'est d'ailleurs avec ce souci que nous
avions proposé les colonnes de la Revue Internationale à ces militants
afin qu'ils y expriment leurs désaccords avec notre conception du rôle
de la fraction dans l'histoire des organisations de la classe ouvrière,
telle qu'elle est présentée dans l'article de la Revue Internationale
n°108 et ici [4], "les fractions de gauche, en défense de la perspective
prolétarienne". Proposition qu'ils se sont évidemment empressés
"d'accepter" en posant un ensemble de conditions préalables,
inacceptables par nous, qui impliquaient que notre organisation s'aligne sur
leurs propres positions. Cet épisode est parfaitement éloquent
du fait que ce qu'ils pourraient avoir à dire à la classe ouvrière
de différent du CCI passe à l'arrière plan de leurs préoccupations.
Loin de s'engager dans une démarche visant à convaincre de leurs
positions par une argumentation politique sérieuse, le "combat"
de ces militants pour la reconnaissance officielle de leur "fraction"
a justifié, à leurs yeux, toute une dérive politique ponctuée
des infractions graves à nos statuts que nous avons déjà
évoquées (si bien qu'au sein du CCI, c'est sous l'appellation
"d'infraction" que ces camarades sont maintenant couramment désignés).
Ils ont foulé aux pieds ce principe de base de notre fonctionnement :
"le fait pour des membres de l'organisation de défendre des positions
minoritaires ne saurait les dégager d'aucune de leurs responsabilités
en tant que militants de celle-ci" (extrait des statuts du CCI) sans lequel
il ne peut y avoir d'organisation unie admettant en son sein des divergences.
L'une de leurs infractions, celle consistant à réduire de 70%
leurs cotisations (obligatoires pour tous) de manière à couvrir
leurs frais de fonctionnement, en constitue une illustration manifeste. Si l'organisation
devait transiger sur ce point alors elle violerait ses propres statuts et ouvrirait
toute grande la porte à une situation où chacun peut moduler le
montant de ses cotisations en fonction de ses désaccords avec telle ou
telle prise de position, telle ou telle analyse de l'organisation. Une telle
situation mène directement à la destruction de l'organisation.
C'est clairement vers la destruction de l'organisation que les amis de Jonas veulent nous entraîner. C'est clairement contre une telle "rage" destructrice que le CCI est plus que jamais déterminé à se défendre et à défendre les principes de classe du mouvement ouvrier.
CCI, le 21-03-02Vie du CCI:
Courants politiques:
ICConline - 2004
- 5105 lectures
ICConline - 2005
- 5771 lectures
'Dirigeants du monde', 'terroristes internationaux' : ils sont tous responsables du massacre des ouvriers !
- 3577 lectures
Qui sont les premières victimes des attentats terroristes dans le centre de Londres le 7 juillet 2005 ? Comme à New York en 2001 et à Madrid en 2004, les bombes visaient délibérément les ouvriers, les gens qui s'entassent dans les métros et les bus pour aller au travail. Al Qaida qui revendique la responsabilité de ce meurtre de masse, dit qu'elle a voulu venger "les massacres perpétrés en Irak par l'armée britannique". Mais la boucherie sans fin que subit la population irakienne,n'est pas la faute de la classe laborieuse de Grande Bretagne ; ce sont les classes dominantes de Grande Bretagne, d'Amérique qui en sont responsables - sans parler des terroristes de la soi-disant 'Résistance' qui sont quotidiennement impliqués dans le massacre d'ouvriers et de civils innocents à Bagdad et dans les autres villes. Pendant ce temps, les architectes de la guerre en Irak, les Bush et les Blair, restent sains et saufs ; pire encore, les atrocités commises par les terroristes leur fournissent le prétexte idéal pour lancer de nouvelles aventures militaires, tout comme ils l'ont fait en Afghanistan et en Irak après le 11 septembre.
Tout cela est dans la logique de la guerre impérialiste : des guerres menées dans l'intérêt de la classe capitaliste, des guerres pour la domination de la planète. La grande majorité des victimes de ces guerres, ce sont les exploités, les opprimés, les esclaves salariés du capital. La logique de la guerre impérialiste excite la haine nationale et raciale, fait, de populations entières, "l'ennemi" à insulter, à attaquer et à abattre. Elle monte les ouvriers les uns contre les autres et les empêche de défendre leurs intérêts communs. Pire, elle appelle les ouvriers à rallier le drapeau national et l'Etat national, à marcher de plein gré à la guerre en défense d'intérêts qui ne sont pas les leurs, mais ceux de leurs exploiteurs.
Dans sa déclaration sur les attentats de Londres depuis la réunion des riches et des puissants au Sommet du G8, Blair a dit : "Il est important cependant que ceux qui sont engagés sur la voie du terrorisme sachent que notre détermination à défendre nos valeurs et notre mode de vie est plus grande que leur détermination à semer la mort et la destruction chez une population innocente".
La vérité, c'est que les valeurs de Blair et celles de Ben Laden sont exactement les mêmes. Ils sont aussi prêts l'un que l'autre à semer la mort et la destruction chez une population innocente pour défendre leurs intérêts sordides. La seule différence, c'est que Blair est un grand gangster impérialiste et Ben Laden un petit. Nous devons rejeter totalement tous ceux qui nous demandent de choisir un camp contre un autre.
Toutes les déclarations de solidarité avec les victimes des attentats de Londres proclamées par 'les dirigeants du monde' sont de la pure hypocrisie. Le système social qu'ils dirigent depuis le siècle dernier, a anéanti des dizaines de millions d'êtres humains dans deux guerres mondiales barbares et des conflits sans nombre, de la Corée au Golfe, du Vietnam à la Palestine. Et contrairement aux illusions que sèment Geldof, Bono et autres organisateurs de concerts humanitaires, ils dirigent un système qui, par sa nature même, ne peut pas "make poverty history", jeter la pauvreté aux poubelles de l'histoire, mais condamne au contraire les populations par centaines de millions à une misère croissante et empoisonne tous les jours la planète pour défendre ses profits. La solidarité que veulent les dirigeants du monde est une fausse solidarité, l'unité nationale entre les classes qui leur permettra de déchaîner de nouvelles guerres dans le futur.
La seule véritable solidarité est la solidarité internationale de la classe ouvrière, fondée sur les intérêts communs des exploités de tous les pays. Une solidarité qui dépasse toutes les divisions raciales et religieuses et qui est la seule force capable de s'opposer à la logique capitaliste du militarisme et de la guerre.
L'histoire a montré la puissance d'une telle solidarité : en 1917-18, quand les mutineries et les révolutions en Russie et en Allemagne ont mis fin au carnage de la Première Guerre mondiale. Et l'histoire a aussi montré le prix terrible que la classe ouvrière a dû payer quand cette solidarité a été à nouveau remplacée par la haine nationale et la loyauté à la classe dominante : l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le capitalisme répand à nouveau la guerre sur la planète. Si nous voulons l'arrêter de nous engloutir dans le chaos et la destruction, nous devons rejeter tous les appels patriotiques de nos dirigeants, lutter pour défendre nos intérêts en tant qu'ouvriers et nous unir contre cette société mourante qui ne peut rien nous offrit que l'horreur et la mort à une échelle toujours grandissante.
Courant communiste international, 7 juillet 2005.
Géographique:
- Grande-Bretagne [9]
Récent et en cours:
- Attentats [10]
Crise de l'émigration à la frontière hispano- marocaine : L'HYPOCRISIE DE LA BOURGEOISIE DÉMOCRATIQUE
- 3746 lectures
Au cours des deux dernières semaines nous avons assisté à une succession de scènes hallucinantes à la frontière Sud de l'Union Européenne. Il y a eu d’abord les assauts massifs des clôtures barbelées installées par le gouvernement espagnol que des milliers d'émigrants ont réussi à franchir, non sans y avoir laissé des lambeaux de vêtements et du sang. Puis il y a eu les rafales de balles qui ont fauché la vie de 5 émigrants, des rafales tirées, selon toute probabilité, et en dépit des contorsions des porte-parole officiels, par les forces du "très démocratique" et "très pacifiste" gouvernement de Monsieur Zapatero qui aime présenter de lui l'image d'un Bambi, d’un faon inoffensif. Ensuite est arrivé le déploiement massif de troupes de la Légion et de la Garde Civile avec la consigne de repousser "de manière humaine" (sic) les émigrants. Le 6 octobre, après d'obscures négociations entre les gouvernements espagnol et marocain, les événements prennent un virage : 6 émigrants meurent mitraillés en territoire marocain. Ces meurtres sont le début du déchaînement d'une série d'actes de plus en plus brutaux : émigrants abandonnés dans le désert au Sud d'Oujda le 7 octobre, coups de filet massifs dans les villes marocaines où se concentrent les émigrants ; vols charter de rapatriement vers le Mali et le Sénégal avec des hommes et des femmes entassés, nouvelle déportation massive d'émigrants, dans des autobus de la mort, vers le désert du Sahara.
À partir du 6 octobre, le gouvernement Zapatero récupère son rôle de "champion du savoir faire". Il "proteste" bruyamment auprès du Maroc pour le traitement "inhumain" que ce dernier réserve aux émigrants et il présente, avec un grand déploiement médiatique, son projet d'une clôture "ultramoderne" (en réalité 3 clôtures juxtaposées) qui empêcherait toute pénétration des émigrants "sans leur causer la moindre égratignure". Ses collègues de l'Union Européenne s'unissent de façon pressante au choeur de la "protestation démocratique" face aux "excès" marocains, ils "exigent" "un traitement respectueux des émigrants" et nous assènent leurs bavardages habituels sur l'Union Européenne "terre d'accueil" et sur la nécessité du "développement" des pays africains. Le ministre espagnol des affaires extérieures, un expert en sourires béats, montre les crocs et annonce très sérieusement que "l'Espagne ne va tolérer aucune émigration illégale bien que cela soit compatible avec le respect aux émigrants" (sic).
Dans cette crise nous pouvons voir les deux visages des États démocratiques. Depuis le 6 octobre, le Gouvernement Zapatero, après avoir habilement sous-traité au Maroc sa sale guerre contre les émigrants, exhibe son masque habituel de promoteur angélique de la "paix", des "droits de l'homme" et du "respect des personnes". C'est le visage du cynisme, du mensonge et de la manoeuvre, le manteau habituel avec lequel s'entourent les "grandes démocraties", celui de l'hypocrisie la plus répugnante.
Cependant, dans les jours précédents, le gouvernement Zapatero est apparu avec l'autre visage : celui du mitraillage massif, celui du Garde civil brutalisant un émigrant, celui des barbelés et des hélicoptères survolant les émigrants, celui des déportations vers les pays africains... Un visage qui déchire le voile hypocrite des discours sur les "droits" et les "libertés" et laisse entrevoir la réalité pure et dure : le "socialiste" Zapatero se conduit envers les émigrants exactement de la même façon que le tellement décrié Sharon avec son mur en Cisjordanie et à Gaza ou que les staliniens Est allemands Ulbricht et Honecker qui avaient élevé le mur de Berlin. Les deux visages, celui de l'hypocrisie démocratique et celui du chien sanglant, ne sont pas en réalité opposés mais ils sont complémentaires. Ils forment une unité indispensable dans la méthode de domination du capitalisme, un système social qui soutient une classe minoritaire et exploiteuse, la bourgeoisie, dont la survie heurte chaque fois plus frontalement les intérêts et les nécessités du prolétariat et de la grande majorité de la population.
Dans le problème tragique de l'émigration nous voyons comment le capitalisme, confronté à une crise chaque fois plus aiguë - et qui prend la forme la plus extrême dans des continents comme l'Afrique - n'est plus capable d'assurer un minimum de survie à des masses chaque fois plus énormes d'êtres humains qui s'enfuient de l'enfer de la faim, des guerres, des épidémies les plus mortifères.
Dans leur fuite, ils sont matraqués et dévalisés par les policiers et les maffias des pays qu'ils traversent, qui disposent toujours de l'approbation intéressée de leurs États respectifs, et quand ils parviennent au but convoité, ils se heurtent à un nouveau mur de la honte, avec des barbelés, des balles, des déportations... Soumis à une crise toujours plus grave, les pays de l'Union Européenne sont toujours moins ce "refuge de paix et de prospérité" avec lequel ils veulent nous éblouir. Leurs économies peuvent absorber seulement quelques gouttes de cette immense marée humaine et dans des conditions d'exploitation toujours plus infamantes qui ressemblent de plus en plus à celles des pays dont s'enfuient les émigrants.
Cette situation est accompagnée d'un contexte croissant de tensions impérialistes entre les différents États chacun cherchant le moyen de frapper son rival ou de trouver des armes pour exercer un chantage sur lui. Cela fait des émigrants une masse de manoeuvre alléchante utilisée par les différents gouvernements. Le Maroc essaie de faire chanter l'Espagne en donnant toutes sortes de facilités aux maffias spécialisées dans la traite des émigrants et qui leur permettent d'effectuer leurs "sauts" de l'autre côté. Mais de son côté, l'Espagne, par sa situation de porte d'entrée du Sud dans l'Union Européenne essaie de se faire rétribuer au meilleur prix ses services de cerbère sanglant.
Ce jeu sanglant de charlatans et d'escrocs se mène au détriment des vies de centaines de milliers d'êtres humains condamnés à une tragique odyssée. Les États les plus forts se présentent devant le monde comme "les plus humains et solidaires" simplement parce que, en coulisse, ils ont obtenu que leurs collègues plus faibles se chargent du sale boulot. Le Maroc apparaît comme le "méchant du film" (la tradition de brutalité la plus sauvage de ses forces policières et militaires lui permettant d'interpréter ce rôle à la perfection) tandis que l'Espagne et les "partenaires" de l'UE, ses commanditaires sans scrupules[1] [11], ont le culot de lui donner des leçons de "démocratie" et de "droits humains". Cependant, les contradictions croissantes du capitalisme, l'approfondissement de sa crise historique, le processus de décomposition qui le mine peu à peu, l'aguisement progressif de la lutte de classes, font que ces grands États, spécialistes consommés du rôle du "vertueux" dans le théâtre démocratique, apparaissent chaque fois plus directement sous le visage de chiens sanglants. Il y a 3 mois, nous avons vu comment la police britannique, la "plus démocratique du monde", a assassiné de sang froid un jeune brésilien [2] [12]; il y a moins d'un mois nous avons vu comment l'armée et la police américaines distribuaient des coups de matraque en lieu et place de nourriture et d’aides aux victimes de l'ouragan Katrina, nous voyons aujourd'hui le Gouvernement Zapatero assassiner des émigrants, déployer des troupes et élever un mur de la honte. Un capitalisme à visage humain n'est pas possible. Les intérêts de l'humanité sont incompatibles avec les nécessités de ce système. Pour que l'humanité puisse vivre le capitalisme doit mourir. Détruire l’État capitaliste dans tous les pays, abolir les frontières et l'exploitation de l'homme par l'homme, telle est l'orientation que le prolétariat doit donner à sa lutte pour que l'humanité puisse, tout simplement, commencer à vivre.
Courant Communiste International 11-10-05
1 [13] Ces derniers jours, les dirigeants de l’Union Européenne ont rappelé ouvertement à leurs confrères marocains qu’ils leur avaient accordés des crédits pour qu’ils jouent leur rôle de gendarmes, ce qu’ils avaient éludé jusqu’à présent.
2 [14] Voir sur notre site l’article "Exécution sommaire dans le métro de Londres: La bourgeoisie démocratique prépare ses ‘escadrons de la mort’" [15].
Géographique:
- Afrique [16]
Exécution sommaire dans le métro de Londres: La bourgeoisie démocratique prépare ses "escadrons de la mort"
- 3892 lectures
Vendredi 22 juillet, à 10 heures du matin, des policiers ont abattu froidement, de 5 balles de révolver tirées à bout portant, Jean-Charles de Menezes, un électricien brésilien de 27 ans. Le crime de ce jeune ouvrier, qui lui a valu cette exécution sommaire : se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et, peut être (car on peut toujours douter de la version officielle), d'avoir pris la fuite devant un groupe de policiers menaçants qui l'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Cela ne s'est pas passé dans une favela de Rio de Janeiro et les policiers flingueurs n'appartiennent pas aux "escadrons de la mort" qui, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays du tiers-monde, ont carte blanche des autorités pour "nettoyer" les "asociaux" (petits délinquants ou opposants politiques). Cela s'est passé à Londres, la capitale du "pays le plus démocratique du monde" et les flics en question sont des "bobbies", connus dans le monde entier pour leur bonhomie, fonctionnaires de la police la plus prestigieuse du monde, Scotland Yard.
Évidemment, ce crime a provoqué une certaine émotion parmi les porte-parole de la classe bourgeoise : le Financial Times parle du "virage potentiellement dangereux" pris par les forces de sécurité. Évidemment, le chef de la police de Londres, Sir Ian Blair, a "regretté" cette "bavure" et a présenté ses condoléances à la famille de la victime. Évidemment, une enquête est ouverte pour "établir la vérité". Il est même possible qu'un ou deux policiers soient sanctionnés pour ne pas avoir su faire la différence entre un brésilien catholique et un pakistanais musulman. Mais les véritables responsables du crime, ce ne sont pas les porte-flingue qui ont appuyé sur la gâchette. S'ils ont assassiné le jeune Jean-Charles, c'est qu'ils avaient reçu l'ordre de "tirer pour tuer".
Les explications ne manquent pas, marquées de toute la subtile hypocrisie qui caractérise la classe régnante britannique. D’après Sir Ian Blair, « Il n’y a là rien de gratuit, pas la moindre légèreté. Il n’y a pas de politique de ‘tirer pour tuer’, il y a une politique de ‘tirer pour tuer pour protéger’ »[1] [17] Son prédécesseur, John Stevens, qui n’a plus besoin de pratiquer la langue de bois, avait annoncé la couleur il y a quelques mois : "Il n'y a qu'un seul moyen sûr de stopper un kamikaze déterminé à accomplir sa mission : lui brûler la cervelle sur le champ et totalement. Cela signifie viser la tête avec une puissance dévastatrice, le tuer immédiatement."[2] [18] Mais il n'y a pas que les flics pour tenir un tel discours ; c'est le très "gauchiste" maire de Londres, Ken Livingstone, qui justifie l'assassinat en ces termes : "Si vous avez affaire à un kamikaze potentiel, qui peut déclencher des explosifs, la politique qui s'applique est celle du 'tirer pour tuer'".[3] [19]
Il ne faut pas s'y tromper, l'argument du "kamikaze déterminé à accomplir sa mission" n'est qu'un prétexte fallacieux : quand les troupes britanniques flinguaient des irlandais innocents qu'elles avaient pris pour des terroristes, ce n'est pas parce que les vrais terroristes de l'IRA étaient des kamikazes (d'ailleurs, l'Église catholique réprouve le suicide). En réalité, pour l'État capitaliste, en Grande-Bretagne et dans tous les pays "démocratiques", les actes terroristes, comme ceux du 7 et du 21 juillet à Londres, sont toujours l'occasion de renforcer les mesures de répression, d'avancer dans la mise en oeuvre de méthodes qui sont celles des régimes "totalitaires" et surtout d'habituer la population à ces méthodes. C'est ce qui s'est passé par exemple après le 11 septembre 2001 aux États-Unis ou en France après les attentats de 1995 attribués aux "Groupes Islamistes Armés" algériens. Pour la propagande officielle de la classe dominante il faut choisir : soit accepter une présence de plus en plus étouffante de la police dans tous les moments et tous les lieux de notre vie, soit "faire le jeu du terrorisme".
Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, cette toute puissance de la police atteint un de ses points extrêmes : les flics ont non seulement le droit mais l'ordre de tuer toute personne qui leur paraît "suspecte" pour peu que celle-ci n'obéisse pas immédiatement à leurs injonctions. Et cela au pays qui a inventé "l'Habeas Corpus", c'est-à-dire l'interdiction des arrestations arbitraires, dès 1679. Traditionnellement, en Grande-Bretagne, comme dans tous les pays "démocratiques", on ne pouvait pas mettre en prison une personne sans la présenter rapidement à un juge. Aujourd’hui, dans ce pays, il y a déjà des personnes enfermées à la prison de Belmarsh (près de Londres) et qui sont détenues sans procès. Maintenant, elles peuvent être tirées à vue dans la rue ![4] [20]
Pour l'heure, ceux qui sont officiellement visés, ce sont les "terroristes kamikazes". Mais ce serait une terrible erreur de croire que la bourgeoisie, la classe qui dirige la société, en restera là. L'histoire a démontré à de nombreuses reprises que lorsque cette classe se sent menacée, elle n'hésite pas à fouler au pieds ses grands principes "démocratiques". Dans le passé, ces principes avaient été un instrument de son combat contre l'arbitraire et la domination de l'aristocratie. Ensuite, lorsqu'elle dominait elle-même sans partage et sans menace la société, elle avait pu les conserver comme ornements, en particulier pour tromper les masses exploitées et leur faire accepter l'exploitation. Ainsi, au 19e siècle, la bourgeoise anglaise toute-puissante pouvait se payer le luxe de laisser entrer en Grande-Bretagne les réfugiés politiques des révolutions vaincues du Continent qui étaient chassés de tous les autres pays, comme les ouvriers français victimes de l'écrasement de la Commune de Paris de 1871.
Aujourd'hui, ce n'est pas le "terrorisme islamiste" qui menace la bourgeoise. Les principales victimes de ce terrorisme criminel, ce sont les ouvriers et les employés qui prennent le métro pour se rendre à leur travail où qui travaillaient dans les bureaux des Twin Towers. De plus, le "terrorisme", grâce à l'horreur légitime qu'il inspire dans la population, a constitué un excellent prétexte à tout une série d'États pour justifier leurs aventures impérialistes en Afghanistan et en Irak.
Non, la seule force dans la société qui puisse menacer la bourgeoisie est la classe ouvrière. Pour le moment, les combats ouvriers sont encore loin d'ébranler l'ordre bourgeois, mais la classe dominante sait parfaitement que la crise insurmontable de son système et les attaques toujours plus violentes qu'elle sera conduite à porter contre les prolétaires pousseront de plus en plus ces derniers à engager des combats de grande ampleur jusqu'à menacer le pouvoir des exploiteurs. Alors, ce ne sont pas les "terroristes" qui se feront tirer comme des lapins, mais les ouvriers les plus combatifs et les éléments révolutionnaires, les communistes (qui seront alors traités de terroristes).[5] [21] Et sans "Habeas Corpus".
Ce ne sont pas là des spéculations ou des prédictions tirées d'une boule de cristal. C'est ainsi qu'a toujours agi la bourgeoise lorsque ses intérêts vitaux étaient menacés. Le traitement habituellement réservé aux populations colonisées ou du tiers-monde par la bourgeoisie de TOUS les pays "démocratiques", elle l'applique aussi aux prolétaires de ces pays quand ils se révoltent contre leur exploitation. Ainsi, en 1919, dans une Allemagne gouvernée alors par le parti Social-Démocrate, c'est-à-dire le parti de Gerhard Schröder, cousin du Labour de Tony Blair, on a massacré par milliers les ouvriers qui, à la suite de la révolution de 1917 en Russie, s'étaient dressé contre l'ordre bourgeois. Quant aux révolutionnaires comme Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, ils ont été assassinés par les militaires qui les avaient arrêtés sous prétexte qu'ils avaient "tenté de fuir".
L'ignoble assassinat du 22 juillet à la station Stockwell ne doit pas seulement être dénoncé. Cela, les pleureuses habituelles qui geignent à chaque "atteinte aux droits démocratiques" sont capables de le faire aussi. Il doit surtout servir aux prolétaires de Grande-Bretagne et de tous les pays à comprendre la véritable nature et les véritables méthodes de leur ennemi de classe, la bourgeoisie. Ce sont des "escadrons de la mort" que la bourgeoisie prépare dès aujourd'hui, partout dans le monde, et que les prolétaires devront affronter demain.
CCI, 24 juillet 2005
[1] [22] Guardian.co.uk, 24 juillet
[ [22]2] [23] News of the World Sunday du 6 mars 2005 page 13, “Oubliez les droits de l’homme, chassez les fanatiques”
Géographique:
- Grande-Bretagne [9]
Récent et en cours:
- Attentats [10]
La FICCI ne marche pas "dans les pas de MC", elle marche sur tous les principes qu'il a toujours défendus
- 3680 lectures
L'obscénité n'a pas de
limites ! Dans le numéro 29 de son "Bulletin
communiste", la soi-disant "Fraction interne du CCI"
(FICCI) a le culot de se revendiquer du combat organisationnel mené
par le camarade MC durant toute sa vie et notamment lorsqu’il
militait dans la Fraction italienne des années trente. La
FICCI déclare, dans un titre de ce "Bulletin" :
« Notre conception de l’organisation est celle qu’a
toujours défendue MC ». Nous devons à la
mémoire du camarade MC (1) [27],
qui a tant apporté au combat du mouvement ouvrier et en
particulier à la naissance et au développement du CCI,
de faire un petit commentaire face à une telle déclaration.
Nous comprenons tout à fait que, pour apparaître plus présentable, l’imposture ait besoin de se parer du combat mené par de véritables combattants du prolétariat. Et il est vrai que le camarade MC est l’un de ceux-là. Staline n’a-t-il pas essayé, immédiatement après la mort de Lénine, de se parer du combat mené par ce grand militant. Ce faisant, cet imposteur n’avait réussi qu’à falsifier ce qui animait le combat de Lénine pour mettre à sa place une idéologie si utile pour mystifier les ouvriers. Nos imposteurs d’aujourd’hui ne peuvent pas avoir l’audience qu’a eue un Staline, mais les méthodes sont identiques : le mensonge répété, la calomnie, la falsification, le vol, sans oublier, pour ces derniers imitateurs du grand maître de l’imposture, le mouchardage.
Nos imposteurs ne disent pas comment et quand MC leur a enseigné à mentir, à calomnier, à voler et à moucharder. De fait, ils ne peuvent pas car MC a toujours combattu de tels comportements de gangsters. L’ensemble de la vie du camarade MC a été animé par le souci de la rigueur théorique, de la défense de la méthode marxiste, de la lutte contre les comportements de voyous, du combat sans concession contre l’opportunisme. Quelques exemples de son parcours en attestent : son exclusion du PCF en février 1928, sa lutte contre la dérive du mouvement trotskiste qu’il quitte, avec Albert Treint (2) [28], en mai 1932, sa rupture avec Treint en 1933 qui glisse aussi vers une analyse opportuniste concernant l’URSS, sa rupture avec l’Union communiste(3) [29] qu’il quitte, après avoir mené un combat minoritaire contre sa capitulation face à l’idéologie anti-fasciste vis-à-vis de la guerre d’Espagne, son entrée dans la Fraction de gauche italienne qu’il rejoint, début 1938… Cette Fraction s’était constituée en 1928 comme « fraction » du Parti Communiste d’Italie en lutte contre la dégénérescence stalinienne de celui-ci. On peut dire que la quasi totalité de la vie de MC a été un combat de fraction, c’est-à-dire un combat pour la défense des principes prolétariens, pour la préparation du futur parti mondial de la révolution communiste. Ce combat et cette conviction de MC étaient sous-tendus, dans les moments les plus noirs de l’histoire, lorsque la contre-révolution était triomphante, par la confiance marxiste qu’il avait dans le fait que le prolétariat se relèverait de la défaite de sa première vague révolutionnaire et qu’il fallait préparer l’avenir.
Ce combat, il l’a mené au niveau théorique comme au niveau organisationnel. Il participe, au sein de la Fraction de gauche italienne, à tout un travail de réflexion et d’élaboration théorique qui en fait une des organisations les plus fécondes de l’histoire du mouvement ouvrier. Dans un contexte historique où le stalinisme fait peser sa chape de plomb, il maintient haut le drapeau de l’internationalisme et ne se laisse pas entraîner dans l’anti-fascisme. Quand se développe dans la Fraction une position révisionniste affirmant que l'économie de guerre permettra au capitalisme de surmonter sa crise et de s'éviter une nouvelle guerre mondiale, il prend la tête de la minorité qui reste fidèle aux positions classiques de la Gauche italienne. Quand la guerre mondiale éclate, il regroupe cette minorité qui se propose de défendre au sein de la classe les positions classiques du marxisme de transformation de la guerre impérialiste en guerre civile alors que la "majorité" théorise une mise en sommeil de la Fraction au nom de la "disparition sociale du prolétariat en temps de guerre". Lorsque fin 1944, à Bruxelles, après la « Libération », Vercesi, un des militants qu’il avait le plus admirés pour sa conviction et sa force théorique, tournant le dos aux principes qu’il avait défendus par le passé, est conduit à prendre la tête d’une « Coalition anti-fasciste » qui publie L’Italia di Domani, un journal qui, sous couvert d’aide aux prisonniers et émigrés italiens, se situe clairement aux côtés de l’effort de guerre des Alliés, il dénonce énergiquement de telles dérives. Cela n’empêchera pas le Partito comunista internazionalista fondé fin 1943 sous l’impulsion d’Onorato Damen et de Bruno Maffi d’accepter Vercesi en son sein, sans lui demander aucun compte sur sa participation à la coalition anti-fasciste de Bruxelles. MC ne suivra pas cette pente opportuniste et cette méthode de recrutement sans principe. Mais désormais, au sein de la Gauche communiste de France (GCF), MC restera le seul membre de la Fraction italienne à poursuivre le combat et à défendre les positions qui avaient fait la force et la clarté politique de cette organisation.
Sur le plan organisationnel, c’est encore MC qui a appris au CCI à exclure de sa pratique les méthodes des voyous. Ce faisant, il défendait là aussi ce qui avait toujours constitué les principes du mouvement ouvrier. Lorsque des éléments de la "tendance Chénier", en Grande-Bretagne, avaient quitté le CCI en 1981, en emportant avec eux du matériel de l'organisation, MC s’était élevé contre ces comportements de voleurs. C’est sous son impulsion que fut organisée la démarche nécessaire pour le récupérer. Et il est vrai que pour convaincre le CCI de ces principes prolétariens, MC a dû combattre le poids de l’idéologie démocratiste qui, à cause de la rupture des traditions prolétariennes due à des décennies de contre-révolution, pesait sur la génération de 1968. Ne parlons pas de la calomnie et du mouchardage.
Est-il besoin d’expliciter que ce combat, que MC a mené jusqu’à sa mort, est aux antipodes des pratiques de la soi-disant Fraction ? Une « Fraction » qui prétend lutter contre la "dégénérescence" du CCI en courtisant le BIPR, une organisation que les membres de la FICCI qualifiaient justement d’opportuniste la veille, quand ils étaient encore dans le CCI ! Une « Fraction » qui quitte l’organisation en volant des fichiers, en détournant de l’argent et en pratiquant le mouchardage (voir nos articles précédents) ! Et malgré tout cela, le CCI, à plusieurs reprises, a invité les éléments de la « Fraction » à venir se défendre devant ses instances suprêmes (la conférence extraordinaire de 2002 et le congrès de 2003) puisque, selon leurs dires, ce dont ce dernier les accuse serait faux. La vérité est que ces messieurs n’ont jamais daigné répondre à ces invitations. Alors de quoi s’agit-il ? Tout simplement de la haine de ceux qui ont trahi les principes et la perspective prolétarienne face à ceux qui poursuivent ce combat. On a déjà vu cela dans l’histoire. Quelle n’était pas la haine d’un Staline pour les Bolcheviks qui sont restés fidèles à leurs convictions révolutionnaires ! Il s'agit aussi pour ces éléments, à l'image de ceux qui par le passé ont trahi leur classe, d'essayer de masquer leur trahison en se réclamant bruyamment des principes qu’ils ont désormais foulés aux pieds et des militants les plus valeureux qui avaient défendu ces principes
Les deux lettres que nous publions ci-dessous (envoyées à la FICCI avec copie au CCI par un ancien membre de notre organisation qu’il a quittée en 1987 pour des raisons personnelles, sans désaccords politiques) illustrent tout à fait l'imposture écoeurante que constitue cette petite bande de voyous dénommée "Fraction interne du CCI".
La première lettre tord le cou, notamment en ce qui concerne l'intervention du CCI dans les luttes ouvrières de la période actuelle, aux déclarations de la FICCI visant à discréditer notre organisation. Face à la revendication de la FICCI d'être la vraie continuatrice des positions du "vieux CCI" (et donc de celles que défendait le camarade MC) que le CCI actuel aurait trahies, la lettre met en évidence que l'intervention actuelle du CCI se situe en continuité de celle qu'il a menée depuis plusieurs décennies alors que les conceptions aujourd'hui mises en avant par la FICCI sont celles du syndicalisme de base que notre organisation a toujours combattues.
La deuxième lettre met en relief que l'attitude actuelle de la FICCI (en laissant de côté tous les comportements de petits voyous de ses membres) n'a rien à voir avec celle d'une fraction, ni donc avec celle qu'avait toujours adoptée MC. Ainsi, lorsqu'en 1945, les camarades de la Fraction italienne qui s'était maintenue au cours de la guerre ont décidé d'apporter leur soutien et de rejoindre le Partito Comunista Internazionalista qui s'était constitué en Italie à partir de 1943, le camarade MC a combattu une telle attitude en démontrant qu'il s'agissait là d'une remise en cause de toute l'orientation défendue par la Fraction italienne auparavant. Plutôt que de rejoindre les rangs du PCInt, dont il estimait que les bases de constitution étaient confuses et opportunistes, il avait appelé à poursuivre cette orientation dans la GCF (qui était une organisation bien moins "importante" et "influente" que la PCInt). Aujourd'hui, au nom de la défense des "vrais positions du vieux CCI", les membres de la FICCI se comportent "comme de vrais militants, de vrais sympathisants, de vrais recruteurs du BIPR [c'est-à-dire de l'organisation qui défend aujourd'hui au niveau international les orientations du PCInt (notre précision)] qui, pourtant, et pour autant que je sache, ne s’est jamais fixé pour tâche, lui, de faire un travail de sauvegarde du programme et des orientations de l’ancien C.C.I, contre le mouvement “actuel” de dégénérescence par vous dénoncé". Nous ne pensons pas, pour notre part, que malgré la dérive actuelle de leur organisation, les membres du BIPR pourraient se livrer aux bassesses (telles que le mouchardage) qui caractérisent ceux de la FICCI. Mais la lettre est tout à fait claire dans sa mise en évidence de la supercherie que représentent les grandes déclarations de fidélité "au vrai CCI" qui occupent les pages des bulletins de la FICCI.
C'est d'ailleurs parce que les membres de la FICCI sont bien conscients de leur imposture grossière qu'ils se sont bien gardés jusqu'à présent de publier ces deux lettres de Ch. (contrairement à ce qu'ils avaient fait avec un de ses courriers précédents où Ch. portait des critiques à notre organisation, preuve qu'il n'est pas un "clone" que nous aurions "téléguidé").
8 mai 20051 [30] Sur la vie militante de notre camarade MC voir notamment notre article "Marc : de la révolution d'Octobre à la 2° guerre mondiale" et "Marc : de la 2° guerre mondiale à la période actuelle" dans les Revues internationales 65 et 66.
2 [31] Albert Treint avait été Secrétaire général du Parti communiste français au début des années 1920 et responsable, à ce titre, de la "bolchevisation" du PCF conduite au niveau international sous la direction de Zinoviev. Par la suite, quand ce dernier avait été écarté de ses responsabilités à la tête de l'Internationale communiste, il avait participé activement, jusqu'au début des années 1930, au travail des courants de gauche combattant la dégénérescence de l'IC et du PCF.
3 [32] Sur les positions et l'évolution de l'Union communiste, voir en particulier nos brochures "La Gauche communiste d'Italie" et "La Gauche communiste de France".
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Première lettre de Ch.
- 2836 lectures
Camarades,
Je continue à recevoir vos bulletins dont je prends connaissance régulièrement. Deux articles de votre numéro 29 ont retenu mon attention : l’un sur la situation internationale centré sur les mouvements de préparation à un conflit généralisé, l’autre concernant la signification de la grève sauvage des ouvriers d’Opel à Bochum et l’intervention des révolutionnaires.
Concernant l’article sur la situation internationale intitulé “Les grandes puissances impérialistes, premières responsables de la généralisation de la barbarie.” Cet article resitue bien les élections américaines, l’intervention militaire sanglante (et non pas musclée !) de la France en Côte d’Ivoire, et les élections en Ukraine, dans le même contexte, comme expressions des grandes tendances historiques à l’oeuvre. Mais ce contexte historique tel que vous l’analysez reste trop étroit :
Vous semblez le faire débuter en 2001 - donc aux lendemains du 11 Septembre 2001 (Guerre en Afghanistan, et surtout en Irak) - alors qu’à mon avis, le véritable contexte et ses principales tendances - que seule vient freiner la “résistance” prolétarienne... - s’est mis en place à partir d’un événement historique autrement plus décisif que le “11 Septembre” qu’il rend possible et auquel il donne son sens, et qui est la chute du Mur de Berlin c’est-à-dire la fin du partage du monde en deux blocs impérialistes bien délimités derrière des leaders incontestables et généralement incontestés ; partage en deux, qui exprimait :
le plus haut point d’unification possible, atteint par des alliances entre États bourgeois, “unification” mise en place au lendemain d’une deuxième guerre mondiale ;
le plus haut point de préparation de la bourgeoisie en vue d’une troisième guerre mondiale, toujours larvée et toujours déplacée, toujours reportée, en raison pour une part décisive de la fonction d’empêcheur de tourner en rond du prolétariat international, Européen, en particulier, alors situé au coeur, au centre des enjeux inter-impérialistes (Est/Ouest).
Cet “oubli” de cette rupture historique de 1989 a pour conséquence que avez du mal à voir que les impasses économiques et idéologiques du capitalisme mondial déjà à l’oeuvre avant 89, et qui ont conduit à cette fin du partage du monde en deux blocs, et seulement deux, sont toujours et plus que jamais à l’oeuvre et n’ouvrent en conséquence, ni sur la possibilité d’un recommencement à l’identique, (d’un nouveau repartage du monde au même niveau), ni sur un Super-Impérialisme (fût-il américain) mais sur un arc historique inédit, marqué par des bouleversements incessants des rapports de forces et des alliances entre Toutes les nations impérialistes, “grandes et petites” donc par une généralisation des tensions inter-impérialistes, une démultiplication des zones de tensions et d’affrontements qui font déjà et feront de plus en plus de la question de la guerre, de la guerre inter-impérialiste, une réalité et/ou une menace, pesant de plus en plus, en permanence et simultanément sur la vie concrète de millions de prolétaires, dans toutes les zones du globe ; exprimant et renforçant la tendance à la décomposition et au chaos généralisés dans lequel le risque de recours à des armements nucléaires et/ou chimiques ne cesseront d’augmenter.
Cet “oubli” vous conduit à “reconnaître” dans les crises, la paralysie croissante des anciennes structures internationales du capital, des signes et des moments de recomposition de deux nouveaux blocs, que vous posez comme condition et expression de la préparation des différentes fractions de la bourgeoisie mondiale à une nouvelle guerre mondiale, alors que la “nouvelle” Guerre généralisée, sous forme du “Tous contre tous” est déjà enclenchée, déjà là en Europe, au Moyen et proche Orient, en Asie, en Afrique... faisant peser ses effets sur un nombre grandissant de prolétaires tant dans des lieux aussi différents par exemple que le Darfour ou les États-Unis...
Ainsi dans votre article vous décrivez les conflits en cours sans relever ce qui s’y démontre de structurel à savoir, l’incapacité des anciennes puissances dominantes, d’avant 1989 - à continuer de faire accepter durablement aux nations jusque là dominées, ou jusqu’ici contenues (Inde, Pakistan, Chine), le maintien de leur leadership, et cela, comme expression et conséquence de la disparition d’une discipline de bloc contre bloc.
Et pourtant c’est :
ce qui se vérifie déjà au niveau de la plus grande puissance que demeurent les USA par rapport à leur tutelle sur la France et à l’Allemagne (et qui n’équivaut en rien à une réelle capacité de la France et de l’Allemagne à créer une nouvelle tête de bloc viable, apte à rivaliser, seule, contre les Américains et leurs alliés) et qui sont à l’origine des deux guerres en Irak, puis demain en Iran... ;
ce qui se vérifie pour des puissances moyennes comme la France par rapport à la Côte d’Ivoire et plus largement par rapport à ses ex-colonies d’Afrique ;
ce qui se vérifie pour l’ancienne grande puissance qu’était la Russie par rapport à l’Ukraine, à la Tchétchénie, etc. ;
ce qui s’exprime dans la démultiplication des intervenants rapaces, des ingérences, dans chaque conflit, de tous les coups tordus et par la bande, dans les conflits, en Irak, en Palestine, en Afrique, au Kosovo comme en Ukraine... ;
ce qui aboutit a un recours de plus en plus massif et généralisé à la force militaire brutale ouverte ;
ce qui se traduit par une tendance accrue à la dévastation, au pourrissement délibéré et à la destruction de pays et de régions entières afin que tout pion perdu ou non maîtrisable pour une fraction bourgeoise, ne puisse servir à ses ennemis (chaos Irakien, Tchétchénie en ruines, partition et effondrement de la Côte d’Ivoire, partition potentielle et risque de guerre “civile” en Ukraine ...) ;
ce qui n’est indicatif d’aucune tendance à une réunification, ou d’une quelconque restructuration, ou d’une quelconque remise en ordre des forces impérialistes autour de pôles stables pour une 3ème guerre mondiale à venir du type de la première et de la deuxième mais bien indicatif de la tendance dominante à un déchaînement de leurs ambitions contradictoires à la démultiplication de leurs interventionnismes militaires et actions terroristes, à une inflation des prétentions de toutes les fractions bourgeoises, petites et grandes, aux fonctions de leadership et ce, à tous les niveaux, localement, régionalement, internationalement, donc à l’instauration de fait, immédiatement, déjà, d’un état de guerre et de chaos qui va aller s’amplifiant et se complexifiant, appelant dès maintenant les contingents prolétariens des grandes, des petites et des moyennes puissances, dans toutes pays donc, à se retrouver confrontés directement à l’enjeu révolution ou guerre, barbarie ou socialisme, internationalisme ou chauvinisme, collaboration avec une quelconque fraction bourgeoise ou résistance et défaitisme révolutionnaire, face à la guerre militaire comme face à la guerre économique qui fait rage.
Ce qui oblige les révolutionnaires dans leurs interventions - et contrairement à ce que vous avez fait dans votre tract de 2003 (cf. mon courrier du 01/08/2003) - à dénoncer en même temps la réalité de la guerre et des attaques économiques, les interventionnistes et les pacifistes, en mettant en avant le lien entre compétition économique et compétition impérialiste, en affirmant la nécessité dans chaque cas, immédiatement de l’internationalisme, sous peine de venir donner du crédit à l’économisme immédiatiste, au corporatisme, au nationalisme au racisme… dont se retrouvent désormais directement porteurs toutes les formes de syndicalisme, (défense de nos, notre emploi (s), défense de notre outil de travail, défense de “notre” service public contre les privatisations, contre les délocalisations de nos entreprises, etc.).
NB : Au passage et de façon pour l’instant secondaire, je relève qu’il y a dans cet article une grosse erreur ou en tout cas un point très important à clarifier entre vous, à savoir cette idée selon laquelle une guerre mondiale, (une troisième guerre mondiale), est ou serait le dessein de la bourgeoisie et sa “solution” à la crise de son système. Y a-t-il là l’idée que la bourgeoisie fait la guerre pour éviter la révolution ? (Vercesi ?)
Pour ma part j’en reste à l’idée que la bourgeoisie, contrairement au prolétariat, n'est pas une classe porteuse d’un quelconque dessein et encore moins d’une solution, et cela d’autant moins quand le système qui l'a fait classe dominante, auquel elle est totalement et définitivement aliénée, est en période de décadence plus qu’avancée.
Ceci m’amène à vous poser une autre question : pourquoi ne faites vous pas signer vos articles par leurs auteurs ? Si les idées principales dans tout groupe sont nécessairement communes et partagées pour l’essentiel, elles ne sont que très rarement homogènes, identiques et formulables d’une seule manière, débarrassées de toute scorie, de toute confusion, de toute faille et comportent nécessairement des erreurs, des approximations, qui sont des expressions de la singularité de chacun, et poussent à l’approfondissement. Pourquoi chercher à gommer ces différences normales, inévitables et généralement fécondes car reconnues comme telles ?
Les nouveaux anciens militants communistes du vieux CCI seraient-ils appelés à se conduire comme des clones ?
**********
Sur le deuxième article concernant la grève sauvage des ouvriers d’Opel à Bochum, contre le plan de licenciements massifs dans l’automobile... Je considère que les citations du CCI que vous critiquez sont pour le moins maladroites et donc critiquables. Surtout si elles constituent, comme vous le laissez entendre le coeur de l’intervention du CCI (je n’ai pas l’occasion de lire), ce dont je doute encore.
Mais si ces citations témoignent de “manquements du CCI” dans son intervention, elle ne me convainquent pas pour autant de la justesse et de la qualité révolutionnaire de votre façon d’envisager une intervention “vraiment révolutionnaire” dans ce mouvement.
D’abord je trouve ridicule - car relevant du voeu pieux et de fanfaronnades - les déclarations du style : “si nous nous avions eu les moyens d’intervenir nous aurions fait ceci et cela contrairement au faux CCI et bla, bla”. Car on tombe ici simplement au niveau du “si ma tante en avait eu deux, on l’aurait sans doute appelée mon oncle” et plus grave pris dans la polémique politicienne, on oublie ce qu’est l’intervention des révolutionnaires dans un mouvement qui ne se réduit jamais à la seule présence physique et/ou politique immédiate sur les lieux même d’une action ouvrière en cours, fût-elle exemplaire, mais se fait sous diverses formes, en tout lieu de lutte ou de débat sur les conditions des luttes ouvrières, à travers tout article, toute intervention, devant des ouvriers ou des membres de groupes’ prolétariens, à propos de telle ou telle action, dans tel ou tel lieu, du fait de la compréhension, que toute lutte est un moment partiel d’un combat historique et mondial, chaque moment ne pouvant être apprécié, compris et investi, qu’en lien avec les enjeux historiques qui se posent à toute la classe ouvrière.
Ensuite dans ce que vous vous seriez proposé “de faire, si...”, je ne vois moi rien, aucun mots d’ordre concret, avancés par vous, en imagination, qui aurait pu vous permettre “naturellement” de vous différencier dans ce mouvement de grève du syndicalisme de base, de ses mots d’ordre contre les licenciements, de ses appel à la généralisation, à la solidarité inter-sectorielle, régionale. J’en suis réduit à vous accorder le bénéfice d’un doute favorable lié à ma reconnaissance que vous êtes encore très différents et éloignés des syndicalistes radicaux car toujours de nature de classe différente.
De plus, je ne reconnais rien du vieux CCI dans l’expression qui assigne aux révolutionnaires la tâche “de disputer la direction de la lutte aux syndicats (!!?)” ce qui est à ma connaissance une expression communes aux trotskistes et aux bordiguistes que le CCI “ancien” a toujours combattue (cf. son combat contre le substitutisme, contre la vision trade-unioniste de la classe ouvrière… auxquels cette expression renvoie.). Une telle expression, par ailleurs, réduit dangereusement le niveau où se situe l’intervention des révolutionnaires (cf. alinéa 2 ci-dessus, cf. ma critique et mon questionnement concernant l’absence de toute référence à la guerre en Irak dans votre tract et vos interventions orales dans le mouvement en 2003 en France) ; elle tend inévitablement à enfermer la question de cette intervention des révolutionnaires et de leur combat nécessaire contre les syndicats et le syndicalisme, sur le terrain même de l’immédiatisme et du corporatisme, de la recherche d’une influence immédiate sur la majorité des ouvriers pour pouvoir les diriger à la place des syndicats, immédiatisme et économisme dont se nourrit et tire sa force le syndicalisme le plus radica1, et partant toute la bourgeoisie, dans son travail de division et de sabotage de l’unification politique ouvrière. (cf. Enjeux historiques posés dans chaque mouvement de résistance ouvrière dans le commentaire du premier article). Alors qu’il s’agit (d’après des souvenirs que nous devrions avoir encore en commun) en intervenant dans une lutte, auprès d’une partie de la classe, de viser à s’adresser à et défendre les intérêts de toute la classe ouvrière, en mettant en avant toujours et partout, les enjeux immédiats et historiques de son combat, les méthodes qui en découlent concrètement dans chaque situation, en tenant compte du cours historique, des potentialités (et les limites) du mouvement (ascendant, descendant), de façon agitatoire ou propagandiste, de l’intérieur ou de l’extérieur, dans le courant ou à contre-courant etc. ... Ce qui interdit toute rodomontade.
Je ne vois pas en quoi, en fait, ici, vous êtes les continuateurs du “vieux CCI” que vous prétendez être, si concernant les méthodes de lutte de classe dans cette période historique-ci, vous ne tenez pas compte du fait que celui-ci - le “vieux CCI” comme vous le nommez - s’est toujours flatté “de ne pas être gréviculteur” et a “depuis” Longwy-Denain, la Grande et Longue Grève des Mineurs en Grande-Bretagne, et le premier manifeste contre le chômage, su tirer comme leçon, non pas que la grève est devenue obsolète en elle-même, à tout moment et en toutes circonstances, mais que toute grève, dure et longue, ou à répétition, dans un secteur, a non seulement cessé d’être le moyen de lutte privilégié de la classe ouvrière, mais est devenue un des moyens privilégiés pour la bourgeoisie, pour enfermer, casser la combativité ouvrière, empêcher toute réelle unification politique… toute généralisation et politisation, de son mouvement qui exige le regroupement des prolétaires sans exclusives dans des assemblées, meetings de quartiers, manifestations de rues sur des mots d’ordre de classe (donc en rupture avec le corporatisme et le nationalisme). Pensez à nouveau aux leçons des grandes grèves de 1936, 1968, pensez à celles 1995, 2003 en France... Pensez à la conclusion que le “vieux CCI” a cru pouvoir tirer, une nouvelle fois de la Lutte en Pologne en 1980, en lien avec la tragédie de l’isolement et de la défaite, aux effets catastrophiques de La Révolution russe. N’oubliez pas que nous ne sommes plus au XIXème siècle, ni même au XXème siècle, et même si vous ne pouvez pas entendre le terme de “phase de décomposition”, n’oubliez pas celui de décadence du capitalisme qui implique bien une différence radicale entre une grève massive sectorielle même sauvage, comme à Opel à Bochum, et la grève de masse qui s’étend sur des mois voire des années au niveau national et international, qui pose la question du pouvoir politique et dans laquelle ce qui prime n’est pas la grève, mais son dépassement par l’entrée en masse des ouvriers dans la lutte, par delà toutes les divisions en corporations, secteurs, entre actifs et chômeurs, ceux du public et du privé, et leur auto-organisation au travers d’assemblées et conseil ouvriers de quartiers, de villes, donnant lieu à des manifestations de rue sur des revendications unitaires contre le pouvoir politique bourgeois et ses symboles.
Et c’est en référence à cette conception de “grève de masse” de l’intervention des révolutionnaires dans les luttes ponctuelles qui peuvent en constituer les prémisses ou les premiers pas, les prodromes, que, critiquant votre intervention dans le mouvement du printemps 2003 en France, j’avais été conduit à vous écrire ceci : Intervenir... “C’était donc également, non pas ironiser sur la question des manoeuvres de la bourgeoisie mise en avant par le CCI (que je n’ai pas lu) mais reconnaître la réalité de la manoeuvre et la dénoncer en prenant conscience et en expliquant que c’est là une question clef pour toute la période historique que la classe ouvrière confronte :
celle de la méthode et du but de son combat, méthode qui ne peut plus être la grève, longue ou à répétition, mais le regroupement, l’unification dans la rue (meetings, manifestations) après, avant le travail, contre les symboles du pouvoir, les lieux du pouvoir etc.) ;
but qui est de faire fonctionner toute la société sur d’autres bases et dans l’immédiat de faire fonctionner les services “publics” (hors impôts, police) et tout particulièrement les moyens de transport sans lesquels il est impossible de maintenir la réunion des ouvriers en lutte, leur concertation, de favoriser leurs déplacements vers les AG ou vers les manifs unitaires... bref construire, favoriser la solidarité active, l’unité.
C’était là une question politique centrale dans ce mouvement de même que celle de proposer un lieu de meeting permanent dans chaque ville ; un lieu de prise de décision de tous les secteurs (Place publique et non pas dépôts de bus,)
C’est ce type de perspective d’action politique ouvrière qui a été attaqué préventivement par la bourgeoisie cette fois… via l’enterrement et la répression de la manifestation organisée par les syndicats devant l’Assemblée.”
Voilà sans doute quelques points qui me semblent, à moi, se situer pleinement dans la continuité du “vieux CCI.” auquel j’ai appartenu et qui me sert encore de référence, de repère, dans mes interventions sur mon lieu de travail, surtout :
quand, comme en ce moment, mes “collègues” et moi-même sommes appelés à faire des grèves sectorielles, comme “postiers”, comme enseignants, comme Cheminots, comme contrôleurs, comme, “membres de la fonction publique”, et le 5 Février comme salariés français, électeurs mécontents, “enfin solidaires et dans la rue entre ceux du privé et du public”.
quand nous réagissons de nous-même, spontanément, “sauvagement”, pour résister localement, ponctuellement, aux formes locales du renforcement général d’une exploitation et d’une ‘oppression capitaliste que l’on perçoit bien comme Mondiale... et qu’on veut nous enfermer immédiatement dans un lutte avec tel ou tel “patron”, tel ou tel “chef”, tel ou tel problème de secteur, de français, d’européens, telle ou telle stratégie commerciale, de privatisation etc..,.
C’est à mon sens aller à contre courant des anciennes “idées reçues”, “ressassées” à en vomir depuis des décennies, autant par les partis de gauche, que par ceux de droite, par les syndicalistes de tous poils comme par les journalistes.
C’est apporter de l’oxygène, une perspective, dans cette puanteur idéologique corporatiste chauvine, et la tendance au fatalisme, à la résignation, au refus de penser, de penser à un avenir possible, qu’elle génère.
C’est favoriser ainsi ce que toute lutte désormais confronte immédiatement et contient de ce fait de nécessité et de possibilité de constituer un moment particulier et privilégié de la seule forme de mondialisation capable de mettre un terme à la barbarie mondialisée du capital, c’est à dire un moment de l’unification politique des prolétaires.
Aujourd’hui comme jamais auparavant dans l’histoire de la classe ouvrière, toute concession à l’économisme, au corporatisme, au nationalisme, contribue à annihiler ses forces de résistances et sa capacité d’action autonome.
Il n’y a plus, s’il n’y en a jamais eu aujourd’hui, aucune place pour une “tactique révolutionnaire” sectorielle, corporatiste, nationaliste ne serait-ce que par défaut de dénonciation ouverte de celle-ci, qui vaille pour des révolutionnaires. Même à Bochum, même en “imagination”.
Meilleurs voeux 2005 à vous tous. Fraternellement,
Le 28 01 2005 Ch. Ex LL
Vie du CCI:
Courants politiques:
Seconde lettre de Ch.
- 2538 lectures
A l’attention de “La fraction Interne du C.C.I.” (copie au C.C.I.)
Camarades,
J’accuse réception par la présente de votre envoi d’un appel à la “Réunion publique du BIPR à Paris le 19 Février 2005 à 14 heures à 1’AGECA, 177 rue de Charonne (75011 Paris) Sur le thème CRISE ECONOMIQUE et REPRISE de la LUTTE DE CLASSE à laquelle vous avez rajouté cette phrase : La fraction Interne du CCI te convie à participer à cette réunion et à y exprimer ton point de vue.
Cet envoi, qui semble pour vous équivaloir à “une réponse politique” à mes commentaires et questions pourtant assez précis, concernant vos articles, vos prises de positions à vous, (et à personne d’autre) dans votre bulletin N° 29 et non les positions défendues par le PCI, me trouble profondément.
En effet, je pensais jusqu’ici que, quand je recevais votre bulletin (que par ailleurs vous avez pris de vous-même l’initiative de m’envoyer) et quand, à l’occasion, je vous faisais parvenir à vous et au C.C.I mes commentaires sur vos prises de positions, j’avais affaire à un groupe de militants du C.C.I. censés s’être organisés en fraction dans le but “déclaré” de faire valoir un point de vue en continuité en sauvegarde du C.C.I. “ancien”, attaqué selon leurs dires “par la dégénérescence” du C.C.I. “nouveau”.
Or, votre “réponse” (de type “faux-cul” ?) montre, dans sa forme comme dans son contenu, non seulement que vous vous refusez -une nouvelle fois- de répondre de façon politique et argumentée aux questions que je peux soulever en tant que membre de la classe ouvrière auquel pourtant, vous vous adressez, mais bien plus grave, que vous évacuez, vous faites l’impasse sur toute forme de réponse politique en tant que fraction du CCI, et vous vous déchargez de “cette réponse” sur une réunion du PCI, groupement dont je ne lis et ne reçois aucune publication, sur les positions duquel je ne formule aucun avis et en direction duquel je ne suis demandeur d’aucune clarification.
Il m’apparaît donc que vous n’agissez plus, ici, comme “fraction du C.C.I.” mais bien, sous le vocable devenu trompeur, de Fraction du CCI - comme de vrais militants, de vrais sympathisants, de vrais recruteurs du BIPR qui, pourtant, et pour autant que je sache, ne s’est jamais fixé pour tâche, lui, de faire un travail de sauvegarde du programme et des orientations de l’ancien C.C.I, contre le mouvement “actuel” de dégénérescence par vous dénoncé.
J’en conclu donc, en attendant un démenti argumenté de votre part et un appel à me rendre à une de vos permanence ou de vos réunions publiques, que vous n’êtes pas ou p1us fraction du C.C.I. et qu’il est donc devenu inutile de m’envoyer un faux bulletin du PCI et inutile pour moi de m’adresser à vous en tant que partie du C.C.I. défenseurs de ses acquis.
Mais peut-être est-ce cette inutilité et cette conclusion que vous vouliez me voir vous signifier ? Je souhaite pour la clarté des débats dans la classe ouvrière que je suis là en train de me tromper.
Salutations prolétaires.
Ch. Ex LL.
Vie du CCI:
Courants politiques:
Prise de position de Wereldrevolutie concernant la foire du livre anarchiste de Utrecht du 3 décembre
- 2895 lectures
Cette année aussi, les "placiers anarchistes" ont refusé, et cette fois sans aucune espèce de raison, de nous accorder un stand à la foire du livre alternatif de Utrecht. Cette attitude est en totale contradiction avec la longue tradition de discussion, aux Pays-Bas et ailleurs, entre d'une part le courant de la Gauche communiste et, d'autre part, les courants au sein de l'anarchisme qui sont à la recherche d'une alternative à la barbarie de la guerre et de la misère dans le capitalisme.
Cela montre une fois de plus à quel point les courants au sein de l'anarchisme qui se rangent du côté de la lutte des ouvriers et des chômeurs pour la révolution ont peu en commun avec les organisations ou les structures anarchistes "établies". Tant sur le plan de leurs positions que sur celui de leur attitude, celles-ci n'ont rien à envier aux cliques staliniennes ou trotskistes. C'est pour cela qu'elles accueillent des groupes nationalistes ou des librairies crypto-staliniennes, mais jugent inacceptables les positions internationalistes et les excluent impudemment.
Nous appelons donc à engager la discussion sur ces points:
- en menant le débat avec nous à l'entrée de la bourse, où nous diffuserons notre presse;
- en envoyant une prise de position à notre adresse e-mail.
Lire aussi:
Le refus de stand au CCI à la bourse du livre alternatif de Gand et d'Utrecht [34] dans Internationalisme n° 319
Lettre ouverte des éditions De Dolle Hond aux maîtres du marché anarchistes de la foire du livre d’Utrecht, sur notre site Web: https://nl.internationalism.org [35]
Les organisateurs de la foire du livre anarchiste d’Utrecht dévoilent leurs pratiques staliniennes dans Wereldrevolutie n° 101.
Vie du CCI:
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [36]
Le Dolle Hond et le CCI
- 2258 lectures
Pourquoi les publications du CCI sur le stand de Dolle Hond?
Nous pouvons tranquilliser nos amis et devons hélas décevoir nos ennemis: le Dolle Hond n'est affilié à aucune secte communiste. Et pourtant, nous avons bien présenté la littérature du CCI sur notre stand à la foire du livre anarchiste. Depuis un certain nombre d'années, le CCI, organisation communiste de gauche (c'est-à-dire, ni stalinienne, ni trotskiste) se voit systématiquement refuser un stand par les organisateurs des foires du livre anarchistes et alternatives à Gand et à Utrecht. Nous nous étonnons depuis longtemps de cette politique absolument arbitraire, d'autant que d'autres clubs non-anarchistes reçoivent de ces organisateurs autant de place qu'ils en veulent, des démocrates bourgeois et réformistes aux groupes nationalistes et même staliniens. A notre demande d'une explication par écrit de cette politique arbitraire, nous n'avons, un an après, enregistré aucune réaction.
Sur de nombreux points fondamentaux, le Dolle Hond est en désaccord avec le CCI. Qu'il s'agisse des déchirements dans la première Internationale, de la révolte de Kronstadt en 1921, de la révolution d'Espagne en 1936 ou même de l'appréciation des récentes émeutes dans les banlieues françaises, nos positions sont à des lieux des siennes.
Pour le Dolle Hond, le CCI est une organisation semi-léniniste, avec des positions désespérément désuètes sur une avant-garde du prolétariat et un matérialisme historique rigide. Selon le CCI, le Dolle Hond est anarchiste, et inspiré par le "conseillisme". Un coup d'œil sur nos valeurs montre clairement que cette étiquette est réductrice: on pourrait tout aussi bien nous prétendre inspirés par le dadaïsme, le surréalisme, le situationnisme, et pour notre part, même par le kayyamisme.
Malgré toutes ces divergences, le Dolle Hond continue à discuter avec le CCI (mais oui, chacun ses goûts) et nous nous élevons contre le refus, selon nous totalement arbitraire, du CCI à la foire du livre anarchiste.
Samedi 3 décembre 2005,
Editions Dolle Hond
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [36]
Lettre signée BW
- 2349 lectures
Chers CCIstes/camarades,
Par la présente, je voulais vous faire savoir que je trouve ridicule votre mise à l'écart de la foire du livre anar de Utrecht. Comme visiteur régulier de cette foire, je sais qu'il s'y trouve une riche variété de stands tenus par des groupes ou des librairies, aussi bien anarchistes (avec toute la diversité de l'anarchisme), que pas clairement définis ou non-anarchistes. Que d'un tel éventail de stands divergents, soit sournoisement exclu un groupe qui se positionne pour une lutte ouvrière internationaliste est totalement arbitraire et ridicule. Si on se réfère aux rencontres et débats historiques entre socialistes libertaires et communistes internationalistes, le CCI ne devrait pas être absent de la foire du livre. De plus, le CCI est volontiers accueilli depuis des années aux journées anarchistes de la Pentecôte. Par la présente, j'appelle l'organisation de la foire à fournir un espace au CCI, ou à tout le moins, à l'autoriser à vendre sa presse à l'intérieur de la foire.
Salutations solidaires,
BW
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [36]
ICConline - 2006
- 5474 lectures
Belgique: Face aux licenciements comme à VW Forest: La seule réponse à la crise capitaliste: la solidarité ouvrière
- 3591 lectures
Hier encore, patrons, gouvernement et syndicats avaient affirmé en chœur aux travailleurs de VW : si vous acceptez plus de flexibilité et une accélération des cadences, vos emplois seront sauvegardés. L’on voit aujourd’hui ce que valent ces belles promesses : 4.000 licenciements directs et 8 à 10.000 licenciements indirects.
Comment réagir à ce bain de sang social d’une brutalité inouïe ? Doit-on rester calme et accepter la logique des licenciements comme le proposent les syndicats ? Doit-on faire confiance aux négociations et s’en remettre aux mascarades de solidarité formelle des délégations syndicales ? Comment développer une lutte réelle, solidaire et collective ? Le capitalisme a-t-il encore un avenir à offrir ? Doit-on croire aux nouvelles promesses de reclassements, nouveaux plans industriels, etc. ou sont-elles de vains espoirs pour contenir la colère et la lutte des travailleurs ? Telles sont les questions cruciales posées dans le conflit social de VW et auxquelles il faut trouver des réponses claires.
L’impasse de l’économie de marché
Depuis plusieurs jours, à coup d’émissions en direct et d’éditions spéciales, les médias bourgeois relaient les larmes de crocodile hypocrites des hommes politiques et étalent tout le désarroi des travailleurs de VW jetés dans la rue comme de vulgaires kleenex. Le message que la bourgeoisie veut faire passer est clair et vise l’ensemble des travailleurs du pays : "C’est triste et regrettable mais il n’y a rien à faire : ce sont les lois de l’économie et les conséquences de la mondialisation. Cela ne sert à rien d’opposer une résistance, car la logique de la concurrence capitaliste s’imposera de toute façon. La seule façon de s’en sortir est d’être plus compétitifs et donc d’accepter encore plus de sacrifices, demandés par nos exploiteurs dans l’intérêt de la sauvegarde de l’économie nationale". Est-ce la seule perspective ? Qu’en est-il en réalité ?
- Ces "lois de l’économie de marché", ce sont les lois du capitalisme, leurs lois à eux : patrons et gouvernants. Des lois qui conduisent à un cycle sans fin de licenciements, de délocalisations, et de baisses des salaires. Des lois qui imposent aux ouvriers des pays industrialisés un rythme de travail et une flexibilité insupportable, et à leurs frères de classe des pays "émergents" des conditions de travail inhumaines. Des lois qui entraînent l’humanité entière à sa perte, aussi bien au niveau économique que dans la multiplication de conflits guerriers ou de catastrophes écologiques si nous ne réagissons pas.
- Quant à la solidarité qui nous est demandée avec le patronat et le gouvernement de "notre pays", c’est la garantie de devoir encore avaler plus de plans d’austérité ou de flexibilité au nom de "la compétitivité de ‘notre’ économie", c’est-à-dire au nom de la défense des taux de profit de la bourgeoisie belge dans la guerre de concurrence impitoyable qu’elle mène avec ses congénères, c’est la garantie d’être opposé aux travailleurs des autres pays dans une spirale sans fin de baisse des salaires, de hausse de productivité et de dégradation des conditions de vie.
Après les licenciements massifs à Renault, Vilvorde, la SNCB, la Sabena, Ford Genk, DHL, Inbev ou AGFA Gevaert, avec demain peut-être Opel et, une fois de plus, la Poste, après ‘le pacte des générations’ pour la compétitivité ou l’emploi, qui a réduit nos salaires et augmenté la flexibilité jusqu’à des niveaux effroyables, quelle perspective offre cette spirale d’austérité et de concurrence effrénée ? L’expérience des semaines passées à VW confirme ce que de plus en plus de travailleurs commencent à ressentir : l’économie capitaliste de marché (avec ou sans régulation "sociale") n’a rien à offrir que la paupérisation, l’insécurité et la misère sans fin.
Gouvernement et syndicats organisent la division et instillent un sentiment d’impuissance
La soi-disant surprise de la bourgeoisie belge face à la brutale attaque à VW et sa ‘compréhension’ envers la colère des travailleurs licenciés ne sont qu’hypocrisie. Rappelons-nous comment elle a cyniquement sacrifié des milliers d’emplois chez DHL au nom de la "lutte contre les nuisances sonores" ou, en tant qu’‘Etat-patron’, comment elle a réduit l’emploi de moitié à la SNCB et bientôt à la poste. De plus, ce séisme social tombe bien à point pour elle au moment où doit se conclure un nouvel accord interprofessionnel devant fixer la ‘modération salariale’ dans l’ensemble de l’industrie. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si, depuis plusieurs semaines avant l’annonce des licenciements massifs, des rumeurs, savamment distillées, couraient déjà sur différents scénarios de licenciements. Aussi, dès que les chiffres se sont concrétisés, la bourgeoisie et ses syndicats étaient sur place pour encadrer la colère, diviser les travailleurs et en faire une démonstration d’impuissance pour l’ensemble de la classe ouvrière :
- Dès avant l’annonce définitive, les syndicalistes socialistes pointaient les responsables : les coupables n’étaient pas le patronat ni l’Etat bourgeois, mais les travailleurs allemands et ‘leurs’ organisations syndicales qui, pour sauver leurs emplois, auraient sacrifié VW-Forest! Quel mensonge répugnant ! Les travailleurs allemands, comme ceux de tous les pays, sont tout autant victimes de l’agression capitaliste. Nos ennemis, ce ne sont pas nos frères de classe d’un autre pays ou d’une autre région : ils subissent les mêmes attaques sauvages sur leurs conditions de vie ou de travail. Non ! Notre ennemi c’est le capitalisme qui engendre fatalement cette logique infernale d’exploitation accrue et de licenciements, cette logique de compétition économique et guerrière de par le monde. En réalité la bourgeoisie et ses syndicats (en Belgique comme en Allemagne) jouent un jeu crapuleux en montant les ouvriers d’un pays contre ceux d’un autre à travers un immonde chantage aux salaires et à l’emploi: ‘si tu n’acceptes pas une baisse de salaires et plus de flexibilité, on part chez le voisin où les coûts salariaux sont moins élevés’ ou ‘si tu n’acceptes pas la restructuration et les licenciements, on transpose la production chez le voisin’.
- En braquant aussi les projecteurs de l’ensemble des médias sur la colère impuissante et le désarroi des ouvriers à VW, l’objectif de la bourgeoisie et des organisations syndicales est d’étaler ce sentiment d’impuissance sur l’ensemble de la classe ouvrière belge. La signification du message est claire: ‘si ce puissant contingent, qui s’est régulièrement fait remarquer par ses luttes et sa combativité (les médias se plaisent à rappeler que l’usine avait la réputation dans les années ’90 d’être une usine ‘gréviste’) ne peut s’opposer à de telles mesures, alors la classe ouvrière ne le pourra nulle part en Belgique’.
Le développement de ce battage n’est pas innocent. Gouvernement, patronat et syndicats sont inquiets face au développement d’un sentiment de colère un peu partout dans la classe ouvrière, sentiment qui commence à se manifester par une reprise du chemin des luttes dans de nombreux secteurs. C’est pour faire barrage à cette montée des conflits que la bourgeoisie essaie de faire passer ce sentiment d’impuissance et de fatalité.
Les syndicats organisent une mascarade de solidarité ouvrière
Les organisations syndicales sont parvenues à éviter l’éclatement de la lutte à VW. Ils ont demandé aux ouvriers de rester isolés chez eux à la maison, sans informations ou perspectives, dépendants du bon vouloir des patrons et des négociations à venir. Ils ont ensuite imposé aux ouvriers une grève, non pas active et de lutte, mais une grève interminable (annoncée jusqu’au 15 décembre, le jour de la notification officielle des décisions en Allemagne), toujours isolé chacun chez soi à la maison. La seule préoccupation des syndicats est de "rester digne", de "préserver l’outil", de "ne pas occuper le site" sous le fallacieux prétexte de ne pas fâcher le patronat qui, disent-ils, tiendrait compte de "cette attitude responsable" ! Purs bobards ! Les syndicats dévoilent là leur véritable nature de défenseurs des intérêts du capitalisme contre les intérêts des travailleurs !
C’est pourquoi, afin de ne pas apparaître comme de purs et simples saboteurs, ils ‘organisent’ une mascarade de solidarité autour du cas de VW. C’est une mascarade parce que ce n’est en rien une réelle solidarité dans la lutte afin de faire plier, tous ensemble, le patronat et le gouvernement, mais une solidarité formelle consistant à organiser une manifestation nationale sans lendemain le 2 décembre et à envoyer quelques délégations syndicales dans les autres usines automobiles pour y rencontrer leurs homologues et quémander leur ‘soutien’. C’est une véritable mascarade puisque tout cela est fait dans le seul but de "négocier avec les patrons les moins mauvaises conditions de licenciement", d’appuyer le gouvernement dans son ‘exigence’ "d’un nouveau projet industriel" qui ne peut, en réalité, qu’être une nouvelle illusion, et de discuter le "reclassement" des milliers de sans-emplois … aux conditions du ‘Pacte des générations’ c’est-à-dire avec obligation d’accepter n’importe quel travail à n’importe quelles conditions sous peine de perdre ses droits aux allocations ! Et comme toutes ces illusions n’aboutiront qu’à un échec, les syndicats auront beau jeu, comme à leur habitude, de rejeter la responsabilité sur le dos des ouvriers qui n’auraient pas été assez solidaires !
Toute l’histoire montre qu’un tel enfermement dans le carcan syndical ne peut mener qu’à la défaite et au découragement. Et ceci non pas parce que les délégués syndicaux de VW ou les secrétaires nationaux de la centrale des métallos seraient des vendus : les syndicats divisent les ouvriers et défendent une gestion responsable de l’économie capitaliste aux dépens des exploités parce qu’ils font partie depuis longtemps des structures de l’Etat capitaliste et qu’ils défendent sa logique.
La seule réponse aux attaques se trouve dans la véritable solidarité ouvrière
Toute l’histoire montre aussi que seule l’extension de la lutte aux autres fractions de la classe ouvrière est capable, même temporairement, de faire reculer la bourgeoisie. Et, vu l’effervescence parmi les travailleurs de nombreux secteurs, vu les menaces de licenciements dans d’autres usines, de telles possibilités d’extension ne sont nullement imaginaires. Mais cela signifie aussi que la solidarité ouvrière et l’extension des luttes ne peuvent être réalisées que par les ouvriers eux-mêmes. Ceci exige des assemblées massives et souveraines, prises en main par les ouvriers au travers d’une participation massive de tous et de tous les secteurs en lutte. Ceci ne peut être réalisé qu’en se confrontant au sabotage syndical et sous le contrôle direct des ouvriers en lutte.
Pour cela, il nous faut prendre exemple sur les combats récents comme les luttes contre le CPE en France, les grèves du métro de New-York ou encore celle des métallurgistes à Vigo en Espagne, où sont réapparues les marques de solidarité prolétarienne, les assemblées générales sous le contrôle des ouvriers ainsi que l’exigence de négocier directement, sans la médiation syndicale.
Aujourd’hui, la crise du capitalisme, la calamité omniprésente du chômage et la barbarie générale du système sont beaucoup plus évidentes. La grande vague de sympathie de la population pour les ouvriers de VW –bien plus forte que lors de l’annonce des licenciements à Ford Genk il y a deux ans-, est directement liée à cette reconnaissance qui se fait jour progressivement de la gravité de la situation générale et du problème fondamental qui se pose pour la société: quelle perspective offre cette spirale d’austérité et de concurrence effrénée ? Les salaires et conditions de travail arrachés au cours de deux siècles de luttes ouvrières sont menacés d’être remis en question. La force de travail humaine, en tant que source des richesses de la société, est de plus en plus surexploitée et dépréciée. Tout cela ne constitue pas le signe de la naissance douloureuse d’un nouveau système mais est au contraire l’expression d’un capitalisme moribond qui est devenu un obstacle au progrès de l’humanité. Les efforts balbutiants d’aujourd’hui vers une résistance ouvrière, vers un retour à la solidarité, vont de plus en plus de pair avec une réflexion en profondeur sur la situation. Ceci peut et doit conduire à remettre en question ce système barbare, dans la perspective d’un système social supérieur, socialiste.
CCI / 24.11.06Vie du CCI:
- Interventions [37]
Situations territoriales:
Cinquante ans après que la révolte des ouvriers eût secoué la Hongrie en 1956
- 3788 lectures
Le texte ci-dessous a été rédigé il y a trente ans, mais cinquante ans après le soulèvement en Hongrie, il reste d'actualité
Vingt ans après que la révolte des ouvriers eût secoué la Hongrie en 1956, les vautours de la bourgeoisie "célèbrent" l’anniversaire dans leur style habituel. La presse bourgeoise traditionnelle verse une larme nostalgique sur la résistance héroïque du "peuple hongrois" contre les "horreurs du communisme", alors qu'à l'autre bout du spectre politique de la bourgeoisie, les trotskistes se souviennent nostalgiquement de l'insurrection comme d'une "révolution politique pour l'indépendance nationale et les droits démocratiques" (New Line, octobre 1976). Tous ces souvenirs ne décrivent que l'apparence de la révolte, et donc masquent et distordent sa signification réelle. La révolte de 1956 en Hongrie, comme les grèves qui ont éclaté la même année et plus récemment en 1970 et 1976 en Pologne, ne sont pas les expressions de la volonté du "peuple" d'Europe orientale de réformer le "communisme" ou de réformer des "Etats ouvriers dégénérés". Elles sont le résultat direct des contradictions insolubles du capitalisme en Europe de l'Est et dans le monde entier.
La crise dans le bloc de l'Est, de 1948 à 1956
L'établissement de régimes staliniens d'Europe de l'Est après la seconde guerre mondiale fut la réponse que le capital russe faisait à l'intensification des rivalités impérialistes à l'échelle mondiale. Le blocus de Berlin, la guerre de Corée, l'avènement de la guerre froide exprimaient la tension incessante entre les deux géants impérialistes, la Russie et l'Amérique, tension qui dominait le monde après la guerre. La Russie, toujours sur la défensive à cause de la supériorité économique américaine, était forcée de transformer les pays d'Europe de l'Est en un glacis économique et militaire contre l'Ouest. Pour assurer la domination du capital russe sur ces économies, l'appareil politique rigide du stalinisme devait leur être imposé. L'étatisation totale de ces régimes était accélérée par la faiblesse de leur économie suite à la guerre. Mais le système stalinien fut même imposé aux pays comme la Tchécoslovaquie, qui avaient "bénéficié" des bienfaits de la démocratie avant la guerre. Le caractère stalinien de ces régimes est inséparablement lié à la domination économique de la Russie; défier l'un revient à défier l'autre. Les événements de 1956, comme ceux de Tchécoslovaquie en 1968, montrent les limites étroites de la "libéralisation" que le Kremlin tolère parmi ses "satellites".
Dans les années 1948-53, la pression de la concurrence inter-impérialiste a poussé le bloc russe à s'engager dans une nouvelle phase d'accumulation frénétique. Industrie lourde et production militaire ont été développées au détriment des biens de consommation et des conditions de vie de la classe ouvrière. En plus de cela, la Russie exigeait un énorme tribut de ses clients en termes d'échanges inégaux, de firmes de propriété russe, etc. Ce "partenariat" brutal avait son expression économique et militaire dans le Comecon et le Pacte de Varsovie. En termes politiques, cette période "d'économie de siège" était accompagnée d'une répression massive tant contre les ouvriers que contre les vieux partis bourgeois, en plus d'une série de purges et de procès spectaculaires de dissidents au sein de la bureaucratie elle-même; Slansky en Tchécoslovaquie, Rajk en Hongrie, etc. Ces charades barbares étaient destinées à éradiquer toute tendance au "Titisme" au sein des bourgeoisies nationales d'Europe de l'Est. Le Titisme fonctionnait simplement comme une étiquette pour éviter toute velléité centrifuge dans le sens d'une autonomie nationale de la part des bourgeoisies locales.
La faiblesse économique du bloc russe par rapport au bloc occidental explique pourquoi la classe ouvrière à l'Est n'a pas commencé à bénéficier de la reconstruction d'après-guerre avant qu'elle ne soit pratiquement achevée. Dans le but de "rattraper" les USA au niveau militaire (le seul niveau où la Russie peut espérer rivaliser avec les USA), la bourgeoisie du bloc russe devait maintenir des bas salaires et développer l'industrie lourde aussi vite que possible. Dans la période 1948-53, les conditions de vie des ouvriers partout dans le bloc de l'Est sont tombées en dessous du niveau d'avant-guerre, mais la Russie est sortie de cette période avec sa bombe H et ses spoutniks.
Néanmoins, de profondes tensions économiques ont commencé à apparaître à l'intérieur du bloc lorsque les marchés du Comecon ont atteint leur point de saturation, et lorsque la classe ouvrière a commencé à s'agiter de façon croissante, suite à ces assauts terribles contre ses conditions de vie. Il devenait de plus en plus nécessaire pour faire face à l'encerclement de procéder à un lifting, et pour la Russie de s'ouvrir au marché mondial. En Europe de l'Est, un certain relâchement de la même sorte était également nécessaire, mais exigeait l'abandon partiel du contrôle russe sur les économies de ses satellites.
La mort de Staline en 1953 a opportunément coïncidé avec le besoin général du capitalisme dans le bloc russe d'un "relâchement", tant politique qu'économique. Les conflits sociaux qui s'étaient envenimés sous la surface éclataient maintenant ouvertement. Une fraction "libérale" de la bureaucratie a commencé à émerger, appelant à un abandon partiel du despotisme économique et politique et à une réorientation de la politique étrangère. De telles mesures étaient défendues comme le seul moyen de restaurer le profit et de maintenir le contrôle sur le prolétariat. Cette dernière exigence était particulièrement accentuée par l'éclatement de révoltes ouvrières massives en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, et même en Russie (dans l'énorme camp de travail de Vorkuta).
En Russie, la mort de Staline a été suivie de luttes de factions qui se sont conclues par la victoire de la "clique révisionniste" de Khrouchtchev au 20ème congrès du PCUS en 1956, où les crimes et les excès de l'ère stalinienne ont été dénoncés devant le monde ébahi. La nouvelle ligne annoncée par Khrouchtchev promettait un retour à la démocratie prolétarienne, accompagnée d'un politique étrangère de "coexistence pacifique", dans laquelle la Russie se restreindrait à une compétition économique et idéologique avec "l’occident capitaliste".
Dans les pays d'Europe de l'Est, la tendance "libérale" dans la bureaucratie exprimait inévitablement une sorte d'indépendance économique par rapport à la Russie. C'était un problème majeur pour les "libéraux" de savoir jusqu'où ils pouvaient sans risque pousser leurs pulsions nationalistes, mais tout d'abord, les Russes encourageaient activement des programmes de réformes prudentes dans les pays satellites. En Hongrie en 1953, Malenkov demande au stalinien Rakosi de céder sa place au réformiste Imre Nagy. Nagy réclamait un ralentissement dans le développement de l'industrie lourde, plus d'insistance sur la production de biens de consommation, une suspension des campagnes de collectivisation dans les campagnes, et un relâchement du contrôle sur la "culture". Durant les quelques années qui ont suivi, la bureaucratie hongroise a été déchirée par le conflit qui en est issu entre "conservateurs" enracinés dans la police et la hiérarchie du parti, et les "réformateurs" qui s'appuyaient sur les échelons inférieurs de la bureaucratie, les directeurs d'usines, etc. En même temps, la libéralisation des arts donnait naissance à un mouvement national d'artistes et d'intellectuels, dont l'aspiration à l'indépendance nationale et à la "démocratie" dépassait considérablement le programme défendu par la fraction Nagy de la bureaucratie.
En dépit de la nature prudente de la "NEP" de Nagy, la bourgeoisie russe a décidé très rapidement qu'il agissait à un rythme trop précipité. En 1955, il était relevé de son poste de premier ministre et l'impopulaire Rakosi reprenait une nouvelle fois les rênes du pouvoir. Mais les Russes et leurs laquais avaient mis en mouvement quelque chose de difficile à contrôler. Le mouvement de protestation des artistes, des intellectuels et des étudiants continuait à enfler. En avril 1956, le cercle Petöfi était formé par des étudiants "Jeunes Communistes". Officiellement groupe de discussion culturel, il devint rapidement une sorte de "Parlement" pour tout le mouvement d'opposition. La censure officielle de ce mouvement n'arriva qu'à lui donner un nouvel élan.
En juin 1956, les ouvriers de Poznan en Pologne déclenchaient une grève de masse, qui prit très vite des allures d'insurrection locale. Bien que rapidement et brutalement réprimée, la révolte déboucha en Pologne sur le triomphe des "réformistes" dirigés par W. Gomulka. Comme son successeur Gierek en 1970, le "gauchiste" Gomulka apparaissait dans son ascension vers le pouvoir comme le seul personnage capable de maintenir le contrôle sur la classe ouvrière.
Les convulsions en Pologne ont donné un formidable coup d'accélérateur aux développements en Hongrie. L'insurrection de Budapest le 23 octobre a suivi une manifestation massive, organisée à l'origine par les étudiants "en solidarité avec le peuple de Pologne". La réponse intransigeante des autorités, qui ont traité les manifestants de "fascistes" et de "contre-révolutionnaires", la répression sanglante menée par l’AVO (la police secrète), et par-dessus tout, le fait que la manifestation "étudiante" ait été renforcée par des milliers et des milliers d'ouvriers, ont transformé la protestation pacifique exigeant des réformes démocratiques et le retour de Nagy en insurrection armée.
Le caractère de classe de l'insurrection hongroise
Ce n'est pas l'endroit de revoir dans tous les détails les événements qui ont mené de l'insurrection du 23 octobre à l'intervention finale de la Russie, qui a coûté la vie à des milliers de personnes, en majorité de jeunes ouvriers. Nous voudrions seulement revenir sur le caractère général de la révolte dans le but de la sortir des terribles confusions qui l'entourent.
Comme nous l'avons vu, l'opposition à la "vieille garde" stalinienne s'exprimait de deux manières. La première provenait de la bourgeoisie elle-même, menée par des bureaucrates libéraux et soutenue par des étudiants, des intellectuels et des artistes un peu plus radicaux. Ils défendaient une forme plus démocratique et plus profitable du capitalisme d'Etat en Hongrie. Mais "l'autre opposition" était la résistance spontanée de la classe ouvrière à l'exploitation monstrueuse qui lui était imposée. Et comme on a pu le voir clairement en Allemagne de l'Est et en Pologne, cette résistance était une menace potentielle non pour une ou l'autre fraction de la classe dominante, mais pour la survie du capitalisme elle-même.
En Hongrie, ces deux mouvements "se sont rejoints" dans l'insurrection. Mais c'est l'intervention de la classe ouvrière qui a transformé un mouvement de protestation en insurrection, et c'est la contamination de l'insurrection ouvrière par toute l'idéologie nationaliste et démocratique des intellectuels qui a affaibli et troublé le mouvement prolétarien.
Les ouvriers ont "rejoint" le mouvement de protestation par haine instinctive pour le régime stalinien et à cause des conditions intolérables dans lesquelles ils étaient forcés de vivre et de travailler. Une fois que les ouvriers eurent jeté leur poids dans le mouvement, celui-ci prit un caractère violent et intransigeant que personne n'avait prédit. Bien que différents éléments aient pris part au combat (étudiants, soldats, paysans, etc.), ce sont essentiellement des jeunes travailleurs qui, dans les premiers jours de l'insurrection, ont détruit le premier contingent de chars russes envoyés à Budapest pour restaurer l'ordre. C'est principalement la classe ouvrière qui a démantelé la police et l'armée hongroises, et qui a pris les armes pour combattre la police secrète et l'armée russe. Lorsque la seconde vague de chars russes arriva pour écraser l'insurrection, ce sont les quartiers ouvriers qu'il a fallu mettre en ruines, parce qu'ils étaient les principaux centres de résistance. Et même après la restauration de "l'ordre" et l'instauration du gouvernement Kadar, même après le massacre de milliers d'ouvriers, le prolétariat a continué à résister en menant des luttes âpres et nombreuses.
L'expression la plus claire du caractère prolétarien de la révolte a été l'apparition de véritables conseils ouvriers à travers tout le pays. Nommés à l'échelle de l'usine, ces conseils faisaient le lien de régions industrielles entières, de villes, et étaient sans aucun doute le centre organisationnel de toute l'insurrection. Ils ont pris en charge l'organisation de la distribution d'armes et de nourriture, la direction de la grève générale, et dirigé la lutte armée. Dans certaines villes, ils détenaient le commandement total et incontesté. L'apparition de ces soviets sema la terreur parmi les capitalistes "soviétiques" et inspira indubitablement la "sympathie" des démocraties occidentales, cependant mal à l'aise à cause du caractère excessivement "violent" de la révolte.
Mais chanter les louanges des luttes des ouvriers hongrois sans analyser leurs faiblesses extrêmes et leurs confusions seraient une trahison de nos tâches comme révolutionnaires, qui n'est pas d'applaudir passivement les luttes du prolétariat, mais de critiquer leurs limites et de souligner les buts généraux du mouvement de classe. Malgré le fait que les ouvriers avaient de facto le pouvoir dans de grandes zones de la Hongrie durant la période insurrectionnelle, la rébellion de 1956 n'était pas une tentative consciente de la part du prolétariat de prendre le pouvoir politique ni de bâtir une nouvelle société. C'était une révolte spontanée, qui a échoué à devenir une révolution parce qu'il manquait à la classe ouvrière une compréhension politique claire des buts historiques de sa lutte.
Dans un sens immédiat, l'obstacle principal au développement d'une conscience révolutionnaire de la part des ouvriers hongrois était l'énorme battage de l'idéologie nationaliste et démocratique qui leur était assénée de toutes parts. Les étudiants et les intellectuels étaient les propagateurs les plus actifs de cette idéologie, mais les ouvriers souffraient eux-mêmes inévitablement de toutes ces illusions. Et donc, au lieu d'affirmer les intérêts autonomes du prolétariat contre l'Etat capitaliste et toutes les autres classes, les conseils tendaient à identifier la lutte des ouvriers avec la lutte "populaire" pour réformer la machine étatique en vue de "l'indépendance nationale". L'indépendance nationale est une utopie réactionnaire à l'époque de la décadence capitaliste et de l'impérialisme. Au lieu d'appeler –comme les Soviets de Russie l'avaient fait en 1917- à la destruction de l'Etat bourgeois et à l'extension internationale de la révolution, les conseils se sont limités à exiger le retrait des troupes russes, une "Hongrie socialiste indépendante" sous la direction de Imre Nagy, la liberté d'expression, l'autogestion des usines, etc. Les méthodes de lutte utilisées par les conseils étaient implicitement révolutionnaires, exprimant la nature intrinsèquement révolutionnaire du prolétariat. Mais les buts qu'ils ont adoptés restaient tous dans le cadre politique et économique du capitalisme. La contradiction dans laquelle les conseils se sont retrouvés peut être résumée dans la revendication suivante, mise en avant par le conseil ouvrier de Miskolc: "Le gouvernement doit proposer la formation d'un Conseil National Révolutionnaire, basé sur les conseils ouvriers des différents départements et de Budapest, et composé de délégués élus démocratiquement par ceux-ci. En même temps, l'ancien Parlement doit être dissous". (Cité dans Bureaucratie et Révolution en Europe de l'Est, de Chris Hermann, p. 161).
Le conseil de Miskolc exprime ici son hostilité au système parlementaire bourgeois, et comme d'autres conseils, il protestait aussi contre la réapparition des anciens partis bourgeois. De telles positions montrent que la classe ouvrière organisée en conseils se dirige en tâtonnant vers le pouvoir politique. Pourtant, on peut voir simultanément les terribles conséquences de la mystification selon laquelle l’Etat stalinien, d’une façon ou d’une autre, appartiendrait déjà à la classe ouvrière, qu’il soit ou non "bureaucratiquement dégénéré". Cette illusion empêchait les conseils de franchir le pas réellement crucial qui aurait fait de la révolte une révolution prolétarienne : la destruction de toute la machine stalinienne de l’Etat bourgeois, tant ses ailes "conservatrice" que "libérale". Mais au lieu de franchir ce pas, les conseils ont adressé leur revendication de dissolution du parlement et la mise sur pied d’un conseil central des ouvriers au gouvernement de Imre Nagy, c’est-à-dire à la force elle-même qu’ils auraient dû supprimer ! De telles illusions ne pouvaient que conduire à l’écrasement des conseils, ou à leur intégration dans l’Etat bourgeois. Il faut porter au crédit de la majorité des conseils ouvriers qu’ils ont soit péri en luttant, soit se sont dissous quand ils ont vu qu’il n’y avait plus d’espoir de développement de la lutte et qu’ils étaient condamnés à devenir des organes d’amortissement social pour le gouvernement Kadar.
L’incapacité des ouvriers hongrois à développer une compréhension révolutionnaire de leur situation est également apparue dans le fait que, à notre connaissance, aucun regroupement politique révolutionnaire n’est issu en Hongrie de ces énormes convulsions. Comme l’écrivait Bilan, la publication de la Gauche italienne, à propos de l’Espagne dans les années 1930, l’échec du prolétariat espagnol à créer un parti de classe malgré la nature radicale de sa lutte était fondamentalement l’expression du profond creux dans lequel le mouvement prolétarien international se trouvait à ce moment-là. A certains points de vue, la situation autour de 1956 était même pire : la dernière des fractions communistes de gauche avait disparu, et pas seulement en Hongrie, mais partout dans le monde, le prolétariat se retrouvait presque sans aucune expression politique propre. Les petites voix révolutionnaires qui peuvent avoir existé étaient facilement submergées par la clameur de ces forces de la contre-révolution dont le rôle est de parler "au nom" de la classe ouvrière. Les staliniens de tous les pays montraient leur nature brutalement réactionnaire en calomniant le soulèvement ouvrier de "conspiration" au service de Horthy ou de la CIA. Beaucoup d’individus ont quitté les PC par dégoût à cette époque, mais les partis eux-mêmes ont soutenu la répression sauvage des ouvriers hongrois. Qui plus est, certains d’entre eux, conduits par le grand timonier, le Président Mao à Pékin, ont critiqué Khrouchtchev pour ne pas avoir réprimé les ouvriers hongrois assez sévèrement ! Les trotskistes, parce qu’ils ont claironné leur "soutien" au soulèvement, peuvent sembler avoir été du côté des ouvriers. Mais en caractérisant la révolte comme une "révolution politique" pour la "démocratie ouvrière" et "l’indépendance nationale", ils contribuent à renforcer la mystification insidieuse selon laquelle l’Etat en Hongrie avait déjà un caractère ouvrier et devait seulement être purgé de ses déformations bureaucratiques pour revenir entièrement aux mains des ouvriers. Cela vaut la peine de se souvenir que même pour les Socialistes Internationaux, qui apparemment voient la Russie comme un pays dominé par le capitalisme d’Etat, la Russie est digne de soutien sur base du fait qu’elle serait un "moindre mal" dans toute situation de confrontation inter-impérialiste avec les USA. Il y a trop d’exemples du soutien de SI à des conflits de "libération nationale" téléguidés par la Russie pour en dresser la liste ici ; un des plus récents, toutefois, est la MPLA en Angola. Par conséquent, leur "soutien" au soulèvement ouvrier de Hongrie en 1956 n’est qu’un vil mélange de moralisme petit-bourgeois et de totale duperie.
Le degré auquel les trotskistes non seulement essaient de maintenir la lutte des ouvriers à l’intérieur du cadre de l’Etat bourgeois, mais aussi agissent comme annexes pures et simples aux bureaucrates "libéraux" des régimes staliniens, est exprimé de manière concise dans la prise de position de 1956 d’Ernest Mandel, grand prêtre de la Quatrième internationale, à propos de la victoire de la clique Gomulka en Pologne : "La démocratie socialiste aura encore beaucoup de batailles à remporter en Pologne, (mais) la bataille principale, celle qui a permis à des millions d’ouvriers de s’identifier à nouveau avec l’Etat ouvrier, est déjà gagnée" (cité par Harman, p. 108).
Depuis 1956, des analyses plus "radicales" des événements en Hongrie ont été publiées, mais peu rompent vraiment avec le cadre du trotskisme. Par exemple, les libertaires de Solidarity, dans leur brochure Hongrie 56, voient la revendication de l’autogestion ouvrière (élaborée par les syndicats hongrois !) comme le véritable noyau révolutionnaire du soulèvement. Mais cette revendication, comme l’appel à l’indépendance nationale et à la démocratie, n’était qu’une diversion supplémentaire de la tâche première des ouvriers : la destruction de l’Etat capitaliste, la saisie par les conseils, non simplement de la production, mais du pouvoir politique.
L’absence de toute tendance communiste claire dans les années 1950 n’était qu’un reflet de la raison historique fondamentale de l’impasse atteinte par le soulèvement hongrois. Dans cette période, le système capitaliste mondial traversait le long boom de la reconstruction postérieure à la guerre, et la classe ouvrière ne s’était pas encore relevée des défaites sanglantes qu’elle avait subies dans les années 1920, 30 et 40. Beaucoup de fractions de la bourgeoisie se rappellent aujourd’hui avec nostalgie des années 1950, car c’était une période où l’idéologie bourgeoise semblait avoir conquis le contrôle absolu de la classe ouvrière, et où les contradictions économiques du système ressemblaient à un cauchemar depuis longtemps disparu. La crise économique et la lutte prolétarienne qui ont toutes deux déferlé sur le bloc russe dans les années 1950 étaient limitées aux pays de ce bloc. Les ouvriers d’Europe de l’Est se sont donc retrouvés isolés et soumis à toutes les illusions issues d’une situation en apparence "particulière". Avec un capitalisme occidental qui semblait aussi prospère et libre, il n’était pas difficile pour les ouvriers du bloc de l’Est de voir leur ennemi dans la Russie ou le stalinisme, et non dans le capitalisme mondial. Cela explique les terribles illusions qu’avaient souvent les insurgés sur les régimes "démocratiques" de l’Ouest. Beaucoup espéraient que l’Ouest "leur vienne en aide" contre les Russes. Mais l’occident avait déjà reconnu à Yalta le "droit" de la Russie d’exploiter et d’opprimer les travailleurs des pays de l’Est, et n’avait aucun intérêt à venir en aide à quelque chose d’aussi incontrôlable qu’un soulèvement massif d’ouvriers. Effectivement, les "démocraties" non seulement ne sont pas restées à l’écart ; elles ont de plus opportunément fourni au Kremlin un écran de fumée moral pour éliminer l’insurrection en lançant leur attaque sur le canal de Suez au moment précis où les Russes préparaient leur entrée dans Budapest. Seuls et isolés, les ouvriers hongrois se sont battus comme des lions, mais leur lutte était condamnée à la défaite.
Hier, aujourd’hui et demain
Le monde capitaliste n’est plus ce qu’il était dans les années 1950. Depuis la fin des années 1960, l’ensemble du système a sombré de plus en plus profondément dans une crise économique insoluble, expression de la décadence historique du capitalisme. En réponse à cette crise, une nouvelle génération de travailleurs, consolidée et renforcée par la période de reconstruction, a ouvert une nouvelle période de lutte de classe à l’échelle internationale. Aujourd’hui, la crise et la lutte de classe déferlent autant à l’Ouest qu’à l’Est. A l’Est, l’avant-garde de ce mouvement a été formée par les ouvriers polonais, dont les grèves en 1970 et 1976 ont constitué un avertissement aux bureaucraties staliniennes partout dans le monde. Si on compare les grèves de Pologne au soulèvement en Hongrie, on peut voir que beaucoup des illusions des années 1950 ont commencé à perdre de leur emprise. Les ouvriers de Pologne ne se sont pas battus comme "Polonais" mais comme ouvriers ; et leur ennemi immédiat n’était pas "les Russes" mais leur propre bourgeoisie ; leur objectif immédiat n’était pas la défense de "leur" pays mais la défense de leur propre niveau de vie. C’est cette réapparition du prolétariat international sur son terrain de classe qui a remis la révolution communiste mondiale à l’ordre du jour de l’histoire. Mais, bien que le soulèvement hongrois appartienne à une période dépassée par la classe ouvrière, il contient beaucoup d’enseignements pour la classe ouvrière actuelle dans sa lutte pour acquérir la conscience de sa mission révolutionnaire. Au travers de ses erreurs et de ses confusions, le soulèvement soulignait de nombreuses leçons cruciales à propos des ennemis de la classe ouvrière : le nationalisme, l’autogestion, le stalinisme sous toutes ses formes, la "démocratie" occidentale, etc., etc. Mais en même temps, dans la mesure où elle a hanté la bourgeoisie de l’Est et de l’Ouest du spectre des conseils ouvriers armés, l’insurrection a été un héroïque signe avant-coureur du futur qui attend le prolétariat partout dans le monde.
C.D. Ward, décembre 1976
Géographique:
- Hongrie [39]
Heritage de la Gauche Communiste:
Face à la tragédie de Valence, en Espagne
- 3089 lectures
Nous ci-dessous un texte publié par la section du CCI en Espagne (voir notre site en langue espagnole) le lendemain de la catastrophe dans le métro de Valence. Mettant à profit la visite du chef du Vatican à Valence, toute la bourgeoisie espagnole, nationale ou régionale, de gauche ou de droite, cherche à mettre sous le tapis les véritables causes de cet accident. La palme de l’intimidation cynique revient sans doute au gouvernement régional de Valence qui a même menacé de faire un procès à ceux qui, ayant eu connaissance d’un risque possible pour la sécurité des personnes sur cette ligne, ne l’ont pas dénoncé avant l’accident de lundi, risque dont ce gouvernement n'aurait pas eu connaissance au préalable… ! Après cela, sans doute, ses différentes fractions vont utiliser cet accident dans leurs guéguerres, mais pour la bourgeoisie, ce qui importe, maintenant, c’est que l’explication selon laquelle il s'agirait d'une "faute humaine" s’ancre bien dans les esprits. C’est ce que nos camarades ont voulu dénoncer immédiatement. La responsabilité de cet accident incombe bel et bien et entièrement à ce système capitaliste devenu totalement inhumain.
Hier, 3 juillet 2006, le pire accident de métro de l’histoire d’Espagne et l’un des plus graves en Europe a arraché brutalement la vie à 41 personnes à Valence et en a blessé gravement 40 autres.
La force de la solidarité
Face à cette catastrophe, une solidarité spontanée s’est rapidement développée et organisée : les victimes encore valides, au lieu de s'éloigner à toute vitesse du lieu de l’accident et de céder à un sentiment de panique ont apporté de l'aide aux autres, des travailleurs et des gens du voisinage sont arrivés pour porter secours, il y a eu la mobilisation des pompiers et du personnel de la santé hors de leurs heures de service, et des donneurs de sang sont accourus en grand nombre… Une solidarité qui exprime un sentiment profond de fraternité vis-à-vis des autres, en opposition radicale avec l’individualisme et la guerre de tous contre tous que la société actuelle transpire par tous ses pores. Une solidarité qui dément dans les faits l’image que les médias, les politiciens, les idéologues de tout poil se plaisent à donner de nous autres, travailleurs : une masse indistincte d’égoïstes mue par le "chacun pour soi", seulement préoccupée par la consommation, non solidaire et irresponsable.
C’est cette solidarité humaine, sociale que nous voulons, en premier lieu, exprimer aux victimes et à leurs proches. Solidarité avec leur douleur et avec leur indignation.
Douleur, parce que, une fois encore –comme c’était arrivé lors de l’accident du métro de Londres il y a trois ans ou lors de l’attentat de l’an dernier dans cette même ville ou encore lors de l’attentat de Madrid à la gare d’Atocha- ce sont les travailleurs qui subissent dans leur chair les conséquences de ces catastrophes. La majorité des victimes de cet accident étaient de Torrente, une ville dortoir de la banlieue de Valence.
Indignation causée par la version honteusement falsifiée qui a été présentée sur les causes de l’accident. Tous les politiciens –autant ceux du PP parti de droite, que ceux du PSOE- ainsi que les médias ont affirmé que l’accident a été causé par la vitesse excessive de la rame, rejetant ainsi la faute sur le conducteur, qui est mort lui aussi dans l’accident.
Voilà le message, clairement délivré par la bourgeoisie : FAUTE HUMAINE, due à un travailleur irresponsable, afin d'incriminer l'exécutant qui aurait mal fait son boulot. Ce n’est pas nouveau : les investigations sur l’accident ferroviaire d’Almansa d’il y a trois ans, qui ont mis en évidence les graves carences dans l’infrastructure, la signalisation et les systèmes de sécurité, se sont conclues en rejetant toute la faute sur un travailleur de la RENFE (Compagnie du chemin de fer espagnol), qui a été condamné à 3 ans de prison.
Avec cette politique, le capitalisme et son Etat se lavent les mains, apparaissent comme des blanches colombes innocentes qui ne portent aucune responsabilité, tout en semant la zizanie et un sentiment de culpabilité chez les travailleurs et dans la population en général.
C’est vrai, le train circulait à 80 km/heure, le double de ce qui est permis à cet endroit. C’est ce qu’a montré la boite noire de la machine. Mais on n'a présenté là qu'une toute petite partie de la vérité, bien distincte d’une série de considérations fondamentales dont l’analyse nous permet de comprendre qu’il existe UNE AUTRE VÉRITÉ sur les causes de l’accident.
Une tragédie qui est une conséquence de la crise du capitalisme
La première des choses que l’on a cachée, c’est que le conducteur avait un contrat précaire, qu’il n’avait pas été embauché en tant que conducteur mais en tant qu’agent de service dans la gare et qu'il n’avait pas reçu la formation adéquate : "Sa relation de travail avec la FGV [Trains régionaux de Valence] était établie à travers une entreprise externe par le biais d’un type de contrat de travail nommé ‘affectation temporaire’. Cependant, Jorge Álvarez, du Syndicat Indépendant Ferroviaire, dénonce le fait que le conducteur faisait ce travail depuis mai tout en n’ayant pas de poste fixe. Son poste était celui d’agent de service dans la gare et il avait un contrat temporaire d’amélioration de l’emploi en tant que conducteur. 'Il a eu un stage de 14 jours, alors qu’auparavant ce qui était normal c’était de passer au moins une année en tant qu’aide machiniste ', affirme-t-il" (El Mundo daté du 4-7-06).Un travailleur précaire, sans expérience, est mis devant l’obligation de conduire tous les jours un tel convoi. C’est une énorme charge de responsabilités, une source certaine de tensions, d’angoisses et de souffrance. Et en même temps, cela veut dire mettre en danger tous les jours la vie de milliers de voyageurs qui dépendent du fait que "tout marche", qu’aucun incident ou contretemps ne se produise sous peine de les transporter au cimetière.
On a envisagé l'hypothèse d’un malaise du conducteur. Ceci nous amène à la deuxième responsabilité de ces autorités qui clament tous azimuts leur "solidarité" : depuis quelques années, à cause de la politique de licenciements massifs et de réduction drastique du personnel, les trains sont conduits par un seul machiniste, la conduite en duo (le conducteur et son aide) n'existe plus. Si quelque chose arrivait au conducteur, s’il ne parvenait plus à contrôler la situation, quelqu’un d’autre pourrait empêcher que les voyageurs soient abandonnés à leur sort.
Ces 41 morts sont le résultat des deux politiques que tous les gouvernements et toutes les entreprises mettent en place : LA PRECARITE ET LES LICENCIEMENTS MASSIFS.
L'abandon et la décomposition des infrastructures
Un autre élément à retenir, c’est l’état calamiteux de la ligne 1, sur laquelle le désastre a eu lieu. Il y a un an, il y avait déjà eu un accident sur cette même ligne qui a mis en lumière des problèmes de sécurité, de matériel détérioré, d'erreurs par manque d’entretien. Et rien, absolument rien, n’a été fait ! Concrètement, "le tronçon où l’accident a eu lieu est un virage très dangereux. C’est un virage très serré avec une petite ornière au début, ce qu’on appelle un ‘garrot’ où la voie se déplace et fait un petit zigzag" (témoignage d’un syndicaliste publié dans le journal Levante du 4 juillet).Mais "aucun ingénieur n’a proposé de corriger le tracé de ce maudit virage, entre autres raisons parce que cela aurait impliqué la fermeture provisoire d’un transport qui depuis le premier jour a été vital pour aérer le quotidien de cette grande ville. La fréquentation de la ligne 1 est le motif principal du grand succès public remporté par le métro valencien, qui a dépassé l’année dernière le chiffre de 60 millions d’usagers" (Levante 4-7-06). L’entreprise du métro de Valence est une entreprise publique, gérée par le Conseil régional, aussi bien par la gauche (le PSOE jusqu’en 1995) que par la droite (le PP) depuis lors et à cause de la sacro-sainte logique de la rentabilité capitaliste, les autorités n’ont pas corrigé ce grave problème, mettant ainsi en danger jour après jour la vie de milliers de personnes.
À cause de cette maudite rentabilité, à cause de cette politique obsessionnelle de réduction toujours plus forte des coûts que la crise impose, les infrastructures se trouvent de plus en plus négligées. On renouvelle de moins en moins, on n’investit pas dans la maintenance, bref, les conditions pour que de telles catastrophes se produisent sont au rendez-vous. Autant dans les pays industrialisés que –avec une portée bien plus extrême- dans les pays périphériques, les tragédies se reproduisent comme une danse macabre, toujours présentées comme "naturelles" ou "dues à des erreurs humaines".
Le capitalisme est une catastrophe permanente
Ce laisser-aller des infrastructures, qui est accompagné de l’abandon des quartiers ouvriers –et même ceux habités par la classe moyenne- tranche avec les investissements très coûteux, consacrés à la réalisation de projets faramineux et autres complexes emblématiques, liés à des événements, comme dans le cas de Valence, tels que la visite du Pape et en 2007 ce montage somptueux de l’American’s Cup. La presse de "gauche" dénonce ce gaspillage du gouvernement régional du PP et réclame "plus de crédits consacrés aux services publics".Le hic est que cette politique suicidaire consacrée à des constructions pharaoniques ostentatoires, livrée à la folie de la spéculation immobilière, est la seule que le capital peut aujourd’hui mener pour tenir hors de l’eau une machine économique de plus en plus grippée par une crise sans issue. Et comme c’est la seule politique possible, elle est pratiquée aussi bien par le gouvernement central de Zapatero, qui avait promis d’en finir avec la spéculation immobilière alors qu'en fait, celle-ci est encore plus débridée qu’auparavant sous son égide et celle de ses séides (comme on le voit avec les municipalités de Saragosse ou de Barcelone, qui sont gouvernées par des “socialistes”), sans oublier l’incroyable gouffre financier qu'a constitué l’Exposition Universelle de Séville, qui est encore le miroir dans lequel s'admirent fièrement ces petits messieurs du PP valencien. C’est cette même politique qu’on peut observer dans d’autres endroits de la planète aussi éloignés que Londres, Dubaï, Shanghai ou Athènes.
La tragédie de Valence s’ajoute à la longue liste de catastrophes, attentats, massacres, et aussi aux souffrances quotidiennes, à ces millions de tragédies silencieuses et invisibles de l'exploitation, que subissent une immense majorité d'êtres humains, conséquence de la précarité, de la misère, du chômage, des accidents du travail et, aussi, de la détérioration des rapports sociaux et humains, induite par la subsistance de ce système social condamné par l’histoire et dont la survie provoque de plus en plus de maux.
Dire ‘ça suffit !’ à travers le combat de classe, voilà le seul chemin. C’est le chemin qui a été emprunté par la classe ouvrière internationale comme on a pu le vérifier lors de luttes comme celle du printemps français de mars 2006 contre le CPE ou lors de la grève de la métallurgie à Vigo en mai 2006. C’est seulement le développement de ces luttes, exigeant des efforts et devant vaincre d’énormes obstacles, qui pourra permettre d’éradiquer de la planète les causes de tant de catastrophes, de tant de barbarie et de souffrances.
Courant Communiste International (4 juillet 2006)
Géographique:
- Espagne [42]
Grève dans les transports new-yorkais
- 3905 lectures
Une tactique commune dans les attaques capitalistes contre les retraites et les avantages de santé est la tentative de créer des systèmes « multi-niveaux », dans lesquels les nouveaux employés perçoivent des avantages ou des retraites plus faibles, que cela prenne la forme de baisse de la valeur des avantages reçus par les plus récents employés ou celle d’exiger d’eux un paiement plus élevé des contributions à l’assurance maladie ou aux fonds de pension. Les ouvriers plus anciens sont bridés par la promesse que les coupes ne les affecteront pas, mais seulement les inconnus qui seront embauchés dans le futur. Traditionnellement, les syndicats aident à faire passer ces « marchés », saluant leurs efforts pour avoir préservé les ouvriers déjà employés comme des « victoires ». Cette tactique divise les ouvriers les uns contre les autres, opposant les intérêts des ouvriers employés de longue date à ceux des nouveaux ouvriers, le vieille génération contre la jeune – une recette désastreuse pour l’unité de la classe ouvrière – permettant aux directions de diviser et de gagner. Cela a précisément été la tentative de diviser les ouvriers qui s’est trouvée au cœur de la récente lutte dans les transports de la ville de New York. La Metropolitan Transit Authority, contrôlée par le gouverneur, et dans une moindre mesure par le maire, a cherché à reculer l’âge de la retraite pour les nouveaux embauchés, des actuels 55 ans à 62 ans, et à exiger que ces derniers paient 6 % de leur salaire dans les fonds de pension. L’âge de la retraite à 55 ans (après 25 ans de service) est depuis longtemps en place du fait de la reconnaissance des conditions de travail extrèmement dures dans lesquelles peinent les ouvriers des transports dans des souterrains vieux de cent ans, avec un air vicié et des fumées, l’infestation des rats et le manque général de structures sanitaires. La proposition du gouvernement n’aurait cependant affectée aucun des ouvriers déjà employés.
Mais les ouvriers du métro et des bus n’étaient absolument PAS prêts à se laisser diviser par cette escroquerie. Au nom d’une classe ouvrière qui a enduré une attaque générale sur ses retraites, les ouvriers des transports ont essentiellement tiré une ligne dans le sable et refusé d’accepter quelque changement que ce soit dans les retraites. Ils se sont mis en grève pour protéger les retraites des ouvriers qui n’étaient pas encore au travail, ceux qu’ils appelaient « nos pas-nés »- leurs collègues futurs, inconnus. En tant que telle, cette lutte est devenue l’incarnation la plus claire du mouvement pour réaffirmer l’identité de classe de la classe ouvrière et sa solidarité à ce jour. Elle n’a pas seulement eu un impact profond sur les ouvriers qui ont participé à la lutte, mais aussi sur la classe ouvrière dans d’autres secteurs. Les ouvriers du métro se sont ainsi mis en grève par solidarité de classe avec la future génération, avec ceux qui n’étaient pas encore embauchés. Cela a résonné chez beaucoup d’ouvriers dans de nombreuses industries, qui ont vu quelqu’un enfin se lever en disant : « Ne touchez pas aux retraites ! ».
La signification de la lutte du métro et des bus
La grève des 33 700 ouvriers du métro qui a paralysé la ville de New-York trois jours durant dans la semaine avant Noël a été la lutte ouvrière la plus significative depuis quinze ans aux Etats-Unis. Elle a été importante pour un nombre de raisons qui sont liées :
- au contexte international dans lequel elle s’est déroulée ;
- au développement de la conscience de classe parmi les grévistes eux-mêmes ;
- et à l’impact potentiel de la grève sur les autres ouvriers.
La signification de cette grève ne doit pas être exagérée ; elle ne peut être comparée aux grèves des années 1980 qui ont mis en jeu l’autorité de l’appareil d’Etat syndical destiné à contrôler et faire dérailler les luttes ouvrières et qui ont posé la question de l’extension de la lutte à d’autres ouvriers. Cependant, considérant le contexte de conditions difficiles dans lesquelles la classe ouvrière lutte aujourd’hui, cette signification doit être clairement comprise.
Bien qu’elle soit restée strictement sous le contrôle d’une direction syndicale locale dominée par les gauchistes et les syndicalistes de base, la grève du métro a reflété non seulement la combativité montante de la classe ouvrière, mais aussi des pas en avant significatifs et importants dans le développement d’un sentiment retrouvé de l’identité et de la confiance en elle-même de la classe ouvrière, ainsi que de la compréhension de la solidarité de classe, de l’unité des ouvriers par delà les frontières des générations et de lieux de travail. Les ouvriers du transports ont entrepris cette grève alors même qu’ils savaient être en violation de la loi Taylor de New-York qui interdit les grèves dans le secteur public et pénalise automatiquement les grévistes de deux jours de salaire pour chaque jour de grève, ce qui veut dire perdre trois jours de salaire pour chaque jour de grève (un jour pour celui non travaillé et deux jours de pénalité). La ville a ainsi menacé de requérir une amende pénale de 25 000 dollars contre chaque ouvrier pour fait de grève, et de la faire doubler chaque jour : 25 000 dollars le premier jour, 50 000 le deuxième, 100 000 le troisième. Avec de telles peines fermes brandies par la bourgeoisie, la décision de faire grève n’a pas été prise à la légère par les ouvriers mais a représenté un acte courageux de résistance militante.
Le contexte international de la lutte
La grève du métro de New York s’est déroulée dans le contexte d’une tendance internationale existant dans la classe ouvrière à renouer avec le combat ouvert de défense de ses intérêts de classe, après un reflux dans la lutte de classe qui a duré presque quinze ans, depuis la chute des deux blocs impérialistes issus de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1989, l’effondrement du bloc stalinien, dirigé par la Russie impérialiste, qui fut suivi de la désintégration du bloc impérialiste rival de l’Ouest, dirigé par les Etats-Unis, ainsi que les évènements chaotiques qui s’aggravèrent au niveau mondial, avaient ouvert une période de désorientation pour la classe ouvrière internationale. Le changement de conditions historiques, l’offensive idéologique répétée de la part de l’Etat bourgeois et de ses médias, proclamant la fin du communisme, le triomphe de la démocratie et la fin des classes, firent leur effet nocif sur le prolétariat. Le processus de clarification qui se développait depuis les années 1960 fut rompu et les avancées de la conscience de classe connurent un recul important. Ceci s’avéra particulièrement problématique concernant la compréhension que les syndicats, qui avaient été dans le passé des organisations de défense de la classe ouvrière, s’étaient intégrés dans l’appareil d’Etat du capitalisme décadent et servaient à présent de flics de base du capitalisme, et concernant la recherche de nouvelles formes de lutte permettant aux ouvriers de prendre leurs luttes en mains. Si profond a été le reflux dans la lutte de classe et si systématique l’attaque idéologique de la classe dominante, que le prolétariat a montré des signes de perte de confiance en lui-même comme classe et une difficulté à même reconnaître sa propre identité de classe.
Cependant, la gravité de la crise économique et l’escalade consécutive des attaques de la classe dominante sur le niveau de vie ouvrier impliqua inévitablement que cette terrible période de désorientation du prolétariat ne pouvait durer éternellement. En 2002, nous avons commencé à voir un tournant dans la lutte de classe internationale, qui fut caractérisé non par des surgissements spectaculaires de luttes combatives, mais plutôt par le début d’une tentative difficile et hésitante à revenir au centre de la scène historique. La première tâche posée par ces luttes naissantes dans de nombreux pays n’a pas été l’extension des luttes au delà des frontières géographiques et de secteurs, mais la ré-acquisition de la conscience, aux niveaux les plus fondamentaux, de l’identité de classe et de la solidarité.
Ce processus s’est mis en route aux Etats-Unis, comme les exemples de la lutte des employés d’épicerie en Californie, les luttes à Boeing et à Northwest Airlines, la grève des transports à Philadelphie, et la lutte des maîtres-assistants de l’université de New York le démontrent. Ce qui rend la grève des transports de New York si significative dans ce processus n’est pas simplement qu’elle est la lutte la plus grande avec l’impact le plus fort, dans le sens qu’elle a paralysé la plus grande ville de l’Amérique trois jours durant, mais par le niveau de progrès dans le développement de la conscience de classe qu’elle reflète.
Comme nous avons dit, la principale question dans la grève était la défense des retraites, qui subissent une attaque incroyable de la bourgeoisie partout dans le monde mais spécialement aux Etats-Unis. Dans ce pays, les allocations gouvernementales de sécurité sociale sont minimales et les ouvriers comptent sur leur entreprise ou sur des fonds de pension liés à leur travail pour maintenir leur niveau de vie une fois en retraite. Ces deux genres de pensions sont en danger dans la situation actuelle, la première sous les efforts de l’administration Bush pour « réformer » la sécurité sociale, et la deuxième à travers le véritable manque de finances et les pressions pour réduire le paiement des retraites. Depuis l’effondrement d’Enron Corporation, dans lequel des milliers d’employés ont perdu leurs retraites entièrement, d’innombrables entreprises américaines sont revenus sur leurs engagements par rapport aux retraites. Plus récemment, devant la banqueroute de ce secteur, des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique n’ont pas honoré leurs fonds de pension. L’agence gouvernementale fédérale qui assume la responsabilité de ses fonds de pensions corporatifs avortés ne peut garantir que 50 % de ce que les ouvriers auraient normalement été en droit de recevoir. Tant de fonds de pension sont en faillite, que cette agence opère avec un déficit anticipé de 24 milliards de dollars.
L’industrie automobile, avec les banqueroutes qui menacent à General Motors et Ford, a aussi mis les fonds de pension en péril.
Le développement de la conscience de classe parmi les grévistes
La réaffirmation de la capacité de la classe ouvrière à se voir et se comprendre en tant que classe a pu être vu à plusieurs niveaux et dans de nombreuses manifestations dans la lutte des transports. Clairement, le problème central lui-même – la protection des retraites pour les futurs ouvriers – contenait cet aspect. Ce n’est pas seulement à un niveau abstrait mais à un niveau concret qu’on pouvait le percevoir et l’entendre. Par exemple, à un piquet de grève d’un dépôt de bus de Brooklyn, des douzaines d’ouvriers se sont rassemblés en petits groupes pour discuter de la grève. Un ouvrier a dit qu’il ne pensait pas qu’il était juste de lutter sur les retraites pour des ouvriers futurs, pour des gens qu’on ne connaissait même pas. Ses collègues s’y opposèrent en argumentant que les futurs ouvriers contraints d’accepter l’attaque contre les retraites « pouvaient être nos enfants ». Un autre a dit qu’il était important de maintenir l’unité des différentes générations dans la force de travail. Il a montré que dans le futur il était probable que le gouvernement essaierait de diminuer les avantages médicaux ou le paiement des retraites « pour nous, quand nous serons en retraite. Et il sera important pour les gars au travail alors de se souvenir que nous nous sommes battus pour eux, afin qu’ils se battent pour nous et les empêchent de casser nos avantages ». Des discussions similaires se sont passées ailleurs dans la ville, reflétant clairement et concrètement la tendance des ouvriers à se concevoir en tant que classe, à rechercher au-delà des barrières de génération que le capitalisme cherche à utiliser pour diviser les uns contre les autres.
D’autres ouvriers passant devant les piquets de grève klaxonnaient en signe de solidarité et criaient des hourras de soutien. A Brooklyn, un groupe d’enseignants d’une école élémentaire a exprimé sa solidarité en discutant de la grève avec les élèves et a amené les classes d’élèves de 9-12 ans à rendre visite à un piquet de grève. Les enfants ont apporté des cartes de Noël aux grévistes avec des messages comme : « Nous vous soutenons. Vous vous battez pour le respect. »
Les enfants ont été chargés par leurs enseignants d’interviewer les grévistes, et ils ont demandé aux ouvriers quel genre de travail ils faisaient et pourquoi ils étaient en grève.
Le jour suivant la fin de la grève, un de nos camarades a pris le bus et a eu une conversation avec le chauffeur qui illustre les avancées faites dans cette lutte. Après avoir payé son ticket, il dit au conducteur, un ouvrier latino de 35 ans : « Vos gars ont fait ce qu’il fallait. »
Le chauffeur a répondu : « Mais nous n’avons pas gagné. Nous sommes retourné au travail sans contrat. »
« Mais le principal est ce que vous avez fait. Vous avez dit ne touchez pas aux retraites, les ouvriers ont besoin de se serrer les coudes, quoi qu’il arrive. C’est un exemple important pour les autres ouvriers. » a dit notre camarade.
A cela, le chauffeur a répondu : « Oui, c’est vrai. Cela a été important que nous nous dressions pour la classe ouvrière. »
L’impact de la lutte pour les autres ouvriers
La grève des transports est devenu un point de référence pour les ouvriers dans d’autres secteurs. A côté des démonstrations de soutien et de la solidarité mentionnées ci-dessus, il y a eu de nombreux autres exemples. Les ouvriers qui n’étaient pas des transports étaient bienvenus aux piquets de grève. Par exemple, un groupe de maîtres-assistants de l’université de New York en grève a rendu visite au piquet de Brooklyn ; ils se sont présentés, pour discuter des problèmes de la grève et de sa stratégie avec les ouvriers. Dans d’innombrables lieux de travail autour de la ville, d’autres ouvriers d’autres secteurs ont parlé de l’importance de la solidarité comme étant un exemple sur la question de la défense des retraites. Parmi les ouvriers municipaux, dont la plupart étaient depuis trois ans ou plus sans nouveau contrat, l’adhésion des ouvriers des transports au slogan : « Pas de contrat, pas de travail », a montré l’importance de la lutte.
La sympathie pour les grévistes a été si forte que les sondages des médias capitalistes montraient que Roger Toussaint, président du syndicat des transports, affichait un taux de popularité plus élevé que le maire ou le gouverneur au premier jour de la grève. L’existence d’un excédent financier de 1,02 milliards de dollars pour la Metropolitan Transit Authority fait apparaître la ligne dure de la direction comme particulièrement sévère et impitoyable aux autres ouvriers. Le deuxième jour de la grève, la bourgeoise s’est appuyée sur une campagne de diabolisation des grévistes. Les tabloïdes, comme le Post et le Daily News, traitaient les grévistes de « rats » et de « lâches ». Même le libéral New York Times dénonçait la grève comme « irresponsable » et « illégale ».
Le thème de « l’illégalité » a été repris par le maire Michael Bloomberg et le gouverneur George Pataki. Pataki a déclaré que la grève était criminelle et qu’aucune négociation n’interviendrait jusqu’à ce que les grévistes retournent au travail. Bloomberg a fait écho à cette position, traitant les grévistes de « voyous » et de « criminels ». Le maire milliardaire est soudain devenu le champion de la cause des ouvriers pauvres incommodés par la grève, prétendument pris en otage par les grévistes des transports comparativement bien payés. De son côté, Toussaint dénonçait le maire et le gouverneur pour leurs accusations insultantes, et se faisait le champion des ouvriers des transports contre les « insultes ».
Les reportages télévisés se centraient sur les difficultés infligées par la grève sur la population essayant de co-voiturer pour aller au travail ou marchant le long des ponts de l’East River pour se rendre à Manhattan. Mais même après ce battage des médias, les dirigeants de la ville savaient que la solidarité de la classe ouvrière avec la grève restait forte. Un juge local a menacé de prison les dirigeants syndicaux et d’amende des grévistes individuellement pour avoir défié une injonction de la cour d’arrêter la grève et de reprendre le travail, mais le maire Bloomberg s’est empressé de proposer que la cour devrait augmenter les amendes et ne pas mettre les dirigeants syndicaux en prison, que cela ferait de Toussaint « un martyr » et risquerait de provoquer des grèves de sympathie chez d’autres employés du secteur public.
L’illégalité de la grève elle-même a déclenché des discussions importantes au sein de la classe ouvrière à travers la ville et dans le pays. Comment pouvait-il être illégal pour les ouvriers de protester en se retirant du travail ? demandaient beaucoup d’ouvriers. Comme l’a dit un ouvrier lors d’une discussion dans une école de Manhattan, « c’est presque comme si on peut faire grève que si elle n’a aucun effet ».
Le rôle du syndicat dans le sabotage de la lutte
De nombreux ouvriers étaient amèrement conscients que la nouvelle direction combative du syndicat avait cédé trois ans auparavant pour un contrat donnant 0 % d’augmentation la première année, et 3 % les deuxième et troisième années. Le syndicat était donc sous la pression d’une colère et d’une combativité montante des ouvriers pour agir de façon plus combative dans la situation actuelle. Alors que le syndicat local des ouvriers des transports conduit par les gauchistes et syndicalistes de base contrôlait clairement la grève, employait une rhétorique combative et adoptait un langage de solidarité pour tenir fermement en mains la grève, le rôle du syndicat a été cependant de miner la lutte et de minimiser l’impact de cette grève importante. Très tôt les syndicats ont laissé tomber la revendication d’une augmentation de salaire de 8 % pendant trois ans, et ont focalisé entièrement sur les retraites. Le meeting syndical qui avait voté la grève ne permit aucune discussion ou débat mais fut conduit comme un défilé syndical, avec en vedette une adresse démagogique du révérend Jesse Jackson.
La collusion entre le syndicat et la direction a été révélée dans un reportage publié après la grève dans le New York Times. Toutes les insultes vicieuses entre le syndicat et les officiels du gouvernement étaient une farce. Tandis que le maire et le gouverneur appelait bruyamment à la reprise du travail comme pré-condition à l’ouverture de négociations, des négociations secrètes étaient en fait en route à l’Hôtel Helmsley, et le maire acceptait secrètement une proposition de Toussaint d’obtenir de la direction le retrait de l’attaque sur les retraites en échange d’une augmentation dans les contributions des ouvriers à la couverture maladie pour dédommager le gouvernement du coût représenté par le maintien des retraites pour les futurs employés.
Cette fin orchestrée par le syndicat et le gouvernement n’est bien sûr pas
une surprise, mais simplement une confirmation de la nature anti-ouvrière de tout
l’appareil syndical, et n’enlève rien à la signification des apports importants
réalisés dans le développement de la conscience de classe. Cela nous remet en
mémoire les tâches importantes qui restent devant la classe ouvrière pour se
débarrasser du carcan syndical et pour garder le contrôle de la lutte dans ses
propres mains.
Internationalism, section du CCI aux Etats-Unis, décembre 2005
Géographique:
- Etats-Unis [43]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
La coupe du monde de football : une occasion pour la bourgeoisie de marquer un but contre la lutte de classe
- 3060 lectures
Partout en Italie, en France, en Allemagne, au Portugal, on a assisté à un déchaînement d'hystérie nationaliste. A l'issue de chaque match, des millions de "supporters" déchaînés ont déferlé dans les rues des villes pendant des heures, dans un concert assourdissant de klaxons, en agitant des bannières ou des pièces de tissus aux couleurs de leur drapeau national tout en vociférant à tue-tête des chants patriotards. Ce prétexte à défoulement et à excès de beuveries a même donné lieu à quelques débordements, parfois mortels.
Sous l'alibi prétendu "apolitique" du Mondial, la classe dominante est parvenue à ses fins : réaliser l'union nationale, l'union sacrée comme lors des guerres mondiales mais, cette fois, autour du ballon rond. Pour l'Allemagne, Etat organisateur, il a été largement souligné que cette coupe du monde a permis de retrouver un véritable sentiment de fierté nationale, d'orgueil à l'Est comme à l'Ouest, toutes générations confondues, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en entonnant l'hymne national et en déployant le drapeau tricolore sans le moindre complexe.
Cette coupe du monde fut donc une aubaine pour la bourgeoisie qui a réussi à rassembler toutes les classes de la société derrière ces "Bleus" ou ces "Azzuris" devenus, pour un temps, les idoles du "peuple ". Tous les journaux de Libération au Journal du Dimanche, en passant par Le Monde et Marianne ont parlé de cette résurrection du sentiment national le temps de la Coupe reprenant même à leur compte le slogan euphorisant utilisé lors des grèves de la fonction publique en 1995 "Tous ensemble !" pour mieux duper les prolétaires et les dévoyer sur ce terrain nationaliste le temps de la coupe du monde.
La bourgeoisie distille le poison du nationalisme
Un des thèmes favoris de cette gigantesque campagne nationaliste, résidait dans l'idée mensongère colportée par les médias, suivant laquelle le Mondial aurait permis de dépasser tous les clivages sociaux, tous les antagonismes de classe. De plus, en France, la bourgeoisie continue depuis 1998 à utiliser la composition "black-blanc-beur" de l'équipe nationale de foot pour faire croire que l'Etat français se soucie de l'intégration des immigrés. C'est nous prendre pour des imbéciles. L'illustration de cette 'hypocrisie de l'Etat français, c'est que ce sont les mêmes qui au gouvernement renforcent les lois anti-immigrés et ne trouvent pas mieux que de surenchérir dans la démagogie. Alors que les attaques contre les travailleurs immigrés n'ont cessé de s'aggraver au fil des années, aussi bien sous les gouvernements de gauche que de droite (flicage permanent, contrôles d'identité pour délit de "sale gueule", expulsions musclées de leurs logements ou vers leurs pays d'origine des sans-papiers et des clandestins, etc.)
L'équipe de France de foot, symbole de l'intégration des immigrés ? Certainement pas ! Pour cette coupe du monde comme pour celle de 1998, comme pour les Jeux Olympiques, ce ne sont pas des "immigrés" que l'Etat bourgeois s'est efforcé "d’intégrer", mais des "champions", capables, grâce à leurs performances sportives de rehausser l'image et le prestige du capital français sur la scène mondiale. C'est pour cela que le président Chirac les a invités à déjeuner en grandes pompes, malgré leur défaite en finale, pour les féliciter et les remercier de leur parcours qualifié "d'extraordinaire épopée" en leur déclarant : "Vous avez fait à tous égards honneur à la France. (…) C'est ainsi qu'une nation se dépasse (…) au-délà de l'exploit, vous avez démontré à la France qu'elle est forte quand elle est rassemblée dans sa diversité et qu'elle a confiance en elle".
L'utilisation du sport comme opium du peuple
Plus le capitalisme décadent s'enfonce dans la décomposition, plus le "chacun pour soi" et l'atomisation dominent la vie sociale, et plus les manifestations sportives se révèlent comme un véritable substitut de la religion. Les spectacles sportifs, par leur fonction d'abrutissement des consciences, non seulement font office de nouvel "opium du peuple" (ils ont été systématiquement développés depuis l’entre-deux guerres), mais ils sèment l'illusion qu'à travers le sport, il est possible de retrouver un semblant de communauté humaine. Lorsque les ouvriers ne peuvent affirmer leur unité de classe dans la lutte, lorsqu'ils sont atomisés et soumis à la pression de l'idéologie dominante, les spectacles sportifs sont pour eux un moyen de s'évader de la réalité du monde capitaliste et de la misère de leurs conditions d'existence.
C'est justement ce besoin d'évasion que la bourgeoisie exploite au maximum et cherche à accentuer. En ce sens, cette coupe du monde de foot n'est pas sans rappeler les jeux romains : quand il n'y a plus de pain, la classe dominante offre des jeux aux ouvriers pour leur faire accepter leur condition de classe exploitée.
A la veille et au moment des congés d'été, elle a cherché à leur faire oublier l'aggravation du chômage et la misère résultant de l'enfoncement inexorable du capitalisme dans une crise économique mondiale sans issue. Elle a cherché à faire passer le plus discrètement possible, et dans le dos des ouvriers, les attaques et les mesures d'austérité qu'elle venait de concocter. Pour détourner l’attention des prolétaires des attaques capitalistes contre leurs conditions de vie, il faut faire diversion et susciter chez eux un artificiel sentiment d’euphorie. En Allemagne, le gouvernement d'Angela Merkel a, par exemple, largement profité de "l'effet coupe du monde" pour annoncer un nouveau plan de réforme du système de santé comportant notamment une hausse généralisée des cotisations pour la sécurité sociale.
Le Mondial est une arme toute trouvée pour l'Etat bourgeois. Non seulement l'exploitation médiatique de cette coupe du monde visait à abrutir les prolétaires derrière le suspens entretenu par la grande question du siècle : "Les Bleus iront-ils jusqu'à la finale ?", mais elle visait encore à les enchaîner à la pire idéologie bourgeoise, celle qui les a conduit par deux fois pieds et poings liés à la guerre mondiale : la défense du drapeau et du capital national. Ce qui distingue principalement les jeux de la Rome antique et ceux du capitalisme décadent, c'est la guerre que se livrent les différents Etats nationaux concurrents derrière les maillots de leurs équipes sportives.
Si aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers ont encore la gueule de bois, l'euphorie du Mondial est appelée à se dissiper rapidement.
Ce Mondial qui les a transportés au paradis, pendant quelques soirs d'apothéose, n'a pas effacé les antagonismes de classe, comme le prétend la bourgeoisie et ses médias aux ordres. La réalité de la crise économique avec son lot incessant d'attaques contre les conditions d'existence des ouvriers ne peut que les conduire à retrouver le chemin de la lutte sur leur propre terrain de classe et à rompre avec l'illusion de l'union nationale.
Derrière la liesse "populaire", interclassiste du Mondial, le prolétariat n'a rien "gagné". Au contraire, il a tout à perdre à faire cause commune avec ses propres exploiteurs derrière les drapeaux nationaux.
Ce terrain n'est pas le sien. C'était avant tout celui des supporters de l'Etat bourgeois, les Chirac, Villepin, Sarkozy, Royal, et consorts, qui, aujourd'hui plus que jamais, ne ratent aucune occasion d'exploiter le sport comme arme idéologique contre la lutte de classe.
Marine (10 juillet)
Géographique:
- France [45]
Situations territoriales:
- France [46]
Le GCI attaque les assemblées ouvrières et défend le sabotage syndical de la lutte
- 3286 lectures
Sur le site du GCI[1] [47], dans la rubrique "nouveautés", daté du 21 mars 2006 on peut trouver un tract, en français et en anglais, sur le mouvement anti-CPE. Dans ce tract, le GCI, qui se vante souvent prétentieusement de développer des analyses sur les forces en présence dans tel ou tel pays, non seulement ne dit pas un mot sur comment se sont déroulés les événements en France, mais, en plus, il ment sur ces luttes, il attaque et dénonce ce qui a été la force du mouvement : la capacité de s'organiser en assemblées générales. Tout cela enveloppé dans un langage ultra-radical de dénonciation du CPE et des syndicats ; mais quand il s’agit de faire des propositions pour développer les luttes, la seule chose qu’on peut lire dans ce tract, c’est "grève générale" et "actions violentes pour bloquer la circulation des marchandises" (c'est-à-dire blocages des routes, des chemins de fer, etc.)… Voilà des méthodes syndicalistes pur sucre ! Face à la dynamique de grève de masse qui a animé la lutte contre le CPE, le GCI oppose la dynamique syndicale de lutte ! Et il a le culot, en mentant, de critiquer les étudiants parce qu’ils "défilent derrière les syndicats" !
Le GCI essaye de culpabiliser les étudiants et les ouvriers en lutte contre le CPE
Pour commencer, le tract confond délibérément les tentatives de la bourgeoisie pour affronter les luttes avec les initiatives décidées au cours de la lutte, en attribuant ainsi aux étudiants les appels syndicaux ou les appels à faire confiance dans les promesses électorales, et même de s’être laissés piéger dans des affrontements stériles avec la police : "Et contre tout cela [le CPE], comment réagit-on ?:
- En défilant comme des moutons derrière ceux qui cassent nos luttes, négocient notre misère avec nos exploiteurs, et nous renvoient au boulot ou à l’école : LES SYNDICATS !...
- En gobant les promesses des politiciens de tout poil qui nous revendent le miracle de l’alternance pour enterrer nos luttes dans les urnes.
- En se laissant piéger dans des affrontements stériles là où les forces de l’ordre bourgeoises nous attendent et sont donc plus fortes" (Tract du GCI).
Ce mouvement de lutte a pris à contre-pied la bourgeoisie française. Le gouvernement de Villepin n’avait pas prévu l’impact que l’attaque du CPE pouvait avoir sur les jeunes générations de prolétaires. Il n’avait pas pris le temps de préparer cette attaque politiquement, en mettant en place une stratégie syndicale et « de gauche » pour l’accompagner[2] [48]. C’est pour cela que les différentes forces de l’Etat bourgeois, les syndicats en tête, ont dû réagir sur le tas, ce qui a laissé une marge de manœuvre aux étudiants. Ainsi, il faut dire clairement que ce ne sont pas les étudiants qui ont défilé derrière les syndicats, mais ces derniers qui ont dû s’y mettre pour essayer de prendre le train en marche et encadrer la lutte.
Pratiquement, jusqu’aux manifestations du 18 mars, les syndicats n’arrivaient pas à être présents dans le mouvement et à s’imposer. Le 7 mars, à Paris, quand les étudiants de Censier se rassemblent pour aller à une manifestation massive, la CGT essaye de se mettre à la tête du cortège avec ses troupes et ses pancartes ; la réaction des étudiants, qui refusent que ce syndicat prenne la tête de la manifestation, consiste à se mettre en avant par différents moyens pour le déloger, prenant la direction de la manifestation et en imposant des slogans unitaires. Le lendemain, le leader de la CGT, Bernard Thibault, déclarait à la télé : "nous sommes face à des faits inconnus" , et plusieurs journalistes des medias bourgeois affirment que "la CGT a été humiliée" . Ainsi, ce ne sont pas les étudiants qui ont défilé derrière les syndicats, mais ceux-ci qui ont été obligés de défiler derrière les étudiants. Même la semaine suivante, le 14 mars, la manifestation principale à Paris est spontanée et ne suit aucun appel syndical.
Mais ce n’est pas seulement dans les appels aux manifestations que s’est exprimée cette confrontation avec les syndicats. Dans les universités elles-mêmes, il y a eu un combat pour prendre le contrôle des AG et la direction du mouvement. Le syndicat étudiant, l’UNEF, de même que des militants des organisations gauchistes (trotskistes surtout), ont essayé de prendre la présidence des AG et de s'accaparer des commissions qui en émanaient ; mais dans une partie importante d’universités, c’est une présidence élue, contrôlée et mandatée par l'AG chaque jour qui a fini par s’imposer, avec l’idée, en permanence, d’en déloger les syndicalistes professionnels.
Sur la question de l’extension de la lutte aussi, il y a eu affrontement avec les syndicats. Certaines AG des universités ont envoyé des délégations aux zones industrielles, mais les syndicats des différents lieux de travail ont tout fait pour éviter tout contact direct entre ces délégations et les travailleurs, prenant eux-mêmes en charge la réception des étudiants pour essayer de les berner. Prenant conscience de la manœuvre, dans certaines universités les plus combatives, on n’a pas renoncé à la discussion directe avec les ouvriers et des piquets ont été envoyés aux stations du métro et aux arrêts de bus où passent les ouvriers pour aller au travail.
On peut en dire autant de l’affirmation du GCI comme quoi ce mouvement de lutte aurait mis sa confiance dans les promesses électorales des politiciens et qu’il se serait fourvoyé sur la voie électorale ( "En gobant les promesses électorales…" ). En fait, rien que la lutte elle-même est déjà un démenti cinglant à cette affirmation selon laquelle il existerait une confiance dans les promesses électorales de la bourgeoisie. Ce n’est pas en votant que les jeunes ont imposé le retrait du CPE, mais en luttant. Tout le long du mouvement, jusqu’à ce que le retrait du CPE s’impose, aucune force politique de la bourgeoisie ne peut se targuer d’avoir été à la tête d’un mouvement qui est resté sur un terrain de classe. C’est seulement lors de la démobilisation actuelle que la bourgeoisie essaye de récupérer le terrain perdu, lançant une campagne idéologique pour éviter qu’on tire une leçon : la lutte autonome, sur un terrain de classe, paye. Alors elle déploie son cirque électoral et démocratique, en essayant d’y amener les jeunes, bien rangés et isolés, à voter pour la gauche du capital aux prochaines élections. Il est évident qu’il est fort possible que pas mal de jeunes se laissent entraîner sur ce terrain et que la gauche de la bourgeoisie française parvienne à canaliser une partie d’entre eux à voter pour elle. Mais ce qui est fondamental, ce qui a pris une profondeur historique, ce qui restera de ces combats, ce sont ces leçons : comment lutter, comment organiser les assemblées et les manifestations, comment on discute, pourquoi et comment on doit chercher la solidarité, etc. Voilà ce que la nouvelle génération ouvrière a gagné. Dans ce sens de l’incorporation d’une nouvelle génération dans la lutte, l’expérience du mouvement anti-CPE est, à tout point de vue, comparable à ce que les luttes de Mai 68 en France, ou 69 en Italie, ou celles des années 70 en Espagne, par exemple, ont signifié pour les générations d’alors[3] [49].
Mais le comble du cynisme est atteint par le GCI quand il accuse ces luttes de se laisser "piéger dans des affrontements stériles là où les forces de l’ordre nous attendent" ; ce groupe, justement, qui n’arrête pas de se laisser éblouir par des "affrontements stériles" en Bolivie, Argentine ou Irak, où la classe ouvrière est entraînée dans des mouvements interclassistes et parfois, dans le pire des cas, dans des affrontements inter-impérialistes[4] [50]. En effet, les médias n’ont pas arrêté d’insister depuis le début du mois de mars sur la violence dans les manifs, en passant en boucle des images d’affrontements avec la police, etc. Le seul objectif de cette campagne a été de décourager les indécis d’aller aux manifestations et aux assemblées.
Dès le début du mouvement, le terrain de la violence a été un terrain de la bourgeoisie. C’est la bourgeoisie qui organisa la provocation et l’assaut à la Sorbonne, c’est elle, avec la collaboration des syndicats (en utilisant leurs services d’ordre), qui organisa les affrontements à la fin des manifestations, qui organisa et permit que des attaques soient déclenchées contre les manifestants par des bandes plus ou moins incontrôlées mais sans doute bien « suivies » par les services de police. Mais il est faux de dire que les étudiants se sont laissés entraîner sur ce terrain. Au contraire, un des aspects qui exprime le mieux la conscience du mouvement, sa volonté d’unification, sa maturité et sa conscience prolétarienne, c’est la façon avec laquelle il a géré cette manœuvre de la bourgeoisie, comment il a abordé cette question de la violence.
La nuit du 10 au 11 mars, lors de l’assaut policier à la Sorbonne, les étudiants parisiens les plus à l’avant-garde, qui sont allés dans cette faculté pour apporter leur solidarité et des victuailles à leurs camarades assiégés, ont dénoncé le fait qu’on était en train de leur tendre un piège, et c’est pour cela qu’ils se sont adressés aux CRS en essayant par tous les moyens d’empêcher la répression et l’affrontement stérile ; ils avaient réussi en partie, jusqu’au moment où les provocateurs se sont mis à agir, ce qui a été le signal pour donner l’assaut à la Sorbonne.
Le mouvement a donné aussi une réponse aux affrontements provoqués par des bandes canalisées par la police. Certaines AG de différents lieux ont envoyé des délégations pour discuter dans les quartiers pour y affirmer que leur lutte était aussi une lutte pour la défense des conditions de vie des habitants des banlieues plongés dans le chômage massif et l’exclusion.
"…En fait, même si il est encore très loin de se poser la question de la révolution, et donc de réfléchir au problème de la violence de classe du prolétariat dans sa lutte pour le renversement du capitalisme, le mouvement a été confronté implicitement à ce problème et a su lui apporter une réponse dans le sens de la lutte et de l'être du prolétariat. Celui-ci a été confronté depuis le début à la violence extrême de la classe exploiteuse, la répression lorsqu'il essayait de défendre ses intérêts, la guerre impérialiste mais aussi à la violence quotidienne de l'exploitation. Contrairement aux classes exploiteuses, la classe porteuse du communisme ne porte pas avec elle la violence, et même si elle ne peut s'épargner l'utilisation de celle-ci, ce n'est jamais en s'identifiant avec elle. En particulier, la violence dont elle devra faire preuve pour renverser le capitalisme, et dont elle devra se servir avec détermination, est nécessairement une violence consciente et organisée et doit donc être précédée de tout un processus de développement de sa conscience et de son organisation à travers les différentes luttes contre l'exploitation. La mobilisation actuelle des étudiants, notamment du fait de sa capacité à s'organiser et à aborder de façon réfléchie les problèmes qui lui sont posés, y compris celui de la violence, est de ce fait beaucoup plus près de la révolution, du renversement violent de l'ordre bourgeois que ne pouvaient l'être les barricades de Mai."i[5] [51]
Le GCI attaque les assemblées générales, poumon du mouvement
Mais là où l’intervention du GCI est carrément abjecte, c’est dans son attaque contre les AG. Sans la moindre explication, sans arguments d’aucune sorte, son tract dit ceci : "CASSONS le démocrétinisme des AG ‘souveraines et massives’, crachons sur les ‘délégués élus et révocables en permanence’ ".
Et pourtant ce sont justement les AG qui confirment la nature de classe de ce mouvement, son ouverture vers l’ensemble de la classe ouvrière, leur recherche de l’extension, leur développement de la discussion et de la prise de conscience. Ce sont elles qui prouvent que ce mouvement de luttes s’inscrit dans le développement de la grève de masse qui conduira à long terme à des affrontements décisifs entre bourgeoisie et prolétariat.
Dans les AG, qui n’ont rien à voir avec les parodies d’assemblées que les syndicats convoquent (même si ça a été le cas dans certaines universités et, surtout, au début du mouvement), celui-ci a pris la lutte en main, en prenant la responsabilité des décisions et des mobilisations, en discutant sur toutes les questions. Dans certaines AG, s’est confirmée cette pratique de la recherche de l’unité de la classe ouvrière. Elles ont essayé de rassembler dans une seule AG des assemblées séparées (personnel, professeurs, étudiants…). Encore mieux, ces AG se sont ouvertes également aux interventions de certains parents et grands-parents qui ont pu ainsi transmettre l’expérience des luttes qu’ils avaient vécues dans les années 1960 ou 70. Il y a même eu des retraités qui ont pu participer aux AG des étudiants, montrant ainsi, dans la pratique, l’unité des différentes générations de la classe ouvrière et la transmission de l’expérience.
Dans certaines AG, on a pu prendre conscience de la nature ouvrière du mouvement qui était en train d’être vécu. C’est ainsi que des demandes ont été formulées pour organiser des discussions sur l’histoire du mouvement ouvrier, demandant aussi aux "anciens" de raconter leurs expériences dans l’organisation des luttes.
Dans beaucoup d’AG, le problème a été posé de rechercher l’extension du mouvement, et, pour ce faire, dans certaines d’entre elles, des décisions ont été prises pour organiser des manifestations et des délégations pour aller dans les quartiers ouvriers et les zones industrielles.
Et, surtout, les AG ont permis la participation, l’implication du plus grand nombre dans le mouvement, dans les luttes, intervenant dans les discussions, faisant des propositions, participant aux piquets de grève et aux délégations… Avec toutes leurs limitations, les AG ont été une expérience politique de la première importance (comment prendre des initiatives, comment centraliser un mouvement), pour une nouvelle génération de prolétaires qui vient d’entrer pour la toute première fois en lutte.
Face à cela, la seule chose que retient le GCI, le seul argument qu’il pointe, pour justifier ce qu’il appelle la "débilité de l’assembléisme ", c’est que "L’AG de Dijon s’est réunie pendant 17 HEURES pour décider de 2 journées de mobilisation".
Nous ne savons pas exactement ce qui a pu se passer dans cette AG de Dijon, qui ne peut pas être considérée comme l’épicentre du mouvement ; mais, quoi qu’il en soit, la durée d’une AG ne peut pas être un argument contre elle. En fait, dans qu’un mouvement de lutte, la seule manière de le prendre en charge est la tenue d’une AG permanente, à travers de laquelle tous les ouvriers peuvent prendre en charge la responsabilité de la lutte. Par ailleurs, ce n’est pas une critique « fulminante » que celle de dire que cette AG a décidé deux, trois ou aucune journée de mobilisation.
Il reste donc à se poser la question : qu’est-ce que le GCI a contre les AG ?
Nous savions déjà, par d’autres de ses prises de position précédentes, que ce groupe "préfère" les organisations minoritaires qui préparent les luttes, telle que … les mères de la place de Mai !, à Buenos Aires, Argentine, "véritables expressions de l’associationnisme ouvrier" comme il disent4. Et le tract en question exprime maintenant une opposition frontale contre les AG, leurs délégués élus et révocables en tant qu’expression de la lutte ouvrière.
Et pourtant, la tendance des luttes ouvrières du 20e siècle a toujours été de développer des AG, avec des délégués élus et révocables, à commencer par les grèves de masse de 1902, 1903, ou 1905 et 1917 en Russie. Les conseils ouvriers ne sont pas autre chose que l’unification et la politisation des AG dans une période révolutionnaire et à une échelle autrement plus élevée. Et cela a été le cas aussi, plus tard dans le siècle, en Pologne en 1976 ou en 1980, ou, en Espagne –à Vitoria, en 1976-, pour ne donner que quelques exemples. Et en négatif, au moment de grandes luttes ouvrières comme celles de mai 68, les syndicats ont tout fait pour tuer dans l’œuf toute tentative de généralisation des AG, dans la plupart des cas en en prenant eux-mêmes le contrôle pour amener le lutte dans des impasses. La grève de masse, avec les AG et leurs délégués élus et révocables, est la forme que prend la lutte ouvrière dans la période de décadence du capitalisme, c’est la forme qui garantit la participation directe, massive et unifiée de la classe ouvrière dans ses luttes. Voilà ce que les révolutionnaires doivent mettre en avant.
Le tour de passe-passe du GCI consiste à faire passer la grève de masse, les AG, les délégués élus et révocables, qui portent en germe le double pouvoir contre la bourgeoisie, qui portent en germe la révolution et la dictature du prolétariat, comme des vulgaires expressions du crétinisme démocratique.
Quelle alternative propose le GCI après avoir rejeté la grève de masse, les AG, et la participation directe des masses au cours historique, et, à long terme, à la dictature du prolétariat ?
L’alternative syndicaliste du GCI
Après tout une bordée de calomnies et d’insultes contre le mouvement de lutte en France, le CGI pointe trois propositions "en positif" , pour, comme le dit le tract, "descendre autrement dans la rue" pour"être réellement victorieux" :
- "étranglons la dictature de l’économie comme nos frères de classe l’ont fait récemment de par le mode (Bolivie, Algérie, Argentine, Irak, etc." ;
- "…grève générale en-dehors et contre la mascarade syndicale" ;
- "organisons des piquets volants, bloquons la circulation des marchandises aux carrefours, gares, aéroports…".
Laissons de coté cette alternative mensongère, qui n’a rien à voir avec la lutte prolétarienne, "[d’étrangler] la dictature de l’économie comme(…) en Bolivie, Algérie, Argentine, Irak", sur laquelle nous avons déjà pris position récemment4.
Il faut d’abord examiner ce que signifie la proposition du tract du GCI : il faut sortir dans la rue "autrement" , d’une manière différente de celle qui s’est développée lors de cette lutte contre le CPE. Et cet "autrement", c'est quoi ? La "grève générale" … Alors que la lutte contre le CPE a surgi spontanément, qu’elle s’est affirmée au fur et à mesure de son extension et de son élargissement vers d’autres étudiants et vers des ouvriers, au fur et à mesure qu’elle prenait conscience d’elle-même et de ses objectifs, avec l’intervention d’ouvriers de différentes générations et des révolutionnaires, la grève générale, par contre, est convoquée pour une journée donnée, sans l’engagement, sans l’implication et la conscience des travailleurs, mais ceux-ci servant de masse de manœuvre aux ordres d’une quelconque direction politique, d’une minorité. Alors que pendant les luttes en France, les minorités faisaient partie du mouvement où elles se joignent à l’ensemble des travailleurs en tant que partie d’une unité, lors d’une "grève générale", les minorités sont séparées de leur classe.
En fait, on en a entendu des "appels à la grève générale" de la part des gauchistes de tout poil, des anarchistes ! Des appels pressants aux syndicats pour que eux, à leur tour, appellent à la grève générale. Ces appels avaient deux tonalités : d’abord ceux qui mettaient l’avenir du mouvement entre les mains des seules forces capables, pour eux, de faire reculer le gouvernement et, d’un autre coté, ceux qui, avec leur critique, voudraient mettre les syndicats au pied du mur. Quelle que soit l’intention, quelle que soit la "bonne foi" de ceux qui font appel à la grève générale, une chose est sûre : derrière, il y a toujours l’idée que ce sont les organisations syndicales qui doivent et peuvent la prendre en charge. De fait, les syndicats ne "" "décréteront" non pas la grève générale, mais une espèce de grève "inter-professionnelle" comme ils disent, que s’ils ont toutes les cartes en main pour éviter tout débordement. Ou bien, comme en Mai 68, pour essayer justement d’enrayer la montée de la grève de masse qui s’est amorcée après le 13 mai, pour « prendre le train en marche » et essayer de le faire dérailler. La grève générale est, dans le meilleur de cas, une confusion dans les termes ou un mythe entretenu. Jamais une grève générale, autrement dit une grève décrétée par les syndicats, n'a fait reculer l’Etat, surtout pas depuis que les syndicats sont devenus pleinement ses serviteurs. Et c’est jouer sur les mots et sur la crédulité des ouvriers que de prétendre qu’on peut "mettre les syndicats au pied du mur" . Alors pour mieux vendre cette marchandise frelatée de la grève générale décrétée par les syndicats (il n’en existe pas d’autre), le GCI adopte une phraséologie encore plus radicale que les gauchistes, en appelant à une "grève générale en-dehors et contre la mascarade syndicale". Autrement dit, c’est vouloir lutter contre l’emprise des syndicats en utilisant l’arme que eux seuls maîtrisent. Pour compenser son vide politique, le GCI se met en rogne pour faire sortir tous les mots insultants de son misérable dictionnaire (débilité/démocrétinisme…) pour dénigrer les AG, autrement dit le SEUL moyen pour que le mouvement puisse aller de l’avant, puisse aller vers une extension des grèves, vers une première étape de la grève de masse. Ce n’est pas une question de terminologie, mais de savoir quelle est la force, quel est le sens d’un mouvement.
Les délégations et les piquets du mouvement contre le CPE émanaient des AG et étaient responsables devant elles. Ils étaient soutenus par elles et ils exprimaient la force de tout le mouvement. Par contre, les piquets pour bloquer les routes et les gares que le GCI propose dans son tract, ne font appel qu’à des minorités agissant de leur propre chef ou de décisions imposées par une minorité. Là aussi, sous des apparences « radicales » et avec la grandiloquence du vide, le GCI ne fait que du syndicalisme radical.
En bref, "la forme" de la lutte contre le CPE en France est celle portée par la dynamique de la grève de masse, alors que "la forme" proposée par le GCI n’est que la lutte syndicale. Pour cela, il suffit de revenir sur l’expérience de la lutte ouvrière dans les vingt ou trente dernières années pour comprendre à quoi ont servi les différentes grèves générales convoquées et décidées par les syndicats. Quant aux "piquets volants, le blocage des marchandises aux carrefours, gares, aéroports…" , cela ne va pas plus loin que toutes ces actions-commandos minoritaires où les syndicats, faisant passer la fumée et l’odeur âcre des pneus qui brûlent sur la chaussée pour le summum de la radicalité, s’amusent à défouler les prolétaires surtout pour qu’ils n’aient pas l’idée d’aller organiser la vraie solidarité dans d’autres lieux de travail.
Parce que, justement, l’importance du mouvement de lutte en France a été de permettre aux nouvelles générations de prolétaires de faire une expérience sur comment s’organiser et prendre en charge les luttes, sur comment doit être la lutte du prolétariat dans la période actuelle. Et c’est justement cela que le GCI attaque.
[1] [52] GCI: Groupe communiste internationaliste. Nous avons pris position récemment sur la nature parasitaire de ce groupe dans "A quoi sert le Groupe Communiste Internationaliste? [53]" Revue Internationale nº 124.
On peut lire son tract : "CPE-CNE, CDI-CDD, RMI-RMA… Derrière ces sigles la même et ignoble réalité capitaliste: des conditions pires d’exploitation !". Nous ne savons pas si, outre leur publication sur Internet, ce tract a été distribué lors des manifestations ou les AG ; en tout cas, dans les différentes villes et mobilisations où nous sommes intervenus, nous n’avons pas vu le moindre exemplaire de ce tract, ni entendu le moindre commentaire. Ce n’est pas étonnant : au vu d’autant de calomnies sur si peu de texte, et du mépris pour les luttes, il se peut que le GCI, malgré le style vantard qui le caractérise, ait craint de ne pas être bien accueilli par les étudiants. En revanche, il a bel et bien lancé un appel pour que d’autres reproduisent leur tract et le distribuent.
[2] [54] Voir notre article : "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France" dans la Revue Internationale nº 125 (https://fr.internationalism.org [55])
[3] [56] "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France" .
[4] [57] Nous n’allons pas faire ici la critique de ces positions. Voir l’article mentionné : "A quoi sert le Groupe Communiste Internationaliste? [58]"
[5] [59] "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France" , point 14.
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [60]
Courants politiques:
Le gouvernement d'Angela Merkel : une "grande coalition" de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
- 3111 lectures
Toutes les lamentations sur l’absence de "grand coup" dans l’accord de coalition négocié entre la CDU/CSU et le SPD ne visent uniquement qu’à détourner l’attention du fait que le gouvernement récemment constitué a concocté la série de mesures la plus brutale de tout l’après-guerre au détriment de la population. Ainsi : l’augmentation drastique de la TVA de près de 3% ; l’allongement progressif de la durée de la vie active jusqu’à 67 ans ; la réduction ou bien même la suppression définitive "d’avantages" fiscaux comme le forfait d'éloignement ou la prime d’accession à la propriété ; d’autres coupes sombres de 4 milliards d’euros sur le dos des plus pauvres parmi les pauvres, les bénéficiaires de l’indemnité prévue par la loi Hartz IV ; la suppression totale de toute protection de l’emploi pendant les deux premières années d’embauche ; la poursuite du blocage des pensions de retraite, lesquelles, eu égard à la hausse actuelle du coût de la vie et des augmentations d’impôts, subissent de fait une réduction drastique.
Une attaque générale contre la classe ouvrière
L’augmentation de la TVA est le symbole de l’aggravation de la guerre des exploiteurs faite aux exploités. Au cours de la campagne électorale le SPD s’emportait contre les projets de réforme fiscale de Kirchhoff, désigné par Merkel pour occuper le poste de ministre des finances, et qui rêvait d’introduire une tranche d’imposition à taux unique s’appliquant aux millionnaires comme aux précaires. Mais précisément l’augmentation du taux de la TVA touche deux fois plus durement les pauvres. En effet, même les sans-abri et les mendiants doivent payer cet impôt dés qu’ils achètent quelque chose.
Une telle attaque générale de la classe dominante contre les intérêts vitaux de la classe ouvrière va certainement provoquer la colère et l’indignation de ceux qu’elle touche. Cependant l’art et la manière avec lesquels cette série d’attaques est préparée, montre que la classe exploiteuse fait tout pour compliquer d’emblée la riposte ouvrière. En plus de la brutalité des mesures prises, un autre aspect est caractéristique de la coalition rouge-noire : les efforts qu’elle effectue afin de monter les salariés les uns contre les autres. L’exemple typique en est donné par la prévision de la baisse de 2% des cotisations à l’assurance chômage. La moitié doit être "contre-financée" par la réduction du soutien apporté aux chômeurs. L’autre moitié doit être fournie par l’augmentation de la TVA. Il doit ainsi en résulter une division entre actifs et chômeurs. En réalité, concernant cette mesure, il s’agit pour le patronat, partenaire paritaire (« à moitié ») de l’assurance-chômage, de baisser les coûts des charges salariales. Le coût de cette baisse - si elle doit avoir lieu - devra être supporté par les seuls salariés et chômeurs. Par exemple, la promesse de la baisse des cotisations à la caisse d’assurance maladie par le gouvernement rouge-vert montre ce que valent les prétendus allègements de charges en faveur de la classe ouvrière. Alors que les soins de santé n’ont pas cessé de se réduire et de se dégrader considérablement, jusqu’à ce jour, aucune baisse des cotisations-maladie n’a eu lieu. Au contraire. Et maintenant la hausse de la TVA va provoquer aussi une nouvelle augmentation également dans ce domaine.
La démocratie parlementaire : l’emballage idéal pour les attaques
Plus largement, ce que confirme l’accord de coalition, c’est le caractère mensonger, non seulement des promesses électorales (par exemple, la CDU/CSU a promis de faire baisser la charge fiscale globale sur la population, et le SPD a promis d’empêcher l’augmentation de la TVA) mais aussi de la campagne électorale même. Ainsi tout le monde a-t-il fait comme si démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates, "libéraux" et "partisans de l’Etat social " formaient des camps politiques irréconciliables. Maintenant chacun voit de nouveau gauche et droite au sein de la coalition gouvernementale s’arranger miraculeusement les uns avec les autres quand il s’agit d’imposer les intérêts du Capital contre les exploités. Cela est valable pour tous les partis, y compris le PDS, qui assume des responsabilités gouvernementales dans certains états fédéraux et des municipalités. Il est plus important encore d’aller au delà de la simple leçon sur le fait que les candidats et les partis en campagne nous mentent, et reconnaître que la démocratie constitue une forme bien plus puissante du totalitarisme étatique que la domination basée sur la violence sans fard d’un Hitler ou d’un Staline, car bien plus raffinée et élastique. Grâce au "suffrage libre" et au "libre choix" des urnes, on donne ainsi l’impression aux opprimés d’instituer eux-mêmes le gouvernement et de disposer ensuite des moyens de le destituer. Le gouvernement n’obéit pas à la volonté du peuple, mais aux nécessités du système capitaliste. C’est la concurrence capitaliste dans le cadre de la crise de déclin du système qui dicte le programme gouvernemental. Cette crise se fiche comme d’une guigne des résultats électoraux. Elle contraint chaque capitaliste pris isolément ainsi que l’état capitaliste, à attaquer la classe ouvrière, sous peine de courir à la ruine. Le cirque parlementaire sert exclusivement à mystifier les prolétaires.
L’accord de coalition, expression de l’absence d’issue à la crise
Le programme de gouvernement rouge-noir est uniquement l’aspect directement étatique de l’attaque capitaliste. Les expériences dans le "privé" nous renseignent sur la manière dont nous devons prendre les promesses des politiciens affirmant qu’accepter les dégradations et « les mesures de rigueur » permettrait pour bientôt l’amélioration de la situation des premiers concernés eux-mêmes. A Deutsche Telekom, après avoir déjà fait accepter la suppression des primes de Noël et des primes de congé, arrive l’annonce de nouvelles suppressions d’emplois - et pas moins de 32 000 ! Chez Volkswagen, alors que toujours plus d’ouvriers changent de grille de rémunération et travaillent pour 20% de moins, on a désormais aussi supprimé le supplément pour travail de nuit ainsi que le paiement des temps de pause. Ce sont des faits produits par la réalité capitaliste, et que tout nouveau gouvernement produira encore.
Les ouvriers n’ont rien d’autre à perdre que leurs chaînes
Les plus récentes luttes ouvrières en Allemagne montrent une classe luttant le dos au mur. Lors des occupations d’usines chez AEG à Nuremberg ou chez Infineon à Munich, il ne s’agissait pas d’empêcher les fermetures d’entreprises, mais d’empêcher que ceux qui sont jetés à la rue par ces fermetures ne se retrouvent sans moyens de vie du jour au lendemain. Les temps sont révolus, où les puissants groupes du secteur high-tech - dont justement Infineon - versaient « de bon gré » des indemnités aux licenciés, afin d’éviter des explosions sociales. Il n’y a pas si longtemps qu’on ressassait encore « le triomphe définitif » du capitalisme et qu’on tenait pour établi que l’affirmation de Marx et Engels selon laquelle les ouvriers n’ont rien d’autre à perdre que leurs chaînes, était contredite par l’histoire. La situation des ouvriers d’AEG et d’Infineon aujourd’hui prouve la complète actualité des la célèbre formulation du Manifeste Communiste.
Ces luttes montrent la colère des ouvriers - rage, qui, comme nous l’avons dit, est attisée par les intentions du nouveau gouvernement. Celle-ci est importante, car sans cette colère, les luttes ne peuvent pas se produire. Mais la colère seule ne suffit pas. La colère sans conscience de classe peut facilement être canalisée dans des impasses inoffensives. Cela aussi, c’est l’une des leçons confirmée par les dernières élections. La colère des victimes des attaques a été détournée en direction des urnes électorales. La proposition de l’Etat démocratique c’est de « sanctionner » les responsables - c’est à dire le SPD comme parti au pouvoir et la CDU/CSU aspirant à la chancellerie - par le bulletin de vote. Effectivement, les deux « partis populaires » ont connu leur plus mauvais résultat électoral depuis longtemps. Pour quel résultat ? Ce sont précisément ceux qui ont été sanctionnés qui forment le nouveau gouvernement, et qui sont récompensés par la classe dominante pour leurs efforts. L’impuissance de la « sanction » démocratique comme forme de protestation ne peut pas être plus clairement mise en lumière.
Se préparer à des décennies de longues luttes
Il est énormément important que la classe ouvrière se débarrasse des illusions sur la réalité du capitalisme qui demeuraient encore toutes ces dernières années. La croissance des attaques ne fait qu’exprimer l’absence d’issue à la crise d’un système social incompatible avec le progrès de l’humanité. C’est une prise de conscience pour laquelle la classe ouvrière devra se battre car justement la gauche, cette partie de l’état démocratique qui prétend défendre les intérêts ouvriers, mobilise pour tuer cette prise de conscience dans l’œuf. C’est ainsi qu’au mois d’octobre et novembre 2005, les syndicats ont organisé des journées d’action dans toute une série d’états européens - entre autres en France, en Belgique et en Grèce, pour protester contre certaines mesures gouvernementales. Ce faisant, ils ne cherchent pas seulement à laisser s’échapper la vapeur, afin que la pression au sein de la classe ouvrière ne puisse s’accumuler dangereusement (pour le Capital). Ils doivent plus largement maintenir l’illusion que ces attaques ne constituent pas l’expression de la faillite du capitalisme, mais qu’il s’agit de mesures isolées ou d’une « politique erronée » qu’il serait possible de remettre en cause en y opposant des actions limitées et ponctuelles. Cela trouve son pendant parlementaire avec les « anti-globalisation », sous la forme du Linkspartei et du PDS, qui, à grand bruit, font leur entrée dans le nouveau parlement. Ces forces affirment que la cause des tourments de la classe ouvrière ne réside pas dans la crise du système mais dans le fait que ces dernières années le capital s’est internationalisé, pour devenir surpuissant. Ce à quoi il proposent de répondre par le renforcement de l’Etat national. De fait, cette manière de voir dissimule la faillite du système. Le fait que le Capital agisse au plan international, n’est absolument pas nouveau. Déjà du vivant de Marx, la classe ouvrière a fondé la première Internationale entre autres afin d’empêcher que des ouvriers d’autres pays puissent être utilisés comme briseurs de grève. Non seulement les mouvements du capital et ses crises, mais la lutte de la classe ouvrière ont pris dés le départ une dimension internationale. Mais ce qui caractérise le capitalisme ce n’est pas seulement la contradiction entre marché mondial et Etat national, entre production internationale et appropriation nationale. La concurrence sans merci entre tous les Etats du monde comme « lieux de production » ainsi que l’embrasement de conflits guerriers, démontre aujourd’hui, que cette contradiction n’a pas disparu. L’Etat national constitue la forme la plus élevée de la concurrence capitaliste. Il est une partie du problème, et, en aucune manière, une partie de la solution.
Ainsi, le nouveau programme de gouvernement allemand n’est-il que l’incarnation en Allemagne d’un phénomène mondial. Compte tenu de ce développement, la classe ouvrière doit se préparer à de grandes luttes, même à des décennies de longues luttes.
La nécessité d’une solidarité internationale
Gouvernement et opposition, gauche et droite, s’affrontent pour défendre la voie la plus efficace, la plus équitable, la plus socialement acceptable pour le renforcement de l’Allemagne comme lieu de production. Dans tous les pays se répète le même cinéma, sous des formes différentes. La bourgeoisie ne connaît aucune autre réponse à la crise du système, que de toujours se livrer à la concurrence. La concurrence n’est pas une réponse à la crise et ne forme pas une issue à celle-ci ; au contraire, elle constitue le principe fondamental du capitalisme. Elle est la racine de l’inhumanité des conditions de vie de la classe ouvrière tout comme de son impuissance. Avant le capitalisme, les exploités étaient contraints par la violence à fournir du surtravail. Au contraire, dans le capitalisme, c’est la concurrence entre les ouvriers, qui force le prolétariat à se soumettre à l’exploitation.. La classe ouvrière ne peut développer sa propre force qu’en opposant à la concurrence capitaliste son principe de solidarité de classe.. Seule cette solidarité permet le développement de la lutte ouvrière comme véritable contre-pouvoir et comme projet de société alternatif à ce monde du chacun pour soi. Là éclôt le germe d’une société nouvelle, sans classes, communiste.
Cette solidarité est avant tout internationaliste. Dans la société actuelle, la classe ouvrière est la seule classe internationale apte à développer une solidarité mondiale. Il ne s’agit là en aucun cas d’un principe abstrait ou d’une question qui se posera seulement dans un lointain futur. A l’instar des salariés de Volkswagen à Wolfburg, qui, récemment, ont été opposés à leurs collègues du Portugal pour avoir le site de production le meilleur marché pour le nouveau modèle Marrakech, l’ensemble de la classe ouvrière se trouve face à cette question. Elle se pose en ces termes : ou bien se soumettre aux intérêts de « ses propres » capitalistes, ou bien, partout, riposter avec détermination aux attaques du capital - en conscience politique, mener un combat commun et solidaire.
" Les prolétaires n’ont rien d’autre à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! "
traduit
de Weltrevolution n° 133 (décembre 2005/janvier
2006), organe du CCI en Allemagne.
Géographique:
- Allemagne [61]
Les CRS à la Sorbonne: Non à la répression des enfants de la classe ouvrière!
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 144.34 Ko |
- 3982 lectures
Téléchargez et diffuser le tract! [62]
Le 8 mars, des étudiants de la Sorbonne ont occupé leur fac pour pouvoir tenir des assemblées générales et discuter de leur participation au mouvement de protestation contre le CPE et les attaques ignobles portées contre les jeunes travailleurs par le gouvernement Villepin.
Le rectorat de Paris a exigé l'évacuation des locaux classés "monuments historiques".
Les étudiants refusent et sont encerclés par les forces de l'ordre qui transforment l'Université en une véritable souricière. Ils sont faits comme des rats, privés de nourriture et de tout contact avec leurs camarades des autres universités en lutte au coeur de la capitale (notamment Censier, Jussieu, Tolbiac).
Le vendredi 10 mars, les étudiants des autres facs décident de se rendre massivement et PACIFIQUEMENT à la Sorbonne pour apporter leur solidarité et de la nourriture à leurs camarades affamés et pris en otage sur ordre du recteur de l'Académie de Paris et du ministère de l'Intérieur. Une partie d'entre eux, accompagnés de travailleurs précaires du spectacle en lutte, réussissent à entrer dans les locaux et décident de prêter main forte à leurs camarades présents sur les lieux depuis plus de deux jours. Dans la nuit du 10 au 11, les forces de "l'ordre" à coups de matraques et de gaz lacrymogènes, envahissent la Sorbonne. Ils expulsent les étudiants en lutte et en arrêtent plusieurs dizaines.
"L'ordre" des matraques et des grenades lacrymogènes
Les étudiants et les jeunes en lutte ne se font aucune illusion sur le rôle des prétendues "forces de l'ordre". Elles sont les "milices du capital" (comme le scandaient les étudiants) qui défendent, non pas les intérêts de la "population" mais les privilèges de la classe bourgeoise. "L'ordre républicain", c'est le "désordre" d'une société qui condamne au chômage, à la précarité et au désespoir des masses croissantes de jeunes qui se décarcassent pour essayer d'avoir une vie décente. Cependant, certains de ceux qui étaient venu prêter main forte à leurs camarades enfermés dans la Sorbonne ont tenté de discuter avec les Gardes Mobiles : ils n'étaient pas venus pour saccager les locaux, ils n'étaient pas venus pour "faire la peau au flics" ni pour s'amuser et "faire la fête" comme le prétendaient les médias bourgeois. Ils étaient venu apporter des vivres à leurs camarades qui avaient faim et leur manifester leur solidarité ! Ceux qui ont essayé de discuter avec les gardes mobiles ne sont pas des naïfs. Au contraire, ils ont fait preuve de maturité et de conscience. Ils savent que derrière leurs boucliers et leurs matraques, ces hommes armés jusqu'aux dents sont aussi des êtres humains, des pères de famille dont les enfants vont être eux aussi frappés par le CPE. Et c'est ce que ces étudiants ont dit aux gardes mobiles dont certains ont répondu qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir.
Aujourd'hui, "l'ordre règne à la Sorbonne" et son président, Jean-Robert Pitte, a déclaré que cela permettrait aux étudiants de "travailler dans des conditions normales lundi". Les barrages d'hommes en armes et la perspective d'une précarité toujours plus grande : voila les conditions "normales" de "l'ordre" capitaliste.
A ceux qu'on attaque avec des mesures ignobles comme le CPE et qui veulent utiliser les facs comme lieux de discussion et de débat pour organiser leur riposte, on envoie la répression, les grenades lacrymogènes et les matraques. Voila le vrai visage de notre belle "démocratie républicaine". Voilà le vrai visage du fameux "Liberté, égalité, fraternité" issu de la révolution bourgeoise de 1789 !
Les étudiants en lutte ne sont pas des émeutiers !
Sur les chaînes de télévision et dans les journaux, on tente de plus en plus de présenter le mouvement des étudiants comme de simples affrontements avec la police, comme des émeutes.
Les médias sont aux ordres de la classe dominante. Nous dénonçons la propagande frauduleuse et mensongère de leurs manipulations et autres intoxications idéologiques. Nous dénonçons, le "Times" qui, dans son édition du 8 mars, avant même les affrontements à la Sorbonne, affichait sur sa première page : "RIOTS..."
C'est faux ! Les étudiants ne sont pas des émeutiers ("riots" signifie "émeutes" en langue anglaise). Cette falsification purement mensongère du journal aux ordres du gouvernement de Tony Blair (qui vient à la rescousse du gouvernement français) n'a qu'un seul but : faire un amalgame entre les violences aveugles et désespérées qui ont embrasé les banlieues en novembre dernier et la LUTTE DE CLASSE des enfants de la classe ouvrière et des travailleurs (notamment les enseignants, les personnels IATOS) qui se sont joint à leur mouvement. Et ce n'est pas un hasard, si lors de la manifestation des étudiants, qui s'est déroulée "pacifiquement" le jeudi 9 mars sur les Champs-Élysées, un tract tout à fait "louche" circulait d'un "comité pour l'extension des émeutes". Qui a fait circuler ce papier pour faire croire que les manifestations des étudiants étaient téléguidées par un prétendu "comité d'extension des éMEUTES" ? Des éléments du lumpen manipulés par le gouvernement et son Ministère de l'intérieur, des mouchards et autres provocateurs ou bien des partis politiques qui veulent pousser les étudiants, paquets par paquets, à se jeter pieds et poings liées sous les coups de la répression afin de sauver la mise à Villepin et à son CPE ?
Ne cédons pas à l'impatience et à la démoralisation !
Aujourd'hui, la Sorbonne est de nouveau sous le contrôle des "autorités". Les étudiants en lutte ne pourront pas se réunir dans ce lieu symbolique de Mai 68. Mais nous ne sommes pas des fétichistes. Nous n'avons pas besoin de "symboles" dans la lutte, car notre lutte n'est pas "symbolique". Elle est réelle et vivante ! S'ils veulent récupérer leur "monument historique", qu'ils se le gardent On peut aller bâtir ailleurs un véritable "monument" qui laissera des traces dans l'Histoire ! On peut se réunir dans d'autres facs moins "chic" et pleines d'amiante. Et s'ils nous virent, on trouvera d'autres lieux !
Et s'il faut tenir jusqu'au temps des cerises, on ira faire nos AG dans les jardins publics; à l'ombre des arbres et au milieu des fleurs ! Au milieu des mamans qui viendront promener leurs bébés et qui pourront participer aux débats !
Comme le disait un professeur en grève dans une AG de la fac de Paris-Censier: les étudiants d'aujourd'hui ont inventé quelque chose de nouveau et de très important. L'imagination créatrice qui est le propre de la classe ouvrière en lutte est déjà au pouvoir dans certaines universités ! C'est le cas de celle de Censier où l'AG étudiante du 9 mars a décidé de tenir des AG communes avec le personnel de la fac en grève et d'ouvrir la fac le samedi et le dimanche pour permettre aux travailleurs de la région parisienne de venir discuter avec les étudiants des perspectives de la lutte, d'une lutte qui est celle de toute la classe ouvrière, parce que c'est toute la classe ouvrière qui est attaquée. Et même si certains rêvent de faire de la journée du 18 mars une manif enterrement, s'ils parviennent d'ici une semaine à saboter le mouvement et à nous conduire à la défaite, nous aurons (peut-être) perdu une bataille, mais nous n'aurons pas perdu la guerre !
Nous reviendrons à la charge dès que nos forces seront reconstituées. Car la plus grande victoire de la lutte, c'est la lutte elle-même ! C'est l'expérience de l'unité, de la solidarité. Ce sont les leçons que nous allons en tirer qui nous permettrons de repartir au combat encore plus forts et plus unis !
Les futurs chômeurs et les futurs précaires en lutte du printemps 2006 sont d'ores et déjà allés plus loin que leurs aînés, ces "enragés" qui avaient construits des barricades en Mai 68 et qui pensaient participer à un "conflit contre les vieilles générations", à une "révolte contre l'autorité". Les années 60 étaient encore des "années d'illusion". Aujourd'hui, avec la crise mondiale de l'économie capitaliste, avec les attaques incessantes contre les conditions de vie des travailleurs, nous sommes entrés dans l'ère des véritables "années de vérité" ! Et, comme le disait le vieux Karl, c'est bien dans la pratique, que l'homme fait la preuve de la vérité, de la profondeur et de la puissance de la pensée !
Solidarité avec les étudiants futurs chômeurs et précaires en lutte !
A bas la répression contre les enfants de la classe ouvrière !
Non à la dispersion de nos forces !
Pour gagner, construisons un front compact et uni de toute la classe ouvrière !
Courant Communiste International (11 mars 2006)
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [60]
Les nouvelles calomnies de la FICCI
- 3136 lectures
Le CCI ne trahit pas les principes du mouvement ouvrier, c'est la FICCI qui fait le travail de la bourgeoisie
La petite bande de voleurs et mouchards [1] [63] autoproclamée "Fraction interne du CCI" (FICCI) s'est donnée comme raison d'être, au nom de la défense des positions du "vrai CCI", de déverser, sur son site Internet, le maximum d'ordures sur notre organisation. Pas un de ses 37 bulletins n'a manqué de publier au moins deux textes visant à calomnier le CCI ou ses militants. Quelques fois, c'est plus de la moitié de ses articles qui est consacrée à ce sale travail, quand ce n'est pas la totalité du bulletin.
Le dernier en date (le n° 37) du "Bulletin communiste" ne fait pas exception à la règle. On y trouve en particulier un long article destiné à couvrir de boue les "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [64]" adoptées par notre organisation au cours même du mouvement et qui tente d'en dégager les principaux enseignements. On y trouve également, mis en exergue, un petit encart intitulé "Dernière nouvelle" dans lequel on peut lire que : "L'intense campagne de presse de la bourgeoisie qui braque tous ses projecteurs sur la "bombe coréenne" (ainsi que sur les ambitions nucléaires de l'Iran) et cherche à en faire LE véritable danger menaçant la paix du monde, s'est trouvé un relais dans le CCI. (…) Le CCI actuel, dans sa logique de dégénérescence en est donc à contribuer à la mise en place des pièges bourgeois les plus grossiers et les plus dangereux, et qui ne visent que la classe ouvrière."
Quels arguments la FICCI a-t-elle trouvés pour appuyer cette accusation ?
"Dans une pompeuse "Déclaration internationaliste depuis la Corée contre la menace de guerre" publiée tout récemment sur son site web, ce groupe qui continue de se revendiquer de la Gauche communiste "dénonce sans réserve ce nouveau pas vers la guerre accompli par l'État capitaliste de Corée du Nord" et va jusqu'à dédouaner, d'une certaine manière, les grandes puissances de leur responsabilité première dans l'aggravation de la situation mondiale, en ne les accusant que... d'hypocrisie. Quand les campagnes idéologiques actuelles de la bourgeoisie font tout pour déformer la réalité, pour brouiller la conscience de la classe ouvrière et la désarmer, on trouve des "internationalistes", avec leurs moyens et leur drapeau, prêts à y apporter leur contribution."
Cela vaut la peine de lire ce qui est effectivement écrit dans cette déclaration adoptée au cours d'une conférence qui s'est tenue fin octobre en Corée du sud et dont le CCI n'était pas le seul signataire (il y a au total 10 signatures de groupes ou d'éléments individuels) :
"Suite à l'annonce de l'expérience nucléaire en Corée du Nord, nous, communistes internationalistes réunis à Séoul et Ulsan :
-
Dénonçons le développement d'une nouvelle capacité nucléaire entre les mains d'un autre État capitaliste : la bombe nucléaire est l'arme ultime de la guerre inter impérialiste ; sa seule fonction étant l'extermination massive des populations civiles en général et de la classe ouvrière en particulier.
-
Dénonçons sans réserve ce nouveau pas vers la guerre accompli par l'État capitaliste de Corée du Nord qui a ainsi démontré une nouvelle fois (si cela était nécessaire) qu'il n'a absolument rien à voir avec la classe ouvrière ou le communisme, et n'est pas autre chose qu'une version extrême et grotesque de la tendance générale du capitalisme décadent vers la barbarie militariste.
-
Dénonçons sans réserve la campagne hypocrite des États-Unis et de leurs alliés contre leur ennemi Nord-Coréen qui n'est pas autre chose qu'une préparation idéologique pour déchaîner – lorsqu'ils en auront la possibilité – leurs propres frappes préventives dont les populations travailleuses seront les principales victimes, comme c'est le cas aujourd'hui en Irak. Nous n'avons pas oublié que les États-Unis est la seule puissance à s'être servi des armes nucléaire, lorsqu'ils ont annihilé les populations civiles de Hiroshima et Nagasaki. (…)"
Comme on peut le voir, le CCI, de même que les autres signataires de la déclaration, n'accusent pas seulement les grandes puissances, à commencer par les États-Unis qui sont à la tête des campagnes actuelles, du simple péché véniel d'hypocrisie comme le prétend la FICCI. La déclaration dit clairement que ces campagnes hypocrites ne sont pas autre chose "qu'une préparation idéologique pour déchaîner – lorsqu'ils en auront la possibilité – leurs propres frappes préventives dont les populations travailleuses seront les principales victimes, comme c'est le cas aujourd'hui en Irak". Et pour enfoncer le clou, la déclaration rappelle que "les États-Unis sont la seule puissance à s'être servie des armes nucléaires, lorsqu'ils ont annihilé les populations civiles de Hiroshima et Nagasaki."
La FICCI veut démontrer que le CCI est en train de trahir l'internationalisme prolétarien. Pour y parvenir, elle n'a rien trouvé de mieux que de falsifier de façon éhontée le contenu véritable de la "Déclaration". Elle démontre ainsi deux choses:
-
qu'elle n'a trouvé aucune formulation réelle dans les textes que nous écrivons ou que nous soutenons pouvant illustrer notre prétendue trahison de l'internationalisme;
-
qu'elle reprend sans scrupule la méthode des faussaires staliniens.
Le mensonge de la FICCI est plus que grossier. Une nouvelle fois, comme nous l'avons constaté à de nombreuses reprises, elle reprend à son compte la devise de Goebbels, chef de la propagande nazie: "Un mensonge énorme porte avec lui une force qui éloigne le doute".
Cependant, la FICCI ne saurait se contenter de falsifications aussi grossières car elle est bien consciente que les lecteurs de sa prose peuvent très facilement vérifier sur notre propre site ce que nous avons réellement écrit. C'est pour cela que, à côté de ses manipulations et de ses mensonges les plus grossiers, la FICCI juge utile de faire preuve de plus de subtilité dans certaines de ses entreprises de falsification destinée à traîner le CCI dans la boue. C'est ce qu'on peut constater dans sa dénonciation de nos thèses sur le mouvement des étudiants.
Dans cette dénonciation, il s'agit de "prouver" que le CCI "[trahit], [travestit] ce que sont et ont toujours été les véritables positions de notre organisation à propos d'une question aussi fondamentale pour le prolétariat que la violence de classe" et que, ce faisant, il "[participe] de la livrer [la classe ouvrière] aux bras armés de la classe ennemie". Mais comme il n'y a aucune ambiguïté dans notre position là-dessus non plus, que nous continuons à défendre celle que le marxisme a adoptée depuis le 19e siècle et qui a été réaffirmée tant par l'Internationale communiste que par la Gauche communiste qui s'est dégagée de celle-ci lors de sa dégénérescence, la FICCI ne peut éviter de faire appel à ses méthodes favorites : le mensonge et la falsification. Sur le fond, il n'y a donc pas de différence entre son petit encart à propos de la Corée et son long texte à propos de notre analyse du mouvement des étudiants. Mais dans ce dernier texte, c'est de façon plus subtile qu'elle procède.
D'abord, elle prépare le lecteur en laissant croire, à partir d'une citation isolée de son contexte, que le CCI serait aujourd'hui frappé du stigmate "d'un éloignement progressif du marxisme et d'une tendance de plus en plus affirmée à mettre en avant (et à défendre) des valeurs bourgeoises et petites bourgeoises en vogue (le "jeunisme", le féminisme et surtout la "non-violence")". Plus précisément, elle a le culot de prétendre que "pour analyser et évaluer un mouvement de lutte, il [le CCI] fait davantage appel à des critères de sexe, de classes d'âge, voire à des critères biologiques et psychologiques qu'à des critères caractérisant le terrain de classe, c'est-à-dire essentiellement des critères d'organisation et de conscience politique." Et quelle serait la "preuve" d'un tel "abandon du marxisme" par le CCI ? Tout simplement le fait que nous écrivons : "En 'temps normal' les femmes prolétaires, du fait qu'elles subissent une oppression encore plus étouffante que les prolétaires hommes sont, en règle générale moins impliquées qu'eux dans les conflits sociaux. Ce n'est qu'au moment où ces conflits atteignent une grande profondeur, que les couches les plus opprimées du prolétariat, notamment les ouvrières, se lancent dans le combat et la réflexion de classe. La très grande participation des étudiantes et des lycéennes dans le mouvement actuel, le rôle de premier plan qu'elles y jouent, constituent un indice supplémentaire non seulement de sa nature authentiquement prolétarienne, mais aussi de sa profondeur."
Évidemment, la FICCI se garde bien d'indiquer que plus de la moitié du texte est destinée à établir, sur la base de "critères d'organisation et de conscience politique" (la nature de classe des revendications, la solidarité entre les étudiants des différentes facultés, avec les lycéens, avec les salariés, avec les travailleurs des autres générations, la grande vitalité, l'ouverture et la qualité d'organisation des assemblées générales, la capacité de déjouer toute une série de pièges tendus par le gouvernement, etc.) le caractère prolétarien du mouvement contre le CPE, ainsi que sa profondeur. La question de l'ampleur de la participation des étudiantes et des lycéennes est signalée, à la fin du texte comme un indice supplémentaire (nous soulignons) de cette réalité. Cela ne gêne pourtant pas la FICCI pour prétendre que ce serait là notre principal "argument".
Une fois qu'on a ainsi "préparé" le lecteur qui n'a pas lu l'ensemble de notre document, on passe à l'étape suivante. On nous sert un passage truffé de citations du CCI tronquées et d'omissions sur ce que nous avons réellement écrit, le tout accompagné de petits commentaires destinés à faire dire à nos textes le contraire de notre pensée véritable :
"Comment s'est positionné le CCI actuel au moment où l'État bourgeois a envoyé massivement ses CRS et ses forces anti-émeutes contre les étudiants mécontents du printemps 2006, au moment où ces mêmes hordes policières ont attiré les étudiants et les ouvriers dans des pièges, ont frappé les plus isolés à coups de matraques, allant jusqu'à envoyer plusieurs d'entre eux à l'hôpital, tandis que des centaines d'autres ont été envoyés aux postes de police avant d'être remis aux mains de la justice bourgeoise ? Et bien le CCI a soutenu… les manifestations de "solidarité avec les CRS blessés", il a salué ceux qui "reconnaissent que les enfants des CRS qui sont mal payés sont eux-mêmes touchés par les attaques du gouvernement", il a encensé, comme ayant fait "preuve de maturité et de conscience" (alors que ce n'était, au mieux, qu'une preuve de naïveté extrême), ces jeunes étudiants qui, selon l'expression du CCI, "savent que derrière leurs boucliers et leurs matraques, ces hommes armés jusqu'aux dents (les forces anti-émeutes, les CRS !) sont aussi des êtres humains, des pères de famille". En d'autres termes, les bras armés de la répression bourgeoise ne sont eux-mêmes que des "opprimés" et des "exploités" qu'il faut comprendre et défendre. Sous cet angle, leurs intérêts ne sont-ils pas les mêmes que ceux du prolétariat ?
Que ce discours écoeurant et mystificateur soit tempéré, par ailleurs, par quelques phrases passe-partout destinées à simuler une dénonciation "radicale" de l'État bourgeois et de sa répression, ne change rien à la prise de position centrale ; celle qu'aura laissé filtrer le CCI actuel dans son intervention et qui se trouve à l'exact opposé de celle qu'a toujours défendue le CCI dans la tradition du mouvement ouvrier."
Après cette deuxième étape de la manœuvre, la FICCI se propose alors d'exposer "quelle est, quelle a été, dans des circonstances similaires, la véritable position défendue par notre organisation ?
Nous avons alors droit à de longues citations d'articles publiés par le passé dans la presse du CCI dans lesquels nous exposions nos positions sur la répression et sur la violence de classe du prolétariat contre la bourgeoisie. Compte tenu de la "préparation" préliminaire, cette partie du texte de la FICCI vise évidemment à ancrer l'idée que, aujourd'hui, nous aurions abandonné ces positions et que nous faisons de ce fait le jeu de la répression.
Ce n'est pas la première fois que la FICCI nous accuse de faire le jeu de la répression à propos du mouvement du printemps 2006. C'était déjà le cas dans le texte "Manifestations et grèves en France : le nouveau CCI affirme sa solidarité avec les CRS et la police anti-émeutes !", publié dans son Bulletin 35. A cette accusation écoeurante nous avions déjà répondu sur notre site avec l'article "La prétendue 'solidarité du CCI avec les CRS' : comment la FICCI essaie de masquer ses propres comportements policiers" [65]. Nous renvoyons le lecteur à cet article puisqu'il démonte avec de nombreuses précisions les accusations de la FICCI en soulignant ses falsifications tant de ce que nous avons réellement écrit que de la position classique du mouvement ouvrier (notamment lors de la révolution de 1905 en Russie) sur comment le prolétariat doit faire face aux forces de répression. Évidemment, le long texte de la FICCI publié dans son Bulletin 37 ne fait pas la moindre référence à cet article du CCI.
Nous le réaffirmons une nouvelle fois, le CCI n'a pas trahi ses principes, que ce soit sur la question de la violence de classe, sur celle de l'internationalisme ou sur toutes les autres questions. L'examen sérieux de nos documents l'atteste amplement. Les véritables trahisons des principes communistes, ce sont les membres de la FICCI qui les ont accomplies puisque le mensonge et la calomnie de même que le vol, le chantage et le mouchardage n'ont jamais fait partie des méthodes des organisations du prolétariat mais de celles de la classe exploiteuse.
Aujourd'hui, alors qu'en différents points du monde se confirme l'apparition d'éléments ou de groupements s'approchant des positions de la Gauche communiste, ou s'en revendiquant directement, les calomnies systématiques de la FICCI contre le CCI ont évidemment comme objectif d'instiller chez ces éléments la méfiance envers notre organisation. Et comme elle constate le manque d'efficacité de son entreprise, la FICCI peut de moins en moins contenir sa rage [2] [66]: ce n'est pas un hasard si elle a réagi au quart de tour suite à la publication de la déclaration internationaliste adoptée fin octobre en Corée. Mais quelle que soit l'efficacité du sale travail de la FICCI, celui-ci, en jetant le discrédit sur la Gauche communiste, ne peut servir que les intérêts de la bourgeoisie.
CCI (17 novembre 2006)
[1] [67] Évidemment, ce n'est pas de façon gratuite que nous qualifions ainsi ces éléments. Dans plusieurs textes publiés dans notre presse et sur notre site Internet, nous avons donné de nombreux exemples des mœurs de petites frappes qu'on adoptées ces anciens membres de notre organisation que nous avons exclus lors de notre 15e congrès international au printemps 2003. Il s'agit notamment des textes suivants : "XVe Congrès du CCI, Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période [68]" dans la Revue internationale n° 114, "Les méthodes policières de la FICCI [69]" et "Défense de l'organisation : Des menaces de mort contre des militants du CCI [70]" respectivement dans Révolution internationale n° 330 et Révolution Internationale n°354.
[2] [71] Et la FICCI enrage d'autant plus qu'elle va de déception en déception dans son entreprise de travail en commun avec le BIPR qu'elle présente pourtant comme le seul pôle de regroupement pour le futur parti du prolétariat (après la prétendue "dégénérescence" du CCI). C'est ce qu'on peut constater dans ce même Bulletin 37 où la FICCI se plaint qu'une lettre que lui a envoyée récemment le BIPR constitue "une fin de non-recevoir, la conclusion définitive d'une discussion dont de nombreux points étaient (et sont encore) en cours d'élaboration et de clarification". On comprend l'amertume de la FICCI qui n'a pas cessé, au cours des dernières années, de passer la brosse à reluire au BIPR, lequel n'a d'ailleurs jugé à aucun moment opportun de mettre l'adresse du site Internet de la FICCI sur la page de liens de son propre site.
Courants politiques:
Manifestations de sans papiers aux Etats-Unis: Oui à l'unité de la classe ouvrière! Non à l'unité avec les exploiteurs!
- 4484 lectures
Au printemps, des centaines de milliers d'ouvriers immigrés, pour la plupart "étrangers illégaux" comme les appelle la bourgeoisie américaine ("illegal aliens") et en grande majorité en provenance des pays d'Amérique latine, ont manifesté dans les rues des principales villes du pays, de Los Angeles à Dallas, de Chicago à Washington et New York, pour protester contre la menace de lois répressives proposées par l'aile droite du parti républicain. Le mouvement a apparemment surgi d'un coup, venant de nulle part. Quelle est la signification de ces événements et quelle est la nature de classe de ce mouvement ?
La législation anti-immigrés qui a reçu l'approbation de la Chambre des députés et provoqué les manifestations, prévoit, pour la première fois de l'histoire américaine, de considérer l'immigration illégale comme un crime. Jusqu'ici, être un immigré illégal constituait une violation des droits civils, pas un délit criminel. Avec cette loi, les immigrés illégaux seraient arrêtés, jugés, condamnés, expulsés et perdraient toute possibilité de jamais pouvoir revenir légalement aux Etats-Unis. Les lois particulières des Etats qui interdisent à des organismes locaux - la police, les écoles, les servies sociaux - de dénoncer les étrangers illégaux aux services de l'immigration seraient annulées et les employeurs qui embauchent des sans papier devraient payer une amende. Avec cette loi, jusqu'à 12 millions d'immigrés devraient être expulsés La fraction dominante de la bourgeoisie ne soutient pas une législation aussi extrême car celle-ci ne correspond pas aux intérêts globaux du capitalisme d'Etat américain qui a besoin d'ouvriers immigrés pour pourvoir aux empois mal payés, pour servir d'armée de réserve de chômeurs et d'ouvriers sous employés afin de faire baisser les salaires de toute la classe ouvrière. Pour elle, l'idée d'une expulsion massive de 12 millions de gens est une absurdité. L'administration Bush, la direction officielle du Parti républicain au Sénat, les Démocrates, les maires des grandes villes, les gouverneurs des Etats, les patrons des grandes entreprises qui ont besoin d'exploiter une réserve abondante d'immigrés (dans les magasins, les restaurants, la boucherie industrielle, l'agroalimentaire, le bâtiment et les aides à domicile), tous sont contre cette proposition répressive, de même que les syndicats qui rêvent de récupérer les cotisations de nouveaux membres sans le sou. Cet assemblage hétéroclite de "champions" bourgeois de la cause des ouvriers immigrés milite pour une loi plus modérée qui renforce le contrôle aux frontières, limite le nombre de nouveaux immigrants, permette aux sans papier ayant vécu aux Etats-Unis un certain nombre d'années d'être légalisés et oblige ceux qui sont présents depuis moins de deux ans à quitter le pays, mais avec la possibilité de revenir légalement dans l'avenir. Une sorte de programme pour des ouvriers "temporaires" serait établi et permettrait aux ouvriers étrangers de trouver légalement du travail aux Etats-Unis pendant une période de temps limitée, ce qui maintiendrait la réserve nécessaire de main d'œuvre bon marché.
C'est dans ce contexte politique et social que les manifestations d'ouvriers immigrés ont surgi. Venant à la suite des émeutes des jeunes chômeurs d'origine immigrée en France l'automne dernier, de la révolte étudiante dans le même pays au printemps contre l'attaque du gouvernement précarisant le travail, et de la grève du métro à New York en décembre, les manifestations des sans papier ont été acclamées par les gauchistes de tous poils ainsi que par beaucoup de groupes libertaires et anarchistes. Les immigrés menacés par la loi sont sans aucun doute un secteur de la classe ouvrière qui subit une exploitation particulièrement dure et brutale, mène une vie harassante, n'a pas accès aux services sociaux ni aux traitements médicaux et sa situation nécessite le soutien et la solidarité de l'ensemble de la classe ouvrière. Cette solidarité est d'autant plus nécessaire que, selon ses méthodes classiques, la bourgeoisie utilise le débat sur la légalité ou l'illégalité du statut des immigrés comme moyen d'exciter le racisme et la haine, de diviser le prolétariat, tout en profitant de l'exploitation des ouvriers immigrés. Cette lutte aurait vraiment pu être une lutte sur le terrain du prolétariat, mais il y a une grande différence entre ce qu'elle aurait pu être et ce qu'elle a été dans la réalité.
Nos désirs ne doivent pas nous aveugler sur la véritable nature de classe des récentes manifestations qui ont été, dans une large mesure, une manipulation de la bourgeoisie. Oui, il y avait des ouvriers dans les rues, mais ils étaient totalement prisonniers du terrain de la bourgeoisie qui a provoqué, manipulé, contrôlé et ouvertement dirigé ce mouvement. Il y a eu, il est vrai, quelques exemples comme les marches spontanées des lycéens immigrés mexicains en Californie - les enfants de la classe ouvrière - qui suggèrent certaines similarités avec la situation en France, mais ce mouvement n'était pas organisé sur un terrain prolétarien ni contrôlé par les ouvriers immigrés eux-mêmes. Les manifestations qui ont rassemblé des centaines de milliers de gens dans les rues ont été orchestrées et organisées par les média de langue espagnole, c'est-à-dire par la bourgeoisie de langue espagnole, avec le soutien des grandes entreprises et des politiciens établis.
Le nationalisme a empoisonné le mouvement : que ce soit le nationalisme "latino" qui est apparu dès le début des manifestations ou, plus récemment, la ruée nauséabonde qui a suivi, pour affirmer son "américanisme" ; et l'opposition nationaliste aux immigrés, basée sur le racisme, fomentée par les animateurs d'entretiens radiophoniques et les républicains de l'aile droite ajoué son rôle de son côté. Après que les médias eurent relayé des plaintes vis-à-vis du fait que trop de manifestants immigrés portaient des drapeaux mexicains en Californie et que cela démontrait qu'ils étaient plus loyaux vis-à-vis de leur pays d'origine que vis-à-vis de leur pays d'adoption, les organisateurs du mouvement fournirent des milliers de drapeaux américains à déployer dans les manifestations qui allaient suivre, pour affirmer la loyauté et l'américanisme des protestations. Fin avril, une version espagnole de l'hymne national a été enregistrée par les pop stars de langue espagnole les plus connues et diffusée à la radio. Evidemment, les nationalistes d'extrême droite ont sauté sur l'occasion - la version espagnole de l'hymne - pour proclamer que c'était un affront à la dignité nationale. La revendication de citoyenneté qui se situe totalement dans le cadre du légalisme bourgeois, constitue un autre exemple du fait que la lutte était sur un terrain non prolétarien. Cette idéologie nationaliste putride a pour but de court-circuiter toute possibilité que les ouvriers immigrés et les ouvriers nés en Amérique reconnaissent leur unité fondamentale.
Nulle part ailleurs que dans la manifestation massive à New York en avril la nature capitaliste du mouvement n'a été plus évidente : 300 000 immigrés ont manifesté devant la mairie et ont reçu le soutien du maire de la ville, le républicain Michael Bloomberg, et des Sénateurs démocrates Charles Schumer et Hilary Clinton qui a parlé à la foule et donné leur lutte en exemple d'acte d'américanisme et de patriotisme.
20 ans se sont écoulés depuis la dernière réforme majeure sur l'immigration, réalisée par l'administration Reagan, qui avait accordé l'amnistie aux sans papier. Mais cette amnistie n'avait pas endigué le flot d'immigration illégale qui s'est sans cesse poursuivi, deux décennies durant, parce que le capitalisme américain a constamment besoin de main d'œuvre bon marché et parce que les effets de la décomposition sociale du capitalisme dans les pays sous-développés y ont dégradé les conditions d'existence au point qu'un nombre croissant d'ouvriers est forcé de chercher refuge dans les métropoles capitalistes relativement plus stables et plus prospères.
Pour la bourgeoisie, le temps est à nouveau venu de stabiliser la situation car il devient de plus en plus difficile d'absorber un flot croissant d'immigrés et de tolérer une situation où des millions d'ouvriers ne sont pas officiellement intégrés dans l'économie ou dans la société, ne paient pas d'impôts, n'ont pas de papiers après presque 20 ans de statut illégal. D'une côté, cela a amené l'administration Bush à faire de maladroits efforts pour restreindre l'immigration à la frontière, en militarisant par exemple la frontière avec le Mexique, en construisant littéralement un Mur de Berlin pour empêcher la traversée des immigrés. D'un autre côté, cela l'a amenée à favoriser la légalisation des ouvriers présents aux Etats-Unis depuis plus de deux ans. Comme l'économie américaine a besoin d'un flot constant de main d'œuvre bon marché dans d'importants secteurs, il est très improbable que plusieurs millions d'ouvriers qui sont aux Etats-Unis depuis moins de deux ans et à qui on va demander légalement de quitter le pays, le fassent. Le plus probable, c'est qu'ils resteront illégalement et constitueront la base de la future force de travail illégale qui continuera d'être nécessaire à l'économie capitaliste, à la fois comme main d'œuvre bon marché et pour faire pression sur les salaires du reste de la classe ouvrière.
Le fait que l'aile droite de la bourgeoisie ne veuille pas accepter cette réalité n'est que le reflet de l'irrationalité politique créée par la décomposition sociale, irrationalité qui s'est déjà manifestée dans la difficulté de la classe dominante à obtenir aux élections présidentielles des résultats conformes à ses désirs. Il est difficile de croire que l'extrême droite ne comprenne pas l'impossibilité d'expulser 12 millions de personnes, ni la nécessité de stabiliser la situation. La capacité de la fraction dominante dans la bourgeoisie d'imposer sa solution au problème et l'arrêt des manifestations massives ne sont qu'une question de temps, puisque la bourgeoisie évolue vers l'intégration de la population nouvellement reconnue légalement dans le processus politique national.
Internationalism, avril 2006
Géographique:
- Etats-Unis [43]
Message d'Inde: Solidarité avec le mouvement des étudiants
- 3032 lectures
Nous avons reçu une déclaration de solidarité avec les jeunes et les ouvriers en lutte contre le CPE – que nous reproduisons ci-dessous – de la part d’un groupe de discussion communiste au Bengale.
Le fait même de cette déclaration est indicatif du fait que la signification des luttes contre le CPE va bien au-delà des frontières françaises. Cette lutte n’est pas un mouvement national, mais une partie de la reprise internationale des luttes de la classe ouvrière contre la "pourriture du capitalisme".
CCI
Nous, les participants d’un groupe de discussion de Bengale en Inde, avons pris connaissance des évènements en France à partir des documents publiés sur votre site web en anglais. Nous considérons que le mouvement en France est un moment significatif de la lutte de la classe ouvrière, surtout dans cette phase où les attaques capitalistes prennent un caractère de plus en plus généralisé, ce qui appelle une réponse de plus en plus généralisée de la part de la classe ouvrière. Nous attendons avec impatience son développement sur un terrain entièrement prolétarien. Nous pensons qu’il est de notre devoir, en tant que partie du mouvement ouvrier international, d’envoyer notre solidarité au mouvement. Cette lettre doit être considérée comme une déclaration de solidarité, de la part des membres du groupe de discussion, à tous les camarades qui luttent contre le CPE, et contre la pourriture du capitalisme en général. Nous serions très heureux si vous pourriez envoyer cette déclaration de solidarité aux camarades en lutte.
Salutations à vous tous, de la part du groupe de discussion du Bengale.
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [60]
Moyen Orient: contre l'enfoncement dans la guerre, la lutte de classe est la seule réponse
- 2999 lectures
Une
fois de plus, le Moyen Orient est en flammes, les avions et les bateaux de
guerre israéliens bombardent systématiquement Beyrouth et d’autres cibles dans
le Sud et le Nord Est du Liban. Des centaines de civils ont déjà été tués ou
mutilés et des infrastructures vitales pour la population sont détruites. Les
réfugiés fuient les lieux bombardés en nombre croissant. Au moment où nous
écrivons, l’armée israélienne entame les préparatifs d’une prochaine
invasion terrestre. Plus au Sud, dans la bande de Gaza, quelques mois
seulement après le retrait des forces israéliennes, la région toute entière est
devenue, plus qu’avant, un champ de bataille pour les troupes israéliennes et
les groupes armés palestiniens. Le blocus militaire des territoires
palestiniens étouffe l’économie et provoque des souffrances sans
précédent chez les civils. La population d’Israël est, elle aussi,
de plus en plus terrorisée par ce conflit sans fin : les roquettes
du Hezbollah ont déjà causé plusieurs décès au Nord à
l’image des 8 personnes qui ont été tuées par le lancement d’un missile sur un
dépôt de chemin de fer à Haïfa.
La raison officielle de cette offensive musclée de l’Etat israélien est
l’enlèvement de certains de ses soldats par le Hamas dans le Sud et par
le Hezbollah au Nord. Mais ceci n’est qu’un prétexte : Israël a
utilisé ces enlèvements comme un alibi pour essayer de liquider le
Hamas dans les territoires palestiniens et pour réduire
le Hezbollah à l’impuissance. Mais il s’agit aussi pour Israël de provoquer la
Syrie et l’Iran et ainsi les pousser à rentrer dans le conflit.
Une menace d'extension de la guerre à toute la région
Le conflit actuel contient donc la menace d’une escalade vers une guerre
embrasant toute la région. Comme le Moyen Orient est une place
stratégique de la plus haute importance pour les puissances
impérialistes, chaque guerre dans cette région implique que le conflit ne soit
pas seulement confiné entre Israël et les groupes armés palestiniens, ou ses
voisins arabes, mais s’élargisse aux grandes puissances mondiales.
En 1948, les gouvernements russes et les américains ont soutenu la
formation de l’Etat d’Israël en tant que moyen de faire une brèche dans la
domination des vieilles puissances coloniales, la France et la Grande-Bretagne
qui contrôlaient jusque là cette zone. La guerre déclenchée par la
nationalisation du canal de Suez par l’Egypte en 1956 a confirmé que
l’Amérique devenait le principal chien de garde de la région : elle a humilié
les Etats français et les anglais en exigeant qu’ils mettent fin à leur
expédition contre l’Egypte de Nasser. Les guerres de 1967, 1973 et 1982 se sont
ensuite intégrées au conflit global entre les blocs américain et russe, avec
les Etats-Unis soutenant Israël et la Russie l’OLP et les régimes arabes. Avec
l’effondrement du bloc de l’Est en 1989, la scène était "prête"
pour une " Pax Americana" au Moyen Orient. Les Etats-Unis
devenaient ainsi le principal artisan des Accords d’Oslo de 1993.
Ils espéraient que mettre fin au conflit entre Israël et Palestine leur
permettrait de devenir les maîtres incontestés de la région. L’énorme démonstration
de puissance militaire des Etats-Unis en Irak en 1991 avait le même but.
Cependant, tous les efforts de l’impérialisme américain pour imposer un
"nouvel ordre" au Moyen Orient n’ont abouti à rien. Depuis les
Accords "de paix" d’Oslo, mais surtout depuis "la seconde
Intifada" en 2000, le conflit permanent entre Israël et
la Palestine a pris la forme d’une spirale interminable d’attentats
kamikazes, suivis de représailles israéliennes brutales, suscitant encore
davantage d’attentats suicides et plus de représailles. Parallèlement,
les efforts des Etats-Unis pour asseoir leur pouvoir en Afghanistan et en
Irak –"la guerre contre le terrorisme"- leur ont explosé à la figure
créant deux "nouveaux Vietnam", plongeant ces deux pays dans un
chaos total. Alors que l’on assiste à une escalade au Liban, la population
irakienne subit chaque jour des massacres épouvantables, tandis qu’en
Afghanistan, le gouvernement soutenu par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne a perdu le contrôle de la majorité du pays. Bien plus, les
conséquences du bourbier militaire en Irak et en Afghanistan ont des
répercussions sur le conflit israélo-palestinien et vice versa. Les discours
provocateurs d’Israël vis-à-vis de l’Iran font écho à la confrontation de la
Maison Blanche avec le gouvernement de Téhéran au sujet de son programme
nucléaire, alors que la progression réalisée par le terrorisme islamique
en Irak influence les actions du Hamas et du Hezbollah. Et le massacre par des
gangs terroristes de civils à New York, Madrid et Londres, confirme que la
guerre au Moyen Orient s’est déjà étendue jusqu’au centre même du système
capitaliste.
En bref, la situation dans tout le Moyen Orient démontre que les
Etats-Unis ne contrôlent pas la situation et se trouvent devant le
développement d’un chaos incontrôlable. La fuite en avant dans l'aventure
militaire est la seule réponse que chaque clique ou chaque puissance, des plus
grandes aux plus petites, puisse apporter pour défendre ses prétentions
impérialistes face à ses rivaux. C’est ce que montre l’attitude ultra agressive
d’Israël[1] [72].
Les rivaux des Etats-Unis se préparent à tirer parti de la situation
En ce qui concerne les autres grandes puissances, elles agitent des banderoles
pour la paix comme elles l’ont fait avant l’invasion de l’Irak. La France et la
Russie ont clairement condamné l’opération militaire
"disproportionnée" d’Israël au Liban. La Grande-Bretagne a
aussi adopté une ligne plus indépendante : elle a fait de sévères critiques à
la "punition collective" des Palestiniens à Gaza par Israël et
elle a fait son grand show en envoyant des bateaux de guerre pour évacuer ses
ressortissants du Liban. Ces puissances, cependant, ne s’intéressent pas à la
paix mais au maintien de leur propre sphère d’influence dans la région. Elles
essaieront certainement de profiter de la faiblesse de l’impérialisme
américain, mais aucune d’elles n’est en position d’assumer le rôle de
gendarme du monde, de plus leurs intérêts impérialistes conflictuels
rendent impossible leur évolution vers une quelconque politique commune
cohérente. C’est pourquoi au récent sommet du G8, si les grandes puissances ont
tenu un discours "unitaire" sur la crise au Liban, elles ont
ouvert immédiatement la voie à des récriminations et à des désaccords
entre elles.
Tous les Etats et toutes les forces impliquées dans ce conflit sont très
occupés à élaborer des plans militaires et diplomatiques qui correspondent à
leurs propres intérêts. Ils utilisent certainement les méthodes de calcul les
plus rationnelles pour élaborer ces plans, mais tous sont englués dans un
processus fondamentalement irrationnel : l’enfoncement inexorable du système
capitaliste dans la guerre impérialiste qui prend aujourd’hui, de plus en
plus, le caractère de la guerre de tous contre tous. Même le
puissant Oncle Sam est happé par ce gouffre. Dans le passé, quand les
civilisations agonisaient, elles étaient de plus en plus entraînées dans des
guerres sans fin. Le fait que le capitalisme soit devenu un système
vivant dans la guerre permanente est la preuve la plus évidente que lui aussi
est dans un état de pourriture avancée et que sa survie même est devenue un
danger mortel pour l’humanité.
La lutte de classe est la seule issue
Si tous les plans de paix du capitalisme sont voués à l’échec, quelle peut être
l’alternative au désordre impérialiste qui les condamne ? Certainement pas les
différents gangs nationalistes ou religieux qui prétendent
"résister" à l’impérialisme américain en Palestine, en Irak ou
en Afghanistan – Hamas, OLP, Hezbollah, Al Qaïda…- eux aussi sont
complètement intégrés dans la logique de l’impérialisme, soit en
affirmant le leur, soit en s’alignant directement sur des Etats capitalistes
existants. Leurs objectifs – que ce soit la création de nouveaux Etats
nationaux ou le rêve d’un califat islamiste sur le Moyen Orient – ne sont
envisageables qu’à travers la guerre impérialiste ; leurs méthodes – qui
impliquent toujours le massacre des populations civiles – sont précisément
celles des Etats auxquels ils prétendent s’opposer.
La seule opposition à l’impérialisme est la résistance de la classe ouvrière à
son exploitation parce qu’elle est la seule lutte ouverte contre le
système capitaliste, une lutte pour remplacer ce système de guerre et de
profit par une société qui vise à satisfaire les besoins de l’humanité. Parce
que les exploités ont partout les mêmes intérêts, la lutte de classe est
internationale et n’a aucun intérêt à s’allier avec un Etat ou son rival.
Ses méthodes s’opposent directement à l’aggravation de la haine entre groupes
ethniques ou nationaux, parce que la lutte requiert le rassemblement du
prolétariat de toutes les nations dans un combat commun contre le capital et
l’Etat.
Au Moyen Orient, la spirale des conflits nationaux a rendu la lutte de classe
très difficile, mais elle existe toujours – pour preuve les manifestations
d’ouvriers palestiniens contre les autorités palestiniennes, les grèves des
ouvriers du secteur public en Israël contre les budgets d’austérité du
gouvernement. Mais la possibilité de création la plus vraisemblable d’une
brèche dans le mur de la guerre et de la haine au Moyen Orient réside en dehors
de cette région : dans les luttes croissantes des ouvriers des pays centraux du
capitalisme. Le meilleur exemple de solidarité de classe que nous pouvons
offrir aux populations qui souffrent directement des horreurs de la guerre
impérialiste au Moyen Orient est de développer les luttes qu’ont commencé à
mener les étudiants en France en tant que travailleurs précaires ou futurs
salariés, les métallurgistes de Vigo en Espagne, les postiers de Belfast ou les
ouvriers de l’aéroport de Londres.
[1] [73] La mise en œuvre directe de la politique guerrière et barbare de l'Etat d'Israël a été prise en charge par Amir Peretz, chef de la gauche du parti travailliste et ministre de la Défense, ancien dirigeant syndicaliste et ancien militant du mouvement pacifiste "La Paix maintenant". On pourrait penser que cette vocation de massacreur jusqu'auboutiste chez un "homme de gauche" est une sorte de "spécificité israélienne" mais ce serait une erreur. Il y a un an, lors de l'assassinat par la police dans le métro de Londres d'un jeune ouvrier brésilien, un de ceux qui a justifié avec le plus de fermeté l'attitude des flics consistant à "tirer pour tuer" toute personne soupçonnée de pouvoir être un "terroriste" n'est autre que Ken Livingstone, le maire très "à gauche" de Londres. Dans la défense armée et sanglante des intérêts du capital national, la "gauche" a toujours fait la preuve de sa détermination et de son absence de scrupules, quel que soit le pays.
Géographique:
- Moyen Orient [74]
Oaxaca : réflexion, organisation et mobilisation prolétarienne face à la répression de l’État.
- 3121 lectures
Au petit matin du 14 juin, 3000 policiers attaquèrent un campement-manifestation établi dans le centre d’Oaxaca, capitale de l’Etat mexicain du même nom. Ce campement y était installé depuis trois semaines par les travailleurs de l’Education de l’Etat pour exiger des augmentations salariales. Dans l’Etat d’Oaxaca il y a des régions entre les plus pauvres du Mexique où des instituteurs sous-payés travaillent dans des conditions inimaginables au milieu des enfants affamés. Les instituteurs, à travers des manifestations massives, ont essayé de trouver le soutien des autres travailleurs. Mais ces travailleurs se sont trouvé face à toutes les manœuvres syndicales, que ce soit celles du syndicat « officiel » ou le syndicat dissident « de base », et face à la répression de l’Etat. Même si les travailleurs ont réussi dans un premier temps à résister à cette répression, leurs revendications salariales, qui sont l’expression de leur condition de classe et leur critique directe du système d’exploitation, ont été annulées. Leur combativité, leurs exigences ont été noyées dans le cadre d’une mobilisation interclassiste prise en main par l’APPO, « Assemblée Populaire du Peuple d’Oaxaca ». L’APPO, sous la radicalité des actions et sa prétendue autonomie, est dominée par les syndicats, les staliniens, et les gauchistes de tout poil. Le mécontentement ouvrier (surtout chez les instituteurs) et d’autres secteurs opprimés (comme les paysans pauvres) a été dévié vers « l’amélioration » de l’ordre démocratique, vers l’exigence de destitution du gouverneur d’Oaxaca, Ulises Ruiz, un véritable gangster dans la meilleure tradition de la bourgeoisie mexicaine et de son ex parti dominant, le PRI.
Depuis le début des mobilisations, l’intromission d’intérêts étrangers à ceux des travailleurs était déjà évidente, à travers la structure syndicale. A travers le syndicat diverses forces de la bourgeoisie tentent de détourner le mécontentement des travailleurs, non seulement pour émousser la combativité dont ils font preuve, mais aussi pour utiliser cette force comme chair à canon dans leurs querelles au sein de la bourgeoisie.
Malheureusement le mouvement d’Oaxaca a tendance à ressembler, du point de vue de la manipulation des masses, à ce qui a été fait par le secteur de la bourgeoisie représenté par Obrador[1] [75] : ils ont réussi à étouffer le mécontentement et la volonté de lutter présente dans de nombreux secteurs, et à les faire participer aux mobilisations « pour la défense du vote ». La tactique était de les impliquer dans une lutte bidon et de les amener à une réflexion erronée, qui s’est achevée par la neutralisation totale du mécontentement (ou sa poursuite dans une autre direction à travers l’activité de la CND[2] [76] et de son « gouvernement parallèle »), le mécontentement fut exploité pour utiliser les masses pour le soutien d’une clique de la bourgeoisie, et c’est ainsi que la confusion s’est répandue et amplifiée.
Dans le cas d’Oaxaca, la colère actuelle des travailleurs de l’éducation qui appellent à la mobilisation, est également utilisée et détournée vers la recherche d’une fausse alternative : la réforme de l’Etat. Ce qui ressort de ces mobilisations n’est pas le progrès de la conscience et de la combativité des masses laborieuses (comme le prétendent les gauchistes) mais l’instrumentalisation de ce mécontentement et le profit qu’en tire une des fractions de la classe dominante. Elle utilise la mobilisation pour mettre en difficulté une fraction rivale.
En cachant les intérêts des fractions de la bourgeoisie impliquées dans la bagarre derrière les manifestations et les actions sincères de milliers de personnes vivant dans cette région, on a réussi à transformer le mécontentement des travailleurs contre l’aggravation de leurs conditions de vie, en « exigences démocratiques » d’une masse de « citoyens » amorphes. Ils encouragent ainsi la vaine espérance comme quoi le capitalisme pourrait changer en mieux, simplement en remplaçant un gouverneur, certes véritable « gangster, voleur et corrompu » par un autre ayant « bon cœur ».
Le prolétariat est la seule classe qui puisse en finir avec le capitalisme.
Les mobilisations impulsées par l’APPO ont en effet été massives et n’ont cessé de démontrer la volonté de combattre. Il y a eu aussi des expressions de solidarité envers les instituteurs de la part de différents secteurs exploités. Cependant tout cela a été anéanti lorsque les intérêts des travailleurs ont été soumis et orientés vers la défense de la démocratie. La structure syndicale et les divers groupes gauchistes, à travers l’APPO, ont très habilement conduit les masses dans une impasse. La nature brutale et sanguinaire du système s’exprime bien sûr par une répression qui va devenir de plus en plus forte, menée par la bourgeoisie contre les manifestants. Mais cela ne confère pas pour autant de caractère « révolutionnaire » ou « insurrectionnel » comme le prétend l’appareil de la gauche du capital[3] [77], le caractère de classe d’un mouvement s’exprime dans les objectifs que se donne la lutte, dans son organisation et sa direction, et dans les moyens avec lesquels se développe le combat. On a fini par imposer aux travailleurs des objectifs et des mots d’ordre qui ne font que renforcer le système. Les objectifs visés montrent que les prolétaires n’ont plus le moindre contrôle sur ces mobilisations. On peut constater que l’organisation de ce mouvement, même si elle a pu surgir avec la volonté d’étendre la solidarité avec les enseignants, a pris un virage pour soumettre les intérêts de classe (représentées par les revendications salariales) aux intérêts « citoyens » impulsés par les différents groupes sociaux qui constituent l’APPO secondés par les groupes qui constituent l’appareil de gauche du capital (du PRD aux groupes trotskistes et staliniens).
Ainsi, les travailleurs agglutinés dans l’APPO on été dépouillés de leur force de classe. Ils ne peuvent plus y exprimer leur volonté, leur courage de classe, étant dénaturés et détournés de leurs objectifs, mais pire encore leur potentiel de combativité fut réduit du fait de l’impossibilité d’auto organisation, en faisant une force stérile, soumise aux décisions et aux méthodes de lutte propres à la classe dominante.
Au cours d’une entrevue avec l’avocat de l’APPO, Ochoa Lara ; il explique, voulant justifier la spontanéité de son organisation, le caractère et la nature de l’APPO, il signale qu’elle regroupe formellement environ 200 groupes et communautés de la région. Mais la plupart d’entre eux sont des initiales sans rien derrière. Le groupe le plus nombreux est le Mouvement d’Unification de la Lutte Triqui[4] [78] (MULT), représenté à l’APPO par Rogelio Pensamiento, lequel, d’après l’avocat, est connu pour « ses accointances avec les gouvernements priistes »[5] [79]. Un autre dirigeant de l’APPO est Flavio Sosa, qui fut député PRD, « il se joignit ensuite à la campagne de Vicente Fox et puis il a constitué le parti Unité Populaire, qui a favorisé le PRI aux élections qui au porté au gouvernorat Ulises Ruiz. » (Proceso 1560, 24-09-06)
Ainsi malgré les rassemblements spectaculaires et la répression menée contre ses membres, les mobilisations menées par l’APPO n’expriment pas la force du prolétariat, mais les agissements désespérés de classes et couches moyennes (qui, bien qu’exploitées et opprimés n’ont pas de perspective historique), qui sont largement utilisés par la bourgeoisie. Il n’y a pas plus faux que les spéculations de l’appareil de gauche du capital, quand il affirme que les mobilisations de l’APPO sont le début de la « révolution » ; des propos identiques se répandirent à l’apparition du mouvement piquetero en Argentine et la réalité démontra que c’était bien loin d’être le cas.
Il s’agit pour nous de clarifier le sens de ces mobilisations et non pas d’agresser ceux qui y participent. Il ne s’agit pas de minimiser les expressions prolétariennes dans cette région, mais, au contraire, d’impulser la réflexion sur la nécessité d’une organisation autonome, qui interdisse à la classe dominante d’imposer ses objectifs, ou que, grâce à ses syndicats et ses appareils gauchistes, elle mette en place des moyens de lutte stériles, qui ne peuvent qu’entraîner la répression et mener à la défaite.
Nous avons la responsabilité en tant que révolutionnaires, de définir clairement quelles sont les forces et les limites des mobilisations auxquelles participent les travailleurs, de signaler sans mentir les dangers que court l’action prolétarienne quand les forces de la bourgeoisie entrent en jeu pour les manipuler, et indiquer quels sont ses alliés et quelle orientation donner à ses luttes. Nous connaissons la difficulté de cette tâche pour les communistes car nous devons aller à contre-courant du discours pragmatique de la gauche du capital, qui gagne des « sympathies » en applaudissant tout ce qui bouge, en encourageant l’impatience et l’immédiatisme. Mais ces agissements ne sont qu’un sabotage, ou, dans le « meilleur des cas », ne sont que l’expression petite-bourgeoise de l’absence total de confiance historique dans le prolétariat, de là cet enthousiasme pour les révoltes inter-classistes. L’exploitation, l’oppression et la misère ne disparaîtront pas avec un simple changement de fonctionnaires, le prolétariat est l’unique classe qui puisse les éliminer, et sa conscience et son organisation sont les seules armes sur lesquelles il peut compter.
Traduit de Revolución Mundial, organe du CCI au Mexique, 20 10 2006
[1] [80] A.M. Lopez-Obrador, dit AMLO, était le candidat du PRD (gauche) aux récentes élections présidentielles mexicaines. Le candidat de droite, Calderón, a gagné de quelques voix. Obrador a fait toute une campagne sur la fraude qui aurait entaché ces élections, ce qui ne serait pas étonnant, vu les mœurs politiques de la bourgeoisie mexicaine. Mais ce qui importe c’est que la gauche mexicaine a profité de cette situation pour renforcer dans les têtes l’idée qu’il pourrait y avoir une bonne et juste démocratie, qu’il faut une « nouvelle constitution », etc. Plus le pouvoir de la bourgeoisie apparaît comme ce qu’il est : une dictature quelque soit l’enveloppe, plus les forces spécialisées dans l’encadrement des classes exploitées, c'est-à-dire la gauche plus ou moins radicale, font miroiter des lendemains démocratiques qui chantent, des démocraties nouvelles, directes, participatives et autres joyeusetés du même tonneau. Dans ce sens, au Mexique on en aura été servi cet automne : De la gauche qui a monté une occupation symbolique du centre de la capitale fédérale jusqu’à la confiscation de la lutte des instituteurs par l’APPO à Oaxaca, en passant par le EZLN (mouvement zapatiste) et sa 6ème déclaration, très critique vis-à-vis de la gauche officielle d’Obrador, on a eu droit à tout l’éventail de « nouveautés » pour éviter que le prolétariat se pose vraiment la vraie question du pouvoir.
[2] [81] La Convention National Démocratique, coalition de la gauche mexicaine qui ne reconnaît qu’Obrador comme président « légitime », organise des forums pour maintenir la pression.
[3] [82] Voir à ce sujet le dernier numéro de Revolución Mundial dans ce même site l’article qui dénonce les mensonges des trotskistes.
[4] [83] Les « triquis » est un des peuples indigènes de l’État d’Oaxaca.
[5] [84] “priiste”, du PRI, Parti Révolutionnaire Institutionnel qui a gouverné le Mexique pendant 70 ans.
Géographique:
- Mexique [85]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Réunion publique à Lille: Etudiants, lycéens, ouvriers au travail ou au chômage : un même combat contre le capitalisme !
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 159.21 Ko |
- 736 lectures
Depuis début février, et malgré la dispersion de la période des vacances scolaires, les étudiants et lycéens, dans la plupart des grandes villes du pays, se sont mobilisés pour exprimer leur colère contre les attaques économiques du gouvernement et du patronat, contre le CPE (Contrat Première Embauche). Et cela malgré le black out des médias bourgeois et notamment de la télévision qui, jour après jour, a préféré focaliser ses projecteurs sur les "exploits" sinistres du "gang des barbares".La colère des étudiants est légitime !
Les institutions de l'éducation nationale (collèges, lycées, universités…) sont devenues des usines à chômeurs, des réservoirs de main d'œuvre bon marché. C’est parce qu’elles l’ont compris, que des assemblées d’étudiants, comme à Caen, ont envoyé des délégations auprès des travailleurs des entreprises voisines et auprès des jeunes chômeurs des cités pour les appeler à rejoindre la lutte. Le CPE, c’est la précarité organisée. Mais la précarité ne frappe pas uniquement les jeunes. Ce sont toutes les générations qui sont touchées par le chômage, la précarité et la misère.
C'est aussi pour cela que, dans certaines universités comme celle de Paris III Censier, les enseignants et les personnels ATOS se sont eux aussi mis en grève en solidarité avec les étudiants.
Le CPE est une expression de la faillite du capitalisme !
Face aux émeutes qui ont embrasé les banlieues au mois de novembre, la bourgeoisie, son gouvernement, ses partis politiques, ont ramené l'ordre en imposant le couvre feu, en expulsant hors des frontières nationales les jeunes immigrés qui ne respectent pas leur "terre d'accueil". Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, veulent continuer à "nettoyer au karcher" les enfants de la classe ouvrière avec un cynisme sans borne : c'est au nom de "l'égalité des chances" qu'ils leurs promettent, avec le CPE, la précarité et la misère. Avec le CPE, les jeunes qui auront la "chance" de trouver un emploi à la fin de leurs études seront à la merci des patrons. Aucune possibilité de trouver un logement, de fonder une famille, de nourrir leurs enfants. Cela veut dire que chaque jour, ils devront aller au boulot avec la peur au ventre, avec l'angoisse de recevoir la fameuse "lettre recommandée" avec sa sinistre sentence : LICENCIé ! Voilà ce qu'est l'esclavage salarié ! Voilà ce qu'est le capitalisme !
La seule "égalité" contenue dans le CPE, c'est l'égalité de la misère : entassement dans les cités ghettos, petits boulots précaires, chômage, RMI, survie au jour le jour. Voilà, l'"avenir radieux" que la classe dominante, la bourgeoisie et son État "démocratique" promettent à coup sûr aux enfants de la classe ouvrière !
Ces enfants dont les parents s'étaient mobilisés en 2003 contre la réforme du système de retraite et à qui le prédécesseur de Villepin, Monsieur Raffarin, avait eu le culot de dire : "Ce n'est pas la rue qui gouverne !"
Après le coup de massue porté contre les "vieux" et futurs retraités, les coups sont maintenant assénés contre les "jeunes" et futurs chômeurs ! Avec le CPE, le capitalisme montre ouvertement son vrai visage : celui d'un système décadent qui n'a plus aucun avenir à offrir aux nouvelles générations. Un système gangrené par une crise économique insoluble. Un système qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a dépensé des sommes pharamineuses dans la production d'armements de plus en plus sophistiqués et meurtriers. Un système qui, depuis la guerre du Golfe en 1991 n'a cessé de répandre le sang sur toute la planète. C'est le même système en faillite, c'est la même classe capitaliste aux abois qui ici jette des millions d'êtres humains dans la misère, le chômage, et qui sème la mort en Irak, au Moyen-Orient, en Côte d'Ivoire !
Jour après jour, le système capitaliste qui domine le monde fait la preuve qu’il doit être renversé. Et c’est parce qu’ils ont commencé à le comprendre, qu’à l'université de Paris Tolbiac, dans une AG, des étudiants se retrouvent derrière une motion affirmant qu’"il faut en finir avec le capitalisme" ! C’est aussi pour cela qu’à Paris Censier, le vendredi 3 mars, les étudiants ont invité une compagnie de théâtre à venir chanter des chants révolutionnaires. Le drapeau rouge flotte et plusieurs centaines d'étudiants, enseignants, personnels ATOS chantent l'Internationale. Le "Manifeste communiste" de Karl Marx est distribué. Dans l'enceinte de l'université, le mot RÉVOLUTION est prononcé, répété. Autour du spectacle, on discute de la lutte de classe, on évoque la révolution russe de 1917 et les grandes figures du mouvement ouvrier, comme Rosa Luxemburg lâchement assassinée, avec son camarade Karl Liebknecht, en 1919 pendant la révolution allemande, par des tueurs aux ordres du parti socialiste qui dirigeait le gouvernement.
Pour affronter le "gang des barbares" en costard cravate qui nous gouverne, les jeunes générations doivent se souvenir de l'expérience de leurs aînés. En particulier, elles doivent se remémorer ce qui s’est passé en Mai 1968.
La grève massive de Mai 68 nous montre le chemin
Dans la foulée des mouvements qui avaient touché auparavant les universités de la plupart des grands pays développés, en particulier les États-Unis et l'Allemagne, les étudiants des universités françaises s'étaient mobilisés massivement en mai 68. Mais cette mobilisation a pris une tout autre ampleur quand tous les secteurs de la classe ouvrière sont entrés dans la lutte : 9 millions de travailleurs en grève ! Les étudiants les plus conscients et combatifs ont alors dépassé leurs revendications spécifiques pour proclamer que leur combat était le même que celui de la classe ouvrière. Ils ont appelé les ouvriers à venir dans les universités occupées pour discuter de la situation et des perspectives. Partout on discutait de la révolution, de la nécessité de renverser le capitalisme.
Mai 68 n’a pas débouché sur la révolution, elle n’était pas encore possible parce que le capitalisme n’était qu’au début de sa crise. Mais les bourgeois ont eu la plus grande trouille de leur vie. Et si le gouvernement a réussi à reprendre le contrôle de la situation, c’est parce que les syndicats ont tout fait pour que les ouvriers retournent au travail ; c’est parce que les partis de gauche, ceux qui se présentent comme les défenseurs des travailleurs, ont appelé à participer aux élections organisées par le régime de De Gaulle.
Mai 68 a montré que la révolution n’est pas une vieille pièce de musée poussiéreuse, qu’elle n’appartient pas à un passé révolu, mais qu’elle représente le seul futur possible pour la société. De plus, ce grand mouvement de la classe ouvrière, qui a été suivi par de nombreuses luttes ouvrières dans beaucoup d’autres pays, a montré à la classe dominante qu’elle ne pouvait pas embrigader les exploités derrière les drapeaux nationaux, qu’elle n’avait pas les mains libres pour déchaîner une troisième guerre mondiale, comme elle l’avait fait en 1914 et en 1939. Si, contrairement à celle des années 1930, la crise économique n’a pas débouché sur un massacre généralisé, c’est bien grâce aux luttes de la classe ouvrière.
L'avenir est entre les mains des jeunes générations
Le mouvement de la jeunesse contre le CPE montre que les germes d'une nouvelle société sont en train de pousser dans les entrailles de la vieille société capitaliste à l'agonie. L'avenir est entre les mains de cette nouvelle génération. Les lycéens et étudiants sont en train de prendre conscience que, en tant que futurs chômeurs et futurs précaires, ils appartiennent, dans leur grande majorité, à la classe ouvrière. Une classe exploitée que le capitalisme tend à exclure de plus en plus de la production. Une classe qui n'aura pas d'autre choix que de développer ses luttes pour défendre ses conditions de vie et l'avenir de ses enfants. Une classe qui n'aura pas d'autre alternative que de renverser le capitalisme pour en finir avec l'exploitation, la misère, le chômage et la barbarie. Une classe qui, elle seule, peut construire un monde nouveau, basé non pas sur la concurrence, l'exploitation, la recherche du profit mais sur la satisfaction de tous les besoins de l'espèce humaine.
En 1914, les enfants de la classe ouvrière, dont la grande majorité étaient encore des adolescents, avaient été envoyés dans les tranchées pour servir de chair à canon. La hyène capitaliste, en se vautrant dans le sang des exploités, avait fauché ces jeunes générations que Rosa Luxembourg appelait la "fine fleur du prolétariat".
Ce système capitaliste décadent, qui a mutilé et massacré les enfants de la classe ouvrière envoyés sur le front en 1914, et une nouvelle fois en 1939, la "fine fleur du prolétariat" du vingt et unième siècle aura la responsabilité de le détruire en développant la lutte aux côtés de toute la classe ouvrière, de toutes les générations.
Récemment, au Brésil, à l'université de Vitoria da Conquista, les étudiants ont manifesté la volonté de discuter de l'histoire du mouvement ouvrier. Ils ont compris que c'est en se plongeant dans l'expérience des générations du passé que les nouvelles générations pourront reprendre le flambeau du combat mené par leurs parents, grands-parents et arrière grands-parents. Ces étudiants ont voulu entendre ceux qui pouvaient leur transmettre ce passé, un passé qu’ils doivent s’approprier et grâce auquel les jeunes générations pourront construire l'avenir. Ils ont découvert que l'histoire de la lutte de classe, l'histoire vivante ne s'apprend pas seulement dans les livres (et encore moins sur les bancs de l'école), mais aussi dans l'action. Ils ont osé parler, poser des questions, exprimer des désaccords, confronter les arguments.
Dans les universités de France, comme dans celles du Brésil, il faut ouvrir les amphis, les AG à tous ceux, ouvriers, chômeurs, révolutionnaires qui veulent en finir avec le capitalisme.
Une seule perspective : unité et solidarité de toute la classe exploitée !
Depuis plusieurs mois, dans tous les pays, le monde du travail est secoué par des grèves dans le secteur public comme dans le privé, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Inde, en Amérique latine. Contre le chômage et les licenciements, partout les grévistes ont mis en avant la nécessité de la solidarité entre les générations, entre les chômeurs et les "actifs".
Étudiants, lycéens, votre colère contre le CPE ne peut être qu'un coup d'épée dans l'eau si vous restez isolés, enfermés dans les murs de l'université ou du lycée ! Exclus des lieux de production, vous n'avez aucun moyen de faire pression sur la bourgeoisie en paralysant l'économie capitaliste.
Travailleurs salariés, au chômage ou retraités, il faut se mobiliser, ce sont vos enfants qui sont maintenant attaqués ! C'est vous qui avez produit et produisez encore toutes les richesses de la société. C'est vous qui êtes le moteur de la lutte contre le capitalisme !
Jeunes chômeurs des banlieues, vous n'êtes pas seuls à être "exclus" ! Aujourd'hui, on vous traite de "racaille". Ce n’est pas nouveau : en 1968 vos parents qui s’étaient révoltés contre l’exploitation capitaliste étaient traités de "chienlit".
La seule perspective, le seul avenir, ce ne sont pas les violences aveugles, les incendies de voitures. Le seul avenir, c'est la lutte solidaire et unie de toute la classe ouvrière, de toutes les générations ! C'est dans les grèves, les assemblées générales, dans les discussions sur les lieux de travail et d'étude, dans les manifestations de rue qu'il faut exprimer TOUS UNIS notre colère contre le chômage, l'emploi précaire et la misère !
A bas le CPE ! A bas le capitalisme ! La classe ouvrière n'a plus rien à perdre que ses chaînes. Elle a un monde à gagner.
Courant Communiste International (6 mars 2006)
Réunion publique à Paris, le 11 mars: luttes des étudiants - débat sur les expériences et les perspectives
- 3726 lectures
Exposé à la réunion publique du CCI du 11 mars à Paris :
Etudiants, lycéens, ouvriers au travail ou au chômage :
un même combat contre le capitalisme !
Comme vous l'avez appris par les médias, hier après-midi plusieurs centaines d'étudiants des universités de la région parisienne sont allés à la Sorbonne occupée depuis plusieurs jours par une cinquantaine d'étudiants de cette faculté située au centre de Paris. A la faculté de Censier, l'Assemblée générale des étudiants qui s'est tenue hier matin avait décidé d'envoyer une délégation massive pour apporter de la nourriture à leurs camarades enfermés dans la Sorbonne par les cordons de flics.
Plusieurs centaines d'étudiants sont entrés de force dans la Sorbonne, en passant par les fenêtres. Mais le mouvement de solidarité avec leurs camarades pris en otage dans le piège de l'occupation de la Sorbonne, était très hétérogène. Certains étudiants, notamment ceux de Censier, ont essayé de discuter avec les gardes mobiles de la gendarmerie. Certains scandaient le slogan "CRS avec nous !" d'autres criaient "Sarkozy, au RMI !" Les flics n'ont pas chargé, même si les plus excités ont quand bousculé et donné quelques coups de matraques discrets. Malgré les échauffourées, il n'y a pas eu, à notre connaissance, d'arrestations à ce moment là. Les forces de l'ordre avaient, de façon évident, reçu la consigne de ne pas charger ce qui a permis l’entrée dans la Sorbonne de étudiants qui ont forcé les portes et les fenêtres. Plusieurs centaines d'étudiants sont donc tombés dans le piège.
La situation a basculé cette nuit où il y a eu des affrontements violents entre les étudiants et les forces de l'ordre. A 4 heures du matin, les CRS ont finit par évacuer la Sorbonne à coups de matraques et de bombes lacrymogène. Plusieurs dizaines d'étudiants ont été arrêtés.
Il est donc arrivé aux enfants de la classe ouvrière la même tragédie que celle de la chèvre de monsieur Seguin. Ils ont tenu jusqu'au petit matin et le loup les a mangés.
Face à la répression, aux arrestations mais aussi au flicage des universités qui sont truffées de mouchards et de RG, le CCI se doit de dénoncer haut et fort toutes les attaques portées par l'État "démocratique" bourgeois contre les enfants de la classe ouvrière. Le CCI se déclare solidaire des enfants de la classe ouvrière attaqués par le CPE, tabassés et arrêtés par la police.
Aujourd'hui, "l'ordre règne" à la Sorbonne. Les enfants de la classe ouvrière ont perdu une bataille, mais le prolétariat n'a pas perdu la guerre de classe.
La meilleure solidarité que la classe ouvrière puisse apporter aux jeunes générations face aux attaques du capitalisme, c'est d'engager maintenant la lutte dans tous les secteurs contre le CPE, contre toutes les attaques de la bourgeoisie et contre la répression. La classe ouvrière doit exiger la libération de ses enfants embarqués dans les paniers à salade.
Pour cela, il faut développer partout des assemblées générales massives, des lieux de débat. Il faut manifester massivement dans la rue.
Mais avant de se mobiliser, il faut réfléchir, discuter tous ensemble, tous unis, des perspectives et des moyens de la lutte. Car la fin ne justifie pas tous les moyens. Les éléments les plus conscients, les plus éclairés de la classe ouvrière, les éléments les plus conscients de la jeunesse estudiantine doivent jouer le rôle d'avant-garde pour que la riposte contre le CPE ne soit pas une aventure sans lendemain. Ce qui s'est passé à la Sorbonne cette nuit n'est qu'un épisode d'un mouvement beaucoup vaste, un mouvement qui va, à un moment ou un autre, faire tâche d'huile au-delà des frontières nationales.
Nous allons maintenant revenir rapidement sur les événements de ces dernières semaines.
Malgré le black-out des médias bourgeois et notamment de la télévision, malgré la dispersion de la période des vacances scolaires, depuis le début du mois de février, les étudiants et dans une moindre mesure les lycéens, se sont mobilisés dans la plupart des universités des grandes villes du pays pour protester contre le fameux Contrat Première Embauche qui vient d'être adopté à l'assemblée nationale.
Dès que nous avons eu écho de ce qui se passait dans les facs et notamment à Paris 3-Censier, nous avons mobilisé immédiatement nos forces pour essayer de comprendre ce qui se passait et la signification de ce mouvement.
Aujourd'hui, nous pouvons affirmer clairement que ce mouvement de la jeunesse estudiantine n'a rien à voir avec une agitation interclassiste. Et cela même si il y a dans les facs, évidement, des enfants de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie dont la plupart sont hostiles à la grève et se font beaucoup d'illusions sur l'avenir que leur promet le capitalisme. La lutte des étudiants contre le CPE, quelle que soit son issue, n'est pas un feu de paille, une révolte sans lendemain. Le CCI salue haut et fort ce mouvement qui s'inscrit pleinement dans le combat de la classe ouvrière.
Pourquoi ?
D'abord, parce que la révolte des étudiants est une riposte légitime à une attaque économique directe, massive et frontale contre l'ensemble de la classe ouvrière. Avec le Contrat Première Embauche, c'est encore plus de précarité et de misère qui attend les nouvelles générations à la fin de leur scolarité.
Ensuite, parce que les étudiants se sont mobilisés immédiatement sur un terrain de classe, comme ils l'ont montré de façon magistrale à la manifestation du 7 mars. Ils ont été capables de laisser de côté leurs revendications spécifiques (comme la réforme du LMD par exemple) pour mettre en avant des revendications derrière lesquelles toute la classe ouvrière peut se reconnaître.
Enfin, pour la première fois depuis Mai 68, on a vu les étudiants lancer des mots d'ordre appelant à l'unité et à la solidarité de toute la classe ouvrière : "Travailleurs, chômeurs, lycéens, étudiants, même combat !"
On les a vu aller plus loin encore que les étudiants de mai 68 : contrairement à la génération de mai 68 qui avait été fortement marquée par l'esprit contestataire et ce qu'on appelait à l'époque "le conflit des génération", les étudiants d'aujourd'hui ont mis en avant la nécessité de l'unité non seulement entre tous les secteurs de la classe ouvrière, mais aussi entre toutes les générations, entre ceux qui sont attaqués par le CPE et les retraités et futurs retraité qui seront attaqués par un contrat "dernière embauche".
Si la nouvelle génération, par certains cotés, est beaucoup plus mûre que celle de la fin des années 60, c'est justement parce que les conditions objectives ont mûri : la crise économique s'est approfondie. Elle dévoile aujourd'hui ouvertement la faillite irrémédiable du système capitaliste.
Mais là où les étudiants d'aujourd'hui sont allés encore plus loin que leurs aînés de mai 68, c'est dans la façon dont ils ont pris eux-mêmes leur lutte en mains, en s'appropriation de façon assez étonnante et remarquable les méthodes de lutte du mouvement ouvrier et en faisant vivre la solidarité dans la lutte. Et cette méthode s'est très clairement révélée dans les Assemblées générales à Censier, et non pas dans l'occupation de la Sorbonne.
Nous voulons d'abord évoquer maintenant ce qui s'est passé ces derniers jours à la fac de Paris 3-Censier.
Tous les jours, les étudiants et les salariés en grève occupent les amphis et tiennent des assemblées générales massives.
Pour avoir été témoins de ce qui se passait dans ces AG de Censier, nous pouvons affirmer clairement qu'elles fonctionnent sur le modèle des conseils ouvriers. La richesse des discussion où chacun peut prendre la parole et exprimer son point de vue, la façon dont la tribune organise les débats, les votes, la création de différentes commissions, la nomination de délégués élus et révocables devant les AG souveraines, toute cette dynamique, cette méthode de lutte son celles qui ont surgi dans les momens les plus élévés de la lutte de classe : en 1905 et 1917 en Russie, en 1918 en Allemagne, en Pologne lors de la grève de masse en Août 1980.
Pour nous, il est clair que le poumon du mouvement, l'épicentre du séisme ne se trouve pas à la Sorbonne où les étudiants ont été enfermés dans la fac occupée et encerclée par les CRS. L'épicentre du séisme se trouve à la fac de Censier. Et cela la bourgeoisie le sait. C'est pour cela que les médias ont fait un black-out total sur les AG de Censier.
Les étudiants de Censier ont réussi à entraîner leurs professeurs et le personnel administratif dans la grève. Ils ont réussi à construire un mouvement solidaire et uni. A tel point qu'il a été décidé de tenir des AG communes entre étudiants et salariés de la fac.
Comment ces jeunes dont certains, parmi les leaders du mouvement, sont en première année de fac, comment ont-ils pu aller aussi vite, prendre une telle décision depuis la manif du 7 mars ?
Tout simplement, parce que la fin de non revoir de monsieur Villepin après la manif du 7 mars a poussé les étudiants à ouvrir leurs assemblées générales aux salariés et à leur donner la parole. En 1968, c'est justement l'enfermement des ouvriers dans les usines, préconisé par les syndicats, qui avait permis à la bourgeoisie d'envoyer la classe ouvrière à la défaite.
La plupart des ouvriers ne pouvaient plus aller discuter avec leurs camarades des autres entreprises ou avec les étudiants. Ils se sont laissé emprisonner derrière les grilles de leurs usines. C'est une expérience que les jeunes générations doivent connaître pour pouvoir déjouer les manoeuvres et les pièges de tous les saboteurs qui veulent les envoyer au casse-pipe paquet par paquet.
Pour revenir à ce qui s'est passé à Censier depuis le 7 mars :
Au lendemain de la manif, une petite minorité de travailleurs d'autres secteurs, qui sont aussi des militants révolutionnaires et des parents d'étudiants en lutte, est allé voir ce qui se passait dans les facs. Et ce que nous avons vu et entendu dans les AG de Censier nous a amenés à reconnaître dans cette agitation estudiantine contre le CPE un combat qui s'intègre pleinement dans celui de la classe ouvrière. Encore une fois, nous réaffirmons aujourd'hui, que l'avenir de la société humaine est bien entre les mains des jeunes générations. Encore une fois, la vieille taupe de l'histoire, comme le disait Marx, a bien travaillé. Encore une fois le marxisme, la théorie révolutionnaire du prolétariat, a été vérifié.
Les militants du CCI sont intervenus dans les AG en tant que travailleurs et parents d'étudiants en lutte. Mais ce qui a guidé le sens général de leurs interventions, c'est le cadre d'analyse du CCI qui seul peut donner une perspective, pour que la lutte des étudiants ne reste pas isolée.
Dès que nous avons compris ce qui se passait Censier, le CCI a décidé de combattre le sale travail des médias bourgeois : c'est pour cela que notre tract est en train d'être traduit dans toutes les langues (et est déjà sur notre site Internet en anglais et en espagnol, ce qui veut dire que la classe ouvrière et les université d'Europe et du continent américain peuvent être informés de ce qui se passe en France).
Dans les AG de ces deux derniers jours, les professeurs de l'université de Censier et les personnels administratifs ont apporté un souffle nouveau au mouvement. Ils ont fait plusieurs interventions pour affirmer qu'ils allaient participer activement à l'extension de la grève dans les facs. Ils ont essayé d'entraîner les étudiants les plus hésitants et hostiles à la lutte en les rassurant : ils se sont engagés à ne pas pénaliser les élèves grévistes pour les examens et pour le versement de leur allocation d'études.
Enfin, pour résumer nous reprenons ici à notre propre compte cette phrase d'un enseignant de Paris 3 : "Les étudiants de Censier ont inventé quelque chose de nouveau, quelque chose de très puissant qui va entraîner les autres universités derrière eux. Et cela, nous l'avons vu très clairement à la manifestation du 7 mars."
Effectivement, que s'est-il passé le 7 mars ?
Plus de mille étudiants se sont retrouvés sur le parvis de la fac de Censier pour partir ensemble à la manifestation organisée à l'appel de tous les syndicats et partis de gauche. Dès qu'ils se rendent compte que les cortèges syndicaux, et notamment celui de la CGT, se sont placés à la tête de la manif, les étudiants font demi-tour. Ils prennent le métro pour se placer devant les cortèges syndicaux en entraînant derrière eux leurs camarades d'autres facs. C'est comme cela que la jeunesse estudiantine en lutte, s'est spontanément retrouvée à la tête de la manif derrière une seule banderole, avec des mots d'ordre unitaires, exigeant le retrait pur et simple du CPE, alors que le tract diffusé par le PCF ne dit pas un seul mot sur le retrait du CPE (ce tract nous l'avons ici et les camarades pourront venir le chercher) !
Grâce à cette ruse de sioux des étudiants de Censier, le cortège du vieux dynosaure stalinien se retrouve ainsi à la queue des enfants du mammouth de l'éducation nationale. La CGT est obligée de raccrocher ses wagons rouillés à la locomotive de cette jeune génération, une génération que Rosa Luxemburg appelait à juste raison la "fine fleur du prolétariat !"
Comme en mai 68, la classe dominante et ses forces d'encadrement dans les rangs ouvriers ont été surprises, dépassées par la situation. Et nous devons le reconnaître, dans une certaine mesure, le CCI lui-même a été surpris par la vitalité et a créativité des étudiants les plus en pointe.
C'est justement parce qu'il n'avait pas prévu le coup que, après la manifestation du 7 mars, dans une interview tétévisé sur la chaîne LCI, le leader de la CGT, Bernard Thibault, a dit aux journalistes : "il est vrai que dans cette manifestation, il y avait une part d'imprévu".
C'est aussi à cause de cette "part d'imprévu", parce qu'ils ont été débordés par la situation, que des gros bras du PCF nous ont agressés à la manif et notamment à notre table de presse. L'un d'entre eux a proféré ces insultes : "J'ai envie de vous cracher à la figure. Vous n'avez pas honte de diffuser votre brochure [ Comment le PCF est passé dans le camp du capital ] alors qu'ils n'y a plus de staliniens au PCF" (sic !)
On va s'arrêter là pour ce qui concerne les événements anecdotiques. Les camarades, et notamment les étudiants qui sont dans cette salle, pourront compléter, rectifier ou préciser cette présentation, dans le débat.
Nous allons maintenant faire brièvement un point sur le black out des médias.
On se souvient qu'à l'automne dernier, lors des émeutes qui ont embrasé les banlieues, la bourgeoisie ne s'était pas privé de faire un battage médiatique très bruyant, non seulement en France, mais aux quatre coins de la planète. Partout, dans tous les pays, sur tous les continents, les émeutes en France avaient fait la Une des journaux et de toutes les chaînes de télé.
Que se passe-t-il aujourd'hui dans les médias ? Jusqu'à la manif du 7 mars, c'était silence radio. Jour après jour, on nous a bassinés avec la grippe aviaire, l'affaire sordide du "gang des barbares" et autres rideaux de fumée pour amuser la galerie et surtout pour ne pas parler de l'essentiel, c'est-à-dire de la mobilisation des étudiants contre le CPE.
Pourquoi les médias aux ordres de l'ordre capitaliste ont-ils gardé le silence sur la grève des étudiants alors qu'ils avaient fait beaucoup de bruits sur les émeutes dans les banlieues ? Tout simplement parce que, contrairement aux émeutes désespérées des jeunes des cités, la lutte des étudiants n'est pas un feu de paille. Elle est porteuse d'une perspective d'avenir pour la société
Et si aujourd'hui, les médias lèvent le black-out, c'est encore pour servir les intérêts de la bourgeoisie. On nous présente les étudiants comme de simples émeutiers. C'est bien le message que veut faire passer Monsieur Tony Blair lorsque le journal anglais le "Times" titrait au lendemain de la manif du 7 mars : "RIOTS,,,", c'est-à-dire "Emeutes dans les universités françaises".
Quant aux médias françaises, elles apportent maintenant leur petite pierre au sabotage de la lutte de classe. Et pas seulement les journaux de droite comme Le Figaro ou Le Parisien. Mais aussi ceux de gauche comme le journal Libération dirigé par l'ex-soixante huitard Serge July qui lui ne sera jamais touché par le chômage. Ainsi, l'édition du 10 mars de Libération était distribué gratuitement dans le hall de Censier parce qu'il y avait un petit article ridicule sur la grève dans cette facr intitulé "un air de mai 68".
Le message est, excusez-nous l'expression, putassier. Un air de mai 68, ça veut dire que les étudiants n'ont fait que chanter des chansons révolutionnaires en invitant la troupe de théâtre "Jolie môme" le 3 mars dans l'enceinte de la fac ! Par contre, il n'y a pas un mot sur la dynamique des AG, sur l'unité et la solidarité du mouvement qui a entraîné les professeurs et le personnel administratif dans la grève.
Et ce silence n'est certainement pas dû au fait que les journalistes de Libé et de la télévision n'étaient pas au courant. Ils ont occupé la fac avec leur caméra et leurs interviews. L'Etat français peut décerner une belle médaille à ses journaleux et à leurs images très artistiques !
Pour le CCI, il est clair que ce mouvement de la jeunesse scolarisée fait peur à la classe dominante. Monsieur Villepin et ses petits camarades, à droite comme à gauche, ont peur tout simplement que la créativité des étudiants de Censier ne donne de mauvaises idées à l'ensemble de la classe ouvrière.
Le silence des médias, la falsification de leurs informations, le tripatouillage de leurs caméras, de leurs reportages, et de leurs interviews n'ont qu'une seule signification : ils sont une illustration de la trouille de la bourgeoisie. Et cette trouille est d'autant plus grande que ces étudiants les plus conscients, ce sont ceux qui sont aujourd'hui aux avant-postes du mouvement. C'est cette avant-garde que la bourgeoisie française, avec ses flics et ses RG, veut démoraliser et soumettre au silence.
Les enfants de la classe ouvrière qui se sont mobilisés massivement contre le CPE, ce sont les enfants de ceux à qui monsieur Raffarin, pour imposer la réforme du système des retraites, avait eu le culot de dire : "Ce n'est pas la rue qui gouverne" .
Et la seule réponse de la bourgeoisie à cette protestation contre la précarité et le chômage, c'est la répression. Le CPE est une illustration de la faillite du système capitaliste. La répression montre aujourd'hui clairement le vrai visage de la démocratie bourgeoise ! Aujourd'hui, la situation sociale est en train que révéler que ceux d'en haut, de plus en plus, ne peuvent plus gouverner comme avant, parce que ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant.
Et c'est bien pour cela que la bourgeoisie française est en train de mettre toutes ses forces dans la bataille pour diviser le mouvement, l'éparpiller, enfermer les étudiants dans les facs pour pouvoir les "nettoyer au karcher", comme elle l'a fait cette nuit à la Sorbonne.
Sur toutes les chaînes de télé, on a pu voir aujourd'hui les images que la bourgeoisie attendait avec ces commentaires, comme le disait Claire Chazal : "Le mouvement a pris un tournant, celui de la violence". Évidemment, il s'agit non pas de la violence de la police, mais de celle des enfants de la classe ouvrière présentés comme des casseurs, comme de la racaille !
Pourquoi l'homme de main de l'État policier, de notre belle démocratie française, Monsieur Sarkozy, a-t-il une fois encore déchaîné la répression ?
Parce que les étudiants ne veulent pas de la misère capitaliste, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver au chômage à la fin de leurs études! Parce qu'ils sont entrés dans la Sorbonne pour apporter leur solidarité et de la nourriture à leurs camarades qui étaient en train de crever de faim. Ces étudiants ont ont été tabassés, arrêtés, tout simplement parce qu'ils ont donné le mauvais exemple de la solidarité dans la lutte.
Mais pour pouvoir tenir la route sur le long terme, dans la lutte de classe, les bataillons les plus conscients du prolétariat doivent garder en mémoire ce que Marx et Engels disaient dans le Manifeste Communiste de 1848 : "les communistes ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien". Ils ne doivent jamais oublier que l'arme la plus tranchante de la classe ouvrière, c'est d'abord sa conscience, contrairement à la violence aveugle des jeunes émeutiers des banlieues.
Face à la violence des milices du capital aux ordres de Monsieur Sarkozy, il faut opposer la conscience de classe dans la lutte !
Les éléments les plus conscients de la classe ouvrière doivent aussi se rappeler ce que Marx et Rosa Luxemburg disaient : "Contrairement aux révolutions du passé, la révolution prolétarienne est la seule révolution de l'histoire qui ne peut arriver à la victoire qu'à la suite de toute une série de défaites." C'est justement parce que la révolution prolétarienne "tire sa poésie de l'avenir" que les révolutionnaires ne doivent jamais céder à la démoralisation et à l'impatience.
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [60]
Sean O’Casey et le soulèvement nationaliste irlandais de Pâques en 1916
- 3709 lectures
Cette année, la République d'Irlande a commémoré les 90 ans du soulèvement nationaliste de Pâques en 1916. Avec le temps, la façon dont cet événement est célébré a changé. De nos jours, il est présenté comme le socle fondateur de la fierté nationale et c'est un jour de liesse pour la bourgeoisie irlandaise : il représenterait le prétendu Tigre indomptable celtique. Le "sacrifice du sang" de nombreux patriotes irlandais, et non pas l’exploitation sans merci de la force de travail des prolétaires sur toute la planète, est mis en avant comme étant la cause du "miracle" des hauts niveaux de croissance de l’économie irlandaise moderne.
Mais tandis que les termes de cette commémoration rituelle changent avec les années, l’idée de base propagée par la classe dominante en Irlande reste la même. Cette idée, c'est que l’indépendance nationale aurait résulté de l’unanimité de toutes les classes, de toutes les courageuses forces "rebelles" de la société irlandaise. Surtout, la mythologie bourgeoise du soulèvement de Pâques le considère comme le produit de l’unité entre le mouvement nationaliste et le mouvement ouvrier, representés par les deux leaders de l’insurrection contre la domination britannique : Patrick Pearse à la tête des "Volontaires irlandais" et le socialiste radical James Connolly qui commandait la milice appelée "Armée des citoyens irlandais".
Afin de maintenir ce mythe, il est régulièrement occulté qu’une figure ouvrière de l’époque s’était opposée au soulèvement de 1916. Cet oubli de la bourgeoisie irlandaise (y compris de ses ailes radicales et soi-disant "marxistes" du Sinn Fein) est très frappant car ce leader, Sean O’Casey, devait devenir un des plus grands dramaturges du 20e siècle. Sa fameuse pièce, La Charrue et les Etoiles (The Plough and the Stars), qui est aujourd’hui reconnue comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature mondiale moderne, est une dénonciation virulente du soulèvement de Pâques. Cette pièce est une épine dans la chair de la bourgeoisie irlandaise, car elle rappelle la vérité historique qui vit non seulement O’Casey, mais une partie de la classe ouvrière en Irlande, refuser de participer ou de soutenir le soulèvement.
La Charrue et les Etoiles
L’Armée des Citoyens Irlandais (Irish Citizen’s Army, ICA) était une milice mise sur pied durant les six mois où Dublin avait été bloquée pour protéger les ouvriers de la sauvagerie de la répression étatique dirigée contre la combativité des ouvriers des transports. "La Charrue et les Etoiles"” était la bannière de l’ICA. C’était un des étendards les plus poétiques du mouvement ouvrier. La charrue symbolisait le retournement du sol de la société capitaliste par la lutte de classe, le travail patient de semaille des graines du futur, mais aussi le besoin impérieux de la récolte quand elles sont à maturité. Quant aux étoiles, elles expriment la beauté et la noblesse des buts et des idéaux du mouvement ouvrier.
La pièce de O’Casey du même nom est une virulente mise en accusation de la trahison de ces idéaux par la participation de l’ICA à l’insurrection nationaliste de 1916. Tandis que la lutte avait lieu dans le centre ville, les habitants des bas quartiers de Dublin mouraient de pauvreté et de tuberculose. O’Casey montre qu’il n’y a rien dans les prétendus grands idéaux des nationalistes qui puisse apporter un meilleur sort ou un réconfort moral aux ouvriers et aux pauvres. Il montre l'existence de l’autre côté de la rue, visible depuis les habitations occupées par les insurgés, de gens affamés qui occupent aussi des bâtiments, non pas dans le but de soutenir l'insurrection, mais pour piller de la nourriture dans les magasins.
Pour exprimer son indignation, O’Casey emploie une série d’images puissantes. Le deuxième acte se passe dans un café. Dehors a lieu la réunion durant laquelle, le 25 octobre 1915, l’ICA s’est alliée aux Volontaires Irlandais. C’est le moment-clé de la trahison des positions de classe de la charrue et des étoiles. Mais cette scène a lieu à l’insu des ouvriers qui se trouvent à l’intérieur du pub. Tout ce qu’on peut voir et entendre est l’ombre en profil de la “voix de la fenêtre”, menaçante comme un cauchemar, comme un fantôme de mort s’imposant sur la vie. C’est la voix du leader nationaliste Pearse, exaltant les vertus du sacrifice de sang pour la cause de la nation. "A l’intérieur", les ouvriers sont enflammés par ce discours. La scène du café montre la façon dont la classe dominante entraîne les ouvriers hors de leur terrain de classe en obscurcissant leur réalité matérielle et en détruisant leur conscience. Alors que Pearse prêche l’héroïsme patriotique consistant à verser le sang, l’intoxication que cela entraîne parmi les occupants du café conduit à une suite de querelles, à une caricature de compétition capitaliste. O’Casey montre comment l’insurrection de Pâques, loin de s’opposer à la barbarie de la Première Guerre mondiale qui se déroule en même temps, a donné à cette barbarie une autre forme. Elle est devenue le premier maillon de la chaîne de la guerre et de la terreur qui a conduit, au début des années 1920, de la guerre irlandaise d’indépendance contre la Grande-Bretagne à la guerre civile au sein de la bourgeoisie du nouvel Etat irlandais. Ces évènements, au cours desquels des degrés de sauvagerie jusqu'alors inconnus apparurent, annonçaient ce qui devait advenir au 20e siècle, particulièrement au cours des “luttes de libération nationale”.
Un personnage important de la pièce de théâtre se trouve être la prostituée Rosie Redmond. Le symbolisme en est clairement identifiable, le renouveau littéraire anglo-irlandais de l’époque aimant peindre l’Irlande ou le nationalisme gaélique sous les traits d'une femme (comme par exemple dans la pièce de W.B. Yeats, Cathleen Ni Houlihan).
Au quatrième acte, les hommes jouant aux cartes sur le couvercle du cercueil d’un habitant des bas quartiers constituent une métaphore sur comment les travailleurs, en renonçant à se battre pour leurs intérêts, en sont réduits à n’être que des pions impuissants dans les luttes pour le pouvoir de forces qui leurs sont étrangères. Ce sont des victimes, pas les protagonistes de l’histoire.
En février 1926, lors de la quatrième représentation de cette pièce à l’Abbey Theater de Dublin, il y eut une émeute. La classe dominante fraîchement installée au pouvoir comprit immédiatement que les fondations mêmes du nouvel Etat étaient menacées par la démolition du mythe de 1916, "crucifixion et résurrection" de la nation irlandaise. Dans le quatrième livre de son autobiographie, Inishfallen, Fare Three Well, O’Casey raconte comment il était apostrophé par les veuves des rebelles de 1916 la nuit en quittant le théâtre. L’une d’elles lui avait crié : "Je veux te faire savoir qu’il n’y a pas une seule prostituée d’un bout à l’autre de l’Irlande". L’auteur émigra à Londres un mois après l’émeute (s'il était resté il aurait pu assister à la destruction par le feu de la version cinématographique d’Hitchcock tirée de sa pièce Junon et le paon à Limerick en 1930, trois ans avant que les hordes nazies ne commencent à brûler les livres en Allemagne).
Depuis longtemps, il était devenu persona non grata à Dublin, du fait de ses positions sur le soulèvement de Pâques. Dans la pièce elle-même, O’Casey traite ironiquement de son image publique. Le personnage dont se sert l’auteur pour exprimer son opinion est celui d’un révolutionnaire de salon lâche et dogmatique nommé le Covey (un terme de l'argot de Dublin signifiant pédant, "Monsieur-Je-sais-tout"). C’est lui qui déclare que l’ICA a trahi La Charrue et les Etoiles tout en assistant à la révolution nationaliste des classes moyennes, et qui qualifie le discours de Pearse de "drogue" en critiquant le soldat socialiste britannique Stoddard pour avoir abandonné l’internationalisme face à la guerre mondiale.
O’Casey et le mouvement ouvrier
La pièce La Charrue et les Etoiles est le couronnement d’une transformation remarquable dans le développement artistique et dans la vision du monde de Sean O’Casey. Tout d’abord, il fut l’auteur de pièces de propagande pleines d’argumentations complexes (dans le style de son contemporain George Bernard Shaw, célébré à Dublin), mais généralement considérées de faible valeur artistique. Dans la première moitié des années 1920, il produit, presque coup sur coup, trois grandes pièces dramatiques, la "trilogie de Dublin". Il s’agit de pièces historiques à caractère contemporain, traitant chacune de façon polémique d’un événement majeur : L’Ombre d’un Franc-tireur (la guerre de l’IRA contre la domination britannique), Junon et le Paon (la guerre civile irlandaise), et La Charrue et les Etoiles. Plus tard, ses pièces atteignirent rarement à nouveau la même qualité artistique. Cette production inégale a conduit certains à parler de "l’énigme O’Casey". Les nationalistes irlandais ont essayé d’expliquer le déclin relatif de cette créativité à partir de 1930 par son émigration, comme s’il ne pouvait produire de grand art sans avoir le "sol natal" sous les pieds. Mais rapidement après avoir gagné Londres, O’Casey écrivit une autre pièce historique puissante, The silver Tassie. Elle est basée sur son expérience de patient dans un hôpital de Dublin (étant soigné pour des maladies qui résultaient directement de sa pauvreté), où il partageait des salles avec de nombreuses victimes de la Première Guerre mondiale qui faisait rage alors. C’est une furieuse condamnation de la guerre impérialiste (que l’Abbey Theater sous contrôle de l’Etat refusa de donner).
En réalité, l’épanouissement d’O’Casey était possible grâce aux idées qui l’inspirèrent à l’époque – celles qui sont mises en avant par le surgissement de luttes ouvrières dès le début de la Première Guerre mondiale, et leur confirmation à travers la révolte ouvrière contre la guerre, surtout la révolution de 1917 en Russie. Il fut un des premiers à mettre la vie des prolétaires au centre de la littérature mondiale, montrant la richesse et la diversité de leurs personnalités. Il fut peut-être le premier à mettre en scène le langage le plus populaire. Il se plaisait dans le langage imagé, le rythme irrésistible et les exagérations baroques des habitants des taudis de Dublin, sachant mettre en valeur la façon dont ils se servaient de la rhétorique pour enrichir leurs vies austères et y gagner le sens de la dignité.
En ce sens, son évolution artistique est inséparable des changements dans sa vision générale du monde. A l’origine, O’Casey était un nationaliste républicain irlandais fanatique. Né dans une famille éduquée mais frappée par la pauvreté, il ne suivit que trois années de scolarité et devint très jeune un ouvrier non-spécialisé et sous-alimenté. A l’époque, le taux de mortalité infantile à Dublin était plus élevé que celui de Moscou ou de Calcutta. Malgré le handicap d'une grave maladie des yeux, il s’éduqua tout seul, devenant un lecteur avide de littérature. A un âge précoce, il devint militant de la Ligue Gaélique, de la Fraternité Républicaine Irlandaise et d'autres groupes nationalistes. Mais du fait même de sa condition d’ouvrier, il était presque inévitable que son développement artistique dépende largement de l’évolution du mouvement socialiste. Ce fut le développement de la lutte prolétarienne qui lui fournit cette sensibilité créatrice, tout comme son déclin artistique ultérieur fut lié à la perversion de ses principes avec la défaite et le reflux de la révolution mondiale dans les années 1920 (O’Casey devint alors un stalinien indécrottable).
1913 : répétition générale pour la révolution
A 18 ans, O’Casey fut licencié pour avoir refusé d’enlever sa casquette en venant toucher sa paie. En 1911, il fut impressionné par la grande grève du prolétariat britannique dans les chemins de fer. Mais ce qui le gagna au mouvement ouvrier fut le grand conflit ouvrier de Dublin en 1913. D’une part, il coïncidait avec l’arrivée (de Liverpool) de Jim Larkin, le leader du mouvement de 1913. Larkin fut pour O’Casey un révélateur du fait que le socialisme révolutionnaire était quelque chose de très différent de la mentalité syndicale. Dans la vision de Larkin, le prolétariat ne se battait pas seulement pour manger, boire et se loger, mais un combat pour conquérir une véritable humanité. L'accès à la sensibilité envers la musique et la nature, le développement de l’éducation et de la connaissance, étaient perçus par lui comme des moments indispensables vers l'émergence de la culture d'un monde nouveau.
Comme O’Casey devait l’écrire plus tard , Larkin "apportait de la poésie dans la lutte des ouvriers pour une vie meilleure" .
Pour lui, ce fut une révélation. Dans l’Irlande de l’époque, être catholique était synonyme d’être pauvre et Irlandais, être protestant d’être riche et Anglais. Mais O’Casey venait d’un milieu protestant. L’intensité de son nationalisme initial, le changement de son nom (il était né John Casey) furent probablement motivés par des sentiments de culpabilité ou d’infériorité.
Tout cela lui parut aussitôt dérisoire et il vécut cette nouvelle vision du monde comme une libération.
Mais ce fut bien sûr l’âpreté du conflit de 1913 qui transforma le regard d’O’Casey. Pour la première fois se produisit une rupture ouverte entre le prolétariat et le nationalisme irlandais. Dans le livre trois de son autobiographie, Le tambour sous les fenêtres, O’Casey se souvient que les rangs des Volontaires Irlandais étaient “quadrillés de patrons qui avaient ouvertement cherché à affamer les femmes et les enfants des ouvriers, suivis humblement par des jaunes et des briseurs de grève venant des éléments les plus arriérés parmi les ouvriers eux-mêmes, la plupart d’entre eux voyant dans cette agitation un moyen en or d’avoir de bons emplois, alors tenus en Irlande par les jeunes fils à papa bons-à-rien de notables anglais."
De son côté, cette autre force nationaliste majeure en Irlande qu’était l’Eglise catholique organisait, par l’intermédiaire de ses prêtres, des bagarres pour empêcher les enfants des familles lock-outées d’être envoyés en Angleterre et pris en charge par les "païens", c’est-à-dire les familles socialistes. Le tambour sous les fenêtres raconte comment un couple appartenant à une organisation catholique militante se rendit au quartier général de la grève à Liberty Hall pour rappeler les ouvriers à la "foi religieuse".
"Questionné par Connolly pour savoir si le chevalier et sa dame prendraient cinq enfants dans leur foyer, le couple resta silencieux ; questionnés pour savoir s’ils en prendraient deux, ils restaient toujours silencieux ; et tournèrent les talons pour sortir avant qu’on ne leur demande s’ils en prendraient un seul ."
Il devint clair que le seul soutien à la vague de lutte des ouvriers irlandais était le prolétariat international. La réalité vivante avait ainsi démontré que la vieille position interprétée comme étant celle du marxisme orthodoxe, selon laquelle les ouvriers anglais et irlandais ne pouvaient agir ensemble que dans la perspective de la séparation nationale, n’était plus à l'ordre du jour.
Dans un sens, l’Irlande, comme l’Empire russe, faisait de l’expérience de 1913 une sorte de "1905" à elle : une répétition générale pour la révolution prolétarienne. De telles luttes pré-révolutionnaires sont une part essentielle de la préparation de la lutte pour le pouvoir. Cela était bien compris par la Gauche marxiste dans la période qui suivit les grèves de masse et les soviets en Russie en 1905. C’est pourquoi Rosa Luxembourg et Anton Pannekoek dénoncèrent l’empêchement de telles "répétitions générales" par le parti social-démocrate en Allemagne non seulement comme une preuve de lâcheté mais comme le début de la trahison.
Mais en Irlande, 1913 ne fut pas le prélude à la révolution socialiste. En ce sens, son évolution ne ressemble pas à celle de l’Empire russe mais à une partie spécifique de celui-ci : la Pologne. Le prolétariat polonais avait magnifiquement participé aux grèves de masse de 1905. Mais en Pologne, comme en Irlande, quand le moment fut mûr pour la révolution mondiale, les ouvriers furent désarmés par l’établissement d’un Etat nation.
La controverse entre O’Casey et Connolly à propos de l’insurrection
En tant que secrétaire du Comité de Secours des Grévistes en 1913, O’Casey avait été en charge des fonds recueillis par les familles des ouvriers mis au chômage. Après la défaite de la grève en janvier 1914, il fut un des premiers à proposer une réorganisation de la milice d’auto-défense des ouvriers, l’ICA, sur une base permanente – et fut élu secrétaire honoraire du nouveau Conseil de l’Armée. Alors que le conflit de classe ouvert était terminé à ce moment-là, cette politique n’avait de sens que dans la perspective de la préparation pour l’insurrection armée. L’éclatement de la guerre impérialiste mondiale la même année ne fit que confirmer cette perspective.
Mais quelle devait être la nature de cette insurrection : socialiste ou nationaliste ? L’ICA était une milice prolétarienne. Mais son vrai nom – Armée des Citoyens irlandais – reflétait le poids mort du nationalisme irlandais, que la lutte de 1913 n’avait qu’en partie dépassé. Et la "Grande Guerre" vit l’apparition d’un renouveau de l’influence du nationalisme radical dans les organisations ouvrières.
La Première Guerre mondiale, qui ouvrit la période de décadence capitaliste, constitua une frontière de classe historique à presque tous les niveaux, y compris psychologique. On peut prendre l’exemple de Patrick Pearse, "commandant en chef" du soulèvement de 1916. Bien que patriote extrémiste, il était connu pour sa noblesse de caractère et ses idées progressistes en matière d’éducation. Mais après que la guerre eut éclaté, il donna une série de discours publics qui ne peuvent être décrits que comme ceux d’un dément. Il devint nationaliste dans le plein sens du terme, se réjouissant des sacrifices des jeunes vies de toutes les nations impliquées dans la guerre, clamant que ce sang qui giclait était comme du vin nettoyant le sol de l’Europe.
Il est significatif que James Connolly se laissa prendre très tôt au charme de cette vision atavique du sacrifice de sang. Connolly avait toujours appartenu à l’aile gauche de l’Internationale socialiste. Né à Edimbourg dans une terrible misère, sans scolarité, autodidacte comme O’Casey, c’était un homme de profondes convictions et d’un grand courage personnel. Néanmoins, l’effondrement de l’Internationale et la folie de la guerre mondiale l’avaient déstabilisé.
A partir de 1915, il commença à annoncer publiquement une insurrection à venir dans la presse ouvrière, emmenant les militants de l’ICA faire des exercices militaires comme l’assaut de bâtiments publics sous les yeux des autorités britanniques. Vers la fin, c’est Connolly qui pressait les Volontaires Irlandais de ne plus repousser l’insurrection, disant qu’il se mettrait sinon de lui-même à la tête de ses 200 "soldats" de l’ICA.
Les historiens irlandais contemporains, comme son dernier biographe Donald Nevan, se sont attachés à montrer que Connolly ne partageait pas la vision de Pearse du sacrifice de sang. Ils citent la série d’articles sur "L’insurrection et la guerre" que Connolly écrivit en 1915 comme preuve qu’il croyait que l’insurrection de 1916 avait une chance réelle de succès. Et en effet, cette série représente une contribution importante à l’étude marxiste de la stratégie militaire. Par exemple, dans l’article sur l’insurrection de Moscou de 1905, un des points mis en lumière est qu’elle n’avait pas été défaite militairement, mais "dissoute de la même façon qu’elle était apparue", dès qu’il fut évident que ni les ouvriers de Saint-Pétersbourg ni les paysans ne suivaient plus sa direction. Ils se fondirent dans les masses prolétariennes protectrices autour d’eux.
Mais dans l’une des controverses au sein de l’ICA entre O’Casey et Connolly avant 1916, ce dernier défendait le point de vue opposé. Cette discussion concernait la question de revêtir ou non des uniformes. De façon évidente, c’est O’Casey qui défendait le même point de vue prolétarien que les insurgés de Moscou, selon lesquels les combattants doivent éviter une bataille perdue d‘avance afin de préserver leurs forces. “Si nous faisons étalage de ce que nous sommes, et de ce que nous faisons, nous prendrons la répression en pleine face et nous nous mettrons la corde autour du cou. Revêtir d' un uniforme – ce serait le pire de tout… Coincés Dans un endroit dangereux, nous aurions une chance de nous en échapper dans nos vêtements de travail de tous les jours. On pourrait alors se glisser dans la multitude, sans se faire remarquer .” (Cité dans Les tambours sous les fenêtres). En définitive, O’Casey proposa à Connolly un débat public, et écrivit un article sur le problème – qui ne fut jamais publié.
Le "sacrifice de sang" de 1916
O’Casey démissionna de l’Armée des Citoyens Irlandais après que la motion interdisant la double appartenance à l’ICA et aux Volontaires Irlandais soit révoquée. Peu après, Larkin partit pour les Etats-Unis (où il participa à la fondation du Parti Communiste d’Amérique en 1919). A partir de ce moment, O’Casey et Delia Larkin se retrouvèrent de plus en plus isolés dans leur opposition à la trajectoire prise par Connolly. Comme O’Casey le dit dans son Histoire de l’Armée des Citoyens Irlandais (1919) “Liberty Hall n’était plus le quartier général du mouvement ouvrier irlandais, mais le centre du mécontentement national irlandais.”
La voie vers l’insurrection de 1916 était à présent ouverte. Mais cette route n’était pas empruntée par le prolétariat irlandais, qui s’était lancé dans la défense de ses intérêts de classe face à la guerre. Certains des derniers articles de Connolly écrits avant sa mort tragique étaient consacrés à cette question. Il se réfère aux grèves des dockers, des ouvriers du gaz et de la construction de Dublin, et aux luttes ouvrières à Cork, Tralee, Sligo, Kingstown (Dun Laoghaire) et d’autres centres industriels. Il écrit aussi sur la grande grève des ouvriers des cartoucheries de la région de Glasgow. Mais Connolly n’a pas une seule fois appelé les ouvriers irlandais à rejoindre le soulèvement de Pâques, ou même à se mettre en grève en signe de sympathie. Et quand il conduisit l’occupation du bureau de poste général le lundi de Pâques, son premier acte fut de faire en sorte que les employés présents ne soient pas sous la menace des armes. Il savait parfaitement bien que le prolétariat de Dublin, encore en colère contre les évènements de 1913, n’en aurait rien à faire d’un soulèvement nationaliste. Et c’était cette attitude des ouvriers qui devait donner à O’Casey la force d’écrire sa grande trilogie dramatique.
En définitive, ce fut le poison idéologique du "sacrifice de sang" de 1916 qui vainquit le mouvement autonome des ouvriers en Irlande pour de nombreuses générations. Car, sacrifice du sang, il y eut. Le jour précédent l'insurrection, la direction officielle des Volontaires Irlandais avait publiquement annulé le soulèvement, après que la tentative de récupérer des armes allemandes eût échoué (un détail qui montre à quel point ce combat faisait partie intégrante des rivalités impérialistes internationales).
L’insurrection fut soutenue contre toute attente par une petite minorité, dans le but de contraindre les autorités britanniques à exécuter les leaders. Il s’agissait d’une version moderne du mythe de la crucifixion et de la résurrection, qui devait prendre place à Pâques. Connolly lui-même fut vaincu. Nous savons par sa correspondance privée qu’il était athée, bien que pour l’extérieur, il le niait parfois pour ne pas s’aliéner les plus religieux des ouvriers. Mais pour la légende, il est mort en catholique dévôt.
C’est en créant des sentiments de culpabilité envers les héros insidieusement accusés d’avoir fait faux bond que la conscience de classe du prolétariat a été détruite. Comme O’Casey le dit : "Ils devaient aider Dieu à soulever l’Irlande : c’est au peuple tout entier de répondre pour eux à présent, et à jamais."
Pourquoi O’Casey fut-il capable de résister à cela ? Il était moins théoricien que Connolly. Même sur la question nationale, il n’était pas forcément plus clair que d’autres autour de lui. Mais il se sentait profondément attaché à ce qu’il comprenait de la dimension humaine de la lutte ouvrière, aux forces célébrant la dignité de l’humanité et à l’importance de la vie-même, face à la mort.
1916 annonçait ce que le capitalisme décadent réservait à l'ensemble de la société. Parce qu’il a conduit l’humanité dans une impasse, le capitalisme a alourdi le fardeau du passé pesant comme un cauchemar dans les cerveaux des vivants. Parce que lui seul détient la perspective d’une société future, le prolétariat révolutionnaire n’a pas besoin de glorifier la culpabilité, l'esprit de sacrifice ou la mort.
Dombrovski (mars 2006)
Géographique:
- Irlande [87]
Heritage de la Gauche Communiste:
Solidarité de tous les travailleurs salariés avec les étudiants et lycéens en lutte contre le CPE!
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 81.54 Ko |
- 4029 lectures
Ouvriers, travailleurs salariés !
Les nouvelles générations, étudiants et lycéens, sont aujourd'hui attaquées massivement par le gouvernement Chirac/Villepin/ Sarkozy qui veut faire passer par la force et par la violence, le Contrat Première Embauche pour généraliser la précarité. Les étudiants et lycéens qui ont protesté sans violences dans les manifestations le 7 mars et encore le 14 mars ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Ils manifestent massivement pour l'avenir de TOUTE la société, pour toutes les générations, pour les chômeurs et les travailleurs précaires, pour donner une perspective aux jeunes des banlieues et leur permettre de surmonter le désespoir qui les a poussés dans une violence aveugle en novembre dernier. Ils luttent contre la décomposition du tissu social, contre la concurrence de tous contre tous, contre le "chacun pour soi" !
La seule réponse qu'ils ont reçue, c'est la répression de l'État policier de Monsieur Sarkozy ! "L'ordre républicain" que cet État est censé préserver, c'est le "désordre" d'une société qui condamne au chômage, à la précarité et au désespoir des masses croissantes de jeunes qui se décarcassent pour essayer d'avoir une vie décente. C'est l'ordre de l'intimidation et de la matraque ! C'est la provocation des bandes réactionnaires de l'extrême droite auxquelles apportent une contribution involontaire quelques petits groupes d'inconscients qui s'imaginent affaiblir l'État en bombardant les CRS, sous les caméras des médias aux ordres, de canettes de bière ou de barrières métalliques ! Un "ordre" qui trouve un soutien puissant dans la manipulation et le black-out organisés par les médias, notamment par la télévision. Un "ordre" que soutiennent aussi les syndicats de salariés qui refusent de dénoncer les mensonges et les manipulations du journal télévisé, qui refusent, malgré leurs déclarations officielles, de faire des tracts et d'appeler à des assemblées générales massives dans les entreprises pour dire la vérité aux salariés. En bloquant l'information, les syndicats veulent empêcher les travailleurs salariés d'apporter immédiatement leur solidarité active contre les attaques, contre la répression des enfants de la classe ouvrière !
Face au blocage et au sabotage de l'extension de la solidarité à tous les secteurs de la classe ouvrière, nous, travailleurs et militants de la classe ouvrière internationale, appelons tous les travailleurs à se mobiliser immédiatement pour défendre l'avenir de leurs enfants menacés par la misère et la barbarie du gouvernement et de tous ses complices !
La solidarité et le courage des étudiants et lycéens en lutte sont exemplaires. La liberté d'expression et la culture du débat qu'on voit dans les assemblées générales massives des étudiants, des décisions et des motions visant à élargir, approfondir et organiser le mouvement adoptées à main levée après discussion, l'élection de délégués responsables devant l'assemblée, c'est la véritable "démocratie", c'est-à-dire une prise en main directe et responsable par les étudiants de leur lutte ! Et cela n'a rien à voir avec ce qui nous est servi par la classe dominante : l'enfermement dans un isoloir à intervalles réguliers pour désigner lesquels de ses "spécialistes", les politiciens, vont aller au Parlement et autres institutions défendre ses privilèges contre les exploités. La mobilisation et les assemblées des étudiants nous montrent le chemin. Si les travailleurs salariés restent passifs, s'ils se laissent intimider, paralyser et intoxiquer par les médias aux ordres du gouvernement et tous leurs complices, ils laissent les mains libres à la classe dirigeante pour cogner encore plus fort sur leurs enfants !
Cet "ordre démocratique" imposé par la minorité qui dirige la société, la classe bourgeoise, c'est le désordre social et le déchaînement du chaos dans un pays situés au coeur de l'Europe "civilisée". C'est l'effondrement de la morale et de la civilisation humaine que la classe dirigeante, et totalement irresponsable, est en train de sacrifier sur l'autel de ses misérables privilèges dont la seule "logique" est celle du profit.
Les étudiants et lycéens les plus conscients n'occupent pas les facs pour "casser du flic" ou du "facho". Monsieur de Robien ment ! Ce ne sont pas les étudiants qui ont détruit leur outil de travail (les livres) ou saccagé le "monument historique" de la Sorbonne car ils savent trop bien qu'il appartient au patrimoine culturel de l'humanité !
Les étudiants ne sont ni des vandales ni des terroristes ! Les médias de la télévision mentent !
Nous dénonçons la duplicité et la lâcheté de tous les bloqueurs de la vérité, ces complices du gouvernement Chirac/Villepin/Sarkozy. Ce sont eux qui prennent en otage la parole des étudiants !
Nous dénonçons l'hypocrisie de ceux qui prétendent que le CPE est une "mesure sociale" pour les jeunes des banlieues. Après le bâton, ils utilisent maintenant la carotte pour tenter d'opposer les jeunes des cités aux étudiants et lycéens en lutte !
Nous dénonçons les appels aux pogroms des hommes politiques et des médias qui présentent les étudiants et lycéens en lutte comme des vandales, des excités, des irresponsables "manipulés" par de "dangereux extrémistes".
Nous appelons tous les travailleurs, ouvriers, précaires, chômeurs, retraités à engager immédiatement un mouvement de protestation générale contre cet "ordre" qui exploite, jette dans le chômage et la misère, réprime de plus en plus de travailleurs, particulièrement les plus jeunes, mais aussi les plus âgés.
Nous les appelons à faire entendre leur voix, à participer massivement et dans le calme à la manifestation du samedi 18 mars contre le travail précaire et le chômage, contre la répression, contre les atteintes au droit de grève. Le droit de grève, la liberté d'expression, sont des acquis des luttes de la classe ouvrière du 19e siècle.
Nous, travailleurs et militants du courant de la Gauche Communiste (qui a lutté contre la boucherie des deux guerres mondiales), nous appelons les travailleurs de tous les pays à témoigner leur solidarité avec les enfants de la classe exploitée victimes de la brutalité du gouvernement français et de tous ses complices !
Non aux blocage de la vérité ! Non à la liquidation des acquis des luttes de la clase ouvrière ! Non à la répression contre les étudiants et enfants de travailleurs !
Solidarité et unité de tous les salariés avec les étudiants, lycéens, chômeurs et travailleurs précaires sauvagement attaqués par Messieurs Villepin, Chirac et Sarkozy !
Les travailleurs militants et sympathisants des sections du Courant Communiste International (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Mexique, Pays-Bas, Suède, Suisse, Venezuela) appellent tous les travailleurs salariés de la "république française" à manifester tous unis, sans violence mais avec détermination, le samedi 18 mars, derrière une seule banderole unitaire pour le retrait du CPE, contre la précarité et les licenciements, contre l'escalade de la violence aveugle provoquée par Monsieur Sarkozy et ses amis !
Ils appellent les jeunes des banlieues à faire confiance à leurs camarades étudiants et lycéens. Les étudiants et lycéens les plus conscients savent que "la haine" aveugle ne mène nulle part. Les étudiants et lycéens ne luttent pas pour "venger" les émeutiers des banlieues mais pour leur offrir une perspective d'avenir, contre leur exclusion du système scolaire et du monde du travail.
Courant Communiste International (16 mars 2006)
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [60]
ICConline - 2007
- 5439 lectures
30 ans après “l’automne allemand” : la terreur d’Etat hier et aujourd’hui
- 4455 lectures
Nous avons publié sur notre site en allemand un article [90] sur le dit “automne chaud” de 1977. A l’époque, le kidnapping et le meurtre du président de la fédération des patrons par la Rote Armee Fraktion (RAF), plus connue sous le nom de « bande à Baader » dans les médias, avaient fourni le prétexte à une vague de répression sans égale dans l’histoire de l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre. C’était une période durant laquelle les forces de sécurité pouvaient à loisir intimider la population. Il y eut des raids policiers partout, des quartiers entiers étaient encerclés, les trains étaient arrêtés en pleine campagne et les passagers contraints de sortir sous la menace des armes des policiers. Pour avoir une idée du climat de peur, d’hystérie et de dénonciation publique qui dominait alors, et du rôle que les médias de l’Etat démocratique y ont joué, on peut se référer à la nouvelle de Heinrich Böll, “Katharina Blum”. La révélation que fit le magazine Stern selon laquelle la police savait où se trouvait Schleyer depuis le début montra à quel point son kidnapping n’était qu’un prétexte à une démonstration de puissance et la justification de nouvelles mesures de répression.
Notre article montre que le terrorisme de la RAF ou du “Mouvement du 2 juin” en Allemagne, comme celui des Brigades Rouges en Italie, exprimait une indignation envers le capitalisme, mais aussi des doutes, voire un sentiment de désespoir, sur le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière. Cela ne peut conduire qu’à une révolte impuissante, car individualiste, contre l’Etat, révolte fondamentalement petite-bourgeoise par sa nature et qui ne peut pas mettre en danger la classe dominante ni même convenir à ses propres desseins. How it all began, le livre de “Bommi” Baumann, un des témoins du mouvement terroriste, montre comment la bourgeoisie se sert de la rébellion terroriste et comment elle peut la manipuler. Par exemple, il explique comment les premiers combattants armés achetèrent leurs armes directement à la police politique allemande ! La classe bourgeoise utilisa cette génération de “lutte armée” de deux façons. D’une part, elle s’en servit d’épouvantail pour justifier un renforcement de l’Etat, dirigé non pas tant contre le “terrorisme” que contre la population de façon préventive, et en particulier contre la classe ouvrière. D’autre part, ces groupes armés, du fait de leurs confusions politiques, tout autant qu'en raison de leur propre impuissance, étaient invariablement entraînés dans les luttes de pouvoir au sein de la bourgeoisie (dans le conflit Est-Ouest ou en défendant la cause nationaliste palestinienne). En fait, déjà à l’époque, le terrorisme était d’abord et avant tout un moyen de lutte impérialiste entre les Etats et les fractions capitalistes (IRA, OLP, etc.).
Loin de s’exclure l’un l’autre, ces deux utilisations principales du terrorisme par l’Etat - arme de la guerre impérialiste et justification de la répression contre la classe ouvrière - se complètent au contraire et se renforcent mutuellement. Cela peut s’illustrer encore plus clairement aujourd’hui. Le terrorisme islamique est, en premier lieu, une arme dans les mains d’une série d’Etats et de cliques contre des rivaux impérialistes le plus souvent supérieurs économiquement et militairement. Mais surtout, c’est la “guerre contre le terrorisme” qui est devenue, au moins depuis le 11 septembre 2001, le cri de guerre de tous les Etats industriels majeurs de la planète. Ceci vaut non seulement pour les Etats-Unis, qui se sont servis de ce prétexte pour justifier l’invasion et l’occupation de l’Irak, mais aussi pour l’impérialisme allemand qui s’est opposé à la guerre en Irak mais justifie ses propres opérations militaires en Afghanistan, en Afrique ou sur la côte du Liban pour les mêmes raisons.
Concernant l’énorme renforcement répressif récent des Etats vis-à-vis de leurs propres populations, qu’on a aussi vu en Allemagne, il est vrai qu’initialement la prévention d’attaques terroristes de la part d’ennemis de ces Etats était le souci prédominant. Mais la classe dominante est pleinement avertie que son ennemi naturel et mortel est le prolétariat. Il est son ennemi à la fois “chez lui” et au niveau mondial. Paradoxalement, la classe dominante ne connaît plus de limites pour s’impliquer dans des activités terroristes. Il est bien connu que les Etats-Unis ont aidé à l’origine à construire, armer et entraîner l’organisation de Ben Laden. Mais les vieux liens entre les politiciens allemands et les groupes terroristes du Moyen-Orient ou des Balkans, ou plus récemment en Afghanistan, sont un sujet qu’il conviendrait aussi d’approfondir.
Six ans après l’attaque terroriste sur New-York, les événements de cette année en Allemagne ont puissamment illustré la “guerre contre le terrorisme” est aussi dirigée contre le front social. Trente ans après l’automne chaud allemand, on peut parler “d’été allemand 2007”. D’un côté, on a vu comment les manifestants, et principalement les plus jeunes qui, à Rostock et Heiligendamm, ont manifesté contre le G8 et “pour un monde différent”, étaient confrontés à la terreur d’Etat ouverte et jetés en prison. D’un autre côté, les activités du prétendu “Groupe militant” (“Militant group” ou MG) a été l’occasion de d’assimiler idéologiquement toute expression critique, anti-capitaliste à la pratique du terrorisme, et d’y répondre par des arrestations et des emprisonnements en cellules d’isolement. Ce groupe est censé avoir causé des dommages à la propriété, “symbole du capitalisme”, en endommageant des voitures et autres véhicules de luxe de l’armée allemande.
Nous n’avons pas d’éléments confirmés sur la nature de ce groupe, sa manifestation publique restant très brumeuse. Ce qui est en revanche clair et frappant, et ce sur quoi nous voulons insister dans cet article, est la façon dont l’Etat y a répondu. Ces attaques symboliques contre du matériel appartenant à l’Etat viennent alimenter le poids et le spectre de la “lutte contre le terrorisme”. Citons une lettre ouverte au procureur général contre la criminalisation de la science critique et de l’engagement politique, publié le 15 août par certains collègues des personnes emprisonnées en Allemagne et au niveau international :
“Le 31 juillet 2007, les appartements et les lieux de travail du Dr Andrej H. et du Dr Matthias B., et de cinq autres personnes, ont été investis par la police. Le Dr Andrej H. a été arrêté, conduit par hélicoptère à la cour fédérale allemande de Karlsruhe et amené au tribunal. Il a ensuite été transféré dans une prison de Berlin en incarcération préventive. Quatre personnes ont été accusées d’être “membres d’une association terroriste selon l’article 129a StGB’ (code pénal allemand, section 7 sur les “Crimes contre l’ordre public”). Ils sont supposés être des membres d’un prétendu “Militant Group” (MG). Le texte d’accusation a révélé que des mesures préliminaires avaient été menées contre ces quatre personnes depuis septembre 2006 et que les quatre avaient été sous surveillance constante.
Quelques heures avant l’investigation aux domiciles, Florian L., Oliver R. et Axel H. furent arrêtés dans la région du Brandebourg et accusés de tentative d‘incendie sur quatre véhicules de l’armée fédérale allemande. Andrej H. est accusé d’avoir rencontré une de ces trois personnes par deux fois dans la première moitié de 2007 dans de prétendues “circonstances conspiratives”.
Le procureur ou avocat général (federal prosecutor) assure donc que les quatre personnes mentionnées ci-dessus tout comme les trois arrêtées dans le Brandebourg sont membres du “Militant Group”, et tous les sept sont interrogés sous la charge d’être suspectés ”d’appartenance à une association terroriste “ selon l’article 129a StGB.
Selon le motif d’arrestation d’Andrej H., ce qui est à charge des quatre personnes mentionnées ci-dessus serait justifié par les éléments suivants listés par le procureur :
-
le docteur Matthias B. est accusé d’avoir utilisé dans sa publication académique, des “termes et des mots-clés” qui sont aussi utilisés par le “Militant Group” ;
-
en tant que scientifique politique titulaire d'un doctorat en philosophie, Matthias B. est considéré intellectuellement à même d’être “l’auteur des textes sophistiqués du MG”. De plus, “en tant qu’employé d’un institut de recherche il a accès à des bibliothèques dont il peut se servir sans en être soupçonné afin de faire le travail nécessaire à l’écriture des textes du “MG” ;
-
un autre accusé aurait rencontré des suspects de façon conspirative : “des réunions étaient régulièrement arrangées sans, cependant, mentionner l’endroit, l’heure et le contenu des réunions ; de plus, il aurait eu un rôle actif sur les “projets de l’extrême gauche” ;
-
dans le cas du troisième accusé, un carnet d’adresses a été trouvé, avec les noms et adresses des trois autres accusés ;
-
le Dr Andrej H., qui travaille comme sociologue urbain, aurait eu des contacts étroits avec trois individus qui seraient accusés, mais restent encore libres ;
-
le Dr Andrej H. est accusé d’avoir été actif dans la “résistance organisée selon le projet d’extrême gauche contre le sommet économique mondial de 2007 à Heiligendamm” ;
le fait qu’il n’ait pas pris – soi-disant de façon intentionnelle – son téléphone mobile avec lui à une réunion est considéré comme un “comportement de conspirateur”.Andrej H., comme Florian L., Oliver R. et Axel H., sont détenus depuis le 1er août 2007 à Berlin-Moabit dans des conditions très strictes : ils sont enfermés seuls en cellule 23 heures par jour et ne peuvent faire qu’une promenade d’une heure. Les visites sont limitées à une demi-heure tous les quinze jours. Les contacts, y compris ceux avec les avocats, se font à travers des panneaux de séparation. Le courrier à la défense est vérifié.
Les charges décrites dans l’acte d’accusation révèlent une construction basée sur un raisonnement par analogie très douteux. Le raisonnement comprend quatre hypothèses de base, dont aucune ne pourrait donner à la haute cour fédérale une évidence concrète et substantielle, mais dont la combinaison laisse une impression “d’association terroriste”. Les sociologues, du fait de leur activité de recherche académique, de leurs capacités intellectuelles et de leur accès à des bibliothèques, sont supposés être les cerveaux d’une prétendue “organisation terroriste”. Car, selon le procureur général, une association appelée “Groupe militant” utiliserait les mêmes concepts que les sociologues en accusation. Comme évidence de ce raisonnement, le concept de “gentrification” est nommé – un des thèmes-clé de recherche d’Andrej H. et Matthias B. dans les années passées, sur lesquelles ils avaient fait des publications au niveau international. Ils n’ont pas limité leurs recherches à faire des trouvailles dans une tour d’ivoire, mais ont rendu leurs travaux disponibles pour les initiatives citoyennes et les mouvements d'opinion. Voila comment des sociologues critiques sont transformés en chefs de bande intellectuels.”
La façon dont ces évènements ont été rapportés dans les médias n’est pas moins frappante. D’un côté, il y a eu très peu de publicité. Les médias se sont évidemment intéressés à faire profil bas afin de ne pas provoquer de réactions hostiles dans la population. Contrairement aux assassinats de la RAF qui ont précédé “l’automne allemand” de 1977, les récentes attaques contre les véhicules militaires à Berlin et dans le Brandebourg sont moins aptes à créer une atmosphère de peur publique et d’hystérie. De plus, les temps ont changé depuis 1977. Dans la période de crise économique ouverte, de démolition massive des services sociaux et de mauvais traitements bureaucratiques en particulier des chômeurs, il est beaucoup plus difficile de mobiliser la population, même temporairement, derrière l’Etat (comme cela s’est vu après le 11 septembre 2001 à New-York). L’objectif des forces de répression semble être plutôt d’intimider et de terrifier ces minorités politiquement en recherche qui ont déjà commencé à remettre la société bourgeoise en question. D’un côté, ces attaques, quand on en parle, sont systématiquement reliées à un certain “environnement théorique” qui est mis en lien avec le “sol fertile du terrorisme”. Les médias font ainsi fréquemment référence à “des discussions sur la révolution mondiale” comme une caractéristique de ce milieu. Il est fait références à de dangereux théoriciens qui, du fait du radicalisme de leurs opinions doivent être considérés comme des “intellectuels incendiaires” même lorsqu’ils rejettent eux-mêmes le terrorisme. Dans la même veine, la récente vague de raids policiers a aussi frappé Rotes Antiquariat, une des rares librairies en Allemagne qui offrent la possibilité de connaître les idées et les publications des groupes révolutionnaires internationalistes. Ici aussi, la différence d’approche de la bourgeoisie par rapport aux années 1970 est frappante. A l’époque, les médias en Allemagne et en Italie ne condamnaient pas les idées politiques de la RAF et des Brigades rouges. Les attaques de ces groupes étaient au contraire présentées comme le résultat de maladies mentales. Il fut même proposé de les traiter avec une chirurgie du cerveau. A ce moment-là, les gens les plus politisés étaient très activistes et tendaient à accepter les slogans du stalinisme de façon plus ou moins critique. Ce qui caractérise la nouvelle génération, c’est une réflexion beaucoup plus critique et profonde –réalité qui menace de devenir un bien plus grand danger pour le capitalisme. Il en est ainsi de la criminalisation de la théorie radicale. La réapparition de la pratique des attaques contre des “symboles du capitalisme” peut sembler étrange. Et bien que ces attaques présentes ne soient pas dirigées contre des personnes, elles montrent que les leçons de l’expérience de la RAF et des Brigades rouges n’ont pas été, ou ont été insuffisamment, tirées. De tels actes de désespoir sont, encore aujourd’hui, l’expression d’une profonde indignation contre le système dominant. Nous partageons pleinement cette indignation, d’où notre solidarité avec les victimes de la terreur d’Etat, indépendamment du fait qu’elles aient ou non été impliquées dans de telles actions. Mais celles-ci sont aussi l’expression d’une profonde difficulté à comprendre où se trouve la réelle force révolutionnaire dans cette société. Une telle difficulté n’est pas surprenante. Ce qui caractérise le monde contemporain, par comparaison avec 1977, ne tient pas seulement à l’impasse bien plus dramatique et dangereuse dans lequel le capitalisme a conduit l’humanité, mais aussi dans le fait que le prolétariat a considérablement perdu le sens de son identité de classe depuis 1989.
Aujourd’hui cependant, le prolétariat mondial commence à redécouvrir sa propre force. Et l’avant-garde politique de cette classe commence à redécouvrir et à développer ses théories et ses positions propres. Une part de la solidarité du prolétariat avec les victimes de la terreur d’Etat se trouve dans la lutte pour gagner les désespérés à la cause et aux méthodes de la classe ouvrière.
D’après Welt Revolution, 31 août 2007
Géographique:
- Allemagne [61]
Questions théoriques:
- Terrorisme [91]
A BAS L'ÉTAT POLICIER ! Solidarité de tous les travailleurs avec les étudiants matraqués par les flics !
- 3005 lectures
La semaine dernière, le gouvernement Sarkozy/Fillon/Hortefeux/Pécresse et consorts (avec la complicité silencieuse du PS et de toute la "gauche plurielle") a franchi le Rubicon de l'ignominie et du sadisme. Après les immigrés chassés manu militari hors des frontières de l'Hexagone, au nom de la politique de sélection de "l'immigration choisie", ce sont maintenant les étudiants grévistes qui sont sauvagement matraqués. La répression féroce s'est abattue sur les étudiants en lutte contre la loi sur la privatisation des universités (appelée LRU). Au nom de la "démocratie" et de la "liberté", certains présidents d'université vendus au capital ont pris la décision inique de faire appel aux CRS et aux gardes mobiles pour libérer les facs bloquées et occupées à Nanterre, Tolbiac, Rennes, Aix-Marseille, Nantes, Grenoble...
L'ordre de la terreur capitaliste !
La répression a été particulièrement ignoble à Rennes et surtout Nanterre.
Après avoir fait intervenir des vigiles armés de chiens policiers, les présidents d'universités ont laissé des centaines de CRS investir les locaux : les étudiants bloqueurs ont été délogés à coup de matraques et de gaz lacrymogène. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et blessés. Les CRS ont poussé le sadisme jusqu'à arracher les lunettes (symbole de ceux qui font des études et lisent des livres !) d'un étudiant de Nanterre et de les lui casser. Les médias sarkozystes aux ordres du capital ont relayé et justifié la répression en donnant la parole aux présidents d'universités. Le 13 novembre, au journal télévisé de 20 heures de France 2, on a pu entendre en effet le président de l'université de Nanterre justifier ainsi la répression : "Ce n'est pas une lutte, c'est de la délinquance". Quant à cet autre larbin hystérique du capital, le président de l'université de Rennes, il n'a eu aucun scrupule à affirmer que ceux qui se révoltent sont des "terroristes et des khmers rouges" !
Il est clair que l'ex-premier flic de France, Nicolas le Petit, est bien déterminé aujourd'hui à "nettoyer au kärcher" les université françaises et à stigmatiser les enfants de la classe ouvrière comme des "voyous", de la "racaille", ou des "délinquants" (dixit le président de Nanterre). Quant à tous ceux qui font de la "politique" (pour Madame Pécresse, le 7 novembre sur LCI : "les blocages sont d'abord politiques"), ce ne sont que des "terroristes". Au moment même où Alliot-Marie donnait l'ordre à ses flics de donner l'assaut dans les facs occupées, sa "copine" Madame Pécresse a poussé le cynisme jusqu'à affirmer à la télé qu'elle voulait "rassurer les étudiants" (sic !).
Les travailleurs du secteur public comme du privé doivent entendre le message : tous ceux qui se lanceront dans des grèves "illégales" et "impopulaires" (et on peut compter sur les médias et Télé-Sarkozy pour accentuer jour après jour la propagande), tous ceux qui comme les travailleurs de la SNCF et de la RATP oseront "prendre en otage" les "usagers" seront montrés du doigt comme des "terroristes", des semeurs de trouble de "l'ordre public".
Le vrai "péril jaune", ce ne sont pas les prétendus "khmers rouges" de l'université de Rennes. Ce sont les "casseurs", les briseurs de grève de la voyoucratie qui cognent et gazent les jeunes générations de la classe ouvrière avec la bénédiction des mouchards et des fayots : les présidents des universités. Les vrais "terroristes", les vrais criminels, ce sont ceux qui nous gouvernent et qui exécutent les basses oeuvres de cette classe de gangsters : la bourgeoisie décadente. Leur ordre, c'est celui de la TERREUR implacable du capital.
Mais cette classe de voyous ne s'est pas contentée d'envoyer ses chiens mordeurs et ses CRS matraqueurs contre les étudiants grévistes. Dans certaines universités évacuées par les flics, ils ont poussé la crapulerie jusqu'à "confisquer" les caisses de grève des étudiants. Ainsi, par exemple, à Lyon, le 16 novembre, les étudiants qui occupaient la fac avaient réussi à collecter un petit pécule de quelques centaines d'euros. Pendant que les CRS armés jusqu'aux dents débloquaient la fac, l'administration de l'université a, quant à elle, confisqué le matériel de cuisine apporté par les étudiants et a fait main basse sur leur caisse de grève. C'est ignoble, honteux, répugnant ! Ces moeurs de petits voyous de la bourgeoisie n'a décidément rien à envier à celle des "casseurs" des banlieues qui ont été manipulés par l'État bourgeois pendant le mouvement de 2006 contre le CPE pour attaquer les étudiants dans les manifestations et leur voler leurs téléphones portables !
Voilà le vrai visage de la démocratie parlementaire : l'ordre "public", c'est l'ordre du capital. C'est l'ordre de la terreur et des matraques, celles des flics et des médias. C'est l'ordre du mensonge et de la manipulation des Télés-Sarkozy ! C'est l'ordre des Machiavels qui cherchent à nous diviser pour mieux régner. C'est l'ordre de ceux qui cherchent à nous monter les uns contre les autres en utilisant la stratégie préconisée par l'ex-gouvernement Villepin/Sarkozy au printemps 2006 : le pourrissement par la violence !
La solidarité entre les étudiants et les cheminots nous montre le chemin
La répression sauvage contre les étudiants est une attaque inique contre l'ensemble de la classe ouvrière. La grande majorité des étudiants en lutte contre la privatisation des universités et la sélection par le fric sont des enfants de prolétaires et non pas de la petite bourgeoisie bien pensante, comme le prétendent certains médias et les socio-idéologues du capital. Bon nombre d'entre eux sont en effet des enfants des travailleurs de la fonction publique ou issus de l'immigration (notamment dans les universités de banlieues comme à Nanterre ou Saint-Denis). La nature prolétarienne de la lutte des étudiants contre la Loi Pécresse s'est clairement révélée par le fait que les grévistes ont été capables d'élargir leurs revendications : dans la plupart des universités bloquées, ils ont mis en avant dans leur plateforme revendicative, non seulement le retrait de la LRU, mais également la défense des régimes spéciaux des retraites, le rejet de la loi Hortefeux et de la politique de "l'immigration choisie" de Sarkozy, le rejet des franchises médicales et de toutes les attaques du gouvernement contre l'ensemble de la classe ouvrière. Ils ont mis en avant la nécessaire SOLIDARITÉ qui doit unir les travailleurs en lutte contre l'enfermement corporatiste et les "négociations" entreprise par entreprise, catégorie par catégorie, préconisées par les syndicats. Cette solidarité, les étudiants ont été capables de la faire vivre concrètement. Ainsi plusieurs centaines d'étudiants à Paris comme en province se sont joints aux manifestations de cheminots (notamment les 13 et 14 novembre) en lutte contre la remise en cause des régimes spéciaux de retraite. Dans certaines villes (Rennes, Caen, Rouen, Saint-Denis, Grenoble), cette solidarité des jeunes générations de la classe ouvrière a été accueillie très favorablement par les cheminots qui leur ont ouvert les portes de leurs AG et ont mené des actions communes avec les étudiants (telles que des interventions aux sorties d'autoroute où les étudiants et les cheminots ont laissé passer gratuitement les automobilistes aux péages en leur expliquant le sens de leur mouvement). Aujourd'hui, il y a donc des étudiants et des cheminots qui réfléchissent, discutent, agissent et mangent ensemble. Dans certaines universités (présidée par des êtres humains et non par des hyènes hystériques qui hurlent avec les loups), ils ont été rejoints par les enseignants et le personnel administratif, comme à Paris 8-Saint-Denis.
Cette nature prolétarienne de la lutte des étudiants est encore réaffirmée par le fait que, en occupant les universités, les étudiants ne veulent pas seulement occuper des locaux pour pouvoir tenir leurs assemblées générales et mener des débats politiques ouverts à tous (oui, Madame Pécresse, l'espèce humaine, parce qu'elle est douée de langage, contrairement aux singes, est une espèce politique, comme l'ont démontré certains chercheurs travaillant dans des "pôles d'excellence" !). Dans certaines facultés, les étudiants grévistes ont décidé d'investir les locaux pour accueillir les immigrés sans papiers.
Et c'est bien à cause de cette solidarité active qui risque de faire tâche d'huile que le gouvernement Sarkozy/Fillon (et ses "dames de fer", Pécresse, Alliot-Marie, Dati et autres "Mi-putes, Mi-soumises") a décidé d'envoyer ses flics pour casser les reins de la classe ouvrière. Ce que veut la bourgeoisie française, c'est mettre en application la même politique que Thatcher. Ce qu'elle veut, c'est interdire, comme en Grande-Bretagne, toutes les grèves de solidarité afin d'avoir les mains libres pour asséner des attaques encore plus brutales en 2008, après les élections municipales. Et c'est aujourd'hui, par l'épreuve de force et par le déchaînement de la répression que la classe dominante, et son homme de main Sarkozy, cherche à imposer l'ordre "démocratique" du capital.
Le mouvement de solidarité dans laquelle les étudiants et certains cheminots se sont engagés montre que les leçons de la lutte contre le CPE n'ont pas été oubliées malgré la campagne électorale assourdissante des dernières présidentielles. La solidarité entre les étudiants en lutte et une partie des travailleurs de la SNCF et de la RATP nous montre le chemin. C'est dans cette voie que tous les travailleurs actifs ou chômeurs, français "de souche" ou immigrés, de la fonction publique comme du privé, doivent résolument s'engager. C'est le seul moyen de construire un rapport de forces contre les attaques de la bourgeoisie et de son système décadent qui n'a qu'un seul avenir à offrir aux jeunes générations : le chômage, la précarité, la misère et la répression (aujourd'hui, les matraques et les gaz lacrymogènes ; demain, la mitraille !)
En 2006, si le premier flic de France, Sarkozy, n'avait pas envoyé ses CRS contre les étudiants "bloqueurs", ce n'est nullement parce qu'il avait à l'époque le moindre scrupule moral. C'est essentiellement parce qu'il était candidat aux présidentielles et ne voulait pas se mettre à dos une partie de son électorat dont les enfants sont scolarisés dans les universités. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, il veut montrer ses muscles et régler les comptes de toute la bourgeoisie française qui a gardé en travers de la gorge le retrait du CPE en 2006 (n'avait-il pas annoncé la couleur au lendemain de son élection en affirmant : "l'État ne doit pas reculer" ?). Ce que veut Sarkozy, c'est montrer à la clique de Villepin que lui, il ne se dégonflera pas (car, comme le disait Raffarin, "ce n'est pas la rue qui gouverne"). Le cynisme avec lequel il a annoncé publiquement, au nom de la "transparence", l'augmentation de son salaire de 140% en même temps qu'il affiche son intransigeance dans toutes les attaques contre le niveau de vie des prolétaires, est une véritable provocation. En roulant des mécaniques et en faisant des pieds de nez à la classe ouvrière, voilà le message qu'il veut faire passer : "Il est hors de question de remettre en cause les privilèges de la bourgeoisie. J'ai été élu par les Français, maintenant j'ai carte blanche pour faire ce que je veux !". Mais au-delà des intérêts et ambitions personnelles de ce sinistre personnage, c'est l'ensemble de la classe capitaliste que Sarkozy représente : force doit rester à la loi du capital. Le bras de fer qu'il a engagé avec les cheminots vise un seul objectif : infliger une défaite cuisante à l'ensemble de la classe ouvrière en effaçant le sentiment laissé par le mouvement contre le CPE, celui que seule la lutte unie paie. C'est pour cela que Sarkozy n'a pas l'intention de céder aux cheminots et qu'il veut transformer les universités en forteresses policières.
Mais quelle que soit l'issue de ce bras de fer entre le gouvernement Sarkozy/Fillon/Pécresse et la classe ouvrière, la lutte a déjà commencé à payer : le mouvement de solidarité engagé par les cheminots et les étudiants et qui a commencé à entraîner derrière lui d'autres partie de la classe ouvrière (notamment les travailleurs des universités) laissera une trace durable dans les consciences, tout comme la lutte contre le CPE. Comme toutes les luttes ouvrières qui se déroulent à l'échelle mondiale, il est un jalon sur le chemin qui mène vers le renversement futur du capitalisme. Le principal gain de la lutte, c'est la lutte elle-même, c'est l'expérience de la solidarité vivante et active de la classe ouvrière en marche vers son émancipation, et vers l'émancipation de l'humanité toute entière.
Travailleurs "français" et immigrés, du public et du privé, étudiants, lycéens, chômeurs : un seul et même combat contre les attaques du gouvernement ! A bas l'État policier ! Face à la terreur du capital, solidarité de toute la classe ouvrière !
Sofiane (17 novembre 2007)
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
AIRBUS : Si on accepte les sacrifices aujourd’hui, la bourgeoisie cognera encore plus fort demain !
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 25.24 Ko |
- 3792 lectures
Après plusieurs semaines de contorsions de la direction d’Airbus et une rencontre Chirac-Merkel, le couperet est tombé : 10 000 suppressions de postes en Europe, fermeture ou vente de plusieurs usines.
La direction, la main sur le cœur, nous dit « il n’y aura pas de licenciements secs », « tout se réglera par des préretraites et des départs volontaires ».
Pas de licenciements à Airbus, mais ce n’est que la moitié des effectifs touchés : les 5000 intérimaires ou salariés des entreprises sous-traitantes seront priés de se faire voir ailleurs. Quant aux salariés d’Airbus, on sait ce que signifient pour eux les « départs volontaires » : le harcèlement par les petits chefs afin de les faire craquer. Au total, il y aura encore plus de chômage, surtout parmi les jeunes qui cherchent du boulot. Et pour ceux qui restent : des cadences encore plus infernales, une augmentation des heures travaillées pour le même salaire, ou moins.
Comment la bourgeoisie et les syndicats expliquent la crise d’Airbus ?
Pour expliquer la crise d’Airbus justifiant de telles mesures, chacun y va de son petit couplet. Pour Gallois, le patron d’Airbus, c’est principalement à cause de l’Euro fort : les avions Airbus sont trop chers par rapport à ceux produits par Boeing. Pour les syndicats, c’est à cause d’une mauvaise gestion ou de l’avidité des actionnaires. Pour le patronat, c’est parce que l’État a voulu se mêler de la politique industrielle, ce qui n’est pas son rôle : il faut laisser les investisseurs privés se débrouiller entre eux. Pour les partis de gauche c’est parce que l’État n’a pas joué son rôle d’actionnaire. Pour la presse française c’est à cause de l’État allemand qui tire la couverture à lui. Pour la presse allemande, et la bourgeoisie qui est derrière, c’est difficile de renvoyer cet argument dans l’autre sens vu que, sans que les français y soient pour quelque chose, 6100 suppressions de postes sont annoncées à Bayer, géant de la chimie, en même temps que la direction de Deutsch Telekom décide de transférer vers des sous-traitants 50 000 de ses salariés, ce qui est un moyen de préparer leur licenciement une fois qu'ils seront dispersés dans de multiples petites entreprises. Et pour faire bonne mesure, ceux qui restent devront travailler 5 heures de plus par semaine, sans augmentation salariale. A travers ses médias, la bourgeoisie allemande essaie plutôt de consoler les ouvriers d'Airbus en disant que cela aurait pu être pire pour eux : ce sont les travailleurs français les plus touchés. Même son de cloche dans la presse espagnole : on ne s’en sort pas trop mal, mais c’est parce qu’on est plus compétitif. Et pour en rajouter une petite couche dans le refrain nationaliste, allemands et français sont accusés de faire leur petite cuisine dans leur coin, sans consulter les espagnols.
Quant à la presse britannique, c’est plutôt la discrétion qui domine : c’est vrai qu’en ce moment même, ce sont des centaines de milliers de travailleurs de la santé qui sont attaqués par un gel de leurs salaires déjà particulièrement bas.
Que nous proposent ceux qui rejettent les décisions de la direction d’Airbus ?
Pour les syndicats allemands, les difficultés d’Airbus sont un exemple parmi d’autres de la mauvaise gestion des patrons, laquelle est également responsable des difficultés de Deutsch Telekom et de Bayer. Ils revendiquent d’être plus présents dans la gestion des entreprises alors qu’ils représentent pratiquement 50% des conseils d’administration et qu’ils ont déjà été associés à toutes les décisions concernant Airbus ou d’autres secteurs. Dans ce cadre, ils proposent que les mesures à prendre pour « préserver l’avenir d’Airbus » soient discutées localement, usine par usine, entre les syndicats et les patrons.
Les syndicats français, pour leur part, dénoncent aussi la mauvaise « gouvernance » de la direction actuelle et proposent que ce soit l’État qui soit plus impliqué dans la gestion d’Airbus, perspective qui est également soutenue par le premier ministre et les candidats de droite et du centre aux prochaines élections présidentielles, Sarkozy et Bayrou. Quant à la candidate socialiste, Ségolène Royal, elle fait en plus la proposition que les régions soient impliquées dans le capital de l'avionneur. C’est-à-dire ce qui existe déjà en Allemagne où les Länder sont partie prenante dans le capital d’Airbus, avec le succès qu’on voit !
Face à la concurrence capitaliste, refusons de nous laisser diviser !
Il peut y avoir une part de vérité dans certaines de ces déclarations. C’est vrai que l’Euro fort est un obstacle à la vente des avions produits en Europe face à la concurrence de Boeing. C’est vrai qu’il y a des problèmes de gestion dans Airbus. En particulier, c’est vrai que la concurrence entre l’État allemand et l’État français n’a pas arrangé les choses. Chacun peut raconter une petite partie de la vérité, mais tous ces gens-là partagent le même mensonge : les travailleurs qui aujourd’hui paient les difficultés d’Airbus auraient les mêmes intérêts que les patrons. En somme, ils devraient adhérer à l’objectif que tous ces discours se donnent : il faut que Airbus soit rentable par rapport à Boeing. C’est exactement aussi ce que disent les patrons américains aux ouvriers américains et c’est aussi pour cela que ces derniers ont subi des dizaines de milliers de licenciements au cours des dernières années. En fin de compte, dans tous les discours que nous font entendre les « responsables », que ce soit le gouvernement, les patrons ou les syndicats, les ouvriers américains seraient les ennemis des ouvriers européens de la même façon que les ouvriers français, allemands, anglais et espagnols seraient les ennemis les uns des autres. Finalement, dans la guerre économique d’aujourd’hui, l’ensemble des forces de la bourgeoisie veut opposer les ouvriers des différents pays entre eux comme elle le fait dans les guerres militaires.
Que les États capitalistes soient en concurrence les uns avec les autres, ils n’arrêtent pas de nous le dire et c’est vrai. Les guerres du 20e siècle nous ont montré que ce sont les travailleurs qui ont le plus à perdre dans ces rivalités entre nations capitalistes et qu’ils n’ont aucun intérêt à se soumettre aux ordres et aux intérêts de leur bourgeoisie nationale. Dans la logique du capitalisme, il faut que les ouvriers américains comme les ouvriers européens fassent toujours plus de sacrifices. Si Airbus redevient rentable face à Boeing, les ouvriers américains subiront de nouvelles attaques (d'ailleurs, ce sont dès aujourd'hui 7000 emplois dont on annonce la suppression) et ensuite ce sera aux ouvriers européens de payer une nouvelle fois la note. Chaque recul des ouvriers face aux exigences capitalistes, et partout, ne fait que préparer de nouvelles attaques encore plus violentes que les précédentes. Il n’y a pas d’autre « option » possible pour le capitalisme car ce système est en crise, une crise insoluble et que la seule réponse qu’il sache opposer à cette crise ce sont toujours plus de suppressions de postes et une exploitation toujours plus féroce des ouvriers qui ont « la chance » de conserver leur emploi… pour le moment.
Une seule solution : unité et solidarité de toute la classe ouvrière !
Pour les travailleurs qui sont aujourd’hui frappés par les mesures de la direction d’Airbus, il n’y a pas d’autre alternative que la lutte. Dans plusieurs usines d'Airbus, ils l'ont compris immédiatement : dès l'annonce des plans de la direction, les 1000 ouvriers de l'usine de Laupheim, dans le sud de l'Allemagne, sont partis en grève spontanément, au même moment où ceux de Méaulte, en Picardie, arrêtaient le travail ; travail qu'ils ont repris lorsque le syndicat leur a annoncé que l'usine ne serait pas vendue, ce qui était un mensonge.
Mais les travailleurs d'Airbus ne sont pas les seuls concernés par cette lutte. C’est l’ensemble des exploités qui doivent se sentir solidaires face aux attaques qui aujourd’hui s’abattent sur les travailleurs de l’aéronautique, qui demain frapperont une nouvelle fois ceux de l’automobile, des Télécoms, de la chimie et tous les secteurs.
Il faut que partout les travailleurs se réunissent en assemblée générale souveraine où ils discutent et décident des objectifs et des moyens de leur lutte. Leur lutte, c’est l’affaire des travailleurs eux-mêmes. Ce n’est pas l’affaire des candidats aux élections dont les promesses seront oubliées dès qu’ils seront au pouvoir. Ce n'est pas l'affaire non plus de leurs « représentants » patentés, les syndicats. Ces derniers passent leur temps à cultiver la division entre les travailleurs, que ce soit au sein d’une même entreprise ou d’une même unité de production (comme on le voit aujourd’hui à Toulouse où les discours du principal syndicat, « Force Ouvrière », tentent d'opposer les « cols bleus » des usines aux « cols blancs » du siège social, eux aussi lourdement frappés). Ou encore d’un pays à l’autre, puisque les syndicats sont les premiers à agiter les chiffons nationalistes. Pour les syndicats français d'Airbus, avec à leur tête le même « Force Ouvrière », il faut « lutter », y compris en paralysant la production pour obtenir une « meilleure répartition des sacrifices », en d'autres termes, pour que les ouvriers allemands soient encore plus lourdement frappés. Et même lorsqu’un syndicat comme IG Metall propose pour la mi-mars une journée d’action commune des travailleurs des différents pays où est implanté Airbus, ce n’est qu’une manoeuvre pour prendre les devants d’une prise de conscience des travailleurs que leurs intérêts ne sont pas ceux du capital national, en même temps qu'il essaie de faire passer ses déclarations contre la grève au nom de la « responsabilité ». C’est aussi un moyen de cultiver une « solidarité » entre ouvriers européens d'Airbus qu’on oppose aux ouvriers américains de Boeing qui pourtant, à l'automne 2005, étaient entrés massivement en grève contre les attaques patronales.
La nécessaire solidarité de tous les travailleurs a commencé à se manifester, notamment à travers des débrayages spontanés dans des usines relativement épargnées comme celles de Hambourg et de Brême, les plus importantes en Allemagne. Il y a peu, dans le sud de l'Espagne, les ouvriers d'Airbus, aujourd'hui attaqués, avaient apporté leur soutien aux manifestations des familles des travailleurs de l'équipementier automobile Delphi jetés à la rue par la fermeture de l'usine de Puerto Real. C'est le chemin dans lequel doivent s'engager tous les travailleurs.
Face aux appels des patrons à accepter les suppressions d’emploi, les baisses de salaires et l’aggravation des conditions de travail, une seule réponse : refus des sacrifices qui préparent des attaques encore plus brutales ! Seule la lutte paie !
Face aux tentatives de diviser les travailleurs par entreprises ou par pays, solidarité de toute la classe ouvrière !
Contre l’isolement qui veut toujours dire la défaite, élargissement des luttes ! Les assemblées ouvrières doivent envoyer des délégations massives aux autres entreprises pour que l’ensemble des travailleurs soit partie prenante d’un mouvement solidaire.
Face à un système capitaliste mondial aux abois qui portera des attaques toujours plus brutales contre tous les travailleurs dans tous les secteurs et dans tous les pays, il n’y a pas d’autre alternative pour la classe ouvrière que de mener des luttes toujours plus déterminées, plus amples, plus solidaires.
C’est le seul moyen pour faire obstacle à une aggravation de l’exploitation, à des conditions de vie et de travail de plus en plus inhumaines, et aussi pour se préparer au renversement de ce système qui sème la misère, la guerre et la barbarie.
Vie du CCI:
Situations territoriales:
Cajo Brendel (1915-2007)
- 3772 lectures
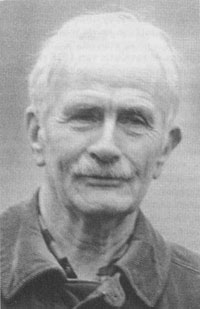 Le 25 juin 2007, décédait Cajo Brendel à l'âge de 91 ans. Il était le dernier des communistes de conseil néerlandais. Cajo était un ami et un compagnon de lutte, qui défendait vigoureusement ses positions mais était également jovial et chaleureux avec son entourage. A l'occasion de son 90ème anniversaire, nous avions publié l'an dernier un article dans Wereldrevolutie, n° 107. Nous voudrions ici revenir plus largement sur sa vie et nos liens avec lui.
Le 25 juin 2007, décédait Cajo Brendel à l'âge de 91 ans. Il était le dernier des communistes de conseil néerlandais. Cajo était un ami et un compagnon de lutte, qui défendait vigoureusement ses positions mais était également jovial et chaleureux avec son entourage. A l'occasion de son 90ème anniversaire, nous avions publié l'an dernier un article dans Wereldrevolutie, n° 107. Nous voudrions ici revenir plus largement sur sa vie et nos liens avec lui.
Cajo se représentait le CCI comme un courant qui se réclamait de « positions dépassées », comme celles du KAPD (Parti Ouvrier Communiste d'Allemagne) au début des années 1920, qui selon lui auraient été dépassées par le GIC (Groupe des Communistes Internationaliste), et en 1981, il caractérisait d'une manière univoque notre conception de la décadence de « humbug » (attrape-nigaud) lors d'un débat à Amsterdam. Mais Cajo était d'abord et avant tout un internationaliste persistant et convaincu, c'est ce que nous avions de commun avec lui, et c'est la raison pour laquelle il nous a toujours inspiré admiration et respect. Nous avions des différences de vue avec lui, entre autres sur les syndicats, qui selon Cajo auraient été « capitalistes » dès le début, et à propos de la question nationale ; selon lui, des « révolutions bourgeoises » se déroulaient encore, et il y incluait aussi bien la guerre civile de 1936 en Espagne que les changements en Chine sous Mao Tse-Toung, aussi bien d'ailleurs que la révolution prolétarienne d'Octobre en Russie en 1917-1923.
Si l'activité politique était pour son ami Jaap Meulenkamp un « hobby d'inspiration sociale », pour Cajo, c'était un peu plus que cela : une profonde conviction dans laquelle il s'investissait infatigablement et qu'il essayait de transmettre aux autres par la force des arguments. Lorsque, avec Otto Rühle, il acquit la conviction que « la révolution n'est pas une affaire de parti », cela ne l'empêcha pas de mener campagne pour les positions de la Gauche Communiste, ni de conférer à ces positions une notoriété sur plusieurs continents. A de nombreuses occasions, nous avons débattu et polémiqué fermement avec lui, à commencer par Mai 68 à Paris, et il faut dire que parfois les esprits se sont échauffés. Mais, alors que d'autres membres de Daad en Gedachte, comme Jaap, refusaient "par principe" de débattre avec des organisations ou des groupes qui se présentaient comme "l'avant-garde politique" du prolétariat, Cajo participa en 1973 à plusieurs conférences à Termonde et à Langdorp en Belgique, où le Communistenbond Spartacus était également présent, tout comme les groupes qui un an plus tard allaient fonder la section du CCI en Belgique, et dont on trouve les répercussions également dans Daad en Gedachte de 1973-1975.
Cajo est né à La Haye le 2 octobre 1915. Originaire comme il le disait lui-même d'une « famille petite-bourgeoise » qui connut de très grandes difficultés financières après le krach de 1929, il s'intéressera aux questions sociales. Initialement sympathisant du trotskisme, en mai 1934, après un débat avec David Wijnkoop devenu stalinien, il entre en contact avec deux ouvriers de La Haye, Arie et Gees, et ensuite Stientje. Ceux-ci s'avèrent être d'anciens membres du Parti Ouvrier Communiste des Pays-Bas (KAPN) et forment la section de La Haye du GIC. En 1933, ils publient le journal De Radencommunist (Le Communiste de Conseil). Pendant des mois, alors âgé de 19 ans, Cajo discutera avec eux tous les soirs jusqu'à ce qu'il soit convaincu en septembre. Plus tard, il dira de cette période que « c'était comme s'il était passé directement du jardin d'enfants à l'université ». Par leur intermédiaire, il entra en contact avec la section amstellodamoise du GIC, dans laquelle Henk Canne Meijer et Jan Appel jouaient un rôle si important, et avec qui Anton Pannekoek était en contact. Il a également été très influencé par des écrivains comme Paul Mattick et Karl Korsch. Jeune et désargenté, Cajo a mené dans le La Haye de ces temps de crise, comme on dit, une existence haute en couleurs. En 1935, après que des groupes à Leiden, La Haye et Groningen se soient séparés du GIC, trop « théorique » selon eux, il publie avec le groupe de La Haye le journal Proletariër, et en 1937-1938 Proletarische Beschouwingen (Considérations Prolétariennes). En 1938-1939, il écrit ensuite chaque semaine un article pour le journal anarchiste De Vrije Socialist (Le Socialiste Libre) de Gerhard Rijnders, à qui le marxisme de Cajo ne posait manifestement aucun problème. Mobilisé en 1940, Cajo diffuse un tract internationaliste parmi les soldats, mais sans trouver le moindre écho. Après son transport vers Berlin comme prisonnier de guerre, il revient aux Pays-Bas, dans la clandestinité, caché sous un journal. Après la guerre, il travaille comme journaliste à Utrecht, sur le plan personnel, ce sont des années plus calmes et plus heureuses. En 1952, Cajo s'affilie au Communistenbond Spartacus, où il fait partie de la rédaction. Cette année-là, il apprend aussi à connaître Anton Pannekoek. Dans les douze années qui suivent, il écrira un très grand nombre d'articles, et aussi des brochures comme De opstand der arbeiders in Oost-Duitsland (la résistance des ouvriers en Allemagne de l'Est) et Lessen uit de Parijse Commune (Leçons de la Commune de Paris), toutes deux en 1953. Lors du conflit de 1964, au cours duquel des membres du Communistenbond ont été exclus, surtout Theo Maassen qui avait déjà été exclu du GIC, alors que d'autres partaient volontairement, Cajo adopte d'abord une attitude conciliatrice, mais finalement il se rallie au groupe qui publiera à partir de 1965 le journal Daad en Gedachte, « consacré aux problèmes de la lutte ouvrière autonome ».
Mais Cajo devient vraiment important lorsqu'il publie Anton Pannekoek, theoretikus vans het socialisme (Pannekoek, théoricien du socialisme) en 1970, un livre qui aura une grande influence aux Pays-Bas sur toute une génération d'éléments à la recherche des positions marxistes, et qui en 2001 paraissait aussi en allemand, sous le titre Pannekoek, Denker der Revolution. En 1970, il existe à l'échelle internationale un regain d'intérêt pour la Gauche Communiste. En 1974, l'année du décès de Theo Maassen, paraît Stellingen over de Chinese revolutie (Thèses sur la révolution chinoise), et cette même année aussi, la brochure en allemand Autonome Klassenkämpfe in England 1945-1972, dont paraîtra aussi une version française, et pour l'écriture de laquelle il passa beaucoup de temps en 1971 au pays de Galles, parmi les mineurs. D'un très grand intérêt aussi, son volumineux ouvrage Revolutie en contrarevolutie in Spanje (Révolution et contre-révolution en Espagne), malheureusement toujours pas traduit à l'heure actuelle. Cajo connaissait les langues, et bien que la plupart de ses écrits aient paru en néerlandais, il publiait aussi en allemand, anglais et français; ses œuvres ont été traduites dans des langues plus nombreuses encore. En conséquence, son influence internationale s'accroît réellement, ne serait-ce qu'au travers de ses contributions à la publication Echanges et Mouvements, éditée en français et en anglais, et de sa participation à des conférences internationales, comme à Paris en 1978.
Lorsqu'en 1981 une conférence de groupes internationalistes fut organisée à Amsterdam Daad en Gedachte avait choisi de ne pas y participer, mais un membre du groupe était toutefois présent à titre personnel, et autant Cajo que Jaap avaient envoyé d'importantes contributions à la discussion, et par conséquent leurs positions y étaient représentées. En 1981 aussi, pendant la grève de masse en Pologne, Cajo défendit devant une salle comble à Amsterdam que la ligne de démarcation « ne se trouvait pas entre d'un côté l'Etat polonais et de l'autre les ouvriers et le syndicat Solidarnosc, mais entre d'une part l'Etat polonais et le syndicat Solidarnosc, et d'autre part les ouvriers », point sur lequel nous étions fondamentalement d'accord. En 1983, lors de la présentation à Anvers du livre Blaffende bonden bijten niet (Des syndicats qui aboient ne mordent pas), plein de citations de la presse du CCI, Cajo défend face à un public hostile d'extrême-gauche que le reproche qui est fait de « faire le jeu de la droite » est totalement injuste : les partis de droite patronaux étaient conscients mieux que personne de l'intérêt qu'avait pour eux le mouvement syndical; nous l'avons soutenu aussi bien que nous le pouvions.
En 1987, apparut clairement le fait que Cajo était en tout premier lieu un internationaliste convaincu lorsque, plus ou moins par erreur, le CCI et un certain nombre de ses membres et sympathisants fut invité à participer à une conférence du groupe Daad en Gedachte. Quelques-uns de nous étaient effectivement présents, et sur notre insistance, la question de l'internationalisme prolétarien avait été mise à l'ordre du jour. A notre grande surprise, nous nous sommes soudain retrouvés aux côtés de Cajo et Jaap face à pratiquement tous les "jeunes" du groupe, favorables à l'antifascisme et prêts à prendre la défense de la démocratie bourgeoise. Nous avons publié un compte-rendu de cette réunion dans notre presse. Il est devenu évident, quand cette question politique de la première importance fut reléguée dans ce groupe à un rang secondaire, que le groupe sombrait dans l'académisme journalistique et ne pouvait plus subsister. Cajo et Jaap étaient des internationalistes, ils ont dénoncé toute leur vie durant les camps fasciste, stalinien et démocratiques avec la même force; mais, bien qu'au sein de leur propre groupe, ils n'ont pas semblé être en mesure de faire passer tout cela à la nouvelle génération. Les plus jeunes ont commencé à se retirer, tendance encore renforcée par l'effondrement du bloc de l'Est, lorsque tout ce qui ressemblait au Marxisme sentait le soufre.
En 1990, à l'occasion des 25 ans du groupe, parut une « rétrospective » résumant le contexte et les positions de Daad en Gedachte. Mais contrairement à l'intention, cela n'attire plus de nouveaux lecteurs, et encore moins de nouveaux collaborateurs. Ce que nous avions vu arriver en 1981 à l'intérieur du Communistenbond Spartacus, les "jeunes" voulant quitter alors que les plus "âgés" veulent continuer, se répète dix ans plus tard dans le groupe Daad en Gedachte. En 1991, après l'effondrement du bloc de l'Est, nous avons invité Cajo pour discuter avec lui du Manifeste du 9ème congrès du CCI à propos de l'effondrement du bloc de l'Est et du stalinisme, publié en sept langues. Nous avons aussi essayé de le pousser à présenter une introduction sur ce sujet pour une réunion publique du CCI. Il était particulièrement ému et remonté : « Je suis totalement en désaccord avec vous, mais je trouve extraordinairement important qu'un tel document soit diffusé à l'échelle internationale ». Il adopta cette même attitude en 1992, lorsqu'il fit la demande de faire publier en néerlandais notre livre sur la Gauche Hollandaise, « la seule étude qui traite de ce sujet dans sa totalité », et pour lequel il avait lui-même fourni beaucoup d'informations et de documents, alors qu'il disait être en désaccord avec beaucoup de points développés dans ce livre, ce qui dépassait toute attente. La publication du périodique Daad en Gedachte devait se poursuivre jusqu'à juillet 1997, mais avec toujours moins de collaborateurs. La structure d'organisation du groupe, celle d'un cercle d'amis, rendait toujours plus difficile sa cohésion. Après la maladie et le décès de Jaap, Cajo se retrouvait seul à assumer cette tâche. Un appel de notre part à ne pas abandonner la publication parce qu'elle signifierait un énorme appauvrissement pour la diffusion des positions internationalistes de la Gauche Hollandaise est resté sans suite. Nous écrivions: « Quelles que soient les positions et les analyses qui nous séparent, nous considérons ce courant politique comme une part fondamentale de l'héritage historique du mouvement ouvrier qui a contribué visiblement à son progrès théorique et pratique » (Wereldrevolutie, n° 85, décembre 1998).
En novembre 1998, Cajo, alors âgé de 83 ans, a donné une série de conférences en Allemagne, où nous étions présents, et dont nous avons publié un compte-rendu dans notre presse internationale (ea Weltrevolution, n° 92, Wereldrevolutie, n° 92, World Revolution, n° 228). Ces conférences ont touché des salles d'une centaine d'auditeurs et de participants au débat. Nos camarades en Allemagne ont été très impressionnés par les analyses précises de Cajo et ses grandes qualités humaines. Toute sa vie, il a donné des conférences, toujours suivies d'un débat et non d'une "heure de questions", non seulement aux Pays-Bas mais dans toute une série de pays comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, et même aux Etats-Unis, en Russie et en Australie. En 2000, nous avons invité Cajo à une réunion publique à Amsterdam, sur la question Le Communisme de conseils, un pont entre marxisme et anarchisme? Cajo n'est pas venu, mais face aux tentatives d'amalgamer la Gauche Hollandaise à l'anarchisme, il nous a écrit, et nous avons salué cela dans notre presse: « Je ne suis absolument pas anarchiste », et « De la méthode de Marx qu'il applique dans ses analyses, de toute dialectique ou réelle compréhension de ce qu'est le marxisme, les anarchistes ne comprennent rien » (Wereldrevolutie, n° 91).
Nous avons visité Cajo pour la dernière fois en 2005, chez lui, et quelque mois plus tard dans la maison de repos où il avait été transporté. Il ne nous a plus reconnus, mais il parlait encore beaucoup de ses activités, même si les noms ou les lieux commençaient à lui échapper. Contrairement à ce que prétend la presse anarchiste, il n'est pas « mort dans le dénuement » : dans l'institution il était bien soigné et ses enfants y ont veillé. Mais il ne recevait plus beaucoup de visites des camarades.
Les archives de Cajo, une mine d'or de presque six mètres, reposent à l'Institut International de l'Histoire Sociale à Amsterdam. Mais ce sont surtout les plus de soixante-dix ans pendant lesquels Cajo Brendel, avec toutes ses facultés et de toutes ses forces, la plupart du temps « contre le courant » a porté haut le flambeau de l'internationalisme prolétarien qui font de lui quelqu'un d'exceptionnel dans l'histoire de la Gauche Hollandaise, dont il était le dernier représentant.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [95]
Campagne de criminalisation de la grève des cheminots : la Sainte Alliance de toutes les fractions du capital et des médias
- 4120 lectures
C'est avec un cynisme sans borne et avec la complicité de la grande majorité de ses médias (notamment de ses chaînes de télévision) que la classe dominante s'est efforcée pendant 9 jours, à chaque édition du journal télévisé, de nous montrer comment la France était menacée par une "petite minorité" de "rebelles" qui ne veulent pas se soumettre à la loi implacable du capital, celle de la misère et de l'exploitation. L'épouvantail Sarkozy a certainement la "tête de l'emploi". Mais il n'est pas le seul. La politique de "fermeté" du gouvernement à qui la France "a fait confiance" devait apparaître tous les jours sur le petit écran dans l'allure "ferme", "déterminée", "musclée" de François Fillon, Patrick Devedjian et Rachida Dati (caricature du personnage de Wald Disney, Cruella, la "preneuse d'otages" des 101 Dalmatiens). Face au mouvement de grève des étudiants et des cheminots, la classe dominante a agité non seulement l'épouvantail Sarkozy mais également tous les autres tyrannosaures du gouvernement pour terroriser et paralyser les travailleurs et mener une campagne sans précédent de criminalisation des grévistes. Une véritable chasse aux sorcières aux relents du maccarthysme des années 1950 aux États-Unis1. Grâce à la manipulation des images, quelques interviews ont été soigneusement sélectionnées d'"usagers" soit disant "pris en otage" : les manifestants du dimanche de "Liberté Chérie" et certains usagers, notamment d'origine africaine (une immigration "choisie" au profit de la propagande télévisée ?). Les montages les plus grossiers ont été étalés à outrance surtout pour dissuader tous ceux qui (comme les travailleurs de l'Éducation nationale, et notamment les instituteurs) seraient tentés à leur tour de "prendre les usagers en otage" pour engager la lutte contre les attaques du gouvernement et apporter leur solidarité aux cheminots et aux étudiants. Le 21 novembre, au lendemain des manifestations massives des fonctionnaires, les médias nous ont sorti un nouveau "scoop" : après avoir débusqué des "khmers rouges" et des "terroristes" parmi les étudiants en lutte contre la loi Pécresse, on apprend avec effroi que des actions de sabotage ont été "coordonnées" et "planifiées" dans toute la France sur des équipements de sécurité des voies ferrées mettant ainsi en péril la vie des usagers. Ce qui a permis à notre "transparent" Premier ministre d'exister un peu en affirmant, haut et fort, que les "coupables seront sévèrement punis". C'est une "petite minorité" qui veut "politiser" la grève des cheminots (car il ne faut par confondre un mouvement "social" et "syndical" avec un mouvement politique, dixit le magouilleur politicard Bernard Thibault2). Comme chacun sait, les travailleurs, dans un pays "démocratique", n'ont pas le droit de se mobiliser sur un terrain "politique"... sauf pour aller coller des affiches lors des foires électorales. Dans une société capitaliste en pleine décomposition, la seule "politique" acceptable, c'est celle des petits hooligans "anti-bloqueurs" de la Fac de Nanterre3.
Ces derniers ne peuvent pas être "sévèrement punis" tout simplement parce que le journal de 20 heures a bien pris soin de ne pas divulguer les images trop "choquantes" de ce "fait divers" (que beaucoup ont pu voir d'ailleurs sur Internet !).
La ficelle était tellement grosse (comme l'ont révélé les "bafouillements" de PPDA au journal de 20 heures) que la classe dominante a dû rapidement mettre un bémol à ces "reportages" cousus de fil blanc et à ces "bavures verbales" des pompiers pyromanes. Une grande majorité des travailleurs qui ont pris les transports aux heures de pointe dans la région parisienne n'ont pas hésité à exprimer, malgré la "galère" dont on nous a rebattu les oreilles heure après heure, leur profonde sympathie envers cette "petite minorité" de "preneurs d'otages" (car ils ont beaucoup apprécié le courage de ces cheminots et traminots qui ont mené une grève non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour toute la classe ouvrière). Certains "usagers en colère" ont même osé dire à d'autres usagers qui attendaient les rames de métro sur les quais, le jour de l'annonce des fameux "sabotages organisés et planifiés" : Ceux qui ne sont pas contents de la grève ont eu le président qu'ils méritent ! Quant aux "manifestants du dimanche", ils ont dû sortir par l'escalier de service tant leurs gesticulations les a fait apparaître, lors de la journée de "galère" qui a rassemblé 750 000 "usagers" dans les manifestations du 20 novembre, comme de piètres "guignols de l'info" ! Le constat que l'on doit faire, c'est que les médias de notre belle république "démocratique", aux ordres du capital, n'ont eu aucun scrupule à mettre en pratique cette phrase du chef de la propagande nazie, Goebbels : "Un mensonge énorme porte avec lui une force qui éloigne le doute" (sauf que nous ne sommes plus dans les années 1930 et que c'est maintenant l'inverse qui est vrai : "plus un mensonge est gros, plus il ouvre la porte au doute"). Cette propagande honteuse de criminalisation des grévistes (qui a commencé avec la stigmatisation des "khmers rouges " des universités de Rennes et Nanterre) n'a pu se déchaîner qu'avec la bénédiction de tous ces grands défenseurs de la classe ouvrière que sont les partis "socialiste" et "communiste" et autres "révolutionnaires" en peau de lapin : notre "Arlette nationale", le petit facteur Besancenot (sponsorisé par l'ex-"lider maximo" de la LCR, Alain Krivine), et tout le gratin de la gauche "écolo" de José Bové à Dominique Voynet. Tous ces brillants "démocrates" se sont enfermés dans un silence très "actif" et très "bruyant"4. C'est bien ce qu'on a vu à la manifestation enterrement de la lutte des cheminots le 20 novembre où il n'y avait aucune banderole syndicale dénonçant la répression. Union sacrée oblige. Il faut croire que tous ces valets du capital ne savent faire entendre leur voix que lors des kermesses électorales pour aller à la soupe et pour mystifier les ouvriers.
Même les touristes étrangers en visite dans la "plus belle ville du monde" ont été époustouflés par la manifestation enterrement ubuesque du 20 novembre où les pieds nickelés de la CGT et des autres syndicats sont même allés jusqu'à faire défiler les CRS5 et le syndicat Alliance (proche de l'UMP) de la police nationale au milieu de leur cortège ! Et les touristes ont pu filmer aussi la cerise sur le gâteau : un cordon très serré de militants "anti-autoritaires" et "antifascistes" de la CNT qui, avec leurs uniformes noirs, leurs médailles (leurs badges au chat noir en colère) et leurs claquements de bottes ressemblaient plus à un détachement militaire ou une milice fasciste qu'à un groupe de militants de la classe ouvrière. C'est le monde à l'envers : les milices du capital manifestent contre les attaques du capital pendant que certains antiautoritaires se revendiquant du courant anarchiste se donnent des allures de fachos.
Les touristes qui ont pu assister au spectacle se mettent maintenant à bavarder dans les cafés parisiens : on les entend dire que la France est, décidément, un pays "très en retard" (pour ne pas dire politiquement "arriérée"). Le "populisme" à la française est aujourd'hui devenu une curiosité touristique (à défaut d'être reconnu par l'UNESCO comme "chef-d'œuvre en péril" à inscrire au "Patrimoine de l'Humanité"...). Heureusement que la classe ouvrière, elle, a un peu relevé le niveau : victime des manoeuvres de division syndicale, elle n'a pas pu se mobiliser massivement pour apporter sa solidarité aux cheminots. Mais le patron de la CFDT Chérèque s'est fait virer de la manif manu militari et a été obligé de partir en courant sous escorte de sa garde rapprochée tandis que le patron de la CGT s'est fait siffler. Ce coup de théâtre, non prévu au programme, n'était pas un numéro de "politique people" affectionné par les médias mais bien une première riposte politique de la classe ouvrière au sale travail des centrales syndicales, partie prenante de la Sainte-Alliance des défenseurs du Capital !
Sylvestre (23 novembre)
1 Le "maccarthysme" a été une campagne de "chasse aux sorcières" (appelée aussi "terreur rouge") aux relents antisémites que certains secteurs de droite de la bourgeoisie américaine, sous la conduite du sénateur McCarthy, avaient déchaînée au début des années 1950 (dans le cadre des tensions impérialistes de la "guerre froide" entre les deux blocs impérialistes rivaux, celui de l'URSS stalinienne et du bloc "démocratique" occidental). Toute une série de personnalités du monde intellectuel ou artistique (comme Joseph Losey) ont été inscrites sur une "liste noire" et persécutées, accusées d'être des "communistes", des "ennemis de la nation", des espions à la solde de l'URSS. Au cours de cette période, cette campagne hystérique relayée par les médias a permis au capital américain de bâillonner les droits "démocratiques" et la liberté d'expression aux États-Unis. Tous les films à coloration "sociale", notamment, ont été mis à l'index. En ce sens, c'était aussi une campagne de terreur contre les ouvriers qui voulaient se défendre contre l'exploitation capitaliste.
2 En URSS (qui avait les faveurs du parti de Bernard Thibault) non plus les travailleurs n'avaient pas le droit de s'engager dans un mouvement politique. La loi du silence a régné en maître pendant plus d'un demi siècle. Et cette "petite minorité" de gestionnaires du capitalisme d'État en URSS, qui vivaient grassement de l'exploitation du travail de la "grande majorité" des travailleurs, a envoyé les tanks pour réprimer dans le sang les ouvriers qui, en URSS, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, menaient des luttes "politiques".
3 Ainsi, à la fac de droit de Nanterre, les anti-bloqueurs de droite et d'extrême droite voulaient (au nom de la "démocratie" et de leur "liberté chérie"), bloquer la solidarité avec les autres étudiants en lutte contre les attaques du gouvernement. Les anti-bloqueurs se sont engouffrés dans la campagne lancée par les médias officiels (la prise en otage des étudiants "démocrates", fine fleur de la Nation, par les "khmers rouges" et autres "terroristes" !). Les anti-bloqueurs leur jettent des projectiles au visage (y compris des morceaux de viande !). Le président de l'université qui ne veut pas faire de "politique" (sic !) fait appel aux forces de l'ordre. Les étudiants anti-bloqueurs encouragent les CRS en scandant : "Allez les bleus !" (l'équipe nationale de foot de Zizou). Excités par les anti-bloqueurs, les milices du capital commencent à montrer les dents. Pour leur part, les bloqueurs commettent une petite "erreur historique" en criant : "Pétain, reviens ! T'as oublié tes chiens !" (en effet, le corps des CRS n'a pas été créé par le maréchal Pétain, mais en 1944 avec une forte participation de "résistants" et des membres et sympathisants du PCF afin de contrecarrer le poids des pétainistes au sein de la police nationale et particulièrement de ses forces de répression). Un ordre est donné (on entend sur un clip vidéo qui a été diffusé sur le web [96] un chuchotement : "Chargez !"). Pendant que les CRS matraquent les bloqueurs, les "enragés" anti-bloqueurs jouent les supporters. Nanterre occupée est enfin libérée. Les "anti-bloqueurs" applaudissent, acclament les CRS en chantant la Marseillaise. On se serrait cru au "bon" vieux temps de la "Libération" de Paris, sauf que ce sont maintenant les commandos de l'"intelligentsia" de droite qui reprennent à leur compte le même état d'esprit revanchard et xénophobe du PCF de 1944 (qui titrait dans son journal "L'Humanité" : "Plus forts les coups sur le boche chancelant ! ", "A chaque parisien son boche !"). La propagande télévisée de criminalisation des grévistes a été soigneusement orchestrée sur fond de campagne anti-"bolchevique" lancée par la presse et les "historiens" du capital (à l'occasion de l'anniversaire de la révolution d'Octobre 1917). Elle a aussi des relents nauséabonds des appels au pogrom (placardés sur les murs des rues de Berlin) et organisée par le parti "socialiste" allemand contre les spartakistes en 1919. Les milices anti-ouvrières du SPD ont fini par faire régner l'ordre du capital à Berlin en assassinant lâchement Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg qui appelaient à des luttes ouvrières "politiques". Pour compléter ce sinistre tableau, on peut encore signaler les menaces ouvertes (qui ont été largement diffusées par exemple sur le site Internet Indymédia) où des défenseurs de la "démocratie" n'ont pas hésité à menacer pendant plusieurs jours les enfants de la classe ouvrière (étudiant à la faculté de Paris 3-Censier) de leur "mettre une balle dans la tête". Ils sont même allés jusqu'à décrire en détail les armes qu'ils vont employer si les grévistes continuent à contester les lois dictées par le capital (alors qu'à Censier, il n'y a jamais eu d'affrontements entre bloqueurs et anti-bloqueurs !). Voilà à quoi conduit la propagande médiatique du journal de 20 heures, les "bavures" verbales du président de la république (qui a dit vouloir "liquider" mai 68) et la délation des Présidents d'université (qui veulent faire de leur boutique des "pôles d'excellence") !
4 Sur les sites Web de "Rouge" (hebdomadaire de la Ligue "Communiste " "Révolutionnaire") et de "Lutte Ouvrière" (journal d'Arlette Laguiller) on ne trouve, en effet, aucune dénonciation de la répression contre les étudiants. Peut-être que ce silence est destiné à ne pas froisser le PC, et surtout le PS, avec qui les "trotskistes" s'apprêtent à passer des accords pour les élections Municipales.
5 Il faut reconnaître que, sans leurs armures et leurs matraques, ces spécialistes de la répression n'étaient pas très impressionnants. Ainsi, à Paris, on a pu voir un CRS aux allures de clochard (style inspecteur Columbo) poussant un petit chariot avec une pancarte : "pour remplir les caddies". Dans une grande ville de province, un CRS schizophrène est même venu nous acheter notre supplément qui titrait "A bas l'État policier !
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Campagnes séparatistes et unitaristes en Belgique: un faux choix!
- 3305 lectures
Situations territoriales:
- Belgique [97]
Catastrophes de l'été : c'est le capitalisme qui tue
- 3407 lectures
En plus des dérèglements climatiques (avec les victimes de la plus terrible mousson depuis un siècle en Inde, au Bengla Desh, en Chine, des inondations en Grande-Bretagne, de la sécheresse dans l'Est et le Sud de l'Europe) (voir par ailleurs), plusieurs catastrophes ont marqué cet été : accident ferroviaire libérant des produits toxiques en Ukraine, séisme au Japon provoquant une fissure dans le réacteur d'une centrale nucléaire, catastrophe aérienne meurtrière au Brésil, effondrement d'un pont aux Etats-Unis. Toutes ces catastrophes tragiques, de natures différentes, sont de plus en plus fréquentes. Elles ont pourtant les mêmes causes fondamentales. Alors que les médias plaident chaque fois que ces calamités qu'on nous présente comme des faits divers seraient le résultat de la fatalité ou d'une mystérieuse loi des séries avec les mêmes mensonges écœurants, la responsabilité première de ces désastres incombe au système capitaliste dans sa course folle à la rentabilité et aux profits immédiats face à la concurrence : produire et vendre au plus bas coût de revient, vétusté, usure jusqu'à la corde des infrastructures et mise en sur-régime permanent des machines, non renouvellement du matériel, économies de personnel, surexploitation de la main d'œuvre, sans la moindre préoccupation des risques pour l'environnement et surtout avec le mépris le plus total de la vie humaine sur la planète entière.
Un mode de production toxique qui sème la mort
Dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Lviv, près de la frontière polonaise, c'est un train transportant 15 citernes de phosphore jaune, produit inflammable et très toxique qui a déraillé le 16 juillet : des valves de pression étaient cassées sur les citernes vétustes, qui auraient dû être retirées du service il y a cinq ans. 6 wagons-citernes remplis de ce phosphore destiné à la fabrication d'engrais se sont retrouvés éventrés, laissant échapper un nuage toxique couvrant un territoire de 86 km2, sur une zone qui compte plus de 11 000 habitants. 16 000 personnes ont subi des examens médicaux dont 184 ont dû être hospitalisées pour empoisonnement aux vapeurs de phosphore. Certains d'entre eux n'avaient pas quitté l'hôpital 3 semaines après. Malgré la pollution de la terre et de l'air, l'évacuation n'a pas été assurée et laissée à l'initiative des habitants de la région : on a certifié que les produits se dissiperaient sans plus de dommage dans l'atmosphère et le porte-parole de l'antenne régionale du ministère des Situations d'urgence s'est empressé d'assurer que la "situation était sous contrôle" et sans danger... Ces propos ne tardaient pas à être démentis par la réalité : des résidus de phosphore se sont spontanément enflammés à nouveau au contact de l'air le 3 août dernier, faisant courir à la population de nouveaux risques d'affection des voies respiratoires et de lésions mortelles. On mesure le risque permanent quand on sait que, pour un seul pays comme l'Ukraine, quelque 50 millions de tonnes de marchandises, dont 70% de substances dangereuses comme le chlore, l'azote, l'ammoniaque et les produits pétroliers, sont transportés chaque année par rail. D'ailleurs, ce 3 août, dans la même région de Lviv, c'est une locomotive qui percutait trois wagons-citernes cette fois emplis de pétrole provoquant un incendie à proximité d'une raffinerie et d'une entreprise de peinture. Une semaine auparavant, dans la même station, une autre rame avait déraillé et était entrée en collision avec des wagons entreposés
Au Japon, le 16 juillet, dans la région de Niigata au nord-ouest du pays, a eu lieu un séisme d'une ampleur de 6,8 sur l'échelle de Richter. Si le bilan du séisme (9 morts, un millier de blessés, plus de 500 maisons individuelles et de 300 immeubles détruits) est très loin d'atteindre celui du tremblement de terre de Kobé le 17 janvier 1995 (6400 morts, 40 000 blessés, 200 000 habitations détruites), il a provoqué l'incendie d'un transformateur électrique dans la plus grande centrale nucléaire du monde, Kashiwazaki Kariwa. L'opérateur de la centrale, Tokyo Electric Power Co. (Tepco), n'a annoncé que plusieurs heures après l'existence d'une fuite de 1200 litres d'eau contaminée, après avoir affirmé dans un premier temps que la secousse n'avait pas eu de conséquences sur la centrale et après avoir nié toute fissure dans le réacteur. Une centaine de fûts emplis de déchets contaminés ont en outre été renversés et le contenu de certains d'entre eux s'est répandu, selon l'agence de presse Kyodo. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a recensé pas moins de 67 anomalies dans le fonctionnement de la centrale. Tepco et une entreprise concurrente avaient déjà reconnu il y a quelques mois avoir dissimulé plusieurs accidents. Le gouvernement nippon a toutefois continué à assurer que la fuite n'avait eu aucune conséquence sur l'environnement et certaines "sommités scientifiques" se sont empressés de rassurer : aucun risque de contamination des populations.
"Je crois que l'on ne peut faire fonctionner les centrales nucléaires qu'avec la confiance de la population", a cyniquement déclaré le Premier ministre Shinzo Abe aux journalistes. "Personnellement, je pense qu'une centrale nucléaire est l'endroit le plus sûr en cas de séisme", a renchéri imperturbablement un éminent professeur à l'Institut de technologie de Tokyo et spécialiste de l'énergie nucléaire 1.
Treize autres unités nucléaires sont en construction et les autorités japonaises n'ont pas l'intention de renoncer à une énergie qui fournit 30 à 40% de l'électricité consommée dans le pays. Cependant, le gouvernement a dû se résoudre à fermer la centrale pour une durée indéterminée (au moins pendant un an) et l'AIEA s'est engagée à inspecter cette dernière.
Le risque n'est limité ni au Japon ni aux secousses sismiques Fin juin, un incendie dans une centrale nucléaire dans le nord de l'Allemagne (à Krümmel dans le Land du Schleswig-Holstein, à proximité d'Hambourg) a provoqué une panne de la pompe de stockage d'eau du réacteur et une série de dysfonctionnements dans le mécanisme d'extinction automatique anti-incendie du réacteur, relançant une nouvelle série de polémiques sur l'avenir du nucléaire. Le spectre d'un nouveau Tchernobyl est partout 2.
Une récente étude de la Banque mondiale fait état le la mort prématurée de 350 à 400 000 morts par an en Chine à cause de la pollution de l'air (dont 30 000 enfants). 300 000 autres mourraient en raison de la mauvaise qualité de l'aération dans les bâtiments. des ateliers et des usines (sans compter les conditions de travail ou la manipulation de produits dangereux). Dans les campagnes, c'est la mauvaise qualité de l'eau qui serait responsable de 60 000 décès annuels.
Le capitalisme est une catastrophe pour l'humanité
Le 1er août, un pont enjambant le Mississipi s'est effondré à Minneapolis dans le Minnesota, Une cinquantaine de véhicules ont basculé dans les eaux du fleuve, 20 mètres plus bas : 5 morts, 79 blessés, une dizaine de disparus. La structure de ce pont d'acier et de béton d'une longueur de 160 mètres, sur lequel passait une autoroute à huit voies construit il y a 40 ans avait été inspecté en 2005 et 2006 mais aucun défaut structurel n'avait alors été identifié. Il était pourtant classé depuis 2005 parmi les "ouvrages défectueux" 3. Des travaux sur la charpente métallique étaient en cours au moment du drame à une heure de sortie du travail, sans toutefois la moindre décision d'interrompre la circulation. Selon le Bureau des transports local, 200 000 véhicules franchissaient ce pont chaque jour et un autocar scolaire transportant une soixantaine d'enfants a évité le drame de justesse 4.
Le pays compte 756 ponts avec une structure similaire en acier dont au moins 27% sont jugés dans un état aussi alarmant que celui qui s'est effondré.
Les lois du profit, la rentabilité immédiate, la concurrence acharnée entre Etats constituent une menace permanente pour le présent comme pour l'avenir du monde. Les chantres du progrès et de la civilisation sont devenus des apprentis-sorciers, les grands prêtres d'une véritable danse de mort, d'un atroce sabbat infernal autour de l'autel du capitalisme décadent qui, au mépris le plus total de la vie humaine, livrent leurs esclaves salariés à des rituels sacrificiels plus absurdes et barbares que les pires et les plus cruelles sociétés de l'histoire.
L'actualité en fournit un autre sinistre exemple dans un tout autre domaine. Au Brésil, le 17 juillet, un avion Airbus de la compagnie TAM a dérapé sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sao Paulo, Congonhas, en pleine zone résidentielle, balayant une avenue très fréquentée avant de percuter une station-service et un entrepôt de la TAM qui ont pris feu. Bilan : au moins 207 morts, la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire du Brésil 5.
Depuis des années, le personnel des aéroports du Brésil proteste contre la détérioration de ses conditions de travail : une quasi-absence de vérification des avions par économie financière et un bourrage de kérosène acheté à bas prix, du matériel non renouvelé, un trafic aérien toujours plus dense allant de pair avec une politique de suppression des personnels mécaniciens et des contrôleurs aériens pour obtenir une rentabilité maximum.
A Sao Paulo, l'enquête a soulevé une multitude d'anomalies : la piste était notoirement connue depuis des années comme très dangereuse, ne remplissant pas les conditions de sécurité avec une aire d'atterrissage trop courte un trafic trop dense.
Le revêtement avait été refait le mois précédent mais les travaux d'aménagement entrepris n'avaient pas été terminés et la piste avait été remise en service fin juin sans que le rainurage des pistes permettant d'évacuer les eaux de pluie ait été effectué et beaucoup ont dénoncé une réouverture prématurée pour des motifs purement commerciaux. Quatre autres incidents similaires ("glissades incontrôlés sur la piste) avaient déjà eu lieu au cours de ces derniers mois. Or, au moment de l'atterrissage, le sol était entièrement détrempé par de violentes pluies. Et la veille de l'accident, le gouvernement avait refusé la fermeture de la piste, pourtant réclamée par les contrôleurs aériens de l'aéroport. De plus, l'avion de la TAM était dépourvu d'un de ses deux inverseurs de poussée, qui permettent à l'appareil de ralentir à l'atterrissage. La chaîne de télévision Globo TV a même affirmé que cet équipement a été retiré après un dysfonctionnement la semaine précédente et que l'avion a difficilement freiné sur cette même piste la veille de l'accident. Une vidéo a montré que l'avion a accéléré après avoir touché le sol tout près de la marque indiquant la distance limite pour les atterrissages, ce qui pourrait signifier que le pilote a tenté de redécoller en réalisant qu'il ne pourrait freiner à temps.
Un responsable de la compagnie aérienne avait cependant assuré que les normes techniques permettaient à l'avion de voler même en l'absence de deux inverseurs de poussée. Pourtant, une panne identique avait tué 99 personnes sur le même aéroport en 1996.
"Le gouvernement tente manifestement de convaincre l'opinion publique que la piste de Congonhas n'est pas en cause. Ils vont tout faire pour accuser le pilote", a réagi le président d'une association de pilotes
Effectivement. Moins de 15 jours après la catastrophe de Congonhas, l'enquête officielle tendait à rejeter la faute sur le pilote dans l'accident6.
C'est face à de tels dangers et contre de telles conditions de travail que les contrôleurs aériens de Brasilia, de Curitiba, de Manaos et de Salvador s'étaient spontanément mis en grève le 30 mars dernier, adressant un message prémonitoire à tous les ouvriers dans un Manifeste avant de paralyser le service, d'entamer une grève de la faim et de s'enfermer dans les locaux pour faire pression sur les autorités du Commandement de l'Aéronautique, organe militaire responsable du contrôle du trafic aérien au Brésil (voir RI n° 380 [98], juin 2007) : "Nous touchons les limites de l'inhumanité, nous ne sommes plus en état de continuer à assumer ce travail si important pour le pays dans les conditions où nous sommes dirigés et traités. Nous n'avons plus confiance ni en nos équipements ni en ceux qui nous gouvernent. Nous travaillons les fusils braqués sur nous...". Déjà fin septembre 2006, en plein Mato Grosso, une collision entre un Boeing et un avion d'affaires avait tué 154 passagers. Les contrôleurs avaient déjà effectué plusieurs débrayages pour protester contre les accusations du gouvernement et des autorités militaires qui les en rendent responsables. Dans leur Manifeste, les travailleurs se défendent contre ces calomnies : "Six mois après la collision du 29 septembre, aucun signe positif n'a été fait pour résoudre les difficultés rencontrées par les contrôleurs aériens. Au contraire, ces difficultés ne font que s'aggraver. Comme si les difficultés d'ordre technique et de conditions de travail ne suffisaient pas, on nous accuse de sabotage dans le seul but de masquer les failles de gestion du système...". La grève exprimait l'indignation des contrôleurs aériens face à la riposte du gouvernement et du haut commandement militaire qui ont en outre décidé d'emprisonner certains d'entre eux : ce Manifeste et cette grève dénonçaient déjà toute l'hypocrisie de l'ensemble de la bourgeoisie brésilienne et sa responsabilité dans la crise des transports aériens, tant de la part de la gauche aujourd'hui au gouvernement que de la droite. La bourgeoisie tentait d'occulter aussi que le déchaînement de la concurrence entre compagnies aériennes, la politique financière de baisse des coûts, la survente de billets, le surencombrement de l'espace aérien, l'augmentation du nombre de vols conduisent de plus en plus le système de contrôle aérien et le pilotage des avions lui-même à s'effectuer dans des conditions extrêmes.
Les conditions se sont encore aggravées aujourd'hui. Six jours après l'accident de Congonhas, une panne d'électricité et des générateurs de secours a encore paralysé le centre de contrôle aérien de l'Amazonie, entraînant l'annulation de 10% des vols sur le territoire brésilien et contraignant une fois de plus les contrôleurs à travailler dans les conditions les plus précaires.
Seule la classe ouvrière à travers le développement de ses luttes peut non seulement désigner mais surtout combattre le vrai responsable de toutes ces tragédies : la société capitaliste.
Wim (10 août)
1 Il est cependant vrai que le Japon est de loin l'Etat dont les centrales nucléaires ont été les mieux équipées pour résister aux séismes. Dans un pays comme la France par exemple où certaines centrales sont construites à proximité ou sur des zones de faille (Alsace, PACA,...) sans la moindre protection anti-sismique, on peut envisager l'horreur que provoquerait un tremblement de terre...
2 Rappelons que le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl avait explosé le 26 avril 1986. Les matières radioactives se sont déposées partout provoquant des cancers de la thyroïde, plus particulièrement dans de vastes zones du Bélarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine. On a d'ailleurs fait croire que le nuage radioactif s'arrêtait aux frontières, sous couvert de protection de l'anticyclone des Açores jusqu'à ce l'on avoue qu'il avait balayé toute l'Europe d'Est en Ouest. Officiellement, le nombre de morts à cause de Tchernobyl varie entre 50 000 et 150 000, l'ex- secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan a pourtant avoué par la suite qu'au moins 7 millions de personnes avaient été affectées par cette catastrophe.
Sur le toit et aux alentours immédiats de la centrale, une cinquantaine d'opérateurs étaient chargés dans les premiers jours suivant la catastrophe de collecter les débris très radioactifs. Chaque opérateur ne disposait que de 90 secondes pour effectuer sa tâche. Il était exposé à cette occasion à des niveaux de radiations extrêmement élevés dont ne le protégeaient guère des équipements de protection dérisoires, principalement destinés à l'empêcher d'inhaler des poussières radioactives. Nombre d'entre de ces travailleurs en première ligne ont développé par la suite des cancers et sont morts dans les années qui ont suivi.
On estime à 350 000 le nombre d'agents de décontamination ou « liquidateurs » appartenant à l'armée, au personnel de l'usine, à la police locale et aux pompiers ayant participé dès le début au confinement et à la décontamination des débris radioactifs au cours de la période 1986-1987. Près de 240 000 de ces « liquidateurs » qui se succèdent à la cadence d'un toutes les 5 minutes ont reçu les doses de rayonnement les plus fortes alors qu'ils procédaient à des activités importantes d'atténuation des effets de la radioactivité dans une zone de 30 kilomètres alentour. Par la suite, le nombre de « liquidateurs » répertoriés est passé à 600 000. Sous le cœur du réacteur en fusion, la dalle de béton menaçait de fondre. On a ainsi amené des dizaines de milliers de mineurs des mines des environs de Moscou et du Donbass pour creuser un tunnel menant sous le réacteur afin d'y creuser une salle. Un serpentin de refroidissement à l'hélium devait y être installé pour refroidir la dalle. Les mineurs travaillaient dans des conditions très difficiles dues à la température élevée et au niveau massif de radiations. Leur sacrifice sera quasiment vain car le circuit de refroidissement ne sera jamais installé et finalement remplacé par un sarcophage de béton coulé par dessus. Depuis quelques années, des fissures sont apparues à leur tour dans ce sarcophage, mais ni l'Ukraine ni la Russie ni aucune autre instance ne veut assumer les nouveaux risques ni le surtout financement énorme des travaux nécessaires... On a fait croire que cette tragédie était une exception due à l'arriération des pays de l'Est et de sa technologie, au manque d'entretien des infrastructures héritées de l'ère stalinienne et que pour les centrales des Etats les plus modernes, un tel risque était nul. La fissure de la centrale japonaise et avant elle, l'accident de Three Mile Islands aux Etats-Unis ont démontré le contraire. Le même risque existe partout.
3Une étude similaire fait aussi état d'une soixantaine de barrages qualifiés de « défectueux » et « à haut risque » dans un pays tel que la France.
4Dans la même période, d'autres "accidents" dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques ont été évitées d'extrême justesse. Ainsi, le l8 juillet, une canalisation souterraine de gaz a explosé à New York en plein coeur de Manhattan, au croisement de Lexington Avenue et de la 41e Rue, tout près de la gare de Grand Central semant une énorme panique (car à cause de la force et la violence de l'explosion, la population a cru à un nouvel attentat terroriste et revivre le même cauchemar que le 11 septembre 2001). Une personne est morte d'une crise cardiaque et une trentaine d'autres ont été blessées. La canalisation de 60 cm de diamètre, installée en 1924, aurait explosé sous un choc thermique. Le maire de la ville a exprimé des craintes vis-à-vis d'une libération éventuelle d'amiante. New York est truffée de canalisations souterraines vieillissantes et plusieurs dizaines de canalisations ont explosé au cours de ces vingt dernières années dans la ville.
Le 29 juillet, un incendie s'est déclaré dans une rame de métro parisien sur l'une des lignes les plus fréquentées du réseau. 150 voyageurs coincés dans les souterrains de la station ont été intoxiqués par une fumée nocive à l'intérieur d'un des compartiments. 35 personnes ont été momentanément hospitalisées. L'embrasement d'un patin de freinage complètement usé d'un wagon est à l'origine de l'incident. Le bilan aurait pu être nettement plus lourd si l'incident ne s'était pas produit un dimanche matin à un moment où l'affluence hebdomadaire était la plus faible.
C'est une indication des dangers permanents auxquels les populations du monde entier sont exposés en permanence.
5 Ce n'est pas la première fois qu'un avion s'écrase en pleine ville sur un immeuble, sur une autoroute ou sur une zone habitée (sans pouvoir incriminer un quelconque attentat terroriste). La liste serait trop longue : au Venezuela, le 16 mars 1969, un DC9 s'était écrasé sur un bidonville. Le bilan était de 163 morts et une centaine de blessés. En Europe, il suffit de rappeler deux accidents du même ordre : en octobre 1992, un Boeing 747 s'était écrasé sur deux immeubles en plein quartier ouvrier de la banlieue d'Amsterdam : 53 morts. Un effet comparable à un bombardement : immeubles éventrés, une mer de feu, des flammes de 30 mètres de haut transformant les victimes en torches vivantes ou écrasées sous des tonnes de béton et d'acier.
Le 25 juillet 2000, un Concorde (célébré comme le fleuron le plus beau et le plus avancé de la technologie) à destination de New York s'était « crashé » sur un hôtel de Gonesse dans le Val d'Oise deux minutes seulement après son décollage de l'aéroport de Roissy. Les 109 passagers étaient tués dans l'accident ainsi que 4 employés de l'hôtel. L'enquête technique avait révèle qu'une roue de l'appareil avait été endommagée au décollage par un lamelle métallique tombée d'un autre avion sur la piste. Les débris du pneu avaient provoqué la rupture d'un réservoir où le feu s'était déclaré.
6 L'hypothèse d'une "erreur humaine" elle-même en pareil cas n'aurait absolument rien d'étonnant avec les charges et les conditions de travail auxquels sont astreints les pilotes qui doivent la plupart du temps assurer des aller-retour sur de longs trajets dans la même journée, ou avec une seule heure de repos, le temps de recharger l'avion en kérosène.
Vie du CCI:
Comment le Groupe Communiste Internationaliste crache sur l'internationalisme prolétarien
- 4354 lectures
Nous avons récemment publié sur notre site Internet un article au sujet de l'intervention du GCI (Groupe communiste internationaliste) à propos de la lutte des étudiants en France [99]. Le GCI est un groupe que beaucoup considèrent comme faisant partie de la tradition de la Gauche communiste, mais comme le montrait notre article, cela est complètement faux. Derrière ce drapeau faussement radical, le tract du GCI préconise des méthodes de combat tout à fait compatibles avec le syndicalisme, tout en manifestant un profond mépris pour les efforts des jeunes prolétaires de France pour s'organiser eux-mêmes en dehors des syndicats, les appelant à "cass[er] le démocrétinisme des AG "souveraines et massives", [à] crach[er] sur les "délégués élus et révocables en permanence" ".
Dans le même registre, quand il parle des massacres impérialistes qui se propagent sur tout la planète, le GCI, lui qui se présente comme l'ennemi de tout nationalisme, crache maintenant ouvertement sur l'authentique internationalisme prolétarien.
Nous avons déjà montré cela dans un autre article : "A quoi sert le GCI ? [58]" dans la Revue internationale n°124. Dans cet article, nous pointions du doigt le fait que, pour le GCI, sur qui les méthodes du terrorisme et de la guérilla exercent depuis longtemps une véritable fascination, la majorité des actions armées attribuées à la "Résistance" en Irak sont en réalité des expressions des luttes de la classe prolétarienne. Nous citions ce passage en particulier :
"C'est tout l'appareil, les services, les organes, les représentants sur place de l'Etat mondial qui sont systématiquement pris pour cible. Loin d'être aveugles, ces actes de résistance armée ont une logique si nous prenons la peine de sortir un peu des stéréotypes et du bourrage de crâne idéologique que les bourgeois nous proposent pour seule explication de ce qui se passe en Irak. Derrière les objectifs, ainsi que dans la guérilla quotidienne qui est menée contre les forces d'occupation, on peut deviner les contours d'un prolétariat qui essaye de lutter, de s'organiser contre toutes les fractions bourgeoises qui ont décidé d'apporter l'ordre et la sécurité capitalistes dans la région, même s'il est encore extrêmement difficile de juger de l'autonomie de notre classe par rapport aux forces bourgeoises qui essayent d'encadrer la colère, la rage de notre classe contre tout ce qui représente de près ou de loin l'Etat mondial. Les actes de sabotages, attentats, manifestations, occupations, grèves... ne sont pas le fait d'islamistes ou de nationalistes pan arabes, cela serait trop facile et irait dans le sens du discours dominant qui veut absolument enfermer notre compréhension dans une lutte entre "le bien et le mal", entre les "bons et les méchants", un peu comme dans un western, évacuant une fois encore la contradiction mortelle du capitalisme : le prolétariat." ("De quelques considérations sur les événements qui secouent actuellement l'Irak" (in Communisme n°55, Février 2004).
En fait, d'après le GCI, le niveau de lutte de classe et de conscience de classe en Irak est si haut que le principal but de l'invasion de l'Irak était de réprimer le mouvement de classe - l'invasion était avant tout une "action policière" menée par ce qu'il appelle "l'Etat mondial" contre une fraction particulièrement combative du prolétariat. Et dans le chaos et les massacres qui ont suivi l'invasion, le GCI continue de voir un mouvement de classe si avancé qu'il aurait déjà atteint un niveau de lutte armée.
Il semblerait que ces distorsions délirantes du vrai cauchemar auquel est aux prises l'Irak, aient même produit des réactions parmi les sympathisants du GCI. La dernière revue, Communisme, arch 200, n°58, publie le débat entre le GCI et ses sympathisants - ce qui est pour ce groupe un pas sans précédent. La revue commence par une lettre qui exprime de sévères réserves au sujet des déclarations du GCI à propos des actions armées et des bombardements en Irak :
"Votre article concernant l'Irak, paru dans le dernier Comunismo, malgré sa tentative de se situer dans une perspective de classe, tenant compte de l'action, des difficultés et du niveau d'autonomie du prolétariat (caractéristique, comme je vous l'ai souvent dit, que je considère qualitativement positive dans les analyses de votre groupe), tombe dans l'amalgame et l'homogénéisation propres aux analyses bourgeoises qui traitent de la situation en Irak en identifiant ce qui se déroule là-bas, aux attentats sanglants et indiscriminés qui n'ont rien à voir avec les expressions de la lutte prolétarienne (qui est bien en cours). Vous tombez dans la même erreur quand vous énumérez certains attentats indiscutablement perpétrés par des fractions bourgeoises (la CIA, les pro-Saddam, la Syrie, l'Iran...?), tels ceux d'Al Hakim, de l'ONU ou encore de l'ambassade de Jordanie durant l'été 2003, comme des expressions de la lutte prolétarienne."
Cette lettre est suivie d'un long texte - on ne voit pas clairement s'il provient de la même source ou d'une autre, mais c'est apparemment le travail d'un groupe - qui, à son tour, exprime des doutes concernant certains aspects des affirmations du GCI sur le niveau avancé de la lutte de classe en Irak. Ce texte questionne l'argument du GCI selon lequel la vague de pillages qui a balayé le pays dans le sillage de l'invasion pourrait être qualifiée de façon générale de mouvement prolétarien, montrant par exemple que ce ne sont pas seulement les bureaux gouvernementaux et les palais de Saddam qui ont été mis à sac, mais aussi beaucoup d'hôpitaux qui ont été dépouillés de fournitures vitales. Il liste également nombre d'actions qui sont plus clairement sur un terrain de classe, telles que des manifestations de chômeurs ou de travailleurs demandant leur salaire. Et tout en semblant toujours d'accord avec le GCI sur le fait que "les actions armées sont pour la plupart enracinées dans la classe ouvrière en Irak", ils disent, par ailleurs, que c'est une erreur énorme de tomber dans la même homogénéisation que les médias bourgeois applaudissent en jubilant.
"Que ces attentats soient l'œuvre de partisans de Saddam, de la Syrie ou d'Iran, désireux de couvrir de boue les USA en Irak, d'islamistes ou de la CIA (si par hasard ce n'était pas la même chose) nous importe peu, ce qui par contre semble clair, c'est qu'ils tentent de diviser et de terroriser le prolétariat irakien, et c'est à nos yeux une terrible erreur que de tomber dans l'amalgame qui fait la fierté des médias bourgeois qui applaudissent ces attentats (comme l'a fait le G.C.I. dans son article sur l'Irak qui, bien qu'il parte d'une perspective de classe, contient une bonne dose d'homogénéisation et de confusion; c'est aussi ce que font les camarades de Arde[1] qui, selon nous, ont d'emblée, et sans beaucoup d'argumentation, présenté ces attentats contre l'ONU ou ces sabotages comme des expressions de l'avancée prolétarienne."
Face à cette critique, le GCI ne revient pas en arrière ; au contraire, il réitère son horrible amalgame de façon encore plus éhontée. Par exemple, devant les réserves sur le fait que l'attentat contre le Quartier général des Nations Unies soit décrit comme une expression du combat prolétarien, il réplique :
"Pour commencer notre explication, nous reprenons un exemple sur lequel il faudrait réfléchir: celui de " l'attentat contre l'ONU " que vous qualifiez allègrement de bourgeois sur base du critère insuffisant selon lequel des civils y sont morts (au cours de l'histoire, il y a énormément d'actes violents du prolétariat qui ont fait des victimes civiles). C'est précisément cet attentat qui a été le plus dénoncé par toutes les fractions bourgeoises d'opposition en Irak, et spécialement celles qui se proclament dirigeantes de "la lutte de résistance" armée en Irak."
En fait, selon toute vraisemblance, c'est le travail du groupe Zarkaoui dont beaucoup d'actions ont aussi été condamnées par une foule d'autres organisations de "résistance". Mais, de toutes façons, le GCI est tout à fait prêt à applaudir de telles attaques contre "l'Etat mondial", même quand les prolétaires qui les effectuent ont été "capturés par les forces bourgeoises" - en d'autres termes, quand ils sont ouvertement effectués par Al Qaida ou d'autres gangs terroristes bourgeois. En fait, le GCI justifie son plaisir face à la destruction des Twin Towers par exactement le même argument :
"Nous avons exposé clairement cette distinction dans la revue Communisme n°53, "Capitalisme = terrorisme contre l'humanité; contre la guerre et la répression capitaliste ", lorsque nous commentons les événements du 11 septembre. Alors que nous montrons que le prolétariat a tout intérêt à détruire ces objectifs qui représentent et réalisent parfaitement le terrorisme du capital mondial, au lieu de pleurer sur les civils morts comme l'ont fait tous les complices de la dictature démocratique, nous affirmons que cela ne signifie pas que cet attentat soit réalisé par le prolétariat en tant que classe. Plus encore, nous expliquons clairement que, même si ces actions sont réalisées par des prolétaires (dans le sens sociologique du terme), alors même qu'elles détruisent des centres de répression et de commerce mondial, actes qui suscitent toute notre sympathie, comme aux révolutionnaires du monde entier, nous n'appuyons pas les organisations qui les réalisent. Ainsi nous n'écartons pas le fait que les dites actions aient été menées par des organisations islamiques, que nous définissons comme centristes, c'est-à-dire par des organisations extrémistes de la social-démocratie qui constituent l'ultime et le plus solide rempart contre la révolution."
Ainsi, pendant que les révolutionnaires à travers le monde dénonçaient le massacre du 11 septembre comme un acte de guerre impérialiste (et un acte qu'en toute probabilité, les Etats Unis ont "laissé faire" pour justifier leurs plans de guerre) ; pendant que nous exprimions notre solidarité avec les milliers de prolétaires immolés dans ce crime barbare, le GCI ne pouvait que ressentir une "grande sympathie" pour les actions de Ben Laden et compagnie, qui sont bizarrement définis comme "centristes" (ce qui définit traditionnellement une fraction du mouvement politique prolétarien confuse et indécise ...), et qui de toute façon accomplissaient un acte - la destruction des centres de répression et du commerce mondial- qui était "dans l'intérêt" du prolétariat.
"Considérer qu'un attentat est correct ou, comme vous le dites, l'applaudir, parce qu'il frappe l'Etat bourgeois international, n'implique pas, pour nous, appuyer l'organisation qui l'a réalisé." La logique est typiquement trotskiste. Tout comme les trotskistes l'utilisent pour soutenir les nationalistes qui revendiquent un Etat, comme l'OLP, le Hezbollah ou l'armée de libération du Kosovo, de même le GCI l'a utilisée dans le passé pour justifier son soutien aux actions du Sentier lumineux au Pérou ou du Bloc populaire révolutionnaire au Salvador.
En effet, pour le GCI pour qui le point culminant de l'action prolétarienne est l'œuvre de petits groupes violents et secrets, il n'y a pas de distinction à faire entre les méthodes du prolétariat et les méthodes du terrorisme bourgeois. Il n'est pas étonnant que les sympathisants critiques du GCI soient confus. Ils veulent pouvoir discerner quels actes de sabotage, quelles attaques à la bombe contre les forces de la coalition sont réalisés par des réactionnaires islamistes ou par les forces de l'Etat qui œuvrent dans l'ombre, et lesquels sont réalisés par des "groupes de prolétaires associés". Ce qu'ils ne peuvent voir, c'est que les initiatives armées de minorités qui n'ont pas de connexion avec une classe qui lutte pour ses propres revendications et avec ses propres formes d'organisation, ne peuvent qu'être récupérées par la bourgeoisie et tournées contre les intérêts de la classe ouvrière, même si ces actions sont initialement le travail de groupes agissant plus ou moins spontanément.
A côté de l'amalgame du GCI entre la violence de classe et le terrorisme, son soutien à la Résistance en Irak est justifié par une hideuse déformation de l'internationalisme prolétarien. Des citations de l'anarchiste mexicain Ricardo Flores Magon parsèment toutes ses réponses. Magon était certainement un militant du prolétariat au 19e siècle jusqu'à ce qu'il soit assassiné par les Etats Unis en 1921. Mais certaines des citations de Magon utilisées par le GCI au sujet de la Première Guerre mondiale montrent une profonde confusion qui le sépare des internationalistes les plus clairs de cette époque. Nous citons donc Magon en 1914 :
"Quand les nôtres meurent, nous devons pleurer ; quand les imbéciles qui se battent dans l'intérêt de leurs propres bourreaux meurent, nous devons rire - cela laisse moins d'obstacles à notre combat pour la destruction du présent système. Ce ne sont pas nos frères, ceux qui meurent par milliers sur les champs de bataille de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. Ce sont nos ennemis ; ils veulent que ce système perdure ; ils sont les laquais du capital, de l'église et de l'autorité."
Juste pour bien clarifier que le GCI est en effet d'accord avec cet épouvantable passage, il répète : "Ricardo Flores Magon n'avait pas de problème à se délecter des milliers de soldats détruits dans la guerre impérialiste de 1914-1918...parce qu'il savait qu'ils mouraient en tant que forces de l'Etat mondial du capital, parce que ceux qui ont été détruits n'étaient pas nos camarades mais nos ennemis, ces soldats obéissants qui consentaient à mourir et à tuer sur les fronts de bataille comme agent de leur propre bourgeoisie."
Cela n'a jamais été l'attitude de révolutionnaires comme Lénine ou Luxemburg de qualifier les soldats qui ont combattu au front de stupides esclaves, d'ennemis du prolétariat. Au contraire : Luxemburg parle de la fine fleur du prolétariat européen abattue sur les champs de bataille. Ces prolétaires, même s'ils sont tombés "au champ du déshonneur, du fratricide, de l'auto-destruction", sont restés nos frères de classe et c'est sur cette base que les organisations révolutionnaires ont appelé à la fraternisation, aux mutineries, à "transformer la guerre impérialiste en guerre civile". Les révolutionnaires ont dénoncé les tueries des deux côtés ; ils ne se sont pas frotté les mains en pensant que c'était la voie sûre qui mènerait à la révolution. Au contraire, plus les massacres duraient, plus le danger que la classe ouvrière ne soit pas capable de faire la révolution socialiste et soit engloutie dans la barbarie grandissait.
Le GCI adopte cette attitude à l'égard des soldats de "notre" camp comme un modèle de sa version du "défaitisme révolutionnaire" - qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'attitude des trotskistes pour qui le défaitisme s'applique invariablement à un seul camp uniquement dans la guerre impérialiste. Bien qu'il argumente que Magon n'a pas commis l'erreur de compter comme ses alliés les armées ennemies pendant la guerre impérialiste de 1914 , cette attitude est plus qu'implicite chez le GCI quand il écrit : "Notre position est celle du défaitisme révolutionnaire et c'est pour cela que chaque coup qui accélère la défaite de notre Etat qui, aujourd'hui même, réprime en Irak, est le bienvenu et ce, malgré que, à maintes reprises, ce coup soit porté par des prolétaires encadrés par des forces bourgeoises. " C'est la logique classique de l'anti-impérialisme : nous soutenons tout ce qui affaiblit notre propre puissance impérialiste. Ce que cette logique ignore, c'est que, sur ce terrain, l'affaiblissement d'une puissance impérialiste est le pendant du renforcement de l'autre. Ainsi, le GCI se fait le complice direct de la guerre impérialiste en Irak.
Le GCI a dupé beaucoup d'éléments intéressés par les positions communistes avec ses phrases ultra radicales et ses imageries violentes, particulièrement ceux influencés par l'anarchisme. Par ailleurs, nous maintenons depuis longtemps que le GCI est une claire expression du parasitisme politique (cf. Thèses sur le parasitisme [100] dans la Revue Internationale n°94), un groupe dont la véritable raison d'être est de jouer un rôle destructeur envers les authentiques organisations révolutionnaires - dans le cas du GCI, jusqu'au point de prôner des attaques violentes, et mêmes meurtrières, contre elles [101]. Les positions prises par le GCI sur le mouvement en France et sur la guerre en Irak devraient mener certains éléments qu'il influence à réfléchir sur la nature de ce groupe. Pour nous, il ne fait aucun doute qu'il fait de plus en plus ouvertement le travail de la bourgeoisie, qu'il soit ou non manipulé par des forces étatiques.
En France, les prolétaires font un grand pas en avant dans les assemblées générales et voilà qu'un groupe qui se dit "communiste", "internationaliste" arrive et leur dit d'abandonner les assemblées, de cracher sur le principe de délégués élus et révocables et de revenir aux actions syndicalistes de type commando. Quoi de mieux pour empêcher toute rencontre véritable entre les minorités communistes et le mouvement de masse ?
En Irak, ce groupe "communiste", "internationaliste" chante les louanges des fusillades, des attentats et des actes de sabotage sans fin qui, loin d'exprimer un mouvement de classe du prolétariat, sont une manifestation de la guerre impérialiste dans une phase de montée du chaos et de la décomposition ; c'est l'œuvre de gangsters bourgeois qui ne combattent pas les forces d'occupation mais, de plus en plus, se livrent à des massacres sectaires et indiscriminés. Par dessus le marché, en faisant cet amalgame nauséabond, le GCI établit clairement un lien, pour les dossiers des forces de sécurité de l'Etat, entre ceux qui se considèrent comme des communistes internationalistes et ceux qui s'identifient au terrorisme international. Quelle meilleure excuse pour effectuer une surveillance, des enquêtes et autres attaques répressives envers les groupes révolutionnaires ?
Si nous ajoutons à cela le dossier du GCI concernant ses propres menaces de violence contre les organisations prolétariennes, il devrait être tout à fait clair que ce groupe, quelles que soient ses réelles motivations, doit être considéré comme un réel danger pour le mouvement révolutionnaire. Ceux qui veulent discuter la politique de classe et l'internationalisme prolétarien doivent rompre autant que possible tout lien avec ce groupe.
Amos
[1] Arde est un groupe en Espagne qui est proche du GCI. Le passage ci-dessus continue par une critique du CCI qui ne serait qu'une pâle copie de la presse bourgeoise ne parlant, à propos de l'Irak, que des sunnites et des chiites et non de classe. C'est entièrement faux. Nous avons, en effet, parlé de la situation du prolétariat en Irak et avons écrit au sujet de certains de ses efforts de lutte, mais nous reconnaissons qu'il est confronté aux difficultés les plus terribles pour affirmer ses intérêts de classe et se trouve en fait devant le danger imminent de se faire mobiliser dans une "guerre civile" bourgeoise.
Courants politiques:
Crise chez Airbus : les économies prévues vont détruire l'emploi et attaquer les salaires de centaines de milliers d'ouvriers
- 3857 lectures
Cette crise, qui touche l’industrie aéronautique européenne à travers Airbus face à son concurrent principal Boeing, est un exemple frappant de la guerre commerciale que se livrent les pays européens et les Etats-Unis. Ainsi, le retard de livraison du nouvel avion d’Airbus l’A380 aujourd’hui porté à deux ans, après plusieurs reports successifs, a permis à Boeing, après l'avantage initial pris par Airbus depuis 2001, de prendre une avance déterminante dans la vente de gros avions porteurs pour les années à venir. Face aux difficultés d’Airbus, les décisions ont été prises dans l’urgence par les bourgeoisies européennes concernées pour tenter de pallier cette poussée de Boeing en diminuant au maximum le coût de fabrication de l'A380 tout en accélérant sa finalisation. Le cri d'alarme que poussent les bourgeoisies européennes n'est pas abusif, car il s’agit bel et bien d'un véritable enjeu et d’une crise majeure dans la guerre sans merci que se livrent les puissances américaines et européennes. Ce qui va en résulter pour la classe ouvrière, en termes de licenciements et d'exploitation dans le secteur de l'aéronautique, comme dans l’industrie automobile, concerne des centaines de milliers d’ouvriers sur l'ensemble des territoires français et européen.
La situation de faiblesse d’Airbus
Les bourgeoisies européennes engagées dans la construction d’Airbus doivent faire face a une très grosse crise financière : les tentatives pour rattraper Boeing ont déjà coûté très cher (l’Airbus A380 ne sera rentable qu’à partir du 450e avion, contre 250 prévus lors du lancement du projet). La direction d’EADS (consortium qui englobe l’entreprise Airbus) a déjà été obligée de créer un montage financier pour trouver l’argent des investissements pour le nouvel avion A350 WBX. La décision de lancer cet avion était devenue incontournable car comme l’avait dit le représentant d’une compagnie : « Si [l'A350] est un échec, Airbus mourra ». Mais il faut savoir que le moyen courrier de Boeing, le 787, effectuera son premier vol dans moins de 2 ans (2008), alors que le projet d’Airbus doit décoller en 2013, cinq ans plus tard. Airbus a besoin de financements énormes pour faire face à la concurrence. Il faut qu'il finance à la fois le coût du retard de l’A380 (12 milliards d’euros -selon la dépêche de l'AFP du 3/10/06-) et le nouveau projet d’A350 (10 milliards d’euros), plus le projet de l’avion militaire A400M dont le premier exemplaire est en cours de construction, et qui lui aussi a pris du retard, et enfin le remplacement des modèles qui vieillissent.
Auparavant, Boeing a connu des situations de crise très graves qui ont été résolues par le licenciement de plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers. Malgré ces mesures drastiques de "dégraissage", à chacune d'entre elles, l’Etat américain a été contraint de financer le redressement de l'entreprise, en y mettant chaque fois plus de temps. Pour Airbus, c’est d’autant plus difficile que les Etats européens sont, aujourd’hui, de plus en plus endettés. Ils ne peuvent plus, malgré les velléités de la France à se poser en première puissance européenne, financer de tels projets qui deviennent colossaux et constituent de véritables gouffres financiers.
Une attaque d'envergure contre la classe ouvrière
Alors que la direction d'Airbus prétend que les mesures du plan de restructuration prendront effet après février 2007, l'attaque a de fait déjà commencé dans toute l'Europe. Le grand mot d’ordre est : "il faut réduire les coûts de production." Depuis l’annonce de la crise (septembre 2006) les contrats précaires (CDD, intérim) ne sont plus renouvelés, ce qui signifie 1000 emplois supprimés sur chacun des sites d’Hambourg et de Toulouse depuis l'automne 2006. Ces 2000 licenciements ont pour conséquence une augmentation des charges de travail qui se traduit déjà par des heures supplémentaires imposées. Et, malgré ces mesures, dans certains ateliers, il devient de plus en plus difficile de tenir les délais de fabrication prévus.
Mais si l’attaque a déjà commencé, elle va toucher dans un premier temps, les sous-traitants. 56 000 personnes, dont le nombre doit être réduit de 80%, sont concernées pour la seule région Midi-Pyrénées. Les chiffres annoncés sont d'une rare brutalité : "Le report du calendrier va coûter près de 5 milliards d'euros à l'avionneur Airbus, qui vient d'annoncer une réduction du nombre des sous-traitants de 3000 à 500. Un sur deux sera installé dans un pays à bas coût de main-d'œuvre" (La Nouvelle République du 14 novembre 2006). Même s’il va y avoir des regroupements de sous-traitants et équipementiers, on peut imaginer les conséquences, car ces entreprises sont fortement encouragées à délocaliser leur production en particulier dans les pays de la zone dollar, c'est-à-dire là où la main d’œuvre est moins chère, Airbus exigeant qu’ils diminuent leur coût jusqu’à 30%.
Toutes ces mesures d’économies, qui sont le contraire de leur appellation « "Power 8" , et plutôt "Impuissance x", sont inévitables pour "restaurer" la compétitivité d'Airbus. Aussi, afin de bien « remettre Airbus sur les rails", ses dirigeants ont aussi préparé un plan d’austérité impitoyable pour les ouvriers d’Airbus eux-mêmes, plan que la direction a commencé à mettre en place depuis bien avant les récentes déclarations de Gallois : « Airbus compte notamment réduire de 30% ses frais de fonctionnement » (AFP du 3 octobre 2006) ; Il faut gagner « 20% de productivité dans toutes les usines dans les 4 prochaines années » et réduire "les coûts de 5 milliards d'euros jusqu'en 2010 » (Libération du 9 octobre 2006). Enfin, « à partir de 2010, l’entreprise doit économiser 2 milliards d’euros par an pendant 3 ans » et « diminuer le nombre de fournisseurs » pour tenter de trouver de nouveaux capitaux.
Il est prévu, également, de « réduire les temps d’essai des nouveaux projets » ; ce qui veut dire une augmentation des cadences et du temps de travail. On peut rajouter en clair que cela signifie la poursuite accélérée tout aussi bien des licenciements que des départs à la retraite anticipés.
Les syndicats ont masqué l'attaque
Lorsqu’on se représente les conséquences du plan d’austérité que l’on vient de décrire, on comprend pourquoi la direction de l’entreprise a pu dire qu'il s'agissait de « prendre des mesures difficiles ». Le nouveau PDG a réuni depuis le mois de septembre tous les « acteurs » du sommet de l’Etat au Comité Central d’Entreprise, c’est-à-dire les syndicats. Il est évident qu’ils ont abordé les conséquences des « mesures difficiles » à prendre. Si, depuis le début du mois de décembre, on ne parle que de l’annonce du lancement des études du nouvel avion A350, les syndicats se préparent de longue date à faire face au développement du mécontentement ouvrier.
Dans cette situation, les syndicats ont tous eu le même langage, celui de minimiser la gravité de ce qui se préparait, s'inscrivant pleinement dans les mensonges que la direction et les différents Etats concernés, ont annoncé comme la seule "vérité" auprès des ouvriers de l'aéronautique : "Ne vous inquiétez pas, tout le monde est au chevet du malade, et il va guérir sans trop de difficultés."
Dés le début, FO, syndicat majoritaire, a fait semblant de dénoncer les commentaires des médias qui amplifieraient la crise : « Il faut arrêter de déstabiliser notre entreprise au risque d’aggraver dangereusement la situation ! » (tract du 10 octobre). De son côté, la CGT minoritaire dénonçait les actionnaires comme fauteur de la crise : « Ce sont bien les actionnaires avec leurs exigences de rentabilité immédiate qui sont à l’origine des difficultés actuelles et à venir dans cette industrie … » (octobre 2006) et continuait en reprochant à l’Etat de ne pas jouer son rôle "d’impulsion" et de "contrôle". Ils félicitaient même les salariés, comme le font les patrons, d’avoir accepté des sacrifices dans l’intérêt de l’entreprise, à l'instar d'un tract de FO du 17 novembre 2006 mettant en avant avec cynisme "Les actions d’amélioration de la performance d’Airbus auxquelles les salariés ont largement contribué depuis plus de quinze ans », et cela "grâce à une rationalisation largement aboutie, nos sites sont optimisés et compétitifs, y compris par rapport aux marchés externes" !
Les syndicats ont montré, par là, qu’ils sont bien les garants de la bonne gestion de l’entreprise et, quand celle-ci est en difficulté, ils révèlent leur rôle de pompier social au grand jour, comme le dit un article du journal Libération en date du 9 octobre 2006 et intitulé : « Syndicalistes à Airbus, un exercice de haute voltige ». Tous les syndicats ont donc appliqué les consignes de discrétion soi-disant pour ne pas "déstabiliser l’entreprise vis-à-vis de la concurrence". Malgré leurs déclarations plus ou moins radicales, la priorité est restée pour les syndicats à la discrétion. Ceci est confirmé par cette déclaration du secrétaire de la section syndicale à Toulouse du syndicat FO : « Si je laisse filer un quelconque document ou si je dis un mot de travers, ça peut se retrouver le lendemain dans la presse américaine ou anglaise. Et je ne voudrais pas être à l'origine d'un effondrement du titre EADS en Bourse.». Cette collusion claire et évidente entre intérêt du capital, intérêt national et sabotage syndical est encore soulignée par cette autre citation d’un leader CGT : "Les salariés de la production sont prêts à faire un nouvel effort après tous ceux déjà consentis."
Aujourd’hui, la CGT fait de grandes déclarations combatives dans ses tracts, allant jusqu’à se féliciter que tous les syndicats européens de l’entreprise Airbus se soient retrouvés unis au niveau européen « pour exiger [de la direction] la présentation exhaustive du plan « Energie 8 » et de toutes ses conséquences au niveau social ». Or nous savons très bien que les syndicats sont parfaitement au courant des mesures qui se préparent puisque la direction a créé « un comité de pilotage social » composé de représentants de la direction spécialisés dans la « réduction des coûts de structure » et des syndicats. Ces derniers savent donc très bien de longue date que les mesures draconiennes d’austérité vont être appliquées et étalées dans le temps.
Les syndicats des sites de Nantes et Saint-Nazaire, ainsi que tous les élus de la région (qui ont eux aussi été mis au courant depuis belle lurette), peuvent bien à présent se "mobiliser" contre la menace de licenciements qui risque de frapper 16 000 emplois en Pays de Loire, tout ce monde qui crie aujourd'hui au charron savait ce qu'il en était depuis des mois.
Pour les syndicats, il faut baliser le terrain et reculer l'échéance des réactions ouvrières afin de mieux s'y préparer et faire passer les licenciements et les attaques. Une de leurs principales armes va être de diviser les salariés de l'entreprise au maximum, de diviser les intérêts de ceux des différents sites frappés par l'attaque. C'est ainsi déjà que les syndicats FO, CGC, et CFTC « revendiquent que les gains de productivité et les efforts d’optimisation à venir se concentrent en priorité sur les secteurs d’Airbus en Europe, qui n’ont pas encore démontré leur engagement résolu au service des performances de notre société. ». Et ils vont demain faire en sorte de séparer et "traiter" les licenciements par régions et par usines.
Aux sacrifices supplémentaires que demande la direction et les « partenaires sociaux », il faut répondre par la lutte. Pour être forts et unis, pour faire reculer les attaques, nous devons rejeter la division entre ouvriers d'EADS et sous-traitants, entre ouvriers français et ouvriers d'Europe ou américains. La concurrence et le profit sont les maîtres-mots des patrons, de l'Etat et des syndicats, pas les nôtres! La classe ouvrière doit au contraire cultiver ce qui fait sa force, celle de la lutte collective qui seule peut faire reculer une exploitation toujours plus féroce. Les « partenaires sociaux » cherchent à diviser les ouvriers pour les empêcher d'entrer en lutte de façon massive et unie, de façon solidaire, contre leurs manœuvres et leurs coups bas.
Pour développer la lutte, il ne faut pas faire confiance aux organisations syndicales qui créent la division et font passer les attaques. Les récents combats menés par d'autres ouvriers, que se soit les jeunes lors des luttes contre le CPE en France, ou lors des grèves des ouvriers métallurgistes à Vigo en Espagne montrent l'exemple du chemin à suivre, par la solidarité ouvrière et la volonté de tenir les luttes en mains dans les assemblées générales les plus massives possibles, en-dehors et contre les syndicats.
Damo
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Débat internationaliste en République dominicaine
- 3409 lectures
Nous avons tenu deux conférences sur le thème Socialisme et décadence du capitalisme dans deux universités du pays : Santiago de los Caballeros (seconde ville du pays) et Santo Domingo (la capitale). Ces débats ont été possibles grâce à la volonté et à l'effort d'organisation d'un noyau de discussion internationaliste que nous remercions chaleureusement pour le travail réalisé. Ces réunions n'ont rien eu d'académique. Comme lors d'une expérience similaire dans une université du Brésil (1), se sont exprimées des inquiétudes et des préoccupations sur le futur que nous offre le capitalisme, sur la façon de lutter pour une nouvelle société qui dépasse les contradictions dans lesquelles se trouve immergé le système actuel, sur les forces sociales capables de réaliser ce changement...
Ces débats sont un moment de l'effort de prise de conscience de la part de minorités du prolétariat. La dimension internationale de cet effort est indiscutable. Publier une synthèse des discussions menées en République dominicaine répond à un double objectif : participer au développement d'un débat international et contribuer à ce que les débats et les discussions qui se sont développés dans un pays s'inscrivent dans le seul cadre qui puisse les faire fructifier : le cadre international et internationaliste (2).
Suite à la présentation (3), beaucoup de questions ont été posées, dont certaines ont suscité la discussion dans la salle. Dans la synthèse que nous proposons ici, nous les avons organisées thématiquement et présentées sous la forme question-réponse.
Il y a eu beaucoup de révolutions au xxe siècle. Vous les condamnez cependant toutes, exceptée la Révolution russe, dont vous dites qu'elle fut un échec. Vous êtes injustes envers les efforts des peuples luttant pour leur libération.
Il ne s'agit pas de dénigrer les luttes des classes exploitées et opprimées, mais de comprendre ce qu'est réellement la révolution à l'ordre du jour à partir du xxe siècle. Il y a eu de ce point de vue un changement fondamental lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale. Cette guerre, qui atteignit des records stupéfiants de barbarie montra au monde que le capitalisme était devenu un système social décadent qui ne pouvait plus offrir à l'humanité que des guerres, des famines, des destructions et la misère. Elle mit fin à la période des révolutions bourgeoises, c'est-à-dire des révolutions populaires démocratiques, réformistes et nationales. Ces mouvements devinrent dès lors de simples ravalements de façade de l'Etat. A partir de cette guerre, la seule révolution capable d'apporter un progrès pour l'humanité est la révolution prolétarienne dont l'objectif est d'instaurer le communisme dans le monde entier. La Révolution russe de 1917 et toute la vague révolutionnaire qui s'ensuivit exprime cet état de fait. Le Premier congrès de l'Internationale communiste, en mars 1919, affirma d'ailleurs : « Une nouvelle période commence. Période de décomposition du capitalisme, de son effondrement interne. Période de révolution communiste du prolétariat » (4).
Pourquoi vous obstinez-vous à rester dans le dogme d'une révolution mondiale et pourquoi rejetez-vous les avancées graduelles par le biais de révolutions nationales ?
Les révolutions bourgeoises avaient un caractère national et pouvaient survivre longtemps à l'intérieur de leurs frontières. C'est ainsi que la révolution anglaise triompha en 1640 et survécut dans un monde pourtant encore féodal jusqu'aux révolutions bourgeoises de la fin du xviiie siècle. La révolution prolétarienne, par contre, sera mondiale ou ne sera pas. D'abord, parce que la production est aujourd'hui mondiale. La classe ouvrière est mondiale. Mais aussi parce que le capitalisme a créé un marché mondial et que les lois de ce marché Les problèmes dus au capitalisme ont un caractère mondial et ne peuvent être résolus que par la lutte unifiée de tout le prolétariat mondial.
Quelle est votre position sur Trotski et le trotskisme ?
Trotski fut toute sa vie un militant révolutionnaire. Il eut un rôle très important durant la Révolution russe de 1917. Mais il lutta aussi contre la dégénérescence de la Révolution russe en défendant des positions internationalistes. Il fut le principal animateur de ce qui se nomma l'Opposition de gauche, qui mena une lutte héroïque pour s'opposer à la contre-révolution stalinienne tant en Russie qu'au sein des différents partis communistes dans le monde. Cependant, Trotski et l'Opposition de gauche ne comprirent jamais la nature de l'URSS et la considéraient comme étant un « Etat ouvrier avec des déformations bureaucratiques » qu'il fallait malgré tout défendre. Les conséquences de cette erreur furent tragiques. Après son lâche assassinat par Ramon Mercader, tueur à la solde de Staline, ceux qui prétendaient être les héritiers de Trotski appelèrent à participer à la Seconde Guerre mondiale et devinrent un courant politique qui défend toujours, de façon bien sûr « critique » et avec un langage « radical », les mêmes postulats que les partis staliniens et sociaux-démocrates (5).
Vous êtes injustes avec Chavez, mais il y a pire : vous ne prenez pas en compte le processus révolutionnaire impulsé par Chavez qui se développe aujourd'hui dans toute l'Amérique latine, la mettant en pleine effervescence révolutionnaire.
Le dilemme chavisme-antichavisme est un piège, comme l'ont démontré récemment les mobilisations des étudiants au Venezuela en tentant de se dégager de cette polarisation stérile et destructive entre chavisme et Opposition (6).
Chavez soutient tant le renforcement de l'intervention de l'Etat dans l'économie que la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne (la Réforme constitutionnelle pour favoriser sa réélection permanente). Il lance des programmes « sociaux » qui, s'ils arrangent momentanément la situation de quelques couches marginalisées, s'inscrivent en réalité dans un programme de renforcement de l'exploitation des travailleurs et d'appauvrissement de la grande majorité de la population. Ce genre de programmes ne sert qu'à faire accepter à la population la misère la plus dégradante. Il s'agit de formules qui se sont souvent répétées tout au long du xxe siècle et qui ont été des échecs retentissants. Elles n'ont rien changé au capitalisme, elles ont simplement contribué à le maintenir en vie, et à maintenir aussi les souffrances de l'immense majorité (7).
Chavez prétend être « anti-impérialiste » sous prétexte qu'il s'oppose vigoureusement au « diable Bush ». Le soi-disant « anti-impérialisme » de Chavez n'est rien qu'un camouflage pour avancer ses propres desseins impérialistes. Les travailleurs et les opprimés ne peuvent baser leur combat sur un sentiment de haine ou de revanche contre un empire tout-puissant comme les Etats-Unis, car ce sentiment est manipulé par les bourgeoisies latino-américaines - tant les fractions au gouvernement que celles dans l'opposition - pour faire en sorte que la population se sacrifie pour leurs intérêts.
Il n'y a pas d'issue nationale à une crise du capitalisme qui est mondiale. L'issue ne peut qu'être internationale et se base sur la solidarité internationale du prolétariat, dans le développement de ses luttes autonomes.
Pourquoi ne parlez-vous que des ouvriers et pas des paysans ou d'autres couches populaires ?
Quelle que soit son importance numérique dans chaque pays, la classe ouvrière est la seule classe mondiale dont les intérêts soient mondiaux. Sa lutte comme classe représente les intérêts et l'avenir pour toute l'humanité opprimée et exploitée. La classe ouvrière cherche à gagner les paysans et les couches marginalisées des grandes villes à sa lutte. Il ne s'agit en rien de former un « front de mouvements sociaux » car l'intérêt profond, la libération authentique des ouvriers, des paysans, des marginalisés des villes n'est pas une somme de revendications corporatistes mais la destruction commune du joug de l'exploitation salariale et mercantile.
Ne tombez-vous pas dans des recettes et des formules dépassées ? La classe ouvrière n'existe plus et ici, en Amérique, il n'y a presque plus d'usines.
La classe ouvrière n'a jamais été limitée aux travailleurs industriels. Ce qui caractérise la classe ouvrière, c'est le rapport social basé sur l'exploitation du travail salarié. La classe ouvrière n'est pas une catégorie sociologique. Les travailleurs de l'industrie, les travailleurs des champs, les employés publics et bien des travailleurs « intellectuels », font partie du prolétariat. Il faut aussi compter sur tous les travailleurs qui sont jetés au chômage et sont obligés pour survivre de vendre à la sauvette dans les carrefours.
Un changement de mentalité n'est-il pas nécessaire pour que les masses ouvrières fassent la révolution ?
Bien sûr ! La révolution prolétarienne n'est pas le simple résultat de facteurs objectifs inéluctables, elle se base essentiellement sur l'action consciente, collective et solidaire des grandes masses de travailleurs. Dans l'Idéologie allemande, Marx et Engels soutiennent que la révolution n'est pas seulement nécessaire pour détruire l'Etat qui opprime la majorité, mais aussi pour que cette majorité s'émancipe elle-même des haillons idéologiques du passé qui lui collent au corps. La révolution prolétarienne se prépare par une transformation gigantesque de la mentalité des masses Elle sera le produit de l'effort indépendant des masses, qui passe non seulement par des luttes mais aussi par des débats passionnés.
CCI
Annexe : exposé introductif
Chers camarades,
Nous ne voulons pas imposer nos positions, nous ne venons pas vous dire « voici la vérité, mettez-vous à genoux ». Notre intention est d'animer un débat, non seulement ici mais qui se poursuive pour tous ceux qui sont intéressés. Comme vous avez pu le voir dans la convocation, le sujet proposé est : socialisme et décadence du capitalisme. Cette question est actuellement débattue dans des cercles de jeunes, ouvriers, étudiants, éléments intéressés, dans de nombreux pays. Ici en République Dominicaine, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique Latine, aux Philippines, en Allemagne, en Corée...
Pourquoi un tel intérêt pour cette question ? Le sentiment que le futur que nous prépare la société capitaliste est toujours plus inquiétant, s'étend de jour en jour. Quoi que l'on regarde, les éléments qui provoquent la préoccupation envers l'avenir ainsi que l'indignation contre le système social s'accumulent. Les jeunes se voient condamnés à une précarité sans issue, au chômage, à l'impossibilité de se loger ; leurs aînés sont condamnés au chômage ou à une retraite de famine ; des masses gigantesques fuient désespérées la campagne pour aller s'installer dans les bidonvilles des grandes villes sans trouver plus de solution ; les guerres impérialistes comme celle d'Irak se radicalisent, mettant en évidence une autre impasse ; il est de plus en plus évident qu'un désastre écologique menace la planète ; les accidents, les catastrophes se multiplient partout, mettant en évidence la totale incapacité des Etats ; l'effondrement de la société, sa perte de éthique est chaque jour plus évidente...
Ces conditions rendent nécessaire le débat, la réflexion sur ce que devrait être une nouvelle société, comment y parvenir, quelles sont les forces qui peuvent la construire, sur les leçons à tirer des expériences historiques des révolutions ou tentatives révolutionnaires du passé.
Qu'est-ce que le socialisme ?
Nous allons avancer une réponse historique et dynamique : le socialisme, c'est la société qui dépasse et résout les contradictions qui provoquent le chaos et le désastre au sein de la vieille société capitaliste. Deux grandes contradictions mènent le capitalisme à la ruine et provoquent les souffrances extrêmes de la grande majorité de l'humanité. D'une part, le capitalisme est un système dans lequel la production n'est pas destinée à satisfaire les besoins humains mais à réaliser de la plus-value qui se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes. D'autre part, la production sous le capitalisme atteint un caractère toujours plus social et mondial alors que l'organisation et le système de production ont un caractère privé et national. Ces deux contradictions provoquent tant la tendance inexorable à la surproduction (pour la première fois dans l'histoire, les hommes meurent de faim non à cause de la pénurie d'aliments mais à cause de leur abondance) que la guerre à mort, l'impérialisme, entre les différents capitaux nationaux pour le partage des marchés, c'est-à-dire du monde.
Pourquoi le socialisme résout-il ces contradictions ?
Le socialisme, c'est l'organisation de la production non en fonction du marché ou du travail salarié, mais en fonction de la pleine et consciente satisfaction des besoins humains. Le socialisme ne peut qu'être une société mondiale, une communauté humaine mondiale qui travaille collectivement et fraternellement pour elle-même.
Le socialisme est-il possible en un seul pays ?
NON. C'est la réponse catégorique qu'a toujours donné le mouvement ouvrier. Le socialisme sera mondial ou ne sera pas. Cette affirmation nous permet de clarifier ce que nous pensons du régime de l'URSS, qui se prétendait être le continuateur de la grande révolution prolétarienne d'Octobre 1917 : ce n'était pas le socialisme, ce n'était pas une « voie vers le socialisme », c'était une forme particulière de capitalisme d'Etat. Des régimes comme celui de Chine, de Cuba, de Corée du Nord, dans lesquels règne une dictature féroce et militarisée sur la classe ouvrière et la population en général, ne peuvent être « socialistes » ou « communistes ».
Nous devons sur ce point être très clairs : il ne faut pas confondre socialisme et capitalisme d'Etat. Ce dernier est une tendance générale qui concerne l'ensemble du capitalisme mondial tout au long du xxe siècle. Cette tendance s'est concrétisée de deux manières : la forme dite « libérale », où l'Etat contrôle et intervient dans l'économie de façon indirecte en respectant la propriété privée, et celle qui est présentée démagogiquement comme « socialiste », où l'Etat contrôle l'économie par la voie des nationalisations et de l'étatisation directe. Le grand mensonge du xxe siècle a été de présenter comme « socialisme » des régimes où l'économie est étatisée plus ou moins complètement et où règne le système du parti unique, de sorte que ce qui s'est nommé cyniquement « dictature du prolétariat » n'est en réalité qu'une dictature étatique sur le prolétariat.
Ceci dit, qu'est-ce que le socialisme ? Nous devons, pour répondre, reprendre les idées qui ont été développées par le mouvement ouvrier. Il ne s'agit pas de répéter simplement de vieilles formules, mais de les analyser de façon critique en les intégrant à la situation actuelle et à la perspective du futur.
1) C'est un système mondial. Le socialisme est impossible en un seul pays. C'est là selon nous la cause fondamentale de l'échec de la Révolution de 1917 ;
2) Il implique la participation active et consciente des masses ouvrières et exploitées organisées en Conseils ouvriers. Le socialisme ne peut s'imposer par décrets de façon administrative, mais est le fruit de la force collective du prolétariat ;
3) Le socialisme ne se construit pas par le renforcement de l'Etat mais par son extinction progressive. Il est certain que perdure un Etat de transition après la destruction politique du capitalisme, mais celui-ci devra être progressivement démantelé. C'est un Etat doté d'une date de péremption.
Ce bref rappel sur des principes du socialisme nous conduit à mettre l'accent sur le fait que le socialisme ne peut qu'être le produit de l'action collective, organisée et consciente du prolétariat mondial, renforcée et soutenue par tous les opprimés et exploités de la planète. Le « socialisme » réalisé par l'Etat, basé sur un parti unique, est une immonde mystification : il n'aurait rien à voir avec le socialisme, mais serait une des formes du capitalisme d'Etat.
Le socialisme surgit de la lutte mondiale du prolétariat. Mais aujourd'hui, où est cette lutte ?
La Révolution russe avait été le fruit de nombreuses luttes non seulement en Russie, mais aussi en Allemagne, en Autriche et de nombreux pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique... Elle fut le fer de lance de grands mouvements mondiaux des masses ouvrières. Nous ne sommes pas des idéalistes, notre prétention n'est pas de vous vendre des illusions. Nous savons parfaitement que nous sommes encore loin d'une situation où la présence généralisée des luttes massives du prolétariat dominerait la scène mondiale. Nous pensons cependant que la situation actuelle se caractérise par une maturation des conditions qui peut conduire à terme à une situation révolutionnaire comme celle qui aboutit à 1917.
Sur quoi nous basons-nous pour avancer cette perspective ? Essentiellement sur deux facteurs : d'une part, les luttes actuelles (malgré leur caractère encore très limité) tendent à se multiplier dans de nombreux pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Nous faisons ici référence à des mouvements significatifs dans un grand nombre de pays : France 2006, Grande Bretagne 2005, Espagne 2006, Dubaï 2006, Bengladesh 2006, Egypte 2007, Pérou 2007, Allemagne 2007... Nous ne décrirons pas ici en détails ces mouvements mais leur analyse sérieuse montre un potentiel important. D'autre part, commence à apparaître un réel processus de prise de conscience. Des minorités de prolétaires dans beaucoup de pays se posent beaucoup de questions, cherchent avec énergie et enthousiasme des positions théoriques révolutionnaires et, ce qui va de pair, une activité révolutionnaire. Des groupes internationalistes apparaissent qui tendent à défendre des positions révolutionnaires, amplifiant ainsi et approfondissant l'action des organisations révolutionnaires internationalistes comme le CCI : aux Philippines, en Corée, au Brésil, en Turquie, en Argentine, en Tchécoslovaquie, en Allemagne, etc.
Nous ne pouvons considérer de façon isolée chacun des efforts de ces minorités. Elles annoncent et préparent un changement formidable dans la mentalité des masses ouvrières. Concentrons-nous sur la réflexion et l'action de ces minorités. A la recherche de positions révolutionnaires, elles croisent inévitablement la route de nombreux partis, organisations, mouvements qui se revendiquent du communisme et du socialisme, de la classe ouvrière, de la révolution, etc. Comment s'orienter ? Comment distinguer entre ces courants d'origine communiste ou qui se prétendent tels ceux qui ne sont qu'un leurre et une mystification ? Répondre à cette question conduirait à un débat détaillé dans lequel nous ne pouvons ici entrer. Nous voulons cependant apporter un début de réponse qui découle de tout ce que nous venons de dire sur le socialisme et son processus de construction.
Toutes ces organisations qui prétendent que le socialisme en un seul pays est possible et qui défendent la nation, qui prétendent être anti-impérialistes et défendent une action nationale impérialiste, qui présentent comme socialiste l'étatisation et la nationalisation de l'économie, qui défendent le renforcement de l'Etat capitaliste sous sa forme démocratique ou totalitaire, toutes ces organisations n'ont rien de socialiste ni de communiste mais défendent au contraire, en fin de compte, le capitalisme.
Cette réalité s'impose quelle que soit la bonne volonté ou la sincérité de bien des militants de ces organisations, par rapport auxquels nous préconisons le débat sincère et profond afin de comprendre s'il est possible de lutter pour le socialisme dans le cadre de ces organisations ou si au contraire ce cadre ne fait que poser des obstacles à cette lutte.
Chers camarades, notre présentation, comme nous l'avons annoncé, ne prétendait pas donner une réponse achevée et systématique, mais ouvrir le débat. C'est pourquoi nous concluons en souhaitant que vous n'hésitiez pas à poser les questions, les problèmes, les arguments, les accords et désaccords, afin que nous puissions clore cette réunion enrichis par l'idée que nous aurons, ensemble, lancé une dynamique vers la clarification sur les problèmes qui assaillent l'humanité.
1 Consulter es.internationalism.org/cci-online/200602/434/cuatro-intervenciones-publicas-de-la-cci-en-brasil-un-reforzamiento-de-las-pos [103].
2 Cela va de soi, si des camarades sont intéressés par l'organisation de débats de ce type dans leur ville ou leur pays, nous sommes disposés à collaborer à leur organisation. Toute initiative en ce sens reste vitale
3 Cette présentation est présente sous forme d'annexe en bas de cet article.
4 Voir sur notre site la brochure sur la Révolution russe [104].
5 Voir sur notre site la brochure sur Trotski et le stalinisme [105].
6 Voir entre autres textes, le plus récent: es.internationalism.org/cci-online/200708/2006/estudiantes-en-venezuela-la-perspectiva-de-lucha-proletaria-el-camino-para-su [106].
7 Voir es.internationalism.org/cci-online/200706/1928/chavez-explota-a-favor-del-capital-los-suenos-de-las-capas-mas-necesitadas [107] et es.internationalism.org/cci-online/200706/1934/acentuacion-de-la-precariedad-en-nombre-del-socialismo [108].
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Géographique:
Espagne. Fermeture de l'usine Delphi, à Puerto Réal : nous ne serons forts qu’avec la lutte massive et solidaire
- 4380 lectures
Fermeture de Delphi (1) : nous ne serons forts qu'avec la lutte massive et solidaire
Ils disent que l'économie espagnole va « à plein tube », ils disent que l'économie mondiale va de l'avant Les gouvernements, les experts, les économistes, les chefs d'entreprises et syndicaux, nous présentent un « monde » qui n'a rien à voir avec le monde réel que nous subissons tous les jours. Dans leur monde il y a des édifices éblouissants, des technologies merveilleuses, des résultats économiques « formidables »...
Cependant, dans notre monde, le monde réel, il se passe des choses très différentes : des licenciements à la pelle, des contrats précaires, des pensions de retraite à chaque fois plus réduites et plus difficiles à obtenir, une augmentation de la pauvreté, l'impossibilité d'accéder à un logement digne, un fonctionnement désastreux des services de santé qui sont débordés en permanence, le chaos dans les transports (pour donner un exemple criant, le désastre dans le fonctionnement des trains de banlieue de Barcelone...)
Ce « monde réel » est subi par les travailleurs du monde entier, par l'immense majorité de l'humanité. En nous limitant uniquement au fléau des licenciements, rappelons-nous qu'aux États-Unis, General Motors projette de licencier 30 000 de nos camarades et Ford 10 000 ; en Allemagne, Wolkswagen prévoit 10 000 autres licenciements ; en Allemagne et en France, 10 000 suppressions de poste à Airbus avec des répercussions probables en Espagne. Ce ne sont que quelques cas au milieu d'une liste interminable de licenciements qui touche les travailleurs des grandes et des petites entreprises et de nombreux pays.
Les plans de sauvetage de l'entreprise : un piège pour finir par imposer les licenciements
A Delphi, avec l'accord du gouvernement régional d'Andalousie et des syndicats, il avait été établi un plan industriel qui, en échange de sacrifices importants des travailleurs, « garantirait l'emploi au moins jusqu'en 2010 ». Ce fut le énième plan de sauvetage de l'entreprise semblable à celui de SEAT, des chantiers navals et de tant d'autres.
Le mécanisme est toujours le même : les gouvernements, le patronat et les syndicats nous proposent de « sauver l'entreprise ». Pour cela ils nous demandent de faire des sacrifices (en nous baissant les salaires, en nous demandant de faire des heures supplémentaires, d'accepter des préretraites et des départs « volontaires ») pour avoir un « plan d'avenir ». Delphi est la énième démonstration que ces promesses sont uniquement de la poudre aux yeux. Accepter les sacrifices aujourd'hui mène à des sacrifices encore pires et plus nombreux avec comme résultat final les LICENCIEMENTS MASSIFS.
En Allemagne nous avons eu la même situation : en 2003, à Wolkswagen, le patronat et les syndicats ont décidé un plan draconien (48 heures de travail par semaine avec 10% de baisse de salaire) pour « empêcher les licenciements ». Le résultat : en 2006 et aujourd'hui en 2007, le patronat a décidé plus de 16 000 licenciements.
A SEAT, en décembre 2005, ils ont dit que les 660 licenciements qu'ils ont réussi à imposer avec la complicité effrontée des syndicats seraient « les derniers ». Ils ont mis moins d'un an pour se dédire et, aujourd'hui, l'entreprise impose une nouvelle série de licenciements, que les syndicats se contentent de juger « inopportuns » !
Nous devons nous poser la question : pourquoi se passe-t-il toujours la même chose ? Pourquoi les sacrifices n'apportent-ils que de nouveaux sacrifices ? Où allons-nous aboutir ? Les « plans d'avenir » instaurés par le patronat, les syndicats et les partis politiques servent-ils à quelque chose ? Ces « plans d'avenir » ne sont-ils pas la carotte avec lequel on nous conduit de sacrifice en sacrifice jusqu'au licenciement final de tout le personnel ? Ces « plans d'avenir » sont-ils une alternative réaliste ou bien, ce qui est plus réaliste, s'agit-il de comprendre que le capitalisme n'a pas d'avenir ?
Le capitalisme comme système mondial est dans une situation à chaque fois plus critique. En témoigne la fermeture continue d'entreprises productives, l'interminable cascade de licenciements, le fonctionnement toujours plus désastreux des infrastructures, le fait que pour amortir les coups de la crise en réduisant les coûts de production on transfère des parties importantes de la production en Chine, en Inde, etc., dans des pays transformés en ateliers du monde à bas prix puisque là-bas les conditions de travail sont insupportables.
Les politiciens, les syndicalistes et les économistes se lamentent sur le fait que les multinationales démantèlent les industries pour les transférer en Chine. Mais quelle est la solution qu'ils mettent en avant ? Eh bien d'accepter une dégradation de nos conditions de travail et de vie jusqu'à nous mettre en situation de pouvoir faire concurrence aux prix de la Chine ! Voilà l'avenir que nous offre le capitalisme ! Nous ramener au niveau de nos camarades en Chine qui supportent jusqu'à 70 heures de travail par semaine, des salaires de misère, sans sécurité sociale ni pension garantie et en logeant dans des taudis infects !
Le seul avenir c'est la lutte massive et solidaire des travailleurs
L'avenir que nous offre le capitalisme c'est la précarité, le chômage chronique, la perte des pensions, une vie de misère indescriptible et, en même temps, des guerres impérialistes, le désastre des infrastructures, des catastrophes écologiques, la barbarie morale... L'avenir que le capitalisme offre à l'humanité c'est la barbarie.
La seule alternative qu'ont les travailleurs, c'est la lutte. La lutte massive et solidaire. La solidarité est vitale. Face à la menace des licenciements qui pèse sur nos camarades et leurs familles à Puerto Real, tous les ouvriers doivent discuter, sur les lieux de travail, dans les quartiers, sur tous les lieux possibles de réunion, de la nécessité de lutter, de développer la solidarité, de lutter ensemble et de façon unie.
Il y a un an, quand les ouvriers de SEAT ont arrêté spontanément le travail en solidarité avec leurs camarades menacés de licenciement, dans un tract où nous appelions à la solidarité des autres travailleurs sans distinction de secteur, de région ou de race, nous disions : « le problème de SEAT ne se réduit pas aux 660 licenciements ; c'est un problèmes de TOUT LE PERSONNEL. Mais ce n'est pas seulement le problème des ouvriers de SEAT, mais de TOUS LES TRAVAILLEURS, tant des fonctionnaires avec la « garantie de l'emploi » (jusqu'à quand ?) que des entreprises privées, tant des sans papiers que de ceux qui ont des papiers, tant des entreprises qui font des bénéfices que des entreprises en déficit. Nous sommes ou serons tous dans la même situation que les camarades de SEAT ! »
La réalité montre que NOUS SOMMES TOUS DANS LA SITUATION DES CAMARADES DE DELPHI. C'est pour cela que la réponse est la SOLIDARITE DE CLASSE de tous les travailleurs, la solidarité de tous les exploités.
Nous saluons le commencement de la lutte à Delphi et le fait que ce soit les femmes et les familles qui, de façon solidaire, ont pris l'initiative à travers des manifestations quotidiennes. Nous saluons le fait qu'à l'usine d'Airbus et à Bazan ils ont commencé à faire preuve de solidarité.
Une manifestation a été convoquée pour le 1er mars à Cadix. Plus les travailleurs seront nombreux à y participer, tant à Cadix qu'à Puerto Real comme d'autres régions, d'autres entreprises, d'autres secteurs, plus LES CAMARADES DE DELPHI AURONT DE FORCE ET PLUS DE FORCE NOUS AURONS TOUS.
La solidarité est une question de vie ou de mort que nous devons discuter et impulser partout.
Solidarité de classe et fausse solidarité
Nous devons distinguer la FAUSSE SOLIDARITÉ, la « solidarité » du bourreau et de ses complices, de la VÉRITABLE SOLIDARITÉ, qui ne peut être que la SOLIDARITE DE TOUS LES TRAVAILLEURS, DE TOUS LES EXPLOITÉS, exprimée de façon directe et massive.
La FAUSSE SOLIDARITÉ c'est la solidarité du gouvernement d'Andalousie qui pousse des cris d'orfraie parce que l'entreprise « ne lui a rien communiqué » alors qu'il lui avait versé des subventions à la pelle, et déroulé un tapis rouge devant elle en échange d'une limitation des salaires des travailleurs et de l'amélioration de leurs conditions de travail en leur faisant du chantage avec le refrain bien connu : « se sacrifier pour obtenir des créations d'emplois ».
La FAUSSE SOLIDARITÉ c'est celle du gouvernement PSOE, qui par la bouche de Madame Fernandez de la Vega (vice-présidente du gouvernement) a déclaré solennellement qu'elle « travaille avec le gouvernement d'Andalousie pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune famille qui souffre des conséquences d'un processus de cette nature », ce qui signifie tout simplement : il faut accepter les licenciements (appelés par euphémisme « le processus ») et se contenter de quelques broutilles. Quelle solidarité pouvons-nous attendre d'un gouvernement qui vient d'augmenter de 12 à 15 ans la durée de travail minimale pour avoir droit à une pension et qui a été l'organisateur des licenciements de 2005 dans les chantiers navals ?
La FAUSSE SOLIDARITÉ c'est celle des organisations syndicales qui, dans le silence des bureaux, signent tout ce que le gouvernement, la CEOE (l'organisation patronale) et les patrons concernés leur mettent sur la table et qui ensuite, pour la galerie, « protestent », « se lamentent ». Quelle alternative nous offrent-elles ? Un nouvel « accord » avec de nouveaux sacrifices pour « préserver l'emploi ». Accord qui consiste à accepter le licenciement de beaucoup de camarades, la dégradation des conditions des « bienheureux » qui restent en poste et la prolongation de l'agonie pour un ou deux ans jusqu'à ce que la Direction, implacable et renforcée par une telle capitulation, annonce une autre série de licenciements qui sera présentée comme la dernière.
La FAUSSE SOLIDARITÉ c'est celle des partis, PSOE, PP (Parti Populaire) et IU (Gauche Unie), celle des maires de la région, qui appellent à la « mobilisation citoyenne » dans laquelle on veut diluer et paralyser une riposte forte, unie et solidaire des travailleurs.
La véritable solidarité réside dans la lutte massive et indépendante des travailleurs à laquelle peuvent et doivent s'associer tous les opprimés et exploités. Nous avons un exemple récent à Vigo, en mai 2006 ; les travailleurs du secteur de la métallurgie ne sont pas tombés dans ces pièges de la fausse solidarité et ont mis en pratique la véritable solidarité en luttant massivement, avec la participation aux manifestations des différentes usines, en établissant le contact direct et la lutte directe des ouvriers eux-mêmes. Ils ont organisé chaque jour une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ouverte aux autres travailleurs et à toute personne qui voulait soutenir la lutte et y participer.
A Delphi se pose la nécessité de rester dans l'usine pour éviter que les installations ne soient fermées pendant la nuit dans le dos des ouvriers. Mais en même temps se pose la nécessité, encore plus vitale, de gagner la solidarité directe des autres travailleurs, de Bazan, d'Airbus, de la baie de Cadix... Pour répondre à ces deux nécessités, il faut s'inspirer de l'exemple des camarades de Vigo : il faut organiser des assemblées massives à la porte de l'usine où peuvent se joindre les femmes, les familles, les autres travailleurs... tous ont quelque chose à apporter, tous unis nous serons forts pour arrêter les licenciements.
CCI (25 février 2007)
(1) équipementier pour l’automobile américain ayant plusieurs usines en Espagne et en Europe. C’est l’usine de Puerto Real, en Andalousie, qui a été fermée provoquant la perte de 1600 emplois directs et 4000 indirects.
Géographique:
- Espagne [42]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Face à toutes les attaques du gouvernement, c'est tous unis qu'il faut se battre !
- 2839 lectures
C'est au nom de « l’équité sociale » que Sarkozy et ses amis milliardaires ont le culot de nous demander d’accepter la suppression ou l’aménagement des régimes spéciaux de retraite en les alignant sur 40 ans pour tous.
Ce que revendiquent les cheminots, les employés de la RATP, les gaziers, les électriciens, ils l’ont clairement proclamé dans leurs AG : ce ne sont pas des « privilèges », c’est 37 ans et demi pour tous !
S’ils laissent passer cette attaque sur les régimes spéciaux, les ouvriers savent bien que l’État nous demandera à tous dès demain d’aller à 41 puis 42 ans de cotisations pour toucher une retraite à taux plein et même bien au-delà comme en Italie (qui passera bientôt à un régime de retraite à 65 ans) et allant jusqu’à 67 ans comme c’est déjà le cas en Allemagne ou au Danemark.
Dans les facultés, ce même gouvernement a adopté en douce, durant l'été (avec la complicité de l'UNEF et du Parti Socialiste), une loi qui prépare une université à 2 vitesses : d’un côté des « pôles d'excellence » réservés aux étudiants les plus friqués, de l’autre des « facs poubelles » qui préparent une majorité des jeunes générations, les enfants issus des milieux les plus pauvres, à leur condition de futurs chômeurs ou de travailleurs précaires.
Dans la fonction publique, le gouvernement se prépare à supprimer 300 000 emplois d’ici 2012 alors que, dès aujourd’hui, les enseignants sont confrontés à des classes surchargées et qu'on impose à tous les fonctionnaires de plus en plus de tâches et d’heures supplémentaires.
Dans les entreprises du privé, les suppressions d’emplois et les vagues de licenciements continuent à tomber à tour de bras alors que le gouvernement Sarkozy se prépare à nous imposer une réforme du Code du travail où le maître mot est la « flexi-sécurité » permettant aux employeurs de nous jeter encore plus facilement à la rue du jour au lendemain.
Au 1er janvier 2008, nous devrons payer de nouvelles franchises médicales qui vont se cumuler avec le déremboursement croissant des médicaments, la hausse du forfait hospitalier (institué par l’ex-ministre PCF Ralite), la franchise sur les actes médicaux de plus de 90 euros, une nouvelle hausse de la CSG…
Sarkozy nous demande de « travailler plus pour gagner plus ». En fait, il est clair qu’il s’agit de travailler plus pour gagner moins. La chute vertigineuse du pouvoir d’achat s’accompagne aujourd’hui d’une augmentation exorbitante de tous les produits alimentaires de base : produits laitiers, pain, pommes de terre, fruits et légumes, poisson, viande…
En même temps, les loyers flambent : de plus en plus de prolétaires vivent aujourd’hui dans des conditions de logement précaires ou insalubres.
De plus en plus de prolétaires, même avec un travail, sont déjà plongés dans la misère, sont incapables de se nourrir, de se loger, de se soigner décemment. Et on nous dit : "ce n’est pas fini". L’avenir qu’on nous réserve, les attaques qu’on nous promet seront demain bien pires encore. Et cela parce que la bourgeoisie française a entrepris de combler son retard par rapport à ses concurrentes des autres pays. Avec l'aggravation de la crise du capitalisme, avec l'exacerbation de la concurrence sur le marché mondial, il faut "être compétitif". C'est-à-dire attaquer toujours plus les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.
La seule façon de s’opposer à toutes ces attaques c’est de développer les luttes
La colère et le ras-le-bol qui s’expriment aujourd’hui dans la rue comme dans les entreprises, ne peuvent que se généraliser partout parce que les travailleurs sont contraints de se battre partout face aux mêmes attaques.
Depuis 2003, la classe ouvrière (qui, selon les dires de la bourgeoisie, serait une « notion dépassée ») démontre sa combativité, précisément face aux attaques sur les retraites en 2003 en France et en Autriche, contre les réformes du système de santé, face aux licenciements dans les chantiers navals galiciens en Espagne en 2006 ou dans l’automobile en Andalousie au printemps dernier. Aujourd’hui, leurs frères de classe cheminots en Allemagne sont en lutte pour des hausses de salaires. Dans toutes les luttes, du Chili au Pérou ces derniers mois, en Égypte comme chez les travailleurs immigrés du bâtiment à Dubaï encore récemment, émerge un profond sentiment de solidarité de classe qui pousse vers l’extension de la lutte face à une même surexploitation. Et c’est cette solidarité de classe, qui s’est manifestée dans la lutte des étudiants contre le CPE au printemps 2006, qui est au cœur des enjeux de la situation. C’est ce que craint par-dessus tout la bourgeoisie.
Les syndicats sabotent et divisent la riposte ouvrière
S’attaquer d’abord aux régimes spéciaux de retraite dans des secteurs particuliers comme les transports publics (SNCF, RATP) et l’énergie (EDF, GDF) ne peut rapporter que des économies dérisoires à l’État. C’est un choix purement stratégique de la bourgeoisie française pour tenter de diviser la classe ouvrière.La gauche et les syndicats sont entièrement d’accord sur le fond avec le gouvernement; ils ont toujours mis en avant la nécessité des « réformes », celle des retraites et des régimes spéciaux en particulier. C’est d’ailleurs l’ancien Premier ministre socialiste Rocard qui avait, au début des années 1980, rédigé le « livre blanc » des retraites qui sert de canevas à toutes les attaques mises en place sur ce plan par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite. Les critiques actuelles de la gauche et des syndicats portent uniquement sur la forme : elles ne sont pas décidées « démocratiquement », il n’y aurait pas assez de« concertation ». La gauche étant momentanément hors jeu, notamment avec les « débauchages » pratiqués par Sarkozy, le rôle essentiel d’encadrement de la classe ouvrière revient aux syndicats. Ces derniers se sont partagés le travail avec le gouvernement (comme entre eux) à tous les niveaux pour saboter et diviser la riposte ouvrière. Il est nécessaire à la bourgeoisie d’isoler les ouvriers du secteur des transports publics, de les couper de la réaction de l’ensemble de la classe ouvrière.
Dans ce but, la classe dominante a mobilisé tous ses médias pour tenter de discréditer la grève et matraquer l’idée que les autres travailleurs étaient les otages d’une minorité égoïste de privilégiés en profitant du fait que le principal secteur concerné par les régimes spéciaux était constitué par les entreprises de transport public. Elle mise sur l’impopularité d’une longue grève des transports et plus particulièrement sur celle de la SNCF (secteur traditionnellement le plus combatif lors des grèves de l’hiver 1986/87 et celles de 1995) pour dresser les « usagers » contre les grévistes.
Chaque syndicat a pris sa part dans la division et l’isolement des luttes :
- La FGAAC (syndicat des conducteurs de train très minoritaire représentant 3% des agents dans l’ensemble de la SNCF mais 30% de cette corporation), après avoir appelé pour le 18 octobre à une « grève reconductible » aux côtés de SUD et de FO, s’empressait le soir même de la manifestation de négocier avec le gouvernement la promesse d’un « compromis » et d’un statut particulier pour les « roulants » en appelant à la reprise du travail dès le lendemain matin, endossant ainsi le rôle du « traître » de service ;
- La CFDT n’a appelé ce jour-là que les seuls cheminots à faire grève et à manifester, pour « ne pas mélanger tous les problèmes et toutes les revendications », selon les déclarations de son secrétaire général Chérèque ; par la suite, cette centrale, fidèle à la même tactique, s’empressait d’appeler à la « suspension de la grève » à la SNCF et à la reprise du travail dans les autres secteurs dès que le gouvernement a manifesté son intention d’ouvrir des négociations entreprise par entreprise ;
- La CGT, syndicat majoritaire, a joué un rôle décisif dans la manœuvre faite dans le dos de la classe ouvrière. Elle s’est limitée à une journée de grève « carrée » de 24 heures le 18 octobre (tout en laissant les unions départementales prendre des « initiatives » pour prolonger la grève). Ensuite, elle prenait l’initiative de lancer un nouvel appel à la grève pour les cheminots cette fois reconductible à partir du 13 novembre au soir qui ralliait les autres secteurs et les autres syndicats derrière cette proposition. Le 10 novembre, le secrétaire général de la CGT Thibault demandait au gouvernement l’ouverture d’une négociation globale tripartite sur les régimes spéciaux (qui n’est que de l’esbroufe car c’est le gouvernement qui dicte directement sa politique aux directions des entreprises publiques) et deux jours après, le 12, à la veille même du début de la grève, il lançait une nouvelle initiative : en proposant toujours des négociations tripartites mais cette fois entreprise par entreprise. C’est prendre les ouvriers pour des imbéciles car c’est précisément dans ce cadre que le gouvernement avait dès le début prévu de faire passer la réforme en « saucissonnant » les négociations, entreprise par entreprise, au cas par cas. Cette volte-face et cette « entourloupe » ont provoqué des réactions houleuses dans les AG contraignant la « base » de ce syndicat à préconiser la poursuite du mouvement de grève ;
- FO et surtout SUD (syndicat piloté par la LCR d'Olivier Besancenot) qui avaient cherché à prolonger minoritairement la grève plusieurs jours au lendemain du 18 octobre, continuent à se concurrencer dans une surenchère plus radicale en poussant les ouvriers à se maintenir en grève reconductible jusqu’à la grève intersyndicale de la fonction publique du 20 novembre, tout en poussant les ouvriers à occuper les voies avec des opérations de commandos au lieu de chercher à étendre la lutte à d’autres secteurs ;
- Un leader de l’UNSA, aussi partie prenante d’une grève reconductible, déclarait de son côté que les cortèges devaient être distincts et que les cheminots ne devaient pas défiler avec les fonctionnaires car « ils n’ont pas du tout les mêmes revendications ».
Pour lutter efficacement, ne comptons que sur nous-mêmes !
Malgré la volonté du gouvernement de casser la résistance des ouvriers, malgré la multiplication des injonctions péremptoires du gouvernement à la reprise du travail, malgré la complicité et tout le travail de sape et de sabotage des luttes par les syndicats, non seulement la colère et la combativité ouvrière subsistent mais la volonté d'unifier les différents foyers de lutte commence à émerger. A Rouen par exemple, le 17 novembre, des étudiants de la faculté de Mont-Saint-Aignan sont allés trouver les cheminots en grève, ont partagé leur repas et ont participé à leur AG ainsi qu’à une opération de mise en place de « péage gratuit » sur l’autoroute. Peu à peu germe ainsi l’idée de la nécessité d’un combat massif et uni de toute la classe ouvrière pour pouvoir faire face à la poursuite inévitable des attaques du gouvernement. Pour cela, les travailleurs en lutte doivent tirer les leçons du sabotage syndical. Pour pouvoir se battre efficacement, opposer une riposte unie et solidaire en recherchant toujours plus l'extension de leur lutte, ils ne peuvent compter que sur leurs propres forces. Ils n'auront pas d'autre choix que de prendre eux-mêmes leurs luttes en mains et de déjouer tous les pièges, toutes les manoeuvres de division et de sabotage des syndicats.
Plus que jamais, l’avenir est au développement des combats de classe.
Wim (18 novembre)Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Journée d'étude du CCI en Grande Bretagne : un débat vivant et fraternel
- 2588 lectures
L'enthousiasme et la volonté de débattre autour de cette question ne se sont pas démentis : les participants sont venus de tout le pays mais aussi d'Espagne, de Suisse et de Turquie 2. Cette discussion riche et animée est retranscrite presque intégralement, ainsi que les présentations introductives réalisées par des camarades non-membres du CCI, sur notre site Web en langue anglaise. Nous nous contenterons ici de relever les questions principales débattues durant cette journée d'étude.
Développement de la conscience et de l'auto-organisation
La question première qui nous avait réunis pour cette journée d'étude était à l'origine : "Le communisme est-il une utopie ?". Mais, en réalité, la plupart des contributions se sont rapidement orientées plus précisément sur la question de "Comment parvenir au communisme ?"
Ainsi, au fil de la discussion, nous avons cherché à mieux comprendre quel est le rôle des révolutionnaires. Sont-ils les organisateurs de la classe ouvrière ? Apprennent-ils à la classe ouvrière la nature du capitalisme et comment elle peut le renverser ? Le rôle des révolutionnaires n'est-il pas de participer au développement de l'auto-organisation, de la conscience et de la solidarité de la classe ouvrière ?
En effet, bien que les minorités révolutionnaires aient un rôle absolument essentiel à jouer, elles ne peuvent se substituer à l'activité consciente de la classe ouvrière dans son ensemble. La discussion a donc développé une vision de la classe ouvrière et du rôle de ses minorités les plus conscientes qui vient démentir les assertions du gauchisme. Ce courant, non seulement ôte toute auto-activité aux ouvriers, mais se pose aussi en sauveur de la classe ouvrière et de sa lutte. Cette politique est aux antipodes des intérêts de notre classe.
La révolution prolétarienne sera un pas de géant pour l'humanité
Différentes interventions ont tenu à rappeler l'immensité de la tâche qui se dresse devant la classe ouvrière. En particulier, nous devons faire attention aux difficultés auxquelles fera face la classe ouvrière par rapport aux autres couches sociales non-exploiteuses. En Europe de l'Ouest, où une majeure partie de la population est salariée et payée par des entreprises petites ou grandes, il peut être facile d'oublier que cette situation ne prévaut pas partout dans le reste du monde. Dans la plupart des pays sous-développés, non seulement il y a des paysans sans terre, mais il y a aussi des millions d'individus dans des situations de grande précarité, vivant au jour le jour par tous les moyens qu'ils peuvent trouver. Dans de nombreuses grandes villes de ces régions, il y a beaucoup de zones extrêmement démunies où les travailleurs agricoles vivent aux côtés de ceux qui peuvent être décrits comme faisant partie de l'économie "informelle", vivant du crime, de la mendicité, d'escroqueries, de troc ou de tout expédient ressemblant à du travail.
La classe ouvrière a une très grande responsabilité face à toutes ces couches de l'humanité. Même si elle partage des conditions de vie tout aussi misérables que ces autres couches, elle fait face au capital et à son Etat dans une relation différente, car elle représente la force qui peut renverser le capitalisme. C'est pourquoi ses luttes, ses actes et sa force de persuasion dans les discussions peuvent entraîner les autres couches exploitées vers la perspective du communisme. Si pour la classe ouvrière, la tâche est donc immense, l'enjeu est grandiose pour toute l'humanité !
L'Etat ne peut pas mener au socialisme
La deuxième partie de la discussion de cette journée d'étude a commencé par une présentation sur le rôle de l'Etat, comment il ne peut amener au socialisme et pourquoi il doit être détruit par la lutte révolutionnaire.
Très vite, nous en sommes venus à prendre en considération la nature des illusions dans les rangs de la classe ouvrière. Avec la force de la campagne actuelle autour de Chavez comme représentant du socialisme au Venezuela, il n'est pas surprenant que des ouvriers aient été pris dans la propagande qui prétend permettre d’accéder graduellement au socialisme par des mesures d’Etat. Ainsi, la vision qu'ont beaucoup d'ouvriers sur l'Etat est qu'il servirait de « protecteur » vis-à-vis des pires excès du capitalisme. Ceci correspond à l'idée que la démocratie pourrait être organisée dans les intérêts de la classe ouvrière.
Dans la discussion, nous avons abordé les exemples de prédilection des tenants de « la possibilité d'un Etat social et protecteur » : l'éducation et la santé publique. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays les plus industrialisés détruisent progressivement l'accès aux soins et à l'éducation. Mais ce n'est absolument pas parce que l'Etat aurait abandonné sa politique sociale de l'après-guerre. Cette « politique sociale » est un mythe. En réalité, si la bourgeoisie a organisé à partir des années 1950 une politique de soins et d'éducation à l'échelle nationale, cela s'est fait dans l'unique but d'avoir une main d'œuvre en bonne santé et éduquée... donc plus productive ! Aujourd'hui, le démantèlement de « l'Etat providence » signifie simplement que la bourgeoisie n'a même plus les moyens de cette politique, que la profondeur de sa crise économique la rend même incapable d'entretenir convenablement la force de travail qu'elle exploite !
Pour finir, il faut dire que cette discussion a été traversée par un très bon état d'esprit. Bien qu'il y ait eu des divergences, elles furent toujours approchées avec camaraderie. La tenue et la réussite d'une telle réunion, internationale et internationaliste, ouverte et fraternelle, témoignent de la dynamique actuelle de notre classe, le prolétariat, qui est en train de réfléchir en profondeur, de développer progressivement sa conscience. L'émergence d'individus et de groupes, portés par la volonté de débattre, en est la démonstration la plus vivante !
A la fin de cette journée d'étude, nous avons demandé aux participants leur impression : tous étaient enthousiastes. Etant donné le succès de cette journée de discussion, nous aimerions la répéter et l'élargir dans l'avenir, en Grande-Bretagne comme ailleurs. Des camarades intéressés à participer à de telles journées doivent nous écrire. Les idées, propositions de thème et autres questionnements, seront les bienvenus.
D'après World Révolution, section du CCI en Grande-Bretagne
1 Le Communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle. Ce livre peut être commandé sur notre site Web internationalism.org ou par courrier ( lire notre adresse page 7).
2 Le camarade de Turquie était là en tant que représentant d'un groupe politique prolétarien nommé Enternasyonalist Komünist Sol (EKS). Ce tout jeune groupe se réclame ouvertement des positions de la Gauche Communiste (courant auquel appartient le CCI) et de l'internationalisme prolétarien. Pour en savoir plus sur EKS, lire notre article « Une voix internationaliste en Turquie [111] », publié dans Internationalisme n° 327, organe du CCI en Belgique.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Kondopoga : A bas le pogrom, arme de l’État pour diviser la classe ouvrière!
- 3997 lectures
La véritable débauche de haine, les émeutes accompagnées d'incendies et de pillages, qui s'est déchaînée contre les Caucasiens et les Tchétchènes à Kondopoga, petite ville industrielle proche de la frontière russo-finlandaise, a eu un large retentissement au plan national, en Russie, et même internationalement.
Les événements de Kondopoga sont loin d'être un cas isolé. Surtout depuis la guerre en Tchétchénie qui a commencé en 1994. Mais ces derniers mois, des pogroms ont éclaté dans plusieurs régions de Russie. Au mois de mai 2006, à Novossibirsk, 20 autochtones ont incendié une dizaine de maisons tsiganes sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue ; dans la ville de Kharagun (région de Tchita), des heurts ont opposé Russes et Azerbaïdjanais, résultat : un mort ; dans la région d'Astrakhan, à la suite du meurtre d'un jeune Kalmouke lors d'une bagarre avec des Tchétchènes, 300 Kalmoukes ont agressé les Tchétchènes et ont incendié leurs maisons. Un mois après, dans le village de Targuis (région d'Irkoutsk) un pogrom anti-Chinois s'est conclu par l'expulsion de 75 Chinois. Quelques jours plus tard, c'est contre les Daghestanais que les habitants de Salsk (région de Rostov) se sont mobilisés ; les troubles ont fait un mort. Le 21 août, une bombe a explosé sur le marché Tcherkizovo à Moscou, où la plupart des commerçants viennent d'Asie centrale ou d'Extrême-Orient ; bilan: 12 morts et plus de 40 blessés. Les Tchetchènes, cherchant refuge contre la guerre, concentrent sur eux la plus forte hostilité, ainsi que les Tsiganes.
A Kondopoga, le pogrom anti-Caucasiens a pris une intensité sans précédent. Pendant cinq jours, du 30 août au 5 septembre 2006, une foule de plusieurs centaines d'individus (en majorité des jeunes hommes de 15 à 20 ans) se déchaîne. Elle porte sa vindicte d'abord contre le marché de la ville où, comme dans toutes les villes de Russie, des Caucasiens tiennent les stands de fruits et légumes. Les stands sont dévastés, les commerces pillés et incendiés. Puis, les émeutes se répètent plusieurs nuits de suite attaquant échoppes, garages et voitures appartenant aux Caucasiens, à coups de pierres, de bouteilles et de cocktails Molotov. On tente aussi d'incendier l'école où plusieurs familles d'Asie centrale avaient trouvé refuge ! Plusieurs mouvements nationalistes se sont impliqués et ont publiquement appelé à la "déportation" immédiate des Caucasiens. Les troubles se sont terminés par un départ massif de la population immigrée de la ville prise de panique. 200 Caucasiens et des dizaines de Tchétchènes ont quitté les lieux et trouvé refuge dans une autre ville à 50 kilomètres de là, pour protéger leur vie.
La complicité des groupes néo-nazis et de l'Etat
De nombreuses voix ont stigmatisé la responsabilité des ultranationalistes du Mouvement contre l'immigration illégale (DPNI). Venus de Moscou et de Saint-Pétersbourg, les militants de ce groupuscule xénophobe pro slave, épaulés par des néonazis, ont joué un rôle central pour chauffer à blanc les jeunes cerveaux et pour organiser les manifestations dans le pogrom qui a déferlé sur Kondopoga. Cependant s'ils ont pu agir ainsi c'est parce qu'ils n'ont pas agi seuls. Leur action n'a été possible qu'avec l'aval des autorités et de la bourgeoisie locales. Le leader ultranationaliste du DPNI, Belov, s'est même rendu sur place à l'invitation du député local du parti populiste LDPR, Nikolaï Kourianovitch, appelant à la formation d'une milice d'anciens combattants russes en Tchétchénie pour y rétablir l'ordre !
Les autorités publiques font des Caucasiens les boucs émissaires responsables de tous les maux qui accablent la population. Elles stigmatisent leur "richesse ostentatoire" et "leur Mercedes roulant à tombeau ouvert" sans parler de leurs "combines maffieuses" ou des pots de vins versés à la police pour qu'elle ferme les yeux. Le gouverneur de la région, Katanandov, membre de Russie Unie, le parti de Poutine, étalant le racisme ordinaire propre à sa classe, a largement contribué à souffler sur les braises pour attiser la vindicte et l'irrationalité pogromistes : "La raison principale [des troubles] est que des représentants d'un autre peuple se sont conduits de façon impertinente et provocatrice, ignorant la mentalité de notre peuple" les Caucasiens auraient ainsi pris l'habitude "de ne pas faire la queue au contrôle technique" en cas d'accident de voiture, "montrant que tout leur est permis" [sic[1]] Il en rajoute dans la surenchère nationaliste, justifiant le pogrom en dénonçant "ces jeunes gens venus du Caucase et d'autres régions" qui se comportent "en occupants" pour clamer : "Ils font profil bas ou ils partent." [2]
La collusion entre les autorités officielles et les groupes néo-nazis n'est pas un dérapage de sous-fifres locaux des échelons inférieurs de l'État. En vérité, l'État russe possède lui-même ses propres raisons pour faire des Caucasiens des boucs émissaires. L'atmosphère de pogrom entre parfaitement dans l'intérêt de l'État russe. Elle est en réalité directement encouragée par la grande bourgeoisie et l'état. C'est l'un des moyens les plus répugnants utilisés dans la défense de ses intérêts impérialistes. Les groupes néo-nazis, s'ils ne sont pas directement des émanations du pouvoir, sont largement manipulés par le Kremlin. D'une part, celui-ci se sert d'eux comme d'une police officieuse et parallèle pour leur sous-traiter la sale besogne de la répression contre tout genre d'opposition. D'autre part, ils constituent de précieux auxiliaires pour propager au sein de la population la haine et l'hystérie nationalistes, propices aux exactions barbares de l'impérialisme russe en Tchétchénie.
Dans le bras de fer entre requins impérialistes qui oppose Géorgie et Russie, c'est en attisant cette atmosphère pogromiste que l'État russe a pris des mesures de rétorsions contre les Géorgiens présents en Russie, pour exercer ses représailles contre Tbilissi, suite à la brusque aggravation des tensions entre les deux états après l'arrestation de quatre officiers russes accusés d'espionnage, le 27 septembre. Ainsi Poutine, début octobre, donne-t-il lui-même dans la dénonciation des "groupes criminels ethniques" qui régissent le commerce de détail exigeant que l'on "mette de l'ordre" sur les marchés, qualifiés de lieux les "plus ethniquement pollués" du pays, pour défendre "les intérêts des producteurs russes et de la population autochtone"[3] afin de procéder à l'expulsion du territoire russe de plusieurs milliers de Géorgiens, "criminalisés" et prétendument en situation irrégulière.
L'autre utilité, et non la moindre, que trouvent la bourgeoisie et l'État en attisant l'esprit de pogrom, c'est le moyen de semer la division dans les rangs de son ennemi mortel, le prolétariat, et pour empêcher les classes opprimées de voir où se trouvent leurs réels ennemis. Ces campagnes abjectes répétées contre les immigrés qui "volent le travail aux Russes et les pervertissent" (credo de l'État comme des groupes ultranationalistes) constituent l'arrière-plan idéologique des attaques et des multiples agressions physiques dont sont victimes les immigrés. Faire porter sur les immigrés la responsabilité du déclin général des conditions de vie de la classe ouvrière, pour en faire les boucs émissaires, est consciemment destiné à saper l'identité et la solidarité de classe du prolétariat.
L'instigation des pogroms par l'État s'inspire directement d'une longue tradition nationale, notamment des crimes du tsarisme envers les Juifs. L'État russe, qui institue la xénophobie comme idéologie officielle, ne fait que remettre au goût du jour la sinistre ‘tradition' des "règlements provisoires destinés à soustraire les Chrétiens de l'exploitation juive" d'Alexandre III (1882) dans la défense de la domination de classe de la bourgeoisie. Prévoyant qu'"un tiers de juifs émigrera, un tiers se convertira, un tiers périra" ceux-ci ont été promulgués en grande partie dans le but d'attiser le déchaînement de pogroms antisémites, pour servir de dérivatif afin de paralyser et empêcher toute lutte contre le pouvoir monarchique. C'est pourquoi le mouvement ouvrier dénonçait dans les pogroms le rôle de l'État et de "l'autocrate de toutes la Russie qui sert de protecteur suprême à cette camorra à demi-gouvernementale de brigands et de massacreurs, soutenue par la bureaucratie officielle (...) et qui a pour état-major la camarilla des courtisans" (Trotsky, 1905) Les têtes couronnées ne servent plus de décorum à l'État capitaliste mais celui-ci préside toujours aux mêmes scénarios barbares !
Les pogroms n'ont rien à voir avec la lutte du prolétariat
Dans une prise de position, Kondopoga - un soulèvement populaire qui tourne au pogrom, publiée sur Internet en septembre 2006[4] et dont nous ne savons pas si elle constitue une initiative individuelle de son auteur (M. Magid) ou si elle reflète la position officielle de l'organisation dont il se revendique (section russe de l'AIT) se trouvent développées de dangereuses confusions tant concernant la nature de classe du mouvement que sur les perspectives dont il est porteur. Bien plus l'auteur s'évertue même à en faire un mouvement, si ce n'est de la classe ouvrière elle-même, à tout le moins utile à son combat. "Partout, ou Presque partout dans la province russe se répand la destruction causée par les bandits de toutes les nationalités qui contrôlent les marchés locaux, les entreprises et les banques. (...) A Kondopoga, nous avons assisté à une tentative des gens pour mettre sur pied un organe d'auto-administration, une assemblée régulière populaire qui prendrait des décisions que les autorités devraient exécuter conformément à l'opinion des gens. Mais les émeutes se sont transformées en émeutes nationalistes. (...) Est-ce que ce mouvement était sous la conduite ou à l'initiative des fascistes ou des négociants locaux ? Non, cette assertion est un mensonge des médias officiels. C'était une émeute populaire, des travailleurs, qui s'est développée dans une direction nationaliste, sans danger pour les autorités, en partie à cause des événements eux-mêmes, en partie à cause de l'initiative des commerçants locaux."
Au final, l'auteur institue les moyens utilisés, l'émeute et le pogrom, comme des armes valables que le prolétariat peut utiliser. Le seul regret critique qu'il émet, c'est le qu'il aurait fallu ne pas se contenter de cibler ceux qu'il nomme les bandits caucasiens mais élargir l'action aux bandits russes. Le plus frappant c'est qu'il prend sans barguigner pour argent comptant les campagnes nationalistes de l'État capitaliste faisant des Caucasiens ‘tous des maffieux'. A aucun moment il ne lui vient à l'idée que cela pourrait être une idée fausse. C'est clairement céder aux mensonges répugnants de l'État, lui apporter sa caution en se faisant le complice de la désignation raciste des Caucasiens comme boucs émissaires.
Cette attitude est en complète contradiction avec celle que doivent prendre les révolutionnaires en continuité du mouvement ouvrier. Face au pogrom antisémite de Kichinev en 1903, le Congrès de fondation du POSDR recommandait aux militants "d'utiliser tous les moyens en leur possession pour combattre de tels mouvements et pour expliquer au prolétariat la nature réactionnaire et classiste des incitations antisémites ou national-chauvines en général." L'attitude de la classe ouvrière et des révolutionnaires a toujours été d'apporter sa solidarité aux victimes des pogroms et de leur offrir sa protection. C'est une partie du rôle exercé par les soviets en 1905 et 1917 : "le soviet organisait les masses ouvrières, dirigeait les grèves et les manifestations, armait les ouvriers, protégeait la population contre les pogroms." (Trotsky, 1905) Sous la direction des conseils, dans un grand nombre de villes, les ouvriers organisèrent des milices armées pour réprimer les débordements des voyous pogromistes. Les Bolcheviks eux-mêmes se sont constamment et fortement impliqués dans la formation de groupes révolutionnaires armés pour s'opposer à eux. Voici un exemple de l'action bolchevique dans la ville d'Odessa : "Là, je fus témoin de la scène suivante : un groupe de jeunes hommes, âgés de 20 à 25 ans, parmi lesquels se trouvaient des agents de police en civil et des membres de l'Okhrana, raflait quiconque ressemblait à un Juif - hommes, femmes, enfants - les dépouillant de leurs vêtements et les battant sans merci... Nous organisâmes immédiatement un groupe de révolutionnaires armés de revolvers... Nous courûmes à eux et fîmes feu sur eux. Ils déguerpirent. Mais, entre les pogromistes et nous, apparut soudain un solide mur de soldats armés jusqu'aux dents et nous faisant front. Nous battîmes en retraite. Les soldats s'en allèrent et les pogromistes réapparurent. Cela se produisit plusieurs fois. Il était clair pour nous que les pogromistes agissaient de concert avec l'armée." [5] Aujourd'hui, le prolétariat n'a pas la force d'adopter de telles mesures: mais pour retrouver sa force, c'est cette attitude des bolcheviques qu'il faut adopter, et non pas celle que nous propose M Magid. Si les ouvriers se laissent diviser et se laissent entraîner dans des pogroms, ils courent à leur perte. Pour la classe ouvrière, c'est une véritable question de vie ou de mort.
La vision, que développe Magid, qui autorise la désignation de boucs émissaires sur lesquels on fait porter la responsabilité de la situation insupportable crée par la crise économique capitaliste procède d'une vision complètement étrangère au prolétariat. Cette ambiguïté sur la nature des pogroms condamne ceux qui l'acceptent à faire le jeu politique de l'État. Ce qui explique ces errements, c'est l'absence de critères de classe pour aborder la réalité de la société capitaliste et les luttes qui la traversent, dissolvant le prolétariat dans le tout indifférencié du ‘peuple' ainsi que le culte bakouniniste de la violence et du déchaînement des passions destructrices, conçu comme le viatique de la révolution, typiques de l'anarchisme. C'est dans ses fondements mêmes que résident les racines de ces confusions dangereuses pour le combat de classe et les bases qui en font le soutien du pogromisme.
Le prolétariat ne peut parvenir à assumer son avenir révolutionnaire qu'en développant sa solidarité et qu'en rejetant toutes les formes de divisions que le capitalisme lui impose. Toutes les formes de nationalisme et de racisme ne peuvent qu'affaiblir son combat pour son émancipation. La révolution n'est pas et ne peut pas être une vengeance exercée contre une partie de la population rendue responsable de sa situation. La lutte de la classe prolétarienne se développe en vue de la destruction du capitalisme comme système, basé sur l'exploitation du travail salarié dans le cadre des rapports de production capitaliste. Son objectif final est la transformation de l'ordre des choses existant dans la société afin de "créer des conditions de vie pour tous les êtres humains tels qu'ils puissent développer leur nature humaine avec leurs voisins dans des conditions humaines, et ne plus avoir peur que de violentes crises bouleversent leurs vie"[6].
A bas tous les pogroms !
A bas le système capitaliste qui les engendre et les utilise pour sa préservation!
Vive la solidarité internationale de tous les travailleurs!
[1] Libération.fr, 08.09.06
[2] Le Monde, 21.09.06
[3] lefigaro.fr, 17.11.06
[4] En russe sur avtonom.org ; en anglais sur https://libcom.org/forums/thought/kondopoga-a-popular-uprising-turned-to... [112]
[5] Piatnitsky, O., Zapiski Bol'shevika, (Memoirs of a Bolshevik), Moscow, 1956.
[6] Engels, Two speeches in Eberfeld, 1845
Géographique:
Courants politiques:
- Fascisme [114]
Nouveau site en langue chinoise
- 3058 lectures
Nous invitons nos lecteurs en Chine ou de langue chinoise à visiter le nouveau site dans cette langue [115] . Etant donné l'importance de la Chine pour le mouvement ouvrier mondial, l'ouverture de ce site est un moment important pour tout le CCI, même si pour l'instant nous n'avons pu afficher que nos positions de base. Nous espérons pouvoir publier d'autres textes ultérieurement.
Nous remercions le camarade responsable de la traduction pour ses efforts.
CCI, 2 octobre 2007
Vie du CCI:
- Interventions [37]
Oaxaca : les leçons d'un piège
- 3014 lectures
Durant plus de sept mois, un important mouvement social a eu lieu au Mexique, à partir d'une grève des enseignants dans la ville principale de la province, Oaxaca. Cette lutte s'est étendue rapidement à toute la population, qui soutenait les revendications des enseignants. Nous avons déjà traité dans notre presse (voir RI n° 375 et 376) de ce mouvement qui a pris de multiples formes. Aujourd'hui, les enseignants ont repris le travail, ayant subi une cuisante défaite et la pire répression. Ceux qui étaient massivement entrés en grève au mois de mai 2006 pour protester contre les conditions de travail et pour exiger l’augmentation des salaires ont été submergés par le déferlement d’organisations en tous genres, « de base », « populaires », venus apporter leur « aide » aux enseignants, comme la corde soutient le pendu. En effet, l’Assemblée Populaire des Peuples d’Oaxaca (APPO), structure interclassiste formée de l’agrégat de pas moins de 365 groupes de gauche, gauchistes et syndicalistes, qui a pris la tête du mouvement, s’est appuyée sur la grève des enseignants pour mettre progressivement au second plan leurs revendications et développer les thèmes pourris de la défense de la démocratie et de la lutte contre la corruption. Elle est parvenue à focaliser la lutte autour d'une seule revendication : réclamer la démission du gouverneur de la province. Ce mouvement s’est achevé dans une répression policière brutale fin décembre, alors que la question des enseignants était totalement laissée de côté, toute la propagande des médias mexicains et internationaux ne parlant plus que de la défense des leaders de l’APPO.
De nombreux mensonges ont été répandus sur ce qu’a représenté le mouvement d’Oaxaca et sur l’APPO comme « organe révolutionnaire ». Ainsi, des idées fausses ont été propagées d’une part sur le fait que le Mexique aurait vécu une véritable période « insurrectionnelle », avec la formation de Communes, voire de soviets et, d’autre part et plus généralement, sur le fait que l’APPO, les syndicats et les organisations gauchistes représentaient réellement les intérêts de tous et qu’ils auraient employé des méthodes authentiquement prolétariennes de lutte. De telles affirmations n’ont fait qu’entretenir la confusion dans la tête des ouvriers tout au long de la lutte et ont eu pour but d’empêcher que les véritables leçons de ce mouvement ne soient tirées par la suite.
Quelles sont les véritables formes de la lutte prolétarienne ?
Certaines formes de lutte qu’on a pu voir à Oaxaca (les sit-in, les blocages de routes, les rassemblements au son des casseroles, les méga-manifs, les grèves de la faim, les affrontements avec les forces armées de l’Etat, etc.), présentées comme des moyens de pression sur l’Etat, ont été autant de moments pour pousser les ouvriers dans l’isolement et l’enfermement, puis dans l’épuisement physique et moral. Elles n’ont réussi qu’à les placer encore plus fortement dans les mains des organisations populistes, gauchistes et syndicales pour le compte de la bourgeoisie.
Quand c’est le prolétariat qui contrôle ses propres grèves, ses manifestations ont pour but de chercher la solidarité active des autres ouvriers. Ainsi, ils s’adressent aux autres centres industriels et de travail, en cherchant à fomenter les discussions et l’extension du mouvement ; cela permet le développement progressif de l’unité, la compréhension de sa propre force, la reconnaissance même de la part des travailleurs de leur être en tant que classe, enfin, le développement de la conscience. On est aux antipodes de ce qui s'est déroulé à Oaxaca où les syndicalistes, les gauchistes, les tenants des partis officiels tenaient le haut du pavé, empêchant tout développement d'une réelle expression de solidarité et d'ouverture vers d'autres secteurs et surtout blindant toute réelle réflexion en réclamant l'"éviction de "l'ennemi principal", le gouverneur Ulyses Ruiz.
Ce qui est arrivé à Oaxaca a encore été baptisé des noms de commune, soviets, insurrection. Ces termes recouvrent les formes supérieures de la lutte de la classe révolutionnaire qui se développent après de longues périodes de combat pendant lesquelles le prolétariat apprend à s’organiser massivement et arrive à prendre une conscience claire de son objectif historique. Ces trois méthodes de lutte du prolétariat sont les formes pour abattre l’Etat et instaurer la dictature du prolétariat.
Les révoltes avec formations de barricades survenues à Oaxaca ne sont qu’une insulte à ces véritables formes de lutte de la classe ouvrière. Elles ont été en partie le résultat de l’immédiatisme, mais surtout de la crapulerie politique délibérée de leurs organisateurs qui ont fait passer ces bagarres sans lendemain avec les forces de répression de l’Etat pour le nec plus ultra de la lutte des classes, pour les prémices d’une insurrection « révolutionnaire ». Les morts, les blessés et les prisonniers sont la démonstration du caractère répressif et sanguinaire de l’Etat. Mais ces morts, ces blessés, ces prisonniers sont aussi la concrétisation de l’impasse mortelle, à la fois physiquement et pour la conscience du prolétariat vers où mènent les mobilisations dévoyées par les syndicalistes et les gauchistes.
L’APPO : une arme contre soumettre la classe ouvrière
Le rôle de l’APPO a été exemplaire en ce sens. Ainsi, la dynamique et la nature d’une lutte prolétarienne se condensent dans la forme que prend la lutte et dans les objectifs qu’elle se propose. Sur ces deux plans, l’APPO a représenté une récupération du mécontentement authentique des travailleurs 1. Cette forme d’organisation n’a jamais favorisé l’indépendance politique du prolétariat, bien au contraire ; ce regroupement de syndicats, d’organisations "sociales" et populaires n’a été qu’un énorme front inter-classiste, une "union sacrée" qui a noyé la moindre expression de recherche de solidarité pour la lutte dans un océan de "leaders syndicaux et sociaux" parmi lesquels pullulaient des personnages connus pour être dévoués corps et âme à l’appareil de gauche du capitalisme.
Rappelons que l’APPO n’a pas surgi avec le mouvement des enseignants (début mai 2006) mais le 23 juin, après que se soit abattue la répression de l’Etat sur les grévistes dès le le 14 juin. L’APPO a servi à stériliser et à détourner, pour la rendre inoffensive, toute l’authentique solidarité qui se développait spontanément parmi les ouvriers et les autres couches exploitées en réaction à la brutalité avec laquelle l’Etat réprimait impunément les enseignants. Cette structure a été le couronnement d’une manœuvre pour parachever idéologiquement la répression physique qu’avaient subi les enseignants. Dès sa mise en place, les travailleurs se sont ainsi retrouvés noyés et liés à une structure qui décidait et négociait en leur nom tout en faisant croire que les décisions se prenaient "à la base". Dans la réalité, elle n’a été qu’une arme pour enfermer, contenir et contrôler l’énorme mécontentement que le capitalisme a provoqué dans cette région où la pauvreté la plus extrême et la marginalisation sont le lot quotidien de milliers d’êtres humains. Cette manœuvre s’est concrétisée immédiatement par le dévoiement de la lutte contre la misère et l’exploitation en "lutte" pour la destitution du gouverneur Ulyses Ruiz, mot d’ordre qui a servi à dévoyer les énergies vers un faux objectif et à obscurcir la conscience des véritables enjeux.
Les assemblées générales organisées par l'APPO, dont l'existence a été répercutée par les gauchistes comme une preuve du contenu révolutionnaire du mouvement d'Oaxaca du fait de «la dynamique assembléiste présente dans la région» n'ont rien été d'autre que l'expression des luttes de cliques au sein de la même APPO. Loin d'être des lieux de réflexion et de discussions ouvertes, ce sont les multiples pressions et marchandages entre les différents intérêts bourgeois que ces organisations représentent qui ont dominé et se sont imposées. Lors de ces assemblées étaient légitimés des leaders « éternels », petits chefs attachés à l’une ou l’autre des fractions bourgeoises.
Dans ce panier de crabes, au sein-même de l'APPO, le syndicat des enseignants (SNTE) et son dissident (CNTE 2) ont pu préparer la défaite totale de ceux qui étaient à l'origine du mouvement, les travailleurs de l'enseignement en vidant de leur substance la solidarité des autres secteurs ouvriers d'Oaxaca et d'ailleurs..
Le développement de la conscience, seule arme véritable contre la répression
L’arrestation des "leaders" de l’APPO a suscité d’importantes discussions sur les "prisonniers politiques" et le "que faire ?" face à la répression. Il est juste et normal que la répression de l’Etat éveille la solidarité des opprimés avec tous ceux qui sont victimes de la répression. Il est aussi légitime et juste que l’indignation s’empare de nous quand on voit la démocratie et ses flics faire valoir leur supériorité "tactique et stratégique" en écrasant des manifestants et des êtres humains qui cherchent à lutter contre l’injustice, l’exploitation et la misère. La question ne se pose pas de savoir si nous devons réagir ou "faire quelque chose". Il faut faire quelque chose, mais nous devons d’abord discuter du contenu de ce quelque chose et de comment le faire.
L’éclairage de l’histoire nous montre que le prolétariat n’a pas beaucoup de chances de victoire dans une confrontation armée directe face à la police et autres sbires de l'Etat. D'une part, les pierres et les gourdins n'ont aucune efficacité contre les tanks, les armes à feu et les gaz de combat utilisés par les forces de répression. Mais d'autre part, ce qui constitue la force essentielle de la lutte ouvrière se trouve dans la conscience qu'elle a de ses buts et des enjeux pour lesquels le prolétariat se bat. La révolution prolétarienne mondiale ne sera pas gagnée par "celui qui cogne le plus fort" ; c’est l’action massive, déterminée et surtout consciente qui donne à la classe ouvrière toute sa force. C'est pour cela que le prolétariat doit se battre sur le terrain de ses revendications propres et que sa lutte ne doit pas être délayée au milieu des revendications démocratiques ou particularistes d'autres couches exploitées (encore moins au milieu de celles des représentants de la bourgeoisie, fussent-ils de gauche ou gauchistes). Dans son combat, la classe ouvrière intègre celui pour les intérêts de l'ensemble des exploités Elle se doit en ce sens de convaincre les couches non exploiteuses et marginalisées de la nécessité de détruire le capitalisme. Cependant, c'est sans concession par rapport à leur être de classe révolutionnaire, à leur situation de classe exploitée et à leur organisation propre que les ouvriers doivent développer leurs luttes.
Les révolutionnaires ne jugent ni ne méprisent la volonté, l’honnêteté et le courage de tous ceux qui, même quand ils agissent de façon volontariste, s’affrontent au système au nom de la défense des opprimés. En réalité, la "révolte" tant exacerbée par les gauchistes et les syndicalistes les poussent à un affrontement inutile et perdu d'avance contre les forces répressives de l'Etat, en leur faisant perdre toute conscience de pourquoi et comment se battre.
C'est pourquoi le destin de millions de marginalisés dépend directement de la capacité du prolétariat à ouvrir la voie de la destruction du capitalisme. C’est encore pourquoi il n’y a pas de lutte particulière, parcellaire (pour les prisonniers, pour les minorités raciales, pour les femmes, etc.) mais une lutte globale contre le capitalisme car c'est la destruction de la domination du capital qui détruira toutes les conséquences de ce système, et que seul le prolétariat peut imposer ce rapport de force.
Oaxaca nous a montré qu’il ne suffit pas d’avoir envie de lutter, encore faut-il que cette envie soit jointe à la conscience de qui sont les ennemis à affronter, des syndicats jusqu’à l’APPO. L’identification de ces ennemis est un grand pas en avant de la prise de conscience et est un moteur pour préparer les futurs combats.
D'après Revolucion Mundial (décembre 2006)
1 Lire le supplément en langue espagnole de Revolución mundial no 95, daté du 18 novembre 2006.
2 Son secteur le plus « radical », la Coordination centrale de lutte (CCL), même alors qu'il n'avait pas participé à la grève des enseignants, a totalement participé au scénario en focalisant sur la création d'une nouvelle centrale syndicale sans jamais remettre en cause l'APPO, au contraire.
Géographique:
- Mexique [85]
Où en est la lutte de classe ? (débat international)
- 2909 lectures
Combien de fois au cours de sa longue histoire, les patrons et les gouvernants ont-ils répété à la classe ouvrière qu'elle n'existait plus, que ses luttes pour défendre ses conditions d'existence étaient anachroniques et que son but ultime, renverser le capitalisme et construire le socialisme, était devenu un vestige désuet du passé ? Suite à l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens en 1989, les campagnes assourdissantes de la bourgeoisie sur la "faillite du communisme", la "victoire définitive du capitalisme libéral et démocratique", la "fin de la lutte de classe", voire de la classe ouvrière elle-même, ont provoqué un recul important du prolétariat, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité. Ce profond recul a duré plus d’une décennie. Il a marqué toute une génération de travailleurs, engendrant désarroi et même démoralisation.
Au cours des années 1990, la classe ouvrière n'a pas renoncé totalement au combat. La poursuite des attaques capitalistes l'a obligée à mener des luttes de résistance mais ces luttes n'avaient ni l'ampleur, ni la conscience, ni la capacité à se confronter aux syndicats qui étaient celles de la période précédente. Ce n'est qu'à partir de 2003, notamment à travers les grandes mobilisations contre les attaques visant les retraites en France et en Autriche, que le prolétariat a commencé réellement à sortir du recul qui l'avait affecté depuis 1989. Depuis, cette tendance à la reprise des luttes de la classe et du développement de la conscience en son sein ne s'est pas démentie. A nouveau, on peut voir et reconnaître un développement des luttes prolétariennes.
La reprise mondiale de la luttes des classes
Beaucoup de luttes ne sont pas connues ou sont complètement dénaturées. Ainsi, la lutte extrêmement importante des étudiants en France contre le CPE au printemps 2006 a d'abord été ignorée par les médias internationaux pour n'être présentée ensuite que comme une suite des épisodes de violence aveugle qui avaient eu lieu dans les banlieues françaises à l'automne précédent. En d'autres termes, les médias ont cherché à enterrer les leçons ( la solidarité ouvrière et l'auto-organisation) qu'avait apportées ce mouvement.
Durant l'année passée, en gros depuis que le mouvement massif des étudiants français a pris fin avec le retrait du CPE par le gouvernement, la lutte de classe dans les principaux pays capitalistes a cherché à répondre à la pression accélérée sur les salaires et les conditions de travail. Cela a souvent eu lieu à travers des actions sporadiques, dans beaucoup de pays et de différentes industries.
En Espagne, le 18 avril, une manifestation réunissait 40 000 personnes, des ouvriers en provenance de toutes les entreprises de la baie de Cadix, exprimant leur solidarité dans la lutte avec leurs frères de classe licenciés de l’entreprise Delphi. Le premier mai, un mouvement plus ample encore mobilisait des ouvriers en provenance des autres provinces d'Andalousie. Un tel mouvement de solidarité a en réalité été le résultat de la recherche active d'un soutien, à l'initiative des ouvriers de Delphi, de leurs familles et, notamment, de leurs femmes organisées pour la circonstance dans un collectif ayant pour but de gagner la solidarité la plus large possible.
Au même moment, il y a eu des débrayages spontanés en dehors de toute consigne syndicale dans les usines d'Airbus dans plusieurs pays européens pour protester contre le plan d'austérité de la compagnie.
Mais c'est dans les pays périphériques que nous avons assisté dans la période récente à la poursuite d'une remarquable série de luttes ouvrières explosives et étendues malgré le risque d'une répression brutale et sanglante.
Au Chili, les mineurs du cuivre, une des principales activités économiques du pays, se sont mis en grève. Au Pérou au printemps, une grève illimitée à l'échelle nationale des mineurs du charbon a eu lieu - pour la première fois depuis 20 ans. En Argentine, en mai et juin, les employés du métro de Buenos Aires ont tenu des assemblées générales et organisé une lutte contre l'accord sur les salaires concocté par leur propre syndicat. Au Brésil, depuis plusieurs semaines, un mouvement de grèves affectant en particulier la métallurgie, le secteur public et les universités, constitue le plus important mouvement de classe depuis 1986.
Au Moyen-Orient, de plus en plus ravagé par la guerre impérialiste, des grèves dans le secteur public ont eu lieu à l'automne 2006 en Palestine et en Israël sur une question similaire : les salaires non payés et les retraites. Une vague de grèves a touché de nombreux secteurs en Egypte au début de l'année. Dans l'industrie textile surtout, les ouvriers ont déclenché une série de grèves illégales contre la forte baisse des salaires réels et les réductions de primes. En Iran, une série de grèves a eu lieu à Téhéran et dans une vingtaine de grandes villes depuis l'automne dernier.
La prise de conscience de l’impasse du capitalisme
Le développement et l'élargissement des attaques contre la classe ouvrière dans le monde entier constituent l'une des principales raisons pour laquelle la lutte de classe a continué à se développer ces dernières années. La dernière période, principalement depuis l'entrée dans le 21e siècle, a remis à l'ordre du jour l'évidence de la crise économique du capitalisme, dissipant les illusions des années 1990 sur la "reprise" et sur la "révolution des nouvelles technologies". Près de quatre décennies de crise ouverte et d'attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière, notamment la montée du chômage et de la précarité, ont balayé les illusions que "ça pourrait aller mieux demain" : les vieilles générations de prolétaires aussi bien que les nouvelles sont de plus en plus conscientes du fait que "demain sera encore pire qu'aujourd'hui".
Dans l'automobile, aux Etats-Unis, General Motors projette 30 000 licenciements et Ford 10 000 ; en Allemagne, Volkswagen prévoit 10 000 nouveaux licenciements ; en France 5 000 sont prévus à Peugeot. L'avionneur Airbus a d'ores et déjà annoncé la suppression de 10 000 emplois et l'entreprise de télécommunication Alcatel-Lucent, le même nombre.
La situation sociale voit une augmentation de la richesse à un pôle de la société et de la pauvreté à l'autre. Non seulement les secteurs les plus pauvres de la classe ouvrière comme les jeunes, les chômeurs et les retraités sont réduits à une pauvreté abjecte, mais les secteurs un peu plus à l'aise financièrement qui font un travail qualifié et ont accès au crédit, sont de plus en plus affectés. Aux Etats-Unis, qui exhibent les meilleurs taux de profit officiels des pays capitalistes avancés, il y avait, en 2005, 37 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté, soit 5 millions de plus qu'en 2001 quand l'économie était officiellement en récession. Le salaire des ouvriers américains a chuté de 4% entre 2001 et 2006.
Le boom immobilier, alimenté par des facilités d'accès au crédit, a permis jusqu'à présent de masquer la paupérisation croissante de la classe ouvrière américaine. Les crédits non remboursés et les saisies de logements sont légion. Le marché des emprunts à garantie minimale s'est effondré en même temps que beaucoup d'illusions sur la sécurité et la prospérité des ouvriers.
L'échelle internationale de la reprise de la lutte de classe est étroitement liée au fait que les ouvriers sont fondamentalement confrontés à la même évolution de leurs conditions économiques sur toute la planète. Aussi les tendances à l’œuvre dans les pays développés se reproduisent-elles pour les travailleurs des pays capitalistes périphériques, mais avec une application encore plus brutale et meurtrière de l'austérité croissante.
L'expansion de l'économie chinoise, loin de représenter une nouvelle ouverture du système capitaliste, dépend en grande partie du dénuement de la classe ouvrière chinoise, c'est-à-dire la réduction de ses conditions de vie en dessous du niveau où elle peut se reproduire et continuer à vivre en tant que classe ouvrière. Les compagnies occidentales font une forte pression contre toutes règles qui accroîtraient de façon substantielle les coûts du travail et réduiraient la flexibilité, menaçant de transférer leurs activités hors de Chine.
Mais au-delà de raisons purement économiques, d'autres facteurs poussent la classe ouvrière à réfléchir plus en profondeur sur son identité de classe et ses buts propres. La permanence des affrontements guerriers prend des formes de plus en plus barbares de même que la menace dès à présent sensible de la destruction de l'environnement engendrent la montée, encore sourde et confuse, du sentiment de la nécessité de transformer en profondeur la société. La dernière semaine de juin, celle où Gordon Brown a succédé comme premier ministre à Tony Blair, a été tout à fait caractéristique de la situation : la guerre en Irak a fait de nouvelles victimes dans les forces britanniques, 25 000 maisons ont été endommagées par les inondations à la suite de chutes de pluie sans précédent en Grande-Bretagne, et les employés des postes ont commencé, pour la première fois depuis plus d'une décennie, une série de grèves nationales contre la baisse des salaires réels et les menaces de réduction d'effectifs.
Quelles perspectives ?
Il ne s'agit pas de parler d'une révolution imminente. Les luttes actuelles sont essentiellement défensives et, comparées aux luttes ouvrières qui ont eu lieu de mai 68 en France à 1981 en Pologne et toutes les autres luttes des années 1980, les apparaissent bien moins marquantes et plus limitées. Néanmoins, ces événements ont une signification mondiale ; ils sont indicatifs de la perte de confiance des ouvriers partout dans le monde vis-à-vis des politiques catastrophiques poursuivies par la classe dominante au niveau économique, politique et militaire.
En comparaison avec les décennies précédentes, les enjeux de la situation mondiale sont bien plus grands, l'ampleur des attaques bien plus vaste, les dangers contenus dans la situation mondiale bien plus accrus. L'héroïsme des ouvriers qui aujourd'hui défient le pouvoir de la classe dominante et de l'Etat, est de ce fait bien plus impressionnant, même s'il est plus silencieux. La situation actuelle demande des ouvriers une réflexion allant au-delà du niveau économique et corporatiste Ainsi, même si les luttes économiques de la classe sont pour le moment moins massives que lors de la première vague, elles contiennent, du moins implicitement, une dimension politique bien plus importante. Et cette dimension politique est déjà passée à une manifestation explicite comme le démontre le fait qu'elles incorporent de façon croissante la question de la solidarité, une question de premier ordre puisqu'elle est au cœur de la capacité du prolétariat mondial non seulement de développer ses combats présents mais aussi de renverser le capitalisme.
La grève générale des ouvriers français en mai 68 a mis fin à la longue période de contre-révolution qui a suivi l’échec de la révolution mondiale dans les années 1920. Cette reprise historique s’est manifestée par plusieurs vagues de luttes prolétariennes qui ont pris fin avec la chute du Mur de Berlin en 1989. Aujourd’hui, un nouvel assaut mondial contre le système capitaliste se profile à l’horizon.
CCI, été 2007 (traduit de notre site Internet en langue russe : [116] ru.internationalism.org [116] )
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Principes révolutionnaires et pratique révolutionnaire
- 6747 lectures
Un certain Cleto, qui se présente comme un «camarade d’accord avec les positions du BIPR» 1, a fait dans le forum «Comunistas internacionales» 2 une critique a notre article «Notes pour une histoire de la Gauche communiste» 3 qu’avait aimablement publié le modérateur du forum 4.
Nous nous livrions dans cet article à une réflexion sur la première époque (de 1943 à 1948) du Parti communiste international, période au cours de laquelle cette organisation qui se réclame de la Gauche communiste commit à notre avis deux graves erreurs : celle d’établir des contacts avec des groupes de partisans 5 et celle de participer aux élections de 1948 en présentant une liste 6.
Mensonges et déformations ou désaccord politique ?
Cleto commence par nous accuser de «mensonges et de déformations». La lecture de son texte confirme cependant totalement tout ce que nous avançons : il reconnaît que le PCI participa aux groupes partisans, qu’une partie de la section de Turin participa à l’insurrection organisée par le Comité de libération nationale où étaient présentes toutes les forces bourgeoises italiennes à l’exception des fascistes qui n’avaient pas encore retourné leur veste, que le PCI participa aux élections de 1948.
Pour que le débat soit réellement enrichissant, il faut commencer par distinguer ce que sont les faits et l’interprétation politique que l’on peut en faire. Les faits sont clairs et évidents, et Cleto ne peut les nier. Cependant, et c’est un aspect différent, son analyse et son interprétations sont différentes de la notre. Cette différence ne l’autorise en rien à nous accuser de «mensonges et de déformations»… à moins de considérer que tous ceux qui ne partagent pas son interprétation sont des menteurs…
Est-il idéaliste d’être intransigeant dans la défense des principes prolétariens ?
Entrons dans la question de fond. Cleto affirme que nous serions aveuglés par un «idéalisme dilettante», prisonniers de «fantaisies» qui n’auraient rien à voir avec la «véritable lutte de classe», que nous vivrions dans un «château enchanté», ce qui nous conduirait à «ne pas comprendre la dialectique des faits historiques» et à «discréditer l’activité de ceux qui risquèrent leur vie sur l’autel du militantisme communiste».
Staliniens et trotskistes ont l’habitude de justifier leurs politiques au nom du «réalisme» et de la sacro-sainte nécessité «d’être avec les masses», qualifiant toute position révolutionnaire «d’infantilisme théorique». Ils se présentent comme les champions du communisme pour finir par dire qu’ils sont «forcés» de soutenir toutes sortes de guerres impérialistes, de mouvements de «libération nationale» ou de fractions de la bourgeoisie «pour rester avec les masses».
Ce qui est pour le moins surprenant, c’est que ce type d’argument vienne de la part de quelqu’un qui se réclame de la Gauche communiste. Il faut alors remettre les choses à leur place, parce que ce qui différencie radicalement la Gauche communiste de tous les autres courants politiques est précisément la défense de la cohérence entre les principes proclamés et les moyens avec lesquels on les défends.
Cleto s’interroge : «Pendant que les masses sont en train de verser leur sang pour une perspective politique mystificatrice (le Front populaire ou la Résistance), que doivent faire les communistes ? Doivent-ils rester enfermés dans leur cercle et écrire scolastiquement de méticuleuses analyses sur les erreurs que commettent les masses ?».
Quand les ouvriers prennent parti pour une des bandes en conflit au cours d’une guerre entre fractions de la bourgeoisie, ils perdent toute leur force, deviennent des pions manipulables à souhait, ils versent leur sang pour leurs exploiteurs et oppresseurs. Face à une telle situation, seuls les principes révolutionnaires peuvent permettre aux ouvriers de retrouver leur autonomie de classe et de lutter de façon décidée contre le capitalisme. Accepter en 1944-45 le terrain de la lutte partisane, c’est-à-dire celui du nationalisme et de l’impérialisme, sous prétexte de «convaincre les masses», c’était contribuer à ce qu’elles restent enfermées dans le cercle infernal de la guerre et de l’exploitation capitaliste. Seul le «cercle fermé» des «analyses méticuleuses» pouvait aider les ouvriers à sortir du piège infernal dans lequel ils s’étaient laissé prendre.
En 1914, le capitalisme put déchaîner la Première Guerre mondiale grâce au soutien de la majorité de la social-démocratie et des syndicats, qui firent croire aux ouvriers qu’ils devaient accepter la mort sur le front et les sacrifices à l’arrière pour défendre une «juste cause» à géométrie variable. Pour les allemands, il s’agissait d’en finir avec la barbarie tsariste alors que pour la bande des Alliés, parmi lesquels figurait le sinistre régime tsariste, l’objectif était d’en finir avec la dictature germanique du Kaiser !
Que firent alors les révolutionnaires ? Ils acceptèrent le terrain de la défense nationale sous prétexte de «rester avec les masses» ? Non ! Mille fois non ! Ils livrèrent le combat pour défendre les principes internationalistes, préconisant la lutte intransigeante pour la révolution prolétarienne mondiale. La minorité internationaliste (Lénine, RosaLuxemburg, Trotski, Bordiga…) «s’éloigna des masses», resta «enfermée dans son cercle» et écrivit des «analyses méticuleuses» sur les erreurs des masses. Elle contribua grâce à cette activité à ce que les masses critiquent leurs erreurs, à ce qu’elles retrouvent leur force, leur solidarité et, ainsi, prépara les conditions de la vague révolutionnaire mondiale qui s'éleva en 1917.
Lénine était idéaliste ?
Quand Lénine revint en Russie en avril 1917 et défendit le besoin d’orienter la révolution commencée en février vers la prise de pouvoir et la lutte pour le socialisme, il rencontra une forte opposition de la part du Parti bolchevique, que dirigeaient alors Staline, Kamenev et Molotov, qui soutenait le Gouvernement provisoire dont les objectifs déclarés étaient la poursuite de la guerre et l’enfermement de la révolution dans le carcan de la démocratie bourgeoise. Au cours de la polémique qui se développa dans le Parti au sujet des positions de Lénine, Kamenev accusa ce dernier d’être «idéaliste» et de se «séparer des masses». Lénine répondit : «Le camarade Kaménev oppose le "parti des masses" au "groupe de propagandistes". Or, aujourd'hui précisément, les "masses" sont intoxiquées par le jusqu'au-boutisme "révolutionnaire" 7. Ne conviendrait-il pas mieux, surtout à des internationalistes, de savoir à pareil moment s'opposer à cette intoxication "massive" plutôt que de "vouloir rester" avec les masses, autrement dit de céder à la contagion générale ? N'avons-nous pas vu dans tous les pays belligérants d'Europe les chauvins chercher à se justifier en invoquant leur désir de "rester avec les masses" ? Ne doit-on pas savoir rester un certain temps en minorité pour combattre une intoxication "massive" ? L'activité des propagandistes n'est-elle pas, surtout à l'heure actuelle, le facteur essentiel qui doit permettre à la ligne prolétarienne de se dégager de l'intoxication jusqu’au-boutiste et petite-bourgeoise où sont plongées les "masses" ?» 8.
Dans un autre document datant de la même époque 9, Lénine clôt la perpétuelle accusation d’idéalisme sur sa position en disant : «Travail de propagande “et rien de plus”, semblerait-il. C’est en réalité un travail révolutionnaire éminemment pratique10; car on ne saurait faire progresser une révolution qui s'est arrêtée, grisée de phrases, et qui “marque le pas”».
Cleto pense peut-être que Lénine aussi était un «idéaliste» qui «dédaignait descendre aux masses parce qu’elles ne seraient pas communistes». Nous pensons quand à nous que cet apport de Lénine est essentiel pour inspirer l’activité des révolutionnaires. Dans sa réponse à Kamenev citée plus haut, Lénine rappelle que «la bourgeoisie se maintient non seulement par la violence, mais aussi grâce à l'inconscience, à la routine, à l'abrutissement, au manque d'organisation des masses».
La classe ouvrière est la classe porteuse du communisme 11, mais c’est aussi une classe exploitée qui est maintenue la plupart du temps soumise à l’emprise de l’idéologie dominante. Sa nature communiste s’exprime, en particulier, par la capacité qu’elle a à sécréter en son sein des minorités communistes qui tentent d’exprimer ses buts et ses principes ainsi que les moyens pour y parvenir.
Ces minorités n’ont pas comme objectif de courir derrière les masses en les suivant dans toutes les situations multiples et contradictoires qu’elles traversent. Il s’agit d’être avec le prolétariat en tant que classe révolutionnaire et non de se coller au «prolétariat sociologique», qui passe par différents stades de conscience. Dans le texte déjà cité, Lénine rappelait qu’il valait mieux «rester seul, comme Liebchnecht –et rester seul ainsi c’est rester avec le prolétariat révolutionnaire– que d’avoir ne serait-ce qu’une minute l’idée d’une union avec le Comité d’organisation 12».
La classe ouvrière n’est pas une masse aveugle à qui il faudrait administrer sans qu’elle ne s’en aperçoive les recettes communistes. Ce tacticisme pragmatique recouvre dans le fond une vision manipulatrice, un profond mépris pour la classe ouvrière. Les ouvriers ne craignent pas la critique de leurs erreurs. Rosa Luxemburg disait du prolétariat que «ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n'y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n'a d'autre maître que l'expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait s'instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l'autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu'au fond des choses, c'est l'air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre.» 13
Quelle fut la position de nos «pères» politiques ?
Cleto mentionne la position de la Gauche communiste d’Italie face au Front populaire et la Guerre d’Espagne de 1936 en affirmant : «Le problème que se posaient nos pères politiques –tant en ce qui concerne l’Espagne que la lutte partisane– et que jamais ne se pose le CCI (ni ses dérivés), car c’est totalement étranger à leur méthode (idéaliste) et à leur compréhension du militantisme communiste : comment faire pour que se rencontrent les principes avec les masses en mouvement, disposées à une lutte sans merci et aux pires sacrifices ?».
Ce passage semble laisser entendre que Bilan aurait maintenu en 1936 la même position que le PCI en 44-48. Rien n’est plus faux. On peut lire notre livre 1936, Franco y la República masacran a os trabajadores (Franco et la République massacrent les travailleurs) 14, qui se base sur les textes de Bilan, pour constater que Bilan maintint alors une politique «idéaliste» de défense intransigeante des principes.
Quelques années auparavant, Bilan avait polémiqué avec l’Opposition de gauche 15 qui évoquait elle aussi –comme malheureusement le firent aussi en 1948 les «parents politiques» de Cleto– le besoin de «ne pas se couper des masses». Le titre de l’article était significatif : «Les principes, armes de la révolution». Il dénonçait «le militant qui expose une position de principe dans une situation donnée et s’empresse d’ajouter que cette position serait valable si tous les ouvriers étaient communistes, qu’elle pourrait alors s’appliquer, mais qu’il se voit forcer de prendre en compte les situations concrètes et en particulier la mentalité des ouvriers» 16. Il met à nu les «arguments» avec lesquels on valide cette capitulation : «Le problème se posera de façon interrogative à chaque occasion : la question de principe est-elle en jeu ? Si on répond négativement, il faudrait se laisser conduire par les suggestions de la situation, se livrer à des conjectures sur les avantages que l’on peut tirer de la lutte puisqu’en définitive même Marx et Lénine, pour intransigeants qu’ils aient été sur les questions de principes, n’hésitaient pas à se lancer dans la lutte pour se gagner le plus grand nombre d’alliés possible, sans prendre en compte leur nature, sans établir préalablementsi leur nature sociale leur permettrait d’être un véritable appui à la lutte révolutionnaire».
Face à ces positions, Bilan défendait que «le Parti doit rester scrupuleusement fidèle aux thèses politiques qu’il a élaborées, car à ne pas le faire il s’interdirait d’avancer dans la lutte révolutionnaire», concluant catégoriquement que «pour préparer la victoire prolétarienne contribuent tant les antagonismes sociaux que le travail conscient des fractions de gauche : le prolétariat ne reprendra la lutte que sur la base de ses principes et de son programme».
1948 : la régression du PCI sur la question électorale et parlementaire
C’est la Fraction communiste abstentionniste constituée en octobre 1919, qui précéda la Gauche communiste d’Italie, qui dénonça la mystification électorale et parlementaire. C’est un de ses militants les plus remarquables, Bordiga, qui apporta les enrichissements les plus clairs sur cette question 17 et qui livra un combat tenace contre la dégénérescence de l’Internationale communiste, s’attaquant à une de ses erreurs les plus graves, le «parlementarisme révolutionnaire».
C’est pour cela que le fait que le Parti communiste internationaliste jette par-dessus bord tout ce patrimoine et préconise la participation à la farce électorale, destinée à avaliser la configuration politique de l’Etat démocratique italien autour d’un gouvernement démocrate-chrétien et d’une opposition constituée par le parti stalinien, est une véritable régression.
Cleto défend néanmoins cette argumentation avec des arguments très peu convaincants : «Que dire des élections de 1948 ? Tout simplement que ce fut une tentative de s’insérer dans la grande excitation politique dans laquelle s’était faite piéger la classe ouvrière afin de mieux faire connaître nos positions en profitant de la vitrine qu’offrait la propagande électorale ; mais personne ne se faisait d’illusions sur une renaissance du parlementarisme révolutionnaire : quiconque affirme le contraire ment ou ne sait pas ce qu’il dit. Dans ses manifestes, dans sa presse, le Parti appelait à l’abstention en l’expliquant politiquement et il ajoutait “si vous ne pouvez éviter de voter, alors votez pour nous”».
Appeler en même temps les masses à l’abstention et à voter ne leur apportait pas la moindre clarté et ne pouvait que démontrer la propre confusion du Parti. Donner comme tâche au Parti de “s’insérer dans la grande excitation politique dans laquelle s’était faite piéger la classe ouvrière” (une excitation nourrie par la bourgeoisie pour que tout le monde accepte son Etat démocratique) ne peut que confirmer ce que nous disons : une organisation révolutionnairene peut se mettre à la remorque d’une «excitation» mais doit participer à développer la conscience des masses pour les aider à s’émanciper précisément de cette excitation.
Cleto dit aussi en passant qu’il faudrait profiter «de la vitrine qu’offrait la propagande électorale» et proclame avec une certaine arrogance que ce n’est pas du parlementarisme révolutionnaire, accusant ceux qui affirment le contraire d’être des menteurs ou des ignorants. Notre censeur ne connaît certainement pas la «Résolution sur le Parti communiste et le parlementarisme» adoptée par le IIe Congrès de l’Internationale communiste en mars 1920, celle qui proclama le «parlementarisme révolutionnaire». Il y est dit que «La participation aux campagnes électorales et la propagande révolutionnaire du haut de la tribune parlementaire ont une signification particulière pour la conquête politique des milieux de la classe ouvrière qui, comme les masses laborieuses rurales, sont demeurées jusqu’à présent à l’écart du mouvement révolutionnaire et de la politique» 18. Quelle différence y a-t-il entre la position de Cleto et celle de l’IC ? Quelle différence avec celle que défendent les trotskistes pour justifier leur participation dans la mystification électorale ? Pas la moindre.
L’argument sentimental
«Nos camarades entrèrent en contact avec les groupes de partisans, risquant leur vie pour tenter de leur faire comprendre l’erreur politique dans laquelle ils étaient tombés ; Ils organisèrent et participèrent à des grèves contre la guerre –en pleine guerre !– et beaucoup payèrent de leur vie leur militantisme révolutionnaire, fusillés ou déportés dans les camps d’extermination nazis. Comment le CCI ose-t-il se permettre d’exprimer publiquement de telles aberrations sur la terrible expérience de nos camarades ?».
Ce qui est en cause, dans notre critique, ce n'est évidemment pas l'organisation et la participation à des grèves. Ce que nous rejetons catégoriquement, c'est la politique (pudiquement baptisée par Cleto "entrer en contact avec les groupes partisans") consistant à pratiquer "l'entrisme" au sein d'une organisation militaire contre-révolutionnaire de la pire espèce, constituée directement sous le contrôle des Alliés et, sur place, du PC et du PS. Une organisation militaire bourgeoise basée sur le volontariat et qui, à ce titre, n'offre aucun terrain propice à la diffusions des principes et tactiques révolutionnaires, ce qui la distingue de l'armée officielle dans laquelle les ouvriers sont mobilisés de force. C'est pourquoi, l’héroïsme des militants ainsi envoyés infiltrer les rangs des "partisans" de même que les persécutions dont ils ont été victimes de ce fait ne peuvent être des arguments justifiant une telle politique. Le seul critère pour analyser celle-ci est de déterminer si elle répond ou pas à la situation en restant en cohérence avec les principes et les moyens de lutte prolétariens. Mélanger tout ne peut qu’introduire la confusion.
Cleto devrait réfléchir sur le fait que les groupes d’extrême-gauche du capital justifient leur politique antifasciste, leur politique de libération nationale, leur politique de soutien à un camp impérialiste en invoquant les morts, les torturés, les détenus de ces causes bourgeoises. L’opposition chilienne à Pinochet n’a pas cessé de rappeler ses morts et ses torturés. Les péronistes, les montoneros, les trotskistes ont fait de même avec les disparus et les torturés de la dictature argentine. Ils profitent du sang versé comme d’un capital dont les intérêts servent à imposer une politique de misère et de répression envers les ouvriers et les exploités, comme l’illustrent Bachelet et le couple Kirchner. Le parti stalinien français se présentait partout dans l’après-guerre de 45 comme le parti «des 100.000 fusillés». Ce chantage émotionnel leur permit entre autre de saboter la grande grève de Renault en 1947 en proclamant que «la grève est l’arme des trusts». Les 100 000 fusillés furent utilisés par leur chef, Maurice Thorez, pour demander aux ouvriers français de «retrousser leurs manches pour relancer l’économie nationale».
Les principes sont l’arme de la révolution
La bourgeoisie traite de fanatisme et de fondamentalisme l’attitude intransigeante de défense des principes. Elle est, quand à elle, la classe du pragmatisme, des combines et des manoeuvres machiavéliques. La politique bourgeoise est devenue un spectacle repoussant d’alliances contre-nature, dans lesquelles les coups fourrés et les contorsions idéologiques les plus délirantes sont de mise. Elle a provoqué un dégoût général de «la politique».
Pour sa part, le prolétariat n’a aucun besoin d’occulter, ni de se cacher à lui-même, les principes et les moyens de sa lutte. Il n’existe pas pour lui de contradiction entre ses intérêts historiques et ses intérêts immédiats, entre ses principes et sa lutte quotidienne. L’apport des révolutionnaires réside dans une politique claire où principes et pratique sont cohérents et ne se contredisent pas à chaque moment. Pour le prolétariat, la pratique, c’est la défense intransigeante des principes de classe, car ce sont eux qui lui donnent une perspective pour sortir de l’impasse dans lequel le capitalisme plonge l’humanité, ce sont eux qui orientent ses luttes immédiates vers la perspective révolutionnaire. Comme l’affirmaient nos camarades de Bilan,les principes sont des armes de la révolution.
CCI 28-10-07
Annexe :texte de Cleto
Salut à tous
Les camarades qui adhèrent aux positions politiques du Bureau international pour le Parti révolutionnaire (BIPR www.ibrp.org [117]) sont depuis longtemps habitués aux entorses, pour ne pas dire aux mensonges, répandus par le CCI. J’ai cependant décidé de ne pas laisser passer impunément les commentaires déversés par le CCI à la fin du compte rendu « Notes pour une histoire de la Gauche communiste » publié dans ce forum de discussion le 26 septembre. Je m’attends naturellement à une contre-réplique du CCI, mais je veux d’abord m’excuser auprès des membres de ce forum pour n’avoir pas répondu plus tôt : je dispose de peu de temps et je préfère le dédier à la véritable lutte de classe et non aux fantaisies du CCI. Celui-ci projette dans le passé son idéalisme dilettante, déformant l’histoire, justifiant son idéalisme caractéristique et, ce qui est pire, discréditant l’activité de ceux qui risquèrent leur vie sur l’autel du militantisme communiste.
Aveuglé par son idéalisme, le CCI n’est même pas capable de lire ce qui est pourtant écrit clairement, et encore moins de comprendre la dialectique des faits historiques. Comment peut-il dire que nos camarades en 43-45 avaient la même position que la minorité qui partit en Espagne ? Nos camarades tentaient de mettre en pratique un marxisme vivant et non un marxisme de recettes de cuisine, tentant d’amener les partisans (des prolétaires en grande partie, illusoirement convaincus de combattre le nazi-fascisme pour préparer la voie de la révolution prolétarienne) sur des positions de classe, ils ne versèrent donc pas leur sang pour une cause bourgeoise ; ils le firent en outre dans des conditions extrêmement difficiles, menacés à la fois par les fascistes et les staliniens. Le problème que se posaient nos pères politiques – tant en ce qui concerne l’Espagne que la lutte partisane – est celui que jamais ne se pose le CCI (nises dérivés), car il est totalement étranger à leur méthode (idéaliste) et à leur compréhension du militantisme communiste : comment faire pour que se rencontrent les principes avec les masses en mouvement, disposées à une lutte sans merci et aux pires sacrifices ? Quand les masses versent leur sang pour une fausse perspective politique mystificatrice (le Front populaire ou la Résistance), que doivent donc faire les communistes ? Doivent-ils rester enfermés dans leur cercle et écrire scolastiquement de méticuleuses analyses sur les erreurs que commettent les masses, dédaignant de s’abaisser à la lutte parce que les masses ne sont pas… communistes pures (si elles l’étaient, quel besoin auraient-elles du Parti ou même de la propagande… cciste ?), ou doivent-ils tenter de traduire en actions leurs principes pour les faire comprendre et assumer par les masses ?
Ils risquent bien sûr de commettre des erreurs, mais c’est le type d’erreurs de ceux qui vivent dans la vraie vie, et non dans la vie livresque d’un château enchanté où tout est forcément juste parce que jamais vérifié par la réalité.
Nos camarades entrèrent en contact avec les groupes de partisans, risquant leur vie pour tenter de leur faire comprendre l’erreur politique dans laquelle ils étaient tombés ; ils organisèrent et participèrent à des grèves contre la guerre – en pleine guerre ! – et beaucoup payèrent de leur vie leur militantisme révolutionnaire, fusillés ou déportés dans les camps d’extermination nazis. Comment le CCI ose-t-il se permettre d’exprimer publiquement de telles aberrations sur la terrible expérience de nos camarades ?
En avril 1945, quand le prolétariat de Turin participa à l’insurrection et qu’une partie de la section de Turin participa avec elles, en totale indépendance du CLN (Comitato diLiberazione Nazionale), sans aucune intention frontiste et sans illusions sur la lutte partisane, alors que la guerre s’achevait et que les Alliés étaient aux portes de Turin, c’était une erreur ? C’est peut-être le genre d’erreur que commettent ceux qui vivent dans la lutte de classe, c’est-à-dire le genre d’erreur que le CCI ne commettra jamais !
Que dire des élections de 1948 ? Tout simplement que ce fut une tentative de s’insérer dans la grande excitation politique dans laquelle s’était faite piéger la classe ouvrière afin de mieux faire connaître nos positions en profitant de la vitrine qu’offrait la propagande électorale ; mais personne ne se faisait d’illusions sur une renaissance du parlementarisme révolutionnaire : quiconque affirme le contraire ment ou ne sait pas ce qu’il dit. Dans ses manifestes, dans sa presse, le Parti appelait à l’abstention en l’expliquant politiquement et il ajoutait “si vous ne pouvez éviter de voter, alors votez pour nous”.
_________
1 - Bureau international pour le Parti révolutionnaire : www.leftcom.org [118]. Sur les origines du BIPR et de notre organisation et sur les diverses façons dont chaque groupe conçoit la continuité avec la Gauche communiste italienne, lire la polémique « A l’origine du CCI et du BIPR », Revue internationale nos 90 [119] et 91 [120].
2 - espanol.groups.yahoo.com/group/comunistasinternacionales
3 - Publié dans la Revue internationale no 9 [121].
4 - Lire la critique de Cleto traduite et publiée en annexe à cet article.
5 - Il s’agissait de groupes de guérilla impulsés par le Parti stalinien pour harceler les armées nazi-fascistes pour le compte du camp rival, celui des staliniens et des démocrates.
6 - Nous avons publié dans la Revue internationale nos 36 et 37 l’analyse du IIe Congrès du PCI (1948) faite par Internationalisme, organe de la Gauche communiste de France, groupe dont nous nous réclamons.
7 - Le “défaitisme révolutionnaire” ouvertement préconisé par les mencheviques et les socialistes-révolutionnaires – et indirectement soutenu parle Comité central bolchevique – consistait en poursuivre la participation de la Russie à la guerre impérialiste car « désormais, la situation avait changé et la Russie était une démocratie ».
8 - Lénine, « Lettres sur la tactique ».
9 - Lénine, Les tâches du prolétariat dans notre révolution (plus connu sous le titre les Thèses d’avril).
10 - Souligné dans l’original.
11 - Ce qui ne veut en rien dire que tous les ouvriers doivent se déclarer de “purs communistes”, ni que pour faire la révolution chacun d’entre eux doive se reconnaître comme communiste.
12 - Centre organisateur du Parti menchevique.
13 - Rosa Luxemburg, la Crise de la social-démocratie.
14 - Nous venons d’en faire une 4e édition. Il peut aussi être consulté sur notre site web [122].
15 - Qui donnera finalement naissance dans sa dégénérescence à ce que l’on a appelé le courant « trotskiste ».
16 - Bilan no 5, « Les principes, armes de la révolution ».
17 - Voir, par exemple, « Le principe démocratique ».
18 - Quatre premiers Congrès mondiaux de l’Internationale communiste – 1919-1923.
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [123]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [124]
Qu'il soit belge, flamand, wallon ou bruxellois Derrière la solidarité avec le système, l'explosion de la misère
- 3882 lectures
S'il faut en croire la bourgeoisie, ça va bien, ça va même mieux: les 200.000 emplois promis par Verhosftadt auraient été créés, le chômage aurait baissé, et même dans une telle mesure que les médias l'ont étalé pendant des semaines dans de nombreux articles allant jusqu'à titrer en première page que "presque toute la Flandre travaille" (De Standaard, 3.10.07). Egalement à Bruxelles, on noterait une diminution du chômage de 10 % parmi les moins de 25 ans qui se présentent sur le marché du travail. Des bonnes nouvelles donc, pourrait-on penser. Et pourtant, la bourgeoise continue à clamer haut et fort que "nous manquons la croissance économique" à cause du manque de personnel qualifié, du vieillissement de la population et surtout, des charges salariales trop élevées. Si nous voulons conserver notre travail, prétend la bourgeoisie, nous devons augmenter nos compétences et nos connaissances, il faut travailler plus pour moins d'argent. Après le "pacte de solidarité entre les géné-rations" de 2005, qui rallonge la durée de la carrière de travail et restreint les prépensions, nous devons maintenant avaler que "la modération salariale est une forme de solidarité", comme nous l'explique Van de Cloot, économiste chez ING, car "nous demandons à tout le monde de sacrifier un peu de pouvoir d'achat, mais moins de gens doivent partir" (De Standaard, 4.10.07). Avec cette logique de la bourgeoisie, nous comprenons beaucoup mieux cet autre gros titre des médias: "Toujours plus de Belges pauvres" (De Standaard¸17.10.07).
Quel cynisme! On demande à la classe ouvrière de se réjouir des statistiques du chômage, alors qu'en fait celles-ci dissimulent une paupérisation de l'ensemble de la classe ouvrière. Dans cet article, nous mettons côte à côte les faits et les plans d'avenir dans le but de démasquer cette duperie. Par-dessus tout, le discours de Van de Cloot symbolise très clairement la vision que la bourgeoisie veut nous imposer à propos de la "solidarité": celle avec son système et ses marges bénéficiaires. Et comme si cela n'était pas suffisant, de l'extrême gauche à l'extrême-droite, on appelle la classe ouvrière à se ranger une nouvelle fois derrière les intérêts régionaux de la bourgeoisie, ou à défendre l'Etat belge unitaire, au nom de "la solidarité". Comme si les intérêts de la bourgeoisie et ceux de la classe ouvrière étaient compatibles!? Dans le passé, les fascistes ont appelé ça le Solidarisme, les démocrates sont un peu plus hypocrites et disent solidarité.
Les faits: où en sont l'emploi et la pauvreté?
Ce que la bourgeoisie omet de mentionner dans sa propagande mensongère, c'est que les statistiques officielles annoncent encore toujours 35 % de chômage chez les jeunes pour Bruxelles, 31 % en Wallonie. Mais même pour l'OCDE (Organisation pour la Coopération économique et le développement), la Belgique dans son ensemble compte toujours 21 % de chômeurs parmi les jeunes, contre 17 % dans l'ensemble de l'Europe. Les régions bruxelloise et wallonne sont même la lanterne rouge des statistiques européennes. Voilà pour ce qui concerne la situation "rose" des jeunes! Par rapport à un taux d'emploi de 60,9 %, un des plus bas d'Europe, le "pacte de solidarité entre géné-rations", conclu en 2005, a fixé la fin de carrière à 65 ans (en attendant les 67 ans comme en Allemagne, ou les 68 ans comme en Grande-Bretagne?) et a sévèrement limité les possibilités de prépensions avant 60 ans. Quarante-cinq ans d'activité devient la base de calcul.
Il faut rajouter à cela que ces vingt dernières années, les allocations sociales ne suivent plus le niveau de vie, parce que tant de gens sont contraints de vivre d'une allocation, et que cela serait trop cher de le faire. En conséquence, pensions et allocations en Belgique sont maintenant moins élevées qu'ailleurs, et se trouvent même souvent en deçà du seuil européen de pauvreté. Si en 1980, avec 12 % de pauvres par-mi les retraités, la Belgique était dans le peloton de tête de l'Europe, elle se trouve maintenant clairement en queue. "Une pension moyenne s'élève aujourd'hui à seulement 992 euros par mois" (De Standaard, 23.10.07). Une personne de plus de 65 ans sur cinq vit par conséquent au-dessous du seuil de pauvreté (20,6 %). Cette situation s'empire sans cesse, puisque les générations maintenant éligibles à la retraite sont aussi de plus en plus touchées par la crise et le chômage. Voilà une autre image des perspectives pour les aînés!
Mais peut-être le reste va-t-il mieux? "Toujours plus de Belges pauvres", comme on l'a déjà dit. En 2003 Eurostat comptait en Belgique 13% de la population vivant dans la pauvreté. Fin 2005 ils sont déjà 15%, soit plus d'1,5 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (1 Belge sur 7), ce qui veut dire en 2007 avec moins de 822 euros de revenus mensuels pour une personne isolée. Même que dans la région bruxellois, un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Les travailleurs de rue, les CPAS, études universitaires et autres sources officielles confirment l'aggravation de cette tendance. La pauvreté est de plus en plus masquée, la montagne de dettes s'accroît. Le rapport de la fédération belge des banques alimentaires nous apprend aussi qu'en 2005, 106.550 personnes ont fait appel aux distributions de nourriture, contre 70.000 en 1995.
De plus, on savait déjà qu'on utilise depuis des années toutes sortes de subterfuges pour minimiser les chiffres du chômage, en excluant des statistiques divers groupes comme les suspendus des droits, les allocataires du CPAS, les petits boulots, les prépensionnés, les illégaux, etc. Quelques exemples parlants pour mieux comprendre la réelle tendance: on comptait déjà 10.955 chômeurs encourant une suspension de leurs droits à une allocation dans les six premiers mois de 2006, en augmentation de 12% par rapport à 2005, rejoignant ainsi très vite l'armée des pauvres, ou encore les chiffres du chômage dans les quartiers ouvriers de grandes villes comme Charleroi, Liège, Bruxelles, Anvers ou Gand, approchant ou même dépassant les 30 %.
Et pour ce qui est des 200.000 nouveaux jobs de Verhofstadt, comme le disait JM. Nollet de Ecolo: " je prend acte mais il faut voir comment Guy Verhofstadt calcule ces 200.000 emplois. Il faut voir aussi quelle est la part des temps partiels dans ces statistiques? Je rappelle qu'entre juin 2003 et juin 2006 le nombre de travailleurs à temps plein a diminué. Leur proportion est passée de 71,98% à 68,71% du nombre total des travailleurs." (Le Soir, 3.11.2007).
En fait, ces mesures sont une attaque contre les conditions de vie et de travail, présentées comme une solution au problème du chômage, pour faire baisser sensiblement les chiffres officiels du chômage. Le contrat à temps plein et à durée indéterminée cède toujours plus de terrain face au développement de jobs précaires, souvent sous-payés et à temps partiel, qui représentent plus de 30 % des emplois. Ainsi, le gouvernement peut parler en toute hypocrisie de la perspective de "plein emploi", alors que dans la réalité, c'est la précarité, le travail à temps partiel et la misère à grande échelle. Même l'emploi n'est plus une garantie contre la pauvreté parce que parmi les travailleurs, on trouve de 4 à 6% de pauvres en 2005. Voilà des faits qui contrebalancent les discours triomphalistes et les promesses d'un lointain futur rayonnant afin d'occulter cette marche vers l'abîme.
L'avenir: poursuite des attaques sur les conditions de vie et de travail
En effet, malgré les discours sur la reprise économique et la baisse du chômage, la crise historique irréversible du système capitaliste comme un tout, le marché mondial saturé dont est prisonnière la bourgeoisie, ont forcé et continuent à forcer la bourgeoisie belge à lancer des attaques importantes pour l'avenir contre la classe ouvrière. Les lignes directrices de l'offensive de la bourgeoisie sont à la poursuite, mais aussi à l'approfondissement, comme cela a été clairement formulé au cours des conférences de 2003 pour l'emploi, qui avaient réuni l'ensemble des forces patronales, syndicales et politiques: "baisse des charges des entreprises, modération salariale, diminution des frais liés au chômage, rallongement de la semaine de travail et de la carrière, et finalement le financement alternatif de la sécurité sociale". C'est ce que nous avons vu par l'adoption du Plan Marshall wallon, du Pacte de solidarité entre les générations, du Pacte de compétitivité, de la concertation salariale, ou du financement alternatif de la sécurité sociale sous le précédent gouvernement.
Globalement, cela signifie:
- un abaissement encore plus important des charges des entreprises et l'assouplissement des procédures de licenciement;
- l'assainissement drastique des frais de production, délocalisation ou pure suppression de forces de travail qui sont et seront à la base des plans de restructuration, que ce soit dans le secteur privé ou public (ainsi VW, Gevaert, GM, Janssens Pharmaceutica,...). Exactement comme en France et aux Pays-Bas, où des centaines de milliers de fonctionnaires sont remerciés, la nouvelle équipe gouvernementale parle de 20.000 fonctionnaires fédéraux en moins (-10 %). De son côté, La Poste annonce qu'elle souhaite se séparer de 6.000 postiers, pour les remplacer par 12.000 jobs précaires, à temps partiel (pour des étudiants, des retraités ou des ménagères, comme une espèce de salaire d'appoint);
- l'augmentation de la productivité (déjà parmi les trois plus élevées du monde) par un accroissement important de la flexibilité sans frais supplémentaires et une diminution de l'absentéisme et des pauses, entraînant un rallongement effectif de la durée de travail et de la carrière. Les négociateurs gouvernementaux pensent aussi à comptabiliser le nombre d'heures travaillées par an, et non plus par jour, par semaine ou par mois. En 2006, le nombre d'heures de travail par an au-delà du temps de travail officiel est déjà passé de 65 à 130, soit une augmentation moyenne de deux heures par semaine;
- la révision à la baisse des normes salariales (réduction et suppression des barèmes d'ancienneté, des primes et suppléments). "L'indexation automatique des salaires" est elle-même devenue un mythe dans la mesure où l'index fait l'objet de nombreuses manipulations, par exemple, les produits pétroliers et les produits "nuisibles pour la santé" en sont exclus. Avec les prix pétroliers qui crèvent les plafonds, et dont seulement jusqu'à ce jour une fraction des aug-mentations est calculée (pensons seulement aux augmen-tations de prix différées au début 2008 pour l'électricité et le gaz), on peut s'attendre à un sérieux recul du pouvoir d'achat. En guise d'illustration, dans les prochaines semaines la livraison de gaz va être interrompue pour plus de 10.000 familles pour la seule Wallonie. De plus, depuis 1990, la bourgeoisie a mis en place une "norme salariale" pour encore limiter l'index, selon laquelle les augmentations de salaires ne peuvent en aucun cas dépasser la moyenne de celle qui est appliquée dans les pays voisins. Le pouvoir d'achat de l'ouvrier belge est par conséquent parmi les plus bas des pays industriels d'Europe, par exemple 25 % moins élevé qu'aux Pays-Bas (selon la Fédération européenne des entrepreneurs, citée dans De Morgen, 5.06.2006). Ainsi, la part des salaires dans le PIB (produit intérieur brut) diminue depuis des années suite aux mesures de la bourgeoisie; pour la première fois depuis 1971, elle est descendue sous les 50 %, ce qui est nettement moins qu'en France par exemple avec 51,9 %. "La masse salariale totale dans notre pays a donc augmenté moins vite que le PIB, alors que les profits des entreprises ont accroissé relativement plus vite" (De Tijd, 3.10.2007).
Avec en perspective une augmentation des prix de 4 à 30 % pour les produits de base, l'appel à une nouvelle baisse des charges salariales prend l'allure d'une gifle en pleine figure;
- enfin, la révision et réduction graduelles du système de la sécurité sociale, surtout au niveau du chômage, des frais de santé et des retraites. Ainsi, gouvernement et patronat veulent fermement diminuer les allocations de chômage en les limitant dans le temps, et des voix de plus en plus fortes se font entendre pour qu'on s'occupe des pensions "excessives" des fonctionnaires et autres régimes spéciaux, exactement comme ce qui se passe actuellement en France.
La lutte: pas de solidarité avec les exploiteurs et leur Etat
Pourquoi ce paquet de mesures ne mène-t-il pas à une plus grande unité, une plus grande solidarité dans la résistance à ces attaques? Comme le rappelle l'introduction de cet article, la bourgeoisie belge tente, comme dans les autres pays, de cacher le plus cyniquement du monde l'aggravation de la crise aux yeux de la classe ouvrière. En plus, les discours visent à présenter une fausse vision de la solidarité aux travailleurs. On détourne la solidarité entre parties de la classe ouvrière vers une collaboration avec les exploiteurs: au nom de l'équité sociale, au nom de l'intérêt collectif, des sacrifices doivent être consentis. De cette manière, on essaye d'enfoncer un coin entre fractions de la classe ouvrière pour déclencher d'autres attaques, encore plus lourdes. On souligne ce qui nous divise, pas ce qui nous unit. Culpabilisées, traitées de "fainéantes" et "d'assistées", les victimes sont taxées de "profiteurs du système". Ainsi, on présente tour à tour différentes catégories comme des privilégiées. Si à l'époque, toute sorte de systèmes spécifiques ont été mis en place pour mettre les ouvriers au travail dans les pires circonstances et avec le salaire le moins élevé possible (pour "se retrousser les manches" lors de la reconstruction après guerre, attirer des forces de travail pour des jobs sales et dangereux, avec des horaires difficiles, et pour des salaires de misère dans les services publics), maintenant tout ça est présenté comme des privilèges indéfendables. Systèmes de pensions, règlements de chômage, barèmes salariaux, primes et suppléments, règlements de congés, pauses de midi, barèmes d'ancienneté, couvertures en cas de maladie, etc., tout y passe dans cette spirale descendante. Et on le justifie par des raisonnements sur les "droits démocratiques", la "solidarité sociale", la "défense des acquis sociaux", la lutte contre les "profiteurs, fraudeurs, corrompus et abus de toutes sortes".
Plus encore: au nom de la démocratie, de la liberté individuelle, de la réconciliation entre travail et vie privée, la bourgeoisie crée une atmosphère de concurrence impitoyable entre travailleurs qui doit saper la solidarité, par un système de sous-traitance, de filialisation, d'îlots qui sont "autonomes" et "responsables" de leurs résultats et des moyens utilisés. De même, le système de rétribution dépendant des prestations (contre lequel les travailleurs de Ikea se sont récemment mis en grève), ou de projets rémunérés suivant le résultat, renforce la concurrence mutuelle et sape la solidarité entre ouvriers.
Enfin, nous sommes depuis des mois matraqués de campagnes nationalistes, une fois de plus sous le mot d'ordre de la "solidarité" qui doit lier les ouvriers à leurs exploiteurs. Les "régionalistes" et "séparatistes" d'une part, veulent nous convaincre que la classe ouvrière serait mieux et pourrait mieux défendre ses acquis sociaux si elle se range sous la bannière flamande, wallonne ou bruxelloise contre les exploiteurs et les profiteurs des autres régions; de leur côté, les "nationaux", avec les syndicats, les partis de gauche et diverses personnalités du monde des médias, de la culture ou des sports en tête, à grand coups de pétitions massives et d'actions du genre "Sauvons la solidarité", amalgament la solidarité avec la mobilisation de la classe ouvrière derrière l'Etat: "Nous sommes flamand, bruxellois ou wallon, nous sommes belges et citoyens du monde. Nous ne voulons pas construire de nouveaux murs entre les gens, les régions ou les pays. Nous ne voulons pas que le principe de solidarité soit remplacé par la concurrence et l'égoïsme" (début de la Pétition pour la solidarité entre Flamands, Bruxellois et Wallons).
Ces campagnes permanentes ne facilitent pas l'unité des forces de la classe ouvrière pour faire barrage aux attaques communes du gouvernement, du patronat et des syndicats. De plus, malgré le poids de ce qu'ils ont déjà subi, les travailleurs sont conscients que le plus dur reste à venir. Momentanément, cela empêche que la lutte soit menée avec une réelle solidarité de classe, qu'un mouvement survienne, s'élargisse, cherche et offre cette solidarité aux autres frères de classe qui subissent les mêmes attaques. C'est pourquoi à l'heure actuelle, l'unification des forces se fait encore avec difficulté et qu'on réussit à faire régner les divisions entre secteur public et privé, entre régions ou communautés, entre ouvriers au travail ou au chômage, entre malades et non-malades, entre aînés et jeunes, entre allochtones et autochtones. Mais cette difficile quête de l'unité et de la solidarité dans la lutte mène inévitablement à l'identification des mensonges et faux-fuyants de la fausse unité, de la fausse solidarité avec l'entreprise, la région ou la nation, avec l'Etat démocratique, et jette donc les bases de la construction d'une véritable solidarité de classe dans la lutte.
Lac / 7.11.07
Situations territoriales:
- Belgique [97]
Quelques témoignages des luttes ouvrières et du mouvement étudiant (Novembre 2007)
- 3043 lectures
Comment les syndicats ouvriers et étudiants pourrissent la lutte et la réflexion (témoignages dans la lutte)
- 2891 lectures
Comme nous l'avons déjà dénoncé dans notre presse, l'attaque que subissent les ouvriers de la RATP, de la SNCF ou EDF contre les régimes spéciaux de retraites ne sont qu'une première étape des attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Demain, ce sera au tour de tous les ouvriers de voir leur régime de retraite remis en cause. En même temps, les attaques contre la protection sociale sont mises en place avec les franchises sur le remboursement des médicaments.
Les étudiants en lutte l'ont bien compris quand les grévistes élargissent leurs revendications, non seulement au retrait de la loi de réforme des universités,mais aussi pour la défense des régimes spéciaux et le retrait des franchises médicales qui sont mises en place.
Le spectre de la lutte contre le CPE réapparaît et les syndicats tant ouvriers qu'étudiants font tout leur possible pour qu'une telle dynamique ne puisse pas s'enclencher à nouveau, dynamique capable de donner une perspective au combat de toute la classe ouvrière en France mais aussi à l'échelle internationale.
Nous avons déjà rendu compte sur notre site de l'intimidation des syndicats (voir «un exemple de sabotage syndical dans les universités»). Notre intervention partout où nos forces nous l'ont permis, dans les AG ouvrières et dans les universités, a rencontré le soutien et la sympathie de beaucoup d'ouvriers et d'étudiants. C'est ainsi qu'en province, un groupe de jeunes étudiants 1] est venu discuter avec nos camarades et nous a transmis leur propre expérience du sabotage syndical de la lutte.
Ce que ces camarades ont vécu dans la lutte et nous ont transmis est révélateur du mépris de ces soit-disant «organisations ouvrières» pour le mouvement lui même. La seule chose qui compte est qu'il n'échappe pas à leur contrôle et ne puisse pas constituer une véritable force autonome qui permettrait aux ouvriers et aux étudiants de développer une véritable solidarité et une confiance accrue dans leur lutte commune.
1– comment les officines gauchistes et les organisations syndicales se combattent férocement la direction du mouvement dans le dos des AG :
Nous allons citer ce que ces camarades nous ont écrit :
- «Vers le 10 novembre, des vols importants furent commis au Mirail. Aussitôt,l'administration menaça l'AGET-FSE 2] de procéder à une fermeture administrative si les bâtiments principaux n'étaient pas évacués. (Même si cela n'a pas été le cas, on sait très bien que la «fermeture administrative» peut signifier l'envoi de CRS, comme cela s'est passé dans d'autres universités).
Pourquoi l'administration menaça t'elle à ce moment là le syndicat ? Parce qu'elle savait qu'il existait un conflit entre les occupants d'une bâtiment (l'Arche) et ceux du bâtiment principal. Il y avait dans un bâtiment l'AGET-FSE et la JCR[3] et dans l'autre les anarchistes.
l'AGET-FSE et la JCR organisèrent une «commission extra-ordinaire» pour débattre de la question, en l'absence des anarchistes.
Il fut décidé de libérer le bâtiment dont l'évacuation était demandée par l'administration, bâtiment occupé par les anarchistes !
Mais cette opération « militaire » ne se passa pas comme prévu. L'AGET-FSE abandonna la JCR au beau milieu de l'opération "musclée". Les anarchistes opposèrent de la résistance. Le «putsch», comme disent les anarchistes, fut un échec.
Cette tentative de putsch a fait beaucoup de mal au mouvement. La plupart des anarchistes boycottent le comité de lutte dominé par l'AGET-FSE et la JCR. De plus, ce coup de force a été caché à l'AG.»
Et les camarades concluent :
- «Si de telles manoeuvres sont possibles, c'est parce que les commissions sont présentées comme quelque chose de tout à fait impersonnel à l'AG. Le mouvement a une direction et une direction bien organisée : ce sont les syndicats comme l'AGET-FSE, SUD Etudiant, les organisations politiques comme la JCR. Il y a de nombreux indépendants et des anarchistes. Mais cette direction est masquée à l'AG par l'anonymat hypocrite des commissions (qui sont sensées mettre en oeuvre les décisions prises pendant les AG !).»
Contrairement aux apparences, donc, l'orientation du mouvement ne résulte pas, ici, de la volonté et des décisions des AG, mais des manoeuvres occultes de syndicats comme l'AGET-FSE, SUD Etudiant ou encore des organisations politiques comme la JCR.
2– Le non respect des décisions des AG :
Nous avons soutenu dans l'AG la proposition de ces camarades d'envoyer une délégation étudiante la plus large possible aux assemblées générales des cheminots. Cette proposition a été votée par l'AG. Mais déjà, le présidium autoproclamé a fait savoir qu'il n'était pas possible d'aller massivement aux AG des cheminots, en prétextant les nombreuses actions à mener simultanément. Au final, ce ne sont donc que 3 étudiants qui ont reçu mandat de l'AG pour cette délégation : un militant de l'AGET-FSE, un militant de la JCR et « une indépendante » comme l'écrive les camarades. Eux mêmes s'étaient présenté au vote de l'AG pour constituer la délégation, mais, n'étant pas connus face aux figures syndicales présentes dans l'AG, ils n'avaient aucune chance d'être mandatés.
Mais laissons la parole à ces camarades :
- «Nous sommes quand même allés aux AG des cheminots, d'une part parce que nous y étions invités par des camarades de la gare, d'autre part parce que nous voulions écouter les interventions de nos délégués.
Mais nous n'avons pas pu les entendre. Nous sommes allés à quatre des assemblées générales et nous ne les avons pas trouvés. Nous avons demandé aux camarades de Sud Rail et à d'autres s'ils les avaient vu dans les autres assemblées générales. Ils n'y étaient pas. En d'autres termes, les délégués étudiants, élus en assemblées générales, n'ont pas respecté leur mandat.
Nous sommes allés le soir au comité de lutte pour demander pourquoi nos délégués n'étaient pas venus aux assemblées générales des cheminots. Un membre de l'AGET-FSE nous a répondu que les délégués ne savaient ni où ni quand étaient ces AG. ...
Il y eut un précédent. Le 18 octobre, je fus moi aussi délégué étudiant auprès des AG de cheminots. Il y avait 5 autres délégués. Personne n'était là au début de l'AG, sauf moi. Seulement deux autres délégués sont arrivés quand l'AG se finissait.
A la deuxième AG, j'étais à nouveau le seul délégué présent. Aucun autre délégué n'avait respecté son mandat.
Et là aussi, on nous a dit qu'on n'avait pas les renseignements !
Cela fait plus de huit jours que se tiennent des assemblées générales de cheminots. Nous ne pouvons pas croire que des organisations comme l'AGET-FSE et la JCR sont incapables d'ouvrir leur carnet d'adresse pour trouver le numéro de téléphone d'un syndicat. Nous qui venons à peine de nous organiser, nous avons pu le faire !».
Pris la main dans le sac de ses magouilles, l'AGET-FSE n'a rien trouvé de mieux que de reprocher aux camarades d'avoir pris des initiatives, soi-disant au nom des AG étudiantes. C'est en leur nom propre que ces camarades sont allés aux assemblées générales des cheminots, où ils ont été bien accueillis et ont pu prendre la parole, proposant aux cheminots de venir dans les AG étudiantes (ce qui a été fait), proposant une distribution de tract commune au métro.
Comme le disent ces camarades :
- «alors que ces opérations ont été des succès, qu'elles ont enfin pu concrétiser le rapprochement des étudiants et des cheminots, on nous reproche d'avoir pris trop d'initiatives, d'avoir outre passé l'assemblée générale ! en allant aux assemblées générales des cheminots,nous n'avons fait qu'appliquer la décision votée depuis bien longtemps par les assemblées étudiantes : se rapprocher des travailleurs. Et en tant que communistes, c'est notre devoir de travailler de toute nos forces pour l'unité pratique de la lutte !
Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait au vu et au su de l'assemblée générale. Nous ne lui avons rien caché. Ceux qui voulaient participer à nos actions l'ont fait, ceux qui ne voulaient pas ne l'ont pas fait. Nous n'avons jamais rien imposé à l'AG. Seulement nous sommes indépendants des organisations qui dirigent actuellement le mouvement».
3– les syndicats ouvriers et étudiants main dans la main contre la solidarité naissante entre ouvriers et étudiants :
La solidarité naissante entre ouvriers et étudiants, le fait que des retraités non cheminots aient pu prendre la parole dans les AG de cheminots, tout cela montre les avancées de cette lutte : le combat des cheminots n'est pas leur combat,mais celui de la classe ouvrière qu'elle soit encore sur les bancs de la fac ou qu'elle soit retraitée. Cela, les syndicats ne peuvent pas l'accepter et ont tout fait pour que de telles manifestations de solidarité ne se propagent pas plus largement.
Le 22 novembre, les camarades ont participé à la manifestation étudiante, dans les rues de Toulouse. Laissons leur encore la parole :
- «A notre AG, Y. a appelé les étudiants à participer à l'assemblée générale à la Médiathèque, à 15h30, lieu de rassemblement de cheminots, électriciens et gaziers. Malheureusement la CGT a jugé bon d'avancer le rassemblement et de saboter toute tentative d'assemblée générale. Avait-elle été réellement organisée et par qui ?
Toujours est-il que la CGT n'a pas attendu les étudiants et qu'ils se sont barrés vite fait : Lorsque les étudiants, accompagnés de lycéens sont arrivés, nous les avons appelés à rejoindre les travailleurs, mais le service d'ordre des étudiants nous a rembarré. De l'autre côté, la CGT a décidé de lever le camp, d'autant plus que certains travailleurs faisaient des gestes amicaux vers les étudiants et leur demandaient de venir. La manifestation des étudiants est passée à 50 mètres de la manifestation des travailleurs.»
La force de la lutte c'est la lutte elle-même. Ces quelques éléments rapportés ci-dessus nous le montrent. D'un côté un mouvement qui commence à poser dans la pratique la nécessité de la solidarité dans la lutte de tous les ouvriers, des étudiants jusqu'aux retraités. Dans la continuité de luttes comme le CPE en France, seule l'unité la plus large des ouvriers peut permettre de constituer un rapport de force capable de faire reculer la bourgeoisie dans ses plans d'austérité et de misère qu'elle nous réserve.
Face à cela, la bourgeoisie et son Etat ont mis en place leurs syndicats et les organisations gauchistes comme les JCR.
Ces quelques exemples montrent que cette perspective est en marche. Une importante victoire pour la classe ouvrière sera de reconnaître quels sont ses véritables ennemis.
C'est ce qu'elle a commencé à faire dans cette lutte.
[1] - un membre de ce groupe se dit trotskiste bien que ne faisant pas partie d'une quelconque organisation et ils signent leurs écrits : Des communistes : branche Marx, Lénine, Trotsky.
[2] AGET -FSE : Association Générale des Etudiants de Toulouse, Fédération Syndicale Etudiante
[3] JCR : Jeunesses Communistes Révolutionnaires, organisation de jeunesse de la LCR, Ligue Communiste Révolutionnaire
Géographique:
- France [45]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Intervention des militants du CCI dans deux AG de travailleurs de la SNCF: les cheminots démasquent les syndicats
- 3259 lectures
Grâce à la solidarité des étudiants, les cheminots démasquent les syndicats
Le lundi 19 novembre, dans une grande ville de province, un petit groupe d'étudiants venus à notre dernière réunion publique a amené une délégation de vieux travailleurs politisés, membres du CCI, dans deux AG de cheminots. Dans la mesure où les syndicats avaient pris soin de bien quadriller les AG par secteurs, nos camarades se sont séparés pour prendre la parole dans deux AG : une du personnel de la gare et une des conducteurs.
Dans les deux AG, l'accueil des cheminots a été très chaleureux. Dans celle du personnel de la gare, notre camarade s'est présenté en disant qu'il n'était pas cheminot, qu'il était travailleur retraité mais qu'il venait leur apporter sa solidarité, ajoutant que, si c'était possible, il aimerait prendre la parole pour exprimer ses idées concernant cette solidarité. La réponse des cheminots qui l'ont accueilli a été de le remercier d'être venu témoigner sa solidarité. Ils ont ajouté : « bien sûr, vous pourrez parler ».
L'AG a commencé vers 11h30 et s'est terminée vers 12h30. Pour diriger cette AG, une brochette de représentants des syndicats était là : FO, CFDT, CFTC, CGT, SUD... Chacun y est allé de son speech pour rappeler les revendications, pour dire qu'il fallait établir un rapport de forces de « haut niveau », pour présenter la négociation qui était annoncée comme une perspective de la lutte, pour affirmer que c'étaient les AG qui décidaient, mais le tout dans une enveloppe très corporatiste. En effet, non seulement c'était une AG de secteur, mais le souci de la situation des étudiants et des autres fonctionnaires pour envisager une lutte commune était totalement absent de leurs interventions. Un délégué syndical a même affirmé que la perspective était de lutter pour « obtenir des réformes » et non pas de lutter tous ensemble parce que l'orientation des syndicats n'était pas de tout « révolutionner ». Le représentant de la CFDT, quant à lui, a dit que la fédération départementale n'était pas d'accord avec l'échelon national qui avait appelé à arrêter la grève.
Suite à ces discours, un jeune cheminot s'est dirigé alors vers notre camarade retraité venu apporter sa solidarité et lui a dit : « Si vous voulez parler, vous pouvez. » Les porte parole des syndicats, comprenant l'enjeu de la situation, ont dit qu'il fallait attendre encore un peu avant de lui donner la parole car il fallait d'abord procéder au vote sur la reconduction de la grève et ensuite écouter encore des propositions d'actions (qui montrent que, à la veille de la manifestation du 20 novembre, les représentants syndicaux ont été obligés de « prendre le train en marche" à toute vitesse alors que dans les entreprises de la Fonction publique ils n'avaient fait aucun appel à engager la lutte en solidarité avec les cheminots)[1] : « aller aux guichets pour inviter ceux qui travaillent à aller à la manif de mardi, et leur dire qu'ils ne risquent rien à le faire », ou encore « distribuer un tract le lendemain matin de bonne heure au métro ».
Il est évident que les syndicats n'avaient nullement envie que cette "minorité" d'étudiants viennent "semer le désordre" dans leur chasse gardée, en ouvrant dans les AG de cheminots leur "boîte à idées", comme lors du mouvement contre le CPE au printemps 2006 (voir notre supplément "Quelles leçons de la lutte contre le CPE ?"). Ce type d'AG organisée, dirigée et sabotée par les syndicats ne prévoyait pas et ne permettait pas un réel débat, un véritable échange d'idées. Et pourtant, il y avait une vraie combativité et un réel mécontentement. Sur 117 votant, 108 cheminots se sont prononcés pour la reconduction de la grève.
C'est seulement après le vote que notre camarade retraité a donc pu parler au micro (car, bien sûr, pour les syndicats, les propositions faites par les "éléments extérieurs" qui ne sont pas concernés par la grève, n'ont pas à être discutées par les cheminots). Voici le contenu de son intervention :
« Je ne suis pas cheminot, je suis retraité. Mais je tiens à apporter ma solidarité à votre lutte. Vu de "l'extérieur", aujourd'hui, il y a plusieurs luttes contre des attaques qui toutes touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs. Vous qui luttez pour préserver vos retraites, les étudiants, qui sont de futurs ouvriers, et qui luttent contre une réforme qui va transformer certaines universités en "facs poubelles", les travailleurs de la fonction publique (comme ceux de l'Éducation Nationale) vont manifester demain car leurs conditions de travail deviennent insupportables et de nombreux postes vont être supprimés. Toutes ces luttes sont une même lutte pour la défense de nos conditions de vie. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il fallait imposer un rapport de forces de "haut niveau", je suis bien d'accord. Mais comment faire ? Je pense qu'il faut lutter tous unis. C'est parce qu'il y a eu une grande solidarité des salariés avec les étudiants que, face aux manifestations massives contre le CPE, le gouvernement a fini par reculer. Demain, il faut aller nombreux à la manif ; mais aussi, je pense que ce serait bien s'il n'y avait qu'une seule banderole sur laquelle serait inscrit quelque chose comme "Cheminots, étudiants, fonctionnaires : tous unis dans la lutte !" Et puis, à la fin de la manif, au lieu de rentrer sagement à la maison ou d'aller au bistrot, il faudrait que les cheminots aillent discuter avec les étudiants, avec les fonctionnaires, les fonctionnaires avec les étudiants et les cheminots. Il faut discuter entre nous, cela nous permettra de commencer à construire l'unité dont nous avons besoin. Car, face aux attaques, la seule façon de nous défendre, c'est de construire cette unité ».
Cette intervention a été accueillie par des applaudissements chaleureux.
Avant que l'AG ne commence, notre camarade retraité avait un peu discuté avec les cheminots des mensonges des médias. Ces mensonges sont évidents pour tout le monde, sauf pour les aveugles et les sourds (et les manifestants du dimanche de "Liberté Chérie"). A la fin de l'AG, il a pu discuter de nouveau avec un petit groupe de jeunes cheminots. Il leur a demandé : « Que pensez-vous de l'idée d'une banderole unique ? ». La réponse de l'un d'eux a été : « A la base, on serait plutôt pour, mais ce sont les fédérations qui ne veulent pas. »
On ne saurait être plus clair sur les manoeuvres de division des syndicats. Néanmoins, bien qu'elle soit contrecarrée par les syndicats, l'idée des nécessaires unité et solidarité de toute la classe ouvrière fait son chemin.
Dans l'autre AG, celle des conducteurs, l'accueil de nos camarades accompagnés par des étudiants a également été chaleureux. Ils ont pu intervenir pour défendre la même orientation que celle mise en avant par notre camarade retraité. Les étudiants ont repris avec enthousiasme l'idée d'une banderole unique. Les interventions des étudiants et de nos camarades ont été bien accueillies malgré le fait que les conducteurs avaient encore l'illusion qu'à eux seuls ils peuvent se défendre efficacement parce qu'ils peuvent "bloquer" le trafic. C'est pourtant l'union des travailleurs et pas seulement un "blocage" qui fait la force de la classe ouvrière. Le fétichisme du "blocage" est aujourd'hui la nouvelle tarte à la crème des syndicats pour empêcher toute réelle extension et unification des luttes et permettre au gouvernement de faire passer ses "réformes".
Depuis le 18 octobre, la construction de cette unité se heurte en permanence au travail de division des syndicats. Mais, comme le disait ce petit groupe d'étudiants dans une discussion que nous avons eue après les AG, « les attaques de la bourgeoisie contre tous les secteurs de la classe ouvrière sont si globales que cette situation ne peut que favoriser la tendance vers l'unité des luttes ».
Ce petit groupe d'étudiants a parfaitement compris que, comme le disait un étudiant de l'université de Paris 3-Censier en 2006, « si on reste tout seuls, on va se faire manger tous crus ». Et c'est parce qu'ils ne voulaient pas que leurs camarades cheminots restent isolés et finissent par se faire eux aussi matraquer par les milices du capital qu'il sont allés chercher la solidarité des vrais communistes (dont certains ont connu les passages à tabac par les bonzes syndicaux du service "d'ordre" de la CGT dans les années 1970 et 1980). Mais il est vrai que depuis la chute du mur de Berlin, la CGT (et le P"C"F) s'est beaucoup "démocratisée". Ces étudiants qui ont été capables de déverrouiller les AG des cheminots (séquestrés dans la prison du "local syndical"), ont dit à nos camarades de la "vieille" génération : « c'est super d'avoir des parents comme vous ! ». C'est un état d'esprit qui se situe aux antipodes de celui de certains étudiants "contestataires" de la fin des années 1960 (marqué par le "conflit des générations") et qui, en rébellion contre leurs parents qui avaient vécu la terreur des régimes nazis et staliniens, voulaient parquer "tous les vieux dans les camps de concentration" ![2]
L'intervention de nos camarades n'avait pas pour but de venir faire de la pêche à la ligne et de vendre des "cartes du parti" car le CCI n'est pas une organisation qui (contrairement aux trotskistes et aux organisations de la "gauche plurielle") participe au cirque électoral bourgeois. Elle ne vise pas non plus à "récupérer le mouvement" comme se l'imaginent les doux rêveurs "anti-parti" et les vrais "récupérateurs" de tout bord.
Quant à ceux qui continuent encore à crier "Au loup !" en mettant en garde contre les "bolcheviks au couteau entre les dents", on ne peut que leur conseiller d'apprendre l'histoire réelle et non celle racontée de façon mensongère, depuis des décennies, par les idéologues patentés du capital et les plumitifs de la propagande bourgeoise (les médias et la petite bourgeoisie de l'intelligentsia républicaine). Les nouvelles générations de la classe ouvrière, qu'ils soient cheminots ou encore étudiants, découvrent ce qu'est la vraie "démocratie" et la vraie solidarité (même s'ils ont encore les illusions de la jeunesse et ne peuvent faire l'économie de l'expérience). Le courage dont ils ont fait preuve pour commencer à "contester" les directives des bonzes syndicaux et faire vivre la vraie culture de la classe ouvrière montre que l'avenir de l'humanité est bien entre leurs mains.
GM
[1] Ça vaut la peine de relever que, dans beaucoup de lieux de travail du secteur public (hôpitaux, ASSEDIC, etc.), les tracts syndicaux (notamment de le CGT) appelant à la grève et la manif du 20 novembre sont arrivés dans les services... le lendemain. En certains lieux, les panneaux syndicaux ont été nettoyés de tous les tracts sur la situation actuelle.
[2] Quarante ans après, il n'est pas étonnant que certains jeunes qui ont "mal vieilli" et sont devenus les serviteurs zélés de la bourgeoisie aient maintenant envie de "liquider" le spectre de Mai 68 en "gazant" les étudiants (qui revendiquent aussi le droit de rêver un peu) ou en les enfermant dans les geôles du capital. Mais il est vrai que les édu-castreurs qui veulent nettoyer la vitrine des universités françaises en cirant les bottes de Monsieur Le Pen, ont les idées bien courtes ...
Vie du CCI:
- Interventions [37]
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- SNCF [126]
Rubrique:
Rassemblement des cheminot(e)s devant le siège de la SNCF le 21 novembre
- 2263 lectures
Nous publions ci-dessous un compte-rendu adressé par un lecteur qui était présent au rassemblement organisé par des cheminots syndiqués et non syndiqués devant la direction de la SNCF le jour des négociations "tripartites" du 21 novembre (au lendemain de la grande manifestation des fonctionnaires) entre le gouvernement, les syndicats et la direction de l'entreprise.
Je vous remercie de publier ces quelques informations que j'ai pu recueillir en allant devant le siège de la SNCF à Paris (Montparnasse) le 21 novembre. D'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec les cheminot(e)s qui étaient là et en écoutant ce que les gens disaient autour de moi, ce rassemblement a été appelé par le syndicat SUD (opposé à la CGT) et les non syndiqués qui ont invité tous les usagers à y participer (mais comme les syndicats n'ont pas appelé à la grève dans la fonction publique après la manifestation du 20, il était difficile de pouvoir réunir davantage de monde). Il y avait un gros attroupement de cheminot(e)s, la plupart avec des badges et des drapeaux verts de SUD (c'étaient des cheminots des dépôts de Montparnasse et Austerlitz qui étaient au syndicat SUD ou non syndiqués ; certains avaient ou étaient sur le point de déchirer leur carte syndicale). Ils avaient l'air anxieux et attendaient la fin des négociations pour connaître le résultat. Il y avait aussi quelqu'un qui tenait un drapeau de FO et un autre qui essayait de distribuer des autocollants de la CNT. D'autres gens sont venus ensuite distribuer des tracts politiques. D'autres personnes, qui travaillaient dans l'Éducation nationale et la santé, sont aussi venues. Les gardes mobiles (pas agressifs) étaient là aussi pour protéger l'accès au siège de la SNCF où les négociateurs étaient en réunion.
Au début de l'après-midi, Bernard Thibault n'était toujours pas sorti de la réunion et les cheminots commençaient à trouver le temps long. Des cheminots ont dit en rigolant : "il est en train de prendre l'apéro avec les huiles de la direction". Des bruits ont circulé qu'il n'y avait pas de représentant du gouvernement dans ces négociations. Finalement, pour faire patienter les gens, le délégué de SUD a sorti un micro et a organisé une petite AG dans la rue en donnant la parole à tous ceux qui voulaient parler. Les cheminot(e)s étaient très en colère mais avaient une attitude très correcte. Ils ont été très dignes pendant tout le rassemblement (même si certains ont allumé des feux de Bengale à la fin, mais ce n'était pas dangereux). Le délégué de SUD a dit qu'il était contre la reprise du travail (car on ne peut pas reprendre le travail sans rien obtenir après neuf jours de grève). Le gars qui portait un badge de la CNT a pris le micro et a commencé à lever la tête vers les gardes mobiles qui étaient sur la balustrade, il s'est adressé à Sarkozy en criant : "On va t'enculer, le nabot des Carpates !" Les gardes mobiles ont gardé leur calme et ont observé tout ça de loin. Les cheminots étaient mal à l'aise et l'un d'entre eux a dit aux personnes présentes (qui ont demandé s'il y avait d'autres syndicalistes de la CNT ici) qu'il n'y avait pas de syndicat CNT chez eux. Pendant la discussion, quelqu'un a jeté une canette de bière en verre au milieu de l'AG. Un jeune homme qui s'est présenté comme cheminot (avec un badge SUD) a pris aussi longuement la parole et a dit que, vu la retraite qu'il allait toucher, il préférait aller "dealer de la cocaïne". Des cheminot(s) de SUD ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vu chez eux.
C'était un peu la confusion et les cheminots avaient un air très grave. A ce moment, quelqu'un a sorti des canettes de bière et a commencé à faire un peu de bruit. Des usagers se sont demandé si ce n'était pas des provocations pour saboter l'AG (quelqu'un a dit : "ils sont venus faire du spectacle" car il y avait des gens qui filmaient et prenaient des photos). Les gardes mobiles étaient devant le rassemblement et il n'y a pas eu de débordement. Des cheminots ont compris qu'il y avait une nouvelle tentative de division et que le gouvernement cherchait à pourrir la grève. Un cheminot qui a compris le danger a dit assez fort à ses camarades : "on reprend le travail mais dans l'unité !". Une cheminote a dit à un usager : "si je reprends, ce sera la tête haute". Un autre, qui discutait avec quelques usagers, a dit qu'il valait peut-être mieux suspendre la grève pour garder les forces et remettre ça plus tard, à un moment plus stratégique. Il a dit aux usagers qu'il en avait marre de faire des grèves pour rien et de perdre à chaque fois autant d'argent en se battant pour les autres. "Il faudrait que les autres s'y mettent à leur tour". Il voulait raconter aux usagers son expérience et a dit des choses très intéressantes du style : "il faut compter à peut près une semaine. Si au bout de 6 à 8 jours, la grève ne s'étend pas, ce n'est pas la peine de continuer". Il y a eu des discussions où des usagers, et des étudiants (venus malgré la grève des transports), ont dit aux cheminots de ne pas se démoraliser. Les gens étaient scandalisés. Il y avait un fort sentiment de solidarité et de colère contre les syndicats car c'était évident pour tout le monde qu'ils étaient des traîtres et qu'il fallait que la fonction publique se mobilise. Mais quand et comment était la question.
L'idée d'une solidarité financière a aussi circulé si les cheminots n'obtiennent pas le paiement des jours de grève. Comme les cheminots en avaient un peu assez de faire le poireau, au bout d'un certain temps (au milieu de l'après-midi), le délégué syndical a annoncé l'arrivée du responsable de SUD qui était présent dans la réunion tripartite et allait donner des nouvelles. Étrangement, le micro avait disparu et tous les cheminots ont dû se rapprocher pour pouvoir entendre sa déclaration car il parlait très bas. Les usagers qui étaient à l'arrière n'ont presque rien entendu. Il a annoncé que SUD appelait à la reconduction de la grève et qu'il avait été décidé un calendrier de négociations jusqu'au 20 décembre. Bref, les cheminots étaient encore maintenus en haleine. Mais personne n'a cru à ce nouveau "calendrier" (dans le meilleur des cas, le gouvernement leur donnera une aumône). Des cheminots (et des usagers) ont dit qu'il fallait arrêter avec des "négociations"-magouilles dans le dos des grévistes. Ce rassemblement a eu lieu dans un climat assez tendu car, le matin même, la radio avait annoncé que des cheminots avaient fait des sabotages sur des voies ferrées du côté de Poitiers et les menaces de sanction étaient annoncées. Tout le monde était scandalisé et a compris que cette "nouvelle" était un avertissement aux cheminots qui voudraient encore faire reculer le gouvernement. Un cheminot a dit que ce n'était pas forcément une fausse nouvelle (c'est déjà arrivé qu'une petite minorité de cheminots désespérés et entraînés dans des actions "coups de poing" des syndicats fassent ce genre de chose).
A.
Quelques commentaires :
Ce témoignage est significatif de la méfiance et de la colère croissante contre les dirigeants syndicaux considérés comme des "traîtres", ceux qui "magouillent dans le dos des grévistes" et "prennent l'apéro avec la Direction". Il révèle aussi qu'une réflexion se fait jour sur la question "comment lutter ?" En particulier, la question de l'élargissement des luttes et de la solidarité entre différents secteurs (au sein de l'entreprise et en dehors) fait son chemin. L'idée que c'est rapidement que cet élargissement doit se réaliser avance également de même que celle qu'il est préférable de "reprendre dans l'unité" plutôt que de laisser la bourgeoisie pourrir le mouvement afin de démoraliser les ouvriers, de les dégoûter de la lutte et lui laisser les mains libres pour continuer à attaquer.
Cela dit, il est clair que le chemin est encore long car, pour le moment, une bonne partie de la colère contre les syndicats "traditionnels", particulièrement la CGT, est récupérée par un syndicat "radical" comme SUD.
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Un exemple de solidarité des lycéens avec les cheminots
- 2373 lectures
Un contact nous a fait parvenir ces photos et cecommentaire que nous reproduisons tels quels ci-dessous comme témoignage vivantet parlant que la recherche de solidarité entre tous les secteurs en lutte faitson chemin parmi les jeunes générations de prolétaires.
Camarades,
Cematin, comme tous les matins, je me suis rendu au boulot sans grandenthousiasme et en traînant franchement des pieds... sans savoir qu'une surprise,et une belle, m'attendait à Fontainebleau.
J'aieu en effet le plaisir de découvrir la rue Grande,principale artère de la ville, jalonnée de slogans. Tous les abris-bus etquelques palissades étaient tagués : on pouvait y lire notamment « A bas les privilèges des riches - GREVE »,« STOP aux privilèges des riches -Vive la république sociale - GREVE », « GREVE - Ils nous respectent pas - GREVE »...
Déjà,ces messages témoignaient d'un esprit combatif... mais ce qui m'a donné le plusde baume au cœur pour le reste de lajournée, ce fut de lire un peu plus loin (je les ai mis en gras) : « Lalutte des cheminots est la nôtre - SOLIDARITE » et « La lutte des cheminots est la nôtre - MARREdes privilèges des riches » !!!!
Quelcontraste entre cet esprit de solidarité et les conneries propagandistes que maradio débitait au même instant dans ma bagnole, du type « regardez comment les cheminots, ces nantis,emmerdent et prennent en otage tous les pauvres travailleurs », etc.,etc.
Ensuivant la piste laissée par ce chemin de slogans (à la façon du Petit-Poucet),je me suis retrouvé devant... un lycée. J'ai essayé de me renseigner auprès desjeunes s'ils savaient qui avait fait ça (en saluant de tels actes)... ils n'ontpas voulu me répondre (fort logiquement)... mais leur très large sourire en disaitlong...
Oui !« La lutte des cheminots est la nôtre - SOLIDARITE » !!!
Jérôme,le 19 novembre.
PS :je vous joins aussi quelques photos que je me suis évidemment empressé deprendre.
Cheminots - solidarité!
Cheminots - marre des riches!
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [127]
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Séisme au Pérou: le capital tire profit des destructions
- 3472 lectures
Cette prise de position sur le dernier tremblement de terre au Pérou nous a été envoyée par un contact de ce pays. Elle respire l'indignation face aux conséquences qui en résultent pour les ouvriers et, de façon générale, pour les miséreux alors que, en ce qui la concerne, la bourgeoisie étale son hypocrisie et sa cupidité. Nous partageons bien sûr la vision que le capitalisme est responsable de ces conséquences et que seule sa destruction pourra permettre d'instaurer et de développer des conditions de vie vraiment humaines.
"C'est une épreuve de plus que Dieu, dans l'au-delà, nous envoie" (Alan Garcia Perez, Président du Pérou)
Il est parfaitement évident que la bourgeoisie tire profit de cette « épreuve divine ». Ces derniers mois, la bourgeoisie locale a dû s'affronter à la combativité de millions de prolétaires mobilisés pour leurs revendications, une combativité qui a favorisé, surtout au sein du prolétariat des mines, le développement d'un haut niveau de solidarité prolétarienne.
Ces dix derniers jours, par le biais des gouvernements régionaux, la bourgeoisie provinciale, avec ses intérêts particuliers mais identiques à ceux de la bourgeoisie nationale, menaçait de paralyser quelques régions. Même certains secteurs de la police menaçaient de faire grève si leur syndicat n'était pas reconnu, et les médecins de « ESSALUD » (sécurité sociale) avaient cessé le travail depuis mercredi matin. La manœuvre de Alan Garcia ([1]) contre la bourgeoisie chilienne avait fait long feu et n'avait eu de résultats que dans la presse aux ordres et dans la bouche des intellectuels à la solde de l'État. Une nouvelle vague de luttes menaçait d'exploser sur divers fronts.
Mercredi dernier à 18 h 40, la terre a tremblé avec une puissance de 7,5 sur l'échelle de Richter à près de 60 kilomètres de Pisco, qui se trouve à près de deux heures de Lima. Des centaines de milliers d'habitants ont tout perdu en 70 secondes, en particulier à Pisco, Chincha et Ica. Ces villes ont été complètement détruites. A Lima, la capitale, l'onde de choc a causé des dommages importants. L'essentiel des dommages se situait par conséquent au nord de Lima et dans tout le département d'Ica et les limitrophes à celui-ci.
L'appareil de l'Etat paraissait en plein désarroi, il n'a pas réagi durant des heures. Négligeant sa fameuse élégance, le Président Garcia posait dans son bureau en manches de chemises, aux côtés de ses acolytes qu'il allait envoyer évaluer l'ampleur du désastre. Personne ne pouvait y arriver par voie de terre, la route panaméricaine étant impraticable à plusieurs endroits, mais quelques journalistes parvinrent à atteindre Chincha, Pisco et Ica, les principales villes dévastées, et ils commencèrent immédiatement à envoyer leurs reportages. A Ica, l'église du Seigneur de Luren s'était effondrée, écrasant des dizaines de fidèles sous les décombres. A Tambo de Mora (le port de Chincha), les murs de la prison se sont effondrés et 600 prisonniers ont pu s'échapper. Le jeudi matin, on comptait déjà 500 morts et plus de mille blessés. Ce même jour, le Président Alan Garcia fit son apparition, accompagné par le Premier ministre Jorge del Castillo, le ministre des Armées Alan Wagner et le Président du Congrès Gonzales Posada. Pendant la campagne électorale, ce dernier s'était engagé à reconstruire l'aéroport de Ica, promesse qu'il n'avait bien sûr pas tenue ; aujourd'hui, les secours ne peuvent toujours pas atteindre cette ville... inaccessible sinon par la voie des airs.
Les premiers signes de mécontentement se sont exprimés dans la population. Quelques exemples de manifestations de mécontentement ont pu filtrer malgré le chaos des informations et la mainmise des médias sur celles-ci, qui montrent la véritable et profonde raison à l'origine du désastre : la misère. Dans les endroits où les villes ont été dévastées, la population construisait ses habitations en torchis et bien sûr sans la moindre précaution antisismique. Par ailleurs, beaucoup de maisons étaient très vieilles et ne purent résister au séisme.
Voici un exemple illustratif : à Pisco, une ville qui possède un port proche et une station balnéaire pour millionnaires, Paracas, la portée de la catastrophe fut très inégale. Les constructions en dur et les villas de plage des riches résistèrent au séisme, alors que toute la ville de Pisco et le port furent totalement détruits. La nature ne fait pas de différences ni n'accorde de privilèges, c'est la division de la société en classes qui les perpétue. C'est cette perpétuation qui a provoqué la catastrophe actuelle dont l'ampleur ne cesse d'augmenter. C'est la misère provoquée par la société capitaliste qui a provoqué autant de destructions, car les pauvres ne pourront jamais vivre dans des maisons solides, construites avec du matériel de bonne qualité et suivant des plans tenant en compte les exigences des zones sismiques. Mais l'ignominie du capitalisme n'en reste pas là, la bourgeoisie se frotte les mains en pensant déjà aux bénéfices qu'elle pourra tirer de la reconstruction du pays.
L'armée, qui compte dans ses rangs des centaines d'ingénieurs experts en construction et possède le matériel lourd nécessaire, reste pour l'heure dans ses casernes car la spéculation financière sur la construction a déjà commencé. Les diverses fractions de la bourgeoisie se disputent en ce moment les prochains marchés. L'exemple le plus significatif a été donné par l'alliance entre la journaliste Cecilia Valenzuela et la compagnie d'assurances La Positiva qui souhaite reconstruire la région.
Les billets d'avion pour cette zone ont déjà augmenté de 400 %, et Alan Garcia s'est contenté de protester à la télévision, car tout doit s'incliner devant les règles du libre-marché. La Banque de Crédit, avec à sa tête Dioniso Romero, a ouvert un compte pour capter les fonds d'aide à la région, un nouveau revenu pour une banque qui veut montrer qu'elle est la plus performante du pays, qu'elle a le sens des affaires inscrit dans ses gènes. La Coopération Espagnole a aussi fait son apparition, de même que Pompiers sans Frontières, tout l'appareil d'aide sociale commence à montrer le bout de son nez alors que le gouvernement central, les gouvernements régionaux et locaux laissent la reconstruction aux mains des entreprises privées. Mais les prolétaires savent déjà que l'Etat, sous le capitalisme, ne peut être que l'Etat des capitalistes.
L'ONU a déjà envoyé un million de dollars et la Banque interaméricaine de développement (BID), qui avait prêté 80 millions à la corporation Wong avec l'aval du Fujimori, n'a envoyé pour sa part que 200 000 dollars. Caritas n'est pas en reste et a aussi mais tardivement ouvert son compte. Les affaires ne doivent bien sûr pas s'interrompre, c'est la leçon essentielle que les bourgeoisies locales ont tiré de la tragédie.
Celle que nous devons tirer pour notre part est que même si la force colossale de la nature peut causer de grands malheurs, la véritable puissance destructive se trouve dans les rapports sociaux auxquels sont soumis des millions d'êtres humains sur la terre. Ces rapports les condamnent à vivre misérablement, dans les pires conditions de logement. Ce n'est que leur disparition, la disparition des rapports sociaux bourgeois, la disparition du capitalisme au niveau mondial qui pourra permettre des conditions de vie décentes et humaines à toute la population de la planète, c'est la seule issue pour la survie que nous ayons dans le futur.
H. Lima, 17 août 2007
[1] L'Etat péruvien avait publié une carte affichant ses prétentions sur les eaux territoriales. La bourgeoisie chilienne avait saisi la balle au bond et envoyé immédiatement son armée effectuer des manœuvres au nord du Chili, dans la zone frontière avec le Pérou. On constate une fois de plus que les revendications nationalistes des Etats ne sont que des manœuvres pour prolonger et renforcer leur pouvoir au prix de millions de travailleurs qui pourraient être envoyés se battre contre leurs frères de classe d'un autre pays. L'ennemi des travailleurs péruviens, c'est la bourgeoisie péruvienne, comme la bourgeoisie chilienne est l'ennemie du prolétariat chilien.
Géographique:
- Pérou [128]
Récent et en cours:
- Catastrophes [129]
VW: l'isolement mène à la défaite
- 3110 lectures
Comment est-on arrivé à un résultat aussi humiliant après trois mois de colère et de combativité ?
Pendant trois mois, les ouvriers de VW-Forest ont été maintenus dans l’angoisse la plus totale sur leur avenir. Il est inutile ici de continuer à spéculer sur les intentions de VW de fermer où pas l’usine qui était à la base du chantage car le résultat de l’ultimatum est bien là aujourd’hui : les ouvriers ont dû accepter, sans aucune garantie pour l’avenir, la perte de 3.000 postes de travail et de nouveaux sacrifices pour les 2.200 emplois restants dont l’augmentation du temps de travail à 38 heures semaines payées au tarif des 35 heures actuels. Le fait que la bourgeoisie a mis trois mois pour arriver à ce résultat ne s’explique pas seulement par la combativité parmi les ouvriers de VW, mais surtout par l’inquiétude générale qui l’accompagne. En effet, aujourd’hui, le capitalisme belge ne maintient sa très haute productivité et compétitivité que par une dégradation constante des conditions de vie et de travail de toute la classe ouvrière. C’est donc un sentiment d’inquiétude général qui existe parmi l’ensemble des travailleurs. C’est aussi pourquoi tous les salariés étaient très sensibilisés à la lutte à VW. La bourgeoisie a donc voulu infliger une sévère défaite à la classe ouvrière à VW avant que cette inquiétude ne se transforme en combativité générale. C’est pourquoi la dégradation économique et sociale très importante que la bourgeoisie a réussi aujourd’hui à imposer aux travailleurs de VW touche tous les travailleurs car ils sentent bien que cette dégradation les atteindront aussi dans un futur proche.La victoire des syndicats sur les ouvriers
En novembre 2006, lorsque le conflit a éclaté à VW, la décision de licencier 4.000 ouvriers a provoqué un choc dans toute la classe ouvrière en Belgique. La bourgeoisie a donc gardé alors une certaine prudence à cause de l’ambiance générale de tensions sociales et elle a laissé le champ libre aux syndicats pour mener les ouvriers sur une voie de garage. Ainsi, alors que la colère était grande parmi de nombreux secteurs de la classe ouvrière, comme l’a montré la mobilisation lors de la manifestation nationale du 2 décembre, les syndicats ont tout fait pour empêcher une réelle solidarité. Pour casser toute perspective de luttes, d’extensions et d’assemblées générales, les syndicats ont vite accepté la perte de 3.000 emplois en les conditionnant à l’octroi d’une prépension et d’une prime de départ … que la direction de VW s’est empressée d’accepter : “950 salariés s’en vont par la prépension, mais selon les normes du nouveau “pacte des générations”. 1950 quittent l’entreprise sur une base “volontaire”, avec pour les 1.500 premiers une prime de départ en récompense. Avec pour la plupart d’entre eux, le chômage comme seule perspective. Pour ceux qui restent, il y a un système de chômage partiel à long terme, mais surtout, en plus des 33% d’augmentation de productivité que les ouvriers avaient réalisé entre 2001 et 2005 et du nouveau règlement en place depuis l’été 2006 concernant la flexibilité (temps de travail jusqu’à 10 heures par jour, 48 heures par semaine), une nouvelle convention collective doit être signée, prévoyant une diminution des salaires et des coûts de production. Les conditions de production en 2009 devraient s’aligner sur celles du siège VW à Mosel (est de l’Allemagne), où le coût salarial se monte à 16,9€/h, contre 23,8€/h aujourd'hui à VW Forest.” (Internationalisme, n° 329). Les manoeuvres de divisions syndicales ont graduellement pris le dessus et les conditions de lutte sont devenues de plus en plus défavorables: “C'est là qu’interviennent les manœuvres syndicales: depuis le début, les ouvriers ont été renvoyés à la maison, isolés les uns des autres, sans information ni perspective. C’est la perspective d’une interminable grève rampante qui a été mise en avant, sans assemblée générale de grévistes où de véritables discussions et décisions sont possibles, sans comité de grève élu, contrôlé et révocable, sans meeting mobilisateur, sans délégation massive pour aller chercher activement la solidarité et l’extension vers d'autres parties de la classe ouvrière. Chaque développement de tout moyen de lutte et d’une dynamique de renforcement de la lutte a été tué dans l’œuf. L’idée même de mener une lutte a été de plus en plus ressentie comme insensée. Il ne restait finalement rien d’autre aux ouvriers que de subir leur sort et de placer toute leur confiance dans les négociateurs gouvernementaux et syndicaux” (Internationalisme, n° 329). Ainsi une réelle perspective de lutte était graduellement réduite á néant.Un dernier sursaut de colère
Progressivement, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à faire peser un sentiment de solitude et d’impuissance sur les 2.200 travailleurs restants. C’est directement le sabotage de la lutte par les syndicats qui a permis à la bourgeoisie, aujourd’hui, d’avancer avec plus de détermination et de brutalité et d’exercer un véritable chantage sur les ouvriers. Les “négociations” ont donc été menées en secret entre la direction et les syndicats pour mettre les ouvriers devant le fait accompli. Néanmoins, si les syndicats pensaient imposer les mesures pour le “sauvetage” sans aucune consultation des ouvriers, “négociant” dans leur dos, ils n’ont pu empêcher la réaction des ouvriers qui n’ont pas hésité de reprendre la grève, après trois mois d’incertitude épuisante, et ce, deux jours avant que les trois syndicats ne signent l’accord avec la direction. Devant l’ignorance totale dans laquelle ils ont été maintenus sur leur sort, les ouvriers restants sont partis spontanément en grève: “Les trois syndicats devaient décider seuls de l’approbation ou non du plan de la direction. Mais les ouvriers ne l’ont pas entendu de la même oreille. Lundi matin, ils ont refusé de reprendre le chemin des lignes d’assemblage. Plus tard, ils sont allés protester devant les fenêtres de la salle où se tenait le conseil d’entreprise. Ils ont dénoncé le manque d’informations sur le contenu du plan et ont reproché à leurs représentants de ne pas les consulter.” (Le Soir, 27/02/2007). Cependant, trois mois plus tard, la situation n’est plus la même. Compte tenu du départ de plus de la moitié des ouvriers et de l’absence totale de perspectives plus larges dans laquelle les syndicats ont pu enfermer les travailleurs, ceux-ci ne pouvaient qu’exprimer leur colère dans un dernier baroud d’honneur. La bourgeoisie et ses médias n’ont d’ailleurs pas manqué de faire ouvertement pression en taxant les ouvriers d’irresponsables s’ils n’acceptaient pas l’accord négocié par les syndicats. De même, alors qu’en décembre 2006 la carte régionale et linguistique ne pouvait être utilisée pour diviser les ouvriers unis dans le combat, aujourd’hui les manœuvres de divisions fleurissent entre les soi-disant Wallons “enragés” de la FGTB et les Flamands “dociles” de l’ACV. C’est dans ce contexte profondément modifié du rapport de force que les syndicats ont pu imposer un référendum par vote secret et individuel autour d’une question qui ne laissait plus de choix si ce n’est d’accepter de légitimer la signature de l’accord que les syndicats avaient conclu avec la direction. Ce vote représente non seulement une victoire pour la direction de VW, mais aussi pour le gouvernement et surtout pour les syndicats et une défaite pour les ouvriers, non seulement de VW en Belgique, en Allemagne et en Espagne, mais pour l’ensemble de la classe exploité en Belgique. Cette victoire de la bourgeoisie va servir d’exemple pour renforcer la productivité sur le dos des ouvriers et de jouer la concurrence entre eux. Néanmoins, malgré cette défaite ponctuelle, la classe ouvrière est encore capable de tirer les leçons de ses échecs, l’expérience ne pourra, à terme, que conduire à la prise de conscience que seul on ne peut pas gagner et que la solidarité ne peut pas rester passive. Un nouveau dynamisme dans ce sens viendra inévitablement de prochains combats.Internationalisme / 2.3.07
Situations territoriales:
La crise immobilière, un symptôme de la crise du capitalisme
- 4113 lectures
A en croire la bourgeoisie, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les bourses battaient des records, la croissance était soutenue, les prix sous contrôle. Et puis, début juillet… patatras, une véritable tempête boursière s’est levée révélant l’aspect mensonger de tous ces beaux discours ! En quelques semaines, dans le sillage du Dow Jones, l’indice new-yorkais qui s’est replié de plus de 10 %, les principales bourses du monde ont toutes connu une chute brutale.
Pour endiguer momentanément cette crise, la FED et la BCE 1 ont déversé plus de 330 milliards de dollars sur les marchés ! Ces sommes colossales injectées par les différentes banques centrales témoignent, à elles seules, de l’amplitude du séisme et des craintes réelles de toutes les bourgeoisies.
Aujourd’hui, les “experts” et autres bonimenteurs essayent une nouvelle fois de nous bercer d’illusions par de jolis “comptes” à dormir debout : cette convulsion estivale ne serait que passagère ou, mieux encore, une “correction salutaire” des excès spéculatifs de ces dernières années ! Mais en réalité, ces secousses sont le signe d’une nouvelle phase d’accélération de la crise, la plus grave et la plus profonde depuis la fin des années 1960. Et c’est une nouvelle fois la classe ouvrière qui va en subir les terribles conséquences.
Le monstre de l’endettement révèle la faillite historique du capitalisme
Dans les colonnes de la presse ou sur les plateaux télé de cet été, quand des millions de dollars partaient chaque jours en fumée, les économistes bourgeois n’avaient qu’un mot à la bouche : “Imprévisible”. La crise aurait éclaté sans coup de semonce, tel un éclair dans un ciel d’azur. Mensonges ! Les records boursiers, la flambée de l’immobilier, et même la croissance, tout ceci était bâti sur du sable et tout le monde le savait. Notre organisation, le Courant communiste international, affirmait déjà au printemps dernier que la prétendue bonne santé de l’économie mondiale, ne reposant que sur l’endettement, préparait un avenir sombre : “En réalité, il s’agit là d’une véritable fuite en avant, qui loin de permettre une solution définitive aux contradictions du capitalisme ne fait que lui préparer des lendemains plus douloureux et notamment des ralentissements brutaux de sa croissance” 2. Il ne s’agissait pas là d’une prémonition mais d’une analyse fondée sur l’histoire du capitalisme. La crise financière actuelle est une crise majeure de l’endettement et du crédit. Or cet endettement monstrueux ne tombe pas du ciel. Il est le produit de quarante années de développement lent et heurté de la crise mondiale.
En effet, depuis la fin des années 1960, le capitalisme se survit à lui-même par un recours, toujours croissant, à l’endettement. En 1967, l’économie mondiale a commencé à ralentir. Et depuis, décennie après décennie, la croissance est de moins en moins importante. La seule réponse de la bourgeoisie a été de maintenir son système sous perfusion, en injectant des sommes d’argent de plus en plus folles sous la forme du crédit et de la dette. L’histoire économique de ces quarante dernières années forme une sorte de spirale infernale : crise… endettement… plus de crise… plus d’endettement... Après les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, il y a eu la récession ouverte de 1991-1993, la crise asiatique de 1997-98 et l’éclatement de la bulle Internet de 2000-2002. Chaque fois, ces convulsions sont plus violentes, les conséquences plus dramatiques.
Aujourd’hui, la crise éclate de nouveau alors que l’endettement a atteint des sommets inimaginables. La dette totale des Etats-Unis, première puissance militaire et économique du monde, est passée de 630 milliards de dollars en 1970 à 36 850 milliards en 2003. Et depuis lors, la machine s’est totalement emballée. Cette dette croît tout simplement de 1,64 milliards de dollars par jour ! Ces chiffres vertigineux mettent en lumière de manière éclatante le fait que la crise financière actuelle est autrement plus profonde que toutes celles qui l’ont précédée.
La crise immobilière a déclenché une crise financière majeure
Depuis une décennie, la folie spéculative a envahi tous les secteurs d’activité. Comme jamais auparavant, l’écrasante majorité des capitaux ne trouvent plus à se placer avec suffisamment de profit dans l’économie réelle (les entreprises qui produisent des biens et des marchandises). Tout naturellement, ils se sont donc orientés vers la spéculation pure et simple. Banques, établissements de prêts, sociétés de spéculation plus ou moins spécialisées dans les placements à risques (les fameux hedge funds 3), partout on a assisté à une véritable ruée vers ce supposé nouvel Eldorado. L’argent, les crédits se sont alors mis à couler à flots. La bourgeoisie semblait n’avoir plus qu’une seule obsession, s’endetter et s’endetter encore.
C’est dans ce contexte totalement fou que les ménages aux Etats-Unis mais aussi, dans une moindre mesure, en Grande-Bretagne et en Espagne, ont été fortement encouragés à acheter appartements et maisons, sans en avoir réellement les moyens. Les organismes financiers se sont mis à prêter de l’argent à des familles ouvrières aux revenus extrêmement modestes sur la seule garantie de leur bien immobilier. Le principe de base de ces prêts hypothécaires (appelés subprimes) est le suivant : lorsque Mr X. veut acheter une maison à 100 000 $, un organisme de crédit, une banque par exemple, lui prête les fonds sans réserve et sans garantie autre que l’hypothèque de cette maison. Si Mr X. est surendetté et qu’il ne parvient plus à rembourser son prêt, l’organisme de crédit reprend la maison, la revend et récupère ses fonds soit 100 000 $. C’est là la seule garantie de la banque. C’est pourquoi ce sont principalement les hedge-funds (spécialisés dans les placements à risques) qui ont participé à ces subprimes. Les ouvriers, pouvant emprunter plus facilement furent donc plus nombreux à vouloir acquérir une maison bien à eux. Les prix immobiliers ont, par conséquent, commencé à monter (de 10 % l’an en moyenne). Ces ouvriers aux salaires extrêmement bas, n’ont finalement que l’endettement comme ressource pour acheter ; ils continuèrent donc à s’endetter au-delà de toute raison en hypothéquant leur maison qui venait de prendre de la valeur. Par exemple, notre Mr X., voyant la valeur de sa maison augmenter jusqu’à 120 000 $, peut de nouveau faire un crédit à la consommation par hypothèque à la hauteur de 20 000 $. Puis la valeur grimpe à 150 000 $. Mr X. peut encore hypothéquer les nouveaux 30 000 $ ! Et ainsi de suite. Mais ce cercle n’est pas sans fin. D’un côté, la classe ouvrière se paupérise (licenciements, gel des salaires…). De l’autre, les prêts aux Etats-Unis étant à taux variables croissants, les échéances sont, mois après mois, d’un montant de plus en plus élevé. Le résultat est aussi inexorable que fatidique. Lorsque trop d’ouvriers ne parviennent plus à rembourser leurs mensualités astronomiques, que les banques multiplient les réquisitions des biens hypothéqués, la crise éclate, et la bulle immobilière s’effondre, comme actuellement. En effet, trop de maisons se retrouvent en vente, les prix du logement chutent (ils pourraient tomber de 15 à 30 %). Effet pervers, le pouvoir d’achat de millions de familles ouvrières reposant justement sur le prix de leur maison et donc de leur capacité à s’endetter, cette chute de l’immobilier signifie pour eux la banqueroute. Ainsi, comme la valeur de la maison de Mr X. a chuté (110 000 $), les banques ne récupèrent plus leurs fonds. Non seulement Mr X. n’a plus de maison, non seulement il a remboursé des intérêts pendant plusieurs années, mais il doit encore la différence aux sociétés prêteuses, soit 40 000 $… plus les intérêts bien sûr ! Le résultat de tout cela ne s’est pas fait attendre : plus de trois millions de foyers devraient se retrouver à la rue cet automne.
Dans le même temps, les hedge-funds, en plus de prêter sous forme de subprimes, n’ont pas hésité eux aussi à se surendetter auprès des banques et autres organismes de crédit pour spéculer sur les biens immobiliers. Le principe, tout simple, est d’acheter un bien puis de le revendre quelques temps plus tard en misant sur la hausse du marché immobilier. Ainsi, l’éclatement de la bulle immobilière signifie aussi la faillite de tous ces fonds. En effet, même en récupérant les biens hypothéqués et en jetant des millions de personnes sur le trottoir, ces organismes héritent de maisons ne valant plus rien. Par effet domino, les banques et autres organismes de crédits sont tout autant touchés. Imaginez ! Ces institutions s’empruntaient les unes aux autres au point de ne plus savoir qui doit de l’argent et à qui ! Chaque jour qui passe nous apprend qu’une banque ou encore un établissement de crédit est au bord de la faillite. Tel est déjà le cas, par exemple de la banque Countrywide aux Etats-Unis ou encore de la Sachen LB et d’IKB en Allemagne. Leurs dettes correspondant à l’investissement dans les secteurs à risques représentent plus de 10 200 milliards de dollars ! C’est maintenant tout le secteur spéculatif et du crédit qui entre en crise ouverte.
La classe ouvrière ici encore paye les pots cassés : on a assisté au cours du mois d’août à une véritable ruée des petits épargnants vers les banques aux Etats-Unis et en Allemagne. Il en sera certainement de même demain en Grande-Bretagne, en Espagne, au Japon ou en Chine.
Derrière la crise financière, la crise de l’économie “réelle”
Une telle crise financière devient toujours une crise de l’économie réelle. La seule question que l’on puisse se poser aujourd’hui est celle de son ampleur. Avant même la crise financière de cet été, les spécialistes de la bourgeoisie commençaient déjà en catimini à revoir à la baisse les prévisions de la croissance mondiale. En janvier 2007, les Nations Unies annonçaient que celle-ci reculerait à 3,2 % cette année (après avoir affichée 3,8 % en 2006 et 4,5 % en 2005). Mais avec l’éclatement de la crise boursière, tous ces chiffres vont être une nouvelle fois revus à la baisse.
En effet, la profonde crise du crédit signifie inexorablement une baisse brutale d’activité pour toutes les entreprises. Plus personne ne veut ou ne peut prêter de l’argent aux entreprises pour investir. Or, les bénéfices records que celles-ci affichent parfois sont en réalité basés en très grande partie sur un endettement massif. Le robinet du crédit coupé, ces entreprises vont donc être, pour la plupart, en très mauvaise posture. L’exemple le plus frappant est sans nul doute le secteur du bâtiment. La bulle immobilière étant basée uniquement sur les prêts à risques, le nombre de constructions va plonger ; cette activité va se réduire fortement aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne et dans bien d’autres pays développés, c’est ainsi toute la croissance qui va en être affectée. Et les répercussions vont encore bien au-delà : “comme aux États-Unis, un prêt immobilier finance au moins 80 % de la consommation, c’est toute la demande des ménages qui est touchée. La consommation américaine va donc fléchir et amputer d’un point à un point et demi, la croissance de l’an prochain qui au lieu d’atteindre 3,5 %, pourrait ne pas dépasser les 2 %” (Patrick Artuis La Tribune de l’Economie du 27/08/07). Et encore sommes-nous là dans le scénario le plus optimiste. Certains spécialistes s’accordent à dire que la croissance américaine devrait en fait se situer sous la barre des 1 % ! Cette récession américaine a, à l’évidence, une importance mondiale. L’Europe a une économie profondément liée à l’activité d’Outre-Atlantique. De plus, le ralentissement maintenant attendu de ces deux économies va avoir nécessairement de fortes répercutions en Chine, comme dans l’ensemble de l’Asie. L’Europe et les États-Unis représentent 40 % des exportations chinoises ! C’est donc toute la croissance mondiale qui va ralentir brutalement.
Mais il manque encore un facteur aggravant pour bien comprendre ce qui est en train de se passer : le retour de l’inflation. En Chine, ce pays prétendument béni des dieux capitalistes avec ses taux de croissance à deux chiffres, a un taux d’inflation s’établissant aujourd’hui à 5,6 % l’an (le plus haut niveau depuis dix ans) et il continue de grimper de mois en mois. Ce pays ne fait là encore que symboliser une tendance qui se développe maintenant internationalement. C’est dans le secteur des matières premières et de l’alimentation, que partout dans le monde, ce phénomène se développe. Les prix de l’alimentation de base devraient grimper de près de 10%. Effet boule de neige : la consommation de la classe ouvrière et de la grande majorité de la population va subir un coup d’arrêt, ce qui va aggraver en retour encore plus la situation des entreprises.
Depuis la fin des années 1960, bien des chutes boursières et des récessions se sont succédées. Chaque fois celles-ci sont plus brutales et profondes. Ce nouvel épisode ne dérogera pas à la règle, il représente un pas qualitatif supplémentaire, une aggravation sans précédent de la crise historique du capitalisme. C’est la première fois que tous les indicateurs économiques passent ainsi au rouge simultanément : crise du crédit et de la consommation, endettement pharaonique, récession et inflation ! Nous voilà face à la pire récession depuis plus de quarante ans. Les coups vont donc tomber sur le dos de la classe ouvrière ; seule la lutte unie et solidaire nous permettra d’y faire face !
Tino (30 août)
1) FED = Banque centrale américaine ; BCE = Banque centrale européenne.
2) Résolution sur la situation internationale adoptée à notre dernier congrès et publiée dans notre Revue internationale n° 130.
3) Les hedges funds gèrent environ 1300 milliards de dollars officiellement.
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
ICConline - 2008
- 4743 lectures
1968 au Japon : le mouvement étudiant et les luttes ouvrières
- 7675 lectures
Introduction du CCI
Comme nous l'avons déjà relevé dans plusieurs articles de la Revue Internationale et dans notre presse territoriale, les événements de mai 1968 en France n'étaient qu'une partie d'un mouvement plus vaste dans le monde.
Nous publions ici un article d'un camarade au Japon qui démontre clairement que ce mouvement plus vaste a aussi compris un épisode dans ce pays malgré les difficultés et les particularités historiques du Japon.
La future révolution prolétarienne sera internationaliste et internationale ou ne sera pas. C'est une des grandes responsabilités des internationalistes du monde entier d'inscrire résolument aujourd'hui leur expérience locale dans le cadre des événements mondiaux, de comprendre le mouvement de la classe ouvrière dans n'importe quel lieu comme n'étant qu'une partie, une expression d'un ensemble plus vaste et de contribuer à un débat international au sein de la classe ouvrière sur les leçons des événements passés, pour l'avenir de la lutte contre un capitalisme moribond. Nous saluons donc l'effort du camarade Ken pour replacer les événements de 1968 au Japon dans un contexte historique et global. Nous soutenons de tout cœur sa conclusion : « Nous serions satisfaits si ce bref résumé de la réflexion sur le « 68 » japonais pouvait contribuer de quelque façon à la coordination internationale de la classe ouvrière dans son ensemble (ce qui était la chose la plus importante et qui est la chose la plus importante maintenant. »
Il y a plusieurs points dans l'article qui sont ambigus pour nous soit à cause des difficultés de traduction soit du fait de notre ignorance de l'histoire du Japon. Nous n'allons en souligner que quelques-uns ici, parce que nous pensons que ce sont des éléments importants pour le débat au sein des internationalistes japonais et plus généralement :
-
Il est clair que les luttes ouvrières ont revêtu plusieurs formes pendant cette période : tentatives d'auto-organisation, et même d'autogestion, beaucoup d'entre elles ayant eu leurs semblables en Europe par exemple. Il était inévitable à cette époque que les ouvriers aient été influencés par les idées des partis « socialistes » et « communistes » (c'est-à-dire staliniens) et des idées trade-unionistes ; il semble que cela ait donné une certaine importance au syndicat SOHYO. Cependant, ce qui n'est pas clair pour nous, c'est à quel niveau SOHYO était une expression d'un réel mouvement ouvrier sous la forme de grève sauvage par exemple, qui aurait été dévoyé vers une tentative impossible de créer un nouveau syndicat ou si c'était une tentative des fractions de gauche de la classe dominante de créer une structure plus « radicale » qui pouvait canaliser le mécontentement et la lutte des ouvriers. Quelles sont les leçons à tirer de l'expérience de SOHYO en termes d'organisation des luttes ouvrières aujourd'hui ? Quelle comparaison pouvons-nous faire avec d'autres luttes ouvrières dans le monde, en particulier avec la grève massive en Pologne en 1980 ?
-
Il nous apparaît clairement, d'après les discussions avec les camarades au Japon, que la dégénérescence des luttes politiques internes entre les principaux groupes gauchistes et les sectes (qui apparemment ont fait au moins 100 morts et plus de 1000 blessés graves au cours des années) a profondément traumatisé le milieu politique en général. Quelles leçons doivent en être tirées ? Pourquoi la « Nouvelle Gauche » a-t-elle été « condamnée à la stagnation » comme le dit le camarade ? Il nous semble que la nouvelle génération au Japon en 1968 a souffert de deux handicaps : d'un côté, une tendance au nationalisme anti-américain, résultat de la situation du Japon, pays occupé militairement, et d'un autre côté, le manque de toute tradition communiste de gauche qui aurait pu servir de point de référence : les travaux de Luxembourg, Pannekoek, Görter, sont pratiquement inconnus et la tradition de la Gauche communiste représentée par la Gauche italienne n'a eu aucun écho.
-
Dans une partie du texte, le camarade parle de « la guerre révolutionnaire indochinoise-vietnamienne » et de la « solidarité révolutionnaire avec les peuples du Vietnam et d'Asie ». Pour nous, la guerre au Vietnam était une confrontation impérialiste entre les États-Unis et le Viêt-Cong qui était soutenu soit par la Chine soit par la Russie. Il n'y a eu que très peu de jeunes gens qui s'opposaient à la guerre au Vietnam et argumentaient leur rejet de la guerre avec une réelle position internationaliste contre la participation à toute guerre impérialiste et un appel à la lutte de classe contre les deux camps dans un conflit impérialiste. C'est une vraie tragédie de l'histoire, qu'à travers le monde, une grande partie de la jeune génération ait été entraînée sur le terrain du soutien aux luttes de libération nationale, en pensant que cela renforcerait la lutte contre « l'impérialisme ». Maintenant, 40 ans après, il est vital d'en arriver à une vision plus profonde de la nature de ces guerres à l'époque. Quel bilan pouvons-nous tirer de ces prétendues luttes de libération nationale ?
Nous avons voulu que cette introduction soit aussi brève que possible de façon à limiter les problèmes de traduction. Il y a clairement d'autres questions soulevées dans cet article qu'il serait nécessaire de discuter ; cependant, nous pensons que les trois mentionnées ci-dessus sont probablement les plus importantes. Nous espérons que la publication de cet article, avec nos commentaires, en anglais, français et japonais, encouragera le débat international qui contribuera à une meilleure compréhension du « Mai 68 japonais » et à un renforcement du milieu internationaliste au Japon même. En ce sens, « le monde devient plus grand, mais aussi plus petit » !
Le soubassement historique
Ce sont les organisations auto-gouvernées d'étudiants qui s'étaient répandues dans les universités de tout le pays, qui ont servi de base massive au mouvement dissident, qui a eu une signification extraordinaire dans l'histoire d'après-guerre pendant la lutte contre le traité de l'AMPO (Coopération mutuelle et Sécurité) entre les États-Unis et le Japon, et qui a cependant semblé stagner dans la période qui a suivi immédiatement. En 1965, après une lutte similaire contre le traité pour la normalisation des relations entre le Japon et la République de Corée (ROK), surgit rapidement la période politique du mouvement anti-guerre, caractérisée par les luttes du Zengakuren et du Zenkyoto dans les luttes anti-AMPO et à propos des luttes des années 1970 contre la présence de bases militaires américaines à Okinawa.
Au sein du mouvement ouvrier, le SOHYO (Conseil Général des Syndicats du Japon) prit de l'importance lorsqu'il mena la grève des mines de charbon Mitsui Miike en 1950-60, le plus grand mouvement de travailleurs dans la période après guerre, ainsi qu'avec sa participation à la lutte contre l'AMPO en 1960, avec des revendications pour la paix, contre la guerre, et toutes sortes de revendications démocratiques.
A côté des partis parlementaires existants, c'est-à-dire le Parti Communiste Japonais (JCP) et le Parti Socialiste Japonais (JSP), les organisations étudiantes/ouvrières sous leur influence, et les syndicats sous celle de SOHYO, il y avait différentes sectes et organisations telles que la Ligue Communiste Japonaise (BUND, la principale section du Zengakuren pendant la lutte contre l'AMPO en 1960) et la Ligue Communiste Révolutionnaire Japonaise « sous l'influence de la Fédération Trotskiste Japonaise » qui organisaient et participaient aux luttes.
Ces groupes étaient des organisations qui se retrouvaient sur une critique de l'URSS et du stalinisme au moment de la répression du soulèvement en Hongrie en 1956 et des critiques à la ligne du Parti Communiste Japonais.
Les luttes dans l'université nationale, Zenkyoto
Alors que l'opposition à la guerre du Vietnam grandit à l'échelle mondiale, la lutte dans les universités s'accélère au Japon.
Des luttes sont menées contre l'augmentation des droits aux universités de Keio en 1964, de Waseda en 1965 et Chuo en 1966.
En 1968, le département de médecine de l'université de Tokyo entre en grève illimitée contre la « loi d'enregistrement des docteurs » (qui aurait augmenté la période d'internat des diplômés de deux ans et introduisait une stricte hiérarchie dans les postes). Un Comité de Lutte de l'ensemble des Étudiants (Zenkyoto) est constitué, une grève illimitée est déclarée et des barricades sont élevées par dix départements académiques. L'année suivante, en 1969, 8500 policiers anti-émeutes attaquent les étudiants en grève et les barricades dans la salle de lecture Yasuda, entre autres, sont évacuées par la force. Plus de 600 personnes sont arrêtées dans l'université de Tokyo. Les examens d'entrée à l'université de Tokyo la même année sont annulés en conséquence.
A la plus grande université privée du Japon à cette époque, l'université Nippon (Nichidai), une grève est déclenchée par une évasion fiscale en lien avec des politiques injustes d'entrée pour les étudiants, tout autant que par la découverte d'environ deux milliards de yens (100 millions de dollars environ) de droits d'inscription non enregistrés. Plus de 35 000 personnes et étudiants assistent à une session massive de négociation à laquelle le directeur de l'université est obligé d'assister.
Ces deux luttes aux universités Todai et Nichidai allaient être les symboles du mouvement étudiant et du Zenkyoto ; le mouvement se répand dans plus de 300 universités et grandes écoles dans le pays. Les blocages, avec des barricades, et les grèves étudiantes continuent jusqu'au début des années 1970, en liaison avec le mouvement anti-guerre, le mouvement anti-AMPO et les luttes concernant Okinawa qui culminent pendant cette période. Ces mouvements occupent les rues.
La différence définitive entre le Zengakuren et le Zenkyoto pendant les luttes anti-AMPO des années 1960 porte sur la question d'organisation.
Le Zengakuren est organisé comme son nom abrégé le reflète : « Fédération de l'ensemble du Japon des associations étudiantes auto-organisées », en organisation verticale qui commence au niveau de l'université, pour concerner ensuite le département, les classes, et les individus (l'adhésion est automatique pour tous les étudiants). En ce sens, le Zengakuren avait été créé selon les « associations auto-dirigées de Postdam », c'est-à-dire la démocratisation du haut vers le bas introduite par les forces américaines d'occupation.
Le Zenkyoto est quant à lui bâti sur une participation extrêmement large et libre, exactement l'opposé des associations auto-dirigées, le Zengakuren ou les partis sectaires, et s'efforce d'être un mouvement de masse basé sur la démocratie directe. Dès le début, le Zenkyoto était une organisation pluraliste, à caractère profondément parlementaire, centré sur les luttes particulières. La majorité de ses membres étaient considérés comme des « radicaux non sectaires », c'est-à-dire ceux qui ne sont affiliés à aucune secte politique particulière.
Le mouvement contre la guerre au Vietnam
Faisant fructifier les luttes des années 1960 anti-AMPO, anti-guerre, et anti-bases militaires américaines, aussi bien que celles contre le traité de normalisation ROK, un mouvement contre la guerre du Vietnam commence à se développer aussi au Japon.
En 1965, une organisation appelée Beheiren (ce qui veut dire « Union des citoyens pour la paix au Vietnam ») se constituait. Il n'y avait ni plate-forme ni adhésion d'aucune sorte, le mouvement dépendait des initiatives indépendantes de ses membres. Beheiren s'étendit à l'échelle nationale, arrivant à constituer jusqu'à 300 groupes.
Le gros du mouvement était constitué du mouvement étudiant dans son ensemble, du Zengakuren, du Parti Socialiste, des syndicats tels que SOHYO et des organisations de la jeunesse contre la guerre. Toutes sortes de luttes contre la guerre étaient menées.
Octobre 1967 voit la première phase de la lutte à l'aéroport de Haneda et une lutte pour empêcher le premier ministre d'alors, Eisaku Sato, de visiter le Sud-Vietnam. Un étudiant de l'université de Kyoto meurt dans une manifestation.
Le même mois : journée internationale contre la guerre. Des manifestations et des meetings se tiennent dans tout le pays, regroupant 1, 4 million de personnes.
Novembre : deuxième phase de la lutte à l'aéroport de Haneda (lutte pour empêcher le premier ministre de visiter les États-Unis). De violents combats entre le Zengakuren et les brigades anti-émeutes durent 10 heures. Plus de 300 arrestations ont lieu dans tout le pays en un seul jour.
Janvier 1968 : lutte pour empêcher le sous-marin nucléaire américain Enterprise d'accoster au port de Sasebo.
Février : meetings massifs pour empêcher la construction d'un nouvel aéroport à Sanrizuka (connu maintenant comme l'aéroport international de Narita). Les fermiers à proximité du site de l'aéroport et les étudiants se battent ensemble pour la première fois. 3000 personnes affrontent la police anti-émeutes.
De février à mars, lutte contre l'ouverture de l'hôpital de guerre d'Ojino. Les luttes violentes débordent dans la ville de Tokyo.
Avril : journée de lutte à propos d'Okinawa. 250 000 personnes participent à l'échelle nationale. Une « loi pour la prévention de l'activisme destructif » est votée contre la Ligue Communiste Révolutionnaire (Chukaku-ha) et la Ligue Communiste.
(Mai : grève générale à Paris et dans toute la France)
Octobre : action internationale unifiée contre la guerre. 4,5 millions de personnes participent à l'échelle nationale, avec les slogans « contre la guerre au Vietnam, pour le retour d'Okinawa, stop à l'accord AMPO ». La Ligue Communiste et la Ligue des Étudiants Socialistes attaquent le Département de la défense ; le Parti socialiste, la Fraction Socialiste de la Libération de la Jeunesse attaquent le parlement et l'ambassade américaine dans laquelle ils se précipitent. La Ligue des étudiants socialistes Chukaku-ha (IVe Internationale) et d'autres gens occupent la station de Shinjuku qui est le point d'approvisionnement crucial pour les tankers américains. Des dizaines de milliers de personnes tiennent un meeting de masse autour de la station. Les deux syndicats nationaux de cheminots partent en grève illimitée. Le gouvernement japonais inculpe les participants pour incitation à l'émeute.
Avril 1969 : journée de lutte sur Okinawa.
Septembre : un meeting de masse constitue un rassemblement national Zenkyoto. 26 000 étudiants dans 178 organisations de 46 universités du Japon se rencontrent à Tokyo.
Octobre : journée internationale contre la guerre. 860 000 personnes marchent avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste et SOHYO. Dans des conditions très dures de répression, les différents partis de la Nouvelle Gauche s'engagent dans la lutte armée autour de Tokyo. Les départements de la police et les locaux de la police sont attaqués. La tactique connaît une escalade avec l'emploi de cocktails Molotov et d'explosifs. 1500 personnes environ sont arrêtées.
Le même mois, les cheminots, suivis par 4 millions de travailleurs de l'industrie dans 67 syndicats, planifient une grève de 24 heures en novembre.
Ces luttes se prolongent dans celles dirigées contre l'AMPO et la base d'Okinawa dans les années 1970.
Le mouvement ouvrier et les autres luttes
Au milieu de l'expansion économique des années 1960, le mouvement ouvrier japonais se trouvait dans une période de croissance continue, centrée sur le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le syndicat SOHYO, et traitait tout un tas de problèmes politiques tels que la place de l'Union Soviétique et du « Bloc socialiste », le progrès de la lutte anti-impérialiste (anti-américaine) et à l'échelle nationale, des luttes contre l'AMPO, Okinawa et la guerre. Les conflits sociaux et les grèves ont culminé après 1968 (en termes de conflits et de participants), avec un pic en 1974. Dans cette période, ont lieu l'offensive sociale nationale du printemps de 1974 (2 270 000 travailleurs dans 71 syndicats, qui ont gagné une augmentation de salaire de 32,9 %), la grève de 1975 pour le droit de grève (menée principalement par le KORYOKO - Fédération des Syndicats des Entreprises gouvernementales et des corporations publiques- et les syndicats nationaux de cheminots), décrite comme la deuxième plus grande grève d'après-guerre, ainsi que d'autres grèves.
Les sectes de la Nouvelle Gauche mettaient en avant des objectifs tels que « créer un mouvement ouvrier sur une base de classe » et intervenaient dans les avant-gardes ouvrières existantes, créant des factions de gauche en leur sein. Ces sectes avaient aussi pour but une direction indépendante incluant l'organisation des ouvriers déshérités inorganisés et celle de ceux qui travaillaient dans des corporations plus petites, en créant des syndicats régionaux et en faisant des tentatives de production autonome et d'auto organisation.
En 1965, le Comité de Coordination anti-guerre affilié au Parti socialiste (mis en place pour s'opposer à la guerre au Vietnam et mettre fin au traité de normalisation des relations Japon-Corée) arriva à s'étendre à une grande échelle avec les slogans « autonomie, originalité et unité », sans impliquer les syndicats de travailleurs ou les organisations verticales ; cependant cette expansion fut déchirée par les luttes hégémoniques des sectes, de la même façon que le sera le mouvement Zenkyoto quelques temps après.
Alors que les luttes anti-AMPO, anti-guerre/anti-bases, la lutte d'Okinawa et de Sanrizuka continuaient sans interruption, les sectes de la Nouvelle Gauche commencèrent à consacrer leur énergie à des luttes plus parcellaires, comme les luttes pour l'immigration (et aussi pour une loi qui reconnaisse les réfugiés), en solidarité avec les Coréens et les Chinois vivant au Japon, en solidarité avec les peuples des pays de l'ASEAN, comme également le mouvement de libération des femmes, le mouvement de libération Buraku et celui des handicapés.
Il y avait en même temps des luttes régionales, des luttes contre la pollution comme le combat contre la maladie de Minamata (du mercure provenant d'une usine locale avait empoisonné des milliers de personnes), le mouvement anti-nucléaire, des mouvements pour la défense de l'environnement, des luttes de journaliers (à Sanya, Kamagasaki, etc.) et la lutte en cours contre le système impérial.
Les fruits de « 68 »
Aujourd'hui, la structure d'après guerre, le soi-disant « système de 1955 », s'est « écroulé ». Nous sommes passés d'une dictature de parti unique, le Parti Démocrate Libéral (LDP) à un système bipartite qui comprend aussi le Parti Démocratique du Japon (DPJ). Le Parti socialiste, qui agissait en tant que pied gauche de la domination politique de la bourgeoisie est démantelé, les sièges du Parti Communiste Japonais au parlement sont nettement moins nombreux et l'influence des organisations de gauche existantes s'est notablement affaiblie.
Le système américano-nippon est très puissant et les bases ou les institutions américaines sont présentes dans 135 endroits de la nation (20 % de la principale île d'Okinawa sont occupés par l'armée américaine). Les envois de troupes en Irak et les « menaces » de la République Démocratique Populaire de Corée ont servi de prétexte à une réforme accélérée de la constitution de la paix centrée sur « l'article 9 ».
En ce qui concerne l'avant-garde ouvrière, SOHYO a été démantelé et aggloméré avec RENGO (la Confédération syndicale japonaise). Les sectes de la Nouvelle Gauche qui avaient œuvré pour la création de « partis révolutionnaires ouvriers pour remplacer les partis socialistes/communistes » et « un mouvement ouvrier sur une base de classe » ont été contraintes à la stagnation.
En prenant cela en compte, il est important de déchiffrer la signification de 1968, qui a été un point de jonction dans l'histoire du monde. Pour nous, la classe ouvrière japonaise, il est particulièrement important de tirer un bilan du « 68 » japonais du point de vue du mouvement communiste international.
-
Les réalisations et les limites du Parti Communiste Japonais (JCP) qui, pendant les deux périodes, quand la branche japonaise du COMINTERN était active et dans la période d'après-guerre pendant laquelle il a été légalisé, avait en vue « l'indépendance souveraine en défense du socialisme scientifique » et a pris le chemin du parlementarisme.
-
La critique du stalinisme et du JPC et ses résultats, la Nouvelle Gauche, la naissance et la stagnation du trotskisme japonais.
Avec ces questions au premier plan, à quel degré le « 68 » japonais, qui a vu surtout se battre les étudiants et les jeunes ouvriers, se connecte-t-il avec les « 68 » américains et français, le « printemps de Prague », « l'automne chaud italien », la grève de masse en Pologne qui s'est déroulée pendant l'hiver 1970-71 et qui a donné naissance à au syndicat Solidarité 1, la guerre révolutionnaire indochinoise-vietnamienne ?
Ce sont des questions que nous devons continuer à examiner.
Le « 68 » japonais a été une lutte qui mit en question la réelle signification de la « démocratie d'après-guerre », qui incluait des luttes faites par les étudiants et les ouvriers eux-mêmes, qui refusaient le futur proposé par la gauche existante, les staliniens et les socialistes. C'était une nouvelle lutte dans laquelle la classe ouvrière japonaise essayait de donner forme au futur en exerçant son hégémonie. Ce « 68 » a été une collection de luttes à la recherche de l'internationalisme prolétarien, en particulier de la solidarité avec les peuples du Vietnam et d'Asie, qui tentaient de réaliser un vrai monde de paix dans lequel les préjugés, la répression et l'exclusion sous toute ses formes seraient éradiqués.
En définitive, dans sa période ascendante il a été incapable de sortir du cadre de la démocratisation rapide et des parties du mouvement se sont orientées vers du simple terrorisme. Incapables de gagner le soutien de plus de 50 millions de travailleurs, les buts des luttes n'ont en grande partie pas été réalisés et restent encore à atteindre aujourd'hui.
Cependant, nous sommes conscients de changements dans le système japonais politique, économique et social après « 68 ».
L'abolition de l'enregistrement des étrangers et de la loi sur les empreintes digitales (obligation pour tous les étrangers sur le sol japonais) ; la promulgation de « la loi sur l'égalité des chances entre les sexes » ; un soutien lent mais croissant à l'élimination des barrages pour les handicapés et à la normalisation (ce pays n'a fait une loi contre la discrimination vis-à-vis des handicapés en matière de droits qu'en 2004 avec la « loi des handicapés ». Cette loi établit que « personne ne peut avoir une conduite qui lèse les droits et le bien-être d'une personne handicapée parce que cette personne est handicapée »). contrairement à la période pendant laquelle la lutte contre la maladie de Minamata avait été menée, aujourd'hui, les officiels et les compagnies font de la surenchère pour promouvoir les thèmes de l'écologie, des économies d'énergie et des dépollutions. Les mouvements pour les droits de l'homme, la préservation de l'environnement et les luttes pour les régions se sont transformés en ONG et organisations à but non lucratifs qui s'organisent à ces fins. Et ainsi de suite !
Des choses qui paraissaient irréalisables à l'époque se sont réalisées à un certain niveau (sans prendre en compte dans quel but cela a été fait). Évidemment, la plupart de ces acquis avaient été des revendications « démocratiques » et ne représentaient rien d'autre que des compromis et l'harmonie avec l'ennemi de classe. Savoir que la collaboration de classe prévaut dans la situation du capitalisme japonais à présent peut nous aider à nous mettre en mouvement pour des victoires réelles sans baisser la garde.
Cependant, « 68 » en tant que mouvement social a encore un poids même aujourd'hui. Les semences de « 68 » qui sont allées au-delà du cadre de la culture du contre-pouvoir et de la résistance à étendre à toute la société contribueront certainement à la germination de changements dans le futur.
Trente après la croisée des chemins de 68, nous serions satisfaits si ce bref résumé de la réflexion sur le « 68 » japonais pouvait contribuer de quelque façon à la coordination internationale de la classe ouvrière dans son ensemble (ce qui était la chose la plus importante et qui est la chose la plus importante maintenant).
A tous nos camarades qui luttent en Europe.
Le monde devient plus grand, mais aussi plus petit. Nous espérons avoir de réelles occasions de nous organiser à vos côtés.
Ken (23 mars 2008)
1 Le camarade fait ici une confusion avec la grève de masse en Pologne de 1980/81 (NDLR).
Géographique:
- Japon [131]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [132]
1968 en Allemagne : au delà du mouvement de protestation, la quête d'une société nouvelle (1ère partie)
- 11298 lectures
Comme nous l'avons montré dans d'autres articles de notre presse, vers le milieu des années 1960, un mouvement international s'est développé contre la guerre au Vietnam et contre les premiers signes d'une aggravation de la situation économique. Dans de nombreux pays, ce mouvement portait le germe d'une remise en question de l'ordre existant. Le mouvement en Allemagne a commencé assez tôt, et il devait avoir un impact international majeur.
L'opposition hors du parlement bourgeois
Alors que de plus en plus de manifestations s'organisaient à partir du milieu des années 1960, principalement contre la guerre au Vietnam, ces manifestations prirent une autre dimension quand le 1er décembre 1966 une large coalition gouvernementale formée par le CDU/CSU et le SPD se mit en place à Bonn et qu'à peine une semaine plus tard, le 10 décembre, Rudi Dutschke appela à la formation d'une "opposition extra parlementaire" (APO). Le ralliement et l'entrée du plus grand parti "de gauche" au gouvernement entraîna une grande déception et les gens se détournèrent du SPD. Alors même que le SPD s'activait à faire campagne pour la participation aux élections, des manifestations se multipliaient dans les rues. Au début de ce mouvement, il existait un nombre considérable d'illusions sur la démocratie bourgeoise en général et sur la social-démocratie en particulier. L'idée était que, puisque le SPD avait rejoint le gouvernement, il n'existait plus de force d'opposition majeure au parlement et donc que c'était de la rue qu'il fallait organiser cette opposition. Puisque le rôle de plus en plus évident de la social-démocratie était de constituer une force de soutien au système au sein de la Grande Coalition, "l'opposition extra parlementaire" était davantage dirigée contre la récupération par le biais de la démocratie bourgeoise, contre la participation aux élections parlementaires et en faveur de l'action directe. Cette orientation fut un élément essentiel du lent processus qui mit fin à la paix sociale.
La résistance d'une nouvelle génération
La classe dirigeante se vit dans l'obligation de faire entrer le SPD au gouvernement, en réaction à la réapparition de la crise économique après le boom qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Après le long miracle économique, la croissance s'est brusquement effondrée en 1965. Même si cet effondrement a démarré alors que la croissance était à un taux très élevé, et que les taux de l'époque passeraient maintenant pour des utopies, quelque chose de capital sur le plan historique s'est produit alors. Le miracle économique de l'après-guerre était révolu. Il y eut une première vague de suppressions d'emplois et on supprima toutes les primes et les avantages pour ne garder que les salaires de base tels qu'ils avaient été négociés. Même si toutes ces mesures apparaissent extrêmement "douces", si on les compare aux mesures d'austérité actuelles, elles provoquèrent un véritable choc dans la classe ouvrière. Le cauchemar de la crise était réapparu. Mais même si cette réapparition fut soudaine, la classe ouvrière ne réagit pas et ne déclencha alors aucune importante vague de grèves. Cependant, entre 1965 et 1967, quelques 300 000 ouvriers participèrent à diverses luttes. Une vague de manifestations démarra dans l'ensemble du pays avec une grève sauvage en décembre 1966 à l'usine de machines d'imprimerie Faber et Schleicher d'Offenbach. Les ouvriers exigeaient le renvoi d'un contremaître qui faisait preuve de brutalité. De plus, des conflits concernant le temps de travail surgirent dans les ateliers ILO à Pinneberg, près de Hambourg, en septembre 1967. Presque toutes ces luttes menèrent à des grèves sauvages. Elles contribuèrent de façon significative à un changement d'attitude, particulièrement chez les jeunes ouvriers et spécialement chez ceux en formation (à l'époque, il n'y avait pas de chômage important des jeunes, la plupart d'entre eux accédaient à un emploi). Alors que pendant des années, l'idéologie du "partenariat social" et l'image d'un Etat paternaliste bienveillant s'étaient largement répandues, les premières fissures de la "paix sociale" apparaissaient maintenant Avec le recul, ces petites grèves étaient les signes annonciateurs d'une rupture plus importante qui devait se produire en Allemagne en 1969.
Avec ces actions peu spectaculaires et hésitantes, la classe ouvrière allemande avait envoyé un message important, ce qui avait également donné une impulsion au mouvement de manifestation des étudiants. Même si, du point de vue international, leurs luttes défensives n'avaient pas placé les ouvriers allemands au premier plan, ils firent partie intégrante du mouvement à son tout début.
Ce ne fut pas principalement la dureté immédiate des premières mesures d'austérité qui déclencha le mouvement. On pouvait aussi deviner l'agitation d'une génération nouvelle. Après les privations de la crise économique des années 1930 et les années de famine pendant et après la guerre, après l'épuisement brutal de la force de travail pendant la période de reconstruction et les longues journées de travail aux salaires très bas, un niveau de consommation plus élevé était en train de se mettre en place. Mais, parallèlement, ces nouvelles conditions de travail forcé eurent un effet répulsif, particulièrement chez les jeunes ouvriers. Un sentiment mal défini mais généralisé se mettait en place : "Nous ne pouvons pas croire que c'est comme ça et pas autrement. Nous avons besoin de quelque chose d'autre que juste des biens de consommation. Nous ne voulons pas faire comme nos parents : nous épuiser à la tâche, être lessivés, usés jusqu'à la corde." Très lentement, une nouvelle classe ouvrière non défaite surgissait, une génération d'ouvriers qui n'avaient pas connu la guerre et qui n'étaient pas prêts à accepter l'ennuyeuse routine capitaliste sans résister. La recherche d'une alternative, encore mal définie et confuse, était en route.
Ce qui se cachait derrière le mouvement de protestation : la recherche d'une société nouvelle
La formation d'une opposition "extra parlementaire" à la fin de 1966 n'a été qu'un pas au milieu d'un mouvement plus grand qui se développait au sein de la jeune génération, en particulier des étudiants. A partir de 1965, avant même que la crise économique n'éclate, de plus en plus d'assemblées générales dans les universités étaient le lieu de débats passionnés sur les façons et les moyens de contester.
Suivant l'exemple des Etats-Unis, dans beaucoup d'universités, on formait des groupes pour contrecarrer les universités bourgeoises "établies" ; une "université critique" se mettait en place. Dans ces forums, il n'y avait pas que des membres de la SDS (Ligue Allemande des Etudiants Socialistes) qui décidaient de toutes sortes de formes spectaculaires de contestation de l'autorité. Au cours de cette première phase du mouvement, la vieille tradition du débat, de la discussion dans les assemblées générales publiques, s'est partiellement ranimée. Même si beaucoup se sentaient attirés par l'envie pressante d'actions spectaculaires, l'intérêt pour la théorie, pour l'histoire des mouvements révolutionnaires a refait surface, avec en même temps le courage d'envisager la victoire sur le capitalisme. Beaucoup ont exprimé l'espoir d'une autre société. Rudi Dutschke l'a résumé en juin 1967 de la façon suivante : "Le développement des forces de production a atteint un point tel que l'abolition de la faim, de la guerre et de la domination est devenue matériellement envisageable. Tout dépend de la conscience des gens et de leur volonté de faire l'histoire, ce qu'ils ont toujours fait, mais maintenant il faut que ce soit fait d'une façon consciente et contrôlée." Un certain nombre de textes politiques du mouvement ouvrier, en particulier de la mouvance conseilliste, ont été réimprimés. L'intérêt pour les conseils ouvriers s'est très fortement accru. A l'échelle internationale, le mouvement de protestation en Allemagne était considéré comme l'un des plus actifs sur le plan de la théorie, le plus passionné de discussions, le plus politique.
Au même moment une grande partie des contestataires, tel Rudi Dutschke, ont tout de suite critiqué le stalinisme d'un point de vue théorique, ou au moins d'un point de vue émotionnel. Dutschke a considéré le stalinisme comme une déformation doctrinaire du vrai marxisme qui s'était transformé en une nouvelle idéologie "bureaucratique" de domination. Il a exigé une révolution profonde et une lutte pour le renouveau du socialisme dans le bloc de l'Est.
La répression étatique crée l'indignation
Pour protester contre la visite du Shah d'Iran à Berlin Ouest, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues le 2 juin 1967. Le gouvernement démocratique bourgeois allemand, qui soutenait inconditionnellement la dictature sanglante du Shah, était fermement déterminé à maintenir les manifestations sous contrôle en faisant usage de la violence policière (utilisation de matraques et arrestations violentes de manifestants par des brigades). Au cours de ces manifestations violentes, l'étudiant Benno Ohnesorg fut assassiné d'une balle dans le dos par un policier en civil (qui fut par la suite acquitté). Ce meurtre d'un étudiant a provoqué une immense indignation chez la jeunesse politisée et a donné au mouvement une dynamique supplémentaire. A la suite de cette répression d'Etat, des discussions lors d'un congrès, qui se tenait une semaine après la mort de Benno le 9 juin 1967, sur le thème "Université et Démocratie", ont révélé l'existence d'un gouffre croissant entre l'Etat et la société. Au même moment, une autre composante du mouvement de contestation prenait de plus en plus d'importance.
Le mouvement contre la guerre
Suivant la même dynamique qu'aux Etats-Unis, les manifestations et les congrès contre la guerre du Vietnam avaient commencé en 1965 et 1966. Les 17 et 18 février 1968, un Congrès International contre la guerre au Vietnam se tînt à Berlin Ouest, suivi d'une manifestation de quelques 12 000 participants. L'escalade de la guerre au Moyen-Orient autour de la "Guerre des Six Jours" en juin 1967 et surtout la guerre du Vietnam ramenaient des images de guerre dans les foyers. A peine 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle génération, dont la majorité n'avait pas connu la guerre ou qui étaient tout petits alors, s'est trouvée confrontée à une guerre qui mettait à nu toute la barbarie du système (bombardement permanent, surtout de la population civile, utilisation d'armes chimiques telles que l'Agent Orange (napalm), massacre de My Lai : davantage de bombes avaient été lâchées sur le Vietnam qu'au cours de toute la Seconde Guerre mondiale). La nouvelle génération n'était plus prête à sacrifier sa vie dans une nouvelle guerre mondiale - et donc dans le monde entier, surtout aux Etats-Unis et en Allemagne, de plus en plus de gens manifestaient contre la guerre au Vietnam.
Cependant, on peut constater le caractère contradictoire et confus du mouvement à travers l'idée de base très largement répandue alors et que Dutschke a clairement exprimée. Lui et beaucoup d'autres au SDS pensaient que la guerre américaine au Vietnam, les lois d'urgence en Allemagne et la bureaucratie stalinienne du bloc de l'Est, en dépit de toutes les différences, avaient une chose en commun : elles constituaient les éléments d'une chaîne mondiale d'un pouvoir autoritaire sur des citoyens impuissants. Les conditions pour vaincre le capital dans les riches pays industrialisés et dans le "tiers-monde" étaient différentes selon eux. La révolution ne serait pas faite par la classe ouvrière en Europe et aux Etats-Unis mais par les peuples pauvres et opprimés de la "périphérie" du marché mondial. C'est pour cela que beaucoup de gens politisés se sentaient attirés par les théories "anti-impérialistes", qui vantaient les luttes de libération nationale comme étant une nouvelle force révolutionnaire, alors qu'en réalité elles n'étaient rien d'autre que des conflits impérialistes, souvent sous la forme de guerres par procuration au cours desquelles des paysans étaient sacrifiés sur l'autel de l'impérialisme.
Même si beaucoup de jeunes étaient fascinés par les prétendues luttes de libération nationales dans le "tiers-monde" et soutenaient le Vietcong, la Russie ou la Chine lors de manifestations contre la guerre, ce qui signifie qu'ils ne défendaient pas une position fondamentalement internationaliste, il devenait quand même clair que le malaise de base par rapport à la guerre grandissait et surtout que la nouvelle génération ne pouvait pas être mobilisée pour une nouvelle confrontation entre les deux blocs. Le fait que la classe dirigeante de l'Etat allemand, qui se trouvait en ligne de front, rencontre des difficultés croissantes pour mobiliser les jeune gens pour un massacre impérialiste était particulièrement significatif.
La spirale de la violence s'installe
Dès 1965, on a assisté à des manifestations contre les projets des lois d'urgence qui donnaient à l'Etat de nombreux droits pour intensifier la militarisation et la répression. Le SPD, qui avait rejoint la coalition avec le CDU en 1966, est resté fidèle aux politiques qu'il avait d'abord pratiquées en 1918/1919 (1). Après l'assassinat de Benno Ohnesorg en juin 1967, les campagnes de diffamation à l'encontre des protestataires, en particulier à l'encontre de leurs leaders se sont intensifiées. Le tabloïd populaire allemand Bild Zeitung exigeait : « arrêtez tout de suite le terrorisme des jeunes Rouges ! ». Lors d'une manifestation pro-américaine organisée par l'Etat berlinois le 21 février 1968, des participants portaient des slogans déclarants: « Ennemi n°1 du peuple : Rudi Dutschke ». Au cours de cette manifestation, un homme qui regardait passer la manifestation fut pris par erreur pour Rudi Dutschke ; des manifestants l'ont menacé de le passer à tabac et de le tuer. Une semaine après l'assassinat de Martin Luther King aux Etats-Unis, la campagne de diffamation a finalement atteint un sommet avec la tentative d'assassinat de Rudi Dutschke le 11 avril, le jeudi avant Pâques. Entre le 11 et le 18 Avril, il y eut des émeutes, principalement dirigées contre Springer, le magnat de la presse (les manifestants criaient : "Bild Zeitung a participé à l'assassinat "). Deux personnes furent tuées, des centaines d'autres blessées. Une spirale de violence s'installa. A Berlin, les premiers cocktails Molotov furent lancés : un agent de police les mettait à la disposition des manifestants qui étaient prêts à utiliser la violence. A Francfort, on mit pour la première fois le feu à un grand magasin.
Malgré une marche sur Bonn le 11 mai 1968 comprenant plus de 60 000 participants, la coalition gouvernementale CDU-SPD s'est empressée d'adopter les lois d'urgence.
Alors qu'en France en mai 68, les manifestations étudiantes étaient repoussées à l'arrière-plan par les grèves ouvrières et que la classe ouvrière remontait sur le devant de la scène de l'histoire, les manifestations en Allemagne se trouvaient déjà dans un cul-de-sac.
Une vague de grèves ouvrières ne se déclencha que plus d'un an plus tard, en septembre 1969, surtout parce que les manifestants prolétariens en 1968 manquaient de points de repère.
Alors que certains contestataires se tournaient vers des actes de violence et que d'autres, essentiellement des activistes étudiants, se jetaient à corps perdu dans la construction d'organisations gauchistes pour « mieux toucher les ouvriers dans les usines », beaucoup de contestataires prolétariens rejetèrent ces options et commencèrent à se replier.
Nous
continuerons la deuxième partie de cet article avec les
événements qui ont suivi mai 1968.
Weltrevolution, mai 2008.
1 On peut constater dans le livre de Uwe Soukup, Comment Benno Ohnesorg est mort, comment la bourgeoisie allemande avait utilisé avec succès en 1918/1919 des campagnes de diffamation dans les journaux et des provocations pour présenter les radicaux comme de violents terroristes et les isoler.
Géographique:
- Allemagne [61]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [132]
Chronique d'un débat sur la crise économique (réunion publique du CCI en Espagne)
- 3773 lectures
Nous
nous contenterons dans ce bref article de souligner son aspect vivant
en mettant en avant prioritairement les différentes
interventions des participants. Des questions seront donc soulevées
sans que toutes les réponses soient forcément
apportées. Pour connaître plus en profondeur notre
vision tant de la crise économique actuelle que de la crise
historique du capitalisme, nous conseillons à nos lecteurs de
se reporter à notre tout dernier article sur la question :
« Existe-t-il
une issue à la crise économique ? »1.
Quelle est la situation actuelle du capitalisme ?
Réagissant à notre exposé introductif, un camarade a tout d'abord affirmé qu'il ne voyait pas en quoi le capitalisme pouvait être en crise : « Vous exagérez sur la question de la crise. Je vois plutôt de la prospérité. Le capitalisme a de la ressource pour un bon bout de temps. La classe dominante peut offrir des reformes pour satisfaire les besoins du plus grand nombre et ceux d'en bas peuvent accéder aux richesses et aux charges publiques ».
D'autres camarades lui répondirent de différentes façons :
-
« Je ne vois pas comment les besoins de la majorité sont satisfaits. On dit que les gens sont repus par tant de consommation. Mais je ne vois du ‘consumérisme' nulle part. Les gens sont obligés de se serrer la ceinture. Payer les crédits immobiliers est devenu une charge qui oblige à réduire la consommation jusqu'au minimum vital. Les familles, pour arriver à la fin du mois, doivent renoncer à plein de choses. Payer la voiture et le logement oblige à dépenser moins en nourriture, en vêtements et bien d'autres choses de base. Si les familles veulent maintenir une consommation minimale, elles sont obligées de s'endetter et de s'enchaîner à une série de crédits qui finit par les obliger à aller demander un reéchelonnement de leurs dettes, avec les intérêts usuriers que cela implique, c'est-à-dire une dette de plus en plus importante. Voilà la réalité et non pas tout ce tintamarre sur la sur-consommation ».
-
« Je ne vois pas une classe dominante qui réponde aux besoins de la majorité, je vois une classe dominante soumise à la logique de la concurrence, ce qui les amène à réduire les salaires, à jeter des gens au chômage, à ce que les besoins de la majorité des gens soient de moins en moins satisfaits. Le capitalisme va vers la barbarie et il ne faut rien attendre de lui ».
-
« Il y a une crise très forte. En plus, la crise n'est pas seulement une crise économique, mais c'est aussi une crise des idéologies. Les idéologies de la bourgeoisie pour rendre attractif le capitalisme s'usent de plus en plus. Jusqu'à maintenant, les crises du capitalisme trouvaient une issue. Je ne pense pas qu'on doive l'appeler tout simplement ‘crise', parce c'est quelque chose de bien pire. »
Entre ces deux positions est apparue au fil de la discussion un troisième point de vue exprimant une série de nuances : « Il y a une crise économique, mais le capitalisme a des issues. La crise économique aiguise les contradictions politiques et sociales, mais la vérité c'est qu'il y a de la prospérité et on le voit dans le fait que les riches le sont de plus en plus. Le capitalisme se trouve actuellement dans un processus de restructuration. Il y a de nouveaux blocs qui vont se constituer (le bloc européen, le bloc nord-américain, le bloc autour de Chavez, etc.) et ceux qui seront les têtes de chaque bloc auront beaucoup plus de marge de manœuvre que les autres. La hausse de la productivité permet au capitalisme d'augmenter les profits et de sortir ainsi de la crise. »
Le débat a donc exprimé une grande hétérogénéité. Alors qu'il y avait des camarades qui partageaient clairement notre position, d'autres estimaient que le capitalisme « en a encore pour longtemps ». Ce débat est très important : si le capitalisme en a vraiment pour longtemps, s'il peut satisfaire ne serait-ce qu'un peu les besoins de la majorité, la lutte devrait alors se placer sur un terrain favorable aux reformes et aux améliorations du système. Nous pensons, par conséquent, que le débat devrait se poursuivre sur la base d'une série de questions :
-
Nous trouvons-nous face à une « crise de restructuration » comme le pense un des intervenants ? Serions-nous dans un processus où, face à aux vieilles puissances en déclin, vont émerger de nouvelles puissances ? La Chine, peut-être ? Ou bien, au contraire, serions-nous dans une nouvelle phase de la descente progressive vers l'abîme, une descente qui a caractérisé les 40 dernières années ? La croissance actuelle de la Chine ne serait-elle pas la conséquence des tentatives pour pallier à cette crise et qui pourrait finir par aggraver encore plus les problèmes de l'économie mondiale ? Ne serions-nous pas face à ce que l'un des participants a qualifié de « quelque chose de pire qu'une crise » ?
-
On peut se poser une autre question : le fait que « les riches soient de plus en plus riches », est-ce vraiment l'expression de la prospérité du système ? Ne serait-ce pas plutôt l'évidence de son échec, la réalité d'une tendance à une fracture irrémédiable dans la société entre une minorité de plus en plus minoritaire et de plus en plus riche et une majorité de plus en plus grande et pauvre ?
-
Et, enfin, la hausse de la productivité, est-ce une issue à la crise ? Ne représente-elle pas plutôt une aggravation de celle-ci ? N'est-ce pas la saturation des marchés le problème principal du capitalisme que la hausse de la productivité ne fait qu'aggraver au-delà de quelques soulagements momentanés qu'elle peut apporter ? 2
La suite du débat (sur Internet ou avec de nouvelles rencontres) permettrait de développer des réponses plus élaborées à ces questions pour ainsi comprendre la politique que la classe ouvrière devrait suivre : ce n'est pas la même chose si le capitalisme a des possibilités d'« octroyer des reformes pour satisfaire les nécessités d'une majorité » - tel qu'un participant l'a affirmé - ou s'il va « vers la barbarie et on ne peut rien attendre de lui », tel qu'une camarade lui a répondu.
Est-ce qu'il y a une réponse de la classe ouvrière ? Comment pouvons nous la développer ?
Cette question est celle qui a pris le plus de temps lors de cette réunion. Il y a eu un débat très animé où une série d'idées ont émergé.
Une position ne voyait pas de capacité de lutte au sein de la classe ouvrière : « Le prolétariat des pays riches se fout de tout, accepte tout. Je n'ai pas confiance dans le prolétariat, parce qu'il est embourgeoisé. Qui plus est, si, comme vous dites, la crise va s'aggraver, ce qui arrivera alors c'est le fascisme, comme ce qui est arrivé dans les années 30. Écoutez le discours de la droite sur l'immigration, il va vers le fascisme et aucunement vers la moindre prise de conscience ».
Nous avons traité ce sujet du fascisme, présenté comme le « mal absolu » face auquel il faudrait choisir le « moindre mal » de la démocratie, dans de nombreux articles auxquels nous renvoyons3 nos lecteurs. Lors de cette réunion, ce sujet n'a pas été abordé par les autres participants, qui se sont surtout attachés à argumenter contre la thèse comme quoi « le prolétariat se serait embourgeoisé ». Pour un participant « Ce truc sur l'embourgeoisement du prolétariat, on nous le raconte depuis 50 ans. Ça n'a aucune base objective. En vérité, si on parle d'embourgeoisement, c'est parce qu'on voit les syndicats qui se disent représentants des ouvriers et tout ce qu'il font est embourgeoisé. Mais c'est un fait que syndicats et classe ouvrière ne sont pas identiques, ils sont même opposés ». Une participante ajouta : « Là où je vois de l'embourgeoisement et de l'aliénation, c'est dans la lutte syndicale, mais dans la lutte ouvrière, au contraire, ce que je vois, ce sont des essais de rupture avec cette aliénation. »
Un autre participant n'arrivait pas à voir la capacité de riposte au sein de la classe ouvrière : « Les ouvriers restent passifs ; tout au plus sont-ils capables de développer des luttes partielles ». Et il attribuait cette difficulté de la classe ouvrière au fait que « la bourgeoisie met en oeuvre toute une stratégie face aux luttes ouvrières, contre la prise de conscience de la classe ouvrière. La bourgeoisie dépense des millions d'euros pour mystifier les ouvriers : la mystification électorale, la mystification politique, la mystification idéologique. La bourgeoisie se coordonne internationalement contre la classe ouvrière».
D'autres interventions ont essayé d'aller plus loin qu'une simple photographie de la situation de la classe ouvrière, au niveau immédiat, et ont essayé de considérer ses luttes, même avec leurs confusions et leurs défauts, dans une dynamique sociale et historique : « Du monde bourgeois, il n'y a rien à attendre. L'espoir se trouve dans le développement des luttes des ouvriers où l'on voit apparaître des éléments de prise de conscience » ou encore « il y a des luttes ouvrières, bien plus que nous ne le pensons. Ce qui arrive, c'est qu'on n'en parle pratiquement pas. Les grèves, ça ne fait pas de l'info. Elles n'existent que pour ceux qui les vivent. Mais elles sont une école. Le meilleur apport des luttes n'est pas tellement les gains économiques, souvent des victoires à la Pyrrhus, mais les leçons sur la conscience, l'unité et la solidarité, l'apprentissage que ces luttes apportent dans la lutte pour le communisme. Il n'y a pas de raccourcis pour arriver à une révolution. C'est le cumul des expériences, la conscience qui grandit peu à peu, qui conduit vers la révolution. Je crois que toutes ces ‘radicalités' de façade font très mal : brûler des pneus par désespoir, faire des grèves qui emmerdent les usagers, avoir des affrontements violents et stériles avec la police... Ce n'est pas ça la ‘radicalité'. Etre radical, c'est aller à la racine des choses. La lutte ouvrière est radicale quand elle s'affronte de façon déterminée à l'exploitation capitaliste, lorsque face à la concurrence et à la division semées par les rapports de production, elle réussit à unifier la majorité des ouvriers, lorsqu'elle arrive à isoler politiquement l'État et les capitalistes ».
Dans ce cadre, un autre participant a posé des questions concrètes sur comment le prolétariat peut avancer, comment peut-il dépasser la faiblesse et le caractère encore embryonnaire de sa lutte présente : « Ce qui est le plus important pour moi c'est la nécessité de riposte du prolétariat. La question que nous devons nous poser c'est : est-ce que les conditions objectives [la crise économique du capitalisme4] entraînent automatiquement la réponse subjective du prolétariat [le développement du combat du prolétariat vers le communisme5] ? Je crois que non, je pense que pour développer sa réponse subjective, le prolétariat a besoin d'une prise de conscience plus globale, ce qui vient se joindre aux conditions économiques ». La réponse du prolétariat n'est pas - comme ce camarade l'a très bien dit - un simple reflet passif de l'exacerbation de la crise (les fameuses « conditions objectives »), ce n'est pas non plus le résultat immédiat et mécanique des luttes, mais elle nécessite que tout cela soit fertilisé et guidé par un processus de prise de conscience - qui est à son tour un puissant facteur pour impulser les luttes elles-mêmes. Dans ce sens, le camarade a poursuivi : «Est-ce que le prolétariat est conscient des traces de l'idéologie qu'il porte dans sa tête ? Le prolétariat a des difficultés pour développer sa conscience uniquement dans ses luttes, il a besoin de la réflexion, de prendre des distances, de regarder ce qui se passe dans le monde, de regarder les choses avec la perspective de l'histoire. »
La discussion doit continuer : c'est un outil pour transformer le sentiment d'indignation et de révolte qui nous anime tous face à la barbarie de ce monde en sentiment de solidarité et en volonté de lutte contre le capitalisme. Comme l'a dit un participant : « Nous sommes venus ici parce que quelque chose nous rassemble tous : la lutte contre le capitalisme. »
Acción Proletaria, organe du CCI en Espagne (5 mars)
1 La première partie de cet article est d'ores et déjà disponible ici [133] ou dans notre journal du mois de mai (Révolution Internationale n°390). La seconde partie est à paraitre début juin (sur le web et dans RI n°391).
2 Pour une réflexion plus générale sur la situation actuelle du capitalisme et de ses perspectives, on peut lire, entre autres « Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [134]. »
3 Voir, entre autres, « Les causes économiques, politiques et sociales du fascisme [135] » dans la Revue internationale nº 3 (1975) et aussi « Crime fasciste à Madrid: l'alternative n'est pas fascisme ou antifascisme, mais barbarie capitaliste ou révolution prolétarienne [136] » (Révolution internationale nº 386, 12/2007).
4 Note de la rédaction.
5 Idem.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Comme en France, il y a 40 ans, un mai 68 se produisait en Afrique, au Sénégal
- 4441 lectures
C'est donc dans ce contexte que Dakar a connu lui aussi un « mai 68 rampant » qui dura une douzaine de jours, entre le 18 mai et le 2 juin, qui a failli ébranler définitivement le régime profrançais de Senghor, avec grèves générales illimitées du monde scolaire puis du monde du travail avant que le pouvoir en place n'arrivât à bout du mouvement par une féroce répression policière et militaire tout en bénéficiant de l'appui décisif de l'impérialisme français.
Le « Mai sénégalais » fut précédé par plusieurs heurts avec le gouvernement Senghor, notamment entre 66 et 68 où les étudiants organisaient des manifestations de soutien aux luttes de « libération nationale » et contre le « néo-colonialisme » et « l'impérialisme ».
De même qu'avant le déclenchement du mouvement de mai, il y a eu en milieu scolaire des « grèves d'avertissement », par exemple, une grève des cours a été déclenchée le 26 mars 1968 par les élèves du lycée de Rufisque (banlieue de Dakar), suite aux sanctions disciplinaires infligées à certains de leurs camarades de classe, mouvement qui dura 3 semaines. Cela avait fini par installer dans les établissements scolaires de la région un climat d'agitation et de contestation du gouvernement.
Le détonateur du mouvement
Le déclenchement du mouvement de mai 68 a eu pour origine immédiate la décision du gouvernement du président Senghor de réduire les mensualités des bourses d'études de 12 à 10 mois tout en diminuant fortement le montant alloué, sous prétexte de « la situation économique difficile que traversait le pays ».
« La nouvelle de la décision du gouvernement se répandit comme une traînée de poudre à la cité universitaire, causant partout l'inquiétude et suscitant un sentiment général de révolte. C'était le seul objet de conversations partout sur le campus. Dès son élection, le nouveau comité exécutif de l'UDES (syndicat étudiant) s'employa à développer l'agitation autour de la question des bourses en milieu étudiant, parmi les élèves des lycées et auprès des syndicats. » (ibid.)
En effet, dès cette annonce gouvernementale, l'agitation s'installe et la contestation du gouvernement s'intensifie, notamment à la veille des élections que les étudiants dénoncent, comme le montre le titre d'un de leurs tracts : « De la situation économique et sociale du Sénégal à la veille de la mascarade électorale du 25 février... ». L'agitation continue : le18 mai, les étudiants décident d'une « grève générale d'avertissement » suite à l'échec des négociations avec le gouvernement sur les conditions d'études, grève massivement suivie dans toutes les facultés.
Galvanisés par le franc succès de la grève et chauffés à bloc par le refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications, les étudiants lancent un mot d'ordre de grève générale illimitée des cours et de boycott des examens à partir du 27 mai. Déjà, à la veille de cette date, les meetings se succèdent dans le campus et en milieu scolaire en général, bref, c'est l'épreuve de force avec le pouvoir. De son côté, le gouvernement se saisit de tous les médias officiels pour annoncer une série de mesures d'intimidation contre les grévistes, tout en visant à opposer les étudiants, qualifiés de « privilégiés », aux travailleurs et aux paysans. Et l'UPS (parti de Senghor) dénonce la « position antinationale » du mouvement des étudiants, mais sans rencontrer aucun écho. Au contraire, les campagnes du gouvernement ne font qu'aggraver la colère des étudiants et susciter la solidarité des salariés et de la population.
« Les meetings de l'UED (Union des étudiants de Dakar) constituaient des temps forts de l'agitation dans le campus. Ils enregistraient une influence considérable d'étudiants, d'élèves, d'enseignants, de jeunes chômeurs, d'opposants et, bien entendu, de nombreux agents de renseignement. Au fil du temps, ils constituaient le baromètre qui indiquait les mouvements de la contestation politique et sociale. Chaque meeting était une sorte de messe de l'opposition sénégalaise et de celles des autres pays présents dans le campus. Les interventions étaient ponctuées des morceaux de musique révolutionnaire du monde entier ». (ibid.)
Effectivement, on assiste là à une véritable veillée d'armes. Dès minuit le 27 mai, les étudiants en éveil entendent le bruit des bottes et voient l'arrivée massive d'un cordon policier autour de la cité universitaire. Dès lors, une foule d'étudiants et d'élèves se rassemblent et convergent vers les résidences en vue de monter des piquets de grève.
En fait, par cette intervention, le pouvoir, en encerclant le campus universitaire par les forces de l'ordre, cherche à empêcher tout mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et inversement.
« Ainsi, des camardes se virent privés de leurs repas et d'autres de leur lit car, comme l'UDE a eu souvent à le dire, les conditions sociales sont telles que nombre de camarades mangent en ville (non boursiers) ou y dorment faute de logement à la cité universitaire. Même les étudiants en médecine qui soignaient leurs malades à l'hôpital restaient bloqués à la Cité en même temps que d'autres étudiants en urgence médicale. C'était l'exemple type de violation des franchises universitaires. » (ibid.)
Le 28 mai, lors d'une entrevue avec le recteur et les doyens de l'université, l'UDE demande la levée du cordon policier, tandis que les autorités universitaires exigent que les étudiants fassent une déclaration sous 24 heures « certifiant que la grève n'a pas pour but de renverser le gouvernement Senghor ». Les organisations étudiantes répondent qu'elles n'étaient pas liées à un régime donné et que le temps qui leur est imparti ne permet pas de consulter leur base. Dès lors, le président du gouvernement ordonne la fermeture totale des établissements universitaires.
« Le groupe mobile d'intervention, renforcé par la police, sonna une nouvelle charge et investit les pavillons les uns après les autres. Il avait reçu l'ordre de dégager les étudiants par tous les moyens. Ainsi à coups de matraque, de crosses de fusils, baïonnettes, de grenades lacrymogènes et quelquefois offensives, défonçant portes et fenêtres, les sbires allèrent chercher les étudiants jusque dans leurs chambres. Les gardes et les policiers se comportèrent en véritables pillards. Ils volèrent tout et brisèrent ce qui leur paraissait encombrant, déchirèrent les vêtements, les livres et les cahiers. Des femmes enceintes furent maltraitées et des travailleurs malmenés. Au pavillon des mariés, femmes et enfants furent frappés. Il y a eut sur le champ un mort et beaucoup de blessés (une centaine) selon les chiffres officiels. » (ibid.)
L'implosion
La brutalité de la réaction du pouvoir se traduit par un élan de solidarité et renforce la sympathie envers le mouvement des étudiants. Dans tous les milieux de la capitale s'exprime une forte réprobation du comportement brutal du régime, contre les sévices policiers et l'internement d'un grand nombre d'étudiants. Au soir du 29 mai, tous les ingrédients sont réunis pour un embrasement social car l'effervescence est à son comble parmi les élèves et les salariés. Ce sont les lycéens (qui étaient déjà massivement présents lors des « grèves d'avertissement » du 26 mars et du 18 mai) qui se mettent les premiers en grève illimitée. Dès lors, la jonction est faite entre le mouvement universitaire et le mouvement dans le secondaire. Les uns après les autres, tous les établissements de l'enseignement secondaire se déclarent en grève totale et illimitée tout en formant des comités de lutte qui appellent à manifester avec les étudiants.
Inquiet de l'ampleur de la mobilisation de la jeunesse, le même jour, le 29 mai, le président Senghor fait diffuser un communiqué dans les médias annonçant le fermeture sine die de tous les établissements scolaires (facultés, lycées, collèges) de la région de Dakar et de Saint- Louis et appelant les parents d'élèves à retenir leurs enfants à la maison. Mais sans le succès escompté.
« La fermeture de l'université et des écoles ne fit qu'augmenter la tension sociale. Les étudiants, qui avaient échappé aux mesures d'internement, les élèves et les jeunes se mirent à ériger des barricades dans les quartiers populaires comme la Médina, Grand Dakar, Nimzat, Baay Gainde, Kip Koko, Usine Ben Talli, Usine Nyari Talli, etc. Dans la journée des 29 et 30 notamment, des cortèges imposants composés de jeunes occupaient les principales artères de la ville de Dakar. Les véhicules de l'administration et des personnalités du régime étaient particulièrement recherchés. Selon la rumeur, de nombreux ministres furent ainsi contraints de renoncer à utiliser leurs voitures de fonction, les fameuses voitures de marque Citroën appelées DS 21. En effet, ce type de véhicule officiel symbolisait, aux yeux de la population et des étudiants et élèves en particulier, le « train de vie insolent de la bourgeoisie politico- bureaucratique et ‘ compradore' ». » (ibid.)
Face à la combativité montante et à la dynamique du mouvement, le gouvernement décide de renforcer ses mesures répressives en les étendant à toute la population. Ainsi dès le 30 mai, un décret gouvernemental indique, d'une part, que jusqu'à nouvel ordre, tous les établissements recevant du public (cinéma, théâtres, cabarets, restaurants, bars) sont appelés à fermer nuit et jour. Et, d'autre part, les réunions, manifestations et attroupements de plus de 5 personnes sont interdits.
Grève générale des travailleurs
Face à ces mesures et à la poursuite des brutalités policières contre la jeunesse en lutte, tout le pays s'agite et la révolte s'intensifie partout, cette fois-ci, plus amplement chez les salariés. C'est à alors que les appareils syndicaux traditionnels, notamment l'UNTS (un regroupement de plusieurs syndicats) décident d'entrer en scène pour ne pas se faire déborder par la base.
« La base des syndicats pressait les directions à l'action. Le 30 mai, à 18 heures, l'union régionale UNTS du Cap-Vert (région de Dakar), à la suite d'une réunion conjointe avec le bureau national de l'UNTS, lança un mot d'ordre de grève illimitée à partir du 30 mai à minuit. »
Face à la situation explosive pour son régime, le président Senghor décide de s'adresser au pays, en tenant un discours menaçant envers les travailleurs en les exhortant de désobéir au mot d'ordre de grève générale, tout en accusant les étudiants d'être « téléguidés de l'étranger ». Mais en dépit des menaces réelles du pouvoir allant jusqu'à donner des ordres de réquisition de certaines catégories de travailleurs, le mouvement de grève s'avère très suivi dans le public comme dans le privé.
Le 31 mai à 10 heures, des AG sont organisées à la bourse du travail auxquelles sont invités les délégations des secteurs en grève afin de décider de la suite à donner au mouvement.
« Mais les forces de l'ordre avaient déjà bouclé le quartier. A 10 heures, l'ordre fut donné de charger les travailleurs à l'intérieur de la Bourse. Les portes et fenêtres furent défoncées, les armoires éventrés, les archives détruites. Les bombes lacrymogènes et les coups de matraque eurent raison des travailleurs les plus téméraires. En réponse aux brutalités policières, les travailleurs auxquels se mêlèrent les élèves et le lumpenprolétariat, s'attaquèrent aux véhicules et magasins dont plusieurs furent incendiés. Le lendemain Abdoulaye Diack, secrétaire d'Etat à l'information, révélait devant la presse que 900 personnes avaient été interpellées dans la Bourse du Travail et ses environs. Parmi celles-ci, on comptait 36 responsables syndicaux dont 5 femmes. En réalité, au cours de la semaine de crise, pas moins de 3.000 personnes avaient été interpellées. Certains dirigeants syndicaux furent déportés (...). Ces actes ne firent qu'accentuer l'indignation des populations et la mobilisation des travailleurs. » (ibid.)
En effet, aussitôt après cette conférence de presse au cours de laquelle le porte-parole du gouvernement donne ses chiffres sur les victimes, grèves, manifestations et émeutes ne font que s'intensifier jusqu'à ce que la bourgeoisie décide d'arrêter les dégâts.
« Les syndicats alliés du gouvernement et le patronat sentaient la nécessité de lâcher du lest pour éviter un durcissement au sein des travailleurs, qui au cours des manifestations, avaient pu prendre conscience de leur poids. »
Dès lors, après une série de réunions entre le gouvernement et les syndicats, le 12 juin, le président Senghor annonce un accord de fin de grève basé sur 18 points dont un qui préconise une augmentation de 15% des salaires. En conséquence, le mouvement prend fin officiellement à cette date-là, ce qui n'empêche pas la poursuite du mécontentement et le resurgissement d'autres mouvements sociaux, car la méfiance est de mise chez les grévistes par rapport aux promesses du pouvoir de Senghor. Et, de fait, quelques semaines après la signature de l'accord mettant fin aux grèves, des mouvements sociaux repartent de plus belle et vont se poursuivre avec une certaine vigueur jusqu'au début des années 1970.
En fin de compte, il convient de souligner l'état de désarroi dans lequel s'est trouvé le pouvoir sénégalais au plus fort de sa confrontation au « mouvement de mai de Dakar », à l'instar du chercheur (Abdoulaye Bathily), l'auteur largement cité :
« Du 1e au 3 juin, on avait l'impression que le pouvoir était vacant. L'isolement du gouvernement était démontré par l'inaction du Pari au pouvoir. Devant l'ampleur de l'explosion sociale, les structures de l'UPS n'ont pas réagi. La fédération des étudiants UPS s'est contentée de la distribution furtive de quelques tracts contre l'UDES au début des événements. Cette situation était d'autant plus frappant que l'UPS s'était vantée, trois mois plus tôt, d'avoir été plébiscitée à Dakar lors des élections législatives et présidentielles du 25 février 1968. Or, voilà qu'elle était incapable de trouver une riposte populaire face à ce qui se passait.
Selon la rumeur, les ministres avaient été consignés au building administratif, siège du gouvernement, et de hauts responsables du pari et de l'Etat s'étaient cachés dans leurs maisons. C'était là un bien curieux comportement pour des dirigeants d'un parti qui se disait majoritaire dans le pays. En un moment, le bruit avait couru que le président Senghor se serait réfugié à la base militaire française de Ouakam. Ces rumeurs étaient d'autant plus vraisemblables que les informations concernant la « fuite » du général De Gaulle en Allemagne, le 29 mai, étaient connues à Dakar. » (ibid.)
Le gouvernement de Senghor a donc fortement tremblé devant la vague de luttes menée par la jeunesse et la classe ouvrière qui lui a apportée son soutien décisif. Par ailleurs, Abdoulaye Bathily semble trop prudent dans l'évocation des « rumeurs », sans doute à cause même de ses fonctions (professeur d'université à Dakar) au moment de la publication de son ouvrage. En effet, à l'époque, d'autres rumeurs plus insistantes indiquaient clairement que ce fut l'armée française sur place qui arrêta brutalement les manifestants qui marchaient sur le palais présidentiel en causant plusieurs victimes, y compris des morts.
Rappelons aussi que le pouvoir sénégalais, pour venir à bout du mouvement social, n'a pas seulement utilisé ses chiens de gardes habituels, à savoir ses forces policières, mais il a aussi eu recours aux forces les plus réactionnaires que sont les chefs religieux et les paysans des campagnes reculées. Au plus fort du mouvement (le 30 et le 31 mai), les chefs de cliques religieuses avaient été invités par Senghor à occuper les médias nuit et jour pour faire des déclarations condamnant la grève et exhortant les travailleurs à reprendre le travail.
Quant aux paysans, le gouvernement a essayé de les dresser contre les grévistes en les faisant venir en ville pour soutenir les manifestations progouvernementales. Comme Bathily l'indique, cette tentative fut un fiasco : « Les recruteurs avaient fait croire à ces paysans que le Sénégal avait été envahi à partir de Dakar par une nation appelée « Tudian » (étudiant) et qu'on faisant appel à eux pour défendre le pays. Par groupes, ces paysans furent déposés aux allées du Centenaire (actuel boulevard du général De Gaulle) avec leurs armes blanches (haches, coupe-coupe, lances, arcs et flèches). Mais ils se rendirent bien vite compte qu'ils avaient été menés en bateau. (...) Les jeunes les dispersèrent à coups de pierres et se partagèrent les victuailles. (...) D'autres furent lapidés lors de leur passage à Rufisque. En tout état de cause, l'émeute révéla la fragilité des bases politiques de l'UPS et du régime en milieu urbain, à Dakar en particulier. » (ibid.)
Décidemment, le pouvoir de Senghor aura utilisé tous les moyens y compris les plus barbares pour venir à bout du soulèvement social contre son régime. Cependant, pour éteindre définitivement le feu, l'arme la plus efficace pour le pouvoir fut sans doute le rôle joué par le chef du principal syndicat de l'époque (UNTS), Doudou Ngom (l'équivalent de Séguy, dirigeant CGT en France en 68) qui « négocia » les conditions de l'étouffement de la grève générale. D'ailleurs, en guise de remerciement, le président Senghor le nomma ministre quelques années plus tard.
Amina ( 4 mai 2008)
1 Abdoulaye Bathily, Mai 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Edit. Chaka, Paris 1992.
Géographique:
- Afrique [16]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [132]
Conférence de Moscou sur octobre 17 : le bolchévisme et la révolution prolétarienne n'ont rien à voir avec le stalinisme
- 3143 lectures
Depuis plusieurs années, le CCI intervient régulièrement parmi le milieu politique qui émerge en Russie. L'article suivant a d'abord été publié sur notre site en langue russe. Il propose un aperçu et un bilan des discussions récentes qui ont impliqué les principales organisations internationalistes actives dans cette partie du monde.
C'est à la révolution d'Octobre 1917 que la conférence du Centre d'Etudes et de Recherche Praxis1 a consacré ses travaux à Moscou en juillet dernier. Ce faisant, elle a fait bien plus que célébrer l'anniversaire d'un simple événement de l'histoire nationale russe. En offrant un cadre sérieux de discussion et de confrontation entre courants venus de divers horizons, en permettant à des groupes révolutionnaires d'y présenter et d'y défendre leurs positions et analyses, cette conférence a contribué à la rappropriation de la plus riche et de la plus grandiose expérience historique du prolétariat au plan international. Faisant la preuve de son aptitude révolutionnaire, le prolétariat détruisait l'Etat capitaliste et, unifié à travers ses conseils ouvriers, assumait l'exercice du pouvoir politique à l'échelle d'un immense territoire.
Un état d'esprit favorable au débat
Il existe bien sûr de nombreuses divergences entre Praxis et notre organisation. Pour autant, celui-ci a encore fait la preuve qu'il est tout à fait capable d'offrir un forum pour un débat ouvert pour tous ceux qui sont en recherche d'une cohérence politique en phase avec leur volonté de transformer la société, qui surgissent et se développent en Russie depuis le début des années 1990.
Le rejet de tout anathème et l'appel plusieurs fois lancé au cours de la conférence par différents participants à s'écouter mutuellement et réellement afin de se répondre avec sérieux, tout comme la volonté exprimée par l'ensemble des participants de séparer les mythes, entretenus par différentes chapelles intéressées, de la réalité et de la vérité historiques, dépassent largement le simple partage de valeurs communes au prolétariat.
C'est une attitude qui contribue directement au renforcement de son combat révolutionnaire. En tant que classe exploitée qui ne dispose d'aucun appui matériel au sein de la société présente, le prolétariat n'a pas d'autres armes à sa disposition que son organisation et sa conscience. Il doit, pour orienter son combat politique, acquérir une conscience démystifiée de la réalité pour agir. Pour forger celle-ci, la confrontation politiques par le débat et la démarche fondée sur l'honnêteté intellectuelle, la recherche de la vérité, l'examen impartial des idées lui sont indispensables.
L'esprit d'ouverture, la rigueur morale qui hait le mensonge, indiscutablement présents au cours de la conférence, ont permis des débats fraternels, l'examen des désaccords et des divergences basé sur un véritable échange d'arguments, où ce sont les idées et les positions politiques qui sont discutées. Du fait que chacun pouvait se prononcer en toute connaissance des arguments présentés, une dynamique de clarification s'est enclenchée conduisant à la remise en cause des préjugés les plus généralement admis.
La première révolution massive et consciente de l'histoire
Au cours de la conférence, on a entendu beaucoup des arguments répétés depuis 90 ans à propos des bolcheviks ou de l'échec final de la révolution démarrée en Russie. Mais l'un des résultats les plus importants obtenu par la discussion, c'est de s'être attaqué au plus grand mensonge du 20e siècle et de l'Histoire, entretenu pendant des décennies par la classe dominante du monde entier et de tous les bords, fasciste, stalinienne ou démocratique, celui qui assimile le régime stalinien au communisme et les bolcheviks à la nomenklatura barbare qui a régné si longtemps en Russie. Mensonge qui a été puissamment réactivé au moment de l'effondrement du bloc de l'Est après 1989 et des campagnes bourgeoises mondiales proclamant la fin de la lutte des classes, la victoire définitive du système bourgeois démocratique, l'inexistence d'alternative à celui-ci.
D'emblée, un participant a affirmé que « la révolution en Russie est née de la crise globale de la guerre mondiale et avait pour enjeu le changement de la société et des bases de la vie sociale. » Le CCI a développé qu'Octobre 1917 avait été la réponse de la classe ouvrière à la plongée du capitalisme dans sa décadence inaugurée par l'éclatement de la première guerre mondiale et le point de départ de la révolution prolétarienne mondiale. Elle n'a pas été le reflet passif de circonstances historiques particulières mais le produit de la prise de conscience collective au sein des masses. C'est avec la création des conseils ouvriers (soviets de députés ouvriers et des soldats), organes grâce auxquels le prolétariat forge son unité et approfondit sa conscience, que le prolétariat s'affirme comme force politique prééminente. La période de février à octobre 1917 montre le processus par lequel les masses ouvrières, initialement soumises et divisées, se transforment en une classe qui agit comme un seul homme et se rendent aptes à se lancer dans la révolution et la prise du pouvoir politique. L'insurrection prolétarienne d'Octobre 17 n'avait rien d'un putsch : elle était le produit de la volonté de l'immense majorité de la classe ouvrière.
La
discussion a trouvé un point de convergence pour rétablir
le rôle et la nature réels des bolcheviks. Un des
participants a souligné que « les
bolcheviks et certains anarchistes à leurs côtés
étaient les seuls à avoir incarné et défendu
en toute conséquence au plan politique la perspective du
changement des bases de la vie sociale et de la société. »
Plusieurs intervenants ont souligné la profonde différence
entre l'internationalisme des bolcheviks qui se sont ardemment
battus pour l'extension de la révolution prolétarienne
dans le monde et le nationalisme du stalinisme, massacreur
d'ouvriers, pas seulement en Russie mais aussi, par exemple, en
Chine en 1927-28. Sous l'angle original de l'écologie, un
participant a évoqué l'aspect méconnu des
préoccupations pour l'environnement et les expériences
écologiques encouragées par Lénine après
l'avènement du bolchevisme.
« Toutes les tendances qui les incarnaient ont péri
dans la terreur stalinienne. »
En montrant que « le
‘productivisme' destructeur développé en URSS à
partir des années 30 n'avait rien à voir avec les
conceptions du marxisme des rapports entre l'homme et la nature ni
avec le bolchevisme, mais avait été une monstruosité
inventée par le stalinisme »,
il a conclu que « sur
ce plan-là aussi, il est nécessaire de faire une
distinction entre le bolchevisme et le stalinisme. »
Face à l'expression de méfiance par rapport au concept de dictature du prolétariat, au nom de laquelle pendant des décennies le stalinisme a justifié ses crimes, l'ouverture de la conférence à la discussion a permis que les organisations révolutionnaires présentent leurs principaux arguments sur la forme du pouvoir de la classe ouvrière.
Si les camarades du KRAS2 ont affirmé récuser le terme de dictature du prolétariat, ils ont souligné qu'ils poursuivaient le but d'une révolution qui établisse le principe de « chacun selon ses moyens ». Le délégué de l'IUPRC3 a développé que « face à l'appareil de coercition de l'Etat, la classe ouvrière doit développer sa violence ; la dictature du prolétariat, c'est la dictature des conseils ouvriers, des assemblées générales des travailleurs. Il est impossible de s'en passer. » Pour le CCI, la révolution russe a permis justement au mouvement ouvrier international de tirer les leçons essentielles que le pouvoir politique du prolétariat ne s'incarne ni dans le pouvoir de l'Etat, ni dans celui d'un Parti. L'organe de la révolution et de l'exercice du pouvoir de l'immense majorité laborieuse contre la minorité bourgeoise, ce sont les conseils ouvriers.
Les conditions de la défaite finale et de la nature de l'URSS à partir de la fin des années 1920 ont naturellement été abordées. Là, il a été possible à un certain nombre de participants de s'approprier et même de reprendre la méthode proposée par le CCI pour qui la révolution prolétarienne est par nature internationale et se développe au plan universel. Contrairement aux mensonges bourgeois, la révolution russe n'a pas dégénéré, puis péri, en premier lieu pour des raisons intérieures, mais du fait de son isolement, de l'échec de la révolution prolétarienne à s'étendre internationalement. Son sort était suspendu avant tout au succès des insurrections ouvrières dans les autres pays du monde. Un participant a ainsi affirmé ensuite « reconnaître que le destin du bolchevisme aurait été différent en cas d'extension de la révolution. » L'un des militants du KRAS a appuyé dans le même sens qu'« il y a eu des moments où les potentialités de la révolution dans le monde pouvaient se réaliser, mais la révolution mondiale a été vaincue » et que si « on peut admettre le fait que par certains de leurs actes les Bolcheviks aient produit certaines conditions de l'apparition du stalinisme, le stalinisme ne procède pas du bolchevisme. » Le stalinisme n'est pas le continuateur du bolchevisme et de la révolution d'octobre : il en a été le fossoyeur et le bourreau.
La conférence a repoussé certaines conceptions de la nature de l'URSS après les années 1920 (comme celle qui en fait un exemple de despotisme asiatique ou celle qui exprime une nostalgie pour « le ‘socialisme de caserne' qui garantissait au moins un minimum pour tous » comme « produit du désarroi dans lequel la crise économique et la dislocation de la société capitaliste en Russie plongent la plus grande partie de la population frappée par la misère. » Très clairement, un militant du KRAS a argumenté que « c'est la bourgeoisie qui a gouverné l'URSS ; elle n'a fait que se révéler en 1992. Les constitutions de 1936 sont complètement bourgeoises. Ce qui fonde cette nature bourgeoise c'est l'existence du travail salarié et de la vente de la main d'œuvre en URSS. La nomenklatura, c'était la bourgeoisie. »
Quelles voies pour la lutte des classes aujourd'hui ?
Les travaux de la conférence ont aussi naturellement fait le pont avec la situation actuelle du prolétariat et abordé, à propos des grèves récentes qui se sont déroulées en Russie, les perspectives que doit se donner aujourd'hui la lutte des classes tout comme les responsabilités qui incombent à ses minorités organisées. Une contribution du KRAS a constitué l'un des points forts de la conférence. La prise de position de ces camarades s'est attachée à dénoncer l'action anti-ouvrière des syndicats dans le mouvement des ouvriers de Ford à Saint-Pétersbourg contre l'allongement du temps de travail. Il est apparu clairement une ligne de clivage entre ceux pour qui la source de la force de la classe ouvrière et la condition de son émancipation sont constituées par la marche vers la révolution prolétarienne, et donc par l'auto-activité des masses, la prise en main de la lutte par les assemblées générales, le développement de la solidarité active entre différents secteurs, et ceux qui veulent faire croire que l'action syndicale est une voie possible pour la lutte, qu'il y aurait quelque chose de bénéfique pour les ouvriers dans une politique de réforme comme « premier pas en avant ». La contribution du KRAS a, à juste raison et avec le plein soutien du CCI, mis en avant que « la politique de réforme et de partenariat social est un leurre et un mensonge et qu'il y a danger pour les ouvriers que de les pousser dans ce mensonge. La lutte pour l'amélioration de ses conditions et pour le changement de la société ne passe pas par le trade-unionisme. Partout, les syndicats sont des organes de la concertation sociale qui font accepter l'augmentation du temps de travail et la baisse des salaires. Anciens ou nouveaux syndicats mènent la même politique. »
Le CCI a soutenu que « les syndicats mènent une stratégie de défaite » (KRAS), que toutes les luttes, laissées à la direction des syndicats, ont, depuis des décennies et dans tous les pays, été vouées à l'échec et ont constitué des défaites cuisantes pour la classe ouvrière. Il en est ainsi parce qu'« il y a eu dans l'histoire un changement dans la fonction des syndicats, un processus de dégénérescence qui a conduit à leur intégration dans l'Etat. » (KRAS)
La contribution du KRAS a fortement défendu que « la lutte des classes est imposée au prolétariat par la bourgeoisie et que face à la classe dominante, le seul choix, c'est ou la résignation ou la lutte. La résignation pose le problème de la dignité humaine. » Pour lutter, la classe ouvrière est placée devant l'alternative : ou bien confier la direction de la lutte à des organes syndicaux saboteurs du mouvement qui dépossèdent les ouvriers de leur action, la détournent de son but dans des impasses ; ou bien « l'action directe dans les assemblées générales qui constituent l'école du communisme, où les ouvriers font l'apprentissage de l'action et de la pensée par eux-mêmes, comme le défendait Lénine. » (KRAS)
Effectivement, la classe ouvrière n'est jamais aussi forte que lorsque qu'elle s'organise elle-même, prend en main ses luttes et développe sa solidarité. Seules les luttes qui, comme le mouvement des jeunes prolétaires encore étudiants en France au printemps 2006 l'atteste, utilisent les assemblées générales et organisent l'extension de la lutte à d'autres secteurs, en dehors et contre la volonté des syndicats, sont capables de faire reculer les gouvernements et la bourgeoisie.
Aujourd'hui, près d'un siècle après le début de la vague révolutionnaire mondiale des années 1920, les expressions de la lutte des classes au plan international nous prouvent que non seulement le prolétariat conserve son caractère de classe révolutionnaire, mais qu'à travers la lente maturation qui le traverse, c'est l'esprit de 1917 qui fermente à nouveau en son sein.
Svetlana, décembre 07
1 Praxis organise des réunions publiques, des conférences et a démarré un programme d'édition et de publication de textes afin de faire connaître « la grande richesse des idées radicales et alternatives (...) qui se rattachent au socialisme démocratique et libertaire et qui s'opposent au totalitarisme. » Voir leur site web : victorserge.ru
2 Confédération anarcho-syndicaliste révolutionnaire de Moscou, section de l'AIT qui a pris une position internationaliste face aux guerres en Tchétchénie. Site web : KRAS.FATAL.ru ; contact : [email protected] [137]
3 Groupe International des Collectivistes Prolétariens Révolutionnaires. Groupe internationaliste actif en Russie et en Ukraine. Voir sur leur site web iuprc.250free.com leurs thèses de présentation (en anglais) « Who we are ». Contact : [email protected] [138]. Le KRAS et l'IUPRC animent depuis juillet 2004 un forum de discussion internationaliste russe. Voir sur le site du CCI.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [139]
Courants politiques:
- Stalinisme [140]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise du néolibéralisme ou crise du capitalisme ?
- 3661 lectures
Le texte ci-dessous est une traduction d'un article réalisé par la section du CCI en Espagne.
Sarkozy proclame aujourd'hui que « le capitalisme doit se refondre sur des bases éthiques ». Madame Merkel insulte les spéculateurs. Zapatero pointe d'un doigt accusateur les "fondamentalistes du marché" qui prétendent que celui-ci se régule tout seul sans intervention de l'État. Tous nous disent que cette crise implique la mort du capitalisme « néolibéral » et que l'espoir aujourd'hui se tourne vers un « autre capitalisme ». Ce nouveau capitalisme reposerait sur la production et non sur la finance, se dégageant de cette couche parasitaire des requins financiers et spéculateurs qui auraient poussé comme des champignons sous prétexte de « dérégulation », « d'inhibition de l'État », de primauté de l'intérêt privé sur « l'intérêt public », etc. À les entendre, ce n'est pas le capitalisme qui s'effondrerait, mais une forme particulière de capitalisme. Les groupes de la gauche (staliniens, trotskistes, altermondialistes...) exultent en proclamant : « Les faits nous donnent raison. Les dérives néolibérales ont provoqué ces désastres ! » Ils rappellent leur opposition à la « globalisation » et au « libéralisme déchaîné », exigeant l'adoption de mesures étatiques pour faire entendre raison aux multinationales, aux spéculateurs et autres crapules qui auraient provoqué ce désastre par leur soif démesurée de profits. Ils proclament que la solution passe par « le socialisme », un socialisme qui consisterait en ce que l'État remette à leur place « les capitalistes » au bénéfice du « peuple » et des « petites gens ».
Ces explications sont-elles valables ? Un « autre capitalisme » est-il possible ? L'intervention bienfaitrice de l'État pourrait-elle porter remède au capitalisme en crise ? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions d'une actualité brûlante. Il faut cependant au préalable éclaircir une question fondamentale : le socialisme est-il l'État ?
Socialisme = État ?
Chavez, l'illustre paladin du « socialisme du xxie siècle », vient de faire quelques déclarations surprenantes : « Le camarade Bush est en train de prendre certaines mesures propres au camarade Lénine. Les États-Unis deviendront un jour socialistes, parce que les peuples ne se suicident pas ». Pour une fois, et sans que cela ne constitue pour autant un précédent, nous sommes d'accord avec Chavez. D'abord sur le fait que Bush est son camarade. En effet, même s'ils sont opposés par une lutte concurrentielle acharnée sur le terrain impérialiste, ils n'en sont pas moins camarades dans la défense du capitalisme et dans l'utilisation de l'État pour sauver le système. Et nous sommes aussi d'accord pour dire que « les États-Unis deviendront un jour socialistes », même si ce socialisme n'aura rien à voir avec celui que préconise Chavez.
Le socialisme véritable défendu par le marxisme et les révolutionnaires tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier n'a rien à voir avec l'État. Le socialisme est même la négation de l'État. L'édification d'une société socialiste exige en premier lieu la destruction de l'État dans tous les pays. S'ouvre alors une période de transition du capitalisme au communisme, la transition du jour au lendemain étant impossible. Cette période de transition doit encore subir la loi de la valeur typiquement capitaliste, la bourgeoisie n'est pas totalement éteinte et, aux côtés du prolétariat, coexistent encore des classes non exploiteuses : paysans, marginaux, petite-bourgeoisie (1). Comme produit de cette situation de transition, l'État continue à être nécessaire mais n'a plus rien à voir avec les autres États dans l'histoire, il devient un semi-État, pour reprendre la formulation d'Engels, un État en voie d'extinction. Pour avancer vers le communisme dans une situation historique de transition, à la fois complexe et instable, pleine de dangers et de contradictions, le prolétariat ne doit pas cesser de porter des attaques à ce semi-État, il doit le démanteler pièce par pièce. Le processus révolutionnaire doit en passer par là sous peine de se bloquer et de voir s'éloigner, sinon se perdre définitivement, la perspective du communisme.
Un des auteurs au sein du mouvement ouvrier qui a le plus abordé cette question, Friedrich Engels, est très clair sur cet aspect : « Il conviendrait d'abandonner tout ce bavardage sur l'État, surtout après la Commune, qui n'était plus un État, au sens propre. Les anarchistes nous ont assez jeté à la tête l'État populaire, bien que déjà le livre de Marx contre Proudhon, et puis le Manifeste communiste, disent explicitement qu'avec l'instauration du régime social socialiste, l'État se dissout de lui-même et disparaît. L'État n'étant qu'une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d'un État populaire libre: tant que le prolétariat a encore besoin de l'État, ce n'est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l'État cesse d'exister comme tel » (2).
L'intervention de l'État pour réguler l'économie, pour la mettre au « service des citoyens », etc., n'a rien à voir avec le socialisme. L'État ne sera jamais « au service de tous les citoyens ». L'État est un organe de la classe dominante et est structuré, organisé et configuré pour défendre la classe dominante et maintenir le système de production qui la maintient. L'État le « plus démocratique du monde » n'en sera pas moins un État au service de la bourgeoisie, qui défendra, bec et ongles, le système de production capitaliste. En outre, l'intervention spécifique de l'État sur le terrain économique n'a pas d'autre objectif que celui de préserver les intérêts généraux de la reproduction du capitalisme et de la classe capitaliste. Engels, dans son livre l'Anti-Dühring, affirme clairement : « l'État moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble ».
Tout au long du xxe siècle, avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence (3), l'État a été son principal rempart face à l'exacerbation de ses contradictions sociales, guerrières et économiques. Les xxe et xxie siècles se caractérisent par la tendance universelle au capitalisme d'État. Cette tendance existe dans tous les pays, quels que soient leurs régimes politiques. On trouve essentiellement deux voies de réalisation du capitalisme d'État :
-
L'étatisation plus ou moins complète de l'économie (c'est celle qui existait en Russie et existe encore en Chine, à Cuba, en Corée du Nord...) ;
-
La combinaison entre la bureaucratie étatique et la grande bourgeoisie privée (comme aux États-Unis ou en Espagne, par exemple).
Dans les deux cas, c'est toujours l'État qui contrôle l'économie. Le premier affiche ouvertement sa propriété d'une grande partie des moyens de production et services. Le second intervient dans l'économie à travers une série de mécanismes indirects : impôts, fiscalité, achats aux entreprises (4), fixation des taux d'intérêt interbancaires, régulation des prix, normes de comptabilité, agences étatiques de concertation, d'inspection, d'investissements (5), etc.
On nous gave avec un matraquage idéologique qui repose sur deux mensonges jumeaux : le premier est l'identification du socialisme avec l'État, le second est l'identification du néolibéralisme avec la dérégulation et le marché libre. Pendant sa période historique de décadence (xxe et xxie siècles), le capitalisme n'aurait pu subsister sans les béquilles omniprésentes de l'État. Le marché « libre » est guidé, contrôlé, soutenu par la main de fer de l'État. Adam Smith (6) disait que le marché était régulé par une « main invisible ». Cette main invisible, c'est l'État (7) ! Lorsque Bush se précipite pour sauver les banques et les compagnies d'assurances, il ne fait là rien d'exceptionnel, pas plus qu'il ne prend des mesures « que prendrait le camarade Lénine ». Il ne fait que poursuivre le travail de contrôle et de régulation de l'économie dont se charge quotidiennement l'État8.
Le « néolibéralisme » a-t-il échoué
Nous avons déjà exposé notre position sur les causes de la crise dans d'autres textes (9). Après une relative période de prospérité de 1945 à 1967, le capitalisme mondial est retombé dans des crises récurrentes, les épisodes convulsifs se sont succédés comme des séismes qui mettaient l'économie mondiale au bord de l'abîme. Rappelons la crise de 1971 qui obligea à désindexer le dollar de l'étalon or ; celle de 1974-75 qui aboutit à une inflation incontrôlable de plus de 10% ; la crise de la dette de 1982, quand le Mexique et l'Argentine se déclarèrent en suspension de paiement ; la chute de Wall Street en 1987 ; la crise de 1992-93 qui entraîna l'effondrement de nombreuses monnaies européennes ; celle de 1997-98 qui mit à mal le mythe des tigres et des dragons asiatiques ; celle de l'éclatement de la bulle Internet en 2001...
« Ce qui caractérise globalement les xxe et xxie siècles, c'est que la tendance à la surproduction - qui était temporaire au xixe siècle et pouvait être résolue relativement facilement - devient chronique, soumettant ainsi l'économie mondiale à des risques plus ou moins permanents d'instabilité et de destruction. Par ailleurs, la concurrence - trait congénital du capitalisme - atteint son paroxysme dans un marché mondial qui tend en permanence à être saturé et perd ainsi son caractère stimulateur de l'expansion pour ne plus développer que le caractère négatif et destructeur du chaos et de l'affrontement » (10). Les différentes étapes de la crise qui se sont succédées tout au long des dernières quarante années sont le produit de cette surproduction chronique et de la concurrence exacerbée. Les États ont tenté de combattre ses effets en usant de palliatifs, le principal d'entre eux étant bien sûr l'endettement. Les États les plus forts ont aussi repoussé les conséquences les plus néfastes en "exportant" les pires effets sur les pays les plus faibles (11).
La politique adoptée dans les années 1970 fut celle, classique, de l'endettement étatique renforcé par une intervention ouverte de l'État dans l'économie : nationalisations, prises de contrôle d'entreprises, supervisions rigides du commerce extérieur, etc. C'était une politique « keynésienne » (12). Il faut rappeler aux amnésiques qui veulent nous imposer le faux dilemme néolibéralisme/intervention étatique que tous les partis, de droite comme de gauche, étaient alors « keynésiens » et péroraient sur les bienfaits d'un « socialisme en liberté » (comme par exemple le modèle social-démocrate suédois), etc. Cette politique eut comme conséquences désastreuses l'emballement de l'inflation et donc la déstabilisation de l'économie et la tendance à la paralysie du commerce international. Pour y remédier, fut alors mise en place pendant les années 1980 ce qui fut rhétoriquement baptisé « la révolution néolibérale », dont les figures de proue étaient alors La Dame de fer » Madame Thatcher en Grande-Bretagne et le cowboy Reagan aux États-Unis. Cette politique étatique avait deux objectifs :
-
Lâcher du lest en liquidant une importante partie de l'appareil productif non rentable, ce qui entraîna une vague sans précédents de licenciements organisée et planifiée par l'État, ouvrant un processus de dégradation irréversible des conditions de vie des travailleurs : début de la précarité, démantèlement des prestations sociales, etc. (13) ;
-
Soulager l'endettement qui étranglait l'État par des politiques de privatisation, de sous-traitance des services et des fonctions ("l'externalisation") comme le report (« la titrisation ») systématique de la dette publique vers les particuliers, les banques, les spéculateurs, etc. Cette seconde étape de la politique « néolibérale » étendit ainsi particulièrement l'endettement de l'État au secteur financier. Le marché se retrouva inondé de toutes sortes de titres, bons, etc., qui prirent des proportions monstrueuses, la spéculation se déchaîna. L'économie mondiale ressembla dès lors à un immense casino dans lequel gouvernants, banquiers et experts « brokers » (les courtiers) se livrent à des opérations compliquées pour obtenir des profits spectaculaires immédiats ... au prix de terribles séquelles de faillites et d'instabilité.
Il ne faut pas nous raconter d'histoires sur « l'initiative privée » qu'encouragerait le « néolibéralisme » : ses mécanismes ne sont pas nés spontanément du marché mais ont été le fruit et la conséquence d'une politique économique étatique dans le but de juguler l'inflation. Elle n'a fait que la reporter mais en payant le prix fort : par d'obscurs mécanismes financiers, les dettes se sont transformées en créances spéculatives à haut niveau d'intérêt, rapportant dans un premier temps de juteux bénéfices mais dont il fallait se débarrasser le plus tôt possible car, tôt ou tard, personne ne pourrait plus les payer... Ces créances furent dans un premier temps les « stars » les plus attractives du marché que se disputaient les banques, les spéculateurs, les gouvernements... mais elles se transformèrent très rapidement en créances douteuses totalement dévalorisées qu'il fallait fuir comme la peste.
L'échec de cette politique se révéla avec le « krach » brutal de Wall Street en 1987 et l'effondrement des caisses d'épargne américaines en 1989. Cette politique « néolibérale » se poursuivit au cours des années 90 mais, étant donné les montagnes de dettes qui pesaient sur l'économie, il a fallu soulager les coûts de production par des politiques de développement de la productivité et... par les délocalisations, consistant à exporter des pans entiers de la production vers des pays comme la Chine, avec ses salaires de misère et ses conditions de travail impitoyables, ce qui a eu comme conséquence une aggravation générale considérable des conditions de vie de tout le prolétariat mondial. Le concept de « globalisation » s'est développé à ce moment-là : les grands États ont imposé aux petits la suppression des barrières protectionnistes, les inondant alors de marchandises pour soulager leur surproduction chronique.
Une fois de plus, ces "médecines" ne firent qu'aggraver le mal et la crise des dragons et des tigres asiatiques de 1997-98 démontra autant l'inefficacité de ces politiques que les dangers qu'elle contenait. Mais le capitalisme sortit alors un lapin de son chapeau, le nouveau siècle apporta avec lui ce qui s'appela la « net-économie », c'est-à-dire une spéculation à outrance sur les entreprises d'informatique et d'Internet. Ce fut rapidement, dès 2001, un échec fracassant. Le capitalisme tenta encore un nouveau tour de magie dès 2003 en se livrant à une spéculation immobilière déchaînée, remplissant la planète de buildings et d'immeubles (accélérant en passant les problèmes environnementaux), provoquant une terrible flambée du prix immobilier et débouchant sur... le terrible fiasco actuel !
... ou est-ce le capitalisme ?
La crise actuelle peut être assimilée à un gigantesque champ de mines. La première à exploser fut la crise des subprimes durant l'été 2007 et on aurait pu croire à première vue que les choses allaient rentrer dans l'ordre, moyennant le versement de quelques milliards. N'en avait-il pas toujours été ainsi ? Mais l'effondrement des institutions bancaires depuis fin décembre a été la nouvelle mine qui a fait exploser toutes ces illusions. L'été 2008 a été vertigineux avec une succession de faillites de banques aux États-Unis et en Grande- Bretagne. Nous en arrivons au mois d'octobre 2008 et une autre des illusions avec lesquelles les bourgeoisies comptaient apaiser nos préoccupations vient de partir en fumée : ils disaient que les problèmes étaient immenses aux États-Unis mais que l'économie européenne n'avait rien à craindre. Soit. Mais les mines commencent à présent à exploser aussi dans l'économie européenne en commençant par son État le plus puissant, l'Allemagne, qui contemple sans réagir l'effondrement de sa principale banque hypothécaire.
D'où viennent ces explosions brutales de mines alors que tout semble « tranquille et serein » ? Elles sont le résultat de 40 années d'accompagnement de la crise, de palliatifs, qui sont parvenus à masquer les problèmes et maintenir plus ou moins debout un système aux prises avec des problèmes insolubles, mais qui, non seulement n'ont rien résolu, mais au contraire, ont aggravé les contradictions du capitalisme jusqu'à ses limites extrêmes et c'est maintenant, avec cette crise, que l'on voit apparaître les conséquences les unes après les autres.
Le capitalisme s'en sortira-t-il « comme il s'en est toujours sorti » ?
Cet aphorisme est une fausse consolation :
-
Les épisodes précédents de la crise avaient pu être « résolus » par les banques centrales en déboursant quelques milliards de dollars (une centaine lors de la crise des Tigres asiatiques en 1998). Les États ont aujourd'hui investi 3 000 milliards de dollars depuis un an et demi et ils ne voient toujours pas d'issue (14).
-
Les pires effets de la crise avaient jusqu'ici été circonscrits à quelques pays (Sud-Est asiatique, Mexique et Argentine, Russie), alors qu'aujourd'hui l'épicentre où se concentrent les pires effets se trouve précisément dans les pays centraux : États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne... et irradient forcément le reste du monde.
-
Les épisodes précédents, en général et à l'exception de celui de la fin des années 1970, étaient de courte durée et il suffisait de 6 mois à un an pour apercevoir le « bout du tunnel ». Cela fait un an et demi que nous sommes dans cette crise et on n'aperçoit pas la moindre lueur. Au contraire, chaque jour, la crise est plus grave et la débâcle plus profonde !
-
Par ailleurs, cette crise va laisser le système bancaire mondial très affaibli. Le mécanisme du crédit se retrouve paralysé à cause de la méfiance généralisée, personne ne sachant vraiment si les « actifs » présentés par les banques (et les entreprises) dans leurs bilans ne sont pas de l'esbroufe. Les immeubles, les propriétés, les installations sont dévalorisés. Quant aux actifs financiers, ils ne sont, selon l'expression-même de Bush que des « actifs toxiques », du papier représentant d'incroyables dettes irrécupérables. Le capitalisme d'État « libéral » ne peut fonctionner s'il n'a pas des banques fortes et solides, l'économie capitaliste s'est à présent tellement accrochée à la drogue de l'endettement que si le système du crédit s'avère incapable d'apporter un flux d'argent abondant, la production sera paralysée. Le robinet du crédit est fermé malgré les sommes énormes allouées aux banques centrales par les gouvernements. Personne ne voit clairement comment va pouvoir se rétablir un système percé de toutes parts et qui perd ces organes vitaux - les banques - les uns après les autres. La course folle entre les États européens pour voir lequel pouvait donner le plus de garanties aux dépôts bancaires est une sinistre augure qui ne révèle que la recherche désespérée de fonds. Cette surenchère de « garanties » révèle précisément que rien n'est garanti !
Les choses sont donc claires : le capitalisme connaît aujourd'hui sa crise économique la plus grave. L'histoire vient de s'accélérer brutalement. Après 40 années d'un développement de la crise lent et heurté, ce système est en train de plonger dans une récession épouvantable et extrêmement profonde dont il ne se relèvera pas indemne. Mais surtout, dès maintenant, les conditions de vie de milliards de personnes se trouvent durement et durablement affectées. Le chômage frappe de nombreux foyers, 600 000 en moins d'un an en Espagne, 180 000 au mois d'août 2008 aux États-Unis. L'inflation frappe les produits alimentaires de base et la faim ravage le monde à une vitesse vertigineuse depuis un an. Les coupes salariales, les arrêts partiels de production avec les attaques qui en découlent, les risques qui pèsent sur les pensions de retraite... Il ne fait pas le moindre doute que cette crise va avoir des répercussions d'une brutalité inouïe. Nous ne savons pas si le capitalisme s'en sortira, mais nous sommes convaincus que des millions d'êtres humains ne s'en sortiront pas. Le « nouveau » capitalisme qui « sortira » de cette crise sera une société bien plus pauvre, avec énormément de prolétaires plongeant dans la précarité, dans un contexte de désordre et de chaos. Chacune des convulsions antérieures tout au long des 40 dernières années s'est soldée par une détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière et par une amputation plus ou moins grande de l'appareil productif ; la nouvelle période qui s'ouvre portera cette tendance à un niveau bien supérieur.
Seule la lutte du prolétariat peut permettre à l'humanité de sortir de l'impasse
Le capitalisme ne va pas jeter l'éponge. Jamais une classe exploiteuse n'a reconnu la réalité de son échec et n'a cédé son pouvoir de son plein gré. Mais nous constatons qu'après plus de cent ans de catastrophes et de convulsions, toutes les politiques économiques avec lesquelles l'État capitaliste a tenté de résoudre ses problèmes non seulement ont échoué, mais elles ont en plus aggravé les problèmes. Nous n'avons rien à attendre des prétendues « nouvelles solutions » que va trouver le capitalisme pour « sortir de la crise ». Nous pouvons être certains qu'elles nous coûteront surtout toujours davantage de souffrances, de misère et nous devons nous préparer à connaître de nouvelles convulsions encore plus violentes.
C'est pourquoi il est utopique de se fier à ce qu'on nous présentera comme une « sortie » de la crise du capitalisme. Il n'y en a pas. Et c'est le système entier qui est incapable de masquer sa faillite. Etre réaliste, c'est participer à ce que le prolétariat reprenne confiance en lui, reprenne confiance en la force que peut lui donner sa lutte comme classe et construise patiemment par ses luttes, par ses débats, par son effort d'auto-organisation, la force sociale qui lui permettra de s'ériger en alternative révolutionnaire face à la société actuelle capable de renverser ce système pourrissant.
CCI (8 octobre)
1 Nous ne pouvons ici aborder en détails toutes ces questions. Pour cela, lire sur notre site : « La perspective du communisme [142] », « Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [143] », « Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [144] ».
2 Engels, Lettre à August Bebel, 1875.
3 La Première Guerre mondiale (1914) met un point final au caractère progressiste du capitalisme et détermine sa transformation en système qui ne charrie plus que des guerres, des crises et la barbarie sans fin. Voir la Revue internationale no 134 [145].
4 Pour s'en faire une idée, aux États-Unis, présentés comme La Mecque du néolibéralisme, l'État est le principal client des entreprises et les entreprises d'informatique sont obligées d'envoyer au Pentagone une copie des programmes qu'elles créent et des composants de hardware qu'elles fabriquent.
5 C'est un conte de fées que de dire que l'économie américaine est dérégulée, que son État est inhibé, etc. : la Bourse est contrôlée par une agence fédérale spécifique, la banque est régulée par le SEC, la Réserve fédérale détermine la politique économique à travers des mécanismes comme les taux d'intérêt.
6 « Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l'histoire comme le père de la science économique moderne, et son œuvre principale, de la richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, il consacra dix années de sa vie à ce texte qui inspira les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique ». (wikipedia.org).
7 Le fléau de la corruption n'est rien d'autre que la preuve évidente de l'omniprésence de l'État. Aux États-Unis comme en Espagne ou en Chine, l'abc de la culture d'entreprise est que les affaires ne peuvent prospérer qu'en passant par les bureaux de la bureaucratie étatique, et en engraissant les hommes politiques du moment.
8 Si les interventions actuelles de Bush semblent écrites par Chavez, celles de Sarkozy sur la nécessité de moraliser le capitalisme semblent sortir tout droit d'un discours de Besancenot, le porte-parole emblématique du tout Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et de la LCR. Contrairement aux apparences, il n'y a ici rien d'étonnant. Ce que proposent le NPA (ex-LCR) et tous les gauchistes n'a rien de révolutionnaire : il s'agit juste d'une forme particulière de capitalisme où l'État ne manipule pas l'économie dans l'ombre (comme dans le ‘néo-libéralisme') mais de façon directe et ouverte. Et c'est justement, pour la bourgeoisie, cette dernière qui est la mieux adaptée au moment présent de crise. Dans la bouche de Sarkozy, toutes ces recettes étatistes apparaissent directement pour ce qu'elles sont : des changements structurels faits par la bourgeoisie pour la bourgeoisie. Mais ces mêmes recettes, déjà d'une efficacité douteuse pour la bourgeoisie, deviennent carrément frelatées et mensongères quand elles sont frauduleusement présentées dans la pure tradition stalinienne par Besancenot, Laguiller et consorts comme étant « des pas vers le socialiisme » accomplis «dans l'intérêt de la classe ouvrière et des couches populaires ». (Note ajoutée par Révolution Internationale, organe du CCI en France).
9 Voir la Revue internationale no 133, « États-Unis, locomotive de l'économie mondiale... vers l'abîme [146] ».
10 in « Existe-t-il une issue à la crise ? [133] ».
11 Dans la série d'articles "30 ans de crise capitaliste" publiée dans les nos 96 [147], 97 [148] et 98 [149] de la Revue internationale, nous analysons les techniques et méthodes avec lesquelles le capitalisme d'État a accompagné cette chute dans l'abîme pour la ralentir, parvenant à ce qu'elle évolue par paliers successifs.
12 Keynes est particulièrement célèbre pour ses encouragements à une politique d'interventionnisme étatique, dans lequel l'État emploierait des mesures fiscales et monétaires avec pour objectif d'enrayer les effets défavorables des périodes de récession cycliques de l'activité économique. Les économistes considèrent qu'il est un des principaux fondateurs de la macroéconomie moderne.
13 Il faut rappeler ici que, contrairement à ce qu'affirment les menteurs de tout poil, cette politique n'était pas une caractéristique des gouvernements « néolibéraux » mais était approuvée à cent pour cent par les gouvernements « socialistes » ou « progressistes ». En France, le gouvernement Mitterrand, soutenu par les communistes jusqu'en 1984, avait adopté des mesures aussi dures que celles qu'appliquaient Reagan ou Thatcher. En Espagne, le gouvernement « socialiste » de Monsieur Gonzalez organisa une reconversion qui impliqua la disparition d'un million d'emplois.
14 Il est en outre stupide de penser que ce déluge de milliards n'aurait pas de conséquences, que ce serait pour ainsi dire une opération "blanche". Il prépare en fait un avenir encore plus sombre. Tôt ou tard, cette folie devra être payée. Le scepticisme généralisé avec lequel a été accueilli le plan de sauvetage financier le plus gigantesque de l'histoire (700 milliards de dollars !) à travers le « plan Paulson » démontre que le remède est en train d'installer de nouveaux champs de mines encore plus puissantes et dévastatrices, dans les sous-sols de l'économie capitaliste malmenée et dont l'effondrement sera, au bout du compte, inévitable.
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Cyclones en Louisiane : l'incurie de la bourgeoisie américaine
- 2884 lectures
On se souvient très bien de la panique qui avait envahi la bourgeoisie américaine devant le délabrement du sud des Etats-Unis après Katrina. Face à une incurie que chacun pouvait aisément constater, les quelques démissions de circonstance avaient laissé la place aux discours bien rodés, larme à l'œil et mine préoccupée, du style "plus-jamais". Georges Bush le premier, la main sur le cœur, avait promis que tout serait fait pour que la Louisiane sinistrée soit reconstruite, que les digues soient renforcées 2, que les plans d'urgence soient révisés, etc. Bref, plus jamais pareille tragédie ne devait se reproduire sur les terres américaines.
Trois ans après, la seule réponse de la bourgeoisie face à l'arrivée d'Ike sur ses côtes fut... l'évacuation ! Car depuis Katrina, rien n'a été fait pour prévenir de nouvelles catastrophes. Les médias s'empressent d'accuser l'accélération de la fréquence des catastrophes naturelles et leur force destructrice sans cesse accrue, mais tout ce vacarme pseudo-scientifique ne peut cacher une réalité bien palpable : que ce soit dans les pays du tiers-monde (voir la prise de position de nos camarades de République dominicaine - RI n°394) ou dans les plus grandes puissances mondiales, la classe dominante ne se donne aucun moyen de faire face aux menaces climatiques. Les bourgeoisies des pays centraux du capitalisme ne peuvent plus accuser tel ou tel dictateur de laisser mourir sa population, protégé derrière les ors de ses palais. Elle-même, dans les mêmes circonstances, pare au plus pressé, consolide ce qu'elle peut, évacue les populations et déblaie ensuite les gravats et les morts. Cette pitoyable impuissance ne doit rien aux hasards météorologiques ou aux effets de surprise. Déjà en 1948, Humprey Bogart et Lauren Bacall se barricadaient dans Key Largo sous la menace d'un puissant ouragan. Aujourd'hui il ne reste plus de planches, plus de clous ; il ne reste que la "solution" de la fuite en croisant les doigts pour que, quand on reviendra, il reste encore quelques murs debout.
Il ne s'agit nullement d'un calcul économique, serait-il même cynique, qui aboutirait à préférer guérir que prévenir. Katrina aura coûté quelques 12 milliards de dollars aux Etats-Unis 3, et Ike pourrait coûter entre 7 et 14 milliards de dollars 4. Des coûts colossaux tout juste suffisants à répondre à l'urgence, mais qui ne sont pas mis en œuvre dans des politiques en amont. Ce capitalisme en faillite est de plus en plus incapable de mettre en œuvre des moyens pour la prévention, il n'a plus que les moyens de panser tout juste quelques plaies.
Ce n'est pas en réduisant l'effet de serre ou en améliorant la prévision météorologique que, fondamentalement, il sera possible de réduire les dégâts occasionnés par les catastrophes climatiques, mais bien en mettant au centre des préoccupations la protection des vies humaines et de ses équipements essentiels dans un seul souci d'efficacité. Mais tout cela est absolument impossible dans le capitalisme.
GD (23 septembre)
1 Source Wikipedia.
2 La Nouvelle-Orléans est construite jusqu'à 6 mètres au-dessous du niveau de la mer, et protégée par des digues de 4 mètres.
3 Source Wikipedia.
4 Estimations établies par la société de réassurance Swiss Re, et relatées par le site tsr.ch.
Récent et en cours:
- Catastrophes [129]
Journée de discussion à Marseille : un débat ouvert et fraternel sur "un autre monde est-il possible ?"
- 3801 lectures
Fort du succès des expériences belge et anglaise 1, le CCI a renouvelé en France l'organisation d'une journée de discussion rassemblant sympathisants, contacts et lecteurs de Révolution Internationale, tous animés par la même préoccupation : quel avenir pour ce monde ? Trente et un participants venus de Toulouse, Lyon, Grenoble, Marseille et Milan, se sont donc réunis début décembre à Marseille et ont choisi de débattre autour du thème : « quelle société voulons-nous ? »
L'exposé introductif a été réalisé par l'un des participants. D'origine nord-africaine, ce dernier a tout d'abord expliqué brièvement son parcours politique : avant de venir en France « je voyais la société occidentale, comme un espoir. On sollicitait l'opinion internationale, l'ONU, Amnesty, le parlement européen etc... On espérait gagner comme ça ! Mais quand je suis arrivé en France, toutes mes illusions se sont effondrées ; alors j'ai commencé à me poser des questions. »
Des questions... tout le monde s'en pose mais peu osent venir en débattre ouvertement ou trouvent les moyens et les lieux pour le faire. Et pourtant, les préoccupations sont identiques de Toulouse à Grenoble, de la France à la l'Angleterre. C'est pourquoi nous saluons l'esprit fraternel dans lequel s'est déroulée cette journée, une journée révélatrice de la lente maturation de la conscience de toute la classe ouvrière depuis quelques années.
Une autre société est-elle possible ?
D'emblée, plusieurs interventions ont affirmé que le système capitaliste nous menait « droit dans le mur » et que l'avenir ne tenait qu'en trois mots : « Socialisme ou barbarie » 2.
« Ça va de mal en pis, affirme ainsi une participante, on dit redistribuer les richesses, mais on sait que ce n'est pas possible, ce n'est pas admis par le système. Voter, faire des pétitions ça ne suffira pas à obtenir ce que je veux, un système équitable, humain où l'on puisse vivre en harmonie avec les autres. Le contraire de ce que l'on voit aujourd'hui. Je veux une société différente et je sais que pour cela il faut détruire le système. L'utopie, c'est de croire que ceux qui arriveront après nous pourront vivre dans ce système. » Le développement au niveau mondial des conflits guerriers, de la misère, de la pollution... signe en effet sans aucun doute possible la faillite du capitalisme. Seule la société communiste présente une alternative pour l'ensemble de l'humanité.
Cependant, beaucoup ont exprimé des doutes quant à la possibilité de construire cette nouvelle société, des doutes qui ne sont pas propres à ces camarades mais qui sont au contraire très répandus dans les rangs ouvriers :
-
« Nous ne sommes pas des anges. Je me pose des questions sur la nature de l'homme toujours fauteur de guerre comme nous le répète la bourgeoisie. Dans le film "Sa Majesté des mouches", des enfants isolés sur une île finissent par se massacrer. Ça fait peur... une autre société est-elle vraiment possible ? » Cette intervention résume parfaitement la question qui revient sur toutes les lèvres : comment améliorer ce monde barbare alors que l'homme serait naturellement mauvais ? « L'homme est un animal social », lui répond un autre participant, « Il ressemble à la société dans laquelle il vit. En fonction des conditions données, l'homme se construit. L'homme peut être soumis au capital mais il peut aussi s'y soustraire ».
Cette nature foncièrement mauvaise de l'homme est l'un des principaux arguments avancés par la bourgeoisie pour justifier la barbarie engendrée par le capitalisme et empêcher la classe ouvrière de rêver d'un autre monde : « Ce que l'on nous renvoie toujours dans les médias, les bouquins, c'est que la nature humaine est terrible, que l'homme est un loup pour l'homme, mais c'est surtout pour nous empêcher de réfléchir collectivement. »
Cette question de la nature humaine est éminemment complexe. Il est impossible d'y répondre ici, dans le cadre de ce court compte-rendu. Simplement, nous pouvons réaffirmer que l'homme est en réalité un être profondément social. L'entraide, la solidarité, la générosité..., toutes ces valeurs sont donc ancrées en lui viscéralement 3.
-
Des doutes se sont aussi exprimés sur la capacité de la classe ouvrière à déjouer les pièges de la bourgeoisie, notamment ceux tendus par les syndicats. Leur rôle : diviser pour mieux régner, encadrer sur le terrain les ouvriers pour mieux faire passer les « réformes » (en clair, les attaques). Ainsi, tout en dénonçant ce sale boulot des syndicats, plusieurs camarades ont aussi exprimé leurs craintes face à la force idéologique de la bourgeoisie et de ses chiens de garde : « Le capital trouve toujours des moyens de réformes, comment arriver à démasquer ces palliatifs ? », « Les revendications ont tendance à se rassembler mais on a toujours les syndicats qui offrent des solutions. ».
Cette puissance de la classe dominante est tout à fait réelle. Pour assurer la défense de ses intérêts de classe et la perpétuation de son système d'exploitation, la bourgeoisie est capable de déployer un machiavélisme consommé et les syndicats représentent un véritable danger pour diviser le prolétariat et saboter sa mobilisation. Jusqu'ici, ils ont réussi à endiguer la combativité et la réflexion de notre classe. Néanmoins, depuis quelques années, le vent semble tourner ; partout dans le monde, la classe ouvrière retrouve progressivement le chemin de la lutte. La confrontation au sabotage syndical et la prise en main des luttes par la classe ouvrière elle-même sera justement l'un des grands enjeux des combats à venir.
-
Enfin, dernière crainte exprimée (mais non des moindres), un camarade a fait part de sa peur qu'il ne soit déjà trop tard : « J'ai peur que si on a une révolution, elle ne puisse arriver avant que capitalisme n'ait provoque des dégâts irréversibles et engendré des effets dramatiques. Guerres, famines, réchauffement climatique... On a du mal à imaginer une révolution dans une même échelle de temps que l'aggravation de la crise. » Cette crainte d'un camarade face à l'état d'urgence de la situation actuelle est entièrement justifiée. Effectivement, plus la révolution tardera, plus l'humanité se retrouvera avec un monde dévasté et difficile à reconstruire. Cependant, aujourd'hui, notre seule chance d'avenir est le prolétariat et la révolution. Et là aussi, il faut tenir compte de la dynamique actuelle de notre classe. Nous pouvons avoir confiance dans le prolétariat ; quand il rentre en lutte, ses capacités sont immenses, l'effervescence et la créativité dont il est alors capable sont souvent insoupçonnées. L'avenir est donc en réalité riche de promesses.
Comment construite une nouvelle société ?
Ces interrogations légitimes quant à la possibilité de la révolution se sont aussi révélés par la recherche de solutions « douces » et « progressives », certains participants s'interrogeant sur « comment construire une société communiste sans passer forcément par la lutte et la révolution » :
-
Ainsi, pour un camarade, « Il faudrait peut-être passer par des expérimentations, par des laboratoires qui permettraient d'affiner notre critique du système. »
Rapidement, deux participants lui ont répondu : « Le capitalisme peut-il permettre à un groupe d'individus un système qui lui soit étranger ? Je pense que non, sinon on l'aurait déjà fait. Après 68, il y a eu les illusions sur le retour à la terre qui s'est transformé en petits commerces, car il fallait faire du profit. Il y a eu aussi une association ‘Le sel' qui prônait l'échange de services, mais l'Etat a vite mis le holà ! », « Sur la question des ‘laboratoires', ce n'est pas possible car on ne peut pas préfigurer ce que l'on va vivre dans 15 ans. Mais on a déjà des expériences, il y a eu une vague révolutionnaire de 1917 à 1923 qui a été un moment très riche. Il ne faut pas l'oublier et tirer des leçons. Par exemple les conseils ouvriers avec délégués révocables, aujourd'hui nous devons nous battre pour que les Assemblées générales soient ouvertes et qu'il y ait de véritables débats. »
Dans les années 70 et 80, il y a régulièrement eu des tentatives pour vivre différemment : retour à la terre, communautés, auto-gestion, etc. Toutes exprimaient une illusion sur la possibilité de créer des îlots de communisme sans avoir à supprimer le capitalisme. Et toutes ont échoué, à l'image des expériences d'autogestion qui ont abouti à ce que les ouvriers acceptent d'eux mêmes des licenciements pour que leur entreprise reste compétitive 4 !
En fait, la société future ne sera possible qu'à l'échelle internationale, unifiant ainsi toute l'humanité, abolissant toutes les divisions de classes et de nations. Le communisme n'a pas sa place au sein du capitalisme. C'est une des leçons de la révolution de 1917 qui fut vaincue parce qu'elle n'avait pu s'étendre (et pourtant, nous étions loin ici de « l'expérimentation » à petite échelle, la classe ouvrière s'étant mise en branle sur toute une partie de la surface du globe !).
-
Ce même intervenant a précisé ensuite quel type « d'expérimentations » il avait en tête, présentant la décroissance comme une alternative : « Pour moi, la plate-forme du CCI et les thèses sur la décroissance visent le même but mais la manière d'y parvenir n'est pas la même. »
La question de la décroissance revient aujourd'hui souvent dans les discussions. Elle s'appuie sur un constat tout à fait juste : la production, dans le système capitaliste, n'est pas réalisée pour répondre aux besoins de l'humanité mais pour le profit, ce faisant elle non seulement elle n'engendre pas le bien-être (loin de là) mais en plus la production capitaliste détruit la planète. La solution, pour les tenants de la décroissance, est donc de mieux et de moins consommer. Ce serait à chacun, à chaque « citoyen du monde », individuellement, que reviendrait la tâche de réagir et de tenter dès maintenant de « vivre autrement » : en limitant les déplacements qui polluent, en ne chauffant pas trop sa maison, en choisissant méticuleusement ce que l'on achète, etc., comportements présentés comme moyens « radicaux » de la transformation des consciences. L'une des actions phares prônée par ce modèle est « la journée sans achat ».
Voilà comment les autres intervenants ont répondu au camarade : « Ce n'est pas la théorie de la décroissance qui va se poser mais la question de l'utilité de tels ou tels produits. Aujourd'hui nous sommes obligés d'acheter une voiture, d'avoir un portable. Mais dans l'avenir, quelle utilité ? » ou encore « En parlant de décroissance, on se met dans la logique de la survie du système et donc du problème de la ‘marchandisation' de tout ! Le système repose sur l'accumulation des moyens de production, s'ils cessent d'accumuler, il s'effondre. Le système capitaliste doit toujours aller de l'avant... C'est parce que la croissance n'est plus possible que la révolution est nécessaire ».
Surtout, cette théorie de la décroissance ne touche qu'une partie du problème et de façon superficielle ; elle ne va pas au fond des choses. Le capitalisme ne peut pas être aménagé, il est un système d'exploitation moribond et il emporte l'humanité dans l'abîme avec lui. A la production anarchique et destructrice du capital, s'ajoute par exemple la guerre ou la paupérisation. Pour sauver l'humanité et la planète, il faut détruire ce système barbare et la seule force capable de le faire, ce n'est pas une somme d'individus (animés des meilleures intentions du monde soient-ils), mais une classe : le prolétariat 5.
La révolution ne sera-t-elle pas trop violente ?
Derrière cette recherche « d'alternatives plus douces », se cache en réalité la peur de la violence de la révolution : « S'il faut une révolution, elle devrait se passer en douceur. Il faut réfléchir, changer tout doucement sinon ça fait peur » affirme ainsi une participante.
En réponse, plusieurs interventions ont réaffirmé qu'en effet la révolution sera forcement violente puisque la bourgeoisie ne se laissera pas déposséder sans réagir, mais qu'elle était aussi et surtout nécessaire : « La révolution ça fait peur, c'est vrai qu'elle sera forcément violente car l'internationalisation ne se fera pas en un clin d'œil. Ça ne fait pas plaisir de souffrir, mais c'est un mal nécessaire car la société capitaliste ne peut pas se réformer. » ; « Sur la peur de la révolution, quand je dis qu'elle sera sans péridurale, cela veut dire que tout le monde a peur du pas à franchir, mais l'usage de la violence ne se pose pas en soi mais c'est le seul moyen possible pour s'affranchir du système capitaliste, pour accoucher d'une autre société sans exploitation . Ce rapport de force ne peut pas être sans violence. » ; ou encore « Pour moi, la question, c'est vivre ou mourir. Ce n'est pas de l'utopie ; c'est du réalisme. Ce n'est pas vrai seulement pour moi mais c'est déjà vrai pour une grosse partie de la planète. Il n'y a pas d'autres solutions, sinon c'est le système qui crève et nous avec. »
La violence sera effectivement nécessaire pour sortir l'humanité de ce système moribond. Mais de quelle violence parle t-on ? Le capitalisme est un système où une minorité impose sa domination à l'écrasante majorité de l'humanité par la terreur ; il impose à des millions d'êtres humains les ravages de la famine, de la guerre et des épidémies. Comme l'a dit l'un des participants « Mais à coté de la violence de tous les jours, la violence de la révolution, il faut la relativiser. Nous subissons aujourd'hui la violence du système et nous n'en sommes pas responsables ». La violence de la classe ouvrière et de sa lutte n'a strictement rien à voir avec la terreur bourgeoise. Au contraire, elle en est à la fois l'antithèse et l'antidote. Comme nous l'affirmons dans notre article « Terreur, terrorisme et violence de classe » : la force invincible de la classe ouvrière « ne réside pas tant dans sa force physique et militaire et encore moins dans la répression, que dans sa capacité de mobiliser ses larges masses, d'associer la majorité des couches et classes non-exploiteuses et non-prolétariennes à la lutte contre la barbarie capitaliste. Elle réside dans le développement de sa conscience et dans sa capacité à s'organiser de façon unitaire en tant que classe autonome, dans la défense intransigeante de ses principes et dans la justesse de ses décisions prises collectivement à travers le débat le plus large et "démocratique" possible (notamment dans ses organes de prise du pouvoir appelés "soviets" en Russie dès 1905 ou "Conseils Ouvriers" en Allemagne en 1918). Telles sont les armes fondamentales de la pratique et de la violence de classe du prolétariat. »
Un des participants a eu cette phrase qui révèle à elle-seule l'une des grandes angoisses des ouvriers : « Si on doit faire la révolution, moi, j'ai besoin de certitude ». Nous avons certainement devant nous la plus haute marche à franchir de l'histoire. Il ne s'agit rien de moins que de sortir de la préhistoire de l'humanité. Aucune ‘mesurette', aucune solution locale n'est possible. La seule perspective est de détruire le capitalisme à l'échelle internationale avant qu'il ne détruise l'humanité, avec une lutte internationale et par une classe internationale, le prolétariat. C'est à la fois grandiose et effrayant. Comme Marx l'a écrit dans son 18 Brumaire : « Les révolutions prolétariennes [...] paraissent [...] reculer constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient : ‘Hic Rhodus, hic salta' 6 ».
Lors de cette journée de discussion à Marseille, toutes les interrogations, toutes les craintes et tous les doutes ont pu être posés. C'est pour cela que de telles journées de discussion sont si importantes car elles permettent de rompre l'isolement, de s'apercevoir que nous ne sommes pas seuls à vouloir que ce monde change. Cela a été tout l'esprit de cette journée : débattre fraternellement pour comprendre et avancer collectivement. La classe ouvrière peut et doit avoir confiance en sa force.
CCI, le 28 février
1 Lire nos articles sur notre site web (www.internationalism.org [150]) : « Journée de rencontre et de discussion avec le CCI d'août 2007 : chercher ensemble une alternative pour cette société agonisante » et « Journée d'étude du CCI en Grande-Bretagne : un débat vivant et fraternel »
2 1er congrès de la 3ème Internationale en 1919.
3 Le CCI débat depuis quelques années, en son sein, de cette question de la « nature humaine ». Ce débat est en parti publie dans l'article « Marxisme et éthique (débat interne au CCI) » publié sur notre site web (www.internationalism.org [151]). En voici un extrait : « La morale est un guide indispensable de comportement dans le monde culturel de l'humanité. Elle permet d'identifier les principes et les règles de vie commune des membres de la société. La solidarité, la sensibilité, la générosité, le soutien aux nécessiteux, l'honnêteté, l'attitude amicale et la bienveillance, la modestie, la solidarité entre générations sont des trésors qui appartiennent à l'héritage moral de l'humanité. Ce sont des qualités sans lesquelles la vie en société devient impossible. C'est pourquoi les êtres humains ont toujours reconnu leur valeur, tout comme l'indifférence envers les autres, la brutalité, l'avidité, l'envie, l'arrogance et la vanité, la malhonnêteté et le mensonge ont toujours provoqué la désapprobation et l'indignation. »
4 Lire nos articles sur Lip, par exemple, où les ouvriers au nom de l'autogestion se sont mis à s'auto-exploiter !
5 Toute une partie de la discussion a d'ailleurs porté sur « qu'est-ce que la classe ouvrière ? ». Cette question est aujourd'hui très présente ; avec le développement des luttes se pose en effet le problème « Avec qui s'unir ? Où chercher la solidarité dans la lutte ?... » Le débat qui s'est développé à Marseille sur ce point fut très proche de ceux menés à Toulouse, Paris, Lyon... lors de nos Réunions Publiques de février dont l'intitulé était justement « qu'est-ce que la classe ouvrière ? » et dont le texte de présentation était « Cet automne, certains étudiants luttant contre la loi "LRU" ont manifesté leur solidarité avec les cheminots grévistes, tentant même parfois de réaliser des AG communes. Par contre, ils n'ont jamais essayé d'entraîner, par exemple, les infirmiers des hôpitaux ou les enseignants, en allant les voir et discuter. Pourquoi ? L'image d'Epinal fait paraître l'ouvrier en bleu de travail et aux mains calleuses. Mais qu'en est-il des million de chômeurs, des retraités, des salariés de bureaux, des fonctionnaires, des travailleurs précaires...? Qui fait partie de la classe ouvrière ? Répondre à ces questions est primordial pour continuer dans l'avenir à développer, dans la lutte, l'unité et la solidarité. » Nous renvoyons donc le lecteur à l'exposé de cette réunion publique publié sur notre site web : www.internationalism.org [151]
6 "Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter". Proverbe latin inspiré d'une fable d'Esope qui signifie : c'est l'épreuve de vérité, c'est le moment de montrer ce dont on est capable.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Journée de rencontre et de discussion avec le CCI d’août 2007: chercher ensemble une alternative pour cette société agonisante
- 2762 lectures
En août 2007, nous avons organisé une ‘journée de rencontre et de discussion avec le CCI', pendant laquelle les participants ont eu l'occasion de poser ‘librement' des questions et de développer leur argumentation sur les thèmes qui leur tenaient le plus à cœur. Ce n'était pas une journée de spécialistes pour spécialistes mais un moment de débat libre entre participants et de recherche de réponses aux questions suscitées par la période actuelle. Ce fut donc une occasion rêvée de discuter plus à fond de certains sujets ou simplement de mieux se connaître.
L'initiative d'organiser cette journée n'est pas tombée du ciel. Les nombreuses réactions positives et la participation active, pleine d'enthousiasme, des présents ont constitué la preuve qu'une telle réunion répond à un besoin qui vit chez beaucoup : réfléchir ensemble sur le futur, chercher ensemble, et pas chacun dans son coin, une alternative pour cette société agonisante, dans laquelle les catastrophes écologiques, la crise économique, le chômage, la guerre et la famine, avec leurs masses de réfugiés, constituent une réalité quotidienne, qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais aussi, tirer des leçons des expériences du passé, des nombreux efforts et des contributions théoriques, et ceci surtout dans la perspective d'appréhender la dynamique, les mécanismes, les forces qui peuvent constituer cette alternative. Qu'est-ce qui fait changer une société ? Qui peut réaliser les changements nécessaires ? Qui peut imposer un rapport de force et pourquoi ?
La discussion politique et le débat ont toujours constitué un souffle vital pour le mouvement ouvrier car c'est de cette manière que sont clarifiées les questions posées par la lutte de classe et par le combat pour l'alternative historique, le communisme. Toutefois, cette discussion peut prendre des formes fort diverses. Ainsi, nous encourageons toujours à nous écrire et il y a aussi les forums internet. Mais il y a bien sûr surtout des réunions, comme celle de l'été passé, où une discussion directe est possible, où les questions, réponses et réflexions se succèdent dans un vrai débat. C'est là que les positions des présents et les vraies questions suscitées par la lutte de classe sont le mieux valorisées.
Pour arriver à coller le mieux possible aux questions que nos lecteurs et contacts se posent, nous avons fait circuler en préparation de la journée de discussion un questionnaire avec une vingtaine de sujets possibles afin que chacun désigne trois sujets qui lui paraissaient les plus urgents à traiter. Les questionnements ci-dessous ont émergé comme étant prioritaires :
-
Où se situe la frontière entre les classes sociales ? Qui fait partie de quelle classe ? Existe-t-il une frontière et comment la détermine-t-on ? Qu'est-ce que la classe ouvrière et qui en fait partie ? Qu'est-ce qu'elle représente ?
-
Qu'est-ce que le communisme et pourquoi est-il plus que jamais actuel ? Qu'est-ce que la perspective du communisme ?
Nous avons ensuite demandé à quelques participants de préparer une introduction à ces deux discussions et ceux-ci ont réalisé un travail magnifique en introduisant pour les participants quelques principes fondamentaux pour la discussion de ces sujets.
Première discussion : qu'est-ce que la classe ouvrière et qui en fait partie ?
La courte introduction est partie de l'affirmation, souvent entendue, que la classe ouvrière n'existe plus et que, même si elle existait, elle n'arriverait plus à imposer une autre société. La lutte pour le changement de la société serait dès lors devenue vaine. Un des arguments avancés est que le capitalisme a connu de grands changements et que nous connaissons aujourd'hui un modèle économique nouveau avec de grands changements sociaux. Il en découlerait la fin de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière. Pourtant, un capitalisme sans classe ouvrière n'existe pas, il n'y a pas de capitalisme sans exploitation et pas d'extraction de plus-value sans travail salarié. Pour terminer, l'introduction a mis l'accent sur la nature particulière de la classe ouvrière, à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire.
La discussion a démarré sur les chapeaux de roues, surtout grâce aux jeunes qui étaient présents. D'abord, il y a eu des questions générales sur l'existence et la réalité actuelle de la classe ouvrière, ainsi que différentes tentatives pour donner une définition de cette dernière. Depuis le début du mouvement révolutionnaire, en particulier chez Marx, la nécessité d'une définition claire de la classe ouvrière a été ressentie. Si au 19ème siècle, personne ne mettait en doute l'existence de classes, au 20ème siècle, il est devenu plus difficile de les reconnaître. Dans la discussion, un consensus s'est développé qu'il fallait donner une définition à partir d'un processus de croissance historique, celle d'une société capitaliste qui succède à une série d'autres sociétés, de l'Antiquité jusqu'à la période présente. Dans la recherche d'une définition, différents critères ont été avancés, comme la place qu'occupent les travailleurs dans le processus de production. La classe ouvrière n'a pas la propriété des moyens de production et ne décide pas non plus ce qui doit être produit, mais elle vend sa force de production et produit de façon collective la plus-value. Mais si la classe ouvrière est caractérisée en tant que classe exploitée, il y a aussi une classe exploiteuse, la bourgeoisie. C'est alors que la question s'est posée de savoir qui fait partie de la classe ouvrière et qui de la bourgeoisie. Ainsi, à travers des exemples, s'est constituée une image de la méthode qu'il faut utiliser pour trouver des réponses. Où faut-il situer les managers d'entreprises, et toute une série de professions libérales ? Un travailleur a un salaire, un manager aussi mais celui-ci est déduit des bénéfices de l'entreprise pour laquelle il travaille. Quant aux paysans, aux instituteurs ou au personnel hospitalier, ils ne produisent pas directement de plus-value mais participent néanmoins indirectement à la production en permettant la reproduction de la force de travail, ils participent donc au processus de travail comme un tout. La conclusion a été qu'il n'existe pas de frontière claire et définitive entre les classes et qu'on ne peut se satisfaire d'une définition purement sociologique et économique ; la conscience de classe joue aussi un rôle important. Ce qui est décisif est de quel côté l'on se trouve au moment de la lutte de classe et cela fait partie d'une dynamique historique. La discussion a fait référence à des exemples dans l'actualité et dans l'histoire du mouvement ouvrier, ce qui lui a donné un aspect vivant et concret.
L'atmosphère était enthousiasmante. Les participants s'écoutaient et se répondaient, chacun se sentait concerné et, à la demande générale, la discussion s'est un peu poursuivie dans l'après-midi, pour se terminer par une synthèse des points abordés.
Deuxième discussion : nécessité et possibilité du communisme
La deuxième partie de la discussion s'est engagée avec une introduction détaillée dans laquelle a été précisé ce que le communisme est et n'est pas. Les présents ont souligné après coup qu'ils avaient rarement entendu un exposé reprenant une esquisse aussi complète des caractéristiques de la société future. L'exposé a été placé sur notre site web (internationalism.org).
La discussion a mis l'accent sur le fait que le communisme est le produit de toute une évolution de l'humanité et n'est pas fixé à l'avance. Les marxistes ne s'intéressent pas uniquement à la question des luttes immédiates des travailleurs mais surtout aussi à la question de comment obtenir la victoire et quelles sont les tâches principales après la révolution. Le communisme ne naît pas spontanément mais est le produit de la lutte et des orientations pour cette lutte. Si le prolétariat n'engage pas massivement la lutte, la société pourrira et la perspective du communisme s'évanouira. Après toutes les campagnes sur la mort du communisme, la disparition de la classe ouvrière et la faillite du marxisme, on assiste cependant aujourd'hui à une résurgence de la lutte. Peu de questions ont porté sur la nécessité même du communisme. Par contre, il y en a eu d'autant plus sur la possibilité de le réaliser. Cela souligne qu'il y a une certaine prise de conscience de la nécessité d'une autre société mais qu'il subsiste beaucoup de doutes sur les circonstances qui peuvent entraîner la réussite de la lutte prolétarienne. La possibilité de l'instauration du communisme a aussi été liée à la question de la nature humaine. Un participant a estimé que le communisme est la réalisation de la nature humaine mais que ce n'est pas la même chose que ce qui est propre à l'homme, ce qui a mené à des considérations intéressantes. Une autre question qui a été avancée par les présents était : comment la classe ouvrière peut-elle mener le combat contre la bourgeoisie, compte tenu de tous les moyens que cette dernière a à sa disposition ? Cela peut susciter chez les travailleurs un sentiment d'impuissance. Un mouvement de milliers de grévistes paraît dérisoire face à l'ampleur immense de la tâche. Cela pose à son tour la question des obstacles que la bourgeoisie érige et du rapport de force à imposer. Est-ce que la classe ouvrière doit chercher des alliés, comme, par exemple, les masses paysannes dans les pays périphériques ? Bien d'autres points n'ont pu être abordés : la question de la culture, des relations humaines, le rapport homme - femme, la dictature du prolétariat et d'autres points plus pratiques concernant la période de transition du capitalisme vers le communisme.
Prolonger l'enthousiasme. Aidez-nous à préparer la journée de rencontre et de discussion de l'été 2008.
Comme nous l'avons déjà dit, les présents à cette journée ne sont pas les seuls à se poser de telles questions. Dans un article concernant notre dernier Congrès International, nous constatons qu'une nouvelle génération de révolutionnaires surgit (lire Internationalisme 333). Relevons simplement les nombreux débats au sein de petits groupes ou sur internet, les courriers que nous recevons de personnes qui nous contactent pour la première fois, les discussions avec toute une série de nouveaux groupes ou avec des gens que nous rencontrons lors de réunions ou de manifestations. Tout cela témoigne du fait qu'un nombre croissant d'éléments, partout dans le monde, se posent des questions fondamentales à propos de la nature de la société capitaliste et veulent débattre à propos de la manière de mettre en avant une alternative. En tant qu'organisation, nous voulons contribuer autant que possible et partout où c'est possible à ce processus, avec tous les moyens dont nous disposons. Ainsi que nous l'avons souligné dans la conclusion de la journée, un tel débat est une expression de la lutte de classe. La lutte de classe n'est pas seulement une lutte sur un plan immédiat mais c'est aussi une lutte politique pour clarifier.
Le résultat de cette journée de discussion est encourageant : des personnes qui ne se connaissaient pas ont engagé le débat avec un esprit ouvert, se sont écoutées et se sont répondu. Des participants venant de trois pays et de diverses générations se sont réunis et ont discuté en trois langues, une expression concrète de l'internationalisme que nous défendons ardemment, bien éloignée des principes de division et d'inégalité que la bourgeoisie promeut. Ce qui est réalisé ici à une échelle restreinte témoigne de l'énorme puissance que l'ensemble de la classe ouvrière peut générer. La lutte dégage en effet une énergie et une puissance créatrice insoupçonnables. Cette réunion de rencontre et de discussion a donné un avant-goût de ce que le prolétariat représente et est capable de faire.
A la fin de la journée, nous avons demandé une évaluation spontanée aux participants - ils étaient tous enthousiastes. Un des participants l'a exprimé de la façon suivante : « beaucoup de jeunes n'en sont sans doute pas conscients, mais cela fait des années que j'ai participé à une discussion sur le communisme et cela fait vraiment du bien ! Nulle part ailleurs, on débat encore du communisme. Cela demande une suite ! ». Dans une série de discussions informelles après la réunion, une série de sujets ont déjà été avancés pour une nouvelle réunion. A présent, le moment est venu de recueillir le feedback des participants afin de préparer la réunion suivante, dans le courant de l'été 2008. Vu le succès de la formule, nous voulons la répéter et si possible l'étendre à plus de participants encore. C'est pourquoi nous appelons les camarades qui aimeraient contribuer à prendre contact avec nous. Les introductions et synthèses des débats de la journée de 2007 seront également publiées sur notre site web.
CCI / 16.01.08
La CGT encore en flagrant délit de nationalisme
- 3495 lectures
Dans ce tract fumeux protestant contre « la casse de la SNCF 1 », la CGT a réussi le tour de force de ne pas mentionner une seule fois la grève menée par les cheminots l'automne dernier 2. Pas un mot non plus sur les autres secteurs de la classe ouvrière : la « casse » de l'hôpital, des écoles, des administrations, des usines est tout simplement passée sous silence, comme si la SNCF était un cas à part et isolé. D'ailleurs, les termes d'ouvriers ou de travailleurs sont introuvables ! Plus fort encore, pas un seul appel à la lutte ! La CGT préfère parler d'union des « USAGERS - CHEMINOTS » et appeler de ses vœux « le gouvernement [à] créer les conditions d'un large débat public sur le financement du service public SNCF ». Exit les « ouvriers » et « la lutte de classe » donc, place aux « usagers » et au « débat public ».
Pourquoi un discours aussi caricatural ? Pourquoi la CGT ne se couvre-t-elle pas d'un peu du verbiage prolétarien dissimulant d'habitude ses manœuvres ? Pourquoi n'y a-t-il même pas la moindre menace de grève, fusse-t-elle hypothétique et encore plus lointaine ? La raison en est simple. Toute la classe ouvrière subit de plein fouet la crise, tous les secteurs sont touchés. La colère gronde et monte peu à peu. La CGT, comme tous les syndicats, craint qu'un mouvement ne se crée en-dehors de son contrôle et ne fasse tâche d'huile. La CGT joue la "paix sociale" "pas de vague, surtout pas de vagues", pensent aujourd'hui secrètement tous les dirigeants syndicaux.
Et, pour mieux couvrir le grondement de la classe ouvrière, la CGT n'hésite pas à marteler une nouvelle fois "La SNCF appartient à la Nation. La Nation doit pouvoir s'exprimer sur l'avenir de la SNCF !...". Sonnez clairons et trompettes nationalistes !
Depuis des décennies, la CGT applique les slogans nationalistes de son parti de tutelle, le PCF (parti communiste FRANCAIS). Quand en 1945, au nom de la reconstruction, Maurice Thorez (alors secrétaire national du PCF) lance : "Retroussez vos manches pour l'économie nationale", la CGT relaie le message au sein des usines en affirmant que "produire est un devoir". Cela se traduit par la condamnation de chaque grève et la culpabilisation des ouvriers : Benoît Frachon (alors secrétaire général de la CGT 3) appellera ainsi les mineurs du Nord, alors engagés dans une grève dure, à reprendre le travail parce que "Le charbon est le pain de notre industrie". A la fin des années 1970 et tout au long des années 1980, le PCF et la CGT auront pour slogan commun le célèbre "Produisons français 4" ! Au nom de la défense de l'industrie française, les ouvriers seront appelés à défendre "leur" entreprise, quitte parfois à accepter de se "sacrifier" en acceptant les licenciements afin de "sauver l'entreprise" (comme l'avaient demandé en cœur la CGT et le maire PCF de Saint-Etienne lors de la restructuration de la manufacture d'arme Manufrance 5). Surtout, ce slogan puant du "Produisons français" permettra de diviser les ouvriers selon le découpage des frontières nationales, les commandos CGT entraînant par exemple les ouvriers de France à détruire le charbon arrivant d'Espagne.
Ce n'est pas l'intérêt des travailleurs que la CGT défend, mais celui de la nation. Parmi les chiens de garde du capital, la CGT est en tête de meute.
Le nationalisme est un poison !
Les prolétaires n'ont pas de patrie !
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Pawel (25 avril)
1 Le budget 2008 prévoit la suppression de 2000 cheminots s'ajoutant aux 16 000 suppressions des cinq dernières années.
2 Et pour cause, on se souvient tous à quel point la CGT a tout fait pour casser ce mouvement et comment Thibault, le secrétaire général, avait été hué dans les différentes manifestations.
3 Il a aussi été membre du bureau politique du PCF.
4 Ce slogan sera d'ailleurs repris ensuite par Le Pen et son Front National avec un petit plus spécifique : « Produisons français avec des français » !
5 Cette usine finira évidemment par fermer, malgré tous ces « sacrifices ».
Situations territoriales:
La guerre des "chefs" au PS est un problème pour la bourgeoisie, pas pour la classe ouvrière
- 2619 lectures
Le Congrès du parti socialiste, qui s’est tenu à Reims à la mi-novembre, vient confirmer la réalité de la crise politique profonde qui affecte ce parti. Alors que la déroute économique plonge avec une violence et une rapidité inouïes des milliers d’ouvriers dans une misère noire, la principale force d’opposition institutionnalisée censée proposer une “ alternative politique ”, en réalité de la poudre aux yeux destinée à endormir la classe ouvrière, est en proie à une guerre digne des règlements de comptes de la mafia.
Les politiciens de gauche, qui se sont toujours vantés de “ débattre pour des projets au service des citoyens ”, viennent d’exhiber au grand jour le spectacle grand’guignolesque de leurs mesquines rivalités et de leurs haineux règlements de comptes. Alors qu’il y a peu de temps, ils stigmatisaient hypocritement avec une feinte indignation le fait que la droite puisse afficher ses rivalités de cliques et étaler sur la place publique ses intérêts particuliers sordides, ils démontrent aujourd’hui que la gauche possède sur le fond les mêmes mœurs de gangsters et les mêmes méthodes de voyous. Les masques tombent lamentablement. Du coup, les médias ne peuvent couvrir ce sinistre spectacle sans pouvoir empêcher de lever un coin du voile sur ce qu’on peut qualifier de véritable panier de crabes. Manœuvres électorales de couloir, fraude des urnes, chantage, crocs en jambes, coups bas, dénigrements, les accusations réciproques de “ tricheries ” et les “ noms d’oiseaux ” vociférés par les différents clans opposés, débouchent sur une intronisation brutale, aux forceps, de la nouvelle secrétaire générale Aubry. Ses tentatives pour faire bonne figure, soit en parlant de “ rassemblement ”, soit en prétendant qu’il existe “ deux lignes politiques ”, n’atténuent en rien l’image d’une guerre intestine au sein d’un PS devenu une véritable “ pétaudière ” ayant perdu toute crédibilité de “ parti responsable ”1. Même le plus abruti des supporters de l’un ou l’autre camp ne peut croire à une “ confrontation des idées ” ! Comme le dit si bien Julien Dray à propos des textes politiques livrés au congrès : on ne “ voit pas d’énormes différences, à moins de vouloir cultiver les virgules et nuances ”. Seules les rivalités de personnes et de clans sont à l’œuvre !
Est-ce, comme tendent à le marteler les médias aux ordres, un simple problème “ d’ego boursouflé ” ? Est-ce, comme ils veulent le faire croire encore, un “ drame ” pour l’ensemble des exploités ?
En réalité, ce chaos dans le parti socialiste, s’il se nourrit bien “ d’un choc d’ego boursouflés ”, trouve surtout ses origines dans sa nature bourgeoise, dans l’impasse, la faillite du système capitaliste, dans les miasmes de sa phase historique de décomposition. Le capitalisme ne peut plus rien offrir d’autre que les fléaux qui s’abattent sur le monde. Et les vernis idéologiques du PS sont usés jusqu’à la trame, incapables de susciter le moindre élan d’adhésion des populations. La réalité dément tous les beaux discours ! Ils ne font pas rêver du tout les “ petites gens ”, selon l’expression de Ségolène Royal. L’état lamentable du PS en France n’est d’ailleurs un cas ni unique, ni isolé. Ses difficultés, sous formes diverses, se rencontrent aussi dans d’autres partis d’opposition et dans d’autres pays, comme on le voit par exemple avec la gauche émiettée en Italie.
De plus en plus, le “ chacun pour soi ” tend à exacerber la concurrence au sein même des différentes fractions et cliques bourgeoises. Le gâteau se rétrécit ; même le sens de l’intérêt de l’Etat, qui était un certain apanage des partis de gauche, et en particulier du PS, et qui faisait sa force, est perdu de vue ! Chacun se lance dans une course éperdue pour défendre bec et ongles sa carrière, mêlant par exemple au PS le siège convoité de premier secrétaire à des ambitions pour les présidentielles de 2012. Chacun voulant sa place réservée au soleil, joue des coudes, fait jouer ses réseaux, soigne sa carrière et avance ses pions. Un Kouchner n’a d’ailleurs jamais trahi les siens en entrant au gouvernement : il est allé “ à la soupe ”, vers ce qu’il a jugé le meilleur “ créneau ” pour sa carrière ! La leçon est claire : les bourgeois n’ont pas de conviction, ils n’ont que des intérêts carriéristes assujettis non seulement à la logique concurrentielle et individualiste du système qu’ils défendent mais aussi à ses mœurs corrompues et cyniques de gangsters.
La classe ouvrière n’a donc rien à déplorer ou à regretter par rapport au délabrement actuel du PS, comme organe de la classe dominante. C’est au contraire la bourgeoisie qui s’inquiète du fait qu’elle se trouve dans une situation plus délicate pour encadrer la classe ouvrière, sans opposition vraiment crédible. La classe ouvrière n’est pas affaiblie par le sort minable de ceux qui sont en réalité ses ennemis. Elle ne doit pas compter sur les politiciens bourgeois, sur les faux amis que sont les partis de gauche qui n’ont fait qu’attaquer ses conditions de vie avant l’arrivée au pouvoir de Sarkozy.
Ce n’est que sur sa conscience et sa force collective, dans les luttes massives et unies, par la solidarité de classe à l’échelle internationale, que le prolétariat devra puiser son énergie, montrer qu’il est la seule véritable force d’avenir pour changer le monde.
WH (17 décembre)
1 On a parlé aussi de “ guerre des deux roses ”, allusion à un terrible conflit meurtrier (à la fin du XVe siècle), opposant les maisons royales rivales d’York et de Lancastre, toutes deux revendiquant l’accession légitime au trône d’Angleterre et ayant quasiment mené à l’autodestruction de l’aristocratie anglaise.
Situations territoriales:
La montée en puissance de l'impérialisme chinois
- 6748 lectures
Profitant de la dislocation des anciens blocs impérialistes de l'après-« Guerre froide » et, notamment, de la perte d'influence des États-Unis, la Chine avance de plus en plus ouvertement ses propres pions de grande puissance.
« La montée en puissance de la Chine et la poursuite de ses intérêts sont indissociables du sentiment d'avoir retrouvé une place historique légitime et d'un besoin psychologique profondément enraciné, que le pouvoir en place n'est que trop heureux d'exploiter. Les ambitions chinoises sont attisées par un nationalisme nourri de blessures de l'histoire et de grandeur avortée, un nationalisme étrange et incompris dans un occident par trop complaisant. (...) La Chine s'est fixée des buts contraires aux intérêts américains, à savoir supplanter la suprématie américaine en Asie, empêcher les États-Unis et le Japon d'établir un front d'endiguement à l'encontre de la Chine et, enfin, déployer son armée dans les mers de Chine méridionale et orientale afin d'acquérir la maîtrise des principales voies maritimes de la région. La Chine a des visées hégémoniques. Son objectif principal, c'est qu'aucun État - qu'il s'agisse du Japon exploitant ses droits de prospection pétrolière dans la mer de Chine orientale ou de la Thaïlande autorisant l'accès de ses ports aux navires de la flotte américaine- ne puisse rien entreprendre sans tenir compte au préalable des intérêts chinois. Ce scénario s'inscrit dans une ambition autrement plus vaste : le défi à la suprématie mondiale de l'Occident, des États-Unis au premier chef.
(...) A ce titre, d'alliée stratégique des États-Unis, elle deviendra son adversaire durable. Une comparaison qui n'augure rien de bon s'impose ici. De 1941 à 1945, les États-Unis nouèrent une alliance stratégique avec l'Union soviétique, l'une des pires dictatures de tous les temps, afin de venir à bout de l'Allemagne nazie. A la fin de la guerre, à cause de la rivalité naturelle entre ces deux superpuissances, l'alliance se défit. Les relations amicales qu'entretinrent les États-Unis et la Chine dans les années 1970 et 1980 ne sont pas sans rappeler l'alliance américano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Véritables alliances de contraires, leur nécessité provenait d'une menace immédiate, l'Allemagne nazie dans un cas et l'expansionnisme soviétique dans l'autre. Une fois la menace écartée, les alliances ne résistèrent pas longtemps aux divergences de valeurs et d'intérêts. »1
Bien qu'un peu daté, l'ouvrage dont cette citation est tirée donne un éclairage particulier sur la réalité de la montée inexorable de la puissance chinoise qui revendique et assume clairement ses ambitions impérialistes planétaires. En effet, l'essentiel des éléments avancés par les auteurs en décrivant les perspectives des relations entre la Chine et les États- Unis correspondent largement à ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, sous le titre « Rivalités militaires en Asie : La Chine affirme ses ambitions navales », un article du Monde diplomatique de septembre 2008, en fait très clairement la démonstration : « (...) Toutefois, Taiwan n'est que l'une des pièces d'un vaste jeu de go maritime. La Chine s'oppose ainsi au Japon à propos des îles Diaoyu (Sankaku en japonais), à proximité de l'île d'Okinawa, qui abrite une base américaine. Tokyo martèle que sa ZEE s'étend à 450 kilomètres à l'ouest de l'Archipel, ce que Pékin conteste en revendiquant l'ensemble du plateau continental prolongeant son propre territoire en mer de Chine orientale. Enjeu annexe du conflit : un gisement qui pourrait abriter jusqu'à 200 milliards de mètres cubes de gaz. La Chine dispute aussi à Taiwan, au Vietnam, aux Philippines, à la Malaisie, à Brunei et à l'Indonésie les îles Spratleys (Nansha en Chinois) et l'archipel des Pratas (Dongsha). Elle s'écharpe avec le Vietnam et Taiwan pour l'archipel des Pracels (Xisha).
(...) Une fois ces verrous ouverts, la Marine Chinoise pourra se consacrer plus librement au deuxième enjeu : la sécurisation des couloirs d'approvisionnement en hydrocarbures en Asie du Sud. Le premier de ceux-ci conduit les pétroliers de moins de 100 000 tonnes, depuis l'Afrique et le Proche-Orient jusqu'à la mer de Chine méridionale via le détroit de Malacca. Des mêmes zones de production, le deuxième couloir mène les pétroliers géants à travers les détroits de la Sonde et de Gaspar. Le troisième, depuis l'Amérique latine, passe par les eaux philippines. Le quatrième, trajet de rechange depuis le Proche-Orient et l'Afrique, serpente entre les détroits indonésiens de Lombok et de Macassar, les Philippines et le Pacifique ouest avant de rallier les ports chinois. »
Quelles ambitions impériales !Manifestement, la Chine ne veut pas être un simple « atelier du monde » capitaliste, mais entend, plus que jamais, appuyer sa croissance économique et son développement pour protéger ses propres intérêts impérialistes partout dans le monde, en se préparant ainsi à affronter toute puissance qui voudrait lui résister, y compris au plan militaire. Dans le même sens, Pékin construit et développe de vastes manœuvres diplomatiques et géostratégiques auprès de nombreux pays pouvant lui servir de ponts. En effet, si l'Inde et le Japon sont historiquement depuis longtemps dans son collimateur, la Chine se sert du Pakistan comme tête de pont, à la fois pour contrer l'alliance entre Washington et New-Delhi et pour accroître son influence dans le golfe arabo-persique et en Asie centrale. Mais, le plus frappant encore, c'est la volonté de Pékin de lutter pour préserver ses approvisionnements énergétiques jusqu'au cœur du Golfe persique et du Moyen-Orient, la zone la plus explosive et la plus convoitée au monde par tous les brigands en chef, à leur tête les États-Unis. Cela veut dire que Pékin n'hésite plus à venir chasser sur le même terrain que Washington considère, depuis des décennies, comme relevant de « son intérêt national ». Cela en dit long sur l'aggravation des risques de confrontations majeures entre la Chine et les États-Unis dans cette zone et ailleurs. Mais d'ores et déjà, la confrontation entre Pékin et Washington est très vigoureuse sur le plan diplomatique, en particulier à l'ONU.
Des
manœuvres navales aux manœuvres diplomatiques
Mieux que quiconque, la Chine sait utiliser la diplomatie pour défendre ses intérêts, en particulier au sein de l'ONU, le bastion suprême des manœuvriers impérialistes. Par exemple, lorsque le Japon manifeste en 2005 son intention de devenir membre permanent du Conseil de sécurité, avec accès au sacré « droit de veto », la Chine décrète aussitôt la mobilisation générale de l'ensemble de son corps diplomatique pour contrer à tout prix l'initiative de Tokyo soutenue par Washington. Ainsi, lors de ce bras de fer, on a vu la Chine se rappeler soudain de sa prétendue appartenance à l'ex- Groupe des 77 dit des « non alignés », en se mettant à « séduire » et « arroser» certains de ces derniers de toutes sortes de promesses et de crédits et, au bout du compte, le gang chinois a pu effectivement barrer la route à son rival japonais (ce qui signifie aussi une claque pour le parrain américain). De même, la Chine joue régulièrement les empêcheurs de tourner en rond en s'appuyant sur son droit de veto pour bloquer systématiquement les initiatives américaines visant, par exemple, à sanctionner Téhéran sur la question nucléaire ou d'autres clients de Pékin (à l'instar du Zimbabwe, de la Corée du Nord, du Myanmar, etc.). En clair, le temps est révolu où les États-Unis pouvaient prétendre faire seuls la pluie et le beau temps à l'ONU et à son Conseil de sécurité. Désormais, Pékin dispute ouvertement ce rôle à Washington. Cette rivalité s'est particulièrement concrétisée au Soudan où Pékin, qui arme le pouvoir soudanais et achète son pétrole, a fermé obstinément les yeux durant des années sur les atrocités que commet le gouvernement de Khartoum au Darfour. Egalement, optant pour la même hypocrisie et le même cynisme que les puissances occidentales agissant au nom des « droits de l'homme », la Chine explique son attitude au nom du respect « de la souveraineté des États (amis) ».
La
Chine fait « un grand bond » en Afrique
Si tout le monde est convaincu que la Chine cherche à étendre son influence sur tous les continents, c'est cependant en Afrique que son offensive est plus massive notamment au plan économique. Mais pour Pékin, il n'y a pas que le domaine économique, il y a aussi le militaire et le géostratégique pour asseoir et préserver ses intérêts impérialistes globaux. En effet, la Chine arme des régimes et vend des armes à de nombreux clients du continent. Dès le début des années 1990/2000, fortement marquées par les massacres en masse et le chaos sanglant dans les principales régions du continent, on savait que Pékin était le fournisseur militaire (souvent masqué) de nombreux pays, notamment dans les Grands Lacs. Ainsi par exemple, les armes chinoises ont servi à commettre les horribles atrocités débouchant sur des millions de victimes en RDC.
En effet, étant devenue pratiquement une grande puissance comme les autres, la Chine brigue désormais le rôle de gangster n°1 en Afrique et, de fait, l'impérialisme chinois est en train de repousser certains de ses concurrents hors de leurs positions traditionnelles. Dans cette optique, il va de soi que la France est pleinement dans le collimateur de la Chine.
La
« Chinafrique » tend à supplanter la « Françafrique »
La Chine a investi dans presque tous les pays du continent africain en mobilisant tous les moyens pour y garder des positions fortes au point d'évincer de fait la France dans un bon nombre de pays appartenant à l'ancien pré-carré de Paris. Comment la Chine s'y prend-elle, avec quelles méthodes ? Prenons un seul exemple qui résume et illustre la force de frappe de la Chine : dans le BTP, les Chinois défient tous leurs concurrents en affichant des prix de 30 à 50 % inférieurs à ceux proposés par les Français. Cela veut dire que certains grands groupes français, comme Bouygues, sont directement menacés par le rapace chinois partout où ils sont implantés ou cherchent à le faire. Du coup, certaines entreprises françaises tentent désespérément de se replier dans d'autres pays africains se situant en dehors de l'ancien bastion colonial de la France (comme l'Afrique du Sud ou l'Angola), où évidemment la concurrence n'est pas moins rude pour autant. De toutes les façons, la Chine utilise grosso modo la même arme des « prix bas » dans tous les autres domaines commerciaux, armement compris. Pour tout dire, la menace chinoise à l'encontre de la France est globale.
L'impérialisme français perd du terrain quasiment partout dans son ancien bastion colonial, aussi bien économiquement que politiquement. D'ailleurs, symboliquement, il est hautement significatif de voir la Chine « draguer » ouvertement la Côte d'Ivoire, ancienne « vitrine », ou « fleuron économique » d'antan de la France en Afrique. En effet, non seulement les grands groupes français sont menacés par l‘offensive chinoise, mais au niveau de l'État, le président ivoirien Gbagbo lui-même est très courtisé par Pékin qui le « protège » à l'ONU contre des sanctions et qui, un moment, a pu lui assurer ses fins de mois afin de payer les salaires des fonctionnaires, chose que Paris ne fait plus. L'autre acte symbolique fort, c'est quand Pékin se met à organiser, lui aussi, ses propres « sommets Chine-Afrique ». Voilà une autre réplique chinoise qui a tout son sens à destination de l'ancienne puissance gaullienne.
Par ailleurs, si la France devait évacuer ses bases militaires en Afrique (son principal atout), comme l'a annoncé le président Sarkozy, la Chine serait, sans aucun doute, très heureuse de l'évincer définitivement du continent.
Les manifestations concrètes de la volonté de la Chine de jouer les premiers rôles dans l'arène impérialiste ne font que débuter et ses principaux rivaux ne manqueront pas une occasion de réagir à la hauteur des enjeux posés par les ambitions chinoises. Autant dire qu'aucun discours de paix et d'entente entre les nations ne pourra suffire à masquer cette réalité, synonyme de désolation et de destructions matérielles et humaines.
Amigos (20 décembre)
1 Bernstein/Munro, Chine- Etats-Unis : danger, Editions Bleu de Chine, 1998
Géographique:
- Chine [153]
La violence des jeunes émeutiers est-elle plus "radicale" que celle des étudiants contre le CPE ? (courrier de lecteur)
- 3451 lectures
Le retentissement international des événements survenus en France, les émeutes de fin 2005 et le mouvement anti-CPE du printemps 2006, ont polarisé la réflexion de ceux qui sont à la recherche d'une perspective et des moyens à employer pour en finir avec ce système de misère qu'est le capitalisme. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux événements ? Entre les émeutes et les assemblées générales massives, laquelle de ces formes porte la promesse de l'émergence d'une lutte véritablement révolutionnaire ? Quel est le rôle de la violence de classe ? Telles sont les questions essentielles abordées dans l'échange de correspondance entre le CCI et un camarade en Russie à propos d'un article de Révolution Internationale de décembre 2006 (RI n° 374) :« Emeutes des banlieues ou mouvement anti-CPE : quelles méthodes de luttes pour l'avenir ? » 1. Cet échange de correspondance, initialement publié sur notre site en langue russe (https://ru.internationalism.org/ [154]) et traduit ici, montre parfaitement que les mêmes questions essentielles se posent partout à la classe ouvrière et que dans tous les pays est en train de se développer progressivement une réflexion sur « comment lutter ? ». A ces questions de dimensions internationales posées à la classe ouvrière, les minorités doivent répondre par un débat vivant et fraternel animé lui aussi inévitablement à l'échelle internationale.
Le
courrier de notre lecteur
Il est difficile de se faire une image complète des événements qui se sont produits en France quand on vit en Russie et, qui plus est, en province. Dans l'article du CCI contre l'OCL, il est évident qu'il y a deux approches diamétralement opposées concernant ces événements. Mais il y a beaucoup de points communs entre ces deux positions. Ni l'une ni l'autre ne font un effort pour analyser les événements, et si l'OCL tente de diffamer et de traîner dans la boue le mouvement des étudiants, le CCI fait la même chose en ce qui concerne les participants aux émeutes de l'automne 2005.
Pour tout marxiste, il ne peut pas y avoir de prolétariat pauvre, puisque ce sont là les conditions objectives qui le constituent (le prolétariat). C'est pourquoi ni l'un ni l'autre ne se tient sur des positions marxistes, bien que tous les deux se considèrent eux-mêmes comme des communistes. Même Noske2 se considérait lui-même comme l'expression des intérêts de la classe ouvrière, mais ceci ne l'a pas dérangé pour supprimer la révolution.
Le CCI écrit que les participants aux émeutes n'ont aucun rapport avec la classe ouvrière. Vous vous trompez, Messieurs ; ceci est la plus authentique lutte de classe. La bourgeoisie dénigre par tous les moyens ce mouvement des ouvriers de banlieue, pour présenter ceux qui y ont participé comme des bandits et des criminels. Et même le CCI rejoint cette analyse, en se faisant ainsi le défenseur des intérêts de la bourgeoisie.
En réalité, c'était un soulèvement d'ouvriers, provoqué par le chômage, la pauvreté et l'arbitraire des autorités, par les conditions dans lesquelles se trouvent les ouvriers. Et si quelqu'un est coupable de ces événements, ce sont les autorités elles-mêmes. Ceci est la conséquence de l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Est-ce que ceci indique que je défends le point de vue de l'OCL ? Naturellement non !
La première différence évidente est que le mouvement des étudiants a été plus ou moins organisé contrairement aux émeutes, qui se sont produites spontanément et confusément. Le CCI, comme la bourgeoisie, essaie de dénigrer le mouvement dans les banlieues au lieu de poser la question : de quel terreau social ce mouvement est-il le produit et pourquoi a-t-il eu un caractère si spontané ? Pourquoi cette lutte de classe a-t-elle pris, pour dire honnêtement la vérité, des formes négatives ? Peut-être parce qu'elle n'a pas été organisée ?
Ce n'est pas de leur faute si les ouvriers ne sont pas organisés, mais c'est bien leur malheur. Et, ici, je veux demander où étaient les organisations communistes quand la crise s'est produite ? Pourquoi le travail envers les banlieues ouvrières n'a-t-il pas été conduit pour organiser leur combat ? Et disons-le franchement, dans les événements passés, il y a une part de responsabilité des organisations communistes qui se sont avérées incapables de coordonner les actions de la classe ouvrière, et ceci a fini dans un grand fiasco. Si le visage reflété dans le miroir ne vous plaît pas, n'en rendez pas le miroir responsable.
Dans l'article, l'importante question de la violence révolutionnaire est soulevée. Le CCI écrit que « l'Etat a multiplié les provocations lors du mouvement anti-CPE, espérant entraîner à leur tour les étudiants dans l'impasse de la violence des émeutes ». Dans la mesure où je sais que le CCI veut établir le socialisme, mais qu'il est contre la violence, la construction du socialisme selon une voie pacifique est un programme social-démocrate. Comme chacun sait, l'ensemble de la social-démocratie occidentale a condamné Lénine en octobre 1917 pour avoir engagé la classe ouvrière en Russie dans l'impasse de la violence stupide !
Mais en même temps, la tactique de l'aventurisme de gauche ne convient pas pour le prolétariat. Il est connu qu'en juillet 1917, Lénine tint sous contrôle des aventuriers du même type que l'OCL, qui tentaient de donner un caractère plus radical au mouvement de la classe ouvrière. Certainement pas parce qu'il avait peur de la violence comme le CCI, mais parce qu'il voulait préserver les forces de la classe ouvrière pour l'offensive décisive.
De l'ensemble des choses dites ci-dessus, il est évident que le CCI s'embourbe dans le marais de l'opportunisme et de la social-démocratie. Ce n'est pas un problème de la classe ouvrière mais du CCI lui-même. (6 avril 2007)
Notre réponse
Cher camarade,
Nous voulons saluer ta volonté de prendre position sur des questions aussi cruciales que celles des émeutes en France en novembre 2005, et plus encore sur le mouvement anti-CPE des jeunes prolétaires au printemps 2006 et sa signification, ainsi que sur les questions que posent ces mouvements, notamment celle de la violence.
Engager la réflexion sur ce que représente et annonce le mouvement contre le CPE est de la plus haute importance pour l'avenir de la lutte des classes.
Les émeutes de 2005 et le mouvement des étudiants du printemps 2006 ont tous les deux les mêmes racines, l'impasse de la société capitaliste, sa crise économique, qui provoque l'inexorable dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière, et qui n'offre comme perspective que la précarité et l'accroissement de la misère, la marginalisation pour une partie sans cesse plus grande des prolétaires condamnés à subir le fléau du chômage. Dans les deux cas, ces mouvements ont impliqué des jeunes prolétaires, révoltés par les conditions qu'on leur impose et que la bourgeoisie leur promet encore d'aggraver.
Mais au-delà de ces points de convergence, de profondes différences distinguent les deux mouvements.t.
Les émeutes ont impliqué une minorité infime des jeunes des quartiers populaires des banlieues ; elles ont représenté une explosion de colère aveugle, sans perspective. Dans leur rage désespérée, ils ne s'en sont pas pris aux symboles de leur oppression (les postes de police, les édifices officiels de l'Etat capitaliste, etc...) mais aux voitures de leurs voisins, aux équipements sociaux de leur quartier... De tels mouvements de violence, le recours à l'émeute, ont déjà existé dans le passé, mais ils ont toujours été la manifestation d'un prolétariat encore peu conscient du but final de son mouvement et de ce qui fait sa force réelle. Au-delà d'affirmer sa solidarité avec eux, le CCI pouvait-il encourager les jeunes émeutiers à continuer à s'engager dans ce genre d'action ?
A l'inverse, le mouvement des étudiants, dans leur grande majorité jeunes prolétaires encore en formation, au printemps 2006, a constitué l'émergence d'une perspective produite par la classe ouvrière. Il a été un grand mouvement de masse rassemblant autour de lui des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers. Il s'est clairement déroulé en réaction aux attaques économiques de la bourgeoisie. Il s'est doté d'assemblées générales massives, forme d'organisation spécifique du prolétariat.. Il s'est caractérisé par la forte volonté d'étendre cette lutte au reste de la classe ouvrière pour la faire entrer en action à ses cotés. Justement, alors que la police française manipulait les jeunes des banlieues en les poussant à s'affronter aux manifestants étudiants, présentés comme des « nantis », des « bourgeois », ceux-ci ont envoyé de larges délégations dans les quartiers ouvriers et se sont adressés aux jeunes des banlieues pour leur expliquer que cette lutte était aussi la leur, pour les intégrer à la lutte, ce qu'ils ont fait finalement, en se rendant massivement aux manifestations suivantes.
Contrairement à ce que tu sembles affirmer, le CCI ne condamne pas en soi l'usage de la violence. Le mouvement ouvrier devra savoir l'employer pour le renversement de l'Etat capitaliste. Mais le prolétariat ne peut pas utiliser n'importe quel type de violence, ni l'employer n'importe comment ou dans n'importe quelles conditions. Notamment, l'emploi de la violence doit être au service du renforcement du mouvement ; elle doit exprimer la force collective du prolétariat et être utilisée de façon consciente, appropriée à son but final qui est de construire une société vraiment humaine3.
Tu sembles par ailleurs penser que le refus des affrontements avec la police constituait à ce moment-là une erreur, un manque de radicalité du mouvement. Mais de quoi s'agissait-il en réalité ?
Il est important de rappeler que les étudiants ont en réalité refusé de tomber dans le panneau d'un véritable traquenard de la bourgeoisie et de l'Etat, associant ses organes que sont les forces de police et les syndicats, consistant à pousser aux affrontements avec les forces de police. L'objectif était de diviser le mouvement, de le discréditer aux yeux du reste de la classe ouvrière et, en focalisant son attention sur l'usage de la violence stérile contre les flics, de le détourner de l'objectif de consacrer le maximum de ses forces à contribuer à élargir le mouvement. Ce faisant, la bourgeoisie cherchait clairement la débandade et le défaite précipitée du mouvement.
Dans ces conditions, les étudiants n'ont-ils pas eu raison de refuser ce piège tendu par l'ensemble des forces bourgeoises, de ne pas compromettre et préserver toutes les potentialités que recelait le mouvement pour gagner à lui d'autres catégories d'ouvriers ?
Bien fraternellement.
Cette lettre envoyée au camarade en réponse à son courrier, conçue comme un moment de cet échange épistolaire, était volontairement concise et ne traitait donc pas de l'ensemble des questions soulevées. En particulier, un aspect important fut momentanément laissé de côté, celui du rôle des organisations révolutionnaires dans la lutte. Le camarade nous écrit en effet « La première différence évidente est que le mouvement des étudiants a été plus ou moins organisé, contrairement aux émeutes, qui se sont produites spontanément et confusément. [...] Pourquoi cette lutte de classe a-t-elle pris, pour dire honnêtement la vérité, des formes négatives ? Peut-être parce qu'elle n'a pas été organisée ? Ce n'est pas de leur faute si les ouvriers ne sont pas organisés, mais c'est bien leur malheur. Et, ici, je veux demander où étaient les organisations communistes quand la crise s'est produite ? Pourquoi le travail envers les banlieues ouvrières n'a-t-il pas été conduit pour organiser leur combat ? ».
Notre lecteur semble donc penser que si les émeutiers en 2005 avaient été "organisés" comme les étudiants en 2006, ils auraient pu être le détonateur des luttes ouvrières. Ce faisant, il reproche au CCI de n'avoir pas rempli son rôle d'"organisateur" de la lutte.
La première chose que l'on doit dire c'est que ce n'est pas le CCI qui a organisé le mouvement des étudiants en 2006. Aucune organisation politique (même celles qui ont les moyens les plus puissants) ne peut mobiliser les masses. Nous savons pertinemment que les minorités révolutionnaires n'ont pas le pouvoir de déclencher les luttes du prolétariat avec une baguette magique. C'est la "vieille taupe de l'histoire" qui a fait ce travail de maturation souterraine de la conscience et a permis que ressurgissent dans les jeunes générations les vieilles méthodes de lutte du prolétariat : les assemblées générales souveraines, les comités de grève, les délégations mandatées et révocables, etc. En 2006, nos militants sont intervenus dans certaines AG, de façon très ponctuelle et en fonction des forces dont nous disposions. Si nos interventions ont été applaudies avec enthousiasme, ce n'est pas parce que nous étions nombreux, mais tout simplement parce que les orientations que le CCI a toujours mises en avant (et qui sont très minoritaires dans la société) coïncidaient avec les besoins ressentis par la grande majorité des étudiants en lutte.
Quant aux adolescents qui se sont laissé embarqués dans la révolte désespérée des émeutes en 2005, il était bien difficile de leur donner une orientation puisqu'ils ne faisaient pas d'assemblées générales et ne faisaient aucun débat politique. Les "actions" minoritaires et violentes des émeutiers n'ont évidemment pas été discutées et votées à la majorité. Et il eut été totalement stérile d'aller au milieu des affrontements entre eux et les forces de répression pour leur dire qu'en brûlant les voitures, les bus, les écoles, ils ne s'en prenaient pas à la bourgeoisie mais aux ouvriers.
La seule chose que les révolutionnaires pouvaient faire, c'est d'abord essayer de comprendre ces événements pour mettre en avant que la seule réponse au désespoir des émeutiers, la seule riposte au renforcement de la répression de l'État capitaliste, se trouve dans la lutte du prolétariat pour le renversement du capitalisme. Ce n'est pas en s'adressant aux émeutiers pendant les échauffourées que le CCI pouvait exprimer sa solidarité envers cette jeunesse désœuvrée mais en s'adressant à toute la classe ouvrière pour œuvrer au développement de sa conscience en mettant en avant les moyens dont se dote le prolétariat pour réaliser son projet révolutionnaire : les grèves, les manifestations, les assemblées générales massives dans lesquelles la passion du débat est fondamentale... C'est bien là qu'est la véritable solidarité envers toute la classe ouvrière, jeunesse des banlieues comprise, car tant que le prolétariat n'aura pas la force d'engager des luttes massives sur son propre terrain de classe et fait surgir ses formes d'organisation unitaire, tant qu'il sera prisonnier des manœuvres syndicales et du syndicalisme, tant qu'il n'aura pas développé sa conscience,... des émeutes sporadiques de plus en plus violentes seront contenues dans la situation historique actuelle (comme on l'a vu en France deux ans après celles de 2005, à Villiers-Le-Bel en novembre 20074).
Nous ne pouvons pas répondre, dans le cadre de cet article, à tous les arguments de notre lecteur. Nous espérons avoir répondu à ses principales critiques. Bien évidemment, nous restons ouverts à d'autres critiques, d'autres arguments, et sommes tout à fait disposés à y répondre publiquement dans notre presse.
Leïla, le 9 mars 2008
1 Cet article fut publié en réponse à l'Organisation Communiste Libertaire (OCL) suite à l'apparition dans son mensuel Courant Alternatif de l'été 2006 d'un long dossier intitulé : "Les émeutes de banlieues au regard du mouvement anti-CPE".
2 Noske, social-démocrate membre du SPD et de la IIe Internationale, fut à la tête de la répression d'une extrême brutalité qui écrasa les masses ouvrières lors de la révolution allemande en 1919-1920 et fit assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, en proclamant : « Il faut un chien sanglant,, je ne recule pas devant cette responsabilité » (NDLR).
3 Voir notre article sur notre site Web (internatiopnalism.org) « Terreur, terrorisme et violence de class ».
4 Lire notre article sur notre site Web (internationalism.org) : « Emeutes à Villiers-le-Bel : face à la violence économique et policière du capital, seule la lutte ouvrière est porteuse d'avenir ».
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [127]
Récent et en cours:
- Banlieues [155]
- Mouvement étudiant [60]
Le plan de lutte contre la cybercriminalité, un prétexte pour renforcer l'État policier
- 2925 lectures
-
Passage de 8 policiers et gendarmes affectés à l'Office central contre la cybercriminalité à une cinquantaine et création de 150 "cyberenquêteurs" régionaux à la police judiciaire (PJ).
-
Surveillance accrue des fournisseurs d'accès à internet qui devront fournir les données d'accès des "connexions suspectes" avec le blocage des sites "à caractère douteux".
-
Mise en place de systèmes de mouchards (équivalents des écoutes téléphoniques pour le net) dans le cadre d'enquête pour "délinquance aggravée" avec captage à distance des données d'un ordinateur.
-
Et enfin, ouverture d'un cybercommissariat recevant des plaintes comme la délation de particuliers.
La police, la surveillance et la répression deviennent des éléments permanents de notre quotidien. Contre la menace terroriste, davantage de flics. Contre l'insécurité routière, davantage de flics. Contre la cybercriminalité, davantage de flics. La prochaine Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (Lopsi2) doit prolonger pour quatre ans encore les mesures «d'exception» prises suite à l'attentat de Londres en 2005 : les soldats, mitraillettes en bandoulière vont rester encore longtemps sur les quais de gare et de métro, et les caméras de surveillance vont continuer de fleurir un peu partout, à chaque coin de rue.
Toutes ces mesures n'ont qu'un seul véritable but : faire en sorte que la "population", c'est-à-dire la classe ouvrière, s'habitue peu à peu au quadrillage par l'Etat français. La classe ouvrière doit se savoir «protégée» mais aussi, et surtout, surveillé en permanence. Il y a ici une dimension de menace latente, une volonté d'impressionner la classe ouvrière pour l'inhiber. "Faites attention, on vous surveille". Le Figaro, en date du 4 juillet, nous donne par exemple un aperçu de l'utilisation possible de la vidéosurveillance : "Lors du mouvement contre le CPE, la police a (...) expérimenté le renvoi des images par satellite considéré comme une solution d'avenir. "
Si cette pression peut être perçue plus intensément par les ouvriers qui commencent à réfléchir sur ce monde et à vouloir lutter, tant mieux, se dit la classe dominante. C'est pourquoi MAM n'a hésité à rappeler, lors de la présentation de son plan de lutte contre la cybercriminalité, les groupes comme "Action directe, la Fraction Armée Rouge ou les Brigades rouges" et leurs liens avec les "partis politiques extrêmes", autant de menaces terroristes à venir. L'assimilation de ces dérives gauchistes et activistes au mouvement ouvrier est du pain béni pour l'Etat policier. Face à la montée actuelle des luttes ouvrières à travers le monde, la bourgeoisie s'empresse de parler de "résurgence violente de l'extrême gauche radicale". Ce n'est pas par hasard si un groupe de jeunes «d'extrême gauche», se définissant eux-mêmes comme "anarcho-autonomes", a récemment fait les frais d'une interpellation de la cybersurveillance policière pour "visées terroristes". Lesquelles ? On n'en sait rien. Mais Michèle Alliot-Marie rappelle elle-même "les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale". En réalité, dans un contexte où les luttes ouvrières sont appelées à se développer de plus en plus massivement, il s'agit de pointer du doigt et d'avertir que tout discours anti-étatique ou anti-bourgeois sera considéré comme "terroriste".
Il ne faut pas se leurrer, l'Etat français et sa police n'ont pas attendu ce plan d'action pour surveiller et infiltrer ordinateurs et correspondances internet de façon ciblée. Mais "Big Mother" permet à la répression de faire encore un pas en avant dans le flicage de la population.
Mulan (19 février)
Géographique:
- France [45]
Mobilisation massive contre la réforme de l'enseignement en Italie : "nous ne voulons pas payer pour leur crise !"
- 2544 lectures
- « Nous ne voulons pas payer pour leur crise ! » est le slogan qui a été adopté par le mouvement des étudiants dans toutes les villes italiennes.
Les attaques de la bourgeoisie
Le monde de l'école et des universités est retourné massivement dans la rue en Italie le 14 novembre, après les gigantesques manifestations du 25 octobre rassemblant des centaines de milliers de personnes en opposition au décret Gelmini et quarante ans après les formidables mouvements qui ont ébranlé le monde entier à partir de mai 1968 en France - et des luttes de 1969 en Italie. Au niveau de l'enseignement, le décret Gelmini est surtout contesté à cause des coupes budgétaires qu'il impose dans l'Education nationale et des conséquences de ces restrictions sur la baisse de qualité de l'enseignement. De fait, la nécessité de faire des économies sur les dépenses scolaires implique en général :
-
la réduction du temps passé dans les crèches et les écoles primaires ;
-
la réduction drastique de personnel (touchant à la fois les postes enseignants, administratifs et techniques), le non-renouvellement des contrats et la réduction des horaires de travail : 87 000 enseignants précaires et 45 000 travailleurs de l'ABA (équivalent des ATOS en France) ne seront plus réembauchés ;
-
l'augmentation du nombre d'élèves par classe ainsi qu'une disparition des enseignements techniques et de la deuxième langue étrangère dans les écoles secondaires ;
-
la réduction des horaires dans les lycées techniques et autres établissements de formation professionnelle.
Au niveau universitaire, à côté de toutes les fariboles que raconte le gouvernement pour détourner l'attention des questions de fond, il faudrait subir :
-
des réductions des fonds de financement de l'université dans le budget de l'Etat. Ces coupes s'élèvent à plus de 500 millions d'Euros dans le prochain plan triennal ;
-
une réduction du renouvellement du personnel universitaire pour les années 2010 et 2011 - qui se traduit par une économie de 20% des dépenses relatives au personnel partant en retraite (une seule embauche pour 5 départs à la retraite) ;
-
des mesures préparatoires à la transformation de l'université publique en Fondations alimentés par des fonds privés.
Ce sont les éléments essentiels de la manœuvre du gouvernement qui suffisent à démolir tout l'édifice de l'instruction publique en Italie ; car il ne s'agit pas tant de lois qui se limitent, comme par le passé, à restructurer ce secteur, mais qui font purement et simplement disparaître une partie de ces structures en réduisant à néant le personnel et les ressources. C'est justement contre cela que s'insurgent aussi bien les personnels qui y travaillent (surtout les jeunes travailleurs précarisés) que l'ensemble des étudiants qui voient justement dans la réforme Gelmini et dans toute la manœuvre financière du gouvernement Berlusconi une attaque contre leur avenir. De fait, avec la baisse de qualification qui s'en suivra dans le monde de l'éducation, il ne pourra y avoir d'avenir que pour ceux qui auront les moyens de se l'acheter en allant dans les écoles et les universités privées. Par exemple, la transformation possible des universités en fondations, au-delà de la querelle sur le choix entre le privé et le public, « constitue un signal sans équivoque du désengagement progressif de l'Etat dans son rôle de financement du système universitaire public qui est la garantie de la possibilité pour tous d'accéder aux niveaux de formation les plus élevés »2.
Ce sentiment d'absence d'avenir est d'autant plus présent dans le mouvement actuel des étudiants et des précaires qu'il se déroule sur toile de fond d'une crise économique qui se manifeste dans cette période avec des aspects inédits et tout à fait préoccupants.
De ce point de vue, il faut reconnaître que ce mouvement des étudiants et des précaires tire sa plus grande force de la reconnaissance que l'attaque actuelle du gouvernement est due à la crise économique qui frappe actuellement l'Italie et le monde entier. En ce sens, le mouvement actuel en Italie se situe dans la continuité du mouvement des étudiants français qui se sont mobilisés en 2006 contre la loi qui voulait introduire le CPE (contrat première embauche) qui, si elle avait été approuvée, aurait permis d'imposer aux jeunes des conditions de travail bien pires que les conditions actuelles. Ce n'est pas par hasard si le mot d'ordre qui unifie tout le mouvement des étudiants et des précaires aujourd'hui en Italie est : « Nous ne voulons pas payer pour la crise ! », expression de la volonté d'aller de l'avant sans se faire berner par tous les discours trompeurs du style : « Il faut donner un coup de main à la nation dans ces moments difficiles » ou : « Il faut que chacun contribue à aider l'Etat en acceptant les sacrifices », etc.
Cette volonté de se battre globalement pour un avenir meilleur se traduit aussi dans d'autres aspects. Par exemple, dans le fait que, contrairement à d'autres luttes par le passé, en particulier, celles de 1968, il n'y a pas d'antagonisme ni de conflit de générations entre étudiants et enseignants, mais plutôt une tendance à lutter tous ensemble.
Les pièges tendus au mouvement
Cependant, le mouvement qui s'est exprimé dans la rue présente une série de faiblesses que la bourgeoisie utilise consciemment pour le faire échouer. Un des problèmes est un certain flou dans les buts et les perspectives que s'est donnée cette mobilisation. Alors que la maturité qu'a montrée le mouvement des étudiants en France avait été favorisée par l'attaque frontale portée par le gouvernement, en Italie, le caractère plus indirect et sectoriel de l'attaque a été un obstacle à une prise de conscience plus prononcée. C'est vrai, comme on l'a dit plus haut, qu'un élément qui favorise le mouvement est la crise dans laquelle s'enfonce l'économie nationale et mondiale. Mais quelle lecture fait-on de cette crise aujourd'hui ? Une crise financière due à des spéculateurs sans scrupule ? Une crise liée à une consommation excessive ou à une population mondiale en excès ? Une crise liée à l'invasion du marché mondial par la Chine ? Ou n'est ce pas plutôt une crise insoluble du système dans lequel nous vivons ?
Il est clair que selon l'interprétation qu'on en a, on peut alimenter l'illusion que les gouvernements du monde passent aux mains des Obama, Veltroni, des partis de gauche en général qu'on nous présente comme « le bon camp » pour gérer le capitalisme et la société, comme des gouvernants justes et équitables. Sur cette question, il y a toute une propagande médiatique sur les infamies de la loi Gelmini, « ministre suppôt du détestable Berlusconi », « responsable de vouloir détruire l'école publique » et de « vouloir la remettre dans les mains du privé ». Il ne fait aucun doute que les mesures du gouvernement Berlusconi sont draconiennes et que l'école et l'université sont durement frappées. Mais il faut sortir de la logique selon laquelle le gouvernement de droite aurait fait cela pour affaiblir un secteur politiquement contestataire, dangereux et camoufler la transformation de l'école publique en école du régime, alors qu'au contraire un gouvernement de gauche n'aurait jamais touché ce secteur1.
A part l'illusion que sème ce discours sur le fait qu'il pourrait réellement exister au sein de cette société un enseignement impartial, apolitique, avec une culture indépendante de la transmission des valeurs de l'idéologie dominante, la réalité est que quel que soit le parti au gouvernement, il ne peut que venir au secours de l'économie capitaliste en crise et ne peut que porter des attaques féroces contre la population exploitée. Il est vrai que le gouvernement Berlusconi, avec sa grossièreté, a eu la main lourde, mais il ne faut pas se laisser bercer par l'illusion de croire que tout cela ne serait qu'une basse manœuvre politique et ne correspondrait pas à une nécessité absolue pour l'Etat bourgeois d'obliger les prolétaires à se serrer la ceinture.2
Mais les pièges ne s ‘arrêtent pas là ! Parce que la dynamique de lutte qui se développe dans le mouvement des écoles et de l'université commence justement à inquiéter la bourgeoisie, celle-ci a commencé à développer d'autres moyens de défense. D'abord, Berlusconi a commencé à parler de la nécessité d'empêcher les étudiants d'occuper les établissements scolaires et les universités, disant qu'il aurait donné des instructions précises au ministre de l'intérieur pour le faire.
Ainsi, le 29 octobre sur la place Navona, où un groupe de militants de droite néo-fasciste a provoqué un affrontement avec les étudiants qui participaient à la manifestation. Derrière cela, il y a la marque provocatrice de l'Etat qui tente de faire resurgir un climat de confrontation sur le terrain fascisme-antifascisme et de faire renaître la même terreur que dans les années 1980 à travers une série d'infiltrations et de provocations policières Avant et après l'épisode de la place Navona, on ne compte plus les épisodes de provocations faites par des bandes de néo-fascistes qui essaient de déplacer la confrontation sur le plan physique, de façon à ce qu'on puisse ensuite retomber au niveau de la défense de simples revendications démocratiques et de respect de la légalité et de l'ordre, tout à fait dans la logique manipulatrice préconisée par l'ancien président Cossiga (voir son interview dans l'article «Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière » sur notre site www.internationalism.org.fr [156]).
Heureusement, le mouvement a réagi sainement face à ce piège, et cela en de nombreuses occasions ; en témoignent aussi les différentes vidéos qui sont apparues récemment et publiées sur les blogs ; les participants au mouvement ont pris conscience du danger de se laisser entraîner dans ce faux affrontement avec les fascistes et qu'il fallait rester fermement enraciné dans la lutte sur le fond que développe le mouvement.
Les perspectives du mouvement
Le mouvement, qui reste actif et vivant, même après l'approbation définitive au Sénat de la loi qui avait été l'élément déclencheur de sa lutte, fait preuve d'une volonté de lutter qui n'est pas éphémère mais est l'expression d'une profonde souffrance provoquée par une misère sociale grandissante.
Même si pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de prévoir ce que sera l'issue de ce mouvement, nous pensons que des mouvements de ce genre ont un rôle important parce que la situation économique, politique et sociale en est arrivée à un seuil intolérable de dégradation des conditions de vie.
Si le mouvement actuel n'a pas atteint la maturité du mouvement français contre le CPE puisque n'ont pas émergé des assemblées générales massives avec des délégués élus et révocables à tout moment en leur sein, s'il n'y a pas une conscience claire de la nécessité de se relier aux autres secteurs en lutte, ce mouvement a cependant exprimé :
-
une nette indépendance vis-à-vis des partis et syndicats, tout en ne tombant pas dans l'illusion mensongère de l'apolitisme ;
-
une préoccupation explicite de faire comprendre à l'ensemble des prolétaires le sens de la lutte qui s'exprime non seulement à travers des manifestations, des slogans ou des pancartes, mais aussi à travers les « leçons dans la rue » faites par des enseignants avec la participation de nombreux groupes d'étudiants, les « nuits blanches » et autres.
Tout cela n'est qu'un début. La partie n'est pas finie. Les manifestations qui ont eu lieu le jour où le décret Gelmini a été approuvé (29 octobre) dans toute l'Italie, la grève de l'école qui a eu lieu le 30 octobre avec un million de manifestants et toute l'élaboration et le pullulement d'initiatives qui se sont développées au niveau de l'école et de l'université, ont été des expressions d'une vitalité essentielle au niveau de la lutte et des initiatives, qui a permis de prendre conscience de la nécessité de mettre en avant des revendications unitaires et d'en appeler aux autres secteurs sociaux à rentrer en lutte.
Ezechiele (4 novembre 2008)
1En réalité, le premier plan de rationalisation du système scolaire a été fait par feu le gouvernement de centre gauche Prodi avec des réductions du nombre de classes et donc d'enseignants et de personnel ATOS.
2 Sur ce plan, une autre mystification politique est à l'œuvre qui tend à focaliser toute l'attaque sur les restrictions budgétaires dans le secteur de la recherche et à se lamenter parce que « nos cerveaux » sont obligés de s'expatrier, comme on l'a vu dans l'émission « Année Zéro » de Michele Santoro, finissant ainsi par réduire la perspective d'un mouvement qui concerne toute la jeune génération actuelle en une attaque qui ne concernerait qu'un secteur particulier et un nombre très limité de personnes.
Géographique:
- Chine [153]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Mouvement de lutte à la Sécurité Sociale, à Marseille
- 2929 lectures
En novembre 2007, nous avions publié un courrier de lecteur signé Sébastien, décrivant de « l'intérieur » la montée de la colère dans les différents services de la Sécurité Sociale de Marseille, sous le titre « Un témoignage de la combativité ouvrière face à l'aggravation des conditions de travail »[1].
Aujourd'hui, seulement quelques mois après ces premières manifestations de mécontentement, les conditions de travail n'ayant fait qu'empirer, la colère éclate à nouveau. Mais à travers ce second courrier de notre camarade Sébastien, nous pouvons voir qu'un véritable processus de réflexion s'est effectué durant ce laps de temps : sur les syndicats, sur la nécessité de se battre de façon unie et solidaire, sur la façon de mener la lutte pour ne pas rester isolé mais au contraire pour parvenir à l'étendre à d'autres services... Toutes ces questions ont commencé à trouver des débuts de réponses, collectivement, dans ce dernier mouvement.
Courrier du lecteur: Une expérience de lutte riche d'enseignements
Dans de nombreux secteurs du service public, le laminage des effectifs a atteint un tel niveau qu'il est souvent impossible aujourd'hui de faire face à la quantité de tâches à effectuer, entraînant une dégradation accélérée des conditions de travail. Le mécontentement que génère une telle situation pousse les travailleurs à réagir.
Dans un grand centre de la Sécurité Sociale, à Marseille, la colère des employés s'est transformée en un mouvement de lutte qui a duré plus d'un mois. Déjà, à la fin de l'été 2007, ces mêmes employés avaient réagi pour les mêmes raisons, la direction ayant à l'époque fait mine de reculer. Aujourd'hui, après des départs à la retraite et autre mutations non remplacés, les effectifs fondent à nouveau à vue d'œil. L'exaspération gagne de plus en plus de services. Un nombre croissant de travailleurs veulent aujourd'hui se battre pour revendiquer plus d'effectifs. Et il ne s'agit plus de mener des actions chacun dans son coin, mais de s'unir, de chercher la solidarité des autres services, de chercher également la solidarité la plus large auprès des « usagers » en les considérant en tant que travailleurs qui viennent régler leurs problèmes de remboursement des frais médicaux, eux aussi confrontés à des problèmes identiques de dégradation accélérée des conditions de travail. Sans demander l'intervention des syndicats qui aurait eu comme effet de les diviser et de les démobiliser, les employés se sont organisés en assemblées générales pour discuter des actions à mener, assemblées qui parfois réunissaient des employés d'autres branches de la Sécurité Sociale confrontés aux mêmes problèmes.
Le déroulement du mouvement
Dès mi-avril, les employés du service prestation envoient une lettre à la direction demandant, pour faire face à l'accumulation de dossiers en retard, une augmentation des effectifs. Suite à une réponse insatisfaisante, les employés décident d'une deuxième lettre fin avril précisant exactement les besoins du service, la direction répond encore par la négative. L'entrée dans le mouvement, mi-mai, du service accueil - confronté à un afflux d'assurés mécontents - en solidarité avec le service prestation, fait sortir la direction de ses bureaux qui envoie ses sbires pour réunir séparément les employés des deux services en leur promettant de prendre des mesures pour diminuer le retard. En fait, elle misait sur le pourrissement du mouvement. Mauvais calcul. Fin mai, des incidents éclatent dans la file d'attente des assurés, les employés arrêtent le travail, se réunissent en assemblée générale et décident l'unité d'action des deux services. La direction réagit en décrétant qu'en dehors des syndicats, toute action est illégale. Les employés décident alors l'envoi d'une délégation pour consulter les syndicats. Pour FO, il ne faut pas déranger la direction qui est en train de réorganiser le travail ! Pour la CGT, par contre, il faut faire grève de suite. Un débat s'enclenche : faire grève d'accord mais pas de suite, il faut tout d'abord construire un rapport de force. Pour éviter des sanctions de la direction, les employés décident de tenir une assemblée générale des deux services pendant les heures de repas. Début juin, les employés réunis décident le dépôt d'un préavis de grève avec envoi d'une lettre commune pour réitérer les revendications sur l'augmentation des effectifs. Quelques jours après, une délégation des employés rencontre la direction qui annonce des premières mesures : mise en place d'heures supplémentaires, aide « inter centre », report des jours RTT. Quant aux effectifs, le résultat est maigre, en deçà de ce qui a été demandé. Les employés rejettent ces propositions comme ne répondant pas au problème de fond. Le préavis de grève est maintenu. Pour l'assemblée générale, la journée de grève doit être conçue comme une journée de mobilisation envers les autres services pour les entraîner dans le mouvement, envers les assurés pour les appeler à la solidarité. La décision de tirer un premier bilan pour tous les employés et services de la Sécurité Sociale est votée. Mais la question de demander ou pas l'aide des syndicats a été l'objet d'un débat. Pour un certain nombre d'employés, il est possible de se servir des syndicats dans les négociations (avec à leurs cotés, une délégation des employés en lutte) et dans la diffusion des informations, sans perdre la maîtrise du mouvement. Pour d'autres, majoritaires, des expériences récentes ou plus anciennes ont démontré concrètement comment ces organismes faisaient tout pour déposséder les travailleurs de leur lutte en ne diffusant pas les informations et en négociant souvent dans le dos des travailleurs. La décision a été prise de ne pas faire appel aux organisations syndicales. C'était l'expression d'une méfiance envers les syndicats s'appuyant sur l'expérience mais pas encore d'une compréhension de ce qu'ils sont, c'est-à-dire, à mon avis, une force d'encadrement des travailleurs pour saboter tout mouvement de lutte.
Comment syndicats et direction vont agir main dans la main pour saboter le mouvement
Cette grande combativité était donc étayée par une véritable réflexion sur « comment mener la lutte collectivement ». Pourtant, tout ce mouvement de lutte n'a finalement pas abouti, la grève n'a finalement pas éclaté. Pourquoi ?
En proposant ces mesures, la direction savait très bien qu'elle agissait dans le sens de la division du mouvement et de l'affaiblissement de la combativité, notamment chez de jeunes employés qui voyaient dans ces heures supplémentaires un moyen d'augmenter leur faible salaire. La direction savait aussi que l'approche des congés d'été allait être un facteur de démobilisation. Mais, en définitive, ce qui a été le plus démobilisateur fut l'action des syndicats et en particulier la CGT. Pour ce qui est de FO, la situation est claire, c'est carrément un syndicat aux ordres de la direction qui a fait ouvertement pression pour que le mouvement cesse. Plus subtil a été le jeu de la CGT : appeler à faire grève quand le mouvement n'était pas mûr début juin, puis proposer d'aller rencontrer la direction qui se trouve de l'autre coté de la ville alors que la force du mouvement a permis que ce soit la direction qui se déplace pour rencontrer les employés en lutte. Et, cerise sur le gâteau, dans le but de diviser les employés, la CGT a mis en avant la participation à la grande journée de « mobilisation nationale » du 17 juin, démonstration de « force syndicale » où chacun était relégué derrière sa banderole d'entreprise et son syndicat. La manœuvre a réussi puisque finalement la journée de grève prévue par les employés eux-mêmes a avorté et n'a pas eu lieu.
Direction et syndicats ont gagné une bataille, mais il est clair pour tout le monde que le mouvement reprendra après les congés d'été. Au cours de cette lutte, un petit noyau plus combatif a décidé de maintenir les liens afin de poursuivre la réflexion sur le bilan de ce mouvement, comment développer la mobilisation, comment l'étendre, s'échanger des informations sur ce qui se passe dans les autres centres et services, quels contacts avoir. C'est une expérience très riche qui a été vécue, comme le dit le bilan : « Ce qui a été important, c'est que nous avons su réellement nous mobiliser, agir de manière unitaire et solidaire, en prenant nous mêmes les décisions, sur la base de réunions communes et en déléguant un certain nombre d'agents pour l'écriture de lettres ou pour rencontrer la direction, délégations qui ont soumis à l'ensemble le travail effectué. C'est une expérience très positive car cela nous a permis de dépasser des divisions entre services, les uns reprochant aux autres la baisse de la qualité du service rendus alors que cela est une conséquence de la dégradation de nos conditions de travail ».
La question de l'unité et de la solidarité, de la prise en charge des luttes non seulement dans un seul secteur mais dans tous les secteurs de la classe ouvrière, a clairement germé dans cette mobilisation.
Sébastien, Marseille (3 juillet)
[1] Ce courrier paru dans Révolution Internationale n° 384 est également disponible sur notre site Internet www.internationalism.org [151].
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [127]
Géographique:
- France [45]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Prise de position du KRASS (Russie) sur la guerre en Géorgie
- 3957 lectures
-
dénonciation des visées uniquement capitalistes et impérialistes des différents gouvernements nationaux et stigmatisation de leur rapacité, notamment celle des grandes puissances ;
-
aucun soutien à l'un ou l'autre des camps en présence dans la guerre capitaliste et impérialiste ;
-
appel des travailleurs de tous les pays belligérants à manifester leur solidarité de classe par dessus les frontières et à mener le combat contre leurs exploiteurs respectifs.
C'est pour cela que nous apportons notre plein soutien à l'essentiel de cette prise de position.
Nous voulons toutefois préciser que les mots d'ordre adressés aux soldats qui figurent à la fin du document (désobéir aux ordres des commandants, retourner les armes contre eux, etc.), s'ils sont parfaitement justes du point de vue d'une perspective historique (et ils ont été mis en pratique lors des révolutions russe en 1917 et allemande en 1918) ne sauraient être immédiatement d'actualité, alors qu'il n'existe pas, tant dans la région qu'à l'échelle internationale, ni une puissance ni une maturité suffisantes des combats de la classe ouvrière. Dans le contexte actuel, une attitude de ce type de la part des soldats les expose à la pire des répressions sans qu'ils puissent compter sur la solidarité de leurs frères de classe.
Cela dit, nous tenons ici à saluer les camarades du KRASS pour leur défense intransigeante de l'internationalisme et pour le courage politique dont ils font preuve depuis des années dans des conditions particulièrement difficiles, tant du point de vue de la répression policière que du poids des mystifications, notamment nationalistes, qui continuent à s'exercer sur la conscience des prolétaires du fait de la chape de plomb de la contre-révolution stalinienne qui a régné dans leur pays pendant des décennies.
NON À LA NOUVELLE GUERRE CAUCASIENNE !
L'éruption de nouvelles actions militaires entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud menace de se développer en une guerre plus large entre la Géorgie soutenue par l'OTAN d'un côté et l'État russe de l'autre. Des milliers de personnes ont déjà été tuées ou blessées, principalement des civils paisibles. Des villes entières et de nombreuses infrastructures ont été rayées de la carte. La société a été emportée par le torrent boueux du nationalisme et de l'hystérie chauvine.
Comme toujours et partout dans les conflits entre états, il n'y a pas et il ne peut y avoir quoi que ce soit de juste dans cette nouvelle guerre caucasienne ; tous sont coupables. Les braises sur lesquelles on a soufflé pendant des années ont finalement entraîné un embrasement militaire. Le régime de Saakashvili a plongé deux tiers de la population géorgienne dans une misère profonde, et plus montait dan le pays la colère contre cette situation, plus ce régime cherchait une échappatoire à cette impasse sous la forme d'une « petite guerre victorieuse » dans l'espoir que cela pourrait tout effacer. Le gouvernement russe est totalement déterminé à conserver son hégémonie dans le Caucase. Aujourd'hui il prétend défendre les faibles, mais son hypocrisie est tout à fait claire : en fait, Saakashvili ne fait que refaire ce que la soldatesque poutinienne a fait en Tchétchénie depuis neuf ans. Les cercles dirigeants d'Ossétie et d'Abkhazie aspirent à renforcer leur rôle d'alliés exclusifs de la Russie dans la région, et en même temps à rallier les populations paupérisées autour de la flamme de l'« idée nationale » et du « secours au peuple ». Les dirigeants des États-Unis, des États européens et de l'OTAN, au contraire, cherchent à affaiblir autant que possible l'influence de leur rival russe dans le Caucase afin de leur permettre de prendre le contrôle des ressources pétrolières et de leur acheminement. Ainsi sommes-nous témoins et victimes du nouveau point de fixation de l'antagonisme mondial dans la lutte pour l'énergie, le pétrole et le gaz.
Ces combats n'apporteront rien aux travailleurs, qu'ils soient Géorgiens, Ossètes, Abkhazes ou Russes, rien d'autre que du sang et des larmes, d'incalculables désastres et privations. Nous exprimons notre profonde sympathie à tous les amis et parents des victimes, à ceux qui n'ont plus de toit sur leur tête ni de moyens de subsistance à cause de cette guerre.
Nous ne devons pas tomber sous l'influence de la démagogie nationaliste qui nous demande l'unité avec « notre » gouvernement et déploie le drapeau de la « défense de la patrie ». L'ennemi principal des gens simples n'est pas le frère ou la sœur de l'autre côté de la frontière ou d'une autre nationalité. L'ennemi, c'est les dirigeants, les patrons de tout poil, les présidents et ministres, les hommes d'affaire et les généraux, tous ceux qui provoquent les guerres pour sauvegarder leur pouvoir et leurs richesses. Nous appelons les travailleurs en Russie, Ossétie, Abkhazie et Géorgie à rejeter le joug du nationalisme et du patriotisme pour retourner leur colère contre les dirigeants et les riches, de quelque côté de la frontière qu'ils se trouvent.
Soldats russes, géorgiens, ossètes et abkhazes ! N'obéissez pas aux ordres de vos commandants ! Retournez vos armes contre tous ceux qui vous envoient à la guerre ! Ne tirez pas sur les soldats « ennemis », fraternisez avec eux ! Plantez les baïonnettes en terre !
Travailleurs de l'arrière ! Sabotez l'effort militaire, quittez le travail pour aller aux réunions et manifestations contre la guerre, organisez-vous et mettez-vous en grève !
Non à la guerre et à ses organisateurs - dirigeants et riches ! Oui à la solidarité des ouvriers au-delà des frontières et des lignes de front !
Fédération pour l'Éducation, la Science et les ouvriers techniques, CRAS-IWA
Géographique:
Récent et en cours:
- Guerre en Géorgie [157]
Courants politiques:
Propagande nationaliste aux épreuves du brevet des collèges (courrier d'une lectrice)
- 3971 lectures
Nous publions ci-dessous le courrier d'une lectrice auquel nous apportons notre soutien. Cette camarade y dénonce la pourriture idéologique de la bourgeoisie qui « n’hésite pas […] à bourrer le crâne de gamins de 14-15 ans de sa propagande nationaliste la plus grossière » lors des épreuves du brevet des collèges.
Courrier de la lectrice
Chers camarades,
En 2005, je vous avais écrit une petite lettre pour vous exprimer mon indignation devant toute la propagande déversée lors de l’épreuve d’histoire – géographie – éducation-civique du brevet des collèges. « Tout le sujet puait l’hypocrisie et la manipulation. L’Etat prétend développer à travers son école la réflexion, l’esprit critique et la compréhension du monde, mais c’est une belle mascarade. » 1 Tous les ans, c’est à peu près la même chose, la bourgeoisie profite de cet examen officiel pour présenter ses mensonges comme des vérités officielles. Elle n’hésite pas ainsi à bourrer le crâne de gamins de 14-15 ans de sa propagande chauvine la plus grossière ! Mais cette année, elle a battu un nouveau record… j’en suis presque tombée de ma chaise.
Le résumé de l’épreuve de géographie peut tenir en une seule phrase : « La France est belle et forte, Vive la France ! ». Je n’exagère pas du tout, sans rire. Le titre de l’épreuve annonce d’ailleurs la couleur (ou, plutôt, les trois couleurs… le bleu, le blanc et le rouge) : « La puissance française dans le monde ». Tout un programme !
Le premier document à étudier est sans nuance. En voici quelques extraits en forme de pot-pourri (mais vraiment pourri) :
-
« La réussite mondiale des grandes entreprises française est spectaculaire ».
-
« Les capacités technologiques françaises (aéronautiques, spatiales…) sont de premier plan ».
-
« A cela s’ajoutent de nombreux autres atouts (…) : notre langue (…), notre politique étrangère, une de celles qui comptent, notre capacité militaire à l’extérieur (…), l’image de qualité de la vie en France (…).
-
Et pour finir en beauté : « Ce tableau ne justifie pas un excès prétentieux de confiance en soi – il y a beaucoup à faire – mais il invalide le pessimisme ambiant » !
J’accorde, en tant qu’enseignante, une mention spéciale à l’Etat pour ce passage va-t-en-guerre qui résonne aujourd’hui de manière si sinistre avec l’actualité : « A cela s’ajoutent de nombreux autres atouts (…) : notre capacité militaire à l’extérieur ». Ces dix militaires, des gosses d’à peine 20 ans, morts en Afghanistan, leurs familles en deuil, ces villages ravagés par la guerre… voici en effet un bel « atout », une belle « capacité ».
Le deuxième document vient illustrer ces affirmations chauvines. Il vante les mérites économiques de quatre grandes entreprises françaises : Danone (« N°1 mondial des produits laitiers (…). Présents dans 45 pays »), Alstom (« Un des leaders mondiaux dans les infrastructures d’énergie et de transport. Présent dans 70 pays »), Louis Vuitton (« Un des leaders mondiaux de l’industrie du luxe ») et Carrefour (« N°1 en Europe et n°2 dans le monde dans le domaine de la grande distribution »). Ce document n’est rien d’autre qu’un encart de pub, une affiche que l’on pourrait retrouver dans le métro ou sur un bus… sauf qu’il est là, planté en plein milieu des copies officielles du brevet distribuées à des collégiens.
Toute cette épreuve de géographie est de la vraie propagande en boîte !
A partir de l’étude de ces documents, les élèves doivent répondre à des questions en en appelant, normalement, à leurs capacités d’observation et de réflexion, et à leur sens critique. Voyez-vous même :
-
Question 1 : « Relevez trois secteurs économiques qui font de la France une puissance mondiale. »
-
Question 2 : « Citez deux éléments qui font de la France une puissance militaire et un élément qui montre son rayonnement culturel. »
-
Question 3 : « Sur quel continent se manifestent à la fois cette puissance militaire et ce rayonnement culturel ? »
-
Et enfin, la question à 10 points, le fameux « paragraphe argumenté » qui en appelle aux connaissances individuelles de l’élève : « A partir des informations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes montrant que la France est une puissance mondiale. »
Ça frise le ridicule, hein ? Tout ce qui est demandé aux élèves, finalement, c’est de répéter sous tous les angles possibles que « oui, la France est une puissance mondiale ». « Répète après moi : ‘Vive la France !’ et tu auras ton diplôme, mon enfant ». A quand chanter La Marseillaise comme épreuve obligatoire ? Mes collègues non plus n’en sont pas revenus. En salle des professeurs, à l’issue de cette épreuve, quelques commentaires ont fusé : « C’est de la pure propagande », « il n’y a aucun argument à retenir dans le premier document de géo, juste des affirmations… et on nous dit qu’il faut apprendre aux élèves à réfléchir !? ». Le nationalisme, la glorification de la puissance guerrière,… toutes ces notions ne cessent d’être martelées de plus en plus brutalement dès le collège (et sûrement dès l’école primaire, j’essayerais de me renseigner), comme s’il fallait convaincre de plus en plus jeune et à tous prix. Pourquoi ce discours aussi caricatural et récurent ?
Je ne suis pas sûre de moi mais je pense que ce n’est pas un hasard si une telle propagande arrive après le mouvement des étudiants contre le CPE en 2006 et le mouvement des lycéens contre la loi LRU en 2007. Il s’agit d’empêcher les jeunes de réfléchir par eux-mêmes, d’occuper le terrain de la réflexion dès le plus jeune âge. La conclusion édifiante du « document 1 » révèle parfaitement cette préoccupation de la classe dominante : « Ce tableau ne justifie pas un excès prétentieux de confiance en soi – il y a beaucoup à faire – mais il invalide le pessimisme ambiant ». Invalider « le pessimisme ambiant », c’est-à-dire nier la dégradation des conditions de vie, les attaques, la noirceur de l’avenir…, voilà à quoi s’attache cette épreuve du brevet en particulier et tous les discours des politiques en général. Si la bourgeoisie le pouvait, elle conditionnerait nos enfants à la mode ‘pavlovienne’ dès le berceau ! Mais elle peut bien faire ce qu’elle veut, elle ne parviendra pas à empêcher les nouvelles générations de prendre conscience de la barbarie de ce système et de développer leur volonté de se battre pour l’avenir… à mon avis.
Fraternellement, le 22 août, Li.
PS : Je vous transmets les documents officiels pour mieux illustrer mon propos. Ça vaut le coup d’œil !
Documents de l’épreuve d’histoire-géographie-éducation civique du brevet 2008
envoyés par la camarade :
1 Nous avions à l’époque publié cette lettre dans notre journal Révolution Internationale n°360 de septembre 2005 sous le titre « Brevet des collèges : la pourriture de l'idéologie bourgeoise [162] ».
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [127]
Qu'est-ce que la classe ouvrière ? (exposé de réunion publique)
- 3879 lectures
Nous publions ci-dessous l'exposé qui a été présenté à nos dernières réunions publiques sur le thème "Qu'est-ce que la classe ouvrière ?"
Pourquoi cette
question se pose-t-elle aujourd'hui ?
En premier lieu, il y a des éléments liés à l'actualité qui mettent en évidence la difficulté à comprendre clairement en quoi consiste la classe ouvrière :
Cet automne, certains étudiants luttant contre la loi "LRU" ont manifesté leur solidarité avec les cheminots grévistes, tentant même parfois de réaliser des AG communes. Par contre, ils n'ont jamais essayé d'entraîner, par exemple, les infirmiers des hôpitaux ou les enseignants, en allant les voir pour discuter. Pourquoi ?
L'image d'Épinal, chère à la bourgeoisie et ses médias, présente l'ouvrier en bleu de travail et aux mains calleuses. Mais qu'en est-il des millions de chômeurs, des retraités, des employés de bureaux, des fonctionnaires, des travailleurs précaires... ?
Qui fait partie de la classe ouvrière ?
Répondre à ces questions est primordial pour continuer dans l'avenir à développer, dans la lutte, l'unité et la solidarité.
Une question similaire
s'est posée lors de la lutte de la jeunesse scolarisée
contre le CPE, au printemps 2006 : la nécessité
d'une solidarité entre les étudiants et les
travailleurs était évidente, cependant les étudiants
ne parlaient pas de la « classe ouvrière »
mais des « salariés », ce qui signifiait
que même lorsqu'ils comprenaient clairement que ce qui les
attendait pour la plupart était une vie de chômage, de
précarité et d'exploitation, ils ne se considéraient
pas eux-mêmes comme de futurs membres de la classe ouvrière.
En second lieu, et plus
généralement, les confusions sur la nature de la classe
ouvrière ont été particulièrement
répandues lors de l'effondrement des régimes
soi-disant « socialistes » en 1989 :
campagnes sur la « mort du communisme », sur la
« fin de la lutte de classe », voire la
« disparition de la classe ouvrière ».
Pourquoi cette
question est-elle importante ?
Parce que ces idées
fausses, qui sont amplement alimentées par les campagnes et
les mystifications de la classe dominante, affectent les deux forces
principales de la classe ouvrière : son unité et
sa conscience.
- L'unité de la classe ouvrière
Toutes les forces de la bourgeoisie sont intéressées et participent à la division de la classe ouvrière :
- Les secteurs de droite : ils ne parlent que de « citoyens tous égaux devant la loi ». Pour eux, il n'y a pas de division ni antagonisme entre les classes sociales, entre exploiteurs et exploités. Il faut manifester une « solidarité » entre « tous les partenaires d'une même entreprise », entre « tous les citoyens du pays ». Conclusions : l'ennemi des salariés de telle entreprise, ce n'est pas leur patron mais les salariés des entreprises concurrentes ; l'ennemi des exploités d'un pays, ce n'est pas leur bourgeoisie nationale mais les exploités des autres pays qui travaillent pour des salaires plus bas (et contre qui il faut prendre les armes en cas de guerre).
- Les sociologues : ils sont spécialistes dans la recherche de toutes sortes de catégories qui aboutissent à masquer les vrais divisions sociales entre exploiteurs et exploités. Ils vont faire un tas d'études, avec eu tas de statistiques à l'appui, sur les différences hommes/femmes, jeunes/vieux, français/immigrés, croyants/non croyants, diplômés/non diplômés, etc. (alors qu'il y a des femmes, des jeunes, des immigrés, des non croyants ou des non diplômés qui appartiennent à la classe des exploiteurs et réciproquement).
- La gauche et
surtout les syndicats : ils admettent qu'il y a des
exploiteurs et des exploités mais ils ont l'habitude de
diviser ces derniers entre entreprises (ils parlent des « Renault »,
des « PSA », etc.), entre branches
professionnelles (fédérations syndicales des
transports, de la fonction publique, de l'enseignement, etc.) et
aussi entre pays (langage chauvin sur « produisons
français » lorsque le problème de
délocalisation se pose).
- La conscience de la classe ouvrière
Elle se compose notamment de sa confiance en soi et de la conscience de sa nature historique, de son futur.
- La confiance en soi de la classe ouvrière : les différents secteurs de la bourgeoisie veulent « montrer » que la classe ouvrière n'est plus une force dans la société car elle est de plus en plus réduite en nombre puisque :-
dans les pays développés, il y a de moins en moins de « cols bleus », de travailleurs « manuels » (les seuls appartenant à la classe ouvrière dans les définitions officielles) ;
-
là où le nombre de « cols bleus » augmente (Chine, Inde, etc.), ils ne représentent qu'une petite minorité de la population.
- La conscience historique : on veut montrer qu'il n'y a rien à tirer de l'expérience historique de la classe ouvrière puisque les salariés ne sont plus les mêmes qu'au 19e siècle ou dans la première partie du 20e siècle.
Voilà la
conclusion que la bourgeoisie et tous ceux qui sont à son
service veulent faire tirer aux exploités : les idées
socialistes, l'idée d'un renversement possible de la
société capitaliste pouvaient se justifier au 19e
siècle ou au début du 20e siècle,
mais aujourd'hui ce sont des idées absurdes, une rêverie
impuissante.
Qui appartient à
la classe ouvrière ?
- Est-ce que tous les
travailleurs manuels appartiennent à la classe ouvrière ?
NON : le
boulanger ou le boucher propriétaire de son commerce travaille
de ses mains, mais il n'appartient pas à la classe ouvrière
car celle-ci est une classe exploitée, qui n'est pas
propriétaire de ses moyens de production. D'ailleurs, les
petits commerçants ne sont en général pas très
amis des ouvriers qu'ils considèrent souvent comme des
« fainéants ». En France, les artisans
et les commerçants constituent les troupes de choc de Le Pen.
Par contre, le garçon boucher ou le boulanger salarié
appartiennent à la classe ouvrière.
- Est-ce que tous les
exploités appartiennent à la classe ouvrière ?
Non : il
existe par exemple (et ils sont nombreux dans les pays
sous-développés) des paysans pauvres, non-propriétaires
de leurs terres, qui sont exploités par les propriétaires
fonciers à qui ils doivent verser un pourcentage de leurs
revenus ou un loyer annuel. Ils peuvent connaître une
exploitation effroyable, mais ils n'appartiennent pas à la
classe ouvrière comme telle. D'ailleurs, les luttes qu'ils
mènent visent surtout à obtenir un partage des terres,
à se transformer en petits propriétaires exploitants
(comme on en a pas mal encore en France et qui ne sont pas exactement
du côté des ouvriers : ils constituent plutôt
la clientèle de Le Pen). En fait, ce type d'exploitation est
un vestige de la société féodale, il appartient
essentiellement au passé.
Quels sont les
critères d'appartenance à la classe ouvrière ?
La
classe ouvrière est la classe exploitée spécifique
du mode de production capitaliste qui est basé sur le
salariat. La spécificité du capitalisme réside
dans la séparation entre producteurs et moyens de production.
Les travailleurs qui mettent en œuvre les moyens de production n'en
sont pas les propriétaires, ils louent leur force de travail à
ceux qui les possèdent. Appartenir à la classe ouvrière
suppose :
-
Être salarié : on ne vend pas le produit de son travail comme le fait un boulanger mais on loue sa force de travail à celui qui possède les moyens de production.
-
Être exploité : c'est-à-dire que le montant que reçoit chaque jour le salarié est inférieur à la valeur de ce qu'il a produit. S'il travaille pendant 8 heures, il reçoit l'équivalent de 4 heures et les 4 autres heures sont appropriées par le patron (Marx a appelé « plus-value » ce montant qui n'est pas payé au salarié). Tous les salariés ne sont pas exploités : les dirigeants des grandes entreprises sont souvent des salariés mais avec leurs salaires de plusieurs millions d'Euros par an, il est clair qu'ils ne sont pas exploités. C'est la même chose pour les hauts fonctionnaires.
Cela suppose également ne pas avoir une fonction dans la défense du capitalisme contre la classe ouvrière : les curés ou les flics ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production (l'église où le panier à salade), ils sont salariés. Cependant, ils n'ont pas un rôle de producteurs de richesses mais de défenseurs des privilèges des exploiteurs et de maintien en place de l'ordre existant.
C'est la même
chose pour le petit chef dans un atelier qui joue un rôle de
flic au service du patron.
Faut-il être un travailleur manuel pour
appartenir à la classe ouvrière ?
Absolument pas ! Pour plusieurs raisons :
-
Il n'y a pas de séparation nette entre travailleur manuel et intellectuel : c'est le cerveau qui commande à la main. Certains métiers « manuels » demandent un très long apprentissage et mobilisent activement la pensée : un ébéniste ou un chirurgien est un « manuel ».
-
D'ailleurs, dans le mouvement ouvrier, on n'a jamais fait cette séparation : traditionnellement, les correcteurs d'imprimerie se considéraient comme des ouvriers à côté des typographes ou des rotativistes. Souvent, ils étaient à l'avant-garde des combats ouvriers. De même, pas il n'y a pas d'opposition entre les conducteurs de train et les « employés aux écritures ». Il n'y a pas de séparation entre « ouvriers aux mains calleuses » et employés.
-
De plus, au niveau des mots, ouvrier veut dire qui « œuvre », qui travaille. En Anglais, ouvrier se dit « worker », travailleur.
Faut-il faut enrichir directement un patron pour
appartenir à la classe ouvrière ?
NON ! C'est clair qu'un ouvrier travaillant à l'entretien d'un hôpital appartient à la classe ouvrière. Mais c'est aussi le cas d'une infirmière qui soigne des malades. En fait, elle participe à l'entretien de la force de travail qui sert à enrichir le capitalisme.
C'est la même chose pour une institutrice qui participe à la formation de la force de travail qui, plus tard, va entrer dans le processus de la production.
De même, un
chômeur (qui momentanément ne travaille pas) ou un
retraité (ancien producteur salarié et exploité)
appartient à la classe ouvrière non pas au jour le
jour, mais du fait de sa place dans la société.
Conclusion
Les luttes que peuvent mener contre l'exploitation les ouvriers de l'industrie, les cheminots, les enseignants, les infirmières, les employés de banque, les fonctionnaires mal payés, les chômeurs, etc. mais aussi les étudiants qui vont entrer dans ces professions appartiennent toutes au combat général contre le capitalisme. Ce sont des luttes de résistance contre les attaques toujours plus brutales que ce système porte contre ceux qu'il exploite. Ce sont aussi des luttes qui préparent l'affrontement général et international contre ce système en vue de son renversement.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Réponse à des attaques sur le prétendu sionisme du CCI
- 3412 lectures
Le CCI fait actuellement l'objet d'attaques graves et répétées sur les sites Indymedia concernant notre prétendu sionisme. Ces attaques prennent deux formes : d'une part un communiqué 1 provenant "d'amis du CCI" qui sont sans le moindre rapport avec nous et usurpent l'adresse de notre site, et d'autre part des articles 2 martelant des positions du CCI qui prouveraient soit-disant son sionisme.
En réponse à ces attaques, nous publions ci-dessous deux communiqués, cette fois-ci émanant véritablement du CCI et rétablissant la vérité sur nos positions. Nous invitons nos lecteurs et sympathisants à renvoyer à cette page dès qu'ils sont témoins ou destinataires de telles attaques.
COMMUNIQUÉ DU CCI SUR LES ACCUSATIONS DE SIONISME CONTRE LE CCI
Depuis un certain temps, des posts signés DO et renvoyant à un site nommé Mai68 accusent le CCI de sionisme.
Nous publions ce communiqué pour affirmer de la manière la plus catégorique qu'aucun texte publié par le CCI depuis le début de son existence en 1975, nulle phrase, nulle expression ne permet d'accréditer une telle accusation. Pour en avoir la preuve, on peut consulter notre site www.internationalism.org [151]
En conséquence, il apparaît que ceux qui formulent de tels mensonges éhontés sont au moins des escrocs sinon des provocateurs.
Nous faisons confiance à tous ceux qui se posent honnêtement la question d'en finir avec la misère et la barbarie du système capitaliste pour refuser tout crédit à ce type d'accusations. Nous les appelons à continuer les débats avec le CCI et avec les autres organisations qui défendent authentiquement les positions du prolétariat.
Le CCI
COMMUNIQUÉ DU CCI SUR UN FAUX APPEL A SOUSCRIPTION
On peut trouver sur des forums du réseau Indymedia (et peut-être sur d'autres) un "Appel à souscription pour la réédition d'ouvrages du CCI 'D'Auschwitz à Gaza, en passant par le ghetto de Varsovie'".
Le CCI n'a jamais lancé un appel à souscription de ce type. Ses appels à souscription se trouvent uniquement sur son propre site ou dans sa presse papier.
Il est clair qu'un tel appel n'est pas autre chose qu'une tentative de discréditer notre organisation. La méthode utilisée est significative du manque de scrupules et de la démarche politique de son auteur, une démarche qui n'a rien à voir avec celle du prolétariat.
Plus généralement, nous mettons en garde contre toute une série de "posts" signés "CCI", "un sympathisant du CCI" ou "Les amis du CCI" qui, prétendant défendre nos positions, ne sont en réalité que des tentatives de jeter le discrédit sur notre organisation. Le CCI, ses militants et ses véritables sympathisants interviennent sur différents forums et comme il ne nous est pas possible de certifier l'authenticité de tous les messages qui sont envoyés, nous engageons les lecteurs qui peuvent trouver surprenants certains des messages signés "CCI" ou "sympathisant du CCI" de vérifier sur notre propre site s'ils sont bien cohérents avec les positions que nous défendons.
Le Courant Communiste International.
1 Voici le texte de ce communiqué :
Appel à souscription pour la réédition d'ouvrages du CCI : "D'Auschwitz à Gaza, en passant par le ghetto de Varsovie"
Le CCI y analyse magistralement les grandes défaites du mouvement ouvrier international. Il montre comment, en se créant des ennemis imaginaires, les prolétaires ont fermé les yeux sur leurs véritables ennemis : leurs bourgeoisies locales. A travers des exemples historiques, nous voyons comment, par exemple, en refusant de lutter contre leur bourgeoisie avec l'aide du prolétariat allemand, les habitants d'Auschwitz ont signé leur perte. De même dans le ghetto de Varsovie, où les armes auraient dû être tournées contre les exploiteurs, non contre les Allemands.
Et à Gaza, n'aurait-il pas été plus simple de creuser des tunnels pour prendre contact avec le prolétariat israélien au lieu d'attaquer l'Etat juif ?
Passez vos commandes aux Amis du CCI : www.internationalism.org [150]
AuteurE : Les Amis du CCI
2 Un certain Do (qui a son propre site Web: https://mai68.org [163]) commente presque systématiquement nos articles par l'accusation de sionisme. Il a même fait tout un article à ce sujet, en voici des extraits:
titre: Le CCI, un groupuscule ''communiste'' qui cache mal son sionisme
Extrait de l'introduction : " Le CCI est un groupuscule qui se prétend "communiste", mais qui camoufle mal son sionisme. Refusant (officiellement) de choisir son camp entre Palestiniens et sionistes, le CCI est donc dans le camp du plus fort : le CCI n'est qu'un attrape-mouche pour juifs de gauche afin d'éviter qu'ils deviennent antisionistes."
Vie du CCI:
Répression contre la grève des employés de banque au Brésil (Tract)
- 2724 lectures
La bourgeoisie brésilienne, confrontée à des mouvements échappant à son contrôle (en fait au contrôle des syndicats), utilise de manière grotesque son appareil répressif, la police, en vue d´intimider les travailleurs. C´est ainsi qu´à Porto Alegre (RS), dans le sud du Brésil, elle a réprimé violemment une manifestation d´employés de banque, le 16 octobre dernier, en faisant usage de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et blessant ainsi environ 10 personnes. Comme si la répression intervenue dans la matinée n´y suffisait pas, la "13e marche des Sans" [1] réunissant le même jour et dans la même ville, une dizaine de milliers de personnes fut, elle aussi, la cible de la répression policière dont il a résulté de nombreux blessés.
Avant cela, les dirigeants des banques et, parmi eux, le propre gouvernement, avaient déjà entrepris de prendre des mesures contre la grève actuelle des employés de banque en persécutant et licenciant des leaders, en vue de contenir le développement du mouvement.
La solidarité de classe : une nécessité
Il est nécessaire de souligner que la lutte des employés de banque va actuellement au delà des revendications économiques classiques puisque sa revendication essentielle est celle de l´homogénéisation du traitement des employés. Les banques, et surtout les banques fédérales, ont créé un abîme entre la situation des employés de longue date et celle de ceux qui ont été embauchés depuis 1998, lorsqu´ont été supprimés certains «avantages» qui avaient été arrachés à travers la lutte même. Bien plus que la revendication d´une simple compensation économique, il s´agit donc d´un geste important de solidarité entre travailleurs, car il n´est pas possible d´accepter que nous soyons traités différemment, comme si certains d´entre nous étaient inférieurs, alors que nous effectuons tous le même travail, dans le mêmes locaux, en étant soumis aux mêmes pressions.
Il est également nécessaire qu'il soit bien clair que, tous nos «avantages» étant le fruit de la lutte, si certains d'entre nous en bénéficient, alors tous doivent en bénéficier, quel que soit le moment où ils ont été embauchés. De la même manière, cette grève cherche à récupérer ce qui nous a été supprimé, à tous cette fois-ci, comme les primes annuelles, etc. Toutes ces conquêtes économiques ont été le produit de nos luttes de résistance mais elles ont été annulées par la suite par les patrons avec la complicité de leurs « partenaires syndicaux ».
Nous voulons également de meilleures conditions de travail, la fin du harcèlement moral, la fin des objectifs de vente de produits et services imposées par les banques ; tout ceci a occasionné tellement de maladies parmi les travailleurs du secteur bancaire. Nous le répétons, nous ne voulons pas être traités différemment les uns des autres. Nous ne pouvons pas être d´accord avec l´amputation de nos « avantages » qui sont le produit de nos luttes et non pas des cadeaux de la part des patrons du secteur privé ou public.
La revendication des mêmes conditions de travail et rémunération pour ceux qui sont actuellement embauchés constitue un acte de solidarité entre les différentes générations de travailleurs de ce secteur. C´est cette même solidarité dont nous devons faire la preuve en actes avec ceux qui ont été victimes de la répression de l´État. Nous ne pouvons pas renoncer à nous joindre et nous solidariser avec tous ceux qui luttent pour ne pas se laisser écraser par les nécessités du capitalisme en crise, avec tous ceux que la bourgeoisie a réprimé ou va vouloir réprimer du fait de leur implication dans les luttes.
Ces luttes et la répression de l´État ne constituent pas une question qui ne concerne que les employés de banques, mais bien l´ensemble des travailleurs, avec ou sans travail.
Tract
commun du CCI et du groupe Opposition Ouvrière
distribué au Brésil le 20 octobre
dans les assemblées générales de lutte des employés de banque
[1] Mouvement qui réunit différentes catégories d´exclus sociaux, le Mouvement des Sans Terre, le Mouvement des Sans Toit, le Mouvement des Sans Travail. Comme son nom l´indique, ce dernier est essentiellement constitué de prolétaires san travail. Le mouvement des Sans toît regroupe des éléments de différentes couches non exploiteuses de la société, qui s´organisent notemment pour occuper des squats. Le mouvement des Sans Terre est constitué lui aussi de différentes couches non exploiteuses de la société en provenance de la ville, sans travail et qui sont organisés au sein de cette structure pour l´occupation de terres à la campagne en vue de les cultiver. Cette structure est solidement contrôlée par l´État, en particulier depuis le premier mandat de Lula à la tête de l'Etat.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Réunion publique du CCI au Pérou sur la crise : un débat prolétarien passionnant et passionné
- 3444 lectures
Lors de cette deuxième réunion publique1, qui s'est déroulée le 24 octobre 2008, beaucoup de monde était présent (la salle était pleine à craquer). Mais bien plus important que cet aspect quantitatif, c'est l'aspect qualitatif du débat qui est à retenir : il y avait des camarades des différentes générations de la classe ouvrière (dont beaucoup de jeunes) ; il y avait des travailleurs, des étudiants, des femmes, des employés ; la discussion a été très vivante, avec de nombreuses interventions qui se répondaient les unes aux autres, chacun pouvant exprimer librement ses opinions. L'écoute a été attentive et respectueuse, les arguments se sont succédé sans jamais tomber dans l'insulte et le dénigrement. L'intérêt de l'assistance était tel que le débat a été prolongé d'une heure. Vers la fin de la réunion, les participants ont orienté le débat sur la question de comment lutter et comment contribuer au développement de la conscience et de la lutte ouvrière, ce qui a amené à se poser la question de la nécessité de continuer ces réunions, comme nous le verrons plus loin.
Ce fut une démonstration vivante de ce qu'est la culture du débat, de ce qu'est un débat prolétarien.
La crise actuelle conduit à une des pires récessions de l'histoire
Après une brève présentation2, la discussion s'est centrée sur la nature de la crise actuelle, ses causes et ses perspectives3. Un des participants a clairement affirmé : « La Grande-Bretagne est entrée en récession, les Pays-Bas ont des sérieux problèmes, le monde entier va subir la récession. »4
Les interventions ont insisté sur le caractère mondial de la crise. Des éléments et des données ont été apportés sur la situation au Pérou, mais l'axe central des interventions a été la situation mondiale et ses conséquences. Tout cela est l'expression même de la vision internationaliste et prolétarienne qui a été celle de la majorité des participants.
La discussion a insisté sur les fait suivants : la crise actuelle est pire que celle de 1929 et le pire de cette crise est encore devant nous.
Une intervention a mis en avant les conséquences de la crise pour l'économie péruvienne, mais la plupart de ces interventions ont porté sur la question de ses conséquences pour la classe ouvrière. En effet, face à la crise, la préoccupation des travailleurs ne doit pas être : « Que va devenir l'économie nationale ? », mais « Comment la crise affecte-t-elle tous les travailleurs et tous les exploités du monde entier ?" et « Comment pouvons-nous y répondre en tant que classe mondiale ? »
Une des personnes présentes affirma que la crise était la conséquence de la toute-puissance de l'impérialisme yankee, des erreurs de Greenspan qui auraient causé le désastre actuel. Mais la majorité des interventions y ont répondu en disant qu'il ne faut pas chercher les causes de la crise dans la politique économique d'un État et encore moins dans les maladresses de tel ou tel personnage, « Le fond de la question n'est pas de savoir si la faute incombe à quelques banquiers pourris, mais le fait que nous nous trouvions face à la pire des crises du capitalisme en tant que système. Le capitalisme, à cause de ses contradictions, finit par éclater dans la crise et ce sont les travailleurs qui en payent le prix le plus élevé », répondit l'un des présents, un autre ajoutant : « le capitalisme a une limite historique, il arrive un moment où cette limite devient patente. La surproduction et l'endettement ont atteint leurs limites ».
Les moyens de lutte de la classe ouvrière
Comme on pouvait s'y attendre, une bonne partie de la discussion a porté sur la question : quels sont les moyens de lutte dont dispose la classe ouvrière pour s'opposer à cette situation insupportable ?
Une polémique respectueuse entre deux personnes présentes, d'un coté, et de l'autre une majorité des présents, surtout des jeunes, s'est alors ouverte. Alors que les deux premiers étaient favorables à des alternatives nationalistes, d'une intervention de l'Etat pour sauver l'économie nationale, les autres ont mis l'accent sur la lutte autonome des travailleurs dans la perspective de la révolution mondiale.
Alors que les premiers disaient : « Il faut faire pression pour que la demande augmente et sortir ainsi de la crise ; lutter pour que les entreprises augmentent leur productivité et le développement technologique, demander que les crédits à la consommation augmentent », les autres répondaient : « Il ne faut pas demander aux capitalistes de faire quelque chose en faveur des travailleurs, il faut lutter pour les besoins des travailleurs de manière autonome sans faire confiance à ce que peuvent faire l'Etat et les capitalistes ».
Tandis que les premiers insistaient sur la nécessité de trouver une issue pour l'économie péruvienne, d'autres interventions considéraient que cela était un piège, une utopie réactionnaire. Aucun pays ne peut sortir tout seul de la crise. Il n'existe pas de solutions nationales à la crise. Il n'y a qu'une issue mondiale à cette crise et celle-ci ne peut être trouvée que par la lutte révolutionnaire des travailleurs.
Un des éléments présents a, cependant, exprimé sa confiance dans la capacité du capitalisme à trouver une solution mondiale à la crise : « Le 15 novembre vont se réunir des leaders du monde entier pour établir une coopération internationale qui permettra de sortir de la crise. » Est-ce qu'un nouveau Bretton Woods5 est possible, comme l'a affirmé cet intervenant ? Est-il possible, ainsi que l'a demandé un autre intervenant, d'assister à une « refondation du capitalisme sur des bases progressistes et favorables aux travailleurs ? ». Plusieurs interventions ont répondu par la négative à ces questionnements : le capitalisme ne porte pas en lui la moindre dynamique de progrès, bien au contraire, sa dynamique va dans l'autre sens, il ne peut apporter que toujours davantage de barbarie et de destruction ; aux sommets des dirigeants du monde, on prendra des mesures pour sauver les banques, les entreprises et les Etats en faillite aux dépens des travailleurs et de la grande majorité de la population mondiale6.
Deux autres intervenants ont insisté dans leur revendication pour que l'État intervienne davantage, pour que celui-ci ne se consacre pas à sauver des banques mais à prendre des mesures pour l'augmentation de la demande et des crédits pour les ménages. En réponse à cela, un débat sur le rôle de l'Etat s'est engagé. Un des présents a dit : « L'État, c'est les gens qui détiennent la richesse et il va prendre des mesures pour protéger cette classe en faisant toujours plus de coupes dans les subventions et les pensions », un autre affirma : « On nous dit de faire confiance à l'État, mais celui-ci n'est pas là pour nous défendre mais pour défendre les capitalistes. Luttons par nous-mêmes pour faire tomber cet État. Il ne faut pas sauver l'État ni demander à l'État de nous sauver. »
À l'appel d'un élément à la mobilisation « pour sauver la patrie péruvienne menacée par l'invasion des produits chiliens », un autre lui a répondu que l'enjeu « n'est pas de sauver la patrie mais de sauver l'humanité ».
L'autogestion est-elle une solution ?
Un des présents a mis en avant qu'« une bonne réponse à la crise, c'est la prise en mains des entreprises pour que les travailleurs les fassent fonctionner, montrant ainsi que le capitaliste ne sert à rien. En Argentine, il y a 185 entreprises autogérées coordonnées en un réseau solidaire ».
La réponse venue d'autres participants, surtout des jeunes, fut très claire : « L'exploitation est mondiale, prendre le contrôle d'une usine pour la gérer, c'est se soumettre à l'exploitation. Rappelons-nous de ce qui est arrivé en Russie, qui est restée isolée et fut happée par le marché mondial, comment une entreprise seule pourrait-elle sortir du marché mondial ? » Un autre participant a dit : « autogestion veut dire auto-exploitation des travailleurs », « les travailleurs ne peuvent pas gérer leur propre exploitation ».
D'une manière simple et claire, les intervenants ont montré que l'autogestion est une mesure pour sauver les entreprises capitalistes mais non pas pour sauver les travailleurs. Les travailleurs tirent les marrons du feu pour le compte du capital et celui-ci récupère l'entreprise pour l'intérêt de l'économie nationale. Ce que la crise actuelle démontre, ce n'est pas que les capitalistes ne serviraient à rien, mais c'est que non seulement on ne peut pas utiliser le système capitaliste au profit des travailleurs, mais que ce dernier représente un danger pour l'humanité et qu'il ne s'agit pas d'autogérer l'exploitation mais de lutter contre elle dans la perspective de l'abolir à échelle mondiale7.
Poursuivre les réunions
Un des présents a dit : « Il est nécessaire de lutter contre le capitalisme, il est nécessaire de lutter en tant que classe ouvrière, mais j'ai beaucoup de doutes, j'ai dans ma tête tellement de questions que parfois j'ai l'impression qu'elle va exploser. »
Cette intervention si spontanée et sincère a donné lieu à une discussion. La lutte ouvrière est loin d'être facile, elle doit surmonter de nombreux obstacles, elle doit faire face à des problèmes gigantesques, elle se pose une foule de questions pour lesquelles il n'existe pas de manuel pour y répondre. Il n'y a qu'à travers les expériences vivantes des luttes, mais, surtout, grâce aux débats les plus larges possibles où l'on discute avec sincérité, dans un effort de réflexion, avec confiance et solidarité, qu'on pourra commencer à répondre aux problèmes énormes que confronte aujourd'hui l'humanité.
Deux des présents proposèrent de poursuivre les réunions, que l'on fixe une date pour une prochaine rencontre où l'on puisse continuer une discussion méthodique et systématique orientée vers la compréhension des expériences de lutte de la classe ouvrière, et à partir de celles-ci, considérer quels sont les meilleurs moyens de lutte de la classe ouvrière.
Cette décision, qui a eu le soutien du responsable du local mis à disposition pour une nouvelle rencontre, est vraiment un grand pas. Il arrive souvent qu'une réunion aboutisse aux meilleures conclusions, les gens en sortent contents, mais qu'est qu'on fait par la suite ? Eh bien, chacun repart de son coté, tombe dans l'atomisation du quotidien, perd peu à peu de vue la chaleur du débat collectif et la vitalité de la discussion qui l'avaient animé. C'est pour cela qu'il faut se donner les moyens de se réunir régulièrement, de sentir le climat chaleureux de la rencontre et de la discussion collective. Il est nécessaire de continuer les éclaircissements, de se donner des perspectives pour contribuer à la lutte et à la conscience de la classe ouvrière.
Les camarades du Pérou qui ont mis en œuvre cette initiative ne sont pas seuls. Dans d'autres pays, des initiatives similaires se concrétisent. Il y a un milieu internationaliste qui, progressivement, est en train de se former en s'orientant vers une discussion et une collaboration internationales pour continuer à forger la meilleure arme que le prolétariat puisse posséder : son unité et sa conscience à l'échelle mondiale.
D'ici, nous vous envoyons, camarades, notre soutien le plus enthousiaste.
Courant Communiste International (30-10-2008)
oOo
PRESENTATION SUR LA CRISE ACTUELLE
Chers participants :
Nous vous remercions de votre présence8. Il ne s'agit pas ici pour nous de faire un meeting ni une conférence. Ce que nous cherchons c'est d'animer un débat où nous puissions tous participer.
Nous allons donc faire une présentation brève.
Nous tous ici présents sommes plus ou moins au courant des convulsions qui secouent actuellement l'économie mondiale. Personne ne cache aujourd'hui que cette crise est très grave, même plus grave, nous dit-on, que celle de 1929.
La crise ne se limite pas à la finance ; c'est bien une crise qui touche surtout l'industrie et le commerce. Ses conséquences sont très cruelles pour l'immense majorité des travailleurs et de toute l'humanité opprimée et exploitée : poussée du chômage, salaires qui tombent en vrille, des cadences de travail de plus en plus fortes sur les lieux de production, des accidents de travail qui se multiplient, des problèmes de logement en augmentation, et aussi, et de plus en plus, le spectre de la famine qui menace de plus en plus de gens.
Ces problèmes touchent tous les travailleurs du monde. Il est très difficile de trouver un pays qui puisse se sauver des dévastations actuelles. Ouvriers des métropoles industrielles, comme ouvriers des pays les plus pauvres, nous sommes tous frappés par la crise.
Mais, pourquoi il y a des crises ?
Nous ne pouvons nous étendre ici. Nous allons seulement rappeler quelques idées de base. Le capitalisme est le premier système social dans lequel la faim, la misère et le manque ne sont pas le produit de la sous-production ou de la pénurie en général, mais à cause de la surproduction, autrement dit de « l'excès » général des marchandises produites que le capitalisme ne parvient plus à vendre.
Dans les régimes féodaux, les famines étaient la conséquence des mauvaises récoltes, de la rareté dramatique de nourriture,, etc. Sous la domination du capitalisme, les famines sont le résultat de la surproduction, de la surabondance générale de nourriture et de marchandises.
Pour quoi une telle chose ?
Répondre à une telle question nous amène à analyser les contradictions qui conduisent le capitalisme à la crise et à la ruine.
Il existe différentes contradictions, mais nous voudrions simplement en souligner deux.
La première c'est que le capitalisme ne produit pas pour satisfaire les besoins humains mais pour en tirer de la plus-value, du profit. Ceci amène au fait que le capitalisme tend à produire au-delà des limites que le marché peut absorber. La capacité de consommation de la société se trouvé limitée par le système de travail salarié qui impose que ce qu'on paye à l'ouvrier ne doit pas aller beaucoup plus loin que ce dont il a besoin pour la reproduction de sa force de travail. Cette situation conduit le capitalisme à la surproduction.
La deuxième contradiction se trouve dans le fait que la production a tendance à prendre un caractère social et mondial, mais son organisation et son appropriation a un caractère privé et national. Ceci entraîne la concurrence féroce entre capitalistes particuliers et surtout entre capitaux nationaux qui se bagarrent à mort pour le partage des marchés existants.
Cette analyse peut nous servir pour répondre aux idées avec lesquelles nous abreuvent les médias, propagées par les gouvernants, les dirigeants syndicaux, les experts économiques, etc.
Ils nous disent qu'il ne faut pas s'en faire, que les crises sont cycliques. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des moments de prospérité et des moments de crise. Par conséquent, « on se tirera encore de celle-ci » comme on a pu se sortir des précédentes.
Nous pensons que ce n'est pas du tout la réalité. Pendant le 19ème siècle et le début du 20ème il y a avait effectivement des crises cycliques, mais, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même époque historique. À cette époque-là, le capitalisme pouvait s'étendre, conquérir de nouveaux marchés et chaque crise se résolvait par un élargissement du champ de la production, par l'avancée vers la formation du marché mondial.
Par contre, depuis le début du 20ème siècle, avec la formation du marché mondial, le capitalisme tend à la saturation, les marchés ne sont pas suffisants pour garantir la réalisation de la plus-value de toute la multitude des concurrents. Le résultat en est une tendance, d'un coté, à la crise pratiquement chronique et, d'un autre coté, à la concurrence impitoyable et de plus en plus destructrice entre les capitalistes du monde entier.
La crise actuelle est inscrite dans ce processus historique et son seul débouché ce sera l'appauvrissement bien plus grave, des convulsions de plus en plus grandes, une misère bien plus forte et étendue.
Encore une autre chose qu'on nous raconte, c'est que la crise actuelle est la crise du néo-libéralisme, mais qu'elle ne serait pas celle du capitalisme en tant que tel.
Les politiques libérales de « laisser faire le marché », « d'éliminer les régulations », « d'inhibition de l'État » auraient conduit au désastre actuel. La solution serait l'intervention de l'État dans l'économie, on trouverait alors une issue à la crise, une issue qui serait « socialiste » puisqu'elle serait trouvée au « bénéfice » de la grande majorité exploitée et appauvrie.
Voilà le sermon du « socialisme du 21ème siècle » de Chávez, de Correa, et d'autres dirigeants de gauche en Amérique latine.
Nous pensons, en premier lieu, que la dichotomie « libéralisme ou étatisme » est fausse. En réalité, le capitalisme fonctionne selon une tendance générale orientée vers le capitalisme d'Etat, qui est opérationnelle dans tous les pays et qui a fondamentalement deux formes :
- l'intervention indirecte de l'État, ce qu'on appelle le « néolibéralisme » ;
- l'intervention directe et ouverte de l'État qu'on appelle faussement « socialisme »
L'État est intervenu dans les économies capitalistes depuis de nombreuses années. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est aussi à l'échec de toutes les politiques étatiques. C'est l'échec des politiques néolibérales, mais c'est parce que préalablement, ce fut également l'échec des politiques keynésiennes et « socialistes ».
Aucune politique capitaliste ne nous sortira de l'impasse. Toute politique économique ne peut que s'appuyer sur encore plus de chômage, encore plus de misère, encore plus de famine.
L'alternative n'est pas : néolibéralisme ou interventionnisme étatique « socialiste », mais poursuite du capitalisme avec son corollaire d'enfoncement dans la barbarie ou lutte massive du prolétariat international pour la révolution mondiale, pour la construction d'une nouvelle société basée sur la communauté humaine mondiale.
Nous vous remercions de votre écoute attentive et nous vous encourageons à poser toutes les questions que vous considérez nécessaires. Il serait aussi très bien que des réponses soient faites ailleurs que de la tribune, par d'autres personnes présentes dans la salle.
1 Une première réunion avait eu lieu en octobre 2007. Voir, en espagnol, Reunión Pública en Perú : hacia la construcción de un medio de debate y clarificación [164]. [164]
2 Voir annexe ci-dessous.
3 Dans ce qui suit ce n'est pas notre position (CCI) que nous transcrivons, mais celle qui a été exprimée par les participants. Pour connaître notre position sur la crise actuelle, nous invitons le lecteur à lire les documents suivants : « Le capitalisme est un système en faillite, mais un autre monde est possible : le communisme [165] », (RI novembre 2008) ; « Crise du néolibéralisme ou crise du capitalisme ? [166] » ; « Va-t-on revivre un krach comme en 1929 [167] ? »(RI Octobre 2008)
4 Nous reprenons ici les notes manuscrites prises lors du débat. Nous pensons rester fidèles à ce qui a été dit. Si l'un des présents considère que son intervention n'a pas été correctement retranscrite, nous l'invitons à nous écrire pour corriger ce qui doit l'être.
5 Les Accords de Bretton Woods sont les résolutions de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies, qui s'est tenue dans le complexe hôtelier de Bretton Woods, (dans le New Hampshire, aux Etats-Unis), entre le 1er et le 22 juillet 1944, où se sont établies les règles des relations commerciales et financières entre les pays le plus industrialisés du monde. On y a décidé aussi la création de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International et l'utilisation du dollar en tant que monnaie d'échange de référence internationale. Ces organismes sont devenus opérationnels en 1946 (source Wikipedia).
6 L'Islande est un pays en faillite et le FMI est allé lui apporter son aide mais en exigeant des mesures d'austérité draconiennes qui affectent les 300.000 habitants de l'île. La Hongrie se trouve aussi en difficulté. Elle va recevoir un crédit de 20 milliards de € du FMI, mais, en échange, celui-ci exige la mise en place de mesures qui vont se concrétiser en licenciements, nouvelles coupes dans les budgets sociaux, élimination de subventions, augmentation des taxes, etc.
7 Les lecteurs intéressés par notre position sur l'autogestion peuvent consulter notre débat (en espagnol) [168] avec le groupe argentin Nuevo Proyecto Histórico.
8 Nous tenons à remercier l'aide fournie par le responsable de la salle qui, par ailleurs, a participé activement à la discussion.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Géographique:
- Pérou [128]
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Réunions publiques : Les révoltes de la jeunesse en Europe confirment le développement de la lutte de classe
- 2961 lectures
A la fin de l'année 2008, quarante ans après l'année 1968, plusieurs pays d'Europe ont été touchés simultanément par des mouvements massifs de la jeunesse scolarisée (étudiants et lycéens). En Grèce, les assemblées générales massives d'étudiants ont même évoqué un nouveau "Mai 68". En effet, ce ne sont pas seulement des jeunes qui se sont mobilisés contre les attaques du gouvernement et contre la répression de l'État policier, mais aussi plusieurs secteurs de la classe ouvrière en solidarité avec les jeunes générations.
L'aggravation de la crise économique
mondiale révèle de plus en plus la faillite d'un système qui n'a
plus d'avenir à offrir aux enfants de la classe ouvrière. Mais ces
mouvements sociaux ne sont pas seulement des mouvements de la jeunesse.
Ils s'intègrent dans les luttes ouvrières qui se développent à l'échelle
mondiale. La dynamique actuelle de la lutte de classe internationale,
marquée par l'entrée des jeunes générations sur la scène de l'histoire,
confirme que l'avenir est bien entre les mains de la classe ouvrière.
Face au chômage, à la précarité, à la misère et à l'exploitation,
le vieux slogan du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous" est plus que jamais d'actualité.
Nous invitons nos lecteurs à venir discuter de ces questions lors de nos prochaines réunions publiques.
- A Lyon, le 10 janvier à 17 h
- A Paris, le 24 janvier à 15 h (et non 17 h comme indiqué par erreur dans notre presse)
- A Toulouse, le 24 janvier à 15h
- A Nantes, le 24 janvier à 16 h
- A Marseille, le 31 janvier à 17 h
- A Caen, le 31 janvier à 17 h
- A Tours, le 7 février à 16 h
- A Lille, le 14 février à 14h30
Pour plus de précisions, reportez-vous à l'encadré "réunions publiques" ci-contre à gauche.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Réunions publiques au Brésil : débats sur mai 68 et la perspective révolutionnaire
- 3135 lectures
Le CCI a tenu récemment deux réunions publiques au Brésil sur Mai 68. La première a eu lieu dans une université (UESB) de l'État de Bahia1 sur l'initiative d'un cercle de discussions et la seconde, assumée conjointement avec deux autres organisations prolétariennes, Opposition Ouvrière2 (OPOP) et le Groupe Anarres3, a eu lieu à São Paulo. Le Brésil ne fait en rien exception pour ce qui concerne la campagne idéologique de toutes les fractions de la bourgeoisie dans le monde, visant à dénaturer Mai 68 et faire en sorte que "ceux qui ont de la sympathie pour ces évènements en retirent des fausses leçons, qu'ils n'en comprennent pas la signification 4." Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre ces évènements ni de pouvoir accéder à des documents permettant une vision plus objective de ce qui est réellement arrivé, les médias ont un discours tout prêt qui résume Mai 68 aux confrontations de rue avec la police et cantonnent l'action de la classe ouvrière à un rôle de figurant, loin à l'arrière plan par rapport au mouvement étudiant. Cependant, au Brésil comme dans beaucoup d'autres pays, il existe des éléments, en particulier parmi les jeunes générations, qui sont intéressés à comprendre ce qui s'est réellement passé en Mai 68. C'est ce qu'a illustré l'assistance significative à l'université, dépassant la quarantaine de personnes.
Le
réel changement historique qu'a représenté Mai 68
La mise en évidence de la signification profonde et historique de Mai 68, qui a marqué la fin d'une période de contre-révolution de 40 années, a été parfaitement prise en charge par certaines interventions :
-
"Il est important de se réapproprier la mémoire historique du prolétariat. Mai 68 est présenté au Brésil comme une lutte contre la dictature alors qu'elle a été l'expression de la crise mondiale du capitalisme. Mai 68 a mis fin à une période de contre-révolution (...) la jeunesse n'en pouvait plus de la contre-révolution. On parlait alors du communisme mais la lutte de classe n'a pas permis le dépassement du capitalisme. (...) Les conditions objectives pour la révolution existaient mais il n'y avait pas de parti révolutionnaire. De nos jours, les conditions sont plus favorables qu'en 68." (Groupe Anarres dans la réunion de São Paulo)
-
"Suite à la défaite de la vague révolutionnaire mondiale, le prolétariat a été dévoyé du chemin de la révolution. (...) On disait alors que le prolétariat s'était accommodé au capitalisme et que la lutte de classe avait disparu. Le rôle de la jeunesse a été central dans le retour du prolétariat sur la scène sociale. En plus de démentir toute cette propagande bourgeoise, le ressurgissement de la lutte de classe a démontré le rôle central des pays industrialisés, contrairement à ce qui se pensait généralement suite à la révolution russe." (OPOP dans la réunion à l'université)
"Pourquoi la révolution n'a-t-elle pas eu lieu en 68 et comment faire pour qu'elle puisse se produire dans le futur ?" On peut dire que cette question a constitué une préoccupation explicite ou implicite ayant traversé le débat dans les deux réunions et à laquelle il a été répondu à travers la discussion de différents questionnements : Qu'est-ce qui a réellement changé en 68 relativement à la période précédente de contre-révolution ? Quelles ont été les limitations de Mai 68 ?
Comprendre
ce qu'a réellement été la période de contre-révolution
Pour comprendre l'importance du changement que les événements de Mai 68 ont apporté, il était nécessaire préalablement d'illustrer ce qu'avaient signifié ces 40 années de contre-révolution subies par le prolétariat. Durant cette période, celui-ci n'a jamais cessé de lutter mais toutes ses luttes, loin de participer à le dégager de l'influence de l'idéologie dominante - qui s'exprimait notamment sous la forme du nationalisme et des illusions démocratiques - et de l'emprise des syndicats, ne faisaient que les renforcer.
Par exemple, dans les luttes massives de mai-juin 1936 en France, le prolétariat, suivant les consignes du Parti "Communiste" Français, manifestait en agitant pêle-mêle les drapeaux rouges et tricolores. Le venin idéologique stalinien avait ainsi pour fonction de faire croire qu'il existait une possibilité de concilier l'intérêt national (nécessairement l'intérêt du capital) et l'intérêt du prolétariat. C'est ainsi que ces luttes, loin de participer à favoriser l'autonomie du prolétariat, ne firent que le soumettre à l'intérêt national jusqu'à son embrigadement dans un camp impérialiste lors de la Seconde Guerre mondiale. Quant à l'action des syndicats pour maintenir la lutte dans le cadre social de l'ordre bourgeois, loin de susciter la méfiance des ouvriers, elle s'était traduite par l'augmentation du nombre des syndiqués.
La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été le théâtre d'un nouveau surgissement révolutionnaire, comme cela avait le cas après la Première, mais a constitué au contraire un facteur supplémentaire de désorientation du prolétariat, notamment grâce à la victoire du camp des Alliés, célébrée comme la victoire de la démocratie sur le fascisme, alors que les deux camps étaient tout autant barbares et capitalistes l'un que l'autre.
Le poids de la contre-révolution s'est exprimé jusque dans les limitations qu'il a imprimées à une lutte réellement prolétarienne comme celle des prolétaires hongrois en 1956 qui avaient fait surgir des conseils ouvriers et participés de mettre clairement en évidence la nature anti-ouvrière du stalinisme. Cependant, contrairement à ce qui s'était passé lors de la première vague révolutionnaire, cette lutte n'a non seulement pas mis en question le pouvoir de l'État mais s'est également prononcée en faveur d'un gouvernement s'appuyant sur la police "ordinaire" (à condition qu'elle ne soit pas au service du stalinisme) et sur l'armée nationale.
En d'autres termes, les luttes du prolétariat dans cette période ne parvenaient pas à dégager une perspective de remise en question de l'ordre dominant, de son idéologie, de ses organes d'encadrement du prolétariat.
La rupture de 68
Le mouvement de 68 a apporté deux contributions inestimables :
-
faire une nouvelle fois la preuve dans la pratique de la capacité de la classe ouvrière à développer spontanément une lutte massive, non seulement sans que les partis et organisations dits ouvriers aient fait quoi que ce soit en faveur de son surgissement mais alors qu'ils avaient tout fait pour que rien ne se produise ;
-
remettre en question des "vérités" qui semblaient éternelles et qui enfermaient la classe ouvrière dans la prison idéologique de la contre-révolution. C'est ainsi que furent remis en question, par des fractions de la classe ouvrière, la nature communiste de l'Union soviétique, la nature ouvrière des partis de gauche, le rôle "ouvrier" des syndicats, etc.
En réalisant cette analyse critique de son passé, le prolétariat se réappropriait sa propre histoire : il redécouvrait qu'avaient existé les conseils ouvriers, organes de sa lutte unitaire et révolutionnaire ; qu'il y avait eu la révolution en Allemagne en 1919, après la révolution russe ; que celle-ci avait été le théâtre de confrontations entre syndicats et ouvriers et qu'elle avait finalement été défaite par l'action de la social-démocratie (traître depuis 1914) au pouvoir. Ce fut alors cette nécessité de comprendre le monde, de vouloir le changer qui animait de nombreuses discussions dans la rue, dans certaines universités transformées en forums permanents et dans certaines entreprises. Toute cette effervescence fut réellement la grande caractéristique de Mai 68.
Cela a constitué une contribution énorme à la reprise de la lutte de classe à l'échelle internationale, mais on ne pouvait exiger de cette nouvelle génération, qui avait grandement contribué à faire de Mai 68 une rupture avec la domination écrasante de la contre-révolution, qu'elle soit également capable d'imprimer une dynamique révolutionnaire, et cela d'autant plus que les conditions de celle-ci n'existaient pas encore.
Les limitations de Mai 68
En effet, en voulant défendre le caractère authentiquement prolétarien de ces événements, notamment face aux campagnes idéologiques ignominieuses de la bourgeoisie visant à défigurer Mai 68, il existe une tendance, de la part d'éléments authentiquement prolétariens et sincères, à sous-estimer certaines limitations de ces épisodes, souvent par manque d'information.
Le poids des manœuvres syndicales
Comme cela a été dit dans la présentation, un million de travailleurs sont entrés en grève avant que les consignes de la CGT appelant à la grève ne soient connues. Ce fut généralement dans les entreprises où la grève a été spontanée, occupées par l'action des ouvriers prenant leurs luttes en mains, que s'est exprimée la vie politique la plus riche et intense. Mais cela ne peut faire oublier que les autres entreprises, c'est-à-dire une majorité d'entre elles, ont été occupées à l'initiative des syndicats qui ont ainsi réussi à établir leur contrôle sur la lutte et se sont empressés de la fragmenter, mettant en place des cordons sanitaires syndicaux pour empêcher l'entrée aux éléments politisés. Les syndicats ont alors organisé des parties de ping-pong dans les usines occupées pour distraire les ouvriers et éviter ainsi qu'ils ne s'intéressent trop à la lutte et à la politique. L'ambiance n'était pas alors à l'effervescence politique mais souvent sinistre. Le contraste était énorme avec les forums permanents de certaines universités ou d'une petite minorité d'autres entreprises.
Ceci signifie qu'il existait des disparités importantes concernant ce que la classe ouvrière était en train de vivre en ces instants.
Le fait que les syndicats aient réussi à prendre le train en marche a eu pour effet d'affaiblir le mouvement spontané de développement de la lutte. Le meilleur, quant à la participation active à la lutte, se rencontrait dans certaines assemblées générales, dans les divers comités qui firent leur apparition. Mais, contrairement à ce que supposaient certaines interrogations qui se sont exprimées dans les discussions, ce processus ne parvint en aucune manière à donner naissance à des conseils ouvriers et encore moins à une situation de double pouvoir, entre bourgeoisie et prolétariat. On en était alors très loin.
Les difficultés propres aux conditions de l'époque
Beaucoup d'étudiants de cette époque qui se considéraient révolutionnaires subissaient encore pleinement des mystifications de la période de contre-révolution. C'est ainsi qu'ils considéraient également comme révolutionnaires des personnages comme Che Guevara, Ho Chi Minh ou Mao, sans percevoir que ces derniers, qui avaient été ou étaient encore protagonistes de la contre-révolution, ne se différenciaient des staliniens classiques du Kremlin que par des choix impérialistes opposés (cas de Mao), voire uniquement au niveau des apparences (Che Guevara ou Ho Chi Minh).
Une difficulté de la situation d'alors fut également la rupture très importante entre la nouvelle génération et celle de ses parents qui étaient critiqués par leurs enfants. En particulier, pour avoir dû travailler dur afin de sortir de la situation de misère, voire de faim, qui avait résulté de la Seconde Guerre mondiale, il était reproché à cette génération de ne se préoccuper que de bien-être matériel. Ceci explique le succès de fantaisies sur la "société de consommation" ou de slogans du type "ne travaillez jamais", favorisés par le faible niveau de la crise économique ouverte qui venait de faire sa réapparition.
Mai 68 n'était qu'un début
Bien que s'étant éveillée à la conscience de nombreuses réalités sociales, la classe ouvrière était loin, en 68, de pouvoir faire la révolution. A cette époque, on parlait beaucoup de révolution, mais les conditions subjectives étaient loin d'être réunies pour cela. La révolution était alors conçue comme une possibilité proche, sans que soit prise en compte la difficulté réelle du processus qui conduit à une situation révolutionnaire. A la différence de la Première Guerre mondiale, et à la différence également des confrontations qui se produiront dans le futur entre prolétariat et bourgeoisie en réaction au désastre de l'actuelle crise économique mondiale, la classe ouvrière de 1968 avait de nombreuses illusions quant aux possibilités du capitalisme de se perpétuer sans être secoué par des crises toujours plus profondes. En d'autres termes, la révolution n'était pas conçue comme une nécessité.
Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on passe d'une situation contre-révolutionnaire à une situation révolutionnaire. Il était nécessaire que s'opère une maturation générale de la conscience au sein du prolétariat en tant que conséquence de l'aggravation de la crise économique. La faillite de ce système devait rendre évidente l'impossibilité de toute amélioration en son sein mais également que lui-même représentait un danger croissant pour l'humanité. A travers tout un processus d'expériences de luttes répétées et d'illusions perdues, le prolétariat devait renforcer sa conscience de la nature des syndicats en tant qu'organes d'encadrement de ses luttes par le capital, de l'impasse électorale, du rôle contre-révolutionnaire de la gauche du capital (PS, PC) et également de l'extrême gauche (trotskistes en particulier) qui ne diffère de la première que par le radicalisme du discours. Actuellement, notre classe a déjà parcouru un long chemin dans cette direction, mais ce chemin est encore loin d'être terminé.
Des luttes significatives après Mai 68 sont venues confirmer que les événements en France n'avaient constitué que le premier pas d'une dynamique nouvelle de développement de la lutte de classe. Ainsi par exemple, les luttes de l'automne 1969 en Italie ont assumé plus explicitement la confrontation aux syndicats. La lutte des ouvriers en Pologne en 1980 a constitué la tentative la plus importante, depuis la vague révolutionnaire mondiale, de la classe ouvrière de s'organiser par elle-même.
Les
limitations de 68 sont-elles imputables à l'absence d'un
parti révolutionnaire?
Déjà implicitement présente dans de nombreux débats, cette question a été posée explicitement à São Paulo. C'est une évidence qu'il n'y avait pas de parti révolutionnaire en 68. Les petits groupes internationalistes et révolutionnaires qui existaient à cette époque et intervenaient dans le mouvement étaient ultra minoritaires (bien que leur audience les dépassait alors largement), dispersés, hétérogènes et généralement très immatures.
En réalité, la question n'est pas "qu'il manquait un parti révolutionnaire pour que la situation soit révolutionnaire" mais l'absence d'un parti révolutionnaire était l'expression de l'immaturité des conditions subjectives pour donner naissance à un tel parti et créer les conditions d'une situation pré-révolutionnaire. En effet, la dimension historique du parti révolutionnaire (qui lui permet de synthétiser l'expérience historique du prolétariat) s'appuie sur la continuité politique des organisations révolutionnaires restées fidèles à la défense des intérêts du prolétariat international. Mais le parti est également le produit de la lutte de classe ouvrière au travers de laquelle il se développe jusqu'à obtenir une influence directe sur celle-ci. En d'autres termes, sans développement de la lutte de classe capable de sécréter une avant-garde révolutionnaire conséquente, il n'y a pas de possibilité qu'existe un parti révolutionnaire. Or, comme nous l'avons vu, la période de contre-révolution n'était en rien propice à l'apparition de l'avant-garde nécessaire. Et les événements de 68 qui ont clos cette période ne pouvaient pas non plus avoir cette capacité immédiate de faire surgir un parti révolutionnaire.
Néanmoins, l'effervescence politique de 68 a constitué une ambiance propice à la cristallisation de groupes politique prolétariens cherchant à rétablir le lien avec les véritables positions révolutionnaires, à intervenir dans la lutte de classe et à oeuvrer au regroupement international des révolutionnaires. Cet acquis de 68 constitue un maillon essentiel du travail de préparation en vue de la formation du futur parti lorsque le permettra le développement de la lutte de classe au niveau international.
Comment
le prolétariat va-t-il parvenir à dépasser le poids de l'idéologie
bourgeoise ?
"Combien de temps encore le prolétariat va-t-il continuer à se manifester comme classe exploitée soumise aux intérêts du capital, avant d'exprimer son être révolutionnaire ? Va-t-il parvenir à se débarrasser de toutes les barrières idéologiques qui constituent autant d'obstacles à la lutte, comme l'individualisme, le corporatisme, etc. ?" Cette question, qui a été explicitement posée à l'université, exprime une certaine anxiété plus générale ressentie par de nombreux éléments lorsqu'ils font le constat que, 40 ans après Mai 68, la révolution n'a pas encore eu lieu.
Comme nous l'avons vu, les conditions objectives et subjectives ont beaucoup évolué depuis 1968, du fait de l'aggravation considérable de la crise économique, de la barbarie (dont la manifestation la plus explicite est la prolifération des conflits impérialistes à travers le monde), mais aussi du renforcement de la conscience de la faillite du système capitaliste, du développement de la lutte de classe, avec des hauts et des bas. Cette dynamique a connu un reflux important au niveau de la conscience du prolétariat au moment de l'effondrement du bloc de l'Est, dont le régime était mensongèrement présenté comme "communiste", ce qui a permis à la bourgeoisie de développer des campagnes sur "la mort du communisme et de la lutte de classe". Mais, depuis 2003, la maturation des conditions subjectives de la révolution a repris son cours. Non seulement il existe actuellement une simultanéité des luttes au niveau international comme il n'en avait jamais existé auparavant, affectant de nombreux pays, développés ou de la périphérie du capitalisme, mais au sein de ces luttes s'expriment aussi des caractéristiques essentielles pour le renforcement du combat de classe : solidarité active entre secteurs de la classe ouvrière, mobilisations massives, tendance à ne pas attendre, voire à ignorer, les consignes syndicales pour entrer en lutte...
Une différence importante avec Mai 68 concerne également les mobilisations étudiantes. Les étudiants qui travaillent pour pouvoir payer leurs études n'ont pas beaucoup d'illusions quant à la situation sociale qui sera la leur à la fin de leurs cursus universitaires. Par-dessus tout, ils savent que leurs diplômes leur donneront à peine le "droit" de se retrouver dans la condition ouvrière sous ses formes les plus dramatiques : le chômage et la précarité. La solidarité qu'ont exprimé les étudiants en lutte en 2006 en France contre le CPE5 envers les travailleurs est en premier la conséquence de la conscience qu'ils avaient en majorité d'appartenir au même monde, celui des exploités en lutte contre un même ennemi, les exploiteurs. Cette solidarité est très éloignée de la démarche d'origine petite-bourgeoise des étudiants de 1968 et dont témoignent entre autres certains slogans de l'époque.
Lorsqu'on évalue le niveau actuel de la lutte de classe et son évolution depuis des décennies, on ne peut se limiter à une vision photographique, dans un pays et à un instant (hors période de lutte) donnés. Il faut une vision internationale, dynamique, capable de prendre en compte le cheminement souterrain de la conscience (la vielle taupe dont parlait Marx) et qui s'exprimera ouvertement et explicitement seulement à des moments particuliers mais significatifs du futur.
Pour évaluer les perspectives, il faut également prendre en compte un facteur important : l'impact de l'idéologie bourgeoise sur le prolétariat qui détermine, d'une certaine façon, la capacité de ce dernier à se libérer ou non de tous les préjugés qui entravent le développement de sa vision historique du futur et des moyens pour assumer son être révolutionnaire. Au sein d'une période historique comme la décadence du capitalisme, depuis le début de laquelle - Première Guerre mondiale - est posée l'alternative Révolution ou barbarie, mais les conditions d'une dynamique vers des confrontations de classe n'existent cependant pas en permanence. En effet, il faut une crise ouverte du système (crise économique comme maintenant ou dans les années 1930) et le refus du prolétariat de se sacrifier au bénéfice du capital national, c'est-à-dire pour les intérêts de la bourgeoisie. La conjonction de ces deux facteurs, crise ouverte et refus de la logique capitaliste de la part du prolétariat, affaiblit l'impact de l'idéologie de la classe dominante. En effet, la base matérielle de l'idéologie bourgeoise, c'est la domination politique et économique de cette classe sur la société. Or, lorsque la crise économique vient remettre en question l'idée selon laquelle le capitalisme est un système universel et éternel, et ouvrir ainsi les yeux des exploités sur la catastrophe que représente sa domination sur le monde, alors tout ce qui peut être dit par la bourgeoisie pour défendre cette société de misère ne peut évidemment être pris pour argent comptant. Au contraire, cela ne peut que susciter l'indignation, la remise en question et la recherche d'une issue politique.
Comment le prolétariat va-t-il parvenir se débarrasser des syndicats ?
Quarante ans après 1968, cette question demeure à l'ordre du jour, comme l'a illustré le fait qu'elle ait été posée explicitement dans la réunion à l'université. Comment expliquer qu'il en soit encore ainsi alors que justement Mai 68 avait constitué une concrétisation explicite du rôle des syndicats, contre la lutte de classe et en faveur de l'ordre dominant ? Mai 68 a surpris la bourgeoisie et la première réponse de son appareil politique est venue de "la gauche", des syndicats. Si les syndicats n'avaient pas eu la capacité de prendre le train en marche, alors la situation aurait probablement connu un niveau supérieur de confrontation entre les classes. Le contrôle qu'ils ont réussi à prendre sur le mouvement a permis à la bourgeoisie de finalement faire en sorte que le travail reprenne, sans que les ouvriers aient arraché des concessions importantes (relativement à l'ampleur de la mobilisation), et que la classe ouvrière subisse ainsi une défaite. Mais ce fut une défaite riche d'enseignements, notamment concernant le rôle anti-ouvrier des syndicats, ce qui s'est traduit à l'époque par le fait que des milliers d'ouvriers aient déchiré leur carte syndicale.
Le problème est que la bourgeoisie a su tirer les enseignements de ces événements pour éviter que se reproduise une situation contraignant les syndicats à se discréditer de façon aussi importante face à la lutte de classe. De façon générale, l'ensemble de l'appareil politique de la bourgeoisie a su s'adapter, notamment ses fractions de gauche et d'extrême-gauche à travers l'adoption d'un langage plus radical, à même de tromper les ouvriers. Les syndicats aussi ont opéré une telle modification de leur attitude face à la lutte, essayant d'anticiper les mobilisations spontanées de la classe ouvrière. En plus de cela, une division du travail entre syndicats modérés et syndicats dits de "lutte de classe" a été systématiquement développée afin de mieux diviser les rangs ouvriers (une telle division s'opérant parfois au sein d'un même syndicat à travers l'opposition base/sommet). Une telle division ne correspond en rien au caractère plus ou moins "ouvrier" de certains syndicats mais uniquement aux nécessités de la stratégie anti-ouvrière de ces organes.
En réalité, la capacité des syndicats de saboter efficacement la lutte de classe dépend de leur capacité à mystifier les ouvriers. Ceci a été illustré par des expériences importantes de lutte de classe dans des pays où les syndicats ne disposent pas d'une telle capacité de mystification et apparaissent directement pour ce qu'ils sont : la police de l'État chargée d'affronter la lutte de classe. L'exemple le plus célèbre demeure à ce jour celui de la Pologne en 1970, 1976 et surtout 1980 où les luttes ont atteint un niveau tel que la bourgeoisie stalinienne s'est trouvée dans l'obligation d'autoriser la création d'un "syndicat indépendant" (Solidarnosc) ayant pour mission de faire reprendre le travail aux ouvriers.
Plus récemment, ces deux dernières années, des luttes de grande envergure se sont développées en Egypte, notamment dans l'industrie textile où les ouvriers ont dû s'organiser au-delà du secteur pour faire face à l'ennemi (aussi bien contre les syndicats que contre l'armée et la police de l'Etat dans la lutte revendicative.
En plus de limiter les possibilités de développement des luttes, en bloquant leur auto-organisation et leur extension, l'action permanente des syndicats contribue pour beaucoup à empêcher que la classe ouvrière prenne confiance dans sa capacité à prendre en charge ses propres luttes, et plus généralement dans sa capacité à acquérir la conscience qu'elle représente une force énorme dans la société. Tout ceci explique en quoi l'obstacle syndical est essentiel sur le chemin du développement de la lutte de classe.
Cependant, il n'est pas insurmontable et l'accélération de la crise économique, une fois de plus, joue en faveur de la lutte de classe, obligeant les syndicats à s'impliquer toujours davantage dans des manœuvres de sabotage des luttes. Or, plus la classe ouvrière est déterminée à assumer les nécessités de la lutte unie au-delà des secteurs et contrôlée par les ouvriers eux-mêmes, et plus les syndicats tendront à être démasqués. La base ouvrière sur laquelle s'appuie le syndicalisme des pays industrialisés démocratiques et qui lui permet de mystifier le prolétariat se trouve chaque fois plus dans l'obligation de devoir choisir son camp. Une partie de cette base renouera alors avec le processus des années 1970 et 1980 de sortie des syndicats et de leur influence.
Des mouvements de classe de grande ampleur étaient contenus dans la perspective ouverte par Mai 68 mais, à cette époque, ils n'étaient pas encore à l'ordre du jour.
Les questions et préoccupations mises en avant durant les débats6 que nous venons de relater expriment, selon nous, la maturation des conditions subjectives qui prépare ces mouvements futurs. Nous ne pouvons qu'encourager nos lecteurs à prendre en charge de tels débats autours d'eux. Quant à nous, nous saurons toujours nous montrer disponibles pour y participer sous une forme ou une autre.
(5 mai 2008)
1 A Vitória da Conquista.
2 Organisation dont nous avons déjà indiqué l'existence dans certains articles de notre presse, notamment Salut à la création d'un noyau du CCI au Brésil ! [170] ; Révolution Internationale n°38.
3 Organisation dont nous avons déjà indiqué l'existence sous le nom "Groupe de Santos" dans l'article cité dans la note précédente.
4 Extrait du document en portugais à partir duquel a été introduit le débat: Mai 68 et la perspective révolutionnaire [171].
5 Lire notre article Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [64], Revue Internationale n° 125.
6 Toutes n'ont pu être répercutées au sein de cet article notamment lorsqu'elles tendaient à s'écartaient du thème initial. Nous voulons cependant signaler une préoccupation qui s'est exprimée à propos de la Chine concernant les perspectives de développement de la lutte de classe dans ce pays et une autre relative à la situation actuelle en Amérique latine.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [132]
Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière
- 7952 lectures
De nombreux commentaires ont paru sur nos sites en français et en espagnol suite à la publication de cet article. Nous avons publié un texte de réponse [172] à une partie des questions qui nous sont posées.
En six mois, les lignes ferroviaires de la SNCF ont été touchées à une douzaine de reprises par des actes de sabotage. Chaque fois s'en est suivie la même galère pour les passagers : des heures d'attente en gare ou en pleine voie, suite à la paralysie du trafic.
Début novembre, l'état français prévient : il va frapper fort ! Il exige de la police une enquête rapide et de la justice la plus grande sévérité. Ainsi, le 8 novembre, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, demande que "tous les moyens, notamment de police technique et scientifique, soient mobilisés au service des investigations" et la ministre de la Justice Rachida Dati donne des "instructions de fermeté aux procureurs généraux". Hasard incroyable, à peine 48 heures après ces injonctions ministérielles, la police parvient à mettre la main sur les "coupables", un groupe de dix personnes se réclamant de la mouvance "anarcho-autonome"1 et installé à Tarnac, en Corrèze, au fin fond de la campagne française ! Tout cela pue la manipulation à plein nez ! D'ailleurs, en réalité, ce groupe était sous étroite surveillance depuis des mois. Le journal Le Monde du 11 novembre avoue ainsi : "Ce groupe faisait l'objet d'une surveillance de la sous-direction de la lutte anti-terroriste de la police judiciaire depuis plusieurs mois, sur instructions de Michèle Alliot-Marie. Une enquête préliminaire avait même été ouverte par le parquet de Paris depuis avril." Tout le cirque médiatico-judicaire actuel autour de ces présumés "terroristes" est donc le fruit d'une longue préparation opérée en amont par la bourgeoisie. A la lumière de ces derniers événements, les propos de Michèle Alliot-Marie (encore elle) de février 2008 prennent ainsi tout leur sens : "Depuis plusieurs mois, j'étais encore ministre de la Défense, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale".
Il n'y a donc aucun doute à avoir, qu'ils soient réellement coupables ou non des actes dont l'État français les accuse, ces "autonomes" n'ont été en réalité que des marionnettes dans les mains de la bourgeoisie. La vraie question est donc pourquoi ? Pourquoi les avoir laissé faire pendant des mois ? Et pourquoi les arrêter en grande pompe aujourd'hui en les traitant comme les pires des criminels ?
Des actes impuissants contre la domination de la bourgeoisie
Ce petit groupe "d'autonomes" est en train d'être broyé par la machine judiciaire. La bourgeoisie qui cyniquement leur a tendu un piège pendant des mois se jette sur ces proies faciles aujourd'hui comme des hyènes enragées avec tout son arsenal répressif. Ainsi, pour avoir (peut-être) bloqué des trains et mis une belle pagaille, cette poignée d'éléments déclassés (bien que provenant d'un milieu familial aisé, insiste lourdement la propagande pour mieux les discréditer) se retrouvent accusés aujourd'hui "d'actes de terrorisme" et "de recours organisé à la lutte armée" contre l'État, encourant des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ! Rien de moins !
Il est possible que ceux qui ont commis ces sabotages pensaient, par ces actes spectaculaires et symboliques, réveiller les consciences et démontrer que le système est finalement vulnérable, etc. Dans une certaine mesure, il y a chez ces éléments l'expression d'un sentiment de révolte brute et désespérée contre l'inhumanité de ce système. Mais en se fourvoyant dans de tels actes stériles qui ne représentent pas plus qu'une piqûre de moustique sur une peau d'éléphant, ces éléments n'ont fait, surtout, que révéler leur propre impuissance. Il s'agit d'éléments déboussolés mus par une révolte avant tout individualiste et qui se livrent à des actions absurdes. Commettre de tels actes ne relève pas seulement de la naïveté mais aussi et surtout de la stupidité. En réalité, de telles actions n'ont aucune chance de réveiller la moindre conscience au sein de la classe ouvrière. Elles ne font que souligner le désespoir impuissant et l'isolement de leurs auteurs. En fait, s'imaginer que de tels actes, émanant par nature d'une infime minorité, pourraient participer de la lutte contre le système d'exploitation relève d'une bonne dose de mégalomanie. De tels actes de sabotage n'ont rien à voir avec les méthodes de lutte de la classe ouvrière. Ces méthodes désespérées sont complètement étrangères et totalement aux antipodes des luttes collectives et solidaires de cette dernière.
Ainsi, si nous dénonçons la répression de l'État bourgeois qui s'abat aujourd'hui sur ces déclassés surveillés et manipulés, nous rejetons aussi sans ambiguïté leurs hypothétiques actes de sabotage.
Des actes toujours utilisés contre la classe ouvrière
En fait, ces éléments n'ont fait que servir ceux-là même contre qui ils croyaient lutter. Quels qu'ils soient, les acteurs de ce sabotage servent effectivement parfaitement les intérêts de la bourgeoisie. C'est pourquoi il y a eu une telle publicité médiatique autour de cette affaire, c'est pourquoi aussi la police a laissé s'enferrer ces éléments durant des mois. La bourgeoisie a manipulé ce petit groupe "d'autonomes" afin de lancer une vaste campagne idéologique cette fois dirigée contre toute la classe ouvrière.
En assimilant aujourd'hui la lutte ouvrière au terrorisme, et en justifiant ainsi que s'abatte sur ceux qui prétendent lutter contre le système capitaliste la plus impitoyable des répressions, elle prépare les esprits à la répression des combats ouvriers futurs. En s'appuyant sur ce bourrage de crâne actuel, elle espère pouvoir réprimer en toute liberté d'éventuelles luttes à venir, au moindre dérapage, au nom du maintien de l'ordre public. Et s'il n'y a pas de dérapages, elle les créera elle-même. Il s'agira ici de la répétition d'un autre grand classique de la bourgeoisie : infiltrer ses agents dans les manifestations pour jouer aux casseurs et justifier l'envoi des forces de l'ordre. Il faut d'ailleurs prêter l'oreille aux propos d'un "expert", vieux maître en coups fourrés de la bourgeoisie italienne qui, au moment où se développent aujourd'hui des luttes en Italie notamment dans les universités2, a livré cette clé dans une interview :
"Président Cossiga, pensez-vous qu'en menaçant d'utiliser la force publique contre les étudiants, Berlusconi ait exagéré ?
Cela dépend, si on pense être le président du conseil d'un État fort, non, il a très bien fait. Mais puisque l'Italie est un État faible et qu'il n'y a pas dans l'opposition le parti de granit qu'est le PCI mais l'évanescent PD, je crains que les faits ne suivent pas les paroles et qu'en conséquence Berlusconi fasse d'autant plus triste figure.
Quels sont les faits qui devraient suivre ?
Maintenant, Maroni (actuel ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Berlusconi, NDLR), devrait faire ce que j'ai fait quand j'étais moi-même ministre de l'intérieur".
C'est-à-dire ?
Laisser faire. Retirer les forces de police de la rue et de l'université, infiltrer le mouvement avec des agents provocateurs prêts à tout, et faire que pendant une dizaine de jours les manifestants dévastent les magasins, incendient des voitures et mettent les villes à feu et à sang".
Et après ?
Après quoi, fort du consensus populaire, le bruit des sirènes des ambulances devrait couvrir celui des autos de la police et des carabiniers".
Dans le sens où... ?
Dans le sens où les forces de l'ordre devraient massacrer les manifestants sans pitié et tous les envoyer à l'hôpital. Ne pas les arrêter pour qu'ensuite les magistrats les remettent tout de suite en liberté, mais les blesser jusqu'au sang et blesser aussi ces enseignants qui les agitent".
Même les enseignants ?
Surtout les enseignants. Pas les vieux, bien sûr, mais les tout jeunes maîtres oui. Se rend-on compte de la gravité de ce qui se passe ? Ce sont les enseignants qui endoctrinent les enfants et les font descendre dans la rue : c'est un comportement criminel !"3.
Tout cela ne fait-il pas étrangement penser aux faux casseurs et vrais provocateurs qui, en novembre 2007, au moment de la lutte des cheminots contre la réforme de leur système de retraite, se sont livrés à des actes similaires de sabotage des voies ferrées permettant de faire passer les cheminots pour des "terroristes" assoiffés de sang et de meurtre alors même qu'une sympathie était née dans les rangs ouvriers pour cette grève4 ?
La bourgeoisie est parfaitement consciente que la perspective est au développement des luttes, que face à la crise économique, la classe ouvrière ne va pas subir les attaques et la paupérisation sans réagir. Cette tendance au retour et au développement de la lutte de classe inquiète tous les gouvernements qui s'y préparent en modernisant et en renforçant particulièrement les appareils de surveillance policière et de répression, en France, en Italie comme partout ailleurs.
Une campagne amalgamant terroristes et révolutionnaires
Mais la perfidie de ce battage orchestré va plus loin encore : elle sert aussi à la bourgeoisie à faire l'amalgame entre les terroristes et les révolutionnaires. Elle vise à assimiler aux "actes terroristes", les paroles et les organisations de tous ceux qui rejettent l'État capitaliste, le parlementarisme bourgeois, l'action syndicale. Terroristes et révolutionnaires sont tous mis dans un même sac baptisé "ultragauche" : "SNCF : le retour de l'ultragauche activiste", "L'ultragauche déraille", "Sabotages SNCF : dix arrestations dans l'ultragauche",... 5 De tels titres se trouvent par dizaines dans la presse ou dans les journaux télévisés6. Et pour couronner le tout, la bourgeoisie insiste lourdement dans cette campagne de calomnies sur les liens internationaux qu'entretiendraient des "terroristes d'ultragauche". En suggérant ainsi la thèse "d'un complot terroriste international", la bourgeoisie cherche à dresser des barrières idéologiques contre le caractère international de la lutte de classe et à distiller la pire défiance envers le caractère tout aussi nécessairement internationaliste des organisations révolutionnaires.
Là aussi, elle justifie ainsi d'éventuelles répressions dans l'avenir. Mais surtout, elle tente de créer dès maintenant une espèce de cordon sanitaire idéologique autour des positions révolutionnaires. Elle agite le terrorisme comme un épouvantail pour décourager les ouvriers de s'approcher de tout individu brandissant dans la rue un journal dont les titres évoquent la révolution (comme c'est le cas, par exemple, de notre journal mensuel Révolution Internationale).7
Voilà l'intérêt de l'amalgame dans une même nébuleuse qualifiée d'"ultra-gauche" entre les positions des révolutionnaires internationalistes soutenant le développement de la solidarité et des luttes ouvrières afin de renverser, à terme, le capitalisme et une "mouvance anarcho-autonome" constituée de révoltés prônant le sabotage et l'action directe individualiste. La bourgeoisie essaye de faire passer pour des terroristes, à criminaliser préventivement, tous ceux qui cherchent à critiquer la domination du capitalisme et à développer le combat contre lui. On instille la défiance envers eux dans le reste de la population et dans la classe ouvrière en particulier. Il est d'ailleurs ici intéressant de voir comment le pouvoir en place, la droite pure et dure de Sarkozy, a à cœur de démarquer par contre cette ultra-gauche honnie de l'extrême gauche, démocratique et respectable. Dans une dépêche du 16 novembre, Michèle Alliot-Marie (toujours elle), tout en estimant l'ultra-gauche en France à 300 personnes, n'oublie pas d'ajouter qu'Olivier Besancenot (le leader actuel de l'extrême gauche) n'est pas de cette espèce, en insistant bien sur le fait que LUI accepte le "débat démocratique". Le message est clair et nous pourrions le sous-titrer ainsi : "Ouvriers, vous qui voulez lutter pour vos conditions de vie, faites attention de ne pas tomber entre les griffes des terroristes de l'ultra-gauche, dirigez-vous plutôt vers des partis responsables comme le NPA". Au passage, ce soutien de la droite révèle la vraie nature de classe (bourgeoise) des organisations d'extrême gauche, ces "premiers opposants à la politique de Sarkozy" !
Le terrorisme ne fait pas partie des méthodes de lutte de la classe ouvrière8. Il est toujours un jouet dans les mains de la classe dominante pour alimenter ses propagandes mensongères et justifier la mise en avant de son arsenal répressif contre son véritable ennemi : le prolétariat.
Non au terrorisme !
A bas la terreur de l'État bourgeois !
Vive la lutte unie et solidaire de toute la classe ouvrière !
CCI, le 17 novembre 2008
1 Cette "mouvance autonome" est extrêmement floue : elle a connu un certain succès d'abord en Italie où plusieurs "groupes autonomes" se sont formés au cours des luttes au printemps et à l'automne 1977, souvent sur les débris des groupes staliniens pro-maoïstes ou en rupture avec le "compromis historique" prôné par le PCI et les centrales syndicales. En France, elle s'est également développée à la même époque s'illustrant notamment lors de la lutte "anti-nucléaire" contre la construction de la centrale de Creys-Malville ou lors de l'occupation du quotidien Libération. Cependant, c'est dans le milieu anarchiste que cette mouvance activiste a connu le plus de succès ; non seulement elle prône l'affrontement violent avec la police dans les manifestations de rue mais elle met en avant la théorisation anarchisante des actions de sabotage destinées à servir symboliquement d'exemple et à défier ou perturber les rouages de l'État. Beaucoup dans cette nébuleuse "autonome" n'ont pas clarifié l'ambiguïté de leurs rapports avec les véritables groupes terroristes paramilitaires des années 1970 marqués par le gauchisme et le stalinisme, que ce soit la RAF en Allemagne, les Brigades Rouges en Italie, les GARI en Espagne, les NAPAP ou Action Directe en France, même s'ils rejettent aujourd'hui catégoriquement le recours au meurtre.
2 Pour le contexte de cette interview, voir notre article sur les manifestations actuelles contre les réformes de l'Instruction publique en Italie.
3 Interview de Cossiga par Andrea Cangini du jeudi 23 octobre 2008 : "Il faut les arrêter, le terrorisme part aussi des universités" publié dans Quotidiano Nazionale.
4 Cette campagne est d'ailleurs internationale comme en témoigne la propagande actuelle des médias envers le film allemand récent sur la "Bande à Baader".
5 Respectivement dans Le Figaro du 14 novembre, sur M6 (chaîne de télévision) le 11 novembre, dans Le Parisien du 11 novembre.
6 En France, le livre de référence définissant "l'ultragauche" est celui de Christophe Bourseiller nommé Histoire générale de l'ultragauche Et en bonne place, dans ce fourre-tout infâme, se trouve la Gauche communiste et donc évidemment le Courant Communiste International. D'ailleurs sur un plateau de télévision sur la 5, un autre "spécialiste de l'ultragauche" a affirmé que le terrorisme actuel des autonomes trouvait ses racines dans le "bordiguisme" des années 1920, qui en tant que Gauche d'Italie constitue une des fractions qui se sont dégagées de la 3e Internationale gangrenée par la contre-révolution stalinienne et dont le CCI revendique l'héritage révolutionnaire. Pour comprendre pourquoi nous ne faisons absolument pas partie de cette pseudo-"mouvance ultragauche", lire notre article "A propos du livre de Bourseiller [173]'Histoire générale de l'ultragauche' [173]".
7 A plusieurs reprises, lors d'actions "terroristes" médiatisées, des membres de notre organisation ont eu à répondre à la question (posée par des passants ou des collègues de travail ayant une vague idée de leurs convictions révolutionnaires) : "Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ces attentats ?".
8 Cette position de base, nous l'affichons au dos de chaque numéro de la presse du CCI et nous la rappelons ici : "Le terrorisme n'est en rien un moyen de lutte de la classe ouvrière. Expression de couches sociales sans avenir historique et de la décomposition de la petite bourgeoisie, quand il n'est pas directement l'émanation de la guerre que se livrent en permanence les États, il constitue toujours un terrain privilégié de manipulation de la bourgeoisie. Prônant l'action secrète de petites minorités, il se situe en complète opposition à la violence de classe qui relève de l'action de masse consciente et organisée du prolétariat."
Géographique:
- France [45]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Terrorisme [174]
Un débat à EKS sur la grève à Türk Telekom en Turquie
- 3611 lectures
Nous publions ici une série de quatre articles traduits du turc par les camarades de Enternasyonalist Komünist Sol (EKS), concernant la grève qui a eu lieu à Türk Telekom fin 2007.
Le premier a été écrit au début de la grève. Il analyse brièvement les forces en jeu dans le conflit.
Le second couvre la fin de la grève considérée ici comme une victoire pour les travailleurs (cette grève de 44 jours s'est achevée avec une augmentation de salaire de 10%).
Les deux articles suivants ont été publiés comme faisant partie d'un débat au sein du EKS quant à la vraie nature de la fin de la grève : le camarade Temel avance qu'en dépit des apparences, la grève a en fait été une défaite, alors que la réponse du camarade Devrim revient à l'analyse originelle de cette grève et sur les critiques du camarade Temel pour conclure que, quelles qu'en aient été ses faiblesses, la grève fut au contraire une victoire tant sur le plan économique que politique. Nous considérons que le débat exprimé dans ces deux articles est un débat important pour la classe ouvrière dans son ensemble.
Non seulement la question de ce qui constitue ou pas une victoire pour les travailleurs est posée, mais elle l'est dans un contexte général qui devrait attirer l'attention des travailleurs et des communistes du monde entier. Pour la majorité des travailleurs dans les grands centres industriels à travers le monde, la guerre impérialiste sert de toile de fond tendue en permanence sur le théâtre de nos vies, comme un rappel permanent de cet énorme mensonge, la promesse " d'un monde de paix et de prospérité " faite après l'effondrement du bloc de l'Est, mais elle n'est pas un enjeu immédiat dans nos vies quotidiennes. Et pourtant la question de la guerre et l'attitude à adopter par rapport à la guerre est pour les travailleurs turcs un enjeu immédiat et brûlant : la classe dirigeante turque mène une guerre plus ou moins permanente contre sa population kurde depuis les années 1980 et les opérations militaires autorisées fin 2007 n'ont été en aucun cas les premières incursions que l'armée turque a effectuées dans le nord de l'Irak (Kurdistan). De plus, à la différence des armées américaine et britannique combattant en Irak, l'armée turque est constituée essentiellement de conscrits. L'horreur et la brutalité de la guerre est un traumatisme quotidien pour les travailleurs dont les fils, frères, pères et maris se battent et meurent dans ce conflit sanglant mais dont on ne parle que très peu (voir le rapport de EKS sur l'invasion de l'Irak sur notre site web ou dans notre journal Révolution Internationale n° 392 de juillet-août 2008). L'attitude des travailleurs turcs revêt ainsi la plus grande importance pour les travailleurs et les communistes du monde entier et nous voulons commenter ici certains des arguments avancés dans les différents articles, afin de contribuer au débat.
Temel se demande tout d'abord " si les conditions nécessaires pour qu'une grève soit déclenchée étaient réunies ", et il est tout à fait vrai que les révolutionnaires ont besoin de se faire une idée précise de l'équilibre des forces (les ouvriers sont-ils plus ou moins dans une position de force face au patronat, par exemple) quand ils entrent en lutte. Cependant les critères qui permettent de juger de la force de cette grève restent certainement à définir.
-
La grève " n'avait pas été suffisamment préparée ". Mais comme la réponse à l'article de Temel le précise, comment est-il possible de le faire dans un contexte de capitalisme en décadence, quand les syndicats- les seules organisations permanentes à exister au sein de la classe ouvrière - sont du côté du patronat ? Temel ne pose pas la question de comment procéder pour préparer une grève. Alors que d'une façon générale nous sommes d'accord avec la réponse de Devrim sur ce point, nous pourrions dire qu'il y a peut-être une sous-estimation de certaines potentialités en ce domaine dans la situation actuelle. Dans les conditions actuelles qui voient s'accroître la méfiance de la classe ouvrière à l'égard des syndicats - phénomène que nous pensons, de manière générale, être mondial - de petits groupes de travailleurs mécontents des syndicats émergent à la fin de nombreuses grèves, décidés à se préparer plus efficacement pour la grève suivante. Au cours des années 1980, cela a conduit (du moins en Europe occidentale) à la création de comités de lutte dans certaines entreprises, dans lesquels les travailleurs les plus avancés, les plus conscients politiquement, pouvaient se rencontrer afin de tirer les leçons des grèves précédentes et préparer l'intervention d'un noyau ouvrier radical dans les assemblées générales des grèves à venir. En fait, cette sorte de " préparation " est possible aujourd'hui, et pousser à la création de tels groupes, voire même en faire partie, constitue une part importante de l'intervention révolutionnaire dans de tels contextes.
-
Les ouvriers " n'ont obtenu que 10% ". Il est vrai qu'avec l'inflation qui est montée à 9,8% en 2007 (selon les chiffres de la CIA), une augmentation de 10% ne représente pas grand-chose. Mais c'est certainement mieux que rien, ce qui aurait été le cas sans la grève, ou que les 4% proposés à l'origine, surtout dans une période d'approfondissement de la crise économique. Ces questions sont communes à la plupart des grèves dans les pays industrialisés aujourd'hui. Mais le point que nous considérons comme le plus important est la réaction des travailleurs de Türk Telekom par rapport à la guerre. Il faut tout d'abord éviter un faux débat : les ouvriers de Türk Telekom ne se sont pas mis en grève pour protester directement contre la guerre ; de même que cela n'aurait été possible, à notre avis, qu'avec un bien plus haut degré de militantisme et de conscience de classe que celui qui existe en cette période. Nous devons seulement nous imaginer ce que représente pour des masses de travailleurs de se mettre en grève consciemment contre des opérations militaires de l'état bourgeois : en effet, cela signifie que la classe ouvrière remet en question le pouvoir et le droit de diriger de la bourgeoisie, et ceci ne peut se produire que dans un contexte révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, précisément parce qu'est posée la question du pouvoir. Dans le contexte de la Turquie d'aujourd'hui, la vraie question est de savoir si les travailleurs sont prêts à renoncer à la lutte pour la défense de leurs propres intérêts afin de ne pas nuire aux intérêts de la machine de guerre de la bourgeoisie. Nous sommes entièrement d'accord avec la réponse à Temel quand nous lisons que : " S'il y avait eu une reprise spontanée du travail afin de maintenir le bon fonctionnement du système Telecom en temps de guerre, cela aurait été un désastre absolu. Et cela ne s'est pas produit. En fait, les travailleurs ont maintenu la grève alors même que les médias et divers membres de la classe politique leur répétaient qu'ils agissaient contre l'intérêt national. Il faut applaudir cela. " Que les travailleurs continuent à défendre leurs droits, en dépit de l'agitation des médias bourgeois en faveur de la guerre, ne suffit pas en soi à empêcher la guerre impérialiste - l'armée turque a quand même envahi le Kurdistan - mais cela met un frein à l'éclatement généralisé de la guerre. C'est le soubassement indispensable au développement d'une plus forte conscience au sein de la classe de l'antagonisme qui existe entre les intérêts de la nation bourgeoise et les leurs.
Pour finir, nous tenons à exprimer chaleureusement notre entier accord avec l'esprit qui a régi et continue de régir ce débat mené par les camarades d'EKS : " Débattre des vraies questions auxquelles les travailleurs doivent faire face ne peut qu'aider au développement des organisations communistes ", et nous pourrions ajouter, plus largement, au développement de la conscience et de la réflexion du prolétariat dans son ensemble.
CCI
Grève à Türk Telekom
La vraie question politique en Turquie aujourd'hui
La grève actuelle menée par 26 000 travailleurs des télécommunications chez Türk Telekom démontre clairement ce que sont pour la classe ouvrière les vraies questions politiques en Turquie aujourd'hui. Alors que le gouvernement tente d'attirer l'intérêt de la population sur le référendum et les guerres permanentes au Sud-Est de la Turquie, la classe ouvrière a posé le problème sans ambiguïté : pour nous la vraie question est celle du salaire des ouvriers.
Les représentants de la bourgeoisie sont très clairs sur ce point. Si certains ne l'ont pas compris, Paul Doany, PDG de Türk Telekom, l'énonce sans détour : " Aucun employé ne doit compter sur une augmentation au-dessus du taux d'inflation ". Ce qui signifie qu'ils aimeraient que chaque employé ne reçoive qu'une augmentation inférieure au taux de l'inflation, c'est-à-dire que chaque employé ait une diminution de revenus.
La vraie question est de savoir si des travailleurs organisés peuvent essayer d'arrêter les attaques continuelles contre les conditions de vie qui ont eu lieu ces dix dernières années. Pour les communistes et pour tous les travailleurs, c'est la question essentielle aujourd'hui.
Calomnies de tous bords contre les travailleurs
Bien sûr, chacun s'attend à ce que la presse capitaliste attaque les travailleurs. Elle continuera à publier des histoires comme celle du regrettable décès de Aysel Tosun1. L'une des choses que nous trouvons pourtant vraiment étranges, c'est le fait que ce décès unique bouleverse autant les commentateurs politiques alors qu'ils soutiennent avec grand enthousiasme les préparatifs de guerre meurtriers dans le Sud-Est.
Ce à quoi beaucoup ne s'attendaient vraiment pas, c'était au discours de "leurs" dirigeants syndicaux. Ali Akçan, dirigeant d'Haber-İs2, a été prompt à rejoindre les possédants pour condamner les actes de sabotage des ouvriers: " C'est de la calomnie. Notre syndicat n'a rien à voir avec aucun de ces incidents. Trouvons les coupables et punissons les ensemble. " La grève ne date que de quelques jours et déjà les syndicats se proposent de travailler avec la police pour attaquer les travailleurs militants. Pour nous, la question est claire : nous soutenons les luttes de la classe ouvrière pour défendre ses conditions de vie, et si cela veut dire couper quelques câbles téléphoniques, eh bien, qu'ils soient coupés ! Ceux qui s'empressent de rejoindre la direction pour condamner les ouvriers prouvent à quel bord ils appartiennent.
A quel côté appartiennent les syndicats ?
Devrions-nous être surpris par la réaction de "nos" leaders syndicaux. Après tout le discours militant de l'an passé, la seule action proposée par le KESK3 a été une journée "sans travailler". Les syndicats considèrent que leur rôle est de faire la promotion de la paix sociale et de se soumettre aux patrons. A la fin de la grève de THU4, Salih Kılıç a déclaré : " Je considère comme un honneur d'apposer ma signature sous ce contrat ". Oğuz Satıcı, président de l'Assemblée des Exportateurs Turcs, a parfaitement exprimé la position des capitalistes : " La sagesse et la conscience ont gagné, la Turquie a eu ce qu'il y a de meilleur ". Nous disons, nous, qu'après une décennie de défaites, il est temps pour les travailleurs de ce pays d'arrêter de faire passer la Turquie en premier, il est temps de commencer à privilégier leurs conditions de vie. Quand les patrons déclarent que " la Turquie a eu ce qu'il y a de meilleur ", ils veulent dire que les travailleurs se sont fait avoir. Quiconque trouve " un grand honneur " à contresigner des documents qui confirme cet état de fait est un ennemi de classe.
Aller de l'avant
Si les travailleurs ne peuvent placer leur confiance dans "leurs propres" syndicats, en qui peuvent-ils avoir confiance ? La réponse est : le seul ami d'un travailleur est un autre travailleur. Les travailleurs des Télécoms doivent former des comités pour contrôler leur propre grève et ne pas la laisser aux mains des syndicats qui ressentiront "un grand honneur" à les vendre aux patrons. Beaucoup de travailleurs à travers la Turquie veulent se battre. THY et les fonctionnaires ont prouvé cette volonté en début d'année. Aujourd'hui les ouvriers de Telekom se dressent fièrement à la tête de la classe ouvrière turque. Il ne revient pas qu'à eux, mais aussi à tous les travailleurs, de faire en sorte qu'ils n'y restent pas seuls. Nous affirmons que pour soutenir les grévistes de Telekom, tous les travailleurs doivent lutter contre les réductions de salaire de façon concrète dans leurs entreprises.
Devrim
Victoire pour les grévistes de Türk Telekom
L'article des camarades de Enternasyonalist Komünist Sol [175] qui suit dresse le bilan de la grève très importante qui a eu lieu chez Türk Telekom fin 2007. Au-delà de l'importance de cette grève par elle-même et des leçons que l'on peut en tirer, les camarades d'EKS ont raison d'insister sur son importance dans le contexte actuel de nationalisme guerrier rampant et de la ligne de classe nette qui sépare la direction du syndicat Haber-İş des travailleurs, déterminés à défendre leurs propres conditions de vie. La défense nationale et l'intérêt des travailleurs ne sont pas compatibles !
La grève massive menée par plus de 26 000 ouvriers de Türk Telekom est terminée. Au bout de 44 jours, les grévistes sont retournés au travail. Une perte de 1 100 000 journées de travail en fait la plus grande grève de l'histoire de la Turquie depuis la grève des mineurs de 1991. Il est temps de dresser le bilan des événements.
La première leçon, et la plus importante, que l'on peut en tirer est que les travailleurs sont capables de protéger leurs conditions de vie par la lutte. L'offre de 4% faite à l'origine par Türk Telekom était bien inférieure aux prévisions du taux d'inflation de 7,7% pour la fin de l'année. En fait, ce que Türk Telekom offrait était une réduction de salaire.
L'accord de 10% cette année et de 6,5% plus l'inflation l'an prochain est certainement une énorme victoire. Arrivant peu de temps après que les travailleurs de THY aient obtenu une augmentation de 10%, cela envoie un message clair à tous les travailleurs de Turquie. L'unité et l'action collective sont les seuls moyens de protéger les salaires de l'inflation.
Cela montre clairement à tous les travailleurs le chemin à suivre et particulièrement aux employés du secteur public à qui le gouvernement a fait l'insulte de proposer une augmentation de 2%. Toute augmentation inférieure à l'inflation est une réduction de salaire. Dans beaucoup de domaines, le secteur public est prédominant en Turquie. De nombreuses familles ouvrières ont au moins un de leurs membres qui travaille pour l'Etat. Une victoire dans ce secteur serait une victoire pour tous les travailleurs du pays.
La seconde leçon à tirer concerne ceux qui ont été accusés d'actes de sabotage. C'est un point positif que tous les employés qui avaient été renvoyés pendant la grève aient été réembauchés. Cependant ces travailleurs sur qui pèsent des charges de sabotage ne pourront reprendre définitivement leur poste que s'ils sont reconnus innocents. Contrairement à la classe dirigeante, aux médias des patrons et aux syndicats, nous refusons de condamner des ouvriers qui se sont battus pour défendre leurs conditions de vie. Il est essentiel que tous les travailleurs de Telekom débattent de comment réagir si ces travailleurs sont jugés coupables d'actes de sabotage et sont renvoyés.
La leçon suivante concerne les allégations de traîtrise. Le dirigeant de Haber-İş, Ali Akcan, s'est empressé de prétendre que les ouvriers en grève n'étaient pas des "traîtres" et que si le pays l'exigeait, dans l'éventualité d'une guerre, les grévistes feraient "leur devoir". Pour nous, il est tout à fait évident que la classe ouvrière de ce pays a placé les intérêts de la nation avant les siens propres depuis bien trop longtemps. La classe ouvrière a payé la guerre nationale du Sud-Est non seulement par des années d'inflation et d'austérité, mais aussi par le sang et la vie de ses enfants. Le temps est venu, en tant qu'ouvriers, de placer nos intérêts en premier.
La leçon finale concerne la classe ouvrière dans son ensemble. Les ouvriers de Telekom se sont battus seuls. Même quand il y avait des piquets de grève sur les lieux de travail, les employés de bureau des Postes travaillaient. Et pourtant, ce pourquoi les travailleurs de Telekom luttaient, la défense des salaires contre l'inflation, concernait la classe ouvrière toute entière. Les syndicats enferment les travailleurs dans leurs secteurs respectifs. Si à eux seuls les travailleurs de Telekom ont obtenu 10%, combien auraient-ils pu gagner s'ils s'étaient battus avec les ouvriers des Postes ? Et aussi si les autres travailleurs du secteur public s'étaient joints à la lutte? Les travailleurs doivent éviter de rester isolés dans leur propre secteur ; ils doivent appeler d'autres secteurs à les rejoindre. Si les grévistes étaient allés chercher les ouvriers des Postes et les avaient convaincus de les rejoindre dans la grève, la victoire aurait été à la fois plus grande et plus rapide.
L'inflation ne va pas disparaître ; la banque centrale a de nouveau révisé ses prévisions à la hausse. Non seulement les travailleurs du secteur public devront se battre pour défendre leurs salaires contre les réductions, mais les ouvriers de Telekom devront se remettre en lutte dans un futur plus ou moins proche pour défendre leur victoire d'aujourd'hui. Et le meilleur moyen pour cela est de se battre tous ensemble.
EKS
Telekom : Autopsie d'une grève
Il s'agit ici de l'article de Temel qui a suscité un débat à l'intérieur d'EKS et auquel Devrim répondra dans le quatrième article de cette série.
Quand le patronat turc s'est réveillé le matin du 28 novembre, il a compris que les choses ne fonctionnaient pas comme d'habitude. Les lignes de la bourse d'Istanbul étaient coupées à cause d'un accident sur un chantier de construction, et comme il y avait une grève à ce moment là chez Türk Telekom, aucun technicien n'a pu être envoyé dans l'entreprise de construction et ainsi la première session de la bourse n'a pas pu ouvrir. Cela a amené Ali Bahçucav, président de la société des investisseurs en bourse, un représentant du capital financier, à élever très haut le ton et d'une façon tout à fait convaincante. Selon Bahçucav, soit l'administration de Telekom devait " résoudre le problème, soit Telekom devait à nouveau être nationalisée ". Si le groupe Oger5 n'était même pas capable de régler des problèmes comme ceux d'aujourd'hui, que feraient-ils demain dans l'éventualité de ‘problèmes sérieux' dans le domaine de la "défense" ? Ainsi les autres fractions de la bourgeoisie ont commencé à harceler les capitalistes de Telekom à cause de leur rôle clef. En conséquence, les " désaccords irréconciliables" et les "demandes inadmissibles" des syndicats ont été réglés lors d'une réunion pendant laquelle il n'y a eu "ni perdants ni gagnants" (ainsi que l'a déclaré le dirigeant syndical), tout cela avec bien sûr la médiation et l'intervention du Ministère de la Communication. Après de longues négociations, les dirigeants de Telekom ont présenté leurs revendications au ministre qui, de son côté, a envoyé une chiquenaude aux bureaucrates syndicaux.
Et ensuite ? Hurriyet6 rapporte le 30 novembre : " Après l'accord mis au point pendant les négociations, Binali Yildirim, Ministre des Communications, Salih Kilic, dirigeant de Turk-Is (la principale confédération syndicale), Ali Akcan, dirigeant de l'union des travailleurs de l'information de Turquie , et Paul Doany, président du comité administratif et directorial de Türk Telekom, sont allés dîner ensemble au ‘Beykoz Trautters and Tripes Saloon'.
Quel était l'enjeu ?
Il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois que la presse, les syndicats, ou la bureaucratie du capital, ont des problèmes, ils essaient de tout réduire à une question de chiffres et de pourcentages en sortant des statistiques compliquées auxquelles ils espèrent que les travailleurs ne comprendront rien. Le problème a commencé de cette façon dans le cas de la grève de Telekom. Au cours de la septième séance des négociations, le syndicat et le groupe Oger s'étaient mis d'accord sur une vingtaine de points et ne l'étaient pas sur environ quatre-vingt-dix autres. Selon le syndicat, la flexibilité, les sous-contrats, les différences entre les salaires des travailleurs syndiqués et non-syndiqués constituaient les problèmes principaux. Le syndicat décrivait ces problèmes comme étant une "attaque" du capital international, étranger. Cependant, en y regardant de plus près, il est facile de voir que le problème est beaucoup plus simple. Turk-Is7 a depuis toujours été un syndicat modelé par les divisions au sein de la classe dirigeante, c'est-à-dire pris entre le bloc au pouvoir et entre le principal courant d'opposition de la bourgeoisie. Si on examine le changement de pouvoir à l'intérieur de Turk-Is, le fait que la majorité de la confédération ait pris une direction pro-AKP, alors que la minorité se soit rapprochée de l'opposition nationaliste, vient renforcer cet état de fait. Juste avant ce changement de pouvoir à la conférence générale de la confédération syndicale, "l'opposition", composée de Haber-Is, Petrol-Is et de quelques autres syndicats, a commencé à reprocher au syndicat pro-AKP sa "soumission" au gouvernement. Bien sûr, le marchandage dans les coulisses pouvait être interprété comme la négociation qui montrerait jusqu'à quel point les bureaucrates nationalistes syndicaux seraient liquidés.
Aussi, il n'est pas surprenant que l'aile pro-AKP se soit chargée de l'administration juste avant la grève de Telekom. En fait, tous les syndicats de l'opposition (Haber-Is, Petrol-Is, Gida-Is8) sont implantés soit dans des entreprises privatisées, soit dans des entreprises en voie de privatisation. Quand ce n'est pas le cas, ces syndicats essaient de s'implanter dans des secteurs de développement récent, tels que Novamed. Dans le premier cas, les syndicats sont en danger de perdre la position représentative qu'ils ont auprès de l'Etat. Comme on le constate à Telekom, les patrons des entreprises privatisées donnent aux ouvriers qui quittent les syndicats certains privilèges et liquident ainsi le syndicalisme d'Etat traditionnel. Dans le deuxième cas, nous constatons les efforts des syndicats liés à Turk-Is pour s'implanter, et cela entre partiellement en conflit avec la politique du gouvernement de main d'œuvre bon marché dans les zones franches.
Ainsi, quand certains syndicats au sein de Turk-Is sont confrontés à l'éventualité d'être liquidés par l'Etat, ils répliquent en agaçant et en menaçant l'Etat avec des grèves. Il serait utile d'examiner l'histoire de Turk-Is afin de comprendre cette tendance dans son fonctionnement interne.
Turk-Is : une abomination créée par le capitalisme d'Etat et l'impérialisme américain
Dès sa création en tant que confédération syndicale, Turk-Is est devenue le résultat d'une lutte politique entre le Parti Démocratique9 et le Parti Populaire Républicain et de leur bataille pour instaurer leur loi sur la classe ouvrière. C'est ainsi que la fraction bourgeoise qui détenait la majorité au parlement s'est toujours retrouvée à la tête de Turk-Is. C'est également ainsi que Turk-Is a assuré le rôle du plus solide cheval de Troie de l'idéologie bourgeoise dominante au sein de la classe ouvrière. Qui plus est, Turk-Is a été créée dans ce seul et unique but. Inspirée de l'exemple de l'AFL-CIO aux Etats-Unis, Turk-Is a été formée, financée et modelée directement par l'impérialisme américain. Même les nationalistes "anti-impérialistes" qui se retrouvent aujourd'hui dans l'aile nationaliste de Turk-Is l'ont dit autrefois, même si la situation est, de toute évidence, différente aujourd'hui (!).
Tous ces faits montrent que Turk-Is a été formée pour manipuler le mouvement ouvrier qui se développait dans les années 1950 en Turquie après la première longue période de contre-révolution commencée à la fin des années 1920. La lutte impérialiste bi-polaire, baptisée Guerre Froide après la fin de la Seconde Guerre mondiale, exigeait que des pays satellites soient modelés de façon étatique.
Tandis que cela était fait au nom du "socialisme" en Russie et dans les pays satellisés de son bloc, cela l'était au nom de la "démocratie" dans les Etats sous contrôle américain. Cette transformation, après les années 1950, qui a poussé l'Etat turc à porter un masque "démocratique et occidentalisé" pour s'opposer à l'URSS, s'est reflétée dans les syndicats. Et les fortes tensions au milieu des années 1950 ont rendu nécessaire la création d'un organe tel que Turk-Is pour défendre les intérêts de l'Etat et de la bourgeoisie. Pour remplacer l'ancienne vision idéologique qui était une vision corporatiste pratiquement fasciste et stipulait que l'Etat représentait toutes les classes, et même que les classes n'existaient pas en Turquie, par un modèle idéologique occidental incluant "la liberté d'expression et d'organisation", des lois commencèrent à être mises en place pour réglementer les syndicats et les grèves. L'ironie, pourtant, a fait qu'en cette période, alors que les droits des syndicats s'étendaient rapidement, le droit de grève s'est trouvé restreint et la structure des règles "d'arbitrage" a été modifiée pour accroître la légitimité de l'Etat aux yeux des ouvriers.
Tous ces changements ont donné naissance à Turk-Is et aux syndicats qui en font partie ; la confédération syndicale est née comme l'arme principale de la nouvelle Turquie "démocratique" et "anti-communiste" au sein du bloc impérialiste américain. Par la suite, Turk-Is est devenue le chien de garde loyal contre la gauche stalinienne et les syndicats qui en étaient proches dans la lutte impérialiste et a été l'instrument principal pour absorber les luttes ouvrières. Bien que ce ne soit pas le seul exemple, le coup d'Etat de 1980 en est une illustration frappante. Pendant le coup d'Etat, Turk-Is a, dans sa pratique, soutenu la junte militaire, et le président de la confédération a même été récompensé en étant nommé ministre du Travail dans le gouvernement provisoire mis en place par l'armée ! Cette situation a changé avec la "normalisation" de la fin des années 1980 et la réapparition de désaccords entre différentes fractions de la bourgeoisie. Par la suite, Turk-Is a rapidement commencé à perdre sa position privilégiée. Tout comme les maîtres ingrats qui font entrer le chien de garde dans la maison quand ils ont peur mais qui le flanquent dehors à coups de pied quand le danger est passé, l'Etat turc a largement oublié Turk-Is dans ses projets. Parce qu'après tout, la classe ouvrière ayant été écrasée dans un bain de sang, et avec l'affaiblissement mondial des tendances politiques staliniennes dites "socialistes" comme de l'impérialisme russe, ajouté à ses pratiques sanglantes, le tout avait complètement achevé sa marginalisation.
Ainsi, il avait fallu, pour Turk-Is, d'un côté, trouver un moyen de faire taire la classe ouvrière pour la défense des intérêts du gouvernement et, de l'autre, essayer de retrouver sa place et reprendre un rôle significatif à l'intérieur de l'Etat et sa légitimité au sein de la bourgeoisie. Dans ce but, elle a commencé à mener une opposition "démocratique" pour tenter de montrer sa force à l'Etat en menaçant de prendre certaines mesures tout en essayant, entre-temps, de démobiliser la classe ouvrière. Les tactiques de Turk-Is pendant la grève chez Telekom peuvent s'expliquer ainsi. Bien sûr, ces tactiques étaient devenues inopérantes avec l'offensive ouvrière de la fin des années 1980 quand Turk-Is s'était massivement décrédibilisée aux yeux de la bourgeoisie, mais cette question dépasse de loin les limites du sujet de ces articles. Le point essentiel sur lequel nous voulons insister est que dans les situations où Turk-Is est écartée de tout rôle significatif, sa façon de mettre en scène des menaces en direction de certaines fractions de la bourgeoisie, tout en conduisant à un épuisement de la combativité ouvrière, montre la pratique d'une très ancienne tactique.
Et qu'en est-il de la classe ouvrière ?
Nous ne pouvons, bien sûr, aboutir à une conclusion saine si nous jugeons une grève du point de vue de la bourgeoisie et de ses instruments au sein de la classe ouvrière. Cependant, l'importance de la grève chez Telekom n'a pas concerné que les travailleurs de Telekom, mais aussi la classe ouvrière toute entière. Cette grève a, à la fois, renforcé l'illusion que les syndicats soutiennent les travailleurs et a aussi enfermé les exigences de classe des travailleurs dans un seul secteur et les a empêchés d'élargir leur lutte au reste de la classe. En fait, la question que nous devons poser est la suivante : quand peut-on considérer qu'une grève est une victoire ? Il faut se demander si les conditions nécessaires étaient réunies pour une grève à Telekom. Il est clair que, même à l'intérieur de Telekom, les syndicats et la direction avaient monté les travailleurs les uns contre les autres. Quand les travailleurs syndiqués ont accusé d'égoïsme les ouvriers non-syndiqués, ou ceux qui avaient quitté les syndicats avant, ils subissaient clairement l'influence des syndicats et les conditions de discussion n'étaient pas réunies avant la grève pour permettre aux deux bords "différents" d'agir ensemble de façon solidaire. Le résultat a été que le syndicat a désigné ceux qui en étaient partis pour une raison concrète, comme celle de gagner un meilleur salaire, comme cibles à leurs propres frères et sœurs de classe.
De plus, le syndicat a élevé le niveau de chauvinisme et de démagogie nationaliste à chaque attaque des médias bourgeois, trompant à nouveau de la sorte la classe ouvrière. En décrivant la vente de Telekom à un groupe étranger comme un acte de "trahison envers la mère patrie", le syndicat a fait passer la nationalisation avant les intérêts des travailleurs. De même que l'acceptation des 10 % offerts par le patronat avant la grève a été justifiée au nom de cette même "mère-patrie". Quand le dirigeant du syndicat Haber-Is a déclaré sans vergogne que " la grève a été une défaite économique mais une victoire politique " en parlant à l'Université Technique du Moyen-Orient, c'est cette situation qu'il admettait de fait, et il a vite pris la fuite devant les questions critiques de quelques étudiants.
Et c'est bel et bien la situation de la classe ouvrière. Une grève qui a duré plus d'un mois... et qui n'a apporté aucune amélioration au niveau de vie et n'a servi qu'à aggraver les divisions au sein de la classe. Quand le gouvernement AKP a annoncé 10% d'augmentation de salaire à la fin de l'année, la situation a été poussée à son comble et, cette fois, les syndicats de l'opposition ont hypocritement accusé la présidence de la confédération d'être des "vendus".
Le bilan
De même que les révolutionnaires communistes doivent tirer les leçons des victoires de la classe ouvrière, il leur faut tirer les leçons des défaites et ils doivent défendre ces leçons dans d'autres secteurs de la lutte de classe. Pour cela, il est nécessaire que les communistes soient clairs sur chacune des erreurs qu'ils font et qu'ils utilisent la critique comme une arme dans chaque situation. Le débat est l'un des instruments les plus importants pour les communistes, tout comme il l'est pour la classe ouvrière en général. Nous devons accepter le fait que la grève chez Telekom ne s'est en aucune façon terminée comme une victoire. Les raisons intrinsèques qui expliquent cela sont les suivantes :
-
Cette grève a creusé des divisions au sein de la classe ouvrière et a engendré de la méfiance entre ouvriers syndiqués et non-syndiqués.
-
La grève à Telekom, en forçant les travailleurs à placer des intérêts "nationaux" inexistants avant leurs intérêts de classe, a servi les intérêts politiques du syndicat.
-
Comme la grève avait été insuffisamment préparée auparavant et qu'il n'y a pas eu suffisamment de solidarité mise en place avec d'autres secteurs de la classe ouvrière, cela a conduit au gaspillage partiel de la volonté naissante de lutter en tant que classe et cela a renforcé les illusions syndicales parmi les travailleurs.
Tout cela ne veut pas dire que nous ne soutiendrons pas des grèves comme celles-là jusqu'au bout. Cela montre seulement que nous devons intégrer le fait que la première tâche des communistes, dans des grèves manipulées par les syndicats à des fins politiques, est de prôner une solidarité active auprès d'autres travailleurs avec les travailleurs qui sont en lutte afin de briser les entraves syndicales et de défendre leurs propres intérêts. C'est seulement ainsi que les travailleurs pourront commencer à voir le vide des illusions qu'ils se font sur les syndicats et qu'ils verront où sont les vraies victoires. Pour nous, communistes, nous devons défendre et protéger cette leçon avec détermination. Dans cet esprit, il ne fait aucun doute que la discussion engendrée par la grève à Telekom au sein de EKS aura un résultat positif.
Temel
Débat dans EKS
Réponse au camarade Temel
Cet article est une contribution au débat au sein d'EKS à propos de la grève à Telekom. C'est une réponse à l'article " Telekom : Autopsie d'une grève ", publié dans le numéro de Gece Notları du mois dernier, qui était lui-même une réponse à un précédent article " Victoire pour les grévistes de Türk Telekom ".
Dans le numéro de Gece Notları du mois dernier, Temel a écrit que la grève chez Türk Telekom " ne s'est en aucune façon terminée comme une victoire. " Ceci était une réponse au titre de première page du numéro de février qui proclamait : " Victoire chez Türk Telekom. " Gece Notları avait déclaré à ce moment-là que la grève était une victoire, et maintient cette position aujourd'hui. Toutefois, nous sommes ouverts à une discussion sur ce sujet et nous encourageons nos lecteurs à nous envoyer leurs contributions à ce débat.
Temel définit la grève comme un échec d'abord, mais pas essentiellement, sur une base économique. Il déclare que 10% avaient été offerts par le patronat avant la grève. Ceci n'est cependant pas exact. L'offre de la direction était de 4%. L'accord final a été de 10% pour cette année et de 6,5% plus l'inflation l'an prochain. Ce sont des chiffres bien différents. Ce à quoi Temel fait référence, ce sont des articles de presse qui indiquaient que Türk Telekom était prêt à aller jusqu'à 10%. Cela est peut-être vrai, mais ne doit pas faire oublier que l'offre était de 4%. Des entreprises comme Türk Telekom font des plans économiques. Ils font des budgets pour ce qu'ils pensent être possible. Cela ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas souhaité que l'accord soit inférieur à ce qu'il a été. Bien évidemment, les patrons veulent toujours que les ouvriers obtiennent l'augmentation de salaire la plus petite possible. S'ils s'en étaient tirés avec 4%, ils en auraient été très heureux. Ils n'ont pas pu et, à notre avis, c'est la grève qui les en a empêchés. Bien sûr, personne ne sait ce qui s'est exactement passé pendant les négociations entre Paul Doany et Salih Kiliç, mais notre perspective va dans le sens de ce qui a été publié. Temel continue en invoquant trois "raisons intrinsèques" pour lesquelles il ressent que la grève a été un échec. La première est que la " grève a creusé des divisions au sein de la classe ouvrière et a engendré de la méfiance entre ouvriers syndiqués et non-syndiqués. " Comme Temel le dit lui-même, ce sont des divisions créées par la classe dirigeante. Aussi absurde que cela puisse paraître, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce pays à ce qu'au sein d'une même entreprise des ouvriers travaillent pendant que d'autres sont en grève. La principale façon pour des ouvriers de développer une lutte est de la généraliser pour y inclure d'autres ouvriers. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que les syndicats n'ont aucun intérêt à cela, et la grève chez Telekom le prouve. Cependant, briser les barrières entre différents groupes de travailleurs n'est en aucun cas chose aisée. On peut le faire en faisant directement appel auprès des autres travailleurs à être solidaires dans l'action. Bien sûr, beaucoup nous dirons qu'il faut faire agir les leaders syndicaux. Nous avons vu récemment ce que signifie leur "action", une grève de deux heures dans laquelle peu de gens ont pris part. Si les ouvriers rentrent dans ce genre d'actions, il faut qu'ils en prennent l'initiative dans leur propre intérêt. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les travailleurs sont liés aux syndicats non seulement de façon organisationnelle, mais aussi idéologiquement. La Gauche communiste a toujours défendu les assemblées générales ouvertes pour les syndiqués de tous bords et les non syndiqués dans lesquelles les ouvriers peuvent discuter de la façon de prendre le contrôle de leur lutte. Cependant, cela n'a en soi pas beaucoup de poids si l'assemblée décide de faire exactement ce que les dirigeants syndicaux disent de faire. Le capitalisme crée des divisions entre les travailleurs pour ses propres besoins. Le rôle des syndicats est de maintenir cet ordre des choses. Au cours de cette grève, les ouvriers n'ont pas réussi à briser la sectorisation et à étendre leur grève à d'autres travailleurs. Mais fallait-il nous attendre à autre chose ? Bien sûr que non. La plupart des grèves sont isolées dans leurs propres secteurs. Cela ne veut pas dire que c'est la grève qui renforce les divisions entre les grévistes et les non-grévistes. Cela veut dire que la classe ouvrière n'est pas assez forte pour dépasser ces divisions.
Le second point dans sa liste est que la grève à Telekom a obligé les travailleurs à faire passer les intérêts nationaux avant les leurs propres. Je pense que c'est une étrange lecture de la situation. Au milieu du déchaînement de l'hystérie collective sur les combattants héros et martyrs en Irak, qui était en arrière-plan de la grève, les travailleurs de Telekom ne se sont nullement fait particulièrement remarquer dans le sens de cette propagande nationaliste. Personnellement, je me rappelle que ce sont les écoliers qui ont fait le plus entendre leurs voix pour la défense des intérêts nationaux. Les ouvriers de Telekom n'ont été ni plus ni moins nationalistes que la grande majorité de la classe ouvrière de ce pays. Oui, des commentaires nationalistes ont été faits par des ouvriers de Telekom, mais les mêmes commentaires étaient faits par la majorité des ouvriers à ce moment là. S'il y avait eu un retour spontané au travail pour faire fonctionner le système de Telekom, cela aurait été un désastre absolu. Cela ne s'est pas produit. En fait, les ouvriers sont restés en grève en dépit du fait que les médias et divers membres de la classe politique leur répétaient qu'ils agissaient contre les intérêts nationaux. Cela, il faut le saluer. Oui, des travailleurs ont proclamé leur patriotisme. Oui, des travailleurs ont manifesté contre le capital étranger. Est-ce différent d'autres secteurs de travail en Turquie ? Existe-t-il des secteurs où les travailleurs rejettent à la fois le patronat étranger et le patronat turc et qui prônent l'internationalisme ? Malheureusement, non. La grève ne s'est pas dissoute dans une vague de sentiment patriotique. Cela aurait été une lourde défaite. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ça.
Le troisième point de Temel est que la grève n'a pas été suffisamment bien préparée. Bien sûr qu'elle ne l'a pas été, mais c'est généralement le cas des grèves. Pour renforcer ce point, il ajoute que cela a fait disparaître dans la classe ouvrière l'envie de lutter, et que cela a renforcé les illusions syndicalistes. C'est une chose difficile à prouver. En ce qui concerne la préparation, cependant, la classe ouvrière n'est pas suffisamment forte pour se préparer réellement aux grèves. La plupart des secteurs militants de la classe ouvrière sont dominés par les "illusions syndicales". A notre avis, la seule chose qui séparera la masse des travailleurs des syndicats est le fait d'entrer en conflit avec eux au cours de la lutte. Des militants isolés ou des petits groupes de militants peuvent être gagnés à l'avance, mais dans la situation actuelle, au début de chaque lutte, la majorité des travailleurs sont dans l'illusion syndicale. Comment est-on alors supposé préparer la grève à l'avance ? Les seuls qui peuvent le faire sont les syndicats. Et nous sommes d'accord ici avec Temel que les syndicats n'agissent pas pour défendre les intérêts de la classe ouvrière. La classe ouvrière n'est actuellement pas assez forte pour affirmer clairement ses propres intérêts de classe. Elle peut, par l'intermédiaire de la lutte, se couper de l'idéologie des autres classes et commencer à agir par elle-même. Elle n'est pas encore assez forte pour le faire et par conséquent ne peut pas se préparer suffisamment pour les grèves. Quant à la suggestion que cette grève a conduit au gaspillage potentiel de la volonté de la classe ouvrière de se battre, nous verrons ce qu'il en adviendra. S'il y a un grand mouvement contre la réforme des retraites, cela renforcera notre conviction que la grève à Telekom a accru la volonté de la classe de se battre. L'illusion syndicale est forte en ce moment. Nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit brisée du jour au lendemain, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit brisée sans lutte. Si cela encourage les travailleurs à lutter, alors cela les mènera finalement à entrer en conflit avec les syndicats. Cela reste à voir.
Nous sommes toutefois entièrement d'accord avec le paragraphe final de Temel. Nous soutenons toutes les grèves que la classe ouvrière mène pour défendre ses intérêts. Nous devons être vigilants sur la façon dont les syndicats manipulent les grèves. Nous devons convaincre de rechercher la solidarité entre les différents secteurs de la classe ouvrière. Et débattre des vraies questions auxquelles les travailleurs doivent faire face dans un conflit ne peut qu'accroître le développement des organisations communistes. C'est ce qui, d'une façon très concrète, nous unit et nous tenons à continuer ce débat, ainsi que d'autres débats qui se développeront à partir d'autres luttes de la classe ouvrière, telles que celle, actuelle, sur les pensions de retraite.
Devrim
1 Une femme qui serait morte à cause de la grève.
2 Le principal syndicat des travailleurs des télécoms.
3 Le syndicat gauchiste des fonctionnaires
4 Compagnie aérienne turque
5 Propriétaire de Türk Telekom
6 ‘Liberté', un important journal bourgeois
7 Littéralement ‘Travail Turc', principale confédération syndicale en Turquie.
8 Petrol-Is et Gida-Is, littéralement ‘Travail du Pétrole' et ‘Travail de l'Alimentation' sont les syndicats des travailleurs du pétrole et de l'alimentation à l'intérieur de Turk-Is.
9 Le vieux Parti Démocrate était au pouvoir dans les années 1950 après avoir battu le Parti Populaire Républicain aux élections. Ils ont été éjectés du pouvoir par un coup d'état qui a abouti à l'exécution du Premier ministre et chef du Parti Adnan Menderes. Le parti fut ensuite interdit. Tous les partis de centre droit et les partis islamiques de droite ont un lien historique avec ce parti.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [95]
Élection d'Obama : les nouveaux habits de l'État américain
- 2684 lectures
Voici un article repris d'Internationalism, section du CCI aux Etats-Unis, dénonçant la propagande mensongère entourant l'élection d'Obama.
La tempête propagandiste autour de la campagne électorale a enfin cessé au bout de presque deux ans. Les médias aux ordres de la classe dominante nous disent qu'il s'agit de l'élection la plus importante de l'histoire des États-Unis, démontrant une fois de plus la puissance et la supériorité de la " démocratie ". Cette propagande crie haut et fort que non seulement nous avons pour la première fois de l'histoire américaine un président afro-américain, mais aussi que, par-dessus tout, la victoire d'Obama porte avec elle un profond désir de changement. On nous dit encore que le " peuple a parlé ", et que " Washington a écouté ", grâce à l'œuvre miraculeuse des urnes. On nous dit même que l'Amérique a dès à présent dépassé le racisme et est devenue une véritable terre de fraternité. Ainsi, aujourd'hui, Obama est devenu président. Mais qu'est-ce cela signifie en réalité ? Obama a promis le changement, mais cette promesse n'est rien d'autre qu'une illusion. Toute cette campagne n'a été qu'un mensonge hypocrite, qui s'est servi des espoirs d'une population, et surtout d'une classe ouvrière terriblement épuisée par la misère et la guerre.
Les véritables gagnants de ces élections ne sont pas plus " Joe le plombier ", symbole de " l'Américain moyen ", que les Afro-américains qui font partie de la classe ouvrière américaine, mais bien plutôt la bourgeoisie américaine et ses représentants. Il est clair que les mêmes attaques incessantes vont continuer de s'abattre sur les ouvriers. La misère va ainsi continuer de s'aggraver inexorablement. Obama n'a pas davantage été un candidat de la " paix ". Sa critique essentielle envers Bush porte sur l'enlisement en Irak et sur sa politique qui a laissé l'impérialisme américain incapable de répondre de façon appropriée aux défis posés à sa domination. Obama prévoit d'envoyer plus de troupes en Afghanistan et a clairement déclaré que les États-Unis devaient être prêts à répondre militairement à toute menace contre ses intérêts impérialistes. Il a été en outre très fortement critique par rapport à l'incapacité de l'administration Bush de répondre au niveau requis à l'invasion de la Géorgie par la Russie l'été dernier. Voilà quel champion de la paix il est !
Pendant les débats présidentiels, Obama a expliqué qu'il soutenait le renforcement de l'éducation aux États-Unis, parce qu'une force de travail bien éduquée était vitale pour une économie forte et qu'aucun pays ne peut rester une puissance dominante sans une économie forte. En d'autres mots, il voit les dépenses d'éducation comme une pré-condition à la domination impérialiste. Quel idéalisme !
Il n'y a donc rien à attendre pour la classe ouvrière de cette venue au pouvoir d'Obama. Pour la classe dominante par contre, cette élection représente un succès presqu'au-delà de ses rêves les plus fous.
Elle a permis de ravaler la vieille façade de l'électoralisme et du mythe démocratique, qui avaient été mis à mal depuis 2000 et avaient conduit à un sentiment de désenchantement par rapport au "système" chez beaucoup de monde. L'euphorie post-électorale - comme les danses dans les rues pour saluer la victoire d'Obama - est un témoignage de l'étendue de la victoire politique de la bourgeoisie. L'impact de cette élection est comparable à la victoire idéologique qui est apparue immédiatement après le 11 septembre 2001. Tout de suite après, la bourgeoisie profitait d'une poussée d'hystérie nationaliste, lançant la classe ouvrière dans les bras de l'État bourgeois. Aujourd'hui, l'espoir dans la démocratie et dans la magie du leader charismatique, fait plonger de larges secteurs de la population vers l'illusion de l'État protecteur. Au sein de la population noire, le poids de cette euphorie est particulièrement lourd ; il existe à présent une croyance largement répandue que la minorité opprimée a pris le pouvoir. Les médias bourgeois célèbrent même le dépassement par l'Amérique du racisme, ce qui est parfaitement faux et tout aussi ridicule. La population noire des États-Unis fait partie des secteurs les plus exploités et les plus désenchantés de la population.
Au niveau international, la bourgeoisie a bénéficié presque immédiatement d'une prise de distance de la nouvelle administration par rapport aux erreurs du régime de Bush sur la politique impérialiste et d'une ouverture opportune vers le rétablissement de l'autorité politique, de la crédibilité et du leadership de l'Amérique dans l'arène internationale.
Au niveau de la politique économique, les efforts de la nouvelle administration Obama pour mettre en oeuvre les nécessaires mesures capitalistes d'État afin de consolider le système d'oppression et d'exploitation vont se déployer à une échelle inégalée. Si dès aujourd'hui les gouverneurs de chaque État, comme de l'État fédéral, sont en train d'attaquer les services et les programmes sociaux à cause de la crise économique, Obama ne promet rien de mieux pour demain. Il est au contraire le premier avocat de la nécessité de soutenir ou renflouer... les plus grandes entreprises, les banques et les compagnies d'assurance, et de les faire financer par de plus grands sacrifices de... la classe ouvrière !
Malgré la griserie de son succès, consciente qu'elle ne pourra pas mettre en oeuvre les changements promis durant la campagne, la bourgeoisie développe déjà une campagne de façon à "temprérer l'enthousisasme". On a ainsi pu entendre des propos soulignant que "Obama ne peut que remettre de l'ordre dans la politique catastrophique et malhonnête de Bush", et que "Il y a un héritage des erreurs du passé", "le changement ne viendra pas immédiatement", "les sacrifices seront nécessaires".
Face à tout cela, nous devons rappeler les positions historiques de notre classe :
-
la démocratie, c'est la dictature de la classe dominante ;
-
la classe ouvrière doit se battre et s'organiser elle-même pour défendre ses propres intérêts ;
-
seule la révolution communiste mondiale peut mettre fin à l'exploitation capitaliste et à son oppression.
L'euphorie actuelle ne peut être que de courte durée. Les programmes d'austérité que chaque État comme le gouvernement central vont devoir mettre en place appelent à un nécessaire développement de la lutte de classe. La faillite prévisible de l'administration Obama pour réaliser les "changements promis", une amélioration des conditions de vie et un "programme plus social", conduira inévitablement au désenchantement et à alimenter l'expression d'un mécontentement de classe plus fort.
Internationalism, organe du CCI aux États-Unis (11 novembre 2008)
Géographique:
- Etats-Unis [43]
Personnages:
- Barack Obama [176]
ICConline - 2009
- 4240 lectures
1968 en Allemagne (II) : au-delà du mouvement de protestation, la quête d'une société nouvelle
- 5280 lectures
L’espoir
déçu
Dans la première partie de notre article sur Mai 68 en Allemagne, nous avons montré que l’on pouvait voir au-delà de ce mouvement celui plus vaste d’une nouvelle génération qui recherchait une alternative au capitalisme. Le rejet de la guerre au Vietnam, le refus de se soumettre sans résistance aux besoins du capital, la montée d’un espoir pour une nouvelle société, tout cela constituait des facteurs importants qui motivaient beaucoup de jeunes, étudiants et ouvriers, à manifester. Mais quelle que fut la force de cet espoir pour une nouvelle société, la déception et la perplexité furent tout aussi fortes quand la première vague de contestation recula au cours de l’été 1968.
Alors qu’en France la grève massive des ouvriers avait fait naître un sentiment de solidarité, de cohésion entre étudiants et ouvriers dans leur lutte contre le gouvernement, les ouvriers en Allemagne n’étaient pas encore entrés en scène de façon massive au printemps 1968. Après la vague de protestations contre la tentative d’assassinat du célèbre leader étudiant Rudi Dutschke en avril, et après les manifestations contre l’adoption des lois d’urgence pendant l’été 1968, le mouvement, essentiellement étudiant, s’étiola. Contrairement à ce qui s’était passé en France, les étudiants en Allemagne ne furent pas immédiatement remplacés par la classe ouvrière comme fer de lance dans les luttes. C’est seulement après les grèves de septembre 1969 que la classe ouvrière en Allemagne entra en scène à une plus grande échelle.
Des
centaines de milliers de jeunes cherchaient un point de référence,
une orientation et un levier pour renverser cette société. C’est
une tragédie de l’histoire que cette jeune génération, au sein
de laquelle beaucoup avaient commencé à se considérer comme des
opposants au système capitaliste, ait été récupérée et que son
mouvement de contestation initial ait été réduit à l’impuissance.
Nous voulons essayer d’expliquer ce qui s’est passé.
La
classe ouvrière avait refait surface mais la lutte de classe ne
jouait pas encore son rôle unificateur
Même si la classe ouvrière en France avait mis en place la plus grande grève de l’histoire en mai 1968, cette première réaction massive de la classe ouvrière n’était pas encore capable de repousser tous les doutes la concernant qui avaient prévalu pendant des années.
Peut-être encore plus que Paris pour la France, Berlin était le centre de la contestation étudiante en Allemagne. Pas la ville de Berlin telle qu’elle est aujourd’hui, mais l’enclave de Berlin-Ouest au milieu de l’Allemagne de l’Est. De nombreux protagonistes à l’époque étaient motivés par des idées vagues telles que l’instauration d’une sorte de république conseilliste à Berlin-Ouest qui aurait servi d’étape transitoire pour transformer à la fois Berlin-Est et Berlin-Ouest.
Mais en examinant la situation particulière de l’enclave pendant la Guerre froide, on peut voir combien cette idée était irréaliste car cette enclave constituait en un certain sens un microcosme des difficultés que devait affronter la résurgence de la classe ouvrière.
D’un côté Berlin-Ouest était une scène centrale pour les gauchistes. Etre résidant à Berlin-Ouest signifiait que l’on était exempté de conscription militaire. D’un autre côté, les secteurs Ouest de Berlin avaient toujours été des centres anti-communistes, qui tiraient parti encore à l’époque de l’aspect romantique du pont aérien de Berlin. Par-dessus tout, nulle part ailleurs dans le monde occidental on ne connaissait aussi bien la face inhumaine du stalinisme par l’expérience même de la population. Dans une telle ambiance, le fait même d’entendre de la bouche d’un étudiant des mots tels que ‘socialisme’ et ‘communisme’ provoquait de vives méfiances, particulièrement de la part des ouvriers les plus âgés. Contrairement à ce qui se passait en France, les étudiants n’étaient pas tant regardés avec de la sympathie ou de l’indifférence, mais plutôt avec de l’hostilité. Le résultat est que les contestataires de la première vague se sentaient profondément dans l’insécurité.
Par conséquent, on peut comprendre que beaucoup d’entre eux aient commencé à chercher des forces révolutionnaires alternatives hors de l’Allemagne, et même hors des pays industrialisés. Cette réaction n’était en aucun cas spécifique à l’Allemagne mais elle y a développé une forme spécifique.
1968/69
ont également constitué le pic du mouvement de protestation contre
la guerre du Vietnam impliquant des centaines de milliers de jeunes
dans le monde entier. Les formes de nationalisme
« anti-impérialiste », telles que le « Black
Power » aux
Etats-Unis, étaient de façon erronée présentées comme faisant
partie d’une solidarité internationale et même comme « une
lutte de classe révolutionnaire ». Cela nous aide à
comprendre le paradoxe qui a fait qu’un mouvement qui, à
l’origine, était dirigé contre le stalinisme se tourne
partiellement à nouveau vers lui. Parce que la première apparition
de la classe ouvrière n’avait pas encore attiré suffisamment de
monde dans son orbite, beaucoup de jeunes devinrent réceptifs à des
idées qui étaient une véritable déformation perverse de leurs
motivations originelles. L’influence des organisations gauchistes a
eu alors un effet négatif, désastreux et destructeur, et un grand
nombre des victimes de ces organisations se trouvaient parmi la jeune
génération.
Le
rôle désastreux de la gauche et des gauchistes
Les dirigeants du mouvement de 1967-68 pensaient qu’une révolution était là juste au coin de la rue. Mais quand le changement rapide attendu échoua, ils durent admettre que leurs forces avaient été trop faibles pour l’entraîner. L’idée leur est venue de fonder ‘le’ parti révolutionnaire, quasiment comme une sorte de panacée. En tant que telle, l’idée n’était pas mauvaise. Les révolutionnaires doivent unir leurs forces et s’organiser pour avoir un impact maximal. Le problème était qu’ils étaient coupés de l’expérience historique de la classe ouvrière à cause de la contre-révolution, quelles que soient ses formes d’expression : démocratique, stalinienne et fasciste, qui avaient duré pendant des décennies. Ils ne savaient ni ce qu’était un parti prolétarien, ni comment et quand il devait être créé. Au lieu de cela, ils voyaient le parti comme une sorte d’église, un mouvement missionnaire, qui convertirait les ouvriers embourgeoisés au socialisme. De plus, le poids très lourd de la petite-bourgeoisie avait un impact considérable sur les étudiants. Comme Mao en Chine au cours de la révolution culturelle, pensaient-t-ils, ils voulaient ‘purger’ les travailleurs de leur ‘embourgeoisement’. Rudi Dutschke, comme les autres leaders de l’époque, a décrit comment, au début du mouvement, les étudiants révolutionnaires et les jeunes travailleurs se rencontraient et établissaient des contacts dans les centres de jeunesse de Berlin-Ouest, et comment les jeunes ouvriers par la suite ont refusé de participer à ce tournant sectaire, étrangers à ce monde-là.
Le déboussolement de la nouvelle génération fut également exploité par les groupes gauchistes, que l’on appelait en général les ‘groupes K’ (Kommunist groups) qui se développaient alors. Les divers et multiples groupes gauchistes, en nombre croissant en Allemagne –il y avait des dizaines d’organisations allant des trotskystes et des maoïstes aux ‘spontanéistes’- agissaient comme un gigantesque piège servant à stériliser politiquement la jeune génération.
Même si en Allemagne, après 1968, plus d’une demi-douzaine de groupes trotskistes ont jailli, ces groupes attiraient moins de monde en Allemagne qu’en France, principalement parce que la classe ouvrière en Allemagne n’avait pratiquement pas fait sa réapparition. Le trotskisme n’est pas moins bourgeois que le maoïsme. Mais comme il était apparu à l’origine comme un mouvement prolétarien d’opposition au stalinisme, la classe ouvrière en était plus proche que du maoïsme, qui s’inspirait plutôt d’un certain romantisme envers la paysannerie.
En Allemagne c’était surtout les groupes maoïstes qui prospéraient. A la fin des années 1968/69, le KDP, Parti Marxiste Léniniste a été fondé ; à Berlin Ouest, un autre KPD fut créé en 1971 comme rival du premier. En 1971, la Ligue Communiste (KB) a de même vu le jour dans le nord de l’Allemagne ; en 1973 le KBW (Ligue Communiste, Allemagne de l’Ouest) se mettait en place à Brême. Ces groupes ont réussi à attirer plusieurs centaines de jeunes. Les groupes maoïstes reflétaient un phénomène qui avait pris une forme particulière en Allemagne. Parce qu’en Allemagne, beaucoup de jeunes reprochaient à leurs aînés d’avoir été responsables des crimes nazis et de la Seconde Guerre mondiale en général, les maoïstes pouvaient tirer profit de ce complexe de culpabilité. De plus, le maoïsme agissait comme organisateur et fervent propagateur de la ‘guerre des peuples’. Le maoïsme prétendait être le défenseur des paysans opprimés du Tiers Monde et voulait les mobiliser dans des guerres de ‘libération nationale’ contre « l’impérialisme américain ». Etant donné que les paysans étaient considérés comme étant la principale force révolutionnaire de la société, le maoïsme agissait comme un agent recruteur de chair à canon pour la guerre.
Cependant, le fait que le mépris pour leurs propres pères les avait conduits à idéaliser les nouveaux leaders (Mao, « l’Oncle Ho », le « Che », Enver Hoxha) n’avait pas beaucoup troublé les supporters des groupes maoïstes car cela correspondait à un besoin d’une partie d’une génération ‘d’avoir quelqu’un à admirer’, de chercher un ‘modèle’, et même une ‘image du père’ afin de remplacer la vieille génération rejetée. Le maoïsme a donné naissance à de telles monstruosités, comme la révolution culturelle au milieu des années 1960 en Chine, où des millions de travailleurs que l’on estimait appartenir à ‘l’intelligentsia’ ou qui avaient une qualification supérieure quelconque étaient envoyés à la campagne pour apprendre auprès des paysans. Tout cela signifiait une terrible humiliation et un grand avilissement. Le maoïsme se distinguait également par un rejet profondément ancré de toute approche théorique. Sa caractéristique principale était le culte des leaders et la psittacose du slogan avec le « petit livre rouge » de Mao comme une Bible entre les mains.
De plus, les maoïstes ont ranimé le "Proletcult" (les cols bleus érigés en icônes) à la manière de ce que prônait Staline dans les années 1920.Le mot d’ordre était d’aller dans les usines pour apprendre auprès des ouvriers et d’instaurer une organisation d’avant-garde. C’était le côté pile de la même pièce qui, sur le côté face, reprochait à la classe ouvrière d’être ‘embourgeoisée’.
Alors qu’avec une longueur d’avance, beaucoup de jeunes avaient commencé à se confronter à l’histoire et aux questions théoriques, maintenant les « groupes K » faisaient tout leur possible avec l’aide des ‘écoles de marxisme’ pour détruire cette soif d’approfondissement théorique en corrompant la relation entre théorie et pratique. Le dogmatisme des gauchistes aura des conséquences désastreuses.
D’un côté, les « groupes K » ont conduit leurs adhérents à un activisme effréné et, de l’autre, ils les ont endoctrinés avec de soi-disant cours sur la théorie marxiste. Ainsi, après 1968, des dizaines de milliers de jeunes ont vu leur opposition première au système être déformée et entraînée dans des activités qui en réalité contribuaient au maintien du capitalisme. Il était difficile de résister à cette pression sectaire. Finalement, beaucoup de jeunes ont été détournés de la politique et en ont été complètement écœurés. On a estimé qu’entre 60 000 à 100 000 jeunes d’Allemagne de l’Ouest étaient impliqués d’une manière ou d’une autre dans des groupes gauchistes. Nous devons les considérer comme des victimes recrutées par les organisations gauchistes pour une politique bourgeoise, et comme des gens qui ont eu les ailes brûlées par ces groupes.
Ce fut l’un des paradoxes de l’histoire de cette époque que les staliniens ‘officiels’, qui combattaient ouvertement les aspirations révolutionnaires de 1968, aient été encore capables de saisir l’occasion d’établir une certaine présence en Allemagne. Au printemps 1969, le Parti Communiste Allemand (DKP) fut créé, composé dans une certaine mesure avec d’anciens membres du KPD qui avaient été bannis au début des années 1950. Au début des années 1970, ce parti, incluant ses nombreuses ramifications, comprenait quelques 30 000 membres. Une des raisons expliquant cet afflux d’adhésions était que beaucoup de ses membres croyaient que le parti, qui était soutenu et financé par l’Allemagne de l’Est, serait capable d’agir comme un contrepoids à l’Etat ouest-allemand ; et ils croyaient également que soutenir Moscou renforcerait une position ‘anti-impérialiste’ dans le monde contre les Etats-Unis. Après un rejet initial des sociétés totalitaires et staliniennes de l’Europe de l’Est par les jeunes générations, nous étions maintenant face à la récupération paradoxale d’une partie d’entre eux par un DKP ultra-stalinien.
De plus, les très rares voix de la Gauche communiste qui existaient à l’époque se voyaient furieusement bâillonnées par les différents groupes gauchistes. Par exemple, si vous dénonciez les mouvements de ‘libération nationale’ comme étant des guerres par procuration entre les blocs impérialistes et si vous prôniez l’expansion de la lutte de classe par l’extension et l’auto-organisation des luttes ouvrières, c’est-à-dire si vous défendiez un point de vue résolument internationaliste, ou si vous vous dressiez contre l’antifascisme et qualifiez la Seconde Guerre mondiale de guerre faite de part et d’autre par des gangsters impérialistes, non seulement vous violiez un tabou, mais vous vous heurtiez de front à l’attitude hostile de tous les gauchistes réunis.
Même
s’ils n’étaient pas exposés de la même manière à l’influence
des gauchistes, un milieu très hétérogène de ‘spontanéistes’
développait lui aussi ses activités : squattant dans les
maisons vides, faisant campagne pour des crèches ou contre les
centrales nucléaires. Cela voulait dire qu’une grande partie de la
jeune génération était engagée dans des luttes partielles. La
perspective qui découlait de ces luttes et les conséquences de ces
activités étaient que la contestation du capitalisme devint très
limitée et fut réduite à un aspect partiel, au lieu de la
compréhension de la nature globale et interactive de ces problèmes
à l’intérieur du système capitaliste. Plus tard, ces mouvements
partiels constituèrent un terreau fertile aux activités du Parti
des Verts qui, par l’intermédiaire de projets pour une réforme
écologique, avait un fort impact sur beaucoup de jeunes, ce qui a
conduit à l’intégration de bon nombre d’entre eux dans des
‘projets’ voulant réformer d’Etat de l’intérieur.
Le
terrorisme – une autre voie sans issue
Un autre cul-de-sac dans lequel s’est précipitée une partie de la génération en plein questionnement de l’époque a été le terrorisme. Conduits par un mélange de haine et de révolte contre le système, prisonniers de leur propre impatience et de la croyance que des actions exemplaires pouvaient ‘secouer les masses’, certains de ces éléments furent entraînés à se livrer à des attaques violentes contre les représentants du système, mais ils étaient également infiltrés par des provocateurs à la solde de l’Etat qui les utilisaient pour le compte des intérêts sordides du gouvernement. A partir de mars 1969, de petites bombes ont commencé à circuler, distribuées par les agents provocateurs. A Berlin-Ouest, le 9 novembre 1969, il y eu une première attaque contre un Centre de réunion juif : pour quelques membres de ces mouvements, cela faisait partie de la lutte contre le sionisme en tant que nouvelle forme de fascisme. Réceptifs à la manipulation, des fractions de ce mouvement furent transformées en propagandistes pour soutenir les mouvements de libération nationale (souvent des terroristes palestiniens) qui étaient prêts à les entraîner dans leurs camps militaires et qui exigeaient une soumission et une discipline totales. En mai 1970, la Fraction Armée Rouge (RAF) fut créée ; les ‘Cellules Révolutionnaires’ « combattantes » commencèrent leurs activités après 1973. Le nombre de leurs supporters et de leurs adhérents semble avoir été assez conséquent, le journal underground Agit 883 prétend avoir imprimé 10 000 à 12 000 copies par semaine.
Cependant,
pour le capitalisme et l’Etat, ces gens n’ont jamais constitué
le danger mortel qu’ils avaient espéré être. Au lieu de cela,
l’Etat a systématiquement utilisé leurs activités pour justifier
le renforcement de son appareil de répression.
La
Social-Démocratie et « l’Etat providence » : un
nouveau piège
Au milieu des années 1960, le long boom d’après-guerre, vanté comme étant un miracle économique, arriva à son terme. Peu à peu, la crise refit son apparition. Parce que le boom avait pris fin d’une façon soudaine, les premiers symptômes de la crise ne furent pas encore trop explosifs et brutaux, et il y eut encore beaucoup d’illusions sur une intervention énergique de l’Etat qui permettrait à l’économie d’être secouée un bon coup et de redémarrer.
S’appuyant sur ces illusions, le SPD a commencé à promettre qu’avec l’aide de mesures keynésiennes (énormes dépenses de l’Etat s’appuyant sur l’endettement, etc.), la crise pourrait encore être maîtrisée. Le SPD plaça même cette propagande au centre de sa campagne. Beaucoup avaient placé leurs espoirs dans cette ‘aide providentielle’ de l’Etat, conduite par la sociale-démocratie. De plus, les premières mesures d’austérité étaient encore assez modérées si on les compare à celles d’aujourd’hui. Ces circonstances nous aident également à comprendre que la contestation ait été vue par l’un des courants du mouvement à l’époque comme la manifestation du rejet de la société « de consommation », de la « société du spectacle » (une idée répandue par les situationnistes)1. Tout cela aide à comprendre un certain retard dans le développement de la lutte de classe en Allemagne et a contribué au fait que la classe ouvrière en Allemagne était encore ‘en sommeil’ jusqu’en septembre 1969. En outre, l’Etat pouvait encore se permettre pas mal de ‘réformes’, en particulier après le retour au pouvoir du SPD dans le gouvernement socio-libéral formé à l’automne 1969 qui injecta de l’argent dans l’économie. Le mythe de « l’Etat providence », largement répandu à l’époque, a contribué à enchaîner les étudiants (beaucoup d’entre eux recevaient des bourses) et les travailleurs à l’Etat, et ainsi leurs velléités de résistance face au pouvoir furent brisées.
Au
niveau politique, en 1969, le SPD faisait campagne pour la
participation aux élections qui approchaient. Alors qu’auparavant,
les mouvements de contestation avaient orienté leurs activités vers
« l’opposition extra-parlementaire », la
social-démocratie réussit à attirer une partie considérable de la
jeune génération vers les urnes. Comme en 1918/19, cinquante ans
plus tard, la social-démocratie aidait à étouffer les tensions
sociales. Le SPD avait encore une forte influence à l’époque,
réussissant à accroître le nombre de ses adhérents de 300 000
(et parmi eux, de nombreux jeunes) entre 1969 et 1972. Beaucoup
considérèrent le SPD comme un ‘moyen de pénétration’ à
l’intérieur des institutions (l’entrisme dans les institutions
d’Etat). Pour beaucoup, la participation dans sa section pour la
jeunesse, le JUSO, signifiait en réalité le début d’une carrière
dans l’appareil d’Etat.
Une
tâche qui unit les générations
Quarante ans après les événements de Mai 68, un simple coup d’œil à la presse internationale montre que ces évènements ont reçu une importante couverture médiatique bien au-delà des frontières de la France. Si les médias ont traité aujourd’hui ces évènements de 1968 avec autant d’intensité, c’est parce que quelque chose est en train de couver dans notre société. Même si ceux qui ont pris part à ces événements et qui depuis ont fait une belle carrière dans l’appareil d’Etat ou dans le business ont honte de leurs activités ou veulent garder le silence à ce sujet, ceux qui à l’époque avaient déjà pour but une société nouvelle, libérée de l’exploitation, peuvent constater par eux-mêmes que leur projet originel est toujours valable et que cette nécessité reste toujours actuelle.
Aujourd’hui, une nouvelle génération est en train de remettre en question les bases de la société capitaliste. Depuis 1968, la société s’est enfoncée dans une crise beaucoup plus profonde et une barbarie qui ne peut plus être ignorée. Ceux qui ont participé à Mai 68 et qui n’ont pas été récupérés par le système, et dont beaucoup ont l’âge de la retraite, ont toutes les raisons et aussi toutes les possibilités d’offrir leur aide à la jeune génération d’aujourd’hui et de se joindre à la lutte pour le renversement du capitalisme. C’est une lutte qui doit englober toutes les générations. En 1968, le conflit entre les générations a eu de graves conséquences. A l’heure actuelle, ce serait une double tragédie pour la génération la plus âgée si elle ne réussissait pas à soutenir la jeune génération d’aujourd’hui dans sa lutte.
TW, 11/07/08
1 La prolétarisation chez les étudiants n’était pas si avancée à l’époque. En comparaison, la proportion d’enfants d’ouvriers parmi les étudiants est beaucoup plus grande aujourd’hui. Alors qu’à l’époque l’influence bourgeoise et petite-bourgeoise était plus importante, aujourd’hui ce sont les conditions d’existence prolétariennes qui dominent chez les étudiants. Chose presque inconnue à l’époque, les étudiants sont maintenant presque tous confrontés au chômage des jeunes et à celui de leurs parents, à la paupérisation, à la perspective d’un emploi dans des conditions précaires etc. Tandis qu’à la fin des années 1960 beaucoup pouvaient espérer une carrière dans leur emploi, aujourd’hui la plupart craignent le chômage et l’insécurité de l’emploi.
Géographique:
- Allemagne [61]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [132]
A Vigo, en Espagne : les méthodes syndicales mènent tout droit à la défaite
- 3496 lectures
Nous publions ci-dessous un article rédigé par Accion Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne et publié sur notre site en langue espagnole dès le 19 juin.
Il y a trois ans, les métallurgistes de Vigo ont été les protagonistes d’une lutte qui a obtenu satisfaction pour une bonne partie de ses revendications, en particulier, des augmentations de salaire égales pour tous, une mesure unitaire et solidaire qui a amélioré les salaires de tous, tout en favorisant les ouvriers les plus mal payés.
Le « secret » de ce succès temporaire est dû au fait que les ouvriers ont utilisé des méthodes prolétariennes de lutte : la grève est partie d’une petite usine de métallurgie et les travailleurs sont parvenus à gagner la solidarité active de leurs camarades des grandes entreprises voisines des chantiers navals et de l’automobile. Cette solidarité s’est développée grâce à des manifestations massives qui se sont rendues aux portes des usines, en organisant des assemblées communes où chacun pouvait participer et où l’on décidait de comment maintenir l’unité et comment poursuivre la lutte. ensemble. En même temps, la grève était dirigée au jour le jour par des assemblées dans la rue ou devant les portes des usines ouvertes à tous où près de 10 000 personnes ont pu participer et dans lesquelles des travailleurs d’autres secteurs étaient invités à donner prendre la parole. La bourgeoisie, à travers le gouvernement de Zapatero, autoproclamé champion de la « tolérance », a employé des méthodes exemplaires de tolérance telles que le passage à tabac, l'utilisation de gaz lacrymogènes et toutes sortes de provocations policières pour essayer d’en finir avec cette lutte. Mais les ouvriers ne sont pas tombés dans le piège. Et quand deux de leurs camarades furent placés en garde-à-vue, plus de 15 000 personnes se sont réunies devant les bâtiments où ils étaient emprisonnés et elles sont arrivées à obtenir leur libération1.
Trois ans plus tard, les ouvriers de Vigo reprennent la lutte
Depuis la fin avril, la lutte de classe est de retour à Vigo. Comme nous l’avons fait à l’époque, notre premier souci est d’exprimer notre ferme solidarité avec les travailleurs en lutte. Aujourd’hui, cependant, les conditions ne sont pas les mêmes qu’en 2006.
D'abord sur le plan de la crise. En 2006, on était en pleine euphorie expansive de « la brique et du béton » et il semblait qu’avec tant de « prospérité », on pouvait bien obtenir quelques miettes supplémentaires, tombées de la table d’un banquet si fastueux. Aujourd’hui, ce doux rêve s’est transformé en un cruel cauchemar qui va surtout hanter le sommeil des ouvriers. Les quelques miettes obtenues en 2006 ont été balayées par la bourrasque de la crise. Un travailleur le disait : « Ça va très très mal. Soit on lutte, soit on meurt ». Les soucis, les tensions, l’anxiété, sont palpables, le futur est plus que sombre, « je finirai au chômage et alors qu’est-ce que j’aurai pour mes quatre enfants ?», se demandait un autre ouvrier.
Mais le changement principal se trouve dans la politique menée par les syndicats.
En 2006, l’élan impulsé par une majorité de jeunes ouvriers avait surpris les syndicats. Dans les assemblées, ceux-ci rejetaient les propositions ouvrières, ce qui provoqua de l’indignation et de nombreuses cartes syndicales furent déchirées. Les manifestations massives n’ont pas pu être arrêtées par les syndicats, malgré leurs tentatives de les « recycler » en actions violentes ou en « arrêts de travail de 24 heures » qui leur auraient permis de contrôler fermement le terrain et d’empêcher les initiatives autonomes et le contact direct entre ouvriers de différents sites.
En 2009, par contre, les syndicats ont pris les devants. Au lieu d’une grève qui surgit des petites entreprises et qui se propage de proche en proche vers les grandes entreprises, les syndicats ont imposé la camisole de force des « journées de lutte » qu’ils dosent, contrôlent et convoquent à leur convenance. Enfermés dans ce corset, les ouvriers éprouvent, au moment où nous écrivons, de grandes difficultés pour développer leurs initiatives, leur solidarité, leurs actions.
Lors de la journée de lutte du 5 mai. « les piquets de grève sont partis de différentes usines de Vincios, de Porriño, de Mos et de Ponteareas.2 La place d’Espagne à Vigo a été le grand point de rencontre. De là, des milliers de travailleurs ont parcouru la Gran Vía jusqu’à la place des Amériques, où se sont joints d’autres manifestants du même secteur d’activité »3. Voilà de nouveau les méthodes classiques : manifestation massive et convergence entre travailleurs de différentes entreprises. À la fin de la manifestation, les ouvriers se sont regroupés dans une assemblée générale sur la place Do Rei. Mais à la différence de 2006, sous prétexte de laisser la parole aux représentants de chaque usine, les syndicats ont empêché l’expression libre qui s’est développée en 2006 et seuls les Comités d’entreprise prirent la parole.
La grève s’est poursuivie le 6 mai, mais au lieu d’aller vers les grandes entreprises, l’action proposée par les syndicats fut d’occuper la Foire Expo. Cela apparaissait comme quelque chose de spectaculaire qui était censé avoir une « forte répercussion médiatique », mais il s’agissait, en réalité, d’isoler les ouvriers, de s’opposer à ce qui peut les renforcer et empêcher ce qui aurait pu avoir un véritable écho social : l'intégration dans la lutte de leurs frères de classe des grandes entreprises.
Le 7 mai, les syndicats ont ouvert des négociations avec le patronat. En fait, il s’agissait pour eux de gagner du temps en noyant le poisson pour écoeurer les ouvriers, mais ce sont l’impatience et l’inquiétude qui ont commencé à se répandre chez les ouvriers. Des assemblées spontanées ont commencé à se produire dans certaines zones industrielles. Pour éviter tout débordement, les syndicats ont convoqué une nouvelle journée de lutte pour le 20 mai. Cette fois-ci, les grévistes sont allés vers les chantiers navals pour y chercher la solidarité et les travailleurs de chez Vulcano se sont joints à eux. Les arrêts de travail étaient programmés par les syndicats pour durer deux jourss, mais le 21 une charge brutale de la police contre une manifestation qui se dirigeait vers le chantier naval Barreras a ravivé la colère. Le lendemain, les ouvriers ont décidé de poursuivre la grève en débordant les syndicats, lesquels ont été contraints d’appeler à un nouvel « arrêt de travail de… 4 heures (!) ». ABC, journal de droite auquel on ne peut attribuer une folle sympathie envers les ouvriers, décrivait ainsi les événements dans son édition du 23 mai : « Près de 5000 manifestants, en tenue de travail, se sont lancés dans la rue pour protester contre les charges policières de la journée précédente, des charges que les syndicats, d’une seule voix, ont qualifiées de ‘disproportionnées’. Aux cris de ‘Vigo, la métallurgie est en grève’, les manifestants ont parcouru les rues principales en demandant le soutien des habitants. La manifestation de ce matin a été la plus puissante, celle qui a rassemblé le plus de gens pour la même cause, à laquelle se sont même joints des travailleurs de quelques entreprises qui jouissent de leur propre convention collective et qui n’ont pas hésité à rejoindre la lutte. »
Lors de l’assemblée qui s’est déroulée sur la place Do Rei, les syndicats proposèrent une trêve de 4 jours pour que « le patronat fasse une proposition sérieuse ». A la fin, ils ont réussi à convaincre les ouvriers rassemblés en proposant, en cas d’échec, une « grève générale illimitée », un mot d’ordre apparemment « radical » mais vide de sens qui s’opposait de fait à la poursuite concrète de la grève, maintenant que les forces, la conscience et l’élan étaient là.
Comme il fallait s’y attendre, il n’y a pas eu la moindre offre sérieuse de la part du patronat, ce qui a contraint les syndicats à lancer un nouvel appel à des journées de lutte pour le 3 et le 4 juin, en reportant le projet de « mobilisation générale » au 15 juin si le patronat ne donnait pas de réponse satisfaisante.
Le 3 juin, il y a eu une mobilisation massive avec la participation de travailleurs de Vulcano et de Metalship. Le 4, les syndicats ont organisé une de leurs actions-spectacle dont ils ont le secret : il s’agissait d’aller au Club Nautique de Vigo et d'empêcher l’accès des passagers au navire de croisière Independent of The Sea . D’un point de vue superficiel, un tel acte peut apparaître comme le summum du radicalisme « révolutionnaire » : est-ce que les croisières ne sont pas par hasard le symbole le plus parfait du luxe capitaliste ? Mais analysée sérieusement, il s’agit là d’une action non seulement inutile mais avec des effets tout simplement contraires. Les travailleurs s’isolent, s’affrontent à des gens qui ne connaissent en rien leurs revendicationsou qui sont dans les plus mauvaises dispositions pour les comprendre et, en fin de compte, ils fournissent les meilleures images pour que la presse et la TV s’en donnent à cœur joie pour les traiter des « vandales » ou les accuser rien de moins que de « faire du mal à l’image touristique de Vigo ». Alors que la méthode prolétarienne de lutte consiste dans le ralliement à la lutte des autres travailleurs à travers l’envoi de délégations massives aux autres usines et l’appel à des assemblées générales ouvertes (dans lesquelles tous les ouvriers y compris les chômeurs peuvent discuter ensemble, comprendre comment développer leur lutte, manifester leur solidarité,, en construisant donc un rapport de force réel et efficace contre l’Etat et le capital), la méthode des syndicats consiste à faire des actions vides, qui attisent les affrontements entre ouvriers, qui les isolent entre eux, les discréditent facilement et qui les exposent, comme ce fut le cas, à la répression policière la plus brutale.
Le show devant le bateau de croisière s’est achevé par une charge brutale de la police qui a dispersé les travailleurs. Mais parmi ceux-ci s’est répandue la consigne de se retrouver devant les portails de Barreras, le plus grand chantier naval de Vigo. Quelques 500 ouvriers sont arrivés à se regrouper sur une place devant l’entrée, même si immédiatement après une quantité impressionnante de fourgons de police ont occupé cette place et les policiers ont commencé à attaquer violemment les ouvriers regroupés. De l’autre coté de la place, dans un centre commercial, des jeunes d’un lycée se sont rassemblés spontanément, avec des clients de ce centre ainsi que d’autres travailleurs qui arrivaient au fur et à mesure. Cette foule criait contre la violence policière et encourageait en applaudissant les actions défensives des travailleurs massés de l’autre coté de la place. Ceci entraîna une violente charge policière qu’un photographe amateur décrit ainsi dans son blog : « À un moment donné donc, la police s’est jetée sur tous ceux qui y étaient rassemblés, d’abord en nous lançant des balles en caoutchouc que nous entendions siffler à nos oreilles et, de suite, en chargeant. Tout cela parce que nous n’étions pas favorables à ses agissements brutaux, injustifiés et disproportionnés. Nous avons couru nous réfugier dans le parking du centre commercial, mais avant d’y entrer un fumigène lancé par les flics est tombé en flammes sur nos têtes. La panique s’est emparée de nous tous et nous avons fermé la grille du parking au cas où l’idée leur viendrait de nous charger à l'intérieur. Soudain, les brigades anti-émeute ont rouvert les grilles et nous ont fait sortir en nous laissant partir avec l’obligation de nous disperser. »4
L’assemblée générale put enfin se dérouler parce que les ouvriers sont arrivés à briser l’encerclement policier et, d’après un témoignage, une autorité quelconque aurait donné l’ordre à la police anti-émeute de partir. L’assemblée lança un appel à une manifestation, en demandant à tous les travailleurs, de quelque secteur que ce soit, de s’y rendre avec leurs familles. La manifestation eut lieu le lendemain et rassembla 7000 personnes.
Pour ne pas rallonger cette chronique5, disons que les jours suivants se sont déroulés entre une succession d’appels à la grève, de poursuite de négociations infructueuses, de tentatives pour gagner la solidarité des travailleurs des autres grandes entreprises, comme à Barreras, à Vulcano et très minoritairement à Citroën. Au moment où nous écrivons ces lignes, mardi 16 juin, la situation est toujours fluctuante ; les travailleurs semblent fatigués parce que leur lutte parait sans perspective. Les syndicats ont proposé une série de mobilisations très compliquées, un véritable casse-tête : « L’action des manifestants et des piquets se focalisera aujourd’hui sur les concessionnaires d’automobiles, pour ainsi paralyser les ventes (...) Les centrales syndicales ont élaboré un programme de mobilisations pour cette semaine dont le contenu général consistera dans la réalisation d’arrêts de travail ‘partiels’ de quatre heures, entre 9. heures et 13 heures, lors du service du matin dans les chantiers navals. Pour les services du soir et de nuit, l’arrêt de quatre heures se fera à la fin de la journée de travail. Cependant, les garages de réparation automobile seraient exclus de ce programme et leurs arrêts de travail seraient réalisés à partir de 12h30 jusqu’à la fin de la journée. Pendant ce temps, les entreprises d’installation du gaz, les plombiers, le chauffage et l’électricité s’arrêteront toute la journée » 6
Les méthodes syndicales de lutte ne conduisent qu’à la défaite
Un des arguments majeurs utilisés par les syndicats pour justifier leur existence, c’est que, eux, « sont des professionnels de la lutte », qu’ils ont l’expérience de l’organisation, des négociations, des appels, etc. Face à de tels « experts », les ouvriers sont présentés comme des éléments malléables et apathiques, qui ne savent pas comment lutter, qui se bagarrent entre eux, qui agissent et pensent chacun pour soi, etc.
Mais la réalité des faits ne cadre pas du tout avec ces clichés. En 2006, les ouvriers laissant parler leur propre initiative ont été capables d’obtenir une forte solidarité, ce qui leur a donné un petit répit dans l’attaque de leurs conditions de vie. Par contre, ce que nous voyons aujourd’hui, en 2009, maintenant que les syndicats semblent avoir réussi à imposer leur marque de « professionnels chevronnés », c’est la fatigue, l’impasse, la démoralisation. On est forcé de conclure que la démarche et les méthodes syndicales ne développent pas la lutte ouvrière, mais qu’au contraire, elles la détruisent.
• Les assemblées générales : en 2006, les assemblées ouvertes permettaient la libre discussion la plus large, de telle sorte que les ouvriers pouvaient réfléchir et décider ensemble en s’appuyant sur l’aide et l’opinion des camarades d’autres secteurs. En 2009, sous la férule des syndicats, les assemblées sont une caisse d’enregistrement ennuyeuse, où il faut supporter de longs discours des leaders syndicaux, où tout est bien réglé pour qu’il n’y ait que les délégués syndicaux qui parlent. Il n’y a aucune vie, les assemblées ressemblent à une caricature du cirque parlementaire. Comme à Vigo en 2006, comme lors des assemblées massives en Grèce, en décembre 2008, les travailleurs ont besoin de retrouver leur authentique tradition des assemblées ouvertes, avec la libre participation de tous, avec des discussions sur tout ce qui tient à coeur, avec des interventions concrètes et brèves. Rappelons-nous de ce que proclamait l’hymne de la Première internationale : «Il n’est pas de sauveurs suprêmes : Ni Dieu, ni césar, ni tribun, Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes !». Les assemblées sont les moyens concrets pour que l’émancipation des travailleurs puisse être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, sans aucun « sauveur » politique ou syndical.
• La solidarité ouvrière : en 2006, les ouvriers rejoignaient massivement les autres entreprises, ils improvisaient des assemblées ensemble, on y créait un contact direct entre travailleurs, on pouvait y parler, établir des liens, dépasser l’atomisation et l’isolement, apprendre à se comprendre, à développer l’estime mutuelle, bref on mettait en avant les moyens pour se sentir en tant que partie de la classe ouvrière, en « se vivant », en s’affirmant comme telle. Et qu’avons-nous en 2009 grâce aux « mains expertes » des syndicats ? Il y a eu de nombreuses tentatives de reprendre les méthodes de 2006, mais les syndicats ont privilégié une action d’après eux « plus efficace » : les blocages ou coupures des voies de circulation et d’axes routiers. Ces coupures ont eu effectivement « un grand succès ». Chaque fois qu’il y a eu une « journée de lutte », Vigo était totalement paralysée, il était impossible d’arriver au travail à l’heure, de faire les livraisons, des affaires, de transporter des marchandises. C'était comme si on avait asséné un coup très dur à l’économie capitaliste.
Mais ce sont les patrons eux-mêmes qui reconnaissent que leur économie a été très peu touchée et les bouleversements, au-delà des situations ponctuelles, ont permis de dégager des stocks énormes et ils en ont même profité pour demander aux ouvriers des petites entreprises de rester chez eux sans être payés « par la faute des grévistes ».
Mais il y avait un autre « grand avantage » suivant les arguments syndicaux : les autres travailleurs « apprendront que le conflit existe », la répercussion sociale est « énorme », « tout le monde parle de ce qui se passe dans la métallurgie de Vigo ».
Dans un barrage de la circulation on impose manu militari la « solidarité » avec les grévistes, il n’y a pas de discussion possible, pas le moindre contact direct ni de rencontre, la seule chose que ça génère c’est l’intimidation, l’énervement contre les grévistes, l’atomisation, chacun enfermé dans « sa bagnole », avec l’angoisse d’arriver en retard au boulot. Aucune solidarité ne peut se développer de cette façon ; seule peut se manifester l’hostilité envers les grévistes. Les automobilistes « apprennent » l’existence du conflit, mais dans des conditions qui ne peuvent favoriser que l’antipathie et le rejet. Peut-être va-t-on parler « des métallos de Vigo », mais comme d’une affaire particulière, comme quelque chose d’étranger, des gens qui sont peut-être forts, mais dont on ne sait pas ce qu’ils veulent ni ce qu’ils revendiquent.
Autrement dit : ces méthodes n’aident en rien ni à l’unité ni à la solidarité, mais, au contraire, provoquent l’affrontement et la division entre travailleurs, elles ne font qu’augmenter encore plus l’atomisation et l’isolement caractéristiques de cette société.
• Les actions-commandos spectaculaires : en 2006, les ouvriers ont réussi à développer une force collective basée sur la solidarité, les manifestations et les assemblées générales massives. Ceci provoqua une certaine alarme au sein du gouvernement qui, après avoir essayé la méthode de la matraque et des provocations policières, encouragea finalement des augmentations salariales pour en finir rapidement avec le conflit.
Aujourd’hui que la lutte est tombée dans les mains si compétentes des syndicats, nous observons tout le contraire : la lutte dure depuis plus de 2 mois et on ne voit pas la moindre issue, tout est en train de pourrir sur pied. Alors qu’en 2006, les autres couches non exploiteuses de la population de Vigo exprimaient une sympathie indubitable envers le mouvement de lutte, aujourd’hui alors que, paradoxalement, le conflit est bien plus connu et trouve un écho sur les écrans de la TV espagnole7, les comportements le plus courants chez « les citoyens » est celui de la lassitude et de l’hostilité vis-à-vis des grévistes. Aujourd’hui que la lutte de Vigo a eu une certaine « répercussion sociale », les travailleurs se retrouvent plus isolés qu’en 2006 alors que leur lutte était à peine connue.
Il faut se poser la question d’un tel paradoxe. Et là, le rôle crucial est joué par la manière avec laquelle le syndicalisme établit le rapport de force avec le système capitaliste. Les syndicats veulent faire croire que les ouvriers renforcent leur lutte contre le capital s’ils mènent des actions spectaculaires qui « s’attaquent au cœur du système » en obtenant un « fort impact social ». On a pu voir à Vigo trois illustrations de cette conception: « l’occupation » de la Foire Expo, le petit numéro sur le port devant le bateau de croisière de luxe et, maintenant, ces actions « de force » programmées pour que les voitures ne soient pas vendues chez les concessionnaires.
Cette radicalité n’est en fait qu’une façade. On prétend s’attaquer aux « temples du capitalisme » telles que la Foire Expo et les croisières, on empêche la vente de voitures, symbole s’il en est du « capitalisme ». On pourrait penser que les bourgeois « ont une trouille bleue » devant de telles actions ; la « circulation des marchandises » est perturbée ou interrompue; pourrait-on imaginer une plus forte attaque aux fondations du système ?
Il est possible que tel ou tel bourgeois individuel ait peur, il est possible aussi que tel ou tel chef concessionnaire perde sa commission à cause de la casse provoquée, il se peut encore qu’un patron perde une affaire juteuse. Mais de telles actions ne laissent pas la moindre griffure sur la peau du mammouth capitaliste.
La base du capitalisme n’est pas un rapport personnel, mais un rapport social. Le capitaliste individuel est, comme le disait Marx, un fonctionnaire du capital, ce qui s’est énormément intensifié aux 20e et 21e siècles avec la présence toute puissante de l’État dans tous les domaines. Le sang empoisonné que charrie ce rapport social est fait d’atomisation, de division, de concurrence entre ouvriers. Si les ouvriers agissent chacun enfermé dans la prison de son entreprise, de son secteur, de sa région ; si chaque lutte ouvrière n’est pas considérée comme la sienne propre par les autres ouvriers, le capital en tant que système peut dormir bien tranquille.
Les actions spectaculaires montées par les syndicats ne rendent pas les ouvriers plus forts ; au contraire, elles les affaiblissent.
Premièrement, parce qu’elles offrent une image lamentable et repoussante des ouvriers impliqués vis-à-vis de leurs propres camarades et des autres couches non-exploiteuses de la société. Quand un groupe d’ouvriers organise le boycott d’une croisière ou une intervention coup de poing dans une Foire Expo, il apparaît comme une bande de gamins capricieux et chahuteurs qui trépignent. On ne les voit pas comme faisant partie d’une classe sociale capable d’avoir sa propre initiative, mais comme de petits vauriens qui viennent saboter une fête. C’est là une vision humiliante de la lutte de la classe ouvrière, qui la ridiculise et la discrédite à ses propres yeux et qui rend plus faciles les campagnes qui se sont multipliées à Vigo présentant les ouvriers comme des « vandales », des « antisociaux », des nouveaux fauteurs de « kale borroka »8.
Deuxièmement, et surtout, parce que les ouvriers sont ainsi dévoyés de la seule chose qui puisse les renforcer : la solidarité, l’action commune avec les autres ouvriers et aussi la sympathie –ou du moins la neutralité bienveillante- des couches sociales non-exploiteuses. Le rapport social capitaliste, le fonctionnement du système, commence vraiment à être bloqué quand face à lui surgit une force sociale capable de lutter de façon unitaire et solidaire, ouvrant ainsi une perspective bien différente de la sinistre réalité quotidienne du capitalisme.
Vigo 2006, Vigo 2009.
Certains répètent jusqu’à la nausée que les ouvriers sont passifs, qu’ils ne veulent pas lutter, que chez eux domine le « chacun pour soi ». Une vision que Zapatero se charge de rendre plus « crédible » quand il proclame que « les travailleurs sont plus responsables que le PP [Parti populaire, droite] car ils renoncent à la grève générale, laissant ainsi de la marge au gouvernement pour sortir de la crise ».
Autant Vigo 2006 que Vigo 2009 montrent tout le contraire : la combativité, la recherche de la solidarité, sont en train de mûrir dans des secteurs encore minoritaires de la classe ouvrière. C’est la pointe de l’iceberg d’un processus profond qui reste encore sous la surface. Pour que tout ce qui est en train de couver jaillisse, il est nécessaire de rompre avec les méthodes syndicales qui étouffent la lutte et celles de Vigo en sont un témoignage éloquent. Il nous faudra reprendre les méthodes prolétariennes de lutte comme celles de Vigo 2006.
CCI (16 juin)
1 Internationalisme n° 326, Juin 2006 "Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne : une avancée dans la lutte prolétarienne [177]".
2 Vigo, et son port transatlantique et de pêche situé sur un profond estuaire (ría), est le centre de la région la plus industrielle du Nord-ouest de l’Espagne. S’y trouvent, en particulier, concentrées les usines de Peugeot-Citroën ainsi que des chantiers navals importants.
3 Note de l’agence EFE du 6-5-09
5 Un dossier avec des informations reprises de certains journaux ainsi que des blogs et des commentaires de différentes personnes publiés sur Internet est disponible sur le blog « lieu de débat » appelé ESPAREVOL. (groups.google.com/g/esparevol/c/xGf-i8A7rHg?hl=es [179])
6 El Faro de Vigo, 16-6-09
7 En 2006 il y a eu une censure rigoureuse : il n’y a eu que quelques rares images sur la TV et la presse de niveau national.
8 C’est le nom de la guérilla urbaine menée au Pays Basque par les nationalistes radicaux pro-ETA.
Géographique:
- Espagne [42]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
A propos d'un bilan de la révolte de décembre 2008 et janvier 2009 en Grèce
- 2365 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article paru en octobre dans World Revolution, organe de presse du CCI en Angleterre.
En décembre 2008, suite à la mort par balle d’un gamin de 15 ans, des luttes ont marqué la Grèce et ont révélé la combativité des étudiants prolétarisés et d’une partie des ouvriers. Des centaines de lycées et un certain nombre d'universités ont été occupés. Les protestataires ont investi des stations de télévision de l’Etat. Le bâtiment de la principale fédération syndicale ainsi que quelques bâtiments de l’université d’Athènes ont été occupés dans le but de les utiliser pour des assemblées générales de salariés, d’étudiants et de chômeurs.
Si nous revenons aujourd’hui sur ces événements, c’est parce qu’un texte très intéressant écrit par des éléments de cette lutte vient de paraître. La Paida Tis Galarias (TPTG, Les Enfants de la Galerie) est un groupe grec qui existe depuis le début des années 90 dont il n'est pas facile de résumer en une simple phrase son histoire pourtant relativement courte. Il a participé aux dernières luttes de Décembre et a publié un bilan provisoire des événements de Février de cette année. Une analyse plus approfondie est apparue sur libcom.org début Septembre, intitulée « Le passage d'une minorité prolétarienne rebelle pendant une brève période de temps" (datée du 30/6/09). Même si son langage peut être parfois obscur, il met en évidence quelques aspects importants du mouvement de l'année dernière.
Un mouvement prolétarien
La première chose à établir est que « La rébellion a été une claire expression de colère prolétarienne contre un mode de vie qui se dévalue de plus en plus, qui est de plus en plus sous surveillance et aliéné. » Bien que les marxistes ne soient pas des sociologues, « Pour autant que la composition de classe de la rébellion soit en cause, celle-ci s'est étendue des étudiants des grandes écoles et universités à de jeunes travailleurs, essentiellement en situation précaire, de divers secteurs comme l’éducation, le bâtiment, les services du tourisme et du spectacle, le transport, et même les médias. Quant à la participation des ouvriers qui sont dans une situation moins précaire, d’après notre connaissance empirique, ces ouvriers qui peuvent être décrits comme des ouvriers ayant un travail stable ou non-précaire, ont participé à la rébellion de façon très limitée. Pour ceux d’entre eux qui ont réellement participé à la rébellion, tenter de l’étendre à leur lieu de travail aurait signifié s'engager dans des grèves sauvages en dehors et contre les syndicats, puisque la plupart des grèves sont appelées et contrôlées par eux."
Ceci est un témoignage important du rôle que les syndicats jouent pour entraver les luttes ouvrières. Bien qu'il y ait eu des luttes en Grèce au cours des vingt dernières années, en particulier dans le secteur public, ces " luttes passées ont révélé que les ouvriers ne pouvaient pas créer des formes autonomes d'organisation ni permettre l’apparition de nouvelles formes qui seraient allées au-delà de la forme syndicaliste."
TPTG perçoit que ceux qui ont un emploi plus ‘stable' ont une participation plus limitée dans les luttes, et que les luttes ne sont pas allées au-delà des limites de la demande syndicale. Il proclame expressément que « la communauté prolétarienne de la lutte » se caractérise par « une négation complète de la politique et du syndicalisme. ». Il va jusqu’à dire qu’ "il était impossible d’être représenté, coopté ou influencé par un appareil politique qui est en cheville avec l’Etat". Bien qu'il ait admis que cette revendication a été temporaire, elle n’en a pas moins été authentique. Pour autant, si l'organisation de la lutte n'était pas aux mains des syndicats ou des gauchistes, mais des participants et si le désir d'appeler à des assemblées générales pour discuter, contrôler et étendre la lutte a sans aucun doute montré une dynamique absolument saine, ce n’était guère "une négation complète de la politique et du syndicalisme.", même si ce fut un pas fondamental dans la bonne direction .
Il viendra certainement un temps où nous verrons « une éruption violente de délégitimisation des institutions capitalistes de contrôle », mais comme TPTG le reconnait, « ce fut juste une rébellion passagère d'une minorité prolétarienne au cours d'une brève période et non une révolution." ; TPTG dit : "le sentiment qu’il y a ‘quelque chose de plus profond’ dans tout ça, l'idée que les questions soulevées par les rebelles concernent tout le monde était si dominante qu'elle seule explique l'impuissance des partis d'opposition, des organisations gauchistes, et même de quelques anarchistes comme on l’a mentionné plus haut » S'il y a eu une moindre participation de la part de ces forces d’encadrement, cela n’a été que de très courte durée. Les idéologies syndicalistes et gauchistes sont très élastiques et en Grèce il y a aussi des illusions sur les actions militaires de ‘l’avant-garde armée’
Contre le militarisme terroriste
Pendant trente ans, les attaques terroristes du 17 novembre et de l'ELA ont été une caractéristique de la situation en Grèce. Et tandis que l'activité de ces groupes semble s'être réduite sous la pression d''un certain nombre de procès et de condamnations, d'autres groupes ont poursuivi cette tradition. Dans la perspective des dernières élections générales grecques, par exemple, on peut lire que « Les cellules anti-terroristes étudient les témoignages recueillis chez des membres présumés de la Conspiration des Cellules du Feu par rapport à ses liens possibles avec le groupe plus brutal de guérilla urbaine, la Secte des Revolutionnaires" ; (Kathimerini 28/9/09). Un des points forts de TPTG est leur rejet de l'avant-garde armée.
Voici ce qu'ils ont écrit à propos des attaques armées de Décembre 2008 et Janvier 2009 : « D'un point de vue prolétarien, même si ces attaques n'ont pas été organisées par l'Etat lui-même, le fait qu'après un mois nous sommes tous devenus les spectateurs de ces 'actes exemplaires' qui ne faisaient pas partie de notre pratique collective, était en soi une défaite ». Ils sont directs dans leur critique: "Ce n'est pas important pour nous maintenant d'avoir des doutes sur la véritable identité de ces tueurs à gage à l'appellation ridicule mais révélatrice de 'Secte Révolutionnaire'; ce qui nous inquiète quelque peu c'est la tolérance politique à leur égard dans quelques quartiers, compte tenu du fait que c'est la première fois que dans un texte de 'l'avant-garde armée' grecque il n'y a même pas la moindre trace de la bonne vieille idéologie léniniste, mais à sa place un nihilisme antisocial et assoiffé de sang ».
Le syndicalisme et les idées réformistes n'ont pas disparu
L'occupation du siège social du syndicat a été l'un des moments forts du mouvement. TPTG y a vu deux tendances: "Pendant l'occupation il est devenu évident que même la version de base du syndicalisme n'a pas pu se rapprocher de la rébellion. Il y avait deux tendances, bien que non clairement définies, même dans la conception de celle-ci : l'une d'un syndicalisme ouvriériste et l'autre prolétarienne. Pour ceux qui appartenaient à la première, l'occupation aurait dû avoir un caractère distinctement 'ouvrier' en opposition à la soi-disant jeunesse ou un caractère de « guerilla urbaine » tandis que ceux appartenant à la seconde ne la voyaient que comme un moment de la rébellion, comme une opportunité pour attaquer l'une des principales institutions du contrôle capitaliste et en tant que lieu de rassemblement et de réunion des étudiants des grandes écoles, des étudiants d'université, des chômeurs, des ouvriers salariés et des immigrés, ce qui en fait une plus grande communauté de lutte contre le malaise général. En fait, la tendance syndicaliste-ouvriériste a essayé d'utiliser l'occupation essentiellement comme instrument indépendant au service de l’influence du syndicalisme évoquée ci-dessus et du syndicalisme de base en général." La 'tendance syndicaliste' aurait pu échouer dans sa tentative pour utiliser l'occupation dans ce cadre particulier, mais les idées du syndicalisme de base restent parmi les plus pernicieuses auxquelles les ouvriers sont confrontés, non seulement maintenant, mais également dans les luttes à venir.
De même, TPTG a compris que d'autres idées étaient dangereusement illusoires pour les ouvriers. « En mettant sur un même plan la sous-traitance ou la précarité en général avec `l’esclavage', la majorité de ce mouvement de solidarité, principalement composé d’activistes de syndicats gauchistes, essaye de mettre sur un même plan certaines luttes contre la précarité - une des formes principales de la restructuration capitaliste dans ce moment historique - avec des revendications politiques générales au contenu social-démocrate concernant l'Etat en tant qu'employeur ‘digne de confiance’ et préférable aux sous-traitants privés et donc mettant de côté la question de l'abolition du travail salarié »
Parfois il y a un certain triomphalisme dans ce que dit TPTG. Mais quand le texte se termine sur « les craintes des patrons du monde entier par rapport à la rébellion de Décembre comme prélude à une explosion prolétarienne généralisée dans le contexte de la crise globale de reproduction", il pose ce qui est en jeu dans la situation actuelle. Les luttes d'aujourd'hui ne sont pas en elles-mêmes une menace pour le pouvoir capitaliste, mais tout mouvement qui met l'accent sur la solidarité et l’auto-organisation pour l’extension du mouvement vers une lutte généralisée, montre qu’il existe un potentiel bien présent pour la perspective des luttes futures.
Car, 28 septembre
Géographique:
- Grèce [180]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
A propos d’un article de la CNT-AIT : Que signifie la crise économique du capitalisme ?
- 3001 lectures
Dans Anarchosyndicalisme n° 110 (janvier-février 2009), la revue de la Confédération Nationale du Travail - Association Internationale des Travailleurs (CNT-AIT), un article traite une question d'une très grande importance pour le combat de la classe ouvrière actuellement : ‘’la crise de 2008 : systémique sans aucun doute mais conjoncturelle ou structurelle ?’’1 De par sa volonté de faire la clarté sur cette question essentielle qui taraude toutes les consciences actuellement, et de l'orientation qu'il se donne de comprendre la situation du capitalisme qui détermine la condition du prolétariat pour savoir quel sens donner à sa lutte, cet article répond à un besoin vital. Ce sont les questions brûlantes dont doivent débattre tous ceux qui veulent oeuvrer à l'émancipation du prolétariat.
En affirmant, à juste raison, la nature ‘’systémique’’ de la crise économique, c’est-à-dire que la cause de la crise économique réside dans le système capitaliste lui-même et non dans de prétendus “abus’’, dans “l'immoralité de spéculateurs’’ et de “patrons-voyous’’ ou dans les “excès du néolibéralisme’’, cet article se distingue nettement du discours de la gauche et de l'extrême gauche (anarchistes, trotskistes ou NPA) et de leurs recettes à la sauce ‘’capitaliste d'Etat’’. Il dénonce la mystification que tous, à divers degrés, véhiculent au sein du prolétariat, de l'Etat comme recours régulateur du système capitaliste et comme soi-disant garant, “au-dessus des classes’’, des conditions de vie et de travail pour les ouvriers. ‘’La critique social-démocrate du libéralisme pense que ce n'est pas l'économie capitaliste adossée au marché qui est mauvaise, c'est son côté excessif, trop brutal : l'Etat et le politique doivent cadrer l'économie et pacifier les antagonismes sociaux, afin d'obtenir une société stable. Il ne faut pas toucher à la structure même du système mais agir sur les effets conjoncturels. (...) La gauche et l'extrême gauche chantent le retour à l'Etat et à ses lois gouvernementales, sa fiscalité, ses douanes, ses nationalisations, son protectionnisme et ses relances économiques (tout en faisant abstraction de sa nature autoritaire : armée, police, prisons...) Le futur nouveau parti anticapitaliste ne propose même pas un nouveau mode économique, ni la suppression de la plus value, mais, comme n'importe quel réformisme le plus plat, de réduire le taux d'exploitation en distribuant davantage au profit des salaires. Or, qu'il y ait ou non croissance et hausse des salaires, il faudra rembourser le crédit, régler les déficits, être compétitifs sur les marchés, juguler les conflits sociaux, mater les révoltes et assumer les éventuels conflits militaires. C'est là que l'Etat intervient comme le produit des sociétés inégalitaires, la fonction de sa machinerie institutionnelle étant de la pérenniser. Refuser la critique de l'Etat, c'est renforcer sa légitimité et en faire la religion civile, c'est tenter d'empêcher les opprimés de le contester...’’
L'article donne sur la crise une série d'observations que nous partageons pleinement, notamment l'idée centrale qu'elle attise les guerres et les conflits impérialistes, le chaos généralisé, ce que nous appelons le ‘’chacun pour soi’’, où chaque Etat, petit ou grand, défend sa place sur l’arène mondiale. Comme le dit l’article : ‘’Les rapports internationaux sont soumis aux desideratas impérialistes de chaque Etat. Toute la géostratégie et politique s’élabore sur le fait que chaque Etat en tant que puissance économique, militaire, technologique… défende ou impose ses intérêts. Les USA veulent garder la première place alors que l’Europe et la Chine la convoite. La Russie espère son retour impérial de feu l’URSS. L’inde, le Brésil, la Turquie et les différents blocs (d’Amérique du Sud, d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie) veulent leur part du gâteau. (…) Les rivalités intestines des capitalistes et des Etats ont et continuent de déboucher sur des conflits sanglants.’’
Il est assez surprenant en revanche qu’il ne s'attache pas à la signification du chômage de masse. Ce phénomène constitue pourtant un concentré de la crise capitaliste. Partout dans le monde, la destruction des emplois marginalise un nombre toujours plus grand de travailleurs. Cette incapacité d’intégrer dans le procès de production leur force de travail, la ‘’marchandise’’ la plus importante pour le capital dont la consommation constitue à la fois la source de la production des richesses et de son profit, est hautement significative de l'impasse et de la faillite du système capitaliste. C'est une illustration majeure de la nature de la crise capitaliste, une expression de la surproduction : il y a trop de bras à vendre sur le marché du travail ! La marchandise force de travail est en surabondance, parce que le capitalisme ne parvient plus à l'exploiter de façon profitable !
La spirale de la descente aux enfers du capitalisme en crise
L’article pose une question fondamentale : ‘’S’agit-il de la crise finale du capitalisme maintes fois annoncée par les tenants du marxisme ? Ou bien est ce la nième crise cyclique nécessaire aux ajustements du capitalisme ?’’ Ses auteurs ont raison de ne pas vouloir donner une réponse précipitée ou superficielle. Mais si l'article s'abstient de trancher nettement cette question, c'est aussi, à notre avis, parce qu'il ne réussit pas à aller tout à fait au fond de la nature de la crise du capitalisme et à la caractériser. L'article s'en tient plus à une description qu'à une véritable explication de ses racines.
Pour répondre à la question posée, nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en garde contre deux écueils auxquels ont été régulièrement confrontés les révolutionnaires :
-
Le premier, c’est de penser que la ‘’crise finale du capitalisme’’, prendrait la forme d'un effondrement brutal sous ses propres contradictions. Cette conception, formulée par une partie de la Gauche Communiste allemande dans les années 20, conduit de facto à minimiser les capacités réactives de ce système, même moribond, pour continuer à se maintenir coûte que coûte, sur des bases de plus en plus étroites.
-
Le second danger consiste à s’imaginer qu’il n’y a "rien de neuf sous le soleil", à sous-estimer la profondeur de la crise en épousant l'angle de vue de l'idéologie bourgeoise selon lequel après toute récession ‘’ça repart forcément’’, parce que le système serait constamment soumis à des cycles, à des "ajustements salvateurs" et autres "purges nécessaires".
Néanmoins, nous soutenons la méthode employée par les camarades consistant à s'appuyer sur des fondements théoriques et à examiner la question de la crise dans sa dimension historique. Ainsi, l'article fait-il référence à l'importance de la plus-value : ‘’Les aléas de l'économie capitaliste (croissance, décroissance, récession, expansion, choix de production, taux d'exploitation...) ne sont que les contradictions liées à la plus-value et ses déclinaisons.’’ Outre que celle-ci mériterait une définition plus précise, l'article pointe la question de fond. Mais, tout en étant dans la bonne direction, il ne parvient pas, selon nous, à prendre en compte le caractère central de la plus-value dans l'explication de la crise du capitalisme, ni à l'articuler avec les formes concrètes prises par le développement des crises dans l'histoire. Nous ne pouvons qu'encourager les camarades à creuser cette importante intuition2. Le capitalisme produit plus de marchandises que ne peut absorber le seul marché formé par les ouvriers et les bourgeois. Il doit trouver une part de ses acheteurs solvables en dehors de ceux qui se trouvent soumis au rapport travail-capital pour réaliser son profit. C'est pourquoi, dans toute l'histoire du capitalisme, les crises économiques se manifestent comme des crises de surproduction et trouvent, au fond, toujours leur origine dans la sous-consommation des masses à laquelle est contrainte la classe ouvrière par l’exploitation du travail salarié qui diminue constamment la part de la production sociale revenant au prolétariat.
Au XIXème siècle, l’existence de larges secteurs de production précapitaliste (artisanale et surtout paysanne) relativement prospères, fournissait les marchés et le sol nourricier indispensables à la croissance capitaliste. Au plan mondial, le vaste marché extra-capitaliste des pays coloniaux en cours de conquête, permettait de déverser le trop plein des marchandises produites dans les pays industrialisés.
La Première Guerre mondiale ouvre brutalement la phase de déclin du capitalisme caractérisée par l'existence d'une entrave désormais permanente au développement des forces productives. Ce conflit trouve son origine dans une des contradictions fondamentales du capitalisme, le caractère nécessairement limité des marchés extra-capitalistes. Bien qu'à cette époque, il n'existait globalement pas encore une pénurie de tels marchés (la Guerre éclate au faîte de la prospérité capitaliste), se garantir l'accès à ceux-ci était néanmoins une nécessité vitale pour toutes les puissances capitalistes, dont le prix devait être payé dans la guerre pour le repartage du monde, du contrôle des colonies en particulier. En effet, il était intolérable pour l’Allemagne, à l’époque en pleine expansion économique mais dépourvue de colonies, de dépendre du bon vouloir de l’Angleterre pour pouvoir exploiter les terres de l’Empire britannique comme débouchées à sa production. C’est pourquoi cette nation ouvrira les hostilités la première. A mesure que se manifestera l'insuffisance des marchés extra-capitalistes, en regard des besoins croissants des grandes puissances industrielles d'écouler la production, les convulsions prendront la forme de crises de surproduction chroniques (de 1929 à la catastrophe actuelle) et de guerres dévastatrices, dont en particulier la Seconde Guerre mondiale.L'observation des camarades que ‘’le capitalisme est en crise permanente et que les épisodes aigus s’accélèrent : 1929 (crash de Wall Street aux Etats-Unis), 1987 (caisses d’épargnes aux Etats-Unis), 1987 (krach boursier mondial), 1989 (crise japonaise), 1990 (crise immobilière européenne)…’’ pointe justement une des réalités de la décadence du capitalisme.
Et si le système a évité un effondrement fracassant depuis les débuts de son déclin, c’est que les Etats ont eu recours de plus en plus massivement au crédit pour créer un marché artificiel, offrant plus ou moins un débouché à une surproduction qui ne cessait d'augmenter. Ce lissage de la crise dans une spirale descendante a permis à la bourgeoisie de nier l’existence même de la crise et de la faillite de son système, mais au prix de l’accumulation de contradictions de plus en plus dangereuses.
Mais aujourd’hui, nous assistons à un changement de rythme, à une accélération de la crise. La chute actuelle est bien plus brutale et plus abrupte que les précédentes. La fragilisation extrême de l'économie mondiale témoigne de l'affaiblissement de la capacité de l'État capitaliste à "accompagner" la crise et de l’usure des palliatifs basés sur l'endettement utilisés à grande échelle par la bourgeoisie depuis 1929 et surtout après 1945.
C’est cela même que souligne l'article : ‘’Le recours aux prêts, emprunts, capitalisations et déficits pour soutenir le capitalisme fut judicieux en 1945 mais ne l’est plus actuellement. Le taux d’endettement est tel qu’il pénalise par son coût la rentabilité du capital et les possibilités budgétaires des états (…) pour éviter la faillite du crédit, on recrée du crédit.’’3
La réalité confirme que le déclin du capitalisme prend la forme d'un l’enfoncement dans une spirale catastrophique d'un système qui ne se maintient que sur des bases toujours plus étroites en générant mille fléaux aux conséquences toujours plus destructrices sur le prolétariat et l'humanité : prolifération des guerres impérialistes, baisse des salaires, accroissement du chômage massif et de la précarité, redoublement de la misère, émeutes de la faim...
L'alternative de la lutte de classe du prolétariat
Nous partageons complètement la perspective que ‘’tant que le capitalisme ne sera pas supprimé, crises, exploitations, guerres, misères et pollutions prospéreront’’ tout comme l'affirmation de la nécessité, comme unique alternative au capitalisme, de l'instauration d'une nouvelle société ‘’dont les bases seraient une économie au service de l'humain et non l'inverse, sa planification suivant l'intérêt collectif’’, la société communiste.
De même, tout à fait à propos, l'article fait la prévision que ‘’les conflits sociaux qui rendent instables les jeux politiques et économiques des pays ont de grandes chances de s’amplifier, voir d’être déstabilisateurs par le manque de réponses positives du système.’’ L'aggravation vertigineuse de la crise ne peut que former le terreau pour le développement de la lutte de classe.
A propos de la nécessité de développer la lutte, l'article avance la ‘’résistance populaire autonome’’. La formulation nous semble obscure. Que faut-il entendre par-là ? La résistance des différentes couches de la société victimes de la crise, y compris les artisans, les pêcheurs ou autres ? Ou alors, s’agit-il de l’autonomie de la classe ouvrière par rapport aux autres couches de la société ? Il est difficile de se faire une idée des forces motrices de la lutte. De notre point de vue, seul le prolétariat est à même d’offrir une réelle perspective dans la lutte contre le capitalisme. Pourquoi?
De ce que nous avons indiqué plus haut à propos des rapports sociaux capitalistes à l'origine, in fine, de la crise de surproduction et compte tenu de la place du prolétariat au sein de ces rapports sociaux comme classe créatrice de toutes les richesses sociales mais subissant en même temps tous les affres de l'exploitation, nous pouvons affirmer que la seule solution à la crise de surproduction, c'est l'abolition de ces rapports de production capitalistes basés sur la marchandise et l'échange - et donc du salariat. Et que l'agent de cette gigantesque transformation ne peut être autre que le prolétariat, c’est-à-dire la classe de la société capitaliste qui subit spécifiquement l'exploitation salariée et qui seule peut trouver intérêt à l'abolition du salariat et du règne de la marchandise qui l'asservit. Le seul véritable dépassement du capitalisme, à bout de souffle, ne peut s’effectuer que par la révolution du prolétariat. En s'émancipant, il libère également toutes les autres couches qui subissent l'exploitation.
Dans cette perspective, la formulation sur les objectifs immédiats des luttes nous paraît recéler un certain danger : ‘’Dans l’immédiat, les objectifs de la résistance populaire autonome seraient de reprendre l’argent de la spoliation des travailleurs (gros salaires, traders, banquiers …), de saisir les biens des spéculateurs. Faire payer les riches, c’est un moyen de garantir à tous les besoins fondamentaux (santé, éducation, logement, nourriture, transport…). Mais soyons lucide : si cela peut soulager à court terme, le système reprendra ce qu’il a concédé et ce sera le retour à l’état antérieur.’’ Reprendre le mot d’ordre ‘’faire payer les riches’’ (qui fait partie de l'attirail idéologique des gauchistes, comme LO, le NPA...), même avec des restrictions critiques, comporte le danger de se retrouver pris au piège des gauchistes qui cherchent à affaiblir la lutte des classes en la détournant de son but. En répandant l'idée qu’il y aurait un simple problème de "répartition" ou de "distribution des richesses" dans la société, les gauchistes cherchent à enfermer le prolétariat dans l'illusion qu'il existerait une issue au sein du système capitaliste. C'est pourquoi le mot d'ordre ‘’faire payer les riches’’ ne peut en rien constituer un mot d’ordre valable pour le prolétariat.
La perspective lointaine du communisme, le constat d'une classe qui a du mal à se politiser et à développer son combat révolutionnaire ne doivent pas conduire à mépriser les luttes revendicatives immédiates. Si la plupart des luttes sont loin d'être révolutionnaires, nous ne devons pas perdre de vue qu'historiquement toutes les luttes révolutionnaires ont commencé par des luttes revendicatives. Le communisme n'est pas seulement le but, mais également le mouvement qui y mène, le ‘’mouvement d'abolition de l'ordre existant des choses’’ (Manifeste Communiste). Chaque lutte ouvrière représente déjà de facto et par elle-même une contestation de l’ordre établi dans la société et porte en elle le spectre de la révolution. C’est la résistance à la dégradation de ses conditions d’existence qui pousse en grande partie la classe ouvrière à développer son combat. C'est dans cette lutte d'abord contre les effets de l'exploitation que la classe prolétarienne accède à la conscience de la nécessité de la lutte contre les causes de l'exploitation : les rapports sociaux capitalistes. La révolution communiste et la lutte pour l'abolition de l'exploitation forment à notre époque de décadence du capitalisme la seule manière de défendre rationnellement les revendications prolétariennes et constituent le dénouement final de la lutte revendicative du prolétariat.
Parce que la classe ouvrière est de plus en plus attaquée aujourd’hui, elle développe son combat et sa conscience. Le développement actuel de la lutte des classes au plan mondial ouvre une porte sur le futur : celui d’une confrontation généralisée entre les classes antagoniques de la société pouvant déboucher sur une nouvelle vague révolutionnaire. De l’issue de ce conflit dépendra le sort de l’humanité.
La gravité des enjeux exige que tous ceux qui se revendiquent vraiment de la révolution sociale débattent et clarifient les questions que pose cette perspective.
WH/Scott (05/07/09)
1 Les citations proviennent toutes de cet article.
2 Cette question possède une très importante portée. D'une part, parce que la plus value est au cœur des rapports sociaux capitalistes, de l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie (elle correspond à la quantité de valeur produite par le prolétariat et appropriée par le capital après défalcation du salaire) En même temps, la production de la plus value (contenue et enfermée dans les marchandises produites) et sa réalisation (par la vente des marchandises sur le marché pour que le capital empoche la plus value sous sa forme argent) se trouvent au cœur de l'explication de toute crise capitaliste. Pour poursuivre la réflexion, nous encourageons les camarades à examiner en particulier les apports des travaux de Rosa Luxembourg sur cette question.
3 Les hypothèses de la bourgeoisie faisant état « que le PIB du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine pourrait dépasser en 2040 le PIB du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie, des USA, du Japon et France » sont fantaisistes. La possible réorganisation de la hiérarchie entre les puissances impérialistes pouvant résulter des effets de la crise actuelle ne doit aucunement donner l'illusion que le système capitaliste va trouver un second souffle grâce à des zones encore ‘jeunes et dynamiques’, opposées à d'anciennes zones de développement devenues ‘séniles’. Déjà, les effets de la crise se font brutalement sentir dans des pays comme la Chine et l’Inde, pourtant promis à un avenir radieux ! Il est plus raisonnable, avec la réalité, de penser que les ‘pays émergents’, déjà plombés, ne seront jamais les nouvelles ‘locomotives’ du capitalisme dont rêve la classe dominante. Aucune partie du monde n’est épargnée et c’est comme un tout que le système capitaliste sombre dans la faillite.
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Courants politiques:
Antilles - La lutte massive nous montre le chemin : solidarité avec les travailleurs aux Antilles !
- 3351 lectures
La grève qui se déroule depuis le 20 janvier en Guadeloupe, a fait tâche d’huile en Martinique à partir du 5 février et menace de s’étendre prochainement à la Réunion et à la Guyane, les autres DOM (départements d’Outre-mer). Elle n’a rien d’un conflit identitaire ou exotique. C’est bien d’une véritable, d’une authentique expression de la remontée internationale de la lutte de classe qu’il s’agit, qui témoigne d’une montée générale de la colère et de la combativité des ouvriers face à la vie chère et à la dégradation des conditions de vie et des salaires.
Aux Antilles, les prix sont en moyenne de 35 à 50% plus chers qu’en métropole (les carottes de 164%, les endives de 135%, les poireaux de 107%, la viande ou le poulet de plus de 50% et les pommes par exemple sont aussi à un tarif double), alors que le chômage touche officiellement plus de 24% de la population- et 56% parmi les jeunes de moins de 25 ans - (ce territoire compte aussi plus de 52 000 RMIstes). Malgré le poids du caractère nationaliste de l’encadrement syndical (autonomiste ou indépendantiste), les 146 revendications mises en avant par les grévistes sont toutes liées à la question des attaques du niveau de vie : baisse immédiate du prix des carburants, baisse des prix de tous les produits de première nécessité, des impôts et taxes, gel des loyers, augmentation des salaires de 200 euros net pour tous les travailleurs, ainsi que pour les pensions de retraites et les minima sociaux, baisse du prix de l’eau et des transports publics, titularisation des contrats pour tous les emplois précaires aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La popularité de ces revendications comme l’obstination de la lutte à faire reculer le gouvernement témoignent aussi de l’ampleur de la mobilisation et de la combativité des ouvriers, au même titre que les manifestations du 29 janvier dernier en France, que les récentes émeutes de la jeunesse prolétarisée en Grèce, que les manifestations en Islande, que les récentes grèves ouvrières en Grande-Bretagne (voir notre article sur notre site Web).
Malgré la propagande diffusée par les médias mettant en avant le folklore local animé par les associations culturelles (manifestations et chants rythmés par le tambour traditionnel), et surtout avec leur battage autour de la revendication de la « créolité » face aux « békés » blancs et une tonalité nationaliste « anti-coloniale », ces caractéristiques traditionnelles du mouvement aux Antilles ont été constamment reléguées au second plan. Le collectif LKP (Lyannaj kont profitasyon, Union contre le surprofit) regroupant 49 organisations syndicales, politiques, culturelles et associatives et son charismatique leader Elie Domota ont cherché à canaliser une lutte remettant clairement en cause les conditions d’exploitation des ouvriers.
Nous devons saluer le caractère massif, unitaire et solidaire de cette grève qui montre la voie dans laquelle l'ensemble de la classe ouvrière doit aujourd'hui s'engager face à la dégradation générale de ses conditions de vie.
Depuis le début de la grève, les bus ne circulent plus, les établissements scolaires, l’université, les hypermarchés, des administrations et la plupart des entreprises et commerces sont fermés. Le port, le centre commercial et la zone industrielle de Pointe-à-Pitre sont désertés. Là encore, face à la pénurie alimentaire ou d’essence, une véritable solidarité de classe s’y est exprimée, s’exerçant à tous les niveaux entre parents, amis ou voisins. Les mouvements de protestation contre la vie chère avaient commencé dès les 16 et 17 décembre 2008 avec des manifestations dans les rues de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre alors que le préfet avait refusé de recevoir une délégation de grévistes jugée trop nombreuse et interdit leur accès à la préfecture par le déploiement de nombreuses forces de police.
En Guadeloupe, la manifestation du 30 janvier à Pointe-à-Pitre partie à quelques milliers de personnes a rapidement rallié 65 000 manifestants en atteignant le centre ville ; c’était la plus grande manifestation jamais réalisée dans l’archipel (en rapport à la population de l’île). Une telle mobilisation équivaut à près de 10 millions de personnes sur les pavés de Paris.
Un millier de lycéens et d’étudiants se sont joints aux ouvriers en grève. Le palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre est devenu un lieu de ralliement, d’expression, de débats où de nombreux travailleurs et en particulier des ouvrières ont pu prendre la parole pour parler de leur colère ou de leur désarroi face à leurs conditions d’existence. Dans une des premières séances de négociations, le 26 janvier, des journalistes et techniciens grévistes de Radio-France Outre-mer (RFO) avaient placé des caméras à l'intérieur de la salle de réunion et des hauts-parleurs à l'extérieur du bâtiment pour permettre à tout le monde de connaître et de suivre en direct toutes les négociations.
Il y a également eu plus de 20 000 manifestants dans les rues de Fort-de-France le 9 février autour des mêmes revendications et des mêmes mots d’ordre qu’en Guadeloupe.
La venue d’Yves Jégo, secrétaire d'État à l’outre-mer sur l’île a permis de faire redémarrer la plupart des 115 stations de carburant (dont les petits patrons étaient également en grève) en promettant la limitation de création de nouvelles stations-service automatiques par les grands groupes pétroliers. Le sous-ministre a multiplié d’autres promesses pour tenter de désamorcer le conflit (baisse des taxes sur les produits pétroliers, sur les produits laitiers, réduction des taux de la taxe d’habitation et la taxe foncière), s’engageant même à favoriser la négociation auprès du patronat d’exonérations diverses équivalant à 130 euros par salarié. Alors que la négociation sur les 200 euros d’augmentation salariale mensuelle était elle-même en cours entre patrons et syndicats, sous l’égide du préfet, Jégo se faisait rappeler à l’ordre par le premier ministre Fillon et rappeler tout court à Paris. Son départ précipité, ses déclarations contradictoires (il a ensuite affirmé qu’il n’avait jamais rien promis en matière d’augmentation salariale : « C’est au patronat et aux syndicats seuls de négocier en ce domaine »), son retour-éclair dans l’île, cette fois quasiment dessaisi du dossier, flanqué de deux « médiateurs » pour l’encadrer, sa nouvelle dérobade, n’ont fait qu’attiser de plus belle la colère de la population, choquée par un tel mépris et par de tels « mensonges ».
Sous la pression de la colère des grévistes excédés et de la population en général, les syndicats et le LKP ont été contraints de radicaliser leurs positions. L’appel était lancé à des AG dans toutes les entreprises, les « délégations marchantes » d’une entreprise à l’autre se sont multipliées, le renforcement des piquets de grève était décidé. La proposition (soutenue par le PS local) pour désamorcer le conflit du versement d’une prime mensuelle de 100 euros pendant 3 mois par le conseil régional a été refusée par les grévistes.
Le 14 février, une manifestation rassemblant plus de 10 000 personnes avait lieu à Moule en commémoration des événements de 1952 où les CRS avaient tiré sur les manifestants, tuant 4 ouvriers travaillant dans la canne à sucre et blessant 14 autres, après une grève qui avait duré 3 mois et demi. Ce lieu abrite encore l’usine de canne à sucre Gardel qui, à proximité d’une centrale thermique, fait vivre encore aujourd’hui plus de 9000 personnes. En mai 1967, une répression encore plus sanglante d’une manifestation d’ouvriers du bâtiment et des travaux publics avait fait plus d’une centaine de morts à Pointe-à-Pitre.
Pendant des semaines, les innombrables manœuvres et les ficelles utilisées pour pourrir et diviser la grève et désamorcer le mouvement, en le dévoyant sur un terrain purement nationaliste, n’ont pas abouti. Le 16 février, alors que le LKP faisait dresser à nouveau des barrages sur les routes pour « dénoncer le blocage des négociations », le gouvernement français haussait le ton, déclarant « intolérable la poursuite de la situation » et la police a commencé à charger les manifestants (alors que jusque là, il n’y avait pas eu le moindre heurt), blessant deux d’entre eux et procédant à une cinquantaine d’arrestations même si tous étaient relâchés 3 heures plus tard.
Aux Antilles, comme en métropole et comme ailleurs, a commencé à souffler cette « tempête sociale » qui effraie tant la bourgeoisie. Partout, à travers la dure expérience de sa confrontation à l’aggravation de la crise et de la faillite du capitalisme, malgré tous les pièges et les obstacles que lui dressent ses ennemis irréductibles, la classe ouvrière est en train de se réapproprier son identité de classe et de s’éveiller à la lente prise de conscience de la force que représente l’unité et la solidarité dans ses rangs. Elle se prépare à entrer dans une période historique où rien ne peut plus être comme avant, « où ceux d’en haut ne peuvent plus et ceux d’en bas ne veulent plus », comme l’affirmait déjà Lénine il y a près d’un siècle.
W. (17 février)
Géographique:
- France [45]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Guadeloupe [181]
- Martinique [182]
- LKP [183]
- Yves Jego [184]
Commémoration du débarquement : derrière les discours de paix, la barbarie capitaliste
- 4322 lectures
Même si cette année la commémoration du 6 juin n’a pas connu l’ampleur hystérique de celle de l’anniversaire du cinquantenaire du Débarquement, la cérémonie du mois dernier s’est déroulée avec une relative publicité encensant le grand invité Obama. C’est dans le sillage de cette prétendue « nouvelle Amérique » qu’ont été, une nouvelle fois encore, vantés les mérites de la « démocratie » et de la « paix ».
A Colleville-sur-Mer, le nouvel hôte de la Maison Blanche a vénéré comme il se doit la « bravoure » des soldats sur le sol de Normandie, soulignant : « On ne pouvait savoir alors que tant de progrès qui façonneraient le XXème siècle sur les deux rives de l'Atlantique découleraient de cette bataille »1. Sarkozy, vantant « l’héroïsme », « l’honneur » et la « gloire » des vainqueurs, celle de se faire trouer la peau à 20 ans (même si « il est bien trop tôt pour mourir »), vantait lui aussi « l’Amérique qui se bat pour la démocratie et les droits de l’homme », ponctuant son discours par un « nous avons fait la paix et nous avons fait l’Europe pour que la paix dure toujours. » Toutes ces paroles ne sont que mensonges ! Car ces faiseurs de cérémonies, qui s’extasient devant les défilés d’engins de mort, vantant la paix dans de beaux discours émouvants, ne sont en réalité que les mêmes politiciens qui font la course aux armements, déclarent la guerre et finissent toujours par programmer des massacres qu’ils mettent à exécution. Ce qu’oublient de dire ces beaux parleurs de l’ancien bloc militaire allié, c’est qu’à peine vaincue, l’Allemagne était déjà convoitée par ces mêmes vautours, déchirés par des intérêts impérialistes divergents. L’après-Yalta plongeait alors le monde dans la terreur de ce qui allait devenir la Guerre froide, avec son cortège de conflits localisés, de massacres coloniaux, sans compter la menace thermonucléaire permanente. Seul le fait que la classe ouvrière n’ait pu être de nouveau embrigadée dans une troisième guerre mondiale par ces charognards de la démocratie, nous vaut le fait que l’Europe et le reste du monde ne soient pas encore complètement un champ de ruines fumantes jonchées de cadavres ! Après la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS, libérant les forces centrifuges contenues par le corset de fer des blocs militaires rivaux, éclatait la première guerre du Golfe, au nom de la « démocratie », contre le « boucher de Bagdad » ! Une guerre dite « chirurgicale » faisant au bas mot 500 000 morts ! Puis ce fut la seconde guerre du Golfe, au nom d’une mensongère menace par des « armes de destructions massives », dont l’objet barbare était en réalité de priver les puissances européennes rivales d’un accès au Proche-Orient et aux matières premières stratégiques comme le pétrole, afin de les isoler du reste du globe. En Europe même, épicentre des tensions, l’horreur s’était rapidement invitée en ex-Yougoslavie dès 1992, avec sa guerre et ses charniers, impliquant les mêmes grandes puissances démocratiques rivales par nations interposées. A l’initiative de l’Allemagne d’ouvrir un accès à la côte Dalmate en soutenant la Croatie, répondait l’appui de la France à la Serbie pour faire barrage à cette entreprise, le tout cerné par le gendarme américain positionné centralement en terre bosniaque pour défendre ses intérêts sordides.
Ce sont ces mêmes rivalités qui se poursuivent toujours aujourd’hui et s’expriment ailleurs sur tous les points chauds de la planète, par puissances ou cliques rivales interposées, notamment en Afrique et au Proche-Orient, mais aussi en Asie. La publicité autour du prétendu « homme de paix » que serait le nouveau président Obama n’est que de la poudre aux yeux. Derrière le masque des beaux discours éduqués et son physique de gentleman, il y a les mêmes pratiques barbares de la bourgeoisie : il a conservé les tribunaux militaires, rationalisé ses forces armées, poursuivi la croisade guerrière de l’Amérique en repositionnant ses forces en Afghanistan. Tous ces prétendus « hommes de paix », au moment même de leur discours en Normandie, étaient positionnés ailleurs et armés jusqu’aux dents sur de multiples terrains d’opérations militaires ! Comme par le passé, les discours de paix d’aujourd’hui ne sont que les mêmes mensonges qui préparent d’autres crimes à venir.
La Libération : un épisode de la barbarie impérialiste
C’est pourquoi la « gloire » du débarquement ne doit pas occulter que les alliés ont pris une large part aux massacres. Des massacres qu’ils ont su longtemps dissimuler, d'une part en exhibant les horreurs du camp adverse et d'autre part en mystifiant le « Jour le plus long », le "D-Day", par des images aseptisées et une plastique cinématographique s’imposant comme l’antithèse des camps de la mort. Dans la réalité, des jeunes ont été tués, des civils bombardés et massacrés en masse. Cette « grande victoire » des Alliés préparait ainsi ce qu’on a appelé la « Libération » et son hystérie nationaliste, son atmosphère de pogrom haineusement exhalée par toutes les composantes de la bourgeoisie, jusqu’au journal L’Humanité qui osait titrer sa Une : « A chacun son boche ! » Cette même atmosphère glorieuse de carnage s’était partout prolongée quelques mois après le débarquement par une barbarie revancharde, au nom de « l’efficacité militaire » : « A partir de l’automne 1944 (…) avec une technique parfaitement rodée, le Bomber command2 (…) entreprend l’attaque et la destruction systématique de villes moyennes ou même de petites agglomérations (allemandes NDLR) sans le moindre intérêt militaire ou économique. (…) Cette volonté de destruction systématique qui prend des allures de génocide se poursuit jusqu’en avril 1945(…) »3. A ces bombardements massifs des alliés s’ajoutent « les raids répétés de l’aviation tactique, bimoteurs et chasseurs-bombardiers. Ces raids visent les trains, les routes, des villages, des fermes isolées, voir des paysans dans leurs champs. Les allemands ne pratiquent plus les travaux agricoles que le matin à l’aube, ou le soir au crépuscule. Des mitraillages interviennent à la sortie des écoles (…). Lors du bombardement de Dresde, les chasseurs alliés s’en prennent aux ambulances et au voitures de pompiers ». Les partenaires soviétiques du camp allié ne sont pas en reste, puisque à cette même période, leurs soldats s’adonnent impunément à des « viols, pillages, incendies de villages. (…) Le soldat soviétique devient l’instrument d’une volonté froide, délibérée, d’extermination. Des colonnes de réfugiés sont écrasées sous les chenilles des chars, mitraillées par l’aviation. La population est massacrée avec des raffinements de cruauté (Il s’agit évidemment de populations allemandes des provinces de l’est NDLR). Des femmes nues sont crucifiées sur les portes de granges. Des enfants sont décapités où ont la tête écrasée a coup de crosse (…) le nombre de victimes peut être évalué à 3 ou 3,5 millions. Comme par hasard, les massacres systématiques cessent dans les régions de l’Allemagne destinées à constituer la zone d’occupation soviétique. » Le même auteur ajoute que « dès le départ, ces crimes font l’objet d’une volonté d’oubli des occidentaux (…) le souvenir se cristallise sur le système concentrationnaire et le génocide, il est vrai effroyable ».
En réalité, ce n’est pas tant un « oubli » qu’une volonté délibérée des alliés de masquer leurs propres crimes à des fins de propagande démocratique. Voilà ce que cachent les retrouvailles et les commémorations, les beaux sourires d’un Obama et les trémolos théâtralisés d’un Sarkozy ! Comme le soulignait Rosa Luxembourg il y a presque un siècle : « Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment. »4
WH
1 Extraits des discours de Obama et Sarkozy à Colleville sur Mer.
2 Centre de commandement des bombardements alliés sous la direction politique de Churchill et d’officiers supérieurs (dont le commandant Harris a été un des plus zélés fanatiques).
3 Cette citation et les suivantes sont extraites de Une guerre totale, coll. Pluriel ( P612 à 614), PH. Masson.
4 Rosa Luxembourg, La crise de la social-démocratie, Spartacus, p.28
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [185]
Compte-rendu des journées de discussion de Lille (I)
- 2463 lectures
En octobre, le CCI a organisé à proximité de Lille un week-end de discussions destiné à ses contacts et lecteurs. Ces réunions se distinguent de nos traditionnelles réunions publiques et permanences par trois éléments essentiels. D'abord, il ne s'agit pas en soi de réunions du CCI mais de réunions organisées par le CCI afin que les participants développent des discussions. C'est ainsi que souvent, par exemple, et ce fut le cas ici, les discussions sont introduites par des participants qui sont volontaires pour le faire. De même, les sujets abordés sont proposés par les participants potentiels en amont de la rencontre.
Ensuite, ces réunions se distinguent par le temps qu'elles laissent à la discussion. En général, deux sujets sont abordés chacun sur une demi-journée, et le temps est laissé pour prolonger les discussions dans les moments conviviaux qui suivent.
Car, et c'est là leur troisième aspect singulier, le but de ces rencontres est aussi de rapprocher les personnes qui partagent les même préoccupations et les mêmes questionnements, à défaut de partager les mêmes positions. C'est pourquoi nous organisons aussi des moments de rencontre plus informels, notamment des repas qui prolongent et offrent un cadre différent à la discussion.
A Lille, nous avions choisi de répartir les deux discussions sur un week-end, le samedi après-midi et le dimanche matin, afin que, grâce à la restauration et l'hébergement sur place, le maximum de temps soit laissé aux échanges entre participants. Nous souhaitions également permettre à des personnes plus éloignées géographiquement de pouvoir nous rejoindre avec le moins de désagrément possible.
C'est finalement une trentaine de participants qui participèrent à la rencontre, venant de toute la France (Lille bien sûr, Paris, Rouen, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon), de Belgique et de Hollande.
Nous reviendrons ultérieurement sur la discussion du samedi après-midi à Lille, consacrée à Darwin, au darwinisme, aux instincts sociaux et à la nature humaine. Cette discussion très riche s'est prolongée jusque tard dans la soirée et continuait même au petit-déjeuner du dimanche matin !
Nous voulons dans le cadre de cet article, nous pencher sur la discussion du dimanche matin consacrée à l'écologie et à la capacité du capitalisme à éviter les catastrophes liées au réchauffement climatique, à la pollution, etc.
L'introduction de la discussion
Cette session a été introduite par un sympathisant du CCI. Son exposé, très clair, a posé d'emblée les questions essentielles auxquelles la discussion allait devoir tenter d'apporter des réponses. D'abord, les faits parlent d'eux-mêmes : « Les niveaux atmosphériques en dioxyde de carbone (CO2) et en méthane (CH4) ont atteint le niveau le plus élevé depuis 650 000 ans, ce qui implique que la température moyenne sur terre devrait augmenter les cent prochaines années entre 1,1 et 6,4 degrés Celsius avec toutes les catastrophes qui en découleront. Pour le moment, la pire des sécheresses de ces 10 dernières années sévit dans sept pays de l’Afrique de l’Est, tels l’Ethiopie, le Kenya et la Somalie. Des dizaines de milliers d’animaux périssent à cause du manque d’eau. 23 millions d’êtres humains sont en danger par le fait qu’à cause de récoltes ratées répétées, ils n’ont plus de réserves de nourriture. A titre de comparaison, la sécheresse de 1984 en Ethiopie a entraîné la mort de 250 000 à 1 million de morts. Avec la hausse des températures liées aux changements climatiques, ces phénomènes devraient continuellement augmenter dans le futur. Une espèce sur six de mammifères européenne est menacée d’extinction et toutes les espèces marines pêchées pourraient s’effondrer vers 2050. La réduction du nombre des abeilles, des chauves-souris et d’autres espèces butineuses cruciales met en danger les espèces agricoles et les écosystèmes en Amérique du Nord. Ce n’est donc pas un hasard si l’année 2010 est placée sous le signe de la biodiversité, on devrait plutôt dire « bio-homogénéité » ? La pollution a également un impact direct. Ainsi, la pollution de l’air dans les villes est la cause de 2 millions de décès prématurés par an. Ensuite, il y a la misère et la guerre : 2,5 milliards d’êtres humains sur un total de près de 7 milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour et nous pouvons affirmer que, depuis la seconde guerre mondiale, il n’y a pas eu un moment sur terre sans guerre, des guerres qui ont d’ailleurs eu un impact gigantesque sur la situation écologique de la planète. »
Tous les discours, les sommets et les accords passés n'ont pas permis d'inverser la tendance. Pour cela, il faudrait au moins, selon le camarade, que tous les États se rangent derrière la même politique de « développement durable ». Est-ce possible dans le capitalisme ?
L'exposé apporte une réponse : « La conférence qui aura lieu à Copenhague devrait mener à une meilleure coopération entre les États dans leur lutte contre la décadence écologique. Mais, sont-ils capables de coopérer ? Sont-ils capables de pousser collectivement le marché mondial dans une direction durable ? Raisonnons dans le cadre des frontières du système. Imaginons que le capitalisme accumule du capital d’une manière écologiquement responsable, on serait alors confronté à un capitalisme écologiquement durable. Toutefois, pour transformer ce capitalisme en une société ‘verte’, des changements profonds s’imposent dans l’industrie, les infrastructures, l’aménagement du territoire... qui exigeront d’énormes investissements en recherche, en technologie, en forces de travail... Si de tels investissements ne sont pas rentables suffisamment à court terme, l’ensemble de l’économie ne se risquera pas à franchir le pas vers la durabilité. Sur un marché sursaturé, avec une concurrence impitoyable, la menace de la faillite plane constamment. C’est alors l’État qui doit intervenir avec des primes, des législations contraignantes, afin de pousser le marché dans un sens ‘vert’.
Une telle logique perd cependant de vue que le capitalisme est divisé en économies nationales qui se concurrencent mutuellement pour s’approprier une partie aussi grande que possible du marché mondial. Par ailleurs, l’État ne se positionne pas au-dessus du marché ‘libre’ mais est une partie intégrante du système. En conséquence, les conflits d’intérêts entre États sont permanents, tant sur le plan économique que stratégique. C’est cette concurrence qui rend l’avènement d’un monde durable impossible. Ceci est apparu clairement lorsque G. W. Bush, lors d’un discours (juin 2001), a rejeté le traité de Kyoto pour deux raisons : (1°) cela aurait un impact négatif sur l’économie américaine, avec pour conséquences le licenciement d’ouvriers et des hausses de prix pour les consommateurs ; (2°) le traité n’impose rien à la Chine et l’Inde, deux des principaux responsables du réchauffement climatique. Nous pouvons même nous demander si le traité de Kyoto a vraiment pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou si ce n’est pas plutôt une forme de guerre visant à limiter le développement économique de certains États à travers des lois et des interdictions, et à maintenir ou au contraire faire évoluer certains rapports impérialistes. »
Mais au-delà de ces aspects importants dans la compréhension de la question, le camarade estime qu'une autre question mérite d'être évoquée, en lien avec une certaine « privatisation de la nature ». Certains théoriciens bourgeois estiment en effet que la solution se trouve justement dans une meilleure intégration de l'environnement aux lois capitalistes. Il suffirait de comptabiliser les coûts indirects de la pollution (maladies des riverains, dégâts causés à la fertilité des sols, etc.) pour en faire la base du « prix de la pollution », que chaque activité polluante devrait alors payer. Les mécanismes du marché ainsi engagés permettraient de réduire l'impact négatif de la pollution sur l'homme et la nature.
Cette théorie soulève évidemment des questions : « La nature est-elle vraiment une marchandise ? La nature est-elle un marché encore à exploiter ? Et son intégration dans le marché, qui constitue en fait une privatisation, est-elle vraiment aussi inéluctable que les économistes le prétendent ? Les forêts destinées à l’industrie du bois font incontestablement déjà partie de l’économie capitaliste. La plupart de ces forêts sont caractérisées par une division et une simplification extrêmes de ce qu’une forêt était avant. Il en va de même de l’agriculture moderne, où les champs gigantesques de maïs, de riz, de canne à sucre constituent la norme. Même si des végétaux y poussent, ces monocultures sont en fait des déserts : aucune autre plante, aucun autre animal ne peut y vivre. Ces végétaux agricoles ne sont-ils pas aussi des exemples d’intégration de la nature dans le marché ? De plus, le marché discernera-t-il les bonnes priorités ? Pourra-t-il protéger une espèce d’oiseaux menacée (et très rentable) par la disparition de son habitat précisément à cause de l’extension du secteur agricole ? Les nombreuses règles et lois que l’État impose au marché soulignent combien artificielle et forcée est la mise en accord des « besoins écologiques, sociaux et économiques ». La pression sur ces nécessités et besoins est constante. Non, la privatisation constante et l’intégration de la nature dans le marché mondial n’auront selon moi aucun effet positif sur elle, mais elles la soumettront encore plus à la véritable force motrice du capitalisme : l’accumulation du capital. C’est cette recherche de profit qui a poussé le capitalisme à conquérir le monde et à exercer une pression constante sur l’écosystème. La soif de bénéfices toujours plus importants dans un monde aux ressources limitées constitue une contradiction fondamentale du capitalisme, qui s’exprime tout particulièrement dans la phase de décadence de la société. C’est aussi cette contradiction qui rend tout développement durable au sein des frontières du capitalisme impossible. »
C'est sur cette conclusion que la discussion s'est engagée. Elle fut très riche et marquée par la participation de la plupart des personnes présentes. L’ensemble des interventions a souligné un accord avec l’exposé introductif et avec les orientations dégagées.
La discussion
Il a d'abord été soulevé que la manière dont la bourgeoisie répond au problème écologique montre très bien qu’elle ne peut se soustraire aux exigences de son mode de production. En créant un « droit à polluer », elle fait immédiatement de la nature une marchandise, dont le prix est fixé sur un marché où elle peut être achetée et vendue. Cette « cotation en bourse » de la pollution s'exonère de prendre en compte que la nature n’est pas la propriété de l’homme.
De la même façon, la toute récente taxe carbone ne répond pas à la problématique de la pollution et du réchauffement climatique. Elle permet surtout de remettre de l’argent dans les caisses des États plus ou moins au bord de la banqueroute.
Ensuite, la question a été posée de savoir le degré de conscience et de sincérité de la bourgeoisie par rapport au désastre écologique. Après tout, son sort est lié à celui de l'humanité, dont la survie est mise en jeu ici. La discussion a permis de mettre en avant que globalement, la bourgeoisie se moque des dégâts causés par son économie, même si au sein de celle-ci il existe des personnes plus sensibilisées. Mais même ces personnes, réellement conscientes du danger couru et sincères dans leur volonté d'y trouver une solution, sont instrumentalisées par toutes les campagnes sur la possibilité de mettre en place un système « propre ». Leur sincérité est même dangereuse car elle donne du crédit aux solutions qu'elles proposent, qui sont évidemment totalement inefficaces.
Cependant, il faut insister sur le fait que de façon générale, il n’y a pas de prise de conscience réelle du problème écologique par la bourgeoisie, il y a plutôt beaucoup d'illusions, même les plus extrêmes : l'écologie pourrait être un nouveau marché qui, tout en sauvant la planète, sauverait aussi l'économie !
Au-delà des illusions, il y a aussi le cynisme d'une classe aveuglée, symbolisé par les rejets massifs des déchets polluants et sensibles dans la mer ou dans des zones reculées de la planète, ou son recyclage dans l'armement.
Toutefois, la bourgeoisie n'est plus totalement inconsciente quand c'est le profit qui est en jeu. Par exemple, elle a parfaitement conscience de l’épuisement de certaines de ses ressources comme le pétrole et elle se prépare à cette adaptation nécessaire, même si les solutions les plus probables sont aussi les plus polluantes (le charbon, par exemple).
Finalement, on peut comparer l’attitude de la bourgeoisie avec celle qu’elle a vis-à-vis de la crise économique : une des causes de la crise financière est l’économie de casino. La bourgeoise tente alors de « moraliser » son système et on voit concrètement que c’est impossible. C’est la même impossibilité pour la question d’une production propre.
La discussion a ensuite continué sur la question de la classe ouvrière. Un axe essentiel de la campagne idéologique sur l'écologie passe par l’individualisation du problème et la culpabilisation individuelle qui en découle en faisant croire entre autres que si tout le monde y met du sien cela ira mieux ; voire même que les comportements individuels sont essentiellement les seuls à modifier. La discussion a mis en avant que l’éthique individuelle qui est en nous fait qu’en tant qu’être humain nous n'avons pas envie de dégrader notre environnement proche : même si nous avons conscience de notre responsabilité limitée, nous n'allons pas jeter nos déchets dans la nature, par exemple. C’est en même temps pour cela que la campagne de la bourgeoisie a un impact certain.
Le catastrophisme sur les dégâts utilisé par certaines fractions de la bourgeoisie tend à rendre encore plus désemparés, voire désespérés les individus, se traduisant en fait par le renforcement de la chape de plomb qui pèse sur la classe ouvrière. Le poids de cette culpabilisation d’ailleurs est d’autant plus fort que le niveau de la lutte de classe est actuellement faible. Il y a une fonction idéologique fondamentale dans cette culpabilisation quotidienne qui joue sur le même ressort que celui de la religion pesant d’un grand poids sur les individus. Après les curés rouges, nous voyons arriver les « curés verts » !
Il apparaît de plus en plus clairement qu’on ne pourra pas se sortir de ce désastre écologique sans remettre en cause le système. Le danger de la prise de conscience de cela par la classe ouvrière fait peur à la bourgeoise, même s’il ne faut pas se faire d’illusion sur le fait que le danger écologique suffise à la prise de conscience de la classe. La question de l’écologie pose le problème à l’échelle de la planète en même temps que celui de ce qu’on produit et pourquoi. Cela amène à la question de quels sont les besoins humains planétaires et de comment ils se posent par rapport aux besoins particuliers : c’est une question que devra résoudre de toute façon le prolétariat. Le capitalisme a développé le marché mondial et c’est sur cette base que les forces productives se développeront dans le communisme. La science aujourd’hui est l’otage du capitalisme. Demain, elle devra être une aide pour dépasser l’irrationalité et les contradictions du système.
D’autre part, il faut rétablir la réalité par rapport aux écrits du marxisme sur la question du rapport avec la nature, que la contre-révolution stalinienne a obscurci. Au début de la révolution en Russie, la question était vue différemment qu’en 1923-1924. Tout développement productif était envisagé dans ses impacts avec le milieu naturel, la révolution avait changé la réflexion sur le lien entre l’homme et la nature. 90 ans de « marxisme productiviste », comme la bourgeoisie aime présenter le stalisnime, a dénaturé la conception matérialiste de ce rapport. L’homme n’est pas en dehors de la nature comme veut le faire croire le capitalisme. Les « écolos » qui font un faux procès au marxisme « productiviste » et qui veulent donner une valeur à la nature sont à l’opposé de la conception marxiste. Nous devons restaurer les idées marxistes relatives au rapport de l’homme avec la nature.
Finalement, il y a une impossibilité pour la bourgeoisie de mettre en accord les trois aspects écologiques, sociaux et économiques des besoins humains. Dès lors, elle élabore ses campagnes de façon à cacher cette impossibilité. Des exemples ont été donnés, comme le « referendum » organisé au sujet de la desserte du port d'Anvers. Le choix était laissé entre un tunnel sous la ville et les installations industrielles ou un immense viaduc au-dessus. En d'autres termes, la présence du trafic n'est pas mise en question, c'est seulement le moindre mal qu'il convient de mesurer... et de choisir.
De même, l'idéologie de la décroissance se développe. Il s'agit de faire croire que la diminution de la consommation amènerait à supprimer le problème environnemental. C'est juste oublier que cette idée est en contradiction directe avec le mode de production capitaliste !
Et le plus grand danger est bien dans ce mode de production dont une des caractéristiques, accentuée par la période, est sa totale irrationalité. Ce dernier aspect, et non un des moindres, a été illustré par différents exemples concrets qui montrent clairement en quoi cette irrationalité amène inexorablement à une aggravation du désastre écologique. L'élevage des porcs en est une illustration flagrante : les bêtes sont élevées en Asie, abattues en Europe du sud pour être vendues en Europe du Nord. Les kilomètres parcourus dans le processus de fabrication d'une marchandise jusqu'à sa vente répondent à des « logiques » industrielles qui ignorent l'impact environnemental. A l'inverse, la réponse de certains passe par une concentration extrême du processus (des tours d'élevages immenses au-dessus de l'eau dans le port d'Anvers, qui prévoient même l'utilisation des déchets pour la nourriture des poissons), mais là encore, l'objectif reste la réduction maximale des coûts, et non celle de la pollution.
Cette irrationalité est une entrave à la mise en oeuvre de solutions techniques qui existent aujourd'hui. De manière plus générale, aujourd’hui l’influence de l’homme sur la nature se caractérise par un mode de production en décomposition ce qui ne fait qu’augmenter dangereusement les dégâts de ce système sur la nature, dégâts déjà dénoncés par Marx à l’époque du développement explosif du capitalisme. Mais aujourd’hui, il y a urgence, l’avenir de l’humanité et peut-être de la vie sur terre est en jeu ! Le capitalisme a une technologie très avancée mais est un mode de production qui entrave le développement des techniques qui pourraient répondre en partie au problème.
C'est sur cette conviction largement partagée, qui pose aussi l'enjeu de la responsabilité des révolutionnaires et de tous ceux qui sont conscients de la nécessité de mettre fin au capitalisme, que s'est achevée cette session de discussion. Bien évidemment, il s'agissait d'une étape dans la réflexion qui doit maintenant continuer.
GD (18 novembre)
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Récent et en cours:
- Ecologie [186]
Derrière les discours de paix d’Obama, une stratégie impérialiste
- 2739 lectures
Le 4 juin dernier, dans la ville du Caire en Egypte, le président des Etats-Unis a tenu un discours que l’ensemble des capitales occidentales se sont empressées de qualifier d’historique. Il faut dire qu’Obama a prononcé des paroles et des analyses qui apparaissent, à première vue, comme étant en rupture complète avec la politique agressive et va-t-en guerre de l’ancien chef d’Etat américain G.W. Bush. Il a lui-même présenté sa politique internationale. Pour Obama, il faut tourner la page et mettre les erreurs de Bush et de son administration sur le compte du traumatisme du 11 septembre 2001. A l’en croire, « la guerre des civilisations », chère à l’ancienne administration américaine, c’est terminé. Dans son discours du 4 juin, Obama a fait clairement passer le message que les Etats-Unis ne sont pas l’ennemi des musulmans, mais un partenaire légitime. Il a parlé sans détour de « l’occupation » et de « l’aspiration des palestiniens à la dignité, à l’égalité des chances et à un Etat indépendant ».1
Il a présenté pratiquement les Etats- Unis comme l’ami des Palestiniens, sur lequel ceux-ci peuvent compter. Il a demandé au Hamas de reconnaître l’Etat israélien mais il n’a pas qualifié cette organisation de terroriste. Et plus remarquable encore, il a comparé le combat des Palestiniens à celui des esclaves noirs d’Amérique ou encore au combat des Noirs d’Afrique du Sud au temps de l’apartheid.
Du point de vue d’un président des Etats-Unis, de telles affirmations publiques sont tout simplement inédites. Et celles-ci viennent faire suite à la politique d’ouverture diplomatique que les Etats-Unis semblent vouloir mener à l’égard de l’Iran, pays présenté, il y a encore peu de temps, comme un danger potentiel pour la sécurité du monde.
Que de changements en si peu de temps ! Hier encore tout particulièrement agressifs, les Etats-Unis seraient-ils devenus tout à coup les chantres du dialogue et de la paix ?
Nous avons au contraire des raisons toutes particulières de nous méfier. L’expérience dramatique nous a appris à ne pas prendre au pied de la lettre les beaux discours bourgeois. En effet, l’histoire nous a démontré que lorsque le capitalisme parle de paix, c’est qu’il prépare en réalité la guerre.
La nécessaire réorientation de la politique américaine
Depuis l’effondrement du bloc russe en 1989, les Etats-Unis sont devenus la seule superpuissance de la planète. Maintenir à tout prix leur domination est l’orientation donnée à leur politique guerrière tout au long des années qui se sont écoulées depuis lors. Mais à partir de 2001, avec la guerre en Afghanistan et en Irak, une réalité s’est progressivement révélée au grand jour, celle de l’affaiblissement accéléré des Etats-Unis. L’enlisement dans les bourbiers irakiens et afghans en sont des manifestations concrètes et particulièrement tragiques. Partout dans le monde, les autres grandes puissances sont venues contester la suprématie américaine et afficher ouvertement leurs propres intérêts. Tel est le cas de la Chine en Afrique par exemple ou de l’Iran au Moyen- Orient. Chaque nation, chaque clique, chaque bourgeoisie étaient ainsi encouragées à défendre ses propres intérêts dans un désordre et un chaos croissants. La politique de l’administration Bush qui consistait à vouloir affirmer la puissance américaine, seul contre tous, n’a en rien enrayé ce phénomène d’affaiblissement. Bien au contraire, cette politique a accéléré le processus d’isolement et d’affaiblissement. Elle a poussé à la montée de la contestation et du mécontentement anti-américain, notamment dans le monde musulman, y compris de la part d’alliés tels que l’Egypte ou l’Arabie Saoudite. Cette politique du cavalier seul des Etats-Unis ne pouvait pas être poursuivie. C’est ce qu’a compris une grande partie de la bourgeoisie américaine, le Président Obama et son administration dépassant ainsi au moins momentanément le traditionnel clivage existant entre les démocrates et les républicains en la matière. Cependant, cette politique orchestrée par l‘administration Obama n’empêchera pas le développement d’un processus croissant d’isolement des Etats-Unis. L’affaiblissement américain et la montée du « chacun pour soi » sont aujourd’hui des réalités irréversibles. Un des aspects de cette réalité se retrouve dans l’impossibilité croissante des Etats-Unis à s’investir militairement et simultanément dans plusieurs guerres régionales dans lesquelles ils sont totalement enlisés. Non seulement leurs ressources militaires ne sont pas inépuisables, notamment en « moyens humains », mais encore la crise économique qui commence à ravager maintenant le monde entier, leur pose un véritable problème. Ce sont des millions de dollars qui sont engloutis chaque jour par l’armée américaine, alors que le pays s’appauvrit de manière accélérée, que le chômage explose, que la couverture santé est inexistante… Au moment où la pauvreté frappe une partie grandissante de la population, comment faire accepter sans rechigner des dépenses militaires toujours en hausse ? De plus, même en augmentant les primes et la solde, il est de plus en plus difficile de trouver des jeunes prêts à s’engager pour aller se faire trouer la peau dans des guerres qui apparaissent de plus en plus néfastes. Cette nouvelle orientation de la politique impérialiste des Etats Unis n’a donc rien à voir avec un humanisme retrouvé de la part d’Obama. Cette politique s’impose de fait comme une nécessité à la bourgeoisie américaine. Elle traduit simplement que l’Amérique doit faire des choix plus ciblés en matière d’interventions guerrières. Et leur choix s’est porté sur le développement de la guerre en Afghanistan et au Pakistan. Ceci implique par conséquent de tenter de calmer au moins momentanément le jeu en direction de l’Iran et de la Palestine. En effet, pour les Etats-Unis, tenter de maîtriser la situation en Afghanistan devient impératif s’ils veulent retrouver une réelle influence au Pakistan. Le Pakistan est une véritable plaque tournante en direction de l’Iran à l’Ouest, du Caucase au Nord et donc de la Russie, et surtout à l’Est en direction de l’Inde et de la Chine. Ce dernier pays ne cessant de montrer ses appétits impérialistes grandissants. Voilà le choix obligé que doivent faire actuellement les Etats-Unis et qui expliquent le sens profond du discours d’Obama au Caire.
Quand Washington fait pression sur Israël
Israël est depuis des décennies le plus fidèle allié des Etats-Unis au Moyen-Orient. Le lien entre la bourgeoisie de ces deux pays est très fort et l’armée israélienne est totalement soutenue par Washington. Du temps de G.W. Bush, les Israéliens avaient acquis de fait une latitude très importante dans le domaine de leur politique impérialiste. Tel-Aviv et Washington étaient pratiquement sur la même longueur d’ondes. Tel n’est plus le cas. L’administration américaine demande à présent à la bourgeoisie israélienne de se plier à ses exigences, à la défense de ses propres intérêts du moment. Ce qui a fait immédiatement monter la tension entre les deux capitales. Les divergences entre Nétanyahou, le chef du gouvernement israélien, et le président Obama sont claires et nettes. Cependant, sous l’importance de la pression américaine, Nétanyahou a dû modérer ses propos dans son discours de Tel-Aviv en réponse à celui d’Obama au Caire. Pour la première fois, Nétanyahou a dû lâcher les mots « Etat palestinien » même s’ils les associent à la démilitarisation de celui-ci et au rejet de tout partage de Jérusalem comme capitale. Ceci démontre que pour le chef du gouvernement israélien, les pressions américaines doivent être très fortes et constantes. En ce sens, il lui fallait gagner du temps et c’est ce qu’il a fait. Mais soyons certains que ceci ne changera rien sur le fond. Il est facile de s’en apercevoir lorsque l’on apprend que Nétanyahou a demandé aux Palestiniens, comme préalable, de reconnaître l’Etat israélien comme un Etat juif. Le chef du gouvernement a fait de cette exigence un élément central conditionnant toutes avancées dans les négociations de « paix », alors qu’il sait pertinemment que ceci est irrecevable pour la bourgeoisie palestinienne.
Nous allons donc très certainement vers la poursuite de la montée des tensions entre Israël et les Etats-Unis. Et il n’est pas certain que cette nouvelle politique américaine ne pousse pas, à terme, Israël dans une fuite en avant guerrière de la part de la fraction bourgeoise au pouvoir.
Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou considère en effet la menace nucléaire iranienne comme une menace insupportable pour Israël. Ces derniers temps, l’escalade verbale entre Mahmoud Ahmadinejad, le leader iranien, et le gouvernement israélien concrétisait cette montée des tensions entre les deux pays. Il n’est pas sûr en ce sens que les événements actuels en Iran rassurent beaucoup la bourgeoisie israélienne. La tentation pour l’Etat israélien, peut alors devenir forte de mettre au pied du mur le gouvernement Obama par une action militaire violente en direction de l’Iran.
Même si une telle perspective ne se réalisait pas, la bourgeoisie israélienne ne peut pas rester sans réactions face à la montée des exigences américaines à son égard. Cette montée des tensions est en fait paradoxalement le résultat de l’affaiblissement américain. La guerre et la barbarie vont continuer, inexorablement, à se développer dans cette région du monde.
Tino (le 2 juillet)
1 Courrier International du 16 juin 2009.
Géographique:
- Israel [187]
Récent et en cours:
- moyen-orient [188]
Deuxième réunion de discussion à Marseille : comprendre la crise
- 3656 lectures
La dynamique de débats et de discussions, soutenue par le CCI, a trouvé une deuxième concrétisation le 18/10/2008 où une trentaine de participants venant de diverses villes du Sud de la France et du Nord de l’Italie se sont réunis. Dans la continuité de la précédente rencontre, qui portait sur « Quelle société voulons-nous ? » (voir sur notre site dans la rubrique ICC Online l’article « Journée de discussion à Marseille : un débat ouvert et fraternel), il a été décidé d’aborder le thème de la guerre. Souvenons-nous : les troupes russes, en plein été 2008, envahissaient la Géorgie, semant la mort et les destructions. Mais très vite la crise financière, avec sa soudaine et spectaculaire aggravation, reléguait au second plan les sinistres bruits de bottes. A l’initiative de contacts, sympathisants et lecteurs de notre presse, le thème de cette rencontre se devait d’être modifié, les événements planétaires que nous vivions déclenchaient une réflexion, un questionnement. Comment comprendre cette crise ? Quelles sont ses conséquences ? Qui en est responsable ? Comment réagir contre ses effets qui ne manqueront de tomber sur toutes les couches de la population, et en particulier sur les travailleurs ?
Un débat sur la crise ? Cela pourrait en rebuter plus d’un. Ce n’était pas le cas pour les participants de cette rencontre. Comme le soulignait une des participantes : « ... j’ai constaté que la réunion de Marseille était un moment de réflexion qui était comme une bouffée d’air frais. Il y avait une ouverture et une interrogation générale, un désir d’aller au fond des choses par rapport à ce qui arrive autour de nous, et en particulier, à regarder ce qu’il y a derrière l’explication des médias sur le dernier et très dramatique tournant dans la crise économique. Cette réunion a prouvé qu’il existe le courage de faire face à des réalités désagréables au sujet de la société dans laquelle nous vivons et de réfléchir sur la façon de la changer ».
C'est le système capitaliste qui est en crise
La crise des « subprimes » qui a entraîné la faillite des grandes banques américaines et européennes est la conséquence d’un endettement colossal généralisé. Par le jeu de spéculations sur des crédits contractés par des ménages pour l’achat de biens de consommation, en l’occurrence ici pour obtenir des biens immobiliers aux Etats Unis, les institutions financières se sont échangé des sommes astronomiques afin d’en retirer des bénéfices immédiats. Il a suffi que ces ménages, souvent des travailleurs, ne puissent plus rembourser, du fait d’un affaiblissement de leur revenu, a eu comme effet que tout cet édifice s’est écroulé comme un château de cartes, révélant au grand jour l’endettement généralisé, non seulement des organismes bancaires et des ménages, mais aussi des entreprises et des Etats, impliqués eux aussi dans des opérations douteuses. Premières conséquences ? Nombre de travailleurs américains, qui ont vu du jour au lendemain leur maison perdre de la valeur, se sont retrouvés à la rue. Alors d’où vient cet argent qui est parti en fumée (des milliards de dollars) ? Il est très difficile d’y répondre, la bourgeoisie elle même ne peut pas donner une réponse claire, ceci dit toute cette masse d’argent qui se promène au niveau planétaire, du fait de la spéculation, a une valeur factice. Qui est responsable de cette situation ? La bourgeoisie, incapable de maîtriser son système, trouve des boucs émissaires : les Etats Unis, les investisseurs sans scrupules, les banquiers affairistes. Et de déclarer qu’il faut moraliser le capitalisme. En fait c’est dans le système lui même que se trouvent les raisons fondamentales de sa crise.
Comprendre le fonctionnement du capitalisme devient l’enjeu central. Son objectif n’est pas de produire pour satisfaire les besoins humains, mais pour permettre de faire des bénéfices qu’il réalise en écoulant sa production sur un marché mondial. Le capitalisme est un système qui a besoin de s’élargir sans cesse, d’accumuler du capital à une échelle toujours plus large, c’est un besoin vital. Trouver des marchés pour écouler le surplus de marchandises que ni l’ensemble des capitalistes ni l’ensemble des ouvriers ne peuvent consommer est le problème fondamental. Si au 19e siècle, il pouvait s’étendre dans des zones où il n’existait pas, au 20e siècle, la tendance est inverse, il domine la planète. Après la grave crise de 1929 qui a abouti à la Seconde Guerre mondiale, nous assistons depuis les années 1970 à une aggravation inexorable de la crise. Pour pallier à la raréfaction des marchés solvables, le capitalisme doit recourir au crédit à outrance, créer un marché artificiel dont la conséquence est une accumulation de dettes qui, à un certain niveau, ne peuvent plus être remboursées. La perspective donc est à une profonde récession dont les conséquences seront dramatiques pour la classe ouvrière, car c’est principalement elle qui va en faire les frais, avec une hausse vertigineuse du chômage, des baisses des salaires et une exploitation accrue sur les lieux de travail.
Alors pourquoi la bourgeoisie ne se lancerait-elle pas dans une politique des grands travaux, comme cela a été le cas dans les années 1930 ? Comme le disait une intervention « des grands travaux il y en a tous les jours, l’Etat intervient déjà beaucoup dans l’économie concrètement. Il faudrait donc que les Etats interviennent plus pour faire baisser le chômage et donc pour trouver des emplois. Or ces Etats sont endettés, sur endettés. Et pour mener une politique de grands travaux à une plus grande échelle, ils doivent s’endetter encore plus, ce qui n’est pas possible car la crise qui se déroule actuellement a pour base un surendettement des Etats » Et un autre participant d' ajouter : « Pourquoi on choisit de sauver les banques et on ne choisit pas d’investir dans les hôpitaux, les écoles... ? Car il faut faire un choix : pour qu’il y ait un marché solvable il faut échanger une marchandise contre de l’argent ; or quel est le rôle des banques ? C’est de faire circuler l’argent, voire d’en créer. Si on laisse s’écrouler les banques, on détruit la circulation de l’argent, on bloque complètement le système. »
Est-ce que la bourgeoisie a provoqué cette crise des « subprimes » pour mieux attaquer la classe ouvrière ? Cette question a son importance puisqu’en effet la bourgeoisie a mené une grosse campagne médiatique dans le but de faire peur et tenter par là de paralyser la classe ouvrière. Ceci dit, la bourgeoisie n’utilise pas la crise comme stratégie dans l’objectif de porter atteinte aux conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Il y a bien une chose que la classe dominante ne maîtrise pas, c’est bien son système économique et les contradictions qui l’assaillent ; en ce sens, l’appauvrissement du prolétariat est la conséquence d’une crise économique que la bourgeoisie est incapable de résoudre.
Tout ceci montre que nous entrons dans une période de plus en plus marquée par de violents soubresauts économiques et en réaction à cela, il faudra s’attendre à un développement de la lutte de classe.
Que faire ?
Alors se pose la question de que faire ? Réforme ou révolution ? Là est la question fondamentale, et que le mouvement ouvrier s’est toujours posé, et a tranché : socialisme ou barbarie. Nous sommes loin de faire la révolution, en attendant ne faut-il pas lutter pour des réformes ? La lutte est nécessaire et il ne faut pas s’y tromper, pas pour obtenir des réformes durables, impossibles à arracher aujourd’hui, mais pour se défendre, résister aux attaques du capitalisme et pour que chaque action soit le résultat d’une réflexion collective afin d’oeuvrer au renforcement de la classe ouvrière, non dans un cadre national, mais dans un cadre international. Quel est le rôle des minorités révolutionnaires ? Doivent-elles se concevoir comme des chefs ? La réponse est non. Les minorités ont une responsabilité: donner une direction politique à la lutte : dénoncer les pièges que nous tend la bourgeoisie et mener un débat au sein de la classe ouvrière pour l’amener à se clarifier sur ses perspectives révolutionnaires. Cette discussion doit continuer, le développement de la lutte de classe va amener les minorités les plus conscientes à agir. Approfondir cette question doit être le thème central d’une prochaine rencontre.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Débat sur la violence (II) : il est nécessaire de dépasser le faux dilemme : pacifisme social-démocrate ou violence minoritaire
- 4023 lectures
[Nous continuons ici le débat sur la violence qui s’est déroulé sur notre site web en espagnol et en français suite à notre article sur les sabotages des voies ferrées de la SNCF1.]
Le 12 décembre dernier, un de nos lecteurs écrivait un commentaire2 qu’on peut lire, en espagnol, à la suite de notre article « Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière ». Ce camarade pense que la seule motivation d’un tel article de notre part ne peut être que « de se démarquer de ces actions, en attaquant ceux qui ont été arrêtés et en adressant un message haut et clair à l’État : ce n’est pas nous, nous ne sommes pas des terroristes, pourvu qu’on ne prenne pas des coups » et que nous aurions agi comme « un regroupement de vieilles femmes terrorisées par le bruit des bottes des chiens de l’État ».
Contrairement à ce que pense cet intervenant, le but de l’article n’était pas du tout « d’attaquer les inculpés », mais de dénoncer l’infâme manœuvre de l’Etat français qui a utilisé les 10 personnes inculpées pour déchaîner une de ses habituelles campagnes contre la lutte ouvrière et l’activité des révolutionnaires. L’article se proposait, en particulier, d’alerter sur des pratiques parfois menées avec toute la meilleure foi du monde, mais que l’État instrumentalise en sous-main pour des objectifs qui sont à l’opposé des intentions de ceux qui mènent ces actions3
Ce camarade affirme « Je ne m’attends pas à ce que le CCI laisse tomber ses positions sur la violence, mais qu’il les expose avec clarté et soit prêt à en débattre ». Nous sommes pleinement d’accord avec cette proposition. Nous allons donc exposer notre position avec la volonté d’ouvrir un débat qui ne doit pas rester un échange entre nous et ce camarade mais qui, au contraire, est ouvert à tous avec l’objectif de dégager une synthèse qui nous permette de chasser les confusions et les insuffisances d’explication.
La situation actuelle et le faux dilemme dans lequel la bourgeoisie voudrait piéger les luttes ouvrières : pacifisme social-démocrate ou violence minoritaire.
Le débat sur la violence est une question brûlante, pleinement à l’ordre du jour. La lutte du prolétariat est violente, mais quels sont les moyens qui la servent ? Comment se construisent ces moyens ? Est-ce que toutes les formes de violence sont valables ? Et pour être plus concrets : les actions de violence minoritaire menées par des groupes isolés et spécialisés représentent-elles une contribution à la lutte prolétarienne ? 4
La situation actuelle est caractérisée par une maturation lente et difficile de la lutte ouvrière. Même si on est en train de vivre des expériences significatives dont il faudra tirer les leçons – en Grèce, en France, en Allemagne - nous n’avons pas encore assisté à des mouvements massifs de lutte où des expériences concrètes de violence prolétarienne aient pu se produire, pour pouvoir vraiment se prononcer sur ces expériences et bien les différencier de la violence venant d’autres couches sociales. Cependant, contribuer à la préparation de ces mouvements massifs et, plus concrètement, à ce qu’en leur sein, la violence de classe soit posée dans le sens de la classe, implique la réappropriation de l’expérience historique du prolétariat sur ce terrain, débat auquel nous invitons ce camarade mais aussi tous ceux que cela intéresse5.
La combativité ouvrière se déploie lentement et péniblement au milieu d’un énorme dispositif de la bourgeoisie – et surtout des syndicats – pour la saboter. Plus concrètement, nous assistons à une tentative idéologique de la bourgeoisie pour piéger les ouvriers dans un faux dilemme que nous pourrions formuler ainsi : « Si tu veux lutter massivement, va aux manifestations pacifistes et légalistes des syndicats, toutes bien situées sur le terrain réformiste, de soutien aux alternatives bourgeoises de gestion de la crise, avec des slogans tels que "les banquiers doivent payer", etc. Mais, attention, si tu es contre ça, il ne te reste que le moyen des actions minoritaires radicales d’affrontement isolé avec la police ».
On pourra rétorquer qu’il est faux de prétendre que la bourgeoisie ait monté un tel dilemme : elle montre une « grande indignation » vis-à-vis des « actes de vandalisme » des jeunes prolétaires grecs en les montrant du doigt comme des ennemis pires que les terroristes. Mais, au-delà des réactions subjectives de tel ou tel bourgeois, n’est-il pas suspect que la bourgeoisie grossisse et souligne à grands traits chaque fois les actes d’affrontements minoritaires avec la police, en occultant soigneusement l’iceberg dont ils ne sont que la pointe : l’existence d’une agitation sociale exprimée dans des manifestations massives de travailleurs, de jeunes, d’étudiants, d’enseignants etc., les assemblées générales, les grèves, les initiatives spontanées des groupes d’ouvriers ?
Et au-delà de ce que voudrait la bourgeoisie, devons-nous, ouvriers, choisir entre ces deux termes ? Le choix serait-il : manifestation pacifique massive ou action radicale minoritaire ? N’est-ce pas là un piège que le prolétariat devra faire sauter pour retrouver son propre chemin de lutte de classe qui n’a rien à voir ni avec le pacifisme social-démocrate ni avec la violence minoritaire ? 6
Il existe beaucoup de formes de violence
Pour comprendre de quelle manière le prolétariat peut développer sa propre violence de classe, il est nécessaire d’aborder la question de la violence, sans prétendre ici en faire une analyse générale7. Nous allons exposer quelques réflexions que nous pensons nécessaires pour entamer un débat.
La violence est un élément de base dans la société de classe. Celle-ci ne peut pas fonctionner sans violence, de la même manière qu’elle ne pourra être abolie que par la violence. La paix est impossible dans les sociétés de classe. Quand on parle de « paix sociale », on parle, en vérité, de la soumission et de l’atomisation des travailleurs livrés à la violence de l’État bourgeois et des rapports capitalistes de production.
Cependant, de cette vérité, valable pour toutes les sociétés de classe, on tire souvent une conclusion erronée : on met la violence au niveau d’un concept abstrait, intangible, indépendant de l’histoire et des classes sociales. Comme nous le disions dans la Revue Internationale nº 14 « Dire et redire cette tautologie “violence = violence” et se contenter de démontrer que toutes les classes en usent, pour établir sa nature identique, est aussi intelligent, génial, que de voir une identité entre l’acte du chirurgien faisant une césarienne pour donner naissance à la vie et l’acte de l’assassin éventrant sa victime pour lui donner la mort, par le fait que l’un et l’autre se servent d’instruments qui se ressemblent : le couteau exerçant une action sur un même objet : le ventre, et recourant à une même technique apparemment fort semblable : celle d’ouvrir le ventre. »
Nous devons faire la différence. La violence des classes exploiteuses n’est pas la même que celle des classes exploitées. Tout au long de l’histoire, la violence et ses formes ont évolué, ont eu des expressions différentes. Et une même classe sociale adopte tout au long de sa trajectoire historique des moyens et des formes de violence différents.
Faire cette analyse est essentiel pour mener à bien le débat qui nous occupe, parce qu’autrement on s’embarquerait dans une discussion stérile et totalement éloignée des vrais problèmes, du genre « tout est violence », « à la violence, il faut répondre par la violence », « si tu n’est pas pour la violence en soi, c’est parce que tu est un pacifiste » et ainsi de suite avec des arguments qui ne mènent nulle part.
La violence de la bourgeoisie et la violence du prolétariat sont radicalement différentes. Non seulement elles ne poursuivent pas les mêmes buts, mais elles n’utilisent pas les mêmes moyens, elles n’ont pas les mêmes formes ni la même expression. C’est une erreur de les identifier parce que dans les deux cas, on pourrait toujours isoler le même élément chimique dans leur composition : la violence en général.
La violence du prolétariat et la violence de couches petites bourgeoises ne sont, elles non plus, pas identiques, ni même comparables. Le prolétariat n’identifie pas la violence de ces couches avec la violence de la bourgeoisie et, par ailleurs, il ressent de la sympathie et de la solidarité pour elles en essayant de les gagner à sa cause. Mais cela n’empêche que le prolétariat rejette catégoriquement les formes et les moyens de violence de ces couches, qui n’ont rien à voir avec sa propre violence de classe.
Violence de la bourgeoisie et violence du prolétariat
La violence de la bourgeoisie est basée sur la terreur. Il est évident que la terreur des États ouvertement dictatoriaux n’est pas la même que celle des États démocratiques. Dans ces derniers, l’État donne la primauté aux moyens politiques et psychologiques sans pour autant renoncer à un vaste arsenal de répression physique aussi bien légale qu’illégale, aussi bien en les confiant à des corps d’État spécialisés qu’à des bandes « privées ». Il va de soi, en plus, que la bourgeoisie n’hésite pas à recourir au terrorisme comme arme pour régler ses conflits internes ou impérialistes, mais aussi comme moyen pour intimider et réprimer le prolétariat. La violence de la bourgeoisie est prise en charge par des corps spécialisés, elle est minoritaire, elle cherche à diviser et à affronter les prolétaires, elle essaye de provoquer chez eux des sentiments de paralysie, de soumission et de docilité ; elle encourage les sentiments les plus destructeurs et irrationnels : le nationalisme, le racisme, la xénophobie, la haine...
La violence du prolétariat peut-elle être de la même nature ? Le camarade souligne d’ailleurs : « Est-ce que cela veut dire que toute forme de violence utilisée par des prolétaires, est en elle-même bonne ? NON. La violence en tant que tactique doit être en accord avec la fin qu’elle sert. Le but des révolutionnaires est celui de renverser l’État capitaliste, et la seule manière réelle d’y parvenir, c’est de rendre possible le changement dans le rapport de forces entre les classes. Pour cela, le prolétariat doit, à travers sa lutte, prendre conscience de ce qu’il est historiquement et agir en conséquence. Ce processus ne peut être mené à bien qu’en élargissant l’auto-organisation et l’unité de la classe ouvrière. Toute tactique qui contribue à l’auto-organisation et à l’unité de la classe ouvrière est par conséquent révolutionnaire. Est-ce que la grève et le sabotage, par exemple, peuvent être révolutionnaires ? : Oui, s’ils contribuent à une telle fin et s’ils ne la bloquent pas. »
Le camarade reconnaît que la violence du prolétariat ne peut pas être en contradiction avec la fin révolutionnaire pour laquelle il lutte. Il affirme aussi que la violence prolétarienne doit contribuer à son auto-organisation et son unité. Nous sommes pleinement d’accord avec cela. Le problème, cependant, c’est quand ce camarade réduit la violence à une question de tactique ou quand il met sur le même plan la grève et le sabotage.
Présenter la violence comme une tactique, c’est la transformer en une espèce d’instrument que nous pourrions utiliser de façon optionnelle, ça signifie qu’on la considère sous l’angle le plus superficiel : on voit le pistolet, le couteau, le heurt physique, mais pas qui s’en saisit et l’empoigne et dans quel contexte général il le fait. Voilà la question essentielle qui permet de comprendre la nature radicalement différente et totalement antagonique entre la violence des autres classes et celle du prolétariat : « La lutte du prolétariat, comme toute lutte sociale, est nécessairement violente mais la pratique de sa violence est aussi distincte de la violence des autres classes comme sont distincts leurs projets et leurs buts. Sa pratique, y compris la violence, est l’action d’immenses masses et non de minorités ; elle est libératrice, l’acte d’accouchement d’une société nouvelle harmonieuse, et non la perpétuation d’un état de guerre permanent, chacun contre tous et tous contre chacun. Sa pratique ne vise pas à perfectionner et perpétuer la violence mais à bannir de la société les criminels agissements de la classe capitaliste et l’immobiliser. (...) Sa force invincible ne réside pas tant dans sa force physique et militaire et encore moins dans la répression, que dans sa capacité de mobiliser ses larges masses, d’associer la majorité des couches et classes travailleuses non prolétariennes à la lutte contre la barbarie capitaliste. Elle réside dans sa prise de conscience et dans sa capacité de s’organiser de façon autonome et unitaire, dans la fermeté de ses convictions et dans la vigueur de ses décisions. Telles sont les armes fondamentales de la pratique et de la violence de classe du prolétariat ».8
Sabotage et grève ne sont pas la même chose et partent de pratiques de classe différentes9. La grève contient deux éléments qui ne sont pas comparables. D’un coté, elle possède un potentiel libérateur qui donne au prolétariat une force considérable : l’union, la solidarité, l’initiative commune, le dépassement de la concurrence et de la division entre ouvriers. D’un autre coté, elle possède un élément de pression, l’arrêt de la production. Ce deuxième élément est inévitable, fait partie de la société de classe de laquelle le prolétariat ne peut pas s’abstraire.
Mais le plus important est le premier élément. Le camarade critique comment les syndicats dénaturent les grèves et il a tout à fait raison. Mais d’où vient ce détournement ? Justement, il réside dans le fait qu’on nie et qu’on détruit le premier élément, celui qui donne la force du prolétariat, et on n’admet que le second, de sorte que les syndicats réduisent la grève à une simple paralysie de la production, que les travailleurs partent chez eux ou au bar du coin. Ils la transforment en un simple instrument tactique destiné à « faire pression » sur les patrons. La bourgeoisie octroie le « droit de grève » pour le frelater en le rabaissant à une simple protestation, à une simple pression contractuelle « entre associés qui négocient ».
Avec cette amputation, la grève finit par ressembler au sabotage. Les deux sont des moyens de pression. Mais la pression ou la nuisance des uns envers les autres ne sont pas des moyens révolutionnaires ni libérateurs mais des aspects les plus quotidiens de la vie sous le capitalisme et qui participent activement à sa reproduction. Les États sont des maîtres en matière de sabotage pour contrer les rivaux, les entreprises exécutent des coups bas en tout genre. La violence du prolétariat veut dire force, imposition, coups, mais par d’autres moyens radicalement différents et qui contiennent en eux-mêmes une perspective de libération de l’humanité : c’est la violence de la massivité, de l’unité, de la solidarité, de l’exercice de la capacité à réfléchir ensemble et de prendre des décisions collectivement, d’agir en tant que classe auto-organisée qui sait imposer avec force ses objectifs.
La conception mécaniciste, parfaitement superficielle, ne voit de la violence que quand il y a des heurts physiques, des cocktails Molotov, des assauts, des destructions... Par contre, la massivité, la solidarité de classe, l’auto-organisation, tout cela ne leur apparait pas comme de la « violence » parce qu‘en apparence c’est « pacifique », ce serait une espèce de « pacifisme genre Gandhi ».
La violence est bien plus que des tirs, des affrontements ou des bombes, c’est essentiellement un changement dans le rapport de forces entre les classes. La violence pour le prolétariat est une question politique : comment établir un rapport de force contre la classe capitaliste et son État de telle sorte qu’il puisse résister à leurs attaques et passer à l’offensive jusqu’à leur abolition définitive ?
Lorsque les ouvriers parviennent à s’unir, ils dépassent la violence du capital qui les réduit à l’atomisation, ils imposent la violence de leur action en tant que classe unie. Lorsque les ouvriers arrivent à étendre leur lutte, ils sont en train de vaincre la division avec laquelle le capital les enchaîne par entreprise, secteur, catégorie ; ils mettent en avant ce qui remet le plus en cause cette société bâtie sur la concurrence et sur les coups portés les uns contre les autres : la solidarité. Lorsque les ouvriers s’organisent en Assemblées générales et développent leurs propres réseaux d’unification, ils font éclater le carcan de fer des syndicats qui les maintiennent dans la passivité, la dispersion et la désorganisation, et ils expriment le défi d’une classe organisée. Lorsque les ouvriers discutent, réfléchissent et décident collectivement, ils sont en train de vaincre la violence quotidienne qui fait d’eux des êtres perdants, grégaires, enfermés dans leurs problèmes, ils soulèvent une force qui oppose à l’Etat sa propre alternative.
Ce processus n’a rien de pacifique. Premièrement, parce qu’il implique l’existence d’initiatives d’affrontement, de défense et d’attaque, ce qui requiert à tout moment des moyens adéquats. Deuxièmement, parce qu’on doit affronter la répression de l’Etat bourgeois, qui emploie toute sorte de moyens, des balles et des gaz lacrymogènes jusqu’aux provocations et les pièges en tous genres, en passant par les plus destructrices : les campagnes de calomnie, de lynchage moral et physique, la haine... Face à cela, la plus grande violence que le prolétariat puisse exercer contre le capital, c’est sa capacité à s’affirmer en tant que masse unie, solidaire, consciente de sa mission et de sa force, prête à lutter jusqu’au bout et à accueillir en son sein les autres classes non exploiteuses de la société. Cette détermination, cette fermeté est celle qui crée les bases pour mener à bien la tâche de détruire l’État, où l’insurrection joue un rôle décisif.
Dans le prolétariat, ce n’est pas la violence qui produit la conscience mais c’est la conscience qui utilise et recourt à des moyens violents, en fonction de l’évolution de la lutte.
La violence du prolétariat est consciente. Le camarade croit que, parce que nous mettons en garde le prolétariat face au danger de provocation et à la présence des provocateurs, nous lui nierions son « droit à se défendre » : « Si demain mes camarades de travail et moi-même, nous sortons manifester dans la rue et nous répondons aux provocations policières ou à l’attaque directe de la police, serions-nous qualifiés par le CCI de provocateurs policiers ? Est-ce que nous, les ouvriers, n’avons pas le droit de nous défendre face aux attaques de l’Etat bourgeois et de sa police ?, Est-ce que nous n’avons pas le droit de contre-attaquer nos ennemis ? Parce que si le CCI ou n’importe quelle autre organisation nous refusent ce droit, elle ne fait que nous livrer pieds et poings liés à la répression ».10
Bien sûr qu’il faut se défendre ! Et que ce soit clair, bien sûr qu’il faut passer à l’offensive ! Mais ceci doit se faire consciemment et non pas en agissant comme un taureau qui court derrière tout ce qui bouge.
Le camarade dit : « je ne crois pas que nous devrions nous préoccuper autant de ce que l’État fait (nous savons très bien comment il va riposter), mais nous devrions nous occuper surtout de ce que notre classe fait ou ne fait pas ». Nous ne sommes pas d’accord avec cette idée : le prolétariat a besoin de connaître la politique de la bourgeoisie et d’avoir pleinement conscience de ses manœuvres, de ses campagnes, etc., pour ainsi apprendre à les anticiper et les démonter. Nous ne devons pas tomber dans les mêmes souricières dans lesquelles l’État essaye continuellement de nous faire tomber ! Cette capacité à comprendre comment la bourgeoisie agit et manœuvre est une des composantes de base de l’action consciente du prolétariat. Le prolétariat est une classe historique. Il n’est pas comme ses frères en souffrance qui l’ont précédé, les esclaves et les serfs qui étaient capables de se révolter, mais qui ne pouvaient pas mener à leur terme une lutte consciente.
L’histoire du prolétariat est remplie de provocations que la bourgeoisie a tendues à notre classe et qui ont été parfois un facteur important de défaite. En Autriche en 1919, au moment où il y avait une possibilité d’extension de la révolution depuis la Hongrie où elle avait triomphé, la bourgeoisie envoya un agent provocateur qui entraîna une partie du jeune parti communiste dans une insurrection prématurée et mal préparée qui contribua à arrêter la maturation d’une possible insurrection massive. La bourgeoisie allemande provoqua le prolétariat de Berlin en janvier 1919 pour l’amener à un affrontement prématuré qui lui permit de défaire les travailleurs paquets par paquets, d’abord à Berlin, puis à Brême, plus tard à Hambourg, en Bavière ensuite, etc.
Pour paraphraser notre camarade, oui, le prolétariat « a le droit » de connaître et de se réapproprier sa propre histoire pour ainsi éviter de retomber dans les pièges et les provocations que la bourgeoisie lui a déjà tendus dans le passé.
Violence des couches petites-bourgeoises et violence du prolétariat
Le prolétariat cohabite avec d’autres couches sociales : petite-bourgeoisie, marginaux urbains, etc. Ces couches sociales ne sont pas des ennemis du prolétariat. Celui-ci doit les gagner à sa cause, parce que cela peut rendre plus efficace la violence qu’il peut opposer à l’État en l’isolant socialement, ce qui est une condition préalable pour mener à bien l’assaut contre lui et sa destruction révolutionnaire.
Or, pour gagner ces couches, il est crucial que le prolétariat affirme son propre terrain de classe, ses propres méthodes de lutte, sa propre organisation et sa propre perspective révolutionnaire.
Ce n’est pas le prolétariat qui doit descendre sur le terrain confus, désespéré et interclassiste de ces couches sociales, mais ce sont celles-ci qui doivent être hissées sur le terrain de classe, révolutionnaire et libérateur, propre au prolétariat.
Cette position n’est pas seulement valable pour ce qui concerne les revendications sociales et politiques, elle concerne aussi les méthodes de violence et l’action de ces couches sociales. Les couches marginalisées urbaines expriment leur violence par le biais d’explosions massives de rage et de désespoir telles des flambées spectaculaires qui s’éteignent rapidement. Les couches petites-bourgeoises désespérées, quant à elles, tendent à faire des actes de sabotage et de terrorisme organisés en groupes minoritaires.
Le prolétariat n’a pas à se perdre dans ce genre de violence stérile qui n’est que l’expression des couches sans avenir historique. Il doit faire le contraire : gagner ces couches sociales non exploiteuses à la violence révolutionnaire, massive et consciente.
Le prolétariat doit exprimer de la sympathie et de la solidarité aussi bien vis-à-vis des couches petites-bourgeoises désespérées que des marginaux des villes. Mais cela ne doit jamais le porter à accepter comme siennes les méthodes de combat chaotiques et sans avenir pratiquées par ces couches sociales. Ceci est particulièrement important vis-à-vis des groupes et des mouvements – comme cette mouvance « autonome » - qui se revendiquent de « principes » fumeux, qui, dans le meilleur des cas se trouvent à osciller entre la bourgeoisie et le prolétariat et qui, en fait, brandissent comme le « principe des principes » la pratique d’une violence minoritaire radicale11.
D’habitude, on donne trois arguments pour spéculer sur une prétendue « contribution » à la lutte ouvrière de la part de ces mouvements pratiquant la violence minoritaire :
1) ils « cassent la paix sociale », ce qui aiderait le prolétariat à prendre conscience et à se lancer dans la lutte ;
2) ils peuvent livrer les combats « préliminaires » dans l’affrontement violent avec l’État bourgeois ;
3) ils développent un travail « d’avant-garde », sur le terrain militaire, en ce qui concerne l’organisation de la violence armée.
Examinons ces arguments.
1º) Ces actions « ne brisent pas la paix sociale », mais, au contraire, elles la renforcent. Au-delà de la sympathie possible que le prolétariat pourrait ressentir pour certains de ces éléments qui se révoltent contre l’oppression existante, le caractère minoritaire et isolé de ce genre d’actions renforce les sentiments d’atomisation, d’isolement, répandent davantage l’impuissance et la passivité que la révolte et la mobilisation. Par ailleurs, quel genre de conscience peut développer ces « actions exemplaires de force » ? La conscience prolétarienne vient de l’expérience collective de lutte, de la compréhension, par le débat, de la situation, de la préoccupation de l’avenir et aucunement du « bruit » que de telles actions pourraient faire. Est-ce que le prolétariat est une masse de moutons à laquelle quelques « héros » doivent montrer « comment lutter » ?
2°) Tout le processus qui va des luttes de résistance jusqu’à l’insurrection révolutionnaire internationale doit être assumé collectivement par le prolétariat et personne ne peut le remplacer dans aucun de différents aspects ou phases. Le substitutionnisme est la vision qui consiste à prétendre qu’une minorité peut livrer et préparer les combats armés « préliminaires » à la révolution. Le substitutionnisme –dans toutes ses manifestations12- ne fait que fomenter la passivité et la démobilisation du prolétariat en le menant à une subordination à une minorité qui se prétend « éclairée », quand elle n’est pas « illuminée », ou « armée ».
3º) La violence, encore une fois, ce n’est pas quelque chose de technique, spécifique, extérieur à la lutte de classe du prolétariat, mais c’est son expression-même face à l’Etat bourgeois, c’est la classe elle-même en lutte, massive et auto-organisée, ce qui veut dire déjà violence contre l’État bourgeois, ce qui implique un défi contre l’ordre établi. De ce point de vue, même si le prolétariat crée des détachements « spécialisés », tels que les piquets de lutte, les patrouilles de contrôle, la garde rouge dans le cas des révolutions russes de 1905 et 1917, il le fait après une décision collective et sous contrôle collectif des assemblées générales et des Conseils ouvriers. Ainsi, par exemple, le Comité militaire révolutionnaire qui dirigea l’insurrection d’Octobre 1917 était un organe créé par les Soviets en septembre 1917 et dans lequel participaient des bolcheviques, des anarchistes internationalistes, des socialistes-révolutionnaires et même des mencheviques !
Le prolétariat n’a rien à espérer de la pratique, et moins encore des principes - généralement inexistants - des couches sociales sans avenir. Ce sont, au contraire, les éléments individuels se détachant de ces couches qui doivent se joindre à la lutte du prolétariat s’ils veulent avoir un avenir.
CCI 23-12-08
1 "Débat sur la violence (I) [172]", Révolution Internationale n° 398 - février 2009.
2 Voir ce commentaire et d’autres aussi bien sur les pages en espagnol qu’en français de notre site.
3 Sans aller chercher bien loin, les lecteurs peuvent s’en convaincre en lisant dans notre article la reproduction d’une partie de l’interview faite à un expert en manipulations et provocations bourgeoises : l’onorevole Cossiga, plusieurs fois ministre (notamment de l’Intérieur et de la Défense), premier ministre et ancien président de la République italienne.
4 Il faut préciser que des affrontements avec la police des groupes de travailleurs ou d’étudiants – même minoritaires - et l’organisation d’actions de violence de la part des groupes minoritaires spécialisés ne sont pas du tout la même chose.
5 Ce camarade dit « Lors de la révolution russe, les révolutionnaires n’ont pas pris d’assaut le palais d’hiver avec des sucettes, et lors de la révolution allemande, les ouvriers ne défendaient pas les barricades à Berlin avec des bonbons ». Il a tout à fait raison. Aussi, nous l’invitons à réfléchir sur les différentes contributions que nous avons faites sur ce sujet. Entre autres, par exemple, « La révolution d'Octobre 1917 : oeuvre collective du prolétariat [189] », Revue internationale nº 72, en particulier le chapitre « L'insurrection, oeuvre des soviets », et aussi « La révolution russe : l'insurrection d'Octobre, une victoire des masses ouvrières [190] » (plus spécialement le chapitre « Le prolétariat prend le chemin de l'insurrection ») Revue internationale nº 91.
6 Quand on parle de manifestation massive, on pense immédiatement à quelque chose de légal, pacifique, bien ordonné, parfaitement contrôlé. Rien de plus faux : les véritables manifestations ouvrières requièrent la rupture avec l’encadrement syndical, l’organisation des piquets de vigilance et, le cas échéant, l’affrontement avec la police. Tout ça n’a rien à voir avec une quelconque « paix » ou légalisme. Et de la même manière, une assemblée ouvrière n’est pas une mer calme. Il faut y affronter la police syndicale, organiser des actions de défense, la réquisition de locaux, etc. L’initiative récente d’un secteur d’ouvriers et d’étudiants grecs est là pour le démontrer. Voir « Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe [191] ».
7 Nous avons déjà fait des analyses générales sur cette question : voir Revue internationale nº 14 « Terreur, terrorisme et violence de classe [192] » et Revue Internationale nº 15 « Résolution sur la terreur, le terrorisme et la violence de classe [193] ». Sauf indication particulière, les citations dans la suite de cet article sont tirées de ces deux articles.
8 “Résolution sur : TERRORISME, TERREUR et VIOLENCE de CLASSE [193]”, dans Revue internationale nº 15, 1978.
9 Pour éviter tout malentendu nous voulons faire trois éclaircissements préalables : 1 : , le sabotage n’a rien à voir avec le terrorisme ; 2, ,: nous n’excluons pas qu’à certains moments de la lutte prolétarienne, des moyens de sabotage soient nécessaires contre ses ennemis; 3: , nous comprenons que certains éléments ouvriers minoritaires le pratiquent comme expression de désespoir et de rage, surtout individuels.
10 Récemment -–en 2007- les ouvriers égyptiens nous ont donné une démonstration de défense consciente contre la police : ils avaient occupé une usine ; on les a avertis que la police arrivait pour les en déloger ; ils ont téléphoné avec des portables à des ouvriers d’autres usines, aux voisins de leurs quartiers, aux femmes, etc. Une heure après l’arrivée de la police, celle-ci, surprise, s’est retrouvée encerclée par une foule de gens que ne faisait que grandir... Lors de la grève générale de Vigo en 2006, en apprenant que des camarades étaient arrêtés dans le palais de justice, plus de 10 .000 ouvriers s’y sont concentrés tout autour avec la menace de le prendre d’assaut. Voir Révolution Internationale n° 380, juin 2007 : "Grèves en Egypte : la solidarité de classe, fer de lance de la lutte [194]", Internationalisme n° 326, juin 2006 : "Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne : une avancée dans la lutte prolétarienne [177]".
11 Ce camarade affirme « qu’il faut savoir différencier ; ou alors, est-ce qu’on mettrait sur le même plan l’ETA et le MIL, Max Hölz et Michael Collins ? Sincèrement, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de si borné. Et j’imagine que même le CCI se serait assis avec le MIL et Max Hölz, et il aurait mis les autres dans le camp qui est le leur, celui de la bourgeoisie». Pour rester dans le cas du MIL, Révolution Internationale, parmi les groupes initiaux du CCI, discuta avec les camarades du MIL et il montra sa solidarité envers Puig Antich, lorsque celui-ci fut assassiné par l’Etat franquiste. Le MIL était animé par des positions prolétariennes, mais celles-ci étaient contaminées par des positions erronées comme celle de la violence substitutioniste. Avec le MIL, le débat était possible. Ceci dit, le camarade a raison de différencier : le MIL ou Max Hôlz n’ont effectivement rien à voir avec l’ETA ou d’autres groupes terroristes qui ne sont, eux , que des représentants nationalistes d’une fraction de la bourgeoisie luttant avec ces moyens-là contre une autre. D’ailleurs, le terrorisme est fondamentalement, comme nous le disons, une méthode typiquement utilisée dans la lutte entre fractions nationalistes de la bourgeoisie.
12 On a souvent une vision bien restrictive et réductionniste du substitutionnisme, qui se limiterait à l’idée de la social-démocratie selon laquelle c’est le parti qui prend le pouvoir au nom de la classe ouvrière et lui “injecte” la consciente de l’extérieur. Il y a d’autres substitutionnismes tout aussi nuisibles comme celui des minorités « armées » qui prétendent « réveiller » la classe ou, de l’extérieur aussi, « préparer son combat armé ».
Récent et en cours:
- Terrorisme [174]
Epreuves de force dans le Caucase : une voix internationaliste en provenance de Russie
- 2670 lectures
Une série de réunions publiques sur la guerre en Géorgie a eu lieu mi-février en Allemagne. Vadim Damier du KRAS (Fédération des Travailleurs de l'éducation, de la science et de la technique), de Moscou, a présenté des exposés à Völklingen, Landshut, Kirchheim, Offenbach sur le Main, Mayence, Nottuln, Münster, Neu-Isenburg, Trèves et Hanovre. La réunion publique à Hanovre du 13 février 2009 était organisée par le DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereignite KriegsdienstgegnerInnen). (association d’objecteurs de conscience). Environ une cinquantaine de participants étaient présents à cette réunion pour s'informer de la situation, poser ses questions et pour écouter une voix internationaliste en provenance de Russie contre la guerre.
Dans le texte d'introduction, le KRAS de Moscou a expliqué que « comme partout et comme toujours dans les conflits entre États, il n'y a pas de côté juste dans cette nouvelle guerre au Caucase. » Et les organisateurs de la réunion publique ont ajouté que « Vadim Damier et sa fédération s'opposent au nationalisme de toutes les parties en présence. »
La situation dans le Caucase
Dans son exposé, Vadim Damier a caractérisé la situation au Caucase comme une poudrière pouvant exploser à tout instant. Il a rappelé comment l'URSS jusqu'en 1989 a constamment cherché à entretenir et simultanément à geler les conflits en ce lieu, afin de monter les différentes communautés nationales les unes contre les autres pour les maintenir sous son contrôle. La pacifique concorde des républiques soviétiques formait ainsi plus une apparence qu'une réalité. L'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990 a ranimé les vieux conflits nationalistes en sommeil. La Géorgie a déclaré son indépendance et a adopté une nouvelle constitution en tant qu'État unitaire, ce qui a poussé en retour les minorités non-géorgiennes, soutenues par la Russie, à réclamer la leur. Cela a fourni l'occasion à Moscou de se poser comme « médiateur » entre le gouvernement de Tiflis et les séparatistes et d’imposer la présence des « troupes de paix » russes stationnées en Géorgie. Le Kremlin considère le Caucase comme un point décisif pour la stabilisation de sa propre fédération. Sa présence en Ossétie du Sud et en Abkhazie renforce aussi sa position par rapport à la Tchétchénie et au Caucase du Nord.
De plus, il y va dans ce conflit d'intérêts liés à l'énergie, parce qu'il passe là, ou sont en construction, des pipelines qui contournent la Russie. Ce qui correspond aux intérêts de l'Europe occidentale dont les gouvernements veulent éviter une dépendance trop forte et unilatérale par rapport à des livraisons énergétiques russes. Pour les États-Unis, il s'agit encore de son hégémonie mondiale. En outre, beaucoup d'argent est en jeu pour toutes les parties. La Russie a ainsi intérêt à faire apparaître les voies de transports traversant des pays comme la Géorgie comme trop dangereux.
Enfin, il y a dans ce conflit des intérêts stratégiques plus globaux. La Russie veut donner un coup d'arrêt à son refoulement hors de ses propres sphères d'influence. À l'époque de la présidence de Chevardnadze dans les années 1990, la Géorgie commençait déjà à jouer franchement la carte pro-occidentale. Tout en visant l'affiliation à l'OTAN, elle était en même temps prête à tolérer la présence des troupes russes sur le territoire national. Cela a été présenté par l'opposition de l'actuel chef d'État Saakaschvili comme une faiblesse. Cela prépara ainsi sa propre prise de pouvoir sur la base d'une position nationaliste radicale. Du fait de la crise économique, de la misère et de la division au sein de son propre parti, la fuite en avant de Saakaschvili s'est accélérée au cours de l'été 2008. En cherchant la confrontation militaire avec la domination russe, il tablait sur le soutien de la puissance protectrice de la Géorgie, l'Amérique. Mais cette puissance protectrice, aux prises à ce moment-là avec ses problèmes particuliers, n'était pas prête à chercher un conflit militaire ouvert avec la Russie. Celle-ci, comptant sur l'aventurisme militaire du gouvernement de Tiflis, s'y était préparée au mieux, de même que les enclaves séparatistes qu'elle soutient.
Toutes les parties en présence ont poursuivi leurs propres intérêts de puissance impérialiste. Il n'y a aucun « côté juste ». Et comme partout dans toute guerre impérialiste, c'est la population de chaque région qui en est la victime.
Les participants de la réunion publique ont voulu savoir, entre autres, quel rôle a joué la constellation des composantes religieuses et ethniques dans la région. Vadim a expliqué que les Géorgiens sont majoritairement des chrétiens orthodoxes, mais avec leur propre église nationale traditionnelle. Les Abkhazes comme les Ossètes sont mixtes religieusement, mais ne sont pas des Géorgiens. Les dirigeants de tous les bords jouent pleinement sur ces différences. Il existe des villages géorgiens dans les enclaves, et inversement, aussi bien que des villages mixtes et de nombreux mariages mixtes. Il a comparé l'actuelle situation tragique à l'ancienne Yougoslavie pendant les guerres des années 1990, où « des nettoyages ethniques » ont également eu lieu et où beaucoup de familles explosèrent pour des raisons ethniques. Il a indiqué que le gouvernement Poutine, critiqué par les occidentaux, a donné exactement la même justification à la guerre que l'OTAN en son temps en Yougoslavie : empêcher le génocide d'un peuple. La partie géorgienne a utilisé de son côté le même argument pour la guerre que celle avancée par Moscou par rapport à la Tchétchénie auparavant : la garantie de l'unité et de l'intégrité nationales.
Le mouvement anti-guerre
En Russie, on ne dispose que de peu d'informations concernant la situation en Géorgie, d'après le camarade. Certes, il y a en Géorgie des pacifistes connus tels « War Resistance Informations ». Cependant, une considérable hystérie guerrière semble y avoir régné parmi la population pendant les opérations militaires. En Russie, ce n'était pas non plus différent. Il y prédomine, comme Vadim Damier l'a appelé, une sorte de « syndrome de Weimar » : la légende d'une « URSS trahie, mais jamais vaincue » qui aurait subi une injustice historique comme l'Allemagne avec le Traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale et que « la nouvelle Russie » aurait à venger. Ainsi y a-t-il eu en Russie pendant la guerre une recrudescence des agressions contre des « étrangers » caucasiens.
Parmi la très petite « opposition à la guerre » en Russie se sont trouvés des groupes de l'opposition libérale extraparlementaire qui souhaitent « de bonnes relations avec l'ouest », des vieux staliniens qui « protestent » contre tout ce que fait le gouvernement, tout comme quelques trotskistes peu nombreux qui ont amorcé un rapprochement avec les positions internationalistes. Il a mentionné le forum Internet « Nouveau Zimmerwald ». Le milieu anarchiste a réagi de façon plus ou moins internationaliste. Quelques actions de protestation se sont déroulées dans des villes comme Moscou et Saint-Petersbourg. Celles-ci n'ont attiré que quelques centaines de participants, où à plusieurs reprises des groupes de défense des droits de l'homme surtout ont focalisé l'attention, comme ceux par exemple qui se sont déclarés en faveur du « plan de paix » du président français Sarkozy.
La situation dans l'armée russe
Actuellement, l'armée est réduite à un million de soldats, le service militaire a été ramené de 2 ans à 1 an. L'opposition libérale réclame une armée professionnelle. Vadim Damier a pris position autant contre la professionnalisation de l'armée que contre le service militaire, et rappelé que l'armée professionnelle peut, le cas échéant, être une arme encore plus sûre dans les mains de la classe dominante, surtout contre sa propre « population ». Il a rappelé que lors de la grève des travailleurs de Novotscherkask, en 1962, beaucoup de conscrits avaient refusé de tirer. Le camarade a également décrit le règne des brimades dans l'armée qui sont tolérées, au moins comme moyen de division et de discipline des appelés du contingent. En revanche, les comités des « Mères des soldats » essayent de faire quelque chose contre cela.
Le travail du KRAS
Enfin, le camarade a présenté le travail de son groupe, le KRAS, qu'il a présenté comme un syndicat anarcho-syndicaliste de Moscou, membre de l'Association Internationale des Travailleurs, éditant la revue en russe « Action directe ». Vadim Damier a caractérisé son groupe comme « a-national » et « antimilitariste ». Ainsi, il a déjà adopté une position internationaliste conséquente par rapport aux guerres en Tchétchénie. Par rapport à la guerre en Géorgie, le KRAS a publié une prise de position internationaliste qui a été traduite par d'autres groupes en de nombreuses langues dans le monde (et aussi par le CCI [195]). Tandis que le KRAS représentait jusqu'à présent un groupe interprofessionnel, il essaye maintenant de se développer comme un syndicat pour les scientifiques. En outre, il essaye d'intervenir dans la lutte des classes et de tirer les enseignements des luttes internationales.
L'importance de l'internationalisme et la question de la lutte des classes
Le CCI a salué à cette réunion publique la position internationaliste conséquente du KRAS par rapport à la guerre impérialiste. Nous avons souligné la fermeté de principe des camarades par rapport à cette question, ainsi que leur courage d'être restés fidèles à ce principe fondamental du prolétariat contre toute agitation chauvine depuis autant d'années au vu et au su de tout le monde. Nous avons souligné, comme il est important pour les internationalistes de tous les pays eu égard à la prolifération des conflits militaires et à la domination de l’idéologie impérialiste pro-russe sur ce plan, d'entendre une voix internationaliste en provenance de là-bas. Nous avons souligné que dans cette attitude, ce n'est pas le succès immédiat qui importe. Il s'agit plutôt de parvenir à rester fermement à contre-courant de l’opinion publique y compris de l'atmosphère empoisonnée régnant au sein de sa propre classe, pour être capable de s’opposer la guerre et surtout de se lier aux réactions de classe du prolétariat. Nous avons aussi rappelé comment la révolution s'est développée justement de cette manière à la fin de la Première Guerre mondiale, en Russie mais aussi par exemple en Allemagne. Séparée de la lutte des classes, la lutte contre la guerre menace de glisser dans un mouvement anti-guerre interclassiste et donc impuissant. Par conséquent, nous avons soulevé la question de l’impact de la crise économique pour le développement de la lutte des classes, en Russie aussi bien qu'au niveau international. La lutte internationale de la classe ouvrière par rapport à la crise de l'économie mondiale possède le potentiel de devenir un mouvement en mesure, par un processus de politisation croissant, d'intégrer la question de la lutte contre la guerre.
Vadim Damier a répondu que le chômage s'élève actuellement officiellement à 1,5 million, mais à 7 millions en réalité. D'ici à la fin de l'année, on prévoit officiellement jusqu’à 7 millions de chômeurs. La misère produite par le non-versement des salaires du temps du gouvernement d'Eltsine au début des années 1990 fait en outre une réapparition massive. Ainsi, la population se trouve-t-elle actuellement en état de choc. Il y a eu des « révoltes sociales » dans les États baltes, et il est probable qu'il s'en produira aussi en Russie à l'avenir. Mais en Russie l'idée d'une alternative manque justement, puisque des décennies de stalinisme ont discrédité toute idée d'une possible société sans classes. Ainsi, le danger d'un nationalisme croissant ne peut pas non plus être écarté.
CCI
Vie du CCI:
Géographique:
Gaza : la solidarité avec les victimes de la guerre, c'est la lutte de classe contre tous les exploiteurs
- 3046 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction de la prise de position sur les massacres au Proche-Orient et dans la bande de Gaza parue sur notre site internet en anglais dès le 31/12/2008. Les événements ont évolué depuis dans le même sens que notre dénonciation : l'usage systématique d'une terreur brutale contre le population bombardée par les voies terrestres, maritimes et aériennes et l'entrée des troupes israéliennes à Gaza depuis le 3 janvier au soir. Mais nous avons vu aussi, d'un autre côté, se manifester de façon croissante l'indignation de la population mondiale devant le déchaînement de ces atrocités et face à l'hypocrisie des grandes puissances. Un sentiment de solidarité s'est également affirmé envers la population palestinienne qui sert d'otage dans ce conflit entre fractions de la classe exploiteuse. En tant que révolutionnaires, nous dénonçons tous ceux qui prétendent dévoyer cette solidarité de classe sur le terrain pourri du nationalisme, de la défense d'une patrie contre une autre, alors que l'unique moyen pouvant libérer l'humanité de l'impérialisme de la guerre et de la barbarie, est, au contraire, le développement de l'internationalisme révolutionnaire jusqu'à l'abolition de toutes les nations, de toutes les frontières et l'édification d'une véritable communauté humaine : le communisme.
Après deux ans d’étranglement économique de Gaza – sans essence et sans médicaments, bloquant les exportations et empêchant les ouvriers de quitter Gaza pour trouver du travail de l'autre côté de la frontière israélienne–, après avoir transformé l’ensemble de la bande de Gaza en un vaste camp de prisonniers, duquel des Palestiniens désespérés ont tenté de s’enfuir en cherchant vainement à passer la frontière avec l’Egypte, la machine militaire israélienne est en train de soumettre cette région très peuplée, appauvrie, à toute la sauvagerie des ses bombardements aériens. Des centaines d’entre eux sont déjà morts et les hôpitaux déjà débordés ne peuvent faire face au flot continu et sans fin des milliers de blessés. Les déclarations d’Israël disant que l’Etat essaye de limiter les morts civils sont une farce sinistre alors que chaque cible « militaire » est située près des quartiers d’habitations ; et alors que les mosquées et l’université islamique ont été ouvertement sélectionnées comme cibles, que reste-t-il de la distinction entre civils et militaires ? Le résultat est là : des cibles civiles, la plupart des enfants, tués et estropiés, et un plus grand nombre terrifiés et traumatisés à vie par les raids incessants. Au moment où cet article a été écrit, le premier ministre israélien, Ehud Olmert décrivait cette offensive comme une première étape. Les tanks attendaient donc à la frontière et une invasion totale de la bande de Gaza n’était pas exclue.
La justification d’Israël pour cette atrocité –soutenue par l’administration Bush aux Etats-Unis – est que le Hamas ne cesse de tirer des roquettes sur les civils israéliens en violation d’un prétendu cessez-le-feu. Le même argument a été utilisé pour soutenir l’invasion du Liban il y a deux ans. Et il est vrai qu’à la fois le Hezbollah et le Hamas se cachent derrière les populations palestinienne et libanaise et les expose cyniquement à la revanche israélienne, présentant faussement le meurtre d’une poignée de civils israéliens comme un exemple de la « résistance » à l’occupation militaire israélienne. Mais la réponse d’Israël est absolument typique de toute puissance occupante : punir la population entière pour l’activité d’une minorité de combattants armés. L’Etat israélien le fait avec le blocus économique, imposé après que le Hamas ait chassé le Fatah du contrôle de l’administration de Gaza ; il l’a fait au Liban et il le fait avec les bombardements sur Gaza. C’est la logique barbare des guerres impérialistes, dans lesquelles les civils servent pour les deux côtés de boucliers et de cibles, et finissent presque invariablement par mourir en plus grand nombre que les soldats en uniforme.
Et comme dans toutes les guerres impérialistes, les souffrances infligées à la population, la destruction des maisons, des hôpitaux et des écoles, n’a pour résultat que de préparer le terrain à de futurs épisodes de destructions. Le but proclamé d’Israël est d’écraser le Hamas et d’ouvrir la porte à un leadership palestinien plus « modéré » à Gaza, mais même les ex-officiers des services secrets israéliens (au moins un des plus… intelligents) peuvent voir la légèreté d’un tel argument. Au sujet du blocus économique de Gaza, l’ex-officier du Mossad Yossi Alpher déclarait : « Le siège économique de Gaza n’a amené aucun des résultats politiques attendus. Il n’a pas orienté les Palestiniens vers une haine anti-Hamas, mais a été probablement contre-productif. Ce n’est qu’une punition collective inutile. » Cela est encore plus vrai des raids aériens. Comme le dit l’historien israélien Tom Segev : « Irsaël a toujours cru que faire souffrir les civils palestiniens les rendrait rebelles à leurs leaders nationaux. Il est démontré que cette affirmation s'avère encore et toujours fausse. » (les deux citations sont extraites du Guardian daté du 30 décembre 2008). Le Hezbollah au Liban s’est vu renforcé par les attaques israéliennes de 2006 ; l’offensive contre Gaza aura probablement le même résultat pour le Hamas. Mais qu’il soit renforcé ou affaibli il ne pourra continuer à répondre que par d’autres attaques contre la population israélienne, et si ce n’est pas avec des roquettes, ce sera avec des bombes humaines.
La spirale de la violence exprime la décadence du capitalisme
Les leaders mondiaux « concernés » comme le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ou comme le pape, nous ont ressassé que de telles actions d’Israël ne servent qu’à enflammer la haine nationaliste et à alimenter la « spirale de la violence » au Moyen-Orient. Rien n’est plus vrai : le cycle du terrorisme et de la violence d’Etat en Israël/Palestine brutalise les populations et les combattants des deux côtés et crée encore de nouvelles générations de fanatiques et de « martyrs ». Mais ce que le Vatican et les Nations Unies ne nous disent pas, c’est que cette descente aux enfers dans la haine nationaliste est le produit d’un système social qui est partout en pleine décadence. L’histoire n’est pas différente en Irak où Chiites et Sunnites s’entr'égorgent, dans les Balkans où les Serbes font de même contre les Albanais et les Croates, en Inde et au Pakistan avec les conflits entre Hindous et Musulmans, ou encore en Afrique où la myriade de guerres avec les divisions ethniques les plus violentes serait trop nombreuse à énumérer. L’explosion de ces conflits à travers le monde est l’expression d’une société qui n’a plus de futur à offrir à l’humanité.
Et ce qu’on ne nous dit pas non plus, c’est l’implication des puissances mondiales démocratiques et humanitaires dans ces conflits, et c’est à peine si on entend parler de division entre elles. La presse britannique n’a pas gardé le silence sur le soutien de la France aux gangs meurtriers hutus au Rwanda en 1994. Elle est moins éloquente sur le rôle joué par la Grande-Bretagne et les services secrets américains dans les divisions Chiites/Sunnites en Irak. Au Moyen-Orient, le soutien de l’Amérique à Israël et celui de l’Iran et de la Syrie au Hezbollah et au Hamas sont évidents, mais le rôle de soutien « en sous-main » joué par la France, l’Allemagne, la Russie et d’autres puissances pour leur propre compte n’est pas moins réel.
Le conflit au Moyen-Orient a ses propres caractéristiques et ses causes historiques particulières, mais il ne peut être compris que dans le contexte global d’une machine capitaliste qui est dangereusement hors de tout contrôle. La prolifération de guerres sur toute la planète, la crise économique incontrôlable, et la catastrophe environnementale accélérée font de toute évidence partie de cette réalité. Mais alors que le capitalisme ne nous offre aucun espoir de paix et de prospérité, il existe une source d’espoir dans le monde : la révolte de la classe exploitée contre la brutalité du système, une révolte exprimée en Europe ces dernières semaines dans les mouvements de jeunes prolétaires en Italie, en France, en Allemagne et surtout en Grèce. Ce sont des mouvements qui, par leur nature même, ont mis en avant le besoin de la solidarité de classe et le dépassement de toutes les divisions ethniques et nationales. Ils ont été un exemple qui peut être suivi dans d’autres régions de la planète, celles qui sont ravagées par les divisions au sein de la classe exploitée. Ce n’est pas une utopie : déjà dans les récentes années passées, les ouvriers du secteur public de Gaza se sont mis en grève contre le non-paiement de leurs salaires presque simultanément avec ceux du secteur public en Israël en lutte contre les effets de l’austérité, elle-même produit direct de l’économie de guerre d’Israël poussée à son paroxysme. Ces mouvements n’étaient pas conscients l’un de l’autre, mais ils montrent la communauté objective d’intérêts dans les rangs ouvriers des deux côtés de la division impérialiste.
La solidarité avec les populations qui souffrent dans les zones de guerre du capitalisme ne signifie pas choisir « le moindre mal » ou soutenir la clique capitaliste « la plus faible » comme le Hezbollah ou le Hamas contre les puissances plus agressives comme les Etats-Unis ou Israël. Le Hamas a déjà montré qu’il était une force bourgeoisie d’oppression contre les ouvriers palestiniens –spécialement lorsqu’il a condamné les grèves dans le secteur public comme étant contre les « intérêts nationaux » en quand, main dans la main avec le Fatah, il a soumis la population de Gaza au combat d’une faction meurtrière contre l'autre pour le contrôle de la région. La solidarité avec ceux qui sont pris dans la guerre impérialiste signifie le rejet des deux camps belligérants et le développement de la lutte de classe contre tous les dirigeants et les exploiteurs du monde.
World Revolution, organe du CCI en Grande-Bretagne (31 décembre 2008)
Géographique:
Récent et en cours:
- Guerre [198]
Grèves en Angleterre : les ouvriers du bâtiment au centre de la lutte de classe
- 2952 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par World Révolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
On nous dit tous les jours que nous devons nous serrer la ceinture, accepter les suppressions de poste, les diminutions de salaire et de pension de retraites, les cadences accélérées au travail, pour le bien de l’économie nationale, pour l’aider à faire face à la récession qui s’approfondit. A British Airways, ils ont même poussé les ouvriers à travailler pour rien pendant tout un mois, en brandissant la menace du chômage. L’idée de lutter contre ces attaques incessantes se heurte à la peur terrible du chômage et à la campagne médiatique sans fin qui nous dit que la lutte ne peut empêcher nos conditions de vie et de travail d’empirer.
Mais, dans les premières semaines de juin, un événement est venu clairement démontrer que le poids de la passivité et de la peur n’était pas une fatalité. Les travailleurs du métro londonien ont fait grève pour défendre 1000 emplois menacés. Les ouvriers de la Poste à Londres et en Ecosse ont lancé des luttes contre les licenciements, les contrats rompus et les suppressions de postes. Et surtout, au même moment, 900 travailleurs du bâtiment de la raffinerie de Lindsey arrêtaient le travail par solidarité avec 51 de leurs camarades qui étaient licenciés. Cette lutte a explosé dans une série de grèves sauvages par solidarité dans les plus grands sites de construction du secteur énergétique en Grande-Bretagne, quand Total a jeté 640 grévistes le 19 juin. Ces luttes montrent que nous ne devons pas accepter notre « destin ».
Le nationalisme contre les ouvriers et les ouvriers contre le nationalisme
Au début de l’année, les ouvriers de la raffinerie de Lindsey avaient été au cœur d’une vague semblable de grèves sauvages, à propos de licenciements d’ouvriers sur le site. Cette lutte, à ses débuts, était freinée par le poids du nationalisme, symbolisé par le slogan « des jobs anglais pour les ouvriers anglais » et par l’apparition de drapeaux de l’Union Jack dans les piquets de grève. Quelques-uns des ouvriers en grève disaient qu’on ne devait pas employer d’ouvriers étrangers alors que les ouvriers anglais étaient licenciés. La classe dominante a utilisé ces idées nationalistes à plein, exagérant leur impact et en présentant cette grève comme étant contre les ouvriers italiens et polonais employés sur le site. Cependant, il a été mis soudainement et de façon imprévisible fin à cette grève, quand ont commencé à apparaître des banderoles appelant les ouvriers portugais et italiens à rejoindre la lutte, affirmant « Ouvriers du monde entier, unissez-vous » et que les ouvriers polonais du bâtiment ont rejoint les grèves sauvages à Plymouth. Au lieu d’une défaite ouvrière longuement préparée, avec des tensions croissantes entre ouvriers de différents pays, les ouvriers de Lindsey ont obtenu 101 emplois de plus, les ouvriers portugais et italiens gardant leur emploi, gagné l’assurance qu’aucun ouvrier ne serait licencié et sont rentrés unis au travail.
La nouvelle vague de luttes, s’appuyant sur cette bonne dynamique, a pu éclater sur une base d’emblée beaucoup plus claire : solidarité avec les ouvriers licenciés. 51 ouvriers étaient licenciés ou, plus exactement, leurs contrats n’étaient pas renouvelés. Au même moment, un autre employeur embauchait des ouvriers. Les ouvriers licenciés ont été avertis qu’on n’avait plus besoin d’eux par des post-it sur leur carte de pointage ! Cela a suscité une réponse immédiate de la part de centaines d’ouvriers, arrêtant le travail par solidarité. Il y avait le sentiment que ces ouvriers étaient attaqués à cause du rôle qu’ils avaient joué dans la grève précédente. Le 19 juin, Total, le propriétaire du site, prenait la mesure inattendue de licencier 640 grévistes. Il y avait déjà eu des grèves de solidarité dans d’autres usines, mais avec ces nouvelles de nouveaux licenciements, des grèves ont éclaté dans tout le pays. « Environ 1200 ouvriers en colère se rassemblaient aux principales entrées hier, agitant des panneaux qui fustigeaient ‘ les patrons cupides’. Des ouvriers des centrales électriques, des raffineries, des usines dans le Cheshire, le Yorkshire, le Nottinghamshire, l’Oxfordshire, en Galles du Sud et Teesside arrêtaient le travail pour montrer leur solidarité ». (The Independent du 20 juin). Le Times rapportait « qu’il y avait aussi des signes que la grève s’étendait à l’industrie nucléaire, puisque EDF Energy disait que les ouvriers contractuels du réacteur de Hickley Point dans le Somerset avaient arrêté le travail. »
Face à ce mouvement, il est plus difficile pour les médias de jouer la carte nationaliste. Ce serait surprenant que le nationalisme ne pèse pas sur quelques ouvriers et les médias savent comment concentrer l’attention sur eux. Le website de la BBC montre une photo d’un piquet avec des ouvriers tenant une banderole disant : « Mettez les ouvriers anglais d’abord, pas en dernier », tandis que le Guardian du 20 juin interviewait un gréviste qui disait : « Nous n’avons rien contre les ouvriers étrangers en tant que tels, mais nous avons le sentiment qu’ils devraient venir en complément de ce que nous ne pouvons fournir. » Mais les journaux de droite tels que le Times et le Daily Telegraph qui d’habitude utilisent à plein ce genre de sentiments, n’en faisaient aucune mention et se concentraient plutôt sur l’action engagée par Total et le danger que ces luttes ne s’étendent. La classe dominante est extrêmement préoccupée par cette lutte, justement parce qu’elle ne peut pas la dévoyer si facilement dans une campagne nationaliste. Elle a peur qu’elle puisse s’étendre à tout le secteur de la construction en général et peut-être même au-delà. Les ouvriers peuvent voir que si Total arrive à licencier des ouvriers en grève, d’autres patrons prendront la suite. La question de la grève est clairement posée comme une question de classe, qui concerne tous les travailleurs.
La vision de la solidarité avec les travailleurs étrangers confirme la nature de classe évidente de cette lutte. Comme le dit clairement un ouvrier licencié : « Total réalisera bientôt qu’ils ont libéré un monstre. C’est honteux que cela soit arrivé sans aucune consultation. C’est aussi illégal et ça me rend malade. S’ils (Total) s’en tirent, le reste de l’industrie s’écroulera et fera du dégraissage. Les travailleurs seront décimés et les ouvriers non qualifiés étrangers seront embauchés au moindre coût, traités comme de la merde et renvoyés quand le travail sera fini. Il y a une sérieuse possibilité que l’électricité soit coupée à cause de cela. Nous ne pouvons pas rester passifs et voir des ouvriers jetés comme des habits sales. » (The Independent du 20 juin).
Cette indignation des ouvriers est celle de toute la classe ouvrière. Pas seulement à cause de ce que fait Total, mais de toutes les autres attaques qu’ils subissent ou voient. Des millions d’ouvriers sont en train d’être jetés tout à fait comme des déchets par la classe dominante. Les patrons s’attendent à ce que les ouvriers acceptent des réductions de salaire ou même travaillent gratis et qu’ils en soient contents ! Le mépris de Total est celui de toute la classe capitaliste : « Comment les ouvriers osent-ils être si arrogants ? Ils doivent être défaits ! »
La nécessité d’une lutte commune
Quoiqu’il arrive dans les prochains jours, cette lutte a démontré que les ouvriers n’ont pas à accepter les attaques, qu’ils peuvent résister. Plus que cela, ils ont vu que la seule façon de nous défendre nous-mêmes est de nous défendre les uns les autres. Pour la deuxième fois cette année, nous avons vu des grèves sauvages de solidarité. Il y a des rapports qui disent que les grèves de Lindsey ont envoyé des piquets volants au Pays de Galles et en Ecosse. Il y a des sites de construction dans tout le pays, en particulier dans la capitale, où les sites olympiques regroupent un grand nombre d’ouvriers de plusieurs nationalités. Envoyer des délégations sur ces sites, appelant à l’action solidaire, serait le message le plus clair que c’est une question qui concerne le futur de tous les travailleurs, quelle que soit leur origine. Les ouvriers de la poste et du métro de Londres essaient aussi de se défendre contre des attaques similaires et ont tout intérêt à former un front commun.
Le vieux slogan du mouvement ouvrier – travailleurs du monde entier, unissez-vous – est souvent tourné en ridicule par les patrons qui ne peuvent pas voir plus loin que leurs intérêts nationaux. Mais la crise mondiale de leur système rend de plus en plus évident le fait que les ouvriers ont les mêmes intérêts partout : nous unir pour défendre nos conditions de vie et pour mettre en avant la perspective d’une autre forme de société, basée sur la solidarité à l’échelle mondiale et la coopération.
Phil. (21 juin)
Géographique:
- Grande-Bretagne [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Honduras: le prolétariat n’a pas de camp à choisir dans un affrontement entre brigands
- 2524 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'une prise de position (en date du 12 juillet 2009) d'Internacionalismo, notre section au Venezuela, sur l’affrontement auquel on assiste actuellement au Honduras.
La crise politique qui s’est déchainée au Honduras avec le coup d’État contre le président Manuel Zelaya dimanche 28 juin n’est pas « un coup d'État de plus » dans cette pauvre et petite « République bananière » de 7,5 millions d’habitants. Cet événement a des répercussions géopolitiques importantes et aussi au niveau de la lutte de classe.
Les faits
Zelaya, patron et membre de l’oligarchie hondurienne, a commencé son mandat début 2006. Il était le candidat du parti Liberal du Honduras, la droite. Depuis l’an dernier il a commencé un rapprochement pour obtenir le « label » chaviste du « Socialisme du 21e siècle » ; en aout 2008, avec le soutien de son parti, il a obtenu que la chambre des députés approuve l’incorporation du Honduras à l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour l’Amérique Latine et les Caraïbes), mécanisme créé par l’administration de Chavez pour contrecarrer l’influence de l’ALCA (Association de Libre échange pour les Amériques) promue par les États-Unis. Cet accord, très critiqué par certaines fractions politiques et patronales, rendrait plus aisé le paiement d’une facture pétrolière qui représente un poids très lourd sur l’économie hondurienne.
En entrant dans l’ALBA, le Honduras pourrait bénéficier d’un crédit de 400 millions de dollars pour acheter du pétrole au Venezuela qui serait remboursé dans des conditions très avantageuses ; voilà une « aide » importante pour un pays avec un PIB de 11 milliards de dollars selon les données les statistiques de la CEPAL pour 2006, avec un paiement pour l’importation d’hydrocarbures qui a dépassé 30% du PIB, selon la même source. Mais le « Socialisme du 21e siècle » n’est pas un simple label commercial : il exige que les gouvernements qui achètent cette « franchise » appliquent une série de mesures populistes à tendance de gauche ; il faut que l’Exécutif contrôle ouvertement les institutions de l’État et les pouvoirs publics, il faut qu’il s’attaque de front aux vieilles « oligarchies » nationales. Et c’est ainsi que Zelaya a fait un virage politique à 180º en quelques mois : il était un libéral de droite et il est presque devenu un gauchiste défenseur des pauvres et du « socialisme ».
Les élections étant proches (novembre 2009), à partir du mois de février, Zelaya met la pression sur les institutions de l’État pour promouvoir sa réélection, ce qui provoque des conflits entre l’exécutif et les autres pouvoirs publics et même au sein de son propre parti. En mai dernier, en s’appuyant sur des organisations populaires et syndicales, il fait pression sur les forces armées pour l’organisation d’un référendum sur la réforme de la constitution en vue d’une réélection ; le Haut-commandement militaire refuse. Le 24 juin, Zelaya révoque le chef de l’État major, qui est immédiatement rétabli dans ses fonctions par la Cour suprême de Justice, ce qui devient l’amorce du coup d’État du 28 juin, date initialement prévue par l’Exécutif pour le référendum. Ce jour-là, Zelaya est contraint par des militaires de quitter « en pyjama et sans chaussettes » Tegucigalpa (capitale du Honduras) pour San José (capital du Costa Rica). Avec le soutien de l’armée et de la Cour suprême, le Congrès désigne Roberto Micheletti (président du Congrès) nouveau Président de la République.
Notre analyse
Il est évident qu’à la racine de la crise politique au Honduras se trouvent les desseins impérialistes du Venezuela dans la région. Dans la mesure où le chavisme s’est consolidé, la bourgeoisie vénézuélienne a fait des avancées au profit de ses intérêts géopolitiques, ce qui n’est pas du tout nouveau, afin de faire du Venezuela une puissance régionale ; c’est avec cet objectif qu’elle brandit la bannière idéologique du « Socialisme du 21e siècle », qui s’appuie sur les couches les plus paupérisées et utilise le pétrole et l’argent du pétrole en tant qu’arme pour convaincre et pour contraindre. La croissance de la paupérisation, la décomposition des vieilles classes dirigeantes et l’affaiblissement géopolitique des États-Unis dans le monde ont permis à la bourgeoisie vénézuélienne de faire progresser son projet auprès de plusieurs pays de la région : Bolivie, Équateur, Nicaragua, Honduras et quelques autres pays de la zone caraïbe.
Ses caractéristiques populistes et son anti-américanisme « radical » exigent que le projet chaviste ait un contrôle total des institutions de l’État, exige le montage d’une polarisation politique autour de « riches contre pauvres », « une poignée d’oligarques contre le peuple », etc., ce qui le transforme en une source permanente de tension et d’instabilité pour le capital national lui-même. Pour que ce projet puisse être un tant soit peu réalisé, il requiert en plus le changement des Constitutions par la création d’Assemblées constituantes qui donnent une base légale aux changements nécessaires pour consolider les nouvelles élites « socialistes » au pouvoir, en faisant la promotion de la réélection présidentielle entre autres mesures. Cette recette cuisinée par le chavisme est bien connue par toutes les bourgeoisies de la région.
Le Honduras est un objectif de grande valeur pour le chavisme : ce pays lui permettra de posséder une tête de pont en Amérique centrale sur l’Atlantique par le port de Cortés, qui sert aussi pour le commerce extérieur du Salvador et du Nicaragua; de cette manière, le Venezuela disposerait d’un « canal » terrestre qui unirait l’Atlantique et le Pacifique, au travers le Nicaragua. D’un autre coté, le fait de contrôler le Nicaragua et le Honduras, favoriserait le contrôle de la part du chavisme sur le Salvador, ce qui entraverait le développement du Plan-Puebla-Panama 1 proposé par le Mexique et les États-Unis.
D’un autre coté, le Honduras possède les conditions « naturelles » pour le développement du projet populiste de gauche de Chavez, car c’est le pays le plus pauvre des Amériques après Haïti et la Bolivie. La masse des pauvres que la crise ne fait qu’augmenter inexorablement est la principale consommatrice des faux espoirs pour sortir de sa situation de misère, des espoirs qui font partie du livre des recettes du « Socialisme du 21e siècle ». C’est à ces masses que le message chaviste est adressé, des masses dont il a besoin d’une mobilisation permanente avec le soutien des syndicats et des partis de gauche et gauchistes, des organisations sociales paysannes, les indigénistes, etc.
Le chavisme, résultat de la décomposition de la bourgeoisie vénézuélienne et mondiale, utilise et accentue les expressions de décomposition au sein des classes dominantes de la région. La nécessité de polariser au maximum l’affrontement entre ces fractions bourgeoises ne fait qu’accélérer encore plus la difficile gouvernance qui est déjà une caractéristique même de la décomposition. La crise récente au Honduras, qui ne fait que commencer, signifie une aggravation de la situation dans ces « Républiques bananières » de l’Amérique centrale, qui ne connaissaient pas de crise comme celle d’aujourd’hui depuis les années 1980, lorsque les conflits au Guatemala, au Salvador et au Nicaragua, laissèrent une séquelle de presque un demi million de morts et des millions de déplacés.
Le bal des hypocrites
Peu de temps avant le coup d’État, Chavez avait déjà mis en marche sa stratégie géopolitique, en alertant les présidents « amis », en dénonçant les militaires « gorilles », etc. Une fois le putsch consommé, il convoqua tous les pays appartenant à l’ALBA où il annonça l’arrêt des envois de pétrole au Honduras et menaça d’envoyer des troupes au cas où l’ambassade vénézuélienne à Tegucigalpa serait attaquée. Il mit aussi à la disposition de Zelaya les ressources de l’État vénézuélien : le ministre des Affaires étrangères est devenu le conseiller personnel du président destitué et il l’accompagne dans ses voyages dans plusieurs pays ; les médias d’État, surtout le canal international TV-Telesur, transmet sans arrêt des informations sur Zelaya, le présentant comme une victime, grand humaniste et défenseur des pauvres ; Le discours de Zelaya à l’ONU fut retransmis au Venezuela sur la radio et la télé nationales.
Chavez ne cesse de faire des appels insistants aux « peuples des Amériques » pour défendre la démocratie menacée par ces « gorilles militaires putschistes », peut-être pour qu’on oublie le fait que lui-même fut l’un d’eux quand il s’est mis à la tête d’un putsch au Venezuela contre le président social-démocrate Carlos Andrés Pérez, en 1992. Et ce sont justement ces « militaires gorilles », cette police de l’État chaviste et ses troupes de choc qui répriment non pas seulement les manifestations des opposants au régime, mais surtout les luttes mêmes des travailleurs au Venezuela, tel qu’Internacionalismo l’a dénoncé 2.
Mais dans ce bal des hypocrites il y a aussi évidemment l’autre partenaire : le reste de ce qu’on appelle la « communauté internationale ». L’OEA, l’ONU, l’UE et bien d’autres pays ont condamné le putsch et ont demandé le retour de Zelaya ; beaucoup d’entre eux ont retiré leurs ambassadeurs du Honduras. Mais ce n’est là que de la pure comédie à usage médiatique pour la galerie, pour essayer de faire présentable une démocratie bourgeoise bien mal en point, et ces organisations en perte constante de crédibilité.
Comment expliquer le comportement de l’administration des États-Unis face à cette crise ?
A la surprise de la « gauche » et de ses appendices « gauchistes », les États-Unis aussi ont condamné le putsch et ont demandé la remise en place de Zelaya. D’après la Secrétaire d'État elle-même, Hillary Clinton, l’ambassade des États-Unis à Tegucigalpa et Tom Shannon, sous-secrétaire d'État pour l’hémisphère occidental, ont pris une part active dans les tentatives de médiation pendant les mois précédant le putsch, pour, selon eux, éviter que la crise n’éclate. On peut se demander : est-ce que les États-Unis ont perdu le contrôle du problème ? Est-ce que la diplomatie étasunienne a perdu autant la main dans la région depuis l’administration Bush ?
L’hypothèse n’est pas à écarter qu’en effet les États-Unis ne soient pas arrivés à contrôler les différentes factions de la bourgeoisie qui s’affrontent, ce qui serait l’expression du degré de décomposition dans les rangs de la bourgeoisie et des faiblesses géopolitiques des États-Unis dans leur propre « arrière cour », au point de leur rendre difficile la possibilité de contrecarrer les effets du néo-populisme de gauche des gouvernements où les présidents ont été élus par les voies « démocratiques » (souvent à une large majorité), mais qui, dès qu’ils sont installés au pouvoir, deviennent ouvertement des dictatures en maintenant seulement une très mince couche de vernis démocratique.
Cependant, nous ne pensons pas que cela corresponde à la réalité. En condamnant le putsch et en exigeant le retour de Zelaya, les États-Unis utilisent la crise hondurienne pour essayer de « redorer leur blason » vis-à-vis des États de la région, blason bien terni par l’administration Bush. Si Obama avait agi comme Bush (lorsque, par exemple, celui-ci soutint le putsch raté contre Chavez en avril 2002), il aurait fourni des arguments pour rallumer l’anti-américanisme dans la région et affaiblir la stratégie d’ouverture diplomatique adoptée la nouvelle administration.
Il n’est pas à écarter que les États-Unis aient laissé « suivre son chemin » à la crise hondurienne pour l’utiliser contre le chavisme dans la région. En agissant ainsi, les États-Unis forcent Chavez à se découvrir et à défendre son « élève et protégé » Zelaya, en montrant son rôle patent de pyromane dans la crise hondurienne. Cela permet, par ailleurs, de mettre en avant que l’OEA et d’autres dirigeants de la région essayent de régler une crise où les États-Unis ne seraient « qu’un des participants au milieu des autres ». Ainsi, c’est la « communauté des États américains » 3 tout entière qui serait responsable du dénouement malheureux de la crise, alors même qu’il apparaît de plus en plus évident que la responsabilité de la crise incombe à Chavez et Zelaya. Le rejet du nouveau gouvernement hondurien de la demande de l’OEA de remettre Zelaya à son poste, « l’échec » de la démarche d’Insulza lors de son voyage du 3 juillet à Tegucigalpa et les actions du gouvernement de Micheletti pour empêcher l’atterrissage de l’avion vénézuélien qui transportait Zelaya depuis Washington dimanche 5 juillet, ont aggravé la crise et ont mis Chavez hors de lui, qui a dénoncé derrière ces événements la main de « l’impérialisme yankee » et a exigé d’Obama, « victime de cet impérialisme », qu’il intervienne plus énergiquement au Honduras !
Il est certain que la situation est assez compliquée pour les États-Unis. D’un coté, il leur faut donner une leçon à Chavez et à ses alliés ; et d’un autre coté, cette situation pourrait dégénérer vers une situation explosive maintenant que la puissance nord-américaine a d’autres priorités géopolitiques telles que l’intervention en Afghanistan, la crise avec l’Iran, la Corée du Nord, etc. Par ailleurs, la décomposition de la bourgeoisie hondurienne elle-même et de toute la région en général, Venezuela inclus, pourraient générer une situation incontrôlable.
On vient d’apprendre que Zelaya avait accepté la médiation du président du Costa-Rica Oscar Arias, à la demande de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton ; ce qui donne une idée du rôle central des États-Unis dans cette crise.
Une réflexion sur la géopolitique régionale
La crise au Honduras est bien plus importante que la crise récente entre la Colombie, d’un coté, et l'Équateur et le Venezuela de l’autre, sur la question des FARC, dans laquelle le gouvernement de Chavez a aussi joué un rôle de premier plan. Le Nicaragua, allié de Chavez, est en conflit avec la Colombie au sujet de l’archipel de San Andrés dans les Caraïbes. On parle de mobilisation de troupes dans ces conflits, le Venezuela concentrant même les siennes sur la frontière avec la Colombie lors du conflit avec l’Équateur. Même si ces mobilisations ont un rôle médiatique pour « distraire » le prolétariat et la population, la réalité est surtout que la bourgeoisie de ces États, face à la crise et la décomposition, utilise de plus en plus le langage et les moyens de guerre.
De même, l’influence de Chavez et de ses alliés se retrouve dans les dernières crises et affrontements en Bolivie, dans la fraude électorale que l’opposition a dénoncée lors des dernières élections municipales au Nicaragua ; le gouvernement péruvien dénonce, quant à lui, l’ingérence de la Bolivie et du Venezuela lors des affrontements à Bagua. Le gouvernement Chavez, à la fois produit et facteur de la décomposition, ne dispose pas d’autres moyens que la fuite en avant dans des aventures bellicistes. Il s’est associé avec des États et des organisations qui pratiquent un anti-américanisme radical : l’Iran, la Corée du Nord, le Hamas, etc. D’un autre coté, la situation au Venezuela est relativement grave du fait de la crise qui affecte les revenus pétroliers (essentiels pour la géopolitique menée par l’État vénézuélien), du fait également du surgissement de luttes ouvrières, tout ceci poussant le gouvernement à maintenir un climat de tension à l’intérieur et à l’extérieur.
Les États-Unis ont des difficultés pour remettre de l’ordre dans leur arrière cour. Certaines classes dirigeantes régionales, la bourgeoise mexicaine ou colombienne, par exemple, pourraient contrecarrer l’action du chavisme et exploiter les crises politiques à l’œuvre dans leur zone d’influence, comme c’est le cas pour le Mexique en Amérique centrale. Mais ce pays est lui-même plongé dans des crises internes de plus en plus aiguës, dans un affrontement sans fin avec les cartels de la drogue, au point qu’un sénateur nord-américain a pu affirmer il y a quelque mois que l'État mexicain n’existait pas. La Colombie, bastion des États-Unis dans la région, n’a pas les moyens de contrecarrer l’offensive de Chavez, avec lequel elle a réussi à maintenir un équilibre assez fragile. Le Brésil, qui a des intérêts économiques en Amérique centrale (forts investissements pour la production de biocombustibles) et qui mène des actions géopolitiques qui l’ont renforcé en tant que puissance régionale, parait ne pas vouloir, comme les autres pays mentionnés, se mêler d’une crise promue par Chavez, qui est son concurrent dans la région, et sans doute le Brésil va-t-il laisser Chavez « mijoter dans son propre jus » ; le Brésil fait des efforts pour amener quelque stabilité à la région, mais il le fait en tant que puissance qui veut se construire son propre domaine impérialiste et c’est dans ce sens qu’il est aussi en concurrence avec les États-Unis.
Les perspectives dans cette région du monde sont dirigées vers des tensions et des conflits de plus en plus aigus, ce qui, sans le moindre doute, va exiger la mise en place des campagnes pour embrigader le prolétariat. La propagande politique bourgeoise s’inscrit dans cette perspective. Nous pensons que le milieu internationaliste tout entier devrait débattre en profondeur sur ces questions qui s’inscrivent dans notre vision sur les tensions impérialistes.
Quelles sont les conséquences pour le prolétariat ?
Il est clair que cette crise renforce la bourgeoisie contre le prolétariat. Que Zelaya rentre ou pas dans son pays, il est clair que l’affrontement politique entre fractions bourgeoises rivales s’est déjà installé au Honduras et qu’il va se renforcer. En ce sens, c’est une source de division et de confrontation au sein de la classe ouvrière elle-même, tel que nous le voyons au Venezuela, en Bolivie, au Nicaragua et en Équateur.
Par ailleurs, la bourgeoise utilise et va utiliser la situation au Honduras pour renforcer la mystification démocratique ; du fait que celle-ci serait capable de s’autocritiquer pour assainir les institutions de l’État. Ainsi, la mystification électorale va se renforcer au niveau régional avec les prochaines élections au Honduras.
La crise va accentuer la pauvreté dans l’un des pays les plus pauvres d’Amérique centrale : l’argent que les émigrés honduriens envoient à leurs familles (autour de 25% du PIB !) a commencé à diminuer. Par ailleurs, la décomposition sociale qui condamne des milliers de jeunes à « vivre » d’agressions en bande, des crimes et de la drogue, va inévitablement s’accélérer avec la crise et la décomposition politique dans les rangs de la bourgeoise. Cette masse paupérisée est un bouillon de culture qui favorise le surgissement d’autres Chavez locaux et régionaux qui sèment de faux espoirs au sein des masses paupérisées, mais dont nous savons très bien qu’ils ne présentent pas la moindre issue.
C’est pour cela que le prolétariat hondurien, régional ou mondial et le milieu internationaliste avec lui doivent rejeter clairement tout soutien aux forces bourgeoises nationales ou régionales en lutte ; ils doivent rejeter cette confrontation induite par des conflits entre fractions bourgeoises, qui ont déjà pris pas mal de vies dans la région, des vies prolétarienne entre autres. L’affrontement au Honduras est l’expression du fait que le capitalisme s’enfonce de plus en plus dans la décomposition qui amène à des affrontements entre factions de la bourgeoisie sur le plan intérieur et entre les grandes, les moyennes et les petites puissances sur le plan régional ; ces affrontements vont être exacerbés par la crise.
Malgré sa faiblesse numérique, seule la lutte du prolétariat hondurien sur son terrain de classe, soutenu par la lutte du prolétariat régional et mondial pourra mettre un terme à toute cette barbarie.
Internacionalismo
1 Ce PPP est une proposition de “développement socio-économique” du Sud mexicain et des sept pays d’Amérique centrale pour renforcer l’intégration régionale.
2 lire, en espagnol, « El Estado "socialista" de Chavez nuevamente reprime y asesina proletarios [199] »
3 L’OEA est l’organisation des États américains, un organisme continental crée au début de la guerre froide sous le contrôle des Etats-Unis contre le bloc de l’URSS. L’adjectif « américain » doit être évidemment compris dans son sens propre, continental. Le secrétaire général de cette OEA est le chilien J.M. Insulza.
Géographique:
La classe ouvrière fait face à la crise économique partout dans le monde
- 2680 lectures
Le Fonds Monétaire International, dans ses perspectives économiques mondiales 2009, s’attend à ce que le déclin continue dans tous les pays les plus avancés. Il ne prévoit la croissance que dans des pays comme l'Inde et la Chine, mais, globalement, selon les économistes en chef : "Nous attendons maintenant que l'économie mondiale parvienne à un quasi-arrêt." Déclarer que les perspectives n’ont jamais été aussi mauvaises depuis la Seconde Guerre mondiale peut paraître assez abstrait. L'Organisation Internationale du Travail (un organisme des Nations-Unies) est très concrète dans ses dernières prévisions. En octobre dernier, elle prévoyait que 22 millions d'emplois seraient perdus dans le monde entier en 2009. En janvier, elle a révisé ce chiffre, affirmant que dans le monde entier c’est plus de 51 millions de travailleurs qui pourraient perdre leur emploi cette année. C'est un calcul simple pour visualiser sur ce que cela signifie : en moyenne, près d'un million de personnes chaque semaine se retrouvera sans travail !
Il n'y a pas d'exception. Aux États-Unis, 4 millions de salariés ont perdu leur emploi l'an dernier, près de 600 000 en janvier dernier, et 2 millions ces trois derniers mois. En Chine, au cours de la dernière année, 15,3% des 130 millions de travailleurs migrants de l’ouest vers les usines des zones côtières sont retournés dans leur foyer rural. A ces 20 millions, il convient d'ajouter tous ceux qui sont restés dans les villes pour chercher du travail. La classe dirigeante chinoise continue d'avertir de la possibilité de troubles sociaux et, plus récemment, a ajouté le danger de «violence» comme une autre issue possible de la situation économique.
Aucun travailleur n'est hors de danger, et même quand ils ont du travail, les salaires sont réduits et les conditions de travail détériorées.
Mais les travailleurs du monde entier manifestent leur refus d'accepter ces attaques : il y a chaque jour des grèves et des manifestations en Chine ; fin janvier, 2,5 millions de travailleurs en France ont manifesté, les étudiants et les jeunes travailleurs en Italie, en France, en Allemagne et surtout en Grèce sont allés dans la rue, démontrant leur rage contre une société qui ne leur offre aucun avenir. La colère exprimée par les grèves sauvages en Grande-Bretagne, dans les raffineries et les centrales électriques, ne sont pas spécifiques au Royaume-Uni, mais sont en partie une réponse internationale à l'aggravation de la catastrophe économique.
La classe dirigeante sait très bien que la classe ouvrière n’est pas restée sans répondre face aux attaques résultant de la crise économique. D'après le Daily Telegraph du 23 janvier : "La Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Grèce et l'Islande ont dû tous faire face aux troubles sociaux et aux émeutes puisque le chômage grimpe et que de nombreux pays européens ont été contraints d'imposer de sévères restrictions budgétaires. Les hauts responsables de l'UE ont déclaré au Daily Telegraph que le sommet de mars des dirigeants européens examinera de plus près les troubles que le chômage engendre dans toute l'Europe et les réductions dans les programmes sociaux."
Le fait d’apprendre que nos exploiteurs ont coordonné leur réponse à donner à notre combat doit nous rappeler que quelles que soient les causes immédiates de nos luttes, nous devons les organiser et les élargir, entraîner d’autres travailleurs dans la lutte, discuter des moyens et des objectifs de notre combat, voir si nous sommes en mesure de créer une force capable d’affronter le capitalisme.
Traduit de World Revolution, section du CCI en Grande-Bretagne
Evènements historiques:
- Crise économique [200]
La défaite à Ssangyong (Corée du Sud) montre la nécessité de l’extension de la lutte
- 2328 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
L’une des manifestations de lutte de classe les plus significatives en Corée du Sud, depuis de nombreuses années, a été l’occupation de l'usine de construction de voiture Ssangyong, à Pyeongtaek près de Séoul, qui s’est terminée début août.
Après avoir occupé l'usine pendant 77 jours dans des conditions de siège où la nourriture, l'eau, le gaz et l'électricité leur étaient refusés, et avoir résisté à des assauts répété de la police soutenue par une unité de rangers, de nervis et de briseurs de grève, les ouvriers ont été obligés d'abandonner leur occupation avec beaucoup de leurs revendications principales non satisfaites, et ils ont été immédiatement soumis à une vague de répression sous forme d'arrestations, d'interrogatoires et dans certains cas d’amendes exorbitantes.
L'économie sud-coréenne ne s’est jamais vraiment remise de l’atterrissage en catastrophe des ‘Tigres et Dragons', en 1997 - un précurseur de l’actuel krach du crédit. Depuis lors, l’ensemble de l'industrie automobile est une crise profonde. La Ssangyong Motor Company, qui est maintenant sous le contrôle d’un conglomérat de véhicules automobiles chinois, a graduellement réduit sa main d’œuvre et a proposé un plan pour offrir l'usine en garantie afin de s’assurer les prêts dont elle avait besoin pour échapper à la faillite. Ce plan impliquait beaucoup plus de licenciements - 1700 ouvriers contraints à une retraite anticipée et la mise à la porte de 300 travailleurs occasionnels - ainsi qu’un transfert de technologie vers la Chine avec l’objectif éventuel de s’approvisionner sur le marché de gros du puissant voisin de la Corée où la main d’œuvre est disponible à prix réduit.
La grève et l’occupation d'usine, qui ont commencé au matin du 22 mai, étaient accompagnées de la demande de ne licencier personne, de ne précariser personne et de ne pas s’approvisionner à l'extérieur. Pendant l’occupation, le millier d’ouvriers qui occupait l'usine a fait preuve d’un courage et d’une ingéniosité exemplaires pour se défendre contre des forces de police équipées d’hélicoptères, de gaz lacrymogènes, de pistolets paralysants et autre matériel militaire. Cette résistance a exigé non seulement la fabrication d’armes improvisées (tubes en métal, cocktails Molotov, frondes) mais également le sens de la stratégie et de la tactique de défense - par exemple, ils ont répliqué à la supériorité écrasante des forces de répression par un repli vers le département de la peinture, calculant (correctement) que les matériaux inflammables qui y étaient entreposés dissuaderaient la police d'utiliser les gaz lacrymogènes, particulièrement à la suite d'une tragédie récente à Séoul où cinq personnes sont mortes dans un incendie allumé au cours d’une confrontation avec la police.
Ces actions réclament un sens aigu de l’initiative et de l’auto-organisation. Il semble que les ouvriers s’étaient organisés en 50 ou 60 groupes de dix membres chacun, chacun de ces groupes choisissant un délégué pour coordonner l'action.
L’occupation a également inspiré des actes de solidarité de la part d'autres ouvriers, beaucoup d’entre eux de trouvant face au même avenir incertain. Les ouvriers de l'usine voisine d'automobiles de Kia-Hyundai ont été particulièrement actifs, avec des centaines d'ouvriers venant à l'usine pour la défendre contre l'attaque concertée de la police. Des tentatives pour atteindre les grilles de l’usine, et apporter de la nourriture et diverses provisions aux occupants, se sont heurtés à une violence aussi brutale que celle exercée contre les ouvriers à l'intérieur. Il n'y a aucun doute que l’occupation a été considérablement soutenue par toute la classe ouvrière coréenne - un fait qui s’est reflété dans la position de la fédération syndicale nationale, le KCTU, qui a appelé à une grève générale de deux jours et à un rassemblement de solidarité nationale fin juillet.
Quelles leçons tirer de cette défaite ?
Mais bien que certaines des mesures proposées à l’origine par les patrons aient été annulées à la fin de la grève, l’occupation s’est achevée dans la défaite. Les ouvriers sont sortis de l’occupation vaincus et meurtris, certains sérieusement blessés, et avec une certaine recrudescence des suicides parmi les salariés ou leurs familles.
« Dans les négociations finales, le secrétaire du syndicat local était d'accord avec la retraite anticipée proposée (c’est-à-dire licenciement avec concession d’une indemnité de licenciement) pour 52% des travailleurs, et avec un congé pour 48% d’entre eux pendant une année sans salaire, après quoi ils seraient réembauchés si les conditions économiques le permettaient. La société paierait également une indemnité mensuelle de 550 000 wons pendant une année à quelques ouvriers transférés sur des postes commerciaux.
Les jours suivants aux insultes se sont ajoutés les coups au cours de la période de détention, à l’encontre de nombreux d'ouvriers emprisonnés, en attendant le dressage des actes d'accusation et un procès intenté par la société contre le syndicat KMWU pour lui réclamer 500 000 000 de wons (45.000.000 $ US). Comme on l’a indiqué, la législation du travail coréenne autorise en ce cas des procès individualisés et des poursuites qui ont déjà par le passé laissé certains ouvriers sans aucune rerssource. La société réclame en la circonstance un dédommagement de 316 milliards de wons (258.6 millions de $) équivalant à une perte de production estimée à 14 600 véhicules, à cause de la grève. »1.
Ce que cette défaite démontre surtout, c’est que même si on organise au mieux la défense et l’occupation d’une usine, si la lutte ne s’étend pas, celle-ci échouera dans la grande majorité des cas. Le besoin central de tout groupe d'ouvriers confrontés aux licenciements est d'aller à la rencontre d'autres ouvriers, de se rendre dans d'autres usines et bureaux, et d’expliquer la nécessité d’une action commune, afin d'établir un rapport de forces qui peut contraindre les patrons et l'Etat à reculer. La solidarité active montrée par les ouvriers de Kia-Hyundai et d'autres à l’extérieur des grilles de l’usine prouve que ce n'est pas utopique, mais que le mouvement doit aller prioritairement vers l’extension plutôt que d’opposer une simple résistance aux attaques de la police contre une usine occupée, quelle que soit la nécessité de cette dernière. Les ouvriers qui réfléchissent à propos de cette défaite doivent poser la question : pourquoi ces authentiques expressions de solidarité ne se sont-elles pas traduites par une extension directe de la lutte, à Kia et dans d'autres lieux de travail ? Plus que cela : ces minorités militantes qui se trouvent en train de remettre en cause la stratégie des syndicats doivent se réunir dans des groupes ou des comités afin de pousser à l’extension et à l'organisation indépendante de la lutte.
Pour nous, la clef du problème est que la question de l’extension a été laissée aux mains des syndicats, pour lesquels le déclenchement de la grève fait partie d'un rituel bien rodé, avec des actions symboliques qui n’avaient absolument pas pour objectif de mobiliser un grand nombre d'ouvriers, y compris à travers leur soutien à l’occupation de Ssangyong, laissant de côté l’extension de la lutte pour mettre en avant leurs propres revendications. A l’intérieur de l'usine, le syndicat (le KMWU) semble avoir maintenu un contrôle global de la situation. Loren Goldner, qui était en Corée quand la lutte a commencé et a pu se rendre dans l'usine, raconte sa discussion avec un ouvrier qui a participé à l’occupation : « J'ai parlé à un ouvrier qui participait activement à l’occupation et qui critiquait le rôle du syndicat. D’après lui, le KMWU gardait le contrôle de la grève. Cependant, contrairement au rôle des syndicats dans la lutte de Visteon au Royaume Uni et dans le démantèlement de l'industrie automobile aux Etats-Unis, le KMWU a soutenu les actions illégales d’occupation de l'usine et de préparation à sa défense armée. D'un autre côté, dans les négociations avec la société, il s'est concentré sur la demande de ne licencier personne et il a mis la pédale douce par rapport aux demandes de sécurité d'emploi pour tous et contre l'externalisation. »
L’extension de la lutte ne peut pas être laissée entre les mains des syndicats. Elle ne peut être prise en charge effectivement que par les ouvriers eux-mêmes. Quand les syndicats soutiennent des actions illégales et quand leurs représentants locaux participent à une lutte, cela ne prouve pas que les syndicats puissent parfois être du côté de la lutte. Cela montre au mieux que les dirigeants syndicaux subalternes, comme dans le cas du secrétaire local de KMWU, sont souvent aussi des ouvriers et peuvent encore agir en tant qu'ouvriers ; mais au mieux cela sert à maintenir l'illusion que les syndicats, au moins au niveau local, sont encore des organes de lutte du prolétariat.
Goldner tire les conclusions suivantes de la défaite :
« La défaite de Ssangyong ne peut pas être seulement attribuée au rôle bancal de l'organisation nationale du KMWU, qui, dès le début, a permis aux négociations d'être canalisées vers l’objectif étroit du ‘aucun licenciement’ … La défaite ne peut non plus être entièrement expliquée par l'ambiance de la crise économique. Ces deux facteurs ont assurément joué un rôle majeur. Mais au-dessus et au-delà de leur impact indéniable, c’est le recul, année après année de la classe ouvrière coréenne, surtout à travers la précarisation, qui affecte maintenant plus de 50% de la main-d’œuvre. Des milliers d'ouvriers des usines voisines ont à plusieurs reprises apporté leur aide à la grève de Ssangyong, mais cela n’a pas été suffisant. La défaite des grévistes de Ssangyong, en dépit de leur héroïsme et de leur ténacité, ne fera qu’approfondir la démoralisation régnante jusqu'à ce qu'une stratégie se développe qui puisse mobiliser un plus large soutien, non pour livrer simplement des batailles défensives mais pour pouvoir passer à l'offensive".
Nous sommes assurément d’accord sur le fait que l'atmosphère de crise économique a certainement un effet paralysant sur de nombreux ouvriers, qui peuvent voir que l'arme de la grève est souvent inefficace quand l'usine ferme de toutes façons, et qui ont vu tellement d’occupations contre les fermetures étranglées après un siège prolongé. Le processus de précarisation joue également un rôle en atomisant la main d’œuvre, bien que nous ne pensions pas que ce soit le facteur décisif et qu’il ne s'applique certainement pas seulement à la Corée. En tous cas, c'est en lui-même un aspect de la crise, une des nombreuses mesures que les patrons utilisent pour réduire le coût de la main-d’œuvre et pour disperser la résistance.
Finalement, Goldner a raison de dire que les ouvriers devront passer à l'offensive, c'est-à-dire se lancer dans la grève de masse qui a pour objectif, à terme, de renverser le capitalisme. Mais c'est précisément la prise de conscience naissante de l’ampleur de la tâche qui, dans un premier temps, peut également inciter les ouvriers à hésiter à s'engager dans la lutte.
Une chose est certaine : la question du passage des luttes défensives aux luttes offensives ne peut pas être posée seulement en Corée. Cela ne peut qu’être le résultat d'une maturation internationale de la lutte de classe, et dans ce sens, la défaite chez Ssangyong et les leçons à en tirer peuvent apporter une véritable contribution à ce processus.
Amos (1er septembre).
1 Cette citation est de Loren Goldner qui est un intellectuel engagé d’origine américaine ayant longuement résidé en Corée du Sud. Il est l’auteur de nombreux articles traitant souvent de manière très pertinente la crise économique du capitalisme et la lutte de classe, en particulier en Corée du Sud. Il a notamment dressé ce bilan détaillé de la lutte à l’usine de Ssangyong consultable sur libcom.org. dont est extraite cette citation et les suivantes.
Géographique:
- Corée du Sud [201]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
La lutte et la solidarité ouvrières en Inde face aux attaques et à la répression
- 2641 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article réalisé par Communist Internationalist, section du CCI en Inde.
Dans la soirée du dimanche 18 octobre 2009, les ouvriers de RICO Auto, à Gurgaon, qui étaient en grève depuis le 3 octobre 2009, ont essayé d’arrêter les briseurs de grève. Les gardiens de la compagnie de sécurité et les briseurs de grève, le plus souvent des éléments criminels amenés pour intimider les ouvriers, ont répondu en attaquant violemment les grévistes. La police, qui avait été déployée aux portes de l’usine depuis le début octobre pour contrôler la grève, a ouvert le feu sur les ouvriers. Un ouvrier a été tué dans la fusillade et quarante autres blessés.
Cette répression violente a créé une vague de colère parmi les ouvriers dans la ceinture industrielle de Gurgaon-Manesar, 30 000 d’entre eux se sont engagés dans des luttes contre leurs patrons.
Cette colère s’est exprimée par le blocage des villes jumelles de Gurgaon et de Manesar le 20 octobre 2009, qui était la première journée ouvrable après le meurtre d'un ouvrier à RICO Auto. Bien que les syndicats aient appelé à la grève, les ouvriers des entreprises qui luttaient contre leur direction ont fait le tour des usines pour inviter les ouvriers à arrêter le travail. Très tôt le mardi matin, les ouvriers de RICO Auto et ceux de Sunbeam Casting ont commencé leur mouvement et ont bloqué la route nationale 8. Ils ont été rejoints par des vagues d’ouvriers d'autres sociétés comme Sona Koyo Steering System, TI Metals, Lumax Industries, Bajaj et Hero Honda MotorsLdt. Selon les déclarations officielles de l'administration locale, près de 100 000 ouvriers de 70 usines de pièces détachées dans Gurgaon-Manesar les ont rejoints le jour de la grève.
Bien que les ouvriers de la plupart des entreprises soient retournés au travail le 21 octobre 2009 et que la lutte ne se soit pas étendue, ces événements constituent une avancée significative de la lutte ouvrière en Inde. C'est le résultat de l’extension de la lutte de classe dans différentes régions de l'Inde incluant Gurgaon-Manesar, qui avait vu les ouvriers se confronter à l'Etat en juillet 2005 pendant la grève des ouvriers de Honda Motorcycles. Depuis lors, à travers de nombreuses luttes, les ouvriers ont renforcé leur résolution de combattre les patrons et ils le font de plus en plus de façon simultanée.
Les fruits amers du boom économique
Pendant toutes les ‘années du boom’ conduisant à 2007 où l'économie indienne a vu une expansion significative, la condition de la classe ouvrière n’a fait qu’empirer. L'expression la plus grave en a été la perte de la sécurité d'emploi. En dépit de l'expansion de l'économie pendant les ‘années de boom’, les patrons ont effectué la destruction massive des emplois permanents et leur remplacement par une main-d’œuvre contractuelle, accompagné de salaires très inférieurs et d’aucun salaire social. C'est le cas d'entreprises comme Hero Honda, Maruti et Hyundai, dont la production est montée en flèche de nombreuses fois pendant ces années. A Hero Honda, par exemple, la production est passée de 2 Lakhs1 à plus de 36 Lakhs, et les emplois permanents ont diminué puis disparu, remplacés par l’embauche de travailleurs temporaires. C'est la même chose dans la plupart des entreprises en Inde. Les usines d'automobiles et de pièces détachées, étant donné la concurrence à couteau tiré dans cette industrie, ont été à l'avant-garde de ces attaques sur les ouvriers. En dépit de ces attaques, pendant la plus grande partie de cette période, les ouvriers ont rencontré des difficultés pour développer leurs luttes. Les attaques impitoyables des patrons et l'incapacité de se battre, telle a été l’amère réalité pour la classe ouvrière du monde entier ces dix dernières années.
Avec l’arrivée de l'effondrement économique en 2007, la situation n’a fait qu’empirer. Tous les secteurs ont vu des suppressions massives d'emplois et des coupes franches dans les salaires et prestations. En outre, il y a eu une croissance massive des prix de tous les biens de première nécessité. Le prix des marchandises essentielles comme les légumes, les légumineuses et autres articles d’épiceries ont plus que doublé. Cette tendance n'a pas été une pointe saisonnière mais elle persiste maintenant depuis plus de deux ans. Avec la montée des prix et le gel des salaires, les conditions de vie des ouvriers ne sont devenues que plus précaires et désespérées.
Aujourd'hui, alors que les patrons parlent de la fin de la récession et de la croissance rapide de l'économie indienne, la situation ne change pas pour les ouvriers. La précarisation du travail et le gel des salaires se poursuivent.
La classe ouvrière développe sa lutte
Face aux crises et aux attaques des patrons, la classe ouvrière tente de se battre. Il y a eu des grèves importantes dans le secteur public, la grève des employés de banque, toute l’Inde a été touchée par la grève des ouvriers du secteur pétrolier en janvier 2009, par la grève des pilotes d'Air India, la grève des employés d'Etat au Bengale Occidental, la grève du personnel gouvernemental en janvier 2009 dans l’Etat de Bihar. Certaines d’entre elles ont été d’âpres conflits où l'Etat a essayé de frapper durement les ouvriers et de les écraser. Ça a été le cas avec la grève des ouvriers du pétrole en janvier 2009 quand l'Etat a utilisé ESMA2 et d'autres lois pour écraser les employés et a pris des mesures répressives. Ça a également été le cas avec la grève du personnel gouvernemental au Bihar où le gouvernement a voulu donner une leçon aux employés. Pour ce qui est des ouvriers du pétrole, le gouvernement s’est montré encore plus répressif car il y avait une menace d’extension de la grève à d'autres entreprises de secteur public.
Comme leurs camarades des secteurs publics, les ouvriers de nombreux autres secteurs ont combattu. Une des luttes massives et radicales a été celle des ouvriers diamantaires au Gujarat en 2008. La majorité de plusieurs centaines de milliers d’ouvriers diamantaires est employée dans des petites entreprises où les syndicats n'ont aucun contrôle. La grève y a débuté et s’est étendue comme une révolte massive qui a submergé plusieurs villes : Surat, Ahmedabad, Rajkot, Amerli etc. Systématiquement, l'Etat a recouru à la répression pour maintenir l'ordre dans toutes ces villes.
En outre, toutes les principales unités automobiles en Inde - Tamilnadu, Maharashtra, et Gurgaon-Manesar ont été témoins des efforts répétés et tenaces des ouvriers pour lutter pour leur travail et leurs conditions de vie.
Les ouvriers de la deuxième plus grande fabrique de voitures en Inde, Hyundai Motor à Chennai, ont fait grève à plusieurs reprises en avril, mai et juillet 2009 pour de meilleurs salaires. Les patrons tentent depuis longtemps de réprimer les luttes des ouvriers et menacent souvent de fermer leurs usines en Inde. Près de Coïmbatore, les ouvriers du fabricant de pièces auto Pricol India ont combattu les patrons depuis plus de deux ans contre les licenciements planifiés et répétés des ouvriers permanents et leur remplacement par des contractuels ou des travailleurs temporaires. La lutte ouvrière a pris récemment un tour violent quand la direction a licencié 52 ouvriers permanents supplémentaires et a décidé de les remplacer par des travailleurs précaires en septembre 2009. Au cours d’une violente confrontation, un cadre supérieur de Pricol a été tué le 22 septembre 2009. Les ouvriers des usines de pneus de MRF et des usines Nokia à Tamilnadu se sont aussi engagés dans des luttes contre leurs patrons à peu près au même moment.
Dans l’Etat de Maharashtra, les ouvriers, de Mahindra à Nasik, ont fait grève pour de meilleurs salaires en mai 2009. Les ouvriers de l’usine Cummins India et ceux de la fabrique de pièces auto Bosch à Pune ont été en grève à partir des 15 et 25 septembre 2009 pour de meilleurs salaires et contre la précarisation.
Simultanéité des luttes et du développement de la solidarité de classe
Ce que nous voyons aujourd'hui, c’est que de plus en plus d’ouvriers sont disposés à entrer en lutte contre les attaques des patrons. Les luttes, tout en étant plus nombreuses dans une grande partie du pays, ont aussi tendance à aller vers la simultanéité dans un même secteur géographique. Ceci ouvre la possibilité de liens entre les luttes et de leur extension. On a pu le voir avec la grève massive des ouvriers diamantaires au Goudjerate où se sont simultanément développées des grèves sauvages dans plusieurs villes. On a pu le voir aussi dans les grèves des ouvriers de l’automobile à Tamilnadu, Pune et Nasik où plusieurs grèves dans le même secteur géographique se sont produites en même temps. Dans d'autres cas, la bourgeoisie a pu sentir cette menace et anticiper sa répression. Cette simultanéité est le résultat d’attaques identiques auxquelles tous les secteurs ouvriers se confrontent aujourd'hui.
Avant les derniers événements, les ouvriers d'un certain nombre d'usines de Gurgaon-Manesar avaient mené la lutte contre leurs patrons. A Honda Motorcycles, les ouvriers se sont agités depuis plusieurs mois pour de meilleurs salaires et contre le travail contractuel. Pour ce qui est de la direction, cette agitation a réduit la production de 50% et a bloqué le démarrage d'une nouvelle série. Pour intimider les ouvriers, le 10 octobre 2009 la direction de Honda Motorcycles a émis la menace d'arrêter ses usines en Inde ou de les déplacer dans d'autres régions. 2500 ouvriers de RICO Auto se sont mis en lutte contre le renvoi de 16 ouvriers et pour de meilleurs salaires depuis la fin septembre 2009. Ils ont commencé la grève à partir du 3 octobre 2009. 1000 ouvriers de Sunbeam Casting se sont aussi mis en grève pour de meilleurs salaires à partir du 3 octobre 2009. Bien que tous ne se soient pas mis en grève, plus de 25 000 ouvriers des métaux de TI Metals, Microtech, FCC Rico, Satyam Auto et de plusieurs autres entreprises ont fait de l’agitation depuis septembre 2009 pour de meilleurs salaires.
Selon un bulletin de Business Line3, daté du 2 octobre 2009, « avec un total d’environ 30 000 ouvriers des unités auxiliaires automobiles dans la ceinture de Gurgaon-Manesar qui s’agitent maintenant depuis environ six jours, les principaux constructeurs automobiles dépendant de ces unités pour leur approvisionnement en composants traversent une dure période. » Exprimant le souci des patrons, Economics Times4 rend compte sur son site Web le 11 octobre 2009 : « Les problèmes récurrents du travail dans la ceinture de Gurgaon et de Manesar est en effet un souci pour toute l'industrie. Les problèmes actuels à certains… des fournisseurs... ont affecté les approvisionnements des principaux constructeurs automobiles comme Hero Honda et Maruti Suzuki... »
Le fait que les ouvriers de plusieurs usines se soient mis en grève et que plusieurs milliers d'ouvriers d'autres usines se soient activement agités a ouvert la possibilité de l’extension et de l'unification des luttes, la seule façon pour les ouvriers de pouvoir combattre et repousser les attaques des patrons. C'est la possibilité que la bourgeoisie craint et que les syndicats veulent éviter. Dans les luttes de Gurgaon, face à la violence faite à la classe ouvrière avec le meurtre d'un ouvrier de RICO, le rôle des syndicats a été de prévenir et de bloquer cette tendance à l’extension et à l'unification. En appelant à une journée d’action, les syndicats ont essayé de stériliser l’impulsion des ouvriers de se rassembler et d’exprimer leur solidarité de classe. Malgré cela, la grève du 20 octobre de 100 000 ouvriers a été une manifestation de solidarité. Elle a également exprimé leur détermination et leur volonté de combattre et de se confronter à la bourgeoisie.
D'un autre côté, dans les luttes actuelles de Gurgaon, pendant les luttes chez Hyundai, Pricol, M & M et d’autres luttes pour de meilleurs salaires et contre les pertes d’emploi, les syndicats ont clairement essayé de les faire dérailler et de les convertir en luttes pour la défense des droits syndicaux.
Sans aucun doute, il existe une puissante dynamique pour le développement de la lutte de classe, pour son extension et pour le développement de la solidarité. Mais pour la réalisation de cette dynamique, il est important que les ouvriers comprennent les machinations des syndicats et prennent les luttes en leurs propres mains.
AM, 27 octobre 2009
1 Unité de mesure indienne (1 Lakh est égal à 100 000 roupies, soit 1700 euros).
2 Loi sur le maintien des services essentiels.
3 Journal financier et des affaires.
4 Idem
Géographique:
- Inde [202]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Le Front “Farabundo Marti de Libération Nationale” (FMLN), de la guérilla stalinienne au gouvernement du Salvador
- 4068 lectures
Le texte publié ci-dessous est une traduction de Revolución Mundial, organe de presse du CCI au Mexique.
Depuis la signature des accords de paix entre le FMLN 1 et le gouvernement du Salvador en janvier 1992 qui certifia la reconversion de ce mouvement de guérilla, autrefois très connu, en parti politique légal d’opposition, avec à la clé une large participation au sein de la police nationale, cette fraction de la bourgeoisie s’est employée à fond dans la construction d’une démocratie « plurielle » si nécessaire pour contrôler la classe ouvrière, et qui était inexistante au Salvador, à l’instar d’une grande partie de l’Amérique Latine. Maintenant, les ex-guérilleros avec leur candidat Mauricio Funes 2 se présentent comme la meilleure alternative électorale pour les prochaines élections présidentielles du 15 mars 2009 face au candidat Rodrigo Ávila du parti de droite Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 3. Un marketing coloré, des discours pleins d’espoir, des actes massifs de prosélytisme, avec des milliards à la clé, voilà le cadre qui doit servir à cette gauche électorale à entraîner le plus grand nombre de travailleurs vers les urnes avec l’illusion que “leur voix” réussisse le miracle d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le contexte économique et social du pays (avec une population d’un peu plus de 7 millions d’habitants) 4 est similaire à celui des autres pays de cette région du monde ; la dégradation des conditions de vie des travailleurs n’est pas seulement insupportable à cause de la misère matérielle et de la réduction alarmante des ressources et l’augmentation imparable du chômage, mais aussi à cause d’une décomposition sociale qui dépasse l’entendement, qui affecte la société tout entière : une violence quotidienne entre bandes, des assauts et des kidnappings, des abus de la part de la police et de l’armée, etc. 5 Devant un tel panorama, la bourgeoisie prétend que, grâce au vote de tous les secteurs du pays, un engagement national va naître pour travailler coude à coude vers une solution.
Après s’être occupé des tâches de pacification et de réorganisation de l’économie, de la politique, de l’appareil répressif, maintenant les ex-guérilleros se lancent à la conquête du fauteuil présidentiel pour boucler l’engagement qu’ils ont signé il y a dix-sept ans au château de Chapultepec 6 dans la ville de Mexico ; selon les mots de Schafik Handal, le rôle du FMLN était de : « ...moderniser l’État et l’économie, construire un pays pluraliste... qui permette aux salvadoriens d’utiliser à fond leur proverbial goût du travail et leur créativité pour ainsi faire décoller le développement... » (16 janvier 1992). Autrement dit, renforcer l’économie bourgeoise grâce à l’exploitation peut-être « créative », mais surtout impitoyable de la classe ouvrière, en prenant la charge de garde chiourme principal du système d’exploitation capitaliste.
Le FMLN, hier et aujourd’hui, un instrument au service du capital
Le FMLN « n’a pas trahi ses origines et ses objectifs révolutionnaires ». Son action actuelle est en effet en continuité avec celle de ses origines, son idéologie et sa pratique de guérilla durant près de douze ans. Son origine et son idéologie sont celles des « Forces populaires de Libération nationale », et d’autres organisations qui, avec le Parti communiste salvadorien, stalinien pur sucre, construisirent un cocktail d’organisations paysannes et urbaines très influencées et inspirées par la prétendue « révolution cubaine » ; leurs étendards étaient celles de la « récupération » de la terre ou la démocratisation du gouvernement contre la fraude électorale ou la dictature militaire. Déçues par la légalité et réprimées par l’État, elles décidèrent d’assumer la lutte de guérilla. En fin de compte, leur action est celle de la petite bourgeoisie qui, en Amérique latine, a essayé de « remettre en place un projet de développement national contre les fractions nationales apatrides et l’impérialisme américain ». Leur naissance se trouve complètement en dehors du terrain du mouvement ouvrier : leur programme est la lutte pour le « renversement de la dictature néo-fasciste ». Même s’ils veulent établir un « gouvernement de type socialiste-révolutionnaire », ce n’est, concrètement dans la réalité des faits, que le même scénario que celui écrit par le sandinisme au Nicaragua : la défense pure et simple du régime bourgeois et de l’économie nationale. 7
La pratique politique du FMLN est pleinement celle de la bourgeoisie : la guérilla exprimait l’action typique des couches et des classes sans avenir, des actions armées minoritaires qui prétendent, souvent en désespoir de cause mais aussi aux ordres d’un camp impérialiste qui veut affaiblir le camp dominant dans la région, remplacer l’action des travailleurs, une action consciente et massive. Le rôle actuel du FMLN, en tant que parti de gauche au sein de l’appareil d’État, est parfaitement cohérent avec son passé. Il n’existe ni « trahison » ni « dévoiement » de son « essence » ; le FMLN n’a fait que s’adapter aux temps nouveaux pour continuer à servir le capital.
Le FMLN, comme les Sandinistes au Nicaragua, a négocié son futur politique pour ne pas disparaître de la scène
La chute du bloc impérialiste de l’URSS laissa dans un état d’abandon une multitude de mouvements de guérilla en Amérique Latine, ainsi qu’ailleurs dans le monde et même des pays entiers comme Cuba. Voilà le contexte qui explique les négociations de paix entre le FMLN et le gouvernement du Salvador avec la médiation des pays comme le Mexique qui essayent aussi de jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle configuration du monde et dans l’arrière cour de l’Oncle Sam. 8 Avec la disparition du sponsor économique, militaire et idéologique du bloc russe, les farabundos décidèrent de négocier pour ainsi s’assurer leur survie dans la recherche de la prise du pouvoir, même si, alors, cela devait se faire dans un cadre d'une participation au jeu parlementaire. En fait, à quelques différences près, c’est le même schéma qui s'est produit avec les Sandinistes au Nicaragua : ceux-ci ont instauré un gouvernement de gauche à la suite d’un putsch militaire (1979), mais ils décident de s’entendre avec leurs rivaux à travers la négociation d’un processus électoral, à la suite d’une décennie de « guerre de basse intensité » (1980-1990) et d’être passés dans l’opposition. 9
Les luttes de libération nationale ou l’affrontement entre les grandes puissances par groupes interposés pendant la Guerre froide
L’auréole romantique des guérillas en Amérique latine, surgies en particulier pendant la période de la Guerre froide après la Seconde Guerre mondiale, pâlit face à l’évidence historique : elles n’ont été que des simples pions sous la coupe du bloc stalinien. L’ancienne URSS, tête de bloc, avait toujours voulu planter quelques lances dans l’arrière-cour des États-Unis, pour renforcer le rôle de Cuba qui était sa tête de pont. Même s’il était impossible pour l’URSS de disputer sérieusement le leadership à la puissance américaine, il lui était toujours avantageux de maintenir une certaine instabilité dans sa chasse gardée, pour ainsi l’obliger à prélever des ressources, des efforts militaires, etc., des zones stratégiques du monde où se jouaient véritablement les intérêts géopolitiques des blocs impérialistes. La politique extérieure des États-Unis pendant toute cette période leur a été pleinement favorable en faisant échouer toutes les tentatives et en réduisant le risque à la seule île « mythique » de Castro.
Pour la classe ouvrière, ces affrontements ne furent qu’une suite de sacrifices monstrueux, enfermée qu'elle était entre deux factions de la bourgeoisie, utilisée systématiquement comme chair à canon pour la défense des intérêts de ses propres exploiteurs. Et lorsque certaines de ces forces de libération nationale ont réussi à atteindre le pouvoir d'État, l’expérience fut tout aussi tragique. Ces champions du nationalisme organisèrent les institutions de l’État derrière un masque socialiste et populiste pour convaincre les ouvriers d’accepter encore plus de sacrifices sur l’autel de l’économie nationale. Et quand les travailleurs ont pu se mettre en lutte contre ces conditions de surexploitation, ces régimes se sont chargés de l'en empêcher et de la briser avec la pire violence.
C’est une longue histoire que celle de ce genre d’organisations prétendument « amies » des travailleurs. Ce que nous voyons aujourd’hui au Salvador est l’énième démonstration du caractère bourgeois non seulement de l’idéologie de ces organisations, mais aussi de leur programme et de leur pratique « guérillériste ». Pendant des années cette pratique a stérilisé les énergies ouvrières, de tant de jeunes paysans et prolétaires qui se sont enrôlés dans leurs rangs, sur un terrain complètement pourri. Et aujourd'hui, ils jouent toujours le même rôle de promoteurs de la démocratie électorale bourgeoise, et redorent le blason du vote grâce à leur « passé glorieux » d’héritiers de la vieille « voie armée », devant l’épuisement accéléré des vieux partis qui fait que la bourgeoisie connaît le plus grand mal à entraîner les travailleurs vers les urnes.
Tous ces éléments de réflexion doivent être présents chez les prolétaires du monde entier. Les masses exploitées d’Amérique centrale ont été prises pendant toutes les années 1980 dans l’étau économique, militaire et idéologique formé par des gouvernements de droite et la guérilla. Les générations qui ont subi ce joug contre-révolutionnaire, ainsi que les ouvriers des générations plus jeunes, doivent tirer les leçons de ce passé, en reconnaissant le caractère bourgeois du FMLN, avec tout son masque et ses discours radicaux, avant et aujourd’hui, en tant que parti d’opposition et, peut-être de gouvernement.
Revolución Mundial, section du CCI au Mexique, février 2009
1 Ce “Front” fut fondé à la fin de 1980, prenant le nom d’Agustín Farabundo Martí, un des organisateurs du soulèvement paysan et indigène de 1932 dans lequel participa aussi le stalinisé Parti communiste du Salvador.
2 C’est un journaliste “indépendant” très populaire qui n’appartient pas au FMNL. C’est un fait très répandu et pratiqué par tous les partis, de droite, de centre ou de gauche, qui mettent en avant des comiques, des vedettes en tout genre, des très respectables leaders d’opinion, etc., pour essayer de convaincre de leurs meilleures intentions.
3 Ces élections du 15 mars (au moment où nous traduisons cet article), ont été remportées par le candidat du FMLN. (NDT).
4 En fait, près de 3 millions des salvadoriens vivent aux USA. Les envois de ces émigrants représentent la deuxième ressource dans le PIB d’un des pays les plus pauvres de l’Amérique Latine. Dans le contexte actuel, cette ressource va se contracter.
5 C’est bien simple : Le Salvador est le pays latino-américains avec le taux le plus élevé de morts violentes.
6 Les Accords de Paix de Chapultepec furent signés le 16 janvier 1992 entre le Gouvernement pro-américain du Salvador et le FMLN qui ont mis fin à douze années d’une guerre civile particulièrement sanglante (100 000 morts).
7 Voir dans Revolución Mundial nº 19, 1994, « Guerrillas en América Latina. Un instrumento de la burguesía, no del proletariado ».
8 On peut rappeler le groupe « Contadora » né en 1983, au sein duquel il n’y avait pas que les intérêts impérialistes des grandes puissances qui comptaient, mais aussi ceux des petits requins de la région comme le Mexique, la Colombie, le Venezuela et même le Panama.
9 À la suite des élections en 2006, ces mêmes sandinistes sont revenus au pouvoir. Voir Revolución Mundial nº96 (2007). « Nicaragua: regresan los sandinistas al gobierno para dar continuidad a la explotación y opresión ».
Géographique:
Le boom économique indien : Illusion et réalité
- 6285 lectures
Ce texte est la traduction d’un article publié en langue anglaise sur notre site web et réalisé par Communist Internationalist, organe du CCI en Inde.
Il a été rédigé en novembre 2008, c’est-à-dire juste avant que la crise économique mondiale ne vienne frapper à son tour de plein fouet toute l’Asie. Néanmoins, en expliquant quels sont les ressorts du fameux “boom économique indien”, cet article montre à quel point cette croissance était bâtie sur du sable et qu’elle ne faisait que participer à la préparation de la brutale récession mondiale actuelle.
La partie indienne de l’économie capitaliste est en train de se développer de manière éblouissante, nous disent la bourgeoisie en Inde et dans le monde ainsi que les professeurs d’économie. Il existe bien sûr une certaine réalité derrière ces lueurs aveuglantes. L’économie indienne a connu un taux de croissance de 9,6% selon les estimations de 2006/2007 faites par la CIA dans le World Fact Book. Il est presque équivalent à celui de l’économie chinoise. Selon un rapport paru sur Indianbooming.com, « les principaux secteurs de croissance en l’Inde sont la technologie d’information (IT), l’ITES et le BPO1, l’industrie pharmaceutique, la technologie, l’immobilier et la vente au détail de même que les secteurs de la chimie et de l’alimentaire. La mode du shopping, les grands magasins, les hypermarchés, et le commerce de détail se développent en Inde et la présence de marques provenant du monde entier montrent leur vif intérêt à implanter des usines de fabrication en Inde ». Selon un rapport paru dans Business World du 12 mars 2008, journal populaire largement répandu de la bourgeoisie indienne, « l’augmentation des produits manufacturés et des services était de plus de 11% en 2006/2007. L’agriculture n’a augmenté que de 2 à 3%”. Le rôle le plus important dans cette croissance a été joué par le secteur des services qui compte pour plus de la moitié du Produit Intérieur Brut de l’Inde. C’est aussi le secteur de l’économie qui croît le plus vite. Les services d’affaires (IT, ITES – Information Technologie Enabled Service – et BPO – Business Processing Outsourcing) sont parmi les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide, contribuant au tiers de la poussée totale des services. IT compte à son actif pour 1% du PIB ou 1/50e des services. Selon le World Fact Book de la CIA, ce secteur se partageait 55% du PIB en 2007 contre 15% en 1950. Il emploie 23% de la force de travail totale. D’après la même source, l’agriculture et les secteurs affiliés ne représentaient que 16,6% du PIB en 2007 en employant 60% de la force de travail totale. Ce rapport établit que la production industrielle a représenté 27 ,6% du PIB la même année pour 17% des salariés.
Si la croissance du PIB mondial était comparée avec celle du PIB indien, ce dernier présenterait évidemment un aspect très brillant comparé à la baisse de la croissance mondiale, qui est estimée à 3,7/3,8% pour 2008/2009. Business Work du 5 mai 2008 rappelle que “les dernières estimations de 3,7 ou 3,8% de croissance prévues pour 2008/2009 sont plus basses d’un point depuis janvier de cette année ».
Il y a eu une croissance très rapide de l’automobile et des deux roues. L’Inde a encore connu un essor dans les secteurs des composants automobiles, de la chimie, de l’habillement, des produits pharmaceutiques et de la joaillerie. On a aussi vu un développement considérable de la construction et de l’immobilier, ainsi que des infrastructures et l’expansion du réseau ferroviaire. De nombreuses autoroutes et voies expresses ont été construites ces derniers temps.
Les causes de la croissance :
1) L’afflux de capitaux étrangers
Selon l’économiste en chef de la Kotak Mahindra Bank dont les propos ont été rapportés dans Business World du 12 février 2008 : « Une grande partie de la récente croissance de l’Inde a été due aux les liquidités fournies par les FII (Foreign Institutional Investors). » Ce point de vue est renforcé par l’affirmation d’un grand patron des opérations indiennes de la Morgan Stanley, pour lequel un facteur clé dans cette croissance accélérée a été l’augmentation en flèche des apports de capitaux en réponse à l’appétit global pour les investissements à risque). Il affirme : « Sur les cinq dernières années, les ménages et le gouvernement ont bu cette liquidité comme du petit lait, augmentant la dette du PIB de 20% qui ont soutenu l’accélération de la croissance du PIB. » L’afflux d’investissement étranger direct (FDI : Foreign Direct Inverstissement) en Inde a atteint un record de 19,5 milliards de dollars durant l’année fiscale 2006/2007. Cela représentait plus du double de l’année précédente. Et ce flux de capitaux serait de 25 milliards de dollars pour 2007/2008.
Les réformes de la politique industrielle des années 1990 ont substantiellement simplifié les règles en matière de licenciements, levé des restrictions à l’expansion et facilité l’accès à la technologie étrangère et à l’investissement venant de l’extérieur. En mars 2005, le gouvernement a autorisé 100% d’investissement venant de l’étranger dans le secteur de la construction et dans d’autres secteurs.
2) La croissance du secteur des services
La croissance exceptionnelle du secteur des services a été alimentée par une augmentation de la demande des consommateurs étrangers intéressés à l’exportation des services vers l’Inde et ceux qui cherchent à externaliser et sous-traiter leurs opérations. « L’Inde a émergé comme une importante destination de ’back office’ (ceci est une référence à toutes les fonctions administratives d’une entreprise) pour l’externalisation globale de services à la clientèle et d’aide technologique. » (BW du 12 février 25007). Selon une étude publiée dans The Statesman du 6 octobre 2008, « L’Inde, qui accueille six des centres d’externalisation principaux du monde, continue d’être une destination d’externalisation globale majeure pour la technologie d’information face à une volonté déterminée de la Chine de la concurrencer dans ce domaine. » Comme le secteur des services compte pour plus de la moitié du PIB total (entre 53 et 55%) et que l’IT, l’ITES et le BPO jouent le plus grand rôle dans la croissance du secteur des services, le récent boom indien est significatif de la montée phénoménale de la « révolution de la technologie de l’information ». C’est ce qui a fait dire au précédent président de la direction générale de Procter and Gamble India que « la croissance indienne est unique. » (BW du 12 février 2007). D’après le directeur de la recherche globale des marchés de la Deutsche Bank, « la trajectoire de la croissance de l’Inde a été unique. La voie traditionnelle asiatique est de démarrer avec des produits de basse technologie comme des jouets et des matériaux tout faits et ensuite de monter en complexité avec des produits comme l’automobile ou l’électronique. La trajectoire de l’Inde a consisté à utiliser les compétences de la classe moyenne éduquée pour « booste »r les services informatiques l’aviation, les banques, les hôtels, les télécommunications, etc. (BW du 12 février 2007) Différentes explications ont été mises en avant par les économistes en vue. Un économiste en chef à CRISIL (Credit Rating and Information Services of India Ltd., principale société indienne de conseils en matière d’investissements en tous genres) a montré que lorsque l’Asie de l’Est a commencé à se développer, il n’y avait aucun instrument significatif pour exporter des services et les pays de cette partie du monde étaient contraints de mettre l’accent sur la manufacture. Selon lui, l’Inde a manqué ce train et ouvert son économie au moment où la demande pour les services augmentait. « La fixation sur les services fut l’effet d’une coïncidence et il n’y avait pas de stratégie économique planifiée dans le sens de l’augmentation du poids des services. » (ibid.) Cela est très significatif dans la compréhension de l’explosion tout à fait soudaine de ce secteur dont on peut dire qu’il a joué le rôle de locomotive de la croissance indienne.
Une économiste spécialiste des marchés globaux de la Standard Chartered Bank a montré que le manque d’infrastructure a été un facteur conduisant les entrepreneurs à préférer les services à la manufacture. Pour elle, « le secteur privé a découvert qu’il pourrait mieux faire dans les services ». Cela est aussi très important pour comprendre la réalité interne actuelle de l’économie indienne et son boom impressionnant.
Tout ceci peut amener à penser que ces développements frappants et le haut niveau des services dans le PIB annonce l’ouverture d’une économie développée ; et certains secteurs de la bourgeoisie indienne et de l’appareil politique y souscrivent avec suffisance et arrogance. Mais le conseiller économique du groupe Tata vient apporter une ombre au tableau. Pour lui, « l’expansion de la part du secteur des services n’indique pas que l’économie est évoluée. La part des services au Bengladesh est de 52% et de 66% au Sénégal ». (ibid.)
Une force de travail compétente et efficace mais pauvre se trouve à la racine de cette croissance dans la sphère des services et de l’externalisation. Elle est aussi à l’origine de la demande grandissante en informatique, en technologie d’information de nombreux pays ; et l’Inde a maintenant un avantage compétitif dans ce domaine. Comme dans celui de la fabrication, « la capacité de produire de petites voitures à des prix plus bas qu’en Corée a aidé l’usine Chennai de Hyundai Motor India à devenir le pivot de production de la Santro de Hyundai Motor. Maruti Suzuki s’est établi comme producteur concurrentiel et exporte des véhicules comme l’Alto et la Switch vers l’Europe et d’autres marchés mondiaux. » (BW du 20 août 2007) Cela indique clairement la validité d’un réservoir de main d’œuvre compétente, efficace et pauvre en Inde ; tout cela attire les capitaux étrangers pour venir exploiter cette source d’extraction de plus-value qui les rendra compétitifs et fournira des profits. Le directeur général de la banque ICICI souligne la « tendance parallèle au nombre grandissant de compagnies choisissant l’Inde comme centre global de fabrication et de sourcing2(…) Elles ont très bien vu l’avantage de l’Inde comme base manufacturière » Il affirme plus loin que “l’aspect important de notre développement économique est l’émergence de capital connu comme le facteur clé de la croissance... C’est une clé de la réalité économique et a résulté dans l’augmentation du revenu des foyers et a stimulé la croissance dans la demande des consommateurs qui a son tour a fouetté la production industrielle. (ibid.)
Ceci renforce de plus l’idée d’un vaste champ de main d’œuvre compétente et pauvre à l’origine de la croissance dans cette partie du monde. Un point de vue similaire s’exprime dans le World Fact Book de la CIA qui affirme que la population de la classe moyenne comptant 300 millions de personnes représente un puissant marché pour la consommation. Il ajoute que l’Inde possède un vaste bassin d’experts techniques et managériaux compétents. Cela a constitué un facteur important de la croissance très impressionnante du secteur immobilier.
3) L’utilisation de la dette
La baisse des taux d’intérêts par la Reserve Bank (la banque centrale du gouvernement indien) de 12/12,5 en 2001 à 8,5 en 2004/2005 a accéléré la demande de construction et de crédits à la propriété, ainsi que du crédit à la consommation comme les réfrigérateurs, les automobiles, les motos et autres deux roues. Il est bien connu que lorsqu’il y a un manque de demande suffisante pour les produits capitalistes, indiquant une crise à venir, l’Etat capitaliste intervient dans l’économie avec différentes mesures comme une action à la baisse ou à la hausse du coût du crédit, sauvant des pans financiers importants de la faillite grâce à une provision d’énormes masses de crédit bon marché provenant des banques centrales, modifiant les taux de change monétaires, ou par la mise en œuvre de différentes prescriptions keynésiennes. La création artificielle de la demande par le crédit bon marché est un moyen très largement utilisé dans cette période de décadence du système capitaliste.
La croissance de l’économie américaine des années précédentes a été soutenue à bout de bras par des crédits venant à la fois de fonds privés et du gouvernement. Le gouvernement indien a aussi suivi les traces de la bourgeoisie américaine et d’autres bourgeoisies développées du cœur du capitalisme. Il revient au crédit bon marché d’avoir joué un rôle important dans la croissance de la demande et donc dans la croissance de l’économie. L’augmentation des dépenses d’Etat, à la fois dans les sphères productives et non productives, contribue à l’augmentation future de la consommation. Ces dernières années, le gouvernement indien a dépensé des sommes énormes dans le secteur du développement d’infrastructures. Certains rapports estiment que les dépenses improductives ont été multipliées par dix depuis 1985/1986 et que les dépenses militaires l’ont été par quatre au cours de la même période. Dans l’année fiscale présente, le gouvernement a annoncé une dette de 700 000 roupies, soit presque 15,6 milliards de dollars, pour les paysans en raison de considérations politico-économiques. Tout cela a bien sûr ajouté à la taille du marché mais aussi à la taille du déficit du budget année après année. Il en est résulté une élévation de la dette publique qui « aujourd’hui est de 31 070 510 millions de roupies (soit 690,5 milliards de dollars) ». (BW du 20 août 2007)
Selon un professeur d’économie de la plus prestigieuse université de l’Inde, « le pays se trouve aujourd’hui dans le piège de l’endettement (où la plupart de ses emprunts est consacré au paiement des intérêts mais pas au principal ». (BW du 4 juin 2007) Aussi, bien que cette croissance de l’économie indienne soit impressionnante, elle est très différente de la nature de celle de l’économie capitaliste au 19e siècle.
La politique agressive de marketing des entreprises produisant des biens de consommation durables, permettant d’acheter avec des traites acceptables, a aussi été un facteur d’accélération de la demande qui, en retour, a conduit à une accélération de la croissance. Cela constitue un marché massif et toutes les fractions du capital national et international sont impliquées dans une compétition à mort pour exploiter ce marché.
La taille du marché indien de détail est de 230 milliards de dollars (BW du 9 avril 2007). En 2008, elle est de 295,6 milliards de dollars. D’après un rapport publié dans The Stateman du 29 septembre 2008, « il est prévu que le secteur de détail du pays va augmenter jusqu’à 700 milliards de dollars en 2010, tandis que celui des affaires atteindra 20% du marché mondial en 2010 ». Les grandes entreprises, nationales aussi bien que les multinationales, ne laissent aucune pierre non retournée pour faire sentir leur présence et dominer ce marché. Les confrontations entre les détaillants et les grandes entreprises sont en augmentation. La majorité écrasante des gens engagés dans ce commerce de détail partout en Inde sont des petits-bourgeois propriétaires de commerces et de magasins, et constituent un marché de taille pour les produits capitalistes.
4) L’expansion aux marchés ruraux
De plus, l’Inde rurale a une population de 700 millions. Un rapport de BW du 20 août 2007 considère que « la capacité de faire des affaires dans l’Inde rurale est en train d’augmenter radicalement. Les villages deviennent liés à des changements dans la technologie de la production agricole et à ce qui s’y rattache ». Il s’est produit une intégration presque générale et une interdépendance entre l’industrie, la finance et l’agriculture. La production agricole est à présent devenue de façon prédominante une production pré-capitaliste de biens. Le développement de l’infrastructure rurale et l’intégration aux centres commerciaux augmente. Le gouvernement indien a porté une attention particulière à la construction de voies ferrées dans les zones agricoles. Il a amené les banques à proposer des crédits peu chers pour ce secteur et mis en œuvre un cadre de garantie de l’emploi pour cette population. Comme le directeur de la recherche en marché global de la Deutsche Bank l'a signalé au monde des affaires : "il faut penser à des salons de beauté à la campagne et à des projets d’infrastructure de transport plutôt qu’aux logiciels dernier cri de l’industrie des jeux informatiques." (BW du 12 février 2007)
L’importance du marché rural qui est restée de façon prédominante pré-capitaliste a été comprise par l’élite capitaliste.
Il existe en outre un nombre grandissant d’agents de grandes entreprises de l’assurance, de la banque, de produits pharmaceutiques et d’autres secteurs. Selon certaines estimations, il y aurait près de 1,1 million d’agents de la Life Insurance Corporation of India (la plus grande compagnie d’assurance de l’Inde) à elle seule. La plupart des gens tirent leurs revenus des services de transport comme producteurs pré-capitalistes et vendeurs de services. Un nombre très important d’hommes de loi ont un mode de vie petit-bourgeois. Il existe de nombreux agents à la fois dans le marché de gros et dans d’autres tels que l'immobilier, en quête de maisons à louer dans les centres urbains, etc. Tout cela réuni constitue un marché considérable pour le secteur capitaliste. Le marché total disponible à l’intérieur des frontières nationales indiennes a joué un rôle très important dans la réalité actuelle du boom indien.
Certains économistes et chercheurs en économie affirment qu’une grande partie de la demande dans les pays de l’Asie de l’Est vient des exportations vers le monde développé, alors qu’en Inde la plus grande part de cette demande est basée sur la croissance de la consommation domestique. Le rapport de la World Bank sur les indicateurs du développement mondial montre que l’exportation des marchandises et des services ne constitue que 19% du PIB alors qu’elle est de 34% pour la Chine et de 44% pour la Corée.
Les limites inhérentes au capitalisme
Le système capitaliste mondial peut augmenter la production autant qu’il veut mais il ne peut pas augmenter de la même façon et au même niveau un marché indispensable. Marx a affirmé que la production s’accroît en progression géométrique mais que le marché augmente dans une progression arithmétique. Aussi il y a toujours une cassure entre le volume de la production capitaliste et le volume du marché capitaliste disponible. Le capitalisme est intrinsèquement incapable de combler ce décalage lui-même. L’environnement pré-capitaliste lui procure cet indispensable secours. Mais à mesure que le capitalisme avance, il intègre les secteurs pré-capitalistes dans sa propre sphère les uns après les autres, et coupe ainsi la branche sur laquelle il est assis. De vigoureux efforts pour une exploitation future des marchés extra-capitalistes accompagnent cette situation mais au cours du temps le marché devient relativement saturé, ce qui a été le cas depuis les années 1960..
La production capitaliste est dirigée essentiellement vers le marché, le profit et l’accumulation. Mais le marché devient de plus en plus incapable d’absorber la production capitaliste globale. Ceci conduit inévitablement à une intensification ultérieure de la compétition et des conflits entre toutes les fractions nationales. Chaque pays capitaliste sans aucune exception devient impérialiste pour sa survie comme fraction du capital. Chaque pays recourt à différentes mesures capitalistes d’Etat pour rester à flots : la dette publique et privée, la tricherie avec la loi de la valeur, le contrôle du marché, la manipulation des réserves monétaires, les taux des prêts bancaires, les taux d’échange, etc. Récemment, les pays capitalistes principaux ont appelé et imposé la globalisation sur le monde pour ouvrir leurs marchés à leurs produits, technologie et capital. La création de l’OMC et de ses activités montre clairement l’intensité de la crise, le conflit et la ruée vers les marchés disponibles qui en découlent. De l’autre côté, les pays développés, les puissances capitalistes principales, usant d’un prétexte ou d’un autre, ont imposé différentes restrictions dans l’exportation des marchandises des pays en développement vers les pays développés. Chaque pays capitaliste est appelé selon ses forces et sa capacité à recourir à toutes les mesures politiques, militaires, diplomatiques et économiques possibles pour s’assurer du marché indispensable à ses produits et donc à sa propre survie comme fraction capitaliste au détriment des autres. Chaque pays, chaque corporation capitaliste fait les plus grands efforts pour être plus compétitif que les autres. La rentabilité est devenue le mot d’ordre du capitalisme d’aujourd’hui et cela nous aide à voir clairement l’essence réelle du capitalisme mondial dans sa phase avancée de décadence.
La vraie nature du capital est de se ruer vers tel secteur ou telle partie du monde où la possibilité de faire le profit maximum existe. Aussi, en cete période de globalisation, les diverses fractions du capital font de fréquentes incursions dans ces secteurs et régions qui assurent au maximum et le plus rapidement du profit. Ces incursions ont ainsi été faites vers les marchés financiers et les marchés boursiers étrangers partout dans le monde. Le capitalisme devient de plus en plus une économie de casino. La somme de tels « capitaux volatiles » qui passent rapidement d’un pays à un autre, là où est possible un profit maximum et rapide, augmente et devient prédominante sur le capital employé dans la production de biens industriels et agricoles et dans d’autres services socialement nécessaires. On la retrouve bien plus dans les secteurs de l’assurance et de la banque dans les différentes parties du monde. Il existe également une claire préférence pour la technologie d’information en lien avec le secteur des services. Dans cette sphère, les fractions développées du capital global ont trouvé dans l’Inde une destination très profitable. Diverses fractions du capital indien telles que Tata Consultancy Services, Reliance, etc., s’efforcent d’en tirer le maximum. Du fait de la politique éducative particulièrement élitiste de l’Etat indien, portant plus l’accent sur l’éducation supérieure que sur le primaire et le secondaire, l’Inde possède une importante force de travail bien formée et efficace tout à fait à l’aise en langue anglaise. Celle-ci est aussi plutôt bon marché en comparaison avec le monde développé. Aussi, les parties du capital international et national se sont attachées à exploiter cette source de travail jeune, compétente mais peu chère, au moment où la demande globale en services de technologie d’information est devenue très forte. Cela a donné naissance au boom de la technologie d’information liée au secteur des services. Nous avons déjà vu que les géants de la fabrication et les grandes compagnies indiennes exploitent elles aussi cette main d’œuvre et les matières premières, et ont fait de l’Inde un centre manufacturier compétitif sur le marché mondial. Un géant des téléphones cellulaires, Nokia, a déjà mis sur pied une unité de production près de l’aéroport de Chennai, et un grand nombre de ses fournisseurs ont aussi ouvert leurs équipements de production dans l’énorme « zone économique spéciale » (en anglais SEZ3) privée appartenant à Nokia. Les produits Nokia sont destinés aussi bien aux consommateurs indiens qu’au reste du monde. Hyundai Motors, Maruti Suzuki, etc., font d’ailleurs de même. Tous ont donné un élan très fort à la relocalisation d’activités industrielles et à l’externalisation de services et de soutien technique. Les établissements industriels et les centres de service ont été fermés dans les pays centraux et établis dans des pays comme l’Inde ou la Chine. Cela conduit inévitablement à une désindustrialisation dans les pays développés. C’est la particularité du modèle grandissant du capital mondial dans cette phase historique de décadence et qui est fondamentalement différent de la phase ascendante.
28% de la population indienne travaille dans le secteur des services (CIA Fact Book) et la part de ces derniers dans le PIB indien était de 53,6% en 2005, selon le rapport de l’Asian Development Bank. On peut avoir ainsi facilement une idée des salaires relativement plus élevés de ceux qui sont employés dans ce secteur. Cela est également vrai pour le secteur manufacturier qui contribue à hauteur de 27,4% du PIB (rapport de l’Asian Development Bank) et emploie 12% de la population (CIA Fact Book). Ces deux secteurs ont représenté un marché de 300 millions de personnes en Inde. En plus de cela, il y a encore un vaste marché extra-capitaliste comme on l’a dit plus haut. Cette demande ne peut qu’attirer à la fois les capitaux locaux et étrangers pour agrandir leurs activités productives et leurs établissements commerciaux.
Mais c’est la création d’une phase historique particulière dans la vie du capitalisme. Dans cette phase, la demande et la croissance de certaines parties ont lieu au détriment des mêmes dans d’autres parties du monde, plus particulièrement au cœur du capitalisme. Nous avons déjà vu qu’alors que la croissance en Inde a atteint deux chiffres ces dernières années ainsi qu’en Chine depuis une période importante, celle des pays développés a fait triste figure, estimée de 3,7 à 3,8% en 2008/2009. Cette grande différence dans le taux de croissance entre les pays centraux et la périphérie en développement en dit long sur la santé du capital global dans cette phase historique de décadence du capitalisme. Cette croissance anormale dans certaines parties périphériques s’accompagne d’une décroissance similaire dans les parties centrales du système doit être considérée comme un cancer, révélant l’état malade, sénile de ce système.
Les gens sont très souvent pris par la propagande de la bourgeoisie mondiale sur le miraculeux boom économique de l’Inde. La bourgeoisie cherche à mystifier la classe ouvrière mondiale et à la convaincre de chanter les louanges de la croissance en Inde et en Chine, et de lui faire croire que tout va bien dans le système capitaliste, qu’il possède un remarquable pouvoir de résilience et qu’il peut revenir à la normale malgré la crise et les explosions financières. Mais nous devons affirmer avec force qu’en dépit des roulements de tambour sur la croissance indienne, la participation de l’Inde au commerce mondial n’est que d’un maigre 1,2% d’après un rapport de l’OMC de 2006 (CIA Book Fact). Cela ne fait qu’une petite bosse dans la courbe vers la baisse de croissance.
D’un côté, il y a toute cette poussée, un marché grandissant de plus de 300 millions de consommateurs. De l’autre, il y a une pauvreté et une misère illimitées. Un rapport de 2007 de la Commission Nationale pour les Entreprises dans le secteur Non-organisé (National Commission For Enterprises in the Unorganized Sector, NCEUS) précise que 65% des Indiens, soit 750 millions de personnes, vivent avec moins de 20 roupies par jour, un peu moins d’un demi-dollar, la plupart travaillant dans « le secteur du travail informel sans sécurité du travail ou sociale, vivant dans une pauvreté abjecte ». (CIA Fact Book) On a aussi vu que 60% des ouvriers sont employés dans les secteurs de l’agriculture, ne contribuant que pour 16,6% du PIB. Le revenu de ces masses de travailleurs est très bas. Ces dernières années près de 25 000 petits paysans se sont suicidés car ils n’arrivaient plus à rentrer dans les frais engagés pour leurs productions. Ce taux de suicide ne cesse d’augmenter. De nombreux économistes bourgeois et d’universitaires reconnaissent aussi un sérieux sous-emploi et un chômage déguisé dans le secteur agricole. La fameuse croissance et ce boom n’ont pas réussi à réduire de façon drastique le pourcentage d’ouvriers employés dans l’agriculture. L’économie indienne est donc à des milliers de kilomètres d’avoir évolué vers une économie développée. La World Bank a classé l’Inde comme un pays à bas revenu.
Bien sûr, un grand nombre de jeunes diplômés se retrouve dans le secteur de la technologie d’information et constitue une base importante effective de consommateurs, mais il n’y a eu aucune réduction du chômage, qui était de 7,6% en 2006
Au contraire, le pourcentage de chômeurs augmente chaque jour. Comme dans les pays développés, la pratique capitaliste est ici de réduire les emplois et de geler les postes. Les départs en retraite ne sont pas remplacés et la charge de travail pour ceux qui restent augmente constamment. C’est un fait admis généralement que le chômage augemente. Ce chômage est cependant totalement différent de celui qui pouvait apparaître dans la phase ascendante du capitalisme, alors que celui-ci intégrait de plus en plus de gens au fur et à mesure que l’activité productrice augmentait. Mais aujourd’hui, aussi formidable que soit une croissance, elle exclut des gens en nombre grandissant. Celle récente de l’Inde n’est pas une exception à cette règle générale de cette phase du capitalisme.
Le contexte impérialiste
L’Inde a commencé à ouvrir son économie autour de 1991/1992. Cette jonction historique est d'une importance cruciale. Les relations internationales parmi les Etats capitalistes partout dans le monde étaient particulièrement tendues. L’ordre impérialiste mondial dominé par les deux blocs impérialistes, l’un conduit par les Etats-Unis, l’autre par l’ex-URSS, était en pièces après la chute du bloc de l’Est et celle de l’URSS. Cette situation a engendré un nouveau désordre mondial, une situation d’instabilité et d’indiscipline. La seule super-puissance restante, les Etats-Unis, s’est trouvé dans une incapacité grandissante à préserver son hégémonie. Tout ce processus a conduit à son affaiblissement actuel. Dans une telle situation internationale, la tendance au « chacun pour soi » et au chacun contre tous est devenue toujours plus affirmée. Et elle a sonné l’ouverture de la phase avancée de la décomposition du système capitaliste. Les bourgeoisies plus faibles des pays en développement ont aussi commencé à remettre en question le diktat de la bourgeoisie militairement la plus puissante, les Etats-Unis. Ceci est la toile fond de la récente croissance indienne. L’aspect stratégique et politique du développement économique a atteint des nouvelles proportions dans ce contexte. La rationalité économique et la recherche de profits énormes ont joué un rôle dominant dans les guerres de la phase ascendante du capitalisme. Mais le souci d’obtenir des gains politiques et stratégiques a joué le rôle principal dans les guerres qui ont surgi en décadence. De même, la poursuite de super-profits n’est pas en soi le facteur déterminant dans le mouvement et l’investissement de capitaux, de technologie, de relocalisation de l’industrie, etc. On connaît le Plan Marshall après les dévastations sans précédent de la Seconde Guerre mondiale et son importante contribution au développement économique remarquable de l’Allemagne, de la France et d‘autres pays européens dans la période d’après-guerre. La participation américaine au développement du Japon et de la Corée a aussi été tout à fait significative. Mais la force motrice derrière ce soutien actif des Etats-Unis tenait dans l’intérêt stratégique, politique impérialiste de l’Amérique dans le nouvel ordre mondial qui émergeait de cette guerre.
Dans le nouvel ordre impérialiste qui naît de la disparition des blocs,, de nouvelles alliances politiques, stratégiques et militaires se sont formées. Dans une telle phase historique, l’importance stratégique et politique de la bourgeoisie indienne a été comprise par les Etats américains et de l’Europe de l’Ouest. La bourgeoisie indienne est d‘ailleurs devenue plus à même d’affirmer son poids, sa force et sa confiance. Elle a commencé à s’éloigner du modèle stalinien de développement capitaliste d’Etat longuement chéri pour se retrouver sur une ligne politique de réformes économiques et d’ouverture de l’économie. Elle a commencé à s’engager vers une forme démocratique de capitalisme d’Etat.
D’un autre côté, la nécessité de contenir la puissance émergente politique, militaire et économique de la Chine a fait que les Etats-Unis et d’autres puissances occidentales ont réalisé qu’il fallait se servir de l’Inde comme d’un contrepoids et donc la développer. Cela a contraint les bourgeoisies de ces pays à utiliser tous les moyens possibles pour pousser en avant le développement économique de l’Inde.
Les raisons économiques mentionnées ci-dessus sont, bien sûr, importantes mais dans le monde d’aujourd’hui, ce sont des facteurs politiques et stratégiques de premier ordre. Le capital de n’importe quelle partie du monde n’est pas aussi libre qu’il pouvait l’être dans la phase d’ascendance pour aller vers une autre partie. Cela dépend aussi de l’Etat vers lequel il veut aller. Ce dernier est non seulement guidé par les calculs économiques mais aussi et surtout par des calculs politiques et stratégiques. C’est nécessairement le cas dans cette période de conflits impérialistes intenses entre tous les pays sans exception. Toute entreprise engagée dans la production d’équipement militaire sensible ne peut aller construire une unité de production sans la permission de son Etat d‘origine. D’après les rapports de journaux bourgeois, certaines entreprises américaines n’ont pas eu l’autorisation de leur gouvernement de vendre des super-ordinateurs à la Chine. Dans de tels cas, les relations militaires ne jouent pas seulement un rôle très important mais déterminant. Ainsi, la position géostratégique, le poids politique et militaire de la bourgeoisie indienne dans la « communauté internationale » dans les années 1990 et après a été un facteur important de son évolution comme destination favorable pour l’investissement étranger.
La croissance indienne et la classe ouvrière
Pour un membre de longue date du parlement indien et dirigeant syndicaliste gauchiste, « les attaques sur les masses ouvrières indiennes se sont dangereusement et diaboliquement intensifiées dans la récente période. La réforme économique n’est pas seulement destinée à accélérer l’industrialisation, elle encourage également l’utilisation de méthodes rigoureuses pour tromper la classe ouvrière et lui renier ses droits de base… près de 95% de la force de travail se trouve dans le secteur non-organisé. La plupart d’entre eux sont de façon lamentable en-dehors de tout cadre de sécurité sociale et sont à la merci des pires exploiteurs. La contractualisation et l’externalisation du travail ont profondément affecté les conditions de travail. Tandis que les heures de travail ont augmenté jusqu’à plus de dix heures par jour dans les petites et moyennes entreprises, surtout dans les usines « nouvelle vague »… le salaire est généralement en dessous du minimum sans aucun bénéfice de statut… Tout cela pour baisser substantiellement le coût du travail et maximaliser les profits… D’un côté, il existe une augmentation frappante des profits dans des unités spécialisées et, de l’autre, on voit une baisse constante du salaire réel. » (The Stateman du 5 septembre 2008) Il faut aussi mentionner que « les petites et moyennes entreprises comptent pour 40% de la production industrielle et pour 45% de ses exportations ». (Business Week du 20 août 2007) « Les petites et moyennes entreprises qui ont grossi de 35% ces deux dernières années enregistrent un taux de croissance de 40%… ce qui contribue à la production manufacturière à hauteur de 46%… la contribution des petites et moyennes entreprises au PIB est prête de toucher les 22% pour 2012, selon une étude de la chambre de Commerce et de l’Industrie. » (The Statesman du 29 septembre 2008)
Ce secteur grandit rapidement et devient de plus en plus important pour les grandes entreprises, qui sous-traitent leurs diverses activités de production avec ces PME. Ces dernières se soucient comme d‘une paille des lois du travail : elles sont les réelles baraques à sueur basées sur l’exploitation maximum et sur la répression contre les explosions ouvrières.
L’inflation a été liée de façon inséparable avec la croissance de l’Inde et a atteint depuis 16 ans un haut niveau. L’économie « au noir », la politique du gouvernement sur les taux d’emprunt, la création d’une demande artificielle grâce à des crédits peu chers, l’augmentation du déficit public, les énormes dépenses d’armement, la politique de subsides et autres mesures capitalistes d’Etat destinées à tricher avec la loi de la valeur – ce sont tous des facteurs importants de la croissance actuelle et qui poussent à une accélération de l’inflation (qui est de 12% actuellement). Ce qui rend les conditions de vie ouvrière beaucoup plus précaires. Elle s’ajoute indirectement à l’exploitation déjà intense de la classe ouvrière. Les mesures du gouvernement ont raté leur but et aggravé le taux d’inflation. Le gouvernement est incapable de prendre des mesures très fortes car elles pourraient remettre en cause le taux de croissance.
Les croissances indiennes et chinoises sont une arme très puissante de mystification de la bourgeoisie mondiale. Elle envoie à travers les vantardises sur ces dernières un message à toute la classe ouvrière : qu’en dépit des crises répétées et des chutes boursières, le système est en bonne santé et que la lumière est au bout du tunnel. Elle avait de même avec les Tigres et les dragons du Sud-Est asiatique avant qu’ils ne boivent le bouillon. Tout cela n’est qu’un piège politique, idéologique pour la classe ouvrière mondiale.
Conclusion
Le système capitaliste est un système plein de contradictions. La splendeur et la brillance apparentes cachent l’horreur de la réalité intérieure inhumaine. Ce n’est pas et ne peut être autrement avec les croissances et les booms indien ou chinois. Dans un article intitulé « Nouveau rendez-vous avec le destin » publié dans The Stateman du 15 août 2008, l’ex-gouverneur de la province la plus troublée politiquement et militairement de l’Inde écrit : « Nous continuons à nourrir des illusions et nous satisfaire de gains à court terme et d’un éclat à l’extérieur. On entend souvent ces jours-ci des propos sur les réserves impressionnantes de capitaux étrangers de l’Inde, ses performances en matière de technologie de l’information… Mais on en dit peu en comparaison sur le fossé s’élargissant toujours plus entre les riches et les pauvres, sur les problèmes aggravés du chômage et du sous-emploi, de l’existence sans fin d’une pauvreté aiguë, de l’augmentation rapide de squatters, de clochards et de bidonvilles dans les zones urbaines, et d’une détérioration profonde de l’environnement à la campagne comme à la ville… L’Inde a aujourd’hui le plus grand nombre de pauvres, le plus nombre d‘illettrés et le plus grand nombre de gens mal nourris dans le monde. Plus de 250 millions d’hommes, de femmes et d’enfants vont se coucher le ventre vide chaque jour. Une femme indienne sur trois est sous-alimentée. Près de 40% des enfants de moins de 5 ans en dessous du poids normal dans le monde sont Indiens. 57 millions d’enfants de ce groupe d’âge sont dénutris ; ce pourcentage (48%) est même pire que celui de l’Ethiopie (47%). Six femmes sur sept sont illettrées. Dans les villes, les bidonvilles et les installations de squatters ont proliféré de 250% plus vite que l’ensemble de la population. Bombay avec presque 12 millions de gens vivant dans de tels baraquements est devenue la capitale mondiale des bidonvilles. L’Inde est encore reconnue comme une des nations les plus corrompues du monde. »
Cette horrible réalité derrière l’éclat extérieur de croissance impressionnante et de boom économique est encore noircie par le fait que “l’économie parallèle représente presque la moitié de l’économie officielle… et le poids de l’argent cash qu’elle génère joue un rôle énorme dans l’aggravation de l’inflation… La plupart de l’argent venant en Inde en tant qu’investissement étranger n’est rien à côté de l’argent du marché noir ». (Business Week du 4 juin 2007) Le professeur d’économie de JNU, l’université la plus élitiste de New Dehli, considère que l’économie “au noir” de l’Inde vaut 500 milliards de dollars.
La brillance de la récente croissance économique de l’Inde est basée sur une intensification de l’exploitation et une aggravation des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, non seulement en Inde mais aussi dans les autres parties du monde.
Communist Internationalist, novembre 2008
1 L’externalisation de conduite d’affaires (Business process outsourcing - BPO) est proche de la sous-traitance. Elle signifie la contractualisation des opérations d’affaire spécifique à un service fournisseur externe. Cette BPO est dépendante de la technologie d’information (IT), donc elle est aussi liée aux services de technologie d’information (information technology enabled services ou ITES). Source Wikipedia (notre traduction).
2 Sourcing (ou identification en français), est un terme utilisé en gestion des ressources humaines pour décrire un processus qui a pour objectif d'identifier des candidats correspondant aux profils recherchés par le client. Le Sourcing est aussi employé dans le monde des affaires pour qualifier l'acte visant à réduire le coût général des achats, en automatisant les processus concernés. Expression anglo-saxonne utilisée pour désigner l’action de recherche, localisation et évaluation d’un fournisseur, afin de répondre à un besoin identifié (en matière de biens ou de services) formulé par une entreprise ou par un service ou un département de cette entreprise.
3 Une « special economic zone »,SEZ, est une région géographique qui se dote de lois commerciales plus libérales que celles auxquelles est astreint un Etat.
Géographique:
- Inde [202]
Les universités prennent le parti de la répression de l'État
- 2526 lectures
En Iran, une des premières réponses du régime islamique aux manifestations massives qui ont suivi le résultat des élections truquées a été d’envoyer ses milices Basij de ruffians dans l’université de Téhéran, pour cogner et assassiner des étudiants sélectionnés pour faire un exemple envers tous les autres.
En France, pendant les mobilisations plus récentes contre la « réforme » de l’université (destinée à accentuer les divisions entre l’élite universitaire et le reste de la population), plus d’un campus occupé a été attaqué par la police armée de chiens et a essayé d’empêcher les étudiants de tenir des débats politiques dans les amphithéâtres.
En Grèce, durant la révolte de décembre 2008, les campus universitaires, particulièrement à l’École Polytechnique d’Athènes, ont servi de base pour des assemblées générales ouvertes aux étudiants, aux ouvriers et aux chômeurs. La police a là aussi été utilisée pour briser les occupations et frapper ainsi les efforts de cette révolte à devenir consciente de ses buts et de ses méthodes.
Dans nombre de ces cas, il y a eu des signes clairs de complicité entre la police et les autorités universitaires.
L’Iran, bien sûr, est une théocratie rigide, les polices française et grecque ont une longue histoire de violence contre l’opposition sociale. Mais les choses sont-elles différentes dans la libérale Grande-Bretagne, avec sa tradition d’universités indépendantes et de tolérance envers les penseurs non-orthodoxes ?
Peut-être pas !
En juin, des étudiants de SOAS (School of Oriental and African Studies) de Londres ont occupé l’université après que des policiers de l’immigration lourdement armés ont organisé un raid pour identifier, arrêter, et dans certains cas expulser, des ouvriers immigrés employés au nettoyage des locaux qui avait été impliqués dans une grève. Ici encore, la police a agi de conserve avec les autorités universitaires :
« Les brigades policières de l’immigration ont été appelés par la société de nettoyage ISS, quand bien même certains employés étaient à son service depuis des années. Il avait été dit à l’équipe de nettoyage qu’une ‘réunion d’urgence de l’équipe’ allait avoir lieu à 6h30 du matin le vendredi (12 juin) ».
Il s’agissait d’un prétexte pour piéger les salariés dans un espace clos où les policiers traquant l’immigration clandestine étaient cachés pour les arrêter.
Plus de 40 policiers en tenue anti-émeutes ont procédé à un interrogatoire musclé et agressif avant de les escorter jusqu’au centre de détention. Aucun représentation légale ni aucun soutien syndical n’étaient présents du fait du secret entourant l’action. La plupart des interpellés étaient incapables de communiquer et incapables de comprendre ce qui se passait du fait du refus de la présence de traducteurs.
« La direction de SOAS était complice du raid de la brigade de répression de l’immigration en donnant aux policiers la possibilité de se cacher dans le local par avance et ne lançant aucun avertissement préalable aux employés grévistes. » 1
A l’Université d’East London, le professeur d’anthropologie Chris Knight a été suspendu de son poste et risque le renvoi pour « grave inconduite ». Il lui est reproché de s’être fait remarquer à la tête d’un « sommet alternatif au G20 » sur le campus (bien qu’au fond, aucune action à l’intérieur des bâtiments n’ait été planifié d’avance) après que les autorités universitaires ont interdit cette manifestation à la dernière minute. Il doit être rappelé que, dans la période qui a conduit au sommet du G20 à Londres, les médias et la police ont organisé une campagne hystérique sur la menace de violence dans la capitale – une menace qu’ils ont eux-mêmes mise à exécution avec un étalage de violence hystérique qui ont provoqué l’excitation de centaines de manifestants et la mort d’un passant, Ian Tomlinson. Il ne fait aucun doute que les autorités universitaires craignaient que le campus de l’UEL ne se transforme en quartier général des manifestations anti-G20. Les journaux ont été fort discrets cependant sur la raison principale de la suspension de Knight et ont donné une publicité maximum aux propos imagés de Knight sur les banquiers à pendre aux réverbères, déclarant que c’était la véritable raison de sa suspension.
Nous ne pensons pas que le sommet alternatif, largement dominé par des gauchistes comme Tony Benn et Lindsay Germain, pouvait offrir une alternative révolutionnaire au G20, comme nous ne sommes pas d’accord avec la focalisation de Knight sur le style de protestation « théâtre de rue ». Mais cela ne nous arrêtera pas dans la dénonciation de la complicité de l’UEL avec les forces de répression, tout comme nous condamnons SOAS pour avoir lâché les mouchards de la répression de l’immigration sur leur propre équipe de nettoyage.
Les visiteurs de notre site web savent que nous avons initié une discussion [203] autour des idées de Chris Knight sur l’origine de la culture humaine.
Celui-ci est un intellectuel original et stimulant qui ne craint pas de sortir des sentiers battus de l’orthodoxie académique. En le suspendant, et en refusant d’abriter le « sommet alternatif », l’UEL a créé un précédent lourd de menaces : dans la période actuelle de crise sociale et économique grandissantes, les lignes de pensée non-orthodoxes ne seront pas permises.
Cette sorte de stalinisme intellectuel allant de pair avec l’allégeance complice des universités aux exigences de la police, il est chaque fois nécessaire de se mobiliser contre cette dynamique ; mais la meilleure méthode pour faire revivre les universités comme centres réels de réflexion est celle mise en œuvre par les étudiants grecs et français qui firent ouvrir les portes des campus et organisèrent leurs assemblées générales de telle façon que tout un chacun intéressé à résister au capitalisme puisse prendre part à une véritable culture du débat prolétarien.
Amos (26 juin 2009)
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Lutte dans les chantiers navals de Sestao (Pays Basque espagnol) : L’accusation de racisme, une calomnie contre les ouvriers
- 3311 lectures
Le journal El País1 du 25 avril présente la lutte de travailleurs des chantiers navals de Sestao2 avec le titre suivant en première page “Les licenciements font naître à Sestao la première manifestation à caractère raciste”. Simultanément, à la SER (radio qui appartient au même groupe médiatique qu’El País), dans les infos du matin, les journalistes spéculaient sur le danger fasciste qui pourrait naître de la crise.
Est-ce que les travailleurs ont réagi d’une façon raciste comme les accusent El País et la SER ?
“La Navale” de Sestao embauche directement 400 ouvriers et un millier par le biais d’entreprises sous-traitantes. Ces derniers temps, une vingtaine de travailleurs y sont licenciés chaque semaine. L’inquiétude a commencé à se rependre. Mais cette inquiétude est devenue indignation quand les licenciés ont été remplacés par des camarades polonais, roumains ou portugais qui étaient payés avec des salaires beaucoup plus bas que ceux établis lors de la convention collective.
Ce fut l’origine de la protestation qui éclata jeudi 23 avril avec une manifestation qui a parcouru Sestao et Baracaldo et à laquelle ont participé des travailleurs du personnel fixe qui n’étaient en rien touchés par les licenciements. Vendredi 24, les ouvriers ont coupé les accès au chantier lors d’une manifestation massive.
Que revendiquaient-ils ? Demandaient-ils l’expulsion des travailleurs étrangers et l’exclusivité des embauches aux espagnols, comme le prétendent des groupes xénophobes de l’engeance d’España 2000 ?3
Non, absolument pas ! « Les travailleurs en sous-traitance embauchés par ‘La Navale’ au Pays Basque touchent en moyenne 14 € de l’heure, alors que les Portugais ou les Roumains en perçoivent entre 3,5 et 6 euros. La main-d’œuvre « moins chère » et la « concurrence déloyale » ont fait bondir les personnes affectées, qui ont décidé de se mobiliser pour exiger qu’on applique aux étrangers les mêmes conditions qu’aux employés locaux».4
La revendication des ouvriers de Sestao est donc solidaire avec leurs camarades du Portugal, de la Roumanie ou de Pologne ; ils demandent que ceux-ci aient les mêmes conditions, ils s’opposent au fait que les entreprises tirent profit de la diminution du prix de la main d’œuvre, qu’elles imposent une nouvelle détérioration des conditions de travail, ce qui est finalement préjudiciable pour tous. Les ouvriers de Sestao luttent pour l’intérêt commun, pour le leur et pour celui de leurs frères roumains, polonais ou portugais. Où est le racisme avec lequel El País et la SER les ont stigmatisés ?
Miguel Fonda Stefanescu, président de la Fédération des Associations Roumaines d’Espagne, déclare à l’agence d’information, Servimedia (26 avril) : « Le problème ici réside dans le fait que nous avons une classe patronale qui est disposée à utiliser la main d’œuvre immigrée pour détruire des heures et des heures de concertation sociale. Les ouvriers ont bien raison de protester. Cela n’a rien à voir avec la xénophobie».
Lundi 27, tous les accès à l’usine étaient coupés par les travailleurs réunis en assemblée. Pour éviter que la protestation continue, « La direction de ‘La Navale’, des représentants syndicaux et des gestionnaires de plusieurs entreprises sous-traitantes qui travaillent pour ce chantier naval biscaïen sont arrivés ce matin à un accord de principe sur les conditions d’embauche des travailleurs étrangers. Dans cet accord, d’après des sources syndicales, est inscrit l’engagement selon lequeli les travailleurs étrangers seront embauchés non pas sous les conditions du pays ‘d’origine’, mais sous les conditions du pays ‘d’arrivée’, autrement dit, selon la convention du secteur de la métallurgie de Biscaye, c'est-à-dire qu’ils auront les mêmes conditions que les autres employés» (Agence EFE 27 avril)
Les raisons de la calomnie et comment la combattre
Les ouvriers de Sestao ont été bassement calomniés par El País et la SER qui se présentent comme très différents des radios et journaux de droite, considérés comme les champions de la démagogie et de la déformation5.
Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que les médias bourgeois mènent une telle campagne médiatique nauséabonde de dénigrement. En janvier, des ouvriers de l’énergie en Grande-Bretagne ont été eux aussi présentés comme des racistes parce qu’ils auraient adopté ironiquement au début de leur lutte, le slogan électoral de Brown, premier ministre travailliste, « des emplois britanniques pour des travailleurs britanniques » 6. Il y a eu un grand trouble et un grand battage autour de cette déformation alors que ouvriers étaient soumis au même chantage qu’à Sestao de l’embauche d’ouvriers étrangers dans de plus mauvaises conditions. Cependant, la presse britannique, qui avait fait tout un barouf à ce sujet, avec la participation active de la presse espagnole, El País et la SER7 en première ligne, a gardé un silence assourdissant quand les travailleurs ont reconnu leur erreur et ont lutté avec ces camarades polonais dans un mouvement solidaire où les pancartes des manifestations du 5 février proclamaient « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous »8.
Un autre exemple édifiant de la calomnie et de la déformation s’est produit avec les mobilisations ouvrières et estudiantines en Grèce à la fin de 2008. Cette lutte fut systématiquement présentée comme étant l’action minoritaire de quelque « 400 vandales » dont l’activité principale serait de casser des vitrines, quand, en fait, il y a eu des manifestations massives de parents, d’étudiants, de retraités, etc., avec des assemblées générales ouvertes à toute la population, avec des appels à la solidarité internationale…9
Pourquoi les moyens de « communication » se livrent à de telles calomnies ? El País, la SER, la COPE et consorts, au delà des différences de style et des intérêts qui les séparent, coïncident tous dans la défense inconditionnelle du soi-disant « ordre » social actuel, le capitalisme, un système basé sur l’exploitation de la grande majorité au bénéfice d’une minorité. Pour maintenir ce système, l’Etat et les sbires à sa solde dans les médias n’hésitent pas à employer les moyens les plus ignobles.
Le rabâchage de l’accusation de racisme contre les travailleurs, l’insinuation selon laquelle leurs protestations pourraient être le bouillon de culture du fascisme, est un moyen de décrédibiliser leur lutte, de créer un coupe-feu fait de suspicion et de les isoler socialement de leur environnement. C’est aussi une manière de semer dans les rangs ouvriers un sentiment de méfiance envers leurs propres forces, de leur inoculer le virus destructeur de la culpabilisation.
La lutte ouvrière n’est pas que le simple reflet des conditions objectives. Les ouvriers ne sont pas comme les chiens de Pavlov qui réagiraient à l’aiguillon de la crise dardant leurs chairs. Nous sommes des êtres humains, avec nos sentiments, nos doutes, nos peurs, nos rêves et nos désirs… Le développement de la lutte naît d’une fusion complexe entre les facteurs objectifs (la crise) et les facteurs subjectifs (la solidarité, la volonté de conquérir un futur différent, la combativité).
Des calomnies comme celle utilisée contre les ouvriers de Sestao – ou celles concernant des ouvriers de Grande-Bretagne ou de Grèce - cherchent à empêcher la maturation des conditions subjectives. Nous vivons dans une société où l’humanité en général souffre d’un manque de confiance en elle-même. Aujourd’hui, beaucoup de personnes pensent que le problème n’est pas le capitalisme, mais qu’il se trouve dans les hommes eux-mêmes, l’homme serait « un loup pour l’homme » comme le pensait Hobbes au 17e siècle. Les travailleurs subissent cette ambiance et cela a des répercussions dans le développement de leurs luttes qui, pour s’étendre et se radicaliser, ont besoin des sentiments libérateurs de la solidarité, de l’unité, de la conscience et la confiance dans le futur.
Pour combattre ces mensonges, la presse prolétarienne est encore très minoritaire et d’une diffusion très restreinte. Il est bien évident que l’effort doit être fait pour l’étendre, pour que sa volonté d’offrir une vision véritable et critique atteigne les plus grand nombre possible de camarades. Mais c’est en premier leiu aux travailleurs eux-mêmes, dans leurs luttes, de se préoccuper de créer les canaux de discussion et d’information autonomes et indépendants. La première préoccupation doit être de faire connaître ces luttes à d’autres ouvriers du même pays et d’ailleurs, en les étendant pour que, d’une façon ou d’une autre, ils la rejoignent.
Est-ce que pour cela, nous pouvons compter sur la presse bourgeoise ? Est-ce qu’il s’agit de monter des processions spectacles pour que la protestation sociale soit vue dans les journaux et les JT ? Nous ne le pensons pas, ce serait comme laisser le renard surveiller un poulailler. Au-delà de la bonne volonté ou non des journalistes envoyés sur le terrain (qu’il faut par ailleurs essayer de convaincre), les moyens dits de « communication » ne sont pas là pour livrer une information impartiale, mais pour contribuer aux campagnes de la classe dominante et aux nécessités du pouvoir en place.
L’alternative, c’est, au cours d’une lutte, de communiquer directement avec les autres travailleurs à travers des assemblées générales ouvertes à tous les ouvriers, comme aux chômeurs, aux précaires, aux jeunes générations étudiantes, à travers l’envoi de délégations massives vers les autres entreprises, de proche en proche, en créant des moyens d’information et de débat indépendants, en développant des réseaux de contacts, par Internet et par des rencontres directes, en faisant circuler les nouvelles, les analyses et les discussions…
Nous pouvons pour cela nous inspirer des expériences historiques du prolétariat. En 1905, lors de la première révolution russe, les ouvriers organisèrent des assemblées générales qui unissaient tous les lieux de travail de la ville ; c’étaient les Soviets. Une décision du Soviet de Saint Petersburg – à ce moment là, capitale politique de la Russie - fut de créer son propre organe de presse, les Izvestia (Les Nouvelles). En Grèce, en décembre 2008, les ouvriers et les étudiants, dégoûtés par les manipulations du pouvoir, occupèrent des stations de radio d’où ils émettaient des communiqués en expliquant les véritables raisons de leur lutte. Et dans le même sens, soucieux de dépasser l’isolement international, ils firent un appel aux jeunes de toute l’Europe. La créativité et l’initiative ouvrière doivent nous donner des moyens pour résoudre ce problème de la calomnie et pour mettre en avant la vérité de notre lutte.
1 El País, journal de « centre-gauche », est sans doute le journal le plus influent d’Espagne. Et la chaîne de radio SER la plus écoutée.
2 Sestao est une ville de la banlieue industrielle de Bilbao (dans la province de Biscaye), au nord de l’Espagne. Cette banlieue a été historiquement marquée comme un centre de l’industrie sidérurgique et des chantiers navals qui ont été largement démantelés pendant les années 1980, ce qui a fait de Sestao la ville où le taux de chômage est un des plus élevés en Espagne, ce qui n’est pas peu dire. « La Navale » est un des seuls chantiers navals qui restent dans la région de Bilbao.
3 Il s’agit d’un groupuscule d’extrême-droite, similaire au FN en France.
5 En particulier, la COPE, radio appartenant à l’Église catholique et son speaker-vedette qui manie insulte à tout va.
6 Le cynisme et la déformation de la presse ont ici été significatifs. Elle a mis la faute sur ceux qui sont victimes de ce slogan, c'est-à-dire les ouvriers, alors qu’aucune voix s’est élevée contre son instigateur, le si « démocrate » Mister Brown.
7 Carlos Fancino, chef des programmes matinaux de la SER, répétait jour après jour sa condamnation des « comportements xénophobes » des ouvriers britanniques.
8 Voir “Grèves en Grande Bretagne : les ouvriers commencent à remettre en cause le nationalisme » https://fr.internationalism.org/node/3690 [206]
9 Voir « Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe [191] » et d’autres articles.
Géographique:
- Espagne [42]
Lutte de classe en Ukraine : contre la revendication de nationalisation
- 3383 lectures
Nous publions ci-dessous de larges extraits d'un article de l’Union des Révolutionnaires Socialistes (ARS)1 présent essentiellement en Russie et en Ukraine. Récemment scissionné de l’Union des Révolutionnaires Prolétariens Internationalistes Collectivistes (IUPRC), l’ARS condamne la participation aux élections bourgeoises et la démocratie bourgeoise comme forme déguisée de la dictature du capital. Il refuse tout soutien aux syndicats existants, instruments aux mains de la bourgeoisie afin de soumettre le prolétariat aux intérêts du capital, ainsi qu’à la création de nouveaux syndicats radicaux. Il se prononce en faveur de l’action des assemblées générales ouvrières et de la nécessité de la révolution mondiale.
Outre les informations que cet article apporte sur la réalité de la lutte de classes dans les pays de l’ex-URSS et sans nécessairement partager l'ensemble des points de vue qu’il développe, nous saluons et soutenons les arguments qu’il présente contre les mystifications anti-ouvrières sur la « nationalisation » et et sur le « contrôle ouvrier » avancées par les gauchistes. Ces arguments critiques ne peuvent qu’intéresser tout élément préoccupé par la lutte des classes et le renforcement politique de la lutte ouvrière.
La crise mondiale actuelle du capitalisme est à l’origine d’une vague de protestations de la part du prolétariat qui va inévitablement se prolonger dans le futur. Dans la CEI (Communauté des Etats Indépendants2), les premiers signes annonciateurs sérieux de ce qui va arriver se trouvent dans la révolte ouvrière de l’usine de construction de machines de Kherson qui a eu lieu en février dernier. Maintenant que le réactionnaire Parti des Régions a vaincu la lutte ouvrière, il est l’heure d’analyser les raisons de cette défaite. Nous devons apprendre de nos erreurs et, afin d’éviter un destin similaire aux futurs combats qui approchent dans la CEI et dans le monde entier, nous devons savoir reconnaître quels sont les facteurs clé de la défaite.
La révolte de Kherson : ce qu’elle a été et comment elle a fini
Le 2 février, des ouvriers de l’usine de construction de machines de Kherson ont fait une marche dans la principale rue de la ville (la rue Ushakov) en direction de l’administration régionale, où ils ont présenté leurs requêtes aux autorités. Parmi celles-ci se trouvaient :
-
la liquidation de la dette salariale (d'un total de 4,5 millions de grivnas3) ;
-
la nationalisation de l’usine sans compensation ;
-
un marché garanti pour le produit, qui est un outil complexe pour l’agriculture.
Ayant vu que leur demande était ignorée, les ouvriers sont entrés par la force dans l’enceinte de l’usine et ont occupé le bâtiment administratif le 3 février. Différents trotskistes et staliniens ont proclamé qu’il s’agissait d’une occupation totale de l’usine, mais en réalité le personnel de sécurité des propriétaires est resté et il semble qu’au mieux cela ait été une situation de partage du travail.
Le 9 février, un syndicat indépendant a été créé à l’usine de Kherson, pour remplacer l’ancien syndicat qui était une cellule du FPU. Le nouveau syndicat, appelé Petrovets, a rejoint la structure de la Confédération des Syndicats Indépendants d’Ukraine, dirigée par Wolynets, ce qui signifie qu'il est entré de façon effective dans la structure confédérée qui sert couramment d’outil au bloc de Timoshenko. A ce propos, nous devons expliquer quelle est la situation politique au sein de la ville. La bourgeoisie ukrainienne est habituellement divisée entre le groupe « orange » (l’alliance perdante Yushenko et Timoshenko) et le groupe « bleu-blanc » (le Parti des Régions dirigé par Yanukovich). Le propriétaire de l’usine de construction de machines de Kherson, A. Oleinik, est aussi un membre important du Parti des Régions ; et, alors que la domination du Parti des Régions sur l’administration régionale de Kherson se chiffre à presque 60%, celui qui se trouve à la tête de l’administration (placé à ce poste par Yushenko) est Boris Silenko, un « orangiste ». Ceci nous donne quelques indices sur les luttes internes entre les cliques bourgeoises de Kherson, et les deux cliques ont essayé de tirer avantage de la révolte ouvrière de Kherson. Finalement, le Parti des Régions, plus puissant, a établi son contrôle sur les ouvriers, conduisant la révolte ouvrière à sa fin en brisant son indépendance et en la transformant en un outil à son service.
L’intérêt d'Oleinik dans tout cela est clair : utiliser les ouvriers comme levier pour obtenir des ressources de l’Etat et l'accès au trésor des commandes d’Etat, du crédit et des subsides. Et il y a réussi. Le matin du 13 février, les représentants du Parti des Régions ont parqué deux moissonneuses en face de l’immeuble de l’administration régionale, inaugurant ainsi un « Maidan bleu »4 dans le but de déplacer Silenkov. La cellule syndicale de l’usine de construction de machines de Kherson se déclara d’accord pour y participer !
Voila maintenant ce qu’écrivent les trotskistes de « Résistance Socialiste" 5:
« Le 13 févier, 2 millions de grivnas ont été donnés à Mr. Oleinik par l’autorité régionale… Ainsi, jusqu’à présent, le seul gagnant a été le propriétaire qui, grâce à l’action des ouvriers, a obtenu une somme confortable de la part des autorités. Il faut noter que la somme donnée ne vient pas du fonds de réserve, et qu’elle a donc été prélevée sur les fonds destinés au ouvriers du secteur public, aux pensions, allocations, etc. »
Le « compromis social », objet de tellement de soins de la part de la bourgeoisie, a été atteint : Oleinik a obtenu l’argent et les ouvriers ont obtenu la promesse qu’ils pourraient, dans une certaine mesure, en avoir quelques miettes.
Après ce « compromis », la demande de nationalisation fut retirée de la part des ouvriers, ou du moins de la part des représentants syndicaux parlant en leur nom.
Le 14 février, UKRinform6 cite Oleinik : « Le collectif ouvrier a annulé la demande de nationalisation et a été d’accord avec moi pour reprendre le contrôle de l’entreprise. Maintenant, je vais me battre pour le droit au travail et pour le fonctionnement de l’entreprise de concert avec le collectif ouvrier ».
Ce que les trotskistes et les staliniens ont presque pris pour l’étincelle qui allait mettre le feu à l’Ukraine, et qui était en réalité une authentique protestation ouvrière, malheureusement basée sur des revendications et des perspectives erronées, s’est finalement transformé en une entreprise de gain d’argent pour les capitalistes. Et cela est arrivé précisément à cause de la perspective fausse (souligné par nous).
La demande de nationalisation n’était pas initialement une demande de révolution sociale, mais pour un soutien de l’Etat à une entreprise capitaliste, pour son sauvetage par l’Etat bourgeois. Et il en est allé ainsi, de la seule façon possible : en donnant aux capitalistes une somme d’argent des impôts, précisément, « la somme qui ne provenait pas du fond de réserve et qui était donc prélevée sur les fonds destinés aux ouvriers de service public, aux pensions, allocations, etc. ». Si les trotskistes et les staliniens espéraient sincèrement que l’Etat bourgeois pouvait agir d’une autre façon, ils ne peuvent blâmer que leur propre myopie.
Nous pouvons ainsi tirer des conclusions. Des ouvriers privés de ressources pour plusieurs mois se sont dressés pour un combat collectif. Au cours de la lutte, ils ont fait quelques revendications erronées ; mais ils ont au moins acquis le soutien total des marxistes en défendant leur position à leurs dépens. Une clique bourgeoise s’est immédiatement emparée de ce slogan bourgeois qui est censé faire trembler de peur les néolibéraux. En l’espace de deux journées, les ouvriers ont courbé le dos, ayant compris les erreurs de leurs revendications et n’ayant à leur disposition aucune idée alternative.
Pendant les événements de l’usine de construction de machines de Kherson, les staliniens et les trotskistes ont défendu l’idée de « la nationalisation sous le contrôle ouvrier ». Nous devrions vérifier la compatibilité de cette position avec la croissance de la conscience de classe du prolétariat et avec l’action révolutionnaire et si, oui ou non, elle conduit à la subordination du prolétariat à la bourgeoisie et à son Etat.
Quelle est la principale différence entre, d’un côté, la demande de nationalisation et, de l’autre, une lutte pour des revendications concrètes et matérielles ? La demande de nationalisation, c'est-à-dire du transfert de l’entreprise dans la propriété de l’Etat (l’Etat bourgeois : il n’y a pas d’autre Etat) implique une lutte pour une stratégie capitaliste alternative, pour le renforcement du capital d’Etat contre le capital privé. Ceux qui se hasardent à conseiller à la bourgeoisie d’adopter une telle stratégie deviennent effectivement de purs conseillers du capital et rien de plus.
Cependant, comme on pourrait le dire, pourquoi ne pas lutter pour une variété de capitalisme qui est matériellement plus avantageux pour les ouvriers ? Devons-nous être de véritables idéologues et coller à une vision utopique d’une révolution socialiste globale tout en ignorant les besoins immédiats des gens qui souffrent ? Bon, nous devons dire que nous ne sommes pas des idéologues et que nous sommes opposés au réformisme. Ceci n’est pas la conséquence d’une quelconque vision utopique, mais de la compréhension claire que le concept d’un type de capitalisme matériellement avantageux pour les ouvriers est en soi utopique.
Pour comprendre que la politique de nationalisation de l’Etat bourgeois ne peut pas être bénéfique pour les masses ouvrières, on n’a qu’à simplement observer la Russie moderne. Le règne de Poutine a vu le développement de l’interventionnisme, l’avancée de la bureaucratie qui a dompté les pseudo- oligarques, la domination des corporations lourdement possédées par l’Etat, comme des secteurs clé du profit économique, où la bureaucratie et le monde des affaires ont prospéré de concert sur le dos de la pauvreté des masses. Cependant, tout cela n’a pas conduit à l’amélioration des conditions matérielles des ouvriers, pas plus qu’au progrès de la bourgeoisie : après 8 années de croissance, l’économie russe n’a même pas atteint son niveau de 1990. Il est maintenant évident que l’interventionnisme du règne de Poutine n’a pas servi les intérêts des masses ouvrières (ce à quoi on ne pouvait que s’attendre) et n’a même pas servi à la réalisation d’une modernisation progressive de l’économie russe ; elle a plutôt servi seulement la consommation parasitaire de la classe exploiteuse, l’hydre bicéphale des bureaucrates et des hommes d’affaire.
De plus, en se référant à l’exemple classique du trotskiste biélorusse Razumovskiy, défenseur de la nationalisation de « Résistance Socialiste », on peut voir à coup sûr à quel point les éléments du capitalisme privé et ceux du capitalisme d’Etat peuvent s’entrelacer autour de l’exploitation du prolétariat. La Biélorussie même est un pays où un vaste secteur de capitalisme d’Etat n’a pas fait barrage à l’intervention de l’Etat en faveur de réformes néolibérales. 7
Malgré les concepts marxiens "classiques"8, l’Etat, après tout, n’est pas un instrument neutre, n’est pas un champ de bataille entre les dominants et les dominés mais, de par sa nature propre, il est lui-même exploiteur. Il n’est pas une entité étrange, mystérieuse, avec ses propres intérêts séparés, mais il est constitué de chefs, de bureaucrates et de flics bien concrets qui sont en soi des exploiteurs et des dominateurs, eux-mêmes attachés aux intérêts capitalistes privés d’autres exploiteurs et dominateurs. Par rapport à la pression des masses prolétariennes sur eux, ce gang exploiteur ne peut jamais cesser d’être ce qu’il est : même lorsqu’il fait quelques concessions aux masses en lutte, il le fait dans l’objectif de vaincre l’esprit révolutionnaire, de le remplacer par des illusions pour, plus tard, rejeter les concessions. L’impératif du mouvement communiste n’est pas de mettre la pression sur l’Etat bourgeois, mais de le détruire. Ce but n’est pas une vision utopique, mais un moyen d’assurer la survie de l’humanité (souligné par nous).
Nous ne soutenons que des exigences qui ne contredisent pas l’impératif révolutionnaire. Nous soutenons les ouvriers qui luttent pour l’amélioration de leurs conditions matérielles, à condition que leurs luttes soient fondées sur un contrôle direct et l’auto-organisation, à partir desquelles les ouvriers forment de nouveaux types de relations sociales, sans compter sur les syndicats intégrés à l’Etat9, sans compter sur l’Etat lui-même ! Ce n’est que dans une telle lutte que les ouvriers peuvent acquérir l’expérience de l’auto-organisation qui est nécessaire pour la destruction du vieux monde et la création d’un monde nouveau.
Staliniens et trotskistes, qui ne sont après tout pas si différents, se font tous deux les avocats de la nationalisation, la justifiant par la restauration d’une entreprise qui fonctionne et qui permettrait aux ouvriers de survivre. Cependant, la nationalisation peut avoir pour résultat la revente de l’entreprise à différents propriétaires privés, comme cela a été montré dans notre premier article. Il n’est en aucune façon certain que l’Etat bourgeois ukrainien actuel, qui est dans une situation de crise permanente, puisse entrevoir une quelconque restauration de l’entreprise.
Le contrôle ouvrier : pourquoi ce n’est pas suffisant
Les « léninistes-bolchevicks » justifient leur défense de la nationalisation en la décrivant comme un cas spécial, une sorte de « bonne » nationalisation, celle qui est sous le contrôle ouvrier. Ils décrivent ce "contrôle ouvrier" comme une miraculeuse goutte de vin qui peut transformer un plein seau de poison bourgeois en un doux breuvage communiste.
Nous avons déjà abordé la question du contrôle ouvrier dans notre article « Le mouvement ouvrier : que doit-il être ? »10.
Par exemple, considérons la demande pour un « contrôle ouvrier sur les comptes de l’entreprise ». La demande pour le contrôle ouvrier suppose que le propriétaire et l’autorité qui s’exerce sur l’entreprise (et l’ensemble de la société) restent du côté de la bourgeoisie, alors que les ouvriers contrôlent simplement le fonctionnement de cette autorité dans sa réalité immédiate. Il est certain qu'aussi longtemps que la bourgeoisie maintiendra son emprise sur l’autorité, elle ne permettra aucun contrôle ouvrier véritable sur cette autorité. Cependant, quand les ouvriers ont suffisamment de pouvoir pour évincer le monopole bourgeois du contrôle, cela n’a pas beaucoup de sens de s’arrêter à mi-chemin. Pourquoi mettre en place le contrôle ouvrier sur l’autorité bourgeoise quand cette dernière peut être complètement évincée ? Donc, la demande d’un contrôle ouvrier dans les conditions d’un capitalisme absolutiste n’est pas réaliste dans la majorité des cas et elle est nuisible dans des conditions de révolution.
La bourgeoisie ne sera favorable à la demande de contrôle ouvrier que dans les circonstances exceptionnelles et précisément alors, les illusions de ses protagonistes seront durement ébranlées. Les propriétaires de l’entreprise dresseront des barrières secrètes autour de leur commerce et ouvriront les livres de comptes dans le but de convaincre les ouvriers de la cruelle situation financière de l’entreprise et de la nécessité de laisser de côté la lutte de classe afin d’éviter la banqueroute. La bourgeoisie, habile dans l’art de la double comptabilité et dans diverses autres manipulations, atteindra sans aucun doute son objectif, et la réalisation du « contrôle ouvrier » ne deviendra plus qu’un instrument au service de la réaction et de l’exploitation.
Par-dessus tout, ce concept trotskistes d’un capitalisme de « transition » contrôlé par les ouvriers n’est qu’une pure utopie, nuisible, parce qu’elle détourne le prolétariat de la lutte authentique pour ses intérêts de classe et pour la révolution.
Nous devons à nouveau mettre l’accent sur ceci : les revendications « transitoires », comme le contrôle ouvrier et la nationalisation, ne sont pas de simples méthodes pour améliorer les conditions matérielles des exploités. De tels petits cadeaux de la part de l’Etat sapent en fait l’autonomie de l’action ouvrière en l’intégrant dans le système d’exploitation.
Dans le cas d’un contrôle ouvrier déjà mis en place, avec l’existence d’une sorte de double pouvoir sur le lieu de travail, nous devons absolument démontrer aux ouvriers l’instabilité et la courte potentialité de vie d’une telle pratique de partage du pouvoir, en expliquant les transformations inévitables de tels arrangements, soit par la restauration de la totalité du pouvoir du capital, soit par l’établissement du plein pouvoir aux assemblées ouvrières. Mais le fait de soutenir les revendications pour le contrôle ouvrier est simplement une idéalisation d’une situation instable et insoutenable, et constitue donc un égarement criant des masses prolétariennes.
La crise ukrainienne et nos tâches
Nous ne pouvons pas encore dire comment se conclura cette crise. Est-ce que l’élite ukrainienne stabilisera la situation ? Est-ce que l’Ukraine s’embrasera dans un feu de guerres impérialistes entre cliques bourgeoises ? Ou est-ce qu’une révolte sociale va s’enflammer et se répandre, se transformant en une révolution sociale ? Nous ne pouvons le dire, mais une chose est claire : pour que la révolution réussisse, les masses ouvrières ne doivent avoir confiance en aucune des cliques bourgeoises, en aucun groupe de pouvoir, en aucun syndicat officiel, parti, Etat ou capitaliste, ils ne doivent pas se transformer en instrument d’un quelconque regroupement bourgeois ; ils doivent préserver leur propre indépendance de classe, ils doivent combattre pour leur propre émancipation. Notre tâche, la tâche des protagonistes de la révolution sociale, est de populariser une telle conscience.
Nous comprenons parfaitement que le « socialisme dans une seule usine » n’est pas possible, qu’il est condamné à l’échec quand il est isolé. Cependant, la lutte prolétarienne ne peut réussir qu’après une série de défaites ; même après une défaite douloureuse, les ouvriers de Kherson ont acquis une expérience inestimable, qui n’est pas seulement la leur, mais que les ouvriers d'Ukraine et l’ensemble du prolétariat doivent s’approprier.
La défaite pendant une lutte farouche donne au prolétariat des leçons de classe inestimables, à l’opposé de la défaite pendant un compromis. Ceci est aussi vrai pour le mouvement de grève. Si une grève est brisée après que les ouvriers se soient permis d’être dupés, le seul résultat est une démoralisation complète. Mais si la grève est vaincue après une lutte farouche à cause d’un manque de forces, le résultat est une leçon apprise, celle qui montre qu’avec des forces suffisantes, la force de tout un collectif, de toute une ville ou même d’un pays, la victoire est vraiment à l’ordre du jour.
Habituellement, la lutte de classe prolétarienne se produit dans deux dimensions faiblement interactives. Dans l’une, il y a la spontanéité, la révolte prolétarienne « sauvage », où les ouvriers qui protestent ont une compréhension très vague de comment et pourquoi lutter ; celle-ci est facilement trompée et réprimée par la classe ennemie. Dans l’autre, il y a une multitude de petits groupes révolutionnaires, qui sont plutôt faiblement reliés aux masses. Etant donné le relatif isolement des deux dimensions de la lutte prolétarienne, il n’y a pas de véritable perspective d’une révolution sociale victorieuse. Ce n’est que lorsque les masses ouvrières comprennent l’impossibilité d’éliminer leur misère dans le cadre du système capitaliste, et lorsqu’ils comprennent la nécessité d’une révolution sociale absolue, qu’alors, et seulement alors, cette révolution, conçue avec les idées de quelques petits groupes, deviendra une pratique révolutionnaire régulière du prolétariat. Ce n’est que lorsque la lutte sera développée sous le contrôle des masses en lutte elles-mêmes, que leurs éléments les plus progressistes se trouveront intégrés dans une organisation révolutionnaire, que pourra se combiner la lutte pour des revendications concrètes avec la lutte pour une révolution sociale plus large. Seulement alors, arrivera la dernière heure du capitalisme…
ARS
1 Voir leur site revolt.anho.org, quelques textes en anglais (adresse mail : [email protected] [207]).
2 La Communauté des États indépendants est une entité intergouvernementale [208] composée de 11 anciennes « républiques » de l’ex-URSS. Dépourvue de personnalité juridique internationale, elle recoupe cpendant des accords de coopération entre ces Etats en matière .
3 Monnaie nationale ukrainienne : 100 grivnas = 13 US $. (note du CCI)
4 Allusion aux rassemblements de masse pendant la « Révolution Orange » pour faire chuter le gouvernement, Place de l’Indépendance (Maidan Nezalezhnosti [209]), la place centrale de Kiev [210]. (Note du CCI)
6 National News Agency of Ukraine.
7 voir : « Bannissement d’un paradis social » par F. Sanczenja.
8 Note du CCI : c'est-à-dire les concepts staliniens.
9 Note du CCI : rappelons que pour nous, syndicats officiels ou non, bureaucratisé ou de "base"… tous les syndicats sont, de part leur nature, des armes aux mains de la bourgeoisie pointées dans le dos de la classe ouvrière (Lire "Dans quel camp sont les syndicats ? [212] ")
10 « Le mouvement ouvrier : que doit-il être, révolutionnaire ou trade-unioniste ?», publié le 30 août 2008. Disponible en russe sur revolt.anho.org/archives/50.
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Manifestations de lycéens et d'étudiants en Allemagne : « Nous manifestons parce qu'on nous vole notre avenir »
- 2425 lectures
Du 15 au 20 juin 2009 a eu lieu en Allemagne une grève dans le secteur de l’éducation. Il s’agissait d’une tentative de bloquer par la grève les lycées et les établissements d'enseignement supérieur pour protester contre la misère croissante de l'éducation capitaliste. Par rapport à l’ambition de ses objectifs, ce mouvement n'a obtenu qu'un succès très modéré. Il est resté l'oeuvre d'une minorité. Précisément dans les plus centres universitaires , il n'est pas parvenu à mobiliser un nombre important d'étudiants. Même dans les établissements scolaires des grandes villes, il y a eu peu d’informations à l’avance sur les mobilisations prévues. Au milieu de la semaine d'action, ce mouvement est tout de même parvenu à rassembler près de 250 000 manifestants dans plus de 40 villes. L'importance de ce mouvement réside d'abord dans le fait qu'une partie de la nouvelle génération a fait son entrée sur la scène politique et a connu ses premières expériences de lutte.
La semaine de “grève de l'éducation”
La semaine d'action a commencé le lundi 15 juin par la tenue d'assemblées générales surtout dans les universités. Comme dans la phase préparatoire, C'est plutôt dans les établissements d'enseignement supérieur les plus petits comme par exemple à Potsdam, que la mobilisation a été la plus forte et la plus remarquée. Ailleurs, les AG siégeaient, tandis qu'à côté, les cours continuaient. Ce n'est même que rarement que le blocage des établissements d'enseignement supérieur, l'objectif visé à l'origine, a pu avoir lieu. En revanche, le travail dans les AG même est politiquement significatif. Un débat collectif a pu s’engager autour des formulations des revendications qui sont en partie allées au-delà des intérêts purement estudiantins pour exprimer ceux des travailleurs dans leur ensemble. Telles la demande d'engagement de dizaines de milliers d'enseignants dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur, la transformation immédiate de tous les contrats à durée limitée en contrats à durée illimitée ou l'appel à une garantie de prise en charge pour tous les apprentis. En outre, en beaucoup d'endroits, ont été rédigées des déclarations de solidarité en direction d'ouvriers en grève ou confrontés à des licenciements massifs. Mais même les demandes centrales de mouvement, comme le refus de payer des droits d'entrée à l'université, de la contrainte accrue de la rentabilité et de la sélection d'une élite par le système d'éducation, résumées dans le mot d'ordre de la “formation pour tous” et volontiers interprétées de façon réformiste par la classe dominante, comme un désir “d'amélioration du système existant”, sont aussi indubitablement l'expression de revendications prolétariennes. Le fait que le capitalisme se souhaite des esclaves salariés stupides et sans culture, et ne leur accorde que le minimum de formation absolument indispensable pour le fonctionnement du système, a depuis longtemps été reconnu par le mouvement ouvrier socialiste. A l'inverse du slogan “We don't need no education” « (Nous n’avons pas besoin d’être éduqués » répandu autrefois par Pink Floyd, la classe ouvrière a combattu dès le début pour l'éducation. Cette tradition est ravivée aujourd'hui, avec les assemblées générales elles-mêmes où tous les présents participent activement et également à la formulation et à l'adoption des revendications et des objectifs du mouvement.
La question de la liaison avec les ouvriers
En France, en 2006, le mouvement dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur a réussi à imposer des revendications essentielles au gouvernement, parce qu'il a placé très tôt au centre des revendications prolétariennes exprimant les intérêts de la population laborieuse dans son ensemble ; en particulier le rejet du CPE, le projet de loi de précarisation de tous les emplois pour les jeunes.
Alors qu'en Allemagne au sein de la jeunesse active grandit visiblement la conviction de la nécessité de la solidarisation avec tous les salariés, le mouvement reste jusqu'à présent centré sur l'éducation en particulier. Ce qui signifie qu'il ne se perçoit pas encore comme partie d'un mouvement beaucoup plus large de la classe ouvrière dans son ensemble. Cependant, il y a les premiers indices d'un potentiel qui conduit le mouvement au-delà du cadre des écoles et de l'éducation. L'immaturité momentanée du mouvement, mais également le potentiel de maturation, se sont déjà manifestés le premier jour de la semaine d'action. L'un des points de cristallisation de cette situation contradictoire a été la manifestation nationale des employés des jardins d'enfants dans le centre-ville de Cologne le 15 juin. La grande assemblée générale estudiantine de l'université de Wuppertal a décidé d'envoyer à Cologne une délégation, afin de se solidariser avec les employés des jardins d'enfants. Cette action n'a pas pu être réalisée uniquement par manque de temps suffisant. À Cologne en revanche l'assemblée générale estudiantine n'était toutefois pas si consciente qu'à quelques kilomètres de là 30 000 grévistes se trouvaient rassemblés dans la rue. Lorsque ensuite cet état de fait s’éclaircit, l'assemblée générale en train de se disperser décida d'envoyer une délégation qui parvint finalement à être mandatée pour s'adresser aux grévistes et à les appeler à la lutte commune.
On constate ainsi que l'idée d'une lutte commune est certes largement répandue, mais qu'elle ne joue toutefois pas encore partout un rôle central. A Wuppertal par exemple, l’université est relativement petite. La proportion de prolétaires parmi les étudiants y est par contre particulièrement grande. Là, le mouvement s'est organisé très fortement sur la base de l'initiative propre des étudiants eux-mêmes. Ainsi, Wuppertal a été un des endroits, peu nombreux, où il s'est produit, au moins au début, un grand mouvement de grève avec blocage du centre d'enseignement supérieur. L'université de Cologne, inversement, est l'une des plus importante d’Allemagne. Un mécontentement plus profond et plus large y serait nécessaire pour provoquer une fermentation générale. En outre, les grandes villes sont les citadelles des milieux réformistes de gauche qui freinent, avec leurs tentatives de produire artificiellement des mouvements, l'auto-initiative des étudiants et les rend méfiants par rapport à d'éventuelles mesures combatives. La grève du secteur de l'éducation y a été de façon prononcée une action minoritaire. La lutte pour s'affirmer sur le terrain et même pour se faire remarquer effectivement, a pu contribuer à rétrécir le champ de vision à la situation immédiate dans l'université.
Les manifestations de rue et le manque de mobilisation dans les lycées
La deuxième journée d'action importante a été le mercredi 17 juin, où des manifestations des étudiants, des lycéens et des apprentis ont eu lieu dans toute l'Allemagne. Les mobilisations les plus importantes se sont déroulées à Hambourg, Cologne et surtout à Berlin avec 27 000 participants. Le nombre de participants aurait pu être de loin plus élevé, si on avait réussi à mobiliser de façon plus large les lycées. En novembre dernier, il y avait déjà eu une journée d'action portée principalement par les lycéens et les lycéennes - souvent activement soutenus par des enseignants et des parents d’élève. On a alors en général remarqué que le mécontentement et la combativité parmi les lycéens étaient souvent beaucoup plus grands que parmi les étudiants. Il s'avérait maintenant que l'action de la semaine de l'éducation a été beaucoup trop peu prise en charge par les lycées. Ceci est lié au fait que pendant cette semaine ceux qui se sont activé ont utilisé pour ainsi dire un cadre donné à l'avance par un collectif d'action bigarré. Si l'action était partie des concernés eux-mêmes, on peine à croire qu'ils auraient choisi d’agir à un moment en plein milieu de la période d'examen à la fin de l'année scolaire ! On ne doit toutefois pas omettre que ces manifestations - parfois décidées par les assemblées générales, parfois spontanées - ont été occasionnellement utilisées pour rendre visite à des lycées et même à des entreprises menacées de licenciements ou de fermeture et d'appeler à la lutte commune.
La fin du mouvement
La semaine d'action s’est terminée par une manifestation dans la capitale du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Düsseldorf, à laquelle ont participé quelques milliers de personnes des villes environnantes. Cette manifestation a été marquée par deux choses :
D'une part, par l'attitude, en quelque sorte martiale et provocatrice, de la police. Il faut encore ajouter que les médias bourgeois ont agité en permanence tout au long de cette semaine d'action le thème de la violence. La violence, dont on s'est manifestement efforcé de faire un thème de discussion, afin de discréditer le mouvement comme douteux. La volonté de falsification du mouvement par les médias a été si loin que certaines assemblées générales ont décidé de donner des interviews uniquement si le montage de la discussion recevait leur propre autorisation pour être diffusé. Exigence qui a été systématiquement écartée par les médias. D'autre part, le déroulement de cette manifestation s'est trouvé naturellement beaucoup moins dans les mains des assemblées générales que le mercredi précédent. Il s'est trouvé dans celles d'un collectif se composant de différentes forces agissant sans aucun contrôle de la base, et représentant en outre une sorte de compromis entre différentes approches de pensée – qui n'ont fait l'objet d'aucun débat préalable. Si nous mentionnons ces faits ce n'est pas pour défendre d'en rester au niveau d'actions locales. Nous voulons plutôt souligner que l'extension et le regroupement géographiques d'un mouvement rendent nécessaire la maturation correspondante de son mode d'organisation, et doivent aller de pair avec l'auto-organisation par les assemblées générales. Lorsque cela n'est pas le cas, certains dangers menacent.
En tout cas : lorsque le cortège a atteint la Königsallee - le boulevard du luxe le plus tapageur d'Allemagne - l'action s'est dispersée. Une partie est restée occuper le carrefour et voulait convertir ainsi l'action en blocage de la circulation aussi longtemps que possible. Parmi ceux-ci ne se trouvaient pas seulement des représentants des Black blocks, tenants de la vision, à notre avis erronée, que la violence en tant que telle est révolutionnaire. Il y avait aussi beaucoup de jeunes frustrés qui ne voulaient pas non plus avoir manifesté en ville sans qu'on les remarque. C’est-à-dire qu'ils étaient déçus le faible niveau de résonance immédiate de la semaine de grève de l'éducation. En outre, ils se sont sentis provoqués par l'attitude des forces policières. L'autre partie, dont le mérite consistait à ne pas consentir à s'embarquer dans le jeu de la violence des forces du pouvoir d'État, exhortait les occupants du carrefour à les accompagner, mais se rendit finalement seule au lieu de rassemblement à la Schlossplatz, loin du danger, en plein secteur touristique. La manifestation se divisa ainsi en deux. Lorsqu'ensuite, l'information que la police allait intervenir contre le blocage de la Königsallee parvint au rassemblement, celui-ci fut également dissous, une partie courant porter assistance à ceux qu'on agressait.
La nécessité d'un processus collectif de prise de décision
Cet incident révèle – a contrario- l’importance des assemblées générales. Nous n’en faisons pas un fétiche. La question n’est pas la forme des assemblées générales en soi, car si elles restent passives,,elles peuvent aisément devenir une coquille vide. Le problème est celui de sa capacité à dynamiser une culture des débats et à prendre des décisions de façon collective et autonome. Le désaccord à Königsallee par exemple aurait probablement pu être résolu de façon positive s’il avait été débattu sur place de ce qu’il fallait faire. Dans de telles situations, c’est la sagesse collective qui aurait permis une décantation et qui aurait réussi à trouver une solution pour rester unis ensemble sans s’exposer à la répression.
Le contexte général des grèves dans le secteur de l’éducation
Il reste encore du chemin à faire – et la semaine de manifestations dans le secteur de l’éducation est un petit pas dans cette direction. La plupart des participants sont conscients de leurs limites. Cependant, nous sommes convaincus pour notre part que ce pas, aussi minime qu’il ait été, n’était pas insignifiant. Parce qu’il signifie que les jeunes prolétaires d’Allemagne ont commencé à répondre aux vibrants appels de la jeunesse en France et en Grèce. Parn comparaison au mouvement dans ces pays, les actions en Allemagne restent très modestes. Mais elles doivent être comprises dans le contexte du besoin pour le prolétariat en Allemagne de combler son retard (au 20e siècle, l’Allemagne a été un maillon fort de la contre-révolution bourgeoise et cela a encore un impact aujourd’hui). Cela est également lié au fait que la lutte ouvrière en Allemagne se heurte à un ennemi de classe particulièrement puissant et habile. En 2006 en France, le gouvernement a boosté la généralisation de la résistance en adoptant contre la volonté des étudiants une loi (le CPE) qui était une véritable attaque générale dirigée contre toute la jeunesse prolétarienne. Le gouvernement de Merkel, qui avait les mêmes plans que le gouvernement français, a retiré immédiatement les siens quand il a vu que les proportions que prenait le mouvement en France. La bourgeoisie en Grèce a employé l’arme de la répression avec zèle, si bien que moyen d’intimidation est devenu l’élément qui a mis le feu aux poudres pour la lutte. C’est l’assassinat d’un jeune manifestant à Athènes qui a fait que le mouvement atteigne une telle ampleur, et donné l’impulsion à une vague de solidarité dans la classe ouvrière.
Les premières luttes de la nouvelle génération en Allemagne sont plus modestes et apparaissent souvent moins radicales que dans d’autres pays. Mais il est significatif que là où elles prennent un caractère prolétarien, elles suivent la même trajectoire qu’ailleurs. Les expressions d’initiative, de culture du débat, de capacité d’organisation, de créativité et d’imagination pendant les derniers jours ont aussi été surprenantes.
La lutte pour le futur
Il est enfin important pour la classe ouvrière dans son ensemble que sa jeunesse ait repris le chemin de la lutte. A l’heure actuelle, les secteurs centraux traditionnels de la classe ouvrière sont frappés par une vague de faillites d’entreprises et de licenciements massifs jamais vu depuis 1929. Cette vague effraie et paralyse momentanément ces fractions de la classe ouvrière. Les ouvriers fièrement combatifs d’Opel, qu,i naguère, réagissaient avec des grèves sauvages et des occupations d’usines contre les menaces de licenciements, sont à présent poussés à faire les mendiants auprès de l’Etat bourgeois. Les employés de la chaîne de magasins Karstadt qui sont sous la menace de la liquidation de l’entreprise sont amenés à soutenir leurs patrons qui prennent maintenant la parole eux-mêmes lors de meetings de protestation et font de l’agitation au mégaphone, mais qui ne cherchent qu’à entraîner les employés derrière eux pour réclamer de l’argent à l’Etat. Au milieu de cette situation tourmentée dans laquelle les ouvriers concernés ne peuvent trouver de réponse immédiate, il est important que les parties de la classe ouvrière qui sont moins directement menacées par la faillite de leur employeur entrent en lutte. Aujourd’hui, c’est la jeunesse étudiante ou et en apprentissage, mais aussi les employés des crèches qui non seulement se défendent mais qui ont commencé plus offensivement à exiger de dizaines de milliers d’embauches. Ils le font tous non seulement pour résister à des conditions de travail et d’enseignement de plus en plus intolérables mais aussi en tant qu’expression d’un lent mûrissement de la conscience que l’enjeu aujourd’hui n’est pas seulement le futur immédiat mais le devenir de la société toute entière. Lors des manifestations de la semaine dernière, les étudiants scandaient : « Nous faisons du bruit parce qu’on nous vole notre éducation. » Et les lycéens proclamaient : « Parce qu’on nous vole notre avenir. »
Weltrevolution (21 juin)
Géographique:
- Allemagne [61]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Manifestations massives en Iran : « Tanks, balles, gardes : rien ne peut nous arrêter »
- 3109 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’une courte prise de position sur les événements qui frappent actuellement l’Iran, prise de position réalisée par Dünya Devrimi1, organe de presse du CCI en Turquie, et publiée en langue anglaise dès le 16 juin sur notre site.
Al-Jazerra a bruyamment proclamé que les protestations en Iran constituent le « le plus grand trouble depuis la révolution de 1979 ». Ces « protestations » qui ont débuté dans Téhéran le samedi 13 juin sont, au fur et à mesure des annonces de résultats, devenues de plus en plus violentes. Dans trois universités de Téhéran, les manifestations ont rapidement été confrontées à la répression, et les protestataires ont attaqué la police et des gardiens de la révolution. La police a isolé les emplacements importants et à leur tour les protestataires ont attaqué des magasins, des bureaux du gouvernement, des commissariats de police, des véhicules de police, des stations service et des banques. Des rumeurs sortant de Téhéran suggéraient que quatre personnes ou plus étaient déjà mortes. L'Etat a également réagi en arrêtant quatre éminentes "figures anti-gouvernementales" et, plus important, en interrompant le réseau Internet, qui avait été utilisé, par l'intermédiaire des messageries SMS et des sites Web pour organiser les manifestations. Les journalistes occidentaux ont dit que « Téhéran ressemblait déjà presque à une zone de guerre ».
Que les gens ne soient pas satisfaits avec ce que la société a à leur offrir et qu’il y ait une volonté croissante de lutter est une chose très claire, non seulement au vu de ces événements, mais également à celui des luttes récentes en Grèce, en Egypte ou en France. Le simple fait de tourner les pages des journaux nous montre que la classe ouvrière est en train de retrouver sa volonté de lutter malgré les craintes provoquées par la brutalité de la crise économique.
Cependant, les communistes ne doivent pas se contenter de simplement encourager de loin les luttes. Il est nécessaire d'analyser, d’expliquer et de proposer une perspective. Jusqu’à présent, ce mouvement est d'un caractère très différent de celui de 1979. Dans les luttes qui ont conduit à la ‘révolution islamique’, la classe ouvrière a joué un rôle énorme. D'après tous les discours des gens dans les rues qui renversaient le régime, ce qui était clair en 1979 était que les grèves des ouvriers iraniens étaient l’élément politique majeur qui conduisait au renversement du régime du Shah. En dépit des mobilisations massives, quand le mouvement ‘populaire’, regroupant presque toutes les couches opprimées en Iran, a commencé à s'épuiser, l'entrée en lutte du prolétariat iranien au début d'octobre 1978, particulièrement dans le secteur pétrolier, a non seulement ravivé l'agitation, mais a posé un problème pratiquement insoluble pour le capital national, en l'absence d'un remplacement possible de la vieille équipe gouvernementale. La répression a été suffisante pour provoquer la retraite des petits négociants, des étudiants et des sans travail, mais elle a prouvé qu’elle était une arme inefficace de la bourgeoisie lorsqu’elle est confrontée à la paralysie économique provoquée par les grèves des ouvriers.
Ce n'est pas pour dire que le mouvement en cours ne peut pas se développer et ne peut pas entrainer la classe ouvrière en tant que classe dans la lutte. La classe ouvrière en Iran a été particulièrement combative ces dernières années, particulièrement avec la grève non officielle forte de 100 000 enseignants qui a eu lieu en mars 2007, à laquelle se sont joints des milliers d'ouvriers d’usines en signe de solidarité. 1 000 ont été arrêtés pendant cette grève. Ca a été la plus grande lutte ouvrière enregistrée en Iran depuis 1979. Cette grève a été suivie durant quelques mois de luttes faisant participer des milliers d'ouvriers dans les industries de canne à sucre, de pneus, des véhicules à moteur et de textiles. Aujourd’hui, bien entendu, il y a des ouvriers dans les rues, mais ils sont maintenant engagés dans la lutte en tant qu’individus et non comme force collective. Il est cependant important de souligner que le mouvement ne peut pas progresser sans cela, sans cette force collective de la classe ouvrière. Une grève nationale d'un jour a été réclamée pour Mardi [16 juin]. Ceci peut donner une indication sur le niveau de soutien dans la classe ouvrière.
Récemment, les discours des médias bourgeois nous ont abreuvé de soi-disant « révolutions » baptisées du nom de diverses couleurs ou plantes. Il y a eu la révolution ‘orange', la révolution des ‘roses', la révolution des ‘tulipes’ et la révolution des ‘cèdres’ etc, pendant tout ce temps, les médias ont bêlé comme des moutons au sujet de la ‘lutte’ pour la démocratie.
Ce mouvement a commencé en tant que protestation au sujet de la fraude dans les élections et les protestataires se sont à l'origine mobilisés en soutien à Mousavi. Cependant, les slogans se sont rapidement radicalisés. Il y a une différence énorme entre les faibles protestations de Mousavi auprès du chef suprême au sujet de l’injustice des élections et des chants de la foule qui criait « mort au dictateur et au régime ». Naturellement la clique de Mousavi est maintenant prise de panique et a décommandé une manifestation prévue pour Lundi [15 juin]. Il reste à voir si les gens respecteront cette décision. Par ailleurs, les appels au calme de Mousavi ont jusqu'ici suscité des slogans contre lui.
Contrairement à ce type de ‘révolutions' colorées, le communisme pose la possibilité d'un type complètement différent de révolution, et d’un type complètement différent de système. Ce que nous préconisons n'est pas simplement un changement de gestion de la société avec de nouveaux patrons ‘démocratiques’, jouant exactement le même rôle que les vieux patrons ‘dictatoriaux’, mais une société de producteurs libres et égaux créée par la classe ouvrière elle-même et basée non sur les besoins du profit mais sur les besoins de l'humanité, une société dans laquelle les classes, l'exploitation et l'oppression politique seront éliminées.
Sabri, le 15 juin
1 Lire notre article « Salut aux nouvelles sections du CCI aux Philippines et en Turquie! [213] »
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Poste, secteur public, transports en Grande-Bretagne : éviter le piège de l'isolement
- 2532 lectures
Malgré les discours incessants sur la "fin de la récession", tous les indicateurs disent que le capitalisme est dans sa crise la plus profonde et qu'il n'y a pas de sortie du tunnel en vue. Devant des profits en baisse et une compétition sauvage au sein des marchés, la classe dominante a une seule réponse : faire payer les exploités, les réels "créateurs de valeur", par des licenciements, des gels de salaires, des conditions de travail "modernisées" (c'est-à-dire nous faire travailler plus dur pour gagner moins) et des réductions massives du salaire social par des coupes dans les services publics. Tories, travaillistes, libéraux-démocrates et le reste sont tous d'accord sur la nécessité de coupes pour le secteur public – leur seul souci porte sur comment y aller et comment les faire passer.
Pour la grande majorité d'entre nous, il ne peut y avoir qu'une seule réponse : résister à ces attaques sur nos conditions de vie, qui ne nous conduisent pas vers un futur prospère mais vers toujours plus d'appauvrissement et de misère. Et les signes sont que les ouvriers commencent à résister, partout dans le monde, des grèves massives en Egypte, à Dubaï et au Bangladesh, aux luttes des ouvriers, au chômage et étudiants, s'organisant eux-mêmes dans des assemblées générales en France, en Espagne et en Grèce, en passant par le déploiement de grèves et les révoltes des fermiers en Afrique du Sud. En Grande-Bretagne aussi, les mêmes signes sont là : par les grèves sauvages dans les raffineries de pétrole l'hiver dernier, où les ouvriers ont étendu la lutte contre les lois anti-grèves et commencé à dépasser les idées nationalistes qui avaient au début distordu le sens de la grève, ou par les occupations à Visteon et Vestas, qui ont connu un large soutien au sein de la classe ouvrière. Et à présent, ce sont les luttes qui couvent ou qui éclatent dans de nombreux secteurs. Les éboueurs de Leeds, les chauffeurs de bus de l'Essex, du Yorkshire et du Nord-Est, tous confrontés à des baisses de salaires, les pompiers manifestant contre leurs nouveaux roulements d'équipe, les ouvriers du métro et de British Airways votant pour la grève, et bien sûr, les ouvriers de la poste.
L'attaque sur les ouvriers de la poste
Parmi toutes les grèves récentes, la lutte à Royal Mail a polarisé l’attention des politiciens et des médias. Au gouvernement, le secrétaire à l'économie, Peter Mandelson, a exprimé son "grand courroux" à l’égard de ces grèves, tandis que Cameron, leader du parti conservateur, accusait le gouvernement de Brown d'être trop tendre avec les employés des postes. Les patrons de Royal Mail ont fait de la provocation en virant des milliers d'employés vacataires pendant les grèves. La presse et la télé ont organisé tout un battage autour de la nature prétendument suicidaire des grèves et des dégâts qu'elles devaient occasionner pour l’économie nationale, proclamant même que ces grèves allaient mettre des vies en danger dans la mesure où les vaccins contre la grippe A devaient être envoyés par la poste.
Cette focalisation n'est pas un hasard. La bourgeoisie est parfaitement consciente qu'il existe une énorme poussée de mécontentement dans la classe ouvrière. Elle sait que ce mécontentement ne pourra que grandir lorsqu'elle va commencer à accélérer les nouvelles séries de coupes claires imposées par la crise économique, surtout dans le secteur public qui est le plus gros employeur du pays. Et elle sait que les ouvriers des postes ont une réputation de combativité et d'auto-organisation. Ils sont en particulier fidèles à une longue tradition d'ignorer les lois anti-grèves et de décider de faire grève en assemblées générales plutôt que d'attendre que les syndicats organisent des votes. C'est pourquoi l'Etat et les patrons prennent aujourd’hui les employés des postes comme boucs-émissaires. Ils veulent les affaiblir avant de s’en prendre à d'autres secteurs – pour les isoler, les écraser, et ensuite les soumettre, pour tenter de prouver au reste de la classe ouvrière que se battre pour la défense de ses conditions de vie ne peut mener qu’à la défaite.
Les syndicats renforcent l'isolement
Il existe dès maintenant un danger que les employés des postes se retrouvent isolés – alors même que les syndicats renforcent cet isolement. Lorsque le patron du syndicat CWU Bill Hayes a dit qu'il était en meilleure position que Scargill1 en 1984, il renforçait de fait une illusion qui a directement conduit à la défaite des mineurs à l’époque : l'idée selon laquelle si on se bat assez longtemps et durement dans un seul secteur, on peut repousser une attaque concertée contre toute la classe ouvrière. C'est l'inverse qui est vrai : plus on combat dans notre coin, plus on est à même d'être battus et défaits. Plus nos dirigeants sentent le danger de luttes qui s'étendent au sein de la classe ouvrière, plus ils sont prêts à reculer et à faire des concessions.
Dans chaque secteur, les syndicats font comme si chaque lutte était confrontée à un problème différent, dont les intérêts seraient séparés du reste, réservés à "leurs" membres. Dans les postes, le CWU – qui s’était déclaré d'accord avec l'essentiel du projet de "modernisation" des services postaux à la fin de la grève de 2007 – présente le problème comme celui de la "consultation" et des plans particulièrement "diaboliques" de la direction de Royal Mail. En fait, la direction de Royal Mail, comme toutes les directions, ne fait que son travail pour la classe capitaliste et l'Etat qui le protège. Ailleurs, les syndicats des transports, des pompiers et d’autres font voter leurs membres sur leurs problèmes particuliers, et préparent des grèves qu'ils veulent voir être contrôlées étroitement par l’encadrement syndical et qui ne connaissent pas de liens avec les autres luttes, même lorsqu'elles ont lieu en même temps.
Comment dépasser l'isolement syndical ?
Le problème n'est pas choisir entre se battre ou ne pas se battre. Le problème est comment se battre. Mais pour cela, nous ne pouvons pas nous en remettre aux syndicats, qui sont les flics chargés de faire respecter les lois des patrons et qui divisent la classe ouvrière en multiples secteurs et catégories.
Au lieu de cela, nous avons besoin de suivre l'exemple des ouvriers de la poste et de leurs luttes passées, ou de celles des ouvriers des raffineries de pétrole l'hiver dernier, en ignorant les lois anti-grève et en faisant des assemblées générales des endroits où les réelles décisions sont prises (comme continuer la grève ou retourner au travail), et où les délégations ou les comités soient élus et responsables devant l'assemblée générale. Nous avons besoin d'assemblées générales comme centres des débats et des discussions, où les ouvriers d'autres secteurs puissent venir, non seulement pour apporter leur soutien, mais pour discuter de comment étendre la grève. Il en va de même pour les piquets de grève et les manifestations : ils doivent être ouverts à tous les ouvriers – au travail, au chômage, à plein temps ou à temps partiel, et quelle que soit leur affiliation ou non à un syndicat – et essayer d'attirer autant de secteurs différents vers un front commun.
Même si, au début, ce ne sont que des petits groupes d'ouvriers qui voient cette nécessité d'auto-organisation et d'unité de classe, ces groupes peuvent faire le lien les uns avec les autres et essayer de répandre leurs idées aussi largement que possible. Le futur est entre nos mains.
World Revolution,, section en Grande-Bretagne du Courant Communiste International (26 octobre 2009)
1 Scargill était le patron du syndicat des mineurs qui fut avec Margareth Thatcher le maître d'œuvre de la défaite de ce secteur réputé combatif et qui servit "d'exemple" pour toute la classe ouvrière en Grande-Bretagne mais aussi internationalement (voir les différents articles qui traitent de ce sujet sur notre site internet en anglais mais aussi en français).
Géographique:
- Grande-Bretagne [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Prise de position d’Internasyonalismo en tant que nouvelle section du CCI aux Philippines
- 2379 lectures
Guerre ou révolution. Barbarie ou socialisme. A notre époque, ce sont les seuls choix auxquels est confronté le mouvement prolétarien international.
Puisque nous choisissons révolution et socialisme, nous choisissons de nous intégrer au CCI. Pour faire de la révolution prolétarienne mondiale une réalité et arriver au communisme, les communistes doivent avoir une organisation qui soit mondiale de par son but et son ampleur. Plus encore, une organisation qui ait une plate-forme marxiste claire et cohérente.
Nous avons entrepris un long processus collectif sérieux de clarification théorique en nous basant sur l’expérience du mouvement ouvrier international et sur notre propre expérience aux Philippines en tant que militants d’un mouvement prolétarien. Ce n’est pas facile pour nous quand on considère qu’il n’y a eu aucune influence de la Gauche communiste aux Philippines depuis 80 ans. Pendant presque un siècle, on nous a inculqué, à nous et à tout le mouvement ouvrier, que le stalinisme-maoïsme était la « théorie du communisme ».
Pour nous, la chose la plus importante est la clarification théorique et la discussion pour le regroupement des révolutionnaires. Etre nombreux dans une organisation ne sert à rien si celle-ci n’est pas construite sur des fondements théoriques clairs et solides, basés sur plus de deux cents ans d’expérience du prolétariat dans le monde.
C’est un grand pas pour les minorités révolutionnaires de comprendre la théorie de la décadence du capitalisme de façon à maintenir le marxisme vivant à l’époque de l’impérialisme. La théorie de la décadence est la base de ce qui nous a convaincu que le CCI a la position la plus correcte et la plate-forme marxiste la plus solide dans le cadre de l’évolution réelle du capitalisme et de par la synthèse des leçons de la pratique du prolétariat international depuis plus de deux siècles.
Cependant la plate-forme du CCI n’est pas une plate-forme figée, c’est une plate-forme vivante, à l’épreuve de la dynamique réelle de la lutte de classe et de l’évolution du capitalisme. C’est pourquoi il est très important de continuer et d’étendre le débat interne non seulement au sein du CCI mais aussi dans le camp prolétarien en général. Nous avons vu comment le CCI suscite et pratique ce débat.
Notre compréhension de la Gauche communiste n’est peut être pas aussi profonde que celle de nos camarades en Europe où réside la classe ouvrière qui a la plus longue et la plus riche expérience. Mais nous sommes confiants dans le fait que notre clarification théorique est suffisante pour intégrer une organisation communiste internationale.
En tant que nouvelle section d’une organisation internationale centralisée et unitaire – le CCI –, la poursuite de discussions vivantes et de débats avec les communistes pour analyser et étudier les questions cruciales pour l’avancée de la révolution communiste mondiale sera plus organisée, plus centralisée et plus large. Et surtout, les interventions des minorités révolutionnaires seront plus efficaces.
Nous savons que nous allons courir un grand risque aux Philippines parce que nous défendons fermement la révolution communiste et l’internationalisme. La droite et la gauche de la bourgeoisie aux Philippines, avec leurs organisations armées, haïssent l’une toute autant que l’autre les révolutionnaires marxistes parce que nous sommes un obstacle face à leurs mystifications et à leurs mensonges pour dévoyer les luttes du prolétariat philippin du chemin de la révolution prolétarienne internationale. Les communistes de gauche sont les ennemis mortels de toutes les fractions de la bourgeoisie philippine.
C’est cela le défi pour les communistes internationalistes aux Philippines : surmonter toutes les difficultés et continuer la clarification théorique, les interventions dans les luttes ouvrières aux Philippines et être en contact avec tous les camarades communistes, en particulier en Asie.
Nous voulons aussi envoyer tous nos saluts les plus chaleureux aux camarades en Turquie (EKS) qui s’intègrent au CCI comme nouvelle section dans ce pays. La formation de deux nouvelles sections du CCI, aux Philippines et en Turquie – au moment où le système est dans une crise très profonde et où il y a une résistance de la classe ouvrière largement répandue – est une indication concrète qu’à travers le monde, des éléments et des groupes en recherche d’une alternative révolutionnaire au capitalisme décadent et en décomposition se développent ; des éléments qui sont conscients que le nationalisme, la démocratie, le parlementarisme et le syndicalisme ne sont que des tromperies et des mystifications.
Internasyonalismo (13 février 2009).
Vie du CCI:
Géographique:
- Philippines [214]
Prises de position depuis le Pérou : le massacre de Bagua est une manifestation du pourrissement du capital !
- 3368 lectures
Des voix prolétariennes se sont élevées contre le massacre de Bagua 1. Les camarades du Noyau Prolétarien du Pérou (également nommé Cercle scientifique d'analyse sociale) nous ont envoyé une prise de position dénonçant le brutal massacre d’indigènes perpétré par l’Etat péruvien dans un conflit lié à l’expropriation de terres d’anciennes communautés amazoniennes sous le prétexte « d’apporter le progrès », d’implanter de nouvelles exploitations à grande échelle pour extraire les hypothétiques ressources naturelles de cette région.
Dans le même temps, nous avons reçu, sous la forme de commentaire sur notre site, un tract signé d’un groupe de Lima se réclamant de l'anarchisme, « Jeunes Prolétaires », qui contient également des positions très valables.
Ces deux tracts ne sont pas qu’une simple prise de position ; ils ont été activement diffusés dans la manifestation qui a eu lieu le 11 juin dernier à Lima contre cette répression.
Nous saluons chaleureusement ces deux initiatives. Nous apprécions beaucoup le courage et l’engagement prolétarien que cela exprime. Face à des événements comme le massacre de Bagua, il est nécessaire que se fassent entendre des voix qui expriment des analyses et qui montrent des perspectives prolétariennes clairement opposées aux visions nationalistes, en défense du capitalisme d’Etat ou de l’inter-classisme comme au nom de la « citoyenneté » ainsi que de la « lutte pour la démocratie », que mettent en avant Ollanta2, les syndicats et tous les adorateurs du « Socialisme du XXIe siècle », cette grande escroquerie montée par Chavez et ses disciples.
Nous publions ci-dessous une nouvelle prise de position internationaliste provenant également de camarades du Pérou qui rejoint les deux précédentes et contient la même vision internationaliste. 3
Le point commun de ces trois documents réside dans le fait qu’ils abordent les événements du point de vue du prolétariat :
- Comment développer la lutte ? Comment manifester sa solidarité envers les victimes du massacre ?
- Comment maintenir l’autonomie de classe des prolétaires ?
- Comment dénoncer non seulement la répression barbare du gouvernement mais aussi les pièges et les fausses orientations des partis d’opposition ?
Ce qu’ont en commun les trois documents c’est, en définitive, la défense des positions internationalistes et prolétariennes et en même temps la dénonciation des positions nationalistes, capitalistes d’Etat, interclassistes, etc., qui amènent avec elles la division, la dislocation et, en fin de compte, la défaite du prolétariat avec, pour finir, celle de l’ensemble de l’humanité.
Ce cadre commun est le plus important et c’est ce qui unit tous les internationalistes.
Ceci étant dit, il existe un thème qui est posé dans les trois textes et qui, à notre avis, devrait être objet d’un débat du plus grand intérêt.
Ce thème nous pourrions le résumer de la façon suivante : quelle attitude doit adopter le prolétariat face aux luttes des autres couches sociales non exploiteuses mais dont la condition sociale n’est pas prolétarienne ?
Ce problème s’est posé de façon brûlante dans la Russie de 1917 dans laquelle il y avait à peine 3 ou 4 millions de prolétaires immergés dans une masse hétérogène de 100 millions de paysans. Le prolétariat avait réussi à rallier à son combat ce gigantesque secteur social. Nous pensons qu’il a réussi à le faire à partir de son propre terrain de classe : la lutte pour en finir avec la guerre impérialiste, la révolution mondiale, la lutte pour réclamer tout le pouvoir aux soviets ou conseils ouvriers. Ceci étant dit, face aux revendications paysannes, il y avait eu un débat très large, tant dans les rangs bolcheviques que dans le mouvement révolutionnaire international, débat dans lequel ressortait notamment la position critique adoptée par Rosa Luxembourg vis-à-vis de la politique bolchevique envers la paysannerie .
Nous pensons qu’il serait très important de reprendre ce débat pour qu’il nous aide à nous orienter dans la situation actuelle qui ne se déroule cependant pas dans le même contexte. Par exemple, le poids de l’agriculture s’est considérablement réduit durant les 40 dernières années dans la majorité des pays, notamment en Amérique latine où, alors qu’au début des années 1960 la population paysanne représentait plus de la moitié de la population totale, elle atteint aujourd’hui à peine 20 %.
Les paysans ont été arrachés à leurs communautés ancestrales dans la montagne ou dans les forêts par la voracité de l’expansion capitaliste. Cela s’est réalisé à travers l’introduction de la production marchande, principalement à travers le rôle de l’Etat, au moyen d’une brutale pression fiscale comme à travers le développement du mouvement coopératif 4, les contraignant à abandonner le travail de la terre qui avait l’inconvénient de l’archaïsme, de l’isolement et de la pauvreté endémique mais qui offrait l’avantage de préserver encore un certain équilibre économique et communautaire.
Et cela, pour quelle perspective ? Soit celle de l’émigration vers l’Europe et l’Amérique du Nord, soit la fuite désespérée vers les grandes villes qui se sont vues inondées de terribles ceintures de misère dans lesquelles s’entassent des millions de personnes dans des conditions de survie épouvantables.
Ce problème nous devons l’aborder au moyen du débat en nous posant des questions telles que :
- Est-ce que le processus de dépeuplement qui continue à se développer dans les zones agraires spoliées par l’aiguisement de la crise capitaliste pourrait s’arrêter ?
- Est-ce qu’il y aurait des revendications qui garantiraient une stabilité minima à ces communautés ?
- Sur quel terrain et sur quelles bases la solidarité du prolétariat peut elle s’exprimer ?
CCI (23 juillet 2009)
Prise de position depuis le Pérou :
Bagua est une manifestation du pourrissement du capital !
Le capitalisme nous confronte actuellement aux pires moments de son existence et les évènements de Bagua en sont une tragique expression. Quand le capitalisme s’exprime à travers des faits comme ceux de Bagua avec à leur suite des rivières de sang partout, on a là un symptôme de plus qui manifeste qu’il traverse son pire moment historique de décadence. Cette décomposition de la société est la caractéristique la plus importante et la plus saillante de cette décadence capitaliste.
Bagua est une manifestation qui montre que le capitalisme traverse actuellement ce processus d’effondrement et les scènes de tuerie et de barbarie en sont les conséquences permanentes. Les guerres sont une menace constante, les grands massacres comme celui de Bagua aujourd’hui, ne sont qu’une manifestation de la barbarie capitaliste qui peut être tout près et mettre en danger l’ensemble de l’humanité à n’importe quel moment.
Il est possible que cela n’apparaisse pas clairement de prime abord, et beaucoup diront que le capitalisme continue à être tout puissant et, malgré sa crise, à être un système qui va de l’avant. Mais ce n’est pas le cas ; depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme est entré dans sa période de décadence et, aujourd’hui, il est dans cette nouvelle phase de la décadence capitaliste qu’est la décomposition, phase qui a pris son plein essor à partir de la fin des années 1980 5.
Pour quelle raison luttaient les communautés indigènes de Bagua ?
Le motif principal de la lutte a été la défense de la petite propriété (indigène, paysanne), laquelle était une revendication juste pour ces secteurs exploités, condamnés à la misère et à la marginalisation. S’il est bien clair que le caractère prolétarien n’était pas présent dans cet affrontement, il appartient au prolétariat en tant que classe de faire son possible pour se joindre à ces secteurs vu que beaucoup d’indigènes et de paysans sont condamnés à la prolétarisation uniquement en tant que force de travail. Nous sommes d’accord avec la nécessité pour le prolétariat d’être solidaire avec ces luttes des communautés indigènes de Bagua et de n’importe où ailleurs.
Ces couches sociales doivent être gagnées par le prolétariat dans sa lutte finale contre le capital. Pour autant, nous ne devons pas mélanger cela avec l’idée que ces secteurs pourraient être les protagonistes d’une lutte similaire à celle du prolétariat, ou que tous nous serions une masse égale et indistincte de prolétaires. Seulement la lutte du prolétariat 6, avec ses revendications de classe, avec ses méthodes de classe, avec la perspective qu’elle porte en elle, peut offrir un avenir, un futur aux autres couches sociales exploitées et à l’humanité dans son ensemble et, pour cela, le prolétariat doit créer une plate-forme dans laquelle les communautés indigènes doivent intégrer leurs problèmes et leurs revendications.
Par contre, si nous prenions les choses à l’envers, si nous prenions comme point de départ une lutte indifférenciée dans laquelle le prolétariat se diluerait dans d’autres couches sociales, nous courrions le risque que ni le prolétariat ne puisse développer sa force, pas plus que ces couches sociales, c’est-à-dire que les deux s’affaibliraient et seraient défaites et écrasées.
L’antagonisme entre la petite et la grande propriété est mis en relief ici à travers le fait que la grande propriété s’impose pour extraire les ressources de la zone, arrachant « leurs terres » aux habitants des forêts et aux paysans. Pour le prolétariat, il ne s’agit pas de défendre la propriété, mais de l’abolir pour mettre toutes les ressources de la nature à la disposition de l’ensemble de l’humanité.
La lutte pour l’abrogation des décrets et pour la demande d’aides budgétaires, pour les écoles, les routes, l’eau, la lumière, pour le développement de cette région, cache que le problème de fond est le capitalisme. Mais, plus particulièrement, cela crée une illusion, celle que le capitalisme à travers l’Etat pourrait être l’agent du progrès (et il ne s’agit pas ici d’une dichotomie modernité contre arriération, comme le prétend le président Alan Garcia 7). Non. Ce que nous mettons en évidence avec ce qui est arrivé à Bagua, c’est la perspective désespérante du capitalisme qui mène à la destruction environnementale et à de grands massacres de populations, dont la perspective n’est pas le travail salarié mais la disparition des vieilles communautés poussant ces populations à s’entasser dans les grandes villes et dans leurs banlieues dans des conditions misérables.
Mais l’idéologie dominante du capitalisme est ici présente avec « l’indigénisme », la « culture de l’ancestralité », le nationalisme, et cette idéologie remplit un rôle de dévoiement des tentatives prolétariennes au moment de se solidariser avec les protestations des communautés indigènes. Cette idéologie, nous l’avons vue quand ils portaient des drapeaux du « tahuantinsuyo » ou le chiffon bicolore. Ils ne comprennent pas non plus que lorsque le gouvernement les massacre, ce n’est pas un acte « autoritaire », « génocidaire » ou « antidémocratique » mais que c’est précisément LA DEMOCRATIE ELLE-MEME QUI LES MASSACRE.
Face à ce qui est arrivé avec la tuerie de Bagua, il est nécessaire que se fassent entendre des voix qui expriment l’analyse et les perspectives prolétariennes en claire opposition avec les prises de position nationalistes, l’idéologie du capitalisme d’état, de l’inter-classisme, du pacifisme et de la « citoyenneté », de « la lutte pour la démocratie », que mettent en avant Ollanta, les syndicats, les ONG, les fronts et tous les adorateurs du « Socialisme du XXIe siècle », la grande escroquerie de Chavez et de ceux qui adoptent sa politique. Ceci implique de dénoncer radicalement la gauche et l’extrême gauche du capital.
Finalement, nous devons réaffirmer clairement que, pendant que le capitalisme est dans ce processus d’effondrement, il entraînera avec lui toujours davantage de massacres, de guerres, et de manifestations de barbarie propres à cette phase de décomposition qui le traverse aujourd’hui. Le prolétariat est appelé à dépasser tout cela en mettant en avant sa perspective de futur, en la montrant à toute l’humanité, alors que sa force, actuellement, est en train de se développer.
Socialisme ou barbarie !
1 Au matin du 5 juin, la police péruvienne s'est déchaînée contre les populations indigènes de la province d'Amazonas (représentant une communauté indienne de plus de 600 000 personnes) qui bloquaient une route en appui à leurs revendications pour défendre leur territoire. Depuis le 15 avril, les communautés indiennes du Pérou amazonien s’étaient soulevées contre des mesures d’expropriation de leurs terres au profit des entreprises minières ou pétrolières dans le Nord-Est du pays. A la mi-mai, ils étaient considérés en « état d’insurrection ». Le bilan des affrontements, extrêmement lourd, est de plusieurs morts, sans doute plus d’une trentaine, peut-être des centaines de blessés et une quarantaine d’arrestations. Les informations sont restées confuses, la zone est depuis bouclée par la police.
2 Ollanta Moisés Humala Tasso est un homme politique et militaire (commandant en retraite) péruvien. Il est membre fondateur et président du parti nationaliste péruvien.
3 Pour les deux prises de position précédentes, voir sur notre site en espagnol : Perú : Voces proletarias contra la matanza de Bagua. [215]
4 Des projets monstrueux de « développement » comme celui projeté par l’Etat péruvien à Bagua nous en voyons dans beaucoup d’autres pays. Par exemple, au Brésil et en Argentine, le développement d’une production « verte » de combustibles « écologiques » conduit à des cultures extensives gigantesques qui non seulement provoquent l’émigration des communautés qui habitent ces terres mais qui, de plus, entraînent de terribles désastres écologiques.
5 pour une analyse plus détaillée de ce phénomène, lire es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [216]
6 Nous rejetons la vision réductrice et partielle du prolétariat réduit uniquement aux ouvriers des usines. Le prolétariat est une classe sociale qui regroupe des couches très larges tant à la ville que dans les campagnes.
7 Seize ans après avoir terminé un premier mandat catastrophique (1985-1990), le chef de file de l’APRA (social-démocrate) Alan Garcia a été réélu président du Pérou en 2006 dans le duel qui l’opposait au candidat nationaliste Ollanta Humala.
Géographique:
- Pérou [128]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Réunion publique du CCI au Pérou : un débat internationaliste
- 3491 lectures
En août dernier, s’est tenue à Lima une réunion publique du CCI sur le thème : « Face à la crise du capitalisme, une seule alternative : la lutte du prolétariat ».
L’assistance à cette réunion a été nombreuse mais, surtout, le débat a été profond et dynamique. Deux groupes internationalistes du Pérou ont participé à cette réunion publique : le Noyau Prolétarien du Pérou (Núcleo proletario de Perú-NPP) et le Groupe de la Lutte Prolétarienne (Grupo de Lucha Proletaria-GLP) ; un camarade délégué par les Noyaux Internationalistes de l’Equateur (Núcleos Internacionalistas de Ecuador-NIE) a aussi participé et Opposition Ouvrière (Brésil, Oposiçao Operaia), qui aurait voulu être présente, n’a pas pu assister pour des raisons diverses1. Tout cela, nous y reviendrons, a donné un caractère nettement prolétarien à cette réunion2.
Après une courte présentation dont le rôle n’était en rien de « semer la bonne parole », mais de donner les bases au débat3, il y a eu beaucoup d’interventions sur différents sujets que nous allons essayer de synthétiser et parfois de retranscrire4.
Il s’y est exprimé un plein accord des participants pour insister sur la gravité de la crise et sur le terrible coût humain qu’elle représente pour le prolétariat et les autres couches sociales non-exploiteuses. Ainsi un camarade du NPP a affirmé : « Nous sommes face à la crise la plus profonde du capitalisme et on n’avait jamais vu aux époques des systèmes précédant le capitalisme ce qu’on voit sous celui-ci : des famines non pas parce que la production serait insuffisante, mais parce qu’elle est excessive. »
La crise n’est pas –comme on nous le dit- le résultat « d’une mauvaise gestion financière » ou « le manque d’intervention de l’État », mais elle est due au fait que le capitalisme se fonde sur le travail salarié et la production marchande et ne peut déboucher que sur une surproduction irrémédiable qui entraîne barbarie, destruction et misère pour le plus grand nombre.
« La crise est comme un trou noir qui avale des vies et des illusions » a dit un camarade. La crise ne peut pas se réduire à quelques chiffres macro-économiques ni à des bilans financiers ; ce qui est le plus important, ce sont ces visages pleins de souffrance de millions de personnes qui, malgré leurs efforts surhumains, sont entraînés par le tourbillon de la misère, de la marginalisation et de la destruction. Un exemple suffit : au Guatemala on est face à une « crise alimentaire sévère qui s’abat sur plus de 54 000 familles pauvres de ce pays et qui, depuis janvier, a emporté 462 personnes ». (El País du 9 septembre 2009)
Est-ce que l’internationalisme et le nationalisme sont compatibles ?
Cependant, la plus grande partie de la discussion n’a pas traité de la crise et de sa nature, mais de comment lutter contre elle : le prolétariat est-il la seule classe révolutionnaire capable de proposer une solution à la crise du capitalisme ? Quels sont les moyens dont dispose cette classe pour ce combat-là ? A quelle société aspire-t-elle ?
Mais c’est là où s’est posée une question de principe, un principe sur lequel un important effort d’éclaircissement a été porté : est-il possible d’être à la fois nationaliste et internationaliste ?
Cette question a été posée par un camarade de tendance trotskiste qui a participé activement à la réunion. D’un coté, il a dit que « le prolétariat est une classe internationale qui doit être solidaire avec les luttes qui se produisent dans le monde », mais de l’autre, il a dit qu’« on est en train de vendre le Pérou à la bourgeoisie chilienne », renchérissant sur ce qu'avait dit un autre participant en disant : « Le Pérou est en train d’être envahi par le capital chilien ».
Diverses autres interventions ont répondu à ces dernières, précisant que le prolétariat au Pérou a, entre autres, un frère : le prolétariat du Chili5, et que seule la solidarité de classe, par-delà les frontières, les races et les secteurs économiques, pourra fournir au prolétariat la force nécessaire pour et dans la lutte. Un camarade du NPP a apporté cet argument fondamental : « Le capitalisme est un système de production mondial parce que le travail du prolétariat est une collectivité mondiale. »
On ne peut pas mélanger nationalisme et internationalisme, c’est l’eau et le feu. Pendant les années 1930, un des symboles les plus évidents du triomphe de la contre-révolution, c’est d’avoir vu lors des grèves en France de 1936, dans les usines occupées, à coté du drapeau rouge, flotter le drapeau tricolore de la « France éternelle » et les ouvriers chantant aussi bien la Marseillaise (hymne national de la bourgeoisie française) que l’Internationale.
Est-il exagéré de parler du prolétariat comme classe révolutionnaire ?
En plus des éclaircissements sur l’internationalisme, la discussion a aussi représenté un effort d’argumentation sur la nature révolutionnaire du prolétariat.
Un camarade de tendance anarchiste a considéré que « nous ne pouvons pas tomber dans le fétichisme du prolétariat, étant donné que celui-ci s’est réduit et a souffert de grands changements qui l’ont diminué et lui ont fait perdre sa conscience de classe ».
Il est vrai que, tout au long de plus de trois siècles d’histoire, le prolétariat a beaucoup changé dans sa composition sociologique, dans les formes du travail, dans le degré de concentration, dans sa formation technique et culturelle, etc. Au milieu du 19e siècle, le trait dominant de la plus grande partie des travailleurs était le travail de métier, alors que à la fin du 19e et début du 20e dominait le travail hautement mécanisé. Si autour des années 1970, ce qui dominait, c’étaient les grandes usines, aujourd’hui, ce qui domine, c’est le travail associé au niveau mondial, de telle sorte qu’on ne peut vraiment pas dire d’un produit qu’il ait été fabriqué par les ouvriers de tel pays ou de telle entreprise. Ce qui est important, c’est le caractère coopératif mondial de la production, ce qui renforce les bases objectives pour l’unité internationale du prolétariat.
Les camarades du NPP ont insisté sur le fait que ces changements n’altèrent pas l’essentiel : « Le prolétariat est la classe productrice de plus-value, il est la classe exploitée », en ajoutant un argument supplémentaire : « Qui peut changer la société ?, Seul le prolétariat peut le faire, parce qu’il est la classe productrice, mais surtout parce qu’il est une classe associée avec une histoire. » Le prolétariat est le producteur collectif de l’essentiel des richesses mondiales. Mais il n’est pas que cela, il est aussi une classe capable d'atteindre une conscience collective tout au long de ses différentes générations. Sa lutte a une continuité historique à travers les générations successives, ce qui lui permet de tirer des leçons de son combat, d’apprendre de ses erreurs, de formuler avec plus de clarté ses principes et ses objectifs. C’est en cela que le prolétariat est différent des classes exploitées du passé -les esclaves et les serfs – qui étaient aussi les classes productrices mais dont la lutte n’avait ni continuité, ni avenir. Le prolétariat est la première classe exploitée de l’histoire qui est aussi la classe révolutionnaire.
Les moyens de lutte du prolétariat
Mais la situation actuelle ne permet pas de vérifier cette réalité d’une façon empirique et immédiate. Les luttes actuelles montrent des aspects très importants de recherche de la solidarité, de prise de conscience, mais elles n’atteignent pas le caractère massif et général qui puisse permettre aux prolétaires de comprendre la force sociale et historique qu’ils possèdent et ne permet pas non plus à l’ensemble de la population de concevoir le prolétariat comme classe ayant sa propre perspective.
Ceci fait surgir des doutes sur la capacité du prolétariat, sur les moyens dont il dispose, et comment va-t-il arriver à vraiment en être maître, etc. Ces doutes se sont exprimés ouvertement et largement lors de cette réunion.
Un camarade a posé la question : « Si les ouvriers travaillent 12 et 14 heures, quel temps leur reste-t-il pour le débat et la mobilisation ? » En voyant les ouvriers intimidés par la crise, encore très atomisés, il est difficile d’imaginer qu’ils seront un jour capables d’agir collectivement et massivement comme une classe autonome représentant une alternative propre. Cependant, Rosa Luxemburg, en analysant la révolution russe de 1905, a montré comment, dans les conditions générales de la grève de masse, « le prudent père de famille chargé d’enfants devient un révolutionnaire passionné ».
La discussion a tenté de comprendre par quels chemins on peut arriver à cette transformation psychologique qui aujourd’hui pourrait paraître un miracle. Un des moyens, c’est l’unité croissante entre lutte revendicative et lutte révolutionnaire. C’est une question qui n’a pas pu être approfondi lors de cette réunion. A notre avis, il n’y a pas d’opposition entre les deux aspects : la lutte revendicative contre l’exploitation et la lutte révolutionnaire pour abolir l’exploitation6.
Un camarade du NPP a mis en avant que « La lutte de classe n’est pas une lutte des minorités, mais une lutte des masses » : c’est à cela que correspond la nécessité pour le prolétariat de se donner une organisation massive et générale capable de l’unifier, de servir de lien pour le débat et la prise de décision. Dans cette discussion, on a réaffirmé que cette organisation est, historiquement, celle des conseils ouvriers, depuis les expériences en Russie en 1905 et 1917. Une camarade du GLP a dit que les conseils ouvriers sont « cette organisation unitaire où tous peuvent participer ».
À ce moment-là, un camarade de tendance anarchiste a demandé : « Sur les conseils ouvriers, est-ce que vous proposez donc le modèle russe ? » La discussion a pu clarifier qu’il ne s’agit pas de prendre les conseils ouvriers de 1905 et 1917 comme un modèle infaillible. Les conseils ouvriers de 1917-23 en Russie –et dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique- sont une expérience qu’il faut analyser en la passant au crible de la critique, en essayant de voir leurs faiblesses et leurs insuffisances, voilà des leçons qui seront vitales pour les nouvelles luttes que le prolétariat développera.
Aussi, à la question du même camarade : « Est-ce que vous êtes partisans du modèle léniniste du parti ? » notre réponse, et celle d’autres participants, est allée dans le même sens : il n’y a pas de modèles à imiter, ce que nous possédons, c’est des expériences qui nous fournissent des leçons pour l’époque historique présente. Le bolchevisme a apporté un internationalisme intransigeant qui l’a mis à la tête de la lutte contre la guerre, il a compris le rôle des conseils ouvriers « forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat », ce qui s'est concrétisé dans le mot d’ordre clair de « Tout le pouvoir aux Soviets ! ». Mais il a aussi défendu des positions erronées –cependant partagées par d’autres courants prolétariens d’alors : la position sur le parti qui doit exercer le pouvoir au nom de la classe ouvrière par exemple, ce qui a contribué à la défaite et à la dégénérescence de la révolution russe7.
Le communisme et la perspective révolutionnaire
Comme une camarade l’a dit : « Quel est le but de l’organisation du prolétariat ? Quel est l’objectif des conseils ouvriers ? Je crois qu’il n’y en a qu’un seul : le communisme. » Cette réunion a débattu sur l’objectif historique de la lutte prolétarienne en réponse à une réflexion faite par un camarade de tendance anarchiste : « Quand l’URSS existait, un modèle existait. Il y avait aussi le modèle de la lutte de guérilla qui créait des zones libérées. Mais, maintenant, tous ces modèles sont tombés. Un nouveau modèle pourrait être l’autogestion, elle pourrait créer de véritables zones (quartiers, entreprises) libérées par les exploités. »
La discussion a pu éclaircir que l’URSS n’était pas un modèle, mais une des formes que prend le capitalisme d’Etat. La guérilla ne l’est pas non plus, parce qu’elle est une des expressions des affrontements sanglants entre fractions de la bourgeoisie qui prennent en otages des prolétaires et des paysans.
Mais en observant avec plus de profondeur : le but du prolétariat peut-il être « un modèle de nouvelle société ? » Plusieurs interventions ont insisté sur le fait que l’erreur consiste précisément à chercher un « modèle » qui ne pourrait être qu’une imposition sectaire et doctrinaire à l’ensemble du prolétariat. La Révolution russe et toute la vague révolutionnaire mondiale qui l’a suivi (1917-23) ne furent aucunement une « expérience sociale de laboratoire », mais la réponse du prolétariat à la terrible situation de barbarie et de destruction créée par la Première Guerre mondiale, qui a signifié l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, c’est-à-dire l’époque dans laquelle il devient une entrave au développement social et où, après avoir été un facteur de croissance et de progrès, il devient son contraire : un facteur de barbarie et de destruction, une menace pour la survie même de l’humanité8.
Le communisme n’est pas une heureuse Arcadie, un état idéal. La base du communisme, c’est le dépassement et la résolution des contradictions qui, sous le capitalisme, mènent l’humanité vers l’abîme et la destruction. Ainsi, la surproduction qui, sous le capitalisme, mène à la faim et au chômage, doit être, dans le communisme, la base pour la satisfaction des besoins de toute l’humanité. Le caractère social et mondial de la production qui, sous le capitalisme, stimule la concurrence et la guerre entre nations, est dans le communisme la base de la coopération fraternelle de tous les travailleurs, pour l’organisation d’une communauté humaine mondiale.
La discussion a mis en avant que le communisme sera mondial ou ne sera pas. C’est dans ce sens que plusieurs interventions ont rejeté le modèle stalinien de « socialisme dans un seul pays » ou le modèle de la guérilla des « zones libérées ». Mais la discussion a aussi mis en avant que l’autogestion ne sortait pas de ce même schéma nationaliste : ni le « socialisme dans une seule usine », ni « le socialisme dans un seul quartier » ne sont une alternative au « socialisme dans un seul pays » du stalinisme9.
La perspective de nouveaux débats
Une camarade a dit que « Ce débat est très bien. Il sert à ce que chacun comprenne ce que l’autre dit parce que, autrement, on a tendance à parler son propre jargon ». Nous pensons que l’intense débat qu'il y a eu lors de cette réunion publique a servi à mieux se comprendre, à approfondir les préoccupations de chacun, à fournir des réponses, à essayer de dépasser les particularismes qui nous enferment : les jargons, la méfiance mutuelle, l’incompréhension ...
Une camarade du NPP a proposé une orientation que nous partageons : « Notre tâche majeure est celle de développer le débat, de créer des cercles de discussion. Voilà notre fonction à court terme. Il s’agit de mettre en place des moyens pour le changement révolutionnaire. Le changement révolutionnaire ne peut pas être forcé, il faut que les conditions pour le mener à bien soient présentes. »
Nous pensons qu’il est devenu nécessaire de refaire d’autres réunions publiques pour y aborder de nouveaux sujets et explorer les différents chemins que la discussion a ouverts. Le débat que nous avons vécu au Pérou fait partie d’une tendance internationale qui est en train d’émerger et à laquelle la récente Rencontre de communistes internationalistes d’Amérique latine10 a donné une impulsion et un moyen d’expression. En ce sens, la réunion publique au Pérou et les nouvelles discussions qui pourront avoir lieu font partie de ce milieu international et constituent une contribution active dans son développement. Comme nous l’avons dit lors de la première réunion publique qui a eu lieu au Pérou en 2007 : « Lutter pour la construction d’un milieu où le débat prolétarien soit au centre de la vie politique, est une perspective qui au Pérou, comme dans le reste du monde, préparera la future révolution mondiale. »
CCI (10 septembre 2009)
On peut lire en espagnol le texte introductif présenté à cette réunion, ainsi que la lettre de salut envoyé par le groupe brésilien Opposition Ouvrière (OpOp) qui n’a pu y assister, sur notre site : https://es.internationalism.org/node/2655 [217]
1 Il y a eu plusieurs rencontres avec ces deux groupes ainsi qu’avec un camarade d’Equateur. Lors de ces rencontres, ont été abordés de très importants sujets : les Conseils ouvriers, le prolétariat, le Parti mondial, la période de transitions entre le capitalisme et le communisme. Lors de ces rencontres, on a lu la lettre des camarades d’Opposition Ouvrière du Brésil.
2 En 2007 et 2008, nous avons eu deux réunions publiques au Pérou. Voir en espagnol : « Reunión Pública en Perú: hacia la construcción de un medio de debate y clarificación » (https://es.internationalism.org/node/2107 [164]) ainsi que « Réunion Publique au Pérou sur la crise ; un débat passionnant et passionné » https://fr.internationalism.org/icconline/2008/reunion_publique_du_cci_au_perou_sur_la_crise_un_debat_proletarien_passionnant_et_passionne.html [218]
3 Voir annexe dans la version espagnole de cet article.
4 Nous avons essayé de refléter fidèlement ce que les participants ont dit, mais si quelqu’un pense qu’il y a déformation ou mauvaise interprétation, nous l’invitons à nous écrire et nous rectifierons si c’est le cas.
5 En 1879 s’est déroulée la guerre du Pacifique où le Pérou a été défait par son ennemi chilien dont l’armée est arrivée jusqu’à Lima. Depuis lors, le nationalisme péruvien brandit l’étendard de « l’invasion chilienne ». Les syndicats et les partis de gauche sont des anti-chiliens, parfois encore plus féroces que la droite. Face à cette phobie nationaliste, le prolétariat doit se rappeler qu’à Iquique, en 1907, les ouvriers chiliens, péruviens et boliviens luttèrent ensemble lors d’une grève solidaire écrasée par l’Etat chilien avec la complicité de ses rivaux du Pérou et de la Bolivie.
6 Pour être plus précis, disons que la lutte revendicative n’a pas grand-chose à voir avec la lutte syndicale, laquelle a une vision déformée des luttes économiques des ouvriers, une vision soumise aux impératifs du capital.
7 Pour connaître notre position sur le Parti, voir « Sur le parti et ses rapports avec la classe » https://fr.internationalism.org/rinte35/orga.htm [219], (1983) et "Le parti défiguré : la conception bordiguiste [220]" (1980). Sur le bolchevisme : « Question d'organisation : sommes-nous devenus "léninistes"? (1999) sur https://fr.internationalism.org/rinte96/leninistes.htm [221]
8 On peut le vérifier aujourd’hui de façon dramatique avec la crise, les guerres –celle d’Afghanistan ou le frénétique réarmement qui sont en train de mettre en place une grande partie des gouvernements sud-américains -, pour ne pas parler de la destruction de l’environnement dont les ravages de la forêt amazonienne sont un terrible exemple.
9 Nous n'avons pas eu le temps de discuter de l’expérience tragique de 1936 en Espagne et le sens réel des collectivités autogérées dont l’anarchisme se revendique.
10 Cf. sur notre site web : « Une rencontre de communistes internationalistes en Amérique latine [222] » (2009),
Vie du CCI:
- Réunions publiques [109]
Géographique:
- Pérou [128]
Salut aux nouvelles sections du CCI aux Philippines et en Turquie!
- 3458 lectures
Lors des derniers congrès du CCI, nous avons pu mettre en évidence une tendance à l'émergence à l'échelle internationale de nouveaux éléments ou groupes s'orientant vers les positions de la Gauche communiste et nous avons souligné l'importance historique de ce processus de même que la responsabilité que cela impliquait pour notre organisation :
"Les travaux du 16e congrès (...) ont placé au centre de leurs préoccupations l'examen de la reprise des combats de la classe ouvrière et des responsabilités que cette reprise implique pour notre organisation, notamment face au développement d'une nouvelle génération d'éléments qui se tournent vers une perspective politique révolutionnaire." ("16e congrès du CCI - Se préparer aux combats de classe et au surgissement de nouvelles forces révolutionnaires [223]", Revue Internationale n° 122)
"La responsabilité des organisations révolutionnaires, et du CCI en particulier, est d'être partie prenante de la réflexion qui se mène d'ores et déjà au sein de la classe, non seulement en intervenant activement dans les luttes qu'elle commence à développer mais également en stimulant la démarche des groupes et éléments qui se proposent de rejoindre son combat." ("17e congrès du CCI - Résolution sur la situation internationale [224]", Revue Internationale n° 130)
"Le congrès a... tiré un bilan extrêmement positif de notre politique en direction des groupes et éléments se situant dans une perspective de défense ou de rapprochement des positions de la Gauche communiste. (...) l'aspect le plus positif de cette politique a été sans aucun doute la capacité de notre organisation d'établir ou de renforcer des liens avec d'autres groupes se situant sur des positions révolutionnaires et dont l'illustration était la participation de quatre de ces groupes au 17e congrès." ("17e congrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien [225]", Ibid.)
Ainsi, lors de notre dernier congrès international, nous avions pu y saluer la présence, pour la première fois depuis un quart de siècle, de délégations de différents groupes se situant clairement sur des positions de classe internationalistes (OPOP du Brésil, le SPA de Corée, l'EKS de Turquie, Internasyonalismo des Philippines [1], même si ce dernier groupe n'avait pu être présent physiquement). Le contact et la discussion se sont poursuivis non seulement avec ces quatre groupes mais également avec d'autres groupes et éléments dans d'autres pays du monde (notamment en Amérique latine ce qui a permis à notre organisation de tenir plusieurs réunions publiques au Pérou, à Saint Domingue et en Equateur [2]). La discussion avec les camarades de Turquie et des Philippines les a conduits à prendre la décision de poser leur candidature au CCI compte tenu de leur accord croissant avec nos positions. Elle s'est donc poursuivie, depuis un bon moment, dans le cadre d'un processus d'intégration tel que nous l'avons défini dans notre article publié sur notre site Internet : "Comment devenir militant du CCI ? [226] [3]
Au cours de la dernière période, ces camarades ont ainsi mené des discussions approfondies sur notre plate-forme et nous en ont adressé les comptes-rendus. D'autre part, plusieurs délégations du CCI se sont rendues sur place pour discuter avec eux et ont pu vérifier la profondeur de leur volonté d'engagement de même que la clarté de leur accord avec nos positions et nos principes organisationnels. A l'issue de ces discussions, la dernière réunion plénière de l'organe central du CCI a pu prendre la décision d'intégrer ces deux groupes comme nouvelles sections de notre organisation.
La plupart des sections du CCI sont basées en Europe [4] ou en Amérique [5] et, jusqu'à présent, en dehors de ces deux continents, il n'y avait qu'une section en Inde. L'intégration de ces deux nouvelles sections au sein de notre organisation élargit de façon importante l'extension géographique de celle-ci.
Concernant les Philippines, il s'agit d'un très vaste pays qui se trouve dans une région du monde ayant connu récemment une croissance très rapide de son industrie et, partant, du nombre d'ouvriers. Cette croissance a engendré au cours de la dernière période de nombreuses illusions sur un "nouveau souffle" du capitalisme mondial" mais il est maintenant clair que, pas plus que les "vieux" pays capitalistes, les pays "émergents" ne seront épargnés par la crise aigüe qui se développe à l'heure actuelle. C'est donc une zone géographique où les contradictions du capitalisme vont s'exacerber de façon violente dans la période à venir, provoquant inévitablement des mouvements sociaux, non seulement des émeutes de la faim comme on l'a vu au printemps 2007 mais aussi des luttes de la classe ouvrière.
La constitution d'une section en Turquie vient renforcer la présence du CCI dans le continent asiatique, et plus particulièrement dans une région proche d'un des lieux les plus critiques dans les tensions impérialistes actuelles, la région du Proche-Orient. D'ailleurs, nos camarades d'EKS ont été amenés à intervenir l'an dernier pour dénoncer les opérations militaires de leur bourgeoisie au nord de l'Irak (voir le "tract d'EKS contre l'opération de l'armée turque" publié sur notre site Web [227]).
A plusieurs reprises, le CCI a été accusé d'avoir une vision "européo-centriste" du développement des luttes ouvrières et de la perspective révolutionnaire parce qu'il avait mis en évidence le rôle décisif des secteurs du prolétariat des pays d'Europe occidentale :
"Ce n'est qu'au moment où la lutte prolétarienne touchera le cœur économique et politique du dispositif capitaliste :
- lorsque la mise en place d'un cordon sanitaire économique deviendra impossible, car ce seront les économies les plus riches qui auront été touchées ;
- lorsque la mise en place d'un cordon sanitaire politique n'aura plus d'effet parce que ce sera le prolétariat le plus développé qui affrontera la bourgeoisie la plus puissante ;
c'est alors seulement que cette lutte donnera le signal de l'embrasement révolutionnaire mondial.
Ce n'est qu'en l'attaquant à son cœur et à son cerveau que le prolétariat pourra venir à bout de la bête capitaliste.
Ce cœur et ce cerveau du monde capitaliste, l'histoire l'a situé depuis des siècles en Europe occidentale. C'est là où le capitalisme a fait ses premiers pas que la révolution mondiale fera les siens, l'un et l'autre étant d'ailleurs liés. C'est là en effet où sont réunies sous leur forme la plus avancée, toutes les conditions de la révolution énumérées plus haut. (...)
Ce n'est donc qu'en Europe occidentale, là où le prolétariat a la plus vieille expérience des luttes, où il est confronté d'ores et déjà depuis des décennies à ces mystifications "ouvrières" les plus élaborées, qu'il pourra développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution." ("Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe [228]", Revue Internationale n° 31)
Notre organisation a déjà répondu à cette critique "d'européo-centrisme":
"Ce n'est nullement là une vision ‘européo-centriste'. C'est le monde bourgeois qui s'est développé à partir de l'Europe, qui y a développé le plus vieux prolétariat, lequel a été doté de ce fait de son expérience la plus grande." (Ibid.)
En particulier, il n'a jamais considéré que les révolutionnaires n'avaient pas un rôle à jouer dans les pays de la périphérie :
"Cela ne veut pas dire que la lutte de classe, ou l'activité des révolutionnaires, n'a pas de sens dans les autres régions du monde. La classe ouvrière est une. La lutte de classe existe partout où se font face prolétaires et capital. Les enseignements des différentes manifestations de cette lutte sont valables pour toute la classe quel que soit le lieu où elles prennent place ; en particulier l'expérience des luttes dans les pays de la périphérie influencera la lutte des pays centraux. De même, la révolution sera mondiale et concernera tous les pays. Les courants révolutionnaires de la classe seront précieux dans tous les lieux où le prolétariat s'affrontera à la bourgeoisie, c'est-à-dire dans le monde entier." (Ibid.)
Cela vaut, évidemment, pour des pays comme les Philippines ou la Turquie.
Dans ces pays, le combat pour la défense des idées communistes est très difficile. Il s'affronte aux mystifications classiques que la bourgeoise met en avant pour faire obstacle au développement de la lutte et de la conscience du prolétariat (les illusions démocratiques et électorales, le sabotage des luttes ouvrières par l'appareil syndical et le poison du nationalisme). De plus, la lutte de la classe ouvrière et la lutte des révolutionnaires se heurtent de façon directe et immédiate, non seulement aux forces de répression du gouvernement officiel, mais également à des groupes armés qui s'opposent à ce gouvernement comme le PKK en Turquie et les différents mouvements de guérilla aux Philippines dont l'absence de scrupules et la brutalité n'ont rien à envier aux gouvernements, pour la simple raison qu'ils ne défendent rien d'autre que le capitalisme, même si c'est sous des formes différentes. Cette situation rend ainsi l'activité des camarades des deux nouvelles sections du CCI plus dangereuses que dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord.
La section aux Philippines qui avait déjà, avant son intégration au CCI, fait un travail de publication sur Internet dans la langue officielle des Philippines (le tagalog), de même qu'en anglais dont l'usage est très répandu dans ce pays, ne pourra pas encore publier une presse papier régulière (sinon de façon ponctuelle). Notre site Internet va donc devenir le support principal de la diffusion de nos positions aux Philippines.
La section en Turquie pourra disposer de la revue Dunya Devrimi, qui était jusqu'à présent l'organe de l'EKS et va devenir l'organe de presse du CCI dans ce pays. Dans la Revue Internationale n° 122 nous écrivions :
"Nous saluons ces camarades qui se tournent vers les positions communistes et vers notre organisation. Nous leurs disons : 'Vous avez fait le bon choix, le seul possible si vous avez la perspective de vous intégrer dans le combat pour la révolution prolétarienne. Mais ce n'est pas le choix de la facilité : vous ne connaîtrez pas des succès rapides, il faudra de la patience et de la ténacité et ne pas être rebutés lorsque les résultats obtenus ne seront pas à la hauteur de vos espérances. Mais vous ne serez pas seuls : les militants actuels du CCI seront à vos côtés et ils sont conscients de la responsabilité que votre démarche représente pour eux. Leur volonté, qui s'est exprimée au 16e congrès, est d'être à la hauteur de cette responsabilité.'" ("16e Congrès du CCI - Se préparer aux combats de classe et au surgissement de nouvelles forces révolutionnaires [223]") Ces mots qui s'adressaient à tous les éléments et groupes qui ont fait le choix de s'engager dans la défense des positions de la Gauche communiste s'appliquent évidemment au premier chef aux deux sections qui ont rejoint notre organisation.
A ces deux nouvelles sections, et aux camarades qui les constituent, l'ensemble du CCI adresse un salut chaleureux et fraternel.
Le CCI
[1] OPOP : Oposição Operária (Opposition Ouvrière) ; SPA : Socialist Political Alliance (Alliance Politique Socialiste) ; EKS : Enternasyonalist Komünist Sol (Gauche Communiste Internationaliste) ; Internasyonalismo (Internationalisme). Pour plus de précisions sur ces groupes, voir notre article "17e congrès du CCI : un renforcement international du camp prolétarien [225]" dans la Revue Internationale n° 130.
[2] A propos de ces réunions publiques, voir notamment sur notre site Internet "Débat internationaliste en République dominicaine [229]", "Réunion publique du CCI au Pérou sur la crise : un débat prolétarien passionnant et passionné [218]".
[3] Le CCI a toujours accueilli avec enthousiasme les nouveaux éléments qui veulent s'intégrer dans ses rangs. (...) Cependant, cet enthousiasme ne signifie nullement que nous ayons une politique de recrutement pour le recrutement, comme les organisations trotskistes.
Notre politique n'est pas celle non plus des intégrations prématurées sur des bases opportunistes, sans clarté préalable. (...) Le CCI n'est pas une auberge espagnole. Il n'est pas intéressé à faire de la pêche à la ligne.
Nous ne sommes pas non plus des marchands d'illusion. C'est pour cela que nos lecteurs se posant la question 'comment fait-on pour adhérer au CCI ?' doivent comprendre que l'adhésion au CCI prend du temps. Tout camarade qui pose sa candidature doit donc s'armer de patience pour engager un processus d'intégration dans notre organisation. C'est d'abord un moyen pour le candidat de vérifier lui-même la profondeur de sa conviction afin que sa décision de devenir militant ne soit pas prise à la légère ou sur un 'coup de tête'. C'est aussi et surtout la meilleure garantie que nous puissions lui offrir pour que sa volonté d'engagement militant ne se solde pas par un échec et une démoralisation.
[4] Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse.
[5] Brésil, États-Unis, Mexique, Venezuela.
Vie du CCI:
Géographique:
- Philippines [214]
- Turquie [230]
Solidarité avec les anarcho-syndicalistes de Belgrade emprisonnés
- 2168 lectures
Nous avons reçu de la part de la CNT-AIT de Toulouse, la communication que nous publions ci-dessous.
Nous sommes entièrement d'accord avec les camarades qu'il s'agit là d'une tentative d'intimidation par l'Etat contre des militants et contre la class ouvrière en général. Le contraste entre la sévérité des peines demandées et la silence bienveillante et complice qui a couvert des criminels de guerre comme Karadzic et Mladic pendant tant d'années depuis la guerre en ex-Yugoslavie est on ne peut plus parlant quant à l'hypocrisie de l'accusation de ‘terrorisme'.
Nous exprimons toute notre solidarité envers les militants emprisonnés et leurs familles, et nous encourageons nos lecteurs de faire diffuser le plus largement possible la déclaration de la CNT-AIT.
CCI, 27/10/2009
Vous êtes certainement au courant que des militants anarcho-syndicalistes serbes, dont l'actuel secrétaire de l'AIT, sont détenus dans la prison de Belgrade. La procédure engagée à leur encontre est celle de « terrorisme ». A l'heure actuelle nous ne savons pas jusqu'où elle ira. L'accusation repose sur des allégations de dégâts matériels minimes qui auraient été commis par un groupe anarchiste à l'encontre de l'ambassade grecque de Belgrade en solidarité avec un compagnon grec toujours emprisonné. Les accusés nient les faits, ils encourent de 3 à 15 ans de réclusion.
Cette disproportion entre les faits reprochés et l'accusation nous fait penser que la volonté du pouvoir serbe est de museler nos compagnons dont l'activité militante gêne visiblement.
Nous vous demandons par la présente de diffuser le plus largement possible le communiqué de l'ASI suivant :
"Le 4 septembre 2009 le Tribunal local de Belgrade a décidé que les militants de l'ASI seront incarcérés durant 30 jours. Nos compagnons sont accusés d'un acte de "terrorisme international".La Confédération de Syndicats "Initiative Anarchosyndicaliste" a été informé par les médias de l'attaque contre l'ambassade grecque et de l'organisation qui l'a revendiquée. Nous en profitons pour rappeler encore une fois à l'opinion publique que ces moyens de lutte politique individualiste ne sont pas ceux de l'anarchosyndicalisme, au contraire : nous affirmons publiquement nos positions politiques et cherchons à attirer les masses vers le mouvement syndicaliste et les organisations libertaires et progressistes à travers notre action.
L'État veut faire taire nos critiques avec ses moyens de répression, il le fait avec sa logique absurde, en déclarant suspects ceux qui expriment publiquement leur point de vue libertaire et conclue l'affaire en les enfermant pour donner une fausse image à l'opinion publique. On peut remarquer les formes peu scrupuleuses d'action des institutions du régime et ce dès les premiers moments de la détention, la perquisition illégale des appartements, l'intimidation des familles et les accusations disproportionnées de terrorisme international.Bien que nous ne soutenions pas les actions du maintenant célèbre groupe anarchiste "Crni Ilija", nous ne pouvons pas les caractériser comme du "terrorisme international" puisque le terrorisme, par définition, est une menace contre la vie de civils, alors que dans ce cas personne n'a été blessé et que les dégâts matériels furent symboliques. Il est clair que cette farce de l'État est un moyen d'intimider ceux qui dénoncent l'injustice et le désespoir de cette société.
En ces temps d'endormissement social il y a des individus qui font le choix d'actions incroyables, quelquefois auto-destructives, pour rompre le blocage médiatique et attirer l'attention sur leurs demandes (souvenons-nous des travailleurs qui se sont coupés les doigts et se les ont mangés, ou par exemple, de cet homme désespéré qui a menacé de faire exploser une grenade dans l'édifice de la Présidence Serbe), cela pour que leurs problèmes soient connus plus largement.
Nous ne laisserons pas convaincre qu'un tel acte symbolique de solidarité, bien qu'exprimé de façon erronée, puisse être considéré comme un acte antisocial ou terroriste, cela comme n'importe quel acte de rébellion de ceux qui ont été dépossédés de leurs droits.
Nous exprimons notre solidarité avec les compagnons incarcérés et leurs familles et demandons qu'on établisse la vérité sur cette affaire.
¡LIBERTE POUR LES ANARCHOSYNDICALISTES!
INITIATIVE ANARCHOSYNDICALISTE
5 septembre 2009
Récent et en cours:
- Militants emprisonnés [231]
Solidarité avec les conducteurs de bus de Sydney en grève
- 2940 lectures
Nous publions ci-dessous un article que nous venons de recevoir de la part de camarades en Australie sur la récente grève de conducteurs de bus à Sydney.
Le lundi 24 août, 130 chauffeurs de bus de Sydney ont mis en place une grève sauvage défiant les patrons, les bureaucrates d’Etat et également les syndicats, grève dénoncée par tous. Les ouvriers de Busways au dépôt de Blacktown à l’est de Sydney ont arrêté le travail à 3h30 du matin, provoquant l’annulation des services de période de pointe dans les zones de Blacktown, Mount Druitt et Rouse Hills.
La décision des ouvriers de se mettre en grève a été prise après la rupture de la négociation entre les syndicats et l'administration de Busways sur la réforme des horaires qui devait être mise en application en octobre. Face à une économie en ruines et à un système de transports en commun à la dérive, les dirigeants des autobus privés, de concert avec le gouvernement, essayent de réduire radicalement les coûts et d'imposer des accélérations de cadence. Les conducteurs ont protesté contre les nouveaux horaires, invoquant le fait que ces derniers représentent une attaque contre les conditions de travail des conducteurs et qu’il sera impossible de les mettre en application car elles sont un empiètement sur les périodes de repos et font pression sur les conducteurs pour qu’ils dépassent des limites de vitesse, mettant en danger la vie des passagers et des autres automobilistes. "Le nouvel horaire signifie moins de temps pour accomplir nos itinéraires. Nous courrons après le retard et serons blâmés par le public. Puisque nous courrons après le retard, il y aura aussi moins de temps de repos.» expliquait un travailleur.1
Depuis des mois, le TWU (le Syndicat des Travailleurs du Transport) et la compagnie font trainer en longueur les négociations sur ces nouveaux horaires qui ne peuvent déboucher sur le moindre résultat positif pour les conducteurs. Pire encore, le TWU a également été complice des attaques contre les conditions de vie et de travail de ces dernières années, notamment à travers les divers accords pour accroître la ‘flexibilité’. Après la rupture complète des négociations, les ouvriers, irrités par le manque de soutien et par la trahison pure et simple du syndicat, ont pris la décision d’arrêter le travail sans consulter le TWU et la direction de Busways tout en se défiant d’eux. Un ouvrier déclare : " Nous n’en pouvons plus. Nous avons essayé, à travers le système, d'obtenir des changements et rien ne s’est jamais produit. Nous ne pouvons strictement rien obtenir avec le syndicat Le but des syndicats était censé être d'améliorer les conditions, pas de les aggraver"2 et un autre que "le syndicat a dénoncé les ouvriers pour ce qu'ils ont fait. Nous avons décidé que nous ne pouvions plus rien attendre du syndicat. Le syndicat ne s’inquiète que des 60 $ mensuels que nous devons lui verser".
La réponse des patrons et du syndicat devant cette grève était de faire en sorte qu'elle se termine le plus rapidement possible. Concernant la gestion des horaires de Busways, la direction et le TWU ont fait volte-face, se déclarant d'accord dans les négociations sur les horaires proposés par les chauffeurs, les conducteurs ayant pris la décision au bout de 6 heures de discussions de retourner au travail à 9h30 du matin, après avoir attendu la fin des services de pointe du matin. Malgré cette décision, les conducteurs ont exprimé leur intention de déclencher de nouvelles actions de grève si la compagnie refusait de revoir à la baisse son programme de réformes. Cependant, l’évocation de cette perspective a provoqué la décision d’interdire d'autres actions de grève ainsi que des menaces de répression, de la part de la Commission des Relations Industrielles.
La réaction rapide du syndicat pour contenir et arrêter la grève confirme que c’est seulement si les ouvriers prennent leur lutte dans leurs propres mains, comme l’ont fait les conducteurs, que la défense des conditions de vie et de travail peut être efficace. Cependant, le résultat de la grève n'a pas encore été une victoire pour les conducteurs. Le nouveau round de négociations entre le TWU et la direction de Busways s’est conclu sur un accord pour procéder à la réforme des horaires, ce qui était déjà cyniquement prévu dès le début, c’est-à-dire de suivre les décisions de la direction de la compagnie..
Nous apportons notre entière solidarité aux ouvriers de Busways et nous considérons cette grève comme un moment important du développement de la lutte de classe en Australie. En réponse à la faillite du système capitaliste et aux attaques contre des ouvriers par le capital, la classe ouvrière doit prendre confiance en sa propre force et en celle de sa lutte, à la fois pour se défendre au quotidien et finalement, pour affirmer ouvertement ses propres intérêts de classe. Pour cet objectif, il est absolument essentiel que les ouvriers prennent la lutte dans leurs propres mains, et plus encore, qu’ils se battent pour étendre et généraliser cette lutte. L’isolement dans lequel les conducteurs se sont trouvés, combiné au spectacle hystérique de la dénonciation des conducteurs qualifiés dans cette ignoble campagne de « bolchos »,, de « brutes », par tous les médias aux ordres de la classe dirigeante, est une cause fondamentale de l’étouffement de la lutte. C’est seulement en prenant directement leur lutte en mains, en dehors du cadre syndical, et en la généralisant, contre toutes les divisions sociales, sectorielles et géographiques, que la classe ouvrière peut trouver la force nécessaire pour développer son combat.
NIC (9 septembre)
1 WSWS, Australie : Grève des chauffeurs de bus au mépris du syndicat [232] , 26 août 200.
2 Idem.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Solidarité avec les travailleurs de "Luz y Fuerza del Centro" au Mexique
- 2630 lectures
Nous publions ci-dessous un texte signé par 3 organisations au Mexique (Revolución Mundial-CCI au Mexique, Grupo Socialista libertario - et Proyecto Anarquista Metropolitano) sur la mise en liquidation d’une entreprise d’État et deux prises de position solidaires faites par deux groupes du Pérou à la suite de ce texte.
Mise en liquidation de « Luz y Fuerza del Centro » :
licenciements et attaques supplémentaires…
Il faut lutter, mais pas derrière les syndicats !
Samedi 10 octobre au soir, la Police fédérale occupait tous les centres et les postes de la LyFC1, en parallèle avec le décret de la Présidence de la république ordonnant la mise en liquidation de cette entreprise et le licenciement de près de 44 000 ouvriers qui, affirme le gouvernement, seront indemnisés « au-delà ce ce que la loi autorise». Ce coup de force a provoqué un désarroi plein de rage et de sentiment d’impuissance, c’est un coup supplémentaire porté par l’État à la classe ouvrière. Cette situation nous oblige à nous poser le problème des méthodes et des réponses que doit apporter notre classe pour manifester son unité,.
Cette attaque nous concerne tous et c’est tous unis que nous devons nous défendre !
La crise généralisée qui frappe le capitalisme mondial contraint la bourgeoisie de chaque pays à prendre des mesures de plus en plus brutales, en faisant porter les pires effets de la crise sur le dos du prolétariat. Avec toutes ces politiques de réajustement, les conditions de vie de tous les ouvriers ne font que s’aggraver : attaques sur les pensions de retraite, les salaires, les prestations sociales… C’est la seule manière que les capitalistes connaissent pour se maintenir la tête hors de l’eau, de sorte que dans tous les pays on « réforme les pensions » (autrement dit, on les baisse !), on augmente les années pour pouvoir « jouir » d’une retraite ; partout les salaires sont laminés, les journées d’exploitation sont de plus en plus insupportables et, au bout d’une vie de misère quotidienne, c’est le chômage qui nous attend.
Ce que nous voyons aujourd’hui au Mexique n’est donc pas une espèce de particularisme folklorique imputable aux erreurs du capitalisme national. L’État, représentant de la classe dominante, la bourgeoise, a pour tâche d’en défendre les intérêts, aussi bien avec des gouvernements de droite comme de gauche. Liquider la LyFC était depuis longtemps un vieux projet de la bourgeoisie, et s’il avait été retardé, c’était pour remercier les centrales syndicales, en particulier le Syndicat mexicain des électriciens (SME) qui, entre autres, rappelons-le, avait apporté son soutien à la candidature présidentielle de Carlos Salinas [en 1988], un soutien que celui-ci honora avec la reconstitution de l’entreprise.
Mais la crise a placé la bourgeoisie dans une situation sans issue, où elle ne peut plus occulter la réalité catastrophique qu’elle-même avait favorisée. À ceci, il faut ajouter la nécessité pour le capital de reformer ses syndicats et non pas de les détruire comme l’appareil de gauche du capital le prétend. Les travailleurs sont en train de connaître dans leur chair le chantage et le joug du syndicalisme pour contrôler et saboter la mobilisation qui puisse les amener vers leurs véritables aspirations. Malgré tous leurs beaux discours, dans les faits les syndicats sont les ennemis du prolétariat, dont la bourgeoisie a besoin pour mettre au pas et soumettre adroitement les exploités.
L’énorme campagne qui s’est déclenchée il y a quelques mois contre ce secteur de la classe ouvrière (les électriciens) en les montrant devant « l’opinion publique » comme des « privilégiés » des « incapables », etc. à tel point que certains travailleurs n’arrivent pas à comprendre qu’on doit lutter contre l’attaque que subissent les électriciens parce qu’aujourd’hui c’est leur tour, mais demain ce sera tous les autres.
Nous, travailleurs, ne pouvons pas cautionner les mensonges de la bourgeoise et ses acolytes : la fermeture de la LyFC n’est pas faite « pour le bien du peuple mexicain », mais il s’agit bien d’une attaque frontale contre le prolétariat comme un tout. Les nouveaux contrats (pour combien de ces 44 000 travailleurs ?) auront sans le moindre doute des conditions de travail bien pires, tandis que beaucoup d’autres ouvriers seront condamnés au chômage tout court.
La bourgeoise et son appareil politique nous assomment pour nous faire accepter le message suivant : les électriciens n’ont rien pu faire malgré la présence d’un « syndicat puissant » ; par conséquent, tous les travailleurs nous devrions nous plier devant les projets du capital et de son État et nous résigner à voir comment nos conditions de vie empirent encore... Non, le prolétariat ne peut pas abandonner la lutte contre le capitalisme ! Les attaques d’aujourd’hui ne sont que le signe avant-coureur de ce qui nous attend si on ne réagit pas en tant que clase. Il devient donc indispensable, face aux attaques qui se reproduisent sans cesse depuis quelques années, auxquelles s’ajoutent la hausse des prix et une répression de plus en plus dure (avec le renforcement de l’appareil militaro-policier), que tous les secteurs du prolétariat –ouvriers au travail et chômeurs, travailleurs déclarés et « au noir » - reconnaissent leur besoin d’unité et la réalisent. Pour y arriver il est indispensable d’identifier nos ennemis.
Syndicats, gouvernement et partis politiques : ce sont tous nos ennemis !
Pour mener à bien cette attaque sans la moindre entrave, toutes les forces de la classe dominante se sont partagé les tâches : les uns en créant une division chez les électriciens dans une lutte stérile entre fractions syndicales au moyen d’élections. Les autres ont déguisé les attaques contre les conditions de vie en les présentant comme des « attaques contre le syndicat et les libertés démocratiques » et d’autres encore ont créé une ambiance de lynchage en présentant les électriciens comme des privilégiés. Ce jeu de rôles a permis la mise en place d’une stratégie pour entraîner beaucoup d’ouvriers dans une lutte irréfléchie « pour la défense du syndicat » ou, aussi, « pour la défense de l’entreprise et de l’économie nationale », des mots d’ordre liés à la meilleure stratégie de dévoiement de la lutte pour que n’importe quel secteur du prolétariat oublie ses revendications en tant que classe exploitée.
Après le coup de force [du 10 octobre], cette campagne s’est accentuée et on a profité de la surprise pour étendre la défaite et la démoralisation. Dans cet intense matraquage, les syndicats ont joué un rôle réactionnaire de premier plan. C’est pour cela qu’essayer de lutter derrière le syndicat, c’est aller tout droit à la défaite...c’est le syndicat en lien avec les autres forces de l’État qui ont enfermé les travailleurs dans cette impasse. Ce ne sont pas les syndicats qui vont les pousser au combat, mais bien au contraire. Un exemple : maintenant le syndicat SME met en avant l’idée que tout pourrait s’arranger en livrant une bataille « légale, sur le terrain juridique devant les tribunaux de justice », en fourvoyant encore une fois les ouvriers dans la voie de l’encadrement derrière la protection bureaucratique et la défense juridique. Rappelons-nous comment la structure syndicale, face à la modification de la loi sur l’ISSSTE2, a tout fait pour créer la dispersion, pour dévoyer le mécontentement et, enfin, elle a contrecarré la mobilisation avec des arguties juridiques ! Le terrain juridique et légaliste vers lequel le syndicat cherche à enfermer le mécontentement est un terrain d’usure stérile : là, les prolétaires n’agissent pas en tant que classe, mais en tant que citoyens qui respectent et défendent « le système légal », celui-là même qui légitime leur condition de précarité et de ruine.
Le rôle des syndicats n’est pas celui de conduire l’unité et d’impulser la solidarité réelle, mais celui de nous diviser ; le fait que le gouvernement puisse aujourd’hui frapper un tel coup sur la tête des électriciens n’est pas l’éclat d’un coup de tonnerre dans un ciel d’azur, mais cela a été rendu possible grâce au travail de division et d’érosion mené par les syndicats depuis tant d’années.
La stratégie de la bourgeoise pour faire passer définitivement cette attaque est celle de dévoyer le réel mécontentement existant chez les ouvriers de l’électricité et d’empêcher que leurs frères de classe puissent exprimer leur solidarité. Pour cela, elle mettra toutes ses forces en action pour orienter toutes les ripostes vers le terrain de la défense de la nation et des syndicats, autrement dit, on voudra nous enfermer dans un combat qui ne mette pas en question le système d’exploitation capitaliste et, finalement, on nous dira qu’on peut bien exprimer notre mécontentement grâce au vote lors du prochain cirque électoral...
Lutter unis, chercher la solidarité de classe... il n’existe pas d’autre voie !
La solidarité na rien à voir avec ces pantomimes syndicales où un cacique se pointe pour proclamer son soutien à un autre hiérarque et ce n’est pas non plus un « soutien moral » factice. La véritable solidarité se fait dans et par la lutte. Aujourd’hui, comme à n’importe quel autre moment ou face à une situation semblable, le secteur des électriciens est attaqué et le reste du prolétariat doit exprimer la véritable solidarité, qui n’est autre que l’impulsion vers un combat où il n’y ait pas de distinction entre chômeurs et actifs, entre secteurs, entre régions. Pour que la véritable solidarité puisse s’exprimer, les travailleurs doivent impulser des assemblées générales ouvertes à tous les prolétaires (actifs, chômeurs et d’autres secteurs) où l’on puisse discuter largement sur la situation que nous affrontons tous et que le mécontentement se concrétise en mobilisations contrôlées par les ouvriers eux-mêmes et non pas par la structure syndicale.
Le syndicat, pour parachever le coup va chercher à isoler les électriciens de leurs frères de classe et à les enrôler dans des mobilisations comme celle qui est menée par López Obrador3. La seule chose qu’ils cherchent, c’est à encadrer les travailleurs pour éviter qu’ils ne retrouvent leurs propres moyens de lutte, en les piégeant dans le faux dilemme : entreprise d’Etat-entreprise privée ; c’est pour cela que face aux attaques qu’ils encaissent de partout, les ouvriers doivent réfléchir ensemble, en marge et contre les syndicats, pour organiser une réponse de lutte et essayer de stopper les attaques. Si nous laissons cela aux mains de syndicats et des partis politiques, nous serons condamnés, un secteur après l’autre, à la défaite. Le cri de guerre du prolétariat parcourt de nouveau le monde : « L’émancipation de la classe ouvrière sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » et il faut rappeler que les exploités n’ont rien d’autre à perdre que leurs chaines !
Octobre 2009
Grupo Socialista libertario https://webgsl.wordpress.com/ [233]
Revolución Mundial, section au Mexique du Courant Communiste International [email protected] [234]
Proyecto Anarquista Metropolitano proyectoanarquistametropolitano.blogspot.com
oOo
Message de soutien du Núcleo Proletario en Perú
(Noyau prolétarien du Pérou), reçu le 24 octobre 2009.
SOLIDARITÉ DEPUIS LE PEROU AVEC LES TRAVAILLEURS AU MEXIQUE
Chers camarades de classe au Mexique,
Nous avons appris avec indignation ce qui est arrivé ce samedi dernier 10 octobre. C’est encore une preuve de la putréfaction et de la deshumanisation dans lesquelles est en train de nous entraîner le système capitaliste.
Au Mexique comme au Pérou, les conditions de vie des travailleurs sont misérables, les entreprises privées ou d’État payent des salaires minables, qui n’arrivent pas à subvenir les besoins de base pour vivre ; les licenciements sont, par contre, le pain quotidien, le chômage est une plaie qui sévit dans les grands centres urbains ; le vol, la délinquance, la prostitution sont devenus monnaie courante dans nos vies, c’est comme si on nous avait habitués, nous les travailleurs, à vivre dans un dépotoir. Les medias, aussi bien au Mexique qu’au Pérou ne servent qu’à attaquer la moindre protestation du prolétariat, quand on exige quelque « droit » que la bourgeoisie nous a promis, alors ils disent de nous qu’on est des révoltés, et quand nous luttons pour exiger ce qui nous revient vraiment parce qu’on est la classe productrice de la société, alors ils nous appellent des terroristes ; dans le meilleur de cas, la presse sert à distraire et à embrouiller les esprits des nôtres. Nous avons pu voir clairement que les medias au Mexique ont élaboré toute une campagne pour discréditer le secteur de l’électricité où travaillent beaucoup d’entre vous. Ce n’est pas un hasard si ces mêmes médias ont évidemment préparé le terrain social pour que les autres secteurs du prolétariat restent résignés et soumis au moment où la répression policière s’est déclenchée pour vous chasser des lieux que vous aviez construits, de vos lieux de travail où vous pouviez assurer vaille que vaille votre subsistance. Frères ! : nous sommes une même classe sociale, là-bas au Mexique ou ici, au Pérou, nous vous apportons notre totale solidarité dans ces moments si difficiles que vous êtes en train de vivre ; nous sommes conscients que l’emploi, le travail, est un maudit mal nécessaire ; nous sommes contre l’exploitation, autant contre celle de l’Etat que celle des patrons privés. Nous savons très bien qu’il faudra lutter pour abolir cette exploitation commune, parce qu’elle est à l’origine de la misère, de la faim et de l’avilissement dans ce monde ; mais jusqu’à ce moment, il faut travailler et, sur cette base, s’organiser pour ne pas se laisser écraser et manipuler par des « leaders » qui se pointent en se prétendant être vos représentants. Ici, au Pérou, beaucoup d’ouvriers, de professeurs, d’étudiants, de chômeurs…ont vécu dans leur chair la tromperie toujours maniée par les syndicats : il est vrai que nous sommes très jeunes et peut-être certains d’entre vous nous diront qu’il existe des syndicats de classe qui luttent véritablement pour vos droits ; eh bien camarades, pour une fois nous vous demandons de faire confiance à la jeunesse, parce que cette jeunesse ne fait confiance qu’à vous-mêmes, à votre force, à votre solidarité et votre unité ; nous sommes avec vous et non pas avec le syndicat, ni avec un quelconque prétendu leader de gauche ou de droite ; nous espérons que vous vous organiserez en tant que travailleurs, que vous débattrez, que vous discuterez, que vous convoquerez des assemblées avec tous les secteurs prolétariens et que vous déciderez vous-mêmes que faire de votre futur. L’isolement serait le poison contre votre lutte ; il faut qu’elle se généralise vers tous les autres secteurs prolétariens ; il ne faut pas que vous ayez peur de demander aux autres camarades qu’ils rejoignent votre cause, qui est la même que la leur. C’est seulement ainsi que la grève, les arrêts de travail ou les manifestations de rues ou tout ce que vous paraîtra efficace, pourront atteindre leur objectif.
Nous vous demandons de nous écouter parce que nous avons vécu les mêmes problèmes que vous et non pas seulement dans le secteur de l’électricité, mais dans tous les secteurs de l’économie. Pour nous c’est clair que le problème n’est pas que celui de la branche de l’électricité, le problème n’est pas que mexicain, il n’est pas que latino-américain ; le problème n’est pas le gouvernement, ni les USA…, le problème c’est le système d’exploitation. Le capitalisme est un système inhumain par nature, ses lois et son État légalisent l’exploitation, les licenciements et le chômage, légalisent les syndicats pour vous tromper, pour que vous vous bagarriez pour la défense deleurs intérêts, qui ne sont autres que les intérêts de la bourgeoisie de réaliser ses profit sur nos vies.
Nous savons que beaucoup d’entre vous ont une famille, des enfants à nourrir, que vous ne voulez évidemment pas vous retrouver sans emploi, que certains voudraient rendre les armes…, mais nous, fils de la classe prolétarienne, qui voyons reflétée chez vous l’image de nos parents et de nos grands frères, nous vous demandons de continuer à lutter, de nous apprendre, de nous éduquer en défendant ce qui vous revient de droit, en ne vous laissant pas marcher dessus par une poignée de bourgeois, par un groupe d’entrepreneurs imbus de vanité et pleins d’argent, eux qui n’ont jamais travaillé. Nous vous demandons, camarades, de continuer la lutte, de vous solidariser, de vous unir jusqu’à exiger le rétablissement des emplois, de mener la lutte contre ceux qui, jour après jour, font que ce monde soit ce qu’il est. Un monde de misère et de pauvreté sur la terre, dans les airs et dans les eaux.
Nous espérons que vous obtiendrez une victoire à cette occasion, nous sommes des milliers d’ouvriers pour un bourgeois, la police voudra freiner votre courage et votre solidarité, de même que les syndicats qui, eux, défendent une patrie qui ne leur appartient pas davantage qu’à vous, défendent des hommes qui les exploitent, défendent ce système vieux et pourri, alors que vous, nos frères, vous défendez la vie, une nouvelle société, un nouvel avenir ; un avenir qui devient chaque jour de plus en plus possible dans l’union serrée de vos poings.
Depuis le Pérou, nous sommes un groupe de jeunes prolétaires, de professeurs, d’ouvriers, de lycéens et d’étudiants et nous vous envoyons notre fraternel salut de classe, nous nous retrouvons avec vous dans votre haine du capital, nous nous joignons à vous dans votre indignation contre les licenciements massifs que vous avez subis et les tâches épuisantes que vous devez subir jour après jour pour ramener du pain sur la table de votre foyer. Nous sommes solidaires avec les luttes que vous menez et que, nous le savons, vous allez continuer à mener. Ne vous rendez pas camarades ! Unissez-vous !, c’est là que réside la force dont vous avez besoin et si elle vous manque, nous sommes là, nous, vos frères prolétariens qui ferons ce qui est dans notre pouvoir pour mener des actions ici et maintenant. Il faut que les grandes masses des exploités se prononcent avec des faits et des mots contre la menace de l’État bourgeois mexicain qui est la même que nous pouvons subir ici au Pérou ou ailleurs dans le monde. Votre douleur est la notre, vos larmes contre l’injustice sont les mêmes que les nôtres, vos poings et votre courage sont les nôtres. D’ici nous vous demandons d’organiser des assemblées générales ouvertes, des débats, des discussions entre vous pour pouvoir vous organiser et affronter les exploiteurs.
Enfin, nous sommes conscients du fait que gagner cette bataille sera un grand succès pour vous, mais une fois l’objectif atteint, il ne faudrait pas s’en contenter, il ne faut pas se contenter de pouvoir retourner au travail. On doit aller plus loin, voir le problème de fond, considérer que le problème est et sera toujours le système capitaliste, et non pas un quelconque Président ou une nouvelle politique. C’est pour cela que nous avons aucune confiance ni dans le Parti nationaliste d’Ollanta au Pérou, ni dans Chavez, ni dans Evo Morales, ni dans le PRI, ni dans le PRD4, ni dans aucun de tous ces partis de gauche de la bourgeoise, quel que soit le radicalisme avec lequel ils se présentent. Nous ne faisons confiance qu’au Parti des travailleurs, le véritable parti du prolétariat qui ne lutte pas seulement contre l’exploitation, les abus et l’oppression du système, mais qui lutte aussi pour la destruction de ce système : nous voulons parler du Parti communiste, le seul qui nous appartient dont la formation est la tâche du moment au niveau mondial, parce que justement c’est dans le monde entier que l’exploitation existe et c’est le rôle du Parti communiste de lutter pour l’abolir et la détruire. Le pouvoir de décider que faire avec la production, que faire du travail que chacun réalise, doit appartenir au producteur, au prolétariat et à personne d’autre.
Camarades : organisation, solidarité et lutte autonome de notre classe avant tout, c’est là que réside notre espoir dans notre lutte contre le capital et sa clique de suiveurs. Stop aux abus, stop à l’humiliation ! La lutte est la seule voie, non pas pour reformer le système, non pas seulement pour obtenir une quelconque revendication nécessaire, mais une lutte pour abolir ce système, parce que tout va continuer toujours pareil, et nos enfants devront continuer à lutter pour ne pas être licenciés par les bourgeois. Allons, camarades, vers la nouvelle société que nous seuls pouvons construire, tous unis vers la révolution prolétarienne mondiale.
A bas les groupes réformistes sociaux-démocrates !
A bas les syndicats qui négocient la vie des travailleurs !
Vive la lutte du prolétariat international !
Prolétaires mexicains, péruviens et du monde entier unis contre le capital
Seule l’union mondiale de classe pourra libérer l’humanité de la misère !
En avant pour la lutte, camarades !
Núcleo Proletario en Perú (Noyau prolétarien du Pérou)
[email protected] [235]
oOo
Le texte ci-dessous est arrivé à notre e-mail le 30 octobre 2009, rédigé par les camarades d’un autre groupe du Pérou, le Grupo de Lucha Proletaria (Groupe de Lutte Prolétarienne),
L’ÉTAT MEXICAIN ATTAQUE LES TRAVAILLEURS DE « LUZ Y FUERZA »
L’État bourgeois chaque fois qu’il veut vendre, privatiser ou déclarer en faillite une entreprise d’État, met toujours en avant des arguments tels que : « c’était une entreprise qui perdait de l’argent », « qui n’était pas rentable », qui « était une charge pour l’État », …enfin toute une série de mensonges mis en avant aussi cette fois-ci par la bourgeoisie du moment, la mexicaine. Beaucoup des spécialistes mexicains ont, cependant, dit le contraire (Voir TV Azteca 22/10/09), d’autres ont confirmé les arguments mentionnés, comme quoi l’entreprise électrique Luz y Fuerza était un boulet de pertes pour l’État.
Ce qui est certain c’est que tous les désavantages tomberont sur le dos ouvriers, sous la forme du chômage. Plus de 44 000 postes de travail vont disparaître avec la mise en liquidation de l’entreprise « Eléctrica Luz y Fuerza ». Tous les travailleurs sont menacés par cette plaie du chômage, la seule chose qu’aujourd’hui peut garantir le capitalisme. En effet, le capitalisme, dans cette dernière crise, a déjà condamné des milliers d’ouvriers, partout dans le monde, à la faim, à la misère et au chômage. Et c’est maintenant le tour de la bourgeoisie et de l’État mexicain, mis sous la pression de la crise mondiale, de prendre des mesures de réajustement et de réduction de personnel. Mais c’est loin d’être un fait isolé : la même chose arrive au Pérou et ailleurs dans le monde. C’est un raz de marée, une attaque massive et dirigée contre le prolétariat au niveau mondial, qui rend encore pires et plus précaires les conditions de travail et de vie de ce dernier. Toutes les bourgeoisies du monde le savent bien, elles savent qu’il leur faut agir en faisant appliquer ces mesures, si elles veulent sortir la tête de l’eau dans cette crise brutale. Et la seule manière est celle qui consiste à frapper encore et encore sur les conditions de vie des ouvriers du monde entier.
Ce qui apparaît certain, c’est que le capitalisme ne peut plus rien garantir à l’humanité. Et ce que l’État capitaliste mexicain est en train de faire contre les travailleurs de « Luz y Fuerza » le montre très bien.
Ce que les ouvriers ne doivent jamais oublier c’est que les politiciens et les syndicats ne sont pas une solution mais une partie du problème, ce sont eux qui se chargent de la continuité du système d’exploitation capitaliste ; leurs appels à la défense de la paix sociale, de la démocratie, de la patrie et de l’ordre ne sont pas les nôtres. Ils ne feront jamais quoi que ce soit pour nous aider, ils sont là pour que les instructions de la classe dominante se réalisent. La lutte des ouvriers n’a de l’avenir qu’en dehors des syndicats et tout autre opportunisme politique. Le prolétariat doit s’organiser et maintenir son unité de classe pour essayer de dépasser ce moment qu’il est en train de vivre au Mexique.
Ce que les travailleurs du Mexique et d’ailleurs doivent bien avoir en tête, c’est que ces attaques contre leurs conditions de vie vont continuer, de plus en plus rapprochés et intenses jusqu’à ce que la situation devienne insoutenable. La classe ouvrière devra comprendre qu’elle possède des armes pour lutter contre cette situation à laquelle le capitalisme l’entraine aujourd’hui ; ces armes sont sa solidarité de classe, sa confiance en elle-même et ses luttes au niveau local et mondial.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
GLP (24/10/2009)
1 Luz y Fuerza del Centro (LyFC): entreprise publique de distribution d’électricité opérant surtout dans la capitale mexicaine. L’Etat mexicain l’a mise en liquidation à la suite de grosses pertes, le 11 octobre 2009 en faisant occuper par sa police tous les locaux le 10 octobre.
2 Sécurité sociale pour les travailleurs de l’État
3 Candidat de la gauche lors des dernières élections présidentielles au Mexique (2006), dénoncées comme ayant été truquées, ce qui a lancé ce candidat dans une campagne de « désobéissance civile » contre le gouvernement.
4 Ollanta est le dirigeant de ce parti ultranationaliste de gauche au Pérou. Le PRI est le parti « révolutionnaire » qui a gouverné le Mexique pendant 70 ans, le PRD, qui est une ancienne scission du PRI, est aujourd’hui le parti de la gauche mexicaine.
Vie du CCI:
Géographique:
- Mexique [85]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [44]
Tract d’Internasyonalismo (section du CCI aux Philippines) : Résistons aux attaques capitalistes ! Etendons la lutte !
- 2568 lectures
Ce qui arrive aux travailleurs de Giardini del Sole se produit aussi dans beaucoup d’usines, pas seulement à Cebu, pas seulement aux Philippines, mais dans le monde entier. En fait, nos frères et sœurs d’Amérique sont les premiers à souffrir des attaques du capitalisme – restrictions, travail en 3x8, chômage partiel, réduction de salaire et d’indemnités.
Pourquoi cela ? Parce que le système capitaliste qui régit les pays et le monde est actuellement dans une crise aiguë de surproduction. En bref, il y a trop de marchandises invendues de par le monde. Il y a surproduction parce que, dans le capitalisme, nous produisons bien au-delà de ce que nous pouvons consommer, bien au delà de ce que nous permettent nos salaires d’esclaves.
Le capitalisme a réduit nos salaires pour faire plus de profit. Résultat : nous sommes submergés de dettes qui rendent encore plus difficile pour nous d’acheter les denrées de base nécessaires que avons produites. La surproduction n’en devient que plus grande.
Pour empêcher la mort lente que le capitalisme nous impose au travers de ses restrictions, des rotations au travail, des réductions de salaire et d’indemnités, nous devons lutter. Pour empêcher les attaques du capitalisme, nous devons nous unir et nous soutenir les uns les autres, dans les différentes usines et entreprises. Personne ne peut nous aider, si ce n’est notre propre classe, nos frères et sœurs. Nous ne pouvons rien attendre du gouvernement, de l’inspection du travail et des politiciens. Ce sont tous des instruments au service de la classe capitaliste. Nous ne pouvons rien attendre du TIPC,1 ou de n’importe quelle réunion tripartite entre nous, les capitalistes et le gouvernement. Nous ne pouvons pas attendre qu’un gouvernement corrompu, couvert de dettes, pro-capitaliste jusqu’au bout, renfloue quoi que ce soit.
Notre seul espoir, c’est notre unité et l’extension de nos luttes à plusieurs usines !
Le gouvernement et les capitalistes voudraient que nous nous sacrifiions, que nous acceptions les restructurations, la précarité, le chômage partiel, la baisse des salaires et des indemnités et que nous souffrions plus pour sauver le système d’exploitation ! C’est une défaite parce que ce dont nous avons besoin, en tant qu’esclaves du capitalisme, c’est d’un travail permanent, de salaires « décents » et de conditions de travail HUMAINES !
S’il y a des luttes ouvrières dans plusieurs usines, il y a une grande possibilité pour que nous puissions défendre nos emplois et nos salaires. NOUS NE DEVONS PAS FAIRE DE SACRIFICES POUR SAUVER LE CAPITALISME DE SA CRISE !
Mais si nous sommes divisés, si nous agissons de façon isolée dans nos différentes entreprises, si nous laissons nos frères et sœurs de classe se battre tout seuls dans une ou deux usines, les capitalistes peuvent gagner et nous serons obligés de subir la crise qu’ils ont eux-mêmes provoquée.
Nous devons tenir des assemblées ouvertes à tous les travailleurs, titulaires, contractuels, syndiqués ou non, nous sommes tous des membres des ASSEMBLEES OUVRIERES. Elles sont la seule forme d’organisation de notre combat. Nous devons discuter et décider nous-mêmes de notre avenir, pas une minorité !
Même si nous acceptions les sacrifices, ils ne pourraient résoudre la crise de ce système pourri. Au contraire, cela irait encore plus mal. Le problème vient de la nature même du capitalisme et il n’y a aucune solution à la crise de surproduction. La solution finale, c’est de RENVERSER le capitalisme et de le remplacer par un système où nous ne serons plus jamais les esclaves du capitalisme.
Internasionalysmo.
1 Conseil tripartite pour la paix industrielle.
Vie du CCI:
Géographique:
- Philippines [214]
Un courrier de lecteur sur l'analyse de la crise actuelle
- 3891 lectures
Nous livrons à la connaissance et à la réflexion de nos lecteurs une contribution sur la crise économique1 que nous a fait parvenir un participant de très longue date aux réunions publiques du CCI. Ce camarade ayant assisté plus fréquemment à nos réunions depuis plus d'un an, il a pu notamment participer à animer des discussions sur des thèmes tels que la signification historique des événement de Mai 68 (et dont c'était l'année dernière le 40e anniversaire), l'analyse de la manifestation actuelle et particulièrement brutale de la crise historique du capitalisme ou encore la signification des mouvements de la jeunesse prolétarisée tels qu'ils se sont récemment manifestés dans certains pays d'Europe et en Grèce en particulier.
Outre la mise en évidence de l'inconsistance des explications et "solutions" couramment avancées par différents secteurs de la bourgeoisie face à l'impasse du système, l'intérêt de ce texte réside en ceci qu'il se base sur des présupposés théoriques ("difficulté croissante du capital à se valoriser") différents de ceux qui constituent la position majoritaire au sein du CCI pour expliquer les contradictions insurmontables du capitalisme (essentiellement l'insuffisance historique des débouchés extra-capitalistes). En ce sens, ce texte peut également être utilement utilisé tant dans la discussion de nos articles d'analyse de la phase actuelle de la crise mortelle du capitalisme2 que dans le débat interne au CCI qui s'est développé autours de l'étude de la période dite des "Trente Glorieuses" pour comprendre les contradictions fondamentales de l'accumulation capitaliste et dont nous avons entrepris la publication à l'extérieur de notre organisation3.
La première crise mondialisée
Confondre les effets et les causes, les conséquences et l’origine, est une des formes les plus fréquentes de la fausse conscience. La crise financière et économique présente en est une illustration parfaite, dans son analyse, son explication et les remèdes proposés. Rien en cela de surprenant tant les « experts », les gouvernements et les agents économiques eux-mêmes ne peuvent aller au delà des apparences et de la description empirique des faits.
Les faits, il est vrai, s’imposent avec une violence inédite et se déroulent avec la rigueur d’une tragique fatalité. Non pas que cette crise soit dans ses modalités originale, mais outre sa gravité, elle se singularise par son extension et par le paradoxe d’éclater et de se développer en raison même de ce qui visait à la prévenir. N’a-t-on pas assez dit que Ben Bernanke, successeur à la FED4 du « génie » Alan Greenspan, était un spécialiste de la crise de 1929 qu’il avait étudiée si intensément qu’il savait quelles erreurs ne pas commettre et comment la résoudre ? Quant à son génial prédécesseur il se vantait d’avoir découvert le secret d’une croissance ininterrompue, même si mezzo voce il s’était parfois inquiété de « l’exubérance irrationnelle des marchés »
Pourtant à partir de défaillances assez localisées, les crédits hypothécaires à risque (« subprime ») et d’une technique financière banalisée (« titrisation »), se sont succédés crise immobilière, crise bancaire, crise boursière, hausse puis effondrement des matières premières, chute des profits, de la consommation, du commerce international, puis récession et chômage, et ce n’est encore qu’un début.
Comment comprendre cet enchaînement implacable ? Tout ce que la bourgeoisie compte de politiques, économistes, universitaires, journalistes, s’essaye à cette tâche, chacun partant d’une partie des faits constatés, et brouillant à l’occasion les frontières idéologiques et politiques.
Les plus véhéments sont ceux qui dénoncent les « dérives » de la financiarisation, de l’économie financière opposée à l’économie réelle, au fond le bon capitalisme, celui qui produit, contre le mauvais, celui qui spécule. Même Sarkozy a embouché ces trompettes. Et en effet la financiarisation est une réalité. Le secteur financier, aux États Unis d’abord puis dans l’ensemble des pays industrialisés, a pris une place majeure. Il a pu représenter un poids apparemment disproportionné dans les profits des entreprises (30% aux USA) et a multiplié les « innovations financières » au travers de modèles mathématiques aussi raffinés qu’incompréhensibles. La titrisation si souvent citée en étant une, mais pas des plus complexes, même si par la mutualisation des risques elle a provoqué la panique (à retardement !) des investisseurs en raison de l’opacité de certains de ses montages. La rentabilité (apparente) de ces « produits financiers » (terme révélateur du fétichisme monétaire !) a justifié les salaires, bonus, stock options et autres parachutes dorés que se sont généreusement attribués dirigeants et acteurs de ces marchés, que seule la crise a fait, hypocritement, juger « immoraux ». Qui peut croire que le rôle et les mobiles des activités financières n’outrepassent pas la cupidité des individus et ne participent pas d’une unité fonctionnelle du capital ?
D’autres critiques, non moins virulents, vilipendent la politique irresponsable des États-Unis qui ont laissé s’accroître un endettement inconsidéré en contrepartie de déficits abyssaux. Nul en effet ne peut douter ni des dettes ni des déficits. Encore faut-il y regarder de plus près. L’endettement est général, pas seulement américain, et dans ses masses globales peu différent d’un pays à l’autre, bien que le rapport entre endettement public et privé puisse s’inverser, le premier l’emportant en France ou en Allemagne, le second en Grande-Bretagne ou en Espagne. Et par ailleurs il ne faut pas oublier qu’à tout déficit correspond un excédent et à toute dette une créance (ce qui est rarement rappelé quand on affirme laisser aux générations futures des dettes en omettant les créances, et sans dire que ceux qui remboursent ne sont pas ceux qui perçoivent les intérêts). Aussi tout dépend du point de vue. L’énorme déficit américain serait le signe d’un déclin de l’hégémonie des États-Unis. Mais on peut tout aussi bien affirmer en regardant la balance des paiements par l’autre côté que le non moins énorme excédent de la balance des capitaux exprime la domination maintenue et la confiance persistante des investisseurs dans cette même hégémonie. La preuve en serait que dans cette période de crise, d’origine si évidemment américaine, les capitaux continuent à s’investir dans les Bons du Trésor US, et que le dollar se renforce, à la surprise de tous les observateurs superficiels qui ne voient pas que la géopolitique commande la finance. Ainsi tous les excédents, certes chinois et moyen-orientaux, mais aussi russes, vénézuéliens, algériens ou ceux de tout ce qui dénonce « l’impérialisme américain », viennent contribuer à accroître sa dette et ne craignent rien tant qu’un affaiblissement du dollar ! Et ce alors même qu’ils ne peuvent douter que leurs créances qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars sont une épargne forcée qu’ils thésaurisent sans grand espoir de pouvoir un jour la convertir en valeurs réelles…
Autre thème qui rejoint le précédent par la référence anglo-saxonne, les méfaits du néo ou ultralibéralisme, coupable de ne se fier qu’aux « anticipations rationnelles », à « l’autorégulation des marchés » et à la bonté infinie de la « main invisible »5. Mais qu’en est-il vraiment ? Jamais les réglementations (la « régulation ») n’ont été aussi larges et précises dans l’histoire du capitalisme. Les marchés boursiers sont contrôlés, les banques sont soumises à des batteries de ratios, les normes comptables ont été renforcées et presqu’unifiées, la création monétaire est sous l’emprise de banques centrales indépendantes, l’OMC veut discipliner le commerce et même ces agences de notation si souvent montrées du doigt ont été soutenues, célébrées comme outils indispensables, par ceux là mêmes qui les vouent aux gémonies. Que ces réglementations n’aient pas été efficaces ou aient été contournées, peut-être, mais les poser, en plus ou en moins, comme origine de la crise est pure mystification. Cela permet de développer deux argumentations contraires (mais au fond complémentaires), l’une dominante sur la nécessité du retour de l'État, du retour du politique, l’autre, plus discrète mais certainement appelée à plus de séduction dans le futur, sur l’excès et l’inefficacité de l’État.
L’État sauveur suprême, incarnation de la raison dans les marchés, est, des keynésiens revendiqués aux tenants inavoués du capitalisme d’État, la chanson partout entonnée. Les milliers de milliards de dollars ou d’euros, des États-Unis à l’Asie, de l’Europe à la Russie, soudainement sortis d’un chapeau magique, se répandent pour sauver les banques, les assurances et demain les industries stratégiques. Tous deviendraient « socialistes », voire reconstitueraient le Kremlin soviétique sur les rives du Potomac. Et les partis de gauche (là où ils ne sont pas au pouvoir) hésitent entre l’approbation honteuse et l’irritation de voir leurs « idées » pillées.
Sur le revers de la médaille les vrais libéraux se lamentent d’un injuste procès. Non sans arguments, ils désignent les interventions de l’État, alors même qu’il était prétendu absent. La financiarisation a été nourrie et soutenue par l’émission de titres d’État qui en forment le compartiment le plus sûr, le plus actif, celui sur lequel s’appuie l’extension des innovations dont ils sont le socle et la garantie. Si les financiers ont usé et abusé des effets de levier et des crédits à risque c’est que la politique monétaire des banques centrales maintenait artificiellement bas les taux d’intérêt. Pour que les subprime se multiplient, il a fallu la volonté délibérée des Pouvoirs publics d’étendre la propriété aux populations les plus modestes, ainsi aux États–Unis, le Community Reinvestment Act et les garanties accordées par ces institutions parapubliques Fanny Mae et Freddy Mac, qui ont dû être ensuite sauvées (d’autant que les chinois y avaient investi une part considérable de leurs dollars !). Et c’est sur cette base que les crédits aux ménages ont pu, grâce au système dit HELOC (Home Equity Line of Credit ) qui adosse la dette aux prix croissants de l’immobilier, prendre une ampleur explosive (près de 95% du PIB, plus de deux fois le niveau français). Enfin les réglementations comptables et bancaires, si contraires selon les libéraux au sens de la responsabilité et à la crainte des sanctions naturelles du marché, ont eu pour effet pervers d’exciter l’imagination toujours fertile des financiers à trouver des techniques de contournement tout en se sentant protégés par le si étrangement nommé « aléa moral », c’est-à-dire la certitude d’être couvert par l’État (les contribuables !) des conséquences éventuelles des erreurs commises. Ce qui, à l’exception de Lehman Brothers sacrifiée sans doute non à la morale mais à l’intérêt bien compris de ses concurrents, s’est entièrement vérifié.
Car l’État, n’en déplaise à nos sociaux-démocrates ou sociaux-libéraux qui font semblant de croire qu’il représente l’intérêt général, n’est que l’instrument chargé d’assurer la pérennité de l’ordre existant. Selon les circonstances et les époques, il adapte son action, modeste ou arrogante, aux besoins des rapports sociaux, capable d’être pompier après avoir été pyromane, autoritaire après avoir été laxiste, se donnant même parfois la prétention de bousculer ses mandants quand les troubles sociaux menacent. Si quiconque en doutait encore, les acrobaties idéologiques de MM Paulson, Sarkozy ou autres Brown, nationalisant à qui mieux mieux, devraient convaincre les plus incrédules. En dépit des apparences et des discours, ce sont les financiers qui imposent leur stratégie et non les politiques qui affirmeraient leur autorité et leur détermination
Comment dans cette grande confusion des idées (et encore aurait-il été bon de dire un mot des ricardiens6 qui ne cessent de dénoncer un « capitalisme sans capital », qui savent qu’il n’y a de valeur que du travail, mais ne voient nulle part l’exploitation), remettre un semblant d’ordre, essayer de remonter la chaine des causes ? Pour cela il faut reconstituer le puzzle de ces pièces dispersées et en découvrir le principe d’organisation, ce qui implique analyse formelle et rappel historique
Directement ou indirectement toute crise se révèle par une surabondance de crédit, ou différemment dit, par un excès de création monétaire par rapport à la production marchande. Mais le crédit n’est pas une aberration, il est consubstantiel au capitalisme et indispensable à son accumulation. De la monnaie au crédit et du crédit au capital financier mondialisé la trajectoire fut aussi logique que nécessaire. La monnaie a cette spécificité d’un caractère double, d’où, au fond, tout découle. Elle est moyen de l’échange, donc équivalent immédiat entre les biens dont elle n’exprime que les valeurs relatives, et instrument de conservation de la valeur, donc équivalent dans le temps où elle doit assurer le maintien absolu de la valeur. Dès lors que le temps intervient dans l’échange, le crédit apparaît, et avec le crédit sa matérialisation sous forme de traites, billets à ordre, lettres de crédit, etc.., chacune de ces matérialisations pouvant servir auprès de prêteurs ou de banques, de garantie pour un nouveau crédit. Ainsi sur une même valeur produite se multiplient les titres de créances qui sont une anticipation sur une valeur future, potentielle. La généralisation de ce système de crédit, qui est une création monétaire, conduit dans le cours historique du capitalisme, par étapes successives vers l’autonomisation de la monnaie, sous des formes de plus en plus virtuelles et au travers de crises récurrentes, à la financiarisation généralisée. Ce caractère double de la monnaie expliquera aussi les politiques monétaires, apparemment concurrentes, mais qui ne font que mettre l’accent sur l’une ou l’autre de ses fonctions.
En moins d’un siècle la monnaie se libérera de sa matérialité métallique, or et argent, d’abord après la Première Guerre mondiale, puis définitivement en 1971 quand Nixon supprimera toute référence du dollar en or et toute possibilité de conversion. Alors seront créées les conditions d’une multiplication illimitée des titres, de toutes formes, de toutes durées, de toute liquidité, qui, avec l’aide des technologies de l’information, assureront une presque parfaite fluidité et flexibilité du capital. Dès lors la monnaie apparaitra comme une richesse en soi, capable de s’auto-valoriser, indépendamment du travail et de la production sociale. Le capital financier devient dominant et s’unifie dans un même fétichisme. Les taux d’intérêt, la valeur actualisée des placements, semblent déterminer l’ensemble des évolutions et des équilibres économiques. Les banques et les institutions financières, publiques, privées ou internationales, répartissent le capital entre les différentes activités, les différents pays, en fonction des rendements attendus, des risques estimés, le déplaçant quasi instantanément, non sans, à l’occasion provoquer des crises brutales et localisées (Asie en 1997) ou des bulles dévastatrices (internet en 2001).
Mais malgré ses limites, cette mobilité du capital, expression de la prééminence du capital financier, est à la fois condition et produit de la mondialisation. Financiarisation et mondialisation ont partie liée, résultats d’un même développement historique. Ils forment un ensemble structuré qui tend à réaliser l’allocation des ressources la mieux adéquate à l’accumulation. Mais ce système, dans lequel il serait vain de chercher une frontière entre « économie réelle » et financière, est affecté d’un vice constitutif. La faculté du crédit à se gonfler démesurément, d’une façon qui apparaît rationnelle tant que l’ensemble des titres, actions, obligations, produits dérivés et autres signes des dettes entassées continuent à percevoir leur rémunération , alors même qu’ils se détachent de la production réelle de valeur, aboutit au développement d’un capital fictif. Et ce caractère fictif ne se révèle que lorsque, à un point quelconque de la chaîne des créances et des dettes, un débiteur insolvable, un investissement sinistré, inverse les anticipations et entraîne ventes précipitées et panique. Rien d’autre ne s’est produit avec les subprime et l’enchaînement qui s’en est suivi. Si la crise est à la fois bancaire, boursière et monétaire c’est que le capital financier a unifié la monnaie et le capital. Aussi se manifestant dans la sphère de la circulation, les mesures proposées pour réduire la crise dans sa racine ne dépassent pas la surface des choses et restent cantonnées à la simple énumération de réglementations, contrôles et autres moralisations.
Mais dans l’urgence il faut bien colmater les brèches. Un des effets les plus singuliers de la financiarisation est l’inversion des qualités : tout doit être fait pour sauver les banques, perpétuer les échanges monétaires, mais des secteurs industriels productifs peuvent être abandonnés ! La représentation abstraite et virtuelle importe plus que le travail humain concret. Aussi faut-il aller au delà des phénomènes monétaires et financiers. Que s’est-il passé pour que ce « modèle » du capitalisme s’instaure ? Habituellement le point d’inflexion est posé au début des années 80, quand les « trente glorieuses » s’achèvent avec ce que les économistes appelaient le compromis fordiste, époque bénie du keynésianisme. Ces années, cela est bien connu et largement décrit, avaient vu s’articuler une forte croissance de la productivité du travail, un taux de profit élevé, des salaires nominaux en progression et une inflation persistante. Cependant une telle configuration ne pouvait être durable. La productivité du travail déclinant, donc les prix réels exprimés en heures de travail augmentant, la croissance nominale des revenus ne suffisait plus à soutenir le niveau de vie des salariés. Le taux d’inflation tendait alors à s’élever au delà de ce qui était supportable en terme de masse de profit accumulable. Car l’inflation n’est pas seulement, comme il est parfois dit, un « impôt sur la monnaie », elle est aussi une sorte de faillite étalée dans le temps. La question de la valorisation du capital se posait donc de façon aiguë. Le temps était venu, celui de Reagan et Thatcher, de reconstituer, au prix d’une violente attaque contre la classe ouvrière, les taux et la masse des profits. Le « coût du travail » a été brutalement réduit, et bien au delà de ce qu’indique le partage salaires/profit de la valeur ajoutée : le rendement du capital, par toute une série d’innovations, a pris la forme privilégiée de plus values qui en comptabilité nationale s’inscrivent en patrimoine. Des théories financières dites « modernes » ont été élaborées qui ne distinguaient plus fonds propres et dettes et qui, grâce à une politique monétaire de taux d’intérêt sous évalués, ont justifié effets de levier, OPA hostiles ou non, rachat de leurs actions par les sociétés. Car évidemment, et contrairement à l’opinion répandue, la rentabilité effective du capital n’atteignit jamais les 15% « exigés » par les investisseurs. Il s’agissait de pures manipulations qui permirent de concentrer la richesse en un nombre toujours plus réduit de mains. Concentration de richesse mais aussi concentration du capital et constitution de groupes monopolistiques, dont moins de 500 contrôlent les deux tiers du commerce mondial. Dans le même temps la mondialisation devenait le thème à la mode. Non que ce soit une nouveauté pour le capitalisme, mais sa mise en avant permettait de masquer sa réalité profonde : une redoutable division internationale du travail. La mobilité du capital, les techniques de production de masse, la réduction du prix des transports, la rapidité des communications, autorisèrent de déplacer vers des pays à prix du travail misérable la production matérielle à faible valeur ajoutée. Et non tant par délocalisations d’industries existantes que par développement de produits nouveaux imposés à coup de campagnes mondiales de marketing.
Les pays du centre du capitalisme, les États-Unis en premier lieu, trouvèrent dans les pays d’Asie, d’Amérique Latine des complices consentants. Complices qui acceptèrent de dévaloriser leur travail national autant par une exploitation forcenée que par le dumping monétaire. Il ne faut pas en effet s’y tromper : les milliers de milliards de dollars accumulés en Chine, Russie ou autres ne sont pas le signe d’un enrichissement mais d’un appauvrissement. Ces excédents sont la contrepartie de la sous-valorisation de leurs produits et du sacrifice de la consommation et de l’investissement imposé à leur population. Il en est de même, bien que ce soit contre intuitif, pour les pays producteurs de pétrole ou de matières premières, qui gaspillent leur richesse et la vendent au dessous de son prix réel de rente (prix de substitution). Par cela s’effectue un transfert massif de valeur vers les pays industrialisés, et c’est bien leur capacité à capter une part majeure de la richesse mondiale qui fonde l’hégémonie des USA et du dollar, donc qui en font, et sans doute pour longtemps encore, le centre directeur du marché mondial. La crise, si surprenante par l’étroitesse de sa cause et l’extension de ses conséquences, est le résultat circonstanciel (toute autre cause aurait pu en être l’origine) de cette organisation du capital.
La financiarisation, c’est-à-dire l’autonomie de la monnaie comme indifférente à la production des biens tout en restant dépendante des valeurs réelles, qui permet à la fois création monétaire privée indéfinie et fluidité internationale du capital, articulée sur un procès de valorisation toujours plus difficile, produit un mélange explosif au moindre incident dans la chaine des crédits. Que l’endettement soit celui des États, des banques, des ménages ou des entreprises a peu d’importance, au bout du compte c’est l’ensemble du capital qui doit être dévalorisé, quel que soit le lieu où la crise prend naissance.
Aussi la « sortie de crise » est-elle problématique. Une simple socialisation des pertes, donc un ajustement par la baisse des salaires, le chômage, l’impôt, ne saurait être suffisant, si loin d’être à la mesure la globalité et de l’internationalisation de la crise. L’injection de « liquidités », par les États nationaux dans les banques, par le FMI dans les de plus en plus nombreux pays insolvables, ne sauraient que repousser les solutions recherchées, puisque la crise ne provient pas d’un manque de liquidités mais au contraire d’un excès, liquidités qui ne circulent plus (la « trappe à liquidités » de Keynes) et qui ne sont que le symptôme d’un capital qui ne peut se valoriser. Les réponses sont toujours les mêmes. Les économistes « classiques » libéraux défendent que la « purge » doit aller à son terme, que l’urgence est de préserver la stabilité et la valeur de la monnaie (son rôle de conservation) et donc d’en détruire le surplus sans contrepartie. Mais la brutalité du remède tuerait le malade, disent les « anti-monétaristes » keynésiens. Pour éviter que la crise ne devienne sociale, il faut des plans de relance, du déficit budgétaire et au bout du compte l’inflation, qui aboutit aussi à une dévalorisation du capital, mais de façon dissimulée et indolore.
En l’absence de toute perspective politique radicale (peut être faudra-t-il encore quelques crises majeures pour qu’elle s’ouvre) le retour de l’État keynésien, ou dit tel car il est douteux que Keynes s’y reconnaisse, est le plus probable. Outre les conséquences internationales -sans doute une nouvelle répartition des forces mais toujours contrairement à ce qui s’écrit partout sous direction américaine, fut-elle plus subtile- dans chaque pays l’État deviendra plus interventionniste, dans la répression et non dans la providence, la politique monétaire plus active et l’inflation acceptée. L’Europe pourrait en exploser et l’euro vivre des jours difficiles. L’hétérogénéité économique des pays européens devrait leur imposer de retrouver une liberté monétaire pour compenser les inévitables différentiels d’inflation. Les banques centrales de chaque pays entreraient en contradiction avec la BCE, qui en tout état de cause ne serait plus capable de définir et de mener une politique commune. Avec le retour au seigneuriage monétaire, le triomphe des souverainistes accompagnerait le renforcement du rôle du dollar et une période d’incertitudes politiques dont nul ne peut dire si elle serait favorable ou défavorable à une lutte des classes qui serait paradoxalement plus encore internationalement déterminée.
Galar
1 Toutes les notes qui apparaissent dans le texte ont été ajoutées par le CCI et consistent à expliciter certaines références en vue d'en faciliter la compréhension par le lecteur.
3 Débat interne au CCI : les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (III) [237]
4 La Fed (pour "Federal Reserve") est la banque centrale des États-Unis.
5 Ce terme de "main invisible" est employé à plusieurs reprises dans trois ouvrages d'Adam Smith (1723-1790), un philosophe du "siècle des lumières", professeur à l'université de Glasgow, qui est aussi le père fondateur de l'économie politique "classique", du temps où la bourgeoisie était encore une classe révolutionnaire. Par la suite, certains de ses épigones ont repris ce terme pour avancer l'idée que la "main invisible" du marché se charge, au delà des intérêts opposés de ses différents protagonistes, d'établir un équilibre économique dont tous ces derniers sont bénéficières et d'assurer une prospérité pérenne à la société.
6 Les économistes qui se réclament des théories de David Ricardo (1772-1823), un des grands noms de l'économie politique classique, dont la thèse que le travail est la seule source de valeur pour une marchandise a été reprise et développée par Marx.
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [127]
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Une contribution au débat sur la crise économique actuelle
- 3683 lectures
Fin février, nous avons reçu le message suivant : « J'ai écrit un texte d'analyse marxiste sur la crise actuelle et je pense qu'il pourrait vous intéresser, vous et vos lecteurs. Il est sur mon blog www.papamarx.wordpress.com [238] et peut être librement copié pour usage non-commercial. Si vous pensez qu'il serait pertinent pour votre site, cela me ferait un grand plaisir de le voir publié chez vous. »
La gravité de la crise qui marque, comme le nomme « papamarx », « un changement d'époque », et le tombereau de mensonges déversé par la bourgeoisie pour cacher les véritables racines de la faillite du capitalisme, obligent les révolutionnaires à approfondir leur compréhension des ressorts économiques de ce système. Pour cela, rien de mieux que le débat, la confrontation saine et fraternelle des idées, en luttant contre tout esprit boutiquier. Nous livrons donc à la connaissance et à la réflexion de nos lecteurs cette contribution qu'effectivement nous pensons «pertinent[e] pour [notre] site ».
En particulier, l'intérêt de ce texte réside en ceci qu'il se base sur des présupposés théoriques (« la baisse tendancielle du taux de profit ») différents de ceux qui constituent la position majoritaire au sein du CCI pour expliquer les contradictions insurmontables du capitalisme (essentiellement l'insuffisance historique des débouchés extra-capitalistes). En ce sens, ce texte peut également être utile tant à la discussion de nos articles d'analyse de la phase actuelle de la crise mortelle du capitalisme (Lire notre article « La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme [236] ») qu'au débat au sein du CCI qui s'est développé autours de l'étude de la période dite des "Trente Glorieuses" pour comprendre les contradictions fondamentales de l'accumulation capitaliste et dont nous avons entrepris la publication à l'extérieur de notre organisation (Lire notre article « Débat interne au CCI : les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (III) [237] » ).
Nous ne pouvons ici, dans le cadre de cette courte présentation, répondre en profondeur à l'analyse de « papamarx ». Nous nous contenterons de poser une seule question. Cet article qui décrit avec justesse l'évolution de la crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale veut mettre au centre de son analyse la question de la baisse tendancielle du taux de profit. Et pourtant, à chaque récession, ce qui est mis en avant concrètement comme cause de la crise est la saturation des marchés. Le terme « surproduction » est ainsi répété 6 fois et « papamarx » affirme même finalement « comme toute crise sous le capitalisme, la crise de 2008 est une crise de surproduction ». S'en suit une tentative d'explication, « Ce qui crée la possibilité d'une crise de surproduction, c'est l'écart qui existe entre le moment où la décision d'investissement est prise et le moment de la réalisation (vente) de ce même investissement. Entre ces deux moments, il est en effet possible que la demande solvable ait été satisfaite, car il n'existe aucun moyen de limiter la quantité des investissements dans un secteur donné. On peut donc décider d'investir dans un marché en demande, et arriver à offrir notre marchandise seulement au moment où la demande se contracte. Si plusieurs agents économiques font de même, on a une crise de surproduction, avec éffondrement des prix, comme en 2006. ». Mais, même si cet écart « entre le moment où la décision d'investissement est prise et le moment de la réalisation (vente) de ce même investissement » existe effectivement, n'y a t'il pas quelque chose de bien plus profond qui explique que « comme toute crise sous le capitalisme, la crise de 2008 est une crise de surproduction » ?[1]
L'article de « papamarx »[2] : Crise économique : un changement d'époque
Le fruit de la misère ne tombe jamais loin de l'arbre de l'exploitation.
La crise économique commencée en 2008 a maintenant pris des proportions mondiales, et laisse désemparés les capitalistes et les États qui n'avaient pas su ou voulu en mesurer l'importance.
Partout le chômage explose alors que des mobilisations sociales de plus en plus radicales et violentes se manifestent. De l'Europe de l'est à la Grèce, de l'Islande aux Antilles françaises, des États-Unis à la Chine, les troubles sociaux fusent en réaction à la crise qui prive les travailleurs de revenus, de logement, de nourriture.
Manifestants exigeant et obtenant la libération d'un prisonnier en Islande
Les classes dominantes tentent tant bien que mal de prendre la mesure d'une crise de plus en plus profonde et qui ne semble pas vouloir se résorber, alors que les plus populistes d'entre eux, Nicolas Sarkozy en tête, mettent la faute de la crise sur les excès du capitalisme, sur la finance immorale, sur un manque de réglementations. Bercés par l'espoir d'un rapide retour à la normale qui serait la conséquence de nouvelles réglementations et d'une moralisation du capitalisme, les politiciens et opportunistes de tout acabit peinent à voir ce que de plus en plus d'observateurs constatent: la crise actuelle marque la fin d'une époque.
Cette crise est le résultat d'une évolution normale et naturelle du capitalisme. Le fruit de la misère ne tombe jamais loin de l'arbre de l'exploitation. Du néolibéralisme caractéristique des trente dernières années à la financiarisation de l'économie, des hypothèques à risques américaines à la crise du papier commercial, de la crise alimentaire mondiale à la crise actuelle, il y a un enchaînement causal indéniable, propre au système capitaliste.
Comprendre la situation actuelle est le préalable à une action efficace. Ce texte veut en conséquence contribuer à une essentielle renaissance de la critique de l'économie politique.
Des « Trente Glorieuses » à la « stagflation »
Pour bien comprendre la crise actuelle, il nous faut faire un retour en arrière jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, en 1944, dans une petite ville du New-Hampshire nommée Bretton Woods. Se souvenant des soubresauts provoqués par la crise de 1929, que seule la guerre mondiale avait pu résorber, les dirigeants des principaux pays alliés mettent alors sur pied un nouveau système économique international destiné à être implanté à la fin de la guerre.
Les accords de Bretton Woods mettent sur pied un nouveau système monétaire international, fondé sur le dollar américain, dont la convertibilité avec l'or au prix de 35$ l'once garanti la stabilité du système international de change. On établi aussi des institutions chargées de garantir et « d'aider », au besoin, les pays en rupture de paiement par l'octroi de prêts destinés à stabiliser et à garantir les échanges internationaux, de même que des prêts à plus long terme servant à financer des infrastructures économiques permettant à des pays en retard de produire pour l'exportation. Ces institutions, le Fonds monétaire international pour les prêts à court terme aux pays en rupture de paiement, et la Banque mondiale pour le financement des infrastructures, vont jouer un rôle prépondérant dans la réorganisation du commerce international et aideront largement les états impérialistes à conserver leur position dominante dans l'économie mondiale.
Le nouveau système monétaire international va permettre au capitalisme d'entamer la plus grande période de croissance de son histoire, de 1945 à 1971, sur des bases solides. La croissance de cette période tire sa source dans une nouvelle organisation du travail et de nouvelles technologies qui vont relancer la croissance, elle-même stimulée par des destructions sans précédant en Europe et en Asie causée par la Seconde Guerre mondiale.
En même temps, la division internationale du travail et les institutions fondées pour en garantir la fluidité (BM et FMI) vont permettre le drainage des ressources des pays en voie de développement vers les métropoles impérialistes, assurant du même coup des surprofits coloniaux juteux aux oligopoles transnationaux. C'est cette nouvelle stabilité dans les échanges internationaux - fondamentalement inégalitaire - qui placera de plus en plus les oligopoles transnationaux dans une position de force face à un nombre grandissant d'États et de communautés. Cette nouvelle force constituera la base sur laquelle, à partir des années 1980, s'édifiera un régime d'accumulation du capital véritablement international.
La plupart des États industrialisés adoptent dans cette période une politique économique d'inspiration keynésienne, ce qui veut dire qu'on intervient beaucoup dans l'économie: on prends en charge les grands travaux d'infrastructures que le secteur privé est incapable de financer, on construit des routes, des écoles, des hôpitaux, on élargi l'accès aux études supérieures, on instaure l'aide sociale, on modernise l'agriculture, on subventionne les entreprises pour stimuler le développement économique.
En même temps, on garantit une relative paix sociale en instaurant des lois sur les relations de travail qui vont officialiser la place des grands syndicats bureaucratiques dans l'économie, on va adopter des lois d'utilité sociale pour protéger les travailleurs contre les abus les plus criants des patrons, la sécurité d'emploi va s'étendre et les salaires vont s'élever sensiblement.
À partir du milieu des années 1960, toutefois, des signes d'affaiblissement de la croissance commencent à se faire voir, et en 1971, la crise éclate ouvertement. Incapable de supporter plus longtemps le système de change international alors que leur balance commerciale est lourdement déficitaire, les États-Unis abandonnent la convertibilité du dollar en or, instaurant ainsi de facto un système monétaire international basé sur des cours de change flottant.
En 1974, les graves problèmes que subissent les économies mondiales se transforment en la plus grave crise économique depuis la fin de la guerre. Les patrons tentent d'abord de répondre à la crise par les moyens habituels : extension du crédit, politiques inflationnistes, dépenses gouvernementales et politique de relance. Bien vite, ces solution apparaissent limitées et la fin des années 1970 est marquée par une inflation galopante et par des taux d'intérêts qui grimpent en flèche pour juguler l'inflation, alors que la croissance stagne. Ce phénomène, inflation élevée et stagnation économique, sera nommé stagflation. Un des facteurs d'aggravation de la crise fut la combativité de la main-d'œuvre et les luttes radicales, souvent très dures, des années 1970. Alors que les taux de profits baissent et que les gouvernements se lancent dans des politiques de stimulation économique débouchant sur l'inflation, le prolétariat refuse de payer seul le prix de la crise et réclame par ses luttes des hausses de salaires conséquentes avec la hausse des prix. C'est la fin du modèle de développement économique qui a cours depuis 1945, les politiques de relance keynésienne causant désormais une inflation si élevée qu'elle en annule les effets bénéfiques, et la forte combativité ouvrière exigeant que le patronat casse violemment les syndicats les plus combatifs[I].
Les causes de la crise
Les causes de cette crise généralisée du régime d'accumulation du capital propre aux Trente Glorieuses sont caractéristiques de l'impasse fondamentale dans laquelle le capitalisme tardif se trouve. En effet, le capital social total, c'est-à-dire l'ensemble du capital dans toute la société, est constamment soumis à des impératifs d'accumulation. L'accumulation du capital implique qu'une partie de la plus-value[II] produite par le travail soit réinjectée dans le capital pour que celui-ci grandisse. Or ce processus d'accumulation cause une chute des taux de profits[III], chute qui sera à la base de la crise structurelle des années 1970.
La tendance à l'accumulation du capital développe les forces productives par un processus qui alloue les capitaux aux diverses branches d'industries en fonction des taux de profits[IV] que chacune d'entre elle offre. Quand une branche d'industrie offre des profits intéressants, les capitaux y affluent à la recherche de profits supérieurs à la moyenne. Comme chaque capitaliste cherche à baisser ses coûts de production pour être à même de baisser ses prix et d'avoir un avantage sur la concurrence, les investissements se font donc dans de nouvelles machines, de nouveaux équipements et de nouveaux procédés de production qui auront pour effet d'augmenter la productivité du travail, et donc réduiront les coûts de production. Cette affluence de capitaux amène donc des transformations dans la structure du capital de ladite branche d'industrie, en faisant augmenter la composition organique du capital[V].
À un certain moment, par la suite de la saturation de la demande et de la stabilisation de la concurrence, les taux de profits de la branche d'industrie en question se réalignent vers le taux de profit moyen. Quand cet alignement est pleinement réalisé, ou quand suite à une surproduction les taux de profits chutent en bas de la moyenne, les capitaux cessent d'être attirés vers cette branche d'industrie et migrent vers une autre branche, répétant le même processus d'élévation de la composition organique du capital de branche en branche, jusqu'à avoir fait le tour de tous les secteurs profitables.
Ainsi, poussé par la recherche des taux de profits les plus élevés, le capital est constamment dans une dynamique d'accumulation qui constitue pour lui une question de vie ou de mort. Mais ce mouvement d'accumulation comporte lui-même une contradiction importante, qui sera à la source de la crise des années 1970. En effet, ce mouvement d'accumulation conduit à une réduction toujours plus prononcée de la part du travail vivant dans la production des marchandises. Comme seul le travail vivant est producteur de valeur[VI], et donc de la plus-value à la base du profit, il en résulte que le taux de profit a tendance à diminuer à chaque cycle d'accumulation du capital.
Dans les années 1970, l'accumulation du capital atteint un point tel que les contre-tendances à la baisse du taux de profit n'opèrent plus. Le résultat est une crise de valorisation du capital, celui-ci ayant de plus en plus de difficultés à continuer à croître et à générer des profits. En même temps, un capital ayant une composition organique très élevée est plus vulnérable aux crises, parce que les crises menacent la reproduction du capital constant. La main-d'œuvre est en effet flexible à souhaits, et le capitaliste peut rapidement mettre au chômage les travailleurs quand les choses vont mal, mettant ainsi le poids de la reproduction de la force de travail sur le dos des travailleurs eux-mêmes. Mais il en va autrement avec les machines, le capital constant, pour lequel le capitaliste n'a d'autre choix, qu'il y ait production ou non, d'en assumer l'achat. La part grandissante du capital constant par rapport au capital total ne fait qu'aggraver le problème.
La crise auquel fait face le capitalisme vers la fin des années 1970 le place donc devant des difficultés de nature structurelles, alors que des événements de nature conjoncturelles, comme le choc pétrolier, viennent aggraver la crise, sans toutefois la causer comme le veut la légende populaire.
Le néolibéralisme: la croissance par l'endettement
La solution pour répondre à la crise devient rapidement évidente : il faudra attaquer directement les acquis des travailleurs pour relancer les profits. Dès lors, le cycle que nous connaissons bien est commencé. Il sera marqué par une série d'attaques contre le prolétariat que certains nommeront néolibéralisme.
Le néolibéralisme est basé sur le contrôle maximal des coûts de main-d'œuvre et la lutte à tout prix contre l'inflation salariale (c'est-à-dire contre l'augmentation des salaires). Il se caractérise par plusieurs délocalisations de la production vers le Tiers-Monde, des compressions dans les programmes sociaux, des diminutions de salaires, l'élagage de la fonction publique, le retour au travail précaire, des licenciements massifs et l'instauration de la concurrence mondiale entre travailleurs. Puis, dans une deuxième phase, il sera marqué par une extension des domaines de valorisation du capital : on veut ouvrir la santé, l'école, l'eau potable et tout une série d'activités productives au capital. On palliera, en partie, la baisse des taux de profit en s'appropriant de manière privée une plus-value autrefois distribuée plus ou moins socialement. C'est une nouvelle configuration du capitalisme qui voit le jour dans les années 1980, le néolibéralisme
Mais les coupes drastiques dans les salaires ont l'effet de faire diminuer la demande solvable, c'est-à-dire la capacité de consommation des masses. Les licenciements massifs, les délocalisations, les coupes dans la fonction publique tirent vers le bas les revenus des ménages, alors qu'en termes absolus la production mondiale continue son ascension et sa croissance. Aux États-Unis - pays qui par son poids économique et politique peut être considéré comme baromètre - le revenu médian réel des ménages n'a augmenté que de 13% entre 1979 et 2005[VII]. Encore pire, selon le Bureau of Labor Statistics, le salaire horaire moyen des travailleurs non-superviseurs a diminué depuis 1970[VIII]. Au Canada, le salaire médian réel n'a augmenté que de 0,1%, ce qui veut dire que les salaires des 50% les plus pauvres n'ont pas augmentés depuis 30 ans[IX]. des Et ces chiffres sont certainement en deçà de la réalité: étant donné que les statistiques de l'inflation sont fortement biaisées[X], l'augmentation du revenu médian des ménages est probablement négative.
C'est donc dire que durant la période « néolibérale » (1980-2008), les salaires réels ont baissés, ou au mieux stagnés. À cette tendance lourde d'abaisser les salaires et les avantages sociaux directs, il faut ajouter une autre tendance systématique de cette période qui fut la diminution du salaire social, c'est-à-dire des prestations, en argent ou en services, offerts par l'État aux travailleurs et travailleuses. Ces années sont les années de vaches maigres pour les services publics, et sont accompagnées en bruit de fond par un discours ultralibéral à saveur économique qui devient rapidement omniprésent dans des média de masses de plus en plus concentrés dans les mains des plus riches. Il faut dire que ces média ont fort justement servi les intérêts de leurs propriétaires, les revenus du 0,1% des américains les plus riches ayant augmentés de 296% durant la période 1979-2005[XI] !
Dans les économies des pays industriels avancés, la consommation des ménages compte pour environ les 2/3 du PIB. C'est dire toute l'importance pour le système d'avoir un bassin de population capable d'absorber l'offre en consommant suffisamment. La diminution des revenus réels durant la période néolibérale aurait en conséquence dû mener à un effondrement de la croissance, voire vers une dépression extrêmement grave. S'il est vrai que la croissance de la période a été anémique, et que 3 récessions (1982, 1990, 2001) l'ont traversée, la demande ne s'est pas brutalement effondrée parce que le recours au crédit s'est considérablement accru durant la même période.
Alors que l'endettement des ménages dans les années 1970 était relativement faible, il n'a cessé de croître depuis, atteignant 96% du revenu annuel des ménages américains en 1996, pour grimper à 129% en 2001. Au Canada, l'endettement des ménages est passé de 80% en 1990 à 130% en 2008, alors que le taux d'épargne a chuté de 13% à 3% durant la même période[XII]. Et ces chiffres sont généralisables à la plupart des pays industrialisés. L'extension du crédit est telle qu'elle est maintenant responsable de toute la croissance économique, tant en Europe qu'en Amérique[XIII]. On a donc compensé les diminutions de salaires, et la baisse de la demande qui y correspond, avec un endettement privé massif.
La croissance chinoise elle-même, nouvelle vedette du capitalisme, est basée sur l'endettement massif des États-Unis et sur des excédants commerciaux fantastiques, correspondant de l'autre côté de la transaction avec des déficits de la balance commerciale américaine de plus en plus abyssaux. Mais la Chine paiera chèrement sa dépendance vis-à-vis la consommation américaine par l'endettement. D'abord parce que la limitation du crédit et les multiples défauts de paiements actuels tariront la demande pour ses produits d'exportations. Ensuite parce que ses exportations étant payées en dollars US, la Chine - qui a constitué avec ce magot des réserves de change considérables - s'expose fortement a une plus que probable dévaluation du dollar US[XIV].
La configuration néolibérale du capitalisme a vu le jour pour tenter de résoudre les difficultés croissantes de valorisation du capital, qui s'exprimaient dans une baisse de profitabilité des investissements et dans des épisodes de surproduction de plus en plus violents, comme en témoignent les crises de 1974 et de 1982. Cette tendance à la baisse des taux de profits s'est paradoxalement accompagnée d'une hausse fulgurante des liquidités disponibles, qui a elle-même permis le modèle de relance de la consommation basé sur la maximisation du crédit. En effet, il est typique des crises économiques de voir la quantité de liquidités augmenter, les capitaux disponibles ne souhaitant pas risquer des investissements aux rendements incertains et aux risques trop élevés. Cette tendance est elle-même renforcée par la diminution des profits, qui décourage les investissements.
L'explosion de la finance
C'est pourquoi, parallèlement aux attaques contre les travailleurs et à la restructuration néolibérale de l'économie productive, la finance va devenir prédominante à partir des années 1980. Cette prédominance s'explique par plusieurs facteurs, dont la naissance d'un système de production de plus en plus mondialisé, phénomène favorisé par l'extension de la sous-traitance et la libéralisation des lois et règlements régulant les échanges internationaux. De plus, il faut voir que la crise systémique commencée dans les années 1970 a dégagé une masse importante de capitaux qui ne trouvent plus des taux de profits suffisant dans l'économie productive et qui vont tenter de se valoriser dans une sphère financière de plus en plus déconnectée de l'économie réelle.
La sphère financière a bercé les illusions de plusieurs sur la capacité du capital à produire de l'argent avec de l'argent, sans passer par l'étape de la production réelle. Le capital fictif se transige sur un marché distinct de celui des marchandises, selon des lois distinctes, renforçant ainsi l'illusion qu'il est un véritable capital à côté de celui qu'il représente. Dans le monde de la finance, même une montagne de dettes peut passer pour de la richesse, puisqu'on peut vendre et acheter des titres de dettes. Mais la déconnexion croissante de la finance et de la capitalisation boursière vis-à-vis du PIB a tranquillement fait évoluer les marchés financiers vers un sommet, dans lequel les valeurs boursières sont sans commune mesure avec la valeur réelle des actifs.
Ainsi dans les années 1990, les cours boursiers ont progressé de façon spectaculaire, alors que la croissance était plutôt limitée, et malgré de nombreuses fermetures d'entreprises. Les entreprises qui annonçaient des mises à pied massives, vu la contraction de la demande, se voyaient récompensée par des hausses importantes de la valeur de leurs titres. Des transnationales achetèrent leurs concurrents, non dans le but de réaliser des économies d'échelle ou de mettre la main sur des capacités de production qu'elles n'avaient pas, mais dans le simple objectif de réduire la concurrence, et ceci à des coûts nettement plus élevés que la valeur réelle des actifs ainsi acquis.
Cette déconnexion existe parce que la sphère financière a ceci de particulier qu'elle est le royaume du capital fictif, capital constitué de titres comme des actions, des obligations, des options, des titres de dettes, titres qui sont en fait des revenus futurs anticipés, qui ne sont pas encore réalisés.
Or, comme le capital fictif est une anticipation de revenus futurs, de la richesse future, il est en quelque sorte un modèle « d'économie casino », qui attire naturellement les manipulations comptables diverses, les fraudes[XV] et les schémas de Ponzi[XVI]. Les gouvernements ont favorisé cet état de fait en libéralisant les normes comptables[XVII] et en permettant une circulation sans limite des capitaux, ce qui a rendu toute surveillance absolument vaine.
La croissance du capital fictif, de la sphère financière, a suivi une courbe ascendante proportionnelle avec l'offre de crédit aux ménages et aux États. La raison en est toute naturelle: si les détenteurs de capitaux estiment que la croissance future sera considérable - et c'est ce que veut dire, en définitive une croissance boursière considérable - il est donc logique et sécuritaire d'augmenter l'offre de crédit, puisque la croissance escomptée fournira aux emprunteurs les moyens futurs de remboursement de leur dette.
En même temps, en l'absence d'investissements productifs gratifiant le capital de taux de profits conséquents, provoque, depuis les années 1980, une crise de suraccumulation des capitaux, c'est-à-dire qu'il y a trop de capitaux disponibles pour ce qu'il est effectivement possible d'investir dans la production. Ces capitaux seront naturellement attirés par les rendements promis par les banques, les sociétés de financement hypothécaires, les compagnies de cartes de crédit, de financement automobile, et autres société spécialisées dans l'offre de crédit.
Les subprimes
Après l'éclatement la bulle des technologies nouvelles en 2000, les capitaux en manque de valorisation ont cherché un terrain fertile pour continuer à rapporter des dividendes à leurs propriétaires. Le secteur de l'immobilier leur offrira l'occasion d'investir leurs capitaux, stimulé par des taux d'intérêts très bas, vu l'abondance de capitaux disponibles. Une politique de dérèglementation du marché hypothécaire, comprenant l'autorisation de prêts sur 40 ans et de prêts représentant 110% de la valeur de la maison achèvera de préparer le terrain à l'invasion de la finance dans l'immobilier.
Les institutions de crédit américaines vont développer tout un système pour attirer dans leurs filets les ménages américains à qui on fait subitement miroiter des maisons luxueuses et accessible facilement, vu le relâchement des règles sur le crédit hypothécaire. Les banques et les institutions de crédit hypothécaire, comme Freddy Mac et Fannie Mae, vont se mettre à financer toute une série de prêts à haut risques à des ménages normalement insolvables. Entre 1994 et 2003, la valeur de ces prêts à risque passera de 35G$ à 332G$[XVIII].
Parallèlement à cela, les ménages déjà propriétaires de leur maison mais qui disposent de revenus de plus en plus limités, comme nous venons de le voir, se verront offrir des marges de crédits hypothécaire, donc un crédit garanti par la valeur résiduelle de la maison.
Tout ce beau système fonctionne tant que les prix immobiliers augmentent et que les taux d'intérêts restent bas. Mais à partir de 2006, la valeur de revente des maisons commence à diminuer, alors que les maisons neuves se vendent de moins en moins bien. C'est que poussés vers le haut par les emprunts pour financer la guerre en Irak, les taux d'intérêts US passent de 1% en 2004 à 5,25% en 2006.
Ces changements sont aggravés par la structure même des subprimes, les hypothèques à risque américaines. En effet, les hypothèques « subprimes », ou hypothèques à surprime, sont consenties à des taux flottants, laissant l'emprunteur à la merci d'une hausse des taux d'intérêts, et incluent aussi une surprime de risque encaissée par le prêteur pour « compenser » le risque représenté par l'éventuelle insolvabilité des ménages. De plus, les subprimes sont ainsi conçus pour que la surprime ne soit pas payable au début du terme de 5 ans, mais selon un ordre croissant d'année en année. Ainsi, l'année 1 est au taux normal, l'année 2 au taux normal assorti d'une surprime de 1%, l'année 3 au taux normal assorti d'une surprime de 2%[XIX], et ainsi de suite. Donc plus on avance dans le temps, plus les taux d'intérêts payés par les emprunteurs montent, autant à cause de la prime de risque qu'à cause de la hausse des taux officiels.
En 2006, le système se met à avoir des ratés, et les premières vagues de défauts de paiement commencent à apparaître. En 2007, c'est 1,3 millions de ménages qui perdent leur logement, et la croissance des saisies immobilière progressera jusqu'à ce jour de près de 100 000 par mois[XX]. Quand on sait le peu de filet de sécurité sociale dont les américains disposent, et si on ajoute que le marché locatif est proportionnellement beaucoup moins important qu'au Canada, on comprends à quel point une telle hécatombe immobilière a pu toucher les travailleurs et les pauvres aux États-Unis.
Des « subprimes » au « PCAA »
Mais les malheurs des pauvres vont, pour une fois, faire aussi le malheur des riches, car la crise immobilière américaine se transmettra à l'ensemble de la finance mondiale par le biais d'un instrument financier complexe, le PCAA (papier commercial adossé à des actifs).
Le PCAA est un titre financier qui regroupe plusieurs créances différentes comportant des niveau de risques différents, que l'on vend sur les marchés financiers pour pouvoir financer de nouveaux prêts, et dont l'échéance est très courte. En échange de son capital, l'acheteur de PCAA se voit attribuer une part des intérêts perçus par les prêteurs. C'est par l'émission de PCAA que les prêteurs hypothécaires américains vont financer leurs prêts à risque, et ils y incluront toutes sortes d'autres créances comme des prêts auto, des créances de cartes de crédit, etc.
Quand les acheteurs de PCAA se rendent comptent que ces titres sont adossés à de mauvaises créances - les subprimes - ils refusent de renouveler leur achat à l'échéance, très courte comme nous l'avons vu, forçant ainsi les émetteurs de PCAA à diminuer drastiquement leurs liquidités pour racheter les titres. De même, beaucoup de banques, de fonds de pension[XXI] et d'investisseurs majeurs restèrent « pris » avec des PCAA, refusant de les vendre aux prix dérisoires qu'ils avaient atteints[XXII].
Les spéculateurs qui avaient réussi à se dégager à temps des PCAA ont évidemment trouvé de nouveaux horizons pour tenter de valoriser tant bien que mal leurs capitaux. La récente crise alimentaire mondiale, épisode de famine paradoxal dans un monde où règne de façon générale la surproduction, s'explique en partie par le déplacement de ces capitaux vers les marchés des matières premières[XXIII], alimentaires et pétroliers principalement. Cet épisode de spéculation fut de courte durée car les fonds spéculatifs durent faire face à la crise des liquidités bancaires, et virent leurs crédits coupés.
La crise financière
La crise du PCAA débouchera sur une crise des liquidités bancaires, certaines des plus grosses banques du monde éprouvant de sérieuses difficultés[XXIV] à financer leurs opérations courantes alors que d'autres feront faillite[XXV]. Refusant de se prêter entre elles et refusant de plus en plus de prêts aux particuliers et aux entreprises, les banques tariront le crédit facile et peu coûteux qui avait été à la base de la croissance des dernières années.
Cette crise bancaire provoquera un effet domino sur les marchés financiers, et les détenteurs de capitaux qui tentent tant bien que mal d'encaisser en liquide leur capital sont mis devant le caractère largement fictif de celui-ci. Les compagnies d'assurances, dangereusement exposées au PCAA parce qu'elles en avaient garantie le capital, sont mise en danger par des réclamations de plus en plus élevées. La plus grande compagnie d'assurances au monde, l'American Insurance Group (AIG) devra se résigner à la nationalisation partielle de ses actifs, à la hauteur de 80G$, faute de quoi elle se retrouverait en situation de défaut de paiement vis-à-vis ses assurés. Les fonds spéculatifs et les fonds de couverture, utilisant leurs marges de crédit pour spéculer, se voient obligés de liquider en catastrophe leurs positions suite aux rappels de leurs marges provenant de banques cherchant des liquidités. Comme nous l'avons vu plus haut, cette situation eu pour effet de faire reculer les prix des matières premières, pétrole et nourriture en premier lieu.
En septembre 2008, les marchés boursiers, déjà en baisse depuis octobre 2007, plongent de plus belle, et pour longtemps. La situation ne se stabilisera que tranquillement à partir de novembre, mais avec une chute de 43% de la valeur des capitalisations boursières par-rapport à leur sommet de 2007. Depuis, les marchés boursiers stagnent, le Dow Jones oscillant au gré des nouvelles économiques autour de 8000 points.
La crise économique de 2008
Le fait que la crise éclate dans l'immobilier peut être considéré comme un facteur aggravant, étant donné que ce secteur est caractérisé par un temps de circulation du capital relativement long. En effet, comme toute crise sous le capitalisme, la crise de 2008 est une crise de surproduction, dans ce cas-ci de maisons. Ce qui crée la possibilité d'une crise de surproduction, c'est l'écart qui existe entre le moment où la décision d'investissement est prise et le moment de la réalisation (vente) de ce même investissement. Entre ces deux moments, il est en effet possible que la demande solvable ait été satisfaite, car il n'existe aucun moyen de limiter la quantité des investissements dans un secteur donné. On peut donc décider d'investir dans un marché en demande, et arriver à offrir notre marchandise seulement au moment où la demande se contracte. Si plusieurs agents économiques font de même, on a une crise de surproduction, avec effondrement des prix, comme en 2006. Contrairement à d'autres secteurs, où une forte demande peut être satisfaite rapidement parce que les capacités productives sont sous-utilisées, l'immobilier se caractérise par un cycle de circulation du capital plus long, ce qui fait que les quantités de capitaux ayant trop produit sont beaucoup plus élevés.
Le tarissement du crédit a débouché, en 2008, sur une baisse de la demande solvable au niveau mondial, avec toutes les conséquences économiques que cela amène. Les secteurs les plus touchés au départ sont ceux de l'automobile et de l'immobilier, largement dépendants de l'offre de crédit à rabais. Mais l'importance relative de ces secteurs dans l'économie capitaliste, couplé à un ralentissement général de la consommation, conduit déjà plusieurs autres secteurs à faire des mises à pieds massives[XXVI].
Comme toujours ce sont les travailleurs qui paieront la facture de la crise. Les mises à pieds massives des derniers mois ont fait exploser le chômage un peu partout, encore une fois beaucoup plus que dans les statistiques officielles, étant donné qu'elle ne font pas la différence entre un emploi à temps partiel et un emploi à temps plein.
Il est aussi certain que l'on demandera aux travailleurs et aux travailleuses de travailler encore pour moins cher, les plans de relance américain dans l'automobile étant conditionnels à des concessions salariales de la part des syndiqués, qui verront leurs salaires diminuer de moitié. La flexibilité de la main-d'œuvre, devant une demande anémique, sera augmentée, pour permettre aux patrons de diminuer les coûteux « temps morts » durant lesquels les travailleurs bien que sur les lieux de travail, disponibles et payés, ne travaillent pas.
Enfin, l'arrivée massive des déficits dans les budgets d'États, déficits engrangés pour relancer l'économie et permettre de nouveau aux patrons de faire des profits faramineux sur notre dos, constitueront à terme, surtout si on les couple avec des baisses d'impôts, le prétexte tout trouvé pour diminuer de nouveau la part des impôts des travailleurs qui leur est distribuée sous forme de services ou de prestations sociales. Il s'agit ici d'une baisse de salaire - le salaire social - plus difficile à voir que la baisse du salaire disponible, mais non moins réelle. Les pressions se feront d'autant plus fortes que certains secteurs d'État ont des potentiels de rentabilité élevées et que les capitalistes voudront certainement profiter de ces secteurs pour se refaire une santé[XXVII].
Le taux d'endettement spectaculaire des États et des entreprises auront aussi un impact majeur sur l'inflation, déjà suffisamment élevée avant l'éclatement de la crise[XXVIII], car de telles dettes sont virtuellement impossibles à rembourser[XXIX]. L'État n'aura donc d'autre choix que d'avoir recours à la création monétaire, ce qui veux dire que les prix augmenteront substantiellement, alors que la crise rendra difficile toute progression salariale.
Enfin, tout le modèle des pensions par capitalisation est en danger. Les travailleurs qui ont cotisés toute leur vie dans un fonds de pension en pensant protéger leurs vieux jours avec les rendements boursiers en sont maintenant quitte à se résigner à une retraite plus qu'appauvrie, certains fonds de pension ayant perdu jusqu'à 30%, voire 40% de leur valeur de 2007. Il est à prévoir que les pressions patronales se feront de plus en plus forte sur les salariés pour que ceux-ci acceptent de transformer leurs régimes de retraite à prestations déterminées (on reçoit à la retraite des prestations déterminées) en régime à cotisation déterminée (on sait ce que l'on cotise, mais on ignore ce que l'on aura le jour de la retraite).
Une nouvelle époque commence
La crise qui commence marque la fin d'une époque, celle dans laquelle la croissance et les revenus peuvent être assurés par l'augmentation de l'endettement. La crise exprime aussi les difficultés croissantes du capitalisme à se valoriser, à produire de la nouvelle richesse et à continuer son accumulation. Bien qu'elle ait été transmise sur toute la planète par une finance internationale au poids démesuré, la crise dépasse les horizons de la simple finance et révèle au monde que le capitalisme est un système désuet, suranné, au bout du rouleau, et que toute tentative de réforme ne fera que repousser l'ultime limite à un moment où la situation sera encore plus grave et plus incontrôlable.
D'autres facteurs viennent s'ajouter à la crise actuelle pour aggraver encore la situation. Le tarissement du pétrole menace les rendements agricoles, largement dépendants des combustibles fossiles, alors que les bio-carburants pourraient monopoliser une part de plus en plus importante des terres cultivables, aggravant ainsi le problème alimentaire. Le réchauffement climatique menace la survie même de l'humanité, et des actions majeures devront être entreprises rapidement pour tenter d'en limiter les effets. Des alternatives énergétiques, particulièrement l'énergie solaire, sont disponibles dès maintenant, et pourraient l'être à une large échelle si ce n'était de leur rentabilité.
Mais le capitalisme n'est pas intéressé par les effets sur l'environnement de sa course effrénée à l'accumulation et aux profits, c'est un système dans lequel seuls les profits comptent, et ce peu importe les conséquences. Le capitalisme, parce qu'il n'a d'autre choix que de croître indéfiniment ou bien de disparaître, ne peut pas être soutenable écologiquement. De plus, les ressources étant limitées, la croissance à l'infinie, nécessité du capitalisme, est strictement impossible. Maintenir le capitalisme indéfiniment est donc mathématiquement inconcevable. Sa disparition est impérative.
Déjà des premières secousses et une nette flambée des luttes marquent un possible réveil du prolétariat. Face à la crise, le prolétariat n'aura pas de fuite possible: ce sera l'appauvrissement, la dégradation des conditions de vie et de travail, la perte du logement et de l'emploi, la diminution de la couverture sociale, l'augmentation de la faim[XXX]; ou bien la lutte pour construire un système différent, dans lequel chacun produira selon ses moyens, et chacun consommera selon ses besoins.
Un système dans lequel les travailleurs et les travailleuses auront un contrôle total sur ce qui doit être produit, et sur comment ça doit être produit. Un système qui répondra directement aux besoins des gens, sans avoir besoin de passer par un marché chaotique qui surproduit des biens de luxe et nous inonde de marchandises invendables, alors que des humains, des enfants, meurent de faim, de froid, de maladies bénignes ou évitables. Un système dans lequel les classes sociales et l'exploitation seront abolis, et dans lequel l'État sera détruit et remplacé par l'administration des choses.
Ce système, c'est le communisme.
Les bases matérielles du communisme existent déjà, le capitalisme ayant socialisé la production et jeté les bases d'une appropriation directement sociale des forces productives. Les procès de production sont le fait d'un travail collectif impliquant l'interconnexion et la collaboration d'un nombre de plus en plus grand de travailleurs, dont on peut de plus en plus difficilement discerner le caractère privé, et qui mettent en œuvre des moyens tels qu'il ne sont qu'à l'échelle de la société entière. La propriété privée des moyens de production entre donc de plus en plus violemment en contradiction avec le caractère social de celle-ci, alors que la prolétarisation a ramenée la structure de classe à l'essentiel: prolétariat contre bourgeoisie.
Seul l'avenir nous dira si le prolétariat sera à la hauteur de sa tâche historique, celle de détruire le joug de l'exploitation sans scrupules, pour donner enfin à l'humanité le plein contrôle sur les forces productives incroyables qu'elle a fait naître. Dans un monde où la majorité de notre temps et de notre énergie est consacrée aux activités productives, ce plein contrôle est aussi la condition préalable à toute forme de véritable liberté, et est devenu une question de vie ou de mort pour l'humanité toute entière.
I. En Angleterre, Madame Thatcher cassera les mineurs, aux USA Reagan cassera les contrôleur aériens, et au Québec, le PQ cassera les syndicats du secteur public.
II. La plus-value, c'est la portion du travail qui n'est pas payée au salarié et que le capitaliste s'approprie. Elle découle de la double nature du travail, qui en tant que valeur d'échange procure un salaire au travailleur, et en tant que valeur d'usage procure du travail au capitaliste. Dès lors que le travail est plus productif que ce qu'il en coûte, le capitaliste dégage une plus-value de l'usage de la force de travail qu'il a achetée.
III. Il existe des contre-tendances à la baisse du taux de profit. Leur analyse dépasse toutefois le cadre de ce texte.
IV. Le taux de profit est la plus-value divisée par le capital total engagé, alors que le taux de la plus-value est calculé par-rapport au capital variable, c'est-à-dire la portion du capital affectée aux salaires.
V. La composition organique du capital est le rapport entre le capital constant (les moyens de production et les matières premières) et le capital variable (les salaires). L'augmentation de la composition organique du capital veut donc dire qu'on investit de plus en plus d'argent dans les moyens de production par rapport aux salaires.
VI. Les machines ne produisent pas de valeur, mais elles transmettent la valeur qu'elles perdent en usure dans la marchandise produite.
VII. Paul Krugman, Introducing this blog [239], ,
VIII. Bureau of Labor Statistics, cité par Paul Krugman, The Great Wealth Transfer,
IX. Statistique Canada, n˚ 97-563-X au catalogue, mai 2008, cité dans Bernard Élie, L'origine de la crise,
X. John Williams, Annual consumer inflation - CPI vs SGS alternate, graphique in Pouvoir d'achat : Les gouvernements nous mentent pour nous voler [240],
XI. Paul Krugman, Introducing this blog [239], ibid
XII. Nicolas Duguay, Quand l'endettement pèse sur tout l'édifice [241],
XIII. Pierre Larrouturou,cité dans:L'hyperlibéralisme nous conduit dans le mur,
XIV. Mei Xinyu, It's US dollar, not yuan, that's the global problem, Shangai Daily du 21 avril 2008,
XV. Nortel, Enron, Worldcom, Norbourg, Parmalat, etc...
XVI. C'est-à-dire une pyramide économique, dans laquelle on paie les dividendes avec de nouveaux appels publics à l'épargne. Le cas de Bernard Madoff est le plus récent, mais durant les années 1990, quelques pays de l'ancien bloc soviétique s'étaient signalés par des schémas de Ponzi généralisés. L'Albanie s'est complètement écroulée sous la colère populaire en 1997 suite à l'effondrement d'une pyramide du genre, et la situation ne pu être « rétablie » que grâce à une intervention militaire italienne.
XVII. Voir Jacques Richard, Une comptabilité sur mesure pour les actionnaires, Manière de voir no102, page 30-33, décembre/janvier 2008
XVIII. Louis Gill, La réalité contemporaine à la lumière de l'analyse marxiste [242],
XIX. Ces chiffres sont hypothétiques
XX. Ce chiffre pourrait bien être sous la réalité, voir Diana Olick, Banks Sitting On An Inventory Time Bomb [243]
XXI. Denis Lessard et André Noël, La caisse de dépôt appauvrie de 38 milliards
XXII. Au Canada, le marché des PCAA a été gelé, la vente ou l'achat de ces titres étant interdite.
XXIII. L'autre facteur majeur de cette crise étant l'augmentation des surfaces cultivées pour le biocarburant, au détriment des terres utilisées pour l'alimentation.
XXIV. HSBC, Macquarie, Goldman Sachs, Bear Stearns, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Crédit Suisse, Deutsche Bank, PNB Paribas, Crédit agricole, Dexia, Royal Bank of Scotland, IKB, Northern Rock, Alliance & Leicester, Dresdner Bank, Hypo Real Estate, etc.
XXV. Lehman Brothers
XXVI. À ce jour (13 février 2009), des mises à pieds importantes ont eu lieu dans l'acier, l'aluminium, les services financiers, les mines, l'aéronautique, l'industrie chimique et l'électronique, et les pertes d'emplois se multiplient - autant en Chine (20 millions !) qu'en Europe, aux USA (500 000 par mois) et au Canada .
XXVII. Au Canada, la santé étant justement un de ces secteurs convoités.
XXVIII. John Williams, Annual consumer inflation - CPI vs SGS alternate [240], ibid note 7
XXIX. À elle seule, la dette publique totale des USA est estimée à 10.718 milliards, et elle croît sans cesse.
XXX. Au Canada, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées, même par des gens qui on un emploi. Aux USA, on estime que 40 millions d'américains sont en situation d'insécurité alimentaire, voir: Ministère de l'Agriculture, cité in Des millions d'Américains sont "en situation de très faible sécurité alimentaire", selon la terminologie officielle, https://dndf.org/?p=2643 [244]
1. Nous devons aussi apporter une autre précision. En marge de cette analyse économique, cet article laisse entrevoir une vision des syndicats qui n'est pas celle du CCI. En effet, il semble que « papamarx » distingue deux types de syndicats, les syndicats « bureaucratisés » (et donc traîtres à la classe ouvrière) et les syndicats combatifs (défendant vraiment la classe ouvrière). C'est ce que laissent penser les deux passages suivants : « on garantit une relative paix sociale en instaurant des lois sur les relations de travail qui vont officialiser la place des grands syndicats bureaucratiques dans l'économie » et plus loin « C'est la fin du modèle de développement économique qui a cours depuis 1945, [...] la forte combativité ouvrière exigeant que le patronat casse violemment les syndicats les plus combatifs. » Pour le CCI, si « les grands syndicats bureaucratiques » ont effectivement officiellement toute « leur place [...] dans l'économie », ce n'est pas un hasard, cela renvoie là aussi à une dimension bien plus profonde : à la nature du syndicalisme. Il ne peut plus y avoir, en période de décadence, de syndicats authentiquement ouvriers. Ceux qui se présentent comme plus « combatifs » ne sont là, eux aussi, que pour fourvoyer les ouvriers et les entraîner dans des impasses (actions violentes mais isolées par exemple). Lire notre article "Dans quel camp sont les syndicats ? [212]".
2. Source : https://papamarx.wordpress.com/2009/02/20/crise-economique-un-changement-depoque/ [245] Toutes les notes de bas de page ci-dessus sont celle de « papamarx ».
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [127]
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Une nouvelle réunion publique en République dominicaine : crise et décadence du capitalisme
- 2944 lectures
Le 25 juin dernier s’est tenue une réunion publique à Santiago, deuxième ville de la République dominicaine, organisée par le Noyau de discussion internationaliste de République dominicaine (NDIRD). C'est la seconde fois que le noyau organise une réunion publique et qu’il invite le CCI à faire la présentation du thème, qui était cette fois « Crise et décadence du capitalisme » (1).
Les camarades du NDIRD ont présenté la réunion, en soulignant l'importance de ce type d'événements pour faire connaître les positions de la Gauche communiste à travers un débat ouvert et fraternel. Précisément pour favoriser le débat, la présentation du sujet n’a duré que vingt minutes.
La réunion a rassemblé plus de 25 personnes. Le nombre de jeunes participants a été remarquable (presque la moitié des assistants), caractéristique que nous observons aussi dans les réunions publiques tenues dans d'autres pays d'Amérique latine où nous avons pu intervenir. Les participants ont manifesté un intérêt réel à l’écoute de la présentation ; et le débat qu’elle a suscité a exprimé une préoccupation authentique en ce qui concerne les inquiétudes provoquées par la crise du capitalisme, non seulement pour le prolétariat mais bien pour l'ensemble de l'humanité.
Voici un bref rapport de cette réunion, et des questions qui furent posées dans le débat.
Comment peut-on expliquer la création de marchés artificiels par l'endettement ?
Cette intéressante question d'un jeune participant répondait à une affirmation de la présentation, où nous disions que le capitalisme requiert pour son développement des marchés solvables ; c'est-à-dire des secteurs ayant une réelle capacité de consommer les marchandises produites. Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, période ouverte avec la Première Guerre mondiale, s’est développé un épuisement progressif de ces marchés solvables. C’est ainsi que « Pour pallier à cet épuisement des marchés solvables extérieurs à la sphère capitaliste, la bourgeoisie a utilisé le crédit comme palliatif ; c’est ce même palliatif qui est utilisé massivement à partir des années 1960 ; en ce sens, le capitalisme décadent pour survivre avait créé un marché artificiel basé sur le crédit » (texte de présentation).
C’est précisément à partir des années 1970 que les pays de la périphérie, et parmi eux ceux d'Amérique latine, entament un recours massif à l’endettement, en grande partie pour acquérir les biens et les services produits dans les pays centraux, eux-mêmes bailleurs de ces crédits. C’est ainsi que pendant les dernières quatre décennies du siècle dernier, les pays de la périphérie ont accumulé des dettes pratiquement impossible à rembourser, qui ne cessent de croître et dont le paiement dilapide un important pourcentage du PIB de ces États.
Nous avons donné comme exemple récent de ces marchés artificiels la croissance du secteur immobilier aux États-Unis, qui s'est fondé sur la vente à crédit des immeubles. La « bulle immobilière » explose « quand les crédits n'ont pas pu être remboursés parce que la crise s’était développée dans le monde, et que les taux d'intérêt avaient augmenté, ce système de crédit a explosé. Mais ce qui explose, sont les contradictions internes de l'économie capitaliste ; celles de la saturation des marchés solvables. C'est aussi la crise du crédit comme palliatif » (idem).
S’il y a eu une reprise après la crise de 1929, pourquoi n'y a-t-il pas à présent une réactivation du type de celles des années 1950 et 1960 ?
Nous avons répondu que la crise de du 1929 a été la première grande crise du capitalisme décadent, dont les effets ont été ressentis pendant la décennie des années 1930 et qui eut comme corollaire la Seconde Guerre mondiale. Nous avons dit qu'après cette crise, il y eut l’importante reprise économique d’après-guerre, qui s’appuyait sur l'application de politiques keynésiennes, sur l'augmentation de la productivité du travail et sur une meilleure exploitation tant des économies pré-capitalistes des pays de la périphérie que des vestiges pré-capitalistes des pays les plus industrialisés. Mais ce sont précisément ces mécanismes qui montrent leur épuisement à la fin des années 1960, quand le capitalisme entre de nouveau en crise ; pour faire face à cette nouvelle crise, la bourgeoisie a recouru à l'utilisation massive de ce palliatif qu’est le crédit, ce qui permit que le capitalisme repousse de plus de quarante années la chute brutale de l'économie, telle que nous le voyons actuellement.
Nous disons que la crise actuelle est plus brutale que celle de 1929. Comme nous l'avions dit dans la présentation, la crise actuelle est une crise du crédit. La « sortie » que propose la bourgeoisie mondiale est celle d’un plus grand endettement, qui prépare inévitablement des crises de plus grande envergure dans le futur.
Comment peut combattre le prolétariat si le chômage tend à le faire disparaître ?
Cette préoccupation d’un des camarades présents donnait comme exemple la situation de la « zone franche » de Santiago, une des plus importantes concentrations d'usines et d'entreprises de sous-traitance du pays, où s’est développé avec la crise un fort niveau de chômage. Nous avons répondu qu'en effet, un des fléaux de la crise du capitalisme est la croissance accélérée du chômage ; mais ceci ne signifie pas la disparition du prolétariat, parce qu'une bourgeoisie sans prolétaires à exploiter est inconcevable. D'une part, le travailleur ne perd pas sa condition de prolétaire quand il se retrouve au chômage ; on commence déjà à voir des mobilisations de chômeurs dans quelques pays. De l’autre, non seulement les travailleurs du secteur manufacturier ou d’usine font partie du prolétariat, mais on peut aussi compter dans ses rangs bon nombre des employés du secteur public ainsi que les enseignants, les travailleurs de la santé, etc., secteurs qui ont un poids quantitatif important dans les pays d'Amérique latine.
Il est indubitable que la crise frappe durement les travailleurs, car ce sont eux qui finissent par payer les pots cassés ; c’est toutefois aussi cette situation qui les propulse inévitablement à la lutte, tant en République dominicaine qu’au niveau mondial.
Pourquoi, au niveau des conséquences de la crise, le CCI parle-t-il du développement d'impérialismes régionaux et locaux ?
Dans notre présentation, nous avons dit que cette crise, une étape de plus dans l'effondrement du capitalisme, avait des conséquences non seulement au niveau économique, mais aussi sur la lutte du prolétariat et au niveau des conflits entre nations. Dans l'histoire du capitalisme, la lutte pour les marchés a été une constante entre nations ; et la crise actuelle ne sera pas une 'exception. Par ailleurs, cette crise intervient dans un contexte où les blocs impérialistes qui ont existé jusqu'à la fin des années 1980 ont disparu, et que se confirme l’effondrement du bloc russe ainsi que l'affaiblissement progressif de l'impérialisme américain. Cette situation a provoqué une anarchie dans les relations internationales, qui s’exprime dans la tendance que tente de renforcer chaque bourgeoisie nationale dans la géopolitique régionale et mondiale. Ces comportements, pour ne mentionner que deux parmi les plus récents, se sont exprimés de façon pathétique en Iran, qui tente de s’ériger en puissance au Moyen-Orient, et au Venezuela, qui se renforce au niveau géopolitique en Amérique latine en utilisant comme armes de pénétration le pétrole et l'idéologie du "socialisme du xxie siècle".
La confrontation entre nations, qui s’est déchaînée après la chute du bloc russe, va inévitablement être exacerbée avec l'avancée de la crise. Le prolétariat doit rejeter tout appui aux fractions de la bourgeoisie nationale ou régionale dans ces conflits qui ne profitent qu’aux classes dominantes.
Devant cette barbarie, quelles sont les perspectives pour l'humanité ?
Cette question exprime de façon limpide ce que nous disions dans l'introduction de ce compte-rendu : « une préoccupation authentique en ce qui concerne les inquiétudes provoquées par la crise du capitalisme non seulement au prolétariat mais bien à l'ensemble de l'humanité ».
Le CCI a affirmé qu’aujourd’hui plus que jamais le futur de l'humanité est menacé par les contradictions internes du capitalisme, ce qui nécessite la réponse de la seule classe révolutionnaire : le prolétariat. Bien que la crise génère toujours plus de misère et de paupérisation, elle pousse aussi le prolétariat à se battre. Il est vrai que les conditions de la lutte sont aujourd'hui difficiles, quand on ne sait pas trop comment lutter ou que faire quand les usines ferment leurs portes. Il est vrai aussi que le prolétariat doute de ses propres capacités. Mais le développement de la crise, notamment à travers des attaques contre l'ensemble des conditions de vie des prolétaires et impliquant ouvertement l'Etat, va de plus en plus attiser la lutte de classe au sein de l'ensemble du prolétariat mondial. Dans cette dynamique, le prolétariat va développer sa réflexion et, peu à peu, reprendre confiance en ses forces.
Le CCI, en tant qu’organisation révolutionnaire, travaille, dans la mesure de ses forces, à accélérer cette dynamique. L’enjeu est tout simplement l’alternative ; société communiste ou barbarie qui anéantirait l’humanité. Face à ces enjeux, des groupes comme le NDIRD qui se développent avec une vision internationaliste, jouent un rôle de premier plan pour le prolétariat de la République dominicaine et le prolétariat mondial. De la même façon, tous ceux, comme les camarades qui assistent à cette réunion, qui se posent des questions sur un terrain internationaliste, doivent débattre entre eux.
Le souci de débattre et d’écouter
Malgré le peu de temps qu’a duré la réunion (à peu près une heure et demie) car il fallait libérer le local, un débat a pu se développer, qui a pu se poursuivre quelques instants tandis que nous partagions un moment de convivialité autour d’un verre.
Plusieurs des participants ont montré leur enthousiasme et leur intérêt à participer à ce genre de réunions. Comme l’a dit un des camarades du NDIRD, les participants ont montré un réel intérêt à débattre et à écouter des positions internationalistes.
Nous saluons chaleureusement cette réunion, ainsi que la capacité politique et organisationnelle dont a fait preuve le NDIRD dans sa préparation. Nous les invitons à poursuivre cet effort, pour lequel le CCI apportera tout son soutien.
Cette réunion a été un moment très réconfortant, puisqu'elle est une manifestation de la capacité de l'internationalisme d'unir les forces du prolétariat dans n’importe quel pays, aussi "petit" puisse-t-il être.
CCI (14 juillet 2009)
1 Voir sur notre site : « Réunion publique en République dominicaine : à la rencontre des positions de la Gauche Communiste [246] ».
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Villes-fantômes aux États-Unis : des milliers d'ouvriers expulsés
- 3256 lectures
Lorsqu’on consulte un dépliant touristique des Etats-Unis, il n’est pas rare de se voir proposer un circuit de découverte des fameuses villes-fantômes du Désert de la Mort ou d’autres régions d’où la nature a chassé les hommes et de celles que les soubresauts des crises capitalistes, en particulier des années de l’entre-deux guerres, ont réduites à néant. Il existe même des fanatiques de ces visites morbides et déprimantes. Ces derniers pourront se réjouir.
Car la crise immobilière qui frappe la population américaine a fait apparaître des dizaines de nouvelles villes ou de quartiers-fantômes. En 2007, 1,3 millions de foyers ont fait l’objet d’une procédure de saisies. Faute de pouvoir payer leur crédit, des centaines de milliers de familles se sont donc retrouvées brutalement jetées à la rue par la police. Et ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2008, 3,1 millions de procédures de saisies ont été engagées (soit une famille sur 54 aux Etats-Unis !) 1.
Pour la seule ville de Cleveland, « plus de 24 000 personnes ont perdu leurs maisons. Plus de 10 000 maisons sont abandonnées » en 2007, selon un journal de la ville, sinistre dont l’ampleur est considérée comme comparable aux dégâts de l’ouragan Katrina de 2005 à La Nouvelle Orléans. Ce sont de véritables cités-fantômes qui naissent sur le territoire des grandes villes, avec des hordes de familles sans abri ou survivant dans leur voiture. Dans la ville-dortoir de Stockton en Californie, une maison sur trente est à l’abandon. Sur 300 000 habitants, 12 000 familles ont été expulsées entre le début et la mi-2008. Dans la capitale mondiale de l’automobile, Détroit, il y a en ce moment plus d’une centaine d’expulsions par jour. Depuis plus d’un an, 70 000 maisons ont été vidées de leurs habitants, dont plus de 55% les avaient achetés avec des crédits à taux variables au cours de la seule année 2006.. C’est dire la rapidité et la violence de la crise immobilière qui s’est abattue, et la rapacité des organismes de crédit.
Des centaines de milliers d’ouvriers, souvent précaires, qui ont fait confiance aux promesses des banques et au miroir aux alouettes du crédit « pas cher », sont devenus tout à coup « insolvables », suite à l’augmentation drastique des prêts hypothécaires calculés sur des taux variables 2. Ils ont donc été impitoyablement jetés sur le trottoir comme des malpropres.
Aujourd’hui, crise économique oblige, ces mêmes banques bradent ces maisons à des prix trois ou quatre fois moins cher que leur prix initial ! Signe de ces délires typiques du système capitaliste, des maisons aujourd’hui pillées et mises à sac sont revendues pour une bouchée de pain. Et ce n’est pas une image ; car à Détroit toujours, certaines sont vendues… un dollar pièce !
Ce dollar symbolique nous montre une fois de plus que, dans le capitalisme, il n’y a pas de petits profits, pas plus qu’il n’y a d’humanité.
Wilma
1 Source : www.e24.fr/economie/monde/article44695.ece [247]
2 2,5 millions de ménages américains se sont vus accorder ces dernières années (avant 2007) des crédits dits « à risque » (pour la banque évidemment) car attribués à des ménages peu « solvables ». En échange de ce risque, l’emprunteur accepte un taux de remboursement élevé et à taux variable. De plus, le crédit est gagé sur le bien acheté. Tant que les prix de l’immobilier sont en hausse, donc que le bien augmente, cela marche et, en cas de défection de l’emprunteur, la banque se paie sur la vente de la maison, ayant théoriquement acquis une plus grande valeur. Cependant, les taux directeurs de la banque centrale ont augmenté de 1 à 5% entre 2004 et 2007, augmentant les remboursements de foyers déjà justes, puis les prix de l’immobilier se sont mis à chuter, phénomène alimenté par la mise en vente des maisons saisies.
Récent et en cours:
- Crise économique [130]
Vu à la télévision : Charles Darwin et l'arbre de la vie
- 3180 lectures
La contribution
de David Attenborough pour le bicentenaire de Darwin à la BBC
(Charles Darwin et l’arbre de la vie, 1/2/09) était une défense
magistrale de la théorie de l’évolution qu’il a assurée avec
sa capacité habituelle de faire passer des idées scientifiques
complexes en utilisant un langage direct et d’abondantes
illustrations magnifiquement filmées, avec son enthousiasme
contagieux habituel et son respect pour le monde de la nature.
En
replaçant les idées de Darwin dans leur contexte historique,
Attenborough a fait ressortir les implications subversives de la
théorie de la sélection naturelle, étant donné que le monde de la
science auquel Darwin était obligé de se confronter, était encore,
dans les années 1840-1850, profondément influencé par une vision
statique de la nature, selon laquelle les espèces avaient été
créées une fois pour toute par décret divin, et dans laquelle
l’étendue de l’histoire passée de la Terre commençait
seulement à apparaître avec le développement des études de
géologie. Attenborough a montré très clairement comment l’élan
donné par ce pas en avant dans la connaissance par l’homme de sa
place dans la nature a inspiré Darwin, malgré sa réticence à
offenser sa dévote épouse et à causer un scandale dans la bonne
société ; la formulation simultanée d’une théorie de la
sélection naturelle par Alfred Wallace, mis à part le fait qu’elle
ait grandement encouragé Darwin à publier ses résultats, a été
le signe de l’irrésistible puissance de l’évolution des idées
quand les conditions sous-jacentes sont mûres.
En passant en
revue les objections contemporaines à la théorie de Darwin,
Attenborough ne les a pas traitées avec mépris ; il les a
simplement situées dans leurs limites historiques et démontré avec
une grande conviction comment les nouvelles recherches en
paléontologie et en zoologie démolissaient leurs fondements – en
prenant, à cette occasion, un plaisir particulier à raconter
l’histoire de l’Archéopteryx et du Platypus à bec de canard,
les formes intermédiaires entre les reptiles et les oiseaux, entre
les reptiles et les mammifères, qui donne une solide réponse à la
question « si les espèces évoluent, où sont les chaînons
manquants ? ».
Darwin était bien sûr le produit d’une
bourgeoisie qui était encore vraiment dans sa phase ascendante. Un
signe clair que cette phase est bien loin derrière nous, c’est le
fait qu’aujourd’hui, au 21e siècle, des fractions de la classe
dominante ayant une grande influence - que ce soit la droite
chrétienne aux Etats-Unis ou les différents partis islamiques sur
la planète - ont régressé jusqu’à en venir à défendre à la
lettre la version de la bible et du coran, et continuent à
vilipender Darwin, bien qu’une masse de preuves en faveur de ses
idées fondamentales se soit accumulée depuis un siècle et demi.
Mais, comme Pannekoek et d’autres l’ont souligné, la tendance de
la bourgeoisie à se réfugier dans la religion et à abandonner les
visions audacieuses et iconoclastes de sa jeunesse a été
perceptible dès que le prolétariat s’est affirmé ouvertement
comme force dangereusement antagonique au sein de la société
capitaliste (surtout après les émeutes de 1848). Du même coup, le
mouvement ouvrier s’est immédiatement saisi de l’implication
révolutionnaire d’une théorie qui montrait que la conscience
pouvait surgir de couches inconscientes du vivant en réponse à des
circonstances matérielles, et non pas à travers la médiation d’un
dirigeant supérieur ; l’implication évidente étant que les
masses largement inconscientes pouvaient aussi devenir conscientes au
travers de la lutte pour la satisfaction de leurs besoins matériels.
Il n’est pas vrai, bien sûr, que la bourgeoisie toute entière
ait sombré dans le créationnisme ; il y aussi un consensus
bourgeois qui voit la science et la technologie comme facteurs de
progrès et qui, en faisant abstraction des rapports sociaux qui leur
permettent de se développer, est incapable d’expliquer pourquoi
une bonne partie de la recherche scientifique et des avancées
technologiques a été utilisée pour créer un chaos complet dans la
société et dans la nature. C’est précisément cette réalité
qui conduit un bon nombre de ceux qui ne profitent pas du système
social actuel à chercher des réponses dans la mythologie du passé.
Le même phénomène de répulsion s’applique aussi à la vision de
la place de l’homme dans l’univers élaborée par tant de
bourgeois « défenseurs » de la science, une façon de
voir qui est constamment attristante parce qu’elle donne libre
cours à une conception profondément aliénée de la séparation
essentielle de l’homme d’avec une nature hostile. Mais
Attenborough ne peut être mis dans cette catégorie. S’émerveillant
devant des oiseaux en vol ou riant des singes en train de jouer,
Attenborough a conclu sa présentation en nous rappelant une autre
implication de la théorie de Darwin – son défi à la vision
biblique de l’homme comme un être qui « domine »
la nature et sa confirmation, au contraire, du profond rapport entre
nous et le reste du vivant, de notre interdépendance totale avec
celui-ci. A ce point, Attenborough avait des accents qui ne
ressemblaient pas qu’un peu à ceux d’Engels dans ce
passage de « Le rôle du travail dans la transformation du
singe en homme » qui contient une mise en garde contre les
prétentions démesurées mais aussi une perspective pour le futur :
" Cependant, ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature.
Elle se venge sur nous de chacune d'elles. Chaque victoire a certes
en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais en
second et en troisième lieu, elle a des effets tout différents,
imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces premières
conséquences. Les poulations qui, en Mésopotamie, en Grèce, en
Asie mineure et autres lieux essartaient les forêts pour gagner de
la terre arable, étaient loin de s'attendre à jeter par là les
bases de l'actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les
forêts les centres d'accumulation et de conservation de l'humidité.
Les Italiens qui, sur le versant sud des Alpes, saccageaient les
forêts de sapins, conservées avec tant de soins sur le versant
nord, n'avaient pas idée qu'ils sapaient par là l'élevage de haute
montagne sur leur territoire; ils soupçonnaient moins encore que, ce
faisant, ils privaient d'eau leurs sources de montagne pendant la
plus grande partie de l'année et que celles ci, à la saison des
pluies, allaient déverser sur la plaine des torrents d'autant plus
furieux. Ceux qui répandirent la pomme de terre en Europe ne
savaient pas qu'avec les tubercules farineux ils répandaient aussi
la scrofule. Et ainsi les faits nous rappellent à chaque pas que
nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne
sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la
nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang,
notre cerveau, que nous sommes dans son sein, et que toute notre
domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur
l'ensemble des autres créatures, de connaître ses lois et de
pouvoir nous en servir judicieusement."
Personnages:
- Darwin [248]
Questions théoriques:
- Religion [249]
ll y a 90 ans, des grèves générales en Amérique
- 2897 lectures
Les combats de classe du prolétariat en Amérique du Nord au cours de la grande vague révolutionnaire de 1917-1923 sont en général ignorés, mal connus ou déformés. Ils démontrent pourtant le caractère mondial essentiel de cette vague révolutionnaire. Ils témoignent également des potentialités d’une classe ouvrière dans cette région du monde dont on nous renvoie encore aujourd’hui l’image faussée d’une classe ayant toujours été intégrée et minée par le réformisme. C’est pourquoi nous publions la traduction d’une série d’articles parus dans Internationalism, organe de notre section au Etats-Unis sur les luttes les plus marquantes de cette période.
La grève générale de Seattle en 1919
Avec en toile de fond l’effervescence prolétarienne sans précédent de 1919, la classe ouvrière américaine n’a pas hésité à développer la lutte de classe au niveau de la production à travers tout le pays, industrie après industrie. Il y eut 3 630 grèves impliquant 4 160 000 ouvriers tout au long de l’année 1919 :
-
une grève générale à Seattle en février ;
-
une grève nationale dure dans la métallurgie avec 375 000 ouvriers luttant contre les 68 heures de travail hebdomadaires et les conditions de travail sans sécurité, en septembre ;
-
une série de « grèves sauvages » culminant dans une grève nationale de 400 000 mineurs ;
-
une grève générale dans l’industrie de l’habillement à New York qui s’acheva victorieusement par la limitation de la semaine de travail à 44 heures ;
-
des grèves dans les tramways à Chicago, Denver, Knoxville, Nashville, Kansas City ;
-
une grève dans le textile de 32 000 ouvriers à Lawrence, dans le Massachusetts.
Dans cette vague de grèves, la participation militante d’ouvriers immigrants, en particulier originaires de l’Europe de l’Est, était spécialement significative. Afin de diviser et d’affaiblir le mouvement, la Fédération Américaine du Travail (AFL) réactionnaire a longtemps dénigré les ouvriers immigrés, en soutenant la législation raciste pour bloquer le flux des migrants venant de l’Europe du Sud et de l’Est et en insistant sur le fait que les ouvriers immigrés étaient inorganisables et indisciplinés. Cependant, sous le souffle des événements secouant le continent européen, les ouvriers immigrés se mirent eux-mêmes à l’avant-garde des luttes à la fois dans les usines et dans le Parti Socialiste, démontrant la véritable nature internationaliste du prolétariat.
La grève générale surgit malgré les syndicats, pas grâce à eux
L’année 1919 commence avec la grève générale de Seattle. Les ouvriers y étaient particulièrement radicalisés, spécialement à travers leur sympathie envers la révolution en Russie et c’est cette radicalisation qui a stimulé la dynamique de la grève. Alors que ce qui a été retenu de Seattle a été le cadre formel d’une grève générale organisée par les syndicats, ce qu’elle révèle en réalité, ce sont moins les caractéristiques d’une puissante grève orchestrée d’en haut par la bureaucratie syndicale que celles d’une grève de masse, dans laquelle les ouvriers de tous les secteurs et de toutes les industries rejoignirent la lutte autour de leurs propres revendications et dans laquelle le contrôle de la lutte était entre les mains d’un comité de grève contrôlé par les masses ouvrières.
La lutte a démarré à l’initiative des métallurgistes de l’industrie navale, qui constituaient une force dominante au sein du prolétariat de Seattle. Pendant la guerre, les leaders syndicaux avaient fiévreusement travaillé à dissuader les ouvriers de la construction navale mécontents de se mettre en grève en utilisant à la fois des appels patriotiques exacerbés et des avertissements menaçants disant que de telles actions étaient une violation de leur contrat et donc illégales. Mais dès que l’armistice fut signé en novembre 1918, les ouvriers exigèrent des augmentations de salaires. Les patrons voulaient ne concéder des augmentations qu’aux ouvriers les plus productifs mais pas pour les autres. Cependant, à cause de la guerre, le secteur était placé sous l’autorité directe du gouvernement et la Corporation de la Flotte d’Urgence gouvernementale ordonna aux compagnies de ne rien accorder à aucun ouvrier et menaça de supprimer la part de bénéfices des patrons si des augmentations étaient accordées. Les ouvriers se trouvèrent rapidement confrontés à une caractéristique centrale de la lutte de classe en période de décadence capitaliste : la lutte économique se transforma très rapidement en rapport de forces directement avec l’Etat capitaliste.
Cela ne fut pas limité aux seuls ouvriers de la construction navale. Les ouvriers d’autres industries perçurent l’intervention du gouvernement comme une attaque dirigée contre toute la classe ouvrière. Le 21 janvier, les 35 000 ouvriers de la construction navale arrêtèrent le travail. Répondant à un appel en soutien de la part des syndicats de la métallurgie, le Conseil Syndical de Seattle adopta une résolution le 22 appelant à une grève générale en solidarité avec les grévistes, qui fut immédiatement relayée par les ouvriers de la base de 24 syndicats, comprenant les peintres, les barbiers, les maréchaux-ferrants, les chaudronniers, les ouvriers de la construction, les charpentiers, les fabricants de cigares, les cuisiniers, les ouvriers du vêtement, les dockers, les distributeurs de lait. En deux semaines, 110 syndicats locaux avaient voté une motion pour rejoindre la grève, y compris même parmi les secteurs réputés les plus conservateurs du syndicat AFL. Mais, alors que ces différentes catégories exprimaient leur solidarité, en grève par « sympathie » envers les ouvriers de la construction navale, la lutte abandonnait le terrain corporatiste car les ouvriers, usine après usine, tout en discutant ouvertement le fait qu’ils avaient aussi des revendications à apporter contre leurs propres patrons, tendaient à transformer la grève en lutte généralisée contre le capital. Ceci illustre encore une autre caractéristique centrale de la lutte de classe dans le capitalisme décadent : la solidarité active et la généralisation des luttes montrait des ouvriers rejoignant la lutte d’ensemble sur la base de leurs propres revendications, et pas seulement par « sympathie ».
Cette poussée vers la grève de masse se développa alors que les 25 leaders syndicaux principaux de Seattle siégeaient lors d’une conférence à Chicago. En bons syndicalistes officiels, ils étaient inquiets de la tournure que prenaient les évènements. Ces prétendus syndicalistes « progressistes » rejoignirent rapidement les chefs de l’AFL pour travailler à bloquer et mettre fin à la grève. Aussi, contre la tendance des gauchistes et des historiens à mettre en avant le rôle des syndicats, la grève de Seattle surgit bel et bien malgré les syndicats, et pas grâce à eux, ce qui met en avant une autre caractéristique importante de la lutte de classe dans le capitalisme décadent : la nature contre-révolutionnaire des syndicats et leur utilisation par la bourgeoisie pour contrôler et saboter les luttes ouvrières.
Le comité de grève générale et la situation de double pouvoir
La grève était prévue pour le mois de février . Un comité de grève générale fut mis sur pied afin de coordonner la lutte. Ce comité était composé de 300 ouvriers – la plupart des ouvriers de la base, avec peu d’expérience de la direction d’une grève – 3 délégués de chaque syndicat se joignant à la grève. Le comité général et un comité exécutif plus restreint composé de 15 membres, dénommé « le comité des quinze », se réunirent chaque jour dès le 2 février, au début pour planifier la lutte, ensuite pour la diriger. Chaque après-midi, une session ouverte du comité était tenue de façon à ce que chaque ouvrier puisse y assister, suivre les débats et participer à la discussion. Le comité prit rapidement les caractéristiques d’une concurrence ouvrière avec le gouvernement de la ville, un exemple embryonnaire de double pouvoir, étant donné que les ouvriers organisèrent la sauvegarde du bien-être générale de la communauté pendant la grève. Des décisions prudentes étaient prises par les sous-comités du comité des 15 pour faire en sorte que les services vitaux ne soient pas touchés par la grève. Par exemple, il fut décidé que les éboueurs ramasseraient les poubelles qui posaient un risque pour la salubrité publique. Les blanchisseurs furent autorisés à garder une boutique ouverte pour assurer la maintenance hospitalière. On demanda aux pompiers de rester à leur poste. Une force ouvrière de 300 vétérans de guerre fut recrutée pour assurer la paix et la sécurité. Ces gardes ouvriers ne portaient pas d’armes mais seulement un brassard blanc en signe de reconnaissance. Ils se servaient de leur pouvoir de persuasion et de l’autorité du comité de grève générale pour régler les situations difficiles et préserver l’ordre.
Reflétant l’existence de cette authentique dualité du pouvoir, les employeurs, les officiels du gouvernement, y compris le maire, ainsi que des groupes d’ouvriers, venaient rencontrer le comité de grève pour demander des exemptions de grève. Une requête des représentants du comté pour que l’équipe des portiers des bureaux gouvernementaux reste à leurs postes fut rejetée. Une demande du syndicat des camionneurs pour acheminer du carburant pour un hôpital fut acceptée. Une proposition des employés des pharmacies pour que les ordonnances puissent être délivrées pendant la grève le fut également. Chaque pharmacie eut l’ordre d’afficher : « Aucun produit vendu durant la grève. Seules les ordonnances seront acceptées. Le comité de grève générale.» Les livreurs de lait pouvaient acheminer le lait pour les enfants de la ville ; chaque camion était porteur d’une affiche précisant : « Exempté de grève par ordre du comité de grève générale ». Les cuisiniers des restaurants, les serveurs et d’autres employés de l’industrie alimentaire mirent sur pied 21 salles de restauration afin de nourrir 30 000 personnes par jour pendant toute la durée de la grève. On demanda aux employés de la téléphonie de se mettre à la disposition des forces de sécurité du comité de grève et de poursuivre le service des communications pour la grève. Le service de l’électricité fut maintenu, sauf dans les entreprises commerciales. Lorsque la grève commença à 10 heures le 6 février, la ville s’arrêta ; au total, 100 000 ouvriers se mirent en grève dont 40 000 non-syndiqués. Les tramways cessèrent de rouler, les magasins fermèrent, rien ne bougeait sans l’autorisation de ce gouvernement ouvrier embryonnaire. L’ordre était maintenu. Les ouvriers du Seattle Union Record, le journal tenu par la Bourse du Travail rejoignirent la grève, et laissèrent malheureusement la lutte sans bulletin quotidien pour garder les grévistes informés et pour contrer les rumeurs et les faux rapports répandus par la bourgeoisie. Cherchant à éviter de fournir un prétexte au gouvernement d’envoyer des troupes ou la police armée contre eux, le comité appela les gens à n’organiser aucune manifestation de masse. Ainsi, les troupes disséminées dans Seattle à la demande du maire dès le deuxième jour de la grève, trouvèrent une ville calme où le taux de criminalité avait baissé de 66%.
Les syndicats brisent la grève
Les forces de la réaction s’organisèrent rapidement pour contrer les ouvriers. Le maire loua les services d’une police supplémentaire, des truands assermentés pour l’occasion, requis davantage de troupes fédérales, et posa aux grévistes l’ultimatum de reprendre le travail. Cependant, ce n’est pas la menace d’usage des forces de répression qui fut décisive pour faire cesser la grève, car le comité de grève ignora l’ultimatum du maire. C’est en réalité l’intervention des syndicats contre les ouvriers qui fut l’élément-clé de la contre-offensive bourgeoise. Dès le début de la grève, les syndicats de l’AFL bombardèrent les grévistes de télégrammes insistant sur l’illégalité du mouvement, les menaçant de suspensions et les pressant de mettre immédiatement fin à la grève. Dès qu’ils purent atteindre Seattle, les leaders syndicaux, tantôt menaçants, tantôt flagorneurs, les mettaient en garde contre des « conséquences terribles ». A un moment donné, le comité sembla fléchir sous la pression, et vota par 12 voix contre 2 et une abstention la fin de la grève. Ses membres apportèrent ensuite cette résolution devant le comité plénier, où la plupart des délégués étaient hésitants. Lors de la pause-déjeuner, les débats furent arrêtés. Les délégués consultèrent les ouvriers qu’ils représentaient durant ce break et, forts de la combativité militante de la base, revinrent vers le comité de grève général pour rejeter la résolution de fin de la grève. Ceci illustre une autre caractéristique de la lutte ouvrière dans le capitalisme décadent : la nécessité pour les ouvriers de contrôler la lutte eux-mêmes à travers des délégués révocables, pour s’assurer d’une véritable représentation dans les organes délibératifs qu’ils ont mis en place pour coordonner la lutte.
Ayant échoué dans leur tentative pour faire cesser la lutte, les centrales syndicales, en quête d’un maillon faible, concentrèrent leur attention sur les syndicats de métier,. Les premiers craquements vinrent des conducteurs de tramway, qui furent remis au travail par leur bureau exécutif sous pression des leaders nationaux, puis ce fut le tour des camionneurs. Sentant que le vent avait tourné, le comité de grève optait à présent pour un repli en bon ordre, et la grève s’acheva le 11 février. Seuls, les travailleurs de la métallurgie des chantiers navals continuèrent la grève.
Trois faiblesses politiques en particulier avaient pesé lourdement sur la grève. La première fut l’incapacité à comprendre la question syndicale, à reconnaître clairement que les syndicats qui les pressaient de saborder la lutte faisaient partie de l’appareil d’Etat capitaliste, c’est-à-dire une arme dirigée contre eux. Les syndicats, pour leur part, étaient parfaitement clairs sur leur rôle contre-révolutionnaire. La Fédération Américaine du Travail se réclamait ouvertement de son sale travail dans l’intérêt de l’ordre capitaliste : « Ce fut l’attitude avertie, avisée et décidée des leaders syndicaux des American International Trade Unions et pas des troupes américaines ou bien les décrets du maire, qui mirent fin à cette brève perturbation du Nord-Ouest. » (American Fedemtiouist, mars 1919)
La deuxième fut l’impossibilité à saisir le danger de rester isolés. Du fait qu’ils étaient entrés en lutte sans comprendre qu’ils se trouvaient face à une attaque généralisée de la classe capitaliste, les ouvriers restèrent confinés à Seattle. On demanda aux grévistes de rester chez eux et pas dans les rues, alors que des délégations ouvrières auraient dû sillonner le nord-ouest et le reste du pays en appelant d’autres ouvriers à rejoindre le combat. En restant isolés, les prolétaires de Seattle ont laissé la porte ouverte à l’offensive des syndicats. Ces derniers purent concentrer leur contre-offensive sur une seule ville, plutôt que d’avoir à faire face à une traînée de poudre à travers tout le pays. Les milliers d’autres grèves qui surgirent cette année-là démontrèrent que la base pour un élargissement de la grève de Seattle était bel et bien présente.
La troisième faiblesse fut l’absence d’une avant-garde révolutionnaire organisée. L’identification émotionnelle avec la Révolution russe n’était pas suffisante pour relever le défi. La lutte avait besoin d’une minorité révolutionnaire capable de montrer les réelles leçons des Soviets et de la grève de masse de Russie. La gauche socialiste était alors empêtrée dans une bataille pour gagner le contrôle du parti socialiste, et repoussa la formation d’un parti communiste à la fin de l’été 1919. Sur les évènements de Seattle, la gauche était en retard. La lutte s’était déroulée sans l’intervention d’une minorité révolutionnaire.
Les leçons de la grève générale de Seattle
La grève de Seattle ne dura que 6 jours, mais elle regorge de leçons. Pour récapituler celles qui sont centrales :
-
dans la période de décadence capitaliste, les luttes économiques sont rapidement transformées en confrontations politiques avec l’Etat ;
-
les luttes ouvrières peuvent et doivent se généraliser, tirant les autres ouvriers autour de leurs revendications propres ;
-
les luttes qui restent isolées géographiquement, comme les luttes qui sont isolées dans une seule industrie sont condamnées ; contrairement au dénigrement idéologique du prolétariat effectué par la propagande bourgeoise, les ouvriers de Seattle ont démontré clairement que le prolétariat a la capacité de s’auto-organiser et de contrôler la société, et peut le faire de façon vraiment rapide et efficace ;
-
les syndicats ne sont plus des organes de l’auto-défense ouvrière, mais des agents de la bourgeoisie au sein du prolétariat, fonctionnant pour contrôler, dévoyer et désarmer les luttes ouvrières ;
-
l’existence de l’organisation révolutionnaire, non pour contrôler la lutte, mais pour y intervenir comme minorité active dans la classe, pour montrer la perspective de la marche vers le communisme, pour tirer les leçons des autres luttes, spécifiquement quant au besoin d’étendre le combat aux autres villes et aux autres industries, est essentielle ;
-
la nécessité pour les ouvriers de contrôler la lutte eux-mêmes et de maintenir les moyens d’une communication avec toute la classe ouvrière (la publication de bulletins quotidiens, les meetings et manifestations de masse quotidiens, etc.)
Nous ne cultivons aucune illusion sur le brève flambée de Seattle. Il n’est pas besoin de montrer sous des couleurs séduisantes, d’exagérer ou de faire du romantisme de la grève générale de Seattle. Les révolutionnaires ne doivent pas un instant hésiter à la saluer comme un magnifique moment dans l’histoire de notre classe, et d’apprendre l’expérience qu’elle représente. Aujourd’hui, toute la classe ouvrière se trouve face à des attaques continues de la classe dominante contre leur niveau de vie et cherche des chemins pour répondre collectivement. Les révolutionnaires doivent donc insister sur la nécessité pour les ouvriers de repousser les syndicats, de prendre le contrôle des luttes dans leurs propres mains, et de travailler à la généralisation du combat. Ce ne sont pas des propositions abstraites, mais les leçons très concrètes de la lutte du prolétariat au siècle dernier, comprenant l’expérience de Seattle.
JG (10 mai 2009), Internationalism n° 109
90 ans depuis la grève générale de Winnipeg
90 ans après la grève générale de Winnipeg, les lecteurs se rappelleront que nous avons réimprimé dans notre dernier numéro un article antérieur sur la grève de Seattle de 1919, qui signalait l'importance de cet événement dans le développement de la lutte de classe en Amérique du Nord, qui analysait ses forces et ses faiblesses et montrait comment, en dépit du mythe persistant de la passivité de la classe ouvrière en Amérique du Nord, la vague révolutionnaire de la fin de la 1° Guerre Mondiale, qui a remis en question les rapports sociaux capitalistes, n'a pas épargné l'Amérique du Nord.
Dans cet article, nous poursuivons notre regard sur l'histoire de la vague révolutionnaire en Amérique du Nord avec un nouvel article sur les événements au nord du 49° parallèle, où la classe ouvrière du Canada a lancé sa propre offensive contre le système capitaliste dans une série de luttes à travers l'année 1919, aboutissant à la grève générale de Winnipeg en Mai et Juin de cette année qui aurait menacé l'ordre social capitaliste et aurait, sous la forme d'assemblées ouvrières massives et spontanées, préfiguré un nouvel ordre social au-delà du capitalisme.
Au printemps 1919, Winnipeg était une ville animée, la plus grande ville de l'ouest canadien et le siège des plus grands buildings de l'Empire Britannique de l'époque. Carrefour de communications important reliant le Canada occidental au Canada oriental aussi bien que sur une route vers les Etats-Unis, Winnipeg se présentait comme un centre important de la vie de la classe ouvrière dans la partie occidentale du continent. Au printemps de 1919, Winnipeg se trouvait isolé sur les immenses prairies nordiques, à presque 500 milles du plus proche centre métropolitain, ce qui ne l'a pas empêché de servir de point focal d'une vague de luttes de la classe ouvrière qui a balayé le Canada occidental.
La classe ouvrière dans Winnipeg a dû surmonter de nombreux obstacles pour s'unifier dans la lutte massive qu'elle avait déclenchée cette année. Ethniquement diverse, avec des ouvriers d'origine anglaise, écossaise, française, juive, allemande, mennonite, ukrainienne et d'ailleurs, la classe ouvrière de Winnipeg était loin d'être homogène. Des différences de métiers, de genre et de langue ont divisé la classe ouvrière, bien que la fracture la plus importante de l'époque ait probablement été celle entre les ouvriers qui avaient servi sur les champs de bataille d'Europe pendant la Première Guerre Mondiale et ceux qui avaient travaillé chez eux dans des usines, des ateliers et sur les voies ferrées. La situation était si mauvaise qu'en janvier 1919, la classe dirigeante a manipulé avec succès les tensions qui existaient entre les vétérans de retour de la guerre, qui avaient à faire face au chômage et à l'insécurité, et les ouvriers immigrés, provoquant des émeutes anti-immigrés. Des soldats de retour du front ont marché sur une usine d'emballage de viande exigeant que les étrangers soient renvoyés de leur travail. Les vétérans ont également attaqué une réunion socialiste en commémoration aux révolutionnaires allemands martyrisés, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Pendant plusieurs jours des immigrés ont été attaqués dans les rues et même dans leurs maisons.
Malgré tous leurs efforts, la bourgeoisie et son appareil d'Etat n'ont pas pu tirer profit de ces divisions pour empêcher les protestations de la classe ouvrière de Winnipeg, car ils ont dû faire face à l'agitation sociale et économique qui a accompagné la guerre et lui a apporté sa conclusion. Tout au long du printemps 1919, la classe ouvrière de Winnipeg a démontré une capacité énorme de dépasser ces diverses divisions et d'agir de façon unifiée en tant que force qui défendait ses propres intérêts de classe. Dans ce qui a peut-être été un des épisodes les plus importants de la lutte de Winnipeg, les vétérans de la classe ouvrière qui, à peine quatre mois plus tôt, avaient été aspirés dans l'émeute anti-immigrés, ont triomphé de l'idéologie bourgeoise xénophobe et ont apporté énergiquement leur appui à la grève.[1] Même les policiers subalternes ont essayé de rejoindre la rébellion.
Ces événements se sont produits dans le cadre d'un soutien et d'une sympathie manifestés en faveur de la révolution prolétarienne en Russie, largement répandus dans la classe ouvrière dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et dans Winnipeg en particulier où, par exemple, une assemblée massive de 1700 ouvriers, incluant des ouvriers immigrés et autochtones, en décembre 1918, a exprimé son soutien en adoptant des résolutions qui approuvaient les luttes révolutionnaires en Russie et en Allemagne. L'exemple de la grève générale de Seattle est lui aussi resté clairement dans les esprits des ouvriers. Les événements de Winnipeg ont pris d'autant plus d'élan que s'est tenue à Calgary, en Mars 1919, la Conférence Occidentale du Travail. Pendant cette conférence, les délégués des syndicats de l'Ouest ont fait sécession avec le Conseil des Métiers et du Travail du Canada (TLC) pour proposer une nouvelle organisation appelée One Big Union (OBU), partageant beaucoup de points communs avec les principes du syndicalisme révolutionnaire défendus par les International Workers of the World (IWW). Beaucoup de délégués qui ont formé l'OBU se sont ouvertement identifiés avec la Révolution Russe et ont appelé la classe ouvrière à commencer une révolution au Canada pour renverser l'Etat bourgeois et pour créer une nouvelle société sur le modèle de la Russie Soviétique. Alors que la vie de l'OBU lui-même se montrait éphémère, sa formation en Mars 1919 a conduit à deux conséquences principales. D'abord, elle a mis la classe dirigeante canadienne au pied du mur, la poussant à mettre en place une Red Scare (alarme rouge) au Canada et faisant réagir les autorités à chaque lutte de la classe ouvrière avec un niveau élevé de paranoïa et de peur. En second lieu, il a imprégné la classe ouvrière d'un esprit de lutte et a apporté l'idée qu'une nouvelle société était vraiment possible et que la classe ouvrière pourrait la faire apparaitre.
En Mai, avec le pays déjà sous tension, les ouvriers du bâtiment et de la métallurgie se sont mis en grève contre l'intransigeance des employeurs peu disposés à négocier. En réponse à la grève de ces ouvriers, le Conseil des Métiers et du travail de Winnipeg (WTLC) a décidé de faire voter par tous les syndicats affiliés une proposition pour déclarer une grève générale. En l'espace d'une semaine, le vote était conclu avec plus de 11.000 ouvriers votant pour la grève générale contre seulement 524 voix contre. Le 15 mai 1919, les usines, les magasins et les chantiers du rail de la ville sont devenus silencieux. La réponse à l'appel à la grève était bien plus impressionnante que ses organisateurs ne l'avaient prévue. Non seulement les ouvriers des syndicats affiliés sont sortis dans la rue, mais des milliers d'ouvriers non organisés ont également rejoint les rangs des grévistes. Pendant les six semaines suivantes, les industries de la ville se sont arrêtées, avec 30.000 grévistes remplissant les rues, les parcs et les salles de la cité pour protester, exprimer leurs revendications et organiser la direction de la lutte. Suivant l'exemple de la grève de Seattle, le comité de grève a autorisé la continuation des services essentiels, démontrant ainsi l'existence embryonnaire d'une situation de double pouvoir dans la ville. Le comité de grève a même donné la permission que le théâtre local reste ouvert pour que les ouvriers puissent avoir un lieu où se réunir pendant la grève.
Presque dès le début, le radicalisme de la classe ouvrière de Winnipeg était évident. La grève s'est étendue, comme un feu de forêt, de secteur au secteur et les ouvriers ont très rapidement pris la grève dans leurs propres mains en formant spontanément des assemblées massives et en nommant des comités pour s'assurer que la ville était alimentée et que les services essentiels étaient assurés. Dans les assemblées massives, les ouvriers débattaient des buts de la grève, prenant les choses dans leurs propres mains, même lorsque cela les mettait en conflit avec les hiérarchies syndicales. Déployant une fantastique unité face à tout ce qui semblait les diviser, la classe ouvrière de Winnipeg a rejeté de façon conséquente le barrage idéologique intense et les efforts de la presse jaune des journaux bourgeois pour les diviser suivant les lignes de démarcation de l'appartenance ethnique, du genre ou du statut de combattant. Un historien a estimé qu'au moins 171 réunions massives distinctes d'ouvriers ont eu lieu au cours des six semaines de la grève.[2]
La classe dirigeante locale dans Winnipeg, tout comme l'Etat fédéral canadien lui-même, n'est pas restée oisive, alors que la classe ouvrière régnait sur ce que la classe dirigeante considérait comme « sa » ville. En plus du barrage idéologique haineux, qui étiquetait les grévistes comme étant des « chiens Bolchevicks » et des « traîtres à la couronne », la bourgeoisie locale s'est organisée dans le Comité des Citoyens des 1000 (CC 1000) dans le but avoué de détruire la grève et de retourner à l'ordre chrétien sous le gouvernement du roi. Fermement convaincu qu'une révolution était en cours, le CC 1000 s'est rapidement assuré de la coopération du gouvernement fédéral en écrasant la grève. Le 26 Mai, le gouvernement fédéral a ordonné aux travailleurs de la poste de Winnipeg de reprendre le travail ou d'être licenciés. Sur les conseils d'un membre supérieur du CC 1000, le gouvernement fédéral a adopté de nouvelles lois d'immigration dures pour permettre l'arrestation et la déportation des étrangers préconisant la subversion ou la destruction de la propriété.
La classe ouvrière de Winnipeg est restée forte, rejetant les ordres de retour au travail. Les soldats de retour du front, bien disposés à l'égard de la grève, ont organisé des défilés dans la ville, autre inquiétude pour les autorités. Le CC des 1000 et les autorités fédérales n'ont pas osé employer la violence pour écraser la grève. Par peur des conséquences d'une fin violente de la grève, les autorités ont joué au jeu délicat du « wait and see », restant tout le temps campés sur leur appel à une fin de la grève et à l'arrestation de ses chefs. Néanmoins, les autorités préparaient constamment les moyens de la répression pour lorsque le moment serait venu, de plus en plus désespérées au fur et à mesure que les enjeux devenaient plus terribles pour leur ordre social dans Winnipeg et que le radicalisme de la classe ouvrière menaçait de s'étendre, étant donné qu'une série de grèves de solidarité éclatait à Saskatoon, à Calgary, à Edmonton et dans d'autres villes du Canada occidental.
Cependant, c'est précisément au moment où les grèves étaient à leur apogée, dirigeant fondamentalement la ville par leurs assemblées massives et les divers comités, que le mouvement a commencé à perdre de son élan. Contrairement aux pires craintes de la bourgeoisie, la classe ouvrière de Winnipeg ne pouvait pas poser la question du renversement de l'Etat bourgeois ni remettre en question d'une façon consciente la nature fondamentale de l'exploitation capitaliste. Bien que leurs actions aient déjà préfiguré ces questions d'une façon semblable à la manière avec laquelle elles avaient été posées en Russie et en Europe durant les deux années précédentes, la classe ouvrière de Winnipeg ne pouvait pas apporter les éléments nécessaires à une conclusion révolutionnaire. Malgré la sympathie largement répandue pour les révolutions russe et allemande, la conscience politique des ouvriers n'avait pas assimilé les leçons des luttes européennes. Les chefs des comités de grève étaient tous, soit des membres du Parti Socialiste, soit du Parti Social Démocrate du Canada, mais leur rôle dans la lutte était guidé plus par leur expérience en tant que leaders syndicaux que par les leçons politiques de la Russie Soviétique. Les exigences de la lutte sont restées embourbées au niveau d'une « conscience trade-unioniste" ; réclamant le droit de négociation pour une distribution plus égalitaire des fruits du développement économique et un droit d'être représentés dans des décisions cruciales au sujet de leur ville et de leurs diverses industries. Dans une certaine mesure, bien que leurs actions aient déjà posé la possibilité d'un ordre social différent, la conscience ouvrière est demeurée au niveau du réformisme.
Ce vide entre les actions des ouvriers et leur conscience et le rôle puissant des syndicats a finalement donné aux autorités bourgeoises le temps dont ils avaient besoin pour retrouver le contrôle de la situation. A la mi-juin, craignant que la fidélité des forces de police de la ville ne tienne pas, les autorités ont organisé une force de police spéciale pour écraser la grève. Cependant, cette police spéciale s'est avérée complètement inadaptée à cette tâche et une foule de 15.000 grévistes a complètement mis en déroute une force de police spéciale de 1200 éléments qui avait été envoyée après qu'une tentative pour diriger le mouvement vers le centre-ville ait conduit à une émeute. Avec des choix aussi inefficaces, les autorités ont consenti à mobiliser la Police Montée Royale du Nord-Ouest (RNWMP) pour écraser la grève. Le 21 juin, la RNWMP et la police spéciale ont brutalement attaqué un défilé de soldats démobilisés, alors que des agents sillonnaient Winnipeg et le pays pour arrêter les principaux leaders de la grève, ainsi que des ouvriers radicaux. Conséquence de la répression, mais aussi du poids de ses propres limites, la grève était officiellement terminée le 26 juin, avec un engagement de gouvernement provincial à enquêter sur ses causes.
Lorsqu'on tire un bilan de la Grève Générale de Winnipeg de 1919, on doit d'abord saluer le radicalisme de la classe ouvrière pendant ces six semaines de printemps. Maintes et maintes fois, les ouvriers ont étonné la bourgeoisie locale, l'Etat fédéral et même leurs propres syndicats par leur détermination à rejeter des divisions et par leur capacité à étendre la lutte et à assurer la gestion de la société. Alors que la classe ouvrière ne pouvait finalement pas poser la question du renversement de l'Etat bourgeois d'une manière consciente et que la classe dirigeante, à travers son Etat, pouvait une fois de plus prendre le dessus, la Grève Générale de Winnipeg de 1919 nous rappelle fermement que, contrairement au stéréotype d'une classe ouvrière nord-américaine passive, les ouvriers de ce continent, ont leur propre histoire de luttes radicales. Une histoire que la classe ouvrière devra se réapproprier pour répondre aux attaques dévastatrices sur ses conditions de travail et de vie et imposées par un système capitaliste global en pleine décomposition.
Henk 06/03/2009
[1] La solidarité récente dont ont fait preuve les ouvriers immigrants ou non-immigrants de la raffinerie de Lindsey en Grande Bretagne est un rappel moderne de la capacité des ouvriers à surmonter la propagande xénophobe pour les diviser.
[2] Michael Butt cité dans « The prairies in the Eye of the Storm » dans Craig Heron, ed. La révolte ouvrière au Canada (Toronto : Presse de l'Université de Toronto) 1997.pg. 187
Géographique:
- Canada [251]