Revue Internationale 2021
- 444 lectures
Revue Internationale numéro spécial: Aventurisme, parasitisme politiques
- 181 lectures
Rubrique:
L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC
- 583 lectures
Le présent article s'inscrit dans la série de ceux que nous avons déjà publiés dénonçant une tentative de falsification des origines réelles de la Gauche communiste émanant d'un blog nommé Nuevo Curso[1] (récemment rebaptisé Communia). Cette tentative est orchestrée par un aventurier, Gaizka[2], dont l'objectif n'est nullement de contribuer à clarifier et défendre les positions de ce courant mais de se "faire un nom" dans le milieu politique prolétarien. Cette attaque contre le courant historique de la Gauche communiste vise à transformer celle-ci en une mouvance aux contours flous, amputée des principes prolétariens rigoureux ayant présidé à sa formation ce qui constitue un obstacle à la transmission aux futures générations de révolutionnaires des acquis du combat des fractions de gauche contre l'opportunisme et la dégénérescence des partis de l'Internationale communiste. Quant à l'aventurier Gaizka, nous avons fourni à son sujet une quantité importante d'informations, à ce jour non réfutées, concernant les relations de ce Monsieur dans le monde des personnalités de la politique bourgeoise (de gauche surtout mais également de droite). C'est un comportement et un trait de personnalité qu'il partage avec des aventuriers plus connus dans l'histoire comme Ferdinand Lassalle et Jean Baptiste von Schweitzer qui avaient opéré au sein du mouvement ouvrier en Allemagne au 19e siècle[3], même s'il est loin, évidemment, d'avoir l'envergure de ces personnages.
Face à notre dénonciation, Gaizka est resté totalement silencieux : réfuter la réalité de ses turpitudes dont nous avons fait état est pour lui "mission impossible". De même, il a reçu très peu de soutiens, le plus explicite et presque unique provenant d'un groupe, le GIGC (Groupe International de la Gauche Communiste) qui, avant de changer de nom en 2014, se nommait la FICCI (Fraction Interne du Courant Communiste International). Un groupe dont la vocation première, depuis une vingtaine d'années, est de calomnier le CCI et dont la prise de position en faveur de Nuevo Curso s'est accompagnée d'une nouvelle attaque haineuse contre notre organisation.[4]
Après avoir dénoncé la fraude que constitue cette soi-disant "Gauche communiste" nommée Nuevo Curso et la véritable nature de son animateur Gaizka, il nous appartient de nous pencher sur le profil de ses "amis". La question n'est évidemment pas sans importance. La Sainte Alliance entre Nuevo Curso et le GIGC en dit long sur la véritable nature de chacun des deux groupes et de leur "contribution" aux efforts des jeunes éléments à la recherche des positions de classe. Mais avant d'examiner le pédigrée du GIGC, il vaut la peine de nous pencher rapidement sur la façon dont ce groupe s'est positionné par rapport à Nuevo Curso lors de son apparition.
Le soutien du GIGC a Nuevo Curso et Gaizka
C'est avec beaucoup d'enthousiasme, et de flagornerie, que le GIGC avait salué l'entrée sur la scène politique du blog Nuevo Curso : "Nuevo Curso est un blog de camarades qui a commencé à publier depuis septembre dernier des prises de position régulières sur la situation et sur des questions plus larges, voire théoriques. Malheureusement, elles ne sont qu’en espagnol. L’ensemble des positions qu’il défend sont très clairement de classe et se situent dans le cadre programmatique de la Gauche communiste … nous sommes très favorablement impressionnés, non seulement par leur rappel sans concession des positions de classe, mais surtout par la qualité "marxiste" des textes des camarades..." (Souligné par nous – Révolution ou guerre n° 9, "De nouvelles voix communistes : Nuevo Curso (Espagne) et Worker’s Offensive (États-Unis)")
De même, "La constitution d’Emancipación comme groupe politique communiste à part entière [qui anime le blog NC] est un pas important dont la signification politique et historique va bien au-delà de la simple apparition d’un nouveau groupe communiste. (…) Ainsi, la constitution d'Emancipación comme groupe politique à part entière exprime le fait que le prolétariat international, bien que soumis et loin de pouvoir repousser a minima les attaques de tout ordre imposées par le capital, tend à résister par la lutte et à se dégager de l'emprise idéologique de ce dernier et que son devenir révolutionnaire reste d'actualité. Elle exprime la "vitalité" (relative) actuelle du prolétariat." (Souligné par nous -Révolution ou guerre nº 12, Lettre du GIGC à Emancipación sur son 1er Congrès).
Le GIGC ne pouvait cependant éviter de relever le problème que pose l'interprétation par Nuevo Curso de la filiation historique de la Gauche communiste qui inclut dans celle-ci le courant "trotskiste" avant sa trahison au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'absence d'une critique de la part du GIGC sur cette question aurait rendu évident le fait que ce groupe ne se sent en rien concerné par la défense réelle de la Gauche communiste, que sa proclamation d'en faire partie et sa prétention de la défendre ne sont qu'un leurre au service de ses manœuvres sordides visant à discréditer le CCI. Cela dit, la "timidité" et la "gentillesse" de la critique adressée par le GIGC à Nuevo Curso peinent à cacher une bienveillance évidente vis-à-vis de l'attaque de ce groupe contre la Gauche communiste : "Nous voulons surtout attirer l’attention des camarades sur l’impasse programmatique, théorique et politique dans laquelle la revendication d’une continuité avec la 4e Internationale est en train d’embarquer Emancipación. (…) Le passage vers un groupe politique à part entière est extrêmement positif en soi et, en même temps, soulève de nouvelles questions et responsabilités. Celles-ci sont apparues dès le congrès. Et l’une d’entre elles, la revendication de la 4e Internationale, doit être débattue –et selon nous combattue– pour permettre à Emancipación et ses membres de remplir au mieux la tâche historique que le prolétariat leur a confiée." (Souligné par nous -Lettre du GIGC à Emancipación sur son 1er Congrès juillet 2019- R ou G n° 12). Au lieu de dénoncer clairement une attaque contre la Gauche communiste, le GIGC élude ce problème fondamental en essayant de nous embobiner avec "l'impasse programmatique, théorique et politique dans laquelle s'embarque Nuevo Curso (Emancipación)" et en évoquant, rien de moins, que "la tâche historique que le prolétariat lui a confiée". Moralité : Le GIGC se moque effectivement de la défense de la Gauche communiste mais se soucie, par contre, du devenir d'Emancipación.
De plus, dès lors que notre organisation avait donné suffisamment d'informations aux lecteurs permettant de caractériser Gaizka (le principal animateur de Nuevo Curso) comme un aventurier présentant la particularité d'avoir entretenu, en 1992-94, des relations avec le plus important parti de la bourgeoisie en Espagne à cette époque, le PSOE, il n'y avait plus de doute permis concernant le sens de la démarche de Nuevo Curso visant à dénaturer la Gauche communiste. Et le doute était encore moins permis pour les membres du GIGC puisqu'ils étaient encore militants du CCI dans les années 1992-94 et qu'ils avaient eu, de ce fait, pleine connaissance de la trajectoire et des faits et gestes de cet individu.
Pourtant, ce ne sont pas ces informations accessibles à tous (et démenties par personne, nous le répétons) qui ont empêché le GIGC de voler au secours de l'aventurier Gaizka, face à la dénonciation que nous en avons faite : "nous devons souligner qu’à ce jour, nous n’avons constaté aucune provocation, manœuvre, dénigrement, calomnie ou rumeur, lancée par les membres de Nuevo Curso, même à titre individuel, ni aucune politique de destruction contre d’autres groupes ou militants révolutionnaires"[5]. Effectivement, Gaizka ne procède pas de la même façon que le GIGC puisque la liste des comportements répugnants que celui-ci évoque ici constitue justement un bon résumé de sa propre façon d'agir. Et il faut vraiment l'aplomb de voyous et de piètres tricheurs comme les membres de ce groupe pour essayer de faire croire qu'il n'y a pas de problème avec Gaizka puisqu'il ne se conduit pas comme eux.
Chez Gaizka, c'est la personnalité politique qui est en cause, se distinguant comme d'autres aventuriers plus connus avant lui par le fait que "Contrairement aux combattants sincères qui se joignent de manière désintéressée à une organisation révolutionnaire pour aider la classe ouvrière à remplir son rôle historique, les aventuriers ne rejoignent des organisations révolutionnaires que pour remplir leur "propre mission historique". Ils veulent mettre le mouvement à leur service et cherchent constamment à être reconnus à cette fin"[6]. Pour Gaizka, c'est la réécriture de l'histoire de la Gauche communiste, en la dénaturant, qu'il pourra mettre à son actif et dont il va s'enorgueillir si l'opération venait à réussir[7].
Retour sur le palmarès des nuisances de la FICCI - GIGC
La FICCI s'est constituée en 2001 sous le signe de la haine du CCI et de la volonté de le détruire. N'y parvenant pas, elle s'est employée à lui nuire autant qu'elle le pouvait. Sous prétexte de vouloir "redresser le CCI" menacé selon eux de "dégénérescence opportuniste", les quelques militants du CCI à l'origine de la FICCI s'étaient, dès le début, caractérisés par l'intrigue (tenue de réunions secrètes[8]), par des agissements de voyous tels que le vol et le chantage et par un travail de provocateurs, notamment à travers une campagne de calomnies contre une camarade accusée publiquement par eux d'être un agent de l'État manipulant indirectement notre organisation.
Ne pouvant pas rendre compte dans le détail des turpitudes de la FICCI-GIGC, nous renvoyons le lecteur aux principaux articles de dénonciation que nous avons écrits à ce sujet[9] et nous nous limitons ici à un certain nombre d'illustrations concrètes de celles-ci.
Les membres de la FICCI se placèrent eux-mêmes et délibérément en dehors de notre organisation comme conséquences des comportements suivants :
- Violations répétées de nos statuts (notamment le refus de payer l'intégralité de leurs cotisations) et leur refus de s'engager à les respecter dans l'avenir ;
- Refus de venir présenter la défense de leur comportement dans l'organisation face à notre critique de celui-ci, devant une conférence extraordinaire de l'organisation ayant spécifiquement mis cette question à son ordre du jour ;
- Vol d'argent et de matériel du CCI (fichiers d'adresses et documents internes).
La FICCI comme groupe policier
Finalement les membres de la FICCI furent exclus[10] de notre organisation, non pour ces comportements pourtant intolérables mais pour leurs activités d'indicateurs avec, à leur actif, plusieurs actes de mouchardage. C'est ainsi, notamment, qu'ils publièrent, sur leur site Internet, la date à laquelle devait se tenir une Conférence du CCI au Mexique en présence de militants venus d'autres pays. Cet acte répugnant de la FICCI consistant à faciliter le travail des forces de répression de l'État bourgeois contre les militants révolutionnaires est d'autant plus ignoble que les membres de la FICCI savaient pertinemment que certains de nos camarades au Mexique avaient déjà, dans le passé, été directement victimes de la répression et que certains avaient été contraints de fuir leur pays d'origine.
Mais les comportements de mouchards des membres de la FICCI ne se résument pas à cet épisode. Avant et après leur exclusion du CCI, ils ont systématisé leur travail d'espionnage de notre organisation et rendu compte régulièrement, dans leurs bulletins, des résultats ainsi obtenus. Certaines des "informations" ainsi publiées, tout-à-fait dignes de la presse à scandale (par exemple des "révélations" sur un couple de militants), n'ont d'intérêt que pour les quelques imbéciles (s'il en existe en dehors des propres membres de la FICCI) qui se complaisent à fantasmer sur une oligarchie familiale au sein du CCI. Par contre, elles en côtoient d'autres qui, loin d'être inoffensives, relèvent directement d'un travail d'indicateur de police. En voici un petit échantillon :
- le bulletin de la FICCI n° 14 est rempli par une prose digne des plus zélés rapports de police : "Ce texte est de la main de CG[11], alias Peter, ce que prouve le style et surtout la référence (plutôt fantaisiste) à une lamentable opération de récupération menée sous sa direction. Ce même Peter est celui qui dirige le CCI et qui, après avoir exclu ou poussé dehors la plus grande partie des membres fondateurs du CCI, se prétend le seul héritier de MC[12]. Mais il faut aussi savoir que si Peter mène cette cabale haineuse contre notre camarade Jonas, c'est pour la raison bien simple que Louise (alias Avril), la militante à propos de laquelle Jonas a osé exprimer clairement des doutes, n'est autre que la compagne du chef."
- dans le bulletin n° 18, nous avons droit à un rapport détaillé (typique des rapports d'indicateurs qu'on trouve dans les archives de la police) sur une réunion publique du Parti communiste international (PCI-Le Prolétaire), où sont rapportés tous les faits et gestes de "Peter alias C.G."
- le bulletin n° 19 revient à la charge sur Peter "qui diffusait seul" dans telle ou telle manifestation et il soulève une question "hautement politique" : "Enfin, et vous comprendrez que nous posions aussi cette question : où est Louise ? Absente des manifestations, absente des réunions publiques, est-elle de nouveau 'malade' ?".
L'échantillon ci-dessus de la sordide récolte d'informations par les membres de la FICCI est tout à fait significatif de la manière dont ces gens concevaient leur "travail de fraction" (commérages, rapports de police). En effet, l'exhibition de telles informations s'adresse également à l'ensemble du CCI, en vue de mettre la pression sur ses militants en leur faisant comprendre qu'ils sont "sous surveillance", que rien de leurs faits et gestes n'échappera à la vigilance de la "Fraction interne". En témoigne l'innocente information publiée dans le bulletin n° 13, qui rapporte que le CCI a loué une "salle luxueuse" pour une réunion publique, information dont la seule fonction est de contribuer à cette ambiance de surveillance permanente. C'est d'ailleurs avec le même objectif que les membres du CCI, de même que nos contacts, recevaient régulièrement dans leur boite à lettres, même quand ils avaient changé d'adresse pour certains d'entre eux, le fameux "Bulletin communiste", malgré les protestations et demandes réitérées pour que cessent de tels envois. C'était un moyen de dire aux destinataires : "Nous vous surveillons et nous ne vous lâcherons pas".
Ce n'est pas parce qu'il émane de cerveaux malades de persécuteurs obsessionnels qu'il ne faut pas prendre au sérieux un tel travail de flicage de notre organisation et plus particulièrement de certains de ses membres.
Pour conclure sur les comportements policiers de la FICCI, il vaut la peine de signaler la publication par celle-ci d'un texte de 118 pages en format A4 et en petits caractères (soit environ 150 000 mots !) intitulé "L'Histoire du Secrétariat international du CCI". Ce texte, d'après son sous-titre, prétend raconter "Comment l'opportunisme s'est imposé dans les organes centraux avant de contaminer et entamer la destruction de l'ensemble de l'organisation...". C'est un récit qu'on peut, à plusieurs titres, qualifier de "roman policier".
En premier lieu, c'est un roman, c'est-à-dire une fiction et nullement un texte historique, même s'il fait référence à des faits et des personnages réels. C'est un peu comme si on considérait "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas comme la véritable histoire de d'Artagnan (qui a réellement existé) et de ses amis. Evidemment, même s'il n'y a pas de comparaison possible entre l'imagination romanesque de Dumas et l'imagination malade et paranoïaque des auteurs de cette "histoire", nous avons droit à un "thriller" avec des personnages bien typés, notamment Louise et Peter. Louise est la principale "méchante" de l'histoire, une véritable Lady Macbeth. Celle-ci avait poussé son mari à assassiner le Roi Duncan pour qu'il s'empare du trône. Pour sa part, Louise, en lien avec les services spécialisés de l'état, manipule de façon diabolique son compagnon Peter pour l'inciter à commettre des méfaits contre le CCI et ses militants.[13] Peter est ainsi devenu le "chef", celui "qui dirige le CCI" (sic) après avoir éliminé "la plus grande partie des membres fondateurs du CCI" et qui "se prétend le seul héritier de MC". Ce n'est plus à Peter-Macbeth que nous avons affaire mais à Peter-Staline. Et c'est ici que se manifeste, encore une fois, le caractère policier de ce texte. En effet, il explique la prétendue "évolution opportuniste" du CCI par les intrigues d'un certain nombre de personnages malfaisants comme si la dégénérescence et la trahison du parti bolchevique avaient été le résultat de l'action du mégalomane Staline et non la conséquence de l'échec de la révolution mondiale et de l'isolement de la révolution en Russie. Ce texte relève de la plus pure conception policière de l'histoire laquelle a toujours été combattue par le marxisme et il faut reconnaître à ses auteurs une certaine avance sur tous les "complotistes" qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans l'entourage de Donald Trump.
Mais le caractère policier le plus odieux de ce texte, c'est bien le fait qu'il divulgue de nombreux détails sur le fonctionnement interne de notre organisation et qui sont pain bénit pour les services de police. La bassesse des membres du GIGC n'a décidément pas de limites.
La politique de "cordon sanitaire" de la FICCI contre le CCI
Faute d'avoir pu convaincre les militants du CCI de la nécessité d'exclure le "chef" et la "compagne du chef", ce groupuscule parasitaire s'est donné comme objectif d'entraîner derrière ses calomnies les autres groupes de la Gauche communiste afin d'établir un cordon sanitaire autour du CCI et le discréditer (voir ci-après les épisodes du "Circulo" et de la "réunion publique du BIPR[14] à Paris"). La FICCI a ainsi demandé au PCI (Le Prolétaire), dans une lettre qu'elle lui a adressée le 27 janvier 2002, en même temps qu'à d'autres groupes de la Gauche communiste, de prendre position en sa faveur contre le CCI : "Aujourd'hui nous ne voyons plus qu'une seule solution : nous adresser à vous pour que vous demandiez à notre organisation d'ouvrir les yeux et de retrouver le sens de ses responsabilités. (...) Parce que nous sommes en désaccord, aujourd'hui le CCI fait tout pour nous marginaliser et nous démolir moralement et politiquement"[15]. Malgré cette lettre, la FICCI a le culot d'écrire dans son Bulletin n° 13 : "nous voulons affirmer que, pour notre part, nous n'avons jamais demandé à personne de prendre parti entre le CCI et la Fraction".
La volonté d'isoler le CCI concernait un périmètre allant au-delà de la Gauche communiste puisqu'il s'agissait de faire écran, partout où c'était possible et à travers différents moyens, entre le CCI et tous ceux qui, à un moment où un autre, étaient susceptibles d'être intéressés par le contenu de notre intervention. C'est le sens de ses campagnes de dénigrement sur son site, parfois même à travers des tracts dédiés à cet effet, dans tous les lieux de discussion qui lui étaient accessibles.
S'il ne nous était pas possible d'interdire aux membres de la FICCI de sillonner les manifestations de rue pour nous surveiller, nous pouvions, en revanche, les empêcher de faire leur sale besogne de flicage dans nos réunions publiques. C'est pourquoi le CCI avait fini par prendre la décision d'interdire la présence à ses réunions publiques et à ses permanences des membres de la prétendue "Fraction interne" du CCI[16]. À plusieurs reprises nous avons dû faire face à des menaces (dont celle proférée à haute voix de trancher la gorge à l'un de nos camarades[17]) et agressions de ces voyous.
La dégénérescence opportuniste du CCI, proclamée mais jamais démontrée par la FICCI !
La FICCI se présente comme "le véritable continuateur du CCI" qui aurait connu une dégénérescence "opportuniste" et "stalinienne". Elle déclare poursuivre le travail, abandonné à ses dires par le CCI, de défense dans la classe ouvrière des "véritables positions de cette organisation" lesquelles seraient menacées par le développement de l'opportunisme en son sein ce qui affecterait, en premier lieu, la question du fonctionnement. On a vu dans la pratique sa propre conception du respect des statuts et même des règles de comportement les plus élémentaires du mouvement ouvrier, "s'asseoir dessus".
Par ailleurs, il n'existe nulle part la trace d'une argumentation "politique" de la FICCI mettant clairement en évidence ses "divergences de fond" avec le CCI, lesquelles auraient justifié la constitution d'une "fraction interne" se situant dans la continuité de toutes les fractions de gauche du mouvement ouvrier, depuis la Ligue Spartakus jusqu'à la Fraction de la Gauche italienne[18]. Ayant toujours été incapable de se contraindre à une telle nécessité de rigueur politique en s'inspirant de l'expérience du mouvement ouvrier, elle préfère agiter l'épouvantail de la vindicte populaire en répétant à satiété que le CCI est une secte "sans espoir de retour maintenant, et qui s’est en grande partie marginalisé, voire s’est mis hors-jeu, du camp prolétarien de par ses positions opportunistes". (Rapport d’activités de la 2e Réunion générale du GIGC. Révolution ou Guerre n° 12).
Pourquoi et comment le CCI se serait-il mis "hors-jeu du camp prolétarien", un concept que nous ne retrouvons nulle part chez nos prédécesseurs de Bilan et Internationalisme[19] (dont la FICCI-GIGC a l'indécence de revendiquer la filiation et en particulier celle de notre camarade MC[20]).
La FICCI-GIGC suggère que nous aurions trahi, ou serions en voie de trahison de l'internationalisme prolétarien, ce qui effectivement constituerait un motif valable pour dénoncer l'opportunisme y conduisant. Mais, à ce jour, la FICCI-GIGC n'a en rien démontré en quoi notre caractérisation de la phase actuelle de la décadence capitaliste, celle de sa décomposition[21] -qui, selon ces gens est une pièce maitresse de l'opportunisme du CCI- est l'illustration de cette trahison !
La FICCI-GIGC suggère que notre sectarisme s'exprime à travers notre conception selon laquelle il existe des groupes parasites agissant dans le milieu de la Gauche communiste[22]. Celle-ci, de même que l'idée que le parasitisme fait courir un danger au milieu politique prolétarien, nous marginaliserait par rapport à ce milieu et constituerait même une menace pour lui. En réalité, cette conception ne constitue un danger que pour les parasites et nous revendiquons sa validité de la même manière que nous nous revendiquons du combat de Marx et Engels contre l'Alliance de Bakounine au sein de l'AIT : "Il est grand temps, une fois pour toutes, de mettre fin aux luttes internes quotidiennement provoquées dans notre Association par la présence de ce corps parasite". (Engels, "Le Conseil général à tous les membres de l'Internationale", avertissement contre l'Alliance de Bakounine)."
La méthode consistant à "suggérer" en évitant le problème politique de fond fait appel au bon sens populaire[23], aux méthodes de la chasse aux sorcières pratiquées au Moyen-âge, et qui connait un regain de vitalité dans la société actuelle en décomposition avec en particulier la recherche tous azimuts de boucs émissaires à tous les maux de la société.
En réalité, la FICCI GIGC n'a jamais expliqué que, lorsque ses membres faisaient partie du CCI, ils ont toujours soutenu les thèses sur le parasitisme et celles sur la décomposition. L'attaque qu'ils ont engagée en 2000 contre notre organisation ne faisait nulle référence à des désaccords sur ces questions. Ce n'est que plus tard qu'ils ont "découvert", de façon très opportune, qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces analyses. Il s'agissait alors, pour eux, d'éliminer des entraves à la justification de leur nouveau projet politique :
- En devenant à leur tour des parasites caricaturaux, ils n'ont évidemment pas supporté l'image que leur renvoyait d'eux-mêmes et de leur comportement le miroir de notre analyse du parasitisme. Il leur fallait casser ce miroir pour rendre le CCI coupable de leurs propres exactions et essayer de priver celui-ci d'une méthode adaptée pour les combattre ;
- En rejetant la théorie de la décomposition du capitalisme élaborée par le CCI, qu'il est le seul à défendre au sein de la Gauche communiste, la FICCI pouvait caresser dans le sens du poil les autres groupes de la Gauche communiste très critiques vis-à-vis de cette analyse.
Par ailleurs, le CCI a été la cible de nombreuses autres accusations de la part de la FICCI que nous n'avons pas évoquées jusqu'ici. D'une manière générale celles-ci sont exprimées au moyen de "formules choc" basées sur des mensonges et déformations, dignes de la devise de Goebbels, chef de la propagande nazie, selon laquelle : "Un mensonge énorme porte avec lui une force qui éloigne le doute". Heureusement, l'obscurantisme moyenâgeux n'empêche pas la bêtise de s'exprimer et, avec elle, la possibilité d'éveiller l'incrédulité des supporters du GIGC. À l'attention de ceux-ci nous reproduisons un tout petit échantillon des accusations portées à notre endroit par la FICCI : le CCI serait aujourd'hui frappé du stigmate "d'un éloignement progressif du marxisme et d'une tendance de plus en plus affirmée à mettre en avant (et à défendre) des valeurs bourgeoises et petites bourgeoises en vogue (le "jeunisme", le féminisme et surtout la "non-violence")[24] ; le CCI "ferait le jeu de la répression"[25] .
L’utilisation policière par le GIGC des bulletins internes du CCI
À peine l'ancienne enseigne de la "FICCI" était-elle remisée et qu'était affichée la nouvelle du "GIGC" que ce groupe parasite tentait un coup d'éclat, encore une fois de nature policière, contre le CCI.
Bien qu'au départ les campagnes anti-CCI de la FICCI aient eu un certain impact sur le milieu politique prolétarien, elles n'étaient pas parvenues néanmoins à marginaliser notre organisation, en particulier du fait que nous les avons énergiquement combattues. La FICCI avait dû se résoudre à cette situation jusqu'à ce que l'histoire semble à nouveau lui sourire grâce à l'arrivée providentielle de bulletins internes du CCI entre ses mains.[26]
Pensant que leur heure de gloire était enfin arrivée, ces parasites revigorés par le nouvel "atout" en leurs mains déchaînaient une propagande hystérique contre le CCI, comme en témoigne le placard publicitaire (jubilatoire) affiché sur leur site Web : "Une nouvelle (ultime ?) crise interne dans le CCI !", accompagné bien sûr d’un "Appel au camp prolétarien et aux militants du CCI". Durant plusieurs jours, ils ont mené une activité frénétique, adressant lettre sur lettre à tout le "milieu prolétarien" ainsi qu’à nos militants et à certains de nos sympathisants (dont ils continuaient d'utiliser les adresses en leur possession après les avoir volées au CCI). Ce prétendu "Groupe international de la Gauche communiste" (le nouveau nom que s'était donné la FICCI) a sonné le tocsin et crié à tue-tête qu’il était en possession des Bulletins internes du CCI. En exhibant leur trophée de guerre et en faisant un tel tintamarre, le message que ces mouchards patentés cherchaient alors à faire passer était très clair : il y avait une "taupe" dans le CCI qui travaillait main dans la main avec l’ex-FICCI ! C’était clairement un travail policier n’ayant pas d’autre objectif que de semer la suspicion généralisée, le trouble et la zizanie au sein de notre organisation. Ce sont ces mêmes méthodes qu’avait utilisées le Guépéou, la police politique de Staline, pour détruire de l’intérieur le mouvement trotskiste des années 1930. Ce sont ces mêmes méthodes qu’avaient déjà utilisées les membres de l’ex-FICCI (et notamment deux d’entre eux, Juan et Jonas, membres fondateurs du "GIGC") lorsqu’ils faisaient des voyages "spéciaux" dans plusieurs sections du CCI en 2001 pour organiser des réunions secrètes et faire circuler des rumeurs suivant lesquelles l’une de nos camarades (la "femme du chef du CCI", suivant leur expression) serait un "flic".
Comment le GIGC a-t-il pu bénéficier d'un tel cadeau du ciel ? Un complice infiltré au sein de notre organisation ? La police elle-même l'aurait-elle obtenu en piratant nos ordinateurs pour le transmettre ensuite au GIGC par un moyen quelconque ? Si, au lieu d'être une bande voyous, le GIGC avait été une organisation responsable, il aurait eu à cœur de résoudre cette énigme et d'informer le milieu politique du résultat de ses investigations.
Notre article de dénonciation de cette nouvelle attaque avait suffi à calmer subitement les ardeurs du GICG mais il est intéressant de noter la réponse qu'il y avait faite : "Notre groupe prend acte du silence et de l’absence de démenti du CCI sur la réalité d’une crise organisationnelle grave au sein de celui-ci et sur la nouvelle mise en cause au sein même du CCI des comportements de la 'militante' Avril-Louise-Morgane. Le GIGC ne répondra pas au tombereau d’insultes que le CCI verse actuellement sur notre groupe (comme il l’a fait hier sur la FICCI). Nous avons autre chose à faire. (…)". Cette réponse était révélatrice à plusieurs titres :
- Le GIGC refusant de répondre au "tombereau d'insultes", il s'évitait de devoir répondre à la seule question d'intérêt et dont on comprend qu'elle le mette dans l'embarras : Comment avait-il obtenu nos bulletins interne ?
- Il accusait le CCI de cacher ses problèmes organisationnels alors que la lecture de l'ensemble de notre presse révèle qu'il s'agit d'un mensonge et d'une calomnie, puisque, à l'image des bolcheviks (voir notamment le livre de Lénine "Un pas en avant deux pas en arrière") nous sommes la seule organisation à en faire systématiquement état en en tirant les leçons.
- Étant en possession de nos bulletins internes, le GIGC savait parfaitement que, une fois de plus, nos problèmes ne seraient pas cachés. Par conséquent, la répercussion de problèmes organisationnels affectant le CCI ne pouvait être attendue avant la tenue d'une réunion générale de l'organisation (un congrès, une conférence) en charge d'en traiter ; elle ne pouvait donc avoir lieu que dans le cadre d'un bilan des travaux d'une telle réunion. Le bilan des travaux de notre conférence extraordinaire de mai 2014 a été publié dans un article paru en septembre 2014, au sein de la Revue internationale n° 153, sous le titre, "Conférence internationale extraordinaire du CCI : La 'nouvelle' de notre disparition est grandement exagérée ! [1]"
La FICCI parasite, mais pas seulement du CCI
Nous avons montré en quoi la FICCI avait tenté d'utiliser le PCI (par courrier) pour qu'il la soutienne contre le CCI et nous allons illustrer comment elle employa la même démarche "en plus grand" vis-à-vis du BIPR. Cette tentative de corrompre ces deux organisations en les entrainant sur un terrain étranger aux règles devant régir les relations au sein de la Gauche communiste, constitue également une attaque parasitaire contre celles-ci.
Ainsi, le BIPR a été la cible en particulier d'une manœuvre osée de la part du la FICCI consistant à organiser au bénéfice de ce groupe une réunion publique à Paris, le 2 octobre 2004. En fait, comme nous allons le montrer, il s'agissait d'une réunion publique qui devait être au service de la réputation de la FICCI, au détriment de celle du BIPR et en vue de porter une attaque contre le CCI.
L'annonce de cette réunion par le BIPR indiquait que son thème était la guerre en Irak. Par contre l'annonce qu'en fit la FICCI soulignait toute l'importance de sa propre démarche : "Sur notre suggestion et avec notre soutien politique et matériel, le BIPR va organiser une réunion publique à Paris (RP qui, nous l'espérons, ne sera pas la dernière) à laquelle nous appelons tous nos lecteurs à participer" (souligné par nous)". Ce qu'il ressort de cet appel c'est que, sans la FICCI, cette organisation de la Gauche communiste, qui existe à l'échelle internationale et qui est connue depuis des décennies, n'aurait pas pu prendre l'initiative et organiser la réunion publique !
En fait, ce groupe parasite a utilisé le BIPR comme un "homme de paille" pour sa propre publicité en vue de l'obtention d'un certificat de respectabilité, de reconnaissance de son appartenance à la Gauche communiste. Et la voyoucratie décomplexée n'a pas hésité à utiliser le carnet d'adresse des contacts du CCI (qu'elle avait dérobée avant son départ de l'organisation) pour diffuser son appel à cette réunion publique.
Comme nous l'avions souligné à l'époque, la FICCI n'avait pas jugé utile d'écrire une seule phrase d'analyse sur son annonce dénonçant la guerre en Irak (contrairement à l'annonce faite par le BIPR). De même son annonce était exclusivement dédiée à une question : "comment reconstruire un pôle de regroupement révolutionnaire dans la capitale française après l'effondrement du CCI, un effondrement depuis lequel ses réunions publiques sont désormais désertées et ne constituent plus un lieu de débat".
En fait, c'est tout le contraire qu'a permis de mettre en évidence le déroulement de la réunion publique du BIPR. Celle-ci devait être la preuve, selon la FICCI, que le BIPR était désormais le "seul pôle sérieux" de discussion et de référence de la Gauche communiste. Or, elle aurait été un fiasco total si le CCI n'y avait pas participé et invité ses contacts à en faire de même. En effet, une importante délégation de militants du CCI et une dizaine de sympathisants de notre organisation étaient présents.
En réalité, la multiplication des compliments apportés par le GIGC-FICCI au BIPR n'était pas autre chose que de la pure hypocrisie. Dès sa constitution, la FICCI avait cherché un appui au sein du milieu politique prolétarien, essentiellement auprès du BIPR, dans la croisade parasitaire qu'elle instillait contre le CCI, en particulier en "élisant" le BIPR comme seul pôle viable pour le regroupement des forces révolutionnaires. Telle la mouche du coche dans la fable de Jean de La Fontaine, elle prodiguait des conseils, distribuait des bons points au milieu politique, reproduisait certains de ses articles … À l'époque, les relations étaient au "beau fixe" entre le BIPR et la FICCI. Le compte-rendu par la FICCI d'une réunion avec le BIPR intervenue en juin 2004 exposait l'analyse suivante de la dynamique existant au sein du camp prolétarien : "Ces différents plans passés en revue nous permettent de conclure qu’il existe bien deux dynamiques au sein de l’actuel camp prolétarien, ces deux dynamiques allant dans deux sens opposés : l’une pour créer un cadre de regroupement pour rassembler les énergies révolutionnaires, favoriser et orienter les débats et la réflexion collective, permettre l'intervention la plus large au sein de la classe ouvrière, cette dynamique, dans laquelle notre fraction s'inscrit, est portée, aujourd'hui, essentiellement par le BIPR ; l’autre allant dans le sens opposé, celui d’entretenir, voire d'accroître la dispersion, la confusion politique, est portée par le CCI et contre laquelle la fraction mène le combat ouvertement." (Compte rendu d'une réunion entre le BIPR et la fraction [2] ; septembre 2004 - Bulletin communiste FICCI 27)
Quinze ans plus tard, le Rapport d’activités de la 2e Réunion générale du GIGC (Avril 2019) renvoie une image beaucoup moins idyllique de ses relations avec la TCI. En effet, il informe ses lecteurs que " ... de nouvelles forces communistes ont émergé dont Nuevo Curso est l’expression et un facteur, mettant ainsi directement les groupes historiques de la Gauche communiste partidiste devant leur responsabilité historique face à cette nouvelle dynamique et devant laquelle la Tendance Communiste Internationaliste, principale organisation de ce camp, a commencé par s’enfermer dans une attitude, ou des réflexes, relativement sectaire à notre endroit et immédiatiste quant à ces nouvelles forces". (souligné par nous - Rapport d’activités de la 2 [3]e [3] Réunion générale du GIGC [3]. Révolution ou Guerre n°12)
Plus encore, "la TCI pourtant liée organiquement avec le PC d’Italie et la Gauche communiste d’Italie, subit le poids d’un relatif informalisme, du personnalisme et de l’individualisme, et donc de l’esprit de cercle" (souligné par nous - Idem) ce qui, selon le GIGC, entrave l'application d'une méthode de parti par la TCI notamment dans la relation avec ses contacts.
Que s'est-il donc passé pour que la FICCI-GIGC, ces lèche-bottes patentés de la TCI, se rebellent ainsi ? Aujourd'hui ils découvrent que la TCI, ex BIPR, se livrerait à ce qui ressemble à une approche opportuniste de l'intervention en direction des contacts : "L’article, écrit par un membre de la CWO, le groupe britannique de la TCI, rejette clairement les "fractions ou cercles de discussion". Au-delà du rejet de la forme organisationnelle en soi et plus grave, il sous-estime, ignore, et de fait repousse, tout processus de confrontation et de clarification politiques comme moyen central et moment indispensable du combat pour le parti". (souligné par nous - Idem)
En fait, ce n'est certainement pas une approche qu'il caractérise comme opportuniste (sans employer le terme) qui perturbe le GIGC, mais bien que la fidèle "mouche du coche" a beaucoup moins de succès que la TCI auprès des nouveaux éléments qui s'approchent de la Gauche communiste. Surtout, le GIGC a le plus grand mal à digérer le fait que ses membres au Canada l'aient quitté pour rejoindre la TCI.
Cette critique du GIGC à la TCI est révélatrice, non pas des méthodes de recrutement de la TCI, mais de l'hypocrisie sans nom du GIGC. En effet, en plus des compromissions politiques / théoriques que la FICCI avait faites pour être plus en phase avec le Milieu politique prolétarien (abandon de la théorie de la décomposition et des thèses sur le parasitisme), ses membres avait mis sous l'étouffoir une autre divergence, d'une grande importance, que le CCI avait toujours eue (et qu'ils partageaient quand ils étaient dans notre organisation), avec le BIPR à propos des principes devant présider à la formation du parti. Brusquement, les membres de la FICCI avaient "oublié" les critiques, qu'avec le CCI, ils avaient portées auparavant sur cette question au Partito Comunista Internazionalista (PCInt) et au BIPR, notamment la démarche opportuniste qui avait présidé à la constitution du Partito en 1945. Aujourd'hui, le GIGC "découvre" que les méthodes de recrutement de la TCI sont un petit peu opportuniste mais ce n'est pas, comme le GIGC veut le faire croire, la TCI qui a changé ses méthodes mais le GIGC qui abandonne son attitude de lèche-bottes tout à son amertume d'avoir été doublé par la TCI qui lui a pris certains de ses membres.
Il existe effectivement des désaccords entre la TCI et le CCI à propos de la méthode de regroupement devant aboutir à la constitution du parti mondial mais ce désaccord se situe au sein du camp prolétarien et donnera lieu à un débat et des confrontations politiques entre camarades luttant pour une même cause. Et il est inacceptable qu'il soit pollué par les jérémiades du GIGC.
Les leçons d'un combat contre l'alliance de la FICCI avec un aventurier (le citoyen B) en 2004
Pour conclure sur les hauts faits d'armes du GIGC-FICCI, et sur leur caractère éminemment nocif, il est nécessaire de revenir sur un épisode qui présente des similitudes avec la situation récente où le parasitisme du GIGC est venu apporter son soutien aux manigances d'un aventurier. Un épisode où l'alliance entre ces deux éléments a eu des effets destructeurs notamment par rapport aux éléments qui s'approchent des positions de classe.
En 2004, le CCI était entré en relation politique avec un petit groupe en recherche en Argentine, le NCI (Nucleo comunista internacional)[27]. Ayant entrepris l’étude des positions des courants de la Gauche communiste, ses membres s'orientaient vers les positions du CCI. Les discussions sur la question des comportements organisationnels inadmissibles au sein du prolétariat avaient convaincu ces camarades, sur la base de l'étude des prises de position de la FICCI et de nos propres articles à ce sujet, du fait que celle-ci "avait adopté une conduite étrangère à la classe ouvrière et à la Gauche communiste". Cela avait alors donné lieu à une prise de position en ce sens écrite le 22 mai 2004 par ces camarades[28].
Il s'est avéré qu'un problème commençait à se poser au sein du NCI du fait que l'un de ses membres - que nous appellerons le citoyen B. dans la suite de la narration - avait une pratique en opposition totale avec un fonctionnement collectif et unitaire, une condition fondamentale d'existence pour une organisation communiste. Ayant initialement impulsé les contacts avec le CCI (il était le seul à pouvoir utiliser Internet), il menait des discussions individuelles avec chacun des membres du groupe mais il manœuvrait pour éviter le développement de toute discussion sérieuse et systématique de l'ensemble de celui-ci, ce qui lui permettait d'en "garder le contrôle". Cette pratique organisationnelle, radicalement étrangère au prolétariat, est typique des groupes bourgeois, particulièrement de gauche ou d’extrême gauche du capital. Monsieur B se proposait en réalité d’utiliser ses camarades comme tremplin pour devenir une "personnalité" au sein du milieu politique prolétarien. Or, le travail systématique de discussion des positions politiques avec le CCI conçu dans la durée de même que notre insistance pour que se tiennent des réunions communes de tous les camarades, contrariaient de plus en plus ses plans immédiats d'aventurier.
C'est ainsi que fin juillet 2004, Monsieur B. tenta une manœuvre audacieuse : il demanda l’intégration immédiate du groupe au sein du CCI. Il imposa cette exigence malgré la résistance des autres camarades du NCI qui, même s’ils se donnaient aussi comme objectif l’adhésion au CCI, ressentaient la nécessité de réaliser préalablement tout un travail en profondeur de clarification et d’assimilation, le militantisme communiste ne pouvant se baser que sur de solides convictions. Le CCI rejeta cette exigence conformément à notre politique s'opposant aux intégrations précipitées et immatures qui peuvent contenir le risque de la destruction de militants et sont nocives pour l’organisation.
Parallèlement à cela, une alliance s'était nouée entre la FICCI et l'aventurier B, certainement à l'initiative de B, au service d'une manœuvre contre le CCI utilisant, à son insu, le NCI.
La manœuvre consistait à faire circuler au sein du milieu politique prolétarien une dénonciation du CCI et de ses "méthodes nauséabondes" qui semblait émaner indirectement du NCI, puisque cette dénonciation était signée d'un mystérieux et fictif "Circulo de comunistas internacionalistas" (soit "CCI" en abrégé !), animé par le citoyen B et qui, selon lui, était supposé constituer le "dépassement politique" du NCI. Ces calomnies furent véhiculées au moyen d'un tract du "Circulo" diffusé par la FICCI à l'occasion de la réunion publique à Paris du BIPR du 2 octobre 2004.
Elles furent également mises en ligne en différentes langues sur le site du BIPR. En plus de cibler directement le CCI, le tract en question prenait la défense de la FICCI remettant totalement en cause la prise de position du NCI du 22 mai 2004 qui avait dénoncé ce groupe.
Lorsqu'ils découvrirent plus tard les manœuvres du citoyen B dans leur dos, en particulier la création du fantoche "Círculo de Comunistas Internacionalistas", de même que le positionnement de celui-ci en soutien à la FICCI et en dénonciation du CCI, les membres du NCI analysèrent la situation de la sorte : "Il est fort probable qu'il (B.) avait déjà pris contact en sous-main avec la FICCI, tout en continuant à nous duper jusqu'à vouloir précipiter l'intégration du NCI au CCI" (Des internationalistes en Argentine -Présentation de la Déclaration du NCI)[29].
La manière dont le citoyen B a été amené à élaborer sa manœuvre est typique d'un aventurier, de ses ambitions et de son absence totale de scrupules et de préoccupation pour la cause du prolétariat. Le recours aux services d'un aventurier, par la FICCI, pour satisfaire sa haine du CCI et tenter de mettre en place, par le dénigrement public, l'isolement politique de notre organisation, est digne des personnages minables et méprisables qui peuplent le monde mesquin de la petite et de la grande bourgeoisie.
À l'époque, le CCI avait riposté, parfois au jour le jour, à la campagne mensongère et usurpatrice du citoyen B jusqu'à ce que, incapable de réfuter l'exposition publique de ses manœuvres, celui-ci se résolve à disparaître politiquement. Malheureusement, les autres membres du NCI, profondément démoralisés par la façon dont ils avaient été utilisés et manipulés par le citoyen B. n'ont pas réussi à se relever et à poursuivre leur effort de réflexion, et ils ont fini par abandonner toute activité politique.
Quant à la FICCI, qui était mouillée jusqu'au cou dans cette affaire et qui avait beaucoup misé sur le citoyen B. pour discréditer le CCI, elle semble ne pas avoir tiré la leçon de cette mésaventure où elle s'est ridiculisée puisque, récemment, elle a de nouveau misé sur les agissements d'un autre aventurier.
Aujourd'hui, à la différence de l'épisode du citoyen B, ce n'est pas le CCI qui est visé spécifiquement par la politique de l'aventurier Gaizka mais bien toute la Gauche communiste[30] dont la réputation subira un préjudice politique si ce dernier n'est pas démasqué et ainsi mis dans l'impossibilité de nuire politiquement. Comme l'enseigne la tradition du mouvement ouvrier, et le vérifie l'expérience récente du CCI aux prises avec les manœuvres et la calomnie du citoyen B, il n'y a pas d'autre choix possible que celui de défendre l'honneur des organisations qui sont la cible d'attaques parasitaire et de l'action d'aventuriers[31], même si cela exige une énergie importante qui pourrait utilement être mise au service d'autres tâches organisationnelles[32].
A l'heure actuelle, dans plusieurs parties du Monde, nous assistons à l'émergence d'un intérêt croissant pour les positions de la Gauche communiste de la part de jeunes éléments. Et c'est ici que le GIGC et le Citoyen Gaizka ont un rôle à jouer. Non pas pour contribuer à la réflexion et à l'évolution de ces éléments vers la Gauche communiste mais au contraire pour mettre à profit leur inexpérience afin de les aguiller vers des impasses, de stériliser et détruire leur conviction militante.[33] Si le GIGC et Gaizka se réclament de la Gauche communiste c'est notamment pour piéger ces jeunes éléments au seul bénéfice de leurs intérêts sordides. Dans le cas du GIGC, il s'agit d'établir un cordon sanitaire autour du CCI afin d'étancher sa haine envers notre organisation. Dans le cas de Gaizka, il s'agit de satisfaire ses ambitions mégalomanes d'aventurier. Les motivations ne sont pas identiques mais si, comme en 2004, avec l'épisode du Citoyen B., on assiste à une convergence entre les parasites et les aventuriers, c'est évidemment qu'ils sont, chacun à leur façon, des ennemis mortels de la Gauche communiste, de ses traditions et de ses principes. Dans le difficile chemin vers la pleine compréhension de ces traditions et principes, il sera nécessaire, sur la base de toute l'expérience du mouvement ouvrier, de s'affronter aux manigances et aux pièges de ces ennemis patentés du mouvement ouvrier.
CCI (22 / 02 / 2021)
[1] "Nuevo Curso et la 'Gauche communiste espagnole' : Quelles sont les origines de la Gauche communiste ? [4]"
[2] "Qui est qui dans [5]Nuevo Curso [5] ? [5] et Gaizka se tait : un silence assourdissant [6]."
[3] Voir notre article "Lassalle et Schweitzer : la lutte contre les aventuriers politiques dans le mouvement ouvrier [7]".
[4] Voir "Nouvelle attaque du CCI contre le camp prolétarien international [8] (1er février 2020)". Le fait que parmi les groupes ou blogs se réclamant de la Gauche communiste seuls les spécialistes du dénigrement du CCI aient attaqué notre mise au point sur Monsieur Gaizka ou essayé de le défendre illustre bien le caractère irréfutable des informations que nous rapportons sur son compte.
[5] "Nouvelle attaque du CCI contre le camp prolétarien international [8] (1er février 2020)"
[6] "Lassalle et Schweitzer : la lutte contre les aventuriers politiques dans le mouvement ouvrier [7]"
[7] "Qui est qui dans Nuevo Curso ? [5]" ; "Gaizka se tait : un silence assourdissant [6]" ; "Questions d'organisation, IV : la lutte du marxisme contre l'aventurisme politique [9]"
[8] Dans lesquelles une méthode du combat politique de ce regroupement de mécontents tient en ces quelques mots : "Il faut les déstabiliser", la "cible" de cette déstabilisation étant bien sûr tous ceux qui ne partageaient pas leur démarche hostile au CCI et de dénigrement ignoble de certains de ses militants.
[9] Voici une liste non exhaustive de ces articles :
"Conférence extraordinaire du CCI : Le combat pour la défense des principes organisationnels [10]" ; Revue Internationale n° 110.
"Communiqué à nos lecteurs : le CCI vient d'exclure un de ses membres [11]", publié dans Révolution Internationale n° 321, mars 2002.
"Défense de l'organisation : les méthodes policières de la 'FICCI'" [12], Révolution Internationale n° 330, janvier 2003.
"Les réunions publiques du CCI interdites aux mouchards [13], Révolution Internationale n° 338, septembre 2003.
"Intervention de la FICCI à la Fête de 'Lutte Ouvrière' : Le parasitisme au service de la bourgeoisie [14]", Révolution Internationale n° 348, juillet 2004).
"Défense de l'organisation : Des menaces de mort contre des militants du CCI [15]", Révolution Internationale n° 354, février 2005.
[10] Lire "XV [16]e [16] Congrès du CCI : Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période [16]" ; Revue internationale n° 114 - Avril 2003.
[11] Ce sont les véritables initiales de ce camarade obligeamment fournies à la police par la FICCI !
[12] MC (Marc Chirik – mai 1907, décembre 1990) fut le principal fondateur du CCI auquel il a apporté toute une expérience de militant révolutionnaire au sein de l'Internationale communiste, de l'Opposition de Gauche et de la Gauche communiste (Gauche italienne et Gauche communiste de France). "Avec Marc, ce n'est pas seulement notre organisation qui perd son militant le plus expérimenté et le plus fécond ; c'est tout le prolétariat mondial qui se trouve privé d'un de ses meilleurs combattants." C'est en ces termes que nous introduisions le premier des deux articles écrits en hommage à la vie militante de notre camarade. Lire à ce propos les articles "Marc : De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale [17]" et "Marc : De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle [18]" publiés dans les n° 65 et 66 de la Revue internationale.
[13] Une commission spéciale nommée par le CCI, constituée de militants expérimentés, avait examiné toutes les "preuves" apportées par les accusateurs de Louise et avait conclu à leur complète absurdité. Louise avait demandé elle-même une confrontation avec ses principaux accusateurs. Celle avec Olivier avait permis de mettre en évidence la bouillie qui avait envahi le cerveau de celui-ci et qui l'avait d'ailleurs conduit à changer complètement de position au moins trois fois en quelques semaines avant qu'il ne devienne un des principaux fondateurs de la FICCI qu'il a quittée par la suite pour suivre son propre chemin. Quant à Jonas, incontestablement le plus intelligent de la bande mais aussi le plus lâche, il a carrément refusé une telle confrontation.
[14] Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, devenu suite à un changement de nom l'actuelle Tendance communiste internationaliste.
[15] Voir "Défense de l'organisation - Le PCI (Le Prolétaire) à la remorque de la 'fraction' interne du CCI"
[16] Voir "Les réunions publiques du CCI interdites aux mouchards" ; Révolution Internationale n° 338, septembre 2003.
[17] Voir "Défense de l'organisation : Des menaces de mort contre des militants du CCI [15]", Révolution Internationale n° 354, février 2005.
[18] Lire à ce propos notre article "'Fraction interne [19]' [19] du CCI : Tentative d'escroquerie vis-à-vis de la Gauche Communiste [19]" ; Revue Internationale n° 112.
[19] Pour que le CCI se mette en dehors du camp prolétarien il faudrait qu'il trahisse les principes fondamentaux de ce dernier tels que l'internationalisme, la perspective de la révolution communiste, le refus de soutien à toutes les institutions de l'appareil politique de la classe dominante (syndicats, partis politiques, démocratie bourgeoise, etc.). La FICCI-GIGC est bien en peine pour trouver de telles trahisons dans nos prises de position et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle ne peut éviter de faire figurer notre organisation dans la liste des "Groupes et organisations du Camp prolétarien" qui se trouve sur son site Internet. Cela dit, l'appartenance au camp prolétarien ne se réduit pas au rejet des positions politiques bourgeoises. Elle se base aussi sur un combat déterminé contre les comportements propres à la classe dominante et dont le stalinisme a été une des plus pures incarnations ; le mensonge systématique, le gangstérisme, les méthodes policières, c'est-à-dire des comportements qui sont au cœur de l'activité des voyous et mouchards de la FICCI-GIGC.
[20] Elle a le culot de se revendiquer du combat organisationnel mené par le camarade MC durant toute sa vie et notamment lorsqu’il militait dans la Fraction italienne des années trente. C'est ainsi qu'elle déclare, dans le numéro 29 de son "Bulletin communiste" : "Notre conception de l’organisation est celle qu’a toujours défendue MC".
[21] Pour des illustrations du niveau de la critique de la part de la FICCI, et d'autres, de notre analyse de la phase de décomposition, phase ultime du capitalisme, le lecteur pourra se reporter à l'article suivant : "Les racines marxistes de la notion de décomposition [20]" de la Revue internationale n° 117. Concernant plus spécifiquement la FICCI, le lecteur pourra se reporter à l'article "Sur la théorie de la décomposition du CCI [21]", bulletin n° 4 de la FICCI, février 2011. Dans ce texte, les membres de la FICCI font une nouvelle fois la preuve de leur malhonnêteté : plutôt que de reconnaître qu'ils remettent en cause la position qu'ils avaient défendue pendant plus de dix dans le CCI, ils prétendent que leur nouvelle "analyse" est dans la continuité de cette position. C'est ainsi qu'on peut lire : "... comment nous avions avancé la question de la décomposition [au sein du CCI] : comme un blocage entre les classes, aucune des deux classes n'étant capable d'imposer sa perspective. Le 11 septembre manifeste le fait que la bourgeoisie est contrainte de rompre cet 'équilibre' et de forcer le passage : la marche à la guerre. (...) Dire, en 2002, que la bourgeoisie cherche à débloquer la situation 'd'équilibre' des années 1990 signifie que le 'blocage décomposant' disparaît." En d'autres termes, la phase de décomposition n'aurait été qu'un moment circonstentiel et réversible qui aurait pu être dépassé avec une nouvelle configuration de la politique impérialiste de la bourgeoisie. En réalité, l'analyse du CCI partagée par les membres de la FICCI quand ils étaient dans notre organisation dit exactement le contraire : "Le cours de l'histoire est irréversible : la décomposition mène, comme son nom l'indique, à la dislocation et à la putréfaction de la société, au néant." (Thèses : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [22] (Revue internationale n° 107)
[22] Nous ne pouvons que recommander à nos lecteurs qui ne l'auraient pas encore fait la lecture (ou la relecture) de nos thèses sur le parasitisme [23], Revue internationale n° 94.
[23] C’est-à-dire et avant tout aux préjugés de notre époque.
[24] "Les nouvelles calomnies de la FICCI [24]", mis en ligne le 18 novembre 2006.
[25] Lire à ce propos nos articles "La prétendue 'solidarité du CCI avec les CRS' : comment la FICCI essaie de masquer ses propres comportements policiers" [25].
[26] Lire "Communiqué à nos lecteurs : le CCI attaqué par une nouvelle officine de l’État bourgeois [26]" ; Révolution Internationale n° 446 – mai-juin 2014.
[27] Le Núcleo Comunista Internacional : Un effort de prise de conscience du prolétariat en Argentine [27]. Revue internationale n° 120.
[28] Publiée dans Révolution internationale n° 350 et dans Acción proletaria n° 179.
[29] Lire à ce propos les articles suivants : Le Núcleo Comunista Internacional : Un effort de prise de conscience du prolétariat en Argentine [27] ; À propos de la FICCI - Prise de position de militants en Argentine [28] ; Nouvelles d’Argentine : Le NCI n'a pas rompu avec le CCI ! [29]
[30] Gaizka "s'intéresse" à la Gauche communiste, en affichant de la bienveillance vis-à-vis d'elle –pour mieux la torpiller- et vis-à-vis de certains groupes qui la composent. Ainsi, dans un courrier que nous adressait Gaizka il y a quelques années, il nous informait de l'importance de l'existence politique qu'il accordait au CCI et à la TCI, et même de l'influence positive qu'avait eue le CCI sur sa propre évolution. Cela est à prendre en compte, non pas pour relativiser la dangerosité de son action, mais au contraire pour mieux la comprendre et mieux appréhender la démarche de l'aventurier qu'il est. Voici comment il présentait son projet "Nuevo Curso" : Nous ne nous considérons pas comme un groupe politique, un proto-parti ou quelque chose comme ça... Au contraire, nous voyons notre travail comme quelque chose de "formatif", pour aider à la discussion sur les lieux de travail, parmi les jeunes, etc. et une fois qu’on a clarifié quelques éléments de base, servant de pont entre ces nouvelles personnes qui découvrent le marxisme et les organisations internationalistes (essentiellement la TCI et vous, CCI) qui, tel que nous le voyons, devraient être les agglutinants naturels du futur parti même si vous êtes très faibles maintenant (comme, bien entendu, la classe toute entière)." (7 novembre 2017 –Nuevo Curso à CCI)
[31] Les trois articles cités que nous avons écrits sur Nuevo Curso et Gaizka sont tous en défense de la Gauche communiste.
[32] Dans une Circulaire à tous les membres de l'Internationale, le Conseil Général de l'AIT déclarait qu'il était largement temps d'en finir une fois pour toutes avec les luttes internes causées par la "présence d'un corps parasitaire". Et il ajoutait : "En paralysant l'activité de l'Internationale contre les ennemis de la classe ouvrière, l'Alliance sert magnifiquement la bourgeoisie et ses gouvernements." Questions d'organisation, III : le congrès de La Haye de 1872 : la lutte contre le parasitisme politique [30] ; Revue Internationale n° 87
[33] Les grands combats menés par le prolétariat en Mai 1968 en France et par la suite dans de nombreux autres pays avaient provoqué l'émergeance de toute une génération d'éléments qui se tournaient vers la perspective de la révolution communiste tout en rejetant le stalinisme. Les groupes gauchistes, notamment maoïstes et trotskistes, avaient eu comme fonction historique de dévoyer vers des impasses l'espérance de ces éléments, de stériliser leur volonté militante, de les démoraliser et même d'en faire des adversaires déclarés de la perspective révolutionnaire (comme ce fut le cas avec Daniel Cohn Bendit). C'est le type de fonction qu'accomplissent aujourd'hui, à leur échelle, les groupes parasites et les aventuriers à l'égard des jeunes éléments qui s'approchent de la Gauche communiste.
Courants politiques:
Rubrique:
Qui est qui dans "Nuevo Curso" ?
- 522 lectures
Le prolétariat ne pourra libérer l’humanité des chaînes de plus en plus étouffantes du capitalisme mondial que si sa lutte est inspirée et fertilisée par la continuité historique critique de ses organisations communistes, ce fil historique qui va de la Ligue des Communistes en 1848 aux organisations actuelles se réclamant de la Gauche communiste. Privées de cette boussole, leurs réactions contre la barbarie et la misère imposées par le capitalisme seront condamnées à des actions aveugles et désespérées, qui peuvent conduire à une chaîne de défaites définitives.
Le blog de Nuevo Curso (NC) a la prétention de faire passer pour “Gauche communiste” l’œuvre de Munis qui n’a jamais vraiment réussi à rompre avec l’approche et les orientations erronées de l’Opposition de gauche qui finira par dégénérer en trotskysme, un courant qui depuis les années 1940 s’est clairement positionné dans la défense du capitalisme, avec ses grands frères, le stalinisme et la social-démocratie.
Nous avons répondu à cette prétention avec l’article “Nuevo Curso et la ‘Gauche communiste espagnole’ : Quelles sont les origines de la Gauche communiste ? [4]” en mettant en avant le fait que “le futur parti mondial, s’il veut apporter une réelle contribution à la révolution communiste, ne peut reprendre l’héritage de l’Opposition de Gauche. Il devra fonder son programme et ses méthodes d’action sur l’expérience de la Gauche communiste. (…) il existe un héritage commun de la Gauche communiste qui la distingue des autres courants de gauche qui ont émergé de l’Internationale Communiste. Pour cette raison, quiconque prétend appartenir à la Gauche communiste a la responsabilité de s’efforcer de connaître et de faire connaître l’histoire de cette composante du mouvement ouvrier, ses origines en réaction à la dégénérescence des partis de l’Internationale Communiste, les différents groupes qui sont liés à cette tradition ayant participé à sa lutte, les différentes branches politiques qui la composent (Gauche Italienne, Gauche germano-hollandaise, etc). En particulier, il est important de clarifier les contours historiques de la gauche communiste et les différences qui la distinguent d’autres courants de gauche, en particulier le courant trotskyste”.
Cet article écrit en août 2019 a été totalement ignoré par Nuevo Curso. Le son de son silence a résonné fort aux oreilles de tous ceux d’entre nous qui défendent l’héritage et la continuité critique de la Gauche communiste. Ceci est encore plus choquant alors que Nuevo Curso publie chaque jour un nouvel article qui traite de tous les sujets imaginables, depuis Netflix ou le message de Noël du roi d’Espagne, jusqu’à l’origine de la fête de Noël. Cependant, il n’a pas jugé nécessaire de consacrer quoi que ce soit à quelque chose d’aussi vital que la justification argumentée de sa prétention à faire passer pour Gauche communiste la continuité plus ou moins critique de Munis avec l’Opposition de gauche qui a donné naissance au trotskysme.
À la fin, notre article posait la question suivante : “Peut-être s’agit-il du culte sentimental d’un ancien combattant prolétarien [Munis]. Si tel est le cas, il faut dire que c’est une entreprise destinée à créer plus de confusion car ses thèses, transformées en dogmes, ne feront que distiller le pire de ses erreurs (…) Une autre explication possible est que la Gauche communiste authentique est attaquée avec une “doctrine” de spam (…) en utilisant les matériaux de ce grand révolutionnaire. Si tel est le cas, c’est l’obligation des révolutionnaires de combattre une telle imposture avec le maximum d’énergie”.
Le pire dans la défaite de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23, c’est la gigantesque adultération perpétrée par le stalinisme en la faisant passer pour du “communisme”, du “marxisme” et des “principes prolétariens”. Les organisations révolutionnaires d’aujourd’hui ne peuvent pas permettre que tout l’héritage qui a été durement développé pendant presque un siècle par la Gauche communiste soit remplacé par une doctrine de spam basée sur la confusion et la gangrène opportuniste que l’Opposition de Gauche fut. Ce serait un coup brutal porté à la perspective de la révolution prolétarienne mondiale.
Les origines de Nuevo Curso
En septembre 2017, nous avons découvert un site web (blog) d’un groupe appelé Nuevo Curso,[1] qui s’est d’abord présenté comme étant intéressé par les positions de la Gauche communiste et ouvert au débat. C’est du moins ce que NC disait dans sa réponse à la première lettre que nous, CCI, leur avons envoyée. Voici leur réponse :
-
"… Nous ne nous considérons pas comme un groupe politique, un proto-parti ou quelque chose comme ça… Au contraire, nous voyons notre travail comme quelque chose de “formatif”, pour aider à la discussion sur les lieux de travail, parmi les jeunes, etc. et une fois qu’on a clarifié quelques éléments de base, servant de pont entre ces nouvelles personnes qui découvrent le marxisme et les organisations internationalistes (essentiellement la TCI et vous, CCI) qui, tel que nous le voyons, devraient être les agglutinants naturels du futur parti même si vous êtes très faibles maintenant (comme, bien entendu, la classe toute entière)".[2]
Cette approche a disparu quelques mois plus tard, sans la moindre explication détaillée et convaincante et peu de temps après, cependant, NC déclarait être la continuation d’une soi-disant Gauche communiste espagnole dont les origines seraient Munis et son groupe, le FOR.[3] Nous avons déjà mis en avant le fait que cette prétendue filiation n’est qu’une confusion entre la Gauche communiste et le trotskysme, et que du point de vue de la continuité des principes politiques, les positions du NC ne sont nullement en continuité avec celles de la Gauche communiste, mais avec celles du trotskysme, ou, dans le meilleur des cas, des tentatives de rupture avec celui-ci.[4] Il n’y a donc pas de continuité programmatique de NC avec la Gauche communiste.
Mais qu’en est-il de la continuité organique ? C’est ce qu’ils disaient eux-mêmes au début :
-
“Sous le blog et ‘l’École du marxisme’, nous sommes un petit groupe de cinq personnes qui ont travaillé et vécu ensemble pendant quinze ans dans une coopérative de travail qui fonctionne comme une communauté de biens. C’était notre façon de résister à la précarité et de gagner notre vie. Et aussi pour maintenir un mode de vie où nous pourrions discuter, apprendre et être utiles à nos familles et nos amis dans une période difficile”. (idem)
Et comme ils le reconnaissent aussi, leur activité principale était loin d’être la critique marxiste ; elle consistait en général, en l’absence d’une plus grande concrétisation, à consacrer leurs efforts “à rendre possible un travail organisé de manière productive (un nouveau mouvement coopératif ou communitariste qui rendrait évidente la possibilité technologique d’une société démercantilisée, c’est-à-dire communiste)".[5] (idem)
D’autre part, en plus de ce noyau central, et provenant apparemment des dynamiques différentes de réflexion et de discussion, différents groupes de jeunes ont convergé vers ce groupe dans plusieurs villes.[6]
Ce qui est surprenant c’est comment avec de tels éléments, le site Internet de NC ait pu se présenter dès le début en se référant aux positions de la Gauche communiste. L’un des éléments qui y contribuent est également expliqué dans sa lettre :
-
“L’un d’entre nous [c’est-à-dire du noyau coopérativiste], Gaizka,[7] qui fut l’un de vos anciens contacts dans les années 1990, et dont, comme il le dit lui-même, la tête s’est bien remplit en apprenant le marxisme avec vous. Le fait de compter sur lui et sur la bibliothèque qu’il a amenée avec lui a été une partie importante de notre processus”. (Idem)
Effectivement. Ce “membre coopérativiste” s’est présenté en décembre 2017 lors de notre réunion publique à Madrid à l’occasion du centenaire de la Révolution russe, et s’est avéré être une vieille connaissance, surnommée Gaizka, qui dans les années 1990 a eu une discussion programmatique avec le CCI. A la fin de la rencontre, il nous a informés qu’il était en contact avec un groupe de jeunes, auxquels “il donnait une formation marxiste”, et nous a encouragés à reprendre contact.
Notre réponse à sa proposition de reprendre contact a été qu’il devait d’abord clarifier certains comportements politiques qu’il n’a pas été en mesure d’expliquer dans les années 1990, et qui l’ont impliqué dans des attitudes carriéristes et dans une relation tenue avec le PSOE [8] en même temps qu’il se revendiquait des positions de la Gauche communiste.[9]
Il n’a pas répondu en décembre (2017), ni après, aux 4 lettres que nous lui avons envoyées dans le même sens. C’est pourquoi, suivant la tradition prolétarienne d’arriver à une clarté sur ce type d’épisodes douteux qui restent obscurs, nous avons continué à demander des explications.
Parce que, en l’absence de ces explications, le suivi de son activité politique [10] depuis notre rencontre montre un lien maintenu principalement avec le PSOE.
La “trajectoire tortueuse " de Gaizka
1992-1994, contact avec le CCI, fuite et dérobade
En 1992, Gaizka a pris contact avec le CCI en se présentant comme membre d’un groupe appelé “Unión Espartaquista”, qui prétendait défendre les positions de la Gauche communiste allemande (des positions qui aujourd’hui ne semblent plus lui plaire). En réalité, c’était essentiellement lui et sa compagne.[11] Leur connaissance des positions et des traditions de la gauche communiste était plus une aspiration qu’une réalité.
Dès le début, il s’est montré intéressé à rejoindre rapidement notre organisation, se sentant mal à l’aise lorsque les discussions s’allongeaient à cause des nécessaires éclaircissements, ou lorsque certains de ses comportements étaient mis en question – en particulier concernant un autre élément qui avait rejoint un cercle de discussions à Madrid, auquel une délégation de Battaglia Comunista a également participé de façon ponctuelle.
La discussion sur sa trajectoire politique avait posé également problème. Bien qu’il nous ait informés qu’il avait été en contact avec les Jeunesses Socialistes (du PSOE), il montrait une sorte de fascination pour l’expérience des kibboutz,[12] et un discours qui semblait parfois le relier à Borrell [13] et au lobby socialiste pro-israélien [14]. Par ailleurs, Gaizka n’avait jamais non plus clarifié sa relation organique avec le PSOE ou sa rupture.[15]
En 1994, dans le CCI, il y a eu des débats sur le problème du poids de l’esprit du cercle dans le mouvement ouvrier depuis 1968 et sur l’affinitarisme sous couvert des projets de vie “communautaristes”. Au cours des discussions sur nos principes d’organisation, nous avions présenté à Gaizka nos positions sur tout cela. Et c’est peut-être pour cette raison que, lorsque nous lui avons demandé directement des explications sur les aspects qui nous semblaient peu clairs sur sa trajectoire [16], de prime abord il n’a pas été surpris du tout, bien que nous ayons présenté cette rencontre comme une confrontation enregistrée (nous n’avions jamais enregistré une discussion avec lui auparavant). Et puis, il n’a tout simplement pas donné d’explication et a disparu du milieu de la Gauche communiste… Jusqu’à maintenant !
Un lien maintenu avec le PSOE
Ce qui pose des questions dans la trajectoire politique de Gaizka n’est pas le fait qu’à un certain moment, il a été sympathisant ou militant des Jeunesses socialistes et qu’il ne l’ait pas dit clairement ; ce qui mérite une explication c’est le fait que, malgré sa prétendue conviction dans les positions de la Gauche communiste, l’histoire de sa vie est pleine de traces qui montrent une relation politique avec des personnages qui sont ou ont été de hauts fonctionnaires du PSOE.
En 1998-99, il participe en tant que “conseiller”, sans jamais préciser ce que cela signifie, à la campagne de Borrell pour les primaires du PSOE, comme c’est indiqué dans certaines de ses propres comptes rendus sur le web. Un de nos militants l’a vu à la télévision dans les bureaux du candidat [17]. Gaizka a essayé de minimiser la question en disant qu’il n’était là-dedans que tout juste le “garçon de courses” de la campagne, quelqu’un que Borrell n’aurait même pas remarqué. Mais la vérité est que certains dirigeants du PSOE, comme Miquel Iceta [18] par exemple, disent publiquement qu’ils ont rencontré Gaizka dans cette campagne. Et il ne semble pas très logique que les hauts cadres du PSOE soient allés demander à Borrell de leur présenter le garçon de courses.
En plus, au cours de ces mêmes années, Gaizka a également participé à une “Mission humanitaire” du Conseil européen pour l’action humanitaire et la coopération de l’UE [19] au Kosovo aux côtés de David Balsa, président en exercice de la Conférence euro-centraméricaine, puis président du Conseil européen pour l’action humanitaire et la coopération, ancien dirigeant des Jeunesses socialistes et ancien membre de l’exécutif du Parti socialiste galicien. Dans une lettre au Parti radical italien, Gaizka dit de lui que c’est “le garçon qui est allé en Albanie à ma place”.
Au-delà de ce que cela peut suggérer en ce qui concerne le soupçon d’une relation entre Gaizka et le PSOE, plus étroite qu’il ne l’a jamais reconnu, cela implique une participation active à une guerre impérialiste sous couvert “d’action humanitaire” et de “droits de l’homme”.[20]
En 2003, il conseille également la campagne de Belloch [21] du PSOE à la mairie de Saragosse, et là, cette fois-ci, il reconnait : “J’ai été très impliqué dans la campagne du maire, Juan Alberto Belloch, pour redéfinir la ville comme un espace urbain, en tant que paysage économique, où peut se développer ce type d’entreprises liées à de véritables communautés, très transnationalisées et hyperconnectées”.
En 2004, après les attentats du 11 mars et la victoire électorale du PSOE, Rafael Estrella préface un livre de Gaizka avec des éloges et des louanges pour ses qualités. Ce monsieur était membre du PSOE, porte-parole de la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés et président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [22]. Le livre souligne l’incompétence du PP à comprendre les attaques d’Atocha, mais il n’y a pas une seule critique au PSOE. Felipe Gonzalez lui-même le cite à l’occasion.
Ce même député du PSOE deviendra plus tard ambassadeur d’Espagne en Argentine à partir de 2007 (jusqu’en 2012) et invitera Gaizka à présenter son livre à l’ambassade, le mettant en contact avec les milieux politiques et économiques de ce pays.
Un autre “parrain” qui a joué un rôle important dans l’aventure sud-américaine de Gaizka était Quico Mañero, dont il a dit dans une dédicace d’un autre de ses livres : “A Federico ‘Quico’ Mañero, ami, connecteur des mondes et tant de fois maitre, qui nous pousse depuis des années à “vivre dans la danse” des continents et des conversations, nous recevant et prenant soin de nous dans chaque lieu où nous débarquons. Sans lui, nous n’aurions jamais pu vivre comme des néo-vénitiens”.
Voilà ce que dit Izquierda Socialista (courant de gauche du PSOE) de ce monsieur :
-
“La partie du REPSOL [23] détenue par l’Argentine est l’affaire de Monsieur Quico Mañero, ex-mari d’Elena Valenciano,[24] leader historique du PSOE (secrétaire général de la jeunesse socialiste), conseiller et repreneur d’entreprises proche de Felipe González, nommé en 2005 membre du conseil d’administration argentin de Repsol-YPF. Il fait actuellement l’objet d’une enquête pour le scandale Invercaria et les fonds andalous “des reptiles” [scandale financier], dont il a reçu 1,1 million d’euros”.[25]
Pendant la même période, en 2005, Gaizka a travaillé pour la Fondation Jaime Vera du PSOE, qui est traditionnellement une institution de formation pour les cadres politiques du parti, et il semble qu’à partir de 2005, celle-ci a commencé un programme international de formation pour cadres dans le but de gagner en influence au-delà des frontières espagnoles. Dans ce contexte, Gaizka participe à la formation des cyberactivistes K en Argentine, qui ont soutenu la campagne de Cristina Kirchner en 2007, quand elle est devenue présidente du gouvernement :
-
“L’idée est née il y a deux ans, d’un accord politique du gouvernement. C’était en 2005, parmi une vingtaine de jeunes sélectionnés par la Casa Rosada [siège de la présidence argentine] pour être formés à la Fondation Jaime Vera, l’école de gouvernement des dirigeants du PSOE, le parti socialiste espagnol. Il y avait les créateurs du cyberactivisme K : le militant Sebastián Lorenzo (www.sebalorenzo.com.ar [32]) et Javier Noguera (“nogueradetucuman.blogspot.com”), secrétaire du gouvernement de José Alperovich, gouverneur du Tucumán”.
-
“Nous avons été stupéfaits lorsqu’ils ont parlé de blogs et de réseaux sociaux ", a déclaré Noguera au journal La Nacion. C’était la moindre des choses : le “professeur” espagnol était la référence mondiale du cyberactivisme… Le même qu’il y a un mois, accompagné de l’ambassadeur Rafael Estrella, a présenté à Buenos Aires son nouveau livre”. (voir précédemment, NdR) [26]
Au cours de la décennie des années 2010 et surtout après la défaite électorale du PSOE, il y a moins de preuves d’engagements avec ce parti.
… et ponctuel avec le libéralisme de droite
En effet, avant la victoire du PSOE en 2004, Gaizka essaye de tirer la couverture du PP vers lui, et collabore cette fois-ci avec la jeunesse du PP, dans la création du liberales.org, qui, selon les mêmes termes des organisateurs servirait à “créer un répertoire dans lequel mettre un peu d’ordre dans le libéralisme hispanique présent sur Internet. Ce week-end, nous nous sommes mis au travail et, après plusieurs heures devant l’ordinateur, nous avons cartographié ce qui existe sur Internet, produit des différentes familles libérales et libertaires (à ne pas confondre avec les anarchistes), parfois antagonistes. C’est ainsi qu’est né LosLiberales.org, un projet non partisan pour les libéraux et ceux qui s’intéressent à ce type de pensée…".[27]
Ce manège comprenait des types tels que Jiménez Losantos [28] et son journal Libertad digital, pour lequel Gaizka a écrit plusieurs articles, ou les libéraux-conservateurs chrétiens, dont les auteurs eux-mêmes ne savaient pas s’ils devaient être considérés comme libéraux ou d’extrême droite.
Comme le dit le journaliste Ignacio Escolar [29] dans le livre La blogosphère espagnole, ce club “n’a pas duré longtemps. Des désaccords idéologiques et personnels entre les fondateurs ont mis fin au projet”.
Que fait quelqu’un comme Gaizka dans un lieu comme la Gauche communiste ? [30]
L’examen du curriculum vitae politique de Gaitzka montre clairement sa relation étroite avec le PSOE. Le PSOE, depuis qu’il a définitivement abandonné le camp prolétarien lors du Congrès extraordinaire d’avril 1921,[31] a un long passé au service de l’Etat capitaliste : sous la dictature de Primo de Rivera (1923-30), son syndicat, l’UGT, était le mouchard de la police trahissant de nombreux militants de la CNT et un ponte du conglomérat PSOE-UGT, Largo Caballero, fut conseiller du dictateur. En 1930, le PSOE tourna rapidement sa veste et se mit à la tête des forces qui, en 1931, établirent la Deuxième République, où il fut chef du gouvernement en coalition avec les Républicains de 1931 à 1933. Il est à noter qu’au cours de ces deux années, 1500 travailleurs ont été tués dans la répression des grèves et des tentatives insurrectionnelles. Plus tard, le PSOE fut l’axe du gouvernement du Front populaire qui dirigea l’effort de guerre, la militarisation et donna carte blanche à la meute stalinienne pour réprimer l’insurrection ouvrière de Barcelone en mai 1937. Avec le rétablissement de la démocratie en 1975, le PSOE a été l’épine dorsale de l’État, étant le parti qui a été à la tête du gouvernement le plus longtemps (1982-1996, 2004-2011 et depuis 2018). Les mesures les plus brutales contre les conditions de la classe ouvrière ont été imposées par les gouvernements du PSOE, soulignant les plans de reconversion des années 1980 qui ont impliqué la perte d’un million de postes de travail ou le programme de coupes sociales que le gouvernement du PSOE de Zapatero avait lancé et que le gouvernement PP de Rajoy allait ensuite poursuivre.
C’est avec ce bastion de l’Etat bourgeois que Gaizka a collaboré ; il ne s’agit pas du tout de relations avec des “éléments de base”, plus ou moins dupés, mais avec de hauts responsables du Parti, ni plus ni moins qu’avec Borrell qui vient d’être nommé responsable de la politique étrangère de la Commission européenne, avec Belloch qui était ministre de l’intérieur, avec Estrella qui était président de l’assemblée parlementaire de l’OTAN.
Dans le curriculum vitae de Gaizka, on ne trouve pas la moindre trace de conviction ferme dans les positions de la Gauche communiste, et pour être clairs, même pas qu’il ait des convictions politiques d’aucune sorte, puisqu’il n’a pas hésité à flirter pendant un moment avec le camp de la droite. Le “marxisme” de Gaizka appartiendrait plutôt au “groucho-marxisme” : souvenons-nous du célèbre comédien Groucho Marx lorsqu’il disait que “Voilà mes principes, s’ils ne vous plaisent pas, j’en ai d’autres dans ma poche”.
C’est pourquoi la question est : qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui Gaizka prétende créer avec Nuevo Curso un lien “historique” avec une soi-disant Gauche communiste espagnole ? Qu’est-ce que ce monsieur a à voir avec ces positions, avec le combat historique de la classe ouvrière ?
Et en continuité avec cela, qu’est-ce qui fait qu’un groupe parasite comme le GIGC, dont certains militants étaient membres des organes centraux de la CCI en 1992-94, et qui étaient au courant du comportement de Gaizka, tout comme ils le sont aujourd’hui du fait qu’il est le principal animateur du Nuevo Curso, détournent leur regard, se taisent et essaient de cacher sa trajectoire et déclarent que ce groupe est le futur de la Gauche communiste et de choses de ce genre ?
-
“Nuevo Curso est un blog de camarades qui a commencé à publier depuis septembre dernier des prises de position régulières sur la situation et sur des questions plus larges, voire théoriques. Malheureusement, elles ne sont qu’en espagnol. L’ensemble des positions qu’il défend sont très clairement de classe et se situent dans le cadre programmatique de la Gauche communiste… nous sommes très favorablement impressionnés, non seulement par leur rappel sans concession des positions de classe, mais surtout par la qualité “marxiste” des textes des camarades…".[32]
-
“Ainsi, la constitution d’Emancipación comme groupe politique à part entière exprime le fait que le prolétariat international, bien que soumis et loin de pouvoir repousser a minima les attaques de tout ordre imposé par le capital, tend à résister par la lutte et à se dégager de l’emprise idéologique de ce dernier et que son devenir révolutionnaire reste d’actualité. Elle exprime la “vitalité” (relative) actuelle du prolétariat”.[33]
Dans la tradition du mouvement ouvrier, dont la continuité historique est aujourd’hui représentée par la Gauche communiste, les principes organisationnels, de fonctionnement, de comportement et d’honnêteté des militants sont aussi importants que les principes programmatiques. Certains des congrès les plus importants de l’histoire du mouvement ouvrier, comme le congrès de La Haye de l’AIT en 1872, ont été consacrés à cette lutte pour la défense d’un comportement prolétarien (et ce malgré le fait que le congrès ait eu lieu un an après la Commune de Paris et se trouvait face à la nécessité d’en tirer des leçons).[34] Marx lui-même a consacré une œuvre, qui lui a pris plus d’un an, interrompant son travail sur le projet du Capital, à la défense de ce comportement prolétarien contre les intrigues de M. Vogt, un agent bonapartiste qui a organisé une campagne de calomnies contre lui et ses camarades. Nous avons récemment publié un article sur la dénonciation par Bebel et W. Liebknecht du comportement malhonnête de Lassalle et Schweitzer.[35] Et au XXᵉ siècle, Lénine consacrait un livre – Un pas en avant deux pas en arrière – à tirer les leçons du 2ᵉ Congrès du POSDR sur le poids des comportements étrangers au prolétariat. On peut aussi citer Trotski, qui a fait appel à un jury d’honneur pour défendre son intégrité contre les calomnies de Staline.
Qu’un personnage ayant des liens étroits avec les hauts dirigeants du PSOE débarque soudainement dans le camp de la Gauche communiste devrait alerter tous les groupes et militants luttant pour les intérêts historiques de notre classe, y compris les participants au blog Nuevo Curso qui le font de bonne foi, croyant lutter pour les principes de la Gauche communiste.
En 1994, nous avons demandé à Gaizka de clarifier sa trajectoire et ses relations qui étaient déjà douteuses à l’époque. Il a disparu de la carte. En 2018, avec un sac à dos plein de contacts de “haut niveau” dans les sphères du PSOE, nous lui avons demandé à nouveau et il est resté silencieux. Pour la défense de la Gauche communiste, de son intégrité et de sa contribution future, nous devons lui demander des comptes.
CCI, 20 janvier 2020
[1] Depuis juin 2019, Nuevo Curso s’est en fait constitué en groupe politique sous le nom d’Emancipación, malgré le fait que son blog fonctionne toujours sous le nom de Nuevo Curso. Cette évolution n’affecte en rien le contenu de cet article.
[2] 7 novembre 2017 – De [email protected] [33] à [email protected] [34]
[3] Voir sur notre site, entre autres les articles : 1) À la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière [35] ; Revue internationale n° 58. 2) Polémique : où va le F.O.R. ? (“Ferment Ouvrier Révolutionnaire”) [36] ; Revue internationale n° 52. 3) Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskysme [37] (I) et (II) ; Revue internationale n° 161 et 162. 4) Crítica del libro Jalones de derrota Promesas de victoria [38] ; 5) Les confusions du “Fomento Obrero Revolucionario” sur Russie 1917 et Espagne 1936 [39] ; Revue internationale n° 25.
[4] Nuevo Curso et la “Gauche communiste espagnole”: Quelles sont les origines de la Gauche communiste ? [4] Revue internationale n° 163.
[5] Comprenne qui pourra ! De notre part, on ne va pas essayer de comprendre ce que ce genre d’activité signifie précisément. Qu’il suffise de dire pour l’instant que malgré les qualificatifs enjoués de “communiste”, cela n’a rien à voir avec une activité révolutionnaire ou vraiment communiste, comme on le reconnaît dans la lettre elle-même, quand on dit que pour avancer vers le marxisme, il faut partir de la critique de cette activité.
[6] “Mais depuis un an et demi ou deux ans, nous avons commencé à remarquer un changement autour de nous. On pouvait parler différemment et des dizaines de jeunes sont arrivés avec un esprit qui nous plaisait mais qui tombaient dans le stalinisme ou le trotskysme le plus folklorique” (de la lettre citée du NC, op. cit.).
[7] La lettre utilise le vrai nom ; ici, nous utilisons le surnom par lequel nous l’avons connu dans les années 1990.
[8] Partido Socialista Obrero Español [40]
[9] Cependant, nous n’avons eu aucun inconvénient – au contraire – à rencontrer les groupes de jeunes, et c’est ce que nous avons fait avec l’un d’eux en novembre 2018.
[10] Sous ses vrai nom et prénom, Gaizka est une figure publique sur le web, ce qui nous permet de suivre sa présence et sa participation à différentes initiatives politiques. Et en même temps, cela explique le fait que nous ne puissions pas fournir toute la documentation ici sans révéler son identité.
[11] Au début, il y avait d’autres personnes qui ont abandonné le groupe.
[12] Cette fascination reste aujourd’hui dans le discours le plus récent de Gaizka, mais elle est déguisée en défense des expériences communautaires du kibboutz, en particulier dans sa première phase au début du XXᵉ siècle, sans référence au rôle politique qu’il a joué dans les intérêts impérialistes de l’Etat d’Israël. “Les ‘indianos’ (c’est-à-dire la commune de Gaizka, NdR) sont des communautés similaires au kibboutz (il n’y a pas d’épargne individuelle, les coopératives elles-mêmes sont sous contrôle collectif et démocratique, etc.) mais il existe des distinctions importantes, telles que l’absence d’une idéologie nationale ou religieuse partagée, distribuée dans plusieurs villes au lieu de se concentrer dans quelques installations et la compréhension du fait que certains critères dépassent la rationalité économique”. (Extrait d’une interview avec Gaizka)
[13] Ingénieur aéronautique et économiste de formation, Borrell est entré en politique dans les années 1970 en tant que militant du PSOE pendant la transition espagnole, et a occupé divers postes de responsabilité au sein des gouvernements de Felipe González, d’abord au de l’Économie et des Finances en tant que secrétaire général du budget et des dépenses publiques (1982-1984) et secrétaire d’État aux Finances (1984-1991) ; puis au Conseil des ministres avec le portefeuille d’Industrie et Transport. Dans l’opposition après les élections générales de 1996, Borrell est devenu inopinément en 1998 le candidat choisi par le PSOE pour la présidence du gouvernement, mais il a démissionné en 1999. Dès lors, axé sur la politique européenne, il devient membre du Parlement européen pour la période 2004-2009 et devient président de la chambre durant la première moitié de la législature. Après s’être retiré de la première ligne politique, il est revenu au Conseil des ministres en juin 2018, avec sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération dans le gouvernement présidé par Pedro Sánchez. (source : Wikipédia). Depuis peu, il est le Commissaire aux Affaires Étrangères de l’Europe.
[14] Borrell était en 1969 dans un kibboutz et sa première femme et mère de ses deux enfants est d’origine juive. Il est connu comme défenseur des intérêts pro-israéliens au sein du parti socialiste.
[15] Ce n’est pas le seul rapport qui reste confus. Aujourd’hui, nous apprenons que dans la même période où il voulait discuter pour rejoindre le CCI, il participait et était le principal animateur en Espagne de la tendance appelée cyberpunk, et le promoteur du cyberactivisme.
[16] Parmi ceux-ci, il y avait le désir d’un mode de vie “communautaire”, qui explique sa fascination pour le kibboutz, et qui était présent dans l’Union Spartakiste, où il y avait la tentative de vivre en communauté.
[17] Dans les années 80, un élément appelé “Chenier” a été découvert et dénoncé dans notre presse comme un aventurier. Peu de temps après, on l’a vu travailler sous les ordres de Mitterrand. Cela nous a mis en alerte sur une possible relation entre Gaizka et le PSOE qui était plus étroite qu’il ne l’avait jamais reconnu.
[18] Secrétaire général actuel du PSC (Parti socialiste de Catalogne) ; militant des Jeunesses socialistes et du PSOE depuis 1978 ; en 1998-99 député de Barcelone au Congrès des députés.
[19] L’institution étant peu connue, voici une référence à sa fondation dans le quotidien Última Hora de Majorque, à partir d’un article de l’agence Efe : Un español preside el nuevo Consejo Europeo de Acción Humanitaria y Cooperación [41]
[20] La guerre en ex-Yougoslavie (les premiers bombardements et massacres en Europe après la Seconde Guerre mondiale) a été menée au nom de l'“humanitarisme”, et les frappes aériennes de l’OTAN ont été présentées comme “aidant la population” contre la guérilla. Pour connaître notre position sur le conflit impérialiste de 1999 au Kosovo, consultez notre site : La “paix” au Kosovo, un moment de la guerre impérialiste [42].
[21] Juan Alberto Belloch a été ministre de la Justice et de l’Intérieur avec Felipe González (1993-1996) avant de se présenter á la mairie de Saragosse.
[22] Asamblea Parlamentaria de la OTAN [43]
[23] REPSOL est l’entreprise espagnole leader dans l’extraction, le raffinage et la commercialisation du pétrole et de ses dérivés. Elle a une présence internationale importante, notamment en Amérique du Sud
[24] Dirigeant du PSOE et numéro deux d’Alfredo Pérez Rubalcaba, ministre de l’Intérieur décédé et authentique “Richelieu” des gouvernements socialistes, qui a forcé les contrôleurs aériens à travailler sous la menace d’une mitraillette.
[25] "PATRIOTAS POR DIOS, POR LA PATRIA Y REPSOL".
[26] Journal La Nación – Argentine.
[27] Ce blog n’existe plus, mais cette citation peut être vue en captures d’écran
[28] Journaliste d’origine maoïste militant de Bandera Roja et du parti stalinien en Catalogne (PSUC), qui soutient aujourd’hui Vox et l’aile la plus à droite du PP. Il a écrit pour ABC et El Mundo et a été speaker à la radio COPE. Il est actuellement animateur du journal Libertad digital et sa radio es.radio.
[29] Fondateur du journal Público qu’il abandonna par la suite pour promouvoir Diario.es dont il est le responsable principal. Il est analyste dans les talk-show de la chaine TV “La Sexta”.
[30] "¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?” (Mais que fait donc une fille comme toi dans un lieu comme celui-ci ?) Expression tirée d’une chanson du groupe madrilène Burning qui a eu un grand succès dans les années 80, à tel point qu’un film en a été tiré (de Fernando Colomo et en vedette Carmen Maura).
[31] Dans ce congrès, il y a eu la séparation des tendances prolétariennes qui résistaient encore dans le PSOE, bien qu’il faille reconnaître qu’elles étaient très confuses (centristes). Le thème de ce congrès était l’adhésion ou non à la Troisième Internationale, qui a été rejetée par 8269 mandats contre 5016 partisans de l’adhésion. Ces derniers ont quitté le congrès pour fonder le Parti communiste ouvrier espagnol.
[32] Révolution ou guerre no 9 (GIGC). De nouvelles voix communistes : Nuevo Curso (Espagne) et Worker’s Offensive (États-Unis)
[33] Révolution ou guerre nº 12. Lettre du GIGC à Emancipación sur son 1ᵉʳ Congrès.
[34] Questions d’organisation, III : le congrès de La Haye de 1872 : la lutte contre le parasitisme politique [30]
[35] Lassalle et Schweitzer : la lutte contre les aventuriers politiques dans le mouvement ouvrier [7]
Rubrique:
Nuevo Curso et la "Gauche communiste espagnole": Quelles sont les origines de la Gauche communiste ?
- 538 lectures
Introduction
La révolution communiste ne peut être victorieuse que si le prolétariat se dote d'un parti politique d'avant-garde à la hauteur de ses responsabilités, comme l'a fait le parti bolchevique lors de la première tentative révolutionnaire en 1917. L'histoire a montré combien il est difficile de construire un tel parti, une tâche qui exige des efforts nombreux et variés. Avant tout, elle exige la plus grande clarté sur les questions programmatiques et sur les principes de fonctionnement de l'organisation, une clarté qui se fonde nécessairement sur toute l'expérience passée du mouvement ouvrier et ses organisations politiques.
À chaque étape de l'histoire du mouvement, certains courants se sont distingués comme les meilleurs représentants de cette clarté, comme ceux qui ont apporté une contribution décisive à l'avenir de la lutte. C'est le cas du courant marxiste dès 1848, époque où de larges secteurs du prolétariat étaient encore fortement influencés par les conceptions de la petite bourgeoisie qui étaient vigoureusement combattues dans le chapitre 3 du Manifeste Communiste, "Littérature socialiste et communiste". Ce fut encore plus le cas au sein de l'Association Internationale des Travailleurs fondée en 1864 : " … cette Association qui s'était constituée dans un but précis - fondre en un tout les forces combatives du prolétariat d'Europe et d'Amérique ne pouvait proclamer d'emblée les principes posés dans le Manifeste. Le programme de l'Internationale devait être assez vaste pour qu'il fût accepté et par les trade-unions anglaises, et par les adeptes de Proudhon [44] en France, Belgique, Italie et Espagne, et par les lassaliens en Allemagne. Marx qui rédigea ce programme de façon à donner satisfaction à tous ces partis, s'en remettait totalement au développement intellectuel de la classe ouvrière, qui devait être à coup sûr le fruit de l'action et de la discussion commune (…) Et Marx avait raison. Quand, en 1874, l'Internationale cessa d'exister, les ouvriers n'étaient plus du tout les mêmes que lors de sa fondation en 1864 (…) À la vérité, les principes du Manifeste avaient pris un large développement parmi les ouvriers de tous les pays" (Engels, Préface à l'édition anglaise de 1888 du Manifeste Communiste [45])
Enfin, c'est au sein de la Deuxième Internationale, fondée en 1889, que le courant marxiste devient hégémonique, grâce notamment à son influence au sein du Parti Social-Démocrate en Allemagne. Et c'est au nom du marxisme que Rosa Luxemburg en particulier s'est engagée dans la lutte contre l'opportunisme qui, dès la fin du XIXe siècle, gagnait du terrain dans ce parti et dans l'ensemble de l'Internationale. C'est aussi au nom du marxisme que les internationalistes ont mené la lutte pendant la Première Guerre mondiale contre la trahison de la majorité des partis socialistes et qu'ils ont fondé en 1919, sous l'impulsion des bolcheviks, la Troisième Internationale, l'Internationale Communiste. Et quand, après l'échec de la révolution mondiale et l'isolement de la révolution en Russie, c'est le courant marxiste de la gauche communiste - représenté notamment par les gauches italienne et germano-hollandaise -qui a initié la lutte contre cette dégénérescence. Comme la plupart des partis de la Deuxième Internationale, ceux de la Troisième Internationale tombèrent finalement, avec le triomphe du stalinisme, dans le camp de l'ennemi capitaliste. Cette trahison, cette soumission des partis communistes à la diplomatie impérialiste de l'URSS, a provoqué de nombreuses réactions à côté de celles de la Gauche communiste. Certaines d'entre elles ont conduit à un retour "critique" dans le giron de la social-démocratie. D'autres ont tenté de rester dans le camp du prolétariat et de la révolution communiste, comme ce fut le cas, après 1926, avec l'Opposition de gauche animée par Trotsky, l'un des grands noms de la révolution d'octobre 1917 et fondateur de l'Internationale communiste.
Le Parti Communiste Mondial, qui sera à l'avant-garde de la révolution prolétarienne de demain, devra s'appuyer sur l'expérience et la réflexion des courants de gauche qui se sont dégagées de l'Internationale Communiste pendant sa dégénérescence. Chacun de ces courants a tiré ses propres leçons de cette expérience historique. Et ces enseignements ne sont pas tous équivalents. C'est ainsi qu'il y a de profondes différences entre les analyses et les politiques des courants de la Gauche Communiste apparus au début des années 1920 et le courant "trotskyste" apparu beaucoup plus tard et qui, tout en se situant sur un terrain prolétarien, était, dès ses origines, fortement marqué par l'opportunisme. Ce n'est évidemment pas un hasard si la majorité du courant trotskyste a rejoint le camp bourgeois face à l'épreuve de vérité de la Seconde Guerre mondiale, alors que les courants de la Gauche communiste restaient fidèles à l'internationalisme.
Par conséquent, le futur parti mondial, s'il veut apporter une réelle contribution à la révolution communiste, ne peut reprendre l'héritage de l'Opposition de Gauche. Il devra fonder son programme et ses méthodes d'action sur l'expérience de la gauche communiste
Il y a des désaccords entre les groupes actuels qui sont issus de cette tradition, et il est de leur responsabilité de continuer à affronter ces désaccords politiques, en particulier pour que les jeunes générations qui s’approchent puissent mieux comprendre leur origine et leur portée actuelle. C'est le sens des polémiques que nous avons déjà publiées et que nous continuerons à publier avec la Tendance Communiste Internationaliste et les groupes bordiguistes. Cependant, au-delà de ces différences, il existe un héritage commun de la Gauche communiste qui la distingue des autres courants de gauche qui ont émergé de l'Internationale Communiste. Pour cette raison, quiconque prétend appartenir à la Gauche Communiste a la responsabilité de s'efforcer de connaître et de faire connaître l'histoire de cette composante du mouvement ouvrier, ses origines en réaction à la dégénérescence des partis de l'Internationale Communiste, les différents groupes qui sont liés à cette tradition ayant participé à sa lutte, les différentes branches politiques qui la composent (Gauche Italienne, Gauche germano-hollandaise, etc). En particulier, il est important de clarifier les contours historiques de la gauche communiste et les différences qui la distinguent d'autres courants de gauche, en particulier le courant trotskyste. C'est le but de cet article.
° ° °
Sur le blog de Nuevo Curso, on peut lire un article qui tente d'expliquer l'origine de la Gauche Communiste : "Nous appelons Gauche Communiste le mouvement internationaliste qui va commencer à lutter contre la dégénérescence de la troisième Internationale, en cherchant à corriger les erreurs héritées du passé qui se reflètent dans son programme, à partir de 1928 face au triomphe du Thermidor[1] en Russie et au rôle contre-révolutionnaire de l'Internationale et des partis staliniens"[2]
Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Que la Gauche communiste a commencé sa lutte en 1928 ? Si c'est ce que pense Nuevo Curso, c'est faux puisque la Gauche communiste s'est élevée contre la dégénérescence de l'Internationale Communiste dès 1920-21, lors des deuxième et troisième Congrès de l'Internationale. Dans cette période agitée où se jouaient les dernières possibilités de la révolution prolétarienne mondiale, des groupes, des noyaux de la Gauche communiste en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Bulgarie, en Russie-même et plus tard en France et dans d'autres pays, ont mené une lutte contre l'opportunisme qui était en train de ronger totalement le corps révolutionnaire de la Troisième Internationale. Deux des expressions de cette Gauche communiste se manifestent clairement dans le Troisième Congrès de l' IC (1921), en faisant une critique sévère mais fraternelle des positions adoptées par l'Internationale :
- "C’est ainsi qu’au 3ème congrès de l’I.C., ceux que Lénine appelle les "gauchistes", regroupés au sein du KAPD, s’élèvent contre le retour au parlementarisme, au syndicalisme, et montrent en quoi ces positions vont à l’encontre de celles adoptées au 1er congrès qui tentaient de tirer les implications pour la lutte du prolétariat de la nouvelle période historique ouverte par la 1ère Guerre mondiale.
C’est aussi à ce congrès que la "Gauche italienne" qui dirige le Parti Communiste d’Italie réagit vivement - bien qu’en désaccord profond avec le KAPD - contre la politique sans principe d’alliance avec les "centristes" et la dénaturation des P.C. par l’entrée en masse de fractions issues de la social-démocratie"[3].
Dans le Parti bolchevik-même, "dès 1918, le "Kommunist" de Boukharine et d’Ossinsky, met en garde le parti contre le danger d’assumer une politique de capitalisme d’État. Trois ans plus tard, après avoir été exclu du parti bolchevik, le "Groupe Ouvrier" de Miasnikov mène la lutte dans la clandestinité en étroite liaison avec le KAPD et le P.C.O. de Bulgarie jusqu’en 24 où il disparaît sous les coups répétés de la répression dont il fait l’objet. Ce groupe critique le parti bolchevik sur le fait que celui-ci commence à sacrifier les intérêts de la révolution mondiale au profit de la défense de l’État russe, réaffirmant que seule la révolution mondiale peut permettre à la révolution de tenir en Russie" (idem).
Ainsi, sur des bases programmatiques profondes - bien qu'encore en cours d'élaboration - les différents courants de ce qui est devenu la Gauche communiste cherchaient une alternative claire face à la dégénérescence de l'Internationale Communiste en 1920-21. Ils ont fait des erreurs, car ils tâtonnaient souvent dans le noir face à des problèmes historiques majeurs. Cependant, pour Nuevo Curso, "on peut dire que l'époque historique de la Gauche communiste s'achève dans la décennie 1943-1953 quand les principaux courants qui ont maintenu une pratique internationaliste au sein de la Quatrième Internationale dénoncent sa trahison de l'internationalisme et configurent une nouvelle plate-forme qui part de la dénonciation de la Russie stalinienne en tant que capitalisme d'État impérialiste".
Ce passage nous dit, d'une part, que la IVe Internationale aurait été le foyer de groupes ayant "une pratique internationaliste", et, d'autre part, qu'après 1953 "le temps historique de la Gauche communiste aurait été épuisé". Examinons ces affirmations.
Qu'est-ce que la Quatrième Internationale et quels ont été les apports de ses origines, l'Opposition de Gauche ?
La Quatrième Internationale se constitue en 1938 à partir de l'Opposition de Gauche dont l'origine première se trouve en Russie avec le Manifeste des 46 en octobre 1923 auquel Trotsky allait adhérer et, au niveau international, avec l'apparition de groupes, individus et tendances qui depuis 1925-26 tentent de s'opposer au triomphe toujours plus écrasant du stalinisme dans les partis communistes.
Ces oppositions expriment une réaction prolétarienne incontestable. Cependant, cette réaction est confuse, faible et très contradictoire. Elle exprime plutôt un rejet épidermique et superficiel de la montée du stalinisme. L'Opposition en URSS, malgré ses batailles héroïques, "s’avère en fait incapable de comprendre la nature réelle du "phénomène stalinien" et “bureaucratique”, prisonnière qu’elle est de ses illusions sur la nature de l’État russe. C’est ainsi que, tout en critiquant les orientations de Staline, elle est partie prenante de la politique de mise au pas de la classe ouvrière par la militarisation du travail sous l’égide des syndicats. Elle se fait, elle aussi, le chantre du capitalisme d’Etat qu’elle veut pousser plus en avant par une industrialisation accélérée. Lorsqu’elle lutte contre la théorie du socialisme dans un seul pays elle ne parvient pas à rompre avec les ambiguïtés du Parti bolchevik sur la défense de la "Patrie soviétique". Et ses membres, Trotsky en tête, se présentent comme les meilleurs partisans de la défense "révolutionnaire" de la "patrie socialiste (…)elle se conçoit elle-même, non comme une fraction révolutionnaire cherchant à sauve garder théoriquement et organisationnellement les grandes leçons de la Révolution d’Octobre, mais comme une opposition loyale au Parti Communiste Russe, elle ne sortira pas d’un certain "manœuvrisme" fait d’alliances sans principes en vue de changer le cours d’un Parti presque totalement gangrené (c’est ainsi que Trotsky cherchera le soutien de Zinoviev et de Kamenev qui ne cessent de le calomnier depuis 1923[4])". ("Le trotskysme, fils de la contre-révolution").
Quant à l'Opposition de Gauche Internationale, "elle se réclame des quatre premiers congrès de l’I.C. Par ailleurs elle perpétue le "manoeuvrisme" qui caractérisait déjà l’Opposition de Gauche en Russie. Par beaucoup d’aspects cette Opposition est un regroupement sans principes de tous ceux qui, notamment, veulent faire une critique "de gauche" du stalinisme. Elle s’interdit toute véritable clarification politique en son sein et laisse à Trotsky, en qui elle voit le symbole vivant de la Révolution d’Octobre, la tâche de s’en faire le porte-parole et le "théoricien"" (idem).
Sur ces bases fragiles, l'Opposition de Gauche fonda en 1938 une "Quatrième Internationale" mort-née pour la classe ouvrière. Déjà dans les années 1930, l'opposition n'avait pas pu "résister aux effets de la contre-révolution qui se développe à l'échelle mondiale sur la base de la défaite du prolétariat international" (idem) parce qu'à travers les différentes guerres localisées qui préparent l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale, l'Opposition a développé une "perspective tactique" de "soutien à un camp impérialiste contre un autre (sans l'admettre ouvertement). Cette tactique fut mise en œuvre sous des formes multiples dans le trotskisme des années 1930 : soutien à la "résistance coloniale" en Ethiopie, en Chine et au Mexique, soutien à l'Espagne républicaine, etc. Le soutien du trotskysme aux préparatifs de guerre de l'impérialisme russe a été tout aussi clair tout au long de cette période (Pologne, Finlande 1939) dissimulé sous le slogan "défense de la patrie soviétique"[5]. C'est ainsi que la tactique d'entrisme dans les partis socialistes (décidée en 1934) fera que "Le programme politique qui est adopté au congrès de fondation de la IVe Internationale, rédigé par Trotsky lui-même, et qui sert de base de référence aux groupes trotskystes actuels, reprend et aggrave les orientations de Trotsky qui ont précédé ce congrès (défense de l’URSS, front unique ouvrier, analyse erronée de la période...) mais en plus est axé sur une répétition vide de sens du programme minimum de type social-démocrate (revendications "transitoires"), programme rendu caduc par l’impossibilité des réformes depuis l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, de déclin historique" ("Le trotskysme, fils de la contre-révolution"). La Quatrième Internationale a défendu "la participation aux syndicats, le soutien critique aux partis dits "ouvriers", les "fronts uniques" et les "fronts antifascistes", les gouvernements "ouvriers et paysans", les mesures de capitalisme d'État (prisonnier de l'expérience en URSS) par "l'expropriation des banques privées", "la nationalisation du crédit", "l'expropriation de certaines branches industrielles" (...) la défense de l'État ouvrier dégénéré russe. Et au niveau politique, elle envisageait la révolution démocratique et bourgeoise dans les nations opprimées à travers la lutte pour la "libération nationale". Ce programme ouvertement opportuniste a ouvert la voie à la trahison des partis trotskistes à travers la défense de leurs États-nations respectifs en 1939-41[6]. Seuls quelques individus, et en aucun cas "des courants à la praxis internationaliste" comme le prétend Nuevo Curso, ont tenté de résister à cette voie réactionnaire ! Parmi eux, Natalia Sedova, la veuve de Trotsky, qui a rompu avec la IVe Internationale en 1951, et surtout Munis, dont nous parlerons plus loin.[7]
La continuité de la Gauche communiste, une continuité programmatique et organisationnelle
Il faut donc comprendre que la lutte pour l'élaboration d'un cadre programmatique au service du développement de la conscience prolétarienne et préparant les prémices de la formation du parti mondial, n'est pas la tâche de personnalités et de cercles isolés, mais le fruit d'une lutte collective organisée qui s'inscrit dans la continuité historique critique des organisations communistes. Cette continuité passe, comme nous l'affirmons dans nos positions de base, par "les apports successifs de la Ligue des Communistes de Marx et Engels (1847-1852), des trois Internationales (l'Association Internationale des Travailleurs, 1864-1872, l'Internationale Socialiste, 1884-1914, l'Internationale Communiste, 1919-28), des Fractions de Gauche qui se sont séparées dans les années 1920-30 de la 3éme Internationale (l'Internationale Communiste) dans son processus de dégénérescence, et plus particulièrement des Gauche allemande, hollandaise et italienne".[8]
Nous avons déjà vu que cette continuité ne pouvait être prise en charge ni par l'Opposition de gauche ni par la Quatrième Internationale[9]. Seules les Gauches communistes pouvaient le faire. Mais selon Nuevo Curso, "la période historique de la Gauche communiste s'achève en 1943-1953". Il ne donne aucune explication, mais dans son article il ajoute une autre phrase : "Les Gauches communistes qui restèrent en marge du regroupement international - les italiens et leurs dérivés français - arriveront, mais pas tous, pas complètement et pas toujours sur des positions cohérentes, à un cadre similaire dans la même période".
Ce passage contient de nombreuses "énigmes". D'abord, quelles sont ces Gauches communistes qui sont restées en marge du "regroupement international" ? De quel regroupement international parle-t-on ? Bien sûr, Bilan et les autres courants de la Gauche communiste ont rejeté l'idée d'"aller vers une Quatrième Internationale"[10]. Cependant, depuis 1929, ils ont tout fait pour discuter avec l'Opposition de Gauche, la reconnaissant comme un courant prolétarien, mais gangrené par l'opportunisme. Cependant, Trotsky a obstinément rejeté tout débat[11], seuls quelques courants comme la Ligue des Communistes Internationalistes de Belgique ou le Groupe Marxiste du Mexique ont accepté le débat qui a conduit à une évolution de leur part et entraîné leur rupture avec le trotskysme[12].
En outre, Nuevo Curso nous dit que ces groupes restés "en marge du regroupement international" "arriveront, mais pas tous, pas complètement et pas toujours sur des positions cohérentes, à un cadre similaire dans la même période". Qu'est-ce qui leur a manqué ? Qu'est-ce qu'ils ont eu d'"incohérent" ? Nuevo Curso ne clarifie rien. Nous allons démontrer, en reprenant un schéma que nous avons fait dans un article intitulé Quelles sont les différences entre la Gauche Communiste et la Quatrième Internationale ?[13], que ces groupes avaient des positions cohérentes avec la fidélité au programme du prolétariat et qu'ils n'étaient en aucun cas "similaires" au bourbier opportuniste de l'Opposition et des groupes de la Quatrième Internationale ayant prétendument "une pratique internationaliste":
|
Gauche communiste |
Opposition de Gauche |
|
|
|
|
Se base sur le premier congrès de l'IC et considère de façon critique les contributions du deuxième. Rejette la plupart des positions des troisième et quatrième congrès. |
Basé sur les 4 premiers congrès sans analyse critique. |
|
Examine de façon critique ce qui se passe |
Considère la Russie comme un État ouvrier dégénéré qu'il faut soutenir malgré tout. |
|
La Gauche communiste germano-hollandaise rejette le travail dans les syndicats, et la Gauche communiste italienne parviendra avec Internationalisme (Gauche communiste de France) à la même conclusion que les syndicats sont devenus des organes de l'État mais sur des bases théoriques et historiques plus fermes. |
Préconise le travail dans les syndicats qu'elle considère comme des organes de la classe ouvrière. |
|
La Gauche communiste germano-hollandaise, Bilan et Internationalisme dénoncent clairement la libération nationale. |
Appuie la libération nationale. |
|
Dénonce le parlementarisme et la participation aux élections. |
Appuie la participation aux élections et |
|
Entreprend un travail de Fraction
|
Entreprend un travail d'"opposition" pouvant même conduire à l'entrisme dans les partis sociaux-démocrates. |
|
Dans les années 1930, et surtout
|
Au milieu de la contre-révolution, Trotsky pense que les conditions pour former le parti sont réunies et, en 1938, fonde la Quatrième Internationale. |
|
Dénonce la Seconde Guerre mondiale ; |
Invite les travailleurs à choisir leur camp parmi les candidats à la Seconde Guerre mondiale, abandonnant ainsi l'internationalisme. |
Il faut ajouter à la comparaison que précède un point qui nous semble très important pour contribuer réellement a la lutte prolétarienne et avancer vers le parti mondial de la révolution : tandis que la Gauche communiste effectuait un travail organisé, collectif et centralisé, basé sur la fidélité aux principes organisationnels du prolétariat et dans la continuité historique de ses positions de classe, l'Opposition de Gauche se présentait comme un ensemble de personnalités, de cercles et de groupes hétérogènes, seulement unis par le charisme de Trotsky auquel on avait confié "l'élaboration politique".
Pour couronner le tout, Nuevo Curso met la Gauche communiste et les communisateurs (un mouvement moderniste radicalement étranger au marxisme) dans le même sac : "Le soi-disant "communisme de gauche" ("left communism") est un concept qui englobe la Gauche Communiste (en particulier les courants italien et germano-hollandais), les groupes et tendances qui assurent sa continuité (depuis le "conseillisme" jusqu’au "bordiguisme") et les penseurs de la "communisation"". À quoi répond cet amalgame ? Un amalgame qui se conclut en plaçant une photo d'Amadeo Bordiga[14] au milieu de la dénonciation qu'il fait des "communisateurs", ce qui laisse penser que la Gauche communiste leur serait liée ou aurait des positions communes avec eux.
Munis et une soi-disant "Gauche Communiste Espagnole"
Ainsi, selon Nuevo Curso, les révolutionnaires actuels n'auraient pas à chercher les bases de leur activité dans les groupes de la Gauche communiste (la TCI, le CCI, etc.) mais dans ce qui aurait pu sortir du programme de capitulation au capitalisme élaboré par la IVe Internationale et concrètement, comme nous le verrons ci-dessous, du travail du Munis révolutionnaire. Cependant, de manière confuse et alambiquée, Nuevo Curso laisse entendre, sans le dire clairement, que Munis serait le maillon le plus important d'une prétendue "Gauche communiste espagnole", un courant qui selon Nuevo Curso "fonde le Parti communiste espagnol en 1920 et crée le groupe espagnol de la gauche d'opposition au stalinisme en 1930, puis la Gauche communiste espagnole, participant à la fondation de l'opposition internationale et servant aussi de germe et référence aux communistes en Argentine (1933-43) et Uruguay (1937-43). Elle adopte une position révolutionnaire sur l'insurrection ouvrière du 19 juillet 1936 et est la seule tendance marxiste à participer à l'insurrection révolutionnaire de 1937 à Barcelone. Elle est devenue la section espagnole de la IVe Internationale en 1938 et, à partir de 1943, s'y bat contre le centrisme ; elle a dénoncé sa trahison de l'internationalisme et son éloignement du terrain de classe lors de son deuxième congrès (1948), qui a conduit à la rupture des derniers éléments internationalistes et à la formation, avec les scissionnistes, du "syndicat international des travailleurs".
Avant d'analyser la contribution de Munis, analysons la supposée "continuité" entre 1920 et 1948.
Nous ne pouvons pas entrer maintenant dans une analyse des origines du Parti communiste en Espagne (PCE). À partir 1918, se constituèrent quelques petits noyaux intéressés par les positions de Gorter et Pannekoek, qui finiront par engager des discussions avec le Bureau d'Amsterdam de la Troisième Internationale qui regroupait des groupes de gauche dans la Troisième Internationale. De ces noyaux naquit le premier parti communiste en Espagne, mais ils furent contraints par l'IC de fusionner avec l'aile centriste du PSOE, qui était favorable à l'adhésion à la Troisième Internationale. Dès que possible, nous ferons une étude sur les origines du PCE, mais ce qui est clair, c'est qu'au-delà de quelques idées et d'une combativité incontestable, ces noyaux ne constituaient pas un véritable organe de la Gauche communiste ni ne donnèrent lieu à aucune continuité. Plus tard, des groupes d'opposition de gauche sont apparus et ont même pris le nom de "Gauche communiste d'Espagne", dirigé par Nin. Ce groupe était divisé entre les partisans de la fusion avec le Bloc ouvrier et paysan (un groupe nationaliste catalan lié à l'opposition de droite au stalinisme, une tendance qui en Russie avait Boukharine à sa tête) et ceux qui prônaient l'entrisme au PSOE, séduits par la radicalisation de Largo Caballero (ancien conseiller d'Etat du dictateur Primo de Rivera) qui avait commencé à se faire appeler le "Lénine" espagnol. Munis fait partie de ces derniers, tandis que la majorité, dirigée par Nin, fusionnera avec le Bloc pour former le POUM en 1935. Ainsi, de la "Gauche communiste", ils n'avaient rien d'autre que le nom qu'ils se donnaient pour être "originaux", mais le contenu de leurs positions et de leurs actions était indiscernable de la tendance opportuniste dominante de l'Opposition de gauche..
Quant à l'existence d'une gauche communiste en Uruguay et en Argentine, nous avons étudié les articles publiés par Nuevo Curso pour justifier son existence. En ce qui concerne l'Uruguay, il s'agit de la Ligue bolchévique léniniste qui est l'un des rares groupes du trotskysme à prendre une position internationaliste contre la Seconde Guerre mondiale. C'est très méritoire et nous saluons chaleureusement son attitude comme l'expression d'un effort prolétarien, mais la lecture de l'article de Nuevo Courso montre que ce groupe pouvait à peine mener une activité organisée et se mouvoir dans un environnement politique dominé par l'APRA péruvienne, un parti bourgeois de la tête aux pieds qui flirtait avec l'Internationale communiste déjà dégénérée : "Nous savons que la Ligue rencontrera les "antidefensistas" à Lima en 1942 chez le fondateur de l'APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, pour confirmer les profondes différences qui les séparent. (...) Après l'échec de leur contact "anti-défense", ils subissent pleinement la chasse aux sorcières organisée contre "les trotskystes" par le gouvernement et le Parti communiste. Sans référents internationaux, la IVe ne leur laissant que la possibilité d'abjurer leur critique de la "défense inconditionnelle de l'URSS", le groupe se dissout"[15].
Ce que Nuevo Curso appelle la Gauche communiste argentine est constitué de deux groupes qui fusionneront pour former la Ligue communiste internationaliste et resteront actifs jusqu'en 1937 pour être finalement laminés par l'action des partisans de Trotsky en Argentine. Il est vrai que la Ligue rejette le socialisme dans un seul pays et revendique la révolution socialiste face à la "libération nationale", mais ses arguments s'avèrent très faibles, même si on doit reconnaître le mérite de sa lutte. Dans Nuevo Curso nous trouvons des citations d'un des membres les plus importants du groupe, Gallo qui affirme :
"Que signifie la lutte pour la libération nationale ? Le prolétariat en tant que tel ne représente-t-il pas les intérêts historiques de la Nation en ce sens qu'il tend à libérer toutes les classes sociales par son action et à les dépasser par leur disparition ? Mais pour ce faire, il faut précisément ne pas les confondre avec les intérêts nationaux (qui sont ceux de la bourgeoisie, puisque c'est la classe dirigeante), qui sur le plan intérieur comme extérieur sont fortement contradictoires. Ce mot d'ordre est donc catégoriquement faux (...)pour affirmer notre critère que seule la révolution socialiste peut être l'étape qui correspond aux pays coloniaux et semi-coloniaux. Prisonnier des dogmes de l'Opposition de gauche sur la libération nationale et incapable de les abandonner, le groupe affirme "La IVe Internationale n'admet aucun mot d'ordre de "libération nationale" qui tendrait à subordonner le prolétariat aux classes dirigeantes mais, au contraire, assure que le premier pas de la libération nationale du prolétariat est la lutte contre ces classes""[16]. La confusion est ici terrible, le prolétariat devrait acomplir une oeuvre "libération nationale" prolétarienne, c'est-à-dire qu'il devrait accomplir une tâche propre à la bourgeoisie.
Examen critique de la contribution de Munis
Très tard, en 1948, du tronc pourri de la IVe Internationale, deux tendances prometteuses (les dernières du mouvement trotskyste)[17] vont émerger : celle de Munis et celle de Castoriadis. Dans l'article Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskysme, nous mettons en évidence la différence entre Castoriadis qui a fini par être un propagandiste convaincu du capitalisme occidental et Munis qui est toujours été fidèle au prolétariat[18].
Cette fidélité est admirable et fait partie des nombreux efforts déployés pour avancer vers une conscience communiste. Cependant, ceci une chose mais il s'agit de considérer sa contribution sous un aspect très différent : le travail de Munis a dans la réalité constitué plus un exemple d'activité individuelle qu'une activité liée à un courant prolétarien authentique et organisé, un apport qui pourrait fournir la base théorique, programmatique et organisationnelle pour continuer jusqu'à aujourd'hui le travail d'une organisations communiste aujourd'hui. Comme nous l'avons montré dans de nombreux articles, Munis en raison de ses origines trotskystes, n'était pas capable de mener à bien cette tâche[19].
Ambiguïtés sur le trotskysme
Dans un article écrit en 1958, Munis fait une analyse très claire dénonçant les dirigeants américains et anglais de la Quatrième Internationale qui ont honteusement renié l'internationalisme, concluant à juste titre que "la Quatrième Internationale n'a pas de raison d'être historique ; elle est superflue, son fondement même doit être considéré comme une erreur, et sa seule tâche est de suivre, plus ou moins de manière critique, le stalinisme. "[20]. Cependant, il pense qu'elle peut être d'une certaine utilité pour le prolétariat, car il semblerait qu'"elle a un rôle possible à jouer dans les pays dominés par le stalinisme, principalement en Russie. Là-bas, le prestige du trotskysme semble encore énorme. Les procès de Moscou, la gigantesque propagande menée pendant près de quinze ans au nom de la lutte contre le trotskysme, la calomnie incessante à laquelle il a été soumis sous Staline et que ses successeurs soutiennent, contribuent à faire du trotskysme une tendance latente de millions d'hommes. Si demain - et c'est un événement tout à fait possible - la contre-révolution devait céder à une attaque frontale du prolétariat, la Quatrième Internationale pourrait rapidement émerger en Russie comme une organisation très puissante".
Munis répète, en ce qui concerne le trotskysme, le même argument qu'il utilise contre le stalinisme et la social-démocratie : que TOUT PEUT SERVIR LE PROLETARIAT. Pourquoi ? Parce que le stalinisme l'a désigné "ennemi public numéro un", tout comme les partis de droite présentent les sociaux-démocrates et les staliniens comme de dangereux révolutionnaires. Il ajoute un autre argument, tout aussi typique du trotskysme concernant les sociaux-démocrates et les staliniens : "Il y a beaucoup d'ouvriers qui suivent ces partis".
Que les partis de gauche soient rivaux de la droite et vilipendés par elle ne les rend pas pour autant "favorables au prolétariat", et de même leur influence parmi les travailleurs ne justifie pas de les soutenir. Au contraire, ils doivent être dénoncés pour le rôle qu'ils jouent au service du capitalisme. Dire que le trotskysme a abandonné l'internationalisme et ajouter immédiatement qu'"il pourrait encore avoir un rôle possible à jouer en faveur du prolétariat " est une incohérence très dangereuse qui entrave le travail nécessaire de distinction entre les véritables révolutionnaires et les loups capitalistes qui portent la peau d'un agneau "communiste" ou "socialiste". Dans le Manifeste communiste, le troisième chapitre intitulé "Littérature socialiste et communiste" établit clairement la frontière entre le "socialisme réactionnaire" et le "socialisme bourgeois", qu'il considère comme ennemis, et les courants du "socialisme utopique critique" qu'il reconnaît comme faisant partie du camp prolétarien.
Les "revendications de transition"
L'empreinte trotskyste se retrouve également chez Munis lorsqu'il propose des "revendications de transition" sur le modèle du fameux Programme de transition que Trotsky avait proposé en 1938. C'est quelque chose que nous avons critiqué dans notre article Où va le FOR ?
Dans son "Manifeste pour un second Manifeste communiste", le FOR a estimé qu'il était correct de formuler toutes sortes de revendications transitoires en l'absence de mouvements révolutionnaires du prolétariat. Celles-ci vont de la semaine de 30 heures, la suppression du travail à la pièce et du chronométrage des tâches dans les usines à la "demande de travail pour tous, chômeurs et jeunes" sur le terrain économique. Sur le plan politique, le FOR exige de la bourgeoisie des "droits" et des "libertés" démocratiques : liberté d'expression, de la presse, de réunion ; droit des travailleurs d'élire des délégués permanents d'atelier, d'usine ou professionnels "sans aucune formalités judiciaire ou syndicale". Tout cela s'inscrit dans la logique trotskyste, selon laquelle il suffit de poser les bonnes exigences pour arriver progressivement à la révolution. Pour les trotskystes, toute la question serait de savoir faire preuve de pédagogie envers les ouvriers, qui ne comprennent rien à leurs revendications, de brandir devant eux les carottes les plus appétissantes pour les pousser vers leur "parti"."
Nous voyons ici une vision gradualiste où "le parti dirigeant" administre ses potions miraculeuses pour conduire les masses à la "victoire finale", ce qui ne peut que semer de dangereuses illusions réformistes chez les ouvriers et de ravaler la façade de l'État capitaliste en occultant que ses "libertés démocratiques" sont en réalité un moyen de division, de tromperie et de diversion dans la lutte des ouvriers. Les communistes ne sont pas une force extérieure au prolétariat, armée des compétences de la direction révolutionnaire et donc capable d'orienter les ouvriers dans la bonne direction. Dès 1843, Marx critiquait l'idée que les communistes seraient des espèces de prophètes apportant la rédemption : "Nous ne nous présentons pas au monde en doctrinaires avec un principe nouveau : voici la vérité, à genoux devant elle ! Nous apportons au monde les principes que le monde a lui-même développés en son sein. Nous ne lui disons pas : laisse là tes combats, ce sont des fadaises ; nous allons te crier le vrai mot d'ordre du combat. Nous lui montrons simplement pourquoi il combat exactement, et la conscience de lui-même est une chose qu'il devra acquérir, qu'il le veuille ou non"[21].
Le volontarisme
Le travail en tant que fraction, que l'Opposition de Gauche a été incapable de concevoir, permet aux révolutionnaires de comprendre l'évolution du rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat, de savoir si nous sommes dans une dynamique, qui permet d'avancer vers la formation du parti mondial, ou, au contraire, si nous sommes dans une situation où la bourgeoisie peut imposer sa propre trajectoire à la société, ce qui la mène à la guerre et la barbarie.
Privé de cette boussole, Trotsky croyait que tout se réduisait à la capacité de rassembler une grande masse d'affiliés qui pourraient servir de "direction révolutionnaire". Ainsi, alors que la société mondiale se dirigeait vers les massacres de la Seconde Guerre mondiale ponctués par les massacres d'Abyssinie, la guerre d'Espagne, la guerre sino-japonaise, etc., Trotsky croyait avoir vu le début de la révolution lors des grèves en France de juillet 1936 et la première réaction courageuse des ouvriers espagnols au coup d'État de Franco.
Incapable de rompre avec ce volontarisme, Munis répète la même erreur. Comme nous l'avons écrit dans la deuxième partie de notre article sur Munis et Castoriadis : "Derrière ce refus d'analyser la dimension économique de la décadence du capitalisme se cache un volontarisme non dépassé, dont les fondements théoriques remontent à la lettre annonçant sa rupture avec l'organisation trotskyste en France, le Parti Communiste Internationaliste, où il maintient avec constance la notion de Trotsky, présentée dans les premières lignes du Programme de transition, selon laquelle la crise de l'humanité est la crise de la direction révolutionnaire."
Ainsi Munis écrivait : "Toutes les explications qui essayent de reporter la responsabilité de l'échec de la révolution sur les conditions objectives, le retard idéologique ou les illusions des masses, sur la puissance du stalinisme ou l'attraction illusoire de l'"État ouvrier dégénéré", sont erronées et seulement bonnes à disculper les responsables, à détourner l'attention du véritable problème et obstruer sa solution. Une authentique direction révolutionnaire, étant donné le niveau actuel des conditions objectives pour la prise du pouvoir, doit vaincre tous les obstacles, surmonter toutes les difficultés, triompher de tous ses adversaires"[22].
Ainsi, une "véritable direction révolutionnaire" suffirait à balayer tous les obstacles, tous les adversaires. Le prolétariat n'aurait pas à compter sur son unité, sa solidarité et sa conscience de classe, mais à remettre la "direction révolutionnaire" entre de "bonnes mains". Ce messianisme mène Munis à une conclusion délirante : "La dernière guerre a offert plus de possibilités révolutionnaires que celle de 1914-1918. Pendant des mois, tous les États européens, y compris la Russie, ont paru battus et discrédités, susceptibles d'être vaincus par une offensive prolétarienne. Des millions d'hommes armés aspirant confusément à une solution révolutionnaire (...) le prolétariat, organisé sur une base révolutionnaire, aurait pu lancer une insurrection dans plusieurs pays et la répandre sur tout le continent... Les bolcheviks de 1917 n'ont pas, de loin, joui d'aussi vastes possibilités"[23].
Contrairement à la Première Guerre mondiale, la bourgeoisie s'était consciencieusement préparée en ayant infligé une défaite au prolétariat avant la Seconde Guerre mondiale : massacré en Allemagne et en Russie, enrôlé sous la bannière de "l'antifascisme" dans les États démocratiques, le prolétariat ne put opposer au massacre qu'une faible résistance. Il y a eu le grand choc prolétarien dans le nord de l'Italie en 1943 que les Alliés démocratiques ont laissé le soin aux nazis d'écraser dans le sang[24], quelques grèves et désertions en Allemagne (1943-44) que les Alliés ont tuées dans l'œuf avec les terribles bombardements de Hambourg, Dresde, etc., des bombardements sans aucun objectif militaire mais visant uniquement à terroriser la population civile. De même la Commune de Varsovie (1944) que l'armée russe a laissée aux nazis le soin de l'écraser.
Ce n'est qu'en s'abandonnant aux illusions les plus suicidaires qu'on pourrait penser qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale "le prolétariat, organisé sur une base révolutionnaire, aurait pu lancer une insurrection dans plusieurs pays". Avec de tels fantasmes, on ne peut guère contribuer à la formation d'une organisation prolétarienne.
Le sectarisme
Un pilier fondamental de l'organisation révolutionnaire est l'ouverture et la volonté de discuter avec les autres courants prolétariens. Nous avons déjà vu comment le Manifeste communiste considère avec respect et esprit de débat les contributions de Babeuf, Blanqui et du socialisme utopique. Pour cette raison, dans la Résolution sur les groupes politiques prolétariens adoptée par notre 2e Congrès international, nous soulignons que "La caractérisation des différentes organisations qui se réclament du socialisme et de la classe ouvrière est de la plus haute importance pour le CCI. Ce n'est nullement une question abstraite ou de simple théorie mais au contraire qui oriente de façon directe l'attitude du Courant à l'égard de ces organisations et donc son intervention face à elles : soit dénonciation en tant qu'organe et émanation du Capital, soit polémique et discussion en vue de tenter de favoriser leur évolution vers une plus grande clarté et rigueur programmatique ou de permettre et impulser en leur sein l'apparition de tendances à la recherche d'une telle clarté"[25].
Contrairement à cette position, Trotsky, comme nous l'avons vu précédemment, a rejeté le débat avec Bilan et s'est plutôt ouvert largement à une soi-disant "gauche de la social-démocratie". Munis a également été affecté par le sectarisme. Notre article en hommage à Munis[26] reconnaît avec satisfaction que "En 1967, il participe, en compagnie de camarades d'"Internacionalismo", à une prise de contact avec le milieu révolutionnaire en Italie. Aussi, à la fin des années 60, avec le resurgissement de la classe ouvrière sur la scène de l'histoire, il sera sur la brèche aux côtés des faibles forces révolutionnaires existantes, dont celles qui vont fonder "Révolution Internationale". Au début des années 70, il reste malheureusement à l'écart de l'effort de discussion et de regroupement qui allait notamment aboutir, en 1975, à la constitution du Courant Communiste International".
Cet effort n'a pas été poursuivi et comme nous le disons dans l'article précité ("Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskysme, deuxième partie") "le groupe souffrait d'une tendance au sectarisme qui affaiblissait encore sa capacité à survivre".
L'exemple de cette attitude évoqué dans l'hommage est le départ plutôt retentissant de Munis et de son groupe lors de la Deuxième conférence de la Gauche communiste, alléguant leur désaccord avec les autres groupes sur le problème de la crise économique.
Aussi important que cela puisse paraître, un désaccord sur l'analyse de la crise économique ne peut conduire à l'abandon du débat entre révolutionnaires. Un tel débat doit être mené avec la plus grande ténacité, avec l'attitude de "convaincre ou d'être convaincu", mais sans jamais claquer la porte dès les premiers échanges et sans avoir épuisé toutes les possibilités de discussion. Notre article souligne à juste titre qu'une telle attitude affecte quelque chose d'essentiel : la construction d'une organisation solide capable d'assurer la continuité. Le FOR n'a pas survécu à la mort de Munis et a disparu définitivement en 1993, comme indiqué dans l'article sur Munis et Castoriadis : "Aujourd'hui, le FOR n'existe plus. Il a toujours été fortement dépendant du charisme personnel de Munis, qui n'a pas su transmettre une solide tradition d'organisation à la nouvelle génération de militants qui se sont ralliés autour de lui, et qui aurait pu servir de base pour le fonctionnement continu du groupe après la mort de Munis."
De même que le poids négatif de l'héritage trotskyste a empêché Munis de contribuer à la construction de l'organisation, de même l'activité des révolutionnaires n'est pas celle d'une somme d'individus, encore moins celle de leaders charismatiques : elle est basée sur un effort collectif organisé. Comme nous le disons dans notre "Rapport sur le fonctionnement de l'organisation révolutionnaire" de 1982, "La période des chefs illustres et des grands théoriciens est révolue. L'élaboration théorique devient une tâche véritablement collective. À l'image des millions de combattants prolétariens "anonymes", la conscience de l'organisation se développe par l'intégration et le dépassement des consciences individuelles dans une même conscience collective"[27]. Plus profondément, "la classe ouvrière ne fait pas surgir des militants révolutionnaires mais des organisations révolutionnaires : il n’existe pas de rapport direct entre les militants et la classe. Les militants participent au combat de la classe en tant qu'ils deviennent membres et prennent en charge les tâches de l'organisation "[28].
Conclusion
Comme nous l'affirmions dans l'article que nous avons publié à la mort de Munis en 1989 : "malgré les erreurs sérieuses qu'il a pu commettre, Munis est resté jusqu'au bout un militant profondément fidèle au combat de la classe ouvrière. Il était un de ces très rares militants qui ont résisté à la pression de la plus terrible contre-révolution qu'ait subit le prolétariat dans son histoire, alors que beaucoup désertaient le combat militant ou même trahissaient, pour être présent aux côtés de la classe ouvrière lors de la reprise historique de ses combats à la fin des années 1960".
Lénine disait à propos des révolutionnaires, "Après leur mort, on essaie d’en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d’entourer leur nom d’une certaine auréole afin de "consoler" les classes opprimées et de les mystifier". Pourquoi Nuevo Curso remplit-il son blog de photos de Munis, publie-t-il certains de ses textes sans le moindre regard critique ? Pourquoi l'élève-t-il au rang d'icône d'une "nouvelle école" ?
Peut-être s'agit-il du culte sentimental d'un ancien combattant prolétarien. Si tel est le cas, il faut dire que c'est une entreprise destinée à créer plus de confusion car ses thèses, transformées en dogmes, ne feront que distiller le pire de ses erreurs. Rappelons-nous l'analyse exacte du Manifeste communiste à l'égard des socialistes utopistes et de ceux qui, plus tard, ont tenté de les justifier : "C'est pourquoi, si, à beaucoup d'égards, les auteurs de ces systèmes étaient des révolutionnaires, les sectes que forment leurs disciples sont toujours réactionnaires, car ces disciples s'obstinent à maintenir les vieilles conceptions de leurs maîtres en face de l'évolution historique du prolétariat.".
Une autre explication possible est que la Gauche communiste authentique est attaquée avec une "doctrine" de spam construite du jour au lendemain en utilisant les matériaux de ce grand révolutionnaire. Si tel est le cas, c'est l'obligation des révolutionnaires de combattre une telle imposture avec le maximum d'énergie.
C.Mir 4-7-19
[1] Dans un article sur la série sur le communisme, "1924-28 : le triomphe du capitalisme d'État stalinien [46]", Revue internationale n° 102, nous avons critiqué l'utilisation du terme "Thermidor", très typique du trotskysme, pour caractériser l'essor et le développement du stalinisme. Le Thermidor de la Révolution française (28 juillet 1794) n'était pas à proprement parler une "contre-révolution" mais une étape nécessaire dans la consolidation du pouvoir bourgeois qui, au-delà d'une série de concessions, ne reviendrait jamais à l'ordre féodal. D'autre part, la montée du stalinisme depuis 1924 signifiait le rétablissement définitif de l'ordre capitaliste, et l'URSS de Staline ne représentait pas, comme Trotsky le pensait toujours à tort, un "terrain socialiste" où "quelques conquêtes d'Octobre" resteraient. C'est une différence fondamentale que Marx a déjà relevée dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte : "Les révolutions bourgeoises, comme celles du 18e siècle, se précipitent rapidement de succès en succès, leurs effets dramatiques se surpassent, les hommes et les choses semblent être pris dans des feux de diamant, l'enthousiasme extatique est l'état permanent de la société, mais elles sont de courte durée. Rapidement, elles atteignent leur point culminant, et un long malaise s'empare de la société avant qu'elle ait appris à s'approprier d'une façon calme et posée les résultats de sa période orageuse ". Le Thermidor était précisément un de ces moments d'"assimilation" des conquêtes politiques de la bourgeoisie, laissant la place aux factions plus modérées de cette classe et plus enclines à faire un pacte avec les forces féodales, qui restaient puissantes.
[2] "La izquierda comunista no fue comunista de izquierda" – La Gauche communiste n'était pas communiste de gauche.
[3] Le trotskysme contre la classe ouvrière [47]. Les erreurs de Trotsky. Le trotskysme, fils de la contre-révolution [48].
[4] En 1926, l'Opposition Unifiée a été formée, réunissant les groupes précédents du Manifeste des 46 avec Zinoviev et Kamenev - ces deux derniers étant des experts en manœuvres et en bureaucratie.
[5] Le trotskysme contre la classe ouvrière [47]. La tactique contre-révolutionnaire des trotskystes. Le trotskysme et la Deuxième Guerre mondiale [49].
[6] Parmi les individus et les petits groupes qui se sont opposé à la trahison des organisations de la IVe Internationale, il faut ajouter le RKD d'Autriche (voir note 16) et le révolutionnaire grec Stinas qui est resté fidèle au prolétariat et a dénoncé le nationalisme et la barbarie de la guerre. Voir Revue internationale n° 72,
[8] Voir par exemple La Gauche communiste et la continuité du marxisme [51] ; Notes pour une histoire de la Gauche communiste [52] (Fraction italienne 1926 - 39), Revue internationale n° 9.
[9] Comme l'écrivait la Gauche communiste de France dans sa revue Internationalisme : "Le trotskysme, loin de favoriser le développement de la pensée révolutionnaire et des organismes (fractions et tendances) qui l'expriment, est un milieu organisé pour le saper. C'est une règle générale valable pour toute organisation politique étrangère au prolétariat, et l'expérience a démontré qu'elle s'applique au stalinisme et au trotskysme. Nous avons connu le trotskysme pendant 15 ans de crise perpétuelle, à travers des divisions et des unifications, suivies d'autres divisions et crises, mais nous ne connaissons pas d'exemples qui ont donné lieu à des tendances révolutionnaires réelles et viables. Le trotskysme ne sécrète pas en lui-même un ferment révolutionnaire. Au contraire, il l'annihile. La condition pour l'existence et le développement d'un ferment révolutionnaire est d'être en dehors du cadre organisationnel et idéologique du trotskysme".
[10] Voir par exemple dans Bilan numéro 1, 1933, organe de la Fraction italienne de la Gauche communiste, l'article "Vers l'internationale 2 et 3/4", qui critique la perspective de Trotsky d'aller vers la formation d'une Quatrième Internationale.
[11] Voir par exemple en Espagnol Trotsky y la Izquierda italiana [53]– Trotsky et la Gauche communiste italienne (Textos de la Izquierda comunista de los años 30 sobre el trotskismo – Textes de la Gauche communiste dans les années 1930).
[12] Voir par exemple Textes de la Gauche Mexicaine (1937-38) [54], Revue internationale n° 10.
[13] Voir en Espagnol ¿Cuales son las diferencias entre la Izquierda Comunista y la IVª Internacional? [55] – Quelles sont les différences entre la Gauche communiste et la IVe internationale ?
[14] Né en 1889 et mort en 1970, il fut l'un des fondateurs du Parti Communiste d'Italie et apporta une contribution importante aux positions de la gauche communiste, surtout jusqu'en 1926.
[15] "¿Hubo izquierda comunista en Uruguay y Chile?" - Y a-t-il eu une Gauche communiste en Uruguay et au Chili ?
[16] "La "Izquierda comunista argentina" y el internacionalismo" - La Gauche communiste argentine et l'internationalisme.
[17] Une troisième tendance doit être ajoutée : le RKD autrichien, qui s'est détaché du trotskysme en 1945. Internationalisme a discuté sérieusement avec eux, mais ils ont fini par sombrer dans l'anarchisme.
[18] Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire : Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec le trotskisme [37] I et II [56]. Revue internationale n° 161 et 162.
[19] En 1948-1949, Munis discuta beaucoup avec le camarade MC, membre du GCF ; et c'est à cette époque que sa rupture définitive avec le trotskysme se concrétisa.
[20] À la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière [35] ; Revue internationale n° 58. Polémique : où va le F.O.R. ? ("Ferment Ouvrier Révolutionnaire") [36] Revue internationale n° 52). Les confusions du « Fomento Obrero Revolucionario » sur Russie 1917 et Espagne 1936 [39] ; Revue internationale n° 25. Crítica del libro jalones de derrota promesas de victoria [38] – Critique du libre Jalons d'une défaite promesses de victoire.
[21] Marx. "Lettres à Arnold Ruge".
[22] Lettre ouverte au Parti Communiste Internationaliste [57]. Natalia Trotsky, Benjamin Péret, Grandizo Munis. Ajoutons, à titre d'exemple de ce volontarisme aveugle et dans un contexte de défaite, l'expérience tragique de Munis lui-même. En 1951, un boycott des tramways a eu lieu à Barcelone. C'était une réaction très combative de la part des travailleurs dans la nuit noire de la dictature franquiste. Munis s'y installe dans l'espoir de "promouvoir la révolution", sans comprendre le rapport de forces entre les classes. Internationalisme et MC lui déconseillent cette aventure. Cependant, rien n'y fait et il est arrêté, passant 7 ans dans les prisons de Franco. Nous apprécions la combativité du militant et nous sommes solidaires avec lui ; cependant, la lutte révolutionnaire exige une analyse consciente et non un simple volontarisme ou, pire encore, un messianisme, croyant qu'en étant "présents" parmi elles, les masses pourront atteindre la "Nouvelle Jérusalem".
[23] Article de Munis : La IVª Internacional [58]
[24] La lutte de classe contre la guerre impérialiste : Les luttes ouvrières en Italie 1943 [59]. Revue Internationale n° 75
[25] Les groupes politiques prolétariens [60]. Revue internationale n° 11.
[27] Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire [61]. Revue internationale n° 29.
[28] Rapport sur la structure et le fonctionnement des organisations révolutionnaires [62]. Revue internationale n° 33. Point 12.
Courants politiques:
Rubrique:
Lassalle et Schweitzer: la lutte contre les aventuriers politiques dans le mouvement ouvrier
- 443 lectures
Il y a 150 ans, au début des années 1860, le mouvement ouvrier international en était encore à ses débuts et ses différentes composantes n’avaient pas encore acquis beaucoup d’expérience dans la création et la défense d’organisations politiques. Suite à la vague de répression qui a suivi les luttes de 1848, de nombreux membres de la Ligue des communistes ont dû s’exiler ou être traduits en justice, comme lors du procès contre les communistes à Cologne en 1852.
En Allemagne, au début des années 1860, il n’y avait pas d’organisation politique indépendante de la classe ouvrière. Dans beaucoup de villes, il y avait des Arbeiterbildungsvereine (clubs d’éducation ouvrière), mais pas encore d’organisation politique prolétarienne avec une démarcation politique claire de la bourgeoisie. Le débat pour déterminer si la classe ouvrière pouvait encore soutenir certaines fractions de la bourgeoisie dans sa lutte pour l’unification nationale ou si l’antagonisme de classe avec la bourgeoisie devait être la question centrale était en plein développement. Dans ce contexte, où la bourgeoisie n’avait pas encore réussi à se débarrasser des chaînes de l’aristocratie et des Junkers, où le capital allemand n’avait pas encore réussi à s’unifier en tant que capital national, des tentatives furent menées pour forger le premier parti politique de la classe ouvrière.
En même temps, la classe ouvrière en Allemagne allait être confrontée à l’un des défis politiques les plus difficiles : celui de faire face aux activités des aventuriers politiques. Bien qu’il n’y ait pas qu’un seul profil de ce type d’individu, leur trait commun est qu’ils utilisent les organisations politiques, non pas pour renforcer la lutte de la classe ouvrière, mais plutôt pour les mettre à leur service, en s’appuyant sur elles pour favoriser leurs ambitions personnelles. Le plus grand défi est de démasquer les aventuriers, car ils n’agissent pas au grand jour et n’affichent pas leurs propres intentions en public. Au contraire, ils ont tendance à avoir une grande habileté à mobiliser un grand nombre de sympathisants derrière eux, ce qui rend la tâche de démasquer de telles figures “très estimées” beaucoup plus difficile.
Comme nous allons le montrer, la véritable nature de l’aventurier Lassalle n’a jamais été complètement démasquée de son vivant. Bien que le vrai visage de l’aventurier Schweitzer ait été dévoilé pour la première fois lors d’une conférence du parti au printemps 1869 à Wuppertal, l’effort pour le démasquer n’a pas vraiment réussi. Ce n’est que quelques années plus tard que la classe ouvrière a réussi, grâce aux efforts du Conseil général de la Première Internationale, à révéler les activités d’un autre aventurier, Mikhaïl Bakounine, au Congrès de La Haye. Les cas de Lassalle, Schweitzer, Bakounine montrent que la classe ouvrière et ses organisations politiques ont été confrontées dès le début aux activités des aventuriers politiques.
Dans cet article, nous traiterons des cas de Lassalle et de Schweitzer. Dans des articles précédents, nous avons déjà donné un compte rendu détaillé de la lutte contre l’aventurisme de Bakounine. (1)
La formation de l’ADAV
En 1862, à Leipzig, les travailleurs d’une association appelée Vorwärts (En avant) proposèrent la préparation d’un congrès général des travailleurs. En janvier 1863, ces protagonistes de Leipzig contactèrent Ferdinand Lassalle. (2) Dans plusieurs conférences, Lassalle avait parlé de façon critique contre la bourgeoisie dans sa querelle avec les Junkers et, en même temps, il avait souligné l’importance de la classe ouvrière pour le progrès historique. Lassalle, cependant, se détachait des visions communistes exposées une bonne douzaine d’années plus tôt dans le Manifeste communiste.
La proposition que Lassalle écrive le programme de l’Association générale des travailleurs allemands (ADAV), finalement fondée à Leipzig le 23 mai 1863, s’adressait à un homme désireux depuis des années de jouer un rôle éminent dans la vie politique en Allemagne. Le fait que la direction ait été confiée à une personne qui, à part une brève activité durant les luttes de 1848, n’avait jamais participé à une organisation prolétarienne et qui ne pouvait représenter la continuité avec la Ligue des communistes, un homme qui s’était auparavant vu refuser l’admission à cette même Ligue et qui devait maintenant agir comme “sauveur” de fait “extérieur”, revendiquant immédiatement un rôle de grand leader, reflétait l’état du mouvement ouvrier à cette époque.
À l’âge de 20 ans, Lassalle avait rencontré Sophie Gräfin von Hatzfeldt, qui était alors deux fois plus âgée que lui. Afin de “la libérer” du mariage forcé avec son mari, Lassalle prit sa défense en tant qu’avocat. Il a non seulement réussi à gagner la cause de la comtesse, mais il a aussi fait une fortune extraordinaire, car la comtesse l’a financé et est devenue son alliée politique. (3) En même temps, en tant que membre de la noblesse, la comtesse entretenait des relations avec diverses parties de la classe dirigeante. En 1856 et 1857, Lassalle vécut dans sa maison à Düsseldorf et en 1858, il déménagea avec elle à Berlin. (4)
“L’auto-dénonciation” d’un aventurier : “Le rapport d’un informateur sur lui-même”
Encouragé par le succès du procès Hatzfeldt et motivé par son ambition de faire carrière, il s’est plaint dès le milieu des années 1850 de l’ “étroitesse de la province” de Düsseldorf, ville natale de la Comtesse. En mai 1855, il demanda au préfet de police de Berlin l’autorisation nécessaire pour déménager de Düsseldorf et se réinstaller à Berlin. (5) Au cours du même mois, il rédigea lui-un “rapport d’informateur sur lui-même”, destiné à être remis entre les mains du chef de la police de Berlin, Hinkeldey. Gustav Mayer a souligné “le vice, fourbe et sournois, la vilenie sophistiquée, la fourberie crapuleuse qui ont été utilisées” pour convaincre et impressionner le préfet de police de l’importance que revêtait sa propre personne. Lassalle se vantait d’être si fortement estimé par les ouvriers de Düsseldorf, qu’ “ils semblent considérer Lassalle comme leur patron et s’il quittait la province nord-rhénane, ils le verraient comme une injustice envers eux et leur relation commune ; ils n’ont pas rompu avec lui, mais comme l’a montré la conversation, ont menacé très énergiquement de rompre avec lui”. À propos du lieu de résidence des anciens rédacteurs en chef du Neue Rheinische Zeitung (y compris Marx) après la répression qui suivit 1848, il se vantait dans son “Spitzelbericht” (rapport de mouchard) de connaître le domicile de Marx : “J’ai fait semblant de supposer qu’ils avaient émigré en Amérique, mais Lassalle m’a dit qu’ils vivaient à Londres et qu’il était apparemment bien informé sur leurs conditions de vie”. Afin d’accroître encore l’intérêt du chef de la police, il se flattait de savoir qu’ “il s’ensuit donc en toute certitude que Lassalle doit être en correspondance continue et ininterrompue avec ces gens à Londres, au moins avec Marx”. Sachant à quel point la police était intéressée à obtenir des informations sur les réseaux de correspondance entre Marx et ses compagnons de combat, il écrit : “J’ai déjà mentionné que Lassalle doit correspondre avec Londres, au moins avec Marx. Je dois ajouter qu’il semble probable (comme je l’ai conclu d’une déclaration) qu’il semble recevoir ces lettres avec un faux nom d’expéditeur”.
Pour appâter le chef de la police avec de nouvelles informations plus croustillantes encore, Lassalle ajoutait : “La raison principale qui le pousse à ce déménagement est la monotonie de la vie à Düsseldorf qui lui est devenue insupportable. À cela s’ajoute une certaine tendance au plaisir et surtout aux distractions avec les femmes qui, malgré son grand amour du travail et sa persévérance, ne s’exprime pas moins fortement dans son tempérament, tendance qu’il ne peut satisfaire à Düsseldorf mais qu’il espère pouvoir satisfaire bien plus à Berlin. Il a répété le motif de son souhait de déménagement à Berlin. (…) Même s’il n’y avait pas eu l’influence de la Comtesse pour le pousser à quitter la province, il y avait principalement sa grande inclination déjà décrite pour le plaisir et le divertissement sensuel et l’insupportable monotonie de sa vie à Düsseldorf qui auraient été pour lui des facteurs décisifs…” Il se décrivait lui-même comme “très ambitieux et de caractère vaniteux”.
Toujours afin d’impressionner la police (et les forces politiques derrière elle), Lassalle se faisait mousser ainsi : “Puisque je considère Lassalle comme l’un des représentants de la démocratie les plus remarquables intellectuellement et doté d’une énergie exceptionnelle, à mon avis, cet homme très dangereux n’est jamais suffisamment surveillé d’assez près…” Lassalle ajoute un autre élément intéressant pour la police : l’auteur de la lettre, c’est-à-dire le mystérieux informateur, a la perspective de pouvoir travailler comme secrétaire de Lassalle. “J’ai déjà gagné dans une large mesure sa confiance. J’ai acquis cela, en partie grâce à une utilisation de sa grande vanité. (…) Dans quelque temps, au poste de secrétaire, je serai devenu non seulement le confident de ses pensées les plus secrètes, mais je serai aussi devenu complètement indispensable pour lui”. Prêt à livrer à la police ceux qui cherchaient à renverser le régime (Lassalle et ses amis), Lassalle termine ainsi son rapport d’espion : “Je n’aurai aucune difficulté, légitimé par ma position auprès de Lassalle et son amitié, à me faire connaître de tous les autres membres plus ou moins éminents de la démocratie et à enquêter sur leurs affaires depuis le début ; en un mot, je le remettrai donc, lui et ses associés, entre les mains des autorités, de telle manière qu’il ne dépendra que de leur propre discrétion de détruire ces incorrigibles partisans de la défaite, quand cela leur semblera opportun”. (6)
Ce rapport d’espion sur lui-même, qui n’a été retrouvé dans ses archives qu’après sa mort, met en lumière ses activités d’aventurier dans les rangs du mouvement ouvrier allemand.
Les vraies motivations de l’aventurier
Nous avons ici un premier trait des aventuriers. Contrairement aux combattants sincères qui se joignent de manière désintéressée à une organisation révolutionnaire pour aider la classe ouvrière à remplir son rôle historique, les aventuriers ne rejoignent des organisations révolutionnaires que pour remplir leur “propre mission historique”. Ils veulent mettre le mouvement à leur service et cherchent constamment à être reconnus à cette fin. Le rapport d’espion de Lassalle sur lui-même n’est rien d’autre qu’un “spectacle publicitaire” pour mettre en valeur ses capacités prétendument exceptionnelles. Par conséquent, les organisations prolétariennes ne leur servent que de tremplin pour leur carrière tant au sein de l’organisation prolétarienne elle-même que dans les rangs des dirigeants. Convaincus que leurs capacités sont plus grandes que celles qui leur sont reconnues, ils cherchent une reconnaissance tant au sein du mouvement ouvrier que dans la sphère dirigeante.
Mettre en avant ou dissimuler leurs revendications de leadership…
Lors de la fondation de l’ADAV en mai 1863, Lassalle réussit à se faire désigner comme président pour cinq ans, avec un pouvoir quasi-dictatorial sur les sections locales. Lassalle insista auprès de l’ADAV sur le fait qu’il ne voulait y participer que s’il était invité directement à prendre le rôle principal. En d’autres termes, au lieu de se joindre à une lutte collective, il a immédiatement revendiqué la direction de l’organisation.
Nous avons ici un autre trait distinctif, que l’on retrouve souvent chez les aventuriers. Non seulement ils aspirent à assumer un rôle de leader dans une organisation, mais ils revendiquent souvent directement une autorité spécifique (et même s’ils ne l’obtiennent pas d’un mandat, ils aspirent pour eux-mêmes à une autorité arbitraire et indépendante). Comme s’il avait été couronné empereur, il déclarait : “Je suis en mesure de répondre positivement aux exigences du poste que vous m’offrez, et je me déclare donc prêt à répondre à votre demande et à prendre la direction du mouvement ouvrier”. (7) Les sections locales de l’association n’avaient aucun droit, elles n’exécutaient que les ordres du chef.
Il s’agissait d’un grand pas en arrière par rapport à la Ligue des communistes qui était une organisation centralisée, qui avait établi un comité central élu par le congrès et des responsables de district qui garantissaient un fonctionnement collectif, et où les assemblées locales avaient un pouvoir décisionnel. À cet égard, Lassalle a réussi à faire tourner la roue de l’histoire à l’envers avec un “rôle de leader” taillé à sa mesure.
Au service de la classe ouvrière ou de ses propres intérêts ?
Bebel a écrit dans son autobiographie : “Lassalle n’était pas satisfait des applaudissements des masses, il attachait une grande importance à avoir à ses côtés des hommes de prestige et d’influence du camp bourgeois, et il se donnait beaucoup de mal pour les gagner”. (8) Alors que le pouvoir en Prusse et dans d’autres parties de l’Allemagne envoyait ses agents pour surveiller le mouvement ouvrier naissant et chercher d’éventuelles forces “coopératives” à attirer du côté de Bismarck, au même moment Lassalle, comme son rapport d’espion le révèle sans équivoque, avait lui-même déployé ses antennes pour capter l’oreille de Bismarck.
Coopération secrète avec les dirigeants
Deux semaines avant la fondation de l’ADAV, le 23 mai 1863, Lassalle commence un échange de lettres avec Bismarck. Bismarck, qui voulait unir l’Allemagne “par le sang et par le fer”, invita Lassalle à un entretien. Dans une série de quatre discussions, Lassalle a non seulement essayé de donner des conseils à Bismarck, mais a également fait des suggestions concrètes pour une collaboration.
Lassalle dit à Bismarck, qui était le bras droit du roi de Prusse, que la classe ouvrière “se sent instinctivement encline à accepter la dictature”. (9) Les ouvriers reconnaîtraient la monarchie comme un “vecteur naturel de la dictature sociale”, si la monarchie devait se transformer d’une “royauté des classes privilégiées en une royauté populaire, sociale et révolutionnaire”. Du point de vue de Lassalle, la monarchie prussienne était capable de devenir une royauté sociale. Ce fut le sujet de la première conversation avec Bismarck. Dans un autre entretien, le suffrage universel et les campagnes contre les factions de la bourgeoisie hostiles à Bismarck ont été discutées. Parce que la police de Düsseldorf avait pris des mesures contre les écrits de Lassalle au moment de la troisième entrevue, le 23 octobre 1863, Bismarck proposa à Lassalle de placer ses œuvres sous sa protection. À cet effet, Bismarck voulut adresser aux procureurs une circulaire interdisant la confiscation des œuvres de Lassalle. Lassalle répondit à Bismarck qu’il était contre cette offre. Il pensait que des mesures répressives à son encontre renforceraient sa crédibilité, alors que si ses écrits étaient “épargnés” par la répression, sa crédibilité en souffrirait. Au cours de cette troisième discussion, la possibilité et la nécessité d’un bloc électoral entre les conservateurs et l’ADAV furent également discutées. Le 12 janvier 1864, à la réunion suivante, Lassalle offrit une coopération politique directe dans la réforme de la loi électorale pour laquelle il voulut formuler un projet. Lassalle dit à Bismarck qu’il craignait la révolution, cette “voie sombre et sinistre”. Pour l’éviter, il proposa à Bismarck d’introduire immédiatement le suffrage universel afin de ne pas être confronté à un assaut révolutionnaire. Puisque, du point de vue de Lassalle, la bourgeoisie allemande était incapable d’une révolution, le parti ouvrier devait donner l’impulsion, et Bismarck devait inciter le roi à effectuer ce revirement. Enfin, Lassalle offrit son soutien à la Prusse dans la guerre contre le Danemark (y compris l’annexion du Schleswig-Holstein) si Bismarck modifiait la loi électorale.
Quand Wilhelm Liebknecht mit Lassalle en garde contre Bismarck, Lassalle lui répondit : “Bah, je mange des cerises avec Herr von Bismarck, mais c’est lui qui a les noyaux”. (10) En septembre 1878, lorsque Bebel interpella Bismarck au Reichstag, au moment des lois anti-socialistes, à propos de ses contacts avec Lassalle, Bismarck lui répondit que “Lassalle l’avait extraordinairement attiré, il avait été l’une des personnes les plus spirituelles et aimables avec lesquelles il avait été en contact. Il n’avait pas non plus été républicain : l’idée à laquelle Lassalle aspirait avait été l’empire allemand. En cela, ils avaient eu des points d’accord. Lassalle avait été très ambitieux”. (11) Lassalle avoua à Hélène von Dönniges, ce que Bebel découvrit plus tard lors d’une conversation avec elle, que Bismarck et Lassalle pensaient tous deux qu’ils étaient trop intelligents pour se piéger mutuellement. (12)
Lassalle, à sa manière de mégalomane, raconte ses rencontres avec les dirigeants du mouvement national italien après son voyage en Italie et déclare avec grandiloquence qu’il vient d’ “empêcher l’intervention de la Prusse avec son “petit livre sur la guerre italienne” et qu’il a, en fait, orienté de façon déterminante l’histoire de ces trois dernières années”. (Nous reviendrons là-dessus plus loin). En ce sens, un aventurier n’est pas la même chose qu’un agent de police ou un mouchard, qui vend ses informations. Les aventuriers n’ont pas besoin d’être corrompus pour servir un régime. Pour eux, le désir de “gloire”, de “reconnaissance”, c’est-à-dire des facteurs psychologiques, sont d’une certaine façon des motivations plus puissantes que de simples “compensations” matérielles.
Duplicité…
Après que Lassalle fut élu à la présidence de l’ADAV en mai 1863, il présenta souvent l’orientation programmatique de l’ADAV de manière complètement différente en fonction de ses interlocuteurs. Cette duplicité est une autre caractéristique des aventuriers (ne pas jouer “cartes sur table” et ne pas entrer sur le ring ouvertement). Tandis que Marx et Engels, par exemple, écrivaient beaucoup de polémiques, Lassalle évitait le débat et changeait de veste en fonction des auditeurs.
… et méthodes de recrutement opportunistes
Lassalle n’avait pas vraiment foi dans la force de la classe ouvrière (qui, selon lui, devait encore se développer), mais voulait rallier le plus grand nombre possible de personnalités du camp de la classe dirigeante à la cause de l’ADAV, car, à son avis, ces gens-là étaient appelés à libérer la classe ouvrière de ses chaînes. C’est ainsi que Lassalle essaya de gagner Johann Karl Rodbertus, un représentant du soi-disant socialisme d’État. Rodbertus soutenait que les “amis de la question sociale”, c’est-à-dire les conservateurs et la bourgeoisie, pouvaient aussi adhérer à l’association. Lassalle a écrit à Rodbertus : “Plus de bons membres bourgeois rejoignent l’association, mieux c’est”. (13)
Parce qu’il ne s’intéressait pas tant à la libération de la classe ouvrière qu’à la promotion du mouvement démocratique général, il plaidait aussi pour l’admission des libéraux et des conservateurs dans l’ADAV. Il s’opposait donc à la conception d’un parti politique ouvrier indépendant. En même temps, tous ceux qui le souhaitaient devaient pouvoir devenir membre et adhérer immédiatement. En conséquence, l’ADAV a été inondé de bourgeois et de petits-bourgeois. Ici aussi, il s’agissait d’un recul par rapport à la Ligue des communistes, dont l’adhésion était fondée sur la défense des principes d’organisation inscrits dans ses statuts.
L’orientation programmatique de Lassalle : le socialisme d’État…
Lassalle plaida la cause de l’État auprès des travailleurs en faisant miroiter que celui-ci “pouvait les approvisionner en capitaux par le biais du crédit, afin qu’ils puissent entrer dans une concurrence libre et égale avec le capital”. Lassalle n’a même pas pensé à la destruction de l’État prussien, mais espérait l’intervention socialiste de l’État prussien ! Il a suscité l’espoir qu’avec l’aide de l’État existant, s’ouvrirait une voie pacifique vers le socialisme. (14)
… et opposant aux luttes économiques au nom de sa théorie sur la “loi d’airain des salaires”.
Selon Lassalle, dans la société capitaliste les travailleurs ne pouvaient recevoir un salaire supérieur au minimum nécessaire pour maintenir et reconstituer leur force de travail. Sur cette base, il s’opposa aux luttes ouvrières pour les revendications, aux grèves contre les licenciements et rejeta la nécessité d’organisation de la classe en syndicats. Bref, l’ADAV devait être une secte.
Au lieu de cela, les travailleurs devaient être élevés au statut d’entrepreneurs. L’État devait prêter de l’argent, construire et financer des coopératives de consommateurs.
Les relations de Lassalle avec Marx et Engels
Bien que Lassalle prétendait connaître à fond le Manifeste communiste, il n’a jamais été marxiste. Bien qu’il ait connu Marx, et plus tard Engels, après 1848, il leur envoya une nombreuse correspondance. Mais bien que Marx ait passé quelques jours dans son appartement de Berlin en 1862, lui et Engels furent en conflit assez rapidement avec Lassalle. Les raisons : les divergences politiques profondes (par exemple, sur la question du soutien à la Prusse, l’exigence de l’introduction du droit de vote et bien d’autres) ainsi que son comportement. Marx écrivit dans une lettre à Engels, le 30 juillet 1862 [63], après que Lassalle lui rendit visite ainsi qu’à sa famille à Londres : “Le séjour à Zurich (avec Rüstow, Herwegh, etc.) et son voyage ultérieur en Italie, puis son “Herr Julian Schmidt” (15), etc. lui ont complètement tourné la tête. Il est maintenant non seulement le plus grand érudit, le penseur le plus profond, le chercheur le plus brillant, etc., mais en même temps un Don Juan et un “révolutionnaire” cardinal de Richelieu. (…) En grand secret, il nous a confié à ma femme et à moi, qu’il avait conseillé à Garibaldi de ne pas faire de Rome la cible de l’attaque, mais d’aller à Naples, de se faire proclamer dictateur (sans que le roi Victor Emmanuel en soit blessé), d’appeler l’Armée populaire à faire campagne contre l’Autriche. (…) Comme levier d’action : l’influence politique de Lassalle et de sa plume à Berlin. Et de mettre Rüstow à la tête d’un corps expéditionnaire allemand avec la participation de Garibaldi lui-même. D’ailleurs, Bonaparte aurait été paralysé par ce “coup d’État” lassallien. Il était maintenant aussi avec Mazzini, et “lui aussi” approuvait et “admirait” son plan. Il s’est présenté à ces gens comme un “représentant de la classe ouvrière révolutionnaire allemande” et Itzig (16) s’est attribué (littéralement !) le mérite d’une connaissance qui “empêchait l’intervention de la Prusse” grâce à sa brochure sur la guerre d’Italie qui, en fait “aurait permis de servir de guide à l’histoire de ces trois dernières années”. Lassalle était très en colère contre moi et ma femme parce que nous nous moquions de ses plans, le taquinions en le traitant de “bonapartiste éclairé”, etc. Il s’est courroucé, s’est vexé, a fait des bonds et s’est finalement profondément convaincu que j’étais décidément trop “abstrait” pour pouvoir comprendre la politique”.
Ces déclarations de Marx sur le personnage, l’autoportrait, la mégalomanie et l’ensemble de son comportement montrent à quel point Marx était scandalisé par Lassalle. Quand Marx et Engels ont partagé leurs impressions sur son comportement, ils ne savaient rien de ses contacts et de son alliance avec Bismarck. Jenny Marx, l’épouse de Marx, a écrit sur Lassalle après sa visite chez eux en 1861. Elle se moque aussi de la façon qu’à Lassalle de se présenter : “Il était presque submergé par le fardeau de la célébrité qu’il a gagné en tant qu’érudit, penseur, poète et homme politique. Une couronne de lauriers frais reposait encore sur son front olympien et sur sa tête bouclée et ses cheveux gominés pour masquer leur rigidité. Il venait de terminer victorieusement sa campagne d’Italie (grâce à un nouveau coup d’État politique déclenché par de grands hommes d’action). Son esprit était agité de grandes batailles intérieures. Il n’était pas encore entré dans certains domaines de la science. Il y avait l’égyptologie, qu’il n’avait pas encore explorée à fond. Il se demandait : “devrais-je étonner le monde en tant qu’égyptologue, ou devrais-je montrer ma connaissance universelle en tant qu’homme d’action, en tant que politicien, en tant que combattant ou en tant que stratège militaire ?” (17)
Ce que Marx pensait des positions programmatiques de Lassalle et de son comportement est également précisé par une lettre qu’il envoya à Engels le 9 avril 1863 : “D’autre part, avant-hier, il m’a envoyé sa “Lettre ouverte de réponse” au Comité central ouvrier pour le Congrès ouvrier de Leipzig. Il s’est comporté (se vantant en lançant les phrases qu’il avait copiées de nos écrits) comme un futur dictateur ouvrier”. Marx avait, d’ailleurs, reconnu dans une lettre à Engels le 28 janvier 1863 que le fameux “Programme Ouvrier” n’était qu’une mauvaise vulgarisation du Manifeste Communiste.
Après que Marx et Engels eurent pris connaissance des négociations entre Lassalle et Bismarck, Marx écrivit à Engels : “D’ailleurs, puisque nous savons maintenant qu’Itzig [Lassalle] (ce qui ne nous était nullement connu jusqu’ici) voulait “offrir” le Parti ouvrier à Bismarck pour se faire connaître comme le “Richelieu du prolétariat”, je n’aurai maintenant aucune retenue pour indiquer suffisamment clairement dans la préface de mon livre qu’il est un simple perroquet et un vulgaire plagiaire”. Dans cette préface de la première édition du Capital, Marx a jugé nécessaire de rappeler la méthode avec laquelle Lassalle avait “emprunté” des idées à ses écrits sans en citer la source… (18)
Manipulation et dénigrement des positions de Marx et Engels
Déjà à l’époque, ils considéraient les discours et les écrits de Lassalle comme “royalistes et totalement abjects”. (19) Marx écrivit à Kugelmann : “Cher ami, j’ai reçu hier votre lettre très intéressante et je vais maintenant répondre aux différents points. Permettez-moi tout d’abord d’expliquer brièvement ma relation avec Lassalle. Au cours de son agitation politique, notre relation a été suspendue : 1. à cause de sa tendance à louer sa propre réputation et sa négligence, alors qu’en même temps il était le plagiaire le plus éhonté de mes textes, etc. ; 2. parce que j’ai condamné sa tactique politique ; 3. parce que je lui avais déjà expliqué en détails avant le début de son activité, ici à Londres, et que j’avais prouvé que l’intervention socialiste immédiate de l’État prussien n’avait aucun sens”. (20) “Dès qu’il fut persuadé à Londres (fin 1862) qu’il ne pouvait pas jouer son jeu avec moi, il a décidé contre moi et le vieux parti de se faire passer pour un “dictateur ouvrier”. (21) “Ce type travaille maintenant uniquement au service de Bismarck…”
La tentative de Lassalle pour isoler Marx et Engels du mouvement ouvrier en Allemagne
Lassalle a, en fait, entravé la diffusion des positions de Marx et Engels parmi les travailleurs et a tenté de les isoler de la classe ouvrière en Allemagne. Il s’est présenté comme le véritable “génie” en plus d’essayer de retarder et d’entraver la publication et la diffusion des textes de Marx et Engels, entre autres choses afin de diffuser ses propres positions qui s’écartaient souvent des leurs, ou qui leur étaient diamétralement opposées. Ou bien Lassalle publiait des textes qui n’étaient souvent qu’un plagiat des articles de Marx et Engels, sans toutefois en citer les sources. Marx a écrit un article là-dessus intitulé “Plagiat”.
Lassalle se présentait comme un “vrai connaisseur” des conditions de vie de la classe ouvrière et de la situation en Allemagne, alors que Marx et Engels vivaient à l’étranger et n’auraient pu avoir les connaissances nécessaires.
Lassalle contre la lutte de Marx et Engels pour défendre l’organisation révolutionnaire
Dans sa correspondance avec Marx, Lassalle défend l’agent de Bonaparte, Karl Vogt. Il conseilla à Marx de ne pas engager d’action publique contre Vogt, de ne pas “remuer” l’affaire, car cela serait mal accueilli par le “public” allemand. Marx avait passé une année entière en 1860 à écrire une réponse au livre de Karl Vogt, Mon procès contre l’Allgemeine Zeitung, dans lequel ce dernier souille d’immondes calomnies les activités politiques de Marx et de ses camarades. “J’écrirai une brochure dès que j’aurai son texte diffamatoire (celui de Karl Vogt). Mais en même temps j’explique dans la préface que je n’en ai rien à foutre du jugement de votre “public allemand”. (22) Lorsque l’œuvre de Marx, Herr Vogt, fut publiée, Lassalle ne fit rien pour promouvoir sa diffusion en Allemagne. La presse bourgeoise était soucieuse de passer sous silence l’écrit de Marx. Le président de l’ADAV, pour sa part, sabota la lutte défensive de Marx.
Résistance dans les rangs de l’ADAV contre les positions et les pratiques de Lassalle
À la fin de 1863, début 1864, la résistance s’était développée contre les positions de Lassalle, en particulier contre ses positions en faveur de la monarchie prussienne. Le 11 avril 1864, il appela ouvertement au soutien de la monarchie. Wilhelm Liebknecht, qui s’était installé à Berlin en juillet 1862 après son exil à Londres, fut l’un des premiers à s’opposer fortement à Lassalle. Marx mis en garde Liebknecht contre ses apparitions publiques aux côtés de Lassalle et lui conseilla de ne pas entrer dans des relations étroites avec lui. Liebknecht répondit : “Dans l’association de Lassalle [l’ADAV], quelque chose fermente. Si Lassalle n’abandonne pas l’attitude dictatoriale et son flirt avec la réaction, il y aura un scandale”. Dans la même lettre, Liebknecht disait : “Il joue un jeu si complexe qu’il ne pourra bientôt plus trouver d’issue”.
Avec d’autres forces comme Julius Vahlteich, le secrétaire de l’ADAV, ils ont tenté de libérer l’ADAV des griffes de son président dictatorial. Lorsque Lassalle a remarqué cette résistance et qu’il a senti qu’il allait bientôt devoir répondre devant l’organisation et donc devoir s’exposer à une demande d’explication publique, il chercha un moyen de quitter le mouvement ouvrier. Ses dernières lettres rendent claire cette recherche d’une “sortie”. Mais la mort subite de Lassalle mit un terme inattendu à ses activités.
Le 31 août 1864, il fut grièvement blessé lors d’un duel pour une femme et mourut trois jours plus tard de ses blessures. (23) Avant sa mort, Lassalle avait rédigé un testament en tant que président de l’ADAV dans lequel il avait choisi Bernhard Becker comme successeur à la présidence, qui, avec l’aide de la comtesse Hatzfeldt, mit tout en œuvre pour s’emparer de la présidence et se mit rapidement à proférer les insultes les plus infâmes à l’encontre du “Parti de Marx”.
Afin de préserver l’existence sectaire de l’ADAV, le successeur de Becker lutta contre l’affiliation à la Première Internationale, fondée entre-temps à Londres, le 28 septembre 1864, presque un mois après la mort de Lassalle.
Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails sur l’importance de la formation de la Première Internationale. Cependant, bien que sa fondation ait été un énorme pas en avant pour l’ensemble du mouvement ouvrier, les forces autour de Lassalle n’ont nullement contribué à la participation des travailleurs en Allemagne à sa formation, ni placé leurs efforts dans la perspective de la construction de la Première Internationale.
La situation matérielle de Lassalle
Lassalle s’assura un revenu financier par l’intermédiaire de la comtesse en remportant son procès en tant qu’avocat… et, en même temps, il devint dépendant de la comtesse. Donc, bien qu’il n’ait pas eu à gagner sa vie en tant qu’avocat, il eut un statut privilégié très particulier. De telles situations véritablement parasitaires sur le plan financier le faisaient apparaître à ses yeux comme “indépendant” à l’égard des représentants de la classe dirigeante avec laquelle il avait des relations. Lassalle ne vécut jamais l’expérience de la dépendance salariale ou des difficultés matérielles.
L’article “nécrologique” d’Engels sur Lassalle
“C’était à ce moment un ami très peu sûr pour nous, à l’avenir un ennemi très sûr”. (24)
Dans leur “nécrologie” sur Lassalle, Marx et Engels ont écrit : “Le brave Lassalle s’avère peu à peu être un méchant ordinaire. Nous n’avons jamais jugé les gens sur ce qu’ils imaginaient être, mais sur ce qu’ils étaient, et je ne vois pas pourquoi nous devrions faire une exception pour Itzig [Lassalle]. Subjectivement, sa vanité a pu lui faire apparaître ses prises de position comme défendables, objectivement c’était une trahison de tout le mouvement ouvrier au profit de l’État prussien. Mais ce type stupide ne semble pas avoir exigé de Bismarck, la moindre chose en retour, aucune contrepartie, encore moins des garanties. Il semble s’être contenté de se fier au fait qu’il a dû tromper Bismarck, tout comme il ne pouvait manquer dans son esprit de tuer Racowitza. Cette attitude est typique pour décrire le baron Itzig [Lassalle]. D’ailleurs, le temps ne sera pas long où il sera non seulement souhaitable, mais nécessaire, de publier tout cela. Cela ne peut que nous servir à nous si l’affaire avec l’ADAV est publiée et si notre journal en Allemagne continue, alors bientôt le legs [au mouvement ouvrier] de cet individu devra être liquidé. Entre-temps, le prolétariat en Allemagne va bientôt voir ce que vaut Bismarck”.
Lassalle fut un aventurier dont le véritable rôle de son vivant n’a été reconnu que par très peu de gens et donc seulement au coup par coup. Comme mentionné ci-dessus, même Marx, Engels, Bebel et Liebknecht, qui avaient appris à mieux le connaître, n’avaient pas une image complète de lui.
Erreurs de jugement de Rosa Luxemburg et Franz Mehring sur l’aventurier
En même temps, le cas de Lassalle montre qu’à cette époque, il y avait des différences importantes entre révolutionnaires quant à l’appréciation de ce type d’individus. Car des décennies plus tard, même des esprits politiques aussi importants que Rosa Luxemburg ou Franz Mehring se sont trompés de manière assez flagrante sur Lassalle.
Par exemple, en 1913, cinquante ans après la fondation de l’ADAV, Rosa Luxemburg écrivait un éloge de Lassalle : “Lassalle a certainement commis des erreurs dans sa tactique de combat. Cependant, ce n’est qu’un plaisir bon marché pour les petits voyous de la recherche historique de trouver des erreurs dans le grand travail d’une vie. Pour évaluer une personnalité aussi bien que son œuvre, il est beaucoup plus important de reconnaître la cause réelle, la source particulière à partir de laquelle ses erreurs ainsi que ses mérites sont nés. Lassalle a souvent péché par sa tendance à “la diplomatie”, à “tricher” avec les idées, comme il l’a fait dans ses négociations avec Bismarck sur le suffrage universel, et dans ses projets d’associations productives financées par un emprunt à l’État. Dans ses luttes politiques avec la société bourgeoise comme dans ses luttes judiciaires avec le pouvoir judiciaire prussien, il aimait se placer au niveau de son adversaire, lui accordant ainsi à première vue une concession de son point de vue, se voyant lui-même comme un acrobate audacieux : comme Johann Philipp Becker l’a écrit, il s’est souvent risqué à sauter au bord du gouffre, ce qui distingue une stratégie révolutionnaire d’un pacte avec la réaction. Mais la cause qui l’a conduit à ces sauts audacieux n’était pas l’insécurité intérieure, le doute intérieur sur la force et la faisabilité de la cause révolutionnaire qu’il représentait, mais, inversement, un excès de confiance en la puissance indomptable de cette cause. Lassalle marchait parfois sur le terrain de l’adversaire dans la lutte, tout en ne voulant abandonner aucun de ses objectifs révolutionnaires, mais ayant l’illusion d’une personnalité puissante. Il croyait qu’il était capable d’arracher tant de choses pour ses objectifs révolutionnaires sur son propre terrain que le sol lui-même aurait dû s’effondrer sous les pieds de l’adversaire. Si Lassalle, par exemple, a greffé son idée d’associations productives basées sur le crédit de l’État sur une fiction idéaliste et non historique de l’État, le grand danger de cette fiction réside dans le fait qu’en réalité, il n’a idéalisé que le pathétique État prussien. Mais ce que Lassalle, sur la base de sa fiction, voulait exiger et imposer à cet État en termes de tâches et de devoirs de la classe ouvrière, aurait non seulement ébranlé la caserne misérable de l’État prussien, mais l’État bourgeois en tant que tel”. (25)
Considérant le point de vue de Luxemburg selon lequel Lassalle était “un acrobate audacieux et téméraire, comme Johann Philipp Becker l’a écrit, il s’est souvent risqué à sauter au bord du gouffre qui distingue une stratégie révolutionnaire d’un pacte avec la réaction”, l’expérience montre en réalité le contraire ; elle montre que des déclarations politiques importantes et correctes, auxquelles un aventurier peut parvenir sur quelques points, ne changent ni son caractère ni sa contribution globale. L’évaluation de Franz Mehring, probablement l’historien du parti le plus célèbre et qui a longtemps été aux côtés de Rosa Luxemburg, n’a pas été moins erronée. Car, de son point de vue, Lassalle était un révolutionnaire et, en tant que tel, “à peu près égal” à Marx. (26) Selon Mehring, Lassalle était quelqu’un “que l’histoire de la social-démocratie allemande mentionnera toujours dans le même souffle que lui [Marx] et Engels”. Les écrits de Lassalle sur l’agitation ont “donné une nouvelle vie à des centaines de milliers d’ouvriers allemands”. Selon Mehring, Marx “n’a jamais complètement surmonté ses préjugés” contre Lassalle. Mehring regrettait que Marx “jugeait Lassalle mort encore plus amèrement et injustement que Lassalle vivant”.
En raison des circonstances historiques, Lassalle n’a jamais été complètement démasqué de son vivant. Comme mentionné ci-dessus, Marx et Engels ont rompu avec lui sur les questions programmatiques et en raison de son comportement vers 1861/62, mais ils n’avaient longtemps pas été au courant de la nature de ses liens avec Bismarck. Sa mort subite a augmenté les difficultés à saisir et à démasquer toute l’étendue de sa personnalité.
Schweitzer, un deuxième aventurier
Après la mort de Lassalle en 1864, Jean-Baptiste von Schweitzer est élu président de l’ADAV en 1867 à l’âge de 34 ans. Pour avoir une idée du caractère de Schweitzer, nous citons August Bebel en détails ici : “Jean-Baptiste von Schweitzer est l’une des principales personnalités qui, après la mort de Lassalle, prit la direction de l’association que Lassalle avait fondée. Avec Schweitzer, l’association a reçu un chef de file qui possédait un grand nombre de qualités d’une grande valeur pour un tel poste. Il avait la formation théorique nécessaire, une vision politique large et un esprit calme. En tant que journaliste et agitateur, il avait la capacité de faire comprendre les questions et les problèmes les plus difficiles au travailleur le plus simple ; il savait comment fasciner, voire fanatiser, les masses comme peu en sont capables. Dans le cadre de son travail journalistique, il publia une série d’articles scientifiques de vulgarisation dans son journal, “Le Social-Démocrate”, qui sont parmi les meilleurs que possède la littérature socialiste. (…) Il savait rapidement saisir une situation donnée et comprendre comment l’exploiter. Enfin, il fut aussi un orateur capable et calculateur qui faisait forte impression sur les masses et les opposants.
Mais en plus de ces qualités, en partie brillantes, Schweitzer possédait un certain nombre de vices qui le rendaient dangereux en tant que dirigeant d’un parti ouvrier qui en était aux premiers stades de son développement. Pour lui, le mouvement auquel il s’est joint après plusieurs errances n’était pas une fin en soi, mais un moyen d’atteindre une fin. Il entra dans le mouvement dès qu’il vit qu’aucun avenir ne s’ouvrait à lui au sein de la bourgeoisie, en ayant été mis au ban très tôt par son mode de vie, il n’y avait l’espoir pour lui de jouer le rôle auquel son ambition et, pour ainsi dire, ses capacités le prédestinaient, que dans le mouvement ouvrier. Il ne voulait pas non plus être simplement le un des chefs du mouvement, mais son dirigeant, et il cherchait à l’exploiter à des fins égoïstes et personnelles. Éduqué dans un institut jésuite d’Aschaffenburg pendant plusieurs années, puis se consacrant à l’étude de la jurisprudence, il avait acquis les outils intellectuels de la casuistique jésuite et de la démagogie juridique qui sont par nature rusés et sournois. Il était un politicien qui cherchait sans scrupule à atteindre son but, à satisfaire son ambition à tout prix, à satisfaire son grand train de vie, ce qui n’était pas possible sans des moyens matériels adéquats, qu’il ne possédait pas”. (27)
La morale de Schweitzer
Après l’élection de Schweitzer à la présidence du Frankfurter Arbeiterbildungsverein (Club d’éducation ouvrière de Francfort), avant même la fondation de l’ADAV en novembre 1861, il était non seulement connu localement comme président du Schützenverein (club de tir) et du Turnclub (club de gymnastique), mais il avait également établi des premières relations avec les notables aristocrates locaux, il fut accusé à l’été 1862 de détournement ou vol de fonds au Schützenverein et de contact pédophile avec un jeune de 12 ans dans un parc. Il a été condamné à deux semaines de prison pour l’agression sexuelle commise contre le garçon et pour avoir suscité la colère publique avec ce scandale.
Même si le garçon n’a jamais été retrouvé et même si Schweitzer a nié toute l’affaire, le reproche de maltraitance et d’abus sexuel envers un enfant était désormais constamment suspendu au-dessus de lui. Il n’a jamais nié le détournement de l’argent de la Schützenverein. Néanmoins, Lassalle l’a protégé et l’a accepté dans l’ADAV, le nommant même membre de son conseil d’administration.
Bebel écrira plus tard sur le comportement de Schweitzer et son soutien par Lassalle : “Il a vite compris qu’il y avait là une opportunité pour acquérir une position importante à l’avenir qui correspondait à son ambition, qui lui avait été coupée à tout jamais au sein du monde bourgeois à cause des événements décrits ci-dessus [abus d’enfant et détournement d’argent]. Dans ces cercles, toutes les portes lui étaient fermées”. (28)
Contacts avec la classe dirigeante…
Suivant les traces de Lassalle, Schweitzer s’efforça rapidement d’établir des contacts avec les milieux dirigeants, en particulier Bismarck et son entourage, par l’intermédiaire du conseiller privé, Hermann Wagener. (29)
Comme Lassalle, Schweitzer a également offert son soutien politique à Bismarck. Par exemple, une déclaration de Bebel dans son autobiographie montre à quel point Hatzfeldt était consciente des efforts de Schweitzer : “La comtesse Hatzfeldt, selon laquelle la politique de Schweitzer en faveur de Bismarck n’était pas allée assez loin, avait déjà essayé de justifier cette politique vers la fin de 1864 dans une lettre à Mme. Herweghs, dans laquelle elle écrivit : “Il y a un abîme formel entre les deux choses suivantes : se vendre à un adversaire, travailler pour lui, que ce soit secrètement ou à découvert, ou saisir le moment comme un grand homme politique, profiter des erreurs de l’adversaire, laisser un ennemi se faire éliminer par l’autre, le pousser sur une trajectoire descendante et profiter de la situation favorable, peu importe qui l’a créée. Les personnes qui ont de simples convictions honnêtes, celles qui se placent toujours seulement du point de vue idéal des choses à venir, flottant dans l’air, et qui n’agissent que par impulsion momentanée, peuvent être considérées en privé comme de très bonnes personnes, mais elles sont complètement incapables d’être utiles à quelque chose, à des actions qui influent réellement sur les événements, en bref, les grandes masses ont besoin de suivre un leader clairvoyant qui les dirige””.
Ici, on peut voir le point de vue que l’on trouve souvent chez les aventuriers : les masses sont stupides et doivent être dirigées, elles ont besoin d’une tête pensante qui peut agir efficacement contre l’adversaire. L’aventurier est “l’élu, l’appelé”. Et une partie de ce comportement est d’agir avec un double langage. Comme l’écrivait Bebel : “La manière dont Schweitzer a su flatter les masses, même s’il les méprisait intérieurement, je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre l’exercer avec une telle ampleur”. (30)
… allant de pair avec l’opportunisme
Parce que Schweitzer disait que “Sa Majesté notre roi vénéré est l’ami des travailleurs” et que le principal ennemi de l’ADAV était les partisans du “parti bourgeois libéral”, il mettait en avant que “la lutte du parti social-démocrate doit avant tout être dirigée contre eux. Mais si vous défendez ce point de vue, messieurs, vous vous direz : Pourquoi Lassalle ne se serait-il pas tourné vers Bismarck ?” (31) Bebel continuait : “Schweitzer savait que le point de vue qu’il prêchait était fondamentalement réactionnaire, une trahison des intérêts des travailleurs, mais il le propageait parce qu’il croyait que cela servirait à promouvoir son ascension sociale. (…) Il était évident que Bismarck et les féodaux acceptaient volontiers une telle aide de l’extrême-gauche et soutenaient peut-être le défenseur d’une telle vision. (…) Les tentatives de rendre l’Association Générale des Travailleurs Allemands, acceptable pour la grande politique prussienne de Bismarck, furent donc entreprises très tôt et de façon permanente. C’est à moi de prouver que Schweitzer a consciemment servi les efforts de Bismarck”. Les efforts déployés pour réaliser leurs ambitions personnelles par des contacts directs ou indirects avec les dirigeants s’accompagnaient donc souvent de faiblesses et d’impostures programmatiques, comme on pouvait le voir dans la question du droit électoral. (32) Engels écrivit plus tard : “À cette époque, on tenta de placer l’ADAV (qui était alors la seule association organisée de travailleurs sociaux-démocrates en Allemagne) sous l’aile du ministère de Bismarck en donnant aux ouvriers la perspective que le gouvernement leur accorde le suffrage universel. Le “droit de vote universel, égal et direct” avait été prêché par Lassalle comme le seul et infaillible moyen de conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière”.
Engels écrivit alors deux textes programmatiques importants, La question militaire prussienne et le Parti Ouvrier Allemand, ainsi qu’une réponse à Schweitzer “À propos de Proudhon”. Comme Engels le commenta, “cet article avait Proudhon comme sujet, mais en fait il devrait aussi être une réponse au lassallisme lui-même”.
Dans le même temps, Schweitzer réagit à la critique de sa position sur la Prusse. Compte tenu du fait que Marx et Engels vivaient en Angleterre et non pas en Allemagne, ils ne pouvaient pas avoir de connaissances précises et profondes de la situation globale de l’Allemagne. Selon Schweitzer, ce n’est que si l’on a une vision “locale” ou “nationale” que l’on peut juger correctement : “En ce qui concerne les questions pratiques de tactique momentanée, je vous demande cependant de considérer que, pour juger ces choses, il faut se tenir au centre du mouvement”. Dans le Social-Démocrate du 15 décembre 1864, un article, “Notre Programme”, défendait ce point de vue national : “Nous ne voulons pas d’une patrie impuissante et déchirée, impuissante à l’extérieur et pleine d’arbitraire à l’intérieur ; nous voulons la toute-puissance de l’Allemagne, le seul État libre du peuple”. (33) Une vision nationaliste aussi forte avait été présentée au moment même où la Première Internationale soulignait le principe essentiel et indispensable de l’internationalisme pour l’ensemble de la classe ouvrière dans le monde.
Le 15 décembre 1865, Schweitzer publia un article dans le Social-Démocrate faisant l’éloge des “mérites” de Lassalle, comme s’il n’y avait eu aucun mouvement ouvrier avant lui. En réponse, Marx envoya l’article mentionné plus haut sur Proudhon afin d’encourager discrètement une réflexion critique sur le rôle de Lassalle. Outre la glorification de Lassalle, le Social-Démocrate de Schweitzer souhaitait élargir encore le soutien à Bismarck. En conséquence, Marx et Engels renoncèrent à leur collaboration au Social-Démocrate, le 23 février 1865, après quoi Schweitzer a de nouveau falsifié les positions de Marx et Engels. (34)
Le culte de la personnalité autour de Lassalle
L’opposition au sein de l’ADAV commença à polémiquer contre les “dispositions organisationnelles dictatoriales dans les Statuts de l’Association visant à entourer d’une sorte de gloire le travail de Lassalle. Le culte de Lassalle était désormais systématiquement promu et tous ceux qui osaient émettre un point de vue différent étaient stigmatisés comme des profanateurs”. (35) Bebel poursuivait en disant : “Schweitzer soutenait ces points de vue idiots, qui finirent par devenir une sorte de croyance religieuse. (…) Au cours des années, le thème “le Christ et Lassalle” devint le sujet à l’ordre du jour de nombreuses réunions publiques”. (36)
Des sources de financement “obscures”
Comme Lassalle, Schweitzer ne s’appuyait pas uniquement sur des sources de financement douteuses. Il n’a jamais expliqué d’où provenaient les fonds importants pour la production et la distribution du Social-Démocrate, après que l’on soupçonna qu’il recevait des fonds du gouvernement. Le simple soupçon exprimé qu’il dépendait de fonds gouvernementaux, qu’il pouvait ainsi non seulement faire l’objet de chantage, mais même être directement corrompu, n’aurait pas dû être laissé sans réponse par Schweitzer. Au lieu de cela, il évita toujours de répondre à cette accusation. (37)
Il n’a non plus rien fait lorsqu’on apprit qu’un informateur de la police nommé Preuß était actif dans l’organisation et se trouvait même en contact avec le chef de la police, avec lequel Schweitzer lui-même entretenait des contacts.
Un traitement de faveur par la police
On pourrait rétorquer : les peines de prison ou les actions répressives contre les aventuriers ne sont-elles pas la preuve de leur “innocence” ?
En novembre 1865, Schweitzer fut emprisonné et aurait dû purger une peine d’un an pour insulte envers le roi et pour avoir bafoué les lois, le privant ainsi de ses droits civils. “Il a été affirmé que les différentes peines de prison sont des preuves contre l’accusation selon laquelle Schweitzer aurait été l’agent de Bismarck. Ce point de vue est tout à fait erroné. Les relations qu’un gouvernement entretient avec ses agents politiques ne les lient pas aux procureurs et aux juges. La condamnation temporaire d’un agent infiltré pour des actes d’opposition est également très appropriée pour éliminer la méfiance à l’égard de la personne concernée et pour renforcer la confiance en elle. Il est bien connu qu’à l’époque où Lassalle et Bismarck eurent leurs conversations politiques et entretinrent des “rapports cordiaux”, les tribunaux de Berlin n’hésitèrent pas à le condamner à une série de peines de prison sévères, même si l’on savait à l’époque comment Bismarck et Lassalle se comportaient l’un envers l’autre”. (38)
Alors que la police berlinoise terrorisait les suspects lors de leurs perquisitions policières tôt le matin, entre autres par des perquisitions à domicile, “Schweitzer […] n’a jamais eu à se plaindre de telles mesures ou de mesures similaires. Il est allé en prison et il en est sorti comme s’il était allé à l’hôtel”. (39) En fait, Schweitzer a été libéré de prison à plusieurs reprises et a presque pu entrer et sortir de prison en continuant ses activités, contrairement aux autres membres de l’ADAV qui y moisissaient.
En fait, la proche alliée de Lassalle, la comtesse Hatzfeldt, dénonça même Liebknecht à la police lorsqu’il séjournait “illégalement” à Berlin en 1865, après quoi il fut expulsé de la ville. (40)
Résistance croissante à Schweitzer dans l’ADAV
Au printemps 1869, une résistance se forma au sein de l’ADAV contre le pouvoir dictatorial de Schweitzer. Tout d’abord contre son mode de vie dispendieux : “Schweitzer fait partie de ces personnages qui dépensent toujours au moins deux fois plus d’argent qu’ils n’en gagnent, et dont le slogan est : les besoins ne doivent pas dépendre des revenus, mais les revenus doivent dépendre des besoins, ce qui exige qu’ils prennent sans scrupules l’argent là où ils le trouvent. En 1862, Schweitzer avait pris 2 600 florins dans la caisse de la Schützenfestkasse (club de tir), mais plus tard, lorsqu’il fut président de l’ADAV et avait ainsi l’argent à sa disposition, il détourna des sommes collectées par des ouvriers mal payés afin de satisfaire ses désirs. Il ne s’agissait pas de sommes importantes, mais elles étaient destinées au maigre contenu de la caisse de l’association et non à Schweitzer. Il a été accusé de mauvaise gestion, même de malversation et cela a également été prouvé lors de diverses assemblées générales de l’ADAV, et Bracke, qui pendant de nombreuses années fut le trésorier de l’association et dû avancer l’argent sur ordre de Schweitzer l’a publiquement accusé de ces activités infâmes, sans que Schweitzer n’ose dire un mot pour sa défense. Mais quiconque est capable d’une telle chose doit être aussi considéré comme capable de se vendre politiquement, ce qui pourrait constituer une affaire encore plus lucrative pour lui. Personne ne peut prouver le montant détourné, car de telles transactions ne sont pas apparues au grand jour”. (41) Lorsque la section locale d’Erfurt voulut faire vérifier la gestion de trésorerie de Schweitzer, il menaça de dissoudre l’association… et trois semaines plus tard, la police monta une expédition punitive et en profita pour dissoudre l’association. Par la suite, après s’être entouré d’un cercle restreint de fidèles, il fonda une nouvelle association. Ses statuts prévoyaient : “Les nouveaux statuts contenaient des dispositions carrément scandaleuses. Ainsi, le président devait être élu six semaines avant l’assemblée générale ordinaire par les membres de l’association, c’est-à-dire avant que l’assemblée générale ne se soit prononcée et n’ait examiné sa gestion”. (42)
Dénigrement de Marx et Engels
“Schweitzer déclara, en outre, contre Marx et Engels, qu’ils s’étaient retirés du “Social-Démocrate” dès qu’ils avaient réalisé qu’ils ne pouvaient jouer le premier rôle dans le parti. Contrairement à eux, Lassalle n’était pas l’homme de l’abstraction stérile mais un homme politique au sens strict du terme, pas un littérateur doctrinaire, mais un homme d’action pratique.
Il ne faut cependant pas oublier que Schweitzer flatta plus tard l’homme de “l’abstraction stérile”, le “littérateur doctrinaire” Karl Marx, et chercha à le convaincre”. (43)
Lors de l’assemblée générale de l’ADAV à Wuppertal Barmen-Elberfeld, fin mars 1869, au cours de laquelle Schweitzer devait rendre des comptes, Bebel rapporta à Marx : “Liebknecht et moi sommes assis ici à Elberfeld dans un petit cercle de personnes partageant les mêmes idées pour préparer le plan de campagne pour la bataille de demain. Ici, nous avons entendu une telle abondance d’actes malveillants et ignobles de Schweitzer que nos cheveux se sont dressés sur nos têtes. Il s’avère aussi que Schweitzer ne propose d’accepter le programme de l’Internationale que dans le but de porter un coup contre nous et de renverser une bonne partie des éléments d’opposition ou plutôt de les attirer à lui”. (44) Bebel ajouta que “Schweitzer utilise tous les moyens de perfidie et d’intrigue contre nous”. Bebel et Liebknecht voulurent mettre en accusation Schweitzer lors de cette séance plénière. (45) “L’après-midi suivant, nous sommes entrés dans la salle bondée, accueillis par les regards furieux des supporters fanatiques de Schweitzer. Liebknecht a parlé en premier, environ une heure et demie, j’ai suivi et parlé beaucoup plus brièvement. Nos accusations contenaient ce que j’avais jusque-là avancé contre Schweitzer. Plusieurs fois, il y a eu des interruptions violentes, notamment lorsque j’ai présenté Schweitzer comme un agent du gouvernement. Je devais retirer cette accusation. J’ai refusé de le faire. Je pensais que j’avais le droit de parler librement, eux, les auditeurs, n’étaient pas obligés de me croire. (…) Schweitzer, qui était assis sur le podium derrière nous lors de nos interventions, n’a pas ouvert la bouche. Nous avons donc quitté la salle, quelques délégués marchant devant et derrière nous pour nous protéger des assauts des supporters fanatiques de Schweitzer. Mais des mots aussi flatteurs que “bandit”, “traître”, “fumier”, “tu mériterais qu’on te brise les os”, etc. ont été entendus dans la foule pendant que nous essayions de nous frayer un chemin vers la sortie. L’une des personnes présentes a également essayé de me faire tomber de l’estrade en me portant un coup au genou. Devant la porte, nos amis nous ont accueillis pour nous escorter jusqu’à notre hôtel comme des gardes”.
Schweitzer a exigé un vote de confiance de la part des délégués. Après un débat animé, il a été confirmé dans ses fonctions de président, bien qu’avec un nombre de voix très réduit : “Même si Schweitzer a été réélu par l’assemblée générale, ses pouvoirs ont été sévèrement limités. Schweitzer a détourné le procès-verbal de l’assemblée générale et l’a fait disparaître. (…) Rien de ce qui le compromettait ne devait être porté à la connaissance de tous les membres de l’association et rendu public”. (46)
Pendant une courte période, les deux ailes dans lesquelles l’ADAV s’était scindée avaient proclamé leur réunification sous l’autorité de Schweitzer. Mais l’aile de l’opposition autour de Bracke conclut que “M. von Schweitzer n’utilise l’association que pour satisfaire son ambition et la transformer en un outil de politique réactionnaire contre les travailleurs”. (47) L’opposition a alors demandé la tenue d’un congrès de tous les travailleurs sociaux-démocrates en Allemagne (à Eisenach). Ils ont démissionné de l’ADAV et se sont exprimés ainsi : “Il deviendra clair si la corruption, la malveillance, les pots-de-vin d’un côté l’emporteront ou si l’honnêteté et la sincérité des intentions de l’autre, finiront par gagner.
Notre slogan est : À bas le sectarisme ! À bas le culte de la personnalité ! À bas les jésuites qui reconnaissent notre principe en paroles, et le trahissent en actes ! Vive la social-démocratie, vive l’Association Internationale des Travailleurs !
Le fait que dans cette déclaration, et plus tard à plusieurs reprises, nous ayons utilisé l’honnêteté de nos intentions contre tous les Schweitzers malhonnêtes sur le terrain, a par la suite valu au parti nouvellement fondé par les opposants le surnom “Le Parti honnête. (…)
La contre-offensive de Schweitzer ne tarda pas à arriver. Le “Social-Démocrate” observait maintenant la tactique consistant à proclamer constamment que notre organisation n’était pas composée de travailleurs mais d’intellectuels, de précepteurs et d’autres bourgeois”. (48) Surtout, l’opposition devait être discréditée par ses propres abus de pouvoir, ses prétentions grotesques et ses insinuations. “Derrière notre Congrès, disait l’article, se tenait toute la bourgeoisie libérale dans toutes ses nuances. Bien sûr, derrière son bataillon de littérateurs, de doctes professeurs, de marchands, etc., il ne saurait être question d’une organisation serrée et uniforme. Chacune de ces personnes éprouve le besoin de se rendre très importante. Toute la presse bourgeoise était à nos ordres, poursuivait-il. Il veillerait à ce qu’un nombre important de délégués viennent au Congrès d’Eisenach, mais pas des littérateurs et des bourgeois, mais de vrais ouvriers”. (49) Enfin, Tölcke, qui avait été élu président de l’ADAV en 1865, accusa Bebel dans le Social-Démocrate du 28 juillet 1869 “d’obtenir 600 thalers par mois de l’ex-roi de Hanovre”, une pure calomnie !
Lors du congrès fondateur d’Eisenach en août, les membres craignaient finalement une violente intrusion des fanatiques partisans de Schweitzer. Une centaine de sympathisants du cercle “Schweitzer” apparurent en effet au Congrès d’Eisenach, mais ne furent pas admis en raison de leur absence de mandats.
Avec la fondation du Parti d’Eisenach en 1869, qui s’était érigé sur la base de l’opposition au sein de l’ADAV, un premier parti fut fondé : le Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschland (SDAP – Parti social-démocrate des travailleurs d’Allemagne).
Dans une lettre directement adressée à Schweitzer en 1868, Marx parle de l’étape indispensable pour passer d’une secte que le mouvement devait dépasser à un véritable mouvement de classe auquel Schweitzer a non seulement refusé de contribuer, mais auquel il s’est également opposé : “D’ailleurs, dès le début, comme celui qui déclare qu’il a dans sa poche une panacée pour les souffrances des masses, [Lassalle] a donné à son agitation un caractère religieux et sectaire. Chaque secte est en fait religieuse. De plus, ce n’est pas parce qu’il était le fondateur d’une secte qu’il a nié tout lien naturel avec le mouvement antérieur, tant en Allemagne qu’à l’étranger. Il tomba dans la même erreur que Proudhon : au lieu de chercher parmi les éléments authentiques du mouvement ouvrier la véritable base de son agitation, il essaya d’imposer ses propres orientations à ces éléments en appliquant une recette dogmatique déterminée.
Ce que je rappelle ici aujourd’hui, je l’avais en grande partie prédit à Lassalle en 1862, quand il vint à Londres et m’invita à me placer avec lui à la tête du nouveau mouvement.
Vous avez vous-même vécu en personne l’opposition entre le mouvement d’une secte et le mouvement d’une classe. La secte voit la justification de son existence et son “point d’honneur”, non pas dans ce qu’elle a en commun avec le mouvement de classe, mais dans le “shibboleth” (signe de reconnaissance propre aux initiés) particulier qui la distingue de lui. Par conséquent, à Hambourg lorsque vous avez proposé au congrès la formation de syndicats, vous n’avez pu vaincre l’opposition de la secte qu’en menaçant de démissionner de la fonction de président. En outre, vous étiez obligé de pratiquer un double langage et d’annoncer que, dans un cas, vous agissiez en tant que chef de la secte et dans l’autre en tant que représentant du mouvement de classe.
La dissolution de l’Association générale des travailleurs allemands vous a donné l’occasion historique de faire un grand pas en avant et de déclarer, pour prouver si nécessaire, qu’un nouveau stade de développement était maintenant atteint, et que le moment était venu pour le mouvement sectaire de se fondre dans le mouvement de classe et de mettre un terme à toute relation de dépendance personnelle vis-à-vis de cette secte. En ce qui concerne le contenu véritable de la secte, il serait, comme pour toutes les sectes ouvrières précédentes, développé dans le mouvement général comme un élément qui l’enrichit en dépassant ce stade. Au lieu de cela, vous avez exigé du mouvement de classe qu’il se subordonne au mouvement d’une secte particulière.
Ceux qui ne sont pas vos amis en ont conclu que quoi qu’il arrive, vous vouliez préserver votre “propre mouvement ouvrier””. (50)
En juillet 1871, la section de Braunschweig du parti publia cet appel : “Mais vis-à-vis de M. von Schweitzer qui, de la manière la plus malveillante et la plus répréhensible qui soit, tente de dresser les travailleurs les uns contre les autres, les sociaux-démocrates contre les sociaux-démocrates, nous sommes obligés de défendre la cause des travailleurs avec toute notre énergie. C’est pourquoi nous appelons les camarades du parti de Barmen-Elberfeld, (…) à prendre sans délai les mesures nécessaires en ce sens ; le parti est coupable et obligé de débarrasser le mouvement général d’un homme qui, sous couvert d’une attitude radicale, a jusqu’ici tout fait dans l’intérêt du gouvernement de l’État prussien pour nuire à ce mouvement. Le parti soutiendra les camarades de Barmen-Elberfeld. Maintenant en avant, avec vigueur !” (51) Au printemps 1871, Schweitzer fut exclu de l’ADAV. (52)
Comme dans le cas de Lassalle, Schweitzer n’a jamais été entièrement démasqué de son vivant (il mourut en 1875 d’une pneumonie). Il a été expulsé de l’ADAV, mais sans que les leçons en aient été suffisamment tirées.
Ce n’est que dans la lutte contre les activités de Bakounine que la Première Internationale et son Conseil Général ont développé la capacité d’exposer les agissements d’un aventurier de manière efficace.
La lutte contre les aventuriers n’est pas possible sans assimiler l’expérience du mouvement révolutionnaire
Le rôle de ces deux aventuriers, tous deux avocats, qui pendant des années ont pu faire leur sale boulot dans l’ADAV (alors qu’aux yeux de beaucoup ils donnaient l’impression d’agir dans l’intérêt de la classe ouvrière) montre combien il est difficile d’identifier et d’exposer au grand jour le comportement, les buts et les méthodes d’un aventurier.
Exposer et découvrir leur comportement, leur carrière, leurs interactions, leurs réactions et leurs véritables motivations est l’un des plus grands défis pour une organisation révolutionnaire. Comme le passé l’a montré, le fait que ces personnes aient gagné la confiance de nombreux membres de l’organisation par ruse et jouissent d’une haute réputation dans l’ensemble de la classe ouvrière est un obstacle majeur, mais cela ne doit pas compromettre la capacité de reconnaître et de comprendre la véritable nature de tels individus. Le démasquage de ces aventuriers rencontre généralement l’horreur et la résistance de ceux qui se sentent les plus proches d’eux et qui sont incapables ou ne veulent pas reconnaître la réalité en raison d’une allégeance de longue date, d’une “fidélité personnelle” et/ou d’une affinité émotionnelle. Comme ces personnes peuvent être des figures “très estimées”, dont “personne n’attend une chose pareille”, il est d’autant plus important d’accepter l’expérience historique douloureuse du mouvement révolutionnaire. Engels écrivit peu avant la fin de sa vie, en 1891, qu’il “ne permettrait plus que la fausse renommée de Lassalle soit maintenue et prêchée à nouveau aux dépens de Marx”. (53)
Il résume ainsi les hésitations, les doutes, les scepticismes au sein du parti, et pourquoi il était important de démasquer Lassalle au grand jour et sans concession : “Vous dites que Bebel vous écrit que le traitement de Lassalle par Marx a provoqué de la rancune [ou de la colère] chez les anciens lassalliens. C’est peut-être le cas. Les gens bien sûr, ne connaissent pas la véritable histoire, et rien ne semble avoir été fait pour les informer. Si ces gens ne savent pas que toute la grandeur de Lassalle était basée sur le fait que Marx lui a permis de se parer pendant des années des résultats des recherches de M[arx] comme si c’était les siens, et en plus de cela pour les déformer par manque de connaissances économiques, ce n’est pas de ma faute. Mais je suis l’exécuteur littéraire de la volonté de Marx et en tant que tel, j’ai mes devoirs.
Durant les 26 dernières années, Lassalle a fait partie de l’histoire. Si lors des lois anti-socialistes, la critique de ses positions a été suspendue, il est grand temps maintenant de valider cette critique et que la position de Lassalle sur Marx soit clarifiée. La légende qui cache et glorifie la figure de Lassalle ne peut devenir une profession de foi du Parti. Qu’importe à quel point les mérites de Lassalle pour le mouvement peuvent être appréciés, son rôle historique dans ce mouvement demeure double. Le Lassalle socialiste est accompagné à chaque fois par le Lassalle démagogue. Derrière l’agitateur et l’organisateur Lassalle, le vrai visage de la vedette du procès Hatzfeld s’éclaire : partout le même cynisme dans le choix des moyens, la même préférence de s’entourer de gens peu recommandables et corrompus qui peuvent être utilisés ou jetés comme de simples instruments. Jusqu’en 1862, en pratique, il fut un vulgaire démocrate prussien à forte tendance bonapartiste (je viens de lire ses lettres à Marx), il a soudain retourné sa veste pour des raisons purement personnelles et a commencé son agitation activiste en tous sens ; et en moins de deux ans, il a exigé que les ouvriers prennent le parti de la royauté contre la bourgeoisie et a triché avec Bismarck qui a le même caractère que lui, d’une manière qui aboutirait à la trahison des intérêts de classe si on ne l’étouffait pas à temps pour assurer la propre survie du mouvement ouvrier. Dans ses écrits sur l’agitation, les choses justes qu’il a empruntées à Marx sont si régulièrement entrelacées de fausses déclarations que les deux peuvent difficilement être séparées. La partie des ouvriers qui se sentent choqués par le jugement de Marx ne connaissent de Lassalle que ses deux années d’agitation et ceci uniquement à travers des lunettes à prisme déformant. Mais face à de tels préjugés, la critique de l’histoire ne peut pas s’en tenir éternellement à une attitude respectueuse et passive. Il était de mon devoir de clarifier enfin la relation entre Marx et Lassalle. C’est fait. Je peux me contenter de cela pour l’instant. J’ai moi aussi maintenant d’autres choses à faire. Et le jugement impitoyable de Marx sur Lassalle publié, fera seul son travail et encouragera les autres. Mais si je devais le refaire, je n’aurai pas le choix : je devrai balayer la légende Lassalle une fois pour toutes”. (54)
Le démasquage des activités de Bakounine à travers le Conseil Général de la Première Internationale a montré que cette lutte n’était possible que grâce à la conscience politique et à la détermination pour démasquer ces aventuriers. Cela ne pouvait se faire qu’en établissant un rapport spécifique comme celui du Conseil Général au Congrès de La Haye. (55) Lorsque Bebel et Liebknecht ont dénoncé Schweitzer en 1869 lors de la conférence du Parti de Wuppertal, ils l’ont fait sans avoir présenté un rapport en bonne et due forme et sans avoir donné une image complète de son pouvoir de nuisance, ce qui a certainement contribué à ce que son démasquage soit seulement “à moitié fait”, et cela n’empêcha pas Schweitzer d’être réélu, malgré une résistance croissante.
La lutte contre les aventuriers, qui, comme l’a montré l’expérience de Marx et Engels dans leur combat contre Lassalle et Schweitzer, est un formidable défi. Il a été porté à un niveau beaucoup plus élevé et efficace par le Conseil Général de la Première Internationale au Congrès de La Haye. En tirant les leçons des faiblesses et des difficultés de la lutte contre Lassalle et Schweitzer, le Conseil Général a offert les armes pour affronter Bakounine. Il appartient aujourd’hui aux organisations révolutionnaires de se réapproprier les leçons de cette lutte.
Dino, juillet 2019
1“Question d’organisation, IV : la lutte du marxisme contre l’aventurisme politique [9]” Revue Internationale n° 88 (1e trimestre 1997)
2Ferdinand Lassalle est né en 1825 à Breslau, fils d’un riche marchand de soie juif. Déjà dans son adolescence, il s’est distingué par ses activités très indépendantes et ses ambitions. En tant qu’étudiant, il aspirait à un poste de professeur d’université.
3À cause de ses relations étroites avec la comtesse Hatzfeld, la Ligue des communistes a refusé de l’accepter dans ses rangs.
4L’un de ses biographes, Schirokauer, a mentionné son style de vie somptueux quand il était jeune homme et sa consommation élevée de vins et champagnes coûteux. Dans la résidence de Berlin, où lui et la comtesse vivaient, il a été rapporté qu’apparemment la consommation de haschisch et d’opium était également une pratique courante. Pour plus de détails, voir en allemand : Arno Schirokauer : Lassalle. Die Macht der Illusion, die Illusion der Macht. (Le pouvoir de l’illusion, l’illusion du pouvoir), aux éditions Paul List, Leipzig 1928.
5À cause la loi sur les associations de 1854, les associations de travailleurs politiques étaient interdites, ainsi que les liens entre les associations autorisées par les autorités.
6Gustav Mayer, Le rapport du mouchard Lassalle à propos de lui-même, republié dans les archives de Grünberg. Voir aussi, en allemand, du même auteur : Bismarck et Lassalle, leur correspondance et leurs entretiens (1928) ainsi que Johann Baptist von Schweitzer et la social-démocratie (1909).
7A.K. Worobjowa, L’histoire du mouvement ouvrier en Allemagne et la lutte de Karl Marx et Friedrich Engels contre Lassalle et le lassalisme (1961).
8Bebel, Ma vie. Plus tard, Bebel interpella à nouveau publiquement Bismarck sur ses liens avec Lassalle. “Par rapport aux relations avec Lassalle que je lui reprochais, il répondit que ce n’était pas lui, mais Lassalle, qui avait émis le souhait de lui parler, et il ne lui avait pas rendu difficile l’accès à la réalisation de ce désir. Il ne l’avait pas regretté non plus. Quant à des négociations entre eux, cela n’était nullement la question : qu’aurait bien pu lui offrir ce pauvre diable de Lassalle ?”.
9Gustav Mayer, Bismarck et Lassalle.
10Bebel, Ma vie.
11August Bebel, Ibid.
12“Hélène von Rakowicza (Hélène von Dönniges), l’ancienne amante de Lassalle, pour qui il provoqua le duel qui lui coûta la vie, a raconté dans son livre : Von anderen und mir, (D’autres et de moi) (1909), qu’ “elle posa la question à Lassalle dans une conversation nocturne : “Est-ce vrai ce qu’on dit ? Avez-vous pu soutirer des secrets de Bismarck ?” Il répondit : “En ce qui concerne Bismarck et ce qu’il attendait de moi et moi de lui ? Il devrait vous suffire de savoir que cela ne s’est pas produit et que cela ne pouvait pas se produire. Nous étions tous les deux trop intelligents (nous avions compris notre ruse mutuelle et nous n’aurions pu que rire ironiquement de nos vues politiques respectives. Mais nous sommes trop bien éduqués pour cela). Donc, nous n’avons eu que des entrevues et des échanges à la hauteur de notre esprit”.
13Lassalle, Archives de ses lettres et écrits (1925).
14Voir aussi Engels, La question militaire de la Prusse et le parti des travailleurs allemands [64] et On the Dissolution of the Lassallean Workers' Association [65].
15Ouvrage de Lassalle consacré à un célèbre journaliste et historien de la littérature de l’époque.
16Surnom donné par Marx à Lassalle.
17Jenny Marx, Bref aperçu d’une vie mouvementée (1865).
18“Itzig [Lassalle] m’envoie, inévitablement, son discours de défense (il a été condamné à quatre mois de prison) au tribunal. Macte puer virtute ! Tout d’abord, cet homme vantard avait la brochure que vous avez entre les mains, le discours sur “la classe ouvrière”, réimprimé en Suisse sous le titre pompeux : “Programme des travailleurs”. Vous savez que la chose n’est rien d’autre qu’une mauvaise vulgarisation du “Manifeste” et d’autres choses si souvent prêchées par nous qu’elles sont, pour ainsi dire, déjà devenues des lieux communs. (Cet énergumène, par exemple, parle de “positions” en parlant de la classe ouvrière.) Eh bien, dans son discours devant le tribunal de Berlin, il n’a montré aucune honte à proclamer : “J’affirme en outre que cette brochure n’est pas seulement un ouvrage scientifique qui, comme beaucoup d’autres, résume des résultats déjà connus, mais qu’elle est même à bien des égards une réalisation scientifique, un développement de nouvelles idées scientifiques… Dans des domaines scientifiques divers et difficiles, j’ai mis au jour de nombreux travaux, je n’ai épargné aucun effort ni aucune nuit blanche pour repousser les limites de la science elle-même, et je peux, peut-être, dire avec Horace : militavi non sine gloria [Je ne me suis pas battu sans gloire]. Mais je vais vous expliquer moi-même : non jamais, dans mes travaux les plus étendus, je n’ai écrit une ligne qui ne serait plus strictement scientifique que cette production de sa première page à sa dernière… Jetez donc un coup d’œil au contenu de cette brochure. Ce contenu n’est rien de plus qu’une philosophie de l’histoire comprimée en 44 pages… Il s’agit d’un développement de la pensée rationnelle objective qui est à la base de l’histoire européenne depuis plus d’un millénaire, d’un épanouissement de l’âme intérieure, etc.”… Cette indécence n’est-elle pas incroyable ? Ce type se prend pour l’homme qui dirige notre travail. C’est grotesque et ridicule !”
19Marx à Engels, 24 novembre 1864.
20Marx à Kugelmann, 23 février 1865.
21Engels, le 11 juin 1863 (trois jours avant la fondation de l’ADAV).
22Marx à Lassalle, le 30 janvier 1860.
23“Lassalle tomba amoureux d’une jeune femme nommée Hélène von Dönniges lors d’un séjour dans une station thermale. Il voulut l’épouser, mais ses parents s’y opposèrent. Afin de poursuivre avec succès son père, le diplomate bavarois Wilhelm von Dönniges, pour la séquestration de sa fille, il tenta, le 16 ou 17 août 1864, de rallier le roi de Bavière Louis II à sa cause. (…) Lassalle décida alors de se rendre en Suisse et de défier Wilhelm von Dönniges en duel. En tant que membre d’une société aristocratique, Lassalle demanda réparation au père d’Hélène, membre d’un autre club aristocratique. Le père, âgé de 50 ans, chargea alors le fiancé de sa fille, le boyard roumain, Janko von Racowitza, de l’affronter en duel en son nom.
Le duel eut lieu le matin du 28 août 1864 dans la banlieue genevoise de Carouge. L’assistant de Lassalle était Wilhelm Rüstow. À 7h30, les adversaires s’affrontèrent au pistolet. Racowitza tira le premier et toucha Lassalle à l’abdomen. Trois jours plus tard, le 31 août 1864, Ferdinand Lassalle mourut à Carouge à 39 ans”. On pourrait banaliser le fait de se battre en duel comme un comportement machiste typique des aristocrates ou, comme dans le cas de Lassalle, des bourgeois. Sa culture des rivalités intenses dans sa jeunesse (parce qu’à l’âge de 12 ans, il sollicita pour la première fois une demande de se battre en duel pour une jeune fille de 14 ans) pouvait encore être mise sur le compte d’un zèle pubère. Mais pour un adulte de 39 ans qui faisait semblant devant les ouvriers de poursuivre des objectifs révolutionnaires, vouloir éliminer un “concurrent” en duel tout en mettant sa propre vie en danger, était une grave perversion contre les objectifs de la classe ouvrière.
24Engels à Marx, 4 septembre 1864.
25Rosa Luxemburg : Lassalle et la révolution (1904).
26Mehring, Histoire de sa vie.
27August Bebel, Ma vie.
28August Bebel, Ma vie.
29Son assistant dans ces affaires était le conseiller supérieur privé du gouvernement, Hermann Wagener. Il y avait également l’agent de police Preuß, sous les ordres de Wagener. Preuß avait dénoncé la présence de Wilhelm Liebknecht à Berlin, à l’automne 1866, à l’encontre de l’ordre de la police, ce qui valut trois mois de prison à Liebknecht. Voir A.K. Worobjowa.
30August Bebel, Ma vie.
31August Bebel, Ibid.
32Voir, par exemple, l’article de Schweitzer : “Le Ministère de Bismarck et le gouvernement des États centraux et des petits États”.
33August Bebel, Ma vie.
34“J’avais écrit à Schweitzer, il y a une dizaine de jours, qu’il devait faire front contre Bismarck, et aussi sur l’impression de flirt du Parti des Travailleurs avec Bismarck. Cette politique devait donc être abandonnée, etc. En réponse, il s’est montré encore plus disposé à pousser son flirt avec Bismarck.” (Lettres de Marx à Engels, des 3 et 18 février 1865)
35August Bebel, Ma vie.
36August Bebel, Ibid. “Les deux premières publications tests contenaient déjà beaucoup de points douteux. J’ai fait une remontrance. Et j’ai notamment exprimé mon indignation devant le fait que, dans une lettre privée que j’ai écrite à la comtesse Hatzfeldt au sujet de la mort de Lassalle, quelques mots de réconfort avaient été extraits, publiés sans ma signature et utilisés sans vergogne pour “proclamer et faire résonner” un éloge servile de Lassalle” (Marx, le 15 mars 1865).
37Dans les rapports ultérieurs des membres du parti, il est devenu évident qu’il avait détourné les fonds du parti (Bebel, Ma vie).
38August Bebel, Ma vie.
39August Bebel, Ibid.
40A.K. Worobjowa, op cit.
41August Bebel, Ma vie.
42August Bebel, Ibid.
43August Bebel, Ibid.
44August Bebel, Ibid.
45En fait, la pratique et la tradition du mouvement ouvrier exigeaient que si un ou plusieurs membres de l’organisation soupçonnent un comportement anti-organisationnel ou expriment un doute sur la crédibilité d’un autre membre, un organe spécialement désigné de l’organisation intervienne afin de mener une enquête avec la discrétion et la méthode appropriées. Un tel organe n’existait pas dans l’ADAV et la situation était d’autant plus compliquée que la personne soupçonnée était le président de l’organisation.
46August Bebel, Ma vie.
47August Bebel, Ibid.
48August Bebel, Ibid.
49August Bebel, Ibid.
50Marx à Schweitzer, 13 octobre 1868.
51August Bebel, Ma vie.
52Bebel a rapporté que les partisans de Schweitzer au moment de la guerre franco-prussienne étaient soupçonnés d’avoir attaqué l’appartement de Liebknecht. (August Bebel, Ma vie)
53Engels à Bebel, 1-2 mai 1891.
54Engels à Kautsky, 23 février 1891.
55Voir les articles dans notre Revue Internationale : n° 84, 85 et 87.
Conscience et organisation:
- La Ligue Communiste [66]
Personnages:
- Lassalle [67]
- Schweitzer [68]
- Karl Marx [69]
- Friedrich Engels [70]
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [71]
Rubrique:
Gaizka se tait: un silence assourdissant
- 324 lectures
Face à la publication de notre article : “Qui est qui dans Nuevo Curso ? [5]”, qui dénonce le fricotage de l’individu nommé Gaizka avec de hauts fonctionnaires et des institutions de l’État bourgeois, ce personnage a jusqu’à présent gardé un silence absolu. No comment… Le silence est sa réponse. Nous avons du mal à croire qu’il n’ait pas entendu ce que nous disons, puisque ses amis ont immédiatement pris sa défense. (1) Mais ni les uns ni les autres n’ont apporté un seul démenti aux faits que nous exposons : rien de rien, zéro.
Ce silence est une confirmation criante de la carrière de Gaizka, celle d’un arriviste et d’un aventurier. Ils ne disent rien parce qu’il n’y a rien à dire.
Ce silence est une réaction bien connue qui ne peut que corroborer le bien-fondé de notre accusation. À cet égard Paul Frölich (2) cite une anecdote édifiante dans son autobiographie sur le comportement d’un des rédacteurs de la presse : “Il avait un instinct pour le comportement tactique. Une fois, j’ai été très surpris qu’il ne réponde pas aux attaques répétées portées contre lui par un autre journal du parti : ‘C’est très simple, avait-il déclaré. J’avais tort sur une question importante et maintenant, je les laisse aboyer jusqu’à ce qu’ils deviennent aphones et que l’histoire soit oubliée. Jusque-là, je reste sourd’.” (3)
Cependant, chaque fois que des révolutionnaires ont été accusés d’être des agents provocateurs ou de collaborer avec la bourgeoisie, ou simplement soupçonnés de comportement indigne, ils ont consacré toutes leurs énergies à le nier. Marx a passé un an à préparer un livre entier en réponse aux accusations de Herr Vogt selon lesquelles il était un agent infiltré. (4) De même, un peu plus tard avec Engels, comme on peut le voir dans leur correspondance, (5) il a participé à tous les combats nécessaires contre les tentatives de discréditer l’AIT et eux-mêmes. Bebel a été accusé d’avoir volé de l’argent dans la caisse de l’Association générale des travailleurs allemands (ADAV) et n’a eu de cesse de se battre jusqu’à ce qu’il ait pu démontrer la fausseté de ces accusations. Trotsky, complètement isolé et harcelé par Staline, a rassemblé encore assez de forces pour profiter du peu de terrain qui lui restait et convoquer la Commission Dewey (6) pour sa défense, etc.
Mais au contraire, les vrais aventuriers et provocateurs ont toujours tout fait pour s’éclipser ou se terrer afin de tenter de passer entre les mailles du filet de la vérité.
Un silence assourdissant
Bakounine, par exemple, face à la circulaire interne de l’AIT sur “Les prétendues scissions dans l’Internationale”, a reconnu, sous l’apparence d’un ton scandalisé, qu’il n’a pu faire autrement que d’y opposer… un silence prolongé : “Pendant deux ans et demi, nous avons enduré en silence cette agression immonde. Nos calomniateurs ont d’abord commencé par de vagues accusations, mêlées de lâches réticences et d’insinuations venimeuses, mais en même temps si stupides que, faute d’autres raisons de se taire, le mauvais goût mêlé au mépris qu’elles avaient provoqué dans ma retraite aurait suffi à expliquer et légitimer mon silence”. (7)
C’est en vain que l’on peut chercher dans ce courrier la recherche d’un argument, qui brille par son absence. Cependant, Bakounine avait annoncé qu’il convoquerait un jury d’honneur et qu’il rédigerait un article avant le congrès de La Haye en 1872 : “D’autre part, je me suis toujours réservé le droit de convoquer tous mes calomniateurs devant un jury d’honneur, ce que le prochain Congrès ne me refusera sans doute pas… Il faut rétablir la vérité, en contribuant autant que possible à la démolition du tissu de mensonges construit par Marx et ses acolytes, tel sera le but d’une communication que j’entends publier avant la réunion du Congrès”.
Il va sans dire qu’il n’a jamais convoqué ce jury d’honneur, ni écrit le moindre article là-dessus. Au contraire, en apprenant la publication du rapport sur l’Alliance de la démocratie socialiste par l’Association internationale des travailleurs, (8) ce qu’il écrit dans une lettre du 25 septembre 1873 au Journal de Genève (en plus d’insultes contre Marx, traité à la fois de “communiste, allemand et juif”) est une capitulation : “J’avoue que tout cela m’a profondément bouleversé dans la vie publique. J’en ai assez de tout cela. Après avoir passé toute ma vie à me battre, je suis fatigué. J’ai plus de soixante ans et un problème cardiaque qui s’aggrave avec l’âge et rend mon existence de plus en plus difficile. Que d’autres jeunes se mettent au travail pour prendre la relève. Quant à moi, je ne ressens plus la force, ni peut-être la confiance, de pousser partout ce rocher de Sisyphe contre la réaction triomphante. Je me retire donc du combat, et ne demande à mes chers contemporains qu’une seule chose : l’oubli”. (9) Bakounine déploie ici aussi une autre des stratégies classiques des aventuriers, qui consiste à se présenter comme une malheureuse victime lorsque son comportement personnel est démasqué.
De la même façon, lorsque Schweitzer (10) a été accusé d’avoir volé et détourné l’argent de la caisse d’entraide aux travailleurs malades qui ne pouvaient pas continuer à travailler, pour le dépenser en champagne et en “amuse-gueules”, contrairement à Bebel, il n’a jamais été capable de se défendre : “Schweitzer a été publiquement accusé plus d’une fois de cette action ignominieuse, mais il n’a jamais osé se défendre”. (11)
De plus, lorsque Bebel et Wilhelm Liebnechkt l’ont dénoncé comme agent du gouvernement au congrès de Barmen-Elberfeld (province de Wuppertal), lui, qui était assis sur la même scène juste derrière eux, n’a pas prononcé un mot, laissant ses acolytes proférer des insultes et des menaces : “Nos discours contenaient un résumé de toutes les accusations que nous avions portées contre Schweitzer. Il y a eu plusieurs interruptions violentes, surtout lorsque nous l’avons accusé d’être un agent du gouvernement ; mais j’ai refusé de retirer quoi que ce soit… Schweitzer, qui était assis derrière nous lorsque nous avons parlé, n’a pas prononcé une seule parole. Nous sommes partis aussitôt protégés par certains délégués contre les assauts des défenseurs fanatiques de Schweitzer, au milieu d’une tempête d’imprécations et d’insultes comme “laquais !”, “traîtres !”, “coquins !”, etc. À la porte, nous avons retrouvé nos amis qui nous ont escortés sous leur protection jusqu’à ce que nous arrivions à l’hôtel en toute sécurité”. (12)
On peut encore citer l’exemple historique de Parvus, accusé par Gorki d’avoir extorqué de l’argent sur les recettes de sa pièce de théâtre Les Bas-fonds en Allemagne, dénoncé comme aventurier et social-patriote par Trotsky, (13) qui avait été son ami, rejeté par Rosa Luxemburg, Clara Zetkin et Leo Jogiches, pour avoir essayé de se vendre à l’impérialisme allemand, et que Lénine a empêché de retourner à Petrograd après la révolution, parce qu’il avait “les mains sales” ; et qui n’a jamais pris la peine de se défendre contre toutes ces accusations, laissant à d’autres (Radek, en particulier) le soin de le défendre dans le milieu des exilés en Suisse.
Et on pourrait continuer : Lassalle, Azev…, etc. ont tous essayé de faire oublier les accusations portées contre eux en dressant un mur de silence, de disparaître ou, comme Parvus, de faire semblant de rien.
Mais il n’est pas nécessaire de remonter si loin. En 2005, nous avons pu voir comment le “citoyen B”, qui s’est proclamé “à l’unanimité” (puisqu’il ne s’agissait que de lui) “Cercle des communistes internationalistes” d’Argentine se mettant au service de la FICCI (14) (aujourd’hui : Groupe international de la gauche communiste – GIGC) pour dénigrer le CCI, mais a déserté le forum dès que nous avons dénoncé son imposture. (15)
Il y a aussi d’autres exemples de silence assourdissant lorsque le CCI a dénoncé des aventuriers dans ses rangs. Tel fut le cas de la découverte des manigances et de la sanction du militant connu sous le nom de Simon, (16) à laquelle il répondit par un silence obstiné qui provoqua même une “Résolution sur le silence du camarade Simon”, qui disait : “Depuis que le camarade Simon s’est retiré de la vie du CCI à la fin du mois d’août 1994, il n’a jamais accédé à la demande de l’organisation de faire connaître par écrit les désaccords qu’il avait avec ses analyses et ses prises de position, ce qui, selon lui, a motivé en partie son retrait… Ce silence de Simon est d’autant plus inadmissible qu’il avait des désaccords fondamentaux avec les deux résolutions adoptées par la réunion élargie du Secrétariat international le 3 décembre 1994”.
Mais ce silence obstiné des aventuriers et des éléments troubles lorsqu’ils sont pris en flagrant délit n’est pas seulement une confirmation des accusations portées contre eux ou une manière de tenter de se faire oublier, c’est aussi une stratégie pour que d’autres prennent leur défense à leur place.
Les amis de Gaizka et compagnie
Si Gaizka n’a pas ouvert la bouche depuis que nous avons publié notre mise en accusation, ses amis n’ont pas perdu de temps pour prendre sa défense. C’est ainsi que le GIGC a publié quatre jours plus tard une déclaration : “Nouvelle attaque du CCI contre le camp prolétarien international. Nous ne sommes pas surpris qu’un groupe de parasites au comportement de gangsters et de voyous vienne prendre la défense d’un aventurier. Il a déjà fait la même chose en 2005 en prenant la cause du citoyen argentin B. Peut-être devrions-nous commencer à penser que le GIGC a des pouvoirs prémonitoires puisqu’il a publié et distribué un communiqué du “Círculo” d’Argentine, avant que le citoyen B ne le publie sur son site web. Le malheur de l’affaire est qu’à l’époque, le GIGC (alors FICCI) avait dupé le BIPR (17) (maintenant TCI) qui, bien que discrètement, sans prendre directement la parole, avait publié les communiqués de la FICCI et du “citoyen B” dénigrant le CCI en encourageant ainsi les comportements indignes de la part de ces deux larrons.
Bien entendu, le GIGC n’apporte dans son communiqué aucun démenti de ce que nous dénonçons dans notre article, à l’exception de la déclaration selon laquelle “ils n’ont rien remarqué” : “nous devons souligner qu’à ce jour, nous n’avons constaté aucune provocation, manœuvre, dénigrement, calomnie ou rumeur, lancée par les membres de Nuevo Curso, même à titre individuel, ni aucune politique de destruction contre d’autres groupes ou militants révolutionnaires”. Déclaration sur laquelle nous ne nous arrêterons même pas une seconde.
En réalité, l’objectif du communiqué est uniquement d’attaquer le CCI, car ce serait lui “qui a développé ces pratiques sous le couvert de sa théorie de la décomposition et du parasitisme et qui y revient maintenant”. D’autre part, le CCI tomberait “dans le domaine pourri de la personnalisation des questions politiques”.
Le site Pantópolis du Docteur Bourrinet (18) a immédiatement reproduit l’article précédé d’une introduction qui concurrence et même dépasse le GIGC en propos haineux contre le CCI.
L’autre groupe qui a condamné notre déclaration sur Gaizka est le GCCF, (19) qui a déclaré (20) : “nous ne pouvons que condamner cet assemblage scandaleux et immoral de ragots personnalisés et complètement en dehors d’un terrain politique”. (21)
En bref, deux récriminations : 1) que ce n’est pas Gaizka, mais le CCI qui se comporterait de manière indigne du prolétariat, ferait preuve de dénigrement et de provocation ; 2) que dans notre dénonciation, les questions politiques sont remplacées par des questions personnelles.
Ce n’est pas la première fois que, face à la rigueur dans la défense du milieu prolétarien et à la dénonciation de comportements indignes, les organisations révolutionnaires sont attaquées avec des calomnies sur leur “autoritarisme” et leurs “manœuvres”, comme si elles employaient les mêmes moyens que les aventuriers et les provocateurs découverts. Ce fut le cas à l’AIT : “Consciente du danger historique que les leçons tirées par la 1re Internationale représentaient pour ses propres intérêts de classe, la bourgeoisie, en réponse aux révélations du Congrès de La Haye, fit tout ce qui était en son pouvoir pour discréditer cet effort. La presse et les politiciens bourgeois déclarèrent que le combat contre le bakouninisme n’était pas une lutte pour des principes mais une lutte sordide pour le pouvoir au sein de l’Internationale. Ainsi, Marx était censé avoir éliminé son rival Bakounine au travers d’une campagne de mensonges. En d’autres termes, la bourgeoisie essaya de convaincre la classe ouvrière que ses organisations utilisaient les mêmes méthodes fonctionnaient exactement de la même manière que celles des exploiteurs et donc n’étaient pas meilleures. Le fait qu’une grande majorité de l’Internationale appuya Marx fut rabaissé au ‘triomphe de l’esprit de l’autoritarisme’ dans ses rangs et à la prétendue tendance à la paranoïa de ses membres à voir des ennemis de l’Association cachés partout. Les bakouninistes et les lassalliens firent même courir des rumeurs selon lesquelles Marx était un agent de Bismarck”. (22)
Bakounine lui-même n’a pas hésité à présenter la lutte de l’Internationale pour la défense de ses statuts et de son fonctionnement contre l’esprit sectaire et ses intrigues comme une “lutte entre sectes” : ainsi, dans Lettre aux frères d’Éspagne, Bakounine se plaint que la résolution de la Conférence de Londres (1872) contre les sociétés secrètes n’a en fait été adoptée par l’Internationale que “pour ouvrir la voie à leur propre conspiration pour la société secrète qui existe depuis 1848 sous la direction de Marx, qui a été fondée par Marx, Engels et Wolff maintenant décédé, et qui n’est rien d’autre qu’une société quasiment exclusivement allemande de communistes autoritaires. […] Il faut reconnaître que la lutte qui s’est engagée dans l’Internationale n’est rien d’autre qu’une lutte entre deux sociétés secrètes”. (23)
Dans la vision du monde d’éléments comme Bakounine, le GIGC ou Gaizka, il n’y a pas de place pour l’honnêteté, les principes d’organisation ou la morale prolétarienne ; ils ne font que projeter sur les autres leur propre façon de se comporter. Comme le dit la sagesse populaire, “le voleur croit que chacun agit comme lui”.
Cependant, “ce qui est plus grave et beaucoup plus dangereux, c’est que de telles infamies trouvent un certain écho dans les rangs du milieu révolutionnaire lui-même. Ce fut le cas, par exemple, dans la biographie de Marx par Franz Mehring. Dans ce livre, Mehring, qui appartenait à l’aile gauche combative de la Deuxième Internationale, déclare que la brochure du Congrès de La Haye contre l’Alliance était ‘impardonnable’ et ‘indigne de l’Internationale’. Dans son livre, Mehring défend non seulement Bakounine, mais aussi Lassalle et Schweitzer, contre les “accusations de Marx et des marxistes”. (24)
Le discrédit qu’a jeté Mehring sur la lutte marxiste contre le bakouninisme et le lassallisme a eu des effets dévastateurs sur le mouvement ouvrier dans les décennies suivantes, car il a non seulement conduit à une certaine réhabilitation d’aventuriers politiques comme Bakounine et Lassalle, mais il a surtout permis à l’aile opportuniste de la social-démocratie d’avant 1914 d’effacer les leçons des grandes luttes pour la défense de l’organisation révolutionnaire des années 1860 et 1870. Ce fut un facteur décisif dans la stratégie opportuniste visant à isoler les bolcheviks dans la Deuxième Internationale, alors qu’en fait leur lutte contre le menchevisme appartient à la meilleure tradition de la classe ouvrière. La Troisième Internationale a également souffert de l’héritage de Mehring. Ainsi, en 1921, un article de Stoecker (“Sur le bakouninisme”), également basé sur les critiques de Mehring à l’égard de Marx, a justifié les aspects plus dangereux et aventureux de la soi-disant Action de mars 1921 du KPD (parti communiste allemand) en Allemagne. (25) Le fait que le BIPR se soit laissé entraîner derrière la FICCI et le “citoyen B” en 2005 a également donné des ailes au parasitisme, rendant plus difficile la lutte contre celui-ci et sa dénonciation dans le milieu prolétarien.
Mais venons-en à la deuxième accusation, celle de la personnalisation des questions politiques. Pour commencer, notre accusation n’était pas basée sur la diffusion d’histoires sur la vie privée, mais sur la mise en lumière d’un comportement politique public, qui est largement documenté. Ce que nous avons exposé sur Gaizka sont des faits qui appartiennent à la sphère de l’activité publique des politiciens bourgeois, et donc ils devraient être soigneusement pris en compte par les militants communistes. Que faisait dans le domaine de la Gauche communiste un individu qui avait fréquenté à plusieurs reprises les cercles politiques de haut niveau de l’État bourgeois ?
Maintenant, en second lieu, il y a des faits “privés” (intrigues, manœuvres, contacts secrets, relations obscures, etc.) qui doivent être connus afin de comprendre et de pouvoir dénoncer les actions destructrices contre le prolétariat ou contre les organisations révolutionnaires. Les dénoncer n’a rien à voir avec des ragots.
Plutôt que d’y répondre nous-mêmes, nous laisserons Engels le faire. Dans l’un des nombreux articles que Marx et lui-même ont dû écrire pour défendre l’AIT, accusée par toute la presse bourgeoise, par les agents provocateurs et les partisans de Bakounine. Interrogé par des militants eux-mêmes indécis, Engels répond à un article de Pyotr Lavrov (26) dans son journal Vpered (En Avant !)27, qui remettait en cause le rapport de la commission du Congrès de La Haye sur “L’Alliance de la démocratie socialiste et l’AIT” (28) parce que ce ne serait qu’une “féroce querelle sur des questions purement personnelles et privées avec des informations qui ne peuvent provenir que de ragots”.
Voici ce qu’il répondait : “La principale accusation [contre le rapport sur l’Alliance], cependant, est que le rapport est rempli de questions personnelles dont la véracité ne pourrait pas être établie par les auteurs, car ils ne pouvaient les recueillir que par des ragots. Il ne nous est pas dit comment ‘l’ami Pierre’ (29) sait qu’une organisation comme l’Internationale, dont les organes officiels sont répartis dans le monde entier, ne pourrait recueillir les faits que par des commérages. Sa déclaration est en tout cas extrêmement faite à la légère. Les faits en question sont étayés par des preuves authentiques et les personnes concernées ont pris soin de ne pas y répondre.
Mais ‘l’ami Pierre’ est d’avis que les questions sur la vie privée, comme les lettres personnelles, sont sacrées et ne devraient pas être publiées dans les débats politiques. Accepter la validité de cet argument en quelques termes que ce soit revient à rendre impossible d’écrire sur l’histoire. Donc, si l’on décrit l’histoire d’une bande de gangsters comme l’Alliance, dans lequel on trouve bon nombre d’escrocs, d’aventuriers, de voleurs, d’espions de la police, de fraudeurs et de lâches, ainsi que sur ceux qui ont été abusés par eux, faut-il falsifier cette histoire en dissimulant sciemment les vilenies individuelles de ces Messieurs comme des ‘affaires privées’ ?
Cependant, lorsque le rédacteur de Vpered décrit le rapport comme une compilation maladroite de questions essentiellement privées, il commet un acte difficile à caractériser. Quiconque peut écrire une telle chose soit n’a pas du tout lu le rapport en question, soit est trop borné ou trop partial pour le comprendre, soit il écrit délibérément quelque chose qu’il sait être faux. Personne ne peut lire ‘Un complot contre l’internationale’ sans être convaincu que les questions privées intercalées en sont la partie la plus significative, qu’elles sont des illustrations pour donner une image plus détaillée des personnages impliqués, et qu’elles ne pourraient être supprimées sans remettre en cause le point principal du rapport. L’organisation d’une société secrète dans le seul but est de soumettre le mouvement ouvrier en Europe à la dictature cachée de quelques aventuriers, les infamies commises dans ce but, notamment par Necthaiev en Russie – c’est le thème central du rapport, et maintenir que tout tourne uniquement autour de questions privées est pour le moins irresponsable”. (30)
Conclusion
Le silence aigri de Gaizka est une confirmation de sa collaboration avec l’État bourgeois que nous dénonçons. Son activité au service des libéraux puis du PSOE, (31) ses contacts avec la Gauche communiste et sa disparition lors de l’enquête sur les aspects problématiques de son comportement pour un militant communiste, (32) constituent la trajectoire d’un aventurier.
L’aspiration d’un groupe formé autour de cet élément à être considéré comme faisant partie de la Gauche communiste, si elle devait se réaliser même occasionnellement, signifierait l’introduction d’un cheval de Troie dont le but ne pourrait pas être autre que de déformer et de saper l’héritage de la tradition prolétarienne et ses principes programmatiques et organisationnels représentés par les organisations de la Gauche communiste. Et ce, même indépendamment de l’honnêteté des autres membres du groupe Gaizka qui peuvent être trompés.
Dans ce sens, et toutes proportions gardées, tout comme Bakounine, comme le dit Engels, voulait imposer sa dictature à l’Internationale, qui regroupait le mouvement ouvrier en Europe, Gaizka veut être, également en se cachant sous la couverture d’un groupe (Nuevo Curso) où il peut y avoir également des éléments éventuellement dupés, comme une référence de la Gauche communiste, surtout pour de jeunes éléments en recherche de positions politiques prolétariennes. Mais son prétendu lien avec la Gauche communiste ne peut que semer la confusion avec les positions de cette dernière en faisant passer les principes et les méthodes aventureuses de la gauche bourgeoise ou du stalinisme pour des positions de la Gauche communiste.
Dans cette entreprise criminelle, Gaizka a le soutien organisé du groupe de parasites et de voyous du GIGC, qui le présente précisément comme un champion du regroupement ; mais il bénéficie aussi du consentement tacite d’autres groupes du milieu prolétarien qui restent muets face à leurs initiatives.
CCI, 11 avril 2020
1 Nous nous référons ici au Groupe International de la Gauche Communiste (GIGC) et au site web de Monsieur Bourrinet : Pantópolis. Nous y reviendront par la suite.
2 Membre de la Gauche de Brême pendant les luttes révolutionnaires en Allemagne. Il fut aussi le délégué envoyé par les Communistes Internationalistes d’Allemagne (IKD) au Congrès de fondation du Parti Communiste d’Allemagne (KPD).
3 Paul Frölich, “Im radikalen Lager” Politische Autobiografie 1890-1921, chapitre : “Leipzig”, Berlin (2013), p. 51 : “He had an instinct for tactical behaviour. Once I was very surprised that he did not respond to repeated attacks from another party newspaper. ‘Very simply’, he said, ‘I was wrong about one important point. Now I let them bark until they are hoarse and history is forgotten. Until then I'm deaf’.”
Il s’agit de Paul Lensch (1873-1926), un personnage douteux par rapport au mouvement ouvrier, qui avait travaillé avec Frölich comme rédacteur talentueux dans le journal social-démocrate Leipziger Volkszeitung, et qu’il avait lui-même caractérisé comme “un bouledogue au corps massif et aux pattes fortes, capable de mordre sans pitié […] qui se plaisait à croire qu’il avait l’élégance de Mehring, mais dont le caractère brutal finissait toujours par apparaître. Un fanfaron manœuvrier […] sans rien qui puisse le relier en son for intérieur à la classe ouvrière”. Il était aussi capable d’adopter une “position politique juste” si cela servait son carriérisme ; en 1910, il faisait partie de l’aile gauche de la social-démocratie mais en jouant un rôle trouble dans l’affaire Radek, ensuite il était présent dans l’appartement de Rosa Luxemburg, la nuit du 4 août 1914 (avec les opposants à la guerre impérialiste) et, peu de temps après, en 1915, on le retrouva avec l’extrême-droite de la social-démocratie comme défenseur, aux côtés de Cunow et de Haenish, du “socialisme de guerre” (qui défendait la guerre avec une argumentation “marxiste”) dans la revue Die Glocke de Parvus, entre autres. Lensch n’était pas simplement un social-démocrate qui s’était laissé entraîner par la droite pour finir par trahir le prolétariat ; tout en étant un élément sans aucune conviction militante et n’ayant pas la moindre confiance en la classe ouvrière, il était avant tout un carriériste malhonnête qui se cachait derrière une façade marxiste et qui était capable de garder le silence quand il l’estimait nécessaire à ses intérêts.
4 Dans ce livre, qui lui a coûté un an de travail, Marx s’est non seulement défendu contre les accusations crapuleuses de Vogt, mais il a également pris la défense de la Ligue des Communistes, même si cette dernière avait déjà disparu. Cependant, défendre la tradition que cela représentait, le Manifeste communiste, les principes d’organisation, la continuité du mouvement ouvrier, était d’une importance vitale, contrairement à tous ceux qui considèrent que Marx aurait perdu son temps sur des détails, ou même y aurait sacrifié la clarté de son jugement politique et son dévouement désintéressé à la lutte du prolétariat.
5 Source : Marx/Engels Collected Works, (2010) Lawrence & Wishart Electric Book, Vol. 24.
6 Étant donné que Staline avait écrasé et laminé tout vestige des milieux ouvriers de la période révolutionnaire, la Commission devait être composée de membres du milieu intellectuel et de la culture reconnus pour leur indépendance d’opinion et leur intégrité. Dewey était l’un d’entre eux. Les sessions de la commission ont eu lieu au Mexique.
7 En espagnol : Jacques Freymond, La Primera Internacional, Ed. ZERO (1973), p. 355.
8 Une commission d’enquête fut chargée d’élaborer le rapport pour le Congrès de La Haye de l’AIT (1872). Après avoir entendu et discuté le rapport, le Congrès prit la décision d’exclure Bakounine et certains de ses disciples de l’Internationale.
9 Source en portugais, traduit par nous : Bakunin por Bakunin – Lettres. “Lettre au Journal de Genève” ("Biblioteca Virtual Sit Inn") : “o Sr. Marx, o chefe dos comunistas alemães, que, sem dúvida por causa de seu tríplice caráter de comunista, alemão e judeu, me odiou”.“Eu vos confesso que tudo isso me enojou profundamente da vida pública. Estou farto de tudo isso. Após ter passado toda minha vida na luta, estou cansado. Já passei dos sesenta anos, e uma doença no coração, que piora com a idade, torna minha existência cada vez mais difícil. Que outros mais jovens ponham-se ao trabalho. Quanto a mim, não sinto mais a força, nem talvez a confiança necessária para empurrar por mais tempo a pedra de Sysipho contra a reação triunfante em todos os lugares. Retiro-me, pois, da liça, e peço a meus caros contemporâneos apenas uma coisa : o esquecimento”.
10 Voir l’article sur notre site internet : “Lassalle et Schweitzer : la lutte contre les aventuriers politiques dans le mouvement ouvrier [7]”.
11 Bebel, My Life, The University of Chicago press, The Baker & Taylor co., New York, p. 152. Texte original en anglais, traduit par nous : “Schweitzer was more than once publicly accused of this shameful action, but he never dared to defend himself”.
12 Ibid., p. 156 : “Our speeches contained a summary of all the accusations we had levelled against Schweitzer. There were several violent interruptions, especially when we accused him of being a Government agent ; but I refused to withdraw anything… Schweitzer, who sat behind us when we spoke, did not utter a Word in reply. We left at once, some of the delegates guarding us against assault from the fanatical supporters of Schweitzer, amid a storm of imprecations, such as “Knaves !” “Traitors !” “Rascals !” and so forth. At the doors our friends me thus and took us under their protection, escorting us in safety to our hotel”.
13 Voir dans Nashe Slovo nº 2 : “Epitaphy for a living friend”.
14 La prétendue “Fraction interne du CCI” est un groupe parasite qui a été exclu du CCI en refusant de défendre ses positions et ses agissements devant la Commission d’investigation nommée par le 15e congrès du CCI. L’un de ses membres éminents, connu sous le nom de Jonas, avait été expulsé auparavant pour un comportement indigne d’un militantisme révolutionnaire.
Voir : “Conférence extraordinaire du CCI : Le combat pour la défense des principes organisationnels [10]” et “Fraction interne du CCI : Tentative d’escroquerie vis-à-vis de la Gauche communiste [19]”.
15 Voir : “Communiqué à nos lecteurs : le CCI attaqué par une nouvelle officine de l’État bourgeois [26]”.
16 Simon a été exclu au 11e Congrès du CCI pour comportements incompatibles avec le militantisme communiste.
17 Bureau Internacional pour le Parti Révolutionnaire, héritier de la tendance Damen du Parti communiste internationaliste, actuellement Tendance Communiste Internationaliste (TCI).
18 Voir notre article : “Conférence-débat à Marseille sur la Gauche communiste : le Docteur Bourrinet, un faussaire qui se prétend historien [72]”.
19 Gulf Coast Communist Fraction.
20 Nous devons préciser ici que nous n’avons nullement l’intention de mettre sur le même plan le GIGC/Bourrinet et la GCCF. Le GIGC est un groupe parasite qui n’existe que pour attaquer le CCI. Même si nous avions publié un article pour dénoncer Mata Hari, ils diraient qu’ils “n’ont rien remarqué”, pour pouvoir passer directement à l’attaque contre nous. On peut dire la même chose de Bourrinet. La GCCF est un jeune groupe sans expérience et en quête de clarification, sensible aux basses flatteries de Gaizka et du GIGC/Bourrinet.
21 Traduit par nous de l’anglais : “we have nothing but condemnation for this egregious and immoral hit-piece of personalized gossips completely removed from a political terrain”.
22 “Questions d’organisation (partie IV) : la lutte du marxisme contre l’aventurisme politique”, Revue Internationale n° 88.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Voir la note 2.
26 Vpered (En Avant !) était un journal en russe édité en Grande-Bretagne, de tendance narodniki (populiste).
27 Lavrov Pyotr Lavrovich (1823-1900) philosophe, sociologue et journaliste russe se rattachant à la branche populiste ; il fut membre de la Ie Internationale et participa à la Commune de Paris.
28 En Allemagne, le rapport a été traduit sous le titre “Un complot contre l’Internationale” et c’est pour cela que dans les œuvres citées en langue anglaise, Engels fait référence sous cette dénomination au rapport de la commission d’investigation de La Haye, au lieu du titre “L’Alliance de la Démocratie Socialiste et l’Association Internationale des Travailleurs”, mais il s’agit bien du même rapport.
29 Engels fait ici référence à Pyotr Lavrov, mais comme il l’explique au début de l’article, afin de respecter l’anonymat que celui-ci lui demandait de respecter scrupuleusement et dont il se moque, puisque le vrai nom de l’éditeur de Vpered était bien connu, tant en Grande-Bretagne qu’en Russie, il désigne donc l’auteur sous le sobriquet de “l’ami Pierre”, un prénom très courant en Russie.
30 Engels, Refugiee Literature III, Marx/Engels Collected Works (2010), Lawrence & Wishart Electric Book, Vol. 24, pp. 21-22 (traduit de l’anglais par nous) : “The main charge, however, is that the report is full of private matters the credibility of which could not have been indisputable for the authors, because they could only have been collected by hearsay. How Friend Peter knows that a society like the International, which has its official organs throughout the civilised world, can only collect such facts by hearsay is not stated. His assertion is, anyway, frivolous in the extreme. The facts in question are attested by authentic evidence, and those concerned took good care not to contest them. But Friend Peter is of the opinion that private matters, such as private letters, are sacred and should not be published in political debates. To accept the validity of this argument on any terms is to render the writing of all history impossible.
Again, if one is describing the history of a gang like the Alliance, among whom there is such a large number of tricksters, adventurers, rogues, police spies, swindlers and cowards alongside those they have duped, should one falsify this history by knowingly concealing theindividual villainies of these gentlemen as “private matters”?… When, however, the Forward describes the report as a clumsy concoction of essentially private facts, it is committing an act that ishard to characterise. Anyone who could write such a thing had either not read the report in question at all ; or he was too limited or prejudiced to understand it ; or else he was writing something he knew to be incorrect. Nobody can read the “Komplott gegen die Internationale” without being convinced that the private matters interspersed in it are the most insignificant part of it, are illustrations meant to provide a more detailed picture of the characters involved, and that they could all be cut without jeopardising the main point of the report. The organisation of a secret society, with the sole aim of subjecting the European labour movement to a hidden dictatorship of a few adventurers, the infamies committed to further this aim, particularly by Nechayev in Russia – this is the central theme of the book, and to maintain that it all revolves around private matters is, to say the least, irresponsible”.
31 Partido Socialista Obrero Español (social-démocrate), actuellement au pouvoir.
32 Voir : “Qui est qui dans Nuevo Curso ? [5]”.
Courants politiques:
Rubrique:
Revue Internationale n°166
- 258 lectures
Présentation de la Revue n°166
- 80 lectures
Notre précédent numéro de la Revue internationale était entièrement dédié à la signification et aux implications de l'irruption du Corona Virus. Nous y mettions en évidence l'importance historique de cet évènement, le plus important depuis l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 de même que sa signification, une nouvelle étape de l'enfoncement du capitalisme dans sa phase de sa décadence, celle de sa décomposition. Nous nous étions également penchés sur les implications de la pandémie sur la crise économique -une accélération considérable de celle-ci devant déboucher sur une récession plus importante encore que celle des années 1930– et sur la lutte de classe, avec des difficultés renforcées pour la classe ouvrière du fait des conséquences aggravées de la décompositions sur la vie de la société. Cet évènement venait confirmer le risque que le rythme du développement de la lutte de classe, en regard de celui de la décomposition, ne soit pas suffisant pour permettre une révolution victorieuse du prolétariat et ensuite l'édification d'une nouvelle société sur les ruines de la société actuelle ravagée par plus d'un siècle de décadence du capitalisme.
Avec le présent numéro de la Revue, nous poursuivons notre intervention sur la pandémie, sous différents angles, et publions également d'autres articles.
Un premier article, "L'épidémie du COVID révèle le délabrement du capitalisme mondial", met en évidence les très grandes difficultés rencontrées par la bourgeoisie face à la première vague de contagion par le virus, alors que de nouvelles vagues ont laissé la bourgeoisie désemparée, incapable de contenir la pandémie et ses conséquences sociales. Et pour causes, tous les ingrédients à l'origine de la pandémie ne peuvent être éliminées au sein même du capitalisme, a fortiori dans la phase ultime de sa décadence : Il n'y avait eu aucune anticipation face à la menace notoire de pandémies, avant que l'une d'entre elles –celle du Covid- ne fasse irruption ; le délabrement du système de soin car non rentable du point de vue capitaliste ; chacun pour soi exacerbé entre les fractions nationales de la bourgeoisie mondiale, et même au sein des frontières nationales, toutes en prise avec la guerre commerciale que la crise ne fait qu'exacerber … Le bilan social, imputable au capitalisme et non à la pandémie, ce sont des millions d'ouvriers jetés au chômage dans le monde, la pauvreté qui s'est étendue et approfondie de façon considérable. Cernées par les dangers de la contagion, la réalité du chômage et la plongée dans la pauvreté, des parties importantes de la population mondiale, de grandes masses précarisées, sombrent dans le désespoir.
À ce propos, nous publions à la suite de cet article un témoignage historique, "La Conservation de la Santé en Russie Soviétiste" concernant la manière dont le prolétariat de la Russie des soviets avait été capable de prendre en charge le problème de la santé dans les années 1918 et 19, et en particulier celui des pandémies qui sévissaient déjà, dans conditions extrêmement difficiles alors que le pays était en butte sur son propre territoire à la coalition de la bourgeoisie internationale à travers l'action des armées blanches visant à affaiblir, pour le détruire, le pouvoir du prolétariat.
Comme cela ressort de cette présentation, le CCI a fourni un effort théorique important en vue de comprendre la signification historique de cette pandémie qui ne peut être réduite à la seule répétition atemporelle des lois du capitalisme, mais est la fois expression et facteur d'aggravation de la phase actuelle de décomposition du capitalisme. La situation aux États-Unis est venue confirmer de manière éclatante le poids de la décomposition dans la vie du capitalisme et notamment l'épisode du capitole aux lorsque "les hordes trumpistes ont violemment tenté d’empêcher la succession démocrate, encouragée par le président en exercice lui-même, comme dans une “république bananière”, ainsi que l’a reconnu George W. Bush." Notre article "Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue", montre en quoi la crise politique actuelle de la démocratie américaine, symbolisée par l’attaque du Capitole, s’ajoute aux conséquences chaotiques et autodestructrices de la politique impérialiste américaine, et montre plus clairement que les États-Unis, qui demeurent encore la plus grande puissance mondiale, sont aujourd’hui le principal acteur de la décomposition du capitalisme.
Nous tenons également à signaler dans cette présentation de la Revue qu'en vue d'accroître et renforcer l'audience de notre intervention nous avons réalisé un tract, "Pandémie du COVID: Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale", diffusé dans les quelques occasions qui se sont présentées à nous et que nous avons essayé de faire circuler le plus possible sur Internet.
Il est établi que le COVID a pu se transmettre de l'animal à l'homme du fait justement de certaines caractéristiques de la décomposition du capitalisme : déforestation à outrance, urbanisation sauvages, proximité entre l'homme et les animaux capables de lui transmettre des virus, hygiène limite … Face à toutes les aberrations du capitalisme dans sa phase finale actuelle, nous avons jugé opportun de publier un article intitulé mettant en évidence quelle devra être l'œuvre de la dictature du prolétariat : "Le programme communiste dans la phase de décomposition du capitalisme : Bordiga et la grande ville", article bâti sur la base de nos propres réflexions et celles suscitées par un article de Bordiga intitulé "Le programme immédiat de la révolution", écrit en 1953. Pour notre article, le texte de Bordiga "conserve un intérêt considérable en essayant de comprendre quels seraient les principaux problèmes et priorités d'une révolution communiste qui aurait lieu, non pas à l'aube de la décadence du capitalisme, comme en 1917-23, mais après un siècle entier au cours duquel le glissement vers la barbarie n'a cessé de s'accélérer, et où la menace pour la survie même de l'humanité est bien plus grande qu'il y a cent ans." Par rapport à la pandémie actuelle, l'article met évidence les limites de tous les services de santé existants, même dans les pays capitalistes les plus puissants, notamment parce qu'ils n’échappent pas à la logique de concurrence entre les unités capitalistes nationales. Face à une telle situation, il faut une médecine, des soins de santé et une recherche qui ne soient pas gérés par l'État, mais véritablement socialisés, et qui ne soient pas nationaux mais "sans frontières" : en bref, un service de santé planétaire.
Nous poursuivons, dans ce numéro de la Revue, la publication de notre série initiée lors du "Centenaire de la fondation de l'Internationale communiste en 1919". Le Congrès de fondation avait été un véritable pas en avant pour l’unité du prolétariat mondial, néanmoins la méthode alors adoptée, privilégiant le plus grand nombre plutôt que la clarté des positions et des principes politiques, n’avait pas armé le nouveau parti mondial. Pire, elle le rendait vulnérable face à l’opportunisme rampant au sein du mouvement révolutionnaire. Contrairement à ce que prévoyaient Lénine et les bolcheviks, l'opportunisme au sein du parti s'est approfondi et a fini par prendre, avec la dégénérescence de la révolution, une place prépondérante, précipitant la fin de l’IC en tant que parti de classe. C'est ce qu'illustre cette troisième partie de notre série.
Le dernier article publié dans ce numéro de la Revue, "La difficile évolution du milieu politique prolétarien depuis mai 1968" est la suite d'une série de deux, dont le premier fut publié dans la Revue 163. Celui-ci couvrait la période 1968-1980, qui avait connu les développements les plus importants au sein du milieu prolétarien international, suite aux évènements de 1968 en France. Si la résurgence de la lutte de classe avait donné un élan significatif à la relance du mouvement politique prolétarien, et donc au regroupement de ses forces, cette dynamique avait commencé à se heurter à des difficultés dès le début des années 1980. Déjà à cette époque, le milieu politique prolétarien traversait une crise majeure, marquée par l'échec des conférences internationales de la Gauche Communiste, les scissions au sein du CCI et l'implosion du Parti Communiste International bordiguiste (Programme Communiste). L'échec général de la classe à politiser ses luttes a aussi signifié que la croissance très sensible du milieu politique prolétarien de la fin des années 60 et des années 70 avait commencé à ralentir ou à stagner. Dans cette deuxième partie, nous mettons en évidence l'impact négatif sur l'évolution du MPP d'un certain nombre de facteurs, en particulier la décomposition de la société et le développement du parasitisme politique.
La minorité révolutionnaire, en tant que partie de la classe, n'est pas épargnée par les pressions d'un système social en désintégration qui n'a manifestement aucun avenir, se traduisant par la fuite vers des solutions individuelles, vers une perte de confiance dans l'activité collective, la méfiance envers les organisations révolutionnaires et le désespoir face à l'avenir.
Par ailleurs, au début des années 2000, le CCI avait été confronté à une grave crise interne avec en son cœur un clan regroupant des militants diffamant des camarades, diffusant des rumeurs selon lesquelles l'un d'entre eux était un agent de l'État manipulant les autres. Ce clan allait donner naissance à une organisation parasitaire à part entière, la FICCI dont les membres ont été exclus du CCI pour des agissements indignes de militants communistes, notamment le vol des fonds de l'organisation et la publication d'informations internes sensibles qui auraient pu mettre nos militants en danger vis-à-vis de la police. Depuis lors, ce groupe, qui a ensuite changé de nom pour devenir le Groupe International de la Gauche Communiste, a donné de nouvelles preuves qu'il incarne une forme de parasitisme si abject qu'il est impossible de le distinguer des activités de la police politique. Cette situation n'a malheureusement pas provoqué au sein du camp prolétarien la réponse adéquate, en exprimant une solidarité capable d'exclure du camp prolétarien des pratiques (et ceux qui s'y livrent) étrangères au mouvement ouvrier.
La période 2004-2011 a donné lieu à l'émergence de nouvelles forces à la recherche de réponses révolutionnaires à l'impasse de l'ordre social. Le CCI a réagi le plus largement possible à ces développements, ce qui était absolument nécessaire : sans transmission de l'héritage de la Gauche Communiste à une nouvelle génération, il ne peut y avoir aucun espoir d'un mouvement vers le parti du futur. Mais il y avait d'importantes faiblesses dans notre intervention, opportunistes en particulier, illustrée en particulier par l'intégration précipitée des camarades qui allaient former la section turque du CCI en 2009, laquelle quittera le CCI en 2015. Cet exemple est significatif du fait que les futures intégrations dans les organisations du camp de la gauche communiste devraient pouvoir bénéficier des leçons de ses expériences depuis la reprise historique de Mai 1968 et sur lesquelles nous revenons largement au sein de l'article en deux parties dédié à l'évolution du MPP depuis 1968.
Malgré les dangers très tangibles de cette dernière phase de décadence capitaliste, nous ne pensons pas que la classe ouvrière ait dit son dernier mot. Un certain nombre d'éléments témoigne d'un processus de politisation communiste au sein d'une minorité, petite mais significative, qui s'oriente vers les positions de la Gauche Communiste.
Le 14 02 2021
La pandémie du COVID-19 révèle le délabrement du capitalisme mondial
- 171 lectures
Depuis plus d'un an toutes les bourgeoisies du monde sont en prise avec l'épidémie de Coronavirus, sans qu'une sortie de tunnel soit aujourd'hui réellement en vue. Jusqu’à présent, c’étaient les pays les plus pauvres et sous-développés qui payaient le plus lourd tribu aux maladies, épidémiques ou endémiques. Ce sont maintenant les pays les plus développés qui sont ébranlés dans leur fondation par la pandémie de Covid-19.
Il y a plus d'un siècle, l'éclatement de la Première Guerre mondiale signifiait l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence. L'effondrement du bloc de l'Est et la dissolution de celui de l'Ouest en 1990 et l'onde de choc mondiale qui s'ensuivit, avec des bouleversements considérables, constituaient des symptômes de la désagrégation mondiale de la société, signaient l'entrée du capitalisme dans la phase ultime de sa décadence, celle de sa décomposition.
Et après le capitalisme ? Si le prolétariat mondial parvient à le renverser avant qu'il ne détruise l'humanité, ce sera alors l'humanité unifiée dans la société communiste qui, face aux problèmes de la maladie et autres calamités, sera capable de donner une réponse qui ne soit pas sapée par l'exploitation, la concurrence et l'anarchie capitalistes.
La pandémie, un phénomène social qui a pour terrain le délabrement du monde
Aux États-Unis, on compte aujourd'hui au moins 25 millions de contaminés, et plus de 410 000 morts. Il y a eu plus de morts du Covid que de soldats américains tués lors de la seconde guerre mondiale ! Au mois d'avril dernier, le nombre de morts avait déjà dépassé celui des morts pendant la guerre du Vietnam ! Dans la grande métropole de Los Angeles, 1 habitant sur 10 est contaminé ! En Californie, les hôpitaux sont pleins à craquer. Au début de la crise sanitaire, toute la population américaine a été frappée par les immenses tranchées où on entassait des morts "non réclamés" dans l'État de New-York, sur Hart Island. En Europe, la Suède qui naguère était réputée pour le "bienêtre social" de ses citoyens avait misé, au début de la pandémie, sur l'obtention rapide d'une immunité collective. Elle vient de battre un record national – celui du nombre de décès - détenu depuis la grande famine de 1869.
La pandémie du Covid-19 n'est pas une catastrophe imprévisible qui répondrait aux lois obscures du hasard et de la nature ! Le responsable de cette catastrophe planétaire, de plus de deux millions de morts, c'est le capitalisme lui-même. Contrairement aux épidémies d'origine animale du passé (comme la peste introduite au Moyen-Âge par les rats) aujourd'hui, cette pandémie est due essentiellement à l'état de délabrement de la planète. Le réchauffement climatique, la déforestation, la destruction des territoires naturels des animaux sauvages, de même que la prolifération des bidonvilles dans les pays sous-développés, ont favorisé le développement de toute sorte de nouveaux virus et maladies contagieuses.
Si ce nouveau virus a été capable de surprendre et paralyser la bourgeoisie c'est parce les études scientifiques sur les coronavirus ont été partout abandonnées il y a une quinzaine d’années, car le développement du vaccin était jugé… “non rentable” ! À côté de cela, l'essentiel des recherches scientifiques et technologiques de pointe, aux États-Unis en particulier, ciblaient prioritairement des produits pour lesquels un marché juteux était garanti ou bien étaient consacrées essentiellement au secteur militaire, avec y compris la recherche d'armes bactériologiques.
Par ailleurs, alors que le monde est encore loin d'avoir maitrisé l'actuelle pandémie, d'autres menaces plus terrifiantes encore[1] –comme le Nipah- et ayant la même cause sont déjà identifiées, sans qu'aucune de ces maladies n'ait à ce jour donné lieu à des projets de recherches des entreprises pharmaceutiques[2] :
La bourgeoisie surprise par la première vague, désemparée par les suivantes
Déjà plusieurs vaccins ont déjà été mis au point en un temps record, ce qui illustre les capacités technologiques qui pourraient être mises au service du bien-être de l'humanité. Néanmoins, aujourd'hui encore, comme au début de l'épidémie, un ensemble de problèmes font obstacle à une réelle prise en charge de la maladie, et ils sont la conséquence directe du fait que ce système est clairement au service d'une classe exploiteuse qui ne se préoccupe de la santé de la population que pour préserver la force de travail de ceux qu'elle exploite.
En effet, le système de santé a été complètement débordé du fait que, face à l'aggravation de la crise économique, dans tous les pays, les gouvernements de droite comme de gauche, n'ont cessé depuis des décennies de réduire les budgets sociaux, les budgets de la santé et de la recherche. Le système de santé n'étant pas rentable, ils ont supprimé des lits, fermé des services hospitaliers, supprimé des postes de médecins, aggravé les conditions de travail des soignants, détruit des stocks de masques jugés trop coûteux à entretenir, .... des respirateurs ont fait défaut en beaucoup d'hôpitaux.
Pour limiter l'emballement de la pandémie, la bourgeoisie n'a pas été capable de faire mieux que recourir à des méthodes moyenâgeuses comme le confinement. Partout, elle doit imposer des couvre-feux, la distanciation sociale, les visages humains masqués. Les frontières sont verrouillées, tous les lieux publics et culturels sont fermés dans la plupart des pays d'Europe. Jamais l'humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'avait vécu une telle épreuve.
De plus, la concurrence entre les différentes fractions de la bourgeoise, tant au niveau international que dans chaque pays, exacerbée par l'aggravation de la crise économique, avait clairement constitué, dès le début de la pandémie, un facteur d'approfondissement de la crise sanitaire, donnant lieux à l'expression ouverte des rivalités tellement acérées parfois qu'elles avaient été qualifiées de "guerres" par les médias.
La "guerre des masques" est un exemple édifiant de la concurrence cynique et effrénée à laquelle s'étaient livrés tous les États, chacun s’arrachant ce matériel de survie à coup de surenchères et même par le vol pur et simple !
La "guerre pour arriver parmi les premiers à produire un vaccin efficace", dans laquelle chaque pays, en concurrence avec tous les autres, garde jalousement les résultats de ses travaux pour essayer d'arriver dans le groupe de tête de ceux qui se partageront le juteux marché. Une telle situation de chacun pour soi empêche toute coordination et coopération internationale pour éradiquer cette pandémie et des délais de production d'un vaccin bien plus long que s'il avait été le produit d'une coopération internationale
La "guerre pour obtenir des vaccins en grande quantité" dont l'enjeu est considérable. En effet, les pays qui, grâce à la vaccination, arriveront parmi les premiers à obtenir l'immunité collective, seront aussi les premiers à pouvoir entreprendre la remise sur pieds de leur appareil productif et de leur économie. Le problème est que, même si le vaccin commence à être produit en grande quantité au sein d'un certain nombre de pays, il l'est toutefois en nombre insuffisant par rapport aux besoins. Cette situation a donné lieu à des tensions très importantes entre, par exemple, l'Union Européenne et le Royaume Uni, alors que ce dernier se trouvait dans l'incapacité d'honorer, dans les quantités et délais contractuels, les commandes du vaccin AstraZeneca (Britannique-Suédois) passées par l'UE. Pour y parvenir, il aurait été obligé de réduire son propre approvisionnement en vaccins de cette fabrication. Face à cela, l'Union Européenne a haussé le ton et l'Allemagne est allée jusqu'à menacer de prendre des mesures de rétorsion en "retenant" les vaccins BioNTech-Pfitzer fabriqués sur le territoire de l'Union Européenne et destinés à la vente au Royaume Unis. Conséquence de ce durcissement, de nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles ont surgi à propos du "protocole nord-irlandais", partie cruciale du traité du Brexit[3].
Les médias européens s'étaient félicité de la bonne tenue de l'Europe face au séisme économique provoqué par l'irruption de la pandémie, notamment grâce à l'obtention de certains accords : l'un portant sur la mutualisation des dettes nouvelles au sein de l'UE, l'autre déléguant la Commission européenne pour l’achat des vaccins destinés aux Etats membres. Mais dans les coulisses, certains des États membres, et pas des moindres, comme l'Allemagne ont passé des contrats spécifiques avec Pfizer-BioNTech, Moderna et Curevac, ce qui "a provoqué un séisme à Bruxelles"[4].
Fait inattendu, l'Allemagne, qui jusque-là avait fait très bonne figure avec un taux de mortalité bien inférieur à celui de tous les pays industrialisés, a commencé à rivaliser d'incohérence avec d'autres pays dits développés comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. "Avec près de 2,1 millions d'infections en un an, l'Allemagne affiche un taux de mortalité de 2,4 %, équivalent à celui de la France.."[5], la moitié des cas de surmortalité survenus au cours des deux vagues de pandémie en Allemagne est liée à l'infection des seniors. Lorsque les premiers vaccins sont arrivés, rares sont les pays industrialisés dans lesquels l'anarchie capitaliste et le crétinisme administratif ne sont pas invités dans la gestion calamiteuse de leur distribution aux différents centres de vaccination ; il en a été de même pour les aiguilles et autre matériel médical. Fait significatif que quelque chose est défaillant dans la société, les gouvernements ont dû, dans un certain nombre de pays, faire appel à l'armée afin que des militaires soutiennent les services médicaux, prennent en charge la logistique de la distribution, le suivi des commandes, mais aussi protègent les vaccins contre le vol.
Alors qu'il y a pénurie de vaccins dans les pays les plus industrialisés, ceux-ci sont absents de pays les moins riches, essentiellement fournis par des vaccins chinois[6] dont l'efficacité n'est pas probante. À contrario, si L'État d'Israël a pu obtenir les doses nécessaires pour pouvoir vacciner toute sa population, c'est parce qu'il a acheté le vaccin Pfizer 43% plus cher que le prix négocié par l'Union Européenne.
L'agonie du capitalisme dans sa phase finale de décomposition empeste la société
Des millions d'ouvriers ont été jetés brutalement au chômage dans le monde, la pauvreté s'est étendue et approfondie de façon considérable. Cernées par les dangers de la contagion, la réalité du chômage et la plongée dans la pauvreté, des parties importantes de la population mondiale, de grandes masses précarisées, sombrent dans le désespoir. Dans les métropoles industrialisées, l'isolement forcé résultant des diverses mesures de confinement a des conséquences sur la santé mentale des populations, ce dont témoignent l'engorgement des services psychiatrique et l'augmentation des suicides.
Si, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, la situation résultant de la pandémie constitue un acte d'accusation sans appel de la bourgeoisie, pour des parties significatives de la population, toute réflexion est par contre polluée par toutes sortes de théories complotistes. C'est le cas notamment aux Etats-Unis, le pays le plus développé du monde, à l'avant-garde de la science. Alors que la pandémie avait déjà commencé à déferler sur le continent américain, une grande partie de la population aux États-Unis s'imaginait que le Covid-19 n'existait pas et que c'était un complot pour torpiller la réélection de Trump ! D'autres versions, moins outrancières mais tout aussi illustratives de théories fantasques, ont fleuri, voyant derrière les mesures de restriction de la liberté de mouvement la main de ceux qui nous manipulent cherchant un prétexte pour nous "confiner" ou permettre aux compagnies pharmaceutiques de faire leur beurre. Des manifestations ont eu lieu sur ce thème dans certains pays. En Espagne, des participants scandaient "les hôpitaux sont vides", et en Israël, ce sont des juifs ultraorthodoxes qui manifestaient. L'extrême-droite s'est aussi invitée à certaines de ces manifestations, aux Pays-Bas en particulier. Dans ce pays, on a assisté à de véritables émeutes avec ponctuellement des débordements ciblant des postes de santé.
Cette crise est le produit de la phase actuelle de décomposition au sein de la décadence du capitalisme et une illustration de ses manifestations. Perte de contrôle de la classe dominante sur son propre système, aggravation sans précédent du "chacun pour soi", montée des thèses et idéologies les plus irrationnelles, tels sont les traits marquants de la situation créée par l'irruption de cette pandémie. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, elles ont envahi la société, se signalant par la montée des idéologies les plus irrationnelles, réactionnaires et obscurantistes, la montée du fanatisme religieux à la base de l'État islamiste et ses jeunes kamikazes embrigadés dans la "Guerre sainte" au nom d'Allah.
Toutes ces idéologies réactionnaires ont été aussi le fumier qui a permis le développement de la xénophobie et du populisme dans les pays centraux, et surtout aux États-Unis. Celui-ci a connu une culmination avec la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier par les troupes de choc de Trump. Cette attaque ahurissante contre le temple de la démocratie américaine a donné au monde entier une image désastreuse de la première puissance mondiale. Le pays de la Démocratie et de Liberté est apparu comme une vulgaire république bananière du Tiers-Monde (comme le reconnaissait l'ex-président George Bush lui-même) avec le risque d'affrontements armés dans la population civile.[7]
L'accumulation de toutes ces manifestations de la décomposition, à l'échelle mondiale et sur tous les plans de la société, montre que le capitalisme est bien entré, depuis trente ans, dans une nouvelle période historique : la phase ultime de sa décadence, celle de la décomposition.
Plus que jamais, la survie de l'humanité dépend de la capacité du prolétariat de renverser le capitalisme avant qu'il ne rende impossible toute forme de vie en société sur la planète. De plus, les caractéristiques de la future société communiste rendront impossible une telle vulnérabilité de la société face à la maladie comme c'est le cas aujourd'hui face à la pandémie de Covid.
Comment la société communiste future fera face aux pandémies
Il ne nous appartient pas, dans le cadre de ce court article, d'entrer dans les considérations du type "Pourquoi, aujourd'hui, une telle société serait-elle possible, alors qu'elle ne s'est pas réalisée dans le passé ?" ou encore "comment le prolétariat révolutionnaire prendra en charge le renversement du capitalisme à l'échelle mondiale et la transformation des rapports de production". Le CCI a déjà consacré de nombreux articles à cette question. Nous ne nous risquerons pas non plus à imaginer quelle serait la vie des membres de la société délivrée de l'aliénation des sociétés de classe, mais nous pouvons cependant affirmer que l’aliénation et le chacun pour soi prennent des formes de plus en plus brutales et inhumaines dans le capitalisme agonisant. Nous allons nous limiter ici à l'aspect économique et ses conséquences sociales directes.
- Le communisme n'est pas seulement un vieux rêve de l'humanité ou le simple produit de la volonté humaine, mais il se présente comme la seule société capable de surmonter les contradictions qui étranglent la société capitaliste. De de fait, ses caractéristiques économiques seront les suivantes ;
- le seul mobile de la production est la satisfaction des besoins humains ;
- les biens produits cessent d'être des marchandises, des valeurs d'échange, pour devenir uniquement des valeurs d'usage ; en d'autres termes on produira pour les besoins des hommes et non pas pour le marché ;
- la propriété privée des moyens de production, qu'elle soit individuelle comme dans le capitalisme des origines ou étatique comme dans le capitalisme décadent (dans sa version stalinienne, fasciste ou démocratique), cède la place à leur socialisation. C'est-à-dire la fin de toute propriété, partant, de toute existence de classes sociales et, donc, de toute exploitation.
En passant en revue les facteurs qui sont à l'origine des très grandes difficultés rencontrées par la société pour se défendre face à la pandémie du Covid, et aussi pour faire face aux conséquences sociales tragiques de cette dernière, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le poids qu'auraient eu ces mêmes facteurs dans une société communiste. En fait, il auraient été inexistants :
- Nous savons qu'à l'origine de la pandémie se trouve l'état de délabrement de la planète, qui s'aggravait avec l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence, plus particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que : "la destruction impitoyable de l'environnement par le capital prend une autre dimension et une autre qualité, l'époque dans laquelle toutes les nations capitalistes sont obligées de se concurrencer dans un marché mondial sursaturé ; une époque, par conséquent, d'économie de guerre permanente, (…) une époque caractérisée par le pillage désespéré des ressources naturelles par chaque nation essayant de survivre dans un combat de rats sans merci pour le marché mondial "[8]. Une fois la bourgeoise défaite politiquement à l'échelle mondiale, une tâche prioritaire sera de réparer les séquelles que le capitalisme a infligées à la planète et de rendre cette dernière apte à permettre l'épanouissement de la vie sur terre. C'est ainsi que seront également éliminées les possibilités d'apparition de pandémies du type de celle du Covid-19.
- Néanmoins, rien ne garantit que d'autres pandémies avec une origine différente de celle du Covid-19 ne pourront pas voir le jour à l'avenir ! C'est la raison pour laquelle, soucieuse de la survie et du bien-être de ses membres, la nouvelle société développera ses connaissances scientifiques en vue d'anticiper au mieux la survenue d'éventuelles maladies inconnues. Un tel effort de la société pourra être considérable en comparaison de ce qu'est capable de faire le capitalisme, dans la mesure où il ne sera plus assujetti à la réalisation de profit mais destiné à la satisfaction des besoins humains. Pour cela, il y aura diffusion et centralisation de tout le savoir à l'échelle planétaire, et non pas "protection" et rétention des connaissances motivée la réalisation de profit et conséquence de la concurrence. Les maladies et les risques qu'elles impliquent ne seront plus cachées pour que "l'économie puisse continuer à tourner", mais la réaction sera collective et responsable sans soumission aucune à des lois économiques "au-dessus" des hommes.
- Ce dernier facteur fait que, contrairement à la situation présente, les installations sanitaires, non soumises à la loi du profit, pourront en permanences être améliorées et non pas laissées à l'abandon.
- Même dans une société communiste, on ne peut cependant pas exclure, malgré l'importance qui sera alors accordée à la prévention, que l'humanité soit amenée à faire face à l'imprévu, à travers, par exemple, la nécessité de fabriquer dans les meilleurs délais d'un vaccin ou un traitement. Il ressort clairement des caractéristiques de la société communiste, sans concurrence entre différentes parties de celle-ci, qu'elle pourrait alors mobiliser au service de cet objectif les forces associées de l'ensemble de l'humanité, tout le contraire de ce qui s'est produit avec la fabrication d'un vaccin contre le Covid. En fait, ce n'est pas spéculer que d'affirmer que l'humanité sera confrontée à des dangers bien réels, qui seront la conséquence des dommages, peut-être irréversibles pour certains, que le capitalisme décadent et en décomposition lèguera aux générations futures. Face à ceux-ci, le prolétariat devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, sanitaires et de restauration de l'environnement pour que vive l'humanité libérée des lois aveugles du capitalisme.
- Et si, malgré un effort toujours plus poussé de prévention par rapport à tout ce qui pourrait menacer l'espèce humaine, l'humanité devait se trouver affectée par de dures épreuves, c'est solidairement, comme un seul homme, qu'elle y ferait face et non pas en rejetant sur le pavé une partie d'entre elle, comme aujourd'hui les millions de laissés pour compte des "bienfaits" du capitalisme.
Entre le moment où le prolétariat aura commencé à renverser le pouvoir politique de la bourgeoisie dans un certain nombre de pays, puis à l'échelle mondiale (un monde sans frontières) et le moment où sera instaurée une société sans classes sociales, sans exploitation, sans argent, …. le prolétariat devra diriger la transition société dans cette direction … et cela prendre beaucoup de temps. Néanmoins, même s'il n'est pas possible de commencer à transformer la société avant la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale, le prolétariat au pouvoir aura face à la maladie une attitude différente de celle de la bourgeoisie. C'est ce qu'illustre l'article que nous publions ci-après, "La Prise en charge de la Santé en Russie Soviétiste" qui est relatif aux mesures prise par le pouvoir des Soviets entre juillet 1918 et juillet 1919.
Alors oui ! La transformation communiste est nécessaire, mais aussi la révolution est possible !
Nous avons jusqu'à maintenant mis l'accent sur les dangers que la décomposition du capitalisme faisait courir à la société et à la possibilité même de la révolution prolétarienne. C'était notre responsabilité car il appartient aux révolutionnaires de parler clairement à la classe ouvrière sans lui masquer les difficultés auxquelles elle va être confrontée. Mais il leur appartient aussi, en particulier face au scepticisme ambiant, de montrer qu'il existe la possibilité d'une issue révolutionnaire à la situation actuelle. Celle-ci résultera d'une part du fait que, bien que connaissant des difficultés importantes, la classe ouvrière n'a pas subi de défaite importante, l'empêchant de réagir, comme dans les années 1930, aux attaques de la bourgeoisie. Et celles-ci pleuvent déjà, et ce n'est qu'un début.
En effet, la crise sanitaire ne peut qu‘aggraver encore plus la crise économique. Et on le voit déjà avec les faillites d’entreprises, les charrettes de licenciements depuis le début de cette pandémie. Face à l’aggravation de la misère, à la dégradation de toutes ses conditions de vie dans tous les pays, la classe ouvrière n’aura pas d’autre choix que de lutter contre les attaques de la bourgeoisie. Même si, aujourd’hui, elle subit le choc de cette pandémie, même si la décomposition sociale rend beaucoup plus difficile le développement de ses luttes, elle n’aura pas d’autre choix que de se battre pour survivre. Avec l’explosion du chômage dans les pays les plus développés, lutter ou crever, voilà la seule alternative qui va se poser aux masses croissantes de prolétaires et aux jeunes générations !
C’est dans ses combats futurs, sur son propre terrain de classe et au milieu des miasmes de la décomposition sociale, que le prolétariat va devoir se frayer un chemin, pour retrouver et affirmer sa perspective révolutionnaire.
Malgré toutes les souffrances qu’elle engendre, la crise économique reste, aujourd’hui encore, la meilleure alliée du prolétariat. Il ne faut donc pas voir dans la misère que la misère, mais aussi les conditions du dépassement de cette misère.
Sylver (17 02 2021)
[1] Le Nipah s’est manifesté dans les années 1995/1999 en Malaisie et à Singapour chez des éleveurs de porcs, il a réapparu de manière épisodique au Bengladesh et en Inde orientale en 2011 puis au Cambodge en 2012 (aux abords notamment des temples touristiques d’Angkor Vat) avant de se manifester en Chine et en Thaïlande en 2020, c’est-à-dire dans des zones de forêts tropicales asiatiques. Il est transmis par l’urine ou la salive des chauves-souris frugivores chassées de leur milieu naturel (du fait des incendies, de la sécheresse, de la déforestation, des pratiques agricoles) vers l’environnement humain proche et se transmet à l’homme via les élevages porcins. Outre des symptômes similaires au Covid, il provoque aussi des encéphalites foudroyantes (son taux de mortalité varie effectivement entre 40 et 75%). Sa période d'incubation et infectieuse, très large, peut varier de 5 jusqu’à 45 jours !!! Source OMS, Virus Nipah [74]
[2] Source La fondation néerlandaise. Pharmaceutical giants not ready for next pandemic, report warns [75]
[3]. Journal Le Monde. "Nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles à propos du "protocole nord-irlandais", partie cruciale du traité du Brexit [76]".
.[4]. Journal Le Monde du 3 février 2021". "Il est stipulé que les participants s'engagent à ne pas contractualiser individuellement avec les mêmes laboratoires. L'Allemagne a pourtant reconnu avoir passé des contrats avec Pfizer-BioNTech, Moderna et Curevac." Covid-19 : après la Hongrie, le vaccin russe Spoutnik pourrait séduire d’autres pays européens [77]..
[5]. Journal Les Echos du 12 février 2021. Coronavirus : les 50.000 morts qui font frémir l'Allemagne [78]
[6]. "En septembre déjà, l'ONG Oxfam estimait que les pays riches, représentant seulement 13 % de la population mondiale, avaient mis la main sur plus de la moitié (51 %) des doses des principaux vaccins à l'étude". Journal Le Monde. "Essais cliniques, production, acheminement… Les six défis de la course au vaccin contre le Covid-19." [79]
[7]. À propos de la situation aux États-Unis, lire note article "Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue [80]". Essais cliniques, production, acheminement… Les six défis de la course au vaccin contre le Covid-19 [79]
[8]. "Ecologie : c'est le capitalisme qui pollue la terre [81]". Revue internationale n° 63.
Evènements historiques:
Rubrique:
La prise en charge de la santé dans la Russie des soviets
- 159 lectures
Nous publions ci-dessous un article relatif à l'évolution de la situation sanitaire dans la Russie des soviets en juillet 1919, un an après la mise sur pied du Commissariat de l'hygiène publique. C'est dans un contexte très défavorable que cette politique sanitaire a alors été mise en œuvre puisque, depuis la prise du pouvoir par le prolétariat en octobre 1917, la Russie subit sur son territoire les menées contre-révolutionnaires soutenues par les gouvernements de l'Entente. Ainsi, au début 1919, la Russie est complètement isolée du reste du monde et confrontée à l'activité tant des armées blanches que des troupes des "démocraties occidentales". Et néanmoins, dans les conditions matérielles parmi les plus difficiles qu'il soit possible d'imaginer, la méthode alors mise en œuvre par le prolétariat, notre méthode, en tout point opposée à celle de la bourgeoisie aujourd'hui confrontée à la pandémie du coronavirus, parvient à des résultats qui, à l'époque, constituent un pas en avant considérable.
S'il nous est apparu opportun de souligner comment deux méthodes s'opposent, celle du prolétariat et celle de la bourgeoisie, ce n'est pas seulement pour mettre en évidence l'incapacité de la bourgeoise à sortir l'humanité de la barbarie dans laquelle elle plonge le monde. C'est aussi pour défendre l'honneur et les réalisations de la classe ouvrière révolutionnaire lorsqu'elle s'élançait à la conquête du monde lors de la première vague révolutionnaire mondiale, alors que depuis sa défaite, les mensonges de la bourgeoisie stalinienne et démocratique n'ont eu de cesse, chacune à leur manière, d'en salir et dénaturer les objectifs.
Il y a certes des concepts et des formulations qui apparaissent dans l'article et que nous ne partageons pas aujourd'hui : par exemple, l'idée de la nationalisation comme étape vers le socialisme ou même l'affirmation que l'exploitation capitaliste a déjà été abolie en Russie, ainsi qu'une partie du langage "médical" (enfants "anormaux" ou "retardés", etc.). Les mesures prises par le pouvoir soviétique à cette époque avaient essentiellement un caractère d'urgence et elles ne pouvaient pas, à elles seules, échapper aux pressions d'un système mondial capitaliste encore dominant. Mais malgré cela, la détermination du nouveau pouvoir soviétique à centraliser, remettre en service et améliorer rapidement les services de santé, à les retirer des mains des exploiteurs et à les mettre librement à la disposition de toute la population, découlait d'une méthode fondamentalement prolétarienne qui reste valable aujourd'hui et pour l'avenir.
La Conservation de la Santé en Russie Soviétiste
(N.A. Semachko)
Conditions générales du travail du Commissariat de l'hygiène publique
Le Commissariat de l'hygiène publique, créé par le décret du Conseil des Commissaires du peuple le 21 Juillet 1918, a dressé au mois de juillet 1919 le bilan de son travail annuel.
Les conditions extérieures défavorables dans lesquelles s'accomplit le travail des Commissariats du Peuple se répercutèrent visiblement sur l'appareil le plus sensible destiné à protéger ce que l'homme a de plus cher : sa vie et sa santé. Le lourd héritage qui nous fut légué par le régime capitaliste et par la guerre impérialiste, tout en entravant l'œuvre de création soviétiste, pesait très lourdement sur l'organisation médicale et sanitaire. Les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement, la désorganisation économique, le blocus de la Russie des Soviets par les impérialistes, la guerre civile, —tout cela contrecarrait péniblement les mesures prises en vue de prévenir les maladies et de les guérir. Il est difficile de mettre en œuvre des mesures sanitaires préventives quand l'alimentation insuffisante affaiblit l'organisme humain et le prédispose aux maladies, quand la population manque des objets les plus indispensables à l'accomplissement des proscriptions élémentaires de l'hygiène ; ou d'organiser un traitement médical rationnel, lorsque, grâce au blocus maintenu par les "alliés" nous sommes privés des médicaments les plus indispensables, et que les difficultés dans l'approvisionnement alimentaire ne nous permettent pas d'organiser de traitement diététique.
Et néanmoins, l'état sanitaire de la Russie Soviétiste est en ce moment tout aussi bon et même bien meilleur que celui des territoires limitrophes, se trouvant sous le joug des gardes blancs " gouverneurs suprêmes " de pays abondamment approvisionnés et largement pourvus en produits de toutes sortes, en médicaments et en personnel médical. Cet été, la Russie Soviétiste n'eut presque pas de cas de choléra ; tandis que dans la satrapie[1] de Dénikine[2], le choléra, comparable à un large torrent, fit d'importants ravages. La Russie Soviétiste vint, cet été, presque complètement à bout de l'épidémie de typhus. En Sibérie, en Oural, dans les territoires que nous libérons de Koltchak le typhus fait rage ; les prisonniers de l'armée de Koltchak sont presque tous infectés de maladies épidémiques. Nous avons supporté facilement l'épidémie de grippe espagnole, bien plus facilement même que l'Europe Occidentale; l'épidémie de choléra de l'année écoulée fut relativement courte, et seule l'épidémie de typhus revêtit l'hiver passé un caractère assez sérieux. Les raisons qui font que nous avons lutté avec suffisamment de succès, en dépit de conditions difficiles, contre les épidémies et les maladies, ces satellites inévitables de la boucherie impérialiste —consistent dans les méthodes nouvelles appliquées par le Pouvoir Soviétiste.
Les épidémies, de tout temps et en tout lieu, exercent surtout leurs ravages parmi les pauvres, parmi les classes laborieuses. Le Pouvoir Soviétiste est le pouvoir des travailleurs. En défendant les intérêts de la classe déshéritée il protège du même coup la santé du peuple. L'abolition de l'exploitation capitaliste donna la possibilité d'établir le règlement de la protection sanitaire du travail : elle permit de recourir aux mesures les plus efficaces pour la protection de la maternité et de l'enfance; l'abolition de la propriété mobilière et foncière permit de résoudre équitablement la question des logements: le monopole du pain eut pour résultat de permettre en premier lieu la répartition des réserves disponibles aux classes laborieuses; la nationalisation des pharmacies permit de distribuer également et économiquement les maigres réserves de médicaments, en les arrachant des mains des spéculateurs, etc... On peut dire que nul autre pourvoir dans les difficiles circonstances actuelles n'aurait pu avoir raison des obstacles incommensurables et apparemment invincibles qui existaient dans le domaine de la protection de la santé publique. Toutefois, il est encore une circonstance qui facilita notre travail dans ces conditions, c'est la concentration de tout le service médical dans les mains d'un seul organe dûment autorisé : le Commissariat de l'hygiène publique. Un seul organe avait été créé qui mena la lutte selon un plan unifié avec la plus grande économie de forces et de moyens. Cet organe vint remplacer le travail désordonné et fractionné des institutions diverses, les agissements mal combinés de plusieurs organes qui s'occupaient de la santé du peuple. La science et la pratique médicale démontraient depuis longtemps la nécessité d'une pareille centralisation du travail en un seul organe compétent. Ce sujet fut surtout débattu très vivement avant la guerre dans des ouvrages spéciaux russes et internationaux. Ainsi le médecin français Mirman écrivait dès 1913 dans l'Hygiène :
- "Très souvent il arrive qu'un préfet s'intéresse à la santé publique et veuille se rendre utile. Désireux d'acquérir l'appui du gouvernement, il doit à Paris visiter tous les ministères et s'entretenir avec tous les chefs de service d'une dizaine d'administrations. Il faut une grande persévérance pour ne pas abandonner la route, pour ne pas jeter le manche après la cognée, tant on finit par être désespéré par toutes ces formalités. Il s'agit surtout de la lutte contre les maladies sociales, la tuberculose et l'alcoolisme, par exemple. Voyons dans quel département ministériel peut être préparée, commencée et organisée la lutte contre la tuberculose. Elle dépend actuellement: du ministère du Travail (logements à bon marché, assurance mutuelle, hygiène des ateliers et des magasins), du ministère de l'Agriculture (hygiène de l'alimentation et analyse du lait), du ministère de l'Intérieur (prescriptions sanitaires aux communes et désinfection), du ministère de l'Instruction publique (inspection médicale des écoles). Lorsque le gouvernement sera interpellé sur les mesures qu'il compte entreprendre pour la défense de la race contre son ennemi le plus acharné, — quatre ministres devront prendre part aux débats (sans compter l'armée, la marine et les colonies) ; bref, par suite de la distribution des services de l'hygiène publique entre les différents ministères et administrations, il n'y a personne parmi les membres du gouvernement qui soit directement responsable de l'hygiène et de la santé publique. L'organisation d'un ministère de l'Hygiène publique mettra de l'ordre dans ce chaos et créera un système au lieu de l'arbitraire actuel."
Cette centralisation de l'œuvre médicale fut réalisée en Russie par le décret du gouvernement soviétiste du 21 juillet 1918. Ce décret créa "le Commissariat de l'Hygiène publique" nanti de tous les droits d'un ministère indépendant et comprenant les sections suivantes : Section sanitaire-épidémiologique, Section des traitements médicaux, Section pharmaceutique, Section des fournitures médicales et générales, Section de la lutte contre les maladies sociales (maladies vénériennes, prostitution et tuberculose), Section de la protection de l'enfance (inspection sanitaire des écoles, soins spéciaux aux enfants anormaux, organisation de la culture physique, etc...). Section des services sanitaires militaires et des voies de communication, etc...
L'administration pratique de toute l'œuvre médico-sanitaire se trouve entre les mains des organisations ouvrières des Soviets de Députés Ouvriers et Députés de l'Armée Rouge. Toutes les mesures sanitaires fondamentales se réalisent avec le concours énergique des organisations ouvrières (rappelons, par exemple, les travaux connus de la Commission, travaux ayant rendu les plus inappréciables services dans la liquidation du choléra et du typhus).
Telles sont les causes fondamentales, créatrices de nouvelles conditions dans l'œuvre sanitaire et médicale et qui, en dépit des conditions extérieures particulièrement pénibles, facilitent le travail. Dans le chapitre suivant, nous donnerons un aperçu sommaire du travail du Commissariat. Ici, nous comparerons, à titre d'exemple concret, l'organisation médico-sanitaire de la ville de Moscou d'avant la révolution d'octobre avec cette même organisation dans son état actuel, après deux années d'existence du Pouvoir Soviétiste
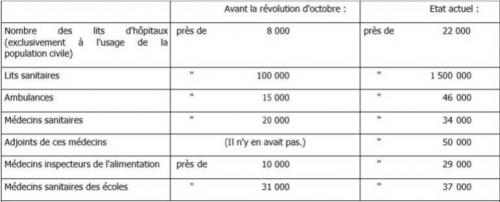
Il faut y ajouter les nouvelles organisations médico-sanitaires créées par le Pouvoir Soviétiste à l'usage de la population la plus pauvre ; assistance gratuite à domicile (cette question fut à l'ordre du jour pendant 10 ans et avant le mois d'octobre 1917, elle se trouvait encore à l'état de discussion). Actuellement, 80 médecins et près de 160 infirmières sont occupés à cette assistance et sont répartis dans les différents quartiers de la ville ; il faut aussi citer des postes de secours pour les cas urgents et dans ce but des services permanents de médecins et d'automobiles sanitaires ont été institués. Mentionnons encore la lutte récemment entreprise contre la tuberculose et la syphilis, en tant que maladies sociales ; une action importante, destinée à populariser les connaissances sanitaires ; une assistance gratuite et largement organisée pour les traitements dentaires (10 ambulances avec 25 fauteuils) ; la mise à la portée de la population de l'assistance psychiatrique (traitements au moyen de rayons) ; la gestion des pharmacies nationalisées, ainsi que la bonne répartition de leurs produits, etc...
Et cette énumération d'exemples n'épuise pas encore tout ce qui fut nouvellement créé par le Pouvoir Soviétiste a Moscou dans le domaine de l'hygiène publique au cours d'une existence de deux années. Ce qui vient d'être mentionné, se rapporte à la quantité. Quant à la qualité, — elle a été égalisée du fait qu'on a fait disparaître l'usage qui divisait la médecine en deux classes : celle dite " de premier ordre " pour les riches et de " troisième ordre " pour les pauvres.
Les meilleurs spécialistes de Moscou reçoivent maintenant les malades dans les hôpitaux de la ville ; et l'on peut affirmer qu'il n'y a pas un grand spécialiste, — docteur ou professeur, — auquel un habitant quelconque de la capitale soviétiste ne puisse s'adresser pour un conseil gratuit.
Cette aide médicale est organisée de fanon semblable, mais naturellement sur une autre échelle, dans toutes les autres villes.
C'est ainsi que le Pouvoir Soviétiste sut organiser l'œuvre médico-sanitaire au cours des deux années écoulées, au milieu de conditions essentiellement défavorables.
Une année de travail
Le développement du travail du Commissariat de l'Hygiène publique, son œuvre organisatrice et la lutte menée contre les épidémies, qui se succédaient, ont été simultanés. L'été dernier, une tourmente de grippe espagnole s'abattit sur toute la Russie. On envoya en divers endroits des commissions à l'effet d'étudier cette maladie encore peu connue, aussi bien que pour la combattre efficacement ; toute une série de conférences scientifiques furent organisées et des enquêtes furent menées sur place. Comme résultat de ces études on put constater la parenté de la grippe espagnole avec l'influenza (grippe) ; des ouvrages spéciaux furent édités traitant de cette maladie sous une forme scientifique et populaire.
L'épidémie de grippe espagnole passa très vite et relativement bien. Beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile fut la lutte contre l'épidémie de typhus, qui prit une grande extension surtout pendant l'hiver de 1918-1919. Il suffit de dire que jusqu'à l'été 1919 près d'un million et demi de personnes furent atteintes de cette maladie. Cette épidémie ayant été prévue, le Commissariat de l'Hygiène publique ne fut pas pris au dépourvu. Dès l'automne de 1918, une série de consultations avec les représentants des sections locales et avec les spécialistes bactériologues avait lieu ; on esquissa le plan de la lutte qui permit d'envoyer en province des instructions précises. On soumit à la ratification du Conseil des Commissaires du Peuple un décret sur les mesures à prendre pour la lutte contre le typhus. Des réunions scientifiques furent organisées en même temps que des expériences étaient tentées avec application d'un sérum pour prévenir et traiter le typhus. On édita de nombreuses brochures scientifiques, des livres populaires et des feuilles concernant le typhus. L'épidémie de choléra qui s'était sensiblement propagée en été et en automne 1918 et qu'on attendait en 1919 ne prit pas cette année d'extension considérable, malgré le danger direct de contamination qui nous venait des troupes de Denikine où sévissait le choléra. Comme mesures préventives on purifia l'eau potable (chlorification), en même temps que les vaccinations anticholériques se faisaient sur une plus vaste échelle. Enfin, un décret sur la vaccination obligatoire fut promulgué et confirmé par le Conseil des Commissaires du Peuple le 10 avril 1919, comblant ainsi une lacune capitale de notre législation sanitaire. Ce décret eut pour but de prévenir une épidémie de petite vérole qui menaçait de se développer en 1918-1919 ; pour compléter ce décret, on élabora des instructions pour les institutions locales, des règlements sur l'entretien, des étables pour l'élevage des jeunes veaux destinés à la préparation du vaccin. On assigna près de 5 millions 1/2 pour réaliser ce décret et près de 5 millions de vaccins furent distribués contre la petite vérole.
Il était matériellement impossible, dans notre république isolée de l'Europe, de se procurer des vaccins médicaux et des sérums. Le Commissariat de l'Hygiène publique nationalisa promptement tous les instituts bactériologiques importants, aussi bien que les étables où étaient élevés les veaux destinés à la préparation du vaccin ; des étables spéciales furent créées (notamment dans le gouvernement de Saratov) : on les munît de tout le nécessaire, on élargit leur travail ; l'approvisionnement de ces institutions en matériel nécessaire fut centralisé, organisé en sorte que, lors des épidémies, le pays ne manqua ni de sérum, ni de vaccin.
Il faut surtout souligner, que toute la lutte pratique contre les épidémies se faisait sur de nouveaux principes, à savoir, sur les principes de la participation directe de toute la population et avant tout, des masses ouvrières et paysannes. Même les correspondants des journaux bourgeois, séjournant en Russie, durent reconnaître que le Pouvoir Soviétiste luttait contre les épidémies d'une façon toute nouvelle, en mobilisant pour cela toute la population. Des services irremplaçables et inestimables furent rendus lors de la lutte contre les épidémies par les commissions, surnommées « commissions ouvrières », composées des représentants de Syndicats, de Comités de Fabriques et d'Usines et d'autres organisations prolétariennes et paysannes. Les Commissions Ouvrières, affectées aux sections du Commissariat de l'Hygiène publique, veillaient activement au maintien de la propreté, prenaient des mesures énergiques pour l'organisation des bains de vapeur et des buanderies à l'usage de la population, facilitaient la possibilité de se procurer de l'eau bouillante pendant l'épidémie de choléra et travaillaient a la propagande sanitaire.
Le Commissariat de l'Hygiène publique, afin de prêter un appui financier à ses collaborateurs sur les lieux — assigna aux Comités Exécutifs locaux pour la lutte contre les épidémies 292 millions de roubles du 1 er octobre 1918 au 1er octobre 1919.
En vue de prévenir le développement des maladies et des épidémies — le Commissariat prenait soin de la surveillance sanitaire de l'eau, de l'air et du sol ; il élaborait et appliquait des mesures en conséquence, s'occupait de questions d'hygiène alimentaire, etc... Les soins concernant les logements destinés à la population laborieuse eurent ici une importance particulière. Le Commissariat de l'Hygiène publique fit accepter par le Conseil des Commissaires du Peuple le décret sur l'inspection sanitaire des habitations, prépara des inspections et des règlements relatifs aux logements et organisa des cours pour la préparation d'inspecteurs de logements.
Tout le travail antiépidémique et sanitaire était mené parallèlement à la propagande sanitaire la plus énergique au sein des masses populaires ; des brochures furent éditées, à Moscou et en province ; des musées d'hygiène sociale et des expositions sur la conservation de la santé furent organisés. Un institut scientifique de l'hygiène publique est en cours de préparation pour être ouvert et le sera très prochainement. On étudiera dans cet institut les questions scientifiques sanitaires d'hygiène et de lutte contre les maladies contagieuses.
Dans le domaine des traitements médicaux, le Commissariat s'occupa l'année passée de centraliser toutes les institutions médicales disséminées jusqu'alors dans les divers ministères et départements. Malgré toutes les conditions défavorables au développement de ce genre de traitement ce dernier fut organisé d'après un système uniforme, et en plusieurs endroits non seulement n'en souffrit pas, mais au contraire, s'améliora et s'élargit ; on fit beaucoup, en particulier, pour obtenir des traitements médicaux gratuits et accessibles a tous.
La lutte contre les maladies vénériennes et contre la tuberculose fut l'objet d'une attention particulière du Commissariat de l'Hygiène publique : il créa des organes spéciaux en province, ouvrit des ambulances ou des hôpitaux pour les malades, intensifia la production des préparations spéciales pour le traitement de la syphilis (plus de 60 kilogrammes de 606 furent employés), accrut le nombre de sanatoria au centre aussi bien qu'en province pour combattre la tuberculose, organisa dans plusieurs endroits des ambulances (dispensaires} et prêta une attention particulière à la tuberculose infantile. Mais le point capital fut l'entreprise sur une vaste échelle de l'œuvre de propagande sanitaire, qui donna la possibilité d'établir un lien vivant avec les organisations ouvrières, ce qui est d'une très grande importance dans la lutte contre les maladies sociales. Denikine nous coupa des principales villes d'eau du Sud ; toutes les autres villes d'eau, Lipez, Staraïa-Roussa, Elton, Sergiyevsk, etc., furent largement fréquentées par les travailleurs. Là, où auparavant les bourgeois se soignaient contre l'obésité et contre les conséquences de la débauche, là où ils brûlaient leur vie par les deux bouts — les ouvriers et les paysans de la Russie Soviétiste trouvent maintenant refuge et soulagement.
On sait que la Russie recevait tous ses médicaments de l'étranger (surtout d'Allemagne). Nous n'avions presque pas d'industrie pharmaceutique. On comprend, aisément, dans quelle situation catastrophique la Russie Soviétiste fut mise par le blocus impérialiste. Le Commissariat de l'Hygiène publique nationalisa promptement l'industrie et le commerce pharmaceutiques et sauva, grâce à cette mesure, les provisions pharmaceutiques du pillage et de la spéculation. En collaboration avec le Conseil Supérieur de l'Economie nationale, on organisa rapidement de nouvelles fabriques, où la production des médicaments fut intensifiée. Les remèdes furent réquisitionnés par dizaines et par centaines de kilogrammes chez les spéculateurs. Le dépôt central du Commissariat de l'Hygiène publique envoya en province, rien que pour la population civile, au cours de 10 mois (septembre 1918-juin 1919), pour 24 millions et demi de médicaments, pour 9 millions de matériel de pansement, pour 1 million et demi d'instruments chirurgicaux, presque pour 1 million de toutes sortes de matériel pour traitement des malades, pour 1 million et demi de vaccins et de sérums, pour 300 000 roubles d'appareils de Rœntgen, etc. Et chaque mois, la livraison des fournitures s'accroît.
Le service militaire sanitaire dans cette guerre, à la différence des autres, fut organisé sur de nouvelles bases. Le pouvoir d'Etat ayant adopté pour principe la création d'une médecine organisée sur un plan uniforme, devait logiquement inclure le service sanitaire militaire dans l'organisation générale du Commissariat de l'Hygiène publique, en retirant les services sanitaires militaires du ressort immédiat et exclusif des organes de l'Administration militaire, comme il en avait été jusque-là. Par une telle organisation, une direction uniforme de toute l'œuvre médico-sanitaire de la République est assurée par le Commissariat de l'Hygiène publique. Un front sanitaire unique se crée dans le pays, ce qui est indispensable surtout pour l'accomplissement systématique des mesures antiépidémiques.
Une pareille structure donna la possibilité de sauver l'armée des ravages des maladies épidémiques qui régnaient dans le pays (le typhus de famine, le typhus abdominal, le typhus récurrent, la petite vérole, la dysenterie, le choléra et autres maladies) et cela malgré les conditions générales extrêmement difficiles de la période transitoire que nous traversons. Il y eut dans l'armée 20 à 30 cas de choléra, les cas de typhus de famine atteignirent, avant l'automne, un maximum de 4 à 5 % dans toute l'armée, les cas de dysenterie 0,01 %, de typhus récurrent près de ½ %. Le service de santé militaire se trouva en état de préparer un grand nombre de lits de malades, bien pourvus matériellement, dont la proportion3, par rapport aux effectifs de l'armée rouge, est de 1 pour 7. Tous les points d'évacuation possédant plus de 2 000 lits de malades disposent d'hôpitaux ou de sections pour les différents genres d'assistance spéciale. Le principe de l'utilisation des médecins selon leur spécialité se réalise de jour en jour.
Tous les points d'évacuation sont pourvus de laboratoires chimio-bactériologiques. Presque tous disposent d'un cabinet pour traitement par rayons Rœntgen.
- Les mesures sanitaires-hygiéniques générales sont appliquées d'une façon régulière.
La campagne de vaccination pour la préservation du choléra et du typhus égala, sous le rapport du pourcentage, les résultats de la campagne 1914-1917.
Pour le traitement des soldats atteints de maladies vénériennes, il y a 11 hôpitaux spéciaux avec 4 630 places ; de plus, dans 49 hôpitaux, des sections pour ces malades sont installées ; un traitement d'ambulance a été créé pour les vénériens et la Première Ambulance modèle du Département militaire pour le traitement des maladies cutanées et vénériennes a été ouverte. Afin de lutter contre la propagation des maladies vénériennes, une campagne active est menée, au moyen de projections lumineuses, pour faire connaître la nature et les dangers de ces maladies.
Pour la première fois, l'assistance dentaire est largement organisée dans l'armée. Il a été ouvert dans les circonscriptions militaires 68 ambulances pour le traitement dentaire et 62 sur le front. De plus, des ateliers spéciaux sont créés pour la préparation des râteliers. La centralisation de toute l'œuvre médico-sanitaire dans un seul commissariat spécial et autonome permit d'organiser rationnellement le travail du traitement médical et le travail sanitaire dans l'année sans porter un préjudice tant soit peu considérable aux intérêts de la population civile. Ce principe fut si largement réalisé que, même pendant la mobilisation du personnel médical, les intérêts de la population civile furent attentivement observés et les travailleurs indispensables du corps médical furent exemptés du service à l'armée. Près de 25 % des médecins furent ainsi libérés dans les cas où on les reconnaissait indispensables.
- Le nombre des médecins mobilisés et envoyés au front donne un médecin sur 300 ou 400 soldats de l'armée rouge.
L'œuvre de propagande sanitaire est l'objet d'une attention particulière, Dans tous les organes d'administration militaire sanitaire ont été introduites des sections ou des personnes chargées de l'éducation sanitaire des corps de troupes. On distribue une grande quantité de littérature de propagande sanitaire, on organise des cours, des conférences populaires, ainsi que des expositions sanitaires et hygiéniques mobiles et permanentes. On procède sur une large échelle à la préparation du personnel médical subalterne et secondaire, principalement des sœurs de charité et des infirmières rouges.
La conservation de la santé des enfants n'occupe nulle part une place plus prépondérante que dans la Russie Soviétiste. Non seulement les médecins mais toute la population est conviée à cette œuvre. Un Conseil de la Conservation de la santé des enfants fut créé au mois de novembre 1917. Il fut composé de médecins du Commissariat de l'Hygiène publique et de représentants des organisations prolétariennes (des syndicats, des Comités de fabriques et d'usines), de l'Union de la Jeunesse Communiste et des représentants des masses laborieuses.
L'intérêt pour la conservation de la santé des enfants se renforça beaucoup parmi les médecins et pédagogues grâce aux deux congrès panrusses de l'hygiène sanitaire des écoles (au mois de mars et au mois d'août). Partout, — non seulement au centre, mais aussi dans les villes provinciales, — s'ouvrirent des sous-sections pour la conservation de la santé infantile, sous-sections rattachées aux sections de l'hygiène publique de gouvernements et en majeure partie aux sections de district.
Le travail de la conservation de la santé infantile se divise en trois branches principales : 1° inspection sanitaire dans toutes les institutions enfantines, dans les écoles, dans les garderies, dans les écoles maternelles, dans les crèches, etc. ; 2° culture physique ; 3° classification des enfants d'après l'état de leur santé et leur répartition parmi les institutions médico-pédagogiques (les écoles forestières et les écoles auxiliaires, les colonies pour les enfants moralement défectueux, etc.).
Afin que toutes les tâches concernant la conservation de la santé des enfants, tâches que se pose la République Soviétiste, soient accomplies d'après un plan défini, on organisa au centre, près de la Section, douze institutions modèles médico-pédagogiques servant à faire connaître en province l'élaboration scientifique et pratique des questions et des mesures sur la conservation de la santé infantile. En octobre 1918, un institut de culture physique avec écoles expérimentales (urbaines et suburbaines) fut ouvert pour les enfants physiquement et moralement bien portants. Cet institut est un laboratoire du travail de l'enfance et d'exercices physiques (sport et gymnastique) et en même temps un instructeur de l'éducation ouvrière socialiste des jeunes générations. Toutes les expériences sur les écoliers sont faites auprès de cet institut où s'élabore pratiquement les processus du travail dans l'école unique du travail de la Russie Soviétiste. Des cours d'instructeurs d'éducation physique y sont aussi donnés.
Les ambulances (des écoles) infantiles sont des organes d'enquêtes sur les enfants ainsi que des organes de traitement. Ces ambulances classent les enfants dont l'état nécessite un traitement ou un allègement du programme d'éducation : a) les enfants malades sont placés dans des hôpitaux et dans des écoles-sanatoriums ; b) les enfants faibles et tuberculeux sont dirigés sur des écoles en plein air (écoles forestières, écoles de steppes) ; c) une autre partie est envoyée dans des écoles auxiliaires et dans des colonies médico-éducatrices. Là où il y a suffisamment d'éléments, les soins dentaires sont donnés dans des ambulances spéciales pour enfants. Dans une ambulance spéciale, les enfants tuberculeux sont examinés par un groupe de médecins (groupe de la lutte contre la tuberculose). Dispensaires : on y étudie la vie de famille de l'enfant prolétarien en même temps qu'on lui donne les soins qu'il nécessite en alimentation (des clubs-réfectoires sont installés à cet effet), en vêtements, en chaussures, en médicaments, huile de foie de morue, etc.
La Section de la Conservation de la santé de l'enfance prend pour principe immuable de son action qu'aucun enfant tombé malade ne doit rester sans recevoir une direction pédagogique dans une institution correspondante médico- pédagogique. Toutes les institutions destinées à la lutte contre la défectuosité physique (surdité, cécité), intellectuelle et morale, sont réunies autour d'un centre général — l'Institut de l'Enfant débile et retardataire. Cet institut possède une section d'observation expérimentale et cinq autres institutions, à savoir : une école auxiliaire pour les légers degrés de défectuosité intellectuelle, une école-hôpital pour les degrés profonds de défectuosité intellectuelle, une école- sanatorium pour les enfants psychiquement malades et les enfants névrosés, une colonie médicale et d'éducation et un institut de sourds-muets. Des médecins et des pédagogues spécialistes enseignent, dans ces institutions, aux futurs pédagogues l'éducation des enfants anormaux.
Pour la première fois dans le monde entier et uniquement dans la Russie Soviétiste, il fut décrété, dès le début de 1918, que les enfants âgés de moins de 18 ans ayant transgressé la loi ne peuvent être reconnus criminels, bien que pouvant être socialement dangereux et même nuisibles à la société. Ces enfants sont les tristes victimes des conditions anormales d'autrefois, de la société bourgeoise et n'ont besoin que d'une rééducation. Les délits de ces délinquants- mineurs ne peuvent être jugés par des juges ordinaires, et ne doivent être soumis — exclusivement — qu'à la Commission pour les délinquants-mineurs avec la participation obligatoire d'un médecin psychiatre et d'un pédagogue, ayant les mêmes droits que les représentants de la justice. De pareilles Commissions avec un personnel d'éducateurs- inspecteurs à domicile sont actuellement créées partout, tant dans les villes de gouvernements que dans les villes de districts. Des points de distribution et d'évacuation sont placés auprès de ces Commissions. Les enfants-délinquants sont, de ces points, rendus à leurs parents ou envoyés dans des colonies médicales et d'éducation. En général, comme toutes les autres institutions médico-pédagogiques, les établissements pour les enfants débiles et retardataires sont ouverts dans les villes de gouvernements et dans les villes de districts.
Actuellement sont ouvertes dans beaucoup de villes de gouvernements : des ambulances infantiles (des écoles), des écoles auxiliaires et des colonies pour les enfants moralement défectueux. Les écoles forestières et les écoles- sanatoriums se rencontrent plus rarement. L'ambulance infantile (des écoles) représente le type de l'institution médico- pédagogique le plus répandu dans les villes de district.
De quelle façon peut-on réaliser la conservation de la santé des enfants dans la période de crise alimentaire que traverse la Russie en ce moment ? La Section de la Conservation de la Santé infantile attachée au Commissariat de l'Hygiène publique porta dès son origine la plus sérieuse attention à la solution de cette question. Au commencement de l'année 1918, le premier convoi des enfants de Petrograd était dirigé, par les soins de cette section sur des colonies. La Section partit de ce principe que dans les conditions urbaines, il fallait avant tout assurer la nourriture de l'enfant, et le placer ensuite dans des conditions hygiéniques. Trois commissariats ont été appelés à collaborer à cette grande tâche par le pouvoir soviétiste, ce sont : le Commissariat de l'Instruction Publique, le Commissariat de l'Approvisionnement et le Commissariat de l'Hygiène publique (organisation des réfectoires diététiques pour les enfants malades et en convalescence après maladies graves). Le Conseil des Commissaires du Peuple institua l'alimentation infantile gratuite par son décret du 17 mai 1919. L'alimentation gratuite des enfants au-dessous de 10 ans est en vigueur dans les deux capitales et dans les rayons industriels des gouvernements non producteurs. Ce décret donna naissance à la répartition socialiste des produits entre les enfants. Mais sans attendre ce décret, la Section de la Conservation de la Santé de l'enfance avait reçu 50 000 000 de roubles en 1919 pour l'alimentation gratuite des enfants.
- Au mois de novembre 1918 la Section obtint à cet effet, le prélèvement d'un impôt spécial.
Si l'on donne un coup d'œil rétrospectif sur ce qui avant la révolution avait été fait en Russie pour la conservation de la santé de l'enfance, on peut dire que tout se résumait à rien ou presque rien. Le budget de l'Etat ne possédait même pas de paragraphe spécial. Après la révolution, le jeune pays socialiste se mit avec énergie à organiser cette action nouvelle. Au cours de deux années, au centre aussi bien qu'en province, on reconnut la nécessité de la conservation la plus minutieuse de la santé des enfants. Ce résultat fut atteint en dépit des conditions difficiles créées par la désorganisation économique. La santé de l'enfance doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes — voilà le principe de la Russie Soviétiste, et il n'est pas moins cher aux ouvriers qu'aux paysans. L'Etat Ouvrier et Paysan porte au plus haut degré la conservation de la santé de l'enfance, se rendant compte parfaitement que les jeunes communistes soit le gage de la future Russie Socialiste — et que seule une génération saine de corps et d'esprit peut préserver les conquêtes de la Grande Révolution Socialiste de Russie et amener le pays à une complète réalisation du régime communiste.
Source : Marxists.org. La conservation de la santé en Russie Soviétiste [83]
[1] Ndlr: Division administrative
[2] Ndlr: Chefs des forces armées de volontaires blancs contre la révolution
Géographique:
- Russie [84]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [85]
Récent et en cours:
- Coronavirus [86]
- COVID-19 [87]
Rubrique:
Pandémie de Covid-19: Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale (Tract international)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 123.2 Ko |
- 996 lectures
Nous publions, ci-dessous, un “tract numérique” internationale sur la crise sanitaire du Covid-19 sous la forme car, dans les conditions actuelles de confinement, il n’est clairement pas possible de distribuer une version imprimée de ce tract en grand nombre. Nous demandons à tous nos lecteurs d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour diffuser ce texte (réseaux sociaux, forums Internet, etc.) et de nous écrire pour nous informer des réactions, des discussions que cela suscite, et bien sûr pour nous faire part de leur propre opinion sur l’article. Il est plus que jamais nécessaire que tous ceux qui luttent pour la révolution prolétarienne expriment leur solidarité les uns avec les autres et maintiennent leurs liens. Même si nous devons nous isoler physiquement pour le moment, nous pouvons encore nous rassembler politiquement !
Une hécatombe ! Des morts par milliers chaque jour, des hôpitaux à genoux, un “tri” odieux entre les malades jeunes et vieux, des soignants à bout de forces, contaminés et qui parfois succombent. Partout le manque de matériel médical. Des gouvernements qui se livrent une concurrence effroyable au nom de “la guerre contre le virus”, des marchés financiers en perdition, des scènes de rapine surréalistes où les États se volent les uns les autres les cargaisons de masques, des dizaines de millions de travailleurs jetés dans l’enfer du chômage, des tombereaux de mensonges proférés par les États et leurs médias… Voilà l’effrayant spectacle que nous offre le monde d’aujourd’hui ! La pandémie du Covid-19 représente la catastrophe sanitaire mondiale la plus grave depuis la grippe espagnole de 1918-19 alors que, depuis, la science a fait des progrès extraordinaires. Pourquoi une telle catastrophe ? Comment en est-on arrivé là ?
On nous dit que ce virus est différent, qu’il est beaucoup plus contagieux que les autres, que ses effets sont beaucoup plus pernicieux et mortifères. Tout cela est probablement vrai mais n’explique pas l’ampleur de la catastrophe. Le responsable fondamental de ce chaos planétaire, de ces centaines de milliers de morts, c’est le capitalisme lui-même. La production pour le profit et non pour les besoins humains, la recherche permanente de la plus grande rentabilité au prix de l’exploitation féroce de la classe ouvrière, les attaques toujours plus violentes contre les conditions de vie des exploités, la concurrence effrénée entre les entreprises et les États, ce sont toutes ces caractéristiques propres au système capitaliste qui se sont conjuguées pour aboutir au désastre actuel.
L’incurie criminelle du capitalisme
Ceux qui dirigent la société, la classe bourgeoise avec ses États et ses médias, nous disent d’un air consterné que l’épidémie était “imprévisible”. C’est un pur mensonge digne de ceux proférés par les “climato-sceptiques”. Depuis longtemps les scientifiques ont envisagé la menace d’une pandémie comme celle du Covid-19. Mais les gouvernements ont refusé de les écouter. Ils ont même refusé d’écouter un rapport de la CIA de 2009 (“Comment sera le monde de demain”) qui décrit, avec une exactitude sidérante les caractéristiques de la pandémie actuelle. Rien n’a été fait pour anticiper une telle menace. Pourquoi un tel aveuglement de la part des États et de la classe bourgeoise qu’ils servent ? Pour une raison bien simple : il faut que les investissements rapportent du profit, et le plus vite possible. Investir pour l’avenir de l’humanité ne rapporte rien, ne fait pas monter les cours de la Bourse. Il faut aussi que les investissements contribuent à renforcer les positions de chaque bourgeoisie nationale face aux autres sur l’arène impérialiste. Si les sommes démentielles qui sont investies dans la recherche et les dépenses militaires avaient été consacrées à la santé et au bien-être des populations, jamais une telle épidémie n’aurait pu se développer. Mais au lieu de prendre des mesures face à cette catastrophe sanitaire annoncée, les gouvernements n’ont eu de cesse d’attaquer les systèmes de santé, tant au plan de la recherche que des moyens techniques et humains.
Si les gens crèvent et tombent aujourd’hui comme des mouches, au cœur même des pays les plus développés, c’est en premier lieu parce que les gouvernements, partout, ont réduit les budgets destinés à la recherche sur les nouvelles maladies ! Ainsi, en mai 2018, Donald Trump a supprimé une unité spéciale du Conseil de Sécurité Nationale, composée d’éminents experts, chargée de lutter contre les pandémies. Mais l’attitude de Trump n’est qu’une caricature de celle adoptée par tous les dirigeants. Ainsi, les études scientifiques sur les coronavirus ont été partout abandonnées il y a une quinzaine d’années, car le développement du vaccin était jugé… “non rentable” !
De même, il est parfaitement écœurant de voir les dirigeants et les politiciens bourgeois de droite comme de gauche pleurnicher sur l’engorgement des hôpitaux et sur les conditions catastrophiques dans lesquelles sont contraints de travailler les soignants, alors que les États ont mené une politique méthodique de “rentabilisation” du système de soins au cours des cinquante dernières années, particulièrement depuis la grande récession de 2008. Partout, ils ont limité l’accès des populations aux services de santé, diminué le nombre de lits des hôpitaux et accru la charge de travail et l’exploitation du personnel soignant ! Que penser de la pénurie généralisée des masques et autres moyens de protection, de gel désinfectant, de tests de dépistage ? Ces dernières années, la plupart des États ont abandonné la constitution des stocks de ces produits vitaux, pour faire des économies. Ces derniers mois, ils n’ont rien anticipé face à la montée de la propagation du Covid-19 repérée pourtant depuis novembre 2019, certains d’entre eux allant jusqu’à répéter pendant des semaines, afin de cacher leur irresponsabilité criminelle, que les masques étaient inutiles pour les non-soignants.
Et que dire des régions du monde chroniquement démunies comme le continent africain ou l’Amérique latine ? À Kinshasa (RDC), les dix millions d’habitants devront compter sur cinquante respirateurs ! En Afrique centrale, des flyers sont distribués, donnant des consignes sur comment se laver les mains quand la population n’a pas même d’eau à boire ! Partout, monte le même cri de détresse : “On manque de tout face à la pandémie !”.
Le capitalisme, c’est la guerre de tous contre tous
La concurrence féroce que se livre chaque État dans l’arène mondiale rend même impossible un minimum de coopération pour endiguer la pandémie. Lorsqu’elle a démarré, il était plus important aux yeux de la bourgeoisie chinoise de tout faire pour masquer la gravité de la situation, pour protéger son économie et sa réputation, l’État n’ayant pas hésité à persécuter puis laisser mourir le premier médecin qui avait tiré la sonnette d’alarme ! Même le semblant de régulation internationale que s’était donné la bourgeoisie pour gérer la pénurie a totalement volé en éclats, de l’impuissance de l’OMS à imposer des directives jusqu’à l’incapacité de l’Union européenne de mettre en place des mesures concertées. Cette division aggrave considérablement le chaos en engendrant une perte totale de maîtrise sur l’évolution de la pandémie. La dynamique du chacun pour soi et l’exacerbation de la concurrence généralisée sont clairement devenues la caractéristique dominante des réactions de la bourgeoisie.
“La guerre des masques”, comme la nomme les médias, est un exemple édifiant de la concurrence cynique et effrénée à laquelle se livrent tous les États. Aujourd’hui, chaque État s’arrache ce matériel de survie à coup de surenchères et même par le vol pur et simple ! Les États-Unis s’approprient sur les tarmacs chinois, au pied des avions, les cargaisons de masques promises à la France. La France confisque les chargements de masques en provenance de la Suède vers l’Espagne et transitant par ses aéroports. La République tchèque confisque à ses frontières les respirateurs et masques destinés à l’Italie. L’Allemagne fait disparaître incognito les masques à destination du Canada. On peut même voir cette foire d’empoigne entre différentes régions d’un même pays, comme en Allemagne et aux États-Unis. Voilà le vrai visage des “grandes démocraties” : la loi fondamentale du capitalisme, la concurrence, la guerre de tous contre tous, a produit une classe de flibustiers, de voyous de la pire espèce !
Des attaques sans précédent contre les exploités
Pour la bourgeoisie, “ses profits valent plus que nos vies”, comme le criaient les grévistes du secteur automobile en Italie. Partout, dans tous les pays, elle a retardé au maximum la mise en place des mesures de confinement et de protection de la population pour préserver, coûte que coûte, la production nationale. Ce n’est pas la menace d’un amoncellement de morts qui l’a finalement fait décréter le confinement. Les multiples massacres impérialistes depuis plus d’un siècle, au nom de ce même intérêt national, ont définitivement prouvé le mépris de la classe dominante pour la vie des exploités. Non, de nos vies, elle n’en a cure ! Surtout que ce virus a “l’avantage” pour la bourgeoisie, de faucher surtout les personnes âgées et les malades, autant “d’improductifs” à ses yeux ! Laisser le virus se répandre et faire son œuvre “naturelle”, au nom de “l’immunité collective”, était d’ailleurs le choix initial de Boris Johnson et d’autres dirigeants. Ce qui dans chaque pays a fait peser la balance en faveur du confinement généralisé, c’est la crainte d’une désorganisation de l’économie et, dans certains pays, du désordre social, de la montée de la colère face à l’incurie et aux hécatombes. D’ailleurs, bien qu’elles concernent la moitié de l’humanité, les mesures de confinement relèvent bien souvent de la pure mascarade : des millions de personnes sont obligées de s’entasser chaque jour dans des trains, des métros et des bus, dans les ateliers d’usines et les grandes surfaces ! Et déjà, partout, la bourgeoisie cherche à “déconfiner” le plus rapidement possible, alors même que la pandémie frappe le plus durement, en réfléchissant à la façon de provoquer le moins de remous et de contestation possibles, en projetant de remettre au travail les ouvriers, secteur par secteur, entreprise par entreprise.
La bourgeoisie perpétue et prépare de nouvelles attaques, des conditions d’exploitation encore plus forcenées. La pandémie a déjà mis des millions de travailleurs au chômage : dix millions en trois semaines aux États-Unis. Beaucoup d’entre eux, en raison d’emplois irréguliers, précaires ou temporaires, ont été privés de tout type de revenu. D’autres, qui n’ont que de maigres subventions ou aides sociales pour survivre, sont menacés de ne plus pouvoir payer leur loyer et d’être privés d’accès aux soins. Les ravages économiques ont déjà commencé à la faveur de la récession mondiale qui se profile : explosion du prix des denrées alimentaires, licenciements massifs, réductions de salaire, précarisation accrue, etc. Tous les États adoptent des mesures de “flexibilité” d’une violence inouïe, en appelant à l’acceptation de ces sacrifices au nom de “l’unité nationale dans la guerre contre le virus”.
L’intérêt national que la bourgeoisie invoque aujourd’hui n’est pas le nôtre ! C’est cette même défense de l’économie nationale et cette même concurrence généralisée qui lui a servi, par le passé, à mettre en œuvre les coupes budgétaires et les attaques contre les conditions de vie des exploités. Demain, elle nous servira les mêmes mensonges quand, après les ravages économiques causés par la pandémie, elle exigera que les exploités se serrent encore plus la ceinture, acceptent encore plus d’exploitation et de misère !
Cette pandémie est l’expression du caractère décadent du mode de production capitaliste, l’une des nombreuses manifestations du degré de délitement et de déliquescence de la société aujourd’hui, comme la destruction de l’environnement et la pollution de la nature, le dérèglement climatique, la multiplication des foyers de guerres et de massacres impérialistes, l’enfoncement inexorable dans la misère d’une part croissante de l’humanité, l’ampleur prise par les migrations des réfugiés, la montée de l’idéologie populiste et des fanatismes religieux, etc. () C’est un révélateur de l’impasse du capitalisme, un indicateur de la direction vers laquelle ce système et sa perpétuation menacent d’enfoncer et d’entraîner toute l’humanité : dans le chaos, la misère, la barbarie, la destruction et la mort.
Seul le prolétariat peut transformer le monde
Certains gouvernements et médias bourgeois affirment que le monde ne sera plus jamais le même qu’avant cette pandémie, que les leçons du désastre vont être tirées, qu’enfin les États vont s’orienter vers un capitalisme plus humain et mieux géré. Nous avions entendu le même baratin lors de la récession de 2008 : la main sur le cœur, les États et les dirigeants du monde déclaraient la “guerre à la finance”, promettaient que les sacrifices exigés pour sortir de la crise seraient récompensés. Il suffit de regarder l’inégalité croissante dans le monde pour constater que ces promesses de “régénération” du capitalisme n’étaient que de purs mensonges pour nous faire avaler une énième dégradation de nos conditions de vie.
La classe des exploiteurs ne peut pas changer le monde pour faire passer la vie et les besoins sociaux de l’humanité devant les lois impitoyables de son économie : le capitalisme est un système d’exploitation, une minorité dominante tirant ses profits et ses privilèges du travail de la majorité. La clef pour l’avenir, la promesse d’un autre monde, réellement humain, sans nations ni exploitation, réside seulement dans l’unité et la solidarité internationale des ouvriers dans la lutte !
L’élan de solidarité spontanée qu’éprouve aujourd’hui toute notre classe face à la situation intolérable infligée aux travailleurs de la santé, les gouvernements et les politiciens du monde entier le dévoient en faisant campagne pour les applaudissements aux fenêtres et aux balcons. Certes, ces applaudissements réchauffent le cœur de ces travailleurs qui, avec courage et dévouement, dans des conditions de travail dramatiques, soignent les malades et sauvent des vies humaines. Mais la solidarité de notre classe, celle des exploités, ne peut se réduire à une somme d’applaudissements pendant cinq minutes. Elle est, en premier lieu, de dénoncer l’incurie des gouvernements, dans tous les pays, quelle que soit leur couleur politique ! Elle est d’exiger des masques et tous les moyens de protection nécessaires ! Elle est, quand c’est possible, de se mettre en grève en affirmant que tant que les soignants n’auront pas de matériel, tant qu’ils seront ainsi précipités vers la mort à visage découvert, les exploités qui ne sont pas dans les hôpitaux, ne travailleront pas !
Aujourd’hui confinés, nous ne pouvons mener de luttes massives contre ce système assassin. Nous ne pouvons pas nous rassembler, exprimer ensemble notre colère et afficher notre solidarité sur notre terrain de classe, à travers des luttes massives, des grèves, des manifestations, des regroupements. À cause du confinement, mais pas seulement. Aussi parce que notre classe doit se réapproprier une force qu’elle a déjà eue maintes fois dans l’histoire mais qu’elle a pourtant oublié : celle de s’unir dans la lutte, de développer des mouvements massifs face aux ignominies de la bourgeoisie.
Les grèves qui ont éclaté dans le secteur automobile en Italie ou dans la grande-distribution en France, devant les hôpitaux new-yorkais ou ceux du nord de la France, comme l’énorme indignation des travailleurs refusant de servir de “chair à virus”, ne peuvent être aujourd’hui que des réactions dispersées car coupées de la force de toute une classe unie. Elles montrent néanmoins que les prolétaires ne sont pas résignés à accepter comme une fatalité l’irresponsabilité criminelle de ceux qui les exploitent !
C’est cette perspective de combats de classe que nous devons préparer. Parce qu’après le Covid-19, il y aura la crise économique mondiale, le chômage massif, de nouvelles “réformes” qui ne seront que de nouveaux “sacrifices”. Alors dès maintenant, préparons nos luttes futures. Comment ? En discutant, en échangeant, sur les réseaux, les forums, le téléphone, chaque fois que possible. En comprenant que le plus grand fléau n’est pas le Covid-19, mais le capitalisme, que la solution n’est pas de s’unir derrière l’État assassin mais au contraire de se dresser contre lui, que l’espoir ne réside pas dans les promesses de tel ou tel responsable politique mais dans le développement de la solidarité ouvrière dans la lutte, que la seule alternative à la barbarie capitaliste, c’est la révolution mondiale !
L’AVENIR APPARTIENT À LA LUTTE DE CLASSE !
CCI, 10 avril 2020
Evènements historiques:
Récent et en cours:
- Coronavirus [86]
- COVID-19 [87]
Rubrique:
Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue
- 158 lectures
L’administration Trump avait déjà provoqué une série de fiascos aussi humiliants que mortifères pour la bourgeoisie américaine (notamment en aggravant d’une manière dramatique la pandémie de Covid en 2020) mais il y avait toujours l’espoir, parmi les fractions les plus éclairées de la classe dirigeante américaine, que le fait d’avoir un narcissique incompétent au pouvoir n’était qu’un cauchemar passager, dont elles se réveilleraient bientôt. Malheureusement, la victoire électorale du Parti démocrate n’a pas entraîné la transition espérée, ni pour la nouvelle administration de Joe Biden ni pour le nouveau Congrès.
Pire encore : sous l’œil des caméras de télévision, une émeute a eu lieu au Capitole, temple sacré de la démocratie américaine, à l’incitation du chef de l’État sortant qui a rejeté les résultats de l’élection présidentielle ! Les hordes trumpistes ont violemment tenté d’empêcher la succession démocrate, encouragée par le président en exercice lui-même, comme dans une “république bananière”, ainsi que l’a reconnu George W. Bush. Il s’agit vraiment d’un moment politiquement significatif dans la décomposition du capitalisme mondial.
L’automutilation populiste du Royaume-Uni avec le Brexit a pu apparaître comme une décision absurde pour les autres pays, parce que la Grande-Bretagne est une puissance de moindre importance que les États-Unis, mais la menace d’instabilité que représente l’insurrection au Capitole, a provoqué une onde de choc et de peur dans toute la bourgeoisie mondiale.
La tentative de destituer Trump, pour la deuxième fois, pourrait bien échouer à nouveau, et, dans tous les cas, elle galvanisera les millions de ses partisans au sein de la population, y compris une part significative du Parti républicain.
L’investiture du nouveau président le 20 janvier, qui est généralement l’occasion d’un spectacle d’unité et de réconciliation nationales, ne le sera pas : Trump n’y assistera pas, contrairement à la coutume, et Washington sera sous haute protection militaire pour empêcher toute nouvelle attaque venant des partisans de Trump. La perspective n’est donc pas le rétablissement en douceur et à long terme de l’ordre et de l’idéologie démocratiques traditionnels par la nouvelle administration Biden, mais une accentuation (d’une nature de plus en plus violente) des divisions entre la démocratie bourgeoise classique et le populisme, ce dernier ne disparaissant pas avec la fin du régime Trump.
Les États-Unis : du statut de superpuissance à celui d’épicentre de la décomposition
Depuis 1945, la démocratie américaine est le fleuron du capitalisme mondial. Ayant joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a largement contribué à transformer l’Europe et le Japon en ruines. Elle a ensuite pu sortir le monde des décombres et le reconstruire à son image pendant la guerre froide. En 1989, avec la défaite et la désintégration du bloc russe rival, les États-Unis semblaient être au sommet de leur domination et de leur prestige mondial. George Bush Senior annonçait l’avènement d’un nouvel ordre mondial. Washington pensait pouvoir maintenir sa suprématie en empêchant toute nouvelle puissance de devenir un concurrent sérieux pour sa domination mondiale. Mais, au lieu de cela, l’affirmation de sa supériorité militaire a accéléré le désordre mondial avec une série de victoires à la Pyrrhus (guerre du Golfe, guerre dans les Balkans dans les années 1990) et de coûteux échecs de politique étrangère en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Les États-Unis ont de plus en plus sapé les alliances sur lesquelles reposait leur ancienne domination mondiale, ce qui a encouragé d’autres puissances à agir pour leur propre compte.
La puissance et la richesse des États-Unis n’ont d’ailleurs pas réussi à atténuer les convulsions croissantes de l’économie mondiale : l’étincelle de la crise de 2008 est venue de Wall Street et a plongé les États-Unis et le monde entier dans la récession la plus grave depuis la réapparition de la crise ouverte en 1967.
Les conséquences sociales et politiques des revers américains, et l’absence d’alternative ont accru les divisions et le désordre dans l’État bourgeois et dans la population en général. Ce qui a conduit à un discrédit croissant des normes politiques établies par le système politique américain.
Les présidences précédentes de Bush et Obama n’ont pas réussi à forger un consensus durable pour l’ordre démocratique traditionnel au sein de la population. La “solution” de Trump n’a pas consisté à résoudre cette désunion mais à l’accentuer davantage par une politique de vandalisme virulente et incohérente qui a encore plus déchiqueté le consensus politique national et a piétiné les accords militaires et économiques avec ses anciens alliés sur la scène mondiale. Tout cela s’est fait sous la bannière de “l’Amérique d’abord”, mais, en réalité, cela accéléré la perte progressive du statut des États-Unis.
En une phrase, la crise politique actuelle de la démocratie américaine, symbolisée par l’attaque du Capitole, s’ajoute aux conséquences chaotiques et autodestructrices de la politique impérialiste américaine, et montre plus clairement que les États-Unis, qui demeurent encore la plus grande puissance mondiale, sont aujourd’hui le principal acteur de la décomposition du capitalisme.
La Chine ne peut pas combler le vide
La Chine, malgré sa puissance économique et militaire croissante, ne sera pas en mesure de combler le vide créé par la perte de leadership américain. D’autant plus que ces derniers sont toujours capables d’empêcher la croissance de l’influence chinoise, avec ou sans Trump. Par exemple, un des plans de l’administration Biden est d’intensifier la politique anti-chinoise avec la formation d’un D10, une alliance des pouvoirs “démocratiques” (le G7 plus la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie). Le rôle que cela jouera dans l’aggravation des tensions impérialistes n’a pas besoin d’être démontré.
Mais ces tensions ne peuvent être canalisées vers la formation de nouveaux blocs impérialistes compte tenu de l’aggravation de la décomposition du capitalisme et la dynamique prédominante du chacun pour soi.
Les dangers pour la classe ouvrière
En 1989, nous avions prédit que la nouvelle période de décomposition du capitalisme allait entraîner des difficultés accrues pour le prolétariat. Les événements récents aux États-Unis confirment à nouveau cette prédiction.
Le plus important par rapport à la situation aux États-Unis est le danger que des parties de la classe ouvrière soient mobilisées derrière les luttes de plus en plus violentes des fractions opposées de la bourgeoisie, c’est-à-dire non seulement sur le terrain électoral mais aussi dans la rue. Une partie de la classe ouvrière peut être trompée par un faux choix entre le populisme et la défense de la démocratie, seule alternative offerte par l’exploitation capitaliste.
D’autres couches non exploiteuses risquent d’être progressivement propulsées dans l’action politique sur ce terrain miné par toute une série de facteurs : les effets de la crise économique, l’aggravation de la catastrophe écologique, le renforcement de la répression étatique et de son caractère raciste, qui les conduit à servir de relais aux campagnes bourgeoises comme le mouvement “Black Lives Matter” ou de support aux luttes interclassistes.
Néanmoins, la classe ouvrière internationale, dans la période de décomposition, n’a pas été vaincue comme dans les années 1930 ; ses réserves de combativité restent intactes et les nouvelles attaques économiques qui s’annoncent contre son niveau de vie (dont la facture des dommages économiques causés par la pandémie de Covid) obligeront le prolétariat à réagir sur son terrain de classe.
Un défi pour les organisations révolutionnaires
L’organisation révolutionnaire a un rôle limité mais très important à jouer dans la situation actuelle car, bien qu’elle ait encore peu d’influence, et même pour une longue période à venir, la situation de la classe ouvrière dans son ensemble amène néanmoins une petite minorité à adopter des positions de classe révolutionnaires, notamment aux États-Unis mêmes.
Le succès du travail de transmission à cette minorité repose sur un certain nombre de besoins ; dans le contexte actuel, il est important de combiner, d’une part, une rigueur et une clarté programmatiques à long terme, liées, d’autre part, à la capacité de l’organisation à avoir une analyse cohérente et évolutive de l’ensemble de la situation mondiale : son cadre historique et ses perspectives.
Au cours de l’année écoulée, la situation mondiale a battu de nouveaux records dans la putréfaction du capitalisme mondial : la pandémie de Covid, la crise économique, la crise politique aux États-Unis, la catastrophe environnementale, le sort des réfugiés, la misère de parties de plus en plus importantes de la population mondiale. La dynamique du chaos s’accélère et devient de plus en plus imprévisible, mettant à l’épreuve nos analyses et exigeant une capacité à les modifier et à les adapter, si nécessaire, en fonction de cette accélération.
CCI, 16 janvier 2021
Géographique:
- Etats-Unis [89]
Personnages:
- Joe Biden [90]
Evènements historiques:
Rubrique:
100 ans après la fondation de l’Internationale Communiste, quelles leçons pour les combats du futur ? (3e partie)
- 224 lectures
Dans les précédentes parties de cette étude, nous avons commencé à identifier les conditions dans lesquelles s’était formée la IIIe Internationale ou Internationale Communiste (IC) au mois de mars 1919. Dans un contexte très compliqué, les révolutionnaires de l’époque n’étaient pas parvenus à clarifier en amont toutes les nouvelles questions et les nouveaux défis qui s’imposaient au prolétariat.
Par ailleurs, le processus de regroupement des forces révolutionnaires s’était caractérisé par un manque de fermeté à l’égard des principes révolutionnaires lors de sa formation. C’est une des leçons que la fraction de la Gauche italienne groupée autour de la revue Bilan puis surtout de la Gauche Communiste de France (Internationalisme) tirèrent de l’expérience de l’IC : "la méthode "large", soucieuse avant tout de rassembler immédiatement le plus grand nombre au dépens de la précision programmatique et principielle, devait conduire à la constitution de partis de masses, véritables colosses aux pieds d’argile qui devaient retomber à la première défaite sous la domination de l’opportunisme"[1]
Alors que le Congrès de fondation avait été un véritable pas en avant pour l’unité du prolétariat mondial, l’évolution de l’IC dans les années suivantes fut essentiellement marquée par des reculs qui désarmèrent la révolution face à des forces contre-révolutionnaires qui ne cessaient pas de gagner du terrain. L’opportunisme rampant dans les rangs du parti, n’a pas été éliminé comme le prévoyaient Lénine et les bolcheviks. Au contraire, avec la dégénérescence de la révolution, il a fini par prendre une place prépondérante et a précipité la fin de l’IC en tant que parti de classe. Cette dynamique opportuniste déjà visible lors du IIe Congrès ne fit que s’approfondir par la suite, aussi bien sur le plan programmatique qu’organisationnel, comme nous essaierons de le démontrer dans cet article.
1920-21 : Le recul de la vague révolutionnaire
Au lendemain du IIIe Congrès de l’IC[2], les révolutionnaires comprennent que la victoire de la révolution sera plus difficile que prévu. Quelques jours après la fin du congrès, Trotsky analysait la situation ainsi : "Le troisième Congrès constate la ruine des fondements économiques de la domination bourgeoise. En même temps, il met énergiquement les ouvriers conscients en garde contre la croyance naïve qu’il en résulte automatiquement la chute de la bourgeoisie, provoquée par les offensives incessantes du prolétariat. Jamais l’instinct de conservation de la classe bourgeoise n’avait créé des méthodes de défense et d’attaques aussi variées qu’à présent. Les conditions économiques de la victoire de la classe ouvrière sont visibles. Sans cette victoire, c’est la ruine, la perte de toute civilisation qui nous menace dans un avenir plus ou moins proche. Mais cette victoire peut seulement être conquise par une direction raisonnable des combats et en première ligne, par la conquête de la majorité de la classe ouvrière. C’est l’enseignement principal du troisième Congrès."[3]
Nous sommes loin ici de l’enthousiasme débordant du congrès de fondation où, lors du discours de clôture, Lénine affirmait que "la victoire de la révolution prolétarienne est assurée dans le monde entier. La fondation de la république internationale des Conseils est en marche." Entre-temps, les assauts du prolétariat lancés dans plusieurs pays se confrontèrent à la riposte de la bourgeoisie. Et tout particulièrement l’échec de la prise du pouvoir en Allemagne en 1919 dont l’importance fut sous-estimée par les révolutionnaires.
Comme l’affirmait une grande majorité dans les rangs de l’IC, la crise du capitalisme et sa chute dans la décadence ne pouvaient que précipiter les masses sur la voie de la révolution. Cependant, la conscience de l’ampleur du but à atteindre et des moyens avec lesquels y parvenir étaient loin d’être à un niveau suffisant. Cette situation fut particulièrement visible à la suite du deuxième Congrès, une période marquée par une série de difficultés qui isolèrent davantage le prolétariat en Russie :
- En Europe de l’Ouest, les luttes ouvrières n’eurent guère la réussite escomptée. En Italie, la bourgeoisie parvint à canaliser et à stériliser le mouvement. En Allemagne, l’action aventuriste de mars 1921[4], pilotée par le KPD avec l’appui de l’IC, se termina par un échec cuisant et démoralisateur.
- Sur le plan militaire, l’offensive de l’Armée Rouge contre la Pologne prit fin avec la défaite et la retraite devant Varsovie, empêchant ainsi d’établir le pont entre la classe ouvrière en Russie et celle d’Europe occidentale.
- En Russie même, la guerre civile engendra d’importantes pénuries alimentaires et une situation économique et sociale dramatique qui nécessitèrent de mettre fin à l’économie de guerre et ses nationalisations pour réinstaurer un certain niveau d’échanges marchands. À cette fin, la Nouvelle politique économique (NEP) fut mise en place à partir de mars 1921.
- Au même moment, eut lieu la répression de l’insurrection des marins de Kronstadt. Une erreur qui eut des conséquences désastreuses dans les relations entre les masses et le Parti communiste de Russie.
Si la bourgeoisie internationale, à ce moment-là, n’était pas parvenue à annihiler totalement la révolution prolétarienne, il n’en demeure pas moins que le cœur de celle-ci, la Russie des Soviets, était particulièrement isolé. Si Lénine avait caractérisé la situation par "un certain équilibre qui, pour extrêmement instable qu’il soit, n’en a pas moins créé une conjoncture originale dans la situation mondiale"[5], avec le recul, nous pouvons aujourd’hui affirmer que les multiples échecs et les difficultés qui se firent jour entre 1920 et 1921, étaient déjà les prodromes de l’échec de la vague révolutionnaire. C’est dans ce contexte particulièrement difficile que nous proposons d’analyser la politique de l’IC. Une politique qui, sur de nombreux points, poursuivra son recul opportuniste de plus en plus marqué.
I- Les conséquences désastreuses du soutien "aux mouvements de libération nationale"
A- Une question non tranchée dans le mouvement révolutionnaire
La question nationale figurait parmi les questions non tranchées dans le mouvement révolutionnaire au moment où fut constituée l’IC. S’il est vrai que, durant la période d’ascendance du capitalisme, les révolutionnaires ont parfois soutenu des luttes nationales, il ne s’agissait pas d’un principe. Le débat avait rejailli dans les années précédant la Première Guerre mondiale. Rosa Luxemburg fut l’une des premières à comprendre que l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence signifiait également que chaque État-nation possédait une nature impérialiste. Par conséquent, la lutte de libération d’une nation sur une autre ne visait qu’à défendre les intérêts d’une bourgeoisie nationale sur une autre et en aucun cas la cause de la classe ouvrière.
Les bolcheviks adoptèrent une position qui se situait plutôt au centre de la social-démocratie puisque le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes figurait dans le programme de 1903 : ils conservaient "leur position avec un acharnement qui ne s’expliquait que par le fait que la Russie tsariste restait le représentant par excellence de l’oppression nationale (la "prison des peuples") ; et en tant que parti principalement "grand russe" (géographiquement parlant), ils pensaient que soutenir les peuples opprimés par la Russie à faire sécession était la meilleure politique pour gagner leur confiance. Bien que cette position fut erronée (l’histoire nous l’a prouvé), elle restait basée sur une perspective de classe. Dans cette période où les "sociaux-impérialistes" allemands, russes et autres plaidaient contre la lutte de libération nationale des peuples opprimés par les impérialismes allemand et russe, les bolcheviks mettaient en avant le slogan "d’autodétermination nationale" comme moyen de miner ces impérialismes et créer les conditions de l’unification de tous les ouvriers."[6] Si Lénine considérait que "le droit des nations à l’autodétermination" était une revendication caduque pour les pays occidentaux, la situation était différente dans les colonies où la floraison des mouvements de libération nationale participait à la formation d’un capitalisme indépendant et par conséquent contribuait à l’apparition d’un prolétariat. Dans ces conditions, l’autodétermination nationale demeurait une revendication progressiste aux yeux de Lénine et de la majorité du parti bolchevik.
En comprenant que l’impérialisme n’était pas simplement une forme de pillage perpétré par les pays développés aux dépens des nations arriérées mais bien l’expression de l’ensemble des rapports capitalistes mondiaux, Rosa Luxemburg fut en mesure de développer la critique la plus clairvoyante à l’égard des luttes de libération nationale en général et de la position des bolcheviks en particulier. À rebours de la vision fragmentée des bolcheviks qui considéraient que le prolétariat n’avait pas nécessairement les mêmes tâches en fonction de la zone géographique concernée, Rosa Luxemburg adopta une démarche qui consistait à décrire un processus global, celui du marché dont l’expansion n’était désormais plus possible : "dans ce contexte, il était impossible à tout nouvel État d’apparaître sur le marché mondial de façon indépendante où de mener à bien le processus d’accumulation primitive en dehors de cette barbarie généralisée" [7]
Ce faisant, "dans le monde capitaliste contemporain, il ne peut y avoir de guerre de défense nationale".[8] Cette capacité à saisir que toute bourgeoisie nationale ne pouvait agir qu’au sein du système impérialiste, l’amena à critiquer la politique nationale menée par les bolcheviks après 1917 quand les Soviets octroyèrent l’indépendance à l’Ukraine, la Finlande, la Lituanie, etc., afin de "gagner les masses". Les lignes qui suivent prophétisent admirablement les conséquences de la politique nationale de l’IC dans les années 20 : "L’une après l’autre, ces nations ont utilisé la liberté qu’on venait de leur offrir pour s’allier en ennemies mortelles de la Révolution russe à l’impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection en Russie même le drapeau de la contre-révolution"[9]
B- Le congrès de Bakou
La question nationale fut abordée pour la première fois dans les rangs de l’IC lors du deuxième Congrès mondial. Partant de la conception erronée de l’impérialisme défendue par les bolcheviks notamment, le Congrès considérait comme "nécessaire de poursuivre la réalisation de l’union la plus étroite de tous les mouvements émancipateurs nationaux et coloniaux avec la Russie des Soviets, en donnant à cette union des formes correspondantes au degré d’évolution du mouvement prolétarien parmi le prolétariat de chaque pays, ou du mouvement émancipateur démocrate bourgeois parmi les ouvriers et les paysans des pays arriérés ou de nationalités arriérées."[10]
Le congrès des peuples de l’Orient tenu à Bakou du 1er au 8 septembre 1920 avait pour tâche de mettre en pratique les orientations du deuxième Congrès mondial qui s’était terminé quelques semaines plus tôt. Près de 1900 délégués, provenant essentiellement du Proche-Orient et d’Asie centrale se réunirent. Si près des 2/3 des organisations représentées se réclamait du communisme, leur adhésion s’avérait extrêmement superficielle. Et pour cause, "les élites nationales orientales étaient davantage attirées par l’organisation et l’efficacité des modes d’action proposées par les bolcheviks que par l’idéologie communiste."[11] C’est pourquoi ce rassemblement était en réalité un grand souk politique composé de multiples classes et couches sociales venues toutes pour des raisons différentes mais bien peu avec la ferme intention d’œuvrer consciemment au développement de la révolution prolétarienne dans le monde. La description de la composition du congrès dressée par Zinoviev devant le Comité exécutif de l’IC après son retour de Bakou se passe de commentaire : "Le congrès de Bakou se composait d’une fraction communiste et d’une fraction beaucoup plus nombreuse de sans-parti. Cette dernière se divisait à son tour en deux groupes : l’un effectivement constitué d’éléments sans-parti, auquel il faut rattacher les représentants de la paysannerie et de la population semi-prolétaire des villes, l’autre formé des gens qui se désignent comme sans-parti mais appartiennent en fait à des partis bourgeois."[12]
Pour de nombreuses délégations, la structuration d’un mouvement révolutionnaire communiste en Orient demeurait secondaire, voire sans intérêt. Pour beaucoup d’entre elles, il s’agissait de s’assurer l’aide de la Russie des Soviets pour repousser le colonisateur britannique afin de pouvoir assouvir leur rêve de souveraineté nationale.
Quelle fut l’attitude des représentants de l’IC devant ces revendications ostensiblement bourgeoises ? Au lieu de défendre l’internationalisme prolétarien avec la plus grande fermeté, la délégation de l’IC affirma son soutien aux mouvements bourgeois nationalistes, et appela les peuples de l’Est à joindre "la première réelle guerre sainte, sous la bannière rouge de l'Internationale Communiste" afin de partir en croisade contre "l'ennemi commun, l'impérialisme britannique."
Les concessions importantes accordées aux partis nationalistes et toute la politique menée à Bakou étaient déjà dictées par les besoins de la défense de la République soviétique plutôt que par les intérêts de la révolution mondiale. Cet axe central de l’IC établi lors du second Congrès montre à quel point la tendance opportuniste gagnait du terrain. Il y eut bien sûr des critiques à ces tentatives de réconcilier nationalisme et internationalisme prolétarien : Lénine mit en garde contre le fait de "peindre le nationalisme en rouge" ; John Reed, présent à Bakou, fit également des objections à "cette démagogie et à cette parade". Cependant, "de telles réponses ne s'adressaient pas aux racines du cours opportuniste qui était suivi, mais restaient au contraire sur un terrain centriste de conciliation avec des expressions plus ouvertes d'opportunisme, se cachant derrière les thèses du second Congrès ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a couvert une multitude de manquements dans le mouvement révolutionnaire."[13]
C- L’IC devient peu à peu un instrument de l’impérialisme russe
Le recul de la révolution en Europe de l’Ouest et l’isolement du prolétariat en Russie dans des conditions dramatiques amenèrent l’IC à devenir progressivement l’instrument de la politique extérieure des bolcheviks, eux-mêmes devenant, au fil des années, l’administrateur du capital russe.[14] Si cette évolution fatale pour la révolution est en partie liée à des conceptions erronées des bolcheviks au sujet des relations entre la classe, le parti et l’Etat dans la période de transition, la raison principale réside dans la dégénérescence irréversible de la Révolution à partir des années 1920.[15]
C’est d’abord et surtout au nom de la défense de l’Etat soviétique que les bolcheviks et l’IC vont nouer des alliances ou soutenir directement des mouvements de libération nationale. Dès 1920, le parti mondial apporta son soutien au mouvement de Kemal Atatürk dont les intérêts étaient très éloignés de la politique de l’Internationale, comme le concédait Zinoviev. Mais cette alliance était un moyen de repousser les Britanniques dans la région. Bien qu’il fit exécuter les "chefs" du Parti communiste de Turquie quelques temps plus tard, l’IC continua à croire aux "potentialités" de ce mouvement nationaliste et maintint son alliance à ce pays stratégique pour l’intégrité de l’Etat russe. Cela n’empêcha pas Kemal de se retourner contre son allié en faisant alliance avec l’Entente dès 1923.
Si la politique de soutien aux luttes de libération nationale fut, pendant tout un temps, une position erronée au sein du mouvement ouvrier, elle s’est transformée à la fin des années 1920 en stratégie impérialiste d’une puissance capitaliste comme une autre. Le soutien apporté par l’IC aux nationalistes du Kuomingtang en Chine qui mena aux massacres des ouvriers de Shanghai en 1927 est un épisode décisif de cette involution. Auparavant, l’IC avait apporté son soutien au mouvement nationaliste dirigé par Abd El-Krim lors de la Guerre du Rif (1921-1926) ou encore aux Druzes et aux Syriens en 1926.
Par conséquent, "de tels actes de trahison ouverte démontrèrent que la fraction stalinienne qui avait entretemps acquis une domination presque complète de l'I.C. et de ses partis, n'était plus un courant opportuniste dans le mouvement ouvrier mais une expression directe de la contre-révolution capitaliste."[16]
II- Gagner les masses au détriment des principes
A- la formation de partis communistes "de masse" en Occident.
Comme nous l’avions indiqué dans la première partie de cette étude[17], il n'existait qu’une poignée de partis communistes véritablement constitués lors du congrès de fondation en mars 1919. Dans les semaines qui suivirent, l’Internationale engagea tout un travail visant à former des partis communistes : "Dès le premier jour de sa fondation, l’Internationale Communiste s’est donnée pour but, clairement et sans équivoque, non pas de former de petites sectes communistes cherchant à exercer leur influence sur les masses ouvrières uniquement par l’agitation et la propagande, mais de prendre part à la lutte des masses ouvrières, de guider cette lutte dans le sens communiste et de constituer dans le processus du combat de grands partis communistes révolutionnaires."[18] Cette orientation reposait sur la conviction d’une extension rapide de la Révolution en Europe occidentale et par conséquent sur un besoin pressant de munir la classe ouvrière des différents pays de partis permettant d’orienter l’action révolutionnaire des masses.
Par conséquent, les bolcheviks poussèrent non seulement à former des partis communistes de masses le plus vite possible mais aussi sur la base d’un compromis entre l’aile gauche du mouvement ouvrier, et l’aile centriste qui n’avait pas rompu avec les visions et les faiblesses de la Seconde Internationale. Dans la plupart des cas, ces partis ne pouvaient être engendrés ex nihilo mais devaient découler d’une décantation à l’intérieur des partis socialistes de la IIe Internationale. Ce fut notamment le cas du Parti communiste d’Italie formé lors du congrès de Livourne en janvier 1921 ou encore du Parti communiste français qui vit le jour lors du congrès de Tours en décembre 1920. Ainsi, dès leur naissance, ces partis comportaient en leur sein toute une série de scories et de faiblesses organisationnelles qui ne pouvaient que compliquer davantage la capacité de ces organisations à orienter les masses sur la voie la plus claire. Si Lénine et les principaux animateurs de l’Internationale avaient pleinement conscience des concessions accordées et du danger que cela pouvait représenter, ils misaient sur la capacité du parti à les combattre en son sein. En réalité, Lénine le premier sous-estimait grandement le danger. L’adoption des 21 conditions pour l’adhésion à l’IC lors du IIe Congrès mondial, considérée à juste titre comme un pas en avant dans la lutte contre le réformisme, resta par la suite dans les tiroirs. Toute la démarche de Lénine reposait sur l’idée que la marche vers la révolution ne pouvait être rompue, que le développement de l’IC au détriment de la IIe Internationale et l’Internationale "deux et demie" était un fait quasiment acquis.[19]
Dans une situation où les masses n’étaient pas encore capables de prendre le pouvoir, la tâche des partis communistes consistait donc à "hâter la révolution, sans toutefois la provoquer artificiellement avant une préparation suffisante".[20] Pour ces raisons, l’une des orientations du deuxième Congrès résidait dans le "groupement de toutes les forces communistes éparses, la formation dans chaque pays d’un Parti Communiste unique (ou le renforcement des partis déjà existants) afin de décupler le travail de préparation du prolétariat à la conquête du pouvoir sous forme de dictature du prolétariat."[21] Orientation tout à fait juste mais qui reposait sur une pratique erronée.
Ainsi, s’explique la fusion aberrante entre l’USPD[22] et le KPD lors du congrès de Halle le 12 octobre 1920. L’exemple le plus significatif demeure très probablement celui de la création du Parti communiste français (PCF). Ce dernier s’est constitué en décembre 1920 au congrès de Tours à travers une scission d’avec la SFIO dont les principaux dirigeants s’étaient ralliés à "l’Union sacrée" et à la Première Guerre mondiale. Sa naissance est le fruit d’un compromis, encouragé par l’IC, entre la gauche (minoritaire et faible) et un fort courant majoritaire centriste. Comme nous l’avons mis en évidence dans notre brochure sur l’histoire du PCF[23] : "Cette tactique est désastreuse parce que l’adhésion ne se fait pas, fait unique dans l’histoire des PC européens, sur les "21 conditions d’admission à l’IC" qui exigeaient en particulier une rupture complète et définitive avec la politique opportuniste du centrisme envers le réformisme, le social-patriotisme, le pacifisme, mais sur des critères nettement moins sélectifs. L’objectif de cette tactique de l’IC était d’entraîner la majorité à se séparer de la droite de la social-démocratie, parti de gouvernement bourgeois et ouvertement patriotard. [...] Le centre largement majoritaire au sein du nouveau parti est infesté d’opportunistes, peu ou prou "repentis" d’avoir trempé dans l’Union sacrée. [...] En même temps, vient s’agréger au parti une autre composante importante, imbibée de fédéralisme anarchisant (surtout représenté au sein de la Fédération de la Seine), qui se retrouvera en chaque occasion, sur le plan organisationnel, aux côtés du centre contre la gauche pour s’opposer à la centralisation internationale et surtout aux orientations de l’IC sur le jeune Parti communiste français." Gangréné par l’opportunisme, le PCF allait subir de plein fouet la dégénérescence de l’IC qui commençait à poindre lors du IIIe Congrès. Il deviendra par la suite un des principaux agents du stalinisme.[24] Il en fut de même en Italie puisque à la suite de la scission d’avec le Parti Socialiste d’Italie lors du congrès de Livourne, le PC d’Italie se composait d’une gauche marxiste et communiste résolument engagée dans la lutte contre l’opportuniste au sein de l’IC et d’un centre amené par Gramsci et Togliatti, incapable de comprendre la fonction politique des Soviets (organes du pouvoir centralisé) et sous-estimant le rôle politique du parti. Par la suite, le centre du parti servira de point d’appui à l’IC pour exclure la gauche durant la période de "bolchevisation".
Enfin, l’exemple le plus caricatural reste peut-être celui du PC de Tchécoslovaquie formé autour de la tendance de Sméral qui soutint la monarchie des Habsbourg durant toute la guerre impérialiste de 1914-1918.
Comment expliquer de telles compromissions ? Comment expliquer que les bolcheviks, ayant mené un si dur combat en leur sein durant des années pour la préservation et l’intransigeance des principes, en venaient à accepter de telles concessions ? La Gauche communiste d’Italie se pencha avec attention sur cet épisode et apporta une première réponse : "Il est évident qu’il ne s’agit pas là d’une soudaine conversion des bolcheviks à un autre procédé de formation des Partis Communistes, mais essentiellement d’une perspective historique qui prévoyait la possibilité d’éluder le chemin difficile parcouru pour la fondation du Parti bolchevik. Lénine et les bolcheviks escomptaient, en 1918-1920, le déclenchement immédiat de la révolution mondiale et, de ce fait, concevaient la fondation des Partis Communistes dans les différents pays comme autant d’appoints à l’œuvre révolutionnaire de l’État russe qui leur apparaissait l’élément essentiel du bouleversement du monde capitaliste."[25]
Indéniablement, le coup d’arrêt porté à la révolution au cours de cette période et les efforts désespérés pour faire face à cela amena Lénine et les bolcheviks à baisser la garde sur la défense des principes et ainsi se faire happer par l’opportunisme. Mais ce sont également les erreurs persistantes sur les tâches du parti et les relations de celui-ci avec la classe qui contribuèrent à forcer la formation des PC dans la confusion la plus totale au cours d’une période marquée par les premiers reculs du prolétariat.
B- La création de partis communistes "fantômes" en Orient
La méthode opportuniste à travers laquelle l’IC laissa se former des partis membres trouva son ultime expression dans l’éclosion des PC dans le monde colonial.
Après le congrès de Bakou, l’Exécutif de l’IC avait mis sur pieds un bureau central d’Asie, en charge du travail en direction des pays du Moyen-Orient jusqu’en Inde. Cet organe composé de Sokolnikov, Grefori Safarov et MN Roy s’installa à Tachkent en Ouzbékistan. Puis en janvier 1921, un secrétariat de l’IC pour l’Extrême-Orient vit le jour et s’installa à Irkoutsk. Ainsi, face aux reculs de la révolution en Europe occidentale, l’IC voulait se donner les moyens de "hâter" cette fois-ci la révolution en Orient. C’est dans cet objectif, qu’entre 1919 et 1923, l’Orient et l’Extrême-Orient virent fleurir des partis communistes sur des bases théoriques et politiques pour le moins extrêmement fragiles.
Avant cette période, des PC avaient vu le jour en Turquie, en Iran, en Palestine, en Egypte mais comme le fait remarquer l’historien trotskiste Pierre Broué : "Les problèmes n’ont pas manqué entre l’Internationale et ces partis communistes qui ne savaient rien du communisme et représentaient des pays où les couches proprement prolétariennes étaient insignifiantes, ce qui n’empêchait pas leurs dirigeants de se réclamer d’une pureté doctrinale et d’un schéma ouvriériste rigoureux dans la révolution qu’ils croyaient proche."[26]
En Inde, les éléments qui s’étaient rapprochés de l’Internationale avaient tous un passé nationaliste, le plus connu étant MN Roy[27]. L’IC donna l’ordre au groupe formé autour de ce dernier d’entrer dans le Parti du Congrès nationaliste, dirigé par Gandhi, en s’alliant d’abord "l’aile gauche" dite "révolutionnaire" et "communiste" puis toutes les fractions opposantes à Gandhi après les débordements du 4 février 1922 lors d’une campagne de désobéissance civile lancée par Gandhi lui-même[28]. Roy fut amené à défendre un programme ouvertement opportuniste au sein du Parti du Congrès : indépendance nationale, suffrage universel, abolition de la grande propriété, nationalisation des services publics... De plus, le but n’était pas de faire adopter son programme mais provoquer son rejet de la part de la direction du parti qui ainsi se "démasquerait". L’entreprise connut un échec cinglant. Le programme de Roy ne trouva aucun écho favorable et la vie du groupe "communiste" dégénéra très vite dans des querelles internes. Les communistes furent par la suite sévèrement réprimés. Ils furent arrêtés puis jugés pour conspiration, ce qui mit un terme à la politique de l’IC en Inde.[29]
En Asie de l’Est, l’IC adopta peu ou prou la même démarche irresponsable. La structuration d’un mouvement communiste en Chine fut menée par le bureau d’Extrême-Orient par des prises de contacts avec des intellectuels et étudiants gagnés au "bolchévisme". Le PC de Chine (PCC) fut constitué lors d’une conférence se déroulant à Shanghai en juillet 1921. Constitué à ses débuts de quelques dizaines de militants, il connut un accroissement numérique significatif par la suite, atteignant près de 60 000 membres en 1927. Si ce renforcement numérique exprimait la volonté révolutionnaire qui animait la classe ouvrière chinoise dans un contexte d’intenses luttes sociales, il n’en demeure pas moins que les adhésions s’effectuèrent sur des bases politiques et théoriques très superficielles. Toujours la même méthode irresponsable qui, là encore, ouvrait la porte au désarmement du parti face à la politique opportuniste qu’allait mener l’IC à l’égard du Kuomindang. En janvier 1922, la Conférence des peuples d’Orient réunie à Moscou posait les bases de la collaboration de classe afin de former "le bloc anti-impérialiste". Dans la foulée, à la demande de l’Exécutif de l’IC, le PCC lançait le mot d’ordre de "Front unique anti-impérialiste avec le Kuomindang" et l’adhésion individuelle des communistes à ce dernier. Cette politique de collaboration de classe était le résultat des négociations engagées en secret entre l’URSS et le Kuomindang. Dès juin 1923, le IIIe congrès du PCC votait l’adhésion des membres du parti au Kuomindang. Si dans un premier temps, cette politique de subordination à un parti bourgeois trouva des oppositions au sein du jeune parti, y compris de la part de sa direction[30]. Sa fragilité politique et sa faible expérience le rendait incapable de combattre efficacement les directives erronées et suicidaires de l’Exécutif de l’Internationale. Quoi qu’il en soit, "cette politique eut les plus funestes conséquences sur le mouvement de la classe ouvrière en Chine. Tandis que le mouvement de grèves et les manifestations se développaient spontanément et impétueusement, le parti communiste, noyé au sein du Kuomintang, s'avérait incapable d'orienter la classe ouvrière, de faire preuve d'une politique de classe indépendante. La classe ouvrière, dépourvue également d'organisations unitaires comme les conseils ouvriers pour sa lutte politique, s'en remit, à la demande du PCC lui-même, au Kuomintang, c'est-à-dire accorda sa confiance à la bourgeoisie."[31]
Nous pourrions donner encore de nombreux exemples de partis communistes formés dans des pays arriérés avec une classe ouvrière très faible qui, dans le tourbillon de la défaite, deviendront très vite des organisations bourgeoises. Retenons que la constitution de "partis de masses", en Occident comme en Orient, fut un facteur qui aggrava la difficulté du prolétariat à faire face au reflux de la vague révolutionnaire en le rendant incapable de se replier en bon ordre.
C- La politique de front unique
Lors du IIIe Congrès, l’IC adopta la position du "Front unique ouvrier"[32]. Il s’agissait de nouer des alliances avec les organisations de la social-démocratie, mener des actions communes avec des revendications similaires et ainsi pouvoir démasquer le rôle contre-révolutionnaire de ces organisations auprès des masses.
Cette orientation qui trouva sa pleine concrétisation lors du IVe Congrès était une volteface totale avec le Congrès de fondation au cours duquel la nouvelle internationale affirmait sa claire détermination à combattre de toutes ses forces le courant social-démocrate en invitant "les ouvriers de tous les pays à entamer la lutte énergique contre l’Internationale jaune et à préserver les masses les plus larges du prolétariat de cette Internationale de mensonge et de trahison".[33] Qu’est-ce qui pouvait pousser, deux ans plus tard, l’IC à adopter une politique d’alliance à l’égard des partis qui s’étaient transformées en agents les plus efficaces de la contre-révolution ?
Avaient-ils fait "amende honorable" en se plaçant sur la voie du repentir ? Bien évidemment non, là encore il s’agissait de "ne pas se couper des masses" : "L’argumentation de l’I.C. pour justifier la nécessité de front unique se basait principalement sur le fait que le reflux avait renforcé le poids de la social-démocratie, et que, pour lutter contre elle, il ne fallait pas se couper des travailleurs prisonniers de cette mystification. Pour cela, il fallait travailler à sa dénonciation par des moyens qui allaient de l’alliance pour les partis les plus forts (en Allemagne, le PC s’est prononcé pour l’unité du front prolétarien et a reconnu possible d’appuyer un gouvernement ouvrier unitaire), à l’entrisme pour les partis les plus faibles ("il est maintenant du devoir des communistes d’exiger, par une campagne énergique, leur admission dans le Labour Party", citations des thèses sur l’unité du front prolétarien du 4ème Congrès, 1922)"[34]
Cette ligne opportuniste fut combattue et dénoncée âprement par les groupes composant la gauche de l’IC. Le KAPD mena le combat dès le IIIe congrès avant d’être exclu de l’IC tout de suite après. La gauche du PC d’Italie lui succéda notamment lors du IVe Congrès en déclarant que le parti n’accepterait "pas de faire partie d’organismes communs à différentes organisations politiques... (il) évitera aussi de participer à des déclarations communes avec des partis politiques, lorsque ces déclarations contredisent son programme et sont présentées au prolétariat comme le résultat de négociations visant à trouver une ligne d’action commune."[35] Le rejet du Front unique était également assumé par le Groupe ouvrier de Miasnikov qui indiquait dans son Manifeste la position la plus conforme aux intérêts de la révolution envers les partis de la IIe Internationale : "Ce ne sera pas le front uni avec la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi qui lui apportera la victoire, mais la guerre contre elles. Voilà le mot d’ordre de la révolution sociale mondiale future." L’histoire devait donner raison à la clairvoyance et à l’intransigeance des groupes de gauche. Dans ces circonstances, le rôle du parti n'était pas de suivre la direction de la classe mais de défendre le programme et les principes révolutionnaires en son sein. Dans la période de la décadence du capitalisme, le retour à un "programme minimum", même sur une base temporaire, était devenu impossible. Avec l’inversion du rapport de force, l’idéologie dominante regagnait de l'influence parmi les masses. Dans ces circonstances, le rôle du parti n’était pas d’épouser la trajectoire de la classe mais de défendre au sein de cette dernière les principes et le programme révolutionnaire. Dans la période de décadence du capitalisme, le retour à un "programme minimum", même de manière temporaire, était désormais impossible. C’est une autre leçon que tira la Gauche communiste d’Italie par la suite : "en 1921, la modification de la situation ne changeait pas les caractères fondamentaux de l’époque comme les tourmentes révolutionnaires de 1923, de 1925, 1927 et 1934 (pour ne nommer que les plus importantes) devaient pleinement le confirmer. [...]
Une telle modification de la situation devait évidemment avoir des conséquences sur les partis communistes. Mais le problème était le suivant : devait-on modifier la substance de la politique des partis communistes ou devait-on déduire de la contingence défavorable la nécessité d’appeler les masses à se concentrer autour des luttes partielles, restant orientées vers une issue révolutionnaire[36], dès que l’appel direct à l’insurrection n’était plus possible immédiatement avec les défaites encourues ? Le 3ème Congrès, l’Exécutif Élargi de 1921 et plus ouvertement le 4ème Congrès devaient donner à ce problème une solution préjudiciable aux intérêts de la cause. Cela se fait surtout au travers du problème du front unique."[37]
Conclusion
Comme nous venons de le voir, la période allant du deuxième à l’après-IIIe Congrès de l’IC est marquée par une percée significative de l’opportunisme dans les rangs du parti. Celui-ci fut la conséquence directe de sa politique erronée consistant à "conquérir les masses" au prix de tous les compromis et toutes les concessions : soutien aux luttes de libération nationale, alliance avec les partis traîtres de la social-démocratie, participation au travail parlementaire et dans les syndicats, formation des partis de masse... L’IC tournait le dos à ce qui avait fait la force des fractions de gauche au sein de la IIe Internationale et tout particulièrement de la fraction bolchevik : l’intransigeance dans la défense des principes et du programme communistes. C’est d’ailleurs déjà ce que rappelait Herman Gorter à Lénine en 1920 : "Vous agissez maintenant dans la IIIe Internationale tout autrement que jadis dans le parti des maximalistes. Ce dernier fut conservé très "pur" et l’est peut-être toujours encore. Tandis que dans l’Internationale, on doit accueillir d’après vous tout de suite ceux qui sont communistes pour une moitié, pour un quart et même pour un huitième [...] La Révolution russe l’a emporté par la "pureté", par la fermeté des principes. [...] Au lieu d’appliquer maintenant aussi à tous les autres pays cette tactique éprouvée, et de renforcer ainsi de l’intérieur la IIIe Internationale, on fait présentement volteface et tout comme la social-démocratie jadis, on passe à l’opportunisme. Voici qu’on fait tout entrer : les syndicats, les Indépendants, le centre français, une portion du Labour Party."[38]
L’erreur fondamentale de l’Internationale communiste fut de considérer qu’elle pouvait à elle seule "conquérir" les masses ouvrières, les extraire de l’influence de la social-démocratie et ainsi élever leur niveau de conscience en les amenant sur le chemin du communisme.
De là découlait la politique de Front unique pour mieux démasquer et dénoncer la social-démocratie, la participation au parlementarisme pour mieux utiliser les divisions au sein des partis bourgeois, le travail dans les syndicats afin de les redresser du côté de la révolution et du camp prolétarien[39]. Aucune de ces tentatives n’eut l’effet escompté. Au contraire, elles ne firent que précipiter l’IC vers la trahison du camp prolétarien. Car au lieu d’élever la conscience de classe, cette tactique ne fit que répandre la confusion et la désorientation parmi les masses, en les rendant plus vulnérables face aux pièges et aux réactions de la bourgeoisie. Bien que les groupes de la gauche de l’IC ne soient jamais parvenus à s’unifier, tous se rejoignaient sur le caractère suicidaire de cette politique considérée comme la "perte du mouvement ouvrier", "la mort de la révolution". Ces groupes défendaient dans le fond une toute autre vision des relations que le parti devait nouer avec la classe[40]. Le rôle du parti n’était pas de bercer le prolétariat d’illusions et encore moins de l’embringuer dans des tactiques douteuses et dangereuses mais plutôt d’élever le niveau de conscience par une défense sans concessions des principes du prolétariat et veiller à ce que celui-ci ne s’en écarte pas. Telle était la seule et véritable boussole permettant de continuer à s’orienter dans la direction de la révolution alors que la vague qui s’était dressée en Octobre 1917 en Russie connaissait ses premiers reflux.
(À suivre)
Najek, 16 juin 2020.
[1] Cité dans Internationalisme n° 7 (année 1946): "À propos du 1er congrès du Parti communiste internationaliste d'Italie", republié dans la Revue internationale n°162. [92]
[2] Ce Congrès s’est déroulé entre le 21 juin et le début du mois de juillet 1921.
[3] Léon Trotsky, "Les enseignements du IIIe Congrès de l’Internationale Communiste", juillet 1921. L'idée de conquête de la majorité de la classe ouvrière, dans le contexte d'alors, contient déjà en germe l'idée de gagner les masses au détriment des principes, comme nous le montrerons plus avant dans cet article.
[4] "Révolution allemande (IX) : L'action de mars 1921, le danger de l'impatience petite-bourgeoise [93]" ; Revue internationale n° 93
[5] "Thèses du rapport sur la tactique du P.C.R présenté au IIIe Congrès de l’Internationale Communiste."
[6] Nation ou classe, brochure du CCI.
[7] L'émergence de la Chine en tant que candidat impérialiste majeur à la fin du XXe siècle ne remet pas en cause cette analyse globale : d'abord parce qu'elle intervient dans les circonstances spécifiques provoquées par la décomposition capitaliste, et ensuite parce que son développement en tant qu'État hautement militarisé et expansionniste n'a aucun contenu progressiste.
[8] Rosa Luxemburg, Brochure de Junius ou La Crise de la social-démocratie, 1915.
[9] Rosa Luxemburg, La Révolution russe, 1918.
[10] "Thèses sur les questions nationale et coloniale" du IIème congrès de l'IC.
[11] Edith Chabrier, "Les délégués du premier Congrès des peuples d’Orient (Bakou, 1er-8 septembre 1920)", in Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 26, n°1, Janvier-Mars 1985, pp. 21-42.
[12] Idem.
[13] "Les communistes et la question nationale (3ème partie", Revue Internationale n°42, 3e trimestre 1985.
[14] Idem.
[15] Voir "La dégénérescence de la Révolution russe", Revue internationale n°3.
[16] "Les communistes et la question nationale (3ème partie)", Revue Internationale n°42, 3e trimestre 1985.
[17] "Centenaire de la fondation de l’Internationale Communiste - Quelles leçons tirer pour les combats du futur ? [94]", Revue internationale n° 162.
[18] Thèses sur la tactique, partie 3 : la tâche la plus importante du moment", IIIe Congrès de l’IC.
[19] "Les Partis de l’Internationale Communiste deviendront des partis de masses révolutionnaires, s’ils savent vaincre l’opportunisme, ses survivances et ses traditions, dans leurs propres rangs, en cherchant à se lier étroitement aux masses ouvrières combattantes, en puisant leurs buts dans les luttes pratiques du prolétariat, en repoussant au cours de ces luttes aussi bien la politique opportuniste de l’aplanissement et de l’effacement des antagonismes insurmontables que les phrases révolutionnaires qui empêchent de voir le rapport réel des forces et les véritables difficultés du combat.", "Thèses sur la tactique", IIIe Congrès de l’IC.
[20] "Les tâches principales de l’Internationale Communiste", Deuxième Congrès de l’IC, juillet 1920.
[21] Idem.
[22] Parti social-démocrate indépendant d’Allemagne dont la majorité n’avait pas rompu avec le réformisme et rejetait de fait la dictature du prolétariat et l’organisation en conseils ouvriers.
[24] Pour une approche plus détaillée voir : "Comment le PCF a quitté le camp du prolétariat", in Comment le PCF a trahi ?, brochure du CCI.
[25] "En marge d’un anniversaire", revue Bilan n°4, février 1934.
[26] Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste. 1919-1943, Fayard, 1997.
[27] Celui-ci, forcé à l’exil au Mexique par l’Empire brtitannique, avait d’ailleurs exercé une influence néfaste lors de la création du PC mexicain en août/septembre 1919 sur les bases déjà fortement imprégnées d’opportunisme de l’IC sur le continent américain.
[28] Bien que MN Roy fut opposé à une telle tactique.
[29] Op. Cit., Histoire de l’Internationale communiste.
[30] L’un des membres fondateurs du parti, Chen Duxiu portait une critique lucide sur cette orientation : "La raison principale de notre opposition était celle-ci : Entrer dans le Guomindang, c’était introduire la confusion dans l’organisation de classe, entraver notre politique et se subordonner à elle. Le délégué de l’IC dit textuellement : "La présente période est une période dans laquelle les communistes doivent effectuer un travail de coolies pour le Guomindang." A partir de ce moment-là, le parti n’était déjà plus le parti du prolétariat, il se transformait en extrême-gauche de la bourgeoisie et commençait à dégringoler dans l’opportunisme" [Chen Duxiu, Lettre à tous les camarades du PC chinois, 10 décembre 1929, in Pierre Broué, La Question chinoise dans l’Internationale communiste.
[31] "Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste (I)", Revue internationale n°81, 2e trimestre 1995.
[32] La "lettre ouverte" adressée le 7 janvier 1921 par la centrale du KPD aux autres organisations (SPD, USPD, KAPD) appelant à mener une action commune parmi les masses et les luttes à venir, fut l’une des prémices de cette politique.
[33] "Résolution sur la position envers les courants socialistes et la conférence de Berne", Premier Congrès de l’IC.
[34] "Front unique, front anti-prolétarien", Révolution internationale n°45, janvier 1978.
[35] Intervention de la délégation du PC d’Italie lors du IVe Congrès de l’IC, in La Gauche communiste d’Italie. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire, Courant communiste international.
[36] Etant donné, qu’à ce moment-là, les conditions étaient devenues moins favorables pour l’extension de la révolution, avec le recul dont nous disposons, il aurait été plus adapté de parler de "luttes partielles orientées" vers une perspective révolutionnaire.
[37] Revue Bilan, Avril 1934.
[38] Herman Gorter, Réponse à Lénine sur "La maladie infantile du communisme", 1920.
[39] La question syndicale a été déjà abordée dans la partie II, nous n’y revenons pas dans cette partie. Retenons cependant, qu’alors que le Ier Congrès mondial avait acté la faillite des syndicats tout comme celle de la social-démocratie (bien que le débat au sein du parti n’était pas clôt sur la nature prolétarienne ou non des syndicats après la Première Guerre mondiale), l’IC revient sur sa position et préconise leur régénérescence par la lutte en leur sein afin de bannir leur direction et gagner les masses au communisme. Cette tactique illusoire préconisée par le IIIème Congrès mondial par l’appel à la formation de l’Internationale Syndicale Rouge sera combattue par certains groupes de gauche (tout particulièrement par la Gauche allemande) qui considérait à juste titre que les syndicats n’étaient plus des organes de lutte prolétarienne.
[40] En dépit du fait qu’une grande partie de la gauche allemande et hollandaise prit par la suite la voie de la négation du parti en formant le courant conseilliste.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Internationalisme [97]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Le programme communiste dans la phase de décomposition du capitalisme - Bordiga et la grande ville
- 633 lectures
"Lumières vives, grande ville, qui sont allées à la tête de mon bébé" (Chanson de Jimmy et Mary Reed, 1961)
Introduction
Cet article est écrit en plein milieu de la crise mondiale de Covid-19, une confirmation étonnante que nous vivons la phase d'agonie de la décadence capitaliste. La pandémie, qui est le produit de la relation profondément déformée entre l'humanité et le monde naturel sous le règne du capital, met en évidence le problème de l'urbanisation capitaliste que les révolutionnaires précédents, notamment Engels et Bordiga, ont analysé de manière assez approfondie. Bien que nous ayons examiné leurs contributions sur cette question dans des articles précédents de cette série[1], il semble donc opportun de soulever à nouveau la question. Nous approchons également du 50e anniversaire de la mort de Bordiga en juillet 1970, l'article peut donc également servir d'hommage à un communiste dont nous apprécions beaucoup le travail, malgré nos désaccords avec nombre de ses idées. Avec cet article, nous commençons un nouveau "volume" de la série sur le communisme, spécifiquement destiné à examiner les possibilités et les problèmes de la révolution prolétarienne dans la phase de décomposition du capitalisme
La révolution face à la décomposition du capitalisme
Dans une partie précédente de cette série, nous avons publié un certain nombre d'articles qui examinaient comment les partis communistes qui ont émergé pendant la grande vague révolutionnaire de 1917-23 avaient essayé de faire passer le programme communiste de l'abstrait au concret -pour avancer une série de mesures à prendre par les conseils ouvriers dans le processus de prise de pouvoir des mains de la classe capitaliste[2]. Et nous pensons qu'il est toujours parfaitement valable pour les révolutionnaires de se poser la question : quels seraient les fondements du programme que l'organisation communiste du futur -le parti mondial- serait obligée de mettre en avant dans un authentique mouvement révolutionnaire ? Quelles seraient les tâches les plus urgentes auxquelles la classe ouvrière serait confrontée lorsqu'elle s'orienterait vers la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale ? Quelles seraient les principales mesures politiques, économiques et sociales à mettre en œuvre par la dictature du prolétariat, qui reste la condition politique préalable nécessaire à la construction d'une société communiste ?
Les mouvements révolutionnaires de 1917-23, tout comme la guerre impérialiste mondiale qui les a alimentés, ont été la preuve évidente que le capitalisme était entré dans : l’époque de sa décadence, "décisive pour la révolution sociale". Depuis lors, le progrès et même la survie de l'humanité sont de plus en plus menacés si le rapport social capitaliste n'est pas dépassé à l'échelle mondiale. En ce sens, les objectifs fondamentaux d'une future révolution prolétarienne sont en pleine continuité avec les programmes qui ont été mis en avant au début de la période de décadence. Mais cette période dure maintenant depuis plus d'un siècle et, selon nous, les contradictions accumulées au cours de ce siècle ont ouvert une phase terminale de déclin capitaliste, la phase que nous appelons décomposition, dans laquelle le maintien du système capitaliste contient le danger croissant que les conditions mêmes d'une future société communiste soient sapées. C’est particulièrement évident au niveau "écologique" : en 1917-23, les problèmes posés par la pollution et la destruction de l'environnement naturel étaient bien moins étendus qu'aujourd'hui. Le capitalisme a tellement faussé "l'échange métabolique" entre l'homme et la nature qu'une révolution victorieuse devrait, à tout le moins, consacrer une énorme quantité de ressources humaines et techniques à la simple réparation du gâchis que le capitalisme nous aura légué. De même, tout le processus de décomposition, qui a exacerbé la tendance à l'atomisation sociale, à l'attitude du "chacun pour soi" inhérente à la société capitaliste, laissera une empreinte très néfaste sur les êtres humains qui devront construire une nouvelle communauté fondée sur l'association et la solidarité. Il faut également rappeler une leçon de la révolution russe : étant donnée la certitude que la bourgeoisie résistera de toutes ses forces à la révolution prolétarienne, la victoire de celle-ci impliquera une guerre civile qui pourrait causer des dommages incalculables, non seulement en termes de vies humaines et de nouvelles destructions écologiques, mais aussi au niveau de la conscience, puisque le terrain militaire n'est pas du tout le plus propice à l'épanouissement de l'auto-organisation, de la conscience et de la morale prolétariennes. En Russie, en 1920, l'État soviétique est sorti victorieux de la guerre civile, mais le prolétariat en avait largement perdu le contrôle. Ainsi, lorsque l'on tente de comprendre les problèmes de la société communiste "telle qu'elle émerge de la société capitaliste, qui donc à tous égards, économiquement, moralement et intellectuellement, porte encore, à sa naissance, les marques de la vieille société de laquelle elle émerge"[3], il faut reconnaître que ces marques de naissance seront probablement beaucoup plus laides et potentiellement plus dommageables qu'elles ne l'étaient à l'époque de Marx et même de Lénine. Les premières phases du communisme ne seront donc pas un réveil idyllique un beau matin de mai, mais un long et intense travail de reconstruction à partir de ruines. Cette reconnaissance devra éclairer notre compréhension de toutes les tâches de la période de transition, même si nous continuons à fonder nos anticipations de l'avenir sur la conviction que le prolétariat peut effectivement mener à bien sa mission révolutionnaire - malgré tout.
Le contexte historique du "programme immédiat pour la révolution" de Bordiga
Tout au long de cette longue série, nous avons tenté d’expliquer le développement du projet communiste en tant que fruit de l’expérience historique réelle de la lutte de classe et de la réflexion des minorités les plus conscientes du prolétariat sur cette expérience. Et dans cet article, nous voulons utiliser cette méthode historique, en examinant une tentative d'élaborer une version mise à jour des "programmes immédiats" de 1917-23, elle-même devenue une partie de l’histoire du mouvement communiste. Nous nous référons au texte écrit en 1953 par Amadeo Bordiga et publié dans Au fil du Temps (Sul Filo del Tempo), "Le programme immédiat de la révolution", que nous avons déjà mentionné dans un article précédent de cette série[4] avec l'engagement d’y revenir plus en détail. De notre point de vue, il est essentiel que toute future tentative de formuler un semblable "programme immédiat" se base sur les points forts de ces précédents efforts au lieu de critiquer radicalement leurs faiblesses. L’ensemble de ce texte, qui a le mérite d’être court, est le suivant :
1) Le gigantesque mouvement de reprise prolétarienne du premier après-guerre, dont la puissance se manifesta à l'échelle mondiale et qui s'organisa en Italie dans le solide parti de 1921, montra clairement que le postulat urgent était la prise du pouvoir politique, et que le prolétariat ne le prend pas par la voie légale mais par l'insurrection armée, que la meilleure occasion naît de la défaite militaire de son propre pays et que la forme politique qui suit la victoire est la dictature du prolétariat. La transformation économique et sociale constitue une tâche ultérieure dont la dictature crée la condition première.
2) Le Manifeste des communistes a établi que les mesures sociales successives qui se révèlent possibles ou que l'on provoque «despotiquement», différent selon le degré de développement des forces productives dans le pays où le prolétariat a vaincu et selon la rapidité avec laquelle cette victoire s'étend à d'autres pays, la marche au communisme supérieur étant extrêmement longue. Il a indiqué les mesures qui convenaient en 1848 pour les pays européens les plus avancés et rappelé qu'elles constituaient non pas le programme du socialisme intégral, mais un ensemble de mesures qu'il qualifiait de transitoires, immédiates, variables et essentiellement «contradictoires».
3) Par la suite (et ce fut un des éléments qui poussèrent certains à prétendre que la théorie marxiste n'était pas stable, mais devait être continuellement réélaboré en fonction des résultats de l'histoire), de nombreuses mesures alors dictées à la révolution prolétarienne furent prises par la bourgeoisie elle-même dans tel ou tel pays, telles que l'instruction obligatoire, la Banque d'État, etc...
Cela n'autorisait pas à croire que soient changées les lois et les prévisions précises du marxisme sur le passage du mode de production capitaliste au socialisme et de toutes leurs formes économiques, sociales et politiques; cela signifiait seulement que changeait et devenait plus facile la première période post-révolutionnaire, l'économie de transition qui précède le stade du socialisme inférieur et le stade ultime du socialisme supérieur ou communisme intégral.
4) L'opportunisme classique consista à faire croire que toutes ces mesures pouvaient, de la première à la dernière, être appliquées par l'État bourgeois démocratique sous la pression du prolétariat ou même grâce à la conquête légale du pouvoir. Mais dans ce cas, ces différentes «mesures» auraient été adoptées dans l'intérêt de la conservation bourgeoise et pour retarder la chute du capitalisme si elles étaient compatibles avec lui, et si elles étaient incompatibles, jamais l'État ne les aurait appliquées.
5) L'opportunisme actuel, avec la formule de la démocratie populaire et progressive dans les cadres de la constitution et du parlementarisme, remplit une tâche historique différente et pire encore. Tout d'abord, il fait croire au prolétariat que certaines de ses mesures propres peuvent être intégrées dans le programme d'un État pluripartite représentant toutes les classes, c'est-à-dire qu'il manifeste le même défaitisme que les sociaux-démocrates d'hier à l'égard de la dictature de classe. Ensuite et surtout, il pousse les masses organisées à lutter pour des mesures sociales «populaires et progressives», qui sont directement opposées à celles que le pouvoir prolétarien s'est toujours proposées, dès 1848 et le Manifeste.
6) On ne peut mieux montrer toute l'ignominie d'une pareille involution qu'en énumérant les mesures qu'il faudrait prendre à la place de celles du Manifeste il y a plus d'un siècle, et qui incluent toutefois les plus caractéristiques d'entre elles, dans le cas où la prise du pouvoir deviendrait possible à l'avenir dans un pays de l'Occident capitaliste.
7) La liste de ces revendications est la suivante:
- «Désinvestissement des capitaux», c'est-à-dire forte réduction de la partie du produit formée de biens instrumentaux et non pas de biens de consommation.
- «Élévation des coûts de production» pour pouvoir, tant que subsisteront salaire, marché et monnaie, donner des payes plus élevées pour un temps de travail moindre.
- «Réduction draconienne de la journée de travail», au moins à la moitié de sa durée actuelle, grâce à l'absorption des chômeurs et de la population aujourd'hui occupée à des activités antisociales.
- Après réduction du volume de la production par un plan de «sous-production» qui la concentre dans les domaines les plus nécessaires, «contrôle autoritaire de la consommation» en combattant la vogue publicitaire des biens inutiles, voluptuaires et nuisibles, et en abolissant de force les activités servant à propager une psychologie réactionnaire.
- Rapide «abolition des limites de l'entreprise» avec transfert autoritaire non pas du personnel, mais des moyens de travail en vue du nouveau plan de consommation.
- «Rapide abolition des assurances» de type mercantile pour les remplacer par l'alimentation sociale des non-travailleurs jusqu'à un minimum vital.
- «Arrêt de la construction» d'habitations et de lieux de travail à la périphérie des grandes villes et même des petites, comme mesure d'acheminement vers une répartition uniforme de la population sur tout le territoire. Réduction de l'engorgement, de la rapidité et du volume de la circulation en interdisant celle qui est inutile.
- «Lutte ouverte contre la spécialisation professionnelle» et la division sociale du travail par l'abolition des carrières et des titres.
- Plus près du domaine politique, évidentes mesures immédiates pour soumettre à l'État communiste l'école, la presse, tous les moyens de diffusion et d'information, ainsi que tout le réseau des spectacles et des divertissements.
8) Il n'est pas étonnant que les staliniens et leurs homologues réclament tout le contraire par leurs partis d'Occident, non seulement dans leurs revendications «institutionnelles», c'est-à-dire politico-légales, mais aussi dans leurs revendications «structurelles», c'est-à-dire économico-sociales. Cela leur permet d'agir de concert avec le parti qui dirige l'État russe et ses satellites où la tâche de transformation sociale consiste à passer du pré-capitalisme au plein capitalisme, avec tout le bagage de revendications idéologiques, politiques, sociales et économiques purement bourgeoises que cela comporte, et qui ne manifeste d'horreur que pour le féodalisme médiéval.
Les renégats d'Occident sont plus infâmes que leurs compères de l'Est, du fait que ce danger-là, qui reste encore matériel et bien réel dans l'Asie en ébullition, est inexistant pour les pays alignés sur la métropole capitaliste bouffie d'orgueil d'Outre-Atlantique, pour les prolétaires qui sont sous sa botte civilisées libérale et «onusienne»."
Ce texte a été publié dans l’année qui a suivi la scission du Parti Communiste International qui s’était formé en Italie au cours de la guerre, à la suite d’une importante vague de grèves ouvrières[5]. La scission, cependant –tout comme l'incapacité de maintenir la Gauche Communiste de France en vie –malgré les efforts de Marc Chirik- suite à la décision de le disperser en 1952, était une expression du fait que, contrairement aux espoirs de nombreux révolutionnaires, la guerre n’avait pas donné naissance à une nouvelle insurrection ouvrière, mais à l’approfondissement de la contre-révolution. Les désaccords entre "damenistes" et "bordiguistes" au sein du Parti Communiste International en Italie concernaient en partie des appréciations divergentes de l’après-guerre. Bordiga et ses partisans avaient tendance à avoir une meilleure compréhension du fait que la période était celle d’une montée de la réaction[6]. Et pourtant, ici nous avons Bordiga qui formule une liste de revendications qui serait plus adaptées à un moment de lutte révolutionnaire ouverte. Le texte apparaît ainsi plus comme une sorte d’expérience de la pensée que comme une plate-forme dont un mouvement de masse devrait s’emparer. Cela pourrait expliquer dans une certaine mesure certaines des plus évidentes faiblesses et lacunes du document, bien que, dans un sens plus profond, elles soient le produit de contradictions et d’incohérences qui étaient déjà inhérentes à la vision du monde bordiguiste.
En lisant les remarques qui introduisent et concluent ce texte, on peut voir qu’il a été écrit en tant que partie d’une polémique plus large contre ce que les bordiguistes caractérisent comme les courants "réformistes", en particulier les staliniens, ces faux héritiers de la tradition de Marx, Engels et Lénine. La principale raison pour laquelle les bordiguistes considèrent les Partis communistes officiels comme réformistes n’est pas qu’ils partagent les illusions des trotskystes sur le fait qu’ils seraient encore des organisations ouvrières, mais bien plus parce que les staliniens sont de plus en plus devenus partisans de former des fronts nationaux avec les partis bourgeois traditionnels et se font les avocats d’une "transition" graduelle vers le socialisme à travers la formation de "démocraties populaires" et de différentes coalitions parlementaires. Contre ces aberrations, Bordiga réaffirme les fondements du Manifeste Communiste qui considère comme point de départ la nécessité d’une conquête violente du pouvoir par le prolétariat (avec le recul, nous pouvons souligner le gouffre séparant Bordiga de beaucoup de ses "porte-paroles", notamment les courants "communisateurs" qui citent souvent Bordiga mais vomissent son insistance de la nécessité d’une dictature du prolétariat et du Parti communiste). En même temps, toujours en visant les staliniens, Bordiga disait clairement que alors que les mesures spécifiques "transitionnelles" préconisées à la fin du second chapitre du Manifeste de 1848 –impôt sur le revenu lourd et progressif, création d’une banque d’État, contrôle étatique des communications et des industries les plus importantes, etc.– devaient former l’épine dorsale du programme économique des "réformistes", elles ne devaient pas être considérées comme des vérités éternelles : le Manifeste lui-même met en avant qu’elles ne doivent "pas être considérées comme le socialisme complet, mais comme des étapes qui doivent être comprises comme préliminaires, immédiates et essentiellement contradictoires", et correspondent à un bas niveau du développement capitaliste à l’époque où elles ont été élaborées ; et de même un certain nombre d’entre elles ont été mises en place par la bourgeoisie elle-même.
On pourrait être pardonné de prendre cela pour une réfutation de l'invariance, c’est-à-dire de l’idée que le programme communiste est resté pour l’essentiel inchangé depuis au moins 1848. En fait, Bordiga fustige les staliniens parce qu’ils "ne suivent pas une théorie fixée, mais pensent qu’elle requiert des développements perpétuels du fait des changements historiques". Et à nouveau, il fait valoir que les "corrections" qu’il propose au programme immédiat "sont différentes de celles que le Manifeste énumère ; cependant ses caractéristiques sont les mêmes". Nous trouvons cela contradictoire et pas convaincant. Alors qu’il est vrai que certains éléments-clé du programme communiste, comme la nécessité de la dictature du prolétariat, ne changent pas, l’expérience historique a également apporté de profondes évolutions dans la compréhension de comment cette dictature peut se mettre en place et des formes politiques qui la composent. Cela n’a rien à voir avec le "révisionnisme" des -sociaux-démocrates, des staliniens ou d’autres qui peuvent invoquer le prétexte de " s’adapter à l’air du temps" pour justifier leur désertion du camp prolétarien.
De nombreux inconvénients, mais quelques avantages importants
En examinant les "corrections" apportées par Bordiga aux mesures proposées par le Manifeste, on pourrait aussi être pardonné de ne voir que leurs faiblesses, notamment :
- Malgré tous les enseignements des mouvements révolutionnaires de entre 1905 et 1923, il n'y a ici aucune indication sur les formes de pouvoir politique prolétarien les plus adaptées pour mettre en œuvre la transition vers le communisme. Aucune référence aux soviets, aucune tentative de s'appuyer sur des exemples comme le programme du KPD de 1918 qui met particulièrement l'accent sur la nécessité de démanteler les institutions de l'État bourgeois, locales et centrales, et d'installer à leur place le pouvoir des conseils ouvriers ; aucune leçon tirée de la dégénérescence de la révolution russe sur les relations entre le parti et la classe, ou entre le parti et l'État. En effet, la seule mention d'une forme quelconque de pouvoir politique à la suite de la révolution est celle de "l'État communiste", une contradiction atroce dans les termes, comme le soutient l'article précédent de cette série par le biais des contributions de Marc Chirik[7]. Ici encore, nous sommes confrontés aux faiblesses sous-jacentes de la "doctrine" bordigiste : les formes d'organisation ne sont pas importantes, ce qui compte, c'est le contenu injecté par le parti, qui est destiné à exercer la dictature du prolétariat au nom des masses. De plus, si Bordiga a bien sûr raison d'insister dans le point 5 sur le fait que la production et la consommation seront basées sur un plan global, son ignorance de la question de savoir comment la classe ouvrière prendra et gardera le pouvoir entre ses propres mains à tous les niveaux, du plus local au plus global, implique une vision hiérarchique de la centralisation. Ceci est particulièrement évident dans le paragraphe traitant des domaines de l'éducation et de la culture, où une sorte de monopole d'État est clairement préconisé. Nous pouvons mettre cela en contraste avec l'opinion de Trotsky selon laquelle l'État postrévolutionnaire devrait avoir une approche "anarchiste" sur la question de l'art et de la culture -par laquelle il voulait dire que l'État devrait intervenir le moins possible dans les questions de style artistique, de goût ou de créativité, et ne devrait pas exiger que tout l'art serve de propagande à la révolution. Plus généralement, sa liste de mesures ne fait guère état de la nécessité d'une vaste lutte politique, morale et culturelle pour surmonter les habitudes et les attitudes héritées non seulement du capitalisme, mais aussi de milliers d'années de sociétés de classes. Il parle bien de la nécessité de lutter contre "la spécialisation professionnelle et la division sociale du travail", mais une telle lutte exige quelque chose de plus qu'une interdiction des titres honorifiques, tandis que l'appel à supprimer "la possibilité de faire carrière" n'a de sens que dans le contexte d'une réorganisation globale de la production et de l'élimination du système salarial.
- Bordiga était parfaitement conscient que l'abolition "des salaires, de l'argent et du marché" est une caractéristique centrale du communisme, et nous savons qu'il ne sera pas possible de s'en passer du jour au lendemain. Mais à part le fait qu'il préconise "plus de rémunération pour moins de temps de travail", Bordiga ne nous donne aucune indication sur les mesures qui peuvent être prises - et ce dès le début de la révolution - pour éliminer ces catégories-clés du capitalisme. En ce sens, les corrections de Bordiga ne s'appuient pas sur les propositions de Marx dans la Critique du programme Gotha (le système des bons de temps de travail, sur lequel nous devrons revenir dans un autre article), ni ne les critiquent de manière cohérente.
Et pourtant, le document conserve pour nous un intérêt considérable en essayant de comprendre quels seraient les principaux problèmes et priorités d'une révolution communiste qui aurait lieu, non pas à l'aube de la décadence du capitalisme, comme en 1917-23, mais après un siècle entier au cours duquel le glissement vers la barbarie n'a cessé de s'accélérer, et où la menace pour la survie même de l'humanité est bien plus grande qu'il y a cent ans.
Les méthodes de la reconstruction communiste
Le document de Bordiga ne tente pas de dresser un bilan des succès et des échecs de la révolution russe au niveau politique, et ne fait, en fait, qu'une référence superficielle à la vague révolutionnaire qui a suivi la Première Guerre mondiale. Toutefois, à un certain égard, il cherche à appliquer une leçon importante des politiques économiques adoptées par les bolcheviks : les propositions de Bordiga sont pertinentes car elles reconnaissent que la voie vers l'abondance matérielle et une société sans classes ne peut pas être basée sur un programme d'"accumulation socialiste", dans lequel la consommation est toujours soumise à la "production au nom de la production" (qui est en fait une production pour la valeur), le travail vivant étant soumis au travail mort. Certes, la révolution communiste est devenue une nécessité historique car les rapports sociaux capitalistes sont devenus une entrave au développement des forces productives. Mais du point de vue communiste, le développement des forces productives a un contenu très différent de celui qu’il a dans la société capitaliste, où il est motivé par la recherche du profit et donc par le désir d'accumuler. Le communisme utilisera certainement pleinement les progrès scientifiques et technologiques réalisés sous le capitalisme, mais il les mettra au service de l'homme, de sorte qu'ils deviennent les serviteurs du véritable "développement" que le communisme propose : la pleine floraison des forces productives, c'est-à-dire des pouvoirs créatifs des individus. Un exemple suffira ici : avec le développement de l'informatisation et de la robotisation, le capitalisme nous a promis la fin de la corvée et une "société de loisirs". En réalité, ces bienfaits potentiels ont apporté la misère du chômage ou du travail précaire à certains, et une charge de travail accrue à d'autres, avec la pression croissante sur les employés pour qu'ils continuent à travailler sur leur ordinateur partout et à tout moment de la journée.
Concrètement, les quatre premiers points de son programme impliquent : de cesser de se centrer sur la production de machines dans le but de produire plus de machines, et d’orienter la production vers la consommation directe. Sous le capitalisme, bien sûr, cette dernière a signifié la production de "biens de consommation inutiles, nuisibles et de luxe" toujours plus nombreux -illustrés aujourd'hui par la production d'ordinateurs ou de téléphones portables de plus en plus sophistiqués, conçus pour tomber en panne après une période limitée et ne pouvant être réparés, ou par les industries de l’automobile immensément polluantes et de la mode éphémère, dans lesquelles la "demande des consommateurs" est poussée jusqu'à la frénésie par la publicité et les médias sociaux. Pour la classe ouvrière au pouvoir, la réorientation de la consommation sera axée sur la nécessité urgente de répondre aux nécessités fondamentales de la vie pour tous les êtres humains et partout sur la planète. Nous devrons revenir sur ces questions dans d'autres articles, mais nous pouvons mentionner certaines des plus évidentes :
- La nourriture. Le capitalisme en déclin a présenté à l'humanité une gigantesque contradiction entre les possibilités de produire suffisamment de nourriture pour tous, et la sous-alimentation réelle et permanente qui hante de grandes parties de la planète, y compris des pans de la population des pays les plus avancés, alors que dans les pays centraux comme dans les pays plus périphériques, des millions de personnes souffrent d'obésité et d'un régime alimentaire de mauvaise qualité délibérément maintenu par les entreprises de production et de commercialisation agroalimentaires, qui contribuent aussi énormément aux émissions mondiales de carbone, à la déforestation et à d'autres menaces pour l'écologie mondiale comme la pollution par les plastiques. L'approvisionnement mondial en eau est également devenu un problème fondamental, exacerbé par le réchauffement climatique. La classe ouvrière devra donc nourrir le monde mais sans recourir aux méthodes capitalistes qui nous ont conduits dans cette impasse, notamment "l'agriculture industrielle" contemporaine avec sa cruauté révoltante envers les animaux et son lien probable avec les maladies pandémiques. Elle devra résoudre l'antagonisme entre une alimentation abondante et une alimentation saine. Et tout cela sur la base d'une transformation socio-économique qui ne peut être résolue immédiatement : c'est une chose, par exemple, d'exproprier le grand "agrobusiness" et les sources étatiques de production alimentaire, une autre d'intégrer les petits exploitants ou les paysans dans une production coopérative puis associée, ce qui prendra du temps car il sera impossible de dépasser immédiatement les relations d'échange entre le secteur socialisé et les petits exploitants.
- Le logement : le problème des sans-abri est devenu endémique dans tous les pays capitalistes, et notamment dans les villes du centre capitaliste ; des millions de personnes sont rassemblées dans les vastes bidonvilles qui entourent les villes du "Sud mondialisé" (et, là encore, dans certaines parties du "Nord mondialisé") ; et au cours des dernières décennies, la prolifération des guerres et la destruction de l'environnement ont créé un problème de réfugiés d'une ampleur inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des millions d'autres personnes vivant dans des conditions désespérées dans des camps qui offrent peu de protection contre les maladies et contre toutes sortes d'exploitation, y compris les formes modernes d'esclavage. Dans le même temps, les grandes villes du monde se sont lancées dans une frénésie de construction principalement consacrée à la spéculation, aux appartements de luxe et aux activités économiques qui n'auraient pas leur place dans une société communiste. L'expropriation à grande échelle de ces bâtiments mal utilisés et mal conçus peut apporter une solution temporaire aux pires expressions du phénomène des sans-abri, mais à long terme, le logement de l'humanité communiste ne peut pas se fonder sur le rafistolage d'un parc immobilier déjà inadéquat et de plus en plus délabré où les résidents sont entassés dans des grands corps de bâtiments ou des cités-dortoirs ressemblant à des cages. Le relogement d'une grande partie de la population mondiale pose un défi bien plus important : le dépassement de la contradiction entre ville et campagne, qui n'a rien de commun avec l'expansion effrénée des villes à laquelle nous assistons dans cette phase du capitalisme. Nous y reviendrons plus loin.
- Les soins de santé : la santé, comme le conclut chaque rapport sur la santé publique, est une question sociale et de classe. Ceux qui sont mal nourris et mal logés, avec un accès limité aux soins de santé, meurent beaucoup plus tôt que ceux qui mangent bien, ont un logement décent et peuvent recevoir un traitement médical adéquat lorsqu'ils sont malades. La pandémie actuelle de Covid-19, cependant, expose les limites de tous les "services de santé" existants, même dans les pays capitalistes les plus puissants, notamment parce qu'ils n’échappent pas à la logique de concurrence entre les unités capitalistes nationales, alors qu'une pandémie ne respecte pas les frontières nationales et cela souligne la nécessité de quelque chose qui ne peut être qu'un cauchemar non seulement pour les grands consortiums pharmaceutiques et tous les Trump de ce monde, mais aussi pour cette version de gauche du nationalisme qui refuse que nous voyions au-delà de "notre service national de santé" : une médecine, des soins de santé et une recherche qui ne soient pas gérés par l'État, mais véritablement socialisés, et qui ne soient pas nationaux mais "sans frontières" : en bref, un service de santé planétaire.
Pas de gaspillages , nous n'en voulons pas
Mais en même temps, ces tâches certes immenses, qui ne sont que le point de départ d'une nouvelle culture humaine, ne peuvent être envisagées comme le résultat d'une augmentation brutale de la journée de travail. Au contraire, elles doivent être liées à une réduction drastique du temps de travail, sans laquelle, ajoutons-le, la participation directe des producteurs à la vie politique des assemblées générales et des conseils ne sera pas possible. Et cette réduction doit être obtenue dans une large mesure par l'élimination du gaspillage : le gaspillage du chômage et des "activités socialement inutiles et nuisibles".
Déjà au début du capitalisme, dans un discours prononcé à Elberfeld en 1845, Engels stigmatisait le fait que le capitalisme ne pouvait pas éviter une terrible mauvaise utilisation de l'énergie humaine et insistait sur le fait que seule une transformation communiste pouvait résoudre le problème.
- "Du point de vue économique, l'organisation actuelle de la société est certainement la plus irrationnelle et la moins pratique que nous puissions concevoir. L'opposition des intérêts a pour conséquence qu'une grande quantité de force de travail est utilisée sans que la société n’y gagne rien, et qu'une quantité substantielle de capital est inutilement perdue sans se reproduire. Nous le voyons déjà dans les crises commerciales ; nous voyons comment des masses de marchandises, que les hommes ont toutes produites avec beaucoup d'efforts, sont bradées à des prix qui causent des pertes aux vendeurs ; nous voyons comment des masses de capital, accumulées avec beaucoup d'efforts, disparaissent sous les yeux mêmes de leurs propriétaires à la suite de faillites. Mais parlons un peu plus en détail du commerce d'aujourd'hui. Réfléchissez au nombre de mains entre lesquelles doit passer chaque produit avant d'arriver au consommateur réel. Considérez, messieurs, combien d'intermédiaires superflus et de spéculateurs et escrocs se sont maintenant interposés entre le producteur et le consommateur ! Prenons, par exemple, une balle de coton produite en Amérique du Nord. La balle passe des mains du planteur à celles d'un quelconque comptoir commercial du Mississippi et descend le fleuve jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Là, elle est vendue -pour la deuxième fois, car l'agent l'a déjà achetée au planteur- vendue, peut-être, au spéculateur, qui la revend à nouveau, à l'exportateur. La balle se rend maintenant à Liverpool où, une fois de plus, un spéculateur avide tend les mains vers elle et la saisit. Cet homme l'échange ensuite avec un commissionnaire qui, supposons, est un acheteur pour une maison allemande. La balle se rend donc à Rotterdam, en amont du Rhin, en passant par une douzaine de mains d’agents intermédiaires qui la déchargent et la chargent une douzaine de fois, et ce n'est qu'alors qu'elle arrive entre les mains, non pas du consommateur, mais du fabricant, qui en fait d'abord un article de consommation, et qui vend peut-être son fil à un tisserand, qui dispose de ce qu'il a tissé pour l'imprimeur textile, qui fait ensuite affaire avec le grossiste, qui traite ensuite avec le détaillant, qui vend finalement la marchandise au consommateur. Et tous ces millions d'intermédiaires, spéculateurs, propriétaires ou gérants commerciaux , exportateurs, commissionnaires, transporteurs, grossistes et détaillants, qui ne contribuent en fait en rien à la marchandise elle-même -ils veulent tous en vivre et faire des bénéfices- et ils le font aussi, en moyenne, sinon ils ne pourraient pas subsister. Messieurs, n'y a-t-il pas de moyen plus simple et moins coûteux d'acheminer une balle de coton d'Amérique en Allemagne et de mettre le produit fabriqué à partir de cette balle entre les mains du vrai consommateur que cette entreprise compliquée qui consiste à la vendre dix fois et à la charger, la décharger et la transporter d'un entrepôt à l'autre cent fois ? N'est-ce pas là un exemple frappant du gaspillage multiple de la force de travail provoqué par la divergence des intérêts ? Un mode de transport aussi compliqué est hors de question dans une société rationnellement organisée. Pour reprendre notre exemple, de même qu'il est facile de connaître la quantité de coton ou de produits manufacturés en coton dont une colonie a besoin, il sera tout aussi facile pour l'autorité centrale de déterminer la quantité dont ont besoin tous les villages et cantons du pays. Une fois ces statistiques établies -ce qui peut facilement être fait en un an ou deux- la consommation annuelle moyenne ne changera que proportionnellement à l'augmentation de la population ; il est donc facile, au moment opportun, de déterminer à l'avance la quantité de chaque article dont la population aura besoin - la totalité de cette grande quantité sera commandée directement auprès de la source d'approvisionnement ; il sera alors possible de s'en procurer directement, sans intermédiaire, sans plus de retard et de déchargement que ne l'exige réellement la nature du voyage, c'est-à-dire avec une grande économie de main-d'œuvre ; il ne sera pas nécessaire de payer les spéculateurs, les petits et les grands négociants, leur ratissage. Mais ce n'est pas tout : de cette manière, ces intermédiaires ne sont pas seulement rendus inoffensifs pour la société, ils lui sont en fait rendus deviendront encore utiles. Alors qu'ils accomplissent aujourd'hui au détriment de tous un travail au mieux superflu, mais qui leur permet néanmoins de gagner leur vie, souvent même d’amasser de grandes richesses, alors qu'ils sont donc aujourd'hui directement préjudiciables au bien général, ils seront alors libres d'exercer un travail utile et d'exercer une profession dans laquelle ils pourront faire leurs preuves en tant que membres effectifs, et non plus seulement apparents et fictifs, de la société humaine, et en tant que participants à son activité dans son ensemble"[8] .
Engels énumère ensuite d'autres exemples de ce gaspillage : la nécessité, dans une société fondée sur la concurrence et l'inégalité, de maintenir des institutions extrêmement coûteuses mais totalement improductives telles que les armées permanentes, les forces de police et les prisons ; le travail humain consacré au service de ce que William Morris appelait "le luxe somptueux des riches" ; et enfin, l'énorme gaspillage de la force de travail engendré par le chômage, qui atteint des niveaux particulièrement scandaleux lors des crises "commerciales" périodiques du système. Il oppose ensuite le gaspillage du capitalisme à la simplicité essentielle de la production et de la distribution communistes, qui est calculée sur la base des besoins des êtres humains et du temps global nécessaire au travail qui satisfera ces besoins.
Tous ces maux capitalistes, observables pendant la période de montée et d'expansion du capitalisme, sont devenus beaucoup plus destructeurs et dangereux pendant l'époque du déclin du capitalisme : la guerre et le militarisme se sont emparés de plus en plus de l'ensemble de l'appareil économique et constituent une telle menace pour l'humanité que c'est certainement l'une des priorités les plus urgentes de la dictature du prolétariat (que Bordiga ne mentionne pas, même si "l'ère atomique" avait déjà clairement commencé au moment où il a écrit ce texte) sera de débarrasser la planète des armes de destruction massive accumulées par le capitalisme -surtout parce qu'il n'y a aucune garantie que, face à son renversement définitif par la classe ouvrière, la bourgeoisie ou ses factions ne préfèrent détruire l'humanité plutôt que de sacrifier leur domination de classe.
Un capitalisme militarisé ne peut également fonctionner qu'à travers la croissance cancéreuse de l'État, avec sa propre armée permanente de bureaucrates, de policiers et d'espions. Les services de sécurité, en particulier, ont pris des proportions gigantesques, tout comme leur image miroir, les bandes mafieuses qui font respecter leur ordre brutal dans de nombreux pays de la périphérie capitaliste.
De même, la décadence capitaliste, avec son vaste appareil bancaire, financier et publicitaire plus que jamais indispensable à la circulation des biens produits, a largement gonflé le nombre de personnes impliquées dans des formes d'activité quotidienne fondamentalement inutiles ; et les vagues successives de "mondialisation" ont rendu encore plus évidentes les absurdités de la circulation des marchandises à l'échelle de la planète, sans parler de son coût croissant au niveau écologique. Et la quantité de travail consacrée aux exigences de ce qu'on appelle aujourd'hui les "super-riches" n'est pas moins choquante qu'à l'époque d'Engels -non seulement dans leur besoin inépuisable de domestiques mais aussi dans leur soif de luxes vraiment inutiles comme les jets privés, les yachts et les palais. Et au pôle opposé, à une époque où la crise économique du système a elle-même tendance à devenir permanente, le chômage est moins un fléau cyclique que permanent, même lorsqu'il se dissimule sous la prolifération d’emplois de courte durée et du sous-emploi. Dans ce que l'on appelle le tiers monde, la destruction des économies traditionnelles a entraîné le développement intensif du capitalisme dans certaines régions, mais elle a également créé un gigantesque "sous-prolétariat" vivant dans les conditions les plus précaires dans les "townships" d'Afrique ou les "favelas" du Brésil et du reste de l'Amérique latine.
Ainsi, Bordiga - même s'il n'était pas cohérent dans sa compréhension de la décadence du système - avait compris que la mise en œuvre du programme communiste à cette époque ne signifierait pas avancer vers l'abondance par un processus d'industrialisation très rapide, comme les bolcheviks avaient tendance à le supposer, étant données les conditions "arriérées" auxquelles ils étaient confrontés en Russie après 1917. Certes, il nécessitera le développement et l'application des technologies les plus avancées, mais il se concrétisera dans un premier temps par un démantèlement planifié de tout ce qui est nocif et inutile dans l'appareil de production existant, et par une réorganisation globale des ressources humaines réelles que le capitalisme ne cesse de dilapider et de détruire.
Le mouvement communiste d'aujourd'hui - même s'il a tardé à reconnaître l'ampleur du problème - ne peut s'empêcher d'être conscient du coût écologique du développement capitaliste au cours du siècle dernier, et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est plus évident pour nous que cela ne l'était pour les bolcheviks que nous ne pouvons pas arriver au communisme par les méthodes de l'industrialisation capitaliste, qui sacrifie à la fois la force de travail humain et la richesse naturelle aux exigences du profit, à l'idole de la valeur et de son accumulation. Nous comprenons maintenant que l'une des principales tâches du prolétariat est de mettre un terme à la menace du réchauffement climatique et de nettoyer le gigantesque gâchis que le capitalisme nous aura légué : la destruction massive des forêts et des espaces sauvages, la contamination de l'air, de la terre et de l'eau par les systèmes de production et de transport existants. Certaines parties de cet "héritage" nécessiteront de nombreuses années de recherche et de patient travail pour être surmontées -la pollution des mers et de la chaîne alimentaire par les déchets plastiques n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la satisfaction des besoins les plus fondamentaux de la population mondiale (alimentation, logement, santé, etc.) devra être cohérente avec ce projet global d'harmonisation entre l'homme et la nature.
C'est tout à l'honneur de Bordiga d'avoir pris conscience de ce problème dès le début des années 50 : son intuition de la centralité de cette dimension se manifeste surtout dans sa position sur le problème des "grandes villes", qui s'inscrit pleinement dans la pensée de Marx et surtout d'Engels.
Démanteler les mégalopoles
La ville et la civilisation ont les mêmes racines, historiquement et étymologiquement. Parfois, le terme "civilisation" est étendu pour inclure l'ensemble de la culture et de la morale humaines[9]: en ce sens, les chasseurs-cueilleurs d'Australie ou d'Afrique constituent également une civilisation. Mais il ne fait aucun doute que le passage à la vie urbaine, qui est la définition la plus généralement utilisée de la civilisation, a représenté un développement qualitatif dans l'histoire humaine : un facteur d'avancement de la culture et de l'histoire elle-même, mais aussi les débuts définitifs de l'exploitation des classes, et de l'État. Avant même le capitalisme, comme le montre Weber, la ville est aussi inséparable du commerce et de l'économie monétaire[10]. Mais la bourgeoisie est la classe urbaine par excellence, et les villes médiévales sont devenues les centres de la résistance à l'hégémonie de l'aristocratie féodale, dont la richesse est avant tout basée sur la propriété foncière et l'exploitation des paysans. Le prolétariat moderne n'en est pas moins une classe urbaine, formée à partir de l'expropriation des paysans et de la ruine des artisans. Poussée dans les conurbations construites à la hâte à Manchester, Glasgow ou Paris, c'est là que la classe ouvrière a pris conscience d'être une classe distincte opposée à la bourgeoisie et a commencé à envisager un monde au-delà du capitalisme.
Au niveau de la relation de l'homme avec la nature, la ville présente le même double aspect : elle est le centre du développement scientifique et technologique, ouvrant le potentiel de libération vis-à-vis de la pénurie et de la maladie. Mais cette "maîtrise de la nature" croissante, qui se produit dans des conditions d'aliénation de l'homme par rapport à lui-même et à la nature, est également inséparable de la destruction de la nature et des catastrophes écologiques récurrentes. Ainsi, le déclin des cultures citadines sumériennes ou mayas s'explique par une forme de dépassement de la ville par elle-même, épuisant le milieu environnant de forêts et d'agriculture, et dont l'effondrement a porté des coups terribles à l'orgueil de civilisations qui avaient commencé à oublier leur intime dépendance vis-à-vis de la nature. De même, les villes, dans la mesure où elles ont entassé les êtres humains comme des sardines, n'ont pas réussi à résoudre le problème fondamental de l'élimination des déchets, et ont inversé les relations séculaires entre les hommes et les animaux, sont devenues le terreau de fléaux tels que la peste noire à l'époque du déclin féodal ou le choléra et le typhus qui ont ravagé les villes industrielles du capitalisme primitif. Mais là encore, nous devons considérer l'autre facette de la dialectique : la bourgeoisie montante a pu comprendre que les maladies qui frappent ses esclaves salariés pouvaient également atteindre les portes des demeures capitalistes et miner tout leur édifice économique. Elle a ainsi pu commencer et mener à bien d'étonnantes prouesses d'ingénierie dans la construction de systèmes d'égouts qui fonctionnent encore aujourd'hui, tandis que l'expertise médicale, à l’évolution rapide, était mobilisée pour éliminer des formes de maladies jusqu'alors chroniques.
Dans l'œuvre de Friedrich Engels en particulier, on peut trouver les éléments fondamentaux pour une histoire de la ville d'un point de vue prolétarien. Dans Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État, il retrace la dissolution des anciens "gens", l'organisation tribale basée sur les liens de parenté, qui laisse la place à la nouvelle organisation territoriale de la ville, marquée par la division irréversible en classes antagonistes et avec elle l'émergence du pouvoir étatique, dont la tâche est d'empêcher ces divisions de déchirer la société. Dans La condition de la classe ouvrière en Angleterre, il brosse un tableau des conditions de vie infernales du jeune prolétariat, de la saleté et des maladies quotidiennes des bidonvilles de Manchester, mais aussi le bouillonnement de la conscience et de l'organisation de classe qui, en fin de compte, joueront le rôle décisif pour contraindre la classe dirigeante à accorder des réformes significatives aux travailleurs.
Dans deux ouvrages ultérieurs, l'Anti-Duhring et La question du logement, Engels se lance dans une discussion sur la ville capitaliste dans une phase où le capitalisme a déjà triomphé au cœur de l'Europe et des États-Unis et est sur le point de conquérir le monde entier. Et on peut remarquer qu'il conclut déjà que les grandes villes ont dépassé les limites de leur viabilité et devront disparaître pour répondre à l'exigence du Manifeste communiste : l'abolition de la séparation entre la ville et la campagne. Rappelons ici que dans les années 1860, Marx se préoccupait aussi de plus en plus de l'impact destructeur de l'agriculture capitaliste sur la fertilité des sols et notait, dans l'ouvrage de Liepig, que l'anéantissement de la couverture forestière dans certaines régions d'Europe avait un impact sur le climat, en augmentant les températures locales et en diminuant les précipitations[11]. En d'autres termes : de même que Marx discernait des signes de la décadence politique de la classe bourgeoise après l'écrasement de la Commune de Paris et que, dans sa correspondance avec les révolutionnaires russes vers la fin de sa vie, il cherchait des moyens pour que les régions où le capitalisme devait encore triompher pleinement puissent éviter le purgatoire du développement capitaliste, Engels et lui avaient commencé à se demander si, en ce qui concernait le capitalisme, trop c'était trop[12]. Peut-être que les bases matérielles d'une société communiste mondiale avaient déjà été posées et que de nouveaux "progrès" pour le capital auraient un résultat de plus en plus destructeur ? Nous savons que le système, par son expansion impérialiste dans les dernières décennies du XIXe siècle, allait prolonger sa vie de plusieurs décennies supplémentaires et fournirait la base d'une phase de croissance et de développement stupéfiante, ce qui conduirait certains éléments du mouvement ouvrier à remettre en question l'analyse marxiste de l'inévitabilité de la crise et du déclin du capitalisme, pour que les contradictions non résolues du capital explosent au grand jour lors de la guerre de 1914-18 (qu'Engels avait également anticipée). Mais les questions de recherche sur l'avenir qu'ils avaient commencé à poser précisément au moment où le capitalisme avait atteint son apogée étaient parfaitement valables à l'époque et sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui.
Dans "La transformation des rapports sociaux [99]"[13], nous avons examiné comment les révolutionnaires du XIXe siècle -en particulier Engels, mais aussi Bebel et William Morris- avaient fait valoir que la croissance des grandes villes avait déjà atteint le point où l'abolition de l'antagonisme entre ville et campagne était devenue une réelle nécessité, d'où la nécessité de mettre fin à l'expansion des grandes villes au profit d'une plus grande unité entre l'industrie et l'agriculture et d'une répartition plus équitable des habitations humaines sur la Terre. C'était une nécessité non seulement pour résoudre des problèmes urgents tels que l'élimination des déchets et la prévention de la surpopulation, de la pollution et des maladies, mais aussi comme base d'un rythme de vie plus humain en harmonie avec la nature.
Dans "Damen, Bordiga et la passion pour le communisme [100]"[14], nous avons montré que Bordiga -peut-être plus que tout autre marxiste au XXe siècle- était resté fidèle à cet aspect essentiel du programme communiste, en citant par exemple son article de 1953 Espace contre ciment [101] [15], qui est une polémique passionnée contre les tendances contemporaines en matière d'architecture et d'urbanisme (domaine dans lequel Bordiga lui-même était professionnellement qualifié), qui étaient motivées par le besoin du capital de rassembler le plus grand nombre possible d'êtres humains dans des espaces de plus en plus restreints -une tendance caractérisée par la construction rapide de tours supposées s'inspirer des théories architecturales de Le Corbusier. Bordiga est impitoyable envers les fournisseurs de l'idéologie moderne de l'urbanisme :
- "Quiconque applaudit de telles tendances ne doit pas être considéré uniquement comme un défenseur des doctrines, des idéaux et des intérêts capitalistes, mais comme un complice des tendances pathologiques du stade suprême de décadence et de dissolution du capitalisme" (donc, aucune hésitation sur la décadence ici !). Ailleurs dans le même article, il affirme : "Le verticalisme, c’est ainsi que cette doctrine déformée s'appelle ; le capitalisme est verticaliste. Le communisme sera "horizontaliste". Et à la fin de l'article, il anticipe avec joie le jour où "les monstres de ciment seront ridiculisés et supprimés" et où les "villes géantes seront dégonflées" afin de "rendre la densité de la vie et du travail uniforme sur les terres habitables".
Dans un autre ouvrage, Espèce humaine et croûte terrestre [102][16], Bordiga cite abondamment l'ouvrage d'Engels La question du logement, et nous ne pouvons pas éviter de céder à la tentation de faire de même. Il s'agit de la dernière partie de la brochure, où Engels s'en prend à Mülberger, disciple de Proudhon, pour avoir affirmé qu'il est utopique de vouloir surmonter l'antagonisme "inévitable" entre ville et campagne :
- "L'abolition de l'antithèse entre ville et campagne n'est ni plus ni moins utopique que l'abolition de l'antithèse entre capitalistes et travailleurs salariés. De jour en jour, elle devient de plus en plus une exigence pratique de la production industrielle et agricole. Personne n'a exigé cela avec plus d'énergie que Liebig dans ses écrits sur la chimie de l'agriculture, dans lesquels sa première revendication a toujours été que l'homme rende à la terre ce qu'il lui prend, et dans lesquels il prouve que seule l'existence des villes, et en particulier des grandes villes, l'empêche. Quand on observe comment, ici à Londres seulement, une quantité de fumier plus importante que celle produite par tout le royaume de Saxe est déversée chaque jour dans la mer avec une dépense de sommes considérables, et quand on observe quels travaux colossaux sont nécessaires pour éviter que ce fumier n'empoisonne tout Londres, alors la proposition utopique d'abolir l'antithèse entre ville et campagne se voit donner une base particulièrement pratique. Et même Berlin, comparativement insignifiante, se vautre dans ses propres ordures depuis au moins trente ans.
D'autre part, il est tout à fait utopique de vouloir, comme Proudhon, transformer la société bourgeoise actuelle tout en maintenant le paysan en tant que tel. Seule une répartition aussi uniforme que possible de la population sur l'ensemble du pays, seule une liaison intégrale entre la production industrielle et agricole ainsi que l'extension nécessaire des moyens de communication - qui suppose l'abolition du mode de production capitaliste - pourraient sauver la population rurale de l'isolement et de l’abrutissement dans lesquels elle végète presque sans changement depuis des milliers d'années" [17].
Plusieurs pistes de réflexion sont proposées dans ce passage, et Bordiga en est bien conscient. Premièrement, Engels insiste sur le fait que le dépassement de l'antagonisme entre ville et campagne est intimement lié au dépassement de la division générale du travail capitaliste - un thème développé plus loin dans l'Anti-Dühring, en particulier la division entre travail intellectuel et travail manuel qui semble si insurmontable dans le processus de production capitaliste. Le dépassement des conditions de ces deux séparations, tout comme celles de la division entre le capitaliste et le travailleur salarié, est indispensable pour l'émergence d'un être humain complet. Et contrairement aux schémas des proudhoniens rétrogrades, l'abolition du rapport social capitaliste n'implique pas la préservation de la petite propriété des paysans ou des artisans ; c’est en transcendant les clivages ville-campagne et les divisions industrie-agriculture que les paysans pourront être sauvés de l'isolement et d’un état intellectuel qui végète autant que les citadins pourront être libérés du surpeuplement et de la pollution.
Deuxièmement, Engels soulève ici, comme il le fait ailleurs, le problème simple mais souvent éludé des excréments humains. Dans leurs premières formes "sauvages", les villes capitalistes n'ont pratiquement rien prévu pour le traitement des déchets humains, et en ont très vite payé le prix en générant des épidémies, notamment la dysenterie et le choléra - fléaux qui hantent encore les bidonvilles de la périphérie capitaliste, où les installations d'hygiène de base sont notoirement absentes. La construction du système d'égouts a certainement représenté un pas en avant dans l'histoire de la ville bourgeoise. Mais le simple fait d'évacuer les déchets humains est en soi une forme de gaspillage puisqu'ils pourraient être utilisés comme engrais naturel (comme c'était d'ailleurs le cas dans l'histoire antérieure de la ville).
En se remémorant l'époque du Londres ou du Manchester d'Engels, on pourrait facilement dire : ils pensaient que ces villes étaient déjà devenues beaucoup trop grandes, beaucoup trop éloignées de leur environnement naturel. Qu'auraient-ils fait des avatars modernes de ces villes ? L'ONU a estimé qu'environ 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des grandes villes, mais si la croissance actuelle des villes se poursuit, ce chiffre atteindra environ 68% d'ici 2050[18].
C'est un véritable exemple de la "croissance de la décadence" du capitalisme, et Bordiga a eu la prescience de voir cela dans la période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Les anthropologues qui cherchent à définir l'ouverture de la période de ce qu'ils appellent "l'ère anthropocène" (qui signifie essentiellement l'ère où l'activité humaine a eu un impact fondamental et qualitatif sur l'écologie de la planète) la font généralement remonter à la diffusion de l'industrie moderne au début du XIXe siècle - en bref, à la victoire du capitalisme. Mais certains parlent aussi d'une "Grande Accélération" qui a eu lieu après 1945, et on peut voir le poids de cette dernière s'accélérer encore plus après 1989 avec la montée en puissance de la Chine et d'autres pays "en développement".
Les conséquences de cette croissance sont bien connues : la contribution de la mégalopole au réchauffement de la planète par la construction sauvage, la consommation d'énergie et les émissions de l'industrie et des transports, qui rendent également l'air irrespirable dans de nombreuses villes (déjà relevées par Bordiga dans l'ouvrage Espèce humaine et croûte terrestre : "Quant à la démocratie bourgeoise, elle s'est abaissée au point de renoncer à la liberté de respirer"). L'expansion incontrôlée de l'urbanisation a été un facteur essentiel de la destruction des habitats naturels et de l'extinction des espèces ; enfin, les mégacités ont révélé leur rôle d'incubateur de nouvelles maladies pandémiques, dont la plus mortelle et la plus contagieuse -Covid-19- paralyse à l'heure actuelle l'économie mondiale et laisse une traînée de mort et de souffrance dans le monde entier. En effet, les deux dernières "contributions" se sont probablement réunies dans l'épidémie du Covid-19, qui est l'une des nombreuses épidémies où un virus a sauté d'une espèce à l'autre. C'est devenu un problème majeur dans des pays comme la Chine et dans de nombreuses régions d'Afrique où les habitats des animaux sont en train d'être détruits, ce qui entraîne une augmentation considérable de la consommation à travers la vente clandestine sur des marchés parallèles de viande d’animaux sauvages avec des espèces qui pullulent désormais en lisière de centres urbains, et où les nouvelles villes, construites pour répondre à la frénésie de croissance économique de la Chine, ont des contrôles d'hygiène minimalistes.
Surmonter l'antagonisme
Dans la liste des mesures révolutionnaires contenues dans l'article de Bordiga, le point 7 est le plus pertinent pour le projet d'abolition de l'antagonisme entre ville et campagne :
- "Arrêt de la construction» d'habitations et de lieux de travail à la périphérie des grandes villes et même des petites, comme mesure d'acheminement vers une répartition uniforme de la population sur tout le territoire. Réduction de l'engorgement, de la rapidité et du volume de la circulation en interdisant celle qui est inutile".
Ce point semble particulièrement d’actualité aujourd'hui, alors que pratiquement chaque ville est le théâtre d'une élévation "verticale" implacable (la construction d'énormes gratte-ciels, en particulier dans les centre-villes) et d'une extension "horizontale", dévorant la campagne environnante. La revendication est tout simplement la suivante : stop ! Le gonflement des villes et la concentration insoutenable de la population en leur sein sont le résultat de l'anarchie capitaliste et sont donc essentiellement non planifiés, non centralisés. L'énergie humaine et les possibilités technologiques actuellement engagées dans cette croissance cancéreuse doivent, dès le début du processus révolutionnaire, être mobilisées dans une autre direction. Même si la population mondiale a considérablement augmenté depuis que Bordiga a calculé, dans Espace contre Ciment, qu’ "en moyenne, notre espèce a un kilomètre carré pour vingt de ses membres"[19], la possibilité d'une répartition beaucoup plus rationnelle et harmonieuse de la population sur la planète demeure, même en tenant compte de la nécessité de préserver de grandes zones de nature sauvage -une nécessité mieux comprise aujourd'hui parce que l'immense importance de la préservation de la biodiversité sur la planète a été scientifiquement établie, mais c'était déjà quelque chose d'envisagé par Trotsky dans Littérature et Révolution [20].
L'abolition de l'antagonisme ville-campagne a été déformée par le stalinisme en un sens : tout paver, construire des "casernes d'ouvriers" et de nouvelles usines sur chaque champ et dans chaque forêt. Pour le communisme authentique, cela signifiera cultiver des champs et planter des forêts au milieu des villes, mais aussi que des communautés viables puissent être implantées dans une étonnante variété d'endroits sans détruire tout ce qui les entoure, et qu'elles ne soient pas isolées car elles auront à leur disposition les moyens de communication que le capitalisme a en effet développés à une vitesse ahurissante. Engels avait déjà évoqué cette possibilité dans La question du logement et Bordiga la reprend dans Espace contre ciment [103] :
- "Les formes de production les plus modernes, qui utilisent des réseaux de stations réalisations technologiques de tout genre, comme les centrales hydroélectriques, les communications, la radio, la télévision, donnent de plus en plus une discipline opérationnelle unique à des travailleurs répartis en petits groupes à d'énormes distances. Ce qui est acquis, c'est le travail associé, avec ses enchevêtrements de plus en plus vastes et merveilleux, tandis que la production autonome disparaît de plus en plus. Mais la densité technologique que nous avons évoquée diminue sans arrêt. Si l'agglomération urbaine et productive subsiste, ce n'est donc pas parce qu'elle permettrait de réaliser la production dans les meilleures conditions, c'est à cause de la permanence de l'économie du profit et de la dictature sociale du capital ".
La technologie numérique a bien sûr fait progresser ce potentiel. Mais dans le capitalisme, le résultat général de la "révolution Internet" a été d'accélérer l'atomisation de l'individu, tandis que la tendance au "travail à domicile" - particulièrement mise en évidence par la crise liée au Covid-19 et aux mesures d'accompagnement de l'isolement social - n'a pas du tout réduit la tendance à l'agglomération urbaine. Le conflit entre, d'une part, le désir de vivre et de travailler en association avec les autres et, d'autre part, la nécessité de trouver un espace pour bouger et respirer, ne peut être résolu que dans une société où l'individu n'est plus en désaccord avec la communauté.
Réduisez votre vitesse
Comme pour la construction d'habitations humaines, il en va de même pour la ruée folle des transports modernes : arrêtez, ou du moins, ralentissez !
Là encore, Bordiga est en avance sur son temps. Les modes de transport capitaliste par voies de terre, de mer et des airs, basés en grande partie sur la combustion d’énergies fossiles, sont responsables de plus de 20 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone[21], tandis que dans les villes, ils sont devenus une source majeure de maladies cardiaques et pulmonaires, touchant particulièrement les enfants. Le nombre annuel de victimes d'accidents de la route dans le monde s'élève à 1,35 million, dont plus de la moitié sont des usagers les plus "vulnérables" : piétons, cyclistes et motocyclistes[22]. Et ce ne sont là que les inconvénients les plus évidents du système de transport actuel. Le bruit constant qu'il génère ronge les nerfs des citadins, et la subordination de l'urbanisme aux besoins de la voiture (et de l'industrie automobile, si centrale dans l'économie capitaliste actuelle) produit des villes sans cesse plus fragmentées, avec des zones résidentielles divisées les unes des autres par le flux incessant du trafic. Pendant ce temps, l'atomisation sociale, caractéristique essentielle de la société bourgeoise et de la ville capitaliste en particulier, est non seulement illustrée mais renforcée par le fait que le propriétaire et conducteur d'une voiture soit en concurrence pour l'espace routier avec des millions d'âmes pareillement atomisées.
Bien entendu, le capitalisme a dû prendre des mesures pour tenter d'atténuer les pires effets de tout cela : la "taxe carbone" pour freiner les déplacements polluants excessifs, la "modération du trafic" et les voies piétonnes sans voiture dans les centres villes, le passage à la voiture électrique.
Aucune de ces "réformes" ne permet de résoudre le problème, car aucune d'entre elles ne s'attaque au rapport social capitaliste qui en est à la base. Prenons l'exemple de la voiture électrique : l'industrie automobile a prévu ce qui l'attendait et tend à se tourner de plus en plus vers cette forme de transport. Mais, même en mettant de côté le problème de l'extraction et de l'élimination du lithium nécessaire aux batteries, ou la nécessité d'augmenter la production d'électricité pour alimenter ces véhicules, qui ont tous un coût écologique important, une ville pleine de véhicules électriques serait légèrement plus silencieuse et un peu moins polluée, mais toujours dangereuse pour les piétons et les voitures.
Il est possible que le communisme fasse effectivement un usage important (mais sans doute pas exclusif) des véhicules électriques. Mais le vrai problème est ailleurs. Le capitalisme doit fonctionner à une vitesse vertigineuse parce que "le temps, c'est de l'argent" et que le mode de transport des marchandises est dicté par les besoins de l'accumulation, qui inclut le temps de "rotation" et donc le transport dans ses calculs globaux. Le capitalisme est également motivé par la nécessité de vendre le plus grand nombre de produits possible, d'où la pression constante pour que chaque individu ait sa propre possession personnelle -encore une fois, la voiture privée est devenue un symbole de richesse et de prestige personnel, la clé de la "liberté de sur la route" à une époque d'embouteillages incessants.
Le rythme de vie dans les villes d'aujourd'hui est bien plus élevé (même avec les embouteillages) qu'il ne l'était dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais dans La femme et le socialisme[23], publié pour la première fois en 1879, August Bebel envisageait déjà la ville du futur, où "le bruit, l'entassement et la précipitation angoissants de nos grandes villes avec leurs milliers de véhicules de toutes sortes cessent substantiellement : la société prend un aspect de plus grand repos" (p. 300).
La précipitation et la congestion qui rendent la vie urbaine si stressante ne peuvent être surmontées que lorsque l'envie d'accumuler aura été supprimée, au profit d'une production planifiée pour distribuer librement les valeurs d'usage nécessaires. Dans l'élaboration des réseaux de transport de l'avenir, un facteur clé sera évidemment de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et les autres formes de pollution, mais la nécessité de parvenir à un "plus grand repos", un certain degré de calme et de tranquillité, tant pour les résidents que pour les voyageurs, sera certainement prise en compte dans la globalité du problème. Comme il y aura beaucoup moins de pression pour se rendre d'un point A à un point B au rythme le plus rapide possible, les voyageurs auront plus de temps pour profiter du voyage lui-même : peut-être, dans un tel monde, le cheval reviendra-t-il dans certaines parties du monde, les voiliers en mer, les dirigeables dans le ciel, tandis qu'il sera également possible d'utiliser des moyens de transport beaucoup plus rapides en cas de besoin[24]. En même temps, le volume du trafic sera considérablement réduit si l'on parvient à briser l'addiction à la propriété personnelle des véhicules et si les voyageurs peuvent avoir accès à divers types de transports publics gratuits (bus, trains, bateaux, taxis et véhicules sans propriétaire). Nous devons également garder à l'esprit que, contrairement aux nombreuses villes capitalistes occidentales où la moitié des appartements sont occupés par des propriétaires ou des locataires célibataires, le communisme sera une expérience de formes de vie plus communautaires ; et dans une telle société, voyager en compagnie d'autres personnes peut devenir un plaisir plutôt qu'une course désespérée entre des concurrents hostiles.
Nous devons également garder à l'esprit qu’un bon nombre des trajets qui encombrent le système de transports, ceux qui permettent d’exercer des emplois inutiles tels que ceux liés à la finance, aux assurances ou à la publicité, n'auront pas leur place dans une société sans argent. Les "heures de pointe" quotidiennes appartiendront au passé.
Ainsi, les rues d'une ville où le vrombissement de la circulation aura été réduit à un ronronnement retrouveront certains de leurs anciens avantages et usages, comme les aires de jeux pour les enfants, par exemple.
Là encore, nous ne sous-estimons pas l'ampleur des tâches à accomplir. Bien que la possibilité de vivre de manière plus communautaire ou associée soit contenue dans la transition vers un mode de production communiste, les préjugés égoïstes qui ont été fortement exacerbés par plusieurs centaines d'années de capitalisme, ne disparaîtront pas de manière automatique et constitueront en effet souvent de sérieux obstacles au processus de communisation. Comme l'a dit Marx :
- "La propriété privée nous a rendus si stupides et unilatéraux qu'un objet n'est à nous que lorsque nous le possédons, lorsqu'il existe pour nous en tant que capital ou lorsque nous le possédons directement, le mangeons, le buvons, le portons, l'habitons, etc. Bien que la propriété privée ne conçoive toutes ces réalisations immédiates de la possession que comme des moyens de vie, et que la vie qu'elles servent est la vie de la propriété privée, du travail et de la capitalisation. Par conséquent, tous les sens physiques et intellectuels ont été remplacés par la simple distanciation de tous ces sens - le sens de la propriété." (Manuscrits économiques et philosophiques de 1844, chapitre "Propriété privée et communisme").
Rosa Luxemburg a toujours soutenu que la lutte pour le socialisme n'est pas seulement une question "de pain et de beurre" mais que "Au point de vue moral, la lutte ouvrière renouvellera la culture de la société"[25]. Cet aspect culturel et moral de la lutte des classes, et surtout de la lutte contre le "sentiment de propriété", se poursuivra certainement tout au long de la période de transition vers le communisme.
CDW
[1] La transformation des rapports sociaux selon les révolutionnaires de la fin du 19e siècle [99], Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13° partie] -Revue internationale n° 85 ; Les années 1950 et 60 : Damen, Bordiga et la passion du communisme [100], Revue internationale n° 158.
[2] 1918 : Le programme du parti communiste allemand [104], Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [3° partie] -Revue internationale n° 93 et 1919 : le programme de la dictature du prolétariat [105], Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [5° partie] -Revue internationale n° 95.
[4] Damen, Bordiga et la passion du communisme, Revue Internationale n° 158, https://en.internationalism.org/international-review/201609/14092/1950s-and-60s-damen-bordiga-and-passion-communism [107]
[5] Il faut souligner que ce texte a été adopté en tant que « document du parti » de la nouvelle organisation, et n’est pas simplement une contribution individuelle.
[6] Mais les damenistes étaient plus clairs sur beaucoup de leçons de la défaite de la Révolution russe et sur les positions du prolétariat dans la période du capitalisme décadent. Voir : Damen, Bordiga et la passion du communisme.
[7] Marc Chirik et l'État de la période de transition [108], Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire - Revue internationale n° 165
[8] Speeches in Elberfeld. Discours d’Elberfeld dans notre traduction.
Voir par exemple À propos du livre L'effet Darwin : une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation [109].
[10] Max Weber, La ville, 1921.
[11] Voir Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism, New York, 2017
[12] Sur Marx et la question russe, voir un article précédent de cette série, Marx de la maturité : communisme du passé, communisme du futur [110], Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [11e partie] -Revue internationale n° 81.
[13] Série "Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13° partie]"- Revue internationale n° 85 ;
[14] Revue internationale n° 158.
[15] Il Programma Comunista, No. 1 of 8-24 Janvier 1953.
[16] Il Programma Comunista no. 6/1952, 18 décembre 1952.
[17] Téléchargeable à cette adresse [111].
[18] Two-thirds of global population will live in cities by 2050, UN says [112] (Les deux-tiers de la population du globe vivront dans les villles en 2050, selon l’ONU).
[19] Bordiga a donné le nombre de 2,5 milliards. Aujourd’hui c’est plutôt 6,8 milliards. Nations Unies.
[20] Littérature et Révolution [113]. Voir aussi Trotsky et la “culture prolétarienne [114], Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [13° partie] – Revue internationale n° 111.
[22] Lire "Road safety facts".
[23] Téléchargeable à cette adresse [116].
[24] Bien sûr, les gens pourront encore apprécier le plaisir de voyager à une vitesse vertigineuse, mais peut-être que dans une société rationnelle, ces plaisirs se limiteront à des lieux réservés à cet effet.
[25] Arrêts et progrès du marxisme [117], 1903 [118].
Personnages:
- Bordiga [119]
Questions théoriques:
- Décomposition [120]
- Communisme [121]
Rubrique:
Il y a cinquante ans, mai 68 : la difficile évolution du milieu politique prolétarien (II)
- 225 lectures
Dans la première partie de cet article, nous avons examiné certains des développements les plus importants au sein du milieu prolétarien international après les événements de Mai 68 en France. Nous avons constaté que, si la résurgence de la lutte de classe avait donné un élan significatif à la relance du mouvement politique prolétarien, et donc au regroupement de ses forces, cette dynamique avait commencé à se heurter à des difficultés dès le début des années 80. Nous reprenons l'histoire à partir de ce point. Cette "histoire" ne prétend nullement être exhaustive et nous ne nous excusons pas du fait qu'elle soit présentée du point de vue " partisan " du CCI. Elle peut être complétée à l'avenir par des contributions de ceux qui peuvent avoir des expériences et des perspectives différentes.
La grève de masse en Pologne en 1980 a démontré la capacité de la classe ouvrière à s'organiser indépendamment de l'Etat capitaliste, à unifier ses luttes dans tout un pays, à unir ses revendications économiques et politiques. Mais comme nous l'avons dit à l'époque : comme en Russie en 1917, le problème pouvait se poser en Pologne, mais il ne pouvait être résolu qu'à l'échelle internationale. La classe ouvrière d'Europe de l'Ouest en particulier s'était vue lancer un défi : face à l'aggravation irréversible de la crise capitaliste, il serait nécessaire d’atteindre les mêmes sommets d'auto-organisation et d'unification de ses luttes, mais en même temps aller au-delà du mouvement en Pologne au niveau de la politisation. Les ouvriers polonais, luttant contre un régime brutal qui prétendait que les sacrifices qu'il exigeait étaient tous des pas sur la voie d'un avenir communiste, n'avaient pas pu, au niveau politique, rejeter tout une série de mystifications politiques, en particulier que leurs conditions pourraient s'améliorer avec un régime démocratique qui permette aux "syndicats libres" d'organiser la classe ouvrière. C'était la tâche spécifique des travailleurs de l'Ouest, qui avaient connu de nombreuses années d'amère expérience de la fraude de la démocratie parlementaire et du rôle de sabotage des syndicats formellement séparés de l'Etat capitaliste, de développer une perspective véritablement prolétarienne : la grève de masse progressant vers la confrontation directe avec le système capitaliste, ce qui constitue l'objectif d'une société véritablement communiste.
Et il ne fait aucun doute que les travailleurs de l'Ouest ont bien relevé le défi en luttant contre une nouvelle série d'attaques qui visaient leur niveau de vie, menée en grande partie par des régimes de droite au pouvoir, prêts à imposer des niveaux de chômage massifs pour "réduire" l'appareil économique gonflé et hérité de la période keynésienne de l'après-guerre. En Belgique, en 1983, les travailleurs ont fait des pas importants vers l'extension de la lutte - ne comptant pas sur les délibérations des responsables syndicaux mais envoyant des délégations massives dans d'autres secteurs pour les inviter à rejoindre le mouvement. Dans les deux années qui ont suivi, les grèves des ouvriers de l'automobile, de l'acier, de l'imprimerie et surtout des mineurs au Royaume-Uni ont constitué la réponse du prolétariat au nouveau régime "thatchérien".
Elles contenaient un réel potentiel d'unification à condition de se débarrasser de l'idée syndicaliste obsolète selon laquelle on peut vaincre l'ennemi capitaliste en résistant le plus longtemps possible enfermés dans un secteur. Ailleurs en Europe - parmi les cheminots et les travailleurs de la santé en France, ou les travailleurs de l'éducation en Italie - les travailleurs sont allés plus loin en essayant de rompre l'emprise paralysante des syndicats, en s'organisant en assemblées générales avec des comités de grève élus et révocables, et en faisant des efforts timides pour coordonner ces comités.
Comme nous l'avons affirmé dans la première partie de cet article, il était absolument nécessaire que les petites organisations révolutionnaires qui existaient à l'époque, même avec leurs moyens limités, participent à ces luttes, fassent entendre leur voix par la presse, des tracts, des interventions dans les manifestations, sur les piquets de grève et dans les assemblées générales, fassent des propositions concrètes pour étendre et auto-organiser la lutte, jouent un rôle dans la formation des groupes d' ouvriers combatifs qui cherchent à stimuler la lutte et à en dégager les leçons les plus importantes. Le CCI a consacré une bonne partie de ses ressources dans les années 1980 à la réalisation de ces tâches, et nous avons produit un certain nombre de polémiques avec d'autres organisations prolétariennes qui, à notre avis, n'avaient pas suffisamment saisi le potentiel de ces luttes, surtout parce qu'il leur manquait une vision générale et historique de la "marche" du mouvement de la classe[1].
Et pourtant, comme nous l'avons également reconnu ailleurs[2], nous avons nous-mêmes manqué de clarté sur les difficultés croissantes de la lutte. Nous avons eu tendance à sous-estimer l'importance des lourdes défaites subies par des secteurs emblématiques comme les mineurs au Royaume-Uni, la réelle hésitation de la classe à rejeter les méthodes et l'idéologie syndicales : même quand il y avait une forte tendance à s'organiser en dehors des syndicats, l'extrême-gauche de la bourgeoisie a créé de faux syndicats, voire des "coordinations" extra-syndicales pour maintenir la lutte dans les limites de la défense d’intérêts sectoriels et finalement du syndicalisme. Et surtout, malgré la détermination et la combativité de ces luttes, il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans le sens de dégager une perspective révolutionnaire. La politisation du mouvement est restée, au mieux, embryonnaire.
Depuis la fin des années 1980, nous soutenons que cette situation - celle d'une classe ouvrière suffisamment forte pour résister à la poussée vers une autre guerre mondiale, et pourtant incapable d'offrir à l'humanité la perspective d'une nouvelle forme d'organisation sociale - constituait une sorte d'impasse sociale qui a ouvert ce que l'on appelle la phase de la décomposition sociale. L'effondrement du bloc de l'Est en 1989, qui a marqué l'entrée définitive dans cette nouvelle phase du déclin du capitalisme, a été comme une sonnette d'alarme qui nous a fait profondément réfléchir sur le destin du mouvement de classe international qui s'était manifesté par vagues successives depuis 1968. Nous avons commencé à comprendre que la nouvelle période poserait des difficultés considérables à la classe ouvrière, notamment (mais pas seulement) à cause de la puissante campagne idéologique déchaînée par la bourgeoisie qui proclamait la mort du communisme et la réfutation finale du marxisme.
Dans la première partie de cet article, nous avons noté que, déjà au début des années 80, le milieu politique prolétarien avait traversé une crise majeure, marquée par l'échec des conférences internationales de la Gauche Communiste, les scissions au sein du CCI et l'implosion du Parti Communiste International bordiguiste (Programme Communiste). Les principales organisations politiques de la classe ouvrière sont ainsi entrées dans cette période nouvelle et incertaine dans un état d'affaiblissement et de désunion. L'échec général de la classe à politiser ses luttes a aussi signifié que la croissance très sensible du milieu politique prolétarien de la fin des années 60 et des années 70 avait commencé à ralentir ou à stagner. Par ailleurs, de notre point de vue, aucune des organisations existantes, à part le CCI, ne disposait du cadre théorique permettant de comprendre les caractéristiques de la nouvelle phase de décadence : certaines d'entre elles, comme les bordiguistes, rejetaient plus ou moins totalement le concept de décadence, tandis que d'autres, comme Battaglia Comunista et la CWO - Communist Workers Organisation - désormais regroupées au sein du BIPR (Bureau International pour le Parti révolutionnaire) disposaient d'un concept de décadence mais n’étaient pas intéressées à évaluer le rapport de force historique entre classes (que nous appelions la question du "cours historique"). L'idée d'une impasse sociale n'avait donc aucun sens pour eux.
L'impact de la décomposition
Le principal danger de la décomposition pour la classe ouvrière est qu'elle sape progressivement le fondement même de sa nature révolutionnaire : sa capacité, voire son besoin fondamental, d'association. La tendance au "chacun pour soi" est inhérente au mode de production capitaliste, mais elle prend une nouvelle intensité, voire une nouvelle qualité, dans cette phase finale de décadence capitaliste. Cette tendance peut être produite par des facteurs matériels et idéologiques - par la dispersion physique des concentrations prolétariennes à la suite de licenciements et de délocalisations massifs, et par l'effort délibéré de divisions entre travailleurs (nationales, raciales, religieuses, etc.) ; par la concurrence pour l'emploi ou les avantages sociaux et par les campagnes idéologiques sur les joies de la consommation ou de la démocratie. Mais son effet global est de miner la capacité du prolétariat à se considérer comme une classe avec des intérêts spécifiques, à se rassembler comme une classe contre le capital. Ceci est intimement lié à la diminution des luttes de la classe ouvrière au cours des trois dernières décennies.
La minorité révolutionnaire, en tant que partie de la classe, n'est pas épargnée par les pressions d'un système social en désintégration qui n'a manifestement aucun avenir. Pour les révolutionnaires, le principe de l'association s'exprime dans la formation d'organisations révolutionnaires et l'engagement dans des activités militantes organisées. La tendance contraire est la fuite vers des solutions individuelles, vers une perte de confiance dans l'activité collective, la méfiance envers les organisations révolutionnaires et le désespoir face à l'avenir. Quand le bloc de l'Est s'est effondré et que la perspective d'une profonde baisse de la lutte de classe a commencé à se manifester, notre camarade Marc Chirik, qui avait vécu toute la force de la période de contre-révolution et avait résisté à son impact par son activité militante dans les fractions de la Gauche Communiste, a dit un jour : "Maintenant nous allons voir qui sont les vrais militants". Malheureusement, Marc, décédé en 1990, n’est plus là pour nous aider à nous adapter à des conditions où nous nageons souvent à contre-courant, même s'il a certainement tout fait pour nous transmettre les principes organisationnels à même de constituer les meilleurs moyens de défense face aux tempêtes à venir.
Dans la première partie de cet article, nous avons déjà expliqué que les crises sont un produit inévitable de la situation des organisations révolutionnaires dans la société capitaliste, du bombardement incessant de l'idéologie bourgeoise sous ses diverses formes. Le CCI s'est toujours ouvert de ses propres difficultés et divergences internes, même s’il vise à les présenter de manière cohérente plutôt que de chercher à simplement "tout mettre sur la table". Et nous avons également insisté sur le fait que les crises devraient toujours obliger l'organisation à en tirer des leçons et à renforcer ainsi son propre arsenal politique.
La décomposition progressive de la société capitaliste tend à rendre ces crises plus fréquentes et plus dangereuses. Cela a certainement été le cas au CCI dans les années 90 et au début de ce siècle. Entre 1993 et 1995, nous avons fait face à la nécessité de nous confronter aux activités d'un clan qui s'était profondément enraciné dans l'organe central international du CCI, une "organisation au sein de l'organisation" qui avait une étrange ressemblance avec la Fraternité internationale des bakouninistes au sein de la Première Internationale, y compris le rôle prépondérant joué par un aventurier politique, JJ, imprégné des pratiques manipulatrices de la franc-maçonnerie. De telles prédilections pour l'occultisme étaient déjà une expression de la puissante marée d'irrationalité qui tend à balayer la société de nos jours. En même temps, la formation de clans au sein d'une organisation révolutionnaire, quelle que soit leur idéologie spécifique, est parallèle à la recherche de fausses communautés qui est une caractéristique sociale beaucoup plus large de cette période.
La réponse du CCI à ces phénomènes a été de les mettre en lumière et d'approfondir sa connaissance quant à la manière dont le mouvement marxiste s'était historiquement défendu contre eux. Nous avons ainsi produit un texte d'orientation sur le fonctionnement qui s'enracine dans les batailles organisationnelles de la Première Internationale et du POSDR, Parti ouvrier social-démocrate de Russie[3], et une série d'articles sur la lutte historique contre le sectarisme, l'aventurisme, la franc-maçonnerie, le parasitisme politique[4]. Ces articles ont en particulier identifié Bakounine en tant qu’exemple de l'aventurier déclassé qui utilise le mouvement ouvrier comme tremplin pour ses propres ambitions personnelles, et la Fraternité internationale en tant qu’exemple précoce du parasitisme politique - d'une forme d'activité politique qui, tout en travaillant en surface pour la cause révolutionnaire, mène un travail de dénigrement et de destruction qui ne peut servir que l'ennemi de classe.
Le but de ces textes n'était pas seulement d'armer le CCI contre les risques d’infection par la moralité et les méthodes de classes qui sont étrangères au prolétariat, mais de stimuler aussi un débat au sein de tout le milieu prolétarien autour de ces questions. Malheureusement, nous n'avons reçu que peu ou pas de réponse à ces contributions de la part des groupes sérieux du milieu, tels que le BIPR, qui avait tendance à les considérer seulement comme d’étranges chevaux de bataille du CCI. Ceux qui étaient déjà ouvertement hostiles au CCI - comme les restes du Communist Bulletin Group (CBG) s'en sont emparés comme preuve finale que le CCI avait dégénéré en une secte bizarre qui devait être évitée à tout prix[5]. Nos efforts pour fournir un cadre clair afin de comprendre le phénomène croissant du parasitisme politique - les thèses sur le parasitisme publiées en 1998[6] - ont suscité le même genre de réactions. Et très vite, le manque de compréhension de ces problèmes par le milieu ne s'est pas seulement traduit par une attitude de neutralité à l'égard d'éléments qui ne peuvent que jouer un rôle destructeur envers le mouvement révolutionnaire. Comme nous le verrons, il a conduit de la "neutralité" à la tolérance, puis à une coopération active avec ces éléments.
Le développement du parasitisme politique
Au début des années 2000, le CCI a de nouveau été confronté à une grave crise interne. Un certain nombre de militants de l'organisation, toujours membres de l'organe central international, qui avaient joué un rôle actif dans la dénonciation des activités du clan JJ, se sont regroupés en un nouveau clan qui reprenait certains des thèmes du précédent, notamment en ciblant des camarades qui avaient défendu le plus fermement les principes organisationnels, voire en diffusant des rumeurs selon lesquelles l'un d'entre eux était un agent de l'État manipulant les autres.
La "Fraction interne du courant communiste international" (FICCI) a amplement démontré depuis lors qu'il existe souvent une ligne de démarcation mince entre l'activité d'un clan au sein de l'organisation et celle d'une organisation parasitaire à part entière. Les éléments qui ont formé la FICCI ont été exclus du CCI pour des agissements indignes de militants communistes, notamment le vol des fonds de l'organisation et la publication d'informations internes sensibles qui auraient pu mettre nos militants en danger vis-à-vis de la police. Depuis lors, ce groupe, qui a ensuite changé de nom pour devenir le Groupe International de la Gauche Communiste, a donné de nouvelles preuves qu'il incarne une forme de parasitisme si féroce qu'il est impossible de le distinguer des activités de la police politique. En 2014, nous avons été obligés de dénoncer publiquement ce groupe qui avait à nouveau réussi à voler du matériel interne au CCI et qui cherchait à l'utiliser pour dénigrer notre organisation et ses militants[7].
Il est clair qu'un groupe qui se comporte de cette manière est un danger pour tous les révolutionnaires, quelles que soient les positions politiques formellement correctes qu'il défend. La réponse d'un milieu communiste qui comprendrait la nécessité d'une solidarité entre ses organisations serait d'exclure du camp prolétarien de telles pratiques et ceux qui s'y livrent ; il faudrait à tout le moins renouveler les traditions du mouvement ouvrier pour qui ce type de comportement, ou, des accusations contre la probité d'un militant ou d'une organisation révolutionnaire exigeaient la formation d'un "Jury d'honneur" pour établir la vérité sur ces conduites ou accusations[8] . En 2004, cependant, une série d'événements que nous avons appelés l'affaire "Circulo" a montré à quel point le mouvement politique prolétarien actuel s'est éloigné de ces traditions.
En 2003, le CCI est entré en contact avec un nouveau groupe en Argentine, le Nucleo Comunista Internationalista (NCI). Après d'intenses discussions avec le CCI, il y a eu un rapprochement incontestable vers les positions de notre organisation et la question de former éventuellement une section du CCI en Argentine a été posée. Cependant, un membre de ce groupe, que nous avons appelé "B", détenait le monopole de l'équipement informatique à la disposition des camarades et donc de la communication avec d'autres groupes et individus, et il était devenu clair au cours de nos discussions que cet individu se considérait comme une sorte de gourou politique qui s'était arrogé la tâche de représenter le NCI dans son ensemble. Lors de la visite de la délégation du CCI en 2004, B" a demandé que le groupe soit immédiatement intégré au CCI. Nous avons répondu que nous étions avant tout intéressés à la clarté politique et non à la création de franchises commerciales et qu'il fallait encore beaucoup de discussions avant qu'une telle étape puisse être franchie. Son ambition d'utiliser le CCI comme tremplin pour son prestige personnel ainsi contrarié, B a alors fait volte-face en adoptant un brusque revirement : à l'insu des autres membres du NCI, il est entré en contact avec la FICCI et, avec leur soutien, il a soudain déclaré que le NCI avait rompu avec le CCI à cause de ses méthodes staliniennes et avait formé un nouveau groupe, le Circulo de Comunistas Internacionalistas. Jubilation de la part de la FICCI qui s'est fait une joie de publier cette grande nouvelle dans son bulletin. Mais le pire, c'est que le BIPR - qui était aussi entré en contact avec la FICCI, sans doute flatté par la déclaration de cette dernière selon laquelle, maintenant que le CCI avait complètement dégénéré, il était devenu le véritable pôle du regroupement des révolutionnaires - a également publié la déclaration du Circulo sur son site Internet, en trois langues.
La réponse du CCI à cette lamentable affaire a été très circonstanciée. Après avoir établi les faits - que le nouveau groupe était en fait une pure invention de B, et que les autres membres du NCI n'avaient rien su de la prétendue scission avec le CCI - nous avons écrit une série d'articles dénonçant le comportement aventurier de B, l'activité parasitaire de la FICCI - et l'opportunisme du BIPR, qui était prêt à prendre tout un tas de calomnies contre le CCI au pied de la lettre, sans aucune tentative d'enquête, et avec l'idée de démontrer que "quelque chose bouge en Argentine " - loin du CCI mais dans leur direction du BIPR. Ce n'est que lorsque le CCI a formellement prouvé que B était effectivement un imposteur politique, et lorsque les camarades du NCI eux-mêmes ont nié avoir rompu avec le CCI, que le BIPR a discrètement supprimé les documents du Circulo de son site Web, sans donner aucune explication et encore moins fait aucune forme d’autocritique. Une attitude tout aussi ambiguë s'est manifestée à peu près à la même période lorsqu'il est devenu évident que le BIPR avait utilisé une liste d'adresses volées par la FICCI lors de son expulsion du CCI pour annoncer une réunion publique du BIPR à Paris[9].
Cette affaire démontre que le problème du parasitisme politique n'est pas une simple invention du CCI, et encore moins un moyen de faire taire ceux qui s'opposent à nos analyses, comme cela a été affirmé. C'est un réel danger pour la santé du milieu prolétarien et un sérieux obstacle à la formation du futur parti de classe. C'est ce que concluent nos thèses sur le parasitisme :
- "Ce qui était valable au moment de l’AIT le reste aujourd’hui. La lutte contre le parasitisme constitue une des responsabilités essentielles de la Gauche communiste. Elle se rattache étroitement à la tradition de ses combats acharnés contre l’opportunisme. Elle est, à l’heure actuelle, une des composantes fondamentales pour la préparation du parti de demain et conditionne en partie, de ce fait, tant le moment où celui-ci pourra surgir que sa capacité à jouer son rôle lors des luttes décisives du prolétariat ".
Les groupes parasites ont pour fonction de semer la division dans le camp prolétarien en répandant des rumeurs et des calomnies, en y introduisant des pratiques étrangères à la morale prolétarienne, comme le vol et les manœuvres en coulisse. Le fait que leur principal objectif ait été de construire un mur autour du CCI, de l'isoler des autres groupes communistes et d’empêcher des éléments émergents de s’engager avec nous ne signifie pas qu'ils ne font que nuire au CCI - tout le milieu et sa capacité à coopérer en vue de former le parti du futur sont affaiblis par leur activité. De plus, comme leurs attitudes nihilistes et destructrices sont le reflet direct du poids croissant de la décomposition sociale, on peut s'attendre à ce qu'elles soient de plus en plus présentes dans la période à venir, surtout si le milieu prolétarien reste ouvert au danger qu'elles représentent.
2004-2011 : l'émergence de nouvelles forces politiques et les difficultés rencontrées
L'article sur notre expérience avec le NCI traite de la relance de la lutte de classe et de l'apparition de nouvelles forces politiques. Le CCI avait noté des signes de cette reprise en 2003, mais la preuve la plus claire que quelque chose était en train de changer était la lutte des étudiants contre la loi sur le Contrat Première Embauche (CPE) en France en 2006, un mouvement qui montrait une réelle capacité d'auto-organisation en assemblées et qui menaçait de s'étendre aux secteurs salariés, obligeant ainsi le gouvernement à annuler le CPE. La même année, la forme "assemblée" a été adoptée par les sidérurgistes de Vigo qui ont également montré une réelle volonté d'intégrer d'autres secteurs dans le mouvement. Et à la suite du krach financier de 2008, en 2010, nous avons assisté à une lutte importante des étudiants universitaires et du secondaire autour des frais d’inscription et des bourses au Royaume-Uni, et à un mouvement contre les "réformes" des retraites en France. L'année suivante, 2011, a vu l'éclatement du "printemps arabe", une vague de révoltes sociales où l'influence du prolétariat variait d'un pays à l'autre mais qui, en Egypte, en Israël et ailleurs a donné au monde l'exemple de l'occupation des places publiques et de la tenue d’assemblées régulières - un exemple repris par le mouvement Occupy aux Etats-Unis, par les assemblées en Grèce et de façon plus importante encore par le mouvement des Indignados en Espagne. Ce dernier, en particulier, a jeté les bases d'un certain degré de politisation à travers des débats animés sur l'obsolescence du capitalisme et la nécessité d'une nouvelle forme de société.
Cette politisation à un niveau plus général s'est accompagnée de l'apparition de nouvelles forces à la recherche de réponses révolutionnaires à l'impasse de l'ordre social. Un certain nombre de ces forces était orienté vers les positions et les organisations de la Gauche Communiste. Deux groupes différents de Corée du Sud ont été invités aux congrès du CCI durant cette période, ainsi que le groupe EKS de Turquie et de nouveaux contacts aux États-Unis. Des discussions ont commencé avec des groupes ou cercles de discussion en Amérique du Sud, dans les Balkans et en Australie ; certains de ces groupes et cercles sont devenus de nouvelles sections du CCI (Turquie, Philippines, Équateur, Pérou). La TCI a également gagné de nouvelles forces depuis de cette période.
Il y a eu aussi un développement important d'un courant internationaliste dans l'anarchisme, qui s'est manifesté par exemple dans les discussions sur le forum internet libcom, et dans la croissance de nouveaux groupes anarcho-syndicalistes qui ont critiqué le syndicalisme "institutionnalisé" d'organisations comme la CNT.
Le CCI a réagi le plus largement possible à ces développements, ce qui était absolument nécessaire : sans transmettre l'héritage de la Gauche Communiste à une nouvelle génération, il ne peut y avoir aucun espoir d'un mouvement vers le parti du futur.
Mais il y avait d'importantes faiblesses dans notre intervention. Quand nous disons que l'opportunisme et le sectarisme sont des maladies du mouvement ouvrier, le résultat de la pression constante de l'idéologie des autres classes sur le prolétariat et ses organisations politiques, nous ne l'utilisons pas seulement comme un moyen de critiquer d'autres organisations, mais comme une moyen d’évaluer notre propre capacité à résister à cette pression et à maintenir les méthodes et acquis de la classe ouvrière dans toutes les dimensions de notre activité.
La section turque du CCI, intégrée en 2009, a quitté le CCI en 2015 pour former un groupe de courte durée, Pale Blue Jadal. Dans notre tentative de dresser le bilan de cet échec, nous avons mis en lumière nos propres erreurs opportunistes dans le processus de leur intégration :
- "Notre intégration du groupe EKS en tant que section turque du CCI a été un processus infesté d'opportunisme. Nous ne proposons pas ici de préciser les raisons de cette situation : il suffit de dire que nous avons essayé de forcer le rythme de l'histoire, et c'est une recette classique de l'opportunisme.
Forcer le rythme, bien sûr, c'était à notre propre niveau ; cela signifiait principalement de décider d'accélérer les discussions avec le groupe EKS, qui allait devenir notre section en Turquie. En particulier, nous avons décidé :
- 1. De réduire drastiquement le temps consacré aux discussions organisationnelles avec les membres d'EKS avant leur intégration, au motif que l'art de construire une organisation s'apprend essentiellement par l'expérience.
- 2. D’intégrer l'EKS en tant que groupe et non en tant qu'individus. Bien que nos statuts le prévoient, il y a le danger que les nouveaux militants se voient, non pas d'abord et avant tout comme des militants individuels d'une organisation internationale, mais comme des membres de leur groupe d'origine"[10].
Comme nous l'avons fait valoir dans la première partie de cet article, opportunisme et sectarisme vont souvent de pair. Et, rétrospectivement, certains éléments de notre réponse à l'affaire Circulo peuvent certainement être considérés comme sectaires. Compte tenu d'une part de l'émergence de nouvelles forces politiques, d'autre part des dernières preuves de la difficulté du BIPR à se comporter selon des principes clairs et du sectarisme inaltérablement rigide des bordiguistes, le CCI avait une certaine tendance à conclure que le "vieux milieu" était déjà épuisé et que nos espoirs pour l'avenir devaient reposer sur ces nouvelles forces que nous commençons à rencontrer.
C'était le côté sectaire de notre réaction. Mais encore une fois, il avait aussi un côté opportuniste. Pour convaincre le nouveau milieu que nous n'étions pas sectaires, en 2012 nous avons fait de nouvelles ouvertures à la TCI, plaidant pour une reprise des discussions et des travaux communs qui avaient été perturbés depuis l'échec des conférences internationales au début des années 80. C'était correct en soi et c'était la continuation d'une politique que nous avions menée, sans grand succès, tout au long des années 80 et 90[11]. Mais pour lancer ce processus, nous avons accepté à première vue l'explication que la TCI a fournie concernant son comportement dans l'affaire Circulo : qu’il s’agissait essentiellement de l'œuvre d'un camarade qui était mort par la suite. Mis à part la moralité douteuse d'une telle approche de sa part, elle n'a apporté absolument aucune clarification de la part de la TCI sur sa volonté de renoncer à former une alliance avec des éléments qui n'avaient pas vraiment leur place dans le milieu prolétarien. Et à la fin, les discussions que nous avons entamées avec la TCI se sont vite enlisées sur ce fossé jusqu'ici infranchissable de la question du parasitisme - la question de savoir quels groupes et éléments peuvent être considérés comme des composantes légitimes de la Gauche Communiste. Et ce n'était pas le seul exemple d'une tendance du CCI à mettre de côté cette question vitale parce qu'elle était résolument impopulaire dans le milieu prolétarien. Elle comprenait également l'intégration de l'EKS qui n'a jamais été d'accord avec nous sur la question du parasitisme, et des approches auprès de groupes que nous considérions nous-mêmes comme parasites, tels que le CBG (approches qui ne mènent nulle part).
Les articles du CCI de cette période montrent un optimisme compréhensible quant au potentiel des nouvelles forces (voir par exemple l'article sur notre 18e congrès[12]). Mais il y avait en même temps une sous-estimation de beaucoup des difficultés de ces nouveaux éléments qui étaient apparus dans la phase de décomposition.
Comme nous l'avons dit, un certain nombre d'éléments issus de cette recrudescence se sont dirigés vers la Gauche Communiste et certains ont été intégrés dans ses principales organisations. Dans le même temps, nombre de ces éléments n'ont pas survécu très longtemps - non seulement la section turque du CCI, mais aussi le NCI, le groupe de discussion formé en Australie[13], et un certain nombre de contacts qui sont apparus aux États-Unis. Plus généralement, l'influence de l'anarchisme sur cette nouvelle vague d'éléments "en recherche" a été omniprésente, exprimant dans une certaine mesure le fait que le traumatisme du stalinisme et l'impact qu'il a eu sur la notion d'organisation politique révolutionnaire étaient encore un facteur opérationnel dans la deuxième décennie après l'effondrement du bloc russe.
Le développement du milieu anarchiste à cette époque n'a pas été entièrement négatif. Par exemple, le forum Internet libcom, qui a fait l'objet de nombreux débats politiques internationaux au cours de la première décennie de son existence, était dirigé par un collectif qui avait tendance à rejeter le gauchisme et les formes de mode de vie anarchiste et à défendre certaines des bases de l'internationalisme. Certains d'entre eux étaient issus de l'activisme superficiel du milieu "anticapitaliste" des années 1990 et avaient commencé à considérer la classe ouvrière comme la force du changement social. Mais cette quête a été en grande partie bloquée par le développement de l'anarcho-syndicalisme, qui réduit la reconnaissance tout à fait valable du rôle révolutionnaire de la classe ouvrière à une perspective économique incapable d'intégrer la dimension politique de la lutte de classe, et qui remplace l'activisme limité à la rue par l'activisme au travail (la notion de formation des "organisateurs" et de "syndicats révolutionnaires"). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce milieu a aussi été influencé par les théories de la "communisation", qui est l'expression très explicite d'une perte de conviction que le communisme ne peut se réaliser que par la lutte de la classe ouvrière. Mais le paradoxe est plus apparent que réel, puisque le syndicalisme et la communisation reflètent une tentative de contourner la réalité qu'une lutte révolutionnaire est aussi une lutte pour le pouvoir politique, et exige la formation d'une organisation politique prolétarienne. Plus récemment, libcom et d'autres expressions du mouvement anarchiste ont été aspirées dans diverses formes de politique identitaire, ce qui constitue la poursuite de l'éloignement par rapport à un point de vue prolétarien[14]. Pendant ce temps, d'autres secteurs du mouvement anarchiste ont été complètement aspirés par les prétentions du nationalisme kurde d'avoir établi une sorte de Commune révolutionnaire à Rojava.
Il faut dire aussi que le nouveau milieu - et même les groupes révolutionnaires établis - avaient peu de défenses contre l'atmosphère morale délétère de la décomposition et en particulier l'agression verbale et les attitudes qui infestent souvent les réseaux sociaux. Sur libcom, par exemple, les membres et sympathisants des groupes communistes de Gauche, et du CCI en particulier, ont dû se battre avec acharnement pour franchir un mur d'hostilité dans lequel les calomnies des groupes parasites comme le CBG étaient généralement considérées comme allant de soi. Et alors que certains progrès au niveau de la culture du débat semblaient se produire dans les premières années de libcom, l'atmosphère s'est nettement détériorée à la suite de l’implication du "collectif libcom" dans le scandale "Aufhebengate". À cette occasion, la majorité du collectif a adopté une attitude de clique en défendant un de ses amis du groupe Aufheben qui avait clairement montré avoir coopéré avec les stratégies policières contre des manifestations de rue[15].
D'autres exemples de ce type de décadence morale parmi ceux qui professent la cause du communisme pourraient être donnés, le membre du groupe de communisateurs grec, Blaumachen, qui est devenu ministre du gouvernement SYRIZA étant peut-être l'un des plus évidents[16]. Mais les groupes de la Gauche Communiste n'ont pas été épargnés par ces difficultés non plus : nous avons déjà mentionné les alliances douteuses que le BIPR a établies avec certains groupes parasites. Et plus récemment, le BIPR a d'abord été contraint de dissoudre sa section au Canada qui avait adopté une attitude apologétique envers l'un de ses membres qui s'était livré à des abus sexuels, tandis qu'un groupe de sympathisants grecs s'est soudainement retrouvé dans le nationalisme le plus féroce face à la crise de l'immigration[17]. Et le CCI lui-même a connu ce que nous avons appelé une "crise morale et intellectuelle" lorsque l'une de nos camarades, parmi les plus déterminés dans son opposition aux politiques opportunistes que nous avions adoptées dans certaines de nos activités (et qui avait été auparavant la cible des clans des années 90), a été soumise à une campagne la prenant comme "bouc émissaire"[18]. Un "Jury d'honneur" constitué au sein de l'organisation a estimé que toutes les charges retenues contre elle étaient nulles et non avenues.
Ces événements démontrent que la question du comportement, de l'éthique et de la morale a toujours été un élément clé dans la construction d'une organisation révolutionnaire digne de ce nom. Le mouvement révolutionnaire ne pourra pas surmonter ses divisions sans affronter cette question.
Problèmes contemporains et perspectives futures
Les signes d'une relance de la lutte de classe apparue en 2006-2011 ont été largement éclipsés par une vague réactionnaire qui s'est traduite par la montée du populisme et l'installation d'une série de régimes autoritaires, notamment dans un pays comme l'Egypte qui était au centre du "printemps arabe". La résurgence du chauvinisme et de la xénophobie a touché certains des domaines-mêmes où, en 2011, les premiers signes d'une nouvelle floraison internationaliste semblaient apparaître, notamment la vague du nationalisme en Catalogne, qui auparavant avait été au cœur du mouvement des Indignados. Et si la montée du nationalisme met en évidence le danger des conflits impérialistes sanglants dans la période à venir, elle souligne également l'incapacité totale du système existant, déchiré par la rivalité et la concurrence, à faire face à la menace croissante de destruction de l'environnement. Tout cela contribue à créer un climat généralisé de déni de l'avenir apocalyptique que nous réserve le capitalisme, ou de nihilisme et de désespoir.
Bref, le sombre climat social et politique ne semble pas propice au développement d'un nouveau mouvement révolutionnaire, qui ne peut être présagé que par la conviction qu'un avenir alternatif est possible.
Et encore une fois, peu de progrès ont été réalisés dans l'amélioration des relations entre les groupes communistes existants, où il semble qu'à un pas en avant succèdent deux pas en arrière : ainsi, si en novembre 2017 la CWO a accepté l'invitation du CCI pour faire une présentation lors de notre journée de discussion sur la révolution d'Octobre, depuis lors ils ont constamment rejeté toute autre initiative de ce type.
Cela signifie-t-il, comme l'a récemment affirmé un membre de la CWO, que le CCI est démoralisé et pessimiste quant à l'avenir de la lutte des classes et au potentiel pour la formation du parti de demain ? [19]
Nous ne voyons certainement aucun sens à nier les difficultés bien réelles auxquelles la classe ouvrière est confrontée et à développer une présence communiste en son sein. Une classe qui a de plus en plus perdu le sens de sa propre existence en tant que classe n'acceptera pas facilement les arguments de ceux qui, contre toute attente, continuent d'insister sur le fait que le prolétariat non seulement existe mais détient la clé de la survie de l'humanité.
Et pourtant, malgré les dangers très tangibles de cette dernière phase de décadence capitaliste, nous ne pensons pas que la classe ouvrière ait dit son dernier mot. Il reste un certain nombre d'éléments indiquant les possibilités d'un éventuel rétablissement de l'identité et de la conscience de classe parmi les nouvelles générations du prolétariat, comme nous l'avons affirmé lors de notre 22e Congrès dans notre résolution sur la lutte de classe internationale[20].
Et nous assistons également à un nouveau processus de politisation communiste au sein d'une minorité, petite mais significative, de cette nouvelle génération, qui prend souvent la forme d'une interaction directe avec la Gauche Communiste. Des personnes en quête d'éclaircissements ainsi que de nouveaux groupes et cercles sont apparus aux Etats-Unis en particulier, mais aussi en Australie, en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud, C'est un véritable témoignage de la capacité de la "vieille taupe" de Marx à continuer à avancer sous la surface des événements.
Comme les nouveaux éléments apparus il y a une dizaine d'années, ce nouveau milieu est confronté à de nombreux dangers, notamment l'offensive diplomatique de certains groupes parasites et l'indulgence des organisations prolétariennes comme le BIPR à leur égard. Il est particulièrement difficile pour beaucoup de ces jeunes camarades de comprendre le caractère nécessairement à long terme de l'engagement révolutionnaire et la nécessité d'éviter l'impatience et les précipitations. Si leur apparence exprime un potentiel qui réside encore profondément dans les entrailles de la classe ouvrière, il est vital pour eux de reconnaître que leurs débats et activités actuels n'ont de sens que dans le cadre d'un travail vers l'avenir. Nous reviendrons sur cette question dans de prochains articles.
De toute évidence, les organisations existantes de la Gauche Communiste ont un rôle clé dans la lutte pour l'avenir à long terme de ces nouveaux camarades. Et ceux-ci ne sont pas à l'abri des dangers, comme nous l'avons déjà mentionné à propos de la vague précédente d'"éléments de recherche". En particulier, ils doivent éviter de courtiser toute popularité facile en évitant de discuter de questions difficiles ou d'édulcorer leurs positions dans le but de "gagner un public plus large". Une tâche centrale des organisations communistes existantes est fondamentalement la même que celle des Fractions qui se sont détachées de l'Internationale Communiste en dégénérescence afin de jeter les bases d'un nouveau parti lorsque les facteurs objectifs et surtout les facteurs subjectifs de la situation auront mis cela à l'ordre du jour : un combat intransigeant contre l'opportunisme sous toutes ses formes, et pour une rigueur maximale dans le processus de clarification politique.
Amos
[1] Voir par exemple: Revue internationale n° 55, "Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR [122]" ; Revue internationale n° 56 "Vingt ans depuis 1968 : l'évolution du milieu politique depuis 1968 (3ème partie) [123]".
[2] Voir par exemple le "Rapport sur la lutte des classes au 21e congrès du CCI [124]", dans la Revue internationale n° 156.
[3] Revue internationale n° 109, La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI [125].
[4] Publié dans les numéros 84, 85, 87, 88 de la Revue internationale.
[5] Revue internationale n° 83, Parasitisme politique : le “C.B.G” fait le travail de la bourgeoisie.
[6] Revue internationale n° 94, Thèses sur le parasitisme [23].
[8] Le jury d’honneur : une arme pour la défense des organisations révolutionnaires (Partie 1) [126] ; Le jury d’honneur : une arme pour la défense des organisations révolutionnaires (Partie 2) [126]
[9] Sur l’affaire Circulo , voir par exemple la Revue internationale n°120, Le Núcleo Comunista Internacional : Un effort de prise de conscience du prolétariat en Argentine [27] ; la Revue internationale n° 121, Polémique avec le BIPR : Une politique opportuniste de regroupement qui ne conduit qu'à des "avortements" [127].
[11] Par exemple, les appels au milieu prolétarien lancés par nos congrès de 1983, 1991 et 1999, ces deux derniers ont accompagné une proposition d'intervention conjointe contre les guerres dans le Golfe et dans les Balkans ; la tenue d'une réunion commune sur la révolution russe en 1997, etc.
[12] Revue Internationale n° 138 : 18e congrès du CCI : vers le regroupement des forces internationalistes [129].
[14] Lire en anglais On recent attacks on the ICC on libcom [131]
[15] Lire en anglais Aufhebengate [132]
[16] Lire en anglais "Dialectical delinquents".
[17] Lire en anglais ICT Statement on the Dissolution of the GIO [133]
[18] Revue internationale n° 153, Conférence internationale extraordinaire du CCI : la "nouvelle" de notre disparition est grandement exagérée! [1]
[19] "Et où en est le CCI aujourd'hui ? Est-il le vestige démoralisé et vaincu d'une organisation autrefois plus grande, construite sur l'illusion que la révolution était à nos portes. Aujourd'hui, il se console en parlant de chaos et de décomposition (ce qui est vrai mais est le résultat de la crise capitaliste qui s'aggrave et non d'une paralysie de la lutte des classes comme le soutient le CCI). Quand le CCI affirme qu'aujourd'hui ils ne sont qu'une "fraction" (et ment ouvertement en disant que cela n'a toujours été qu'une fraction !), ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a rien à faire sinon écrire de stupides polémiques contre d'autres organisations (mais cela a été la méthode du CCI depuis 1975)". Article signé par la rédactrice en chef du forum, Cleishbotham, sur le forum BIPR à la suite d'une discussion sur le rapport de forces entre les classes avec un sympathisant du CCI : The Party, Fractions and Periodisation [134].
[20] Revue internationale n° 159, "22ème congrès du CCI : Résolution sur la lutte de classe internationale [135]"
Structure du Site:
- Séries [136]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [137]
Rubrique:
Revue Internationale n°167
- 304 lectures
Comprendre la situation historique et préparer l'avenir
- 153 lectures
Malgré les difficultés occasionnées par la Pandémie, le CCI a tenu son 24e congrès international et nous tirons un bilan positif de celui-ci. Comme nous l'avons toujours fait, et conformément à la pratique du mouvement ouvrier, nous rendons compte de ses travaux par cette prise de position globale et à travers un ensemble de documents qui vont orienter notre activité et intervention durant les deux années à venir, rapports et résolution dont la publication a déjà été effectuée depuis plusieurs mois sur notre site Internet1. Le congrès s'est tenu avec la pleine conscience de la part de ses participants de la gravité de la situation mondiale, du fait en particulier de la persistance de l'une des pandémies les plus dangereuses de l'histoire qui est loin d'être surmontée.
Le pire serait de sous-estimer cette situation alors que, d'une part, les gouvernements proclament que "tout est sous contrôle" et que "nous sommes revenus à la normale", et d'autre part, la horde des négationnistes et antivacs (l'autre face, également mensongère, des mensonges des gouvernements) qui nient la réalité de la pandémie en parlant de "conspirations", de "sombres manœuvres", et utilisent un fait réel -le renforcement du contrôle totalitaire de l'État- pour le monter en épingle au nom de la "défense des libertés démocratiques" dissimulant ainsi l'importance des dangers que la pandémie fait courir à la vie humaine[1]. Le plus grave de la pandémie réside dans la manière dont tous les États ont réagi : de façon totalement irresponsable, en prenant des mesures contradictoires et chaotiques, sans le moindre plan, sans aucune coordination, en jouant plus cyniquement que jamais avec la vie de millions de personnes[2]. Et cela ne s'est pas produit dans les États habituellement qualifiés de "voyous", mais aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, les pays les plus "avancés", qui se prétendent à l'avant-garde de la "civilisation et du progrès". La pandémie a mis en évidence la décadence et la décomposition du capitalisme, la pourriture de ses structures sociales et idéologiques, le désordre et le chaos qui émanent de ses rapports de production, l'absence d'avenir d'un mode de production en proie à des contradictions de plus en plus violentes qu'il ne peut surmonter. Pire encore : ce que la pandémie annonce, ce sont de nouvelles convulsions plus profondes dans tous les pays, des tensions impérialistes, la destruction écologique, la crise économique... Le prolétariat mondial ne peut pas être dupé par de vagues promesses de "retour à la normale". Il a besoin de voir la réalité en face, de comprendre que le visage de la barbarie a été clairement dessiné par la pandémie et le sera avec encore plus de virulence dans les temps à venir.
L'accélération de la décomposition capitaliste
Le 24e congrès du CCI s'est déroulé, comme les congrès des organisations révolutionnaires à travers l'histoire, dans un contexte de fraternité et de débat profond. Il avait la responsabilité de confirmer le cadre d'analyse sur la décomposition du capitalisme, en rectifiant les éventuelles erreurs ou les évaluations insuffisamment élaborées. Le congrès a répondu à une série de questions nécessaires :
- La notion de décomposition et son élaboration progressive est-elle pleinement conforme à la méthode du marxisme ?
- Comment se manifestent les effets de la décomposition, de leur accélération et de leur accumulation, et de leur interaction avec les autres plans de la vie sociale, principalement l'économie ?
- Comment les effets de la décomposition affectent-ils la lutte de classe et quelle est la perspective de celle-ci ?
- Enfin, quel est le rôle de l'organisation des révolutionnaires dans cette situation et comment prépare-t-elle l'avenir face à ces défis ?
La méthode d'analyse de la décomposition capitaliste
Ce congrès a confirmé que l'analyse de la décomposition se situait dans la continuité du marxisme. En 1914, avec la Première Guerre mondiale, les marxistes avaient identifié l'entrée du capitalisme dans son époque de décadence, une analyse confirmée en 1919 par l'Internationale communiste, "l'époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur" (Plateforme de l'IC). Fidèle à cette démarche, le CCI a identifié il y a plus de trois décennies l'entrée dans une phase spécifique et ultime de la décadence du capitalisme : celle de sa décomposition. Cette phase de décomposition se caractérise par l'accumulation d'un ensemble de contradictions que la société capitaliste a été incapable de résoudre, comme le point 3 des Thèses de la décomposition[3] l'explicite : "Dans la mesure où les contradictions et manifestations de la décadence du capitalisme qui, successivement, marquent les différents moments de cette décadence, ne disparaissent pas avec le temps, mais se maintiennent, et même s'approfondissent, la phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l'accumulation de toute ces caractéristiques d'un système moribond, celle qui parachève et chapeaute trois quarts de siècle d'agonie l'un mode de production condamné par l'histoire. Concrètement, non seulement la nature impérialiste de tous les États, la menace de guerre mondiale, l'absorption de la société civile par le Moloch étatique, la crise permanente de l'économie capitaliste, se maintiennent dans la phase de décomposition, mais cette dernière se présente encore comme la conséquence ultime, la synthèse achevée de tous ces éléments". Cette analyse que nous avons effectuée il y a 30 ans a été confirmée avec une force et une gravité extrêmes qui nous a amenés à conclure dans la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI : "la plupart des développements importants des trois dernières décennies ont en effet confirmé la validité de ce cadre, comme en témoignent l'exacerbation du chacun-pour-soi au niveau international, le "rebond" des phénomènes de décomposition vers les centres du capitalisme mondial à travers le développement du terrorisme et la crise des réfugiés, la montée du populisme et la perte de contrôle politique de la classe dirigeante, la putréfaction progressive de l'idéologie à travers la propagation de la recherche du bouc émissaire, du fondamentalisme religieux et des théories du complot (.) la pandémie actuelle de Covid-19 est la distillation de toutes les manifestations-clés de la décomposition, et un facteur actif de son accélération[4]". Depuis que notre congrès a conclu ses travaux, les événements se sont succédés avec une virulence sans précédent, confirmant clairement notre analyse : les guerres impérialistes en Éthiopie, en Ukraine, au Yémen, en Syrie..., l'affrontement Etats-Unis/Chine, s'intensifient ; la crise écologique a imprimé une énorme empreinte sur le monde, notamment avec la multiplication des inondations et des incendies catastrophiques. Aujourd'hui, la pandémie connaît une nouvelle flambée de contaminations et fait face à la menace très dangereuse du variant Omicron ; alors qu'en même temps, la crise économique s'aggrave... La défense du cadre marxiste de la décomposition est aujourd'hui plus nécessaire que jamais face à l'aveuglement des autres groupes de la Gauche communiste et à l'infiltration dans le milieu révolutionnaire de toutes sortes de positions modernistes, sceptiques, nihilistes... qui ferment les yeux sur la gravité de la situation. En ce moment, nous voyons se dérouler dans un certain nombre de pays des luttes ouvrières combatives qui ont plus que jamais besoin de la force et de la lucidité de ce cadre d'analyse.
Accumulation et accélération des effets de la décomposition
Le 24e Congrès a pu identifier l'accélération de la décomposition capitaliste en examinant en profondeur les racines et les conséquences de la pandémie : celle-ci, "la première d'une telle ampleur depuis l'épidémie de grippe espagnole de 1918, est le moment le plus important dans l'évolution de la décomposition capitaliste depuis l'ouverture irrémédiable de cette période en 1989. L'incapacité de la classe dirigeante à empêcher les 7 à 12 millions de morts et plus qui en résultent confirme que le système capitaliste mondial, laissé à lui-même, entraîne l'humanité vers l'abîme de la barbarie et vers sa destruction, et que seule la révolution prolétarienne mondiale peut stopper cette dérive et conduire l'humanité vers un autre avenir." (Ibid.) Ainsi, la pandémie a montré et confirmé les réalités suivantes :
- Si le capitalisme est le premier système de l'histoire dont les rapports de production se sont étendus et sont dominants à l'échelle de la planète, il n'en reste pas moins que cette domination est éminemment chaotique car basée sur une compétition à mort pour la domination du marché mondial entre les États capitalistes. Le caractère mondial du capitalisme ne lui permet pas une action organisée et coordonnée à l'échelle mondiale -ce qui serait la seule réponse rationnelle et efficace face à des phénomènes tels que la pandémie de COVID- car il n'est pas unifié et centralisé mondialement. Bien au contraire, la concurrence à mort pour les marchés et pour le contrôle impérialiste du monde l'a conduit à des comportements de plus en plus aberrants et dangereux de la part des États, qui ont laissé les populations sans défense face à la pandémie et l'ont même dramatiquement aggravée. La Chine a délibérément caché le foyer initial de la pandémie à Wuhan pendant deux mois. Par la suite, de grands pays comme les États-Unis ont mis beaucoup de temps à réagir de peur de paralyser leur économie, ce qui a exacerbé la pandémie à des niveaux de risque élevés, obligeant à prendre des mesures extrêmes hâtives et désorganisées telles que le confinement, etc.
- Les États capitalistes, sans exception, ont agi de la même manière contre la classe ouvrière : restrictions sans aucune planification en utilisant la répression ; fermeture des centres d'approvisionnement sans tenir compte des conditions économiques des travailleurs ; maintien des secteurs de production et des services sans tenir compte de la vie des travailleurs, comme cela s'est produit avec les travailleurs de la santé dans tous les pays (d'après Amnesty International, on estimait en mars 2021 que 17 000 travailleurs de santé étaient morts du COVID et que, rien qu'aux États-Unis, 570 000 avaient été infectés[5]).
- La fondation de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), après la Seconde Guerre mondiale, avait permis une certaine coordination entre les États pour lutter contre les épidémies. Cependant, face à la pandémie, l'OMS a été ignorée, chaque État ayant suivi sa propre voie, avec pour conséquence l'envolée des contagions, des décès et l'impossibilité de toute action organisée. C'est une expression claire de l'avancée de la décomposition capitaliste[6].
- La bataille autour de la production et la distribution des vaccins exprime le chaos et la pourriture de la bourgeoisie. Face à la crise économique, de tels conflits d'intérêts immédiats deviendront plus virulents entre les factions bourgeoises.
Notre 24e Congrès a conclu que la pandémie ne peut être réduite à une "calamité" ou considérée uniquement comme une crise sanitaire (dans le style de celles qui se sont produites périodiquement dans les sociétés précapitalistes et dans le capitalisme lui-même au cours du XIXe siècle). C'est une crise globale -sanitaire, économique, sociale et politique, mais aussi morale et idéologique. Il s'agit d'une crise de la décomposition du capitalisme en tant que produit de l'accumulation des contradictions du système au cours des 30 dernières années, comme le met en évidence notre rapport sur la pandémie et la décomposition pour le 24e Congrès[7]. Plus précisément, la pandémie est le résultat :
- Du démantèlement du système de santé dans tous les pays du monde. Depuis le début du 21e siècle, les États capitalistes étaient informés et conscients de la prolifération des épidémies telles que EBOLA, SARS, etc., … Cependant, les budgets ont diminué dans les services de santé et la recherche scientifique. Et dans le même temps s'envolaient les budgets alloués aux armements et au renforcement des forces de répression.
- Les maladies virales, comme le COVID-19, sont également le produit des conditions de vie de larges fractions de la classe ouvrière dans tous les pays, forcées de vivre dans des conditions insalubres et de surpeuplement.
- L'irrationalité de la production capitaliste, qui privilégie exclusivement le profit, ravage les forêts, les rivières, les mers. En particulier, la destruction des forêts altère dangereusement la "chaîne biologique" entre les animaux, les plantes et les humains avec des conséquences imprévisibles... La plupart des scientifiques attribuent l'émergence du COVID 19 à cette cause.
"Le CCI est pratiquement seul à défendre la théorie de la décomposition. D'autres groupes de la Gauche communiste la rejettent complètement, soit, comme dans le cas des Bordiguistes, parce qu'ils n'acceptent pas que le capitalisme puisse être un système en déclin (ou au mieux sont incohérents et ambigus sur ce point) ; soit, comme pour la Tendance Communiste Internationaliste, parce que parler d'une phase "finale" du capitalisme sonne beaucoup trop apocalyptique, soit parce que définir la décomposition comme une descente vers le chaos est une déviation du matérialisme qui, selon eux, cherche à trouver les racines de chaque phénomène dans l'économie et surtout dans la tendance à la baisse du taux de profit " (Idem). La résolution sur les activités du 24e Congrès souligne que "la pandémie de Covid-19 qui a débuté au début de 2020 a confirmé de manière frappante l'accélération de l'impact de la décomposition sociale du capitalisme".
La crise pandémique a révélé une avancée de la décomposition : 1) elle a touché préférentiellement les pays centraux, en particulier les Etats-Unis ; 2) il y a une combinaison et une concomitance entre les différents effets de la décomposition, contrairement aux périodes précédentes où ils étaient localement contenus et ne s'influençaient pas mutuellement. Ce que cette crise annonce, ce sont des convulsions de plus en plus violentes, une accentuation des tendances à la perte de contrôle des États dans les relations sociales. La décennie des années 2020 est pleine de graves incertitudes, faites de catastrophes plus fréquentes et liées entre elles. Le glissement du capitalisme vers la barbarie y revêtira un visage de plus en plus terrifiant.
La perspective de la lutte de classe
- Les perspectives pour le prolétariat doivent être analysées dans le cadre de la décomposition capitaliste. La résolution sur le rapport de forces entre les classes adoptée par notre précédent congrès[8] a identifié les difficultés et les faiblesses de la classe ouvrière au cours des 30 dernières années. Avec l'effondrement du bloc de l'Est, le CCI a identifié l'ouverture de la phase finale de décomposition du capitalisme et ses conséquences sur le prolétariat, en termes de difficultés accrues pour développer ses luttes, difficultés qui ont encore été aggravées par les campagnes de la bourgeoisie sur la "mort du communisme" et sur la "disparition de la classe ouvrière" Cependant, le CCI a pris acte à son 24e Congrès, comme il l'avait fait à ses Congrès précédents, que la classe ouvrière n'est pas vaincue : "Malgré les énormes problèmes auxquels le prolétariat est confronté, nous rejetons l'idée que la classe a déjà été vaincue à l'échelle mondiale, ou qu'elle est sur le point de subir une défaite comparable à celle de la période de contre-révolution, un genre de défaite dont le prolétariat ne serait peut-être plus capable de se remettre. Le prolétariat, en tant que classe exploitée, ne peut éviter de passer par l'école des défaites, mais la question centrale est de savoir si le prolétariat a déjà été tellement submergé par l'avancée implacable de la décomposition que son potentiel révolutionnaire a été effectivement sapé. Mesurer une telle défaite dans la phase de décomposition est une tâche bien plus complexe que dans la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, lorsque le prolétariat s'était levé ouvertement contre le capitalisme et avait été écrasé par une série de défaites frontales"
- Il est clair que nous devons aiguiser nos capacités d'analyse pour détecter cette situation de "non-retour" car "la phase de décomposition contient en effet le danger que le prolétariat échoue tout simplement à répondre et soit étouffé sur une longue période -une "mort par mille coup" plutôt qu'un affrontement de classe frontal".
- Cependant, le congrès a affirmé "qu'il y a encore suffisamment d'éléments qui montrent que, malgré l'avancée incontestable de la décomposition, malgré le fait que le temps ne joue plus en faveur de la classe ouvrière, le potentiel d'une profonde renaissance prolétarienne -menant à une réunification entre les dimensions économiques et politiques de la lutte de classe- n'a pas disparu".
- Le congrès a identifié "Les signes, petits mais significatifs, d'une maturation souterraine de la conscience, se manifestant par une ébauche de réflexion globale sur la faillite du capitalisme et la nécessité d'une autre société dans certains mouvements (notamment les Indignés en 2011), mais aussi par l'émergence de jeunes éléments en recherche de positions de classe et se tournant vers l'héritage de la Gauche communiste".
Nous devons également garder à l'esprit que la situation à laquelle la classe ouvrière est confrontée n'est pas la même que celle qui a suivi l'effondrement du bloc russe et la confirmation de la phase de décomposition en 1989. À cette époque, la bourgeoisie a pu présenter ces événements comme la preuve de la mort du communisme, de la victoire du capitalisme et le début d'un avenir radieux pour l'humanité. Trente années de décomposition ont sérieusement ébranlé cette fraude idéologique, et la pandémie en particulier a mis en évidence l'irresponsabilité et la négligence de tous les gouvernements capitalistes, ainsi que la réalité d'une société en proie à de profondes divisions économiques, dans laquelle nous ne sommes en aucun cas "tous dans le même bateau". Au contraire, la pandémie et le lock-out ont révélé les conditions de la classe ouvrière, à la fois en tant que principale victime de la crise sanitaire et en tant que source de tout le travail et de toute la production matérielle et, en particulier, de tout ce qui concerne la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Cela peut être la base d'une future réappropriation de son identité de classe par le prolétariat. Et, avec la prise de conscience croissante que le capitalisme est un mode de production totalement obsolète, cela a déjà été un élément dans l'émergence de minorités politisées dont la motivation est avant tout de comprendre la situation dramatique à laquelle l'humanité est confrontée.
Malgré l'atomisation sociale résultant de la décomposition, malgré les tentatives délibérées de fragmenter la force de travail à travers des stratagèmes comme "l'économie verte", ou les campagnes idéologiques qui visent à présenter les fractions les plus éduquées du prolétariat mondial comme la "classe moyenne" et les pousser vers l'individualisme, les travailleurs restent une classe qui, ces dernières années, a augmenté et est interconnectée au niveau mondial, même si, avec l'avancée de la décomposition, il est également vrai que l'atomisation et l'isolement social s'intensifient. C'est un facteur qui, pour l'instant, rend plus difficile pour le prolétariat la mise en œuvre de sa propre identité de classe. Ce n'est que par ses luttes sur son propre terrain de classe que, la classe ouvrière pourra développer son action collective, annonçant ainsi la force collective dont elle devra disposer à l'échelle mondiale pour renverser le capitalisme.
Les travailleurs sont réunis par le capital dans le processus de production, le travail associé s'y effectue sous la contrainte, mais le caractère révolutionnaire du prolétariat implique de renverser dialectiquement ces conditions dans une lutte collective. La lutte collective contre l'exploitation, guidée par la conscience communiste issue du prolétariat, contient le potentiel pour la libération du caractère social du travail, car une société qui peut utiliser consciemment tout le potentiel de l'activité associée, cette société pour laquelle le prolétariat mondial doit lutter, c'est la société communiste.
Le débat : une force de l’organisation révolutionnaire
- "Contrairement à la vision bordiguiste, l'organisation des révolutionnaires ne peut être "monolithique". L'existence de divergences en son sein est la manifestation qu'elle est un organe vivant qui n'a pas de réponses toutes faites à donner immédiatement aux problèmes qui se posent dans la classe. Le marxisme n'est ni un dogme ni un catéchisme (...) Comme toute réflexion humaine, celle qui préside au développement de la conscience prolétarienne n'est pas un processus linéaire et mécanique, mais un processus contradictoire et critique, qui implique nécessairement la discussion et la confrontation des arguments"[9].
Dès avant le 23e Congrès international, des divergences s'étaient exprimées au sein du CCI sur différentes questions : les tensions impérialistes mènent-elles à une nouvelle guerre mondiale ? Le prolétariat est-il déjà vaincu ? Quelle est la tâche du moment pour l'organisation ? Cela soulève la question de savoir ce que l'on entend par activité en tant que fraction[10] dans la phase actuelle de décomposition. Les divergences sur l'analyse de la situation internationale ont donné lieu à une première publication, celle du texte "Divergences avec la résolution sur la situation internationale du 23e Congrès du CCI[11]". La résolution sur les activités de notre récent congrès souligne que "l'organisation s'est efforcée à tous les niveaux -au congrès, aux réunions des organes centraux, aux réunions de section et dans quelque 45 contributions individuelles dans les bulletins internes internationaux au cours des quatre dernières années- de répondre aux divergences des camarades et a également commencé à porter le débat à l'extérieur. L'effort de l'organisation pour affronter les divergences durant cette période exprime une volonté positive de renforcer la défense polémique de ses positions et analyses".
Les divergences se sont précisées lors du 24e Congrès :
- La polarisation des tensions impérialistes, principalement entre les États-Unis et la Chine, ne prépare-telle pas le terrain pour une troisième guerre mondiale ?
- Les mesures brutales de confinement prises par les États ne seraient-elles pas un moyen caché de préparer les populations à la guerre impérialiste ?
- La pandémie serait-elle simplement un phénomène "socio-naturel" que les États peuvent exploiter à des fins de contrôle de la population ou, au contraire, exprimerait-elle et accélérerait-elle la décomposition générale du capitalisme ?
- Comment le prolétariat pourrait-il faire face à cette grave situation historique ? Aurait-il d'abord besoin d'une conscience claire de ce qu'est le communisme ? Ou bien la situation nécessiterait-elle le développement de ses luttes sur son terrain de classe et le renforcement ainsi que la clarté de ses organisations communistes ?
Ces divergences, ainsi que d'autres, ont été abordées lors du Congrès et, dans le but d'obtenir la plus grande clarté possible dans leur expression, elles seront présentées publiquement dans des documents de discussion. Il s'agit d'une pratique du mouvement ouvrier que le CCI a prise très au sérieux, comme le souligne le texte cité plus haut :
"Dans la mesure où les débats qui traversent l'organisation concernent en général l'ensemble du prolétariat, il convient que celle-ci les porte à l'extérieur, en respectant les conditions suivantes :
- ces débats concernent les questions politiques générales et ils ont atteint une maturité suffisante pour que leur publication constitue une réelle contribution à la prise de conscience de la classe ouvrière ;
- la place donnée à ces débats ne doit pas remettre en cause l'équilibre général des publications ;
- c'est l'organisation comme un tout qui décide et prend en charge cette publication en fonction des critères valables pour la publication de n'importe quel article dans la presse : qualités de clarté et de forme rédactionnelle, intérêt qu'ils présentent pour la classe ouvrière."
Les fondements de la construction de l'organisation
Le congrès a dressé un bilan positif de l'activité de l'organisation au cours des deux dernières années, en soulignant notamment la solidarité avec tous les camarades touchés par la pandémie ou par les graves conséquences économiques du confinement (bon nombre de camarades ont perdu leurs moyens de subsistance).
Ce bilan positif ne doit pas nous faire baisser la garde. L'organisation communiste est soumise à de multiples pressions, les avancées -qui coûtent cher à gagner- peuvent être rapidement perdues. Comme le souligne la résolution sur les activités adoptée par le Congrès, "l'accélération de la décomposition pose d'importants problèmes au niveau du militantisme, de la théorie et du tissu organisationnel".
Ces problèmes ne sont pas nouveaux, ils sont l'expression de l'impact de la décomposition sur le fonctionnement et le militantisme des organisations communistes puisque "Les différents éléments qui constituent la force du prolétariat se heurtent directement aux diverses facettes de cette décomposition idéologique:
- l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le "chacun pour soi", la "débrouille individuelle";
- le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la déstructuration des rapports qui fondent toute vie en société;
- la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le "no future";
- la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérisent notre époque." (Thèse 13 [22] de La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste).
Compte tenu de ces dangers, notre tâche consiste avant tout à préparer l'avenir. L'objectif fondamental du CCI, qui est de construire un pont vers le futur parti communiste mondial du prolétariat, a été défini lors de sa Conférence de fondation en 1975 et réaffirmé lors du 23e Congrès ; mais la nature de cet objectif a été précisée ces dernières années par plusieurs facteurs : l'accélération de la décomposition et les difficultés de la lutte de classe du prolétariat intensifient de plus en plus les défis pour l'organisation des révolutionnaires ; le vieillissement et en même temps l'émergence de nouveaux militants qui rejoignent l'organisation dans le contexte de la décomposition ; les attaques croissantes du parasitisme contre l'organisation ; le poids de l'opportunisme et du sectarisme dans les groupes hérités de la Gauche communiste.
À son 24e Congrès, le CCI s'est appliqué à identifier la perspective, les difficultés et les dangers qu'il doit affronter pour assumer son rôle de transmission ; il a adopté une série de "fondements" qui seront la base de l'orientation de la prochaine période. Or, face à cette situation, la préparation de l'avenir ne peut se comprendre qu'à contre-courant.
Historiquement, le mouvement marxiste n'a pu se développer qu'en affrontant avec succès des événements capitaux et s'est donc basé sur un esprit de combat, sur une volonté de surmonter tous les obstacles que la société bourgeoise met sur son chemin. L'expérience du CCI n'est pas différente à cet égard. Les organisations auxquelles l'histoire demande de jouer un rôle de transmission ont dû faire leurs preuves face à de véritables épreuves du feu : le courant marxiste du milieu du XIXe siècle, malgré l'emprisonnement, l'exil et la grande pauvreté de ses militants après la défaite de 1848, a servi de tremplin à la création de la 1e Internationale dans les années 1860. Bilan et la Gauche Communiste de France ont traversé les épreuves de la contre-révolution des années 30, 40 et 50, du stalinisme, du fascisme et de l'antifascisme, de la Seconde Guerre mondiale pour maintenir vivante la flamme révolutionnaire pour les générations futures. Il est clair que la période de décomposition constitue l'épreuve décisive du CCI.
La capacité d'analyser le monde et la situation historique est l'un des "fondements" de notre perspective immédiate ; la méthode marxiste du matérialisme historique et la référence constante à l'héritage des acquis antérieurs, ainsi que la confrontation des divergences, font partie de la préparation de l'avenir. Notre activité d'intervention, d'élaboration théorique, de défense de l'organisation se fonde sur la transmission et le développement des acquis historiques d'un siècle de lutte de la gauche communiste et ce n'est que sur cette base solide que peut être réalisée la préparation du futur parti communiste mondial du prolétariat.
Dans le cadre de la préparation de l'avenir, il y a aussi la lutte sans compromis contre le parasitisme. L'effort de ces dernières années montre la nécessité de poursuivre cette lutte, en dénonçant le parasitisme comme le CCI l'a fait face à la classe ouvrière, face à ses contacts et face au milieu de la Gauche communiste.
La lutte contre l'opportunisme dans les organisations de la gauche communiste, en lien avec celle contre le parasitisme[12], sera importante dans la prochaine période car le danger est grand de voir se perdre et s'atrophier le potentiel du futur regroupement des révolutionnaires. L'expérience de ces deux dernières années concernant la défense de l'organisation contre les attaques du parasitisme et pour la rupture du cordon sanitaire dont il entoure le CCI montre que la lutte contre l'opportunisme et le sectarisme implique la connaissance et la défense de notre histoire.
Au cours de la période à venir, le CCI entend améliorer sa presse. Au cours des dernières décennies, la préoccupation pour les polémiques avec le milieu politique prolétarien a diminué. L'organisation entend renverser cette situation et notre travail de type fraction consiste aussi à préparer l'avenir en élargissant la polémique et lui permettant de s'inspirer de ce qu'a été la première phase de l'Iskra ou les premiers numéros d'Internationalisme, la publication de la GCF, consacrés à la polémique contre Vercesi et sa dérive opportuniste. En réponse à la putréfaction de l'idéologie bourgeoise, à l'obscurantisme de ses mystifications, la presse doit pouvoir constituer un point de repère contre l'intoxication idéologique qui émane de la décomposition idéologique du capitalisme, et présenter à la classe ouvrière une perspective rationnelle et concrète de renversement du capitalisme. Il nous faut donc renforcer la diffusion de notre presse imprimée et numérique.
La perspective du communisme est dans la préparation de l'avenir
En tirant les leçons des erreurs du passées, en combattant sans relâche le parasitisme et l'opportunisme, en comprenant le plus rapidement possible les développements permanents de l'évolution historique, en défendant l'organisation et son fonctionnement uni, solidaire, international et centralisé, le 24e Congrès a eu pour vocation de préparer l'avenir. Mais cela exige de s'appuyer fermement, de manière critique, sur la continuité historique des organisations communistes, comme le conclut la résolution d'activité du congrès :
- "Dans la transition orageuse vers un avenir de "guerres et de révolutions", Rosa Luxemburg a déclaré au congrès fondateur du parti communiste allemand en 1919 [que le parti] "revenait sous la bannière du marxisme". (...) Alors que la classe ouvrière en Russie se préparait, pour la première fois dans l'histoire, à renverser l'État bourgeois, Lénine a rappelé les acquis de Marx et Engels sur la question de l'État dans "l'État et Révolution (…) Le CCI, alors qu'il se prépare à faire face l'instabilité et à l'imprévisibilité sans précédent de la putréfaction du capitalisme mondial, doit récupérer l'héritage, l'exemple militant et l'expérience organisationnelle de MC[13], trente ans après sa mort. C'est-à-dire revenir à la tradition et à la méthode de la Gauche communiste dont le CCI a hérité (…) Cette tradition est vivante et doit être réappropriée de manière critique, en fait c'est la seule qui peut guider le CCI et la classe ouvrière à travers l'épreuve du feu qui est à venir."
[1] Nous avons jugé d’adjoindre aux documents du congrès un rapport sur les conflits impérialistes adopté dans une réunion récente de l'organe central international du CCI.
[2]Tous les modes d’exploitation qui ont précédé le capitalisme (despotisme asiatique, esclavage, féodalisme) ont criminellement joué avec la vie de milliers de personnes, mais le capitalisme a porté cette barbarie à ses expressions les plus extrêmes. Qu'est-ce que la guerre impérialiste ? Des millions d'êtres humains utilisés comme chair à canon pour les sales intérêts économiques et impérialistes des nations, des États, des capitalistes, et qui sont des jouets dans les mains du capitalisme. Il n'y a donc rien de nouveau lorsque les gouvernements conçoivent la gestion de la pandémie comme un pari irresponsable avec la vie de millions de personnes.
[4] Résolution sur la situation internationale (2021).
[5] Voire le site "COVID-19. Au moins 17 000 morts parmi les professionnels de santé : il faut une campagne de vaccination rapide."
[6] Le capitalisme est basé, comme nous l'avons noté plus haut, sur la concurrence à mort entre les États et entre les capitalistes, donc le "chacun pour soi" est inscrit dans son ADN, mais cette caractéristique a été aiguisée à des extrêmes sans précédent avec la phase de décomposition capitaliste.
[7] Rapport sur la pandémie [139] et le développement de la décomposition.
[8] Résolution sur le rapport de forces [140] entre les classes (2019).
[9] Rapport sur la structure et le fonctionnement [62] des organisations révolutionnaires - conférence internationale (janvier 82)
[11] Article online Divergences avec la résolution [142] sur la situation internationale du 23e congrès
[12] Lire construction de l’organisation des révolutionnaires : thèses sur le parasitisme [23]. Revue internationale n° 94
[13] Marc Chirik [143] : Principal fondateur du CCI qui s'était distingué notamment par sa capacité à maintenir vivants les acquis théoriques du mouvement révolutionnaire, en particulier ceux élaborés par la Fraction de Gauche du Parti communiste d'Italie. Il put ainsi s'orienter de façon critique et lucide dans l'analyse de l'évolution de la situation mondiale. Ce "flair" politique, fondé sur l'analyse globale du rapport de forces entre les classes, lui permit de remettre en cause certains "dogmes" du mouvement ouvrier, sans pour autant s'écarter de la démarche et de la méthode marxiste du matérialisme historique mais en l'ancrant au contraire dans la dynamique de l'évolution de la réalité historique concrète. Lire à ce propos les articles : “MARC : De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale [17]” et MARC : De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle [18]”
Vie du CCI:
Evènements historiques:
Rubrique:
Résolution sur la situation internationale (2021)
- 376 lectures
Cette résolution vise à rassembler tous les éléments majeurs de la situation mondiale : l'accélération de la décomposition, l'aiguisement des rivalités impérialistes, une crise économique sans précédent, et les perspectives de la lutte de classe.
Préambule
Cette résolution s'inscrit dans la continuité du rapport sur la décomposition présenté au 22e congrès du CCI, de la résolution sur la situation internationale présentée au 23e congrès, et du rapport sur la pandémie et la décomposition présenté au 24e congrès. Elle est basée sur l’idée que non seulement la décadence du capitalisme passe par différents stades ou phases, mais que nous avons depuis la fin des années 1980 atteint sa phase ultime, la phase de décomposition ; en outre, la décomposition elle-même a une histoire, et un objectif central de ces textes est de "tester" le cadre théorique de la décomposition par rapport à l'évolution de la situation mondiale. Ces textes ont montré que la plupart des développements importants des trois dernières décennies ont en effet confirmé la validité de ce cadre, comme en témoignent l'exacerbation du chacun-pour-soi au niveau international, le "rebond" des phénomènes de décomposition vers les centres du capitalisme mondial à travers le développement du terrorisme et la crise des réfugiés, la montée du populisme et la perte de contrôle politique de la classe dirigeante, la putréfaction progressive de l'idéologie à travers la propagation de la recherche du bouc émissaire, du fondamentalisme religieux et des théories du complot. Et tout comme la phase de décomposition est l'expression concentrée de toutes les contradictions du Capital, surtout à son époque de déclin, la pandémie actuelle de Covid-19 est la distillation de toutes les manifestations-clés de la décomposition, et un facteur actif de son accélération.
La phase finale du déclin capitaliste et l’accélération du chaos
1. La pandémie de Covid-19, la première d'une telle ampleur depuis l'épidémie de grippe espagnole de 1918, est le moment le plus important dans l'évolution de la décomposition capitaliste depuis l'ouverture irrémédiable de cette période en 1989. L'incapacité de la classe dirigeante à empêcher les 7 à 12 millions de morts et plus qui en résultent confirme que le système capitaliste mondial, laissé à lui-même, entraîne l'humanité vers l'abîme de la barbarie et vers sa destruction, et que seule la révolution prolétarienne mondiale peut stopper cette dérive et conduire l'humanité vers un autre avenir.
2. Le CCI est pratiquement seul à défendre la théorie de la décomposition. D'autres groupes de la Gauche communiste la rejettent complètement, soit, comme dans le cas des Bordiguistes, parce qu'ils n'acceptent pas que le capitalisme puisse être un système en déclin (ou au mieux sont incohérents et ambigus sur ce point) ; soit, comme pour la Tendance Communiste Internationaliste, parce que parler d'une phase "finale" du capitalisme sonne beaucoup trop apocalyptique, soit parce que définir la décomposition comme une descente vers le chaos est une déviation du matérialisme qui, selon eux, cherche à trouver les racines de chaque phénomène dans l'économie et surtout dans la tendance à la baisse du taux de profit. Tous ces courants semblent ignorer que notre analyse est dans la continuité de la plate-forme de l'Internationale communiste de 1919, qui non seulement insistait sur le fait que la guerre impérialiste mondiale de 1914-18 annonçait l'entrée du capitalisme dans "l'époque de l'effondrement du Capital, de sa désintégration interne, l'époque de la révolution communiste du prolétariat", mais encore soulignait également que "l'ancien "ordre" capitaliste a cessé de fonctionner ; son existence ultérieure est hors de question. Le résultat final du mode de production capitaliste est le chaos. Ce chaos ne peut être surmonté que par la classe productive et la plus nombreuse - la classe ouvrière. Le prolétariat doit établir un ordre réel - l'ordre communiste". Ainsi, le drame auquel l'humanité est confrontée se pose effectivement en termes d'ordre contre chaos. Et la menace d'un effondrement chaotique était liée à "l'anarchie du mode de production capitaliste", en d'autres termes, à un élément fondamental du système lui-même - un système qui, suivant le marxisme, et à un niveau qualitativement plus élevé que dans tout mode de production antérieur, implique que les produits du travail humain deviennent une puissance étrangère qui se dresse au-dessus et contre leurs créateurs. La décadence du système, du fait de ses contradictions insolubles, marque une nouvelle spirale dans cette perte de contrôle. Et comme l'explique la Plate-forme de l'IC, la nécessité d'essayer de surmonter l'anarchie capitaliste au sein de chaque État-nation - par le monopole et surtout par l'intervention de l'État - ne fait que la pousser vers de nouveaux sommets à l'échelle mondiale, culminant dans la guerre mondiale impérialiste. Ainsi, alors que le capitalisme peut à certains niveaux et pendant certaines phases retenir sa tendance innée au chaos (par exemple, à travers la mobilisation pour la guerre dans les années 1930 ou la période de boom économique qui a suivi la guerre), la tendance la plus profonde est celle de la "désintégration interne" qui, pour l'IC, caractérise la nouvelle époque.
3. Alors que le Manifeste de l'IC parlait du début d'une nouvelle "époque", il y avait des tendances au sein de l'Internationale à considérer la situation catastrophique du monde d'après-guerre comme une crise finale dans un sens immédiat plutôt que comme une ère entière de catastrophes qui pourrait durer plusieurs décennies. Et c'est une erreur dans laquelle les révolutionnaires sont tombés à de nombreuses reprises (du fait d'une analyse erronée mais aussi parce qu'on ne peut prévoir avec certitude le moment précis où va intervenir un changement au niveau historique) : en 1848, lorsque le Manifeste communiste proclamait déjà que l'enveloppe du capital était devenue trop étroite pour contenir les forces productives qu'il avait mises en mouvement ; en 1919-20 avec la théorie de l’effondrement brutal du capitalisme, développée notamment par la Gauche communiste allemande ; en 1938 avec la notion de Trotsky selon laquelle les forces productives avaient cessé de croître. Le CCI lui-même a également sous-estimé la capacité du capitalisme à s'étendre et à se développer à sa propre manière, même dans un contexte général de déclin progressif, notamment avec la Chine stalinienne après l'effondrement du bloc russe. Cependant ces erreurs sont les produits d'une interprétation immédiatiste de la crise capitaliste, et non un défaut inhérent à la théorie de la décadence elle-même, qui voit le capitalisme dans cette période comme une entrave croissante aux forces productives plutôt que comme une barrière absolue. Le capitalisme est en déclin depuis plus d'un siècle, et reconnaître que nous atteignons les limites du système est tout à fait cohérent avec la compréhension du fait que la crise économique, malgré des hauts et des bas, est essentiellement devenue permanente ; que les moyens de destruction ont non seulement atteint un niveau tel qu'ils pourraient détruire toute vie sur la planète, mais qu'ils sont entre les mains d'un "ordre" mondial de plus en plus instable ; que le capitalisme a provoqué un désastre écologique planétaire sans précédent dans l'histoire humaine. En somme, la reconnaissance du fait que nous sommes effectivement au stade ultime de la décadence capitaliste est basée sur une évaluation lucide de la réalité. Encore une fois, cela doit être considéré sur une échelle de temps historique et non au jour le jour. Cela signifie que cette phase finale est irréversible et qu'il ne peut y avoir d'autre alternative historique que le Communisme ou la destruction de l'humanité. C'est l’alternative face à laquelle est placée notre époque.
4. La pandémie de Covid-19, contrairement aux vues propagées par la classe dirigeante, n'est pas un événement purement "naturel" mais résulte d'une combinaison de facteurs naturels, sociaux et politiques, tous liés au fonctionnement du système capitaliste en décomposition. L'élément "économique" est en effet crucial ici, et encore une fois à plus d'un niveau. C'est la crise économique, la chasse désespérée au profit, qui a poussé le capital à envahir chaque partie de la surface du globe, à s'emparer de ce qu'Adam Smith appelait le "don gratuit" de la nature, à détruire les derniers sanctuaires de la vie sauvage et à augmenter considérablement le risque de zoonoses. À son tour, le krach financier de 2008 a entraîné une réduction brutale des investissements dans la recherche de nouvelles maladies, dans les équipements et les traitements médicaux, ce qui a augmenté de manière exponentielle l'impact mortel du Coronavirus. Et l'intensification de la concurrence, du "chacun pour soi" entre les entreprises et les nations au niveau mondial a beaucoup retardé la fourniture de matériel de sécurité et de vaccins. Et contrairement aux espoirs utopiques de certaines parties de la classe dirigeante, la pandémie ne donnera pas lieu à un ordre mondial plus harmonieux une fois qu'elle aura été mise en échec. Non seulement parce que cette pandémie n'est probablement qu'un signe avant-coureur de pandémies plus graves à venir, étant donné que les conditions fondamentales qui l'ont générée ne peuvent être éliminées par la bourgeoisie, mais aussi parce que la pandémie a considérablement aggravé une récession économique mondiale qui était déjà imminente avant que la pandémie ne frappe. Le résultat sera le contraire de l'harmonie, car les économies nationales chercheront à s'égorger mutuellement dans la lutte pour des marchés et des ressources qui s'amenuisent. Cette concurrence exacerbée s'exprimera certainement au niveau militaire. Et le "retour à la normale" de la concurrence capitaliste fera peser de nouveaux fardeaux sur le dos des exploités de la planète, qui supporteront l'essentiel des efforts du capitalisme pour récupérer une partie des dettes gigantesques qu'il a contractées en tentant de gérer la crise.
5. Aucun État ne peut prétendre être un modèle de gestion de la pandémie. Si certains États d'Asie ont, dans un premier temps, réussi à y faire face plus efficacement, (même si des pays comme la Chine se sont livrés à la falsification des chiffres et de la réalité de l’épidémie) c'est en raison de leur expérience de la confrontation aux pandémies sur le plan social et culturel, puisque ce continent a historiquement constitué le terreau de l'émergence de nouvelles maladies, et surtout parce que ces États ont conservé les moyens, les institutions et les procédures de coordination mis en place lors de l'épidémie de SRAS en 2003. La propagation du virus au niveau planétaire, la génération internationale de nouveaux variants, posent d'emblée le problème au niveau où l'impuissance de la bourgeoisie est la plus clairement exposée, notamment son incapacité à adopter une approche unifiée et coordonnée (comme le montre l'échec récent de la proposition de signer un traité de lutte contre les pandémies) et à faire en sorte que l'ensemble de l'humanité soit protégé par des vaccins.
6. La pandémie, produit de la décomposition du système, se révèle ainsi être une force redoutable dans la poursuite de l'accélération de cette décomposition. De plus, son impact sur la nation la plus puissante de la Terre, les États-Unis, confirme ce qui avait déjà été noté dans le rapport du 22e Congrès : la tendance des effets de la décomposition à revenir avec plus de force au cœur même du système capitaliste mondial. En fait, les États-Unis sont maintenant au "centre" du processus mondial de décomposition. La gestion catastrophique de la crise du Covid par l'administration populiste de Trump a certainement joué un rôle important dans le fait que les États-Unis connaissent les taux de mortalité les plus élevés au monde du fait de cette maladie. Dans le même temps, l'étendue des divisions au sein de la classe dirigeante américaine a été mise à nu par les élections contestées de novembre 2020, et surtout par la prise d'assaut du Capitole par les partisans de Trump le 6 janvier 2021, poussés par Trump et son entourage. Ce dernier événement démontre que les divisions internes qui secouent les États-Unis traversent l'ensemble de la société. Bien que Trump ait été évincé du gouvernement, le trumpisme reste une force puissante, lourdement armée, qui s'exprime aussi bien dans la rue que dans les urnes. Et avec l'ensemble de l'aile gauche du Capital se ralliant derrière la bannière de l'antifascisme, il y a un réel danger que la classe ouvrière aux États-Unis soit prise dans des conflits violents entre des factions rivales de la bourgeoisie.
7. Les événements aux États-Unis mettent également en évidence l'avancée de la décomposition des structures idéologiques du capitalisme, où là encore ce pays "montre la voie". L'accession au pouvoir de l'administration populiste de Trump, la puissante influence du fondamentalisme religieux, la méfiance croissante à l'égard de la science, trouvent leurs racines dans des facteurs particuliers de l'histoire du capitalisme américain, mais le développement de la décomposition et en particulier le déclenchement de la pandémie a imprégné le courant dominant de la vie politique de toutes sortes d'idées irrationnelles, reflétant précisément l'absence totale de perspective d'avenir offerte par la société existante. En particulier, les États-Unis sont devenus le point nodal du rayonnement de la "théorie du complot" dans l'ensemble du monde capitaliste avancé, notamment via internet et les médias sociaux, qui ont fourni les moyens technologiques permettant de saper davantage les fondements de toute idée de vérité objective à un degré dont le stalinisme et le nazisme n'auraient pu que rêver. Même si elle apparaît sous différentes formes, la théorie du complot présente certains traits communs : la vision incarnée d'élites secrètes qui dirigent la société depuis les coulisses, un rejet de la méthode scientifique et une profonde méfiance à l'égard de tout discours officiel. Contrairement à l'idéologie dominante de la bourgeoisie, qui présente la démocratie et le pouvoir d'État existant comme les véritables représentants de la société, la théorie du complot a pour centre de gravité la haine des élites établies, haine qu'elle dirige contre le capital financier et la façade démocratique classique du capitalisme d'État totalitariste. C'est ce qui a conduit les représentants du mouvement ouvrier du passé à qualifier cette approche de "socialisme des imbéciles" (August Bebel, en référence à l'antisémitisme) - une erreur encore compréhensible avant la Première Guerre mondiale, mais qui serait dangereuse aujourd'hui. Le populisme de la théorie du complot n'est pas une tentative tordue d'approche du socialisme ou de tout ce qui ressemble à une conscience de classe prolétarienne. L'une de ses principales sources est la bourgeoisie elle-même : cette partie de la bourgeoisie qui n'apprécie pas d'être exclue précisément des cercles élitistes de sa propre classe, soutenue par d'autres parties de la bourgeoisie qui ont perdu ou sont en train de perdre leur position centrale antérieure. Les masses que ce type de populisme attire derrière lui, loin d'être animées par une quelconque volonté de défier la classe dominante, espèrent, en s'identifiant à la lutte pour le pouvoir de ceux qu'elles soutiennent, partager d'une certaine manière ce pouvoir, ou du moins être favorisées par lui aux dépens des autres.
8. Si la progression de la décomposition capitaliste, parallèlement à l’aiguisement chaotique des rivalités impérialistes, prend principalement la forme d'une fragmentation politique et d'une perte de contrôle de la classe dirigeante, cela ne signifie pas que la bourgeoisie ne puisse plus recourir au totalitarisme d'État dans ses efforts pour maintenir la cohésion de la société. Au contraire, plus la société tend à se désagréger, plus la bourgeoisie a besoin de s'appuyer sur le pouvoir centralisateur de l'État, qui est le principal instrument de la plus machiavélique des classes dirigeantes. La réaction des fractions de la classe dirigeante les plus responsables des intérêts généraux du capital national et de son État face à la montée du populisme en est un exemple. L'élection de Biden, soutenue par une énorme mobilisation des médias, de certaines parties de l'appareil politique et même de l'armée et des services de sécurité, exprime cette réelle contre-tendance au danger de désintégration sociale et politique très clairement incarné par le Trumpisme. À court terme, de tels "succès" peuvent fonctionner comme un frein au chaos social croissant. Face à la crise du Covid-19, les lock-downs sans précédent, dernier recours pour freiner la propagation effrénée de la maladie, le recours massif à l'endettement de l'État pour préserver un minimum de niveau de vie dans les pays avancés, la mobilisation des ressources scientifiques pour trouver un vaccin, démontrent le besoin de la bourgeoisie de préserver l'image de l'État protecteur de la population, son refus de perdre sa crédibilité et son autorité face à la pandémie. Mais à plus long terme, ce recours au totalitarisme d'État tend à exacerber davantage les contradictions du système. La semi-paralysie de l'économie et l'accumulation de la dette ne peuvent avoir d'autre résultat que d'accélérer la crise économique mondiale, tandis qu'au niveau social, l'augmentation massive des pouvoirs de la police et de la surveillance de l'État introduite pour appliquer les lois de confinement - augmentation inévitablement utilisée pour justifier toutes les formes de protestation et de dissidence - aggrave visiblement la méfiance envers l'establishment politique, qui s'exprime principalement sur le terrain anti-prolétarien des "droits du citoyen".
9. La nature évidente de la décomposition politique et idéologique de la première puissance mondiale ne signifie pas que les autres centres du capitalisme mondial soient capables de constituer des forteresses alternatives de stabilité. Encore une fois, ceci est le plus clair dans le cas de la Grande-Bretagne, qui a été frappée simultanément par les taux de mortalité les plus élevés de Covid en Europe et par les premiers symptômes de la mutilation du Brexit, et qui fait face à une réelle possibilité d'éclatement en ses "nations" constituantes. Les répugnantes dissensions actuelles entre la Grande-Bretagne et l'UE au sujet de la viabilité et de la distribution des vaccins offrent une preuve supplémentaire que la principale tendance de la politique bourgeoise mondiale d'aujourd'hui va dans le sens d'une fragmentation croissante, et non d'une unité face à un "ennemi commun". L'Europe elle-même n'a pas été épargnée par ces tendances centrifuges, non seulement autour de la gestion de la pandémie, mais aussi autour de la question des "droits de l'homme" et de la démocratie dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. Il est remarquable que même des pays centraux comme l'Allemagne, auparavant considérée comme un "havre" de relative stabilité politique et qui a pu s'appuyer sur sa force économique, soit cette fois-ci touchée par un chaos politique croissant. L'accélération de la décomposition dans le centre historique du capitalisme se caractérise à la fois par une perte de contrôle et par des difficultés croissantes à générer une homogénéité politique.
Après la perte de sa seconde plus importante économie, même si l'UE ne court pas le risque immédiat d'une scission majeure, de telles menaces continuent de planer sur le rêve d'une Europe unie. Et tandis que la propagande d'État chinoise met en évidence la désunion et l'incohérence croissantes des "démocraties", se présentant comme un rempart de la stabilité mondiale, le recours croissant de Pékin à la répression interne, comme contre le "mouvement démocratique" à Hong Kong et les musulmans ouïgours, est en fait la preuve que la Chine est une bombe à retardement. La croissance extraordinaire de la Chine est elle-même un produit de la décomposition. L'ouverture économique au cours de la période de Deng dans les années 80 a mobilisé d’énormes investissements, notamment en provenance des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Le massacre de Tiananmen en 1989 a montré clairement que cette ouverture économique a été mise en œuvre par un appareil politique inflexible qui n'a pu éviter le sort du stalinisme dans le bloc russe que par une combinaison de terreur d'État, une exploitation impitoyable de la force de travail qui soumet des centaines de millions de travailleurs à un état permanent de travailleur migrant et de croissance économique frénétique dont les fondations semblent maintenant de plus en plus fragiles. Le contrôle totalitaire sur l’ensemble du corps social, le durcissement répressif auxquels se livre la fraction stalinienne de Xi Jinping ne représentent pas une expression de force mais au contraire une manifestation de faiblesse de l’État, dont la cohésion est mise en péril par l’existence de forces centrifuges au sein de la société et d’importantes luttes de cliques au sein de la classe dominante.
La marche du capitalisme vers la destruction de l'humanité
10. Contrairement à une situation dans laquelle la bourgeoisie est capable de mobiliser la société pour la guerre, comme dans les années 1930, le rythme exact et les formes de la dynamique du capitalisme en décomposition vers la destruction de l'humanité sont plus difficiles à prévoir car ils sont le produit d'une convergence de différents facteurs, dont certains peuvent être partiellement cachés. Le résultat final, comme le soulignent les Thèses sur la décomposition, est le même : "Laissé à lui-même, (le capitalisme) conduira l'humanité au même sort que la guerre mondiale. Que nous soyons anéantis par une pluie de bombes thermonucléaires ou par la pollution, la radioactivité des centrales nucléaires, la famine, les épidémies et les massacres d'innombrables petites guerres (où les armes nucléaires peuvent aussi être utilisées), c'est finalement la même chose. La seule différence entre ces deux formes d'anéantissement réside dans le fait que l'une est rapide, tandis que l'autre serait plus lente, et provoquerait par conséquent encore plus de souffrances". Or, aujourd'hui, les contours de cette dynamique d’anéantissement se précisent. Les conséquences de la destruction de la nature par le capitalisme deviennent de plus en plus impossibles à nier, tout comme l'incapacité de la bourgeoisie mondiale, avec toutes ses conférences mondiales et ses promesses d'aller vers une "économie verte", à arrêter un processus qui est inextricablement lié au besoin du capitalisme de pénétrer le moindre recoin de la planète dans sa poursuite compétitive du processus d'accumulation. La pandémie de Covid est probablement l'expression la plus significative à ce jour de ce profond déséquilibre entre l'homme et la nature, mais d'autres signaux d'alarme se multiplient également, de la fonte des glaces polaires aux incendies dévastateurs en Australie et en Californie, en passant par la pollution des océans par les détritus de la production capitaliste.
11. Dans le même temps, les "massacres d'innombrables petites guerres" prolifèrent également, alors que le capitalisme, dans sa phase finale, plonge dans un chacun-pour-soi impérialiste de plus en plus irrationnel. L'agonie de dix ans de la Syrie, un pays aujourd'hui complètement ruiné par un conflit impliquant au moins cinq camps rivaux, est peut-être l'expression la plus éloquente de ce terrifiant "panier de crabes", mais nous voyons des manifestations similaires en Libye, dans la Corne de l'Afrique et au Yémen, des guerres qui ont été accompagnées et aggravées par l'émergence de puissances régionales telles que l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite, dont aucune ne voudra accepter la discipline des principales puissances mondiales : ces puissances de deuxième ou troisième niveau peuvent forger des alliances contingentes avec les États les plus puissants pour se retrouver dans des camps opposés dans d'autres situations (comme dans le cas de la Turquie et de la Russie dans la guerre en Libye). Les affrontements militaires récurrents en Israël/Palestine témoignent également de la nature insoluble de nombre de ces conflits. Dans ce cas, le massacre de civils a été exacerbé par le développement d'une atmosphère de pogrom au sein même d'Israël, ce qui montre l'impact de la décomposition au niveau militaire et social. Dans le même temps, nous assistons à un durcissement des conflits entre les puissances mondiales. L'exacerbation des rivalités entre les États-Unis et la Chine était déjà évidente sous Trump, mais l'administration Biden va continuer dans la même direction, même si c'est sous des prétextes idéologiques différents, comme les violations des droits de l'homme par la Chine ; en même temps, la nouvelle administration a annoncé qu'elle ne "se laisserait plus rouler" par la Russie, qui a maintenant perdu son point d'appui à la Maison Blanche. Et même si Biden a promis de réinsérer les États-Unis dans un certain nombre d'institutions et d'accords internationaux (sur le changement climatique, le programme nucléaire iranien, l'OTAN...), cela ne signifie pas que les États-Unis renonceront à leur capacité d'agir seuls pour défendre leurs intérêts. La frappe militaire contre les milices pro-iraniennes en Syrie par l'administration Biden quelques semaines seulement après l'élection était une déclaration claire à cet effet. La poursuite du chacun pour soi va rendre toujours plus difficile, voire impossible, aux États-Unis d’imposer leur leadership, illustration du tous contre tous dans l’accélération de la décomposition.
12. Dans ce tableau chaotique, il ne fait aucun doute que la confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine tend à occuper le devant de la scène. La nouvelle administration a ainsi démontré son attachement à l'"inclination vers l'est" (désormais soutenue par le gouvernement conservateur en Grande-Bretagne) qui était déjà un axe central de la politique étrangère d'Obama. Cela s'est concrétisé par le développement du "Quad", une alliance explicitement antichinoise entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Toutefois, cela ne signifie pas que nous nous dirigeons vers la formation de blocs stables et une guerre mondiale généralisée. La marche vers la guerre mondiale est encore obstruée par la puissante tendance au chacun pour soi et au chaos au niveau impérialiste, tandis que dans les pays capitalistes centraux, le capitalisme ne dispose pas encore des éléments politiques et idéologiques – dont en particulier une défaite politique du prolétariat – qui pourraient unifier la société et aplanir le chemin vers la guerre mondiale. Le fait que nous vivions encore dans un monde essentiellement multipolaire est mis en évidence en particulier par les relations entre la Russie et la Chine. Si la Russie s'est montrée très disposée à s'allier à la Chine sur des questions spécifiques, généralement en opposition aux États-Unis, elle n'en est pas moins consciente du danger de se subordonner à son voisin oriental, et est l'un des principaux opposants à la "Nouvelle route de la soie" de la Chine vers l'hégémonie impérialiste.
13. Cela ne signifie pas que nous vivons dans une ère de plus grande sécurité qu'à l'époque de la Guerre froide, hantée par la menace d'un Armageddon nucléaire. Au contraire, si la phase de décomposition est marquée par une perte de contrôle croissante de la part de la bourgeoisie, cela s'applique également aux vastes moyens de destruction - nucléaires, conventionnels, biologiques et chimiques - qui ont été accumulés par la classe dirigeante, et qui sont maintenant plus largement distribués à travers un nombre bien plus important d'États-nations que dans la période précédente. Bien que nous n'assistions pas à une marche contrôlée vers la guerre menée par des blocs militaires disciplinés, nous ne pouvons pas exclure le danger de flambées militaires unilatérales ou même d'accidents épouvantables qui marqueraient une nouvelle accélération du glissement vers la barbarie.
Une crise économique sans précédent
14. Pour la première fois dans l'histoire du capitalisme en dehors d'une situation de guerre mondiale, l'économie s’est trouvée directement et profondément affectée par un phénomène – la pandémie de Covid 19 – qui n’est pas lié directement aux contradictions de l’économie capitaliste. L’ampleur et l’importance de l’impact de la pandémie, produit de l'agonie d'un système en pleine décomposition et devenu complètement obsolète, illustrent le fait sans précédent que le phénomène de la décomposition capitaliste affecte aussi désormais, massivement et à l’échelle mondiale l’ensemble de l’économie capitaliste.
Cette irruption des effets de la décomposition dans la sphère économique affecte directement l'évolution de la nouvelle phase de crise ouverte, inaugurant une situation totalement inédite dans l'histoire du capitalisme. Les effets de la décomposition, en altérant profondément les mécanismes du capitalisme d'État mis en place jusqu'à présent pour "accompagner" et limiter l'impact de la crise, introduisent dans la situation un facteur d'instabilité et de fragilité, d'incertitude croissante.
Le chaos qui s'empare de l'économie capitaliste confirme les vues de Rosa Luxemburg selon lesquelles le capitalisme ne connaîtra pas un effondrement purement économique. "Plus s’accroit la violence avec laquelle avec laquelle à l’intérieur et à l’extérieur le capital anéantit les couches non capitalistes et avilit les conditions d’existence de toutes les classes laborieuses, plus l'histoire quotidienne de l'accumulation dans le monde se transforme en une série de catastrophes et de convulsions, qui, se joignant aux crises économiques périodiques finiront par rendre impossible la continuation de l'accumulation et par dresser la classe ouvrière internationale contre la domination du capital avant même que celui-ci n’ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement." (Accumulation du capital, chapitre 32)
15. Frappant un système capitaliste qui, depuis le début de l'année 2018, entrait déjà dans un net ralentissement, la pandémie a rapidement concrétisé la prédiction du 23e congrès du CCI selon laquelle nous nous dirigions vers une nouvelle plongée dans la crise.
La violente accélération de la crise économique - et l’effroi de la bourgeoisie - se mesurent à la hauteur de la muraille de la dette élevée en toute hâte pour préserver son appareil de production de la faillite et maintenir un minimum de cohésion sociale.
L'une des manifestations les plus importantes de la gravité de la crise actuelle, contrairement aux situations passées de crise économique ouverte et à la crise de 2008, réside dans le fait que les pays centraux (Allemagne, Chine et États-Unis) ont été frappés simultanément et sont parmi les plus touchés par la récession, la Chine par une forte baisse du taux de croissance en 2020. Les États les plus faibles voient leur économie étranglée par l'inflation, la chute de la valeur de leur monnaie et la paupérisation.
Après quatre décennies de recours au crédit et à l’endettement afin de contrecarrer la tendance croissante à la surproduction, ponctuées de récessions de plus en plus profondes et de reprises de plus en plus limitées, la crise de 2007-09 avait déjà marqué une étape dans l’enfoncement du système capitaliste dans sa crise irréversible. Si l’intervention massive des États a pu sauver le système bancaire de la faillite complète en poussant la dette à des niveaux encore plus vertigineux, les causes de la crise de 2007-2011 n’ont pas été dépassées. Les contradictions de la crise sont passées à un stade supérieur avec le poids écrasant de la dette sur les États eux-mêmes. Les tentatives de relance des économies n’ont pas débouché sur une véritable reprise : fait sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, en dehors des États-Unis, de la Chine et, dans une moindre mesure, de l'Allemagne, les niveaux de production de tous les grands pays du monde ont stagné ou même baissé entre 2013 et 2018. L'extrême fragilité de cette "reprise", en empilant toutes les conditions d'une nouvelle détérioration significative de l'économie mondiale, présageait déjà de la situation actuelle.
Malgré l'ampleur historique des plans de relance et en raison du redémarrage chaotique de l’économie, il n'est pas encore possible de prévoir comment - et dans quelle mesure - la bourgeoisie parviendra à stabiliser la situation, caractérisée par toutes sortes d'incertitudes, au premier rang desquelles l’évolution de la pandémie elle-même.
Contrairement à ce que la bourgeoisie a pu faire en 2008 en réunissant le G7 et le G20, composés des principaux États, et en se mettant d'accord sur une réponse coordonnée à la crise du crédit, aujourd'hui chaque capital national réagit en ordre dispersé, sans autre préoccupation que la relance de sa propre machine économique et de sa survie sur le marché mondial, sans concertation entre les principales composantes du système capitaliste. Le chacun pour soi prédomine de façon décisive.
L’apparente exception du plan européen de relance, incluant la mutualisation des dettes entre les pays de l’UE, s’explique par la conscience des deux principaux États de celle-ci de la nécessité d’un minimum de coopération entre eux comme condition pour éviter une déstabilisation majeure de l’UE pour faire face à leurs principaux rivaux chinois et américain, sous peine de risquer un déclassement accéléré de leur position dans l’arène mondiale.
La contradiction entre la nécessité de contenir la pandémie et d'éviter la paralysie de la production a conduit à la "guerre des masques" et à la "guerre des vaccins". Cette guerre des vaccins, leur fabrication et leur distribution, forme un miroir du désordre croissant dans lequel s'enfonce l'économie mondiale.
Après l'effondrement du bloc de l'Est, la bourgeoisie a tout mis en œuvre pour maintenir une certaine collaboration entre les États, notamment en s'appuyant sur les organes de régulation internationale hérités de la période des blocs impérialistes. Ce cadre de la "globalisation" a permis de limiter l'impact de la phase de décomposition au niveau de l'économie, en poussant à l'extrême la possibilité d'"associer" les nations à différents niveaux de l'économie - financier, productif, etc.
Avec l'aggravation de la crise et des rivalités impérialistes, les institutions et mécanismes multilatéraux étaient déjà mis à l'épreuve par le fait que les principales puissances développaient de plus en plus leurs propres politiques, notamment la Chine, en construisant son vaste réseau parallèle des Nouvelles routes de la soie, et les États-Unis qui tendaient à tourner le dos à ces institutions en raison de l’inaptitude grandissante de ces outils à préserver leur position dominante. Le populisme s'imposait déjà comme un facteur aggravant la détérioration de la situation économique en introduisant un élément d'incertitude face aux affres de la crise. Son accession au pouvoir dans différents pays a accéléré la détérioration des moyens imposés par le capitalisme depuis 1945 pour éviter toute dérive vers un repli sur le cadre national favorisant la contagion incontrôlée de la crise économique.
Le déchaînement du chacun pour soi découle de la contradiction du capitalisme entre l'échelle de plus en plus globale de la production et la structure nationale du capital, contradiction exacerbée par la crise. En provoquant un chaos croissant au sein de l'économie mondiale (avec la tendance à la fragmentation des chaînes de production et la fragmentation du marché mondial en zones régionales, au renforcement du protectionnisme et à la multiplication des mesures unilatérales), ce mouvement totalement irrationnel de chaque nation à sauver son économie au détriment de toutes les autres est contre-productif pour chaque capital national et un désastre au niveau mondial, un facteur décisif de détérioration de l'ensemble de l'économie mondiale.
Cette ruée des factions bourgeoises les plus "responsables" vers une gestion de plus en plus irrationnelle et chaotique du système, et surtout l'avancée sans précédent de la tendance au chacun pour soi, révèlent une perte croissante de contrôle de son propre système par la classe dominante.
16. Seule nation à avoir un taux de croissance positif en 2020 (2%), la Chine n'est pas sortie triomphante ou renforcée de la crise pandémique, même si elle a momentanément gagné du terrain au détriment de ses rivaux. Bien au contraire. La dégradation continue de la croissance de son économie, la plus endettée au monde, et qui comporte également un faible taux d'utilisation des capacités de production et une proportion d'"entreprises zombies" de plus de 30%, témoigne de l'incapacité de la Chine à jouer désormais le rôle qui a été le sien en 2008-11 dans le redressement de l'économie mondiale.
La Chine est confrontée à la réduction des marchés à travers le monde, à la volonté de nombreux États de se libérer de leur dépendance à l'égard de la production chinoise, et au risque d'insolvabilité d’un certain nombre pays impliqués dans le projet de la Route de la soie parmi les plus durement touchés par les conséquences économiques de la pandémie. Le gouvernement chinois poursuit donc une orientation vers le développement économique interne du plan "Made in China 2025", et du modèle de "circulation duale", qui vise à compenser la perte de la demande extérieure par la stimulation de la demande intérieure. Ce changement de politique ne représente cependant pas un "repli sur soi", l'impérialisme chinois ne voulant ni ne pouvant tourner le dos au monde. Au contraire, l'objectif de ce changement est de gagner une autarcie nationale au niveau des technologies clés afin d'être d'autant plus capable de gagner du terrain au-delà de ses propres frontières. Elle représente une nouvelle étape dans le développement de son économie de guerre. Tout cela provoque de puissants conflits au sein de la classe dirigeante, entre les partisans de la direction de l'économie par le Parti communiste chinois et ceux liés à l'économie de marché et au secteur privé, entre les "planificateurs" du pouvoir central et les autorités locales qui veulent orienter elles-mêmes les investissements. Tant aux États-Unis (par rapport aux géants technologiques "GAFA" de la Silicon Valley) que - plus résolument encore - en Chine (par rapport à Ant International, Alibaba, etc.), on observe une forte tendance de l'appareil d'État central à réduire la taille des entreprises devenues trop grandes (et trop puissantes) pour être contrôlées.
17. Les conséquences de la destruction effrénée de l'environnement par un capitalisme en décomposition, les phénomènes résultant du dérèglement climatique et de la destruction de la biodiversité, conduisent en premier lieu à une paupérisation accrue des parties les plus démunies de la population mondiale (Afrique subsaharienne et Asie du Sud) ou de celles en proie à des conflits militaires. Mais ils affectent de plus en plus toutes les économies, les pays développés en tête.
Nous assistons actuellement à la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes, de pluies et d'inondations extrêmement violentes, de vastes incendies entraînant des pertes financières énormes dans les villes et les campagnes par la destruction d'infrastructures vitales (villes, routes, installations fluviales). Ces phénomènes perturbent le fonctionnement de l'appareil de production industriel et affaiblissent également la capacité productive de l'agriculture. La crise climatique mondiale et la désorganisation croissante du marché mondial des produits agricoles qui en résulte menacent la sécurité alimentaire de nombreux États.
Le capitalisme en décomposition ne possède pas les moyens de lutter réellement contre le réchauffement climatique et la dévastation écologique. Ceux-ci ont déjà un impact de plus en plus négatif sur la reproduction du capital et ne peuvent que constituer un obstacle au retour de la croissance économique.
Motivée par la nécessité de remplacer les industries lourdes obsolètes et les combustibles fossiles, l’"économie verte" ne représente pas une issue pour le capital, que ce soit sur le plan écologique ou économique. Ses filières de production ne sont pas plus vertes ou moins polluantes. Le système capitaliste n'a pas la capacité de s'engager dans une "révolution verte". Les agissements de la classe dominante dans ce domaine aiguisent inévitablement une compétition économique destructrice et les rivalités impérialistes. L'émergence de nouveaux secteurs potentiellement rentables, comme la production de véhicules électriques, pourrait au mieux bénéficier à certaines parties des économies les plus fortes, mais compte tenu des limites des marchés solvables, et des problèmes croissants rencontrés par l’utilisation toujours plus massive de la création de monnaie et de l’endettement, ils ne pourront pas servir de locomotive à l'ensemble de l'économie.
L'"économie verte" constitue surtout un véhicule privilégié pour de puissantes mystifications idéologiques sur la possibilité de réformer le capitalisme et une arme de choix contre la classe ouvrière, justifiant les fermetures d'usines et les licenciements.
18. En raison des tensions impérialistes croissantes, tous les États augmentent leur effort militaire, tant en volume que sur la durée. La sphère militaire s'étend de plus en plus à de nouvelles "zones de conflictualité", comme la cyber sécurité et la militarisation croissante de l'espace. Toutes les puissances nucléaires relancent discrètement leurs programmes atomiques. Tous les États modernisent et adaptent leurs forces armées.
Cette course folle aux armements, à laquelle chaque État est irrémédiablement condamné par les exigences de la concurrence inter-impérialiste, est d'autant plus irrationnelle que le poids croissant de l'économie de guerre et de la production d'armes absorbe une part considérable de la richesse nationale : cette masse gigantesque de dépenses militaires à l'échelle mondiale, même si elle constitue une source de profit pour les marchands d'armes, représente au plan du capital global, une stérilisation et une destruction du capital. Les investissements réalisés dans la production et la vente d'armes et d'équipements militaires ne constituent aucunement un point de départ ou la source de l'accumulation de nouveaux profits : une fois produites ou acquises, les armes ne peuvent plus servir qu’à semer la mort et la destruction ou à attendre d’être remplacées quand elles sont obsolètes. Complètement improductives, ces dépenses ont un "impact économique (...) désastreux pour le capital. Face à des déficits budgétaires déjà incontrôlables, l'augmentation massive des dépenses militaires, que la croissance des antagonismes inter-impérialistes rend nécessaire, est un fardeau économique qui ne fait qu'accélérer la descente du capitalisme dans l'abîme." ("Rapport sur la situation internationale [145]", Revue internationale n° 35).
19. Après des décennies de dettes gigantesques, les injections massives de liquidités des derniers plans de soutien à l’économie surpassent de très loin le volume des interventions précédentes. Les milliards de dollars débloqués par les plans américains, européens et chinois ont porté la dette mondiale au niveau record de 365% du PIB mondial.
La dette, qui n'a cessé d'être utilisée par le capitalisme tout au long de sa période de décadence comme palliatif à la crise de surproduction, consiste à reporter les échéances dans le futur, au prix de convulsions toujours plus graves. Elle a atteint aujourd'hui des niveaux sans précédent. Depuis la Grande Dépression, la bourgeoisie a montré sa détermination à maintenir en vie son système de plus en plus menacé par la surproduction et l’étroitesse croissante des marchés par la sophistication de l’intervention de l’État en exerçant un contrôle général sur l’économie. Mais elle ne dispose d’aucun moyen pour s'attaquer aux causes réelles de la crise. Même s'il n'existe pas de limite fixe et prédéterminée à la fuite en avant dans l'endettement, un point à partir duquel cela deviendrait impossible, cette politique ne peut pas se poursuivre infiniment sans que l’accroissement de la dette ait de graves répercussions sur la stabilité du système, comme le montre le caractère de plus en plus fréquent et l’ampleur des crises de la dernière décennie mais également parce qu’une telle politique s’avère être, au moins depuis quatre décennies, de moins en moins efficace pour relancer l’économie mondiale.
Non seulement le poids de la dette condamne le système capitaliste à des convulsions toujours plus dévastatrices (faillites d'entreprises et même d'États, crises financières et monétaires, etc.) mais aussi, en restreignant de plus en plus la capacité des États à tricher avec les lois du capitalisme, il ne peut qu'entraver leur capacité à relancer leurs économies nationales respectives.
La crise qui se déroule déjà depuis des décennies va devenir la plus grave de toute la période de décadence, et sa portée historique dépassera même la première crise de cette époque, celle qui a commencé en 1929. Après plus de 100 ans de décadence capitaliste, avec une économie ravagée par le secteur militaire, affaiblie par l'impact de la destruction de l'environnement, profondément altérée dans ses mécanismes de reproduction par la dette et la manipulation étatique, en proie à la pandémie, souffrant de plus en plus de tous les autres effets de la décomposition, il est illusoire de penser que dans ces conditions qu'il y aura une reprise quelque peu durable de l'économie mondiale.
20. En même temps, les révolutionnaires ne doivent pas être tentés de tomber dans une vision "catastrophiste" d'une économie mondiale au bord de l'effondrement final. La bourgeoisie continuera à se battre jusqu'à la mort pour la survie de son système, que ce soit par des moyens directement économiques (comme l'exploitation de ressources inexploitées et de nouveaux marchés potentiels, illustrés par le projet chinois de la Nouvelle route de la soie) ou politiques, surtout par la manipulation du crédit et les tricheries avec la loi de la valeur. Cela signifie qu'il peut toujours y avoir des phases de stabilisation entre des convulsions économiques ayant des conséquences de plus en plus profondes.
21. Le retour d'une sorte de "néo-keynésianisme" initié par les énormes engagements de dépenses de l'administration Biden et des initiatives pour l'augmentation de l'impôt sur les sociétés - bien que motivé aussi par la nécessité de maintenir la cohésion de la société bourgeoise tout comme par le besoin tout aussi pressant de faire face à l'aggravation des tensions impérialistes - montre la volonté de la classe dirigeante d'expérimenter différentes formes de gestion économique, notamment parce que les déficiences des politiques néo-libérales lancées dans les années Thatcher-Reagan ont été sévèrement mises en évidence par la crise pandémique. Toutefois, de tels changements de politique ne peuvent empêcher l'économie mondiale d'osciller entre le double danger de l'inflation et de la déflation, de nouvelles crises du crédit et des crises monétaires ouvrant toutes sur des récessions brutales.
22. La classe ouvrière paie un lourd tribut à la crise. D'abord parce qu'elle est la plus directement exposée à la pandémie et qu'elle est la principale victime de la propagation de l'infection, ensuite parce que le plongeon de l'économie déclenche les attaques les plus graves depuis la Grande Dépression, sur tous les plans de ses conditions de vie et de travail, même si tous ne seront pas affectés de la même manière.
La destruction d'emplois quatre fois plus importante en 2020 qu'en 2009, n'a pas encore révélé toute l'ampleur de l'augmentation considérable du chômage de masse qui s'annonce. Bien que les subventions publiques accordées dans certains pays aux chômeurs partiels visent à atténuer le choc social (aux États-Unis, par exemple, au cours de la première année de la pandémie, le revenu moyen des salariés, selon les statistiques officielles, a augmenté - pour la première fois, en période de récession, dans l'histoire du capitalisme), des millions d'emplois vont disparaître très prochainement...
L'augmentation exponentielle du travail précaire et la baisse générale des salaires entraîneront une augmentation gigantesque de la paupérisation, qui frappe déjà de nombreux travailleurs. Le nombre de victimes de la famine dans le monde a été multiplié par deux et la faim réapparaît dans les pays occidentaux. Pour ceux qui conservent un emploi, la charge de travail et le rythme d'exploitation vont s'aggraver.
La classe ouvrière ne peut rien attendre des efforts de la bourgeoisie pour "normaliser" la situation économique, si ce n'est des licenciements et des réductions de salaires, l’augmentation du stress et de l'angoisse, des augmentations drastiques, des mesures d'austérité à tous les niveaux, dans l'éducation comme dans les pensions de santé et les prestations sociales. En bref, nous assisterons à une dégradation des conditions de vie et de travail à un niveau qu'aucune des générations de l'après-Seconde Guerre mondiale n'a connu jusqu'à présent.
23) Puisque le mode de production capitaliste est entré dans sa décadence, la pression pour lutter contre ce déclin avec des mesures capitalistes d'État est croissante. Cependant, la tendance à renforcer les organes et les formes capitalistes étatiques est tout sauf un renforcement du capitalisme ; au contraire, ils expriment les contradictions croissantes sur le terrain économique et politique. Avec l'accélération de la décomposition dans le sillage de la pandémie, nous assistons également à une forte augmentation des mesures capitalistes d'État ; celles-ci ne sont pas l’expression d’un plus grand contrôle de l’État sur la société mais constituent plutôt l'expression des difficultés croissantes à organiser la société dans son ensemble et à empêcher sa tendance croissante à la fragmentation.
Les perspectives pour la lutte de classe
24. Le CCI a reconnu au début des années 90 que l'effondrement du bloc de l'Est et l'ouverture définitive de la phase de décomposition créeraient des difficultés croissantes pour le prolétariat : le manque de perspective politique, qui avait déjà été un élément central des difficultés du mouvement de la classe ouvrière dans les années 1980, serait sérieusement aggravé par les campagnes assourdissantes sur la mort du communisme ; lié à cela, le sentiment d'identité de classe du prolétariat serait sévèrement affaibli dans la nouvelle période, à la fois par les effets d'atomisation et de division de la décomposition sociale, et par les efforts conscients de la classe dominante pour exacerber ces effets à travers des campagnes idéologiques (la "fin de la classe ouvrière") et les changements "matériels" apportés par la politique de globalisation (éclatement des centres traditionnels de la lutte de classe, délocalisation des industries vers des régions du monde où la classe ouvrière n'a pas le même degré d'expérience historique, etc.).
25. Le CCI a eu tendance à sous-estimer la profondeur et la durée de ce recul de la lutte de classe, voyant souvent des signes que le reflux était sur le point d'être surmonté et que nous verrions à une échéance relativement brève de nouvelles vagues internationales de lutte comme dans la période après 1968. En 2003, sur la base de nouvelles luttes en France, en Autriche et ailleurs, le CCI a prédit un renouveau des luttes par une nouvelle génération de prolétaires qui avait été moins influencée par les campagnes anticommunistes et serait confrontée à un avenir de plus en plus incertain. Dans une large mesure, ces prédictions ont été confirmées par les événements de 2006-2007, notamment la lutte contre le CPE en France, et de 2010-2011, en particulier le mouvement des Indignés en Espagne. Ces mouvements ont montré des avancées importantes au niveau de la solidarité entre les générations, de l'auto-organisation par le biais d'assemblées, de la culture du débat, des préoccupations réelles quant à l'avenir qui attend la classe ouvrière et l'humanité dans son ensemble. En ce sens, ils ont montré le potentiel d'une unification des dimensions économiques et politiques de la lutte de classe. Cependant, il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre les immenses difficultés auxquelles était confrontée cette nouvelle génération, "élevée" dans les conditions de la décomposition, difficultés qui empêcheraient le prolétariat d'inverser le recul post-89 au cours de cette période.
26. Un élément clé de ces difficultés était l'érosion continue de l'identité de classe. Cela avait déjà été visible dans les luttes de 2010-11, en particulier dans le mouvement en Espagne : malgré les avancées importantes réalisées au niveau de la conscience et de l'organisation, la majorité des Indignés se voyait comme des "citoyens" plutôt que comme des membres d'une classe, ce qui la rendait vulnérable aux illusions démocratiques colportées par des groupes comme Democratia real Ya ! (le futur Podemos), et plus tard au poison du nationalisme catalan et espagnol. Au cours des années suivantes, le reflux qui s'est produit à la suite de ces mouvements a été approfondi par la montée rapide du populisme, qui a créé de nouvelles divisions au sein de la classe ouvrière internationale - des divisions exploitant les différences nationales et ethniques, alimentées par les attitudes pogromistes de la droite populiste, mais aussi des divisions politiques entre populisme et anti-populisme. Partout dans le monde, la colère et le mécontentement grandissaient, fondés sur de graves privations matérielles et de réelles angoisses quant à l'avenir ; mais en l'absence d'une réponse prolétarienne, une grande partie de ce mécontentement a été canalisée dans des révoltes interclassistes telles que les Gilets Jaunes en France, dans des campagnes parcellaires sur un terrain bourgeois telles que les marches pour le climat, dans des mouvements pour la démocratie contre la dictature (Hong Kong, Biélorussie, Myanmar, etc.) ou dans l'enchevêtrement inextricable des politiques identitaires raciale et sexuelle qui servent à dissimuler davantage la question cruciale de l'identité de classe prolétarienne comme seule base pour une réponse authentique à la crise du mode de production capitaliste. La prolifération de ces mouvements - qu'ils apparaissent comme des révoltes interclassistes ou des mobilisations ouvertement bourgeoises - a accru les difficultés déjà considérables non seulement pour la classe ouvrière dans son ensemble mais pour la Gauche communiste elle-même, pour les organisations qui ont la responsabilité de définir et de défendre le terrain de classe. Un exemple clair de cela a été l'incapacité des bordiguistes et de la TCI à reconnaître que la colère provoquée par le meurtre de George Floyd par la police en mai 2020 avait été immédiatement détournée vers des canaux bourgeois. Mais le CCI a également rencontré d'importants problèmes face à cet éventail de mouvements souvent déconcertants et, dans le cadre de son examen critique des 20 dernières années, il devra sérieusement examiner la nature et l'étendue des erreurs qu'il a commises au cours de la période allant du printemps arabe de 2011 à ces révoltes et mobilisations plus récentes, en passant par les manifestations dites aux bougies en Corée du Sud.
27. La pandémie en particulier a créé des difficultés considérables pour la classe ouvrière :
- Alors que la crise Covid-19 perdure depuis près de deux ans avec son lourd impact sanitaire, social, politique et économique sur la plupart des Etats du monde, cela n'a en rien modéré leurs appétits impérialistes. La montée des tensions a été particulièrement marquée ces derniers mois par une nette exacerbation de l'opposition entre les Etats-Unis et la Chine, soulignée tout récemment par l'accord dit "Aukus" entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, et visant explicitement la Chine.- Comme toujours, la bourgeoisie n'hésite pas à utiliser les effets de la décomposition contre la classe ouvrière. Si les confinements ont été principalement motivés par le fait que la bourgeoisie n'avait pas d'autre recours pour empêcher la propagation de la maladie, elle profitera certainement de la situation pour renforcer l'atomisation et l’exploitation de la classe ouvrière, notamment par le biais du nouveau modèle de "télétravail ". Cette nouvelle étape dans l'atomisation de la population active est source d'une souffrance psychologique croissante, notamment chez les jeunes (accroissant même les cas de suicides).
- De même, la classe dirigeante a profité des conditions de la pandémie pour renforcer ses systèmes de surveillance de masse et pour introduire de nouvelles lois répressives limitant les protestations et les manifestations, ainsi qu'une violence policière de plus en plus manifeste contre toute expression de mécontentement social.
- L'augmentation massive du chômage résultant du confinement ne sera pas, dans cette situation et à court terme, un facteur d'unification des luttes ouvrières mais aura plutôt tendance à renforcer encore l'atomisation.
- Bien que le confinement ait provoqué un grand mécontentement social, lorsque celui-ci s'est exprimé ouvertement, comme en Espagne en février et en Allemagne en avril 2021, il a pris la forme de manifestations "pour la liberté individuelle" qui sont une impasse totale pour la classe ouvrière.
- Plus généralement, la période de pandémie a vu une nouvelle recrudescence de la "politique identitaire", dans laquelle l'insatisfaction de l’existence dans le système actuel est fragmentée en un maelström d'identités qui s'affrontent, basées sur la race, le genre, la culture, etc. et qui constituent une menace majeure pour le rétablissement de la seule identité capable d'unifier et de libérer l'ensemble de l'humanité derrière elle : l'identité de classe prolétarienne. De plus, derrière ce chaos d'identités concurrentes pénétrant l'ensemble de la population, se cache la concurrence entre différentes factions bourgeoises de droite et de gauche, portant avec elle le danger d'entraîner la classe ouvrière dans de nouvelles formes de "lutte culturelle" réactionnaire et même de guerre civile violente.
28. Malgré les énormes problèmes auxquels le prolétariat est confronté, nous rejetons l'idée que la classe a déjà été vaincue à l'échelle mondiale, ou qu'elle est sur le point de subir une défaite comparable à celle de la période de contre-révolution, un genre de défaite dont le prolétariat ne serait peut-être plus capable de se remettre. Le prolétariat, en tant que classe exploitée, ne peut éviter de passer par l'école des défaites, mais la question centrale est de savoir si le prolétariat a déjà été tellement submergé par l'avancée implacable de la décomposition que son potentiel révolutionnaire a été effectivement sapé. Mesurer une telle défaite dans la phase de décomposition est une tâche bien plus complexe que dans la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, lorsque le prolétariat s'était levé ouvertement contre le capitalisme et avait été écrasé par une série de défaites frontales, ou que dans la période qui a suivi 1968, lorsque le principal obstacle à la marche de la bourgeoisie vers une nouvelle guerre mondiale fut le renouveau de la lutte de classe par une nouvelle génération invaincue de prolétaires. Comme nous l'avons déjà rappelé, la phase de décomposition contient en effet le danger que le prolétariat échoue tout simplement à répondre et soit étouffé sur une longue période - une "mort par mille coups" plutôt qu'un affrontement de classe frontal. Néanmoins, nous affirmons qu'il y a encore suffisamment d'éléments qui montrent que, malgré les l’avancée incontestable de la décomposition, malgré le fait que le temps ne joue plus en faveur de la classe ouvrière, le potentiel d'une profonde renaissance prolétarienne - menant à une réunification entre les dimensions économiques et politiques de la lutte de classe - n'a pas disparu, comme en témoignent :
- la persistance d'importants mouvements prolétariens qui sont apparus dans la phase de décomposition (2006-7, 2010-11, etc.) ;
- Le fait que, juste avant la pandémie, nous avons vu une réapparition fragile de la lutte de classe (aux États-Unis en 2018, et surtout en France en 2019). Et même si cette dynamique a ensuite été largement bloquée par la pandémie et les confinements, nous avons vu, dans un certain nombre de pays, des mouvements de classe significatifs même pendant la pandémie, notamment autour des questions de sécurité, notamment sanitaire, au travail ;
- Les signes, petits mais significatifs, d'une maturation souterraine de la conscience, se manifestant par une ébauche de réflexion globale sur la faillite du capitalisme et la nécessité d’une autre société dans certains mouvements (notamment les Indignés en 2011), mais aussi par l'émergence de jeunes éléments en recherche de positions de classe et se tournant vers l'héritage de la Gauche communiste ;
- Plus important encore, la situation à laquelle la classe ouvrière est confrontée n'est pas la même que celle qui a suivi l'effondrement du bloc de l'Est et l'ouverture de la phase de décomposition en 1989. À cette époque, il était possible de présenter ces événements comme la preuve de la mort du communisme et de la victoire du capitalisme et le début d'un avenir radieux pour l'humanité. Trente ans de décomposition ont sérieusement ébranlé cette fraude idéologique d'un avenir meilleur, et la pandémie en particulier a mis à jour l'irresponsabilité et la négligence de tous les gouvernements capitalistes et la réalité d'une société déchirée par de profondes divisions économiques où nous ne sommes en aucun cas "tous dans le même bateau". Au contraire, la pandémie et le confinement ont eu tendance à révéler la condition de la classe ouvrière à la fois comme principale victime de la crise sanitaire mais aussi comme source de tout le travail et de toute la production matérielle et en particulier les biens de première nécessité. Cela peut être l'une des bases d'une future récupération de l'identité de classe. Et, avec la compréhension croissante que le capitalisme est un mode de production totalement obsolète, cela a déjà été un facteur dans l'apparition des minorités politisées dont la motivation a été avant tout de comprendre la situation dramatique à laquelle l'humanité est confrontée.
- Enfin, à un niveau historique plus large, le capital mobilise de plus en plus de travailleurs dans le monde, le processus de prolétarisation et donc d'exploitation du travail vivant est ininterrompu. La classe ouvrière d'aujourd'hui est plus nombreuse et plus interconnectée que jamais, mais avec le progrès de la décomposition, l'atomisation sociale et l'isolement s'intensifient. Cela s'exprime également dans les difficultés de la classe ouvrière à faire l'expérience de sa propre identité de classe. Ce n'est que par ses luttes sur son propre terrain de classe que la classe ouvrière est capable de créer son pouvoir "associatif" qui exprime une anticipation du travail associé dans le communisme. Les travailleurs sont réunis par le capital dans le processus de production, le travail associé est réalisé sous la contrainte, mais le caractère révolutionnaire du prolétariat signifie le renversement dialectique de ces conditions dans une lutte collective. L'exploitation du travail commun est renversée dans la lutte contre l'exploitation et pour la libération du caractère social du travail, pour une société qui sait utiliser consciemment tout le potentiel du travail associé.
Ainsi, la lutte défensive de la classe ouvrière contient les germes des relations sociales qualitativement plus élevées qui sont le but final de la lutte de classe - ce que Marx appelait les "producteurs librement associés". Par l'association, par la réunion de toutes ses composantes, de toutes ses capacités et de toutes ses expériences, le prolétariat peut devenir puissant, il peut devenir le combattant toujours plus conscient et uni pour une humanité libérée et son signe avant-coureur.
29. Malgré la tendance du processus de décomposition à agir sur la crise économique, cette dernière reste l'"alliée du prolétariat" dans cette phase. Comme le disent les Thèses sur la décomposition :
"l'aggravation inexorable de la crise du capitalisme, constitue le stimulant essentiel de la lutte et de la prise de conscience de la classe, la condition même de sa capacité à résister au poison idéologique du pourrissement de la société. En effet, autant le prolétariat ne peut trouver un terrain de rassemblement de classe dans des luttes partielles contre les effets de la décomposition, autant sa lutte contre les effets directs de la crise elle-même constitue la base du développement de sa force et de son unité de classe. Il en est ainsi notamment parce que:
- si les effets de la décomposition (par exemple la pollution, la drogue, l'insécurité, etc.) affectent de façon relativement indistincte toutes les couches de la société et constituent un terrain propice aux campagnes et mystifications a-classistes (écologie, mouvements antinucléaires, mobilisations antiracistes, etc.), les attaques économiques (baisse du salaire réel, licenciements, augmentation des cadences, etc.) résultant directement de la crise affectent de façon spécifique le prolétariat (c'est-à-dire la classe produisant la plus-value et s'affrontant au capital sur ce terrain);
- la crise économique, contrairement à la décomposition sociale qui concerne essentiellement les superstructures, est un phénomène qui affecte directement l'infrastructure de la société sur laquelle reposent ces superstructures; en ce sens, elle met à nu les causes ultimes de l'ensemble de la barbarie qui s'abat sur la société, permettant ainsi au prolétariat de prendre conscience de la nécessité de changer radicalement de système, et non de tenter d'en améliorer certains aspects." (Thèse 17 [22])
30. Par conséquent, nous devons rejeter toute tendance à minimiser l'importance des luttes économiques "défensives" de la classe, ce qui est une expression typique de la conception moderniste qui ne voit la classe que comme une catégorie exploitée et non également comme une force historique, révolutionnaire. Il est bien sûr vrai que la lutte économique seule ne peut pas faire barrage à la décomposition : comme le disent les Thèses sur la décomposition, "Pour mettre fin à la menace que constitue la décomposition, les luttes ouvrières de résistance aux effets de la crise ne suffisent plus: seule la révolution communiste peut venir à bout d'une telle menace." Mais c'est une erreur profonde de perdre de vue l'interaction constante et dialectique entre les aspects économiques et politiques de la lutte, comme Rosa Luxemburg l'a souligné dans son travail sur la grève de masse de 1905 ; et encore, dans le feu de la révolution allemande de 1918-19, lorsque la dimension "politique" était au grand jour, elle a insisté sur le fait que le prolétariat devait encore développer ses luttes économiques comme seule base pour s'organiser et s'unifier en tant que classe. Ce sera la combinaison du renouveau des luttes défensives sur un terrain de classe, se heurtant aux limites objectives de la société bourgeoise en décomposition, et fertilisée par l'intervention de la minorité révolutionnaire, qui permettra à la classe ouvrière de récupérer sa perspective révolutionnaire, d'avancer vers la politisation pleinement prolétarienne qui lui permettra de sortir l'humanité du cauchemar du capitalisme en décomposition.
31. Dans une première période, la redécouverte de l'identité et de la combativité de classe constituera une forme de résistance contre les effets corrosifs de la décomposition capitaliste - un rempart contre la fragmentation de la classe ouvrière et la division entre ses différentes parties. Sans le développement de la lutte de classe, des phénomènes tels que la destruction de l'environnement et la prolifération du chaos militaire tendent à renforcer le sentiment d'impuissance et le recours à de fausses solutions telles que l'écologisme et le pacifisme. Mais à un stade plus développé de la lutte, dans le contexte d'une situation révolutionnaire, la réalité de ces menaces pour la survie de l'espèce peut devenir un facteur de compréhension du fait que le capitalisme a effectivement atteint la phase terminale de son déclin et que la révolution est la seule issue possible. En particulier, les pulsions guerrières du capitalisme - surtout lorsqu'elles impliquent directement ou indirectement les grandes puissances - peuvent être un facteur important dans la politisation de la lutte de classe, car elles impliquent à la fois une augmentation très concrète de l'exploitation et du danger physique, mais aussi une confirmation supplémentaire que la société est confrontée au choix capital entre socialisme et barbarie. De facteurs de démobilisation et de désespoir, ces menaces peuvent renforcer la détermination du prolétariat à en finir avec ce système moribond.
- "De même, dans toute la période qui vient, le prolétariat ne peut espérer utiliser à son bénéfice l'affaiblissement que provoque la décomposition au sein même de la bourgeoisie. Durant cette période, son objectif sera de résister aux effets nocifs de la décomposition en son propre sein en ne comptant que sur ses propres forces, sur sa capacité à se battre de façon collective et solidaire en défense de ses intérêts en tant que classe exploitée (même si la propagande des révolutionnaires doit en permanence souligner les dangers de la décomposition). C'est seulement dans la période prérévolutionnaire, quand le prolétariat sera à l'offensive, lorsqu'il engagera directement et ouvertement le combat pour sa propre perspective historique, qu'il pourra utiliser certains effets de la décomposition, notamment la décomposition de l'idéologie bourgeoise et celle des forces du pouvoir capitaliste, comme des points d'appui et qu'il sera capable de les retourner contre le capital." (Thèses sur la décomposition [22]).
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [146]
Rubrique:
Rapport sur la pandémie et le développement de la décomposition
- 420 lectures
D’une certaine façon, « la Gauche communiste se trouve aujourd’hui dans une situation similaire à celle de Bilan des années 1930, au sens où elle est contrainte de comprendre une situation historique nouvelle sans précédent » (Résolution sur la situation internationale [147], 13e congrès du CCI, Revue internationale n°97, 1999). Ce constat, plus adéquat que jamais, requerrait des débats intenses entre organisations du milieu prolétarien pour analyser la signification de la crise du Covid-19 dans l’histoire du capitalisme et les conséquences qui en découlent. Or, face à l’extension fulgurante des événements, les groupes du MPP apparaissent totalement désemparés et désarmés : au lieu de se saisir de la méthode marxiste comme d’une théorie vivante, ils la réduisent à un dogme invariant où la lutte de classe est vue comme une répétition immuable de schémas éternellement valides sans pouvoir montrer non seulement ce qui persiste mais aussi ce qui a changé. Ainsi, les groupes bordiguistes ou conseillistes ignorent obstinément l’entrée du système dans sa phase de décadence. D’autre part, la Tendance communiste internationale (TCI) rejette la décomposition comme une vision cataclysmique et limite ses explications au truisme selon lequel le profit est responsable de la pandémie et à l’idée illusoire que cette dernière n’est qu’un événement anecdotique, une parenthèse, dans les attaques de la bourgeoisie pour maximiser ses profits. Ces groupes du MPP se contentent de réciter les schémas du passé sans analyser les circonstances spécifiques, le moment et l’impact de la crise sanitaire. En conséquence, leur apport dans l’évaluation du rapport de force entre les deux classes antagoniques de la société, des dangers ou opportunités qui se présentent à la classe et à ses minorités est aujourd’hui dérisoire.
Une démarche marxiste ferme est d’autant plus nécessaire que la méfiance envers le discours officiel engendre actuellement l’émergence de nombreuses « explications alternatives » fallacieuses et fantaisistes des événements. Des théories « complotistes » plus fantaisistes les unes que les autres voient le jour et son partagées par des millions d’adeptes : la pandémie et aujourd’hui la vaccination massive seraient une machination des Chinois pour assurer leur suprématie, un complot de la bourgeoisie mondiale pour préparer la guerre ou restructurer l’économie mondiale, une prise de pouvoir par une internationale secrète de virologues ou encore une conspiration mondiale nébuleuse des élites (sous la direction de Soros ou Gates), … Cette ambiance générale provoque même une désorientation du milieu politique, un véritable « Corona blues ».
Pour le CCI, le marxisme est « une pensée vivante pour laquelle chaque événement historique important est l'occasion d'un enrichissement. (…). Il revient aux organisations et aux militants révolutionnaires la responsabilité spécifique et fondamentale d'accomplir cet effort de réflexion en ayant bien soin, à l'image de nos aînés comme Lénine, Rosa Luxemburg, la Fraction Italienne de la Gauche Communiste Internationale (Bilan), la Gauche Communiste de France, etc., d'avancer à la fois avec prudence et audace :
- en s'appuyant de façon ferme sur les acquis de base du marxisme ;
- en examinant la réalité sans œillères et en développant la pensée sans "aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme" (Bilan).
En particulier, face à de tels événements historiques, il importe que les révolutionnaires soient capables de bien distinguer les analyses qui sont devenues caduques de celles qui restent valables, afin d'éviter un double écueil : soit s'enfermer dans la sclérose, soit "jeter le bébé avec l'eau du bain » (Texte d'orientation Militarisme et décomposition [148], 1991).
Dès lors, la crise du Covid-19 impose au CCI de confronter les éléments marquants de cet événement majeur au cadre de la décomposition que l’organisation met en avant depuis plus de 30 ans pour appréhender l’évolution du capitalisme. Ce cadre est clairement rappelé dans la résolution sur la situation internationale [149] du 23e congrès international du CCI (2019) : « Il y a 30 ans, le CCI a mis en évidence que le système capitaliste était entré dans la phase ultime de sa période de décadence et de son existence, celle de la décomposition. Cette analyse se basait sur un certain nombre de faits empiriques, mais en même temps elle donnait un cadre pour la compréhension de ceux-ci : "Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s’affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l’histoire ne saurait pourtant s’arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l’ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de "gel", de "stagnation" de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s’aggraver, l’incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l’ensemble de la société et l’incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l’immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société." (La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [22], Point 4, Revue Internationale n° 107). Notre analyse prenait le soin de préciser les deux significations du terme "décomposition" ; d’une part, il s’applique à un phénomène qui affecte la société, particulièrement dans la période de décadence du capitalisme et, d’autre part, il désigne une phase historique particulière de cette dernière, sa phase ultime : "… il est indispensable de mettre en évidence la différence fondamentale qui oppose les éléments de décomposition qui ont affecté le capitalisme depuis le début du siècle [le 20e siècle] et la décomposition généralisée dans laquelle s’enfonce à l’heure actuelle ce système et qui ne pourra aller qu’en s’aggravant. Là aussi, au-delà de l’aspect strictement quantitatif, le phénomène de décomposition sociale atteint aujourd’hui une telle profondeur et une telle extension qu’il acquiert une qualité nouvelle et singulière manifestant l’entrée du capitalisme décadent dans une phase spécifique – la phase ultime – de son histoire, celle où la décomposition devient un facteur, sinon le facteur, décisif de l’évolution de la société." (Ibid., Point 2)
C’est principalement ce dernier point, le fait que la décomposition tende à devenir le facteur décisif de l’évolution de la société, et donc de l’ensemble des composantes de la situation mondiale – une idée qui n’est nullement partagée par les autres groupes de la Gauche communiste – qui constitue l’axe majeur de la présente résolution » (Résolution sur la situation internationale [149], 23è congrès du CCI, Revue Internationale n° 164).
Dans ce contexte, le but de ce rapport est d’évaluer l’impact de la crise du Covid-19 sur l’approfondissement des contradictions au sein du système capitaliste et les incidences de celle-ci sur l’approfondissement de la phase de décomposition.
1. La crise du Covid-19 révèle la profondeur du pourrissement sur pied du capitalisme.
La pandémie sévit dans le cœur du capitalisme : une première, puis une seconde, voire une troisième vague d’infections déferlent sur le monde et en particulier sur les pays industrialisés ; leurs systèmes hospitaliers sont au bord de l’implosion et ils sont obligés d’imposer à répétition des confinements plus ou moins radicaux. Après un an de pandémie, les chiffres officiels, largement sous-évalués dans de nombreux pays, comptabilisent plus de 500.000 morts aux USA et plus de 650.000 dans l’Union Européenne comme en Amérique Latine.
Durant les douze derniers mois, dans ce mode de production aux capacités scientifiques et technologiques illimitées, les bourgeoisies, non seulement de pays périphériques mais surtout des principaux pays industrialisés, se sont montrées incapables :
- d’empêcher l’extension de la pandémie, puis sa reprise à travers une deuxième, troisième, …. vague ;
- d’éviter la saturation des systèmes hospitaliers, comme en Italie, en Espagne, mais aussi en Grande-Bretagne ou aux USA ;
- de mettre en place des techniques et des instruments pour contrôler et endiguer les différentes vagues ;
- de coordonner et centraliser la recherche d’un vaccin et de mettre en place une politique de production, de diffusion et de vaccination planifiée et réfléchie pour l’ensemble de la planète.
Au contraire, elles ont rivalisé dans la prise de mesures incohérentes et chaotiques et ont eu recours, en désespoir de cause, à des mesures datant des tréfonds de l’histoire, telles que le confinement, la quarantaine ou le couvre-feu. Elles ont condamné à la mort des centaines de milliers de personnes en sélectionnant les malades du Covid admis dans les hôpitaux surchargés ou en postposant à une date lointaine le traitement d’autres pathologies graves.
Le déroulement catastrophique de la crise pandémique est fondamentalement lié à la pression implacable de la crise historique du mode de production capitaliste. L’impact des mesures d’austérité, encore accentuées depuis la récession de 2007-2011, la concurrence économique impitoyable entre les États et la priorité accordée, en particulier dans les pays industrialisés, au maintien des capacités de production au détriment de la santé des populations au nom de la primauté de l’économie ont favorisé l’ampleur de la crise sanitaire et constituent une entrave permanente à son endiguement. Cette immense catastrophe que constitue la pandémie n’est pas le produit de la fatalité ni de l’insuffisance des connaissances scientifiques ou des outils sanitaires (comme cela a pu être le cas dans des modes de production antérieurs) ; elle n’arrive pas non plus comme un coup de tonnerre dans un ciel serein ni ne constitue une parenthèse passagère. Elle exprime l’impuissance fondamentale du mode de production capitaliste déclinant, qui va au-delà de l’incurie de tel ou tel gouvernement mais qui est au contraire révélatrice du blocage et du pourrissement sur pied de la société bourgeoise. Et surtout elle révèle l’ampleur de cette phase de décomposition qui s’approfondit depuis 30 ans.
1.1. Son surgissement met en lumière 30 années d’enfoncement dans la décomposition
La crise du Covid-19 ne surgit pas du néant ; elle est à la fois l’expression et la résultante de 30 années de phase de décomposition qui ont marqué une tendance à la multiplication, à l’approfondissement et à une convergence de plus en plus nette des différentes manifestations du pourrissement sur pied.
(a) L’importance et la signification de la dynamique de décomposition ont été appréhendées par le CCI dès la fin des années ’80 : « Alors que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour imposer sa "solution" : la guerre impérialiste généralisée, et que la lutte de classe n'est pas encore suffisamment développée pour permettre la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, le capitalisme est entraîné dans une dynamique de décomposition, de pourrissement sur pied qui se manifeste sur tous les plans de son existence :
- dégradation des relations internationales entre États manifestée par le développement du terrorisme ;
- catastrophes technologiques et soi-disant naturelles à répétition ;
- destruction de la sphère écologique ;famines, épidémies, expressions de la paupérisation absolue qui se généralise ;
- explosion des "nationalités" ;
- vie de la société marquée par le développement de la criminalité, de la délinquance, des suicides, de la folie, de l'atomisation individuelle ;
- décomposition idéologique marquée entre autre par le développement du mysticisme, du nihilisme, de l'idéologie du "chacun-pour-soi", etc. » (Résolution sur la Situation internationale [150], 8e congrès du CCI, 1989, Revue internationale n° 59).
(b) L’implosion du bloc soviétique marque une accélération spectaculaire du processus malgré les campagnes pour le dissimuler. L’effondrement de l’intérieur d’un des deux blocs impérialistes qui se faisaient face, sans que cela soit le produit, ni d’une guerre mondiale entre les blocs, ni de l’offensive du prolétariat, ne peut être compris que comme une expression majeure de l’entrée dans la phase de décomposition. Cependant, les tendances à la perte de contrôle et à l’exacerbation du chacun pour soi que cette implosion manifeste ont été largement dissimulées et contrées dans un premier temps, d’abord par le regain du prestige de la « démocratie » du fait de sa « victoire sur le communisme » (campagnes sur la mort du communisme et la supériorité du mode de gouvernement démocratique), ensuite par la 1ère guerre du golfe (1991), engagée au nom des Nations Unies contre Saddam Husein qui permet à Bush senior d’imposer une « coalition internationale des États » sous la direction des USA et de freiner ainsi dans un premier temps la tendance au chacun pour soi ; enfin, par le fait que l’effondrement économique découlant de l’implosion du bloc de l’Est touche uniquement les anciens pays du bloc russe, une partie particulièrement arriérée du capitalisme, et épargne largement les pays industrialisés.
(c) Au début du 21e siècle, l’extension de la décomposition se manifeste avant tout par l’explosion du chacun pour soi et du chaos sur le plan impérialiste. L’attaque des Twin Towers et du Pentagone par Al Qaeda le 11 septembre 2001 et la riposte militaire unilatérale de l’administration Bush ouvre toute grande la « boîte de pandore » de la décomposition : avec l’attaque et l’invasion de l’Irak en 2003 au mépris des conventions ou des organisations internationales et sans tenir compte de l’avis de ses principaux « alliés », la première puissance mondiale passe du statut de gendarme de l'ordre mondial à celui d'agent principal du chacun pour soi et du chaos. L’occupation de l’Irak, puis la guerre civile en Syrie (2011) vont puissamment attiser le chacun pour soi impérialiste non seulement au Moyen-Orient mais sur toute la planète. Elles accentuent également la tendance au déclin du leadership US, tandis que la Russie revient à l’avant-plan, en particulier par un rôle impérialiste « perturbateur » en Syrie et que la Chine monte rapidement en puissance en tant que challenger de la superpuissance US.
(d) Dans les deux premières décennies du 21e siècle, la croissance quantitative et qualitative du terrorisme, favorisée par l’extension du chaos et la barbarie guerrière dans le monde, prend une place centrale dans la vie de la société comme instrument de guerre entre États. Cela a conduit à la constitution d'un nouvel État, « l’État Islamique » (Daesh), avec son armée, sa police, son administration, ses écoles, dont le terrorisme est l'arme de prédilection et qui a déclenché une vague d’attentats suicides au Moyen-Orient comme dans les métropoles des pays industrialisés. « La constitution de Daesh en 2013-14 et les attentats en France en 2015-16, en Belgique et en Allemagne en 2016 représentent une autre étape de premier plan de ce processus » (Rapport sur la décomposition aujourd'hui [151], 22è Congrès du CCI, 2017). Cette expansion de ce terrorisme ‘kamikaze’ va de pair avec la progression du radicalisme religieux irrationnel et fanatique partout dans le monde, du Moyen-Orient au Brésil, des USA à l’Inde.
(e) En 2016-17, le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne et l’avènement de Trump aux USA révèlent le tsunami populiste qui constitue une nouvelle manifestation particulièrement saillante de l’approfondissement de la décomposition. « La montée du populisme constitue une expression, dans les circonstances actuelles, de la perte de contrôle croissante par la bourgeoisie des rouages de la société résultant fondamentalement de ce qui se trouve au cœur de la décomposition de celle-ci, l’incapacité des deux classes fondamentales de la société d’apporter une réponse à la crise insoluble dans laquelle s’enfonce l’économie capitaliste. En d’autres termes, la décomposition résulte fondamentalement d’une impuissance de la part de la classe régnante, d’une impuissance qui trouve sa source dans son incapacité à surmonter cette crise de son mode de production et qui tend de plus en plus à affecter son appareil politique. Parmi les causes actuelles de la vague populiste on trouve les principales manifestations de la décomposition sociale : la montée du désespoir, du nihilisme, de la violence, de la xénophobie, associée à un rejet croissant des "élites" (les "riches", les politiciens, les technocrates) et dans une situation où la classe ouvrière est incapable de présenter, même de façon embryonnaire, une alternative » (Résolution sur la situation internationale [149], 23e Congrès du CCI, pt3, Revue internationale n° 164). Si cette vague populiste touche en particulier les bourgeoisies des pays industrialisés, elle se retrouve aussi dans les autres régions du mode sous la forme de la venue au pouvoir de leaders forts et « charismatiques » (Orban, Bolsonaro, Erdogan, Modi, Duterte, …) souvent avec le soutien de sectes ou de mouvements extrémistes d’inspiration religieuse (églises évangélistes en Amérique latine ou en Afrique, Frères Musulmans en Turquie, mouvements identitaires racistes hindous dans le cas de Modi).
La phase de décomposition a déjà 30 ans d’histoire et le bref survol de cette dernière montre comment le pourrissement du capitalisme s’est étendu et approfondi à travers des phénomènes qui ont progressivement affecté de plus en plus d’aspects de la société et qui constituent les ingrédients qui ont provoqué le caractère explosif de la crise planétaire du Covid-19. Certes, pendant ces 30 ans, la progression des phénomènes a été discontinue, mais elle s’est déroulée sur différents plans (crise écologique, chacun pour soi impérialiste, fragmentation d’États, terrorisme, émeutes sociales, perte de contrôle de l’appareil politique, pourrissement idéologique), minant de plus en plus les tentatives du capitalisme d’État de contrer son avancée et de maintenir un certain cadre partagé. Pourtant, si les différents phénomènes atteignaient un niveau d’intensité appréciable, ils apparaissaient jusque-là comme « une prolifération de symptômes sans interconnexion apparente, contrairement aux périodes précédentes de la décadence du capitalisme qui étaient définies et dominées par des repères aussi évidents que la guerre mondiale ou la révolution prolétarienne » (Rapport sur la pandémie Covid-19 et la période de décomposition capitaliste [152] (juillet 2020)). C’est précisément la signification de la crise du Covid-19 d’être, telle l’implosion du bloc de l’Est, hautement emblématique de la phase de décomposition en cumulant l’ensemble des facteurs de putréfaction du système.
1.2. Son impact résulte de l’interaction des manifestations de décomposition qu’elle favorise
A l’instar les différentes manifestations de la décadence (guerres mondiales, crises générales de l’économie, militarisme, fascisme et stalinisme, …), il y a donc aussi accumulation des manifestations de la phase de décomposition. L’ampleur de l’impact de la crise du Covid-19 s’explique non seulement par cette accumulation mais aussi par l’interaction des expressions écologiques, sanitaires, sociales, politiques, économiques et idéologiques de la décomposition dans une sorte de spirale jamais observé jusqu’alors, qui a débouché sur une tendance à la perte de contrôle de plus en plus d’aspects de la société et à une flambée d’idéologies irrationnelles, extrêmement dangereuses pour le futur de l’humanité.
(a) Covid-19 et destruction de la nature
La pandémie est clairement une expression de la rupture de la relation entre l'humanité et la nature, qui a atteint une intensité et une dimension planétaire inégalées avec la décadence du système et, en particulier, avec la dernière phase de cette décadence, celle de la décomposition, à travers plus spécifiquement ici la croissance et la concentration urbaines incontrôlées (prolifération de bidonvilles surpeuplés) dans les régions périphériques du capitalisme, la déforestation et le changement climatique. Ainsi, dans le cas du Covid-19, une étude récente de chercheurs des universités de Cambridge et d’Hawaii et du Potsdam Institute for Climate Impact Research (dans la revue Science of the Total Environment) indiquerait que les changements climatiques en Chine du Sud au cours du siècle passé auraient favorisé la concentration dans la région d’espèces de Chauve-souris, qui sont porteuses de milliers de coronavirus, et permis la transmission du SARS-CoV-2, via probablement le pangolin, vers l’homme.[1]
Depuis des décennies, la destruction irrémédiable du monde naturel génère un danger croissant de catastrophes environnementales mais aussi sanitaires, comme l'ont déjà illustré les épidémies de SRAS, de H1N1 ou d'Ebola, qui, par chance, ne sont pas devenues des pandémies. Pourtant, bien que le capitalisme dispose de forces technologiques telles qu'il est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, de produire des armes monstrueuses capables de détruire la planète des dizaines de fois, il n’a pu se doter des moyens nécessaires pour remédier aux problèmes écologiques et sanitaires qui ont conduit au déclenchement de la pandémie Covid-19. L'homme est de plus en plus séparé de son "corps organique" (Marx) et la décomposition sociale accentue cette tendance.
(b) Covid-19 et récession économique
En même temps, les mesures d’austérité et de restructuration dans la recherche et les systèmes de santé, intensifiées encore depuis la récession de 2007-2011, ont réduit les disponibilités hospitalières et ralenti, si pas arrêté, les recherches sur les virus de la famille des Covid, alors que différentes épidémies précédentes avaient averti de la dangerosité de ceux-ci. D’autre part, au cours de la pandémie, l’objectif premier des pays industrialisés a toujours été de maintenir les capacités de production intactes autant et aussi longtemps que possible (et, dans leur prolongement, les crèches, l’enseignement gardien et primaire pour permettre aux parents d’aller travailler) tout en sachant qu’entreprises et écoles constituent un foyer non négligeable de contagion malgré les mesures prises (porter un masque, garder ses distances, etc.). En particulier, lors du déconfinement de l’été 2020, la bourgeoisie a joué cyniquement avec la santé des populations au nom de la primauté de l’économie, qui a toujours prévalu, même si cela doit contribuer au surgissement d’une nouvelle vague de la pandémie et à la répétition de confinements, à l’augmentation du nombre d’hospitalisations et de décès.
(c) Covid-19 et chacun pour soi impérialiste
L’accentuation du chacun pour soi entre États a constitué depuis le début un puissant stimulant à l’expansion de la pandémie et a incité même à son exploitation à des fins hégémoniques. D’abord, les tentatives initiales de la Chine de camoufler le surgissement du virus et son refus de transmettre des infos à l’OMS ont largement favorisé l’expansion initiale de la pandémie. Ensuite, la persistance de la pandémie et de ses différentes vagues ainsi que le nombre des victimes ont été favorisés par le refus de nombreux pays de « partager » leurs stocks de matériel sanitaire avec leurs voisins, par le chaos grandissant dans la coopération entre les différents pays, y compris et surtout au sein de l’UE, en vue d’harmoniser les politiques de limitation des contaminations ou la politique de conception et d’achat des vaccins, et encore par la « course au vaccin » entre les géants pharmaceutiques concurrents (avec de juteux bénéfices pour les gagnants à la clé) au lieu de réunir l’ensemble des compétences disponibles en médecine et en pharmacologie. Enfin, la « guerre des vaccins » sévit pleinement entre les États : ainsi, la Commission Européenne avait initialement refusé de réserver 5 millions de doses de vaccin supplémentaires proposées par Pfizer-BioNTech sous la pression de la France qui exigeait une commande supplémentaire équivalente pour l’entreprise française Sanofi ; le vaccin d’AstraZeneca/ Université d’Oxford est réservé en priorité à l’Angleterre au détriment des commandes de l’UE ; par ailleurs, les vaccins chinois (Sinovac), russe (Spoutnik V), indiens (BBV152) ou américains (Moderna) sont largement exploités par ces États comme des instruments de la politique impérialiste. La concurrence entre États et l’explosion du chacun pour soi ont accentué le chaos effrayant dans la gestion de la crise pandémique.
(d) Covid-19 et perte de contrôle de la bourgeoisie sur son appareil politique
La perte de contrôle sur l’appareil politique était déjà une des caractéristiques marquant l’implosion du bloc de l’Est mais elle était apparue alors comme une spécificité liée au caractère particulier des régimes staliniens. La crise des réfugiés (2015-16), l’émergence d’émeutes sociales contre la corruption des élites et surtout le raz-de-marée populiste (2016), toutes des manifestations certes déjà présentes mais de manière moins proéminentes lors des décennies passées, vont mettre en évidence dès la deuxième partie de la décennie 2010-2020 l’importance de ce phénomène comme expression de la progression de la décomposition. Cette dimension jouera un rôle déterminant dans l’extension de la crise du Covid-19. Le populisme et en particulier les dirigeants populistes comme Bolsonaro, Johnson ou Trump ont favorisé par leur politique « vandaliste » l’expansion et l’impact létal de la pandémie : ils ont banalisé le Covid-19 comme une simple grippe, ont favorisé une mise en place incohérente d’une politique de limitation des contaminations, exprimant ouvertement leur scepticisme envers celle-ci, et ont saboté toute collaboration internationale. Ainsi Trump a ouvertement transgressé les mesures sanitaires préconisées, ouvertement accusé la Chine (le « virus chinois ») et a refusé toute coopération avec l’OMS.
Ce « vandalisme » exprime de manière emblématique la perte de contrôle par la bourgeoisie de son appareil politique : après s’être montrées incapables dans un premier temps de limiter l’expansion de la pandémie, les différentes bourgeoisies nationales ont échoué à coordonner leurs actions et à mettre en place un large système de « testing » et de « track and tracing » en vue de contrôler et de limiter de nouvelles vagues de contagion du Covid-19. Enfin, le déploiement lent et chaotique de la campagne de vaccination souligne une fois de plus les difficultés de l’État à gérer adéquatement la pandémie. La succession de mesures contradictoires et inefficaces a nourri un scepticisme et une méfiance croissants dans les populations envers les directives des gouvernements : « On voit bien que, par rapport à la première vague, les citoyens ont davantage de mal à adhérer aux recommandations » (D. Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé en France, LMD 800, nov. 2020). Cette inquiétude est bien présente au sein des gouvernements des pays industrialisés (de Macron à Biden), conjurant la population de suivre les recommandations et les directives des autorités.
(e) Covid-19 et rejet des élites, idéologies irrationnelles ou montée du désespoir
Les mouvements populistes s’opposent non seulement aux élites mais favorisent également la progression d’idéologies nihilistes et des sectarismes religieux les plus rétrogrades, déjà renforcés par l’approfondissement de la phase de décomposition. La crise du Covid-19 a provoqué une explosion sans précédent de visions complotistes et anti-scientifiques, qui nourrissent la contestation des politiques sanitaires des États. Les théories conspirationnistes foisonnent et répandent des conceptions totalement fantaisistes concernant le virus et la pandémie. Par ailleurs, les dirigeants populistes comme Bolsonaro ou Trump ont exprimé ouvertement leur mépris pour la science. L’extension exponentielle de la pensée irrationnelle et de la mise en doute de la rationalité scientifique au cours de la pandémie est une illustration frappante de l’accélération de la décomposition.
Le rejet populiste des élites et les idéologies irrationnelles ont exacerbé une contestation de plus en plus violente sur un terrain purement bourgeois des mesures gouvernementales, telles les couvre-feu et les confinements. Cette rage anti-élites et anti-État a stimulé le surgissement de rassemblements (Danemark, Italie, Allemagne) ou d’émeutes « vandalistes », nihilistes et anti-étatiques contre les restrictions (aux cris de « "Liberté ! », « pour nos droits et la vie »), contre la « dictature du confinement » ou encore la « tromperie d’un virus qui n'existe pas », comme celles qui ont éclaté en janvier en Israël, au Liban, en Espagne et surtout dans de nombreuses villes des Pays-Bas.
1.3. Elle marque la concentration des manifestations vers les pays centraux du capitalisme
Les effets de la phase de décomposition ont d’abord touché de plein fouet des zones périphériques du système : pays de l’Est avec l’implosion du bloc soviétique et de l’ex-Yougoslavie, guerres au Moyen-Orient, tensions guerrières en Extrême-Orient (Afghanistan, Corée, Conflit frontalier sino-indien), famines, guerres civiles, chaos en Afrique. Cela change avec la crise des réfugiés, qui a entraîné un flot massif de demandeurs d’asile vers l’Europe, ou avec l’exode de populations désespérées du Mexique et d’Amérique centrale vers les USA, ensuite avec les attentats djihadistes aux USA et au cœur de l’Europe et enfin avec le tsunami populiste de 2016. Au cours de la deuxième décennie du 21e siècle, le centre des pays industrialisés est de plus en plus affecté et cette tendance est confirmée de manière spectaculaire avec la crise du Covid-19.
La pandémie touche de plein fouet le cœur du capitalisme et notamment les USA. Par rapport à la crise de 1989, l’implosion du bloc de l’Est, qui ouvrait la phase de décomposition, une différence capitale est précisément que la crise du Covid-19 ne touche pas une partie particulièrement arriérée du mode de production capitaliste, qu’elle ne peut donc être présentée comme une victoire du « capitalisme démocratique » puisqu’elle impacte au contraire le centre du système capitaliste à travers les démocraties d’Europe et les États-Unis. Comme un boomerang, les pires effets de la décomposition, que le capitalisme avait repoussé pendant des années vers la périphérie du système, reviennent en pleine figure des pays industrialisés, qui sont maintenant au centre de la tourmente et loin d’être débarrassés de tous ses effets. Cet impact sur les pays industrialisés centraux avait certes déjà été souligné par le CCI au niveau du contrôle du jeu politique, en particulier à partir de 2017, mais aujourd’hui, les bourgeoisies américaine, anglaise, allemande (et à leur suite celles des autres pays industrialisés) se trouvent au coeur de l’ouragan pandémique et de ses conséquences au niveau sanitaire, économique, politique, social et idéologique.
Parmi les pays centraux, c’est le plus puissant d’entre eux, la superpuissance US, qui subit le plus fortement l’impact de la crise du Covid-19 : nombre absolu d’infections et de décès le plus élevé au monde, situation sanitaire déplorable, une administration présidentielle « vandale » qui a géré catastrophiquement la pandémie et qui, sur le plan international a isolé le pays par rapport à ses alliances, une économie en grande difficulté, un président qui a décrédibilisé les élections, a appelé à marcher sur le parlement, a approfondi les divisions au sein du pays et a nourri la méfiance envers la science et les données rationnelles, qualifiées de « fake news ». Aujourd’hui, les USA constituent l’épicentre de la décomposition.
Comment expliquer que la pandémie semble effectivement moins affecter la « périphérie » du système cette fois-ci (nombre d’infections, nombre de morts), et en particulier l’Asie et l’Afrique ? Il y a bien sûr une série de raisons circonstancielles : le climat, la densité de population ou l’isolement géographique (comme le montrent les cas de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie ou de la Finlande en Europe) mais aussi la fiabilité relative des données : par exemple, le chiffre des décès par le Covid-19 en 2020 en Russie s’avère être trois fois plus élevé que le chiffre officiel (185.000 au lieu de 55.000) selon une des vice-premières ministres Tatjana Golikova sur base de la surmortalité (De Morgen, 29.12.2020).
Plus fondamentalement, le fait que l’Asie et l’Afrique ont une expérience antérieure de gestion de pandémies (N1N1, Ebola) a certainement joué en leur faveur. Ensuite, il y a diverses explications d’ordre économique (la densité plus ou moins forte des échanges et des contacts internationaux, le choix de confinements limités permettant la poursuite de l’activité économique), social (une population âgée « parquée » par centaines dans des « maisons de retraite »), médical (une durée de vie moyenne plus ou moins élevée : cf. France : 82,4/ Vietnam : 76/ Chine : 76,1/ Égypte : 70,9/ Philippines : 68,5/ Congo : 64,7 et la résilience plus ou moins forte aux maladies). Par ailleurs, les pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine subissent et subiront un impact indirect lourd de la pandémie à travers e.a. les retards dans la vaccination à la périphérie, les effets économiques de la crise du Covid-19 et le ralentissement du commerce mondial, comme l’indique le danger actuel de famine en Amérique centrale du fait de l’arrêt de l’économie. Enfin, le fait que les pays européens et les USA évitent autant que possible d’imposer des confinements et des contrôles drastiques et brutaux, comme ceux décrétés en Chine, est sans doute aussi lié à la prudence de bourgeoisies envers une classe ouvrière, déboussolée certes mais non battue, qui n’est pas prête à se laisser « enfermer » par l’État. La perte de contrôle de son appareil politique et la colère au sein d’une population confrontée à l’effondrement des services de santé et à l’échec des politiques sanitaires, lui imposent d’autant plus d’agir avec circonspection.
2. La crise du covid-19 annonce une accélération puissante du processus de décomposition
Face à un milieu politique prolétarien qui, après avoir nié les expressions passées de la décomposition, considère la crise pandémique comme un épisode transitoire, le CCI doit souligner au contraire que l’ampleur de la crise du Covid-19 et de ses conséquences implique qu’il n’y aura pas de « retour à la normale ». Même si l’approfondissement de la décomposition, tout comme ce fut le cas pour la décadence, n’est pas linéaire, même si le départ du populiste Trump et l’arrivée au pouvoir de Biden dans la première puissance mondiale peut dans un premier temps présenter l’image d’une illusoire stabilisation, il faut être conscient que différentes tendances qui se sont manifestées pendant la crise du Covid-19 marquent une accélération du processus de pourrissement sur pied et de destruction du système.
2.1. Le pourrissement des superstructures infecte à présent la base économique
En 2007, notre analyse concluait encore que « Paradoxalement, la situation économique du capitalisme est l'aspect de cette société qui est le moins affecté par la décomposition. Il en est ainsi principalement parce que c'est justement cette situation économique qui détermine, en dernière instance, les autres aspects de la vie de ce système, y compris ceux qui relèvent de la décomposition. (…). Aujourd'hui, malgré tous les discours sur le "triomphe du libéralisme", sur le "libre exercice des lois du marché", les États n'ont renoncé ni à l'intervention dans l'économie de leurs pays respectifs, ni à l'utilisation des structures chargées de réguler quelque peu les rapports entre eux en en créant même de nouvelles, telle l'Organisation mondiale du commerce » (Résolution sur la situation internationale [153], Revue internationale n° 130, 2007). Jusqu’alors, crise économique et décomposition avaient été séparées par l’action des États, la première ne semblant pas affectée par la seconde.
De fait, des mécanismes internationaux du capitalisme d’État, déployés dans le cadre des blocs impérialistes (1945-89), avaient été maintenus à partir des années ‘90 à l’initiative des pays industrialisés comme palliatif à la crise et comme bouclier de protection face aux effets de la décomposition. Le CCI avait appréhendé les mécanismes multilatéraux de coopération économique et une certaine coordination des politiques économiques non pas comme une unification du capital au niveau mondial, ni comme une tendance au super-impérialisme, mais comme une collaboration entre bourgeoisies sur le plan international en vue de réguler et organiser le marché et la production mondiale, de ralentir et réduire le poids de l’enfoncement dans la crise, d’éviter l’impact des effets de la décomposition sur le terrain névralgique de l’économie et enfin de protéger le cœur du capitalisme (USA, Allemagne, …). Or, ce mécanisme de résistance contre la crise et la décomposition tendait à s’éroder de plus en plus. Depuis 2015, plusieurs phénomènes ont commencé à exprimer une telle érosion : une tendance à l’ affaiblissement considérable de la coordination entre pays, notamment concernant la relance de l’économie (et qui contraste clairement avec la réponse coordonnée mise en place face à la crise de 2008-2011), une fragmentation des rapports entre États et au sein de ceux-ci. Depuis 2016, le vote en faveur du Brexit et la présidence de Trump ont accru la paralysie et le risque de fragmentation de l’Union Européenne et intensifié la guerre commerciale entre les USA et la Chine, mais aussi les tensions économiques entre les États-Unis et l’Allemagne.
Une conséquence majeure de la crise du Covid-19 est le fait que les effets de la décomposition, l’accentuation du chacun pour soi et la perte de maîtrise, qui touchaient jusqu’alors essentiellement la superstructure du système capitaliste, tendent aujourd’hui à impacter directement la base économique du système, sa capacité à gérer les secousses économiques dans l’enfoncement dans sa crise historique. « Lorsque nous avons développé notre analyse de la décomposition, nous avions considéré que ce phénomène affectait la forme des conflits impérialistes (voir "Militarisme et décomposition [148] [2]", Revue internationale n° 64) et aussi la prise de conscience du prolétariat. En revanche, nous avions considéré qu'il n'avait pas d'impact réel sur l'évolution de la crise du capitalisme. Si la montée actuelle du populisme devait aboutir à l'arrivée au pouvoir de ce courant dans certains des principaux pays d'Europe, on pourrait voir se développer un tel impact de la décomposition » (Rapport sur la décomposition aujourd’hui [151], 22è Congrès du CCI, 2017). De fait, la perspective avancée en 2017 s’est rapidement concrétisée et désormais, nous devons considérer que la crise économique et la décomposition interfèrent et s’influencent mutuellement de plus en plus.
Ainsi, les restrictions budgétaires dans les politiques de santé et dans les soins hospitaliers ont favorisé l’expansion de la pandémie, qui a son tour a provoqué un effondrement du commerce mondial et des économies, en particulier des pays industrialisés (les P.I.B. des principaux pays industrialisés présentent en 2020 des taux négatifs jamais atteints depuis la 2e guerre mondiale). La récession économique constituera à son tour un stimulant à l’approfondissement du pourrissement de la superstructure. D’autre part, l’accentuation du chacun pour soi et la perte de contrôle qui marquent globalement la crise du Covid-19 infectent dorénavant aussi l’économie. L’absence de concertation internationale entre pays centraux sur le plan économique est frappante (absence de toute réunion du G7, G8 ou G20 en 2020) et la faillite de la coordination des politiques économiques et sanitaires entre pays de l’UE est également patente. Face à la pression des contradictions économiques au sein même des pays centraux du capitalisme, face aux hésitations de la Chine sur sa politique à mener (poursuivre l’ouverture sur le monde ou amorcer un repli stratégique nationaliste sur l’Asie), les chocs au niveau de la base économique tendront à devenir de plus en plus forts et chaotiques.
2.2. Les pays centraux au coeur de l’instabilité croissante des rapports au sein des bourgeoisies et entre bourgeoisies
Dans les années précédentes, nous avons vu une exacerbation des tensions au sein des bourgeoisies et entre bourgeoisies. En particulier, avec la venue au pouvoir de Trump et la mise en oeuvre du Brexit, cela s’est manifesté intensément au niveau des bourgeoisies américaine et anglaise, considérées jusqu’alors comme les plus stables et les plus expérimentées du monde : les conséquences de la crise du Covid-19 ne peuvent qu’aiguiser encore plus ces tensions :
- La bourgeoisie anglaise s’engage dans le brouillard du post-Brexit en ayant perdu l’appui du grand frère US à cause de la défaite de Trump, tout en subissant de plein fouet les conséquences de la pandémie. En ce qui concerne le Brexit, l’insatisfaction par rapport à l’accord flou avec l’UE apparaît autant parmi ceux qui ne voulaient pas cet accord (les Ecossais, les Irlandais du Nord) que parmi ceux qui voulaient un Brexit dur (les pêcheurs), tandis qu’il n’y a pas (encore ?) d’accord avec l’UE pour les services (80% des échanges) et que les tensions entre l’UE et le Royaume-Uni s’accentuent (à propos des vaccins, par exemple). Quant à la crise du Covid-19, l’Angleterre a dû reconfiner en hâte, a dépassé le cap des 120.000 décès et subit une pression terrible sur ses services de santé. Pendant ce temps, la situation est délétère au sein de ses principaux partis politiques, les Tories et le Labour, tous les deux en proie à une grave crise interne.
- L’exacerbation des tensions entre les USA et d’autres États était patente sous l’administration Trump : « Le vandalisme d'un Trump qui peut dénoncer les engagements internationaux américains du jour au lendemain, au mépris des règles établies, représente un nouveau facteur d'incertitude et d'élan puissant pour« chacun pour soi. C'est une indication de plus de la nouvelle étape que prend le système capitaliste en sombrant dans la barbarie et l'abîme du militarisme extrême » (Résolution sur la situation internationale [149], pt 13, 23è Congrès du CCI). Mais au sein de la bourgeoisie US même, les tensions sont également vives. Cela s’était déjà manifesté à propos de la stratégie à adopter pour assurer le maintien de sa suprématie lors de l’aventure irakienne catastrophique de Bush junior : « L'accession en 2001 à la tête de l'État américain des "neocons" a représenté une véritable catastrophe pour la bourgeoisie américaine. (…). En fait, l'arrivée de l'équipe Cheney, Rumsfeld et compagnie aux rênes de l'État n'était pas le simple fait d'une monumentale "erreur de casting" de la part de cette classe. Si elle a aggravé considérablement la situation des États-Unis sur le plan impérialiste, c'était déjà la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouvait ce pays confronté à une perte croissante de son leadership, et plus généralement au développement du "chacun pour soi" dans les relations internationales qui caractérise la phase de décomposition » (Résolution sur la situation internationale [153], 17e CI du CCI, Revue internationale n° 130, 2007). Mais avec la politique « vandaliste » de Trump et la crise du Covid-19, les oppositions au sein de la bourgeoisie US sont apparues comme étant bien plus larges (immigration, économie) et surtout, la capacité de l’appareil politique à maintenir la cohésion d’une société fragmentée semble entamée. De fait, « l’unité » et « l’identité » nationale y présentent des faiblesses congénitales qui les rendent vulnérables à la décomposition. Ainsi, l’existence de larges communautés ethniques et migrantes, subissant une discrimination raciale dès les origines des USA et dont certaines sont exclues de la vie « officielle », le poids des églises et des sectes propageant la pensée irrationnelle et antiscientifique, la grande autonomie de gestion des États de l’« Union américaine » par rapport au pouvoir fédéral (il existe par exemple une mouvance indépendantiste au Texas), l’opposition de plus en plus tranchée entre les états des côtes Est et Ouest (Californie, Oregon, Washington, New York, Massachusetts, …), profitant pleinement de la « mondialisation », et les états du Sud (Tennessee, Louisiane, …), de la « rust belt » (Indiana, Ohio, …) et du centre profond (Oklahoma, Kansas, …) nettement plus favorables à une approche plus protectionniste, tendent à favoriser une fragmentation de la société américaine, même si l’État fédéral est encore loin d’avoir perdu le contrôle de la situation. Cependant, le vaudeville de la contestation du processus et des résultats des dernières élections présidentielles de même que la « prise d’assaut » du Capitole par les supporters de Trump au vu du monde entier comme dans n’importe quelle république bananière confirme l’accentuation de cette tendance à la fragmentation.
Concernant l’exacerbation future des tensions au sein et entre bourgeoisies, deux points méritent d’être précisés.
(a) La nomination de Biden ne change pas le fondement des problèmes des USA
L’avènement de l’administration Biden ne signifie nullement la réductions des tensions intra et inter-bourgeoisies et en particulier la fin de l’empreinte sur la politique intérieure et extérieure du populisme trumpien : d’une part, 4 années d’imprédictibilité et de vandalisme de Trump, récemment encore en ce qui concerne la gestion catastrophique de la pandémie, marquent profondément la situation intérieure des USA, la fragmentation de la société américaine, ainsi que leur positionnement international. De plus, Trump aura tout fait durant la dernière période de sa présidence pour rendre la situation encore plus chaotique pour son successeur (cf. la lettre des 10 derniers ministres de la défense enjoignant Trump de ne pas impliquer l’armée dans la contestation des résultats des élections en décembre 2020, l’occupation du Congrès par ses partisans). Ensuite, le résultat obtenu par Trump lors des élections montre qu’environ la moitié de la population partage ses idées et en particulier son aversion pour les élites politiques. Enfin, l’emprise de Trump et de ses conceptions sur une grande partie du parti républicain annonce une gestion difficile pour la peu populaire (sauf parmi les élites politiques) administration Biden. Sa victoire est plus due à une polarisation anti-Trump qu’à un enthousiasme pour le programme du nouveau président.
Aussi, si au niveau de la forme et dans certains domaines, tels la politique climatique ou l’immigration, l’administration Biden tendra à rompre avec la politique de Trump, sa politique intérieure de « revanche » des élites des deux côtes contre « l’Amérique profonde » (les questions des énergies fossiles et du « mur » sont précisément liées à cela) et extérieure, marquée par le maintien de la politique de Trump au Moyen-Orient et par un renforcement de la confrontation avec la Chine (cf. l’attitude dure de Biden envers Xi lors de leur premier entretien téléphonique et la demande US à l’UE de revoir son traité commercial avec la Chine) ne peuvent conduire à terme qu’à un renforcement de l’instabilité au sein de la bourgeoisie US et entre bourgeoisies.
(b) la Chine n’est pas la grande victorieuse de la situation
Officiellement, la Chine se présente comme le « pays qui a vaincu la pandémie ». Quelle est sa situation dans la réalité ? Pour y répondre, il s’agit d’apprécier l’impact à court-terme (contrôle effectif de la pandémie) et à moyen-terme de la crise du Covid-19.
La Chine a une responsabilité écrasante au niveau du surgissement et de l’expansion de la pandémie. Après l’épidémie de SARS en 2003, des protocoles ont été établis afin que les autorités locales préviennent les autorités centrales ; déjà avec l’épidémie de peste porcine en 2019, il est apparu que cela ne fonctionnait pas parce que, dans capitalisme d’État stalinien, les responsables locaux craignent pour leur carrière/ promotions s’ils annoncent de mauvaises nouvelles. Idem au début du Covid-19 à Wuhan. Ce sont les « oppositions citoyennes démocratiques » qui ont en fin de compte fait passer les infos et, en conséquence avec retard, ont fait arriver les infos au niveau central. Le « niveau central » a dans un premier temps brillé par son absence : il n’a pas averti l’OMS et, pendant 3 semaines, Xi a été aux abonnés absents, trois précieuses semaines de perdues. Depuis lors d’ailleurs, la Chine refuse toujours de fournir à l’OMS les données vérifiables sur le développement de la pandémie sur son territoire.
L’impact à court-terme est avant tout indirect. Au niveau direct, les chiffres officiels de contaminations et de décès ne sont pas fiables. (ces derniers vont de 30.000 à plusieurs millions) et, selon le New York Times [154], il se pourrait que le gouvernement chinois lui-même ignore l'étendue de l'épidémie puisque les autorités locales mentent à propos du nombre d'infections, de tests et de morts par crainte de représailles provenant du gouvernement central. Cependant, l’imposition de lock-down impitoyables et barbares à des régions entières, enfermant littéralement des millions de gens dans leurs maisons pendant des semaines (à nouveau imposés régulièrement ces derniers mois), paralysent totalement l’économie chinoise pendant plusieurs semaines, ce qui a mené à un chômage massif (205 millions en mai 2020) et à des conséquences désastreuses au niveau des récoltes (en combinaison avec des sécheresses, inondations et invasions de sauterelles). Pour 2020, la croissance de son PIB recule de plus de 4% par rapport à 2019 (+6,1% à +1,9%) ; la consommation intérieure a été maintenue par une libération totale des crédits de la part de l’État.
A plus long terme, l'économie chinoise est confrontée à une délocalisation des industries stratégiques par les États-Unis et les pays européens et aux difficultés de la « nouvelle route de la soie » à cause des problèmes financiers liés à la crise économique et accentués par la crise du Covid-19 (financement chinois mais surtout niveau d’endettement de pays « partenaires » comme le Sri-Lanka, le Bangladesh, le Pakistan, le Népal …) mais aussi par une méfiance croissante de la part de nombreux pays et à la pression antichinoise des États-Unis. Aussi, il ne faut pas s’étonner qu’en 2020, il y a eu un effondrement de la valeur financière des investissements injectés dans le projet « Nouvelle route de la soie » (-64%).
La crise du Covid-19 et les obstacles rencontrés par la « nouvelle Route de la Soie » ont également accentué les tensions de plus en plus manifestes à la tête de l'état chinois, entre la faction « économiste » qui mise avant tout sur la mondialisation économique et le « multilatéralisme » pour poursuivre l’expansion capitaliste de la Chine et la faction « nationaliste » qui appelle à une politique plus musclée et qui met en avant la force (« la Chine qui a vaincu le Covid ») face aux menaces intérieures (les Ouïghours, Hong-Kong, Taiwan) et extérieures (tensions avec les USA, l’Inde et le Japon). Dans la perspective du prochain Congrès du Peuple en 2022 qui devrait nommer le nouveau (l’ancien ?) président, la situation en Chine est donc également particulièrement instable.
2.3. Le capitalisme d’État comme facteur exacerbant les contradictions
« Comme l'a souligné la GCF dans son organe de presse Internationalisme en 1952, le capitalisme d'État n'est pas une solution aux contradictions du capitalisme, même s'il peut en retarder les effets, mais en est l'expression. La capacité de l'État à maintenir la cohésion d'une société en déclin, aussi envahissante soit-elle, est donc destinée à s'affaiblir avec le temps et à devenir finalement un facteur aggravant des contradictions mêmes qu'il tente de contenir. La décomposition du capitalisme est la période au cours de laquelle une perte de contrôle croissante de la classe dominante et de son État devient la tendance dominante de l'évolution sociale, ce que Covid révèle de façon si dramatique » (Rapport sur la pandémie Covid-19 et la période de décomposition capitaliste [152] (juillet 2020)). Avec la crise pandémique s’exprime de manière particulièrement aigüe la contradiction entre la nécessité d’un interventionnisme massif du capitalisme d’État pour tenter de limiter les effets de la crise et une tendance opposée à la perte de contrôle, à la fragmentation, elle-même exacerbée par ces tentatives de l’État de maintenir son contrôle.
La crise du Covid-19 a en particulier marqué une accélération dans la perte de crédibilité des appareils étatiques. Alors que le capitalisme d’État est intervenu de manière massive pour faire face aux effets de la crise pandémique (mesures sanitaires, confinements, vaccination massive, compensation financières généralisées pour amortir l’impact économique, …), les mesures prises sur les différents plans se sont révélées souvent inefficaces ou ont provoqué de nouvelles contradictions (la vaccination exacerbe l’opposition anti-étatique des « antivacs », les compensations économiques pour un secteur suscitent le mécontentement des autres). Dès lors, si l’État est censé représenter l’ensemble de la société et maintenir sa cohésion, cela est de moins en moins vu ainsi par la société : face à l’incurie et l’irresponsabilité croissantes de la bourgeoisie, de plus en plus évidentes dans les pays centraux aussi, la tendance est de voir l’État comme une structure au service des élites corrompue, comme une force de répression aussi. En conséquence, il a de plus en plus de difficultés à imposer des règles : dans de nombreux pays d’Europe, comme par exemple en Italie, en France ou en Pologne, et également aux USA, des manifestations se sont produites contre les mesures gouvernementales de fermeture de commerces ou de confinement. Partout, en particulier parmi les jeunes, apparaissent des campagnes sur les médias sociaux pour s’opposer à ces règles, comme le hashtag « I don't want to play the game anymore » (je n’accepte plus de jouer le jeu) en Hollande.
L’incapacité des États à affronter la situation est à la fois symbolisée et affectée par l’impact du « vandalisme » populiste. La perturbation du jeu politique de la bourgeoisie dans les pays industrialisés se manifeste de manière saillante dès le début du 21e siècle avec des mouvements et partis populistes, souvent proches de l’extrême-droite. Relevons ainsi l'accession-surprise de Le Pen « en finale » de l’élection présidentielle de 2002 en France, la percée fulgurante et spectaculaire de la « liste Pim Fortuyn » aux Pays-Bas en 2001-2002, les gouvernement Berlusconi avec l’appui de l’extrême-droite en Italie, la montée de Jorg Haider et du FPÖ en Autriche, ou la montée du Tea Party aux USA. A ce moment encore, le CCI avait tendance à lier le phénomène à la faiblesse des bourgeoisies : « Ils dépendent de la force ou de la faiblesse de la bourgeoisie nationale. En Italie, les faiblesses et les divisions internes de la bourgeoisie, même d'un point de vue impérialiste, tendent à faire resurgir une droite populiste importante. En Grande-Bretagne, au contraire, la quasi-inexistence de parti d'extrême droite spécifique est liée à l'expérience et à la maîtrise supérieure du jeu politique par la bourgeoisie anglaise [sic !] » (Montée de l'extrême-droite en Europe : Existe-t-il un danger fasciste aujourd'hui ? RINT 110, 2002). Si la tendance à la perte de contrôle est bien mondiale et a marqué la périphérie (des pays comme le Brésil, le Venezuela, le Pérou en Amérique latine, les Philippines ou l’Inde en Asie), elle touche aujourd’hui de plein fouet les pays industrialisés, les bourgeoisies historiquement les plus fortes (Grande-Bretagne) et aujourd’hui tout particulièrement les USA. Tandis que la vague populiste surfait sur la contestation de l’establishment, la venue au pouvoir de populistes décrédibilisent et déstabilisent encore plus les structures étatiques par leur politique « vandaliste » (cf.Trump, Bolsonaro mais aussi le « gouvernement populiste » M5S et Lega en Italie), dans la mesure où ils ne sont ni disposés ni capables de prendre en charge de manière responsable les affaires de l'État.
Ces observations vont à l’encontre de la thèse que la bourgeoisie, à travers ces mesures, réalise une mobilisation et une soumission de la population en vue d’une marche vers une guerre généralisée. Les politiques sanitaires chaotiques et l’inaptitude des États à affronter la situation expriment au contraire la difficulté des bourgeoisies des pays centraux à imposer leur contrôle à la société. Le développement de cette tendance peut altérer la crédibilité des institutions démocratiques (sans que cela n’implique dans le contexte actuel le moindre renforcement du terrain de classe) ou au contraire voir se développer des campagnes pour la défense de celles-ci, voire pour la restauration d’une « vraie démocratie » : ainsi, lors de l’assaut du Capitole, s’opposaient ceux qui voulaient reconquérir la démocratie « prise en otage par les élites » (« le Capitole est notre maison ») et ceux qui défendaient la démocratie contre un putsch populiste.
Le fait que la bourgeoisie est de moins en moins capable de présenter une perspective pour l’ensemble de la société génère également une expansion effrayante d’idéologies alternatives irrationnelles et un mépris croissant pour une approche scientifique et raisonnée. Certes, la décomposition des valeurs de la classe dominante n’est pas nouvelle. Elle apparaît dès la fin des années ’60, mais l’enfoncement de plus en plus profond dans la décomposition, le chaos et la barbarie favorise l’avènement de la haine et de la violence d’idéologies nihilistes et de sectarismes religieux les plus rétrogrades. La crise du Covid-19 stimule l’extension à grande échelle de ceux-ci. Des mouvements comme QAnon, Wolverine Watchmen, Proud Boys ou le Boogaloo movement aux USA, les sectes évangéliques au Brésil, en Amérique latine ou en Afrique, des sectes musulmanes sunnites ou chiites mais aussi hindouistes ou bouddhistes diffusent les théories conspirationnistes et répandent des conceptions totalement fantaisistes concernant le virus, la pandémie, l’origine (le créationnisme) ou le futur de la société. L’extension exponentielle de la pensée irrationnelle et du rejet des apports de la science tendra à s’accélérer.
2.4. La multiplication d’émeutes antiétatiques et de mouvements interclassistes
Les explosions de révoltes populaires contre la misère et la barbarie guerrière étaient présentes dès le début de la phase de décomposition et s’accentuent au 21e siècle : l’Argentine (2001-2002), les banlieues françaises en 2005, l’Iran en 2009, Londres et d’autres villes anglaises en 2011, la flambée d’émeutes au Maghreb et au Moyen-Orient en 2011-12 (le « printemps arabe »). Une nouvelle vague d’émeutes sociales éclate au Chili, en Équateur ou en Colombie (2019), en Iran (en 2017-18 et à nouveau en 2019-20), en Irak, au Liban (2019-2020), mais aussi en Roumanie (2017) en Bulgarie (2013 et 2019-2020) ou en France avec le mouvement des « gilets jaunes » (2018-2019) et, avec des caractéristiques spécifiques, à Ferguson (2014) et Baltimore (2016) aux USA. Ces révoltes manifestent le désespoir croissant de populations subissant la déstructuration des rapports sociaux, soumises aux conséquences traumatisantes et dramatiques de la paupérisation liée à l’effondrement économiques ou à des guerres sans fin. Elles visent aussi de plus en plus la corruption des cliques au pouvoir et plus généralement les élites politiques.
Dans le prolongement de la crise du Covid-19, ce genre d’explosions de colère se multiplient, prenant la forme de manifestations, voire d’émeutes. Elles tendent à se cristalliser autour de trois pôles :
(a) des mouvements interclassistes, exprimant une révolte face aux conséquences économiques et sociales de la crise du Covid-19 (exemple des ‘gilets jaunes’) ;
(b) des mouvements identitaires, d’origines populiste (MAGA) ou parcellaire, tendant à exacerber les tensions entre composantes de la population (tels les révoltes raciales (BLM), mais aussi des mouvements d’inspiration religieuse (en Inde par exemple), etc.) ;
(c) des mouvements anti-establishment et anti-État au nom de la « liberté individuelle », de type nihiliste, sans réelles « alternatives », tels les mouvements « antivax » ou complotistes (« récupérer mes institutions des mains des élites »).
Ces types de mouvements débouchent souvent sur des émeutes et des pillages, servant d’exutoire à des bandes de jeunes de quartiers minés par la décomposition. Si ces mouvements mettent en évidence l’importante perte de crédibilité des structures politiques de la bourgeoisie, aucun de ceux-ci n’offre de quelque manière que ce soit une perspective pour la classe ouvrière. Toute révolte contre l'État n’est pas toujours un terrain propice pour le prolétariat : au contraire, elles le détournent de son terrain de classe pour l’entraîner sur un terrain qui n’est pas le sien.
2.5. L’exploitation de la menace écologique par les campagnes de la bourgeoisie
La pandémie illustre l'aggravation dramatique de la dégradation de l’environnement, qui atteint des niveaux alarmants selon les constats et les prévisions qui font aujourd'hui l'unanimité dans les milieux scientifiques et que la majorité des secteurs bourgeois de tous les pays eux-mêmes ont repris à leur compte (Accord de Paris, 2015) : pollution de l'air des villes et de l'eau des océans, dérèglement climatique avec des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, avancée de la désertification, accélération de la disparition des espèces végétales et animales qui menacent de plus en plus l'équilibre biologique de notre planète. « Toutes ces calamités économiques et sociales qui, si elles relèvent en général de la décadence elle-même, rendent compte, par leur accumulation et leur ampleur, de l'enfoncement dans une impasse complète d’un système qui n'a aucun avenir à proposer à la plus grande partie de la population mondiale, sinon celui d'une barbarie croissante dépassant l'imagination. Un système dont les politiques économiques, les recherches, les investissements, sont réalisés systématiquement au détriment du futur de l'humanité et, partant, au détriment du futur de ce système lui-même » (Thèses, 7).
La classe dominante est incapable de mettre en œuvre les mesures nécessaires du fait des lois mêmes du capitalisme et plus spécifiquement de l’exacerbation des contradictions provoquée par l’enfoncement dans la décomposition ; par conséquent, la crise écologique ne peut qu’empirer et engendrer de nouvelles catastrophes dans le futur. Cependant, ces dernières décennies, la bourgeoisie a récupéré la dimension écologique pour tenter de mettre en avant une perspective « de réformes au sein du système ». En particulier, les bourgeoisies des pays industrialisés placent la « transition écologique » et « l’économie verte » au centre de leurs campagnes actuelles pour faire accepter une perspective d’austérité draconienne dans le cadre de leurs politiques économiques post-Covid visant à restructurer et renforcer la position concurrentielle des pays industrialisés. Ainsi, elles sont au centre des « plans de relance » de la commission européenne pour les pays de l’UE et des mesures de relance de l’administration Biden aux USA. L’écologie constituera donc dans les prochaines années plus que jamais une mystification majeure à combattre par les révolutionnaires.
3. Conclusions
Ce rapport a montré que la pandémie n’ouvre pas une période nouvelle mais qu’elle est d’abord un révélateur du niveau de pourrissement atteint durant les 30 années de phase de décomposition, un niveau souvent sous-estimé jusqu’ici. En même temps, la crise pandémique annonce aussi une accélération sensible de divers effets de la décomposition dans la période à venir, ce qui est illustré en particulier par l’impact de la crise du Covid-19 sur la gestion de l’économie par les États et par ses effets dévastateurs sur les pays industriels centraux, et en particulier sur la superpuissance US. Des possibilités de contre-tendances ponctuelles existent, qui peuvent imposer une pause ou même une certaine reprise de contrôle par le capitalisme d’État, mais ces événements spécifiques ne signifieront nullement que la dynamique historique d’enfoncement dans la phase de décomposition, mise en évidence dans ce rapport, soit remise en question.
Si la perspective n’est pas à la guerre mondiale généralisée (entre blocs impérialistes), la plongée actuelle dans le chacun pour soi et la fragmentation apporte néanmoins la sinistre promesse d’une multiplication de conflits guerriers meurtriers, de révoltes sans perspectives noyées dans le sang ou de catastrophes pour l’humanité. « Le cours de l'histoire est irréversible : la décomposition mène, comme son nom l'indique, à la dislocation et à la putréfaction de la société, au néant. Laissée à sa propre logique, à ses conséquences ultimes, elle conduit l'humanité au même résultat que la guerre mondiale. Être anéanti brutalement par une pluie de bombes thermonucléaires dans une guerre généralisée ou bien par la pollution, la radioactivité des centrales nucléaires, la famine, les épidémies et les massacres de multiples conflits guerriers (où l’arme atomique pourrait aussi être utilisée), tout cela revient, à terme, au même. La seule différence entre ces deux formes d'anéantissement, c'est que la première est plus rapide alors que la seconde est plus lente et provoquerait d'autant plus de souffrances » (Thèses, 11).
La progression de la phase de décomposition peut aussi entraîner un recul de la capacité du prolétariat à mener son action révolutionnaire. Celui-ci est donc engagé dans une course de vitesse contre l’enfoncement de la société dans la barbarie d’un système historiquement obsolète. Certes, les luttes ouvrières ne peuvent empêcher le développement de la décomposition, mais elles peuvent porter un coup d’arrêt aux effets de celle-ci, du chacun pour soi. Pour rappel, « la décadence du capitalisme était nécessaire pour que le prolétariat soit en mesure de renverser ce système ; en revanche, l'apparition du phénomène historique de la décomposition, résultat de la prolongation de la décadence en l'absence de la révolution prolétarienne, ne constituait nullement une étape nécessaire pour le prolétariat sur le chemin de son émancipation » (Thèses, 12).
La crise du Covid-19 engendre donc une situation encore plus imprédictible et confuse. Les tensions sur les différents plans (sanitaire, socio-économique, militaire, politique, idéologique) généreront des secousses sociales majeures, des révoltes populaires massives, des émeutes destructrices, des campagnes idéologiques intenses, comme celle autour de l’écologie. Sans cadre d’appréhension solide des événements, les révolutionnaires ne pourront pas y jouer leur rôle d’avant-garde politique de la classe mais contribueront au contraire à sa confusion, au recul de sa capacité à mener son action révolutionnaire.
[1] Ce texte a été écrit en avril 2021, et ne pouvait pas prendre en compte une information récente considérant comme plausible la thèse que l'épidémie ait eu son origine dans un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine (Lire à ce propos l'article suivant : "Origines du Covid-19 : l’hypothèse d’un accident à l’Institut de virologie de Wuhan relancée après la divulgation de travaux inédits [155]"). Ceci étant dit, cette hypothèse, si elle était vérifiée, ne viendrait en rien amoindrir notre analyse selon laquelle la Pandémie est un produit de la décomposition du capitalisme. Tout au contraire, elle viendrait illustrer que celle-ci n'épargne pas la recherche scientifique dans un pays dont la croissance fulgurante des dernières décennies porte le sceau de la décomposition.
Vie du CCI:
- Rapports de Congrès [156]
Questions théoriques:
- Décomposition [120]
Rubrique:
Rapport sur la lutte de classe internationale au 24ème Congrès du CCI
- 242 lectures
Ce rapport examine quelques-unes des principales questions auxquelles est confrontée la lutte de classe internationale dans la phase de décomposition capitaliste: le problème de la politisation du mouvement de classe, les dangers posés par l'interclassisme, la maturation souterraine de la conscience, et la signification des défaites dans cette période.
Partie 1 : construire sur la base du travail de notre 23ème Congrès
Lors de son 23e Congrès international, la CCI a clairement indiqué que nous devons faire la distinction entre le concept de rapport de force entre les classes et le concept de cours historique. Le premier s'applique à toutes les phases de la lutte des classes, aussi bien à l'ascendance qu'à la décadence, tandis que le second ne s'applique qu'à la décadence, et seulement dans la période comprise entre l'approche de la Première Guerre mondiale et l'effondrement du bloc de l'Est en 1989. L'idée d'un cours historique n'a de sens que dans les phases où il devient possible de prévoir le mouvement général de la société capitaliste vers soit une guerre mondiale, soit des affrontements de classe décisifs. Ainsi, dans les années 1930, la gauche italienne a pu reconnaître que la défaite préalable du prolétariat mondial dans les années 1920 avait ouvert la voie à la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'après 1968, le CCI a eu raison d'affirmer que, sans une défaite frontale d'une classe ouvrière renaissante, le capitalisme ne serait pas en mesure d'enrôler le prolétariat pour une Troisième Guerre mondiale. En revanche, dans la phase de décomposition, produit d'une impasse historique entre les classes, même si la guerre mondiale a été retirée de l'ordre du jour dans un avenir prévisible par la désintégration du système des blocs, le système peut glisser vers d'autres formes de barbarie irréversible sans une confrontation frontale avec la classe ouvrière. Dans une telle situation, il devient beaucoup plus difficile de reconnaître quand un "point de non-retour" a été atteint et que la possibilité d'une révolution prolétarienne a été enterrée une fois pour toutes.
Mais "l'imprévisibilité" de la décomposition ne signifie nullement que les révolutionnaires ne se préoccupent plus d'évaluer le rapport de force global entre les classes. Ce point est évidemment affirmé par le titre de la résolution du 23e Congrès sur la lutte des classes : "Résolution sur le rapport de force entre les classes". Il y a deux éléments clés de cette résolution que nous devons souligner ici :
- "dans le rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat, c'est toujours la classe dominante qui est à l'offensive, sauf dans une situation révolutionnaire"(point 11). A certains moments, les luttes défensives de la classe ouvrière peuvent repousser les attaques de la bourgeoisie, mais dans la décadence, la tendance est que de telles victoires deviennent de plus en plus limitées et de courte durée : c'est un facteur central pour que la révolution prolétarienne devienne une nécessité aussi bien qu'une possibilité à cette époque ;
- Le premier moyen de "mesurer" le rapport de force est l'observation de la tendance de la classe ouvrière à développer son autonomie de classe et à présenter sa propre solution à la crise historique du système. En bref, la tendance à la politisation - le développement de la conscience de classe jusqu'au point où la classe ouvrière comprend la nécessité d'affronter et de renverser l'appareil politique de la classe dominante et de le remplacer par sa propre dictature de classe.
Ces thèmes constituent le "fil rouge" de la résolution, comme l'annonce la première partie :
- "À la fin des années 1960, avec l’épuisement du boom économique de l’après-guerre, la classe ouvrière avait ressurgi sur la scène sociale face à la dégradation de ses conditions d’existence. Les luttes ouvrières qui ont explosé à l’échelle internationale avaient ainsi mis un terme à la période de contre-révolution la plus longue de l’Histoire. Elles avaient ouvert un nouveau cours historique vers des affrontements de classe, empêchant ainsi la classe dominante d’apporter sa propre réponse à la crise aiguë du capitalisme : une 3e guerre mondiale. Ce nouveau cours historique avait été marqué par le surgissement de luttes massives, notamment dans les pays centraux d’Europe occidentale avec le mouvement de Mai 1968 en France, suivi par celui de l’"automne chaud" en Italie en 1969 et de bien d’autres encore comme en Argentine au printemps 1969 et en Pologne à l’hiver 1970-71. Dans ces mouvements massifs, de larges secteurs de la nouvelle génération qui n’avait pas connu la guerre avaient posé de nouveau la question de la perspective du communisme comme une possibilité.
En lien avec ce mouvement général de la classe ouvrière à la fin des années 1960 et au début des années 1970, on doit souligner aussi le réveil international, à une échelle très petite mais non moins significative, de la Gauche communiste organisée, la tradition qui est restée fidèle au drapeau de la révolution prolétarienne mondiale au cours de la longue nuit de la contre-révolution. Dans ce réveil la constitution du CCI a signifié un renouveau et une impulsion importante de la Gauche Communiste dans son ensemble.
Face à une dynamique vers sur une tendance à la politisation des luttes ouvrières, la bourgeoisie (qui s’était laissé surprendre par le mouvement de Mai 68) a immédiatement développé une contre-offensive de grande envergure et sur le long terme afin d’empêcher la classe ouvrière d’apporter sa propre réponse à la crise historique de l’économie capitaliste : la révolution prolétarienne."[1].
La résolution retrace ensuite dans les grandes lignes comment la bourgeoisie, classe machiavélique par excellence, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour bloquer cette dynamique :
- "Dans une première période, en offrant à la classe ouvrière une alternative politique purement bourgeoise. A la fin des années 60 et au début des années 70, en faisant dévier ses aspirations vers la fausse perspective de gouvernements de gauche capables d'humaniser le capitalisme et même d'instaurer une société socialiste, et à partir de la fin des années 70, par la division du travail entre une droite dure au pouvoir effectuant les réductions brutales du niveau de vie de la classe ouvrière exigées par la crise économique, et une "gauche dans l'opposition" mieux placée pour absorber la menace posée par les vagues de lutte qui ont caractérisées cette période ;
- L'utilisation massive de l'extrême gauche du capital (maoïstes, trotskystes, etc.) pour récupérer la recherche grandissante de réponses politiques par une minorité significative de la nouvelle génération ;
- L'utilisation du syndicalisme radical et même de formes d'organisation "extra-syndicales" manipulées par l'extrême gauche pour faire échouer le désenchantement croissant des travailleurs à l'égard des syndicats et le danger pour les travailleurs de parvenir à une compréhension politique du rôle des syndicats dans l'époque de décadence ;
- L'utilisation de l'idéologie corporatiste et nationaliste pour isoler les luttes importantes des travailleurs et, si nécessaire, pour les écraser par une répression directe de l'Etat (cf. la grève des mineurs en Grande-Bretagne et, à une échelle beaucoup plus grande, la grève de masse en Pologne en 1980).
- La réorganisation consciente de la production et des échanges mondiaux qui a pris son envol à partir des années 1980 : la politique de "mondialisation", bien que fondamentalement déterminée par la nécessité de répondre à la crise économique, contenait également un élément directement anti-ouvrier en ce qu'elle cherchait à briser les centres traditionnels de combativité prolétarienne et à saper l'identité de classe ;
- En retournant la décomposition même de la société capitaliste contre la classe ouvrière. Ainsi, la tendance au "chacun pour soi" amplifiée dans cette nouvelle phase a été utilisée pour renforcer l'atomisation sociale et les divisions corporatistes. Par-dessus tout, l'effondrement du "socialisme réellement existant" dans le bloc de l'Est a été la rampe de lancement d'une gigantesque campagne autour de la mort du communisme, qui a approfondi et étendu les difficultés de la classe ouvrière à développer sa propre perspective révolutionnaire."
Alors que ces difficultés s'étaient déjà accrues dans les années 80 -et étaient à l'origine de l'impasse entre les classes- les événements de 1989 ont non seulement ouvert définitivement la phase de décomposition mais ont entraîné un profond recul de la classe à tous les niveaux : dans sa combativité, dans sa conscience, dans sa capacité même à se reconnaître comme une classe spécifique dans la société bourgeoise. En outre, elle a accéléré toutes les tendances négatives de la décomposition sociale qui avaient déjà commencé à jouer un rôle dans la période précédente : la croissance cancéreuse de l'égoïsme, du nihilisme et de l'irrationalité qui sont les produits naturels d'un ordre social qui ne peut plus offrir à l'humanité aucune perspective d'avenir[2].La résolution de la 23e conférence, il faut le noter, réaffirme également que, malgré tous les facteurs négatifs de la phase de décomposition qui pèsent dans la balance, il existe encore des signes d'une contre-tendance prolétarienne. En particulier, le mouvement des étudiants contre le CPE en France en 2006, et le mouvement des "Indignados" en Espagne en 2011, ainsi que la réapparition de nouveaux éléments à la recherche de positions authentiquement communistes, fournissent des preuves concrètes que le phénomène de maturation souterraine de la conscience, le creusement de la "Vieille Taupe ", opère encore dans la nouvelle phase. La quête d'une nouvelle génération de prolétaires pour comprendre l'impasse de la société capitaliste, le regain d'intérêt pour les mouvements antérieurs qui avaient soulevé la possibilité d'une alternative révolutionnaire (1917-23, Mai 68 etc.) ont confirmé que la perspective d'une politisation future n'avait pas été noyée dans la boue de la décomposition. Mais avant d'avancer vers une meilleure compréhension du rapport de force entre les classes depuis une dizaine d'années, et surtout dans le sillage de la pandémie de la Covid, il est nécessaire d'approfondir ce que l'on entend exactement par le terme de politisation.
Partie 2 : La signification de la politisation
Tout au long de son histoire, l'avant-garde marxiste du mouvement ouvrier a lutté pour clarifier l'interrelation entre les différents aspects de la lutte de classe : économique et politique, pratique et théorique, défensive et offensive. Le lien profond entre les dimensions économique et politique a été souligné par Marx dans sa première polémique avec Proudhon :
"Ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement politique. Il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit en même temps social.
Ce n'est que dans un ordre de choses où il n'y a plus de classes et d'antagonismes de classes que les évolutions sociales cesseront d'être des révolutions politiques "[3]Cette polémique se poursuit à l'époque de la Première Internationale dans la lutte contre les doctrines de Bakounine. A cette époque, la nécessité d'affirmer la dimension politique de la lutte des classes est principalement liée à la lutte pour les réformes, et donc à l'intervention dans l'arène parlementaire de la bourgeoisie. Mais le conflit avec les anarchistes, ainsi que l'expérience pratique de la classe ouvrière, ont également soulevé des questions relatives à la phase offensive de la lutte, surtout les événements de la Commune de Paris, premier exemple de pouvoir politique de la classe ouvrière.
Pendant la période de la Deuxième Internationale, surtout dans sa phase de dégénérescence, une nouvelle bataille a été lancée : la lutte des courants de gauche contre la tendance croissante à séparer rigoureusement la dimension économique, considérée comme la spécialité des syndicats, et la dimension politique, de plus en plus réduite aux efforts du parti pour gagner des sièges dans les parlements bourgeois et les municipalités locales.
A l'aube de l'époque de décadence du capitalisme, l'apparition spectaculaire de la grève de masse en 1905 en Russie, et l'émergence des soviets, ont réaffirmé l'unité essentielle des dimensions économique et politique, et la nécessité d'organes de classe indépendants qui combinent les deux aspects. Comme l'a dit Luxemburg dans son pamphlet sur la grève de masse, qui était essentiellement une polémique contre les conceptions dépassées de la droite et du centre social-démocrate :
"Il n'y a pas deux luttes de classe différentes de la classe ouvrière, une économique et une politique, mais une seule lutte de classe, qui vise à la fois la limitation de l'exploitation capitaliste au sein de la société bourgeoise et l'abolition de l'exploitation avec la société bourgeoise elle-même "[4]Cependant, il est nécessaire de rappeler que ces deux dimensions, tout en faisant partie d'une unité, ne sont pas identiques, et leur unité n'est souvent pas saisie par les travailleurs engagés dans les luttes réelles. Ainsi, même lorsqu'une grève autour de revendications économiques peut rapidement être confrontée à l'opposition active des organes de l'État bourgeois (gouvernement, police, syndicats, etc.), le contexte politique "objectif" de la lutte peut n'être visible que pour une minorité combative des travailleurs impliqués.
En outre, cela souligne que dans le mouvement de prise de conscience des enjeux politiques de la lutte, deux dynamiques différentes sont en jeu : d'une part, ce que l'on pourrait appeler la politisation des luttes, et d'autre part, l'émergence de minorités politisées qui peuvent ou non être liées à l'essor immédiat de la lutte ouverte.
Et encore une fois, dans le premier cas, nous sommes face à un processus qui passe par différentes phases. Dans la décadence, s'il ne peut plus y avoir d'intervention prolétarienne dans la sphère politique bourgeoise, il peut encore y avoir des revendications et des débats politiques défensifs qui ne posent pas encore la question du pouvoir politique ou d'une nouvelle société, comme par exemple, lorsque les prolétaires discutent de la manière de répondre aux violences policières, comme lors des grèves de masse en Pologne en 1980 ou du mouvement "anti-CPE" en 2006. Ce n'est qu'à un stade très avancé de la lutte que les travailleurs peuvent envisager la prise du pouvoir politique comme un véritable objectif de leur mouvement. Néanmoins, ce qui caractérise généralement la politisation des luttes, c'est l'éclatement d'une culture massive du débat, où le lieu de travail, le coin de la rue, la place publique, les universités et les écoles sont le théâtre de discussions passionnées sur la manière de faire avancer la lutte, sur les ennemis de la lutte, sur ses méthodes d'organisation et ses objectifs généraux, comme Trotsky et John Reed l'ont décrit dans leurs livres sur la révolution russe de 1917, et qui ont peut-être été le principal "signal d'alarme" à la bourgeoisie sur les dangers posés par les événements de mai-juin 1968 en France.
Pour le marxisme, la minorité communiste est une émanation de la classe ouvrière, mais de la classe ouvrière considérée comme une force historique dans la société bourgeoise ; elle n'est pas un produit mécanique de ses luttes immédiates. Certes, l'expérience d'un conflit de classe amer peut pousser des travailleurs individuels à des conclusions révolutionnaires, mais les communistes peuvent aussi être "façonnés" par une réflexion sur les conditions générales du prolétariat et du capitalisme en général, et ils peuvent aussi avoir leurs origines sociologiques dans des couches extérieures au prolétariat. C'est ainsi que Marx l'exprime dans L'idéologie allemande :
- "Dans le développement des forces productives, il arrive un stade où apparaissent des forces productives et des moyens d'échanges qui, dans les rapports existants, ne font que causer des méfaits et ne sont plus des forces productives mais des forces destructrices.... et il s'ensuit l'apparition d'une classe qui doit supporter tous les fardeaux de la société sans en jouir, qui, exclue de la société, est forcée d'entrer dans l'antagonisme le plus résolu avec toutes les autres classes ; une classe qui forme la majorité de tous les membres de la société et d'où émane la conscience de la nécessité d'une révolution fondamentale, la conscience communiste, qui peut, bien entendu, naître aussi parmi les autres classes par la contemplation de la situation de cette classe."
Évidemment, la convergence des deux dynamiques -la politisation des luttes et le développement de la minorité révolutionnaire- est essentielle pour qu'une situation révolutionnaire émerge ; et nous pouvons même dire qu'une telle convergence, comme le note le début de la résolution à propos de Mai 68 en France, peut même être l'expression d'un changement du cours de l'histoire vers des affrontements de classe majeurs. De même, les avancées dans la lutte générale de la classe ouvrière et l'apparition de minorités politisées sont toutes deux, à la base, des produits de la maturation souterraine de la conscience, qui peut se poursuivre même lorsque la lutte ouverte a disparu de la vue. Mais mélanger les deux dynamiques peut aussi conduire à des conclusions erronées, notamment à une surestimation du potentiel immédiat de la lutte des classes. Comme le dit l'expression "une hirondelle ne fait pas le printemps".
La résolution (point 6) nous met également en garde contre les difficultés considérables qui empêchent la classe ouvrière de prendre conscience qu'elle est "révolutionnaire ou rien". Elle parle de la nature de la classe ouvrière en tant que classe exploitée soumise à toutes les pressions de l'idéologie dominante, de sorte que "la conscience de classe ne peut pas progresser de victoire en victoire mais ne peut se développer que de manière inégale à travers une série de défaites". Elle note également que la classe est confrontée à des difficultés supplémentaires dans la décadence, par exemple la non-permanence d'organisations de masse dans lesquelles les travailleurs peuvent maintenir et développer une culture politique ; l'inexistence d'un programme minimum, ce qui signifie que la lutte de classe doit atteindre les hauteurs vertigineuses du programme maximum ; l'utilisation des anciens outils des organisations de la classe ouvrière contre la lutte de classe qui -dans le cas du stalinisme en particulier- a contribué à créer un fossé entre les organisations communistes authentiques et la masse de la classe ouvrière. Ailleurs, la résolution, faisant écho à nos Thèses sur la décomposition, souligne les nouvelles difficultés imposées par les conditions particulières de la phase finale du déclin capitaliste.
L'une de ces difficultés est longuement évoquée dans la résolution : le danger que représentent les luttes interclassistes comme celle des Gilets jaunes en France ou les révoltes populaires provoquées par la paupérisation croissante des masses dans les pays moins "développés". Dans tous ces mouvements, dans une situation où la classe ouvrière a un très faible niveau d'identité de classe, et est encore loin de rassembler ses forces au point de pouvoir donner une perspective à la colère et au mécontentement qui s'accumulent dans toute la société, les prolétaires participent non pas en tant que force sociale et politique indépendante mais en tant que masse d'individus. Dans certains cas, ces mouvements ne sont pas simplement interclassistes, mélangeant les revendications prolétariennes avec les aspirations d'autres couches sociales (comme dans le cas des Gilets jaunes), mais épousent des objectifs ouvertement bourgeois, comme les manifestations pour la démocratie à Hong Kong, ou l'illusion du développement durable ou de l'égalité raciale au sein du capitalisme, comme dans le cas des marches des Jeunes pour le climat et des manifestations "Black Lives Matter". La résolution n'est pas tout à fait précise sur la distinction à faire ici, ce qui reflète des problèmes plus larges dans les analyses de ces événements par le CCI : d'où la nécessité d'une section spécifique de ce rapport pour clarifier ces questions.
Partie 3 : Le danger central de l'interclassisme
"En raison de la grande difficulté actuelle de la classe ouvrière à développer ses luttes, de son incapacité pour l'instant à retrouver son identité de classe et à ouvrir une perspective pour l'ensemble de la société, le terrain social tend à être occupé par des luttes interclassistes particulièrement marquées par la petite bourgeoisie... Ces mouvements interclassistes sont le produit de l'absence de toute perspective qui touche l'ensemble de la société, y compris une partie importante de la classe dirigeante elle-même... La lutte pour l'autonomie de classe du prolétariat est cruciale dans cette situation imposée par l'aggravation de la décomposition du capitalisme :
- contre les luttes interclassistes ;
- contre les luttes partielles mises en avant par toutes sortes de catégories sociales donnant la fausse illusion d'une "communauté protectrice";
- contre les mobilisations sur le terrain pourri du nationalisme, du pacifisme, de la réforme "écologique", etc". (Résolution sur le rapport de force entre les classes, 23e Congrès du CCI)
Difficultés récurrentes dans l'analyse de la nature des mouvements sociaux apparus ces dernières années
Les luttes interclassistes et les luttes partielles sont des obstacles au développement de la lutte des travailleurs. Nous avons vu récemment combien le CCI a eu du mal à maîtriser ces deux questions :
- En ce qui concerne les Gilets Jaunes, le mouvement était considéré au début comme ayant des éléments positifs pour la lutte des classes (à travers la question du rejet des syndicats).
- Dans le mouvement des jeunes autour de la question climatique, qui est une lutte partielle, la mobilisation des jeunes a été vue comme quelque chose de positif, en oubliant le point 12 de la plate-forme.
- Sur le meurtre de George Floyd, il y a eu des tendances à y voir un mouvement interclassiste alors que l'indignation qu'il a suscitée a conduit à une mobilisation sur un terrain directement bourgeois, demandant une police et un système judiciaire plus démocratiques.
Des difficultés qui perdurent
Le bilan des mouvements au Moyen-Orient : une question à clarifier
La présentation sur la lutte des classes au 23e Congrès a rappelé que l'analyse des mouvements du Printemps arabe n'avait pas été incluse dans le bilan critique que nous avons entrepris depuis le 21e Congrès malgré l'existence de divergences non résolues, notamment "des questions de glissements opportunistes que nous avons faits dans le passé vers par exemple les mouvements interclassistes du Printemps arabe et autres"[5]
Revenons à notre analyse des mouvements de 2011.
Si l'organisation, dans son intervention, n'a pas utilisé le terme "interclassisme" pour qualifier ces mouvements, elle les a décrits d'une manière qui développait toutes les caractéristiques d'un mouvement interclassiste, montrant qu'elle n'était pas totalement dans l'ignorance de leur nature : " La classe ouvrière ne s’y est [dans ces luttes] jusque-là jamais présentée comme une force autonome en mesure d’assumer la direction des luttes qui ont souvent pris la forme d’une révolte de l’ensemble des classes non-exploiteuses, de la paysannerie ruinée aux couches moyennes en voie de prolétarisation "[6]
- La position développée - " En général, la classe ouvrière n'a pas été à la tête de ces rébellions, mais elle a certainement eu une présence et une influence considérables qui peuvent être perçues tant dans les méthodes et les formes d'organisation adoptées par le mouvement que, dans certains cas, par le développement spécifique des luttes ouvrières, comme les grèves en Algérie et surtout la grande vague de grèves en Egypte "[7] - n'a pas réussi à situer précisément le terrain de classe sur lequel elles se développaient ni à dégager la dynamique de la composante ouvrière qui pouvait se trouver dans ces mouvements ;Notre analyse était basée sur une approche marquée par l'empirisme : la comparaison avec l'Iran en 1979, certes inspirante, était utilisée sans la replacer dans la nouvelle situation, sans la replacer dans son contexte à l'aide de notre cadre : "Lorsqu'on essaie de comprendre la nature de classe de ces rébellions, nous devons donc éviter deux erreurs symétriques : d'une part, une identification générale de toutes les masses en lutte avec le prolétariat (la position la plus caractéristique de cette vision est celle du Groupe Communiste Internationaliste), et d'autre part, un rejet de ce qui peut être positif dans des révoltes qui ne sont pas explicitement celles de la classe ouvrière "[8]. La deuxième partie de la citation fait des concessions à une approche qui considère les "points positifs" et les "points négatifs" sans se baser sur leur nature de classe.
Une surestimation de ces mouvements : "Toutes ces expériences sont de vrais tremplins pour le développement d'une conscience véritablement révolutionnaire. Mais la route dans cette direction est encore longue, elle est parsemée de nombreuses et indéniables illusions et faiblesses idéologiques"[9] ; "L’ensemble de ces révoltes constitue une formidable expérience sur la voie qui conduit à la conscience révolutionnaire ".[10]
Faiblesses dans l'application de notre cadre politique
Oublier le cadre de la critique du maillon faible
Si l'organisation a eu raison de rappeler que le mouvement des "Indignados" et les soulèvements des classes exploitées et notamment de la classe ouvrière au Moyen-Orient ont une origine commune dans les effets de la crise économique mondiale, elle l'a fait en mettant sur le même plan, ou en amalgamant, tous les mouvements, qu'ils viennent des pays centraux ou des pays périphériques. C'est-à-dire sans les placer dans le cadre de la critique de la théorie du maillon faible (voir la résolution sur la situation internationale du 20e congrès)[11].
Le CCI a défini le mouvement des Indignados[12] comme un mouvement de la classe ouvrière marqué :
- Par une perte d'identité de classe : "Ceci explique en partie pourquoi la participation du prolétariat comme classe n’a pas été dominante mais qu’il fut présent à travers la participation des individus ouvriers (salariés, chômeurs, étudiants, retraités…) qui tentent de se clarifier, de s'impliquer selon leur instinct mais à qui manquent la force, la cohésion et la clarté que donne le fait de s’assumer collectivement comme classe".
- - Par une "forte présence de couches sociales non prolétariennes, en particulier une couche moyenne en voie de prolétarisation ". "Bien que le mouvement semble vague et mal défini, cela ne peut remettre en cause son caractère de classe, surtout si nous considérons les choses dans leur dynamique, dans la perspective de l’avenir... La présence du prolétariat n’est pas visible en tant que force dirigeante du mouvement ni à travers une mobilisation à partir des centres de travail. Elle réside dans la dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social, de reconnaissance du combat qui se prépare. Là se trouve toute son importance, malgré le fait que ce ne soit qu’un petit pas en avant extrêmement fragile".
Nos textes de cette période ne font pas de distinction entre le mouvement des Indignados en Espagne et les révoltes dans les pays arabes. Pourtant, il existe des différences très importantes : en Espagne, même si l'aile prolétarienne n'a pas dominé le mouvement des Indignados, elle a lutté pour sa propre autonomie face aux efforts de "Démocratie maintenant" pour la détruire. Dans les pays arabes, le prolétariat, au mieux, n'a pas été capable de se maintenir sur son propre terrain, ni d'utiliser ses propres méthodes de combat pour développer sa conscience, se laissant mobiliser derrière des factions nationalistes et démocratiques.[13]
Absence du cadre de décomposition
Sans jamais nier son existence ni le poids des difficultés profondes de ces mouvements, en soulignant les "aspects positifs" des révoltes sociales[14], l'analyse de ces mouvements dans les pays arabes n'a pas été placée dans le cadre de la décomposition[15]. Cela a conduit à atténuer la dénonciation ferme du poison démocratique et nationaliste si puissant dans ces pays, et le danger que cela représentait surtout dans ces parties du monde, mais aussi et surtout face à la propagande des bourgeoisies occidentales envers le prolétariat européen, soulignant la nécessité de la démocratie dans les pays arabes.
Des faiblesses plus générales de l'organisation déterminant ses analyses et prises de position
L'impatience de voir partout et rapidement une sortie du repli après 1989 suite à la relance des luttes en 2003 a été un lourd fardeau : "L'actuelle vague internationale de révoltes contre l'austérité capitaliste ouvre la porte à une toute autre solution : la solidarité de tous les exploités au-delà des divisions religieuses ou nationales ; la lutte des classes dans tous les pays avec pour but ultime une révolution mondiale qui sera la négation des frontières et des états nationaux. Il y a un an ou deux, une telle perspective aurait semblé complètement utopique à la plupart des gens. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes considèrent la révolution mondiale comme une alternative réaliste à l'ordre du capital mondial qui s'effondre."[16]
La position du CCI a été marquée non seulement par une surestimation générale de la situation, mais aussi par une surestimation de l'importance des mouvements dans les pays arabes pour le développement d'une perspective prolétarienne. De même, la tendance à négliger l'importance du débat dans le milieu politique prolétarien a également eu une influence négative : alors que la contribution du NCI à l'analyse du mouvement des Piqueteros en 2002-4 avait été très importante, le CCI n'a pas été en mesure de prendre en compte ultérieurement les critiques formulées à son égard ultérieurement, en 2011, par Internationalist Voice.
Avons-nous fait des erreurs opportunistes dans l'analyse des mouvements arabes ?
Nous pouvons conclure des éléments précédents que le CCI, sur la question de l'analyse des mouvements dans les pays arabes en 2011, où leur caractère massif, leur simultanéité avec d'autres mouvements dans les pays occidentaux, les formes prises par ces mouvements (assemblées, etc), la présence de la classe ouvrière (différente du caractère chaotique d'un certain nombre d'émeutes interclassistes ou dominée par des groupes gauchistes comme les Piqueteros par exemple) ont été examinés, sans prendre de recul et sans avoir une vision lucide de ce qu'ils représentaient réellement, dans un contexte où les parties les plus expérimentées du prolétariat mondial n'étaient pas en mesure de fournir une perspective et une direction. Cette approche s'inscrit dans l'immédiatisme.
Dans le contexte général qui favorisait l'impatience et la précipitation qui existaient dans l'organisation, en imaginant que le prolétariat mondial était déjà en train de surmonter massivement le recul post-89, cet immédiatisme était certainement l'antichambre de l'opportunisme, le point de départ d'un glissement vers l'opportunisme et l'abandon des positions de classe, comme peuvent l'attester les différentes manières dont cet immédiatisme s'est manifesté :
- Le caractère plutôt contradictoire de nos prises de position sur les révoltes au Moyen Orient ;
- L'absence de cohérence et d'articulation à partir des positions cardinales de l'organisation qui sous-tendent nos analyses politiques, voire leur oubli ou leur abandon (par exemple, en remplaçant le concept de luttes interclassistes par celui de révoltes sociales, et sans vraiment expliquer ce que nous entendions par "révoltes sociales".
- L'approche plutôt empirique et superficielle qui tendait à rester à la surface des choses et qui tendait à se substituer à notre cadre politique ;
- Le rôle majeur joué par notre vision de l'indignation comme facteur unilatéralement positif pour le développement de la conscience prolétarienne (ou même comme indice de la nature positive d'un mouvement, appliqué à toutes sortes de mouvements) ;
- La tendance à voir des éléments positifs là où la situation était dominée par les plus grands dangers pour la classe, ce qui conduit à un affaiblissement de la dénonciation de l'idéologie bourgeoise par l'organisation.
Si tous ces éléments combinés réunissent les conditions pour des positions ouvertement opportunistes -si la clarté prolétarienne et la défense des positions de classe par le CCI ne constituent pas une barrière à ces tendances délétères- il faut souligner que le CCI n'a pas pris des positions qui contredisaient directement sa plate-forme et les positions de classe. Il faut situer ces difficultés au niveau de ce qu'elles représentaient réellement (ce qui ne veut pas dire relativiser leur importance et leurs dangers). L'analyse et l'intervention du CCI ont été affaiblies par l'immédiatisme (avec tout ce que cela implique au niveau de l'ambiguïté, de la superficialité, du manque de rigueur, de l'oubli de la défense de notre cadre et de nos positions politiques, et d'une dynamique ouvrant la porte à l'opportunisme), mais on ne peut pas en conclure qu'il a pris des positions directement opportunistes (ce qui a été le cas concernant le mouvement de jeunesse autour de l'écologie).
Relation entre luttes partielles et interclassisme
La dérive sur le mouvement des jeunes contre la destruction écologique a montré un oubli du point 12 de notre plateforme : "La question écologique, comme toutes les questions sociales (qu'il s'agisse de l'éducation, des relations familiales et sexuelles ou autres) sont appelées à jouer un rôle énorme dans toute prise de conscience future et toute lutte communiste. Le prolétariat, et lui seul, a la capacité d'intégrer ces questions dans sa propre conscience révolutionnaire. Ce faisant, il élargira et approfondira cette conscience. Il pourra ainsi diriger toutes les "luttes partielles" et leur donner une perspective. La révolution prolétarienne devra affronter très concrètement tous ces problèmes dans la lutte pour le communisme. Mais ils ne peuvent être le point de départ du développement d'une perspective de classe révolutionnaire. En l'absence du prolétariat, ils sont au pire le point de départ de nouveaux cycles de barbarie. Le tract et l'article du CCI en Belgique sont des exemples flagrants d'opportunisme. Cette fois, il ne s'agit pas d'opportunisme en matière d'organisation, mais d'opportunisme par rapport aux positions de classe telles qu'exposées dans notre plate-forme" (Camarade S. Bulletin interne 2019).
Nous pouvons dire que le rapport sur la lutte des classes au 23e Congrès n'était pas sans ambiguïté à ce niveau. Il adoptait une position ambiguë sur la nature de ces mouvements et laissait la porte ouverte à l'idée qu'ils pouvaient jouer un rôle positif dans le développement de la conscience.[17]
Nous avons eu du mal à voir ce qui distingue ces deux types de mouvements, avec une tendance à les amalgamer, à les mettre sur le même plan. Qu'est-ce qui distingue donc les luttes interclassistes et les luttes partielles ? Dans les mouvements interclassistes, les revendications ouvrières sont diluées et mélangées à des revendications petites bourgeoises (cf. les Gilets jaunes). Ce n'est pas le cas des luttes partielles qui se manifestent essentiellement au niveau des superstructures, leurs revendications se concentrant sur des thèmes qui laissent de côté les fondements de la société capitaliste, même si elles peuvent désigner le capitalisme comme responsable, comme avec la question climatique, ou avec l'oppression des femmes qui est imputée au patriarcat capitaliste. Ils sont aussi des facteurs de division au sein de la classe ouvrière, divisions avec les travailleurs employés dans le secteur de l'énergie dans le premier cas, ou en renforçant les divisions entre les sexes. Les travailleurs peuvent être entraînés dans des luttes partielles mais cela ne les rend pas interclassistes . Il s'agit de clarifier la différence entre les luttes partielles et les luttes interclassistes, et ce qu'elles peuvent avoir en commun.
Sur l'indignation
Dans les années 2010, le CCI a reconnu l'indignation comme une composante importante de la lutte de classe du prolétariat et un facteur de sa prise de conscience. Cependant, le CCI a eu tendance à définir son importance "en soi", de manière quelque peu métaphysique. Une des racines de nos difficultés réside dans l'utilisation inappropriée et unilatérale du concept d'indignation comme quelque chose de nécessairement positif, une indication de la réflexion et même du développement de la conscience de classe, sans tenir compte de la nature de classe de son origine, ou du terrain de classe sur lequel elle s'exprime. Avec la poursuite du plongeon dans la décomposition, il y aura de nombreux mouvements mus par l'indignation, le dégoût, la colère dans de larges couches de la société contre les phénomènes de cette période.
Le rapport sur la lutte des classes au 23ème congrès du CCI traite de la propagation de l'indignation sociale contre la nature destructrice de la société capitaliste (par exemple en réaction contre le meurtre des noirs, la question climatique ou le harcèlement des femmes). En affirmant que ces mouvements basés sur la colère peuvent être récupérés lorsque celle-ci aura retrouvé son identité de classe et luttera sur son terrain, cela introduit une ambiguïté sur le fait que le prolétariat, en luttant sur son propre terrain, peut récupérer toute cette colère. Ceci est en contradiction avec ce qui est dit au point 12 de la plate-forme : "La lutte contre les fondements économiques du système contient en son sein la lutte contre tous les aspects super-structurels de la société capitaliste, mais ce n'est pas vrai dans l'autre sens". De plus, de telles luttes partielles tendent à entraver le combat de la classe ouvrière, son autonomie, et c'est pourquoi la bourgeoisie sait très bien comment les récupérer pour préserver l'ordre capitaliste. En ce sens, l'indignation n'est pas en soi un facteur de développement de la conscience de classe : tout dépend du terrain sur lequel elle s'exprime. Cette réaction émotionnelle qui peut provenir de différentes classes ne conduit pas automatiquement à une réflexion qui peut contribuer au développement de la conscience de classe.
Le rapport sur la lutte des classes au 23ème Congrès du CCI contient une section sur la propagation de l'indignation sociale contre la nature destructrice de la société capitaliste (par exemple en réaction contre le meurtre des noirs, la question climatique ou le harcèlement des femmes). Mais en affirmant que la colère exprimée par ces mouvements peut être récupérée par le prolétariat lorsque celui-ci aura retrouvé son identité de classe et luttera sur son terrain, on introduit l'idée fausse que le prolétariat pourrait "assumer" la direction de tels mouvements dans leur forme actuelle. En réalité, ces mouvements devraient se "dissoudre" avant que les éléments qui y participent puissent rejoindre la lutte prolétarienne.
L'organisation doit clarifier quelles seraient les conditions, à l'échelle historique, pour qu'un mouvement prolétarien autonome donne une orientation et une direction entièrement nouvelles à toutes les différentes doléances et oppressions imposées par la société capitaliste, et qui aujourd'hui, en l'absence d'une direction prolétarienne, trouvent leur seul exutoire sur le terrain des mobilisations interclassistes ou bourgeoises.
L'impact de la crise capitaliste sur l'ensemble de la société pose une autre question à clarifier : quel est le rapport de la lutte du prolétariat avec les autres classes, couches intermédiaires ou non exploitées, existant encore dans le capitalisme et capables de développer leurs propres mobilisations contre la politique de l'Etat (comme les mouvements paysans).
Partie 4. Qu'estce qui a changé depuis le 23e Congrès ?
Près d'une décennie s'est écoulée depuis le mouvement des Indignados. Aussi important qu'il ait été, il n'a en aucun cas marqué un retour en arrière par rapport au recul ouvert en 1989. Nous savons également que la bourgeoisie -surtout en France où le danger de contagion était le plus évident- a pris des contre-mesures pour empêcher qu'un mouvement similaire, ou plus avancé, n'éclate dans le "foyer" traditionnel des révolutions.
À bien des égards, le recul de la classe s'est accentué après l'affaissement des mouvements autour de 2011. Les illusions qui ont prédominé dans le Printemps arabe, étant donné l'incapacité de la classe ouvrière à fournir un leadership aux différentes révoltes, ont été noyées dans la barbarie, la guerre, le terrorisme et la répression féroce. En Europe et aux États-Unis, la marée populiste, en partie alimentée par les développements barbares en Afrique et au Moyen-Orient qui ont précipité la crise des réfugiés et le retour en force du terrorisme islamique, a affecté une partie de la classe ouvrière. Dans le "tiers-monde", la montée de la misère économique a eu tendance à provoquer des révoltes populaires dans lesquelles la classe ouvrière a été à nouveau incapable de se manifester sur son propre terrain ; de manière encore plus significative, la tendance du mécontentement social à prendre un caractère interclassiste s'est clairement exprimée dans un pays central comme la France, avec les manifestations des Gilets jaunes qui ont persisté pendant toute une année. À partir de 2016, avec l'arrivée au pouvoir de Trump et le vote pour le Brexit au Royaume-Uni, la montée du populisme a atteint des niveaux spectaculaires, entraînant une partie de la classe ouvrière dans ses campagnes contre les "élites". Et en 2020, tout ce processus de décomposition s'est accéléré de manière encore plus spectaculaire avec la pandémie. Le climat de peur généré par la pandémie, et le verrouillage qui en résulte, ont encore accru l'atomisation de la classe ouvrière et créé de profondes difficultés pour une réponse de classe aux conséquences économiques dévastatrices de la crise de Covid-19.
Et pourtant, peu de temps avant que la pandémie ne frappe, nous assistions à un nouveau développement des mouvements de classe : les grèves des enseignants et des ouvriers de l'automobile de GM aux États-Unis ; les grèves généralisées en Iran en 2018, qui ont posé la question de l'auto-organisation même si, contrairement aux exagérations d'une partie du milieu, on était encore loin de la formation de soviets. Ces dernières grèves ont notamment posé la question de la solidarité de classe face à la répression étatique.
Surtout, nous avons vu les luttes en France fin 2019, où des bataillons clés de la classe ouvrière étaient dans les rues autour de revendications de classe, écartant le mouvement des Gilets jaunes qui était réduit à une présence symbolique à l'arrière des cortèges.
D'autres expressions de combativité ont eu lieu dans d'autres pays, par exemple en Finlande. Mais la pandémie a frappé le cœur de l'Europe, paralysant dans une large mesure la possibilité pour les luttes en France de prendre une dimension internationale. Néanmoins, à plusieurs endroits dans le monde ont eu lieu des grèves de travailleurs pour la défense de leurs conditions de travail face aux mesures sanitaires totalement inadaptées prises par l'Etat et le patronat[18]. Ces mouvements n'ont pas pu se développer davantage en raison des conditions restrictives du premier confinement, bien que le rôle central de la classe ouvrière pour permettre que la vie continue dans la société ait été mis en évidence par les secteurs qui n'ont pas eu d'autre choix que de continuer à travailler pendant le confinement : santé, transports, alimentation, etc. La classe dirigeante a fait de gros efforts pour présenter ces travailleurs comme des héros au service de la nation, mais l'hypocrisie des gouvernements -et donc la base de classe des "sacrifices" de ces travailleurs- était évidente pour beaucoup. En Grande-Bretagne, par exemple, les travailleurs de la santé ont manifesté leur colère lorsqu'il est apparu que leur "héroïsme" ne valait pas une augmentation de salaire [19].
En plus de la pandémie, la classe ouvrière a rapidement été confrontée à d'autres obstacles au développement de la conscience de classe, surtout aux États-Unis où les manifestations de "Black Lives Matter" se sont polarisées sur une mobilisation parcellaire, celle de la race, suivies rapidement par l'énorme campagne électorale qui a donné un nouvel élan aux illusions démocratiques. Ces deux campagnes ont eu un impact international majeur. Aux États-Unis en particulier, le danger que la classe ouvrière soit entraînée, via les politiques identitaires de droite et de gauche, dans des confrontations violentes derrière des factions bourgeoises concurrentes reste très réel : l'assaut dramatique du Capitole par les partisans de Trump démontre que même si Trump a été écarté du gouvernement, le trumpisme reste une force puissante au niveau de la rue. Enfin, les travailleurs sont maintenant confrontés à une deuxième vague de la pandémie et à une nouvelle série de restrictions, qui non seulement renouvellent l'atomisation de la classe par l'État, mais ont également conduit à des explosions de frustration contre les restrictions qui ont entraîné certaines parties de la classe dans des protestations réactionnaires alimentées par les théories du complot et l'idéologie de "l'individu souverain".
Pour le moment, la combinaison de toutes ces questions, mais surtout les conditions imposées par la pandémie, ont agi comme un frein important à la fragile relance de la lutte des classes entre 2018 et 2020. Il est difficile de prévoir combien de temps cette situation va persister et nous ne pouvons donc pas fournir de perspectives concrètes pour le développement de la lutte au cours de la période à venir. Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que la classe ouvrière sera confrontée à des attaques brutales contre ses conditions de vie. Cela a déjà commencé dans un certain nombre de secteurs où les employeurs ont réduit de manière drastique leurs effectifs. Les gouvernements des pays centraux du capitalisme font encore preuve d'une certaine prudence à l'égard de la classe, en subventionnant les entreprises pour leur permettre de conserver leurs employés, en "mettant au chômage" les travailleurs qui ne peuvent pas travailler à domicile afin d'éviter une plongée immédiate dans la paupérisation, en prenant des mesures pour éviter les expulsions des locataires incapables de payer leurs loyers, etc. Ces mesures coûtent très cher aux gouvernements et alourdissent considérablement le poids de la dette. Nous savons que, tôt ou tard, les travailleurs seront appelés à payer pour cela.
Partie 5. Débats sur le rapport de force entre les classes
L'évolution dramatique de la situation mondiale depuis le dernier congrès du CCI a inévitablement donné lieu à des débats tant au sein de l'organisation que dans notre milieu de contacts et de sympathisants. Ces débats ont porté sur l'importance de la pandémie et l'accélération de la décomposition, mais ils ont également posé de nouvelles questions sur le rapport des force entre les classes. Lors du Congrès du RI de l'été 2020, des critiques ont été formulées à l'encontre du rapport sur la lutte des classes, notamment son évaluation du mouvement contre la réforme des retraites en France début 2019. Une contribution dans le bulletin interne (2021, camarade M) en particulier a fait valoir - nous pensons à juste titre - que le rapport prétendait que le mouvement avait atteint un certain niveau de politisation sans fournir de preuves suffisantes d'une telle avancée ; en même temps, qu'il y avait un manque de clarté dans celui-ci concernant la distinction entre la politisation des luttes, et la politisation des minorités - une distinction que le présent rapport a cherché à élucider. Cette contribution met en garde contre une surestimation du niveau actuel de la lutte des classes (une erreur que nous avons souvent commise dans le passé - cf. .le rapport du 21e Congrès) :
- "La tendance à la politisation des luttes ne s'est nullement révélée dans le mouvement contre la réforme des retraites en France. Il n'y a pas eu d'espace de débat prolétarien, pas d'assemblée générale. La politisation de la classe ouvrière sur son propre terrain de classe sera inséparable de sa sortie du profond recul qu'elle a subi depuis 1989. Le prolétariat en France, comme dans tous les pays, n'a pas encore retrouvé le chemin de sa perspective révolutionnaire, chemin bloqué par l'effondrement du bloc de l'Est. Avec l'aggravation de la crise et les attaques contre ses conditions de vie, il est évident que la classe ouvrière prend aujourd'hui de plus en plus conscience que le capitalisme n'a aucun avenir à lui offrir. Elle cherche une perspective, mais elle ne sait pas encore que c'est entre ses mains et dans ses luttes que cette perspective est cachée et enfouie. Cette conscience de la réalité monstrueuse du monde actuel ne signifie pas une politisation sur son propre terrain de classe, c'est-à-dire en dehors du cadre de la démocratie bourgeoise. Malgré son énorme potentiel de combativité (qui n'a pas été épuisé par l'irruption de la pandémie), le prolétariat en France ne pose pas encore la question de la révolution prolétarienne. Même si le mot "révolution" est revenu sur certaines banderoles, quel contenu y a-t-il ? Je ne pense pas que ce soit une question de révolution "prolétarienne". La classe ouvrière en France n'a pas encore retrouvé son identité de classe (qui était encore très embryonnaire dans le mouvement contre la réforme des retraites). Il y a encore en son sein un rejet ou en tout cas une méfiance très profonde à l'égard du mot 'communisme'".
En outre, est souligné que cette surestimation de la tendance à la politisation peut ouvrir la porte à une vision conseilliste : "La politisation des luttes ne peut se vérifier que lorsque l'avant-garde révolutionnaire commence à avoir une certaine influence dans les luttes ouvrières (notamment dans les assemblées générales). Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le rapport du congrès de RI ouvre donc la porte à une vision conseilliste en affirmant qu'il existe déjà 'les indices d'une politisation de la lutte'".
Le danger d'une vision conseilliste est également soulevé dans les divergences exprimées par le camarade S. lors et après le 23e Congrès, mais pas à partir du même point de départ. Ces divergences se sont approfondies depuis et ont donné lieu à un débat public qui, à son tour, a eu un certain impact sur certains de nos interlocuteurs contacts. Dans la mesure où elles concernent le problème du rapport de force entre les classes, ces divergences touchent à trois questions essentielles :
- Le potentiel et les limites des luttes économiques
- La question de la maturation souterraine
- La question des "défaites politiques". A ce propos, la publication du premier tour du débat sur les divergences a amené certains de nos contacts à s'interroger sur ce qui s'est passé dans les années 1980.
Luttes économiques et maturation souterraine
Dans sa réponse à notre réponse (Bulletin interne 2021), le camarade S. affirme qu'il est d'accord avec le CCI sur la nécessité de la lutte économique : parce que les travailleurs doivent défendre leur existence physique contre l'exploitation capitaliste ; parce que les travailleurs doivent lutter pour "avoir une vie" au-delà de la journée de travail afin d'avoir accès à la culture, aux débats politiques, etc. ; et parce que, comme Marx l'a dit, une classe qui ne peut pas lutter pour ses intérêts à ce niveau ne peut certainement pas se présenter comme une force capable de transformer la société. Mais en même temps, dit-il, dans les conditions de décomposition, notamment en raison de l'affaiblissement de la perspective d'une révolution sociale par l'impact de l'effondrement du bloc de l'Est, les liens historiques entre les dimensions économiques et politiques de la lutte ont été rompus au point que cette unité ne peut être restaurée par un développement des seules luttes économiques. Et il cite ici Rosa Luxemburg dans Réforme ou Révolution pour mettre en garde le CCI contre toute rechute dans une vision conseilliste dans laquelle les "travailleurs eux-mêmes", sans le rôle indispensable de l'organisation révolutionnaire, peuvent retrouver leur perspective révolutionnaire : "Le socialisme n'est pas du tout une tendance inhérente aux luttes quotidiennes de la classe ouvrière. Il n'est inhérent qu'à l'aggravation des contradictions objectives de l'économie capitaliste d'une part, à la compréhension subjective de la nécessité de la surmonter par une transformation socialiste d'autre part".
S. en conclut que le principal danger auquel est confronté le CCI est une déviation conseilliste dans laquelle l'organisation laisse à la résurgence des luttes économiques le soin de se politiser "spontanément", et ignore ainsi ce qui devrait être sa tâche première : réaliser l'approfondissement théorique nécessaire qui permettrait à la classe de reprendre confiance dans le marxisme et la possibilité d'une société communiste.
Nous avons vu que le danger du conseillisme ne peut être écarté lorsqu'il s'agit de comprendre le processus de politisation : nous avons appris à nos dépens que le danger de devenir trop enthousiaste quant aux possibilités et à la profondeur des luttes immédiates est toujours présent. Nous sommes également d'accord avec Luxemburg -et avec Lénine- pour dire que la conscience socialiste n'est pas le produit mécanique de la lutte quotidienne, mais qu'elle est le produit du mouvement historique de la classe, qui inclut de manière certaine l'élaboration théorique et l'intervention de l'organisation révolutionnaire. Mais ce qui manque dans l'argumentation de S., c'est une explication du processus réel par lequel la théorie révolutionnaire peut à nouveau "saisir les masses". À notre avis, cela est lié à un désaccord sur la question de la maturation souterraine.
Dans son texte, le camarade dit : "La réponse demande si je considère que la situation actuelle est pire que celle des années 1930 (lorsque des groupes comme Bilan ont contribué à une "maturation souterraine" politique et théorique de la conscience malgré la défaite de la classe), alors que je nie l'existence d'une telle maturation à l'heure actuelle. Oui, au niveau de la maturation souterraine, la situation est effectivement pire que dans les années 30, car aujourd'hui la tendance parmi les révolutionnaires est plutôt à la régression politique et théorique".
Afin de répondre à cela, il est nécessaire de revenir à notre débat initial sur la question de la maturation souterraine -à la lutte contre le point de vue conseilliste selon lequel la conscience de classe ne se développe que dans les phases de lutte ouverte.
Ainsi, l'argument du camarade MC[20] dans "Sur la maturation souterraine" (Bulletin interne1983) était que le rejet de la maturation souterraine sous-estimait profondément le rôle de l'organisation révolutionnaire dans l'élaboration de la conscience de classe : "La lutte de classe du prolétariat connaît des hauts et des bas, mais ce n'est pas le cas de la conscience de classe : l'idée d'une régression de la conscience avec le recul de la lutte de classe est contredite par toute l'histoire du mouvement ouvrier, histoire dans laquelle l'élaboration et l'approfondissement de la théorie se poursuivent dans une période de recul. Il est vrai que le champ, l'étendue de son action se rétrécit, mais pas son élaboration en profondeur".
S. ne nie évidemment pas le rôle de l'organisation révolutionnaire dans l'élaboration de la théorie. Ainsi, lorsqu'il parle de "régression souterraine", il veut dire que l'avant-garde politique communiste (et donc le CCI) ne parvient pas à effectuer le travail théorique nécessaire pour restaurer la confiance de la classe ouvrière dans sa perspective révolutionnaire - qu'elle régresse théoriquement et politiquement.
Mais rappelons que le texte de MC ne limite pas la maturation souterraine au travail de l'organisation révolutionnaire :
- "Le travail de réflexion se poursuit dans la tête des travailleurs et se manifestera par la recrudescence de nouvelles luttes. Il existe une mémoire collective de la classe, et cette mémoire contribue aussi au développement de la prise de conscience et à son extension dans la classe". Ou encore : "Ce processus de développement de la conscience n'est pas uniquement réservé aux communistes pour la simple raison que l'organisation communiste n'est pas le seul siège de la conscience. Ce processus est aussi le produit d'autres éléments de la classe qui restent fermement sur un terrain de classe ou tendent dans cette direction".
Ce point est important car S. semble précisément restreindre la maturation souterraine à la seule organisation révolutionnaire. Si nous le comprenons bien, puisque le CCI tend à la régression théorique et politique, ce serait une preuve de la "régression souterraine "dont il parle. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec cette évaluation de la situation actuelle du CCI, mais c'est une autre discussion. Le point sur lequel il faut se concentrer ici est que l'organisation communiste et le milieu politique prolétarien ne sont que la pointe de l'iceberg dans un processus plus profond qui se déroule dans la classe :
Dans une polémique avec le CWO dans la Revue internationale n° 43 sur le problème de la maturation souterraine, nous avons défini ce processus comme suit :
- "au niveau de conscience le plus bas, ainsi que dans les plus larges couches de la classe, cela (la maturation souterraine) prend la forme d'une contradiction croissante entre l'être historique, les besoins réels de la classe, et l'adhésion superficielle des ouvriers aux idées bourgeoises. Ce heurt peut rester longtemps en grande partie non-reconnu, enfoui ou réprimé, ou bien il peut commencer à émerger sous la forme de désillusion et de désengagement vis-à-vis des thèmes principaux de l'idéologie bourgeoise ;
- dans un secteur plus restreint de la classe, parmi les ouvriers qui restent fondamentalement sur le terrain prolétarien, cela prend la forme d'une réflexion sur les luttes passées; de discussions plus ou moins formelles sur les luttes à venir, l'émergence de noyaux combatifs dans les usines et parmi les chômeurs. Récemment, la manifestation la plus spectaculaire de cet aspect du phénomène de maturation souterraine a été donnée par les grèves de masse en Pologne en 1980, dans lesquelles les méthodes de lutte utilisées par les ouvriers ont montré qu'il y avait eu une réelle assimilation de nombreuses leçons des luttes de 1956, 70 et 76 …...
- dans une fraction de la classe, qui est encore plus limitée en taille, mais destinée à croître avec l'avancée de la lutte, cela prend la forme d'une défense explicite du programme communiste, et donc de regroupement en avant-garde marxiste organisée. L'émergence d'organisations communistes, loin d'être lune réfutation de la notion de maturation souterraine, est à la fois un produit et un facteur actif de celle-ci "[21]
Ce qui manque dans ce modèle, c'est une autre couche constituée par les éléments qui souvent ne sont pas des produits directs des mouvements de classe, mais qui sont à la recherche des positions communistes ; Ils constituent le "marais" (ou une partie de celui-ci qui est le produit d'une avancée politique, même si elle est confuse, et non pas ces éléments qui expriment une régression à partir d'un niveau de clarté plus élevé), et aussi ceux qui se dirigent plus explicitement vers les organisations révolutionnaires.
L'émergence d'une telle couche n'est pas le seul indice de maturation souterraine, mais c'est certainement le plus évident. S. a soutenu que l'apparition de cette couche peut être expliquée simplement en se référant à la nature révolutionnaire de la classe ouvrière. Du fait que nous comprenons la classe non pas comme une force statique, mais comme une force dynamique, il est plus exact de considérer cette couche comme le produit d'un mouvement vers la conscience au sein de la classe. Et il est certainement nécessaire d'étudier le mouvement à l'intérieur du mouvement : comprendre s'il y a un processus de maturation qui a lieu dans cette couche - en d'autres termes, est-ce que le milieu des éléments de recherche lui-même montre des signes de développement ? Et si nous comparons les deux "poussées" des minorités politisées qui sont apparues depuis 2003 environ, il y a effectivement des indications qu'un tel développement a eu lieu.
La première poussée a eu lieu au milieu des années 2000 et a coïncidé avec ce que nous avons appelé une nouvelle génération de la classe ouvrière, qui s'est manifestée dans le mouvement "anti-CPE" et les "Indignados". Une petite partie de ce milieu a gravité vers la gauche communiste et a même rejoint le CCI, ce qui a donné l'espoir que nous rencontrions une nouvelle génération de révolutionnaires (cf. le Texte d'orientation sur la culture du débat[22]). En réalité, il s'agissait d'une "mouvance" largement présente au sein du marais et qui s'est avéré très perméable à l'influence de l'anarchisme, du modernisme et du parasitisme. L'un des traits distinctifs de cette mouvance était, à côté d'une méfiance à l'égard de l'organisation politique, une profonde résistance au concept de décadence et donc aux groupes de la gauche communiste, perçus comme sectaires et apocalyptiques, surtout le CCI. Certains des éléments de cette poussée avaient été impliqués dans l'ultra-activisme du mouvement anticapitaliste dans les années 90, et bien qu'ils aient fait un premier pas en voyant le rôle central de la classe ouvrière dans le renversement du capitalisme, ils ont conservé leurs penchants activistes, poussant certains d'entre eux (par exemple la majorité du collectif qui organise Libcom) vers un anarcho-syndicalisme renaissant, vers des idées d'"organisation" sur le lieu de travail, qui se nourrissent de la possibilité de remporter de petites victoires et se détournent de toute notion selon laquelle le déroulement objectif et historique de la crise serait lui-même un facteur de développement de la lutte des classes.
La seconde vague d'éléments en recherche, dont nous avons pris conscience ces dernières années, bien que peut-être de moindre ampleur que la précédente, se situe certainement à un niveau plus profond : elle tend à considérer la décadence et même la décomposition comme une évidence ; elle contourne souvent l'anarchisme, qu'elle considère comme dépourvu des outils théoriques permettant de comprendre la période actuelle, et craint moins de contacter directement les groupes de la gauche communiste. Souvent très jeunes et sans expérience directe de la lutte des classes, leur souci premier est d'approfondir, de donner un sens au monde chaotique qui leur fait face en assimilant la méthode marxiste. Il s'agit ici, à notre avis, d'une concrétisation claire de la conscience communiste résultant, selon les termes de Rosa Luxemburg, de "l'acuité des contradictions objectives de l'économie capitaliste d'une part, (et) de la compréhension subjective du caractère indispensable de son dépassement par une transformation socialiste d'autre part".
En ce qui concerne cette couche émergente d'éléments politisés, le CCI a une double responsabilité en tant qu'organisation de type "fraction". D'une part, bien sûr, l'élaboration théorique vitale nécessaire pour fournir une analyse claire d'une situation mondiale en constante évolution et pour enrichir la perspective communiste[23] Mais il s'agit aussi d'un patient travail de construction de l'organisation : travail de "formation des cadres" comme le disait le GCF après la Seconde Guerre mondiale, de développement de nouveaux militants qui tiendront le cap ; de défense contre les incursions de l'idéologie bourgeoise, les calomnies du parasitisme, etc. Ce travail de construction organisationnelle n'apparaît pas du tout dans la réponse de S., et pourtant il est certainement l'un des éléments principaux de la lutte réelle contre le conseillisme.
En outre, si ce processus de maturation souterraine est réel, s'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg des développements qui ont lieu dans des couches beaucoup plus larges de la classe, le CCI a raison d'envisager la possibilité d'une future reconnexion entre les luttes défensives et la reconnaissance croissante que le capitalisme n'a aucun avenir à offrir à l'humanité. En d'autres termes, il annonce le potentiel intact de politisation des luttes et leur convergence avec l'émergence de nouvelles minorités révolutionnaires et l'impact croissant de l'organisation communiste.
Sur les "défaites politiques"
La publication d'un premier cycle de débat sur le rapport de force entre les classes a fait apparaître diverses divergences dans notre milieu de proches sympathisants. Sur le forum du CCI, en particulier dans le fil "Débat interne au CCI sur la situation internationale"(Internal debate in the ICC on the international situation | International Communist Current (internationalism.org) [157]), dans un échange de contributions avec MH ; Débat sur le rapport de force entre les classes (Debate on the balance of class force | International Communist Current (internationalism.org) [158]), dans nos réunions de contact, et sur le propre blog de MH[24]. Le camarade MH en particulier est devenu de plus en plus critique de notre point de vue selon lequel c'est essentiellement l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 qui a précipité le long retrait de la classe dont nous devons encore sortir. Pour MH, c'est en grande partie une offensive politique/économique de la classe dominante après 1980, menée par la bourgeoisie britannique en particulier, qui a mis fin à la troisième vague de luttes (plutôt : l'a étranglée à la naissance). De ce point de vue, c'est la défaite de la grève des mineurs en 1985 au Royaume-Uni qui a marqué la défaite des luttes des années 1980. Cette conclusion conduit actuellement MH à réévaluer notre vision des luttes après 1968 et même à remettre en question la notion de décomposition, bien que ses divergences semblent parfois impliquer que "la décomposition a gagné", et que nous devons faire face à la réalité d'une grave défaite historique pour la classe ouvrière. Le camarade Baboon est largement d'accord avec MH sur l'importance clé de la défaite de la grève des mineurs, mais il ne l'a pas suivi jusqu'au point de remettre en question la décomposition, ou de conclure que le recul de la classe ouvrière a peut-être franchi une étape qualitative vers une sorte de défaite historique[25].
Le camarade S., cependant, semble maintenant être de plus en plus explicite sur le fait que c'est le cas. Comme il l'a dit dans une récente lettre à l'organe central:
- "Y a-t-il ou non une divergence fondamentale sur le rapport de force entre les classes ?
La position de l'organisation est que la classe ouvrière est invaincue. La position opposée existe également dans nos rangs, à savoir que la classe ouvrière, au cours des cinq dernières années, a souffert d'une défaite politique, dont le principal symptôme est l'explosion de l'identitarisme de tout type, qui résulte avant tout de l'incapacité de la classe à retrouver sa propre identité de classe. La position de l'organisation est que la situation de la classe est meilleure qu'elle ne l'était dans les années 1990 sous le choc de la "mort du communisme", alors que l'autre position dit que la situation de la classe aujourd'hui est pire que dans les années 1990, que le prolétariat mondial est aujourd'hui sur le point de subir une défaite politique d'une ampleur telle qu'il lui faudra peut-être une génération pour s'en remettre".
Comme nous l'avons souligné au début de ce rapport, la reconnaissance par le CCI que le concept de cours historique ne s'applique plus dans la phase de décomposition signifie qu'il devient beaucoup plus difficile d'évaluer la dynamique globale des événements, et en particulier d'arriver à la conclusion que la porte vers un avenir révolutionnaire est définitivement fermée, puisque la décomposition peut submerger le prolétariat dans un processus graduel, sans que la bourgeoisie ait à le vaincre directement, dans un combat face à face, comme elle l'a fait dans la période de la vague révolutionnaire. Il est donc difficile de savoir ce que S. entend par une "défaite politique d'une ampleur telle qu'il faudra peut-être une génération pour s'en remettre". Si le prolétariat n'a pas encore affronté l'ennemi de classe dans une lutte politique ouverte, comme il l'a fait en 1917-23, quels critères utilisons-nous pour juger que le recul de la lutte de classe au cours des trois dernières décennies a atteint un tel point ; et de plus, puisqu'une telle défaite serait vraisemblablement suivie d'une accélération majeure de la barbarie, et - selon S. - d'une guerre mondiale, ou au moins d'un holocauste nucléaire "limité"- quelles possibilités de "récupération" resteraient à la génération suivante ?
Un dernier point : S. prétend que nous considérons la situation actuelle de la classe "meilleure" qu'au lendemain de l'effondrement des blocs. C'est inexact. Nous avons certes dit que les conditions des futurs affrontements de classe sont inévitablement en train de mûrir, et, comme l'a souligné le rapport sur la lutte de classe au Congrès du RI, ceci dans un contexte très différent de la situation au début de la phase de décomposition :
- Alors que 1989 pouvait être présenté comme la défaite du communisme et la victoire du capitalisme, la pandémie ne peut être présentée comme une justification de la supériorité du système actuel. Au contraire, malgré toutes les mystifications entourant les origines et la nature de la pandémie, elle fournit une preuve supplémentaire que le système capitaliste est devenu un danger pour l'humanité, même si pour l'instant seule une petite minorité l'a clairement compris ;
- Alors que les événements de 1989 ont constitué un coup dur pour la combativité et la conscience de classe, et que le développement de la décomposition a eu tendance à aggraver la perte d'identité de classe, la pandémie s'est déclarée dans le contexte d'une certaine renaissance de la lutte de classe : la volonté de la bourgeoisie de sacrifier la santé et la vie dans l'intérêt du profit, ainsi que sa gestion chaotique de la pandémie, tend à provoquer une prise de conscience que nous ne sommes pas "tous dans le même bateau"- que la classe ouvrière et les pauvres sont les premières victimes de la pandémie et de la négligence criminelle de la classe dirigeante.
Mais tous ces "plus" viennent s'ajouter à 30 ans de décomposition -une période pendant laquelle le temps n'est plus du côté du prolétariat, qui continue à souffrir des blessures accumulées infligées par une société qui pourrit sur ses pieds. À certains égards, nous serions d'accord pour dire que la situation est "pire" qu'elle ne l'était dans les années 1980. Mais nous échouerions dans notre tâche en tant que minorité révolutionnaire si nous ignorions les signes qui indiquent une renaissance de la lutte des classes- d'un mouvement prolétarien qui contient la possibilité d'empêcher la société de plonger définitivement dans l'abîme.
[1] Résolution sur le rapport de force entre les classes (2019) [159] Revue internationale n° 164
[2] Dans son premier article exposant ses désaccords avec les résolutions du 23e Congrès sur la situation internationale, le camarade S. soutient que la résolution sur le rapport de force entre les classes montre que le CCI abandonne son point de vue selon lequel l'incapacité du prolétariat à développer sa perspective révolutionnaire pendant la période 1968-89 était une cause première de la phase de décomposition. Dans notre réponse, nous avons déjà souligné ce que nous répétons dans ce rapport : la résolution sur le rapport de force entre les classes place la question de la politisation - en d'autres termes, le développement d'une alternative prolétarienne pour l'avenir de la société - au cœur même de sa compréhension de l'impasse actuelle entre les deux grandes classes. Il est vrai que la résolution aurait pu être plus explicite sur le fait que l'impasse est le produit non seulement de l'incapacité de la bourgeoisie à mobiliser la société pour la guerre mondiale, mais aussi de l'incapacité de la classe ouvrière - en particulier de ses bataillons centraux dans le sillage de la grève de masse polonaise - à comprendre et à assumer les objectifs politiques de sa lutte. Nous pensons que ce point - qui est simplement l'élément de base de notre analyse de la décomposition - a été clarifié dans notre réponse publiée à S..
[3] Misère de la philosophie, 1847
[4] Grève de masse, parti et syndicats, 1906
[5] Contribution (J.) dans le bulletin interne en 2011.
[6] "Révoltes sociales en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, catastrophe nucléaire au Japon, guerre en Libye : Seule la révolution prolétarienne peut sauver l'humanité du désastre du capitalisme [160]", Revue internationale n° 145 . La résolution du 21e Congrès a une démarche encore ambiguë sur les mouvements au Moyen-Orient comme étant "marqués par l'interclassisme".
[7] "Que se passe-t-il au Moyen-Orient [161] ?", Revue internationale 145.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] "Révoltes sociales en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, catastrophe nucléaire au Japon, guerre en Libye : Seule la révolution prolétarienne peut sauver l'humanité du désastre du capitalisme [160]", Revue internationale 145
[11] "La métaphore des 5 cours :
- 1. des mouvements sociaux de la jeunesse précaire, au chômage ou encore étudiante, qui commencent avec la lutte contre le CPE en France en 2006, se poursuivent par les révoltes de la jeunesse en Grèce en 2008 et qui culminent dans les mouvements des Indignés et d’Occupy en 2011 ;
- 2. des mouvements massifs mais très bien encadrés par la bourgeoisie qui avait préparé le terrain à l'avance, comme en France en 2007, en France et en Grande-Bretagne en 2010, en Grèce en 2010-2012, etc ;
- 3. des mouvements subissant le poids de l’interclassisme comme en Tunisie et en Égypte en 2011;
- 4. des germes de grèves massives en Égypte en 2007, Vigo (Espagne) en 2006, Chine en 2009;
- 5. la poursuite de mouvements dans des usines ou des secteurs industriels localisés mais contenant des germes prometteurs comme Lindsay en 2009, Teckel en 2010, les électriciens en Grande-Bretagne en 2011.
Ces 5 cours appartiennent à la classe ouvrière parce que malgré leurs différences, ils expriment chacun à son niveau l'effort du prolétariat pour se retrouver lui-même malgré les difficultés et les obstacles que sème la bourgeoisie ; chacun à son niveau a porté une dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social. A différents niveaux, ils s'inscrivent dans la recherche "du mot qui nous emmènera jusqu’au socialisme" (comme l'écrit Rosa Luxemburg en parlant des conseils ouvriers) au moyen des assemblées générales". (Résolution sur la situation internationale [162], 20e Congrès du CCI, IR 152)
[12] “Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe [163]”, Revue internationale 147.
[13] Comme l'indique le titre de l'article de l'IR 147, les mouvements en Grèce et en Israël en 2011 (mais aussi les protestations en Turquie et au Brésil en 2013) ont été analysés de manière très similaire aux Indignados en Espagne. Une révision critique de tous nos articles de cette période s'impose donc.
[14] Une question à réexaminer est également l'existence d'ambiguïtés et de confusions quant à l'impact positif des émeutes de la faim sur le développement de la conscience de classe (cf. Crise alimentaire, émeutes de la faim : Seule la lutte de classe du prolétariat peut mettre fin aux famines [164] ; Revue internationale n° 134
[15] Le chapitre sur "Les luttes contre l'économie de guerre au Proche -Orient" du rapport sur la lutte de classe du 23e Congrès du CCI [165] n'a pas été discuté en profondeur. Le rapport parle de l'existence de mouvements prolétariens dans plusieurs pays, et il est nécessaire de réévaluer ces mouvements sur une base plus solide et plus approfondie, en cherchant à situer l'analyse de ces mouvements dans le cadre de la critique du maillon faible, ainsi que dans le contexte de la décomposition (ce que le rapport ne semble pas faire explicitement, adoptant l'approche appliquée aux mouvements de 2011) afin d'examiner la nature de ces mouvements et leurs force et faiblesses.
[16] " Manifestations en Israël : "Moubarak, Assad, Netanyahou !", ICC en ligne, cité dans l'article de IR 147
[17] "Le fait qu'il ne s'agisse pas de mouvements spécifiquement prolétariens les rend certainement vulnérables aux mystifications autour de la politique identitaire et du réformisme, et à la manipulation directe par les factions bourgeoises de gauche et démocratiques".
[20] Pour l'histoire de notre camarade, ancien membre de la Bilan et de la Gauche communiste de France, membre fondateur du CCI et décédé en 1991, lire nos articles 'MARC : De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale [17]" et "MARC : II - De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle [18]" des numéros 65 et 66 de la Revue internationale.
[21] "Réponse à la CWO : sur la maturation souterraine de la conscience de classe [168]"; Revue internationale n° 43.
[23] Comme cela a été souligné lors d'une discussion lors d'un réunion de l'organe central du CCI en 2021, le CCI ne peut être accusé de négliger l'effort d'approfondissement de notre compréhension du programme communiste. L'existence de trente ans de publications sur le communisme prouve bien que nous ne partons pas de zéro ici...
[25] Nous n'approfondirons pas ces discussions ici, sauf pour dire qu'elles semblent être basées sur une sous-estimation à la fois des luttes importantes qui ont eu lieu après 1985, où la remise en cause des syndicats dans des pays comme la France et l'Italie a contraint la classe dirigeante à radicaliser son appareil syndical, et surtout une sous-estimation de l'impact de l'effondrement du bloc de l'Est sur la combativité et la conscience de classe.
Vie du CCI:
- Rapports de Congrès [156]
Rubrique:
Rapport sur la crise économique pour le 24e Congrès du CCI
- 97 lectures
Ce rapport fait suite au rapport adopté par le 24e Congrès de Révolution Internationale[1]. Plusieurs aspects sont traités de manière adéquate dans ce rapport, notamment les mesures prises dans le domaine économique face à la pandémie, l'incursion violente de la décomposition sur le terrain économique, l'attaque des conditions de vie des ouvriers qui devient un véritable cauchemar. Nous ne développerons pas ces éléments mais nous nous concentrerons sur la perspective : où va l'économie mondiale après le grand cataclysme qui a éclaté avec la pandémie ?
1. Une crise largement annoncée
Le rapport sur la crise économique adopté par le 23e Congrès annonçait : "nous devons considérer la possibilité de secousses significatives dans l’économie mondiale pour 2019-2020. Les facteurs négatifs s’accumulent : une dette de plus en plus incontrôlable ; la guerre commerciale qui se déchaîne ; dévaluations brutales des actifs financiers surévalués; contraction de -0,1% de l’économie allemande au troisième trimestre de 2018, l’économie chinoise est tombée à son rythme le plus bas de la dernière décennie".
Pour 2020, la Banque mondiale a enregistré une baisse globale de la production de 5,2%, soit 7% pour les 23 premières économies du monde et 2,5% pour les "économies en voie de développement". Selon la Banque mondiale, la baisse de la production est la pire depuis 1945 et "pour la première fois depuis 1870, un nombre sans précédent de pays vont enregistrer une baisse de leur production par habitant"[2]. Un phénomène très important est la chute du commerce mondial. Un indicateur est la baisse du commerce maritime mondial, qui a diminué de 10% en 2020. Mais, paradoxalement, "les prix des conteneurs ont en moyenne quadruplé au cours des deux derniers mois. D'environ 1.500 dollars à près de 5.000 dollars. Et dans certains cas, il a même atteint 12.000 dollars. Cela s'explique par le fait que des pays comme la Chine utilisent leurs navires et leurs conteneurs pour leur propre usage, les soustrayant au trafic mondial [3].
Pour 2021, un rebond de l'économie mondiale est prévu, à condition toutefois que la pandémie soit vaincue d'ici juin 2021, sinon les prévisions sont beaucoup plus pessimistes. Il y aura des augmentations fébriles de la croissance, mais au-delà, il faut considérer que les prévisions les plus sérieuses indiquent une stabilisation de l'économie mondiale à partir de 2023. L'expérience de la reprise post-2008 est qu'elle a mis du temps à s'installer (à partir de 2013), qu'elle a été plutôt anémique et qu'en 2018, elle a montré des signes d'épuisement. Comme nous le verrons tout au long de ce rapport, les conditions actuelles de l'économie mondiale sont bien pires qu'en 2008 et, plutôt que de faire des prédictions, l'important est de comprendre cette importante détérioration.
D'une part, les "experts" donnent une image trompeuse des effets de la crise pandémique sur l'économie. Ils partent de l'axiome selon lequel une telle crise n'aura pas d'effets irréversibles sur l'appareil économique et que l'économie se redressera à un niveau supérieur à celui de la période précédente. Une telle hypothèse sous-estime l'importante détérioration de longue date du tissu productif, financier et commercial, que la crise pandémique risque d'affaiblir profondément. On estime que 30% des entreprises pourraient disparaître définitivement dans les pays de l'OCDE. Nous avons là plus de 100 ans de décadence capitaliste, avec une économie distordue par l'économie de guerre et les effets de la destruction de l'environnement, profondément altérée dans ses mécanismes de reproduction par l'endettement et les manipulations étatiques, érodée par les pandémies, et de plus en plus touchée par les effets de décomposition. Dans ces conditions, il est illusoire de penser que l'économie se redressera sans la moindre égratignure.
D'autre part, la profonde faiblesse de la "reprise" proclamée de 2013 - 2018 annonçait déjà la situation actuelle. En dehors des États-Unis, de la Chine et, dans une moindre mesure, de l'Allemagne, la production de tous les grands pays du monde a stagné ou baissé (selon les estimations de la Banque mondiale) - ce qui ne s'était pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale.
2. L'irruption de la décomposition sur le terrain économique
Déjà au 22e Congrès, nous avons constaté l'impact croissant des effets de la décomposition sur le terrain économique et en particulier sur la gestion capitaliste d’État de la crise. Nous étions conscients de cette tendance dans le rapport sur la crise économique adopté par le 23e Congrès qui notait cette irruption de la décomposition comme l'un des principaux facteurs de l'évolution de la situation économique et, enfin, le rapport sur la crise adopté par le 24e Congrès de "Révolution Internationale" approfondissait cette analyse de la pandémie comme résultat de la décomposition et aussi de l'aggravation de la crise économique mais, en même temps, comme puissant facteur d'accélération de cette dernière.
Il est important de souligner notre approche de la question : l'une des caractéristiques de la décadence est que le système capitaliste tente d'étendre toutes les possibilités contenues dans ses rapports de production jusqu'à leurs limites extrêmes, même au risque de violer ses propres lois économiques. Ainsi, "une des contradictions majeures du capitalisme est celle découlant du conflit entre la nature de plus en plus mondiale de la production et la structure nécessairement nationale du capital. En poussant vers ses dernières limites les possibilités des "associations" de nations sur les plans économique, financier et productif le capitalisme a obtenu une "bouffée d’oxygène" significative dans son combat contre la crise qui le gangrène, mais en même temps il s’est mis dans une situation risquée" (Rapport du 23e Congrès). Cette "situation risquée" a démontré ses graves conséquences liées à l'impact de la décomposition sur le terrain économique, en particulier au cours des cinq dernières années de la décennie 2010.
La pandémie représente une accélération de la décomposition et, en même temps, une aggravation de celle-ci. Le rapport sur la crise économique est centré sur cette réalité fondamentale. La résolution sur la situation en France (Bulletin interne ; 2020) met en évidence cet axe central : "En 2008, lors de "la crise des Subprimes", la bourgeoisie avait su réagir de façon coordonnée à l’échelle internationale. Les fameux G7, G8,… G20 (qui faisaient la Une de l’actualité) symbolisaient cette capacité des États à s’entendre a minima pour tenter de répondre à la "crise de la dette". 12 ans plus tard, la division, la "guerre des masques" puis la "guerre des vaccins", la cacophonie régnant dans les décisions de fermetures des frontières contre la propagation de la Covid-19, l’absence de concertation à l’échelle internationale (hormis l’Europe qui tente difficilement de se protéger contre ses concurrents) pour limiter l’effondrement économique, signent l’avancée du chacun pour soi et la plongée des plus hautes sphères politiques du capitalisme dans une gestion de plus en plus irrationnelle du système". Cette tendance est particulièrement forte aux États-Unis où une longue tendance au déclin économique se combine avec une aggravation sans précédent de la décomposition de son appareil politique et de son tissu social.
Toutefois, ce serait une erreur de penser que cette tendance se limite aux États-Unis. En Europe, l'Allemagne semble avoir réagi, mais les tensions au sein de l'UE sont de plus en plus évidentes et le choc du Brexit aura des conséquences qui ne sont pas encore visibles. La "stabilité" de la Chine est plus apparente que réelle.
Par conséquent, nous pouvons dire que les effets de la rupture dans la sphère économique et dans la gestion étatique de l'économie sont destinés à perdurer et auront une influence de plus en plus forte sur les développements économiques. Il est vrai que la bourgeoisie va mettre en place des contre-tendances (par exemple, les accords de l'UE sur la mutualisation partielle des dettes ou l'annulation par Biden de certaines mesures adoptées par Trump). Cependant, au-delà des freins ou des revirements, le poids de la décomposition sur l'économie et sur la gestion étatique de cette dernière va se renforcer avec des conséquences pour l'instant difficiles à prévoir. Plutôt que de tenter des prédictions, nous devons suivre de près l'évolution de la situation et en tirer des conclusions dans le cadre global que nous avons mis en place.
3. Le sauvetage de l'économie ne peut se faire dans les mêmes conditions qu'en 2008
Avec la réponse que le capital dans la plupart des pays a été contraint de donner à la pandémie (le confinement qui n'a pas encore pris fin), l'une des pires récessions de l'histoire s'est produite.
Pour éviter un effondrement généralisé, la bourgeoisie a été obligée d'injecter des milliards. Cela lui a permis de "s'en sortir", de "résister à la tempête".[4] Il va falloir "sauver l'économie mondiale". Et comment va se dérouler cette opération compliquée ?
Nous pouvons dire qu'elle se fera dans des conditions bien pires qu'en 2008, qu'elle impliquera une violente dose d'austérité et que l'économie mondiale se retrouvera dans un état bien plus dégradé, avec une moindre capacité de reprise, du chaos et des convulsions importantes.
Cinq facteurs participent de l'aggravation du contexte :
- Le poids croissant de la décomposition dans l'économie et le capitalisme d'État ;
- La Chine ne pourra plus jouer le rôle de locomotive, offrir une bouée de sauvetage, comme elle l'a fait en réponse à 2008 ;
- La catastrophe environnementale ;
- Le poids de l'économie de guerre ;
- Le poids écrasant de la dette.
4. La dislocation progressive de l'édifice économique de la mondialisation
Avec la pandémie, nous avons assisté à une réponse chaotique et irrationnelle des États, à commencer par les plus grands et les plus puissants. L'OMS a été ignorée par tous les États, empêchant ainsi une stratégie internationale nécessaire basée autant que possible sur des critères scientifiques. Chaque État a essayé de fermer son économie le plus tard possible afin de ne pas perdre ses avantages compétitifs et impérialistes sur ses rivaux ;Les économies qui ont été rouvertes dans le but de prendre l'avantage sur les rivaux, et les fermetures provoquées par l'aggravation de la pandémie se sont trouvé piégées par la contradiction existant entre, d'une part la nécessité de maintenir et d'augmenter la production face aux rivaux et, d'autre part, celle d'éviter que l'appareil productif et la cohésion sociale ne soient affectés par de nouvelles vagues de contagion.
La guerre des masques a donné lieu à un spectacle dégradant : des États considérés comme "sérieux", tels que la France ou l'Allemagne, volaient ouvertement des cargaisons de masques destinées à d'autres capitaux nationaux. Il en a été de même pour les équipements tels que les appareils respiratoires, l'oxygène, les équipements de protection individuelle, etc.
Dans le contexte de l’actuelle guerre des vaccins, leur fabrication, leur distribution et les vaccinations elles-mêmes sont autant d'indices du désordre croissant dans lequel s'enfonce l'économie mondiale.
Dans le domaine de la recherche et de la fabrication de vaccins, nous avons assisté à une course chaotique entre des États en concurrence féroce. La Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, les États-Unis... se sont lancés dans une course contre la montre pour être les premiers à disposer du vaccin. La coordination internationale a été absente. Les vaccins ont été testés en un temps record, sans réelle garantie d'efficacité.
La distribution est tout aussi chaotique. Le conflit entre l'UE et la société britannique Astra Zeneca en témoigne. Les pays les plus riches ont laissé les plus pauvres sans protection. Israël a vacciné ses ressortissants tout en négligeant les Palestiniens. La Russie utilise une propagande trompeuse pour présenter son vaccin comme le meilleur. C'est la preuve que le vaccin est utilisé comme un instrument d'influence impérialiste. La Russie et la Chine ne le cachent pas et proclament ouvertement qu'elles offriront des prix plus bas aux pays qui se plieront à leurs exigences économiques, politiques et militaires.
Enfin, la manière dont la population est vaccinée est vraiment ahurissante de désorganisation et d'indiscipline. En France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour ne citer que quelques exemples, on constate un manque constant d'approvisionnement, des retards de vaccination même dans les groupes identifiés comme prioritaires (personnel de santé, personnes de plus de 65 ans). Les plans de vaccination ont été retardés à plusieurs reprises. Souvent, la première dose est administrée et la seconde est retardée sine die, annulant ainsi l'efficacité du vaccin. Les dirigeants, les politiciens, les hommes d'affaires, les militaires, etc. ont contourné la liste des groupes prioritaires et ont été vaccinés en premier.
Ce spectacle dégradant autour des vaccins nous montre une tendance croissante du capitalisme à saper la capacité de "coopération internationale" qui avait réussi à atténuer la crise économique au cours de la période 1990-2008. Le capitalisme est fondé sur la concurrence à mort - et cette caractéristique constitutive du capitalisme n'a pas disparu à l'apogée de la "mondialisation" - mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une concurrence exacerbée, qui prend pour champ d'action quelque chose d'aussi sensible que la santé et les épidémies. Si dans la période ascendante du capitalisme, la concurrence entre les capitaux et les nations était un facteur d'expansion et de développement du système, dans la décadence, elle est au contraire un facteur de destruction et de chaos : Destruction avec la barbarie de la guerre impérialiste ; chaos (qui inclut également la destruction et les guerres) surtout avec l'irruption des effets de la décomposition sur le terrain économique et sa gestion étatique. Ce chaos affectera de plus en plus les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, la planification de la production, la capacité à combattre les phénomènes "inattendus" tels que les pandémies ou autres catastrophes.
Le rapatriement de la production dans le pays d'origine par les multinationales était déjà en cours depuis 2017 mais semble s'être accéléré avec la pandémie : "Une étude publiée cette semaine par Bank of America, portant sur 3.000 entreprises totalisant une capitalisation boursière de 22 billions de dollars et situées dans 12 secteurs mondiaux majeurs, indique que 80% de ces entreprises ont des plans de relocalisation pour rapatrier une partie de leur production depuis l'étranger. 'C'est le premier tournant d'une tendance qui dure depuis des décennies', proclament les auteurs. Au cours des trois dernières années, quelque 153 entreprises sont retournées aux États-Unis, tandis que 208 l'ont fait dans l'UE"[5].
Ces mesures sont-elles irréversibles ? Assistons-nous à la fin de la phase de "mondialisation", c'est-à-dire une production mondiale, fortement interconnectée avec une division internationale du travail, avec des chaînes de production, de transport et de logistique organisées à l'échelle mondiale ?
La première considération est que la pandémie dure plus longtemps que prévu. Le 28 septembre 2020, le chiffre d'un million de morts était atteint ; le 15 janvier, moins de trois mois plus tard, il atteignait deux millions. Bien que la vaccination soit en cours, la directrice scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan, prévoit qu'il faudra attendre 2022 pour atteindre une immunisation raisonnable de la population en Europe. Il est probable que les perturbations et les interruptions de production se poursuivront tout au long de l'année 2021.
Deuxièmement, si nous examinons l'expérience historique, nous pouvons constater que les mesures de capitalisme d'État qui ont été prises en réponse à la Première Guerre mondiale n'ont pas complètement disparu après la fin de la guerre, et 10 ans plus tard, avec la crise de 1929, elles ont fait un bond gigantesque, confirmant la prédiction correcte du premier congrès de l'Internationale communiste : "toutes ces questions fondamentales de la vie économique du monde ne sont plus réglées par la libre concurrence, ni même par des combinaisons de trusts ou de consortiums nationaux et internationaux. Elles sont tombées sous le joug de la tyrannie militaire pour lui servir de sauvegarde désormais. Si l'absolue sujétion du pouvoir politique au capital financier a conduit l'humanité à la boucherie impérialiste, cette boucherie a permis au capital financier non seulement de militariser jusqu'au bout l’État, mais de se militariser lui-même, de sorte qu'il ne peut plus remplir ses fonctions économiques essentielles que par le fer et par le sang"[6].
De même, il est probable que les mesures prises en réponse à la pandémie sur le terrain économique resteront en place, même s'il y aura des reculs partiels.
Cela est confirmé par le fait que, depuis 2015, comme nous l'avons précisé dans le rapport du 23e Congrès, la Chine, l'Allemagne et les États-Unis s'orientent dans cette direction. Les mesures prises pendant la pandémie ne font qu'accentuer une orientation qui était déjà présente dans les années 2010.
Le fait que les grandes puissances n'aient pas, pour l'instant, coordonné leurs réponses financières et économiques au danger de faillite en est l'illustration. Alors que, lors de la crise de 2008, les réunions du G8, du G20, etc. se sont multipliées, ce type de réunion est aujourd'hui manifestement absent[7].
Cependant, la structure mondialisée de la production mondiale offre des avantages majeurs aux économies les plus puissantes, et celles-ci prendront des mesures pour corriger les principales perturbations décrites ci-dessus. Un exemple très clair : le plan de mutualisation des dettes dans l'UE profite particulièrement à l'Allemagne qui va consolider ses exportations vers l'Espagne, l'Italie, etc. Ces pays, présentés comme "les grands bénéficiaires", seront finalement les grands perdants, car leur tissu industriel sera affaibli par la concurrence écrasante des exportations allemandes. En fait, la mutualisation des dettes aidera l'Allemagne à contrer la présence chinoise dans les pays du sud de l'Europe, qui s'est renforcée depuis 2013. Nous n'assistons pas à un démantèlement de la mondialisation, mais plutôt à sa dislocation croissante - par exemple, à travers la tendance à la fragmentation en zones régionales -, à l'importance grandissante des tendances protectionnistes, à la relocalisation des zones de production, à la multiplication des mesures que chaque pays prend de son côté, en violation des accords internationaux. Bref, à un chaos croissant dans le fonctionnement de l'économie mondiale.
5. La politique chinoise
Au cours de la période 2009-2015, la Chine a joué un rôle essentiel, par ses achats et ses investissements, dans la faible relance de l'économie mondiale après les graves bouleversements de 2008. Face à la situation actuelle, la Chine peut-elle jouer le même rôle de locomotive de l'économie mondiale ?
Nous pensons que cette possibilité est très peu probable pour au moins 4 raisons :
- 1 La situation actuelle de la Chine est bien plus fragile qu'à l'époque : la croissance de la production continue de diminuer lentement mais sûrement ; selon le FMI, la Chine connaîtra sa pire croissance en 35 ans : seulement 1,2%. Pour le PCI – Le Prolétaire (cité dans le BII 528 page 60) "en Chine, le taux officiel du chômage était de 6 % fin avril ; mais l’étude d’une organisation chinoise estimait à la même date que le chômage réel était de 20,5 % (soit 70 millions de chômeurs) ; l’étude a été retirée et la direction de l’organisation punie par les autorités, mais des économistes occidentaux avancent des chiffres du même ordre". Le niveau d'endettement de la Chine est gigantesque (300% du PIB en 2019) ; la situation de beaucoup de ses entreprises est très fragile. Par exemple, en Chine, il y a 30% d'entreprises zombies[1], ce qui est le pourcentage le plus élevé au monde (en Allemagne et en France, il est estimé à 10%). De plus, les entreprises d'État détiennent toujours une part importante de l'économie et ces entreprises sont les plus endettées.
- 2 Le projet de Route de la soie - un plan d'expansion commerciale, économique et impérialiste concernant 60 pays - vise à définir une zone économique mondiale exclusive à la Chine, avec pour conséquence une diminution du rôle qu'elle peut jouer dans la stimulation du commerce mondial. Les rivaux de la Chine, et en particulier les États-Unis, ont répondu par une guerre commerciale et, dans la zone Asie-Océanie, par l'Accord de partenariat transpacifique qui lie 12 pays de la zone. Et, parmi les pays qui ont dû s'endetter auprès de la Chine dans le cadre de leur participation au projet de Route de la soie, certains ont été plus durement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, menaçant leur solvabilité.
- 3 Ces "accords" montrent que la dynamique qui dominera les années à venir - sauf changement de tendance, ce qui est hautement improbable - n'est pas celle de la "coopération", mais plutôt celle d'une grande fragmentation de la production mondiale en zones réservées, sous tutelle chinoise, américaine ou allemande.
- 4 L'accumulation de dettes, qui a servi à "alimenter" le moteur chinois après 2008, a permis une croissance à deux chiffres en Chine et a également créé des marchés plus importants en Chine même pour de nombreux exportateurs des États-Unis, d'Asie de l'Est et d'Europe. Mais les conditions pour que cela se répète ne sont pas réunies. Tous les pays sont devenus plus protectionnistes. En outre, la main-d'œuvre chinoise, qui percevait des salaires parmi les plus bas, a reçu des salaires plus élevés, ce qui a entraîné d'importants transferts d'emplois de la Chine vers d'autres pays, toujours moins chers (Asie du Sud-Est, Afrique).
6. La catastrophe environnementale
Le processus de destruction écologique (dévastation et pollution de l'environnement et des ressources naturelles) ne date pas d'hier. La guerre impérialiste et l'économie de guerre ont contribué à ce processus dans une large mesure. Cependant, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure ce processus a influencé négativement l'économie capitaliste en entravant l'accumulation.
Dans le cadre de ce rapport, nous ne pouvons pas donner une réponse élaborée. Cependant, il est probable que dans le contexte des difficultés croissantes de collaboration entre les pays, de manœuvres nationalistes de chaque État, … la destruction écologique aura un impact de plus en plus négatif sur la reproduction du capital et contribuera à rendre les moments de reprise économique de la période à venir beaucoup plus faibles et instables que par le passé.
On estime que la pollution atmosphérique tue 7 millions de personnes chaque année. La consommation d'eau contaminée provoque environ 485.000 décès par an.[9]
Au cours du XXe siècle, 260 millions de personnes sont mortes de la pollution de l'air intérieur dans le tiers-monde, soit environ deux fois le nombre de victimes de toutes les guerres du siècle. Ce chiffre est plus de 4 fois supérieur à celui des décès dus à la pollution de l'air extérieur[10].
Les phénomènes météorologiques extrêmes, les extinctions massives, la baisse des rendements agricoles et la toxicité de l'air et de l'eau nuisent déjà à l'économie mondiale, la pollution coûtant à elle seule 4,6 billions de dollars par an[11].
La protection même des villes situées le long des côtes engloutira des sommes considérables, égales, sinon supérieures, à tous les plans de sauvetage qui ont dû être adoptés dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Les implications économiques de ce chaos sont bien réelles. L'impact de ce processus d'autodestruction est stupéfiant. Il est calculé que, si le changement climatique augmente la température de 4ºC, alors le PIB mondial chutera de 30% par rapport aux niveaux de 2010, la chute pendant la dépression des années 1930 ayant atteint 26,7% (la chute actuelle sera permanente). 1,2 milliards d'emplois pourraient ainsi être perdus. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'aggravation de la crise économique ni de l'impact du COVID.
Tous ces dommages sont considérablement aggravés par la crise COVID, même s'il faudra du temps pour en évaluer l'impact. En effet, celle-ci illustre clairement les conséquences pour l'économie de la destruction écologique : "La colonisation des espaces naturels et le contact humain avec les animaux réservoirs de virus et d'agents pathogènes est le premier maillon de la chaîne qui explique les pandémies. La destruction des habitats forestiers dans les zones tropicales permet la transmission aux humains de nombreux agents pathogènes qui étaient auparavant confinés dans des endroits inaccessibles. Les gens rencontrent des espèces avec lesquelles ils n'étaient pas associés auparavant, ce qui augmente le risque d'être infecté par des maladies d’origine animale. Les marchés d'animaux, les transports et la mondialisation les propagent ensuite"[12].
Des institutions telles que la Banque mondiale mettent clairement en garde contre les conséquences de la destruction écologique, par exemple en termes d'expansion de la pauvreté : "Selon de nouvelles estimations, le changement climatique pourrait entraîner de 68 à 135 millions de personnes dans la pauvreté à l'horizon 2030. Il représente une menace particulièrement grave pour les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, ces deux régions concentrant la plupart des pauvres de la planète. Dans un certain nombre de pays, comme le Népal, le Cameroun, le Liberia et la République centrafricaine, une grande partie des pauvres vivent dans des zones à la fois en situation de conflit et fortement exposées aux inondations."[13].
L'effondrement de la coopération internationale autour de la pandémie de COVID est un avant-goût de l'attitude de chacun pour soi qui prédominera face au changement climatique. La concurrence économique accrue résultant du COVID ne peut qu'accélérer cette dynamique. La capacité du capitalisme à limiter l'augmentation de la température globale s'affaiblit.
- "Ensemble, une action rapide contre la hausse des températures et un engagement renouvelé en faveur de la mondialisation permettraient à l'économie mondiale d'atteindre une production de 185 billions de dollars en 2050. Si l'on tarde à prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone et si l'on laisse les liens transfrontaliers se distendre, elle pourrait plafonner à 149 billions de dollars, ce qui équivaudrait à dire adieu à la totalité du PIB des États-Unis et de la Chine de l'année dernière"[14].
La contradiction entre les intérêts de la nation capitaliste, et de l'ensemble du système capitaliste, et l'avenir de l'humanité ne pourrait être plus claire. Si des mesures suffisantes sont prises contre le changement climatique, les tensions impérialistes et économiques s'intensifieront qualitativement avec la montée en puissance de la Chine comme principale économie mondiale. Si aucune mesure n'est prise, l'économie mondiale se contractera de 30% avec toutes les conséquences que cela entraînera.
Cela ne peut que développer de manière exponentielle la destruction de l'environnement par le capitalisme et préparer le terrain pour d'autres pandémies au fur et à mesure que les conditions de celles-ci se développent, comme le montrent plusieurs contributions dans les bulletins internes[15].
7. La barrière de l'économie de guerre
L'économie de guerre, comme nous l'a rappelé Internationalisme, est un poids mort pour l'économie mondiale. Malgré la position claire du texte d'orientation Militarisme & Décomposition[16] des parties de l'organisation ont eu tendance à penser que dans le cadre de la décomposition, les dépenses d'armement auraient tendance à être réduites et n'auraient pas l'impact énorme qu'elles avaient à l'époque des blocs et de la Guerre froide. Cette vision est fausse, comme le souligne le rapport adopté par le 23e Congrès. "Les dépenses militaires mondiales ont connu - en 2019 - leur plus forte augmentation en dix ans. Au cours de l'année 2019, les dépenses militaires ont atteint 1,9 billion de dollars (1,8 billion d'euros) dans le monde, soit une augmentation de 3,6 % en un an, la plus importante depuis 2010. "Les dépenses militaires ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide", a déclaré Nan Tian, chercheur au SIPRI"[17].
La nécessité de faire face au COVID n'a pas ralenti le réarmement. Le budget de la Bundeswehr augmente de 2,85% pour 2021, l'Espagne augmente ses dépenses militaires de 4,7%, la France de 4,5%, tandis que le Royaume-Uni les accroît de 18,5 milliards d'euros supplémentaires[18].
Aux États-Unis, attisant l'hystérie anti-Chine, le Sénat a approuvé une augmentation astronomique des dépenses militaires, qui atteindront 740 milliards de dollars en 2021. Au Japon, "le Premier ministre Yoshihide Suga a approuvé lundi la neuvième hausse consécutive du budget militaire, établissant un nouveau record historique à 5,34 billions de yens (environ 51,7 milliards de dollars), soit une augmentation de 1,1 % par rapport au budget de l'année précédente"[19].
"Les guerres américaines en Afghanistan, en Irak, en Syrie et au Pakistan ont coûté aux contribuables américains 6,4 billions de dollars depuis leur début en 2001. Ce total est supérieur de 2 billions de dollars à l'ensemble des dépenses du gouvernement fédéral au cours de l'année fiscale qui vient de s'achever"[20].
Il n'y a pas de données disponibles pour la Chine pour 2021, mais les dépenses militaires ont apparemment moins augmenté en 2020 qu'en 2019. Cependant, "l'Armée populaire de libération a franchi deux étapes majeures, en dévoilant son premier porte-avions 100 % indigène et son premier missile balistique intercontinental capable d'atteindre les États-Unis. La Chine a également construit sa première base militaire à l'étranger à Djibouti en 2017. Pékin conçoit également une nouvelle génération de destroyers et de missiles pour renforcer sa dissuasion contre ses voisins asiatiques et la marine américaine."[21]
La Russie a augmenté de façon spectaculaire ses dépenses militaires au cours de la période triennale 2018-2021, l'Australie "a lancé au cours des deux dernières années un ambitieux programme naval visant à créer une marine de douze nouveaux sous-marins qui seront construits par le chantier naval français DCNS, neuf frégates (un programme pour lequel Navantia soumissionne), deux navires logistiques et douze patrouilleurs ; elle recevra également 72 avions de combat américains F-35 de Lockheed Martin d'ici 2020. Les autorités australiennes prévoient même de doubler son budget en une décennie pour le porter à 21 milliards de dollars par an (…) [Les pays scandinaves] considèrent que les menaces russes sur leur espace aérien et dans l'Arctique relèvent de moins en moins de la fiction, et dans le cas de la Suède, le rétablissement du service militaire obligatoire et des augmentations significatives du budget de la défense ont été annoncés"[22].
Ce survol de la jungle sanglante des dépenses militaires montre que l'économie de guerre et l'armement, au-delà de l'impulsion initiale qu'ils peuvent donner, finissent par constituer un fardeau de plus en plus lourd pour elle, et on peut prévoir qu'ils participeront à la tendance à rendre plus fragile et convulsive la reprise économique que le capitalisme recherche pour la période post-COVID[23].
8. Le poids écrasant de la dette
En 1948, le plan Marshall a représenté un montant total de prêts de 8 milliards de dollars ; le plan Brady pour sauver les économies sud-américaines en 1985 a impliqué 50 milliards de dollars ; les dépenses pour sortir du bourbier de 2008 ont atteint le chiffre astronomique de 750 milliards de dollars.
Les chiffres actuels font de ces injections dans l'économie de la menue monnaie. L'UE a déployé un programme de 750 milliards d'euros. En Allemagne, "le gouvernement déploie le plus grand plan d'aide de l'histoire de la République fédérale. Pour financer ce programme, la Fédération contractera de nouveaux emprunts pour un montant total d'environ 156 milliards d'euros."[24] Biden a proposé au Congrès un programme de soutien et de relance économique de 1,9 billion de dollars. Le montant total des mesures de relance versées dans l'économie américaine en 2020 est estimé à 4 billions de dollars.
La dette mondiale au troisième trimestre 2020 était de 229 billions d'euros, soit 365% du PIB mondial (un nouveau record historique). Cette dette atteint 382% dans les pays industrialisés. Selon l'Institut de la finance internationale, cette escalade s'accélère depuis 2016 avec une augmentation sur les 4 dernières années de 44 billions d'euros. C'est dans ce cadre que nous devons aborder les conséquences de l'escalade actuelle de l'endettement mondial[25].
L'accumulation du capital (la reproduction élargie définie par Marx) a pour base de développement les marchés extra-capitalistes et les zones non encore complètement intégrées au capitalisme. Si les uns et les autres se réduisent, la seule issue pour le capital, organisé par l'État, est l'endettement, qui consiste à jeter des sommes toujours plus importantes dans l'économie en acompte de la production attendue des années à venir.
S'il n'y a pas de chocs inflationnistes dans les grandes économies, c'est pour trois raisons :
- 1 La tendance déflationniste qui touche l'économie mondiale depuis 2008.
- 2 La surévaluation des actifs des entreprises et même des États est devenue chronique et a dégradé les chiffres économiques qui ont cessé d'être fiables depuis des décennies.
- 3 Taux d'intérêt nuls ou même négatifs.
L'un des facteurs qui a permis au capital global d'amortir les effets de la dette était la coordination internationale des politiques monétaires, un certain degré de coordination et d'organisation des transactions financières à l'échelle mondiale. Si ce facteur commence à faire défaut et que le "chacun pour soi" l'emporte, quelles sont les conséquences attendues ?
Le capitalisme a utilisé l'équivalent de trois ans et demi de production mondiale. S'agit-il d'un chiffre insignifiant qui pourrait être étiré à l'infini ? Absolument pas. Cette gigantesque gangrène est le terreau non seulement de folles poussées spéculatives qui ont fini par s'institutionnaliser dans le labyrinthe indéchiffrable que sont les transactions financières, mais aussi de crises monétaires, de gigantesques faillites d'entreprises et de banques, voire de faillites d'États importants. Logiquement, ce processus implique que le marché intérieur pour le capital ne peut croître à l'infini, même s'il n'y a pas de limite fixe en la matière. C'est dans ce contexte que la crise de surproduction au stade actuel de son développement pose un problème de rentabilité au capitalisme. La bourgeoisie estime qu'environ 20% des forces productives mondiales sont inutilisées. La surproduction des moyens de production est particulièrement visible et touche l'Europe, les États-Unis, l'Inde, le Japon, etc.[26]
Depuis 1985, date à laquelle les États-Unis ont abandonné leur position de créancier pour devenir l'un des plus gros débiteurs, l'économie mondiale souffre d'une situation aberrante : pratiquement tous les pays sont endettés, les plus gros créanciers sont à leur tour les plus gros débiteurs, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, après des décennies de dettes gigantesques, ces récents plans de sauvetage ont surpassé toutes les interventions précédentes. Cependant, en raison du niveau actuel d’endettement de tous les grands acteurs, le risque de "détonations"/avalanches de dettes augmente. La situation actuelle de "taux d'intérêt zéro" facilite encore la politique d'augmentation du fardeau de la dette, mais - tous les autres facteurs mis à part - si les taux d'intérêt augmentent..... Quelque chose s'écroulera ...
9. Une économie mondiale affaiblie et instable
L’arrêt brutal de la production a des conséquences. Tout d'abord, la Chine et l'Allemagne, ainsi que d'autres grands pays producteurs, vont se retrouver avec une énorme surcapacité de production qui ne pourra pas être compensée immédiatement. D'une manière générale, le secteur des machines, l'électronique, l'informatique, l'approvisionnement en matières premières, les transports, etc. se retrouveront avec des stocks énormes et une reprise lente de la demande.
Même s'il y aura indubitablement des moments de reprise de la production (qui seront applaudis avec enthousiasme par la propagande capitaliste) et même s'il y aura des contre-tendances que les secteurs les plus intelligents du capital activeront[27], ce qui est indiscutable, c'est que l'économie mondiale sera secouée et affaiblie au cours de la prochaine décennie.
Au cours du dernier demi-siècle, le capitalisme a montré une capacité à "continuer" face aux nombreux bouleversements qu'il a subis (1975, 1987, 1998, 2008). Cependant, les conditions globales que nous venons d'analyser nous permettent d'avancer que cette capacité a été considérablement affaiblie. Il n'y aura pas - comme l'espèrent les conseillistes et les bordiguistes - un Grand Effondrement Final mais, parce que c'est le cœur de l'économie mondiale qui est fortement déstabilisé - en particulier les USA et de manière croissante aussi certaines parties de l'Europe - il sera plus difficile de coordonner une réponse à la crise au niveau international, ce qui, avec le poids écrasant de la dette, fournit une confirmation claire de la perspective esquissée par le rapport du 23ème Congrès sur la crise : "Poids déstabilisateur d’un endettement sans frein ; saturation croissante des marchés ; difficultés croissantes de "gestion globalisatrice" de l’économie mondiale provoquées par l’irruption du populisme, mais aussi l’aiguisement de la concurrence et le poids des investissements énormes demandés par la course aux armements ; enfin, un facteur qu’il ne faut pas négliger, les effets de plus en plus négatifs de la destruction galopante de l’environnement et le bouleversement incontrôlé des équilibres "naturels" de la planète".
L'une des politiques que les États vont lancer pour donner un coup de fouet à l'économie sont les plans dits d'"économie verte". Ceux-ci sont motivés par la nécessité de remplacer la vieille industrie lourde et les combustibles fossiles par l'électronique, l'informatisation, l'IA, les matériaux légers et les nouvelles sources d'énergie qui permettent une plus grande productivité, une réduction des coûts et des économies de main-d'œuvre. Pendant un certain temps, les investissements importants qu'exigera une telle relance de l'économie - qui inclura également la production d'armements - pourront donner un coup de fouet aux économies des pays les mieux placés dans le processus, mais le spectre de la surproduction reviendra une fois de plus hanter l'économie mondiale.
10. La résistance ouvrière - un facteur clé dans l'évolution de la situation
La détérioration des conditions de vie des ouvriers a été très progressive au cours de la période 1967-80.
Elle a commencé à s'accélérer dans les années 1980, lorsque les prestations sociales ont commencé à être limitées, que des licenciements massifs ont eu lieu et que la précarité du travail a commencé à s'installer.
Au cours de la période 1990-2008, la détérioration s'est poursuivie : la réduction systématique des ouvriers employés est devenue "normale". Une crise du logement a également commencé. La migration massive a exercé une pression à la baisse sur les salaires et produit une détérioration des conditions de travail dans les pays centraux. Cependant, la baisse des conditions de vie dans les pays centraux restait graduelle et limitée. Il y avait quelque chose de pervers qui masquait la baisse : le développement du crédit massif dans les ménages ouvriers.
Dans le rapport adopté par le 23e Congrès, nous avons montré l'énorme dégradation du niveau de vie du prolétariat dans les pays centraux, les coupes importantes dans les retraites, la santé, l'éducation, les services sociaux, les prestations sociales etc..., la hausse du chômage et surtout le développement spectaculaire de la précarité de l’emploi. Les années 2010 ont signifié une escalade majeure de la dégradation de la vie professionnelle dans les pays centraux. Les attaques graduelles auxquelles nous avons assisté entre 1970 et 2008 ont commencé à s'accélérer dans la décennie 2010-2020.
La crise pandémique a intensifié les attaques contre les conditions de vie des ouvriers. Tout d'abord, dans tous les pays, les ouvriers ont été envoyés à l'abattoir parce qu'ils ont été contraints de se rendre au travail en empruntant des transports publics bondés et se sont retrouvés sans équipement de protection sur leur lieu de travail (il y a d'ailleurs eu nombre de protestations dans des usines, des entrepôts, etc. au début du confinement à cause de cela). Il convient toutefois de noter que les travailleurs de la santé et ceux des maisons de retraite ont souffert d’un nombre élevé d'infections et de décès. Les travailleurs de l'industrie alimentaire ont également été durement touchés[28], de même que les travailleurs agricoles, dont la plupart sont des migrants[29].
Les attaques contre la classe ouvrière dans tous les pays, mais particulièrement dans les pays centraux, sont clairement à l'ordre du jour. Le rapport de l'OIT "Le COVID-19 et le monde du travail" ne mâche pas ses mots : "le COVID-19 a engendré la crise la plus grave jamais enregistrée par le monde du travail depuis la Grande dépression des années 1930".
Le chômage. Les surcapacités dans l'industrie, et la lente et faible reprise de la demande vont fortement stimuler les licenciements massifs. Pendant la période de strict confinement, les énormes subventions de l'État aux chômeurs à temps partiel ont masqué la gravité de la situation de nombreux ouvriers souffrant d'une réduction drastique de leurs revenus. Cependant, une "normalisation" graduelle du fonctionnement économique entraînera une nouvelle dégradation des conditions de vie des ouvriers, la rendant dans de nombreux cas irréversible. Selon l'OIT, les estimations mondiales pour 2021 sont celles d’une perte allant de 36 millions d'emplois au mieux à 130 millions au pire[30].
Nous pouvons illustrer cela par une analyse des sombres perspectives pour l'industrie automobile : "Un expert de l'industrie automobile allemande a donné l'aperçu, la prévision suivants : selon les prévisions, tous les grands marchés automobiles connaîtront une contraction en pourcentage à deux chiffres. La France et l'Italie seront les plus touchées, avec un déclin de 25% chacune, l'Espagne avec 22%, et l'Allemagne, les États-Unis et le Mexique avec 20% chacun. Pour le plus grand marché automobile du monde, la Chine, Dudenhöffer prévoit une baisse des ventes d'environ 15%. Dans les usines allemandes, il y a soudainement une capacité excédentaire de 1,3 à 1,7 million de véhicules. Le chômage partiel ne peut combler que de courtes périodes. Aucune entreprise ne pourrait conserver des capacités de production inutilisées pendant des années. C'est pourquoi 100.000 des 830.000 emplois actuels chez les constructeurs et équipementiers automobiles en Allemagne sont menacés - "selon des hypothèses optimistes", écrit Dudenhöffer."[31]
La précarité. L'OIT appelle la précarité "emploi sous-utilisé" et estime qu'il y a 473 millions de travailleurs dans le monde dans cette condition (2020). Le travail informel est tout aussi important : "plus de 2 milliards de travailleurs sont engagés dans des activités économiques qui sont soit insuffisamment couvertes, soit pas du tout couvertes par des dispositions formelles en droit ou en pratique". Selon l'OIT, "plus de 630 millions de travailleurs dans le monde ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir se sortir eux-mêmes et leur famille de la pauvreté"[32].
Les salaires. En ce qui concerne les salaires, l'OIT a évalué la baisse globale des salaires dans le monde à 8,3% jusqu'en 2020. Malgré les mesures de soutien gouvernementales, les salaires ont baissé en 2020 (selon les données de l'OIT) de 56,2% au Pérou, de 21,3% au Brésil, de 6,9% au Vietnam, de 4,0% en Italie, de 2,9% au Royaume-Uni et de 9,3% aux États-Unis.
Le rapport susmentionné de l'OIT prévient que "La crise a eu des effets particulièrement dévastateurs sur nombre de catégories de populations vulnérables et de secteurs à travers le monde. Les jeunes, les femmes, les personnes faiblement rémunérées et les travailleurs peu qualifiés disposent d’un potentiel inférieur pour embrayer rapidement sur la reprise économique et les risques de stigmates à long terme et d’un éloignement du marché du travail sont bel et bien réels en ce qui les concerne".
Le niveau incroyable d'endettement national ne peut être maintenu indéfiniment ; à partir d'un certain point, il conduira nécessairement à l'adoption de mesures d'austérité drastiques touchant l'éducation, la santé, les retraites, les subventions, les prestations sociales, etc.
On ne peut rien attendre de la "gestion intelligente" du capitalisme d'État, seulement l'austérité, la misère, le chaos et aucun avenir. L'avenir de l'humanité est entre les mains du prolétariat, sa résistance contre l'austérité brutale, et la politisation de cette résistance seront la clé de la période à venir.
[1] L’irruption de la décomposition sur le terrain économique [171] (Rapport juillet 2020). Revue internationale n°165
[2] La pandémie de COVID-19 plonge l’économie planétaire dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre [172] mondiale
[4] Les chiffres et l'analyse de ce gigantesque déploiement d'injections monétaires sont fournis dans le rapport sur la crise économique adopté par le 24e Congrès de RI, nous ne les répéterons donc pas ici.
[6] Manifeste du [175]1 [175]er [175]Congrès de l'Internationale communiste [175]
[7] Biden a bien proposé de mettre en place une réunion du G10 non pour une coordination économique, mais pour isoler la Chine.
[8] Les entreprises zombies sont celles qui doivent constamment refinancer leur dette, au point que le remboursement de celle-ci absorbe tous leurs profits et les oblige même à contracter de nouvelles dettes.
[9] Source : Britannica [176]
[10] Source : assessment paper AIR POLLUTION [177]
[12]Source LAVANGUARDIA [179] Rapport de l'Agence européenne pour l'environnement
[13] LA BANQUE MONDIALE [180]
[14] Bloomberg Businessweek [181]
[15] "la conquête inconsidérée par le capital de territoires "sauvages", comme on l'a déjà vu avec Ebola [qui] a à voir avec la soif de terre de ce système capitaliste, c'est-à-dire avec le fonctionnement de la rente. L'urbanisation croissante, l'exploitation de chaque centimètre carré de la planète (...) conduit à une coexistence forcée entre les espèces." (D.). "Il y a effectivement tendance à sous-estimer à quel point la pandémie est un produit de la dimension écologique, autre caractéristique fondamentale de la décomposition. La citation de Le Fil Rouge est intéressante : la façon dont la tendance aux pandémies est liée à l'échange métabolique avec la nature (Marx) - qui a atteint des proportions déformées par le développement du capitalisme dans la décadence et la décomposition. L'idée qu'il s'agit presque d'une catastrophe naturelle - conduit aux racines sociales qui ont été mises sur la touche." (B.)
[17] Rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publié le 27/04/2020. Source : DW [182].
[21] Source EL COMERCIO [186].
[22] China y Rusia doblan su gasto militar en una década ABC Internacional [187]
[23] L'économie de guerre peut, dans un premier temps, stimuler l'économie. Mais cette stimulation est trompeuse, et on peut le constater si l'on regarde sur le long terme. Il y a l'exemple de la Russie. Plus récemment, il y a le cas de la Turquie qui, après un décollage spectaculaire, est aujourd'hui de plus en plus affaiblie par le poids étouffant de l'effort de guerre. De même, les économies de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, engagées dans une rivalité extrême, sont de plus en plus affaiblies.
[24] Cité par le communiqué sur l'Allemagne dans le bulletin interne de l'année 2020
[26] Rapport sur la crise économique (juillet 2020) [189] adopté par le 24e Congrès de Révolution Internationale.
[27] Voir à ce sujet le rapport sur la crise économique du 24e Congrès de Révolution Internationale.
[28] "La situation dans l'industrie du conditionnement de la viande a révélé une image similaire à celle des abattoirs de Chicago d’il y a plus d'un siècle. Tout à coup, les taux d'infection élevés parmi le personnel des abattoirs ont été connus. On a appris qu'il s'agissait d'ateliers de misère modernes en Allemagne, avec une main-d'œuvre très bon marché venant d'Europe de l'Est, vivant dans des baraquements ou des appartements particulièrement délabrés et surpeuplés - loués par des sous-traitants des abattoirs. Des centaines d'entre eux ont été infectés, en raison de leurs conditions d’entassement au travail comme au logement" (communiqué de Welt-D, dans le bulletin interne de l'année 2020).
[29] En Espagne, en avril 2020, des cueilleurs de fraises, pour la plupart des ouvriers originaires du Maroc et d'Afrique, ont tenté de faire grève contre la surpopulation effroyable dans leurs quartiers et le gouvernement de coalition de gauche a immédiatement envoyé la Guardia Civil.
[30] Observatoire de l’OIT [190] Le COVID‑19 et le monde du travail. Septième édition
[31] Cité par le communiqué sur la situation en Allemagne de l'année 2020.
Vie du CCI:
- Rapports de Congrès [156]
Questions théoriques:
- L'économie [192]
Rubrique:
Rapport de novembre 2021
- 179 lectures
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la résolution sur la situation internationale adopté par le 24e congrès du CCI, et plus particulièrement les points suivants (nous soulignons) :
- "8. Si la progression de la décomposition capitaliste, parallèlement à l’aiguisement chaotique des rivalités impérialistes, prend principalement la forme d'une fragmentation politique et d'une perte de contrôle de la classe dirigeante, cela ne signifie pas que la bourgeoisie ne puisse plus recourir au totalitarisme d'État dans ses efforts pour maintenir la cohésion de la société. (…) L'élection de Biden, soutenue par une énorme mobilisation des médias, de certaines parties de l'appareil politique et même de l'armée et des services de sécurité, exprime cette réelle contre-tendance au danger de désintégration sociale et politique très clairement incarné par le Trumpisme. À court terme, de tels "succès" peuvent fonctionner comme un frein au chaos social croissant. (…)
9. La nature évidente de la décomposition politique et idéologique de la première puissance mondiale ne signifie pas que les autres centres du capitalisme mondial soient capables de constituer des forteresses alternatives de stabilité. (…)
12. Dans ce tableau chaotique, il ne fait aucun doute que la confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine tend à occuper le devant de la scène. La nouvelle administration a ainsi démontré son attachement à l'"inclination vers l'est""
Dans ce cadre, il vise, à appréhender les événements de ces derniers mois afin de contribuer à la réflexion autour des trois questions suivantes :
1. Où en sommes-nous en ce qui concerne le déclin de l’hégémonie américaine ?
2. Est-ce que la Chine a tiré avantage des événements de cette période ?
3. Quelle est la tendance dominante aujourd’hui sur le plan des confrontations impérialistes ?
1. Déclin de l’hégémonie américaine et polarisation des tensions États-Unis / Chine
"Confirmés comme la seule superpuissance subsistante, les États-Unis feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter qu'aucune autre superpuissance -en réalité, aucun autre bloc impérialiste- ne vienne défier leur "nouvel ordre mondial". (Résolution sur la situation internationale, Point 4, 15e congrès du CCI [193], 2003). L’histoire des 30 dernières années est caractérisée en ce qui concerne les États-Unis par un déclin systématique de leur leadership malgré une politique persistante visant à maintenir leur position hégémonique dans le monde.
1.1. Bref aperçu du déclin de l’hégémonie américaine
Différentes étapes caractérisent les efforts des États-Unis pour maintenir leur leadership face à des menaces qui évoluent. Elles sont aussi marquées par les dissensions internes au sein de la bourgeoisie américaine sur la politique à mener et vont par ailleurs les accentuer.
a) Le "Nouvel Ordre Mondial" sous la direction des États-Unis (Bush1 et Clinton : 1990-2001)
Le président Bush senior exploite l’invasion du Koweït par les forces irakiennes, pour mobiliser une large coalition militaire internationale autour des États-Unis pour "punir" Saddam Hussein. La 1ère guerre du golfe vise à faire un "exemple" : face à un monde de plus en plus gagné par le chaos et le "chacun pour soi", il s'agit d'imposer un minimum d'ordre et de discipline, et en premier lieu aux pays les plus importants de l'ex-bloc occidental. La seule superpuissance qui se soit maintenue veut imposer à la "communauté internationale" un "nouvel ordre mondial" sous son égide, parce que c'est la seule qui en ait les moyens mais aussi parce que c'est le pays qui a le plus à perdre dans le désordre mondial.
Cependant, elle ne sera en mesure de tenir ce rôle qu'en enserrant de façon croissante l'ensemble du monde dans le corset d'acier du militarisme et de la barbarie guerrière, comme lors de la sanglante guerre civile en ex-Yougoslavie où elle devra contrer les appétits impérialistes des pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne et France) en imposant sous son autorité, la "pax americana", dans la région (accords de Dayton, déc. 1995).
b) Les États-Unis en tant que "Shérif Mondial/Gendarme Mondial" (Bush2 : 2001-2008)
Les attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001 amènent le président Bush junior à déclencher une "War against terror" contre l’Afghanistan et surtout l’Irak en 2003. Malgré toutes les pressions et l’utilisation de "fake news" visant à mobiliser la "communauté internationale" derrière les États-Unis contre "l’axe du mal", les États-Unis échouent à mobiliser les autres impérialismes contre l’"État voyou" de Saddam et envahissent quasiment seuls l’Irak avec pour seul allié significatif l’Angleterre de Tony Blair.
L’échec de ces interventions, souligné par le retrait d’Irak (2011) et d’Afghanistan (2021), a mis en évidence l’incapacité des États-Unis de jouer au "shérif mondial" pour imposer "son ordre" au monde. Au contraire, cette "war against terror" a pleinement ouvert la boîte de Pandore de la décomposition dans ces régions, en exacerbant l’expansion du chacun pour soi, qui s’est manifestée en particulier par une multiplication tous azimuts des ambitions impérialistes de puissances telles la Chine et la Russie, bien sûr l’Iran, mais aussi la Turquie, l’Arabie Saoudite, voire les Emirats du Golfe ou le Qatar. L’impasse croissante de la politique des États-Unis et la fuite aberrante dans la barbarie guerrière, ont mis en évidence le net affaiblissement de leur leadership mondial.
L’administration Obama a tenté de réduire l’impact de la politique catastrophique menée par Bush (l’exécution de Ben Laden en 2011 a souligné la supériorité technologique et militaire absolue des États-Unis) et a pointé de plus en plus clairement l’ascension de la Chine comme le principal danger pour l’hégémonie américaine, ce qui a déclenché d’intenses débats au sein de cette bourgeoisie et de son appareil étatique.
c) La politique de "America First" (Trump, fondamentalement poursuivie par Biden : 2017)
La politique de type "America First" sur le plan impérialiste, mise en œuvre par Trump à partir de 2017, constitue en réalité la reconnaissance officielle de l’échec de la politique impérialiste américaine de ces 25 dernières années : "L’officialisation par l’administration Trump de faire prévaloir sur tout autre principe celui de la défense de leurs seuls intérêts en tant qu’état national et l’imposition de rapports de force profitables aux États-Unis comme principal fondement des relations avec les autres États, entérine et tire les implications de l’échec de la politique des 25 dernières années de lutte contre le chacun pour soi en tant que gendarme du monde et de la défense de l’ordre mondial hérité de 1945.(…)" (23e congrès du CCI, Résolution sur la situation internationale [194], Revue Internationale n° 164).
Si elle implique une limitation maximale des opérations avec des "boots on the grounds" face au manque d’embrigadement des masses ouvrières par rapport à des engagements massifs et aux pertes conséquentes qu’un déploiement massif de militaires dans le monde impliquerait (cf. déjà la difficulté de recrutement de Bush II pour la guerre en Irak), elle va surtout de pair avec une polarisation croissante et une agressivité accentuée envers la Chine, tendant à être de plus en plus identifiée comme le danger principal. Si cette position reste discutée au sein de l’administration Obama et si des tensions apparaissaient encore au sein de l’administration Trump entre les tenants du combat contre les "États voyous", tels l’Iran (Pompeo, Kushner), et les tenants du "danger majeur chinois" (services secrets et armée), la polarisation sur cette dernière option est incontestablement l’axe central de la politique étrangère de Biden. Il s’agit là de la part des États-Unis d’un choix stratégique pour concentrer leurs forces sur la compétition militaire et technologique avec la Chine, en vue de maintenir et même d’accentuer leur suprématie, de défendre leur position de "Parrain" du clan dominant face aux clans concurrents (la Chine et accessoirement la Russie) qui menacent le plus directement son hégémonie. Déjà en tant que gendarme mondial, les États-Unis exacerbaient la violence guerrière, le chaos et le chacun pour soi ; leur politique actuelle n’est en rien moins destructive, bien au contraire.
1.2. Polarisation des tensions en mer de Chine
La polarisation américaine envers la Chine et un redéploiement des forces en conséquence, initiés par l’administration Trump, ont été pleinement repris par l’administration Biden. Celle-ci a non seulement maintenu les mesures agressives économiques contre la Chine, mises en œuvre par Trump, mais elle a surtout accentué la pression par une politique agressive :
- sur le plan politique : défense des droits des Ouïghours et de Hong Kong, rapprochement diplomatique et commercial avec Taïwan, accusations de piratage informatique envers la Chine ;
- au niveau militaire en mer de Chine, par des actions assez explicites et spectaculaires ces derniers mois : multiplication d’exercices militaires impliquant la flotte américaine et celles d’alliés en mer de Chine du Sud, rapports alarmistes sur les menaces imminentes d’intervention chinoise à Taïwan, présence à Taïwan de forces spéciales américaines pour encadrer les unités d’élite taïwanaises, conclusion d’un nouvel accord de défense, l’AUKUS, entre les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne, qui instaure une coordination militaire orientée explicitement contre la Chine, engagement par Biden d’un soutien à Taïwan en cas d’agression chinoise.
Taïwan a toujours joué un rôle important dans la stratégie des États-Unis envers la Chine. Si pendant la "guerre froide", elle constituait une pièce importante du dispositif d’endiguement du bloc communiste, elle a représenté dans les années 1990 et au début des années 2000 la vitrine de la société capitaliste globalisée dans laquelle la Chine était intégrée. Mais avec la montée en puissance de cette dernière, le point de vue a changé et Taïwan joue à nouveau un rôle géostratégique pour barrer l’accès au Pacifique ouest à la marine chinoise. Par ailleurs, sur un plan stratégique, "les fonderies de l’île produisent en effet la majeure partie des semi-conducteurs de dernière génération, composants indispensables à l’économie numérique mondiale (smartphones, objets connectés, intelligence artificielle, etc.)" (Le Monde diplomatique [195], octobre 2021)
La Chine pour sa part a réagi furieusement à ces pressions politiques et militaires, particulièrement celles qui concernent Taïwan : organisation de manœuvres navales et aériennes massives et menaçantes autour de l’île, publication d’études alarmistes, qui indiquent un risque de guerre "qui n’a jamais été aussi élevé" avec Taïwan, ou de plans d’attaque surprise contre Taïwan, qui conduirait à une défaite totale des forces armées de l’île.
Mises en garde, menaces et intimidations se sont donc succédé ces derniers mois en mer de Chine. Elles soulignent la pression croissante exercée par les États-Unis sur la Chine. Dans ce contexte, les États-Unis ont tout fait pour entraîner derrière eux d’autres pays asiatiques, inquiets des velléités expansionnistes de Pékin, en tentant par exemple de créer une sorte d’OTAN asiatique, le QUAD, réunissant les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde et d’y associer la Corée du Sud. D’autre part et dans le même sens, Biden a voulu raviver l’OTAN dans le but d’entraîner les pays européens dans sa politique de pression contre la Chine. Paradoxalement, la constitution de l’AUKUS indique les limites du ralliement des autres nations derrière les États-Unis. L’AUKUS signifie d’abord une gifle à la France et annihile les belles paroles de Biden sur le "partenariat" au sein de l’OTAN. Par ailleurs, cet accord confirme aussi la frilosité de pays comme l’Inde, avec ses propres ambitions impérialistes, et surtout de la Corée du Sud et du Japon, coincés entre la crainte du renforcement militaire de la Chine et leurs liens industriels et commerciaux considérables avec la Chine.
2. Signification et impact du retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan
Après l’enfoncement de l’Irak et de la Syrie dans le chaos et la barbarie sanglante, les événements de septembre 2021 en Afghanistan confirment pleinement les tendances marquantes de la période : le déclin du leadership US et la montée du chaos et du chacun pour soi.
2.1. La débâcle US en Afghanistan
L’effondrement total du régime et de l’armée afghane, l’avancée éclair des Talibans, malgré une intervention militaire américaine de 20 années dans le pays et des centaines de milliards de dollars engloutis dans le "nation building", ainsi que l’évacuation en panique de ressortissants américains et de collaborateurs confirment de manière saisissante que les États-Unis ne sont plus en mesure de remplir le rôle de "gendarme du monde". Plus spécifiquement, le retrait dramatique et chaotique des troupes américaines d'Afghanistan a mené à une déroute intérieure et extérieure pour l’administration Biden.
(a) sur un plan extérieur, la débâcle a sapé aux yeux de ses "alliés" la fiabilité des États-Unis
Dans la mesure où même le secrétaire de l’OTAN, J. Stoltenberg a dû reconnaître que les États-Unis ne garantissent plus de défendre les alliés européens contre leurs ennemis, toute l’opération de charme de Biden envers l’OTAN et les alliés a été annihilée. L’absence totale de concertation au sein de l’OTAN et le "cavalier seul" absolu des États-Unis a provoqué des réactions indignées à Londres, Berlin et Paris. Quant aux collaborateurs des américains en Afghanistan (comme les kurdes en Syrie, trahis par Trump), ils craignent à juste titre, pour leur vie : voilà une première puissance mondiale incapable de garantir la vie de ses collaborateurs et le soutien à ses alliés. Elle ne mérite donc pas la "confiance" (comme l’a souligné sarcastiquement Xi Jinping !).
(b) sur le plan intérieur, elle a érodé la crédibilité de l’administration Biden
La résolution sur la situation internationale du 24e congrès du CCI souligne que "L'élection de Biden, soutenue par une énorme mobilisation des médias, de certaines parties de l'appareil politique et même de l'armée et des services de sécurité, exprime cette réelle contre-tendance au danger de désintégration sociale et politique très clairement incarné par le Trumpisme. À court terme, de tels "succès" peuvent fonctionner comme un frein au chaos social croissant" (point 8). Cependant, la débâcle afghane a mis en évidence non seulement le manque de fiabilité des États-Unis envers les alliés mais elle accentue aussi les tensions au sein de la bourgeoisie américaine et ouvre un boulevard à toutes les forces adverses (Républicaines et populistes) qui condamnent cette retraite hâtive et humiliante par une administration qui "déshonore les États-Unis sur le plan international". Et cela au moment où la politique de relance industrielle et de grands travaux, prônée par l’administration Biden et supposée contenir les ravages causés par populisme, se heurte à une opposition féroce des Républicains au Capitole et de Trump et que, face à une politique vaccinale anti-Covid qui stagne, elle a été obligée de prendre des mesures contraignantes envers la population.
2.2. Imprédictibilité de la situation pour les autres impérialismes
L’absence de centralisation du pouvoir Taliban, la myriade de courants et de groupes aux aspirations les plus diverses qui composent le mouvement et les accords conclus avec les chefs de guerre locaux pour investir rapidement l’ensemble du pays font que le chaos et l’imprédictibilité caractérisent la situation, comme les attentats récents visant la minorité Hazara le démontrent. Cela ne peut qu’intensifier la volonté d’intervention des différents impérialismes mais aussi l’imprévisibilité de la situation, donc aussi le chaos ambiant.
- L’Iran est liée aux minorités Hazara le long de ses frontières et entend bien maintenir son influence dans cette région. Le Pakistan est inquiet que cette victoire des Talibans (qu’il finance via ses services secrets) ne mène à un mouvement d’indépendance des populations pachtounes au sein même de ses propres frontières. L’Inde, qui finançait largement le régime qui s’est écroulé, est dès à présent confrontée à une intensification des guérillas musulmanes dans le Cachemire indien. La Russie a renforcé ses troupes dans les ex-républiques soviétiques d’Asie pour contrer toute velléité d’apporter un soutien aux mouvements djihadistes locaux.
- Et la Chine en particulier, tire-t-elle un quelconque avantage du retrait américain ? Le contraire est vrai. Le chaos en Afghanistan même rend toute politique cohérente et à long terme dans le pays aléatoire. Par ailleurs, la présence des Talibans aux frontières de la Chine constitue un danger potentiel sérieux pour les infiltrations islamistes en Chine (les Ouïghours), surtout que les "frères" pakistanais des Talibans (les TTP, cousins des ISK) sont engagés dans une campagne d’attentats contre les chantiers de la "nouvelle route de la soie", ayant déjà entraîné la mort d’une dizaine de "coopérants" chinois.
La Chine tente de contrer le danger en Afghanistan en s'implantant dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale (Turkménistan, Tadjikistan et Ouzbékistan). Mais ces républiques font traditionnellement partie de la zone d’influence russe, ce qui augmente le danger de confrontation avec cet "allié stratégique", auquel de toute façon ses intérêts à long terme (la "nouvelle route de la soie" l’opposent fondamentalement (cf. point 4.2. qui traite de l’alliance sino-soviétique).
3. La position de la Chine sur l’échiquier impérialiste
La Chine a connu ces dernières décennies une ascension fulgurante sur le plan économique et impérialiste, qui en a fait le challenger le plus important pour les États-Unis. Cependant, comme l’illustrent déjà les événements de septembre 2021 en Afghanistan, elle n’a pu profiter, ni de la poursuite du déclin US, ni de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences pour renforcer ses positions sur le plan des rapports impérialistes, bien au contraire. Nous examinons les difficultés auxquelles la bourgeoisie chinoise est confrontée sur le plan de la prise en charge de la Covid, de la gestion de l’économie, des rapports impérialistes et des tensions en son sein.
3.1. Difficultés dans la gestion de la crise de la Covid
La Chine mise sur l’immunité collective avant d’ouvrir le pays, mais la politique de lock-down stricte, qu’elle applique en attendant dans des villes et des régions entières, chaque fois que des infections sont identifiés, pèse lourdement sur les activités économiques et commerciales : ainsi, la fermeture du port de Yantian, le troisième port de conteneurs du Monde en mai a conduit au blocage de milliers de conteneurs et des centaines de navires pendant des mois, désorganisant totalement le trafic maritime mondial.
Cette recherche de l’immunité collective pousse par ailleurs certaines provinces et villes chinoises à imposer des sanctions financières aux retardataires. Face aux nombreuses critiques sur les réseaux sociaux chinois, le gouvernement central a bloqué ce genre de mesures, qui tendaient à "mettre en péril la cohésion nationale".
Enfin, le plus grave vient sans doute des données convergentes sur l’efficacité limitée des vaccins chinois, communiquées par divers pays qui les utilisent : "Au total, la campagne de vaccination chilienne –importante avec 62% de la population vaccinée actuellement– ne semble avoir aucun impact notable sur la proportion de décès" (H. Testard, "Covid-19 : la vaccination décolle en Asie mais les doutes augmentent sur les vaccins chinois", Asialyst, 21.07.21). Les responsables chinois envisagent même aujourd’hui des accords pour importer Pfizer ou Moderna afin de pallier l’inefficacité de leurs propres vaccins.
Au-delà de la responsabilité indéniable de la Chine dans l’éclatement de la pandémie, la gestion peu efficiente de la crise de la Covid par Beijing pèse sur la politique générale du capitalisme d’État chinois.
3.2. Accumulation de problèmes pour l’économie chinoise :
La forte croissance que la Chine connaît depuis quarante ans -même si ces chiffres reculaient déjà la dernière décennie- semble arriver à son terme. Les experts s’attendent à une croissance du PIB chinois inférieure à 6% en 2021, contre 7% en moyenne sur la dernière décennie et plus de 10% lors de la décennie précédente. Divers autres facteurs accentuent les difficultés actuelles de l’économie chinoise :
a) Le danger d’éclatement de la bulle immobilière chinoise : Evergrande, le numéro deux de l’immobilier en Chine, se retrouve aujourd’hui écrasé par quelque 300 milliards d’euros de dettes, soit à elles seules 2% du PIB du pays, auxquelles il ne peut plus faire face. D’autres promoteurs sont contaminés, tels Fantasia Holdings ou Sinic Holdings quasiment en défaut de paiement face à leurs créanciers. De manière générale, le secteur de l’immobilier, qui représente 25% de l’économie chinoise, a généré une dette publique et privée colossale qui se chiffre en milliers de milliards de dollars. La faillite d’Evergrande n'est en réalité que la première séquence d’un effondrement global à venir de ce secteur. Aujourd’hui les logements vides sont tellement nombreux qu’ils pourraient héberger 90 millions de personnes. Certes, l’effondrement immédiat du secteur sera évité dans la mesure où les autorités chinoises n’ont d’autre choix que de limiter les dégâts du naufrage au risque sinon d’un impact très sévère sur le secteur financier : "(…) il n’y aura pas d’effet boule de neige comme en 2008 [aux États-Unis], parce que le gouvernement chinois peut arrêter la machine, estime Andy Xie, économiste indépendant, ancien de Morgan Stanley en Chine, cité par Le Monde. Je pense qu’avec Anbang [groupe d’assurance, NDLR] et HNA [Hainan Airlines], on a de bons exemples de ce qui peut se produire : il y aura un comité rassemblant autour d’une table l’entreprise, les créditeurs et les autorités, qui va décider quels actifs vendre, lesquels restructurer et, à la fin, combien d’argent il reste et qui peut perdre des fonds". (P.-A. Donnet, Chute d’Evergrande en Chine : la fin de l’argent facile, Asialyst, 25.09.21).
Cependant, si l’immobilier chinois fonde son modèle économique sur un endettement pharamineux, de nombreux autres secteurs sont dans le rouge : fin 2020, la dette globale des entreprises chinoises représentait 160% du PIB du pays, contre 80% environ pour celle des sociétés américaines et les investissements "toxiques" des gouvernements locaux représenteraient aujourd’hui, selon des analystes de Goldman Sachs, à eux seuls 53.000 milliards de yuans, soit une somme qui représente 52% du PIB chinois. Ainsi, l’éclatement de la bulle immobilière risque de non seulement de contaminer d’autres secteurs de l’économie mais aussi d’engendrer une instabilité sociale (près de 3 millions d’emplois directs et indirects liés à Evergrande), la grande crainte du PCC.
b) Les coupures d’énergie : elles sont la conséquence d’un approvisionnement en charbon insuffisant causé entre autre par les inondations records dans la province du Shaanxi qui, à elle seule, produit 30% du combustible dans tout le pays, et aussi du durcissement de la réglementation anti-pollution décidée par Xi. La pénurie pèse déjà sur l’activité industrielle dans plusieurs régions : les secteurs de la sidérurgie, de l’aluminium et du ciment souffrent déjà de la limitation de l’offre d’électricité. Cette limitation a réduit d’environ 7% les capacités de production d’aluminium et de 29% celles de ciment (chiffres de Morgan Stanley) et le papier et le verre pourraient être les prochains secteurs touchés. Ces coupures freinent désormais la croissance économique de l’ensemble du pays. Mais la situation est encore plus grave qu’il n’y paraît à première vue. "En effet, cette pénurie d’électricité se répercute désormais sur le marché résidentiel dans certaines régions du Nord-Est. La province du Liaoning a ainsi étendu les coupures de courant du secteur industriel à des réseaux résidentiels" (P.-A. Donnet, Chine : comment la grave pénurie d’électricité menace l’économie, Asialyst, 30.09.21).
c) Les ruptures dans les chaînes de production et d’approvisionnement. Celles-ci sont liées à la crise énergétique mais aussi aux lock-down découlant des infections Covid (cf. point précédent). Elles affectent la production dans les industries de diverses régions et accentuent le risque de rupture des chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales déjà tendues, d’autant plus que certains fabricants sont confrontés à une pénurie aigüe de semi-conducteurs.
3.3. Essoufflement du projet de la "nouvelle route de la soie"
La "nouvelle route de la soie" devient de plus en plus difficile à réaliser, ce qui est dû aux problèmes financiers liés à la crise de la Covid et aux difficultés de l’économie chinoise, mais aussi aux réticences des partenaires :
- d’une part, le niveau d’endettement de pays "partenaires" a été accru par la crise de la Covid, et ceux-ci se retrouvent dans l’incapacité de payer les intérêts des prêts chinois. Des pays comme le Sri-Lanka, le Bangladesh, le Kirghizstan, le Pakistan, le Monténégro, et divers pays africains, ont demandé à la Chine de restructurer, de retarder ou d'annuler le paiement de leurs dettes qui sont dues cette année.
- d’autre part, il y a une méfiance croissante de la part de nombreux pays envers les agissements de la Chine (Union Européenne, Cambodge, Philippines, Indonésie), conjuguée à la pression antichinoise exercée par les États-Unis (comme en Amérique latine), et il y a aussi les conséquences du chaos produit par la décomposition, déstabilisant certains pays clés de la "nouvelle route", comme par exemple l’Éthiopie.
Bref, il ne faut pas s’étonner qu’en 2020, il y a eu un effondrement de la valeur financière des investissements injectés dans le projet "Nouvelle route de la soie" (-64%), alors que la Chine a prêté plus de 461 milliards de dollars depuis 2013.
3.4. Accentuation des antagonismes au sein de la bourgeoisie chinoise
Sous Deng Xiao Ping le capitalisme d’État de type stalinien chinois, sous le couvert d’une politique de "créer des riches pour partager leur richesse", a établi des zones "libres" (Hong Kong, Macao, etc.) afin de développer un capitalisme de type "libre marché" permettant l’entrée de capitaux internationaux et favorisant aussi un secteur capitaliste privé qui, avec l’effondrement du bloc de l’Est et la "globalisation" de l’économie dans les années 90, s’y est développé de manière exponentielle, même si le secteur public sous le contrôle direct de l’État représente toujours 30% de l’économie. Comment la structure rigide et répressive de l’État stalinien et du parti unique a-t-elle prise en charge cette "ouverture" au capitalisme privé ? Dès les années 1990, le parti s’est transformé en intégrant massivement des entrepreneurs et des chefs d’entreprises privées. "Au début des années 2000, le président d’alors, M. Jiang Zemin avait levé l’interdiction de recruter des entrepreneurs du secteur privé, vus jusque-là comme des ennemis de classe, (…). Les hommes et les femmes d’affaires ainsi sélectionnés deviennent membre de l’élite politique, ce qui leur garantit que leurs entreprises soient, au moins partiellement, protégées de cadres aux tendances prédatrices" (Que reste-t-il du communisme en Chine ? Le monde diplomatique n°68 [196], juillet 2021). Aujourd’hui, les professionnels et managers diplômés du supérieur constituent 50% des adhérents du PCC.
Les oppositions entre les différentes fractions s’exprimeront donc non seulement au sein des structures étatiques mais au sein même du PCC. Depuis plusieurs années (cf. déjà le Rapport sur les tensions impérialistes du 20e congrès du CCI, 2013), les tensions croissent entre différentes fractions au sein de la bourgeoisie chinoise, en particulier entre celles plus liées aux secteurs capitalistes privés, dépendant des échanges et des investissements internationaux, et celles liées aux structures et au contrôle financier étatiques au niveau régional ou national, celles qui prônent une ouverture au commerce mondial et celles qui avancent une politique plus nationaliste. En particulier, le "tournant à gauche", engagé par la faction derrière le président Xi, et qui signifie moins de pragmatisme économique et plus d’idéologie nationaliste, a intensifié les tensions et l’instabilité politique ces dernières années : en témoignent "les tensions persistantes entre le premier ministre Li Keqiang et le président Xi Jinping sur la relance économique, tout comme la "nouvelle position" de la Chine sur la scène internationale". (Chine : à Beidaihe, "l'université d'été" du Parti, les tensions internes à fleur de peau", A. Payette, Asialyst, 06.09.20), la "politique guerrière" menée par la diplomatie chinoise envers Taïwan mais en même temps la déclaration spectaculaire de Xi que la Chine veut atteindre la neutralité carbone pour son économie en 2060, les critiques explicites envers Xi qui surgissent régulièrement (dernièrement l’essai "alerte virale" publié par un professeur réputé de droit constitutionnel à l'Université Qinghua à Pékin et prédisant la fin de Xi), les tensions entre Xi et les généraux dirigeant l’armée populaire, les interventions de l’appareil d’État envers des entrepreneurs trop "flamboyants" et critiques envers le contrôle étatique (Jack Ma et Ant Financial, Alibaba). Certaines faillites (HNA, Evergrande) pourraient d’ailleurs être rapportées aux luttes entre cliques au sein du parti, dans le cadre par exemple de la campagne cynique pour "protéger les citoyens des excès de la "classe capitaliste"".
Bref, loin de tirer profit de la situation actuelle, la bourgeoisie chinoise, comme les autres bourgeoisies, est confrontée au poids de la crise, au chaos de la décomposition et aux tensions internes, qu’elle tente par tous les moyens de contenir au sein de ses structures capitalistes d’État désuètes.
4. L’extension du chaos, de l’instabilité et de la barbarie guerrière
Les données analysées dans les points précédents montrent certes que les tensions entre les États-Unis et la Chine tendent à occuper une place prédominante dans la situation impérialiste, sans toutefois qu’elles induisent une tendance à la formation de blocs impérialistes. En effet, au-delà de certaines alliances limitées comme l’AUKUS, la puissance principale de la planète, les États-Unis, aujourd’hui non seulement n’arrive pas à mobiliser les autres puissances derrière sa ligne politique (contre l’Irak ou l’Iran précédemment, contre la Chine aujourd’hui), mais est en outre incapable de défendre ses propres alliés et de se donner la posture d’un "chef de bloc". Ce déclin du leadership US mène à une accentuation du chaos qui impacte même de plus en plus la politique de l’ensemble des impérialismes dominants, y compris la Chine qui n’arrive pas non plus à imposer de manière durable son leadership à d’autres pays.
4.1. Chaos et guerre
Le fait que les talibans aient "battu" les Américains enhardira tous ces petits requins qui n'hésiteront pas à avancer leurs pièces en l'absence de quelqu'un pour "imposer des règles". Nous entrons dans une accélération de l'empire sans loi et le plus grand chaos de l'histoire. Le chacun pour soi devient le facteur central des relations impérialistes et la barbarie guerrière menace des zones entières de la planète.
(a) Asie Centrale, Moyen-Orient et Afrique :
Outre la barbarie de la guerre civile en Irak, Syrie, Lybie ou Yémen et la plongée de l’Afghanistan dans l’horreur, les tensions sont fortes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, stimulées par la Turquie qui provoque la Russie, la guerre civile a éclaté en Éthiopie (soutenue par l’Érythrée) contre la "province rebelle" du Tigray (soutenue par le Soudan et l’Égypte) ; enfin, les tensions croissent entre l’Algérie et le Maroc. La "Somalisation" d’États, et la zone d’instabilité et de "non-droit" (cf. déjà Rapport du 20e congrès [197] du CCI, 2013) n’ont cessé de s’étendre : le chaos règne à présent de Kaboul à Addis-Abeba, de Sanaa à Erevan, De Damas à Tripoli, de Bagdad à Bamako.
(b) Amérique Centrale et du Sud :
Le Covid frappe durement le sous-continent (1/3 des décès mondiaux en 2020 pour 1/8 de la population mondiale) et le plonge dans sa pire récession depuis 120 ans : contraction du PIB de 7,7% et accroissement de la pauvreté de près de 10% en 2020 (LMD, oct. 2021). Le chaos croît, comme à Haïti, plongée dans une situation désespérée, sous le règne sanglant de gangs, et dans une misère horrible, et la situation est également catastrophique en Amérique Centrale : des centaines de milliers de gens désespérés fuient la misère et le chaos et menacent de submerger la frontière sud des États-Unis. La région subit de plus en plus de convulsions liées à la décomposition : révoltes sociales en Colombie et au Chili, confusion populiste au Brésil. Le Mexique essaie de jouer ses propres cartes (proposition d'une nouvelle OAS, etc.) mais est trop dépendant des États-Unis pour affirmer ses propres aspirations. Les États-Unis n'ont pas été en mesure de renverser Maduro au Venezuela, auquel les Chinois et les Russes et même l'Iran continuent à apporter un soutien "humanitaire", ainsi que à Cuba. La Chine s’est infiltrée surtout depuis 2008 dans l’économie de la région et est devenue un créancier important de nombreux États latino-américains mais la contre-offensive américaine exerce actuellement une forte pression sur certains États (Panama, Équateur, Chili) pour prendre leurs distances envers "l’activité économique prédatrice" de Beijing.
(c) Europe :
Les tensions entre l’OTAN et la Russie se sont intensifiées ces derniers mois : après l’incident du vol Ryanair détourné et intercepté par le Belarus pour arrêter un dissident, réfugié en Lituanie, il y a eu en juin les manœuvres de l’OTAN en Mer Noire au large de l’Ukraine, où un accrochage s’est produit entre une frégate anglaise et des navires russes, et, en septembre, des manœuvres conjointes entre armées russe et biélorusse aux frontières de la Pologne et des Pays Baltes face à des exercices de l’OTAN en territoire ukrainien, une véritable provocation aux yeux de Poutine.
4.2. Instabilité croissante
Le chaos croissant augmente aussi les tensions au sein des bourgeoisies et renforce l’imprédictibilité de leur positionnement impérialiste : c’est le cas de pays comme le Brésil, où la situation sanitaire catastrophique et la gestion irresponsable du gouvernement Bolsonaro mène à une crise politique de plus en plus intense, et d’autres pays d’Amérique latine (instabilité politique en Équateur, au Pérou, en Colombie ou en Argentine). Au Proche et au Moyen-Orient, les tensions entre les clans et tribus qui dirigent l’Arabie Saoudite peuvent déstabiliser le pays, tandis que Israël est marqué par une opposition d’une large part des fractions politiques de la droite à la gauche contre Netanyahu et contre les partis religieux, mais aussi par des pogroms à l'intérieur du pays contre les arabes "israéliens". Enfin, il y a la Turquie qui cherche une solution pour ses difficultés politiques et économiques dans une fuite en avant suicidaire dans des aventures impérialistes (de la Lybie à l’Azerbaïdjan).
En Europe, la débâcle en Afghanistan et "l’affaire des sous-marins" ainsi que l’après-Brexit accentuent la déstabilisation d’organisations émanant de période des blocs, comme l’OTAN ou l’UE. Au sein de l’OTAN, des pays européens doutent de plus en plus de la fiabilité des États-Unis. Ainsi, l’Allemagne n’a pas cédé face aux pressions américaines en ce qui concerne le pipeline avec la Russie en Mer Baltique et la France ne digère pas l’affront infligé par les États-Unis dans le deal des sous-marins avec l’Australie, alors que d’autres pays européens continuent à voir dans les États-Unis leur principal protecteur. La question des rapports avec la GB pour implémenter les accords du Brexit (Irlande du Nord et quota de pêche) divisent les pays de l’UE et les tensions sont fortes entre la France et l’Angleterre. Au sein de l’UE même, les flux de réfugiés continuent à opposer les États, pendant que des pays comme la Hongrie et la Pologne remettent de plus en plus ouvertement en question les "pouvoirs supranationaux" définis par les traités européens, et que l’hydre du populisme menace la France lors des élections au printemps 2022.
Chaos et accentuation du chacun pour soi tendent également à entraver la continuité de l’action des impérialismes majeurs : les États-Unis se voient obligés de maintenir la pression par des bombardements aériens réguliers sur des milices chiites qui harcellent leurs forces subsistantes en Irak ; les Russes doivent "jouer aux pompiers" dans la confrontation armée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, instillée par le chacun pour soi impérialiste de la Turquie ; l’extension du chaos dans la Corne de l’Afrique à travers la guerre civile en Éthiopie, avec l’implication du Soudan et de l’Égypte qui soutiennent la région du Tigray et l’Érythrée le gouvernement central éthiopien, bouleverse en particulier les plans chinois qui faisaient de l’Éthiopie, vantée comme un pôle de stabilité et le "nouvel atelier du monde", un point d’appui pour leur "Belt and Road project" en Afrique du Nord-Est et avaient dans ce but installé une base militaire à Djibouti. L'impact continu des mesures et des incertitudes liées à la pandémie est également un facteur déstabilisateur dans la politique impérialiste des divers États : stagnation de la vaccination aux États-Unis après un départ en fanfare, nouveaux confinements massifs de régions entières et manque d'efficacité patent des vaccins en Chine, explosion des contaminations et de la surmortalité (660.000), méfiance de la population envers les vaccins en Russie (taux de vaccination d’un peu plus de 30%)
Cette instabilité caractérise aussi les alliances comme en particulier celle entre la Chine et la Russie. Si ces pays développent une "coopération stratégique" (caractérisation du communiqué sino-russe du 28.06.21) contre les États-Unis et par rapport au Moyen-Orient, l’Iran ou la Corée du Nord organisent même des exercices communs de leurs armées et marines, leurs ambitions politiques sont radicalement différentes : l’impérialisme russe vise avant tout la déstabilisation de régions et ne peut viser guère plus que des "frozen conflicts" (Syrie, Lybie, Ukraine, Géorgie, …), alors que la Chine déploie une politique économique et impérialiste à long terme, la "nouvelle route de la soie". Par ailleurs, la Russie est parfaitement consciente que les parcours de la "Silk Road" par la terre et par la zone arctique s’opposent directement à ses intérêts dans la mesure où ils menacent directement les zones d’influence russes en Asie centrale et en Sibérie et que, sur le plan de l’appareil industriel, elle ne fait pas le poids face à la 2ième économie mondiale, elle qui a un PNB correspondant à celui de l’Italie.
4.3. Développement de l’économie de guerre
"L'économie de guerre (…) n'est pas une politique économique qui peut résoudre les contradictions du capitalisme ou créer les fondements d'une nouvelle étape du développement capitaliste. (…). La seule fonction de l'économie de guerre est... la GUERRE ! Sa raison d'être est la destruction effective et systématique des moyens de production et des forces productives et la production des moyens de destruction - la véritable logique de la barbarie capitaliste" (De la crise à l’économie de guerre, Revue Internationale n°11 [198], 1977). Le fait que la perspective ne soit pas à la constitution de larges alliances stables, de "blocs" impérialistes s’engageant dans une confrontation mondiale et donc qu’une guerre mondiale ne se pose pas actuellement n’enlève rien à une accentuation aujourd’hui de l’économie de guerre. Soumettre l'économie aux nécessités militaires pèse lourdement sur l'économie, mais cette irrationalité n'est pas un choix : elle est le produit de l'impasse du capital que la décomposition sociale accélère.
La course aux armements engloutit des sommes phénoménales, dans le cas des États-Unis, qui ont encore un avantage important sur ce plan, mais aussi de la Chine qui a accru significativement ses dépenses militaires durant les deux dernières décennies. "L’augmentation de 2,6% des dépenses militaires mondiales survient l’année où le produit intérieur brut (PIB) mondial a reculé de 4,4% (projection du Fonds monétaire international, octobre 2020), principalement en raison des impacts économiques de la pandémie de la Covid-19. En conséquence, les dépenses militaires en pourcentage du PIB –dit fardeau militaire- ont atteint une moyenne mondiale de 2,4% en 2020, contre 2,2% en 2019. Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle de ces dépenses depuis la crise économique et financière mondiale de 2009" (communiqué de presse du Sipri [199], avril 2021). Cette course concerne non seulement les armes conventionnelles et nucléaires, mais aussi la militarisation encore plus nette des programmes spatiaux et l’extension de la course à des zones autrefois épargnées, telles les régions arctiques.
Vu l’expansion terrifiante du chacun pour soi impérialiste, la course aux armements ne se limite pas aux impérialismes majeurs mais touche tous les États, en particulier sur le continent asiatique qui connaît une hausse significative des dépenses militaires : ainsi, l'inversion du poids respectif de l'Asie et de l'Europe entre 2000 et 2018 est spectaculaire : en 2000, l'Europe et l'Asie représentent respectivement 27% et 18% des dépenses de défense mondiales. En 2018, ces rapports sont inversés, l'Asie en représente 28% et l'Europe 20% (données du Sipri).
Cette militarisation s’exprime aujourd’hui aussi par un développement impressionnant des activités cybernétiques des États (attaques de hackers, souvent liés directement ou indirectement à des États, telle l’attaque cybernétique d’Israël contre les sites nucléaires iraniens), ainsi que de l’intelligence artificielle et de la robotique militaire (robots, drones), qui jouent un rôle de plus en plus important dans les activités de renseignement ou dans les opérations militaires.
Cependant, "la véritable clé de la constitution de l'économie de guerre (…) [est] la soumission physique et/ou idéologique du prolétariat à l'État, [le] degré de contrôle que l'État a sur la classe ouvrière" (Id., Revue Internationale n°11 [198], 1977). Or, cet aspect est loin d’être acquis. Cela explique pourquoi l’accélération de la course aux armements va de pair aujourd’hui avec une forte réticence parmi les puissances impérialistes majeures (les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne ou la France) à l’engagement massif de soldats sur le terrain ("boots on the ground") par peur de l’impact d’un retour massif de "body bags" sur la population et, en particulier la classe ouvrière. Relevons ainsi l’utilisation de sociétés militaires privées (organisation Wagner par les Russes, Blackwater/Academi par les États-Unis, …) ou l’engagement de milices locales pour mener des actions : utilisation de milices sunnites syriennes par la Turquie en Lybie et en Azerbaïdjan, de milices kurdes par les États-Unis en Syrie et Irak, du Hezbollah ou de milices chiites irakiennes par l’Iran en Syrie, de milices soudanaises par l’Arabie Saoudite au Yémen, une force régionale (Tchad, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Fasso) "coachée" par la France et l’UE dans la région du Liptako, …
5. Impact sur le prolétariat et sa lutte
- La perspective est donc à une multiplication de conflits barbares et sanglants :
"10. Dans le même temps, les "massacres d'innombrables petites guerres" prolifèrent également, alors que le capitalisme, dans sa phase finale, plonge dans un chacun-pour-soi impérialiste de plus en plus irrationnel.
13. Cela ne signifie pas que nous vivons dans une ère de plus grande sécurité qu'à l'époque de la Guerre froide, hantée par la menace d'un Armageddon nucléaire. Au contraire, si la phase de décomposition est marquée par une perte de contrôle croissante de la part de la bourgeoisie, cela s'applique également aux vastes moyens de destruction -nucléaires, conventionnels, biologiques et chimiques- qui ont été accumulés par la classe dirigeante, et qui sont maintenant plus largement distribués à travers un nombre bien plus important d'États-nations que dans la période précédente." (Résolution [194] sur la situation internationale)
Dans la mesure où nous savons que la bourgeoisie est capable de retourner les pires effets de la décomposition contre le prolétariat, nous devons être conscients que ce contexte de barbarie meurtrière ne facilitera nullement la lutte ouvrière :
- L’accélération de la décomposition entraînera des guerres sans fin partout dans le monde, une multiplication de massacres et de la misère, des millions de réfugiés errant partout sans but, un chaos social indescriptible et une destruction de l’environnement, et tout cela accentuera le sentiment de peur et de démoralisation dans les rangs du prolétariat.
- Les différents conflits armés seront utilisés pour déclencher d’intenses campagnes de défense de la démocratie, les droits humains, les droits des femmes, comme c’est le cas avec l’Afghanistan, l‘Éthiopie, la Syrie ou l’Irak.
En conséquence, notre intervention doit dénoncer la progression de la barbarie et le caractère insidieux de la situation, elle doit mettre constamment le prolétariat en garde contre la sous-estimation des dangers que la situation de multiplicité chaotique des conflits engendre dans le contexte du chacun pour soi comme dynamique dominante :
- "Laissée à sa propre logique, à ses conséquences ultimes, elle [la décomposition] conduit l'humanité au même résultat que la guerre mondiale. Être anéanti brutalement par une pluie de bombes thermonucléaires dans une guerre généralisée ou bien par la pollution, la radioactivité des centrales nucléaires, la famine, les épidémies et les massacres de multiples conflits guerriers (où l’arme atomique pourrait aussi être utilisée), tout cela revient, à terme, au même. La seule différence entre ces deux formes d'anéantissement, c'est que la première est plus rapide alors que la seconde est plus lente et provoquerait d'autant plus de souffrances" (Thèses sur la décomposition [22], pt11).
23.10.2021

